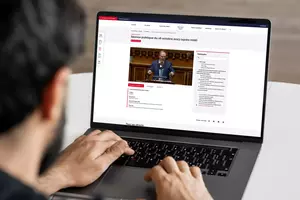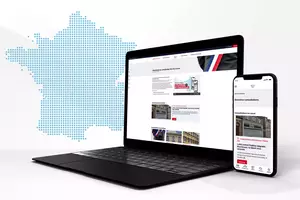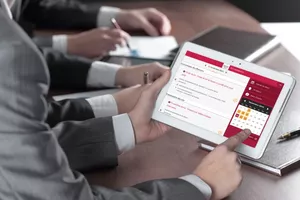M. le président. La parole est à M. Bruno Rojouan.
M. Bruno Rojouan. Madame la ministre, alors que nous avons besoin d’une simplification des comités et des multiples dispositifs environnementaux existants, il est légitime de s’interroger sur l’efficacité des nouvelles COP régionales que vous avez mises en place.
Les collectivités territoriales sont en première ligne pour la transition écologique et jouent un rôle essentiel dans la planification, qui doit s’ancrer dans les réalités du terrain. L’acceptabilité des mesures est primordiale et les COP régionales ne seront utiles que si elles aboutissent à une adaptation des objectifs nationaux au tissu local.
Reste un sujet incontournable : le mur d’investissement qui se dresse devant les collectivités locales et les particuliers. Aujourd’hui, le financement de la planification écologique pose question. Des territoires ont calculé que, pour remplir les engagements de la stratégie nationale bas carbone à l’échelle locale, il faudrait multiplier par trente les financements de leur agglomération et par trois les engagements de l’État. Or les financements publics et privés, prévus à hauteur de plusieurs dizaines de milliards d’euros, restent insuffisants au regard de l’ampleur de la transition à effectuer.
Les récentes annonces de coupes dans le budget de l’État et de votre ministère mettent en cause la capacité du Gouvernement à financer une transition que les collectivités ne peuvent en aucun cas supporter seules.
La lisibilité de l’action publique et la sécurisation des investissements nécessitent une programmation pluriannuelle des financements : c’est un outil essentiel pour les élus locaux. Pouvez-vous nous assurer que vous travaillez à une loi de programmation des financements accompagnant la planification écologique ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Dominique Faure, ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Vous avez parfaitement raison, monsieur le sénateur Rojouan : l’efficacité des COP sera étroitement corrélée à l’appropriation par les collectivités locales des travaux et de la nouvelle méthode mise en place.
Comme de très nombreux sénateurs, vous m’interrogez sur les financements qui accompagneront les COP. J’ai déjà largement répondu à cette question, mais je rappellerai tout de même que 200 millions d’euros seront fléchés au sein du fonds vert pour les PCAET et les CRTE.
Tout comme vous, j’appelle de mes vœux une loi prévoyant la pluriannualité des financements au profit des collectivités locales. Sachez que j’y travaille actuellement avec Thomas Cazenave.
M. le président. La parole est à M. Laurent Somon.
M. Laurent Somon. Madame la ministre, territorialiser la planification écologique via les COP régionales : voilà l’articulation opérationnelle de la loi Climat et Résilience et de la SNBC, une doctrine nationale dont les débats sur les objectifs et l’évolution sont occultés à l’échelon parlementaire et dont l’évaluation annuelle est jugée par la Cour des comptes, dans son rapport de mars dernier, comme impossible, les conditions n’étant pas réunies.
Les objectifs régionaux sont réclamés, comme l’indique d’ailleurs le rapport d’information de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation de mars dernier. Le fait de guider l’action avec des tableaux Excel où le relief des écrans informatiques s’est rapidement heurté à la déclinaison opérationnelle, donc territoriale, sans oublier son volet budgétaire. Comme le souligne la Cour des comptes, la transition écologique devra mobiliser des ressources publiques et privées ; les ménages, les entreprises et les collectivités territoriales supporteront une part importante des dépenses.
Face au cadencement désordonné de textes de loi relatifs à différents sujets – nous sommes amenés à discuter de nucléaire et d’énergies renouvelables avant le débat sur la PPE – et à une visibilité budgétaire chaotique, les collectivités attendent que leur rôle et la déclinaison des Sraddet et des PCAET soient bien clarifiés, sachant que nombre de leviers dépendent d’acteurs privés et que les besoins de financement sont importants.
L’Institut de l’économie pour le climat (I4CE) évalue à 14 milliards d’euros par an les investissements que doivent réaliser les collectivités territoriales en matière de climat. Bref, passer d’une abstraction digne de Mondrian à l’action se révèle un challenge ambitieux dans un cadre de contraintes sociales et budgétaires.
Madame la ministre, pour que la planification s’opère concrètement, les communes, qui sont l’échelon de l’action, doivent être associées et disposer d’une réelle capacité d’agir, d’autant qu’elles pilotent un grand nombre de sujets.
Pouvez-vous clarifier les livrables, les feuilles de route, les plans d’action et les cadres de contractualisation avec les territoires, comme la circulaire CRTE ? Pouvez-vous préciser les moyens que l’État compte mettre en œuvre pour accompagner les collectivités territoriales et les acteurs privés ?
Pouvez-vous garantir, tant du point de vue du fond que de la méthode, que l’exercice est en parfaite adéquation avec les stratégies déjà en place localement, comme dans la région Hauts-de-France, par exemple, avec la politique Rev3, engagée depuis 2016 ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Dominique Faure, ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Vous me posez trois questions, monsieur le sénateur Somon : quels sont les livrables ? quels sont les moyens de l’État ? quelles sont les garanties ?
Concernant les livrables, il existe un état des lieux partagé du territoire sur les dynamiques en cours et les programmes déjà engagés, avec une mobilisation forte de l’ensemble des collectivités. En outre, un plan d’action cohérent et pragmatique tenant compte des initiatives lancées dans chaque collectivité a été mis en place. Encore une fois, l’objectif de ce plan sera tenu juste après l’été.
Vous m’interrogez aussi sur les moyens de l’État. Les moyens financiers, nous les connaissons : ce sont les 2 milliards d’euros engagés au travers du fonds vert, dont 200 millions d’euros seront fléchés en faveur des PCAET et des CRTE afin de financer ces plans d’action. Je tiens ensuite à citer un outil original, que je n’ai pas encore évoqué : un simulateur de gaz à effet de serre sera mis à disposition, notamment pour des besoins de méthodologie. Enfin, tous les services déconcentrés de l’État qui travaillent aux côtés des collectivités locales seront accompagnés.
En ce qui concerne les garanties, sachez que le lancement de chaque COP s’est fait après un travail de concertation entre préfectures et conseils régionaux, et ce dans chacune des régions. C’est la garantie que tout ce qui a été accompli par les conseils régionaux est bien pris en compte.
Bref, qu’il s’agisse du fond ou de la méthode, l’adéquation entre cet exercice et les stratégies existantes nous paraît bonne.
Conclusion du débat
M. le président. Mes chers collègues, nous en avons terminé avec le débat sur le thème « Planification écologique et COP régionales : quelle efficacité ? ».
Je tiens à remercier M. Didier Mandelli, qui a renoncé à son intervention finale, afin de nous permettre de tenir les délais d’examen des points inscrits à l’ordre du jour.
5
Création d’une commission spéciale
M. le président. L’ordre du jour appelle, en application de l’article 16 bis, alinéa 2, du règlement, la proposition de création d’une commission spéciale en vue de l’examen du projet de loi de simplification de la vie économique.
Je soumets cette proposition au Sénat.
Il n’y a pas d’opposition ?…
Il en est ainsi décidé.
6
Candidatures à une commission spéciale
M. le président. En application de l’article 8 bis, alinéa 3, de notre règlement, les listes des candidats présentés par les groupes pour cette commission ont été publiées.
Elles seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d’opposition dans le délai d’une heure suivant cette publication.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures vingt-cinq, est reprise à dix-sept heures trente, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)
PRÉSIDENCE DE M. Gérard Larcher
M. le président. La séance est reprise.
7
Hommage à Guy-Dominique Kennel, ancien sénateur
M. le président. Mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, c’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Guy-Dominique Kennel, qui fut sénateur du Bas-Rhin de 2014 à 2020 et secrétaire du Sénat. (Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que Mmes et MM. les ministres, se lèvent.)
Je veux saluer aujourd’hui la mémoire d’un grand homme politique alsacien, engagé et profondément attaché à son territoire. Fervent défenseur du conseil unique d’Alsace, il avait soutenu ce projet avec passion en 2013, souhaitant que l’Alsace « prenne son destin en main ».
C’était un élu de terrain. Comme beaucoup d’entre nous, il était entré en politique en devenant conseiller municipal, avant de devenir maire de Preuschdorf en 1989. Pendant vingt ans, il resta à la tête de sa commune. Parallèlement, il entra au conseil général du Bas-Rhin en 1992 et en devint le président en 2008, et ce jusqu’en 2015. Depuis 2021, il était conseiller régional de la région Grand Est.
Au Palais du Luxembourg, Guy-Dominique Kennel fut élu en 2014. Il siégea à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, où il s’intéressa surtout aux questions ayant trait à l’enseignement scolaire, lui, l’ancien enseignant de formation et inspecteur de l’éducation nationale. Il fut également un membre assidu et actif de la délégation sénatoriale aux entreprises.
Chacun garde le souvenir de cet homme pas très grand, au sourire malicieux et à l’immense gentillesse. Guy-Dominique Kennel était attentif aux autres, ouvert, tolérant, et il savait partager.
Ayant appris la maladie qui l’avait frappé subitement, j’ai échangé avec lui au téléphone. Je ressens, comme tous ceux qui l’ont connu ici, une émotion particulière.
Au nom du Sénat tout entier, je veux assurer son épouse, ses enfants, sa famille et ses proches de notre sympathie et leur dire que nous pensons à eux.
Mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, je vous propose d’observer quelques instants de silence à la mémoire de celui que nous surnommions tous ici affectueusement « Guy-Do ». (Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que Mmes et MM. les ministres, observent un moment de recueillement.)
8
Questions d’actualité au Gouvernement
M. le président. L’ordre du jour appelle les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement.
Avant toute chose, je veux excuser l’absence de M. Premier ministre, qui est retenu à l’Élysée.
Mes chers collègues, je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet.
Au nom du bureau, j’appelle chacun de vous à observer au cours de nos échanges l’une des valeurs essentielles du Sénat : le respect, qu’il s’agisse du respect des uns et des autres ou de celui du temps de parole.
dissuasion nucléaire française et européenne
M. le président. La parole est à M. Cédric Perrin, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Cédric Perrin. Ma question s’adressait à M. le Premier ministre.
Une nouvelle fois, des propos du Président de la République en matière de défense suscitent la polémique. Nous n’avions pas besoin de cela, surtout en un moment où les tensions géopolitiques sont à leur comble.
Il y a quelques mois, nous débattions ici même du projet de loi de programmation militaire 2024-2030. Dans un contexte marqué par la montée des périls, le Gouvernement écartait les demandes du Sénat de réfléchir au format des armées. Le ministre des armées répétait alors que le problème de la masse de forces conventionnelles ne se posait pas pour nous, puisque nous disposions de la dissuasion nucléaire.
Or voilà qu’au détour d’une interview le Président de la République tient le discours inverse, affirmant qu’il faut « tout mettre sur la table » : le conventionnel, la défense antimissile, les missiles de longue portée – desquels parlait-il exactement ? – et l’arme nucléaire.
La dissuasion, c’est l’assurance vie des Français ; c’est aussi le fruit de leurs impôts depuis soixante-dix ans, depuis que le général de Gaulle a souhaité que la France acquière son indépendance stratégique.
Si le débat mérite certainement d’être ouvert, on ne peut lancer une telle idée dans la presse, sans avoir expliqué au préalable avec qui et comment nous irions vers un tel changement, ni qui paiera et décidera.
Ce sujet ne souffre pas l’improvisation et mérite davantage qu’une petite phrase évasive. Quelles sont les prochaines étapes envisagées par le Gouvernement après ce ballon d’essai ? Que compte-t-il dire à nos partenaires, et avec quels objectifs concrets ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée des anciens combattants et de la mémoire.
Mme Patricia Mirallès, secrétaire d’État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire. Monsieur le président Perrin, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de Sébastien Lecornu, qui se trouve actuellement auprès de nos forces armées et qui m’a chargé de vous répondre.
Il convient tout d’abord de rappeler deux points essentiels.
En premier lieu, la stratégie nucléaire française a toujours garanti une pleine compatibilité entre l’indépendance de la dissuasion française et la volonté de préserver en toutes circonstances la liberté d’action du Président de la République, d’une part, et l’appartenance européenne, associée à la solidarité inébranlable qui en découle, de l’autre.
En second lieu, notre dissuasion nucléaire s’est vu conférer, depuis la fin de la guerre froide, un rôle européen qui n’est pas limité au seul cadre de l’Union européenne.
Permettez-moi ensuite de répondre à vos interrogations sur les récentes déclarations du Président de la République.
Le contexte impose une réflexion collective sur la stratégie de défense de l’Europe. Or la dissuasion française fait partie de l’équation. Elle est au cœur de la défense de notre pays : elle est donc par essence un élément incontournable de la défense européenne.
Dans un discours prononcé en 2022 à l’École militaire, le Président de la République avait déjà affirmé la dimension européenne de nos intérêts vitaux. Ce lien entre notre dissuasion nucléaire et l’Europe n’est pas nouveau. En 2006, le président Chirac avait déjà fait le constat que la dissuasion française, par sa seule existence, était un élément incontournable de la sécurité du continent. Le président Mitterrand l’avait également énoncé.
En clair, le Président de la République a rappelé que les intérêts vitaux de la France ont une dimension européenne, ce qui n’a rien de nouveau.
La dissuasion nucléaire française est pleinement souveraine. Le Président de la République est le seul à décider de sa mise en œuvre ; la décision ne sera partagée avec personne. Par sa dissuasion, la France contribue à la crédibilité de la défense de l’Europe. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
M. le président. La parole est à M. Cédric Perrin, pour la réplique.
M. Cédric Perrin. Je vous remercie de votre réponse, madame la secrétaire d’État, mais ce débat souhaité par le Président de la République est-il vraiment la priorité en ce moment ?
Le problème se pose moins sur le fond que sur la forme. Ne devrions-nous pas commencer par nous préoccuper des difficultés actuelles de nos armées ?
Quarante ans de désindustrialisation nous empêchent aujourd’hui de produire comme nous devrions le faire, la faiblesse de notre production étant due notamment au manque de commandes. Nos armées ont par ailleurs du mal à recruter et souffrent de l’insuffisance de nos moyens, qui, certes, progressent, mais pas aussi vite que les besoins.
Mme Patricia Mirallès, secrétaire d’État. Et le doublement du budget prévu par la loi de programmation militaire ?
M. Cédric Perrin. Madame la secrétaire d’État, tous vos ballons d’essai ne constituent malheureusement pas une stratégie ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
contexte universitaire actuel
M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
Mme Patricia Schillinger. Ma question s’adresse à Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Madame la ministre, ces derniers jours, des groupes d’étudiants et de militants ont manifesté dans l’enceinte de Sciences Po ou aux abords de la Sorbonne, en soutien à la Palestine. Ces protestations ont entraîné des blocages, ainsi que plusieurs occupations de sites universitaires, avec le seul et unique objectif de contester, non de dialoguer.
Un retour au calme était nécessaire, alors que les étudiants passent des examens dans quinze jours. Les cours ayant repris hier, je tiens à saluer l’engagement du Gouvernement, qui a permis aux élèves de reprendre le travail.
Si ce mouvement a pour le moment été circonscrit à quelques campus, il faut nous interroger sur les causes de ces manifestations, ainsi que sur la méthode employée par ces groupes, qui n’ont de cesse de mettre la pression sur les autorités en recourant à des procédés discutables.
L’université est un lieu essentiel pour la construction intellectuelle des jeunes et le développement de leur pensée critique. En son sein, il est donc possible de discuter, d’argumenter, d’être en désaccord, de faire valoir ses idées et d’en débattre, et même – qui sait ? – de changer d’avis.
M. François Bonhomme. Pas quand tout est bloqué !
Mme Patricia Schillinger. Pour autant, il est inacceptable de voir des groupes minoritaires tenter de bâillonner et d’exclure de leurs réunions des personnes ayant des opinions différentes des leurs.
Aidés de leurs soutiens politiques de La France insoumise, lesquels sont venus les saluer pour attiser les flammes de la haine et de l’intolérance, certains manifestants se sont permis de stigmatiser une partie des étudiants. Dans un pays qui a érigé la liberté d’expression en liberté fondamentale, ce n’est pas tolérable !
Ma question, madame la ministre, est donc la suivante : au-delà des mouvements de ces dernières semaines sur les campus de Sciences Po, comment accompagner les universités pour que ces dernières restent des lieux d’apprentissage, de partage des opinions et de débat et ne deviennent pas des espaces de censure ou le lieu d’une pensée unique, comme certains le souhaitent ? (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi que sur des travées du groupe RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Mme Sylvie Retailleau, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. Madame la sénatrice Patricia Schillinger, comme vous l’avez dit, nous devons garantir à nos étudiants, non seulement de bonnes et sereines conditions d’études, comme il en existe dans nos écoles et nos universités, mais aussi le respect d’un cadre à la fois démocratique et républicain.
M. François Bonhomme. C’est raté !
Mme Sylvie Retailleau, ministre. Ma position, qui est également celle de M. le Premier ministre, est simple et très claire : oui au débat quand il est respectueux et se déroule dans un cadre républicain ; non, toujours non, au blocage ! Je tenais à le redire.
Je regrette comme vous que certains irresponsables soufflent sur les braises et instrumentalisent le conflit israélo-palestinien. Ils utilisent les étudiants en appelant au soulèvement, ce qui est très grave. Je crois que nous devrions tous le condamner fermement.
L’outrance et la surenchère ne font pas de bien à notre démocratie. Cela suffit !
M. Roger Karoutchi. Avec ce genre de propos, nous ne sommes guère avancés !
Mme Sylvie Retailleau, ministre. Il faut que tout cela cesse.
On a comparé un président d’université à un nazi. Aussi ai-je porté plainte pour injure publique à un agent public.
Vous m’interrogez sur notre capacité à rétablir un environnement favorable à la fois aux études et au débat d’idées, y compris contradictoire, dans nos établissements. Cette exigence est aussi la mienne.
Aussi, au regard du contexte actuel, j’ai souhaité réunir rapidement les présidents d’université. Jeudi prochain, je les rassemblerai pour que chacun puisse exprimer ses positions et, surtout, pour que nous réfléchissions à l’élaboration de mesures concrètes selon un calendrier que nous fixerons.
Nous appelons tous de nos vœux la préservation de la construction et de la transmission des savoirs comme mission première de nos universités, ainsi que le maintien d’un cadre propice aux études et à un débat serein, dans le respect de la loi et des règlements intérieurs des campus.
M. Roger Karoutchi. Ce n’est pas le cas !
Mme Sylvie Retailleau, ministre. Les personnels, les étudiants de nos universités et de nos écoles méritent de travailler et d’étudier dans de bonnes conditions. Nous ne transigerons pas sur ce point, fidèles à la ligne que nous avons toujours appliquée, et cela dans le respect du cadre républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – Marques de scepticisme sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP, ainsi que sur des travées du groupe UC.)
Mme Vanina Paoli-Gagin. Ma question s’adresse à Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Madame la ministre, à mon tour, je souhaite vous interroger sur la situation à Sciences Po et dans les universités, ce qui atteste tant de la prégnance que de la gravité du sujet.
Nous assistons avec consternation et inquiétude à des opérations de manipulation de la part de pseudo-mouvements étudiants au sein de nos universités. En première ligne, Sciences Po et la Sorbonne, temples de la connaissance et du pluralisme des idées,…
M. Laurent Burgoa. Ça, c’est fini !
Mme Vanina Paoli-Gagin. … sont prises en otage par une minorité radicale.
Cette mobilisation a pris des proportions dangereuses à Paris comme dans le reste de notre pays. Nous ne pouvons tolérer l’occupation de locaux universitaires ni l’instrumentalisation politique des étudiants, et encore moins la profération d’appels à la haine antisémite.
Au fil des années, on a baissé la garde sur la défense du pacte républicain. Aujourd’hui, cette situation désastreuse a pris une tournure très politique, puisque les étudiants à l’origine des mouvements de blocage sont soutenus activement par l’extrême gauche, dont le naufrage se profile un peu plus de jour en jour.
M. Roger Karoutchi. Ça, c’est sûr !
Mme Vanina Paoli-Gagin. Nous assistons à une dérive idéologique croissante au sein d’établissements pensés – rappelons-le – pour former nos élites républicaines.
Ces lieux devraient être consacrés à la confrontation des idées, au débat raisonné, à la transmission éclairée. Nous faisons face à une forme de négationnisme intellectuel – j’ose l’expression –, diamétralement opposé à l’esprit des Lumières. Dans ces établissements, tout tend ainsi à devenir opinion.
Comme cela a été dit, la polarisation et l’outrance n’ont jamais permis de trouver un point d’équilibre. Face à la radicalisation, refusons la capitulation intellectuelle et restons fermes !
Madame la ministre, que pouvons-nous faire de plus pour que notre université renoue avec son universalité ? (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)
M. Emmanuel Capus. Bravo !
M. le président. La parole est à Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Mme Sylvie Retailleau, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. Madame la sénatrice Paoli-Gagin, tout d’abord, je vous remercie d’avoir rappelé, car c’est important, le rôle et les missions des universités et de tous nos établissements d’enseignement supérieur.
Il faut le répéter, le débat et la liberté d’expression respectueuse, maîtrisée et cadrée constituent l’une des vocations des universités. Les blocages et, surtout, les intimidations, c’est non ! A fortiori, nous refusons les incitations à la haine et les appels au soulèvement ou même, j’ose le dire, à l’insurrection. (Exclamations sur les travées du groupe SER.)
C’est pourquoi nous restons très fermes et vigilants. Il est de notre responsabilité, je dirais même de notre responsabilité collective, de veiller au respect du cadre républicain, ainsi qu’à la sécurité des biens et des personnes, et de faire en sorte que l’on retrouve cette objectivité, cette maîtrise, cet équilibre et ce cadre.
Permettez-moi de le rappeler, aucune sanction contre les auteurs de faits graves, comme des actes d’antisémitisme, ne sera abandonnée, ni aujourd’hui ni demain. (Exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. Roger Karoutchi. Vous êtes aveugle !
Mme Sophie Primas. Et sourde !
Mme Sylvie Retailleau, ministre. Honte à ceux qui choisissent de souffler sur les braises, de diffuser de fausses informations et d’attiser les haines ! Honte à ceux qui instrumentalisent ces conflits et qui utilisent notre jeunesse et, ici, nos étudiants ! C’est tout simplement irresponsable et dangereux.
Permettez-moi aussi de m’associer à vos propos sur la nécessité du débat d’idées, du débat contradictoire et de la controverse. Je l’ai dit, je rencontrerai prochainement les présidents d’université, en vue de mettre rapidement en place des actions concrètes.
Les déchaînements de haine, les appels à l’insurrection, la reprise d’odieux symboles, c’est non ! Les universités sont des lieux d’études. Leur mission est trop importante et trop précieuse pour que l’on piétine leur image et que l’on empêche leur bon fonctionnement, en tentant d’importer cette mobilisation des États-Unis. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
M. Mickaël Vallet. Et le budget des universités ?
M. le président. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour la réplique.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Je vous remercie, madame la ministre.
Nous comptons vraiment sur votre action (Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.) pour protéger de la tentation du rejet de toute altérité notre jeunesse, qui est parfois instrumentalisée par des forces obscures étrangères. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
beauvau de la sécurité civile et inquiétudes des sapeurs-pompiers