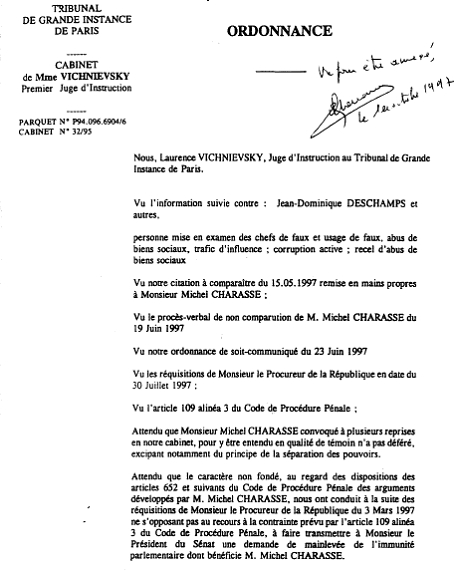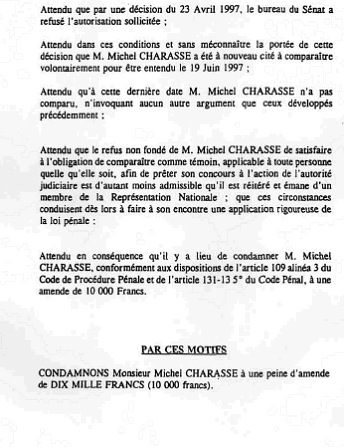N°15
SENAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 2 octobre 1997.
PROPOSITION DE RESOLUTION
tendant à requérir la suspension des poursuites engagées contre M. Michel Charasse, sénateur du Puy-de-Dôme,
PRÉSENTÉE
Par M. Michel CHARASSE,
Sénateur.
(Renvoyée à une commission de trente membres nommée à la représentation proportionnelle des groupes.)
Immunité parlementaire.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
I. - RAPPEL DES FAITS
1° Les conditions de ma convocation par un juge d'instruction.
Comme le sait le Sénat, je fais actuellement l'objet de poursuites à l'initiative d'un juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris, sur la base de l'article 109 du code de procédure pénale.
C'est ainsi que, le 10 septembre 1997, j'ai été condamné, en première instance, à une peine d'amende de 10000 F. J'ai aussitôt fait appel de cette décision.
Cette sanction prétend tirer les conséquences de mon refus de déférer à une convocation de ce magistrat, exigeant que je m'explique, en qualité de simple témoin, sur les actes non délictueux que j'aurais accomplis dans l'exercice de mes fonctions de ministre du budget entre le 29 juin 1988 et le 2 octobre 1992.
Le juge d'instruction a, en effet, souhaité m'entendre, en décembre 1996, dans le cadre d'une procédure dont j'ignore tout et qui, selon la presse, mettrait en cause des relations financières illégales conclues entre la Compagnie générale des Eaux et le Parti communiste français, via sa filiale spécialisée GIFCO.
Or, lorsque j'exerçais mes fonctions ministérielles, je n'ai jamais été saisi de ce dossier, pas plus que mon cabinet. Je ne sais même pas s'il a fait l'objet d'une vérification fiscale. En tout cas, si contrôle il y a eu, ce n'est pas sur mon ordre ni sur celui de mes collaborateurs. En outre, tout au long de cette éventuelle vérification, l'administration n'a sollicité ni mon avis, ni mon arbitrage, ni ceux de mon cabinet
Enfin, comme tout le monde le sait, je ne suis pas membre du Parti communiste et je n'ai, ni n'ai eu, dans le passé, aucune relation privée, administrative ou d'affaires avec la Compagnie générale des Eaux. Je ne me suis à aucun moment occupé de financements politiques et je ne connais aucun des protagonistes impliqués.
Aussi ai-je confirmé au juge, par téléphone, après qu'il se soit entretenu dans le même sens avec mon avocat, que je ne voyais pas en quoi mon témoignage pourrait éclairer ses investigations ni enrichir ses réflexions.
Le magistrat m'a alors indiqué :
- d'une part, qu'il savait parfaitement que je n'étais pas intervenu dans ce dossier et qu'il ne disposait de ce fait d'aucun élément susceptible de mettre en cause ma responsabilité pénale ;
- d'autre part, qu'il ne comptait donc pas m'interroger sur les faits eux-mêmes, puisque je ne les connais pas, mais sur les instructions ministérielles - contenu, modalités d'application, etc. - données de tout temps à l'administration fiscale pour traiter les anomalies liées à des financements politiques.
En conclusion de cet entretien, j'ai refusé de comparaître.
2° Ma réponse : le principe de séparation des pouvoirs.
J'ai indiqué au juge que, dès lors que les dispositions toujours en vigueur de la loi des 16-24 août 1790 sur la séparation des pouvoirs, et notamment son article 13, interdisent à un magistrat de s'immiscer dans le fonctionnement de l'administration, les membres et anciens membres du Gouvernement n'ont pas à répondre à une autorité judiciaire les invitant à s'expliquer et à se justifier sur les actes de leur gestion politique et administrative.
Les auditions des deux autres anciens ministres convoqués en même temps que moi - MM. Emmanuelli et Sarkozy - et qui ont admis les prétentions du juge, confirment, d'après ce qui m'a été indiqué, que les questions du magistrat ne portent absolument pas sur le dossier à l'instruction, qu'aucun des deux anciens ministres n'a eu, semble-t-il, à connaître. Ces questions viseraient exclusivement des décisions administratives et politiques de portée générale prises par les ministres en matière de contrôle fiscal. Le juge s'immisce donc bien dans le fonctionnement de l'administration, contrairement au principe de la séparation des pouvoirs.
A ce sujet, souvenons-nous que l'une des toutes premières tâches des constituants de 1789 a consisté à mettre un terme aux excès des « Parlements » - c'est-à-dire des tribunaux - de l'Ancien Régime.
Est-il besoin de rappeler que, dès le mois d'août 1789, l'Assemblée constituante a posé, parmi les principes fondamentaux de la démocratie garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celui de la « séparation des pouvoirs », sans laquelle il n'est «point de Constitution» (art. XVI), et que, jusqu'à preuve du contraire, cette Déclaration fait aujourd'hui partie de notre « bloc de constitutionnalité » ?
Est-il besoin de rappeler que moins d'un an plus tard, ce principe a été clairement confirmé et précisé par la loi, toujours en vigueur, des 16-24 août 1790 dont l'article 13 non seulement interdit aux juges de se mêler du fonctionnement de l'administration, mais encore leur fait défense de citer devant eux « les administrateurs pour raisons de leurs fonctions » ?
Faut-il enfin rappeler le décret, lui aussi toujours en vigueur, du 16 fructidor An ffl, qui « défend au tribunaux de connaître des actes d'administration et annule toute procédure et jugement intervenus à cet égard » et qui fait « défenses itératives (...) aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit » ?
II - UN PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA RÉPUBLIQUE
1° Un principe qui ne saurait se discuter.
La citation de trois anciens membres du Gouvernement par un juge pour s'expliquer sur leur politique viole à l'évidence le principe fondamental de la séparation des pouvoirs, élément essentiel de la démocratie et de la République et dont l'objet est double :
A. - D'une part, assurer le respect de la règle constitutionnelle selon laquelle le suffrage universel est la seule source du pouvoir. Seuls les élus du peuple - et les juges n'en sont pas ! - peuvent agir au nom de la souveraineté nationale, voter la loi et l'appliquer.
La Constitution de la V e République à tiré la conséquence logique de cette règle traditionnelle de notre démocratie en refusant d'ériger la justice en « pouvoir ». Elle l'a limitée au rôle de simple « autorité ».
B. - D'autre part, assurer l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Là encore, la Constitution de 1958 ne fait que tirer les conséquences des règles posées par la Déclaration de 1789 , la loi de 1790 et le décret de l'An III.
On sait combien les magistrats sont attachés, à juste titre, à la séparation des pouvoirs lorsqu'elle garantit leur indépendance. Aussi ne peut-on que s'étonner que ce principe sacré ne soit pas considéré, par certains, comme devant évidemment s'appliquer dans les deux sens.
Souvenons-nous que les excès des juges avant la Révolution française avaient été tels, au détriment de l'exécutif comme du citoyen, que la loi de 1790 a retenu à rencontre de ceux qui violeraient la séparation des pouvoirs une incrimination particulièrement grave : la « forfaiture », définie par l'ancien code pénal jusqu'en février 1994 comme un « crime » relevant de la cour d'assises.
Depuis le 1 er mars 1994, cette disposition ne figure plus dans le code pénal : elle aurait été - hasard ou erreur ? - supprimée au motif qu'elle n'avait jamais été appliquée à aucun magistrat depuis la Révolution !
2° Un principe battu en brèche par une autorité judiciaire.
J'ai évidemment demandé au juge de m'expliquer sa conception de la séparation des pouvoirs. Mon interlocuteur s'est borné à me rappeler que les seules dispositions prévues par le code de procédure pénale - articles 652 et suivants - concernent l'audition des membres du Gouvernement en exercice. Lorsque le Conseil des ministres ne les autorise pas à déférer à une convocation comme témoin, ceux-ci sont en effet tenus de déposer par écrit, à leur cabinet, entre les mains du Premier président de la cour d'appel.
Le magistrat instructeur tire donc deux conclusions de ce dispositif :
a) d'une part, la procédure spéciale prévue pour les membres du Gouvernement ne leur permet pas de refuser de témoigner. Ils sont seulement dispensés de se déplacer dans le cabinet du juge ;
b) d'autre part, cette procédure spéciale ne s'applique qu'aux ministres en exercice.
Les anciens membres du Gouvernement, même convoqués es qualités, relèvent donc du droit commun.
Si ce raisonnement devait devenir la règle, les tribunaux pourraient dorénavant se prononcer indépendamment de toute référence aux grands principes constitutionnels qui fondent la République et la démocratie.
Cet alignement sur la démarche des tribunaux des dictatures est inadmissible : car elle rendrait vaines les nombreuses décisions du Conseil constitutionnel, du Tribunal des conflits, du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, qui guident avec précision et rigueur la démarche de l'autorité judiciaire au regard, justement, des exigences de valeur constitutionnelle.
Le droit pénal ne peut s'affranchir de la hiérarchie des nonnes et, a fortiori, des grands principes de la République.
Les articles 652 et suivants du code de procédure pénale seraient contraires à la Constitution s'ils autorisaient les juges à questionner les ministres sur leur politique.
Et cette règle applicable aux ministres en exercice l'est également aux anciens ministres : on sait que, même après avoir quitté le Gouvernement, les anciens ministres relèvent toujours de la Cour de justice de la République pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
Est-ce à dire que les ministres et anciens ministres, et plus généralement les responsables politiques, ne sont pas des citoyens comme les autres et se situent au-dessus des lois ?
Évidemment non. De tels sous-entendus sont injurieux pour les intéressés. Ils n'ont en réalité qu'un seul objet : dresser l'opinion publique contre eux.
II- UN PRINCIPE TOUJOURS VIVANT
1° La mise en jeu de la responsabilité des ministres est clairement prévue mais encadrée.
Les règles qui organisent la mise en jeu de la responsabilité des ministres comme des anciens ministres sont très claires :
A. - Pour les crimes et délits accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne relèvent que de la Cour de justice de la République qui leur applique les règles pénales ordinaires.
Toutefois, l'instruction procède d'une commission spéciale formée de magistrats de la Cour de cassation. Les juges de droit commun ne sont donc pas compétents.
C'est ce que j'ai rappelé fermement au juge concerné.
Il m'a rétorqué que puisque aucune charge ne pouvait être retenue contre moi, il restait compétent (sic !) pour m'entendre comme témoin, ainsi que nos deux autres collègues aujourd'hui députés, sans qu'il y ait lieu à renvoi à la Cour de justice.
B. - Leurs actes administratifs, sauf ceux qualifiés de « voie de fait », ne relèvent pas des tribunaux civils ou répressifs, mais seulement de la juridiction administrative.
Celle-ci a justement été mise en place, au XIX e siècle, pour préserver strictement la séparation des pouvoirs sans toutefois soustraire les actes des ministres au contrôle de légalité.
C. - Enfin, leurs actes politiques non délictueux relèvent, depuis le 10 mars 1792 et la démission du ministre des affaires étrangères De Lessart, de la seule appréciation des Assemblées.
C'est, en effet, pour préserver et respecter le principe de la séparation des pouvoirs que l'Assemblée nationale a supprimé la « mise en accusation » des ministres qui n'avaient plus sa confiance, car ses conséquences étaient manifestement exagérées et inadaptées. Elle l'a remplacée par la « responsabilité politique » du Gouvernement devant le Parlement : c'est aujourd'hui le fondement du régime parlementaire.
Ces rappels, vainement portés à la connaissance du magistrat instructeur, conduisent à deux conclusions de bon sens.
En premier lieu, seul le Parlement peut exiger des explications sur la politique et la gestion d'un ministre ou d'un ancien ministre.
Pour ma part, je suis prêt, comme je l'ai souvent dit, n'étant de surcroît coupable d'aucun délit et n'ayant rien à cacher, à m'expliquer devant les Assemblées de la République française, si elles jugent utiles de m'entendre.
En second lieu, si le code de procédure pénale n'interdit pas à un juge de droit commun de recueillir le témoignage d'un ministre ou d'un ancien ministre, encore faut-il que ce témoignage ne soit pas sollicité « pour raisons de (ses) fonctions ».
Pour des raisons qui tiennent aux exigences de la séparation des pouvoirs, un membre ou ancien membre du Gouvernement ne peut évidemment être entendu que sur des faits détachables de ses responsabilités ministérielles et n'ayant aucun lien avec elles.
H en est ainsi lorsqu'un membre, ou ancien membre du Gouvernement, a été témoin, comme simple citoyen, d'un crime ou d'un délit sans lien avec ses fonctions, même s'il survient à l'intérieur de son ministère.
2° L'exception : l'article 40 du code de procédure pénale.
Pour les faits, susceptibles d'être qualifiés de crime ou de délit, portés à la connaissance des ministres à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, le code de procédure pénale, respectueux de la séparation des pouvoirs, impose, dans son article 40, de les « dénoncer » sans commentaire au procureur de la République.
Si témoignage il y a, il doit se borner à cela.
Ajoutons que celui - ministre ou agent public - qui pratique cette dénonciation n'a pas à qualifier les faits. La séparation des pouvoirs lui interdit de se substituer aux magistrats en suggérant une incrimination.
Il doit donc, s'il a un doute, se contenter de signaler ce qu'il sait, à charge pour l'autorité judiciaire, si elle l'estime utile, de qualifier et de poursuivre. Enfin, le dénonciateur n'est jamais « partie » à la procédure découlant de l'article 40 précité (séparation des pouvoirs encore !).
Telles sont les raisons - et pour ne pas être le complice d'une forfaiture ni participer à une tentative d'abaissement de l'autorité de l'Etat et du pouvoir exécutif par un tribunal - pour lesquelles j'ai refusé de me présenter devant le juge d'instruction.
3° Un principe appliqué et respecté quotidiennement
Certains se sont interrogés et s'interrogent : le principe de la séparation des pouvoirs ne serait-t-il pas tombé aujourd'hui en désuétude, sauf lorsqu'il protège et assure l'indépendance de l'autorité judiciaire ?
Poser cette question est non seulement inconvenant dans une vraie démocratie - car seules les dictatures concentrent tous les pouvoirs entre les mains d'un seul -, mais aussi parce que c'est se comporter comme si la séparation des pouvoirs n'était pas minutieusement organisée par et dans nos institutions.
Or, comme la prose de M. Jourdain, elle s'applique tous les jours, et pas seulement à l'égard des juges :
1. La Constitution fait du Président de la République le garant de l'indépendance de la justice, qu'il assure avec le concours du Conseil supérieur de la magistrature. Aucun de ceux qui se sont succédé à l'Elysée n'a manqué à ce devoir. Récemment, en décembre 1994, le chef de l'Etat n'a pas hésité à soumettre au Conseil supérieur la situation d'un juge d'instruction qu'on envisageait, fort maladroitement, de dessaisir.
2. La Constitution interdit au pouvoir exécutif d'affecter ou de muter un magistrat du siège sans son consentement (inamovibilité).
3. La loi n'autorise les instructions du garde des Sceaux qu'aux seuls magistrats du parquet.
4. Le pouvoir exécutif n'est pas responsable des missions de la police judiciaire, qui ne relèvent que des magistrats.
5. Aucune commission d'enquête parlementaire ne peut être instituée sur des faits qui donnent lieu à une procédure judiciaire.
6. Les rapporteurs spéciaux des commissions des finances des Assemblées ne peuvent effectuer aucun contrôle sur place et sur pièces s'il est susceptible de mettre en cause la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.
7. Le Parlement ne peut pas se substituer au Gouvernement dans le domaine réglementaire. Inversement, le Gouvernement ne peut interférer dans l'organisation interne des Assemblées (Règlement, résolutions, etc.) ni voter la loi à leur place, sauf consentement des chambres à la procédure des ordonnances.
8. Les Assemblées jouissent de l'autonomie administrative et financière. Aussi, leurs services échappent à l'autorité du pouvoir exécutif et leurs budgets et leurs comptes à l'appréciation du ministre des Finances, de la Cour des comptes et de la Cour de discipline budgétaire.
Enfin, dans la période récente, le Parlement a eu le souci de tenir compte des exigences du principe de la séparation des pouvoirs, par exemple :
- en précisant expressément que c'est « par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 » que l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1957 donne compétence aux tribunaux de l'ordre judiciaire pour statuer sur les dommages causés par les véhicules automobiles des administrations ;
- en refusant, dans la loi du 31 décembre 1989 sur le surendettement des particuliers, que le juge judiciaire s'immisce dans le recouvrement des créances, fiscales ou non, du Trésor public ;
- en précisant que seul le garde des sceaux peut solliciter des Bureaux des Assemblées la levée de l'immunité d'un parlementaire, rappelant ainsi par la même occasion que la séparation des pouvoirs n'autorise pas les magistrats à communiquer directement avec les Chambres.
Pourquoi, dans ces conditions, considérer la séparation des pouvoirs comme une notion désuète ?
IV. - LES SUITES JUDICIAIRES ET PARLEMENTAIRES
1 ° La procédure mise en enivre par le juge.
A la suite de mon refus de déférer à la convocation du magistrat, pourtant solidement argumenté et juridiquement justifié, le juge a sèchement écarté mes explications, sans même les examiner sérieuse-
ment, et a demandé au Bureau du Sénat d'autoriser mon arrestation pour me faire conduire devant lui par la force publique.
Le 23 avril 1997, le Bureau du Sénat a rejeté cette requête.
Malgré cette décision sans ambiguïté, le magistrat m'a convoqué une nouvelle fois, selon la même procédure et pour le même motif, à la mi-juin 1997.
Pour des raisons identiques à celles précédemment exposées, y compris au Bureau du Sénat, je n'ai pas plus déféré à cette convocation qu'aux précédentes.
Après avoir demandé ses réquisitions au parquet de Paris, qui lui a fait savoir qu'il jugeait inopportun d'aller plus avant dans cette affaire dès lors que le Bureau du Sénat s'était prononcé, le juge d'instruction, en application de l'article 109 précité du code de procédure pénale, a passé outre. D m'a condamné, par ordonnance pénale du 10 septembre 1997, à la peine maximum prévue par la loi : une amende de 10 000 F.
C'est ce qui me conduit à demander au Sénat de bien vouloir placer mon mandat sous la protection qu'autorisé le troisième alinéa de l'article 26 de la Constitution, selon lequel « la poursuite d'un membre du Parlement (est suspendue) pour la durée de la session si l'Assemblée dont il fait partie le requiert ».
2° Compétence et pouvoir du Sénat
La résolution soumise à la Haute Assemblée va la conduire à répondre à au moins deux questions :
- la procédure un peu particulière et sans précédent mise en oeuvre à mon encontre est-elle bien une « poursuite » au sens de notre droit pénal ?
- les conditions requises par la tradition républicaine et la pratique parlementaire pour faire bénéficier les membres des Assemblées de l'immunité sont-elles réunies en l'espèce ?
Il convient d'éclairer la réflexion du Sénat par les observations suivantes.
A. - La procédure employée à mon égard est-elle une « poursuite » au sens pénal du terme ?
Avant d'argumenter sur ce point, il convient de s'interroger un instant sur la légalité de la démarche du juge.
En effet, l'article 109 du code de procédure pénale lie étroitement les mesures à la disposition du juge. Le troisième alinéa de cet article prévoit que lorsque le témoin ne comparaît pas, le juge « peut (...) l'y contraindre par la force publique et le condamner à l'amende ».
La lecture littérale du texte amène la conclusion suivante : l'amende ne peut intervenir qu'aussitôt après que le témoin ait été conduit par la force devant le juge. Elle est donc prononcée en présence du témoin.
Or, en l'espèce, le juge a d'abord fait une exacte application de l'article 109 : il a envisagé le recours à la force publique et a demandé au Bureau du Sénat de l'autoriser ; une fois intervenue la décision du Bureau du Sénat, il a interrompu le processus reconnaissant implicitement qu'il ne pouvait pas infliger une amende à un témoin dont la force publique n'avait pas pu se saisir.
Puis le juge a engagé une nouvelle procédure en reconvoquant le témoin quelques semaines plus tard. Estimant inutile de saisir une deuxième fois le Bureau du Sénat - dont la position n'aurait sans doute pas été différente, le dossier étant rigoureusement identique -, il a prononcé l'amende. Ce faisant, le juge a interprété l'article 109 d'une autre manière, comme si le « et » de la première lecture était devenu « ou » à la seconde.
En quelque sorte, le juge admet, la première fois, qu'il n'a pas le choix entre la contrainte et l'amende et que les deux sont liées. Mais la seconde fois, il interprète l'article 109 autrement, comme s'il lui laissait le choix entre la contrainte et l'amende.
C'est cette analyse qui, entre autres arguments, est soumise en appel à l'appréciation de la chambre d'accusation.
Quant à la nature de la procédure, il est difficile de nier qu'il ne s'agit pas d'une « poursuite ».
a) Le fait qu'il n'y ait aucun précédent et que l'article 109 du code de procédure pénale soit si rarement employé qu'il n'existe aucune jurisprudence sur ce point ne suffit pas pour considérer que nous ne sommes pas en présence d'une poursuite pénale ;
b) il s'agit d'un acte d'un juge d'instruction, et donc d'un acte d'instruction.
D paraît difficile de soutenir qu'un acte d'instruction n'est pas un élément - ou un moyen - de la poursuite alors que le juge d'instruction n'a pas d'autre fonction que de diligenter en matière de poursuites pénales
c) l'article 109 du code de procédure pénale, comme d'ailleurs l'ordonnance du 10 septembre 1997, indiquent clairement qu'il s'agit d'une « condamnation ».
Or, seuls les magistrats du siège peuvent prononcer des condamnations pénales. Les contraventions sont de la compétence des officiers et agents de police judiciaire qui ne relèvent pas du statut des magistrats. Et les condamnations prononcées par les magistrats ont toujours un caractère pénal, sauf lorsqu'il s'agit d'indemniser la partie civile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce
d) la condamnation a été prononcée, comme devant tout tribunal, à la suite d'une procédure contradictoire.
La convocation du juge portait la mention de la peine encourue en cas de refus du témoin. Mon absence a été constatée par un procès-verbal de carence qui a ouvert la procédure de la poursuite. Conformément à la loi, et après avoir pris connaissance de mes explications, le magistrat instructeur a invité le parquet à lui adresser ses réquisitions.
Le procureur de Paris a alors fait connaître son opinion au juge d'instruction : au vu de la décision du Bureau du Sénat, il lui aurait semblé inopportun d'infliger une amende au témoin défaillant dans de telles conditions.
C'est à la suite de cette procédure contradictoire, au cours de laquelle se sont exprimés le juge qui poursuit, le témoin défaillant -devenu prévenu - et le ministère public, que le magistrat instructeur a prononcé la condamnation à la peine d'amende maximum prévue par la loi.
La procédure suivie devant toute juridiction pénale a donc été strictement respectée et on peut estimer que c'est dans un souci de simplification et de rapidité que le législateur a retenu la compétence du juge d'instruction plutôt que celle du tribunal correctionnel.
e) Le fait que le magistrat instructeur soit érigé à la fois en juridiction des poursuites et du jugement ne change pas le fond : il s'agit bien d'une poursuite aboutissant à une condamnation prononcée par un magistrat du siège.
Le même raisonnement s'applique au fait que l'appel relève de la chambre d'accusation : celle-ci ne peut remettre en cause que des actes d'instruction qui constituent un élément de la poursuite.
f) il s'agit bien d'une amende pénale et non d'une simple contravention.
Le fait que la loi laisse le soin au juge d'instruction de fixer le montant de la peine par référence aux tarifs applicables aux contraventions de la cinquième classe ne saurait priver l'amende de son caractère de condamnation pénale. Or, les condamnations pénales sont toujours prononcées au terme d'une poursuite.
g) S'agissant d'une condamnation à laquelle s'applique le droit commun des poursuites, elle peut être frappée d'appel. Elle l'a été dès sa notification. Elle n'a donc pas, à ce jour, un caractère définitif.
Or, l'article 26, troisième alinéa, de la Constitution ne peut concerner que des poursuites. Car l'immunité parlementaire n'autorise pas les Assemblées à dispenser leurs membres d'exécuter une peine définitive. Nous sommes dans ce cas, puisque la procédure se poursuit maintenant en appel.
h) L'immunité parlementaire n'a pas pour objet de soustraire un citoyen-parlementaire à l'application des rigueurs de la loi. Elle a seulement pour effet de placer le mandat de député ou de sénateur à l'abri de manoeuvres visant à en empêcher ou à en contrarier le libre exercice.
C'est donc une question qui ne relève que de l'appréciation des Assemblées et de la conscience de chacun de leurs membres. Ainsi, le Sénat est seul souverain en cette matière, puisque sa décision n'est pas susceptible de contestation ou de réformation.
A l'évidence, nous sommes bien en présence de poursuites pénales en cours à l'égard d'un parlementaire.
Cette poursuite n'est pas contraventionnelle et ne concerne pas un crime. Concerne-t-elle un délit ? Le code est muet à ce sujet. Concluons donc que, dès lors que notre droit pénal ne reconnaît que les crimes, les délits et les contraventions, elle doit plutôt être rattachée à la catégorie des délits et qu'elle est donc un « quasi-délit ».
Mais est-il nécessaire de rattacher formellement cette procédure à l'une des trois catégories d'incriminations définies par le code pour que le Sénat s'en saisisse ? Car le troisième alinéa de l'article 26 de la Constitution, après les modifications apportées en 1995 à son dispositif, vise « la poursuite » sans la limiter strictement aux crimes et aux délits. Une poursuite tendant à infliger à un parlementaire une amende de 10 000 F tous les quinze jours n'est-elle pas de nature à perturber gravement sa vie et à le priver des moyens financiers d'exercer son mandat?
B. - Les conditions habituellement requises pour que le mandat parlementaire bénéficie de la protection édictée par l'article 26 de la Constitution sont-elles réunies ?
La pratique des Assemblées en matière d'immunité d'un député ou d'un sénateur procède d'une longue et constante tradition parlementaire. Elle s'est forgée tout au long des xrx* et XX e siècles dans l'esprit que décrivait le 16 juin 1884 le rapporteur de la commission ad hoc du Sénat : « n y a simplement lieu de rechercher ici si la poursuite est commandée par des intérêts supérieurs susceptibles de faire fléchir l'inviolabilité du sénateur. »
C'est la même analyse qui avait conduit le rapporteur de la Chambre à déclarer, le 10 juin 1880, qu'il n'y avait pas lieu de s'opposer à des poursuites « sincères et loyales » dès lors que les faits qui justifient les poursuites sont « certains, réels et sérieux ».
La poursuite engagée ne répond pas, à l'évidence, à ces diverses définitions.
a) Nul ne peut nier que le juge méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs. On ne saurait tolérer un tel outrage à la République sans réagir.
Car que dira-t-on si, désormais, les ministres et anciens ministres sont convoqués à tout propos par des juges pour s'expliquer sur des actes non délictueux de leurs fonctions ? Ces actes ne relèvent que de l'appréciation du Parlement et de la souveraineté nationale, dont aucun individu, fût-il juge, ne peut « s'attribuer l'exercice » (art. 3 de la Constitution).
Ce n'est tout de même pas un hasard si, dans un passé récent, un magistrat de l'ordre judiciaire a fini par lasser au point d'être révoqué pour avoir abusé de la convocation du Premier ministre et de ministres en exercice (affaire Bidalou).
Et ce n'est pas un hasard non plus si la Constitution a mis en place un « filtrage » des affaires adressées à la Cour de justice de la République, pour éviter que ministres et anciens ministres soient soumis à des procédures fantaisistes. Sans ce filtrage, le rôle de la Cour serait aujourd'hui particulièrement encombré !
Qu'adviendra-t-il si, demain, les parlementaires, pourtant irresponsables en vertu du premier alinéa de l'article 26 de la Constitution, sont eux aussi convoqués à tout propos par des juges pour s'expliquer, sans conséquences pénales, sur les actes quotidiens de leur mandat : questions écrites, propositions de loi, amendements, discours, etc.
La question est particulièrement grave et dépasse de beaucoup mon cas personnel, sans même parler des 10 000 F !
Il s'agit en réalité du statut et de l'indépendance des pouvoirs publics constitutionnels.
b) Chacun sait que le simple fait d'être invité à s'expliquer comme témoin devant un juge, même sans conséquences pénales, s'accompagne désormais d'une grand renfort de trompettes médiatiques.
Les conséquences sur l'opinion publique sont souvent irréparables. Etre convoqué aujourd'hui, c'est être forcément coupable, et en tout cas suspect.
c) Par son acharnement, le juge se comporte comme un mandataire de la souveraineté nationale.
Or, la seule source du pouvoir en France est le suffrage universel et les magistrats ne sont que des agents publics non élus, seulement chargés d'appliquer la loi dictée par le Parlement.
La procédure qui m'oppose à ce magistrat instructeur est révélatrice de ce comportement. Depuis qu'elle a été engagée, en décembre 1996, l'opinion publique n'a pas cessé d'être prise à témoin. Les atteintes au secret de l'instruction se sont multipliées.
Ainsi, l'ordonnance du 10 septembre 1997 qui me condamne, et bien qu'elle soit un acte d'instruction et qu'elle n'ait pas été prononcée en audience publique, a fait l'objet d'une dépêche de l'AFP le 11 septembre dans l'après-midi.
Pendant plus de vingt-quatre heures, j'ai tout ignoré de la sentence qui me frappait. Je n'ai eu connaissance de son contenu que lorsque l'huissier me l'a notifiée le vendredi 12 septembre à 18 h 05.
d) Enfin, on relèvera que, parmi les motivations qui justifient la sévérité de sa sanction, le magistrat écrit que mon attitude est « d'autant moins admissible (qu'elle) (...) émane d'un membre de la représentation nationale ».
Etre aujourd'hui un élu du peuple serait donc une circonstance aggravante ? C'est en tout cas transformer en circonstance aggravante le fait que les parlementaires sont soumis à un statut constitutionnel .particulier, et qu'ils sont contraints de le respecter.
Rappelons que l'immunité n'est pas toujours une faculté dont le parlementaire disposerait à sa convenance. Elle protège le mandat et l'élu, mais pas le citoyen.
C'est pourquoi, si la suspension des poursuites doit être demandée expressément, selon le cas, par un député ou un sénateur, voire par l'intéressé lui-même le garde des Sceaux, actionné par l'autorité judiciaire, est tenu de saisir le Bureau de l'Assemblée concernée s'il s'agit de porter atteinte à la liberté d'un parlementaire.
Ce n'est donc pas moi qui ai fait appel au Bureau du Sénat : je n'en avais pas le droit. Aussi, la garantie constitutionnelle dont j'ai bénéficié ne peut pas être considérée comme une circonstance aggravante.
En tout cas, on peut imaginer, à la lumière de cette ordonnance, ce qu'a pu être la réaction du juge en Usant la décision du Bureau du Sénat. En réalité, à travers ma condamnation, n'est-ce pas un peu -beaucoup ? - le Bureau du Sénat qui est visé ?
Avant d'exercer normalement leurs attributions, les pouvoirs élus devront-ils désormais s'assurer préalablement qu'il ne se trouvera pas un juge pour en être froissé ?
La République française ne peut pas devenir un régime de « Gouvernement des juges ». C'est contre ce danger que la souveraineté nationale, qu'exprimé le Parlement par délégation du peuple, doit réagir.
* *
*
A travers mon cas personnel, qui en soi présente peu d'intérêt, c'est bien la République qui serait atteinte s'il n'était pas mis un terme à ces errements.
A l'évidence, les poursuites engagées contre moi ne sont ni sérieuses, ni loyales, ni sincères. Ceci justifie qu'en sa qualité de protecteur des institutions et des immunités constitutionnelles, le Sénat requiert leur suspension comme la Constitution lui en donne la faculté.
Et qu'on ne croie pas que ma démarche ne vise qu'à défendre l'indépendance des pouvoirs élus : c'est aussi dans l'intérêt de la justice que j'en appelle au Sénat !
Qui, en dehors de la souveraineté nationale, ou de ses représentants, pourrait rétablir l'équilibre sur lequel repose la République, qui est autant nécessaire à la liberté d'action des pouvoirs constitutionnels qu'à la liberté d'appréciation de l'autorité judiciaire ?
Pour ces motifs, j'ai l'honneur de demander au Sénat de bien vouloir délibérer et adopter la proposition de résolution suivante.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Article unique
Le Sénat, en application de l'article 26, alinéa 3 de la Constitution, requiert la suspension des poursuites engagées contre M. Michel Charasse, sénateur du Puy-de-Dôme.
ANNEXE
Ordonnance du 10 septembre 1997 condamnant M. Michel Charasse à une amende de 10 000 F.