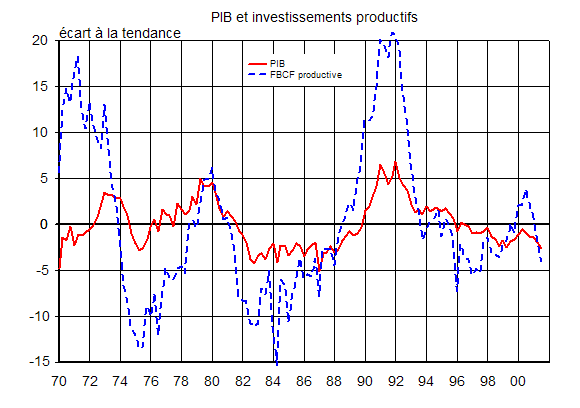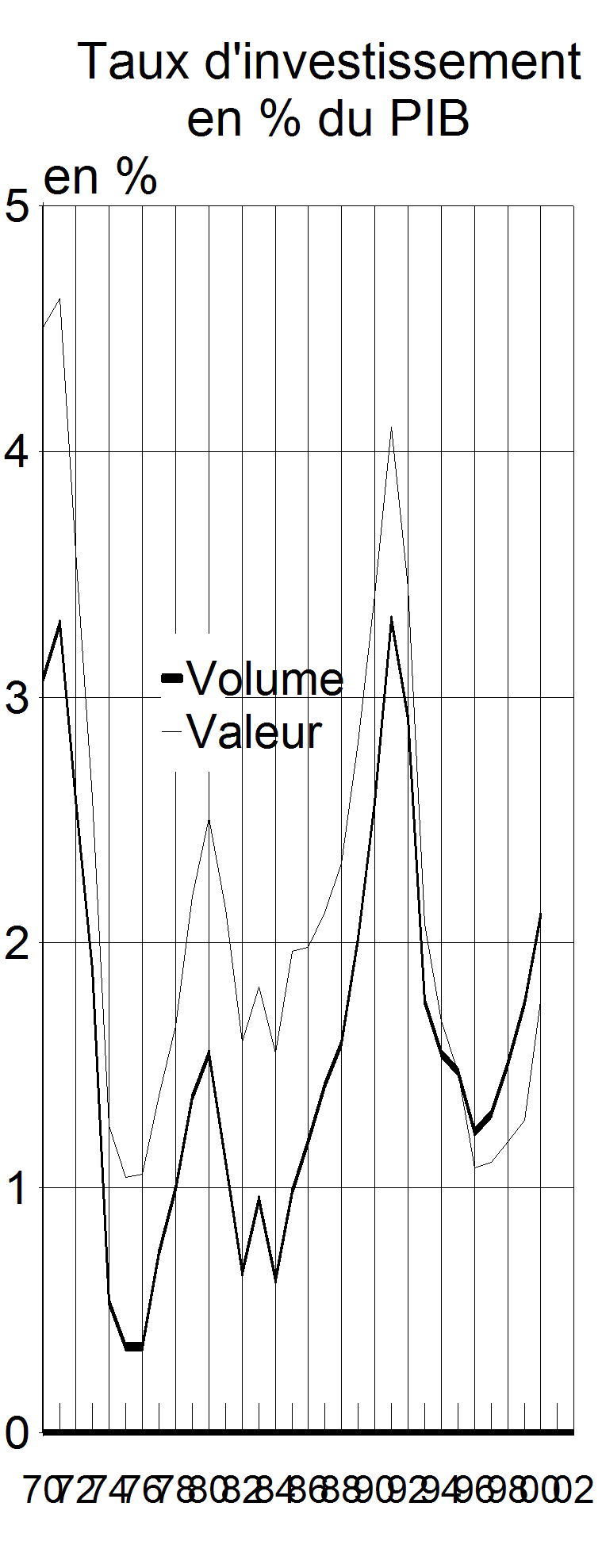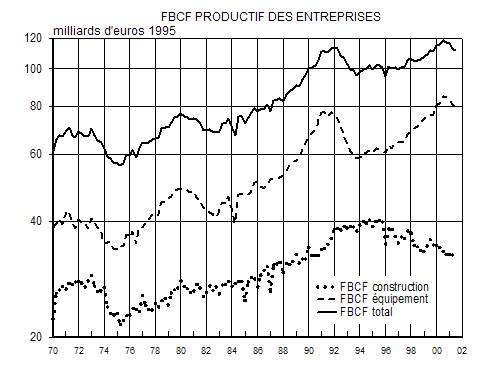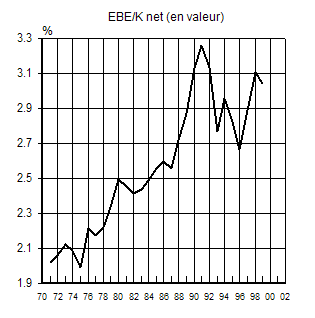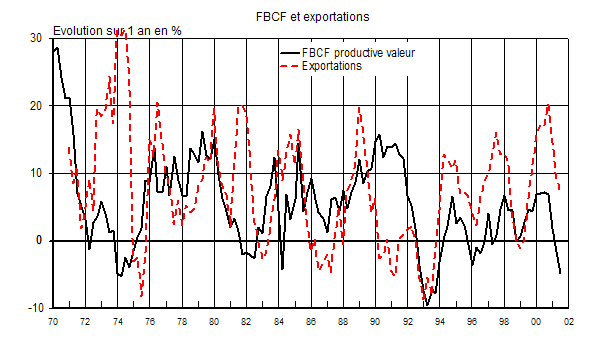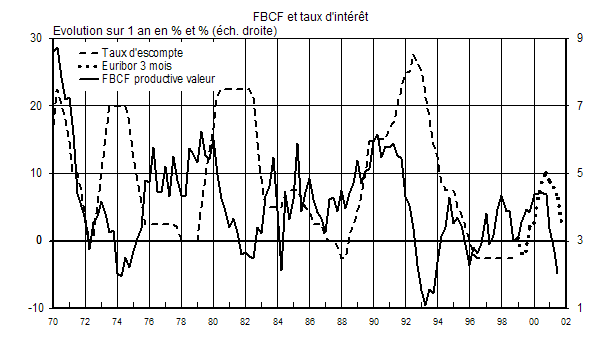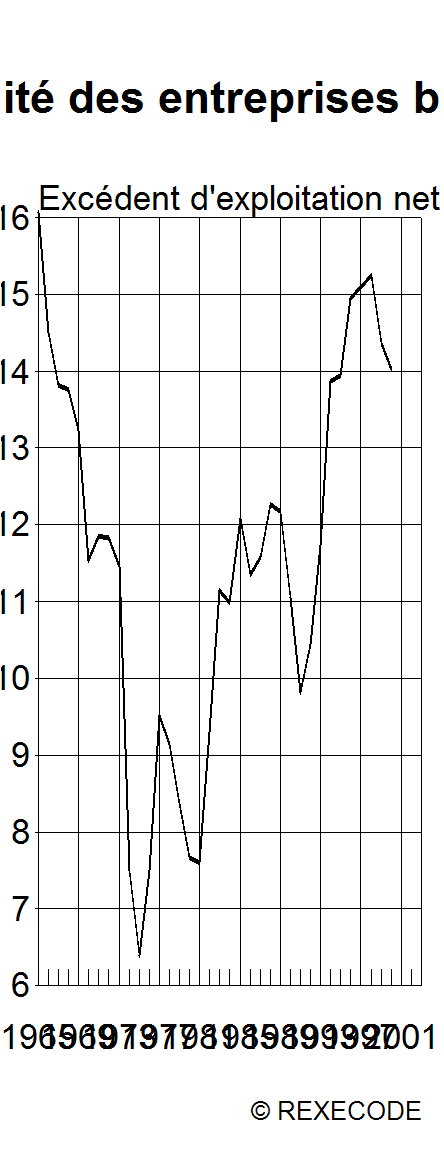Rapport d'information n° 35 (2002-2003) de M. Joseph KERGUERIS , fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification, déposé le 29 octobre 2002
Disponible au format Acrobat (873 Koctets)
-
INTRODUCTION
-
PREMIÈRE PARTIE :
LA RELATIVE LANGUEUR DE L'INVESTISSEMENT COMPROMET LA CROISSANCE
-
I. L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES EN FRANCE, UN
FAIBLE DYNAMISME
-
II. UN FAIBLE RYTHME D'INVESTISSEMENT
DÉFAVORABLE À LA CROISSANCE DE L'ÉCONOMIE
FRANÇAISE
-
III. LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS EN FRANCE
NE PERMETTENT PAS DE COMPENSER LA FAIBLESSE DE L'INVESTISSEMENT INTERNE
-
I. L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES EN FRANCE, UN
FAIBLE DYNAMISME
-
DEUXIÈME PARTIE :
L'APPORT DE LA THÉORIE ÉCONOMIQUE
À LA CONNAISSANCE DES DÉTERMINANTS
DE L'INVESTISSEMENT
-
TROISIÈME PARTIE :
POLITIQUES PUBLIQUES ET INVESTISSEMENT
-
I. PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT
MACROÉCONOMIQUE FAVORABLE À L'INVESTISSEMENT
-
II. ADAPTER LA FISCALITÉ À
L'INVESTISSEMENT
-
III. POUR UNE DÉPENSE PUBLIQUE PLUS
FAVORABLE À L'INVESTISSEMENT GLOBAL
-
IV. FACILITER LE FINANCEMENT DES
INVESTISSEMENTS
-
V. PRENDRE EN COMPTE LA RELATION ENTRE
FLEXIBILITÉ DES MARCHÉS ET INVESTISSEMENT
-
I. PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT
MACROÉCONOMIQUE FAVORABLE À L'INVESTISSEMENT
-
QUATRIÈME PARTIE :
LES PHÉNOMÈNES DE SURINVESTISSEMENT
-
I. LES ÉPISODES RÉCENTS DE
SURINVESTISSEMENT : JAPON, ETATS-UNIS, EUROPE :
-
A. UN PRÉCÉDENT
PRÉOCCUPANT : LE CAS JAPONAIS :
-
B. SYMPTÔMES DU SURINVESTISSEMENT
AMÉRICAIN :
-
C. SURINVESTISSEMENTS SECTORIELS : LE CAS DES
TÉLÉ-COMMUNICATIONS :
-
1. Une croissance des capacités de
production sans lien avec la progression de la demande :
-
2. Les stratégies d'internationalisation
ont eu un coût élevé :
-
3. La vente des licences UMTS, facteur
déclenchant de la crise des télécoms ?
-
4. Le financement de ces investissements a
précipité le lourd endettement du secteur :
-
1. Une croissance des capacités de
production sans lien avec la progression de la demande :
-
A. UN PRÉCÉDENT
PRÉOCCUPANT : LE CAS JAPONAIS :
-
II. ELÉMENTS
D'INTERPRÉTATION :
-
III. QUELLES RÉPONSES DE POLITIQUE
ÉCONOMIQUE ?
-
I. LES ÉPISODES RÉCENTS DE
SURINVESTISSEMENT : JAPON, ETATS-UNIS, EUROPE :
-
CONCLUSION
-
PRINCIPALES OBSERVATIONS DU RAPPORT
-
BIBLIOGRAPHIE
-
ANNEXE 1 :
COMPTE-RENDU DE L'AUDITION DE M. BRUNO CRÉPON,
ADMINISTRATEUR DE L'INSEE, LE 5 JUIN 2002
-
ANNEXE 2 :
COMPTE-RENDU DE L'AUDITION DE
M. CHRISTOPHE RUDELLE, ET DE MME LUCILE SIMON, CONSULTANTS AU BIPE, SPÉCIALISÉS DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (23 JUILLET 2002).
-
ANNEXE 3 :
COMPTE-RENDU DE L'AUDITION DU 10 SEPTEMBRE 2002,
DE MME FRANÇOISE GRI, PDG D'IBM FRANCE,
ET DE M. JEAN-PATRICE SAVEREUX, DIRECTEUR DES RELATIONS EXTÉRIEURES D'IBM FRANCE
-
ANNEXE 4
LES DÉTERMINANTS DE L'INVESTISSEMENT
-
INTRODUCTION
-
CHAPITRE 1
-
PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET
PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L'ÉTUDE
-
I. 1. L'ÉVOLUTION RÉCENTE DE
L'INVESTISSEMENT EN FRANCE
-
II. 2. LES TENDANCES LONGUES DE L'INVESTISSEMENT
EN FRANCE
-
A. 1. L'EXAMEN DES TENDANCES LONGUES NE
SUGGÈRE PAS À PREMIÈRE VUE UN RETARD D'INVESTISSEMENT EN
FRANCE.
-
B. 2. LE CONSTAT EST ANALOGUE POUR LE TAUX
D'INVESTISSEMENT (INVESTISSEMENT EN VALEUR RAPPORTÉ À LA VALEUR
AJOUTÉE).
-
C. 3. LE CONSTAT DIFFÈRE
LÉGÈREMENT SI L'ON EXAMINE LE TAUX DE CROISSANCE DU STOCK NET DE
CAPITAL PRODUCTIF (SELON LES CALCULS DES COMPTES NATIONAUX).
-
A. 1. L'EXAMEN DES TENDANCES LONGUES NE
SUGGÈRE PAS À PREMIÈRE VUE UN RETARD D'INVESTISSEMENT EN
FRANCE.
-
III. 3. LA POSITION DE LA FRANCE VIS À VIS
DES AUTRES PAYS ÉTUDIÉS
-
A. 1. LE TAUX D'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES
FRANÇAISES VIENT DE RETROUVER LE NIVEAU DES GRANDS PAYS
INDUSTRIALISÉS
-
B. 2. DES SIMILITUDES DANS LA RÉACTION DE
L'INVESTISSEMENT À LA CROISSANCE...
-
C. 3. ...MAIS LA TENDANCE LONGUE DU VOLUME DE
L'INVESTISSEMENT EST PLUS FAIBLE EN FRANCE
-
D. 4. LE RÔLE DES CONTRAINTES
FINANCIÈRES DANS LA DÉCISION D'INVESTISSEMENT EST FORTE DANS TOUS
LES PAYS, MAIS IL EST DIFFICILE DE PORTER UN DIAGNOSTIC SUR LE POIDS RELATIF DE
CES CONTRAINTES SELON LE PAYS.
-
A. 1. LE TAUX D'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES
FRANÇAISES VIENT DE RETROUVER LE NIVEAU DES GRANDS PAYS
INDUSTRIALISÉS
-
IV. 4. LES FLUX D'INVESTISSEMENTS ENTRE LA FRANCE
ET L'ÉTRANGER
-
V. 5. UN RETARD FRANÇAIS DE
L'INVESTISSEMENT DANS LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
-
VI. 6. LES ENJEUX D'UNE POLITIQUE DE
L'INVESTISSEMENT
-
I. 1. L'ÉVOLUTION RÉCENTE DE
L'INVESTISSEMENT EN FRANCE
-
CHAPITRE 2
-
L'INVESTISSEMENT : DÉFINITION ET
CONCEPT
-
CHAPITRE 3
-
LES DÉTERMINANTS DE L'INVESTISSEMENT
PRODUCTIF
-
CHAPITRE 4
-
L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF EN FRANCE
-
CHAPITRE 5
-
L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF EN ALLEMAGNE
-
CHAPITRE 6
-
EVOLUTION DE L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF AU
ROYAUME-UNI
-
CHAPITRE 7
-
EVOLUTION DE L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF AUX
ETATS-UNIS
-
BIBLIOGRAPHIE
N° 35
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
|
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 octobre 2002 |
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la délégation du Sénat pour la planification (1) sur les déterminants de l'investissement ,
Par M. Joseph KERGUERIS,
Sénateur.
(1) Cette délégation est composée de : M. Joël Bourdin, président ; Mme Évelyne Didier, MM. Serge Lepeltier, Marcel Lesbros, Jean-Pierre Plancade, vice-présidents ; MM. Pierre André, Yvon Collin, secrétaires ; MM. Gérard Bailly, Joseph Kergueris, Patrick Lassourd, Michel Pelchat, Daniel Percheron, Roger Rinchet, Gérard Roujas, Bruno Sido .
|
Politique économique - Comparaisons internationales - Coût des facteurs de production - Croissance - Demande anticipée - Financement des investissements - Fiscalité - Investissements directs étrangers - Investissement public - Marchés - Modèles macroéconomiques - Nouvelles technologies - Profitabilité - Surinvestissement - Taux d'intérêt - Valeur ajoutée. |
INTRODUCTION
La croissance dépend doublement de l'investissement. En effet, l'investissement est, au côté de la consommation, une des composantes importantes de la demande. Une diminution de l'investissement se traduit, toutes choses égales par ailleurs, par un ralentissement de la croissance, comme l'illustre l'actuel épisode conjoncturel. Mais il joue aussi un rôle déterminant pour modeler la capacité productive d'une économie. Du niveau et de la composition de l'investissement dépendent fortement les capacités productives de l'économie, lesquelles conditionnent largement la prospérité des pays développés.
Ce lien très fort entre investissement et croissance incite à analyser les déterminants de l'investissement, afin notamment de mieux comprendre quelle stratégie de politique économique serait susceptible de soutenir une progression équilibrée de l'investissement.
C'est l'objet du présent rapport, étayé par une étude commandée, publiée en annexe, de l'institut Rexecode, qu'il convient de remercier pour la qualité de sa collaboration avec le service des Etudes du Sénat.
Nulle étude sur l'investissement ne peut ignorer les difficultés que posent les méthodes de comptabilisation aujourd'hui en vigueur.
L'investissement consiste en l'acquisition de biens et services en vue de la production ultérieure d'autres biens et services.
En Comptabilité nationale, source statistique fondamentale, l'investissement est habituellement appréhendé à travers la notion de Formation brute de capital fixe (FBCF). Cet agrégat représente « la valeur des biens durables acquis par les unités de production résidentes sur le territoire français afin d'être utilisées pendant au moins un an dans le processus productif. Il est donné brut d'amortissement ».
Cette définition conventionnelle de la FBCF est souvent jugée limitative. Elle exclut en effet les acquisitions de terrain, et l'investissement dit « immatériel », qui comprend les achats de brevets, marques de fabrique, modèles, droits d'auteur, fonds de commerce, les dépenses de recherche et développement, les actions de formation du personnel, la publicité et le marketing.
L'INSEE a ainsi procédé en 1999 à une révision des règles comptables pour mieux prendre en compte l'investissement incorporel ; l'ensemble des achats de logiciel, précédemment traités en « consommations intermédiaires » sont désormais intégrés au calcul de la FBCF. En faisant passer des dépenses de la rubrique consommations intermédiaires à la rubrique FBCF, l'INSEE a procédé par la même occasion à une légère réévaluation du PIB.
Il n'en reste pas moins que la plupart des dépenses d'investissement immatériel demeurent exclues de la définition conventionnelle de la FBCF. Cette exclusion peut se justifier par de solides arguments comptables, notamment la grande difficulté qu'il y a à distinguer les investissements immatériels des dépenses courantes de consommation intermédiaire. Il est également difficile de transposer aux investissements immatériels les règles applicables aux investissements physiques en matière d'amortissement et de dépréciation des stocks. Il n'en reste pas moins qu'une part importante, et croissante, de l'investissement productif des entreprises n'est pas prise en compte par la comptabilité nationale.
C'est ainsi que, si la structure de l'investissement se déforme au profit de l'immatériel, l'investissement global peut augmenter alors que l'investissement mesuré par la FBCF diminue. Or un tel processus est probablement à l'oeuvre depuis une quinzaine d'années. D'après les calculs du Crédit National, l'investissement immatériel représentait, en 1987, 30 % de l'investissement matériel ; aujourd'hui, l'investissement immatériel non inclus dans la FBCF représenterait plus de 40 % de la Formation brute de capital fixe, selon les calculs de Rexecode 1 ( * ) .
Une constante attention mérite donc d'être portée aux méthodes de recensement de l'investissement.
L'investissement est le fait de trois grandes catégories d'agents économiques : les ménages, les administrations publiques et les entreprises. En 2000, la FBCF totale s'est élevée en France à 276,5 milliards d'euros. L'investissement des ménages, correspondant aux dépenses d'achat et d'entretien de logement, représentait près de 30 % de ce total, soit quelque 81,5 milliards d'euros. L'investissement des administrations publiques représentait environ 15 % du total, soit 42,2 milliards d'euros. Les 55 % restant étaient donc le fait des entreprises, pour un montant de 152,8 milliards d'euros. C'est l'investissement des entreprises qui retiendra l'attention dans cette étude, même si on ne peut oublier le rôle de l'investissement public, qui est un instrument important de politique économique .
L'analyse théorique de l'investissement a connu une relance ces dernières années.
On distinguait traditionnellement trois types d'investissements définis en fonction de leurs motivations : l'augmentation des capacités de production, le remplacement de matériel obsolète, et l'amélioration de la productivité. Dans la réalité, il est cependant bien difficile de faire la part entre ces diverses motivations. Comme il est rare qu'une entreprise achète des machines dépassées, tous les investissements de remplacement, ou de capacité, ont aussi un impact sur la productivité du travail. Les investissement réalisés à niveau de demande égale, donc de productivité, s'accompagnent généralement d'une augmentation des capacités, puisque les nouveaux équipements, plus modernes, permettent de produire davantage. Ces distinctions conservent cependant un intérêt pour la discussion du lien entre investissement et emploi.
Mais, ce sont surtout les débats autour de l'émergence de la « nouvelle économie », l'apparition de nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), qui ont relancé, dans la période récente, l'intérêt porté à l'analyse de l'investissement, au moins sous son aspect de vecteur par lequel les innovations technologiques se diffusent dans l'économie. La vigueur de la croissance américaine, au cours de la décennie 1990, a ainsi été mise en relation avec le haut niveau d'investissement en NTIC observé dans ce pays. A contrario , le retard relatif de l'Europe et de la France en matière de croissance pourrait découler d'un investissement insuffisant dans les nouvelles technologies.
De fait, le taux d'investissement français a connu, dans la décennie 1990, des niveaux historiquement bas, que la reprise de l'investissement amorcée à partir du second semestre 1997 n'a pas suffi à compenser. Cette faiblesse prolongée de l'investissement contraste défavorablement avec la vigueur de l'investissement américain, et fait craindre pour le potentiel de croissance de l'économie française. Le rattrapage du retard d'investissement européen et l'élévation de la croissance potentielle de l'Europe, semblent devoir être des préoccupations majeures pour les années à venir.
Les analyses traditionnelles des causes de l'investissement peinent à rendre compte de certaines évolutions observées au cours de la décennie écoulée. Il est donc intéressant d'approfondir l'étude d'autres déterminants possibles de l'investissement, en particulier, les variables financières dont l'analyse a été renouvelée dans la période récente.
Le constat d'un retard d'investissement français invite à réfléchir aux mesures de soutien que les pouvoirs publics seraient susceptibles d'adopter pour y remédier. Une stratégie macroéconomique favorable à l'investissement apparaît, en premier lieu, souhaitable. Elle pourrait être complétée par une politique de soutien à l'investissement dans les infrastructures, et dans la recherche-développement, publique et privée. La question de l'accès au crédit, notamment pour les petites et moyennes entreprises, doit être posée.
Le contexte présent de globalisation économique, et le niveau très élevé atteint par les investissements français à l'étranger ces dernières années incitent à s'interroger sur la dimension internationale de l'investissement. La question d'un éventuel effet d'éviction de l'investissement à l'étranger par rapport à l'investissement national est souvent envisagée.
Outre la question de l'élévation du niveau de l'investissement, il importe d'examiner les phénomènes de surinvestissement, qui ont affecté depuis deux ans d'importants secteurs de l'économie mondiale et européenne, au premier chef le secteur des télécommunications. Une réflexion devrait être engagée pour définir les conditions d'un meilleur suivi de l'investissement productif des entreprises.
PREMIÈRE
PARTIE :
LA RELATIVE LANGUEUR DE L'INVESTISSEMENT COMPROMET LA
CROISSANCE
Un des phénomènes économiques marquants de la décennie 1990 est l'apparition d'un écart significatif de croissance dans les performances des Etats-Unis et de l'Europe. Entre 1991 et 1999, la croissance moyenne du PIB en volume a été de 2,7 % par an outre-Atlantique, contre un peu plus de 1,5 % dans l'Europe des 15, et 1,3 % pour la France.
Cette première partie s'efforcera de l'expliquer. En moyenne, le niveau d'investissement de l'économie française est demeuré faible au cours de la décennie , alors qu'il progressait à un rythme soutenu aux Etats-Unis. Il semble donc exister une corrélation entre performances de croissance et rythme de l'investissement.
I. L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES EN FRANCE, UN FAIBLE DYNAMISME
L'examen du profil de l'investissement productif accrédite-t-il la thèse d'un « retard d'investissement » français ?
Plusieurs approches sont envisageables pour analyser le profil de l'investissement productif français. On peut comparer la progression du volume de l'investissement, et la progression du stock de capital, par rapport à leurs tendances passées. On peut analyser le taux d'investissement des entreprises, c'est-à-dire le rapport entre la FBCF et la valeur ajoutée qu'elles dégagent. On peut enfin s'engager dans des comparaisons internationales. De ces trois approches, c'est la dernière qui donne le plus de poids à la thèse d'un « retard français » d'investissement. Ce retard serait plus particulièrement marqué dans le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC).
A. LE PROFIL HÉSITANT DE L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF FRANÇAIS
L'investissement des entreprises ne représente qu'une partie de l'investissement total (de l'ordre de 55 %).
Dans les années 1990, l'investissement des entreprises a oscillé autour de 10 % du PIB. Un peu plus de la moitié de ce montant est assuré par le secteur des services. Environ 30 % est assuré par le secteur industriel (secteur de l'énergie inclus). L'agriculture et le BTP (bâtiment et travaux publics) représentent respectivement 6 et 4 % du total. Les 10 % restants sont assurés par les secteurs du commerce et des transports.
L'étude réalisée par Rexecode, publiée en annexe de ce rapport, présente de manière détaillée le profil de l'investissement depuis dix ans.
L'investissement brut progresse, sur longue période (1970-2000), à un rythme de 2,6 % l'an en volume . Au cours de la décennie 1990, le rythme de progression de l'investissement a fluctué autour de cette tendance, mais sans s'en écarter durablement. On note toutefois un creux assez marqué sur la période 1993-1998 . Le rythme de progression de l'investissement est revenu au-dessus de sa tendance historique après 1998. Le rythme de l'investissement productif s'est cependant infléchi à nouveau dès 2001.
Graphique 1
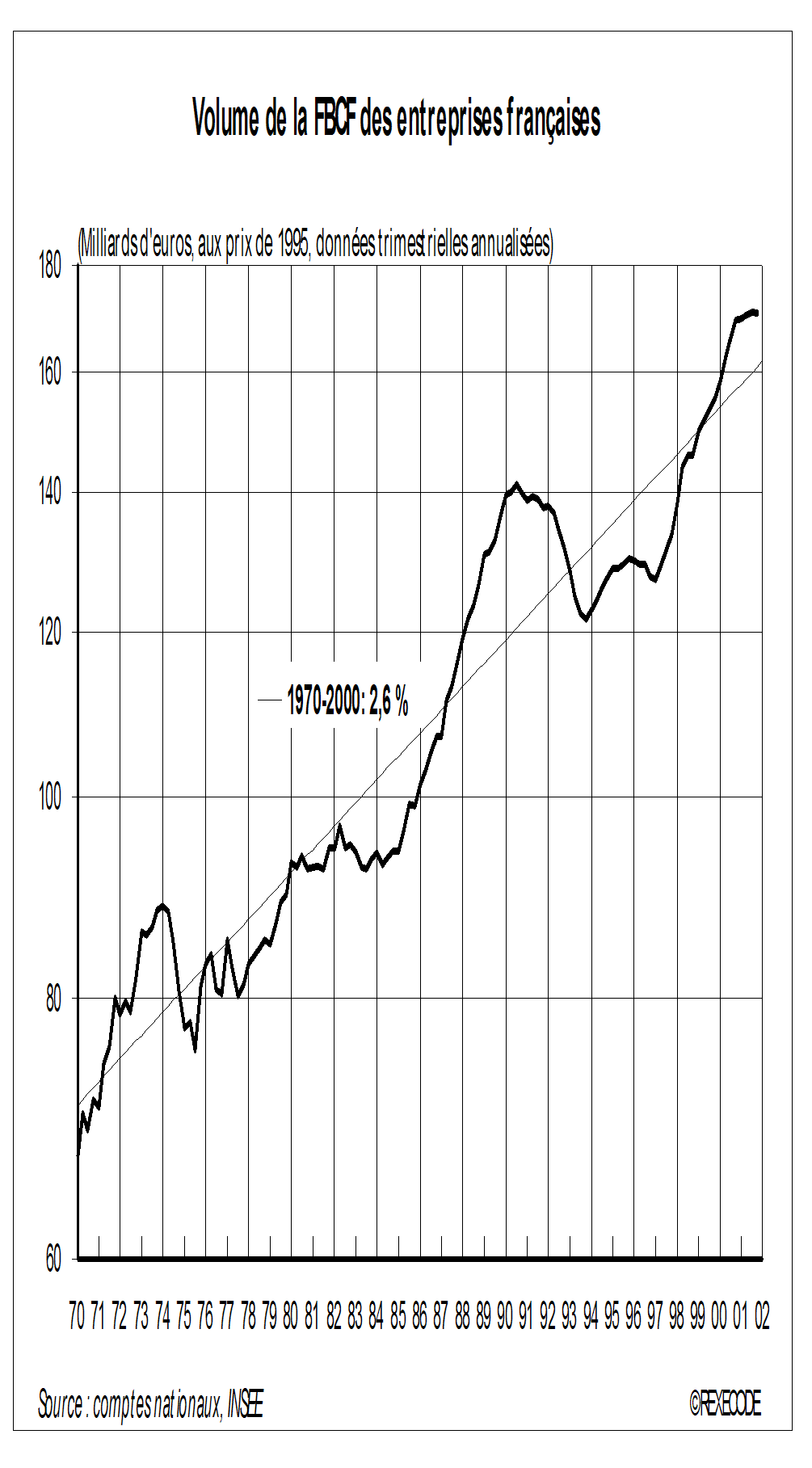
Un autre indicateur pertinent en matière d'investissement est la progression du stock de capital physique 2 ( * ) . Si le stock de capital augmente au même rythme que le PIB, l'économie peut continuer à croître de manière équilibrée sans buter sur les capacités physiques de production. Si le capital physique augmente moins vite que la production, un effort d'investissement est nécessaire pour éviter l'apparition de goulots d'étranglement, venant entraver la croissance. Si, en revanche, le stock de capital augmente plus vite que la production, l'apparition de capacités de production excédentaires est à craindre.
Pour l'ensemble des secteurs de l'économie, le taux d'accroissement du capital productif physique, net d'amortissements, était de 6 % par an au début des années 70. Il est tombé à moins de 3 % au milieu des années 80. La vague d'investissements de 1986-1990 l'a fait remonter à 4,4 % en 1990. Puis, il a fortement diminué pour se situer à un niveau inférieur à 2 % en 1994 et 1995. Il remonte ensuite très légèrement à partir de ce point bas. Mais il faut attendre l'année 2000 pour que le taux d'accumulation 3 ( * ) du capital retrouve son niveau de 1984, soit le niveau qu'il avait avant le cycle de reprise de l'investissement de la fin des années 80. Il diminue pourtant dès l'année 2001. Le mouvement de reprise de l'investissement, observé à la fin des années 90, apparaît donc bien modeste en comparaison de celui constaté une décennie plus tôt . Le ralentissement du rythme d'accumulation du capital productif apparaît, en outre, plus marqué que le ralentissement de la croissance. Une insuffisance du stock de capital est susceptible de faire obstacle à une accélération - durable - de la croissance du PIB au-delà de 2 % l'an.
Un troisième indicateur intéressant à suivre en matière d'investissement est le taux d'investissement des entreprises , défini comme la FBCF des entreprises rapportée à leur valeur ajoutée. Cet indicateur mesure l'effort financier que les entreprises consacrent à l'investissement. Il révèle une certaine faiblesse de l'investissement depuis une dizaine d'années. En comparaison avec la croissance de la valeur ajoutée, l'effort d'investissement a été peu soutenu jusqu'en 1997. Le taux d'investissement des sociétés non financières chute dans la première moitié des années 90 pour atteindre en 1997 un niveau historiquement bas (voir graphique 2 ci-dessous). La phase ascendante qui s'amorce à partir du second semestre 1997 ne permet toutefois pas de retrouver les niveaux de la fin des années 80. Compte tenu de la durée de vie des investissements réalisés à la fin des années 80, les entreprises auraient dû ressentir le besoin de renouveler leurs équipements vers le milieu des années 90, ce qui ne semble pas s'être produit, ou seulement partiellement. Les chefs d'entreprise semblent être devenus plus prudents depuis la récession de 1993. Le non-renouvellement d'une partie des investissements risque d'entraîner une relative obsolescence de l'appareil productif. Se pose aussi la question de l'incorporation à l'appareil de production des nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui n'ont pleinement émergé que dans la décennie écoulée.
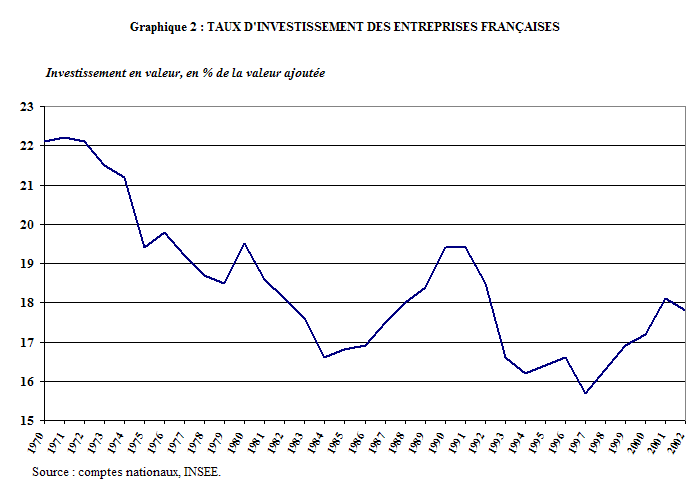
B. UNE TENDANCE PRÉOCCUPANTE
Plusieurs arguments ont pu être avancés pour relativiser l'importance de la baisse tendancielle du taux d'investissement des entreprises.
En premier lieu, comme cela a été indiqué en introduction, le concept de FBCF, au sens de la comptabilité nationale, exclut la plupart des investissements immatériels. De ce fait, il est possible que les séries statistiques disponibles ne retracent pas convenablement le profil réel de l'investissement des entreprises françaises.
En second lieu, l'évolution différenciée des prix doit également être prise en considération. Les prix de l'investissement tendent à progresser moins vite que l'indice des prix à la consommation. La baisse régulière des prix du matériel informatique en est l'illustration la plus flagrante. La baisse apparente de la part des investissements dans la valeur ajoutée pourrait ainsi cacher une progression en volume, les entreprises payant de moins en moins cher leurs équipements.
En troisième lieu, les progrès dans les méthodes d'organisation du travail, et le travail en équipes ont accru le taux d'utilisation des équipements. Le facteur capital est utilisé de manière plus intensive, comme l'atteste l'augmentation de la durée d'utilisation des équipements (DUE). A l'automne 2000, la DUE hebdomadaire a atteint 53,7 heures, soit son plus haut niveau depuis 1963 4 ( * ) . Les machines elles-mêmes tendent à être de plus en plus adaptables : elles peuvent produire des pièces ou des produits variés sans qu'il soit nécessaire de procéder à des modifications coûteuses. Tous ces éléments se conjugueraient pour expliquer que les entreprises aient des besoins d'investissement moindres que par le passé, pour un niveau de production donné.
Ces éléments d'explication sont, au moins partiellement, contrebattus par d'autres considérations. Plusieurs tendances lourdes de l'économie contemporaine devraient en effet conduire, au contraire, à une hausse du taux d'investissement des entreprises. L'accélération du progrès technique, qui entraîne un vieillissement plus rapide de certains biens d'équipement (en informatique notamment), devrait entraîner logiquement une hausse du taux d'investissement des entreprises, contraintes de renouveler plus souvent leurs équipements. L'intensification de la concurrence incite également les entreprises à renouveler plus fréquemment leurs produits, ce qui entraîne de nouveaux besoins en biens d'équipement.
Enfin, et surtout, la situation française contraste défavorablement avec les évolutions observées aux Etats-Unis, où les dépenses d'investissement des entreprises ont fortement augmenté au cours de la décennie écoulée.
C. UN RÉEL RETARD DANS UNE PERSPECTIVE INTERNATIONALE
Après avoir examiné le profil de l'investissement productif par rapport à sa tendance historique, il convient de le replacer dans son contexte international. L'expérience française - et européenne - s'oppose ici nettement à l'expérience américaine ; l'investissement est resté peu dynamique en Europe, alors qu'il a fortement progressé outre-Atlantique. Outre une analyse en termes de niveau, il faudra s'intéresser également à la nature des dépenses d'investissement effectuées.
L'investissement des entreprises françaises, rapporté au PIB, est demeuré, depuis 1995, à un niveau faible (moins de 12 %), inférieur à celui de nos principaux partenaires, ainsi que l'illustrent les graphiques suivants.
Graphique 3
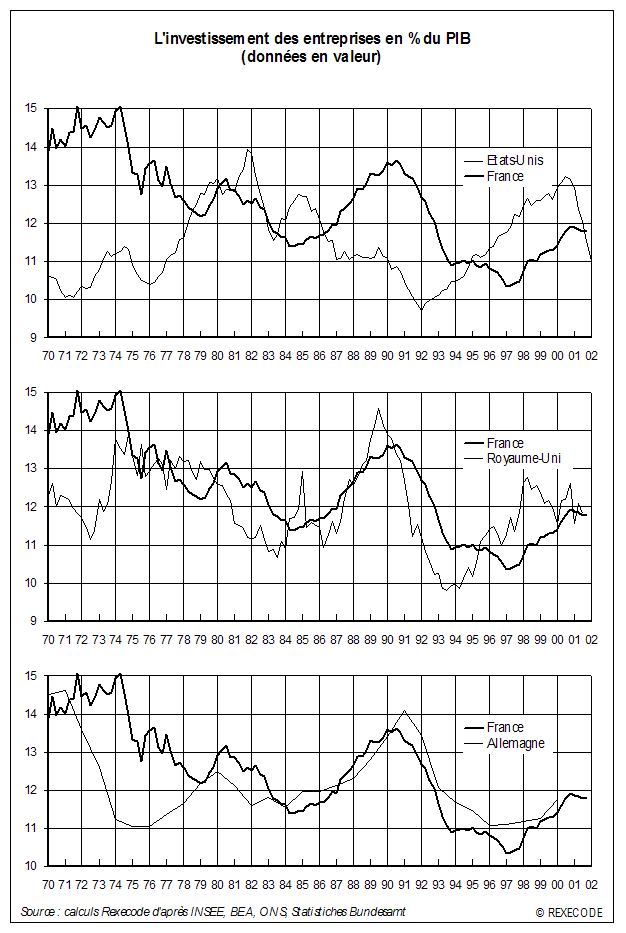
L'écart apparaît particulièrement marqué avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Un élément d'explication peut être trouvé dans les positions différenciées des pays dans le cycle. Sur les quinze dernières années, les cycles d'investissement européen et américain ont en effet évolué en sens opposé. Aux Etats-Unis, il y a eu une baisse du taux d'investissement jusqu'en 1992, puis un redressement spectaculaire, qui a débouché sur l'une des plus longues phases d'expansion de l'après-guerre. En Europe continentale, au contraire, l'essor du taux d'investissement jusqu'en 1990-92 a fait place à une réduction, puis à une stagnation à des niveaux proches de ceux du milieu des années quatre-vingt. Il est donc possible que l'écart des taux d'investissement productifs entre les Etats-Unis et l'Europe traduise pour partie un décalage cyclique dans le temps.
La progression particulièrement forte du volume de l'investissement aux Etats-Unis, ces dernières années, permet cependant d'envisager que des mutations plus profondes soient à l'oeuvre. Une rupture de tendance dans l'augmentation de l'investissement productif américain semble s'être produite au cours du dernier cycle.
Le rythme d'accroissement du volume de l'investissement américain a été multiplié par deux au cours de la décennie 1990-2000, par rapport à la tendance passée. De 1970 à 1990, le volume de l'investissement productif a progressé en moyenne de 4 % l'an. De 1990 à 2000, l'augmentation moyenne a été de 8,1 % par an.
Aucun phénomène similaire n'a été observé en France, ni en Europe. L'investissement productif dans l'Union européenne a progressé en moyenne de 2,8 % sur la période 1990-2000 (1,8 % pour la France), contre 2,6 % sur la période 1970-1990 (2,7 % pour la France).
L'investissement massif des entreprises américaines dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication explique pour une large part cette divergence entre Etats-Unis et Europe.
D. UN DOMAINE PARTICULIÈREMENT TOUCHÉ : LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Les comparaisons internationales en matière de nouvelles technologies sont souvent malaisées. En effet, les contours du secteur des technologies de l'information et de la communication ne sont pas identiques dans les différents systèmes statistiques nationaux. Les données chiffrées présentées dans cette section sont tirées, pour l'essentiel, d'une étude parue dans la Revue de Rexecode du deuxième trimestre 2001 5 ( * ) . La définition du secteur des TIC, retenue par les auteurs de cette étude, est celle du Département américain du Commerce, définition au demeurant proche de celle de l'OCDE. Selon cette définition, le secteur des TIC recouvre la production de matériel informatique (hardware), de logiciels (software), de services informatiques, de matériel de communication, et de services de communication. L'ensemble des activités de distribution de nouvelles technologies informatiques, y compris les activités de vente au détail de matériel informatique, sont prises en compte dans cet agrégat. On observe que l'investissement du secteur privé en biens et services des TIC est, depuis 10 ans, nettement plus élevée aux Etats-Unis qu'en France, le Royaume-Uni occupant une position intermédiaire.
|
Tableau 1 : FBCF en produits et services des TIC
du secteur privé non résidentiel
|
||||||||
|
1990 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
France |
1,5 |
1,4 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
1,7 |
|
Royaume-Uni |
nd |
1,8 |
1,8 |
1,9 |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
2,5 |
|
Etats-Unis |
3,1 |
3,1 |
3,3 |
3,3 |
3,6 |
3,7 |
3,8 |
4,1 |
|
Source : Rexecode (2001) |
||||||||
L'écart est manifeste également si l'on examine la seule composante informatique de l'investissement en TIC. L'investissement français en informatique n'a que faiblement progressé au cours de la décennie passée. La supériorité américaine se manifeste aussi bien dans le secteur du « hardware » que du « software ». A la fin des années 1990, les entreprises américaines investissaient pour 0,6 point de PIB par an en matériel informatique, contre 0,3 point pour les entreprises françaises. Et elles consacraient 1,6 point de PIB à l'achat de logiciels et de services informatiques, soit un point de plus que les entreprises françaises.
En terme de stock, les TIC ne représentent que 4,8 % du capital des entreprises françaises, soit un taux trois fois moindre que celui observé aux Etats-Unis.
En outre, les niveaux de Formation brute de capital fixe, en biens et services des technologies de l'information et de la communication, divergent entre la France et les Etats-Unis. La part des TIC dans la FBCF productive totale aux Etats-Unis a plus que doublé en dix ans, passant de 21 % au début de 1990 à près de 47 % à la fin 2000. En France, cette proportion est passée de 16 à 24 % sur la même période, soit une progression de huit points, de bien moindre ampleur qu'aux Etats-Unis.
Les entreprises françaises ont pourtant intensifié leur effort d'investissement dans les TIC depuis cinq ans, comme l'atteste le graphique 4. Une phase d'expansion de l'investissement beaucoup plus longue serait cependant nécessaire pour amener la France au niveau américain.
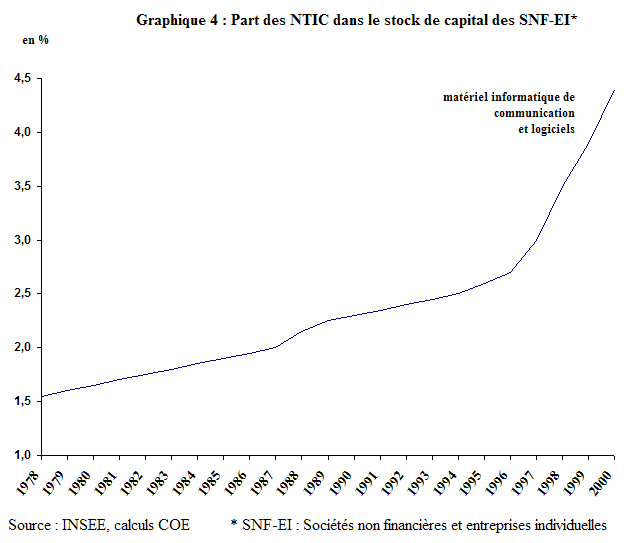
E. L'ATONIE DE L'INVESTISSEMENT EN CONSTRUCTION
L'investissement des entreprises est composé d'investissements en équipements, en logiciels, mais aussi d'une part importante d'investissement en bâtiments. En 2001, l'investissement en bâtiment représentait, en valeur 25 % de la FBCF des entreprises. Dans les années 1990, la faiblesse de l'investissement en construction a contribué à l'atonie de l'investissement total des entreprises françaises.
L'investissement en construction a fortement progressé du milieu des années 1980 jusqu'en 1992. Sur cette période, la FBCF en construction passe de 33 milliards d'euros (aux prix de 1995) à un sommet historique de 44,5 milliards d'euros. Puis, l'investissement en construction traverse une période de morosité prolongée ( cf . graphique 5). En 2001, le niveau de la FBCF en construction retrouve à peine son niveau de 1980, à 36,2 milliards d'euros.
Graphique 5
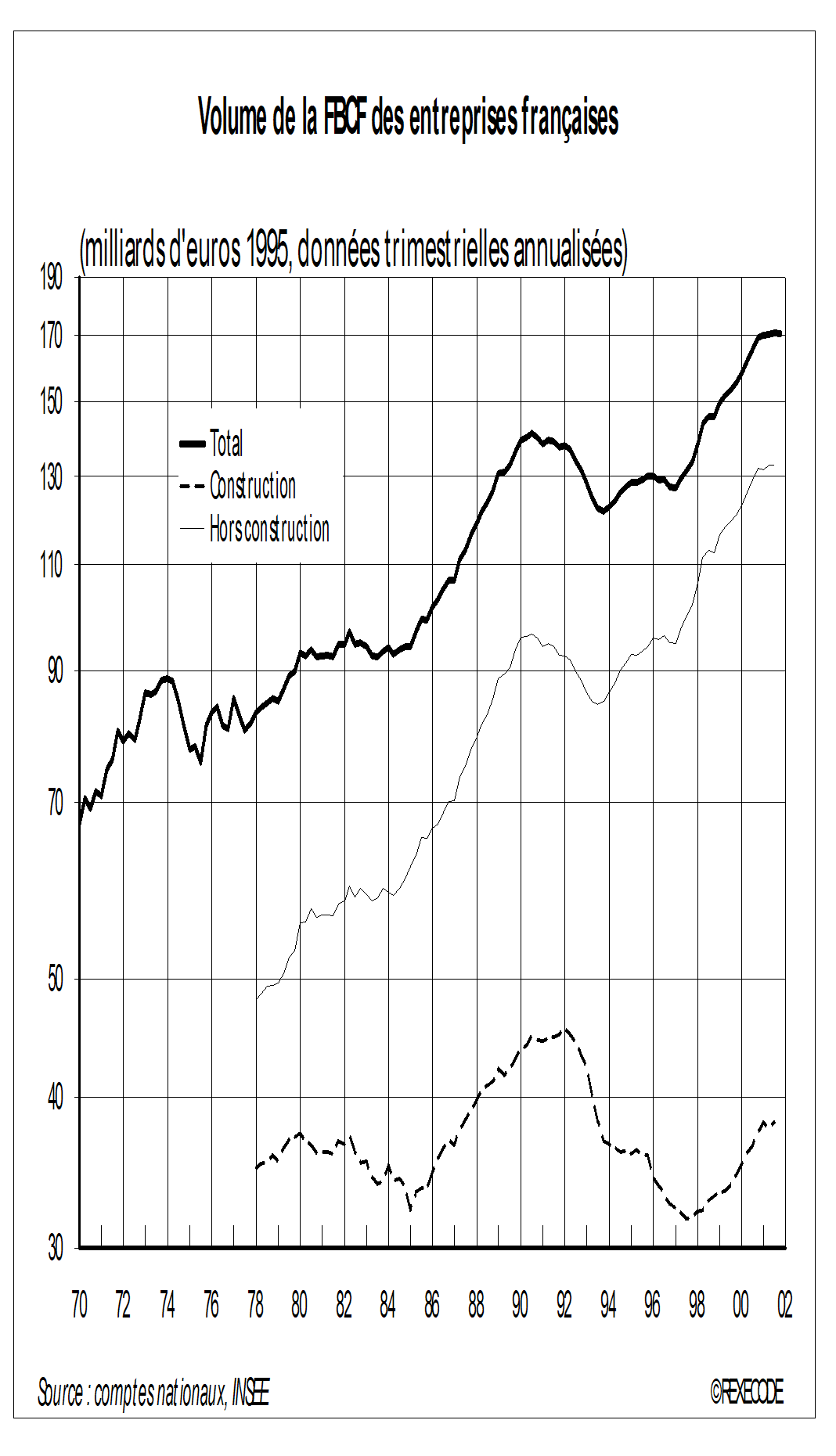
La part de l'investissement en construction dans la FBCF productive tend historiquement à décliner. Elle représentait 36 % de la FBCF en valeur des entreprises en 1978, contre seulement 25 % en 2001. Les modes de production des entreprises deviennent plus économes en espace, mais davantage utilisateurs de biens d'équipements et de nouvelles technologies.
Le niveau relativement bas de l'investissement en France, dans la dernière période, s'est traduit par un taux de croissance du PIB également ralenti. Une décomposition des facteurs de la croissance montre qu'une part importante de l'écart de croissance entre la France et les Etats-Unis peut être attribuée à la différence dans les niveaux d'investissement .
II. UN FAIBLE RYTHME D'INVESTISSEMENT DÉFAVORABLE À LA CROISSANCE DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE
La progression lente de l'investissement français est une cause majeure de la modestie de la croissance enregistrée dans les années 1990. Elle affecte le potentiel de croissance de l'économie française. Un niveau plus élevé de l'investissement serait favorable à la croissance et à l'emploi.
A. UNE DÉCOMPOSITION DES FACTEURS DE LA CROISSANCE SOULIGNE LE RÔLE DÉTERMINANT DE L'INVESTISSEMENT
Quels facteurs ont contribué à la croissance française, dans la dernière décennie, et quels facteurs ont contribué à la croissance américaine ? Les services de la Commission européenne ont apporté des éléments de réponse à ces questions dans une étude très éclairante publiée en 2000 6 ( * ) .
Il ressort de ces travaux que la croissance plus forte observée aux Etats-Unis, comparée à la croissance européenne et française, a été la résultante de deux phénomènes concomitants : une plus forte mobilisation du facteur travail, et une augmentation sensible, à partir de 1995, des gains de productivité.
La mobilisation du facteur travail est un important élément explicatif des différences de résultats de croissance entre pays durant les deux dernières décennies. Un taux d'emploi, et une durée moyenne du travail, plus élevés aux Etats-Unis qu'en Europe expliquent les deux tiers de l'écart de PIB par habitant. Cet aspect du problème, tout à fait majeur, se situe cependant en dehors du champ de notre étude, et ne sera donc pas développé ici.
Le second facteur de croissance économique, à savoir la croissance de la productivité , entretient, en revanche, des liens étroits avec l'investissement. Deux éléments doivent en fait être distingués : la croissance de la productivité apparente du travail, d'une part, et la productivité globale des facteurs, d'autre part.
La productivité apparente du travail dépend notamment de l'intensité capitalistique de la combinaison productive. A priori , plus le stock de capital par travailleur est élevé, plus la production par travailleur l'est également. L'investissement permet d'accroître le stock de capital par travailleur (à condition que le taux d'investissement soit supérieur au taux de dépréciation du capital), et donc la productivité du travail. A nombre de travailleurs inchangé, l'économie pourra croître plus rapidement. A long terme, l'amélioration de la productivité du travail est essentielle pour soutenir une croissance durable : le facteur travail ne peut, en effet, être augmenté à l'infini.
Une fois pris en compte l'apport du facteur travail, et celui du facteur capital, une part de la croissance reste inexpliquée, d'un point de vue comptable. Cette part de croissance inexpliquée est attribuée à un résidu, la productivité globale des facteurs (PGF), qui mesure l'apport du progrès technique. L'investissement est un moyen d'élever la productivité globale des facteurs, en ce qu'il permet d'incorporer le progrès technique à l'appareil de production.
Pendant longtemps toutefois, le haut niveau d'investissement dans les TIC observé aux Etats-Unis ne s'est traduit par aucune accélération des gains de productivité, ce qui a alimenté le fameux paradoxe de Solow, selon lequel : « on voit des ordinateurs partout sauf dans les statistiques de productivité ». Le paradoxe de Solow semble s'être dénoué dans la deuxième moitié des années 1990, aux Etats-Unis. Les statistiques fédérales américaines mettent, en effet, en évidence une forte montée des gains de productivité depuis fin 1995 . Dans l'ensemble des secteurs marchands non agricoles, le taux de croissance annuel de la productivité horaire du travail aurait été en moyenne de 2,15 % entre 1995 et 1999, contre 1,1 % entre 1972 et 1995, la productivité globale des facteurs connaissant, elle aussi, une accélération sensible, d'environ 0,6 point.
Le graphique ci-dessous, réalisé par les services de la Commission européenne, présente une décomposition de la productivité horaire du travail. Il met en relief la part prépondérante de la croissance de la PGF dans l'accélération des gains de productivité observée aux Etats-Unis à partir de 1995. Il souligne les évolutions divergentes entre les Etats-Unis et l'Europe : alors que la croissance de la productivité du travail s'est accélérée aux Etats-Unis dans les années 1999, elle a ralenti d'environ 0,5 point dans l'Union européenne.
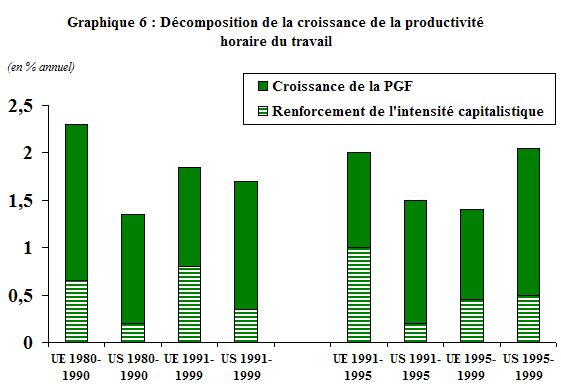
Source
:
Commission européenne (2000)
La tendance française s'inscrit dans la tendance européenne. Selon une évaluation de Cette, Mairesse et Kocoglu 7 ( * ) , la croissance de la productivité du travail, en France, aurait baissé de 0,5 point depuis 1992-1993.
Ces auteurs soulignent que ce ralentissement, effectif, de 0,5 point, pourrait masquer un ralentissement structurel plus important encore, de l'ordre de 1 point. L'ampleur du ralentissement structurel des gains de productivité aurait été en partie masquée par une hausse conjoncturelle de la productivité, résultant de la reprise économique de la fin des années 1990.
La France aurait connu cependant une augmentation des gains de productivité globale des facteurs, évaluée à 0,6 point par ces auteurs, soit un niveau comparable à celui observé aux Etats-Unis ; les deux tiers de cette hausse seraient localisés dans les secteurs producteurs des TIC.
Dans le cas de la France, la décélération des gains de productivité s'expliquerait donc surtout par une diminution de l'intensité capitalistique du système productif. Cette diminution de l'intensité capitalistique n'est autre que le corollaire de l'enrichissement de la croissance en emplois, observé en France à la fin de la décennie 1990 et en 2000.
Les conclusions de Cette, Mairesse et Kocoglu doivent cependant être traitées avec prudence. D'autres auteurs 8 ( * ) soulignent que « l'incertitude quant à l'ordre de grandeur des effets de la diffusion des NTIC sur l'économie française depuis 1995 est extrêmement forte ». Ils considèrent que « l'impact sur les gains de productivité du travail de l'accumulation en capital NTIC est positif, mais faible », et l'estiment seulement à un dixième de point à long terme.
B. LE RÉSULTAT D'UNE DÉCENNIE DE FAIBLE INVESTISSEMENT : UNE CROISSANCE POTENTIELLE PLUS FAIBLE EN EUROPE QU'AUX ETATS-UNIS
La croissance potentielle désigne le rythme de croissance compatible avec la stabilité des prix. Si l'économie croît à un rythme supérieur à celui de la croissance potentielle, des tensions inflationnistes apparaissent, qui dégradent la compétitivité de l'économie nationale et la ramènent sur un sentier de croissance plus faible. Dès lors, un enjeu important de la politique économique est d'élever le niveau de la croissance potentielle, afin que le pays puisse soutenir une croissance plus élevée, sans qu'apparaissent de déséquilibres.
1. Evaluations de la croissance potentielle :
L'histoire économique américaine récente semble montrer que les Etats-Unis pouvaient soutenir une croissance du PIB de 4 % l'an, assortie d'un faible taux de chômage, sans qu'apparaissent de tensions inflationnistes significatives. Le potentiel de croissance de l'économie française et européenne est bien moindre. Une étude de S. Doisy, de la direction de la Prévision, indique que la croissance potentielle de l'économie française serait passée, dans la deuxième moitié des années 1990, de 2 à 2,5 % par an 9 ( * ) .
Comme il apparaît dans le tableau ci-dessous, les experts de CDC-Ixis retiennent un chiffre un peu inférieur pour la croissance potentielle française autour de 2 %. Ces différences peuvent s'expliquer par des estimations divergentes quant à la tendance des gains de productivité.
|
Tableau 2 : Croissance potentielle
|
|||
|
Productivité/tête lissée |
Croissance de la population de 20 à 59 ans |
Croissance
|
|
|
Etats-Unis |
2,6 |
1,0 |
3,6 |
|
Allemagne |
1,8 |
- 0,5 |
1,3 |
|
France |
1,6 |
+ 0,4 |
2,0 |
|
Espagne |
1,3 |
+ 0,5 |
1,8 |
|
Italie |
1,3 |
- 0,2 |
1,1 |
|
Royaume-Uni |
1,8 |
- 0,2 |
1,6 |
|
Source : CDC Flash (2002) |
|||
2. Une inflexion nécessaire de l'effort d'investissement :
Dans sa Lettre en date du 15 septembre 2002, l'Institut Rexecode propose une évaluation du niveau d' investissement industriel qui serait nécessaire pour que l'économie française puisse croître, de manière équilibrée, à un rythme de 3 % l'an. Historiquement, un taux de croissance global de l'économie de 3 % est associé à un taux de croissance de la production industrielle de l'ordre de 3,5 à 4 % par an.
Pour atteindre ce rythme de croissance de la production industrielle, un taux de croissance annuel moyen du stock de capital industriel de près de 2 % par an serait nécessaire dans les années à venir. Cela supposerait, en retenant l'hypothèse d'une augmentation tendancielle du taux de dépréciation, que l'investissement industriel progresse d'environ 4 % par an, en moyenne, d'ici 2010 . Or, comme il a été indiqué précédemment, l'investissement industriel a progressé au rythme annuel moyen de 2,6 % sur la période 1970-2001. Une forte inflexion du taux d'investissement national serait donc nécessaire pour que l'économie française connaisse un niveau de sa croissance potentielle plus élevé.
Et cette inflexion du taux de croissance de l'investissement devrait encore être complétée par une augmentation moyenne de 0,5 % par an du nombre d'heures travaillées dans l'industrie (alors que la tendance, au cours des trente dernières, a été une diminution de 1,7 % par an du nombre d'heures travaillées dans ce secteur).
C. LES LIENS POSITIFS ENTRE INVESTISSEMENT ET EMPLOI
Investissements et emploi ont parfois été présentés comme antinomiques à travers l'analyse des effets des investissements de productivité.
Par définition, un investissement de productivité réduit les besoins en main-d'oeuvre d'une entreprise, ce qui a un effet négatif sur l'emploi, au moins à court terme. Le faible niveau de l'investissement en France dans les années 1990 a conduit à un ralentissement de la substitution du capital au travail, et, par là, à un enrichissement du « contenu de la croissance en emplois ». Faut-il déplorer cette évolution, dans un contexte français qui demeure marqué par un niveau de chômage élevé ?
Les mesures structurelles qui ont pour effet de modifier le coût relatif des facteurs de production incitent les entreprises à adapter leurs combinaisons productives. Les entreprises privilégient des modes de production plus intensifs en travail, et moins intensifs en capital, ce qui a, temporairement, un effet positif sur les créations d'emplois. Mais ces mesures ne modifient pas le potentiel de croissance de l'économie. Ainsi, une fois cette phase d'adaptation passée, le niveau des créations d'emplois redevient dépendant du rythme de la croissance, qui est lui-même contraint par le niveau de la croissance potentielle.
Par ailleurs, la substituabilité entre facteurs de production est, au mieux, partielle. Il n'est pas possible de faire baisser indéfiniment la part du capital dans la combinaison productive. Dans les secteurs où la complémentarité entre travail et capital est forte, l'augmentation du stock de capital et l'élévation du niveau de l'emploi vont de pair. Les estimations de Crépon et Gianella suggèrent que l'élasticité de substitution entre les facteurs de production est assez faible, de l'ordre de 0,7 dans le secteur secondaire, et de 0,4 dans le tertiaire 10 ( * ) . Une autre conclusion importante de leurs recherches économétriques est que la demande de facteurs de production est beaucoup plus influencée par les variations de la demande adressée aux entreprises que par le coût relatif des facteurs de production.
Or, un pays dont les entreprises investissent trop peu s'expose au risque de voir la compétitivité-prix de ses produits se dégrader, et ses parts de marché se réduire, ce qui risque d'entraîner des destructions d'emplois bien plus importantes que celles obtenues grâce aux modifications du coût relatif des facteurs.
Les travaux menés sur longue période, et à un niveau macroéconomique, montrent une corrélation forte entre croissance de la productivité, croissance du PIB, élévation du niveau de vie, et créations d'emplois. Une étude récente de la Banque de France 11 ( * ) , portant sur les pays du G 7, ainsi que sur les Pays-Bas et la Belgique, indique que ce sont les pays ayant connu les gains de productivité les plus faibles après le choc pétrolier de 1973, qui ont les performances de croissance et de créations d'emplois les plus médiocres. Les gains de productivité permettent, en effet, de libérer des ressources, en capital et en travail, qui autorisent une progression plus soutenue de l'activité.
Au niveau microéconomique, différentes observations suggèrent que les entreprises qui investissent et innovent beaucoup sont davantage créatrices d'emplois que les autres. Une étude de l'OCDE de 1995 12 ( * ) indique que les entreprises ayant lancé des produits nouveaux au cours des deux années précédentes présentent un niveau d'emploi supérieur de 4 % à celui des entreprises n'ayant pas signalé d'innovation de ce genre.
A long terme, donc, l'investissement est favorable à la création d'emplois, parce qu'il permet de soutenir une croissance plus forte. Les créations d'emplois engendrées par une croissance plus forte sont bien plus importantes que les destructions d'emplois résultant d'une croissance des gains de productivité, ainsi que l'atteste l'expérience américaine des années 90.
III. LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS EN FRANCE NE PERMETTENT PAS DE COMPENSER LA FAIBLESSE DE L'INVESTISSEMENT INTERNE
Même si la notion d'investissement direct étranger (IDE) 13 ( * ) n'appartient pas directement au champ de l'investissement étudié dans ce rapport, dans un contexte de globalisation économique, accentuée depuis une dizaine d'années, il est difficile d'analyser l'investissement en France sans la mentionner. Un examen des flux entrants et sortants d'IDE montre que les investissements étrangers en France sont significatifs, et tendent à croître sur longue période, mais que le solde net (investissements entrants - investissements sortants) est légèrement, mais structurellement négatif.
A. LA FRANCE ACCUEILLE UN MONTANT ÉLEVÉ D'INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS
Ainsi que l'illustre le graphique suivant, le montant des investissements directs étrangers en France progresse tendanciellement depuis 10 ans. En 2000, les investissements directs étrangers en France avoisinaient les 50 milliards d'euros.
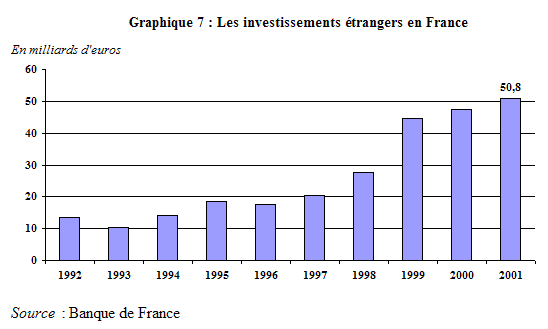
Le stock des investissements directs étrangers en France est évalué, par la Banque de France 14 ( * ) , à 277,1 milliards d'euros, au 31 décembre 2000, ce qui place la France au quatrième rang des pays industrialisés pour l'accueil des IDE, derrière les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne. L'estimation, proposée par la Banque de France pour le stock d'investissements directs étrangers en France à la fin 2001, fait ressortir une nouvelle hausse sensible de ce stock, puisque celui-ci s'établirait à 335 milliards d'euros.
En raison d'une différence de périmètre, on ne peut induire directement des données relatives aux investissements directs étrangers des enseignements sur la FBCF. En effet, une partie importante des IDE reçus par la France correspond à l'acquisition de parts de capital d'entreprises françaises, et non à des investissements physiques supplémentaires.
Cependant, une enquête, réalisée chaque année par l'Agence française pour les investissements internationaux (AFII) 15 ( * ) , renseigne sur les créations d'emplois dues à des investisseurs internationaux. Etant donné la complémentarité, plus ou moins grande, qui existe entre le facteur travail et le facteur capital, on peut voir dans la progression du nombre de créations d'emplois dues à des investisseurs étrangers le témoignage d'une contribution accrue de ces mêmes investisseurs à l'extension du stock de capital physique. Selon l'AFII, les IDE en France ont permis de créer ou sauvegarder, entre 1993 et 2000, plus de 221 000 emplois, principalement dans les secteurs des services, de l'automobile et des nouvelles technologies.
B. MAIS LE SOLDE NET DES FLUX D'INVESTISSEMENTS ENTRE LA FRANCE ET L'ÉTRANGER EST NÉGATIF
Important pays d'accueil, la France est aussi un grand investisseur à l'étranger. En 2000, la France s'est ainsi classée au deuxième rang des investisseurs mondiaux, seulement devancée par les Etats-Unis.
Les flux entrants et sortants d'IDE se sont longtemps situés à des niveaux très proches, les flux sortants ayant tendance, toutefois, à dépasser légèrement les entrées de capitaux. Depuis 1998, le solde net de la France s'est considérablement dégradé, suite à un essor des investissements français à l'étranger, sans commune mesure avec la progression des IDE entrants. En 1999, le solde net représentait près de 5 points de PIB, et près de 10 points de PIB en 2000. Ces chiffres sont à rapprocher de la FBCF moyenne des entreprises au cours de la décennie 1990, qui est de 11,6 points de PIB.
Cette situation, sans précédent dans l'histoire économique récente de la France, s'explique par la très forte croissance des opérations de fusions et acquisitions entre 1999 et 2000. Les entreprises françaises ont massivement investi pour s'implanter sur des marchés étrangers (achat de Seagram par Vivendi, d'Orange par France Télécom...). L'ampleur nouvelle de ces sorties de capitaux, hors du territoire national, est difficile à interpréter. On peut y voir le signe d'une préférence des entreprises françaises pour les investissements à l'étranger, qui traduirait une perte d'attractivité du territoire national, et des perspectives de profit plus élevées sur les marchés extérieurs. Mais, on peut y voir aussi le signe d'un dynamisme des entreprises françaises, qui s'internationaliseraient pour mieux faire face à la concurrence des multinationales étrangères, et conquérir des parts de marché à l'étranger.
On observe que la croissance des investissements directs français à l'étranger ne s'est pas faite au détriment de l'investissement intérieur. Au contraire, il semble y avoir une corrélation positive entre ces deux types d'investissements. Lorsque les entreprises ont les moyens d'investir, et qu'elles anticipent une hausse de la demande, elles développent leurs investissements en France et à l'étranger. De fait, l'envolée des investissements français à l'étranger à partir de 1998 coïncide avec une phase de reprise de l'investissement productif intérieur.
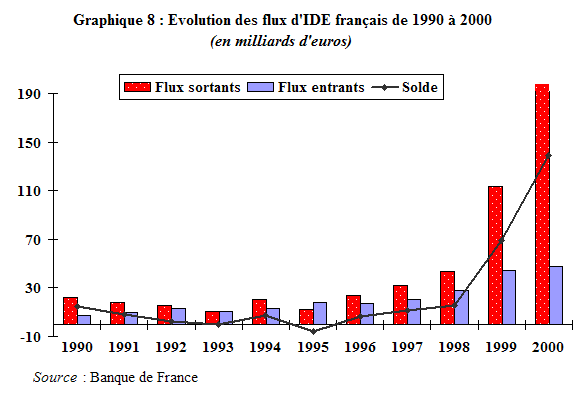
Au total, l'apport de l'investissement international à l'économie française est ambigu : les IDE localisés en France rehaussent le niveau de l'investissement productif total ; mais le solde net des flux d'investissement est défavorable à la France. Le niveau satisfaisant de l'épargne nationale a permis, ces dernières années, de financer des investissements très importants à l'étranger, sans évincer l'investissement intérieur. Des contraintes plus fortes sur le financement des investissements pourraient conduire, à l'avenir, les entreprises françaises à devoir arbitrer de manière plus exigeante entre investissements en France et investissements à l'étranger, ce qui poserait de manière plus aigue la question de l'attractivité des territoires.
Par ailleurs, la prise en compte des flux internationaux d'investissement ne remet pas en cause les conclusions des comparaisons entre pays faites précédemment. En effet, les Etats-Unis et le Royaume-Uni, qui devancent nettement la France en matière de FBCF productive intérieure, la devancent également quant au niveau des flux d'IDE entrants. Le fait que les Etats-Unis, et, dans une moindre mesure, le Royaume-Uni, bénéficient d'un niveau de croissance potentielle supérieur à celui des pays d'Europe continentale, rend ces destinations particulièrement attractives pour les investisseurs étrangers.
*
* *
Au terme de cette première partie, il est possible de poser un diagnostic : la relative faiblesse de l'investissement productif français, dans la décennie écoulée, explique, pour une large part, des performances de croissance plutôt décevantes. La croissance française ne devrait pas être plus soutenue à l'avenir, à moins qu'une reprise durable de l'investissement ne permette d'élever la croissance potentielle de l'économie française.
La question qui se pose alors est celle des voies et moyens à même d'encourager l'investissement des entreprises. Avant d'arriver à des recommandations de politique économique, un détour par les théories relatives aux déterminants de l'investissement apparaît indispensable.
DEUXIÈME PARTIE :
L'APPORT DE LA THÉORIE
ÉCONOMIQUE
À LA CONNAISSANCE DES DÉTERMINANTS
DE
L'INVESTISSEMENT
On distingue traditionnellement quatre déterminants principaux de l'investissement : la demande anticipée par les entreprises ; le coût des facteurs de production ; les contraintes de financement et la profitabilité des projets d'investissement des entreprises .
A partir de ces quatre déterminants, les économistes ont formalisé deux modèles permettant de représenter, et de prévoir, le comportement d'investissement des entreprises. Il s'agit du modèle accélérateur-profit, et du modèle Q de Tobin.
Dans la période récente, ces deux modèles ont cependant parfois échoué à retracer fidèlement le comportement d'investissement des entreprises. D'où l'intérêt de se pencher sur les derniers développements de la recherche économique, qui apportent des éclairages nouveaux sur la question de l'investissement.
I. LES DÉTERMINANTS TRADITIONNELS DE L'INVESTISSEMENT
Cette section se propose de passer de passer en revue les quatre déterminants traditionnels.
A. LA DEMANDE ANTICIPÉE :
Il semble admis que la demande anticipée est le déterminant principal de l'investissement 16 ( * ) .
En période de faible croissance ou de récession, les entreprises adoptent une stratégie d'investissement prudente, elles ne cherchent pas à augmenter leurs capacités de production, et parfois même ne renouvellent pas les équipements devenus obsolètes. Au contraire, en période de croissance soutenue, les entreprises sont incitées à investir pour augmenter leurs capacités de production, afin de profiter de la hausse de la demande.
Les enquêtes réalisées par l'INSEE 17 ( * ) , auprès des chefs d'entreprises semblent confirmer ce raisonnement théorique. Les chefs d'entreprise interrogés citent surtout la demande comme motif déterminant de leurs projets d'investissement.
Si l'on suppose que le capital physique nécessaire à la production est proportionnel au niveau de la production à réaliser, et que les entreprises veulent adapter rapidement leur niveau de capital, la croissance de l'investissement sera plus forte que celle de la demande. Ce phénomène est connu sous le nom d' accélérateur . Il s'explique par le fait que les biens d'équipement participent au processus de production au-delà de la seule période où ils sont acquis. En raison du phénomène d'accélération, une faible variation de la demande, dans une situation de plein emploi des capacités de production, suscite une forte variation de l'investissement. A l'inverse, un simple ralentissement de la demande peut suffire à provoquer une baisse de l'investissement.
La mesure de l'accélérateur se fait par le rapport entre le stock de capital et le niveau de production : la constante obtenue, appelée « coefficient de capital » mesure l'intensité du phénomène d'accélération. Plus elle est élevée, plus l'investissement doit être important pour atteindre le niveau de production souhaité.
L'effet d'accélération s'inscrit dans la vision keynésienne d'un équilibre économique contraint par les débouchés. Dans ce cadre théorique, une politique de relance budgétaire, suscitant une demande autonome supplémentaire, est un instrument efficace de relance de l'investissement (l'efficacité de la politique budgétaire est cependant moindre en économie ouverte). Cette analyse de l'investissement par le facteur demande doit cependant être tempérée par la prise en compte du coût des facteurs de production.
B. LE RÔLE DU COÛT DES FACTEURS DE PRODUCTION
Dans un cadre d'analyse microéconomique, la maximisation du profit par la firme fait dépendre le niveau de capital désiré du coût des facteurs travail et capital. Les entreprises ont le choix entre plusieurs combinaisons productives possibles, et choisissent celle qui minimise les coûts, et maximise donc leurs profits.
A court terme, lorsque le niveau de production est contraint par les débouchés, c'est le coût relatif des facteurs de production qui est pris en compte. Ainsi, si le coût du capital s'élève par rapport aux charges salariales, l'entreprise a intérêt à limiter les dépenses d'investissement, en substituant une plus grande quantité de travail au capital. Dans un cadre de plus long terme, où le programme de production n'est pas contraint par les débouchés, c'est le coût réel de chaque facteur qui intervient dans la décision d'investissement.
Cette relation entre coût des facteurs de production et niveau de l'investissement apparaît théoriquement solide. Pourtant, les études empiriques réalisées au niveau macroéconomique ont longtemps échoué à mettre en évidence l'incidence du coût des facteurs de production sur l'investissement. En 1997 encore, Dormont 18 ( * ) ne parvenait pas à identifier de lien clair entre la demande des facteurs et le coût relatif capital/travail, et encore moins avec le seul coût du capital.
Mais, au prix d'autres hypothèses de travail, Crépon et Gianella ont, récemment, mis en évidence, économétriquement, un impact significatif du coût d'usage du capital sur l'investissement 19 ( * ) .
Le concept de « coût d'usage du capital », utilisé dans cette étude, intègre de nombreux éléments : taux d'intérêt bancaire propre à chaque entreprise, structure du bilan, fiscalité pesant sur les sociétés et les détenteurs d'actions, inflation et amortissements. Cet indicateur permet d'évaluer de manière rigoureuse le coût effectif du capital, alors que, sur données agrégées, le coût du capital est généralement approché par le taux d'intérêt réel.
Au cours de la période considérée dans cette étude (1984-1997), le coût du capital a sensiblement baissé, principalement sous l'effet de la détente des taux d'intérêt réels. La fiscalité n'a contribué que marginalement à la baisse du coût d'usage du capital. Ses variations ont été erratiques : l'impôt sur les sociétés a diminué du milieu des années 1980 à 1995, mais la pression fiscale a augmenté ensuite.
Crépon et Gianella distinguent deux effets d'une variation du coût d'usage du capital : un effet de substitution et un effet de profitabilité . Une hausse du coût du capital devrait inciter les entreprises à substituer du travail au capital ; ainsi, la demande de travail devrait s'accroître (effet de substitution). Mais, dans le même temps, une hausse du coût du capital augmente le coût de production unitaire pour l'entreprise, ce qui alourdit ses prix, et risque, in fine , de réduire la demande qui lui est adressée (effet de profitabilité). Les estimations proposées suggèrent que l'effet de profitabilité domine l'effet de substitution. Une hausse du coût du capital entraînerait donc une baisse de la demande pour les deux facteurs de production, capital et travail, et pénaliserait donc l'emploi .
L'étude simule les effets qu'aurait eu une augmentation, de 36,7 % à 50 %, du taux de l'impôt sur les sociétés en 1995. Un tel relèvement du taux d'imposition aurait conduit à une progression substantielle du coût du capital, de 9 % en moyenne, également répartie entre les secteurs industriel et tertiaire. Le choc aurait été moins important pour les entreprises fortement endettées, qui déduisent les intérêts pour établir leur résultat fiscal. D'après le modèle, les entreprises auraient alors réduit l'intensité capitalistique de leur combinaison productive, de 6 % en moyenne dans l'industrie, et de 3,1 % dans le tertiaire. Cette répercussion plus faible dans le tertiaire s'explique par de moindres possibilités de substitution entre les facteurs de production. La production devenant moins intensive en capital, la productivité du capital augmente substantiellement. Au total, la simulation met bien en évidence une baisse de la production (en valeur), ainsi qu'une diminution du volume de chacun des facteurs. La diminution est, logiquement, plus forte pour le capital que pour le travail. Les effets mis en évidence dans cette étude sont d'une ampleur non négligeable. Ils suggèrent qu'une hausse du coût de capital a bien un effet négatif, et significatif, sur l'investissement des entreprises.
Les conclusions de cette étude présentent un intérêt certain pour la définition de la politique économique. Elles suggèrent qu'une politique d'expansion budgétaire, qui s'accompagnerait d'une hausse des taux d'intérêt, aurait un effet beaucoup moins positif pour l'économie que ce que la seule prise en compte de l'effet d'accélération laisserait supposer.
Le taux d'intérêt agit sur l'investissement par l'augmentation du coût du capital qu'il induit. Mais il exerce aussi un effet sur l'investissement par l'intermédiaire de la profitabilité.
C. LA PROFITABILITÉ
L'effet de la profitabilité ne doit pas être confondu avec celui du profit, qui sera examiné dans la section suivante. Il fait référence à une notion distincte, celle de la rentabilité de l'investissement comparée au coût du capital.
|
COMMENT MESURER LA PROFITABILITÉ DU CAPITAL ? Il faut d'abord calculer le rendement du capital, c'est-à-dire le montant de la rémunération du capital rapporté au stock de capital. En comptabilité nationale, la fraction de la valeur ajoutée qui rémunère le capital correspond à l'excédent d'exploitation. Cette rémunération peut être nette ou brute (ENE ou EBE), selon que l'on tient compte, ou non, de l'usure ou de l'obsolescence du stock de capital. Afin qu'il représente de manière plus précise la rémunération du stock de capital, il est nécessaire d'en retirer la rémunération des non-salariés qui lui est incorporée dans les données de la comptabilité nationale. Comme cette rémunération n'est pas précisément connue, on procède à une correction qui consiste à affecter à chaque non-salarié une rémunération moyenne des salariés. On peut alors calculer le rendement brut du capital, qui correspond au rapport de l'excédent brut d'exploitation sur le stock brut de capital, ou le rendement net, qui correspond à l'excédent net d'exploitation rapporté au stock net de capital. La profitabilité du capital productif mesure l'écart entre le rendement du capital, et le rendement, en termes réels, d'un placement sans risque, assimilé au niveau des taux d'intérêt à long terme.
L'écart entre le rendement d'un investissement
physique, et celui d'un investissement sans risque doit être suffisant
pour que le chef d'entreprise décide d'investir. Edmond Malinvaud
considère qu'une profitabilité de 4 % est incitatrice
à l'investissement.
|
Plus précisément, la profitabilité mesure l'écart entre le rendement anticipé du capital physique et un rendement financier (taux d'intérêt ou valorisation boursière des actifs).
Lorsqu'une entreprise dispose d'une capacité de financement, ses dirigeants ont le choix entre utiliser leur capital pour financer des investissements physiques, ou le placer sur les marchés financiers.
Si la rentabilité attendue de l'investissement est inférieure à la rentabilité d'un placement financier sans risque, l'investissement n'aura pas lieu.
Lorsqu'une entreprise veut financer un projet par l'emprunt, ses dirigeants doivent s'assurer que le rendement attendu de l'investissement est supérieur au coût du capital, sans quoi, il n'est pas rentable d'investir.
Derrière ce modèle abstrait, très simple, se cachent des réalités d'une grande complexité.
La théorie économique montre, en particulier, que l'évaluation de la profitabilité d'un investissement, par un chef d'entreprise, doit intégrer des données multiples. L'incapacité à les maîtriser toutes confère à la décision d'investissement les caractéristiques d'une décision à risque. Cela n'est pas sans conséquence, puisque l'on sait que l'aversion au risque varie selon la position des acteurs et leur environnement.
Abel 20 ( * ) et Hayashi 21 ( * ) ont ainsi insisté sur la nécessité pour les entreprises lorsqu'elles évaluent la profitabilité d'un investissement, de tenir compte des coûts d'ajustement du capital productif. Ces coûts d'ajustement augmentent avec le volume de l'investissement, et sont composés, notamment, de coûts d'organisation, et de coûts de formation dans l'entreprise. L'investissement optimal résulte alors de l'arbitrage entre le surcroît des profits engendrés par l'investissement et celui des coûts occasionnés par son installation.
Edmond Malinvaud 22 ( * ) a, quant à lui, insisté sur les notions d' incertitude , et d' irréversibilité des investissements, pour mettre en relief l'importance des calculs de profitabilité dans les décisions d'investissement. Les capacités de production ne peuvent s'adapter instantanément aux inflexions de la conjoncture (irréversibilité), et il est coûteux pour une firme d'avoir des capacités excédentaires ou insuffisantes. La décision d'investir consiste alors à déterminer un taux d'utilisation des capacités de production moyen sur la base d'une demande anticipée, et d'un risque lié à l'erreur d'anticipation (incertitude). La profitabilité sera d'autant plus faible que la demande anticipée est modeste et incertaine.
Plus récemment, Abel et Eberly 23 ( * ) ont cherché à montrer, dans le cadre d'un modèle néoclassique, qu'il existerait un seuil de profitabilité en deçà duquel il serait préférable de ne pas investir et d'attendre de meilleures perspectives de profit. Ils rattachent ce seuil de profitabilité à l'existence de coûts fixes lors de l'installation du capital physique . Au-delà de ce seuil, l'investissement deviendrait positif, et fonction croissante de la profitabilité.
Une comparaison de la profitabilité du capital, effectuée dans six pays développés sur la période 1965-1999 24 ( * ) , montre que la profitabilité du capital est nettement plus élevée aux Etats-Unis qu'en Europe ou au Japon . En moyenne, sur la période, la profitabilité brute du capital atteint 23 % aux Etats-Unis, 16 % en Allemagne, au Royaume-Uni, ou aux Pays-Bas, 13,5 % en France , et 12,5 % au Japon. La profitabilité du capital a diminué jusqu'en 1982 dans tous les pays, avant de connaître une tendance à la hausse jusqu'à la fin des années 1990 (sauf au Japon où elle continue de diminuer depuis une dizaine d'années). Cette hausse de la profitabilité du capital s'explique par une détente des taux d'intérêts, mais aussi, en Europe continentale, par une remontée du taux de marge des entreprises. Dans les pays anglo-saxons, c'est plutôt l'augmentation de la productivité du capital qui est à l'origine du redressement de la profitabilité.
La France se distingue de ses partenaires à la fin des années 1980 et au début des années 1990 ; la profitabilité du capital a, en effet, diminué pendant cette période, avant de rattraper la moyenne européenne. Cette divergence, par rapport à la tendance générale, s'explique par l'évolution des taux d'intérêt réels. Ils se sont situés à des niveaux élevés, au cours de la période considérée, ce qui a dégradé la profitabilité moyenne du capital. La hausse des taux d'intérêt s'explique par la volonté des autorités françaises d'alors de garantir la stabilité du taux de change du franc par rapport au mark.
Une profitabilité trop faible, en raison de taux d'intérêts réels élevés, décourage l'investissement physique, et peut inciter les entreprises à privilégier les placements financiers. Il y a éviction de l'investissement par les placements financiers Une analyse plus fine invite cependant à distinguer ces deux impacts.
Les observations empiriques, et les réflexions des théoriciens de l'économie industrielle, conduisent à penser qu'une partie des investissements financiers est complémentaire des investissements physiques, de sorte que le niveau des taux d'intérêt jouerait principalement à travers son impact sur le coût d'usage du capital. Les prises de participation dans un but de croissance externe répondent à la même logique que l'investissement physique, à savoir assurer le développement de l'entreprise. Lorsqu'on exclut du montant des investissements financiers les placements en valeurs mobilières correspondant à une logique de court terme, on observe une corrélation positive entre investissements financiers et investissements physiques. Autrement dit, les entreprises qui investissent le plus en prises de participations externes sont aussi celles qui dépensent le plus pour leurs investissements physiques.
Dès lors que la profitabilité du capital est positive et suffisante, il devient non seulement intéressant d'investir, mais aussi de financer l'investissement par recours à l'emprunt, en raison de l' effet de levier . Le mécanisme de l'effet de levier est le suivant : lorsque la rentabilité du capital est supérieure au coût moyen de la dette, les dirigeants d'entreprise sont incités à recourir davantage à un financement par endettement, dans la mesure où ce mode de financement permet, mécaniquement, d'augmenter la rémunération des fonds propres. Mais il y a des limites à l'endettement, ce qui pose le problème des contraintes de financement pesant sur les entreprises.
D. LES CONTRAINTES D'ACCÈS AU FINANCEMENT
Une entreprise dispose, en priorité, pour investir de ses ressources propres. Si celles-ci sont insuffisantes, l'entreprise doit emprunter. Elle peut aussi, si sa taille le lui permet, lever des capitaux propres. Les conditions de financement de l'investissement productif dépendent ainsi de caractéristiques propres à la situation financière de chaque entreprise .
|
Les réflexions relatives au financement de
l'investissement ont longtemps été menées dans un cadre
théorique délimité par le théorème de
Modigliani-Miller (1958). Selon ce théorème, il est
indifférent pour une entreprise de financer ses investissements par
endettement, émission d'actions, ou rétention des profits. Ce
théorème n'est cependant valide que sous des conditions
très restrictives, qui, en pratique, ne sont pas
vérifiées : hypothèse de perfection des
marchés financiers, d'absence de conflit entre les dirigeants et les
actionnaires, et d'absence de distorsions liées à la
fiscalité. Les conditions d'application très strictes de ce
théorème ont conduit à sa remise en cause, et ont
orienté les chercheurs vers l'idée d'une structure optimale du
capital des entreprises. Les entreprises ont intérêt à
s'endetter pour profiter de l'effet de levier, et de l'avantage fiscal
lié à la dette (les intérêts sont déductibles
de l'impôt sur les sociétés). Mais la croissance de
l'endettement entraîne un risque de défaillance accru.
L'entreprise doit arbitrer entre les avantages liés à
l'endettement, et le coût du risque de défaillance.
|
La capacité d'emprunt d'une entreprise dépend beaucoup des garanties qu'elle peut offrir, ainsi que des conditions du marché (niveau des taux d'intérêt). Le niveau des profits et le niveau de l'endettement de l'entreprise sont les deux indicateurs privilégiés pour évaluer les capacités de remboursement de l'emprunteur. Par ce biais, l'investissement est donc déterminé par le niveau des profits et de l'endettement .
La recherche économique souligne la très grande hétérogénéité des comportements d'investissement des entreprises. Cette hétérogénéité s'explique largement par les conditions de financement différentes qui leur sont offertes. Les variables taux de profit et taux d'endettement ont ainsi un pouvoir explicatif réel pour l'investissement des petites entreprises, mais non pour l'investissement des grands groupes 25 ( * ) . Les petites entreprises ont moins de garanties à offrir aux banques, et ont donc plus de difficultés à financer leurs investissements. Les contraintes sont renforcées en période de ralentissement de la croissance, ou de récession.
Le modèle du canal du crédit 26 ( * ) donne un fondement théorique à ces observations empiriques. Il souligne le rôle important des asymétries d'information qui existent dans la relation entre les banques et les entreprises. Ces asymétries d'information portent sur deux aspects différents de la relation entre prêteurs et emprunteurs. D'une part, les prêteurs sont moins bien informés que l'entreprise qui emprunte sur la situation réelle de celle-ci, et sur le caractère plus ou moins risqué des projets qu'elle veut financer. D'autre part, les prêteurs ne peuvent contrôler que très imparfaitement l'action de l'entreprise, une fois les prêts accordés ; le risque est que l'emprunteur adopte un comportement imprudent, qui affecte sa capacité de remboursement ultérieure.
De ce fait, les banques sont amenées à intégrer dans le coût du crédit une prime de financement externe qui reflète notamment les risques de non-recouvrement. Cette prime prend en compte les caractéristiques observables de l'entreprise, qui renseignent sur sa probabilité de défaillance : sa taille, son endettement, son appartenance ou non à un groupe. La prime de financement externe est également une fonction inverse de la richesse nette de l'entreprise, c'est-à-dire de la valeur de l'ensemble de ses actifs fixes, immobiliers ou financiers, diminuée de ses dettes. Cette richesse nette reflète la capacité de l'entreprise à apporter des garanties.
La prime de financement est sensible, par l'intermédiaire de la richesse nette, aux modifications de l'environnement économique. En particulier, une hausse des taux d'intérêt s'accompagne d'une baisse de la valeur des actifs financiers, et donc d'une hausse de la prime de financement. Les effets d'un durcissement de la politique monétaire sont ainsi répercutés de façon amplifiée : à la hausse des taux d'intérêt s'ajoute la hausse induite de la prime de financement. En conséquence, les petites entreprises, qui se financent exclusivement par le crédit bancaire, sont plus affectées que les grands groupes par un durcissement de la politique monétaire.
Une étude de Crépon et Rosenwald 27 ( * ) , réalisée à partir de données d'entreprises couvrant la période 1987-1994, montre que la prime de financement externe moyenne serait de l'ordre de 5 %, par rapport au taux d'intérêt. Au-delà de ce chiffre moyen, l'étude confirme que les différences de situations financières entre entreprises conduisent à des conditions de financement différentes. Pour certaines entreprises, la prime de financement est négligeable par rapport au taux d'intérêt. Pour d'autres entreprises, en revanche, l'effet peut être ponctuellement important, pouvant aller jusqu'à doubler le niveau des taux d'intérêt.
Sur la base de ces déterminants de l'investissement, dégagés par la théorie économique, deux grands efforts de modélisation ont été réalisés. Le modèle « accélérateur-profit » et le modèle Q de Tobin tentent de représenter, de manière synthétique, le comportement d'investissement des entreprises. Ils sont un outil de prévision des évolutions de l'investissement productif. Les écarts constatés entre les estimations économétriques et la réalité observée invitent à s'interroger sur les transformations intervenues dans les comportements d'investissement des entreprises.
II. MODÉLISATIONS DES COMPORTEMENTS D'INVESTISSEMENT
Les premiers travaux de modélisation des comportements d'investissement datent des années 1950 et du début des années 1960, avec les travaux de Klein et de Jorgenson. En 1969, James Tobin a proposé une méthode de modélisation alternative, connue sous le nom de Q de Tobin.
A. LE MODÈLE « ACCÉLÉRATEUR-PROFIT »
Les premières tentatives de modélisation des comportements d'investissement se sont inscrites dans un cadre théorique néoclassique. Ils décrivent une situation dans laquelle les entreprises maximisent leurs profits en dehors de toute contrainte.
Ces modèles initiaux - dits de « demande notionnelle » de capital - ont été contestés par des économistes de l'école keynésienne 28 ( * ) . Ces derniers ont introduit l'hypothèse d'une contrainte chronique pesant sur les débouchés des entreprises. Cette contrainte sur les débouchés permet d'introduire l'effet d'accélération, mentionné précédemment. Le niveau désiré de capital dépend alors du coût relatif des facteurs de production, de la productivité tendancielle, et du niveau anticipé des débouchés. L'investissement est dépendant de la demande, et augmente avec l'accélération de celle-ci.
Ce modèle d'accélérateur simple a ensuite été enrichi par la prise en compte de variables de profit. Dans les années 1980, en effet, le lien entre les facteurs financiers et les décisions réelles des agents a bénéficié d'un regain d'attention de la part des économistes. Les modélisateurs se sont efforcés d'intégrer les problèmes posés par les modalités d'accès des entreprises au financement bancaire. Ainsi, dans les nouveaux modèles « accélérateur-profit », l'investissement est fonction non seulement de la croissance des débouchés, mais aussi d'une variable de profit et de coût de l'investissement. Le profit est appréhendé par le rapport entre l'excédent brut d'exploitation et le capital évalué à son coût de remplacement. Le coût de l'investissement est défini comme le taux d'intérêt annuel déflaté du glissement annuel du prix de l'investissement. On considère ordinairement que le taux de profit est le déterminant financier le plus robuste
Cette modélisation « accélérateur-profit » est aujourd'hui la plus couramment employée. Elle traduit l'idée qu'une partie des entreprises est contrainte sur la demande, et une autre partie sur les conditions de financement. Toutefois, il convient de noter que l'indicateur de taux de profit introduit dans l'équation ne reflète pas uniquement des problèmes de financement : il indique également l'existence d'opportunités rentables d'investissement.
B. UNE FORMULATION ALTERNATIVE : LE Q DE TOBIN
L'idée de base de ce modèle est la suivante : l'entrepreneur investit dans de nouveaux projets si le marché les valorise au-delà de ce qu'ils ont coûté. L'investissement est rentable tant que l'accroissement de la valeur de la firme reste supérieur à son coût.
James Tobin 29 ( * ) propose de suivre un ratio, dit Q-moyen, rapport de la valeur boursière de la firme à son capital au coût de remplacement. En effet, sous l'hypothèse d'efficience du marché boursier, la valeur de marché d'une firme est exactement égale à la somme actualisée de ses flux de profit futurs. Un Q-moyen supérieur à 1 révèle que le marché anticipe une profitabilité de l'investissement au-delà de son coût. Au contraire, si le ratio Q est inférieur à 1, le marché anticipe une profitabilité de l'investissement inférieure à son coût. Dans cette dernière hypothèse, l'intérêt des actionnaires serait de revendre les équipements existants à leur coût de remplacement. Si cela est impossible, il convient au moins de ne plus investir, et d'amortir progressivement le capital existant.
En principe, le Q de Tobin résume toute l'information utile.
L'effet du taux d'intérêt sur l'investissement est spontanément intégré par le ratio Q. En effet, les marchés valorisent les entreprises en actualisant leurs recettes futures attendues à l'aide du taux d'intérêt réel ; ainsi, une hausse des taux d'intérêt réduit la valeur actualisée de l'entreprise, et, de ce fait, le cours actuel de ses actions. La variation du taux d'intérêt modifie ainsi la valeur du ratio Q.
Le Q de Tobin permet de contourner le problème de la modélisation des anticipations, puisqu'il utilise les anticipations des agents économiques contenues dans les cours boursiers. Les investisseurs présents sur les marchés boursiers évaluent en permanence les flux de revenus futurs des entreprises, et l'évolution de leurs débouchés. Les cours boursiers, et le Q de Tobin avec eux, fluctuent en fonction de la synthèse qu'ils effectuent de toute l'information disponible.
Le Q de Tobin présente néanmoins un inconvénient majeur : il n'est calculable que pour les entreprises cotées. Dès lors, « expliquer l'investissement macroéconomique à partir de ce ratio suppose une agrégation des comportements [des entreprises] pour laquelle on fait l'hypothèse que la décision d'investir des plus grosses entreprises est reproduite sur les plus petites. Cette hypothèse apparaît forte » 30 ( * ) . De plus, les marchés boursiers sont parfois affectés par des phénomènes de « bulles spéculatives », qui conduisent à une forte divergence entre les cours boursiers et les fondamentaux de l'économie. Les marchés boursiers connaissent des mouvements plus brutaux et erratiques que l'économie réelle, ce qui peut conduire à un écart temporaire entre le comportement d'investissement prédit par le ratio Q, et celui effectivement réalisé par les entreprises.
III. LA FAIBLESSE DE L'INVESTISSEMENT DANS LA DÉCENNIE ÉCOULÉE RESTE, EN PARTIE, INEXPLIQUÉE PAR LES MODÈLES USUELS
L'investissement observé après 1993 a été plus faible que ce que les modèles théoriques laissaient prévoir. Un renforcement des contraintes de financement pesant sur les entreprises semble devoir expliquer cette discordance.
A. UN INVESTISSEMENT RÉALISÉ PLUS FAIBLE QUE CELUI ANTICIPÉ
La faiblesse de l'investissement depuis 1990 résulte essentiellement d'un déficit marqué d'investissement sur la période 1993-1998. Divers travaux réalisés par des chercheurs de l'INSEE 31 ( * ) soulignent que l'atonie de l'investissement pendant cette période de cinq ans est mal expliquée par les modèles usuels.
La spécification accélérateur-profit retrace convenablement la baisse de l'investissement sur la période 1990-1993. Après la forte croissance de la fin des années 1980, l'activité économique a considérablement ralenti, pour finalement déboucher sur une récession de près de 1 % en 1993. Le facteur demande était donc fortement orienté à la baisse. De plus, la persistance de taux d'intérêts réels élevés a contribué à détériorer la solvabilité des entreprises, et la profitabilité des projets d'investissement disponibles.
Après la récession de 1993, les estimations rendent moins bien compte du profil de l'investissement. En particulier, la reprise de 1995 ne se traduit pas par une hausse de l'investissement conforme à ce que l'on aurait pu attendre du lien habituellement constaté entre l'investissement et la valeur ajoutée. La déconnexion se poursuit pendant les années 1996 et 1997.
C'est seulement depuis 1998 que l'investissement redevient conforme au phénomène d'accélération vis-à-vis de la valeur ajoutée.
L'approche par le Q de Tobin pose le même problème d'interprétation. Herbet et Michaudon 32 ( * ) ont montré que le taux d'accumulation et le Q de Tobin ont suivi, au cours de la période 1975-1991, des évolutions parallèles, ce qui semble confirmer la validité du modèle sur longue période. Mais la relation entre ces deux grandeurs n'est plus établie depuis 1993. Le Q de Tobin progresse en effet sensiblement, atteignant, à partir de 1995, des valeurs proches de 1,2, indiquant l'existence d'opportunités d'investissement non satisfaites. Pourtant, le taux d'accumulation reste faible pendant cette période.
Graphique 9 : Q de TOBIN et taux d'accumulation
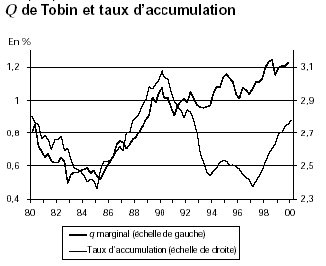
Source : Herbet J.B. (1995).
Alors que l'investissement productif français est resté faible sur la période 1993-1998, l'investissement américain a décollé à partir de 1992. La reprise de l'investissement français entre 1998 et 2000 a été trop brève pour permettre de rattraper le retard accumulé dans la période précédente.
Les éléments avancés pour rendre compte de cet écart entre l'investissement réalisé et les prévisions des modèles tournent autour de la notion de contrainte financière.
B. UN RENFORCEMENT DES CONTRAINTES FINANCIÈRES PESANT SUR LES ENTREPRISES ?
Comme l'analyse des déterminants de l'investissement l'a montré, le rôle des contraintes financières est pris en compte dans les théories de l'investissement. Mais différents indices laissent à penser que le poids de ces contraintes se serait accru dans la période récente. Une actualisation des modèles en vue d'accroître le poids de ces facteurs permet d'améliorer leur représentation de l'investissement.
Michaudon et Vannieuwenhuyze 33 ( * ) montrent que l'introduction d'une variable d'endettement améliore sensiblement les performances de l'équation d'investissement pour la période considérée. Ce résultat peut s'interpréter de la manière suivante : suite à une phase d'endettement excessif, qui avait conduit à de nombreuses défaillances d'entreprises à la fin des années quatre-vingt, les entreprises françaises ont nettement privilégié leur désendettement, au détriment du financement de nouveaux projets.
La contrainte d'endettement aurait été particulièrement forte pour les petites entreprises, celles-ci subissant plus durement l'impact de taux d'intérêt réels élevés, en raison du phénomène du canal du crédit. Cette hypothèse est confirmée par les observations de Duhautois 34 ( * ) , qui rappelle que « le ralentissement de l'investissement est plutôt le fait des petites entreprises tertiaires ». L'incapacité du ratio Q à appréhender convenablement le comportement des petites entreprises expliquerait la déconnexion entre Q de Tobin et investissement productif.
Cependant, malgré la baisse des taux d'intérêt à partir de 1995, et l'assainissement de la situation financière des entreprises, perceptible au niveau macroéconomique, l'investissement est demeuré faible jusqu'au deuxième semestre 1997. P. Artus 35 ( * ) émet l'hypothèse que les entreprises, fortement marquées par la période passée de fragilité financière, ont pu continuer à se conformer à des normes d'endettement restrictives.
Une autre interprétation de la faiblesse de l'investissement pourrait être trouvée dans les exigences accrues de rentabilité des actionnaires. L'internationalisation des marchés financiers aurait conduit à la diffusion de normes de rentabilité plus élevées, en l'occurrence celles en vigueur dans les pays anglo-saxons (taux de rentabilité de 15 %). Les grandes entreprises françaises auraient ainsi été incitées à limiter leurs investissements à ceux offrant les meilleures perspectives de rentabilité. La sélection des investissements les plus rentables expliquerait à la fois la baisse de l'investissement, et la hausse du Q de Tobin.
C. LE RÔLE DE L'INVESTISSEMENT EN CONSTRUCTION
Selon une étude économétrique d'Irac et Jacquinot 36 ( * ) , c'est l'investissement en construction qui expliquerait l'atypisme de l'investissement observé en France dans les années 1990.
Une phase d'expansion vigoureuse de l'investissement en bâtiment s'est, en effet, produite de 1985 à 1992. Elle s'est achevée avec l'éclatement de la bulle immobilière. Il a fallu ensuite plusieurs années pour effacer la suraccumulation qui était intervenue, d'où une morosité prolongée de l'investissement en construction, qui ne s'achève qu'en 1999. La composante construction de l'investissement a donc diminué, pendant plusieurs années, la FBCF totale des entreprises.
Pour ces auteurs, l'investissement hors construction a eu, dans les années 1990, un comportement conforme à la dynamique observée dans les années 1980, c'est-à-dire déterminé essentiellement par l'activité et le profit.
TROISIÈME PARTIE :
POLITIQUES PUBLIQUES ET
INVESTISSEMENT
L'investissement relève d'abord d'une décision des entreprises du secteur privé, mais les pouvoirs publics peuvent agir pour soutenir et orienter l'investissement. Ils disposent pour cela de plusieurs instruments : la politique monétaire, la politique fiscale, l'investissement public, la politique de réglementation, le soutien au crédit bancaire, etc.
La politique économique peut se préoccuper du niveau de l'investissement, mais aussi de la qualité des investissements : un investissement plus important en recherche et développement (R&D) est la clé des innovations et de la croissance de demain. La politique économique devrait également veiller à éviter des phénomènes de suraccumulation, préjudiciables à la croissance. Il apparaît aujourd'hui, par exemple, que l'investissement productif a été excessif aux Etats-Unis, dans le secteur informatique, et en Europe, dans le secteur des télécommunications. Ces phénomènes de suraccumulation, qui ne sont pas nouveaux, posent la question de la formation des anticipations relatives aux débouchés.
Bien que disposant d'instruments variés pour soutenir et orienter l'investissement productif, la politique économique française évolue dans un contexte de contraintes fortes. La maîtrise de la politique monétaire appartient à la Banque centrale européenne, qui arrête ses décisions en fonction de la situation observée dans l'ensemble de la zone euro, et en fonction d'un objectif de stabilité des prix. En conséquence, l'arme des taux d'intérêt ne peut être mobilisée directement dans un but de soutien à l'investissement.
Différents éléments laissent penser que l'investissement public entretient une relation positive avec l'investissement privé ; mais une politique de relance de l'investissement public est difficile dans un contexte marqué par une forte contrainte budgétaire.
Les mesures fiscales de soutien à l'investissement ont fréquemment été employées dans le passé, mais elles n'ont obtenu, semble-t-il, que des résultats limités et transitoires. Ainsi, si les objectifs sont clairs, les moyens permettant de les atteindre sont plus délicats à définir. Toutefois, comme le contexte économique général, au-delà des mesures de politique économique ponctuelles, joue un rôle important dans les incitations à investir, il convient de porter l'attention sur les contextes favorisant l'investissement.
La présentation des modalités de l'action publique complète logiquement l'approche théorique des déterminants de l'investissement, qui rend assez peu compte de la complexité du contexte (économique, juridique, institutionnel...) dans lequel évoluent les entreprises.
I. PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE FAVORABLE À L'INVESTISSEMENT
La politique macroéconomique, si elle veut s'attacher à soutenir l'investissement, doit rechercher des taux d'intérêt réels bas. Comme l'investissement des entreprises est sensible à l'incertitude, la politique économique devrait s'efforcer d'être lisible et de privilégier la stabilité. Mais cet objectif de stabilité pour l'environnement économique des entreprises doit parfois être concilié avec une politique, de court terme, de soutien de la demande.
A. DES TAUX D'INTÉRÊT BAS SONT FAVORABLES À L'INVESTISSEMENT
Un bas niveau des taux d'intérêt de long terme est une des conditions de la baisse du coût d'usage du capital et de l'augmentation de la profitabilité des investissements. Leur baisse comporte deux conséquences favorables sur l'investissement :
La baisse des taux d'intérêt de court terme permet de desserrer la contrainte de solvabilité. Elle provoque en effet une réduction du montant du service de la dette, ce qui allège la contrainte de trésorerie et limite la ponction sur le profit des entreprises.
La baisse des taux d'intérêt de court terme peut avoir des conséquences favorables sur l'accumulation du capital par l'influence qu'elle peut exercer sur les taux longs. L'action de la politique monétaire sur le segment court du marché, conjuguée à l'inscription de la politique monétaire dans un cadre crédible de moyen terme, permet de réduire les primes de risque incorporées dans les taux longs, et rend possible leur décrue. Les agents économiques constatent que la profitabilité s'améliore et sont incités à investir. Pour qu'un effet positif de relance de l'investissement s'exerce, il est cependant indispensable que les agents anticipent la baisse du coût d'usage du capital comme durable. La crédibilité de la politique monétaire est, de ce fait, une condition impérative du succès d'une telle politique.
Dans le cadre de l'Union économique et monétaire, la fixation des taux d'intérêt de court terme ne dépend plus des autorités nationales françaises, mais de la Banque centrale européenne. Celle-ci s'est efforcée de stabiliser les anticipations des agents économiques, en rendant public un objectif d'inflation : l'indice des prix à la consommation ne doit pas progresser de plus de 2 % sur l'année.
Les Etats membres de l'Union européenne, dont la France, peuvent cependant, par leur politique budgétaire, favoriser la baisse des taux d'intérêt. Une diminution du besoin de financement public facilite la baisse des taux. Le Pacte de stabilité et de croissance vise précisément à assurer une certaine discipline budgétaire, garante de la détente monétaire en Europe.
B. POUR UN ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE STABLE
Les développements récents de la théorie économique 37 ( * ) soulignent l'intérêt qu'il y a, pour les Etats, à réduire l'incertitude qui caractérise l'environnement économique des entreprises. Le lien entre les décisions d'investissement et l'incertitude s'explique par l'existence d'un certain degré d'irréversibilité des investissements. L'investissement est, en grande partie, irréversible, parce qu'au coût d'achat des nouveaux biens s'ajoutent les coûts d'installation et d'adaptation au nouveau matériel. L'addition de ces dépenses peut rendre le coût du désinvestissement prohibitif.
Dès lors, l'entreprise ne doit pas seulement arbitrer entre investir ou ne pas investir, mais entre investir maintenant et investir plus tard. Attendre ne représente pas seulement un coût d'opportunité, lié à la perte de profit q'un investissement immédiat permettrait éventuellement d'obtenir, mais offre aussi un avantage. Cet avantage est à la mesure du coût que subirait l'entreprise si, après avoir choisi d'investir sans attendre, elle préférait finalement revendre le bien d'investissement en raison de l'évolution défavorable de l'environnement économique. Ainsi, attendre est une option pouvant présenter une certaine valeur, ce qui peut conduire une entreprise à différer ses investissements.
En conséquence, la réduction de l'incertitude peut être l'un des objectifs des responsables en charge de la politique économique. Cette analyse est partagée par la Direction générale des affaires économiques et financières de la Commission européenne, qui écrit 38 ( * ) : « des politiques macroéconomiques axées sur la stabilité sont indispensables à la création d'un environnement porteur pour l'investissement et la croissance économique parce qu'il réduit les degrés globaux d'incertitudes. Les objectifs de ces politiques sont un faible taux d'inflation, la discipline budgétaire et une instabilité conjoncturelle limitée ».
La stabilité des prix est un facteur déterminant pour la réduction de l'incertitude. En effet, un niveau d'inflation élevé, qui s'accompagne généralement d'une forte irrégularité dans son évolution, fausse les évaluations de rentabilité réelle des investissements et les calculs d'amortissement.
L'instabilité des prix a pu, dans le passé, être aggravée par l' instabilité des taux de change entre devises. Depuis 1999 et l'introduction de la monnaie unique, ce problème est atténué pour les pays européens.
La stabilité des règles fiscales revêt également une grande importance ; elle garantit la validité des calculs de rendement, net d'impôts, des investissements, et assure ainsi la rationalité des décisions des entreprises.
Au demeurant, outil de la politique budgétaire, la fiscalité exerce une influence importante sur les comportements d'investissement des entreprises, et mérite, de ce fait, un traitement plus approfondi.
II. ADAPTER LA FISCALITÉ À L'INVESTISSEMENT
L'analyse des rapports entre fiscalité et investissement conduit à se poser plusieurs questions : comment se situe la France, par rapport à ses partenaires étrangers en matière d'imposition des entreprises ? Les incitations fiscales sont-elles un bon instrument de régulation de l'investissement ?
A. LE POIDS DE LA FISCALITÉ PESANT SUR LES INVESTISSEMENTS
La comparaison des régimes fiscaux nationaux est toujours un exercice délicat, tant les règles applicables peuvent être complexes, et hétérogènes selon les entreprises. Une comparaison pertinente suppose de calculer un taux d'imposition moyen effectif, c'est-à-dire le taux d'imposition que supporte un investissement type, qui rapporterait, avant impôt, une rentabilité donnée.
La Commission s'est efforcée, en 2001, d'effectuer une telle évaluation pour les pays membres de l'Union européenne 39 ( * ) . Elle cherche à calculer l'imposition effective moyenne que supporterait un investissement dont la rentabilité serait de 20 %. Le taux moyen d'imposition effective intègre, dans le cas de la France, l'impôt sur les sociétés (IS), mais aussi la fiscalité locale (taxe professionnelle, impôts fonciers). Mais certaines caractéristiques de l'impôt sur les sociétés, comme le traitement des pertes ou le report des déficits, ne sont pas prises en compte, par souci de simplification. L'investissement-type retenu dans l'étude porte sur un actif composite (combinaison de machines, de biens intangibles, etc.), et son financement combine, dans des proportions définies, autofinancement, endettement et émission d'actions.
Les résultats des travaux de la Commission figurent dans le tableau suivant :
Tableau 3
|
Taux effectif moyen d'imposition en 1999 |
Taux effectif moyen d'imposition en 2001 |
|
|
Autriche |
29,8 |
27,9 |
|
Allemagne |
39,1 |
34,9 |
|
Belgique |
34,5 |
34,5 |
|
Danemark |
28,8 |
27,3 |
|
Espagne |
31 |
31 |
|
Finlande |
25,5 |
26,6 |
|
France |
37,5 |
34,7 |
|
Grande-Bretagne |
28,2 |
28,3 |
|
Grèce |
29,6 |
28 |
|
Irlande |
10,5 |
10,5 |
|
Italie |
29,8 |
27,6 |
|
Luxembourg |
32,2 |
32,2 |
|
Pays-Bas |
31 |
31 |
|
Portugal |
32,6 |
30,7 |
|
Suède |
22,9 |
22,9 |
|
Lecture : le taux moyen effectif d'imposition pour un investissement type (bien et financement composite), qui rapporte avant impôt 20 %, est de 34,7 % en France et de 34,9 % en Allemagne en 2001. Source : Rapport Commission européenne 2001. |
||
Les charges fiscales auxquelles sont soumises les entreprises apparaissent relativement disparates. Trois groupes de pays peuvent être distingués : l'Irlande et les pays du Nord de l'Europe (Suède, Finlande) affichent les taux d'imposition les plus bas, inférieurs à 25 % ; un groupe intermédiaire (Italie, Grande-Bretagne, Autriche, etc.) connaît des taux d'imposition avoisinant les 30 % : enfin, la France et l'Allemagne se distinguent par des taux d'imposition plus élevés, proches de 35 %.
Le haut niveau d'imposition de la France s'explique, en grande partie, par l'incidence de la fiscalité locale, qui est d'autant plus pénalisante pour les entreprises qu'elle est indépendante de leurs résultats. L'impôt sur les sociétés, quant à lui, a vu son taux décroître dans les années 1990, pour passer de 50 % à 33,3 %, de sorte que l'impôt sur les sociétés pèse, en 2001, pour 2,8 points de PIB, contre 3,1 points de PIB, en moyenne, en Europe.
Les conclusions de la Commission sont, globalement, confirmées par une étude de Bretin et Guimbert, réalisée en 2002 40 ( * ) . Ces auteurs calculent, à nouveau, un taux effectif moyen d'imposition. A la différence de la Commission, ils considèrent un investissement-type dont le rendement attendu est de 30 % (contre 20 % de l'étude précédente). Cet investissement type donne droit à amortissement, ce qui réduit le bénéfice imposable. Le bénéfice peut aussi être réduit s'il sert à verser des intérêts, puisque ceux-ci sont déductibles du résultat fiscal. Par ailleurs, ces auteurs prennent en compte, dans leurs calculs, non seulement la fiscalité qui pèse sur les entreprises, mais aussi celle qui pèse sur les particuliers bénéficiaires de revenus du patrimoine (intérêts, dividendes, plus-values) afin d'évaluer la charge fiscale totale supportée par un investisseur. Leurs calculs portent sur les années 1991 et 1999.
Pour 1999, les résultats sont les suivants, pour les principaux pays européens :
Tableau 4
|
Taux moyen effectif d'imposition en 1999 |
||
|
Allemagne |
46,1 % |
|
|
France |
50,0 % |
|
|
Italie |
27,3 % |
|
|
Pays-Bas |
50,4 % |
|
|
Royaume-Uni |
19 % |
|
|
Source : S. Guimbert (2001) |
||
On observe que la charge moyenne pesant sur le capital présente, à nouveau, d'importantes disparités entre Etats européens. Dans cette évaluation, la France fait encore partie des Etats où la fiscalité et la plus lourde.
Le niveau élevé de l'imposition des entreprises françaises a des conséquences aux niveaux national et européen. Au niveau national, un haut niveau d'imposition réduit la rentabilité, après impôt, des investissements : cet effet négatif sur la profitabilité freine l'investissement. Les bénéfices des entreprises sont, par ailleurs, réduits, ce qui augmente la contrainte de financement qui pèse sur leurs investissements. Pour ces deux raisons, un haut niveau d'imposition est défavorable à l'investissement productif. S. Guimbert, se fondant sur les travaux de Crépon et Gianella 41 ( * ) , et de Goodsbee 42 ( * ) , arrive à la conclusion que l'effet de la fiscalité sur l'investissement serait « très significatif » : ainsi, une hausse de 1 % du coût du capital résultant, par exemple, de changements fiscaux, réduirait de 1 % le stock de capital.
Au niveau européen, l'écart entre l'imposition en France et à l'étranger dégrade l'attractivité du territoire national, comme lieu d'implantation d'unités de production. Ceci est susceptible de décourager l'investissement direct étranger en France, voire de favoriser des délocalisations. Mme Françoise Gri, Président-directeur général d'IBM France, auditionnée par votre rapporteur, a souligné qu'un engagement clair en faveur de la baisse de la dépense publique serait un « signal apprécié par les investisseurs internationaux », dans la mesure où il rendrait crédible la perspective d'une baisse durable des prélèvements obligatoires.
B. LES MESURES DE RÉGULATION CONJONCTURELLE DE L'INVESTISSEMENT SEMBLENT PEU EFFICACES
Les pouvoirs publics ont régulièrement tenté d'utiliser l'instrument fiscal à des fins de régulation conjoncturelle de l'investissement. L'objectif est de lisser les évolutions de l'investissement grâce à des mesures fiscales temporaires.
On peut citer, à titre d'illustration, les mesures suivantes : en 1975, était décidée une aide fiscale exceptionnelle représentant 10 % de la commande de biens d'équipements passée par l'entreprise pendant la période aidée (30 avril - 31 décembre) ; en 1982, a été institué un mécanisme de déduction de l'impôt sur les sociétés d'un pourcentage de l'investissement réalisé par chaque entreprise ; en 1979-1980, la déduction fiscale portait sur le supplément d'investissement réalisé par rapport à l'exercice précédent ; de 1983 à 1985, a été appliqué un régime d'amortissement exceptionnel (un amortissement exceptionnel supplémentaire de 40 % était accordé la première année suivant l'investissement).
Les travaux effectués 43 ( * ) pour évaluer ces mesures d'incitation suggèrent que leurs effets sont limités, et que le rapport coût-efficacité de ces mesures est peu favorable.
Les mesures fiscales temporaires conduisent, en effet, davantage à un phénomène d'anticipation des investissements qu'à un véritable surcroît d'investissement. Une étude économétrique réalisée par l'INSEE, pour le Conseil national des impôts, indique que 80 % des commandes passées dans le cadre d'une déduction fiscale auraient été passées en tout état de cause. Une étude de la Direction de la prévision suggère que l'incitation de 1975 n'expliquerait que 5 % de l'investissement effectué au cours de la période. Le Conseil national des impôts ajoute : « Ce résultat ne témoigne pas d'une grande efficacité de la mesure si l'on considère que son coût budgétaire s'est élevé à 5,3 % de la formation brute de capital fixe des sociétés et entreprises individuelles sur l'ensemble de l'année 1976 ».
L'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) s'est efforcé de comparer systématiquement le supplément d'investissement engendré par les incitations fiscales, mises en oeuvre entre 1966 et le milieu des années 1980, avec leur coût budgétaire.
Il semble que l'impact sur l'investissement de ces procédures ait toujours été inférieur à la dépense fiscale correspondante. En moyenne, le surcroît d'investissement représenterait 80 % du coût budgétaire de la mesure. Le rapport est plus favorable pour la mesure de 1979-1980, calculée sur l'accroissement de l'investissement. Le coût des incitations fiscales temporaires apparaît donc disproportionné par rapport à leurs effets.
Par ailleurs, au-delà même de la question de leur efficacité, les incitations fiscales à l'investissement altèrent la neutralité et l'équité de l'impôt. Trois effets pervers ont pu être identifiés :
- Les incitations fiscales profitent principalement aux grandes entreprises ; les PME sont, d'une manière générale, moins bien informées des évolutions de la législation et peuvent, de ce fait, omettre de tirer partie d'incitations fiscales ; de plus, seules les grandes entreprises investissent de manière régulière, et procèdent à une programmation pluriannuelle de leurs investissements, qui permet des anticipations.
- Elles privilégient également les investissements physiques par rapport aux investissements immatériels. Cet effet est une conséquence de la définition retenue de l'investissement, assimilé aux commandes de biens d'équipement. Au niveau macroéconomique, l'amélioration de la formation brute de capital physique peut ainsi s'accompagner d'une baisse non désirée des dépenses en recherche et développement, marketing, formation...
- Enfin, l'avantage fiscal consenti est indépendant de la rentabilité avant impôt des projets d'investissement. Ce sont donc les projets dont la rentabilité avant impôt est la plus faible qui sont proportionnellement les plus aidés.
Ces analyses formulées en 1987 par le Conseil national des impôts ne semblent pas devoir être démenties par les expériences récentes. En 1996, une mesure, temporaire, d'aide à l'investissement des entreprises a été instaurée. Elle prenait la forme d'un amortissement dérogatoire : les entreprises pouvaient amortir plus vite, et pour des montants plus importants, les biens d'équipement achetés pendant cette année. Or, c'est en 1996 que l'évolution de la FBCF s'est retournée, accusant une baisse de 0,2 %, après une hausse de + 4,8 % en 1995.
En conclusion, les mesures d'incitation temporaires à l'investissement échouent à stimuler, de manière significative, la FBCF, parce qu'elles tiennent insuffisamment compte de la nature des décisions d'investissement : investir représente un pari sur l'avenir, qui se situe dans une perspective de moyen-long terme. Les marges de manoeuvre budgétaires doivent donc être employées pour financer des mesures durables, et générales, d'allégement de l'impôt sur les sociétés ou de la fiscalité locale, de préférence à des mesures de régulation conjoncturelle de l'investissement.
C. DES MESURES INCITATIVES PERMANENTES PEUVENT, EN REVANCHE, ORIENTER L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES.
La question du niveau de la dépense des entreprises en recherche et développement 44 ( * ) a préoccupé les pouvoirs publics au début des années 1980. A l'époque, en effet, l'effort de recherche des entreprises françaises les plaçait assez défavorablement par rapport à leurs concurrentes étrangères. Pour stimuler l'effort de recherche a donc été institué, en 1983, un crédit d'impôt-recherche. D'abord conçu comme une mesure transitoire, ce dispositif a été, depuis, pérennisé.
Le crédit d'impôt-recherche permet aux entreprises de déduire de leur impôt sur les sociétés un pourcentage de l'excédent des dépenses de recherche financées au cours d'une année par rapport à celles engagées pour l'exercice précédent. Il correspond à une dépense fiscale d'un peu plus de 450 millions d'euros par an.
Ce mécanisme de crédit d'impôt présente la caractéristique d'être non discriminant, en ce sens que tout projet de recherche a, en principe, vocation à être aidé. La gestion du dispositif en est simplifiée, et l'Etat n'interfère pas dans les choix des entreprises. En contrepartie, on accepte un « effet d'aubaine » massif : des projets de recherche qui auraient de toute manière été engagés sont subventionnés.
Quoique non discriminant en théorie, le crédit d'impôt-recherche peut toutefois l'être, dans la pratique, comme le fait remarquer Dominique Guellec 45 ( * ) . Il ne s'applique a priori qu'aux entreprises imposables, donc à celles qui ont réalisé des bénéfices sur la période couverte. Or, les start-up technologiques ne réalisent généralement pas de profits dans leurs premières années d'existence. Pour pallier cette difficulté, et étendre le bénéfice de l'aide publique, est désormais prévu un remboursement, sous forme de subvention directe, du crédit d'impôt pour les jeunes entreprises innovantes non imposables.
A côté du crédit d'impôt-recherche, existent des mesures d'aide finalisées : des projets ou des entreprises sélectionnées bénéficient d'une assistance, sous forme d'une subvention (programmes de la direction générale en charge de l'Industrie : environ 450 millions d'euros de dépenses par an), ou de prêts à des conditions favorable (l'ANVAR 46 ( * ) accorde chaque année quelque 150 millions d'euros de prêts sans intérêt, remboursables en cas de succès). Le choix des projets aidés est effectué, le plus souvent, au cas par cas, sur chaque dossier soumis, dans le cadre de programmes visant des secteurs, ou des types de technologies ou d'entreprises, et incluant un cahier des charges. L'exemple phare de ce type de mécanisme est le système d'avances remboursables accordées au secteur aéronautique et, en particulier, à Airbus.
Quelle est l'efficacité de ces dispositifs ? On a observé un accroissement de l'effort de recherche accompli par les entreprises françaises : depuis une vingtaine d'années, la dépense de recherche-développement des entreprises françaises, rapportée au PIB, a progressé. Elle représentait 1,22 point de PIB en 1999 (dernière donnée disponible), contre 0,92 point en 1984.
En outre, le nombre d'entreprises qui participent à l'effort de recherche et développement a été multiplié par cinq au cours des quinze dernières années. Ce bon résultat peut s'expliquer par le fait que le crédit d'impôt-recherche est accordé à toutes les entreprises qui se dotent d'une capacité de recherche et développement, même minime (moins d'un chercheur à temps plein par an). L'allègement fiscal perçu au titre du crédit d'impôt est plafonné à 6,1 millions d'euros par an, ce qui le rend surtout intéressant pour les PME.
Toutefois, ces deux constats ne permettent pas d'identifier l' impact spécifique des mesures d'incitation fiscale.
C'est pourquoi, des études économétriques ont été menées pour essayer d'évaluer la relation entre le volume de R&D et les incitations fiscales.
Pour permettre une comparaison internationale des mesures d'incitation fiscales, les chercheurs calculent un indice standardisé (appelé « indice B ») qui donne une mesure globale du degré de générosité fiscale d'un Etat. Il ressort de cette comparaison que la France fait partie des Etats qui fournissent l'effort fiscal le plus important en faveur de la recherche-développement. Elle réalise un effort, proportionnellement plus important que les Etats-Unis, et n'est devancée que par l'Espagne, l'Australie, le Canada, le Danemark et les Pays-Bas 47 ( * ) .
Les estimations proposées, dans la littérature, de l'élasticité de la R&D aux incitations fiscales, sont assez disparates, puisqu'elles varient entre 0,07 et 2,7. La plupart sont toutefois inférieures à l'unité. Cela suggère un effet positif mais modéré des incitations fiscales sur la recherche-développement privée. L'effet des incitations fiscales semble être également différencié dans le temps : il ne devient significatif qu'avec un retard d'une année, et tendrait à diminuer à long terme. L'impact plus faible des incitations fiscales dans le long terme peut signifier que les entreprises ne seraient que peu sensibles, sur longue période, aux variations du coût de la recherche-développement. Il semble que d'autres facteurs, tels que la stratégie globale de l'entreprise ou les contraintes financières, ont une plus forte incidence. D'autre part, un crédit d'impôt qui s'applique à l'accroissement de l'effort de recherche, comme c'est le cas en France, produit essentiellement des effets à court terme : il incite les entreprises à pratiquer une politique d'investissement en recherche-développement très heurtée et irrégulière, avec des efforts de recherche concentrés sur certaines années. Ce comportement maximise la réduction fiscale, mais peut se faire au détriment de la qualité de l'effort de recherche, qui nécessite souvent un accroissement plus régulier des investissements consentis. Cet effet pourrait être éliminé si l'on prenait en compte non plus l'accroissement de dépense, d'une année sur l'autre, pour calculer l'avantage fiscal, mais le volume absolu de l'investissement en R&D.
Si l'efficacité des mesures d'incitations fiscales tend à décroître avec le temps, il en va autrement pour les mesures de soutien direct aux investissements (subventions). L'effet est ici plutôt faible à court terme, et se manifeste essentiellement à long terme.
Les différents rythmes temporels de ces deux politiques - crédit d'impôt et subventions - reflètent, en fait, deux mécanismes distincts. Les avantages fiscaux, type crédit d'impôt-recherche, peuvent encourager les entreprises à élargir ou accélérer leurs projets en cours. Les soutiens directs, concentrés sur des projets sélectionnés par l'Etat, sont à l'origine de programmes de recherche nouveaux, étalés sur plusieurs années ; ils peuvent contribuer à initier une politique de RD durable, que l'entreprise poursuivra avec ses propres fonds.
Outre les incitations fiscales, l'Etat peut soutenir l'investissement productif par une politique bien conduite d'investissement public.
III. POUR UNE DÉPENSE PUBLIQUE PLUS FAVORABLE À L'INVESTISSEMENT GLOBAL
Le thème de ce rapport est bien l'investissement productif des entreprises et l'objet de cette section n'est donc pas d'analyser de manière approfondie les déterminants de l'investissement public. L'investissement public obéit à des déterminants qui sont, naturellement, fort différents de ceux de l'investissement privé, et qui ont plus à voir avec l'analyse des choix publics qu'avec l'analyse économique usuelle.
Toutefois, on peut difficilement ignorer les retombées importantes de l'investissement public sur l'investissement privé. Un défaut grave d'investissement public peut menacer la croissance du secteur marchand. A l'inverse, une politique adaptée d'investissement public peut stimuler, encourager l'investissement privé
A. ALORS QUE LA DÉPENSE PUBLIQUE PEUT EXERCER UN EFFET D'ENTRAÎNEMENT SUR L'INVESTISSEMENT PRIVÉ,
De manière plus précise, deux formes d'investissement public revêtent une importance particulière pour l'essor de l'économie :
• L'investissement en infrastructures : une
économie moderne ne peut prospérer sans des réseaux de
transport, de communications, d'approvisionnement en énergies fiables et
denses. Ces réseaux structurent les échanges, qui sont
indispensables au fonctionnement d'une économie de marché
fondée sur la division des tâches. La problématique des
réseaux a trouvé une nouvelle actualité, suite à
l'essor de la « nouvelle économie », à tel
point que de nombreux économistes en appellent aujourd'hui à une
relance de l'investissement public en France. Une étude de l'OCDE met en
évidence, économétriquement, une relation positive entre
l'investissement public infrastructurel et l'investissement autre
qu'infrastructurel. Cette étude est fondée sur des données
couvrant douze pays pour la période 1967-1987. Diverses
spécifications sont utilisées pour estimer l'incidence de
l'investissement en infrastructure sur d'autres grandeurs :
productivité totale des facteurs, productivité du travail,
accumulation de capital, et emploi.
L'OCDE aboutit à la
conclusion que « la croissance du stock d'équipement en
infrastructures est associée de manière positive (...) à
l'accumulation de capital autre qu'infrastructurel ».
• Après avoir examiné les incitations publiques à la recherche privée, il convient de rappeler que l'Etat est lui-même un important acteur de la recherche française. D'un point de vue théorique, l'investissement public en R&D se justifie par le « modèle du bien public ». L'activité de recherche engendre des externalités positives, en ce sens qu'une découverte ou une innovation bénéficie à la société bien au-delà du cercle de ses seuls auteurs. Ces derniers supportent la totalité du coût de la recherche, mais ne peuvent s'en approprier totalement les bénéfices 48 ( * ) . Cette imperfection de marché n'incite pas les agents privés à investir dans la R&D et risque d'aboutir à une situation dans laquelle l'effort de recherche est inférieur à son niveau socialement optimal. Une intervention publique devient dès lors justifiée.
En dépit des retombées positives, et de l'effet d'entraînement, de l'investissement public sur l'investissement privé, l'Etat tend, depuis une dizaine d'années, à réduire son effort d'investissement.
B. LES « DÉPENSES D'INVESTISSEMENT PUBLIC » SONT EN DIMINUTION
L'accentuation de la contrainte budgétaire, au cours de la dernière décennie, a conduit, non à une baisse des dépenses publiques de fonctionnement, mais à une contraction de l'investissement public. L'investissement public total est passé, de 1992 à 2001, de 3,7 à 3,3 % du PIB ( cf . graphique 10).
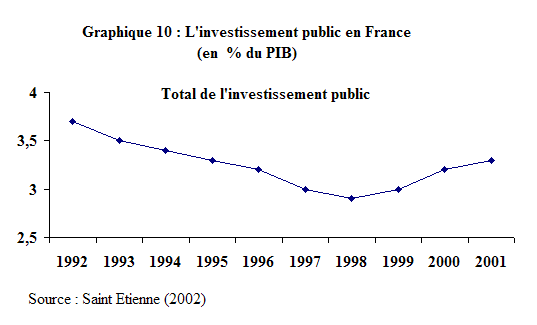
L'investissement public français est assuré, pour les deux tiers, par les collectivités locales. L'Etat n'assure plus qu'un sixième de l'investissement public total, ce qui représente une dépense d'investissement légèrement inférieure à 0,5 point de PIB.
L'investissement public français, rapporté au PIB, est désormais à un niveau inférieur à celui observé aux Etats-Unis. L'investissement public américain s'est, en effet, maintenu, depuis douze ans, à un niveau proche de 3,5 points de PIB, avec des fluctuations mineures autour de cette tendance. Mais l'investissement public français se compare encore favorablement à l'investissement public observé chez nos principaux partenaires européens. En 2002, l'investissement public au Royaume-Uni et en Allemagne représente environ deux points de PIB, et un peu moins de 2,5 points de PIB en Italie.
L'investissement public français se décompose en travaux neufs (45 % du total), et travaux d'entretien ou de renouvellement (55 % du total). Cette décomposition amène à poser deux questions : les dépenses d'entretien sont-elles à un niveau compatible avec le maintien dans un état satisfaisant du stock de capital public national ? Et la création d'infrastructures nouvelles progresse-t-elle à un rythme compatible avec un objectif de croissance ambitieux pour l'économie française ?
La réponse à ces deux questions semble devoir être négative. Diverses évaluations suggèrent que les travaux d'entretien et de rénovation des réseaux physiques sont, probablement, inférieurs aujourd'hui d'un cinquième à ce qu'ils devraient être, pour maintenir le stock de capital public à un niveau constant d'efficacité, de qualité et de sécurité 49 ( * ) .
Par ailleurs, les schémas officiels de développement des infrastructures nationales sont fondés sur des hypothèses de croissance arrêtées sur le rythme de la croissance tendancielle : croissance comprise entre 2 et 2,5 % l'an pour le rapport Bonnafous 50 ( * ) , croissance à 2,3 % (voire 1,9 % dans un scénario plus défavorable) pour la DATAR 51 ( * ) . Une politique volontariste visant à élever le niveau de la croissance potentielle, à 3 % l'an par exemple, risquerait, dès lors, de se heurter à des goulets d'étranglement, résultant d'un développement insuffisant des infrastructures nationales .
Un effort plus soutenu d'investissement public pourrait être la première étape d'une telle politique volontariste. On se souvient que les Etats-Unis ont conduit un programme spécial de développement des infrastructures - notamment de réseaux - en 1994-1998, prélude à la forte croissance de la période 1996-2000 .
La France pourrait se donner comme objectif de revenir au niveau d'investissement public par rapport au PIB qui était le sien il y a dix ans, ce qui porterait l'investissement public français, rapporté au PIB, à un niveau comparable à celui observé aux Etats-Unis . Le financement d'un surcroît d'investissement public ne doit bien sûr pas reposer sur une augmentation du déficit public. Une augmentation du besoin de financement public risquerait en effet d'élever le coût du crédit, créant ainsi un effet d'éviction de l'investissement privé par l'investissement public. L'effort d'investissement devrait être financé par des redéploiements budgétaires, ou par le recours plus fréquents à des partenariats publics-privés.
C. ET L'ETAT A RÉDUIT SON EFFORT EN FAVEUR DE LA RECHERCHE PUBLIQUE
La situation française en matière de recherche et développement se caractérise depuis plusieurs années par un relatif désengagement de l'État. Depuis 1995, l'effort de recherche n'est plus financé majoritairement par l'État, mais par les entreprises. Ce changement s'explique par un double mouvement : baisse de l'effort public de R&D, et augmentation de la dépense de recherche privée.
En 1990, la part de la dépense intérieure de recherche et développement (DIRD) exécutée par les administrations représentait 0,95 point de PIB. En 1999, cette part ne représentait plus que 0,81 point de PIB. La baisse des crédits consacrés à la recherche militaire explique, pour une bonne part, cette diminution Ainsi, le budget de la recherche militaire, qui représentait encore près de 35 % du budget de la recherche publique en 1990, a été divisé par deux en dix ans. Entre 1994 et 2000, les crédits publics pour la recherche et la technologie dans le domaine de la défense sont passés de 963 à 521 millions d'euros.
Cette tendance baissière ne doit cependant pas faire oublier que l'Etat français est l'un de ceux qui maintiennent les plus importants dispositifs de recherche publique. De tous les pays avancés, c'est la France qui entretient la plus forte proportion de chercheurs employés dans le secteur public ( cf . graphique 11).
Graphique 11 :
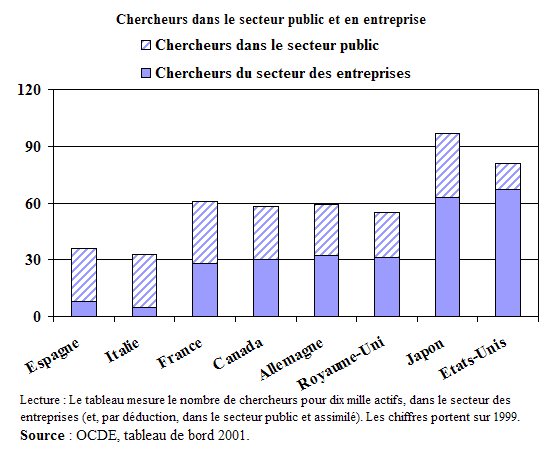
Ainsi, en dépit de l'effort de recherche plus marqué accompli ces dernières années par les entreprises françaises, la France demeure encore caractérisée par un poids important du secteur public de la recherche.
Au-delà des données quantitatives, il importe d'essayer d'évaluer l'efficacité de la dépense française de recherche. Or celle-ci serait, au vu des indicateurs disponibles, plutôt défavorable. La France est, parmi les pays comparables, celui qui a connu le taux de croissance du nombre de brevets le plus faible entre 1995 et 2000. De plus, « l'indice d'impact 52 ( * ) des publications scientifiques françaises aurait baissé par rapport à 1985, alors qu'il est resté stable au Royaume-Uni, et qu'il s'est accru en Allemagne ». La performance de la recherche française semble donc être inférieure à ce que les moyens financiers et humains déployés pourraient laisser attendre.
D. Guellec 53 ( * ) suggère que l'incitation à innover serait moindre dans l'univers de la recherche publique, en raison de l'absence de pression concurrentielle issue des mécanismes de marché. Il souligne également que les retombées de la recherche publique vers l'industrie, seule porteuse d'innovation de produits, ne sont pas automatiques. Elles supposent, en particulier, une politique active de diffusion de la part des organismes publics, notamment à travers des partenariats publics-privés. Or, ces partenariats demeurent encore relativement peu nombreux en France, selon les dernières données disponibles qui portent sur les années 1994-1996 ( cf . graphique 12). Pourtant, le volume des contrats associant entreprises et laboratoires publics a été décuplé en quinze ans. Cela en dit long sur la modestie passée des échanges entre public et privé, qui a longtemps été l'un des traits distinctifs de la recherche française.
Le succès de la recherche aux Etats-Unis s'explique, pour beaucoup, par les synergies créatrices qui s'établissent entre Universités et entreprises privées, qui sont généralement regroupées en « clusters » ( mot qui signifie littéralement « grappe » ou « essaim »). La Silicon Valley, en Californie, est l'exemple le plus célèbre d'une telle concentration d'activités de recherches, publiques et privées, en un même lieu. Il n'existe pas d'équivalent européen de ces « clusters », sans doute pour des raisons historiques et culturelles, mais aussi en raison de la dispersion des efforts de recherche nationaux. Une meilleure coordination des efforts de recherche nationaux contribuerait à réduire l'écart entre la performance de la recherche européenne, et française, et celle de la recherche américaine.
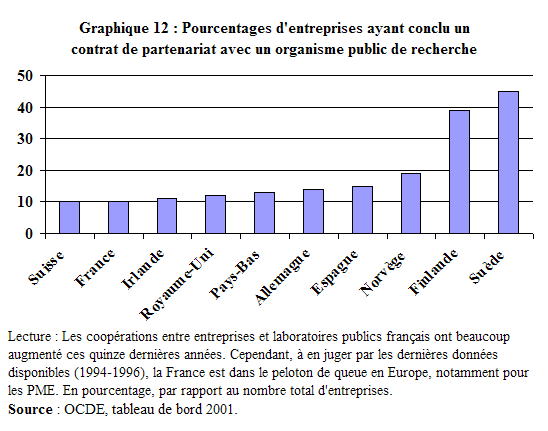
|
Encadré :
L'effort de recherche est mesuré par un indicateur, la dépense intérieure de recherche et de développement (DIRD), qui correspond à l'ensemble des travaux de RD exécutés sur le territoire national. Cet indicateur englobe donc recherches publique et privée. On observe que le niveau de la DIRD française demeure nettement inférieur à celui des Etats-Unis ou du Japon, voire de l'Allemagne. La part de la recherche financée par l'Etat tend à diminuer, en Europe et aux Etats-Unis, en grande partie sous l'effet de la diminution des crédits de recherche militaire. L'effort de recherche des principaux pays de l'OCDE |
DIRD/PIB % |
Part de l'Etat dans le financement % |
DIRD militaire/
% |
|||
|
1992 |
1998 |
1992 |
1998 |
1992 |
1998 |
|
|
Allemagne |
2,50 |
2,29 |
36,3 |
35,2 |
4,1 |
2,2 |
|
Etats-Unis |
2,81 |
2,74 |
41,7 |
33,8 |
21,9 |
16,1 |
|
France |
2,40 |
2,18 |
44,8 |
39,1 |
16,8 |
10,1 |
|
Italie |
1,31 |
1,02 |
48,5 |
51,1 |
- |
- |
|
Japon |
2,80 |
3,06 |
23,8 |
26,2 |
2,2 |
Ns |
|
Royaume-Uni |
2,12 |
1,83 |
37,6 |
35,9 |
16,3 |
14,8 |
L'encouragement à la recherche et à l'innovation contribue pourtant à élever le niveau de la croissance potentielle. L'innovation permet d'élever les gains de productivité, et favorise l'apparition de nouveaux marchés porteurs qui stimulent la consommation des ménages.
IV. FACILITER LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
Comme cela a été montré dans la deuxième partie, un accès difficile aux financements freine les projets d'investissement des entreprises. L'un des moyens de faciliter le financement de l'investissement réside dans l'allégement de la fiscalité pesant sur les entreprises. Déjà examiné précédemment, ce point ne sera pas étudié à nouveau ici. D'autres éléments doivent cependant maintenant être traités : la question du partage de la valeur ajoutée, qui concerne l'ensemble des entreprises ; les dispositifs spécifiques destinés au financement des PME ; les soutiens aux projets innovants.
A. L'IMPÉRATIF D'UNE RÉPARTITION ÉQUILIBRÉE DE LA VALEUR AJOUTÉE
La répartition de la valeur ajoutée entre salaires et profit influence de manière décisive la capacité des entreprises à autofinancer leurs investissements. L'autofinancement est la forme la plus simple de financement pour les entreprises, puisqu'il consiste simplement pour les entreprises à affecter une partie de leurs ressources internes à leurs projets d'investissement. L'autofinancement importe tout particulièrement pour les entreprises jeunes et des PME 54 ( * ) , pour lesquelles il est le mode de financement prépondérant.
1. Principales évolutions
La hausse de la part des profits, dans la valeur ajoutée des entreprises, est l'un des traits marquants de l'histoire économique française de ces vingt dernières années.
La part des profits dans la valeur ajoutée a atteint un point bas au début des années 1980. En 1981, les salaires absorbaient 67,5 % de la valeur ajoutée des sociétés et entrepreneurs individuels. Leur part a, depuis lors, baissé de dix points (57,5 %), de sorte qu'elle se situe désormais sous la moyenne historique de longue période, qui est de 62-63 %.
Si l'on considère un champ plus restreint (les sociétés non financières à l'exclusion des entrepreneurs individuels et des sociétés financières), la chute est moins spectaculaire (la part des salaires baisse de seulement 6,6 points), mais la tendance reste identique ( cf . tableau 5). La baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée depuis 1981 a été, pour partie, compensée par une augmentation de l'imposition des entreprises (la somme des impôts à la production, nets des subventions, et de l'impôt sur les sociétés, a augmenté de 2,9 points de valeur ajoutée). Le revenu disponible des entreprises a néanmoins augmenté de 3,9 points. Le tableau suivant détaille ces évolutions.
Tableau 5
|
Distribution de la valeur ajoutée (sociétés non financières) (en points de valeur ajoutée) |
||||
|
1981 |
1990 |
1995 |
2000 |
|
|
Valeur ajoutée |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
( moins ) Salaires bruts bruts 1) |
71,2 |
64,6 |
63,4 |
63,6 |
|
Salaires bruts 2) |
53,2 |
47,3 |
46,4 |
47,1 |
|
Cotisations sociales effectives |
16,1 |
15,5 |
15,1 |
14,9 |
|
Cotisations sociales fictives |
2,0 |
1,8 |
1,9 |
1,6 |
|
Impôts sur la production |
3,6 |
3,8 |
4,7 |
4,8 |
|
Subventions |
- 1,3 |
- 1,0 |
- 1,1 |
- 1,0 |
|
Autres opérations exploitation |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(reste) Excédent brut d'exploitation (EBE) |
26,4 |
32,6 |
33,0 |
32,5 |
|
( moins ) Intérêts |
8,5 |
6,7 |
6,8 |
5,3 |
|
Dividendes |
2,9 |
4,5 |
5,0 |
7,0 |
|
Divers revenus primaires |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,2 |
|
(reste) Solde des revenus primaires |
15,0 |
21,5 |
20,6 |
20,0 |
|
( moins ) Impôt sur le revenu |
3,1 |
3,4 |
2,9 |
4,0 |
|
Primes d'assurance dommage |
1,7 |
1,6 |
1,5 |
1,1 |
|
Transferts courants divers |
0,4 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
|
Divers revenus secondaires |
- 1,3 |
- 1,3 |
- 1,1 |
- 0,6 |
|
(reste) Revenu disponible |
11,2 |
17,7 |
17,2 |
15,4 |
|
( moins ) FBCF |
23,4 |
24,0 |
20,3 |
21,1 |
|
Variations de stocks |
- 0,7 |
1,1 |
0,5 |
1,1 |
|
Acquisition d'objets de valeur |
- 3,7 |
- 3,2 |
- 3,0 |
- 2,8 |
|
(reste) Capacité de financement |
- 7,7 |
- 4,2 |
- 0,6 |
- 4,0 |
|
1. Salaires, y compris cotisations sociales employeurs, salariés et CSG. 2. Salaires, y compris cotisations sociales salariés et CSG. Les données ne sont pas corrigées de la salarisation croissante mais, sur la période considérée, cette approximation est mineure. Le tableau concerne uniquement les sociétés non financières. La part des salaires est ainsi supérieure de 3 points à celle que l'on calcule sur le champ « sociétés et entrepreneurs individuels » en 1981 et de 5 points en 2000. La différence de champ ne change pas le sens des évolutions au cours des deux dernières décennies, et un champ plus restreint permet d'avoir une vision plus détaillée de la distribution de la valeur ajoutée au-delà de l'excédent brut d'exploitation. Source : Revue de l'OFCE (2002) |
||||
Cette augmentation du revenu disponible des entreprises leur a permis de réduire fortement leur besoin de financement. Elles sont ainsi passées d'un besoin de financement, représentant 7,7 points de valeur ajoutée, en 1981, à un besoin de financement de 0,6 point de valeur ajoutée, en 1995. On remarque que cette progression (écart de 7,1 points) est plus importante que l'amélioration du revenu disponible des sociétés (+ 4,2 points entre 1981 et 1995). La diminution de l'effort d'investissement explique en partie la différence (2,3 points de réduction entre 1981 et 1995).
La réduction de l'investissement productif, alors que la capacité de financement des entreprises s'améliorait significativement, peut paraître contre-intuitive. En fait, les entreprises ont consacré l'essentiel de leur nouvelle capacité de financement à la réduction de leur endettement. Ce désendettement se traduit par une baisse importante de la part des intérêts dans la valeur ajoutée. Ce constat vient corroborer les hypothèses formulées, dans la deuxième partie de ce rapport, concernant un possible renforcement de la contrainte d'endettement pesant sur les entreprises. L'atonie de l'investissement productif français, jusqu'au second semestre 1997, n'est pas expliquée de manière pleinement satisfaisante par les évolutions de la demande, ou par celles du coût des facteurs de production. Elle résulte du choix fait par les entreprises de privilégier le désendettement, afin de consolider leur situation financière.
Entre 1997 et 2000, la part de la valeur ajoutée allant aux profits a légèrement décliné, suite à des créations d'emplois particulièrement dynamiques sur la période, notamment en 1999 et 2000 (la masse salariale versée par les entreprises a crû de 4 % en 1999, et de 5 % en 2000). Une forte reprise de l'investissement a accompagné la hausse des créations d'emplois. Ces deux phénomène combinés ont beaucoup réduit le taux d'autofinancement des entreprises, qui est tombé à 78 % en 2000 Ils ont induit une nette reprise de l'endettement ( cf . graphique 13).
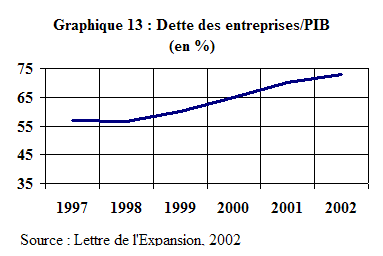
La progression rapide de l'endettement des entreprises françaises, depuis quelques années, peut également refléter des stratégies financières visant à tirer profit de l'effet de levier. La diminution des taux d'intérêt réels depuis 1997 a significativement redressé l'effet de levier. Dans ces conditions, le financement par endettement peut être préféré au financement par fonds propres, puisqu'il permet de mieux rémunérer les actionnaires.
En tout état de cause, ce haut niveau d'endettement n'est pas de bon augure dans la perspective d'une reprise prochaine de l'investissement productif. L'expérience des années 1990 montre qu'il a fallu plusieurs années, pendant lesquelles l'investissement est resté atone, pour que les entreprises rétablissent leur situation financière, et reviennent à un niveau d'endettement autorisant une accélération des dépenses en capital.
2. Eléments d'explication
L'Etat ne peut déterminer directement la répartition de la valeur ajoutée entre salaires et profits, qui dépend de la situation du marché du travail, et des conditions de la négociation salariale. Il peut cependant influencer cette répartition, par la politique des revenus, par la politique monétaire, et par les politiques structurelles. On observe que la baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée, à partir de 1983, est concomitante du « tournant de la rigueur », initié par le gouvernement à la même date. La politique menée à cette époque s'est orientée autour de quelques grands axes :
la priorité accordée à la désinflation, dans le cadre d'une politique dite de « désinflation compétitive » ; cette orientation a impliqué une plus grande modération salariale, qui s'est traduite, notamment, par la fin de l'indexation des salaires sur l'inflation. A partir de 1983, les salaires réels progressent moins vite que la productivité du travail. Le salaire minimum, qui avait beaucoup augmenté au début des années 1980, progresse, à partir de cette date et jusqu'au milieu des années 1990, en phase avec le salaire médian. Il n'exerce donc plus un fort effet d'entraînement sur la dynamique des salaires
En outre, l'objectif de stabilité des prix a été acquis au prix d'une augmentation des taux d'intérêt réels. L'INSEE estime que les mouvements des taux d'intérêt réels auraient fait baisser d'environ deux points et demi la part des salaires dans la valeur ajoutée dans la décennie quatre-vingt 55 ( * ) . L'augmentation des taux d'intérêt élève le coût d'usage du capital, ce qui diminue les ressources que les entreprises peuvent affecter à la rémunération du facteur travail.
le choix de l'insertion de l'économie française dans le commerce international a été un autre axe fort de cette politique. Soumises à une pression concurrentielle plus forte, les entreprises ont dû veiller à la maîtrise de leur masse salariale, afin de ne pas mette en péril leur compétitivité-prix.
Toutefois, l'INSEE souligne également le rôle que jouent sur la répartition de la valeur ajoutée les fluctuations des prix de l'énergie, grandeurs sur lesquelles les autorités nationales n'ont guère de prise. L'énergie est, pour les entreprises, une consommation intermédiaire. Elles ne répercutent pas forcément en totalité les variations des prix des consommations intermédiaires sur leurs prix à la production. Ainsi, une baisse du prix des consommations intermédiaires peut être à l'origine d'une hausse de la valeur ajoutée, captée par les entreprises. Selon l'INSEE, le contre-choc pétrolier aurait ainsi réduit de six points la part des salaires dans la valeur ajoutée, de 1986 à 1990 56 ( * ) .
A la fin des années 1990, la dégradation relative de la part des profits dans la valeur ajoutée a vraisemblablement été accentuée par les politiques de l'emploi mises en oeuvre. La mise en place des 35 heures et l'allégement des charges sur les bas salaires ont, en effet, induit une dynamique particulièrement forte des créations d'emplois. Le poids de la rémunération des salariés dans la valeur ajoutée s'est accru plus vite que les gains de productivité du travail.
Dans le contexte actuel - faiblesse de l'investissement, hausse de l'endettement des entreprises - une politique de modérations salariale paraît la plus indiquée. Les entreprises ont besoin de nouvelles marges de profit pour relancer leurs investissements. La consommation des ménages, qui demeure à un niveau satisfaisant 57 ( * ) , ne semble pas devoir appeler d'importantes mesures de soutien. La formation des salaires est d'abord le fait du marché du travail, mais le Gouvernement peut l'influencer par sa propre politique salariale ou par les modulations du SMIC. Par ailleurs, l'Etat peut contribuer à améliorer la situation financière des entreprises, en allégeant davantage la fiscalité qui pèse sur elles.
B. FACILITER LE FINANCEMENT DES PME
Le soutien public au financement des PME est ancien. Dès 1936, une loi autorisait la Caisse nationale des marchés de l'Etat 58 ( * ) à intervenir pour garantir la solvabilité de certaines catégories d'entreprises. A partir de 1979, l'Etat met en place des fonds de garantie, destinés à supporter une partie du risque encouru par les banques. Cette sollicitude ancienne pour les petites et moyennes entreprises s'explique par leur poids dans l'économie française, mais aussi par la prise en compte des enjeux particuliers que représente pour elles l'accès au crédit bancaire.
Concernant l'importance des PME pour l'économie française, il peut être utile de rappeler quelques chiffres : les petites et moyennes entreprises emploient environ 70 % des effectifs salariés, produisent plus de 60 % de la valeur ajoutée, et supportent plus des deux tiers de l'endettement des entreprises françaises.
Un bon accès des PME au crédit, condition nécessaire à leur développement, revêt donc une grande importance au plan macroéconomique.
En effet, les PME 59 ( * ) sont souvent confrontées au problème d'un accès difficile au crédit. Les hésitations des organismes financiers à prêter aux PME s'expliquent par la corrélation négative forte, qui existe entre taille de l'entreprise et taux de défaillance : autrement dit, les petites entreprises ont un taux de défaillance plus élevé que les grandes 60 ( * ) . Le risque associé au prêt à une PME est donc important.
En outre, les banques, manquant d'informations sur les PME, ont tendance à traiter de manière très globale cette catégorie d'emprunteurs, sans discriminer suffisamment en fonction de la solvabilité de chaque entreprise. Cette faible capacité à discriminer les entreprises débitrices se traduit par une tarification des prêts peu différenciée, qui pénalise les entreprises présentant le plus de garanties, et par une tendance au « rationnement » du crédit.
Placés en situation d'asymétrie d'information, les établissements de crédit sont réticents à prêter pour financer des projets qu'ils estiment, à tort ou à raison, trop risqués, et ce, même à des taux d'intérêt très élevés. Les banques peuvent estimer, en effet, que seules les entreprises les plus « risquées » (les moins à même de rembourser leurs emprunts) accepteraient d'emprunter à de telles conditions. Un véritable cercle vicieux du crédit peut alors s'enclencher.
Une intervention publique peut alors être utile pour limiter ces phénomènes de rationnement du crédit, et pour réduire la prime de financement imposée aux PME, en raison du risque élevé associé à leurs emprunts.
L'instrument privilégié d'intervention publique en faveur des PME est aujourd'hui la Banque de développement des PME (BDPME), créée en 1997 par la fusion de la CEPME et de la SOFARIS (Société française de garantie des financements des petites et moyennes entreprises). L'Etat et la Caisse des Dépôts et Consignations contrôlent cette institution.
Les interventions de la BDPME empruntent plusieurs modalités :
Partage du risque : la BDPME partage, avec les établissements de crédit qui souhaitent une garantie, le risque encouru en cas de défaillance d'entreprise. Lorsqu'un prêt n'est plus remboursé par une société, la moitié du capital restant à régler est payée par la BDPME à la banque de l'entreprise défaillante. Cette possibilité de garantie réduit les risques encourus par l'établissement créditeur, ce qui limite les phénomènes de rationnement du crédit. En 2000, la BDPME a accompagné en garantie plus de 3,6 milliards d'euros de crédits bancaires d'investissement.
Cofinancement de projets : comme une banque classique, la BDPME accorde des prêts aux entreprises, pour venir compléter les prêts accordés par les autres établissements de crédit. En 2000, la BDPME a accompagné en cofinancement plus de 3 milliards d'euros d'investissement.
Produits spécifiques : la BDPME développe également des produits spécifiques : avances de paiement sur marchés publics (4,2 milliards d'euros en 2000, au bénéfice de 7 600 entreprises) ; prêt à la création d'entreprise (13 000 créations aidées en 2000, pour un montant de prêts de 625 millions d'euros), qui permet de compléter un prêt fait par une banque à un jeune créateur ; prêt de reprise industrielle, destiné à faciliter la transmission d'entreprises (3 000 entreprises concernées en 2000, pour un coût de 1 milliard d'euros).
Les modes d'action de la BDPME ne lui permettent pas de mener une politique volontariste de financement des entreprises, indépendante des signaux du marché. La BDPME a pour vocation de soutenir des initiatives de marché. Elle aide à finaliser des projets engagés par un chef d'entreprise et un banquier, qui croient suffisamment dans leurs chance de succès pour conserver pour eux-mêmes une part du risque. Son activité est donc conditionnée par la situation économique d'ensemble.
L'impact macroéconomique de l'activité de la BDPME n'est pas négligeable. En 2000, les 3 milliards d'euros de crédit, accordés en cofinancement par la BDPME, représentaient environ un cinquième des crédits à moyen et long terme mis en place pour les PME en France. 13 000 créateurs d'entreprises ont bénéficié d'un prêt, soit 7,65 % du total des créateurs. Et 6 % des opérations de transmission d'entreprises ont bénéficié d'un prêt BDPME pour la reprise industrielle.
Au-delà de ces données brutes, on peut regretter cependant qu'il n'existe pas d'estimation du nombre de projets qui n'auraient pas abouti en l'absence de soutien. De telles données permettraient d'évaluer de manière plus fine l'effet de l'activité de la BDPME.
C. POUR UN SOUTIEN EN FINANCEMENT DES ENTREPRISES INNOVANTES
Les entreprises innovantes, dans leur phase de création, sont de petites entreprises qui peuvent bénéficier, en conséquence, des aides accordées aux PME. Mais l'enjeu particulier que représente l'innovation pour la croissance économique a motivé l'adoption de mesures spécifiques destinées à ce type d'entreprises.
Les jeunes entreprises technologiques recourent souvent pour leur financement au capital-risque, qui est essentiellement le fait d'investisseurs privés.
Toutefois, l'Etat a créé en 1998 un fonds public pour le capital-risque, doté de 600 millions de francs (91 millions d'euros). Ce fonds n'investit pas directement dans les entreprises nouvelles, mais il abonde, sous forme d'avances, les fonds de capital-risque privés qui apportent des fonds propres aux jeunes entreprises innovantes.
L'action de l'Etat est complétée par celle des régions, qui détiennent aujourd'hui de l'ordre de 75 millions d'euros de participation dans trente-sept structures de capital-risque régionales 61 ( * ) .
Enfin, il convient de rappeler que les entreprises innovantes peuvent bénéficier de financements publics au titre de leurs programmes de recherche et développement.
Les statistiques disponibles montrent que les financements publics ont couvert, sur la période 1997-1999, 11,2 % des dépenses de R&D des entreprises 62 ( * ) . Ce chiffre global se décompose de la manière suivante :
- les commandes directes à l'industrie, pour les besoins de la Défense nationale, ont représenté 40 % des financements publics ;
- les subventions en ont représenté 30 % ;
- les avances, remboursables en cas de succès, 16 % ;
- le crédit impôt-recherche en a représenté, enfin, 14 %.
Les financements publics sont la deuxième source de financement des projets de R&D des entreprises françaises, loin cependant derrière l'autofinancement (73,8 % du total).
V. PRENDRE EN COMPTE LA RELATION ENTRE FLEXIBILITÉ DES MARCHÉS ET INVESTISSEMENT
Certaines politiques publiques visent explicitement à soutenir l'investissement. Mais il est aussi des moyens indirects de soutenir l'investissement productif, par une action sur l'environnement des entreprises. Le degré de flexibilité des marchés de biens et services, comme celui du marché du travail, ne semblent pas être sans incidence sur les incitations à investir des entreprises.
A. INTENSITÉ DE LA CONCURRENCE ET INVESTISSEMENT
Selon l'OCDE 63 ( * ) , des marchés de produits concurrentiels incitent les entreprises :
- à améliorer la productivité globale des facteurs (PGF), ce qui est favorable à l'investissement ;
- et à innover, ce qui suppose des investissements en recherche et développement, et des investissements physiques pour assurer les productions nouvelles.
Sur des marchés peu concurrentiels, la survie des entreprises n'est pas vraiment menacée par le maintien de pratiques sous-optimales, pas plus qu'elle ne l'est par l'absence d'innovations.
A mesure que les pressions concurrentielles se renforcent, la menace de perdre des parts de marché incite les entreprises à éliminer toutes les sources d'inefficience, c'est-à-dire à élever la PGF.
Ce raisonnement théorique est conforté par des analyses empiriques : se fondant sur des données sectorielles, Scarpetta et alii montrent que la PGF est positivement affectée par les cadres réglementaires qui favorisent la concurrence, même une fois prises en compte les autres influences potentielles, comme le niveau de R&D, et les facteurs spécifiques aux pays et aux secteurs 64 ( * ) .
Des recherches empiriques récentes ont montré que les réglementations des marchés de produits favorables à la concurrence avaient un effet positif sur l'intensité de R&D dans le secteur manufacturier 65 ( * ) . Selon l'OCDE, « les différences de réglementations entre les pays expliquent en grande partie les écarts, secteur par secteur, de l'intensité de R&D des pays membres par rapport à la moyenne de l'OCDE à la fin des années 90 » 66 ( * ) . L'OCDE avance des estimations de l'effet, sur l'intensité de R&D, des différences de réglementation : celles-ci expliqueraient près d'un tiers du dépassement de l'intensité moyenne de R&D par les Etats-Unis, le Japon, l'Allemagne et la Suède ; en revanche, les restrictions réglementaires auraient constitué une importante contribution négative pour la R&D en France et en Belgique.
Interrogés sur les causes de l'écart d'investissement entre Etats-Unis et Europe, MM. Didier et Martinez ont, eux aussi, insisté sur la relation entre pression concurrentielle et incitation à investir et à innover. La déréglementation et l'ouverture à la concurrence, opérées aux Etats-Unis dans les années 1980, auraient ainsi contribué à la phase de croissance et de progrès technologique observées dans la décennie suivante. L'Europe a pris du retard, car elle ne s'est engagée franchement sur la voie de la libéralisation des marchés que dans les années 1990.
B. MARCHÉ DU TRAVAIL ET INVESTISSEMENT
La flexibilité du marché du travail est, probablement, aussi un facteur propice au développement de l'investissement. La Commission européenne et l'OCDE semblent en tout cas partager cette analyse.
Pour la Commission européenne, les rigidités du marché du travail peuvent être considérées comme un « obstacle aux mutations technologiques » 67 ( * ) , en raison des coûts associés aux mesures de redéploiement du personnel. Aux Etats-Unis, le coût moindre des licenciements accroîtrait la rentabilité des investissements, et stimulerait fortement la mise en oeuvre de technologies génératrices d'économies de main-d'oeuvre. Cette analyse est confirmée par l'OCDE : « les politiques qui rendent l'embauche et le licenciement difficiles peuvent accroître le coût de la mise en oeuvre des innovations, lorsque celles-ci exigent une réduction ou une réorganisation des effectifs » 68 ( * ) . L'OCDE ne s'aventure pas toujours à donner une estimation des effets agrégés de la législation du travail sur l'activité d'innovation, et sur l'investissement.
Cette relation entre fonctionnement du marché du travail et investissement est, apparemment, bien perçue aussi par les chefs d'entreprise. Mme F. Gri, président-directeur général d'IBM France, a ainsi souligné, au cours de son audition par votre rapporteur, que la France était souvent considérée comme un « piège à investissement ». Les coûts du désinvestissement sont en effet élevés dans notre pays, en raison, notamment, du coût et de la longueur, supérieure à deux cents jours, des procédures de licenciement collectif. Les investissements sont difficilement réversibles. D'une manière générale, la lenteur des procédures sociales est jugée inadaptée au rythme rapide de la vie des affaires.
La libéralisation des marchés de produits a sensiblement progressé en France, depuis une dizaine d'années, souvent sous l'impulsion du droit communautaire (libéralisation des télécommunications, et du transport aérien, du gaz et de l'électricité, etc. ; suppression progressive des barrières tarifaires et non tarifaires à l'intérieur du Marché unique). Mais il faudra sans doute encore du temps avant que ces mesures ne fassent pleinement sentir leurs effets au niveau macroéconomique. Concernant le marché du travail, en revanche, les réformes récentes ont plutôt renforcé les rigidités relatives aux procédures de licenciement.
QUATRIÈME PARTIE :
LES PHÉNOMÈNES DE
SURINVESTISSEMENT
L'investissement est, en raison du phénomène de l'accélération, une composante particulièrement cyclique de l'activité. Les variations de l'investissement sont, généralement, beaucoup plus amples que celles du PIB. Ainsi, par exemple, la forte croissance du PIB de la fin des années 1980 (+ 3 à 4 % par an) s'est accompagnée d'une croissance de l'investissement encore plus rapide (de 8 à 10 % par an). Et, en sens inverse, la récession de 1993 (contraction du PIB de 1 %) s'est accompagnée d'un effondrement de l'investissement de 10 %.
Les variations de l'investissement des entreprises de technologie sont encore plus amples que celles observées pour l'économie dans son ensemble. Le Conference Board 69 ( * ) souligne que l'investissement des entreprises de haute technologie reflète, pour partie, la grande volatilité de la demande qui leur est adressée. La demande en biens et services technologiques progresse, selon leurs calculs, de 8 % par an, en moyenne, aux Etats-Unis. Mais les fluctuations autour de cette tendance sont considérables : la croissance annuelle du secteur a pu connaître, depuis le milieu des années 1980, des variations comprises entre + 28 et - 10 %. Des retournements brutaux sont observés également sur le marché français : à la fin des années 1990, la demande en matériels et services informatiques progressait à un rythme de 10 % par an ; 2002 marque une rupture, puisque le marché devrait se contracter par rapport à 2001. Face à de tels retournements de l'activité, les entreprises du secteur peuvent difficilement éviter l'apparition d'importantes surcapacités.
Mais il arrive que l'investissement connaisse des variations plus importantes encore que celles qui devraient naturellement découler de l'effet d'accélération. On est alors en présence de véritables « bulles » de surinvestissement. Les phénomènes de surinvestissement sont, vraisemblablement, dommageables pour l'économie. Ils conduisent, en effet, à une allocation moins efficiente du capital. Pendant la phase de surinvestissement, des capitaux sont alloués à des projets peu ou non rentables, au détriment d'investissements dans d'autres secteurs d'activités. Cette allocation inefficiente des facteurs de production peut aussi concerner le facteur travail : les entreprises des secteurs « traditionnels » ont été confrontées à des difficultés de recrutement, pour certaines compétences pointues, face à la concurrence inhabituelle de « start-up », au moment de la « bulle » de l'Internet, à la fin des années 90 et en 2000. Le surinvestissement conduit, à terme, à l'apparition de surcapacités de production. Des quantités importantes de capital sont alors inemployées. La situation financière des entreprises qui ont participé au surinvestissement se dégrade, au point parfois que la survie de ces firmes est menacée.
Après une description des phénomènes de surinvestissement, seront examinées les possibles facteurs explicatifs de l'apparition de tels déséquilibres. Cette réflexion sur les causes du surinvestissement conduit naturellement à s'interroger sur les moyens à mettre en oeuvre pour prévenir ces phénomènes.
I. LES ÉPISODES RÉCENTS DE SURINVESTISSEMENT : JAPON, ETATS-UNIS, EUROPE :
L'histoire économique récente fournit trois exemples de « bulles » de surinvestissement. La première a affecté le Japon à la fin des années 1980, et au début des années1990. La seconde s'est manifestée aux Etats-Unis, à la fin des années 1990, et concerne particulièrement les investissements en nouvelles technologies. En Europe, l'engouement pour l'Internet a été réel, mais plus bref, et de moindre envergure. Sur le vieux continent, c'est plutôt le secteur des télécommunications qui a connu un emballement des investissements, ayant conduit à l'apparition de surcapacités.
A. UN PRÉCÉDENT PRÉOCCUPANT : LE CAS JAPONAIS :
La dernière décennie au Japon a été caractérisée par une stagnation persistante, à laquelle les divers plans de soutien gouvernementaux n'ont pu apporter de solution efficace. Une analyse a posteriori permet de mettre en évidence un phénomène de suraccumulation, à l'oeuvre dans l'économie japonaise à la fin des années 1980, suraccumulation qui porte une part de responsabilité dans la stagnation présente.
Le rythme d'accumulation du capital a connu une forte accélération au Japon entre 1987 et 1991. Entre ces deux dates, le taux d'investissement en machines et équipements des entreprises nipponnes a augmenté de cinq points. Cette très forte hausse de l'investissement a soutenu la croissance pendant plusieurs années. Les achats de machines et équipements ont contribué à hauteur de 50 % à la croissance du PIB japonais en 1989, et ce ratio s'est maintenu à 40 % jusqu'au troisième trimestre 1991. Le stock de capital a augmenté à un rythme accéléré, passant d'un taux de croissance inférieur à 5 % en 1984, à un taux de 6,5 % entre 1985 et 1992.
La hausse des investissements s'est produite à la faveur de conditions monétaires et financières propices . Dans un contexte de baisse des prix de l'énergie (contre-choc pétrolier), d'appréciation du yen, et de baisse de l'inflation, la Banque du Japon a opté pour une politique de détente monétaire, qui a réduit le coût du capital, et a ainsi facilité l'investissement des entreprises. La forte appréciation de la Bourse de Tokyo, à la même époque, a également facilité le financement de l'investissement.
Mais, suite à cette envolée des investissements, la rentabilité du capital a rapidement décliné ; après une légère remontée en 1988, la rentabilité du capital baisse au début des années 1990 à un rythme d'environ 3,5 % par an. La baisse de la demande finale au Japon, mais aussi sur les marchés d'exportations américain et européen, a fait apparaître d'importantes surcapacités de surproduction. L'apparition de ces surcapacités, suite au retournement des perspectives de demande, est contemporaine de la chute du cours des actions.
La baisse de la rentabilité du capital implique une forte dégradation des profits des firmes japonaises . Cette dégradation des profits explique la crise de solvabilité de nombreuses entreprises japonaises, qui est à l'origine des difficultés actuelles du système bancaire (accumulation de « créances douteuses »).
D'abord perçue comme une crise conjoncturelle, la langueur japonaise est de plus en plus souvent analysée comme un problème structurel. Les rigidités affectant les marchés de biens et services au Japon auraient entravé le processus spontané de réallocation du capital, ralentissant ainsi la résorption des surcapacités. La politique macroéconomique suivie (taux d'intérêt très bas, politique de grands travaux) a pu également ralentir la restructuration de l'économie japonaise, en facilitant le maintien en activité d'entreprises peu rentables.
B. SYMPTÔMES DU SURINVESTISSEMENT AMÉRICAIN :
Différents indices laissent à penser que l'économie américaine a elle aussi été affectée par une bulle de surinvestissement, observable notamment sur la période 1998-2000.
L'investissement aux Etats-Unis représente, en moyenne, environ un sixième du PIB. Mais, de 1998 à 2000, l'investissement a cru jusqu'à représenter 30 % du PIB américain. Cette croissance de l'investissement est sensiblement plus accentuée que lors des cycles précédents, ou l'investissement n'a jamais représenté plus de 22 % de la croissance totale.
Cette progression de l'investissement tient pour beaucoup, comme cela a été indiqué dans la première partie de ce rapport, à une forte hausse des investissements dans les NTIC. La part des investissements en technologies de l'information dans l'investissement total n'a cessé de croître dans les années 1990, jusqu'à représenter plus de 30 % du total à la fin de la décennie.
Comme au Japon, la progression de l'investissement a coïncidé avec une très forte appréciation des cours boursiers et une politique monétaire accommodante. Celle-ci a facilité le financement des investissements américains. En effet, la très forte valorisation des actions émises par les entreprises leur permet de lever plus facilement des capitaux. Cela équivaut à une baisse du coût du capital, qui incite les entreprises à investir. Il est vraisemblable que des investissements peu rentables, ou particulièrement aléatoires, aient pu, dans ce contexte, trouver leur financement.
Les symptômes du surinvestissement ont commencé à se manifester à partir de l'année 2000. Le retournement de la demande s'accompagne d'une chute brutale du taux d'utilisation des capacités de production dans l'industrie manufacturière, comme l'atteste le graphique ci-dessous. Ce taux est aujourd'hui nettement inférieur à sa moyenne historique.
Graphique 14 : Taux d'utilisation des capacités aux Etats-Unis (%)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
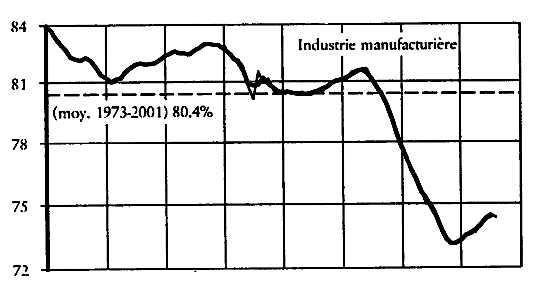
Source : Rexecode, 2002.
L'accumulation de capacités de production excédentaires a un impact négatif sur la rentabilité des entreprises américaines. La part des profits dans la valeur ajoutée aux Etats-Unis diminue fortement depuis 1998.
Graphique 15
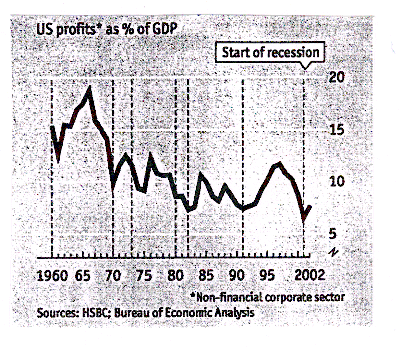
La baisse des profits a réduit le taux d'autofinancement des entreprises américaines, ce qui les a contraintes à augmenter leur endettement pour poursuivre le financement de leurs investissements. La dette des sociétés américaines représente, en 2002, 48 % du PIB, soit 10 points de plus que cinq ans auparavant. Nombre d'entreprises ont consacré une partie de leurs ressources à des opérations de rachat d'actions, et ont joué de l'effet de levier, pour augmenter la rentabilité du capital pour leurs actionnaires, sans augmentation de la rentabilité réelle des investissements. Ces stratégies d'entreprises créent une incitation, transitoire, à des investissements supplémentaires. Elles trouvent leurs limites lorsque la montée de l'endettement finit par menacer la solvabilité de l'entreprise.
Les similitudes observées entre les épisodes de surinvestissement américain et japonais peuvent-elles faire craindre, pour l'économie américaine, un scénario à la japonaise ?
Il est probable que la correction des déséquilibres caractérisant l'économie américaine ne soit pas encore achevée, et que celle-ci se poursuive pendant encore plusieurs années, pesant ainsi sur les perspectives de croissance.
Toutefois, l'économie américaine se distingue par une importante flexibilité, propice à une réallocation rapide du capital. Les déséquilibres de l'investissement peuvent donc se résorber dans des délais plus courts outre-atlantique qu'au Japon.
En outre, si l'on admet que le surinvestissement est particulièrement concentré dans le secteur des TIC, on peut supposer que le rythme d'obsolescence rapide de ces biens d'équipement entraînera une diminution rapide du stock de capital excédentaire. 70 ( * )
Beaucoup dépendra, enfin, des réponses de politique économique apportées par les autorités nationales. La question de la stratégie à mettre en oeuvre face à des bulles de surinvestissement sera examinée à la fin de ce chapitre.
C. SURINVESTISSEMENTS SECTORIELS : LE CAS DES TÉLÉ-COMMUNICATIONS :
Il n'y pas eu, globalement, de surinvestissement en Europe, dans la période récente. Au contraire, comme cela a été montré en première partie, l'Europe dispose encore de marges de progression de l'investissement productif, susceptibles d'élever le niveau de sa croissance potentielle. L'Europe a cependant été affectée, de manière particulièrement nette, par l'épisode de surinvestissement sectoriel, qui a affecté les télécommunications. Cette section se propose d'illustrer, par un exemple concret, le déroulement de ce processus de surinvestissement. La crise actuelle des télécoms résulte d'investissements physiques excessifs, et d'opérations de croissance externe mal maîtrisées, aggravées, en Europe, par l'achat à des prix élevés des licences UMTS.
1. Une croissance des capacités de production sans lien avec la progression de la demande :
Le développement des capacités de production des entreprises de télécommunications a été très soutenu au cours des quatre dernières années. Entre 1998 et 2001, les opérateurs ont, au niveau mondial, multiplié par cinq la quantité de câbles enterrés. Dans le même temps, des innovations technologiques ont permis de multiplier par 100 les capacités de transmission des réseaux disponibles. Les capacités de transmission des réseaux mondiaux ont donc été multipliées par 500 en quelques années. Pourtant, la demande a été « seulement » multipliée par quatre sur la même période 71 ( * ) . Ce quadruplement de la demande aurait dû assurer la prospérité des entreprises du secteur. Mais, du fait de ces surinvestissements massifs, la situation financière des entreprises du secteur s'est, en fait, beaucoup dégradée. Environ 500 milliards d'euros ont été investis, dans le monde, en quatre ans, pour construire ces nouveaux réseaux de communication 72 ( * ) .
2. Les stratégies d'internationalisation ont eu un coût élevé :
Tout en développant leurs investissements physiques, les entreprises de télécommunications, et notamment les opérateurs historiques européens, ont mené de nombreuses opérations de croissance externe.
D'anciens monopoles nationaux, comme France Telecom ou Deutsche Telekom, ont souhaité s'internationaliser, pour profiter davantage de la croissance du marché, et compenser la perte de recettes liée à l'ouverture de leurs marchés nationaux à la concurrence. Dans un contexte de forte appréciation des cours de Bourse, les opérations de croissance externe ont été particulièrement volumineuses. A titre d'exemple, au cours de la seule année 2000, France Telecom a dépensé 4 milliards d'euros pour l'achat de Global One, 40 milliards d'euros pour l'achat d'Orange, 2 milliards d'euros pour l'achat des parts de Deutsche Telekom dans Wind, 4,8 milliards d'euros pour l'achat d'Equant. Ainsi, 50,8 milliards d'euros (environ 333 milliards de francs) ont été investis, en un an, au titre des opérations de croissance externe par une entreprise dont le chiffre d'affaires annuel était alors de l'ordre de 40 milliards d'euros.
3. La vente des licences UMTS, facteur déclenchant de la crise des télécoms ?
L'endettement des groupes européens de télécommunications a été encore massivement accru par l'achat des licences UMTS 73 ( * ) . Ces licences autorisent l'accès aux fréquences nécessaires à l'utilisation de la téléphonie mobile de troisième génération (Internet mobile).
L'attribution des licences a résulté d'un processus d'enchères, organisées au niveau national. Au total, les entreprises de télécommunications ont dépensé environ 115 milliards d'euros pour l'achat de ces licences. Un investissement d'un montant équivalent devrait être nécessaires, selon les analystes, pour une mise en place effective de l'UMTS 74 ( * ) .
Chronologiquement, la conclusion des opérations d'enchères allemande et britannique, au cours de l'année 2000, coïncide avec le début de la chute du cours de Bourse des entreprises de télécommunications ( cf graphique 16). Il semble que la perception, par les investisseurs, des perspectives de profit du secteur aient été fortement révisées à la baisse compte tenu des coûts fixes importants que représentait l'achat de ces licences. Cette analyse est partagée par les auteurs du rapport « Enjeux économiques de l'UMTS », qui écrivent que « les pays qui ont capté la plus grande partie de la «rente» économique du projet UMTS ont largement contribué à déstabiliser le secteur » 75 ( * ) . La vente des licences a considérablement accru l'endettement des opérateurs, ce qui a réduit leur capacité à réaliser aujourd'hui les investis-sements physiques nécessaires à l'aboutissement du projet.
Graphique 16 : Les opérateurs européens victimes de l'UMTS
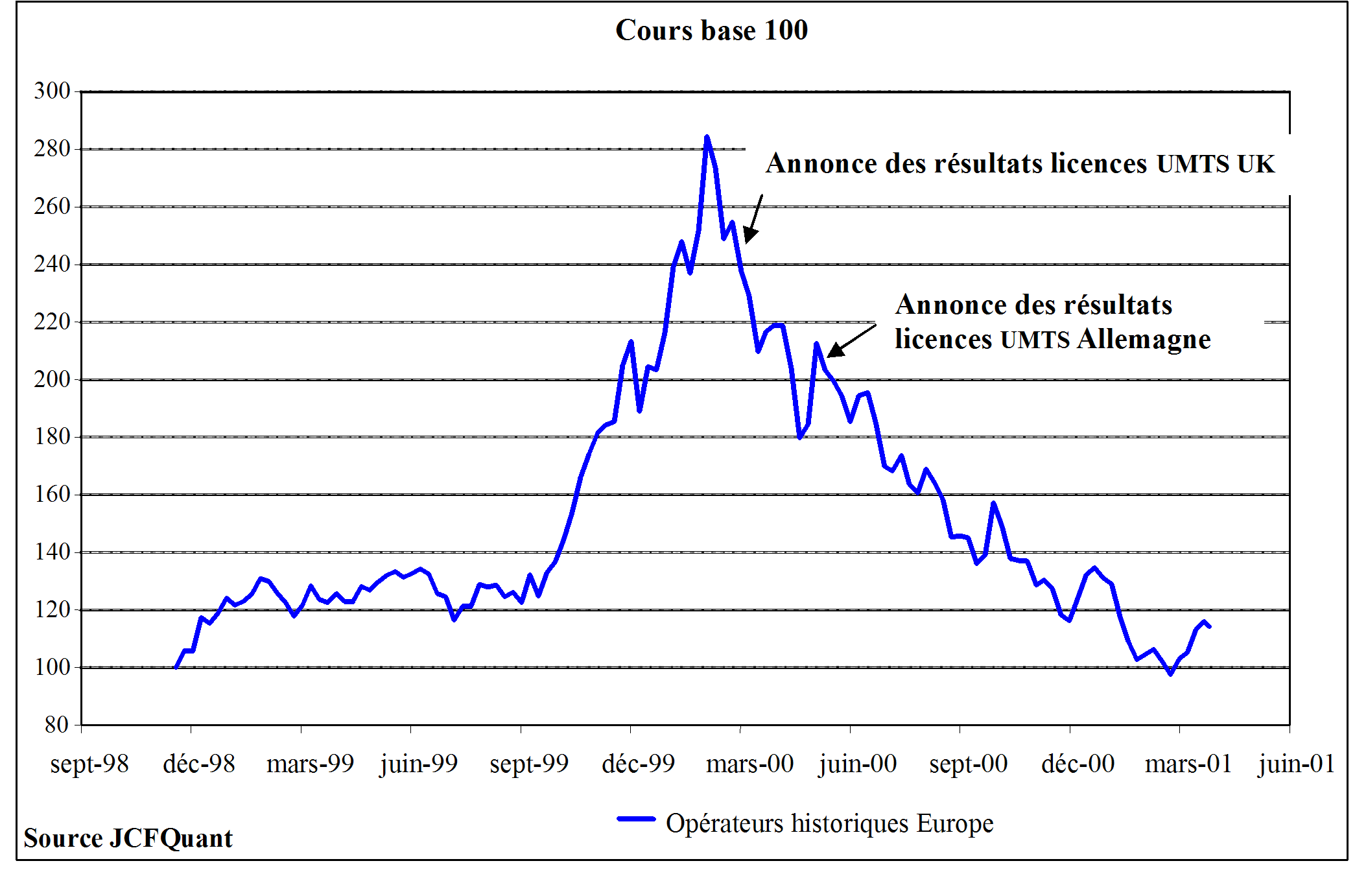
L'absence de coordination, à l'échelle européenne, explique une part de ces difficultés . La vente des licences a été effectuée au niveau national, alors que la technologie a vocation à être européenne. Quelques Etats (Allemagne, Grande-Bretagne notamment) ont, via leur procédure d'enchères, effectué un prélèvement massif sur des profits futurs, et aléatoires. La maximisation de la recette budgétaire a été, dans ces pays, le principal objectif poursuivi. Les Etats qui ont souhaité procéder à des enchères ultérieures (Pays-Bas, Italie) ont été pénalisés du fait des limites aux capacités d'endettement du secteur.
Il aurait, sans doute, été moins déstabilisant pour les firmes d'attendre que les profits de l'UMTS se soient matérialisés, avant de les taxer. L'intervention publique a accru le risque financier auquel sont exposés les opérateurs, alors qu'elle aurait dû contribuer à réduire les incertitudes et à stabiliser les anticipations.
4. Le financement de ces investissements a précipité le lourd endettement du secteur :
Les opérateurs de télécommunications ont drainé des capitaux considérables : parmi les dix plus gros emprunteurs mondiaux en 2001, six sont des opérateurs de télécommunications (il s'agit, dans l'ordre, de France Telecom, AT&T, MCI Worldcom 76 ( * ) , Deutsche Telekom, British Telecom et NTT). Les crédits aux sociétés européennes atteignent 300 milliards de dollars début 2002.
L'endettement des entreprises de télécommunications a, en conséquence, fortement augmenté, en quelques années. Le graphique suivant témoigne de la croissance de cet endettement pour quelques grands groupes.
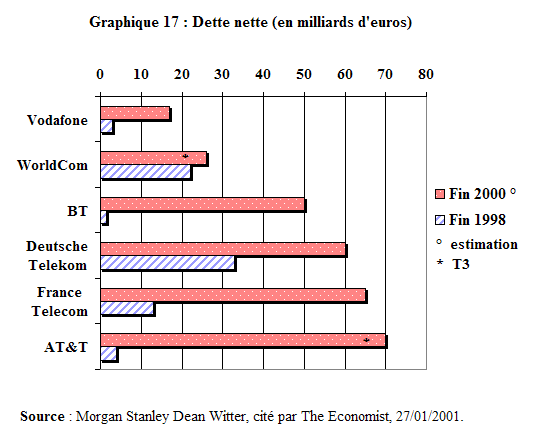
En résumé, le secteur des télécommunications se caractérise, aujourd'hui, par un endettement massif, et par d'importantes surcapacités. L'association de ces deux éléments suggère une allocation inefficiente du capital. L'existence de surcapacités exerce une pression à la baisse des prix 77 ( * ) qui réduit les profits, et donc les capacités de remboursement, des opérateurs.
Comment expliquer un tel enchaînement d'événements, qui a conduit nombre d'entreprises à une situation financière difficile, alors que leur marché continue à croître à un rythme soutenu (le marché français des services de télécommunications a encore crû de 6 % au quatrième trimestre 2001) ? Répondre à cette question suppose de s'interroger sur les causes des phénomènes de surinvestissement.
II. ELÉMENTS D'INTERPRÉTATION :
Deux déterminants de l'investissement - la demande anticipée et les conditions de financement - semblent jouer un rôle important dans le déroulement des épisodes de surinvestissement. Les politiques publiques peuvent amplifier le surinvestissement. Les phénomènes de surinvestissement peuvent, enfin, être éclairés par les théories relatives à l'analyse des cycles économiques.
A. LE PROBLÈME DE LA FORMATION DES ANTICIPATIONS :
L'investissement est fonction de la demande anticipée. Or, il est particulièrement difficile, dans les secteurs innovants, d'estimer la demande à venir, du fait de l'absence de tendance historique passée. Les opérateurs de télécommunications, avec la téléphonie de troisième génération, ou les entreprises de l'Internet, ont été confrontées à la même difficulté.
1. Anticiper la demande pour des produits nouveaux est un exercice difficile :
Les entreprises de télécommunications ont longtemps fondé leurs politiques d'investissement sur des prévisions de croissance de la demande, qui apparaissent aujourd'hui irréalistes. L'entreprise américaine World Com a, par exemple, augmenté la capacité de ses réseaux de communication en prévision d'un doublement, tous les 100 jours, du trafic Internet. Or, la croissance réelle du trafic, extrêmement rapide au demeurant, a varié entre + 75 et + 150 %, selon les années. La dispersion des prévisions relatives à la taille du marché de l'UMTS, au moment du lancement du processus de vente des licences, est un autre signe de la difficulté à anticiper la demande pour des produits innovants. La Commission européenne envisageait un marché européen de 200 millions de consommateurs en 2005, alors que les opérateurs, plus circonspects sur les délais de mise au point des équipements, tablaient sur un nombre de clients de 60 millions seulement à la même date. Le poids de l'incertitude est encore accru, dans le secteur des télécommunications, par l'ampleur des investissements en infrastructures à réaliser et par l'horizon, éloigné, de rentabilisation de tels investissements. De tels investissements ne sont rentables qu'à long terme, ce qui impose aux entreprises de faire des prévisions sur leur nombre de clients, et sur le chiffre d'affaires généré par chaque client, pour un horizon temporel éloigné (au-delà de 2010).
La formation des anticipations de demande dans le secteur des nouvelles technologies a, probablement, aussi été influencée, un temps, par le paradigme de la « nouvelle économie », dont les principales caractéristiques étaient les suivantes : confiance dans la réussite commerciale des nouvelles technologies, confiance dans la capacité de l'économie à dégager des gains de productivité suffisants pour soutenir une croissance durable non-inflationniste, confiance dans les perspectives d'amélioration des marchés boursiers. La perte de confiance dans les perspectives de succès de la « nouvelle «économie » a eu un impact psychologique fort sur les comportements des investisseurs.
2. Un pari sur la recomposition à venir du marché :
C. Rudelle, consultant au BIPE, auditionné par votre rapporteur, a souligné que les décisions d'investissement de nombre d'entreprises ont aussi été affectées par une analyse portant sur la recomposition à venir de leurs marchés. Les analyses des opérateurs de télécommunications, comme des entrepreneurs de l'Internet, reposaient sur l'idée que seul un petit nombre d'entreprises parviendraient à se maintenir, à terme, sur le marché européen, voire mondial.
Du fait de l'importance des coûts fixes dans le secteur des télécommunications, la survie d'un opérateur est subordonnée à la détention d'une part de marché minimale. Cette obligation de détenir une part de marché minimale signifie qu'il n'y a de place, sur le marché, que pour un nombre limité d'opérateurs. La structure du marché est oligopolistique. Tout l'enjeu, pour les compagnies, consiste alors à survivre à la concentration en cours, dans leur secteur d'activité, afin de figurer parmi les quelques groupes détenteurs, à terme, d'une position dominante. Pour les opérateurs historiques, survivre à la concentration du secteur supposait d'être présents sur tous les grands marchés européens, et d'être offreurs de services de téléphonie de troisième génération (UMTS). Face à ces deux impératifs, la question de la maîtrise du coût des investissements est passée au second plan. France Telecom ou Deutsche Telekom ne pouvaient s'abstenir d'acquérir des licences UMTS, ou de mener des opérations de croissance externe, sans quoi leur présence future, parmi les grands acteurs européens du marché, aurait été compromise. Il fallait investir aujourd'hui, ou prendre le risque de disparaître demain. Cette disposition d'esprit a naturellement poussé à la hausse le coût des acquisitions.
Les entreprises du secteur de l'Internet ont, elles aussi, été influencées par une analyse erronée quant à l'évolution future de leurs marchés. La concentration du secteur ne devait pas, ici, résulter de la présence d'importants coûts fixes, mais plutôt d'effets de réseau. L'idée est que la valeur d'un réseau augmente avec le nombre de ses utilisateurs. On conçoit aisément qu'un forum de discussion sur Internet, ou qu'un site de vente aux enchères entre particuliers, n'ait aucune valeur pour un consommateur isolé. En revanche, si un million d'utilisateurs sont présents sur le réseau, la valeur du réseau devient considérable. Beaucoup d'investisseurs dans le secteur de l'Internet ont donc investi des sommes élevées pour se constituer, le plus rapidement possible, une importante clientèle. Une fois acquise, la clientèle était supposée devenir captive. En effet, comme la valeur d'un réseau augmente avec le nombre de ses utilisateurs, il est très difficile pour un nouvel entrant de s'imposer sur le marché. Le nouvel entrant ne peut conquérir une part du marché que si un nombre suffisant de consommateurs choisissent simultanément son produit, ce qui, en pratique, n'a que peu de chance de se réaliser, en raison de l'absence de coordination entre les agents. Selon l'analyse longtemps dominante, le secteur de l'Internet aurait donc obéit à une logique de « winner takes all ».
La disparition d'un grand nombre d'entreprises de l'Internet pionnières sur leur marché conduit aujourd'hui à une remise en cause de ces analyses. La concrétisation des effets de réseau a manifestement été surestimée 78 ( * ) . Pour cette raison, les investissements réalisés ont été disproportionnés par rapport à la demande effectivement adressée à chacune de ces entreprises. Cette situation de déséquilibre a conduit à la crise actuelle du secteur.
Ces éléments d'explication valent pour certains secteurs d'activité. Or, le surinvestissement, dans les cas américain ou japonais, a concerné l'ensemble de l'économie. D'autres explications du surinvestissement sont donc à rechercher dans les interactions entre la sphère financière et la sphère réelle.
B. LE RÔLE DES FACTEURS FINANCIERS :
Les épisodes de surinvestissement examinés sont tous contemporains d'une forte appréciation des cours boursiers, et d'un important mouvement d'expansion du crédit. Il ne peut, en effet, y avoir surinvestissement que si les financements sont abondants, et peu coûteux. Sans quoi la contrainte de financement vient rapidement limiter les projets des entreprises.
1. Influence des cours de Bourse sur l'investissement des entreprises :
Des études - voir, en particulier, P. Artus et J. Genet 79 ( * ) - ont cherché à mettre en évidence une influence spécifique des cours boursiers sur le taux d'investissement américain depuis 1997. Leur thèse est que la hausse du taux d'investissement américain ne peut s'expliquer par les déterminants habituels de l'investissement (croissance, profits, durée de vie des équipements, crédit...), mais qu'elle peut être rattachée à la hausse des cours de Bourse. En temps ordinaire, les cours boursiers ne font que synthétiser l'information disponible, et n'apportent donc pas d'incitation supplémentaire à investir. Mais, s'il y a anomalie de valorisation, le cours boursier (ou l'excès de rendement boursier) peut avoir un effet propre sur l'investissement. Une surévaluation des cours enrichit fortement les actionnaires et les incite à investir : les nouveaux investissements sont en effet plus faciles à financer, et la poursuite du programme d'investissement laisse espérer une nouvelle hausse très profitable des cours boursiers. La surévaluation des cours est synonyme d'un ratio Q particulièrement élevé 80 ( * ) .
Et, de fait, l'étude d'Artus et Genet révèle une forte corrélation entre la hausse du Q de Tobin et la hausse du taux d'investissement américain. Le ratio Q progresse fortement entre 1998 et 2000, passant de 1 à 1,4 . Sur la même période, le taux d'investissement productif en volume progresse de 20 %. En sens inverse, la chute des cours boursiers à partir de 2000 s'accompagne d'une baisse concomitante du taux d'investissement. Selon Artus et Genet, un retour du Q de Tobin à sa valeur historique devrait entraîner un recul supplémentaire de 10 % de l'investissement productif des entreprises américaines.
L'analyse d'Artus et Genet porte sur l'ensemble des entreprises américaines cotées. Il est probable que l'effet qu'ils décrivent s'applique avec particulièrement de force au cas des entreprises technologiques. Ce sont en effet les entreprises du secteur des TIC qui ont vu leur valorisation boursière augmenter le plus.
En Europe, la période de progression rapide des investissements en télécommunications coïncide également avec l'envolée des cours boursiers des entreprises du secteur. La progression des dépenses d'investissement a permis de financer à la fois un développement des investissements physiques, mais aussi de nombreuses opérations de croissance externe (rachat d'entreprises).
2. Le surinvestissement est favorisé par une politique monétaire peu restrictive :
Les investissements physiques des entreprises américaines, tout comme les investissements sur les marchés financiers, se sont développés à la faveur d'un large accès au crédit. La politique monétaire est l'instrument par lequel l'accès au crédit peut être facilité ou restreint, via la manipulation des taux d'intérêt.
Traditionnellement, la politique monétaire poursuit un objectif d'inflation, l'inflation étant mesurée par les variations de l'indice des prix à la consommation. Par construction, l'indice des prix à la consommation ne contient pas d'information relative à une possible bulle sur les prix des actifs boursiers, pas plus qu'il ne renseigne sur le rythme d'expansion du crédit.
Or, la croissance rapide qu'ont connue les Etats-Unis dans les années 1990 a été fort peu inflationniste. La Banque centrale américaine s'est, en conséquence, abstenue de tout resserrement prononcé de sa politique monétaire ( cf. graphique 18). Le loyer de l'argent étant maintenu à un niveau modéré, l'offre de crédit des banques a pu se développer, alimentant ainsi le cycle de surinvestissement, financé par l'endettement des agents privés.
Graphique 18 : Taux d'intérêt (%)
Variations sur 3 mois au taux annuel
Variations sur 12
mois
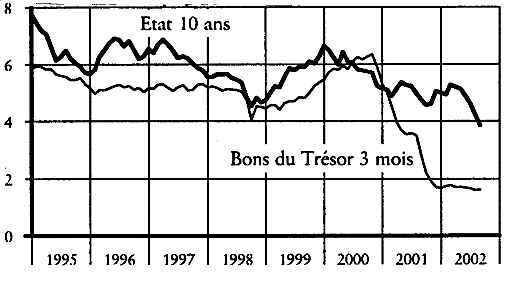
Source : Rexecode
C. INTERPRÉTATION DU SURINVESTISSEMENT PAR LA THÉORIE DES CYCLES ÉCONOMIQUES :
Plusieurs théories ont été avancées par les économistes pour expliquer l'existence de cycles économiques. L'une d'elle, la théorie du cycle des affaires, développée, au début du XX e siècle, par Friedrich Hayek et Ludwig von Mises, voit dans le surinvestissement une cause essentielle des cycles économiques. Elle offre donc une intéressante grille d'interprétation des phénomènes de surinvestissement décrits dans ce chapitre.
Pour Hayek et von Mises, les retournements conjoncturels sont la conséquence d'un excès d'offre, résultant d'une période de surinvestissement. Le surinvestissement est la conséquence d'un écart entre le taux d'intérêt pratiqué par la Banque centrale, et le taux d'intérêt d'équilibre. Le taux d'intérêt d'équilibre est celui qui égalise ex ante la demande de crédit, émanant des firmes, avec l'épargne des ménages. Si le taux d'intérêt effectif est inférieur à ce taux d'équilibre, l'offre de crédit et l'investissement vont croître à un rythme trop rapide, et les ménages ne vont pas épargner suffisamment. A moyen terme, le déséquilibre entre épargne et investissement finit par provoquer une remontée des taux d'intérêt, qui réduit la profitabilité des investissements réalisés. Un important déséquilibre apparaît entre l'offre, qui augmente à un rythme soutenu, du fait de la hausse des investissements, et la demande, qui se contracte lorsque les ménages reconstituent leur épargne.
La contraction de la demande fait apparaître d'importantes surcapacités, qui réduisent les profits des entreprises. Les firmes se trouvent confrontées à la nécessité de réduire rapidement leurs capacités de production, ce qui provoque une contraction forte de l'investissement. Cette contraction de l'investissement est à l'origine du retournement conjoncturel, qui peut déboucher éventuellement sur une récession.
Les cycles japonais et américain présentent des traits qui les rapprochent de ce schéma théorique. Dans ces deux pays, l'investissement a fortement augmenté, et a été favorisé par un contexte de relative détente monétaire. Hayek considérait que le taux d'intérêt d'équilibre d'une économie pouvait augmenter, lorsque les gains de productivité s'accéléraient, et qu'ils provoquaient une révision à la hausse des anticipations de profits futurs, et des projets d'investissements. La réponse de politique économique adaptée devait alors être, selon Hayek, une augmentation des taux d'intérêt pratiqués par la banque centrale. Les Etats-Unis de la fin des années 1990 ont effectivement été témoins d'une hausse des gains de productivité, qui a eu les effets annoncés sur les anticipations des agents. Mais, en raison de l'absence de tensions inflationnistes, et du taux de change élevé du dollar par rapport à l'euro, la Réserve fédérale américaine n'a pas relevé fortement ses taux directeurs. Le coût du capital a ainsi été maintenu, pendant plusieurs années, à un niveau inférieur au rendement anticipé du capital. Cette situation a encouragé une hausse inconsidérée des investissements, à l'origine du cycle de surinvestissement américain.
Ces considérations relatives à la politique monétaire américaine amènent à s'interroger sur les mesures de politique économique à mettre en oeuvre pour maîtriser, et éventuellement éliminer, les phénomènes de surinvestissement.
III. QUELLES RÉPONSES DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE ?
Les cycles de surinvestissement sont la conséquence d'un grand nombre de facteurs, mais les facteurs financiers (hausse des cours de Bourse, expansion du crédit) semblent y prendre une place très importante. La politique monétaire semble donc devoir être l'instrument de politique économique le plus adéquat pour tenter de maîtriser ces phénomènes. Par ailleurs, ses délais d'action sont moins longs que ceux de la politique budgétaire, ce qui présente un avantage dans une perspective de régulation conjoncturelle.
A. OUTILS DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE À LA DISPOSITION DES AUTORITÉS MONÉTAIRES :
Les autorités monétaires disposent de deux outils pour agir sur le crédit et l'investissement : les taux d'intérêt, et les ratios prudentiels imposées aux banques :
1. L'arme des taux d'intérêt
Comme cela a été suggéré précédemment, les autorités monétaires peuvent faire varier le niveau des taux d'intérêt, pour tenter de limiter la progression de l'investissement, lorsque celle-ci apparaît déraisonnable. Un resserrement prononcé de la politique monétaire est susceptible de stopper rapidement une hausse excessive de l'investissement.
2. Des réponses plus ciblées
La question des ratios de capitalisation imposés aux banques n'a, en revanche, pas été mentionnée jusqu'ici. En 1988, une norme prudentielle, appelée ratio Cooke, a été définie par les Banques centrales des pays du G 10 réunies sous l'égide de la Banque des règlements internationaux (Comité de Bâle). Elle impose aux banques privées de détenir des réserves proportionnelles à leurs engagements, pondérés par le risque associé à ces engagements. Autrement dit, plus les engagements des banques sont risqués, plus celles-ci doivent renforcer leurs fonds propres, afin de pouvoir faire face, dans les meilleures conditions, à un éventuel défaut de leur client.
Les ratios de capitalisation peuvent être utilisées comme un instrument de régulation de l'offre de crédit. Elever le niveau de ces ratios est, en effet, une manière, indirecte, de renchérir le coût du capital. Dès lors, on peut concevoir qu'une modulation, par les autorités de supervision bancaire, du niveau des réserves prudentielles soit un moyen de régulation fine de l'offre de crédit, et donc de l'investissement privé. Les autorités monétaires pourraient imposer des réserves plus élevées aux banques, dès lors qu'elles percevraient une aggravation des risques de marché, conséquence de politiques d'investissement mal maîtrisées de la part des entreprises. L'appréciation portée sur l'aggravation des risques pourrait être générale (porter sur l'ensemble de l'économie), ou sectorielle. Un niveau d'endettement très élevé dans un secteur pourrait justifier que les banques fortement engagées auprès des entreprises de ce secteur détiennent un niveau de fonds propres plus élevé que leurs concurrentes. Un tel mécanisme de modulation des ratios de capitalisation permettrait d'éviter une aggravation des déséquilibres.
Les banques centrales ont ainsi à leur disposition deux moyens d'intervention. Leur mise en oeuvre s'avère cependant très délicate.
B. DIFFICULTÉS DE MISE EN oeUVRE DE CES INSTRUMENTS DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE :
1. Les régulateurs sont-ils légitimes ?
Une première difficulté, théorique, tient au fait que les autorités monétaires ne peuvent réguler les marchés que si elles sont plus clairvoyantes que les agents privés. Il faut qu'elles soient capables de discerner les phénomènes de bulle, et d'intervenir à bon escient. Or, cette capacité ne leur est pas reconnue par tous les théoriciens de l'économie.
Pour l'école des anticipations rationnelles, en effet, la question d'une éventuelle irrationalité des marchés ne se pose pas. Les agents privés intègrent toute l'information disponible, et l'exploitent rationnellement, c'est-à-dire sans erreur systématique d'appréciation. Les fluctuations, apparemment erratiques, des marchés reflètent simplement des modifications de l'information disponible, et l'adaptation rationnelle des agents à ces données nouvelles. L'intervention publique ne peut, dans ce cadre théorique, que venir altérer le fonctionnement des marchés, sans apporter aucun supplément de bien-être.
Le Gouverneur de la Banque centrale américaine, M. Greenspan, s'est longtemps illustré par son aptitude à réguler la conjoncture américaine. Il paraît donc difficile voir en lui un partisan de la théorie des anticipations rationnelles. Pourtant, ses récentes déclarations semblent mettre en doute la capacité des Banques centrales à réguler les phénomènes de bulle spéculative, et de surinvestissement.
Selon M. Greenspan, « intervenir pour crever une bulle pose un problème fondamental : cela suppose que vous en savez plus que le marché » 81 ( * ) . Apparemment, le Gouverneur de la Réserve fédérale américaine ne se considère pas plus clairvoyant que les agents privés. M. Greenspan développe deux types d'argument pour justifier sa position 82 ( * ) :
*Il n'existe, selon lui, aucun élément précis permettant de dire qu'un marché est entré dans une phase de bulle boursière ou de surinvestissement. L'incertitude est trop grande pour que la Banque centrale puisse agir avec efficacité.
*De plus, dans les phases de bulle spéculative, l'aversion au risque des investisseurs diminue, en raison d'un très grand optimisme sur les perspectives de demande et de profit futurs ; dans ces conditions, seul un resserrement fort de la politique monétaire est susceptible de restreindre leurs projets d'investissement ; mais un resserrement trop marqué de la politique monétaire risque d'entraîner l'économie dans la récession ; or, c'est précisément ce résultat que l'on cherche à éviter.
M. Greenspan considère, en conséquence, que la Banque centrale ne doit pas se préoccuper des phénomènes de bulle. Les marchés finissent toujours par corriger spontanément leurs déséquilibres éventuels.
2. Les marchés sont-ils parfaits ?
D'autres approches offrent toutefois une autre grille de lecture qui conduit à un plus grand optimisme quant aux capacités d'intervention des autorités publiques. Le comportement des agents sur les marchés y est caractérisé par des phénomènes de mimétisme (« comportements moutonniers »), ou d'anticipations auto-réalisatrices, qui peuvent faire diverger durablement les évolutions du marché des fondamentaux de l'économie. Dans ce cadre théorique, on peut concevoir que les autorités publiques, qui ne sont pas soumises aux mêmes contraintes que les agents privés, qui travaillent dans une perspective de plus long terme, et qui ont une vision globale de l'économie ou d'un secteur, puissent exploiter différemment l'information disponible, et aboutir à des conclusions plus rationnelles que les agents privés. Elles auraient alors la capacité de discerner les phénomènes de bulles, et pourraient concevoir une stratégie de politique économique pour y répondre.
Les difficultés d'intervention pour les Banques centrales n'en restent pas moins réelles.
En premier lieu, il convient de rappeler que les autorités monétaires n'ont pas explicitement pour mission de lutter contre le surinvestissement ou les bulles boursières. La Banque centrale européenne a pour mandat unique de veiller à la stabilité des prix. Or, comme les exemples américain ou japonais l'ont montré, une bulle peut se former sur les marchés boursiers, et l'expansion du crédit et de l'investissement être très rapide, sans que cela se traduise par des tensions sur les prix à la consommation.
Il est, en outre, très difficile de poursuivre deux objectifs de politique économique avec un seul instrument. Un resserrement de la politique monétaire, dans un contexte de stabilité des prix, risque de créer une situation de déflation dommageable à l'économie.
La question du moment de l'intervention est également difficile à résoudre. Une intervention trop tardive, alors que les agents économiques sont déjà lourdement endettés, risque de précipiter la crise, au lieu d'apporter une amélioration. Une mesure qui viserait, par exemple, à imposer un ratio de solvabilité plus élevé aux banques massivement engagées auprès du secteur des télécommunications serait, aujourd'hui, contre-productive. Elle renchérirait le coût du crédit pour des entreprises déjà confrontées à une situation financière difficile, et n'aurait aucun effet sur les incitations des banques à prêter à ces entreprises, puisque les banques sont maintenant pleinement conscientes des risques associés au secteur. Une mesure de ce type aurait pu être utile en amont, à une époque ou les banques continuaient à prêter massivement au secteur, sans avoir une perception claire des risques croissants associés aux projets qu'elles finançaient. Cela suppose que les décideurs publics puissent déceler suffisamment tôt l'apparition de déséquilibres financiers. Or, il n'y a pas d'indicateur avancé auquel les autorités monétaires pourraient se référer sans hésitation pour établir leur diagnostic. Les analyses qui précèdent conduisent, cependant, à penser que la combinaison d'une forte appréciation boursière, avec une importante expansion du crédit, pourrait être un signe précurseur d'une crise de surinvestissement future.
Ces difficultés pratiques aident à comprendre la relative inaction des autorités monétaires face aux phénomènes de surinvestissement. Le plus souvent, les Banques centrales n'agissent que lorsque la crise est manifeste. Leur réaction consiste alors à mener une politique monétaire plus accommodante, dans un souci de relance de l'économie.
Il importe donc que les pouvoirs publics améliorent leurs outils de surveillance de l'investissement. Deux pistes de réflexion méritent sans doute d'être explorées :
- les banques centrales devraient approfondir leurs recherches relatives aux signes précurseurs des bulles de surinvestissement. Les analyses contenues dans ce rapport suggèrent que la combinaison d'une forte appréciation boursière, et d'une importante expansion du crédit, pourraient être un élément annonciateur, relativement fiable, d'une crise de surinvestissement future.
Si des recherches plus approfondies venaient confirmer cette première analyse, on pourrait concevoir que les banques centrales prennent en compte les variations des cours des actifs boursiers, dans leurs décisions de politique monétaire, de la même manière qu'elles s'intéressent aujourd'hui aux variations de l'indice des prix à la consommation, ou de tel agrégat monétaire.
- Un deuxième axe de réflexion conduit à s'interroger sur la transformation éventuelle des autorités de surveillance bancaire, en véritables organes de régulation du crédit. Certaines discussions en cours permettent de penser qu'une telle évolution n'est pas inenvisageable.
En effet, le Comité de Bâle, qui réunit les représentants des Banques centrales, travaille aujourd'hui à une refonte des ratios prudentiels. Le ratio Cooke devrait être remplacé en 2006 par un ratio Mc Donough, au fonctionnement plus élaboré.
Le Comité de Bâle envisage d'imposer trois types d'obligations aux banques :
- elles devraient conserver, comme le ratio Cooke le prévoit déjà, un niveau minimum de fonds propres, pondéré en fonction du risque ;
- les autorités de surveillance du système bancaire, c'est-à-dire, en France, la Commission bancaire, pourraient aller au-delà de ces obligations minimales, et imposer aux banques des niveaux de fonds propres plus élevés, lorsque les risques augmentent ;
- enfin, les banques seraient obligées de transmettre des informations plus détaillées aux autorités de surveillance bancaire, ainsi que de rendre publique une partie de ces informations.
L'adoption de ces réformes devrait permettre de renforcer le contrôle du système financier. Au-delà, elle pourrait permettre d'envisager une transformation de la Commission bancaire en un véritable organe de régulation du financement des entreprises. Lieu de centralisation des informations, la Commission serait mieux informée que chaque agent pris individuellement sur l'état du marché. La vue d'ensemble dont elle bénéficierait devrait, en principe, lui éviter d'être sujette aux phénomènes de comportements mimétiques, qui affectent parfois la rationalité des agents.
Ses interventions pourraient prendre la forme de mises en garde publiques, destinées à attirer l'attention des agents sur une aggravation inconsidérée des risques.
En l'absence de réactions, elle pourrait imposer un relèvement des réserves prudentielles, en fonction de l'accroissement du risque, de manière à modérer l'expansion du crédit.
Jusqu'à présent, c'est un accord international, conclu entre les représentants des banques centrales, qui fixe le niveau des ratios de solvabilité. Une modification de ces ratios ne peut donc intervenir que dans des délais assez longs, incompatibles avec une stratégie de régulation de l'économie. Il serait donc utile que les autorités nationales de surveillance se voient reconnaître la possibilité d'adapter les règles prudentielles aux conditions présentes des marchés.
CONCLUSION
L'évolution de l'investissement, dans les années 1990, a été globalement décevante dans notre pays. Au-delà de l'observation des tendances passées, ce sont les conséquences défavorables, pour la croissance et l'emploi, de l'insuffisance de l'investissement qui méritent d'être soulignées. Une amélioration, durable et significative, du niveau de vie des Français ne peut résulter que d'une élévation du potentiel de croissance de l'économie. Or, ce potentiel de croissance est aujourd'hui borné par l'insuffisance du stock de capital.
La crise qui frappe le secteur des TIC depuis deux ans ne doit pas conduire à sous-estimer les évolutions structurelles de l'économie dont les nouvelles technologies sont porteuses. L'investissement des entreprises américaines dans des équipements de haute technologie a eu un impact significatif, au niveau macroéconomique, en termes d'amélioration des gains de productivité. La France, comme ses grands partenaires européens, continue d'accuser un retard important en ce domaine.
Le détour par l'analyse théorique des déterminants de l'investissement a montré que c'est la demande qui est, traditionnellement, considérée comme son déterminant majeur. Pourtant, la faiblesse de l'investissement en France, dans la dernière décennie, a été plus prononcée que ce que les relations habituelles entre demande et investissement laissaient prévoir. L`interprétation de cet écart ne fait, comme on l'a vu, pas l'unanimité. Il peut être attribué au comportement particulier de l'investissement en construction des entreprises ou, comme c'est probable, être la conséquence d'une sensibilité plus forte des firmes au niveau de leur endettement. Les analyses des modélisateurs confirment les observations relatives au partage de la valeur ajoutée, qui témoignent d'un effort notable de désendettement des entreprises jusqu'en 1997.
Ces analyses suggèrent que l'investissement serait devenu plus sensible aux contraintes financières qui pèsent sur les entreprises. Si cette hypothèse est avérée, l'attention des pouvoirs publics devrait se porter, principalement, sur l'amélioration des conditions de financement des investissements, de préférence à des stratégies de gestion de la demande, dont les effets se font sentir essentiellement à court terme. D'autant plus que la forte croissance de la fin des années 1990 s'est accompagnée d'une importante remontée du taux d'endettement des sociétés, qui peut faire craindre, pour les années à venir, une nouvelle phase d'atonie de l'investissement.
L'action des pouvoirs publics peut porter sur l'allégement de la fiscalité pesant sur les investissements. Si l'on en croit les calculs de la Commission européenne, une diminution d'un cinquième de l'imposition effective des investissements serait nécessaire pour ramener la France au taux moyen d'imposition observé dans l'Union européenne. Outre la baisse de la fiscalité, les pouvoirs publics pourraient réfléchir à une réforme des incitations fiscales à la recherche, afin d'éliminer les défauts du dispositif actuel.
L'action publique doit se préoccuper également de créer, pour les entreprises, un environnement favorable à l'expansion de l'investissement. La réduction de l'incertitude doit être l'objectif prioritaire, tant il est vrai qu'un environnement incertain dissuade l'investissement. La stabilité de la politique macroéconomique doit être complétée par celle du cadre juridique et fiscal. Si l'investissement présente un certain degré de réversibilité, la prise de risque associée à la décision d'investissement diminue d'autant, ce qui est susceptible d'encourager aussi l'investissement. Ceci pose la question du degré de flexibilité supplémentaire à accorder au marché du travail, puisque les rigidités qui caractérisent ce marché sont souvent citées comme l'obstacle principal à la réorganisation des unités de production.
Un haut niveau d'investissement public contribue à créer un environnement favorable à l'investissement privé, en raison notamment des externalités positives qui découlent de ce type d'investissement. Il faut donc veiller à ce que la régulation budgétaire ne se fasse pas au détriment de l'investissement public.
L'investissement productif, comme d'autres grandeurs économiques, évolue de manière cyclique. Pour éviter que des phases de surinvestissement ne soient suivies de longues périodes de stagnation, les autorités en charge de la politique économique, dans les grands pays développés, devraient réfléchir au développement d'outils nouveaux de régulation. Les autorités bancaires et monétaires semblent les mieux placées pour assumer cette mission de surveillance. Leurs interventions pourraient contribuer à orienter les anticipations des investisseurs, et à modérer leur confiance ou leur défiance, parfois excessives.
PRINCIPALES OBSERVATIONS DU RAPPORT
|
Constats : L'investissement productif a été peu dynamique, en France, au cours de la décennie écoulée. Il apparaît particulièrement faible lorsqu'on le compare à la vigueur de l'investissement outre-Atlantique. La France, comme ses voisins européens, accuse un retard, par rapport aux Etats-Unis, dans l'investissement en TIC (technologies de l'information et de la communication). L'évolution de l'investissement en construction explique une part de la faiblesse de l'investissement des entreprises françaises. Après l'éclatement de la « bulle » immobilière, en 1992, l'investissement en construction a fortement diminué. Il a retrouvé en 2001 son niveau de 1980. La faiblesse de l'investissement est une cause essentielle, quoique non exclusive, de l'écart de croissance qui s'est manifesté entre l'Europe et les Etats-Unis dans les années 1990. Le haut niveau d'investissement aux Etats-Unis a entraîné une accélération des gains de productivité, qui a permis à l'économie américaine de soutenir une croissance plus rapide sans tensions inflationnistes. Elever le niveau de l'investissement productif est indispensable pour élever le niveau de la croissance potentielle de l'économie française, aujourd'hui évalué à 2-2,5 %. La progression ralentie de la population active impose des gains de productivité plus rapides pour atteindre un niveau de croissance donné. L'investissement des entreprises est sujet à des variations cycliques d'une forte amplitude. Au-delà de ces variations cycliques ordinaires, on assiste parfois à de véritables phénomènes de surinvestissement, comme l'illustre, en Europe, le cas du secteur des télécommunications. Conditions d'un investissement dynamique : L'investissement des entreprises est sensible à l'incertitude et au risque. Les pouvoirs publics et les autorités monétaires doivent donc s'efforcer de maintenir un environnement macroéconomique et réglementaire stable. Le partage de la valeur ajoutée s'est déformé, depuis une vingtaine d'années, dans un sens plus favorable aux profits. La modération salariale est une condition d'un financement satisfaisant de l'investissement productif. Elle est d'autant plus nécessaire que les entreprises se sont fortement endettées ces dernières années. Des marchés de biens et services concurrentiels, et un marché du travail flexible, créent, selon diverses études, une incitation positive à l'investissement. Une libéralisation de ces marchés viendrait stimuler l'investissement en France. Le niveau d'imposition supporté par les investissements réalisés en France serait, d'après une étude de la Commission européenne, supérieur d'environ six points à la moyenne européenne. Ramener l'imposition française vers la moyenne européenne favoriserait le développement des investissements en France. L'efficacité des mesures temporaires d'incitation fiscale à l'investissement apparaît limitée. Ces mesures peuvent avoir un coût important pour les finances publiques, et n'ont qu'un impact marginal sur le niveau de l'investissement à moyen terme. Elles devraient donc être évitées, ou réservées à des fins d'ajustement conjoncturel. L'investissement privé français en recherche-développement (R&D) apparaît insuffisant comparé à celui de nos principaux partenaires. Les études économétriques suggèrent un effet positif des aides publiques sur l'investissement privé en R&D. Un réaménagement des soutiens publics à l'investissement, et notamment du crédit d'impôt-recherche, est souhaitable pour améliorer leur efficacité. L'investissement public est un facteur de dynamisme de l'investissement privé. Mais il a eu tendance à décliner au cours de la décennie écoulée, notamment en raison de la baisse de l'effort d'investissement de l'Etat. Le niveau de l'investissement public pourrait être durablement porté à 3,5 points de PIB, niveau observé de manière pérenne aux Etats-Unis. La prise en compte des phénomènes de surinvestissement appelle une réflexion sur les conditions d'exercice de la politique monétaire, ainsi que sur la supervision des marchés et du système bancaire. Une meilleure diffusion de l'information auprès des acteurs de marché est souhaitable. |
BIBLIOGRAPHIE
|
• Abel A.B., Investment and the Value of Capital , New York, Garland Publishing, 1979. |
|
|
• Abel A.B. et Eberly J., « A unified model of investment under uncertainty », NBER Working Paper , n° 4296, 1993. |
|
|
• Ahm S., « Competition, innovation and productivity growth : a review of theory and evidence », Documents de travail du Département des affaires économiques de l'OCDE , n° 317, 2002. |
|
|
• Artus P., « Les entreprises françaises vont-elles recommencer à s'endetter ?», Revue d'Economie Financière , n° 46, 1998. |
|
|
• Artus P. et Genet J., « Investissement aux Etats-Unis et évolutions boursières », CDC Flash , 14 février 2002, n° 37. |
|
|
• Audenis C., Deroyon J., Fourcade N., « L'impact des nouvelles technologies de l'information et de la communication sur l'économie française. Un bouclage macroéconomique », documents de travail de l'INSEE , G 2002/06, mai 2002. |
|
|
• Banque de France, Bulletin de la Banque de France , n° 102, juin 2002. |
|
|
• Banque de France , Bulletin de la Banque de France , n° 104, août 2002. |
|
|
• Banque Magazine, « En 2000, 45 000 entreprises aux guichets de la BDPME », n ° 235, mars-avril 2001. |
|
|
• Bassanini A. et Ernst E., « Labour market institutions, product market regulation, and innovation : cross-country evidence », Documents de travail du département des Affaires économiques de l'OCDE , n° 316, 2002. |
|
|
• Bardos M., « Défaillance d'entreprises et délais de paiement », note pour l'Observatoire des délais de paiement , 1997. |
|
|
• Barel E., Beaux C., Kesler E., Sichel O, Economie politique contemporaine , Armand Colin, édition 2002. |
|
|
• Biais B., Malecot J.F., « Incentives and efficiency in the bankruptcy process : the case of France », The World Bank, Occasional paper n° 23, April 1996. |
|
|
• Bienaymé A., « Les leçons du boom technologique américain », Sociétal , n ° 36, deuxième trimestre 2002. |
|
|
• Bloch L., Coeuré B., « Profitabilité, investissement des entreprises et chocs financiers : France, Allemagne, Etats-Unis et Japon, 1970-1993 », Economie et Statistique , n° 268-269, 1993-8/9. |
|
|
• BNP-Paribas, Conjoncture , juillet-août 2002. |
|
|
• Rapport Bonnefous, « 2000-2006 : Quelles priorités pour les infrastructures de transport », Commissariat général du Plan, 1999. |
|
|
• Bourdieu J., Coeuré B., Sédillot B., « Investissement, incertitude et irréversibilité. Quelques développements récents de la théorie de l'investissement », Revue économique , vol. 48, n° 1, janvier 1997. |
|
|
• Bretin E., Guimbert S. (2002), « Tax competition : to cure or to care ? », Conférence « Corporate and Capital Income Taxation in the European Union : the EU Commission Report on Companies'Taxation and Beyond », Fucam, décembre 2001. |
|
|
• Cette G., Mairesse J. et Kocoglu Y., « Croissance économique et diffusion des TIC, le cas de la France sur longue période », Revue française d'économie , vol. 16, n° 3, 2002. |
|
|
• Chavagneux, C. « Alan Grenspan fait aveu d'impuissance », Alternatives économiques , n° 207, octobre 2002. |
|
|
• Collectif, La Lettre de l'Expansion , n°1626, lundi 30 septembre 2002. |
|
|
• Commission européenne, direction générale des affaires économiques et financières, Economie européenne , n° 71, 2000. |
|
|
• Commission européenne, Rapport Company Taxation in the internal Market , SEC 2001, 1681. |
|
|
• The Conference Board, « Straight Talk », mai 2002. |
|
|
• Conseil national des Impôts, Neuvième rapport au Président de la République, relatif à la fiscalité des entreprises , édition des Journaux officiels, 1987 |
|
|
• Crépon B. et Gianella C. (2001), « Fiscalité et coût d'usage du capital : incidences sur l'investissement, l'activité et l'emploi », Economie et Statistique , n°341-342, 2001. |
|
|
• Crépon B. et Rosenwald F., « Investissement et contraintes de financement, le poids du cycle, une estimation sur données françaises », Document de travail INSEE , 1999. |
|
|
• Deneuve C. « Investissement et situation financière des entreprises », Problèmes économiques , n° 2717, 13 juin 2001. |
|
|
• Didier M. et Lorenzi J.H ., Enjeux économiques de l'UMTS , Rapport du Conseil d'Analyse économique n° 36, La Documentation française, 2002. |
|
|
• Doisy S., « La croissance potentielle de l'économie française. Une évaluation », Revue économique , vol. 53, n° 3, mai 2002. |
|
|
• Dormont B., « L'influence du coût salarial sur la demande de travail », Economie et Statistique , n° 301-302, 1997. |
|
|
• Duhautois R., « Le ralentissement de l'investissement est plutôt le fait des petites entreprises tertiaires », Economie et Statistique , n° 341-342, 2001. |
|
|
• The Economist, article, « Too many debts ; too few calls », 20 juillet 2002. |
|
|
• Epingard P., « Etude d'un objet conceptuel déstabilisant. L'investissement immatériel », Revue économique , vol. 49, n °6, novembre 1998. |
|
|
• Goodsbee S., «The importance of measurement error in the cost of capital », National Tax Journal , 53 (2) juin 2000. |
|
|
• Greenan N., et L'Horty Y. « Le paradoxe de la productivité », Travail et Emploi , n ° 91, juillet 2002. |
|
|
• Guellec D., « Les politiques de soutien à l'innovation technologique à l'aune de la théorie économique », Economie et Prévision , n° 150-151, 2001, 4-5 |
|
|
• Guellec D. et van Pottelsberghe de la Potterie B., « Le soutien des pouvoirs publics stimule-t-il la RD privée ? », Revue économique de l'OCDE , n° 29, 1999. |
|
|
• Guimbert, S. « Réformes de la fiscalité du capital en Europe », Revue française d'économie , n°4, vol. XVI. |
|
|
• Hayashi F., « Tobin's marginal q. and average q : a neoclassical interpretation », Econometrica, vol. 50, n° 1, 1982. |
|
|
• Herbet J.B., « Peut-on expliquer l'investissement à partir de ses déterminants traditionnels au cours de la décennie 90 ? », Economie et Statistique , n° 341-342, 2001. |
|
|
• Herbet J.B et Michaudon H., « Y a-t-il un retard d'investissement en France depuis le début des années 1990 ? », Document de travail INSEE , 1999. |
|
|
• INSEE, L'économie française , édition 1998-1999, « Le partage de la valeur ajoutée », p. 63-90, 1998. |
|
|
• INSEE, L'Economie française , éd. 1999-2000, « Faiblesse de l'investissement depuis 1990 et financement », p. 49-70, 1999. |
|
|
• Khaber R., Parisot C., Mourier J.-L., « Le spectre du surinvestissement », Le Point de Conjoncture - Aurel Leven , janvier 2001 |
|
|
• Lachmann J., « Le capital-risque au coeur du financement de l'innovation des PME », Problèmes économiques , n° 2658, mars 2000. |
|
|
• Lhomme Y., « Comment se financent les projets innovants dans l'industrie ? », Le 4 pages des statistiques industrielles , n° 156, novembre 2001. |
|
|
• Malinvaud E., « Capital productif, incertitude et profitabilité », Annales d'économie et de statistique , n° 5, 1987. |
|
|
• Maurin L., « Pourquoi l'investissement est en panne ? », Alternatives économiques , n °148, mai 1997. |
|
|
• Michaudon H. et Vannieuwenhuyze N., « Peut-on expliquer les évolutions récentes de l'investissement ? », Note semestrielle de conjoncture de l'INSEE , mars 1998 ; |
|
|
• Muet P.A., « Les modèles «néo-classiques», et l'impact du taux d'intérêt sur l'investissement », Revue économique , n° 2, mars 1979. |
|
|
• Nakamura JL., « La relation Banque-PME », Revue d'économie financière , n°54, 1999. |
|
|
• OCDE, Perspectives économiques de l'OCDE , n° 71, 2002. |
|
|
• OCDE, L'étude de l'OCDE sur l'emploi. Investissement, productivité et emploi , 1995. |
|
|
• Postel-Vinay O., « Quel avenir pour la science française ? », Problèmes économiques , n ° 2769, 10juillet 2002. |
|
|
• Reiffers V., « Une mise en perspective des déterminants de l'investissement. Rôle du Q de Tobin sur la période 1972-1991 en France », Revue économique , vol. 46, n ° 4, juillet 1995. |
|
|
• Rexecode, « La position de la France dans les technologies de l'information », Revue de Rexecode , n° 71, 2 ème trimestre 2001. |
|
|
• Rosenwald F., « Le financement de l'investissement des petites entreprises industrielles : la place prépondérante de l'autofinancement », Revue d'économie financière, n °54, 1999 . . |
|
|
• Saint Etienne C., « La nouvelle économie a besoin de réseaux », Sociétal , n° 37, 3 ème trimestre 2002. |
|
|
• Scarpetta S., Hemmings P., Tressel T. et Woo J., « The role of policy and institutions for productivity and firm dynamics : evidence from micro and industry data », Document de travail du département des affaires économiques de l'OCDE , n° 329. |
|
|
• Sylvain A, « Rentabilité et profitabilité du capital : le cas de six pays industrialisés », Economie et Statistique , n° 341-342, 2001. |
|
|
• Timbeau X., « Le partage de la valeur ajoutée en France », Revue de l'OFCE , n° 80 janvier 2002. |
|
|
• Tobin J., « A general equilibrium approach to monetary theory », Journal of Money , Credit and Banking , n° 1, 1969. |
ANNEXE
1 :
COMPTE-RENDU DE L'AUDITION DE M. BRUNO
CRÉPON,
ADMINISTRATEUR DE L'INSEE, LE 5 JUIN 2002
Cette audition porte sur un important aspect théorique des déterminants de l'investissement, à savoir le rôle joué par le coût des facteurs de production. MM. Bruno Crépon, et Christian Gianella, administrateurs de l'INSEE , sont les auteurs d'une étude 83 ( * ) relative à l'incidence du coût du capital sur le comportement d'investissement des entreprises. M. Bruno Crépon est venu présenter oralement à votre rapporteur les principaux résultats de ce travail de recherche.
M. Bruno Crépon, administrateur de l'INSEE , a introduit son exposé en évoquant l'importance de l'investissement comme facteur de croissance. Il a souligné le rôle joué par les investissements en technologies de l'information et de la communication dans la croissance américaine. Il a ensuite présenté les principaux résultats de ses travaux.
Il a d'abord rappelé que, dans les modèles néo-classiques traditionnels, l'investissement dépendait de la variation du coût des facteurs de production, mais que les économètres avaient longtemps échoué à mettre en évidence un impact significatif du coût du capital sur l'investissement. MM. Bruno Crépon et Christian Gianella sont les premiers à être parvenus à mettre en évidence un effet significatif d'une variation du coût du capital sur l'investissement.
M. Bruno Crépon a précisé quels étaient les contours de la notion de « coût d'usage du capital », utilisée dans son étude. Le coût d'usage du capital dépend du niveau des taux d'intérêt, mais aussi de la fiscalité. Du fait de l'application de règles fiscales différentes, le coût d'usage du capital varie selon que l'entreprise se finance par emprunt bancaire, émission d'action ou en réinvestissant ses bénéfices. Le coût d'usage du capital est donc différent d'une entreprise à une autre.
Cette remarque a d'importantes conséquences méthodologiques. L'étude réalisée par MM. Crépon et Gianella repose, en effet, sur l'analyse de données individuelles d'entreprises. Le coût d'usage du capital est évalué pour chaque entreprise séparément, en fonction des caractéristiques de sa structure de financement.
M. Bruno Crépon a ensuite relevé quelques faits saillants, relatifs à la distribution du coût du capital, et à son évolution :
* le coût d'usage du capital a baissé entre 1984 et 1997, principalement sous l'effet de la détente des taux d'intérêt réels ;
* la fiscalité n'a contribué que marginalement à la baisse du coût d'usage du capital ; ses évolutions ont été importantes, mais erratiques : baisse de l'impôt sur les sociétés jusqu'au milieu des années 1990, mais accroissement rapide de la pression fiscale à partir de 1995.
* les taux d'intérêt bancaires se caractérisent par une forte hétérogénéité entre entreprises; les petites entreprises ont des conditions de financement moins favorables, car elles présentent de moindres garanties ; l'accès au crédit des PME se détériore dans les périodes de stagnation de l'activité ;
* La dispersion du coût du capital a, cependant, baissé, de 1984 à 1997, grâce à la convergence des conditions de financement des entreprises via l'emprunt bancaire, et à la baisse du coût des fonds propres.
Une analyse plus fine montre que les deux composantes du coût du capital coût de l'endettement et coût des fonds propres ont connu des évolutions divergentes. Le coût moyen de la dette est resté stable autour de 8 %. En revanche, le coût des fonds propres a fortement baissé, passant de vingt points en 1984, à 11 points en 1997. Cette baisse relative du coût des fonds propres a incité les firmes françaises à se désendetter : la part moyenne des dettes dans le bilan des entreprises est passée de 51 % en 1990, à 42 % en 1997.
La baisse des taux d'intérêt réels se répercute sur le coût des fonds propres de la manière suivante : la baisse des taux réduit le rendement des obligations d'Etat, ce qui conduit les associés à être moins exigeants quant au rendement de leurs actions.
M. Bruno Crépon a ensuite présenté les conséquences de la variation du coût d'un facteur de production sur la demande de facteurs. Deux effets doivent ici être distingués : un effet de substitution et un effet de profitabilité.
Une hausse du coût du capital, par rapport au coût du travail, incite les entreprises à réduire l'intensité capitalistique de leur combinaison productive. C'est ce que l'on appelle l'effet de substitution. Il est d'autant plus prononcé que l'élasticité de substitution entre les facteurs est importante.
En même temps, une hausse du coût du capital augmente le coût de production unitaire pour l'entreprise. Si cette hausse se répercute sur les prix, la demande adressée à l'entreprise va se réduire. L'ampleur de cette réduction dépend de la sensibilité au prix de la demande adressée à l'entreprise.
Comme l'a fait remarquer M. Bruno Crépon , effet de substitution et effet de profitabilité ont des conséquences opposées sur la demande de travail. D'une part, l'activité de l'entreprise devient plus intensive en main d'oeuvre, ce qui fait augmenter la demande de travail. Mais, d'autre part, la production de l'entreprise se réduit, ce qui diminue la demande de travail. L'effet de substitution, ou l'effet de profitabilité peuvent prédominer, en fonction des possibilités de substitution entre les facteurs, et du degré de sensibilité de la demande au prix.
Après ces considérations théoriques, M. Bruno Crépon a donné une estimation de l'importance relative des effets de substitution et de profitabilité. Il a indiqué que l'élasticité de substitution entre capital et travail était modeste : elle serait de l'ordre de 0,7 dans l'industrie, et de 0,4 dans le tertiaire. En revanche, l'effet de profitabilité apparaît très significatif (2,32). Ainsi, l'effet de profitabilité l'emporte de beaucoup sur l'effet de substitution. L'effet de déformation de la combinaison productive est plus que compensé par la baisse de la demande adressée à l'entreprise. En conséquence, une hausse du coût du capital entraîne une baisse de la demande de travail.
Dans la dernière partie de son exposé, M. Bruno Crépon a présenté les résultats d'une simulation, dont l'objet était d'évaluer l'impact sur la demande de facteurs (investissement et emploi), qu'aurait eu, en 1995, une augmentation du taux de l'impôt sur les sociétés de 36,7 à 50 %.
En premier lieu, un tel relèvement du taux de l'IS aurait conduit à une augmentation sensible du coût d'usage du capital, évaluée à 9 % en moyenne. Ce relèvement du coût du capital aurait fait sentir ses effets de manière différenciée selon les entreprises. Les entreprises les plus endettées auraient supporté une hausse moins prononcée du coût du capital. Une répartition des entreprises par quartile, en fonction de leur endettement, montre que le surcoût se situe aux alentours de 5,5 % pour le premier quartile, de 12,5 % pour le troisième.
En second lieu, le coût relatif du capital augmentant, l'intensité capitalistique désirée se réduit, plus fortement dans l'industrie (-6 % en moyenne), que dans le tertiaire (- 3,1 %). Cette répercussion plus faible dans le tertiaire s'explique par de moindres possibilités de substitution entre facteurs.
Enfin, la simulation met en évidence une baisse de la production (en valeur), ainsi qu'une diminution du volume de chacun des facteurs. La baisse est toutefois plus prononcée pour le facteur capital que pour le facteur travail. Elle atteint des niveaux particulièrement importants dans le tertiaire (- 12 % en moyenne), secteur où la baisse de l'activité est aussi plus prononcée (- 4 %).
En conclusion, M. Bruno Crépon a rappelé que cette étude mettait en évidence, de manière convaincante, un effet du prix des facteurs de production sur les décisions des entreprises relatives au volume de ces facteurs. Cet effet est quantitativement important. L'effet de profitabilité affecte l'ensemble des facteurs de production. L'effet de substitution vient le tempérer, ou l'accentuer, mais ne le remet jamais en cause. Ainsi, une hausse du coût du capital conduit à une baisse des effectifs : la croissance est plus riche en emplois, mais la croissance est moindre.
M. Joseph Kerguéris, sénateur, rapporteur , a alors demandé quels seraient les effets, probables, sur l'emploi, d'une taxation de la valeur ajoutée des entreprises, qui viendrait se substituer aux cotisations sociales, uniquement assises sur le facteur travail. Une telle mesure élèverait le coût d'usage du capital.
M. Bruno Crépon a répondu que l'impact d'une telle réforme serait très différencié selon les entreprises. Les entreprises de main d'oeuvre seraient bien sûr les plus avantagées. On peut supposer qu'elles gagneraient d'importantes parts de marché aux dépens des entreprises plus intensives en capital. L'effet redistributif entre entreprises d'une telle réforme serait considérable, et conduirait à de nombreuses réallocations d'emplois. Une telle mesure pénaliserait, par construction, les entreprises intensives en capital, qui sont souvent les plus innovantes. Or, à long terme, les sources profondes de la croissance sont à chercher dans les chocs d'innovation, qui sont associés à des conditions de financement des projets favorables.
ANNEXE
2 :
COMPTE-RENDU DE L'AUDITION DE
M. CHRISTOPHE RUDELLE, ET DE
MME LUCILE SIMON, CONSULTANTS AU BIPE, SPÉCIALISÉS DANS LE
SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (23 JUILLET 2002).
M. Christophe Rudelle, consultant au BIPE , a commencé son exposé en rappelant l'une des principales caractéristiques du secteur des télécommunications : il s'agit d'une industrie d'infrastructures, qui nécessite de lourds investissements, rentables seulement sur le long terme. Déjà dans les années 1970, le plan « Téléphone pour tous » avait nécessité plus de 35 milliards d'euros d'investissement 84 ( * ) , qui avaient généré un lourd endettement.
Au cours de ces dernières années, le secteur des télécommunications a, de nouveau, mobilisé des capitaux considérables. A titre d'illustration, le secteur des télécoms a été à l'origine, en 2001, de 50 % des émissions d'obligations privées dans le monde 85 ( * ) . Les financements (dettes et fonds propres) accordés au secteur des télécommunications, au niveau mondial, seraient passés de 110 milliards de dollars en 1995, à plus de 440 milliards en 2000. Les crédits accordés aux sociétés européennes atteignent 300 milliards de dollars (à peu près autant d'euros) début 2002.
Le risque supporté par les banques européennes, s'il est réel, semble néanmoins relativement limité. Le risque de non-paiement est évalué à 14 milliards d'euros pour l'ensemble des sociétés européennes. Selon le cabinet Fitch, les télécoms représentent moins de 5 % des encours totaux des banques françaises.
M. Christophe Rudelle a précisé à quels usages ces capitaux avaient été employés. Ces capitaux ont servi à financer des investissements en infrastructures, mais aussi d'importantes opérations de croissance externe. En 2000, les opérations de croissance externe ont occupé une place prépondérante dans les investissements de France Télécom.
En revanche, les opérateurs historiques, comme les équipementiers, ont eu tendance à réduire leurs investissements en recherche et développement, et leur effort d'innovation. Ainsi, les dépenses en RD de France Télécom, qui représentaient 4 % de son chiffre d'affaires en 1987, n'en représentaient plus que 1 % en 2001. Les entreprises ont privilégié, un temps, la recherche de la rentabilité à court terme (de 18 à 24 mois), au détriment de leurs programmes de recherche. Les entreprises de télécommunications traditionnelles ont également été confrontées, durant quelques années, à un certain tarissement des compétences disponibles sur le marché du travail, en raison de l'engouement de nombreux chercheurs pour les « start-up ».
M. Christophe Rudelle a ensuite évoqué la crise de surinvestissement qui affecte aujourd'hui le secteur. Il a souligné que de nombreux projets de construction de réseaux supplémentaires avaient été abandonnés en Europe, ces trois dernières années, du fait de l'apparition d'importantes surcapacités. Un tiers seulement, par exemple, des fibres transatlantiques installées sont actuellement utilisées.
Le surinvestissement s'explique par des anticipations de demande déraisonnables, voire irrationnelles. Il a, en outre, été encouragé par l'appréciation remarquable du cours de Bourse des entreprises du secteur, qui a facilité le financement de leurs investissements.
Interrogé sur les raisons de la formation de ces anticipations irrationnelles, M. Christophe Rudelle a souligné le lien entre anticipations et cours boursiers : formuler des anticipations de demande exagérément optimistes était aussi une manière de justifier des cours de Bourse excessivement élevés. Par ailleurs, la rationalité de chaque acteur pris individuellement peut être tenue en échec par une logique collective qui s'impose à tous ; une entreprise qui n'aurait pas participé au mouvement général d'investissement et de concentration du secteur se serait immédiatement mise hors jeu.
Il a ensuite décrit l'enchaînement ayant conduit à la « bulle » de la nouvelle économie : la demande en technologies de l'information et de la communication (TIC) a augmenté, alimentant la croissance de l'investissement des entreprises du secteur ; la croissance de l'investissement a été financée par une expansion du crédit; la progression rapide de la production des entreprises de télécommunications, comme des équipementiers, a fait naître des anticipations très positives quant aux perspectives de croissance du secteur, encore renforcées par les discours autour du thème de la « Nouvelle Economie »; ces anticipations positives ont suscité un afflux de capitaux, à l'origine de la forte appréciation des cours boursiers ; l'appréciation des cours boursiers a créé un effet de richesse positif, qui a incité à augmenter encore les investissements. Ce cercle vertueux a soutenu la forte croissance du secteur.
Mais l'épisode de la vente des licences UMTS ( Universal Mobile Telecommunication Systems ) a renversé les anticipations, et brisé le cycle de croissance de l'investissement. La chute des cours de Bourse a entraîné un important effet de richesse négatif, à l'origine d'un rationnement du crédit aux entreprises de télécommunications (« credit-crunch »), malgré la baisse concomitante des taux d'intérêt. Lourdement endettés, et privés d'un accès facile au financement, les opérateurs sont contraints de réduire fortement leurs investissements, et certains sont menacés de disparaître (World Com, deuxième opérateur mondial, est en faillite). Le secteur des télécommunications n'est pas victime d'une insuffisance de la demande, mais d'une véritable crise de l'offre.
M. Christophe Rudelle a souligné que les investissements des entreprises de télécommunications présentent des caractéristiques propres aux investissements des entreprises innovantes : une rentabilité extrêmement incertaine ; une très forte sensibilité aux anticipations de marché ; des coûts fixes élevés ; des coûts variables faibles.
On peut voir, dans le surinvestissement, le résultat d'un aveuglement collectif. On peut aussi l'interpréter comme la conséquence d'un « pari mortel » fait par les opérateurs de télécommunications : il fallait survivre à la concentration à l'oeuvre dans le secteur, afin de faire partie des trois ou quatre grands acteurs européens qui devaient, à terme, contrôler le marché. A la perspective de faire partie des quelques opérateurs détenant une position dominante, était associée la promesse de profits élevés. La stratégie des entreprises a donc été marquée par une logique de « casino » : il s'agissait de « tout gagner ou de tout perdre ». L'ampleur des gains espérés a justifié une importante prise de risque.
M. Christophe Rudelle a ensuite expliqué que l'offre de télécommunications tendait effectivement à se structurer en oligopole. Le nombre d'opérateurs décroît, mois après mois, en raison de la liquidation de certaines entreprises, et d'opérations de fusion-absorption. La réduction du nombre d'opérateurs conduit à un relâchement de la pression concurrentielle. Le mouvement de baisse des prix s'atténue en conséquence, et on note même des hausses de tarif dans certains domaines (accès à Internet par exemple). M. Joseph Kerguéris, sénateur, rapporteur , s'est félicité de l'évolution du marché vers une structure oligopolistique ; il estime en effet que les caractéristiques du marché des télécommunications (importance des coûts fixes, montant élevé des dépenses en recherche et développement) appellent la constitution de grands opérateurs européens. Il a relevé la contradiction qui peut exister entre le souhait de certains Etats, dont la France, de conserver des champions nationaux, et l'évolution du marché européen vers une structure oligopolistique.
Suite à cette phase de surinvestissement, le secteur des télécommunications se trouve dans une situation paradoxale : la situation financière des entreprises est très dégradée, alors que les fondamentaux économiques du secteur restent favorablement orientés. Le marché français des télécommunications croît, par exemple, de 10 % par an. Et le taux de pénétration du téléphone mobile sur le marché français est de seulement 61 %, contre une moyenne européenne de 76 %, ce qui laisse penser qu'il existe encore d'importantes marges de croissance dans ce secteur.
Le secteur des télécommunications est aujourd'hui confronté à une véritable pénurie d'investissements. Les opérateurs restants consacrent leurs ressources au désendettement, et la communauté bancaire a développé une forte aversion pour le secteur, ce qui réduit fortement les possibilités de nouveaux emprunts. Or des investissements restent nécessaires, par exemple pour développer la boucle locale haut débit, ou pour assurer le lancement de l'UMTS. Ces investissements supplémentaires doivent permettre de préserver la compétitivité européenne dans le secteur des TIC, ainsi que le leadership des constructeurs et opérateurs européens.
M. Christophe Rudelle a indiqué que les faillites dans le secteur pourraient accélérer le retour à l'équilibre du marché. Mais il arrive fréquemment que les actifs des entreprises en faillite soient repris par un concurrent, pour un prix symbolique, ce qui ralentit le rythme de résorption des surcapacités. Deux à trois années seront vraisemblablement nécessaires pour que la situation financière du secteur s'assainisse, en l'absence de toute intervention publique.
M. Christophe Rudelle , pour conclure son intervention, a posé la question de l'intérêt d'une ré-implication des pouvoirs publics dans le secteur des télécommunications. Une action peut être envisagée au niveau national et européen. Deux pistes de réflexion ont été, plus particulièrement suggérées : un soutien public accru à la recherche, d'une part, et une éventuelle nationalisation de la boucle locale 86 ( * ) , d'autre part. M. Joseph Kerguéris , rapporteur, sénateur , a approuvé l'idée d'un renforcement du soutien public à la recherche, en rappelant son importance cruciale, notamment pour faire face à la concurrence américaine.
M. Joseph Kerguéris, sénateur, rapporteur , a également noté que l'enjeu central, pour la prospérité du secteur, était le développement des services de télécommunications, davantage que celui des infrastructures. Mme Lucile Simon, consultante au BIPE , a approuvé ce point de vue, en s'appuyant sur le cas de l'UMTS (téléphonie de troisième génération). Il ne suffit pas de mettre au point une technologie performante, il faut aussi une offre de services à même de séduire les consommateurs. Or, il est très difficile d'anticiper quels usages les clients feront de cette nouvelle technologie. C'est ce qui explique que les calculs de profitabilité relatifs à l'UMTS soient si délicats et incertains.
En réponse à une question de M. Joseph Kerguéris, sénateur, rapporteur , M. Christophe Rudelle a ajouté que le surinvestissement dans les télécommunications avait pu priver de sources de financement d'autres secteurs d'activité, conduisant à des sous-investissements sectoriels. Il a cité en particulier le cas du secteur de l'électricité aux Etats-Unis. Il a également signalé que, depuis deux ans, les sommes investies au titre du capital-risque s'étaient effondrées, ce qui fait peser une menace sur le financement de l'innovation future.
M. Joseph Kerguéris, sénateur, rapporteur , a évoqué le problème de l'actionnariat de France Télécom. Mme Lucile Simon a d'abord indiqué qu'il n'y avait pas de relation évidente entre le caractère, public ou privé, de l'actionnariat, et la situation financière des entreprises. L'Etat détient certes la majorité (55 %) des actions de France Télécom, mais des entreprises étrangères, contrôlées majoritairement par des capitaux privés, sont dans une situation financière qui n'est guère plus favorable ( cf . Deutsche Telekom, ou World Com). Elle a, en revanche, relevé la position singulière dans laquelle se trouve l'Etat français : il est à la fois acteur du marché des télécommunications, via l'entreprise France Télécom, mais aussi organisateur, et régulateur, de la concurrence sur le marché. Cette situation est, potentiellement, source de conflits d'intérêts.
ANNEXE
3 :
COMPTE-RENDU DE L'AUDITION DU 10 SEPTEMBRE 2002,
DE MME
FRANÇOISE GRI, PDG D'IBM FRANCE,
ET DE M. JEAN-PATRICE SAVEREUX,
DIRECTEUR DES RELATIONS EXTÉRIEURES D'IBM FRANCE
Mme Françoise Gri, Président-Directeur Général d'IBM France , a commencé son intervention par une présentation générale de l'entreprise IBM. Leader mondial dans le secteur de l'informatique, IBM a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires de plus de 88 milliards de dollars, et emploie 316 000 salariés. La filiale française d'IBM représente un chiffre d'affaires d'environ 4,7 milliards d'euros, dont un quart est réalisé à l'export, et emploie 13 600 salariés sur le territoire national.
L'activité d'IBM a évolué pour s'adapter aux demandes du marché; ainsi, la part des services dans le chiffre d'affaires de l'entreprise est aujourd'hui supérieure à celle de la production et de la vente de matériel informatique. IBM est devenue la première société de services dans le monde, et ses effectifs se sont transformés en conséquence.
L'entreprise a été fortement restructurée après la période difficile qu'elle a connue au début des années 1990. Du fait de l'intensification de la concurrence, la nécessité d'une adaptation permanente de l'entreprise aux évolutions de son marché a été soulignée.
Le siège d'IBM Europe est localisé à Paris. IBM dispose également sur le territoire français d'un centre de recherche, de cinq directions régionales à vocation commerciale, et de deux usines, qui produisent pour le marché européen, et produiront bientôt pour le marché mondial.
Mme Françoise Gri a souligné l'importance des investissements en recherche et développement pour une entreprise de haute technologie comme IBM. Six milliards de dollars sont dépensés chaque année, dans le monde, à ce titre. Le coût élevé de chaque investissement implique une recherche d'optimisation, qui exclut toute redondance; les programmes de recherche initiés dans un pays doivent donc profiter à l'ensemble du groupe.
Mme Françoise Gri a ensuite exposé l'enjeu majeur que représente le recrutement en France de personnels très qualifiés, notamment pour les activités de services. Le risque de délocalisation des activités de services est aujourd'hui une réalité. Pour IBM France, la concurrence provient notamment d'Inde, et des pays d'Europe centrale et orientale. Ces pays disposent d'une main-d'oeuvre qualifiée, et moins coûteuse que la main-d'oeuvre française. La fourniture de prestations intellectuelles devient l'un des enjeux majeurs pour la compétitivité des nations, ce qui pose le problème de l'insertion future sur le marché du travail des travailleurs peu qualifiés.
Mme Françoise Gri a indiqué que les filiales géographiques d'IBM étaient en concurrence pour la captation des missions opérationnelles ou de recherche. A titre d'illustration, l'activité « comptabilité fournisseur », à l'échelle de l'Europe, a récemment été confiée à la filiale allemande du groupe. Ce choix peut surprendre, mais s'explique par la présence d'un centre administratif à Bratislava, piloté par la filiale allemande. M. Joseph Kerguéris, sénateur, rapporteur, a souligné qu'un pays développé pouvait bénéficier, quant à sa capacité à attirer les investissements internationaux, de la proximité de pays à bas coût de main-d'oeuvre.
Mme Françoise Gri a souligné que les PME participaient, indirectement, au mouvement de délocalisation des activités. En effet, ces entreprises font souvent appel à des firmes multinationales, comme IBM, pour la fourniture de prestations de services, au lieu de réaliser ces activités en interne.
Mme Françoise Gri a ensuite passé en revue les principaux éléments pris en considération dans le cadre de l'entreprise au moment de décider de la localisation d'un investissement (les éléments du « business case »).
La répartition des investissements entre filiales est d'abord dépendante des performances commerciales de chaque entreprise sur son marché national. Une filiale qui perd des parts de marché sera désavantagée par rapport aux autres.
Le coût du travail est aussi un déterminant majeur des décisions d'investissement. Mais il ne doit pas être considéré indépendamment de la qualité du personnel. A cet égard, Mme Françoise Gri a indiqué que la qualité du personnel français permettait de compenser l'écart de coût observé entre la France et des pays à plus bas salaires. La fiscalité sur les hauts revenus, plus lourde en France que chez nos voisins, représente une charge. Pour attirer et retenir en France des managers ou des chercheurs de haut niveau, IBM gère, en interne, le différentiel fiscal; autrement dit, l'entreprise garantit à ces salariés un certain niveau de rémunération après impôt, et prend en charge la différence. Un statut fiscal des impatriés permettrait d'améliorer l'attractivité de la France. IBM n'a pas, jusqu'ici, rencontré de difficultés de recrutement de personnel qualifié telles qu'elles l'aient amené à restreindre ses investissements. Mme Françoise Gri a porté un jugement globalement positif sur les performances du système éducatif français, mais a regretté le manque d'ouverture internationale de certaines filières de formation (en économie, en sciences de l'ingénieur), qui oblige l'entreprise à fournir, en interne, une formation complémentaire aux jeunes diplômés, notamment pour leur assurer un bon niveau en langue anglaise. L'enseignement universitaire est jugé encore trop théorique, au regard des besoins des entreprises. Enfin, on ne peut exclure, d'ici une dizaine d'années, un manque de personnel qualifié dans le secteur des technologies de l'information, du fait de l'insuffisance du système français de formation en ce domaine. Les besoins des entreprises risquent de croître plus rapidement que le nombre de diplômés formés à ces technologies nouvelles, si l'on s'en tient aux tendances actuelles.
La flexibilité de l'économie est un autre atout majeur dans la compétition internationale pour attirer les flux d'investissements. Or, à cet égard, investir en France est souvent considéré comme un « piège », en ce sens que les coûts de sortie de l'investissement sont très élevés. Une fois réalisé, l'investissement devient presque irréversible. Le coût et la longueur, supérieure à 200 jours, des procédures de licenciements collectifs sont particulièrement mis en cause. La lenteur des procédures sociales est jugée inadaptée au rythme rapide de la vie des affaires.
Mme Françoise Gri a, par ailleurs, souligné que les éléments objectifs contenus dans le « business case » étaient généralement pondérés par le facteur d'image associé au pays. Cette image, qui n'est pas toujours le reflet fidèle de la réalité, pèse dans les décisions de localisation des investissements. M. Joseph Kerguéris, sénateur, rapporteur, a rappelé que des éléments irrationnels pouvaient influencer les décisions entrepreneuriales. Or, selon les deux intervenants, l'image de la France perçue par les investisseurs étrangers se serait dégradée, du fait notamment de l'introduction des 35 heures, qui vient s'ajouter à une réputation ancienne de forte conflictualité sociale.
M. Joseph Kerguéris, sénateur, rapporteur, a demandé si une délocalisation du siège d'IBM Europe était parfois envisagée. Mme Françoise Gri a alors indiqué que la question centrale était de savoir combien d'emplois étaient en fait attachés au siège. Il est en effet possible de ne conserver au sein du siège qu'un nombre réduit de managers, en délocalisant toutes les fonctions de support. La qualité du cadre de vie est un élément important dans le choix de localisation d'un siège, et, de ce point de vue, Paris est fort bien placé. La fiscalité des personnes physiques peut être un élément de choix, mais, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, IBM gère en interne les différences en matière d'imposition du revenu.
Interrogé sur les implications en matière d'impôt sur les sociétés de la localisation du siège à Paris, M. Jean-Patrice Savereux, directeur des relations extérieures d'IBM France, a indiqué qu'il n'y avait pas de consolidation du chiffre d'affaires européen au niveau français. Chaque filiale nationale paie l'impôt sur les bénéfices en fonction des règles d'imposition propres à son Etat d'implantation.
En réponse à une question évoquant un éventuel phénomène de surinvestissement dans le secteur informatique, Mme Françoise Gri a considéré qu'il y avait lieu de distinguer entre les phénomènes boursiers, et les phénomènes réels. Il a y eu incontestablement une « bulle » boursière, liée à l'engouement passager pour la « net-économie », suivie d'une forte chute des cours. Mais il n'y a pas eu de surinvestissement dans la sphère réelle. L'apparition de surcapacités au cours de l'année 2002 résulte d'un brutal retournement du marché. A la fin des années 1990, la demande en matériels et services informatiques progressait à un rythme de 10 % l'an. L'année 2002 marque une rupture, puisque le marché devrait se contracter par rapport à 2001. Ce retournement est le plus fort observé depuis 25 ans, et n'avait pas été anticipé à ce niveau. Il impose à l'entreprise un important effort de réduction de ses coûts de structure.
La croissance du PIB français reste relativement soutenue par rapport à la moyenne européenne, mais les entreprises investissent fort peu, notamment dans le domaine informatique. Mme Françoise Gri y a vu le signe d'un manque persistant de confiance dans l'avenir, de la part des entreprises nationales, résultant d'appréciations sur la situation structurelle du pays.
M. Jean-Patrice Savereux a fait remarquer qu'il était très difficile d'anticiper les retournements du marché, et d'adapter les investissements en conséquence. Et, quand bien même les retournements du marché seraient parfaitement anticipés, l'entreprise manquerait de la flexibilité nécessaire pour adapter ses capacités de production aux nouvelles anticipations dans un délai rapide. Pour réduire le montant de leurs investissements irréversibles, les entreprises externalisent un nombre croissant d'activités. C'est une manière de reporter sur d'autres agents économiques les difficultés et les coûts liés à une restructuration.
A moyen terme, Mme Françoise Gri estime qu'il est peu probable que le marché informatique progresse à nouveau à un rythme de 10 % l'an. L'économie française se caractérise pourtant par un net retard d'investissement en informatique par rapport aux Etats-Unis, ce qui pourrait laisser envisager un phénomène de rattrapage. En réalité, les entreprises françaises cherchent aujourd'hui un investissement informatique efficace et rationalisé. La croissance du marché informatique ne devrait donc pas excéder 5 % par an à l'avenir.
M. Joseph Kerguéris, sénateur, rapporteur, a relevé que les entreprises françaises souffraient aussi d'un retard dans le développement de leurs activités logistiques. M. Jean-Patrice Savereux a confirmé ce point de vue, en indiquant que le retard français en la matière pouvait être évalué à trois ou quatre ans.
Mme Françoise Gri a conclu son intervention en indiquant qu'un engagement clair en faveur de la baisse des dépenses publiques serait un signal apprécié par les investisseurs internationaux. Un tel engagement rendrait en effet crédible la perspective d'une baisse durable des prélèvements obligatoires.
ANNEXE
4
LES DÉTERMINANTS DE L'INVESTISSEMENT
ÉTUDE RÉALISEE PAR L'INSTITUT REXECODE
Sommaire
INTRODUCTION 127
CHAPITRE 1
PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L'ÉTUDE 131
1. L'ÉVOLUTION RÉCENTE DE L'INVESTISSEMENT EN FRANCE 132
2. LES TENDANCES LONGUES DE L'INVESTISSEMENT EN FRANCE 134
3. LA POSITION DE LA FRANCE VIS À VIS DES AUTRES PAYS ÉTUDIÉS 139
4. LES FLUX D'INVESTISSEMENTS ENTRE LA FRANCE ET L'ÉTRANGER 148
5. UN RETARD FRANÇAIS DE L'INVESTISSEMENT DANS LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 156
6. LES ENJEUX D'UNE POLITIQUE DE L'INVESTISSEMENT 157
CHAPITRE 2
L'INVESTISSEMENT : DÉFINITION ET CONCEPT 168
1. LA FBCF : UNE CONCEPTION LIMITATIVE DE L'INVESTISSEMENT 168
2. LES DIFFÉRENTS SECTEURS INVESTISSEURS 173
CHAPITRE 3
LES DÉTERMINANTS DE L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF 177
1. LE MODÈLE NÉO-CLASSIQUE PUR 177
2. LE MODÈLE DE L'ACCÉLÉRATEUR SIMPLE 182
3. LE MODÈLE ACCÉLÉRATEUR PROFIT 183
4. LE Q DE TOBIN 187
CHAPITRE 4
L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF EN FRANCE 188
1. EVOLUTION DE L'INVESTISSEMENT DE 1970 À 2001 188
2. LA DYNAMIQUE DE L'INVESTISSEMENT S'EXPLIQUE PAR LES DÉTERMINANTS CLASSIQUES 190
3. A LA RECHERCHE DES DÉTERMINANTS DE L'INVESTISSEMENT : LE RÔLE DES CONTRAINTES FINANCIÈRES 200
CHAPITRE 5
L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF EN ALLEMAGNE 206
1. EVOLUTION DE L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF DE 1970 À 2001 206
2. LA PROFITABILITÉ ET L'INVESTISSEMENT 210
3. L'INFLUENCE DU MARCHÉ EXTÉRIEUR 212
4. ANALYSES EMPIRIQUES EN ALLEMAGNE SUR L'INFLUENCE DES TAUX D'INTÉRÊT 212
CHAPITRE 6
EVOLUTION DE L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF AU ROYAUME-UNI 215
1. CYCLES DE L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF ET CYCLES ÉCONOMIQUES 215
2. LA FAIBLESSE DE L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF AU DÉBUT DES ANNÉES 1990 : QUELS FACTEURS EXPLICATIFS ? 217
3. ANALYSE THÉORIQUE ET EMPIRIQUE DE L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF 220
L'APPROCHE PAR LE Q DE TOBIN 220
CHAPITRE 7
EVOLUTION DE L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF AUX ETATS-UNIS 224
1. LE BOOM DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 225
2. LA CRISE IMMOBILIÈRE DATE DU DÉBUT DES ANNÉES 1980 228
3. LA PROFITABILITÉ S'AMÉLIORE EN 1992 229
4. LES ANALYSES QUANTITATIVES DOIVENT PRENDRE EN COMPTE L'EFFET DES TIC 231
BIBLIOGRAPHIE 233
INTRODUCTION
Les années quatre-vingt-dix ont été relativement médiocres pour l'investissement productif en France. Dans la première partie de la décennie, les déficits publics excessifs, les taux d'intérêt élevés imposés par la contrainte de change et les politiques visant explicitement à modifier la combinaison capital-travail ont déprimé l'investissement. Dans la deuxième partie de la décennie, la réduction des déficits publics mise en oeuvre en 1995 et la forte baisse des taux d'intérêt qui en est résulté ont permis un retour de la croissance économique et une reprise de l'investissement. Cette reprise s'est interrompue depuis dix-huit mois. Un risque pèse à nouveau sur la dynamique de l'investissement.
L'objet de la présente étude est d'apprécier le niveau actuel de l'investissement au regard des tendances longues en France et dans les autres grands pays, et d'examiner les orientations susceptibles de soutenir l'effort d'investissement dans les années à venir. Trois pays ont été retenus pour les comparaisons : les Etats-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni.
De 1970 à 2000, le volume de l'investissement brut productif a progressé en moyenne de 2,6 % par an. Après un creux marqué au-dessous de la tendance entre 1993 et 1998, l'investissement productif est désormais revenu au-dessus de la ligne de tendance. Il n'y aurait donc pas à première vue de « retard » actuellement par rapport à la tendance passée. Mais cette tendance est inférieure à celle des autres grands pays étudiés. La tendance française, soit 2,6 % par an, se compare à 4,4 % aux Etats-Unis, 3,9 % au Royaume-Uni. Elle est légèrement supérieure à celle de l'Allemagne (2,2 %) mais inférieure à celle de la moyenne de l'Union européenne (3,1 %).
En 2000, l'investissement productif représentait 11,7 % du PIB en France. Ce pourcentage est à comparer à 11,8 % pour l'Allemagne et le Royaume-Uni, 12,4 % pour les Etats-Unis, et près de 13 % pour l'Union européenne. Après plusieurs années de retard, le taux d'investissement productif est revenu au voisinage de la moyenne des grands pays, résultat qui est surtout dû au recul conjoncturel du taux des Etats-Unis et du Royaume-Uni.
Par ailleurs, le contraste est saisissant entre d'une part les Etats-Unis (et à un degré moindre le Royaume-Uni) et d'autre part la France ou l'Allemagne. Dans l'Union européenne, le volume de l'investissement reste dans la ligne des tendances passées (+2,8 % pour la décennie 1990-2000) alors que le rythme d'accroissement du volume de l'investissement a été multiplié par deux aux Etats-Unis (8,1 %), du moins avant le creux économique de 2001. La croissance américaine a été très intensive en capital par comparaison avec tous les précédents cycles de croissance. Il y a là une différence entre les Etats-Unis et l'Europe, qui s'explique notamment par une forte utilisation des technologies de l'information et des communications aux Etats-Unis (voir chapitre 7).
Les projections économiques à moyen et long terme laissent penser qu'un changement de régime économique est nécessaire pour élever le potentiel de croissance de l'économie française. En particulier, l'objectif d'un rythme de croissance proche de 3 % passe par un renforcement de notre potentiel d'offre. Il subsiste certes une marge de baisse du chômage, notamment structurel, mais à plus long terme l'incidence défavorable du vieillissement démographique va commencer à se manifester. Le renforcement de la croissance potentielle reposera essentiellement sur un accroissement significatif et durable du rythme de constitution du capital productif. Le développement naturel des technologies de l'information et des communications offre une opportunité de renouvellement du stock de capital, mais il faut pour cela que le volume d'investissement soit suffisant.
La plupart des études rétrospectives montrent que le niveau de la profitabilité des entreprises est de plus en plus un facteur déterminant du niveau de l'investissement productif. Ces études s'accordent à reconnaître un accroissement de la sensibilité de l'investissement productif à la profitabilité dans les années 1990. Elles montrent par exemple que toutes choses égales par ailleurs, une hausse de un point de la profitabilité (soit une hausse de la rentabilité économique de un point ou une baisse du taux d'intérêt réel de un point) engendre une augmentation de l'effort d'investissement (mesuré par le taux d'investissement) de 0,1 à 0,3 point, qui augmente d'autant la croissance potentielle.
Un autre résultat marquant des travaux récents concerne l'incidence du coût des facteurs sur les décisions d'embauche et d'investissement. Les estimations récentes montrent qu'une hausse de coût de l'un des facteurs de production affecte négativement la demande de l'entreprise pour chaque facteur. En d'autres termes, à la suite d'une augmentation du coût du capital, la production devient plus riche en emploi, mais elle baisse suffisamment pour que l'effet net sur l'emploi soit négatif. De même, une hausse du coût du travail exerce un effet négatif sur l'investissement et l'emploi. Autrement dit, à long terme, capital et emploi sont plus complémentaires que substituts.
Enfin, une caractéristique des comportements d'investissement des entreprises est leur forte hétérogénéité. D'une façon générale, le rôle des variables financières est d'autant plus fort que les entreprises sont petites. Les plus petites entreprises ont sans doute été plus touchées que les grandes par le resserrement de la politique monétaire des années 1980 car elles n'ont pas accès à d'autres modes de financement que les crédits bancaires.
Plusieurs axes de réflexion peuvent être envisagés pour dynamiser l'investissement en France : établir les conditions d'une rentabilité suffisante des entreprises, stabilité et allègements de la fiscalité, effort de soutien à la recherche et à l'innovation, politique budgétaire et monétaire appropriées.
L'étude est présentée en sept chapitres qui développent certains points essentiels à la compréhension de l'investissement productif. Le premier chapitre donne une présentation d'ensemble de l'étude développée dans les six chapitres suivants. Le chapitre 2 rappelle la définition traditionnelle de l'investissement ainsi que les conceptions élargies qui doivent être prises en compte. Le chapitre 3 propose des rappels méthodologiques et les concepts économiques utilisés dans l'analyse des comportements d'investissement. Les chapitre 4, 5, 6 et 7 sont consacrés à l'analyse sur longue période de l'investissement des entreprises en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.
CHAPITRE 1
PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L'ÉTUDE
L'investissement total s'est élevé en France en 2001 à 288 milliards d'euros pour un PIB de 1 459 milliards d'euros. Il représente ainsi 19,7 % du PIB.
L'importance de l'investissement dans les mécanismes de la croissance économique tient moins à son poids, bien inférieur à celui de la consommation, qu'au rôle particulier qu'il joue dans l'économie. D'une part, à court terme, l'investissement constitue une des composantes les plus cycliques de la demande. D'autre part, à long terme, l'investissement est un facteur déterminant de la croissance potentielle de l'économie.
A court terme, toutes les théories économiques s'accordent sur le rôle de l'investissement dans l'explication du cycle. Entre 1970 et 2001, l'élasticité 87 ( * ) apparente de l'investissement par rapport au PIB en volume a été en moyenne de 2,5 en France. Cette élasticité est de 1,6 aux Etats-Unis, de 0,8 au Royaume-Uni et de 2,1 en Allemagne.
A long terme, le niveau de l'investissement a des conséquences importantes sur la dynamique de l'économie et sur la croissance. La croissance de long terme d'une économie dépend fortement de l'investissement, et tout particulièrement de l'investissement productif directement réalisé par les entreprises. D'une part, il détermine le rythme d'accumulation du capital. D'autre part, il permet d'améliorer le processus de production et d'incorporer le progrès technique, notamment en permettant la diffusion de l'innovation et des nouvelles technologies dans l'économie.
Par ses liens avec la croissance potentielle et l'emploi, l'investissement se situe au centre des débats concernant la politique économique. L'identification des déterminants de l'investissement des entreprises est donc importante pour comprendre la dynamique et les perspectives de l'économie.
I. 1. L'ÉVOLUTION RÉCENTE DE L'INVESTISSEMENT EN FRANCE
L'investissement total est traditionnellement décomposé en trois masses distinctes : l'investissement des administrations publiques (pour l'essentiel des collectivités locales) qui représente 3 % du PIB, l'investissement en logement des ménages, soit 4,9 % du PIB, enfin, l'investissement des entreprises, entrepreneurs individuels ou sociétés, auquel on réserve traditionnellement le nom d'investissement productif parce que c'est l'investissement tourné vers la production de biens et services. L'investissement des entreprises représentant 11,8 % du PIB en France en 2000.
Au cours des années 1990, l'évolution de l'investissement des entreprises est longtemps restée décevante. Le volume de la FBCF des entreprises avait doublé en vingt ans, de 1970 à 1990, passant de 69,6 milliards d'euros à 140,3 milliards d'euros (aux prix de 1995). Entre 1985 et 1991, le volume de l'investissement productif s'était montré particulièrement dynamique (+6,5 % l'an en moyenne). Le cycle s'est inversé en 1990. Pénalisé par des taux d'intérêt très élevés et les crises monétaires européennes, l'investissement productif (en volume) a baissé de 7,6 % entre 1990 et 1996. En 1997, le taux d'investissement des entreprises a touché un point bas historique à 15,9 % de leur valeur ajoutée 88 ( * ) .
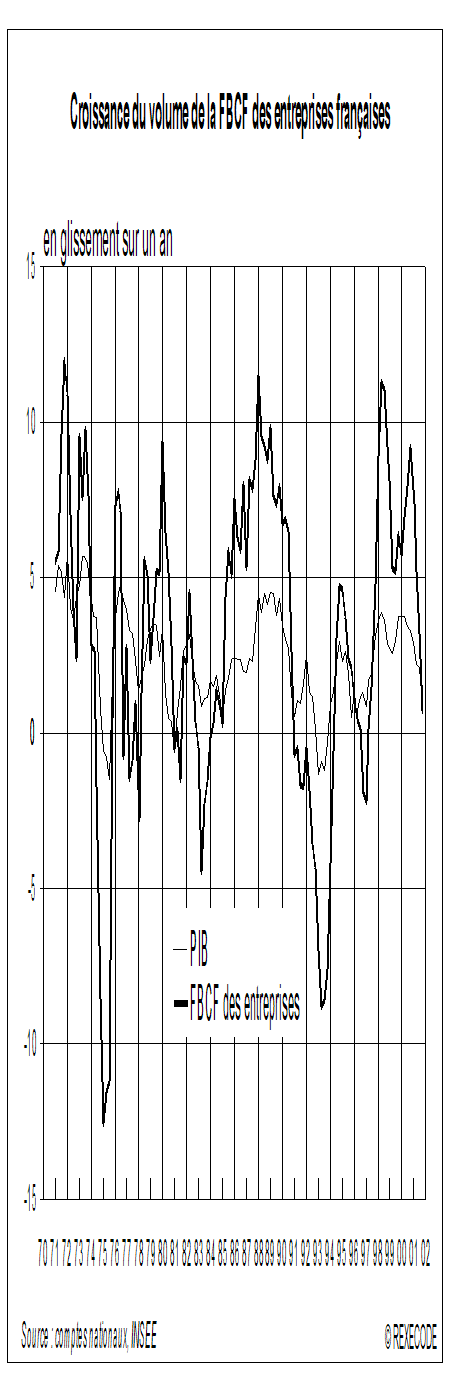
La forte baisse des taux d'intérêt de 1995-1996 et l'amélioration conjoncturelle générale ont autorisé une reprise de l'investissement dans la deuxième partie des années 90. Dès 1998, on retrouve un niveau d'investissement légèrement supérieur à celui de 1990 (143,6 milliards d'euros aux prix de 1995). A partir de 1998, la croissance de l'investissement productif s'accélère rapidement (+6,2 % l'an en moyenne de 1998 à 2001), comblant le retard pris au début de la décennie
.
Cette trajectoire de l'investissement n'est pas spécifique à la France. La plupart des pays européens ont connu une évolution semblable au cours des années 1990 et l'Allemagne, dont le choc lié à la réunification a perturbé l'ensemble des pays européens, a été encore plus affectée que la France par le recul de l'investissement.
II. 2. LES TENDANCES LONGUES DE L'INVESTISSEMENT EN FRANCE
L'évolution des années 90 invite à s'interroger sur l'hypothèse éventuelle d'un retard français de l'investissement qui pourrait constituer un danger pour notre croissance et notre compétitivité.
A. 1. L'EXAMEN DES TENDANCES LONGUES NE SUGGÈRE PAS À PREMIÈRE VUE UN RETARD D'INVESTISSEMENT EN FRANCE.
Pour porter un jugement sur la situation actuelle de la France, une première approche consiste à comparer les données les plus récentes à leur tendance passée. La tendance longue de l'investissement peut être appréciée par la droite de régression linéaire par rapport au temps sur la période 1970-2000. Celle-ci donne un ordre de grandeur du niveau et de la progression de l'investissement en rythme annuel sur longue période. Si le rythme de croissance ne subit pas de rupture structurelle, la position du niveau de l'investissement par rapport à sa tendance donne une première indication d'un « retard » possible, « retard » qui pourrait avoir une explication d'origine cyclique ou d'origine structurelle.
De 1970 à 2000, le volume de l'investissement brut productif est en moyenne en progression de 2,6 % par an contre 2,2 % pour le volume du PIB. Après un creux marqué au-dessous de la tendance entre 1993 et 1998, l'investissement productif est désormais revenu au-dessus de la ligne de tendance. Il n'y aurait donc pas actuellement à première vue de « retard » par rapport à la tendance.
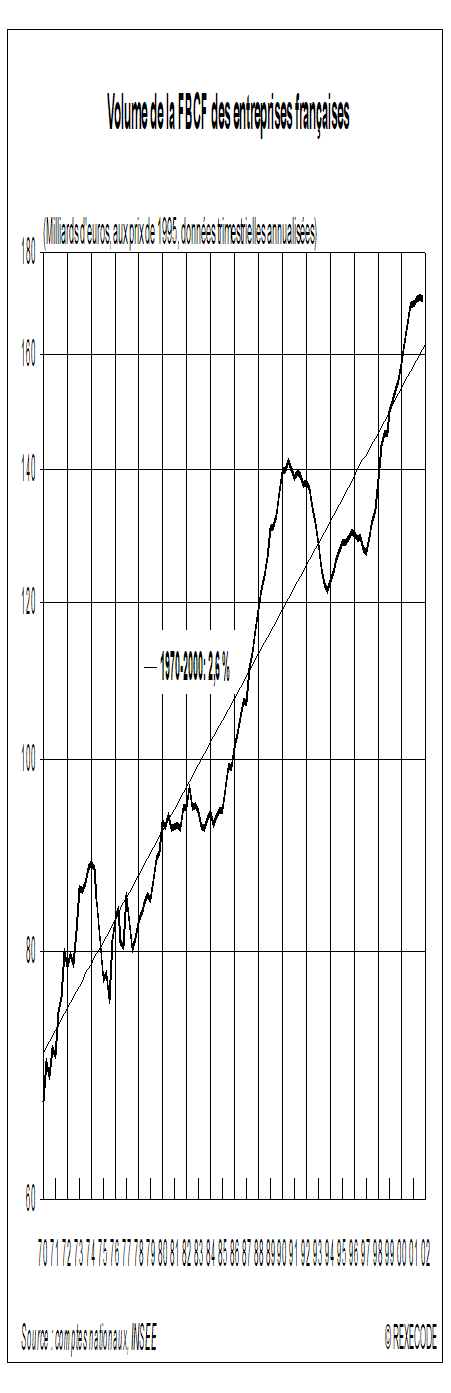
Un tel constat n'est pas surprenant. L'étude détaillée de l'évolution de la FBCF en France (chapitre 3) montre que les déterminants traditionnels de l'investissement (essentiellement les perspectives de production et les contraintes financières) suffisent à rendre compte du comportement d'investissement productif des entreprises françaises au cours des trois dernières décennies. La croissance de l'économie a à peu près retrouvé sa tendance longue et il en est de même pour l'investissement.
B. 2. LE CONSTAT EST ANALOGUE POUR LE TAUX D'INVESTISSEMENT (INVESTISSEMENT EN VALEUR RAPPORTÉ À LA VALEUR AJOUTÉE).
De 1980 à 1990, le taux d'investissement (en valeur) des entreprises françaises a été en moyenne de 17,8 % de leur valeur ajoutée. Ce taux diminue légèrement à 17,2 % en moyenne de 1990 à 2001. Le taux d'investissement suit assez bien les fluctuations de l'activité. Il faut cependant signaler qu'en 2000 et 2001 alors que l'activité a été relativement forte, le taux d'investissement des entreprises est demeuré sensiblement en deçà des ses points hauts historiques (17,8 % en 2000 contre 19,4 % en 1990).
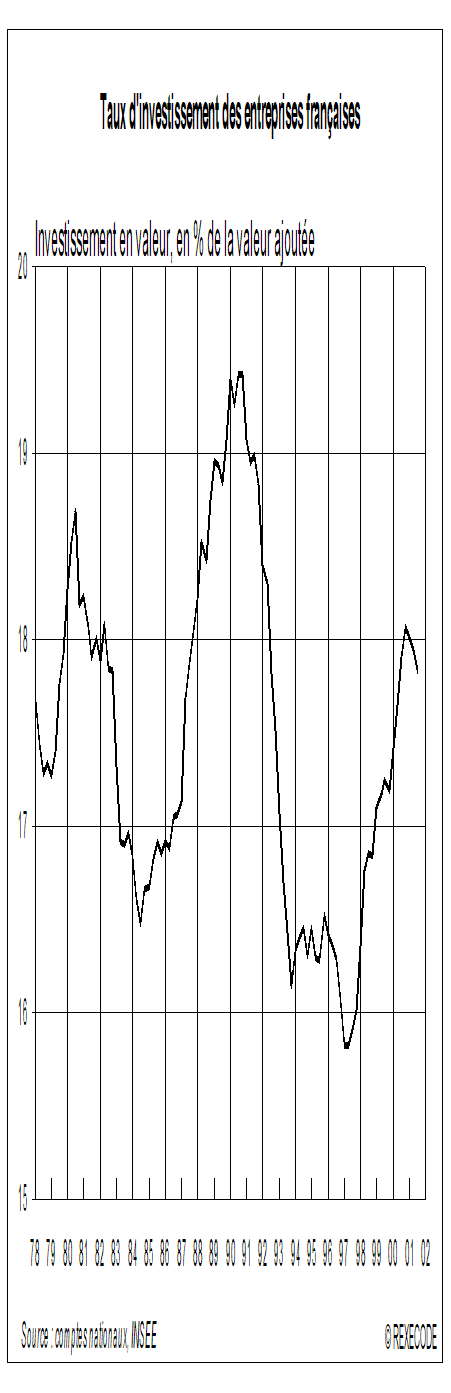
C. 3. LE CONSTAT DIFFÈRE LÉGÈREMENT SI L'ON EXAMINE LE TAUX DE CROISSANCE DU STOCK NET DE CAPITAL PRODUCTIF (SELON LES CALCULS DES COMPTES NATIONAUX).
La croissance moyenne du capital productif net a été de 3,7 % l'an au cours des trente dernières années. Elle est revenue à 2,9 % au cours des quinze dernières années. Ce ralentissement est plus prononcé que celui de la croissance de l'économie française enregistré sur la même période et signifie que la productivité du capital a eu tendance à diminuer entre les deux périodes.
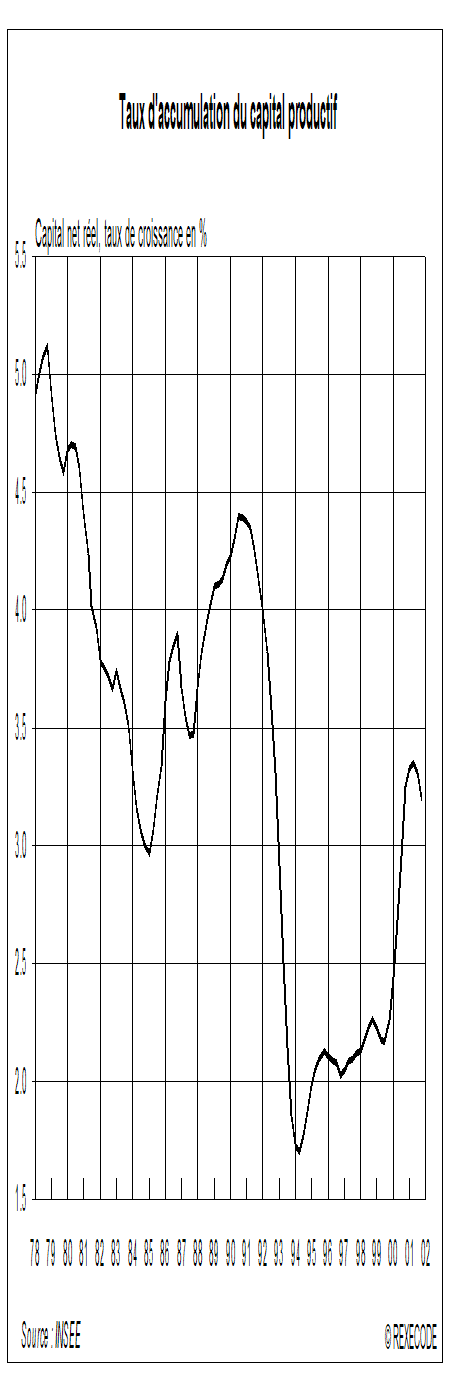
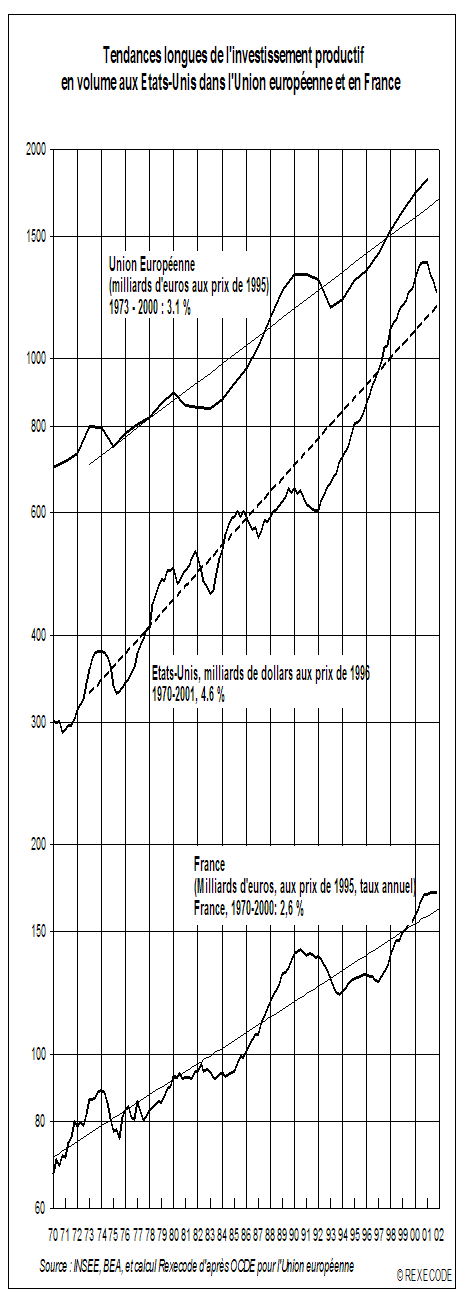
III. 3. LA POSITION DE LA FRANCE VIS À VIS DES AUTRES PAYS ÉTUDIÉS
Une seconde approche du problème de l'investissement consiste à comparer la position de la France en matière d'investissement à celle des autres grands pays industrialisés. Nous retenons les trois autres pays examinés dans cette étude : Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni.
A. 1. LE TAUX D'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES FRANÇAISES VIENT DE RETROUVER LE NIVEAU DES GRANDS PAYS INDUSTRIALISÉS
Globalement sur les trente dernières années, la France se situe dans la moyenne des nations développées en ce qui concerne le taux d'investissement des entreprises. L'investissement productif représentait 11,7 % du PIB en 2000 en France (164,6 milliards d'euros). Ce pourcentage est à comparer à 11,8 % pour l'Allemagne et le Royaume-Uni, 12,4 % pour les Etats-Unis, et près de 13 % pour l'Union européenne (selon la Commission européenne). Après plusieurs années de retard, le taux d'investissement productif est revenu au voisinage de la moyenne des grands pays. Ce résultat n'est obtenu que par la baisse du taux d'investissement de certains de nos partenaires. C'est en effet le recul du taux des Etats-Unis et du Royaume-Uni qui a ramené la France vers la moyenne des grands pays.
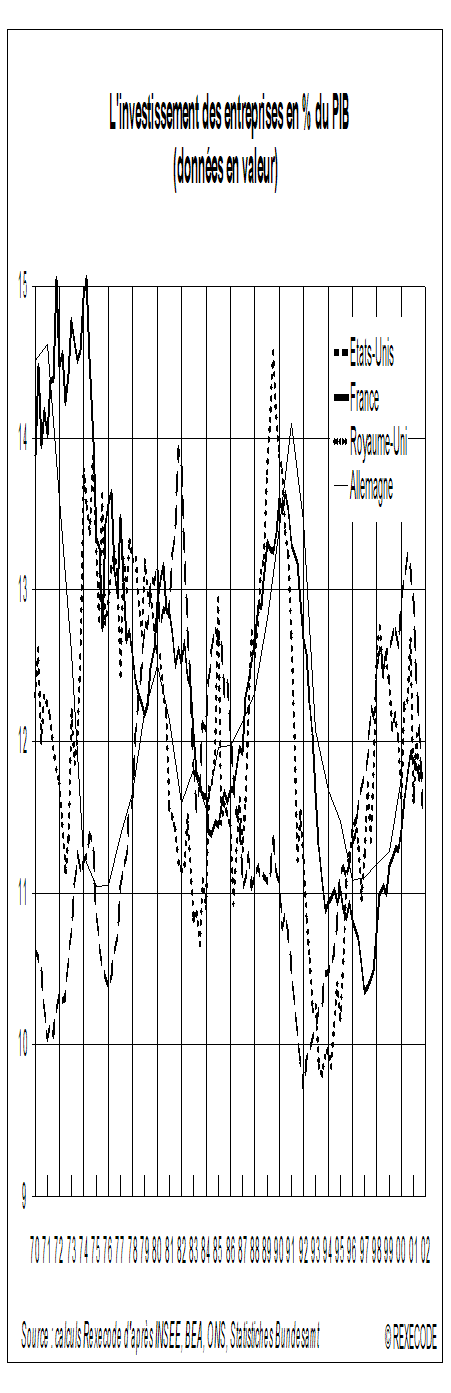
B. 2. DES SIMILITUDES DANS LA RÉACTION DE L'INVESTISSEMENT À LA CROISSANCE...
Parmi les principaux pays de l'Union économique et monétaire (UEM) dont la France et l'Allemagne, on observe une convergence du taux de croissance du PIB dans les vingt dernières années, et en particulier depuis la récession européenne de 1993. Toutefois, à partir de 1998, en réaction aux déséquilibres créés par la réunification la croissance de l'économie allemande s'est essoufflée plus rapidement que celle des autres pays. En ce qui concerne l'investissement, la France et l'Allemagne ont réagi de façon assez similaire au cours des dix dernières années.
Les pays anglo-saxons, Etats-Unis et Royaume-Uni, se distinguent par une réaction commune. Ils ont connu une récession au cours de l'année 1991, soit deux années plus tôt que les pays de l'UEM, dont la France et l'Allemagne. Les États-Unis n'ont connu que trois trimestres de récession avant de retrouver rapidement une croissance vigoureuse. La Grande-Bretagne a dû faire face à une récession plus longue, six trimestres. Enfin, la récession continentale de 1993 ne semble pas avoir particulièrement touché la Grande-Bretagne ou la croissance du PIB a suivi un rythme soutenu jusqu'à la mi-1995. La relative stabilité de la croissance aux Etats-Unis entre 1995 et 2000 a engendré une chronique d'investissement élevé et stable sur la même période avant les
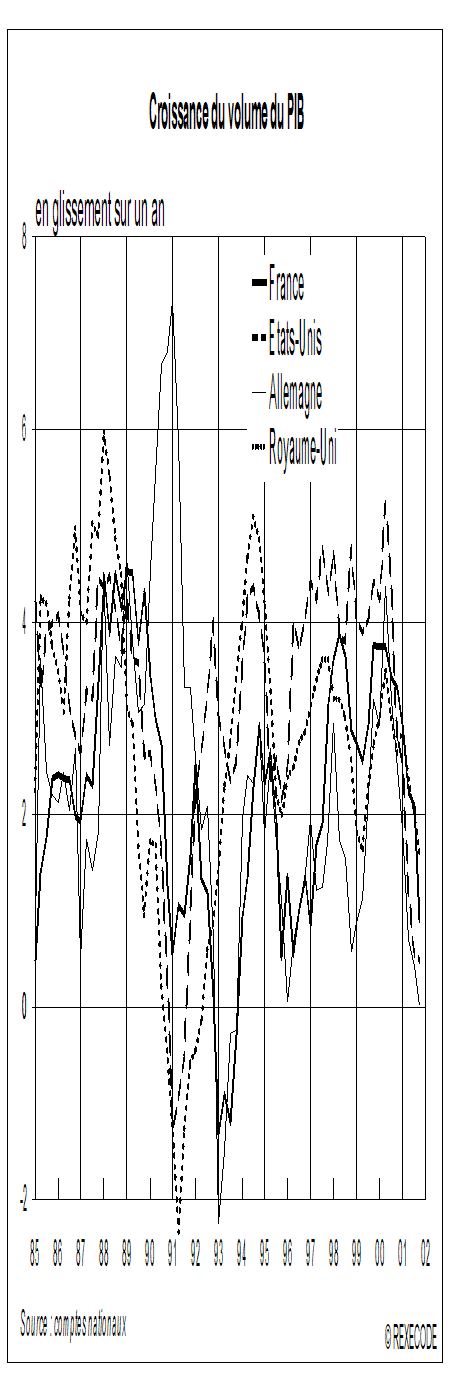
effets du ralentissement de 2000-2001.
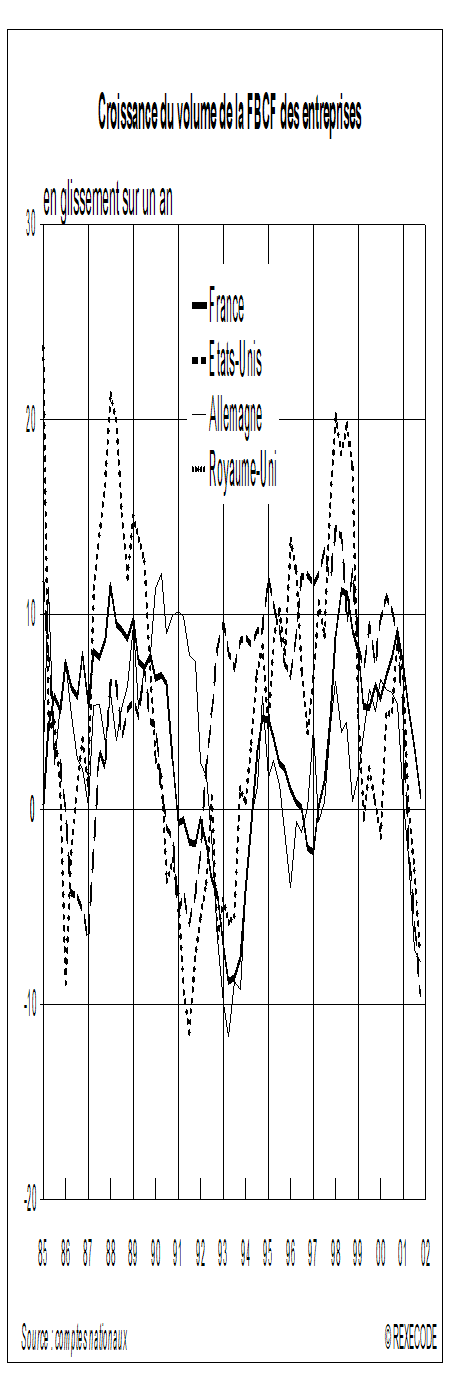
C. 3. ...MAIS LA TENDANCE LONGUE DU VOLUME DE L'INVESTISSEMENT EST PLUS FAIBLE EN FRANCE
La tendance du volume de l'investissement productif sur les trente dernières années est plus faible en France. Elle s'établit à 2,6 % par an, contre 4,4 % aux Etats-Unis, 3,9 % au Royaume-Uni. La croissance moyenne française de l'investissement est légèrement supérieure à celle de l'Allemagne (2,2 %) mais inférieure à la moyenne de l'Union européenne (3,1 %).
Sur la décennie des années 1990, le contraste est saisissant entre les Etats-Unis et les pays de l'Union européenne. En Europe, le volume de l'investissement reste dans la ligne des tendances passées (+2,8 %) alors que le rythme d'accroissement du volume de l'investissement est multiplié par deux aux Etats-Unis (8,1 %), rythme lui-même nettement supérieur à celui de l'économie (3,3 %). La croissance américaine a été très intensive en capital par comparaison avec tous les précédents cycles de croissance. Il y a là une différence entre les Etats-Unis et à l'Europe qui s'explique notamment par une forte utilisation des technologies de l'information et des communications aux Etats-Unis (voir chapitre 7).
|
Taux de croissance annuel moyen du volume de l'investissement productif |
|||
|
1970-2000 |
1970-1990 |
1990-2000 |
|
|
France |
2,6 |
2,7 |
1,8 |
|
Royaume-Uni |
3,9 |
3,8 |
4,2 |
|
Allemagne |
2,2 |
1,9 |
0,4 |
|
Union européenne |
3,1 |
2,6 |
2,8 |
|
Etats-Unis |
4,4 |
4 |
8,1 |
|
Taux de croissance annuel moyen du volume du PIB |
|||
|
1970-2000 |
1970-1990 |
1990-2000 |
|
|
France |
2,2 |
2,4 |
1,8 |
|
Royaume-Uni |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
|
Allemagne |
2,2 |
2,1 |
1,5 |
|
Union européenne |
2,3 |
2,4 |
2,1 |
|
Etats-Unis |
3 |
3 |
3,3 |
En terme de taux de croissance tendanciel du volume du PIB comme du volume de la FBCF productive, on observe une différence entre d'une part la France (et surtout l'Allemagne), et d'autre part le Royaume-Uni. A long terme (1970-2000), il semble que l'élasticité du volume de l'investissement productif au PIB soit légèrement supérieure à 1 dans tous les pays : 1,2 en moyenne pour la France, 1 pour l'Allemagne, 1,5 aux Etats-Unis et 1,7 au Royaume-Uni.
|
|
D. 4. LE RÔLE DES CONTRAINTES FINANCIÈRES DANS LA DÉCISION D'INVESTISSEMENT EST FORTE DANS TOUS LES PAYS, MAIS IL EST DIFFICILE DE PORTER UN DIAGNOSTIC SUR LE POIDS RELATIF DE CES CONTRAINTES SELON LE PAYS.
Il est difficile de faire des comparaisons internationales de sensibilité de l'investissement à la profitabilité. Les différences de méthodes de comptabilité jouent sur le niveau du taux de profitabilité. Pour l'Allemagne, le choc de la réunification perturbe l'interprétation. Pour le Royaume-Uni, les données permettant de reconstituer un taux de profit ne sont disponibles que depuis 1987.
Toutefois, quels que soient les pays considérés dans les études empiriques récentes, celles-ci s'accordent à reconnaître une sensibilité plus forte de l'investissement productif à la profitabilité dans les années 1990 que dans les années 1980. Ces résultats sont à rapprocher de l'évolution de la profitabilité au cours des deux décennies passées dans la plupart des pays industrialisés. La profitabilité dégradée des entreprises a pesé sur les décisions d'investissement pendant la première moitié des années 80. La décennie 90 est caractérisée par une influence positive de ce facteur.
Dans tous les pays étudiés ici, la période de 1983 à 1989 est une période d'amélioration de la rentabilité économique du capital. De 1989 à 1992, cette rentabilité connaît des évolutions heurtées, à la hausse puis à la baisse, qui peuvent s'expliquer par des contingences nationales : récessions dans les pays anglo-saxons, bulle immobilière en France, réunification en Allemagne. A partir de 1993-1994, la rentabilité économique se stabilise à nouveau.
Dans la seconde moitié des années 1980, les entreprises françaises (et à un degré moindre allemandes) redressent significativement leurs marges ce qui leur permet de restaurer leur rentabilité dans une période où la politique monétaire devient légèrement plus restrictive. Au cours des années 1990, c'est par contre la baisse des taux d'intérêt réels qui assure une progression continue de la profitabilité à un moment où les entreprises françaises parviennent à stabiliser leurs marges et leur rentabilité.
On observe le mouvement inverse aux Etats-Unis, et d'une manière similaire au Royaume-Uni. Aux Etats-Unis, la profitabilité e du début des années 1980 s'explique alors par le haut niveau des taux d'intérêt réels alors même que la rentabilité des entreprises américaines reste stable sur la période. Pendant cette période, la dégradation des taux de marge des entreprises est compensée par une forte amélioration de la productivité apparente du capital. Le mouvement s'inverse au cours des années 1990. Les taux d'intérêt réels se stabilisent et ne contribuent plus à la croissance de la profitabilité. C'est l'amélioration de la rentabilité des entreprises - grâce à la conjugaison d'une amélioration des marges et d'une accélération de la productivité du capital- qui assure une meilleure profitabilité.
Les études économiques sur la sensibilité de l'investissement productif à la contrainte financière donnent des résultats intéressants. Toutes choses égales par ailleurs, elles montrent qu'une hausse de 1 point de la profitabilité (soit une hausse de la rentabilité économique de 1 point ou une baisse des taux d'intérêt réels de 1 point) engendre une augmentation du taux d'investissement en volume de 0,1 à 0,3 point.
Selon Mairesse, Mulkay et Hall (2001), l'élasticité de l'investissement des entreprises à leur profitabilité est plus faible en France qu'aux Etats-Unis. Les auteurs en concluent que les entreprises françaises seraient moins « contraintes financièrement » que leurs homologues américaines. La raison d'une telle asymétrie tient sûrement aux différences de mode de financement et d'accès aux marchés financiers de part et d'autre de l'Atlantique. Caselli, Pagano et Schivardi (2000) trouvent également des différences entre les entreprises de la zone euro d'une part, et celle des pays anglo-saxons : les entreprises de la zone euro seraient moins « vulnérables » que celles des pays anglo-saxons mais la différence apparaît peu significative. Au sein de la zone euro, selon Vermeulen (2000) les entreprises allemandes seraient plus contraintes financièrement que les entreprises françaises.
Il est intéressant de noter que dans tous les pays étudiés, l'amplitude des variations des taux d'intérêt réels a été au moins aussi forte que celle de la rentabilité économique. En moyenne sur les vingt dernières années, on peut considérer que les changements de politique monétaire ont exercé un effet au moins aussi important sur la profitabilité et la décision d'investir que les seules variations des taux de profits.
IV. 4. LES FLUX D'INVESTISSEMENTS ENTRE LA FRANCE ET L'ÉTRANGER
Dans une économie fortement impliquée dans les réseaux de production et d'échanges mondiaux, la politique d'investissement tend à se globaliser. Les ressources dégagées pour l'activité courante de l'entreprise peuvent être ainsi déployées sur un vaste ensemble de territoires, au-delà du territoire national. Cela est vrai des entreprises françaises qui s'implantent à proximité de marchés porteurs, comme d'entreprises étrangères choisissant de s'implanter ou de renforcer leur implantation en France.
A priori , ces redéploiements de ressources financières peuvent entraîner des déplacements de capital productif et par conséquent de la localisation des nouveaux investissements. La localisation des nouveaux investissements français sur des territoires étrangers a ainsi été avancée comme une explication possible de la relative faiblesse de l'investissement observée de 1990 à 1998. Cette intuition pouvait sembler conforter par plusieurs faits d'observation, parmi lesquels certaines décisions de déplacement d'unités de production vers des territoires étrangers ou le fort accroissement des flux d'investissement français à l'étranger.
C'est un fait que les investissements français à l'étranger ont augmenté. Mais il s'avère aussi que la France est un pays attractif pour les investissements étrangers. Sur la période 1998-1999, elle se situait en septième position des pays d'accueil des capitaux d'investissement directs, loin derrière les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la Belgique-Luxembourg, mais dans des ordres de grandeurs identiques (autour de 40 milliards de dollars par an) à l'Allemagne, les Pays-Bas et la Chine. En 2000, la France occupait également la septième position mais était cette fois devancée sensiblement par l'Allemagne, le Canada et les Pays-Bas à la suite d'opérations majeures de fusions-acquisitions.
Tableau 1 : Investissements directs entrants en milliards de dollars
|
Rang |
Pays |
Moyenne sur la période |
||
|
1998-1999 |
2000 |
1998-2000 |
||
|
1 |
Etats-Unis |
239,55 |
287,7 |
255,6 |
|
2 |
Royaume-Uni |
81,2 |
134 |
98,8 |
|
3 |
Belgique-Luxembourg |
77,85 |
208,5 |
121,4 |
|
4 |
Chine |
41,25 |
38,4 |
40,3 |
|
5 |
Pays-Bas |
39,7 |
54,1 |
44,5 |
|
6 |
Allemagne |
39,5 |
189,2 |
89,4 |
|
7 |
France |
38,1 |
43,2 |
39,8 |
|
8 |
Canada |
10 |
62,8 |
27,6 |
|
Définition des Investissements Directs à l'Etranger (IDE) Les investissements directs regroupent les opérations effectuées par les investisseurs afin d'acquérir, d'accroître (ou de liquider) un intérêt durable dans une entreprise et d'avoir (ou de ne plus avoir) une influence sur sa gestion. Par convention, on considère qu'une relation d'investissement direct est établie dès lors qu'une personne physique ou morale (l'investisseur) détient au moins 10 % des droits de vote lors des assemblées générales d'une entreprise (l'entreprise investie) ou à défaut 10 % du capital social. Lorsque ce seuil est atteint, l'ensemble des opérations financières entre les deux entreprises est alors enregistré en investissements directs. Cette définition est large. Elle inclut les prises de participation d'une année mais également l'ensemble du stock antérieur au moment du passage du seuil des 10 %. Elle inclut aussi les mouvements financiers, à long terme et à court terme. Les statistiques d'IDE doivent donc être prises comme des indices d'alerte, mais seule une étude complète permettrait de conclure à un impact favorable ou défavorable des mouvements d'IDE. |
Pendant de nombreuses années, les entrées et les sorties d'investissements directs en France sont demeurées faibles. De 1990 à 1997, les investissements directs à l'étranger avaient même fortement reculé, accompagnant le ralentissement de l'investissement en France. L'année 1998 semble marquer une rupture à la fois pour la FBCF et pour les flux d'investissement directs à l'étranger. L'investissement intérieur reprend et les entreprises françaises accroissent très sensiblement leurs investissements à l'étranger. Parallèlement, on observe que les investissements étrangers en France augmentent eux aussi fortement.
Au total, le solde net entre les investissements directs à l'étranger (IDE) des entreprises françaises et les investissements directs des entreprises étrangères en France, qui était inférieur à 1 % du PIB jusqu'en 1998 a augmenté à 4,8 % du PIB en 1999 et à près de 10 % en 2000 (139,3 milliards d'euros). Ces ordres de grandeurs sont à rapprocher de la FBCF des entreprises, qui a représenté 11,6 % du PIB en moyenne au cours des années 1990. Au total, fait sans précédent sur les vingt dernières années, le solde net négatif des investissements directs croisés est du même ordre de grandeur que l'investissement des entreprises réalisé sur le territoire français.
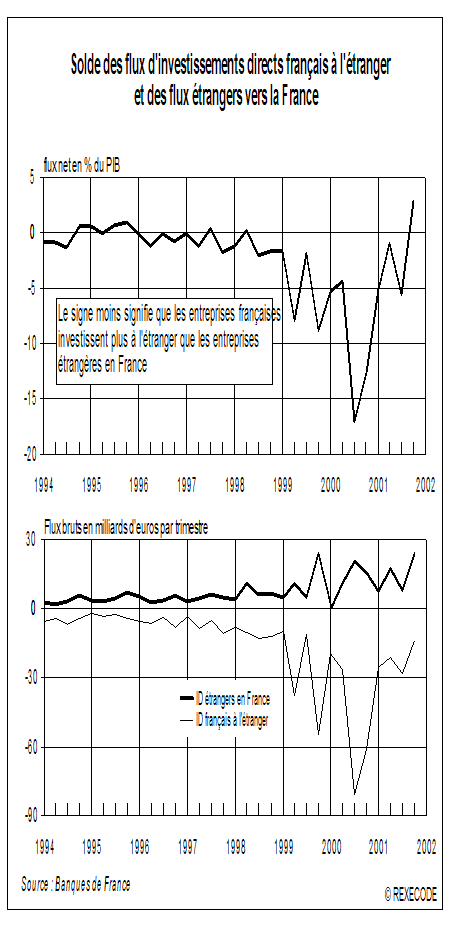
La forte augmentation des investissements directs français à l'étranger en 2000 (187,2 milliards d'euros) s'explique en partie par quelques opérations de rachats d'entreprises étrangères portant sur des sommes considérables -telles que « Orange », « Ernst & Young » ou « Seagram »- par des entreprises françaises. De telles opérations témoignent de l'effort de rattrapage qu'effectuent certaines entreprises agissant dans plusieurs secteurs (TMT, bancassurance, chimie, pétrole...) dans un contexte de mondialisation croissante. Il est difficile de déterminer s'il s'agit de stratégies spécifiques à des entreprises multinationales ou aussi en partie de comportements macroéconomiques liés à une meilleure espérance de profitabilité à l'étranger.
En 2001, les opérations de fusions transfrontières se sont sensiblement réduites, ce qui s'est traduit par un fort recul des investissements directs français à l'étranger. Malgré ce ralentissement important, la France se place en 2001 au deuxième rang mondial derrière les Etats-Unis, en termes de montant annuel de flux d'investissements directs à l'étranger. Sur les trois premiers trimestres de l'année, le flux net (négatif) des IDE représente environ 4 % du PIB, un niveau équivalent à la moyenne de l'année 1999 mais qui reste encore largement supérieur aux niveaux moyens des vingt dernières années (moins de 1 % du PIB).
Tous les pays développés ont connu une augmentation des IDE depuis 1998. Ainsi, en 2000, le montant total des flux d'IDE investis dans l'UE par le reste du monde s'élevait à 125 milliards d'euros (total sans les bénéfices réinvestis), en augmentation de 27 % par rapport à 1999. Ce montant est cinq fois plus élevé que celui qui avait été enregistré en 1992 (23 milliards d'écus en 1992). Inversement, en 2000, les flux d'IDE en provenance du reste du monde ont dépassé pour la première fois 100 milliards d'euros pour s'établir à 1,5 % du PIB de l'UE. A l'exception des Etats-Unis et du Canada, les pays les plus industrialisés sont investisseurs nets à l'étranger, ce qui est assez naturel pour des pays développés.
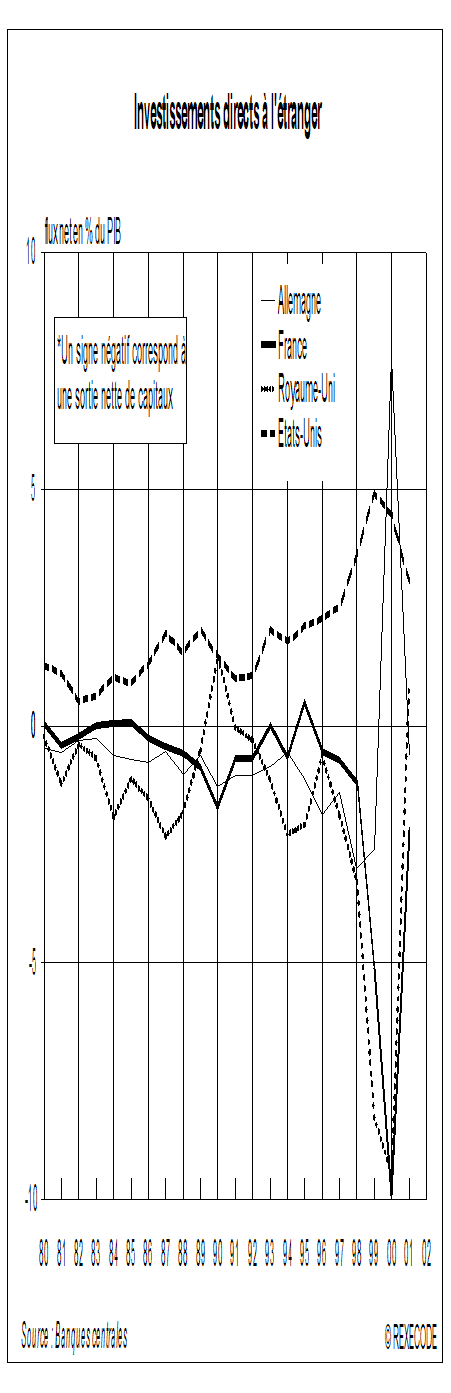
Le phénomène de mondialisation conduit de plus en plus les entreprises françaises et étrangères à racheter des entreprises à l'étranger pour atteindre la taille mondiale et demeurer concurrentielles dans un contexte de globalisation internationale. Etant donné que les mouvements de consolidation au niveau international ne sont pas achevés, il est raisonnable d'envisager que le niveau des investissements directs français à l'étranger demeure encore quelques années au niveau actuel.
En conclusion, il apparaît difficile de conclure de façon claire à une moindre attractivité du territoire français comparé aux autres pays. En premier lieu, la définition même d'investissement direct pose problème. Cet indicateur ne donne qu'une indication imparfaite de l'attractivité d'un pays pour les investisseurs internationaux. Par exemple de simples opérations de trésorerie entre affiliés sont incluses dans la définition des IDE. De même une extension de la participation, même marginale, dès qu'elle permet de franchir le seuil de 10 % de propriété, fait passer la totalité de l'encours d'investissement direct en tant que flux d'investissement direct. Une étude minutieuse des comportements d'IDE devrait aussi accorder une place important aux niveaux des encours d'IDE. Par ailleurs, les investissements directs en France sont autant un signe de l'attractivité de la demande française ou de la position géographique de la France sur les marchés européens que des conditions de production offertes aux entreprises.
En second lieu, des mouvements de délocalisation d'activité productive, résultant d'une moindre attractivité du territoire français comparé aux autres pays, devraient se traduire, le cas échéant, par une baisse des flux d'investissements directs étrangers en France et par une augmentation des investissements directs français à l'étranger. Depuis 1998, tous ces flux se sont emballés et il est vrai que le solde net de ces flux est devenu très fortement négatif, mais c'est aussi le cas du Royaume-Uni. Les Etats-Unis et l'Allemagne se distinguent mais pour des raisons différentes. Structurellement, les Etats-Unis attirent des flux d'investissements directs qui couvrent le tiers du déficit de leur balance courante. L'Allemagne a connu en 2000 une vaste opération de fusion- acquisition (le rachat de Mannesman par Vodafone) et cette opération est d'une telle ampleur qu'elle gêne l'interprétation macro-économique. Au total, il est difficile de distinguer dans la très forte expansion des flux nets d'investissements directs entre la France et l'étranger ce qui relève de la relocalisation d'activités productives hors du territoire national, et ce qui relève de la conquête de marchés extérieurs dans le cadre de stratégies de globalisation.
Il reste que l'accroissement très important des sorties nettes de capitaux au titre des investissements directs et la tendance longue à l'accroissement de ce solde suggèrent une vigilance accrue sur le niveau de notre compétitivité.
|
Répartition géographique des flux d'IDE Les flux d'investissements français à l'étranger sont principalement à destination des pays de l'Union européenne (près de 60 % de l'ensemble des IDE), et en particulier de l'Allemagne (28 %), de la Belgique et du Luxembourg (17 %) et du Royaume-Uni (6 %). En dehors de l'Union européenne, le principal pays développé destinataire reste les Etats-Unis, qui représente 28 % des flux d'IDE. Il est intéressant de noter que sur l'ensemble des années 1990, les pays émergents n'ont accueilli qu'une part marginale des flux d'investissement français à l'étranger (bien que cela puisse poser des problèmes sectoriels importants). |
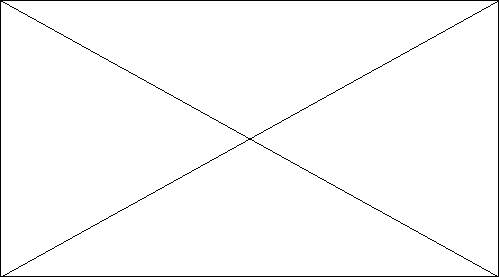
|
De même, les investissements directs étrangers en France proviennent essentiellement des pays de l'Union européenne, et dans une proportion même plus importante que les IDE français à l'étranger (plus de 80 %). Les principaux pays investisseurs sont l'Allemagne, le Benelux et l'Espagne. Les Etats-Unis n'investissent que très peu en France (4,8 milliards d'euros en 2000), en comparaison des flux inverses (29,3 milliards d'euros). La prépondérance de l'Union européenne dans les flux d'IDE est manifeste. Malgré l'accroissement soutenu des flux en provenance des pays tiers, les flux d'IDE au sein de l'Union européenne supplantent très largement les flux hors de l'Union européenne. En 2000, la moyenne des flux intra-UE (moyenne des flux d'IDE intra-UE sortants et entrants) est estimée par Eurostat à 476 milliards d'euros, un montant quatre fois plus élevé que celui des flux d'IDE provenant du reste du monde et qui correspond à 6 % du PIB de l'UE. |
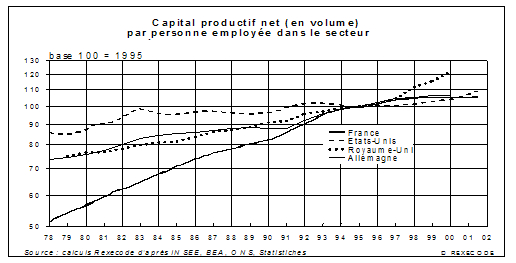
|
La date de 1998 constitue là encore une date charnière pour les flux d'IDE au sein de l'Union européenne. Les opérations transfrontalières au sein de l'UE, ont doublé en 1998, puis ont presque triplé en 1999 (+173 %) avant de progresser de 50 % en 2000. L'ensemble de ces observations tend à montrer que les comportements d'investissement sur le sol national et d'investissements directs à l'étranger sont plutôt de nature complémentaire. Les flux d'investissement directs viseraient à augmenter la couverture géographique des entreprises nationales et les territoires considérées concerneraient à 80 % l'Union européenne. |
V. 5. UN RETARD FRANÇAIS DE L'INVESTISSEMENT DANS LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Malgré l'éclatement de la bulle technologique, l'engouement pour les technologies de l'information ne se dément pas. Pour l'instant, il semble que la France marque un important retard en termes de technologies de l'information par rapport à des pays comme les Etats-Unis ou le Royaume-Uni.
Le capital productif en technologies de l'information et des communications (TIC) représentait en 2000 4,8 % du total en France. L'investissement de l'ensemble de l'économie française en TIC s'élevait en 2000 à 26,5 milliards d'euros soit moins de 10 % de l'effort d'investissement de l'économie nationale. Toutefois, on a assisté de 1995 à 2000 à un accroissement significatif du taux d'investissement de l'économie française en TIC qui est passé de 1,3 % du PIB à 1,9 %.
Ces ordres de grandeurs demeurent toutefois modestes au regard du boom technologique observé outre-atlantique et à un degré moindre au Royaume-Uni. Aux Etats-Unis, le capital productif en TIC s'élevait en 2000 à 14,7 % du total, soit près de triple de la France. Le seul secteur privé non résidentiel a investi en 2000 un peu moins de 466 milliards de dollars dans les TIC, soit 4,7 % du PIB 89 ( * ) et plus de 47 % des dépenses en biens d'équipement et logiciels. Même en tenant compte des problèmes de comparabilité des données de dépenses en TIC 90 ( * ) entre la France et les Etats-Unis (Lequiller, 2001), la différence reste énorme. Le retard français est également important vis-à-vis du Royaume-Uni puisqu'en 1998, la part de l'investissement dans l'économie nationale en biens et services des technologies de l'information et de la communication s'élevait à 1,7 % du PIB en France contre 2,5 % au Royaume-Uni.
Qui plus est, selon Cette et alii (2001), l'écart entre la France et les Etats-Unis se serait même creusé au cours de la période récente, et la contribution de la diffusion des technologies de l'information à la croissance française demeurerait marginale, alors qu'elle expliquerait plus de la moitié de l'accélération de la croissance de l'économie américaine depuis 1995.
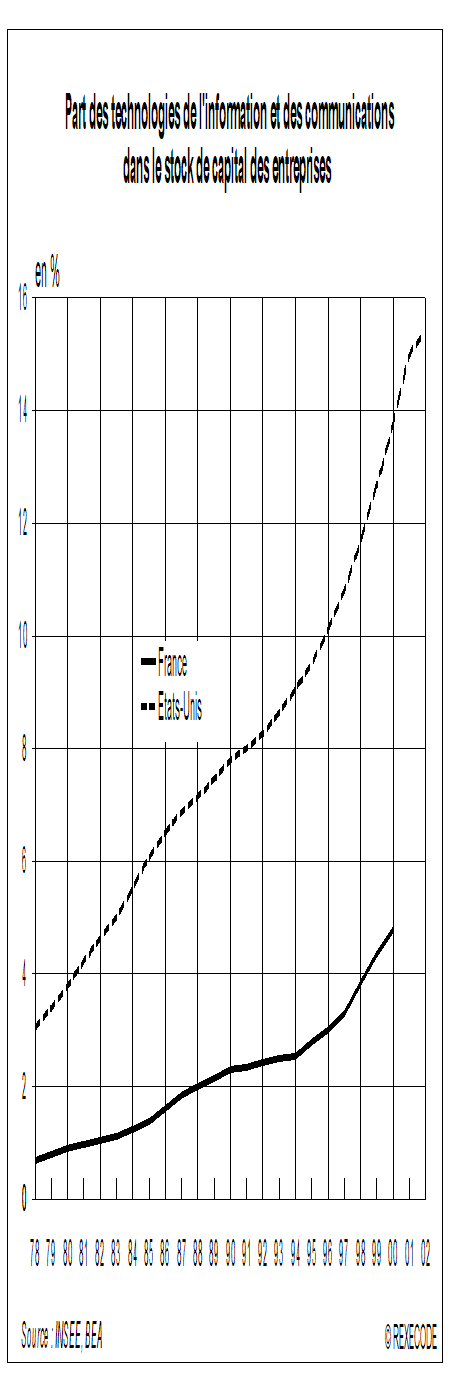
VI. 6. LES ENJEUX D'UNE POLITIQUE DE L'INVESTISSEMENT
Les enjeux associés à l'effort d'investissement sont considérables. Une pénurie de capital, si celui-ci était insuffisamment renouvelé, pourrait placer l'économie française en situation de ne pas pouvoir soutenir une reprise vigoureuse de l'économie mondiale dans les années à venir. On a déjà pu observer en 2000 une certaine saturation des capacités de production. En outre, l'investissement, l'emploi et la compétitivité vont généralement de pair. Une panne d'investissement ne serait pas une chance mais un frein pour l'emploi.
A. 1. LES DÉBATS SUR LA CROISSANCE POTENTIELLE
Des travaux récents apportent un éclairage particulier sur le lien entre la croissance, l'emploi et l'investissement et sont de nature à reconsidérer fortement le rôle de l'investissement. De nombreux travaux économétriques sur données individuelles 91 ( * ) semblent montrer, en France comme aux Etats-Unis qu'existe à long terme une forme de complémentarité entre l'emploi et la demande de capital, donc l'investissement. A long terme, les facteurs favorables à l'emploi sont aussi favorables à la croissance et à l'investissement. Toute politique de nature à soutenir l'investissement et à augmenter le niveau de la croissance potentielle exerce à long terme un effet positif sur l'emploi.
On rappelle que la croissance potentielle est définie comme le rythme de croissance compatible avec une inflation stable. Elle dépend de l'augmentation des quantités de travail et de capital disponibles, des gains d'efficacité réalisés par les entreprises et de l'ensemble des mécanismes macroéconomiques d'ajustement des prix et du marché du travail. Pour une entreprise, la production potentielle ne constitue pas à proprement parler une limite physique de capacité, elle représente plutôt le niveau de production qui leur assure la meilleure profitabilité. A très long terme pour l'ensemble de l'économie, la croissance potentielle est contrainte par la progression de la population active et le progrès technique qui constituent les deux ressources rares de l'économie. Le capital, pour sa part, est productible et accumulable et il vient donc s'ajuster aux besoins de la main d'oeuvre et de la technologie. Sur un horizon de plus court terme, en revanche, la croissance potentielle peut être contrainte par une progression insuffisante du stock de capital. C'est en particulier le cas si l'investissement passé a été déprimé par une faible profitabilité des entreprises. Les tensions sur l'appareil productif français observées à la fin de l'année 2000 rappellent à quel point cette contrainte a pu peser sur les entreprises françaises au cours des années 1990.
Les débats sur la croissance potentielle de l'économie française ont été relancés par l'exemple des Etats-Unis. Aux Etats-Unis, la plupart des travaux mettaient en évidence le rôle fondamental de l'investissement, notamment en technologies de l'information et des communications, dans l'accélération des gains de productivité du travail depuis 1995. C'est l'expansion phénoménale de l'investissement qui, en augmentant l'intensité capitalistique, aurait élevé le niveau de la croissance potentielle, permettant ainsi aux Etats-Unis de connaître un des plus long cycle de croissance non inflationniste de son histoire. La croissance potentielle de l'économie américaine, à l'issue de plusieurs années de fort dynamisme de l'investissement, est ainsi supérieure de près d'un point à celle qu'autorise la croissance de la population active et du progrès technique (4 % contre 3 % respectivement). Une telle situation a permis à ce pays de connaître un des plus faible taux de chômage de son histoire (moins de 4 %).
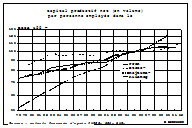
C'est exactement l'inverse qui s'est produit en France. La substitution du capital au travail a nettement ralenti en France au point que l'intensité capitalistique a diminué avec pour conséquence le ralentissement des gains de productivité du travail. Cette dernière conséquence, autrement dit « l'enrichissement de la croissance en emploi », était un des objectifs affichés des pouvoirs publics pour réduire le chômage. Depuis 1993, le rythme de la progression du capital par tête s'est nettement ralenti en France (+1,1 % l'an) alors qu'il a eu tendance à progresser fortement aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni. Le processus de substitution du travail au capital a été également observé en Allemagne, mais dans des proportions plus faibles.
Tant que la production était contrainte par une insuffisance de la demande 92 ( * ) , la recherche des gisements d'emploi par des freins aux gains de productivité devait être considérée comme un élément de la politique de l'emploi. Mais de nombreux indicateurs semblent témoigner que cette période d'économie contrainte par l'insuffisance de demande est révolue.
Selon une étude de la Direction de la Prévision (Doisy 2001), la croissance potentielle de l'économie française s'est relevée au cours de la seconde moitié des années 90, passant de 2 % à 2,5 % l'an. Ce constat est également effectué par l'OCDE dans son Etude économique sur la France (2001).
Cette accélération du potentiel de croissance s'explique par le dynamisme récent de l'investissement et par l'amélioration structurelle de l'emploi (le taux de chômage structurel s'établirait à 8,5 % et aurait baissé de près de 2 points depuis le milieu des années 90, sous l'effet des allégements de charges et de la baisse du coût du capital). Et si l'économie française a pu croître sur la période 1997-2000 sans accélération des prix et à un rythme proche de 3 %, supérieur à la croissance potentielle, c'est parce que la France rattrapait un déficit de la demande.
A moyen terme, un objectif de croissance proche de 3 % par an passe par un renforcement de notre potentiel d'offre. Comme le note Doisy, ceci suppose que l'investissement des entreprises reste très dynamique et que les mesures d'aide au retour à l'emploi manifestent pleinement leurs effets sur le chômage structurel et les taux d'activité. La vision de cette économie est celle d'une économie fortement créatrice d'emplois où se conjuguent croissance, investissement, gains de productivité du travail, et réduction du chômage à l'instar de l'expérience américaine récente.
L'augmentation de la croissance potentielle
au cours des années 1990 et prévision à 2005
|
2003-2005 |
|||||||||||||||
|
1980-1989 |
1990-1997 |
1998-2001 |
Hypothèse basse |
Hypothèse forte |
|||||||||||
|
Croissance potentielle :
|
1,9 |
2,2 |
2,3 |
2,6 |
2,9 |
||||||||||
|
- secteur privé |
1,7 |
2,3 |
2,4 |
2,6 |
2,9 |
||||||||||
|
dont |
|||||||||||||||
|
Capital |
1,1 |
0,9 |
0,9 |
1,2 |
1,2 |
||||||||||
|
Travail |
-0,6 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,5 |
||||||||||
|
Productivité globale des facteurs |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,2 |
1,2 |
||||||||||
Source : Direction de la Prévision, Doisy, 2001
A l'horizon 2005, les estimations de croissance potentielle retenues par Doisy reposent sur un prolongement des tendances passées de progrès technique (les effets éventuels d'une accélération due à la diffusion des technologies de l'information et des communications seront de toute façon lents à venir) et un repli d'ampleur modérée du chômage structurel. La réduction du taux de chômage structurel se poursuivrait sous l'effet principalement des baisses d'impôts directs et indirects. Le taux de chômage pourrait s'établir en fin de période à 7,5 %. Mais l'hypothèse centrale de ce scénario a trait à la croissance du capital productif qui resterait forte (3 % par an). Si le taux d'accroissement du capital physique augmente comme le produit national, l'économie peut poursuivre son chemin à un rythme constant sans buter sur les capacités de production. Une croissance potentielle du PIB de l'ordre de 3 % suppose donc une croissance du capital physique du même ordre. Or, une telle croissance suppose que l'investissement des entreprises françaises demeure dynamique, avec une croissance équivalente à celle de la période 1998-2000, de l'ordre de 6 % par an. Une telle hypothèse paraît ambitieuse au vu de la situation financière actuelle des entreprises françaises.
B. 2. LES ORIENTATIONS POSSIBLES D'UNE POLITIQUE DE L'INVESTISSEMENT
Si l'enjeu de l'accélération de la croissance potentielle repose sur un rythme élevé d'investissement, quels sont les facteurs susceptibles de favoriser un tel mouvement ? La politique de l'investissement soulève des problèmes complexes : les mesures fiscales sont-elle efficaces ? Vaut-il mieux baisser les taux d'intérêt ou soutenir la demande globale ?
Les mesures de politiques budgétaires globales paraissent d'une efficacité faible et transitoire. On peut distinguer deux catégories de politique budgétaire destinées à favoriser l'investissement productif : les incitations fiscales et les aides financières directes.
En France, la politique de l'investissement s'est profondément modifiée au cours des années 1980. Au début de la période, l'investissement avait été encouragé par des actions sectorielles sous formes d'aides directes et de subventions, traduisant une politique industrielle au profit des secteurs en crise (textile, construction navale, sidérurgie, chimie) ou de secteurs supposés porteurs (constitution d'une filière électronique). Il est vite apparu que le soutien aux secteurs porteurs ou en déclin, souvent temporaire, conduisait à une mauvaise allocation des ressources, les premiers bénéficiant d'un effet d'aubaine alors qu'ils auraient de toute façon investi, la restructuration des seconds étant retardée. Il s'avère que dans ce domaine comme dans d'autre, l'efficacité des aides sectorielles directes à court terme est mise en doute à la fois par beaucoup d'économistes comme par la plupart des chefs d'entreprises. Les aides sectorielles à long terme, par un soutien financier ou des commandes directes, peuvent rester légitimes pour des projets risqués (A3 XX, dépenses de défense nationale,...) en raison notamment de la myopie des marchés financiers ou des primes de risque élevées qui seraient réclamées sur ces mêmes marchés.
En termes d'aides directes, l'efficacité de la politique de l'Etat devrait se concentrer sur la politique d'innovation et de recherche. Les découvertes et les innovations scientifiques et techniques se diffusent de sorte que les entreprises ou les auteurs ne peuvent pas en capter tous les bénéfices et peuvent ne pas être suffisamment incités à engager les coûts nécessaires, ce qui justifie une intervention publique. Le gouvernement américain a toujours cherché à soutenir la recherche et les industries de pointe à la base de leur démarrage. L'Etat fédéral américain participe au financement des activités de recherche (près de 70 milliards de dollars par an en 1995 dont plus du tiers est versé directement aux entreprises américaines) et cet effort est monté en puissance au cours des dernières années. Le nouvel environnement géopolitique laisse à penser que cet effort n'est pas prêt de diminuer. Il existe dans ce domaine un retard considérable de l'Union européenne par rapport aux Etats-Unis (Muldur, 2000, estime ce rapport d'environ 1 à 4). A cet égard, un des exemples les plus marquants des vingt dernières années tient au développement des TIC : une partie importante de l'effort de R&D est assuré sur le budget du Department of Defense , qui a été et reste à la source du développement de l'Internet. Le financement de ces recherches ont sans nul doute permis aux entreprises américaines d'acquérir des avantages compétitifs dans les secteurs technologiques et ce n'est certainement pas une coïncidence si la « nouvelle économie » s'est développée à partir d'une formidable croissance des investissements dans les nouvelles technologies.
Toutefois, les demandes des entreprises mettent la priorité sur la nécessité pour l'Etat d'assurer un environnement stable qui favorise les comportements tournés vers la croissance et la prise de décisions de long terme. Aussi, depuis le milieu des années 1980, la politique de l'investissement passe par une action sur l'environnement des entreprises, principalement sous formes de mesures fiscales, au rang desquelles figure l'abaissement progressif du taux de l'imposition sur les sociétés en France.
Les incitations fiscales à l'investissement peuvent se présenter sous des formes variées : taux d'intérêt ou taux d'imposition préférentiel pour certains projets, possibilité de mettre en place des procédures d'amortissement accéléré, déductibilité des intérêts d'emprunts ou crédits d'impôt...Toutes ces mesures en en commun d'alléger le coût du capital. Les travaux récents de Crépon et Gianella (2001) pour la France montrent que leur effet serait non négligeable alors qu'elles ont été longtemps considérées comme peu efficaces : selon ces travaux, si le taux de l'impôt sur les sociétés était porté à 50 %, il faudrait s'attendre à une baisse du niveau de l'investissement productif de près de 10 %, ce qui se traduirait par une récession majeure et une perte de croissance potentielle. Le même raisonnement associerait un résultat positif inverse à une baisse du taux de l'impôt.
Les travaux récents insistent sur l'hétérogénéité des comportements d'investissement et sur les contraintes de financement qui pèsent sur les PME-PMI, notamment dans les périodes de récession. Ces difficultés renforcent le caractère pro-cyclique de l'investissement. Les PME, et plus particulièrement les entreprises en création, rencontrent des difficultés d'accès aux marchés financiers en raison d'asymétries d'information entre elles et leurs banquiers. Les plus fragiles par leurs tailles et leurs moyens, ces entreprises fournissent près des deux tiers de l'investissement productif et sont représentatives de la compétitivité d'une économie. Il importe donc de favoriser leur développement et ceci nécessite de dispositifs spécifiques. Le caractère global et non sélectif des aides financières directes conduit à faire bénéficier certaines entreprises d'un effet d'aubaine au détriment de celles auxquelles elles sont destinées. En revanche, les mesures favorables au financement en fonds propres ou le développement des possibilités d'accès au crédit apparaissent particulièrement adaptées à la situation des PME-PMI. Ces considérations font partie des préoccupations des pouvoirs publics, notamment depuis la création de la Banque de financement des Petites et Moyennes Entreprises (BDPME). Elles devraient rester un enjeu de politique économique.
En France, une source d'inefficacité majeure de la fiscalité sur l'investissement est sa complexité. Les PME ne disposent des moyens suffisants pour en tirer partie. Entre les aides de l'Etat, les aides européennes et celles des collectivités locales, ce sont de nombreux dispositifs. Une autre source d'inefficacité tient à l'incertitude sur l'environnement fiscal des entreprises : la fréquence des changements législatifs porte probablement préjudice à l'investissement. La simplification et la stabilisation des dispositions réglementaires existantes paraissent donc souhaitables.
L'étude de l'évolution de l'investissement productif dans les différents pays étudiés a permis d'expliciter les facteurs de développement de l'investissement. Le niveau d'investissement des entreprises dépend des perspectives d'évolution de la demande et du niveau de la profitabilité. La vitesse de diffusion de l'innovation sous toutes ses formes et des technologies de l'information et des communications en particulier sera en outre un des enjeux majeurs de la prochaine décennie. Enfin, les difficultés particulières rencontrées par les PME et PMI et leur poids considérable dans l'économie nationale justifient des mesures spécifiques.
C. A. L'IMPORTANCE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
La période de croissance économique de l'investissement qu'ont connue les Etats-Unis au cours des années 1990, sans précédent depuis la fin de la seconde guerre mondiale, a montré le rôle spécifique joué par la diffusion des technologies de l'information. Cette diffusion a été facilitée par l'accélération de la baisse des prix de ces technologies. Il est souhaitable que notre pays entre dans une telle dynamique, ce qui passe probablement par une concurrence et un haut niveau d'innovation dans les secteurs producteurs, par des baisses de prix dans les domaines régulés, notamment en matière de services de télécommunications et d'accès à Internet au haut débit. Il importe également d'orienter l'épargne vers les secteurs des nouvelles technologies, dont les besoins de financement demeurent considérables. Le développement du capital risque est essentiel pour permettre aux entreprises françaises de développer de nouveaux projets.
D. B. LE RÔLE ESSENTIEL DE LA PROFITABILITÉ
De façon générale, un des principaux déterminants de la décision d'investir est la profitabilité du capital. Cette idée constitue l'un des résultats majeurs des travaux économiques des dix dernières années (voir chapitre 3). Le retour attendu de l'investissement doit être tel que la rémunération du capital soit sensiblement supérieure à celle que l'on peut obtenir sans risque sur les marchés obligataires d'Etat, couvrant ainsi la prime de risque associée à chaque investissement. Toute politique économique de nature à préserver ou améliorer la profitabilité des entreprises favorise également l'investissement. Il existe de multiples moyens d'améliorer la profitabilité. Le premier canal transite par l'augmentation de la rentabilité économique. Le second canal repose sur la baisse des taux d'intérêt réels.
La rentabilité économique, qui est le rapport entre la rémunération du capital nette de son amortissement au stock net de capital, mesure la performance économique du point de vue de l'entreprise des entreprises. La rentabilité économique croit avec le taux de marge (ou le taux de profit) ainsi qu'avec l'efficacité productive du capital. Toute politique visant à l'amélioration des marges des entreprises (baisses des impôts indirects, baisse des charges sociales) ou visant à la préservation des profits (baisse des impôts directs) est donc de nature à améliorer la rentabilité du capital et favorise l'investissement des entreprises.
La modération salariale, si elle conduit à un maintien des taux de marges, constitue aussi l'un des enjeux les plus importants du maintien de la rentabilité des entreprises. Elle est favorable à l'emploi et à l'investissement.
Les baisses des taux d'intérêt réels constituent également l'un des déterminants majeurs de la décision d'investir. L'Europe a créé un grand marché, vaincu l'inflation, assaini ses finances publiques, institué une monnaie commune qui constitue dès aujourd'hui un succès. Ces évolutions ont contribué à la baisse des taux d'intérêt réels observée au cours des dix dernières années. L'Europe dispose de beaucoup d'atouts pour une croissance durable, mais il faut pour y parvenir qu'elle mette en place une bonne articulation des différents volets de politique économique.
E. C. UNE POLITIQUE MACROÉCONOMIQUE ADAPTÉE
L'expérience des Etats-Unis de la décennie passée a illustré les vertus de l'articulation entre politique monétaire et politique budgétaire. La condition de la détente de la politique monétaire est la maîtrise des déficits publics, voire la reconstitution d'excédents publics. Les pays européens ont encore une situation budgétaire peu favorable ; ils font face à des problèmes de finance publique très sérieux liés au vieillissement et à l'accumulation d'engagements implicites par les administrations publiques. Tout plaide pour que la coordination entre les gouvernements européens et le dialogue avec la Banque centrale Européenne, tracent la voie d'un policy mix européen combinant consolidation budgétaire et politique monétaire favorable à la croissance.
F. D. LES POLITIQUES STRUCTURELLES
Toute aussi importante pour le renouvellement des capacités productives est la qualité de l'articulation entre politiques structurelles et politiques macro-économiques. Les réformes structurelles, qu'il s'agisse de l'accroissement des taux d'emploi par une remontée des taux d'activité et une baisse du chômage structurel, de la libéralisation des marchés des biens et des services, restent l'une des priorités majeures de l'Union européenne. Elles permettent de renforcer le potentiel de croissance de l'économie, soutiennent la demande et obligent les entreprises à améliorer leur profitabilité.
Il appartient aux gouvernements de mettre en oeuvre les mesures structurelles et à la banque centrale européenne de mettre en place leur accompagnement monétaire. Cela nécessite d'établir un cadre conceptuel sur les objectifs et les moyens d'une politique de croissance durable au niveau européen. Certaines instances européennes de coordination existent déjà mais il est nécessaire de poursuivre les efforts. L'absence totale de coordination sur les modalités d'attribution des droits d'usage des fréquences radioélectriques UMTS - l'un des plus importants projets d'investissement de quinze prochaines années- montre l'ampleur des progrès qui restent à accomplir.
CHAPITRE 2
L'INVESTISSEMENT : DÉFINITION ET CONCEPT
Dans le langage courant, la notion d'investissement décrit une multitude d'opération : on investit en bourse, dans l'achat d'une nouvelle voiture, dans l'éducation de ses enfants, dans l'acquisition d'un logement ou dans une nouvelle machine. La définition économique est plus précise : c'est l'acquisition de biens de production. C'est un flux qui alimente le stock de capital.
Au niveau microéconomique, la comptabilité privée identifie trois grands types d'investissement : les investissements matériels (terrains, constructions, machines, outillage...), les investissements financiers (prises de participation, achats de titres...) et certains investissements immatériels (brevets, licences, marques, fonds de commerce). La comptabilité nationale privilégie la notion d'accroissement du capital fixe.
I. 1. LA FBCF : UNE CONCEPTION LIMITATIVE DE L'INVESTISSEMENT
La comptabilité nationale française définit l'investissement par la Formation Brute de Capital Fixe (FBCF) « les actifs fixes sont des actifs produits, corporels ou incorporels, utilisés dans un processus de production pendant au moins un an ». Il s'agit donc de l'acquisition de bâtiments, machines, logiciels, ... dont la durée de vie est supérieure à un an.
|
L'investissement dans le système européen de comptabilité 1. La FBCF (Formation Brute de Capital Fixe) est le solde entre les acquisitions et les cessions d'actifs fixes réalisées par les producteurs résidents sur le sol français au cours de la période de référence. Les actifs fixes sont des actifs produits, corporels ou incorporels, utilisés dans un processus de production pendant au moins un an, tels que les bâtiments, ouvrages de génie civil, et des machines. La FBCF comprend également les animaux utilisés dans le processus de production. Elle est évaluée au prix d'acquisition (y compris les frais d'installation et les coûts relatifs au transfert de propriété). 2. Les comptes nationaux sont désormais établis selon le système européen de comptabilité en base 1995 (SEC 95), qui se substitue à l'ancienne base 1980. A l'occasion de cette transformation, la notion de FBCF a été élargie aux logiciels, aux dépenses de prospections minières, aux oeuvres littéraires ou artistiques et aux dépenses militaires pouvant servir à des fins civiles (aérodromes, routes, hôpitaux, camions), alors que ces dépenses étaient auparavant considérées comme une consommation intermédiaire. Leur inclusion dans la FBCF a donc eu pour conséquence un accroissement du PIB. 3. Les départements et territoires d'outre-mer (DOM-TOM) ont été incorporés au territoire économique de la nouvelle base. Au total, en 1996, la FBCF des entreprises se trouve rehaussée de 10 % par rapport à l'ancienne base. Près des deux tiers de cet écart sont dus à l'incorporation des DOM, et un tiers à la prise en compte des produits immatériels (essentiellement logiciels). 4. Cette nouvelle définition de la FBCF, adoptée au niveau européen, reste très éloignée des préconisations des comptables français. Ceux-ci recommandent en effet d'incorporer les dépenses de R & D dans la FBCF. |
Certaines dépenses de services peuvent également être assimilées à des investissements dans la mesure où elles accroissent la capacité de production de l'entreprise. Il en est ainsi des dépenses commerciales, de formation, de recherche développement, que l'on nomme souvent « investissements immatériels ». Ceux-ci, quoique de plus en plus présents dans les comptes des entreprises, demeurent exclus pour l'essentiel de l'investissement par la comptabilité nationale qui les considère comme des consommations intermédiaires (à l'exception notable des logiciels). De même, la comptabilité nationale ne prend pas en compte dans la FBCF les « investissements financiers » (nationaux ou étrangers) qui constituent en fait des placements.
Il s'agit donc d'une définition plutôt restrictive, soulignant le rôle de l'investissement dans les capacités de production physiques d'une économie, mais apparaissant à tous les égards trop limitée par rapport à cet objectif même.
Pour situer les enjeux, la FBCF des entreprises françaises était de 164,6 milliards d'euros en 2000. Les investissements immatériels hors FBCF (publicité, formation, R & D) représentaient près de 42 % de ce montant (voir tableau 1). L'effort de recherche et développement des entreprises représentait en 1998 17,7 milliards d'euros soit 1, 4 % du PIB. Les dépenses de publicité, essentielles dans la valorisation de la marque qui constitue un actif intangible central dans le processus de création de valeur, représentaient 26,4 milliards d'euros soit 2 % du PIB.
Les investissements directs de l'étranger en France s'établissaient en 1998 à 12 milliards d'euros, les investissements français à l'étranger s'élevant à 46,8 milliards d'euros.
|
Tableau 1 L'investissement matériel et immatériel des Sociétés non financières et entreprises individuelles françaises |
||||||
|
(en milliards d'euros) |
||||||
|
1990 |
1995 |
1998 |
En % de la FBCF |
|||
|
FBCF |
127,0 |
122,4 |
130,1 |
100 |
||
|
dont investissement matériel |
124,1 |
118,8 |
124,6 |
95,8 |
||
|
dont investissement immatériel |
2,9 |
3,6 |
5,5 |
4,2 |
||
|
dont logiciels |
2,1 |
2,6 |
4,3 |
3,3 |
||
|
Formes d'investissement immatériel hors FBCF |
40,8 |
49,0 |
53,8 |
41,4 |
||
|
dont recherche et développement |
14,5 |
16,6 |
17,7 |
13,6 |
||
|
dont transferts techniques |
2,1 |
2,3 |
2,9 |
2,2 |
||
|
dont formation |
6,0 |
6,8 |
6,9 |
5,3 |
||
|
dont publicité |
18,2 |
23,4 |
26,4 |
20,3 |
||
|
Sources : calculs Rexecode d'après INSEE (Comptabilité Nationale), SJTI, INPI, CEREQ, MRT |
||||||
D'après les comptes de patrimoine de l'INSEE, les actifs non financiers hors stocks des entreprises (hors entreprises individuelles) représentaient en 2000 1 849 milliards d'euros, les stocks 299 milliards d'euros. Les actifs financiers des sociétés non financières étaient équivalents à 3 324 milliards d'euros, dont 582 milliards d'euros de crédit interentreprises et de crédit de trésorerie.
Dans la terminologie FBCF, il s'agit de la formation brute de capital. Le stock de capital mesure un ensemble de biens matériels ou immatériels dont l'usage s'étend sur plusieurs périodes. Le stock de capital est soumis à deux flux opposés, l'investissement brut et l'amortissement. Le premier, appelé FBCF, permet d'accroître le stock de capital ; le second, l'amortissement ou consommation de capital fixe, correspond à l'usure, au déclassement et à l'obsolescence du capital antérieur. Cette dépréciation peut être due à des facteurs techniques (usure), mais surtout à des facteurs économiques : certains équipements ou logiciels sont déclassés car non rentables ou dépassés, et on ne les utilise plus, bien qu'ils soient en état de fonctionner.
L'accumulation du capital ou investissement net correspond à la différence entre l'investissement brut et l'amortissement. Ainsi, une partie de l'investissement brut sert-elle à compenser la dépréciation du stock de capital, de manière à maintenir à l'identique l'appareil productif. Cet investissement de remplacement est appelé par la comptabilité nationale « consommation de capital fixe ». Il s'agit de l'amortissement économique et non de l'amortissement comptable ou des dotations pour amortissement enregistrées dans les comptes des entreprises, notions qui sont calculées en fonction des règles fiscales en vigueur. On notera que du point de vue économique, les deux notions ne sont toutefois pas très différentes.
En 2000, le taux de dépréciation économique du stock de capital net des entreprises s'est élevé à 7,9 %, ce qui signifie que la consommation de capital fixe représentait 7,9 % du stock de capital net installé. Il y a bien sûr des différences entre produits. Le taux de dépréciation des bâtiments non résidentiels s'établissait à 3,7 % et celui des équipements et logiciels à 14,3 %.
Seul l'investissement net permet d'accroître le stock de capital net et a des effets sur l'augmentation du potentiel de croissance de l'économie.
|
Le stock de capital fixe Le stock de capital n'est pas mesuré directement par la comptabilité nationale, mais évalué sous des hypothèses de durée de vie hétérogènes selon la nature des biens ou produits. On distingue deux notions associées au stock de capital. Le capital fixe brut résulte simplement de l'accumulation au fil du temps des actifs acquis en FBCF. Etant donné qu'il ne tient pas compte de l'usure des équipements et de la consommation de capital fixe, on préfère généralement utiliser le capital fixe net , qui correspond au capital fixe brut diminué du cumul de la consommation de capital fixe. Cette notion économique représente en principe la dépense qu'il conviendrait d'effectuer pour reconstituer en l'état ce capital existant. |
II. 2. LES DIFFÉRENTS SECTEURS INVESTISSEURS
La comptabilité nationale distingue plusieurs agents économiques qui investissent : les ménages, les administrations publiques et les entreprises. Parmi ces dernières, trois secteurs sont parfois distingués : les sociétés non financières, les entreprises individuelles, et les sociétés financières. Les sociétés non financières comprennent également les entreprises détenues majoritairement par les administrations publiques appelées autrefois les grandes entreprises nationales (GEN). En 2000, la FBCF totale en France s'est élevée à 276,5 milliards d'euros, soit 19,6 % du PIB. L'investissement des administrations publiques représentait 42,2 milliards d'euros (3 % du PIB). L'investissement des ménages s'établissait à 81,5 milliards d'euros (5,8 % du PIB). Cette dernière dépense est constituée essentiellement d'achat et d'entretien de logement (4,9 % du PIB), le reste (0,9 % du PIB) étant le fait des entreprises individuelles.
Les sociétés non financières ont dépensé pour plus de 141 milliards d'euros en 2000 en FBCF, alors que la FBCF des sociétés financières, très dynamique, atteignait 11,4 milliards d'euros. Au total, l'investissement productif qui correspond à l'investissement de toutes les entreprises françaises, sociétés financières et non financières, et entreprises individuelles, a représenté en 2000 164,6 milliards d'euros, soit 11,7 % du PIB.
Dans les années 1990, l'évolution de la composition de la FBCF des entreprises (tableau 2) fait ressortir l'essor des services marchands, qui passent de 57 % de l'investissement total en 1990 (78 milliards d'euros) à près de 65 % en 1999 (98,6 milliards d'euros), alors que l'investissement industriel régresse en monnaie courante (de 42,1 à 35,3 milliards d'euros). Ainsi en 1999, l'investissement des activités de services principalement marchands représentait plus de trois fois celui de l'industrie.
Tableau 2
Formation brute de capital fixe des entreprises par branche, à prix courants
|
FBCF |
Part dans la VA |
|||||||
|
en milliards d'euros |
en % du total |
|||||||
|
1990 |
1999 |
1990 |
1999 |
1999 |
||||
|
Ensemble |
132,4 |
147,1 |
100 |
100 |
100,0 |
|||
|
Agriculture, sylviculture, pêche |
8,6 |
9,6 |
6,5 |
6,5 |
3,7 |
|||
|
Industrie |
42,1 |
35,3 |
31,8 |
24,0 |
25,9 |
|||
|
Industries agricoles et alimentaires |
6,0 |
4,4 |
4,5 |
3,0 |
3,3 |
|||
|
Industries des biens de consommation |
4,7 |
4,0 |
3,5 |
2,7 |
4,2 |
|||
|
Industrie automobile |
3,5 |
3,1 |
2,6 |
2,1 |
1,9 |
|||
|
Industries des biens d'équipement |
4,1 |
4,4 |
3,1 |
3,0 |
4,7 |
|||
|
Industries des biens intermédiaires |
16,1 |
14,0 |
12,2 |
9,5 |
8,5 |
|||
|
Energie |
7,7 |
5,5 |
5,8 |
3,7 |
3,3 |
|||
|
Construction |
3,7 |
3,5 |
2,8 |
2,4 |
5,6 |
|||
|
Services principalement marchands |
78,0 |
98,6 |
58,9 |
67,1 |
64,8 |
|||
|
Commerce |
11,4 |
13,7 |
8,6 |
9,3 |
12,5 |
|||
|
Transports |
13,2 |
13,3 |
10,0 |
9,1 |
5,2 |
|||
|
Activités financières |
10,1 |
10,2 |
7,7 |
6,9 |
5,8 |
|||
|
Activités immobilières |
14,4 |
23,9 |
10,9 |
16,3 |
15,4 |
|||
|
Services aux entreprises |
20,2 |
28,8 |
15,3 |
19,6 |
18,7 |
|||
|
Postes et télécommunications |
6,2 |
6,4 |
4,7 |
4,4 |
2,7 |
|||
|
Conseils et assistance |
4,3 |
6,3 |
3,2 |
4,3 |
8,4 |
|||
|
Services opérationnels |
8,8 |
14,4 |
6,6 |
9,8 |
5,9 |
|||
|
Location sans opérateur |
5,7 |
11,8 |
4,3 |
8,0 |
1,2 |
|||
|
Loc. de véhicules automobiles |
2,8 |
5,5 |
2,1 |
3,8 |
0,4 |
|||
|
Services aux particuliers |
8,6 |
8,7 |
6,5 |
5,9 |
7,1 |
|||
Sources : INSEE, comptes nationaux
Cette évolution correspond à une tendance de fond des économies industrialisées, à la suite de la montée du secteur tertiaire. Cela montre aussi le caractère limitatif (ou partiel) des enquêtes centrées sur l'investissement industriel qui ne décrivent ou ne retracent qu'une part de moins en moins importante de l'investissement (mais qui reste déterminante pour la compétitivité de notre économie). Peut-être faudrait-il développer un suivi conjoncturel de l'investissement dans les secteurs tertiaires.
Aujourd'hui, l'investissement est essentiellement le fait du secteur tertiaire des services. Dans celui-ci, le rôle des activités immobilières et des services opérationnels (notamment, la location sans opérateur, d'automobiles, de matériel informatique, de machines et équipements divers) devient prépondérant dans les années 1990. Pendant cette décennie, leur contribution à la croissance de l'investissement productif en France représente près de 100 % du total (+15,1 milliards d'euros entre 1990 et 1999 pour une variation totale de 15,3 milliards d'euros). De telles transformations du secteur productif s'expliquent par un mouvement continu d'externalisation. Les entreprises françaises, comme leurs homologues étrangères, trouvent préférable la location de services (immobilier, biens d'équipement et transport) plutôt que d'investir par leurs propres moyens.
Répartition des entreprises au régime
réel des bénéfices industriels
et commerciaux suivant
la taille des effectifs
|
Effectif |
Proportion cumulée du Chiffre d'affaire |
Proportion cumulée de l'investissement
|
|
0 |
4,5 |
17,9 |
|
1 |
6,0 |
19,9 |
|
2 à 4 |
10,1 |
23,3 |
|
5 à 9 |
16,0 |
27,2 |
|
10 à 19 |
21,8 |
31,2 |
|
20 à 49 |
33,5 |
39,9 |
|
50 à 99 |
39,9 |
46,9 |
|
100 à 199 |
46,9 |
56,0 |
|
200 à 499 |
57,2 |
64,9 |
Source : INSEE (SUSE), Année 1998
Proportionnellement à leur chiffre d'affaires, les petites et moyennes entreprises investissent plus que les grandes. Les entreprises de moins de 20 salariés, qui représentent 21,8 % du chiffre d'affaires total des entreprises françaises investissement pour plus de 31 % de l'effort total d'investissement des entreprises. Une politique de soutien à l'investissement doit donc tenir compte du rôle important des PME.
CHAPITRE 3
LES DÉTERMINANTS DE L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF
Le comportement d'investissement des entreprises fait l'objet d'un grand nombre de travaux théoriques et empiriques. Leur but est d'identifier les déterminants de l'investissement des entreprises et de mesurer la façon dont la politique économique - essentiellement à travers la fiscalité des entreprises et des ménages et le niveau des taux d'intérêt - influence ce comportement.
D'un point de vue théorique, plusieurs conditions sont à réunir pour un développement de l'investissement. Une demande suffisante justifiant un besoin d'équipement nouveau, une capacité financière suffisante permettant l'effort d'investissement, un avenir assez assuré autorisant une prise de risque. Une seule condition ne suffit pas pour accroître l'investissement, mais un frein suffit à en reporter la réalisation.
I. 1. LE MODÈLE NÉO-CLASSIQUE PUR
L'analyse microéconomique de l'entreprise en concurrence parfaite 93 ( * ) fournit le cadre conceptuel le plus traditionnel du comportement d'investissement. Dans ce cadre théorique plutôt adapté aux comportements de long terme, la flexibilité des prix du marché des biens qu'elle produit et des facteurs qu'elle utilise, travail et capital, permet d'assurer l'équilibre entre offre et demande de biens ; l'entreprise n'est pas contrainte sur ses débouchés. Elle choisit la combinaison productive capital/travail qui lui permet de réaliser le profit le plus élevé, étant donnés les coûts de ses facteurs. En généralisant à l'ensemble des firmes, on obtient un modèle théorique simple de l'investissement, qui fait intervenir comme seuls déterminants de l'investissement 94 ( * ) le coût d'usage du capital, lequel tient compte non seulement du taux d'intérêt mais aussi des prix des équipements, de leur obsolescence et de la fiscalité des entreprises et des ménages, et le coût réel du travail.
Au niveau individuel, une variation du coût d'un facteur agit sur les demandes de facteurs principalement par deux canaux. Le premier correspond à une modification de la combinaison productive . Ainsi une hausse du coût du capital (par rapport à celui du travail) conduit à réduire l'intensité capitalistique. Ce mouvement est d'autant plus prononcé que le processus de production de l'entreprise le permet (on dit que l'élasticité de substitution entre les facteurs est importante). La production devient ainsi plus intensive en travail. Outre cet ajustement sur la combinaison productive, une hausse du coût du capital aura également un effet sur la demande des facteurs via l'élévation du coût de production unitaire . Si l'entreprise répercute cette hausse dans les prix -et on peut considérer qu'à long terme ceci est inéluctable-, ses ventes se réduisent toutes choses égales par ailleurs.
Au total, l'activité de l'entreprise est plus intensive en main-d'oeuvre, mais sa production est moindre. Suivant l'importance des possibilités de substitution et la sensibilité aux prix de la demande adressée aux entreprises, une hausse du coût du capital peut aussi bien conduire à une hausse qu'à une baisse de l'emploi ; si les possibilités de substitution entre les facteurs sont limitées et que la demande est très sensible aux prix, une hausse du coût du capital engendrera inévitablement une baisse des effectifs, concomitante à la baisse de la production.
Le même raisonnement s'applique au prix du travail. Une hausse du coût du travail peut engendrer une baisse de la production qui pénalise l'investissement et ce malgré la substitution naturelle du capital au travail. De plus, la baisse des prélèvements ne constitue que l'un des facteurs d'amélioration du marché du travail : la plus grande fluidité du marché du travail, le développement du travail à temps partiel, l'incidence favorable de l'ouverture à la concurrence des marchés de produits sur les créations d'emploi constituent autant de facteurs favorables à l'emploi et à la croissance. Pour satisfaire les besoins des clients, les entreprises ont besoin de pouvoir organiser la production et plus généralement l'entreprise dans son ensemble de façon plus réactive : cela concerne bien évidemment les conditions d'embauche et de licenciement.
|
Le coût d'usage du capital : définition Quel est le coût du capital ? A de nombreux égards, il semble assez peu légitime de l'assimiler au taux d'intérêt réel. Et comme le capital est par définition, un bien utilisable sur plusieurs périodes, il n'est pas légitime de l'assimiler non plus au coût de l'investissement. Jorgenson (1963) a formalisé la notion de coût d'usage du capital. D'un point de vue théorique, le coût du facteur capital peut se définir comme un prix de location ou d'immobilisation. Le stock d'actifs physiques est détenu sur longue période et l'écriture d'un prix de location pour une période revient a supposer que la firme est en mesure de revendre son capital productif à chaque fin de période.
On considère fréquemment que le coût de
détention réel du capital appelé également
coût d'usage
c
t
.
est égal au produit du prix
réel des biens d'équipement
La justification d'une telle mesure du coût d'usage du capital correspond en fait à un processus simple d'optimisation des investisseurs. Supposons qu'un investisseur dispose à la date t-1 d'un patrimoine m t-1 qu'il désire récupérer un an plus tard. Deux alternatives s'offrent à lui : i) un placement sur les marchés financiers au taux d'intérêt réel. ii) un placement dans une entreprise qu'il recouvre l'année suivante. Pour ce faire, il utilise son patrimoine initial m t-1 dans une entreprise en achetant du capital K t au prix relatif p I, t-1 (si bien que m t-1= p I, t-1 K t ). Pendant l'année t, le capital installé K t lui rapporte un coût d'usage par unité c t . En fin de période, le capital installé s'est déprécié (de ) mais il peut être revendu sur un marché d'occasion au prix p I, t . A la date t, l'investisseur récupère le patrimoine m t . qui correspond au placement qu'il a choisi. S'il a choisi la solution i), alors son patrimoine réel est m t = m t-1 (1+r t ). Dans le cas ii), alors son patrimoine est la somme du coût d'usage et du prix de revente sur le marché d'occasion du capital installé mais déprécié : m t = c t K t + p I, t K t (1-). Si les marchés sont parfaits, l'absence d'arbitrage entre ces deux placements implique un rendement identique après liquidation :
m
t=
m
t-1
(1+r
t
) =
p
I, t-1
K
t
(1+r
t
) = c
t
K
t
+ p
I, t
K
t
(1-) soit c
t
=
p
I, t-1
(1+r
t
) - p
I, t
(1-). En notant
I,t
le taux de croissance du prix réel de l'investissement
(
Des définitions plus larges du coût du capital (Crépon et Gianella, 2001) peuvent intégrer à la fois la structure du bilan et le taux d'intérêt bancaire auquel se financent les entreprises, mais aussi la fiscalité pesant sur les sociétés et les détenteurs d'actions, l'inflation et les amortissements, qui constituent autant de facteurs affectant la détention du capital productif. Si ces facteurs sont omis, la mesure du coût d'usage du capital est entachée d'un certain nombre d'erreurs et d'approximations, ce qui explique peut-être que les travaux empiriques menés sur données agrégées ne permettent pas d'obtenir d'élasticités significatives des demandes de facteurs au coût relatif. Empiriquement, on observe au cours des quinze dernières années, en France comme à l'étranger, une baisse du coût du capital qui s'explique essentiellement par la baisse du coût réel des fonds propres et la constante diminution du prix relatif des biens d'investissement. Le coût des fonds propres dépend simultanément de l'évolution du taux d'intérêt nominal et de l'évolution de la fiscalité (et notamment de l'avantage fiscal lié à la dette, les intérêts étant déductibles de l'impôt sur les sociétés). En France, compte tenu de la relative stabilité du poids de la fiscalité, c'est principalement la baisse des taux d'intérêt qui explique l'évolution du coût des fonds propres. Il en est par conséquent de même pour ce qui concerne le coût d'usage du capital. |
L'analyse empirique de la sensibilité de l'investissement des entreprises au coût d'acquisition du capital était source de controverse. En particulier, la plupart des études macro-économétriques sur données françaises n'identifient pas un quelconque lien négatif entre l'investissement et le coût d'usage du capital ou même entre l'investissement et le taux d'intérêt réel (voir Artus et Muet, 1984 et Dormont, 1997). En revanche, des études plus récentes à partir de données d'entreprises mettent en évidence une réponse significative du capital à une variation de son coût d'usage, aussi bien en France (Crépon et Gianella, 2001) qu'aux Etats-Unis (Chirinko et alii, 1999).
Crépon et Gianella (2001) trouvent ainsi que les coûts des facteurs de production, travail et capital, expliquent les comportements de demande de travail et d'investissement des entreprises françaises. Selon leurs estimations, une hausse du coût d'un facteur affecte négativement la demande de l'entreprise pour chaque facteur. En d'autres termes, à la suite d'une élévation du coût du capital , la production devient plus riche en emploi, mais elle baisse suffisamment pour que l'effet net sur l'emploi soit négatif . De même, une hausse du coût du travail exercerait un effet négatif sur l'investissement et l'emploi.
Ceci signifie que l'effet de l'élévation du coût unitaire de production l'emporte largement sur l'effet de substitution entre les facteurs. A long terme, compte tenu des ajustements de l'offre et de la demande, on peut donc considérer que les facteurs de production capital et travail sont plus complémentaires que substituts.
Autre résultat intéressant, Crépon et Gianella montrent que la fiscalité des entreprises comme celle des ménages pèse plus fortement sur le financement par fonds propres que sur celui par endettement. Leurs résultats vont même un peu plus loin puisqu'ils permettent de quantifier les effets d'une modification de la fiscalité du capital. Ces auteurs considèrent à titre d'exemple la situation hypothétique dans laquelle le taux d'imposition des sociétés aurait été relevé de 36,7 % à 50 % en 1995, en considérant la structure de financement de l'entreprise inchangée.
Le choc de coût du capital ex-ante , causé par le relèvement du taux d'imposition, conduit à une progression substantielle du coût du capital, d'un ordre de grandeur de l'ordre de 9 % en moyenne. Le choc n'a pas la même ampleur pour toutes les entreprises. Il est d'autant moins important que l'entreprise est plus fortement endettée et recourt plus faiblement aux fonds propres. Les conséquences d'un tel choc sont significatives et résumées dans le tableau suivant :
Tableau 2
Effets de long terme d'une hausse du taux d'impôt
sur les sociétés de 36,7 % à 50 %.
|
Tertiaire |
Industrie |
|
|
Coût réel d'usage du capital |
8,9 |
9,4 |
|
Production |
-1,7 |
-4,3 |
|
Stock de capital |
-5,8 |
-12 |
|
Emploi |
-2,6 |
-6 |
L'activité décroît de 2 à 4 %. Cette baisse est d'autant plus forte que la demande est sensible aux prix (l'industrie est plus sévèrement affectée que le secteur tertiaire). Le volume de chacun des facteurs est également affecté : l'emploi diminue de 2,6 à 6 % et la demande d'investissement recule de 6 à 12 %.
II. 2. LE MODÈLE DE L'ACCÉLÉRATEUR SIMPLE
A court terme, les entreprises sont le plus souvent contraintes par les débouchés, par leurs capacités financières, par l'incertitude de leur environnement et le risque de défaillance. L'investissement s'ajuste donc sur la contrainte la plus forte qui peut être tour à tour l'une des trois précédentes. Il n'y a donc pas une seule loi de l'investissement, mais plusieurs lois qui se juxtaposent et s'additionnent.
L'effet d'accélération s'inscrit dans la vision keynésienne d'un équilibre économique contraint par les débouchés. La demande anticipée, généralement assimilée à la demande observée, est inférieure à l'offre constitue alors le principal déterminant de l'investissement. L'entreprise choisit les quantités de capital et de travail qui minimisent son coût, pour un niveau de production donné . Ce modèle est conforme à l'intuition des responsables d'entreprise qui constatent qu'une reprise de la demande entraîne plus ou moins rapidement une reprise de l'investissement.
L'adjonction de cette contrainte de débouchés conduit à un niveau de capital désiré qui dépend alors du coût relatif des facteurs de production, de la productivité tendancielle et du niveau anticipé des débouchés. Empiriquement, ces modèles donnent des résultats décevants sur données agrégées qui peuvent être liés à la construction de séries de coût des facteurs.
L'anticipation de la demande formulée par les entrepreneurs joue un rôle fondamental dans la détermination de l'investissement (Muet, 1979). En période de conjoncture morose, il est raisonnable de penser que les entreprises adoptent une stratégie d'investissement prudente, se contentant de limiter leurs dépenses aux investissements de renouvellement. On retrouve la situation du début des années 90 où, face à une demande moins forte qu'auparavant, l'investissement amplifie le mouvement de la valeur ajoutée. Les perspectives insuffisantes de débouchés sur le marché domestique, ou à l'étranger pour les firmes exportatrices, ont donc vraisemblablement contribué à ralentir l'effort d'investissement en France au début des années 90. De même en période de croissance soutenue, il est intéressant d'accroître les capacités productives afin de bénéficier de la hausse de la demande. Le dynamisme de l'investissement observé en France de 1998 à 2001 comme de 1988 à 1990 est à rapprocher de celui de la valeur ajoutée pendant les mêmes périodes.
Ce mouvement conjoint de l'investissement et de la valeur ajoutée décrit, dans sa version la plus simple, le principe de l'accélérateur : l'investissement est proportionnel à l'amélioration de la demande et augmente par conséquent avec l'accélération de celle-ci.
III. 3. LE MODÈLE ACCÉLÉRATEUR PROFIT
La relation précédente est bien vérifiée empiriquement et fournit la base des équations économétriques d'accélérations d'investissement. Cependant, cet effet d'accélération laisse sans explication une partie non négligeable des mouvements de l'investissement. En outre, il serait trop simplificateur de ramener les décisions d'investissement à une attitude consistant à suivre avec retard la demande. Créer ou conduire une entreprise comporte toujours une prise de risque, un pari sur l'avenir qui prend la forme d'un investissement. C'est en investissant que de nouveaux produits apparaissent, que des revenus supplémentaires sont distribués et que se crée en permanence une demande nouvelle. L'aptitude à innover, l'environnement économique et financier plus ou moins favorable à la prise de risque, le degré de confiance dans l'avenir sont autant de facteurs qui influencent l'investissement au-delà ou en deçà de la tendance de la demande du moment.
|
Le concept de rentabilité économique et de profitabilité Si l'on peut faire remonter le concept de profitabilité de l'investissement à la Théorie Générale de Keynes, sa définition formelle n'a été proposée qu'à la fin des années 1960 par Tobin, puis par Malinvaud dans ses Essais sur la théorie du chômage (1983). L'intuition du concept est simple : si un investissement est profitable, il doit être réalisé. Techniquement, la rentabilité économique brute est le ratio entre une mesure de la rémunération du capital ou du profit (excédent brut d'exploitation, marge brute d'autofinancement ou épargne brute, appelé également cash-flow) et le stock de capital net évalué à son coût de remplacement. Si l'on utilise une mesure de profit net d'amortissement, on parle de rentabilité nette. Dans nombre d'études, l'indicateur macroéconomique de profit brut retenu est généralement la marge brute d'autofinancement plutôt que l'excédent brut d'exploitation. La rentabilité économique peut être décomposée comme le produit de trois termes : le taux de profit (ou taux de marge), qui rapporte la mesure du profit à la valeur ajoutée, la productivité du capital, qui rapporte la production en volume au capital physique, et l'inverse du prix relatif de l'investissement. Toute baisse de la part des profits dans la valeur ajoutée ou de la productivité du capital diminue la rentabilité de l'investissement. Par contre, toute baisse du prix relatif de l'investissement augmente la rentabilité. La décision d'investir n'est pas uniquement fonction de la rentabilité du capital . Elle doit aussi considérer les emplois alternatifs du capital. Or les taux d'intérêt réels jouent un rôle primordial dans l'évaluation des rendements alternatifs. La profitabilité (nette) évalue la différence entre la rentabilité (nette) et le taux d'intérêt réel à long terme, mesuré comme le taux des obligations émises par le secteur privé déflaté des évolutions du prix du PIB. La profitabilité est donc une mesure de la rentabilité de l'investissement productif, nette du coût de l'argent. On peut même défendre l'idée qu'une forte profitabilité est nécessaire pour que les entreprises prennent le risque de se trouver en surcapacité de production avec des coûts fixes supplémentaires. Dès lors que la profitabilité du capital est positive et suffisante (Malinvaud considère une profitabilité de 4 % comme suffisante), il devient non seulement intéressant d'investir mais il redevient aussi possible de financer ces investissements par recours à l'emprunt, bénéficiant ainsi de l'effet de levier. Un niveau de profitabilité élevé doit donc inciter à l'endettement pour investir. La notion de contrainte financière s'interprète alors simplement : une entreprise dont l'investissement dépend fortement de sa profitabilité supporte une contrainte financière plus sévère. |
Les responsables d'entreprises estiment en général que leurs décisions sont contraintes par les capacités financières ou les modalités d'accès au financement bancaire, le souci de rentabilité ou la crainte de mettre en place prématurément des capacités qui s'avéreraient ensuite mal employées, voire par la nécessité d'embaucher.
La contrainte financière ne peut donc pas être ignorée. Dans les études macroéconomiques, elle est souvent présentée de façon résumée par la profitabilité du capital, qui mesure l'écart entre la rentabilité du capital et le coût réel des ressources financières. La profitabilité est en quelque sorte la rémunération du risque de l'entreprise au-delà de ce qui doit être préempté pour rémunérer les ressources financières. Les profits jouent un double rôle : si la recherche des profits (futurs) est le mobile de l'investissement, les profits présents et passés en constituent une condition de financement. Mais la décision d'investir dépend aussi du coût réel de l'argent, mesuré par le taux d'intérêt réel. Les décisions d'investissement seront d'autant moins nombreuses que celui-ci est élevé.
Il est clair qu'une profitabilité trop faible dissuade les investissements. A la limite, une profitabilité nulle ou négative peut conduire à privilégier les placements financiers par rapport à l'investissement productif.
Par ailleurs, l'investissement peut buter sur une contrainte de solvabilité, qui mesure le fait qu'une entreprise doit être en mesure de rembourser les emprunts arrivant à échéance et les frais financiers sur la base des profits qu'elle dégage. Dans ce cas, l'investissement est déterminé principalement par le niveau des profits, celui de l'endettement ainsi que par le niveau des taux d'intérêt. En pratique, parmi ces déterminants, le plus robuste est, de longue date, le taux de profit ; le taux d'endettement et le taux d'intérêt rendent moins compte, en général, d'évolutions significatives de l'investissement (Morin, Norotte et Venet, 1987).
La Commission européenne (2001) a testé sur l'ensemble des pays industrialisés (Union européenne, Japon, Etats-Unis) un modèle à long terme de l'investissement. Ce modèle fait dépendre le taux d'investissement de la rentabilité économique et des taux d'intérêt réels. L'effet des deux variables est de même ampleur. Un accroissement durable de la rentabilité économique de 1 % accroît le taux d'investissement de 0,1 à 0,15 points. Un accroissement durable des taux d'intérêt réels à long terme de 1 % diminue de 0,09 points le taux d'investissement. Ce modèle fait également apparaître le rôle des prix relatifs de l'investissement : une baisse des prix relatifs de l'investissement de 10 % entraîne une hausse du taux d'investissement de 0,5 point.
Travaillant sur les pays européens, Beaudu et Heckel (2001) trouvent des résultats semblables. Selon ces auteurs, une variation de la rentabilité économique de 1 point augmente le taux d'investissement de 0,22 point. Par contre, ils trouvent un effet plus prononcé des taux d'intérêt réels : lorsque le taux d'intérêt passe de 5 à 6 %, le taux d'investissement baisse de 0,32 points.
IV. 4. LE Q DE TOBIN
Tobin (1969) formalise l'analyse de Keynes selon laquelle l'investissement est principalement déterminé par la situation sur les marchés boursiers. La profitabilité est définie par le célèbre ratio q de la valeur de marché de la firme à la valeur comptable, c'est à dire la valeur de remplacement, d'une unité marginale supplémentaire de capital.
L'intuition en est la suivante : l'entrepreneur investit dans de nouveaux projets si le marché les valorise au-delà de ce qu'ils ont coûté ; l'investissement est rentable tant que l'accroissement de la valeur de la firme résultant de ce nouvel investissement reste supérieur à son coût. Si q<1, le capital nouveau coûte trop cher par rapport à la valorisation boursière du capital existant : mieux vaut acheter une entreprise sur le marché plutôt que d'investir. Si q>1, au contraire, il est rentable d'investir, puisque les anticipations de profit contenues dans le cours boursier dépassent le coût d'achat du capital.
En principe, le q de Tobin résume donc toute l'information utile. Cependant, il existe de nombreux problèmes conceptuels et empiriques à son utilisation. Ce ratio ne peut être calculé que pour une partie des entreprises, celles pour lesquelles on dispose d'une cotation en bourse. Il existe un réel biais de sélection dans la mesure où il s'agit des plus grosses entreprises du pays. Expliquer l'investissement macroéconomique à partir de ce ratio suppose une agrégation des comportements pour laquelle on fait l'hypothèse que la décision d'investir des plus grosses entreprises est reproduite par les plus petites. Cette hypothèse apparaît forte et constitue la raison de principale de sa faible utilisation dans les études macro-économiques.
CHAPITRE 4
L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF EN FRANCE
I. 1. EVOLUTION DE L'INVESTISSEMENT DE 1970 À 2001
L'investissement des entreprises françaises est une composante importante du produit intérieur brut. De 1970 à 2001, la FBCF des entreprises a représenté en moyenne de 10 à 15 % du PIB de l'économie française. Sur cette période, le volume du PIB a augmenté en moyenne au rythme de 2,2 % l'an et le volume de la FBCF a augmenté un peu plus vite (2,6 % l'an).
C'est aussi une composante très cyclique du PIB puisqu'au cours des trente dernières années, les périodes de croissance ou les épisodes de récession se sont généralement accompagnés d'un mouvement concomitant de l'investissement des entreprises.
Au cours des années 1990, l'évolution de l'investissement des entreprises est longtemps restée décevante. Le volume de la FBCF des entreprises avait doublé en vingt ans, de 1970 à 1990, passant de 69,6 milliards d'euros à 140,3 milliards d'euros (aux prix de 1995). Entre 1985 et 1991, le volume de l'investissement productif s'était montré particulièrement dynamique (+6,5 % l'an en moyenne). Le cycle s'est inversé en 1990. Pénalisé par des taux d'intérêt très élevés et les crises monétaires européennes, l'investissement productif (en volume) a baissé de 7,6 % entre 1990 et 1996. En 1997, le taux d'investissement des entreprises a touché un point bas historique à 15,9 % de leur valeur ajoutée.
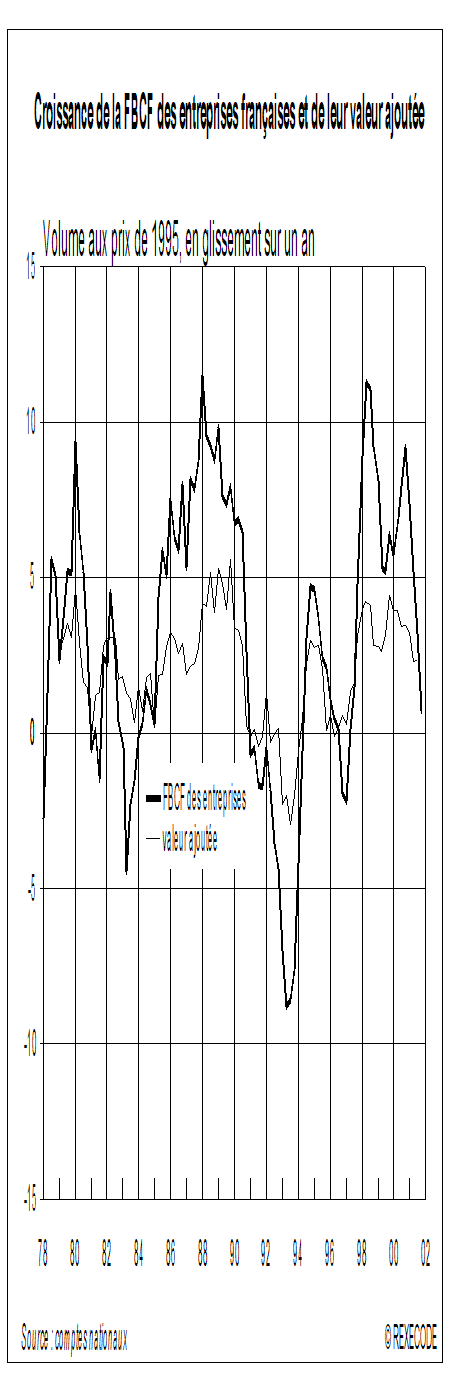
La forte baisse des taux d'intérêt de 1995-1996 et l'amélioration conjoncturelle générale ont autorisé une reprise de l'investissement dans la deuxième partie des années 90. Dès 1998, on retrouve un niveau d'investissement légèrement supérieur à celui de 1990 (143,6 milliards d'euros aux prix de 1995). A partir de 1998, la croissance de l'investissement productif s'accélère rapidement (+6,2 % l'an en moyenne de 1998 à 2001), comblant le retard pris au début de la décennie
. Il faut cependant signaler qu'en 2000 et 2001, le taux d'investissement des entreprises est demeuré sensiblement en deçà des ses points hauts historiques (18 % contre 19,4 % en 1990).
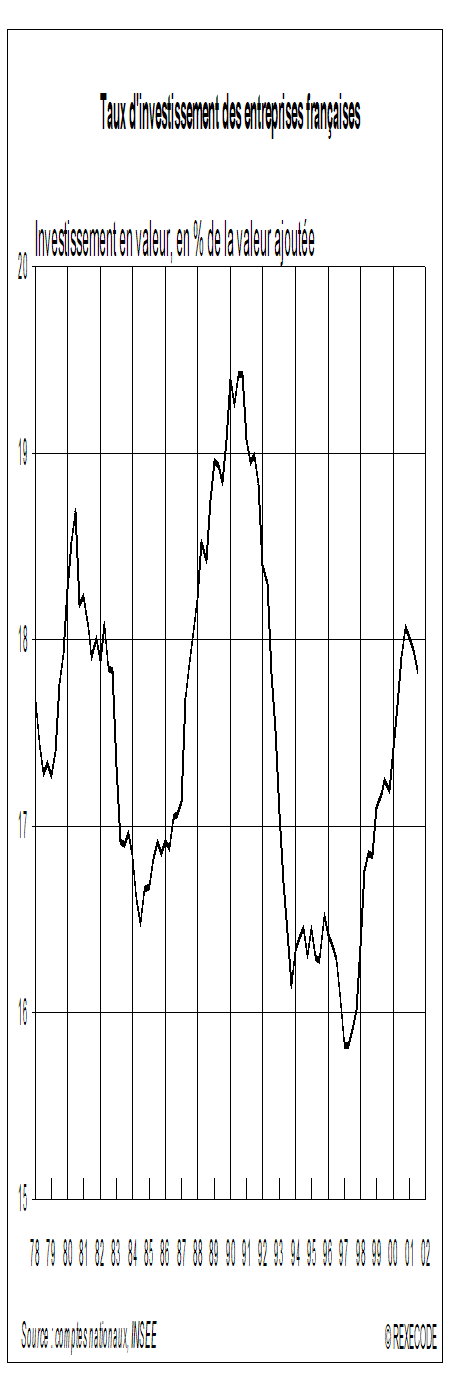
Cette trajectoire de l'investissement n'est pas spécifique à la France. La plupart des pays européens ont connu une évolution semblable au cours des années 1990 et l'Allemagne, dont le choc lié à la réunification a perturbé l'ensemble des pays européens a été encore plus affectée que la France par le recul de l'investissement.
II. 2. LA DYNAMIQUE DE L'INVESTISSEMENT S'EXPLIQUE PAR LES DÉTERMINANTS CLASSIQUES
Les travaux les plus récents montrent que les déterminants traditionnels de l'investissement, à savoir les variations de l'activité et de la profitabilité, suffisent à rendre compte de la trajectoire de l'investissement observée au cours des trente dernières années. Ces résultats sont renforcés si l'on tient compte de la bulle immobilière apparue au début des années 1990.
A. UN PROBLÈME SPÉCIFIQUE DE L'INVESTISSEMENT EN CONSTRUCTION
L'évolution de l'investissement productif total des années 1990 doit être expliqué à la lumière de sa composante en construction.
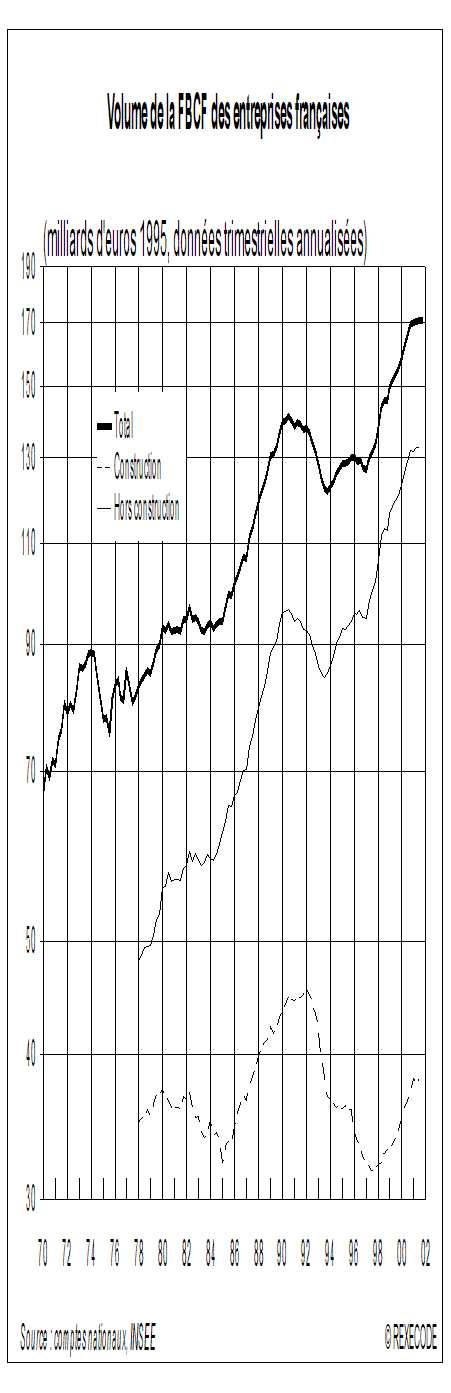
L'investissement a en effet connu des évolutions différenciées selon les produits. De 1984 à 1990, l'investissement en matériels et logiciels d'une part et l'investissement en construction d'autre part, ont augmenté tous deux à des rythmes élevés : 8,3 % en moyenne pour le matériel et logiciels et 4,9 % pour le bâtiment. Ainsi, jusqu'en 1990, la FBCF en construction semblait complémentaire à l'investissement en équipements et logiciels et contribuait fortement au cycle de l'investissement total. Ces évolutions jointes sont liées à la forte accélération de la valeur ajoutée observée sur cette même période.
Cette embellie de toutes les composantes de l'investissement cesse de façon brutale en 1990. La guerre du Golfe en août 1990 ne vient en réalité qu'ajouter à un climat international dégradé. La croissance qui s'est déjà infléchie dans les pays anglo-saxons et les incertitudes liées à la réunification allemande ont pesé à la fois sur les décisions de consommation privée et d'investissement des entreprises. Les niveaux élevés du change et des taux d'intérêt limitent alors les capacités de financement des entreprises françaises. L'accumulation du capital connaît alors une longue décélération qui durera jusqu'au début de l'année 1997.
Toutefois, cette rupture ne touche dans un premier temps que la FBCF en équipements et logiciels, et épargne un temps, jusqu'en 1992, la FBCF en construction. Depuis 1990, les deux types d'investissement, « construction » et équipements et logiciels connaissent donc des évolutions qui semblent déconnectées.
A partir de 1990, l'investissement en équipements et logiciels se retourne et connaît de 1990 à 1994, durant quatre années consécutives, une baisse continue (2,4 % en moyenne). La baisse est spectaculaire en 1993 : d'environ 10 % en glissement annuel aux deuxième et troisième trimestres. Cette période correspond à des épisodes de croissance nulle ou de récession. En phase avec une amélioration de l'activité et de la profitabilité, l'investissement en équipements et logiciels redémarre dès 1994 (soit trois ans plus tôt que l'investissement total) et il faut attendre l'année 1997 pour voir s'estomper les effets de la crise économique sur l'investissement dans sa totalité.
Entre 1980 et 2001, la FBCF en construction est passée de 36,6 milliards d'euros aux prix de 1995 à 36,2 milliards d'euros aux prix de 1995, mais elle avait atteint un niveau historique en 1991-1992 à plus de 44,5 milliards d'euros. La phase d'expansion de l'investissement en bâtiment qui commence en 1985 ne s'achève qu'avec l'éclatement de la bulle immobilière en 1992. Ce retard de deux ans du cycle de la construction par rapport au cycle économique s'est traduit par une morosité durable de l'investissement en construction dans les années qui suivent. Le rebond intervient certes en 1999, mais le point haut de l'année 1992 n'a toujours pas été retrouvé.
Comme le montre le graphique qui suit, l'investissement en bâtiment des entreprises, qui constituait plus de 36 % de leur FBCF en valeur en 1978, n'en représente plus que 25 % en 2001.
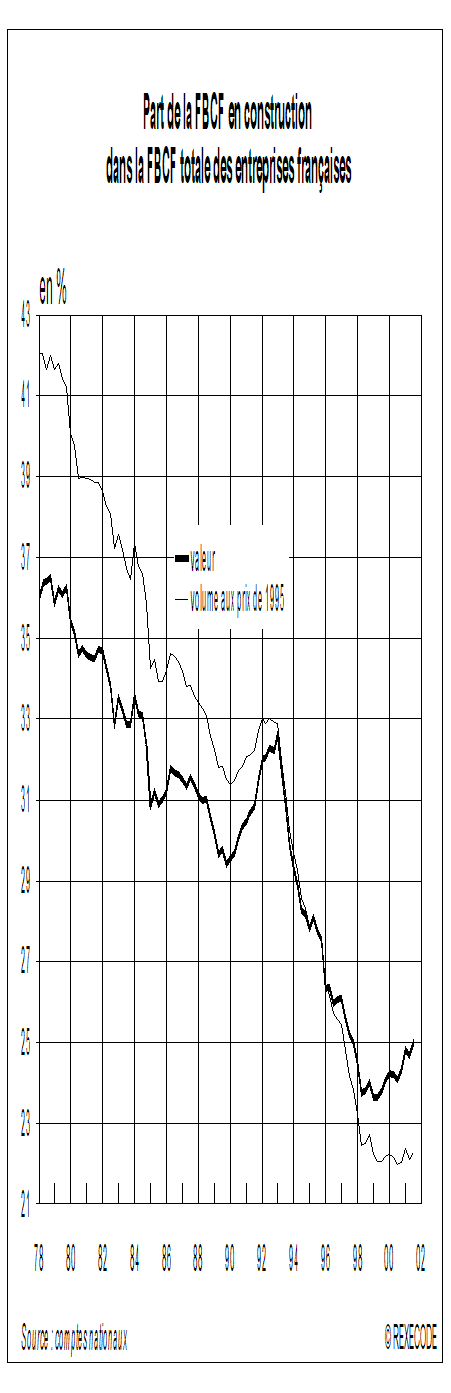
L'investissement en bâtiment a donc tiré globalement vers le bas le taux de croissance de la FBCF totale, à l'exception de la période 1990-1993, et plus récemment depuis 1999. A l'opposé, la FBCF en équipements et logiciels a été multipliée par 2,3 entre 1980 et 2001. L'évolution un moment décevante de l'investissement des entreprises françaises apparaît, par conséquent, moins nette si l'on exclut la composante « bâtiment » de la FBCF et si l'on se concentre sur l'investissement hors bâtiments.
C'est ce que montrent en effet plusieurs études économétriques. Pour Irac et Jacquinot (1999), c'est l'investissement en construction qui est à la source de l'atypisme en partie constaté de l'investissement total de la décennie 1990. Pour ces auteurs, l'investissement hors construction a eu dans les années 1990 un comportement tout à fait conforme à la dynamique des années 1980 reposant essentiellement sur l'activité (et en partie sur le profit). Irac et Jacquinot montrent qu'entre 1990 et 1995, l'investissement en construction s'est maintenu à des niveaux trop élevés au regard du cycle de la valeur ajoutée ou du taux d'utilisation des capacités de production. Il semble que pour effacer cette période de suraccumulation, l'investissement en construction ait du tomber à présent à des niveaux assez faibles.
B. L'ACTIVITÉ EST UN DÉTERMINANT MAJEUR...
C. L'investissement est la variable économique la plus fluctuante des grandes données macro-économiques et celle qui est le plus sensible aux variations de l'activité. En 1988, l'investissement productif a augmenté de 9,7 % pour une croissance du volume du PIB de 4,6 %. En 1993, il a reculé de 8 % en volume. Cette réduction de l'investissement n'est pas exceptionnelle. Bien que le recul de l'investissement ait été très prononcé de 1991 à 1993, il correspond à la récession économique la plus forte depuis la seconde guerre mondiale (-0,8 % en 1993). Et encore, la chute de la FBCF en 1993 a été inférieure à celle enregistrée en 1975 (-8,9 %), bien que la récession ait été plus forte. De manière symétrique, en 1998, la croissance de la FBCF des entreprises s'est montrée particulièrement vigoureuse (10,1 %), aussi vigoureuse que dans les précédentes phases de reprise. Elle s'est maintenue sur des rythmes élevés de 1999 à 2001.
Toutefois, certaines variations de l'investissement ont pu paraître inexpliquées au regard de celles de la seule activité. Ainsi, l'année 1995 se caractérise par une croissance comparable à celle des années 1985-1990, mais la hausse de l'investissement en biens d'équipements est décevante au regard de cette reprise. Quant aux années 1996-1997, elles font apparaître des évolutions contradictoires entre investissement (qui diminue) et valeur ajoutée (en reprise). C'est seulement depuis 1998 que l'investissement redevient conforme au phénomène d'accélération vis-à-vis de la valeur ajoutée.
Il semble que l'on puisse attribuer cette relative déconnexion à l'histoire des marges des entreprises. Leur restauration progressive sur la seconde moitié des années 80 a été suivie d'une nouvelle dégradation sur le début de la décennie 90.
D. ... MAIS LA PROFITABILITÉ AUSSI
La première moitié des années 80 est marquée par une action négative de la profitabilité sur l'accumulation du capital, qui atteint son point culminant courant 1983, sous l'effet de la déformation du partage de la valeur ajoutée en faveur des salariés (le taux de marge atteint un minimum historique à 21 %). La politique de rigueur instaurée en France à compter de mars 1983 permet aux entreprises de restaurer leurs marges et d'accroître leur rentabilité. Toutefois, il faut attendre le début de 1985 pour que la profitabilité des entreprises joue favorablement sur l'accumulation du capital, malgré l'accroissement des taux d'intérêt réels lié à la désinflation. La seconde moitié des années 80 voit un impact favorable de la profitabilité des entreprises, qui provient essentiellement de la reconstitution de leur marge, mais aussi à une baisse moindre de la productivité du capital. Celle-ci progresse jusqu'en 1990 et sa contribution au dynamisme de l'investissement s'accroît pour connaître son apogée en 1990.
Le ralentissement de 1990 et le niveau élevé des taux d'intérêt, qui avaient nettement progressé dans les années 1980, avaient resserré les contraintes financières sur les entreprises. Ce resserrement a contribué à freiner l'investissement au début des années 1990. Face à cette situation, les entreprises ont réagi rapidement et n'ont pas laissé se dégrader leurs ratios financiers en engageant une stratégie de désendettement.
Les taux d'intérêt réels ont ensuite lentement baissé et cette baisse s'est accompagnée d'une restauration de la rentabilité du capital ce qui a conduit à une remontée progressive de la profitabilité du capital. En 1995-1996, la baisse des taux d'intérêt réels est plus prononcée, ce qui se traduit par une nette amélioration de la profitabilité. La restauration de la rentabilité du capital s'observe quant à elle dès 1993. La forte substitution du travail au capital favorisée par les allègements de charge et la modération salariale interrompent la baisse tendancielle de la productivité du capital, ce qui améliore durablement la rentabilité du capital.
Mais il faut attendre 1998, et la baisse des taux d'intérêt réel rendue possible par l'entrée dans la zone euro pour que la profitabilité retrouve un niveau moyen de l'ordre de 4 % (celui jugé suffisant par Malinvaud). La contrainte financière se dessert alors et l'investissement repart. La restauration des marges des entrepreneurs semble avoir également favorisé l'accumulation du capital dans d'autres pays européens comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni.
Ainsi, la vigueur de l'investissement constatée depuis 1998 trouve ses origines non seulement dans la vigueur de la demande mais également dans la restauration de la profitabilité, grâce notamment à la forte baisse des taux d'intérêt en 1995-1996.
E. UN TAUX D'AUTOFINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT FIXE ÉLEVÉ DANS LES ANNÉES 1990
Un des phénomènes marquants des années 1990 est l'ampleur du taux d'autofinancement de l'investissement, en moyenne de l'ordre de 94 % contre 74 % dans les années 1980. Ce bouleversement s'explique en partie par la transformation du système financier français. Mais il est surtout dû à la volonté de désendettement des firmes à la suite de la baisse du coût des fonds propres relativement à celui de l'endettement. Le ralentissement économique et la faiblesse de l'inflation avaient alourdi après 1990 le poids de la dette (et son coût) de sorte que les entreprises ont été contraintes de privilégier pour un temps le désendettement.
Dans la première moitié des années 1990, pour se désendetter, les firmes ont comprimé l'investissement et l'emploi, pour retrouver un taux d'autofinancement élevé et alléger leur dette.
Ces contraintes financières se sont desserrées entre 1993 et 1998 grâce aux efforts de productivité des entreprises. Depuis 1998 et la restauration d'un niveau de profitabilité jugé suffisant, les entreprises ont de nouveau investi en s'endettant. Leurs conditions financières se sont de nouveau tendues et atteignent aujourd'hui des niveaux élevés. Le niveau actuel de l'endettement ainsi que des capacités de financement laisse craindre une faiblesse de l'investissement dans les prochaines années.
III. 3. A LA RECHERCHE DES DÉTERMINANTS DE L'INVESTISSEMENT : LE RÔLE DES CONTRAINTES FINANCIÈRES
Cette section fait la synthèse des modèles de l'investissement sur des données françaises.
L'investissement des entreprises est déterminé selon une logique assez semblable dans les principaux modèles macro-économiques français : les perspectives de production (l'accélérateur) jouent un rôle central, mais d'autres variables interviennent fréquemment. La prise en compte d'autres déterminants de l'investissement en biens d'équipement des entreprises que l'anticipation de la croissance des débouchés , comme la profitabilité des entreprises, le coût ou les conditions de financement de l'investissement, enrichissent le pouvoir explicatif des modèles traditionnellement retenus. Plusieurs modèles de type « accélérateur-profit » (INSEE, Banque de France) donnent des résultats extrêmement satisfaisant pour la France. La contribution des coûts relatifs des facteurs demeurait en général mais les résultats empiriques récents, sur données individuelles, apportent maintenant des éléments d'éclairage (voir le chapitre 3). Les principales divergences entre les modèles concernent l'appréciation de la dimension financière et le rôle des taux d'intérêt, et reflètent une difficulté générale à intégrer les variables financières et réelles, particulièrement embarrassante dans une période où l'économie réelle subit des chocs financiers de grande ampleur.
A. LES MODÈLES « ACCÉLÉRATEUR-PROFIT »
A la fin des années 1970, la demande et le coût relatif des facteurs constituaient les déterminants les plus satisfaisants de l'investissement (Muet, 1979). Cependant, dans la première moitié des années quatre-vingt, le pouvoir explicatif du modèle accélérateur - coût relatif des facteurs s'est fortement affaibli (Artus et Morin, 1991).
La détérioration de la situation financière et le surendettement des entreprises au cours de cette période a conduit à introduire des indicateurs exprimant une contrainte de solvabilité. Si l'investissement peut buter sur une contrainte de solvabilité, il est déterminé principalement par le niveau des profits, celui de l'endettement ainsi que par le niveau des taux d'intérêt. L'introduction d'une variable de profit dans les équations d'investissement soulève néanmoins de nombreuses difficultés. Tout d'abord, le statut théorique de cette variable est mal assuré. S'agit-il d'une contrainte financière ou d'un indicateur de profitabilité de l'investissement.
Plusieurs modèles macro-économiques retiennent une spécification de type « accélérateur-profit », comme le modèle AMADEUS 95 ( * ) de l'INSEE (voir aussi Herbet, 2001). Ils permettent d'expliquer de façon satisfaisante l'évolution de l'investissement en biens d'équipements ou global en France sur la période. L'estimation de ces équations fait apparaître une grande significativité de la sensibilité à long terme du taux d'investissement au taux de profit. Toutefois, compte tenu des variations de la profitabilité, la contribution du taux de profit à la dynamique de l'investissement ne paraît forte que dans les années 1980 (Morin, Norotte et Venet 1987) ou à la fin des années 1990 (Herbet, 2001). Par son ampleur, elle reste cependant faible par rapport à celle de la valeur ajoutée.
Dans les recherches d'Herbet (2001), ces résultats ne sont pas propres à l'économie française puisque les mêmes déterminants (production et taux de profit) se retrouvent pour les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Italie et l'Espagne. Un résultat fort de ces travaux est que dans tous les pays, le taux d'investissement dépend positivement du taux de profitabilité (un point de profitabilité en plus, qu'il provienne d'une baisse des taux d'intérêt ou d'une hausse de la rentabilité économique entraîne en moyenne une hausse de l'ordre de 0,3 point du taux d'investissement). L'assurance d'une profitabilité durable se traduit par un effort plus prononcé d'investissement, susceptible à terme de renforcer la croissance.
B. DES CONTRAINTES DE FINANCEMENT PLUS FORTES POUR LES PETITES ENTREPRISES
La caractéristique la plus frappante des comportements d'investissement des entreprises est leur forte hétérogénéité. Une des explications les plus souvent avancées tient compte de l'interaction forte entre la décision d'investissement d'une entreprise et les conditions auxquelles elle peut se financer, conditions qui dépendent étroitement de ses caractéristiques propres.
Plusieurs travaux récents traitent explicitement du lien entre l'investissement et son financement. Duhautois (2001) teste un modèle théorique de contraintes financières. Cet auteur aboutit à trois conclusions intéressantes.
1) Pour les plus petites entreprises, le taux de marge et le taux d'intérêt ne jouent pas de la même façon sur l'investissement dans la période de croissance (1985-1990), où leur rôle est limité, et dans la période de récession (1990-1996) où leur influence est forte.
2) D'une façon générale, le rôle de ces variables financières est d'autant plus fort que les entreprises sont petites.
3) Ce rôle est enfin plus important pour les entreprises du secteur tertiaire que pour les entreprises du secteur industriel.
Au total, les plus petites entreprises ont été plus touchées que les grandes par le resserrement de la politique monétaire depuis le milieu des années 1980, car elles n'ont pas accès à d'autres modes de financement que les crédits bancaires.
C. LE CANAL DU CRÉDIT SUR LES PETITES ENTREPRISES
Beaudu et Heckel (2001) s'attachent à étudier l'impact des politiques monétaires sur l'économie réelle en Europe (dont la France), via un de leurs canaux de transmission : le canal du crédit 96 ( * ) . Ce dernier met en jeu des mécanismes liés à l'existence d'asymétries d'information sur les marchés financiers et vient modifier les conditions de financement des agents.
La thèse du canal du crédit prédit que la sensibilité de l'investissement à l'épargne ( cash-flow ) va augmenter à la suite d'une période de restriction monétaire, en particulier pour les petites entreprises : en période de taux d'intérêt élevés, certaines entreprises (les plus petites) ne peuvent s'endetter qu'en payant des primes de risques élevées 97 ( * ) .
Leurs estimations montrent que les réactions de l'investissement aux conditions de financement sont cohérentes avec les prédictions du canal du crédit, et que l'impact des chocs monétaires en Europe par ce canal serait source d'asymétrie entre pays 98 ( * ) et entre entreprises de taille différentes. Vermeulen (2000) obtient des résultats équivalents sur un grand nombre de pays européens dont la France et concluent à une plus grande vulnérabilité des entreprises allemandes.
A partir des estimations effectuées, Beaudu et Heckel obtiennent une idée de l'ordre de grandeur des effets macroéconomiques du canal du crédit, relativement aux effets traditionnels du taux d'intérêt. Une hausse de 1 point du taux d'intérêt diminue directement le taux d'investissement de 1,5 % via le canal classique (baisse de la profitabilité). Quant au canal du crédit (la prime de risque associée au coût de l'endettement), son impact est estimé à 3,25 % pour les petites entreprises. Cet effet serait est donc substantiel, surtout comparé à celui du canal classique.
Kremp et Stöss 99 ( * ) (2001) trouvent des résultats semblables qui distinguent les plus petites entreprises. Ils trouvent qu'en 1995, les petites entreprises françaises avaient un coût de financement apparent de 7 %, contre 4,4 % pour les plus grandes ; pour l'Allemagne, ces chiffres sont respectivement de 8 % et 5,8 %. L'ampleur de la « prime » que paieraient les plus petites entreprises est donc de l'ordre de 2 à 2,5 %.
Au total, de nombreuses études attestent que le coût d'emprunt varie pour chaque entreprise en fonction de sa taille, de son taux d'endettement et du taux d'intérêt ambiant de l'économie. La façon dont le taux d'intérêt subi varie avec l'endettement de l'entreprise peut dépendre de sa taille (les modèles de contraintes financières voudraient que l'effet soit plus fort pour les petites entreprises que pour les grandes) et de l'année considérée (les mêmes modèles voudraient que l'effet soit plus fort lorsque la politique monétaire est restrictive). Dans ces études, le niveau des garanties rend effectivement compte de différences significatives dans le comportement d'investissement. La prime de financement qui en résulte pour les petites entreprises apparaît importante, de l'ordre de 2 % en 1994, et ce, en dépit de l'assainissement de leur situation financière, alors qu'elle est inférieure à 1 % pour les grandes entreprises.
CHAPITRE 5
L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF EN ALLEMAGNE
I. 1. EVOLUTION DE L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF DE 1970 À 2001
L'investissement productif en Allemagne a progressé de manière similaire au volume du PIB au cours de ces trente dernières années. En effet, sur les trente dernières années, la croissance de la FBCF productive est ressortie à 2,2 % l'an, un rythme identique à la croissance du volume du PIB.
L'Allemagne a été l'un des pays les plus affecté par le ralentissement de l'activité au cours des années 1990 et a éprouvé des difficultés importantes à digérer les conséquences de la réunification. Pendant cette période, le rythme d'accroissement du volume du PIB est tombé à 1,5 % l'an et l'investissement productif n'a augmenté que de seulement 0,4 % l'an.
Répartition de l'investissement selon les branches
|
Investissements bruts |
Valeur ajoutée brute |
|||||
|
milliards d'euros |
% du total |
milliards d'euros |
% du total |
milliards d'euros |
% du total |
|
|
1991 |
1991 |
1999 |
1999 |
1999 |
1999 |
|
|
Ensemble |
698,0 |
100 |
745,2 |
100 |
1624,2 |
100 |
|
Agriculture |
12,2 |
1,7 |
11,6 |
1,6 |
21,6 |
1,3 |
|
Industrie hors construction |
168,8 |
24,2 |
149,1 |
20,0 |
428,3 |
26,4 |
|
Industries extractives |
3,8 |
0,6 |
4,0 |
0,5 |
9,9 |
0,6 |
|
Industries manufacturières |
138,2 |
19,8 |
110,2 |
14,8 |
382,2 |
23,5 |
|
Alimentation et tabac |
16,0 |
2,3 |
15,3 |
2,1 |
36,1 |
2,2 |
|
Biens intermédiaires |
58,3 |
8,4 |
50,7 |
6,8 |
167,3 |
10,3 |
|
Biens d'équipement |
56,6 |
8,1 |
38,6 |
5,2 |
156,3 |
9,6 |
|
Biens de consommation |
3,5 |
0,5 |
3,0 |
0,4 |
11,8 |
0,7 |
|
Construction |
15,3 |
2,2 |
16,6 |
2,2 |
114,1 |
7,0 |
|
Services |
512,6 |
73,4 |
583,9 |
78,3 |
1126,5 |
69,4 |
|
Commerce |
39,5 |
5,7 |
44,6 |
6,0 |
202,4 |
12,5 |
|
Transports |
65,7 |
9,4 |
69,2 |
9,3 |
97,1 |
6,0 |
|
Activités financières |
15,9 |
2,3 |
20,1 |
2,7 |
85,2 |
5,2 |
|
Activités immobilières |
269,5 |
38,6 |
314,1 |
42,2 |
377,1 |
23,2 |
|
Services aux entreprises et services publics |
122,0 |
17,5 |
135,8 |
18,2 |
364,7 |
22,5 |
Au cours des années 1990, les industries des biens d'équipements et des biens intermédiaires ont subi des restructurations très importantes qui ont pesé sur l'investissement productif. Entre 1991 et 1999, l'investissement des industries de biens d'équipement baisse ainsi de 40 % en valeur. Comme en France, la branche des activités immobilières est celle qui a contribué le plus à la croissance des investissements des entreprises allemandes.
Les amplitudes des cycles de l'investissement productif sont nettement supérieures à celles du PIB. En 1991 et 1992, pendant que le volume du PIB progressait de 5 points au-dessus de sa tendance de long terme, la croissance des investissements productifs est ressortie vingt points au-dessus de leur tendance. On a observé des variations similaires dans les cas de récession, notamment après les chocs pétroliers.
|
|
On peut décomposer l'investissement productif entre construction et biens d'équipement. La croissance de la FBCF productive (en volume) n'a progressé que de 2,2 % l'an depuis 1970.
Le volume des investissements en construction a progressé de 1,6 % l'an en moyenne au cours des trente dernières années, mais il est la principal cause de la faiblesse de l'investissement productif au cours des années 1990 (-0,5 % l'an). De son côté, la FBCF productive des entreprises en biens d'équipement a progressé de 2,6 % l'an entre 1970 et 2000 et son rythme de croissance s'est ralenti à 1,2 % l'an entre 1990 et 2000, un rythme légèrement plus faible que celui de l'activité (1,5%).
Conséquence de la réunification, au cours des années 1990, le comportement d'investissement des entreprises s'est fortement modifié. Ainsi, la FBCF productive en construction a progressé de 35 % entre 1991 et 1995 : l'exploitation des équipements industriels dans les nouveaux Länder nécessite de nouveaux bâtiments. La part de la construction dans la FBCF productive passe alors de 36 % en 1991 à 45 %, record historique, en 1995. Depuis cette date, ce ratio est revenu à son niveau antérieur (35 %). Une des conséquences de ce fort investissement en construction est un accroissement significatif du stock de capital des entreprises allemandes au cours des années 1990.
On peut noter que, parallèlement aux suites de la réunification, un autre effet, plus structurel, joue à la baisse sur le volume de la FBCF en construction. Dans un pays profondément industriel, le processus séculaire de miniaturisation des équipements entraîne une baisse tendancielle du volume exploité en bâtiments. Cette tendance de fond pourrait continuer de peser sur l'investissement en construction dans les années à venir.
Par ailleurs, il semble que s'opère une délocalisation des entreprises industrielles allemandes dans les pays d'Europe centrale.
|
|
II. 2. LA PROFITABILITÉ ET L'INVESTISSEMENT
La profitabilité des entreprises et notamment leur capacité à engendrer de l'épargne ( cash flow ) est un élément déterminant de l'investissement.
Selon les calculs de la Bundesbank 100 ( * ) , l'excédent brut d'exploitation des entreprises a progressé de 4,5 % l'an entre 1991 et 1999, en dépit d'un fort repli observé au cours des années 1992-1993. Cette croissance a été plus particulièrement soutenue dans le secteur des services alors qu'en revanche, dans le secteur industriel, le taux de profitabilité n'a pas augmenté, restant très inférieur (environ 60 % inférieur) à celui observé dans le secteur des services. De surcroît, l'effet de cette hausse a été renforcé dans les années récentes par la baisse du taux d'imposition sur les sociétés qui est passé de 50 % en 1994 à 45 % en 1999 et cette baisse a continué avec la réforme fiscale réalisée par le gouvernement Schröder.
Figure 1 : rentabilité de l'investissement
|
|
Malgré la bonne progression des résultats des entreprises, la forte progression du stock de capital net des entreprises, consécutive aux efforts d'investissements en construction, a pesé sur la rentabilité économique et il faut attendre 1996, au moment même où les taux d'intérêt réels reculent, pour assister un net rebond de la profitabilité, favorable à l'investissement.
III. 3. L'INFLUENCE DU MARCHÉ EXTÉRIEUR
En Allemagne, pays où le poids de l'industrie reste fort (plus de 26 % du PIB), la dynamique des marchés extérieurs reste un élément important de l'évolution des investissements productifs. En effet, sur les trente dernières années, on observe une corrélation entre l'évolution des exportations en variation annuelle et celle des investissements productifs, et cette corrélation se renforce au cours des années 1990.
|
|
IV. 4. ANALYSES EMPIRIQUES EN ALLEMAGNE SUR L'INFLUENCE DES TAUX D'INTÉRÊT
Un des sujets d'étude des déterminants de l'investissement concerne l'influence des taux d'intérêt.
N. Siegfried (2000) démontre que les grandes entreprises cotées en bourse sont peu « vulnérables » aux variations de la politique monétaire. Une remontée des taux n'engendre qu'une réaction faible des volumes d'investissement (l'élasticité n'est que de 0,3 environ). Par ailleurs, sur ces mêmes entreprises, la contrainte de solvabilité serait significative pour les entreprises fortement endettées. Sur les grandes entreprises, la politique monétaire européenne n'aurait donc qu'un impact marginal.
Une autre étude dont l'objet est le « canal du crédit » (A. Beaudu et T. Heckel, 2001) distingue petites et grandes entreprises. Sur cet échantillon plus représentatif, ces auteurs démontrent un fort impact de la politique monétaire sur les petites entreprises. Cette étude utilise le modèle de l'accélérateur-profit. Une politique monétaire restrictive augmente les taux d'intérêt payés par les entreprises et, par conséquent, pèse sur leur investissement. Mais la sélection des périodes de politique monétaire permet d'isoler les décisions des banques centrales sur l'investissement des entreprises. L'étude montre que dans l'ensemble des pays étudiés (zone euro à l'exception des petits pays), la dépendance de l'investissement par rapport au cash-flow augmente en période de restriction monétaire. Cette sensibilité est surtout observée auprès des petites entreprises, qui ne peuvent pas avoir accès de la même manière que les grandes entreprises, y compris dans les périodes d'expansion monétaire. L'étude montre un résultat fort : en Allemagne, plus que dans les autres pays européens, les petites entreprises seraient plus sensibles aux variations des taux d'intérêt.
Une autre étude 101 ( * ) de B. Monjon, F. Smets et P. Vermeulen (2001) étudie également l'impact de la politique monétaire et révèle une forte sensibilité du volume de l'investissement des entreprises d'une part par rapport au volume de la dette et d'autre part par rapport au niveau des taux d'intérêt à court terme . Toutefois, la sensibilité des entreprises allemandes au taux d'intérêt serait moins élevée que dans les autres pays. Ceci serait dû à la structure de la dette des entreprises allemandes dont une part importante est à maturité longue. Par conséquent, les décisions d'investissement des entreprises allemandes seraient conditionnées plutôt par les variations de taux d'intérêt à long terme qu'à court terme. Enfin, cette étude confirme que les grandes entreprises sont deux fois moins sensibles à l'évolution des taux d'intérêt que ne le sont les petites entreprises.
Au total, toutes ces études mettent en évidence le lien entre la politique monétaire, le coût du crédit et le niveau des investissements des entreprises et insistent sur la vulnérabilité des petites entreprises à des changements de politique monétaire.
|
|
CHAPITRE 6
EVOLUTION DE L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF AU ROYAUME-UNI
I. 1. CYCLES DE L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF ET CYCLES ÉCONOMIQUES
Depuis 25 ans, le Royaume-Uni a connu deux récessions. La première a duré sept trimestres, entre le deuxième trimestre 1979 et le premier trimestre 1981. Sur cette période, le volume du PIB a chuté d'environ 6 %. La seconde récession, qui a eu lieu entre 1990 et 1991, a été de durée plus courte (cinq trimestres) et d'amplitude plus faible, le volume du PIB n'ayant baissé que de 2,5 %. Depuis, la croissance britannique est restée soutenue, avec un résultat moyen de 2,7 % par an, soit bien mieux que les autres grands pays européens (France, Allemagne et Italie), à égalité avec l'Espagne, et légèrement moins bien que les Pays-Bas..
Taux de croissance annuel moyen comparé du PIB
et de l'investissement productif en volume
|
1970-2000 |
1970-1990 |
1991-2000 |
|
|
PIB |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
|
Investissement productif |
3,9 |
3,8 |
4,3 |
Le cycle de l'investissement productif a été similaire à celui du PIB, puisqu'on note essentiellement deux périodes de baisse, une au début des années 80 et une deuxième entre 1990 et 1993. L'investissement a également connu un petit décrochage en 1986, en raison de la réforme de l'impôt sur les entreprises de 1984, qui a réduit les sommes déductibles pour l'investissement. En revanche, entre 1994 et 2000, l'investissement productif a connu une période de forte expansion, avec un rythme annuel moyen de croissance supérieur à 8 %, en volume. Dans le même temps, le PIB a cru d'environ 3 % par an en moyenne. En fait, par rapport à la tendance de long terme, on a observé un phénomène de rattrapage sur cette période, la récession du début des années 90 étant marquée par un fort sous-investissement par rapport à la croissance tendancielle de l'investissement productif. Depuis le premier trimestre 2001, on note un net retournement de l'investissement productif, alors que le PIB n'a que faiblement ralenti.
Globalement depuis 25 ans, on peut dire que le cycle de l'investissement a suivi celui de la croissance, justifiant l'utilisation des modèles d'accélérateur simple pour expliquer l'évolution de l'investissement.
Toutefois, au contraire de ce qu'on observe pour la croissance, la chute de l'investissement productif a été beaucoup plus forte et plus longue au début des années 90, que ce qu'on avait pu observer au début des années 80.
Ventilation de l'investissement par branche, à prix courants
|
Formation brute de capital fixe |
Valeur ajoutée |
||||
|
En millions de £ |
En % du total |
||||
|
1992 |
1999 |
1992 |
1999 |
1999 |
|
|
Ensemble |
78 383 |
121 605 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Agriculture |
2 077 |
1 615 |
2,6 |
1,3 |
1,1 |
|
Industrie |
26 998 |
29 325 |
34,4 |
24,1 |
22,5 |
|
Industrie minière |
7 219 |
4 750 |
9,2 |
3,9 |
2,1 |
|
Industrie manufacturière |
13 023 |
18 631 |
16,6 |
15,3 |
18,5 |
|
Electricité, gaz et eaux |
6 756 |
5 944 |
8,6 |
4,9 |
1,9 |
|
Construction |
847 |
2 048 |
1,1 |
1,7 |
5,0 |
|
Services |
48 461 |
88 617 |
61,8 |
72,9 |
71,4 |
|
Distribution, hôtellerie et restauration |
8 372 |
15 794 |
10,7 |
13,0 |
15,2 |
|
Transport et communication |
9 028 |
21 323 |
11,5 |
17,5 |
8,0 |
|
Services financiers et aux entreprises |
12 371 |
27 210 |
15,8 |
22,4 |
26,7 |
|
Services publics |
8 555 |
6 827 |
10,9 |
5,6 |
4,8 |
|
Education, santé et travail social |
4 620 |
6 404 |
5,9 |
5,3 |
11,8 |
|
Autres services |
5 515 |
11 059 |
7,0 |
9,1 |
4,8 |
Source : Office for National, Statistics, « Blue Book ».
Dans les années 1990, la croissance de l'investissement productif au Royaume-Uni a concerné un grand nombre de secteurs. Contrairement à la France ou à l'Allemagne, l'industrie manufacturière britannique progresse fortement (de 13 milliards de livres en 1992 à 18,6 en 1999) et cela s'explique par de forts investissements des secteurs des TIC. De nombreuses activités du secteur tertiaire contribuent sensiblement à la croissance de l'investissement productif, parmi lesquelles on trouve le secteur des transports et des communications (opérateurs de télécommunications).
II. 2. LA FAIBLESSE DE L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF AU DÉBUT DES ANNÉES 1990 : QUELS FACTEURS EXPLICATIFS ?
La faiblesse de la croissance de l'investissement productif au début des années 90 a surpris les économistes, en raison en particulier du décalage de sa reprise par rapport à celle de l'activité. Les recherches font apparaître que les modèles économiques traditionnels, expliquant la croissance de l'investissement par celle du PIB et le coût de financement ne suffisent plus à expliquer l'évolution de l'investissement au début des années 1990 (et conduiraient à la surestimer, Hall, 2001).
Un certain nombre d'analyses suggère que les facteurs financiers ont joué un rôle important (Young, 1993, Smith et alii, 1994, Whitaker, 1998). La situation financière des entreprises était beaucoup moins favorable au début de la récession de 1990 que lors de la récession précédente de 1981. Malgré un taux de rentabilité élevé, les montants importants de dividendes versés à la fin des années 80 ont pesé sur la capacité d'épargne des entreprises. Par ailleurs, l'augmentation de l'endettement des entreprises ayant été fort à la fin des années 80, les paiements d'intérêts ont pesé sur le résultat des entreprises. La part des intérêts payés dans le revenu après impôts était environ deux fois plus important qu'au début de la récession de 1980. Au total, à la sortie de la récession de 1990, les entreprises britanniques étaient devenues beaucoup plus dépendantes des conditions de financement externes que dix ans plus tôt.
|
|
Après la récession de 1980, la confiance quant à l'amélioration des profits et aux possibilités de financements liées à la libéralisation financière avait contribué à la montée de la dette des entreprises, aggravant la sensibilité des entreprises aux variations du taux d'intérêt. La révision à la baisse des perspectives de profits au début des années 90 a été une des causes de la faiblesse persistante du prix des actifs financiers, et favorisait également la montée de l'endettement des entreprises. Le taux d'endettement (ratio dette sur PIB), qui est généralement utilisé pour mesurer la fragilité financière des entreprises, dépasse 40 % à cette époque alors qu'il était resté en dessous de 25 % entre 1979 et 1986. La situation financière des entreprises au début des années 90 n'était donc pas très saine (Ashworth et Davis, 2001). Les entreprises n'ont pas anticipé l'apparition de la crise et n'ont donc pas agi en conséquence. Aussi, les faillites d'entreprises ont-elles atteint un niveau historiquement élevé entre 1991 et 1992.
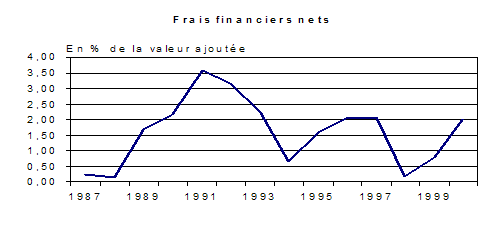
Contraintes financières des entreprises

Devant la détérioration de l'économie britannique, les entreprises ont par la suite préféré rembourser leurs dettes que de continuer à investir. L'investissement a donc chuté d'autant plus que l'incertitude quant à la demande future grandissait et que les coûts de financement augmentaient. Par ailleurs, l'offre de financement s'est également réduite avec l'augmentation du risque de défaut.
III. 3. ANALYSE THÉORIQUE ET EMPIRIQUE DE L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF
Dans les modèles théoriques usuels d'inspiration néoclassique, les déterminants de l'investissement sont la demande et le coût d'usage du capital, qui dépend lui-même du taux d'intérêt et des prix relatifs. Toutefois, comme dans d'autres pays, les modèles macroéconomiques ne parviennent pas à montrer un effet spécifique du coût d'usage du capital (Cuthbertson et Gasparro, 1995), probablement en raison de problèmes de mesures.
A. L'APPROCHE PAR LE Q DE TOBIN
Une autre approche des déterminants de l'investissement concerne la théorie du q de Tobin (voir chapitre 3). Le Q de Tobin est mesuré par le rapport de la valorisation boursière de l'entreprise au stock de capital. Si ce ratio est supérieur à 1, le marché valorise l'investissement futur au-dessus de son coût ce qui favorise l'investissement. Au Royaume-Uni, ce ratio est monté fortement après la fin de la récession du début des années 80, dépassant 1 vers la fin de la décennie. Or ce niveau n'était pas soutenable longtemps et est redescendu lors de la récession du début des années 90. On retrouve l'idée que les marchés ont surestimé à cette époque les résultats des entreprises britanniques et le niveau de la demande, d'où un surajustement plus violent par la suite qui est à l'origine de la faiblesse de l'investissement du début des années 90.
Ce phénomène s'est reproduit après cette nouvelle crise, le ratio Q dépassant le niveau de 1 dans la deuxième moitié des années 90, suivant en cela les Etats-Unis. L'augmentation de l'investissement sur cette période est essentiellement due aux biens d'équipement, et en particulier au développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette croissance s'est accompagnée de la création d'une bulle financière, qui a commencé à éclater au printemps 2000, et explique le niveau élevé antérieurement atteint par le Q de Tobin. La chute boursière intervenue depuis a permis de revenir vers des niveaux plus raisonnables et soutenables, entraînant par ailleurs une chute de l'investissement et un ralentissement de l'économie, toutefois plus marqué aux Etats-Unis qu'au Royaume-Uni.
D'un point de vue empirique, il apparaît que le Q de Tobin ne donne pas une explication satisfaisante de l'évolution de l'investissement au Royaume-Uni, aussi bien avec des données macroéconomiques que sur données de panel (Schaller, 1990). Par ailleurs, l'utilisation du Q de Tobin pose des problèmes de prévision dans la mesure où il est difficile de prévoir l'évolution des marchés financiers. Il est intéressant de noter que l'introduction du Q de Tobin, qui est une mesure de la profitabilité, dans un modèle d'investissement néoclassique (Cuthbertson et Gasparro, 1995) apporte un pouvoir significatif à la détermination de l'investissement.
Depuis quelques années, une autre approche, reposant sur les conditions financières des entreprises, s'est développée. Bernanke, Gertler et Gilchrist (1999) ont développé un modèle « d'accélérateur financier » qui montre que la santé financière des entreprises joue un rôle important dans la détermination de l'investissement, en particulier en situation d'information imparfaite sur le risque financier des entreprises. Quand les entreprises sont fortement dépendantes du financement externe, le coût de financement est plus élevé, ce qui décourage l'investissement. Cet effet financier s'ajoute aux effets habituels, ce qui amplifie et prolonge généralement l'impact des chocs sur l'économie. Or, l'application de ce modèle au Royaume-Uni semble montrer que les effets financiers expliquerait en partie la faiblesse de l'investissement au début des années 1990, alors qu'ils n'auraient pas joué de rôle au début des années 80, la situation financière des entreprises étant à l'époque plus saine (Hall, 2001).
Comme nous l'avons déjà remarqué, la santé financière des entreprises n'ayant pas été la même au cours de ces deux périodes, l'effet sur l'investissement a également été différent, même si l'analyse empirique n'arrive pas à mettre en évidence le rôle du financement par emprunt dans l'évolution de l'investissement. En fait, les travaux empiriques au Royaume-Uni montrent que le lien entre les variables financières et l'investissement est plus fort pour les firmes qui ont une fragilité financière, en période de récession et de politique monétaire restrictive (Guariglia, 1999). En ajoutant dans un modèle néoclassique standard des variables financières compatibles avec les approches de l'accélérateur financier et du canal du crédit, Ashworth et Davis (2001) montrent que la composition du financement externe des entreprises a un effet significatif au Royaume-Uni. A long terme, le niveau de l'investissement diminue quand le ratio dette sur actions augmente. On retrouve le même genre de spécification pour la France et l'Allemagne.
L'effet du ratio dette sur action sur l'investissement implique qu'une baisse du prix des actions associée à une accumulation de la dette peut conduire à une baisse de l'investissement plus forte que celle prévue par les modèles traditionnels, basés sur les variables de production et de stock de capital.
L'ensemble de ces observations souligne l'importance, plus cruciale ces dernières années que dans les années 1980, des contraintes de solvabilité et des contraintes de structure de bilan. Un endettement trop élevé au regard des fonds propres, une profitabilité trop faible, sont de facteurs limitatifs de l'investissement.
CHAPITRE 7
EVOLUTION DE L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF AUX ETATS-UNIS
Aux Etats-Unis, de 1960 à aujourd'hui, la part de l'investissement des entreprises dans le PIB a oscillé entre 9 et 14 %. Ce niveau est inférieur aux niveaux européens.
Plus encore qu'en France ou en Europe, le cycle économique des Etats-Unis dépend de la volatilité de l'investissement des entreprises. Ainsi, le recul très violent de la croissance aux Etats-Unis en 2001 provient surtout de l'effondrement de l'investissement (et des stocks) des entreprises. L'influence de l'investissement des entreprises est tel que cet indicateur est utilisé comme variable clé par le National Bureau of Economic Research pour définir les dates des cycles économiques.
Inversement, les reprises de l'investissement sont fortement corrélées aux anticipations de rebonds de la production.
I. 1. LE BOOM DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
Depuis 1992, la remontée du taux d'investissement a constitué l'un des traits du dynamisme retrouvé de l'économie américaine.
En même temps, la part dans cet investissement des technologies de l'information et des télécommunications n'a cessé d'augmenté. Pour les tenants du New Age, ce phénomène est essentiel dans la compréhension de l'économie américaine. Le recours accru aux nouvelles technologies, rendu possible par cette évolution de l'investissement, doit en effet permettre des gains de productivité plus élevés que par le passé. C'est ce que confirment certaines études (Oliner et Sichel, 2000 ou Jorgenson et Stiroh, 2000) pour lesquelles la moitié des gains de productivité réalisés dans la seconde moitié des années 1990 s'expliquent par la croissance du stock de capital productif en technologies de l'information et des communications.
A nombre d'égards, on peut considérer que l'économie américaine a connu un nouveau cycle d'expansion économique à compter de 1992. L'investissement privé non résidentiel est reparti au deuxième trimestre 1992 après la récession de 1990-1992, et entre 1992 et 2000, a augmenté au rythme de plus 10 % l'an en volume, et ce de façon quasi continue (à l'exception de quelques trimestres en 1995 ou 1997). En part du PIB nominal, il est passé de 9,9 % en 1992 à 13,1 % en 2000. Le poids de l'investissement en équipement des entreprises a atteint en 2000 un point haut historique (9,9 % du PIB contre guère plus de 6 % dans les années 1960), après avoir crû sans discontinuer pendant huit ans, de 1992 à 2000, au rythme moyen de 11,5 % l'an. Une telle expansion est exceptionnelle dans l'histoire des Etats-Unis depuis la seconde guerre mondiale.
Comme on l'a déjà dit, cette forte progression de l'investissement s'est accompagnée d'une déformation marquée de sa composition. En 2000, les technologies de l'information et des communications représentaient près de 35 % des dépenses d'investissement total des entreprises (contre 10 % au début des années 1960) et près de 48 % des dépenses d'équipement !
Mesurée en valeur, cette déformation est d'autant plus notable que le prix de ces biens a baissé nettement plus rapidement que celui des autres équipements. Au cours des années 1990, le rythme de cette baisse s'est accéléré pour atteindre 10 % par rapport au prix de la valeur ajoutée en 1999. D'où une augmentation en volume de cette composante de l'investissement de plus de 16 % l'an au cours des six dernières années. Le taux de croissance annuel du seul investissement en ordinateurs a même dépassé 40 % en moyenne entre 1995 et 2000 !
Cette croissance rapide du volume de l'investissement en informatique et télécommunications n'est toutefois pas exceptionnelle. Au cours des trente dernières années, cette composante de l'investissement des entreprises avait toujours progressé beaucoup plus rapidement que les autres. L'originalité de la période récente (depuis 1995) mérite d'être soulignée. Alors que c'était essentiellement l'accélération des dépenses nominales pour ce type d'équipement qui expliquait la croissance de l'investissement en volume, depuis 1995, la contribution essentielle provient de l'accélération de la baisse des prix.
A la suite du boom de l'investissement, le stock de capital a également progressé rapidement pour retrouver à la fin des années 1990 des taux de croissance identiques à ceux des années 1960. Un tel résultat n'était toutefois pas évident puisque le poids croissant des technologies de l'information et des communications dans le stock de capital a pour effet direct d'en raccourcir la durée de vie, ce qui se traduit par une augmentation continue du taux d'amortissement.
La durée de vie moyenne d'un investissement en ordinateurs (1,4 ans), par exemple, est nettement inférieure à celle des autres équipements (6,3 ans en moyenne). Le taux d'amortissement est ainsi passé de 5 % en 1980 à 9,8 % en 2000, soit un doublement en vingt ans.
Pour autant, le cycle d'investissement qu'a connu les Etats-Unis ne s'est pas réalisé sans à-coups. L'éclatement de la bulle technologique à l'automne 2000 correspond vraisemblablement à une crise de suraccumulation comme en produit régulièrement le capitalisme. Les entreprises ont probablement surestimé la profitabilité espérée de cette nouvelle génération du capital que sont les technologies de l'information et des communications, si bien que les Etats-Unis ont souffert d'un excès de capacités en TIC, nécessitant un fort ajustement à la baisse de l'investissement.
II. 2. LA CRISE IMMOBILIÈRE DATE DU DÉBUT DES ANNÉES 1980
Aux Etats-Unis, la crise immobilière avait commencé au début des années 1980, alimentée notamment par la réforme fiscale américaine de 1981 et par la déréglementation des caisses d'épargne ( Savings and Loans ), autorisées enfin à financer la construction de l'immobilier non résidentiel (surtout de bureaux). La crise immobilière prend fin une dizaine d'année après, au moment même où elle éclate en France. Il y a donc un retard de près de dix ans dans le cycle de la construction non résidentielle de part et d'autre de l'Atlantique. Le fait que la bulle immobilière ait été effacée dès le début des années 1990 explique que l'investissement en construction ait pu rebondir dès 1992.
Par ailleurs, comme nous l'avons déjà mentionné, la structure de l'investissement productif privé s'est profondément modifiée au profit des biens d'équipement et au détriment de la composante « construction ». En valeur nominale, les dépenses d'investissement en construction non résidentielle ne représentent plus désormais que 3 % du PIB. En 2000, les bâtiments et constructions de toute nature représentaient seulement 57 % du stock de capital privé non résidentiel contre plus de 80 % il y a cinquante ans. Cependant, son âge moyen est aujourd'hui plutôt élevé (21 ans en moyenne), ce qui est susceptible de nourrir des besoins de remplacement.
III. 3. LA PROFITABILITÉ S'AMÉLIORE EN 1992
La remontée de l'investissement a eu lieu, aux Etats-Unis, quelques temps après le moment où la politique monétaire commence à devenir plus expansionniste. Les taux d'intérêts réels deviennent vraiment faibles à compter de la fin de l'année 1990 mais l'investissement ne repart que deux ans plus tard. Selon certaines études de la CDC, les délais d'action de la politique monétaire sur l'investissement des entreprises sont d'environ deux ans, et ce constat serait vrai également en Europe. Cependant, la diminution de la charge d'intérêt supportée par les entreprises américaines depuis 1990 représente plus d'un point de revenu national et explique une part importante de la hausse des profits.
Entre 1992 et 1999, la croissance des profits des entreprises américaines (sociétés et entreprises individuelles) a été spectaculaire. La marge brute d'autofinancement de l'ensemble des entreprises américaines est ainsi passé de 637 milliards de dollars, fin 1991, à 1 149 milliards de dollars fin 1999. En termes réels (par rapport au prix de la valeur ajoutée), la croissance des profits nets d'amortissement augmente alors en moyenne de plus de 10 % par an entre 1992 et 1999, et elle approche les 14 % entre 1995 et 1999.
Dès 1991, le partage de la valeur ajoutée se déforme en faveur de la rémunération du capital. A partir de 1994, le redressement de la rentabilité du capital provient surtout d'une amélioration notable de la productivité du capital. Conjugué à la baisse des taux d'intérêt réels, la profitabilité s'est redressée encore plus vite.
Parallèlement à l'amélioration de leurs résultats, les entreprises américaines ont donc investi massivement depuis 1992. Traditionnellement, la reprise de l'investissement en début de cycle s'accompagnait d'une dégradation des capacités de financement des entreprises, qui freinait à son tour l'investissement. Or, entre 1992 et 1998, ce mécanisme ne semble pas avoir joué. L'investissement des entreprises a sensiblement progressé sans que leur besoin de financement ne s'aggrave.
S'il a fallu attendre plusieurs années (1998) avant qu'une détérioration du besoin de financement des entreprises américaines ne soit observée, c'est en grande partie à l'évolution exceptionnellement favorable du prix des équipements qu'on le doit. Parallèlement à la hausse des profits, l'accélération de la baisse du prix relatif de l'investissement a joué un rôle non négligeable dans le maintien d'un besoin de financement réduit des entreprises américaines.
Au total, on peut considérer que l'effort d'investissement des entreprises américaines a pu être financé par les entreprises elles-mêmes dans la mesure où elles ont bénéficié d'une baisse de leurs charges d'endettement et d'une conjoncture exceptionnelle. De surcroît, l'accélération de la baisse du prix des équipements a joué dans le même sens.
Aujourd'hui, cette conjonction de facteurs favorables - taux d'intérêt faible, croissance forte, profit élevés, baisse très rapide du capital- est interrompue. On peut même observer que tous ces facteurs évoluent défavorablement au point que le besoin de financement s'est sensiblement dégradé.
IV. 4. LES ANALYSES QUANTITATIVES DOIVENT PRENDRE EN COMPTE L'EFFET DES TIC
Le comportement de l'investissement en biens d'équipement a été particulièrement remarquable au cours des années 1990.
Les modèles économétriques de l'investissement donnaient des résultats satisfaisant jusqu'en 1992 (Bernanke, Bohn et Reiss, 1988 ou Oliner, Sichel, et Rudebusch, 1995 ou Duval, 2000). Depuis lors, il semble que les modèles traditionnels de type accélérateur-profit sous-estiment considérablement la croissance de l'investissement en biens d'équipement des entreprises.
Tevlin et Whelan (2000) montrent que la raison en est simple. La part prépondérante des technologies de l'information dans le stock de capital productif a exercé deux effets majeurs.
Le premier effet tient au taux de dépréciation du stock de capital productif, qui a doublé en vingt ans. Or, tous les modèles traditionnels supposaient jusqu'alors un taux de dépréciation du stock de capital constant. En levant cette hypothèse, on parvient mieux à rendre compte de l'évolution du stock de capital.
Le deuxième effet tient à l'accélération de la baisse du coût d'usage du capital. La baisse exceptionnelle des prix relatifs des TIC a modifié la sensibilité des entreprises à ces prix. Alors qu'il ne semblait pas significativement joué jusqu'au début des années 1990, le coût d'usage du capital exerce maintenant un effet important.
Duval (2000) montre que l'accumulation de capital en équipements hors informatique a été globalement conforme à ses déterminants traditionnels que sont notamment l'effet d'accélérateur (les perspectives de production) et le taux de rentabilité économique.
Tevlin et Whelan (2000) montrent qu'en désagrégeant les TIC et les équipements hors TIC, on obtient des résultats très satisfaisants, à la condition toutefois d'incorporer dans la modélisation le coût d'usage des TIC. Duval montre que cette envolée de l'investissement en informatique et télécommunications traduit pour l'essentiel un phénomène de substitution aux autres types de capital et de travail 102 ( * ) .
Le rôle « spécifique » des technologies de l'information dans le comportement d'investissement des entreprises américaines soulève quelques problèmes d'ordre méthodologique. L'approche hédonique 103 ( * ) conduit à des chutes de prix des ordinateurs de l'ordre de 20 à 30 % par an. Or, il est permis de douter qu'après trois années d'utilisation, le remplacement d'un ordinateur par un ordinateur au même prix apparent entraîne un doublement du volume disponible. De même, supposer que le taux de dépréciation des ordinateurs est de 55 %, comme le font les statisticiens américains, revient à dire que la durée de vie des ordinateurs est inférieure à deux ans, ce qui à nombre d'égards peu paraître faible. Il faut donc garder à l'esprit ces réserves, qui sont susceptibles d'avoir des conséquences sur le profil futur de l'investissement en technologies de l'information.
BIBLIOGRAPHIE
Artus P. et Morin P., 1991, Macroéconomie appliquée, Puf, Paris
Artus P. et Muet P.-A., 1984, « Un panorama des développements récents de l'économétrie de l'investissement », Revue Économique , n° 5, pp. 791-830
Ashworth P. et Davis E.P., 2001, « Some evidence on financial factors in the determination of aggregate business investment for the G7 countries », NIESR Discussion Paper , n°187
Beaudu et Heckel (2001, « Le canal du crédit fonctionne-t-il en Europe ? une étude de l'hétérogénéité des comportements d'investissement à partir de données de bilan agrégées », INSEE , Document de travail n G 2001/04
Bernanke, B., Bohn H., and P. Reiss, 1988. « Alternative Non-Nested Specification Tests of Time Series Investment Models », Journal of Econometrics , 37, pp 293-326
Bernanke B., Gertler M. et Gilchrist S., 1999, « The financial accelerator in a quantitative business cycle framework », in Taylor J. and Woodford M., Handbook of Macroeconomics , volume 1, North Holland, Amsterdam
BLOCH, Laurence, COEURE, Benoît, « Profitabilité, investissement des entreprises et chocs financiers : France, Allemagne, Etats-Unis et Japon, 1970-1993 », Economie et Statistique, 1993/8-9, N°268-269, pp.11-30
Caselli, Pagano et Schivardi (2000), « Investment and growth in Europe and iin the United States in the Nineties », Banca d'Italia, temi di discussionne, n° 372, march.
Chirinko R. S., Fazzari S. M. et Peyer A.P. (1999) « How responsive is business capital formation to its user cost ? An exploration with micro data », Journal of Public Economics , 74, pp.53-80.
Cette G., Mairesse J. et Kocoglu, Y., 2001, « Les technologies de l'information et des communications en France : diffusion et contribution à la croissance », Economie et Statistique, n°339-340.
Commision européenne, 2001, « Determinants and benefits of investment in the euro area », EUROPEAN ECONOMY, No 73, chap3 . Office for Official Publications of the EC. Luxembourg
Crépon B. et Gianella C., 2001, « Fiscalité et coût d'usage du capital : incidences sur l'investissement, l'activité et l'emploi », Economie et Statistique, n°341-342
Crépon B. et Rosenwald F., « Des contraintes financières plus lourdes pour les petites entreprises », Economie et Statistique, n°341-342
Cuthbertson K. et Gasparro D, 1995, « Fixed investment decisions in UK manufacturing : the importancve of Tobin's Q, output and debt », European Economic review , 39(5), mai, p.919-941
DEUTSCHE BUNDESBANK, 2000, « Problems of international comparisons of growth caused by dissimilar methods of deflation -with IT equipment in Germany and the United States as a case in point », DEUTSCHE BUNDESBANK MONTHLY REPORT , N°8, août, encadré p. 8. vol.52
DEUTSCHE BUNDESBANK, 2000, « The profitability and investment behaviour of non-financial corporations », DEUTSCHE BUNDESBANK MONTHLY REPORT , N°10, octobre, pp. 31-40.vol.52
DOISY S., 2001, « La croissance potentielle de l'économie française : une évaluation », Direction de la Prévision, Ministère de l'Economie et des Finances et de l'Industrie, Document de travail, Novembre 2001
Dormont B. (1997) « L'influence du coût salarial sur la demande de travail », Economie et Statistique 301-302, pp. 95-109.
Duhautois R., 2001, « Le ralentissement de l'investissement est plutôt le fait des petites entreprises tertiaires », Economie et Statistique, n°341-342.
Duval R., 2001, « Quel crédit faut-il accorder à la nouvelle économe américaine », Economie et Statistique, n°339-340
Fazzari, S. M., Hubbard, R. G. et Petersen, B. C., 1988, « Financing constrainst and corporate Investment », Brooking Papers on Economic Activity , 1, pp 141-206
Guariglia A., 1999, « The effects of financial constraints on inventory investment ; evidence from a panel of UK firms », Economica , 66, p.43-62
Hall S., 2001, « Financial effects on corporate investment in UK business cycles », Bank of England Quaterly Bulletin , 41(4), hiver, p. 449-458
Herbet J.-B., 2001, « Peut-on expliquer l'investissement à partir de ses déterminants traditionnels au cours de la décennie 90 ? », Economie et Statistique, n°341-342
Irac D. et Jacquinot P., 1999, « L'investissement en France depuis le début des années 1980 », Note d'études et de recherche, Banque de France.
Jorgenson, D. W., 1963, « Capital Theory and Investment Behaviour », American Economic Review, 53 (2), pp.247-259.
Jorgenson et Stiroh, 2000, « Raising the Speed Limit : U.S. Economic growth in the information Age », American Economic Review
KALCKREUTH, Uls von, « Monetary transmission in Germany: new perspectives on financial constraints and investment spending » , BANQUE CENTRALE EUROPEENNE , WORKING PAPER - BC, 2001, N°109,décembre,62 p.
Kremp, E. et Stöss, E., 2001, « L'endettement des entreprises industrielles françaises et allemandes : des évolutions distinctes malgré des déterminants proches », Economie et Statistique, n°341-342
Lequiller , 2001, « La nouvelle économie et la mesure de la croissance », Economie et Statistique, n°339-340
Mairesse J., B. Mulkay et B. H. Hall., 2001, « Investissement des entreprises et contraintes financières en France et aux Etats-Unis », Economie et Statistique, n°341-342
OCDE, 2001, Etude économique sur la France . OCDE
Oliner, S. et Sichel, D., 2000, « The Resurgence of Growth in the Late 1990s : Is Information Technology the Story », Journal of Economic Perspectives, vol. 14, n°4, Fall
Oliner, S., Rudebusch G, et D. Sichel, 1995. « New and Old Models of Business Investment: A Comparison of Forecasting Performance », Journal of Money , Credit, and Banking, 27, 806-826
MOJON, Benoît, SMETS, Franck & VERMEULEN, Philip, 2001, « Investment and monetary policy in the Euro area », BANQUE CENTRALE EUROPEENNE, WORKING PAPER - BCE,N°78,octobre,33 p.
Mairesse J., Mulkay B. et B. Hall., 2001, « Investissement des entreprises et contraintes financières en France et aux Etats-Unis », Economie et Statistique, n°341-342.
Morin P., Norotte M. et Venet G., 1987, « Le comportement d'investissement des entreprises françaises : analyse et problèmes », Économie et Prévision , n° 80, pp. 5-50
Muet P.-A. (1979), « Les modèles « néoclassiques » et l'impact du taux d'intérêt sur 'investissement », Revue Économique , n° 2, pp. 244-280
Mudur U. (2000), « L'allocation des capitaux dans le processus global d'innovation est -elle optimale en Europe », in Politiques industrielles pour l'Europe, Conseil d'Analyse Economique. La documentation française.
Schaller H., 1990, « A re-examination of the Q theory of investment using firm data », Journal of Applied Econometrics , 5, p. 309-325
Smith J., Sterne G. et Devereux M., 1994, « Personal and corporate sector debt », Bank of England Quaterly Bulletin , 34(2), mai, p. 144-155
Tobin, J., 1969, « A General Equilibrium Approach to Monetary Theory », Journal of Money. Credit and Banking, 1, p. 15-29.
Tevlin, S., et K. Whelan, 2000, « Explaining the Investment Boom of the 1990s », miméo, Federal Reserve Board
VERMEULEN, Philip, « Business fixed investment: evidence of a financial accelerator in Europe », Banque Centrale Européenne , 2000, WORKING PAPER N°37, novembre,34 p.
WIRTSCHAFT UND STATISTIK, « Wie produktiv sind Investitionen in industrielle Forschung und Entwicklung », WIRTSCHAFT UND STATISTIK , DESTATIS, Wiesbaden, 2001, N°4,avril, pp. 312-320
Whitaker S., 1998, « Investment in this recovery », Bank of England Quaterly Bulletin , 38(1), février, p. 38-47
Young G., 1993, « Debt, deflation and the company sector : the effects of balance sheet adjustment », National Institute Review , 144, mai, p.74-84
L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES,
CLÉ D'UNE
CROISSANCE DURABLE
Joseph KERGUÉRIS
Sénateur
Délégation du Sénat pour la Planification
La croissance de l'économie française est, depuis une dizaine d'années, bridée par la faiblesse de l'investissement des entreprises.
La première partie de ce rapport recense les symptômes du retard français en matière d'investissement. Elle montre à quel point la langueur de l'investissement français contraste, défavorablement, avec la vigueur de l'investissement outre-Atlantique. L'écart est particulièrement accusé dans le domaine des nouvelles technologies.
Pour comprendre les causes de ce retard, un détour par la théorie économique a paru nécessaire. C'est l'objet de la deuxième partie, qui dégage quatre déterminants majeurs de l'investissement : il s'agit de la demande anticipée, du coût des facteurs de production, de la profitabilité des investissements, et, enfin, des conditions d'accès au financement des entreprises. L'importance relative de chacun de ces facteurs varie au fil du temps.
Cette analyse théorique conduit naturellement à réfléchir aux orientations de politique économique susceptibles de soutenir l'investissement productif.
La troisième partie passe ainsi en revue les principaux leviers dont dispose la puissance publique pour dynamiser l'investissement des entreprises. La politique macroéconomique, la politique des revenus, les mesures de soutien à la recherche, les aides au financement des petites et moyennes entreprises, l'investissement public, la réforme des marchés sont successivement examinés.
La dernière partie s'intéresse aux phénomènes de surinvestissement, qui ont pu affecter les Etats-Unis et le Japon, ainsi que le secteur des télécommunications en Europe. Elle ouvre des pistes de réflexion quant aux moyens à mettre en oeuvre pour mieux prévenir ces phénomènes.
Ce rapport s'appuie, enfin, sur une étude commandée à l'institut Rexecode par le Service des études économiques et de la prospective du Sénat.
* 1 cf. l'étude annexée à ce rapport, p. 169.
* 2 Le stock de capital physique augmente avec l'investissement, et diminue au rythme de dépréciation du capital (amortissement).
* 3 Le taux d'accumulation est le taux de croissance du capital, soit le rapport entre l'investissement net et le stock de capital.
* 4 Cf. Deneuve C. « Investissement et situation financière des entreprises », Problèmes économiques, n° 2717, 13 juin 2001, p. 18 à 23.
* 5 Revue de Rexecode, n° 71, 2 ème trimestre 2001, « La position de la France dans les technologies de l'information », p. 41.
* 6 Cf. « Croissance économique de l'UE : l'émergence d'un nouveau modèle ? », in Economie européenne, n° 71, 2000, p. 91 à 152.
* 7 Cette G., Mairesse J. et Kocoglu Y., « Croissance économique et diffusion des TIC, le cas de la France sur longue période », Revue française d'économie, vol. 16, n° 3, p. 155-192, 2002.
* 8 Audenis C., Deroyon J., Fourcade N., « L'impact des nouvelles technologies de l'information et de la communication sur l'économie française. Un bouclage macroéconomique, documents de travail de l'INSEE, G 2002/06, mai 2002.
* 9 Doisy S., « La croissance potentielle de l'économie française. Une évaluation », Revue économique, vol. 53, n°3, mai 2002, p. 611-624.
* 10 Crépon B., et Gianella, C. « Fiscalité et coût d'usage du capital : incidences sur l'investissement, l'activité, et l'emploi », Economie et Statistique, n° 341-342, janvier-février 2002.
* 11 Bulletin de la Banque de France, n°102, juin 2002, p.5 à7.
* 12 OCDE, « L'étude de l'OCDE sur l'emploi. Investissement, productivité et emploi », 1995 p. 82.
* 13 Les investissements directs étrangers (IDE) sont les investissements qu'une entité résidente d'une économie (investisseur direct) effectue dans le but d'acquérir un intérêt durable dans une entreprise résidente d'une autre économie. Un intérêt durable implique une relation de long terme, et l'exercice d'une influence notable sur la gestion de l'entreprise. De manière conventionnelle, on considère qu'une relation d'investissement direct est établie, dès lors qu'un investisseur détient au moins 10 % du capital social de l'entreprise investie. En deçà de ce seuil, les opérations sur titres sont classées dans les investissements de portefeuille.
* 14 Cf. Bulletin de la Banque de France, n° 104, août 2002, p. 105.
* 15 Voir AFII «Les décisions d'investissement étranger en France », Les Notes Bleues de Bercy, n° 238, octobre 2002.
* 16 Muet P.A., « Les modèles «néo-classiques», et l'impact du taux d'intérêt sur l'investissement », Revue économique, n° 2, mars 1979.
* 17 Enquête de conjoncture INSEE, 4 ème trimestre 1999.
* 18 Dormont B. (1997) « L'influence du coût salarial sur la demande de travail », Economie et Statistique, n° 301-302, p. 95-109
* 19 Crépon B. et Gianella C. (2001), « Fiscalité et coût d'usage du capital : incidences sur l'investissement, l'activité et l'emploi », Economie et Statistique, n° 341-342, p. 107-127.
* 20 Abel A.B., Investment and the Value of Capital, New York, Garland Publishing, 1979.
* 21 Hayashi F., « Tobin's marginal q. and everage q : a neoclassical interpretation », Econometrica, vol. 50, n° 1, 1982, p. 213-224.
* 22 Malinvaud E., « Capital productif, incertitude et profitabilité », Annales d'économie et de statistique, n° 5, 1987, p. 1-36.
* 23 Abel A.B. et Eberly J., « A unified model of investment under uncertainty », NBER Working Paper, n° 4296, 1993.
* 24 Sylvain A, « Rentabilité et profitabilité du capital : le cas de six pays industrialisés », Economie et Statistique, n° 341-342, 2001,1/2, p.129-151.
* 25 Cf. Duhautois R., « Le ralentissement de l'investissement est plutôt le fait des petites entreprises tertiaires », Economie et Statistique, n° 341-342, 2001-1/2, p.47-66.
* 26 La littérature distingue un canal strict du crédit et un canal large. Le canal strict du crédit s'intéresse au rôle particulier des banques. Le canal large traite du financement des entreprises et des ménages, et des problèmes d'information qu'ils rencontrent, en envisageant l'ensemble de leurs créanciers.
* 27 Crépon B. et Rosenwald F., « Investissement et contraintes de financement, le poids du cycle, une estimation sur données françaises », Document de travail INSEE, 1999.
* 28 Cf. Muet P.A., « Les modèles «néo classiques »et l'impact du taux d'intérêt sur l'investissement », Revue économique, n°2, mars 1979, p. 244-281.
* 29 Tobin J., « A general equilibrium approach to monetary theory », Journal of Money, Credit and Banking, n° 1, 1969, p. 15-29.
* 30 Herbet J.B., « Peut-on expliquer l'investissement à partir de ses déterminants traditionnels au cours de la décennie 90 ? », Economie et Statistique, n° 341-342, 2001, p. 94.
* 31 Herbet J.B., op. cit., 1995 ; Michaudon H. et Vannieuwenhuyze N., « Peut-on expliquer les évolutions récentes de l'investissement ? », Note semestrielle de conjoncture de l'INSEE, mars 1998 ; INSEE, L'Economie française, éd. 1999-2000, article « Faiblesse de l'investissement depuis 1990 et financement », p. 49-70.
* 32 Herbet J.B et Michaudon H., « Y a-t-il un retard d'investissement en France depuis le début des années 1990 ? », Document de travail INSEE, 1999.
* 33 Op. cit.
* 34 Duhautois R., « Le ralentissement de l'investissement est plutôt le fait des petites entreprises tertiaires » », Economie et Statistique, n° 341-342, 2001, p. 47-67.
* 35 Artus P., « Les entreprises françaises vont-elles recommencer à s'endetter ? », Revue d'Economie Financière, n° 46, 1998, p. 143-162.
* 36 Irac D., et Jacquinot P., « L'investissement en France depuis le début des années 1980 », Note d'étude et de recherche, Banque de France, 1999.
* 37 Cf. Bourdieu J., Coeuré B., Sédillot B., « Investissement, incertitude et irréversibilité. Quelques développements récents de la théorie de l'investissement », Revue économique, vol. 48, n° 1, janvier 1997, p. 23-53.
* 38 Citation tirée de Economie européenne, n°71, 2000, p. 146.
* 39 Voir le rapport de la Commission, Company Taxation in the Internal Market, SEC 2001,n° 1681.
* 40 Bretin E., Guimbert S. (2002), « Tax competition : to cure or to care ? », Conférence « Corporate and Capital Income Taxation in the European Union : the EU Commission Report on Companies'Taxation and Beyond », Fucam, décembre 2001. Les conclusions de cette étude sont présentées dans l'article de S. Guibert, « Réformes de la fiscalité du capital en Europe », Revue française d'économie, n° 4, vol. XVI, p. 119 et 120.
* 41 Op. cit.
* 42 Goodsbee S., «The importance of measurement error in the cost of capital », National Tax Journal, 53 (2) juin 2000.
* 43 Le Rapport du Conseil national des Impôts de l'année 1987 présente une synthèse des évaluations réalisées en la matière.
* 44 Rappelons que les dépenses en R&D ne sont pas des investissements au sens de la Formation brute de capital fixe. Mais elles peuvent être considérées comme des investissements au sens économique du terme : ces dépenses engagent l'avenir, et sont susceptibles de modifier les conditions de production dans l'entreprise.
* 45 Guellec D., « Les politiques de soutien à l'innovation technologique à l'aune de la théorie économique », Economie et Prévision, n° 150-151, 2001, 4-5.
* 46 Agence nationale pour la valorisation de la recherche.
* 47 Guellec D. et van Pottelsberghe de la Potterie B., « Le soutien des pouvoirs publics stimule-t-il la RD privée ? », Revue économique de l'OCDE, n° 29, 1999.
* 48 Le dépôt d'un brevet permet au découvreur d'une innovation de s'en approprier les retombées commerciales, mais seulement de manière temporaire.
* 49 Cf. Saint Etienne C., « La nouvelle économie a besoin de réseaux », Sociétal, n° 37, 3 ème trimestre 2002, p. 48.
* 50 Rapport Bonnefous, « 2000-2006 : Quelles priorités pour les infrastructures de transport », Commissariat général du Plan, 1999.
* 51 DATAR, « Schémas multimodaux de services collectifs : transports de voyageurs et de marchandises », automne 2000.
* 52 L'impact des publications scientifiques est mesuré par référence au nombre de citations dont elles font l'objet. L'indice d'impact est égal à la part des citations rapporté à la part des publications.
* 53 D. Guellec, « Les politiques de soutien à l'innovation technologique à l'aune de la théorie économique », Économie et Prévision, n° 150-151, 2001.
* 54 Cf. Rosenwald F., « Le financement de l'investissement des petites entreprises industrielles : la place prépondérante de l'autofinancement », Revue d'économie financière, n°54, 1999.
Lhomme Y., « Comment se financent les projets innovants dans l'industrie ? », Problèmes économiques, n° 2742, 2 janvier 2002.
* 55 INSEE, L'économie française, édition 1998-1999, « Le partage de la valeur ajoutée », p. 63-90, 1998.
* 56 Idem, p. 89.
* 57 La consommation des ménages a progressé de 2,5 % en volume en 2001, et elle devrait croître encore d'un peu moins de 2 % en 2002.
* 58 La CNME a fusionné en 1981 avec le Crédit hôtelier pour donner naissance au CEPME (Crédit d'équipement des PME).
* 59 La définition des PME retenue ici est celle de l'INSEE : sont considérées comme des PME les entreprises employant de 10 à 500 salariés.
* 60 Pour une confirmation de ces données, voir Biais B., Malecot J.F., « Incentives and efficiency in the bankruptcy process : the case of France », The World Bank, Occasional paper n° 23, April 1996 ; ou Bardos M., « Défaillance d'entreprises et délais de paiement », note pour l'Observatoire des délais de paiement, 1997. En 2000, les trois quarts des défaillances d'entreprises ont concerné des entreprises dont le chiffre d'affaires était compris entre 1 et 5 millions de francs.
* 61 Voir, à ce sujet, Lachmann J., « Le capital-risque au coeur du financement de l'innovation des PME », Problèmes économiques, n° 2658, mars 2000, p. 6.
* 62 Cf. Lhomme Y., « Comment se financent les projets innovants dans l'industrie ? », Le 4 pages des statistiques industrielles, n° 156, novembre 2001.
* 63 OCDE, Perspectives économiques de l'OCDE, n° 71, 2002, p. 205 à 219.
* 64 Scarpetta S., Hemmings P., Tressel T. et Woo J., « The role of policy and institutions for productivity and firm dynamics : evidence from micro and industry data », Document de travail du département des affaires économiques de l'OCDE, n° 329.
* 65 Bassanini A. et Ernst E., « Labour market institutions, product market regulation, and innovation : cross-country evidence », Documents de travail du département des Affaires économiques de l'OCDE, n° 316, 2002 ; Ahm S., « Competition, innovation and productivity growth : a review of theory and evidence », Documents de travail du Département des affaires économiques de l'OCDE, n° 317, 2002.
* 66 Commission, 2000, op. cit., p. 135.
* 67 Commission, 2000, op. cit., p. 135.
* 68 OCDE, 2002, op. cit., p. 214.
* 69 « Straight Talk », The Conference Board, mai 2002.
* 70 Voir, à ce sujet, Khaber R.., Parisot C., Mourier J.-L., « Le spectre du surinvestissement », Le Point de Conjoncture - Aurel Leven, janvier 2001
* 71 Cf l'article, « Too many debts ; too few calls », The Economist, 20 juillet 2002.
* 72 Chiffre fourni par C. Rudelle, consultant au BIPE, auditionné par votre rapporteur le 23 juillet 2002.
* 73 UMTS : Universal Mobile Telecommunication System.
* 74 Cf. Didier M. et Lorenzi J.H., « Enjeux économiques de l'UMTS », Rapport du Conseil d'Analyse économique n° 36, La Documentation française, 2002.
* 75 Op. cit., p. 126.
* 76 Cette entreprise est aujourd'hui en faillite.
* 77 Ce point peut être illustré par des données récentes fournies par l'Autorité de régulation des télécoms(ART) pour le marché français. Elles indiquent que la facture moyenne acquittée par un consommateur a baissé, entre 2000 et 2001, en raison d'une diminution de 8% du prix des communications. La baisse a été particulièrement forte (-35% entre 1999 et 2001) pour les communications interurbaines.
* 78 Pour une analyse approfondie de ces questions, se reporter à Liebowitz S., Re-thinking the Network Economy, AMACOM, 2002.
* 79 Artus P. et Genet J., « Investissement aux Etats-Unis et évolutions boursières », CDC Flash, 14 février 2002, n° 37.
* 80 Voir deuxième partie, chapitre II, B.
* 81 Citation tirée de Conjoncture BNP-Paribas, juillet-août 2002, p. 1.
* 82 Ces arguments sont développés dans un discours de M. Greenspan du 30 août 2002, disponible sur le site de la Réserve fédérale www.federal.reserve.org . Pour un commentaire critique, voir C. Chavagneux, « Alan Grenspan fait aveu d'impuissance », Alternatives économiques, n° 207, octobre 2002, p. 51.
* 83 Cette étude est publiée dans Economie et Statistique , n° 341-342, janvier-février 2001, p. 107 à 127.
* 84 Source : Conseil d'analyse économique
* 85 Source : Dealogic Capital Data
* 86 La boucle locale est la partie terminale d'un réseau de télécommunications, celle qui dessert directement l'abonné. Actuellement, France Télécom est le seul opérateur en France à disposer d'une boucle locale ; il loue son réseau à ses concurrents. Cette situation place les concurrents de France Télécom dans une situation de dépendance par rapport à l'opérateur historique.
* 87 Il s'agit de l'élasticité de court terme (un trimestre). Une croissance de 1 % du PIB est associée à une croissance de 2,5 % de la FBCF.
* 88 On rappelle pour mémoire que le PIB comprend la valeur ajoutée des branches marchandes mais aussi celle des branches non marchandes. Il est donc sensiblement supérieur à la valeur ajoutée des entreprises. Les taux d'investissement diffèrent selon qu'ils sont calculés sur la base de la valeur ajoutée des entreprises ou du PIB total.
* 89 L'ordre de grandeur serait proche de 5,3 % en incluant les administrations publiques dont 0,15 % pour le ministère de la Défense.
* 90 Il s'agit du partage entre dépenses finales (considérées comme de l'investissement) et dépenses de consommation intermédiaire des technologies de l'information. Pour un même niveau de dépenses en matériels informatiques et logiciels, les comptables américains obtiendraient 60 % de dépenses d'investissement de plus que les comptables français.
* 91 voir une présentation des résultats de l'étude de Crépon et Gianella, 2001 dans le chapitre trois de cette étude.
* 92 On parle d' output-gap qui correspond à l'écart entre la croissance effective et croissance potentielle. Un écart négatif témoigne d'une insuffisance de la demande.
* 93 ou de concurrence monopolistique
* 94 on parle de demande « notionnelle » de capital
* 95 Le modèle AMADEUS de l'INSEE ajoute à la spécification « accélérateur-profit » un terme de tensions sur les capacités de production, jouant positivement sur l'investissement.
* 96 En fait, deux approches se sont développées dans la littérature sur ce sujet : celle du canal strict du crédit et celle du canal large du crédit. Alors que le canal strict du crédit fait jouer un rôle particulier aux banques, le canal large du crédit se concentre essentiellement sur le financement des entreprises et des ménages et sur leurs problèmes d'information avec l'ensemble de leurs créanciers sans distinction. Par la suite, sauf précisions, nous nous intéressons uniquement au canal large du crédit.
* 97 En fait, le niveau de capital dont disposent les entreprises sert de garantie pour leurs prêts et permet ainsi de réduire le taux auxquelles elles se financent. Lors de sa décision d'investissement, une entreprise doit donc tenir compte, pour actualiser ses profits futurs, du coût de financement externe lié aux conditions sur le marché du crédit mais également du fait que le capital étant gage de son propre financement, son accumulation réduit la prime de financement bancaire.
* 98 Les petits pays étant plus sensibles que les grands.
* 99 Pour ces auteurs, le taux d'endettement des entreprises françaises serait indépendant de la taille des entreprises : les contraintes financières que subiraient les plus petites entreprises passeraient donc essentiellement par les conditions de financement auxquelles elles ont accès et pas nécessairement par des plafonds d'endettement plus bas que ceux pratiqués pour les plus grandes entreprises.
* 100 Selon les données provenant de la centrale des bilans.
* 101 Cette étude se fonde sur la base de données BACH (données homogènes européennes sur les comptes des entreprises) et sur une fonction de production à élasticité constante.
* 102 Ceci signifie simplement que le capital technologique a cru plus rapidement que les autres types de capital et que le volume de travail.
* 103 La méthode hédonique aboutit davantage à une évaluation de consentement à payer de l'acheteur, un certain volume pour un certain prix, plutôt qu'à une mesure pertinente du volume d'un facteur de productivité mobilisé pour évaluer la productivité des facteurs.








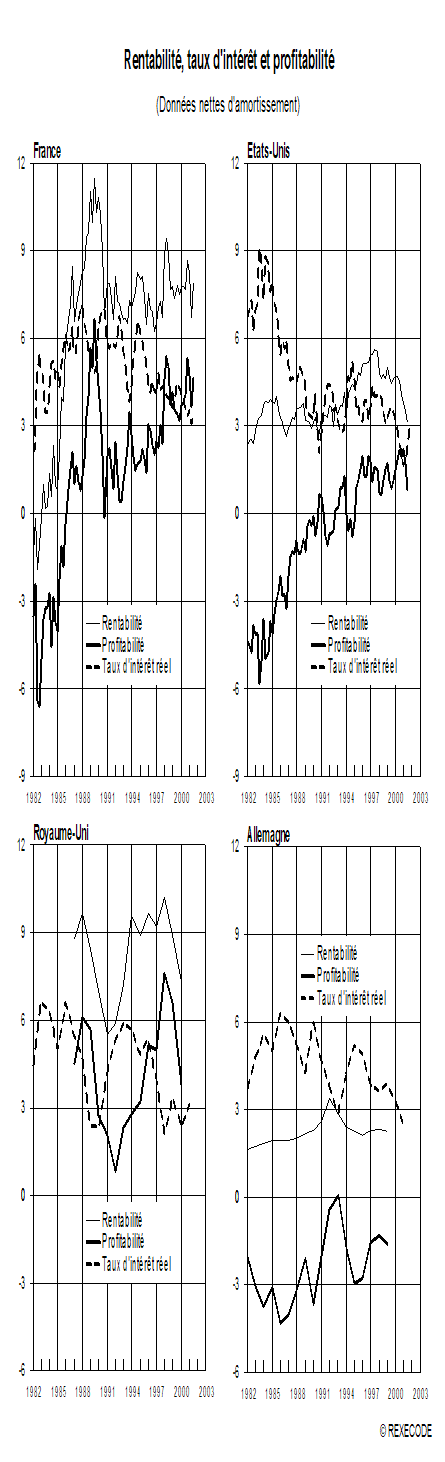
 c
t
= p
I,
t-1
[r
t
+-
I,t
(1-)]
c
t
= p
I,
t-1
[r
t
+-
I,t
(1-)]
 ), on obtient la formule ci-dessus.
), on obtient la formule ci-dessus.