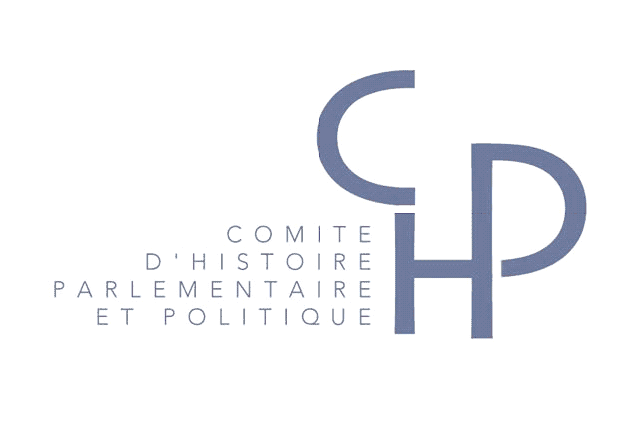La laïcité : des débats, une histoire, un avenir (1789 - 2005)
Sénat - 4 février 2005
-
MESSAGE DE M. CHRISTIAN PONCELET,
PRÉSIDENT DU SÉNAT
lu par M. Aymeri de Montesquiou, Sénateur du Gers
-
PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE
Jean Garrigues, président du Comité d'Histoire
Parlementaire et Politique.
-
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE À LA LOI DE 1905
-
LES DÉBATS DU XIXe SIÈCLE
Session sous la présidence de Philippe Levillain,
professeur à l'Université de Paris X-Nanterre
et à l'Institut Universitaire de France
-
L'INVENTION DE LA LAÏCITÉ DE LA RÉVOLUTION À L'EMPIRE
Jacques-Olivier Boudon, professeur à l'Université de Paris-Sorbonne
-
DÉBATS ET ENJEUX DE LA RESTAURATION AU SECOND EMPIRE
Jérôme Grondeux, maître de conférences à l'Université de la Sorbonne
-
LES DÉBATS AU DÉBUT DE LA IIIe RÉPUBLIQUE
Philippe Levillain, professeur à l'Université de Paris X-Nanterre
et à l'Institut Universitaire de France
-
ÉCHANGES AVEC LA SALLE
-
L'INVENTION DE LA LAÏCITÉ DE LA RÉVOLUTION À L'EMPIRE
-
LA LOI DE 1905 ET SON APPLICATION
Table ronde présidée par Philippe Levillain
-
L'ÉCHEC DU CONCORDAT RÉPUBLICAIN
Jérôme Grévy, maître de conférences à l'IUFM de Poitiers
-
PATRICK CABANEL
-
CHRISTOPHE BELLON,
doctorant à l'Institut d'études politiques de Paris,
allocataire de recherche à l'Assemblée Nationale
-
JEAN BAUBÉROT,
directeur de recherches à l'École Pratique des Hautes Études
-
ÉCHANGES AVEC LA SALLE
-
L'ÉCHEC DU CONCORDAT RÉPUBLICAIN
-
LES DÉBATS DU XIXe SIÈCLE
-
LES DÉBATS SUR LA LAÏCITÉ DEPUIS 1905
-
LA LAÏCITÉ ET L'ÉCOLE DE 1905 À 1945
Antoine Prost, professeur émérite à l'Université de Paris I
-
LA LAÏCITÉ ET L'ÉCOLE DEPUIS 1945
Table ronde sous la présidence d'Émile Poulat,
directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales
-
LA LAÏCITÉ DANS LA SOCIÉTÉ D'AUJOURD'HUI ET LE STATUT DE LA RELIGION EN EUROPE
Table ronde sous la présidence de René Rémond,
président de la Fondation nationale des Sciences politiques
-
René Rémond, président de la Fondation nationale des Sciences politiques
-
Jacques Barrot, ancien ministre, commissaire européen
-
Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret
-
Alima Boumediene-Thiery, sénatrice de Paris
-
Jean Baubérot, directeur de recherches à l'École Pratique des Hautes Études
-
Peut-on parler d'un modèle européen de laïcité ?
par Philippe Portier, professeur de Science politique à l'Université Rennes 1
-
René Rémond, président de la Fondation nationale des Sciences politiques
-
LA LAÏCITÉ ET L'ÉCOLE DE 1905 À 1945
-
CLÔTURE DE LA JOURNÉE
|
LA LAÏCITÉ : DES DÉBATS, UNE HISTOIRE, UN AVENIR (1789-2005) Actes du colloque organisé sous le haut patronage de M. Christian Poncelet, Président du Sénat, en partenariat avec le Comité d'Histoire Parlementaire et Politique le vendredi 4 février 2005 |
|
|
|
PARIS, PALAIS DU LUXEMBOURG
MESSAGE DE M. CHRISTIAN PONCELET,
PRÉSIDENT DU SÉNAT
lu par M. Aymeri de Montesquiou, Sénateur du Gers
Monsieur le ministre, Monsieur le président, Messieurs les universitaires, Mesdames, Messieurs, je vais vous lire un message de M. Christian Poncelet, président du Sénat, à l'occasion du colloque « La laïcité : des débats, une histoire, un avenir, 1789-2005 ».
Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'accueillir au Sénat ce colloque organisé en partenariat avec le Comité d'Histoire Parlementaire et Politique, à l'occasion de la célébration du centième anniversaire de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Il était naturel que cette célébration se déroulât dans l'enceinte parlementaire car ce fut un grand moment de notre histoire législative.
Les débats ont duré près d'une année. Le texte, déposé à la Chambre des députés en novembre 1904, y fut discuté de mars à juillet 1905, avant d'être examiné par le Sénat du 9 novembre au 6 décembre 1905.
Lors des voeux que j'ai adressés en ce début d'année, j'ai souligné combien le hasard du calendrier faisait de cette année 2005 une année de commémoration riche pour notre vie républicaine puisque nous célébrerons, à la fois le soixantième anniversaire du vote des femmes et le centième anniversaire de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, sujets finalement très proches puisqu'il y a un lien étroit entre le statut de la femme et les conceptions religieuses et également entre le degré d'engagement civique des femmes et le degré de maturité politique d'une société.
En célébrant le centième anniversaire de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, il me plaît d'évoquer un autre anniversaire qui a occupé l'année 2004, le bicentenaire du code civil, pour souligner que c'est le même homme, Portalis, qui fut à la fois le père du code civil et le négociateur habile du Concordat.
Le Concordat et la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État ont en commun d'être, contrairement à ce que l'on a pu longtemps penser, non pas des textes de combat, mais des textes d'équilibre qui, chacun dans les circonstances historiques de l'époque, ont clos une période d'affrontements et permis à la Cité de fonctionner sur de nouvelles bases.
Il est aujourd'hui acquis, et même inscrit à l'article premier de notre Constitution, que la France est une république laïque. On est frappé de la belle simplicité des principes qui fondent cette laïcité et qui se résument, si j'ose ce terme religieux, dans une trinité - la liberté de conscience, puisque l'État ne persécute aucun culte, l'égalité en droit de ces cultes, qui oblige à les traiter tous de manière identique, la neutralité enfin, du pouvoir politique, qui s'abstient de toute ingérence dans les affaires spirituelles, comme il entend que les Églises s'abstiennent de revendiquer le pouvoir temporel, notamment dans les choses de l'éducation. Cette laïcité ne fait finalement qu'appliquer le principe des Lumières tel que Condorcet l'avait exprimé : « la Constitution, en reconnaissant le droit à chaque individu de choisir son culte, en établissant une entière égalité entre tous les habitants de France, ne permet pas d'admettre dans l'instruction publique un enseignement qui donnerait à des dogmes particuliers un avantage contraire à la liberté des opinions ».
Ces principes de laïcité - votre colloque aura l'occasion de le relever - sont très actuels et pourtant très inscrits dans une tradition multiséculaire. Ils sont actuels car notre pays est confronté à la montée des communautarismes et au danger que représente la politisation abusive du phénomène religieux par des ambitieux sans scrupule qui cherchent à exploiter des croyances populaires.
Notre pacte républicain ne pouvait pas être exposé plus longtemps à des tentatives sournoises de déstabilisation et de remise en cause. Sous l'effet, parfois, d'un relativisme de bon aloi ou d'une bienveillance bien trop grande, nous risquions insidieusement de laisser ébranler les principes mêmes sur lesquels notre République est fondée et il est heureux que l'an dernier nous ayons pu, sur la question des symboles religieux, aussi limitée et symbolique soit-elle, montrer de manière efficace et exemplaire le sens même de notre conception républicaine du citoyen.
Il nous semble donc que cette laïcité est toujours vivante et utile mais que, pour autant, comme certaines des communications de votre colloque le montreront, elle plonge ses racines loin dans notre histoire. Peut-être même pourrait-on, dans la ligne des travaux d'Emmanuel Todd, faire un lien entre la conception française de la Nation et de la citoyenneté, entre la conception française de l'appartenance au royaume et les structures anthropologiques de la France.
Sans doute pourrait-on, en remontant au conflit entre les rois de France et l'Église de France, entre les rois de France et les papes, trouver la trace ancienne d'une tradition nationale qui nous inclinerait, depuis fort longtemps, à vouloir séparer la chose publique de la chose divine, tradition qui aurait trouvé, grâce au siècle des Lumières et au moment de la Révolution française, son expression la plus éclatante, jusqu'à ce que la III e République, succédant à la monarchie, lui donne la forme législative que nous célébrons aujourd'hui.
Je ne me cache pas que, dans l'Europe d'aujourd'hui, ce modèle laïque qui nous est si naturel est presque une exception et que, dans tel ou tel pays, dans l'éducation et jusqu'à la perception de l'impôt, les Églises et l'État ne sont pas réellement séparés, que parfois le poids moral des autorités religieuses se fait sentir puissamment dans le débat public.
Je conçois parfaitement que, sans doute, d'autres modèles sont possibles et que, dans d'autres cultures, il peut y avoir des formes harmonieuses de communautarisme. Toutefois, et même si la laïcité peut sans doute se renouveler et ne pas être vécue comme un dogme rigide, il reste que je ne crois pas, compte tenu de notre histoire nationale et de nos mentalités, que d'autres modèles que le nôtre puissent jamais réussir en France, car il est consubstantiel à notre identité nationale, magnifiée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de ne considérer le citoyen que comme un homme libre, débarrassé de toute attache.
Déjà, avant la Révolution française, Louis XVI demandait à Malesherbes de lui faire des propositions tendant à donner des droits aux juifs en tant qu'individus, comme il venait de le faire pour les protestants, mais de ne rien leur accorder comme communauté, manifestant ainsi la permanence d'une conception proprement française qui affirme le primat de l'individu sur la communauté, de l'appartenance à la communauté de la Nation sur l'appartenance à une communauté particulière.
Et si j'ai dit que je pouvais concevoir, avec le plus grand respect pour les autres nations, que d'autres modèles étaient possibles, vous me pardonnerez d'avoir la faiblesse et la fierté d'exprimer la conviction qu'il y a quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus humain dans l'idée de considérer chaque citoyen comme une singularité irremplaçable, sans regarder son appartenance éventuelle à une religion, un groupe ou une ethnie.
Voilà pourquoi, en célébrant la loi de 1905, nous ne nous contentons pas, si je peux encore risquer une image religieuse, de brûler les cierges devant quelques « vieilles barbes » de cette III e République, dont la barbe était sans doute aussi un emblème, mais nous nous ressourçons au contraire dans notre pacte républicain avec une modernité éclatante.
PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE
Jean Garrigues, président du Comité d'Histoire
Parlementaire et Politique.
Merci, Monsieur le sénateur du Gers, d'avoir bien voulu vous faire le porte-parole du président du Sénat.
Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier d'être venus si nombreux à cette journée d'étude. Je sais que la salle de l'extérieur, où se trouve un écran, va être remplie elle aussi et que le turn over de la journée permettra à tous, à un moment ou à un autre, d'accéder au « saint des saints » qu'est cette salle.
Je remarque que de nombreux étudiants d'université, de classes préparatoires ou de l'Institut d'études politiques de Paris, sont présents et je m'en réjouis, car l'objectif majeur du Comité d'Histoire Parlementaire et Politique que j'anime est, en effet, de mieux faire comprendre et, si possible, apprécier l'histoire politique, essentiellement par les jeunes générations, les chercheurs de demain que vous êtes.
Pourquoi avoir choisi le thème de la laïcité ? La justification historique s'impose avec le centenaire de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État. S'y ajoute pour nous une justification citoyenne car ce thème de la laïcité est, depuis plusieurs mois voire plusieurs années, au coeur de nombreux débats, de nombreuses polémiques qui méritent le regard distancié, les explications précises, voire les commentaires de texte des historiens.
Le port des signes ostensibles à l'école, le financement du culte musulman, l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne ont été autant d'occasions de brandir, parfois à tort et à travers, l'étendard de la laïcité. Ces débats, ces polémiques et l'abondance, peut-être l'excès, des colloques consacrés à la commémoration de 1905 nous ont conduits à chercher une approche de la question à la fois originale et riche d'enseignements pour le présent et pour l'avenir. Il s'agit pour nous de replacer les débats et les polémiques d'aujourd'hui dans une continuité historique, qui permette à la fois de les expliquer, de les éclairer et d'en nuancer les enjeux.
C'est pourquoi nous avons choisi de suivre l'histoire des grands débats parlementaires et, plus largement, des grands débats politiques qui se sont focalisés sur l'enjeu de la laïcité. Et nous avons choisi de le faire, non pas en commençant avec les débats de 1905, mais en inscrivant ces débats dans une continuité historique issue de la Révolution française et du Consulat bonapartiste, qui ont profondément modifié les rapports entre les Églises et l'État.
Grâce aux communications des spécialistes de ces questions, Jacques-Olivier Boudon, dont les travaux sur le Consulat et l'Empire font autorité, Jérôme Grondeux, au confluent de l'histoire politique et intellectuelle et Philippe Levillain, à la fois historien de la papauté et de la III e République, vous comprendrez à quel point les débats de 1905 ne sont pas seulement un point de départ, mais aussi un aboutissement et une étape - décisive ou non, il nous appartiendra d'en juger - dans la fabrication d'un modèle de laïcité à la française.
Bien sûr, nous ferons ensuite une halte nécessaire sur les débats spécifiques de 1905, grâce à d'autres spécialistes : Jérôme Grévy, spécialiste de la III e République, Patrick Cabanel, qui nous parlera notamment du rôle majeur des protestants dans ces débats, Christophe Bellon, qui soulignera le rôle d'Aristide Briand, rapporteur du projet, et Jean Baubérot qui occupe, à l'École pratique des hautes études en sciences sociales, la seule chaire universitaire consacrée à la laïcité.
Pour ouvrir l'après-midi, le professeur Antoine Prost abordera la période du premier XX e siècle par une réflexion sur la laïcité à l'école, l'un des enjeux majeurs de ce colloque.
Lui succéderont deux tables rondes. La première, présidée par le professeur Émile Poulat, spécialiste du catholicisme et de la laïcité contemporaine, s'inscrira dans la continuité de la réflexion ouverte par Antoine Prost. Cette table ronde mettra en lumière les grands débats parlementaires qui ont focalisé le thème de la laïcité sur la place de l'enseignement privé, depuis les grands débats des années cinquante jusqu'aux projets Savary et Bayrou, qui ont suscité beaucoup de remous dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix. C'est là qu'interviendront nos grands témoins politiques : Jean Foyer, qui fut garde des Sceaux de 1962 à 1967, député de 1959 à 1963 et de 1967 à 1988, ainsi que Bruno Bourg-Broc, qui est député de la Marne et qui fut rapporteur de la loi Bayrou en 1993. Jean-Pierre Delannoy, docteur en droit et auteur d'une thèse sur le fait religieux dans les travaux parlementaires de 1958 à 1975, leur apportera une sorte de contrepoint de l'histoire.
Avec la seconde table ronde, nous avons voulu ouvrir la perspective sur les débats actuels, voire sur ceux de l'avenir. Je tiens à remercier tout particulièrement le professeur René Rémond, de l'Académie française, d'avoir accepté de présider cette table ronde. Jean Baubérot qui, comme René Rémond, a siégé dans la fameuse commission Stasi, participera au débat, de même que la sénatrice de Paris, Alima Boumediene-Thiery, dont le regard sur ces questions de laïcité et d'intégration sera du plus grand intérêt, et de même que le sénateur du Loiret, Jean-Pierre Sueur. Le professeur Philippe Portier, spécialiste des enjeux de la laïcité à l'échelle européenne, nous permettra de sortir du cadre franco-français. Il dialoguera notamment avec M. Jacques Barrot, ancien ministre et commissaire européen, qui a bien voulu nous consacrer un peu de son temps pour donner une vision un peu surplombante du débat sur la laïcité. La perspective de ce colloque, unique en son genre, permettra de mieux comprendre les enjeux qui se posent à notre société et, plus largement, aux sociétés européennes.
Avant de terminer, permettez-moi de remercier tous ceux qui ont rendu possible cette journée : en premier lieu, M. le Président du Sénat, son directeur de cabinet, M. Alain Méar, M. Alain Delcamp, directeur général au Sénat, responsable, entre autres, de la communication et des relations internationales, ses collaborateurs, MM. Wicker et Coppolani, ainsi que mes collègues et amis du Comité d'Histoire Parlementaire et Politique, Noëlline Castagnez, Christophe Bellon, Alexandre Borrel et Frédéric Attal, notre secrétaire général, qui a été, une fois de plus, la cheville ouvrière de ce colloque. Merci de votre attention.
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE À LA LOI DE 1905
LES DÉBATS DU XIXe SIÈCLE
Session sous la présidence de Philippe Levillain,
professeur à l'Université de Paris X-Nanterre
et à l'Institut Universitaire de France
Jean Garrigues
Je voulais m'improviser président de cette première moitié de matinée, mais je vais demander au professeur Philippe Levillain d'exercer dès maintenant cette présidence, qui n'était prévue que pour la table ronde, s'il a la gentillesse de bien vouloir présider : me donne-t-il un avis favorable ?
Philippe Levillain
Je n'ai pas le choix ! Je voudrais remercier Jean Garrigues du mot qu'il a prononcé tout à l'heure, qui vous donne le niveau de mon âge : « mon toujours jeune maître Philippe Levillain ». Cela signifie que j'ai dépassé soixante ans, puisque, quand on qualifie de jeune un professeur, cela veut dire qu'on essaie d'évoquer plutôt la nostalgie des souvenirs que l'avenir ! Je vais volontiers présider, mon cher Jean, mais présentez tout de même Jacques-Olivier Boudon, puis je prendrai le relais si vous le voulez. Il n'y a que le problème de la répartition du temps qui se pose, à savoir : combien donne-t-on de temps à chacun pour parler ?
Jean Garrigues
Nous donnons vingt, vingt-cinq minutes.
Jacques-Olivier Boudon est professeur à l'université de la Sorbonne, il a notamment publié Napoléon et les cultes chez Fayard, en 2002 et Histoire du Consulat et de l'Empire chez Perrin, qui a été réédité en 2003. C'est un spécialiste reconnu internationalement de ces questions et il va nous parler de l'invention de la laïcité, de la Révolution à l'Empire. Je lui laisse tout de suite la parole.
L'INVENTION DE LA LAÏCITÉ DE LA RÉVOLUTION À L'EMPIRE
Jacques-Olivier Boudon, professeur à l'Université de Paris-Sorbonne
Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, chers collègues, il n'est pas besoin de relire La Révolution d'Edgar Quinet pour savoir que la religion a une place centrale dans les débats de la Révolution et que ce qui advient en 1789, à savoir cette profonde transformation de la société, a évidemment beaucoup à voir avec le problème des relations entre la religion et la société, entre la religion et l'État. Je n'insisterai pas ici sur les problèmes liés à la réflexion sur la nature et l'origine du pouvoir, mais il faut tout de même rappeler qu'à partir des débats qui s'ouvrent en 1789 et qui se déploient jusqu'en 1799 et au-delà - nous y reviendrons avec le Consulat, voire l'Empire - c'est bien une remise en cause de l'ordre ancien qui s'opère, de cet ordre ancien fondé sur une société dans laquelle le clergé avait une place de choix, la première dans la cité, une société d'Ancien régime fondée sur l'idée d'une monarchie dont le pouvoir était d'origine divine.
Tout cela s'écroule à partir de 1789 et je voudrais essayer de vous montrer, à travers quelques éléments de débat, comment se met en place une notion, la notion de laïcité, qui n'est pas encore explicitée comme telle. De ce point de vue, il est anachronique de parler de laïcité pour la période de la Révolution et de l'Empire, mais c'est un moyen de faire comprendre les choses. Je voudrais donc essayer de vous montrer comment, dès cette période de la Révolution, mais aussi du Consulat, - et il faut insister sur les continuités plutôt que sur les ruptures - se mettent en place des relations nouvelles entre Église et État. C'est aussi à ce moment-là que se conçoit une nouvelle manière de vivre en société. Dans un premier temps, nous verrons les débuts de la Révolution, puis la radicalisation qui conduit à la première séparation de 1795 et enfin, la reconstruction concordataire.
Le choc de la Révolution et de la destruction de l'ordre ancien
On peut rappeler qu'il s'opère en quelques phases successives. Une première phase : la nuit du 4 août, la fin des privilèges. Le clergé perd ses privilèges à la fois financiers (la dîme), mais aussi juridiques (le for ecclésiastique). Les membres du clergé sont désormais des citoyens à part entière, des citoyens comme les autres. Puis, dans les jours qui suivent, les débats sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sont décisifs sur la place qui doit être celle de la religion dans l'État et dans la société.
Je n'ai pas le temps de le développer longuement, mais je voudrais vous rappeler simplement deux ou trois éléments. D'une part, on exclut Dieu en tant que tel de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, après de vifs débats sur ce point. On substitue à Dieu l'Être suprême qui figurera dans le préambule de la Déclaration, ce qui permet de réconcilier, en quelque sorte, catholiques mais aussi déistes et spiritualistes notamment. On exclut aussi la religion en tant que telle et là, également - Claude Langlois l'avait rappelé lors des débats sur le bicentenaire de la Révolution - le débat sur la religion et sur la place de la religion au moment de la Déclaration des droits de l'homme est extrêmement vif, sans doute le plus vif de ces débats qui ont accompagné la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On exclut la religion en tant que telle, en renvoyant le problème de la religion ou du culte, selon une distinction qu'opérera Talleyrand, à la Constitution, à la loi. On ne les inclut pas dans ce qui doit être une déclaration à caractère universel.
On maintient tout de même une dimension, un concept qui va demeurer dans l'article 10, celui d'"opinion religieuse". Parmi les tenants d'une conception de la religion comme pilier de la société, on trouve, en premier lieu, les représentants du clergé, qui considèrent qu'il ne peut y avoir de société, d'État sans religion. Ces débats ont opposé ces tenants d'une conception traditionnelle de la religion aux libéraux, Talleyrand parmi d'autres, qui ont considéré, au contraire, qu'il fallait concevoir la diversité des religions et que parler de la religion conduisait, d'une certaine manière, à envisager une primauté, ce qu'ils ne voulaient pas.
On passe donc d'une conception de la religion unique, avant 1789, à une conception diversifiée notamment défendue par les protestants, comme Rabaut Saint-Étienne, qui rappellera la nécessité de la liberté religieuse. Cette conception substitue à la tolérance qui avait eu cours assez largement dans l'Europe du temps, y compris en France avec l'Édit de 1787, la notion de liberté religieuse, fondamentale dans les débats qui nous occupent, qui renvoie à l'idée que les religions sont placées sur un pied d'égalité et que les citoyens sont placés devant les religions face à un choix, alors que la tolérance suppose une forme de condescendance de la religion dominante, majoritaire, par rapport aux religions minoritaires.
Le débat se clôt, finalement, sur l'approbation de l'article 10 : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu qu'il ne porte pas atteinte à l'ordre public ». Cette incise "même religieuses" signifie que, pour les constituants, la religion ou les religions sont une opinion parmi d'autres. Il faut rapprocher cet article de l'article suivant sur la liberté d'expression, la liberté de pensée, de conscience, qui forme un tout.
Ainsi, désormais, la liberté religieuse est introduite dans le pays, l'égalité aussi, puisque la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen favorise la reconnaissance de la citoyenneté sur des critères qui ne sont plus religieux. C'est la fin de l'équation "catholique et français". Les critères religieux ne sont plus déterminants pour qualifier la citoyenneté française, ce qui permet aux protestants d'abord, puis aux juifs, selon des modalités un peu différentes, dans les deux années qui suivent, d'être reconnus comme citoyens français et comme citoyens à part entière dans la nation.
Dans les mois qui suivent, on va débattre du statut de la religion catholique. L'Assemblée constituante compte près d'un quart de membres du clergé du fait de sa composition initiale et plusieurs d'entre eux vont revenir sur cette idée qu'il faut définir le catholicisme comme religion de l'État, ce qui n'est plus le cas depuis les réformes que je viens d'évoquer. Les amendements de Mgr de La Fare, en février 1790, à l'occasion du débat sur la suppression des voeux solennels, ceux de Dom Gerle, en avril de la même année, vont conduire, dans l'un et l'autre cas, à éluder la question, si bien que, en 1790, le catholicisme n'est plus religion de l'État. Ce n'est pas affirmé en tant que tel, mais le fait de refuser de se prononcer sur ce point aboutit au même résultat.
Il faudra donc, néanmoins, réorganiser le culte. Ce sera chose faite avec la Constitution civile du clergé, votée le 12 juillet 1790 et prévue pour être incluse dans la Constitution à venir, celle adoptée en 1791. Cette Constitution civile du clergé manifeste le rôle que veut jouer l'État - et c'est une constante qu'on va retrouver avec Bonaparte - dans l'organisation et dans le contrôle du culte, mais un État qui entend jouer ce rôle hors de l'influence religieuse, puisqu'il ne fait appel ni à Rome - et le Saint-Siège le lui reprochera - ni même aux évêques français. Boisgelin, par exemple, dans L'Exposition des principes publiée la même année, demandait la réunion d'un concile national pour que l'on discute de ces problèmes d'organisation de l'Église, mais l'État, en 1790, préfère la solution législative et préfère être, finalement, le véritable organisateur de l'Église catholique, conçue ici comme un service public fonctionnarisé et établi dans un cadre administratif rationalisé, s'adaptant au cadre défini en février 1790, celui des départements.
Il y a là une anticipation que l'on va retrouver notamment avec Bonaparte en 1801, mais en aucun cas remise en cause de la liberté religieuse et donc de l'égalité de tous. Simplement, une religion, de fait, obtient un financement de la part de l'État. C'est la contrepartie de la mise à la disposition de la nation des biens de l'Église en novembre 1789, dont il faut rappeler, avec Talleyrand, qu'elle en avait été l'une des légitimations : l'Église, c'est la communauté des fidèles, ce n'est pas simplement le clergé ou la hiérarchie ; la Nation, c'est la communauté des citoyens, donc la communauté des fidèles égale la communauté des citoyens, et l'Église égale la nation ; de ce fait, les biens de l'Église appartiennent à la nation. C'est, de façon très résumée, l'argumentation qui a été utilisée pour justifier cette mise à disposition de la nation, qui va susciter les débats que l'on sait au moment de la loi de séparation, à travers et en passant par le Concordat de 1801.
La radicalisation
À la fin de 1791, la liberté religieuse est effective dans le pays, ce qui signifie que si l'Église constitutionnelle s'est organisée avec le soutien de l'État, il existe aussi une Église réfractaire qui a la liberté de culte, ce que l'on oublie parfois. Ce n'est qu'à partir de 1792 que cette liberté lui est déniée, avec le motif que cette Église cesse d'être une Église nationale. Le clergé réfractaire, à partir de 1792, est dénoncé comme ennemi de la Révolution, à la solde de l'étranger. C'est un élément que l'on va retrouver à de très nombreuses reprises dans le problème des relations entre l'Église et l'État.
La radicalisation intervient avec la politique de déchristianisation engagée à l'automne 1793, qui est, en quelque sorte, le stade ultime de la manière dont l'État peut tenter de régler ses relations avec les religions et les Églises. Cette parenthèse a marqué les esprits. Dans les débats du XIX e siècle, jusqu'à la séparation, elle reste très présente dans un certain nombre de conceptions de ce que doivent être les relations entre l'Église et l'État. Cette radicalisation, à laquelle Robespierre met déjà un terme au printemps 1794 en substituant à l'idée d'un culte de la Raison celui de l'Être suprême, a pour conséquence, au-delà des mesures prises contre le clergé - « déprêtrisation », mariage des prêtres et exécution de deux à trois mille prêtres cette année-là -, de détruire l'organisation officielle de l'Église constitutionnelle, si bien que, même si la liberté religieuse réapparaît à partir de Thermidor (juillet) 1794, il faut bien constater la situation suivante dans la France du début de l'année 1795 : une liberté religieuse plus ou moins recouvrée et une Église constitutionnelle qui a été totalement défaite et qui, de toute manière, n'est plus salariée.
L'État ne remplit plus ses obligations de ce point de vue, il en tire donc les conséquences et la Convention thermidorienne déclare, le 21 février 1795, que l'État ne salariera plus aucun culte. Ceci vaut pour celui qui est déjà théoriquement salarié mais également pour les autres cultes, y compris les cultes révolutionnaires qui se sont développés depuis lors. Et, parallèlement, la Convention réaffirme la liberté des cultes comme l'un des principes fondamentaux, il est vrai qu'il n'avait d'ailleurs pas été mis en cause dans la Constitution non appliquée de l'an I. Puis, quelques semaines plus tard, en septembre 1795 - nous sommes toujours à l'époque de la Convention thermidorienne -, intervient la confirmation de la séparation de l'Église et de l'État.
Mais surtout, ce décret de septembre 1795 est un décret portant organisation des cultes, donc limitant leur exercice. C'est sur ce point-là qu'il faut attirer l'attention, sur ce processus qui conduit à l'invention de la laïcité, puisque l'État se fait gendarme vis-à-vis des cultes : il surveille les manifestations des cultes, les ministres des cultes, il oblige à un nouveau serment, moins rigoureux que le précédent mais, tout de même, à un serment d'obéissance aux lois de la République et il limite aussi les relations entre ce clergé, qui doit être un clergé national, et les éléments extérieurs, ce qui vaut à la fois pour le pape, à Rome, mais aussi pour les évêques réfractaires en émigration.
Ce décret de 1795 précise aussi quels doivent être les éléments de laïcisation de la société à travers, en particulier, l'interdiction des signes extérieurs religieux sur les édifices, dans les rues et donc dans l'espace public, les signes religieux devant être réservés au seul espace privé et aux lieux de culte eux-mêmes. Dans le même ordre d'idée, les cérémonies religieuses sont interdites à l'extérieur des lieux de culte, selon une disposition que reprendra Portalis dans la rédaction des Articles organiques en 1802. On confirme aussi, à travers ce décret de septembre 1795, la laïcisation de l'état civil, qui était évidemment l'une des conséquences de la fin du lien étroit entre Église et État puisque, du fait de la séparation et même, déjà, du fait de la reconnaissance de l'égalité de tous devant la loi, ce n'est plus désormais le curé qui tient les registres d'état civil. Il continue à tenir les registres paroissiaux mais ceux-ci ne font plus office de registres d'état civil. Ce sont les officiers municipaux qui sont investis de cette mission.
La réorganisation concordataire
Elle s'opère d'abord dans un contexte extrêmement tendu. Bonaparte est favorable à une reprise des relations avec l'Église catholique, sur la base d'une négociation avec le pape et, au-delà, avec la frange du catholicisme qui est la plus forte, l'Église réfractaire. Au-delà de cette volonté de négociation, il y a de fortes tensions puisqu'un certain nombre de membres de l'entourage de Napoléon Bonaparte, gardiens de cet héritage révolutionnaire, dénoncent ce qui leur apparaît comme une volonté de restituer tous ses pouvoirs à l'Église et vont essayer d'entraver ce processus. Mais Bonaparte parvient à ses fins en deux temps : d'abord par la négociation du Concordat avec le pape. Puis pour satisfaire cette opinion publique et les parlementaires qui menaçaient de repousser le projet de loi sur le Concordat dans les assemblées, il y ajoute, sur proposition de Portalis devenu directeur des Cultes, les fameux Articles organiques qui, avec le Concordat, dans le cadre de la loi du 18 Germinal an IX, forment ce que l'on va appeler le système concordataire, valant pour les catholiques, mais aussi pour les protestants, luthériens et réformés, dont les derniers Articles organiques prévoient l'organisation.
Comment peut-on brièvement résumer les conceptions qui prévalent à l'élaboration de ces textes ? Tout d'abord, il y a l'idée, longuement débattue avec les représentants de la papauté, en 1800-1801, que le catholicisme ne peut, en aucun cas, redevenir la religion de l'État. Sur ce point, les débats sont vifs, même si Bonaparte, qui n'est pas un fin spécialiste de droit canon, était, au départ, prêt à accepter cette disposition que Talleyrand lui suggère de repousser. Le catholicisme n'est donc plus religion de l'État, mais simplement la religion de la grande majorité des citoyens français, ce qui est une manière de reconnaître un état de fait : la majorité des Français ont été baptisés dans la religion catholique.
Mais, en même temps, dès la négociation du Concordat, dans des débats houleux, il est prévu que l'État ait un droit de regard sur l'organisation publique du culte et cette distinction, cette mise en avant du rôle de gendarme de l'État se retrouve dans les Articles organiques. Ces Articles organiques et, plus généralement, la conception qui prévaut et qui s'exprime dans le discours de Portalis devant le Corps législatif, en avril 1802, confirment que Bonaparte veut le maintien de la liberté religieuse. C'est l'un des principes intangibles, on pourrait même dire que c'est la seule liberté qui, à l'époque du Consulat et de l'Empire, n'ait finalement pas été remise en cause.
Cette volonté de liberté religieuse est réaffirmée lors du serment que prête Napoléon à l'issue de la cérémonie du sacre de 1804. Il y a aussi la reconnaissance de l'égalité religieuse, qui est exprimée dans les Articles organiques sur les cultes protestants, adjoints aux Articles organiques sur les cultes catholiques puisque, d'une certaine manière, l'État met sur un pied d'égalité trois cultes et il en adjoindra un quatrième, en 1808, avec la reconnaissance du culte israélite qui est organisé - le salaire des rabbins excepté - sur des bases comparables.
La laïcisation, telle qu'elle a été enclenchée par la Révolution, n'est donc pas remise en cause dans les principes qui sont réaffirmés, en particulier à travers les Articles organiques, dans la laïcisation de l'état civil ou l'obligation que les mariages soient célébrés par le maire avant de l'être par le curé. Cette laïcisation est aussi confirmée dans le texte évoqué par le président Poncelet dans son message, le texte du Code civil, dans lequel il n'y a pas de place pour les éléments religieux. Elle est confirmée également par les lois sur l'enseignement, par la fameuse loi créant l'Université en 1806, qui, en accordant un monopole de l'enseignement à l'Université, vient rappeler que, si l'on confie des taches d'enseignement au clergé, notamment à des religieuses ou à des frères des écoles chrétiennes, ceux-ci enseignent, mais restent sous la tutelle de l'État.
Naturellement, le Consulat et l'Empire ne sont pas un régime tel que pourra l'être la III e République et les éléments de laïcisation, fondés sur un certain nombre de principes, ne doivent pas faire oublier qu'en même temps l'Empire se construit comme une monarchie chrétienne. Il y a là un paradoxe qu'il faut tout de même évoquer pour conclure. Si, depuis janvier, on célèbre le centenaire de la loi de séparation, il faut bien concevoir que le sacre de Napoléon, en 1804, revêt une dimension religieuse : la venue du pape, l'ensemble de l'épiscopat présent à Notre-Dame, le choix du lieu le confirment. En même temps, cette cérémonie est aussi une cérémonie personnelle, qui concerne l'empereur lui-même, en tant que souverain d'une nation à dominante catholique.
De ce point de vue, Napoléon est un homme des Lumières, un homme de son temps qui considère qu'il ne peut y avoir à la tête d'un État à dominante catholique, un souverain qui ne le soit pas. D'ailleurs, le Concordat reconnaît cette dimension puisque c'est en tant que consul de confession catholique qu'il nomme les évêques. Sans cela, le pape n'aurait pas accepté la disposition en question. C'est donc à titre personnel que Napoléon est sacré, son sacre n'engage pas et ne remet pas en cause la neutralité de l'État ou sa laïcité. J'en veux pour preuve l'invitation, en même temps que de l'ensemble des évêques, des représentants des consistoires protestants et de personnalités de la religion israélite. J'en veux aussi pour preuve la volonté de bien manifester que le sacre se termine par ce qui était à l'origine de la cérémonie : la prestation de serment prévue par la Constitution de l'an XII - serment que le pape refuse d'entendre - dans lequel Napoléon réaffirme son attachement aux principes de 1789, à l'égalité civile, à la liberté religieuse, et dit ne pas vouloir remettre en cause le principe de la vente des biens nationaux.
Néanmoins, Napoléon Bonaparte a bien conscience - mais les républicains opportunistes des années quatre-vingt qui réutilisent le Concordat feront-ils autrement ? - que le système concordataire lui permet de contrôler une Église qui peut s'avérer une arme puissante contre son pouvoir et que, bien plus, cette Église peut être une arme à sa disposition : le catéchisme impérial de 1806 et les Te deum qu'il fait chanter pour le succès de ses armées, le contrôle qu'exerce le clergé pour une meilleure application de la conscription en font foi. Il a bien conscience que la religion catholique est une nécessité comme pilier de l'ordre social. En cela, il est un bon héritier et un bon disciple de Rousseau.
L'État se fait donc, là encore, État gendarme, qui contrôle l'Église et ses manifestations. Dans la continuité d'un certain joséphisme, pourrait-on dire, il va s'employer à contrôler les congrégations, qui ont été interdites par la Révolution française en deux temps, en 1790 et en 1792, et qui sont à nouveau encadrées à partir du Consulat et de l'Empire.
Naturellement, le Consulat et l'Empire ne sont pas un régime laïque mais ce sont les éléments de continuité qui doivent ici retenir notre attention : le Consulat et l'Empire reprennent, d'une certaine manière, l'héritage de la Révolution en un certain nombre de principes qui ne seront pas fondamentalement remis en cause par la suite : le principe de liberté religieuse, essentiel et qui est finalement l'un des fondements de la société moderne ; le principe également d'égalité des religions, des cultes, même s'il faut y mettre un bémol - mais ce sera une constante au XIX e siècle - avec le rôle que doit jouer l'État dans le contrôle de l'organisation des cultes.
Philippe Levillain
Merci, Jacques-Olivier Boudon, pour cet exposé d'ouverture et de synthèse. Vous avez parfaitement rempli le rôle du premier orateur, c'est-à-dire que vous avez calibré le temps, puisque vous avez parlé exactement vingt-sept minutes, ce qui fait que personne ne peut plus, maintenant, se permettre de vous dépasser, sinon, il y aura abus de pouvoir !
Vous avez mis en relief ce qui va nous occuper toute la journée : l'importance des controverses qui commencent avec la Révolution et l'importance des ambiguïtés. Le terme d'Être suprême, que vous avez signalé tout à l'heure comme servant de substitution au terme de Dieu, dont Philippe Boutry a traité dans Les lieux de mémoire de Pierre Nora, désigne Dieu dans certains sermons du XVII e siècle. Bourdaloue emploie les termes d'"Être suprême". Il y a donc une ambiguïté étonnante, il y a une laïcisation de Dieu par "Être suprême", qui renvoie, d'ailleurs, à des perspectives plutôt maçonniques. Dans un débat que j'ai eu l'occasion d'entendre entre vous et Jean Tulard, vous avez traité de la spécificité du sacre et du couronnement de Napoléon Bonaparte en 1804, et l'un ou l'autre d'entre vous a prononcé, à un moment, les mots de "république impériale" pour désigner l'Empire.
Je donne la parole à Jérôme Grondeux, maître de conférences à l'université de la Sorbonne, Paris IV.
DÉBATS ET ENJEUX DE LA RESTAURATION AU SECOND EMPIRE
Jérôme Grondeux, maître de conférences à l'Université de la Sorbonne
La période qui s'étend de la chute du régime napoléonien aux premières années de la Troisième République est fondamentale en ce qui concerne la construction des identités politiques. Si le vocabulaire parlementaire emploie déjà les termes de "droite", de "gauche", de "centre", on préfère très souvent, à l'époque, employer des couleurs. Ces couleurs, caractéristiques de la manière dont les Français de l'époque se situent politiquement, renvoient à des attitudes religieuses, et ce en raison du poids du grand drame révolutionnaire au sein duquel le rôle du religieux (qu'il s'agisse des forces religieuses traditionnelles ou de l'émergence d'une religiosité ou d'une mystique politique) ne doit pas être sous-évalué. On distingue ainsi schématiquement les bleus, ceux qui veulent 1789 sans 1793, les rouges, qui veulent 1789 et 1793 et, parfois, plus 1793 que 1789, et les blancs, qui ne veulent ni de 1789, ni de 1793, et dans lesquels on trouve une fraction importante du catholicisme militant.
Alors que se construisent et s'affirment ces identités politiques, le vocabulaire lié à la laïcité comme enjeu politique se forge. On peut certes parler de laïcité avant 1871, date à laquelle on trouve la première attestation du mot, parce qu'effectivement, très souvent, les choses précèdent les mots, mais dès la période qui nous intéresse ici, on relève l'apparition de mots importants 1 ( * ) : peut-être vers 1815, en tout cas à coup sûr en 1835, dans Le colonel Chabert de Balzac, on trouve le terme "clérical", pour signaler quelqu'un qui est dévoué aux intérêts du clergé. Cela n'est pas neutre. En 1855, peut-être, pense-t-on, par l'action de journalistes belges - parce qu'en Belgique, il y a aussi toute une expérience de force politique du catholicisme - on voit apparaître le terme de "cléricalisme". En 1848, dans un ouvrage qui ne sera publié qu'en 1890, L'avenir de la science , Renan emploie le terme de "sécularisation". Ce n'est pas une nouveauté, mais il l'utilise dans un sens moderne en le définissant comme un processus d'élimination progressive de tout élément religieux dans un domaine donné. Puis on voit apparaître, en 1863, le terme d'"anticlérical". Le lexique est ici témoin de l'importance de ces débats.
Je voudrais, en évoquant quelques débats précis, mettre en relief deux phénomènes. Tout d'abord l'enchevêtrement entre ces questions de laïcité et l'interrogation relative au régime politique que la France devrait se donner. L'histoire de la laïcité confirme ici l'idée de François Furet selon laquelle la Révolution française ne se termine vraiment que dans les années 1880. Ensuite, la manière dont l'élaboration de la laïcité s'inscrit dans une tradition libérale française, beaucoup plus large que la tradition républicaine, et dont la Troisième République sera largement l'héritière.
Le premier régime qui nous intéresse est celui de la Restauration, régime de notables, mais aussi régime qui a une dimension de compromis ou d'ambiguïté, selon la manière dont on veut connoter la chose. On sait qu'en 1814, dans la Charte, le catholicisme est à nouveau religion de l'État et non plus religion de la majorité des Français, et cela jusqu'en 1830. Une telle logique, redonnant à l'État une religion, devrait aboutir à remettre en cause ce système concordataire qu'on nous a présenté tout à l'heure. Et effectivement, en 1817, il y a bien une tentative de négocier un nouveau Concordat ou d'en revenir à l'ancien Concordat de Bologne. Je m'arrêterai un temps sur cette tentative parce que la manière dont elle échoue est très révélatrice 2 ( * ) .
Il semble bien que la papauté ait accepté de négocier la remise en question du Concordat parce que Rome ne s'est jamais résigné, sur le fond, au contenu des Articles organiques. Le projet d'un nouveau concordat était suivi par une commission parlementaire dans laquelle se trouvait un catholique très pieux, le comte de Marcellus, un « blanc » qui appartenait au camp dit « ultraroyaliste » Le comte de Marcellus, s'inquiétait parce que la commission avait tendance à accepter des modifications du texte initial issu des négociations, et que ces modifications n'avaient pas été négociées avec Rome. Il prit sur lui d'écrire au pape pour lui demander son avis sur les modifications que le gouvernement et la commission ont proposées. Le pape lui répondit en mars 1818 : « Il est tout à fait déplacé que les décisions données sur des matières religieuses par le Saint-Siège apostolique après s'être concerté avec le roi soient soumises à la délibération d'un conseil de laïcs, quelque illustres qu'ils puissent être. Nous attendons de votre piété que vous vous opposiez avec courage à la loi proposée. »
La loi se trouve donc désavouée par le pape avant même d'arriver devant les Chambres. Ce petit extrait est révélateur à plusieurs titres : tout d'abord, il témoigne de la conception romaine des rapports entre l'Église et l'État, conception que Rome peut parfois mettre sous le boisseau, mais qui resurgit souvent en temps de crise. On reste fidèle à l'idée qu'en dernière analyse, l'autorité spirituelle est supérieure à l'autorité temporelle. Le « conseil de laïcs » désigne en particulier la commission parlementaire, et ce terme indique bien que c'est sur le terrain des rapports entre clercs et laïcs que se joue l'acceptation ou le refus des modifications. D'autre part, on note que, s'il y a eu un échec dans cette renégociation, c'est parce qu'il y a eu une volonté gouvernementale de passer non pas seulement par la voie diplomatique, comme Rome l'aurait souhaité, mais de considérer que l'abandon du Concordat de 1801 était une affaire qui relevait de la loi française. C'est donc bien une conception de suprématie de la loi qui est à l'origine de cet abandon. Enfin, on peut noter, avec Emmanuel de Waresquiel, que « l'affaire du Concordat de 1817 marque les débuts d'une opposition anticléricale, virulente dans les dernières années de la Restauration 3 ( * ) ».
Cette affaire de 1817 est donc importante. Elle mobilise d'autant plus l'opinion que l'année précédente, un jeune avocat auprès de la Cour de cassation, futur leader politique, Odilon Barrot, plaidant en faveur d'un protestant de Nîmes, qui ne voulait pas être obligé de pavoiser lors des processions catholiques, avait, par une formule fracassante, voulu mettre en avant la neutralité religieuse de la loi. Pour expliquer que la loi ne peut pas obliger un non-catholique à pavoiser, il prononce les phrases suivantes : « La loi est athée ? Oui, elle l'est et doit l'être, si vous entendez par là que la loi, qui n'existe que pour contraindre, doit être étrangère à la croyance religieuse ».
On évoquait tout à l'heure l'importance de la laïcisation par le Code civil. Cette formule de la « loi athée » ne reflète pas les croyances personnelles d'Odilon Barrot, qui est spiritualiste, mais elle pointe toute l'importance du rôle du droit dans le processus de sécularisation, et en particulier dans l'émergence de la laïcité française.
Les plus célèbres débats politico-religieux, sous la Restauration, concernent deux mesures essentiellement symboliques, qui prennent place après 1824, alors que Charles X a succédé à son frère Louis XVIII. Celui-ci était plutôt sceptique sur le plan religieux, il a tenté de mener une politique prudente et souvent conciliatrice. Charles X, lui, est un catholique ardent, un dévot, comme on dit encore à l'époque. Cette dévotion inquiète les milieux libéraux.
La célèbre loi de 1825 sur le sacrilège relance la polémique. Cette loi prend la suite d'un projet mis en chantier avant même que Charles X ne monte sur le trône : un projet de punition du vol dans les églises qui se transforme en un projet de punition du vol d'objets sacrés et devient une loi prévoyant même la profanation d'hosties. Le profanateur d'hosties consacrées devient passible de la peine de mort précédée de la mutilation du poing, ce qui correspond, dans le Code pénal, au châtiment réservé aux parricides.
Le débat à la Chambre des députés a duré cinq jours, en avril 1825, et a été l'occasion pour un libéral de l'école doctrinaire, Royer-Collard, d'argumenter son refus que la loi tranche en matière religieuse. L'originalité de la position de Royer-Collard, qui est d'une famille d'origine janséniste, est de combattre la loi en se présentant lui-même comme catholique. Voici un extrait de son discours : « Nous croyons, nous, catholiques, nous savons par la foi que les hosties consacrées ne sont plus les hosties que nous voyons, mais Jésus-Christ, le Saint des Saints, Dieu et homme tout ensemble. Mais la loi fait descendre la religion au rang des institutions humaines ». Ce que Royer-Collard n'admet pas, c'est qu'une croyance catholique, qu'il dit partager, devienne l'objet d'une loi. « Si la loi a une croyance religieuse, dit-il, elle est comme souveraine, elle doit être obéie. La vérité en matière de foi est son domaine, la souveraineté en décide. Elle la règle avec un pouvoir absolu, elle la sanctionne, s'il en est besoin, par des supplices. » Telle est la logique que refuse Royer-Collard.
Pour notre orateur, qui s'inscrit dans la logique concordataire, l'État ne peut s'allier avec la religion qu'en la considérant d'un point de vue purement humain, eu égard à son utilité sociale. La religion peut être admise comme un facteur de moralisation publique, mais l'État ne doit pas se prononcer sur la vérité religieuse. L'optique de Royer-Collard est radicalement différente de celle du pair de France Bonald, célèbre contre-révolutionnaire qui, à la Chambre des pairs, affirmait : « Que faites-vous en punissant le blasphémateur et le profanateur, sinon le renvoyer devant son juge naturel ? ». Aux yeux de ce dernier, les croyances catholiques sont la description d'un ordre « naturel », elles renvoient à une vérité incontestable que l'État se doit de sanctionner.
La loi sur le sacrilège a été votée, elle n'a jamais été appliquée. Elle procura à ses partisans une satisfaction d'ordre symbolique, ce sur quoi nous reviendrons.
Le 29 mai 1825, Charles X se fait sacrer dans la cathédrale de Reims. Il faut noter qu'il y a eu tout de même un effort pour adapter cette cérémonie du sacre, effort perceptible dans le texte du serment prononcé par le roi : « En présence de Dieu, je promets à mon peuple de maintenir et d'honorer notre sainte religion, comme il appartient au roi très chrétien et au fils aîné de l'Église, de rendre bonne justice à mes sujets, enfin, de gouverner conformément aux lois du royaume et à la charte constitutionnelle que je jure d'observer fidèlement. Ainsi, que Dieu me soit en aide et ses saints Évangiles. » On voit ici une tentative de glisser la Charte dans le serment, elle ne suffit pas pour rassurer l'opinion libérale.
Il faut s'arrêter sur ces deux initiatives, la loi sur le sacrilège et le sacre, qui relèvent toutes deux de l'ordre symbolique. Il est remarquable de constater que les ultras, sous la Restauration, au moment même où ils dominent le jeu politique, n'obtiennent que des succès de ce type. Alors que les ultras laissent debout le Concordat et l'Université, deux facteurs de sécularisation, ils soutiennent des mesures qui, parce qu'elles sont emblématiques, sont précisément celles qui permettent le mieux à leurs adversaires de se mobiliser. On peut y voir un simple manque de réalisme politique, mais je crois que nous nous trouvons en face d'une attitude plus fondamentale. Ce n'est pas un hasard si le romantisme se développe d'abord dans « un royalisme proche des ultras 4 ( * ) ». La sensibilité religieuse affirmée des plus idéologues des ultras les conduisait en outre à valoriser le symbole, à considérer que l'univers symbolique, qui renvoie aux conceptions, aux idées, est le plus important, à pratiquer une sorte de « spirituel d'abord » avant la lettre - et à se trouver vulnérable dans un jeu politique où les passions s'entrechoquent avec la raison et les intérêts.
Il faut enfin signaler tout de même, avant de quitter la Restauration, un épisode peu connu du gouvernement Martignac de 1828 5 ( * ) : Charles X a tenté ce que l'on appellerait aujourd'hui « un gouvernement de cohabitation » avec une chambre majoritairement libérale. Et ce ministère Martignac a mené une politique anticléricale avant la lettre, une tentative de limiter l'influence de l'Église catholique.
D'abord, le gouvernement Martignac se préoccupe des petits séminaires. Les petits séminaires fonctionnent à l'époque comme une sorte d'enseignement secondaire privé catholique qui ne dirait pas son nom. Des familles catholiques, désireuses que leur enfant suive un enseignement confessionnel, le mettent au petit séminaire, quand bien même il n'est pas destiné, par la suite, à entrer au grand séminaire et à devenir membre du clergé. Martignac décide que le nombre des élèves des petits séminaires sera limité à vingt mille, chiffre présenté comme suffisant pour assurer le recrutement du clergé. Le gouvernement s'en prend de même aux jésuites, sur lesquels se focalise, depuis le siècle des Lumières, toute une hostilité : Raoul Girardet 6 ( * ) estimait qu'il y avait un « mythe jésuite » qui était l'équivalent, chez les libéraux et les républicains du XIX e siècle, de ce que sera le mythe du « complot maçonnique » dans les milieux conservateurs. Les jésuites n'ont, après les ordonnances Martignac, plus le droit de diriger des petits séminaires.
Et on remarque que, dans ces années, il y a une forte campagne anticléricale. Paru en 1826, le Mémoire à consulter de Montlosier qui invente l'expression de « parti prêtre » afin de désigner les milieux catholiques qui mèneraient la monarchie de Charles X à sa perte, a connu un vif succès. Les chansons de Béranger se répandent, Béranger qui stigmatise ainsi les jésuites :
« Hommes noirs, d'où sortez-vous ?
Nous sortons de dessous terre.
Moitié renards, moitié loups,
Notre règle est un mystère ».
Incontestablement, l'opinion est déjà mobilisée par ces questions. Ajoutons que sous la Restauration, comment à s'affirmer, dans la Société de la morale chrétienne, chez les libéraux du Globe, et chez certains catholiques autour de Lamennais, un discours favorable à la séparation de l'Église et de l'État 7 ( * ) .
La Révolution de 1830, qui met en place la monarchie de Juillet, a eu une portée nettement anticatholique ou « anticléricale ». Le nouveau régime a souvent été vu comme une "monarchie bourgeoise", mais l'historiographie, prenant en compte l'origine du personnel politique, a depuis une décennie fortement relativisé cet aspect 8 ( * ) en soulignant la place des notables. Quoi qu'il en soit, la monarchie de Juillet apparaît comme un régime moins favorable à l'Église catholique que la Restauration. Elle fut cependant le lieu d'une tentative de ce qu'on n'appelle pas une laïcité conciliante 9 ( * ) , dont les principaux acteurs seraient François Guizot, historien et homme politique protestant, et le philosophe de Victor Cousin 10 ( * ) , d'origine catholique. Cette tentative a lieu dans un cadre concordataire davantage assumé, puisque dans la charte révisée de 1830 la religion catholique est désignée comme religion « professée par la majorité des Français » (article 6). Guizot comme Cousin sont animés par deux convictions profondes, qui s'inscrivent parfaitement dans le cadre concordataire et que nous pouvons résumer ainsi : il faut que l'État soit émancipé de toute tutelle religieuse, mais il faut aussi que l'État sache collaborer avec les forces religieuses.
La loi Guizot de 1833 - je ne reviendrai pas sur le rôle de cette loi dans l'alphabétisation des Français, que Ferry lui-même a reconnu - et la question de liberté de l'enseignement secondaire et de la défense de l'Université illustrent à la fois l'ambition du régime et les difficultés qui y mettent obstacle. La loi Guizot de 1833, à l'élaboration de laquelle Cousin a participé et dont il fut rapporteur, prévoit, en effet, une forme de collaboration entre l'Église et l'État. On reste dans l'idée que les forces religieuses sont les pourvoyeuses naturelles d'une première éducation morale, en prévoyant que l'instituteur donnera à la fois les premiers éléments d'éducation religieuse et les premiers éléments d'éducation morale, sous le contrôle d'un Conseil de surveillance. Une question fut âprement débattue : est-ce que le curé (ou le pasteur dans les terres protestantes) doit être membre de ce Conseil de surveillance ? C'est un débat difficile : la Chambre des députés vote contre la présence des membres du clergé dans le Conseil de surveillance, la Chambre des pairs vote pour, et, finalement, c'est la Chambre des pairs qui l'emporte. On a souvent dit que la loi Falloux de 1850 plaçait face à face le curé et l'instituteur. La loi Falloux a aggravé cette tension, si structurante pour la laïcité française, mais qu'elle ne l'a pas créée. Les premiers signes de difficultés apparaissent bien dès l'application de la loi Guizot, sous la monarchie de Juillet.
D'autre part, la loi Guizot établissait la liberté de l'enseignement primaire, consacrant législativement un état de fait. Mais la Charte révisée de 1830 avait prévu la liberté de l'enseignement dans son article 69, sans la restreindre au seul enseignement primaire. Cet article, classé avec l'article 68 sous la rubrique « dispositions particulières », annonçait l'élaboration de lois concernant divers objets, dont, au huitième rang, l' « instruction publique et la liberté de l'enseignement ».
L'enseignement secondaire constitue un enjeu différent de l'enseignement primaire, car il est vu, à cette époque - comme d'ailleurs Napoléon lui-même l'avait conçu - comme destiné à former les élites de la nation. Il ne s'agit donc plus de savoir qui se charge d'enseigner des principes de morale élémentaire à propos desquels l'accord peut être assez large, mais de contribuer à déterminer, indirectement, les grandes orientations de la vie publique. De ce point de vue, l'enseignement de la philosophie devient un « lieu » potentiellement très conflictuel. Et cela concerne au premier chef Victor Cousin, membre du Conseil royal de l'Instruction publique. En effet, la philosophie aborde des questions sur lesquelles les communautés religieuses peuvent estimer avoir leur mot à dire : la source de la morale, l'existence de Dieu, par exemple. Et le magistère catholique demeure fidèle à l'idée d'une soumission de la philosophie à la théologie.
Toute l'idée de Cousin sera de faire accepter ce qu'on appelle son "régiment" (parce qu'il contrôle très étroitement ses professeurs de l'Université) dans les lycées de l'État, par l'Église catholique. Dès qu'il y a - et il y en a régulièrement - des frictions avec l'évêque, Cousin gère l'affaire personnellement. Son but est d'arriver à sauvegarder l'indépendance de la démarche philosophique rationnelle, en évitant le choc frontal avec le clergé. Il parvient à ses fins jusqu'aux années 1840 où, à partir de 1842-1843, un catholicisme à nouveau en position de force - il y a beaucoup de conversions dans la jeunesse d'alors - lance, derrière un chef politique talentueux, le pair de France Montalembert, ancien compagnon de Lamennais, une campagne pour la liberté de l'enseignement secondaire. Cette campagne se double d'une attaque très violente contre l'Université ; des figures politiques de premier plan sont ainsi amenées à « monter au créneau » pour défendre l'Université et la philosophie. Ainsi, Thiers, dans son rapport de 1844, résume parfaitement cette idée d'une sorte de laïcité qui parviendrait à éviter les chocs, en affirmant que l'Université est le lieu « où règne la raison calme, respectueuse mais inflexible ».
Cousin qui est aussi Pair de France et s'exprime donc à la Chambre des Pairs insiste sur le fait qu'il n'y a rien dans la philosophie qui doive choquer les catholiques. Une partie de ses disciples, parmi lesquels le futur grand homme politique Jules Simon, se séparent de lui pour fonder une revue, La liberté de pensée, visant à la défense d'une philosophie affirmant plus nettement son aspect laïque, sécularisé. L'importance du côté diplomate et de la visée stratégique cousinienne rendent la figure de Cousin difficile à juger. Mais il semble bien qu'il faille cependant lui donner une place importante dans l'émergence de l'idée laïque. Quand Cousin, en 1832, présidait le jury qui a reçu Adolphe Franck, le premier agrégé de philosophie juif de France, il aurait déclaré à cette occasion : « La philosophie est sécularisée. »
La monarchie de Juillet n'est pas parvenue à mettre en place la liberté de l'enseignement secondaire, en trouvant un compromis qui aurait satisfait à la fois les libéraux et le catholicisme militant. La constitution de décembre 1848 consacre tout un article, l'article 9, à la question de la liberté d'enseignement : « L'enseignement est libre. La liberté d'enseignement s'exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminés par les lois, et sous la surveillance de l'État. Cette surveillance s'étend à tous les établissements d'éducation et d'enseignement, sans aucune exception. » Nous y trouvons deux éléments fondamentaux de la laïcité française : une visée libérale, couplée avec une responsabilité importante conférée à l'État.
Les débuts de la II e République se déroulent dans un climat d'unanimité, et on peut croire au règlement aisé des conflits anciens. L'espérance des démocrates les plus enthousiastes était de voir surgir, grâce au suffrage universel, une communauté nationale vraiment fraternelle. Mais cette unanimité est de façade : le régime se trouve bien vite confronté au conflit entre des intérêts divergents, sur les plans économique, social et religieux.
À partir des journées de juin 1848, un processus de bipolarisation s'affirme. Relevons, pour ce qui nous occupe, que les anciens adversaires de la monarchie de Juillet vont se retrouver dans le même camp, celui du parti de l'ordre, rassemblant des orléanistes et d'anciens légitimistes, des députés catholiques désireux d'accroître une influence de l'Église qu'ils estiment indispensable à la bonne santé du corps social.
Cette alliance se traduit dans les faits. L'expédition de Rome rétablit en 1849 le pape Pie IX dans ses États, dont il avait été chassé par la révolution romaine. D'autre part, la loi Falloux se propose de clore le débat relativement à la liberté de l'enseignement secondaire.
Le 15 mars 1850, cette loi Falloux départementalise l'Université, accorde, dans ses organismes de tutelle, une part importante aux forces religieuses. Elle accorde une très large liberté à l'enseignement secondaire. Elle suscite une forte opposition parmi les républicains, comme Quinet, ou comme Hugo, dont on sait que l'anticléricalisme est pour beaucoup dans sa rupture avec le parti de l'ordre. Victor Hugo, en janvier 1850, prononce contre le projet un grand discours. Il n'est pas très rompu aux règles de l'éloquence parlementaire. Sa démarche peut être résumée ainsi : « Je vais commencer par donner mon idéal sur cette question. Ensuite seulement, je me prononcerai sur le projet. » Son idéal comporte tout d'abord « un grandiose enseignement public, donné et réglé par l'État, partant de l'école de village et montant de degré en degré jusqu'au Collège de France, plus haut encore, jusqu'à l'Institut de France. Partout où il y a un champ, partout où il y a un esprit, qu'il y ait un livre. » Hugo n'est cependant pas partisan du monopole de l'État en matière scolaire : « Je donnerais également une liberté absolue de l'enseignement, [...] je n'aurais pas besoin de donner à l'enseignement privé le pouvoir inquiet de l'État pour surveillant, parce que je lui donnerais l'enseignement gratuit de l'État pour contrepoids. » Relevons que Hugo va plus loin que l'article 9 de la constitution de 1848, qui n'envisageait pas cette liberté absolue.
Mais, constate-t-il, la situation n'est pas mûre pour la réalisation de ce grand projet. À l'époque, beaucoup reculent devant son coût budgétaire. Aussi faut-il pour l'écrivain prendre position hic et nunc . « Au point de vue restreint mais pratique de la situation actuelle, énonce Hugo, je veux, je le déclare, la liberté de l'enseignement. Mais je veux la surveillance de l'État et, comme je veux cette surveillance effective, je veux l'État laïque, purement laïque, exclusivement laïque. » Nous voici cette fois dans la logique de l'article 9.
Ce discours est important parce qu'on retrouve les deux dimensions de la laïcité française, sur lesquelles Jean Baubérot a insisté. C'est à la fois une volonté de séparer le domaine religieux d'un domaine laïque et, en même temps, de maintenir une certaine tutelle, une certaine surveillance de l'État laïque. Dans ce discours, Victor Hugo évoque aussi une thématique porteuse d'avenir puisqu'il parle des droits de l'enfant, qu'il estime supérieurs aux droits du père de famille. Cela donne d'ailleurs toute la mesure de la prudence de la Lettre aux instituteurs de Jules Ferry, qui insiste au contraire sur l'espèce de délégation que l'instituteur reçoit de la part du père de famille, et dont il doit user avec prudence.
Le Second Empire ne doit pas être uniquement vu comme un régime « clérical ». Frédéric Bluche a défini le bonapartisme comme un « centrisme autoritaire ». Cette formule, qui sonne peut-être un peu curieusement à nos oreilles contemporaines, rend bien compte de l'ambiguïté du régime. Éric Anceau l'a rappelé dans une synthèse récente 11 ( * ) , la résistance au coup d'État a conduit Louis Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, à rechercher l'appui des forces conservatrices. On pourrait dire qu'il se « jette dans les bras » des blancs parce qu'il a besoin d'accréditer la thèse du « péril rouge ». Et dans les premiers temps du régime, puis du Second Empire à partir de 1852, l'Église catholique obtient beaucoup de choses. Cependant, le catholicisme ne redevient pas religion d'État, et si le Panthéon est rendu au culte catholique, la constitution du 14 janvier 1852 invoque, dans son article premier, « les grands principes proclamés en 1789 ».
La politique italienne de Napoléon III conduit à une prise de distance envers certains catholiques, inquiets pour le pouvoir temporel du pape. Il reste cependant toujours un côté catholique de ce régime, en particulier en politique extérieure - on pense à l'expédition du Mexique. De même, Jacques-Olivier Boudon a mis en lumière le projet du régime de faire de Paris une véritable capitale religieuse 12 ( * ) . Mais il y a aussi une dimension laïque de cet Empire. Cela se voit même pendant l'Empire autoritaire. Ainsi, Fortoul qui, pourtant, fait peser une tutelle terrible sur les professeurs, revient sur la départementalisation de l'Université par la loi Falloux et remet en place les recteurs, parce qu'il lui semble qu'il faut quelqu'un qui puisse faire contrepoids à l'évêque 13 ( * ) . D'autre part, l'œuvre de Victor Duruy, ministre de l'Instruction publique de 1863 à 1869 doit être prise en considération. Personnellement partisan d'une instruction gratuite et obligatoire et de la neutralité religieuse de l'enseignement d'État, il développe des cours d'instruction secondaire pour les jeunes filles, ce qui lui vaut l'hostilité Mgr Dupanloup, redonne aussi toute leur place aux humanités classiques et à la philosophie (ce qui correspond aux revendications des libéraux) et veut développer l'Université - il crée ainsi en 1868 l'École Pratique des Hautes Études.
En conclusion de ce trop rapide survol, rappelons qu'en 1870, la laïcité a déjà une longue histoire. On en voit apparaître bien des thèmes, bien des tensions aussi. La quête de la liberté dans tous les domaines ne conduit pas, hors certains cénacles, toujours dans l'opposition, au développement de l'idée d'une séparation pure et simple entre l'Église et l'État - c'est que l'affirmation du rôle de l'État demeure forte, reflet d'une méfiance des libéraux vis-à-vis de l'Église catholique. Maintenir l'unité de la nation, éviter la discorde civile est déjà une préoccupation forte. Ainsi, c'est Victor Cousin qui le premier développe le thème des « deux jeunesses », pour s'opposer à une liberté illimitée de l'enseignement secondaire, thème qui sera repris par Jules Ferry. Cette tension entre une volonté du Pacte républicain de souder l'unité nationale et, en même temps, la volonté d'organiser le pluralisme religieux est probablement plus une richesse et un atout pour la laïcité française qu'un handicap.
LES DÉBATS AU DÉBUT DE LA IIIe RÉPUBLIQUE
Philippe Levillain, professeur à l'Université de Paris X-Nanterre
et à l'Institut Universitaire de France
Je remercie Jérôme Grondeux de cette analyse, à la fois vue d'en haut et, en même temps, vue dans le détail, d'une période longue, ce qu'on peut appeler une série de systèmes dynastiques qui, pour le coup, même si la légitimité n'est pas la même en 1830 et en 1851, se réclament tout de même d'autres principes que ceux de la Législative ou de la Convention, voire du Directoire.
Je vais essayer de traiter de la période qui m'a été impartie. La communication qui m'a été proposée par Jean Garrigues et Frédéric Attal, que je remercie et dont je constate le succès de l'entreprise lancée voici deux ou trois ans, est au fond plus facile pour moi que celles des deux jeunes collègues qui viennent de promener ce terme de laïcité, sur le chemin de l'histoire avant 1870, de son apparition à sa transformation en arme républicaine. On peut même se demander s'il est utile de revenir sur des débats qui ont dominé la vie parlementaire et aiguillonné la vie politique depuis les débuts de la III e République et ont suscité une littérature surabondante.
Indépendamment du fait que cette salle, que j'ai fréquentée assez souvent - le Sénat est d'une générosité remarquable qu'il faut toujours remarquer - est peuplée d'une façon extraordinaire, je crois pouvoir donner un exemple de l'intérêt quasi génétiquement français et donc républicain pour la laïcité en disant que, de tous les cours que j'ai pu professer en licence, au cours des dernières années - et déjà à Lille dans ma jeunesse -, c'est celui sur la laïcité en France depuis la séparation des Églises et de l'État qui a rencontré le plus vif succès auprès des étudiants, qui s'arrachaient exposés ou fiches de lecture sur une bibliographie sommaire, que je leur avais établie, de plus de cent cinquante titres et qui était peu de chose.
Des débats nés avec la loi de 1875 sur l'enseignement supérieur, sur laquelle je vais revenir, à ceux suscités par la question du voile islamique et des résolutions suggérées par la commission Stasi, il n'y a pas de solution de continuité pour une raison simple que résume parfaitement l'ouvrage de Guy Coq, publié en 1995 aux Éditions du Félin, Laïcité et République, le lien nécessaire . Comme chacun le sait, « nécessité fait loi », au singulier et au pluriel. Dans les analyses de la laïcité et celles des enjeux que le terme comporte, il y a plus loin de Jean Baubérot, Guy Coq, Jean-Marie Mayeur, Émile Poulat, René Rémond - selon l'ordre alphabétique qui ne distingue par conséquent pas les nuances - par rapport à Jules Ferry que de Jules Ferry par rapport à Condorcet, comme il y a plus loin de la Terre à Saturne et de la Terre à la Lune.
Dans tous les cas de figure, toutefois, demeure la question de l'apparition du mot, de son sens premier et de sa forme excessive. Sur l'apparition du mot, nous avons été éclairés précédemment par mes deux collègues. Sa forme excessive s'appelle le laïcisme, aujourd'hui, et c'est une doctrine qui, selon Guy Coq, « ferait de la laïcité une philosophie complétée et guidée par la volonté d'expulser toute foi religieuse du coeur de l'homme ». Comme l'indique le dictionnaire d'Émile Littré, le laïcisme se développa en Angleterre au XVI e siècle, sous la forme d'une doctrine très forte qui entend, en effet, reconnaître aux laïques le droit de gouverner l'Église. Donc, il y a un laïcisme à l'intérieur de ce qu'on peut appeler la position de l'Église comme institution, qui est propre à la situation de la Réforme. D'une façon générale, les deux attributs se complètent : la référence à l'apparition du terme, en termes de proposition étendard et non pas de concept, et la recherche d'une définition juridique de la laïcité. La première démarche justifie un combat, la seconde postule une justification.
Le mot laïcité fait une apparition sémantique d'abord discrète. Littré relève le terme en 1871. Quand un nom apparaît dans un dictionnaire, l'établissement du scriptim équivaut à la fixation du verbatim . Littré relève donc, en 1871, dans le journal La Patrie publié le 11 novembre 1871, au sujet de l'enseignement laïque, que le Conseil général de la Seine a procédé au vote sur la proposition de la laïcité, qui a été repoussée. Il aurait été utilisé peu de temps, cependant, pendant la Commune de Paris. Si l'on en croit un certain nombre d'autres auteurs, qui s'interrogent, eux aussi, au fond, sur les dix dernières années du Second Empire, il aurait été utilisé, d'après Maurice Barbier dans La Laïcité , publiée aux éditions de l'Harmattan en 1985, dès 1861, sous la plume d'Arsène Meunier, dans un ouvrage intitulé Lutte du principe clérical et du principe laïque dans l'enseignement . Et celui-ci préconise un État et un enseignement laïques, c'est-à-dire dégagés de toute religion positive. Qu'appelle-t-on une religion positive ? C'est une religion qui se réfère à des textes fondateurs comme, par exemple, pour le catholicisme, la Révélation, l'Ancien et le Nouveau Testament, les Pères de l'Église et un certain nombre de textes conciliaires comme, par exemple, le Concile de Nicée pour le credo.
Dans son Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire publié en 1908, Ferdinand Buisson souligne la nouveauté de ce mot "laïcité", pour lequel il rédige un article assez long où, de manière remarquable, il exprime la nécessité de ce néologisme. Il fait de la laïcité une présentation qui mérite désormais d'être considérée comme classique. Cet auteur met clairement en évidence que la laïcité est la reconnaissance de l'autonomie de la société et de l'État par rapport à toute religion. « La grande idée, la notion fondamentale de l'État laïque, c'est-à-dire la délimitation profonde entre le temporel et le spirituel, est entrée dans nos moeurs de manière à n'en plus sortir. » Cette formule ajoute à l'idée d'autonomie celle de séparation. Ces deux aspects sont en effet constitutifs de la laïcité telle qu'on l'entend progressivement à partir de 1871, si on prend le Littré comme référence, tout en ayant démontré que le terme avait déjà vogué au fil des régimes et de ce qu'on peut appeler l'expression des idées politiques - pour ne pas employer le terme d'idéologie -, avant 1871 et les événements qui en découlent. Ces deux aspects sont en effet constitutifs de la laïcité : l'autonomie et la séparation, l'une menant plus ou moins inéluctablement à l'autre.
Dans l'exposé qui m'est proposé, il est évident qu'il y a débat dans le débat. Je me réfère au colloque très intéressant qui a été également organisé par le Comité d'Histoire Politique et Parlementaire lundi dernier sur Henri Wallon. À partir de quel moment la République est-elle instituée ? Il a été établi que c'était probablement, dans ce qu'on peut appeler le mythe, plutôt que la légende républicaine, le 31 janvier 1875. À partir de là, il y a la volonté de transformer le provisoire en durable et l'idée que, dans ce durable, précisément, la laïcité ou la laïcisation, ou la sécularisation, fait partie du durable. Donc, on ne sait pas très bien (et la laïcité aide, à cet égard, à affiner la chronologie) si c'est le 31 janvier 1875, si c'est à partir des lois de 1880 et du fameux article 7, si c'est à partir de la non-révision de la réforme républicaine ou à partir de la séparation de l'Église et de l'État, avant même que ce ne soit le parti radical qui remporte les élections du début du siècle, que la République est véritablement installée et que le lien indissoluble, le lien nécessaire entre République et laïcité fait que la République est la République.
Mais il est clair que l'autonomie du pouvoir politique de l'État, la soustraction de toutes les sphères de la vie sociale de tout pouvoir d'une ou de plusieurs religions, appelle l'idée de séparer Églises et État même si, au départ, il s'agit de séparer l'État, donc la République, de la religion catholique de façon prioritaire. En ce sens, on peut dire que Buisson va plus loin que Renan, lequel reprendra Littré à son compte et soulignera, dans l'article intitulé « Le progrès continu de la laïcité » : « l'État neutre entre les religions, tolérant pour les unes, forçant l'Église catholique à lui obéir en un point et sur ce point capital. » C'est un problème d'obédience et, par conséquent, de deux souverainetés, qui sont de l'ordre du temporel et de l'ordre du spirituel, selon la vision cléricale que l'on peut avoir et qui remonte à Rome. Il y aurait beaucoup à dire sur la responsabilité de Rome dans la non-signature de la Constitution civile du clergé, mais ce n'est pas l'objet du débat. Donc, c'est là que se trouvent le coeur du sujet et le développement nécessaire d'une laïcité qui passe par le combat fondamental de l'enseignement et, parallèlement, de l'alphabétisation. C'est à ce combat que Gambetta réfère naturellement ce qu'est l'avenir d'une véritable République, parlementaire, certes, en 1871, mais démocratique à l'avenir, par le fonctionnement régulier du suffrage universel.
Inversement, aujourd'hui encore, le terme fait débat juridiquement. J'y viens un instant pour donner « l'arc » de ce que représente l'examen de la période 1870-71, jusqu'en 1905. Un mémento juridique de la laïcité française rencontre dès l'abord une difficulté : les termes "laïque", "laïcité", ne sont pas définis par le droit. Pourtant, de nombreux textes législatifs ou réglementaires, qui font de la France une république laïque, sont importants. Le juriste Jean Rivero pouvait écrire en 1960 : « L'idéologie de la laïcité recèle dans ses principes un certain nombre d'éléments qui rendent sa traduction particulièrement difficile dans l'ordre juridique. » Mais il ajoutait : « Pour la première fois depuis qu'il y a un pouvoir, il se présente à ses sujets dans l'État laïque, dépouillé de toute justification autre que purement humaine. »
La conception de l'État laïque est un fait immense, il ne s'ensuit pas que ce soit une donnée aisée à traduire dans le droit et je me réfère à ce que dit Rivero pour expliquer que, depuis le Concordat jusqu'aux derniers éléments qui ont conduit à la commission Stasi, il n'y a pas de solution de continuité. Toutefois, les textes qu'on peut appeler laïques forment un ensemble, car les débats sans cesse renaissants autour de la laïcité font souvent apparaître que, tout en se référant à la législation laïque, ceux qui la défendent, comme ceux qui la contestent et voudraient la faire évoluer, la connaissent assez mal ou l'interprètent à la lumière de leur conception personnelle de la laïcité.
C'est d'ailleurs un fait curieux : les Français, qui se réclament volontiers de l'État de droit démocratique et républicain, sont souvent ignorants du droit en vigueur dans cet État, ils n'en ont pas la connaissance qu'on rencontre chez des citoyens des pays anglo-saxons, je pense notamment à la Grande-Bretagne. L'étude des textes montre que l'idéologie ou la philosophie qui leur est sous-jacente est, sur certains points, différente des philosophies ou idéologies qui se réclament, ici et là, de la laïcité.
On suivra donc Claude Nicolet, selon lequel « la laïcité ne nous a pas été donnée comme une révélation », c'est-à-dire que ce serait l'antithèse de la religion positive. « Elle n'est sortie d'aucune tête, de la tête d'aucun prophète. Elle n'est exprimée dans aucun catéchisme, même s'il y a eu un catéchisme impérial. Aucun texte sacré n'en contient les secrets : elle n'en a pas. Elle se cherche, s'exprime, se discute, s'exerce et, s'il le faut, se corrige et se répand. » Ceci explique bien la difficulté à définir la notion de façon satisfaisante. Maurice Barbier, déjà cité tout à l'heure à propos de la définition du terme, en 1866, dans le livre La Laïcité , y voit trois raisons d'importance. La première, dit-il, c'est que « la laïcité n'appartient pas à la catégorie de la substance, mais à celle de la relation ». La deuxième, c'est qu'elle « n'est pas un lieu positif mais une séparation ». La dernière, c'est qu'elle « n'est pas une notion statique mais dynamique ». Cela justifie d'ailleurs, cher Jean Garrigues, la division que vous avez organisée de cette première matinée de colloque en trois périodes. Il faut suivre l'invitation d'Émile Poulat, dans Notre laïcité publique , publié aux éditions Berg International, en 2004, qui conseille de se méfier de quatre pièges : le piège des origines, le piège des mots, le piège du singulier et le piège du jacobinisme. Ces quatre pièges sont ceux, sur le chemin de l'histoire, qui touchent à la question de la laïcité surtout à partir de 1870.
Pour comprendre le débat dans sa nature, après les hésitations de sécularisation en 1791, les hésitations concordataires en 1801-1802, avec les Articles organiques, les reculs, ensuite, puis les avancées et le caractère politique de la relation entre l'Église et l'État, je voudrais que l'on se réfère tout de même à une analyse que j'ai empruntée à André Vauchez, dans la revue Études de janvier 2005 : « Les laïcs du Moyen Âge, entre ecclésiologie et histoire ». Il rappelle que le terme grec laikos (en latin laicus ), que l'on peut traduire par profane, ne se trouve pas dans le Nouveau Testament et est resté rare jusqu'au III e siècle. La distinction, rappelle-t-il, entre laïcs et clercs s'établit progressivement et se transforme en clivage hiérarchique et fonctionnel avec la réforme grégorienne au XI e siècle, dont on peut dire qu'elle établit véritablement deux peuples : le peuple chrétien, d'un côté, et le peuple profane, de l'autre. D'autre part, il souligne, et c'est une chose peu connue, que les laïcs qui se trouvent dans la situation du peuple chrétien, mais avec une hiérarchie censée les instruire - la culture savante et la culture populaire naissent à partir du XII e , XIII e siècle, et la notion d'éducation, au XIX e siècle, revient sur un thème récurrent dans toute l'histoire de la France - ont donc une fonction subordonnée, ce qui n'empêche pas que, d'un côté, il y ait une inventivité spirituelle (et on le voit au XIX e siècle) et, en même temps, dit-il, un anticléricalisme virulent, qui débouche sur des formes de contestation de la part de baptisés, qu'on appelle les « hérésies ». Et la question est de savoir si, au fond, la laïcité est une hérésie acceptée par la République ou si la République a besoin de la laïcité en termes philosophiques et que l'on pourrait qualifier d'idéologiques.
J'exprime cette continuité car je suis favorable aux datations, aux ruptures, mais pas d'une façon systématique et, donc, sans mettre en cause la partition qui vient d'être fournie, je relie ceci à tout ce que représente la situation de l'Église au début du XIX e siècle, en France, à la suite de la Révolution. Il est certain que la Révolution est une des causes fondamentales de ce qu'on appelle la laïcité à la française. La République n'avait pas d'autre moyen que d'établir la laïcité face aux propositions de compromis qui ont été fournies par un certain nombre de conservateurs, même de catholiques conservateurs - il ne faut pas oublier qu'Henri Wallon a voté contre la loi Falloux -, et même de républicains, qui sont des républicains soit spiritualistes, soit déistes et qui n'étaient pas forcément en faveur d'une séparation, même si la séparation est inscrite dans le programme de Belleville en 1869.
Ainsi, de l'héritage de la Révolution au Concordat, l'Église voit sa position largement péricliter et, comme l'a rappelé dans un certain nombre d'ouvrages Bernard Plongeron, c'est plutôt le Directoire qui a assumé la séparation entre l'Église et l'État, que les régimes antécédents. Ce déclin va avoir une conséquence fondamentale pour l'Église : la mise en place d'une stratégie de conservation et de renforcement de la place traditionnelle qu'elle détenait au niveau de l'enseignement depuis des siècles. Ce nouvel enjeu représenté par l'école sera d'autant mieux intégré par l'Église que l'État, jusqu'aux lois laïques, ne se donnera pas les moyens de son ambition en matière scolaire, malgré l'affirmation du droit des peuples à l'instruction dès la Constitution de 1791, et malgré la reprise de responsabilité de l'État en matière d'éducation dans toutes les constitutions suivantes.
Paradoxalement, cette démarche ecclésiastique, qui trouve son acmé dans les lois de libéralisation de l'enseignement, les lois Guizot et Falloux, va certainement contribuer à rapprocher le système français de la laïcité. Ainsi, le caractère proclérical des lois Guizot du 28 juin 1833, Falloux et Dupanloup, va inévitablement provoquer une réaction laïque et l'étude de la loi de 1875 sur l'enseignement supérieur marque ce qu'on peut appeler l'établissement d'un « front » entre les cléricaux et les républicains, sans que, pour autant, ce soit véritablement un front anticlérical, ce qui est important. L'économie de ces lois est remarquable dans le sens où elles sont ostensiblement favorables aux congrégations religieuses. Je parle de la loi Guizot, de la loi Falloux et de la loi sur l'enseignement supérieur. En un mot, tandis qu'un laïc ne pouvait enseigner sans un brevet délivré par le ministre de l'instruction publique, il suffisait aux membres des congrégations d'une lettre d'obédience de l'Église, sans compter qu'à un moment donné un amendement a été posé qui permettait à l'évêque de fonder une école chrétienne sans avoir à s'en référer au ministère des cultes. Nous avons donc, sans entrer dans le détail des lois - je renvoie à l'ouvrage fondamental d'Antoine Prost, qui est ici et que je salue - des textes qui sont favorables à l'Église. Cette prise d'importance du clergé est l'un des facteurs, mais non le seul, tendant à expliquer la méfiance du pouvoir face à l'appropriation progressive et au démantèlement insidieux de l'enseignement par l'Église.
Cependant, un autre phénomène sera, dans la réalité, celui qui va motiver les fameuses lois laïques. Il s'agit des pratiques cléricales dans l'école publique. C'est à ce niveau que se pose la question du cléricalisme, des brèches dans le monopole universitaire et des relations entre catholicisme et politique, à commencer par le problème des partis dynastiques : légitimiste, orléaniste, voire bonapartiste, qu'on peut résumer par le terme de conservateurs, encore qu'entre chacun d'entre eux, le terme n'ait pas le même sens. La frontière est extrêmement mouvante. Jacqueline Lalouette a expliqué tout cela dans un livre, La République anticléricale , publié au Seuil en 2002. Mais, ayant survolé les lois de libéralisation de l'enseignement, on peut aisément imaginer que les religieux ont trouvé dans cette évolution au moins un motif de soulagement. Bien plus, une volonté de conquête de l'instruction publique s'est développée et concrétisée pendant tout le XIX e siècle, incertain du type d'héritage qu'il pouvait porter de la Révolution française.
Les congrégations religieuses ne se sont pas contentées de saisir l'opportunité que représentaient pour elles les écoles libres, mais elles ont, au gré d'un contexte qui était plutôt favorable, réussi à investir l'enseignement public, après l'intermède bonapartiste de l'Université impériale. Les chiffres sont d'ailleurs éloquents : en 1879, à la veille des grandes lois laïques, sur trente-sept mille congréganistes enseignants, la moitié exerçait dans les écoles primaires publiques. Mais le contexte est loin d'être suffisant pour expliquer l'aboutissement inévitable aux lois de 1880. Pendant toute la période considérée, de grands noms se sont investis en faveur de la laïcité et ont joué un rôle en tant qu'inspirateurs. Il convient maintenant de s'intéresser à eux.
J'ai expliqué que le rapport de Condorcet à Jules Ferry et aux grands fondateurs était plus près de la Terre à la Lune et que celui de Jean Baubérot à Jules Ferry de la Terre à Saturne. Je cite une phrase de Jules Ferry, qui rendit à Condorcet un hommage posthume tout à fait singulier, qui va dans le sens de la continuité : « J'avoue que je suis resté confondu, écrit Jules Ferry, qu'en cherchant à vous apporter autre chose que mes propres pensées, j'ai rencontré dans Condorcet ce plan magnifique et trop peu connu d'éducation républicaine. Je vais tâcher de vous en décrire les traits principaux : c'est bien, à mon avis, le système d'éducation normale, logique, nécessaire, celui autour duquel nous tournerons peut-être longtemps encore et que nous finirons un jour ou l'autre par nous approprier. »
Cependant, la contribution indéniable de Condorcet ne doit pas occulter les autres rapports doctrinaux tendant à remettre en cause les doctrines religieuses. « La science, voilà la lumière, l'autorité, la religion du XIX e siècle », écrit le philosophe Vacherot. En 1862, Clémence Royer traduit De l'origine des espèces de Darwin, alors que les Églises maintiennent le sens littéral de la genèse et combattent l'évolutionnisme. Ce n'est plus seulement la philosophie qui met en cause la religion, mais le progrès des sciences. C'est une chose assez connue, mais que je tenais à rappeler pour expliquer le contexte dans lequel cela se passe, avec la rupture de l'institution des lois républicaines (qui ne sont pas une constitution, comme il est dit trop souvent ou comme le croient nos amis anglo-saxons), en février et décembre 1875.
Vers 1860, le positivisme d'Auguste Comte invite à une conception rationaliste de l'univers où tout surnaturel est exclu ; avec Renan et Larousse, le comtisme aboutit au scientisme. Il y aurait beaucoup à dire sur les nuances qui interviennent à l'intérieur de la pensée d'Auguste Comte, mais je n'ai pas le temps de le faire. Jules Ferry déclare toujours, lui, en 1875, avoir pour le christianisme une admiration historique très grande, mais il considère que les illusions théologiques ne tiennent plus debout. On est là dans un phénomène d'ailleurs actuel : le christianisme considéré comme une culture. Le physiologiste Paul Bert compare le clergé au phylloxéra. Il sera ministre de l'Instruction publique entre 1881 et 1882.
Je rappelle tout de même que c'est en 1866 qu'est fondée par Jean Macé la Ligue de l'Enseignement, pour multiplier les bibliothèques populaires. Celles-ci, naturellement, poseront la question fondamentale du contenu de l'enseignement à l'école. On a parlé de tout laboureur qui aurait un livre au champ et la charrue dans l'autre main, c'est cela les questions de bibliothèque populaire. La question de la laïcisation des lois a été traitée, je voudrais tout de même rappeler qu'il ne faut pas focaliser sur la séparation de l'Église et de l'école, comme l'a fait, à juste titre, Pierre Chevalier dans son livre La Séparation de l'Église et de l'école . C'est effectivement la pierre angulaire.
Mais, à côté des lois scolaires, une série de dispositions législatives vont mettre fin à toute influence de l'Église dans les services publics : la suppression du caractère confessionnel des cimetières, le service militaire imposé aux clercs ou l'établissement du divorce, que l'Église n'admet pas, par une loi du 19 juillet 1884. C'est enfin la suppression par la loi du 12 juillet 1880 du repos dominical. À ces mesures anticléricales sont ajoutées des mesures proprement antireligieuses, comme l'exclusion des congrégations religieuses de la liberté d'association, proclamée par la loi de 1901, ou l'interdiction faite à des évêques de se rendre à Rome sur convocation du pape.
Il y a là deux grands moments. Il y a une querelle que je qualifierais de byzantine, qui est la querelle du Nobis nominavit : Thiers, qui était pourtant plutôt républicain, conservateur et qui était un orléaniste, considère qu'il n'est pas possible d'accepter que le Nobis nominavit signifie qu'on désigne au pape les évêques que l'on souhaite avoir dans les diocèses et que le pape considère que c'est à lui que revient le choix définitif. On estime que c'est précisément une prérogative propre à la République. Je crois qu'il faut suivre les analyses assez subtiles qui sont faites un peu partout et qui rappellent que, dans la laïcité, il y a une très forte inspiration du gallicanisme et même des quatre articles de Bossuet en 1682. Il y a là une transposition des quatre articles et du gallicanisme, qui renaît très fortement en France, malgré un clergé français en principe sous l'influence du régime en place. Il a été écrit que l'épiscopat français était arrivé sous le Second empire à un type de byzantinisme qu'on n'avait jamais connu dans sa relation avec la cour, c'est-à-dire un mode d'allégeance qui n'était pas véritablement le type de rapport entre le temporel et le spirituel auquel on pouvait aspirer de la part d'une Église instituée. On en arrive donc à la loi contre les congrégations, avec l'article 7, qui passe donc par un détour.
Je veux rappeler aussi - c'est peu connu - que François Renault, dans sa biographie sur Lavigerie a montré qu'il y avait eu là un compromis entre l'Église et l'État, c'est-à-dire entre la République et Rome, dans la mesure où toutes les congrégations non autorisées devaient être expulsées, et que, finalement, ce sont les jésuites, par la médiation de Mgr Czacki, qui sont choisis pour être sacrifiés - ils en ont l'habitude - sur l'autel de ce que doit être l'exemplarité laïque. Il y a donc là des conversations qui ont été rapportées dans une thèse et qui ont lieu, d'ailleurs, avec le président Grévy.
Avant d'en terminer, je voulais tout de même dire que c'est en 1885 que Jean-Marie Guyau - qui est le frère d'Augustine Fouillée, auteur du Tour de France par deux enfants - publiait l' Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction : il y a tout de même un mouvement parallèle entre l'esprit du positivisme et la défense religieuse. Il y a d'ailleurs un Comité de la défense religieuse. Le livre connut un immense succès dans l'intelligentsia française et étrangère, il fut lu et annoté par Nietzsche, il fut réédité en 1985, à l'occasion du centenaire de sa parution chez Fayard.
Je n'en cite qu'un paragraphe. « Nous nous proposons donc, dit Jean-Marie Guyau, de rechercher ce que serait et jusqu'où pourrait aller une morale où aucun "préjugé" n'aurait aucune part, où tout serait raisonné et apprécié à sa vraie valeur, soit en fait de certitudes, soit en fait d'opinions et d'hypothèses simplement probables. Si la plupart des philosophes, même ceux des écoles utilitaires, évolutionnistes et positivistes, n'ont pas pleinement réussi dans leur tâche, c'est qu'ils ont voulu donner leur morale rationnelle comme à peu près adéquate à la morale ordinaire, comme ayant même étendue, comme étant presque aussi impérative dans ses préceptes, ce qui renvoie à Kant. Cela n'est pas possible. Lorsque la science a renversé les dogmes des diverses religions, elle n'a pas prétendu les remplacer tous ni fournir immédiatement un objet précis, un aliment défini au besoin religieux. Sa situation à l'égard de la morale est la même qu'en face de la religion. Rien n'indique qu'une morale purement scientifique, c'est-à-dire uniquement fondée sur ce qu'on sait, doive coïncider avec la morale ordinaire, composée en grande partie des choses qu'on sent ou qu'on préjuge. » Ce texte est extraordinaire, je conseille à tous ceux qui auront envie de se plonger dans l'étude de ce qu'est la véritable pensée d'une morale que l'on peut dire scientifique de relire Jean-Marie Guyau, que l'on trouve difficilement.
Je voudrais terminer en citant une phrase d'un grand philosophe allemand, Reinhart Koselleck qui, dans le livre Le futur passé , a écrit en 1979 : « Rien dans les Lumières n'écrit que l'affranchissement du christianisme conduit à l'amoralisme et pousse à la décadence, au contraire. » C'est une opinion qu'on peut partager ou ne pas partager, mais il y a débat. Merci.
ÉCHANGES AVEC LA SALLE
Jean-Guy Jaïs
Bonjour. Je suis journaliste et producteur de documentaires historiques. Je voudrais intervenir par rapport aux origines de la laïcité. Le modèle de la laïcité française, le modèle de la Révolution, a eu une grande importance sur le plan international, parce qu'il est à l'origine d'autres modèles, ailleurs, jusqu'en Russie, où la séparation de l'Église et de l'État a été aussi dure, sinon plus dure qu'en France, et jusqu'en Chine. En même temps, ce qui pourrait nous intéresser par rapport à l'islam, il a inspiré un homme comme Atatürk.
La laïcité a existé avant le modèle révolutionnaire et, notamment, dans la période des Lumières, avec un personnage qui a été très important dans la Révolution française et qui est mal enseigné en France, mais qui est enseigné partout ailleurs. C'était un grand ami de Maximilien Robespierre, c'était un des inspirateurs de Napoléon Bonaparte, je veux parler de Pascal Paoli. Il a été à la fois un philosophe et le chef d'État d'un petit territoire indépendant de la République de Gênes avant qu'il n'entre dans la France, la Corse, qui est la république qui s'est dotée de la première Constitution écrite. Pour les Corses, cette Constitution a été promulguée dans un couvent, avec des évêques qui portaient aussi l'éducation et les sciences : le couvent d'Orezza. La laïcité, ce n'était pas un problème à cette époque, même pour Rousseau qui avait un slogan disant que toute l'Europe devrait être corse. La laïcité n'est pas un problème dans la mesure où, lorsque qu'on fait cohabiter des communautés religieuses, à partir du moment où on a des principes forts, on ne se pose pas la question de statufier les relations entre les communautés religieuses. Je voulais resituer cela parce que je pense que, pour des historiens, cela mériterait qu'on fasse un travail de restauration historique. Maintenant que la Corse fait partie de la France, on doit aussi intégrer son histoire et il y a des principes qui peuvent nous inspirer.
Geneviève Thibaut, doctorante en droit canonique
Merci Messieurs les professeurs, pour ces exposés qui nous aident énormément. Ce qui me frappe dans ce débat sur la laïcité, ce sont les paradoxes qui sont soulevés sur trois points importants.
Le premier porte sur la laïcité elle-même : n'est-elle qu'une définition négative ? Nous avons beaucoup parlé de religion et moins de ce que pourrait être une laïcité intrinsèque. Y a-t-il une laïcité intrinsèque ? Peut-on découvrir ou exposer les valeurs républicaines de la laïcité ? Y a-t-il une laïcité positive ? À la fin de votre exposé, M. Levillain, vous avez exposé cet aspect des choses, je crois que c'est important pour le débat de savoir si on peut sortir du débat négatif pour aborder un débat positif.
Le deuxième aspect du paradoxe, c'est le rapport entre individu et communauté : il a été dit qu'au niveau même des lois constitutionnelles, la liberté religieuse a constamment été reconnue, qu'il y avait une continuité pour dire que la liberté religieuse était un droit, reconnu par la loi et à présent par la Constitution. Mais, si elle est reconnue pour un individu, cet individu doit-il être tout seul ? N'a-t-il pas le droit de s'associer à d'autres ? C'est le problème de la communauté, sans tomber dans le communautarisme. Autre paradoxe, comment peut-on passer du droit privé au droit public au niveau de la religion ?
Le troisième aspect concerne la suprématie : on a souvent opposé - cela fait même partie de tout un chapitre de l'histoire de France - ce qui concerne le temporel et le spirituel. Y a-t-il une supériorité du spirituel sur le temporel ? Je crois que c'est M. Grondeux qui a évoqué cette question. D'abord, il me semble que le terme de supériorité est toujours un peu polémique, on pourrait parler, éventuellement, de suprématie : y a-t-il une suprématie du spirituel sur le temporel ? Il me semble que, là encore, on peut dépasser le débat en essayant de voir qu'il y a des champs d'influence différents et que c'est le terme de "pouvoir" qui peut être la délimitation. Mais enfin, sans aller au-delà, je voudrais simplement rappeler - je terminerai par ce sourire à l'actualité théâtrale - que dans une très bonne pièce qui se joue en ce moment, L'Évangile de Pilate , il est intéressant de savoir que la phrase « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » peut-être aussi un principe de droit.
Philippe Levillain
Je cherchais, Madame, pour vous répondre, un texte de Claude Nicolet que je n'arrive pas à retrouver, concernant ce que vous appelez la laïcité positive - j'aime beaucoup citer Claude Nicolet pour qui j'ai la plus grande admiration, même si nous ne partageons pas toujours les mêmes idées -, mais je ne le trouve pas. En tout cas, ce terme d'évolution par rapport à la laïcité, il y a un texte conciliaire qui y répond, qui est la déclaration Dignitatis humanae , du 7 décembre 1965. Il prend acte du fait qu'en réalité, la laïcité est favorable à l'exercice de la liberté de culte. C'était le cas notamment dans les anciens pays de l'Est, en 1965. Réclamer, accepter la liberté religieuse qui est donc acceptée pour les autres confessions - et, comme dit Paul VI dans une intervention, il faut que ce soit la liberté de croire comme la liberté de ne pas croire - fait partie de l'évolution vers une laïcité de type positif. Le débat est traité, d'ailleurs, sous la III e République, sous la question de savoir si c'est un anticléricalisme négatif ou un anticléricalisme positif. Jacqueline Lalouette en traite dans son livre La République et la laïcité . Je crois vous avoir répondu. Je vais chercher pendant que mes collègues vont vous répondre et, si je le retrouve, je vous citerai le texte de Claude Nicolet.
Jacques-Olivier Boudon
Concernant l'exercice de la liberté religieuse et l'éventuelle organisation de communautés, il faut bien se rappeler la méfiance constante de l'État à l'égard de tout ce qui peut apparaître comme l'organisation d'une communauté. En revanche, c'est déjà vrai en particulier avec la Constitution civile du clergé et davantage avec l'organisation concordataire, on voit l'organisation, non pas de communautés, mais d'Églises. Le culte est organisé et le fait d'adhérer à un culte, le culte catholique, les cultes protestants, voire le culte israélite, est déjà la manifestation d'une appartenance à une religion, mais avec la nuance suivante, c'est que l'État est très soucieux d'éviter tout ce qu'on n'appelle pas à l'époque le communautarisme, puisque l'un des objectifs aussi de l'organisation des cultes protestants mais surtout juifs, est précisément d'intégrer ces communautés à la nation.
Je rappelle simplement que les décrets portant organisation du culte juif sont suivis ou accompagnés de décrets qui précisent l'obligation pour les juifs de se plier aux règles de la vie en société, au Code civil. La discussion qui a précédé, dans l'Assemblée des notables, avait porté notamment sur le fait de savoir si les juifs étaient polygames ou bigames, etc. L'État a donc vraiment le souci que la communauté juive s'intègre à la nation et, exemple précis, adopte l'état civil de l'ensemble des citoyens.
Cet aspect des choses est une constante et on peut considérer que toute la question autour des congrégations est liée à ce souci d'empêcher la création de communautés particulières. De ce point de vue, la loi de 1792 interdisant les congrégations, les confréries et également les congrégations laïques est tout de même l'état d'esprit qui prévaut largement au XIX e siècle.
Jérôme Grondeux
Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Jacques-Olivier Boudon. Il faut se rappeler que l'on est dans un pays où, finalement, la liberté d'association n'existe pas véritablement jusqu'en 1901, si on excepte l'épisode de 1848. On n'envisage pas de communauté organisée hors du cadre de l'État.
Ce que vous dites est vrai, mais c'est un point de vue de personne du début du XXI e siècle, c'est-à-dire avec la dose de relativisme, de culte du pluralisme que, bon gré mal gré, on a fini par intégrer. Mais les gens du XIX e siècle, les intellectuels, ceux qui construisent des systèmes de pensée, sont très peu à être pluralistes. Un libéral comme l'anglais Stuart Mill qui dit : « Finalement, peut-être qu'on ne sera pas d'accord sur ce qui fonde la morale, la religion, et puis peut-être que cela va fonctionner comme cela et que ce ne sera pas plus mal », c'est très rare, à l'époque. Les penseurs et les hommes politiques, dans cette France qui a été déchirée par la Révolution, sont plutôt des obsédés du consensus. Ils vivent la déchirure et ils cherchent à retrouver un consensus. L'idée qu'il y ait des champs, le religieux bien dans son domaine religieux, le temporel bien autonome dans son domaine temporel, finalement très peu de gens y adhèrent vraiment. Et, en général, ils ont des arrière-plans métaphysiques très différents : pour les uns, les communautés croyantes sont un obstacle au progrès de l'esprit humain ; pour les autres, hors du fondement religieux, la société va à la catastrophe. Ce sont donc des gens qui ont d'excellentes raisons de s'affronter.
Finalement, cet affrontement a été plutôt bien régulé par la politique. Il a été d'une grande violence symbolique mais il est rarement devenu violent de façon concrète. Les deux camps ont évolué. Ils ont été obligés d'intégrer des choses qui venaient d'ailleurs et qu'ils ne voulaient pas intégrer. Le monde dans lequel nous vivons surprendrait peut-être autant Jules Ferry que Pie IX, parce que les traditions ont dû s'adapter, évoluer de façon un peu forcée.
Philippe Levillain
Pour résumer le texte de Nicolet, il explique une chose très juste : en réalité, tous les penseurs, tous les acteurs de la laïcité, fussent-ils députés, sénateurs, entre 1871 et 1905, restaient tout de même pétris d'un fond de christianisme. En fait, il y a un détachement qui stipule un véritable remodelage au sein d'une société et l'obsession des républicains, c'est l'unité. N'oublions pas que la défaite y est pour quelque chose. Les confessions religieuses sont en tout cas au nombre de trois. Il a été rappelé par Jean-Marc Guislin qu'au moment de la loi de 1875, une proposition a été faite par un député qui s'appelait Brunet pour qu'il y ait une organisation de l'éducation en faveur des Français de confession judaïque. Donc, beaucoup de choses bouillonnent. Mais je crois que la thèse de Nicolet est très forte, en ce sens que se détacher du christianisme pour un athéisme pur et dur, cela existe, mais ce n'est pas majoritaire. Et cela explique les méandres dans lesquels passent la mise en forme de la laïcité et le primat qui est donné à l'école et à l'enseignement. Jean-Marie Mayeur explique que la gratuité stipule précisément qu'il n'y a plus option religieuse, mais qu'il y a nécessité d'éducation laïque.
LA LOI DE 1905 ET SON APPLICATION
Table ronde présidée par Philippe Levillain
Jérôme Grévy, maître de conférences à l'IUFM de Poitiers
Jean Beaubérot, directeur de recherches à l'École Pratique des Hautes Études
Christophe Bellon, doctorant, allocataire de recherches à l'Assemblée nationale
Patrick Cabanel, professeur à l'Université de Toulouse II-Le Mirail
Philippe Levillain
Cette table ronde arrive à l'argument principal : la loi de 1905 et son application. D'abord, Jérôme Grévy, qui a travaillé sur les opportunistes, parlera des lois de 1880 et du Concordat. Ensuite, Patrick Cabanel, professeur à l'université de Toulouse-Le Mirail, parlera du rôle des protestants et de la place du protestantisme dans l'élaboration de la pensée de la laïcité et surtout de la loi de 1905 et de ce qu'il en est advenu, par rapport aux catholiques. Ensuite parlera Christophe Bellon, doctorant, qui prépare une thèse sur Aristide Briand. Enfin, le rôle de la « vedette américaine » sera donné à Jean Baubérot. J'interviendrai parfois pour recentrer le débat, si cela est nécessaire. La parole est d'abord à Jérôme Grévy, maître de conférences à l'IUFM de Poitiers.
L'ÉCHEC DU CONCORDAT RÉPUBLICAIN
Jérôme Grévy, maître de conférences à l'IUFM de Poitiers
La Séparation des Églises et de l'État a souvent été présentée comme la conséquence logique et inéluctable des principes de 1789, enfin mise en œuvre par les radicaux après plus d'un siècle d'affrontements entre les héritiers de la Révolution et ceux de la Contre-Révolution. C'est ainsi que bon nombre de contemporains la vécurent. Selon l'interprétation républicaine, la société avait enfin réussi à se libérer de l'emprise de la religion. C'est pourquoi la loi de 1905 revêtait un caractère exemplaire. De même que la Révolution française avait inauguré un système politique fondamentalement nouveau, la Troisième République était supposée avoir inventé sa traduction en matière de politique religieuse.
Pourtant, les républicains français avaient essayé avant 1905 un autre mode de relation entre l'État et les Églises : le maintien du système concordataire en régime républicain. Or ces années furent un temps de conflit permanent, jalonné de crises et de tensions. Les enjeux furent dramatisés. L'objet de notre communication sera de déterminer pourquoi le système concordataire ne put s'accommoder du régime républicain, au point que la Séparation apparût comme inévitable.
Un anticléricalisme politique...
Les républicains firent de l'anticléricalisme un programme de gouvernement puis un principe d'État. À partir de 1873, exaspérés par les provocations du « parti clérical », ils inaugurèrent dans leurs journaux une véritable campagne de presse contre les jésuites, les congrégations, le pape. Ceux-ci étaient rendus responsables de tous les maux, passés, présents et à venir, de la société. Bien loin d'être des modèles de vertu, ils étaient supposés se livrer à toutes sortes de turpitudes. Surtout, ils tentaient par tous les moyens d'influencer le pouvoir. La question devint particulièrement aiguë après 1875, lorsque la République sembla sauvée : elle était désormais dotée de lois constitutionnelles et les républicains, vainqueurs aux élections législatives de 1876, étaient majoritaires à la Chambre des députés.
La première expérience de concordat républicain ne fut pas concluante. Le premier gouvernement républicain fut constitué en 1876 par le républicain modéré Jules Simon. Celui-ci avait, sous l'Empire, participé à la réflexion sur la question des rapports entre l'État et les Églises. Il estimait que la Séparation constituait un objectif théorique, pour que la liberté de conscience soit pleinement réalisée, mais que les conditions pour la réaliser n'étaient pas remplies. L'État avait le devoir d'entretenir les édifices du culte qui existaient et il s'était engagé, le 2 novembre 1789, à rétribuer convenablement les ministres du culte. Mais Jules Simon était allé plus loin dans son raisonnement : il estimait qu'il était du ressort de l'État d'aller jusqu'à édifier de nouveaux édifices cultuels, car l'existence d'un culte public convenable était la condition de la liberté de culte. « Donner la liberté et refuser les instruments de la liberté, c'est tout uniment ajouter l'hypocrisie à la tyrannie. On doit considérer aussi qu'un culte mesquin, un clergé besogneux, sont à la fois un scandale et un danger publics. C'est une fausse politique et une fausse logique que de souffrir une religion dans l'État et de la condamner à la misère et à la honte 14 ( * ) . » Jules Simon avait également reconnu que, si l'Église s'organisait pour collecter les offrandes et les répartir, on risquait de créer un État dans l'État, alors que le budget des cultes permettait de contrôler plus facilement la perception des recettes et d'assurer l'égalité entre les ministres du culte.
Jules Simon était désireux de marquer les prérogatives de l'État, mais il ne désirait pas inaugurer un gouvernement républicain par des actions de violence. Son libéralisme se trouva pris entre les feux des deux extrêmes, les légitimistes ultramontains qui menaient la politique du pire pour mettre à bas ce régime qui s'installait et les radicaux qui n'avaient de cesse de dénoncer les prétentions de l'Église catholique. Cet équilibre délicat fut mis à mal par la crise de 1877. En cette circonstance, son attitude de conciliation fut débordée par la surenchère des extrêmes : les monarchistes, qui espéraient porter un coup fatal à la République et les radicaux, qui voulaient en finir avec un catholicisme décidément bien trop politisé.
Gambetta, qui s'était imposé comme le leader des républicains, s'efforçait d'infléchir le discours anticlérical dans un sens moins pamphlétaire et plus politique. Il fit de l'anticléricalisme un élément du programme de gouvernement. Le respect de la liberté de conscience devait conduire à mettre d'abord les pouvoirs publics « en dehors et au-dessus des dogmes et des pratiques des différentes confessions religieuses 15 ( * ) . » Il ne combattait ni l'Église ni la religion, mais le cléricalisme, c'est-à-dire l'usage politique qui était fait de la religion par les ennemis de la République. Sa formule du 4 mai 1877 -- « le cléricalisme ? Voilà l'ennemi ! 16 ( * ) » --, doit donc être prise avec précaution : il ne s'agissait pas d'une dénonciation classique de l'Église, mais d'un programme politique, qui identifiait les hommes combattus. Il affirmait lutter non contre les clercs mais contre les cléricaux. Ce terme désignait des hommes politiques qui se servaient de la religion catholique, qui la mettaient au service de leurs idées et leur programme politique : « ... autrefois une foi religieuse ardente, des convictions dogmatiques étaient au fond de ces querelles, tandis que, aujourd'hui, il n'y a qu'un calcul politique, qu'une combinaison de partis déçus dans leurs espérances, une coalition de convoitises dynastiques 17 ( * ) . » Il ne se plaçait pas sur le plan du débat d'idées théologiques et philosophiques, mais circonscrivait la question au champ politique. Les ennemis de la République étaient présents dans toutes les associations catholiques, qu'ils utilisaient pour conquérir le pouvoir. Gambetta désignait nommément les hommes qui selon lui étaient coupables de cette collusion du religieux et du politique : Chesnelong, Ernoul, Depeyre, etc... :
« ... je dis que vous avez poussé le clergé dans l'urne électorale...
( Protestations et dénégations à droite. - Très bien ! Très bien ! et applaudissements à gauche. )
Avez-vous oublié, Messieurs, les mandements de Nosseigneurs les évêques, les brefs d'indulgences, les prières publiques, les triduums auxquels on avait convoqué le ban et l'arrière-ban des fidèles, véritable levée de boucliers de la milice cléricale ? Avez-vous oublié cette ardeur qui précipitait dans chaque chaire de France, non pas un ministre de la Parole de Dieu, mais un ministre de la parole ministérielle, transformant ainsi ce qu'il y a de plus sacré en un moyen électoral au bénéfice de l'entreprise du 16 mai 18 ( * ) ? »
Pour agir, les cléricaux usaient de moyens illégaux, puisqu'ils constituaient des associations clandestines et secrètes, qui savaient détourner et utiliser toutes les ressources du droit à leur profit.
« Tandis que les uns ignorent le droit d'association, ignorent presque le droit de réunion, les autres ont à leur disposition toutes les facultés, tous les privilèges, tous les lieux de réunion ; ils ont toute liberté d'acquérir, de recevoir, de transmettre, de s'agréger, de se dissoudre, de se déguiser, de prendre toutes les formules de l'anonymat, de la commandite ; ils sont les seuls qui, dans la France, ont le privilège d'être placés au-dessus de la loi qu'ils violent sans aucun souci, donnant ainsi au monde le spectacle affligeant d'un État mis en tutelle presque avec son consentement. ( Bravos et applaudissements prolongés à gauche et sur divers bancs au centre. )
Nous en sommes arrivés à nous demander si l'État n'est pas maintenant dans l'Église... à l'encontre de la vérité des principes qui veut que l'Église soit dans l'État 19 ( * ) . »
Ils étaient donc l'exact contrepoint de ce qu'étaient devenus les républicains sous la houlette de Gambetta. Depuis 1871, son action avait consisté pour une bonne part à discipliner les militants, à substituer une culture de responsabilité et de gouvernement à l'esprit de clandestinité hérité de l'Empire. Ce faisant, il avait contribué à définir la République comme un État de droit, tandis que ses adversaires, bonapartistes ou monarchistes, étaient dénoncés comme partisans de l'arbitraire. Ceci explique sans doute l'importance que son argumentation accordait au rapport à la loi, qui laisse transparaître la nature des rapports entre l'État et l'Église dans une société démocratique. Les Églises devaient se soumettre à la loi et donc occuper une position inférieure et subalterne. L'État, garant de l'ordre public, avait donc le droit et le devoir d'intervenir dans les affaires religieuses si celles-ci sortaient du domaine strictement privé.
Le second argument de Gambetta, qui n'était pas nouveau mais qui prenait une coloration nouvelle après la défaite de 1870, était que les cléricaux étaient de mauvais patriotes puisqu'ils se mettaient au service d'un prince étranger. Les cléricaux appartenaient à une organisation antifrançaise. De nombreux intellectuels accusaient alors l'enseignement primaire, géré jusqu'alors par l'Église, d'être responsable des désastres militaires 20 ( * ) . Par glissement, on en vint à dénoncer les congrégations enseignantes : en laissant volontairement le peuple dans l'ignorance, elles avaient préparé la déroute des armées françaises. 21 ( * ) L'instituteur prussien l'avait emporté sur les Frères des Écoles chrétiennes et les Jésuites. Ceux-ci, en particulier, ne pouvaient être que des ennemis de la France, des agents de l'étranger puisque leur patrie était à Rome. Autour du pape s'était constituée une internationale cléricale redoutable. Depuis la proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale, les évêques et les prêtres s'étaient rangés d'un seul élan sous la bannière du pape. Il n'y avait plus d'opposants, l'unanimité la plus absolue régnait 22 ( * ) . « Ce n'est pas seulement en France qu'on fait appel à toutes les populations catholiques ; dans toute l'Europe, dans tout l'univers, on voit des pasteurs se lever, prononcer les mêmes discours, écrire les mêmes lettres, se livrer à la même ardente propagande 23 ( * ) . »
S'appuyant sur cet argument, Gambetta se posait en défenseur du gallicanisme. Au moment où l'on discuta les lois sur l'enseignement supérieur, il présenta les républicains comme les héritiers des rois, puisqu'ils défendaient la religion nationale contre les prétentions ultramontaines 24 ( * ) . Il s'indignait de ce que le pape s'adressait aux catholiques de France sans en référer au pouvoir civil 25 ( * ) . Cherchant à rouvrir la fracture entre gallicans et ultramontains, il opposait volontiers le prêtre de paroisse, proche de ses ouailles, au congréganiste, qui poursuivait d'autres buts. À partir de 1876, Gambetta distingua soigneusement, dans ses discours, le « parti clérical », les Jésuites, les congrégations, d'un côté, et la religion, les catholiques et le prêtre français, de l'autre. Le parti républicain n'entendait pas combattre la religion, mais l'ingérence de l'Église dans la vie politique 26 ( * ) .
Gambetta avait saisi qu'une politique ouvertement antireligieuse était dangereuse car elle risquait de précipiter les modérés et tous les catholiques dans le camp antirépublicain. La République devait se garder de déclencher une nouvelle guerre de religion qui, à terme, risquait de faire le lit d'un nouveau despotisme réactionnaire. Il convenait donc de ne pas attaquer la religion, mais l'ultramontanisme. Désormais, il fallait distinguer le clergé séculier du clergé régulier ; les républicains pouvaient attirer « le prêtre des campagnes vivant au milieu des populations ». En revanche, ils devaient « combattre à outrance les corporations en qui s'incarne l'ultramontanisme 27 ( * ) ».
En somme, le cléricalisme devait être combattu parce qu'il se proposait de conquérir l'État et de diriger les foules 28 ( * ) , en usant de moyens illégaux. Il était donc contraire à la démocratie définie comme un État de droit. Les congrégations étaient montrées du doigt car elles étaient des organismes allogènes, au service d'intérêts qui n'étaient pas ceux de la France. À l'heure où le nationalisme en gestation diffusait l'image de la nation comme un tout homogène et unitaire, l'existence d'une institution qui n'était pas soumise à l'État central paraissait un ferment de dissolution. Dans la France centralisée, héritée de l'absolutisme royal et du bonapartisme, il n'était pas admissible que la religion fût organisée et administrée selon ses propres intérêts. Un État républicain fort constituait la seule réponse possible à la puissance de la « caste sacerdotale » 29 ( * ) .
Le programme politique qui en découlait était clairement établi. Fidèle à sa vocation révolutionnaire, la France devait devenir « la nation laïque par excellence ». Pour Gambetta, la France avait une mission à remplir, pour elle-même et pour l'Europe, qui consistait à délivrer les populations des « étreintes de la politique ultramontaine 30 ( * ) », afin de permettre aux principes de « l'Évangile de 1789 » de définitivement l'emporter sur le jésuitisme et le Syllabus 31 ( * ) . Dans cette perspective, le concordat devait être maintenu par « opportunisme » ; il constituait le meilleur instrument de contrôle du clergé :
« Depuis tantôt trente ans, dans ce pays, on s'est habitué sous l'influence de doctrines lâches et molles, sous l'influence de sophismes, contre la puissance de l'État, contre le rôle de l'État, à prêter la main à tous les envahissements, à toutes les usurpations de l'esprit clérical (...)
On a demandé à enseigner, d'abord les petits, les humbles, puis on s'est élevé, on est passé à l'enseignement secondaire, et aujourd'hui nous voici à l'enseignement supérieur, à la collation des grades par les universités catholiques au détriment de l'État [...]
Nous en sommes arrivés à nous demander si l'État n'est pas maintenant dans l'Église, à l'encontre de la vérité des principes qui veut que l'Église soit dans l'État [...]
Quant à moi, [je suis] partisan sincère du système qui rattache l'Église à l'État (...) Oui ! J'en suis partisan, parce que je tiens compte de l'état social et moral de mon pays, mais je ne veux, entendez-le, je ne veux défendre le Concordat et rester fidèle à cette politique, que pour autant que le Concordat sera interprété comme un contrat bilatéral qui vous oblige et vous tient, comme il m'oblige et me tient ! (Vifs applaudissements à gauche et au centre) . » 32 ( * )
La campagne de 1877 se fit sur le thème de l'anticléricalisme. La victoire persuada Gambetta que son argumentation avait convaincu les électeurs. Il n'hésita pas à la reprendre en 1881, en agitant le danger d'un retour toujours possible des cléricaux et en dénonçant « ... une Église qui avait pris à tâche de combattre l'esprit humain dans toutes ses libertés, dans toutes ses franchises, de ramener violemment la France aux pires traditions du passé 33 ( * ) . » La République devait contraindre le clergé à être « le respectueux serviteur du régime que la France s'est librement donné 34 ( * ) . »
« Le cléricalisme a été vaincu et abattu, mais il n'est pas mort. (Mouvement.) Et je pense qu'il y a mieux à faire qu'à le traiter selon des formules plus ou moins creuses. Il faut s'enquérir de ce qu'il détient encore de puissance administrative et publique ; il faut se livrer à un travail minutieux d'enquêtes et d'investigations sur les forces de son influence et de son crédit ; lui couper toute espèce de communication avec l'administration laïque et politique, rayer ces privilèges, ces prérogatives que lui confère le décret de messidor et dont il tire si grande vanité ; examiner son budget, le réduire et le maintenir dans les limites de la législation concordataire 35 ( * ) . »
Paul Bert fut l'une des figures les plus représentatives de cette évolution. Appartenant à l'aile gauche de l'Union républicaine, groupe parlementaire de Gambetta, il n'avait jamais caché ses ressentiments très virulents contre les Jésuites et le cléricalisme que, en élu de pays vigneron, il considérait comme un fléau semblable au phylloxera. Ministre de l'Instruction publique et des cultes, il définit devant l'Administration des cultes la ligne qu'il entendait suivre. La police des cultes devait veiller à l'exécution des lois qui réglaient les rapports des Églises avec l'État en exécutant strictement les lois concordataires. Il estimait que toute la politique de l'Église, depuis l'établissement du contrat concordataire, avait consisté à augmenter ses privilèges, aux dépens de l'État et de la société civile. Le travail en voie d'accomplissement consistait à retourner au Concordat et aux articles organiques 36 ( * ) . Paul Bert estimait que le concordat n'était sans doute pas la meilleure manière de régler les relations entre État et Église, mais il entendait le conserver et le faire appliquer par souci politique : « ...nous voyons dans le Concordat la garantie la plus sûre contre les envahissements de l'Église catholique, qui marche constamment en avant. » L'objectif, à terme, restait la séparation : « Nous voyons, dans sa stricte exécution, la ressource la plus certaine pour ajourner à son temps ce grand mouvement qui commence dans le pays et qui nous porte vers la séparation de l'Église et de l'État, mouvement qui n'a eu pour raison d'être que le spectacle des faiblesses des uns et des intempérances des autres 37 ( * ) . »
Ainsi, dans la bouche des républicains opportunistes, le combat opposait deux adversaires politiques, dont l'un se servait de la religion pour conquérir le pouvoir. Les mesures anticléricales seraient prises pour empêcher que le clergé apportât le moindre appui aux conservateurs désireux de renverser la République. Cette expérience de trois décennies apparut rétrospectivement comme un échec car elle feignait d'ignorer que l'anticléricalisme n'était pas déterminé exclusivement par le sens des prérogatives de l'État. Certains étaient en effet animés par une animosité virulente contre la religion.
... superposé à des anticléricalismes d'essence religieuse
Cette analyse strictement politique ne doit pas en effet occulter la dimension religieuse du conflit. Pour les protagonistes, il ne s'agissait pas seulement d'un processus de conquête du pouvoir, mais d'un choix entre deux modèles de société absolument exclusifs, qui eux-mêmes reposaient sur des conceptions de l'homme fondamentalement différentes. Qu'il s'agisse d'une détestation du catholicisme ou de sentiments irréligieux, ces conceptions étaient animées par une mystique qui donnait au conflit le caractère d'une guerre de religion.
Sous le Second Empire, l'anticléricalisme était devenu l'un des éléments essentiels de l'idée républicaine. Alors que la Seconde République avait été mystique et qu'elle avait pensé réconcilier le christianisme et la démocratie, une nouvelle dissociation s'était opérée qui, comme en 1793, les avait dressés l'un contre l'autre comme deux systèmes absolument irréconciliables. Le combat était plus qu'un débat opposant des doctrines politiques. Il s'apparentait à une véritable guerre de religion. En effet, il ne s'agissait pas de confronter des points de vue adverses, mais de combattre un ennemi avec lequel l'entente était impossible car impensable. Chacun était persuadé qu'il détenait la vérité, qu'il incarnait le bien, tandis que l'autre était dans l'erreur, représentait le mal. La lutte ne pouvait se terminer que par la victoire finale et définitive de l'un des combattants.
En effet, les doctrines en présence ne se contentaient pas d'élaborer un point de vue sur les pouvoirs. Elles étaient sous tendues par des visions de la société et de l'homme qui ne paraissaient pas compatibles. À ce titre, l'anticléricalisme était plus qu'une haine à l'égard du clergé et un refus d'une religion dogmatique. Il mettait en jeu un système de croyance qui touchait aux fondements de l'existence. C'est ce qui explique la dramatisation du conflit et qui nous permet d'affirmer qu'il s'agissait d'une guerre de religion.
Il convient de remarquer ici que des différences notables existaient entre les anticléricalismes, qui étaient plus que des nuances et qui les empêchaient de construire un projet commun de société. Certains, comme Jules Simon, étaient spiritualistes. Sensibles à la dimension métaphysique des religions, ils se refusaient à choisir entre elles et estimaient que la seule réponse possible dans une société moderne était un régime de liberté, qui donnerait à chaque individu la possibilité de choisir celle qui lui conviendrait le mieux. Leur pluralisme était exaspéré par la prétention qu'avait l'Église catholique de détenir la vérité. Suivant une démarche de philosophe, Jules Simon entendait se laisser guider par sa seule raison.
D'autres, comme Edgar Quinet, Renouvier ou Ferdinand Buisson, dénonçaient dans le catholicisme un dévoiement du message évangélique. Ils estimaient que, depuis les temps apostoliques, l'Église catholique détournait de leur sens les évangiles et utilisait le message du Christ à la seule fin d'établir son pouvoir. Aux origines se trouvait une supercherie, une captation d'héritage. Depuis, l'Église s'était substituée à la religion du Christ. Le catholicisme, loin d'avoir permis l'accomplissement de la pensée évangélique, en constituait une dégradation. Quelques hommes avaient utilisé le message d'un prophète hors du commun, d'une « personne supérieure 38 ( * ) », pour établir leur pouvoir, qui avait pris la forme d'une Église hiérarchisée et dogmatique. La religion de Jésus, qu'ils admiraient, n'avait pas besoin de dogmes à croire aveuglément ni de clercs pour les enseigner.
Cette thématique était née du temps de la réforme protestante. Les exégètes allemands avaient, au XIX e siècle, donné une caution scientifique à cette interprétation et considéré les évangiles comme l'expression des croyances des premiers chrétiens et la justification de leur organisation plus que comme un récit véridique des gestes et paroles de Jésus. Toute l'histoire de la chrétienté était relue à l'aide de cette grille d'interprétation. L'Église de l'Antiquité avait par la violence détruit le paganisme. L'alliance de l'Empire et de l'Église, réalisée par Constantin, avait ouvert la voie à des siècles d'intolérance et de persécution. L'Église du Moyen Âge - c'est le terme utilisé le plus fréquemment par Quinet -, n'était qu'une institution humaine dont la seule fin était d'établir un pouvoir théocratique. Renouvier publia en 1857 un livre d'histoire-fiction, Uchronie , dans lequel il imaginait ce qui serait advenu si les empereurs romains avaient réussi à vaincre le christianisme. Il supposait que le monde aurait pu marcher beaucoup plus tôt vers le progrès et le bonheur 39 ( * ) .
Les républicains se donnaient pour les héritiers de tous ceux qui, de Giordano Bruno à Girolamo Savonarole en passant par Galilée, Etienne Dolet 40 ( * ) et Michel Servet avaient contesté l'ordre établi et avaient été persécutés. On élabora un récit mythologique et magnifié, tragédie jalonnée de grands moments, sublimée par ses héros. Cette relecture du passé s'accompagna de l'érection de la Révolution en moment de re-fondation de la liberté : en 1789, la nation française avait retrouvé ses principes fondateurs qui, depuis des siècles, s'étaient en vain efforcés de briser le carcan indûment imposé par l'Église.
Le dogme de l'infaillibilité pontificale, proclamé par Pie IX en 1870 lors du concile du Vatican, constituait pour les anticléricaux la preuve incontestable de ce que l'absolutisme ecclésial reposait sur des fondements archaïques. Le pape refusait la moindre mise en cause de son pouvoir en invoquant son origine divine. Les anticléricaux n'avaient pas de mots assez durs pour dénoncer cet « infaillibilisme ».
Un dernier anticléricalisme était plus minoritaire. Il combattait non une religion mais la religion. Inspiré de matérialisme et de scientisme, il considérait que le fait religieux était l'apanage des sociétés archaïques, qui inventaient des dieux pour expliquer les phénomènes naturels mystérieux dont la cause était inconnue. Ferry, qui disait n'avoir pour sa part plus besoin des « béquilles théologiques », estimait que l'enseignement de la science finirait, à terme, par faire disparaître la religion.
Ce point de vue se généralisa au tournant du siècle. La plupart des socialistes souscrivaient à cette analyse de la religion. À leurs yeux, le clergé et la religion étaient au service des classes possédantes. C'est pourquoi ils acceptèrent, en 1905, de faire alliance avec les radicaux, qu'ils considéraient cependant comme des représentants de la petite et moyenne bourgeoisie, pensant qu'il serait ensuite possible de passer aux réformes sociales. Lors de la discussion sur la loi de Séparation, Maurice Allard se distingua par la virulence de son propos et son projet explicite de porter un coup fatal à la religion :
« Il faut le dire très haut : il y a incompatibilité entre l'Église, le catholicisme ou même le christianisme et tout régime républicain. Le christianisme est un outrage à la raison, un outrage à la nature. (Bruits à droite) Aussi je déclare très nettement que je veux poursuivre l'idée de la Convention et achever l'œuvre de déchristianisation de la France qui se poursuivait dans un calme parfait et le plus heureusement du monde jusqu'au jour où Napoléon conclut son Concordat (...) Pourquoi nous républicains et, surtout, nous socialistes, voulons-nous déchristianiser ce pays ? Pourquoi combattons-nous les religions ? Nous combattons les religions parce que nous croyons, je le répète, qu'elles sont un obstacle permanent au progrès et à la civilisation. Le jour où le Dieu anthropomorphe des Juifs quitta les bords du Jourdain pour conquérir le monde méditerranéen, la civilisation disparut du bassin de la Méditerranée, et il faut remercier les empereurs romains qui ont combattu de toutes leurs forces l'invasion de cette philosophie puérile et barbare, si contraire au panthéisme et au naturalisme de notre race ; il faut remercier Julien l'Apostat qui fit tous ses efforts pour combattre le fléau. (...)
Et plus tard, quand le christianisme quitta Rome et la Grèce où il avait étouffé toute civilisation et où il n'avait laissé que ruines et décombres et arriva en France, il n'y eut plus en notre pays, ni arts, ni lettres, et surtout ni sciences (Bruits à droite) .
Il fallut la Renaissance, il fallut la Révolution française pour redonner au cerveau de notre race sa véritable puissance de normale évolution et sa possibilité de progrès. Sous l'influence du judéo-christianisme, toute lumière avait disparu ; il n'y avait plus que ténèbres. Aujourd'hui encore, combien de progrès ne se sont pas réalisés parce que nous traînons derrière nous ce lourd boulet de judéo-christianisme avec son cortège de préjugés et de mensonges traditionnels.
Nous combattons donc la religion parce que nous voyons dans la religion le plus grand moyen qui reste entre les mains de la bourgeoisie, entre les mains des capitalistes, pour conserver le travailleur dans un état de dépendance économique. Voilà pourquoi nous faisons la guerre à tous les cultes et pourquoi nous en sommes les adversaires les plus acharnés 41 ( * ) . »
Le 3 juillet, dernier jour de la discussion à la Chambre des députés, il promit de « prendre d'assaut les églises et les chapelles » pour parachever l'œuvre que les Conventionnels n'avaient pu conduire à son terme.
Une véritable mystique anticléricale fut élaborée. Elle relisait le passé comme une longue lutte de libération. Elle célébrait ses prophètes, persécutés par l'Église. Elle se donnait une mission à remplir impérativement, pour le bien de l'humanité. Aucun doute : l'anticléricalisme empruntait à la religion certains de ses traits. Il ne s'agissait pas seulement d'une parodie. Le ton usité et la dramatisation des enjeux nous conduisent à penser que tous prenaient à coeur cette vision du combat à mener. Cette œuvre de salut public libérerait les hommes de la servitude à laquelle les clergés les avaient réduits.
Ces anticléricalismes n'étaient pas séparés par des cloisons étanches. Les arguments des uns étaient repris, développés, complétés par les autres. Déistes ou athées, ils estimaient que l'homme devait être absolument maître de son destin et que tout clergé, qui tirait son autorité du dogme, devait disparaître des sociétés humaines modernes. Leur modèle repoussoir était la religion catholique, dont la dogmatique et les formes de la piété paraissaient absolument contraires à la raison. Une haine virulente était exprimée à l'égard de l'Église catholique dont le principe et l'organisation étaient dénoncés comme incompatibles avec les fondements des sociétés démocratiques.
Un conflit permanent
Les différents anticléricalismes reposaient sur des fondements divergents, voire antagonistes, mais ils se trouvèrent d'accord pour fustiger le catholicisme, qui représentait tout ce qu'ils rejetaient : un clergé riche, amoral et apatride, organisé comme une monarchie absolue, et cherchant à asservir les esprits et les corps. Au nom de la liberté et par crainte d'une réaction, il ne pouvait être question d'instituer une nouvelle Terreur. Aux yeux des opportunistes, il suffirait de développer un enseignement scientifique pour que la religion disparaisse d'elle-même. Le peuple, éclairé, se détournerait des archaïques superstitions que véhiculait la religion catholique. En attendant, il s'agissait de limiter l'influence du clergé sur les populations.
La position des républicains de gouvernement était lourde de conséquence. L'anticléricalisme d'État était ambigu. De contrat synallagmatique, qui obligeait les deux parties, le Concordat devint un outil de contrôle du clergé entre les mains de la République. Interprétant les textes dans un sens restrictif, les gouvernements successifs donnèrent au clergé le sentiment d'être surveillé, voire harcelé, sans autre objectif que de porter atteinte à son autorité.
Une première mesure impressionna l'opinion publique : en 1880, les congrégations non autorisées, à commencer par les Jésuites, furent expulsées de leurs bâtiments, monastères ou collèges. Le gouvernement républicain entendait montrer que force était à la loi et que la République savait faire respecter son autorité. Jules Ferry, qui décida ces opérations, entendait toucher le cléricalisme en son organe vital, l'enseignement. Il donnait également des gages à l'extrême gauche, dont le soutien lui était nécessaire 42 ( * ) .
L'État établit une discipline ecclésiastique plus étroite que jamais et que même la réforme tridentine n'était pas parvenue à accomplir. Tout membre du clergé était contraint à résidence et devait solliciter des pouvoirs publics toute autorisation de sortie du territoire national, notamment pour se rendre à Rome. L'évêque et les curés devaient être présents à certaines cérémonies officielles et devaient, jusqu'à 1884, rendre des hommages publics aux autorités républicaines. Ils devaient également accepter de voir flotter le drapeau tricolore au sommet du clocher ou à la porte du presbytère pour le 14 juillet. Le maire pouvait requérir l'usage des cloches pour certaines cérémonies civiles. Ce fut le cas lors des festivités du centenaire de la Révolution, ce que d'aucuns perçurent comme un véritable sacrilège. Les prêches et les leçons d'instruction religieuse étaient l'objet de surveillance, de même que la conduite du curé. Tout écart était bien vite signalé par des fidèles, parfois par lettre anonyme. La préfecture ordonnait une enquête et prenait les mesures qui s'imposaient.
Ce faisant, l'État se faisait, à son corps défendant, théologien. Le culte et la religion étant considérés comme un service public, les curés ne pouvaient imposer de conditions pour administrer les sacrements. Tout refus d'admettre un enfant à la première communion était perçu comme un acte politique à l'encontre de la famille de celui-ci De même, certaines municipalités interdisaient, au nom de l'ordre public, les cérémonies extérieures du culte. Processions et pèlerinages, parfois fort anciens, étaient considérés comme des formes de dévotion dont l'objet était de manipuler les fidèles en entretenant de vieilles superstitions.
La République avait à sa disposition une gradation des instruments de pression pour se faire respecter : le blâme, le déplacement, la suspension de traitement. L'arme financière était d'autant plus redoutable que le clergé du XIX e siècle était le plus souvent d'origine fort modeste, rurale le plus souvent, et qu'il n'avait d'autre moyen de subsistance. C'est pourquoi le plus souvent, la simple menace de suspension suffisait à ramener le curé contestataire à résipiscence.
De leur côté, en effet, certains curés et religieux attisaient la discorde. Persuadés que la République était le mal, ils multipliaient les actes de résistance, voire de provocation. Refus de sonner les cloches et de pavoiser le 14 juillet, de donner la première communion aux enfants qui fréquentaient l'école publique, organisation de processions en dépit des interdictions, allusions politiques voilées lors des sermons émaillaient le conflit dans certaines communes, qui se partageaient entre les partisans de l'Église et ceux de la République. Au tournant du siècle, lors de processions ou de pèlerinages, la confrontation avec les anticléricaux n'était pas rare.
La société semblait irrémédiablement séparée en deux ensembles rivaux, à en croire un certain nombre d'observateurs, dont un instituteur des Deux-Sèvres :
« La population marchait sur deux voies parallèles : deux enseignements, deux musiques, deux bibliothèques populaires, deux sociétés à allure sportive (la gymnastique à droite, le tir à gauche), deux sociétés de secours mutuels, deux salles des fêtes, deux comités (le républicain, et les hommes catholiques du Poitou) ; deux groupes séparaient les conscrits pour les festivités annuelles, un seul, celui des républicains, avait le drapeau tricolore. Cependant, une seule subdivision de pompiers qui relevait de la Préfecture ; sinon on aurait vu des incendies de droite et des incendies de gauche. La division était étendue à la vie économique. On voyait, avec des opinions bien marquées, deux médecins, deux pharmaciens, deux hôtels, deux marchands de journaux : le républicain et la bonne presse. Les cafés, les maisons de commerce, les artisans étaient tous également catalogués, et certains n'avaient guère que la clientèle de leur parti. Bien qu'en minorité dans le bourg, les républicains n'étaient pas lésés, grâce à la clientèle massive et fidèle des protestants 43 ( * ) . »
Des deux côtés, les militants se mobilisaient pour défendre leur cause. Les catholiques se préparaient à revivre les persécutions de l'Église primitive ou celles de la Terreur, tandis que les républicains agitaient le spectre de l'Inquisition et des Croisades. Les pouvoirs publics se présentaient alors comme garants de l'ordre public et justifiaient ainsi des mesures autoritaires à l'encontre du clergé.
Les années 1890 virent malgré tout une tentative de pacification, concrétisée par « le ralliement » et l'esprit nouveau qui était supposé présider aux relations entre la République laïque et l'Église catholique. Mais l'Affaire Dreyfus fit rejouer les antagonismes. L'alliance des nationalistes et des catholiques intransigeants entraîna, en réaction, la reconstitution d'une majorité de défense républicaine. Waldeck-Rousseau puis Combes, aiguillonnés par les anticléricaux, prirent des mesures qui, à terme, conduisirent à la Séparation.
Conclusion
Pouvoir civil et pouvoir religieux ne dialoguaient plus et n'avaient plus que des rapports basés sur la force, l'intimidation, la violence. Le cadre concordataire n'était pas responsable de cet état de fait, mais il ne pouvait l'empêcher. La Séparation, définie comme absence de relations officielles entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux, apparut comme l'unique issue de cet affrontement. Elle établissait une barrière entre le civil et le religieux.
Exaspérés des provocations des catholiques intransigeants, les anticléricaux voulurent faire la loi de Séparation pour affaiblir l'Église catholique et faire de la religion une affaire strictement privée. Inquiets des menaces des anticléricaux les plus virulents, les catholiques n'en voulaient pas car ils craignaient que ce ne fût une nouvelle étape avant une persécution plus radicale encore. C'est pourquoi la loi de 1905 fut élaborée dans un climat de quasi guerre civile.
Philippe Levillain
Je vous remercie beaucoup : vous avez dit des choses très importantes. La parole est à Patrick Cabanel.
PATRICK CABANEL44
(
*
),
professeur à l'Université de Toulouse II - Le Mirail
Les organisateurs m'ont demandé de parler des protestants, et je vais le faire bien volontiers, tout en signalant que des choses très comparables peuvent être dites à propos des juifs confrontés au processus de Séparation.
Commençons par reprendre ce proverbe yiddish, célèbre chez les juifs allemands : « Heureux comme Dieu en France ». Oui, le Dieu des protestants, et celui des juifs, ont été des Dieux heureux dans la France concordataire du XIX e siècle. N'allons donc pas imaginer que les protestants et les juifs aient demandé et souhaité la Séparation. Ils l'ont acceptée, ils l'ont même accompagnée, d'une manière à la fois confiante et critique, mais ils n'étaient pas plus désireux que les catholiques de rompre avec les privilèges que leur accordait le système concordataire, ou système des « cultes reconnus ». Je dois préciser que le mot « concordataire » ne peut, en justesse de termes, s'appliquer ni aux protestants, ni aux juifs (seul le Saint-Siège signe des concordats avec les États) ; il est vrai, en revanche, que quatre cultes, catholique, calviniste, luthérien et juif ont bénéficié à partir de 1802 pour les trois premiers (via les articles organiques), de 1808 et 1831 pour le dernier, de leur reconnaissance par l'État.
Cette reconnaissance a beaucoup apporté aux protestants et aux juifs, parce qu'elle leur offrait une forme d'égalité sans précédent, devant la loi et l'État, avec la puissante, historique et jadis intolérante Église catholique. Avoir des pasteurs et rabbins aumôniers dans les grands lycées de l'État, jouissant des mêmes prérogatives que l'aumônier catholique, cela est précieux. Avoir accès à l'argent public pour financer la formation et les activités de son clergé, est également précieux, quand on sort du « Désert » (les protestants) ou du ghetto. Bâtir ses temples au grand jour, ici encore avec des aides de l'État, revêt une signification plus forte encore pour des protestants dont la totalité des temples avaient été rasés sur l'ordre de Louis XIV, dans les années 1680. On peut parler à ce propos d'un authentique vandalisme monarchique, qui a définitivement privé la France d'une partie de son patrimoine religieux et architectural, les grands temples bâtis au XVII e siècle à Charenton, Caen, Rouen, La Rochelle, Montpellier, Nîmes, Orange, etc. L'État du XIX e siècle a offert une forme de réparation nationale aux protestants en les aidant à rebâtir leur parc cultuel. Et les synagogues se sont multipliées à leur tour dans les principales villes. Ce sont là, pour deux minorités habituées à moins de clémence de la part de la nation, de profonds motifs de satisfaction.
Aussi ne demandent-elles pas la Séparation. À une exception, il est vrai, celle d'une minorité à l'intérieur d'une minorité : ces protestants marqués par le mouvement du Réveil, à partir des années 1820-1840, et qui estiment qu'une Église doit être libre de tout lien avec l'État si elle entend garder intacte la fibre évangélique et contribuer au salut de ses membres et de la société. Ceux-là ont rompu dès 1849 avec le système des cultes reconnus. Mais, répétons-le, ils sont une minorité. Le gros des troupes protestantes, et plus encore chez les juifs, se satisfait de l'organisation mise en place en 1802.
Il y a même, dans les premières années de la III e République, un accord plus intime entre le régime et les deux minorités religieuses. Prenons les protestants, de loin les plus nombreux et les plus influents. On peut dire qu'ils ont fait un rêve, dans les années 1870 et 1880 : non pas celui d'une revanche de la Réforme en France (quelques-uns tout de même l'ont souhaitée explicitement), mais d'une possible transformation de la nation en une République à l'américaine, en quelque sorte. À partir de la démonstration suivante : le cléricalisme (catholique), certes, est condamné dans une République que lui-même ne manque jamais de condamner. Mais s'il existe un religion non cléricale, vraiment républicaine, alors pourquoi la République ne pourrait-elle pas être religieuse, comme l'est celle des États-Unis ? S'il existe une religion laïque, comme n'hésitent pas à dire certains théologiens et philosophes protestants, alors la laïcité pourrait être religieuse ? Et ne pas se limiter à une séparation, une neutralité, encore moins un refus anticlérical ? Cette religion républicaine et laïque, les protestants sont persuadés qu'il s'agit de la leur, et qu'ils peuvent la mettre à disposition de la France ; les juifs se trouvent sur une position très voisine, et peuvent même se targuer du privilège de l'antériorité, lorsqu'ils font de Moïse le premier législateur moderne, avant un Calvin !
Les uns et les autres, les protestants surtout, alors répandus dans divers cercles dirigeants, surtout pédagogiques, souhaitent édifier une République qui n'ait pas peur du religieux, qui sache prendre en charge la question du sens, comme nous le dirions aujourd'hui. L'ancien théologien protestant Félix Pécaut, devenu à l'École normale supérieure de Fontenay-aux-Roses la conscience parfois tragique de la laïcité, allait disant qu'un peuple ne se nourrit pas seulement de pain, mais qu'il faut lui apprendre à vivre, et aussi à mourir. Son compagnon Ferdinand Buisson, dont le rôle majeur auprès d'un Ferry et bien au-delà a été fortement réévalué par l'historiographie, n'a pas hésité à rédiger un long et stupéfiant article « Prière » dans son Dictionnaire de pédagogie , publié au début des années 1880. Non pas pour parler du catéchisme et de la prière collective à l'école, que la loi de 1882 venait de supprimer. Mais pour mettre l'accent sur la prière personnelle, sur ce dialogue avec des choses qui nous excèdent, des abîmes extérieurs et intérieurs (Pascal et Kant ne sont pas loin), dialogue dont ont besoin les individus et les sociétés, sous peine de s'empêtrer dans une conception strictement matérialiste, et bientôt violente, des êtres et des échanges. Si la morale de Jésus ne peut plus être donnée comme telle, alors l'impératif catégorique de Kant nourrira la morale laïque : et c'est un philosophe converti au protestantisme, Charles Renouvier, lui aussi redécouvert récemment, qui effectue ce travail de passeur entre l'univers du penseur allemand et celui du jeune régime issu de la défaite de 1870...
Mais cette affinité, pour féconde qu'elle ait été, n'a eu qu'un temps. L'affaire Dreyfus a accéléré la montée en puissance d'une laïcité nouvelle, formée dans ses propres écoles, plus sûre d'elle-même, plus agressive à l'égard du catholicisme et, il faut bien le dire, parfois peu soucieuse de distinguer entre les variétés de christianisme. Aux yeux de cette nouvelle génération, le cléricalisme, le militarisme, l'antidreyfusisme ont compromis l'ensemble des religions ; le protestantisme lui-même n'a plus rien à apporter, en dépit de son dreyfusisme massif. La démocratie française, dont la seule source est à chercher dans les Lumières et la Révolution, est devenue adulte, elle n'a plus à passer par les ménagements que le protestantisme, vingt ans auparavant, pouvait offrir aux plus habiles ou aux plus pusillanimes.
Du coup, les protestants se montrent à leur tour plus vigilants : ils découvrent une laïcité qui n'est pas celle qu'ils avaient voulu bâtir. Ils ne vont pas hésiter à pratiquer une opposition constructive, pour ne pas dire de lobbying. Ils savent qu'ils peuvent encore peser sur le cours des choses, parce qu'ils ne sont pas politiquement suspects aux yeux des républicains, sauf chez de rares extrémistes. Un catholique qui s'oppose à la Séparation (et beaucoup sont dans ce cas) est littéralement inaudible, tant les positions sont alors irréconciliable ; un protestant qui prétend que les projets de loi peuvent et doivent être améliorés, dans un sens plus libéral à l'égard des Églises, peut espérer être écouté, et même entendu.
C'est en partie ce qui s'est passé. En quelques mots, on peut rappeler que le projet de Séparation présenté par le gouvernement d'Émile Combes, à l'automne 1904, a été la cible d'une attaque patiemment ourdie par les milieux protestants, puis épaulée par un Péguy qui publie à deux reprises ces campagnes de presse dans les Cahiers de la Quinzaine . Pourquoi cette rupture ? Combes redoutait le pouvoir de nuisance d'une Église catholique parlant d'une même voix au niveau national, et son projet prévoyait donc d'interdire toute union d'Églises au-delà du cadre départemental. Ce faisant, il aurait gravement compromis -- mais sans l'avoir cherché ! --, les intérêts des protestants et des juifs, trop peu nombreux et trop disséminés pour ne pas avoir à demander à une organisation nationale des ressources, des clercs, des structures de formation et de publication, etc.
Le projet du gouvernement écarté, on sait qu'Aristide Briand a travaillé pour l'essentiel à partir de textes de loi déposés par les députés Francis de Pressensé et Eugène Réveillaud, le premier fils de pasteur, le second protestant converti très orthodoxe. On sait aussi que le vote décisif, et le plus largement acquis, a couronné la nouvelle mouture de ce qui allait devenir l'article 4 de la loi : une rédaction proposée par F. de Pressensé, et qui sauvegardait rien moins que l'autorité absolue de l'évêque sur les futures associations cultuelles de son diocèse. Ce faisant, la loi républicaine stipulant la fin de la reconnaissance des cultes... reconnaissait discrètement mais clairement le fonctionnement hiérarchique, absolument non démocratique, du pouvoir dans l'Église. Les députés catholiques ne s'y sont pas trompés, qui ont voté cet article ; et pas plus le Vatican. Certes, la loi dans son ensemble a été solennellement condamnée par le pape Pie X (1906) ; mais moins de vingt ans plus tard (1924), Pie XI autorisait la formation d'associations diocésaines qui entraient dans le cadre de la loi, préparant ainsi la voie à un ralliement de l'Église à une Séparation dont elle vante aujourd'hui l'excellence.
Pourquoi des protestants, au-delà de leurs préoccupations confessionnelles propres, ont-ils cherché à obtenir une loi dont l'Église catholique puisse un jour reconnaître le bien fondé ? Ce n'est ni par oecuménisme avant la lettre, ni par générosité à l'égard d'une Église pour laquelle bien peu, alors, nourrissent la moindre sympathie. J'oserai dire que c'est par un intérêt doublement bien compris : intérêt des minorités religieuses, intérêt de la République elle-même, l'un et l'autre évidemment indissolubles. Bâtir une loi trop agressive à l'égard d'un catholicisme qui certes ne l'était pas moins, c'était accepter le risque d'une volonté de revanche dans l'Église, qui serait tôt ou tard venue frapper la laïcité et ses alliés protestants et juifs. De ce point de vue, les premiers mois du régime de Vichy, en 1940-1941, ont bien exhalé un fort parfum de revanche catholique, antilaïque et antisémite à défaut d'être antiprotestante. Mais à l'inverse, mettre en place une séparation qui insiste autant sur la liberté de religion et de culte public (article 1) que sur la fin de la reconnaissance et des subventions (article 2), et qui, sur le point crucial de l'organisation interne, respecte les règles catholiques, c'était rendre possible un ralliement futur, c'était promettre à la loi une véritable durée, et lui donner la capacité d'apaiser un conflit pourtant si aigu en 1905.
Nous savons que ce double pari a été gagné : la loi est centenaire, l'Église est réconciliée avec la laïcité. Dans ce tableau de la sérénité enfin acquise -- au mois entre ces deux partenaires-adversaires --, les protestants, en quelque sorte, se sont fait oublier : mais n'est-ce pas une condition élémentaire de survie et de bonheur, pour une minorité, que de se faire oublier ? Les minorités heureuses, comme les Dieux sans doute, n'ont pas d'histoire(s), on le sait.
Philippe Levillain
Je vous remercie beaucoup, Patrick Cabanel, de ce raccourci stimulant. Je remarque que nous faisons des commémorations positives. En 1889, on a fait une contre-manifestation, contre la Révolution, contre le centenaire. Maintenant, tous les colloques sont positifs, pour la séparation, etc. Il n'y a pas de contre-colloque.
Je passe la parole à Christophe Bellon qui va nous parler d'Aristide Briand.
CHRISTOPHE BELLON,
doctorant à l'Institut d'études politiques de Paris,
allocataire de recherche à l'Assemblée Nationale
Merci, Monsieur le président.
En effet, on ne peut pas évoquer la crise de la séparation sans parler du rapporteur de la loi et du futur ministre des Cultes, Aristide Briand, tant son influence sur le libéralisme de la loi de 1905 et dans les lois de 1907 et 1908 est grande. Comment parvint-il à établir ce libéralisme ?
Je vais essayer d'aborder la question en trois points : le travail en commission, la discussion parlementaire et le vote. Je comptais parler de l'application, mais je crains de ne pas en avoir le temps.
L'élaboration de la loi en commission
Il faut savoir qu'avant que le libéralisme ne s'applique au sein de la commission et de ses travaux, la commission met une année à s'installer, tant le climat politique lui est défavorable. Il faut d'abord vaincre l'opinion du président du Conseil, Émile Combes, qui ne voit pas la séparation s'accomplir rapidement. Plus concrètement, il faut modifier le règlement de la Chambre des députés, pour qu'une commission ad hoc , de trente-trois membres, et non une commission permanente, puisse voir le jour rapidement. Le 11 juin 1903, la commission est installée.
Il faut citer aussi quelque chose qui ne laisse pas présager une rapidité des travaux de la commission : cette commission de trente-trois membres est séparatiste à une voix (dix-sept membres séparatistes, seize antiséparatistes). Au sein des dix-sept membres séparatistes, l'influence socialiste et radicale-socialiste est dominante : les socialistes sont sept sur trente-trois, les radicaux-socialistes sont dix et il n'y a aucun radical, puisque cent cinquante députés ont décidé de s'abstenir pour l'élection de leurs collègues au sein de la commission, pour des raisons certainement attentistes, car ils considèrent, pour beaucoup, que la séparation ne se fera pas rapidement.
Très rapidement, les travaux de la commission sont marqués par un grand libéralisme, d'abord par le choix du rapporteur, provisoire dans un premier temps, puis rapporteur définitif, en la personne d'Aristide Briand, député à l'expérience parlementaire récente, puisqu'il est élu en 1902 dans la Loire. Il est proche de Jaurès : il travaille avec lui au sein du Parti socialiste français. C'est quelqu'un qui n'est pas jusqu'au-boutiste, qui n'est pas un fanatique de la séparation ; d'ailleurs la réforme de la séparation n'est pas inscrite dans sa profession de foi. Même s'il a défendu par le passé des positions anticléricales, il n'est pas d'un anticléricalisme virulent. Il n'est pas très intéressé, d'ailleurs, par le travail de la commission ; il est membre de la commission des congrégations mais n'est pas candidat à celle de la séparation. Il y est poussé par Jaurès et ses collègues socialistes qui le connaissent bien et qui connaissent aussi ses capacités d'orateur. Il est élu par cooptation : un de ses collègues socialistes lui laisse la place et le travail peut commencer.
D'abord, l'habileté et la souplesse de Briand se trouvent dans la synthèse qu'il fit très rapidement des différentes propositions de loi qui avaient été déposées préalablement à la constitution de la commission. Il fit cette synthèse entre les différents courants séparatistes : un courant représenté, par exemple, par le président de la commission de séparation, Ferdinand Buisson (et sa foi laïque), les courants des anticléricaux farouches, notamment le député du Var Maurice Allard ou Édouard Vaillant et les projets des radicaux modérés, comme Eugène Réveillaud, député radical de la Charente Inférieure. Il mêle aussi à la discussion les tenants de l'opposition membres de la commission. Il les associe tellement bien qu'il gagne en vingt et un mois, un à un, tous ses collègues de la commission, si bien qu'un membre de l'opposition, le député Lefas, déclara que « Briand se révéla un excellent avocat d'assises, plus soucieux de l'argument que de la cause ». D'ailleurs, les membres de la commission ont loué « cette sorte d'habileté souple, démultipliée par la ténacité à saisir l'essentiel de ce lourd travail, pour n'en retenir que les angles et en prolonger lui-même, mieux que ses interlocuteurs, les côtés ».
Dès 1904, c'est-à-dire après un an de travail en commission, un avant-projet est proposé. Cet avant-projet est la synthèse libérale des différentes propositions que je viens d'évoquer. Sur le fond, il est assez proche de celui d'un collègue de Briand, député du Rhône, protestant, Francis de Pressensé, battu, d'ailleurs, lors de l'élection en commission. Il aurait certainement été nommé rapporteur s'il avait siégé dans cette commission. Briand s'inspire de ses travaux, notamment de sa proposition de loi, qui figure parmi les sept premières propositions de loi analysées. Il est influencé également par celle d'Eugène Réveillaud, son coreligionnaire. Je passe sur les propositions libérales, parce que je souhaite uniquement montrer ici la tactique, en quelque sorte, du travail de commission et du débat en hémicycle.
Le libéralisme de Briand et de la commission se retrouve à nouveau, durant cette année 1904, dans l'épreuve que fait subir à la commission le président du Conseil, Émile Combes, en déposant à l'automne 1904 un projet de loi sur la séparation des Églises et de l'État, alors que, concordataire, il y avait été jusqu'alors relativement opposé. Les relations avec le Saint-Siège ont été rompues pendant l'été. Au début juillet, la loi sur la suppression de l'enseignement congréganiste est votée. Le climat est donc très tendu. La majorité est aussi tendue, la délégation des gauches commençant un peu à se décomposer. Combes décide de reprendre la main et de proposer ce projet de loi, qui va à l'encontre des travaux jusqu'alors réalisés par la commission. C'est un mauvais coup pour la commission puisque ce projet de loi est qualifié, même par les républicains, de « fausse séparation », de « régime concordataire sans concordat », de « coup fatal porté à la séparation ». On va alors voir le libéralisme du rapporteur qui, plutôt que de s'opposer frontalement au président du Conseil, décide au contraire de négocier avec lui pour ne pas mettre à bas les travaux d'une année de discussion en commission. Il y arrive et, de plus, quelques points de consensus sont trouvés. Il parvient même à faire entrer Combes dans les vues de la commission.
Seulement, à la suite de l'affaire des fiches, le gouvernement Combes tombe en janvier 1905 et Briand décide de poursuivre les travaux, à partir de son avant-projet de 1904, afin de présenter un rapport, deux mois plus tard, en mars 1905, (conclusion de l'ensemble des travaux de la commission). Pour ce faire, d'ailleurs - et le libéralisme est encore marqué ici -, il est aidé par trois collaborateurs : un catholique, Léon Parsons, chargé de la rédaction de la partie historique du rapport, un israélite, Paul Grunebaum-Ballin, qui s'occupera de la partie sur les missions étrangères, et enfin un protestant, dont le rôle fut certainement le plus important parmi ces trois personnes, Louis Méjan, frère de François Méjan, chargé de la partie du rapport sur l'analyse des différents propositions et projets de loi. Enfin, ce libéralisme de la commission est bien maintenu, en février, par le remplacement de Combes et l'arrivée à la présidence du Conseil de Maurice Rouvier et, au ministère des Cultes, de Jean-Baptiste Bienvenu Martin. Ces derniers s'avèrent être assez effacés et laissent toute latitude au rapporteur pour commencer les débats.
Je passe rapidement à la deuxième partie de ce lourd travail parlementaire. D'après Jaurès, qui suivait les travaux de près, « la commission de séparation détient le record du travail parlementaire de la législature présente, de celles passées et peut-être même de celles à venir ». La fréquence des travaux est accélérée, passant d'une seule séance hebdomadaire à parfois deux séances par jour. Son travail est rédigé sur mille pages de procès-verbaux de commission, ce qui n'est pas rien, notamment si on le compare avec la commission du Sénat, à l'automne.
La discussion en séance publique et le vote de la loi à la Chambre des députés (3 juillet 1905)
Comment comprendre la discussion politique qui va permettre à la loi d'être votée, puis appliquée ? Comment comprendre la délibération parlementaire qui va permettre d'aboutir au vote ? Je prendrai deux éléments, qui sont d'ailleurs très liés l'un à l'autre : d'abord, la démarche argumentaire de Briand qui va lui permettre, dans un second temps, de trouver sa diagonale rhétorique et de construire une majorité, une majorité qui le soutiendrait dans la discussion.
L'argumentaire de Briand repose sur le futur article premier et sur les notions de liberté de conscience et de liberté religieuse, ou libre exercice du culte. Ce sont deux points importants du débat même pour Briand. Il introduit aussi la notion de séparation en tant que rupture avec le régime concordataire, ce sera le futur article 2. Il précise donc les arguments de suppression du budget des cultes et de non-reconnaissance des différents cultes par l'État. Enfin, la plus grande victoire obtenue dans ce débat est l'article 4, qui permet d'organiser la dévolution des biens de l'Église concordataire aux associations cultuelles. Pour que la loi puisse être appliquée, il propose de reconnaître même officieusement la hiérarchie, notamment la hiérarchie de l'Église catholique. Cet argumentaire est naturellement sous-tendu par la puissance de l'éloquence du rapporteur, qu'on mesure mal aujourd'hui parce qu'on dispose très peu d'enregistrements, mais la basse de sa voix de violoncelle en avait charmé plus d'un. L'argumentaire est tout de suite nécessaire pour construire sa majorité, la majorité parlementaire, qui va s'avérer finalement assez originale dans le débat.
Tout d'abord, comment s'organise cette majorité ? Très rapidement, il va considérer que les positions des extrêmes, l'extrême gauche, c'est-à-dire l'aile socialiste révolutionnaire de la majorité républicaine, et puis les droites non progressistes, ont des positions absolument inconciliables avec les arguments et notamment le rapport de la commission. Très rapidement, les extrêmes vont être rejetés « dos à dos ». Briand joue avec l'extrême gauche contre l'extrême droite et vice versa. Il dit en s'adressant à l'extrême gauche : « Il y a des curés dans l'Église catholique, il y a aussi des prêtres, il y a même un pape. Que voulez-vous ? Ce sont des mots qui peuvent écorcher les lèvres de chacun d'entre nous, mais qui correspondent à des réalités. » La citation montre bien que Briand se détache un peu de cette extrême gauche. Mais il faut tout de même construire la majorité parlementaire, le renvoi des extrêmes ne suffirait pas à la construction d'une majorité.
La majorité construite est fondée sur deux axes. Le premier axe, réunit les socialistes réformistes dits « parlementaires » de Jaurès, une grande partie des radicaux, une partie seulement des radicaux-socialistes et le centre gauche (groupe de l'Union démocratique) représenté par les alliancistes, menés par Louis Barthou. Jaurès mène un travail de couloir considérable puisque, parallèlement au débat de la séparation, a lieu l'unification des partis socialistes en SFIO. Cette unification se fait à l'avantage des guesdistes sur les jaurésistes. Les guesdistes posent problème à Briand dans le débat et ne cessent de critiquer une séparation libérale, Jaurès a beaucoup de mal à faire le trait d'union entre son soutien fondamental au rapporteur et, en même temps, à sauvegarder la future unité, puisque ses collègues réformistes considèrent que l'unité du parti est prioritaire. Le choix sera fait de soutenir les efforts réformistes de Briand, tout en allant vers l'unité socialiste.
Le deuxième axe de la majorité de Briand est la main tendue au centre droit concordataire, même s'il s'agit d'un soutien ponctuel. D'ailleurs, il ne le retrouvera pas lors du vote solennel, le 3 juillet, à la Chambre, puisque la loi est votée par trois cent quarante et une voix contre deux cent trente-trois, c'est-à-dire l'ensemble de la majorité républicaine du bloc de 1902. Mais, sur certains articles importants (notamment l'article 4), il réussit à rallier le centre droit, afin que la loi puisse non seulement être votée, mais surtout appliquée, ce qui était son principal souci. Il le dit très clairement : « Je n'ai pas reculé devant les concessions nécessaires, j'en ai fait aussi à la minorité elle-même et je m'en félicite, car nos collègues de la droite et du centre, en nous permettant d'améliorer la loi, en apposant leur signature aux nôtres sous des articles importants, nous auront aidés puissamment à la rendre plus facilement applicable, en réduisant au minimum les résistances qu'elle aurait pu susciter dans le pays. » Finalement, il y a eu une conjonction de centres, élargie par le soutien des réformistes de Jaurès, qui montre que l'histoire des centres sous la III e République n'est pas négligeable : à bien des heures difficiles, ils assurèrent la continuité du pouvoir. Je vous remercie.
Philippe Levillain
Je vous prie de m'excuser, mon cher collègue, de ce principe anglais qui s'appelle, dans le parlementarisme, la guillotine ! J'en profite pour rappeler qu'il y a trois grands moments de l'histoire de France qui sont importants, quand est votée à une voix la mort de Louis XVI, à une voix l'amendement Wallon et la commission de 1903, à une voix. Les Français avaient lu Rousseau, contrairement à ce que prétend Daniel Mornet, puisque la majorité à une voix est la majorité, ce qui fait que nous sommes imbus de la philosophie de Rousseau, sans le savoir, peut-être. Jean Baubérot va avoir droit à un quart d'heure, c'est la concession que fait un catholique à un protestant de son âge, presque, lui donner donc un quart d'heure pour intervenir à son tour !
JEAN BAUBÉROT,
directeur de recherches à l'École Pratique des Hautes Études
Merci, Monsieur le président. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Peut-être, à la suite de ces différentes interventions, il reste tout de même une question : pourquoi la loi a-t-elle été libérale et, en même temps, inaudible par une grande partie des catholiques ? Les historiens disposent de matériaux pour le savoir, mais c'est peut-être cela qu'il faut expliquer ; c'est peut-être encore, pour un certain nombre d'entre nous, le paradoxe qu'il faut approfondir.
Pour cela, il faut revenir au contexte. Je ne vais pas reprendre ce qui a été déjà indiqué : un contexte très large a été donné à cette table ronde sur la loi de 1905. Je vais revenir au contexte le plus immédiat, c'est-à-dire aux années 1901-1904, dans la mesure où ce qui s'enclenche alors est d'abord une radicalisation de la laïcité scolaire. Le débat sur la laïcité est d'abord un débat sur l'école. La laïcité scolaire constitue un débat récurrent en France, qui a continué d'ailleurs après la loi de 1905. Il s'agit, à cette époque, la lutte contre les écoles congréganistes, qui aboutit à la loi du 7 juillet 1904 ; mais il s'agit aussi de l'espoir d'un certain nombre de gens d'instituer le monopole intégral de l'État sur l'éducation : le congrès du parti radical le vote en 1903 et Buisson, qui est contre, est mis en minorité. Il existe des tentatives à la Chambre de l'imposer, contre lesquelles Clemenceau, par exemple, prononce un très beau discours contre l'État Dieu...
On se trouve donc dans ce processus de radicalisation, avec le mot d'ordre de « laïcité intégrale ». Chaque mesure de laïcisation prise, au lieu d'être la dernière, amène la nécessité d'une mesure plus radicale. Il se produit, à partir de la rhétorique de « la République menacée », un engrenage du conflit. On interdit aux congrégations l'enseignement, mais on n'est pas sûr qu'un congréganiste sécularisé se soit vraiment dépouillé de son imaginaire congréganiste, exactement comme on soupçonnait les marranes d'être toujours juifs, comme on soupçonnait les « nouveaux catholiques », après 1685, d'être toujours protestants. Quand on oblige quelqu'un à changer, il est ensuite suspect de ne pas avoir « intériorisé le changement ». Pour parer à cette nouvelle menace, on tente de prendre une mesure encore plus grave contre les congréganistes sécularisés. Clemenceau l'arrête au Sénat, mais on a l'impression que chaque mesure induit logiquement, parce que la « menace » ne peut pas être étouffée, la mesure suivante. Car une fois qu'on aurait interdit aux congréganistes sécularisés d'enseigner, on se serait aperçu que cela ne résolvait pas le problème : les mêmes manuels « antirépublicains » se trouvant utilisés par des laïcs catholiques dans les écoles privées. L'étape suivante était donc le monopole de l'enseignement pour l'État. Mais, en même temps, certains commençaient à dire que, dans l'école laïque elle-même, il existait des cléricaux larvés, qui déforment à leur gré la « cire molle » qu'est l'élève. Il faudrait donc épurer l'école laïque.
Finalement, on aurait donné raison à ce que dira Allard, à la Chambre, le 10 avril 1905 : pour lui, la véritable laïcisation, c'est la destruction de la religion. L'horizon de la laïcisation intégrale amène à se situer dans une logique qui n'est pas du tout la logique majoritaire chez les républicains, mais où un engrenage s'effectue. Il est important de parler d'engrenage, parce que cela permet de dissocier ce qui s'est fait de la personnalité d'Émile Combes, qui n'est pas le borné, le sectaire, l'homme limité et obsessionnel qu'on a dit. Émile Combes a combattu Allard au début de 1903, exactement comme Briand a combattu Allard en 1905. Cet engrenage de la menace et du fait de se défendre contre la menace - plus on se défend contre la menace, plus on prend des mesures radicales, plus le conflit s'étend - conduisait logiquement à une République totalisante ou à une « République absolue », pour parler comme Odile Rudelle. La séparation obligeait d'attaquer frontalement ce problème parce que, si on faisait une séparation stricte, effectivement, on était en marche vers la laïcisation intégrale. Mais on devait alors s'éloigner du modèle démocratique.
On disait du mal des congrégations depuis le XVIII e siècle, certaines régions avaient un peu bougé, mais il n'y avait pas de révolte générale. Avec la séparation, on s'attaquait non seulement au catholicisme militant, mais à un catholicisme de consommateurs, à tous ceux qui voulaient bénéficier des « secours de la religion », même s'ils n'obéissaient pas forcément aux normes édictées par l'Église catholique et si, dans le dogme, ils en prenaient, ils en laissaient. Ils avaient leur quant-à-soi religieux.
La séparation pose donc le problème suivant : jusqu'où voulez-vous aller dans la laïcisation ? Quelle sorte de laïcité voulez-vous réaliser ? Voulez-vous réaliser une « laïcité intégrale », selon l'expression utilisée explicitement à l'époque, ou une laïcité libérale ? Mais cette laïcité libérale est alors un autre chemin que celui pris depuis la fin de l'affaire Dreyfus, depuis le gouvernement de Défense républicaine de Waldeck-Rousseau. Ce retournement était très difficilement crédible et audible pour les adversaires du Bloc des gauches. Un certain nombre d'adversaires de centre droit de la séparation, des républicains concordataires, et bien sûr surtout des membres de la droite disent en substanc : « Nous ne serions pas contre la séparation si cela pouvait se faire de manière paisible, progressivement. Mais, dans le contexte actuel, que vous le vouliez ou non, la séparation va forcément continuer la politique anticongréganiste. Cette voie-là va forcément amener de la persécution : même si vous ne le voulez pas, même si la loi ne le veut pas, vous serez obligés, parce qu'on ne sort pas facilement d'un engrenage. »
Ribot commence à se dire, le 21 avril : « Peut-être est-il possible de sortir du dilemme ? » Mais, avant, ce n'est pas tout à fait plausible, même si Briand, depuis le début, s'éloigne de la logique combiste. Quand on fait une politique modérée, il faut souvent calmer ses troupes, il faut calmer les anticléricaux stricts. On fait des références idéologiques à la Révolution. Jaurès dit : « La France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire. » En fait, il tient ce propos pour légitimer une mesure qui va donner des garanties à l'Église catholique, mais si des esprits avertis le comprennent, pour le catholique moyen ce n'est pas forcément rassurant d'entendre dire cela.
Donc, cette séparation prenait politiquement un autre chemin, très difficile à suivre, semé d'embûches entre des peurs contradictoires. Car les rumeurs se multipliaient des deux côtés. On a gardé le souvenir des peurs catholiques d'une « persécutions », d'églises devant fermer. On a oublié, mais il faut aussi en tenir compte pour évaluer la difficulté de la situation, les peurs républicaines : certains voient déjà le pape nommer des jésuites, des membres congrégations interdites comme évêques et une Église catholique prenant sa revanche de la lutte congréganiste.
On voit là le poids des hommes en politique. Quelqu'un comme Briand a été un artisan du retournement de politique laïque et il fallait avoir de nombreuses qualités pour pouvoir le faire. Mais cela se faisait dans un climat idéologique, dans un contexte historique tel que ce retournement n'était pas audible par tous et qu'on ne pouvait pas aller jusqu'au bout dans l'expression de ce retournement. La séparation libérale ne pouvait pas exprimer complètement, explicitement, sa philosophie. Quand on voit la manière dont Briand répond à Ribot le 21 avril, on se rend compte qu'il « marche sur des oeufs » et qu'il est obligé de dire en substance : « Attendez, cette Église catholique n'est pas figée à jamais, elle va évoluer, nous espérons bien la voir évoluer ». Et finalement, on peut penser alors que continue le combat de la raison, de la libre-pensée, qu'on est toujours dans le combat des gens éclairés contre ceux qui ne le seraient pas.
Mais il s'est tout de même produit une rupture très nette : la République abandonne cette collusion avec la libre-pensée qui, jusqu'alors, avait été assez forte. Combes, dans son discours à Tréguier, parle à la fois comme président du Conseil et comme libre penseur militant. Il dit être pour la liberté de conscience, mais il parle alors du sentiment religieux et il déclare : « L'ennemi de la religion, c'est le ministre du Culte ». Il ne dit pas : « Ce sont ceux des ministres du Culte qui ont trempé dans le légitimisme ». Il est obligé, par la logique de cet engrenage, de tenir des propos assez radicaux. Quand on dit qu'on garantit la liberté de conscience en évoquant le « sentiment religieux » individuel et que l'on polémique très vivement contre l'institution religieuse, les adeptes des « religions positives » ne peuvent évidemment pas se sentir rassurés. Ce qui se passe à partir d'avril, sans être audible pour l'ensemble de l'opinion publique, c'est cette séparation de la libre-pensée et de la République, préalable à la séparation des Églises et de l'État. Et si on étudie finement la réponse de Briand à Allard, le 10 avril, on est dans cette optique où est prônée autant une séparation avec la libre-pensée qu'avec les Églises. Mais ce virage n'est perceptible que pour une élite, la masse pense qu'il s'agit d'un leurre. Ne lui avait-on pas promis que l'application de la loi de 1901 serait libérale ?
Car, finalement, on n'a que l'affirmation de la volonté politique de Briand et d'un certain nombre de ses amis, comme Jaurès qui, comme vous dites, « fait les couloirs ». Mais comme Jaurès a été très combiste, est-il tout à fait crédible ? On voit bien des gens comme Brunetière, comme Denys Cochin, qui vont signer l'appel des cardinaux verts qui, bien informés, ont compris qu'un certain virage se trouvait pris. Mais le catholique moyen pouvait difficilement le comprendre, surtout après le moment où le pape dit en substanc : « Non seulement je condamne la séparation - ce qui n'a étonné personne - mais j'interdis de constituer des associations cultuelles. »
La course-poursuite s'est accentuée après le vote de la loi, entre les années 1906 et 1908, pour arriver à tenir ensemble cette majorité républicaine composite. Il ne fallait pas que la guerre des deux France devienne une guerre interne à la laïcité et il fallait rattraper l'Église catholique dans son refus de la loi, à partir de la condamnation du pape, pour que la pacification puisse se faire. Malgré le souci de Briand de donner par la loi des garanties à l'Église catholique, l'application a été plus difficile qu'il ne pensait. Il croyait s'être donné toutes les garanties au moment du vote pour que l'application soit facile, mais l'application s'est avérée encore un rude combat.
Pour conclure, lorsqu'on examine le vocabulaire employé, notamment par Briand, cela est significatif. Briand parle de « sang-froid », de savoir « résister aux surenchères », de ne pas craindre « d'être taxés de modérés » ; ensuite il « supplie » de ne pas agir sous le coup de l'émotion. Ce n'est plus le discours de la République menacée, c'est, au contraire, la République qui se menace elle-même si elle ne réalise pas une séparation qui ouvre la voie à la liberté. « Soyons à distance de nos affects, soyons à distance de l'émotion, gardons notre sang-froid » déclare Briand et il ajoute : « On m'accuse de cléricalisme, on vous accusera d'être cléricaux, mais ce n'est pas grave, ne craignez pas ce genre d'accusation, c'est ridicule. » Finalement, c'est la République du sang-froid qui a gagné contre la République se croyant menacée, c'est sans doute encore une leçon pour aujourd'hui. Je vous remercie.
Philippe Levillain
Merci, Jean Baubérot. De l'utilité des colloques, parce qu'ils remettent dans le contemporain. Plus tard, on expliquera que la séparation a été finalement bénéfique à l'Église, à commencer par le Saint-Siège qui obtiendra la liberté de nommer les évêques qu'il voudra, ce qui sera le cas des premiers évêques de Pie X. Ultérieurement, il y aura d'autres explications, mais on voit dans l'instant, dans ce qui a été expliqué par Jean Baubérot, la difficulté de transaction, l'art de Briand, qui est connu, et, surtout, la non-perception de ce qui a été la réalité d'un état de transaction qui était craint depuis très longtemps : un certain nombre de catholiques intransigeants voyaient cette séparation comme inéluctable dès les années 1875. Au moment où la loi de l'enseignement supérieur s'est mise en place, ils savaient qu'elle serait menacée par la suite du 16 mai. La parole est à la salle pour dix minutes.
ÉCHANGES AVEC LA SALLE
Odile Rudelle
On a parlé de ces années 1870, 1905, sans prononcer les mots "défense nationale" et "guerre". Or, les catholiques étaient tout de même liés au Second Empire, qui avait conduit à la défaite. Dans les années soixante-dix, on les a accusés de vouloir faire la guerre pour le Saint-Siège. Autour de 1900, 1905, le sentiment du danger change : d'un côté, la République se sent légitime, elle a gagné contre l'affaire Dreyfus et, en même temps, il y a une menace qui n'est plus une menace interne mais une menace externe et les catholiques sont toujours très fidèles pour voter le budget de la défense nationale au moment où les socialistes se retirent.
Ma question est pour Christophe Bellon : Aristide Briand, qui jouera sur la scène internationale le rôle que l'on sait, plus tard, avait-il déjà ce sens des équilibres internationaux dans la nécessité de récupérer les catholiques, pour une République qui n'est plus absolue, mais quasiment constitutionnelle ?
Christophe Bellon
Je ne crois pas, puisque l'expérience de Briand avant son arrivée au Parlement est essentiellement fondée sur son activité au sein des Bourses du travail : à l'occasion, il est avocat des milieux révolutionnaires et a fréquenté les pays étrangers seulement à l'occasion des comités, des congrès socialistes. Je ne pense pas, pour répondre à votre question, que Briand ait eu une connaissance ou une culture internationale, antérieure à son action sur la séparation.
Philippe Levillain
Mgr Dupanloup dénonce, à la suite du discours de Saint-Quentin de Gambetta, « la République à la fois grotesque, ruineuse et sanglante qui, pendant six mois, a infligé la guerre à la France. » Il dit à Gambetta : « J'ai le droit de vous demander compte, comme évêque, de la guerre qui va se déclarer à l'État et à la religion. »
Patrick Cabanel
Au sujet du paradoxe : au début du siècle, lorsque la République chasse les congrégations, leur interdit d'enseigner, etc., elle sait très bien que ces congrégations sont déjà implantées partout dans le monde et, en particulier dans le Levant et l'Amérique latine. Renforcées précisément par ces milliers d'exilés qui arrivent, ces congrégations en exil servent la langue française, servent la culture française. Chaque année, on vote donc de façon officielle, publique, une forte somme d'argent, qui est votée par les députés contre Allard et quelques autres, qui rêvent de faire supprimer ces fonds. La République laïque subventionne des écoles chrétiennes, des jésuites, des collèges en exil, parce qu'on sait qu'en exil, le catholicisme sert la France.
Jean Baubérot
Briand, effectivement, n'était pas encore préoccupé de questions internationales mais, dans les mémoires de Combes, nous trouvons quelque chose de tout à fait intéressant : il essayait de proposer à l'Allemagne de rendre l'Alsace-Moselle soit contre le Tonkin, soit contre Madagascar, pour créer une alliance franco-allemande. Il suivait de plus près qu'on ne l'a dit la politique des affaires étrangères. Il voyait bien la politique d'éviter l'encerclement par l'Allemagne et, au contraire, de faire différentes alliances, mais il espérait couronner cela par une entente franco-allemande et il a proposé cela à l'ambassadeur d'Allemagne : « Dites-nous ce que vous voulez, si vous voulez le Tonkin, si vous voulez Madagascar, on pourrait vous les donner contre l'Alsace-Moselle. Ainsi, vous auriez des colonies où mettre votre population excédentaire, nous récupérerions l'Alsace-Moselle, et l'antagonisme franco-allemand pourrait se dissoudre. »
J'ai trouvé, chez des journalistes français, l'idée qu'il faut une séparation libérale, à cause de la victoire du Japon sur la Russie. La victoire du Japon montre une nouvelle donne internationale, montre que le Pacifique est en train de remplacer la Méditerranée comme centre stratégique du monde, que la politique internationale de la France doit intégrer cette nouvelle donne et que, à ce niveau-là, il faut finir la guerre religieuse. Ce sont des gens de centre droit, mais cela correspond un peu à Jaurès disant aussi : « Il faut finir la guerre religieuse pour s'attaquer à la question sociale. » Dans le centre droit, il y a des gens qui disent : « Il faut finir la question religieuse et accepter une séparation si elle n'est pas persécutrice, pour pouvoir avoir enfin une grande politique étrangère française. » Effectivement, cela a pu jouer aussi, mais sans doute à la marge, tout de même.
M. Bariéty, université Paris-Sorbonne
Je reviens à la question qu'a posée Mme Rudelle, que je crois très importante. Si vous permettez, cher ami, M. Bellon, je voudrais un peu compléter ce que vous avez dit. Je m'intéresse beaucoup à la politique étrangère de Briand. Je suis persuadé, comme vous, que le danger allemand n'était pas présent à l'esprit de Briand en 1904-1905 et que cela n'a donc pas joué de rôle dans sa façon de se comporter. Mais il a été très rapidement conscient, par la suite, du danger allemand. J'en suis absolument persuadé. C'est peut-être une des choses qui l'écartaient aussi de Jaurès. Enfin, n'oublions pas que c'est Briand qui est à l'origine de la loi du service militaire de trois ans.
Nous savons que dans les années avant 1914, s'il n'a jamais eu à s'occuper, professionnellement, comme ministre, des affaires étrangères et de la politique extérieure, il était en relations étroites avec Poincaré. De la place Vendôme, il allait souvent, en se promenant à pied, jusqu'au quai d'Orsay, parler de la situation internationale avec Poincaré. Et puis, enfin, Poincaré a fait de Briand, en octobre 1915, un chef de gouvernement de la France en guerre, ce qu'il est resté jusqu'en mars 1917. Quant aux années 1920, n'en parlons pas, cela dépasserait notre affaire. Je voudrais simplement rappeler que la loi de 1905 n'a finalement trouvé son complément qu'en janvier 1924, grâce à Poincaré.
Christophe Bellon
Je suis d'accord avec vous, sauf peut-être sur la loi des trois ans : Briand n'en est pas vraiment l'initiateur, il la met en application. Mais effectivement, toute la connaissance diplomatique qu'il aura par la suite, il l'a tout de même largement après les débats proprement dit sur la séparation, peut-être à partir de 1905, l'affaire du Maroc.
Bernard Oudin
Je suis biographe de Briand et, à ce titre, je voudrais un peu contredire ce qui a été dit tout à l'heure. Il y avait des gens qui étaient très préoccupés par le danger allemand, notamment Delcassé, au quai d'Orsay, au début du siècle, mais ce n'était vraiment pas le cas de Briand. Je ne pense pas qu'il ait été très tôt obsédé par le danger allemand. Il a occupé tous les postes ministériels possibles et imaginables avant 1914, les Cultes, l'Intérieur, la Justice, mais jamais les Affaires étrangères. Il y a été pour la première fois pendant la guerre. Il n'avait jamais mis les pieds à l'étranger, sauf pour des congrès socialistes et il était extrêmement peu préoccupé de ces questions, qui ne sont venues qu'à la veille de la guerre, en 1913. Mais nous étions déjà dans une période de crise. Il a été partisan très tardivement - mais non pas l'initiateur, comme le disait M. Bellon très justement - de cette loi de trois ans.
Je voudrais revenir un peu sur la période de 1905, pour dire que la « main tendue » aux catholiques, à laquelle M. Bellon a fait allusion tout à l'heure, est allée très loin : jusqu'à des contacts discrets, sinon secrets, avec certains éléments de la hiérarchie catholique. Il y avait des évêques qui étaient moins extrémistes que leur propre pape et, notamment, l'archevêque de Rouen, Mgr Fuzet, nettement plus libéral, plus conciliant dans cette affaire. Et il y a eu des contacts directs, personnels, entre Briand et Mgr Fuzet, ainsi qu'avec quelques autres grandes personnalités catholiques qui ont joué un rôle très important. On parlait tout à l'heure de ce fameux article 4, parce que cela a permis à Briand de comprendre exactement ce à quoi les catholiques étaient prêts, de mauvais gré, à accepter et les points qu'ils n'accepteraient en aucun cas. Effectivement, en aucun cas, ils n'auraient accepté que les associations cultuelles soient le terreau de futurs schismes, ce qui était d'ailleurs un peu l'envie de gens comme Maurice Allard, qui souhaitaient bien qu'un jour les schismes se développent au sein de l'Église catholique et qu'elle soit touchée de ce côté-là. Mais, en fait, justement, Briand a parfaitement mesuré ce qui était acceptable et ce qui ne l'était pas et, finalement, un député catholique a donné le mot de la fin, il a dit que la séparation était inacceptable et il a ajouté : « Mais on passe son temps à accepter des choses inacceptables. »
Philippe Levillain
À propos de ce que vous disiez, Monsieur, il y a non seulement des évêques qu'on peut dire favorables à la séparation, il y a aussi des catholiques intransigeants ralliés. Il y a notamment Albert de Mun, qui a tenté de convaincre le pape qu'il fallait faire des associations cultuelles, et cela a échoué. C'est très compliqué. Dans l'ordre des nuances, on peut aller très loin.
LES DÉBATS SUR LA LAÏCITÉ DEPUIS 1905
Le professeur Antoine Prost va nous faire entrer dans le XX e siècle avec une réflexion sur la laïcité et l'école, essentiellement dans l'entre-deux-guerres, mais il a tout le loisir de poursuivre sa réflexion sur la période qui l'intéresse. Je lui laisse la parole. Ensuite, nous aurons une table ronde présidée par le professeur Émile Poulat.
LA LAÏCITÉ ET L'ÉCOLE DE 1905 À 1945
Antoine Prost, professeur émérite à l'Université de Paris I
Du point de vue de la laïcité et de l'école, la période qui s'étend de 1905 à 1945, est une période au cours de laquelle il ne se passe rien, en apparence. De ce fait, elle est un peu négligée : les études ont surtout porté sur la création de l'école républicaine dans les années 1880, ou sur l'évolution de la question laïque de 1945 à nos jours, en passant par la loi Debré, la loi Guermeur et la loi Savary, mais la période de l'entre-deux-guerres n'est guère traitée. Or, c'est pendant cette période que se noue de façon irréductible la question scolaire à la française. J'organiserai mon propos en trois points : un premier sur le « statu quo institutionnel » de l'entre-deux-guerres, un second sur la radicalisation théorique qui se produit alors paradoxalement et un troisième sur la commission Philip et l'émergence de la question scolaire à la fois comme problématique et comme solution, en 1945, car, avec cette commission, une page se tourne et l'on entre vraiment dans le second XX e siècle. La question scolaire se pose dans des termes nouveaux.
Le statu quo institutionnel de l'entre-deux-guerres
L'intervention de Jean Baubérot ce matin simplifie ma tâche. Les républicains ne sont pas unanimes et parmi eux, on peut distinguer au moins deux groupes : des républicains décidés à construire une société sans Dieu et sans roi, qui mènent une entreprise de sécularisation résolue mais qui, comme Jules Ferry, font confiance au temps pour que les derniers vestiges de l'ignorance, de l'obscurantisme et de la religion s'éteignent ; à côté d'eux, des libres-penseurs et des radicaux sont beaucoup plus véhéments, beaucoup plus convaincus que, hors de la science et de la raison qui fonde la science, il n'y a pas de salut pour la République. Ceux-ci sont absolument résolus à « écraser l'infâme », comme disait Voltaire, c'est-à-dire à éradiquer non seulement le catholicisme institutionnel et la puissance temporelle de l'Église, mais la religion elle-même. Pour eux, il ne s'agit pas seulement de tracer de bonnes frontières entre l'Église et l'État, mais de lutter contre la religion. C'est l'opposition de la superstition et des dogmes d'une part, de la raison et de la science d'autre part.
Le lien entre la conception prudente, modérée et la conception activiste de la lutte antireligieuse est évident. Les républicains de ce temps-là font face à une Église catholique que nous n'imaginons plus, une Église qui nous est devenue profondément inimaginable. L'Église du Syllabus , celle des catéchismes de persévérance de la Belle Époque, nous est totalement étrangère, elle appartient à un autre siècle, et c'est contre cette Église-là que se battaient les républicains. Et il n'y avait pas moyen, en effet, d'organiser une société moderne, reposant sur le droit du citoyen et les principes de 89, si l'Église avait conservé la « surintendance des écoles » pour citer Ferry. À côté de ce catholicisme, on trouve du côté républicain, une foi dans la raison qui appartient elle aussi à un autre univers que le nôtre. Personne aujourd'hui, aucun savant, aucun prix Nobel ne dirait, comme Marcellin Berthelot en 1856, après la synthèse de l'acide urique : « Le monde est désormais sans mystère. » Je citais tout à l'heure le grand discours de Viviani, dont l'affichage a été voté : « Ensemble et d'un geste magnifique, nous avons éteint dans le ciel des lumières qu'on ne rallumera jamais plus. » C'est splendide, mais cela veut dire que la raison permet de tout expliquer, de tout comprendre : l'univers est devenu limpide. La raison permet d'accéder à une vérité absolue, définitive. Entre ce catholicisme qui appartient à un autre univers que le nôtre et cette foi dans la science et dans la raison qui appartient aussi à un autre univers que le nôtre, l'incompatibilité est radicale.
À la suite de l'affaire Dreyfus, le conflit entre ces deux conceptions du monde et de la société s'exaspère. La loi de 1901 a pour objectif premier de contrôler les congrégations car on ne l'a pas attendue pour qu'il y ait des associations dans ce pays. Aujourd'hui encore, même les associations qui ne sont pas déclarées conformément à la loi de 1901 sont légales et l'on peut les poursuivre devant les tribunaux. La loi de 1901 a été faite avant tout pour contrôler les congrégations. Elle est appliquée par Combes en 1902, d'une manière extrêmement brutale, contrairement aux assurances qui avaient été données aux catholiques préalablement et avec la garantie du Conseil d'État, qui a renversé sa doctrine pour la circonstance.
La loi sur les congrégations ne suffit pas pour éradiquer la religion catholique, notamment dans les écoles privées. C'est le processus décrit par Jean Baubérot ce matin. La loi de 1901 ne suffisant pas, on fait une nouvelle loi en 1904, qui interdit aux congrégations d'enseigner. Elle est, elle aussi, appliquée de manière extrêmement brutale, avec des fermetures d'écoles congréganistes quinze jours avant les grandes vacances. Pour les catholiques, la loi de 1905, placée dans cette séquence, est une loi de plus, un pas supplémentaire dans la même direction et ils la voient donc d'un mauvais œil, jusqu'au moment où certains vont commencer à percevoir que cela pourrait être une sorte d'"Édit de Nantes" des catholiques.
De même qu'on a caractérisé une certaine période des relations diplomatiques, comme une période de « guerre froide », on peut caractériser cette période la période antérieure à la loi de 1905, comme une période de persécution froide, mais de persécution tout de même. Imaginons un instant ce qui se passerait aujourd'hui si un gouvernement républicain faisait procéder à l'inventaire des synagogues et des mosquées. Or on a fait l'inventaire des 35 000 églises de ce pays. Certes, cela s'explique, les catholiques avaient eu des comportements inacceptables au moment de l'Affaire Dreyfus, et la réaction des républicains est une réponse à une menace, dans une situation de combat. Mais elle est malgré tout très forte et très véhémente. La loi de 1905 est perçue initialement par les catholiques, d'autant qu'elle est refusée par le pape, comme une agression supplémentaire, voire un coup de grâce. Et les républicains les plus intransigeants la veulent aussi comme un coup fatal. De même que les catholiques, qui le redoutent, ils pensent qu'en supprimant les traitements des desservants et des évêques, la religion va s'éteindre.
En fait, les choses sont différentes. Par la volonté de Briand, de Jaurès, de Pressensé, par suite de l'évolution des travaux parlementaires, la loi de 1905 ne va pas être cette loi de plus, elle va être l'Édit de Nantes des catholiques. Elle leur garantit en fait qu'ils pourront continuer à pratiquer leur culte dans leurs églises, et c'est toute l'importance de l'article 4 sur les associations cultuelles. Mais pour les laïcisateurs, le combat continue. Après avoir séparé l'Église de l'État, il faut en finir avec ce qui reste d'influence cléricale dans l'école. Mais les choses vont prendre un autre tour et les législateurs, les hommes politiques vont s'apercevoir qu'aucun des deux camps ne peut plus bouger. La situation est complètement bloquée.
Comme les catholiques sont libres, des associations catholiques de pères de famille se fondent à l'instigation des évêques, et elles font la chasse aux manuels qu'elles jugent attentatoires à leur religion dans les écoles primaires. Une guerre des manuels sévit en 1906-1910 : les catholiques font des procès aux instituteurs. Un instituteur de la Côte-d'Or, Morizot, est poursuivi pour avoir déclaré en classe que ceux qui croient en Dieu sont des imbéciles. Après un grand débat juridique pour savoir si cela relève du tribunal administratif ou du tribunal civil, l'affaire va jusqu'en cassation et Morizot est condamné en 1907. Cela veut dire clairement que les tribunaux défendront les élèves de religion catholique contre les provocations de leurs instituteurs.
Mais les amicales d'instituteurs estiment cette contestation de leur liberté pédagogique inacceptable et à leur tour, ils poursuivent les évêques. Dans tous les départements, ils intentent des actions en diffamation contre les évêques, pour avoir fait en chaire des proclamations disant que l'école sans Dieu, c'était l'enfer, l'abomination, la désolation, et il est vrai qu'ils ont tenu des propos extrêmement véhéments. L'évêque de Reims est condamné un peu plus tard, justement sur plainte d'une amicale des instituteurs. Le débat se judiciarise, les tribunaux frappant « un coup à droite et un coup à gauche ». Les instituteurs par leurs amicales et les députés radicaux, les députés intransigeants, demandent à l'État d'intervenir et de faire une loi pour protéger les instituteurs contre les associations de parents d'élèves. Le législateur fait la sourde oreille. Une sorte de statu quo s'établit ainsi, dénoncé par les milieux laïques, qui ne concilie pas les milieux catholiques, mais qui est une sorte de trêve.
La guerre de 1914 provoque une certaine pacification religieuse, parce qu'elle favorise une interconnaissance entre des milieux qui s'ignoraient. Les prêtres n'avaient pas l'habitude de fréquenter des instituteurs radicaux ou francs-maçons et réciproquement. Certes, des prêtres ont été mobilisés comme aumôniers, brancardiers, infirmiers, mais beaucoup ont été poilus comme tous les hommes de leur génération. Quand ils étaient dans la même tranchée, il fallait bien qu'ils se parlent. À force de se parler, ils se comprennent un peu mieux et, surtout, ils s'aperçoivent que, des deux côtés, il y a des des gens estimables, des gens courageux, serviables et d'autres qui le sont moins. Une sorte de décrispation se produit, qui va d'ailleurs se poursuivre dans les associations d'anciens combattants, à commencer par la plus importante, l'Union fédérale des Anciens combattants. Cette association a été présidée très longtemps par un instituteur très laïque, ancien élève de l'École normale primaire de Varzy dans la Nièvre, professeur d'école primaire supérieure, qui n'était sans doute pas franc-maçon, mais incontestablement laïque. Or parmi les dirigeants de l'Union Fédérale, on trouve des prêtres, comme le chanoine Matteudi ou l'abbé Secret, un des militants de l'éducation postscolaire catholique en Savoie. Cela ne pose pas de problème, mais ce n'est qu'une partie de la société.
Une certaine pacification laïque intervient après 1919, sous la chambre « bleu horizon ». Cette chambre est dénoncée par les radicaux-socialistes pour avoir rétabli les relations diplomatiques avec le Vatican, en 1921 et pour avoir accepté le compromis avec le Vatican en 1924 : l'encyclique Maximam gravissimamque permet de créer des associations cultuelles diocésaines et donc présidées par l'évêque, au lieu des associations locales dont le pape craignait qu'elles n'encouragent des schismes. Une association cultuelle présidée par l'évêque, c'est une reconnaissance de l'Église comme institution. Cela entraîne une certaine détente.
Mais les catholiques font très attention à ne pas aller plus loin. Je vais taquiner M. Bourg-Broc en évoquant l'article 69 de la loi Falloux, qu'il a voulu amender, car il limite à 10 % les subventions versées par les collectivités publiques aux enseignements privés. Sa proposition de loi visait à supprimer cette barrière des 10 %, qu'il jugeait trop contraignante. En 1921, un de ses prédécesseurs, M. de Baudry d'Asson, a déposé dans la discussion budgétaire un amendement proposant justement d'utiliser l'article 69 de la loi Falloux pour accorder, dans cette limite de 10 %, des bourses aux élèves de l'enseignement privé. Cet amendement utilisait donc au profit de l'enseignement privé la marge de 10 % dont la proposition Bourg-Broc de 1993 ou 1994 considérait au contraire qu'elle constituait une entrave intolérable. Dans la chambre bleu horizon, les catholiques étaient sans doute majoritaires. Mais les catholiques modérés interviennent contre l'amendement Baudry d'Asson. M. Isaac, député de Lyon, ministre du Commerce, un grand patron catholique, libéral, déclare ainsi : « Depuis que nous avons commencé la discussion du budget de l'instruction publique, nous sommes arrivés au chapitre 121 sans que la moindre allusion ait été faite à des divergences d'opinion qui, autrefois, dans une chambre comme celle-ci, auraient surexcité les passions et donné lieu aux développements les plus étendus ». Et Isaac combat l'amendement, pour ne pas rallumer la querelle scolaire. L'abbé Lemire, député du Nord, intervient lui aussi en disant : « Quand on veut être libre, il faut savoir être pauvre. » Il défend la laïcité d'une façon très intéressante, au nom de la défense des élèves catholiques des écoles publiques : « Je demande en second lieu qu'on n'entre pas dans la voie des subventions officielles par souci de l'enseignement public lui-même. Aujourd'hui, l'enseignement de l'État est, par définition, ouvert à tout le monde. - "Très bien", disent la gauche et l'extrême gauche - Il peut, en effet, n'être pas du goût d'un père de famille que la bourse accordée soit une bourse dans les écoles de l'État. Je dis que, précisément parce que c'est une bourse dans les écoles de l'État, le père doit savoir que les convictions de son enfant seront respectées dans cette école. - Exclamations à droite, "très bien, très bien" à gauche - . Le propre de l'école de l'État, c'est qu'étant payée par l'argent de tous, elle doit être respectueuse des convictions de tous. Et donc, je ne veux pas donner de subventions aux écoles privées parce que, si je donnais des subventions pour les écoles privées, cela veut dire que je supposerais que la liberté de conscience n'est pas respectée dans l'enseignement public. » 45 ( * ) Et cela, c'est une supposition inacceptable pour un député de la République. L'amendement Baudry d'Asson est repoussé par 120 voix pour, 335 contre. Parmi les abstentions, il y a Isaac, l'abbé Lemire vote contre. Parmi les députés qui ont voté pour l'amendement, je signale Robert Schuman, alors député de la Moselle.
Cet apaisement relatif va être troublé d'abord par la modification des programmes de l'enseignement primaire, avec Lapie, qui en retire les devoirs envers Dieu en 1923, puis par la victoire du Cartel en 1924 et la relance laïque avec l'arrivée au pouvoir, rue de Grenelle, de François Albert. C'est un radical franc-maçon des Deux-Sèvres, une terre où le combat rouge blanc est très dur. Il est aussi président de la Ligue de l'enseignement. Le Cartel essaie d'étendre les lois laïques à l'Alsace-Lorraine et de faire appliquer les lois sur les congrégations. Ce qui est d'ailleurs paradoxal parce que les congrégations qui sont revenues en France et qui se sont donné un statut légal, ont souvent adopté le statut d'association loi 1901 qui les protège juridiquement, sans passer par les procédures d'autorisation particulières aux congrégations, qui font l'objet du titre IV de la loi de 1901.
Le Cartel échoue devant la mobilisation énorme, massive, de l'Église catholique, la création de la Fédération nationale catholique par le général de Castelnau et une série de meetings départementaux. Il existe aux Archives nationales un carton sur ces manifestations, parce que le Cartel a naturellement envoyé les inspecteurs de police les surveiller ; tant qu'il est au pouvoir, on a un rapport, puis quand il est renversé, les rapports de police s'arrêtent du jour au lendemain, ce qui est fâcheux pour l'historien, mais politiquement explicable. 46 ( * ) Devant cette mobilisation extrêmement forte, et qui connaît des incidents graves - deux morts à Marseille en 1925 - le Cartel renonce à ses projets. La pacification va durer jusqu'à la guerre, puisqu'aucune mesure d'extension de la laïcité ne figure au programme du Front populaire, ce qui lui sera violemment reproché par les laïques ; la seule mesure annoncée est la prolongation de la scolarité obligatoire. Des deux côtés, on laisse donc le problème en attente.
La radicalisation théorique
Paradoxalement, au même moment, les positions théoriques se radicalisent.
Du côté catholique, la campagne pour la représentation proportionnelle scolaire est extrêmement vive au début des années vingt. Elle perd de son intensité après la condamnation de l'Action française, en 1926, et la nomination du père Merklen à la direction du grand journal catholique La Croix , à la place de Guiraud, qui était beaucoup plus intransigeant. Mais, du côté catholique, les condamnations de l'école laïque se succèdent, chaque fois plus précises. L'Église élabore toute une théorie de l'école catholique, avec une déclaration du cardinal Dubois, archevêque de Paris, à la Semaine des écrivains catholiques en 1922, puis une déclaration des cardinaux et archevêques en 1925, extrêmement véhémente : « Les lois de laïcité sont injustes d'abord parce qu'elles sont contraires au droit formel de Dieu. Elles procèdent de l'athéisme et y conduisent dans l'ordre individuel, familial, social, politique, national, international. Elles supposent la méconnaissance totale de notre Seigneur Jésus-Christ et de son Évangile et elles tendent à substituer au vrai Dieu des idoles : la liberté, la solidarité, l'humanité, la science, etc., à déchristianiser toutes les vies et toutes les institutions. Ceux qui en ont inauguré le règne, ceux qui l'ont affermi, étendu, imposé, n'ont pas eu d'autres buts. De ce fait, elles sont l'œuvre de l'impiété, qui est l'expression de la plus coupable des injustices, comme la religion catholique est l'expression de la plus haute justice. » 47 ( * ) On ne peut pas dire que ces condamnations soient particulièrement mesurées !
Mais il y a plus grave : pour la première fois, le pape se prononce explicitement, avec l'encyclique Divini illius Magistri de 1929. Ce texte de grande ampleur théorise le droit prééminent de l'Église comme éducatrice première, le droit des familles, et ne reconnaît à l'État qu'un droit en quelque sorte subsidiaire. Ses affirmations sont tranchées : « il ne peut y avoir d'éducation complète et parfaite en dehors de l'éducation chrétienne ». La condamnation des écoles mixtes est formelle. « De là, il ressort nécessairement que l'école dite neutre ou laïque, d'où est exclue la religion, est contraire au premier principe de l'éducation. Une école de ce genre est d'ailleurs pratiquement irréalisable car, en fait, elle devient irréligieuse. Inutile de reprendre ici tout ce qu'ont dit nos prédécesseurs. La fréquentation des écoles non catholiques ou neutres, ou mixtes - à savoir, qui s'ouvrent indifféremment aux catholiques et non catholiques sans distinction - doit être interdite aux enfants catholiques. Il ne peut donc même être question d'admettre pour les catholiques cette école mixte, plus déplorable encore si elle est unique et obligatoire pour tous, où, l'instruction religieuse étant donnée à part aux élèves catholiques, ceux-ci reçoivent tous les autres enseignements de maîtres non catholiques, en commun avec des élèves non catholiques. » 48 ( * ) Au terme de cette théorisation, il n'est d'école pleinement satisfaisante pour un catholique que l'école totalement catholique. C'est une position extrêmement tranchée.
Parallèlement, de l'autre côté, le camp laïque durcit sa position. La théorie qu'il adopte n'est pas exactement le monopole. Le monopole a été défendu par des radicaux au moment de l'époque combiste mais il était aussi combattu par d'autres, comme Clemenceau, qui demandait : « Quel concile de pions définira la doctrine du jour ? » Il y avait au sein du radicalisme une tradition libérale hostile au monopole et même chez Clemenceau un certain mépris pour cette solution étatiste. Pour les instituteurs, le monopole n'était pas non plus une bonne solution, parce qu'il aurait signifié qu'ils étaient au service de l'État. Or les instituteurs pensent qu'ils enseignent en vertu des droits de l'enfant et d'une vérité rationnellement établie. Entre les mains d'un gouvernement réactionnaire, le monopole pourrait devenir très dangereux pour la laïcité. On n'imagine pas encore l'exemple soviétique ou totalitaire, mais on se méfie cependant d'une dérive dont le Second Empire a montré la possibilité. Jusqu'à la guerre de 1914, le thème du monopole n'est pas très répandu chez les instituteurs.
Il va pourtant devenir après la guerre leur position officielle, mais sous une forme amendée. À la même époque, la CGT imagine en effet, et adopte comme l'une de ses revendications fortes, la nationalisation "industrialisée" qu'elle oppose à l'étatisation. La nationalisation industrialisée suppose une autonomie complète des entreprises nationalisées, et leur gestion tripartite par la coopération, sous le contrôle de la nation, des producteurs et des consommateurs. Les instituteurs appliquent ce schéma à la gestion de l'enseignement et revendiquent sa nationalisation et sa gestion tripartite par les usagers, - ils ne disent pas "les parents" parce qu'ils se méfient des parents catholiques et qu'ils voudraient voir les usagers représentés par les syndicats - les techniciens - c'est-à-dire les enseignants - et l'État. Mais la nationalisation équivaut, pour l'enseignement privé, au monopole, car elle implique la suppression de tout enseignement en dehors du service public ; c'est une solution radicale. L'idée est adoptée au congrès du SNI à Strasbourg en 1927 : « Considérant que l'enseignement est l'exercice d'un pouvoir public et non l'usage d'un droit naturel, que l'éducation tend de plus en plus à devenir un grand service public, que la réalisation de l'école unique exige un contrôle rigoureux de tous les établissements d'instruction, contrôle qui ne peut être effectif que dans le cadre d'un enseignement nationalisé, qu'il importe de réaliser l'unité et l'autonomie d'une université nouvelle, que seule une école nationale peut développer harmonieusement les esprits, le Syndicat National se prononce en faveur d'un enseignement nationalisé comportant : 1° la suppression de l'enseignement privé confessionnel, 2° la laïcité complète des programmes d'enseignement, 3° la délégation par la nation et sous son contrôle de son pouvoir enseignant à tous ceux, individus ou associations, qu'elle en jugerait digne. » Il s'agit de laïciser l'école privée. Ce qu'explicite l'année suivante la motion du congrès du Syndicat National, qui définit clairement la nationalisation tripartite. La proposition est reprise par la Ligue de l'Enseignement, par le parti radical et, sur rapport de Léon Blum, par le Parti socialiste unanime à son congrès de 1929.
D'un côté, les catholiques disent : « Rien que l'école catholique » et, de l'autre, les laïques disent : « Rien que l'école publique ». De plus, ils se mettent à faire la chasse aux catholiques à l'intérieur de l'enseignement public. On connaît cela par la jurisprudence du Conseil d'État, parce qu'un certain nombre des victimes de ces mesures discriminatoires ont porté plainte devant le Conseil d'État. Cela a donné lieu à des arrêts du Conseil d'État qui sont en quelque sorte la « partie émergée de l'iceberg ». L'arrêt Demoiselle Beis du 25 juillet 1939 montre une institutrice suppléante qui a été écartée de la titularisation parce qu'elle avait fait ses études dans l'enseignement confessionnel et que, de ce fait, elle ne présentait pas les garanties nécessaires de laïcité. Le ministère de l'Éducation nationale exigeait des candidats aux écoles nationales professionnelles un certificat attestant qu'ils sortaient d'un établissement public. Dans un arrêt du 22 mars 1941, le Conseil d'État a cassé cette décision discriminatoire. Il a cassé pour la même raison, en 1944, je le signale au passage, l'arrêté du gouverneur général d'Alger limitant à quatorze pour cent le nombre d'élèves juifs dans les écoles primaires et secondaires : c'est une mesure discriminatoire. Une demoiselle a été refusée du cadre des assistantes sociales de l'hygiène scolaire au motif de ses croyances religieuses. On a refusé à un instituteur l'inscription au concours d'inspecteur d'académie au motif qu'il « a placé sous un symbole religieux l'enseignement de l'école publique. » Il se défend et en racontant les faits : le programme de chant du certificat d'étude est arrivé huit jours avant l'examen ; il s'est demandé comment faire apprendre rapidement ce chant à ses élèves et pour cela a décidé de le leur jouer sur un instrument de musique ; or le seul disponible dans son village était l'harmonium de l'église. Il a donc emmené ses élèves à l'église. Une institutrice ayant fait visiter le château d'Amboise à ses élèves a eu des ennuis avec son administration pour ne pas avoir empêché le gardien du château de les faire pénétrer dans la chapelle Saint-Hubert. Il y a donc à cette époque un incontestable sectarisme dans l'enseignement primaire, qui témoigne de la radicalisation des options. Il prête à sourire aujourd'hui, parce qu'il est périmé, mais il correspondait à l'époque à quelque chose de profond. Un directeur d'école normale disait en 1935 : « Laïcité ne veut pas dire respectueux de toutes les croyances, sens dépassé depuis longtemps, mais antireligieux ». 49 ( * )
Vichy est une revanche des catholiques, sur tous les plans : suppression des écoles normales (18 septembre 1940), rétablissement des devoirs envers Dieu dans le programme de morale des écoles primaires (23 novembre 1940), autorisation des curés à faire le catéchisme dans les écoles (6 janvier 1941). Ces dispositions sont annulées par Carcopino, mais elles témoignent d'une incontestable volonté de revanche. La législation des congrégations est modifiée le 3 septembre 1940, la loi du 8 avril 1942 admet qu'une congrégation non autorisée est légale ; les élèves des écoles libres sont admis à la caisse des écoles et aux bourses. Enfin et surtout, la loi du 2 novembre 1941 inscrit 386 millions au budget du ministère de l'Intérieur pour des subventions aux écoles privées, subventions qui sont versées aux évêques. Il y a donc une rupture, dans des circonstances exceptionnelles.
La commission André Philip
À la Libération, la commission André Philip est la première d'une longue série de commissions. Elle est constituée pour étudier le maintien ou la suppression des subventions aux écoles libres, puisque cette subvention a été reconduite au budget de 1944 mais que, pour celui de 1945, la décision est à prendre. C'est une commission bien composée. Du côté laïque, il y a Senèze, qui était le rapporteur des motions que je vous ai lues, au congrès national du SNI. Du côté catholique, on trouve le directeur de la France de l'Ouest et le chanoine Amayon, directeur diocésain de l'enseignement privé de Paris. Les interlocuteurs sont bien choisis, le président aussi : c'est André Philip, un homme politique de premier plan. Il est socialiste, il a été ministre, c'est un résistant incontestable et, de plus, c'est un protestant. Il va donc tenir un langage religieux à l'intérieur de la commission, tout en étant laïque. Il va adopter une méthode pragmatique et éviter de commencer par discuter des droits respectifs de Dieu, de l'État, de l'Église, du père de famille : on sait que cela ne conduit nulle part. Il essaye d'aborder les problèmes de façon pragmatique.
Le travail de la commission Philip est très intéressant, parce qu'il jette les bases de tout ce qui va se passer ensuite. On peut dire que tous les problèmes et toutes les solutions sont déjà en germe dans la commission Philip. D'abord, il y a, dans cette commission, l'idée d'une réduction des ambitions en termes de valeurs et de contenu idéologique central de l'école publique. Il n'y a pas d'école sans valeurs. Une école ne peut pas être totalement neutre et aseptisée. Cela n'existe pas, il faut un minimum de valeurs. Pour André Philip et pour la commission, ce noyau commun, ce sont les valeurs de la Résistance, « nous avons été capables de nous battre contre les Allemands au nom de certaines valeurs, ce sont ces valeurs sur lesquelles nous pouvons nous entendre ». La commission le suit. Au cours d'une séance, Henri Wallon présente une longue justification d'un enseignement proprement rationaliste. Il est contredit par André Philip. Celui-ci réaffirme certes l'existence d'un fond commun qui peut être enseigné à l'enfant, ce qui distingue la laïcité d'une neutralité purement négative et passive, mais il ne comprend pas la foi rationaliste telle que Wallon la définit. « Si cette foi laïque et rationaliste est en fait une des familles de la France, si elle veut être une tendance à côté d'autres dans l'école, ce n'est pas elle qui doit être enseignée dans l'école publique. Sinon, l'on courrait le risque d'une école rationaliste en face de l'école confessionnelle. Ce qui doit être le fondement de notre enseignement, c'est l'ensemble des valeurs humaines pour lesquelles nous tous, catholiques, protestants ou libres-penseurs, avons combattu dans la Résistance, et qui sert vraiment à définir la communauté nationale française. » 50 ( * )
Il y a donc une réduction par rapport à ce qui est le noyau dur de valeurs de l'enseignement laïque et une prise de distance à l'égard d'un rationalisme qui, scientifiquement, se fait plus probabiliste. L'idée fondamentale de Philip est de considérer l'enseignement comme un service public. Mais, pour lui, il y a deux manières de gérer un service public : on peut le gérer en régie directe, on peut le concéder. Si on le concède, il y a un cahier des charges. Ses interlocuteurs ont quelque peine à entrer dans cette logique, mais la logique du service public concédé sera exactement la logique de la loi Debré : c'est un service public puisqu'il y a un besoin scolaire reconnu ; si l'école privée fait double emploi, on s'en passe ; elle doit accueillir tous les élèves - ce qui n'est pas le cas, par exemple, aujourd'hui, de certaines écoles confessionnelles -, elle doit les accueillir dans le respect de la liberté de conscience et, cependant, on maintient son caractère propre, ce qui fait toute l'ambiguïté de la loi Debré. Mais c'est ce que Philip appelait un service public concédé. Enfin, il y a une proposition concrète de mise en œuvre de ce service public qui permettrait de régler le problème qui se pose dans les petites communes. Dans les communes de moins de deux mille habitants - le seuil peut être discuté -, si l'école publique est majoritaire, on ne change rien. Si l'école privée est seule, on la nationalise, on paie son maître, on le titularise, mais on organise un enseignement religieux dans l'école, en dehors des heures de classe, fait par le curé. Et quand l'instituteur s'en va ou part à la retraite, un conseil de parents donne son avis sur le choix du successeur. S'il y a deux écoles, une privée et une publique, on nationalise l'école privée, on la fusionne avec l'école publique et l'on adopte le système prévu pour l'école privée nationalisée.
En conclusion, ce dispositif n'est même pas discuté et la question posée par la commission Philip est appelée à prospérer tout au long du XX e siècle. Philip n'a pas de soutien politique. Les membres de la commission Philip qui appartenaient aux partis politiques sont absents et ne prennent pas part au débat. Le gouvernement ne soutient pas sa proposition. Le chef du gouvernement provisoire, qui est le général de Gaulle, n'a pas mesuré l'ampleur du problème et sans doute est-il aussi mal disposé envers les évêques, dont le comportement pendant la période de Vichy n'a pas été ce qu'on aurait pu attendre. Toujours est-il qu'il ne fait rien. On laisse André Philip aller seul à l'échec. Son ministre Capitan le soutient, mais en vain.
D'autre part, il n'y a pas de volonté chez les acteurs. Les négociateurs de la commission Philip sont désavoués et savent qu'ils vont être désavoués par leurs mandants, à la fois par les milieux laïques et par les évêques. Selon l'un d'entre eux, « Même si les évêques nous suivaient, il n'est pas sûr que, dans l'ouest, les curés suivraient les évêques », tellement les concessions qui sont faites sont importantes, aussi bien du côté laïque que du côté confessionnel. Aucun des deux camps n'a envie de céder. Pourquoi ? Le camp laïque est dans une situation de revanche, il n'est pas demandeur. Pour lui, le statu quo de 1939 est tout à fait convenable. Les évêques se font encore des illusions et n'ont pas compris qu'ils avaient intérêt à faire des concessions pour une négociation qui de toute façon les court-circuiterait en ayant lieu d'école à État. C'est le plus gros obstacle du côté catholique : ce type de service commun concédé l'aurait été au cas par cas et l'Église comme institution n'aurait pas eu à intervenir dans ces négociations entre l'État et chaque école. Les évêques, donc, n'en veulent pas.
C'est aussi que tout le monde sous-estime le problème. Or, et le retour au statu quo et la nationalisation de l'enseignement privé sont également difficiles. Les laïques n'en ont pas conscience et les catholiques n'ont pas joué la politique du pire. S'ils avaient dit : « Nous fermons nos écoles et nous ne faisons pas la rentrée en septembre 1945 », on ne sait pas ce qui se serait passé, mais le problème serait apparu dans toute son ampleur : à l'époque, vingt-cinq pour cent des élèves du primaire et plus de la moitié des élèves du secondaire étaient scolarisés dans des établissements confessionnels. Sans doute ces établissements auraient-ils été nationalisés. Mais, dans la situation financière où se trouvait la France de 1945, la nationalisation aurait rencontré d'énormes difficultés. Le problème a été donc sous-estimé des deux côtés et on a laissé le problème entier.
Pourquoi la situation était-elle intenable ? Parce que l'enseignement privé s'était lui-même sécularisé. Les congréganistes avaient été partiellement remplacés par des pères et des mères de famille qui n'avaient pas fait voeu de pauvreté mais qui, en revanche, avaient une famille à élever dans des conditions décentes. Les subventions de Vichy avaient interrompu les circuits de financement de l'enseignement privé ; or il est beaucoup plus difficile de reconstituer des circuits de financement que de maintenir en vie des circuits qui existent. Enfin, on est dans un contexte d'inflation galopante, dans lequel reconstituer des circuits de financement à partir de mécènes dont les rentes fondent est évidemment acrobatique.
Les solutions de la commission Philip tracent en pointillé les solutions qu'adoptera quinze ans plus tard la loi Debré, mais la vraie question se pose ensuite. Ceci est mon point de vue personnel, je ne parle plus comme historien mais comme citoyen : le service public concédé avec un cahier des charges est une solution acceptable pour un républicain. Mais les laïques se sont battus contre le principe de la concession, et non pour son cahier des charges. Le résultat est que nous avons un service public concédé sans cahier des charges. Nous avons donc un système pluraliste, mais il est bien loin du service public concédé tel que le concevaient André Philip ou Michel Debré, qui partageaient un même incontestable sens de l'État.
LA LAÏCITÉ ET L'ÉCOLE DEPUIS 1945
Table ronde sous la présidence d'Émile Poulat,
directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales
Bruno Bourg-Broc, député, rapporteur de la loi Bayrou en 1993
Jean Pierre Delannoy, docteur en droit
Jean Foyer, ancien garde des Sceaux
Émile Poulat, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales
Je remercie Antoine Prost pour son brillant exposé, vos applaudissements montrent que vous l'avez entendu. Je prends donc la relève de cette communication avec une table ronde dont vous connaissez les participants. Je n'ai pas besoin de vous les présenter, ce sont des personnages historiques : Jean Foyer, ancien garde des Sceaux, juriste éminent, Bruno Bourg-Broc dont le nom est associé à une proposition de loi, et Jean-Pierre Delannoy à qui l'on doit une thèse sur les questions qui nous préoccupent.
Antoine Prost nous a fait remarquer combien l'Église avait changé depuis un siècle, j'ajouterai combien notre société a changé depuis un siècle. C'est probablement ce qui nous fait une telle difficulté pour bien comprendre et entrer dans ces problèmes de la loi de séparation de 1905. Je ne m'étendrai pas sur ces changements de la société, sur ces changements de l'Église, je prendrai simplement une image pour symboliser ce que je veux dire. Ceux qui sont de ma génération ont tous connu des cardinaux en cappa magna , c'est-à-dire en soutane rouge, avec une traîne rouge. Il fallait même quelqu'un pour porter cette grande traîne, c'était un vêtement très lourd, très majestueux. J'évoquerai simplement l'actuel archevêque de Lyon, Mgr Barbarin, qui a été nommé cardinal peu après sa nomination à l'archevêché de Lyon. C'est le maire de Lyon, Gérard Collomb, un député socialiste - depuis sénateur -, qui lui a donné l'information qu'il venait d'apprendre par un flash ou par l'AFP, mais Mgr Barbarin était bien empêché de le savoir, car il était en train de courir le marathon de Lyon. Vous imaginez que, pour courir un marathon, il ne faut pas être un vieil archevêque « chenu », courbant sous le poids des ans et de la cappa magna . Vous avez dans cette image tout le changement intervenu.
Nous sommes ici à l'occasion de la loi de 1905 mais, en même temps, les organisateurs ont voulu élargir puisque nous évoquons la période de 1789 à 2005. Cette table ronde est consacrée au problème scolaire. Contrairement à ce qu'on entend souvent dire, la loi de 1905 ne concerne en rien l'enseignement public ou privé. J'ai participé à un jury à l'Académie des sciences morales et politiques : l'Académie est chargée de préparer les cérémonies du centenaire grâce à un certain nombre de colloques et avec des cérémonies solennelles. Elle a imaginé d'éditer une médaille commémorative de cet événement. Elle a donc ouvert un concours, avec un jury pour examiner les projets. Nous avions une vingtaine de projets, rarement convaincants, d'ailleurs, un seul a fini par s'imposer. Mais l'un des projets était une médaille sur laquelle figurait « La laïcité, c'est le savoir pour tous ». Nous sommes en pleine question scolaire, mais nous sommes aux antipodes de la loi de 1905.
Qui a lu la loi de 1905 ? Je vois qu'il y a quelques mains qui se lèvent, mais j'ajouterai, dans quel texte l'avez-vous lue ? Car c'est cela, le problème. L'avez-vous lue dans le texte originel, publié au Journal Officiel du 11 décembre 1905 ou dans le texte qui est actuellement disponible à la direction des Journaux Officiels, qui est un texte remanié ? Faut-il modifier la loi de 1905 ? En général, tous ceux qui s'interrogent ainsi et qui répondent oui, précisément, n'ont jamais eu accès à ce texte et on a beaucoup de mal à leur faire préciser ce qu'ils entendent par là. Le plus extraordinaire, c'est que la dernière modification en date est passée inaperçue de ceux qui en discutaient. De plus, on a beaucoup de mal à comprendre ce dont il s'agit, car c'est le seul article qui touche précisément à la question scolaire : l'article 30, abrogé par l'ordonnance du 15 juin 2000. Il porte sur l'interdiction d'enseigner le catéchisme pendant les heures de classe. On se demande comment un tel article a pu être abrogé par ordonnance. Il se trouve que cet article abrogé a tout simplement été maintenu textuellement, mais réintroduit dans le code de l'Éducation promulgué par cette ordonnance. On se trouve là devant des problèmes extrêmement compliqués. Aujourd'hui, devant la loi de 1905, on a beaucoup de mal à s'y retrouver. C'est pourquoi je travaille à une édition critique de la loi de 1905. C'est indispensable pour essayer d'y voir clair et de commencer non pas par modifier la loi de 1905, mais par l'alléger de tous les articles qui sont désormais sans objet : c'était une loi de transition et les mesures de transition ont fait leur temps. Maintenant, c'est une page tournée.
Il n'y a donc guère de rapport entre la loi de 1905 et les lois scolaires, mais il y en a tout de même un, considérable, qui fait partie du non-dit de la loi. Notre République laïque, la République des républicains, celle qui est arrivée au pouvoir en 1879, a pris toute une série de mesures et de lois laïques qui ont été évoquées. Les premières ont été les lois scolaires. On en a évoqué d'autres, sur les cimetières, sur l'Assistance publique. La loi du 9 décembre 1905 est une sorte d'aboutissement ou de couronnement de ces lois laïques. C'est, en quelque sorte, la dernière des grandes lois laïques, en dehors des séquelles de cette loi. Il est important de bien voir le massif, le bloc, l'unité que forme toute cette législation. Si bien que, de la même manière qu'auparavant ce n'était pas le Concordat qui nous régissait mais le régime concordataire avec ses extensions, les cultes protestant et israélite, c'est un régime de lois laïques qui aujourd'hui nous gouverne, dont la loi de 1905 est une partie essentielle mais très limitée.
On s'aperçoit que, dans la loi de 1905, on ne trouve pas les mots "laïcité", "séparation", "Église", "neutralité", c'est-à-dire tous les mots dont on la charge aujourd'hui. Nous parlons aujourd'hui de la loi de 1905 avec les mots qui sont les nôtres, mais qui ne sont pas les siens. En revanche, la loi de 1905 parle des cultes, d'exercice public des cultes et de financement de l'exercice des cultes. Or, on parle de loi de séparation des Églises et de l'État, de séparation du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Vous me permettrez de dire que le spirituel est complètement absent de la loi de 1905. Ce qu'on sépare - et encore, de manière relative -, ce sont deux temporels, le temporel public et le temporel ecclésiastique, c'est-à-dire les édifices du culte, le traitement des ministres du culte. Ce sont des questions d'argent, de biens, de propriété. Cela brouille peut-être un peu l'image que vous en avez, mais je crois qu'il faut revenir à des idées simples, claires et les problèmes se résolvent presque d'eux-mêmes.
En revanche, il y a un problème qui a mis un siècle à se résoudre : c'est le problème scolaire. C'est une question qui traîne depuis 1880 et qui remonte même auparavant. En 1923, ont été supprimés des programmes les devoirs envers Dieu. C'est aussi l'année où va se résoudre la question des associations cultuelles catholiques. Par conséquent, on a le sentiment que c'est une sorte de démarche à plusieurs vitesses. Tout n'est pas coordonné : cela avance dans un secteur, cela se pacifie et, dans l'autre, au contraire, la violence ou les conflits rebondissent. Nous sommes donc devant une histoire très compliquée.
C'est la période postérieure à 1945 qui doit nous occuper maintenant. Cette question scolaire a empoisonné toute la IV e République, encore plus que la III e , puisque démocrates chrétiens du MRP et socialistes se trouvaient ensemble et avaient donc à collaborer pour faire une majorité ou à se séparer avec tous les problèmes d'instabilité que cela posait. Guy Mollet, président du Conseil et président du Parti socialiste, a essayé de régler une fois pour toutes ces affaires religieuses. C'est ce que l'on a appelé, dans un livre publié par la suite, une « concorde sans concordat » : Guy Mollet s'est dit que, pour sortir de cette question scolaire, il fallait reprendre l'ensemble du contentieux en matière religieuse entre la France et le Vatican, entre la République et le Saint-Siège, et que, pour cela, il fallait conduire une négociation discrète et même secrète. Par conséquent, les membres des deux délégations s'engageaient à ne pas en parler. Il fallait ensuite que ce soit une négociation d'ensemble, sur la totalité des problèmes religieux, et non pas une négociation limitée à la question scolaire. Une fois l'accord obtenu, le Parlement serait saisi, ce serait non pas un nouveau concordat, non pas une nouvelle convention, mais un accord entre les deux parties sur ce problème.
Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que l'accord entre la France et le Saint-Siège a pu se faire : Guy Mollet était président d'un parti plutôt anticlérical à l'époque, la SFIO ; Pie XII n'était pas réputé pour être libéral ou prêt à transiger ; on se trouvait donc avec deux intransigeances. Pourtant, un accord a réussi à se faire sur la question scolaire. En fait, l'accord a « capoté » pour une première raison précise, c'est que les Alsaciens et les Mosellans, en Alsace-Lorraine, ont refusé de « faire les frais » de cette affaire, donc le bruit s'est répandu par eux et cela n'a pas pu aboutir. De plus, c'était dans le contexte de la IV e République finissante et le Saint-Siège n'était pas très pressé, car il se disait : que vaudra un accord signé avec une agonisante ? et qu'en sera-t-il avec son successeur ? ratifiera-t-il ce qui a été conclu ?
Nous arrivons donc à la V e République pour laquelle j'ai deux témoins de grande qualité. Le premier, par ordre chronologique d'ancienneté est Jean Foyer, le deuxième est Bruno Bourg-Broc, avec la fameuse proposition de loi, en 1993. Je me suis trouvé là devant un cas de conscience comme en connaissent tous les présidents de séance : faut-il donner la parole aux témoins d'abord, puis à l'historien, à l'érudit qui s'est plongé sur ce dossier ? Ou, au contraire, faut-il donner en premier lieu la parole à l'historien, à l'érudit, et laisser les témoins parler ensuite ? J'ai pensé qu'il valait mieux laisser l'historien nous exposer son affaire, plutôt que de lui laisser la charge de rectifier les souvenirs des témoins, en leur disant : « Vous savez, vous y étiez sans doute, mais moi, j'ai vu les papiers, j'ai vu les dossiers et, croyez-moi, les papiers sont plus sûrs que votre mémoire. » Les témoins, les acteurs sont toujours suspects, je le sais moi-même pour avoir été historien de périodes auxquelles j'avais participé : de jeunes collègues historiens m'ont dit que je n'étais pas qualifié pour traiter de ces sujets, puisque j'y avais été mêlé. C'est un éternel débat. Nous donnerons la parole à Jean-Pierre Delannoy.
Jean-Pierre Delannoy, docteur en droit
Il me serait difficile de rectifier les hypothétiques erreurs du président Foyer ; ma situation professionnelle ne me permet guère de l'envisager, et de toute manière, ayant eu l'honneur et le plaisir de travailler avec lui, je sais par expérience qu'il a une mémoire infaillible.
Mon seul titre à prendre part à ce colloque est en fait la thèse que j'ai récemment soutenue, sous la direction de mon amie Mme Brigitte Basdevant-Gaudemet, sur le fait religieux dans les travaux parlementaires de 1958 à 1975. Pour la préparer, j'ai lu tous les documents et comptes rendus dont la Constitution et les règlements des Assemblées organisent la publicité. J'ai simplement essayé, très modestement, de tirer en juriste quelques enseignements de ce que j'ai lu.
Dans ce cadre limité, je voudrais rappeler les idées-forces des grands débats parlementaires sur la laïcité à l'école avant, en conclusion, de vous proposer un élargissement de la perspective de notre réflexion hors du problème scolaire.
Il y a eu en gros, dans les dix-sept premières années de la V e République, trois grands débats législatifs sur l'école et la laïcité : l'élaboration de la législation sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privés (la « loi Debré », en 1959 ; la pérennisation de cette législation en 1971 ; la réforme de l'Éducation, dite « réforme Haby » en 1975. Je les aborderai successivement.
Auparavant, je vous proposerai une brève incursion dans les travaux préparatoires de la Constitution, qui ont été intégralement publiés à la Documentation française en 1987. À propos de la laïcité et de l'école, la moisson est quantitativement réduite ; il est vrai que la préoccupation prioritaire du général de Gaulle n'était pas de remettre en chantier la formulation des grands principes républicains. L'accord se fait très tôt pour reprendre, tels quels, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le préambule de la Constitution de 1946, auxquels le préambule de la nouvelle Constitution renvoie purement et simplement. Les quatre qualificatifs attribués à la République, « indivisible, laïque, démocratique et sociale », par cette même Constitution de 1946 sont littéralement reproduits dans l'avant-projet, en date du 19 juillet 1958, qui sert de base de discussion au conseil de cabinet réuni autour du général de Gaulle. Ils n'ont plus été discutés par la suite.
Mais, à plusieurs reprises au cours des étapes ultérieures de la procédure, on s'est attaché à souligner l'importance de maintenir tel quel le compromis politique de 1946, et parmi les termes de ce compromis, figurait incontestablement la consécration expresse de la laïcité, et de la laïcité scolaire, par le texte constitutionnel. Au cours des travaux du Comité consultatif constitutionnel, Pierre-Henri Teitgen, alors député MRP, a proposé un amendement tendant à faire figurer parmi les matières pour lesquelles compétence était expressément attribuée à la loi, la liberté de l'enseignement : au terme d'un débat dont le compte rendu restitue une image confuse, cet amendement a été rejeté après que Marcel Champeix, sénateur socialiste de la Corrèze et proche de Guy Mollet, eut invoqué le respect de l'accord politique passé douze ans auparavant sur la laïcité. À l'assemblée générale du Conseil d'État, Charles Blondel, conseiller d'État, insiste pour sa part sur la nécessité de maintenir tels quels les quatre attributs de la République, pour éviter les fausses interprétations qu'une modification ne manquerait pas de faire naître, et il prend comme illustration de ses craintes l'abandon éventuel du terme « laïque ». Les questions d'enseignement n'ont ainsi été abordées, au cours des travaux préparatoires de la Constitution, que dans une perspective de défense laïque.
Vient ensuite l'année 1959, pendant laquelle, sur le fond dramatique du conflit algérien, le second en importance des dossiers politiques est incontestablement l'école. Comme je l'ai rappelé au début de mon propos, je suis juriste et non pas historien, et d'ailleurs les aspects historiques du problème ont été largement abordés lors d'un très intéressant colloque tenu à Amiens en 1999 ; je vais donc simplement essayer de donner quelques aperçus sur les grandes fractures du débat parlementaire et les lignes de partage idéologique qu'il fait apparaître.
Le premier courant que l'on observe alors est la réaffirmation de l'idéologie laïque traditionnelle, essentiellement portée par les parlementaires socialistes, Guy Mollet en tête, naturellement. Mais je voudrais citer le très beau discours de Charles Privat, député des Bouches-du-Rhône, qui s'attache, le 23 décembre 1959, à définir ce qui distingue les deux écoles. Il affirme : « En réalité, deux conceptions de l'enseignement s'opposent profondément : celle de l'école républicaine et celle de l'école confessionnelle » . Puis il définit le but de l'école laïque : « développer l'intelligence de l'enfant, exercer sa raison » , avant de poursuivre : « La morale de l'école laïque est une morale universelle. Elle enseigne la recherche du beau, du bien, du vrai. Mais l'école laïque est aussi l'école de la liberté (...). L'autre école est l'école d'une église. Et ce n'est pas attaquer l'Église que de rappeler son dogme. Son dogme, c'est celui de la vérité révélée, en dehors de laquelle il n'y a qu'erreur et hérésie. L'école confessionnelle est donc l'école de la ségrégation, l'école qui n'est pas neutre, l'école qui ne cherche pas à former l'esprit de l'enfant à la recherche de la vérité, mais qui lui apprend ce qu'est l'explication du monde d'après sa doctrine et seulement la sienne » . C'est la plus belle expression, à l'époque, de cette idéologie laïque dont Antoine Prost et d'autres intervenants ont, tout à l'heure, décrit les développements.
Les élus communistes forment le second courant du camp laïque. On parlait tout à l'heure de l'anachronisme de la cappa magna . On pourrait éprouver un sentiment de décalage analogue en rapprochant la tonalité actuelle des échanges entre le Parti communiste français et l'Église catholique du vocabulaire utilisé par les parlementaires communistes en 1959 et au cours des années suivantes. Les discours de cette année-là présentent l'Église, ou en tout cas sa hiérarchie, comme un instrument de pouvoir idéologique au service du gaullisme, lui-même instrument de la domination économique des grands monopoles : avec la loi scolaire, l'Église catholique recevrait sa récompense. La réalité de l'Église est exclusivement présentée à travers la grille d'une analyse marxiste assez primaire. Cette démarche s'inscrit dans un effort de réinvestissement, par le Parti communiste, des valeurs républicaines dont il propose une lecture révolutionnaire, un peu comme, après 1935, dans le cadre de la nouvelle stratégie de front populaire, il mêlait les plis du drapeau rouge et du drapeau tricolore. La laïcité est une valeur libératrice.
Parmi les orateurs communistes, une grande figure se détache : Georges Cogniot, sénateur de la Seine de 1959 à 1977, agrégé de l'Université. Porte-parole du groupe communiste sur les questions d'éducation, il a écrit sur le sujet précis qui nous occupe un ouvrage intitulé Laïcité et réforme démocratique de l'enseignement , dont la première édition paraît en 1963 et la seconde en 1974. Héritier de la tradition contestataire franc-comtoise (comme le fut le père d'André Frossard), il met au service de l'idéologie révolutionnaire de son parti ses convictions personnelles laïques et rationalistes.
En face, dans le camp majoritaire de la droite et du centre favorable à une nouvelle définition des rapports entre l'État et des établissements privés aux neuf dixièmes catholiques, l'argumentation dominante ne se fonde pas essentiellement sur le droit qu'aurait l'Église catholique de posséder des établissements d'enseignement qui lui seraient propres, mais sur le principe de la liberté d'enseignement, même si des considérations religieuses viennent à l'appui de ce principe pour certains élus.
Michel Debré, Premier ministre, qui s'est investi profondément dans le dossier scolaire, défend une position originale. Les arguments qu'il développe au cours du débat sont très bien repris et explicités dans le tome III de ses Mémoires, Trois Républiques pour une France . On a parlé tout à l'heure des critiques qui avaient pu être exprimées à l'encontre de l'attitude de l'Église catholique pendant l'Occupation, et qui resurgissent en 1959 : Michel Debré explique dans ses mémoires comment il a répondu aux représentants des milieux laïques venus lui rappeler ces critiques, et qui lui reprochaient de vouloir obtenir la conciliation avec l'école catholique et l'Église catholique, alors que celle-ci avait donné des preuves de sa compromission pendant la guerre. Mais l'essentiel du débat n'est pas là.
L'important, dans la pensée de Michel Debré, est en effet le recours au système consultatif pragmatique déjà illustré, sous la IV e République, par la commission André Philip. Il constitue au début de 1959 une nouvelle commission, dont il confie la présidence à Pierre-Olivier Lapie, ancien ministre socialiste, avec mission de présenter des éléments de réflexion en vue d'une réforme des rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privé. La commission entend des personnalités extrêmement diverses, de tous les horizons, depuis le Comité national d'action laïque jusqu'à Mgr Blanchet, recteur de l'Institut catholique de Paris. Or Mgr Blanchet déclare lors de son audition, le 30 octobre 1959, que l'encyclique Divini illius Magistri du 31 décembre 1929, du pape Pie XI, dont les principaux enseignements ont été renouvelés et confirmés par Pie XII, constitue toujours la base de la doctrine catholique en fait d'enseignement : autrement dit, pour faire bref, que les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants, et que les parents catholiques ont le devoir de confier le soin de l'éducation de leurs enfants à des écoles où serait assurée, dans des conditions convenables, la transmission de la foi. Parlementaires communistes et socialistes demandent donc au Gouvernement de prendre parti sur cette doctrine et sur sa compatibilité avec l'établissement de relations suivies avec l'école catholique. Henri Darras, député socialiste du Pas-de-Calais, pose avec insistance la question lors de l'audition du Premier ministre et du ministre de l'Éducation nationale, André Boulloche, par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. André Boulloche, approuvé par Michel Debré, répond qu'il n'est pas opportun d'introduire le thème dans le débat. C'est une manière, non pas de se dérober, mais d'ôter toute portée idéologique ou juridique aux positions de l'Église et, par conséquent, aux revendications qu'elle pourrait exprimer en tant qu'institution.
Michel Debré propose, pour sa part, de résoudre le problème des relations avec l'école privée en recourant à l'idée de service public. La première base du compromis politique qu'il a proposé à l'époque est l'association de l'école confessionnelle à l'exécution des missions de service public relevant de l'éducation, en tenant compte de la poussée démographique et des besoins qu'elle engendrerait inévitablement. Mais il y avait une contrepartie à la mise en œuvre de ces relations d'association (je prends le terme en son sens générique) : l'ouverture de l'école catholique à tous les élèves, sans restriction ni exclusive, l'application des programmes et des principes pédagogiques de l'Éducation nationale ; et l'aide de l'État était reçue par le canal d'un système de contrats.
Suivant les propositions de la commission Lapie, Michel Debré articulait cette association de l'enseignement privé (tout qualificatif confessionnel est soigneusement évité dès lors qu'il s'agit de définir les éléments du nouveau régime juridique) avec une définition plus claire de la place de l'aumônerie catholique dans les établissements d'enseignement public. On retrouve là la loi de 1905 et plus précisément son article 2 qui prévoit l'organisation des aumôneries dans les services comme les hôpitaux, les écoles ou les prisons. Cette disposition, qui n'a jamais été d'ailleurs considérée comme limitative (les aumôneries militaires sont régies par d'autres textes), est confirmée et précisée par l'article premier de la loi du 31 décembre 1959.
Quant au contenu des enseignements et aux spécificités de l'école catholique, un compromis a, là encore, été recherché et obtenu autour de la réaffirmation du respect de la liberté de l'enseignement et du respect du caractère propre des établissements privés. Le président Foyer a d'ailleurs participé activement à l'affinement ultime de la traduction textuelle de ce compromis. En 1959, certaines déclarations de Michel Debré laissaient entendre qu'il rattachait la manifestation du caractère propre à ce qui était extérieur aux actions d'enseignement stricto sensu, aux cours (on se demandait à l'époque s'il y avait une manière catholique d'enseigner les mathématiques). Aujourd'hui le caractère propre est davantage perçu comme une manière de concevoir la vie globale de l'établissement scolaire et les rapports entre les personnes qui participent à un titre ou à un autre à sa vie.
Il faut insister sur un point : la loi de 1959 a définitivement ancré dans le vocabulaire juridique la notion d'enseignement « privé ». Cette évolution terminologique illustre la parfaite réussite de l'action de désamorçage du conflit scolaire tentée par Michel Debré. Du coup un certain nombre de querelles sont tombées à plat : à titre d'anecdote, quand la Revue administrative a ouvert ses colonnes aux lecteurs désirant conforter l'analyse hypercritique faite par François Méjan, devant la commission Lapie, des intentions captatrices de l'Église catholique en matière d'enseignement, elle n'a trouvé à publier que deux lettres dénonçant les outrances du prestigieux auteur.
Bien sûr, il y a eu, au cours des années qui ont suivi, des protestations parfois massives, les syndicats d'enseignants se sont mobilisés, une campagne de signatures a été lancée, des cas de résistance administrative ont été dénoncés. Et la controverse s'est aussi portée sur les aumôneries. Georges Cogniot a fait preuve à leur encontre d'un zèle particulier. Il est allé jusqu'à voir dans le projet de nomination de « catéchistes » à la place de prêtres la source d'une dégradation de la qualité de l'enseignement en général (c'était sa préoccupation dans une question écrite... du 25 avril 1968). Plus au fond des choses, il défend l'idée que l'organisation d'une aumônerie (catholique, toujours) dans une école était impossible lorsqu'une majorité de parents s'y opposait. Ce sont là survivances d'une certaine laïcité militante et un brin sectaire, mais elles représentent un courant beaucoup plus large.
Les contrats prévus par la loi Debré n'étaient en vigueur que pour une période de neuf ans éventuellement prorogeable par décrets. Lorsque les possibilités de prorogation réglementaire furent épuisées, il fallut bien revenir devant le Parlement. Un projet de loi, tirant les leçons de treize ans d'application du nouveau régime, fut déposé par Jacques Chaban-Delmas, alors Premier ministre, et défendu par Olivier Guichard, récemment décédé, ministre de l'Éducation nationale.
Quand on pense à l'intensité de la querelle confessionnelle préalable à l'élaboration et à l'adoption de la loi de 1959, on ne peut qu'être frappé par le complet effacement de ce thème en 1971. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Olivier Giscard d'Estaing, part d'un constat : si l'enseignement privé est, en France, largement confessionnel, c'est pure contingence historique. Il n'y a pas de raison pour que cet état de choses perdure. Par conséquent, l'enjeu du débat sur l'enseignement privé est le développement d'une conception libérale de l'enseignement, ouvrant la voie à l'établissement de la concurrence entre privé et public : enjeu important, certes, mais où la considération religieuse est inexistante.
La discussion est d'autant plus confuse que la controverse sur la laïcité, très présente dans le débat parlementaire, ne porte pas sur le religieux, mais sur le politique. Nous sommes trois ans après 1968, dans une période d'agitation « gauchiste ». Quand les parlementaires de la majorité gaulliste de l'époque (majorité absolue, rappelons-le), parlent de défendre la laïcité, ils entendent par là lutter contre la pénétration du politique (c'est-à-dire de l'extrême-gauche, de fait) à l'école. Par un curieux retournement, la situation est très proche de celle du Front populaire : la première circulaire, du 31 décembre 1936, par laquelle Jean Zay, ministre de l'éducation nationale du gouvernement Léon Blum, entend proscrire le prosélytisme dans les établissements scolaires, vise la propagande des groupements politiques (de fait, d'extrême-droite) ; ce n'est que le 15 mai 1937 que le ministre signe une seconde circulaire qui étend au champ religieux, par un pur et simple renvoi, les directives du texte de décembre. En 1971, les parlementaires sont d'autant plus enclins à privilégier l'aspect politique de la laïcité qu'ils constatent l'effacement de l'Église institutionnelle dans le débat scolaire ; le recteur Capelle, député gaulliste, affirme que le problème de l'enseignement privé n'est plus le problème de l'Église catholique. En tout cas la laïcité scolaire, dans le débat parlementaire de 1971, est une valeur presque exclusivement politique.
Troisième débat législatif sur l'école, la réforme de l'Éducation dite « réforme Haby » du nom du ministre de l'époque (la majuscule à Éducation est, si j'ose dire, dans le texte). Le mouvement de déplacement du débat sur la laïcité se poursuit et s'amplifie. Dans l'exposé des motifs du projet de loi qui contient le volet législatif de la réforme, il n'est pas du tout question de la laïcité comme principe constitutionnel ; les syndicats d'enseignants et les partis de gauche en font reproche au gouvernement de M. Jacques Chirac. Le ministre répond que ce principe est maintenu, confirmé, sous-entendu par les textes proposés, mais qu'il s'agit de trouver une nouvelle formulation, plus moderne, du principe. Cette formulation, dit-il, est le respect de la personne de l'enfant et de ses convictions.
Ainsi, selon un mouvement qui n'est pas du tout propre à la laïcité scolaire et à la laïcité en général, on passe de la conception collective d'une valeur au respect d'un droit individuel ; pour la laïcité, ce transfert pose particulièrement problème car il s'agit d'une valeur au moins aussi collective qu'individuelle. En commission comme en séance publique, avec l'active participation du rapporteur, M. Jacques Legendre, futur secrétaire d'État et actuel sénateur du Nord, le débat a été fort long. Mais il ne porte plus du tout sur des questions religieuses. Il oppose à nouveau conceptions « libérales » et conceptions « étatistes », de l'aveu même des protagonistes.
Par la suite, le débat scolaire se reproduit, mais, pour parler franchement, l'aspect religieux de la question laïque n'y est pas abordé de façon renouvelée, et on peut même avancer que, mis à part l'affinement de la revendication d'un grand service public unifié de l'éducation nationale, ses termes restent stables. Ce qui change, ce sont évidemment les rapports de force dans le monde politique et particulièrement au Parlement, c'est aussi l'attitude de l'Église catholique. Est-elle pour ou contre le maintien d'un enseignement confessionnel ? Elle est divisée sur ce point, notoirement. Comment définir les relations entre l'institution ecclésiale et le monde scolaire catholique ? Ce sont des questions complexes, qui évoluent et dont il serait, encore aujourd'hui, bon de réexaminer les termes.
Je conclurai en posant une question qui ne se veut nullement provocatrice : faut-il précisément poursuivre le débat sur la laïcité en privilégiant encore aujourd'hui le terrain scolaire ? Il est normal qu'on le fasse dans une attitude de défense républicaine. Mais je me demande si la compréhension de la laïcité n'est pas faussée par sa spécification dans le seul domaine scolaire. J'ouvrais récemment un lexique élémentaire de termes juridiques à l'usage des étudiants en droit débutants : le seul exemple que l'on donnait pour la laïcité, c'était l'école. Alors que d'autres problèmes appellent, pour reprendre un titre de Jean-Marie Mayeur, une « solution laïque ». Si on considère la laïcité comme la neutralité de l'État et de la puissance publique par rapport aux influences confessionnelles, la laïcité intervient dans de nombreux autres secteurs de la vie sociale et notamment dans le domaine des moeurs. C'est dans l'élaboration de la législation sur la contraception et sur l'avortement que s'est poursuivie, depuis le milieu des années 60, une entreprise systématique de déconfessionnalisation de la morale collective.
La formule de Marcellin Berthelot sur « le monde sans mystère » rappelée à l'instant par Antoine Prost, a été reprise en 1974 par les prix Nobel, Lwoff, Jacob et Monod, non pas au sujet de l'école, mais au sujet des moeurs. Le rationalisme, la recherche de rationalité dans la décision politique, l'esprit scientifique, sont désormais invoqués à propos du domaine beaucoup plus large des questions de société. Chacun en tirera les conclusions qui lui appartiennent ; pour ma part, j'ai essayé de dégager des évolutions en restituant ce que j'ai cru lire dans les travaux parlementaires.
Émile Poulat
Merci, M. Delannoy, pour ce survol rapide mais suffisamment clair et jalonnant bien les débats. Je me permettrais simplement de nuancer un peu ce que vous avez dit sur François Méjean, parce que je l'ai bien connu. Il était le fils de Louis Méjean qui avait été le collaborateur de Briand et il était très attaché à l'esprit de son père, donc pacificateur. En même temps, il avait été l'homme de confiance de Maurice Deixonne dans les négociations de Guy Mollet entre la France et le Saint-Siège. Ce qui vous montre bien qu'il était moins viscéralement anticlérical que ce qu'il pouvait donner à penser. En revanche, c'était probablement le dernier des gallicans. Et lui-même tenait à raconter l'un des signes montrant qu'il n'était pas si anticlérical : il rappelait qu'en 1946, au moment du traité de paix entre la France et l'Italie, il y avait eu des rectifications de frontière sur les Alpes, appelant, après entente avec le Saint-Siège, une nouvelle délimitation entre le diocèse de Suse et le diocèse savoyard de Tarentaise. Et c'est lui qui a fait attribuer les biens de l'évêque de Suse à l'association diocésaine de Tarentaise. Il n'était pas anticatholique, mais il avait des principes, des principes gallicans, auxquels il se tenait.
Jean-Pierre Delannoy
Quand j'évoquais la rugosité de M. François Méjan, je visais la forme particulièrement abrupte de son langage. Sur le gallicanisme, je voulais simplement rebondir sur l'observation de M. Poulat en notant la quasi-similitude des termes par lesquels Michel Debré, dans ses mémoires, et Georges Cogniot condamnent l'hypothèse de pourparlers avec le Vatican : on ne négocie pas, disent-ils, le sort de l'école française avec un État étranger.
Émile Poulat
C'est effectivement la différence qu'il y avait entre Michel Debré et Guy Mollet, c'est ce que disait le général de Gaulle : « L'école en France ne se négocie pas avec le Saint-Siège. »
Nous allons maintenant entendre Jean Foyer qui a vécu tout cela et va réagir à ce savant exposé.
Jean Foyer, ancien garde des Sceaux
Monsieur le président, je serai aussi bref que je le pourrai. Je vais simplement égrener quelques souvenirs. Je commencerai par la fin de mon propos : vous avez tout à l'heure évoqué la mémoire de François Méjean, il se trouve que je l'ai beaucoup fréquenté à une certaine époque. Il était, à ce moment-là, conseiller au Tribunal administratif de Lille et j'enseignais le droit à la Faculté de droit de cette ville. À je ne sais combien de reprises, nous nous sommes trouvés dans les mêmes wagons de chemin de fer, entre Lille et Paris ou entre Paris et Lille. Durant la traversée, il ne parlait guère que de questions liturgiques ou de questions religieuses. Il était d'un gallicanisme absolument « déchaîné ». Ce qui, en particulier, l'irritait par-dessus tout était que le nonce apostolique eût pontifié dans une église française. Il disait : « Il est là, c'est un envoyé diplomatique et il n'a pas à pontifier dans une église française dont il n'est point l'évêque. »
Je reviens maintenant à divers problèmes qui ont été examinés depuis le début de l'après-midi, en rappelant quelles raisons j'ai de m'exprimer : la première, c'est que j'ai appartenu, à la Libération, dans une très modeste condition, au cabinet ministériel de René Capitan qui était ministre de l'Éducation nationale. La deuxième chose qui me permet de parler ici, c'est que, pendant le deuxième semestre de 1958, j'ai participé au groupe de travail constitutionnel qu'avait constitué Michel Debré et que j'ai, en cette qualité, exercé les fonctions de Commissaire du gouvernement devant le Comité consultatif constitutionnel et devant le Conseil d'État. Et enfin, troisièmement, j'ai exercé un mandat parlementaire pendant une longue période, qui a duré de 1959 à 1988 et j'ai été amené à intervenir dans la discussion de la loi Debré et à m'occuper quelque peu de ses suites.
Tout d'abord, 1945. Tout à l'heure, M. Prost a, semble-t-il, regretté que le général de Gaulle n'ait pas tiré, pendant ce gouvernement provisoire, les conclusions des propositions de la commission André Philip. Je crois vraiment qu'on peut difficilement le lui reprocher. La commission André Philip a terminé son travail au début de l'automne de 1945. À ce moment-là, nous étions lancés dans l'aventure du référendum constitutionnel. D'autre part, l'Assemblée consultative provisoire avait voté la suppression des subventions de Vichy à l'école privée et on y avait entendu des discours extrêmement sévères à l'égard de l'école privée. Le peuple français était consulté sur des questions qui étaient tout de même d'une tout autre ampleur : l'abolition des lois de 1875, l'élection d'une Constituante, un régime constitutionnel provisoire. Ce n'était pas le moment de lancer sur le terrain cette question que le gouvernement provisoire pouvait vraiment très difficilement régler à ce moment-là par une ordonnance. Je crois donc que, là-dessus, il était très difficile de faire autre chose que de s'abstenir, c'est-à-dire de ne rien faire.
En ce qui concerne la période de 1958, le caractère laïque de la République, repris de la Constitution de 1946, est un point auquel le président Guy Mollet, l'un des quatre ministres d'État qui participaient, sous la présidence du général, à l'élaboration du projet constitutionnel, tenait énormément. Il voulait que fût proclamé dans le nouveau texte, comme il l'avait été en 1946, le caractère laïque de la République. Il en faisait même une question de maintien personnel dans le gouvernement. Il était impossible de lui résister. Mais, tout de même, à cette époque, un conseil ministériel, sur la proposition du président Pflimlin, a entendu préciser le caractère non agressif de la laïcité, en ajoutant que la République laïque respectait toutes les croyances. Quant à la question de la liberté d'enseignement, personne n'a trop insisté là-dessus, considérant que le problème était déjà réglé par l'astuce de Paul Coste-Floret : il avait été alors le rapporteur du projet de constitution élaboré par la deuxième Constituante. Il avait découvert, dans un texte de 1931, voté à l'initiative d'un gouvernement Laval, une incise qui disait : « le principe de la liberté de l'enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République ». Alors que la commission de la Constitution, dans la deuxième constituante, avait refusé, comme la première, d'inscrire la liberté de l'enseignement dans le texte constitutionnel, il avait imaginé d'y insérer une référence aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. De cette petite incise, le Conseil constitutionnel actuel a tiré un certain nombre d'applications, d'ailleurs probablement inexactes, car je crois que le texte de la loi de 1931 de la III e République n'entendait viser que la liberté d'enseignement, et que le Conseil constitutionnel a considéré qu'étaient visées de la même façon la liberté d'association et un certain nombre d'autres libertés. En 1946, finalement, je ne suis pas certain que les socialistes aient été dupes de l'astuce de Coste-Floret, mais ils n'ont pas voulu soulever la guerre là-dessus. Le"principe fondamental reconnu par les lois de la République" les choquait moins que de parler de la liberté de l'enseignement, qui avait quelque chose d'inquiétant, si ce n'est d'épouvantable, à leurs yeux. C'est ainsi que, par cette formule contournée, la liberté d'enseignement était d'ores et déjà inscrite dans les textes, puisque la Constitution de 1958 se réfère expressément à la déclaration qui précédait la Constitution de 1946.
Quelques mots à propos de la loi Debré. Tout d'abord, du projet de règlement concordataire, je ne suis pas certain que le Saint-Siège y ait beaucoup tenu, et qu'il ait cru à la longévité d'un règlement de cette matière. Il eût fallu, d'ailleurs, le faire approuver par les assemblées. Mais il y avait quelqu'un qui n'en voulait pas, c'était le général de Gaulle. Il considérait que le problème de l'organisation de l'enseignement en France devait être réglé par le législateur français et n'avait pas à être réglé par une convention avec le Saint-Siège. Par conséquent, l'affaire du concordat partiel a été définitivement enterrée et je crois que cela vaut mieux ainsi. On ne s'en serait jamais sorti autrement. On aurait déjà quelques difficultés à faire voter la loi Debré, ce n'était pas la peine d'en ajouter. Cette loi Debré, qui porte la date du 31 décembre 1959, j'ai été amené à m'en occuper car j'avais été chargé de parler sur ce texte au nom du groupe parlementaire auquel j'appartenais à l'époque. Je ne vais pas vous infliger l'exercice assommant d'écouter la lecture de ce que j'ai dit il y a quarante-cinq ans, mais je l'ai relu. Je me suis dit qu'après tout je parlerais probablement dans le même sens si j'avais à refaire ce discours aujourd'hui.
Comment cette loi a-t-elle été préparée ? Le gouvernement avait désigné une commission, sous la présidence de Pierre-Olivier Lapie, ancien député de Meurthe-et-Moselle, qui fut membre de l'Institut. Il a proposé des mesures qui sont, pour l'essentiel, ce qui a figuré dans le projet de loi. À ce moment, il y a d'ailleurs eu un problème gouvernemental. Dans la composition du gouvernement, Michel Debré avait appelé aux fonctions de ministre de l'Éducation nationale André Boulloche, qui était un de ses vieux camarades d'enfance et qui appartenait au groupe socialiste. C'était un socialiste qui n'avait rien de sectaire et un esprit tout à fait ouvert et libéral. Mais au bout d'un certain temps, il a craint de heurter ses amis politiques et de se discréditer à leurs yeux s'il se prêtait à la présentation et au soutien du projet de loi en question. Il a donné sa démission du ministère de l'Éducation nationale et il a été remplacé dans cette fonction par le Premier ministre qui s'est chargé de l'intérim, de telle sorte que c'est Michel Debré, ministre de l'Éducation nationale par intérim, qui a défendu lui-même son projet de loi.
Ce projet de loi proclame, dans un article premier, des principes tout à fait indiscutables : « Suivant les principes définis dans la Constitution, l'État assure aux enfants et adolescents, dans les établissements publics d'enseignement, la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes, dans un égal respect de toutes les croyances. L'État proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts. » Tout cela évoque d'ailleurs beaucoup la rédaction des premiers articles de la loi du 9 décembre 1905. Cette imitation en est manifestement inspirée. « Il prend toute disposition utile pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus ci-dessous. L'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'État. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants, sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyance, y ont accès. »
Voilà les principes généraux qui président à la loi Debré, laquelle a ouvert aux écoles privées, qui se trouvaient pour la plupart dans une situation financière extrêmement difficile, la possibilité de survivre grâce au concours de l'État. Le texte disait que les établissements privés auraient une option entre trois partis : soit l'intégration dans l'enseignement public, soit, pour les établissements d'enseignement secondaire, un contrat d'association au service public de l'Éducation, soit pour les établissements primaires - avec la possibilité de quelques extensions - un système de contrat simple. Ce régime a été finalement adopté sans soulever de véritable tempête ou de véritable guerre par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Il a été voté par le Sénat sans qu'il fût nécessaire de recourir ensuite à la procédure de la commission mixte paritaire.
Ce texte prévoyait la mise au point d'un certain nombre de règlements d'application. C'est un travail qui a été difficile et qui a été conduit à bien essentiellement grâce à l'intervention de trois personnes. Les deux premières sont les deux ministres de l'Éducation nationale qui ont été nommés après qu'eut pris fin l'intérim de Michel Debré : Louis Joxe est demeuré ministre de l'Éducation nationale jusqu'en novembre 1960 et, ayant été, à ce moment-là, nommé ministre d'État chargé des Affaires algériennes, a été remplacé par un ministre universitaire qui était Lucien Paye, recteur d'académie. Du côté de l'enseignement catholique, la troisième personne est un prélat pour lequel j'ai conservé beaucoup d'estime et d'amitié, Mgr Julien Gouet, qui était alors secrétaire, non pas de la Conférence épiscopale car elle n'existait pas encore, mais de la Conférence des cardinaux et archevêques. Les décrets successifs ont été élaborés sans lenteur excessive pendant les années 1960 et 1961. Pour l'application de ces textes, la loi avait prévu la constitution de comités de conciliation : un comité de conciliation national et des comités de conciliation départementaux qui étaient consultés sur les difficultés d'application de la loi et dont le concours était sollicité pour qu'ils intervinssent dans la solution, ce qu'ils ont d'ailleurs bien fait. Le comité national de conciliation a été présidé par l'un de mes anciens maîtres, qui a peut-être été aussi le vôtre, le doyen Joseph Hamel, professeur et plus tard doyen de la faculté de droit de Paris.
Voilà comment la loi a été mise en vigueur. On se demandait si elle aurait la vie très longue et serait acceptée ; elle avait d'ailleurs été votée pour une période limitée et c'était au terme de cette période qu'on devait examiner la question de savoir s'il convenait de maintenir ce système en vigueur, tel quel ou en le modifiant. Finalement, il a subsisté, sans donner une satisfaction absolument totale ni à l'une ni à l'autre des deux parties car, du côté laïque, avait jusqu'alors régné la maxime : « À école publique, deniers publics, à école privée, deniers privés ». Finalement, l'école publique s'est accommodée des concours réalisés sous la forme de paiement de traitement d'enseignants privés ou d'enseignants publics mis à la disposition d'écoles privées par l'État. Du côté de l'enseignement privé, le système imaginé par la loi n'apportait pas la satisfaction espérée : l'enseignement privé aurait préféré le système vichyssois, c'est-à-dire que lui fût versée une subvention globale dont il eût ensuite fait lui-même la répartition. Mais cela, le Premier ministre n'en voulut d'aucune façon.
Qu'est devenue la loi Debré par la suite ? On a rappelé tout à l'heure comment sa prolongation avait été décidée, comment le régime du contrat simple et son extension avaient été admis. À un certain moment, c'est l'enseignement privé qui a relevé le combat et qui a exigé un certain nombre de modifications. Peut-être d'ailleurs les a-t-il réclamées parce qu'à ce moment-là s'était déjà manifestée la menace du grand service public laïque et unifié de l'Éducation nationale, qui figurait dans le programme commun de gouvernement des partis communiste et socialiste, et qui avait été mis à l'étude et adopté à la suite du congrès socialiste d'Épinay en 1971. Le groupe de pression que constituait l'enseignement privé souhaitait un certain nombre de modifications de la loi du 31 décembre 1959. Il avait trouvé, à l'Assemblée nationale, un porte-parole incisif et éloquent en la personne de mon ancien collègue Guy Guermeur, qui représentait le département du Finistère. Il a obtenu, en 1977, le texte d'une loi votée le 25 novembre 1977, qui modifiait dans un certain sens le texte de 1959 et qui contenait d'ailleurs des dispositions intéressantes pour l'enseignement privé : il renforçait le rôle des directeurs d'établissement en ce qui concerne le choix des enseignants, notamment le choix de ceux appartenant à l'enseignement public. Alors que le texte de 1959 disait que les fonctionnaires de l'enseignement public mis à la disposition d'établissements privés étaient choisis par l'Administration, le texte Guermeur disait qu'ils le seraient désormais sur la proposition du directeur de l'établissement, qui restait donc, dans cette mesure, maître de la composition de son corps enseignant ou, tout au moins, qui avait le pouvoir d'empêcher l'introduction, dans son corps enseignant, de personnes qu'il n'eût point souhaitées. D'autre part, le texte prévoyait la possibilité de financements, de subventions, d'investissements et s'efforçait d'assimiler, dans toute la mesure du possible, l'égalité de traitement et la parité entre les enseignants de l'enseignement public et de l'enseignement privé, en ce qui concerne le traitement, les retraites des enseignants et les dépenses de fonctionnement en général.
Ce système-là est resté en vigueur pendant un petit nombre d'années, mais était appelé à recevoir des modifications, surtout la loi Guermeur, après que l'alternance politique du 10 mai 1981 se fut produite et que le gouvernement socialiste se mit à réaliser le fameux « service public, laïque et unifié » de l'Éducation nationale. Cela a encore été une histoire assez curieuse : le ministre de l'Éducation nationale qui avait été chargé de cette tâche était Alain Savary. C'était un député socialiste, qui avait des titres de résistance éminents et qui était de confession protestante. Il était un homme de caractère et d'esprit libéral. Il avait élaboré un projet de texte qui, en fait, comme l'avait prévu le programme commun, tendait à réaliser la fusion définitive de l'enseignement privé avec l'enseignement public, mais Alain Savary avait tout de même été un négociateur assez adroit pour faire accepter son texte par l'épiscopat, un épiscopat complexé qui ne voulait pas avoir l'air de se mettre en travers des projets d'un gouvernement de gauche et qui, en définitive, avait accepté, bon gré mal gré, ce que le ministre de l'Éducation nationale lui avait proposé.
Le projet de loi fut déposé. J'étais nommé membre de la Commission spéciale qui devait le rapporter, tout le monde pensait qu'on n'avait pas grande chance de l'améliorer. Mais, fort heureusement, l'excès en tout est un défaut, il faut se méfier de l' hubris que dénonçaient les anciens grecs. La commission qui avait été désignée par l'Assemblée nationale pour rapporter ce projet de loi avait élu comme rapporteur un député de l'Indre qui était un laïque particulièrement sectaire, André Laignel. Il trouva que le projet de loi de M. Savary, que le gouvernement avait pourtant accepté car il était passé en Conseil des ministres, était trop mou et devait être renforcé. Il a élaboré une batterie d'amendements beaucoup plus violents que le texte déposé, il est allé apporter ces amendements au Premier ministre qui lui a donné son accord, et il les a déposés. On a alors assisté à une révolte de mitres et de crosses, car l'épiscopat qui s'était résigné à l'acceptation du texte Savary a considéré qu'il était véritablement trompé par les amendements Laignel et qu'il était contre. Cela a redonné du muscle aux partisans de l'enseignement privé qui avaient déjà organisé, dans diverses villes de France, des manifestations contre ces projets qu'ils considéraient comme « scélérats ». Ils ont organisé une grande manifestation à Paris, le jour de la Saint-Jean, le 24 juin 1984. Il y est venu un nombre considérable de manifestants qui, paraît-il, auraient atteint le million. Du coup, le gouvernement a reculé : le ministre de l'Éducation nationale, qui n'était vraiment pas coupable de quoi que ce fût, a été renvoyé à ses études et remplacé par M. Chevènement, et le gouvernement, finalement, n'a pas insisté, même pour faire voter le texte Savary.
C'est un autre texte, qui revenait sur un certain nombre de mesures de la loi Guermeur et même sur les dispositions initiales du projet de loi Debré, qui a été voté en 1985. Les dispositions qui modifiaient la loi de 1959, dans l'état modifié par la loi de 1985 et par des textes ultérieurs, en sont aujourd'hui insérées dans le Code de l'Éducation. C'est aujourd'hui l'essentiel des textes en vigueur en cette matière. Quelques autres dispositions sont intervenues, notamment une qui n'est pas sans intérêt, qui est d'ailleurs toute récente. Elle prévoit que les agents autres que les fonctionnaires de l'Éducation nationale qui sont recrutés pour enseigner dans les établissements sous contrat ne sont pas, en ce qui concerne l'exécution du contrat d'association, considérés comme étant liés par ce contrat à l'établissement. L'évolution tend à les fonctionnariser.
Ce n'est qu'une première étape qui sera probablement suivie de plusieurs autres, de telle sorte qu'on peut se poser une question : en définitive, subsistera-t-il une différence entre l'enseignement public et l'enseignement privé, lorsque les enseignants de chacun de ces deux établissements seront soumis au même régime juridique ? Ils ont déjà tendance à se syndiquer à des formations syndicales qui relèvent des mêmes confédérations, n'allons-nous pas assister à une transformation qui, à mon avis, se produit sous nos yeux ? Nous n'aurons plus ni un enseignement public, ni un enseignement privé, nous aurons désormais un enseignement syndiqué. Dans l'un et l'autre enseignements, les syndicats feront la loi.
Émile Poulat
Merci, Monsieur le ministre. Vous débouchez sur ce qui va constituer l'objet de la prochaine table ronde avec René Rémond : les points d'interrogation sur l'avenir. Si vous me permettez, j'ajouterais simplement une petite note bibliographique à votre exposé : tous ceux qui s'intéressent à la loi Debré pourront se reporter à un colloque qui s'est tenu à Amiens pour son quarantième anniversaire, en 1999, et dont les actes ont été publiés sous la direction de Bruno Poucet 51 ( * ) . L'histoire continue, avant même d'entrer dans l'avenir, et le témoin privilégié ici sera Bruno Bourg-Broc, à qui je donne la parole.
Bruno Bourg-Broc, député, rapporteur de la loi Bayrou en 1993
Merci. À la différence des orateurs que vous avez entendus depuis ce matin, je suis effectivement témoin et acteur, et je l'ai été aux côtés de Jean Foyer, d'ailleurs, il y a plus de vingt ans. Témoin et acteur, donc, pour reprendre votre expression tout à l'heure, suspect, M. Poulat, et je plaide l'indulgence à l'avance. Je m'efforcerai de parler avec sérénité et impartialité mais, étant encore acteur, mes propos peuvent effectivement être suspectés de partialité, d'autant plus que la loi du 21 janvier 1994 dont je vais vous parler, censurée par le Conseil constitutionnel, est une loi symbole d'une attaque contre la laïcité, au moins aux yeux des tenants d'une certaine forme de laïcité.
Je voudrais replacer le contexte. Nous sommes au printemps 1993 et la droite, c'est-à-dire la majorité RPR-UDF de l'époque, vient de remporter les élections de façon massive. On n'est pas dans une chambre « bleu horizon », mais presque, et les tenants de cette majorité peuvent penser, sinon croire, que les électeurs les ont élus sur la foi du programme électoral qui avait été présenté. On dit souvent que cette proposition de loi est sortie du « chapeau » de la majorité, sans qu'auparavant l'opinion publique en ait été alertée. Or, je peux témoigner, pour avoir participé à la rédaction de ce programme de 1993, que les dispositions que nous allions proposer faisaient l'objet d'une petite partie du programme. Presque personne n'en avait parlé pendant la campagne de 1993, mais cela figurait bien et je peux vous dire, parce qu'il y a controverse là-dessus, pour avoir moi-même participé à la rédaction de ce programme avec François Bayrou, que la disposition que je vais vous lire y figurait bien. « L'État ne doit pas pratiquer de discrimination financière dans l'aide apportée aux établissements. Les collectivités locales pourront, en toute équité, financer les investissements pour les écoles privées, comme elles le font pour les écoles publiques. » Je vous rappelle qu'on est dans un débat récurrent. Depuis les années 1990, le problème de l'aide aux écoles privées revient régulièrement dans le débat public. Nous sommes dans la foulée des accords Lang-Cloupet et, si le problème a essentiellement porté sur l'aide au fonctionnement, l'aide aux investissements a été soulevée dans le cadre de la décentralisation par les conseils généraux et par les conseils régionaux, de façon de plus en plus prégnante.
Les élections sont gagnées, on applique le programme, c'est du moins ce qu'on peut penser, mais dans un contexte que je voudrais rappeler. Au début de cette législature de 1993, le gouvernement de M. Balladur pratique un audit sur les finances publiques et, pour parler trivialement, laisse se « morfondre » les parlementaires sans pratiquement proposer de texte dans les premières semaines. C'est alors que s'est posé le problème de l'application de ce point du programme : la possibilité, pour les collectivités locales, d'aider les établissements privés d'enseignement secondaire. C'est ce qui est décidé au mois de mai 1993, dans le cadre d'une proposition de loi plutôt que d'un projet de loi. Pourquoi une proposition plutôt qu'un projet ? Sans doute pour faire plaisir aux députés qui « piaffaient » d'impatience, justement, et qui n'avaient rien à se « mettre sous la dent ».
C'est ainsi que plusieurs propositions de loi sont déposées, qui correspondent d'ailleurs à des formes d'aide différentes des collectivités. Je rappelle ces propositions de loi : une proposition de loi de M. Couanau, encore député-maire de Saint-Malo aujourd'hui, une proposition de loi de M. Lequiller, alors député-maire de Louveciennes, une proposition de loi de M. Pons, président du groupe RPR à l'époque, et une proposition de loi de M. Charles Millon. Ces propositions de loi sont réunies dans une discussion qui va avoir lieu tardivement, à la fin du mois de juin. Sans doute, les choses se seraient passées différemment si le calendrier parlementaire avait été autrement élaboré. Dans ce qui a été une victoire de l'opposition de l'époque, le choix des dates de la discussion, la manière dont les choses ont été programmées, tout cela ne relève pas du détail. Les quatre propositions de loi sont discutées le 22 juin, très tardivement : la session prend fin, je le rappelle, le 30 juin.
Et le 22 juin, c'est incroyable mais j'en témoigne, sans doute est-ce l'inattention générale parlementaire qui a été la cause de cette erreur, on s'aperçoit que les quatre propositions de loi peuvent se voir objecter l'article 40 de la Constitution, qui empêche les parlementaires de participer à l'aggravation d'une dépense publique : pas seulement d'une dépense de l'État mais d'une dépense publique, c'est-à-dire des dépenses des collectivités locales également. Nous étant aperçus tardivement de cette erreur, nous avons décidé de ramasser ces propositions de loi en une seule proposition de loi dont j'ai eu l'honneur d'être à la fois l'auteur et le rapporteur. Puis, en accord avec le gouvernement - pourquoi le nierait-on aujourd'hui ? Nous ne l'avons pas nié à l'époque -, nous avons demandé que le gouvernement complète la proposition de loi par l'adjonction, justement, de la disposition qui, en modifiant l'article 69 de la loi Falloux, permettait aux collectivités locales d'intervenir dans l'aide à l'investissement des établissements d'enseignement privé, étant entendu qu'à l'époque nous étions en face de trois situations différentes pour ce qui concernait les différents niveaux d'enseignement : la loi Goblet de 1886, qui concernait l'enseignement primaire, interdisait toute aide publique ; la loi Falloux permettait une aide à hauteur de dix pour cent des dépenses de fonctionnement des établissements secondaires et la loi Astier de 1919, qui concernait uniquement l'enseignement professionnel et l'enseignement technique, nous permettait et permet encore aux collectivités locales d'intervenir sans limite dans l'aide aux établissements d'enseignement privé.
Nous avons donc commencé la discussion à l'Assemblée nationale le 27 juin, après nous être assurés de la constitutionnalité ou, du moins, du respect des dispositions de l'article 40. Le président Barrot était président de la commission des Finances à l'époque et, selon une procédure relativement inhabituelle, je suis allé devant le bureau de la commission des Finances, le matin du débat, pour m'assurer auprès de la commission des Finances, qui a voté là-dessus, autour de son président et de son rapporteur, que l'article 40 ne s'appliquait pas et que nous pouvions débattre. Et nous avons commencé un débat dont le caractère idéologique ne m'a pas paru très marqué, à la différence de ce que nous avons pu entendre au travers des autres exemples cités aujourd'hui. Il n'y avait pas de débat sur la laïcité. Il n'y avait pas de débat sur l'existence d'un enseignement privé ou pas. Cela était reconnu comme une évidence mais, en revanche, il est vrai que nous avons eu une obstruction de la part de l'opposition sur cette loi pendant deux jours et deux nuits. Je siège maintenant à l'Assemblée nationale depuis vingt-trois ans, je crois que c'est la seule fois en vingt-trois ans. Nous avons une politique d'obstruction qui était, j'allais dire, habilement menée par l'opposition, puisque le but était que l'ensemble de la loi ne puisse être voté avant le 30 juin et il fallait que la loi, après être passée à l'Assemblée Nationale, passe au Sénat. Sur le contenu du débat lui-même, je dirais qu'il y avait moins d'idéologie que dans la plupart des débats auxquels nous avons fait allusion, même si parfois il y a eu des actes de foi, dans un sens ou dans l'autre, mais souvent dissimulés sous un certain nombre d'arguments. L'aspect confessionnel est pratiquement absent de ce débat.
Deux jours après, le débat commence au Sénat et le 30 juin, la session ordinaire étant close, on ne peut pas continuer le débat au Sénat. C'est le Président de la République qui est maître de l'ordre du jour de la session extraordinaire et le Président de la République, M. François Mitterrand, n'a pas souhaité que le débat puisse se poursuivre lors de la session extraordinaire. Ces détails qui n'en sont pas, expliquent un petit peu le climat dans lequel se sont déroulées ultérieurement la discussion et la contestation de la loi, qui, au fil des semaines et des mois, et en dehors du Parlement, a pris un tour idéologique.
Au mois de septembre, le gouvernement, le ministre de l'Éducation en l'occurrence, a chargé, car c'était l'un des objets de la loi, le doyen Vedel assisté d'un magistrat de la Cour des comptes et d'un magistrat du Conseil d'État, de préparer un rapport qui ferait l'état des lieux dans l'enseignement privé sous l'angle de la sécurité et des mesures d'urgence à prendre ce qui, en l'occurrence, pouvait apparaître comme une justification de la loi. Au mois de décembre, et seulement deux jours après avoir eu connaissance du rapport Vedel qui faisait un état des lieux pessimiste, mais réaliste en même temps, de la situation des établissements d'enseignement privé, secondaires en particulier, le débat reprend dans cette maison dans des conditions que, là aussi, je n'ai jamais vues. J'étais présent dans les tribunes et c'est sans doute une des seules fois dans l'histoire de cette maison qui est quand même réputée pour sa sérénité, où l'on a pu voir des sénateurs encercler la tribune de l'orateur, les huissiers intervenir physiquement et le président de séance, le président Monory, avoir les plus grandes difficultés pour ramener l'ordre dans l'hémicycle.
La loi a été votée par le Sénat selon un dispositif relativement classique, c'est-à-dire que la majorité RPR-UDF a voté "pour" comme à l'Assemblée Nationale, à une ou deux exceptions près, car il n'y avait pas, au sein de la majorité, de véritables débats ou de véritables contestations. Il y avait une unanimité apparente en tout cas, parce qu'il y a eu quand même dans les rangs de la majorité à laquelle j'appartenais, quelques contestations du principe de la loi. À titre d'exemple, on n'a jamais vu apparaître au cours des débats, le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation, M. Bayrou, ce qui, dans le vote d'une loi, est plutôt exceptionnel. On ne l'a pas vu une seule fois dans l'hémicycle, aussi bien à l'Assemblée Nationale qu'au Sénat.
La loi est votée. Nous sommes quelques jours avant Noël 1993 et cette loi est immédiatement portée devant le Conseil constitutionnel par 60 députés et 60 sénateurs. Et c'est à ce moment-là que l'aspect idéologique des choses a sans doute prévalu. Il a été question à ce moment d'une grande manifestation qui a été convoquée pour le 20 janvier par les forces syndicales pour protester contre ce qui a été présenté à tort comme l'abrogation de la loi Falloux. Le Conseil constitutionnel s'est penché sur les recours. Je ne vais pas insister sur les recours, ils étaient un peu différents selon les groupes de l'Assemblée Nationale ou du Sénat. Et puis, le 13 janvier 1994, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le plus important de la loi, non pas les cinq articles dont j'étais l'auteur et le signataire, mais l'article 2 qui était un amendement gouvernemental et qui permettait précisément l'intervention financière des collectivités locales.
S'agissant des conditions requises pour l'octroi des aides des différentes collectivités territoriales et la fixation de leur montant, il était estimé que l'article 2 de la loi ne comportait pas les garanties nécessaires pour assurer le respect du principe d'égalité entre les établissements d'enseignement privés sous contrat se trouvant dans des situations comparables. En fait, c'était la distorsion des systèmes d'aide qui était contestée, et puis, les différences de traitement n'étaient pas aux yeux du Conseil constitutionnel justifiées par la loi. C'était donc une annulation de l'article 2 de la loi. Le reste de la loi a été promulgué le 21 janvier 1994, mais c'était la fin de ce qui était l'un des aspects du programme de la majorité.
Je voudrais simplement pour conclure, dire encore une fois qu'il n'a jamais été question dans ce débat, à la différence de ce qui s'est passé l'année dernière pour le vote de la loi baptisée à tort "loi sur le voile" qui a été promulguée le 15 mars 2004 - au demeurant personne n'a fait remarquer jusqu'à présent la coïncidence des dates entre la loi Falloux, 15 mars 1850, et la loi sur le "voile", 15 mars 2004 - de défense de la laïcité même si, à tort ou à raison, cette loi du 21 janvier 1994 censurée par le Conseil constitutionnel apparaissait comme le symbole d'une attaque anti-laïque.
Émile Poulat
Mesdames, Messieurs, nous avons prévu de faire une pause extrêmement courte avant la dernière table ronde notamment parce que M. Jacques Barrot, commissaire européen, a un emploi du temps très chargé et on voudrait qu'il ait le temps de s'exprimer le plus longuement possible. Si vous le voulez bien, je vais vous demander de regagner vos places et d'écouter le président René Rémond qui va présider cette dernière session, cette dernière table ronde, je lui laisse la parole.
LA LAÏCITÉ DANS LA SOCIÉTÉ D'AUJOURD'HUI ET LE STATUT DE LA RELIGION EN EUROPE
Table ronde sous la présidence de René Rémond,
président de la Fondation nationale des Sciences politiques
Jacques Barrot, ancien ministre, commissaire européen
Jean Pierre Sueur, sénateur du Loiret
Alima Boumediene-Thiery, sénatrice de Paris
Jean Baubérot, directeur de recherches
à l'École Pratique des Hautes Études
Philippe Portier, professeur de Science politique
à l'Université de Rennes I
René Rémond, président de la Fondation nationale des Sciences politiques
S'ouvre donc maintenant la dernière séquence de cette journée. Les précédentes ont retracé à grands traits l'évolution depuis un siècle et même plus. La conviction a été que nous sommes fort loin de 1905. Émile Poulat, en ouvrant la précédente séquence, prenait acte de ce que la société avait profondément changé. Les textes aussi donnent une interprétation de la laïcité différente de celle proposée. N'y revenons pas. J'ajouterai simplement une chose qui intéresse l'évolution de la question scolaire : c'est le protocole signé en 1992 à égalité par le ministre socialiste de l'Éducation nationale de l'époque, Jack Lang, et le secrétaire général de l'Enseignement catholique, disant que l'enseignement catholique participe au service public de l'enseignement. C'est peut-être la dernière étape de cette évolution dont, à l'instant même, Jean Foyer évoquait les perspectives d'apaisement total. Ce qui explique que nous puissions aujourd'hui commémorer cette loi de 1905, qui a été adoptée dans le climat éminemment conflictuel qu'Antoine Prost a rappelé, tout en lui faisant un mérite d'avoir contribué à l'apaisement et à l'effacement de la discorde.
Pourtant le problème demeure et le débat a rebondi. Des clivages ont resurgi, des préoccupations, des passions, mais pour de tout autres raisons. Trois au moins que j'évoque sommairement.
La première a été rappelée tout à l'heure pour mémoire, le problème posé par la législation sur les moeurs et la séparation de la légalité de la tradition morale détenue par l'Église. Le processus n'est pas achevé et il rebondit périodiquement avec l'évolution des moeurs. Ce n'est plus l'école qui est en cause.
Le second problème, qui touche à l'Europe et, curieusement, on a vu se réactiver de vieux débats, que l'on pouvait croire définitivement réglés dans chacun de nos pays, dans le débat sur l'identité européenne, avec des revendications étagées dont les unes étaient modestes et les autres allaient beaucoup plus loin. La plus limitée était de décider si on ferait mention du passé ou si cette Europe se construirait sans référence à ses racines. C'est le problème de l'héritage religieux. Simple constat : l'Europe d'aujourd'hui a-t-elle été partiellement modelée et façonnée par les religions ? S'il n'y avait pas eu les religions, serait-elle ce qu'elle est aujourd'hui ? La deuxième revendication va plus loin : elle s'inscrit déjà dans l'ordre des normes. C'est le problème d'une référence éventuelle à des valeurs chrétiennes ou à la tradition judéo-chrétienne. La troisième ramenait à une problématique qui était plutôt d'Ancien régime que des sociétés sécularisées du XIX e et du XX e siècle : c'était le souhait d'une référence explicite à une transcendance divine, et de placer le texte de la Constitution sous les auspices de Dieu.
Quant au régime des cultes, il est entendu par le traité d'Amsterdam que tout ce qui le concerne reste de la compétence des États nationaux, dans l'échelle de subsidiarité. La crainte de certains que l'intégration européenne ait pour conséquence de contraindre la France à modifier son régime des cultes n'est donc pas fondée juridiquement.
La troisième raison est évidemment la présence sur le territoire de la République d'une religion nouvelle, qui pose des problèmes spécifiques. L'expérience des deux dernières années, des travaux de la commission Stasi et du vote de la loi sur le voile, a montré que ce problème a totalement éclipsé les autres. Jean Baubérot peut en témoigner comme moi-même : nous n'avons jamais réussi, à la commission Stasi, à intéresser les médias à autre chose qu'à l'autorisation ou l'interdiction de porter le voile, alors que c'était peut-être la centième partie de nos préoccupations. Aucun média n'a jamais prêté le moindre intérêt à tous les autres problèmes, alors que le contrat, le cahier des charges qui avait été fixé par le Président de la République était le plus large possible : il s'agissait d'une réflexion sur l'ensemble du problème posé par le rapport entre le fait religieux dans sa totalité et sa diversité et la société civile et politique. On aurait pu aussi bien parler des sectes, des rythmes scolaires, mais le problème de l'Islam a tout éclipsé.
C'est évidemment une tout autre problématique que celle de 1905. On l'a rappelé tout à l'heure, 1905 tranche un conflit de pouvoir et un conflit idéologique entre la République et l'Église, entre la république positiviste et l'intransigeantisme catholique. Il s'agissait de trancher les liens qui, jusque-là, unissaient la religion historique, celle la majorité des Français, avec la Nation, non pas par conséquent d'évincer les catholiques de la société mais de faire en sorte que la société n'ait plus de référence explicite au catholicisme. Le problème avec l'Islam est inverse, non pas qu'il s'agisse d'en faire une religion nationale, mais d'intégrer une population qui n'était pas française, alors que le problème de l'intégration ne se posait évidemment pas pour les catholiques puisqu'ils étaient français depuis quinze siècles.
C'est donc un problème tout différent et qui, d'ailleurs, n'intéresse la laïcité que subsidiairement et comme par ricochet : c'est le problème de l'intégration, de la compatibilité entre les coutumes, les règles, les pratiques d'une population qui emprunte ses règles à ses références religieuses, et notre tradition juridique, pour le statut des personnes et le droit civil. Le problème intéresse plus la société civile que la société politique, et plus la Nation que la laïcité, mais les choses sont évidemment liées et on a évoqué le lien consubstantiel entre le système éducatif et la laïcité. Il est significatif qu'à partir du moment où on posait le problème de l'Islam par rapport à la laïcité, on n'adopte qu'une seule disposition, qui intéresse l'école, alors que nous avions proposé un ensemble de dispositions concernant tous les secteurs de la société où se pose aujourd'hui le problème du respect de la laïcité, celui des hôpitaux n'étant pas le moindre, ni celui du service public. On aboutit à légiférer non pas pour les agents publics mais pour les usagers, non pas pour les majeurs mais pour les mineurs, pour un seul sexe, pour un seul âge, pour un seul secteur, tellement, depuis un siècle ou deux, la conjonction, la confusion entre la laïcité et l'école est prégnante.
Voilà succinctement introduit le débat qui va clore cette journée et que les acteurs et les observateurs, les témoins et les historiens vont éclairer de leurs regards croisés. Je vais donner la priorité à ceux qui ont été engagés dans les combats et qui ont eu des responsabilités publiques et politiques.
Jacques Barrot, ancien ministre, commissaire européen
Merci beaucoup René Rémond, et pardon par avance : je vais essayer d'être bref.
Je voudrais quand même dire, en effet, après ce qu'a dit René Rémond, que la constitution européenne va laisser tout le problème de la gestion des cultes à la responsabilité des états nationaux. Cela étant, vous savez qu'il y a eu, notamment au Parlement européen, de très grandes discussions sur le préambule, à savoir fallait-il mentionner nommément l'héritage chrétien. La décision a été prise, non sans difficultés, car encore aujourd'hui on voit constamment revenir sur ce point, notamment les Polonais et un peu les Italiens. Je pense, pour ma part, comme certains l'ont dit que, certes on aurait pu faire figurer la mention chrétienne, mais en réalité on peut se dire aussi que, pour une conscience chrétienne, le christianisme n'est pas l'apanage de l'Europe : il a vocation à être universel et après tout, ce n'est pas dramatique qu'il ne figure pas dans ce préambule. Mais c'est un raisonnement que j'ai personnellement beaucoup de mal à faire partager à certains amis européens. Par contre, ce qui est important, c'est que nous avons maintenant, en effet, dans la Charte des droits de l'homme qui est maintenant constitutionnalisée - enfin qui va l'être si la constitution est ratifiée -, les articles qui prévoient, notamment le 2-70 : « Toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion, la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accompagnement des rites. » J'ai essayé de souligner cela auprès d'un certain nombre d'évêques qui s'inquiétaient beaucoup. Je pense que cet article est très fort et qu'il implique en effet pour les États membres un devoir de reconnaître et de faciliter l'exercice de la pratique religieuse. Il peut être invoqué dans l'avenir notamment devant les juridictions compétentes. C'est un point important et il ne faut pas que cela nous échappe.
Cela étant dit, je voudrais vous dire comment je me pose personnellement des questions et combien je serais heureux que ce colloque, comme tous les travaux que font les éminents spécialistes sur cette tribune, puissent nous aider. Je crois qu'en effet, il faut que nous arrivions dans cette société européenne à passer d'une laïcité d'ignorance, d'indifférence, à une laïcité de reconnaissance et d'intelligence. Tout le problème est là. D'ailleurs, la loi de 1905 ne nous a pas empêchés de progresser dans cette direction. Le fait religieux est très important et intéressant dans la mesure où il nous permet de réussir un certain nombre de politiques d'intégration, de lutter contre un individualisme qui est une menace pour cette société européenne un peu vieillissante, qui aura du mal à intégrer de nouveaux arrivants. Les différentes religions permettent et offrent donc des possibilités supplémentaires aux citoyens de se retrouver, de pratiquer l'accueil et le partage. Je crois qu'un certain laïcisme agressif a tort de ne pas reconnaître au fait religieux, sur un simple plan humain, cette capacité à créer du lien social. C'est une valeur positive dans une Europe qui, aujourd'hui, comme toutes ces sociétés, est menacée par la montée des individualismes, pour ne pas parler de la montée des égoïsmes. Nous voilà donc à peu près convaincus d'aller vers cette laïcité de reconnaissance et d'intelligence qui consiste éventuellement, de la part des États, à accompagner les religions, sans vouloir les mettre sous leur coupe, pour qu'elles puissent jouer leur rôle.
Le problème qui surgit à l'horizon est la montée des intégrismes. Je ne mets pas uniquement l'islam dans ce risque qui est latent dans les sociétés aujourd'hui où le phénomène religieux peut être dévié de l'essentiel de ce qu'il est. Si la religion est instrumentalisée pour en faire un instrument de différenciation, d'identification et d'opposition à l'autre, alors elle ne peut plus jouer le rôle que j'ai indiqué. Elle ne peut plus aider à la création du lien social, au développement de l'esprit de partage, du sens des responsabilités : responsabilité de soi-même, responsabilité de la communauté tout entière et responsabilité intergénérationnelle. Or, c'est cela qui pose problème et c'est pourquoi, à mon avis, il faut que nous trouvions des cadres juridiques pour gérer ce nouveau pluralisme religieux qui notamment pour l'islam, est menacé par un intégrisme, qui non seulement n'apporte pas à la société européenne une cohésion accrue mais risque de jeter les germes de division, d'opposition. De plus, il charrie avec lui un certain nombre de comportements, de règles, de pratiques qui sont hautement contestables au regard des valeurs de la société européenne : je pense notamment à l'égalité des sexes, je pense aussi bien sûr à tout l'épanouissement de la personne et à son autonomie.
C'est en termes de questionnement que je termine cette rapide intervention : comment faire en sorte que l'on puisse établir des relations constructives entre la société et ses représentants c'est-à-dire l'État, la puissance politique, et les religions ? Cela devrait sans doute prendre la forme de contrats, mais pour contracter, il faut être deux parties. La partie publique est tenue à présent par les textes et par la Charte des droits. C'est à la partie religieuse d'offrir elle aussi des garanties.
Déjà, Aristide Briand s'était heurté à ce problème : avec qui l'État allait-il contracter ? Les associations cultuelles ? Cela ne fut pas facile, jusqu'au moment où le pape accepta que les associations cultuelles puissent contracter avec l'accord de la hiérarchie. Les religions pratiquées en Europe ont en commun d'être monothéistes, mais l'Islam n'a pas de hiérarchie. Comment la puissance publique peut-elle être assurée que la religion aidée sera, par ses propres fidèles, par sa propre organisation, mise à l'abri des déviances de l'intégrisme ? Toutes proportions gardées, dans la loi sur l'enseignement catholique sur laquelle Bruno Bourg-Broc nous a donné des éclairages intéressants, il n'a jamais été possible de passer des contrats avec une école intégriste même si elle se voulait catholique, dès lors qu'elle n'acceptait pas les termes du contrat avec la République. D'ailleurs, les intégristes se sont bien gardés de demander le contrat.
Le vrai problème est là : comment gérer ce pluralisme religieux en Europe ? Je pense qu'il faut une approche pragmatique et comparative : comment, dans les autres États membres de l'Union, cette gestion du pluralisme religieux se fait, peut-être, de manière plus apaisée. Je crois, en tout cas, que si l'Union doit laisser aux États membres le soin d'organiser le régime des cultes, il faut quand même qu'elle s'interroge sur la manière dont on peut gérer ce pluralisme religieux. Je suis très frappé et je termine là-dessus, de voir l'ébranlement de la société hollandaise. La société des Pays-Bas est aujourd'hui à la veille de voir la majorité de la population de ses grandes villes devenir musulmane dans des proportions tout à fait significatives : Amsterdam, Rotterdam, La Haye et Utrecht auront d'ici 20 ans une très large majorité religieuse islamique. Manifestement, cela conduit à s'interroger sur la meilleure manière de gérer ce pluralisme religieux.
Je ne fais pas un cas particulier pour l'islam : je pense que les menaces que nous connaissons aujourd'hui sont plus manifestes au niveau de l'islam, mais il n'est pas exclu que l'intégrisme et aussi les fondamentalismes puissent se manifester du côté du christianisme ou du côté du judaïsme. Au demeurant, je suis un partisan résolu d'un regard positif sur le fait religieux, parce qu'il peut beaucoup apporter à ces sociétés qui, on le dit souvent, ont besoin de trouver « une âme ». Le fait religieux constitue une richesse pour la société européenne. Encore faut-il que ceux qui « portent » ce fait religieux réussissent eux-mêmes à s'organiser, pour prévenir les déviances qui n'ont rien à voir avec une foi authentique et peuvent menacer les valeurs d'un humanisme qui constitue l'âme de l'Europe.
René Rémond
Votre intervention met en évidence l'ambivalence du fait religieux : il appelle donc de la part de la société civile et de l'État à la fois une reconnaissance pour ce qu'il peut avoir de positif, au-delà de la reconnaissance qui s'impose, de la liberté de conscience et la liberté des cultes, mais aussi une vigilance à l'égard des dérives possibles.
Si je puis encore citer les travaux de la commission Stasi, une des trois définitions que nous proposions était qu'il y ait toujours prépondérance de l'appartenance à la communauté nationale sur les communautés particulières. Citoyen d'abord, et pas à travers une confession religieuse.
Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret
Je voudrais vous dire en premier lieu la passion qui est la mienne pour la laïcité. Je suis persuadé de la grande supériorité des systèmes institutionnels qui se réclament de la laïcité par rapport aux autres. Je me souviens avoir beaucoup discuté naguère avec un professeur tunisien qui enseignait une matière qui s'intitulait " instruction civique et religieuse ". Je lui disais : « Tu ne peux pas enseigner l'instruction civique et la religion en même temps » et il me répondait : « Mais il est impossible que l'on dissocie l'une de l'autre ». Parlant avec lui, et voyant que je ne parvenais pas à le convaincre, je mesurais combien, dans beaucoup de situations, dans beaucoup de pays du monde, la laïcité ne va pas de soi. C'est une autre logique qui va de soi. Dans notre pays, où cette laïcité existe, où elle est maintenant bien reconnue, nous devons la défendre parce que je pense qu'elle nous permet d'offrir une réponse aux fanatismes, aux intégrismes et aux intolérances qui se développent dans beaucoup d'endroits de la planète.
Il y a donc cet héritage de la laïcité, qui est à la fois respect de la conscience de chacune et de chacun, mais aussi respect de la pluralité d'institutions, notamment religieuses.
Je ne suis pas favorable à la modification de la loi de 1905. Je crois que cela présenterait beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages, même si on a dit ici le contexte très particulier dans lequel cette loi a été votée. Certains disent qu'une telle modification est nécessaire pour financer les mosquées. J'habite un quartier, à Orléans, qui s'appelle La Source, que certains connaissent ici, où il y a une église qui est gérée et financée par ceux qui la fréquentent, comme c'est le cas pour tous les édifices religieux construits depuis 1905. Il est tout a fait vrai que l'islam des caves est insupportable. Certains disent que si on n'instaure pas un financement public des mosquées, cela posera problème car ce sont des États ou des intérêts étrangers qui les financeront. Pour ma part, cela ne me paraît pas du tout inéluctable car, dès lors qu'il y a des millions de personnes qui pratiquent cette religion en France, je ne vois pas pourquoi elles ne pourraient pas trouver les moyens pour construire ou entretenir ces mosquées, comme ce fut et comme c'est le cas pour l'église de La Source que j'évoquais à l'instant. D'ailleurs, je remarque que les communautés musulmanes que je connais ne revendiquent pas d'argent public, mais revendiquent la capacité de construire des mosquées et butent souvent sur des obstacles de permis de construire qui sont, soi-disant juridiques, mais qui, en fait, ne le sont pas du tout. Ces oppositions latentes sont inacceptables. Or ces oppositions sont aujourd'hui des obstacles beaucoup plus forts que la question du financement de la construction des mosquées.
Jacques Barrot, tu as parlé à plusieurs reprises, et je t'ai bien reconnu là, de la nécessité de mettre en œuvre enfin - tu n'as pas dit « enfin », je l'ajoute - une laïcité intelligente, une laïcité d'intelligence. Cela m'ennuie parce que cela semble présupposer que la laïcité antérieure était dépourvue d'intelligence. Je ne le crois pas. Je pense, en tout cas, que s'il y avait des manques d'intelligence dans le passé, ils étaient assez largement répartis. Je pourrais citer un auteur qui m'est cher, Charles Péguy, qui a écrit à peu près ceci : « Quand on voit ce que la politique cléricale a fait de la mystique chrétienne, comment s'étonner de ce que la politique radicale a fait de la mystique républicaine 52 ( * ) ». Je crois que la laïcité, c'est en fait le "pacte républicain" qui permet de vivre ensemble, dans le respect des convictions de chacun.
Pour conclure, je voudrais évoquer deux questions qui me préoccupent en ce moment.
La première est relative aux obsèques et, plus précisément à un aspect de la crémation qui, comme vous le savez, se développe actuellement. Il n'y a aujourd'hui, dans notre pays, contrairement à tous les autres pays d'Europe, aucune législation sur le statut des cendres après la crémation. J'en suis venu à considérer - c'est une position tout à fait personnelle - qu'il fallait sans doute proscrire l'appropriation privée des cendres. Lorsqu'un défunt avait plusieurs personnes qui, dans sa vie, lui étaient chères - c'est une situation assez banale -, si l'une de ces personnes installe l'urne contenant les cendres sur sa cheminée, l'autre, qui peut être son où sa rival(e), doit s'introduire chez la première ou chez le premier de manière à pouvoir faire son "travail de deuil", se recueillir devant les "restes humains" de l'être cher. On voit des difficultés et des procès apparaître à ce sujet. Le jugement d'un tribunal du Nord a déclaré que les cendres étaient une "copropriété familiale". Si on en revient tout simplement à ce qu'on fait nos prédécesseurs lorsqu'ils ont voté une loi sur le cimetière qui était une loi de la laïcité, on mesure combien il est finalement positif que les "restes" de chacune et de chacun reposent les uns à côté des autres dans les mêmes cimetières ouverts et accessibles à tous et à toutes, quelles que soient les convictions de chacune et de chacun et dans le respect de ces convictions. Il serait, je crois, pertinent, d'étendre ces principes républicains fondés sur la laïcité à une prochaine législation sur le devenir des cendres après crémation.
Je termine en évoquant un sujet qui a déjà été évoqué, notamment par Jacques Barrot. Je suis attaché à ce que, dans le respect de la laïcité, l'on enseigne le fait religieux à l'école, au collège, au lycée. Je crois qu'il faut que l'on continue à travailler sur ce sujet, car il est évident que si, par le passé, beaucoup de jeunes avaient connu le catéchisme, etc., et vivaient dans un univers de symboles qu'ils comprenaient et qu'ils décryptaient, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Or, sans la connaissance d'un certain nombre de prérequis qui relèvent de l'histoire, mais aussi tout simplement de la connaissance de textes fondamentaux comme la Bible, je ne vois pas comment on peut comprendre Racine, Voltaire, Victor Hugo... - je ne vais pas citer tous les auteurs de la République des lettres française, vous les connaissez aussi bien que moi ! On a dit que cela devait faire partie de l'enseignement de l'histoire. Je ne sais pas si cette réponse est suffisante, dans la mesure où il faut aussi connaître les textes fondamentaux des religions, des civilisations, de nos cultures, et je crois qu'à cet égard nous avons à travailler encore.
La laïcité doit être un respect des consciences et un partage des richesses que nous détenons tous et dont nous sommes tous porteurs.
René Rémond
Votre intervention montre bien que le travail n'est pas achevé et que la notion de laïcité, et ses applications, sont indéfinies : de nouveaux problèmes surgissent pour lesquels il faut trouver des réponses qui soient en conformité avec l'inspiration de la laïcité. Lorsqu'il parlait d'une laïcité intelligente, Jacques Barrot l'opposait aux applications tracassières ou sectaires dont Émile Poulat et Antoine Prost nous ont cité de nombreux exemples dans la première moitié du siècle. Nous achevons le tour des politiques avec vous, Mme Boumediene-Thiery.
Alima Boumediene-Thiery, sénatrice de Paris
La laïcité est une question à l'ordre du jour depuis un certain temps, mais surtout elle suscite beaucoup de passion, comme on l'a vu ces derniers temps. A mon sens, cette passion révèle une certaine inquiétude ou des peurs de cette différence ou de cette évolution que l'on a du mal à maîtriser, et de ce passage qui est en train de se produire dans la société entre la tradition et la modernité.
Si l'on entend tout ce qui nous est dit depuis ce matin, on a l'impression que la laïcité à la française est une spécificité. La laïcité est en fait un modèle forgé par une succession d'événements historiques et l'histoire de la laïcité nous prouve d'ailleurs - les différents intervenants avant moi vous l'ont montré de manière beaucoup plus détaillée - que c'est un combat qui a été mené. Nous devons arrêter de nous regarder le nombril et voir les différentes conceptions de la laïcité chez nos voisins. En France, la laïcité s'est souvent construite dans ce combat, non pas contre la religion ou les religions, mais contre une organisation sociale et politique dont le pouvoir était celui d'une religion ou appartenait à une religion. On s'aperçoit en fait que, lorsque la France est devenue laïque, c'est aussi sa société qui est devenue laïque, sa Nation qui est devenue laïque et non seulement son État. Il y a eu donc un processus de sécularisation, c'est-à-dire une laïcité qui s'est construite tout doucement et qui s'est étendue à la société civile. Dans les années soixante d'ailleurs, on s'aperçoit avec les mouvements d'autonomie : les mouvements de femmes, les mouvements de libération, le mouvement pour le droit à l'avortement, qu'il y a une autonomie et une indépendance qui se construisent de manière de plus en plus radicale par rapport à la religion.
Pourtant, ce n'est pas exceptionnel : j'ai une toute petite expérience en Europe, étant députée européenne à un moment donné, j'ai vécu quelque temps à Bruxelles et j'ai travaillé au sein de la Commission des libertés publiques sur cette question en particulier. J'ai eu l'occasion à cette époque d'organiser une grande rencontre sur cette question avec un ensemble de partenaires, d'acteurs européens venant non seulement des 15 pays européens, mais de beaucoup plus. On s'aperçoit en fait que la laïcité en Europe est définie non pas comme une laïcité de combat, mais plutôt comme un cheminement. En effet, c'est plutôt un cheminement, un processus vers le respect de l'autre et notamment au niveau religieux. On s'aperçoit que dans différents pays, au fur et à mesure des événements historiques, il n'y a pas eu le combat de l'État contre le pouvoir religieux, mais plutôt une forme d'alliance entre la foi et la raison.
Lorsque l'on regarde, par exemple, le monde germanique, on est passé tout doucement d'un principe qui disait qu'un prince dans telle région donnait telle religion dans cette région, à une forme de coopération qui s'est construite entre l'État et l'Église, les Églises d'ailleurs. Par exemple, il n'y a pas très longtemps en Allemagne, un jugement a décidé que, la question du foulard était une question importante, qu'on pouvait l'interdire mais on ne l'interdisait pas aux enfants, seulement à l'enseignant.
Lorsque l'on regarde d'un peu plus près le monde anglo-saxon, nous sommes plutôt dans une forme d'accord, de traité de "tolérance". Mais tout le monde s'exprime de manière un peu différente dans ce domaine et lorsque l'on regarde les États - je ne vais pas faire un état des lieux, pays par pays, de toute l'Europe parce que ce serait beaucoup trop long et qu'on ne m'a pas donné beaucoup de temps -, il y a quand même une différence dans les espaces où il y a une Église établie, qui permet d'établir cette relation et qui continue d'avoir un lien particulier avec l'État. Il y a des pays en Europe, comme la Grèce par exemple, où cela reste quand même assez difficile : la religion il n'y a pas très longtemps, était encore inscrite sur le passeport. Dans les nouveaux pays qui ont rejoint l'Union, on s'aperçoit que, par exemple, à Malte on n'a pas le droit au divorce, au Portugal et en Irlande, les femmes n'ont pas le « droit à l'avortement ». Dans cette Europe qui s'élargit se pose de plus en plus la question de la laïcité, - et pas du pouvoir de l'Église mais peut-être du rôle de l'Église - de l'impact des religions, du fait religieux sur la société, sur la vie au quotidien. Je crois que c'est en cela que la question doit rester posée.
Cela ne date pas d'aujourd'hui, et cette différence existe depuis toujours. Par exemple au Danemark, à une époque où tout le monde mettait l'étoile jaune aux juifs, le Danemark avait décidé que tout le monde, et le roi en premier pour montrer l'exemple, mettrait une étoile jaune. Cela montrait bien qu'il y a une conception différente des religions et de la façon de vivre sa religion. On s'aperçoit aujourd'hui, lorsque l'on y regarde de plus près, que seulement 9 pays sur 25 financent, partiellement en tout cas, un ministère du Culte, des programmes d'enseignement ou bien des écoles. On s'aperçoit également, y compris dans ces pays qui se sont libérés tardivement du joug communiste, par exemple dans 8 des 10 derniers pays qui nous ont rejoints, - alors que le communisme avait banni la religion - que si la constitution réaffirme une liberté de pensée, de croire, d'exercer sa religion, en même temps, elle ne se construit pas contre la religion, mais plutôt vers le dialogue et l'ouverture.
Cette notion de laïcité est importante en Europe car d'une part, elle est polymorphe c'est-à-dire qu'elle est différente dans l'espace, d'autre part, elle évolue dans le temps et en fonction de la société qui évolue elle-même.
Je crois que c'est important parce que ces sociétés sont assises sur un socle indéfectible de valeurs, qui sont universelles : le respect de l'autre, l'égalité, les libertés.
A partir de ce moment-là, la question des croyances ne peut pas être approchée de la même manière. Est-ce que ces États qui financent ou ne financent pas certaines activités religieuses sont laïques ? Force est de constater que dans tous ces États, il y a un Parlement indépendant, autonome du pouvoir religieux, qui vote des lois, une société et une religion qui se sécularisent et une laïcité qui se construit même si elle est certainement différente de la nôtre.
Pour revenir en France, je pense qu'il est important de voir ce qui se passe et pourquoi on a sans arrêt l'impression que nous sommes les seuls porteurs de la laïcité, que nous la défendons pratiquement avec les armes au poing. C'est vrai que le débat que nous avons connu récemment à l'occasion de la constitution européenne, comme M. Barrot nous l'a rappelé - fallait-il parler ou non d'un héritage religieux ? - a fait fureur surtout en France. Dans les autres pays, la question n'était pas du tout posée dans ces termes. Par ailleurs, lorsque le projet constitutionnel nous parle de relation avec les Églises, du respect des croyances, de l'exercice de ces croyances, il dit que, bien sûr, chaque État restera maître et souverain. La Constitution ne nous apporte rien de plus ! Mais par ailleurs, elle dit dans l'article 3 (si je me souviens bien), "on gardera un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les Églises". On peut interpréter cet article comme on veut - après tout, c'est l'art du politique, quelque part, on y trouve « à boire et à manger » - et on peut facilement l'utiliser pour défendre la laïcité mais on peut aussi considérer que la laïcité est en danger. Le discours et le dialogue transparent et régulier avec les Églises : pourquoi, comment, quel discours, quel lien ? On n'en parle pas. Les Églises au sens large ou stricto sensu ? Dans ce cas, pourquoi les « Églises » ?
Abordons maintenant cette question du foulard qui a bousculé beaucoup nos écoles françaises : il faut être honnête, le débat que nous avons connu sur cette loi sur le voile, que l'on a appelée loi sur la laïcité, a quand même été une occasion manquée de rediscuter de la véritable question de l'école, des problèmes de l'école, des problèmes qui se posent à l'école, des moyens donnés à l'école. On est en resté à l'arbre qui cache la forêt et on s'est focalisé sur le voile de quelques jeunes filles, comme si quelques voiles faisaient trembler la République, faisant croire que notre République était menacée par quelques mollahs barbus qui seraient cachés derrière ces voiles.
Dans ce débat, c'est la notion de la laïcité de combat qui a ressurgi face à cette notion d'une laïcité plurielle qui est en train de se construire. Je crois que le principe de la laïcité qui nous rassemble en France et en Europe, c'est un principe de la neutralité du service public, de la liberté d'expression, de croire ou de ne pas croire. C'est le renforcement de notre cohésion nationale ou européenne. C'est le sentiment de solidarité, de citoyenneté comme vous l'avez dit, le refus de la discrimination, des discriminations, et puis le respect de la dignité des personnes, l'égalité entre les sexes, le respect des droits humains et des différences. Ce sont des valeurs universelles mais qu'on peut aussi retrouver dans différentes religions.
Cette loi sur la laïcité, qui a fait couler autant d'encre et qui s'en est prise malheureusement à ces jeunes filles, n'a pas donné de perspectives à celles et à ceux qui utilisent la religion pour afficher une réaction de rejet. Les discriminations, qui sont en fait le reflet d'un « racisme quotidien » : discrimination à l'embauche, au travail, au logement, à l'apprentissage - je pourrais aussi dire la discrimination à l'expression du culte : quand on continue à être dans des caves, il y a une discrimination - discrimination également pour les langues et le droit des langues minoritaires, tout cela a conduit les victimes de cette discrimination, souvent sans preuves et sans moyens de se défendre, à se désespérer du modèle républicain et de nos valeurs. Par ailleurs, ces mêmes personnes ne supportaient plus la manière dont leurs parents avaient été traités jusqu'à aujourd'hui, avec mépris, et continuaient à être tenus dans un espace de non droit ou d'inégalité des droits.
Il est clair qu'à un moment donné lorsque nous, moi, enfant d'immigrés, je sors d'une cité, j'arrive dans un espace où, par l'école, par le savoir, je me rends compte que la question de l'intégration n'est pas une vraie question. Depuis que je suis née en France, cela fait bien longtemps que j'ai intégré la société française et je ne pense pas parler avec un accent différent. Mais la question d'intégration se pose bien en termes politiques, en termes sociaux, en termes économiques, en termes culturels, « comment on appréhende ma différence ? ». Pour moi, la différence est peut-être assez facile, en dehors du fait que je m'appelle Boumediene et qu'elle rappelle un certain passé, mais elle peut être plus difficile pour d'autres, pour des jeunes, des frères un peu turbulents, elle peut être plus difficile pour ceux qui sont "blacks" comme on dit dans nos cités. Le refus et le non-respect de la dignité sont différents pour mes parents, en particulier pour mon père qui n'a jamais obtenu le droit de vote dans ce pays où il s'est battu. L'année dernière, il est décédé et il n'a pas pu être enterré parce qu'il n'y avait pas un cimetière religieux dans la ville qu'il avait défendue et libérée 60 ans avant, on a dû le rapatrier dans son pays d'origine où il n'avait pas mis les pieds depuis plus de 20 ans !
Bien sûr que toutes ces questions ont touché de « plein fouet » les jeunes que nous sommes, et les plus jeunes qui arrivent encore après moi, qui ressentent cette discrimination avec violence, « au fond de leurs tripes », et qui ont envie de l'exprimer. Ils l'expriment justement parce qu'ils ne supportent pas cette manière de les traiter. Ils l'expriment en revalorisant a contrario une origine culturelle souvent stigmatisée, parfois même en la mythifiant avec des supports qui sont à portée de la main, parce que nous ne connaissons pas très bien notre religion alors nous utilisons des accessoires. En face, nous avons une réaction qui, au lieu d'être une réaction qui comprend et tente le dialogue, non seulement n'arrive pas à répondre aux véritables questions de société qui interpellent un changement de fond, mais n'arrive pas non plus à répondre aux véritables questions des discriminations et de l'exclusion vécue au quotidien.
La lutte contre l'oppression des femmes dont on parle à tort et à travers, cette lutte sur le foulard est un combat que je renouvelle - et que nous renouvelons chaque jour - en tant que femme, en tant que féministe, en tant que politique, mais aussi en tant que Maghrébine et musulmane. Mais lorsque je vois des gens, des politiques, exclure de jeunes filles de la scolarité au nom de la laïcité et d'un droit à l'égalité hommes/femmes sans protéger nos mères du Code de la famille, et continuer à signer des accords d'association avec nos pays d'origine où les droits de nos mères sont bafoués. Lorsqu'à côté de cela, on exclut ma petite soeur à cause du foulard, permettez-moi de dire qu'une violence s'exprime en moi.
À travers cette loi, on a ressenti de nouveau une certaine forme de racisme. Certains ont tenu à réaffirmer qu'il n'y avait pas de défiance envers une culture, mais alors comment interpréter une laïcité qui fait son choix, comment interpréter une école publique qui choisit son public, s'il n'y a pas réellement de défiance envers quelqu'un ? Même vigoureuse, la laïcité française a toujours été accompagnée de beaucoup de complexité et elle s'est même accommodée des aumôneries dans les prisons, dans les hôpitaux, du régime fiscal favorable à des dons dans les églises, des charges financières y compris dans nos collectivités. Quant à la remarque de Jean-Pierre Sueur, j'étais moi aussi, élue locale et dans mon budget municipal, j'ai voté une subvention pour l'église. Bien entendu, notre laïcité « à la française » participe aussi financièrement à l'instauration, à la charge financière des édifices religieux. Pourquoi ne participerai-elle pas également financièrement à l'édifice religieux d'autres citoyens français ? L'islam de France, Monsieur Rémond, n'est pas que l'islam des étrangers, c'est l'islam des Français et aujourd'hui l'islam des Européens. Or, nous entendons encore des sonneries de cloche (notamment les messes de gendarmeries). On voit encore l'absence d'école publique dans certaines régions. Mon mari est Breton. Au fin fond de la Bretagne, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas d'école publique, qu'on était obligé d'envoyer ses enfants à l'école religieuse.
Excusez-moi, mais je ne puis que constater que cette laïcité, « dite exceptionnelle », à la française est une laïcité à géométrie variable, ce qui m'inquiète ! Soudain, c'est le voile d'une religion qui a posé problème. L'objet de la laïcité, c'est-à-dire les programmes scolaires, la diversité, le respect de nos valeurs fondamentales, comme l'égalité des droits, tout cela a été masqué par un foulard. Et pourtant, en faisant tomber le foulard grâce à cette loi, on n'a pas fait tomber par miracle tout ce qui nous mobilise encore aujourd'hui : la fragilisation de la mixité, la parité en politique, il nous a fallu une loi et les débats ici nous ont prouvé qu'il n'y a pas eu beaucoup de femmes à la tribune pour parler, l'absentéisme dans les heures d'éducation, les comportements machistes méprisants et qui, parfois, n'ont pas grand-chose à voir avec les religions.
Pour conclure, nous sommes conscients que les enjeux sont importants. En effet les raisons et les conséquences d'un certain mal-être sont connues, c'est le sentiment d'exclusion dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la recherche d'une identité pour se raccrocher à quelque chose. C'est aussi la recherche d'un socle identitaire commun pour des personnes qui appartiennent à un environnement multiculturel ou sont issues d'une autre culture, mais qui appartiennent à une même société, parce que nous appartenons à cette société européenne. Lorsque nous faisons une loi comme celle sur la laïcité, loi d'exception, il y a presque un an, nous nous trompons dans notre réponse, car nous restons arc-boutés dans une histoire qui refuse d'appréhender un monde en mouvement, un monde qui évolue, un monde qui change. Nous avons du mal à dépasser un passé peut-être empreint par ce passé colonial, qui a certainement des impacts sur la famille, mais qui laisse aussi des traces sur ceux qui acceptent mal cette histoire commune. Et cette histoire influe sur la manière dont on aborde aujourd'hui la question de l'immigration, puisqu'on continue à nous penser comme étrangers alors que nous sommes en France, nés en France et qu'on continue à penser que nous avons un problème d'intégration, alors que nous n'avons pas de problème d'intégration. On continue « à poser l'Islam » comme problème, alors que l'Islam n'est pas un problème en soi, l'Islam est une religion qui s'ajoute aux autres religions qui constituent aujourd'hui la mosaïque culturelle de l'Europe.
Si je crois dans le projet européen, c'est parce que c'est justement le cadre géographique, culturel et politique où le croisement des histoires et des civilisations nous permet d'extirper cela et de pratiquer une solution qui me semble la plus adaptée.
La société n'a pas besoin d'une nouvelle guerre de religions, elle a plutôt besoin de s'ouvrir et de réaffirmer ses principes et ses valeurs de respect des différences, d'ouverture, de dialogue, de laisser chacun s'épanouir quels que soient ses choix individuels, afin de permettre à chacun de tirer profit au mieux de notre République et de l'enrichir. La laïcité plurielle telle que je la conçois aujourd'hui, est celle qui est en évolution avec les citoyens européens. C'est le défi que l'Europe doit relever, car l'Europe sera de cette laïcité européenne ou ne sera pas ! L'Europe doit alors porter haut l'étendard du respect des droits humains et de sa diversité. Sans le respect de cette laïcité plurielle, elle sera en échec.
Je crois que le point d'équilibre à trouver aujourd'hui pour justement concilier la foi et la raison, se trouve peut-être dans une autre manière de coopérer, de continuer un travail de séparation des pouvoirs, séparation du politique bien entendu, mais aussi de coopération avec la société. Le lien de coopération me semble indispensable. Aujourd'hui nous ne sommes pas seulement devant un retour de la religion mais peut-être aussi devant un retour de ces religieux, du fait religieux, parce que justement, il y a des manques auxquels nous n'arrivons pas à répondre. Le débat est encore loin d'être clos, je crois. En Europe, il commence à se construire. De plus en plus de diversité existe dans cette Europe, vous l'avez dit. Ailleurs, il y a de plus en plus de musulmans - et déjà même plus de musulmans que de Hollandais en Europe. Nous serons bien obligés à un moment donné d'accepter l'Islam, comme un élément plein et entier qui a toute sa place dans la société actuelle. L'essentiel sera de trouver comment un « vivre mieux ensemble » est possible, dans le respect de nos différences, mais aussi dans le respect de l'égalité des droits.
René Rémond
Madame, l'assistance entière vous a entendue avec gravité et reconnaissance et je vous remercie de votre intervention. Dans la dernière partie, vous avez mis le doigt sur un certain nombre de lacunes, de défaillances ou de contradictions de cette laïcité dont nous sommes si fiers : il resterait encore beaucoup à faire pour transformer les principes en réalité. Vous avez désigné nommément un certain nombre de carences ou d'anomalies.
Dans la première partie, vous avez touché à une autre question essentielle - les deux sont d'ailleurs liées et s'articulent sur l'Europe - : cette laïcité, est-elle est aujourd'hui encore une exception française ? Elle a pu l'être et, à cet égard, la France garde aujourd'hui l'avantage d'une antériorité : c'est évidemment la naissance de la laïcité qu'on peut dater de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, lorsque, dans son article 10, il est dit que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions mêmes religieuses ». C'est la première fois que l'on découple la citoyenneté de la confession. Il n'est plus nécessaire d'adhérer à la religion de la majorité pour jouir de la plénitude des droits civils et politiques. C'est le fondement de la laïcité, le point de départ qui assure la liberté personnelle, la liberté de conscience, la liberté de choix.
Cette laïcité - votre expérience de député européenne et votre connaissance des autres pays permettent d'apporter une réponse argumentée -n'est plus aujourd'hui une spécificité française. Je pense à ce qui fait l'essentiel de la laïcité, indépendamment des modalités particulières par lesquelles les principes sont mis en œuvre ou des vestiges de l'histoire, accidentelle et conjoncturelle, par laquelle la laïcité s'est imposée. L'affirmation de la liberté de conscience reprend l'héritage d'un siècle : la liberté de conscience, la reconnaissance de la dimension sociale du fait religieux. La loi de 1905 ne connaît le fait religieux que par son expression collective, le culte. Sur ce point, il y a une avancée. Pour les constituants de 1789, la croyance religieuse est encore une opinion individuelle. Pour la loi de 1905, c'est une croyance qui donne naissance à des communautés organisées, et qui se célèbre. L'État doit être neutre, c'est le principe de la reconnaissance de la pluralité, de l'égalité entre toutes les religions.
Quand on regarde les textes de référence à la Charte des droits fondamentaux, le projet de traité constitutionnel, nous retrouvons, formulés en termes de droits, tous les acquis essentiels de notre philosophie de la laïcité. Même l'exemple de Grèce, que vous avez évoqué, est ambivalent parce que les autorités européennes ont pu exercer légitimement une pression sur le gouvernement grec pour lui demander de retirer la mention de la religion sur la carte d'identité hellénique. C'est bien la preuve qu'il y a un consensus : elles ne l'ont pu que parce qu'il était clair que, pour tous les États européens, la discrimination ne pouvait pas trouver son principe dans la référence religieuse.
Il faut faire justice de cette idée d'une exception, qui relève un peu de notre arrogance « francocentrique » et, après tout, on doit se réjouir que ces principes soient universels. Aujourd'hui, incontestablement, l'entrée en Europe est une garantie que ce sera aussi la loi pour de nouveaux États.
Jean Baubérot, directeur de recherches à l'École Pratique des Hautes Études
Merci, M. le président. Comme vous l'avez dit, je serais bien resté sur l'exposé de Mme Boumediene-Thiery, mais puisqu'il a été prévu que je parle, je ne vais pas non plus me dérober.
Très rapidement, je voudrais dire au sujet de la laïcité, entre la France et l'Europe, que je crois qu'il peut exister une confrontation positive, où l'Europe peut apporter à la France et la France peut apporter à l'Europe et, où France et Europe doivent faire face à des interrogations communes. Évidemment, on pourrait développer ces trois aspects, mais je vais simplement prendre quelques exemples.
Ce que l'Europe peut apporter à la France, ce sont d'abord des garanties. Jacques Barrot a cité l'article de la Charte européenne des droits de l'homme qui va être constitutionnalisé, si la Constitution est adoptée, mais il faut savoir que cet article reprend l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme qui lui-même reprenait l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La nouveauté qu'a apportée la Convention européenne des droits de l'homme, c'est la création d'institutions chargées de veiller à l'application effective et non plus d'en rester à la déclaration de principes. Comme vous l'avez rappelé, M. le président, l'Europe a pu faire pression sur la Grèce grâce à l'existence d'une Commission européenne des droits de l'homme et d'une Cour européenne des droits de l'homme qui fonctionne et qui commence à avoir une jurisprudence tout à fait intéressante en matière de laïcité. La Grèce a été condamnée à plusieurs reprises, mais la Suède aussi a été condamnée et c'est à la suite de cette condamnation qu'elle est entrée dans un processus de séparation de l'Église nationale et de l'État, qui n'est certes pas la séparation française mais qui est une évolution notable de la situation suédoise.
Il faut savoir que la France elle-même a reçu un avertissement de la Commission européenne par suite d'une plainte de l'Union des athées, qui n'était pas traitée à égalité avec les associations cultuelles. Au-delà de ce qui est arrivé et de ses divers aspects, c'est le principe selon lequel les droits de l'homme sont déconnectés de la puissance étatique et qu'un État peut être condamné au nom des droits de l'homme par une instance supra étatique et non étatique qui me semble extrêmement important. Il s'agit pour moi d'une victoire collective du processus de laïcisation, du processus de laïcité. Je rappelle, on l'évoquait aujourd'hui, que Clemenceau a dit que l'on n'avait pas fait la révolution pour remplacer l'Église-Dieu par l'État-Dieu. L'Europe nous garantit effectivement contre l'État-Dieu.
La deuxième leçon est la garantie que l'Europe peut donner à la laïcité justement par rapport à la manière particulière dont la laïcité s'est construite en France, on l'a rappelé à plusieurs reprises, d'abord dans un univers qui a été longtemps monocolore sur le plan religieux, puis ensuite dans un conflit dualiste où les frères ennemis risquaient de se ressembler. D'autres États au contraire, ont une expérience beaucoup plus ancienne du pluralisme. Évidemment ce n'est pas une solution miracle pour résoudre les difficultés actuelles, mais je crois qu'il existe une possibilité pour la France d'apprendre quelque chose de l'Europe et notamment que le pluralisme ne signifie pas ipso facto du communautarisme, comme on en a peur trop souvent.
Au contraire, rester figé sur un universalisme abstrait et qui nierait en fait la réalité des choses peut engendrer du communautarisme. Suivant ce que l'on pourrait appeler la « métaphore de l'élastique », la négation de communautés, de collectivités, de groupes peut amener par réaction une existence plus agressive de ces groupes parce qu'ils se sentiraient menacés, parce qu'ils sentiraient qu'ils ne pourraient pas avoir de vie paisible et auraient donc une attitude agressive. Brunetière s'est rallié à la loi de 1905, lui qui était au départ farouchement opposé à la séparation. Elle nous donne la possibilité, affirmait-il « de croire ce que nous voulons et de pratiquer ce que nous croyons ». Eh bien, il faut que les minorités de notre pays puissent croire ce qu'elles veulent et pratiquer ce qu'elles croient, dans le respect de l'ordre public d'un pays démocratique.
Par ailleurs, à force de refuser le pluralisme, on ne se rend pas compte qu'il existe souvent du communautarisme subi et on vient de nous en parler longuement. Pour ne donner qu'un seul exemple, nous nous sommes posés, par exemple, la question de savoir si on allait obliger les demandeurs d'emplois à rédiger des curriculum vitae anonymes, puis nous avons considéré qu'il n'était pratiquement pas possible de faire des curriculum vitae anonymes. Mais cette question prouvait que des discriminations existent. Et d'Europe nous vient la notion de discriminations indirectes c'est-à-dire de discriminations qui existent en dépit d'une loi qui est la même pour tous.
Cela montre bien que l'universalisme abstrait ne fonctionne pas dans la réalité sociale, que les particularités sont de toute façon présentes. Si on ne veut pas les prendre en compte au niveau de l'idéal républicain, elles seront prises en compte au niveau des handicaps sociaux, des caractérisations qu'on en fait. Elles ne seront pas positivement prises en compte et il ne faut pas s'étonner ensuite si l'on se trouve face à des groupes qui apparaissent agressifs mais parce qu'ils ont été discriminés d'abord, parce qu'on les a d'abord empêchés de vivre sereinement. Voilà donc deux exemples où l'Europe peut apporter à la laïcité française.
Inversement, je pense que la France peut apporter quelque chose de positif à l'Europe. Je donnerai deux exemples. Le premier exemple, il en a déjà été question, c'est l'attitude qu'a eue la France dans le refus de la mention d'une identité chrétienne ou d'une référence à Dieu dans la Constitution européenne.
Il ne s'agit absolument pas de prétendre que, dans l'histoire, il n'y ait pas une part de l'héritage européen qui soit un héritage religieux et même, plus particulièrement, chrétien. Bien sûr, quand on écrira des livres d'histoire européens, il faudra rendre compte, rendre justice et donner le plus scientifiquement possible tous les aspects de cet héritage. Mais il me semble clair que, dans un texte juridique, constitutionnel, la mention particulière d'un héritage chrétien pouvait être dangereuse, notamment dans des pays qui n'ont pas une expérience historique de la laïcité.
L'élargissement de l'Europe le prouve, on a parlé de la Grèce mais j'ai été en Bulgarie, en Roumanie : on voit bien que ces pays orthodoxes qui n'ont pas eu l'expérience des Lumières, qui n'ont pas eu les mêmes expériences historiques que l'Europe occidentale, auraient pu interpréter cette mention d'héritage chrétien comme signifiant finalement qu'on pouvait légitimement donner des privilèges à une religion par rapport à d'autres. Ils ne sont déjà que trop tentés d'être dans cette démarche, pour des raisons qu'on peut comprendre. Effectivement, il y a eu une Église orthodoxe qui a joué un rôle national important pendant des siècles et il y a eu récemment le régime communiste avec la politique que l'on sait.
À ce niveau, dans l'histoire de France malgré ses aspects tourmentés, cette loi de 1905, d'un côté a été très libérale, mais, d'un autre côté, a clos la question lancinante de la France, nation catholique, de la France avec une identité religieuse catholique officielle et pas seulement avec le catholicisme comme une partie de son héritage historique. Je pense que tenir bon sur un certain nombre de fondamentaux de la laïcité qui ne sont pas agressifs ou sectaires, constitue un rôle important de la France au sein de l'Europe et cette conviction est d'ailleurs partagée par beaucoup d'Européens dans d'autres pays.
Le deuxième point, on y a également fait allusion, est l'enseignement laïque du « fait religieux ». Depuis des années que cette question est posée - parce qu'elle a été posée dès la fin des années 1980 -, quand je vais ailleurs en Europe, des professeurs me disent : « Mais pourquoi la France n'est pas plus audacieuse dans cet enseignement laïque du fait religieux ? Nous, cela nous aiderait beaucoup : on a des cours confessionnels de religion qui marchent plus ou moins bien, qui posent un certain nombre de problèmes, etc. et si la France pouvait donner un exemple positif d'enseignement laïque du fait religieux, alors cela ferait évoluer la situation dans notre propre pays, cela permettrait de construire effectivement une réalité européenne au niveau des connaissances ».
Je pense qu'il s'agit d'un sujet très important : au-delà du devoir de culture, et il est clair qu'il existe un devoir de culture en matière de religion comme dans les autres domaines, cette démarche d'enseignement laïque du fait religieux oblige à poser explicitement la question de la frontière entre connaissance et croyance. M. Prost l'a rappelé en début d'après-midi, il y a eu une époque pas si lointaine finalement dans l'histoire d'un pays, un siècle pas si lointain, où la connaissance appelait connaissance des croyances et où la croyance appelait croyance des connaissances. Et on sort de là, on sort de ce combat des deux France où chacun finalement, avait une doctrine totalisante et où cette frontière entre croyance et connaissance qui est difficile, qui peut toujours faire objet de débats, n'était pas bien tracée. Un enseignement laïque du fait religieux nous obligera à nous confronter à ce problème de la frontière entre connaissance et croyance et je pense que cela nous rendra plus laïque tous, que nous nous situions dans une idéologie agnostique ou athée, ou dans une croyance religieuse.
Les problèmes communs à la France et en Europe que nous avons à traiter : j'en finirai par là. Le premier, je viens de le signaler, concerne l'articulation entre connaissance et croyance mais je voudrais préciser ce point en rappelant que l'époque du conflit des deux France constituait un moment où il pouvait exister une foi au progrès, une confiance dans le progrès et même dans la conjonction des progrès, c'est-à-dire dans l'assurance que le progrès technique et scientifique donnait du progrès moral et social. Le progrès pouvait apparaître « bienfaisant », selon une expression employée alors. Quelqu'un comme Émile Combes le dit à plusieurs reprises : il y a une convergence entre le progrès scientifique et le progrès moral et social, pour lui cela fait un tout et l'humanité marche vers le progrès. Inversement, il y existait aussi des doctrines des fins dernières, une croyance en l'au-delà dont certains pensaient qu'elle était objective et qu'elle s'imposait à tout être raisonnable, à tout être rationnel et donc qu'il s'agissait d'une vérité à inculquer.
Aujourd'hui, on est dans le brouillage de telles situations car s'il y a réussite du progrès technique et scientifique, on s'est aperçu que ce progrès scientifique et technique aboutissait à de nouveaux dilemmes et à des dilemmes anthropologiques. Toutes les questions que posent la bioéthique, les biotechnologies, montrent bien que l'on aboutit à de nouvelles questions et ces nouvelles questions sont des questions de sens. Quand le problème se focalisait sur l' « espérance de vie », tout le monde pouvait trouver raisonnable la lutte pour la prolongation de l'espérance de vie, mais maintenant ce n'est plus tellement l'espérance de vie que l'on souhaite, c'est « mourir dans la dignité ». Qu'est-ce que cela signifie mourir dans la dignité ? Nous ne sommes plus dans l'ordre du quantitatif mais dans le débat sur le qualitatif, sur ce qui est humain et ce qui peut être une perte d'humanité, liée à un progrès scientifico-technique. On voit bien que les questions éthiques, les questions de sens resurgissent. En même temps, les théologiens eux-mêmes sont moins péremptoires, moins persuadés qu'ils peuvent imposer une doctrine de l'au-delà. Finalement, le doute fait partie de la foi elle-même.
Je pense qu'effectivement la laïcité en Europe pourra affronter ce problème et je remarque par exemple que l'article 3 de la Charte européenne met des limites à la médecine au nom de la dignité humaine, ce qui n'existe pas dans la Convention européenne des Droits de l'homme, ce qui était impensable il y a 50 ans.
Je voudrais attirer l'attention sur un point et je terminerai par là : ces questions de sens sont indispensables à poser sur la place publique - on ne peut pas les restreindre à la sphère privée -, mais pour autant il ne faut pas que les religions en soient les propriétaires. Il faut qu'il puisse y avoir un pluralisme symbolique qui aille au-delà des religions et qui fasse droit, à égalité avec les options religieuses, à des options philosophiques non religieuses. À ce niveau-là, sans vouloir copier un modèle, sans vouloir en dire qu'ils ont réussi à trouver la fin de l'histoire, je pense que l'expérience de nos amis belges peut être une expérience intéressante. À côté des aumôniers de prisons, d'hôpitaux, etc. il existe aussi des conseillers humanistes, et cette ouverture du sens à la fois sur des options religieuses et sur des options philosophiques constitue peut-être une manière nouvelle de vivre une laïcité pour le XXI e siècle.
René Rémond
Merci des directions que vous avez ouvertes à notre réflexion et de cette estimation positive du resserrement des liens entre la pratique française de la laïcité et les expériences faites par nos partenaires et nos voisins dans le cadre de l'Union européenne. C'est à Philippe Portier que revient de prononcer la dernière intervention.
Peut-on parler d'un modèle européen de laïcité ?
par Philippe Portier, professeur de Science politique à l'Université Rennes 1
J'ouvrirai volontiers cette intervention 53 ( * ) par une formule fameuse d'Émile Poulat : « En Europe, nous sommes tous laïques 54 ( * ) ». L'auteur de Notre laïcité publique voulait ainsi signifier que les peuples européens ne sont pas rassemblés seulement par des solidarités économiques, mais qu'ils sont liés aussi par le partage d'une commune intelligence du vivre ensemble, trouvant elle-même son fondement dans la philosophie politique de la modernité. Cet ethos européen, trois grands traits permettent de le définir.
Il s'adosse tout d'abord à une certaine conception du sujet. Dans le monde pré-laïque, celui d'avant la grande rupture des XVIII e -XIX e siècles, l'homme est pensé comme créature de Dieu : il doit à ce titre respecter les devoirs que lui impose Celui qui l'a porté à l'existence. Dans l'univers moderne, l'homme est considéré au contraire comme son propre créateur, "l'auteur de ses propres jours" disait Shakespeare : les droits deviennent premiers alors, et l'emportent sur les devoirs. On en saisit l'effet dans le domaine de la religion : chacun doit être libre de déterminer à son gré ses adhésions de foi sans que son choix (ou son non-choix) ne débouche sur quelque discrimination que ce soit. Commune figure du sujet, commune figure de l'État également. Dans l'ère théologico-politique, l'État trouve son principe dans la transcendance. Né de la volonté de Dieu, il est enrôlé au service de son ordre : il lui revient de transcrire dans le droit positif les décrets de la loi numineuse. Rien de cela ne subsiste dans le monde laïque : institué par les êtres qu'il dirige, le pouvoir est au service de l'homme et de ses droits. Sa fonction est simplement, en assurant l'ordre et la paix, de permettre à chacun de construire, comme il l'entend, son propre univers de vie. À cela s'ajoute une commune conception de l'Église. Elle avait hier le statut d'une institution englobante : douée d'un privilège de véridiction, elle donnait à chacun dans la société les critères de l'action juste. Elle n'est plus, dans le monde moderne, qu'une institution sectorielle. Sa parole n'est plus la vérité, mais une opinion comme les autres que l'État, dans sa souveraineté, peut fort bien méconnaître. Le sociologue anglais James Beckford a résumé de la sorte cette mutation : "L'Église était naguère une institution sociale ; elle n'est plus qu'une ressource culturelle".
Cette nouvelle théorie du vivre ensemble soulève, on le devine, un problème pratique : comment, dans ce système politique rendu dorénavant à ses propres raisons, organiser la relation entre l'État et les Églises ? Quelle place, dans ce monde dissocié de la transcendance, accorder aux organisations religieuses ? David Martin, dans sa Théorie générale de la sécularisation 55 ( * ) , rappelle que la question n'a pas été résolue partout de la même manière. Elle a au fond, explique-t-il, donné lieu à deux grandes réponses juridiques, correspondant à la grande division confessionnelle du continent européen. Dans les pays catholiques s'est mis en place, non sans conflit le plus souvent, un système de type séparatiste : c'est sur le fondement d'une dissociation institutionnelle avec l'Église dominante - romaine - que la modernité ici a trouvé sa forme. Dans les seconds, s'est maintenue au contraire, malgré l'affirmation des Lumières, un modèle de religion d'État, caractérisé par la compénétration continuée de l'institution politique et de l'institution ecclésiale.
Le schéma produit par David Martin pour analyser l'entrée de l'Europe, aux XVIII e -XIX e siècles, dans l'ère de la subjectivité politique permet-il de rendre compte de la période immédiatement contemporaine ? Je voudrais, dans les quelques minutes qui me sont imparties, proposer une réponse nuancée. Un premier moment conduira à confirmer la "thèse de la division" : à l'examen, les modèles nationaux se distribuent encore autour des deux grands idéaux-types à l'instant énoncés. On ne saurait ignorer cependant le mouvement de fond qui se fait jour depuis quelques décennies.
Les pays de l'Union ne restent pas figés dans la reconduction absolue du même. Ils s'extraient de plus en plus volontiers du "sentier de dépendance" (G. Pierson) qui les attachait à leur passé pour converger vers un modèle commun d'organisation de la relation Églises/État. Il semble bien qu'une "Europe de la religion" soit aujourd'hui, à côté de l'Europe de l'Agriculture ou de l'Éducation, en train d'apparaître.
Un univers fragmenté
Permanence donc : telle est la première leçon qu'il faut extraire de l'analyse des droits nationaux des religions. Les pays non catholiques demeurent régis le plus souvent par une formule de confessionnalité (ou, l'expression est aussi employée, de "pluralisme élitiste") ; les pays de culture catholique restent fidèles pour leur part au modèle de séparation, marqué par un "pluralisme égalitaire" 56 ( * ) .
Abordons le cas, d'abord, des pays confessionnalistes. Leur système de régulation de la croyance s'articule autour de deux grands principes. Le premier est celui de hiérarchisation : dans les pays qui l'ont adopté, une religion - ou parfois deux comme en Finlande - se trouve distinguée des autres : elle est appréhendée comme "religion d'État", ou "religion dominante", ou "religion officielle", et reçoit de ce fait des prérogatives et des responsabilités particulières. Le second est celui de tolérance. Toutes les religions ne bénéficient pas certes de la même "reconnaissance" étatique ; elles ont droit de cité néanmoins : la loi leur accorde en principe une pleine liberté d'organisation et de communication, et sanctionne toute discrimination à l'égard de leurs membres pris isolément. Cette formule résume la situation : "La liberté des cultes sans doute, pas leur égalité" 57 ( * ) . Ce système caractérise en premier lieu la zone protestante de l'Europe. La Suède l'a expérimenté jusqu'en 2000. La Finlande et l'Angleterre la connaissent encore ; et le Danemark bien sûr. Dans ce dernier pays, qu'on peut retenir à titre illustratif, tout est suspendu à l'article 4 de la Constitution de 1953, encore en vigueur : "L'Église évangélique luthérienne est l'Église nationale danoise ; elle bénéficie à ce titre du soutien de l'État". Ce soutien se manifeste à un double niveau. Au niveau symbolique, d'une part. C'est à l'institution luthérienne qu'est confié l'important cérémonial du sacre royal, où s'exprime la dimension chrétienne de l'imaginaire national ; à elle encore qu'est attribuée la gestion de l'état civil et des cimetières. En outre, l'éducation religieuse, "évangélique" initialement, est considérée comme une discipline ordinaire des programmes d'enseignement. Au niveau financier, d'autre part. L'État prend en charge sur son propre budget, en s'appuyant en partie sur la taxe confessionnelle recouvrée auprès des luthériens déclarés, la quasi totalité des frais de fonctionnement et d'équipement de son Église nationale. Les autres confessions ne peuvent bénéficier que de subventions ponctuelles, et uniquement pour leurs activités sociales, éducatives ou culturelles. Comme dans tous les systèmes de confessionnalité, cette officialisation ne va pas sans contrôle : les règles internes de la Folkkirke sont appelés à être validées par un acte du Parlement (ou par un décret royal) et les pasteurs, intégrés à l'Administration d'État, sont appelés à rendre compte de leur activité auprès du ministère de l'Église 58 ( * ) .
C'est un schéma similaire d'organisation qu'on voit à l'œuvre dans la zone orthodoxe de l'Europe. On pense ici à la Grèce 59 ( * ) . Promulguée "sous les auspices de la très sainte Trinité une et consubstantielle", la Constitution de 1975 affirme clairement la position privilégiée de l'Orthodoxie : "La religion dominante en Grèce est l'Église orthodoxe orientale du Christ". Même principe, mêmes effets. D'abord, l'institution religieuse se voit reconnaître un appui symbolique de la part de l'État. Il est prévu par exemple que les autorités - le président de la République, les parlementaires - prêtent serment, au moment de leur entrée en fonction, "au nom de la très sainte Trinité" ; quant au système d'éducation, il se voit assigné, selon la formule de la Loi fondamentale, la charge de transmettre aux élèves une "éducation tout à la fois religieuse et nationale". Certes, on ne connaît pas en Grèce l'impôt d'Église ; il reste que le budget de l'État abonde annuellement l'Église orthodoxe, et salarie ses prêtres. Ce soutien a sa contrepartie juridictionnaliste : le personnel religieux est nommé par le Ministère de l'Éducation et des Affaires ecclésiastiques ; quant aux Actes du Saint-Synode, ils doivent, pour entrer en vigueur, être enregistrés par le Parlement et publiés au Journal Officiel. Ce contrôle toutefois est assez nominal, tant est puissante la hiérarchie épiscopale. Il s'exerce plus lourdement, en revanche, sur les autres cultes : le prosélytisme, qui permettrait aux religions minoritaires d'étendre leur influence, est interdit par la Constitution même ; et la législation - elle date, sur ce point, du régime de Metaxas à la fin des années 1930 - leur impose, lorsqu'elles veulent installer un édifice cultuel, d'obtenir, outre l'accord de l'État, celui aussi de l'évêque orthodoxe du lieu.
On peut s'interroger bien sûr sur le maintien de ce système de compénétration institutionnelle hérité de l'âge théologico-politique. Comment a-t-il pu résister à l'expansion d'un régime politique dont la singularité est de trouver en lui-même, loin de toute normativité divine, ses propres principes ? J'ai proposé ailleurs cette explication 60 ( * ) : dans les zones non catholiques de l'Europe, les États n'ont pas eu besoin, pour conquérir leur souveraineté, de se dissocier des Églises dominantes. Orthodoxes ou protestantes, celles-ci n'ont, en effet, nullement fait obstacle à l'émancipation du politique : portées par une "théologie de la sécularité", elles ont admis très vite, se repliant sur la seule administration des affaires spirituelles (et souvent désormais sur la gestion des questions existentielles), que l'État pût fixer à son gré la politique du pays. Avec ces forces-là, à ce point accommodantes, il n'était pas insensé pour le gouvernement de pérenniser la structure d'alliance des temps pré-modernes. Raison doctrinale, raison sociale également. Dans les zones de référence, la population s'est, jusqu'à une période très récente, toujours opposée à l'idée d'une relégation de l'Église dominante dans l'espace privé. Massivement rassemblée autour d'elle (souvent à plus de 90 %), elle en faisait le symbole même de son identité. En décrétant la séparation, l'État aurait pris le risque, dans ces conditions, d'une mesure gravement impopulaire.
L'option des pays catholiques (ou à forte présence catholique) a été toute différente. C'est la voie de la séparation que l'État a retenue, lorsqu'il s'est agi d'entrer dans la modernité. Pour des raisons symétriquement opposées à celles qui expliquent ailleurs le maintien de la confessionnalité. D'abord, le gouvernement n'a pas été confronté ici à la même théologie : l'Église romaine - au moins jusqu'à Vatican II - s'est appuyée sans trêve sur la philosophie bellarminienne du "pouvoir indirect" et a, du coup, toujours revendiqué un droit de contrôle sur la détermination des affaires temporelles. Ensuite, la religion, dans la zone concernée, n'a jamais été perçue comme le fondement exclusif de la conscience nationale ; elle est apparue au contraire, à travers l'histoire récente au moins, comme le motif même de sa déchirure (songeons simplement à la "guerre des deux France", à "la guerre des deux Espagne", au Kulturkampf allemand). Voilà qui ne pouvait pas ne pas engendrer la rupture : on voit mal comment l'État aurait pu se maintenir dans l'ancienne compénétration avec une institution ecclésiale qui, dissociée d'une grande partie de la population, le contestait de la sorte dans son dessein d'indépendance. Deux principes, globalement, caractérisent le système séparatiste. Le principe, d'une part, d'extranéité étatique : dans le système confessionnaliste, l'État intervient dans le mode d'organisation des Églises, de l'Église officielle en tout cas ; il n'en va pas de même dans le régime séparatiste : les forces religieuses sont laissées à leur autonomie de fonctionnement. Le principe, d'autre part, d'égalité confessionnelle. Ce modèle, en droit du moins, refuse l'idée d'une hiérarchisation entre les cultes : traitées de manière équivalente par le pouvoir, les religions disposent toutes des mêmes prérogatives et des mêmes devoirs.
S'ils adhèrent à cette norme de fonctionnement, les systèmes de séparation ne sont pas cependant en tous points identiques. Une cartographie plus précise permet de déceler en leur sein deux sous-catégories. Certains pays ont adopté un régime de séparation souple ; d'autres un régime de séparation plus rigide. La "séparation souple", repérable principalement dans les pays du nord et du centre de l'Europe (Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas) définit, dans le cadre certes de la dissociation des instances, un système de coopération entre les Églises et l'État : le gouvernement se refuse à admettre l'existence d'une "religion officielle" ; il se montre "bienveillant" cependant à l'égard des institutions ecclésiales, auxquelles il accorde, sur le fondement le plus souvent d'un dispositif concordataire, une dimension proprement publique. Le cas allemand en fournit une illustration très claire 61 ( * ) . D'abord, la Constitution (1949) reconnaît ici, expressément, l'importance sociale du fait religieux : dans le même temps qu'elle fait du Dimanche, dédié au "recueillement spirituel", un jour obligatoirement chômé, elle rappelle le peuple allemand à "sa responsabilité devant Dieu et les hommes" et, suivant les termes repris de la Constitution de Weimar, accorde aux Églises la possibilité d'accéder au statut de "corporation de droit public". Ensuite, la puissance publique abonde les institutions religieuses. Les Länder et les communes peuvent, sans risque d'être sanctionnés, soutenir financièrement les manifestations qu'elles organisent et les constructions qu'elles initient. En outre, un pouvoir légal de taxation leur est reconnu, dès lors qu'elles bénéficient du statut de corporation de droit public : c'est l'administration fiscale qui intervient en prélevant auprès de leurs membres et pour leur compte cet impôt confessionnel. Surtout, les Églises sont convoquées à intervenir dans l'espace étatique. Elles organisent dans les écoles publiques les cours de religion, que la Loi fondamentale de 1949 a élevés au rang de discipline ordinaire dans le cursus de l'enseignement primaire et secondaire. L'État n'hésite pas de surcroît à les associer très officiellement à la réflexion et à l'action (pensons aux centres de prévention de l'avortement) des instances politiques, au niveau central comme au niveau local.
Le système de "séparation rigide" marque la France essentiellement 62 ( * ) , même si on a connu par le passé une tendance analogue en Italie (au moment du Risorgimento ), au Portugal (dans les années 1910), en Espagne (dans les années 1930). Ses traits sont symétriquement opposés à ceux du système de séparation souple. D'abord, la République française n'admet aucune reconnaissance particulière du fait religieux. Si l'on excepte la référence - inspirée par la philosophie des Lumières - à l'Être suprême dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution de 1958 n'évoque nullement la figure de Dieu, non plus d'ailleurs que l'importance de la spiritualité. En outre, les institutions religieuses ne peuvent prétendre à aucun statut de droit public : elles doivent s'organiser selon les règles du droit privé, soit sous la forme d'associations ordinaires (loi de 1901), soit sous celle d'associations cultuelles (loi de 1905). Autre différence : la question du financement. Dans le modèle français, les cultes ne peuvent, en principe, être soutenus par l'État. C'est ce que précise avec force, revenant sur le "dispositif concordataire", l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 : « La République ne subventionne, ni ne salarie aucun culte ». Reste enfin l'intervention des religions dans l'espace public. Sans doute admet-on, je le disais plus haut, que les forces confessionnelles s'organisent à leur gré et donnent même une expression sociale à la foi qu'elles défendent. On entend cependant qu'elles demeurent à l'écart de la sphère étatique. Un exemple parmi d'autres. Partout en Europe existent des cours de religion dans l'enseignement public. Ce n'est pas le cas en France (hormis l'Alsace-Moselle), où l'on considère depuis la III e République que la morale naturelle suffit pour fonder l'éthique de la nation. Plusieurs observateurs ont cru pouvoir repérer au cours des toutes dernières années une résurgence de ce dessein de relégation dans les positions gouvernementales sur la référence aux "racines chrétiennes de l'Europe" dans le traité portant Constitution de l'Union et dans le débat qui a précédé le vote de la loi du 15 mars 2004 sur le port des signes religieux à l'école publique.
Il faudrait expliquer l'origine de cette séparation stricte. Deux raisons au moins semblent avoir joué. La première est de nature culturelle. La philosophie des Lumières a pris en France, avec d'Holbach, Helvétius, Diderot, un contenu volontiers irréligieux : « faute, disait Hegel, d'avoir connu la Réforme », elle a assimilé la croyance à la « superstition et au fanatisme », et milité donc pour que l'État, incarnation de la raison, s'en dissocie le plus nettement possible. L'Allemagne, ou les Pays-Bas, n'ont pas connu cette situation : la forte présence ici du protestantisme, plus en phase avec les réquisits de l'individualisme moderne, a conduit les philosophes de la subjectivité - qu'on songe à Kant ou à Fichte - à penser l'adhésion religieuse comme une expérience souhaitable, nécessaire même, de l'existence humaine, que la société devait reconnaître à sa juste valeur. La seconde est de nature politique. La laïcité s'est imposée en France dans le cadre d'une démocratie "agonistique" : le camp catholique, en "guerre" avec le camp républicain, n'a jusqu'aux années 1940 guère pu accéder à la sphère de la décision gouvernementale, ni du coup défendre ses intérêts confessionnels autant qu'il l'aurait souhaité. Il n'en a pas été de même dans les pays du nord de l'Europe. Ici, comme l'a bien montré Lijphart, la démocratie s'est faite "consociative" : constitués en "piliers", les catholiques, - mais aussi les protestants, comme aux Pays-Bas -, ont pu accéder aux sommets de l'État et obtenir, par négociation avec les élites des autres "piliers", une réponse plus favorable que dans le modèle français à leurs revendications.
Un mouvement convergent
Il apparaît donc que les droits des religions des différents pays européens demeurent aujourd'hui encore dans une forte dépendance à l'égard de leurs matrices primordiales. Cet attachement n'est pas un simple reliquat du passé : en lui s'exprime d'évidence une part de l'identité des nations. Les auteurs de la Constitution européenne l'ont d'ailleurs parfaitement remarqué, qui ont comme "sanctuarisé" le statut national des religions : « L'Union, dispose l'article I-52, respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres ». Il reste que la distribution géographique que j'ai à l'instant proposée est sans doute moins précise actuellement qu'elle ne l'était hier : une dynamique de convergence est à l'œuvre depuis les années 1960-1970 qui vient "griser" les zones de référence. Un modèle commun de laïcité se met progressivement en place, répondant globalement aux critères (égalité et publicisation des appartenances confessionnelles) propres au système de "séparation souple".
Ce rapprochement procède d'une double évolution. La première concerne les pays confessionnalistes. Au cours des dernières décennies, ceux-ci ont massivement répudié leur unitarisme religieux pour s'ouvrir - tendanciellement - à un pluralisme égalitaire. On l'a vu dans certains pays catholiques. On songe à l'Italie par exemple 63 ( * ) . Par les Accords du Latran conclus entre Pie XI et Mussolini, la religion catholique avait été érigée en "religion d'État", avec tous les privilèges qui en résultaient (en termes de droit matrimonial, d'organisation de l'Éducation, de financement des cultes). Or, ce régime de préférence - maintenu, avec quelques adaptations jurisprudentielles, sous la République elle-même - n'est plus dorénavant. À l'orée des années 1980, le gouvernement a renégocié avec le Saint-Siège (accords de 1984) les termes de la présence de l'institution romaine dans l'espace public et instauré progressivement un système de séparation traitant à parité (relative) les différents cultes. On pense également à l'Espagne 64 ( * ) . Le franquisme avait, en rupture avec la Constitution de 1931, restauré l'Église romaine dans ses "droits ancestraux" : reconnu "seule religion de la nation espagnole" par les fueros de 1945, eux-mêmes confirmés par le Concordat de 1953, le catholicisme s'est vu doté, "conformément à la loi divine et au droit canon", d'immunités et de privilèges particuliers (contrôle de l'enseignement public, subventions étatiques, participation à l'élaboration de la législation civile...). Mais ici non plus le système n'a pas perduré. La Constitution de 1978, complétée en 1976 et 1979 par des accords nouveaux avec le Vatican, est venue mettre fin au modèle confessionnaliste : tout en appelant à tenir compte des religions à "enracinement notoire", elle dispose que l'Espagne ne connaît plus désormais de "religion d'État". S'agit-il dans les deux exemples qu'on vient de donner d'un retour au statu quo ante ? Nullement. Ce retour à la séparation ne s'est pas opérée pas suivant la logique strictement dissociative de la fin du XIX e siècle et du début du XX e . En Italie comme en Espagne, c'est une séparation souple qui a pris corps, fondée sur une reconnaissance publique du fait religieux. Les croyances ne sont pas reléguées dans la sphère privée des individus ; elles ont vocation, dans leur pluralité, à être soutenues positivement (financement étatique des cultes, interventions des religions dans les écoles...) par la puissance étatique.
Le cas est tout aussi parlant pour ce qui concerne les pays de confessionnalité non catholique. Tantôt la déconfessionnalisation s'est faite de manière officielle, comme en Suède. Elle s'organisait jusque dans les années 1990 selon un mode d'articulation Églises/État proche du modèle danois. Elle est, depuis le 1 er janvier 2000, entrée elle aussi dans un système de dissociation ouverte. L'Église luthérienne est soutenue par l'État certes ; elle ne bénéficie plus toutefois du statut, qui lui apportait des prérogatives exclusives (dans la gestion des existences administratives ou l'obtention des subventions publiques), de "religion nationale" : elle est, si l'on excepte son poids historique et sociologique, une Église ordinaire, sans plus de droits ni de devoirs que les autres confessions. Tantôt la déconfessionnalisation s'est opérée de manière implicite. Tel est le cas en Angleterre notamment. Elle semble avoir conservé son modèle traditionnel : en dépit d'appels de plus en plus fréquents en faveur du "desétablissement", l'Église anglicane y demeure religion de l'État, soumise au "pouvoir temporel" de la Reine. Pour autant, sa préséance n'est plus ce qu'elle était : les cultes minoritaires, du catholicisme à l'islam, des divers protestantismes au judaïsme, disposent, en termes de subventionnements (il existe ainsi des écoles catholiques d'État, et depuis quelques années des écoles musulmanes financées sur fonds publics), en termes aussi d'accès aux espaces de décision politiques ou même d'organisation du cérémonial national, de droits de plus en plus semblables à ceux de l'Église officielle 65 ( * ) . La Grèce connaît une évolution similaire. Bien sûr, le projet, formulé dès le tournant des années 1970-1980 par le Premier ministre socialiste Papandréou, de séparer l'Église et l'État n'a toujours pas abouti, malgré l'assentiment sans cesse croissant de la population. Il reste que le droit des religions est affecté ici aussi par la dynamique de l'égalité. Deux exemples parmi d'autres. L'expression publique des religions non orthodoxes a, on l'a dit, longtemps été prohibée ; elle est depuis le milieu des années 1990, à la suite de l'arrêt fameux de la Cour européenne des droits de l'homme ( Kokkinakis contre Grèce , 1993), autorisée. Hier, les cartes d'identité mentionnaient la religion d'appartenance de leurs titulaires. Ce n'est plus le cas désormais. Contraint sur ce point aussi par les institutions européennes, l'État grec s'est converti à la doctrine de la neutralité. Il importe d'ajouter que cette "déconfessionnalisation" - qu'elle ait pris, comme en Suède, forme explicite, ou, comme en Angleterre, forme implicite - ne s'est pas faite sur le fondement d'une privatisation du fait religieux comme dans les pays catholiques, les religions font l'objet, par les financements qu'elles reçoivent, par les divers dispositifs qui les associent au système éducatif et souvent à la détermination de certaines politiques publiques, d'une reconnaissance réelle de la part de l'État.
Deux facteurs interfèrent, semble-t-il, dans ce processus de déconfessionnalisation. La confessionnalité se défait "par le haut" tout d'abord, par un effet de la logique européenne. Le droit de l'Union comme celui du Conseil de l'Europe sont inspirés l'un et l'autre par l'axiomatique du "différentialisme égalitaire" : ils entendent, en préservant cependant la régulation nationale, que chacun puisse affirmer librement son identité culturelle et religieuse, et que toutes les religions donc puissent disposer des mêmes prérogatives. Cela ne va pas sans incidences concrètes : c'est bien sous l'influence de condamnations pour discriminations infligées par la Cour européenne des droits de l'homme que la Suède et la Grèce ont évolué. Mais la déconfesionnalisation est venue d'"en bas" également. Les sociétés changent : la Suède, la Grèce, le Danemark connaissaient hier une forte homogénéité religieuse 66 ( * ) . Il n'en va plus exactement de même aujourd'hui. En leur sein s'installent des poches - souvent importantes - de populations exogènes, musulmanes notamment, ou de populations incroyantes (ou autrement croyantes) détachées de la religion majoritaire. Il fallait bien que le droit s'adapte à cette conjoncture, d'autant d'ailleurs qu'au sein des différentes confessions dominantes, l' ethos de la reconnaissance égalitaire devient, suivant une logique très tocquevillienne, de plus en plus prégnant 67 ( * ) .
Les pays de séparation stricte - je pense à la France, mais aussi à ces pays anciennement communistes qui ont rejoint l'Union européenne - sont affectés par un phénomène parallèle de réassociation. Je m'arrêterai sur le cas français 68 ( * ) . Notre pays a construit, sous la III e République, un modèle assis sur le partage du privé et du public : les différences religieuses doivent pouvoir s'affirmer dans la sphère privée ; elles ne sauraient en revanche pénétrer l'espace public, réservé au seul travail de la raison naturelle. Certains éléments de ce schéma demeurent, sans doute aujourd'hui encore : la pérennité même de la loi de 1905 en atteste, comme d'ailleurs, en partie, la législation récente sur les signes religieux à l'école publique. On ne peut ignorer cependant les mutations qui l'ont frappé depuis les années 1960. Marcel Gauchet a résumé le changement d'une formule : en France, « le public s'est privatisé tandis que le privé s'est publicisé 69 ( * ) ». Deux indices permettent de le démontrer. Le premier concerne le financement des activités ecclésiales. Le droit français a développé une lecture très large, très extensive de l'article 2 de la loi de 1905. La république d'abord, qui devrait « ne subventionner aucun culte », abonde considérablement, par le truchement des contrats mis en place par la loi Debré en 1959, le secteur privé d'éducation : les écoles catholiques sont les premières concernées, mais aussi les écoles juives et demain les écoles musulmanes. Il en va de même pour les associations à vocation sportive, culturelle ou sociale liées aux différentes confessions. Mais le gouvernement soutient aussi les activités religieuses elles-mêmes. La restauration des lieux de culte est prise en charge par les collectivités qui en sont propriétaires. Des aides à la construction interviennent également (mise à disposition de terrains, garanties d'emprunts, soutiens directs même comme à Rennes ou Évry). Quant aux associations cultuelles, diverses mesures fiscales - débouchant sur des exonérations d'impôts - les assurent de subventionnements indirects. C'est au total, estiment les spécialistes des finances publiques, plus de neuf milliards d'euros qui sont de la sorte, chaque année, versés aux Églises.
Second indice : la publicisation des appartenances religieuses. Elle se manifeste au niveau de l'espace scolaire. Certes, on a voulu récemment extirper de l'école publique les signes "ostensibles", ou "militants", d'appartenance religieuse. Les "signes discrets", "visibles", que certains avaient voulu supprimer, demeurent possibles cependant. En outre, la jurisprudence (et la réglementation) reconnaît aux élèves le droit d'obtenir des autorisations d'absence pour obligation confessionnelle. Plusieurs enquêtes ont montré aussi que les pratiques des administrations sont souvent, à la base, très respectueuses des croyances, en matière par exemple de détermination des menus scolaires ou des dates d'examen. L'édiction d'une réglementation très favorable à l'installation d'aumôneries dans les lycées et collèges (décret de 1960 confirmé par une circulaire de 1988), comme le développement de l'enseignement du fait religieux à l'école publique, participent également de ce saut qualitatif. Ouverture de l'espace scolaire, ouverture d'autre part de l'espace politique. C'est une innovation de la V e République : les institutions confessionnelles participent de plus en plus fortement aux différents "réseaux d'action publique", aux différents "forums" de réflexion et de décision où s'élabore la norme collective. La création du Conseil français du culte musulman, l'institutionnalisation de la relation entre le gouvernement et l'Église catholique (et, demain, la Fédération protestante) signalent, parmi d'autres éléments, cette tendance lourde de la vie politique française.
Cet assouplissement de la laïcité n'est pas un effet du hasard. Il est le produit sans doute d'une modification de notre système de représentations collectives 70 ( * ) . Nous sommes passés progressivement, rejoignant par là la norme et l'opinion européennes, d'une épistémè "universaliste" à une épistémè "différentialiste". Celle-ci repose sur une conception inédite du sujet. On a longtemps considéré, dans la France républicaine, que les hommes ne pouvaient être définis que par leur raison, et qu'ils devaient donc, pour coller à leur essence, être arrachés à leurs appartenances premières qu'elles fussent ethniques, régionales ou religieuses. On n'en est plus là aujourd'hui : on admet très majoritairement que l'identité de chacun est liée à une mémoire, dépend d'un enracinement auquel il convient de faire droit nécessairement. À cela s'ajoute une approche nouvelle de l'État. Dans le modèle d'hier, l'État était pensé comme l'"instituteur du social", chargé d'élever ses administrés au niveau de la généralité publique. La "démocratie" se substituant à la "république", on l'appréhende désormais comme le "scribe de l'opinion", sommé de rendre justice simplement aux multiples identités qui structurent la société. Voilà qui nous ramène à la transformation de notre laïcité : en s'ouvrant, comme on l'a vu, à la reconnaissance positive des affiliations confessionnelles, le droit français des cultes n'a rien fait d'autre en somme que de s'adapter à cette nouvelle donne axiologique.
Même s'il n'abolit pas totalement les singularités nationales, ce double mouvement - déconfessionnalisation ici, réassociation là - produit de l'homogène sans aucun doute : il dessine, encore timidement, un système commun, européen, de régulation de la croyance. Cette laïcité juridique, qui vient couronner la laïcité culturelle, s'organise, me semble-t-il, autour de trois grands principes. Le principe d'égalité d'abord : on admet de moins en moins aujourd'hui que les cultes puissent ne pas être traités à parité par les institutions politiques. Le principe de positivité ensuite : l'égalité ne doit pas se vivre dans l'indifférence de l'État. On entend que les religions bénéficient, symboliquement et financièrement, du soutien de la puissance publique. Laïcité de "bienveillance" donc, et non point de simple "neutralité". Le principe de raisonnabilité enfin. L'ouverture de l'espace public à la présence du religieux ne peut se faire sans conditions. Il importe qu'elle respecte une normativité supérieure : celle des droits de l'homme (auxquels on adjoint souvent les réquisits de l'"ordre public"). Ce n'est pas là seulement, contrairement à ce qui est dit souvent, une particularité hexagonale : les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Angleterre rencontrent aussi ce problème sur leur chemin. Le philosophe américain Michaël Walzer explique dans son Traité sur la Tolérance que l'avenir est sans doute à une "citoyenneté à trait d'union" 71 ( * ) . Les êtres seront appelés demain à se construire une identité ubiquitaire : ils se définiront certes par leur allégeance à l'universalité d'une communauté politique, mais par leur appartenance aussi à des collectifs plus particuliers, ethniques, régionaux, religieux. C'est en adossant à ce modèle-là, sans doute, que l'Europe, par tâtonnements et approximations, tente aujourd'hui de composer son vivre ensemble.
CLÔTURE DE LA JOURNÉE
René Rémond
Soyez très vivement remerciés pour cette synthèse, cette vision globale qui met en place toutes sortes d'éléments et qu'on souhaiterait pouvoir relire maintenant qu'on l'a assimilée.
Je pense que cette journée n'appelle pas de conclusion. Elle a été très riche. Nous avons entendu des interventions assez remarquables. Ce qui se dégage à l'évidence, c'est que la laïcité s'inscrit dans le temps et dans l'espace, qu'elle a une histoire, une dimension historique, une évolution continue : et la notion et la pratique et l'idée et les régimes juridiques n'ont pas cessé d'évoluer. Les processus d'adaptation progressive à des problèmes nouveaux ou à l'évolution des esprits et des mentalités ne pouvaient pas être prévus par le législateur et que je crois qu'un regard jeté sur ses 200 années mettait en évidence la sagesse des politiques souvent, l'ingéniosité des administrations, le souci de la concorde, le bon sens qui ont fait prévaloir des solutions empiriques à ces problèmes généraux.
La plupart des solutions pratiques qui ont été adoptées, d'abord pour mettre en œuvre la loi de séparation et la suite n'ont généralement pas été dictées par des préoccupations idéologiques. C'est le principe de réalité et la recherche d'une solution qui permette de vivre ensemble et d'apaiser les conflits. Dans le temps et dans l'espace, il n'est effectivement plus possible aujourd'hui de raisonner sur la laïcité, abstraction faite des expériences voisines. Je crois que ce que vient de dire Philippe Portier rejoint mon intuition - et vous-même le suggériez -, il y a une convergence. Au départ les régimes sont très différents et progressivement, il y a des influences réciproques, des échanges, des empreintes, des imitations et puis l'adaptation à des réalités. Plus on va et plus il est clair que les Européens sont amenés à vivre une expérience, une relation relativement apaisée entre les pouvoirs publics et le fait religieux. Merci à tous ceux qui sont intervenus au cours de la journée.
* 1 Pour le développement qui suit, on a utilisé le Trésor de la Langue Française.
* 2 Cf. Emmanuel de Waresquiel et Benoît Yvert, Histoire de la Restauration 1814-1830. Naissance de la France moderne , Paris, Perrin, 1996, p. 226-7.
* 3 Ibid ., p. 227.
* 4 Jean-Pierre Chaline , La Restauration, Paris, PUF, 1998, p. 81.
* 5 Mentionnons une récente biographie de Martignac : Fabrice Boyer, Martignac (1778-1832). L'itinéraire politique d'un avocat bordelais, Paris, Éditions du CTHS, 2002.
* 6 Mythes et mythologie politiques, Paris, Seuil, 1986, rééd. 1992.
* 7 Cf. Jacqueline Lalouette, La Séparation des Églises et de l'État. Genèse et développement d'une idée. 1789-1905, Paris, Seuil, 2005. p. 111-25.
* 8 Cf. Guy Antonetti, Louis-Philippe, Paris, Fayard, 1994 - étude qui déborde largement la personne royale pour constituer une véritable radiographie du régime.
* 9 Cf. l'excellent ouvrage classique de Georges Weill, Histoire de l'idée laïque en France au XIX e siècle, Paris, Alcan, 1929, rééd. Hachette, 2004, ch. III : « La politique d'apaisement sous Louis-Philippe ».
* 10 Cf. Patrice Vermeren, Victor Cousin. Le jeu de la philosophie et de l'État, Paris, L'Harmattan, 1995.
* 11 Éric Anceau, La France de 1848 à 1870. Entre ordre et mouvement, Paris, Le Livre de Poche, 2002.
* 12 Cf. Jacques-Olivier Boudon , Paris capitale religieuse sous le Second Empire, Paris, Cerf, 2001.
* 13 Cf. Paul Gerbod, La condition universitaire en France au XIX e siècle, Paris, PUF, 1965, Livre III, chapitre II, « L'Université sous le joug ».
* 14 Jules Simon, La Liberté de conscience, Hachette, 2 e édition, 1857, p. 24.
* 15 Gambetta, Discours à Belleville du 23 avril 1875, dans Discours et plaidoyers choisis de Léon Gambetta, Paris , Charpentier, 1883, vol. 1, p. 174.
* 16 Joseph Reinach, Discours et plaidoyers de Léon Gambetta , Paris, Charpentier, 1883, Discours à la Chambre des députés, 4 mai 1877
* 17 Discours et plaidoyers choisis de Léon Gambetta, op. cit., p. 215.
* 18 Gambetta, Discours du 15 novembre 1877 (à la Chambre des députés), dans Discours et plaidoyers choisis de Léon Gambetta , op. cit., p. 263.
* 19 Gambetta, Discours du 4 mai 1877 (à la Chambre des députés), dans Discours et plaidoyers choisis de Léon Gambetta , op. cit., p. 227.
* 20 Voir C. Digeon, La crise allemande de la pensée française , Paris, P.U.F, 1959.
* 21 La République Française , 25 novembre 1871.
* 22 Discours du 4 mai 1877, dans Discours et plaidoyers choisis de Léon Gambetta, op. cit., p. 220.
* 23 Discours du 4 mai 1877, dans Discours et plaidoyers choisis de Léon Gambetta, op. cit., p. 218.
* 24 Gambetta, Discours , tome 4, Versailles, banquet en l'honneur de Hoche, 25 juin 1875.
* 25 Discours du 4 mai 1877, dans Discours et plaidoyers choisis de Léon Gambetta, op. cit., p. 219.
* 26 Gambetta, Discours , tome 5, p. 227, Chambre des députés.
* 27 APP, Ba 918 (3), rapport du 4 avril 1875. L'officier rapporte une conversation entre Victor Hugo et Gambetta.
* 28 Gambetta, Discours du 4 mai 1877 (à la Chambre des députés), dans Discours et plaidoyers choisis de Léon Gambetta, op. cit., p. 228.
* 29 Quinet avait déjà fait remarquer que les États constitués selon un principe de centralisation étaient ceux dans lesquels il était besoin d'un pouvoir fort comme contrepoids à la puissance de l'Église catholique. E. Quinet, L'enseignement du peuple, op. cit., p. 104-105.
* 30 Discours du 4 mai 1877, dans Discours et plaidoyers choisis de Léon Gambetta, op. cit., p. 230.
* 31 Discours du 15 août 1877, dans Discours et plaidoyers choisis de Léon Gambetta, op. cit., p. 257.
* 32 Gambetta, Chambre des députés, 4 mai 1877 dans Joseph Reinach, Discours et plaidoyers de Léon Gambetta ,
* 33 Discours prononcé le 12 août 1881 à la réunion électorale du XX e arrondissement, dans Discours et plaidoyers choisis de Léon Gambetta, op. cit., p. 373-374.
* 34 Discours prononcé le 12 août 1881 à la réunion électorale du XX e arrondissement, dans Discours et plaidoyers choisis de Léon Gambetta, op. cit., p. 376.
* 35 Discours prononcé le 12 août 1881 à la réunion électorale du XX e arrondissement, dans Discours et plaidoyers choisis de Léon Gambetta, op. cit., p. 374.
* 36 Considérant que les représentants de l'Église n'avaient pas protesté lorsque les articles organiques avaient été établis, Paul Bert les considérait comme « partie intégrante » du Concordat.
* 37 Paul Bert, réponse au discours prononcé par Flourens à l'occasion de son départ, 25 novembre 1881, Journal officiel, 26 novembre 1881, p. 6556-6557, cité par Jean-Michel Leniaud , L'Administration des Cultes pendant la période concordataire , Nouvelles Éditions Latines, 1988, p. 303-304-305.
* 38 La formule est de Renan, Vie de Jésus (1863), Paris, Édition Nelson-Calmann-Lévy, s. d., p. 17.
* 39 Blais, Marie-Claude, Au principe de la République. Le cas Renouvier, Paris, Éditions Gallimard, nrf, Bibliothèque des idées, 2000.
* 40 Jacqueline Lalouette, « Du bûcher au piédestal : Etienne Dolet, symbole de la libre pensée », dans Romantisme, 1989, p. 84-100, repr. dans La République anticléricale , Seuil, 2002, p. 201 sq.
* 41 Annales de la Chambre des députés , 10 avril 1905.
* 42 Jérôme Grévy, « La mise en scène des expulsions des congrégations non autorisées (1880) », colloque L'Eglise dans la rue. Les cérémonies extérieures du culte en France au XIX e siècle, organisé par l'Université de Limoges, 23-24 mars 2001.
* 43 Témoignage d'un instituteur des Deux Sèvres, cité par Jacques Ozouf, Nous les maîtres d'école, Julliard, 1967, p. 136.
* 44 Patrick Cabanel a publié, sur ces sujets, les ouvrages suivants : Les protestants et la République, de 1870 à nos jours, Bruxelles, Complexe, 2000 ; Les mots de la religion dans l'Europe contemporaine , Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2001 ; Le Dieu de la République. Aux sources protestantes de la laïcité (1860-1900) , Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003 ; Les mots de la laïcité , Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2004 ; 1905, la séparation des Églises et de l'État , La Crèche, Geste Éditions, 2005.
* 45 Chambre des députés, séance du 11 décembre 1921.
* 46 Archives nationales, F7/13228.
* 47 Texte cité par Jean Baubérot, Guy Gauthier, Louis Legrand, Pierre Ognier, Histoire de la laïcité , Paris/Besançon, Cerf/CRDP de Franche-Comté, 1994, p. 218.
* 48 Pie XI, L'éducation chrétienne de la jeunesse, "Divini illius magistri" (Lettre encyclique du 31 décembre 1929), Paris, Éd. Bonne Presse, 1962, respectivement p. 5 et 33.
* 49 Jean Rivero, "De l'idéologie à la règle de droit : la notion de laïcité dans la jurisprudence administrative", in Université d'Aix-Marseille, Centre de sociologie politique de l'Institut d'études juridiques de Nice, La laïcité, Paris, PUF, 1960, pp. 263-283.
* 50 Séance du 4 décembre 1944, Archives nationales, 71 AJ 66.
* 51 Bruno Poucet dir., La loi Debré : paradoxes de l'État éducateur , actes du colloque d'Amiens des 9 et 10 décembre 1999, Amiens, CRDP de Picardie, 2001.
* 52 Charles Péguy, Notre jeunesse , Paris, Gallimard, coll. Folio Essais, 1993, p. 117.
* 53 Ce texte est la transcription de notre intervention au Sénat le 4 février 2005. Le style oral en a donc été presque totalement conservé.
* 54 Émile Poulat, "En 1990, la laïcité pour une confession majoritaire : la catholicisme", in Hubert Bost (dir.), Genèse et enjeux de la laïcité , Genève, Labor et Fides, 1990, p. 108-109.
* 55 David Martin, A General Theory of Secularization , Oxford, Blackwell, 1978.
* 56 L'opposition entre "systèmes à pluralisme élitiste" et "systèmes à pluralisme égalitaire" est empruntée à Pauline Côté, "Autorité publique, pluralisation et sectorisation en modernité tardive", Archives de Science Sociales des Religions , 121, janvier-mars 2003, p. 19-40.
* 57 Nous reprenons ici la formule du précédent "ministre de l'Église" (2001-2004) danois pour décrire la situation confessionnaliste de son pays.
* 58 Ce ne sont là bien sûr que quelques éléments d'analyse. Pour une présentation plus complète, voir, par exemple, J. P. Sorensen, The Evangelical Lutheran Church in Denmark, Copenhague, The Council of Inter-Church relations, 1997 ; Inger Dübcek, "État et Églises au Danemark", in Gerhard Robbers (ed.), État et Églises dans l'Union européenne , Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1997, p. 39-59. Le contrôle de l'État n'est pas toujours de pure forme. La ministre de l'Église en poste entre 2001 et 2004 a de la sorte voulu accentuer son contrôle sur les psautiers et a même engagé une procédure disciplinaire contre un pasteur qui s'était déclaré incroyant.
* 59 Sur le modèle grec, voir, par exemple, Costas G. Papathatis, "Church and State in Greece", Revue européenne des relations Églises-États , I, 1994, p. 53-59.
* 60 Ph. Portier, "Les laïcités dans l'Union européenne : vers une convergence des modèles ?", in G. Saupin, Rémi Fabre, Marcel Launay, La tolérance , Presses Universitaires de Rennes, 1999, p. 300-315.
* 61 Pour une approche plus complète, Francis Messner, "Liberté religieuse, neutralité et coordination entre les États et les Églises. L'exemple de la république fédérale d'Allemagne", Revue d'éthique et de théologie morale , Le supplément, n° 175, 1990, p. 95-117. Voir aussi le livre d'Olivier Bobineau, Dieu change en paroisse. Comparaison d'une paroisse française et d'une paroisse allemande , Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005.
* 62 Pour une lecture en ce sens, Julien Bauer, Politique et Religion , Paris, PUF, 1999, p. 27 et s.
* 63 Sur le mouvement de déconfessionnalisation en Italie, voir par exemple Francesco Margiotta Broglio, "La laïcité en Italie, pays concordataire", in Jean Baubérot (dir.), La laïcité à l'épreuve. Religions et libertés dans le monde , Paris, Universalis, 2004, p. 77-93.
* 64 M. Gimenez y de Carjaval, "La sortie du catholicisme d'État en Espagne", Revue d'éthique et de théologie morale, Le Supplément , n° 175, décembre 1990, p. 95-117.
* 65 Sur la déconfessionnalisation dans les pays protestants, voir les informations données par D. Tamm, "Les relations Église/État dans les pays nordiques", Revue de droit canonique , n° 45, 1995, p. 63-75 ; et, pour l'Angleterre, par Grace Davie, "Le Royaume-Uni, un modèle communautariste anti-laïque ?", in J. Baubérot, op. cit. , p. 65-76.
* 66 Le cas de l'Espagne et de l'Italie est différent. Nominalement catholiques, les populations des deux pays considérés étaient en fait divisées entre une fraction - dominante sous Franco et Mussolini - qui acceptait le rôle recteur de l'Église et une fraction qui la réduisait à n'être qu'un dispensateur de rituels et refusait donc les privilèges dont l'État la dotait.
* 67 On aura soin de noter qu'il peut y avoir, ici ou là, des rétractions confessionnalistes. Le Danemark a connu au cours de ces dernières années, sous l'influence du Parti du Peuple, ce type de réaction. On a vu le ministère de l'Église recommander aux enseignants de recentrer leur propos sur la religion chrétienne, en tant qu'elle est au fondement de l'identité nationale ; et le gouvernement appeler la conférence des imams - qui venait de prendre position lors des élections - à demeurer dans la sphère exclusive du privé. Cela n'empêche pas cependant qu'un mouvement lourd d'égalisation des statuts religieux se manifeste ici aussi, au point qu'on évoque fréquemment depuis les années 1990 l'éventualité, comme en Suède, d'une séparation de l'Église et de l'État. Celle-ci est défendue assez volontiers par certaines forces politiques (Parti radical par exemple) et par l'Église elle-même excédée par les immixtions du précédent ministre de l'Église.
* 68 Sur l'évolution du régime français de laïcité, Ph. Portier, "De la séparation à la reconnaissance. L'évolution du régime français de laïcité", in J. R. Armogathe et J. P. Willaime, Les mutations contemporaines du religieux, Turnhout, Brepols, 2003, p. 1-25.
* 69 Marcel Gauchet, La religion dans la démocratie. Parcours de la laïcité , Paris, Gallimard, 1999, p. 125.
* 70 Sur cette hypothèse, Ph. Portier, "Les mutations de la laïcité française. Éléments d'analyse cognitive", Bulletin d'Histoire Politique , Montréal, 2005 (à paraître).
* 71 Michaël Walzer, Traité sur la tolérance , Paris, Gallimard, 1996.