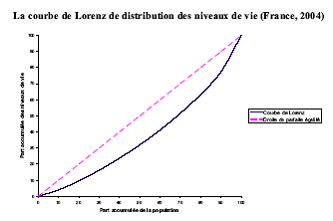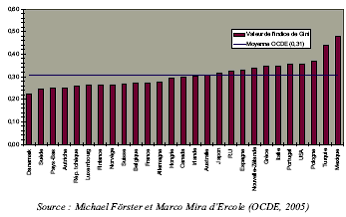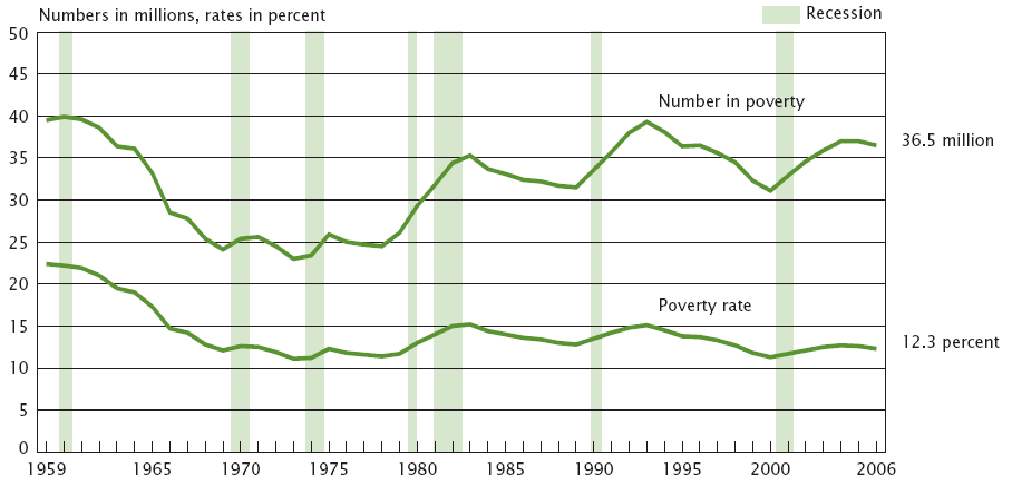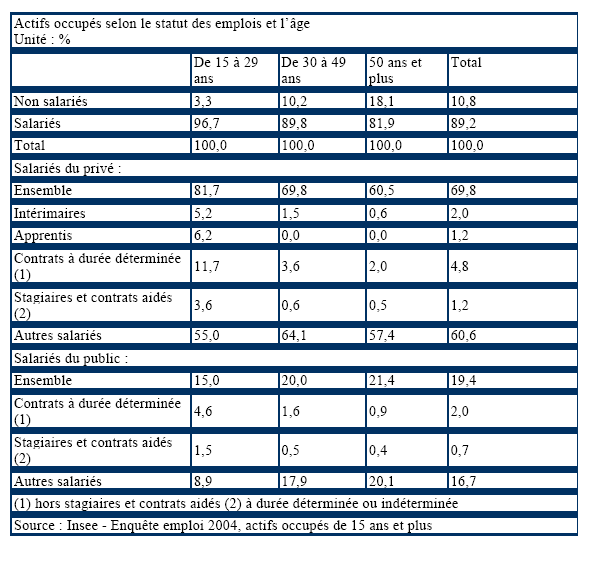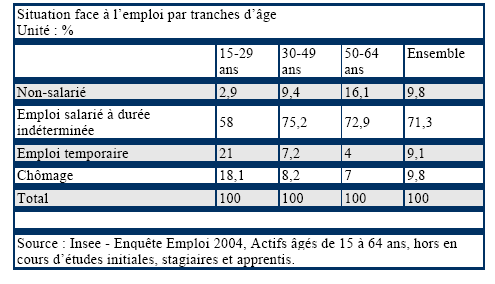Rapport d'information n° 445 (2007-2008) de M. Bernard SEILLIER , fait au nom de la Mission commune d'information pauvreté et exclusion, déposé le 2 juillet 2008
Synthèse du rapport (91 Koctets)
Disponible au format Acrobat (1,3 Moctet)
-
AVANT-PROPOS
-
INTRODUCTION
-
TITRE PREMIER - LA MESURE DE LA PAUVRETÉ ET
DE L'EXCLUSION SOCIALE : QUELS INDICATEURS ?
-
I. LA PAUVRETÉ MONÉTAIRE : UNE
MESURE DES INÉGALITÉS
-
II. LA PAUVRETÉ MONÉTAIRE : UNE
APPROCHE À COMPLÉTER
-
III. QUELLE GRILLE DE LECTURE ?
-
I. LA PAUVRETÉ MONÉTAIRE : UNE
MESURE DES INÉGALITÉS
-
TITRE II - PRIVILÉGIER LES POLITIQUES
PRÉVENTIVES ET GLOBALES POUR GARANTIR L'ACCÈS DE TOUS AUX DROITS
DE TOUS
-
I. UN ACCÈS ENCORE DIFFICILE AUX DROITS
FONDAMENTAUX POUR LES PERSONNES LES PLUS VULNÉRABLES
-
A. LA PAUVRETÉ TOUCHE LES CATÉGORIES
LES PLUS FRAGILES DE LA POPULATION
-
1. Une part de personnes pauvres importante parmi
les bénéficiaires de minima sociaux
-
a) Les minima sociaux visent à garantir aux
personnes qui les perçoivent un revenu minimum
-
b) Les minima sociaux offrent des revenus
inférieurs au seuil de pauvreté
-
c) Une faible revalorisation des minima sociaux
par rapport au Smic
-
d) Plus de la moitié des personnes vivant
dans un ménage bénéficiaire de minima sociaux ne sont pas
pauvres
-
a) Les minima sociaux visent à garantir aux
personnes qui les perçoivent un revenu minimum
-
2. Les demandeurs d'emploi, plus exposés au
risque de pauvreté
-
3. Un phénomène nouveau, les
« travailleurs pauvres »
-
4. L'isolement, facteur d'aggravation de la
pauvreté
-
5. La concentration des personnes en situation de
précarité à la périphérie des villes et dans
les zones urbaines sensibles
-
1. Une part de personnes pauvres importante parmi
les bénéficiaires de minima sociaux
-
B. LA PAUVRETÉ, UN PHÉNOMÈNE
MULTIDIMENSIONNEL QUI SE TRADUIT PAR DES DIFFICULTÉS D'ACCÈS AUX
DROITS FONDAMENTAUX ET PAR DES ATTEINTES À LA DIGNITÉ DE
L'INDIVIDU
-
1. Des difficultés d'accès aux soins
et un état de santé souvent précaire
-
2. Des difficultés d'accès au
logement accrues par la crise de l'immobilier
-
a) Une offre de logements inadaptée
à la demande
-
b) Une hausse continue du taux d'effort des
ménages pour le logement
-
c) La relégation des personnes en situation
de précarité à la périphérie des centres
urbains
-
d) Le développement des situations de
« mal-logement »
-
e) Le cas spécifique des personnes
sans-abri
-
a) Une offre de logements inadaptée
à la demande
-
3. Un accès difficile au crédit et
aux services bancaires qui résulte d'une augmentation
préoccupante du surendettement des ménages
-
4. Le développement de la
« grande exclusion »
-
1. Des difficultés d'accès aux soins
et un état de santé souvent précaire
-
C. UN SYSTÈME DE SOLIDARITÉ COMPLEXE
ET CLOISONNÉ ENCORE PEU INCITATIF À LA REPRISE
D'ACTIVITÉ
-
D. LA PERSISTANCE DE NOMBREUX OBSTACLES AU RETOUR
À L'EMPLOI
-
A. LA PAUVRETÉ TOUCHE LES CATÉGORIES
LES PLUS FRAGILES DE LA POPULATION
-
II. MALGRÉ LA MISE EN oeUVRE DE POLITIQUES
AMBITIEUSES, DES DIFFICULTÉS SUBSISTENT
-
A. LES LIMITES DE LA COUVERTURE MALADIE
UNIVERSELLE
-
1. Les publics exclus du fait des effets de
seuil
-
2. Un tiers des bénéficiaires
potentiels n'a pas recours à la couverture maladie universelle
complémentaire
-
3. Le refus de soins par les médecins
limite l'accès aux soins des personnes bénéficiant de la
couverture maladie universelle
-
4. Une réticence à recourir aux
structures d'accueil et de soins gratuits
-
5. Une rationalisation des coûts de la CMU
pénalisante pour les personnes les plus démunies
-
1. Les publics exclus du fait des effets de
seuil
-
B. LES OBSTACLES À LA MISE EN oeUVRE
EFFECTIVE D'UN DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE
-
C. L'AUGMENTATION DU SURENDETTEMENT DES
MÉNAGES NÉCESSITE UN RENFORCEMENT DES POLITIQUES DE LUTTE CONTRE
L'EXCLUSION BANCAIRE
-
D. DES RÉFORMES PONCTUELLES DU
SYSTÈME DE SOLIDARITÉ DANS L'ATTENTE D'UNE INÉVITABLE
REFONTE GLOBALE
-
A. LES LIMITES DE LA COUVERTURE MALADIE
UNIVERSELLE
-
III. LES PROPOSITIONS DE LA MISSION :
PRIVILÉGIER LES POLITIQUES GLOBALES DE PRÉVENTION ET POURSUIVRE
LES ACTIONS ENTREPRISES EN FAVEUR DE L'INSERTION DURABLE
-
A. AMÉLIORER ENCORE LA PRISE EN CHARGE ET
L'ACCÈS AUX SOINS DES PERSONNES DÉFAVORISÉES
-
1. Généralisation des permanences
d'accès aux soins de santé
-
2. Développer les unités mobiles de
soins et de prise en charge
-
3. Développement des programmes de
prévention et de dépistage
-
4. Favoriser l'accès à la CMU,
à la CMU-c et à l'ACS
-
5. Responsabiliser les bénéficiaires
de la CMU et les médecins pour limiter les refus de soins
-
1. Généralisation des permanences
d'accès aux soins de santé
-
B. CONCENTRER LES ACTIONS EN FAVEUR DE
L'HÉBERGEMENT ET DU LOGEMENT SUR LES PERSONNES EN SITUATION DE GRANDE
PRÉCARITÉ, SUR LES ZONES LES PLUS TENDUES ET SUR LA
PRÉVENTION
-
1. Responsabiliser les maires et développer
des partenariats avec les associations de proximité afin de ne laisser
dans la rue aucun SDF
-
2. Améliorer la prise en charge des grands
exclus
-
3. Inciter les communes à produire plus de
logements très sociaux de type PLA-I
-
4. Redéfinir les conditions d'accès
au logement social au profit des personnes les plus
défavorisées
-
5. Prévenir les expulsions locatives
-
6. Mobiliser plus activement le parc privé
à vocation sociale
-
7. Favoriser l'accession sociale à la
propriété
-
1. Responsabiliser les maires et développer
des partenariats avec les associations de proximité afin de ne laisser
dans la rue aucun SDF
-
C. AMÉLIORER L'ACCÈS AU
CRÉDIT ET AUX SERVICES BANCAIRES ET RENFORCER LA PRÉVENTION POUR
LUTTER CONTRE LE SURENDETTEMENT
-
D. RÉFORMER LE SYSTÈME DES MINIMA
SOCIAUX POUR LE RENDRE PLUS EFFICACE, PLUS LISIBLE, PLUS ÉQUITABLE ET
UNIVERSEL
-
E. AMÉLIORER L'ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS
DANS LEUR PARCOURS D'INSERTION POUR GARANTIR L'EFFECTIVITÉ DE LEURS
DROITS
-
1. Poser le principe d'un référent
unique ou d'un binôme assurant l'accompagnement social et professionnel
pour toute personne en insertion
-
2. Favoriser le développement de formations
polyvalentes des travailleurs sociaux et des accompagnateurs
référents
-
3. Définir de façon concertée
des principes communs d'évaluation des professionnels de
l'insertion
-
4. Intensifier les relations entre les entreprises
du bassin d'emploi et les professionnels de l'insertion
-
1. Poser le principe d'un référent
unique ou d'un binôme assurant l'accompagnement social et professionnel
pour toute personne en insertion
-
A. AMÉLIORER ENCORE LA PRISE EN CHARGE ET
L'ACCÈS AUX SOINS DES PERSONNES DÉFAVORISÉES
-
I. UN ACCÈS ENCORE DIFFICILE AUX DROITS
FONDAMENTAUX POUR LES PERSONNES LES PLUS VULNÉRABLES
-
TITRE III - L'ÉCOLE NE JOUE PAS SON
RÔLE DANS LA RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ ET DANS LA
PRÉVENTION DE L'EXCLUSION SOCIALE
-
I. L'ÉCOLE, REPRODUCTRICE
D'INÉGALITÉS ?
-
II. L'ÉCHEC DES POLITIQUES
CENTRALISÉES
-
III. LIBÉRER LES INITIATIVES
ÉDUCATIVES
-
I. L'ÉCOLE, REPRODUCTRICE
D'INÉGALITÉS ?
-
TITRE IV - FAIRE DE L'INSERTION PAR
L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE UNE PRIORITÉ
-
I. UN DÉVELOPPEMENT INÉDIT DE
L'EXCLUSION PAR L'EMPLOI
-
A. UN LIEN BIEN ÉTABLI ENTRE QUALITÉ
DE L'EMPLOI ET EXCLUSION
-
1. Une partie substantielle de la population en
marge du marché du travail
-
2. Les travailleurs pauvres, un
phénomène nouveau et préoccupant
-
3. Une augmentation des formes précaires de
travail
-
1. Une partie substantielle de la population en
marge du marché du travail
-
B. UN ACCÈS À L'EMPLOI DIFFICILE
POUR LES POPULATIONS ÉLOIGNÉES DU MARCHÉ DU TRAVAIL
-
C. DES ASSOCIATIONS TRÈS INVESTIES
-
D. DES ENTREPRISES ENCORE INSUFFISAMMENT
IMPLIQUÉES
-
1. Une perception encore ambiguë du monde de
l'entreprise
-
2. La responsabilité sociale des
entreprises, une idée neuve
-
3. Parrainage et tutorat, des outils efficaces
restant à développer
-
4. La lente montée en puissance de la
fondation d'entreprise
-
5. Un recours encore limité aux groupements
d'employeurs pour l'insertion et la qualification
-
1. Une perception encore ambiguë du monde de
l'entreprise
-
A. UN LIEN BIEN ÉTABLI ENTRE QUALITÉ
DE L'EMPLOI ET EXCLUSION
-
II. DES INSTRUMENTS D'ACTION RESTANT À
ADAPTER AUX ENJEUX
-
A. LA FORMATION PROFESSIONNELLE, MAILLON FAIBLE DU
SYSTÈME D'INSERTION
-
1. La difficulté d'accès des publics
précaires à la formation
-
2. Une diminution de l'effort des entreprises en
faveur de la formation continue
-
3. Une inégalité entre travailleurs
stables et travailleurs précaires
-
4. Un partage de compétences complexe entre
différentes structures
-
5. Une validation des acquis de
l'expérience très insuffisamment développée
-
6. Des instruments de formation peu efficaces en
vue d'un retour à l'emploi
-
1. La difficulté d'accès des publics
précaires à la formation
-
B. LA CRÉATION D'ENTREPRISE, VOIE
PRIVILÉGIÉE D'INSERTION
-
1. Un potentiel très important du fait de
la place du secteur informel
-
2. Une efficience économique et sociale
avérée
-
3. Des dispositifs incitatifs existants
-
4. Une montée en puissance progressive du
micro crédit et des fonds d'investissement
-
5. Des obstacles restant à lever pour
solliciter pleinement les potentiels existants
-
1. Un potentiel très important du fait de
la place du secteur informel
-
C. L'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE, UN DISPOSITIF LARGEMENT PERFECTIBLE
-
1. Un secteur central dans le domaine de
l'insertion
-
2. Un rapport coût-résultat
insatisfaisant
-
3. Des carences statistiques et une absence
d'indicateurs
-
4. Des difficultés à l'entrée
dans le dispositif
-
5. Des parcours d'insertion partiellement
inadaptés aux besoins
-
6. Une sortie du dispositif
problématique
-
1. Un secteur central dans le domaine de
l'insertion
-
D. LES CONTRATS AIDÉS, UN DISPOSITIF EN
ATTENTE DE SIMPLIFICATION
-
1. Quatre grands types de contrat pour les
secteurs marchand et non marchand
-
2. Un empilement de dispositifs nuisant à
la lisibilité du système
-
3. Un coût restant élevé pour
une gestion incohérente
-
4. Une efficacité difficilement mesurable
et très variable selon les types de contrats
-
5. Une plus-value réduite en termes de
qualification et de formation
-
6. Le cas particulier du contrat de
professionnalisation
-
7. Vers un contrat unique
d'insertion ?
-
1. Quatre grands types de contrat pour les
secteurs marchand et non marchand
-
E. LE SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, UN INSTRUMENT
ESSENTIEL EN COURS DE RÉFORME
-
1. Une organisation complexe associant un grand
nombre d'acteurs
-
2. Une vaste réforme en cours de mise en
oeuvre
-
3. La nécessité d'un profond
remaniement structurel
-
a) Des agences pour l'emploi mal adaptées
à l'accueil d'un nombre important de chômeurs
-
b) Une relation de confiance entre chômeurs
et agences de l'emploi entamée
-
c) Une procédure de sanction des
chômeurs propre à les stigmatiser
-
d) Un service de l'emploi inadapté au
traitement des problématiques sociales
-
e) Un rôle d'« orientateur en
dernier ressort » délicat à tenir
-
f) Un recours discuté à des
prestataires extérieurs pour le placement des chômeurs
-
a) Des agences pour l'emploi mal adaptées
à l'accueil d'un nombre important de chômeurs
-
1. Une organisation complexe associant un grand
nombre d'acteurs
-
A. LA FORMATION PROFESSIONNELLE, MAILLON FAIBLE DU
SYSTÈME D'INSERTION
-
III. DES PROPOSITIONS POUR UNE INSERTION
PROFESSIONNELLE DYNAMISÉE
-
A. PRÉCONISATIONS
GÉNÉRALES
-
B. RENFORCER LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN LIEN
AVEC L'EMPLOI
-
1. Inciter les entreprises à mettre en
place des instruments de formation adaptés au profil de leurs
travailleurs les moins qualifiés
-
2. Rendre la formation des chômeurs
obligatoire
-
3. Développer les groupements d'employeurs
pour l'insertion et la qualification
-
4. Soutenir l'établissement public
d'insertion de la Défense (EPIDe)
-
5. Rendre plus attractif le recours à la
validation des acquis de l'expérience
-
1. Inciter les entreprises à mettre en
place des instruments de formation adaptés au profil de leurs
travailleurs les moins qualifiés
-
C. SOUTENIR LES ASSOCIATIONS DANS LEUR ACTION
POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE
-
D. MOBILISER LES ENTREPRISES
-
E. ENCOURAGER LE TRAVAIL
INDÉPENDANT
-
F. MUSCLER L'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
-
G. RENFORCER L'EFFICACITÉ DU SERVICE
PUBLIC DE L'EMPLOI
-
H. RENDRE PLUS OPÉRANTS LES CONTRATS
AIDÉS ET DE PROFESSIONNALISATION
-
A. PRÉCONISATIONS
GÉNÉRALES
-
I. UN DÉVELOPPEMENT INÉDIT DE
L'EXCLUSION PAR L'EMPLOI
-
TITRE V - LA GOUVERNANCE : UNE COMPLEXITE
EXCESSIVE
-
I. LA REPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE
L'ETAT ET LES COLLECTIVITES : UNE DÉCENTRALISATION INACHEVEE
-
A. DU TRANSFERT DE L'AIDE SOCIALE À
L' « ACTE II » DE LA DÉCENTRALISATION :
UNE POLITIQUE PARTIELLEMENT DÉCENTRALISÉE
-
B. LE MAINTIEN DE FORTES COMPÉTENCES DE
L'ETAT ET LA QUESTION RÉCURRENTE DU FINANCEMENT DES COMPÉTENCES
DÉCENTRALISÉES
-
C. LA MULTIPLICITÉ DES ORGANISMES
D'OBSERVATION ET D'ÉVALUATION
-
D. LES FINANCEMENTS EUROPÉENS
-
A. DU TRANSFERT DE L'AIDE SOCIALE À
L' « ACTE II » DE LA DÉCENTRALISATION :
UNE POLITIQUE PARTIELLEMENT DÉCENTRALISÉE
-
II. UNE GOUVERNANCE TERRITORIALE ILLISIBLE
-
A. L'AFFIRMATION DIFFICILE DU CONSEIL
GÉNÉRAL COMME CHEF DE FILE DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION
-
1. L'élaboration de la stratégie
d'insertion des départements
-
2. La difficile construction des partenariats des
départements avec les acteurs de la lutte contre la
pauvreté
-
3. La relative efficacité du dispositif
pour aider les personnes les moins éloignées de l'emploi
-
1. L'élaboration de la stratégie
d'insertion des départements
-
B. LA PERSISTANCE DE LA COMPLEXITÉ DU
SECTEUR DE L'INSERTION
-
1. La multiplicité des acteurs
-
a) Les multiples acteurs de l'insertion
professionnelle
-
b) L'insuffisante intégration de l'IAE aux
dispositifs départementaux d'insertion
-
c) L'association des partenaires privés
à la politique de l'emploi
-
d) Le rôle essentiel des associations dans
le dispositif
-
e) Une participation croissante des partenaires
sociaux
-
f) Une tentative de guichet unique : les maisons
de l'emploi
-
a) Les multiples acteurs de l'insertion
professionnelle
-
2. La coordination des acteurs : une
superposition d'instances
-
3. L'éclatement des compétences en
matière de logement
-
4. La coordination en matière de
santé
-
1. La multiplicité des acteurs
-
C. DES DISPOSITIFS D'INSERTION À
L'EFFICACITÉ PARFOIS INCERTAINE FAUTE D'ÉVALUATIONS
SUFFISANTES
-
A. L'AFFIRMATION DIFFICILE DU CONSEIL
GÉNÉRAL COMME CHEF DE FILE DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION
-
III. SIMPLIFIER LA GOUVERNANCE DE LA LUTTE CONTRE
L'EXCLUSION
-
A. L'ETAT DOIT ACCEPTER PLEINEMENT LA
DÉCENTRALISATION EN RESTANT LE GARANT DE L'ÉQUITÉ DES
POLITIQUES D'INSERTION
-
1. Garantir la stabilité du financement
des compétences d'action sociale du Conseil général
-
2. Donner davantage de contenu au rôle de
chef de file du Conseil général
-
3. Un Etat garant de l'équité des
politiques d'insertion
-
4. L'unification des organismes
d'évaluation et de contrôle
-
5. Mieux mobiliser les financements
européens
-
1. Garantir la stabilité du financement
des compétences d'action sociale du Conseil général
-
B. DÉVELOPPER LA CONTRACTUALISATION
TERRITORIALE ET LA COORDINATION DES ACTEURS POUR SIMPLIFIER LES PARCOURS
D'INSERTION
-
A. L'ETAT DOIT ACCEPTER PLEINEMENT LA
DÉCENTRALISATION EN RESTANT LE GARANT DE L'ÉQUITÉ DES
POLITIQUES D'INSERTION
-
I. LA REPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE
L'ETAT ET LES COLLECTIVITES : UNE DÉCENTRALISATION INACHEVEE
-
RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL DES
PROPOSITIONS DE LA MISSION
-
EXAMEN DU RAPPORT DE LA MISSION
-
CONTRIBUTION DE MME ANNIE DAVID ET DE M. GUY
FISCHER AU NOM DU GROUPE CRC
N° 445
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007-2008
|
Annexe au procès-verbal de la séance du 2 juillet 2008 |
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la mission commune d'information (1) sur les politiques de lutte contre la pauvreté et l' exclusion ,
Par M. Bernard SEILLIER,
Sénateur.
Tome I : Rapport
(1) Cette mission commune d'information est composée de : M. Christian Demuynck, président ; Mmes Brigitte Bout, Annie Jarraud-Vergnolle, Muguette Dini, Annie David, vice-présidents ; M. Bernard Seillier, rapporteur ; MM. Jean-François Humbert, Yannick Bodin, secrétaires ; M. Paul Blanc, Mmes Isabelle Debré, Béatrice Descamps, MM. Jean Desessard, Claude Domeizel, Guy Fischer, Adrien Giraud, Alain Gournac, Mme Odette Herviaux, MM. Benoît Huré, Serge Lagauche, Mmes Colette Mélot, Jacqueline Panis, M. Jackie Pierre, Mme Gisèle Printz, M. Charles Revet, Mmes Michèle San Vicente-Baudrin, Esther Sittler et M. André Vallet.
AVANT-PROPOS
« Je ne suis pas, Messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance de ce monde, la souffrance est une loi divine, mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère »
Victor Hugo : discours à l'assemblée législative du 9 juillet 1849 sur la proposition de loi du vicomte Armand de Melun, relative à la prévoyance et à l'assistance publique.
« Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les Droits de l'Homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. »
Père Joseph Wresinski : extrait de l'inscription gravée sur la dalle du Parvis des Droits de l'Homme du Trocadéro, le 17 octobre 1987.
Mesdames, Messieurs,
Dans sa séance du 10 janvier 2008, le Sénat a autorisé, en application de l'article 21 de son règlement, les commissions des affaires sociales, des affaires culturelles et des affaires économiques à désigner les membres de la mission commune d'information sur les politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
La création de cette mission résultait d'une initiative de M. Bernard Seillier, par ailleurs président du Conseil national de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (CNLE), relayée par M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales auprès de ses collègues des deux autres commissions concernées et ensuite acceptée par le Bureau du Sénat.
Cette mission apparaissait particulièrement justifiée du fait de la persistance, à un niveau toujours élevé, de la pauvreté et de l'exclusion dans notre pays, même si ces phénomènes tendent à emprunter des formes nouvelles qui justifient la tenue d'un Grenelle de l'insertion appelé à définir de nouvelles politiques.
La mission avait donc vocation à analyser les causes et les composantes de la pauvreté qui perdure en dépit des moyens pourtant non négligeables affectés à sa réduction, à démêler l'entrelacs des procédures, à tenter d'y voir clair dans le maquis des multiples acteurs concernés : administrations centrales et déconcentrées, Etat et collectivités territoriales aux compétences plus incertaines que croisées, associations de toute nature appelées à pallier les carences de l'Etat, organismes consultatifs les plus divers, observatoires et instituts statistiques sources de doublons, fonds bruxellois dont les crédits considérables sont loin d'être consommés dans leur totalité...
Bref, être pauvre dans la France d'aujourd'hui n'est pas simple et suppose une solide formation de droit public, de droit social, de droit des collectivités territoriales, en sciences administratives... pour pouvoir prétendre à toutes les prestations offertes, sauf à ce qu'un guichet unique et une simplification des procédures et des allocations existantes, dont la dizaine de minima sociaux censés répondre à la diversité des publics relevant de la précarité et de l'exclusion, viennent y mettre bon ordre.
En dépit des politiques engagées, des moyens mis en oeuvre, de la multiplication des structures créées pour réduire la pauvreté, celle-ci est encore mal mesurée et cette incertitude n'est pas sans alimenter les inquiétudes qui s'expriment dans l'opinion.
Le rappel de quelques données générales, présentées ci-après et confirmées pour l'essentiel par les interlocuteurs les plus autorisés de la mission permettent cependant d'appréhender les principales caractéristiques de la pauvreté française :
- plus de 7 millions de personnes, soit 12 % de la population française, sont en-dessous du seuil européen de pauvreté, qui est fixé à 60 % de la médiane des niveaux de vie, soit 817 euros par mois pour une personne seule ;
- 50 % des pauvres vivent avec moins de 669 euros par mois ;
- les pauvres représentent 7 % de la population active, 34 % des chômeurs et 14 % des inactifs : notre pays compte ainsi plus de 1,5 million de travailleurs pauvres ;
- le taux de pauvreté des personnes âgées de 65 à 74 ans est de 7 %, et de près de 13 % pour les femmes de plus de 75 ans ;
- le nombre de sans-abri se situe entre 80.000 et 100.000 ;
- la France compte 3 millions de mal logés, et entre 400.000 et 600.000 logements indignes ;
- les Restos du Coeur servent 82 millions de repas par an, bénéficiant à 700.000 personnes ;
- le taux de pauvreté est de 5 % pour les diplômés de l'enseignement supérieur, de 8,8 % pour les titulaires d'un CAP-BEP et de près de 30 % pour ceux dépourvus de tout diplôme : 150.000 jeunes sortent chaque année du système éducatif sans formation ni qualification ;
- notre pays regroupe 1,76 million de familles monoparentales et 18 % des enfants y vivent, dont 85 % avec leur mère : 20 % de ces familles sont en-dessous du seuil de pauvreté ;
- 30 % des SDF du Canal Saint-Martin n'avaient pas la nationalité française ;
- le système français d'allocations familiales tend à réduire de moitié le taux de pauvreté ;
- 60 % des Français redoutent de devenir SDF...
De l'examen et du recoupement de ces quelques indications, il ressort que le diplôme protège de la pauvreté, que notre système de protection sociale, aussi imparfait et coûteux qu'il soit, constitue encore un efficace filet de sécurité, que plus du tiers des chômeurs sont pauvres ainsi qu'une proportion croissante, avec l'âge, de titulaires de retraites modestes, et surtout que l'emploi n'est plus un rempart contre la pauvreté, comme le montre le phénomène récent des travailleurs pauvres, qui ne sont pas seulement des travailleuses à temps partiel imposé.
Il reste que dans notre « époque formidable », un accident de la vie -maladie, licenciement, rupture familiale...- a tôt fait de précipiter dans la gêne, la précarité, la pauvreté, voire dans la rue, notamment des familles déjà rendues plus vulnérables par les coûts croissants du logement et de l'énergie qui déséquilibrent les modes traditionnels de consommation.
A cet égard, et au risque de heurter le politiquement correct, l'évolution de la société française engagée depuis 40 ans, le recul et la fragilisation du mariage, la fréquence du divorce, l'éclatement et la recomposition des familles 1 ( * ) , bref la liberté des uns et des autres qui prend peut-être le pas sur la responsabilité d'autrefois... se traduisent directement par un développement des familles monoparentales -en fait des femmes seules avec des enfants- qui sont infiniment plus exposées à la pauvreté, à la difficulté de trouver un emploi et d'assurer sans l'assistance de la collectivité, l'éducation de leurs enfants : ces derniers ont vocation à être les pauvres de demain, car trop souvent comme le montrent des études convergentes, on naît pauvre, on le reste faute de remédiation ad hoc qui devrait pourtant être assurée par notre école républicaine, on ne le devient que plus rarement ...
Certes, la pauvreté dans la France d'aujourd'hui n'est plus celle des misérables de l'Occident médiéval, que l'on entourait pourtant de respect jusqu'aux environs du XII e et du XIII e siècle comme enfants préférés du Seigneur, ni celle des vagabonds, des marginaux, des simples et des gueux de Villon, ni celle des laissés pour compte de la révolution industrielle décrits par Hugo, Zola, Dickens, condamnés à « l'aumône qui dégrade » et privés de « l'assistance qui fortifie ».
Enfin, la mission ne peut pas ne pas rappeler quelques lignes de l'intervention de notre ancien collègue Victor Hugo, le 9 juillet 1849 à l'Assemblée législative, lors de l'examen de la proposition de loi du vicomte Armand de Melun, 2 ( * ) relative à la prévoyance et à l'assistance publique, au lendemain des journées de 1848, sur la réalité de la misère dans la capitale : « Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément, il y a des rues, des maisons, des cloaques, où des familles, des familles entières, vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n'ayant pour lits, n'ayant pour couverture, j'ai presque dit pour vêtements, que des morceaux infects de chiffons en fermentation, ramassés dans la fange du coin des bornes, espèce de fumier des villes, où des créatures humaines s'enfouissent toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver... ».
Un siècle plus tard, dans l'hiver ô combien rigoureux du Paris de 1954, l'Abbé Pierre lançait un appel à la bonté directement inspiré de l'indignation du poète.
Les travaux de la commission
Les auditions de la commission
Du 28 janvier au 26 mai 2008, la mission a tenu 15 réunions qui lui ont permis de procéder à l'audition de 50 personnalités spécialistes 3 ( * ) , à un titre ou à un autre, des problèmes de la pauvreté, de la précarité, de l'exclusion et de l'insertion et, par ailleurs, membres pour nombre d'entre-elles du conseil national de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
Elle a ainsi notamment entendu les principales associations et mouvements de lutte contre la pauvreté : Emmaüs, ATD Quart-Monde, Secours populaire, Médecins du Monde, Restos du Coeur... mais aussi associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS), associations pour la promotion et l'insertion par le logement (FAPIL), oeuvres et organismes sanitaires et sociaux (UNIOPSS), centres communaux et intercommunaux d'action sociale (UNCCAS).
Elle a également auditionné les représentants de divers organismes et conseils concernés : Haut comité pour le logement des personnes défavorisées (HCLPD), Centre national de l'insertion par l'activité économique (CNIAE), Conseil national des missions locales (CNML), Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale (ONPES), Centre d'études de l'emploi, Conseil d'orientation pour l'emploi (COE).
Elle a, en outre, évidemment entendu des représentants des associations des régions et des départements , des syndicats , des chômeurs et précaires, de nombreuses personnalités qualifiées dont les travaux font autorité ainsi que des personnalités ayant une expertise particulière ou s'étant engagées dans la lutte contre la précarité : on citera notamment, à cet égard, Mme Maria Nowak , initiatrice en France du micro-crédit, M. Jean-Baptiste de Foucauld , président de Solidarités nouvelles face au chômage, le général Valentin , responsable de l'établissement public d'insertion de la défense, Mme Françoise Bernon , responsable de Manpower Egalité des chances, M. Jacques Attali , président de PlaNet Finances, M. Franck Riboud , PDG du groupe Danone, M. Etienne Pinte , chargé par le Premier ministre d'une mission temporaire sur l'hébergement et le logement des sans-abri ou mal logés... Enfin, le Haut Commissaire, M. Martin Hirsch a conclu le programme d'auditions de la mission en lui présentant les conclusions du Grenelle de l'insertion et les perspectives de mise en place du revenu de solidarité active actuellement expérimenté.
|
Les déplacements de la mission Outre ce programme d'une cinquantaine d'auditions, la mission a privilégié les déplacements de terrain aussi bien en France qu'à l'étranger. Elle s'est d'abord rendue en Seine-Saint-Denis dans deux lieux emblématiques de la lutte contre la grande pauvreté : après une réunion au conseil général et une rencontre avec son nouveau président, elle a ainsi visité la communauté Emmaüs « historique » de Neuilly-Plaisance , ville dont le maire est le président de la mission, et qui a été la première communauté fondée par l'Abbé Pierre en 1949. Après avoir partagé avec des associations un repas préparé par les compagnons, la délégation de la mission s'est déplacée au Centre de formation familiale d'ATD Quart-Monde de Noisy-le-Grand, installé sur le site même du camp des sans-logis où vécurent en situation de transit plus de 500 familles de 1954 à 1971, rejointes par le père Joseph Wresinski en 1956 . La mission s'est ensuite rendue à Bruxelles pour y rencontrer le jeune et dynamique secrétaire d'Etat à la lutte contre la pauvreté, et surtout le responsable de la Direction « protection et intégration sociales » à la Commission européenne , afin de mesurer les compétences et la stratégie préconisée par l'Union européenne dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, celui-ci constatant que la France éprouvait des difficultés pour utiliser l'intégralité des fonds européens et regrettant ses retards dans l'évaluation de la dépense sociale. La mission a également rencontré le représentant du réseau flamand des « Associations où les pauvres prennent la parole » qui lui a notamment communiqué un singulier décret du 21 mars 2003 adopté par le Parlement flamand, et relatif à la pauvreté, publié au Moniteur belge (Belgisch Staatsblad) du 16 juin 2003, rédigé conjointement par ces associations et les autorités politiques. Le déplacement de la mission à Lyon lui a permis de prendre la mesure des opérations lancées par le préfet de région pour améliorer l'insertion des jeunes et des personnes en difficulté sur le marché de l'emploi, de constater à l'occasion d'une table ronde sur la situation du logement et de l'hébergement dans le département tenue dans la maison-relais « Le Bistrot des Amis », la réalité du tissu associatif lyonnais en faveur des démunis dont la vitalité ne date pas d'aujourd'hui. Un déjeuner de travail au conseil général, à l'initiative du Président Mercier , lui a permis notamment de faire la lumière sur les problèmes de gestion du RMI et d'entrevoir les difficultés de mise en oeuvre du futur RSA. Enfin, la délégation a participé à une table ronde à la CCI sur la participation des entreprises à l'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Une délégation de la mission s'est ensuite rendue à Dijon. Après un entretien au conseil général avec le Président Sauvadet, celle-ci a pu constater les avancées de l'expérimentation du RSA dans le département de la Côte d'Or et l'ambition du plan d'insertion. A la préfecture, on lui a présenté les problèmes du logement social dans le département et un déjeuner de travail a été consacré au thème de l'éducation. La délégation a ensuite visité le magnifique collège Marcelle Pardé , situé dans des locaux historiques rénovés en centre-ville, et qui comporte un internat de réussite éducative et une classe-relais accueillant une demi-douzaine de jeunes en difficulté. Elle s'est enfin rendue à la Société dijonnaise de l'assistance par le travail qui, depuis le début du siècle dernier, oeuvre en faveur des personnes démunies par une prise en charge globale des problèmes d'insertion, qu'il s'agisse du logement, du travail ou de la santé. La mission s'est ensuite déplacée au Royaume du Danemark, qui est aussi celui de la flex-sécurité et du plein emploi , puisque le taux de chômage y est inférieur à 2 %. Après avoir été reçue à Copenhague dans les locaux « cliniques » de l'agence danoise pour l'emploi , elle a visité le remarquable établissement de réinsertion sociale « Kofoeds-skole », fondée en 1928 et qui accueille chaque année environ 4.000 personnes en graves difficultés sociales, dont des sans-abri d'origine groenlandaise. Au Folketing, devant lequel manifestaient pacifiquement des infirmières en grève, elle a eu un entretien avec une député de la liste unitaire « rouge-verte » qui a, en particulier, souligné les difficultés d'insertion des familles issues de l'immigration, notamment irakiennes. Au ministère du « Bien-être » , elle a ensuite rencontré les responsables des divisions des prestations sociales et des groupes marginalisés. Elle a enfin été reçue à l'Hôtel de ville de Copenhague, par M. Jacob Hougaard, le jeune maire portant jeans, chargé de l'emploi et de l'intégration. Une délégation de la mission s'est enfin rendue en Pologne à Jankowice, dans la lointaine Voïvodie de Sainte-Croix après un long périple routier, via Katowice et Cracovie. Cette région principalement rurale de la Voïvodie, en dépit de ses arbres fruitiers, et notamment de ses noyers, est particulièrement pauvre et connaît un taux de chômage élevé ainsi qu'un faible niveau de formation de sa population. La délégation a eu le privilège d'y rencontrer Soeur Malgorzata Chmielewska , directrice de la branche polonaise de la communauté du Pain de vie, qui a créé la fondation Chleb Zycia en 2002 : cette religieuse est très populaire en Pologne où elle est notamment comparée à l'Abbé Pierre ; elle a reçu de nombreuses récompenses, dont le prix Totus, sorte de prix Nobel de l'Eglise polonaise. Sous sa direction, la délégation a visité les différents sites de la fondation, ateliers (menuiserie, couture, conserverie) et bâtiments d'habitation où sont hébergées et transitent environ 1.000 personnes chaque année (SDF, personnes âgées, malades...), puis a été conviée à un déjeuner de travail préparé par les membres de la fondation. |
*
* *
INTRODUCTION
La pauvreté et l'exclusion sociale sont des réalités difficiles à comprendre de manière précise et dans toutes leurs dimensions, parce que ceux qui ont le pouvoir d'en parler n'en sont généralement pas les victimes. Une certaine analogie avec l'autisme est éclairante. Par nature il s'agit d'états le plus souvent décrits et observés de l'extérieur que surmontés de l'intérieur. Or c'est pourtant la seule démarche qui soit conforme à la dignité et à l'aspiration de l'homme que de se délivrer de la pauvreté non voulue et de l'exclusion subie par un effort personnel.
C'est pourquoi s'il est rarement possible de surmonter par ses seules forces personnelles un état d'exclusion sociale et professionnelle, l'accompagnement indispensable doit s'attacher à stimuler les capacités de la personne plutôt que de l'assister de manière excessive en agissant à sa place.
Ce n'est pas sans intérêt et il est même nécessaire de considérer les réalités de l'extérieur, du point de vue d'un observateur indépendant, mais lorsqu'il s'agit de réalités sociales, il est plus qu'en tout autre domaine nécessaire de souligner l'insuffisance de la démarche, voire sa perversité.
Une société étant par nature un ensemble de liens entre des personnes, l'affaiblissement, l'univocité voire la rupture de ces liens ne peuvent être réparés de manière unilatérale. L'intervention des deux parties est indispensable pour que la restauration et la qualité du lien s'opèrent.
L'inégalité initiale de situation entre celui qui est « inclus » et celui qui est « exclu » requiert une aide du premier à l'égard du second. C'est ce qu'expriment le principe et la nécessité de l'accompagnement.
Mais ce n'est pas suffisant car la démarche peut rester encore trop unilatérale. La véritable harmonie du lien social réclame une relation plus équilibrée par laquelle celui qui est en situation d'infériorité et d'exclusion doit pouvoir prendre une part active voire déterminante à son rétablissement dans la société, comme citoyen à part entière.
L'analyse sociologique, toujours intéressante par le recul qu'elle permet par rapport aux réalités sociales, induit facilement cependant une déformation de l'approche des réalités si elle prétend constituer l'unique source d'analyse et le seul guide pour l'action, car elle favorise inconsciemment la transformation du recul en détachement voire en indifférence et même en assurance doctorale. La prévalence du fait accompli, la puissance de la position dominante et la suprématie de l'opinion majoritaire tendent à devenir un véritable caractère culturel de nos sociétés.
Or l'harmonie sociale n'atteint à sa perfection que, lorsque non seulement celui qui partait d'une situation d'infériorité a retrouvé une juste place dans la société par son action propre, mais qu'également celui qui était dans une situation de supériorité incontestée a accepté de s'abaisser pour partager son pouvoir et faire place à celui qui était injustement écarté.
Ainsi peut naître et se développer le sens d'une responsabilité partagée, fondatrice de la cité et donc d'un lien social conforme aux exigences de la dignité de la personne humaine.
Celle-ci est en effet profondément blessée par toutes les formes de liens qui ne seraient que juridiques, conventionnelles, contractuelles, caractéristiques de relations artificielles hétérogènes aux aspirations profondes de l'être humain qui sont celles d'une unité substantielle.
C'est par rapport à ce sens de l'unité profonde de l'humanité que le concept de justice peut revêtir dans toute son ampleur un sens qui ne comporte aucune condescendance. Sinon, toute conception individualiste de l'humanité isole chaque individu dans une sphère de responsabilité personnelle exclusive et enferme celui qui vient en aide à l'autre, dans une logique d'assistanat, de domination et d'une forme égoïste et pervertie de la générosité puisqu'en fait ne se cherchant qu'elle-même pour fin.
Seul le souci du bien commun appelant la participation de chacun à l'oeuvre commune du corps social est conforme à la nature profonde de l'homme et à son éminente dignité. Autrement dit on devrait s'interdire de parler de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale en ne prenant en considération que les personnes qui se trouvent dans cet état de décrochage. Il faut en vérité considérer la globalité de la société.
Une problématique de même nature s'est posée au travail social et au service social il y a quelques décennies quand il est apparu qu'il était peu fécond de ne considérer un jeune en situation de rupture au sein d'une famille que de manière isolée sans prendre en compte la globalité de la famille. Ici aussi l'approche doit être globale et une situation de pauvreté ou d'exclusion met en cause la globalité de la structure sociale ou son fonctionnement et pas seulement l'individu affecté par la situation incriminée.
Cette perspective conduit alors à ne pas postuler ce bien commun comme une donnée intangible. Il est plus fructueux de le considérer comme le fruit d'une oeuvre perfectible à réaliser ensemble, de manière consciente et critique. L'ensemble de la vie collective, dans ses composantes culturelles, économiques et sociales devient ainsi objet de débat, et pas seulement le sort de ceux qui sont éloignés de la moyenne statistique. L'enjeu de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale trouve alors toute son ampleur puisqu'il s'agit de permettre à tout un chacun, quelle que soit sa position initiale, de participer, en donnant et recevant comme artisan d'un avenir commun, voulu comme bon pour tous, et non pas seulement de tenter de faire une place à tous dans un dynamisme collectif aveugle et préservé de toute évaluation critique.
La lutte contre la pauvreté ne peut pas dès lors consister seulement à la recherche d'une inclusion dans une société postulée comme parfaite, de personnes qu'il faut aider à rejoindre la fête collective, mais comme une action pluridimensionnelle et fondamentalement politique.
De ces observations liminaires se déduit aisément le plan de ce rapport.
Le critère de classement des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale est tout naturellement fondé sur le degré et la nature de l'éloignement de la personne concernée par rapport aux exigences de l'ordre économique et social établi.
Cet instrument d'analyse est à la fois simple et pertinent car il peut dans des situations extrêmes faire apparaître les prétentions abusives fixées par cet ordre économique et social pour s'y insérer.
Tel serait le cas par exemple s'il exigeait systématiquement des compétences ou des renoncements excessifs mettant en cause la vie familiale ou la vie psychique des citoyens.
Ce serait alors la réforme globale de l'ordre économique et social qu'il conviendrait d'envisager et non pas les efforts excessifs qui seraient demandés aux personnes en situation d'exclusion.
*
* *
Les développements ci-après seront consacrés aux outils permettant de mieux mesurer la pauvreté et l'exclusion (Titre I er ), ainsi qu'au nécessaire développement des politiques préventives et actives en faveur de l'insertion durable (Titre II).
La mission s'interrogera ensuite sur le rôle de l'école dans la réduction de la pauvreté et dans la prévention de l'exclusion sociale (Titre III), et consacrera un volet spécifique à l'insertion économique qui doit devenir une priorité (Titre IV).
Elle rappellera enfin la complexité de la gouvernance de la lutte contre l'exclusion et proposera une indispensable simplification en ce domaine, notamment au plan territorial (Titre V).
*
* *
TITRE PREMIER - LA MESURE DE LA PAUVRETÉ ET DE L'EXCLUSION SOCIALE : QUELS INDICATEURS ?
A la demande de la mission commune d'information, le service des études économiques et de la prospective du Sénat a réalisé une étude approfondie concernant la méthode française de mesure de la pauvreté.
Cette étude a été publiée dans la nouvelle série de documents de travail -séries études économiques, en juin 2008, sous le n° EC01- précédé d'un avant-propos de M. Joël Bourdin, Président de la Délégation du Sénat pour la planification.
Compte-tenu de l'extrême qualité de ce document de travail et de son caractère particulièrement exhaustif, la mission a souhaité l'insérer en tête de son rapport et en faire une partie à part entière qui éclaire très utilement les suivantes.
Mesurer la pauvreté et l'exclusion est un exercice difficile car les phénomènes sociaux considérés comportent de multiples dimensions. Leur appréciation est pour partie subjective et leurs formes varient selon les époques et les lieux, en fonction du degré de développement économique et des structures de la société. Définir la pauvreté et l'exclusion, afin de pouvoir les mesurer, implique un jugement de valeur sur ce qu'est le bien-être. La mesure de ces phénomènes multiformes dépend de l'angle de vue adopté et des définitions formulées.
Toute frontière tracée entre situations jugées ou non acceptables comporte un caractère conventionnel. Les choix effectués affectent les chiffres, la population étant très concentrée à des niveaux intermédiaires « limites » , proches du basculement vers la pauvreté et susceptibles d'interprétations divergentes.
|
Pauvreté : une frontière mouvante, des chiffres très variables Quelle que soit l'approche retenue pour mesurer la pauvreté, le résultat dépend du tracé de la « ligne de pauvreté » , selon la terminologie anglo-saxonne. La statistique donne des outils mais ne saurait porter en elle-même les jugements de valeur qui sont du domaine de l'interprétation des résultats. En attestent les deux exemples suivants : 1°/ En adoptant la définition préconisée au niveau européen , c'est-à-dire en retenant le seuil de pauvreté à 60 %, plutôt qu'à 50 % de la médiane des niveaux de vie, le taux de pauvreté s'établit à 12,1 % au lieu de 6,3 % de la population globale en France en 2005. La définition européenne, aujourd'hui adoptée par l'INSEE, aboutit donc à un quasi-doublement du nombre de pauvres. Par ailleurs, ce mode de calcul comporte des aspects difficilement compréhensibles par le grand public. Ainsi, si on doublait le niveau de vie de chacun, le nombre de pauvres resterait inchangé, ce qui résulte du caractère relatif du seuil de pauvreté. 2°/ Si l'on se réfère à l'approche par les conditions de vie , reposant sur le repérage d'un certain nombre de privations d'éléments de bien-être matériel (relatifs notamment au logement et à la consommation), le taux de pauvreté varie là encore très fortement selon le nombre jugé acceptable de carences : ainsi, en 2004, 14,3 % de la population subit un nombre de privations supérieur ou égal à 8. Ce taux est de 8,4 % si l'on considère un nombre de privations supérieur ou égal à 10 et de 4,8 % pour un nombre de privations supérieur ou égal à 12. |
Les choix à effectuer sont de plusieurs ordres :
1°) En premier lieu, plusieurs approches sont possibles.
Les approches monétaires , purement quantitatives, peuvent se fonder soit sur le revenu, soit sur la consommation. Privilégier le revenu permet d'être le moins dépendant possible des choix effectués par les individus, et le plus proche possible d'une approche par les « capacités » au sens développé par le prix Nobel d'économie Amartya Sen.
Les approches non monétaires se fondent sur une analyse des conditions de vie. Elles évaluent le degré de privation par rapport à certains éléments de bien-être (alimentation, logement, habillement, santé, éducation, relations sociales, sentiment de sécurité...).
2°) En deuxième lieu, pour une approche donnée, mesurer la pauvreté implique la définition d'un seuil .
Ce seuil peut être relatif ou, au contraire, absolu :
Un seuil relatif est défini par rapport à la distribution générale des revenus (ou de la consommation) ;
Un seuil absolu suppose un jugement de valeur sur les éléments dont un individu doit disposer pour couvrir ses besoins fondamentaux.
La France et, plus généralement, l'Union européenne ont fait le choix d'indicateurs monétaires relatifs. Ce choix suppose que le bien-être d'un individu est étroitement lié à sa position sociale relative. Il suppose également que la croissance économique n'a pas nécessairement d'impact sur l'ampleur de la pauvreté. En effet, si le revenu de chacun augmentait dans les mêmes proportions, le taux de pauvreté demeurerait identique. L'impact du taux de croissance sur le taux de pauvreté dépend des effets de la croissance sur les inégalités.
Ces seuils relatifs ou absolus, lorsqu'ils sont monétaires, peuvent être réestimés chaque année ou, au contraire, « ancrés dans le temps » , c'est-à-dire réévalués annuellement uniquement en fonction de l'inflation. En l'espèce, pour mesurer l'atteinte de l'objectif de réduction d'un tiers de la pauvreté en cinq ans, le gouvernement a choisi de suivre l'évolution d'un taux de pauvreté « ancré dans le temps » calculé en prenant comme seuil de pauvreté celui de 2005, augmenté de l'inflation.
3°) Pour une approche et un seuil donnés, plusieurs mesures sont possibles.
Deux mesures au moins doivent être analysées conjointement :
Le taux de pauvreté , appelé aussi « risque de pauvreté », ou « incidence de la pauvreté » : il s'agit de la part de la population qui n'atteint pas le seuil ;
« L'intensité de la pauvreté », c'est-à-dire l'écart par rapport au seuil, pour les individus situés sous le seuil.
Il est important de combiner ces deux approches pour analyser les situations et évaluer les effets des politiques : les évolutions du taux de pauvreté doivent en effet être examinées conjointement aux variations de l'intensité de la pauvreté . Par exemple, une réduction de la probabilité d'être pauvre (l'incidence de la pauvreté), qui résulterait d'actions ciblées uniquement sur la population se situant juste en dessous du seuil, pourrait s'accompagner d'une aggravation de l'intensité de la pauvreté. Inversement, améliorer le sort des plus pauvres n'aurait pas forcément d'impact sur l'incidence de la pauvreté en général.
D'autres indicateurs sont par ailleurs utiles pour appréhender le phénomène d'exclusion, notamment les indicateurs de persistance de la pauvreté et d'accès aux ressources fondamentales (logement, éducation, santé notamment).
Il serait donc illusoire d'espérer appréhender la pauvreté grâce à un indicateur unique, ou de tenter l'alchimie d'indicateurs synthétiques qui nuiraient à la lisibilité des phénomènes.
Ces préalables de méthode étant posés, cette note examinera la question des indicateurs de la pauvreté tout d'abord sous son angle le mieux connu en France, à savoir la mesure des inégalités monétaires. Elle examinera ensuite les autres dimensions de la question, avant de présenter les approches combinées retenues aux plans national et européen, que le rapport d'un groupe de travail du CNIS 4 ( * ) a récemment proposé de compléter.
I. LA PAUVRETÉ MONÉTAIRE : UNE MESURE DES INÉGALITÉS
La pauvreté est principalement appréhendée en France d'un point de vue relatif, sous l'angle des inégalités. Sont considérés comme « pauvres » les individus dont le niveau de vie est inférieur à 60 % du niveau de vie médian .
Mais, la mesure des inégalités ne se réduit pas à celle du taux de pauvreté monétaire ; elle comporte d'autres aspects.
A. LA MESURE DES INÉGALITÉS
Les inégalités sont mesurées en France sur la base du concept de niveau de vie, qui se distingue des notions de revenu ou de pouvoir d'achat.
1. La mesure des niveaux de vie
Le niveau de vie d'un individu se calcule en rapportant le revenu disponible du ménage auquel il appartient au nombre d'unités de consommation de ce ménage. Le ménage est défini comme l'ensemble des personnes partageant le même logement. Tous les individus d'un ménage ont donc par définition le même niveau de vie.
a) Le revenu disponible
Le concept de revenu disponible, utilisé pour mesurer les niveaux de vie, est distinct du concept de revenu disponible brut , qui sert de base au calcul du pouvoir d'achat.
Le revenu disponible brut (RDB) est une grandeur macroéconomique mesurée dans le cadre de la comptabilité nationale. Il correspond à la masse des revenus perçus par l'ensemble des ménages, nets des impôts et cotisations qu'ils paient. L'évolution du pouvoir d'achat est mesurée en rapportant l'évolution du RDB à celle des prix 5 ( * ) . Cette mesure peut différer de la perception que les ménages ont de leur niveau de vie 6 ( * ) .
La notion de revenu disponible est, quant à elle, estimée au niveau micro-économique à partir de l'enquête « Revenus fiscaux » (ERF) . Le revenu disponible d'un ménage est la somme de toutes les ressources des différentes personnes qui le composent : revenus d'activité (salaires nets, bénéfices, etc.), de remplacement (allocations chômage, retraites, etc.), revenus du patrimoine déclarés, et prestations reçues (allocations familiales, aides au logement, minima sociaux). De ce total sont déduits les impôts directs payés par le ménage ainsi que les prélèvements sociaux.
|
L'enquête « Revenus fiscaux » L'enquête « Revenus fiscaux » (ERF) fournit une approche du revenu disponible monétaire des ménages enrichie des données de l'enquête Emploi. Elle se déroule en deux étapes : - La première consiste en un appariement statistique des fichiers fiscaux des revenus et du fichier de l'enquête Emploi en continu (EEC) . L'EEC est une enquête par sondage trimestriel. Elle se déroule tout au long de l'année. L'appariement consiste à retrouver les déclarations fiscales des individus interrogés dans le cadre de l'EEC qui représente environ 37.000 ménages. A cette fin, la Direction générale des impôts (DGI) transmet à l'INSEE un fichier contenant l'ensemble des éléments de taxation du foyer fiscal à l'impôt sur le revenu (déclaration n° 2042) ainsi qu'un fichier contenant l'ensemble des données relatives à la taxe d'habitation. - Dans un second temps, les informations sur les revenus non fournies par la source fiscale sont complétées par des estimations réalisées par l'INSEE . Les revenus non imposables des ménages ne figurent pas dans les fichiers fiscaux. Ils sont estimés par l'INSEE sur barème ou par des simulations économétriques. Les revenus ainsi imputés sont les suivants : Les allocations familiales de base ou sous condition de ressources : elles sont déterminées en fonction du nombre et de l'âge des enfants (ces données étant fournies par l'EEC) ; Les minima sociaux : RMI, API, AAH, Minimum Vieillesse : leur estimation est imparfaite car leur perception dépend de paramètres complexes ; L'allocation logement : estimée économétriquement en fonction des caractéristiques et du revenu des ménages. L'ERF permet l'analyse des revenus suivant des critères sociodémographiques connus par l'enquête Emploi : catégorie socioprofessionnelle et âge des personnes composant le ménage, statut d'activité de ces personnes, taille du ménage. Elle précise également comment se cumulent les divers types de revenus (salaires, chômage, pensions, revenus agricoles, industriels, commerciaux, non commerciaux etc.) perçus par chaque membre du ménage. Source : INSEE |
b) Les unités de consommation (UC)
Le nombre d'UC d'un ménage diffère du nombre de personnes que comporte ce ménage, pour tenir compte des économies d'échelle qui existent pour certaines dépenses. L'échelle d'équivalence retenue est celle dite de l'OCDE modifiée 7 ( * ) . Cette échelle attribue une unité de consommation au premier adulte du ménage, 0,5 pour chaque adulte supplémentaire, et 0,3 pour chaque enfant de moins de quatorze ans. Dans son rapport précité en date de mars 2007, le groupe de travail du CNIS sur les niveaux de vie et les inégalités sociales reconnaissait le caractère partiellement conventionnel des échelles d'équivalence . Préconisant de mieux prendre en compte le caractère variable des économies d'échelle réalisées par le ménage (en fonction notamment de sa position dans la distribution des revenus et du type de famille considéré), il suggérait de calculer des variantes d'échelle et de tester la sensibilité des résultats à l'échelle retenue.
Dans son rapport sur la mesure du pouvoir d'achat des ménages 8 ( * ) , la Commission Quinet s'est également interrogée sur la pertinence des valeurs retenues dans l'échelle de l'OCDE modifiée , notamment dans certaines situations particulières telles que les familles monoparentales ou les familles nombreuses de plus de trois enfants. En préconisant la publication d'un indicateur de pouvoir d'achat par unité de consommation , qui permettrait de tenir compte des évolutions démographiques et familiales dans l'évolution du pouvoir d'achat, la Commission Quinet a néanmoins souligné indirectement l'intérêt de l'utilisation d'une échelle d'équivalence .
2. La mesure des inégalités de distribution des niveaux de vie
a) Les inégalités en 2005
Le tableau suivant présente les principaux indicateurs d'inégalités :
Niveau de vie des individus et indicateurs d'inégalités (2005)
|
Premier décile (D1)* |
776 € |
|
Moyenne* |
1.550 € |
|
Médiane (D5)* |
1.362 € |
|
Neuvième décile (D9)* |
2.448 € |
|
Rapport interdécile (D9/D1) |
3,15 |
|
Masse détenue par les 20 % les plus riches (en %) |
36,7 % |
|
Masse détenue par les 50 % les plus riches (en %) |
68,1 % |
|
Masse détenue par les 20 % les plus pauvres (en %) |
9,6 % |
|
* En moyenne par mois. Champ : individus vivant dans des ménages en France Métropolitaine, dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante. Source : enquête Revenus fiscaux 2005, Insee-DGI |
|
|
Note : la médiane est le niveau de vie en dessous duquel se situe la moitié des individus. Le premier décile est le niveau de vie en dessous duquel se situent 10 % des individus. Le neuvième décile est le niveau de vie en dessous duquel se situent 90 % des individus. |
Selon l'ERF, le niveau de vie moyen s'établit à 1.550 euros par mois en 2005. Le niveau de vie médian s'élève à 1.362 euros par mois , ce qui signifie que la moitié de la population a un niveau de vie inférieur à ce niveau.
Le niveau de vie moyen est supérieur au niveau de vie médian , ce qui dénote une concentration des revenus vers le haut de l'échelle de distribution, résultant du fait que les revenus sont bornés vers le bas de distribution (salaire minimum, minima sociaux), alors qu'ils ne sont pas bornés vers le haut, avec des revenus qui peuvent être très élevés, ce qui relève la moyenne mais pas la médiane.
Les inégalités de revenus se lisent ainsi :
- les 10 % d'individus les plus aisés ont un niveau de vie au moins 3,15 fois plus élevé que les 10 % d'individus les plus pauvres (il s'agit du rapport interdécile ) ;
- les 20 % des individus aux niveaux de vie les plus faibles perçoivent 9,6 % de la masse des revenus par équivalent adulte ; les 20 % des individus les plus aisés 36,7 %.
Les niveaux de vie sont moins dispersés que les revenus disponibles des ménages, car le nombre moyen d'unités de consommation est plus important dans les ménages bénéficiant d'un revenu disponible élevé.
Le niveau de vie moyen augmente avec l'âge jusqu'à 65 ans. Parmi les ménages dont la personne de référence a moins de 65 ans, les personnes vivant seules ou dans une famille monoparentale ont en moyenne des niveaux de vie plus faibles (respectivement 1.430 euros et 1.170 euros par mois). Le niveau de vie des couples est en moyenne d'autant plus faible que le nombre d'enfants est plus élevé.
L'indice de Gini est stable à 0,27. Étant par nature synthétique, cet indice ne donne pas d'indication sur les évolutions relatives au sein des diverses catégories de population.
|
Les indicateurs synthétiques d'inégalités de Gini, Theil et Atkinson
Note de lecture : La courbe de Lorenz représente la répartition des niveaux de vie entre déciles de la population. Ainsi par exemple en France, le premier décile de la population (c'est-à-dire les 10 % les moins riches) perçoit 4 % de la masse totale des niveaux de vie. Le deuxième décile perçoit 5,6 % du total (le premier quintile - les 20 % les moins riches - détient donc 9,6 % du total), etc. La bissectrice correspond à ce que serait une répartition parfaitement égalitaire. Plus la courbe est éloignée de la diagonale, plus l'inégalité constatée des revenus est prononcée. L'indice de Gini vise à résumer la courbe de Lorenz. Il est représenté graphiquement par la surface entre la courbe de Lorenz et la première bissectrice (droite de parfaite égalité de distribution des revenus). Il est compris entre 0 (situation d'égalité parfaite correspondant à la première bissectrice) et 1 (situation la plus inégalitaire, où l'ensemble des revenus serait détenu par un seul individu). L'indice de Gini est estimé en France à 0,27. Il a peu évolué récemment et place la France dans une position plutôt favorable, par rapport à celle de ses principaux partenaires de l'OCDE dont l'indice de Gini moyen est évalué à 0,31 (cf. graphique ci-après).
Pour mémoire, il existe d'autres indicateurs synthétiques des inégalités. L'indice de Theil 9 ( * ) s'inspire de la mesure de l'entropie, c'est-à-dire qu'il mesure l'écart entre une distribution égalitaire uniforme et la distribution constatée. Plus une suite est désordonnée, plus son entropie est grande. Ici, plus les revenus sont dispersés, plus l'indice de Theil est élevé. Cet indice a la propriété remarquable de pouvoir être décomposé, c'est-à-dire qu'il peut s'additionner pour différents sous-groupes ou régions d'un pays. L'indice d'Atkinson traduit l'aversion de la population pour l'inégalité. Un indice d'Atkinson valant x % signifie que la population accepterait de perdre x % de son revenu actuel pour que la distribution devienne égalitaire. Cet indice dépend d'un paramètre d'aversion pour l'inégalité. L'avantage de cet indicateur est de faire apparaître clairement la mesure retenue comme dérivant d'un choix qu'il faut justifier (celui du paramètre). |
b) L'évolution des inégalités
Entre 1996 et 2005, les inégalités de revenus ont légèrement reculé. Le rapport interdécile est passé de 3,35 en 1996 à 3,15 en 2005. Depuis 2003, on observe une stagnation du rapport interdécile .
Évolution du rapport interdécile (D9/D1)
|
1996 |
1998 |
2000 |
2002 |
2002 rétropolé |
2003 |
2004 |
2005 |
|
|
D9/D1 |
3,35 |
3,26 |
3,27 |
3,20 |
3,21 |
3,17 |
3,14 |
3,15 |
Source : INSEE-DGI, ERF. D1 désigne la limite supérieure du plus bas décile de niveau de vie ; D9 la limite inférieure du décile supérieur.
Le mouvement de baisse des inégalités s'est interrompu : alors que le niveau de vie des 10 % les plus modestes a augmenté de 3,3 % en moyenne par an entre 1996 et 2002, il a stagné ensuite entre 2002 et 2005. Le niveau de vie des 5 % les plus aisés, qui avait augmenté de 2,4 % par an sur la première période, a continué à augmenter mais dans une moindre mesure (de 1 % par an) au cours de la seconde période 10 ( * ) .
Cette stagnation récente des inégalités se traduit par une stagnation de la pauvreté. Moyennant le choix d'un seuil, la mesure des inégalités débouche en effet sur une mesure de la pauvreté.
B. LA MESURE DE LA PAUVRETÉ
L'indicateur d' incidence de la pauvreté (le taux de pauvreté monétaire) doit être complété par des données concernant son intensité et sa persistance .
1. La pauvreté monétaire
Le ralentissement du mouvement de baisse des inégalités sur la période récente se traduit par une stagnation de la pauvreté relative. L'évolution est plus favorable si l'on considère l'indicateur semi-absolu de pauvreté « ancré dans le temps » . Cet indicateur est toutefois critiquable .
a) Le seuil de pauvreté
Le seuil de pauvreté à 60 % de la médiane des niveaux de vie a été adopté par souci d'harmonisation avec nos partenaires européens , à la suite du Conseil européen de Laeken (décembre 2001) qui a approuvé une série d'indicateurs de pauvreté et d'exclusion sociale (cf infra ). Ce seuil remplace celui de 50 % auparavant utilisé par l'INSEE.
Le choix de la médiane, de préférence à la moyenne, exprime le fait qu'être pauvre, c'est avant tout être à l'écart du mode de vie courant, puisque le niveau de vie médian est celui au-dessous duquel se situent 50 % des individus. La médiane est préférée à la moyenne pour deux raisons :
- d'une part, elle n'est pas tirée artificiellement vers le haut par les niveaux de vie très élevés d'un très petit nombre d'individus ;
- d'autre part, elle n'est pas affectée par l'incertitude qui entoure la mesure des valeurs extrêmes.
Le seuil de pauvreté à 60 % de la médiane est de 817 euros en France en 2005. Ceci signifie qu'un individu est pauvre si son niveau de vie est inférieur à 817 euros mensuels, ce qui correspond, en termes de revenu disponible par ménage, à :
•
817 euros
par mois
pour
une personne seule
(UC = 1) ;
•
1.226 euros
par mois
pour
un couple
(UC = 1,5) ;
•
1.471 euros
par mois
pour
un couple avec un enfant
de moins de 14 ans (UC = 1,8).
Il faut ajouter ensuite au revenu disponible du ménage 245 euros par enfant de moins de 14 ans et 409 euros par personne de plus de 14 ans, pour déterminer si les individus qui composent le ménage sont ou non en situation de pauvreté.
Le seuil à 50 % de la médiane (égal à 681 euros en 2005), qui était anciennement le seuil de référence au niveau national, est encore utilisé, tant par l'INSEE que par l'Observatoire national de la pauvreté 11 ( * ) (ONPES), ainsi qu'au plan international, notamment dans le cadre de travaux de l'OCDE.
L'évolution du niveau des seuils à 60 % et à 50 % dépend de l'évolution des niveaux de vie médians. L'approche dite « ancrée dans le temps » fait au contraire varier les seuils uniquement en fonction de l'inflation (cf. infra ). Dans le premier cas, la pauvreté est appréciée de façon plus dynamique que dans le second cas, où le seuil est mobile en fonction de l'inflation mais fixe au regard d'éventuelles modifications de la répartition des revenus.
Seuils de pauvreté (en euros)
|
2002 rétropolée* |
2003 |
2004 |
2005 |
||
|
En euros constants 2005 |
Seuil à 60 % |
805 |
805 |
803 |
817 |
|
Seuil à 50 % |
671 |
671 |
669 |
681 |
|
|
En euros courants |
Seuil à 60 % |
758 |
774 |
788 |
817 |
|
Seuil à 50 % |
632 |
645 |
657 |
681 |
|
|
* L'ERF 2002 rétropolée correspond au début d'une nouvelle série de statistiques sur les revenus, s'appuyant sur les résultats annuels du recensement de la population. Cette nouvelle série prend par ailleurs en compte les revenus soumis à prélèvements libératoires. Champ : individus des ménages dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante. Source : enquêtes revenus fiscaux, Insee-DGI |
|||||
b) Les taux de pauvreté
En 2005, 12,1 % de la population ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté à 60 % de la médiane. Ce taux est de 6,3 % au regard du seuil à 50 % de la médiane.
L'évolution des taux de pauvreté en France depuis 1970 (en %)
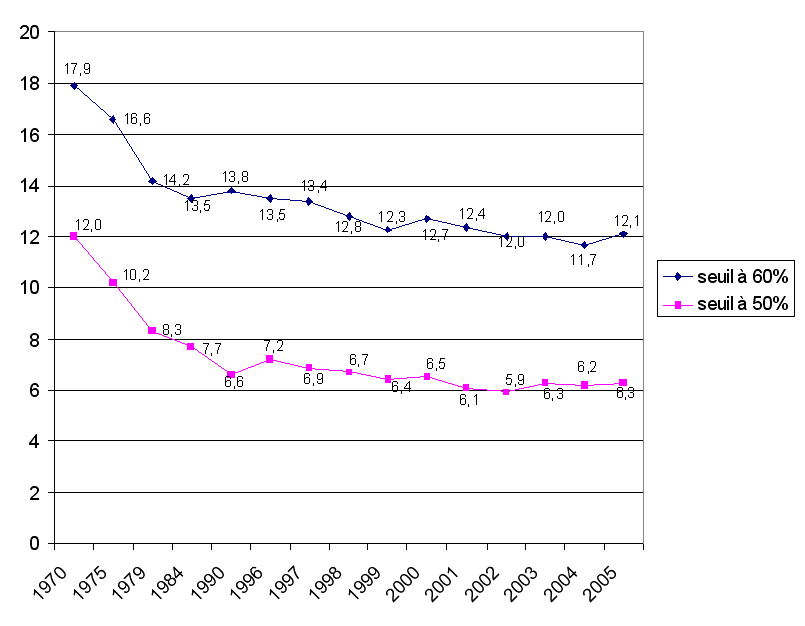
Note : à partir de 2002, les données correspondent à une nouvelle série de statistiques sur les revenus, s'appuyant sur les résultats annuels du recensement de la population. Cette nouvelle série prend par ailleurs en compte les revenus soumis à prélèvements libératoires.
Champ : individus des ménages dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.
Source : enquêtes revenus fiscaux, Insee-DGI
Après une forte baisse des taux de pauvreté entre 1970 et 1990, le mouvement s'est ralenti . La tendance à la baisse est néanmoins demeurée nette au cours de la période 1996-2002, en conséquence d'une conjoncture et d'une évolution de l'emploi favorables. Un ressaut du taux de pauvreté est toutefois observable en 2000, malgré un taux de croissance du PIB en volume de 3,9 % à cette date, ce qui souligne l'absence de corrélation systématique entre croissance économique et baisse de la pauvreté relative.
Sur la période 2002-2005, on observe une quasi-stagnation de la pauvreté.
Il faut toutefois conserver à l'esprit que la marge d'incertitude dans la mesure des taux de pauvreté est de 0,5 point pour le seuil à 60 % et de 0,4 point pour le seuil à 50 %. Les évolutions constatées en 2005 sont donc considérées par les statisticiens comme non significatives .
La source fiscale (ERF) permet des décompositions selon le statut d'activité ou type de ménages. A long terme, le profil sociodémographique de la pauvreté s'est modifié : touchant autrefois principalement le monde agricole et les retraités, celle-ci pèse désormais davantage sur les ouvriers et sur les jeunes. Le chômage et l'instabilité des trajectoires familiales sont des facteurs importants de ce phénomène .
Taux de pauvreté (au seuil de 60 %) - Année 2005 (en %)
Selon le statut d'activité
|
Actif occupé |
6,8 |
|
Chômeur |
34 |
|
Étudiants de 18 ans ou plus |
17,2 |
|
Inactifs de 18 à 64 ans |
24,2 |
|
Retraités / inactifs 65 ans et + |
8,9 |
|
Enfants de moins de 18 ans |
15,5 |
|
Ensemble de la population |
12,1 |
Selon le type de ménage
|
couple sans enfant |
7,2 |
|
couple avec un enfant |
8,2 |
|
couple avec deux enfants |
8,3 |
|
couple avec trois enfants ou + |
18,2 |
|
famille monoparentale |
24,6 |
|
personne seule |
16,0 |
|
Ensemble de la population |
12,1 |
Champ : individus appartenant à des ménages dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n'est ni étudiante ni militaire du contingent
Le gouvernement a récemment souhaité s'affranchir de ce type de mesure purement relative de la pauvreté. Il a choisi de mesurer les résultats des politiques menées à l'aune d'un autre indicateur, le taux de pauvreté ancré dans le temps . Celui-ci est calculé en prenant comme seuil de pauvreté celui d'une année précédente augmenté de la seule inflation. Il est considéré comme semi absolu, puisque le seuil, déterminé de façon relative pour une année, reste ensuite constant en termes réels d'une année sur l'autre. Ainsi, par exemple, en 2005, le taux de pauvreté (au seuil à 60 %) ancré en 2004 est de 11,4 % (au lieu de 12,1 % en termes purement relatifs).
L'objectif de réduction de la pauvreté d'un tiers en cinq ans, énoncé dans le cadre de l'« engagement national » mis en oeuvre par le Haut-Commissaire aux Solidarités actives, se fonde sur cette mesure de la pauvreté « ancrée dans le temps ». Il s'agit de ramener le taux de pauvreté, calculé avec le seuil de 2005 augmenté de l'inflation, de 12,1 % au début du quinquennat à 8 % en 2010 . Cette mesure est présentée comme plus appropriée que la mesure de la pauvreté par le suivi du taux de pauvreté d'une part, parce qu'elle rendrait mieux compte de l'impact des politiques publiques et, d'autre part, car elle traduirait plus directement le sentiment des personnes qui, à court terme, verraient leur niveau de vie fluctuer en fonction du coût de la vie plutôt qu'en fonction de leur place dans l'échelle sociale.
Dans les faits, la pauvreté sera ainsi évaluée en fonction d'un seuil historiquement figé , réestimé en fonction de l'inflation, mais ne tenant pas compte de l'augmentation continue des niveaux de vie résultant de la croissance du PIB en volume. Or dans un contexte non récessif, la diminution des taux de pauvreté ancrés dans le temps est une tendance prévisible , liée à l'augmentation des revenus et indépendante de tout effort de réduction de la pauvreté. Un bref retour sur le passé le confirme :
- entre 2000 et 2005, le taux de pauvreté ancré dans le temps (2000) est passé de 12,7 % à 9,7 %, soit une diminution d'environ un quart ; cette diminution ralentit toutefois nettement au cours des trois dernières années.
- entre 1997 et 2000, le taux de pauvreté ancré dans le temps (1997) est passé de 13,4 % à 10,2 %, soit une diminution d'environ un quart, mais sur trois ans.
La cible visée par le gouvernement implique une accélération du rythme de réduction de la pauvreté, compte tenu de l'essoufflement observé au cours des dernières années. L'objectif consiste à revenir à une tendance observée antérieurement.
c) L'impact des politiques de redistribution
L'approche par les niveaux de vie ne permet pas de mesurer l'impact des politiques de redistribution sur la pauvreté monétaire dans un pays donné. Les revenus disponibles sont en effet pris en compte après transferts sociaux. Or il est utile de tenter d'évaluer le degré d'inégalité d'une économie, avant intervention des politiques publiques de redistribution . En Europe, ce type d'approche révèle un tableau contrasté, reflet de la diversité des systèmes économiques, sociaux et fiscaux du continent.
Dans l'Union européenne, les transferts sociaux réduisent la proportion de personnes exposées à la pauvreté de 38 % en moyenne (UE 25) Ce chiffre est de 32 % dans la zone euro. La réduction de la pauvreté varie de 20 % ou moins en Grèce, Italie, Espagne, à plus de 60 % en Danemark, Suède, Finlande et République tchèque.
En France, la réduction est estimée à 46 %.
Taux de pauvreté monétaire avant et après transferts sociaux 12 ( * ) (2003 ou 2004)
|
Pays |
Taux de pauvreté (seuil de 60 %) |
Impact |
|
|
Avant transferts (%) |
Après transferts (%) |
||
|
Danemark |
31 |
11 |
65% |
|
Suède |
30 |
11 |
63% |
|
Finlande |
29 |
11 |
62% |
|
République tchèque |
21 |
8 |
62% |
|
Luxembourg |
22 |
11 |
50% |
|
Belgique |
28 |
15 |
46% |
|
France |
26 |
14 |
46% |
|
Pologne |
31 |
17 |
45% |
|
Royaume-Uni |
29 |
18 |
38% |
|
Allemagne |
24 |
16 |
33% |
|
Slovaquie |
28 |
21 |
25% |
|
Espagne |
25 |
20 |
20% |
|
Italie |
23 |
19 |
17% |
|
Grèce |
23 |
20 |
13% |
Source : Eurostat (SILC)
Lecture : les transferts sociaux permettent de diminuer le taux de pauvreté de 46 % en France, passant de 26 % à 14 %.
Le taux de pauvreté avant transferts est ici défini comme la proportion de personnes dont le revenu disponible équivalent, avant transferts sociaux, se situe en dessous du seuil de risque de pauvreté , fixé à 60 % du revenu disponible équivalent médian national (après transferts sociaux). Les pensions de retraite et de réversion sont considérées comme revenus d'origine et non pas comme des transferts sociaux.
Ces travaux ne reflètent pas l'impact des transferts fiscaux , puisque les revenus avant transferts sont nets d'impôts, mais seulement celui des prestations sociales. Par ailleurs, ils ne donnent pas d'indication quant à l'effet des transferts sociaux sur l'intensité de la pauvreté 13 ( * ) .
D'autres travaux ont été menés à l'échelle de l'OCDE pour évaluer les effets des impôts et transferts sur les taux de pauvreté relative 14 ( * ) . Ces travaux montrent que les effets combinés des impôts et transferts sociaux permettent de faire sortir de la pauvreté plus de la moitié de la population à risque 15 ( * ) (en moyenne dans l'OCDE) .
Cet effet varie d'environ un quart de la population située sous le seuil de pauvreté avant impôts et transferts (États-Unis) à plus des deux tiers de cette population (Danemark, France). Cet effet a toutefois décliné au cours de la seconde moitié des années 1990 dans la plupart des pays de l'OCDE.
Les effets des impôts et transferts sur la pauvreté monétaire relative
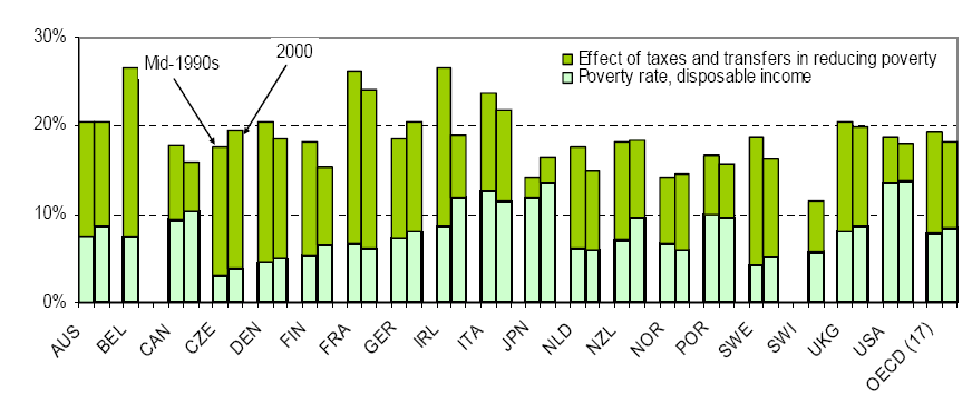
 Taux de pauvreté calculé à
partir du revenu disponible
Taux de pauvreté calculé à
partir du revenu disponible
 Effet des impôts et
transferts en termes de réduction de la pauvreté
Effet des impôts et
transferts en termes de réduction de la pauvreté
Note de lecture : la partie claire de la barre représente le taux de pauvreté relatif calculé à partir du revenu disponible (après impôts et transferts), avec un seuil fixé à 50 % du revenu médian national. La partie foncée représente l'impact des politiques de redistribution, c'est-à-dire la différence entre le taux de pauvreté qui résulterait du marché, et celui calculé après impôts et transferts. En France par exemple les impôts et transferts réduisent la pauvreté d'environ 3/4.
Source : Förster et Mira d'Ercole (OCDE, 2005)
2. Intensité et persistance de la pauvreté monétaire
a) L'intensité de la pauvreté monétaire
L'évolution des taux de pauvreté monétaire doit être analysée parallèlement à celle de l'intensité de la pauvreté monétaire , c'est-à-dire au regard de la distribution des revenus à l'intérieur de la catégorie des individus considérés comme « pauvres ». La pauvreté recouvre vraisemblablement des réalités très différentes selon que les individus considérés ont un niveau de vie plus ou moins proche du seuil.
Les indicateurs d'intensité de la pauvreté mesurent l'écart entre le revenu médian (ou moyen) des ménages pauvres et le seuil de pauvreté à 60 % de la médiane.
Il est exprimé en pourcentage du seuil de pauvreté. Plus ce chiffre est élevé, plus le revenu médian (ou moyen) des personnes pauvres est éloigné du seuil de pauvreté. L'indicateur privilégié par l'ONPES est l'intensité en termes d'écart relatif au revenu médian des personnes pauvres, cet indicateur figurant également au nombre des indicateurs centraux européens (cf. infra ).
Le graphe ci-dessous montre qu'après une diminution régulière de l'intensité de la pauvreté entre 1996 et 2002, celle-ci est significativement remontée, notamment en 2003 . L'intensité de la pauvreté a quasiment rejoint en 2005 son niveau de 1996.
Ceci signifie qu'entre 1996 et 2002, le niveau de vie médian de la population pauvre s'est rapproché du seuil de pauvreté à 60 % : l'écart était d'environ 16 % en 2002, contre 18 % en 1996. Sur la période 2002-2005, cet écart tend à revenir à 18 %.
L'évolution de l'intensité de la pauvreté depuis 1996 (en %)
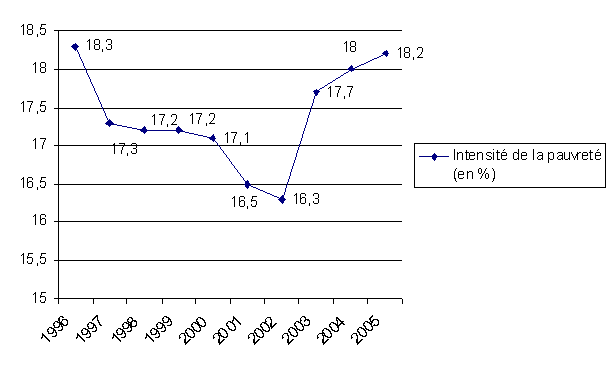
Note : une rupture de série s'est produite en 2002 (cf. supra).
L'intensité de la pauvreté mesure l'écart entre le seuil de pauvreté et le niveau de vie médian des personnes pauvres, en pourcentage du seuil de pauvreté.
Champ : individus appartenant à des ménages dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n'est ni étudiante ni militaire du contingent.
La faible croissance du PIB en volume depuis 2001 s'est donc accompagnée d'une stagnation du taux de pauvreté (cf. supra ) et d'une augmentation de son intensité. Cette tendance n'a pas été modifiée par l'amélioration de la conjoncture en 2004 (avec une croissance du PIB de +2,5 %). Elle s'est confirmée en 2005, année qui voit tant le taux que l'intensité de la pauvreté stagner, dans le contexte d'une croissance économique à 1,7 %.
b) La persistance de la pauvreté monétaire
Le phénomène de pauvreté est d'autant plus pénalisant qu'il s'inscrit dans la durée, engendrant des processus cumulatifs d'exclusion. Il est utile de savoir si la pauvreté est un phénomène transitoire ou au contraire un phénomène structurel , car ces diagnostics appellent des politiques distinctes.
L'indicateur de persistance de la pauvreté permet de connaître la part des individus ayant un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté pendant plusieurs années, par exemple (par convention au niveau européen) pendant l'année courante et deux des trois années précédentes. L'emploi d'un tel indicateur est recommandé tant au niveau national, par le groupe de travail du CNIS sur les niveaux de vie et les inégalités sociales, qu'à l'échelle européenne, dans le cadre des « indicateurs de Laeken » (cf. infra ).
Toutefois, l'indicateur de persistance de la pauvreté n'est pas à ce jour calculable en France . Il nécessite un suivi longitudinal des personnes pauvres sur au moins quatre années. Or un tel suivi a été interrompu suite à la suppression du panel communautaire des ménages, utilisé de 1994 à 2001 par Eurostat. De 1997 à 2000, le taux de persistance de la pauvreté était estimé en France entre 8 % (en 1998) et 9 % (en 1997, 1999 et 2000).
Ce panel a été remplacé par les Statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) , projet qui a démarré en 2003 suite à un règlement cadre du Parlement européen et du Conseil (n° 1177/2003). En conséquence, l'INSEE a mis en place en 2004 un panel, dans le cadre d'enquêtes dites SRCV (statistiques sur les ressources et les conditions de vie des ménages). Le panel sur les ressources et conditions de vie, partie française du système de statistiques communautaires (SILC), compte environ 12.000 ménages interrogés sur leur revenu, leur situation financière et leurs conditions de vie. Ce dispositif complète les anciennes enquêtes permanentes sur les conditions de vie (1996-2004), qui n'étaient pas panélisées.
Les résultats obtenus dans le cadre des enquêtes SILC n'étant pas comparables à ceux de l'ancien panel européen, on ne dispose pas pour le moment d'un recul suffisant pour calculer la persistance de la pauvreté. Cette lacune sera comblée en 2008, lorsque les données de quatre années (2004-2007) auront été collectées dans le cadre du nouveau dispositif.
II. LA PAUVRETÉ MONÉTAIRE : UNE APPROCHE À COMPLÉTER
A. LES LIMITES ET VARIANTES
1. Les limites
La mesure de la pauvreté par le revenu, qui traduit de nécessaires choix conceptuels, est contrainte par l'imperfection des sources.
a) Des sources statistiques incomplètes
L'approche monétaire des inégalités se fonde sur l'enquête « revenus fiscaux » (ERF), qui est imparfaite, ce qui explique des divergences avec les résultats obtenus en comptabilité nationale. Cette source est toutefois en cours d'amélioration.
En premier lieu, le champ couvert par l'ERF est celui des ménages .
Ce champ présente deux inconvénients :
• d'une part,
il suppose admis que les
revenus sont également répartis au sein des
ménages
, et que
le logement constitue bien le
critère pertinent d' « unité de
vie »
. Pour vérifier la robustesse de ces
hypothèses, le CNIS a suggéré, dans son rapport
précité, de mettre en place une enquête visant à
rendre compte :
- des disparités des situations individuelles au sein des ménages
- et de l'impact des liens familiaux hors ménages.
• d'autre part, ce champ d'enquête exclut
les personnes ne disposant pas d'un logement (cf.
infra
), ainsi que
celles hébergées en collectivité ou dans des formes
particulières de logement.
Elle exclut notamment les personnes
hébergées en institution, ainsi que les personnes sans
domicile
. Le champ de l'ERF est ainsi estimé à
98 % de la population de métropole
.
En deuxième lieu, l'ERF appréhende mal les revenus du patrimoine, et en particulier du patrimoine financier.
Les revenus sont en effet appréhendés au travers des déclarations fiscales. Y échappent notamment les revenus issus des produits exonérés d'impôt (livrets d'épargne, plans d'épargne en actions). Ceux soumis au prélèvement libératoire ne sont pris en compte que depuis 2002. D'après des estimations réalisées par l'INSEE en 2001, l'ERF collectait alors entre 12 % et 23 % des revenus des valeurs mobilières enregistrés par la Comptabilité nationale. La couverture était meilleure mais n'atteignait que 47 % pour les revenus des patrimoines immobiliers.
Des informations détaillées sur les revenus du patrimoine existent toutefois, grâce aux enquêtes patrimoine de l'INSEE, réalisées environ tous les six ans depuis 1986. Des travaux 16 ( * ) ont été menés afin d'introduire les revenus du patrimoine dans l'enquête ERF en 2003, à partir des données recueillies dans le cadre de l'enquête patrimoine 2004. Puisque les revenus du patrimoine sont plus concentrés que les revenus d'activité, leur prise en compte dans les niveaux de vie accroît logiquement les inégalités et, dans une moindre mesure, le taux de pauvreté. L'ajout des revenus du patrimoine absents de la déclaration fiscale accroît le niveau de vie de 3 % pour les individus du premier décile de niveau de vie contre 9,8 % pour le dernier décile. Le rapport interdécile augmente de 3,19 à 3,34 et le taux de pauvreté (seuil à 60 %) passe à 12,7 % 17 ( * ) (contre 12 %) .
Une amélioration de la prise en compte des revenus du patrimoine doit intervenir lors de la prochaine ERF, à paraître fin 2008 (données 2006). Cette évolution devrait avoir un impact non seulement sur le taux de pauvreté, mais aussi sur les caractéristiques de la population pauvre. Les revenus du patrimoine s'accroissent en effet avec l'âge. En outre, ils sont concentrés chez les travailleurs indépendants et les cadres, et bénéficient plus particulièrement aux individus ayant les revenus hors patrimoine les plus élevés.
En troisième lieu, le montant des prestations familiales, minima sociaux et allocations logement est estimé dans l'ERF à partir de barèmes et de simulations économétriques.
Leur prise en compte sur des bases réelles nécessite un appariement des fichiers des organismes dispensateurs de prestations sociales avec les déclarations fiscales prises en compte dans l'ERF. Le principe de l'appariement consiste à essayer de retrouver les prestations perçues par les individus des ménages de l'enquête Emploi (dont l'ERF identifie déjà les déclarations fiscales). Ce travail est en cours de réalisation.
Par ailleurs, l'allocation personnalisée pour l'autonomie (APA), destinée aux personnes âgées dépendantes 18 ( * ) n'est pas prise en compte par l'ERF , ce qui constitue une lacune importante.
|
Prestations prises en compte par l'ERF L'ERF évalue les niveaux de vie à partir des données fiscales, transmises par la DGI, et d'estimations des montants de prestations sociales. Les prestations estimées sont les suivantes :
- Allocations familiales
Par ailleurs, la prime pour l'emploi est prise en compte. Source : INSEE |
Plus largement se pose la question de l'augmentation de la taille de l'échantillon ERF, qui compte actuellement environ 40.000 ménages.
Une telle évolution aurait un double intérêt :
- d'une part, combinée au recours croissant à des données détenues par les prestataires sociaux, elle permettrait de mieux évaluer les niveaux de vie à l'échelon local ;
- d'autre part, elle permettrait de remonter jusqu'aux causes au moins apparentes, ou directes, du phénomène de pauvreté. L'impact du chômage et celui des politiques de redistribution pourraient être mieux appréhendés.
b) Des limites conceptuelles
La définition du revenu
Le choix de mesurer la pauvreté par rapport au revenu, plutôt que par rapport à la consommation ou aux conditions de vie, résulte de deux considérations :
- en premier lieu, il s'agit de se situer du côté des « causes » plutôt que des conséquences du phénomène de pauvreté, c'est-à-dire d'appréhender le bien-être en termes de capacités (ce qui permet d'éviter la confusion entre pauvreté et ascèse choisie) ;
- en second lieu, il s'agit de remédier aux difficultés de l'observation statistique en mesurant un aspect résumant apparemment tous les autres, plutôt que d'évaluer conjointement toutes les conséquences résultant, en aval, de la situation de pauvreté.
Ce choix du revenu, s'il procède d'une volonté de simplification, soulève néanmoins des problèmes de méthode .
Mesurer la pauvreté en termes monétaires implique l'adoption d'une définition du revenu, ce qui pose des problèmes théoriques. Dans un pays donné, la notion de revenu est pour beaucoup tributaire du système fiscal , ce qui peut poser des problèmes de comparabilité internationale.
Plus généralement, la question se pose de délimiter correctement le revenu monétaire d'un ménage. Faut-il ne déduire que les impôts directement prélevés sur les revenus, ou faudrait-il prendre en compte la fiscalité de façon plus globale et déduire notamment les impôts indirects et les taxes locales ? Faut-il déduire du revenu les dépenses qui lui sont associées, tels que frais de transport, de gardes d'enfants, ou d'assurances obligatoires, susceptibles d'amputer de façon significative le salaire perçu, notamment le second salaire perçu dans un ménage ? Comment distinguer les frais contraints et ceux qui résultent de choix individuels, par exemple en ce qui concerne le logement ?
S'agissant par exemple des impôts indirects (TVA, droits d'accise, TIPP), on peut arguer que leur paiement n'est pour partie pas contraint, puisqu'il résulte de choix de consommation qui n'ont pas à entrer en compte dans le calcul des niveaux de vie. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue l'effet anti-redistributif relativement élevé de la fiscalité indirecte. La prise en compte de la fiscalité indirecte accroît le coefficient de Gini de 1,3 point, de 0,274 avant à 0,287 après 19 ( * ) .
Plus largement, se pose la question de l'élargissement de la notion de revenu aux ressources non monétaires qui participent également au bien-être. Parmi ces ressources non monétaires figurent notamment :
- les services collectifs gratuits ou à prix bonifiés, notamment dans les domaines de l'éducation ou de la santé (avec ici un effet contraire à celui qui pourrait résulter de la prise en compte de la fiscalité indirecte, en raison du caractère redistributif de ces services) ;
- le service de logement que s'offrent à eux-mêmes les propriétaires-occupants, mesurable grâce à la notion de « loyer fictif » ;
- plus généralement, la valeur de la production domestique , notamment celle du travail accompli par un conjoint non-occupé, la valeur du temps libre, l'insertion dans un réseau de relations, etc.
La fixation d'un seuil
Au-delà de cette question de définition du revenu, la fixation d'un seuil de pauvreté est également problématique. Le seuil de 60 % de la médiane des niveaux de vie est un seuil conventionnel, « un point arbitraire de la distribution statistique » 20 ( * ) . Il est arbitraire car on ne peut identifier un seuil traduisant une rupture nette, en deçà duquel l'engrenage qui conduit à la pauvreté apparaîtrait très clairement.
Le choix d'un seuil relatif signifie que ce n'est pas le niveau du revenu qui est l'aspect le plus essentiel, mais sa place au sein de la distribution . De fait, percevoir un revenu moins élevé signifie être exclu d'un certain nombre de biens et services auxquels les autres ont accès.
Il est intéressant de noter que, selon la terminologie européenne, le seuil à 60 % de la médiane est désigné comme « seuil de risque de pauvreté » plutôt que comme seuil de pauvreté. En France, le changement de seuil 21 ( * ) ne s'est pas accompagné d'un changement de terminologie. Dans d'autres pays, le seuil à 60 % de la médiane est considéré comme un indicateur de risque de pauvreté, devant être complété par des données sur les conditions de vie (cf infra , concernant l'Irlande et la notion de pauvreté « consistante »).
Le choix de situer le seuil de pauvreté commune une fraction du revenu médian, c'est-à-dire celui en deçà duquel se situe la moitié de la population, a des implications fortes. Le seuil de pauvreté étant, par construction, inférieur au revenu médian, il est impossible que plus de la moitié de la population puisse être pauvre . Des résultats paradoxaux pourraient être observés dans des pays très égalitaires, ayant par conséquent des taux de pauvreté faibles, alors que la pauvreté absolue y serait forte.
En Europe, par exemple, plusieurs pays d'Europe centrale et orientale figurent parmi les pays de l'Union où il y a le moins de pauvres, ce qui pose la question de la pertinence des comparaisons de taux de pauvreté relatifs (cf. infra ).
A tout le moins faut-il garder à l'esprit que la pauvreté, telle que mesurée en Europe, est un indicateur des inégalités en bas de l'échelle de distribution des niveaux de vie , et non un indicateur absolu . Il ne permet pas de dire si un pays est « pauvre » ou « riche », mais seulement s'il est « égalitaire » ou « inégalitaire ».
A cet égard, des seuils absolus pourraient être jugés plus proches des représentations que l'on se fait de la pauvreté. Aux États-Unis par exemple, les seuils de pauvreté ont été fixés en fonction d'un niveau de consommation jugé minimal au regard de besoins fondamentaux (cf. encadré). Toutefois, ce type d'approche implique des choix normatifs pour la définition dudit seuil, qui demeure en tout état de cause daté et localisé . Il a pour cette raison été qualifié d' « absolu relatif » ou d' « absolu socio-historique » 22 ( * ) . Il s'agit là aussi d'un seuil conventionnel, surtout lorsque, comme aux Etats-Unis, il n'a pas été réactualisé depuis 45 ans.
|
La mesure de la pauvreté aux Etats-Unis La pauvreté est mesurée aux Etats-Unis selon des modalités prévues par l'Office of Management and Budget (OMB) 23 ( * ) . Les indicateurs sont publiés par le Bureau du recensement (Census Bureau), sur la base des revenus monétaires après transferts sociaux, mais avant impôts. Ces revenus sont mis au regard de seuils de pauvreté qui diffèrent en fonction de la taille de la famille et de l'âge de ses membres. Il existe ainsi 48 seuils de pauvreté, initialement calculés en 1963-1964 à partir de budgets alimentaires établis par le département de l'agriculture, et de données concernant la part consacrée à l'alimentation dans les budgets des ménages. Les seuils furent définis comme le coût du budget alimentaire minimal, multiplié par trois pour prendre en compte les autres dépenses de biens et services. Ces seuils, géographiquement uniformes, sont révisés chaque année en fonction de l'inflation . Il s'agit donc d'une mesure de la pauvreté « absolue » et « ancrée dans le temps ». Elle est fondée sur l'idée d'un revenu minimum calculé en fonction des besoins, selon une approche initiée, en Angleterre, par B. S. Rowntree en 1901. Cette méthode est fortement critiquée, principalement pour trois raisons : - En premier lieu, elle ne permet pas de distinguer entre ménages ayant des besoins différents, en fonction :
- En deuxième lieu, la révision des seuils de pauvreté en fonction de l'inflation ne permet pas de prendre en compte l'élévation générale des niveaux de vie ; - En dernier lieu, cette approche ne reflète ni les effets des politiques fiscales, ni ceux des politiques d'aide sociale non monétaire (« noncash benefits ») dans les domaines de l'alimentation, du logement et de la santé. Nombre de pauvres et taux de pauvreté aux Etats-Unis de 1959 à 2006
Sources : Constance Citro et Robert Michael, « Measuring poverty : a new approach » (1995) ; US Census Bureau, « Income, poverty and health insurance coverage in the United-States : 2006 ». |
2. Les variantes
L'approche de la pauvreté par le revenu monétaire présente l'avantage de la simplicité et d'une relative indépendance par rapport aux choix effectués par les individus. Le bien-être n'étant toutefois pas réductible au concept de revenu monétaire, des approches complémentaires apportent un éclairage utile quant à la valeur des ressources tirées d'une part de l'autoproduction et d'autre part des services publics collectifs individualisables. Il serait intéressant de pouvoir calculer ces variantes au niveau européen, dans la mesure où les modèles nationaux présentent de fortes disparités dans ces deux domaines.
a) Les effets de l'autoproduction
S'agissant de la question de la prise en compte des ressources tirées de la production domestique, la question la plus discutée est celle des imputations de loyers fictifs 24 ( * ) . Ces loyers fictifs sont la traduction monétaire de l'avantage tiré par les ménages du fait d'être propriétaires de leur résidence principale, ou d'être logés gratuitement. Ce revenu supplémentaire est évalué comme le loyer que les propriétaires percevraient si leur logement était loué au prix du marché. Le montant du loyer est estimé en fonction des caractéristiques du logement, des caractéristiques du ménage, de l'ancienneté dans le logement ainsi que du type d'habitat concerné. Le loyer est imputé à partir d'équations économétriques estimées dans l'enquête Logement 2002 de l'INSEE. Sont déduits les intérêts d'emprunt contractés pour l'achat de la résidence principale.
Cette imputation modifie sensiblement la hiérarchie des niveaux de vie, puisque la population à bas revenus apparaît alors plus jeune et plus urbaine. Ainsi, si les ménages où la personne de référence est âgée de plus de 65 ans représentent près du tiers des ménages à bas revenus (au seuil de 50 % de la médiane des niveaux de vie), ils n'en représentent plus qu'un cinquième si l'on tient compte des loyers imputés. Les imputations de loyers fictifs accroissent par ailleurs le poids au sein des ménages à bas revenu des familles de trois enfants et plus. Globalement, elles conduisent à une légère baisse du taux de pauvreté.
Au niveau européen, il est prévu que le dispositif d'enquête sur le revenu et les conditions de vie SILC permette à terme l'imputation de loyers fictifs aux propriétaires occupants.
b) Les effets des revenus implicites tirés des services publics
L'appréciation des niveaux de vie est sensiblement modifiée si l'on calcule le revenu disponible ajusté, qui prend en compte les transferts implicites résultant des services collectifs individualisables, en plus du revenu disponible. L'impact de ces dépenses publiques sur le niveau des inégalités est exposé dans un rapport de M. Bernard Angels, sénateur, qui sera examiné en juillet 2008 par la délégation pour la planification.
Ces transferts, qui représentent un montant proche de celui des transferts sociaux en espèces, contribuent à réduire les inégalités, dans une proportion qui dépend de leur progressivité. Les modalités de cette redistribution sont variables en fonction du type de dépense considéré : tandis que les dépenses d'éducation bénéficient plutôt aux familles avec enfants et très peu aux personnes âgées, les services de santé profitent en revanche massivement à ces dernières.
L'imputation des dépenses de santé 25 ( * ) repose sur l'identification de catégories de la population (sexe, âge) réputées homogènes en matière de consommation de soins. Cette imputation conduit à réévaluer le seuil de pauvreté, qui passe à 966 euros, tandis que le taux de pauvreté diminue à 8,5 %. Pour les plus de 70 ans, le taux de pauvreté serait même ramené à 1,1 %. Des travaux similaires pour l'imputation des dépenses d'éducation, actuellement en cours à l'INSEE, permettront de donner une vision globale plus équilibrée, car plus exhaustive, de l'impact des dépenses publiques sur les niveaux de vie en fonction des caractéristiques des individus.
Taux de pauvreté après prise en compte des dépenses de santé en 2005
|
Après prise en compte des transferts monétaires |
Après prise en compte des transferts monétaires et de la santé |
|||
|
Seuil de pauvreté (montant mensuel en euros) |
823 |
966 |
||
|
Taux de pauvreté (en %) |
11,8 |
8,5 |
||
|
Selon le type de ménage |
La personne de référence a moins de 60 ans |
Couples sans enfant |
6,1 |
5,3 |
|
Couples, 1 enfant |
9,0 |
7,7 |
||
|
Couples, 2 enfants ou + |
13,3 |
9,7 |
||
|
Célibataires |
16,5 |
17,4 |
||
|
Célibataires, 1 enfant ou + |
32,9 |
29,7 |
||
|
La personne de référence a plus de 60 ans |
Couples sans enfants |
6,9 |
1,3 |
|
|
Célibataires |
14,3 |
4,6 |
||
|
Selon l'âge |
0-10 ans |
15,4 |
11,7 |
|
|
10-19 ans |
17,5 |
14,2 |
||
|
20-29 ans |
11,6 |
10,3 |
||
|
30-39 ans |
10,1 |
8,0 |
||
|
40-49 ans |
11,1 |
9,3 |
||
|
50-59 ans |
10,1 |
8,2 |
||
|
60-69 ans |
8,0 |
3,8 |
||
|
70 ans et plus |
9,6 |
1,1 |
||
|
Note : le seuil de pauvreté correspond au seuil de pauvreté pour une personne seule. Champ : individus vivant dans un ménage ordinaire dont le niveau de vie est positif ou nul Source : modèle INES, enquête santé 2002-2003, calculs François Marical (INSEE) |
||||
La question de l'imputation de la subvention implicite dont bénéficient les locataires du parc social a également été discutée 26 ( * ) . Il s'agit de mesurer un avantage équivalent au versement d'une allocation, mais non pris en compte dans les revenus des bénéficiaires, parce que versé à des tiers. Cette imputation est contestée car elle suppose l'existence dans le parc privé de biens comparables aux logements du parc social. Elle repose par ailleurs sur l'hypothèse d'une égale capacité des deux parcs à loger les plus défavorisés.
Dans le même ordre d'idée, on pourrait songer à mesurer la subvention implicite perçue dans le cadre des systèmes de soutien aux prix agricoles .
Un autre aspect sur lequel il existe peu de données concerne l'impact des dépenses d'action sociale des collectivités locales sur les niveaux de vie. Les régions, départements et communes versent en effet des prestations financières ou en nature, de caractère non obligatoire. Il s'agit :
- d'une part, d 'aide extra-légale , c'est-à-dire versée dans des conditions ou pour des montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements ;
- d'autre part, d 'action sociale facultative, dans d'autres domaines que ceux de l'aide sociale légale.
Les enquêtes réalisées régulièrement par la DREES 27 ( * ) mettent en évidence la diversité des pratiques des collectivités locales, sans qu'il soit possible d'évaluer l'impact de ces politiques sur les niveaux de vie. Un exemple simple (cf. encadré ci-dessous) montre que ces aides peuvent avoir un impact significatif sur les niveaux de vie individuels. Lorsque ces aides sont liées à la perception d'un minimum social, il en résulte des effets de seuil importants.
|
L'impact des aides locales sur les niveaux de vie Les aides locales facultatives ont à l'évidence un impact important sur les niveaux de vie en bas de la distribution . Afin de donner une idée des proportions dans lesquelles ce type d'aide est susceptible de modifier les niveaux de vie, prenons l'exemple d'un parent isolé à Paris, ayant deux enfants à charge, percevant l'Allocation parents isolés c'est-à-dire 812 euros par mois (montant maximal de l'API dans ce cas, après déduction du forfait logement et des autres ressources de l'allocataire : salaire, pension alimentaire, prestations sociales), correspondant à un niveau de vie de 508 euros mensuels (812 / 1,6), soit 37 % du revenu médian (1 er décile des niveaux de vie). Cette famille peut par exemple bénéficier d'une place en crèche à tarif réduit pour 81 euros par mois, ce qui représente un « gain » implicite de 394 euros mensuels par rapport au tarif maximal. En outre, la région Ile-de France propose aux parents isolés : - 75 % de réduction sur le prix de la carte de transport (« carte orange ») mensuelle, soit 89 euros par mois (pour la carte la plus onéreuse) ; - 180 euros par an de chèques emploi services prépayés (soit 15 euros par mois) La ville de Paris propose d'autres aides, sous conditions de ressources, aux familles monoparentales non titulaires de l'API (prestation logement de la ville de Paris) ainsi qu'à d'autres catégories de la population. Si l'on tient compte des seules trois aides mentionnées ci-dessus (sans compter les services publics individualisables : école, services de santé, et d'autres aides telles que : cantines, centres de loisirs, colonies de vacances, réductions SNCF... qui bénéficient également à d'autres catégories de la population), les ressources de la famille considérée passeraient à 1310 euros mensuels, soit 819 euros en termes de niveaux de vie (+ 60 %). Étant donné que la plupart des aides locales existantes sont sous conditions de ressources, leur prise en compte ferait probablement baisser de façon significative le taux de pauvreté. Pour mesurer l'impact des aides locales sur les niveaux de vie, il faudrait accroître la taille de l'échantillon de l'enquête revenus fiscaux . L'échantillon actuel est trop restreint pour rendre compte avec suffisamment de fiabilité des situations locales. Cet exemple suggère également une certaine réserve à l'égard des comparaisons internationales , puisque ce qui est pris en compte dans le calcul des niveaux de vie peut être très différent dans chaque pays, selon les caractéristiques des politiques sociales redistributives. |
Les limites de l'approche « centrale » par le revenu rendent utile un examen des méthodes complémentaires de mesure de la pauvreté.
B. LES APPROCHES COMPLÉMENTAIRES
Connaître le phénomène de pauvreté nécessite de recouper le risque de pauvreté, mis en évidence par les indicateurs monétaires, avec des éléments plus qualitatifs relatifs aux conditions de vie des individus . Une telle approche permet en outre d'aller au-delà de l'approche par les inégalités et de ne pas définir le bien-être uniquement en termes de position sociale relative.
1. Pauvreté en conditions de vie et pauvreté subjective
a) La pauvreté mesurée par les conditions de vie
Une approche globale des phénomènes de pauvreté et d'exclusion doit comporter une dimension relative à l'analyse des conditions de vie, dans l'esprit de l'approche pratiquée par exemple en Irlande (cf. encadré). Cette dimension est parfois appelée « pauvreté d'existence » .
|
La mesure de la pauvreté en Irlande L'intérêt de la méthode irlandaise de mesure de la pauvreté réside dans la combinaison de deux critères se rapportant respectivement au revenu et aux conditions de vie. Un individu est en effet considéré comme étant en situation de pauvreté « consistante » s'il cumule les deux caractéristiques suivantes : - d'une part son niveau de vie est inférieur à 60 % de la médiane des niveaux de vie : cette situation est qualifiée de « risque de pauvreté » ou de « pauvreté relative ». Ce seuil de 60 %, qui correspond au seuil européen, est toutefois estimé en Irlande d'après une échelle d'équivalence nationale, distincte de celle dite « de l'OCDE modifiée ». Cette échelle particulière attribue un poids de 1 au premier adulte du ménage, puis 0,66 aux autres individus de 14 ans et plus, et enfin 0,33 aux enfants âgés de moins de 14 ans. Elle est utilisée pour permettre des comparaisons rétrospectives, tandis que l'échelle de l'OCDE modifiée est employée par ailleurs afin de rendre possibles des comparaisons internationales ; - d'autre part , cet individu vit dans un ménage privé d'au moins un item figurant parmi une liste de huit indicateurs de privation . Parmi ces 8 indicateurs, 3 portent sur l'alimentation, 3 sur l'habillement, 1 sur le chauffage et 1 sur l'endettement. Selon cette méthode de calcul, tandis que 18,5 % de la population se trouvait en situation de pauvreté relative en Irlande en 2005, 7 % de la population se trouvait en situation de pauvreté « vérifiée ». Source : CSO (Central Statistics Office) d'Irlande. |
Cette approche, en apparence similaire aux mesures absolues de la pauvreté fondées sur la construction de paniers de consommation minimaux, est néanmoins « d'essence relative » 28 ( * ) : les pauvres sont en effet, ici aussi, « les plus mal lotis », ceux qui sont en dessous d'un seuil fixé de façon arbitraire et conventionnelle. Ce seuil n'est pas similaire aux seuils absolus « de survie décente » utilisés aux Etats-Unis, dans le sillage des travaux de Rowntree au début du siècle (cf. supra ).
L'analyse des inégalités de conditions de vie et de consommation consiste à repérer un certain nombre de privations . Par rapport à l'approche monétaire de la pauvreté, cette analyse réduit l'effet des fluctuations à court terme du revenu des individus. L'impact de ces fluctuations sur la consommation est en effet atténué, si l'on suppose que les individus consomment non pas en fonction de leur revenu courant, mais en fonction de leur « revenu permanent » anticipé sur le long terme.
Cette méthode soulève toutefois la question de la nature du référentiel de privations à adopter, car elle implique une définition normative absolue, c'est-à-dire un jugement de valeur sur ce qu'est la pauvreté. Elle se heurte également au fait que la consommation reflète en partie des préférences individuelles . La pauvreté, ainsi définie, pourrait résulter d'un choix individuel plutôt que d'une contrainte en termes de ressources.
La pauvreté en termes de conditions de vie est définie comme un manque global d'éléments de bien-être matériel, mesuré à l'échelle du ménage. En France, dans le cadre de l'enquête permanente sur les conditions de vie des ménages (EPCV) jusqu'en 2004, puis des statistiques sur les revenus et les conditions de vie des ménages (SRCV 29 ( * ) ), un individu est dit pauvre s'il vit dans un ménage cumulant au moins 8 privations parmi 27 unités prédéfinies (cf. encadré).
Ce seuil de 8 privations est fixé afin que le taux de ménages pauvres en termes de conditions de vie soit du même ordre que le taux de pauvreté monétaire, ce qui souligne là encore le caractère conventionnel de tout référentiel en matière de pauvreté.
|
Unités retenues pour mesurer le taux de pauvreté en conditions de vie Les unités retenues sont au nombre de 27, réparties en 4 catégories : - insuffisance des ressources : être soumis à des remboursements d'emprunt élevés par rapport à ses revenus, avoir été en découvert bancaire au cours des 12 derniers mois, avoir des revenus insuffisants pour équilibrer le budget du ménage, puiser dans ses économies pour équilibrer le budget, ne disposer d'aucune épargne, considérer sa situation financière comme difficile ; - retards de paiement : avoir été dans l'impossibilité de payer, au cours des 12 derniers mois, des factures d'électricité ou de gaz, des loyers, ses impôts ; - restrictions de consommation : maintenir le logement à la bonne température, se payer une semaine de vacances, remplacer des meubles, acheter des vêtements chauds, acheter de la viande, recevoir parents ou amis, offrir des cadeaux au moins une fois par an, posséder deux paires de chaussures, ne pas faire de repas par manque d'argent au moins une fois au cours des 2 dernières semaines ; - difficulté de logement : surpeuplement, pas de salle de bains, pas de toilettes, pas d'eau chaude, pas de système de chauffage, logement trop petit, difficulté à chauffer, humidité, bruit. |
L'indicateur synthétique des conditions de vie cumule pour chaque ménage le nombre de difficultés sur les vingt-sept ci-dessus énumérées. La pauvreté en conditions de vie marque globalement une évolution favorable, qui exprime la diminution de la part des situations de grande privation.
Taux de difficulté de conditions de vie en France (en %)
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
13,1 |
12,0 |
11,9 |
12,1 |
11,6 |
11,9 |
11,4 |
10,6 /14,7* |
13,3 |
12,7 |
Source : ONPES
*La rupture de série observable en 2004 s'explique par le passage de l'enquête EPCV (enquête permanente sur les conditions de vie) à l'enquête européenne SILC-SRCV (statistiques sur les revenus et les conditions de vie).
On observe, logiquement, que la pauvreté en conditions de vie est fortement liée au niveau de revenus du ménage ; elle est d'autant plus fréquente que ce revenu est faible. Par ailleurs, elle concerne davantage les personnes sans conjoint (notamment famille monoparentales) que les couples.
Le recoupement entre pauvreté monétaire et pauvreté en conditions de vie n'est toutefois que partiel .
Près du quart de la population (22 %) appartient à l'une ou l'autre catégorie (pauvreté monétaire ou en conditions de vie). Ce nouvel ensemble d'individus « pauvres » est donc deux fois plus étendu que chacun des deux ensembles dont il constitue la réunion.
A l'intersection des deux ensembles, 5 % des individus « seulement » cumulent les deux formes de pauvreté 30 ( * ) . Il s'agit, d'après la terminologie européenne, du taux de pauvreté consistante (« consistent poverty ») .
b) La pauvreté subjective
La pauvreté subjective se définit comme la difficulté à équilibrer son budget quelles que soient les causes de cette situation.
Cette approche est qualifiée de subjective pour deux raisons :
- d'une part parce qu'elle repose sur la perception par les individus eux-mêmes de leurs difficultés à « boucler les fins de mois » ;
- d'autre part parce que ces difficultés peuvent résulter du choix implicite de dépenser plus qu'on ne gagne, sans que les niveaux de revenu ou de consommation de l'individu soient ici considérés.
Cette dimension de la pauvreté n'est toutefois bien évidemment que partiellement subjective .
Une étude parue en 2005 31 ( * ) étudie le recoupement entre pauvreté monétaire, pauvreté en conditions de vie et pauvreté subjective. Dans cette étude, un ménage est jugé pauvre dans l'acception subjective du concept s'il cumule trois difficultés budgétaires parmi six difficultés prédéfinies concernant :
- l'insuffisance de revenu (un revenu ne permettant de vivre que « difficilement ») ;
- la nécessité de s'endetter ;
- et des retards de paiement (loyer, factures, impôts...)
Le taux de pauvreté subjective des ménages, ainsi calculé, est de 12,4 % en 2001.
La même étude montre, ici encore, que les différentes formes de pauvreté ne se cumulent pas systématiquement : près du quart des ménages présente au moins un symptôme de pauvreté (monétaire, de conditions de vie ou subjective), un sur soixante-dix cumule les trois dimensions 32 ( * ) .
Ce recoupement entre plusieurs approches de la pauvreté souligne l'intérêt de plusieurs éclairages , puisque ceux-ci ne se recouvrent que partiellement.
Étant donné les lacunes des dispositifs de mesure, ce tableau n'est toutefois pas complet . Il est nécessaire d'y joindre les informations fournies par des enquêtes spécifiques menées auprès des populations les plus démunies, s'agissant notamment de la situation des sans-domicile, demeurée longtemps mal connue.
2. Les enquêtes spécifiques : le cas des « sans domicile »
Les personnes ne disposant pas d'un logement étant par hypothèse exclues de l'enquête ERF, des enquêtes spécifiques sont nécessaires pour connaître cette population.
Ainsi que l'a mis en évidence un récent rapport de l'Inspection générale des Affaires sociales (IGAS) 33 ( * ) , de nombreuses données sur les sans-domicile ont été collectées depuis les années 1990, mais dans un cadre trop peu structuré, avec un déficit d'organisation et de diffusion des connaissances.
En 2001, à la suite du rapport d'un groupe de travail du CNIS 34 ( * ) , et à une enquête pilote de l'INED 35 ( * ) , l'INSEE a réalisé sa première enquête nationale sur les utilisateurs des services d'hébergement et de distribution de repas chauds (dite enquête Sans-domicile). Ce travail, qui doit être renouvelé tous les dix ans, évaluait à 86.000 le nombre de sans-domicile 36 ( * ) .
D'autres sources existent. Des enquêtes complémentaires à celles de l'INSEE ont été menées par l'INED. Des données sont collectées à l'occasion des recensements, et lors des enquêtes sur le logement et sur la santé de l'INSEE. La DREES 37 ( * ) dispose de la base FINESS 38 ( * ) des établissements sanitaires et sociaux. Elle mène, depuis 1982, des enquêtes sur les établissements sociaux (ES) et notamment sur l'activité de centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) 39 ( * ) . Enfin, des études sociologiques ont été réalisées, des témoignages ont été recueillis et des études ont été menées par les associations pour décrire les difficultés des personnes rencontrées.
Toutefois, ainsi que le soulignait l'IGAS, ce dispositif ne permet pas d'identifier des fluctuations dans le nombre de sans-domicile, ni de repérer des modifications dans les caractéristiques de ces personnes. Une amélioration du répertoire FINESS et de son articulation aux autres sources permettraient d'améliorer la connaissance statistique des personnes les plus en difficulté. Des études de trajectoire sont également nécessaires, pour expliquer les processus d'exclusion et identifier les leviers d'action les plus efficaces. L'ONPES devrait dans ce domaine jouer le rôle d'interface entre les acteurs « de terrain » et les administrations , les premiers étant mieux à même d'identifier les évolutions qualitatives, que les secondes peuvent ensuite examiner d'un point de vue statistique.
III. QUELLE GRILLE DE LECTURE ?
Le caractère multidimensionnel de la pauvreté rend chaque indicateur insuffisant s'il est considéré isolément. Il est donc nécessaire de synthétiser les données existantes , ce qui peut se faire de deux façons :
- soit par la construction d'indicateurs synthétiques ;
- soit par la présentation de tableaux hiérarchisés d'indicateurs.
A. LES INDICES SYNTHÉTIQUES
On présentera ici trois exemples d'indicateurs synthétiques, tout en considérant, d'emblée, que cette approche, bien que séduisante par la simplicité de ses résultats, n'est toutefois pas satisfaisante. Les indicateurs synthétiques sont en effet trop peu lisibles. Leur niveau et leur évolution ne peuvent être interprétés simplement.
1. Les indicateurs de développement humain du PNUD
Le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD) calcule depuis 1990 (pour l'indice de développement humain) et 1997 (pour les indices de pauvreté humaine) plusieurs indices composites ayant pour vocation de permettre des comparaisons internationales des niveaux de développement des pays.
L'indice de développement humain (IDH) est la moyenne de trois indices mesurant respectivement trois aspects du niveau de développement d'un pays. Ces trois aspects sont les suivants :
- l'espérance de vie ;
- le niveau d'éducation ;
- le PIB par tête.
|
Calcul de l'IDH : un exemple concret L'IDH est calculé à partir de trois indicateurs élémentaires mesurant les résultats obtenus dans trois domaines fondamentaux du développement humains : l'espérance de vie, l'éducation et le revenu par tête. Les indices élémentaires sont calculés de la façon suivante : indice = (valeur observée - valeur minimum) / (valeur maximum - valeur minimum). Chaque indice élémentaire varie donc entre 0 (pour le pays dont l'indicateur serait à la valeur minimum) et 1 (pour le pays dont l'indicateur serait à la valeur maximum). L'IDH est une moyenne des indices reflétant ces trois dimensions. Ainsi, par exemple, pour la Turquie : 1. Indicateur d'espérance de vie : Pour la Turquie, avec une espérance de vie de 71,4 ans en 2005, l'indicateur d'espérance de vie est de 0,773. En effet, les valeurs minimum et maximum d'espérance de vie ayant été fixées respectivement à 25 ans et 85 ans : Indicateur d'espérance de vie = (71,4 - 25) / (85 - 25) = 0,773 2. Indicateur d'éducation : cet indicateur combine deux indicateurs : un indicateur d'alphabétisation des adultes (ici 87,4 %) et un indicateur d'accès à l'enseignement (ici 68,7 %). Une pondération de 2/3 est attribuée au premier indicateur et d' 1/3 au second. Indicateur d'éducation = 2/3 (0,874) + 1/3 (0,687) = 0,812 3. Indicateur de PIB / tête : la Turquie ayant un PIB par tête de 8.407 USD, cet indicateur est calculé à partir de valeurs minimum et maximum fixées respectivement à 100 USD / tête et 40.000 USD / tête. Indicateur PIB = log (8.407) - log (100) / log (40.000) - log (100) = 0,740 4. Calcul de l'IDH : il s'agit d'une moyenne simple : IDH = 1/3 (indicateur d'espérance de vie) + 1/3 (indicateur d'éducation) + 1/3 (indicateur PIB) IDH = 0,775 Source : PNUD |
La France se situe en 10 ème position du classement des pays selon l'IDH avec un score de 0,952. Les meilleurs résultats sont obtenus par l'Islande et la Norvège, avec un score de 0,968. Les Etats-Unis sont en 12 ème position avec un score de 0,951, le Royaume-Uni figure à la 16 ème place (0,946) et l'Allemagne à la 22 ème (0,935).
L'indice de pauvreté humaine pour les pays en développement 40 ( * ) (IPH-1) est une moyenne de 4 mesures relatives à des privations subies dans trois domaines (durée de vie, connaissances et conditions de vie). Les indicateurs pris en compte sont les suivants :
- la probabilité à la naissance de ne pas vivre jusqu'à l'âge de 40 ans ;
- le taux d'illettrisme ;
- le pourcentage de la population qui n'a pas accès à une source d'eau potable ;
- le pourcentage d'enfants en sous poids pour leur âge.
L'indice de pauvreté humaine (IPH-2) pour les pays développés (pays de l'OCDE sélectionnés) est une moyenne de 4 mesures :
- la probabilité à la naissance de ne pas vivre jusqu'à l'âge de 60 ans ;
- le pourcentage d'adultes privés de compétences en lecture et écriture ;
- le pourcentage de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté fixé à 50 % du revenu disponible ;
- le taux de chômage de longue durée (12 mois ou plus).
La France se situe en 11 ème position du classement des pays en fonction de l'IPH-2.
Si ces indices ont un certain intérêt pour des comparaisons internationales, ils sont en revanche assez peu exploitables au plan national. Comme on le voit, s'agissant de l'IDH, les résultats obtenus sont assez peu discriminants entre pays développés. Leur lisibilité est faible car leur objet n'est pas ciblé. Leur évolution n'est donc pas clairement interprétable.
Néanmoins ces indices ont le mérite de rappeler que certains éléments fondamentaux du bien-être, tels que la santé ou les niveaux d'éducation, sont des éléments à prendre en compte non seulement dans l'analyse du développement des pays mais aussi au plan national pour la compréhension des phénomènes d'inégalité et de pauvreté. Ils montrent que la question des revenus ne saurait résumer celle du bien-être.
2. L'indice BIP 40
Au niveau national , un indicateur synthétique a été élaboré en 2004 par un collectif dénommé « réseau d'alerte sur les inégalités » , regroupant des associations, des syndicats et des chercheurs.
Cet indicateur, appelé BIP 40 (baromètre des inégalités et de la pauvreté), est né d'un débat sur la pertinence et l'exhaustivité des statistiques publiées par l'INSEE dans les domaines de la pauvreté et de l'exclusion, au moment où était également critiquée la mesure par cet organisme de l'inflation et du pouvoir d'achat des ménages.
En plus du pourcentage d'individus situés sous le seuil de pauvreté, l'indicateur BIP 40 agrége cinq autres dimensions : emploi et conditions de travail, santé, éducation, logement et justice. Chaque dimension est évaluée par plusieurs indicateurs, ramenés à un chiffre entre 0 et 10. Le BIP 40 est ainsi composé en tout de 6141 ( * ) indicateurs très divers , pondérés d'après des choix effectués par les concepteurs de cet outil.
L'évolution des inégalités depuis 1980 d'après l'indicateur BIP 40
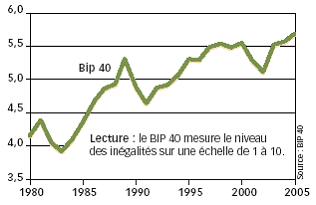
Source : Alternatives économiques
L'évolution de cet indicateur suggère que les inégalités se sont réduites entre 1999 et 2002 avant d'augmenter à nouveau entre 2002 et 2005. La hausse du taux de chômage, l'aggravation des inégalités entre catégories sociales face au chômage et la hausse de la proportion de chômeurs non indemnisés auraient contribué pour un quart à cette montée des inégalités, qui s'expliquerait également par la précarisation de l'emploi et par la dégradation des conditions de travail et de logement.
Cet indicateur soulève toutefois des problèmes théoriques et pratiques : d'une part, il nécessite de définir et de pondérer un certain nombre de données, ce qui implique des choix nécessairement subjectifs ; d'autre part, il se heurte à la difficulté d'agréger des séries hétérogènes et d'interpréter les résultats ainsi obtenus. C'est le type même de l'indicateur « éthiquement non neutre », c'est-à-dire normatif plutôt qu'objectif, selon la terminologie développée par Amartya Sen.
Le débat engendré par la publication du BIP 40 a entraîné la saisine du CNIS, qui a abouti au rapport précité sur les indicateurs de niveaux de vie et d'inégalités sociales. Ce rapport n'est pas favorable aux indicateurs synthétiques. Il préconise plutôt l'établissement d'un panorama d'indicateurs, à partir d'un système d'information national prenant en compte les aspects non monétaires de la pauvreté.
3. L'indice de Sen
Par rapport aux indices présentés précédemment, l'indice construit par Amartya Sen a pour intérêt de synthétiser des indicateurs dont l'analyse conjointe procède d'une certaine logique. Cette analyse conjointe peut même être considérée comme indispensable dans la mesure où chaque indicateur pris isolément pourrait être interprété de façon erronée.
L'apport de cet indice est de tenir compte simultanément de la proportion des pauvres, de l'intensité de la pauvreté et de l'inégalité de répartition des revenus parmi les pauvres.
|
L'indice de Sen Le taux de pauvreté d'un pays est mesuré par la proportion d'individus vivant dans des ménages disposant d'un revenu équivalent (c'est-à-dire un niveau de vie) inférieur à un seuil égal à 60 % de la médiane nationale des revenus équivalents. Le taux de pauvreté ne reflète que la proportion d'individus pauvres dans la population, il ne tient pas compte de l' intensité de la pauvreté . En effet, un même taux peut correspondre à des situations sensiblement différentes selon que les ménages pauvres ont des revenus proches ou éloignés du seuil. Cet écart peut être mesuré en valeur absolue ou en pourcentage du seuil. Ainsi, l'intensité apporte une information différente par rapport au taux de pauvreté : elle mesure une distance moyenne entre les pauvres et la ligne qui définit la pauvreté. Lorsqu'il est mesuré en valeur absolue, l'écart de pauvreté indique le montant du transfert qu'il faudrait en moyenne verser à chaque ménage pauvre pour que tous atteignent le seuil de pauvreté, à un facteur près égal au nombre d'unités de consommation dans chaque ménage (les calculs étant effectués sur les revenus par unité de consommation perçus par chaque ménage). Enfin, la troisième dimension, l'inégalité de distribution des revenus parmi les pauvres , n'est prise en compte ni par le taux ni par l'écart de pauvreté moyen. En particulier, l'intensité reste identique pour différentes dispersions des revenus de pauvres autour de la même moyenne. L'inégalité de distribution des revenus parmi les pauvres peut se mesurer par l'indice de concentration de Gini calculé sur la sous-population constituée uniquement par les ménages pauvres. Cet indice est compris entre 0 et 1. Il vaut 0 si la répartition des revenus est absolument égalitaire (tous les pauvres disposent du même revenu) ; il vaut 1 si un seul individu concentre tous les revenus, les autres n'ayant aucune ressource. L'indice de Sen s'écrit : S = T.[I + (1 - I).G] où T est le taux de pauvreté, I est l'écart de pauvreté moyen (intensité) mesuré relativement au seuil, et G est l'indice de Gini mesuré sur les pauvres. Source : DREES « Pauvreté et transferts sociaux en Europe », Marc Cohen-Solal et Christian Loisy (n° 18 - juillet 2001). |
L'indice de Sen n'étant pas calculable pour un certain nombre de pays , on se référera ici à un indice composite plus simple, produit du taux de pauvreté et de l'intensité de la pauvreté (ou écart de pauvreté, défini ici comme la différence entre le revenu moyen des pauvres et le seuil de pauvreté à 50 % du niveau de vie médian, en % de ce seuil). Cette mesure indique quel transfert de niveau de vie serait nécessaire pour élever le niveau de vie des pauvres jusqu'au seuil de pauvreté. L'indice varie de 7 % de la masse des niveaux de vie au Mexique à moins de 1 % en République tchèque et au Luxembourg.
Indicateur composite de la pauvreté relative dans l'OCDE (2000)
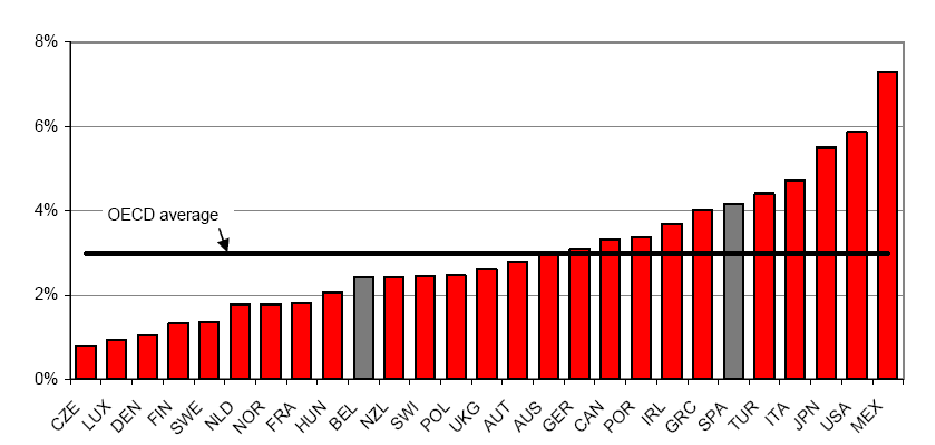
Source : Michaël Förster et Marco Mira d'Ercole (2005, op cit.)
Cet indice est le produit du taux de pauvreté et de l'écart de pauvreté. Il mesure l'ampleur du transfert de revenu équivalent (niveau de vie) qui serait nécessaire pour élever le niveau de vie de la population située sous le seuil de pauvreté jusqu'à ce seuil. Les données pour la Belgique et l'Espagne remontent à 1995.
B. LES TABLEAUX DE BORD
In fine , les indicateurs de la pauvreté et de l'exclusion sociale n'ont de sens que présentés conjointement, afin de donner une vision d'ensemble des phénomènes. Une hiérarchisation est nécessaire, par la distinction entre des indicateurs de base et des indicateurs secondaires ou « de contexte ». Ce type d'approche, préconisé au niveau européen, est également recommandé en France par le CNIS. Il aboutit toutefois au niveau national à une multiplicité de tableaux de bord et de grilles de lecture, au risque parfois de nuire à la lisibilité d'ensemble .
1. La méthode européenne de mesure de la pauvreté et de l'exclusion sociale
a) Les indicateurs de Laeken révisés
A l'intérieur de l'Union européenne, les dispositifs nationaux de mesure de la pauvreté et de l'exclusion sociale tiennent compte des principes définis dans le cadre de la « méthode ouverte de coordination » (MOC) dans les domaines de la protection et de l'inclusion sociale, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Lisbonne 42 ( * ) .
|
Le volet social de la stratégie de Lisbonne Visant à faire de l'Union européenne « l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique au monde » et à parvenir au plein emploi avant 2010, la stratégie adoptée lors du Conseil européen de Lisbonne (23-24 mars 2000), et développée au cours de plusieurs conseils postérieurs, repose sur trois piliers : - un pilier économique ; - un pilier social ; - un pilier environnemental. Le pilier social doit permettre de moderniser le modèle social européen grâce à l'investissement dans les ressources humaines et la lutte contre l'exclusion sociale, dans l'objectif de « donner un élan décisif à l'élimination de la pauvreté ». Pour atteindre les buts fixés en 2000, une liste d'objectifs chiffrés a été arrêtée. Étant donné que les politiques concernées relèvent presque exclusivement des compétences attribuées aux États membres, une méthode ouverte de coordination (MOC) incluant l'élaboration de plans d'action nationaux a été mise en place. |
Lors du Conseil européen de Stockholm, qui s'est tenu en mars 2001, il a été décidé l'élaboration d'un ensemble d'indicateurs devant permettre aux États membres et à la Commission :
- de surveiller les progrès réalisés dans la recherche des objectifs fixés par le Conseil européen de Lisbonne ;
- de favoriser une meilleure compréhension de la pauvreté et de l'exclusion sociale dans le contexte européen, et de repérer et d'échanger les bonnes pratiques.
Dans le cadre de la MOC, chaque État membre rédige tous les deux ans un « plan national d'action pour l'inclusion sociale » (PNAI) 43 ( * ) qui fait l'objet d'une revue par les pairs (c'est-à-dire d'un examen croisé entre États membres). La Commission et le Conseil européen présentent conjointement un rapport de synthèse de ces plans nationaux d'action 44 ( * ) .
Des travaux ont été réalisés par le sous-groupe technique « indicateurs » (SGI) du comité de la protection sociale, à partir de février 2001. Lors de sa réunion de Laeken (décembre 2001), le Conseil européen a avalisé une première série de 18 indicateurs de pauvreté et d'exclusion sociale.
Les indicateurs européens de l'inclusion sociale comportent un noyau dur fondé sur une approche relative de la pauvreté, en termes monétaires, complété par une large palette destinée à rendre compte de toutes les dimensions du phénomène de pauvreté en Europe.
Il a par ailleurs été choisi de privilégier des indicateurs de résultat, plutôt que de moyens, et de refuser l'élaboration d'un indicateur composite unique.
|
Indicateurs de Laeken : les principes méthodologiques Dans son rapport sur les indicateurs dans le domaine de la pauvreté et de l'exclusion sociale (octobre 2001), le Comité de la protection sociale propose de mettre l'accent davantage sur les indicateurs qui mettent en évidence les résultats obtenus dans le domaine social plutôt que sur les moyens grâce auxquels ils sont atteints. Les principes méthodologiques généraux retenus sont issus d'un rapport 45 ( * ) rédigé par un groupe d'économistes européens coordonné par le professeur Tony Atkinson, qui comporte un ensemble de recommandations méthodologiques pour la sélection des indicateurs sociaux : - un indicateur doit être bien ciblé pour saisir le coeur du problème et son interprétation doit être claire et acceptée sans réserve ; - un indicateur doit être solide et statistiquement validé ; - un indicateur doit s'adapter aux interventions stratégiques sans être sujet à manipulations ; - un indicateur doit pouvoir permettre la comparaison entre les États membres et, autant que faire se peut, satisfaire aux normes appliquées au niveau international ; - un indicateur doit pouvoir être actualisé sur la période récente et se prêter à la révision ; - la mesure d'un indicateur ne doit pas faire peser un fardeau trop lourd sur les États membres, les entreprises et les citoyens de l'Union ; - le portefeuille d'indicateurs doit être équilibré dans ses différentes dimensions ; - les indicateurs doivent être cohérents entre eux et le poids des différents indicateurs dans le portefeuille doit être proportionné ; - le portefeuille d'indicateurs doit être aussi transparent et accessible que possible aux citoyens de l'Union européenne. Constatant qu'il était nécessaire de pouvoir disposer d'un grand nombre d'indicateurs pour évaluer correctement la nature pluridimensionnelle de l'exclusion sociale, le comité de la protection sociale a proposé de classer ces indicateurs par ordre de priorité en les répartissant en trois niveaux : - un premier niveau constitué de 10 indicateurs primaires ; - un deuxième niveau consistant en 8 indicateurs secondaires ; - un troisième niveau à la discrétion de chaque Etat membre, afin de mettre en évidence les spécificités de domaines particuliers et de contribuer à l'interprétation des deux premiers niveaux d'indicateurs. Source : Comité de la protection sociale, Rapport sur les indicateurs dans le domaine de la pauvreté et de l'exclusion sociale, Octobre 2001 . |
A la suite de la révision à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne, un travail de renforcement et de rationalisation de la MOC a été mené, dans un cadre fixé par la Commission européenne 46 ( * ) . En juin 2006, le SGI a proposé un cadre rénové d'indicateurs communs, consistant en un portefeuille transversal de 14 indicateurs conçus pour refléter le recentrage de la stratégie de Lisbonne sur la croissance et l'emploi, accompagnés de 12 « indicateurs de contexte » , ainsi que trois portefeuilles thématiques portant respectivement sur l'inclusion sociale, les retraites et la santé. Le portefeuille relatif à l'inclusion sociale , largement issu des « indicateurs de Laeken », comporte 11 indicateurs primaires, 3 indicateurs secondaires et 11 indicateurs de contexte.
Les indicateurs européens de l'inclusion sociale
|
N° |
Indicateur |
Définition |
||
|
Indicateurs primaires |
||||
|
SI-P1 |
Taux de risque de pauvreté
47
(
*
)
(i.e taux de bas revenus)
|
Pourcentage de personnes vivant dans des ménages dont le revenu équivalent (sur la base de l'échelle de l'OCDE modifiée) est inférieur à 60 % de la médiane |
||
|
SI-P2 |
Taux de persistance du risque de pauvreté |
Part des ménages dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté à 60 % dans l'année courante et au moins 2 années sur les trois années précédentes |
||
|
SI-P3 |
Intensité de la pauvreté |
Ecart entre le revenu médian des personnes se situant en dessous du seuil de bas revenu et ce seuil de bas revenu |
||
|
SI-P4 |
Taux de chômage de longue durée |
Part des chômeurs de plus d'un an au sens du BIT au sein de la population active |
||
|
SI-P5 |
Personnes vivant dans des ménages sans emploi |
Proportion d'individus vivant dans des ménages sans emploi dans la population totale du même âge (0-17 ans ; 18-59 ans) hors étudiants |
||
|
SI-P6 |
Jeunes quittant prématurément l'école et ne poursuivant pas d'études ou une formation quelconque |
Part des 18-24 ans ayant un bas niveau d'éducation (= 2 selon la classification internationale type de l'éducation -CITE- de l'UNESCO) et ne poursuivant aucune études ou formation |
||
|
SI-P7 |
Écart de taux d'emploi entre personnes immigrées et non immigrées |
Écart en points de pourcentage entre le taux d'emploi des non immigrés et celui des immigrés |
||
|
SI-P8 |
Indicateur de privation matérielle |
En cours de développement |
||
|
SI-P9 |
Logement |
En cours de développement |
||
|
SI-P10 |
Besoins de santé non satisfaits |
En cours de développement |
||
|
SI-P11 |
Bien-être des enfants |
En cours de développement |
||
|
Indicateurs secondaires |
||||
|
SI-S1 |
Taux de risque de pauvreté détaillé par tranches d'âge |
Pourcentage de personnes vivant dans des ménages dont le revenu équivalent est inférieur à 60 % de la médiane pour les 0-17 ; 18-24 ; 25-54 ; 55-64 ; +65 ans. |
||
|
SI-S1a |
Taux de risque de pauvreté par type de ménages |
Taux de risque de pauvreté en fonction de la taille et de la composition du ménage |
||
|
SI-S1b |
Taux de risque de pauvreté en fonction de l'intensité de travail des ménages |
L'intensité de travail des ménages se mesure en divisant le nombre de mois travaillés (par les membres du ménage d'âge actif) par le nombre de mois théoriquement « travaillables ». |
||
|
SI-S1c |
Taux de risque de pauvreté selon le statut d'activité |
Le statut d'activité (emploi ; chômage ; retraité ; inactif) est celui déclaré par les individus plus de la moitié de l'année de référence. |
||
|
SI-S1d |
Taux de risque de pauvreté selon le statut d'occupation du logement |
Propriétaire ou loyer gratuit / locataire |
||
|
SI-S1e |
Dispersion autour du seuil de risque de pauvreté |
Nombre de personnes vivant dans des ménages dont le revenu équivalent est inférieur à 40 %, 50 %, et 70 % du revenu médian national équivalent |
||
|
SI-S2 |
Personnes ayant un faible niveau d'études |
Proportion de la population adulte ( > 25 ans) dont le niveau d'éducation est = 2 selon la classification internationale type de l'éducation -CITE- de l'UNESCO) |
||
|
SI-S3 |
Performance en lecture des élèves |
Proportion des élèves de 15 ans dont les performances en lecture sont = 1 dans l'enquête PISA (programme international pour le suivi des acquis des élèves) de l'OCDE. |
||
|
Indicateurs de contexte |
||||
|
SI-C1 |
S80/S20 |
Rapport inter-quintiles de revenus |
||
|
SI-C2 |
Coefficient de Gini |
|||
|
SI-C3 |
Cohésion régionale |
Dispersion des taux d'emploi régionaux |
||
|
SI-C4 |
Espérance de vie à la naissance et espérance de vie en bonne santé |
|||
|
SI-C5 |
Taux de risque de pauvreté ancré dans le temps |
Proportion de personnes sous le seuil de risque de pauvreté de l'année n-3 augmenté par le facteur d'inflation sur les 3 années |
||
|
SI-C6 |
Taux de risque de pauvreté avant transferts sociaux (hors retraites) |
|||
|
SI-C7 |
Taux de ménages sans emploi par type de ménages |
|||
|
SI-C8 |
Taux de risque de pauvreté au travail |
En distinguant travail à temps plein et travail à temps partiel |
||
|
SI-C9 |
Incitation financière au travail |
Trappes à chômage, à inactivité et à bas salaires |
||
|
SI-C10 |
Revenu des ménages vivant uniquement de prestations sociales en % du seuil de risque de pauvreté |
|||
|
SI-C11 |
Restrictions d'activité dans la vie quotidienne |
|||
Source : Commission européenne (rapport sur les indicateurs en date du 7 juin 2006)
b) Des indicateurs à compléter
Le portefeuille d'indicateurs relatif à l'inclusion sociale met l'accent sur des indicateurs relatifs de pauvreté monétaire . Cette orientation était justifiée ainsi 48 ( * ) :
« Une notion absolue est moins pertinente pour l'UE, essentiellement pour deux raisons. En premier lieu, le principal défi posé à l'Europe est de permettre à l'ensemble de la population de partager les bénéfices d'une prospérité moyenne élevée, et non d'atteindre des niveaux de vie élémentaires comme dans certaines parties moins développées du monde. Ensuite, ce qui peut être considéré comme un niveau de vie acceptable dépend largement du niveau de développement social et économique général, qui présente des différences considérables selon les pays ».
L'élargissement à douze nouveaux États membres invalide au moins partiellement ce constat, qui était déjà intrinsèquement contradictoire, puisqu'il soulignait l'existence de disparités de développement à l'intérieur de l'UE. Les taux de pauvreté monétaire ne suffisent pas à refléter la diversité des conditions de vie entre États membres, notamment entre les 15 « anciens » et des douze « nouveaux ».
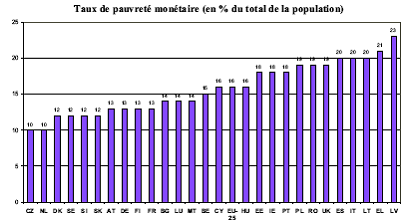
|
AT Autriche ; BE Belgique ; BG Bulgarie ; CY Chypre ; CZ République tchèque ; DE Allemagne ; DK Danemark ; EE Estonie ; EL Grèce ; ES Espagne ; FI Finlande ; FR France ; HU Hongrie ; IE Irlande ; IT Italie ; LU Luxembourg ; LV Lettonie ; LT Lituanie ; MT Malte ; NL Pays-Bas ; PL Pologne ; PT Portugal ; RO Roumanie ; SE Suède ; SI Slovénie ; SK Slovaquie ; UK Royaume-Uni |
Source : SILC 2006, données 2005
Les taux de pauvreté monétaires sont très similaires dans les anciens et les nouveaux États membres. La République tchèque, la Slovénie et la Slovaquie sont ainsi parmi les États les plus égalitaires de l'Union, avec des taux de pauvreté monétaire inférieurs au taux français. Les Etats baltes et la Roumanie figurent au contraire parmi les plus inégalitaires, au même titre que la Grèce, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni.
La diversité des situations est mieux reflétée par des indicateurs de privation matérielle : ainsi, en 2003, la proportion de la population ne pouvant pas s'offrir un repas composé de viande ou de poisson tous les deux jours si elle le souhaite se situe autour de 30 % dans quatre 49 ( * ) des dix nouveaux États membres ayant adhéré en 2004, la moyenne de l'UE-15 étant de 4 %. En France, ce taux est de 2 %.
La mise en place du projet SILC (statistiques sur le revenu et les conditions de vie) , pour succéder au panel communautaire des ménages, ouvre des perspectives pour l'évaluation du degré de privation matérielle et donc pour une meilleure connaissance des aspects non monétaires de la pauvreté. SILC vise à fournir deux types de données :
- des données transversales (pour une année donnée) sur le revenu et les conditions de vie ;
- des données longitudinales (sur plusieurs années pour un même individu) permettant d'appréhender des évolutions dans le temps.
Lancé en 2003 sur la base d'un règlement 50 ( * ) , le projet SILC a conduit l'INSEE à réviser ses enquêtes permanentes sur les conditions de vie, créant une rupture puisque les données ne sont pas comparables. Toutefois, des désaccords persistent entre Etats membres, notamment concernant le mode d'agrégation des données de privation issues de SILC.
Ces désaccords conduisent à une prise en compte insuffisante de la dimension non monétaire de la pauvreté au niveau européen, alors même que cet aspect est essentiel dans la définition que le conseil européen donnait de la pauvreté en 1984 :
« Des personnes vivent dans des situations de pauvreté si leur revenu et leurs ressources (matérielles, culturelles et sociales) sont à ce point insuffisantes qu'elles les empêchent d'avoir des conditions de vie considérées comme acceptables dans le pays où elles vivent . »
Certes le taux de pauvreté monétaire est un outil d'analyse indispensable, mais, comme le souligne la terminologie européenne (« taux de risque de pauvreté »), il constitue davantage un indice du risque de pauvreté qu'un taux de pauvreté avérée .
Il doit être complété par des indicateurs de conditions de vie, et par des informations concernant l'accès à des éléments de bien-être et à des ressources fondamentales telles que le logement, l'éducation, l'accès aux services de santé.
2. Les grilles de lecture en France
De nombreux travaux ont été menés en France pour la construction d'indicateurs de pauvreté et d'exclusion. Il existe ainsi plusieurs grilles de lecture , avec de nombreux indicateurs communs , mais des objectifs différents .
a) Les indicateurs généraux
L'Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion sociale (ONPES) a réalisé un tableau de bord d'indicateurs dits « centraux », à l'usage des acteurs politiques et sociaux. Par ailleurs, le CNIS a récemment proposé de compléter les données disponibles et de les insérer au sein d'un véritable système d'information sur les inégalités.
Un socle de 11 indicateurs de pauvreté a été défini par l'ONPES.
Il met l'accent sur les indicateurs monétaires de pauvreté, complétés par un indicateur de difficultés d'existence et par des données relatives aux minima sociaux et à l'accès aux ressources fondamentales.
Les onze indicateurs « centraux » retenus par l'ONPES
Tous les indicateurs sont exprimés en pourcentage. Ils ne concernent que la France métropolitaine
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
|
Pauvreté |
||||||||||||
|
Taux de pauvreté : part des individus dans la population globale vivant dans un ménage au revenu inférieur à 60% de la médiane |
13,5 |
13,4 |
12,8 |
12,3 |
12,7 |
12,4 |
12,2 /12,0* |
12,0 |
11,7 |
12,1 |
||
|
dont : part des individus dans la population globale vivant dans un ménage dont le revenu est inférieur à 50% de la médiane |
7,2 |
6,9 |
6,7 |
6,4 |
6,5 |
6,1 |
6,0 /5,9* |
6,3 |
6,2 |
6,3 |
||
|
Intensité de la pauvreté (écart entre le revenu médian des ménages pauvres et le seuil de pauvreté à 60% de la médiane) |
18,3 |
17,3 |
17,2 |
17,2 |
17,1 |
16,5 |
16,2 /16,3* |
17,7 |
18 |
18,2 |
||
|
Taux de pauvreté de la population en emploi : part des individus en emploi vivant dans un ménage dont le revenu est inférieur à 60% de la médiane |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
8 |
5,3* |
6,1 |
6,4 |
|||
|
Taux de difficultés de conditions de vie |
13,1 |
12,0 |
11,9 |
12,1 |
11,6 |
11,9 |
11,4 |
10,6 / 14,7* |
13,3 |
12,7 |
||
|
Minima sociaux |
||||||||||||
|
Évolution du nombre d'allocataires de minima sociaux d'âge actif (RMI, AAH, API, ASS+AER à partir de 2002) |
5,2 |
1,9 |
2,6 |
1,8 |
-3,4 |
-1,6 |
0,7 |
3,2 |
4,9 |
4,6 |
0,5 |
|
|
Persistance des allocataires dans le RMI (supérieure à 3 ans) |
35,4 |
37,5 |
39,4 |
40,7 |
43,2 |
47,2 |
48,9 |
48,7 |
47,0 |
44,9 |
44,5 |
46,1 |
|
Non accès aux droits fondamentaux |
||||||||||||
|
Taux de renoncement aux soins pour raisons financières |
17,0 |
14,0 |
14,0 |
15,7 |
11,2 |
13 |
||||||
|
Taux de sortants du système scolaire à faible niveau d'études |
15,4 |
15,2 |
14,1 |
14,9 |
14,7 |
13,3 |
13,5 |
13,4 |
12,7 |
13,4 |
12,6 |
13,1 |
|
Taux de demandeurs d'emploi non indemnisés (RAC et ASS) |
43,4 |
44,7 |
46,4 |
46,24 |
46,2 |
44,3 |
39,9 |
36,5 |
36,1 |
37,7 |
40,5 |
40,3 |
|
Part des demandes de logement social non satisfaites après un an |
35,3 |
33,6 |
45,8** |
|||||||||
|
Inégalités de revenu |
||||||||||||
|
Rapport inter-déciles des revenus |
3,35 |
3,34 |
3,26 |
3,23 |
3,27 |
3,23 |
3,2 |
3,17 |
3,14 |
3,15 |
||
*Nouvelle valeur (en raison d'une rupture de série,
explications p. suivante) ** Rupture de série en 2006 :
données non comparables à 2002 (modification du
questionnaire).
Source : ONPES
Dans son rapport précité, le groupe de travail du CNIS sur les niveaux de vie et les inégalités sociales demande la mise en place d'une publication centrale annuelle sur les inégalités, qualifiée de véritable « système d'information ».
Ce système d'information comporterait notamment une cinquantaine d'indicateurs de base, définis par le CNIS, concernant les revenus, le patrimoine, les salaires, l'emploi, l'éducation, le logement, la santé. D'autres indicateurs sont suggérés concernant notamment la culture, la justice... ou encore la participation des femmes à la vie politique, pour laquelle le groupe de travail suggère comme indicateur unique le ratio « nombre d'hommes au Sénat / nombre de femmes »...
L'analyse de la pauvreté ne constitue qu'un aspect de ce travail qui porte, plus généralement, sur la mise en évidence d'inégalités de toutes sortes.
b) Les indicateurs d'efficacité des politiques
Les plans triennaux d'action , présentés dans le cadre de la méthode ouverte de coordination européenne (cf. supra ) donnent lieu à la présentation par le gouvernement de nombreux indicateurs de pauvreté et d'exclusion.
Par ailleurs, le projet de loi de finances est l'occasion de rendre compte annuellement de l'efficacité et de l'efficience des politiques menées, c'est-à-dire d'évaluer les résultats obtenus non seulement par rapport aux objectifs fixés mais également au regard des moyens engagés.
Dans le cadre du plan national d'action pour l'inclusion sociale (PNAI) , la France s'est engagée pour trois ans (2006-2008) sur des objectifs prioritaires :
- l'accès et le retour à l'emploi ;
- l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ;
- le développement de l'offre de logement.
Ce plan est accompagné d'une annexe statistique qui comporte notamment les indicateurs généraux de résultat définis par le sous-groupe « indicateurs » du Comité de protection sociale 51 ( * ) . Ces indicateurs sont complétés d'une part par le tableau de bord de 11 indicateurs centraux retenus par l'ONPES (voir ci-après), et d'autre part, par des indicateurs relatifs aux priorités nationales précitées.
Dans le cadre du projet de loi de finances présenté chaque année, un document de politique transversale 52 ( * ) (DPT) retrace l'ensemble des objectifs et indicateurs des programmes du budget de l'État, concourant aux politiques de lutte contre l'exclusion. Ce DPT reprend les trois axes précités du PNAI, et y ajoute un quatrième axe relatif à l'amélioration de la gouvernance, de la transparence et de la participation des parties intéressées à la conception et à l'exécution des politiques.
Pour chaque axe, les thématiques privilégiées sont :
- la réduction de la pauvreté, dont celle des enfants ;
- l'insertion des jeunes ;
- la lutte contre l'illettrisme ;
- l'éradication de l'habitat insalubre ;
- l'amélioration de l'accès à la santé et aux soins.
Les indicateurs du DPT doivent rendre compte de l'impact des politiques d'inclusion sociale . Ils sont donc conçus comme des indicateurs de résultat. S'agissant plus précisément de l'évaluation de la pauvreté, les indicateurs retenus sont par exemple :
- l'intensité de la pauvreté ;
- le pourcentage des allocataires de minima sociaux (RMI, API, ASS) retournant à l'emploi ;
- le pourcentage d'enfants vivant en situation de précarité ;
- le pourcentage de jeunes insérés dans un emploi durable (CDI) à 25 ans révolus ;
- le nombre de logements sortis de l'indignité ;
- la part des personnes sortant des CHRS bénéficiant d'une insertion en matière de logement ou d'emploi.
Les indicateurs du PNAI et du DPT ont vocation à être complétés ou modifiés lorsque seront achevés les travaux actuellement en cours dans le cadre de l' « engagement national » conduit par M. Martin Hirsch, Haut-Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, visant à « réduire d'un tiers la pauvreté en France en cinq ans ».
L'indicateur central adopté ici est, comme il a été indiqué plus haut, celui de pauvreté ancrée dans le temps , qui constitue un compromis entre approches relatives et absolues. Il faut en effet conserver à l'esprit :
- d'une part que la baisse de cet indicateur est une tendance historique lourde ;
- et d'autre part que le suivi de ce seul indicateur pourrait dissimuler d'autres évolutions , s'agissant notamment des inégalités au sein de la population pauvre et de la situation des plus démunis, qui est mal reflétée par les indicateurs existants.
Plutôt que de communiquer sur un seul indicateur, il semble plus logique de se référer à une grille de lecture plus étendue . Le projet d'engagement national pour réduire d'un tiers la pauvreté prévoit d'ailleurs que plusieurs indicateurs soient associés à l'indicateur central en sorte d'éviter de n'avoir les yeux rivés que sur un objectif, ce qui pourrait avoir des « effets pervers » sur d'autres signaux. Il est donc prévu de mettre aussi l'accent sur l'intensité de la pauvreté , afin de vérifier que la diminution de la pauvreté ne s'accompagnera pas d'une dégradation de la situation de ceux qui ont les ressources les plus faibles. Il est également prévu de rendre compte du caractère multidimensionnel de la pauvreté, grâce à des indicateurs relatifs à l'emploi, à l'éducation, à la santé et au logement.
*
* *
Le choix d'indicateurs adéquats pour la mesure de la pauvreté et de l'exclusion sociale n'est pas une simple question technique ; en effet, ce choix est le reflet des objectifs prioritaires assignés à une politique. Il induit par ailleurs des stratégies et une allocation des moyens susceptibles de faire évoluer le « thermomètre » choisi dans le sens souhaité.
Aux plans européen et français, l'accent a été mis, de façon jugée trop prononcée par certains, sur les aspects monétaires de la pauvreté, dans une perspective relative, c'est-à-dire par la mesure des inégalités. Pour intéressante qu'elle soit, cette analyse est nécessairement incomplète.
D'un point de vue statistique, l'approche par les revenus fiscaux comporte certains défauts de mesure, notamment une prise en compte lacunaire des revenus du patrimoine. Des rapprochements entre bases de données fiscales et sociales sont par ailleurs nécessaires, afin d'améliorer l'exactitude d'une enquête dont beaucoup d'éléments sont encore fondés sur des imputations, c'est-à-dire déduits de barèmes ou d'équations économétriques. Ce rapprochement, parallèlement à une augmentation de la taille de l'échantillon ERF, pourra permettre de mieux analyser les inégalités :
- d'une part, en donnant une meilleure idée de leurs causes , ou du moins des phénomènes directement corrélés (emploi, logement, éducation, accès à la culture, etc.), permettant de passer du constat à l'action de la façon la plus appropriée ;
- d'autre part, de mener ce type d'analyse y compris au plan local . La place des collectivités, notamment du département, dans les politiques sociales justifierait l'existence d'indicateurs locaux de niveaux de vie ; or ceux-ci seraient, en l'état actuel de l'échantillon ERF, insuffisamment fiables.
Dans cette double perspective, le suivi longitudinal, mis en place depuis 2004 dans le cadre européen SILC, doit permettre d'améliorer la connaissance des trajectoires des individus, afin d'identifier le plus précisément possible le processus de cumul de difficultés, qui conduit à une mise à l'écart sur un plan social. Dans ce cadre, il faudrait s'attacher à mettre en évidence les stades auxquels il serait le plus approprié d'agir .
Au-delà de cette amélioration de la connaissance des inégalités et de leur processus de formation, il est également nécessaire de renforcer l'approche qualitative de la pauvreté, notamment en ce qui concerne les conditions de vie . Des comparaisons européennes pourraient être utiles, mais elles se heurtent à l'hétérogénéité des méthodes, cet aspect demeurant marginal dans la grille de lecture européenne. A l'échelle nationale, l'attention est focalisée sur le taux de pauvreté monétaire relatif ou « ancré dans le temps ». Faisant l'objet de peu de communication, le taux de pauvreté par les conditions de vie semble négligé. Or un recoupement plus systématique entre indicateurs monétaires et indicateurs de conditions de vie serait susceptible de fournir des informations intéressantes, malgré les lacunes inhérentes à chacune de ces mesures.
Enfin, et paradoxalement, la très grande pauvreté est mal connue, alors même qu'elle en constitue l'aspect le plus aigu et celui qui vient sans doute le plus communément à l'esprit à l'évocation de ces questions de pauvreté et d'exclusion. La très grande pauvreté demeure un indéfini sur le plan statistique . Cette situation peut être améliorée, d'autant que l'évolution du taux de pauvreté monétaire nous dit peu de chose concernant cette dimension particulière. S'agissant de la prise en compte des sans-domicile, le récent rapport de l'IGAS a suggéré des pistes relatives notamment à une meilleure articulation des sources statistiques existantes. Il serait très utile à la connaissance du sujet, qu'en partenariat avec les associations, il soit possible de définir un certain nombre d'indicateurs d'alerte, plus qualitatifs que les indicateurs existants et susceptibles d'être mesurés et publiés dans des délais plus brefs.
|
La mesure de la pauvreté et de
l'exclusion :
- Continuer le travail d'enrichissement de l'enquête revenus fiscaux afin que tous les revenus monétaires y soient pris en compte, notamment en rapprochant les bases de données fiscales et sociales actuellement disjointes ; - Élargir l'échantillon de cette enquête afin que soient connues de façon plus fiable les conditions de vie au plan local, et pour établir précisément les corrélations existant entre pauvreté, emploi, logement, éducation, etc. ; - Mieux connaître l'impact des politiques sociales locales sur les niveaux de vie ; - Améliorer la connaissance des trajectoires qui mènent à la pauvreté et à la persistance dans la pauvreté (suivi longitudinal) ; - Encourager une meilleure prise en compte, au plan européen, des dimensions qualitatives de la pauvreté, s'agissant notamment des difficultés en termes de conditions de vie ; - Encourager aussi, au plan européen, le calcul de variantes afin que l'ensemble des aspects des politiques fiscales et de redistribution puissent être pris en compte dans le calcul des niveaux de vie (notamment l'impact des services publics collectifs individualisables et des aides locales) ; - Améliorer la connaissance de la très grande pauvreté, en suivant notamment les préconisations de l'IGAS sur la coordination de l'observation statistique des personnes sans abri ; - Définir des indicateurs d'alerte publiables rapidement, afin de pouvoir infléchir les politiques conduites sur le fondement de remontées d'expériences des acteurs de terrain ; - Communiquer, non pas sur un indicateur central unique (la pauvreté ancrée dans le temps) mais de préférence sur un ensemble réduit d'indicateurs ; - Ne pas multiplier les grilles de lecture. |
TITRE II - PRIVILÉGIER LES POLITIQUES PRÉVENTIVES ET GLOBALES POUR GARANTIR L'ACCÈS DE TOUS AUX DROITS DE TOUS
Le phénomène de pauvreté se caractérise d'abord par l'insuffisance de moyens matériels et financiers (pauvreté monétaire), que l'on mesure en référence à la définition du seuil de pauvreté européen, fixé, en 2005, à 817 euros, soit 60 % du revenu médian.
Selon l'intensité du phénomène 53 ( * ) , sa persistance dans la durée 54 ( * ) , la pauvreté peut se traduire par une altération durable des conditions de vie et par des difficultés d'accès à des éléments fondamentaux ou de bien-être, tels que le logement, l'éducation, les soins ou la culture, qui conduisent les personnes à une situation d'exclusion.
Cette approche traduit assez fidèlement la définition de la pauvreté proposée par le père Joseph Wresinski, fondateur de l'association ATD Quart - Monde, dans le rapport « Grande pauvreté et précarité économique et sociale », présenté au Conseil économique et social (CES) en 1987 et qui précise que « la précarité est l'absence d'une ou de plusieurs sécurités , notamment celles de l'emploi, permettant aux personnes et aux familles d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de leurs droits fondamentaux. L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. »
Cette définition, qui associe les notions de « sécurité » et de pauvreté, rejoint celle de l'économiste Amartya Sen, selon lequel la pauvreté résulte de la « perte durable de sécurités ». Les responsables d'ATD Quart - Monde, auditionnés par la mission 55 ( * ) , ont également souligné le lien indissociable qui existe entre grande pauvreté et perte des droits fondamentaux, dont l'interdépendance et l'indivisibilité ont été érigées en principes par une communication du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies 56 ( * ) . Le texte rappelle que l'exercice de ces droits conditionne l'élimination de la pauvreté et que « le rétablissement d'un droit pris isolément n'est pas une condition suffisante » .
De ces deux principes, découle la préférence pour des politiques globales, plutôt que sectorielles, visant le rétablissement simultané de l'ensemble des droits fondamentaux, afin de redonner aux individus leur dignité et d'enrayer la spirale négative qui conduit à l'exclusion sociale. Ces politiques, qui interviennent en aval des phénomènes de pauvreté et d'exclusion sociale, ne sont donc que curatives ou palliatives .
Toutefois, la plupart des personnes auditionnées l'ont souligné, si ces politiques sont indispensables, elles doivent s'accompagner de politiques de prévention , permettant d'intervenir en amont, afin d'interrompre le continuum qui existe entre précarité et grande pauvreté. Cette idée inspirait déjà l'article premier de la loi du 29 juillet 1998 57 ( * ) relative à la lutte contre les exclusions qui préconisait la mise en oeuvre de politiques destinées à « connaître, prévenir et supprimer toutes les situations pouvant engendrer l'exclusion » ; dans un rapport plus récent 58 ( * ) , le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (CNLE) recommandait le développement d'une « culture de la prévention ».
Ces politiques, encore peu développées, supposent tout d'abord une connaissance des situations de pauvreté et d'exclusion et de leurs causes . Elles consistent ensuite à mettre en place un système d'alertes multiples , qui doit permettre aux acteurs publics d'anticiper et d'intervenir au plus tôt pour prévenir la dégradation des conditions de vie des populations les plus fragiles. Enfin, il s'agit d' intégrer au sein des politiques de droit commun (éducation, emploi, logement, santé...) des éléments propres à sécuriser les parcours des personnes tout au long de la vie .
Dans cette perspective, les politiques d'insertion ne sont plus « le dernier maillon de la chaîne qui doit supporter les insuffisances des autres politiques publiques » 59 ( * ) .
Les développements ci-après tendront d'abord à mettre en évidence le caractère multidimensionnel de la pauvreté et de l'exclusion, qui touchent, à des degrés divers, différentes catégories de la population et se traduisent notamment par des obstacles ou difficultés d'accès à certains droits fondamentaux. On montrera ensuite que les politiques mises en oeuvre pour pallier ces situations, si elles ont permis d'obtenir quelques résultats encourageants, présentent un bilan contrasté, qui justifie l'élaboration de politiques nouvelles, à la fois globales et préventives, et qui s'inscrivent dans la continuité des mesures qui ont été prises ces dernières années en faveur d'une insertion durable.
I. UN ACCÈS ENCORE DIFFICILE AUX DROITS FONDAMENTAUX POUR LES PERSONNES LES PLUS VULNÉRABLES
L'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale (ONPES) présente chaque année un rapport, qui dépeint de façon précise la situation de la pauvreté et de l'exclusion sociale en France ainsi que les réalités contrastées qu'elle recouvre.
Dans son dernier rapport 60 ( * ) , l'ONPES a identifié les catégories les plus fragiles de la population et mis en évidence une dégradation de la situation des plus pauvres et de leurs conditions de vie, ainsi que des difficultés croissantes d'accès à certains droits , tels que le logement, la santé ou l'éducation.
A. LA PAUVRETÉ TOUCHE LES CATÉGORIES LES PLUS FRAGILES DE LA POPULATION
En 2005, 7,1 millions de personnes vivaient au-dessous du seuil européen de pauvreté de 817 euros, soit 12,1 % de la population française et 3,7 millions disposaient de revenus inférieurs à 681 euros (50 % du niveau de vie médian), soit 6,3 % de la population totale. Si le taux de pauvreté reste relativement stable, l'intensité de la pauvreté s'accroît , l'écart entre le revenu médian des ménages pauvres et le seuil de pauvreté atteignant, en 2005, 18,2 %.
Une étude approfondie des publics concernés montre que le risque de pauvreté est accru pour les allocataires de minima sociaux, les chômeurs, les titulaires d'un emploi précaire, les personnes isolées ou les chefs de familles monoparentales. Enfin, on observe une concentration des phénomènes de précarité à la périphérie des grandes villes et dans les zones urbaines sensibles (ZUS).
1. Une part de personnes pauvres importante parmi les bénéficiaires de minima sociaux
a) Les minima sociaux visent à garantir aux personnes qui les perçoivent un revenu minimum
Le système de solidarité nationale compte, encore aujourd'hui, neuf minima sociaux. Il s'agit de prestations non contributives, versées sous condition de ressources et visant à assurer un revenu minimum aux personnes qui, temporairement ou durablement, ne sont pas en mesure de vivre des revenus de leur activité.
Ces allocations diffèrent selon les publics qu'elles visent (personnes âgées ou familialement isolées, personnes handicapées ou exclues du monde du travail) et les inégalités qu'elles entendent corriger. Leurs conditions d'accès, leurs modalités de calcul et de versement variant sensiblement, il en résulte des situations très hétérogènes pour les plus de 3,5 millions de bénéficiaires . Si l'on inclut les conjoints et les enfants, on estime à environ 6,4 millions le nombre de personnes qui dépendent des revenus de la solidarité nationale .
Entre 2005 et 2006, le nombre de bénéficiaires de minima sociaux a globalement diminué de 0,3 %. Cette baisse , particulièrement significative pour les allocataires du RMI depuis 2006, s'est confirmée en 2007, atteignant 6,6 % entre 2007 et 2008. On peut s'inquiéter en revanche de la dégradation du taux de maintien des allocataires dans le RMI 61 ( * ) (correspondant à une perception de ce revenu depuis plus de trois ans), qui atteint, en 2006, 46,1 %, soit 1,6 point de plus qu'en 2005.
L'augmentation du nombre d'allocataires de minima sociaux d'âge actif 62 ( * ) (RMI, AAH, API, ASS, AER) s'est en revanche poursuivie en 2006, mais s'est limitée à 0,5 % contre 4,9 % et 4,6 % en 2004 et en 2005.
b) Les minima sociaux offrent des revenus inférieurs au seuil de pauvreté
Par construction, les montants de la plupart des minima sociaux se situant au-dessous du seuil de pauvreté, il est logique que leurs bénéficiaires représentent la part la plus importante des personnes pauvres .
Ainsi, un tiers des ménages pauvres (seuil de 60 %) perçoit un minimum social. Au seuil de 50 %, cette proportion atteint près d'un ménage sur deux.
|
Part des ménages bénéficiaire de
minima sociaux
|
|||||
|
(en %) |
|||||
|
Minima sociaux |
RMI |
API |
Minimum vieillesse |
AAH |
|
|
Seuil de pauvreté 60 % |
34,5 |
22,0 |
2,1 |
7,9 |
3,1 |
|
Seuil de pauvreté 50 % |
47,4 |
36,5 |
1,3 |
7,6 |
2,5 |
|
Lecture : 7,9 % des ménages pauvres (au sens européen) ont au moins un membre qui perçoit le minimum vieillesse. |
|||||
|
Champ : Ensemble des ménages pauvres dont la personne de référence n'est pas étudiante. |
|||||
|
Source : Insee-DGI, ERF, 2005 |
|||||
|
LES MINIMA SOCIAUX EN FRANCE |
||||
|
Minimum social |
Personnes ciblées |
Barèmes mensuels au 1 er janvier 2008 (en euros) |
2006 |
Evolution 2005/2006 (en %) |
|
Revenu minimum d'insertion (RMI) ou RSO (revenu de solidarité Dom) |
Personne de vingt-cinq ans et plus ne disposant d'aucune autre prestation de solidarité. |
Plafond de ressources et allocation
garantie :
|
1 278 800 |
- 0,8 |
|
11 000 |
+ 10,3 |
|||
|
Allocation de parent isolé (API) |
Personnes isolées assumant seules la charge d'un ou plusieurs enfants |
Plafond de ressources et allocation garantie :
|
217 500 |
+ 5,5 |
|
Allocation de solidarité spécifique (ASS) |
Chômeurs ayant épuisé leurs droits à l'assurance chômage et justifiant d'au moins cinq ans d'activité salariée au cours des dix dernières années précédant la rupture de leur contrat de travail |
Plafond de ressources :
Dans la limite de ces plafonds de ressources, l'allocation versée est de : 448,34 € au taux normal, 643,62 € au taux majoré |
393 200 |
- 2,1 |
|
Allocation d'insertion(1) (AI)
|
Détenus libérés, personnes en attente de réinsertion, rapatriés, réfugiés et demandeurs d'asile |
Plafond de ressources : ATA : montant du RMI selon composition familiale. Ds la limite de ce plafond, le montant de l'allocation versée est de : 315,73 € |
22 500 |
- 34,9 |
|
Allocation équivalent retraite (AER) |
Chômeurs de moins de soixante ans totalisant déjà 160 trimestres de cotisation à l'assurance vieillesse |
Plafond de ressources : Personne seule : 1 527,36 €, Couple : 2 195,58 €. Dans la limite de ces plafonds, l'allocation versée est de : 967,86 € |
60 100 |
44,8 |
|
Allocation supplémentaire vieillesse ASV/ASPA |
Personnes âgées de plus de soixante-cinq ans (soixante ans en cas d'inaptitude au travail) disposant de droits nuls ou très faibles à l'assurance vieillesse |
Plafond de ressources :
Allocation garantie :
|
599 400 |
- 1,6 |
|
Allocation supplémentaire d'invalidité (3) |
Personnes titulaires d'une pension d'invalidité de très faible montant, servie par la sécurité sociale au titre d'une incapacité permanente |
111 400 |
- 1,1 |
|
|
Allocation aux adultes handicapés (AAH) |
Personnes handicapées qui ne peuvent prétendre ni à un avantage invalidité, ni à une rente d'accident du travail |
Plafond de ressources : célibataires : 628,10 € par mois. Couple : 1256,20 € par mois +314,05 € par enfant à charge. Alloc. garantie : 628,10 €. Complément d'ATA : 100,50 € |
804 000 |
0,4 |
|
Allocation veuvage (5) |
Conjoints survivants d'assurés sociaux décédés |
Plafond de ressources : 693,87 €
|
6 100 |
- 7,5 |
|
Ensemble des minima sociaux |
3 503 900 |
- 0,3 |
||
|
(1) Supprimée par la loi de finances pour 2006 et remplacée par l'allocation temporaire d'attente (ATA). |
||||
|
(2) Montant de l'ATA, qui est versée sous condition de ressources aux demandeurs d'asile pendant la durée de la procédure d'instruction de leur demande, lorsqu'ils ne peuvent accéder à des revenus de remplacement du travail ou à d'autres minima sociaux. |
||||
|
(3) A partir du 14 janvier 2007, l'allocation de solidarité aux personnes âgées et l'allocation supplémentaire d'invalidité remplacent les diverses prestations constitutives du minimum vieillesse. |
||||
|
(4) Majoration pour la vie autonome. |
||||
|
(5) La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a supprimé cette allocation qui est en voie d'extinction progressive. |
||||
c) Une faible revalorisation des minima sociaux par rapport au Smic
Une telle situation conduit à se poser la question de la revalorisation des minima sociaux. Depuis 1998, le pouvoir d'achat des principaux minima sociaux d'âge actif (RMI, API, ASS et AAH) a connu une évolution relativement stable, s'appréciant de 1,3 % pour l'AAH à environ 2,7 % pour le RMI et l'ASS. Seuls les bénéficiaires de l'API ont subi une dépréciation de leur pouvoir d'achat (- 0,7 %) sur la même période.
|
Evolution du pouvoir d'achat
|
||||
|
(Base 100 en 1998) |
||||
|
RMI |
API |
ASS |
AAH |
|
|
1990 |
99,3 |
100,5 |
98,9 |
96,6 |
|
1998 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
2007 |
102,7 |
99,3 |
102,6 |
101,3 |
|
Source : Cnaf, Drees |
||||
Dans le même temps, le pouvoir d'achat du Smic s'étant apprécié de 5,6 %, il en résulte une diminution du niveau relatif des minima sociaux par rapport au salaire minimum . Ainsi, le RMI, qui représentait 48,7 % du Smic en 1990, n'en vaut plus que 44,3 % en 2007.
|
Evolution des principaux minima sociaux d'âge actif relativement au Smic |
||||
|
(en %)* |
||||
|
RMI |
API |
ASS |
AAH |
|
|
1990 |
48,7 |
64,9 |
48,6 |
67,8 |
|
1998 |
45,6 |
60,0 |
45,6 |
65,1 |
|
2007 |
44,3 |
56,4 |
44,3 |
62,4 |
|
(*) : Smic mensuel 39 heures jusqu'en 2001 et Smic mensuel 35 heures à partir de 2006 net de prélèvements (cotisations sociales, CSG, CRDS), en moyenne annuelle. |
||||
|
Source : Cnaf, Drees |
||||
Doit-on pour autant revaloriser tous les minima sociaux pour sortir de la pauvreté l'ensemble des bénéficiaires ? Cette question doit être envisagée avec prudence, la mesure de la pauvreté ne permettant pas encore, à ce stade, de prendre en compte l'ensemble des prestations et aides que perçoivent les allocataires de minima sociaux, et notamment les aides locales. La plupart des allocataires bénéficient en effet de prestations ou droits connexes (aides au logement, couvertures maladie universelle et complémentaire, exonérations d'impôts, tarifications sociales, etc.), qui complètent le revenu minimum et permettent souvent d'approcher ou de dépasser le seuil de pauvreté européen.
d) Plus de la moitié des personnes vivant dans un ménage bénéficiaire de minima sociaux ne sont pas pauvres
Cette réalité explique d'ailleurs en partie que plus de la moitié des personnes vivant dans un ménage dont l'un des membres touche un minimum social ne soit pas considérée comme pauvre au sens européen.
Outre la présence de prestations ou aides complémentaires, l'autre explication réside dans le fait que le revenu minimum d'un ménage peut être associé à un revenu d'activité (conjoint ou jeune de moins de 25 ans en activité resté au foyer) ou à des prestations supplémentaires liées à la présence d'enfants notamment (prestations familiales ou minima majoré par part supplémentaire) qui permettent de franchir le seuil de pauvreté.
|
Individus pauvres (au seuil de 60 %) vivant dans
un ménage
|
|||||
|
Minima sociaux |
RMI |
API |
Minimum vieillesse |
AAH |
|
|
Nombre de personnes pauvres vivant dans un ménage allocataire de minima sociaux (en millions) |
2,397 |
1,526 |
0,210 |
0,405 |
0,345 |
|
Proportion de personnes pauvres parmi les personnes vivant dans un ménage allocataire de minima sociaux (en %) |
48,8 |
72,6 |
60,9 |
43,6 |
19,2 |
|
Lecture : 1,526 million de personnes vivant dans un ménage allocataire du RMI sont pauvres ; elles représentent 72,6 %de l'ensemble des personnes vivant dans un ménage dont l'un des membres est allocataire du RMI. |
|||||
|
Champ : Ensemble des individus vivant dans un ménage dont au moins un membre bénéficie de minima sociaux. |
|||||
|
Source : Insee-DGI, ERF, 2005 |
|||||
On observe ainsi que le cumul d'une situation d'isolement et de perception d'un minimum social augmente le risque de pauvreté. L'exemple du RMI illustre bien cette réalité : le faible niveau de la prestation et la forte proportion des personnes isolées parmi les bénéficiaires pauvres (43 %) expliquent que 72 % d'entre eux perçoivent des revenus inférieurs au seuil de pauvreté.
|
Répartition des ménages pauvres
allocataires de minima
|
|||||||
|
Type de ménage pauvre (seuil de 60 % du revenu médian) |
Minima sociaux |
RMI |
API |
Minimum vieillesse |
AAH |
Ménages pauvres |
Ensemble des ménages |
|
Ménage d'une seule personne |
42,1 |
42,9 |
Ns |
57,9 |
17,6 |
41,0 |
31,1 |
|
Familles monoparentales |
22,3 |
24,3 |
88,8 |
2,3 |
14,3 |
14,2 |
7,6 |
|
Couples sans enfant |
14,4 |
9,5 |
Ns |
30,5 |
14,9 |
16,4 |
27,6 |
|
Couples avec enfant(s) |
17,3 |
19,9 |
Ns |
3,9 |
45,2 |
25,6 |
31,2 |
|
Ménages complexes de plus d'une personne |
3,9 |
3,4 |
11,2 |
5,4 |
8,0 |
2,8 |
2,5 |
|
Ensemble |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Lecture : 57 ,9 % des ménages pauvres bénéficiant du minimum vieillesse sont des ménages d'une seule personne. |
|||||||
|
Champ : Ensemble des ménages pauvres dont la personne de référence n'est pas étudiante et dont le revenu déclaré est positif ou nul. |
|||||||
2. Les demandeurs d'emploi, plus exposés au risque de pauvreté
a) Une part importante de chômeurs non indemnisés
Au mois d'avril 2008, on comptabilisait 2,2 millions de chômeurs indemnisés (chômage, formation et préretraites) soit une baisse de plus de 6 % sur les douze derniers mois. Hors formation et préretraites, environ 2 millions de demandeurs d'emploi étaient indemnisés, dont environ 20 % pris en charge par l'Etat au titre de la solidarité (ASS, AI, ATA, AER, ...), les 80 % restants l'étant au titre de l'assurance chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi [ARE], ancienne allocation unique dégressive [AUD], allocation chômeurs âgés [ACA]).
Mais la part des chômeurs indemnisés ne représente que moins de 61 % des demandeurs d'emploi (environ 3,45 millions). Ainsi, quatre chômeurs sur dix ne bénéficient d'aucune indemnisation . Cette situation résulte des réformes intervenues en 2004 et en 2006, qui ont restreint les conditions d'accès au régime d'indemnisation et renforcé les contrôles et le suivi des bénéficiaires, réduisant de fait la durée moyenne de perception des allocations.
b) Plus d'un tiers des chômeurs vit au-dessous du seuil de pauvreté
Dans le rapport précité, l'ONPES estime à 34 % la part des chômeurs ayant un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté européen . Si cette part est relativement importante au regard de celle des personnes en activité (moins de 7 %), elle démontre néanmoins la capacité du système de protection sociale français à préserver de la pauvreté près de deux tiers des chômeurs. En effet, le montant mensuel moyen d'indemnisation des bénéficiaires de l'ARE, qui s'élevait au 30 septembre 2007 à 1 075 euros, est supérieur au seuil de pauvreté de 817 euros : les chômeurs non indemnisés sont en moyenne deux fois plus exposés au risque de pauvreté que les chômeurs bénéficiant d'une prise en charge financière par l'assurance chômage ou par l'Etat.
Toutefois, une étude récente 63 ( * ) montre que le système d'assurance chômage n'est pas le seul élément protecteur des demandeurs d'emploi contre le risque de pauvreté. La situation des demandeurs d'emploi, qu'ils soient indemnisés ou non, s'améliore en effet considérablement, lorsqu'ils vivent avec d'autres « apporteurs de ressources ». Le complément apporté peut prendre la forme de revenus d'activité ou de prestations sociales (allocations familiales, allocations logement majorées par la présence de plusieurs personnes dans le logement, etc.).
c) L'éloignement durable du marché du travail augmente le risque de pauvreté et d'exclusion sociale
En outre, la durée passée au chômage joue un rôle non négligeable dans les parcours individuels de réinsertion. Pour cette raison, une durée de chômage supérieure devrait constituer un véritable signal d'alerte pour les pouvoirs publics : plus cette durée est longue, plus il est difficile de retrouver un emploi et de se réinsérer. Des mesures ciblées ont d'ailleurs été prises pour favoriser l'embauche des chômeurs de longue durée, mais la part qu'ils représentent encore dans l'ensemble demeure préoccupante : en 2006, 42 % des demandeurs d'emploi (au sens du BIT) étaient au chômage depuis plus d'un an , dont plus de 20 % depuis deux ans et plus.
Si l'on ajoute les demandeurs d'emploi inscrits depuis plus de deux ans (400 000 environ à la fin de 2006) aux allocataires du RMI qui se trouvent dans la même situation, on compte plus de 800 000 personnes en difficulté durable sur le marché du travail que l'ONPES qualifie de « noyau dur » de la pauvreté .
3. Un phénomène nouveau, les « travailleurs pauvres »
a) L'emploi ne représente plus une garantie absolue contre la pauvreté
Si l'exercice d'une activité diminue le risque de pauvreté et d'exclusion sociale, cela ne constitue plus aujourd'hui une protection absolue, puisque près de 7 % des personnes actives en emploi perçoivent des revenus inférieurs à 817 euros par mois.
Selon la définition française retenue par l'Insee, cette nouvelle catégorie de travailleurs pauvres regroupe 1,74 million de personnes actives durant la moitié de l'année (alternance possible de périodes de chômage et d'emploi), ayant travaillé pendant au moins un mois et dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté.
La définition européenne est plus restrictive, puisqu'elle considère comme travailleurs, les personnes ayant occupé un emploi pendant au moins sept mois dans l'année. Selon ce critère, la France compte 1,53 million de travailleurs pauvres en 2005, soit 6,4 % des personnes en emploi.
Dans les deux cas, le nombre de personnes concernées s'est accru de façon significative entre 2004 et 2005 : de 30 000 personnes, selon la définition française, à 100 000, selon la définition européenne. Au total, 4 millions de personnes sont touchées par ce nouveau phénomène, 2,35 millions de personnes vivant aux côtés d'un travailleur pauvre.
b) La précarité de l'emploi explique partiellement la pauvreté des ménages
La réalité des situations peut être assez diverse : temps partiel subi, jeunes faiblement diplômés titulaires d'un emploi précaire, personnes qui alternent périodes d'activité et de chômage ou qui se retirent progressivement du marché du travail.
On observe toutefois que dans leur très large majorité (78 %), les travailleurs pauvres occupent un emploi toute l'année, parmi lesquels environ 20 % exercent une activité à temps partiel. Les travailleurs indépendants , qui constituent 10 % de l'ensemble des travailleurs, sont surreprésentés, puisqu'ils correspondent à 27 % des travailleurs pauvres . Ils sont également davantage exposés au risque de pauvreté que les travailleurs salariés (19,2 % contre 5,8 %, soit environ trois fois plus). En moyenne, les sommes perçues par les travailleurs pauvres au titre de leur activité s'élèvent à 775 euros par mois, tandis que la moitié d'entre eux perçoit moins de 741 euros.
Au-delà des facteurs aggravants liés à la précarité de l'emploi, plusieurs études mettent également en évidence l'influence déterminante de la structure des ménages : on constate par exemple que plus du tiers des travailleurs pauvres perçoivent un revenu individuel supérieur au Smic, qui excède de 16 % le seuil de pauvreté. Ces travailleurs ne sont donc pas pauvres en raison de la précarité de leur emploi mais parce que la répartition du revenu disponible au sein du ménage qu'ils font vivre aboutit à la pauvreté de chacun des membres qui le composent.
A l'inverse, trois quarts des travailleurs dont les revenus sont inférieurs à un Smic ne sont pas pauvres, parce qu'ils bénéficient, du fait de leur situation familiale, de revenus complémentaires (salaires de leur conjoint, transferts sociaux, etc.).
La structure familiale apparaît donc comme un facteur déterminant dans l'appréciation des situations individuelles au regard de la pauvreté. C'est pourquoi une approche complémentaire, fondée sur la notion de « pauvreté économique individuelle » 64 ( * ) , permet de neutraliser l'effet de la composition familiale sur les revenus du ménage et d'apprécier la situation de pauvreté d'une personne à partir de ses seuls revenus individuels d'activité.
Selon cette approche, 3,7 millions de personnes seraient considérées comme pauvres, soit 15 % de l'ensemble des travailleurs : un sur cinq est indépendant ou alterne période de chômage et d'activité, un tiers travaille à temps partiel et seulement 14 % travaillent à temps complet toute l'année.
4. L'isolement, facteur d'aggravation de la pauvreté
Les personnes isolées (célibataires, veufs, parents isolés) sont particulièrement fragilisées et exposées au risque de pauvreté : en moyenne, quel que soit l'âge ou le statut marital, elles présentent un taux de pauvreté deux fois plus élevé que le reste de la population, d'environ 15 % .
En effet, dans le cas des travailleurs pauvres, l'absence de conjoint constitue un facteur aggravant : le taux de pauvreté des personnes isolées en activité et celui des travailleurs vivant en famille monoparentale s'élèvent respectivement à 8 % et 15 %, contre seulement 4,3 % pour les personnes ayant un conjoint actif. Il est vrai que lorsque le conjoint est chômeur ou inactif le taux de pauvreté est supérieur à celui d'une personne seule puisqu'il atteint près de 10 %.
Pour mesurer précisément l'impact de la composition familiale sur la pauvreté des ménages, celle-ci doit être appréciée au regard de plusieurs éléments :
- les revenus d'activité complémentaires apportés par les autres membres du ménage, ceux-ci pouvant enrichir ou, au contraire, appauvrir le ménage ;
- les transferts sociaux dont le ménage peut bénéficier, qui varient en fonction du nombre de personnes et du niveau de ressources ;
- enfin, le nombre d'unités de consommation qui fixe la clé de répartition des revenus globaux perçus par le ménage.
a) Les jeunes ne vivant pas en couple sont particulièrement touchés
Les jeunes adultes de 18 à 25 ans qui ne sont pas en couple et ne vivent plus chez leurs parents sont particulièrement exposés à la pauvreté : environ un tiers d'entre eux appartient au quartile le plus modeste de la population.
Particulièrement touchés par le chômage (21 % des jeunes actifs de moins de 25 ans), ils n'ont pas non plus accès au RMI. Au-delà de la pauvreté monétaire, 17 % des jeunes souffrent également de pauvreté en conditions de vie , ce qui se traduit pour la plupart d'entre eux par des logements exigus et des difficultés financières récurrentes.
Cette situation concerne en premier lieu les jeunes sortis du système scolaire sans aucun diplôme ou ayant un niveau de qualification très faible.
b) La situation des personnes âgées isolées s'est dégradée
Si la situation des personnes âgées de plus de 60 ans (près de 13 millions en 2006) s'est globalement améliorée dans les trente dernières années, leur niveau de vie s'étant rapproché de celui des actifs, celle des personnes seules s'est en revanche dégradée.
La diminution régulière du nombre de bénéficiaires (4 % des personnes de 60 ans et plus en 2005, contre un tiers en 1959) du minimum vieillesse, fortement revalorisé au cours de la même période, l'amélioration du système de retraites et des carrières professionnelles et le développement de l'emploi féminin ont permis un rattrapage du niveau de vie des actifs , qui est d'autant plus net lorsque l'on intègre les revenus du patrimoine et les loyers imputés (74 % des personnes âgées sont propriétaires contre seulement 56 % des actifs).
Cette situation plus favorable a permis un net recul de la pauvreté des personnes âgées de 65 à 74 ans : en 2005, leur taux de pauvreté était d'environ 7 % contre 12,1 % pour l'ensemble de la population. Au-delà de 75 ans, on observe une dégradation de la situation, le taux de pauvreté étant respectivement de 12,8 % pour les femmes et de 9,2 % pour les hommes.
Outre le caractère incomplet des carrières féminines, cette différence de situation entre les hommes et les femmes tient également à la part importante de femmes isolées dans cette tranche d'âge. En effet, sur les trois quart de personnes pauvres âgées de plus de 65 ans vivant seules, il s'agit le plus souvent de femmes, qui perçoivent la pension de réversion de leur conjoint.
Mais la dimension monétaire n'explique qu'une partie de la réalité des conditions de vie des personnes âgées. Il se trouve qu'en situation de dépendance, leurs revenus, même s'ils se sont améliorés, ne permettent pas de couvrir les frais d'une éventuelle prise en charge à domicile ou en établissement. Le coût moyen mensuel d'un accueil en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) s'élève à 1 200 euros, ce que la plupart des personnes retraitées ne sont pas financièrement en mesure d'assumer.
Cette réalité se traduit par le recours de plus en plus fréquent à des structures d'accueil associatives dont le coût est moindre. Lors de son déplacement en Côte-d'Or, la mission a eu l'occasion de rencontrer des associations proposant de telles structures, telles que la Maison d'accueil pour personnes âgées marginalisées de la Société dijonnaise de l'assistance par le travail (SDAT). A Lyon, elle a constaté que l'association « Habitat & humanisme » développait un réseau de solidarité intergénérationnelle, qui favorise la cohabitation d'un jeune et d'une personne âgée dans un même appartement.
c) Les familles monoparentales particulièrement vulnérables
Alors que les familles monoparentales ne représentent que 7 % de l'ensemble des ménages, elles représentent 20 % des ménages vivant au-dessous du seuil de pauvreté . Dans leur grande majorité, le chef de famille est une femme, ce qui explique la part relativement importante de femmes parmi les personnes défavorisées.
La précarité survient souvent brutalement, soit à la suite de la rupture du lien conjugal ou de la vie commune, soit après le décès du conjoint. Leur fragilité s'explique par le cumul de vulnérabilités : enfants à charge, difficulté à exercer une activité à un haut niveau de responsabilité, frais de garde importants... Cela conduit de nombreuses mères de familles monoparentales à renoncer à travailler, notamment lorsque les enfants sont jeunes. Elles bénéficient dans ce cas de l'allocation de parent isolé (API) puis basculent, dans un cas sur deux, vers le RMI, lorsque leurs droits à l'API arrivent à échéance. Ainsi, près du tiers des parents isolés perçoit un minimum social .
Au total, près d'une personne sur quatre vivant au sein d'une famille monoparentale se trouve dans une situation de précarité , qui se caractérise dans de très nombreux cas par son intensité et sa persistance : disposant de revenus dont le niveau est souvent très inférieur au seuil de pauvreté, les chefs de familles monoparentales, du fait des nombreux obstacles qu'ils ont à surmonter pour reprendre une activité, s'installent durablement dans la pauvreté. Parmi les motifs invoqués par les bénéficiaires de l'API pour expliquer leurs difficultés à retrouver un emploi, le problème de la garde d'enfants est cité dans plus de 80 % des cas.
Les revenus de la solidarité constituent ainsi une part importante des ressources de ces ménages.
5. La concentration des personnes en situation de précarité à la périphérie des villes et dans les zones urbaines sensibles
a) Des disparités fortes selon les départements
Les données territoriales relatives aux phénomènes de pauvreté sont encore peu nombreuses. C'est la raison pour laquelle, l'ONPES dans son rapport de 2005-2006 et le Conseil national de l'information statistique (CNIS) dans un récent rapport de 2007 65 ( * ) , recommandent le développement des observations territoriales relatives à la précarité et à l'exclusion .
Suivant ces préconisations, l'ONPES a mis en évidence, dans son dernier rapport, les disparités de niveaux de vie qui existent d'un territoire à l'autre.
L'Observatoire fait tout d'abord le constat d'une forte concentration de la pauvreté dans les départements du Nord (Nord-Pas-de-Calais) et du Sud (Bouches-du-Rhône, Corse, Pyrénées-Orientales et Languedoc-Roussillon), pour lesquels le taux de pauvreté excède 14,6 %.
A l'inverse, la Bretagne, l'Alsace et la Savoie se caractérisent par des taux de pauvreté faibles, inférieurs à 9,5 %. Cette cartographie de la pauvreté reflète bien la situation des départements face au chômage ainsi que la répartition sur le territoire des bénéficiaires de minima sociaux.
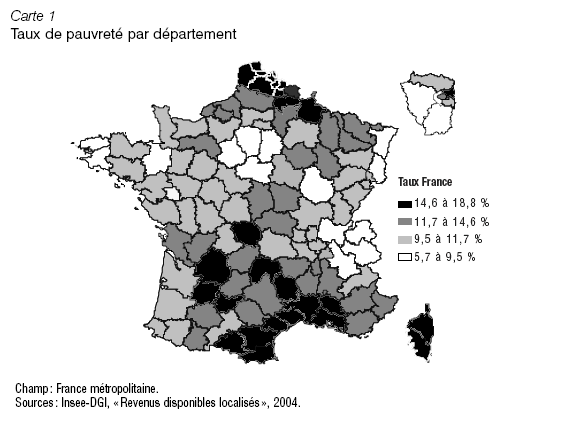
b) La concentration de la pauvreté dans les zones urbaines
La répartition géographique de la pauvreté fait également apparaître une forte concentration de la précarité dans les zones urbaines : un quart des personnes défavorisées vit aujourd'hui dans une agglomération de plus de 200 000 habitants, contre seulement une sur cinq en 1996.
On observe ainsi depuis dix ans un fort exode rural de la pauvreté , le nombre de personnes démunies habitant dans une commune rurale étant passé sur cette période de 2,3 millions à 1,6 million de personnes.
Si ce mouvement en direction des centres urbains se poursuit aujourd'hui, la mission s'est néanmoins inquiétée de la persistance du phénomène de pauvreté rurale, dont les contours sont souvent mal connus. La « relégation rurale » constitue en effet une réalité d'autant plus préoccupante que, contrairement aux populations urbaines, les personnes défavorisées résidant dans les territoires ruraux les plus reculés ne bénéficient pas des services publics de proximité et d'une prise en charge qui permettraient de les sortir de leur condition. De plus, on peut se demander dans quelle mesure l'augmentation des prix des logements dans les centres urbains ne vont pas contribuer à moyen terme à freiner cette tendance de fond, en confinant les franges les plus pauvres de la population dans les zones rurales. Aussi, à l'image des politiques mises en oeuvre dans les zones urbaines sensibles (ZUS), la mission préconise que les poches de pauvreté rurales fassent également l'objet d'une attention particulière des pouvoirs publics.
c) Près d'un tiers des habitants des ZUS vivent au-dessous du seuil de pauvreté
Les conditions de vie des habitants vivant dans les 751 zones urbaines sensibles (ZUS) se caractérisent par un taux de pauvreté de 17 points supérieur au taux de pauvreté national hors ZUS : ainsi, en 2005, près de 28 % des individus qui y résidaient vivaient au-dessous du seuil de pauvreté , soit une hausse de 2,7 points depuis 2002.
Le niveau de vie moyen des habitants des ZUS s'élève à 1 130 euros par mois , soit 27 % de moins que celui de l'ensemble de la population française (1 550 euros). L'intensité de la pauvreté est également particulièrement forte, puisqu'en termes de revenus, le premier décile de la population résidant en ZUS se situe à un niveau inférieur à 610 euros, tandis que le dernier décile se caractérise par un niveau de revenus près de trois fois supérieur, de 1 730 euros ou plus.
Cette situation reflète les conditions d'emploi particulièrement difficiles des habitants des ZUS, dont le taux de chômage (14 % en moyenne) et le taux d'inactivité (34 %) représentent près du double de ceux de la population française. Cela explique ainsi la part importante que représentent en moyenne les transferts sociaux (23 %, contre 7 % hors ZUS et 35 % pour les populations pauvres) dans le revenu disponible des populations concernées.
Toutefois, selon les régions ou les départements, on observe des disparités de situation importantes d'une ZUS à l'autre : celles-ci se recoupent en réalité avec les inégalités territoriales observées à l'échelle de la France entière. En effet, si les ZUS constituent des « poches visibles de pauvreté », la situation économique et sociale qui les caractérise s'applique souvent, au-delà de leurs frontières, aux territoires qui les entourent.
On y constate une accumulation des difficultés pour leurs populations : taux de chômage élevé, notamment pour les jeunes, bas niveau de revenus, faible niveau de qualification, difficultés scolaires pour les jeunes, conditions de logement dégradées, difficultés d'accès aux soins, etc., qui reflètent le caractère multidimensionnel de la pauvreté.
B. LA PAUVRETÉ, UN PHÉNOMÈNE MULTIDIMENSIONNEL QUI SE TRADUIT PAR DES DIFFICULTÉS D'ACCÈS AUX DROITS FONDAMENTAUX ET PAR DES ATTEINTES À LA DIGNITÉ DE L'INDIVIDU
Fondatrice des politiques de l'insertion, la grande loi du 29 juillet 1998 66 ( * ) rappelle dans son article premier que leur objectif est de « garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l'éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l'enfance. » .
Pourtant, dix ans après, le dernier rapport de l'ONPES met en évidence les défauts ou difficultés d'accès des ménages les plus défavorisés à certains droits fondamentaux , qu'il s'agisse des biens de première nécessité, du logement, des services de santé, de la culture ou de l'éducation.
1. Des difficultés d'accès aux soins et un état de santé souvent précaire
Malgré la mise en place, en 1999, de la couverture maladie universelle (CMU) et de l'aide médicale d'Etat (AME), l'accès aux soins et l'état de santé des personnes les plus démunies n'est pas satisfaisant.
a) Un état de santé souvent précaire
Ainsi, 8 % des personnes pauvres déclarent que leur santé est mauvaise , voire très mauvaise, contre seulement 4 % pour le reste de la population. Ce constat est encore plus marqué pour les bénéficiaires de minima sociaux et pour les habitants des ZUS, l'état de santé étant négativement perçu, pour 17 % des hommes touchant le RMI et pour un tiers des habitants des ZUS.
Dans 25 % des cas, il s'agit de jeunes de moins de 25 ans, porteurs de pathologies multiples ou présentant une dépendance à l'alcool ou à la drogue. De façon plus générale, on observe une recrudescence des pathologies infectieuses ou virales (tuberculose, hépatites B ou C, VIH...) et des altérations psychiques ou psychiatriques, résultant soit de mauvaises conditions de vie, soit de conduites addictives. On observe par ailleurs une négligence dans les comportements alimentaires, ainsi que dans le traitement des caries dentaires et des troubles de la vision.
Plusieurs associations, parmi lesquelles l'association « Médecins du Monde » 67 ( * ) qui accueille et prend en charge dans ses centres de soins et d'orientation les personnes les plus démunies, ont confirmé ce diagnostic. L'état de santé dégradé que présentent certaines personnes ayant souvent tardé à recourir aux soins justifie, dans 10 % des cas, des interventions urgentes.
|
Satisfaction et renoncement aux soins des bénéficiaires de la CMU en 2006 |
||
|
Indicateurs 2006 |
Population CMU |
Population non CMU |
|
Etat de santé ressenti |
6,6/10 |
7,3/10 |
|
Taux de perception négative de la santé |
46,7 % |
29,8 % |
|
Vulnérabilité sociale |
45,2 % |
21,8 % |
|
Non-recours au médecin |
10,4 % |
5,5 % |
|
Non-recours au dentiste |
30,1 % |
18,1 % |
|
Source : Fonds CMU |
||
b) Des difficultés d'accès aux soins pour les personnes les plus démunies
Cette situation résulte principalement d'un recours tardif aux soins ou du renoncement à consulter , notamment les médecins de ville, généralistes et spécialistes : en 2006, 14 % des personnes en situation de précarité disaient renoncer aux soins pour des raisons financières. Ceci explique que les personnes défavorisées aient davantage recours aux soins hospitaliers que le reste de la population.
Après la mise en place de la CMU, le taux de renoncement aux soins avait sensiblement diminué, chutant de 15,7 % en 2000 à 11,2 % en 2002. On observe depuis une dégradation de la situation qui semble suivre celle du taux d'intensité de la pauvreté, qui s'est accru de 2 points sur la même période. Le renoncement aux soins concernerait en premier lieu les personnes les plus défavorisées.
Ainsi, près d'un tiers des allocataires de l'API et du RMI et 45 % des bénéficiaires de l'ASS indiquent avoir renoncé à au moins un soin médical, principalement dentaire ou optique, pour des raisons financières 68 ( * ) . Il en est de même pour les bénéficiaires de la CMU, plus de 10 % d'entre eux déclarant en 2006 avoir renoncé à consulter un médecin et plus de 30 % n'ayant pas recouru aux soins d'un dentiste faute de moyens suffisants.
On peut faire le même constat s'agissant de la prévention et des actions de dépistage. Les personnes défavorisées recourent moins fréquemment que le reste de la population à des tests de dépistage. De même, les femmes âgées de plus de 40 ans disposant de revenus modestes réalisent deux fois moins de contrôles par mammographie que les autres femmes du même âge.
L'absence de couverture complémentaire explique très souvent le renoncement aux soins . Bien que facultative, elle constitue un élément déterminant de l'accès aux soins les moins bien remboursés par l'assurance maladie obligatoire : prothèses dentaires, optique et soins de spécialistes souvent concernés par des dépassements. Elle permet en effet de diminuer sensiblement le taux d'effort moyen des ménages en faveur de la santé . On observe que celui-ci est inversement proportionnel au niveau de revenus des ménages : de 10,3 % pour les ménages dont les revenus sont inférieurs à 800 euros, il s'établit à moins de 3 %, lorsque les revenus excèdent 1 867 euros. Or, 14,4 % des personnes disposant de revenus inférieurs à 800 euros n'ont pas de couverture complémentaire.
2. Des difficultés d'accès au logement accrues par la crise de l'immobilier
La situation des ménages disposant de revenus modestes par rapport au logement est contrastée : 42,7 % d'entre eux sont propriétaires occupants, tandis que 29,1 % sont locataires dans le parc social et 28,2 % dans le parc privé.
Les difficultés que rencontrent certains ménages pour accéder à un logement proviennent à la fois d'une offre insuffisante de logements socialement accessibles , d'un manque de solvabilité des ménages et du développement de situations d'extrême précarité qui se traduisent par la multiplication des cas de mal-logement ou de non-logement.
a) Une offre de logements inadaptée à la demande
En premier lieu, l'offre de logements est nettement insuffisante par rapport à la demande , l'augmentation du nombre de ménages - 320 000 par an - ayant été plus importante que celle des nouvelles constructions. Aujourd'hui, compte tenu des retards accumulés depuis près de 30 ans, les besoins sont estimés à environ 800 000 logements, ce qui a justifié la mise en oeuvre d'un programme de construction de 400 000 logements par an jusqu'à 2010 pour résorber le déficit cumulé.
|
Evolution du nombre des ménages
|
||
|
Variation annuelle moyenne |
1990-1998 |
1999-2004 |
|
Ménages (résidences principales) |
250.000 |
320.000 |
|
Besoins globaux de logements |
300.000 |
390.000 |
|
Mises en chantier de logements |
280.000 |
320.000 |
|
Déficit de logements |
20.000 |
70.000 |
|
Déficit cumulé sur la période |
180.000 |
420.000 |
|
Sources : Ministère de l'équipement, Insee, Crédit agricole. |
||
En outre, l'offre de logements ne répond pas à la demande des ménages à faibles revenus . En effet, l'effort réalisé en faveur de la construction de logements se concentre essentiellement sur les logements accessibles à des ménages disposant de revenus intermédiaires (un tiers des logements sociaux programmés en 2005), financés à l'aide d'un prêt locatif social (PLS). Les logements très sociaux, accessibles aux ménages les plus démunis, financés par des prêts locatifs aidés d'intégration (PLA-I), ne représentent qu'un peu plus de 10 % de l'ensemble des logements sociaux construits.
Il en résulte une forte insatisfaction de la demande de logements locatifs sociaux : en 2006, 45,8 % des demandes de logement n'étaient pas satisfaites après un an . En 2004, sur 1,3 million de demandes réelles, seules 433 000 avaient pu être honorées, laissant 870 000 demandes en attente. De ce fait, l'obtention d'une habitation à loyer modéré dans le parc social ou conventionné privé se traduit par des délais d'attente de plus en plus longs, qui peuvent atteindre environ dix ans à Paris.
Cette situation provient à la fois de l'insuffisance de l'offre de logements sociaux disponibles (seulement 10 % du parc), mais aussi d'un afflux croissant de demandes (plus d'1,3 million encore en 2005), 70 % des ménages pouvant prétendre à un logement HLM.
La politique des loyers des offices HLM, qui favorise le maintien dans les lieux, sans limitation de durée, des personnes payant un supplément de loyer de solidarité du fait de revenus supérieurs au plafond de ressources, ainsi que l'écart substantiel entre les loyers du parc social et du parc privé constituent des entraves importantes à la mobilité dans le parc social.
Enfin, en dépit des dispositifs d'incitation mis successivement en oeuvre, on observe parallèlement un nombre encore trop élevé d'habitations vacantes dans le parc privé , puisque plus de 100 000 logements sont désaffectés ou laissés volontairement vides par leurs propriétaires.
b) Une hausse continue du taux d'effort des ménages pour le logement
Depuis 2000, les prix de l'immobilier ont augmenté, tant dans le parc social que dans le parc privé : en 2006, les loyers se sont accrus de 3,7 % après des hausses respectives de 2,6 % et 3,5 % en 2004 et 2005. Cette augmentation est nettement supérieure à celle de l'indice des prix, ce qui traduit un taux d'effort des ménages en faveur du logement supérieur à celui des années précédentes, qui peut atteindre jusqu'à 38 % dans certaines régions pour les familles les plus défavorisées.
|
Evolution des loyers moyens par catégorie de logements |
|||||||
|
(en pourcentage) |
|||||||
|
Années |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Indice général des loyers |
1,3 |
1,2 |
1,7 |
3,0 |
2,6 |
3,5 |
3,7 |
|
Secteur libre |
1,2 |
1,4 |
2,3 |
3,0 |
2,4 |
3,8 |
3,9 |
|
HLM |
1,4 |
0,4 |
0,7 |
2,9 |
3,0 |
2,9 |
3,0 |
|
Indice prix à la consommation |
1,6 |
1,2 |
2,2 |
2,0 |
2,0 |
1,6 |
1,8 |
|
Source : Insee, enquête trimestrielle loyers et charges |
|||||||
Afin de ralentir la hausse des prix des logements, notamment dans le secteur libre, le Gouvernement a engagé une politique de modération des loyers, grâce à la mise en place d'un nouvel indice de référence des loyers 69 ( * ) (IRL) depuis le 1 er janvier 2006. Il a été remplacé depuis par un nouvel IRL trimestriel correspondant à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers 70 ( * ) , afin que le niveau des loyers suive mieux les fluctuations du pouvoir d'achat.
Les aides au logement 71 ( * ), versées à près de 6 millions de ménages et qui sont censées venir en allégement des charges locatives ou des remboursements des emprunts, n'ont que partiellement compensé les répercussions de la hausse des prix de l'immobilier.
Si elles contribuent toujours à réduire de façon significative le taux d'effort des locataires, on observe en effet qu'elles couvrent de moins en moins bien les coûts supportés par les ménages les plus modestes. Entre 2000 et 2006, le taux de couverture des aides au logement s'est réduit , passant de 50,2 % à 47,8 %. Il en résulte une augmentation du taux d'effort moyen des locataires qui a atteint 24,6 % à la fin de 2006.
C'est dans le parc privé que les taux d'effort se sont le plus dégradés, avec une hausse de 5,1 points entre 2002 et 2006 contre seulement 1,1 point dans le parc public. Pour les ménages les plus défavorisés résidant dans le parc privé, le taux d'effort excède parfois le tiers des revenus. Ceci s'explique principalement par l'écart grandissant entre les loyers effectifs et les loyers plafonds de référence des aides : ainsi en 2006, 71 % des allocataires devaient assumer un loyer supérieur aux loyers plafonds de référence des aides contre seulement 58 % cinq ans plus tôt.
|
Taux d'effort médian des
bénéficiaires d'une aide
|
||
|
Situation familiale |
Taux avant AL |
Taux d'effort |
|
Isolé (sans enfants) |
68,1 |
36,1 |
|
Couples (sans enfants) |
61,5 |
34,2 |
|
Familles monoparentales - 1 enfant |
56,6 |
24,3 |
|
Couples - 1 enfant |
48,1 |
25,7 |
|
Familles monoparentales - 2 enfants |
50,7 |
18,2 |
|
Couples - 2 enfants |
39,6 |
21,0 |
|
Familles monoparentales - 3 enfants et + |
40,0 |
7,2 |
|
Couples - 3 enfants et + |
31,1 |
13,0 |
|
Ensemble |
53,5 |
24,6 |
|
Source : Cnaf - Fileas au 31 décembre 2006 |
||
En outre, alors que le nombre d'accédants a augmenté de 8 % entre 2003 et 2006, la part de ceux bénéficiant d'une aide au logement est passée de 12,2 % à 8,6 %. Cela se traduit par une augmentation du taux d'effort des ménages accédants, qui atteint 38,2 % pour les ménages les plus pauvres, contre 30,5 % pour l'ensemble des ménages.
c) La relégation des personnes en situation de précarité à la périphérie des centres urbains
L'accroissement relatif du coût d'accès au logement explique que les personnes les plus défavorisées soient contraintes de s'installer dans les zones où les loyers et le prix du foncier sont moins élevés.
On observe par exemple que les ménages modestes résident plus fréquemment en province (87 %) que le reste de la population (80 %) et plus précisément dans des communes rurales ou dans de petites villes . Cette répartition est encore plus manifeste pour les locataires du parc social, qui vivent à 80 % en province lorsqu'ils disposent de faibles revenus contre seulement 65 % des locataires du parc HLM disposant de revenus plus élevés.
On constate également un mouvement d' éloignement progressif des familles nombreuses modestes des centres urbains , tandis que les personnes seules ont tendance à se concentrer en centre ville . L'agglomération de Dijon en donne un bon exemple 72 ( * ) : les familles de classes moyennes avec enfants migrent du centre vers la périphérie, pour acquérir un logement à des prix moins élevés qu'en centre ville ; à l'inverse, les personnes les plus fragiles (jeunes décohabitants, ménages en recherche d'emploi, personnes isolées ou familles monoparentales...) cherchent en centre ville un logement locatif à prix accessible.
d) Le développement des situations de « mal-logement »
Selon le rapport de 2006 de la Fondation Abbé Pierre 73 ( * ) , le mal-logement recouvre cinq réalités : l'absence de logement, les difficultés d'accès à un logement, le manque de confort et l'insalubrité, les difficultés de maintien dans les lieux et la faible mobilité ou « l'assignation à résidence ».
Si l'on se réfère aux chiffres de ce rapport, 86 000 personnes seraient dépourvues de logement , parmi lesquelles on compte 16 000 enfants ; plus de 120 000 seraient accueillies dans des structures d'hébergement d'urgence et d'insertion ; au moins 200 000 personnes habiteraient chez des amis ou parents et plus de 2 millions seraient logées dans un habitat indécent ou suroccupé .
Une baisse de la part des ménages disposant
d'un logement sans confort
Poursuivant une tendance à long terme, la proportion de ménages dont le logement ne comporte pas le confort sanitaire de base est en diminution par rapport à 2002, pour se situer en 2006 à 1,3 %. Il s'agit en grande majorité de logements construits avant 1948. Parmi les ménages occupant ce type de logement, près d'un quart est dans des situations de logement particulières (soit en meublé, en hôtel, en garni, en sous-location, ou il peut s'agir également de ménages logés gratuitement par un tiers...) contre 5 % de l'ensemble des ménages. La part des ménages dont la personne de référence a plus de 60 ans y est prépondérante, ainsi que celle des ménages dont la personne de référence est ouvrier ou employé.
|
Logements sans confort sanitaire en 2006* |
||
|
2002 |
2006 |
|
|
Nombre de logements
|
612 000 (2,5 %) |
353 000 (1,3 %) |
|
Dont : |
||
|
Propriétaires |
304 500 (50 %) |
183 400 (52 %) |
|
Locataires |
173 900 (28 %) |
88 000 (25 %) |
|
Autres |
133 800 (22 %) |
81 500 (23 %) |
|
Dont : |
||
|
Habitat locatif |
209 500 (34 %) |
144 300 (41 %) |
|
Dont : |
||
|
Logement construit avant 1948 |
508 100 (83 %) |
305 400 (87 %) |
|
Dont : |
||
|
Ouvriers, employés** |
369 000 (60 %) |
233 000 (66 %) |
|
Dont*** : |
||
|
Moins de 40 ans |
96 700 (16 %) |
52 600 (15 %) |
|
40 à 60 ans |
155 500 (25 %) |
78 600 (22 %) |
|
60 ans et plus |
359 800 (59 %) |
221 700 (63 %) |
|
* Sans confort sanitaire : logements auxquels il manque au moins l'un des trois éléments suivants : eau courante, installation sanitaire (baignoire ou douche), wc intérieurs. |
||
|
** Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence ; pour les retraités : dernière profession exercée. |
||
|
*** Age de la personne de référence |
||
|
Champ : France métropolitaine ; en 2006, un logement peut contenir plusieurs ménages. On a alors retenu l'unité de vie principale, c'est-à-dire le ménage locataire ou le propriétaire en titre. |
||
|
Source : enquête logement 2006 |
||
Ce sont en grande partie les locataires et les ménages vivant en appartement qui se plaignent de leurs conditions de logement, confirmant une tendance déjà constatée dans les enquêtes précédentes. Dans l'ensemble, la part des propriétaires parmi les ménages insatisfaits baisse encore par rapport à la situation de 2002. En revanche, les mécontents ont nettement progressé chez les locataires du secteur libre. Les jeunes y sont fortement représentés, en lien avec le fait qu'ils sont nombreux à ne pas avoir accédé à la propriété et ont du mal à se trouver un logement dans le secteur locatif.
Les jeunes sont également concernés de façon croissante par le surpeuplement, qui est une caractéristique du logement en appartement. L'indicateur de surpeuplement, qui avait connu une forte amélioration dans les années soixante-dix et quatre-vingt, demeure stable depuis cette époque. Les ménages d'ouvriers et d'employés sont particulièrement concernés par cette situation.
|
Ménages vivant en situation de surpeuplement accentué* |
||
|
2002 |
2006 |
|
|
Nombre de ménages
|
218 100 (0,9 %) |
183 300 (0,7 %) |
|
Dont : |
||
|
Habitat locatif |
180 900 (83 %) |
159 000 (87 %) |
|
Dont : |
||
|
Logement construit avant 1948 |
88 900 (41 %) |
77 600 (42 %) |
|
Dont : |
||
|
Ouvriers, employés** |
162 400 (75 %) |
133 300 (73 %) |
|
Dont*** : |
||
|
Moins de 40 ans |
82 900 (38 %) |
83 800 (46 %) |
|
40 à 60 ans |
118 700 (54 %) |
85 900 (47 %) |
|
60 ans et plus |
16 600 (8 %) |
13 500 (7 %) |
|
* Le nombre de pièces dont dispose le ménage est inférieur d'une unité au nombre de pièces dit nécessaire, soit une pièce de séjour pour le ménage, une pièce pour chaque personne de référence d'une famille, une pièce pour les personnes hors famille non célibataires ou les célibataires de 19 ans et plus, une pièce pour deux enfants s'ils sont de même sexe ou ont moins de 7 ans, une pièce par enfant sinon. Ne sont pas considérés comme surpeuplés les logements d'une pièce de plus de 25m 2 occupés par une seule personne. |
||
|
** Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence ; pour les retraités : dernière profession exercée. |
||
|
*** Age de la personne de référence. |
||
|
Champ : France métropolitaine. Source : enquête logement 2006 |
||
143 000 logements n'ont aucun moyen de chauffage en 2006. Par ailleurs, le chauffage sommaire (assuré par des appareils indépendants, sans chaudière collective ou individuelle ni chauffage urbain) concerne un peu moins d'un million de ménages. Ces situations sont essentiellement celles de personnes vivant en habitat individuel : les propriétaires et locataires du secteur privé sont surreprésentés parmi les personnes connaissant ces problèmes, en augmentation depuis 2002.
La proportion de ménages qui disent avoir souffert du froid pendant l'hiver en raison d'une mauvaise installation de chauffage (1,2 million de personnes en 2006), d'une mauvaise isolation du logement (1,5 million de personnes) ou du coût du chauffage (800 000 personnes) 1 a presque doublé entre 2002 et 2006, passant de 5,9 % à 10 %. La hausse du nombre de ménages déclarant souffrir du froid en raison du coût a probablement pour principale raison la hausse du prix de l'énergie.
Près de 6 % des ménages modestes connaissent des situations de surpeuplement, contre seulement 2 % pour les catégories supérieures de revenus. Dans le logement social, la moitié des cas de surpeuplement concerne les familles nombreuses, qui peuvent regrouper jusqu'à 10 personnes dans un appartement de 3 ou 4 pièces. Dans le parc privé, la suroccupation se traduit le plus souvent par l'installation de ménages de 1 à 4 personnes dans un studio ou de 3 à 6 personnes dans un deux pièces.
1 Certains ménages ont pu indiquer les trois raisons mentionnées ci-dessus.
e) Le cas spécifique des personnes sans-abri
Peuvent être définies comme sans domicile les personnes ayant dormi la veille soit dans un lieu non prévu pour l'habitation (personnes sans abri), soit dans un centre d'hébergement. Contrairement au Royaume-Uni, la France n'a pas de définition législative de cette situation.
La Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri (Feantsa) a établi une typologie qui regroupe quatre « situations de vie » :
- être sans abri , c'est-à-dire à la rue ou en hébergement d'urgence ;
- être sans logement , avec un abri provisoire dans un centre d'hébergement ;
- habiter un logement précaire (occupation illégale d'un bâtiment, hébergement par un tiers, menace d'expulsion, victime de violences domestiques) ;
- habiter dans un logement inadéquat (insalubre ou surpeuplé).
Cette situation résulte principalement de l'expulsion du domicile pour des raisons familiales ou financières : 41 % des personnes aidées sans domicile sont au chômage et 47 % vivent seules. Dans 47 % des cas, la perte de logement est consécutive au départ du domicile conjugal (26 %) ou parental (21 %), tandis que la survenance de difficultés économiques n'explique que 16 % des abandons de logement. On observe ainsi que la famille ne joue plus son rôle traditionnel de protection, alors que l'expression des solidarités familiales constituait bien souvent le dernier « filet de sécurité » avant l'exclusion. Désormais, dans la moitié des cas, son délitement (divorce, départ précoce des enfants, ...) est à l'origine de l'entrée dans la grande pauvreté. Toutefois, s'il est difficilement envisageable que les pouvoirs publics interfèrent dans les relations privées, la mission estime qu'il ressort de la prévention des ruptures familiales que de mettre en oeuvre toute mesure valorisant les liens affectifs qui relient les individus entre eux et de contribuer à leur épanouissement et leur consolidation.
Par ailleurs, on observe que la privation de logement , souvent temporaire, peut durer parfois plusieurs mois, voire plusieurs années : 21 % des anciens sans domicile sont restés en centres d'hébergement moins de 3 mois, tandis que 15 % d'entre eux peuvent y avoir séjourné plus de 3 ans et 25 % ont dormi dans la rue ou dans un abri de fortune pendant au moins de deux semaines, tandis que 28 % y ont passé un an ou plus.
Le profil des personnes sans abri est le suivant : en moyenne 25 % des personnes accueillies dans un établissement social vivent des revenus de leur travail. Parmi elles, 18 % disposent également en complément du RMI et 11 % perçoivent des allocations familiales. Les travailleurs pauvres sont principalement des hommes généralement hébergés dans les CHRS (63 %) ou, pour un quart des cas, des femmes isolées avec enfants vivant dans des établissements d'accueil « mère- enfant » ou en hébergement diffus (petits appartements indépendants regroupés en maisons relais par exemple).
Près de 10 % ayant le statut de réfugié sont accueillies en centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) ou en centres provisoire d'hébergement (CPH) et 4 %, souvent isolées et âgées de 60 ans et plus, sont orientées vers les maisons relais.
Ainsi, l'absence de logement n'est pas forcément liée à l'absence d'emploi ; en revanche, on observe une corrélation entre le non-recours aux prestations sociales et la précarisation des conditions de logement. La nouvelle procédure de domiciliation, instaurée par la loi du 15 mars 2007 instituant un droit au logement opposable, devrait désormais faciliter les démarches administratives pour les personnes sans abri.
3. Un accès difficile au crédit et aux services bancaires qui résulte d'une augmentation préoccupante du surendettement des ménages
a) Un accès aux services bancaires encore théorique pour de nombreuses personnes
Malgré l'existence d'un « droit au compte 74 ( * ) » et alors que la France se caractérise par un haut niveau de bancarisation de la population, se traduisant par un recours très développé à la carte de crédit et aux paiements par virements ou prélèvements bancaires, un récent rapport du Comité consultatif du secteur financier 75 ( * ) estimait le nombre de personnes n'ayant aucun accès bancaire entre 500 000 et un million.
L'accès aux services bancaires suppose d'une part l'accès aux comptes, d'autre part la mise à disposition par la banque d'une carte de paiement (ou de retrait d'espèces) et d'un chéquier. L'exclusion bancaire peut donc se traduire à la fois par la privation d'un accès aux services bancaires mais aussi, plus modérément, par un accès incomplet à ces services. Celle-ci résulte parfois de pratiques sélectives de la part des établissements bancaires, mais aussi d'une auto-exclusion par les usagers eux-mêmes, qui anticipent les difficultés d'usage des services bancaires qu'ils risquent de rencontrer au regard de leur situation financière.
b) L'augmentation préoccupante des situations de surendettement
De nombreux ménages modestes connaissent temporairement ou structurellement des difficultés pour assumer leurs charges courantes et accéder, sans avoir recours à l'endettement, aux services et biens de première nécessité. Cette situation s'est aggravée depuis un an du fait de l'augmentation des prix des denrées alimentaires, qui représentent en moyenne plus de 15 % du budget des ménages et du prix du pétrole qui a infléchi à la hausse les dépenses de transport et de chauffage.
Ainsi, en France, 173 000 dossiers de surendettement sont déposés chaque année auprès de la Banque de France, avec une progression de 6,5 % par an. On dénombre ainsi, plus d'un million de ménages ayant eu recours à la procédure de surendettement de la Banque de France depuis 1989. Si l'on prend en compte les personnes n'ayant pas déposé de dossiers en commission mais déclarant avoir des difficultés à rembourser leurs dettes, le chiffre s'élève à 1,5 million de ménages, soit au total 6 millions de personnes concernées.
Selon le récent rapport du CES sur le surendettement des particuliers 76 ( * ) , la croissance de ces chiffres est particulièrement préoccupante puisqu'elle s'explique principalement par la baisse du pouvoir d'achat et « une dégradation des conditions de vie ». Considéré jadis comme une dérive de la société de consommation, le surendettement résulte aujourd'hui en réalité principalement de situations de précarité où le recours au crédit s'avère nécessaire pour combler l'insuffisance des ressources.
c) Un accès au crédit souvent difficile et coûteux
Compte tenu de cette situation, il paraît légitime de se poser la question de l'existence d'un « droit au crédit », non encore reconnu dans le droit positif : on observe en effet un moindre recours au crédit des personnes disposant de faibles revenus, qui résulte des contraintes d'accès relatives aux capacités de remboursement, jugées souvent excessives et très restrictives par les ménages concernés 77 ( * ) .
Pour autant, il ne faut pas perdre de vue les risque liés à l'ouverture d'un crédit à des personnes non solvables, à la fois pour les banques mais aussi pour les personnes elles-mêmes, qui devront faire face ensuite à des échéances qu'elles ne pourront pas surmonter. Environ 4 % des ménages (soit environ 1 million) sont considérés comme non objectivement solvables du fait du dépôt d'un dossier de surendettement ou d'une situation jugée financièrement insoutenable pour faire face à un crédit (charges élevées et dettes inévitables à court terme).
Par ailleurs, sans aller jusqu'à un dépôt de dossier de surendettement, 3,6 millions de ménages déclarent avoir des difficultés à rembourser leurs dettes . On observe à cet égard une hiérarchisation stratégique des remboursements des créanciers en fonction des sanctions encourues : les crédits immobiliers et les crédits à la consommation connaissent généralement peu d'incidents (respectivement moins de 1 % et 2,5 % des ménages), tandis que les loyers, les impôts et les charges courantes se caractérisent par un taux d'impayé assez élevé.
d) Le développement du « malendettement », facteur aggravant du surendettement des ménages
Faute d'accès au crédit bancaire, les ménages se tournent souvent vers des solutions de financement inadaptées aux problèmes financiers qu'ils rencontrent : on assiste en réalité au développement du « malendettement » , qui se traduit par un recours de plus en plus fréquent au crédit à la consommation ou au « crédit revolving » 78 ( * ) , permettant de disposer d'une réserve d'argent avec un taux d'intérêt généralement compris entre 16 % et 19,85 %. Plus de 80 % des dossiers déposés en commission comportent au moins un crédit de ce type et dans 15 % des cas, on observe la souscription à plusieurs crédits de ce type, parfois plusieurs dizaines. Dans ces derniers cas, la surabondance de crédits se traduit pour les personnes concernées par une accumulation dramatique de dettes, dans des délais parfois très rapides.
Le « credit revolving », d'accès facile et parce qu'il offre la possibilité de faibles mensualités, incite les personnes en difficulté à y recourir pour les dépenses courantes ou pour rééquilibrer leur budget. Or, ces offres portent généralement sur une réserve d'argent supérieure aux besoins réels des personnes ayant de faibles ressources (souvent de l'ordre de 1 500 à 3 000 euros), ce qui contribue à en accroître le coût. Les risques de défauts de paiement sont alors automatiquement supérieurs. D'où la nécessité de développer une offre de crédits plus souple, permettant de financer des petites sommes, inférieures à 500 euros.
4. Le développement de la « grande exclusion »
La pauvreté, qui se caractérise en premier lieu par un faible niveau de ressources, présente en réalité des situations contrastées, selon son intensité mais aussi selon la diversité des difficultés accumulées.
La prise en compte du temps dans l'analyse des phénomènes de pauvreté et d'exclusion sociale permet, selon l'ONPES 79 ( * ) , de « mieux éclairer l'expérience individuelle des personnes », le cumul des précarités sur une durée plus ou moins longue pouvant avoir des conséquences négatives sur le degré d'autonomie des personnes et porter ainsi atteinte à leur dignité.
Illustrant ce constat dans son ouvrage consacré à la disqualification sociale 80 ( * ) , Serge Paugam explique que « l'installation dans l'assistance tient autant à la dégradation des revenus qu'à la transformation durable des représentations de soi ». Pour sa part, Patrick Boulte 81 ( * ) décrit un « individu en friches » tandis que certains responsables associatifs évoquent les « grands déstructurés » 82 ( * ) .
De même, le Père Joseph Wresinski, dans la définition qu'il donne de la grande pauvreté 83 ( * ) rappelle que lorsque la précarité affecte plusieurs domaines de l'existence et devient persistante, « elle compromet les chances de réassumer ses responsabilités et de reconquérir ses droits par soi-même dans un délai prévisible. »
Le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées (HCLPD) 84 ( * ) s'est inquiété du développement de ce phénomène, qui se caractérise en particulier par des problèmes psychiques et sanitaires d'autant plus importants que la durée d'exclusion a été longue et qui nécessite une prise en charge spécifique tenant compte de la dimension médicale et sanitaire, articulée avec la problématique de l'hébergement et du logement. Certaines personnes en situation de grande fragilité psychologique ne sont en effet très souvent pas en mesure d'accéder à un logement autonome.
Pour que le droit au logement opposable ne reste pas théorique pour ces « très grands exclus », le traitement individualisé de chaque personne est indispensable : les réponses ne peuvent donc se limiter à des dispositifs « juridiques ou techniques » mais doivent s'ajuster à chaque personne et s'appuyer à la fois sur un grand professionnalisme et « une relation humaine personnelle », constituant déjà en soi une insertion.
L'attention que l'on porte à ces personnes renvoie à la question éthique de la place des exclus dans notre société. La prise en compte de ces réalités donne toute son importance à l'accompagnement , mais aussi au développement de cadres de vie de transition, qu'il s'agisse du logement, du domaine professionnel ou de la prise en charge sociale.
Une part importante de l'accompagnement sera ainsi consacrée à la reconquête des droits fondamentaux , auxquels les personnes en situation de très grande exclusion n'ont souvent pas recours, situation qui s'explique notamment par la trop grande complexité de notre système de solidarité nationale ou l'absence de domiciliation.
C. UN SYSTÈME DE SOLIDARITÉ COMPLEXE ET CLOISONNÉ ENCORE PEU INCITATIF À LA REPRISE D'ACTIVITÉ
Les défauts de notre système de solidarité nationale sont désormais bien connus, de nombreux rapports ayant mis en évidence sa complexité et ses nombreux paradoxes, qui découragent les bénéficiaires de minima sociaux de reprendre une activité professionnelle 85 ( * ) .
Depuis une dizaine d'années, plusieurs projets de réformes se sont succédé 86 ( * ) , mettant en évidence les écueils et effets pervers du système des minima sociaux.
1. Un système trop complexe bien souvent illisible par les usagers
Notre système de solidarité nationale comporte neuf minima sociaux , créés au fil du temps, sans cohérence, en fonction des nécessités et des urgences. Il s'agit de prestations non contributives, c'est-à-dire dont l'attribution n'est pas conditionnée par le versement de cotisations préalables telles que l'assurance chômage ou la retraite.
a) Une diversité de statuts
Les minima sont versés, sous conditions de ressources, à différentes catégories de la population : les personnes âgées ou handicapées (ASV, AER, ASI et AAH) ; les personnes familialement isolées (API et allocation veuvage) ou encore les personnes exclues du marché du travail (ASS, AI et RMI). Ainsi, le régime français se caractérise par une juxtaposition de dispositifs spécifiques, beaucoup plus nombreux, que dans les autres pays économiquement comparables.
b) Des conditions de versement très disparates
Outre cette diversité de statuts, on observe aussi une grande disparité dans le montant des allocations versées , la fixation des plafonds de ressources et les conditions d'attribution des aides .
Globalement, les allocations versées sont d'autant plus élevées qu'elles sont destinées à des personnes que l'on sait durablement ou définitivement exclues du marché du travail. A l'inverse, elles sont plus faibles lorsqu'elles ont vocation à permettre le passage d'une période de transition avant une reprise d'activité : c'est le cas, notamment, du RMI, de l'ASS ou de l'allocation d'insertion (AI).
De la même manière, des variations existent dans la définition du plafond de ressources , selon que l'allocation est différentielle ou forfaitaire. Par exemple, les prestations familiales sont incluses dans le calcul des ressources pour le RMI et l'API alors que ce n'est pas le cas pour l'AAH et l'ASS. En outre, la période de référence peut varier, selon les cas, de trois à douze mois. Enfin, la composition du foyer et la présence d'enfants peuvent être plus ou moins prises en compte pour la fixation de l'allocation servie.
2. Les paradoxes de situation créés par l'existence des droits connexes et des effets de seuil
La qualité d'allocataire d'un minimum social ouvre droit, de façon plus ou moins automatique et dans des proportions variables en fonction de la prestation considérée, au bénéfice d'un nombre important de « droits connexes » .
Il peut s'agir d' avantages fiscaux (exonération de taxe d'habitation, de redevance audiovisuelle, suppression des dettes fiscales), de la prise en charge partielle ou complète de la couverture maladie , un accès plus ou moins privilégié aux aides au logement , l'accès aux tarifications sociales (eau, gaz, électricité, téléphone) et la désormais traditionnelle « prime de Noël ».
S'y ajoutent les aides locales , le plus souvent attribuées en fonction du statut, et qui comprennent notamment : les aides des fonds de solidarité logement (FSL), les dégrèvements spécifiques de taxe d'habitation, les aides au transport et à la mobilité, la tarification sociale de certains services publics (crèches, centres aérés, colonies de vacances, restauration scolaire, piscine) et l'aide alimentaire.
|
Droits connexes et exonérations liés au statut d'allocataire de minimum social |
|||||
|
Minimum social |
Exonérations |
Droits connexes liés au statut |
|||
|
CRDS (1) |
CSG (2) |
IR (3) |
RA (4) |
||
|
RMI |
oui |
oui |
oui |
oui |
Allocation logement à taux plein automatique, suspension des dettes fiscales, exonération de taxe d'habitation (TH) automatique et prolongée un an après la suspension de l'allocation, exonération de cotisation CMU, accès automatique et gratuit à la CMU-c, tarification sociale téléphone, prime de Noël |
|
AAH |
oui |
oui |
oui |
oui |
Majoration pour vie autonome, tarification sociale téléphone, exonération de la taxe d'habitation sous conditions de ressources. |
|
ASS |
oui |
non |
non |
non |
Prime de Noël, tarification sociale téléphone |
|
API |
oui |
oui |
oui |
non |
Allocation logement à taux plein automatique, suspension des dettes fiscales, exonération de TH sous conditions de ressources |
|
Minimum vieillesse |
oui |
oui |
oui |
oui |
Exonération de TH sous conditions de ressources |
|
Minimum invalidité |
oui |
oui |
oui |
oui |
Exonération de TH selon l'incapacité ou non de travailler |
|
AER |
oui |
non |
non |
oui |
Prime de Noël, exonération de TH sous conditions de ressources |
|
Allocation veuvage |
oui |
oui |
oui |
oui |
Exonération de TH sous conditions de ressources |
|
(1) Contribution au remboursement de la dette sociale. |
|||||
|
(2) Contribution sociale généralisée. |
|||||
|
(3) Impôt sur le revenu. |
|||||
|
(4) Redevance audiovisuelle. |
|||||
Ces aides ou avantages, qui représentent une part importante du revenu des ménages allocataires de minima sociaux et qui sont liés pour l'essentiel au statut de l'allocataire, disparaissent lorsqu'un allocataire perd le bénéfice de ses prestations et contribuent ainsi à amplifier les effets de seuil désincitatifs à la reprise d'activité .
Par ailleurs, les différences de périodes de référence pour le calcul des prestations (un trimestre ou un an) et les délais de carence entre l'ouverture des droits et la perception de l'aide créent une discontinuité dans les versements et constituent une autre source d'effet de seuil. Certains de ces effets ont été corrigés partiellement grâce au développement d'un système d'intéressement à la reprise d'activité qui se traduit, pour une période transitoire, par le cumul du minimum social et du revenu professionnel.
Au total, ce système apparaît opaque pour ses bénéficiaires et cette illisibilité crée de grandes insatisfactions, donnant parfois une impression d'arbitraire ou d'injustice aux demandeurs d'aide. Il entraîne aussi d'inévitables effets pervers, au premier rang desquels de nombreux effets de seuil et, dans des cas encore trop nombreux, une désincitation à l'emploi.
D. LA PERSISTANCE DE NOMBREUX OBSTACLES AU RETOUR À L'EMPLOI
Outre les effets de seuil ou pertes de revenus liés à la perte du statut d'allocataire, les enquêtes récentes mettent en évidence d'autres freins au retour à l'emploi , notamment s'agissant des bénéficiaires du RMI et de l'API :
- parmi eux, une part non négligeable (29 % pour le RMI et 53 % pour l'API) déclare ne pas occuper d'emploi et ne plus en chercher, invoquant le plus souvent des raisons de santé ou des contraintes familiales ;
|
Raisons invoquées par les
bénéficiaires de minima sociaux sans activité
|
||||||
|
(en %) |
||||||
|
Catégorie de bénéficiaires |
RMI |
API |
||||
|
Raisons invoquées |
MS (1) |
Sortis |
Moy. |
MS (1) |
Sortis |
Moy. |
|
Problèmes de santé |
41 |
36 |
40 |
3 |
16 |
8 |
|
Indisponibilité pour raisons familiales |
28 |
42 |
32 |
89 |
70 |
81 |
|
Pas de travail qui convient |
11 |
6 |
9 |
0 |
1 |
1 |
|
Pas financièrement intéressant |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
En formation, a déjà trouvé un emploi, attente création entreprise |
7 |
6 |
7 |
5 |
11 |
7 |
|
Autre raison, ne sait pas |
12 |
8 |
11 |
2 |
1 |
2 |
|
(1) MS : toujours titulaire du minimum social au moment de l'enquête. |
||||||
|
Champ : personnes sans emploi déclarant ne pas en rechercher un (hors retraités dispensés de recherche). |
||||||
|
Guide de lecture : 40 % des personnes interrogées, actuellement ou anciennement bénéficiaires du RMI et sans emploi, déclarent ne pas en chercher à cause de leurs problèmes de santé. |
||||||
|
Source : DREES, Enquête auprès des bénéficiaires de minima sociaux 2006 Études et résultats - n° 567 - avril 2007. |
||||||
- de plus, parmi les personnes sans activité qui recherchent un emploi, nombreuses sont celles qui disent rencontrer des obstacles importants pour en trouver un, l'absence de formation adéquate ou d'emploi adapté à proximité , les problèmes de santé et de transport sont le plus souvent cités.
|
Raisons identifiées par les
bénéficiaires de minima sociaux sans
activité
|
||||||
|
(en %) |
||||||
|
Catégorie de bénéficiaires |
RMI |
API |
||||
|
Raisons invoquées |
MS (1) |
Sortis |
Moy. |
MS (1) |
Sortis |
Moy. |
|
Absence de formation adéquate |
22 |
21 |
22 |
24 |
27 |
26 |
|
Absence d'emploi à proximité dans votre domaine |
14 |
19 |
15 |
11 |
7 |
9 |
|
Problèmes de santé |
14 |
9 |
13 |
3 |
4 |
3 |
|
Absence de véhicule ou du permis |
15 |
13 |
15 |
18 |
17 |
17 |
|
Trop âgé pour les employeurs |
11 |
5 |
10 |
3 |
5 |
4 |
|
Les emplois proposés ne conviennent pas (salaires, horaires...) |
6 |
5 |
6 |
5 |
7 |
6 |
|
Indisponible pour l'instant |
2 |
4 |
2 |
19 |
15 |
17 |
|
Autre raison |
13 |
15 |
13 |
13 |
12 |
12 |
|
Ne sait pas |
3 |
9 |
4 |
4 |
6 |
6 |
|
(1) MS : toujours titulaire du minimum social au moment de l'enquête. |
||||||
|
Champ : personnes déclarant rechercher activement un emploi sans en occuper déjà un. |
||||||
|
Guide de lecture : 21 % des personnes interrogées, anciennement bénéficiaires du RMI et sans emploi, déclarent que l'absence de formation adéquate est la première cause de leurs difficultés pour trouver un emploi. |
||||||
|
Source : Drees, Enquête auprès des
bénéficiaires de minima sociaux 2006 -
|
||||||
A ce stade, on observera que :
- dans les deux cas, l'aspect financier ne constitue pas le premier frein à la reprise d'un emploi, n'étant d'ailleurs invoqué que de façon très marginale ;
- les causes avancées diffèrent d'un minima à l'autre : pour l'API c'est, pour plus de 80 % des bénéficiaires sans activité ayant abandonné la recherche d'un emploi, l'indisponibilité du fait de leurs contraintes familiales ; pour le RMI, il s'agit dans 40 % des cas de raisons de santé ;
- par ailleurs, si la reprise d'emploi est le premier motif de sortie du RMI, la réalité est un peu différente pour l'API : la fin de la durée légale de son versement en est la cause principale. En effet, une fois sur deux, un sortant de l'API s'inscrit au RMI à l'échéance de son allocation.
Les raisons qui expliquent le non-retour à l'activité sont donc nombreuses et variables. Elles appellent la mise en oeuvre de politiques publiques d'insertion multiples et complémentaires, une mesure isolée ne pouvant à elle seule produire les effets escomptés.
1. Un accompagnement souvent insuffisant des personnes bénéficiaires
Le soutien et l'accompagnement sont également insuffisants . Et pourtant ils permettraient aux allocataires de mobiliser plus efficacement les aides auxquelles ils ont droit et d'être mieux orientés dans leur recherche d'emploi ou d'activité d'insertion.
Ainsi une faible part des allocataires de minima sociaux a bénéficié d'un tel accompagnement. En témoigne le très faible taux de contractualisation des bénéficiaires (moins de 40 %) qui a conduit à l'échec du « volet insertion » du dispositif initial prévu par la loi de 1988 instituant le RMI.
2. La situation des jeunes peu prise en compte
On l'a vu, aucune prestation n'est prévue dans notre système de solidarité nationale pour soutenir de façon temporaire les jeunes qui, sortis du système éducatif, sont à la recherche d'un emploi.
Or, selon le contexte familial, cette situation peut s'avérer être plus ou moins problématique, contraignant souvent les jeunes à recourir à des « petits boulots ».
La mission estime que les difficultés rencontrées pour accéder au service public de l'emploi et au logement constituent une question centrale qui doit faire l'objet d'une analyse plus approfondie 87 ( * ) , dans le prolongement des réflexions conduites dans le cadre de la Commission nationale pour l'autonomie des jeunes 88 ( * ) , sous la direction de Jean-Baptiste de Foucault.
Ainsi, dix ans après le vote de la loi de lutte contre les exclusions, les actions développées pour sa mise en oeuvre ont été d'ampleur très inégale selon les domaines et selon les publics concernés, ce qui explique les résultats contrastés que l'on observe concernant l'accès des plus démunis aux droits fondamentaux.
II. MALGRÉ LA MISE EN oeUVRE DE POLITIQUES AMBITIEUSES, DES DIFFICULTÉS SUBSISTENT
Suivant les préconisations des différents rapports d'évaluation de la loi et des principaux acteurs de la lutte contre les exclusions, le plan national d'action pour l'inclusion sociale (PNAI) et le document de politique transversale (DPT) ont fixé plusieurs priorités qui ont été progressivement mises en oeuvre dans le cadre des grandes politiques de lutte contre les exclusions et la pauvreté.
Il s'agit de l'accès et du retour à l'emploi, de l'insertion professionnelle des jeunes, de la lutte contre l'illettrisme, du développement de l'offre de logements et de l'amélioration de l'accès à la santé et aux soins.
A. LES LIMITES DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE
La loi du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle 89 ( * ) a représenté une avancée, dans la mesure où elle visait à permettre aux personnes les plus démunies d'accéder à la prise en charge des soins dans les mêmes conditions de ressources partout sur l'ensemble du territoire.
A la fin de 2007, 4,8 millions de personnes bénéficiaient de la CMU-c et près de 240 000 personnes avaient fait valoir leurs droits à l'aide à l'acquisition d'une couverture complémentaire (ACS).
Cette loi a permis la mise en place, dès le 1 er janvier 2000, de :
- la couverture maladie universelle (CMU) qui, accordée pour un an, permet l'accès à l'ensemble des prestations en nature de l'assurance maladie. Ses bénéficiaires doivent résider en France de manière stable et régulière et ne pas disposer d'un autre droit à l'assurance maladie. Sans assurance complémentaire, le bénéficiaire est redevable du ticket modérateur et du forfait hospitalier, non pris en charge par l'assurance maladie ;
- la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c) , protection complémentaire publique, complète et gratuite, attribuée sous conditions de résidence et de ressources. Grâce à la couverture intégrale des soins pris en charge et à la dispense d'avance de frais, elle vise à assurer un haut niveau de protection complémentaire aux personnes disposant de faibles revenus.
Afin de limiter les effets de seuil, elle a été complétée depuis par une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé 90 ( * ) (ACS), que les ménages disposant de revenus inférieurs au plafond ouvrant droit à la CMU-c, majoré de 20 %, peuvent désormais obtenir sous la forme d'un « chèque-santé » qui finance directement une partie du coût de leur couverture complémentaire ;
- l'aide médicale d'Etat (AME) qui offre, sous condition de ressources, à environ 190 000 bénéficiaires , pour une durée d'un an renouvelable, une couverture médicale gratuite aux personnes étrangères résidant en France depuis plus de trois mois qui ne peuvent pas bénéficier de la CMU.
En outre, la réforme de la procédure de domiciliation 91 ( * ) a facilité l'accès à l'ensemble des droits, aides et prestations légales des personnes sans domicile stable, notion plus large qui englobe un public plus vaste que les seules personnes sans domicile fixe. La nouvelle procédure prévoit en effet que les personnes dépourvues de logement stable peuvent désormais élire domicile, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet par le préfet, soit auprès d'un centre communal d'action sociale (CCAS) ou d'un centre intercommunal d'action sociale (CIAS). La demande de prestation, quelle qu'elle soit, peut alors se faire auprès de l'organisme ou association ayant accueilli la domiciliation.
Mais si ces réformes ont favorisé l'accès aux services de santé d'une très large majorité de la population, certaines personnes ne sont pas encore en mesure d'assumer dans des conditions pleinement satisfaisantes la prise en charge des soins nécessaires à l'amélioration de leur état de santé.
Ainsi, à la fin de 2007, 6 millions de Français ne disposaient pas d'une complémentaire santé, soit 7 % de la population. Hors le reste à charge pour ces personnes, après l'intervention de l'assurance maladie obligatoire, est en moyenne de 500 euros. Les complémentaires santé jouent alors le rôle de « premier bouclier sanitaire », permettant de réduire le reste à charge des personnes couvertes.
L'absence de complémentaire, qui concerne principalement les personnes en situation de précarité (22 % déclarent ne pas en avoir), est alors particulièrement préjudiciable pour leur état de santé et leur insertion sociale et professionnelle.
Cette situation s'explique à la fois par le bas niveau des plafonds d'accès et par les effets de seuil qui excluent de la couverture maladie universelle complémentaire de nombreuses personnes en situation de précarité, mais aussi par le non-recours à la CMU-c ou à l'ACS de nombreux bénéficiaires pourtant éligibles.
Enfin, lorsqu'ils sont couverts, il peut arriver que certains patients subissent des refus de soins de la part des praticiens.
1. Les publics exclus du fait des effets de seuil
Au 1 er juin 2008, les plafonds mensuels d'accès à la CMU, la CMU-c et à l'ACS étaient, pour une personne seule, respectivement de 720,33 euros 92 ( * ) , 606 euros et 727,25 euros, soit un niveau nettement inférieur au seuil européen de pauvreté de 817 euros.
|
Comparaison du seuil de pauvreté et des barèmes d'attribution de la CMU-c |
||
|
(en euros) |
||
|
Personne seule |
Couple sans enfants |
|
|
Seuil de pauvreté à 50 % du revenu médian |
681 |
1 022 |
|
Seuil de pauvreté à 60 % du revenu médian |
817 |
1 226 |
|
Barème d'attribution de l'aide à la complémentaire santé (ACS) |
727 |
1 091 |
|
Barème d'attribution de la CMU-complémentaire |
606 |
909 |
|
Barème d'attribution de la CMU |
720 |
1 080 |
|
Lecture : pour une personne seule, le seuil de pauvreté est situé à 817 euros, le barème de la CMU-c à 606 euros et le barème de l'ACS à 727 euros. |
||
|
La comparaison de ces valeurs doit être faite avec prudence car les revenus pris en compte pour l'attribution de l'ACS et de la CMU-c ne correspondent pas exactement à ceux pris en compte pour le calcul du seuil de pauvreté. |
||
|
Source : Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie |
||
Ainsi, les allocataires de minima sociaux d'un niveau supérieur à ces montants se trouvent exclus du système de couverture maladie universelle. Tel est le cas par exemple des bénéficiaires de l'AAH, de l'ASV, de l'ASS majorée ou de l'AER, qui n'ont pas accès à la CMU-c.
L'ACS a corrigé en partie cet effet de seuil en permettant aux allocataires de ces minima (à l'exception de l'AER) d'en bénéficier. Toutefois, on peut légitimement s'interroger sur la revalorisation de ces plafonds, notamment celui de la CMU-c, qui demeure inférieur au seuil de pauvreté fixé à 50 % du revenu médian, soit 681 euros.
La détermination des plafonds d'accès devra également tenir compte des conséquences d'une éventuelle généralisation du revenu de solidarité active (RSA) et de la revalorisation de 25% de l'AAH, confirmée le 10 juin dernier par le Président de la République.
2. Un tiers des bénéficiaires potentiels n'a pas recours à la couverture maladie universelle complémentaire
Mais alors que l'on s'interroge sur l'opportunité d'élargir l'accès de la couverture complémentaire, on observe qu'une grande partie des bénéficiaires potentiels n'a pas recours aux dispositifs d'aide existants.
En effet, selon la direction de la sécurité sociale, 6 millions de personnes seraient en droit de bénéficier de la CMU-c et plus de 2 millions de l'aide à l'acquisition d'une couverture complémentaire (ACS). Cela signifie que près de 1,2 million de personnes n'auraient pas fait valoir leurs droits à la CMU-c et que 1,7 million de personnes n'auraient pas sollicité l'ACS ou omis de présenter leur attestation à un organisme complémentaire pour obtenir le remboursement d'une partie de leur cotisation 93 ( * ) . Ainsi, près de 3 millions de personnes seraient privées d'un accès à une couverture maladie complémentaire ou d'une aide pour la financer.
Des études récentes 94 ( * ) ont émis des hypothèses permettant d'expliquer le non-recours à la CMU-c et à l'ACS par leurs potentiels bénéficiaires : méconnaissance des droits en l'absence d'une information suffisamment accessible, compréhensible et personnalisée, difficultés ou découragement pour faire valoir ses droits du fait de la complexité des démarches administratives, attitudes de repli ou craintes d'une stigmatisation.
L'enquête de l'Institut régional de travail social (IRTS), conduite dans 29 foyers et résidences sociales d'Ile-de-France hébergeant plus de 6 000 personnes confrontées à une forte précarité, a mis en évidence un taux de non-recours à la CMU-c de 23,7 % et un non-recours quasi total à l'ACS.
Parmi les personnes éligibles à ces dispositifs, l'Observatoire des non-recours aux droits et services (Odenore) a pu même observer que certains allocataires du RMI n'en bénéficiaient pas alors que leur affiliation est de droit du fait de leur statut. Ils pensent en réalité être automatiquement couverts sans avoir à faire de démarches particulières.
Il est probable que cette situation se soit améliorée grâce à la domiciliation et à la mise en place du « chèque-santé », plus lisible et accessible que l'ancien système d'aide à l'acquisition d'une couverture complémentaire.
3. Le refus de soins par les médecins limite l'accès aux soins des personnes bénéficiant de la couverture maladie universelle
Les personnes couvertes par la CMU, la CMU-c et l'AME se heurtent parfois à des refus de soins de la part des médecins ou des dentistes. Le rapport de l'ONPES dénonce la « persistance de pratiques inacceptables » dix ans après la mise en place de ces dispositifs désormais bien connus des médecins.
Selon l'étude réalisée en 2006 par le fonds CMU, le taux de refus atteindrait 41 % pour les spécialistes, 39 % pour les dentistes, 16 % pour les généralistes du secteur 2 et seulement 1,6 % pour ceux du secteur 1. S'agissant des généralistes, on observe que le nombre de refus a significativement diminué, du fait de l'obligation pour les patients de choisir un médecin traitant. Parallèlement, Médecins du Monde a réalisé une étude montrant également que 37 % des médecins refusent de soigner les bénéficiaires de l'AME.
Ainsi, on l'aura compris, des difficultés d'accès aux soins subsistent malgré l'amélioration substantielle qui résulte de la mise en place d'une couverture maladie universelle.
4. Une réticence à recourir aux structures d'accueil et de soins gratuits
Cela justifie ainsi le maintien des dispositifs spécifiques créés par la loi de lutte contre les exclusions, tels que les programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins (PRAPS) et les permanences d'accès aux soins de santé (PASS), spécialement conçues pour les personnes qui rencontrent des difficultés à faire valoir leurs droits à l'assurance maladie. S'y ajoutent les centres de soins gratuits principalement gérés par les réseaux associatifs et humanitaires, à l'image de ceux de Médecins du Monde 95 ( * ) .
Les personnes accueillies dans ces structures sont souvent en situation de grande précarité sanitaire et sociale et nécessitent une prise en charge lourde du fait des problèmes d'addictions ou des troubles mentaux qu'elles présentent. Outre des consultations médicales, les centres de soins et les PASS proposent un accompagnement social pour aider les personnes qui le souhaitent dans leurs démarches administratives de reconnaissance de leurs droits à la CMU ou à l'AME.
Médecins du Monde a observé une baisse de fréquentation de ses centres d'accueil en 2006, qui pourrait résulter, selon les responsables, soit d'une amélioration des conditions d'accès au système de santé de droit commun, soit, plus vraisemblablement, de la peur des étrangers en situation irrégulière d'être interpellés.
5. Une rationalisation des coûts de la CMU pénalisante pour les personnes les plus démunies
Un décret en date du 15 mai 2007 prévoit la suspension du remboursement des soins en cas de fraude ou de fausse déclaration sur le montant des ressources pour obtenir la CMU.
Jusqu'à présent, le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie ne pouvait pas être suspendu si l'intéressé remplissait les conditions d'accès à la CMU-c, s'il était concerné par une procédure de surendettement des particuliers ou si son cas faisait l'objet d'un examen spécifique par la sécurité sociale au titre des débiteurs retardataires.
La suspension des prestations aura lieu désormais quelle que soit la situation de l'assuré et pourra en outre être assortie d'une pénalité financière.
B. LES OBSTACLES À LA MISE EN oeUVRE EFFECTIVE D'UN DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE
L'application de la loi du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable (DALO), à compter du 1 er janvier 2008, a justifié, dès 2007, la mise en oeuvre rapide de moyens importants pour offrir aux personnes dépourvues de logement des solutions adaptées d'hébergement ou de logement. Selon les estimations du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, 600 000 personnes pourraient être reconnues comme prioritaires au titre du droit au logement opposable par les commissions de médiation.
Ainsi que l'a souligné Etienne Pinte 96 ( * ) , le principal problème réside dans l'absence de débouché dans le parc social, ce qui nécessite en premier lieu un renforcement des capacités d'accueil des structures d'hébergement d'urgence, temporaire ou durable, en améliorant parallèlement la qualité du suivi et de l'accompagnement social. En effet, 20 % à 30 % des demandes d'hébergement concernent en réalité des personnes en activité qui seraient capables d'intégrer un logement autonome, mais dont les revenus sont insuffisants pour accéder à un logement locatif privé.
C'est pourquoi, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le Premier ministre, M. Etienne Pinte a recommandé, dans son premier rapport d'étape 97 ( * ) , de faire de l'hébergement et du logement « un chantier national prioritaire » pour la période 2008 à 2012.
1. Les limites du plan d'action renforcé pour les sans-abri (PARSA)
Dès l'hiver 2006, le Gouvernement a mobilisé des moyens importants pour financer le plan triennal de renforcement et d'amélioration du dispositif d'accueil et d'hébergement d'urgence, qui a prolongé l'effort engagé par le plan de cohésion sociale.
Doté de 50 millions d'euros, ce plan comportait quatre objectifs :
- l'ouverture à l'année de cinq mille places d'hébergement auparavant accessibles durant la seule période hivernale ;
- l'humanisation des conditions d'hébergement, grâce à l'amélioration des modalités d'accueil et l'élargissement des horaires d'ouverture ;
- le développement d'une offre d'hébergements pérennes afin de favoriser l'insertion des personnes accueillies ;
- le renforcement de la veille sociale et des équipes mobiles.
Prévue pour la période 2007-2009, l'application de ce plan a été anticipée pour répondre à la situation d'urgence créée par le grand froid de l'hiver 2006. Il a été conforté, en 2007, par la présentation du plan d'action renforcé pour les sans-abri (PARSA) .
Sa mise en place s'inscrit dans la logique de création d'un droit au logement opposable, qui suppose la réalisation d'un parcours résidentiel sans rupture, de l'hébergement au logement. Pour cette raison, sont privilégiées une prise en charge plus longue en centres d'hébergement d'urgence (CHU) et une diversification de l'offre d'hébergement, afin de mieux répondre aux besoins spécifiques des publics accueillis : familles, personnes seules, travailleurs pauvres, personnes âgées ou souffrant de troubles psychiques... Les résidences hôtelières à vocation sociale ou les maisons relais en sont un bon exemple.
Il s'agit, selon les termes de M. Etienne Pinte, d'offrir des solutions à toutes les personnes dépourvues de logement, en améliorant les conditions d'hébergement et d'accompagnement .
|
Les objectifs du plan triennal et du Parsa en faveur de l'hébergement d'urgence |
|||||
|
Plan triennal |
2006 (1) |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
|
Places d'urgence ouvertes à l'année |
500 |
2 000 |
2 000 |
500 |
5 000 |
|
Humanisation des conditions d'accueil |
Ouverture des CHU à l'année, 24h/24 |
||||
|
Places de stabilisation |
300 places d'« accueil durable » |
||||
|
Places de CHRS |
Transformation de 3 000 places d'urgence |
||||
|
ALT |
3 000 places financées par l'ALT |
||||
|
Montant des crédits |
50 millions d'euros |
||||
|
PARSA |
2007 |
||||
|
Places d'urgence ouvertes à l'année |
Au 31 août, 2 821 places pérennisées |
||||
|
Humanisation des conditions d'accueil |
Au 31 août, 9 000 places ouvertes 24h/24 |
||||
|
Places de stabilisation |
Transformation de 6 000 places en CHU |
||||
|
Places de CHRS |
Transformation de 4 000 places en CHU |
||||
|
Logements très sociaux |
80 000 logements PLA-I et PLUS |
||||
|
Montant des crédits (2) |
70 millions d'euros |
||||
|
(1)
: la mise en oeuvre du plan a
été anticipée pour répondre aux demandes dès
l'hiver 2006.
|
|||||
|
Source : d'après le projet annuel de performances, 2008 |
|||||
Cela suppose également de permettre aux personnes hébergées aptes à occuper un logement autonome de pouvoir y accéder. Or, on l'a vu, le parc social ne dispose pas de logements en nombre suffisant pour répondre à la demande exprimée.
2. Des efforts de construction sans précédent qui tardent à produire leurs effets
Ce constat a conduit le Gouvernement à mettre en oeuvre, dès 2003, le programme national de rénovation urbaine (PNRU), puis en 2005, le plan de cohésion sociale, qui prévoit un effort très important de l'Etat en faveur du logement.
a) Un effort sans précédent de construction de logements
Ces programmes ambitieux, dont l'échéance a été fixée à 2009 pour le plan de cohésion sociale et portée à 2013 pour le PNRU, commencent aujourd'hui à produire leurs effets.
Mis en oeuvre depuis 2005, le plan de cohésion sociale a prévu, hors PNRU, la construction de 100 000 logements locatifs sociaux par an jusqu'en 2009 : 310 000 logements de type PLUS et PLA-I, 140 000 logements financés par un PLS et 50 000 logements construits par l'association foncière logement (AFL), avec le PLS « foncière ». Cette programmation a été renforcée par loi du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable , qui a prévu, outre l'augmentation du nombre de logements financés, l'intensification de l'effort de construction en direction des logements très sociaux de type PLA-I.
Au total, ce sont plus de 591 000 logements qui devraient être construits dans le parc social , 200 000 logements locatifs privés à loyers maîtrisés mis à disposition ainsi que 100 000 logements vacants réhabilités et remis sur le marché par l'Agence nationale de l'habitat (Anah). S'y ajouteront, dans le cadre du PNRU, 250 000 logements démolis puis reconstruits et 400 000 habitations réhabilitées.
|
Programmation de la construction de logements locatifs sociaux 1 |
||||||
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
|
|
Logements financés
|
58.000 |
63.000 |
80.000 |
100.000 |
100.000 |
401.000 |
|
Dont PLA-I, au moins |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
60.000 |
||
|
Logements financés par des PLS |
22.000 |
27.000 |
27.000 |
32.000 |
32.000 |
140.000 |
|
Logements construits
|
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
50.000 |
|
Total |
90.000 |
100.000 |
117.000 |
142.000 |
142.000 |
591.000 |
|
(1) : modifiée par la loi DALO du 5 mars 2007 : les chiffres en italiques ont été modifiés. |
||||||
b) Des efforts qui tardent à produire leurs effets
Plusieurs raisons expliquent que, malgré l'ampleur des moyens engagés par l'Etat pour augmenter le nombre de logements disponibles dans le parc social et mobiliser davantage ceux du parc privé, l'effort consenti ne soit pas encore pleinement perceptible sur le terrain :
- la mobilisation du foncier pour construire les logements est souvent difficile, notamment dans les zones très tendues (région parisienne et grandes agglomérations) ;
- les délais de construction, incluant le montage financier des dossiers, sont au minimum de trois ans, ce qui signifie que les premières livraisons de logements financés par le plan de cohésion sociale ne devraient intervenir au mieux qu'à la fin de cette année ;
- le coût économique et social que représentent ces constructions pour les communes étant faiblement pris en compte (équipements communaux supplémentaires : crèches, écoles ou moyens de transport), celles-ci sont encore peu incitées à s'acquitter de leur obligation légale de disposer d'au moins 20 % de logements sociaux ;
- la mobilité à l'intérieur du parc social est encore trop faible, du fait de la rigidité du principe de maintien dans les lieux, qui ne permet pas par exemple d'adapter la taille du logement à l'évolution du nombre d'occupants ;
- les particuliers sont encore réticents à rénover et louer leur logement, du fait des risques d'impayés et du coût des assurances correspondantes ;
- enfin, les avantages des conventions à loyers maîtrisés mises en oeuvre par l'ANAH pour développer une offre locative privée à vocation sociale sont encore trop largement méconnus.
C. L'AUGMENTATION DU SURENDETTEMENT DES MÉNAGES NÉCESSITE UN RENFORCEMENT DES POLITIQUES DE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION BANCAIRE
1. La mise en place d'un service bancaire universel
La procédure de droit au compte est fortement ancrée dans le paysage bancaire français et sert aujourd'hui de référence à de nombreux pays européens . Cette procédure, créée par la loi du 24 janvier 2004, dite loi bancaire, permet à toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue de compte de dépôt, d'en obtenir l'ouverture dans un établissement de crédit 98 ( * ) .
Le traitement des demandes relève de la Banque de France qui, après avoir vérifié leur régularité, désigne un établissement de crédit qui est ensuite tenu d'ouvrir un compte.
Depuis le 28 avril 2006, afin de faciliter les démarches des demandeurs, toute personne dépourvue de compte de dépôt a la faculté de donner mandat à l'établissement qui lui en refuse l'ouverture de transmettre sa demande à la Banque de France, accompagnée d'une lettre motivant cette décision. La Banque de France dispose alors d'un jour ouvré pour traiter la demande et désigner un établissement pour faire valoir le droit au compte.
L'établissement retenu a alors la possibilité de limiter les services liés à l'ouverture du compte aux « services bancaires de base » gratuits, qui comprennent outre l'ouverture, la tenue et l'éventuelle clôture du compte : un éventuel changement d'adresse ; la délivrance de relevés d'identité bancaire ; la domiciliation de virements bancaires ; l'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ; la réalisation des opérations de caisse ; l'encaissement de chèques et de virements bancaires ; les dépôts et retraits d'espèces au guichet ; les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ; des moyens de consultation à distance du solde du compte ; une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit émetteur et deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services.
Enfin, toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France, avec un préavis minimum de 45 jours.
En quatre ans, plus de 100 000 ouvertures de comptes ont pu être réalisées dans ce cadre. Le nombre de désignations, qui a atteint 30 500 en 2006 et en 2007, s'est aujourd'hui stabilisé alors que la progression avait été de 14 % en 2006 et de 37 % en 2005. Cette évolution résulte à la fois d'un assouplissement des conditions d'ouverture des comptes payants par certains réseaux bancaires et de l'absence de campagne d'information en 2007, contrairement aux années précédentes.
Toutefois, l'année 2008 devrait voir une recrudescence du nombre du recours à cette procédure, du fait de l'entrée en vigueur du nouveau dispositif de domiciliation des personnes sans domicile stable issu de la loi du 5 mars 2007 instituant le DALO. Dès lors, on s'acheminerait progressivement vers la mise en place d'un véritable service bancaire universel.
2. Les limites du système actuel
Il est important de noter que le détail de la procédure, qu'il s'agisse des délais ou des documents nécessaires pour solliciter la Banque de France, ne fait l'objet d'aucune disposition réglementaire ou législative. Les règles en ont été fixées par le comité consultatif du secteur financier. C'est ainsi à son initiative que, depuis avril 2006, la demande d'ouverture de compte peut être transmise directement à la Banque de France par l'établissement refusant l'ouverture du compte et que le délai de réponse a été ramené de huit jours à un jour ouvré.
Or, les engagements pris par les banques constituent des modalités essentielles pour l'exercice effectif du droit au compte. C'est pourquoi, dans le cadre de l'examen à l'Assemblée nationale du projet de loi de modernisation de l'économie, un amendement de la commission des finances a proposé que ces éléments figurent à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier sous la forme d' une Charte adoptée par l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et destinée à assurer l'effectivité du droit au compte.
Par ailleurs, si la France est assez avancée dans le domaine de l'accès aux services bancaires, le système français offre peu de solutions adaptées aux difficultés que rencontrent les ménages les plus modestes dans le domaine du crédit .
Les réflexions actuelles s'orientent davantage vers un assouplissement des règles du crédit (faibles montants de prêts, taux socialement accessibles, durées plus courtes de remboursement...) pour rendre le système plus inclusif plutôt que vers la constitution d'un réseau bancaire parallèle qui serait dédié aux personnes défavorisées.
Plusieurs expériences ont été conduites et peuvent alimenter la recherche de solutions innovantes dans ce domaine :
- mise en place de structures locales spécifiques sur le modèle des « points passerelles » lancés par le Crédit agricole ou des « Parcours confiance » du réseau des Caisses d'épargne qui permettent l'accompagnement personnalisé et gratuit des personnes rencontrant des difficultés financières ;
- développement des expérimentations de microcrédit social dans le cadre du Fonds de cohésion sociale mis en place par la loi du 18 janvier 2005 dite de cohésion sociale 99 ( * ) . L'octroi et le suivi de ces prêts se font le plus souvent dans le cadre d'un partenariat avec un établissement financier et une ou plusieurs associations qui assurent l'accompagnement du projet. Le succès de ce type de crédit réside essentiellement dans la souplesse du dispositif : montant adapté aux besoins à financer, taux d'intérêt raisonnable, accompagnement et suivi personnalisé.
D. DES RÉFORMES PONCTUELLES DU SYSTÈME DE SOLIDARITÉ DANS L'ATTENTE D'UNE INÉVITABLE REFONTE GLOBALE
Plusieurs mesures ont déjà été prises pour améliorer la situation économique des bénéficiaires de minima sociaux et favoriser leur retour à l'emploi.
1. Les mesures récentes favorisant le retour à l'emploi des bénéficiaires de minima sociaux mériteraient d'être amplifiées
Après le renforcement des effets incitatifs de la prime pour l'emploi (PPE) dans le cadre du vote de la loi de finances pour 2006, la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 pour le retour à l'emploi et sur les droits et devoirs des bénéficiaires de minima sociaux a procédé à une première refonte du système d'intéressement à la reprise d'une activité professionnelle pour les allocataires du RMI, de l'API et de l'ASS.
Elle permet d'accorder aux personnes reprenant un emploi avec un horaire mensuel d'au moins 78 heures :
- le cumul intégral des minima sociaux et du salaire de l'activité professionnelle pendant trois mois ;
- une prime de retour à l'emploi de 1 000 euros après le quatrième mois de travail ou dès la fin du premier mois, si le contrat est à durée indéterminée ou d'une durée déterminée supérieure à six mois ;
- une prime forfaitaire mensuelle de 150 euros pour les personnes isolées et de 225 euros pour les couples ou familles durant neuf mois, au terme de la période de cumul intégral du revenu d'activité et de l'allocation.
Ces mesures d'intéressement sont ouvertes aux personnes accédant à un emploi aidé, sauf s'il s'agit d'un contrat d'avenir (CA) ou d'un contrat d'insertion - revenu minimum d'activité (CI - RMA), pour lesquels la prime de retour à l'emploi de 1 000 euros n'est pas accordée. Ces contrats offrent en effet déjà une forme d'intéressement, qui s'ajoute aux nouvelles primes forfaitaires mensuelles.
Pour leur part, les allocataires de l'API et du RMI travaillant moins de 78 heures par mois continuent de bénéficier du système d'intéressement antérieur qui leur permet de cumuler, durant neuf mois, 50 % de leur revenu d'activité avec leur minimum social.
Ce nouveau système d'intéressement, simple, harmonisé et plus lisible pour les bénéficiaires de trois minima sociaux, leur permet de prévoir plus aisément les sommes qu'ils vont percevoir en cas de reprise d'activité, en limitant les effets d'aubaine et le recours massif au temps partiel.
a) Des résultats encourageants
Les premiers résultats sont d'ailleurs encourageants.
A l'exception de l'API, on observe en effet une baisse du nombre de bénéficiaires de minima sociaux :
- le nombre d'allocataires du RMI a diminué de 6,6 % entre 2007 et 2008, poursuivant la tendance amorcée en 2006 (- 0,8 %) ;
- le nombre de bénéficiaires de l'ASS a diminué de 2,1 % à la fin de 2006, principalement du fait de la baisse du chômage de très longue durée
Cette tendance, qui s'inscrit dans le contexte favorable d'une amélioration de la situation du marché du travail, s'explique également par l'efficacité des mesures d'intéressement mises en place pour les bénéficiaires du RMI, de l'API et de l'ASS.
A la fin 2006, la proportion d'allocataires cumulant minimum social et revenus d'activité, a significativement augmenté : elle atteint 15,1 % pour l'ASS, 14,5 % pour le RMI et seulement 8,2 % pour l'API. Le nouveau dispositif n'étant pleinement opérant qu'à partir de 2007, on commence seulement à en percevoir les premiers effets. Ainsi, au cours du premier trimestre de 2008, 85 000 allocataires bénéficient de la nouvelle prime forfaitaire versée à compter du quatrième mois. Si on ajoute les bénéficiaires du système de cumul antérieur, on compte au total 93 000 personnes payées au titre du RMI et bénéficiant d'une mesure d'intéressement.
Le moindre succès des mesures d'intéressement pour les bénéficiaires de l'API s'explique par les nombreuses difficultés matérielles que rencontrent les allocataires pour reprendre une activité. Les raisons financières n'interviennent généralement qu'en second rang, les problèmes de gardes d'enfants demeurant l'obstacle majeur.
Ainsi, les mesures d'intéressement, qui semblent démontrer leur efficacité pour les bénéficiaires du RMI et de l'ASS, présentent certaines limites, notamment pour les allocataires de l'API.
b) La persistance de freins à la reprise d'activité
Le nouveau système n'a en effet pas permis de supprimer l'ensemble des obstacles à la reprise d'activité.
D'abord, la prime de retour à l'emploi de 1 000 euros qui vise à couvrir les charges nouvelles qui résultent de la reprise d'activité (garde des enfants, présentation, frais de transports) n'est versée qu'au bout de quatre mois tandis que certains bénéficiaires ne remplissent pas les conditions pour y avoir accès (travail à temps très partiel ou contrats aidés).
En outre, le nouveau système ne tient pas compte des aides sociales, qu'elles soient nationales ou locales, attribuées selon le statut, c'est-à-dire par référence au bénéfice de tel ou tel minimum social, d'où leur appellation désormais bien connue de « droits connexes ».
Il résulte de l'existence de ces aides :
- un manque d'équité entre les allocataires des différents minima sociaux et entre ces derniers et les « travailleurs pauvres » ;
- une dégradation de la situation financière des personnes qui, consécutivement à leur reprise d'activité, perdent le plus souvent le bénéfice de ces aides, rendant de fait moins attractif voire dissuasif tout retour à l'emploi. Pour cette raison, on parle de « trappes à inactivité ». Les effets sont d'autant plus perceptibles que les droits connexes représentent en réalité une part importante du revenu des ménages, le minimum social n'excédant pas, en moyenne, 20 % de leurs ressources globales. Partant de ce constat, chacun s'accorde à reconnaître la nécessité de supprimer toute référence au statut et de ne retenir comme seul critère d'éligibilité à ces aides, le niveau des ressources. 100 ( * )
2. Des personnes exclues du système d'intéressement
Par ailleurs, certaines personnes sont exclues du dispositif d'intéressement :
- soit parce qu'elles sont bénéficiaires de contrats aidés, pour lesquels l'intéressement est partiellement versé sous forme d'aide pour l'entreprise. Dans ce cas, les personnes bénéficiaires du RMI qui acceptent un CA ou un CI-RMA ne percevront pas plus d'argent qu'en restant au RMI ;
- soit parce qu'elles ne sont pas dans une situation de reprise d'activité après avoir cessé de travailler. Tel est le cas par exemple des bénéficiaires de minimum social qui exercent une activité à temps partiel : 14 % des allocataires du RMI sont actifs, et, parmi eux, 6 % ont exercé une activité professionnelle sans interruption pendant les dix-huit derniers mois 101 ( * ) .
L'ensemble de ces dysfonctionnements justifie bien évidemment une refonte globale du système de solidarité nationale, afin d'en simplifier l'organisation et le fonctionnement et d'en améliorer la lisibilité et l'accès pour les bénéficiaires. Le revenu de solidarité active (RSA), actuellement expérimenté dans une trentaine de départements, répond en partie aux critiques formulées précédemment et permet de surmonter la plupart des obstacles à la reprise d'emploi.
3. Les premiers enseignements de l'expérimentation du revenu de solidarité active
Le revenu de solidarité active (RSA) est l'aboutissement de la réflexion engagée en 2005 par la commission « Familles, vulnérabilité, pauvreté », présidée par M. Martin Hirsch 102 ( * ) .
a) Définition et objectifs du RSA
Calculé en fonction des revenus du travail, de la situation familiale et des autres ressources d'un ménage, le RSA consiste à cumuler durablement revenus du travail et de la solidarité, afin d'accroître le pouvoir d'achat des travailleurs pauvres et d'inciter au retour à l'activité les bénéficiaires des minima sociaux : il joue ainsi le rôle de revenu minimum pour les personnes n'ayant aucune activité et représente un complément de revenu pour les personnes en activité dont les ressources se situent au-dessous du seuil de pauvreté (817 euros pour une personne seule).
Il vise à répondre à trois objectifs : lutter contre la pauvreté ; inciter à la reprise d'une activité et simplifier et rendre plus lisible le système de solidarité nationale.
Si les objectifs et principes qui définissent ce nouveau dispositif de solidarité sont clairs et font l'objet d'un relatif consensus, ses modalités concrètes de mise en oeuvre font l'objet de discussions sur plusieurs points, dont les enjeux sont liés : le barème du RSA ; ses modalités de financement ; les bénéficiaires concernés ; son pilotage (centralisé, mixte ou décentralisé) ; la durée de versement du RSA ; les modalités d'évaluation du dispositif.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a prévu une première phase d'expérimentation, avant la généralisation du dispositif, en laissant aux départements candidats une marge de manoeuvre assez large pour en définir les modalités concrètes d'application.
b) Modalités et premiers résultats de l'expérimentation
La dite loi Tepa du 21 août 2007 103 ( * ) , qui a défini le RSA expérimental, devrait permettre à quarante départements de le tester, pour une durée de trois ans, sur une partie de leur territoire, au profit des seuls bénéficiaires du RMI et de l'allocation de parent isolé (API).
L'article 18 de la loi indique que le RSA expérimental a pour objectif d'assurer l'augmentation des ressources d'une personne bénéficiaire d'un minimum social qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité .
Il peut également être tenu compte des droits connexes, c'est-à-dire des prestations et aides locales ou extralégales à caractère individuel recensées par chaque département et, dans la mesure du possible, de l'ensemble des droits et aides (exonération de redevance audiovisuelle, taxe d'habitation...) qui sont accordés aux bénéficiaires du RSA.
Sur quarante départements candidats à l'expérimentation, trente-quatre ont déjà été autorisés à la mettre en oeuvre, vingt-six l'ayant effectivement lancée au 1 er février et trente et un ayant défini leurs règlements locaux . Seuls dix départements expérimentaient le RSA à la fin de l'année 2007. A ce jour, environ 10 000 personnes ont signé un contrat RSA au titre de l'expérimentation.
Pour les bénéficiaires de l'API, qui relèvent de l'Etat, les conditions d'expérimentation du RSA (barème, accompagnement des bénéficiaires) ont été fixées par le décret du 5 octobre 2007.
Pour les allocataires du RMI , chaque département est libre de fixer son barème ainsi que les modalités de cumul des revenus et du RSA, et de délimiter le champ des bénéficiaires concernés.
Les trente et un règlements départementaux illustrent la diversité des solutions retenues :
- quant aux bénéficiaires du dispositif : selon le type de contrat, selon leur situation par rapport à l'emploi (selon qu'ils se trouvent en reprise d'emploi, en activité ou qu'ils ont augmenté leur activité) ;
- quant au barème : dix-huit départements, dont la Côte-d'Or , ont opté pour un barème identique à celui fixé par l'Etat pour le « RSA-API » , six ont choisi des taux de cumul différents (60 ou 65 % au lieu de 70 %), six ont adopté un barème non linéaire combinant des taux de cumul différents selon les quotités de temps de travail, permettant, soit d'accorder un taux de cumul plus élevé pour les petites quotités de travail, qui diminue au-delà du quart de temps ou du mi-temps, pour s'annuler autour d'un Smic à temps plein (Eure et Seine-Maritime), soit de privilégier, à l'inverse, les emplois à forte quotité de travail, pour ne pas favoriser le travail précaire (Bouches-du-Rhône, Creuse, Haute-Saône, Marne) ;
- quant aux modalités d'accueil et d'accompagnement vers l'emploi : tous les départements ont accentué l'effort d'accompagnement personnalisé, et rationalisé l'intervention des différents acteurs, l'exemple le plus abouti étant celui de « la plate-forme unique d'accueil de l'Eure », regroupant la Caf, la CPAM, l'ANPE et qui donne des résultats spectaculaires. Les autres départements ont au minimum opté pour un binôme constitué d'un référent professionnel (ANPE) et d'un référent social (CCAS, CPAM, Caf) ;
- quant aux outils complémentaires mobilisés pour surmonter les obstacles à la reprise d'activité : aide personnalisée à la reprise d'activité, fonds d'aide à la reprise d'emploi, « RSA + » (aides financières individuelles et accompagnement spécifique), aides à la mobilité professionnelle ou géographique, garde d'enfants, aide à l'installation pour les travailleurs indépendants... ;
- quant à la mobilisation et l'implication des entreprises : appui à l'intégration professionnelle, contractualisation avec l'employeur, dispositif incitatif à l'augmentation des heures travaillées favorisant l'emploi à temps plein (Hérault, Bouches-du-Rhône), parrainage ou tutorats au sein des entreprises.
Un comité national d'évaluation du dispositif a été mis en place en juillet 2007, afin d'appuyer les départements dans la conduite des évaluations locales et de définir un cadre comparatif national de l'ensemble des expérimentations. Une première enquête est en cours auprès des Caf (volet API) et des départements (volet RMI) ayant démarré l'expérimentation.
Les résultats de ces études permettront d'affiner les modalités de généralisations du RSA.
c) La généralisation du RSA
L'intervention du Président de la République, le 24 avril 2008, a permis de clarifier certains points concernant la généralisation du RSA, notamment relativement aux bénéficiaires visés par la réforme, à la date de mise en oeuvre et à ses modalités de financement.
Selon les dernières informations recueillies par votre rapporteur auprès du Haut-commissariat aux solidarités actives 104 ( * ) , le RSA devrait être généralisé dans le courant de l'année 2009 et concerner trois à quatre millions de personnes : les bénéficiaires du RMI (1,1 million de personnes), de l'API (200 000 personnes environ), et de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), ainsi que les travailleurs pauvres, vraisemblablement ceux disposant de revenus inférieurs à 1,2 Smic (1 536 euros bruts), ce point n'étant pas encore tranché.
Le RSA devrait donc se substituer à ces trois minima sociaux et intégrer la prime pour l'emploi (PPE) ainsi que les primes d'intéressement créées par la loi du 23 mars 2006 pour le retour à l'emploi des bénéficiaires de minima sociaux 105 ( * ) , répondant ainsi à l'objectif de simplification et de lisibilité du système.
d) Le financement
Le RSA serait ainsi financé par le redéploiement :
- des sommes consacrées au financement des minima sociaux intégrés au RSA (au minimum le RMI et API), soit environ 7 milliards d'euros ;
- des sommes consacrées au financement des dispositifs d'intéressement ou des primes forfaitaires de retour à l'emploi , soit environ 450 millions d'euros ;
- des montants consacrés au financement de la PPE ( 4,2 milliards d'euros ), qui devraient être redéployés, de telle manière que les contribuables actuellement bénéficiaires de la PPE et disposant de revenus compris entre 1,2 et 1,4 Smic, ne soient pas éligibles au RSA. Cette mesure, qui pénaliserait environ 4 millions de personnes , permettrait néanmoins de recentrer la PPE sur les travailleurs les plus pauvres, répondant ainsi aux préoccupations de ses détracteurs, parmi lesquels la Cour des Comptes dans un rapport de 2006 ;
- et par une enveloppe budgétaire supplémentaire de 1 milliard à 1,5 milliard d'euros, soit moitié moins que celle initialement prévue.
|
La prime pour l'emploi (PPE)
Instaurée en 2001, la PPE est perçue par près de 8,6 millions de foyers fiscaux en activité dont les revenus sont compris entre 0,3 et 1,4 Smic, soit entre 384 euros et 1 792 euros bruts).Son montant moyen est passé de 252 euros en 2002 à 460 euros en 2007 et peut représenter au maximum jusqu'à 961 euros. |
e) Les questions à trancher
- le barème du RSA : doit-il être uniforme ou non sur tout le territoire ? Son niveau doit-il être fixé par rapport au seuil de pauvreté européen ou celui de 50 % du revenu médian ? Doit-il tenir compte des droits et aides connexes ?
- le risque de précarisation des emplois , du fait du versement du RSA, assimilé en quelque sorte à une subvention de l'emploi précaire ; la construction d'un « RSA à deux étages » ou la variation du taux de cumul en fonction de la quotité du temps de travail pouvant représenter des alternatives 106 ( * ) ;
- la durée de versement du RSA (actuellement fixée à trois ans dans le cadre de l'expérimentation) ;
- la répartition du pilotage et du financement du dispositif entre l'Etat et les départements, constituant légitimement un sujet d'inquiétude pour les conseils généraux alors que le transfert de la gestion du RMI n'a été, à ce jour, que partiellement compensé par l'Etat 107 ( * ) ;
- les conditions d'octroi du RSA (durée dans l'emploi, reprise d'activité ou situation d'emploi, type de contrat, etc.) ;
- maintien des spécificités des minima sociaux (intégration des allocataires de l'ASS, problématique du maintien du RSA-API en cas de modification de la situation familiale, complément « parent isolé » pour tenir compte de la monoparentalité) ;
- révision corrélative des plafonds d'accès à la CMU et à la CMU-c (actuellement 606 euros par mois).
III. LES PROPOSITIONS DE LA MISSION : PRIVILÉGIER LES POLITIQUES GLOBALES DE PRÉVENTION ET POURSUIVRE LES ACTIONS ENTREPRISES EN FAVEUR DE L'INSERTION DURABLE
A. AMÉLIORER ENCORE LA PRISE EN CHARGE ET L'ACCÈS AUX SOINS DES PERSONNES DÉFAVORISÉES
1. Généralisation des permanences d'accès aux soins de santé
Les nombreuses carences ou difficultés observées dans l'accès aux soins pour les plus démunis justifient, selon Médecins du Monde, le développement, à plus grande échelle, des PASS sur l'ensemble du territoire. L'objectif serait de porter leur nombre à 500 au moins, notamment dans les zones rurales faiblement pourvues en médecins ou services de santé , et de développer les PASS dentaires, pédiatriques et psychiatriques pour pallier les défauts de soins et de prise en charge dans ces trois spécialités.
2. Développer les unités mobiles de soins et de prise en charge
Certaines populations très marginalisées, en grande détresse sanitaire, psychique et sociale nécessitent une prise en charge de proximité par des équipes mobiles assurant un maillage quartier par quartier. Ces équipes médicales interviennent de façon complémentaire avec celles assurant l'orientation et l'accompagnement vers un hébergement (115, équipes de veille sociale, etc.).
3. Développement des programmes de prévention et de dépistage
Il s'agit de lutter contre la recrudescence des maladies infectieuses (tuberculose, hépatites B et C) en développant les politiques vaccinales et de prévention et en diffusant des informations relatives aux comportements à risque (VIH), en utilisant le réseau hospitalier, des PASS et des centres de soins.
4. Favoriser l'accès à la CMU, à la CMU-c et à l'ACS
Il convient de faciliter les démarches d'inscription des personnes n'ayant pas fait valoir leurs droits mais aussi de celles qui, du fait des effets de seuil, sont exclues des dispositifs d'aide à l'accès aux soins.
Plusieurs mesures peuvent y contribuer :
- l'affiliation automatique à la CMU, la CMU-c et à l'ACS pour les bénéficiaires de la solidarité nationale, dont les revenus n'excèdent pas les plafonds de ressources. Pour les Rmistes par exemple, l'affiliation à la CMU-c est de droit, mais elle n'est pas automatique ;
- l'étude systématique des droits lors de l'accueil dans une structure d'hébergement - centre d'hébergement, foyer, résidence sociale - ou un établissement médicosocial ;
- le développement des guichets uniques pour limiter le non-recours à la CMU ou à la CMU-c ;
- la revalorisation des plafonds, notamment celui de la CMU-c, au moins au niveau du seuil de pauvreté fixé à 50 % du revenu médian , soit 681 euros.
Il faudra également étudier attentivement la situation des bénéficiaires de l'AAH dont l'allocation devrait augmenter de 25 % d'ici à 2012 et qui, à taux plein, devrait s'établir à 785 euros, soit au-dessus du plafond actuel d'éligibilité à la CMU et à l'ACS ;
- protéger d'une éventuelle suspension des droits à la CMU les personnes de bonne foi, accusées de fraude ou de fausses déclarations de ressources, dont la situation financière est particulièrement fragile.
Il s'agit de rétablir pour ces personnes les exceptions à la suspension automatique des prestations en cas d'endettement ou lorsque le niveau de leurs revenus leur permet l'accès à CMU-c. Il ne paraît en effet pas judicieux de placer des individus en grande fragilité sociale dans une situation de non-recours aux soins. Le coût pour la société peut s'avérer à terme plus élevé que les économies réalisées grâce à ces nouvelles dispositions.
5. Responsabiliser les bénéficiaires de la CMU et les médecins pour limiter les refus de soins
Afin de limiter le refus de soins par les praticiens aux bénéficiaires de la CMU, il serait souhaitable d'envisager à la fois :
- d'établir une convention entre les médecins et le fonds CMU , rappelant les règles de déontologie médicale et mentionnant les devoirs qui en résultent pour les médecins, ainsi que les sanctions auxquelles ils s'exposent en cas de violation des principes actés dans la convention ;
- d'assortir l'inscription au bénéfice de la CMU de la signature d'un contrat avec les bénéficiaires stipulant leurs droits et devoirs , tels que le respect du parcours de soins, des rendez-vous pris et des traitements prescrits.
B. CONCENTRER LES ACTIONS EN FAVEUR DE L'HÉBERGEMENT ET DU LOGEMENT SUR LES PERSONNES EN SITUATION DE GRANDE PRÉCARITÉ, SUR LES ZONES LES PLUS TENDUES ET SUR LA PRÉVENTION
Depuis 2003, les gouvernements qui se sont succédé ont engagé un effort important en faveur du logement et de l'hébergement pour rattraper le retard accumulé durant les années 80 et 90 : PNRU, plan de cohésion sociale renforcé par la loi DALO, PARSA complété par les mesures d'urgence suggérées par le rapport Pinte, qui ont amélioré de façon significative les perspectives en la matière et rendu de fait moins illusoire l'application effective du droit au logement opposable.
Selon un avis partagé par plusieurs personnes auditionnées par la mission 108 ( * ) , si les politiques en faveur du logement et de l'hébergement ont été globalement bien orientées, il semble que les moyens mis en oeuvre devraient se concentrer encore davantage sur les mesures de prévention et sur l'offre de solutions pour les personnes les plus démunies .
1. Responsabiliser les maires et développer des partenariats avec les associations de proximité afin de ne laisser dans la rue aucun SDF
Il s'agit de responsabiliser les maires en développant des partenariats avec les associations de proximité au travers de conventions d'objectifs visant la prise en charge de toute personne dépourvue de logement. Pour les plus grandes villes, une convention d'objectifs par quartier devrait permettre d'assurer un quadrillage plus fin, afin que les équipes mobiles puissent mieux repérer les personnes en déshérence dans la ville.
Lesdites conventions devront mentionner notamment les moyens mis à disposition des associations pour permettre la prise en charge des personnes accueillies : places disponibles d'hébergement, équipes mobiles et frais d'hébergement.
2. Améliorer la prise en charge des grands exclus
Le HCLPD 109 ( * ) recommande d'organiser la prise en charge des grands exclus en trois temps : l'urgence, la post-urgence et l'insertion.
L'urgence répond à une méthode qui suppose à la fois une plus grande compétence et plus de temps à consacrer à chaque personne : cette première étape comprend la prise de contact, la mise à l'abri, l'évaluation ou le diagnostic accompagnés, le cas échéant, de soins et l'orientation.
L'analyse approfondie de l'état social, psychique et sanitaire des personnes nécessite l'intervention de professionnels polyvalents et expérimentés, afin que le diagnostic débouche sur une orientation adaptée aux besoins des personnes.
La post-urgence constitue la deuxième étape de la prise en charge des grands exclus : elle se traduit par une période de durée de reconstruction en hébergement de stabilisation, dont les conditions de vie sont plus respectueuses de l'intimité des personnes et les règles de fonctionnement et d'accueil plus souples pour rendre effectif le principe d'accueil inconditionnel et durable (tolérance des chiens par exemple). La place de l'accompagnement social doit être centrale et principalement orientée sur l'acquisition des codes de la vie en société (respect d'autrui, des horaires, de l'hygiène, de l'image de soi, etc.).
L'insertion peut s'appuyer sur différentes formes d'habitat, l'hébergement de transition ou le logement d'insertion, tels que les maisons relais, les résidences sociales ou les pensions de famille constituant des structures particulièrement adaptées. La mission considère en effet que ces structures ayant démontré leur efficacité, il est particulièrement opportun de les développer.
3. Inciter les communes à produire plus de logements très sociaux de type PLA-I
• en modifiant les règles de décompte des logements sociaux :
- les logements de type PLA-I et les hébergements devant être plus fortement pondérés que les logements de type PLS ;
- les logements sociaux vendus par les bailleurs ne devant plus être décomptés au bout de cinq ans ;
- les efforts réalisés par les communes pour développer les infrastructures publiques correspondantes (crèches, écoles, etc.) devant être mieux prises compte.
• en fixant la part minimale de logements très sociaux à 30 % des nouveaux logements construits
Dans leur programmation annuelle de construction de logements, il est souhaitable que les communes prévoient la réalisation d'au moins 30 % de logements très sociaux, de type PLA-I.
4. Redéfinir les conditions d'accès au logement social au profit des personnes les plus défavorisées
- contenir à 60 % de la population le nombre de personnes pouvant accéder au parc social ;
- mettre en place une incitation financière (modulation du loyer, prime de déménagement) à la mobilité vers des logements de plus petite taille pour les locataires occupant des logements sociaux surdimensionnés ;
- créer une prime de mobilité vers le parc privé pour les locataires dont les ressources dépassent le niveau du plafond.
5. Prévenir les expulsions locatives
La mission se rallie pour l'essentiel à l'esprit des propositions émises dans ce domaine par le rapport d'étape de M. Etienne Pinte, en allant parfois au-delà. Elle recommande ainsi :
- la mise en application effective des dispositions de la loi de cohésion sociale 110 ( * ) et de la loi portant engagement national pour le logement 111 ( * ) relative aux « créances hyper privilégiées » (dettes locatives, impayés de factures d'énergie ou d'eau) ;
- la mise en place d'une garantie universelle des risques locatifs, concernant tous les locataires et propriétaires, quels que soient leurs revenus ou leurs statuts (association, bailleur, particulier) ;
- la possibilité pour le préfet de suspendre une procédure d'expulsion pour les personnes de bonne foi moyennant l'indemnisation du bailleur ou le recours à l'intermédiation locative ;
- la mise à disposition par le préfet de logements ou d'hébergements pour reloger les personnes éventuellement expulsées au terme de la procédure d'accompagnement et de prise en charge par les nouvelles commissions départementales de prévention des expulsions locatives.
6. Mobiliser plus activement le parc privé à vocation sociale
- en luttant plus activement contre l'habitat indigne ;
- en rendant financièrement plus accessible la garantie contre les risques locatifs (GRL) pour les propriétaires acceptant de louer leur logement à des ménages disposant de revenus modestes ;
- en renforçant les incitations fiscales et financières pour les propriétaires de logements situés dans des zones très tendues et offrant des loyers socialement accessibles à des ménages défavorisés ;
- en facilitant la réalisation d'opérations de démembrement de propriété, consistant à céder temporairement l'usufruit de logements privés à des organismes privés ou publics (associations, entreprises ou bailleurs sociaux) qui seront en charge de louer le bien et d'en assumer les risques (impayés, dégradations, etc.) ;
- en développant les sous-locations à loyers socialement accessibles par des associations ou des organismes publics ;
- en augmentant le montant des primes versées aux propriétaires acceptant de remettre sur le marché leur logement vacant en contrepartie de l'engagement de céder le bail à une association ou un organisme public qui le sous-loueront à des personnes défavorisées.
7. Favoriser l'accession sociale à la propriété
La mission est très favorable à l'accession à la propriété, qui représente une sécurité essentielle pour les ménages et constitue une véritable mesure de prévention de l'exclusion dans le domaine du logement.
Plusieurs mesures peuvent y contribuer :
- la généralisation du prêt d'action social (PAS) foncier à tout type d'habitat, qu'il soit individuel ou collectif ;
- l'intégration dans le décompte des 20 % de logements sociaux des logements acquis en accession sociale à la propriété, les acquéreurs bénéficiant du même niveau de revenus que les locataires du parc HLM ; des logements cédés par les organismes HLM et des logements préemptés par les communes dont l'acquisition est financée par un prêt d'origine publique ;
- le développement de mesures financières incitatives encourageant l'achat par les locataires de leur logement social (décote à l'achat, capitalisation des loyers, etc.).
C. AMÉLIORER L'ACCÈS AU CRÉDIT ET AUX SERVICES BANCAIRES ET RENFORCER LA PRÉVENTION POUR LUTTER CONTRE LE SURENDETTEMENT
1. Garantir un accès effectif des ménages les plus modestes aux services bancaires
Malgré l'existence d'un droit au compte, le coût qu'il représente pour les ménages les plus défavorisés peut représenter une entrave à l'accès aux services bancaires. Plusieurs mesures peuvent permettre de progresser vers la garantie effective de ce droit :
- développer les campagnes d'information sur le droit au compte et les modalités de recours auprès de la Banque de France ;
- plafonner les frais bancaires liés aux incidents de paiement grâce à la mise en place d'un « forfait annuel bancaire de solidarité » pour les ménages bénéficiaires du droit au compte englobant l'ensemble des coûts liés aux découverts (agios, rejet de chèque sans provision, etc.).
2. Mieux prévenir le surendettement des ménages
- en garantissant un accès permanent aux denrées alimentaires de première nécessité à des prix accessibles pour les ménages les plus modestes : certains ménages modestes doivent, dans les situations les plus extrêmes, recourir aux épiceries solidaires ou aux associations humanitaires auprès desquelles ils peuvent trouver des paniers repas. La flambée des prix agricoles (entre 25 % et 100 % selon les produits), fortement ressentie par les associations, nécessite un ajustement de l'enveloppe financière consacrée au programme européen d'aide aux plus démunis 112 ( * ) (PEAD), sans lequel le nombre de repas distribués diminuera de façon significative l'hiver prochain (diminution estimée à 14 millions de repas pour la prochaine campagne des Restos du Coeur 113 ( * ) ).
C'est pourquoi la mission souhaite, outre le développement des épiceries solidaires , notamment dans les communes rurales éloignées des centres urbains, l'indexation de l'enveloppe financière du PEAD sur l'évolution des prix des denrées alimentaires ;
- en favorisant l'acceptation des moyens de paiements alternatifs au chèque (cartes, prélèvements automatiques et virements bancaires, mandats postaux, etc.) notamment dans les services publics de proximité, sur le modèle des expériences conduites dans les départements de la Sarthe et de la Seine-Saint-Denis ;
- en développant la médiation bancaire comme mode alternatif de règlement des litiges entre un client et sa banque , grâce à la création d'un répertoire des médiateurs disponible sur Internet et l'élargissement des compétences légales des médiateurs bancaires aux questions relatives au crédit et à l'épargne ;
- en améliorant la qualité de l'information délivrée par les établissements financiers et les professionnels du crédit grâce à la diffusion de livrets, plaquettes et brochures d'information auprès de leur clientèle et à une meilleure formation des conseillers commerciaux sur l'accès au crédit et le surendettement.
3. Mieux accompagner les ménages dans l'accès au crédit et favoriser le microcrédit social
Souvent difficilement accessible aux ménages en situation financière délicate, le crédit se révèle être également très coûteux, surtout lorsqu'il prend la forme du « credit revolving », souvent inadapté et sur lequel les ménages disposent d'informations très partielles et « trompeuses », selon l'avis du CES 114 ( * ) .
C'est pourquoi il semble nécessaire de :
- privilégier un accès accompagné au crédit :
Dans de nombreux cas, les ménages disposent d'informations restreintes sur les différentes solutions qui s'offrent à eux pour résoudre leurs problèmes financiers. La mise en place de dispositifs d'accompagnement dans l'accès au crédit semble particulièrement opportune pour limiter le recours à des crédits inadaptés et éviter la dégradation de leur situation économique et financière. Cet accompagnement pourrait prendre la forme de consultations gratuites proposées par les permanences d'accès aux droits (PAD) ou les fonds de solidarité pour le logement (FSL), dont les compétences ont été étendues à l'ensemble des dettes liées au logement (eau, électricité, téléphone, etc.) lors du transfert de la gestion de ces fonds aux départements ;
- renforcer l'encadrement des « credits revolving » par un contrôle plus systématique de l'information délivrée aux consommateurs par les directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (notamment sur la tarification et le coût du crédit) ;
- développer une offre de microcrédit social à bas coûts : d'une part pour répondre aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés financières et de ce fait n'ont pas accès au crédit bancaire et recourent à des dispositifs de crédits coûteux ; d'autre part pour permettre aux personnes qui le souhaitent de réaliser un projet personnel (création ou reprise d'entreprise, achat d'une voiture par exemple) visant à faciliter ou conforter leur insertion professionnelle 115 ( * ) . Dans son avis, le CES estime que le microcrédit social doit être à la fois une alternative au « credit revolving », trop coûteux, et un « vecteur d'insertion bancaire et économique ». Outre un accompagnement personnalisé et des taux raisonnables, les prêts octroyés doivent proposer la possibilité de porter de petites sommes, inférieures à 500 euros, montant qui correspond au revenu mensuel moyen versé, pour une personne seule, aux allocataires de minima sociaux.
D. RÉFORMER LE SYSTÈME DES MINIMA SOCIAUX POUR LE RENDRE PLUS EFFICACE, PLUS LISIBLE, PLUS ÉQUITABLE ET UNIVERSEL
1. Créer les conditions du succès du RSA généralisé
On l'a vu précédemment, le principe du RSA suscite l'intérêt et l'adhésion du plus grand nombre , car il répond aux préoccupations de réduire la pauvreté, de simplifier notre système de solidarité nationale et de le rendre plus lisible pour les concitoyens mais aussi de le rendre plus incitatif à la reprise d'activité. Aussi, la mission est-elle favorable à terme à sa généralisation.
Toutefois, les nombreuses réserves exprimées au sujet de la généralisation du RSA par les interlocuteurs de la mission la conduisent, au regard des enjeux sociaux et financiers d'une telle réforme, à recommander la poursuite des expérimentations engagées par les départements , afin d'en retirer tous les enseignements et de mieux appréhender les différentes options retenues par les conseils généraux, notamment concernant le barème du RSA et les mesures d'accompagnement mises en oeuvre.
Il convient donc de créer les conditions du succès du RSA en se laissant le temps de l'expérimentation et de l'évaluation.
Notre système de solidarité nationale a trop longtemps souffert de la mise en place précipitée de dispositifs successifs , politiquement visibles, mais sans souci de cohérence et d'efficacité sur le long terme .
Ce temps supplémentaire permettrait notamment :
- d'approfondir notre connaissance des aides et droits accordés localement par les collectivités territoriales et qui doivent faire l'objet d'un inventaire précis et d'une étude d'impact sur le niveau de vie de nos concitoyens . Il apparaît en effet indispensable de simplifier notre système, d'en améliorer la lisibilité et l'équité en harmonisant, sur l'ensemble du territoire, les politiques d'aides sociales aux personnes les plus démunies. Cette harmonisation doit se faire dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales et sans brider les initiatives, qui sont à l'origine de nombreux progrès sociaux ;
- préparer dès maintenant l'extension du RSA aux travailleurs pauvres, en évaluant mieux l'impact que son versement pourrait avoir sur la qualité des emplois des personnes bénéficiaires. L'avis rendu par le Conseil d'orientation pour l'emploi (COE) invite à la plus grande prudence sur les risques de précarisation des emplois qui pourraient en résulter, notamment par la légitimation des activités à temps partiel subi 116 ( * ) . Il s'agit en effet d'étudier de façon plus approfondie les propositions faites par le COE 117 ( * ) pour encourager l'augmentation du temps de travail hebdomadaire et favoriser l'emploi à temps plein ;
- de reconsidérer le coût global du dispositif et la répartition des moyens disponibles : on peut en effet craindre que le niveau relativement élevé du RSA crée des « trappes à inactivité » ou, en cas de reprise d'activité, des « trappes à précarité ». Ce phénomène pourrait d'ailleurs être amplifié par le recentrage de la PPE au détriment des personnes disposant de faibles revenus. La mission émet les plus vives réserves quant au redéploiement de la manne financière que représente la PPE, et qui devrait pénaliser de nombreux ménages modestes, au premier rang desquels les jeunes de moins de 25 ans ou les femmes exerçant une activité et vivant en couple sans enfants ;
- de clarifier les responsabilités de l'Etat et des départements ainsi que les charges financières afférentes, par l'établissement d'un pacte de confiance ;
- d'envisager un redéploiement des moyens consacrés au financement du RSA vers l'accompagnement et l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi, peu prises en compte dans le dispositif actuel.
La mission tient à rappeler l'objectif que s'est fixé le Gouvernement de faire reculer la pauvreté en cinq ans. Si elle approuve cet objectif, elle considère qu 'il serait socialement dangereux de réduire les politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion à des objectifs exclusivement quantitatifs et de court terme .
En effet, le succès des politiques mises en oeuvre dans ce domaine ne peut être évalué que sur le long terme, lorsque l'insertion des individus s'inscrit dans la durée, grâce à la création de conditions de vie qui en garantissent la pérennité.
A cet égard, la fixation d'un objectif quantitatif de court terme tend à privilégier l'orientation de l'argent public et des moyens d'accompagnement sur les personnes les plus facilement employables, le risque étant de reléguer au second rang les « grands exclus », qui devraient pourtant faire l'objet d'une attention particulière.
2. Evaluer l'efficacité du « contrat d'autonomie » expérimenté pour les jeunes des ZUS en vue de sa généralisation aux jeunes en difficultés
De nombreux jeunes entre 16 et 25 ans, sortis du système scolaire précocement sans diplôme, sont confrontés au chômage et ne bénéficient d'aucun revenu. En outre, ils échappent dans de nombreux cas aux circuits traditionnels de recrutement et ne sont éligibles ni au régime d'assurance chômage, n'ayant jamais cotisé, ni au RMI, son bénéfice n'étant ouvert qu'à partir de 25 ans.
La mission estime que l'accès à un revenu minimum n'est pas opportune pour les jeunes , toute allocation visant à l'autonomie ne pouvant être versée que ponctuellement et être assortie de la construction d'un projet d'insertion professionnelle durable, qui nécessite que toute aide financière soit conditionnée à la signature préalable d'un contrat 118 ( * ) .
Dans ce domaine, les missions locales 119 ( * ) jouent un rôle fondamental d'accueil, de conseil et d'orientation, qui pallie en partie les carences du service public de l'emploi : chaque année, elles accueillent près de 1,2 million de jeunes et trouvent, pour une grande majorité, des solutions d'insertion ou de formation.
Les jeunes des ZUS (entre 150 000 et 200 000) sont particulièrement exposés aux risques de pauvreté et d'exclusion sociale, du fait des difficultés spécifiques d'insertion professionnelle qu'ils rencontrent. C'est pourquoi le ministère de la ville et du logement expérimente pour 45 000 d'entre eux, un contrat d'autonomie , destiné à les accompagner vers l'emploi sur une durée limitée à un an (6 mois avant l'entrée dans l'emploi et 6 mois après l'embauche).
Le programme, doté de 250 millions sur trois ans, finance le dispositif d'accompagnement qui sera confié à des organismes publics ou privés et offre aux jeunes une « bourse d'autonomie » de 300 euros par mois durant les six premiers mois pour faciliter leur recherche d'emploi.
Il s'agira d' évaluer ce dispositif et de le comparer notamment aux résultats obtenus par le contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS) , outil principal d'insertion des missions locales, dont le coût ne représente que 900 euros sur un an et qui a déjà permis d'accompagner 500 000 jeunes et d'offrir à plus de 105 000 d'entre eux un emploi durable.
E. AMÉLIORER L'ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS DANS LEUR PARCOURS D'INSERTION POUR GARANTIR L'EFFECTIVITÉ DE LEURS DROITS
L'accompagnement joue un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs visés par les dispositifs d'insertion mis en oeuvre. Sans accompagnement, l'effectivité de certains droits est compromise selon l'ONPES, qui souligne la nécessité d'un accompagnement dans tous les domaines et à tous les niveaux d'intervention des politiques d'insertion.
Cette activité nécessite de plus en plus de compétences voire une certaine polyvalence afin d'assumer les multiples missions qu'elle recouvre : écoute et dialogue, évaluation et diagnostic relatif à la situation de la personne accompagnée, orientation dans un système de solidarité et médicosocial de plus en plus complexe et conseils à chaque étape du parcours.
1. Poser le principe d'un référent unique ou d'un binôme assurant l'accompagnement social et professionnel pour toute personne en insertion
L'insertion doit être conçue comme un parcours que l'individu réalise dans la durée, en plusieurs étapes, allant du diagnostic lors de la prise en charge au simple suivi dans la dernière phase du parcours, lorsque la personne insérée se stabilise.
La réussite de ce parcours suppose la présence à ses côtés d'une personne référente ou d'un binôme assurant à la fois l'accompagnement social et professionnel de façon complémentaire. Qu'il s'agisse d'un référent unique ou d'un binôme selon la situation de la personne en insertion, la qualité de l'accompagnement dépend en premier lieu de la continuité de la prise en charge , ce qui suppose qu'une personne soit suivie sur le long terme par le même travailleur social.
Le rapport de synthèse du Grenelle de l'insertion a prévu la mise en place d'un référent professionnel unique pour tous les bénéficiaires de minima sociaux qui recherchent un emploi. Ce référent, qui dépendra du service public de l'emploi ou d'organismes privés missionnés à cette fin par le nouvel opérateur, accompagnera la personne tout au long de son parcours de réinsertion professionnelle et pourra faire appel le cas échéant à un référent social, d'où l'éventuelle nécessité d'un binôme.
Cela suppose au préalable que l'ensemble des bénéficiaires de minima sociaux en mesure de travailler puissent être inscrits à l'ANPE et accéder au service public de l'emploi, ce qui n'est actuellement le cas que pour un tiers des allocataires du RMI, par exemple. La mission estime que l'accompagnement professionnel et social constitue un droit à part entière dont chacun doit pouvoir bénéficier au cours de son parcours professionnel, notamment lors des ruptures ou transitions inévitables qu'il comporte. L'organisation institutionnelle actuelle, qui a souvent conduit à une segmentation des publics en insertion, ne doit en effet pas se traduire par un accès inégalitaire au service public de l'emploi.
2. Favoriser le développement de formations polyvalentes des travailleurs sociaux et des accompagnateurs référents
Les personnes qui accompagnent les populations en insertion sont de plus en plus spécialisées : conseiller ANPE ou des missions locales, assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, technicien de l'intervention sociale et familiale, moniteur éducateur, conseiller en économie sociale et familiale, éducateur technique spécialisé ou auxiliaire de vie sociale...
Ces métiers, qui sont destinés à répondre à la demande sociale de personnes confrontées à des situations de plus en plus spécifiques, montrent à quel point le métier de travailleur social s'est diversifié. Si cette spécialisation s'est révélée utile, elle ne doit pas négliger le développement nécessaire de travailleurs sociaux généralistes, capables de gérer des situations très diverses.
L'intervention d'un référent ou d'un binôme unique suppose en effet une certaine polyvalence des travailleurs sociaux et des acteurs associatifs, le champ de leurs compétences devant couvrir à la fois : le domaine sanitaire et social ; une bonne connaissance de l'organisation du système de solidarité nationale et des aides locales pour orienter au mieux les personnes vers les dispositifs adaptés ; des compétences juridiques pour assister les personnes dans l'acquisition ou le rétablissement de leurs droits ; des connaissances médicales de base dans le domaine de la prévention et de la psychologie.
Une réflexion générale sur les métiers du secteur social et médicosocial est actuellement en cours au ministère en charge de la solidarité, intégrant à la fois la question centrale des formations mais aussi celle de la revalorisation du statut des travailleurs sociaux selon leur niveau de qualification.
3. Définir de façon concertée des principes communs d'évaluation des professionnels de l'insertion
L'efficacité des politiques d'insertion repose essentiellement sur les résultats obtenus par les accompagnateurs référents. Le principe posé d'un référent unique présente l'avantage, outre le repère qu'il représente pour la personne accompagnée, de responsabiliser le conseiller par rapport aux individus qu'il prend en charge
Aussi paraît-il souhaitable de valoriser les résultats que chaque conseiller obtient dans des conditions qui restent à définir. Il est vrai que l'efficacité des actions entreprises dépend pour une grande partie des moyens mis à leur disposition pour faciliter l'accomplissement de leur mission.
La mission estime que ce sujet doit faire l'objet d'une concertation avec les associations et organismes représentatifs des intérêts des acteurs impliqués dans l'accompagnement professionnel et social des personnes en insertion.
4. Intensifier les relations entre les entreprises du bassin d'emploi et les professionnels de l'insertion
S'agissant notamment de l'insertion professionnelle, la mission a eu l'occasion de mesurer tout l'intérêt d'une bonne connaissance du réseau économique local par les conseillers en insertion.
Ainsi, les partenariats entre les chambres de commerce et les missions locales 120 ( * ) , qui donnent des résultats encourageants (développement du parrainage et du tutorat, intégration des jeunes dans l'emploi ou accompagnement dans un projet de création d'entreprise) mériteraient d'être développés.
De même, la mise en place par le conseil général de la Côte-d'Or d'un réseau d'entreprises locales, mobilisable pour offrir des stages d'insertion de courte durée aux jeunes ou aux bénéficiaires de minima sociaux en recherche d'emploi, et qui permet d'évaluer in situ leurs compétences et facultés d'adaptation au monde de l'entreprise, constitue un autre exemple de partenariat fructueux.
L'inscription de l'insertion à l'ordre du jour des négociations entre syndicats patronaux et salariés devrait permettre de conforter les initiatives observées dans ce domaine.
|
Récapitulatif des propositions de la mission 1) Améliorer encore la prise en charge et l'accès aux soins des personnes défavorisées - Développer les unités mobiles de prise en charge et généraliser les permanences d'accès aux soins de santé ; - Favoriser l'accès des bénéficiaires de la solidarité nationale à la CMU-c par le développement de l'affiliation automatique et l'étude systématique des droits lors de toute prise en charge ; - Revaloriser les plafonds d'accès à la CMU-c au niveau du seuil de pauvreté ; - Responsabiliser les bénéficiaires de la CMU et les médecins pour limiter les refus de soins. 2) Poursuivre les actions engagées en faveur de l'hébergement et du logement des ménages modestes - Responsabiliser les maires au travers de conventions d'objectifs conclues avec les associations de proximité visant la prise en charge de toute personne sans abri ; - Inciter les communes à produire plus de logements très sociaux par une meilleure reconnaissance des efforts consentis et en fixant à 30 % la part minimale qu'ils doivent représenter parmi les logements nouvellement construits ; - Libérer des logements dans le parc social au profit des ménages les plus défavorisés en limitant à 60 % la part des ménages éligibles et en développant des mesures incitatives à la mobilité vers le parc privé ; - Mettre en oeuvre dès que possible les mesures préconisées par la mission Pinte en faveur de la prévention des expulsions locatives ; - Mobiliser plus activement le parc privé à vocation sociale en renforçant la lutte contre l'habitat indigne et en recentrant les incitations financières et fiscales sur les logements socialement accessibles situés dans les zones tendues ; - Favoriser l'accession sociale à la propriété en intégrant dans le décompte des 20 % de logements sociaux les logements acquis par des ménages modestes. 3) Prévenir le surendettement et améliorer l'accès des personnes en difficultés au crédit et aux services bancaires - Garantir l'accès effectif de tous aux services bancaires ; - Prévenir le surendettement des ménages en difficultés en favorisant la médiation bancaire et en indexant l'enveloppe financière du PEAD sur l'évolution des prix des denrées alimentaires ; - Protéger les ménages emprunteurs du « malendettement » en privilégiant un accès accompagné au crédit ; - Favoriser le développement du microcrédit social. 4) Réformer le système de solidarité nationale - Simplifier le système et le rendre plus incitatif à la reprise d'activité grâce à l'intégration des « droits connexes » dans toute réforme des minima sociaux ; - Créer les conditions du succès du RSA généralisé en se laissant le temps de l'expérimentation et de l'évaluation ; - Recentrer les politiques d'insertion sur les personnes les plus éloignées de l'emploi ; - Evaluer le contrat d'autonomie expérimenté au profit des jeunes des ZUS dans la perspective de sa généralisation à l'ensemble des jeunes en difficultés 5) Améliorer l'accompagnement des personnes en insertion - Poser le principe d'une personne ou d'un binôme référent assurant l'accompagnement social et professionnel pour toute personne en insertion ; - Favoriser le développement de formations polyvalentes des travailleurs sociaux ; - Définir de façon concertée des principes communs d'évaluation des professionnels de l'insertion - Intensifier les relations entre les entreprises du bassin d'emploi et les professionnels de l'insertion. |
TITRE III - L'ÉCOLE NE JOUE PAS SON RÔLE DANS LA RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ ET DANS LA PRÉVENTION DE L'EXCLUSION SOCIALE
La mission d'information, tout au long de ses travaux, a tenté de comprendre comment les gens « tombent » dans la grande pauvreté et la précarité. Elle n'a pu que constater qu'une grande part des adultes pauvres sont en fait nés pauvres. Trop souvent, on naît pauvre, on le reste, on ne le devient que plus rarement .
Force est donc de s'interroger sur le faible rôle de notre système éducatif, de l'école primaire jusqu'à l'enseignement supérieur, pour sortir de situations initiales de pauvreté, voire sur une certaine faillite de l'école pour s'adresser à des publics pauvres.
Si aux États-Unis, près de la moitié des enfants nés de parents pauvres deviennent ainsi des adultes pauvres 121 ( * ) , 50% des jeunes Français sortis de l'école à 17 ans sans diplôme vivent dans 20% des ménages les plus pauvres.
La mission considère qu'il s'agit d'un échec majeur de notre système scolaire alors que l'école républicaine est censée permettre aux jeunes issus de milieux défavorisés de trouver une autre place dans la société, conforme à leurs aspirations, à leurs capacités et à leur mérite. Dès lors qu'elle ne garantit plus l'égalité des chances et que les inégalités scolaires ne sont plus seulement le fruit d'une histoire personnelle mais obéissent à des déterminants sociaux, ses fondements sont remis en cause, ce qui appelle des mesures spécifiques en faveur des élèves pauvres.
Ces inégalités ne s'ajoutent pas seulement aux inégalités devant l'emploi, le logement, la santé, elles tendent aussi à les reproduire. Elles en sont, comme l'a souligné Mme Marie Duru-Bellat, « la courroie de reproduction ».
Si les conditions de vie des enfants de pauvres 122 ( * ) sont difficiles, leur capacité à les améliorer l'est encore davantage.
Considérant que la question de l'échec scolaire constitue un enjeu prioritaire, la mission a souhaité en analyser les causes, les effets, et proposer quelques pistes de réforme.
Elle s'est tout d'abord attachée à établir un état des lieux des inégalités à l'école, afin de déterminer à quelles étapes de la vie scolaire la pauvreté constituait un handicap et quelles en étaient les causes.
La mission a ensuite analysé les faiblesses des politiques scolaires centralisées menées depuis une vingtaine d'années, notamment en matière d'éducation prioritaire et d'orientation.
Estimant nécessaire d'encourager les initiatives innovantes, notamment locales, la mission a recensé les bonnes pratiques scolaires et formulera des propositions concrètes visant à ce que les enfants pauvres aient les mêmes chances que les autres.
I. L'ÉCOLE, REPRODUCTRICE D'INÉGALITÉS ?
A. TROP D'IMPASSES SCOLAIRES POUR LES ENFANTS PAUVRES
1. Le diplôme, passeport pour sortir de la précarité et de l'exclusion sociale
Selon les critères européens, 17 % des jeunes français de 20 à 24 ans n'ont aucune qualification , c'est-à-dire ne possèdent aucun diplôme du cycle secondaire tel que brevet d'études professionnelles (BEP), certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ou baccalauréat 123 ( * ) . Si la proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans sortis du système scolaire prématurément a connu une baisse de deux points entre 1996 et 2000, puis s'est stabilisée aux alentours de 13 %, elle ne diminue plus aujourd'hui.
Le fait que la France se situe en position favorable au sein de l'Union européenne, avec un taux inférieur de quatre points à la moyenne européenne (en 2006, cet indicateur indiquait 30 % en Espagne, 40 % au Portugal, mais 8 % en Finlande et 9,6 % en Autriche) ne doit pas empêcher de renforcer les moyens de prévenir l'échec scolaire.
En effet, chaque année environ 150 000 jeunes sortent du système scolaire sans diplôme ni qualification et éprouvent les plus grandes difficultés à trouver un emploi.
A la différence d'autres pays, le niveau scolaire en France est un facteur essentiel justifiant la position sociale ou le salaire.
La probabilité d'être sans emploi est ainsi nettement plus importante pour les personnes sans diplôme : selon le rapport 2007-2008 de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale (ONPES), « quatre ans après la fin de leur formation, si 70 % des jeunes non diplômés disposent d'un emploi, 20 % d'entre eux sont au chômage (contre 9 % des jeunes sortis de formation la même année) et 10 % sont inactifs. En outre, un jeune sur huit est confronté à un temps partiel subi ».
EMPLOI, CHÔMAGE ET INACTIVITÉ SELON LE DIPLÔME (25-64 ANS)
|
Emploi |
Chômage |
Inactif |
Taux de chômage |
|
|
Sans diplôme |
57 |
8 |
35 |
12,8 |
|
CAP/BEP |
77 |
6 |
17 |
6,7 |
|
Baccalauréat |
78 |
6 |
16 |
7 |
Sources : enquête emploi de mars 2002, calculs CERC
Le niveau de rémunération est également plus faible . La prime salariale associée à l'obtention d'un niveau CAP/BEP par rapport à une sortie sans qualification est de l'ordre de 12 % environ, tandis qu'elle est de l'ordre de 20 % pour un bac professionnel.
Quant aux jeunes peu qualifiés, quatre ans après la fin de leur formation, ils sont deux fois plus souvent au chômage que la moyenne des jeunes. Selon l'enquête Génération du Céreq, qui a suivi une cohorte de jeunes sortis de l'école en 1998, 73 % d'entre eux occupent un emploi à durée indéterminée et 13 % un emploi à durée déterminée sept ans après la fin de leur formation.
Cette question du diplôme est donc particulièrement importante lorsqu'on évoque la question de la pauvreté car une insertion professionnelle difficile a des conséquences à long terme sur les trajectoires des jeunes concernés, en dégradant leur « capital humain » et en les enfermant durablement dans une situation de précarité ou de pauvreté. A cet égard, il convient de rappeler que l'amélioration de la réussite scolaire des pauvres, loin de se faire au détriment de catégories sociales plus favorisées bénéficierait bien à l'ensemble de la société, et tendrait à réduire le coût économique et social de la pauvreté et de l'échec scolaire.
La mission insiste, en outre, sur le fait que les enfants pauvres ayant subi un échec scolaire sont nettement plus exposés que les autres enfants au risque de pauvreté une fois devenus adultes et entrés dans la vie active. En effet, les faibles perspectives d'emploi et de salaire, attachées à l'absence ou à l'insuffisance de formation scolaire, sont renforcées par le faible niveau de capital social que leur transmettent les parents.
Force est malheureusement de constater que les enfants de pauvres ne sont pas seulement défavorisés sur le marché du travail, mais aussi pendant toute leur scolarité.
2. Des enfants pauvres moins diplômés
Près d'un tiers des jeunes sans diplôme se trouvent dans les 10% des ménages ayant le plus faible niveau de vie, et leur probabilité de sortir de l'école à 17 ans sans diplôme ni qualification est trois fois plus forte que dans l'ensemble de la population 124 ( * ).
Il s'agit là d'un gâchis humain pour la société résultant du fait que des élèves qui pourraient réussir se trouvent relégués dans des filières scolaires inadaptées doublées d'une injustice sociale.
Selon une enquête de la direction de l'évaluation et de la prospective (DEP) du ministère de l'éducation nationale, environ 11 % des enfants pauvres entrés en classe de sixième en 1995 ont atteint une terminale générale sans redoublement et sont considérés en réussite, 38 % sont passés par l'enseignement professionnel (les filières du CAP ou du BEP), 25 % ont été affectés selon la nature des difficultés rencontrées dans une des voies suivantes : quatrième ou troisième d'insertion ou technologique, classe d'initiation préprofessionnelle par alternance, classe préparatoire à l'apprentissage, enseignement adapté (SEGPA). Enfin, durant la période étudiée, 24 % de ces jeunes ont quitté le système éducatif.
Afin de combattre cette réalité, il faut en comprendre les raisons et analyser la situation de ces enfants pauvres à chaque étape de leur vie scolaire.
B. REMONTER LA FILIÈRE DE LA PAUVRETÉ
La progression scolaire des élèves se construit dans le temps, mais à mesure qu'ils avancent dans leur scolarité, le champ de leurs perspectives se réduit du fait des choix effectués et des difficultés rencontrées.
L'ONPES a ainsi mené une enquête visant à apprécier comment se modifient au fil des ans les chances pour un jeune d'accéder au niveau IV de formation (baccalauréat), sept ans après l'entrée en sixième. Le principe est d'estimer pour chaque jeune, à différentes « dates clefs » de sa trajectoire, quelles sont ses chances d'accéder au niveau IV, en supposant à chaque « date clef » considérée qu'il se comporte par la suite comme la moyenne des jeunes du groupe 4 (groupe référence correspondant à un niveau moyen) ayant connu jusqu'alors le même cursus. Les « dates clefs » retenues par l'étude de l'ONPES sont 1995 (année d'entrée en sixième), 1998 (trois ans après l'entrée en sixième), 1999 (quatre ans après l'entrée en sixième) et 2001, l'année de l'obtention du baccalauréat.
L'enquête révèle que le taux d'accès au niveau IV du groupe 1 (groupe des élèves les plus en difficulté) est inférieur de 33 points à celui du groupe 4, et se ventile ainsi qu'il suit :
- 27 points (81 %) ont été perdus avant le collège ;
- 3,5 points (11 %) au cours des années de collège ;
- 2 points (6 %) lors de l'orientation en fin de collège ;
- 0,5 point (2 %) pendant les années de lycée.
TAUX D'ACCÈS AU NIVEAU IV À DIFFÉRENTES « DATES CLEFS » (EN %)
|
Groupe 1 |
Groupe 2 |
Groupe 3 |
Groupe 4
|
Ecart
|
|
|
Taux simulé en 1995-1996 |
23,2 |
31,3 |
38,3 |
50,2 |
27,0 |
|
Taux simulé en 1998-1999 |
19,5 |
27,3 |
36,1 |
50,2 |
30,6 |
|
Taux simulé en 1999-2000 |
17,6 |
25,6 |
33,7 |
50,2 |
32,6 |
|
Taux observé en 2001-2002 |
17,0 |
24,9 |
32,3 |
50,2 |
33,2 |
Les informations retenues pour appréhender le cursus scolaire et composer les groupes sont en 1995, l'âge d'entrée en sixième et le niveau d'acquis à l'entrée en sixième ; en 1998, les données de 1995 et la classe de 1998 ainsi que les notes éventuelles au brevet ; en 1999, les données de 1995 et 1998 et la classe de 1999.
Cette enquête illustre bien le poids prépondérant du primaire dans le processus de différenciation des trajectoires scolaires . Au fil des ans, les écarts se creusent de moins en moins.
Les données des travaux statistiques sur les sortants sans qualification confirment cet impact du niveau scolaire en fin de primaire. Parmi les élèves qui se situaient parmi les 25 % les plus faibles au niveau national à leur entrée en sixième en 1995, 24 % d'entre eux sont sortis sans qualification (contre 9,3 % sur l'ensemble des élèves) 125 ( * ) . Dans cette population des sortants sans qualification, le CP ou le CE1 était la première classe redoublée pour la moitié d'entre eux . Il faut affiner la connaissance de cette réalité qui pourrait suggérer qu'il y a une inadaptation du processus scolaire et de ses méthodes d'apprentissage à certaines formes d'intelligence ou de personnalité.
En dépit de ces redoublements, les études primaires se terminent avec un niveau de compétences en français et en mathématiques souvent insuffisant . Aux épreuves nationales d'évaluation de 6 e , près de deux tiers des élèves sortis sans qualification obtiennent ainsi des résultats qui les situent parmi le quart des élèves les plus faibles dans ces deux disciplines 126 ( * ) .Les recherches sur les trajectoires scolaires des élèves des dispositifs relais 127 ( * ) vont dans le même sens : elles indiquent que la plupart des élèves accueillis en dispositifs relais ont redoublé plusieurs fois, surtout les classes en début de cycle (CP et CE1), avec pour 10 % d'entre eux de graves problèmes de maîtrise de la langue, et pour 20 % des cas, de très faibles capacités de lecture.
La question qui se pose est celle de savoir si les enfants des classes populaires sont concernés par les mêmes évolutions et si « leur sort est joué » dès la sortie de l'école primaire.
1. L'école primaire : terreau des inégalités ?
M. Jacques Attali, lors de son audition par la mission, a souhaité l'alerter sur l'aggravation de l'exclusion en expliquant cette évolution par des facteurs nombreux et complexes, au premier rang desquels il a placé la faiblesse de l'enseignement primaire128 ( * ).
Une évaluation menée en septembre 2002 ( Repères et références statistiques, 2003) indique que, dès le CE2, le niveau en français et mathématiques des enfants des classes populaires est bien moins élevé que celui des autres. Les enfants des familles les plus touchées par la précarisation et la disqualification (économique et symbolique) connaissent le plus souvent des difficultés d'apprentissage très précoces.
En se fondant sur les évaluations nationales et les recherches menées à d'autres niveaux de classe, Mme Marie Duru-Bellat montre que les premières « traces » statistiques des inégalités sociales à l'école s'observent dès la moyenne section de maternelle, et que leur caractère cumulatif apparaît nettement à partir du cours préparatoire . Au primaire, les difficultés persistantes se traduisent très vite en un cumul des lacunes, et une dégradation très nette des performances intervient en début de collège. En adoptant la même démarche, M. Jean-Pierre Terrail conclut, quant à lui, qu' « une partie des enfants de cadres qui ont commencé par rater les apprentissages élémentaires finissent quand même par s'en sortir ; quant aux élèves des milieux populaires, ceux qui les ont plus ou moins réussis peuvent perdre pied par la suite, au collège ; mais ceux qui les ont ratés ne s'en relèvent quasiment jamais » 129 ( * ) .
Le dernier rapport du Haut conseil de l'éducation qui établit chaque année un bilan des résultats obtenus par le système éducatif a même fait le constat que l'école maternelle est une étape importante et note que « les difficultés repérées chez [les enfants] à l'entrée du CP compromettent à jamais leurs chances de réussite scolaire ». Dès l'entrée en CP, la catégorie socioprofessionnelle des parents est le facteur le plus discriminant pour les avantages des enfants : davantage que le trimestre de naissance qui est, à cet âge, un second facteur assez discriminant, le fait d'être en zone d'éducation prioritaire (ZEP) ou pas, le nombre d'années de scolarisation, le sexe ou la nationalité. La politique de scolarisation précoce à deux ans permet cependant de rapprocher les résultats des élèves des ZEP de la moyenne, même si ces effets paraissent limités au regard des différences de scores entre catégories socioprofessionnelles. Ces différences entre les enfants issus de catégories socioprofessionnelles favorisées et ceux issus de catégories moins défavorisées sont les plus fortes dans le domaine de la familiarité avec l'écrit ou les nombres, facteur favorisant un accroissement ultérieur des différenciations pendant le primaire.
Il faudrait alors essayer de voir si la différence de catégorie socioprofessionnelle de la famille ne se traduit pas en réalité, non pas par une différence d'aptitude des enfants, mais plutôt par une différence de forme d'intelligence, plus concrète que conceptuelle par exemple, au moins au moment d'entrée dans le processus éducatif.
Les méthodes modernes d'apprentissage des fondamentaux ne seraient elles pas en définitive quoiqu'en pensent certains, plus ségrégatives qu'universelles en raison des qualités de synthèse ou d'éducation familiale préscolaire qu'elles présupposent comme innées ou uniformes, et qui ne le sont pas du tout, au contraire.
En outre, le Haut conseil de l'éducation estime que le redoublement est plus néfaste à l'apprentissage que le passage de justesse dans une classe supérieure. Or, en 2001, si environ le quart des élèves étaient en retard à l'entrée en 6 e , 45 % des enfants pauvres l'étaient alors que le taux était seulement de 12 % pour le quintile le plus favorisé 130 ( * ) .
RÉSULTATS SELON L'ORIGINE SOCIALE DES
ÉLÈVES
À L'ENTRÉE EN CE2 ET EN
6
E
|
Entrée en CE2 |
Entrée en 6 e |
|||
|
Français |
Mathématiques |
Français |
Mathématiques |
|
|
Cadres et professions libérales |
79,8 |
73,8 |
78,0 |
74,9 |
|
Professions intermédiaires |
77,4 |
71,7 |
73,4 |
70,5 |
|
Employés |
73,0 |
69,5 |
69,5 |
64,9 |
|
Artisans, commerçants |
74,3 |
68,5 |
67,9 |
66,5 |
|
Agriculteurs exploitants |
73,2 |
69,0 |
68,7 |
64,5 |
|
Ouvriers |
67,5 |
63,4 |
63,0 |
59,1 |
|
Inactifs |
60,3 |
54,4 |
59,2 |
53,7 |
|
Moyenne |
72,0 |
67,1 |
68,5 |
64,6 |
|
Écart cadres/ouvriers
|
17 % |
15 % |
22 % |
24 % |
Note : résultats obtenus à la rentrée de septembre 2000. Les protocoles d'évaluation reposent sur un nombre variable d'items (par exemple 94 items pour l'évaluation de français de CE2), les résultats sont ici systématiquement ramenés à 100.
Sources : Andrieux, Dupé et Robin, 2001 et Andrieux, Brésillon et Chollet-Remvikos, 2001.
2. Le collège accentue ces inégalités
Les écarts s'accentuent ensuite encore au collège, dès les deux premières années. Mme Marie Duru-Bellat souligne ainsi que « dans la mesure où les élèves de milieu populaire abordent le collège avec un niveau plus faible, l'élitisme du collège va en lui-même creuser les inégalités sociales, sans compter les inégalités sociales attachées spécifiquement aux progressions à ce niveau » 131 ( * ) . Ces inégalités spécifiques aux collèges seraient liées aux choix d'options ou d'établissement qui seraient eux-mêmes directement liés au milieu familial de l'enfant.
Cette explication sociologique est celle qui vient directement à l'esprit, mais pourquoi ne serait elle pas corrélée là encore avec une différenciation due à d'autres facteurs ?
Les différenciations sont essentiellement visibles à ce stade au travers du retard scolaire. Or il est démontré que le retard à l'entrée en 3 e est fortement corrélé avec le revenu. Selon le rapport précité du CERC, alors qu'un tiers des enfants sont en retard, plus de la moitié des enfants pauvres le sont. Le taux décroît de 54 % pour les deux premiers déciles à 14 % pour le dernier décile de niveau de vie, et « il est près de huit fois plus probable qu'un enfant du premier décile soit en retard qu'un enfant du dernier décile. »
RETARD (UN AN ET DEUX ANS ET PLUS) À
L'ENTRÉE EN 3
E
EN FONCTION DU DÉCILE DE
REVENU
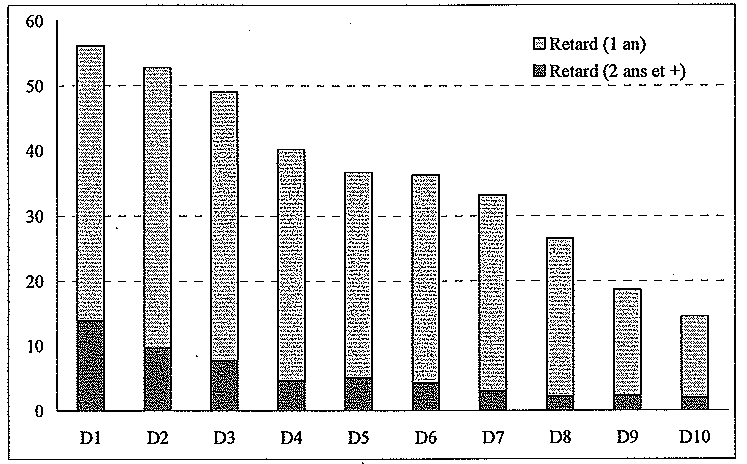
Note : retard à la présence en 3 e à la rentrée de septembre. Les enfants entrant en troisième sans retard ont 14 ans à la rentrée et atteignent 15 ans durant l'année scolaire.
Les enfants nés en 1985 avaient 14 ans à la rentrée de septembre 1999 et ont atteint 15 ans durant l'année scolaire 1999-2000.
Sources : rapport CERC, sur les enfants pauvres en France, 2004.
Encore plus inquiétant, le taux de grand retard est beaucoup plus concentré dans le bas de la distribution : il est très fort pour le premier décile et diminue très vite avec le niveau de vie.
3. Le mythe du baccalauréat pour tous
Selon le récent rapport du groupe de travail de M. Jacques Legendre sur le baccalauréat, la France ne se caractérise pas par un excès de bacheliers, « mais par une insuffisance, tant pour les bacheliers généraux que les bacheliers professionnels ». Les comparaisons internationales montrent que la proportion de bacheliers par génération en France est nettement plus faible qu'elle ne l'est en moyenne dans les pays de l'OCDE et de l'Union européenne (à 19).
PROPORTION DE BACHELIERS DANS UNE GÉNÉRATION (2005)
Les bacheliers généraux et professionnels sont ainsi sous-représentés en France. Alors que l'économie de la connaissance est le moteur de la croissance en Europe, la France est donc en retard dans la qualification de ses jeunes.
De plus, la répartition des diplômés du secondaire en fonction de la nature des études suivies (voie générale préparant à des études longues, voie technologique préparant à des études courtes, voie professionnelle ouvrant la voie à une insertion professionnelle) est particulièrement déséquilibrée en France.
A cet égard, la mission s'est intéressée au devenir des enfants issus de familles défavorisées particulièrement susceptibles de pâtir de cette scolarisation insuffisante.
Dans l'enquête « Emploi » de 1998, la proportion de jeunes adultes de 25-39 ans dotée d'un diplôme égal ou supérieur au baccalauréat variait de 42 % chez les enfants d'ouvriers à 82 % chez les enfants de cadres et professions libérales 132 ( * ) .
Dix ans plus tard, le niveau de réussite au baccalauréat n'a pas évolué et l'origine sociale des jeunes a toujours un impact direct sur leur taux de réussite.
Le suivi du « panel 1989 » établi par la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère de l'éducation nationale est à cet égard très instructif. Les conclusions des enquêtes menées dans ce cadre montrent que les chances d'un élève de quitter le système scolaire sans le baccalauréat varient très fortement selon l'origine sociale de l'élève.
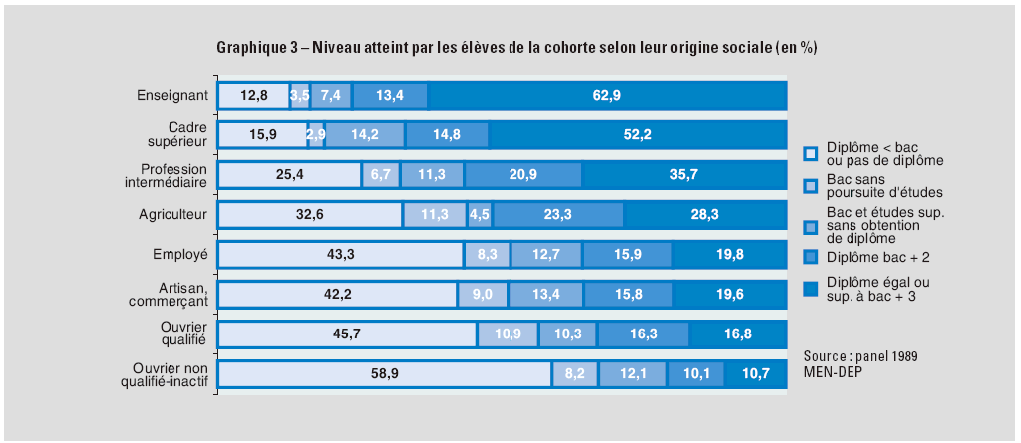
Si 12,8 % des enfants d'enseignants et 15,9 % des enfants de cadres supérieurs achèvent leurs études sans avoir obtenu le baccalauréat, 45,7 % des enfants d'ouvriers qualifiés et 58,9 % des élèves dont les parents sont ouvriers non qualifiés ou inactifs n'ont pas le baccalauréat.
Encore plus inquiétant, si l'on ne retient que le baccalauréat général, qui offre les perspectives les plus intéressantes pour les élèves, seulement 15,8 % des élèves dont le père et la mère sont ouvriers qualifiés ou inactifs en sont détenteurs. Le baccalauréat n'est donc pas « donné » à tous les élèves et les objectifs de 80 % d'une classe d'âge au baccalauréat est loin d'être atteint. Pour la mission, un objectif de réussite des enfants défavorisés devrait être fixé par l'éducation nationale tant cette injustice scolaire est criante.
En effet, sans constituer une garantie totale, le fait d'obtenir le baccalauréat réduit considérablement le risque de devenir pauvre, même si l'enseignement supérieur est aussi, mais à un degré moindre, un creuset d'inégalités.
TAUX DE PAUVRETÉ DES MÉNAGES SELON LE DIPLÔME (EN %)
|
Taux de pauvreté monétaire |
||
|
Pas de diplôme |
22,9 |
|
|
CEP |
10,3 |
|
|
CAP-BEP |
8,8 |
|
|
BEPC |
7,2 |
|
|
Bac général |
6,1 |
|
|
Supérieur au bac |
5 |
|
Source : Insee
En dépit de leur intérêt, ces éléments chiffrés n'apportent pas d'explication concrète aux raisons des difficultés scolaires aux élèves des catégories défavorisées et ne donnent que peu d'indications sur les pistes à suivre pour y remédier. Or la question des causes de l'échec scolaire des enfants pauvres renvoie directement à l'interrogation essentielle de la mission : pourquoi les pauvres ne parviennent-ils pas à sortir de la pauvreté ?
4. Pourquoi les pauvres ne réussissent-ils pas à l'école ?
Outre le lien direct entre « milieu social et familial » et performances scolaires, Mmes Marie Duru-Bellat et Agnès van Zanten 133 ( * ) ont tenté de pondérer le poids des différents facteurs expliquant cette causalité. Elles ont notamment mis en lumière les faits suivants :
- le déroulement de la scolarité est plus sensible au niveau d'instruction de la famille qu'à son niveau économique ou matériel ;
- le niveau d'études des parents est un critère plus fiable que celui d'un seul, l'essentiel, quant à la réussite scolaire, étant de disposer dans la famille d'un « stock » minimal d'instruction ;
- l'influence du niveau de formation des mères s'avère plus forte que celle de la profession du père.
Ce n'est donc pas la pauvreté monétaire qui défavoriserait le plus les enfants mais le niveau scolaire de leurs parents et, par conséquent, le traitement social de la pauvreté n'aurait pas un impact direct sur la réussite scolaire.
D'autres sociologues ont plus spécifiquement étudiés les déterminants « matériels » de la réussite scolaire. M. Eric Maurin 134 ( * ) explorant les liens entre pauvreté et échec scolaire , a notamment montré que le nombre d'enfants par chambre, et donc la taille du logement, avait un impact sur la réussite scolaire et, à cet égard, que le soutien social aux familles était utile pour la scolarité des enfants.
MM. Mathias Millet et Daniel Thin ont, quant à eux, souligné que dans le cas des familles les plus pauvres, les conditions d'existence entrent clairement en contradiction avec les conditions d'une scolarité normale en raison des effets qu'elles engendrent sur les pratiques familiales 135 ( * ) . Ils notent ainsi que l'accès à un certain degré de maîtrise du temps et de l'avenir nécessaire au suivi scolaire est rendu difficile « tant par les temporalités familiales de l'urgence et de l'imprévu que par les décalages des horaires de travail de certains parents, ou l'absence de rythmes de ceux qui sont sans emploi parfois depuis de longues années ». D'autres sociologues ont montré que les situations spécifiques des familles et leurs conditions sociales d'existence concourent à réduire leur autorité et emprise sur le comportement de leurs enfants, ce qui nuit forcément à leur réussite scolaire136 ( * ).
Il reste que davantage que les conditions matérielles de vie, c'est plutôt un ensemble de facteurs socioculturels - dont le poids est difficile à pondérer - qui expliqueraient les difficultés scolaires des enfants de classes défavorisées. Plus que la pauvreté c'est donc une forme d'exclusion socioculturelle qui aurait l'impact le plus fort sur l'échec scolaire des élèves. Elle explique pourquoi certains enfants sont moins bien adaptés à un système scolaire qui semble fonctionner pour les enfants des classes moyennes et favorisées, sans que la question des ressources financières n'entre directement en compte.
La mission a choisi de mettre en lumière ces causes socioculturelles de l'échec scolaire parce qu'elle estime qu'à chacune d'entre elles, l'école ou la société devra apporter une réponse permettant de réduire l'impact du milieu social sur la réussite, et de l'exclusion sociale sur l'exclusion scolaire.
Selon l'étude du CERC de 2004 relative aux enfants pauvres, il s'avère ainsi que l'implication des parents dans la vie scolaire de l'élève est très différente selon les familles. Si l'aide au travail scolaire fournie par les parents varie par exemple peu avec le revenu elle évolue beaucoup en fonction du niveau de formation des parents et leur catégorie socioprofessionnelle .
RAPPORT À L'ÉCOLE DES FAMILLES ET AIDE AUX DEVOIRS
en %
|
Groupe 1 |
Groupe 2 |
Groupe 3 |
Groupe 4 |
|
|
Adhésion à une association de parents |
3,7 |
8,0 |
10,5 |
23,0 |
|
Délégués de parents d'élèves |
2,3 |
5,2 |
6,8 |
14,7 |
|
Elève aidé à la maison |
74,2 |
80,5 |
81,1 |
81,3 |
|
Elève suit un cours de soutien gratuit |
11,8 |
7,8 |
4,8 |
2,9 |
|
Elève suit un cours particulier |
5,6 |
8,0 |
9,2 |
12,1 |
Source : rapport du CERC, sur la pauvreté des enfants, 2004
S'agissant des cours gratuits de soutien, le soutien aux enfants défavorisés est bien moindre que celui engagé auprès des enfants favorisés.
Les familles « pauvres » semblent également avoir moins de contrôle sur le temps libre de l'élève . C'est dans ces familles que les heures du coucher ou celles passées devant la télévision sont le moins réglementées.
Enfin, les aspirations des familles quant au devenir scolaire des enfants a un impact réel , notamment au moment des choix de redoublement et d'orientation. Ainsi, selon le CERC, les moindres aspirations professionnelles des enfants issus de catégories socioprofessionnelles pauvres par rapport à ceux issus de milieux aisés « ne recoupent que partiellement leurs écarts de résultats scolaires ». Il a également été montré qu'à niveau scolaire comparable, les élèves pauvres sont moins orientés vers une seconde générale et technologique, sans même que ces écarts puissent être totalement expliqués par la prise en compte des différences de projets professionnels 137 ( * ) . Au vu de constat, on pourrait légitimement s'interroger sur la volonté de l'école, consciente ou non, de reproduire les schémas sociaux, thème développé dès 1970 par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron 138 ( * ) . Il apparaît toutefois que les décisions des conseils de classe, d'orientation et de redoublement correspondent plutôt au choix des familles plutôt que de l'institution scolaire, et que la faible ambition de certains choix scolaires corresponde davantage à un phénomène d'auto-sélection de la part des catégories sociales défavorisées (sans que l'on puisse déterminer si ce comportement est influencé simplement par l'origine sociale ou par une pression implicite du système scolaire).
Il est enfin intéressant de noter que les abandons prématurés d'études des enfants présentent un aspect intergénérationnel : les parents ont pour la plupart été confrontés à des fortes difficultés scolaires, ils sont en profond décalage par rapport à l'institution scolaire, ne disposent pas des savoirs et compétences qui permettent d'aider l'enfant en cas de difficultés. Surtout, comme le notait l'Observatoire de la pauvreté en 2003, « celles-ci apparaissent comme la continuité naturelle de leur propre sentiment d'exclusion scolaire, ce qui génère une limitation des attentes de formation pour leur enfant et l'acceptation de l'échec scolaire comme une fatalité sur laquelle la famille a peu de prise » 139 ( * ) .
Si les pistes pour favoriser les « sorties de pauvreté » sont développées dans l'ensemble du rapport, la première partie, consacrée au rôle social de l'école républicaine, se concentrera davantage sur les politiques qui permettent de donner aux enfants de pauvres les mêmes chances que les autres en apportant des contrepoids à « la culture de la pauvreté » et en redonnant son sens à l'expression d'égalité des chances.
II. L'ÉCHEC DES POLITIQUES CENTRALISÉES
A. L'ÉCOLE PRIMAIRE REPLACÉE AU CENTRE DU DÉBAT
Le constat établi dans la première partie est sans équivoque : les inégalités scolaires se constituent surtout à l'école primaire et sont quasiment irrémédiables ensuite 140 ( * ) .
15 % des élèves seraient ainsi en difficulté à la fin de l'école primaire, les enquêtes internationales montrant que certains pays, tels la Suède ou la Pays-Bas parviennent à faire baisser cette proportion à moins de 5 % 141 ( * ) .
C'est la raison pour laquelle le ministre de l'éducation nationale a souhaité recentrer l'école sur sa mission de transmission et d'acquisition des savoirs de base.
La mission estime que la définition d'un socle commun de connaissances et de compétences, l'évaluation dès le CE1 et la mise en place de dispositifs d'aide individualisée sont autant de mesures directement favorables aux enfants défavorisés .
Il semble aujourd'hui que les améliorations qui restent à apporter sont relatives à la pédagogie scolaire, inadaptée aux élèves issus de milieux populaires, dont la culture relève davantage « de formes sociales orales à faible degré d'objectivation du savoir » 142 ( * ) , peu mises en valeur à l'école.
Une réflexion doit en outre porter sur la scolarisation précoce des enfants des classes populaires.
Enfin, si la question des moyens doit être soulevée dans l'éducation nationale, c'est bien dans l'enseignement primaire. Les recherches de M. Thomas Piketty ont en effet montré « qu'une réduction de la taille des classes à 17 élèves en CP et CE1 (au lieu de 22 actuellement) permettrait de réduire de près de 45 % l'inégalité en mathématiques à l'entrée en CE2 entre écoles ZEP et hors ZEP. En appliquant la méthode aux collèges et aux lycées, on obtient des effets statistiquement significatifs, mais sensiblement moins importants » 143 ( * ) .
B. DES ZONES D'ÉDUCATION PRIORITAIRES AUX RÉSEAUX « AMBITION RÉUSSITE »
1. L'éducation prioritaire
La naissance de la politique d'éducation prioritaire il y a plus de vingt-cinq ans, est liée à la prise de conscience que l'enseignement obligatoire pour tous ne suffisait pas à assurer l'égalité des chances. L'échec scolaire des enfants issus de milieux défavorisés et leur présence massive ont conduit les autorités politiques à mettre en place une forme de discrimination positive qui consiste à concentrer des moyens supplémentaires, humains et financiers, dans des territoires où les inégalités socio-économiques sont les plus accusées.
La direction des affaires financières du ministère de l'éducation nationale a évalué les dépenses annuelles en faveur de la politique d'éducation prioritaire à 927 millions d'euros , répartis entre les crédits d'encadrement et le coût des mesures indemnitaires.
LES DÉPENSES EN FAVEUR DE L'ÉDUCATION PRIORITAIRE
|
Objet de la mesure |
Coût en emplois temps plein |
Coût en millions d'euros |
||
|
PREMIER DEGRÉ |
Enseignants |
Surcoût d'encadrement |
367 estimés |
|
|
Mesures indemnitaires |
59 constatés |
|||
|
Crédits pédagogiques |
9 constatés |
|||
|
Sous-total 1 er degré |
435 |
|||
|
SECOND DEGRÉ |
Personnels enseignants et d'éducation |
4 500 enseignants (214 M€) et 1 750 personnels d'éducation (39 M€) |
253 |
|
|
Personnels ATOSS (notamment santé et sociaux) |
39 |
|||
|
Personnels enseignant et ATOSS |
97 |
|||
|
Crédits pédagogiques |
7 |
|||
|
Fonds sociaux |
4 |
|||
|
Sous total 2nd degré |
399 |
|||
|
1 er et 2 nd degré |
Avantage spécifique d'ancienneté (enseignants et ATOSS) |
- |
93 |
|
|
Total du surcoût |
927 |
|||
Source : Rapport des inspections générales de l'éducation nationale et de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, La contribution de l'éducation prioritaire à l'égalité des chances des élèves , rapport n° 2006-076, octobre 2006.
Ces sommes sont soit directement fléchées (régimes indemnitaires) et donc liées à la carte de l'éducation prioritaire, soit liées aux procédures de répartition des moyens aux académies et relayées par les décisions rectorales (taux d'encadrement, crédits pédagogiques et fonds sociaux) 144 ( * ) .
Dans la pratique, ces dépenses sont consacrées au paiement des personnels d'enseignement et d'éducation (67 % de la dépense) à l'augmentation du nombre d'heures devant élèves (qui entraîne une différence de l'ordre de 2,2 à 2,5 élèves par classes entre les établissements en ZEP et les autres) et, pour une très faible part, au renforcement des crédits pédagogiques et en fonds sociaux 145 ( * ) qui représentent 16 et 8,5 euros par élève).
S'agissant de l'engagement financier des collectivités territoriales, la Cour des comptes, dans son étude sur « le contrôle de gestion de l'éducation prioritaire » précise qu'elles s'impliquent financièrement dans des politiques éducatives de manière significative, mais que leurs actions en ZEP restent d'ampleur modeste.
2. Une mise en oeuvre critiquable
Le rapport précité des inspections générales d'octobre 2006 conteste assez fortement le contenu de la politique d'éducation prioritaire, qui s'est « peu à peu éloignée du discours d'intention et des objectifs initiaux ».
En effet, les zonages ont été empilés sans cohérence (zones d'éducation prioritaires, zones sensibles, zones « violence ») et les critères de classement en ZEP ont été très hétérogènes selon les académies. Ainsi la proportion moyenne d'élèves issus de catégories socioprofessionnelles défavorisées dans les établissements relevant de l'éducation prioritaire était-elle comprise en 2004 entre 53 % à Rennes et 77 % à Lille. A la même date, dans l'académie de Versailles, le taux d'élèves issus de catégories socioprofessionnelles défavorisées variait de 31 % à 91 % dans les établissements situés dans les zones ou réseaux d'éducation prioritaires 146 ( * ) . En conséquence, les élèves étaient plus nombreux dans les écoles primaires classées en dehors de l'éducation prioritaire dans l'académie de Créteil (24 élèves en moyenne par classe) qu'ils ne le sont dans le reste de la France (23,5 élèves par classe).
Par ailleurs, le nombre d'établissements concernés à continûment augmenté à un point tel que 20 % d'élèves sont aujourd'hui inscrits en éducation prioritaire. Alors que l'objet d'un établissement situé en ZEP est d'en sortir, cette situation s'est donc le plus souvent pérennisée, du fait de l'inertie du classement administratif, mais aussi en raison de la stigmatisation de l'établissement scolaire. Ainsi, en dépit de son importance, l'hétérogénéité et le saupoudrage de l'investissement ont fortement nuit à son efficacité.
En outre, la très forte dépense de l'éducation prioritaire liée au surcroît de rémunération des personnels n'a eu aucun impact sur son attractivité et les académies qui concentrent des moyens importants dévolus à l'éducation prioritaire ont constitué, selon le rapport des inspections générales, les variables d'ajustement des mouvements nationaux. L'objectif de stabilité des équipes recherchées n'a pas été atteint, la proportion des jeunes enseignants affectés dans les ZEP restant très importante (34 % de moins de 30 ans contre 18 % hors éducation prioritaire).
Au final, les études évaluant l'incidence de la mise en place des ZEP sur la réussite scolaire indiquent ainsi que leur effet est sans doute significatif, quoique faible à l'école élémentaire et qu'il est très faible, voire pas significatif, au collège et au lycée .
Au collège, les résultats du panel 1995 des entrants en 6 e étudiés par M. Jean-Paul Caille en 2001 indiquent ainsi que les élèves scolarisés en ZEP réussissent moins bien que ceux qui n'ont jamais été scolarisés en ZEP, mais que cet écart peut être expliqué par les différences de caractéristiques familiales et de réussite à l'école primaire 147 ( * ) . Soulignant que les élèves qui restent tout le collège en ZEP atteignent un peu plus tôt la seconde générale à caractéristiques de départ identiques , l'auteur de l'étude nuance cependant ce constat en montrant que les lycéens issus de ZEP redoublent davantage que les autres au lycée et qu'au bout du compte, leurs chances, d'obtenir le baccalauréat sont ramenées à la moyenne des enfants en sixième 148 ( * ) .
La mission estime que la raison principale de cet échec est que le contenu de la politique d'éducation prioritaire a privilégié l'organisation et les personnels et non la mission de service public qu'est la réduction des inégalités scolaires. Comme le souligne le rapport des inspections générales précitées, les moyens ont davantage « servi à afficher des mesures gestionnaires quantitatives (taux d'encadrement et mesures indemnitaires) qu'à résoudre des difficultés repérées ». La mission estime en fait que la véritable faiblesse de la politique des ZEP est qu'elle ne responsabilise pas les établissements dans leur mission sociale, laquelle n'est en outre pas suffisamment affirmée. Cette mission sociale n'a au demeurant pas vocation à être menée dans les seules ZEP mais bien dans l'ensemble des établissements scolaires, dans lesquels des enfants sont en difficulté.
On notera néanmoins que des efforts récents très intéressants ont été faits pour adapter les dispositifs ZEP aux impératifs d'efficacité de la dépense publique et d'amélioration de l'égalité des chances.
3. Les nouveaux dispositifs d'accompagnement
Prenant acte des critiques émises à l'encontre des ZEP, le Gouvernement a revu les modalités de la politique de l'éducation prioritaire.
Afin qu'une véritable politique de lutte contre l'échec scolaire soit mise en place, 249 réseaux « ambition réussite » et « réussite scolaire » ont été créés et dotés de 1 000 enseignants et 3 000 assistants pédagogiques supplémentaires.
Ils regroupent, autour d'un collège, des écoles élémentaires et maternelles d'où proviennent ses élèves. Un comité exécutif comprenant les chefs des établissements scolaires est constitué afin de piloter l'éducation prioritaire dans le réseau. L'idée selon laquelle les initiatives locales menées en faveur des enfants défavorisés doivent être coordonnées, mais surtout pilotées localement, paraît excellente à la mission.
En outre, selon la circulaire n° 2006-058 du 30 mars 2006, un projet pédagogique sera formalisé à travers un contrat de réussite scolaire entre le réseau et les autorités académiques, qui définira les objectifs de programme d'enseignement.
La mission estime, à cet égard, que le contrat devrait explicitement fixer des objectifs chiffrés précis en matière de réduction de l'échec scolaire, notamment s'agissant des élèves issus de milieux défavorisés.
Par ailleurs, il est prévu que l'établissement signe une convention de partenariat avec une institution culturelle, un complexe sportif de haut niveau, un laboratoire d'université, un organisme de recherche ou une personnalité reconnue, ce qui devrait permettre, selon le ministère « d'insuffler un nouvel esprit en développant chez les élèves un sentiment fort d'appartenance et de fierté pour leur établissement et en donnant à chaque réseau une dimension d'excellence ». Cette initiative qui vise à sortir les ZEP de la stigmatisation convainc encore la mission. Le changement de dénomination des ZEP en zones « ambition réussite » a au demeurant le même objectif et paraît heureux, tant les aspects psychologiques sont un ressort essentiel de la réussite scolaire.
Toutefois, elle estime qu'il serait intéressant que cette convention de partenariat puisse être passée avec une entreprise implantée localement , avec laquelle des projets pédagogiques pourraient très utilement être montées.
La connaissance du monde de l'entreprise est, en effet, un facteur important dans la naissance des aspirations professionnelles des élèves, qui jouent elles-mêmes un rôle moteur dans l'implication scolaire.
Il est prévu que les enseignements supplémentaires affectés dans les réseaux puissent notamment prendre part aux programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE), co-intervenir dans les classes et partager leur service entre le premier et le second degré. Cette façon de mettre à profit les postes supplémentaires est conforme au souhait de la mission selon lequel il ne suffit pas de baisser le nombre d'élèves par classe mais mener une politique spécifique et individualisée à l'égard des élèves en échec scolaire .
La personnalisation de la relation , à travers les PPRE et la prise en charge personnelle pendant le cours grâce au professeur co-intervenant dans la classe, et le suivi de la trajectoire particulière de l'élève par les professeurs intervenant dans le primaire et le secondaire et les comités exécutifs, sont autant d'avancées en faveur de l'intégration des enfants défavorisées aux parcours chaotiques.
Le programme personnalisé de réussite éducative vise à empêcher les redoublements : l'élève en difficultés est suivi à travers un livret de compétence tenu par les équipes pédagogiques, qui fixe les objectifs qu'il doit atteindre. Une aide individualisée lui est fournie pour lui redonner confiance. Ce soutien est utilement complété par un dispositif d'études accompagnées, qui sont dorénavant proposées quatre soirs par semaine dans les réseaux « ambition réussite ».
La mission accorde une grande importance à ces deux initiatives parce qu'elles permettront de suivre un élève dans la durée, et offriront à celui-ci une approche différente de l'école, en dehors du cadre habituel des heures de cours où ils ont pour l'instant échoué. Les assistants pédagogiques se consacreront notamment à l'aide aux devoirs. La mission considère que le défaut de cette politique est qu'elle ne soit pas généralisée à l'ensemble des établissements, dans lesquels des élèves en situation précaire sont également en difficulté.
C. UNE ORIENTATION POUR L'INSTANT INEFFICACE
1. Le constat
Auditionné par la mission, M. Jean-Marie Lorenzi, chargé de mission auprès du délégué interministériel à l'orientation, a fait observer que « le taux d'insertion professionnelle des jeunes varie selon les domaines et les niveaux de formation : ainsi, dans le secteur de la santé, le taux de chômage des jeunes est de seulement 2 %, alors que dans le domaine des lettres et sciences humaines, il atteint 12 %. De même, pour les élèves titulaires du baccalauréat, le taux est de 20 %, alors qu'il atteint 31 % pour les jeunes ayant un CAP ou un BEP et 40 % pour ceux qui n'ont aucun diplôme » 149 ( * ) .
L'enjeu crucial de l'orientation scolaire est de guider les élèves vers les filières les plus actives tout en respectant leurs aspirations personnelles. C'est un double projet qu'il faut mener de front parce que si la vocation des élèves détermine leur implication, l'orientation vers des filières sans débouchés peut entraîner un sentiment de relégation discréditant l'institution scolaire.
M. Jean-Louis Nembrini, directeur général de l'enseignement scolaire, auditionné par la mission sénatoriale sur la formation professionnelle dont M. Bernard Seillier était le rapporteur en 2007, avait particulièrement insisté sur cet aspect en indiquant que « les taux d'abandon au sein de la formation professionnelle initiale sont élevés pour les filières peu attractives. Cette situation est particulièrement forte en ce qui concerne les filières disposant de réels débouchés mais qui ne font par l'objet d'un choix de la part des élèves. C'est notamment le cas du bâtiment ou de la confection industrielle ». M. Claude Thélot rappelait, quant à lui, que « le tiers des jeunes orientés dans les filières professionnelles n'ont pas choisi leur spécialité ».
Aujourd'hui l'école a un double retard qui creuse le fossé entre l'école et le monde professionnel : elle ne parvient ni à informer les élèves sur les débouchés intéressants, ni à créer des vocations susceptibles de les motiver. C'est l'une des causes de la reproduction des inégalités sociales à l'école : faute d'information, les enfants ont en effet tendance à suivre la voie tracée par leurs parents.
Le prochain rapport du Haut Conseil de l'éducation qui sera intitulé « l'orientation, une machine à exclure », estime ainsi que l'orientation à la française, « fonctionne comme un couperet pour de nombreux élèves », « reproduit une hiérarchie actée dès l'école primaire », et « reste éloignée des réalités de la voie professionnelle » 150 ( * ) .
2. Les remèdes proposés
Afin de remédier à ces difficultés, l'éducation nationale a pris récemment, notamment dans les zones d'éducation prioritaires, les initiatives suivantes :
- les élèves des classes de quatrième et troisième des établissements de l'éducation prioritaire bénéficient d'un entretien individuel d'orientation , organisé chaque année avant la fin du deuxième trimestre de l'année scolaire ;
- cet entretien est conduit par le professeur principal, assisté d'une personne issue du monde professionnel.
L'orientation est ainsi directement prise en charge par les personnels enseignants, ce qui permet de mieux relier le suivi scolaire et l'orientation. Comme l'a souligné M. Patrick Chauvet, chef de bureau de l'orientation à la sous-direction de l'orientation, de l'adaptation scolaire et des actions éducatives, « la participation active des enseignants [...] suppose qu'ils reçoivent des centres d'information et d'orientation une formation et un soutien logistique adapté » 151 ( * ) , lesquels ne sont pas forcément assurés pour le moment.
Par ailleurs, des dispositifs de réorientation en cas de décrochage scolaire ont été mis en place, notamment un dispositif spécifique d'insertion pour les jeunes de plus de 16 ans en situation de décrochage scolaire, privilégiant le maintien dans l'établissement, et prévoyant en cas d'échec, un plan adapté d'orientation vers un autre type d'établissement ou d'enseignement ou une insertion en milieu professionnel.
Mme Marie-Véronique Samama-Patte, chef du bureau de la formation professionnelle initiale, de l'apprentissage et de l'insertion 152 ( * ) , a insisté sur le fait que des efforts avaient récemment été engagés pour limiter les situations d'échec définitif par ce type de dispositif. Soulignant que les actions préventives ont été privilégiées, conformément aux études réalisées au niveau européen, elle a affirmé que « pour 60 % des élèves, ces interventions se sont traduites par un retour en formation ».
La mission est favorable à ces pratiques innovantes en matière de prévention de l'échec scolaire, dans la mesure où il constitue non seulement une injustice, mais aussi une perte de ressources très importante pour la Nation.
Elle considère donc qu'il faut les encourager et, pour qu'elles fonctionnent, s'assurer que les personnels de l'éducation nationale se sentent investis d'une mission économique et sociale.
III. LIBÉRER LES INITIATIVES ÉDUCATIVES
L'objectif du ministère de l'éducation nationale est que 100 % des jeunes sortent du système scolaire avec un diplôme du cycle secondaire, que 85 % d'entre eux soient titulaires du baccalauréat et que 50 % accèdent à l'enseignement supérieur. Si ces chiffres étaient atteints, on pourrait considérer que les enfants de pauvres, même victimes d'inégalités, seraient susceptibles de se sortir de leur condition sociale. Toutefois, la mission les complèterait par un objectif de garantie de l'acquisition des connaissances du socle obligatoire par tous les élèves et de mise en place de filières d'enseignement aboutissant à des débouchés réels.
Elle ne peut qu'adhérer au changement de philosophie du ministère de l'éducation nationale, qui est passé d'une logique de garantie de moyens à une exigence de résultats. Elle a en effet la conviction que c'est dans un changement de méthode et de système de valeur que les solutions seront trouvées .
A cet égard, M. Miles Corak a montré au niveau international que, « suivant les pays, l'impact de la dépense pour l'éducation sur la mobilité intergénérationnelle diffère significativement, et que davantage de dépense peut amplifier plutôt que diminuer les différences entre enfants favorisés et défavorisés » 153 ( * ) . Il souligne que ces différences ont leurs racines dans les avantages plus subtils que des parents hautement qualifiés sont capables de transmettre à leurs enfants : compétences, opinions et motivations issus de la culture et du style de parentalité d'une famille favorisée. Les sociétés qui compensent ces influences au sein de la population affichent une mobilité intergénérationnelle plus élevée.
Il en conclut que l'État-Providence doit être pensé en matière d'éducation comme une institution qui « rend capable » , en d'autres termes qui investit dans les enfants afin de faire bouger la relation intergénérationnelle entre revenus des parents et des enfants, davantage qu'en tant que système de redistribution et d'assurance sociale .
La mission considère que les conditions de réussite d'une politique visant à rendre les enfants capables, passe par la définition d'une véritable politique sociale des établissements scolaires , la mise en place d'une orientation active , l'encouragement de dispositifs innovants regroupant différents acteurs, et la concrétisation de partenariats entre l'école et l'extérieur permettant d'agir sur les facteurs extrascolaires de réussite de l'élève.
A. CONFIER UNE MISSION DE PROMOTION SOCIALE À L'ÉDUCATION NATIONALE
1. Prévenir plutôt que guérir
Mme Marie-Véronique Samama-Patte a rappelé que le ministère de l'éducation nationale avait créé une mission générale d'insertion pour les jeunes en difficulté qui s'est traduite par la mise en place d'un dispositif spécifique d'insertion pour les jeunes de plus de 16 ans en situation de décrochage scolaire. Il s'agit d'une politique d'insertion professionnelle, plutôt que d'une mesure d'insertion sociale pour les jeunes défavorisés.
Or c'est précisément d'une conscience sociale plus aiguisée dont le système scolaire a besoin, afin que l'ensemble des acteurs, du professeur au chef d'établissement soit naturellement impliqué dans l'effort de lutte contre les inégalités scolaires et sociales.
Une politique préventive passe tout d'abord par une meilleure détection des difficultés susceptibles d'apparaître et une information du professeur principal de la situation sociale de l'élève grâce à la mise en réseau des professeurs des écoles, des psychologues scolaires et des services de la protection maternelle et infantile.
Elle impose ensuite d'individualiser davantage les parcours scolaire pour les élèves les plus en difficulté, dans l'ensemble des établissements scolaires (le tutorat et les études du soir sont à ce titre des aides indispensables à la prévention de l'échec scolaire), mais aussi pour les élèves les plus brillants de quelques établissements situés en ZEP (dispositif Sciences-Po...) qui servent de modèle à suivre et de symbole d'ascension sociale.
Elle nécessite enfin l'évaluation de l'efficacité des politiques mises en place et leur remise en cause lorsqu'elles ne fonctionnent pas. Ainsi, les cours de soutien existant depuis plusieurs décennies dans les collèges sont-ils poursuivis sous la même forme alors que leur impact sur la réussite des élèves est très contesté 154 ( * ) . De même les classes de troisième d'insertion et les dispositifs relais, loin de modifier les destinées scolaires, remplissent de facto une fonction d'accompagnement vers des voies de faible ou de non-qualification 155 ( * ) .
L'élitisme républicain ne doit ainsi pas conduire à laisser trop d'élèves au bord du chemin sous peine de voir se créer une société duale. Les formes de discrimination positive dans l'enseignement sont essentielles car elles permettent de relever le niveau des plus faibles sans remettre en cause l'efficacité générale du système.
2. Responsabiliser les établissements scolaires
Le maître d'oeuvre de l'ensemble des politiques de l'Éducation nationale est l'établissement scolaire. Or il dispose de très faibles marges de manoeuvre, ce qui impose de redéfinir la place de chacun des acteurs concernés.
Pour l'éducation prioritaire, il serait normal que ce soit l'État qui gère les crédits plutôt que les académies, afin que les redéploiements soient nationaux. Cela permettrait d'éviter de demander aux académies cumulant les difficultés sociales de gérer la pénurie entre les établissements scolaires quand des moyens supplémentaires sont nécessaires.
En revanche, s'agissant des publics en difficulté, il semble cohérent que les académies soient responsables des crédits distribués en fonction des critères sociaux et territoriaux.
Parallèlement, la mobilisation des équipes pédagogiques et administratives en faveur d'une politique sociale des établissements passe par le renforcement de leur autonomie . Celle-ci doit viser l'organisation des cours, la pédagogie, la gestion des ressources humaines et l'utilisation des moyens , ce qui suppose de donner une autorité renforcée aux chefs d'établissement.
Dans la logique de la LOLF, l'administration déconcentrée doit, quant à elle, fixer des objectifs précis en matière de réduction de l'échec scolaire, évaluer les résultats enregistrés et encadrer les activités des établissements.
Comme le souligne le rapport précité des inspections générales, il s'agit notamment, afin de s'assurer que les moyens sont bien consacrés aux publics prioritaires, que les académies veillent à ce que « les efforts faits sur l'éducation prioritaire ne soit pas neutralisés par l'encouragement institutionnel direct ou indirect, conscient ou inconscient, de politiques d'écoles ou d'établissements élitistes (par le jeu des filières, options, dérogations) dans des secteurs voisins ».
La mission souhaite que les dispositifs créés par l'Éducation nationale prennent systématiquement en compte les enjeux sociaux.
Ainsi considère-t-elle par exemple que le débat sur la scolarisation à 2 ans ne doit pas éluder son impact sociétal. Or, il ressort de différentes études que ce sont les enfants des catégories favorisées et les enfants de nationalité étrangère ou de parents immigrés qui bénéficieraient le plus de la préscolarisation à 2 ans. Il semble à la mission que toute réflexion sur le renforcement de la préscolarisation doive intégrer l'objectif de réussite des enfants défavorisés, qui n'est pour l'instant pas assuré.
3. Insister sur l'école primaire
Divers dispositifs sont aujourd'hui mis en place pour améliorer la réussite scolaire à l'école primaire : des moyens supplémentaires ont ainsi été attribués dans les ZEP, les réseaux d'aide et de soutien aux enfants en difficultés (RASED) permettent quant à eux une prise en charge plus personnalisée du système scolaire.
La mission considère que l'on doit aujourd'hui changer d'échelle et porter sur un effort intensif, précoce sur les élèves repérés en difficulté, via le dédoublement de CP, l'aide aux parents, le soutien scolaire. Par ailleurs, une attention particulière doit être portée aux enfants de familles immigrées : la lutte contre le risque d'échec scolaire doit être coordonnée avec les politiques d'aide à l'intégration des parents. Ainsi lors du déplacement en Côte d'Or, la mission a-t-elle pu constater l'efficacité des actions conduites par les missions locales de lutte contre l'illettrisme associant à la fois parents et enfants.
A cet égard, la mission rappelle que toute l'importance de la question de l'illettrisme qui est l'absence de maîtrise des compétences de base nécessaires pour faire face de manière autonome à des situations courantes : 3,1 millions de personnes sont en situation d'illettrisme , soit 9 % des personnes de 18 à 65 ans ayant été scolarisées en France, parmi lesquels 26 % sont bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. C'est à l'école primaire que ce fléau doit être combattu.
B. ÉLARGIR L'HORIZON DES ÉLÈVES PAR UNE ORIENTATION ACTIVE
1. La connaissance du monde extérieur
Le monde de l'éducation est aujourd'hui encore un monde clos. Le plus souvent, ni les élèves, ni les professeurs ne connaissent l'univers professionnel de l'entreprise.
Faute de disposer d'une connaissance suffisante de l'extérieur, les enfants s'orientent vers un métier correspondant à la catégorie socioprofessionnelle de leurs parents qui est le premier facteur d'orientation. En outre, les inégales ambitions mises en avant par les familles sont le plus souvent entérinées par la procédure d'orientation.
M. Patrick Chauvet a indiqué à la mission qu'avait été récemment mise en place des classes de découverte professionnelle, dès la troisième, qui permettent aux collégiens d'approfondir leur connaissance des métiers et d'acquérir une première expérience professionnelle 156 ( * ) . Cette démarche s'inscrit dans le cadre du « p arcours de découverte des métiers et des formations », initié dès la classe de quatrième par la visite d'un lycée agricole, professionnel ou d'enseignement général.
Il a précisé que « cet itinéraire se poursuit au lycée avec un entretien d'orientation conduit par le professeur principal 157 ( * ) en classe de première et bientôt en classe de terminale ». Il s'agit de préparer les élèves à faire un choix éclairé sur leur orientation post-lycée, par la construction d'un projet personnel, ce qui contribuera à limiter ensuite les échecs. Un entretien d'accueil est également prévu lors de l'arrivée des élèves en lycée agricole ou professionnel.
Est par ailleurs expérimentée à Nantes une plate-forme regroupant les établissements scolaires, le milieu associatif, les missions locales, les entreprises et les agences pour l'emploi. L'objectif, selon M. Jean-Marie Lenzi, chargé de mission auprès du délégué interministériel à l'orientation, est « de favoriser et de permettre une meilleure adéquation entre la formation initiale et les caractéristiques du bassin d'emploi » 158 ( * ) .
La mission est favorable à ces mesures mais estime qu'il faut aller beaucoup plus loin.
Si l'on souhaite que les élèves puissent avoir le désir de s'orienter vers des métiers diversifiés, il faut leur en donner une expérience concrète.
La mission proposera ainsi d'instituer chaque année un stage en entreprise à l'ensemble des élèves de la quatrième à la seconde.
Elle est convaincue que cet effort permettra un échange social beaucoup plus important. En effet aujourd'hui deux élèves en légère difficulté en fin de troisième, l'un issu des couches populaires, l'autre d'un milieu favorisé, choisiront probablement l'un la voie professionnelle, et l'autre de s'accrocher dans la voie générale, même si leurs goûts et leurs aspirations ne les poussent pas dans ces directions. La découverte des métiers par les stages permettrait d'affiner leurs goûts, de renforcer leurs convictions et de choisir l'orientation plutôt que de la subir. Elle favoriserait une orientation davantage conforme à leurs goûts qu'à leurs aptitudes scolaires, qui ne doivent pas être les seuls critères de choix d'une filière 159 ( * ) .
La participation active des enseignants à la construction de ce projet suppose également qu'ils reçoivent des centres d'information et d'orientation (CIO) une formation et un soutien logistique adaptés.
La mission préconise à cet égard, ainsi que l'a proposé le Haut Conseil pour l'éducation, qu'une fonction de professeur référent en orientation soit créée , pour rapprocher à la fois les élèves et les professeurs de la personne qui donne des conseils en matière orientation.
En effet, les conseillers d'orientation-psychologues ne sont pas forcément la première personne que l'élève ira voir pour parler de son avenir professionnel. Le recrutement de ces conseillers, limité aux licenciés en psychologie, pourrait au demeurant être revu afin de l'adapter aux véritables enjeux de ce métier. A tout le moins, les personnels d'orientation devraient approfondir et actualiser en permanence la connaissance concrète de leur environnement extérieur, comme le proposait le rapport de la mission sénatoriale d'information sur la formation professionnelle 160 ( * ) .
La mission propose, à cet égard, de dissocier la fonction de conseiller d'orientation, qui pourrait être exercée par un professeur, de celle de psychologue scolaire , dont l'intervention plus ponctuelle serait adaptée aux élèves ayant des problèmes de cet ordre.
M. Jean-Marie Lenzi a également insisté sur la nécessaire rationalisation du réseau local d'insertion, qui comprend outre les missions locales, les bureaux d'information jeunesse, les permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO) et les maisons de l'emploi, estimant que « la mise en cohérence des informations relatives aux métiers et aux carrières passe, d'une part, par la fusion de ces structures en un guichet unique et, d'autre part, par l'amélioration des systèmes publics d'information en ligne sur les filières de formation ».
La mission souhaite enfin insister sur le fait que la connaissance du monde extérieur passe, pour les élèves défavorisés, par une information complète sur les filières d'excellence et une incitation à y accéder . Ainsi, les dispositifs tels que les conventions de Sciences-Po avec des lycées en ZEP sont-ils intéressants et s'inscrivent parfaitement dans les objectifs de la mission : organiser une discrimination positive en faveur des jeunes issus des milieux défavorisés , valoriser les filières d'excellence qu'ils connaissent mal, et mettre en avant des réussites sociales symboliques qui leur permettent de croire en leur chance.
2. L'adéquation de l'offre de formation aux offres d'emplois
M. Bruno Lacroix, président du Conseil économique et social de la région Rhône-Alpes, a insisté devant la mission sur « l'enjeu que représente une meilleure adéquation du système éducatif et de la formation continue aux besoins des entreprises, qui souffrent de plus en plus fréquemment d'une insuffisance de main d'oeuvre », notamment dans certains secteurs (restauration, bâtiment) 161 ( * ) .
C'est indéniablement l'une des principales missions de l'Éducation nationale que d'adapter l'offre d'enseignements à la demande des entreprises.
Cet objectif suppose de créer des schémas d'orientation active pour guider les choix des élèves vers les secteurs offrant le plus de débouchés et de développer en amont un système d'information efficace sur les débouchés de chaque secteur, permettant d'éviter l'orientation de cohortes d'étudiants vers des professions pour lesquelles l'offre d'emplois disponibles n'est pas suffisante. La délégation interministérielle à l'orientation s'emploie à mettre en oeuvre ces dispositifs.
Localement, cette tâche devrait inciter les académies à adapter l'offre d'enseignement aux demandes du bassin d'emploi . Lors du déplacement de la mission en Bourgogne, elle a pu constater une prise de conscience de l'éducation nationale dans ce domaine. Ainsi les interlocuteurs de la mission ont-ils salué le fait que le rectorat ait fermé un CAP dans un secteur en perte de vitesse au profit de l'ouverture d'une filière équivalente dans une activité en manque de main d'oeuvre.
A cet égard, le développement des filières professionnelles offre des perspectives trop peu exploitées pour lutter contre l'échec scolaire. 162 ( * )
3. Renforcer l'attractivité de la filière professionnelle
L'orientation tardive vers ces filières est particulièrement dommageable pour l'insertion des jeunes et pour les entreprises appartenant à des secteurs en manque de main d'oeuvre. L'un des moyens de la renforcer est de revaloriser le baccalauréat professionnel.
Trois mesures ont été annoncées lors de la rentrée de 2007 pour revaloriser ces lycées : la rénovation des enseignements généraux du BEP et du baccalauréat professionnel, la généralisation dès la rentrée 2009 du bac professionnel en trois ans directement après la classe de troisième et le développement des lycées des métiers. Pour renforcer l'attractivité et la valeur du Bac pro, les lycées professionnels se sont en effet engagés dans une démarche d'acquisition d'un label qualité (« lycée des métiers ») en mettant en place des dispositifs d'insertion professionnelle et de validation des acquis de l'expérience (VAE) en partenariat avec les entreprises et les collectivités territoriales.
La mise en place de parcours modulaires semble pertinente. Certains pays comme le Canada permettent ainsi aux élèves de faire une pause durant leur parcours scolaire afin d'adapter le système au rythme d'évolution et à la maturité des élèves.
La mission rappelle enfin que l'effort en matière d'orientation est d'autant plus nécessaire en France que la formation continue joue un rôle trop réduit en matière de promotion sociale et professionnelle des actifs , notre système de mobilité sociale reposant presque exclusivement sur la formation initiale et le diplôme obtenu à son terme.
Mais son rôle de prévention peut se développer et être amélioré. Dès le début du premier cycle de l'enseignement secondaire une initiation de l'ordre de quatre heures hebdomadaires à l'usage de l'outillage et des machines outils élémentaires d'un atelier de fabrication rééquilibrerait très naturellement dans l'esprit des adolescents et celui de leur famille l'attractivité des filières de formation professionnelle par rapport à celles de la formation générale, sans parler du bénéfice pratique de cette initiation pour la vie pratique quotidienne.
C. ENCOURAGER LES INITIATIVES INNOVANTES
Convenant de la situation préoccupante des jeunes, M. Martin Hirsch a indiqué qu'il était indispensable d'identifier ceux qui sortent sans qualification du système scolaire , afin qu'ils puissent être pris en charge par les missions locales ou orientés vers des formations ou des écoles de la deuxième chance. Il a indiqué qu'une étude serait engagée sur les sorties précoces des dispositifs d'apprentissage et s'est dit favorable au développement des écoles de la deuxième chance 163 ( * ) .
La mission se déclare également très favorable à ces dispositifs de rattrapage, particulièrement utiles à ceux qui ne se sont jamais adaptés à l'enseignement classique.
1. Les dispositifs permettant de maintenir les jeunes dans le système scolaire
De nombreux enfants de familles défavorisées quittent le système scolaire sans qualification, ce qui risque de les conduire dans des situations de précarité dont il sera difficile de sortir. C'est la raison pour laquelle des dispositifs spécifiques sont à étudier afin d'inciter à la poursuite d'études.
a) Les écoles de la seconde chance
Les écoles de la 2e chance (E2C) accueillent des jeunes orientés par leur mission locales qui ont quitté le système scolaire sans diplôme ni qualification. Etant en alternance, ils ont le statut de stagiaires rémunérés de la formation professionnelle et perçoivent environ 540 euros par mois. Les stages s'effectuent dans des domaines variés, ce qui permet d'affiner l'orientation professionnelle. Si les règles sont strictes s'agissant des horaires et des absences, le suivi individuel de chaque élève et l'accompagnement global, à la fois éducatif, professionnel et social, permettent de ne pas les mettre en situation d'échec.
Le réseau E2C France compte aujourd'hui 35 écoles en fonctionnement, qui ont accueilli 2 700 jeunes en 2006, pour un coût médian de 9 000 euros par élève, hors indemnisation des stagiaires. Le taux de sorties positives vers l'emploi ou la qualification est de 63 %. Le budget total de fonctionnement des E2C est de 25 millions d'euros en 2007, et se situerait, dans l'hypothèse de 10 000 jeunes entrants à l'horizon 2020/2020, aux alentours de 90 à 100 millions d'euros.
La mission considère que ces écoles sont une excellente initiative et qu'elles réunissent les critères du succès : la formation en alternance assure souvent des débouchés pour les élèves, la scolarité en petits effectifs favorise la réussite et la collaboration avec les missions locales garantit leur ancrage territorial. Si ce dispositif parvient à court terme à donner une qualification à 10 000 élèves, ce sera une réelle avancée.
C'est la raison pour laquelle la mission se félicite de l'annonce par le président de la République, lors de sa présentation du plan pour les banlieues le 8 février dernier, du développement des E2C, avec l'objectif de parvenir à un chiffre de 15 000 à 20 000 jeunes à l'horizon 2012, avec une école par région et un développement en priorité dans les quartiers les plus difficiles. Elle sera attentive à l'accroissement promis des ressources des E2C et à l'avenir de la proposition d'étendre la possibilité pour les entreprises de les financer au moyen de la part de la taxe d'apprentissage destinée habituellement à financer les formations correspondant aux BEP, CAP et baccalauréat.
Toutefois, ces écoles seront insuffisantes pour résorber le nombre de sorties sans qualification du système scolaire. C'est la raison pour laquelle des méthodes alternatives doivent être définies.
b) Le dispositif « Défense deuxième chance »
Les centres « défense deuxième chance », géré par l'établissement public d'insertion de la défense (EPIDe), accueillent des jeunes isolés ou marginalisés du fait d'un triple échec familial, scolaire et professionnel, auxquels sont proposés des services pédagogiques selon trois grands axes :
- une formation comportementale et civique leur permettant de se socialiser. Au coeur du dispositif, elle est prodiguée en grande majorité par d'anciens militaires ;
- une maîtrise des savoirs fondamentaux : lecture, écriture, calcul et informatique, assurée par des équipes d'enseignants ;
- et une formation professionnelle débouchant sur des métiers où l'offre d'emploi est importante, en partenariat avec l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) et les entreprises.
Le général Valentin, auditionné par la mission, a rappelé que « ce programme pédagogique, qui débouche sur des diplômes, est proposé sur la base du volontariat dans un cadre d'internat et selon des périodes de formation de six mois renouvelables à des jeunes âgés de 18 à 21 ans révolus, et dispensé au sein de 22 centres accueillant au total 2 000 stagiaires 164 ( * ) ».
En dépit du nombre important d'abandons, 40 % des jeunes, incapables de se soumettre à une discipline et d'acquérir des repères, arrêtant la formation au bout de deux mois, le général Valentin s'est félicité que les trois quarts de ceux poursuivant le cursus se voient proposer à leur sortie un emploi durable de type contrat à durée déterminée ou contrat de formation en alternance.
La mission est favorable à ce système innovant et rappelle que M. François Trucy, dans son rapport d'information n°290 (2007-2008) sur la défense et l'insertion des jeunes, fait au nom de la commission des finances du Sénat, a reconnu l'intérêt et l'efficacité du dispositif « Défense deuxième chance ».
Afin de renforcer leur efficacité, la mission préconise un développement des implantations de l'EPIDe dans les secteurs où l'emploi est dynamique.
En effet, leurs relations avec les entreprises sont reconnues et aboutissent à des partenariats fructueux. Dans la mesure où ils fonctionnent sur le principe de l'internat, ils ont en outre tout intérêt à attirer les élèves dans des zones dans lesquelles ils trouveront un emploi à la sortie.
Par ailleurs, il est important, au vu du coût de ces écoles, que l'EPIDe se concentre sur les élèves les plus en difficulté , afin qu'il ne se substitue pas à d'autres dispositifs moins coûteux qui fonctionnent pour certains jeunes assez proches du marché du travail (notamment le CIVIS).
c) Des incitations financières au maintien dans le système scolaire après 16 ans
Le Royaume-Uni a expérimenté un dispositif de soutien financier en direction des familles modestes ayant des enfants de 16 à 19 ans encore scolarisés : une allocation d'environ 150 euros par mois leur est proposée pour les aider à financer la poursuite des études de leurs enfants. Selon le rapport de M. Martin Hirsch d'avril 2005 sur la réduction de la pauvreté, la comparaison des zones pilotes avec les zones n'ayant pas bénéficié du dispositif a révélé que le soutien financier accroît significativement la poursuite des études des enfants d'origine modeste .
M. Jean-Baptiste de Foucauld a également fait cette proposition, dont l'évaluation n'a pas encore été faite.
La mission n'a pas pu évaluer le coût de cette mesure qui lui paraît utile, dès lors qu'elle s'articule convenablement avec les autres dispositifs et qu'elle correspond à un engagement pertinent de l'étudiant.
Elle préconise donc que le coût d'un dispositif de soutien financier du maintien dans les études soit évalué afin que l'État puisse éventuellement s'engager dans cette voie.
d) Le débat sur le contrat d'autonomie
Selon M. Jean-Baptiste de Foucauld, la société reste très fermée à ses jeunes . Il a préconisé, à cet égard, de s'inspirer du rapport de la commission nationale pour l'autonomie des jeunes (2002), qui avait proposé « la création d'un véritable service public de l'orientation, la possibilité d'un report des bourses non utilisées, la garantie d'une expérience professionnelle pour tous les jeunes et l'instauration d'un contrat d'allocation d'autonomie » 165 ( * ) . Si les trois premières propositions recueillent l'adhésion de la mission, celle-ci est en revanche plus circonspecte sur la dernière, en l'absence d'une étude sur les possibilités de mise en oeuvre de manière à responsabiliser les bénéficiaires, sur les modalités de son financement et sur sa neutralité par rapport à l'efficacité des autres dispositifs proposés. Mme Marie-Laure Meyer s'est par exemple opposée à la mise en place du contrat d'autonomie, considérant « que les dispositifs existants devaient être privilégiés pour produire les résultats attendus alors que ce contrat ne favorise ni l'alternance ni l'apprentissage ». Elle a ainsi proposé que l'Etat finance davantage des outils comme le contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS), le programme trajet d'accès à l'emploi (TRACE), ou les écoles de la seconde chance166 ( * ).
La mission est également prudente sur cette question tant il lui semble que la responsabilisation des élèves est un élément moteur de leur implication dans les études.
2. Développer des partenariats
Mme Pierrette Catel, chargée de mission au Conseil national des missions locales, a évoqué devant la mission la nécessité que les missions locales travaillent « en étroite collaboration avec l'éducation nationale : centres d'information et d'insertion (CIO) et mission générale d'insertion (MGI)167 ( * ) ». Elle a également insisté sur l'importance de la participation de la société civile à l'insertion des jeunes, soulignant par exemple que « le système de parrainage permettait aux jeunes d'entrer en contact avec l'entreprise tout en conduisant les parrains à devenir des vecteurs de la lutte contre les discriminations dont les jeunes sont souvent victimes » .
Il apparaît à la mission que l'école aurait tout intérêt à se rapprocher des acteurs locaux de l'insertion.
Elle proposera ainsi que des stages dans des entreprises ou des collectivités territoriales soient imposés aux enseignants , de façon à améliorer leur connaissance du monde extérieur.
De même, un partage des informations avec les services de la petite enfance paraîtrait utile. La mission préconise par conséquent un échange d'information très largement renforcé entre la PMI et de la médecine scolaire.
Le contact des élèves avec des publics différents pourrait également s'avérer utile. Le général Valentin a ainsi proposé que le renforcement de l'encadrement scolaire dans les ZEP puisse parfois passer par « la présence dans les classes de sur-répétiteurs maintenant l'ordre ou de tuteurs aidant individuellement les élèves en difficulté », qui seraient par exemple des militaires volontaires menacés par la réduction du financement de l'armée. La mission ne doute pas que certains collèges ou lycées pourraient se montrer intéressés par ce type de partenariat.
Si les initiatives prises par les collectivités territoriales sont souvent pertinentes, du fait de leur connaissance de la situation locale, leur efficacité passe par une logique de partenariat.
Il en est ainsi des internats de réussite éducative , comme l'a constaté la mission lors de sa visite du collège Marcelle Pardé de Dijon. Situé en centre-ville, il se caractérise par une population relativement favorisée, ayant généralement de bons résultats scolaires avec la spécificité d'offrir des enseignements optionnels (langues rares, classes musicales à horaires aménagés...) et la réussite des enfants méritants des zones urbaines sensible accueillis à l'internat est réelle. Cette initiative est un succès en raison du soutien financier de l'État, de l'implication de l'équipe pédagogique et surtout de l'engagement du conseil général.
De même le « busing », qui consiste à transférer en car scolaire certains élèves de la périphérie où résident les familles défavorisées dans les lycées de centre-ville ne fonctionne que lorsque la collectivité est directement maître d'oeuvre et qu'elle est en mesure de faire accepter le projet aux familles.
Une initiative réussie doit en effet faire l'objet d'un consensus et d'une implication de plusieurs acteurs. S'agissant des élèves en situation socialement difficile, les services sociaux, ceux de l'éducation nationale, les établissements et les collectivités territoriales doivent marcher main dans la main, en collaboration avec le monde professionnel et la société civile.
En dépit de ces efforts, de nombreux obstacles se dressent devant l'égalité des chances : la difficile gouvernance de l'éducation nationale, l'insuffisante prise de conscience de la mission sociale de l'école, le manque d'évaluation des dispositifs mis en place, autant d'éléments sur lesquels le législateur ne peut influer. C'est au Gouvernement de mettre en place des dispositifs volontaristes, pérennes et suivis visant à mettre fin aux discriminations négatives de l'école.
On ne peut pas tout attendre de l'école et elle ne règlera pas à elle seule le problème de la pauvreté à l'âge adulte.
En vue de rééquilibrer l'attractivité des filières de formation professionnelle par rapport à celles de la formation générale dans l'esprit des adolescents et celui de leur famille, la mission propose, par ailleurs, que soit renforcé au collège l'enseignement de la technologie, qui doit notamment être axé sur l'usage des outils et la fabrication afin de mettre en valeur les facultés manuelles des individus.
Mais son rôle de prévention peut se développer et être amélioré. Tel est, par exemple, l'objet de la proposition de la mission de renforcement de l'enseignement technologique au collège.
|
RÉCAPITULATIF DES PROPOSITIONS DE LA MISSION 1. Confier une mission de promotion sociale à l'éducation nationale - Fixer des objectifs chiffrés précis en matière de réduction de l'échec scolaire, notamment s'agissant des élèves issus de milieux défavorisés. - Donner la possibilité aux établissements scolaires de passer des conventions de partenariat avec des entreprises implantées localement. - Renforcer l'autonomie des établissements scolaires en matière de pédagogie, de gestion des ressources humaines et d'utilisation des moyens. - Renforcer en conséquence les pouvoirs du chef d'établissement 2. Élargir l'horizon des élèves par une orientation active - Instituer un stage en entreprise annuel pour l'ensemble des élèves de la quatrième à la seconde. - Renforcer l'enseignement de la technologie au collège, en l'axant notamment sur le travail manuel. - Créer une fonction de professeur référent en orientation. - Dissocier la fonction de conseiller d'orientation de celle de psychologue scolaire. - Mettre en place des parcours modulaires dans les lycées professionnels. 3. Encourager les initiatives innovantes - Encourager le développement de l'EPIDe dans les secteurs où l'emploi est dynamique. - Inciter l'EPIDe à se concentrer sur les élèves les plus en difficulté. - Évaluer le coût d'un dispositif de soutien financier de maintien dans les études. - Instituer des stages dans des entreprises ou dans les collectivités territoriales pour les enseignants. |
TITRE IV - FAIRE DE L'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE UNE PRIORITÉ
I. UN DÉVELOPPEMENT INÉDIT DE L'EXCLUSION PAR L'EMPLOI
A. UN LIEN BIEN ÉTABLI ENTRE QUALITÉ DE L'EMPLOI ET EXCLUSION
La question de l'emploi et, en négatif, de l'inactivité, constitue un élément essentiel dans les problématiques liées à l'exclusion. « Les causes de la pauvreté sont multiples. (...). Toutefois, nous en avons cerné une, majeure, dans le système économique : le chômage », a ainsi résumé l'une des personnes auditionnées par la mission.
Mais le fait d'occuper un emploi, s'il favorise une bonne insertion, n'est cependant plus en soi une garantie absolue contre l'exclusion, celle-ci s'étendant désormais au salariat. « L'accès à l'emploi, objectif qu'il reste nécessaire d'atteindre, ne constitue plus une assurance de sortir de la pauvreté et de l'exclusion, s'il ne s'accompagne pas d'un travail décent ou, selon l'Union européenne, de qualité », a souligné ainsi M. Jacques Freyssinet, président du conseil scientifique du Centre d'études de l'emploi.
1. Une partie substantielle de la population en marge du marché du travail
a) Une population en difficulté d'insertion excédant largement celle des chômeurs
L'exclusion du marché du travail est un facteur aggravant les risques d'une exclusion sociale dans son sens le plus large. Or, l'estimation du nombre de personnes exclues du marché de l'emploi et de nature à bénéficier de mesures d'insertion est sujette à débat.
Lato sensu , elle recouvre l'ensemble de la population en situation de chômage . Au sens du Bureau international du travail (BIT), généralement retenu pour les comparaisons internationales 168 ( * ) , ce dernier s'établit, pour l'ensemble de la France 169 ( * ) , à 7,5 % de la population active , soit 2,1 millions de personnes. Plus généralement en France métropolitaine, 2,7 millions de personnes ne travaillent pas mais souhaiteraient travailler, qu'elles soient ou non disponibles dans les deux semaines pour travailler, et qu'elles recherchent ou non un emploi.
Toutes les personnes en situation de chômage n'ont cependant pas vocation à y demeurer à moyen ou long terme et à bénéficier des politiques d'insertion. Seules doivent être prises en compte celles astreintes à un chômage de longue durée 170 ( * ) , lesquelles représentent 4 % de la population active .
Toutefois, ce chiffre ne prend pas en compte l' ensemble des publics rencontrant des difficultés d'insertion . Si l'on y ajoute les effectifs des personnes suivant un parcours dans des dispositifs d'accompagnement et d'insertion professionnelle, plus ou moins éloignés de l'emploi, tout en neutralisant les cas de double compte 171 ( * ) , on aboutit, selon le rapport général du Grenelle de l'insertion, à un taux de 13 % de la population active . Ainsi, 3,5 millions de personnes, soit un actif sur huit, rencontre des problèmes d'insertion dans l'emploi.
Une enquête menée dans le cadre du Grenelle donne une traduction spectaculaire de ces chiffres en flux. Elle indique que le chômage concerne ou a concerné directement une personne sur deux, et qu'une personne sur cinq est ou a été dans un dispositif d'insertion.
b) La perte d'emploi, porte d'entrée dans la précarité
Si l'emploi n'est pas une condition suffisante pour garantir l'inclusion sociale, son absence ou sa perte est en revanche un facteur de risque de basculement vers la précarité, laquelle peut conduire, si d'autres facteurs s'y surajoutent, à la pauvreté et l'exclusion.
La définition même de la précarité fait une place centrale au paramètre « emploi ». Ainsi, selon celle donnée par le père Joseph Wrezinski, fondateur de l'association ATD Quart-Monde, « la précarité est l'absence d'une ou de plusieurs sécurités, notamment celle de l'emploi ».
D'après une enquête menée sur des SDF et citée par M. Patrick Dugois, délégué général d'Emmaüs France, cette perte d'emploi , au même titre que d'autres « accidents de la vie », peut générer une série de conséquences allant jusqu'à l'exclusion : « il existe des moments clés conduisant les personnes à la rue : la perte d'un emploi, la fin des allocations chômage, un décès, un divorce, etc. Il s'agit de ce que nous appelons communément les « accidents de la vie ». (...). Dans une société stable, marquée par le plein emploi, une personne fragile confrontée, par exemple, à une activité professionnelle insupportable peut démissionner et changer d'employeur, en raison de l'abondance du travail. Dans la société actuelle, une telle attitude n'est plus possible. Il est très facile aujourd'hui de se retrouver à la rue. Tout peut aller très vite pour celui victime d'un moment de faiblesse ou d'une perte d'emploi suite à une dépression grave ». Le responsable France d'Emmaüs a cité à la mission l'exemple, qui n'est plus rare aujourd'hui, d'un cadre commercial qui, en deux ans, a été licencié, a divorcé avant d'échouer dans un petit studio, puis dans la rue.
Selon Julien Damon, professeur associé à Sciences-Po et rapporteur général du Grenelle de l'insertion, « les pertes de travail et la dégradation des relations sociales et amicales constituent les principales raisons amenant les gens à vivre dans la rue. Il arrive souvent que des personnes aient une famille stable, mais qu'elles s'en soient éloignées pour chercher du travail à Paris où elles vivent dans la rue ».
Les centres communaux d'action sociale confirment, sur le terrain, que la perte d'une activité professionnelle est de plus en plus à l'origine d'un basculement dans la grande précarité . M. Daniel Zielinski, délégué général de l'Unccas, a indiqué qu'y avait été repérée « l'arrivée de nouveaux publics pauvres », au premier rang desquels « des personnes venant de perdre leur emploi ».
M. Jean-Baptiste de Foucauld, président de Solidarités nouvelles contre le chômage, a dit des mots très justes devant la mission pour exprimer la rupture radicale d'avec la société ressentie par les « inactifs contraints » . « Ceux qui vivent le chômage se découragent, se sentent plus jugés qu'aidés et n'ont plus confiance dans la société. Nous ne sommes pas suffisamment conscients du caractère moralement dévastateur dû à l'insuffisance quantitative d'emplois et de ses effets délétères sur l'ensemble du tissu social. (...). La souffrance sociale relative au chômage ne génère pas de réflexes de solidarité, contrairement aux autres catastrophes sociales. Le chômage, phénomène complexe et anxiogène, délie le lien social là où, au contraire, il devrait créer de la solidarité ».
c) Une frange de la population définitivement perdue pour l'emploi ?
Si l'exercice d'une activité rémunérée a des vertus certaines en matière d'insertion et si l'obtention d'un nouvel emploi peut être un objectif prioritaire pour les personnes l'ayant perdu, encore faut-il que celles-ci soient en mesure d'y accéder. Or, il semble qu'une fraction incompressible de la société ne soit pas apte -pour des raisons qui peuvent être passagères, comme pour des motifs plus profonds- à exercer une activité professionnelle dans des conditions de travail normales, du moins sans une prise en charge étroite et suivie.
« Le travail constitue notre principe de base. Mais nous savons bien que certains individus ne seront jamais très rentables », a ainsi reconnu devant la mission M. Patrick Dugois, délégué général d'Emmaüs France. « Jusqu'à l'avant-guerre, il existait des processus collectifs de socialisation dans le monde paysan, auquel était intégré l'idiot du village ou la personne improductive. Or, de tels espaces ne sont plus présents. Il est demandé aujourd'hui aux personnes faibles d'entrer dans le modèle économique dominant. (...). Certaines personnes ne pourront jamais se prendre en charge ou s'assumer, soit parce qu'elles ont été abîmées par la vie, soit parce qu'elles n'ont jamais eu les ressorts pour le faire. (...). Nos compagnons ne pourront jamais, en effet, avoir la productivité demandée dans le système économique actuel ».
Cette impossibilité quasi structurelle pour certains publics de s'insérer professionnellement peut tenir à des motifs psychologiques que les circonstances de l'existence ont fait naître. « Pour certaines personnes, la vie a tout simplement été trop dure et leur état de santé psychique les rend inaptes à travailler », a fait ainsi observer M. Bruno Grouès, conseiller technique à l'Uniopss.
Les inégalités se font jour dès le plus jeune âge : le milieu familial, l'éducation reçue et les codes culturels inculqués auront ensuite, arrivé à l'âge où doit se faire l'entrée sur le marché du travail, une influence capitale dans la capacité à s'insérer professionnellement. Les publics les plus défavorisés de ce point de vue seront les plus délicats à accompagner vers l'emploi par les structures spécialisées.
Le témoignage de Mme Pierrette Catel, chargée de mission au Conseil national des missions locales, rend compte de cette catégorie de personnes cumulant des handicaps rendant extrêmement difficile leur insertion : « Plus de 50 % de ces jeunes ont un bas niveau de qualification et sortent du système scolaire sans diplôme. De plus, ils souffrent souvent de phénomènes d'illettrisme extrêmement prégnants. Ces jeunes ne connaissent pas le monde de l'entreprise. Leurs parents sont souvent dans une situation de pauvreté ou s'approchant de la pauvreté, et sont au chômage depuis plusieurs années. Ces jeunes n'ont donc pas encore conscience de la valeur du travail et ne savent pas comment la mettre en pratique dans leur parcours ».
L'honnêteté intellectuelle et l'objectivité imposent d'admettre l'inemployabilité, du moins dans le secteur marchand, d'une partie de la population active. Cet état de fait conduit à réfléchir à des dispositifs de soutien et d'accompagnement adaptés ; en quelque sorte à des dispositifs « cousus main » aujourd'hui encore inexistants .
« Il ne faut pas se faire d'illusion , a ainsi reconnu devant la mission M. Claude Alphandéry, président du Conseil national de l'insertion pour l'activité économique (CNIAE). Pour certaines personnes, aucune solution ne pourra être mise en place. Que faisons-nous d'elles ? Leur versons-nous les minima sociaux ad vitam aeternam , rendons-nous le système de prise en charge très dérogatoire pour elles, les orientons-nous vers d'autres débouchés que ceux offerts par l'économie marchande ? L'insertion peut avoir lieu au travers soit de l'économie classique, soit de l'économie non marchande, basée sur des activités utiles mais situées en dehors du marché. Ce problème n'a pas été traité pour l'instant ».
2. Les travailleurs pauvres, un phénomène nouveau et préoccupant
Si l'existence de chômeurs en situation de précarité matérielle peut paraître à tout le moins compréhensible, l'apparition de travailleurs pauvres est excessivement inquiétante. Elle renvoie en effet à une catégorie de personnes pour laquelle l'exercice d'une activité professionnelle ne permet pas, à elle seule, de vivre dans des conditions satisfaisantes au regard des normes sociales.
a) Une définition posant question
La notion de travailleur pauvre est englobée dans celle, plus large, d'actif pauvre. Les actifs sont les personnes en activité ou en recherche d'activité professionnelle. Au sein de cette catégorie coexistent donc la sous-catégorie des actifs n'exerçant pas d'activité (chômeurs pauvres) et celle de ceux possédant au contraire un emploi (travailleurs pauvres proprement dit).
Une approche stricto sensu consiste donc à ne prendre en considération que les personnes effectivement employées, et ainsi à ne pas compter comme travailleurs pauvres les chômeurs aux revenus inférieurs au seuil de pauvreté. Mais une définition plus large rassemble tous les actifs, détenteurs ou à la recherche d'un emploi, dont la rémunération ne permet pas à leur ménage de se situer au dessus du seuil de pauvreté.
Par ailleurs, il faut veiller à ne pas confondre les personnes à bas salaire et les travailleurs pauvres : « il s'agit de deux catégories de population presque disjointes , a fait ainsi observer M. Jacques Freyssinet. En effet, les salariés avec un faible niveau de rémunération sont surtout des personnes employées à temps partiel et massivement des femmes. Mais les femmes travaillant à temps partiel ne peuvent survivre que si elles appartiennent à un ménage où il existe un autre revenu que le leur. Par conséquent, elles ne sont pas, en général, des travailleuses pauvres ».
Ainsi, faible salaire n'équivaut pas systématiquement à travailleur pauvre dès lors que la personne qui le perçoit appartient à un ménage bénéficiant d'autres sources de revenus. « Les travailleurs pauvres sont ceux qui font partie d'un ménage où il n'existe pas de salaire ou un faible revenu, du niveau du SMIC, avec lequel doit vivre une famille nombreuse. C'est la raison pour laquelle les liaisons entre la précarisation de l'emploi et les phénomènes de pauvreté et d'exclusion sociale sont complexes à analyser. Elles sont évidentes, mais pas mécaniques. Toute personne qui touche un bas salaire n'appartient pas à une famille vivant dans la pauvreté et inversement, un individu travaillant à plein temps sur la base du SMIC peut constituer un travailleur pauvre s'il a une famille nombreuse vivant sur son seul revenu ».
b) Un phénomène d'ampleur au niveau national
(1) Un phénomène renseigné statistiquement
Selon l'approche, stricto ou lato sensu , retenue du « travailleur pauvre », le phénomène revêt une ampleur variable, mais dans tous les cas préoccupante.
Comme le souligne l'Observatoire des inégalités 172 ( * ) , dont sont extraites les données suivantes 173 ( * ) , on peut considérer qu'il touche, en France, entre 1 et 4 millions de personnes. Certains analystes, retenant une approche beaucoup plus large, vont jusqu'à en décompter 7 millions 174 ( * ) . A l'inverse, si l'on restreint le phénomène à son sens le plus strict, soit au nombre des personnes exerçant une activité rémunérée et dont les revenus sont inférieurs à la moitié du revenu médian 175 ( * ) , notre pays compte entre 1,3 et 1,4 million de travailleurs pauvres depuis le début des années 2000 .
Or, si le nombre et la proportion des travailleurs pauvres ont diminué entre l'apparition du phénomène au milieu des années 90 et le début des années 2000, la tendance est à nouveau à la hausse depuis 2002 . M. Jean-François Trogrlic, directeur du bureau de l'Organisation internationale du travail (OIT) en France, a ainsi fait état d'« un total en hausse de 30.000 personnes entre la période de 2002 à 2003 et celle allant de 2004 à 2005 ». Selon le rapport 2007-2008 de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale (ONPES), le nombre de travailleurs pauvres est passé, selon la définition française, de 1,47 million en 2003 à 1,74 million en 2005, soit 7 % des travailleurs.
(2) Un phénomène ressenti par les acteurs sociaux
Le phénomène des travailleurs pauvres a été évoqué à de nombreuses reprises lors des auditions de la mission commune d'information comme l' une des données nouvelles d'importance à prendre en compte dans les politiques de lutte contre l'exclusion .
« Nous voyons aussi arriver dans nos permanences d'accueil des travailleurs pauvres, par exemple, des jeunes couples dont les deux membres travaillent, mais dont la rémunération n'est pas régulière. Leurs ressources ne permettent pas de subvenir à leurs besoins », a ainsi indiqué Mme Henriette Steinberg, secrétaire nationale du Secours populaire.
Lors de son audition, la présidente de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, Mme Agnès de Fleurieu, a dit avoir constaté, lors d'une action de médiation auprès de l'association Médecins du Monde, « que des wagons de la gare de l'Est étaient loués pour trois euros la nuit à des travailleurs, comme par exemple à des employés de restaurant qui habitaient en grande couronne et dont les horaires atypiques ne leur permettaient pas de rentrer chez eux ».
M. André Gachet, président de la fédération des associations pour la promotion de l'insertion par le logement (Fapil), a fait un constat similaire : « Nous observons une modification importante de la demande qui n'est pas nécessairement visible ou prise en compte. Nous constatons ainsi, dans tous nos lieux d'accueil, une paupérisation des salariés dont les revenus sont faibles et qui connaissent des difficultés pour accéder au logement ».
Même constat de la part de Mme Nicole Maestracci, présidente de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (Fnars) : « Nous recevons aujourd'hui dans nos centres d'hébergement des personnes qui travaillent mais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté ». Constat identique, encore une fois, chez M. Gilles Mirieu de Labarre, président du Centre d'action sociale protestant (CASP), qui a rapporté que certaines des structures de son association abritaient « des travailleurs pauvres, n'ayant pas les moyens de payer un loyer dans le parc du logement social ou privé ».
Ainsi, l' accès à l'emploi constitue une condition nécessaire mais pas suffisante pour se prémunir de la pauvreté , comme l'a souligné M. Jacques Freyssinet : « Il s'agit d'une condition nécessaire, car l'accès à l'emploi renvoie au droit à l'emploi reconnu par notre Constitution à tout citoyen. Toute personne apte au travail et désireuse d'exercer une activité doit se voir reconnaître ce droit et pouvoir obtenir un emploi convenable. Toutefois, (...) il n'est plus suffisant d'avoir un emploi pour quitter la pauvreté et même l'exclusion, comme en atteste l'existence des travailleurs pauvres qui peuvent enchaîner les emplois à court terme sur une longue période ».
c) Une réalité à l'échelle européenne
Dans le cadre de la stratégie communautaire pour l'emploi, elle-même intégrée à la stratégie dite « de Lisbonne », la diminution du nombre de travailleurs pauvres est devenue une priorité de l'Union européenne.
A partir de 2003, il a donc fallu bâtir un indicateur pour évaluer et comparer le phénomène. Une définition communautaire, légèrement plus souple que la française , a été élaborée par le Comité de protection sociale européen. La notion de travailleur pauvre renvoie à toute personne qui, durant l'année de référence, est « principalement au travail » -c'est-à-dire pendant plus de la moitié de l'année- comme salariée ou indépendante et vit au sein d'un ménage dont le revenu total est inférieur à 60 % du revenu médian national 176 ( * ) .
Selon cette définition, l'Union européenne à 15 rassemblait, en 2001, 11 millions de travailleurs pauvres. C'était le cas de 14 millions de travailleurs dans l'Union à 25 177 ( * ) . Ainsi, environ 7 % de la population active dans l'Union européenne -à 15 comme à 25- se trouve concernée directement par la « pauvreté au travail ».
d) Des salariés inclus dans le marché du travail mais socialement exclus
Les travailleurs pauvres cumulent une pluralité de handicaps : problèmes de formation et d'adaptation au marché de l'emploi, état de santé déficient, difficulté de logement, relations sociales distendues, perte de confiance en soi ... Leur statut professionnel est éminemment précaire, qu'ils soient le plus souvent intérimaires ou saisonniers. Forme extrême de la pauvreté active, les travailleurs sans domicile représentent pas moins de 30 % du nombre de personnes dépourvues de logement 178 ( * ) .
S'ils restent intégrés au marché de l'emploi, les travailleurs pauvres sont exclus des systèmes de solidarité traditionnels attachés au statut de salarié à plein temps , qu'il s'agisse des droits au chômage, à la santé ou à la retraite.
Toutefois, le salariat reste un élément de protection contre la pauvreté : ainsi, « seulement » 7 % des personnes actives en sont victimes, contre 14 % parmi les inactifs et 34 % parmi les chômeurs.
e) Des situations choquantes pour l'opinion publique
Le regard que portent les travailleurs pauvres sur eux-mêmes est douloureux, la pauvreté étant plus durement ressentie lorsque les personnes affectées possèdent un emploi. Or, si la pauvreté « non active » est mal perçue socialement, les travailleurs pauvres bénéficient d'un capital d'empathie de la part du reste de la population , leur situation étant perçue comme inacceptable et eux-mêmes étant considérés comme méritants. Ainsi, les Français sont 45 % à estimer que le droit au logement opposable devrait bénéficier en priorité à cette catégorie de travailleurs 179 ( * ) , devant les sans domicile fixe (27 %) et les personnes en logement précaire ou insalubre (22 %).
Le caractère choquant de la situation des travailleurs pauvres tient sans doute au fait que l'occupation d'une activité rémunérée, longtemps perçue comme un rempart indestructible contre les formes avancées de pauvreté et l'exclusion, a perdu cette fonction. Il réside également dans le constat de l'incapacité de notre système de protection sociale à prendre en considération cette catégorie de la population à laquelle ne peut être reprochée une quelconque oisiveté.
3. Une augmentation des formes précaires de travail
a) Un système marchand globalisé aux effets sociaux délétères
Le système économique libéral, de par les pressions qu'il exerce naturellement sur ses composantes, tend à reléguer les plus faibles d'entre elles vers ses marges et à devenir une « machine à produire de l'exclusion ». Autrefois exceptionnelles, les formes précaires de travail tendent aujourd'hui à devenir normales, et seront demain peut-être majoritaires.
|
Les « déséquilibres du capitalisme en voie de mondialisation » : l'analyse de M. Jean-Baptiste de Foucauld, président de Solidarités nouvelles contre le chômage « Le capitalisme constitue une machine dynamique, mais elle est toujours en état de déséquilibre. Il s'agit de l'une de ses caractéristiques naturelles. Ce déséquilibre a tendance à changer de sens. Ainsi, au lendemain de la guerre, les dirigeants et les salariés étaient en position de force face aux consommateurs qui subissaient les effets d'une forte inflation, et par rapport aux actionnaires, plus ou moins bien rémunérés. Aujourd'hui, la donne a changé : l'actionnaire demande des rendements de plus en plus élevés et les entreprises cherchent de plus en plus à accroître leur rentabilité. Le consommateur, de son côté, souhaite bénéficier de prix bas et de produits de bonne qualité. Ses intérêts sont opposés à ceux de l'actionnaire. Il existe donc une pression continue sur le manager et les salariés, laquelle concourt à cette volonté de diminuer la quantité de travail. En effet, le travail, qui devrait être une ressource de développement de l'être humain, finit par apparaître comme un coût, une pénalisation. A cet endroit réside un déséquilibre du système, qu'il n'est pas aisé de corriger dans une économie de marché, et qui apparaît comme un facteur d'exclusion. Car ce sont les "maillons faibles" de notre société qui sont éliminés en priorité. (...). Nous convenons tous du fait que le capital doit avoir un rendement normal et régulier. Mais nous faisons actuellement face à un excès de financiarisation. Selon moi, la réalité montre qu'il est essentiel de s'orienter vers un actionnariat et une consommation responsables et équitables. J'ajouterai que la globalisation elle-même crée, en quelque sorte, une interdépendance croissante entre les phénomènes et rend plus difficile la possibilité de mener des actions sélectives. (...). Aujourd'hui, nous n'avons plus qu'un ou deux leviers à notre disposition pour agir. (...). C'est pourquoi je pense qu'une réflexion doit être menée pour faire évoluer le mode de fonctionnement actuel du système capitaliste. Nous ne pouvons pas traiter de questions relatives à l'exclusion sans nous interroger sur ce sujet. Un autre facteur d'accroissement du risque d'exclusion est difficile à évoquer. Il s'agit du décalage entre la machine à fabriquer des désirs, très puissante dans notre société, et les moyens de satisfaire ces mêmes désirs. Les moyens pour résorber ce décalage sont limités. (...). Dans les années 1960, la population était tellement habituée à voir ses désirs freinés que, plus tard, elle a été agréablement surprise par cette haute productivité. Aujourd'hui, la situation s'est inversée : les citoyens, habitués à voir leurs désirs satisfaits, n'ont pas toujours les moyens de les assouvir. Se crée alors un écart, un effet de ciseau psychologique, entre la machine à fabriquer des désirs -stimulée par l'arrivée de nouveaux produits techniques et technologiques très coûteux, par la publicité et le système politique lui-même (gauche et droite confondues)- et les moyens de les satisfaire. Nous sommes, en permanence, dans une situation de porte-à-faux. A cette situation s'ajoute la contrainte écologique (...). Chaque fois que nous créons des normes, les personnes les plus défavorisées sont celles qui rencontrent le plus difficultés à les respecter. Bien sûr, nous pouvons observer une convergence entre la croissance écologique et la croissance sociale. Mais une divergence en la matière s'observe également. De fait, je perçois la société actuelle comme une société marginalisée, constituée, non plus de classes, mais de zones (...). De plus, si une partie de la société, frustrée, peine financièrement en fin de mois, une autre partie (les créatifs culturels ayant réussi), elle, se dit heureuse. Enfin, naît également une société quelque peu cynique, en voie de dérapage ; d'où la nécessité de recréer de l'unité entre ces différentes zones et donc de recentrer nos développements vers l'essentiel ». |
M. Patrick Viveret, conseiller maître à la Cour des comptes et auteur du rapport « Reconsidérer la richesse », a évoqué à son tour les « effets collatéraux » d'un modèle de société marchande débridée, et souligné la responsabilité du politique dans sa régulation.
« Dans La grande transformation, a-t-il ainsi indiqué, M. Karl Polanyi a bien montré que la société de marché, qui naît lorsque l'économie en vient à marchandiser des liens sociaux qui sont d'un autre ordre, comme le lien politique, le lien de réciprocité et la recherche de sens, atteint la substance même du lien social. L'issue des sociétés de marché est ainsi très négative, avec un retour régressif aux fondamentaux que sont le politique et la recherche de sens dans la société. (...). Les acteurs politiques ont donc l'immense responsabilité d'empêcher que le retour du politique soit régressif. Ils doivent pour cela transformer leur rapport au pouvoir ».
b) Une partie importante du salariat ne bénéficiant pas d'un emploi stable
Si la population active française est salariée à près de 90 % -70 % dans le secteur privé et 20 % dans le secteur public, ce salariat recouvre des statuts et des situations très variables. Ainsi, 12 % de l'ensemble des personnes employées ont un statut précaire , qu'il s'agisse d'un contrat à durée déterminée (CDD), d'un emploi en intérim, d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de stage ou d'un contrat aidé, comme le montre le tableau suivant.
Mme Nicole Maestracci, présidente de la Fnars, a mentionné à cet égard la montée de « temps partiels subis qui rendent la situation des personnes beaucoup plus difficile qu'elle ne l'était auparavant ».
En valeur absolue, ce salariat précaire se retrouve le plus souvent dans le secteur privé, qui emploie 3,5 fois plus de salariés que le public. En proportion cependant, le secteur public compte autant de précaires que le privé.
|
|
c) Des publics particulièrement exposés aux formes précaires de travail
Comme l'a montré auprès de la mission M. Jacques Freyssinet, l'analyse des flux montre un phénomène, « non pas de précarisation générale de l'emploi, mais de segmentation croissante des statuts de l'emploi avec une focalisation de la précarité sur une partie relativement peu importante de la population qui enchaîne des périodes de chômage et d'emplois de courte durée. Cette situation touche beaucoup les seniors, les jeunes non diplômés et les femmes, de moins en moins cependant, qui retournent sur le marché du travail après avoir consacré plusieurs années de leur vie à l'éducation de leurs enfants ».
(1) Les seniors
S'il est couramment admis que les seniors, de par leur expérience, devraient constituer une richesse pour le monde du travail, force est de constater que leur statut y est davantage exposé que celui des travailleurs des tranches d'âge inférieures.
Une étude très récente du Centre d'étude de l'emploi 180 ( * ) évoque à cet égard « un compromis social -élaboré depuis plus d'un siècle- qui fait des travailleurs plus âgés la variable d'ajustement privilégiée des phases de recomposition quantitative et qualitative de la force de travail ». Cette notion de « variable d'ajustement », qui fait de l'âge au travail un paramètre favorisant les risques de basculement vers la précarité, est d'ailleurs reprise par le Plan national d'action concerté pour l'emploi des seniors 2006-2010, qui reconnaît leur « éviction du marché du travail » et les « drames humains qu'elle engendre ».
D'un point de vue quantitatif, les seniors sont proportionnellement plus touchés par l'inactivité que le reste de la population. Ainsi, avec un taux d'emploi de 40,1 % des hommes de 55 à 64 ans, la France se classe au 26 ème rang parmi les pays de l'Union européenne. Plusieurs explications à cette situation sont couramment avancées. D'une part, les dispositifs administratifs imaginés spécifiquement pour favoriser l'embauche des travailleurs âgés n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. D'autre part, les mécanismes d'éviction de l'emploi des travailleurs plus âgés se poursuivent, malgré l'arrêt officiel des mesures de préretraite.
D'un point de vue qualitatif, il faut faire une distinction selon la situation des seniors. Ceux implantés depuis une durée assez longue -parfois toute une carrière- dans une même entreprise bénéficient généralement d'emplois de qualité, surtout dans les catégories d'emploi supérieures. En revanche, lorsqu'ils sont recrutés, les seniors sont davantage embauchés en contrats précaires que leurs cadets. Ainsi, selon les chiffres de l'Insee 181 ( * ) pour la région Île-de-France, que l'on peut considérer comme constituant un échantillon représentatif à l'échelle nationale, les recrutements en CDD représentent 77 % des embauches de seniors de plus de 60 ans entre 2001 et 2006, dans les établissements de 50 salariés ou plus.
(2) Les jeunes
En raison de leur inexpérience, mais aussi d'une conjoncture rendue difficile par un taux de chômage élevé et une réticence des entreprises à embaucher, les jeunes, surtout lorsqu'ils sont peu ou pas diplômés, restent particulièrement fragilisés sur le marché du travail. Même avec des prétentions salariales inférieures à celles de leurs aînés, l'entrée sur le marché de l'emploi reste un parcours d'obstacles, souvent fait de stages nombreux et de périodes de précarité. Si la majorité des jeunes occupe toutefois un contrat à durée indéterminée, un cinquième des jeunes actifs exerce un emploi temporaire, contre 8,2 % « seulement » des actifs de 30 à 49 ans.
On notera aussi que le chômage, à l'origine d'une exclusion bien supérieure à celle des formes précaires d'emploi, frappe d'abord les plus jeunes : ainsi, 18 % des actifs 182 ( * ) de 15 à 29 ans n'ont pas d'emploi. « Le marché de l'emploi est fermé aux jeunes. Leur taux de chômage est deux fois plus élevé que la moyenne », a très clairement indiqué M. Jean-Baptiste de Foucauld, président de Solidarités nouvelles contre le chômage.
|
|
(3) Les femmes
Si les femmes ont investi le marché du travail depuis les années 60, leur situation y reste globalement plus précaire que celle de leurs homologues masculins.
Comme le souligne Françoise Milewski 183 ( * ) , économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), « ce sont les ruptures de parcours, professionnels et personnels, qui créent la précarité ou son risque. Quand les caractéristiques des emplois occupés témoignent d'une relation instable au marché du travail (...) ou stable dans le sous-emploi (...), les femmes peuvent basculer vers la précarité, tout particulièrement après une rupture conjugale, car se cumulent plusieurs facteurs défavorables. Elles peuvent même tomber dans la pauvreté quand, sans emploi stable ou parce qu'elles occupent des emplois mal rémunérés, elles ont des charges de famille ».
Les CDD, les temps partiels contraints 184 ( * ) et les dispositifs de la politique de l'emploi concernent le plus souvent les femmes, et sont moins pour les femmes que pour les hommes un mode d'insertion vers l'emploi durable. Emplois instables, peu ou non qualifiés 185 ( * ) et mal rémunérés, relation lâche et discontinue au marché du travail du fait des charges familiales dont elles s'acquittent plus fréquemment que les hommes, autant de facteurs exposant davantage les femmes que les hommes aux formes précaires d'emploi.
B. UN ACCÈS À L'EMPLOI DIFFICILE POUR LES POPULATIONS ÉLOIGNÉES DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Cumulant souvent une multitude de handicaps, tant professionnels que personnels, les publics durablement exclus du marché du travail éprouvent d'autant plus de difficultés à se réinsérer économiquement que leur profil est très largement stigmatisant auprès des employeurs potentiels et qu'ils ne disposent pas d'instances de médiation organisées auprès de ces derniers et des acteurs socioéconomiques.
1. Un environnement inadapté à la recherche d'emploi
Dans un contexte de taux de chômage relativement élevé comme le connaît notre pays, qui induit une forte concurrence entre demandeurs d'emploi, l'environnement immédiat de ces derniers constitue une donnée importante pour déterminer leur capacité à retrouver et exercer une activité professionnelle. Posséder un logement fixe et confortable, bénéficier d'une vie de famille stable, avoir accès à des conditions matérielles d'existence correctes constituent de ce point de vue un atout pour les personnes socialement insérées par rapport aux publics marginalisés.
M. Patrick Dugois a ainsi insisté sur les « sur les handicaps » que doivent gérer les personnes recherchant un emploi alors qu'elles connaissent une situation de précarité . Rappelant que 30 % des SDF travaillaient, il a souligné combien « pour eux, vivre dans la rue et être présentable le matin pour se rendre au travail constitue une vraie performance. (...) lorsque vous êtes en situation de détresse, vous ne vous trouvez pas dans les dispositions de signer un contrat. Vous tentez de survivre. Les SDF ne connaissent pas l'avenir. Un SDF ne sait jamais s'il pourra se rendre à un rendez-vous fixé le lendemain. Il lui est impossible de se projeter dans le temps. Il vit dans l'heure qui suit ».
2. Des discriminations profondément stigmatisantes
En plus des handicaps objectifs que doivent affronter les publics les plus précaires en vue de s'insérer ou de se réinsérer professionnellement, se surajoute la difficulté liée à la mauvaise image que peuvent avoir d'eux leurs employeurs potentiels. Parce qu'ils sont souvent désocialisés et n'ont plus conscience des codes tacites que requiert toute relation professionnelle, parce qu'ils appartiennent à des minorités ou catégories sociales stigmatisées (jeunes, femmes, étrangers, handicapés, personnes âgées...), ces publics sont en effet préférentiellement l'objet des discriminations de la part du marché du travail et du monde de l'entreprise.
Dans son rapport pour 2007, la Haute autorité de lutte contre les discriminations (Halde) relève ainsi que plus de 50 % des réclamations qu'elle a enregistrées concernent l'emploi , la discrimination sur l'origine restant la plus invoquée (27 % des cas), tandis que progresse le critère handicap (de 19 à 22 %).
M. Jean-François Trogrlic, directeur du bureau de l'OIT en France, a insisté sur cette donnée immatérielle qui est peut-être insuffisamment prise en compte dans l'analyse des trajectoires d'emploi des travailleurs précaires. « Nous avons du mal à séparer la pauvreté de l'exclusion. Les faits montrent, en effet, que plus les personnes sont fragiles, plus elles sont susceptibles de basculer dans la précarité. Par conséquent, il convient, dans les pays développés, de lutter notamment contre les discriminations, celles-ci formant un des vecteurs majeurs de l'exclusion et donc de la pauvreté » .
Lors de son audition, M. Jacques Attali s'est dit partisan « d'agir pour faire culpabiliser les entreprises qui se rendent coupables de discrimination ». Non par des instruments de discrimination positive, c'est-à-dire en instaurant des quotas, mais en obligeant « les entreprises à indiquer le nombre de femmes, de personnes handicapées ou issues de minorités visibles recrutées et les banques à signaler le nombre de crédits accordés à des femmes, des seniors et des jeunes des cités ».
3. Un manque patent de formation
Le niveau de formation, initiale comme continue, conditionne très largement l'obtention d'un emploi de qualité permettant de prévenir les risques d'exclusion. En négatif, l'absence de diplôme ou de formation qualifiante, ou bien la faible reconnaissance de ceux-ci, accroît les difficultés d'insertion professionnelle qui, combinées avec d'autres facteurs, peuvent conduire à la précarité.
Ce lien entre manque ou insuffisance de formation et précarité professionnelle est particulièrement patent chez les jeunes publics , comme l'a montré une enquête du Centre d'études et de recherches sur les qualifications (Cereq) sur une cohorte de jeunes sortis de leur formation initiale en 1998. Ceux ne possédant qu'un faible niveau de qualification sont confrontés, lors de leur entrée dans la vie active, à des difficultés plus importantes que l'ensemble des jeunes. Leur situation sur le marché de l'emploi est moins favorable que la moyenne : quatre ans après la fin de leur formation, 20 % d'entre eux sont au chômage (contre 9 % des jeunes sortis de formation la même année) et 10 % sont inactifs. En outre, un jeune sur huit est confronté à un temps partiel « subi ».
L'enquête du Cereq souligne très clairement le lien entre le faible niveau de formation, la difficulté d'insertion professionnelle et le risque de glissement vers la précarité . « En effet, une insertion professionnelle difficile peut (...) avoir des conséquences de long terme sur les trajectoires des jeunes concernés, en dégradant leur "capital humain" et en les enfermant durablement dans une situation de précarité ou de pauvreté ».
Répartition par grands niveaux de diplôme selon le type de trajectoires, en %
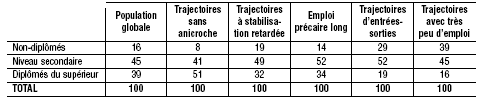
Lecture : 52 % des trajectoires avec emploi précaire long concernent les jeunes avec un diplôme secondaire, alors que ceux-ci représentent 45 % de la population étudiée.
Source : Cereq, Insertion professionnelle et autonomie résidentielle des jeunes, enquête sur la génération sortie de formation initiale en 1998.
4. Des sans emplois mal représentés dans les instances de négociation
Dans une société où les notions de participation active à la prise de décision collective et de représentativité des intérêts sectoriels sont largement développées et appliquées, l'absence de prise en compte de la « voix des exclus » dans la sphère économique semble particulièrement choquante .
Le président de Solidarités nouvelles contre le chômage, M. Jean-Baptiste de Foucauld, a insisté sur l'absence de médiation de ces derniers. « Les problématiques sociales ne sont jamais vraiment portées par ceux qu'elles concernent » a-t-il fait remarquer. « En effet, les demandeurs d'emploi ne s'organisent pas et ne font pas entendre de voix collective. Ils sont isolés et s'abstiennent de contribuer à la co-construction des politiques qui devraient les aider. Il existe, à ce niveau, un déficit de démocratie, déficit aujourd'hui à la base de nos sociétés. Nous avons ainsi d'importants progrès à réaliser pour co-construire les politiques avec ceux à qui elles sont destinées ».
Arguant également du fait que les chômeurs constituaient « l'une des seules catégories de personnes dont la voix n'est pas portée par une quelconque structure », M. Jean-Pierre Guenanten, délégué national du Mouvement national des chômeurs et précaires (MNCP), a discuté de la légitimité d'une participation des associations de chômeurs aux réunions d'institutions intervenant dans le domaine de l'emploi.
S'il a longtemps été défendu que les syndicats avaient pour vocation de représenter cette catégorie d'actifs, ce constat ne serait plus valable . Ceci du fait de la masse critique atteinte par le chômage dans notre pays, qui fait des sans-emploi une catégorie spécifique répondant à ses problématiques propres. Le reproche a également pu être adressé aux syndicats -dont les représentants sont salariés- de défendre davantage le maintien dans l'emploi et la garantie de statut qui y est associée, que le retour au travail des chômeurs.
M. Bruno Grouès, conseiller technique au pôle « lutte contre les exclusions » de l'Uniopss, a fait référence à « l'identification des moyens à mettre en place pour permettre la participation des personnes défavorisées aux décisions qui les concernent », constatant à cet égard : « l'un des grands problèmes est que nous décidons pour les pauvres », aucun d'entre eux, a-t-il reconnu, ne siégeant dans les conseils d'administration des associations.
Créés par la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, les comités de liaison doivent constituer des lieux de rencontre entre représentants des chômeurs et responsables du service public de l'emploi, sous la maîtrise d'oeuvre de l'ANPE. Mais ce dispositif « a globalement suscité une faible implication de la part des acteurs concernés » 186 ( * ) .
C. DES ASSOCIATIONS TRÈS INVESTIES
Très présentes dans le domaine de l'insertion par l'activité et recouvrant des réalités extrêmement variées, les associations sont des acteurs incontournables de l'insertion par l'économique.
Elles assurent une action diversifiée en faveur des publics exclus, allant de la fourniture aux personnes qu'elles accueillent d'une occupation en-dehors d'une relation de travail proprement dite à l'aide à la création d'entreprise.
1. L'occupation non marchande
Il ne s'agit pas ici pour l'association de procurer à la personne exclue une activité économique en tant que telle, mais davantage une occupation lui permettant de se reconstruire symboliquement, de s'obliger à se projeter dans le futur et de retrouver une certaine estime de soi .
La branche « communautaire » d'Emmaüs France vit ainsi essentiellement en « ramassant » des objets, activité qui permet de proposer une activité aux compagnons, dont certaines n'exigent que très peu de qualifications. La recherche du profit n'y est pas le but ultime, les compagnons ne se trouvant d'ailleurs pas dans une relation salariale avec leur communauté de rattachement. Cette occupation permet d'assurer une activité suivie à des personnes qu'elle responsabilise et dont elle contribue à structurer la vie quotidienne. Par ailleurs, elle entretient et développe pour une partie de ces publics la possibilité, à terme, de se réinsérer sur le marché du travail, dans des conditions d'accompagnement toutefois poussées.
L'occupation des publics précarisés en milieu associatif peut en effet constituer un sas de réadaptation à une activité économique à part entière , à condition que le parcours personnel de réinsertion ne soit pas précipité. « Une personne qui nous rejoint dans un très mauvais état de santé pourra passer plusieurs mois, voire plusieurs années, à effectuer un travail purement symbolique, jusqu'à ce qu'elle soit capable de faire autre chose. Il nous paraît indispensable de respecter les personnes et leur rythme de vie », a ainsi témoigné devant la mission M. Patrick Dugois au nom d'Emmaüs France.
Le modèle communautaire permet d'offrir à ces personnes en marge du système économique classique un espace de protection et de liberté adapté à leurs caractéristiques. Comme l'a souligné M. Dugois, il se caractérise par une position juridique particulière puisque les compagnons ne sont ni salariés -ils ne relèvent pas du droit du travail, selon un arrêt de la cour de cassation de 1994-, ni bénévoles.
2. L'aide à la recherche d'emploi
Le milieu associatif constitue aujourd'hui un espace privilégié pour aider les exclus à passer de la sphère de l'assistance à celle de l'autonomie , de l'occupation non marchande à l'activité économique.
M. Jean-Baptiste de Foucauld a ainsi décrit la façon dont son association, Solidarités nouvelles contre le chômage, met à disposition du demandeur d'emploi un binôme d'accompagnateurs. « Ces derniers, pendant une période de temps non déterminée, l'aideront dans ses recherches, l'écouteront, partageront sa souffrance, en particulier morale. Tous les mois, ils se retrouveront au sein d'un groupe de solidarité chargé de soutenir ceux qui aident et de réguler leur mode d'accompagnement. En effet, la relation d'aide constitue une relation difficile. Elle exige de se situer, ni sur le terrain de l'assistance, ni sur celui de l'autoritarisme ».
Les responsables du MNCP ont indiqué pour leur part que leur association informait les chômeurs de leurs droits et travaillait efficacement avec la ville de Paris. « Les chômeurs se retrouvent souvent isolés et il est important de mettre à leur disposition des lieux où ils peuvent se réunir pour discuter de leurs problèmes et de leurs projets. Des chefs d'entreprise et des retraités participent également à la vie de l'association. La participation des chômeurs à son fonctionnement est déterminante. (...). Il nous faudra travailler avec les missions locales, et non pas seulement avec l'ANPE, concernant leur accueil et leur accompagnement dans leur recherche d'emploi et en matière de formation ».
3. La création d'emplois solidaires
La troisième branche d'activité du mouvement Emmaüs, qui est aussi la plus récente, est sans doute l'un des meilleurs exemples de cette capacité des associations de lutte contre la pauvreté et l'exclusion à recréer de l'activité économique pour les publics les plus précaires dans des secteurs d'activité à faible qualification (collecte et tri des déchets, tri postal, jardinage, épiceries solidaires, bâtiment et services à la personne ...). Dans ce schéma, les personnes exclues sont dans une relation de salariat avec l'association dont elles relèvent.
Composée de 63 groupes représentant 3.000 salariés, cette branche est structurée en plusieurs entreprises dont la plus importante s'appelle « Le Relais » et emploie 1.000 salariés. L'ensemble formé par les communautés d'Emmaüs et Le Relais constitue le premier acteur français en matière de retraitement des vêtements et des tissus, soit 67 % du recyclage du textile en France. Le réseau Emmaüs est aussi l'un des premiers collecteurs dans le domaine des déchets électroménagers. Pour son responsable, Emmaüs France constitue véritablement « un mouvement entrepreneurial alimenté par le recyclage ». Une délégation de la mission s'est d'ailleurs rendue sur le principal site Emmaüs, à Neuilly-Plaisance, qui accueille un nouvel espace en construction destiné au réemploi des déchets.
De la même façon, Solidarités nouvelles contre le chômage propose aux personnes qu'elle accueille un travail rémunéré, après leur avoir tout d'abord apporté un soutien matériel et moral dans leur recherche pour une insertion à l'extérieur de l'association.
Comme l'a expliqué son président, M. Jean-Baptiste de Foucauld, ce n'est que « si cet accompagnement n'aboutit pas à un emploi pour le demandeur (que) nous créons l'emploi nous-mêmes, grâce à la collecte de dons et au partage des revenus. Un partage financier s'ajoute donc au partage de temps que représente l'accompagnement. Nous subventionnons ainsi l'embauche des personnes dans une association, pour une durée d'un ou deux ans. La conséquence est que nous mutualisons le revenu et le temps pour aider les personnes ayant du mal à trouver du travail ».
Une délégation de la mission a par ailleurs visité le centre de promotion familiale, d'hébergement et de réinsertion sociale d'ATD Quart-Monde, à Noisy-le-Grand. Elle a rencontré des salariés de deux entreprises solidaires crées par l'association et s'occupant, l'une du recyclage de matériels informatiques, l'autre de travaux de rénovation immobilière.
4. Le portage d'ateliers et de chantiers d'insertion
Les ateliers et chantiers d'insertion (ACI) constituent l'un des supports de l'insertion par l'activité économique (IAE) et sont préférentiellement pris en charge par des associations. Leurs bénéficiaires sont alors dans une relation contractuelle de travail avec l'association qui les emploie ; il s'agit donc ici d'une des modalités de création d'emplois solidaires par ces dernières.
L' utilité des ACI a été globalement saluée par les différentes personnes auditionnées par la mission. « Travaillant au bénéfice du maintien ou de la rénovation du patrimoine », son bénéficiaire va « participer à la vie civile et, par là même, le regard porté par la collectivité locale sur lui va changer », a indiqué Mme Pierrette Catel, chargée de mission au Conseil national des missions locales.
Une association comme Les restos du coeur parvient à réinsérer, selon les chiffres communiqués par son président à la mission, 26 % des personnes qui se trouvent dans ses chantiers d'insertion. « Il s'agit d'un taux considérable », a-t-il fait valoir, « compte tenu du fait que nous n'effectuons aucune sélection à l'entrée des chantiers d'insertion. Nous accueillons tous les publics, y compris ceux très éloignés de l'emploi, à qui nous apportons un accompagnement très renforcé ».
L'objectif des ACI est pluriel , aussi bien économique que social. « Pas seulement un moyen de soutenir l'économie solidaire », comme l'a fait valoir M. Michel de Vorges, responsable du volet insertion des Restos du coeur, mais également « une manière de réduire le chômage de masse et surtout d'aider une personne à revenir dans l'emploi » et de « prendre conscience (...) de l'importance d'avoir un emploi ». Le travail en ACI n'est donc censé être que transitoire, et préparer à un retour sur le marché du travail : « vient un moment où la personne (...) doit franchir la dernière étape de son parcours en trouvant un emploi ».
Toutefois, certaines limites freinent le développement des ACI et réduisent leur efficacité en termes d'insertion. La présidente de la Fnars, qui regroupe la moitié des ACI, a ainsi noté l'insuffisant suivi des travailleurs évoluant sur ces ateliers et chantiers qui, s'ils sont accueillis et accompagnés durant la période de leur contrat aidé, ne sont plus secondés par l'équipe de travailleurs sociaux au-delà.
5. L'aide à la création d'entreprise
L'ultime degré d'investissement associatif en faveur des sans emploi consiste dans l'accompagnement vers la création d'entreprise.
Le MNCP a ainsi rapporté qu'il soutenait des porteurs de projets dont les initiatives connaissent un taux de réussite de 65 % après deux ans d'activité, taux très satisfaisant au regard de celui enregistré pour la création d'entreprise « de droit commun ». A été accompagnée de la sorte la création de centrales d'achat sur l'île de la Réunion, qui a permis la commercialisation de produits économiquement accessibles auprès de la population locale.
D. DES ENTREPRISES ENCORE INSUFFISAMMENT IMPLIQUÉES
Si l'entreprise est un acteur incontournable des problématiques liées à l'exclusion, elle n'assure pas encore dans ce champ le rôle qui devrait lui revenir. A la fois à l'origine de l'exclusion du marché du travail et au point d'entrée de toute politique d'insertion par l'emploi, elle occupe une situation ambiguë qu'elle devra clarifier en s'investissant davantage socialement, dans l'intérêt des populations précarisées autant que dans le sien propre.
1. Une perception encore ambiguë du monde de l'entreprise
De façon générale, et plus encore pour des populations ayant un rapport difficile avec le marché du travail, l'entreprise ne bénéficie pas d'une grande considération . Selon un sondage réalisé en 2004 187 ( * ) , 38 % des Français en ont une mauvaise image. Leur jugement varie en réalité en fonction de la taille de l'entreprise. Ainsi, si les PME bénéficient très largement d'une bonne image (73 %), les entreprises de taille plus importante suscitent une majorité d'opinions négatives (50 %), taux encore accru à l'égard des entreprises multinationales (57 %).
Les explications de ce regard mitigé vis-à-vis des entreprises tiennent sans doute à des considérations culturelles et historiques, le libéralisme économique ne s'étant pas implanté aussi fortement dans notre pays que dans ceux d'influence anglo-saxonne. Mais elles renvoient aussi très certainement à la présence, toujours vive à l'esprit du grand public, des plans sociaux, faillites et scandales financiers largement relayés par les médias.
Soulignant le rôle qu'ont à jouer les responsables politiques en ce domaine, M. Jacques Attali a insisté sur l'obstacle que constitue aujourd'hui encore l'inertie de l'opinion commune à l'égard du monde de l'entreprise, et la nécessité de promouvoir davantage les exemples de réussite entrepreneuriale porteurs d'espoir pour les publics en marge de l'emploi.
« Le discours des élus est essentiel pour faire évoluer les mentalités, car ceux-ci sont porteurs d'un message collectif. Il évolue un peu, mais il serait bien qu'il consiste à mettre en avant des talents et des gens issus de milieux défavorisés et ayant réussi. Très souvent, malheureusement, les jeunes des cités ayant connu la réussite sont présentés de manière sulfureuse. Un jeune malien arrivé en France à l'âge de quatorze ans sans parler un mot de notre langue a créé la quatrième entreprise de vêtements sportifs du monde : Airness. (...). Je connais plusieurs exemples de réussites de ce type, qui sont très valorisants pour la société française ».
Il a également stigmatisé la présentation souvent non valorisante qui est faite de l'économie dans les établissements d'enseignement . « L'évolution des mentalités suppose aussi, comme nous l'avons indiqué dans notre rapport, de changer l'enseignement économique, catastrophique, dans lequel l'argent est malsain, l'entreprise un lieu de perdition et le patron un voleur, dispensé dans les lycées ».
2. La responsabilité sociale des entreprises, une idée neuve
a) Un phénomène récent encore en cours d'encadrement
Née à la suite des problèmes environnementaux rencontrés à une échelle globale depuis les années 1970, la responsabilité sociale des entreprises (RSE) est la déclinaison pour l'entreprise et sur une base volontaire des concepts de développement durable qui intègrent trois piliers environnementaux, sociaux, et économiques.
Depuis les années 1980, sous l'impulsion de la société civile, les concepts de finance éthique, de commerce équitable ou de développement durable ont ainsi fait irruption dans le débat politique . Ils ont donné lieu au développement d' outils permettant de déterminer le niveau de responsabilité des entreprises, à travers la mise au point de référentiels internationaux, de codes de conduite, de certifications, normes et labels, ainsi que d'audits sociaux ou environnementaux.
En France, l'exigence de RSE a débouché sur une disposition normative dépassant la simple logique volontariste. Ainsi, l'article 116 de la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (NRE) exige des entreprises cotées en bourse qu'elles indiquent dans leur rapport annuel une série d'informations relatives aux conséquences sociales et environnementales de leurs activités.
Créées à la fin des années 90, des agences de notation sociale et environnementale évaluent les entreprises selon leur propre méthodologie, en se basant sur des documents publics et des questionnaires. En pleine expansion, ce secteur comprend une trentaine de structures. En France, l'Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE) publie un guide de ces agences de notation avec leur méthodologie.
b) Une acculturation dans les milieux politique et économique
Cette notion de responsabilité sociale des entreprises semble faire son chemin. Dans les sphères politiques , tout d'abord. Ainsi, elle fera partie des priorités de l'agenda social de la France durant la présidence de l'Union européenne.
Ce concept progresse également chez les entrepreneurs . Ainsi, le réseau Alerte et les partenaires sociaux188 ( * ) ont adopté un texte commun, rendu public le 13 décembre 2007, sur l'accès des personnes en situation de précarité à un emploi permettant de vivre dignement, parmi les propositions duquel figure l'augmentation de la responsabilité sociale des entreprises.
A l'échelle internationale également, la responsabilisation des acteurs progresse. Elle y fait l'objet d'un encadrement institutionnel, comme l'a souligné M. Jean-François Trogrlic, directeur du bureau de l'OIT en France.
« L'OCDE tient compte aujourd'hui, pour mesurer la performance d'un pays, de la qualité des emplois qui y sont offerts. (...). Cette performance est évaluée par elle au travers d'autres indicateurs comme la responsabilité sociale des entreprises. Il s'agit de savoir notamment, pour les grands groupes, si les normes sociales en vigueur dans la maison mère sont appliquées également dans les filiales installées à l'étranger et chez les fournisseurs. En la matière, plus d'une centaine de multinationales ont passé des accords négociés, et non des déclarations de principe, avec les fédérations syndicales internationales de leurs secteurs au sujet de leurs responsabilités sociales. Ces accords représentent un nouveau vecteur de diffusion des bonnes pratiques sociales, lequel s'est mis en place sous la pression des salariés mais aussi des consommateurs et des ONG ».
c) Une notion recouvrant toutefois des réalités très diverses
La responsabilité sociale des entreprises est loin de se traduire par des pratiques uniformes . Selon M. Trogrlic, « la responsabilité sociale des entreprises peut cacher le meilleur et le pire ». Une étude réalisée par l'agence VIGEO, à la demande du bureau de Paris de l'OIT, sur la façon dont les multinationales européennes luttent contre la discrimination, montrait que si toutes disent agir dans ce domaine, seulement 50 % d'entre elles ont mis en place un dispositif en ce sens et 10 % un système de recours et de sanctions en cas de faits avérés.
« Aujourd'hui , a indiqué M. Trogrlic, de nombreuses entreprises, par obligation, mettent en avant leur responsabilité sociale. Toutefois, celle-ci, dans certain cas, se limite à un simple vernis que seule la certification sociale permet de révéler ». De manière générale, elles ont cependant intérêt à diffuser les bonnes pratiques sociales afin d'apporter une aide pérenne aux territoires où elles s'installent pour développer leurs activités.
Par ailleurs, la notion de responsabilité sociale des entreprises met en lumière, en négatif, celle de leur irresponsabilité , qui peut se traduire par des politiques marketing extrêmement agressives en direction des personnes en grande difficulté.
Les situations de surendettement auxquelles elles aboutissent constituent ensuite une charge collective dont la gestion revient à la puissance publique ou aux associations, et non aux entreprises qui en sont à l'origine, amenant Emmaüs France à demander « l'instauration d'un principe de responsabilisation, par exemple au travers d'un système de bonus malus consistant à favoriser les entreprises ne générant pas trop de dossiers de surendettement et à pénaliser les autres, celles faisant preuve d'irresponsabilité ».
3. Parrainage et tutorat, des outils efficaces restant à développer
a) Des instruments d'insertion dans le milieu de l'entreprise adaptés aux publics en difficulté
Outil d'échange et de pérennisation des compétences dans l'entreprise, mais également d'insertion de publics a priori éloignés de l'emploi, le tutorat poursuit un double objectif : pour le tuteur, une reconnaissance de ses capacités professionnelles ; pour le salarié bénéficiaire : la garantie d'un apprentissage par une personne compétente. Salarié -ou ex salarié- de l'entreprise, le tuteur encadre l'apprenant et lui transmet la pratique du métier ainsi que tout ce qui l'accompagne, depuis le comportement au travail jusqu'à l'environnement économique et les habitudes de la profession.
Présenté par le comité interministériel à l'intégration du 10 avril 2003 comme une mesure phare pour favoriser, par un accompagnement personnalisé, l'insertion professionnelle des jeunes et des adultes, le parrainage consiste à faciliter l'accès ou le maintien dans l'emploi de demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle en les faisant accompagner par des personnes bénévoles. A la différence des tuteurs, les parrains sont extérieurs à l'entreprise. Les personnes parrainées sont des demandeurs d'emploi qui connaissent des difficultés et des obstacles spécifiques à l'emploi : faible niveau de formation, milieu social défavorisé, risque de discrimination ...
b) Un dispositif bénéficiant aux accompagnés comme aux entreprises
L'expérience montre que tutorat et parrainage sont deux dispositifs profitant directement à leurs bénéficiaires . Selon des chiffres communiqués par la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle au mois d'avril 2008, près des trois quarts (73,1 %) des jeunes accompagnés dans le cadre d'une action de parrainage accèdent à un emploi ou entrent en formation. Mme Pierrette Catel, chargée de mission au Conseil national des missions locales, a souligné que le parrainage « engendre des bénéfices collatéraux importants » et « représente une avancée non négligeable dans la lutte contre l'exclusion et contre les discriminations ».
Mais le tutorat et le parrainage profitent également aux entreprises. Celles qui ont su développer en interne des dispositifs associant de façon étroite les tuteurs, parrains et apprenants dans une démarche active bénéficient d'un retour sur investissement significatif, que ce soit en matière d'intégration et de niveau de compétences des personnes accompagnées comme en ce qui concerne les nouvelles compétences acquises par l'entreprise et les salariés.
Du reste, les acteurs de l'insertion par l'économie ont une image positive du tutorat et du parrainage comme instrument de lutte contre la précarisation dans le travail. Selon Mme Catel, « le parrain qui aide le jeune à se familiariser avec le monde de l'entreprise, va, dans le même temps, changer son regard sur ce dernier. Les parrains, qui ne sont pas formés pour rencontrer les jeunes, sont, en effet, souvent étonnés du bas niveau de qualification et de connaissances générales de ces jeunes. Par conséquent, ce type de rencontre représente une avancée non négligeable dans la lutte contre l'exclusion et contre les discriminations ».
c) Des bonnes pratiques restant largement à diffuser
Si le tutorat et le parrainage bénéficient d'un regain de faveur depuis quelques années et peuvent jouer un rôle important dans la lutte contre la précarisation du travail, ils ne sont pas organisés en tant que tels et dépendent souvent de la bonne volonté des référents et de leurs compétences relationnelles.
En outre, s'il existe des formations, généralement sanctionnées par un certificat, les tuteurs et parrains sont souvent très engagés dans leur activité professionnelle quotidienne et n'ont souvent pas le temps de les suivre pour assurer complètement leur mission.
Enfin, les entreprises estiment souvent ne pas avoir les ressources et connaissances nécessaires à leur mise en oeuvre.
4. La lente montée en puissance de la fondation d'entreprise
a) Un investissement croissant dans le domaine de la solidarité
La législation française distingue trois types de fondations, parmi lesquelles la fondation d'entreprise 189 ( * ) . Cette dernière est créée par des entreprises en vue de mettre en oeuvre un programme d'action d'une durée minimale de cinq ans dans un but d'intérêt général.
La fondation d'entreprise est, en pratique, le cadre dans lequel l'entreprise exerce et valorise son action de mécénat. Son attractivité a été renforcée par la loi du 1 er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations -dite loi Aillagon-, qui a notamment amélioré le régime fiscal pour les dons des particuliers et des entreprises, ainsi que celui auquel se trouvent soumises les fondations.
Ce type de fondation constitue un cadre d'action privilégié pour l'entreprise dans le domaine de la solidarité : en 2006, 43 % se rattachent ainsi à cette thématique, qui est aussi la plus investie. On notera que 14 % ont pour objet l'aide à la création d'entreprise ou d'activités, qui constitue un autre moyen d'action en faveur de l'insertion sociale et professionnelle.
b) Des expériences restant à généraliser
Malgré ces avancées récentes, la fondation, qui pourrait jouer un rôle important en matière d'insertion des personnes exclues du marché du travail, n'a toujours pas suscité dans notre pays de véritable engouement . On n'y compterait ainsi qu'un millier de fondations, contre 10.000 en Allemagne et 16.000 aux Etats-Unis.
Plusieurs des personnes auditionnées par la mission ont regretté que cet instrument ne soit pas davantage développé dans le secteur de l'insertion, car il permettrait de financer des actions très concrètes au service des exclus de l'emploi.
Soulignant que le système fiscal américain, très incitateur de ce point de vue, avait conduit le président de Microsoft, Bill Gates, à investir l'essentiel de sa fortune personnelle dans sa fondation, M. Jacques Attali a estimé que l'on se dirigeait, « au niveau mondial, vers un capitalisme pur et dur, système dans lequel les fondations d'entreprises se développent très peu », ajoutant qu'il s'agissait d'un « risque majeur ».
Pourtant, la création de fondations répondrait parfaitement aux préoccupations sociales croissantes des entreprises , pour des raisons aussi bien éthiques qu'économiques. Ainsi que l'a exprimé M. Attali devant la mission « une entreprise a besoin de plus en plus, pour exister, que ses salariés soient fiers d'y travailler et, pour cela, d'avoir notamment une action sociale. Beaucoup de groupes deviennent mécènes pour cette raison. Ils veulent que leurs cadres soient fiers d'appartenir à leurs structures et ils les aident à nourrir cette fierté en ayant une dimension éthique et morale, tout simplement parce qu'ils tiennent à les garder et donc à survivre ».
M. Franck Riboud, président-directeur général du groupe Danone, a estimé que si notre pays comptait de nombreux entrepreneurs qui seraient prêts à initier des projets de développement social, les instruments -au premier rang desquels des fondations, encadrés par un régime juridique incitatif- manquaient. Il a recommandé, à cet égard, une défiscalisation plus poussée des sommes investies dans la mise en place de telles fondations dans les domaines sanitaires et sociaux , à l'exemple du modèle américain.
5. Un recours encore limité aux groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification
Association loi 1901, le groupement d'employeurs est créé par plusieurs employeurs pour répondre à un besoin de recrutement commun afin de répartir entre eux le temps de travail des collaborateurs : ceux-ci sont recrutés par le groupement d'employeurs pour des temps partiels ou saisonniers récurrents en vue de leur mise à disposition au sein des entreprises adhérentes. Il en existe deux types : le groupement d'employeurs (GE) et le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ).
Souvent multisectoriel, le GE vise au partage durable de collaborateurs et de compétences en réponse à des besoins saisonniers récurrents et des besoins à temps partiel.
Généralement mono sectoriel, le GEIQ a pour objet d'organiser des parcours d'insertion et de qualification professionnelle au profit des demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés (jeunes sans qualification, demandeurs d'emploi de longue durée, bénéficiaires du RMI...). Réunissant des partenaires d'origines diverses (opérateurs économiques, acteurs du monde de l'insertion, collectivités territoriales...) aux objectifs convergents, il répond également aux besoins de main-d'oeuvre des entreprises dans une profession ou une branche d'activité donnée.
Les avantages du GEIQ pour les salariés les plus précaires sont patents . Ils y bénéficient d'un contrat de travail unique dont la durée varie, en fonction des branches, entre douze et vingt quatre mois. Contrairement à l'intérim, le risque de variation de l'activité n'est pas assumé par le salarié -qui voit alors sa rémunération s'interrompre- mais par le collectif d'entreprises. A l'accompagnement social qui renforce cette stabilité s'ajoute l'accès à une formation longue et à des éléments de qualification validés. Surtout, le capital « social » ou relationnel créé par le GEIQ au fil du temps bénéficie directement au salarié. Ce dernier a ainsi non seulement accès au réseau des entreprises adhérentes et à leurs possibilités d'embauche, mais également aux entreprises non adhérentes (démarchées par le GEIQ) auprès desquelles il peut valoriser la qualification acquise et l'expérience professionnelle obtenue.
Le GEIQ est un outil potentiellement efficace en matière de lutte contre la précarité et l'exclusion. La mission a ainsi rencontré les responsables d'un GEIQ du Rhône obtenant d'excellents taux de certification -de l'ordre de 70 %- et de remise à l'emploi -de l'ordre de 80 %-.
Cependant, son développement reste encore bien en deçà de ce qu'il pourrait légitimement être . Moins qu'à une quelconque réticence de la part des entrepreneurs, cette situation est due sans doute davantage à une méconnaissance de cet instrument par les structures qu'il pourrait intéresser, à savoir les PME, les collectivités territoriales et les maisons de l'emploi.
II. DES INSTRUMENTS D'ACTION RESTANT À ADAPTER AUX ENJEUX
A. LA FORMATION PROFESSIONNELLE, MAILLON FAIBLE DU SYSTÈME D'INSERTION
En permettant l'acquisition et le transfert de savoirs et en facilitant l'adaptation des travailleurs à la demande d'emploi des entreprises, la formation en cours de vie active est susceptible de freiner le développement de la précarité de l'emploi, d'aider à la stabilisation des trajectoires professionnelles les plus marquées par l'incertitude et le chômage et d'ouvrir à de meilleures perspectives en matière d'emploi et d'insertion.
Pourtant, la façon dont elle est organisée et l'utilisation qui en est faite ne permettent pas d'en tirer tous les bénéfices escomptés pour les personnes en marge du marché du travail. Ce ne sont pas, paradoxalement, les travailleurs les plus exposés à l'instabilité de l'emploi qui accèdent le plus à des dispositifs de formation , alors que leur situation le requerrait. Ainsi, le rapport de MM. Pierre Cahuc et André Zylberberg 190 ( * ) n'hésite pas à parler de « système à la dérive », profitant avant tout aux salariés les mieux formés et les mieux payés au départ.
1. La difficulté d'accès des publics précaires à la formation
« Tous les rapports montrent qu'en France, la formation est très difficilement accessible pour les personnes situées en bas de l'échelle sociale, leur rendant d'autant plus difficile l'accès à l'emploi » a clairement indiqué à la mission M. Bruno Grouès, conseiller technique à l'Uniopss. Selon un paradoxe aujourd'hui bien établi, accèdent le plus facilement aux instruments de formation les publics déjà les plus formés , pour lesquels leur usage est d'ailleurs moins crucial que pour ceux en étant dépourvus.
Comme l'a regretté Mme Nicole Maestracci, présidente de la Fnars, « un ciblage très important a lieu en direction des chômeurs indemnisés et l'attention portée aux personnes non indemnisées, comme les personnes en fin de droits, les personnes âgées, les jeunes ou les personnes ayant des problèmes de santé, est très faible. Ces personnes sont confrontées à des difficultés d'accès aux programmes de formation ».
Si les chômeurs indemnisés bénéficient d'un meilleur accompagnement que les personnes non indemnisées, leur accès à la formation reste toutefois beaucoup plus difficile que celui des actifs .
Comme l'a fait observer M. Jean-Baptiste de Foucauld, président de Solidarités nouvelles contre le chômage, « l'accès à la formation des demandeurs d'emploi représente un problème conséquent. A travers notre association, je constate à quel point il est difficile, pour bon nombre de gens, de se réorienter professionnellement ou même d'améliorer une de leurs compétences. Pour cela, il faut trouver la bonne structure, les bons financeurs qui sont multiples. (...). Un chantier important est à mener sur le terrain de la formation. Cette dernière, en effet, n'est pas toujours orientée vers les zones où les besoins s'expriment le plus ».
Même avis de la part de M. Jean-Pierre Guenanten, délégué national du Mouvement national des chômeurs et précaires (MNCP), qui a indiqué à la mission que « l'accès à la formation des demandeurs d'emploi est compliqué. Il est en effet très difficile pour les chômeurs de trouver une formation, a fortiori lorsqu'ils sont bénéficiaires du RMI ».
2. Une diminution de l'effort des entreprises en faveur de la formation continue
Les dépenses des entreprises en matière de formation professionnelle obéissent, en France, à une logique du type « former ou payer » . La loi impose une obligation minimale de financement de la formation professionnelle fixée, depuis 2004, à 1,6 % de la masse salariale dans le cas des entreprises de dix salariés ou plus. Cette contribution est affectée par les entreprises à la formation de leurs propres salariés ou -c'est obligatoire pour les entreprises de moins de dix salariés- au profit d'un organisme paritaire mutualisateur (OPCA).
Or, comme le montrent les chiffres communiqués par la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère en charge de l'économie 191 ( * ) , depuis 1999, le taux de participation financière -rapport entre les dépenses consenties et la masse salariale- a diminué depuis 1999 dans les entreprises d'au moins dix salariés, alors qu'il était resté stable de 1993 à 1998.
3. Une inégalité entre travailleurs stables et travailleurs précaires
En théorie , les travailleurs précaires ont les mêmes opportunités d'accès à la formation que leurs homologues employés en CDI dans l'entreprise, que ce soit pour s'adapter à leur emploi ou pour acquérir une qualification. En effet, le droit des salariés à la formation continue prévoit que les salariés, quel que soit le statut de leur emploi, bénéficient formellement des mêmes dispositions. Ainsi, le plan de formation de l'entreprise, auquel sont notamment inscrites les formations d'adaptation à l'emploi, couvre les actions de formation de tous les salariés de l'entreprise sans distinction de statut. De la même manière, le droit à un congé individuel de formation (CIF) est ouvert à l'ensemble des salariés.
En pratique , les travailleurs précaires -sauf cas particuliers- rencontrent des difficultés d'accès à la formation continue bien supérieures à celles des salariés possédant un emploi stable. C'est ce qui ressort d'une étude de l'INSEE, qui s'appuie sur des données d'une enquête réalisée avec le Céreq 192 ( * ) .
« Toutes choses égales par ailleurs, les personnes situées sur ces trajectoires ont moins de chance que les autres (salariés « stables ») d'accéder à la formation. La durée de celle-ci, en moyenne plus longue, semble à première vue compenser ce handicap. Elle est également l'indice d'une formation plus qualifiante. Ce constat globalement positif recouvre en réalité de profondes inégalités au sein de la population marquée par la précarité. En matière d'accès à la formation, les itinéraires dominés par les stages et contrats aidés ainsi que les emplois temporaires de la Fonction publique sont les seules catégories à se situer à un niveau comparable à celui des personnes bénéficiant d'une situation stable. Les formations longues sont associées au chômage et principalement financées par l'Etat ; tandis que l'emploi flexible donne plutôt accès à des formations d'adaptation à l'emploi occupé, de courte durée. Ainsi, les salariés précaires ont à la fois moins de chances d'accéder à une formation financée par l'employeur que leurs homologues stables, et peu d'opportunités de suivre une formation qualifiante financée par l'Etat. (...). Les trajectoires de mobiles en CDD et celles dominées par le chômage sont particulièrement pénalisantes de ce point de vue ».
4. Un partage de compétences complexe entre différentes structures
En matière de formation professionnelle, l'insuffisante coordination entre les différentes structures concernées sur un même espace territorial semble être à l'origine d'une déperdition des moyens engagés 193 ( * ) .
Le principal problème proviendrait en fait de l' absence de coordination , voire du cloisonnement, entre la région , en charge de la formation professionnelle, et l'insertion professionnelle, gérée par les conseils généraux . De plus, la région serait amenée à se substituer aux autres structures, publiques comme privées, dont la carence en ce domaine serait établie. Un recalage global des dispositifs reste donc à réaliser.
5. Une validation des acquis de l'expérience très insuffisamment développée
Reconnue par le code du travail, la validation des acquis de l'expérience (VAE) permet de faire reconnaître son expérience, professionnelle ou non, afin d'obtenir un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle selon d'autres modalités que l'examen.
Mise en place par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, la VAE est un droit ouvert à tous : salariés (en contrat à durée indéterminée ou déterminée, intérimaires...), non-salariés, demandeurs d'emploi, bénévoles, agents publics. Et ce, quels que soient les diplômes précédemment obtenus ou le niveau de qualification. Une seule condition est exigée : justifier d'une expérience professionnelle de trois ans en continu ou en discontinu, en rapport avec le contenu de la certification (diplôme, titre...) envisagée.
La VAE est un moyen efficace de lutte contre l'exclusion . En effet, elle révèle les compétences « cachées » et influe ainsi sur l'estime de soi de ses bénéficiaires. Par ailleurs, elle corrige en partie les méthodes de recrutement consacrant la survalorisation des diplômes par rapport aux compétences opérationnelles. En outre, elle permet à des personnes n'ayant pas suivi un parcours académique d'obtenir un emploi correspondant à leurs compétences.
Si la VAE constitue un outil intéressant au service de l'insertion des personnes éprouvant des difficultés dans leur parcours professionnel et souffrant d'un insuffisant niveau de formation, ses critères actuels ne favorisent pas son utilisation par les personnes les plus marginalisées . Comme l'a fait observer Mme Marie-Laure Meyer, la VAE, notamment dans les domaines du sanitaire et du social, « est assez apocalyptique. Il est assez extraordinaire de constater combien le nombre de personnes assurant des fonctions dans ces secteurs est élevé, et faible quand il est demandé de procéder à des validations. Je ne comprends pas très bien pourquoi une personne ne peut pas devenir automatiquement, sans avoir à reprendre d'études coûteuses, infirmière quand elle a assumé, seule et pendant cinq ans, la sécurité des patients dans un service. Cette situation pose problème, d'autant plus que nous manquons d'infirmières. La VAE constitue un outil dont nous n'avons pas beaucoup parlé. Or il revêt une grande importance, notamment parce qu'il donne envie de se former ».
Il y aurait quelque chose d'incohérent, voire de paradoxal, à ne pas développer davantage la VAE pour les emplois les moins qualifiés du secteur privé quand elle est aujourd'hui valorisée pour l'accès aux plus hautes fonctions de la fonction publique. En effet, le troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration (ENA) ouvre son recrutement aux personnes de moins de 40 ans justifiant d'une expérience professionnelle de huit années au moins en entreprise, dans le secteur associatif, comme membre d'une profession libérale ou encore en tant qu'élu.
6. Des instruments de formation peu efficaces en vue d'un retour à l'emploi
L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) constitue le premier organisme de formation professionnelle qualifiante pour adultes demandeurs d'emploi et salariés en France. Or, le taux de placement dans l'emploi durable (CDI ou CDD de plus de 6 mois) des stagiaires AFPA six mois après leur sortie de la formation, qui constitue un indicateur renseigné par le ministère en charge du travail dans le cadre des documents budgétaires accompagnant le projet de loi de finances, oscille depuis plusieurs années entre 50 et 55 % .
S'il est à peu près en ligne avec les objectifs fixés, ce taux est faible , en réalité. Selon M. Jean-Baptiste de Foucauld, « les formations AFPA devraient conduire à un taux de placement de 80 %. Solidarités nouvelles contre le chômage n'a pas les moyens d'une puissance publique. Mais 60 % à 65 % des personnes qui passent par notre structure trouvent un emploi. Je peux comprendre que le taux de placement des personnes fréquentant les ateliers chantiers d'insertion soit de 30 %, car il concerne les publics les plus difficiles. Mais les personnes prises en charge par l'AFPA ne présentent pas ce profil ».
B. LA CRÉATION D'ENTREPRISE, VOIE PRIVILÉGIÉE D'INSERTION
Comme cela était proclamé par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, la création d'entreprise constitue une voie privilégiée d'insertion.
Dans cet esprit, ainsi que l'a très justement souligné M. Jacques Attali devant la mission, « malgré la politique générale de l'emploi qui consiste à aider les gens à sortir du chômage, il ne sera pas possible de créer les conditions permettant à tout le monde de devenir salarié. C'est pourquoi il est fondamental d'encourager la création d'emplois indépendants et donc d'entreprises ».
1. Un potentiel très important du fait de la place du secteur informel
Le secteur informel , qui représente environ 12 % du PNB français , occupe une place très importante en Europe, notamment en France, et est actuellement en plein essor.
L'existence dans notre pays d'un « vivier » de créateurs d'entreprise potentiels ne fait pas de doute, et ce y compris parmi les populations a priori les plus éloignées du marché du travail .
« La plupart des gens au chômage, qui se trouvent marginalisés et dans un grand état de détresse morale, peuvent créer leur entreprise et retrouver leur dignité », a souligné à cet égard M. Jacques Attali. « Evidemment, la création d'entreprise par des jeunes des cités ne saurait à elle seule résoudre tout le problème de l'exclusion. Mais elle peut aider un certain nombre de personnes en situation de désespérance à s'en sortir et à exprimer toute l'énergie, la force et la créativité qu'elles ont en elles ».
Les expériences réussies de micro crédit témoignent de la motivation des porteurs de projets. Selon la présidente de l'Association pour le droit à l'initiative économique (Adie), Mme Maria Nowak, les personnes soutenues « s'engagent pleinement dans leur projet. Elles veulent vraiment s'insérer socialement et notre fonction est de leur apporter l'appui financier et technique dont elles ont besoin ».
Les populations les plus jeunes et les plus éloignées de l'emploi sont souvent les plus motivées par la création d'entreprise. Comme l'a souligné Mme Nowak, « les jeunes souhaitent largement s'engager dans cette voie. Un tiers des nouveaux emplois créés est le fait de fondateurs d'entreprises, dont 40% sont des chômeurs. Ce pourcentage n'est donc pas marginal. En même temps, seulement 4% des chômeurs créent des entreprises. Ce taux pourrait passer à 10 % ou 15 % sans aucune difficulté ».
L' utilité économique et sociale de l'entrepreneuriat est donc incontestable. « La création d'entreprise représente (...) l'un des ascenseurs sociaux qui fonctionnent dans ce pays, autant pour un immigré que pour un diplômé de Polytechnique. Le micro crédit constitue un outil extrêmement démocratique, servant aussi bien à des vendeurs ambulants qu'à de petites entreprises », a souligné Mme Nowak à cet égard.
2. Une efficience économique et sociale avérée
M. Jacques Attali, fondateur d'une entreprise -PlaNet finance- au coeur de l'aide à la création solidaire d'entreprise, a illustré devant la mission les externalités positives que présentent l'accès ou le retour à l'emploi via la création d'entreprise . « Aider une personne à sortir de l'exclusion, ce n'est pas l'aider à mes dépens. Soutenir quelqu'un, par exemple en lui permettant de ne plus être au chômage, peut m'être utile. Pour l'instant, notre action a conduit à la création de 100 entreprises, dans quatre quartiers, en un an. Or le coût de la création d'une entreprise sur un an est trois fois moins élevé que celui d'un chômeur sur la même période (3.000 euros contre 10.000 euros). Ces chiffres parlent d'eux-mêmes et incitent à réorienter l'utilisation de l'argent public ».
Le système du micro crédit , très incitateur à la création d'entreprise, a fait la preuve de son efficacité économique . L'Adie, qui octroie ces micros prêts, relève ainsi un taux d'impayés de 6,4 % et un taux de perte de 2,55 %. Selon sa présidente, Mme Maria Nowak, « le taux de pérennité des entreprises créées est du même ordre que celui des entreprises individuelles. Le coût moyen de l'aide à la création est de 1.600 euros sur deux ans, une somme extrêmement faible par rapport au coût du chômage et des emplois aidés ».
Non seulement le coût net du soutien à la création d'entreprise est inférieur à celui occasionné par le subventionnement des chômeurs et des emplois aidés, mais le différentiel s'avère plus important encore si l'on raisonne en coûts évités . Estimant à environ 300.000 le nombre de jeunes aptes à monter une entreprise, mais qui ne peuvent le faire par la faute d'obstacles qui se dressent sur leur chemin, M. Attali a souligné combien « ces 300.000 jeunes sont en situation d'exclusion et le seront de plus en plus car ils ne possèdent pas de diplômes et d'entregent. Leur exclusion se traduit par de la passivité, de la criminalité pour une petite partie d'entre eux et, pour une autre partie d'entre eux, infime, par de la violence exercée sous toutes ses formes ».
Dans les cités les plus difficiles, la création d'entreprise, outre l'activité économique qu'elle génère, se traduit souvent par un développement des liens interindividuels et une pacification des rapports sociaux. De plus, elle offre des modèles de réussite à des jeunes trop souvent résignés et cantonnés dans une attitude passive ou nihiliste. M. Attali a ainsi fait remarquer que les responsables des antennes locales de son association « sont issus des quartiers, ont monté des entreprises qui connaissent le succès et peuvent donc servir de modèles. Il leur est demandé d'apporter de la confiance aux jeunes qu'ils accueillent, de les encadrer et de les aider à formuler leurs projets ».
3. Des dispositifs incitatifs existants
L' aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) est l'une des mesures du dispositif d'appui à l'initiative économique gérée par le ministère en charge de l'emploi au bénéfice de demandeurs d'emploi, salariés licenciés, jeunes, personnes en difficulté... afin de les inciter à créer ou reprendre une entreprise, ou à exercer une activité professionnelle non salariée.
L'ACCRE se traduit par une exonération de cotisations sociales pendant une période d'un an renouvelable permettant le maintien, pour une durée déterminée, de certains minima sociaux. Le cumul d'allocations ASSEDIC et de revenus d'activité après la création d'entreprise est possible, sous certaines conditions, pendant 18 mois maximum et dans la limite de ses droits.
L'ACCRE peut s'appuyer sur la mobilisation de deux autres mesures complémentaires :
- une aide financière dans le cadre du dispositif d'encouragement au développement d'entreprises nouvelles . Ce programme EDEN, destiné aux demandeurs d'emploi, est recentré sur les créateurs les plus en difficulté par le second programme de lutte contre les exclusions. Outre le soutien financier, il offre un suivi et un accompagnement renforcés, le cumul avec les minima sociaux restant possible ;
- une aide au conseil sous forme de chèques conseil permettant au créateur l'accès à une offre d'expertise dont une part du financement est prise en charge par l'Etat. Ces chéquiers permettent de financer des consultations de professionnels répondant aux besoins des créateurs pour monter leur projet.
Par ailleurs, les bénéficiaires du RMI se voient proposer un appui technique à la création d'entreprise . Assuré par des associations d'aide à la création d'entreprise agréées sur le département, il donne lieu à un soutien vers la création d'entreprise en quatre phases :
- un accueil qui permet de faire le diagnostic du projet, d'étudier sa faisabilité en fonction des compétences professionnelles et personnelles du candidat. En cas d'échec, les personnes seront réorientées vers les dispositifs d'accompagnement social ou d'accès à l'emploi ;
- un appel d'offres , à travers la mise en place d'un réseau de chefs d'entreprise bénévoles avec lesquels le candidat aura au moins quatre rencontres en quatre mois ;
- des formations en sessions courtes , permettant d'acquérir les bases pour permettre au créateur de gérer son entreprise ;
- un contrôle régulier des différentes étapes du parcours par l'organisme agréé, dont les audits doivent permettre de déterminer les potentialités de sortie du RMI et la pérennité de la structure créée.
4. Une montée en puissance progressive du micro crédit et des fonds d'investissement
a) Le micro crédit
L'activité de micro crédit consiste en l' attribution de prêts de faible montant à des porteurs de projet qui ne peuvent accéder aux prêts bancaires classiques . Encourageant les microprojets au niveau local, il permet d'induire des mutations « à la base », dont l'effet de maillage et de diffusion s'avère plus efficace que certains projets de plus grande ampleur.
S'inscrivant dans la sphère plus globale de la micro finance, qui comprend d'autres outils tels que l'épargne ou la micro assurance, le micro crédit fait aujourd'hui l'objet d'une reconnaissance internationale . Ainsi, les Nations Unies ont décrété 2005 l'année internationale du micro crédit. Et en 2006, le prix Nobel de la paix a été attribué conjointement au Bangladeshi Muhammad Yunus et à la banque qu'il a créée, la Grameen Bank.
Le micro crédit s'est diffusé surtout dans les pays en développement , où il permet d'initier des projets de développement à petite échelle. M. Jean-François Trogrlic, directeur du bureau de l'OIT en France, a évoqué les nombreuses expériences concluantes menées en Asie, qualifiant le soutien au micro crédit comme « première piste » à développer en matière de lutte contre la pauvreté.
En effet, le micro crédit tend à se diffuser dans les pays en transition, ainsi que dans les pays développés , où il est de plus en plus appréhendé comme une arme nouvelle, souple et efficace au service de la lutte contre l'exclusion. Si, comme l'a fait remarquer M. Jacques Attali, « le mécanisme du micro crédit se présente de manières différentes dans les pays du Sud, où 80 % des gens n'ont pas accès au crédit, et en France, où presque tout le monde a un compte dans une banque et a la possibilité de lancer une entreprise », il y voit toutefois son importance croître significativement. Il constitue en effet un outil d'accompagnement particulièrement adapté aux grandes tendances que sont l'essor des services et des nouvelles technologies, et l'aspiration à un développement du travail indépendant.
En France , le développement du micro crédit a été favorisé par l'action de l' Adie , qui l'a « acclimaté » au contexte d'une économie industrielle . Selon les chiffres transmis par la présidente de l'association, Mme Maria Nowak, 53.000 micro crédits ont été accordés depuis sa création, ayant permis de financer et d'accompagner 45.000 entreprises, soit environ 1.000 par mois. Il s'agit, pour beaucoup, d'entreprises nécessitant peu d'investissements, dans les secteurs du commerce, des services à la personne ou aux entreprises, ou encore de l'artisanat. L'Adie prend en charge 70 % du risque crédit associé aux prêts, les banques couvrant le solde. Les collectivités, notamment les communes, financent quant à elles l'accompagnement aux projets.
Le micro crédit profite autant à ses bénéficiaires , à qui il offre la possibilité de s'insérer économiquement et socialement, qu'aux banques qui le financent . Outre l'amélioration de leur image que leur procure le statut d'établissement à dimension sociale, elles bénéficient potentiellement, dans les personnes financées, de nouveaux clients dont elles contribuent à la solvabilité.
M. Daniel Zielinski a témoigné pour l'Unccas que les prêts octroyés par l'intermédiaire de ces structures « ont été démultipliés, notamment à travers le micro crédit social », sur la base d'une convention d'expérimentation passée avec la Caisse des dépôts et consignations, et avec la perspective d'un partenariat avec la Banque postale qui permettrait d'élargir encore les publics cible, certains « franchiss(ant) plus facilement la porte d'un bureau de poste que d'une banque ».
b) La prise de participation dans des entreprises nouvellement créées
Parallèlement à la montée du micro crédit, apparaît une forme de soutien financier à l'initiative privée encore embryonnaire : la prise de participation dans les entreprises créées. L'aide consiste dans ce cas, pour un porteur de capital, non à subventionner directement le projet, mais à en devenir actionnaire .
Cette prise de participation joue un rôle très important , les banques demandant toujours aux créateurs d'entreprises, surtout aux jeunes des cités, de contribuer financièrement à leurs projets.
Le témoignage de M. Attali est éclairant à cet égard. « Il y a quelques mois, nous avons créé un deuxième levier d'action qui se révèle très utile. Il s'agit d'un petit fonds d'investissement, baptisé Financité, alimenté par des fonds provenant de la Caisse des dépôts et consignations, de grandes entreprises et de banques, et avec lequel nous prenons des participations dans les sociétés fondées par les jeunes des quartiers qui viennent nous voir. Nous les aidons, non pas en leur donnant de l'argent, mais en devenant actionnaires de leurs projets. (...). Cette prise de participation (...) se traduit par des apports en capitaux dont les montants varient entre 10.000 et 80.000 euros pour l'instant. Elle est très efficace et a permis notamment à un jeune au chômage d'Aubervilliers, au travers d'un apport en capital de 60.000 euros, de monter son entreprise de BTP spécialisée dans le ravalement de façade. Aujourd'hui cette personne emploie six salariés et a un plan de charges plein jusqu'à la fin 2009. Les banques refusant toujours de lui prêter de l'argent, nous avons réinvesti récemment 50.000 euros dans sa structure pour lui permettre d'honorer ses commandes en embauchant neuf personnes supplémentaires, toutes issues de son quartier ».
M. Riboud a, quant à lui, évoqué la création, à la quasi unanimité de son groupe, d'un fonds d'investissement géré par une banque privée et réservant 10 % de ses investissements dans des projets à risque.
5. Des obstacles restant à lever pour solliciter pleinement les potentiels existants
? Tout d'abord, des limites continuent de brider le développement du micro crédit dans un pays comme le nôtre. Le témoignage de M. Attali a montré quelles étaient les carences en matière d'accompagnement par les structures publiques et parapubliques . « Pour l'instant, les financements publics n'existent pas dans le secteur du micro crédit. Nous avons beaucoup de difficultés à trouver des ressources ailleurs qu'auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Les collectivités locales n'ont pas encore compris, à mon sens, combien il est nécessaire d'encourager la création d'entreprise pour permettre la sortie de l'exclusion et de mettre l'accent sur une politique de formation permanente, laquelle est assurée pour l'instant par des associations comme la nôtre, les boutiques de gestion, France initiative réseau ou Entreprendre. La puissance publique ne participe pas encore à nos actions. Elle regarde ce que nous faisons de loin et nous considère comme des sortes de francs-tireurs ».
Pour Mme Béatrice Longueville, déléguée générale adjointe de l'Unccas, la montée en puissance du micro crédit a été plus lente que prévue du fait des rapprochements qu'il implique entre les publics bénéficiaires et le monde bancaire . « Or, permettre à un travailleur social de faire son choix entre plusieurs acteurs bancaires en lui permettant d'avoir accès au droit commun bancaire interroge de nouvelles pratiques d'insertion, d'un point de vue social ou professionnel ».
Par ailleurs, du point de vue des centres communaux d'action sociale, il est souvent plus rapide et plus efficace d'accorder une aide d'urgence correspondant à un besoin immédiat. Le micro crédit a cependant pour avantage d'être associé à un « accompagnement et (...) un suivi des accidents de parcours » et de permettre « d'interroger le projet de la personne, mais aussi de questionner les pratiques des professionnels ».
? S'agissant du nouveau levier d'action au soutien des initiatives privées que constitue la prise de participation dans des petites entreprises, M. Attali a décrit l'action de son association Financité en la matière 194 ( * ) et le « potentiel considérable » qu'il recèle.
Il a néanmoins regretté qu'il ne se développe pas davantage. « Personne d'autre que nous n'effectue ce travail en France où les fonds d'investissement s'intéressent seulement aux grandes entreprises et parfois aux PME », a-t-il indiqué.
? Le travail indépendant , par ailleurs, pourrait être largement développé si le cadre légal de cette forme d'activité était mieux adapté aux caractéristiques des publics défavorisés et s'il bénéficiait de la même reconnaissance que le travail salarié.
Il serait tout d'abord incitatif de réduire les charges sociales pesant sur les personnes ayant une activité indépendante dont elles ne tirent qu'un faible revenu. Comme l'a souligné Mme Maria Nowak, président de l'Adie, « moins les personnes gagnent d'argent et plus elles doivent payer de charges. Cette situation conduit celles-ci à ne pas déclarer leur travail, ce qui ne leur est pas profitable, puisqu'elles ne peuvent pas développer leur entreprise, et ne l'est pas non plus pour les caisses de cotisations sociales ».
Par ailleurs, le régime assez strict de la qualification professionnelle artisanale peut empêcher l'exercice de certains métiers par des personnes indépendantes. Ainsi que l'a illustré Mme Nowak, « un réparateur de vélos exerçant pour son compte personnel doit être titulaire d'un diplôme de carrossier, lequel n'est pas nécessaire si le réparateur est salarié. De même, un tondeur de gazon indépendant doit posséder un diplôme de paysagiste et un individu ne peut être commerçant s'il a été condamné à une peine de prison dans le passé ».
En outre, l' absence de locaux dans les quartiers urbains -nombreux en zones rurales en revanche- constitue un important obstacle à la création d'entreprise. Une première mesure, visant à faciliter la location d'espaces professionnels, a été intégrée dans la loi du 5 mars 2007 instaurant un droit au logement opposable. Cette disposition n'a pas été élargie à une mixité d'usage pour les locaux des HLM. De nombreux garages, dont les habitants des quartiers ne se servent plus du fait de la hausse des charges due au coût de l'énergie, gagneraient à être transformés en locaux professionnels.
C. L'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, UN DISPOSITIF LARGEMENT PERFECTIBLE
La spécificité du secteur de l'insertion par l'activité économique est d'associer un accompagnement social à l'exercice d'une activité économique pour permettre aux personnes en grande difficulté d'exercer un travail avec un encadrement et selon des rythmes adaptés à leurs difficultés.
S'il mobilise de très nombreux acteurs et touche un vaste public, son efficience reste encore perfectible.
|
L'insertion par l'activité économique Expérimentée dès la fin des années 70 et reconnue par la loi 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, l'insertion par l'activité économique s'adresse à des personnes sans emploi durablement exclues du marché du travail qui rencontrent des difficultés sociales et/ou professionnelles, à qui elle propose de s'inscrire dans un parcours permettant d'enclencher une dynamique de réinsertion. Ces personnes sont orientées vers des structures dont l'activité est précisément l'insertion sociale et professionnelle : entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI), entreprises d'insertion (EI), associations intermédiaires (AI), ateliers et chantiers d'insertion (ACI), régies de quartier et groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ). Elles signent une convention avec l'Etat déterminant les conditions d'exercice de l'activité et le type d'aide qui leur est fourni (subventions, aides directes aux postes de travail ou allègements de charges). L'orientation vers ces structures conventionnées repose sur un diagnostic de la situation socioprofessionnelle de chaque personne, opéré sous la responsabilité de l'ANPE, en association avec les intervenants sociaux. Sur la base de ce diagnostic est délivré par l'ANPE un agrément préalable à l'embauche. Valable pendant une durée de 24 mois, il va ainsi permettre à la personne en difficulté d'insertion d'être en mesure d'intégrer une structure d'insertion par l'activité économique. Le parcours d'insertion qui s'ouvre alors à la personne agréée s'effectue dans le cadre du salariat . Il existe différents contrats selon les catégories de structures de l'IAE, qui ont comme caractéristique commune d'être limités dans le temps et renouvelables. Un accompagnement social et professionnel est réalisé durant l'ensemble du parcours. Ce suivi permet la construction d'un projet professionnel par l'acquisition de compétences, la réalisation de bilans professionnels, des actions de formation et une aide à la recherche d'emploi. |
Les principales caractéristiques des structures de l'IAE
|
Associations intermédiaires |
Entreprises d'insertion |
Entreprises de travail temporaire d'insertion |
Ateliers et chantiers d'insertion |
|
|
Statut |
Les AI sont des associations de la loi 1901 conventionnées par l'Etat. |
Les EI sont des entreprises du secteur marchand ; elles peuvent adopter toute forme juridique : SA, SARL, association, EURL, coopérative... |
Les ETTI sont des entreprises de travail temporaire. |
Les ACI sont des structures créées et portées par l'un des organismes suivants : - organisme de droit privé à but non lucratif, - commune, - département, - établissement public de coopération intercommunal (EPCI), - syndicat mixte, - centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS ou CIAS), - établissement professionnel de l'Etat, - établissement d'enseignement agricole de l'Etat, - chambre départementale d'agriculture ou par l'office national des forêts. |
|
Modalité d'intervention |
Les Al mettent les personnes en difficulté à disposition de particuliers, d'associations, de collectivités locales et d'entreprises pour la réalisation de travaux occasionnels. |
Les EI produisent des biens ou des services destinés à être commercialisés sur un marché. |
Les ETTI mettent à disposition d'entreprises clientes, dans le cadre de missions d'intérim, des personnes en difficulté selon la réglementation rattachée aux entreprises de travail temporaire. |
Les ACI ont pour mission l'accueil, l'embauche et la mise au travail par des actions collectives de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. |
|
Statut des personnes
|
L'agrément préalable à l'embauche (délivré par l'ANPE) est obligatoire pour les mises à disposition d'une durée supérieure à 16 heures auprès des entreprises. |
Les personnes embauchées doivent avoir reçu au préalable l'agrément de l'ANPE. |
Les personnes embauchées doivent avoir reçu au préalable l'agrément de l'ANPE. |
|
|
Lien de la personne en insertion avec la structure |
La personne en insertion bénéficie d'un contrat de travail avec l'AI. |
La personne en insertion est embauchée en CDD par l'entreprise d'insertion. |
La personne en insertion dispose d'un contrat de travail temporaire. Elle est salariée de l'entreprise d'intérim. |
Les personnes embauchées en ACI sont en contrat aidé (CAE, CAV, CIE ou CIRMA) ou ont le statut de stagiaire de la formation professionnelle. |
|
Missions des structures |
Les AI embauchent des personnes en difficulté mais
exercent aussi une mission de suivi et d'accompagnement des personnes fragiles
qu'elles ne peuvent embaucher
immédiatement :
|
Les EI proposent à des personnes en difficulté une activité productive assortie de différentes prestations définies selon les besoins de l'intéressé (réentraînement aux rythmes de travail, formation, accompagnement social...). |
L'activité des ETTI est centrée sur l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Elles proposent un suivi social et professionnel pendant et en dehors des missions. |
L'ACI organise le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions de leur insertion professionnelle durable. |
|
Contrat de travail, mise à la disposition |
La durée totale des périodes de mise à
disposition ne peut excéder 240 heures au cours des douze mois suivant
la date de la première mise à disposition lorsque celle-ci
s'effectue auprès d'une entreprise.
|
CDD limité à 24 mois, renouvellement compris. Rémunération au moins égale au SMIC. |
Contrat de travail temporaire limité à 24 mois, renouvellement compris. Rémunération au moins égale au SMIC horaire. |
CAE, CA, CIE, CIRMA d'une durée minimum de 20 heures par semaine. |
|
Nature de l'aide de l'Etat |
Exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, de TVA, d'impôts sur les sociétés, de taxe professionnelle et de taxe d'apprentissage pour les personnes en difficulté mises à disposition. L'aide à l'accompagnement est versée aux AI qui favorisent la recherche de qualité de parcours offert à la personne en insertion. Elle n'est pas attribuée systématiquement et son montant est modulable en fonction du projet d'accompagnement proposé par l'AI. Au premier janvier 2005, le montant maximum était de 30.000 euros pour l'année. |
Allégement des cotisations patronales de sécurité sociale (Allégement Fillon) depuis le 1er juillet 2005 pour tous les salariés en insertion agréés par l'ANPE. L'aide au poste d'insertion permet la prise en charge de la rémunération et de l'accompagnement des salariés agréés embauchés par l'EI. Cette mesure peut être cofinancée par le Fonds social européen (FSE) à hauteur de 50 %. Son montant est depuis le 1 er janvier 2005 de 9.681 euros par poste de travail occupé à temps plein par des salariés en insertion. |
Allégement des cotisations patronales de sécurité sociale (Allégement Fillon) pour tous les salariés en mission de travail temporaire agréés par l'ANPE. L'aide au poste d'accompagnement permet la prise en charge de la rémunération des salariés permanents de l'entreprise qui assurent l'accueil, le suivi, la professionnalisation et l'accompagnement social et professionnel des salariés en insertion agréés par l'ANPE. Le montant annuel est de 51 000 euros pour l'accompagnement de douze salariés (équivalent-temps plein) en insertion agréés par l'ANPE. |
Les ACI bénéficient d'une prise en charge par l'Etat d'une partie significative de la rémunération du salarié en contrat aidé, ainsi que d'exonérations de certaines cotisations à la charge des employeurs pour ces mêmes contrats. L'aide à l'accompagnement n'est pas attribuée systématiquement et son montant varie en fonction de la qualité du projet d'accompagnement présenté par la structure. Le montant annuel de l'aide est fixé par le préfet du département et son montant s'élève à 1.500 euros par atelier et chantiers d'insertion dans la limite de 45.000 euros au total par organisme conventionné. Les Dispositifs locaux d'accompagnement (DLA) ont vocation à aider les ACI dans leur développement ou leur consolidation. |
Source : DARES - Août 2007
1. Un secteur central dans le domaine de l'insertion
Les chiffres communiqués par la DARES fin 2005 195 ( * ) montrent bien l'importance de l'IAE en termes de structures . A cette date, il y avait, en France métropolitaine, 840 associations intermédiaires, 820 entreprises d'insertion, 210 entreprises de travail temporaire d'insertion, auxquelles s'ajoutaient 3.300 ateliers et chantiers d'insertion portés par divers organismes, associations ou collectivités locales notamment.
Cette importance se retrouve au niveau des publics touchés par l'IAE. Ainsi, en 2005, 160.000 salariés ont été mis à disposition par les AI, pour 30 millions d'heures travaillées. 30.000 salariés ont été mis à disposition des ETTI, pour 7,4 millions d'heures travaillées. 14.500 salariés ont été embauchés par une EI. Enfin, 27.000 personnes ont été embauchées en ACI.
D'un point de vue économique , l'IAE est présentée comme « productive » par ses acteurs. Si l'on prend en compte à la fois les recettes fiscales et sociales produites et les coûts évités (indemnisations, allocations, soins...), elle est, selon les termes mêmes du rapport du Conseil national de l'insertion par l'activité économique (CNIAE) 196 ( * ) , un « investissement socialement responsable et (en intégrant l'ensemble des facteurs) assurant à la collectivité un retour sur investissement ». Selon M. Claude Alphandéry, président du CNIAE, des indicateurs « encore approximatifs » montrent que « le rapport net - soit la différence entre le bénéfice et le coût de l'insertion par l'activité économique - est de 40 millions d'euros, sans parler des coûts évités ultérieurs ».
En effet, les structures de l'IAE ont acquis un savoir-faire éprouvé dans l'accompagnement de personnes éloignées de l'emploi et, parfois, dans leur qualification et leur formation. Elles développent une valeur ajoutée strictement économique, contribuant à la croissance nationale et exercent un rôle significatif dans l'économie locale. Pour répondre à leurs missions d'intérêt général, tout en étant viables économiquement, elles mobilisent des ressources diverses qui complètent celles issues du marché et de l'aide publique. Enfin et surtout, elles favorisent le retour vers l'emploi des personnes les plus désocialisées ou les moins qualifiées par un accompagnement adapté à leur profil.
2. Un rapport coût-résultat insatisfaisant
Dans son rapport de 2007, le CNIAE, tout en reconnaissant la nécessité et l'utilité d'un système d'IAE, se montre très critique sur ses modalités de mise en oeuvre. Plusieurs éléments sont développés à cet égard :
- une aide insuffisante, complexe et instable des pouvoirs publics . Concentrée sur les EI, l'aide de l'Etat est en revanche manifestement insuffisante pour les ACI, les AI, les ETTI et les GEIQ. Le financement des collectivités territoriales est inégal suivant les territoires et le type de collectivités, alors que les fonds communautaires vont être amenés à diminuer considérablement. Les caractères mouvant et non durable des sept types de contrats aidés nuisent à leur bonne utilisation par les acteurs et sont préjudiciables au développement du secteur. Enfin, les principes de répartition du financement public de la fonction d'accompagnement des structures sont « très variés, sans réelle cohérence entre eux » ;
- une gouvernance totalement inadéquate 197 ( * ) ;
- des résultats à l'efficacité variable selon les structures. Plus de la moitié des sortants d'ETTI ont retrouvé un emploi salarié, aidé ou non aidé. En revanche, ils ne sont que 23 % pour les sortants d'une EI, qui se retrouvent fréquemment au chômage (31 %) et connaissent de fait les plus grandes difficultés d'insertion.
3. Des carences statistiques et une absence d'indicateurs
En réalité, l'efficacité de l'action des structures d'IAE est difficile à apprécier en raison de l'insuffisance des données statistiques à partir desquelles devraient être fixées des stratégies, mais également du fait d'une carence des indicateurs de résultats.
Le secrétaire général du CNIAE, M. Jacques Dughera, a été très clair sur le manque de données statistiques . « La notion de parcours renvoie à la difficulté d'avoir des données. Aujourd'hui personne n'est capable de dire quelles sont les caractéristiques d'un salarié lorsqu'il rentre dans un parcours d'insertion par l'activité économique, ce qu'il faisait par le passé et ce qu'il fera dans le futur. Le taux de retour à l'emploi est calculé à J+1, soit à la fin du contrat de travail. Il existe un déficit de nos politiques publiques à ce niveau. Nous ne disposons pas, en effet, d'enquêtes de panels, longitudinales, nous permettant de cibler nos actions. En fait, deux études de ce type ont eu lieu, une en 1993, une autre en 2003. J'espère que nous n'attendrons pas 2013 pour avoir la suivante ».
S'agissant de l'absence d' indicateurs adaptés , M. Claude Alphandéry, président du CNIAE, a indiqué que son organisme était en train d'élaborer des instruments de mesure aptes à « fournir une bonne idée de ce que représente l'activité économique mais aussi l'activité sociale des différentes structures d'insertion » et « qui ne se limiteraient pas au taux de retour à l'emploi, cet indicateur ne rendant pas compte des missions diverses qu'assure (l'IAE) ». En effet, il serait utile, par exemple, de s'intéresser au rôle des salariés des structures de l'IAE.
4. Des difficultés à l'entrée dans le dispositif
Pose d'abord problème l' agrément des personnes par l'ANPE permettant d'avoir accès aux financements de l'Etat.
Selon le CNIAE, et comme le reconnaît elle-même l'ANPE 198 ( * ) , la mise en oeuvre de cet agrément ne répond pas aux objectifs que le législateur et les acteurs de l'IAE lui avaient donnés :
- sortir d'une approche administrative des personnes éligibles au profit d'un examen circonstancié de leur situation. Or la pratique de l'agrément oscillerait entre l'absence de contrôle et la décision en opportunité, sans tenir compte des circonstances. De plus, la fonction de contrôle dont a été investie l'ANPE a pu être mal perçue par certains autres acteurs. M. Alphandéry a reconnu que la procédure d'identification des publics, qui concerne des personnes en mesure a priori de rechercher du travail, avait abouti « à laisser des gens très éloignés de l'emploi » et qu'il faudrait « généraliser et à renforcer l'agrément des publics pour mieux les identifier » ;
- impliquer l'ANPE non seulement au début, mais aussi tout au long du parcours, pour contrôler le bienfondé des financements des structures de l'IAE. Or, les agences locales pour l'emploi ont rarement mis en oeuvre l'accompagnement souhaité, faute de temps mais aussi du fait de la priorité donnée aux demandeurs d'emploi. Les exceptions à l'agrément ont été élargies aux personnes recrutées sur contrats aidés gérés par les départements, ce qui introduit une différenciation de statuts.
En outre, la procédure d'agrément est incertaine d'un point de vue juridique au regard de la législation communautaire. M. Jacques Dughera, secrétaire général du CNIAE, a indiqué que son organisme cherchait à « mettre en place un agrément pour éviter à notre système d'autorisations d'être considéré par l'Union européenne comme un dispositif n'ayant pas lieu d'être et méritant d'être supprimé au nom de la concurrence ».
Par ailleurs, les structures de l'IAE sont prises entre des exigences contradictoires : les objectifs de performance, voire d'équilibre des comptes, fixés aux structures de l'IAE les incitent à sélectionner les personnes les plus aptes au retour rapide à l'emploi, ce qui paraît en contradiction avec les exigences propres à l'insertion. En outre, les efforts réalisés en faveur de certains publics (femmes, jeunes...) sont insuffisants.
5. Des parcours d'insertion partiellement inadaptés aux besoins
Les structures de l'IAE ont pour mission d'accueillir et d'accompagner les salariés dans leur parcours d'insertion. Or, ce soutien pose des problèmes de méthode et le parcours reste le plus souvent chaotique.
La formation des salariés en parcours d'insertion, notamment, est très insuffisante . Dans le champ de l'IAE, il y a en effet aujourd'hui relativement peu de formations professionnelles adaptées aux personnes en difficulté. L'obligation de formation imposée par la loi de cohésion sociale dans le cadre des contrats aidés demeure donc sans contenu. L'absence de pérennisation des dispositifs de formation proposés aboutit à ce que « depuis 25 ans, l'articulation des parcours d'insertion et de formation semble relever de l'expérimental », a pu constater la Cour des comptes.
Le niveau de formation du personnel des structures d'insertion pose également problème . L'encadrement de publics parfois très éloignés de l'emploi nécessite en effet des compétences spécifiques que tous n'ont pas acquises ou développées.
Enfin, le manque d'attractivité des parcours , tant en termes de revenus proposés que de possibilités d'insertion professionnelle ultérieure, affaiblit l'appétence et la motivation des personnes en IAE.
6. Une sortie du dispositif problématique
Le questionnement sur les débouchés de l'IAE dépend, pour une large part, du profil des publics considérés.
Pour ceux ayant réellement bénéficié de l'IAE, l'objectif est de faciliter l'accès à un emploi régulier , en choisissant les filières d'activités porteuses d'emplois et d'avenir, en faisant reconnaître et valider l'expérience acquise, ainsi que l'aptitude à être embauché. Cela suppose des liens actifs avec le monde de l'entreprise, et plus particulièrement les secteurs à fort besoin de main d'oeuvre, ce qui est encore loin d'être le cas.
Pour les autres, auxquels le parcours en IAE n'a pas apporté de réel bénéfice, l'objectif est plus modeste : il s'agit souvent de trouver des solutions alternatives à l'exercice d'un emploi stable et ainsi « éviter l'échec définitif ».
M. Alphandéry a convenu, à cet égard, de l'importance du défi à relever : « il ne faut pas se faire d'illusion. Pour certaines personnes, aucune solution ne pourra être mise en place. Que faisons-nous d'elles ? Leur versons-nous les minima sociaux ad vitam aeternam , rendons-nous le système de prise en charge très dérogatoire pour elles, les orientons-nous vers d'autres débouchés que ceux offerts par l'économie marchande ? L'insertion peut avoir lieu au travers soit de l'économie classique, soit de l'économie non marchande, basée sur des activités utiles mais situées en dehors du marché. Ce problème n'a pas été traité pour l'instant ».
D. LES CONTRATS AIDÉS, UN DISPOSITIF EN ATTENTE DE SIMPLIFICATION
Les contrats aidés sont des dispositifs contractuels visant à faciliter l'accès ou le retour à l'emploi de publics rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles, ainsi qu'aux bénéficiaires de minima sociaux.
Ils constituent un instrument privilégié d'action des pouvoirs publics en faveur de l'insertion, leur efficacité est aujourd'hui sujette à débat.
1. Quatre grands types de contrat pour les secteurs marchand et non marchand
L'architecture actuelle des contrats aidés est issue de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, qui les a fortement remodelés.
Dans le secteur marchand , le contrat insertion revenu minimum d'activité (CI-RMA) est ouvert aux bénéficiaires de minima sociaux. Les autres demandeurs d'emploi en difficulté sont orientés vers le nouveau contrat initiative emploi (CIE).
Dans le secteur non marchand , le contrat d'avenir (CAV), ouvert prioritairement aux bénéficiaires de minima sociaux, ainsi que le contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), destiné aux autres demandeurs d'emploi en difficulté, se substituent au contrat emploi solidarité (CES) et au contrat emploi consolidé (CEC).
Les contrats aidés du plan de cohésion Sociale (législation 2005)
|
Secteur marchand |
Secteur non marchand |
|||
|
Contrat iniative emploi
|
Contrat insertion - revenu minimum d'activité (CI-RMA) |
Contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) |
Contrat d'avenir (CA) |
|
|
Publics éligibles |
Les publics sont définis au niveau régional. |
Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'allocation de parent isolé (API) de plus de six mois* |
Les publics sont définis au niveau régional. |
Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'allocation de parent isolé (API) de plus de six mois* |
|
Contrat de travail |
> CDI ou CDD de 24 mois maximum > Temps partiel ou temps complet; s'il est à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail doit être d'au moins 20 heures |
> CDI ou CDD de 6 mois minimum ou contrat de travail temporaire (CTT) renouvelables deux fois dans la limite de 18 mois > Temps partiel ou temps complet ; s'il est à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail doit être d'au moins 20 heures |
> CDD de 6 mois minimum renouvelable dans la limite de 24 mois > Temps partiel ou temps complet ; s'il est à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail doit être d'au moins 20 heures |
> CDD de 24 mois, renouvelable dans la limite de 36 mois (voire 60 mois pour les plus de 50 ans et les travailleurs handicapés). Par dérogation, CDD d'une durée comprise entre 6 et 24 mois, renouvelable 2 fois dans la limite de 36 mois > Durée hebdomadaire fixée à 26 heures. À partir du début 2006, elle peut être comprise entre 20 et 26 heures lorsque l'embauche sera réalisée par les ateliers et chantiers d'insertion ou par une entreprise ou une association de services à la personne |
|
Avantages pour l'employeur |
> Aide mensuelle de l'État fixée par arrêté du préfet de région, dans la limite de 47 % du SMIC > Cumul possible avec certains dispositifs d'allégement ou d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale |
> Aide forfaitaire égale au montant du RMI garanti à une personne isolée > Cumul possible avec certains dispositifs d'allégement ou d'exonération de cotisations sociales |
> Aide mensuelle de l'Etat fixée par arrêté du préfet de région, dans la limite de 95 % du SMIC > Exonérations des cotisations et contributions patronales de sécurité sociale dans la limite du SMIC, de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage, de la taxe due au titre de l'effort de construction |
> Aide forfaitaire égale au montant du RMI garanti à une personne isolée > Aide dégressive de l'Etat : 75 % du coût restant en charge de l'employeur la première année, 50 % les années suivantes. Pour les conventions signées jusqu'au 1 er mars 2006**, l'aide complémentaire de l'Etat est égale à 90 % du coût restant à la charge de l'employeur les 6 premiers mois. Pour les ateliers et chantiers d'insertion, le taux de l'aide est fixé à 90 % pendant toute la durée d'exécution du contrat > Exonération de cotisations et de contributions patronales de sécurité sociale > Aide supplémentaire de 1.500 € en cas d'embauche en CDI avant la fin du contrat |
* Aux termes du décret du 22 mars 2006, la condition d'ancienneté dans le droit à l'une ou l'autre de ces allocations pour pouvoir conclure un tel contrat a été supprimée. À cette même date, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) devient un critère d'éligibilité pour conclure un contrat d'avenir. Suite au décret du 20 avril 2006, cette allocation permet également d'accéder au CI-RMA.
*Aux termes du décret du 8 mars 2006, cette période a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2007.
Source : DARES, septembre 2006.
Un rapport de la commission des finances du Sénat de février 2007 199 ( * ) , faisant suite à une enquête demandée à la Cour des comptes, a mis en évidence les nombreuses limites du système de contrats aidés, allant jusqu'à évoquer une « politique complexe, éclatée et mal évaluée ».
2. Un empilement de dispositifs nuisant à la lisibilité du système
Depuis le lancement des premiers contrats aidés, en 1977, tous les gouvernements successifs ont eu recours à ce type d'instrument. « Cette succession a conduit à une sédimentation de dispositifs qui n'avaient plus de raison de perdurer », objectait en 2003 la direction de la prévision. En effet, les nouveaux contrats ont eu tendance, non à se substituer aux anciens ou à les adapter, mais à s'ajouter à eux, quitte à en reprendre le contenu et à n'en modifier parfois que l'intitulé. La suppression d'un contrat existant, qui aboutit in fine à mettre son bénéficiaire en situation d'inactivité, crée ainsi un « effet cliquet » difficilement réversible pour des raisons autant sociales que politiques : les bénéficiaires de contrats aidés n'apparaissent pas, en effet, dans les statistiques du chômage.
La Cour des comptes a stigmatisé cette instabilité réglementaire dans son rapport annuel 2005, son premier président, M. Philippe Séguin, s'étant plaint de ce que « les mesures (soient) souvent modifiées avant que leurs effets n'aient été mesurés ». Les pouvoirs publics ne réalisent bien souvent aucune étude préalable à la mise en place d'un nouveau contrat et ne cherchent pas plus à mesurer son efficacité une fois qu'il a été lancé. Et si des études sont faites, elles sont souvent partielles et ne permettent pas réellement de mesurer la portée des dispositifs.
Par ailleurs, les dispositifs d'aide sont extrêmement cloisonnés et obéissent à des objectifs et logiques différenciés . Dès lors, les destinataires de ces contrats peinent à en discerner la logique et à en optimiser l'utilisation. Cela vaut tant pour les bénéficiaires des contrats, qui certes peuvent normalement s'appuyer sur les organismes sociaux d'accompagnement, que pour les employeurs, confrontés à des dispositifs nombreux et en perpétuel changement. Lors des auditions, les responsables de l'Uniopss ont dénoncé des « politiques de l'emploi très instables, avec un développement du nombre de contrats aidés pendant une période, suivi d'une baisse dans une autre période ».
3. Un coût restant élevé pour une gestion incohérente
En 2008 , les dépenses de l'Etat pour l'emploi aidé mobiliseront 1,5 milliards d'euros . Si la politique de l'emploi passe désormais davantage par des allégements généraux de charges sociales sur les bas salaires, les sommes affectées aux emplois aidés restent toutefois conséquentes et appellent donc une gestion cohérente.
La répartition des crédits d'Etat entre les différents contrats s'opère, depuis 2005, dans un cadre déconcentré : celui de l'« enveloppe unique régionale », sous l'autorité du préfet de région. Or, le rapport de la commission des finances soulignait que des décisions nationales, portant sur la réalisation d'objectifs ciblés précis ou la création de dispositifs spécifiques, n'on pas manqué de modifier les décisions régionales. Le croisement de ces logiques, régionale et nationale, est facteur de complexité et de confusion sur le terrain.
En sus, le rapport fait observer que l'ANPE est confrontée à des problèmes techniques et de gestion et que l' attitude réservée de certains conseils généraux vis-à-vis du contrat d'avenir et du CI-RMA, dont ils sont financeurs, a longtemps compromis le développement de ces contrats.
Par ailleurs, est souvent mise en avant l'incohérence d'une gestion des publics en fonction, non de leur situation réelle, mais de leur appartenance statutaire ou catégorielle. « Répartir les individus par profils constitue une erreur. Actuellement, il existe neuf minima sociaux, huit catégories de chômeurs et de multiples contrats aidés. Le résultat de ce dispositif est que les personnes ne sont plus employées pour leurs compétences, mais selon la catégorie à laquelle elles appartiennent », a ainsi fait observer M. Jean-Pierre Guenanten, délégué national du MNCP.
4. Une efficacité difficilement mesurable et très variable selon les types de contrats
Tout en relevant que leur valeur ajoutée ne se mesure pas uniquement au regard de l'accès à un emploi durable, le rapport général faisant suite au Grenelle de l'insertion a jugé le dispositif des contrats aidés « largement insatisfaisant » en matière d'efficacité.
Tout d'abord, des effets de distorsion difficilement réductibles limitent la portée des contrats aidés et rendent leur évaluation difficile :
- effet d'aubaine. De nombreux employeurs recourant à ce type de contrats pour créer un poste auraient, même sans son existence, décidé de créer cet emploi ;
- effet de substitution. Certaines réformes du dispositif d'aide à l'emploi visent à favoriser un public jugé prioritaire à un moment donné et peuvent s'opérer au détriment d'un autre public, sans que le volume de chômage ou d'exclusion n'ait été affecté ;
- effet de concurrence. Une nouvelle mesure peut entrer en concurrence avec une mesure déjà existante.
Le rapport sénatorial révèle que les contrats aidés du secteur non marchand, nettement plus subventionnés que ceux du secteur marchand, ont un impact plus immédiat et direct sur les chiffres du chômage. En revanche, le CIE -et les contrats en alternance, particulièrement l'apprentissage- favorisent davantage l'accès de leurs bénéficiaires à l'emploi non aidé et à des contrats de travail durables.
Les bénéficiaires de contrats aidés en secteur non marchand sont dans une situation beaucoup moins favorable à l'issue de leur contrat, et font même parfois l'objet d'une stigmatisation . Ce constat peut s'expliquer en partie par l'insuffisance de la formation et de l'acquisition de compétences professionnelles en cours de contrat.
5. Une plus-value réduite en termes de qualification et de formation
L'appareil d'accompagnement et de formation associé aux différents contrats aidés, dont la contribution à l'efficacité du contrat comme passerelle vers un emploi durable, apparaît relativement étoffé. Cependant, et en dépit des obligations légales, ils sont insuffisamment mis en oeuvre.
En effet, la programmation budgétaire par l'Etat de ces contrats porte essentiellement sur les budgets d'aide aux employeurs, sans garanties sur le financement de la formation et de l'accompagnement.
Par ailleurs, la durée limitée des contrats ne permet pas toujours d'engager des actions de formation aux effets substantiels.
Dès lors, le recours à la VAE devrait être encouragé pour la construction d'un parcours qualifiant. Or, l'accès des bénéficiaires de contrats aidés à la VAE semble relativement réduit.
6. Le cas particulier du contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation diffère des contrats aidés par son aspect qualifiant .
Il s'adresse à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus et aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus. Son objectif est de leur permettre d'acquérir une qualification professionnelle et de favoriser leur insertion ou réinsertion professionnelle. Les bénéficiaires âgés de 16 à 25 ans révolus sont rémunérés en pourcentage du Smic selon leur âge et leur niveau de formation, les salariés âgés de 26 ans et plus perçoivent une rémunération qui ne peut être ni inférieure au SMIC ni à 85 % du salaire minimum conventionnel. Ce contrat ouvre droit pour l'employeur, pour certaines embauches et dans certaines limites, à une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale. Des aides incitatives à la reprise d'emploi dans le cadre d'un contrat de professionnalisation peuvent être versées par l'Assedic.
Le contrat de professionnalisation semble jouir d'un certain succès . Selon une étude de la DARES 200 ( * ) , en 2006, 144.000 nouveaux contrats de professionnalisation ont été enregistrés, soit 50 % de plus qu'entre octobre 2004, date d'ouverture du dispositif, et la fin décembre 2005. Et 177.000 étaient attendus pour l'année 2007. Le dispositif se développe plus fortement dans le secteur tertiaire et la construction que dans l'industrie. Près de la moitié des contrats vise une qualification ou une certification de branche.
Cependant, en profitent surtout les jeunes issus du système scolaire qui cherchent à obtenir un diplôme ou un titre d'Etat. Ils représentent près du tiers des entrées.
Les responsables de l'Agence Ville Emploi ont souligné devant la mission l'excessive orientation de ces contrats vers les publics les plus jeunes, et la place insuffisante qui y est faite à la formation. Ils ont ainsi regretté qu'ils n'aient « pas du tout été développés en direction des publics adultes. Cette décision est regrettable car ce contrat de professionnalisation représente un excellent contrat, tout comme pourrait l'être le contrat d'avenir, plutôt dédié aux adultes en grande difficulté, s'il était accompagné de modules de formation ».
7. Vers un contrat unique d'insertion ?
Parmi les différentes pistes de réforme des contrats aidés actuellement discutées, l'une d'entre elles semble recueillir un assentiment plus généralisé : il s'agit du contrat unique d'insertion. Présentant une architecture commune marquée par les principes de l'alternance et de l'accompagnement, déclinée selon des durées variables en fonction des besoins des bénéficiaires, et ce aussi bien en durée totale qu'en durée hebdomadaire de travail, il permet de simplifier un système aujourd'hui difficilement lisible tout en donnant plus de souplesse à ses bénéficiaires.
Dans un rapport au Premier ministre ayant pour objet le contrat d'accompagnement généralisé 201 ( * ) , votre rapporteur avait largement abordé cette problématique et souligné qu'il apparaissait nécessaire de « rénover les principaux outils existants (...) pour aboutir à un instrument d'insertion professionnelle plus souple, permettant un suivi individualisé et adapté de chaque bénéficiaire dans son parcours d'accès ou de retour vers l'emploi ». Insistant sur l'importance d'un suivi étroit et personnalisé des publics ciblés, le rapport préconisait de retenir la formule générique de contrat d'accompagnement généralisé (CAG), renvoyant à deux sous-types de contrats distincts :
- le contrat de travail accompagné (CTA), qui qualifierait tous les contrats relevant du même processus d'accompagnement, quelles que soient leurs appellations spécifiques (contrats d'apprentissage, de qualification, d'adaptation ...) ;
- le contrat de création accompagné (CCA), désignant tous les contrats signés organisant l'accompagnement d'une initiative économique de reprise, transmission ou création d'activité.
Un tel dispositif de contrat unique d'insertion est aujourd'hui expérimenté par certains départements , tel celui de la Côte d'Or, où s'est rendue une délégation de la mission d'information. Pouvant être signé sous forme de CDI ou de CDD, avec une durée minimale de six mois, il y est assorti d'un financement modulable en fonction des difficultés d'accès à l'emploi du bénéficiaire et des engagements pris par l'employeur en matière d'accompagnement et de formation.
C'est cette voie vers laquelle semble d'ailleurs se diriger le Gouvernement . Le Premier ministre, M. François Fillon, l'a en effet à la fin du mois de mai dernier, lors de la clôture du Grenelle de l'insertion. Ce contrat, dont les modalités doivent encore être précisées, prévoirait des contreparties en termes de pérennisation de l'emploi ou de qualification et s'accompagnerait de la mise en place d'un référent unique pour les parcours d'insertion. Son dispositif législatif serait inclus dans le projet de loi portant sur la généralisation du RSA et la réforme des politiques d'insertion, qui devrait être discuté par le Parlement à l'automne.
E. LE SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, UN INSTRUMENT ESSENTIEL EN COURS DE RÉFORME
Le service public de l'emploi (SPE) assure les missions de placement, d'indemnisation, d'insertion, de formation et d'accompagnement des demandeurs d'emploi. A ce titre, il devrait jouer un rôle central dans l'accueil et l'orientation des personnes les plus éloignés du marché du travail.
En pratique, et malgré une vaste réforme en cours, l'efficacité de son action dans l'insertion de ces publics reste mesurée.
1. Une organisation complexe associant un grand nombre d'acteurs
L'Etat a la responsabilité de la politique publique de l'emploi. Il anime l'action des principaux membres du SPE, finance des mesures d'aides à l'emploi et les met en oeuvre au niveau déconcentré.
L'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) est le principal opérateur de l'intermédiation active. Etablissement public administratif, elle a pour mission d'assister les personnes à la recherche d'un emploi, mais aussi les employeurs désirant embaucher.
L'Unedic est chargée de la gestion de l'assurance chômage. Association gérée paritairement, tout comme les trente associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) et leurs équivalents en région parisienne qui forment son réseau, l'Unédic sert à ce titre diverses prestations, comme l'ARE et l'ASS.
En matière de formation, le principal opérateur est l' Association pour la formation professionnelle des adultes (Afpa), aujourd'hui dans une phase de décentralisation.
Les collectivités territoriales concourent également au service public de l'emploi. Les régions sont compétentes en matière de formation professionnelle, les départements sont chargés de la réinsertion des titulaires du RMI et les communes interviennent par l'intermédiaire des maisons de l'emploi. Initiées par les communes et intercommunalités, ces maisons sont destinées à fédérer les actions publiques et privées en faveur de l'emploi sur leur territoire.
Enfin, participent au SPE toute une série d'acteurs aux statuts divers , publics ou privés. On y trouve notamment l'agence pour l'emploi des cadres (APEC), l'association chargée de gérer le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), les missions locales, les organismes de formation, les associations et entreprises d'IAE, les entreprises de travail temporaire...
2. Une vaste réforme en cours de mise en oeuvre
a) Une réforme visant à simplifier et moderniser le service public de l'emploi
En application de la loi de cohésion sociale, l'Etat, l'ANPE et l'Unedic ont conclu, le 5 mai 2006 , une convention pluriannuelle pour définir les modalités de leur coordination dans le cadre du SPE.
L'objectif affirmé de cette réforme est non seulement de simplifier les démarches des demandeurs d'emploi en systématisant les guichets uniques, mais aussi de renforcer le suivi des chômeurs en diminuant le nombre de ceux dont doit s'occuper chaque conseiller, soit de 120 à 130 actuellement. Elle doit aussi permettre de recenser davantage les offres et de mieux connaître les besoins en termes de qualification et de formation.
La loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi qui en est résulté prévoit, en application de cet accord :
- une fusion de l'ANPE et du réseau opérationnel de l'Unedic qui donnera naissance à un nouvel opérateur du service public de l'emploi. Chargé du placement des demandeurs d'emploi et de leur indemnisation, il s'adressera à deux catégories d'usagers : les demandeurs d'emploi et les employeurs ;
- le maintien de l'Unedic . Si elle continuera de gérer la convention d'assurance chômage, elle ne collectera plus les cotisations chômage, charge qui reviendra à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) ;
- la création d'un Conseil national de l'emploi et la conclusion d'une convention entre l'Etat, l'Unedic et le nouvel opérateur qui résultera de la fusion de l'ANPE et des Assedic pour améliorer la coordination des acteurs du service public de l'emploi.
En conséquence, l' accueil et l'accompagnement des demandeurs d'emploi ont d'ores et déjà été profondément modifiés par trois dispositions depuis le début 2006 prévoyant :
- la mise en place, pour chaque demandeur, d' entretiens mensuels à compter du 4 ème mois d'inscription, ces entretiens étant assurés par un même conseiller ;
- la réalisation d'un « profilage statistique » de tous les demandeurs d'emploi, indemnisés ou non ;
- enfin la substitution, au dispositif d'accompagnement précédent -programme d'aide au retour à l'emploi et plans d'action personnalisés (PARE-PAP)- des parcours du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE). La logique de parcours, qui repose principalement sur l'évaluation de la distance à l'emploi, vise à fournir à chaque demandeur les prestations les plus adaptées.
b) Une période de transition restant à parachever
Dans sa partie consacrée à l'évolution des structures et des services aux demandeurs d'emploi, le rapport de la Cour des comptes pour 2008 met l'accent sur les avancées déjà réalisées dans le cadre de la réforme, mais également sur les progrès nombreux restant à accomplir.
S'agissant du dispositif de guichet unique , elle fait état de la « faible proportion des rapprochements physiques dans l'ensemble ».
Pour ce qui est de l'action de l' ANPE , la Cour fait valoir que « la gamme (de ses) prestations (...) doit être mieux adaptée à chaque parcours » et que « l'effort en faveur de l'évaluation des incidences sur le retour à l'emploi doit être poursuivi ».
Elément essentiel dans la mise en oeuvre de la réforme au niveau local, les maisons de l'emploi restent un « dispositif encore en phase de montée en charge » du fait d'une intervention de l'Etat « empirique et parfois hésitante » qui fait que leur développement dépend largement des circonstances et volontés locales.
Concernant l' accueil et l' accompagnement des demandeurs d'emploi, la Cour s'est prononcée pour une amélioration de la définition des parcours, qui n'est « pas encore assez sélective ».
3. La nécessité d'un profond remaniement structurel
Au-delà des améliorations qu'apportera l'actuelle réforme de l'organisation du SPE, s'impose une révision en profondeur de ses logiques et de ses modes d'action qui tienne compte des publics les plus éloignés de l'emploi. La Cour des comptes reconnaît ainsi que si la fusion « remédiera à certaines difficultés frictionnelles », elle ne « permettra pas l'économie d'une réflexion en profondeur sur les méthodes d'accompagnement à mettre en oeuvre en vue d'un retour rapide de l'emploi ».
a) Des agences pour l'emploi mal adaptées à l'accueil d'un nombre important de chômeurs
Réparties sur l'ensemble du territoire, les agences locales pour l'emploi ont pour mission principale d'accompagner les demandeurs d'emploi dans leurs recherches et de mettre les entreprises en relation avec les candidats. Or, le caractère limité des moyens -tant humains que matériels- dont elles disposent ne leur permet pas de réaliser cette mission dans des conditions satisfaisantes.
Les responsables du MNCP ont tenu, à cet égard, des propos relativement sévères devant la mission : « Les dispositifs d'accueil de cette structure constituent aujourd'hui une véritable usine à gaz. Chaque conseiller reçoit entre 150 et 200 personnes et ne peut accorder à chacune qu'à peine cinq minutes d'entretien. Il serait opportun de mettre en place un véritable service d'accueil public, permettant de renseigner et d'accompagner les chômeurs de manière satisfaisante ».
b) Une relation de confiance entre chômeurs et agences de l'emploi entamée
L'efficacité de l'accompagnement vers l'emploi suppose qu'une relation de confiance et de loyauté s'instaure entre les personnels du SPE et les publics bénéficiaires. Or, il semble que cet équilibre ne soit pas systématiquement trouvé, notamment pour les demandeurs d'emploi les plus éloignés du marché du travail. Cette situation, outre le fait qu'elle obère le bon déroulement du parcours vers l'emploi, va jusqu'à décourager les publics les plus fragiles de faire appel aux services du SPE.
Ainsi que l'a expliqué M. Jean-Pierre Guenanten, délégué national du MNCP, « certaines personnes sont angoissées à l'idée de se rendre à l'ANPE, craignant d'y être sanctionnées. Il s'agit d'un souci majeur. Car il n'est pas possible d'offrir un accueil de qualité quand les conseillers de l'ANPE sont à la fois juge et partie et qu'il n'existe plus de relation de confiance entre eux et les chômeurs. C'est pourquoi de plus en plus de demandeurs d'emplois deviennent invisibles. Ils sont tellement angoissés à l'idée de se rendre à l'ANPE qu'ils préfèrent ne pas y aller, d'autant plus quand ils ne savent pas utiliser les outils informatiques présents partout dans les agences ; d'où la nécessité de mettre en place des accompagnements en leur direction ».
c) Une procédure de sanction des chômeurs propre à les stigmatiser
Afin de sanctionner les chômeurs ne participant pas activement au processus de recherche d'emploi, le délégué départemental de l'ANPE peut les radier de la liste des demandeurs d'emploi. Or, sans doute du fait de la multiplication des convocations exigée par la mise en place d'un plan d'accompagnement personnalisé des chômeurs, le nombre de radiations tend à augmenter sans qu'elles soient toujours totalement justifiées.
Ainsi, les responsables du MNCP ont estimé que les radiations étaient « souvent signifiées pour des raisons abusives et sans être accompagnées d'une quelconque explication ». Estimant que « la présomption d'innocence n'est pas suffisamment respectée », ils ont regretté que « les chômeurs n'(aient) accès à une commission de recours qu'après avoir été sanctionnés. Ils perdent ainsi, dans tous les cas, au moins deux mois de revenus, un manque de ressources pouvant amener leurs familles à plonger dans le surendettement ».
Ils ont rapporté avoir, au cours des six derniers mois, « accompagné 265 personnes dans leurs démarches de saisie de la commission de recours, dont 263 ont été réintégrées en raison de radiations abusives ». S'il ne s'agit pas ici de procéder à des généralisations hâtives, ces faits sont de nature à susciter des questionnements.
Ce sujet trouve un relais dans le projet de loi relatif aux droits et devoirs des demandeurs d'emploi, actuellement débattu devant le Parlement, qui tente de définir l'offre « raisonnable » à laquelle un demandeur d'emploi est tenu de répondre au risque d'être radié des listes de l'opérateur et de voir suspendue son allocation chômage. Ce texte tend à prévoir des « devoirs renforcés » à la charge du demandeur, contrebalancés par des « droits plus nombreux » tels que des démarches simplifiées, un accompagnement personnalisé ou encore une offre de service personnalisée.
d) Un service de l'emploi inadapté au traitement des problématiques sociales
La mission stricto sensu du SPE étant la mise en adéquation de l'offre et de la demande d'emploi, il ne dispose pas des compétences requises pour accueillir et réorienter les publics les plus défavorisés qui, du fait de leurs handicaps, ne sont pas à même de s'orienter immédiatement vers un parcours professionnel.
Mme Marie-Laure Meyer, conseillère régionale d'Ile-de-France et membre de la commission formation professionnelle et apprentissage de l'ARF, a insisté sur ce point. « Nous avons besoin d'avoir un service public de l'emploi qui réoriente correctement les personnes incapables de rechercher un travail vers les services sociaux. Je pense notamment ici aux gens rencontrant des problèmes de drogue, d'alcool et de santé. L'ANPE n'est pas armée pour traiter de ces cas dont peuvent s'occuper uniquement des structures spécialisées. Le seul problème est de réussir à mettre l'ensemble des acteurs en charge de l'insertion en réseau, de manière à ne pas laisser les gens à leur solitude ».
e) Un rôle d'« orientateur en dernier ressort » délicat à tenir
Le SPE a normalement vocation à recevoir l'ensemble des personnes à la recherche d'un emploi, quels que soient leur secteur professionnel, leurs qualifications ou leur statut. Or, par un effet de sélection inverse, les employeurs recherchent par eux-mêmes des candidats possédant l'ensemble des qualités requises pour les postes qu'ils cherchent à pourvoir et ne font appel aux services de l'ANPE que lorsqu'ils ne trouvent pas la personne adéquate.
Dès lors, comme l'a souligné M. Jacques Freyssinet, président du conseil scientifique du Centre d'études de l'emploi, « le fonctionnement du marché du travail fait que se déversent, sur l'ANPE, des offres d'emplois que les autres intermédiaires sont incapables de satisfaire et auxquelles elle aura du mal à répondre elle-même ».
f) Un recours discuté à des prestataires extérieurs pour le placement des chômeurs
En vu de maximiser les chances d'insertion des chômeurs, la convention tripartite signée entre l'Etat, l'ANPE et l'Unedic prévoit le recours à des agences privées pour le placement des « allocataires de l'assurance-chômage rencontrant des difficultés particulières de reclassement », la rémunération de ces organismes devant dépendre de leurs résultats. Plusieurs appels d'offres et marchés publics ont donc été lancés par les agences pour l'emploi afin de recourir à des prestataires privés, lesquels peuvent être français, européens et même provenir d'Etats tiers.
Si elle se justifie par la volonté de diversifier et de renforcer les instruments de placement, cette évolution n'est pas sans susciter des interrogations . Son efficacité a pu être remise en cause, au regard des expériences étrangères autant que celles ayant déjà été menées en France. Par ailleurs, selon l'Alliance villes emploi, elle aboutirait à « détruire le travail effectué par les nombreuses petites associations dans l'ensemble de la France avec des moyens relativement faibles », ainsi qu'à « casser le savoir-faire des associations, un savoir-faire fragile, souvent pointu, ne leur permettant pas de répondre à des appels d'offres d'importance ».
L'audition par la mission de Mme Françoise Bernon, responsable du développement de l'activité de placement en France de Manpower Egalité des chances a toutefois été de nature à nuancer fortement ces inquiétudes . Travaillant en liant étroit avec les acteurs institutionnels et opérationnels de l'insertion, et plus spécifiquement les conseils généraux, l'entreprise mène des actions ciblées vers des publics particulièrement fragiles (étudiants, anciens détenus, jeunes de quartiers difficiles ...). Reconnaissant qu'elle était tenue « de rechercher une certaine efficacité » dans son activité de placement, sa représentante a indiqué qu'elle offrait aux demandeurs d'emploi un service personnalisé associant, au sein d'un contrat géré par un conseiller unique, un diagnostic suivi d'une préparation préalable à une embauche dans la durée, puis très rapidement une activité rémunérée et enfin un accompagnement pérennisé pendant une période d'au moins six mois comportant notamment un suivi qualité de son parcours.
Mme Bernon a attiré l'attention sur les problèmes rencontrés par son entreprise dans ses activités de suivi et de placement, à savoir un tri insuffisamment sélectif par les conseils généraux des personnes qui lui sont adressées, certaines relevant plus d'un traitement social que de la recherche d'emploi ; l'insuffisante durée d'attribution des marchés publics, qui ne permet pas d'acquérir suffisamment de visibilité et donc de s'investir dans un travail sur le long terme ; et enfin l'absence d'uniformité des demandes des conseils généraux en matière de reporting des publics traités.
III. DES PROPOSITIONS POUR UNE INSERTION PROFESSIONNELLE DYNAMISÉE
A. PRÉCONISATIONS GÉNÉRALES
Les principes généraux structurant actuellement la politique de l'emploi ne sont plus adaptés aux réalités et aux nécessités des populations cibles.
Il est aujourd'hui indispensable de passer d'une logique administrative à une logique contractuelle , en sollicitant et obtenant l' adhésion de tous les acteurs à une stratégie d'insertion déclinant des objectifs, des moyens et les outils d'évaluation correspondants.
Pour toute aide versée ou toute action mise en oeuvre, il conviendrait par ailleurs d' agir au plus près des publics visés, en fonction des caractéristiques et des besoins particuliers des personnes , et non de leurs statuts.
B. RENFORCER LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN LIEN AVEC L'EMPLOI
1. Inciter les entreprises à mettre en place des instruments de formation adaptés au profil de leurs travailleurs les moins qualifiés
Les entreprises, qui peinent à trouver des formations adaptées pour leurs postes peu qualifiés, forment généralement moins leurs collaborateurs les moins qualifiés, ce qui crée à terme une précarité en termes d'employabilité. Il serait indispensable pour elles de permettre à leurs salariés les moins qualifiés de suivre un parcours de formations qualifiantes, voire diplômantes , en interne ou bien au sein de structures rattachées à l'entreprise.
Dans un souci de rationalisation et d'économie, cela passerait d'abord par une mutualisation des moyens de formation entre entreprises d'une même branche ou d'un même bassin d'emploi, en partenariat avec des organismes de formation professionnelle.
Comme l'idée a été évoquée devant la mission, cela pourrait également se traduire par l' intégration de la formation dans les processus de recrutement , voire dans les obligations de l'employeur. Des partenariats pourraient être développés entre entreprises et organismes de formation professionnelle , afin de proposer des formations adaptées aux postes à pourvoir et accessibles à des personnes pas ou peu qualifiées. Ces formations précéderaient et conditionneraient systématiquement l'embauche. A terme, ces organismes de formation deviendraient des espaces de recrutement pour les entreprises partenaires.
2. Rendre la formation des chômeurs obligatoire
M. Jean-Baptiste de Foucauld, président de Solidarités nouvelles contre le chômage, a évoqué devant la mission le système danois de flexsécurité dont il pourrait être opportun de s'inspirer.
Au terme d'une année de recherche d'emploi, lorsque la personne à la recherche d'un emploi est toujours au chômage, elle est quasiment contrainte de suivre une formation longue et rémunérée . Dans la plupart des cas, les chômeurs retrouvent un emploi ; à défaut, ils reçoivent une formation qualifiante qui, en général, conduit à un poste rémunéré.
3. Développer les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification
Les GEIQ constituent un outil de lutte contre la précarité bénéficiant autant aux travailleurs précaires qu'aux entreprises, surtout petites et moyennes. Il conviendrait donc de soutenir son développement, et ce selon deux axes.
Tout d'abord, il serait opportun de promouvoir les GEIQ comme un outil privilégié de la politique de l'emploi . Les acteurs de l'emploi -ministères, conseils régionaux, ANPE, syndicats salariaux et patronaux- devraient reconnaître les GEIQ comme instruments centraux et intégrer systématiquement le recours à cette forme de travail dans les différents plans et programmes qu'ils proposent. Encore méconnus par les PME, les collectivités territoriales et les maisons de l'emploi, ils devraient bénéficier de campagnes d'information à l'échelle nationale comme à celle d'un bassin d'emploi.
Ensuite, il faudrait offrir plus de souplesse et de simplicité aux utilisateurs . En permettant tout d'abord qu'une entreprise puisse appartenir à plusieurs groupements, là où elle est limitée à deux pour l'instant. En ouvrant en second lieu les GEIQ aux collectivités locales, ce qui s'avèrerait pratique pour des missions ponctuelles et constituerait une bonne mesure de rationalisation des finances locales. Enfin, en clarifiant le cadre juridique lorsque le GEIQ est multisectoriel, ce qui oblige pour l'instant à la création d'une convention collective ad hoc ou au rattachement à celle d'un autre secteur.
4. Soutenir l'établissement public d'insertion de la Défense (EPIDe)
L'un des trois modules de l'EPIDe vise à dispenser des formations professionnelles, qui doivent déboucher sur un emploi dans un secteur caractérisé par une forte demande en main d'oeuvre. Menées en partenariat avec l'Afpa, l'ANPE et des entreprises concernées par les métiers visés, ces formations sont validées par des diplômes.
L'un des intérêts de ce dispositif est que la formation professionnelle s'effectue à l'échelon du bassin local d'emploi, au sein d'entreprises désireuses d'employer les stagiaires qu'elles ont contribué à former. Surtout, elle s'avère très efficace en termes de remise sur le marché du travail : trois-quarts des jeunes sortent de ces centres avec un emploi durable .
Or, l'action de l'EPIDe et sa diffusion sur l'ensemble est mise sous contrainte pour des motifs budgétaires. Il paraitrait de bonne politique d' assurer à l'EPIDe les moyens de poursuivre et d'étendre son action , s'agissant d'un dispositif qui a fait la preuve de son efficacité, y compris pour des publics difficiles.
5. Rendre plus attractif le recours à la validation des acquis de l'expérience
Comme en matière de développement des supports au tutorat et au parrainage, la mutualisation des moyens , en termes de ressources humaines et de main d'oeuvre disponible, entre entreprises d'un même bassin d'emploi, permettrait un meilleur accompagnement de leurs salariés dans des processus de VAE.
Les autorités publiques chargées d'organiser la VAE devront quant à elles la rendre plus attractive pour ses publics potentiels.
Cela doit passer par une simplification des démarches , car la VAE demande un investissement très important de la part des personnes accompagnant leurs bénéficiaires. Il semble également nécessaire de préférer, à des critères trop abstraits qui réclament des connaissances par trop théoriques traditionnelles, la prise en compte des expériences vécues . Enfin, il paraîtrait utile de valoriser les compétences para professionnelles -qu'elles soient relationnelles, associatives...- que les personnes candidates à la VAE ont pu développer. Et cela d'autant plus que ces personnes ont un grand besoin de reconnaissance sociale pour arriver se reconstruire socialement.
C. SOUTENIR LES ASSOCIATIONS DANS LEUR ACTION POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE
Le chèque associatif consiste à attribuer à chaque chômeur une somme déterminée pour lui permettre de demander à une association ou un syndicat de défendre ses droits. Evoqué depuis une quinzaine d'années, ce dispositif constituerait un moyen de financement indirect des associations à visée d'insertion sur l'ensemble du territoire. Il permettrait en outre aux demandeurs d'emploi d'être mieux représentés dans la défense de leurs droits.
Par ailleurs, il serait sans doute très utile de créer un statut adapté à la vie en communauté sur le modèle retenu par l'association Emmaüs pour les personnes qui ne souhaitent pas intégrer le monde de l'entreprise. A mi-chemin entre bénévolat et salariat, il donnerait lieu à la signature par les parties précisant leurs droits et obligations respectifs.
D. MOBILISER LES ENTREPRISES
1. Réaffirmer la place première des entreprises dans l'insertion
Loin de stigmatiser le monde de l'entreprise comme initiateur unique de la précarité, la mission souhaite au contraire qu'il soit davantage mobilisé dans les politiques de lutte contre l'exclusion et la pauvreté , dont il devrait constituer l'un des acteurs majeurs. L'exercice d'un emploi, surtout s'il est de qualité, constitue en effet aujourd'hui une condition bien souvent indispensable, à défaut d'être suffisante, pour favoriser l'insertion économique et sociale.
Comme l'a fait remarquer à juste titre M. Jean-François Trogrlic, directeur du bureau de l'Organisation internationale du travail (OIT) en France, « c'est le monde du travail qui tient les clefs d'une limitation progressive, véritable et durable de la pauvreté (...). Les entreprises jouent un rôle déterminant. Elles constituent le moteur de la création d'emplois, sont capables d'investir de nouveaux marchés et activités et doivent être à la pointe, ce qu'elles parviennent à faire parfois, du développement de modèles économiques et durables ».
2. Renforcer les liens entre entreprise et IAE
Afin d'encourager leur action en matière sociale, il serait bon d'impliquer les entreprises qui se sont engagées à faire de l'insertion un élément nouveau du dialogue social en fixant des objectifs concernant l'accueil en leur sein des salariés sortant des structures de l'IAE .
3. Développer le tutorat et le parrainage
D'une façon générale, l'entreprise n'a souvent pas les ressources pour encadrer et soutenir les acteurs de l'insertion professionnelle que sont tuteurs et parrains.
Dès lors, il serait opportun de créer dans l'entreprise un poste de référent insertion ou missionner un collaborateur actuel en vue de soutenir les tuteurs et parrains . Ce référent, qui devrait connaître à la fois les modes de fonctionnement de l'entreprise et les instruments de l'insertion professionnelle, serait amené à travailler aussi bien en interne avec la direction des ressources humaines, les tuteurs et les parrains qu'en externe, avec les organismes de l'action sociale.
Lorsque l'entreprise n'a pas les moyens de créer un tel poste de référent insertion, elle pourrait s'associer avec un opérateur externe (entreprise d'insertion, organisme public, syndicat, association...) pour effectuer le suivi de ses collaborateurs, ou bien recourir à un intervenant externe pour épauler son référent insertion.
? S'agissant plus spécifiquement des tuteurs, ils doivent être à la fois mieux formés à encadrer, accompagner et résoudre les problèmes par l'écoute et la gestion des crises, et mieux reconnus au sein de leur entreprise.
Soutenir une personne longtemps exclue est délicat et nécessite, soit de former ses tuteurs avec les méthodes d'accompagnement développées par des entreprises d'insertion, soit de faire appel à des intervenants extérieurs. A ce titre, l' expérience d'un autre tuteur peut être un atout significatif.
Parallèlement, la fonction de tuteur doit être mieux valorisée , et ce par une reconnaissance symbolique aussi bien que matérielle. Le tuteur doit ainsi se voir accorder les moyens nécessaires à ses interventions, notamment le temps, qui doit être considéré comme un temps travaillé. Le tutorat pourra être inclus dans le contrat de travail, lequel précisera les objectifs assignés, fixera un critère d'évaluation et proposera une perspective de promotion.
? Concernant plus particulièrement les parrains , il serait utile de mettre en place un dispositif de médiation entre ceux-ci et l'entreprise afin de les recruter, former et évaluer. Cela pourrait passer par la constitution , par plusieurs employeurs intéressés, d'une association ou un groupement d'intérêt économique chargé de développer, mutualiser et professionnaliser le parrainage des salariés. Par ailleurs, à l'heure où l'arrivée de nombreux cohortes de travailleurs à l'âge de la retraite va accroître l'offre de compétences inexploitées pour l'entreprise, il pourrait être intéressant de mobiliser des seniors venant de prendre leur retraite mais désireux de rester actifs et de transmettre leur savoir.
E. ENCOURAGER LE TRAVAIL INDÉPENDANT
Le rapport de M. François Hurel en faveur d'une meilleure reconnaissance du travail indépendant a souligné que seulement un peu plus de la moitié des 2,9 millions d'entreprises que comptait notre pays en 2007 avait le statut d'entreprises individuelles, et que seule une seule petite partie d'entre elles pourrait se classer dans la catégorie des auto entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui ont créé une activité pour répondre à un besoin immédiat.
Or, le désir d'entreprendre est aujourd'hui très important dans la population active française, et notamment dans ses composantes les plus éloignées du marché du travail. La mission commune d'information ne peut, à cet égard, que conforter les préconisations avancées dans le rapport Hurel et consistant à :
- créer les conditions pour qu'il soit simple de créer et de cesser une activité économique indépendante . Il devrait être rendu possible de pouvoir lancer rapidement une activité par une simple déclaration, et de pouvoir y mettre fin tout aussi aisément. L'appui des centres de formalités des entreprises et la mise en place d'un « kit du créateur d'entreprise » seraient, à cet égard, des mesures concrètes fort utiles ;
- simplifier le paiement des prélèvements obligatoires . L'idée d'instaurer une forme de prélèvement à la source pour le paiement des prélèvements sociaux et fiscaux de l'auto entrepreneur mériterait d'être approfondie. Toute personne créant une nouvelle activité devrait être exonérée de charges sociales et fiscales tant qu'elle n'a pas encaissé de revenus. Et tout salarié souhaitant travailler quelques heures, quelques jours ou quelques semaines à son compte ne devrait payer de charges que s'il enregistre effectivement des recettes ;
- lever les barrières légales et réglementaires à la création d'entreprises indépendantes . L'assouplissement du régime de la qualification professionnelle artisanale pourrait utilement être examiné, afin que ne soit pas contrainte l'offre dans les secteurs où la demande est vive, comme c'est le cas dans celui des services à la personne. Les conditions d'installation d'une activité professionnelle dans son propre logement gagneraient à être allégées ;
- protéger le patrimoine personnel de l'auto entrepreneur . En créant un véritable patrimoine de l'entreprise individuelle, réceptacle des capitaux propres dédiés, il permettrait d'introduire en droit français le concept de « patrimoine professionnel affecté ».
F. MUSCLER L'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
L'IAE souffre d'un manque flagrant de données statistiques quant à ses publics et d'un suivi de ses performances déficient. Afin de mieux appréhender son périmètre d'action, ses effets et les objectifs pouvant lui être fixés, il convient d' organiser les conditions de sa meilleure connaissance statistique et de l' évaluer sur la base d'indicateurs rendant compte de sa triple mission d'insertion socioprofessionnelle, de production de service et de développement des territoires.
Par ailleurs, le système d'agrément de l'IAE ne joue pas son rôle de filtre et d'identification des publics. Il s'agirait donc de généraliser et de renforcer l'agrément des publics pour mieux les identifier, tout en le simplifiant. Il serait opportun que soient harmonisées sur le territoire les procédures d'agrément et de diagnostic de la personne et que les bases de ce diagnostic et de prescription soient concertées entre le service public de l'emploi, les prescripteurs et les structures de l'IAE.
Dans la lignée de l'uniformisation préconisée par ailleurs en matière de contrats aidés, il y aurait lieu de simplifier le cadre d'emploi des salariés en insertion et l'unifier sur le modèle du CDD de droit commun , avec l'ensemble des droits sociaux afférents, en l'adaptant à la situation de certaines catégories de personnes sans emploi.
Enfin, il semble prioritaire de renforcer le cadre de gouvernance territoriale de l'IAE . Ce cadre serait rénové par la loi en prévoyant notamment des conventions territoriales d'objectif et de moyen de l'IAE liant les différents financeurs (Etat et collectivités territoriales) dans le cadre d'une programmation budgétaire pluriannuelle. La maille territoriale de cette convention pourrait être la région , en prévoyant une déclinaison départementale de la convention régionale.
G. RENFORCER L'EFFICACITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI
Afin de « ne laisser personne sur le bord de la route », il ne serait pas inutile d' affirmer le principe de la vocation universelle du SPE qui devra accueillir tous les publics , y compris les jeunes et les bénéficiaires des minima sociaux, même lorsque les personnes concernées ne sont pas inscrites à l'ANPE.
Il conviendrait par ailleurs, en vue d'offrir à tous, et notamment aux publics les plus précaires, un accueil simplifié et mieux adapté à leurs besoins, d' accélérer la mise en oeuvre de la réforme du SPE , qui tarde à s'étendre. La création des « guichets uniques » et un suivi personnalisé du parcours de chaque demandeur d'emploi devraient être deux axes prioritaires de sa mise en oeuvre.
Enfin, il serait utile de veiller à établir des relations plus étroites entre les agences de l'ANPE et les structures sociales en charge de l'insertion afin de réorienter au mieux et au plus vite les demandeurs d'emploi manifestement inadaptés à un retour immédiat sur le marché du travail.
H. RENDRE PLUS OPÉRANTS LES CONTRATS AIDÉS ET DE PROFESSIONNALISATION
? La simplification de l'organisation et de la gestion des contrats aidés doit permettre d'offrir à ses bénéficiaires -personnes aidées comme employeurs- des instruments utilisables de façon uniforme quel que soit le statut des publics cibles. Dans cette optique, il serait utile de mettre enfin en place un véritable contrat unique d'insertion , fusionnant l'ensemble des contrats aidés en un dispositif commun, ouvert à tous les publics, modulable en fonction des besoins du salarié et de l'employeur et permettant d'assurer une meilleure transition vers un emploi durable.
? Si les contrats de professionnalisation sont reconnus comme des outils particulièrement adaptés pour l'accès à l'emploi durable, ils bénéficient peu aux adultes et jeunes sans qualification, et leur développement n'est pas assez stimulé.
Il conviendrait donc de développer le contrat de professionnalisation , reconnu pour son efficacité dans l'accès à un emploi durable, au bénéfice des demandeurs d'emploi les plus éloignés du marché du travail que sont les adultes et les jeunes sans qualification . Ces contrats constituent en effet un outil particulièrement adapté pour répondre aux besoins de main d'oeuvre dans certains secteurs où elle est insuffisante.
|
RÉCAPITULATION DES PROPOSITIONS 1. Préconisations générales - Passer d'une logique administrative à une logique contractuelle, en sollicitant et obtenant l'adhésion de tous les acteurs à une stratégie d'insertion déclinant des objectifs, des moyens et les outils d'évaluation correspondants ; - pour toute aide versée ou toute action mise en oeuvre, agir au plus près des publics visés, en fonction des caractéristiques et des besoins particuliers des personnes, et non de leurs statuts. 2. Renforcer la formation professionnelle en lien avec l'emploi - Inciter les entreprises à mettre en place des instruments de formation adaptés au profil de leurs travailleurs les moins qualifiés ; - rendre la formation des chômeurs obligatoire ; - développer les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification ; - soutenir l'établissement public d'insertion de la Défense (EPIDe) ; - rendre plus attractif le recours à la validation des acquis de l'expérience. 3. Soutenir les associations dans leur action pour l'insertion professionnelle - Mettre en place le chèque associatif ; - créer un statut adapté à la vie en communauté pour les personnes qui ne souhaitent pas intégrer le monde de l'entreprise. 4. Mobiliser les entreprises - Réaffirmer la place première des entreprises dans l'insertion ; - renforcer les liens entre entreprise et IAE ; - développer le tutorat et le parrainage ; 5. Encourager le travail indépendant Conforter les préconisations avancées dans le rapport Hurel et consistant à : - créer les conditions pour qu'il soit simple de créer et de cesser une activité économique indépendante ; - simplifier le paiement des prélèvements obligatoires ; - lever les barrières légales et réglementaires à la création d'entreprises indépendantes ; - protéger le patrimoine personnel de l'auto entrepreneur. 6. Muscler l'insertion par l'activité économique - Améliorer la collecte de données statistiques et le suivi des performances ; - généraliser et renforcer l'agrément des publics pour mieux les identifier ; - simplifier le cadre d'emploi des salariés en insertion et l'unifier sur le modèle du CDD de droit commun, avec l'ensemble des droits sociaux afférents, en l'adaptant à la situation de certaines catégories de personnes sans emploi ; - renforcer le cadre de gouvernance territoriale de l'IAE. 7. Renforcer l'efficacité du service public de l'emploi - Affirmer le principe de la vocation universelle du SPE qui devra accueillir tous les publics, y compris les jeunes et les bénéficiaires des minima sociaux, même lorsque les personnes concernées ne sont pas inscrites à l'ANPE ; - accélérer la mise en oeuvre de la réforme du SPE ; - veiller à établir des relations plus étroites entre les agences de l'ANPE et les structures sociales en charge de l'insertion. 8. Rendre plus opérants les contrats aidés et de professionnalisation - Fusionner l'ensemble des contrats aidés en un contrat unique d'insertion, ouvert à tous les publics et modulable en fonction des besoins du salarié et de l'employeur et permettant d'assurer une meilleure transition vers un emploi durable ; - développer le contrat de professionnalisation au bénéfice des demandeurs d'emploi les plus éloignés du marché du travail que sont les adultes et les jeunes sans qualification. |
TITRE V - LA GOUVERNANCE : UNE COMPLEXITE EXCESSIVE
Les chapitres précédents, qui établissent un état des lieux des principaux domaines de la lutte contre les exclusions, mettent aussi en exergue la grande complexité des politiques menées dans ce secteur. Celle-ci est due en grande partie à la superposition des acteurs et des dispositifs, qui ne permet pas de distinguer une hiérarchie claire des responsabilités. En outre, la loi de 1998 de lutte contre les exclusions spécifie que la lutte contre la pauvreté est une obligation nationale qui mobilise tous les acteurs, même s'ils ne sont pas intégrés dans le réseau de l'administration publique. Se pose ainsi la question de la gouvernance du système d'insertion.
Les pouvoirs publics ont certes tenté, au cours des vingt dernières années, de répondre à cette question par la décentralisation de l'action sociale. Cependant, il ressort des travaux de la mission que cette décentralisation n'a pas été menée avec assez de constance ni de rationalité (par exemple en respectant le principe des blocs de compétence) pour qu'une organisation simple puisse en résulter.
La lutte contre la pauvreté, malgré la désignation d'un chef de file, le département , reste donc une politique complexe et éclatée, au détriment des acteurs de terrain qui la mettent en oeuvre, comme de ceux qui sont censés en bénéficier.
I. LA REPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES : UNE DÉCENTRALISATION INACHEVEE
L'Etat n'a décentralisé qu'une partie de ses compétences d'action sociale au département. En outre, il a transféré à une autre collectivité territoriale, la région, des compétences dont la mobilisation est, elle aussi, nécessaire aux politiques d'insertion. Le résultat de ces transferts successifs et incomplets est un système mixte, mi-centralisé mi-décentralisé, avec deux pilotages parallèles (Etat et conseil général) et peu de lisibilité.
A. DU TRANSFERT DE L'AIDE SOCIALE À L' « ACTE II » DE LA DÉCENTRALISATION : UNE POLITIQUE PARTIELLEMENT DÉCENTRALISÉE
1. Des lois de décentralisation à la loi de 1998 sur les exclusions : une répartition déjà complexe
a) Les lois de 1983 et 1986
Les lois du 22 juillet 1983 et du 6 janvier 1986 ont attribué au département la compétence de droit commun en matière d'aide sociale , en lui confiant la responsabilité et le financement :
- du service départemental d'action sociale,
- du service d'aide sociale à l'enfance,
- de la protection sanitaire de la famille et de l'enfance,
- de la lutte contre les fléaux sociaux.
Le conseil général a ainsi été chargé de l'organisation et de la distribution des prestations sociales relevant du département, ainsi que de l'adoption d'un règlement départemental d'aide sociale, définissant les règles d'attribution des prestations, et des schémas d'organisation sociale et médico-sociale. L'Etat conserve cependant de larges compétences sociales, notamment pour les prestations se rattachant à l'idée de solidarité nationale : prise en charge des personnes sans domicile de secours, aide médicale en faveur des étrangers et des réfugiés, allocation simple aux personnes âgées, allocation aux adultes handicapés et allocation différentielle aux personnes handicapées.
b) De la création du RMI à la loi sur l'exclusion de 1998
Les compétences du conseil général en matière d'insertion ont été renforcées par la loi du 1er décembre 1988 instituant le revenu minimum d'insertion (RMI). Or, le RMI enfreint dès son origine le principe de la décentralisation par blocs de compétences. En effet, le financement du RMI est assuré par l'État, tandis que les actions d'insertion des bénéficiaires font l'objet d'un co-pilotage Etat-conseil général.
Le conseil départemental d'insertion (CDI), instance partenariale coprésidée par le préfet et le président du conseil général et réunissant les présidents des commissions locales d'insertion (CLI), des représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des associations, est chargé de définir les grands axes de la politique d'insertion conduite par le département.
En outre, la loi prévoit l'obligation pour les départements de consacrer à l'insertion des bénéficiaires du RMI 20 % (réduits à 17 % lors de l'instauration de la couverture maladie universelle en 2000) des dépenses effectuées au titre de l'allocation.
Parallèlement, la gestion des dossiers et le paiement du RMI sont confiés à d'autres partenaires : les caisses d'allocations familiales (CAF) et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) . D'autres acteurs tels que les centres communaux d'action sociale (CCAS) et les services sociaux départementaux, ainsi que les associations, assurent la réception des demandes et l'instruction des dossiers.
L'organisation de la gestion de la prestation est ainsi quelque peu paradoxale. Comme le souligne le rapport de 1992 de la commission nationale d'évaluation du RMI 202 ( * ) , « le RMI a contredit l'esprit des lois de décentralisation en pratiquant d'abord une certaine inversion des compétences : l'Etat verse une allocation qui n'est pas étrangère à l'aide sociale, et le département est invité à intervenir dans le soutien à l'insertion, qui passe surtout par l'emploi, compétence revenant à l'Etat. Surtout, il est en contradiction avec la théorie des « blocs de compétences » en mettant en oeuvre une compétence cogérée, l'insertion, dans laquelle l'Etat est un partenaire « obligé » du conseil général, alors que l'objectif d'autonomie des différentes collectivités -avec son corollaire : « qui décide paie »- était essentiel dans les lois de décentralisation ».
La bonne gestion du RMI implique ainsi la coordination des actions de plusieurs acteurs. En particulier, la collaboration entre l'Etat et les services du département aurait du être étroite pour que le volet « insertion » accompagne de manière efficace l'allocation. Or, le rapport d'évaluation souligne que, d'emblée, « le partenariat entre l'État et le conseil général n'a pas toujours fonctionné de manière satisfaisante ».
La loi de 1992 203 ( * ) relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle a cependant pérennisé ce dispositif, tout en élargissant le rôle des commissions locales d'insertion (CLI). Par ailleurs, la loi de 1998 204 ( * ) (corriger format de l'indice 2 de note en bas de page) sur l'exclusion a tenté d'améliorer la coordination au niveau local et a créé un organisme national d'observation et de cohérence , l'observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale (l'ONPES), sans remettre en cause la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités.
Enfin, parallèlement à ce transfert partiel de compétence en matière d'insertion, des lois de 1997 et 2001 205 ( * ) ont confié au conseil général la prestation spécifique dépendance pour les personnes âgées puis l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).
2. L'acte II de la décentralisation
a) La décentralisation du RMI par la loi de 2003
La question de la décentralisation du revenu minimum d'insertion s'est posée dès l'instauration du dispositif puis de manière récurrente, la hausse continue du nombre d'allocataires démontrant l'échec relatif des actions d'insertion professionnelle et la nécessité de réformer le dispositif existant. Cette réforme n'a cependant eu lieu qu'à l'occasion de «l'acte II » de la décentralisation.
La loi de 2003 portant décentralisation du RMI 206 ( * ) préserve ainsi le caractère national de la prestation et de son montant, mais décentralise sa gestion :
- le financement du dispositif est transféré aux départements;
- le co-pilotage de l'insertion entre l'État et le département, par le biais du CDI et des CLI, est supprimé au profit du président du conseil général . Le CDI, parfois critiqué pour n'avoir pas su mettre en place une véritable stratégie d'insertion au niveau départemental, est ainsi désormais présidé par le seul président du conseil général et n'a plus qu'un rôle consultatif, le PDI étant désormais adopté directement par le conseil général;
- l'autorité du conseil général sur les commissions locales d'insertion (CLI) est renforcée , le législateur ayant considéré que les CLI avaient parfois privilégié leurs compétences en matière de contrat d'insertion au détriment de l'élaboration de l'offre d'insertion. La loi de 2003 recentre ainsi l'activité des CLI sur la connaissance des besoins locaux en matière d'insertion et sur la construction de l'offre d'insertion ;
- les décisions individuelles concernant le droit à l'allocation sont désormais de la compétence du président du conseil général et la CLI ne donne plus son avis que sur les suspensions du versement de l'allocation ;
- si les CLI élaborent toujours le programme local d'insertion (PLI) qui définit les orientations d'insertion locales, recense les moyens correspondants et prévoit les actions d'insertion, il s'agit uniquement de propositions qui doivent être approuvées par le président du conseil général ;
- la loi donne aux départements la possibilité d'organiser librement le dispositif d'instruction des demandes d'allocation . Le département peut ainsi ouvrir aux CAF et aux caisses de MSA volontaires, à travers des procédures d'agrément, la possibilité d'instruire les demandes de RMI, et/ou leur déléguer certaines décisions individuelles relatives à l'allocation. Le département est désormais obligé de désigner un référent pour chaque allocataire, qui sera chargé de son suivi tout au cours du processus d'insertion ;
- enfin, après des débats très vifs, le Sénat a réussi à imposer la suppression de la clause de 17 % des dépenses d'allocations attribuées à l'insertion. Selon le président Michel Mercier, lors de l'examen de la loi, « il faut faire confiance aux collectivités territoriales et leur laisser une certaine liberté quitte, ensuite, évaluer et, éventuellement, à corriger leur action ».
b) La loi du 13 août 2004 : le département « chef de file » de l'action sociale
Le transfert du RMI représente le noyau de la décentralisation de l'action sociale mais ne constitue encore qu'une mesure particulière et limitée. L'article 49 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales va plus loin en affirmant le rôle de chef de file au sens de l'article 72 de la Constitution du département en matière sociale :
« Le département définit et met en oeuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent ».
Cette nouvelle disposition fait du conseil général le chef de file de l'ensemble des politiques sociales . En effet, d'une part le terme d'action sociale doit être compris dans son acception la plus large, et non par opposition avec celui d'aide sociale, c'est-à-dire qu'il comprend à la fois les prestations obligatoires et les actions facultatives. D'autre part le Sénat a élargi le rôle de coordination du département à l'ensemble des actions entreprises en matière sociale , et non, comme le prévoyait la rédaction initiale, aux seules actions menées en matière de prévention et de lutte contre les exclusions.
Dans le même esprit, la loi de 2004 transfère en outre aux départements :
- le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) 207 ( * ) chargé d'accorder des aides financières aux personnes dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations financières locatives, tout en le maintenant au sein du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) co-élaboré par l'État et par le département;
- le Fonds d'aide aux jeunes (FAJ) 208 ( * ) , auparavant cogéré et cofinancé par l'Etat et le département, et qui peut attribuer des aides aux jeunes en difficulté ;
- la compétence de planification en matière sociale. Le conseil général adopte en effet, après consultation du préfet, le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale qui dresse le bilan de l'offre sociale, définit les orientations nouvelles et recherche la cohérence des équipements.
c) La décentralisation de la formation professionnelle au profit des régions
L'Etat a également transféré aux régions certaines compétences nécessaires aux politiques de lutte conte l'exclusion.
La loi du 7 janvier 1983 a confié à la région une compétence générale en matière de formation professionnelle et d'apprentissage, renforcée par des lois successives 209 ( * ) . Cependant, le rôle de l'Etat est resté prédominant du fait de ses compétences en matière d'orientations prioritaires, de contenu des formations, de filières, de diplômes, d'actions de formation relevant de la solidarité nationale (détenus, handicapés), ainsi que du fait de sa tutelle sur l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA).
La loi de 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a cependant accru de manière importante les compétences des régions en matière de formation professionnelle, leur donnant ainsi davantage d'instruments pour participer aux politiques d'insertion professionnelle .
En effet, les régions deviennent pleinement responsables de l'organisation des actions de formation professionnelle des demandeurs d'emploi ainsi que pour les jeunes de moins de 26 ans rencontrant de grandes difficultés d'insertion professionnelle .
Par ailleurs, la loi prévoit le transfert, au plus tard au 31 décembre 2008 (à la demande des régions, ce transfert n'interviendra finalement pas avant le 31 décembre 2009), de la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de l'AFPA.
Les régions doivent en outre désormais organiser et coordonner, en concertation avec l'Etat et les partenaires sociaux, l'ensemble de l'offre de formation grâce au Plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes et des adultes (PRDFP) ainsi que le réseau des centres d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience (VAE). La loi de programmation pour la cohésion sociale de 2005 instaure enfin un contrat d'objectifs et de moyens entre l'Etat, les régions et les organismes de formation, afin de développer l'apprentissage.
Par ailleurs, les actions des régions en matière d'insertion peuvent aussi s'appuyer sur leurs compétences d'aménagement du territoire, de planification économique et d'aides aux entreprises, renforcées par la loi du 13 août 2004, ainsi que sur leurs compétences en matière de politiques des transports régionaux.
B. LE MAINTIEN DE FORTES COMPÉTENCES DE L'ETAT ET LA QUESTION RÉCURRENTE DU FINANCEMENT DES COMPÉTENCES DÉCENTRALISÉES
1. L'Etat conserve de nombreuses compétences en matière d'action sociale
a) La législation, la réglementation et la programmation budgétaire
Au sein des ministères ayant en charge les affaires sociales, la direction générale de l'action sociale (DGAS) , qui s'appuie notamment sur les travaux du conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (CNLE) et du comiteì interministériel de lutte contre l'exclusion (CILE), continue à avoir en charge la législation et la réglementation concernant le taux minimum des prestations d'aide sociale et les conditions d'accès à celle-ci et à piloter la politique de lutte contre l'exclusion de l'Etat . Elle apporte également un soutien financier aux grandes associations et réseaux d'associations intervenant dans le champ social.
|
Le conseil national des politiques de lutte contre la pauvretéì et l'exclusion sociale (CNLE) Créé en 1992, Le CNLE est l'outil partenarial principal entre l'Etat et les autres acteurs des politiques d'inclusion sociale. Il a vu ses attributions renforcées par la loi du 29 juillet 1998. Le CNLE : -donne un avis au gouvernement sur toutes les questions de portée générale qui concernent la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ; -assure une concertation entre les pouvoirs publics et les associations, organisations et personnalités qualifiées qui agissent dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ; -peut être consulté par le Premier ministre sur les projets de texte législatif ou réglementaire et sur les programmes d'action relatifs à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ; -peut être saisi pour avis par les membres du Gouvernement dans les domaines qui relèvent de leur compétence ; -peut, de sa propre initiative, proposer aux pouvoirs publics les mesures qui lui paraissent de nature à améliorer la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Le CNLE est un lieu d'échanges et de dialogue entre ses différentes composantes et joue un rôle de conseil et d'initiateur. Il participe à la réflexion et à l'organisation de tous les documents et évènements relatifs à l'inclusion sociale dont l'élaboration des plans nationaux d'actions, du DPT (document de politique transversale) « inclusion sociale » et les conférences de prévention et de lutte contre l'exclusion. |
Par ailleurs, la programmation budgétaire des politiques de lutte contre l'exclusion révèle l'importance persistante du rôle de l'Etat dans ce domaine, malgré la décentralisation.
Ainsi, dans le cadre de la nouvelle présentation budgétaire issue de la loi organique sur les lois de finances LOLF, les interventions sociales de l'Etat sont-elles regroupées dans une mission « solidarité, insertion et égalité des chances » qui comprend sept programmes pour environ 12 milliards d'euros (projet de loi de finances pour 2008). Trois de ces programmes concernent plus directement la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et représentent environ 2,3 milliards d'euros :
- le programme « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables » ; les axes stratégiques de ce programme répondent aux priorités définies par le Comité interministériel de lutte contre l'exclusion du 12 mai 2006 qui complètent la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
- le programme « Lutte contre la pauvreté : expérimentation » (qui correspond à l'expérimentation du revenu de solidarité active) ;
- le programme « Actions en faveurs des familles vulnérables ».
A titre de comparaison, les dépenses de RMI représentent quant à elles environ 7 milliards d'euros et l'ensemble des dépenses d'aide sociale des départements, RMI compris, environ 27,75 milliards d'euros en 2006.
Il existe en outre un document de politique transversale (DPT) « inclusion sociale » regroupant tous les programmes de l'Etat concourant à cet objectif (santé publique et prévention, aide à l'accès au logement, accès et retour à l'emploi, enseignement scolaire...). En cohérence avec les exercices européens, le périmètre du DPT « inclusion sociale » reprend celui du plan national d'action pour l'inclusion sociale (PNAI), rédigé par la DGAS et soumis à la Commission européenne.
Chacun des programmes liés à la lutte contre l'exclusion ainsi que le DPT comportent un projet annuel de performance assorti d'objectifs et d'indicateurs.
La politique d'action sociale de l'Etat représente ainsi toujours un volume budgétaire considérable comparé aux dépenses sociales des départements, et son pilotage est totalement autonome par rapport aux orientations stratégiques déterminées par les conseils généraux.
|
Les politiques de l'Etat en matière de lutte contre l'exclusion 1-Dans le programme « prévention de l'exclusion et insertion des personnes les plus vulnérables » : -l'amélioration de l'accès aux droits sociaux avec la création des Pôles d`accueil en réseau pour l`accès aux droits sociaux (PARADS) ; -l'insertion des jeunes avec les points accueil écoute jeunes (PAEJ) ; -la mise en oeuvre du droit au logement ; -les mesures d'appui social individualisé (ASI) ; -l'insertion par l'activité économique (IAE) ; -l'hébergement d'urgence, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les maisons-relais ; -l'aide aux rapatriés. 2-Dans le programme « lutte contre la pauvreté : expérimentations » : le RSA. 3-Dans le programme « action en faveur des familles vulnérables » : -l'allocation de parent isolé (API); -les 250 établissements d'information, de conseil conjugal et familial (EICCF) ; -les réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents (REEAP) ; -les actions d'accompagnement à la scolarité. 4-Dans le programme handicap et dépendance : -l'AAH ; -l'aide aux personnes âgées. 5-Enfin dans le programme protection maladie : -la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC); -l'aide médicale d'Etat (AME). |
b) La déclinaison au niveau local des politiques de l'Etat
Malgré la décentralisation, l'Etat dispose toujours de ses services déconcentrés chargés de l'aide sociale et de la lutte contre l'exclusion, ainsi que d'institutions de coordination locale des acteurs de l'insertion :
- les directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) sont responsables de la mise en oeuvre des politiques sanitaire, médico-sociale et sociale au niveau régional, comprenant notamment le contrôle de l'application de la législation et de la gestion des organismes de protection sociale et l'évaluation de ces politiques;
- l'échelon opérationnel est constitué par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDAS) . Le décret du 6 décembre 1994 210 ( * ) prévoit que les DDASS assurent, sous l'autorité du préfet, la responsabilité de la mise en oeuvre des politiques sanitaire, médico-sociale et sociale définies par les pouvoirs publics. Cependant, cet échelon a vu ses compétences se réduire considérablement par suite des transferts au conseil général ;
- le pilotage ainsi que l'animation sur les territoires des politiques de prévention et de lutte contre l'exclusion s'appuient depuis 2007 sur les commissions départementales de la cohésion sociale (CDCS) , dont le rôle est défini par une circulaire de 2007 211 ( * ) . Cette circulaire rappelle aux services de l'Etat que le département est bien le chef de file de l'aide sociale et que l'Etat doit laisser aux autorités locales « le maximum de marge de manoeuvre ». L'Etat doit en outre « mieux associer les collectivités à l'élaboration des politiques qui les concernent ». Parallèlement cependant, l'Etat garde, par le biais des CDCS, un rôle d'impulsion et de coordination locale qui semble à première vue concurrencer le rôle de chef de file du conseil général, d'autant qu'il existe deux autres commissions sociales de l'Etat dites « proches » de la CDCS : la CDEI (commission départementale de l'emploi et de l'insertion) et la commission départementale pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté (COPEC).
Ainsi, bien que le département soit désormais, dans les textes, le chef de file de l'insertion, l'Etat pilote toujours une politique de lutte contre la pauvreté avec ses propres objectif et indicateurs , en s'appuyant sur ses propres services centraux et déconcentrés, avec des organes de coordination locaux parallèles à ceux des départements.
2. La « querelle » du financement du RMI et des contrats aidés
a) L'écart entre les recettes et les dépenses du RMI
La loi portant décentralisation du RMI de 2003, votée après l'adoption de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 212 ( * ) , s'inscrit dans le cadre des dispositions du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, qui prévoit une compensation des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales.
L'article 4 de la loi de 2003 précise ainsi que « les charges résultant, pour les départements, des transferts et créations de compétences réalisés par la présente loi sont compensées par l'attribution de ressources constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'État dans les conditions fixées par la loi de finances ». La loi de finances pour 2004 a octroyé aux départements une fraction de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP). Cependant, cette part de la TIPP (fixée en 2003 à la somme de 4,941 milliards d'euros) ne couvre qu'environ 80% des dépenses engagées au titre du RMI en 2007 , en partie en raison de la hausse du nombre de bénéficiaires du RMI depuis 2003 (environ 200 000 allocataires de plus entre 2003 et 2006).
b) Les compensations exceptionnelles versées par l'Etat
Pour tenir compte de la croissance des dépenses de RMI en 2004, l'Etat a versé une subvention exceptionnelle de 457 millions d'euros. La dépense afférente au RMI ayant continué d'augmenter plus vite que la TIPP en 2005, le Gouvernement a créé, lors de l'examen de la loi de finances pour 2006 et pour deux ans, un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) doté de 100 millions d'euros en 2006 et de 80 millions d'euros en 2007, afin de compenser, en partie, cet écart.
En 2007, à l'issue d'une concertation avec l'assemblée des départements de France (ADF), le dispositif a été amélioré sur deux points : le FMDI est créé non plus pour deux ans mais pour trois ans (de 2006 à 2008) ; le fonds dispose annuellement de ressources qui ont quintuplé et qui atteignent donc 500 millions d'euros par an .
|
Le FMDI est composé de 3 parts : - la première part représente 50 % du fonds (soit 250 M€) en 2006 et 40 % ensuite. Elle est versée en fonction du niveau de dépenses de RMI, et a donc vocation à combler partiellement le « déficit » effectif que chaque département enregistre entre son droit à compensation et le montant réel des allocations versées ; - la deuxième part représente 30 % du fonds (soit 150 M€, d'où il faudra retrancher une quote-part pour les DOM). Elle est destinée à la péréquation. Les inégalités entre départements sont mesurées par un indice synthétique de ressources et de charges. Pour les ressources, il s'agit du potentiel financier par habitant. Pour les charges, il s'agit de la proportion de bénéficiaires du RMI dans la population ; - la troisième part représente initialement 20 % du fonds (soit 100 M€ en 2007) puis 30% ensuite). Elle est dite d'« insertion », car il s'agit d'une dotation destinée à encourager les efforts accomplis par les départements. Elle est versée en fonction du nombre de contrats d'avenir, de CI-RMA et de mesures d'intéressement observés au 31 décembre de l'année précédente. |
Par ailleurs, en application de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), la loi de finances pour 2006 a créé un compte de concours financiers intitulé « avances aux collectivités territoriales ». Ce compte verse par douzième, et par avance, le produit des impôts recouvrés par l'Etat au profit des collectivités territoriales. La part de TIPP revenant aux départements y a été incluse, de sorte qu'il est reversé environ 412 millions d'euros par mois aux départements.
Malgré ces améliorations, le FMDI ne permet pas de compenser l'écart d'environ 1 milliard d'euros entre les recettes de TIPP et les dépenses d'allocations. Or, les départements n'ont aucune maîtrise du montant de l'allocation, celle-ci ayant été revalorisée par l'Etat d'environ 7 % entre 2003 et 2007, ni de ses critères d'attribution. En outre, la TIPP est un impôt non dynamique dont le produit stagne et devrait décliner en raison des économies d'énergie.
On constate certes depuis 2006 une baisse du nombre de bénéficiaires du RMI (-0,8 % en 2006, -6,6 % entre 2007 et 2008) tandis que le nombre de CI-RMA et de Contrats d'avenir a augmenté pour atteindre 78 000 personnes en décembre 2007, soit une hausse de 20,4 % en un an.
Cependant, comme l'a remarqué M. Michel Mercier, président du Conseil général du Rhône, lors du déplacement de la délégation dans le Rhône, ce mouvement ne s'est pas traduit en 2006 par une baisse des dépenses des départements au titre du RMI . Cette divergence s'explique, selon la caisse nationale d'allocations familiales (CNAF), par l'augmentation du montant moyen perçu par les allocataires, due notamment à la revalorisation du RMI, ainsi qu'à des effets de structure de la population des allocataires, le montant du RMI variant en fonction de la situation familiale des bénéficiaires.
La question est en outre désormais posée du financement du nouveau revenu de solidarité active (RSA), qui fusionnera sans doute le RMI, l'allocation de parent isolé (API), et la prime pour l'emploi (PPE).
C. LA MULTIPLICITÉ DES ORGANISMES D'OBSERVATION ET D'ÉVALUATION
De nombreux organismes d'observation et d'évaluation effectuent des analyses, des enquêtes et des évaluations dans le domaine de la lutte contre l'exclusion : Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale, Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale (ONPES), Observatoire national de l'action sociale décentralisée (ODAS), Centre d'analyse stratégique (CAS), Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), Inspection générale des affaires sociales (IGAS), Observatoire national des zones urbaines sensibles (ONZUS), Observatoire des inégalités, Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC), Centre d'études et de recherches sur les qualifications (CEREQ), etc.
Ainsi, selon Mme Agnès de Fleurieu, présidente de l'ONPES, « il existe une multitude d'observatoires et d'observations. Ainsi, l'observatoire national des ZUS a-t-il pour champ d'étude l'exclusion urbaine, tandis que nous nous intéressons à l'exclusion dans sa globalité. Nous devrions réfléchir à la mise en place de regroupements donnant plus de poids à notre mission dans ces domaines. »
Certes, l'ONPES, a spécifiquement reçu la mission de rassembler les données relatives aux situations de pauvreté, de précarité et d'exclusion et de contribuer au développement de la connaissance de ces phénomènes en faisant réaliser des travaux d'études, de recherche et d'évaluation.
Cependant, l'ONPES ne dispose pas de moyens propres . Comme l'a noté Mme Agnès de Fleurieu devant la mission, « il (l'ONPES) ne dispose pas de moyens identifiés en tant que tels. La distinction entre les études demandées par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) et les études spécifiquement demandées par l'Observatoire est parfois difficile à effectuer ». L'ONPES ne peut donc pas jouer pleinement son rôle d'observatoire de référence en matière de pauvreté et d'exclusion.
En outre, certains acteurs de l'insertion recueillent et analysent eux-mêmes des données concernant les publics auxquels ils s'adressent. Ainsi, les CCAS doivent-ils obligatoirement réaliser une « analyse des besoins sociaux » en application d'un décret du 6 mai 1995 213 ( * ) . Les données ainsi recueillies ne sont cependant pas systématiquement consolidées à des échelles plus larges, par exemple au niveau du département.
La connaissance des publics en difficulté souffre ainsi d'une certaine dispersion, au détriment de l'élaboration des politiques d'insertion et de leur évaluation. Dans certains domaines, le manque de connaissances est particulièrement dommageable : les pouvoirs publics, par exemple, ne disposent pas de données récentes et fiables sur le nombre de sans-abri , ce qui rend une évaluation de l'efficacité des politiques récentes menées dans ce domaine quasiment impossible.
D. LES FINANCEMENTS EUROPÉENS
Depuis 2000, la France s'inscrit dans la stratégie européenne pour l'inclusion sociale qui a fixé un objectif de réduction significative de la pauvreté et de l'exclusion sociale à l'horizon 2010. La DGAS rédige donc un plan national d'action pour l'inclusion sociale (PNAI) soumis à la Commission européenne.
Par ailleurs, notre pays bénéficie du fonds social européen (FSE), notamment dans le cadre de l'objectif 3, doté pour la France de 4,713 milliards d'euros et qui vise à soutenir l'adaptation et la modernisation des politiques et des systèmes d'éducation, de formation et d'emploi . En particulier, l'axe 2 de cet objectif, intitulé « égalité des chances, intégration sociale», permet de faire bénéficier des fonds européens des projets portés par des conseils généraux, d'autres collectivités locales, des plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE) et des associations.
A cet égard, certaines personnalités auditionnées par la mission ont vivement regretté que la France n'ait pas consommé tous les crédits dont elle disposait pour la période de programmation 2000-2006. Plus de 300 millions d'euros seraient ainsi définitivement perdus pour les politiques d'insertion .
L'Alliance villes emploi a souligné, par la voix de sa déléguée générale, Mme Marie-Pierre Establie, l'incongruité de cette situation. « Ce qui est surprenant est que la France annonce avec satisfaction qu'elle consommera 95 % des crédits européens, en oubliant de préciser que les 5 % restants représentent 350 millions d'euros. Cette somme correspond à 80 % du coût d'une programmation de 200 PLIE sur une durée de 6 ans. Si elle avait été utilisée, 150.000 personnes auraient pu retrouver un emploi. (...) cette situation est inacceptable ».
II. UNE GOUVERNANCE TERRITORIALE ILLISIBLE
La gouvernance territoriale de la lutte contre la pauvreté et plus généralement de l'action sociale, c'est à dire l'organisation des relations entre les différentes institutions ou acteurs ayant des compétences en la matière, est très complexe du fait du grand nombre d'intervenants du secteur, du chevauchement de leurs compétences qui se sont ajoutées au fil des strates législatives et de la persistance des organismes et des dispositifs même s'ils se sont montrés inefficaces.
Néanmoins, au cours des dernières années et en particulier depuis l'acte II de la décentralisation, cette gouvernance a été théoriquement simplifiée puisqu'un acteur, le département, a été désigné comme chef de file de l'action sociale. C'est donc la réussite de cette nouvelle organisation qu'il convient d'évaluer.
A. L'AFFIRMATION DIFFICILE DU CONSEIL GÉNÉRAL COMME CHEF DE FILE DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION
1. L'élaboration de la stratégie d'insertion des départements
De 2002 à 2005, le nombre d'allocataires du RMI a augmenté de 4,7% en moyenne par an alors qu'il avait fortement diminué au cours de la période 2000-2001. Compte-tenu des incertitudes sur la compensation des dépenses de financement du RMI, les départements ont été contraints de s'approprier rapidement leurs nouvelles compétences pour tenter de maîtriser cette augmentation. Ils ont ainsi renforcé la dimension d'insertion professionnelle de leur politique afin d'augmenter le taux de sortie du RMI .
Pour élaborer leur PDI, comprenant leurs orientations stratégiques en matière d'insertion, la plupart des départements se sont appuyés sur les programmes locaux d'insertion (PLI), dispositifs locaux d'insertion réalisés au niveau infra-départemental par les commissions locales d'insertion (CLI). Ils ont également consulté leurs partenaires dans le domaine de l'insertion . Une étude de l'ODAS 214 ( * ) permet d'effectuer le recensement de ces partenaires et donne un premier aperçu de la complexité de la gouvernance départementale de l'insertion et de l'effort de coordination du département.
Ainsi, ont participé à l'élaboration des PDI :
- dans la plupart des départements : l'ANPE, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), les associations, les CAF et le secteur de l'IAE;
- dans 70 % des départements : les collectivités territoriales et les associations;
- dans la moitié des départements : les CCAS, les PLIE et les branches professionnelles ;
- les syndicats dans 17% des départements et les bénéficiaires du RMI dans environ 11 % des départements.
-enfin, un rapprochement a eu lieu récemment entre les départements, les villes et les intercommunalités. Ainsi, le volet « insertion professionnelle » du PDI est-il intégré au contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) dans au moins un des territoires dans 40 % des départements, tandis que le volet social de la politique de la ville est intégré au PDI dans 33% des départements.
2. La difficile construction des partenariats des départements avec les acteurs de la lutte contre la pauvreté
S'étant ainsi dotés d'orientations stratégiques, les conseils généraux ont du, pour les mettre en oeuvre, faire évoluer ou créer des partenariats avec les autres acteurs de l'insertion.
a) Les relations avec les CAF et avec les CCAS
(1) Les partenariats avec les CAF
La loi de 2003 portant décentralisation du RMI a confirmé les CAF et les caisses de la MSA comme organismes payeurs du RMI, en redéfinissant leur position : elles n'interviennent désormais plus pour le compte et sous la tutelle de l'État, mais dans le cadre d'une convention établie avec le département , qui précise leurs attributions respectives ainsi que l'étendue des compétences qui leur sont déléguées.
Pour établir ces conventions, les CAF pouvaient s'appuyer sur une convention-type conçue par la caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) et sur un certain nombre de repères établis par celle-ci avec l'ADF.
Selon une étude réalisée entre 2005 et 2006 par la CNAF 215 ( * ) , les conventions se sont appuyées sur le contenu du partenariat qui existait déjà entre les CAF et l'État avant 2003, mais ont marqué une extension du champ de délégation de compétences accordées aux CAF par le département . Les conseils généraux, confronté à l'importance des tâches qui leur incombaient depuis janvier 2004, ont en effet souhaité s'appuyer au maximum sur l'expertise gestionnaire des CAF.
Les nouvelles délégations de compétences non prises en charge par les CAF avant la décentralisation concernent notamment les avances, acomptes et remises de dette de l'allocation, les dérogations à destination des indépendants et des étudiants, l'évaluation des revenus des membres des associations communautaires.
La CNAF comme l'ADF soulignent que les relations entre les départements et les CAF ont ainsi été établies sur des bases globalement satisfaisantes pour les deux partenaires lors de la décentralisation du RMI. Néanmoins, deux points de tension sont apparus, concernant la question les contrôles et celle des indus . M. Michel Mercier, président du conseil général du Rhône, a confirmé ces difficultés lors du déplacement de la mission dans ce département.
|
Les contrôles effectués par les CAF Les départements reprochent aux CAF de ne pas leur fournir suffisamment d'éléments pour justifier les dépenses engagées. L'article L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles permet aux CAF et aux caisses de MSA de vérifier, dans l'exercice de leur mission, les déclarations des bénéficiaires, et, à cette fin, de demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, à condition que ces informations soient « limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation (...) ainsi que de la conduite des actions d'insertion ». Les informations recueillies par les personnels des CAF ou des caisses de MSA ne peuvent être communiquées qu'au président du conseil général et au président de la commission locale d'insertion. Le président du conseil général peut donc avoir accès à ces informations, mais il ne s'agit en aucun cas d'une obligation. Dans son rapport de synthèse sur la gestion du revenu minimum d'insertion 216 ( * ) , l'IGAS relève également que la communication entre les systèmes des CAF et des conseils généraux présente, dans l'ensemble des départements rencontrés, des difficultés persistantes, la dispersion de l'information ne permettant pas de répondre complètement aux besoins de pilotage exprimés par les conseils généraux. Les conseils généraux sont certes, selon la CNAF, destinataires d'un tableau de bord mensuel, d'éléments statistiques établis trimestriellement, de même que de résultats annuels présentant la situation du département au 31 décembre de l'année écoulée. Par ailleurs, les agents des conseils généraux ont également accès à un service spécifique, intitulé « CAFPRO », qui leur permet d'accéder, pour chaque allocataire désigné nominativement, aux informations relatives à son droit au RMI, à sa situation familiale, à sa situation financière ainsi qu'à ses droits à d'autres prestations. Les informations ainsi fournies par les CAF ne sont cependant, semble-t-il, pas facilement exploitables, ou sont insuffisantes pour permettre aux départements d'effectuer un réel contrôle sur la dépense. La question des indus Le RMI génère de nombreux indus. En effet, la présomption de droit au RMI dès lors qu'il est demandé, implique que l'essentiel des contrôles ne soient menés qu'a posteriori, ce qui permet difficilement de limiter le montant des indus versés. Cette charge n'a pas été prise en compte au moment de la décentralisation du RMI 217 ( * ) . Or, ces indus représenteraient environ 335 millions d'euros par an, dont la moitié est annulée et environ le quart seulement récupéré. |
(2) Le partenariat avec les CCAS et les communes
Les CCAS instruisent une partie importante des dossiers de demande de RMI. L'Union nationale des CCAS (UNCCAS) a par ailleurs créé des unions départementales de CCAS pour offrir un interlocuteur élu au président du Conseil général.
En effet, comme le souligne M. Daniel Zielinski, délégué général de l'UNCCAS : « Jusqu'à présent, nous étions confrontés parfois à des situations difficiles, avec des CCAS réunis par le Conseil général et où un chef de service expliquait ce que devait accomplir chacune des collectivités locales. Dès lors, il nous fallait être doté, nous aussi, des outils pour pouvoir apporter une réponse politique, et ces outils sont aujourd'hui les unions départementales qui favorisent le travail commun par l'intermédiaire de conventions signées entre les Conseils généraux et les collectivités locales ».
Par ailleurs, la loi de 2005 sur la cohésion sociale a permis la création des centres intercommunaux d'action sociale (CIAS) . Les CCAS et les CIAS vont ainsi souvent, quoique de manière très inégale selon les territoires, au-delà de la simple instruction des dossiers des demandeurs de RMI, par exemple en aidant les conseils généraux à élaborer le PDI, grâce à leur connaissance du terrain, formalisée dans l'analyse des besoins sociaux (ABS) déjà évoquée.
Plus généralement, les communes ont développé au fil des années de nombreuses interventions dans le domaine de l'insertion, comme l'élaboration d'un PLIE, souvent au niveau intercommunal, ou le suivi des jeunes aÌ travers les missions locales. Les CCAS distribuent enfin aux personnes en difficulté des aides extra-légales très variées, qui sont mal connues mais représentent probablement une aide non négligeable pour ces publics 218 ( * ) . Or, l'articulation de ces initiatives avec les politiques du département est insuffisante, « l'acte II » de la décentralisation n'ayant pas permis de clarifier sur ce point les relations entre départements et villes.
Ainsi, selon une enquête de l'ODAS 219 ( * ) , 71% des villes estiment insuffisante l'articulation entre la politique d'insertion communale, intercommunale et départementale , et 60% souhaiteraient intégrer le PLIE (plan local pour l'insertion et l'emploi) au PDI.
Un rapprochement semble s'être néanmoins opéré récemment entre les départements, les communes et EPCI dans ce domaine, notamment avec l'élaboration croisée des documents de stratégie et d'animation (PDI et CUCS). Enfin, la participation des communes au sein des CLI rénovées est de plus en plus forte, en cohérence avec un redécoupage fréquent des zones de compétence de celles-ci visant à mieux adhérer au bassin d'emploi, souvent proche du territoire communal ou intercommunal.
b) Le partenariat avec le service public de l'emploi et avec le conseil régional
De manière cohérente avec leur objectif principal d'insertion professionnelle des allocataires du RMI, les conseils généraux ont tenté depuis la loi de 2003 d'améliorer et de formaliser davantage leurs relations avec le service public de l'emploi et avec les régions.
(1) L'élaboration des conventions avec l'ANPE
Les bénéficiaires du RMI peuvent s'inscrire aux Assedic et à l'ANPE même sans avoir droit à l'indemnisation chômage et bénéficier ainsi du suivi offert par l'agence. Bien que l'ANPE ne soit pas elle-même dispensatrice de formations, elle propose aux demandeurs d'emploi inscrits le catalogue de formations du programme de formation régionale (les formations de ce programme pouvant être payantes), les formations de l'AFPA ou bien, de manière croissante, les formations ASSEDIC, orientées vers les secteurs en tension, gratuites pour les chômeurs indemnisés et faisant l'objet d'appels d'offres.
En revanche, les allocataires du RMI non inscrits peuvent certes bénéficier de certains services de l'ANPE (consultation des offres, entretiens avec des conseillers), mais ils ne sont pas véritablement suivis , ne bénéficient pas de l'entretien mensuel obligatoire, et ne seront pas contactés par l'ANPE en cas d'offre correspondant à leur profil. Ils ne peuvent pas non plus bénéficier des formations proposées par l'ANPE.
Or, beaucoup d'allocataires sont considérés par les services sociaux des départements, ainsi que par l'ANPE, comme trop éloignés de l'emploi pour être inscrits en tant que demandeurs d'emploi. Ces institutions ne les incitent donc pas à effectuer leur inscription.
Afin d'obtenir une prise en charge spécifique des bénéficiaires du RMI, les conseils généraux ont ainsi du mettre en place des partenariats avec l'ANPE . La négociation ayant essentiellement porté sur le financement de postes de conseillers ANPE chargés de prendre en charge les allocataires, les tarifs proposés par l'agence ont d'abord été considérés comme excessifs par les conseils généraux. Ainsi, selon l'ADF, les tarifs proposés allaient jusqu'à 93 000 € par poste de conseiller et par an. Plusieurs conseils généraux se sont alors orientés vers le recours à des prestataires privés.
Pour surmonter ce désaccord, une négociation s'est engagée au niveau national entre l'ADF et la direction générale de l'ANPE. Un accord-cadre national a finalement pu être signé le 6 décembre 2005 , formalisant le partenariat entre les conseils généraux et l'ANPE pour le suivi professionnel des bénéficiaires du RMI.
Les départements considèrent aujourd'hui globalement que leur relation avec l'ANPE est satisfaisante. Cependant, la fusion ANPE/UNEDIC appellera sans doute un réajustement des conventions, notamment afin de faire davantage bénéficier les allocataires du RMI des formations organisées par l'UNEDIC.
|
Les accords signés par les conseil généraux et l'ANPE Alors qu'en 2005, seulement 30 % des départements avaient signé des conventions avec l'ANPE, ce taux s'élevait à 82 % en 2007. Dans huit départements sur 10, l'un des accords conclus avec l'ANPE porte sur le financement de postes. En moyenne, chaque département finance huit postes ANPE. Ces postes se situent soit dans les structures ANPE (agences locales, direction départementale, etc.), soit dans le service d'insertion du département. Exceptionnellement, ils se situent dans des structures partenariales telles que les maisons de l'emploi. En outre, 70 % des départements ont passé un accord avec l'ANPE sur le financement de prestations spécifiques pour les bénéficiaires du RMI telles que des prestations d'accompagnement ou de diagnostic, ainsi qu'une participation à la commission locale d'insertion. Dans 20 % des cas seulement, les conseils généraux adoptent, de façon novatrice, un financement sur résultat . En outre, l'ANPE contribue de façon importante à la réorientation de la politique d'insertion du département vers les contrats aidés : 80 % des conventions confient à l'établissement public le rôle de négociation de ces emplois. Par ailleurs, les conseils généraux ont recours à des concurrents de l'établissement public pour le suivi professionnel et pour la prospection de l'offre. Les organismes de formation et de reclassement (Aidelor, AMOFOPE) effectuent ainsi souvent des missions de suivi professionnel pour le compte des conseils généraux. Un quart des départements font également appel à des entreprises privées de placement (Manpower, Ingeus). Enfin, le partenariat avec l'association pour la formation professionnelle des adultes s'est également renforcé, 40 % environ des conseils généraux ayant passé au moins un accord avec l'AFPA à la fin de l'année 2006 220 ( * ) . |
c) Un partenariat insuffisamment développé avec les conseils régionaux
(1) Une collaboration non prévue par les textes
Une des principales causes de complexité du secteur de l'insertion résulte du cloisonnement entre ses dimensions professionnelle et sociale , reflétée au premier chef par l'attribution des compétences correspondantes à deux collectivités différentes, le département et la région . Cette séparation est d'autant plus dommageable que les départements ont fait de l'insertion professionnelle des bénéficiaires du RMI une priorité. De nombreuses personnalités auditionnées par la mission ont ainsi souligné le défaut de cohérence de cette organisation.
Si la loi de 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a en effet rendu les régions compétentes en matière de formation professionnelle des demandeurs d'emploi ainsi que pour les jeunes de moins de 26 ans rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle, les personnes en insertion âgées de plus de 26 ans et titulaires du RMI ne relèvent pas spécifiquement de leur responsabilité .
Ainsi, selon Mme Marie-Laure Meyer, conseillère régionale d'Ile-de-France et membre de la commission formation professionnelle et apprentissage de l'Association des Régions de France (ARF), « la position ambiguë des Régions sur les problématiques d'exclusion et de pauvreté s'explique aussi par le fait que les lois de décentralisation leur ont confié la formation professionnelle des demandeurs d'emplois, mais sans préciser la façon dont celle-ci s'articule avec la formation professionnelle des bénéficiaires du RMI, laquelle relève de la responsabilité des départements, et la formation professionnelle des demandeurs d'emplois financée par d'autres acteurs que les Régions comme les Assedic .».
Les régions n'ont aucune obligation de prévoir au sein de leur plan régional de développement de la formation professionnelle (PRDFP) des mesures à l'intention des publics en insertion de plus de 26 ans. Ceux-ci peuvent néanmoins être concernés par cet instrument, mais dans les faits, c'est le statut de demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE qui déclenche la prise en charge de la région . Or, seuls 30 à 40% des bénéficiaires du RMI sont inscrits à l'ANPE.
Cette répartition des compétences est à l'origine d'une situation dénoncée par plusieurs intervenants lors des auditions de la mission comme caractéristique d'un système fondé sur une prise en charge en fonction du statut , et non, comme cela devrait être le cas, en fonction des besoins des personnes concernées. Deux personnes dans une situation identique auront en effet des droits à la formation différents si l'une est inscrite à l'ANPE et l'autre non. Ainsi, selon Mme Nicole Maestracci, présidente de la fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS), « on constate pour le moment un ciblage des politiques sur les chômeurs indemnisés mais une attention insuffisante portée aux personnes non indemnisées ». Ces difficultés ont été notamment mises en exergue par le président du conseil général de Seine Saint-Denis lors du déplacement de la mission dans ce département.
En outre, l'insuffisance de coordination entre les départements et les régions en matière de publics en insertion isole ceux-ci par rapport aux acteurs économiques. Selon Marie-Laure Meyer : « cela confine les rmistes dans un bassin d'emploi restreint, ce qui exclut les partenaires sociaux et les entreprises de la réflexion sur la formation des personnes les plus en difficulté » .
Enfin, les autres organismes de la politique de l'emploi (PLIE, IAE, missions locales, maisons de l'emploi...) sont amenés à passer d'un système à un autre en fonction des opportunités. Selon Mme Marie-Laure Meyer, « au niveau de certains territoires, les prescripteurs (ANPE, plans locaux pour l'insertion et maisons de l'emploi) glissent d'un type de schéma vers l'autre (des dispositifs du département vers ceux de la régions et vice-versa) quand ils ont besoin de proposer une formation adaptée à une personne. »
(2) Un rapprochement progressif
Cependant, si aucun cadre n'oblige les conseils régionaux à discuter des problématiques d'insertion avec les conseils généraux, certains efforts ont été accomplis récemment par les régions pour prendre en compte la problématique des publics de plus de 26 ans en insertion .
Ainsi, dans l'enquête réalisée par l'ODAS en 2007, 12 des 22 régions indiquent avoir construit des programmes de formation spécifiques pour les bénéficiaires du RMI titulaires de contrats aidés . Ces formations visent essentiellement la conclusion de contrats d'avenir mais aussi de contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE) et de CI-RMA. La moitié des départements interrogés indiquent quant à eux être concernés par la mise en place de ces dispositifs spécifiques.
En outre, plusieurs régions prévoient dans leur PRDFP l'instauration d'une conférence des financeurs réunissant les départements, afin de définir les engagements réciproques au titre de la formation des bénéficiaires du RMI titulaires d'un contrat aidé.
Certaines régions et certains départements apportent des innovation dans le domaine de l'articulation des formations régionales avec les parcours d'insertion des bénéficiaires du RMI. Ainsi la mission a-t-elle pu auditionner le Président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle, M. Michel Dinet, qui a fait part de sa collaboration avec la Région Lorraine sur le volet formation professionnelle du contrat « TTEM » (Travailler et transmettre en Meurthe et Moselle) créé en fonction des besoins des bénéficiaires du RMI.
d) Les partenariats avec les autres acteurs de l'insertion
Au-delà du noyau de ces partenariats de base, indispensables à la mise en oeuvre de leurs nouvelles compétences, les départements déploient des relations plus ciblées avec de multiples organismes et associations qui animent les politiques locales d'insertion, par exemple dans le domaine de la santé. Cependant, dans la majorité des cas, les accords relatifs à l'insertion sociale prennent la forme de simples subventions versées par le département.
Par ailleurs, la plupart des départements cofinancent le fonctionnement des structures d'insertion par l'activité économique (IAE). Ainsi, la plupart participent au financement des ateliers ou chantiers d'insertion, des entreprises d'insertion, des associations intermédiaires, et, dans une moindre mesure, des entreprises de travail temporaire d'insertion.
3. La relative efficacité du dispositif pour aider les personnes les moins éloignées de l'emploi
Plusieurs rapports soulignent que les conseils généraux se sont bien approprié leurs nouvelles compétences en matière d'insertion . Ainsi, le rapport de l'IGAS d'évaluation de la loi de 2003 portant décentralisation du RMI publieì en janvier 2007, précise-t-il que « dans un contexte difficile, les départements se sont bien appropriés leurs nouvelles responsabilités ». Il souligne les progrès dans la construction des parcours d'insertion : meilleur suivi des bénéficiaires, amélioration des taux de contractualisation, diversification de l'offre d'insertion, meilleure adaptation des parcours au profil des bénéficiaires.
En outre, le nombre d'allocataires du RMI a commencé à diminuer en 2006, sans qu'il soit possible toutefois de faire les parts respectives de l'amélioration due à la conjoncture économique, de celle due à la politique de l'emploi en général et de celle directement imputable à la politique partenariale d'insertion menée par les Conseils généraux.
Cependant, ces résultats positifs semblent concerner en grande majorité des personnes qui étaient relativement proches de l'emploi. Tant le président du conseil général du Rhône que celui de la Seine Saint-Denis ont en effet souligné devant la mission que les efforts récents se sont montrés impuissants à améliorer la situation du tiers des bénéficiaires du RMI les plus éloignés de l'emploi, souffrant souvent de problèmes sociaux graves comme l'illettrisme ou de problèmes de santé physique ou mentale.
B. LA PERSISTANCE DE LA COMPLEXITÉ DU SECTEUR DE L'INSERTION
Grâce à leurs nouvelles compétences et sous l'effet de l'incitation forte qu'a constituée jusqu'en 2006 la hausse continue du nombre d'allocataires, les conseils généraux ont ainsi organisé au niveau départemental un dispositif d'insertion tourné vers l'emploi et faisant appel à l'ensemble de leurs partenaires.
Cette nouvelle organisation est loin cependant d'avoir radicalement simplifié la gouvernance territoriale de l'insertion. M. Julien Damon, rapporteur du Grenelle de l'environnement, a ainsi évoqué devant la mission un « système baroque et éclaté » .
De nombreux autres intervenants auditionnés par la mission ont souligné la complexité extrême des dispositifs mis en place par les nombreux acteurs de la lutte contre la pauvreté, ainsi que leur grande instabilité. Cette complexité et cette instabilité ont pour premier effet de décourager les acteurs de terrain qui doivent consacrer une grande partie de leur énergie à comprendre les règles qu'ils doivent appliquer et à chercher, parmi tous les dispositifs et les acteurs existants, celui qui pourrait leur venir en aide dans le cas particulier qu'ils ont à traiter. L'instabilité décourage également l'innovation puisque les acteurs et organismes qui en font preuve craignent toujours qu'un changement des règles ne remettent en cause ce qu'ils ont entrepris.
Par ailleurs, la complexité est finalement subie par les personnes en difficulté, qui subissent des ruptures dans leur parcours d'insertion lorsqu'elles doivent passer d'une institution à une autre qui n'a pas les mêmes pratiques, n'exige pas les mêmes documents ou n'applique pas les mêmes critères pour attribuer une prestation.
1. La multiplicité des acteurs
a) Les multiples acteurs de l'insertion professionnelle
(1) Une utilité certaine
Parallèlement aux grands acteurs, couvrant l'ensemble du territoire (Etat, service public de l'emploi, régions et départements), qui tentent de mettre en place une gouvernance territoriale tournée vers l'insertion professionnelle, une multitude d'acteurs plus modestes forme le tissu local du secteur de l'insertion . Il s'agit notamment des missions locales et PAIO, des PLIE, du secteur de l'IAE, des bureaux d'information jeunesse, des maisons d'information sur la formation et l'emploi (MIFE), des associations, et, de manière plus récente, des maisons de l'emploi (MDE).
|
Les plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE) Créés à l'initiative des collectivités locales, les plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE) constituent la traduction stratégique et opérationnelle des politiques d'insertion et d'emploi sur un territoire. A ce titre, ils ont pour fonction d'être des « plates-formes partenariales » au sein desquelles se coordonnent les programmes et les actions de ces politiques soit en direct, soit par délégation de la collectivité territoriale les ayant créés à une structure support. La mise en oeuvre des PLIE peut en effet être confiée à un ensemble d'opérateurs très divers : ANPE, missions locales pour l'emploi, centres communaux d'action sociale, structures d'insertion par l'activité économique, associations d'utilité sociale, ateliers et chantiers d'insertion, organismes de formation ... Ainsi, les PLIE ont principalement pour mission : - de réunir les acteurs et opérateurs locaux concernés autour d'objectifs qualitatifs et quantitatifs d'accès de personnes en difficulté à un emploi durable, en organisant pour ces personnes des parcours d'insertion professionnelle individualisés avec un accompagnement renforcé assuré par des référents spécialisés ; - d'assurer l'ingénierie technique et financière des actions et des dispositifs locaux contribuant soit au retour à l'emploi de leurs bénéficiaires puis à leur maintien pendant au moins six mois, soit à l'accès à une formation qualifiante. On comptait, en 2006, 209 PLIE en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Au total, environ 5.500 communes adhèrent à ces dispositifs. Les PLIE couvrent environ 25,5 millions d'habitants et accueillent en moyenne dans l'année près de 150.000 personnes ayant en commun de connaître d'importantes difficultés pour accéder à un emploi. Selon l'association ville emploi (AVE), ils ont permis, de 2000 à 2006, le retour à l'emploi durable de 46 % des publics accueillis. |
L'utilité de ces acteurs de l'insertion résulte d'abord de l'incapacité des grandes politiques portées par l'Etat et les collectivités territoriales à atteindre et à aider une partie des publics en grande difficulté. Selon Mme Marie-Laure Meyer, de l'ARF, « le début des parcours d'insertion doit s'effectuer dans des structures de proximité. Tout ce qui peut permettre de tisser des liens à des niveaux locaux est le bienvenu ».
Les missions locales tentent également de prendre contact avec les jeunes qui ne se rendent pas spontanément à l'ANPE ou dans les services sociaux. Elles collaborent ainsi avec les centres d'information et d'insertion (CIO) de l'éducation nationale et avec la mission générale d'insertion (MGI), afin de ne pas perdre la trace des jeunes en difficulté scolaire au moment où ils quittent l'enseignement.
Par ailleurs, les petites structures sont à même de mobiliser de manière dynamique tous les instruments disponibles autour des personnes en difficulté, en surmontant les limites administratives. Elles introduisent ainsi une certaine souplesse dans le secteur très cloisonné de l'insertion. Mme Pascale Schmit, chef par intérim de la mission Insertion des jeunes à la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, a présenté à la mission l'ensemble des outils de politique publique que peuvent mobiliser une mission locale ou une PAIO : actions de formation financées par les collectivités territoriales, actions de formation de l'AFPA ou actions financées par l'Unedic, actions d'accompagnement, mobilisation de prestations de placement dans l'emploi.
Les missions locales disposent également du système d'information « Parcours 3 » qui permet l'échange d'information entre tous les acteurs du réseau, et sur lequel s'appuie la DREES pour la réalisation de certaines de ses études.
(2) Un manque d'articulation et de gouvernance
En dépit de ces points positifs, le manque d'articulation de ces acteurs entre eux et avec les politiques nationales de l'insertion sociale et professionnelle alimente encore la complexité du secteur de l'insertion et enferme les publics en difficulté dans des dispositifs trop restreints.
Ainsi les PLIE, dont l'efficacité est par ailleurs reconnue, souffrent-ils d'un manque de coordination avec les autres acteurs du service public de l'emploi . De même, les relations entre les PLIE et le secteur de l'IAE sont insuffisantes. Les PLIE peuvent en effet contribuer au financement des parcours et aÌ la fonction d'accompagnement des SIAE. Ils peuvent ainsi, grâce aÌ une aide d'ingénierie, faciliter le suivi des parcours d'insertion ou la découverte de nouveaux secteurs d'activité et de nouveaux marchés pour cet accompagnement. Cependant, les PLIE ne sont pas présents partout et cette fonction d'ingénierie leur est parfois contestée .
De même, malgré leur ancienneté, les missions locales sont parfois critiquées et n'ont été que récemment reconnues comme acteurs du service public de l'emploi. La loi de cohésion sociale de 2005 les qualifie de membres concourant au service public de l'emploi et, à ce titre, garantes de l'accompagnement des jeunes jusqu'à ce qu'ils obtiennent un emploi durable.
Les missions locales souffrent également de leur diversité et de leur manque de coordination. M. Jean-Marc Lenzi, chargé de mission auprès du délégué interministériel à l'orientation, souligne: « il apparaît aujourd'hui que, même si les missions locales sont bien réparties sur le territoire, l'institution ne se révèle pas suffisamment cohérente ».
Le manque de cohérence et d'articulation des structures se traduit également par l'éclatement de la prise en charge de certains publics spécifiques. Ainsi les jeunes, en fonction du territoire où ils se trouvent et des hasards de leur parcours, peuvent-ils être pris en charge notamment par les missions locales et les PAIO, les bureaux d'information jeunesse, les points d'accueil et d'écoute des jeunes (PAEJ), les maisons de l'emploi, etc. M. Jean-Marc Lenzi a déclaré à la mission, à propos de cet accueil des jeunes à la sortie du système scolaire : « nous nous intéressons aux réseaux d'accueil et d'information. Il en existe environ 18 sur l'ensemble du territoire et leur présence, disséminée, soulève le problème du manque d'optimisation de l'organisation des guichets ».
Ce manque de gouvernance risque également d'enfermer les bénéficiaires dans des territoires trop restreints, au lieu de leur permettre de bénéficier des dynamiques économiques des territoires voisins. Comme le souligne Mme Marie-Laure Meyer (ARF), il s'agit « de ne pas enfermer les personnes en difficulté sur un territoire large de 20 kilomètres. L'action locale dans le domaine de l'insertion n'a de sens que si elle est bien reliée à d'autres actions stratégiques prises à différents échelons. Tout le monde n'est pas destiné à travailler à côté de chez soi ».
b) L'insuffisante intégration de l'IAE aux dispositifs départementaux d'insertion
Le secteur de l'insertion par l'activité économique dépend à la fois de l'Etat, qui en a formellement la compétence, de la région, compétente en matière de formation professionnelle et de coordination du développement économique, du conseil général compétent en matière d'insertion sociale, de l'intercommunalité et des élus des communes qui participent à la lutte contre le chômage et l'exclusion.
Or, ce partage des compétences entre les diverses catégories de collectivités territoriales complique l'exercice de la double vocation de l'IAE, économique et sociale . Pour construire le parcours des personnes accueillies tout en assurant la viabilité économique de leurs activités, les SIAE doivent s'adresser aÌ plusieurs financeurs, dont les stratégies ne sont pas coordonnées. Selon un rapport du CNIAE 221 ( * ) « le dirigeant d'une SIAE doit s'improviser diplomate spécialisé dans l'ingénierie de l'action publique tout en restant chef d'entreprise et en garantissant l'exécution du projet social de sa SIAE ».
En outre, il existe un cloisonnement entre la coordination de l'IAE et la stratégie d'insertion du conseil général. En effet, le conventionnement actuel entre l'Etat et la structure a lieu au niveau départemental, sous l'égide du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique (CDIAE) 222 ( * ) , présidé par le préfet. Le CDIAE a pour mission d'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs de l'IAE et aux demandes de concours du fonds départemental pour l'insertion, et de déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'IAE.
Or, s'il est prévu que « le CDIAE élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à sa cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment le programme départemental d'insertion (élaboré par le conseil général) », cette coordination n'est pas effective. L'un des instruments les plus efficaces des politiques d'insertion échappe ainsi à la stratégie d'insertion du conseil général , alors même que celui-ci est censé en être le chef de file depuis 2004.
En outre, les régions, en tant que territoire pertinent de la politique économique, revendiquent elles aussi la coordination de l'IAE. Ainsi, selon Mme Marie-Laure Meyer (ARF) : « La coordination de l'insertion par l'activité économique est effectuée au niveau départemental, une compétence que ne possède pas le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. Il s'agit d'une carence majeure ».
Le secteur de l'IAE est enfin insuffisamment articulé avec le service public de l'emploi . Le rôle de l'ANPE dans l'accompagnement des trajectoires professionnelles des salariés en parcours d'insertion, redéfini en 2003, demeure en effet très variable selon les territoires. En outre les comités techniques d'animation (CTA), qui ont la responsabilité du diagnostic local pour définir le profil des personnes pouvant accéder aÌ une SIAE en tenant compte des caractéristiques du bassin d'emploi et en fonction des orientations du service public de l'emploi, ne se sont pas constitués dans tous les départements. Pourtant, ils devraient jouer un rôle essentiel dans la mobilisation des moyens des agences locales de l'emploi au profit des salariés en parcours d'insertion.
c) L'association des partenaires privés à la politique de l'emploi
On a vu que les départements faisaient appel à des concurrents de l'ANPE pour la prospection des offres ou le suivi des demandeurs d'emploi : organismes de formation et de reclassement et opérateurs privés de placement (OPP).
L'ANPE fait aussi appel à ces organismes privés afin d'assurer certaines missions correspondant à des besoins particuliers, qu'elle assure également pour partie elle-même : ateliers thématiques, modules d'accompagnements courts. En outre l'Unedic a passé contrat avec des OPP chargés de prendre en charge l'accompagnement de certains demandeurs d'emploi.
Selon le rapport Boulanger 223 ( * ) , « le recours à des OPP est profitable au service public. Il permet en effet de répondre quantitativement à certains besoins que l'opérateur ne peut prendre en charge lui-même, il apporte aussi une capacité d'innovation stimulante dans la prise en charge dont les autres opérateurs pourront profiter, il peut enfin répondre à des problématiques spécifiques ».
Cependant, certaines personnalités entendues par la mission soulignent le risque que les acteurs privés, se substituant aux acteurs associatifs, mettent en péril la pérennité et l'expérience acquise par ceux-ci dans le domaine de l'insertion.
Ainsi, selon Mme Marie-Pierre Establie, déléguée générale de L'Alliance ville emploi : « deux logiques s'affrontent, comme peuvent en témoigner les acteurs avec la mise en oeuvre d'un autre marché public portant sur les prestations publiques de l'Agence nationale de l'emploi. Ce recours à des prestataires par le biais de marchés publics aboutit à détruire le travail effectué par les nombreuses petites associations dans l'ensemble de la France avec des moyens relativement faibles. Il aboutira à casser le savoir-faire des associations, un savoir-faire fragile, souvent pointu, ne leur permettant pas de répondre à des appels d'offres d'importance, lesquels provoquent une grande émotion dans les missions locales ».
Par ailleurs, une inquiétude se fait jour dans les régions qui souhaitent pouvoir continuer à ne pas avoir recours à des organismes privés de formation si elles le souhaitent, alors que les formations jusqu'alors organisées par l'AFPA feront prochainement systématiquement l'objet d'appels d'offre. Ainsi, selon Mme Marie-Laure Meyer (ARF) : « nous considérons que, si les formations en bureautique peuvent être traitées par le marché, celles relatives à l'apprentissage des gestes de base doivent relever des services publics au travers d'un certain nombre d'outils (ateliers pédagogiques personnalisés, AFPA, GRETA, CNAM, Universités pour la validation des acquis de l'expérience ou les diplômés d'accès aux études universitaires). Nous nous bagarrons pour imposer ce point de vue ».
d) Le rôle essentiel des associations dans le dispositif
Souvent en charge de véritables missions de service public, les associations et réseaux d'associations (la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS), l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPPS), la fédération des associations pour la promotion et l'insertion par le logement (FAPIL)...) participent à l'accompagnement social des populations en difficulté et relaient au niveau local les politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
Elles interviennent notamment dans les domaines de l'accompagnement social des bénéficiaires du RMI, de l'insertion des jeunes, du logement, de l'amélioration de l'accès à la santé, de la lutte contre les addictions, de la gestion des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, de l'insertion par l'activité économique, du soutien à la création d'entreprises et de l'accès à la culture. Elles sont consultées par les Conseils généraux pour l'élaboration des plans départementaux d'insertion (PDI).
Les associations travaillent en étroite collaboration avec les autres acteurs de l'insertion . M. André Gachet, président de la FAPIL, a souligné que « ces associations possèdent la caractéristique commune de s'engager auprès des personnes, mais aussi auprès des collectivités. Ainsi, dans la charte de la FAPIL, il est stipulé que chacune des associations pratique son activité en prenant place dans les dispositifs locaux ».
Pourtant, les associations souffrent de l'évolution aléatoire des crédits des politiques du secteur. Les représentants des associations rencontrés par la mission ont ainsi fréquemment regretté le manque de sécurité des crédits qui leur sont octroyés . Ainsi, l'Etat finance des contrats aidés, notamment dans le secteur non marchand (contrats d'avenir et contrats d'accompagnement dans l'emploi). Ces contrats sont très utilisés par les associations, en particulier dans le secteur de l'IAE, car ils sont adaptés aux publics éloignés de l'emploi. Or, l'Etat continue à prendre des décisions unilatérales de réduction du volume de ces contrats.
Deux circulaires du 24 décembre 2002 et du 16 janvier 2007 224 ( * ) définissent pourtant le cadre du subventionnement des associations par l'Etat, en encourageant les financement pluriannuels , en permettant aux associations d'obtenir une avance sur la subvention de 50 % de son montant et en encourageant les services de l'Etat à établir un plan de financement des associations permettant une rationalité et une stabilité de ces financements. Un dossier unique de demande de subvention, avec une liste close de documents à fournir, a également été créé pour faciliter les démarches des associations. Les circulaires citées encouragent les collectivités à adopter ce dossier unique à leur tour.
Concernant les conseils généraux, certains PDI prévoient également un conventionnement pluriannuel, ou des chartes d'engagement réciproques entre le département et les associations. Des communes mettent également en place des chartes du financement des associations.
Ces instruments restent cependant trop peu utilisés. Or, s'il est parfaitement légitime que les crédits dont dispose une association ne lui soient pas définitivement acquis , les décisions de reconduction ou de non reconduction devraient reposer sur des éléments objectifs tels que des évaluations de leurs résultats, prenant en compte la spécificité de leurs missions (par exemple l'accompagnement de longue durée des personnes en difficulté) et la nature des publics qu'elles prennent en charge (personnes souvent très éloignées de l'emploi pour lesquelles une réinsertion ne peut être que très progressive).
e) Une participation croissante des partenaires sociaux
La mission considère que les partenaires sociaux ont un rôle important à jouer dans l'aspect préventif de la lutte contre l'exclusion. Ils peuvent en effet faire de ce thème l'un des sujets des négociations de branche ou d'entreprise.
Les partenaires sociaux semblent désormais manifester un certain intérêt pour la question de l'exclusion. Un accord a été signé à cet effet en décembre 2007 par le collectif d'associations ALERTE et les grandes organisations syndicales (le MEDEF, la CGPME, la FNSEA, l'UPA, la CGT, la CFDT, la CFTC, l'UNSA). Cet accord marque la reconnaissance d'une « responsabilité sociétale » des entreprises . Les discussions entre les partenaires sociaux et les associations de lutte contre l'exclusion se poursuivent par ailleurs dans ce cadre autour de deux thèmes : les différentes manières de lutter contre la pauvreté et la participation des personnes défavorisées aux décisions qui les concernent.
Selon Bruno Grouès, conseiller technique de l' Union interfédérale des oeuvres et organismes sanitaires et sociaux (UNIOPSS) : « Cet engagement commun montre combien la société est enfin devenue mûre pour réfléchir aux conditions à mettre en oeuvre pour améliorer l'accès à l'emploi, indépendamment des considérations politiques et des intérêts particuliers des uns et des autres ».
En outre, le MEDEF a récemment diffusé un guide pour conseiller les entreprises souhaitant travailler avec le secteur de l'IAE, tandis que la CFDT va également publier prochainement quatre guides similaires. Enfin, la CGT propose de soumettre à la négociation des partenaires sociaux la création d'un « contrat personnalisé de parcours d'insertion sociale et professionnelle sécurisée » destiné à garantir un parcours d'insertion sécurisé pour les personnes en difficulté, après un diagnostic de chaque cas par le nouvel opérateur du service public de l'emploi.
Par ailleurs, certains syndicats développent des actions concrètes, d'une part pour rapprocher les publics en difficulté des entreprises, d'autre part pour les accompagner au sein même de celles-ci :
- concernant le premier point, les syndicats s'appuient sur les entreprises de l'IAE ou sur les missions locales, dont l'expertise est reconnue en la matière, pour prendre contact avec des personnes en difficulté et les rapprocher des entreprises, notamment dans les secteurs en tension, de sorte que ce rapprochement répond aussi à une demande des employeurs ;
- concernant l'accompagnement au sein des entreprises, les syndicats s'efforcent de convaincre les employeurs d'embaucher des personnes ayant eu un parcours difficile puis de mettre en place des tutorats pour les suivre et les intégrer progressivement à la vie de l'entreprise.
Malgré cette prise de conscience et ces innovations, la mission a constaté que la prise en compte des problématiques de lutte contre la pauvreté et d'insertion par les partenaires sociaux n'en était qu'à ces débuts et devrait s'affirmer contre une longue tradition de non prise en compte des chômeurs et des exclus par le monde de l'entreprise.
f) Une tentative de guichet unique : les maisons de l'emploi
|
Le dispositif des maisons de l'emploi Les maisons de l'emploi (MDE), créées par la loi de cohésion sociale de 2005, s'inspirent d'expériences menées depuis 1993 par plusieurs structures locales, soutenues par l'association Alliance Villes Emploi, notamment à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), Cherbourg (Manche), Mulhouse (Alsace), Dunkerque (Nord), et qui regroupaient notamment une mission locale, un PLIE et une maison de l'information sur la formation et l'emploi (MIFE). La plupart sont présidées par des élus ; cependant, certaines ont à leur tête des personnalités indépendantes ou des chefs d'entreprises. Les membres constitutifs obligatoires sont les collectivités territoriales ou leurs groupements porteurs de projet, l'Etat, l'ANPE, et l'ASSEDIC. Par ailleurs, le conseil régional, le conseil général, les intercommunalités et les communes (en l'absence d'intercommunalités compétentes) peuvent, aÌ leur demande, être membres constitutifs. Les autres acteurs locaux de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle (regroupés par collèges) peuvent être associés : AFPA, PLIE, missions locales, MIFE, structures d'IAE, associations d'insertion, organismes consulaires, partenaires sociaux, entreprises, organismes d'observation du marcheì de l'emploi local et des besoins en formation, conseil de développement, etc. Dans un souci supplémentaire de simplification, la loi a aussi prévu que certains partenaires (missions locales, plans locaux pour l'insertion et l'emploi...) pouvaient faire évoluer leurs statuts afin de créer une maison de l'emploi ou pour fusionner avec elle. L'ensemble des partenaires apportent avec eux les moyens financiers et humains constitutifs de la MDE, l'Etat apportant une contribution financière en fonction de l'apport des membres. Les projets de MDE portés par les partenaires sont instruits par le préfet, en vue de l'obtention du label accordé par le ministre. Les MDE font en principe l'objet d'une évaluation qui peut conduire à la perte du label. Leur mission est triple : établir un diagnostic du territoire sur lequel elles sont implantées en analysant de manière prospective le marché du travail local ; assurer un rôle de « guichet unique » pour recevoir et accompagner les personnes, en leur offrant en un même lieu les services de tous les partenaires ; favoriser le développement ou la restructuration du tissu économique local en menant une gestion prévisionnelle des compétences et en contribuant au maintien et à la création d'activités. |
Les MDE constituent à la fois une tentative de territorialisation et de simplification de la politique de l'emploi et de l'insertion . Or, après 227 créations de MDE, l'Etat a mis un coup d'arrêt au déploiement du dispositif en septembre 2007, dans l'attente de la fusion annoncée ANPE-UNEDIC.
La loi du 13 février 2008 225 ( * ) déterminant les modalités d'organisation du nouvel organisme issu de la fusion de l'ANPE et de l'UNEDIC a maintenu l'existence des maisons de l'emploi , tout en prévoyant leur collaboration avec le nouvel organisme. Ainsi, le nouveau conseil national de l'emploi comprend-il des représentants des maisons de l'emploi. Par ailleurs, la convention annuelle signée entre l'Etat et le nouvel opérateur au niveau de chaque Région doit prévoir les modalités de coopération de celui-ci avec les maisons de l'emploi.
La loi du 13 février 2008 a également créé un organe de gouvernance territoriale du service public de l'emploi, le conseil régional de l'emploi, présidé par le préfet de Région et dont peuvent notamment être membres les maisons de l'emploi .
Le rapport d'étape 226 ( * ) d'évaluation des MDE souligne d'abord leur hétérogénéité . Une maison peut exister sur un territoire correspondant à une seule comme à 498 communes, avec une moyenne de 89 communes par MDE. Plus de 50 % des MDE prennent la forme d'un site central d'accueil avec mise en réseau d'antennes, mais dans un quart des cas, elles exercent une coordination sans accueil. La moitié des maisons de l'emploi ont un budget inférieur à 6,7 millions d'euros sur quatre ans. Le budget moyen s'établit à 8,2 millions d'euros, dont 2,2 millions d'euros pour 2008.
Le rapport souligne également les synergies effectivement créées grâce à la mise en place des maisons de l'emploi : partage d'informations entre les différents partenaires, création de nouveaux services (mise en réseau de chefs d'entreprise, création de « cyberbases » d'emplois), actions en direction de publics-cibles, notamment les bénéficiaires des minima sociaux et les jeunes. Plusieurs intervenants ont confirmé devant la mission ces aspects positifs des MDE.
Cependant, les MDE présentent certains défauts. D'abord, elles ne sont pas allées au bout de la logique du guichet unique de l'emploi et de l'insertion . Les personnes qui se rendent dans les MDE savent bien qu'elles trouveront aussi des offres d'emploi à l'ANPE. En outre, les représentants des organismes présents dans la MDE ne disposent pas toujours dans celles-ci de l'ensemble des outils nécessaires et proposent donc parfois aux personnes des rendez-vous au sein de leur institution d'origine.
Ensuite, certains acteurs importants de l'insertion professionnelle ne sont pas systématiquement présents dans la MDE, qui est aussi parfois mal reliée aux dynamiques économiques . Selon Mme Marie-Laure Meyer (ARF) : « Des acteurs sont incontournables. Or ils me semblent avoir été oubliés un peu par la loi. Il s'agit des partenaires sociaux, de l'éducation nationale, des conseils généraux, des conseils régionaux et des chambres consulaires. Si nous ne voulons pas construire une maison du chômage, nous sommes obligés de mettre à disposition, non seulement un service public pour les demandeurs d'emplois, mais aussi un service public du recrutement dans lequel les employeurs doivent tenir une place à part entière ».
En outre, la création de MDE de simple coordination, sans accueil du public (comme par exemple à Paris), ajoute un niveau de gouvernance sans apporter de service supplémentaire aux publics de l'insertion professionnelle.
Enfin, l'intérêt des MDE résidait en grande partie dans le fait qu'elles associaient l'ANPE et l'ASSEDIC, désormais en voie de fusion dans le nouvel opérateur. La réforme récente de l'organisation du service public de l'emploi risque ainsi d'aboutir à la création de deux réseaux parallèles concurrents , celui des MDE et celui du nouvel opérateur du service public de l'emploi.
Ainsi, l'Alliance ville-emploi évoque-t-elle la nécessité d'une nouvelle instance de coordination entre le nouvel opérateur et les maisons de l'emploi en raison de leur mode de fonctionnement différent, le premier obéissant à une logique « territorialisée » (c'est-à-dire centralisée et descendante) et les secondes à une logique « territoriale » (partant du terrain).
Au total, il apparaît que les MDE n'ont pas permis de limiter radicalement la complexité de l'animation et de la gouvernance des politiques d'emploi au niveau territorial . En outre, se pose à présent avec acuité la question de la coordination et de la répartition des missions entre les MDE et le nouvel opérateur.
|
Une autre source de complexité : les multiples périmètres des politiques d'insertion - le département pour les conseils généraux et les DDAS ; - les circonscriptions d'action sociale départementale du conseil général; - le ressort des CLI, déterminé depuis la loi de 2004 sur les libertés et responsabilités locales par le président du conseil général. Ce ressort épouse fréquemment mais pas toujours les circonscriptions d'action sociale départementale ; - le périmètre des PLIE, qui coïncide en principe avec l'agglomération ou le bassin d'emploi ; - les quartiers relevant des Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) ; - les communes ou les EPCI pour les CCAS et CIAS ; - l'arrondissement, le pays, la communauté d'agglomération, ou encore le bassin d'emploi pour les missions locales/ PAIO ; - les zones d'éducation prioritaires; - le ressort des CAF (qui ne coïncide pas toujours avec celui du département, pour qui elles assurent le versement du RMI) ; - les bassins d'emploi des ANPE. |
2. La coordination des acteurs : une superposition d'instances
De nombreux intervenants ont souligné devant la mission le paradoxe de la persistance d'un manque de coordination malgré l'empilement des dispositifs censés jouer ce rôle en matière de lutte contre l'exclusion. Mme Nicole Maestracci, présidente de la FNARS, constate « un déficit de pilotage et de coordination de l'ensemble des dispositifs d'insertion, gérés par les missions locales, le service public de l'emploi, l'AFPA et tous les autres dispositifs de formation professionnelle ». Et M. Jean le Garrec, président de l'Alliance villes emploi, a également souligné que « tout le monde conviendra que le service public de l'emploi français est celui qui est le plus éclaté en Europe ».
Des instances ayant un rôle de coordination, de concertation et d'animation au niveau départemental et permettant à l'ensemble des acteurs institutionnels, associatifs ou des entreprises d'apporter leur contribution à l'insertion, se sont pourtant ajoutées les unes aux autres au cours des années. Mais, ce faisant, elles ont rendu la gouvernance locale incompréhensible .
Une simplification a certes eu lieu depuis 2004, avec le recentrage de la coordination départementale autour de deux pôles, l'un décentralisé, l'autre déconcentré . Dans la logique de cette nouvelle organisation, le président du Conseil général, disposant d'un conseil départemental de l'insertion (CDI) qui n'a plus qu'un rôle consultatif, dialogue avec le préfet, qui s'appuie sur la commission départementale de la cohésion sociale (CDCS), la commission départementale de l'emploi et de l'insertion (CDEI) et les autres commissions dont il peut organiser librement le travail.
Cette simplification n'est cependant en réalité qu'ébauchée. Ainsi, le CDI, la CDCS, la CDEI, le CDIAE (insertion par l'activité économique), voire la COPEC (égalité des chances) ont des compétences très proches et les acteurs du champ de l'insertion et de l'emploi qui y participent sont souvent les mêmes. En outre, une source incompressible de complexité réside en tout état de cause dans l'existence de deux systèmes de coordination parallèles , l'un sous l'autorité de l'Etat, l'autre sous celle du conseil général.
Dans ce contexte, il est difficile d'imaginer que chacune de ces commissions puisse apporter sa propre contribution à l'insertion sans empiéter sur les compétences des autres. En outre, la multiplicité des dispositifs ne peut que favoriser le caractère par trop « descendant » des politiques d'insertion , souligné par de nombreux interlocuteurs de la mission, chaque acteur et chaque commission ayant tendance à « produire » ses propres actions d'insertion, au détriment d'une réponse adaptée aux véritables besoins des publics en difficulté .
|
La « comitologie » et la planification départementale en matière d'insertion 1-En matière d'insertion sociale ou professionnelle - le conseil départemental d'insertion (CDI) , présidé par le président du conseil général et consulté pour l'adoption du plan départemental d'insertion (PDI) ; - la commission départementale de la cohésion sociale (CDCS) , créée en 2006 et présidée par le préfet, qui coordonne la politique de l'Etat en matière d'insertion ; - la commission départementale de l'emploi et de l'insertion (CDEI) , commission « pivot » compétente dans tout le champ de l'emploi, créée en 2006 et placée sous l'autorité du préfet ; - le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique (CDIAE) , sous-formation des CDEI consacrée à la coordination de l'insertion par l'économique ; - la commission départementale pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté (COPEC) , également créée en 2006, dirigée par le préfet et le président du tribunal de grande instance, qui lutte contre les discriminations ; - les Pôles d'accueil en réseau pour l'accès aux droits sociaux (PARADS) créés en 2005 et rassemblant, à un niveau infra-départemental (bassin d'emploi, agglomération...) la plupart des acteurs locaux de l'insertion afin d'améliorer l'accès effectif aux droits sociaux des personnes en situation de précarité ; En revanche, la loi de 2004 sur les libertés et responsabilités locales a supprimé deux commissions, les missions de coordination correspondantes étant confiées aux conseils généraux : - le comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions , qui réunissait depuis 1998 sous l'autorité du préfet des représentants des différents comités et instances départementaux liés à la lutte contre les exclusions; - la commission de l'action sociale d'urgence (CASU) , également issue de la loi de 1998 et qui rassemblait l'Etat, les collectivités territoriales, des organismes sociaux voire des associations pour coordonner les diapositifs allouant des aides d'urgence. 2-En matière le logement ou d'hébergement des personnes défavorisées - la commission de médiation départementale pour le droit au logement ; créée par la loi du 5 mars 2007 instituant le "droit au logement opposable"; - le plan départemental pour l'hébergement d'urgence créé en 1994, élaboré par le préfet en association avec les collectivités territoriales, les groupements intercommunaux compétents, les associations, les caisses d'allocations familiales et les organismes HLM, et qui analyse les besoins et prévoit les capacités d'hébergement d'urgence à offrir; - le programme départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDLPD) créé en 1990, signé par le préfet et le président du conseil général, et qui coordonne les efforts de l'Etat et des collectivités territoriales en matière d'accès au logement pour les personnes défavorisées. 3-La simplification des commissions consultatives départementale de l'Etat Des textes successifs 227 ( * ) se sont efforcés de simplifier le dispositif départemental de l'Etat en matière d'insertion et d'emploi. Outre la constitution déjà évoquée de la CDCS ainsi que de la CDEI, commission dite «pivot» comportant deux formations spécialisées (le CDIAE et la commission emploi), sont ainsi supprimés : - le comiteì départemental de l'emploi (CODE) qui jouait le rôle de pivot sur le champ de l'emploi ; - la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés . Ces reformes donnent au préfet de département une plus grande latitude pour adapter les modalités de la concertation au contexte local, notamment concernant la composition des commissions, la répartition des consultations entre commission pivot et formations spécialisées, l'organisation de formations restreintes, l'invitation de personnes extérieures. |
3. L'éclatement des compétences en matière de logement
L'ensemble des acteurs de l'insertion déplorent également la complexité de la gouvernance du secteur de l'hébergement et du logement social.
Cette complexité résulte d'abord du partage de compétences entre l'Etat et les collectivités, source de dilution des responsabilités. Selon Laurent Chambaud, inspecteur général des affaires sociales, « actuellement, les collectivités locales ont la possibilité, pour la prise en charge des personnes en grande précarité, de se tourner vers l'Etat, sous le prétexte, réel sur le plan juridique, qu'elles sont de sa responsabilité ».
De même, selon Julien Damon, rapporteur général du Grenelle de l'environnement : « le même constat (de complexité excessive) vaut pour le dispositif de prise en charge des sans-abri. Je crois qu'il serait judicieux de l'unifier, ce qui ne signifie pas qu'il ne puisse pas être adapté au niveau local. Plutôt que de rechercher vainement à en assurer la coordination, il serait souhaitable de simplifier radicalement ce système incompréhensible ».
Or, cet enchevêtrement de compétences risque d'être préjudiciable à la mise en oeuvre de la loi DALO, qui suppose d'une part une collaboration étroite des différents acteurs, d'autre part l'existence d'un chef de file qui puisse trancher si aucun acteur ne veut assumer la charge du relogement d'une personne dont le droit a été reconnu.
En effet, même si l'Etat est le garant du droit au logement, dans les faits aucune autorité politique n'a été désignée comme responsable de l'application effective de la loi, avec des moyens permettant de faire respecter ses décisions. Selon M. Bernard Lacharme, secrétaire général du haut comité pour le logement des personnes défavorisés, « les participants aux débats qui ont eu lieu au sein du comité DALO estiment nécessaire la recherche du consensus entre les différents acteurs concernés. Ce consensus suppose l'existence d'un diagnostic partagé sur les besoins et une harmonisation des actions. Toutefois, le législateur doit prévoir le cas d'une absence de coopération entre les acteurs et donc la possibilité d'aboutir à un arbitrage ».
|
L'enchevêtrement des compétences en matière de logement social et d'hébergement L'Etat : - a la responsabilité de ma mise en oeuvre du droit au logement ; - définit et conduit une politique nationale d'aide au logement ; - finance au titre de la solidarité nationale les aides à la pierre (subventions aux HLM, subventions ANAH pour l'habitat privé), les aides à la personne (allocation logement APL) ; - finance et assume la responsabilité de l'hébergement (centre d'hébergement d'urgence et centre d'hébergement et de réinsertion sociale) ; - co-pilote les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD); - dispose de réservations dans le logement social ; - a le droit de réquisition. Le conseil général: - co-pilote avec l'État les PDALPD ; - finance et préside seul les fonds de solidarité logement depuis le 1er janvier 2005 ; - finance et assume la responsabilité de l'hébergement pour les jeunes, les femmes enceintes et les mères isolées avec des enfants de moins de trois ans ; - peut disposer d'un office HLM ou d'un OPAC ; - peut, depuis le 1er janvier 2005, recevoir délégation des aides à la pierre sauf sur le territoire des intercommunalité qu'il revendique. La commune : - a la maîtrise de l'urbanisme et délivre les permis de construire ; - définit la politique de l'habitat sauf si celle-ci est une compétence de l'agglomération ; - garantit les emprunts des organismes HLM, peut disposer d'un office HLM ou d'un OPAC ; - dispose de droits de réservations sur les logements sociaux et peut demander délégation des droits du préfet. La communauté d'agglomération et la communauté urbaine : - ont une compétence obligatoire en matière de logement social; - définissent un programme local de l'habitat (PLH) qui fixe les objectifs, en particulier de logement social, et doit tenir compte du PDALPD ; - assurent la cohérence des plans locaux d'urbanisme des communes de leur territoire ; - peuvent se doter de leurs propres outils : office HLM ou OPAC notamment ; - peuvent obtenir délégation des aides à la pierre depuis le 1er janvier 2005 ; - peuvent obtenir délégation du contingent préfectoral uniquement si les communes membres sont d'accord. Les communautés de communes peuvent prendre une compétence en matière de logement mais n'y sont pas obligés. La région , qui n'a pas de compétences obligatoires en matière de logement, intervient souvent au soutien des collectivités au moyen d'aide financière, ou en mettant à leur disposition un établissement public d'intervention foncière. |
4. La coordination en matière de santé
La coordination de la politique de santé en direction des personnes en situation de précarité est effectuée au niveau régional par le biais des programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (PRAPS) , créés par la loi de lutte contre les exclusions de 1998.
Les PRAPS visent à associer mutuelles, organismes d'assurance maladie, hôpitaux, organismes professionnels, associations, collectivités locales et services de l'Etat, pour améliorer l'accès à la prévention et aux soins des personnes en situation de précarité. Ils comprennent une analyse des besoins, la définition des priorités et objectifs et un programme d'actions. Celles-ci peuvent consister dans la mise en place de lieux d'écoute, de formations ou de consultations.
Les objectifs des PRAPS sont relayés par les permanences d'accès aux soins de santé (PASS), cellules de prise en charge médico-sociale destinées à faciliter l'accès des personnes démunies aux organismes de santé.
En mai 2004, à partir de l'ensemble des évaluations réalisées, un rapport de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) de mai 2004 228 ( * ) a classé les PRAPS dans les dispositifs dont le bilan est jugé globalement positif, même s'ils appellent certaines améliorations . Les PRAPS paraissent être un « dispositif légitime et apte à motiver une réelle dynamique de transversalité ». Si ces programmes restent largement perfectibles, « tous les acteurs s'accordent à souligner leur rôle dans le décloisonnement entre santé et social, entre les divers services de l'Etat concernés, entre les services déconcentrés de l'Etat et les collectivités territoriales, avec le monde associatif.
La DGAS a rédigé une circulaire 229 ( * ) donnant des indications visant à guider l'élaboration des PRAPS de troisième génération (2008-2012). Une des orientations retenues est le développement du partenariat avec la politique de la ville , en particulier les ateliers santé ville (volet santé des contrats urbains de cohésion sociale (CUCS)).
C. DES DISPOSITIFS D'INSERTION À L'EFFICACITÉ PARFOIS INCERTAINE FAUTE D'ÉVALUATIONS SUFFISANTES
Le recours à l'évaluation doit permettre un pilotage plus efficace de l'action publique au niveau décentralisé. Cependant, l'évaluation n'est pas encore systématique, et, lorsqu'elle existe, elle n'aboutit pas souvent à infléchir les politiques menées en fonction des résultats.
En outre, si les grands acteurs de l'insertion voient leur action régulièrement faire l'objet de rapports de l'ONPES, de l'IGAS, de la DREES, etc., il est plus difficile d'évaluer les performances des petits acteurs, notamment des associations. Néanmoins, les grands réseaux de l'insertion professionnelle comme les missions locales ou les PLIE ont fait l'objet d'évaluations :
- concernant les missions locales , selon l'enquête nationale Génération 1998 du Centre d'études et de recherches sur les qualifications (CEREQ), 60 % des jeunes sans qualification se rendent dans une mission locale ou une PAIO à leur sortie du système scolaire ; 6 % des premiers emplois occupés par les jeunes peu ou pas qualifiés (niveau inférieur au CAP-BEP) sont trouvés par l'intermédiaire du réseau et 50 % des entrées en formation des jeunes sans qualification sont dues au réseau ;
- concernant les PLIE , l'Alliance villes emploi conduit chaque année depuis 2001 une consolidation de leurs résultats, cofinancée par le Ministère de l'emploi et le FSE. Les PLIE auraient ainsi permis, de 2000 à 2006, le retour à l'emploi durable de 46% des publics accueillis ;
- concernant les maisons de l'emploi, outre le rapport d'étape de Jean-Paul Anciaux déjà cité, l'Alliance villes emploi publie un guide d'autoévaluation des MDE à la demande du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi ;
- concernant le secteur de l'insertion par l'activité économique (IAE) , le rapport du CNIAE déjà cité souligne le manque de connaissances récentes sur les dispositifs (les dernières données de la DARES, parues en 2007, portent sur l'année 2005) et la dispersion des données en raison des multiples acteurs compétents dans ce secteur. La complexité de la gouvernance rejaillit directement sur la qualité de l'évaluation. De même, si l'IAE, en tant que compétence de l'Etat, fait l'objet d'une évaluation dans le cadre de la LOLF, les indicateurs sont trop partiels pour évaluer globalement ses performances. Ainsi l'évaluation se concentre-t-elle essentiellement sur des taux de retour à l'emploi, sans prendre en compte la situation des personnes au moment de leur recrutement. L'évaluation ne tient donc pas compte des améliorations de la situation sociale des individus.
Les tentatives d'évaluation des associations oeuvrant dans le champ de l'insertion rencontrent d'ailleurs le même genre de difficultés que l'évaluation de l'IAE. Par exemple, une évaluation classique ne peut prendre en compte le fait qu'une association a réussi simplement à établir une relation de confiance avec un sans-domicile fixe, relation qui aboutira peut-être ultérieurement à une amélioration de la santé de cette personne, puis, plus tard encore, à la reprise d'un emploi. Des référentiels spécifiques doivent donc être mis en place pour mesurer ce genre d'actions.
Enfin, l'évaluation souffre de la multiplicité des organismes d'observation et d'évaluation, dont chacun effectue certes des analyses pertinentes, mais pas de manière assez suivie et assez partagée pour qu'une évaluation permanente du secteur soit possible et puisse se traduire par une amélioration constante des dispositifs.
III. SIMPLIFIER LA GOUVERNANCE DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION
Le constat de la complexité excessive du dispositif amène la mission à proposer quelques évolutions afin d'enclencher une dynamique de simplification autour de deux aspects complémentaires : l'approfondissement de la décentralisation et la mise en place d'une gouvernance territoriale efficace.
A. L'ETAT DOIT ACCEPTER PLEINEMENT LA DÉCENTRALISATION EN RESTANT LE GARANT DE L'ÉQUITÉ DES POLITIQUES D'INSERTION
Le caractère incomplet de la décentralisation des politiques de lutte contre l'exclusion est indéniablement une des premières causes de leur complexité. Ainsi, au niveau départemental, l'Etat et le conseil général, chacun avec ses objectifs, ses services, ses moyens financiers et ses instances de coordination, s'efforcent de lutter contre la pauvreté, tandis que les régions et les communes se greffent, parfois sans réflexion stratégique, aux dispositifs mis en place par les deux autres acteurs.
Pourtant, une partie du problème est théoriquement résolue depuis que la loi de 2004 sur les libertés et responsabilités locales a fait du conseil général le chef de file de l'action sociale. En réalité, cette réforme n'a pas abouti à une réelle simplification. Cet échec résulte d'une part d'un contexte financier difficile marqué par une forte hausse des dépenses sociales des départements, d'autre part de la réticence des autres acteurs, en particulier l'Etat, à tirer les conséquences de la réforme.
1. Garantir la stabilité du financement des compétences d'action sociale du Conseil général
L'établissement de relations financières faisant l'objet d'un consensus entre l'Etat et les départements est ainsi le préalable indispensable à tout approfondissement de la décentralisation de l'action sociale. En effet, pour le moment, l'absence de confiance réciproque résultant de la « querelle » du financement du RMI bloque les évolutions nécessaires.
La mission considère donc qu'il est nécessaire de garantir aux départements une stabilité et un volume de ressources suffisants pour assurer le financement de leurs compétences en matière d'insertion.
La solution la plus ambitieuse consisterait à transférer aux conseils généraux un impôt plus dynamique et plus pérenne que la TIPP, vouée au déclin. Il pourrait s'agir, comme le suggère le rapport Valletoux 230 ( * ) , d'une taxe établie sur les mêmes bases que la CSG : soit une partie d'une CSG augmentée, soit un taux additionnel à la CSG.
Cette formule aurait le mérite d'établir un lien logique entre les compétences sociales du département et l'assiette de leur financement. Elle implique cependant une réforme plus large, notamment parce qu'elle devrait être effectuée à pression fiscale constante, donc compensée par une diminution de la fiscalité d'Etat.
Cependant, en attendant qu'une telle solution soit possible, la mission propose de pérenniser et d'améliorer la compensation par l'Etat de l'écart entre la TIPP versée et les dépenses effectives de RMI . Cette compensation serait intégrale et serait versée après constatation de l'écart entre dépenses de RMI effective et le montant de la TIPP, sous réserve toutefois, pour maintenir la responsabilité du département, de ne prendre en compte, selon la suggestion du rapport Mercier 231 ( * ) , que les « meilleurs efforts du conseil général pour en réduire le montant : suivi individuel de tous les bénéficiaires ; bénéficiaires dotés d'un référent ; bénéficiaires titulaires d'un contrat d'insertion ». Il s'agirait ainsi d'institutionnaliser le fonds de mobilisation de l'insertion (FMDI) et de le renforcer.
En tout état de cause, la mission insiste particulièrement sur la nécessité d'établir enfin des règles claires, après discussion approfondie avec les collectivités et au sein du comité des finances locales (CFL), pour la compensation des transferts de compétences sociales aux départements.
Les départements devront être associés à cette réforme. De manière plus générale, il conviendra de les associer systématiquement aux décisions ayant des effets directs ou indirects sur leurs dépenses sociales.
Enfin, les conseils généraux doivent pouvoir bénéficier de davantage d'informations sur les bénéficiaires des allocations de la part des CAF et des caisses de la MSA, afin de mieux piloter leur dépense d'insertion et de pouvoir évaluer correctement les résultats de leur politique d'insertion.
La mission suggère donc de reprendre la proposition de loi du 15 février 2008 du président Michel Mercier et ainsi de rendre obligatoire pour les organismes payeurs la fourniture au département, à l'occasion de chaque demande de règlement, des justificatifs récapitulant les bénéficiaires, les prestations, l'objet de la prestation et son montant. Les conventions signées entre les conseils généraux et les CAF ou caisses de MSA devront en outre comporter les délais de paiement entre le département et l'organisme payeur, les modalités d'échanges de données entre les partenaires, l'imputation des indus selon leur origine ainsi que les délégations de gestion consenties par le département à l'organisme payeur.
2. Donner davantage de contenu au rôle de chef de file du Conseil général
Une fois ces règles établies, un approfondissement maîtrisé de la décentralisation pourrait être envisagé avec sérénité.
Il s'agit d'abord d'appliquer pleinement l'article 49 de la loi de 2004 sur les libertés et responsabilités locales : « Le département définit et met en oeuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent.
Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l'article L. 116-1 à la définition des orientations en matière d'action sociale et à leur mise en oeuvre ».
Une véritable application du deuxième alinéa suppose que le conseil général puisse donner des orientations au Conseil régional sur la formation des bénéficiaires du RMI, à l'Etat sur l'organisation dans le département de l'Insertion par l'activité économique (si celle-ci reste de la compétence de l'Etat, la mission suggérant plutôt de la décentraliser), l'hébergement et le logement social, les actions de santé en direction des publics précaires, etc.
Si la loi de 2004 a supprimé les commissions d'aide sociale d'urgence (CASU) et les comités départementaux de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions, la pleine application de son article 39 implique également la simplification de la coordination parallèle de l'aide sociale par l'Etat : CDCS, CDEI, COPEC devraient ainsi être unifiées, leur suppression pure et simple étant rendue impossible par le maintien des autres compétences de l'Etat dans le domaine social.
Par ailleurs, dans le droit fil de cette revalorisation du rôle de chef de file du conseil général, la mission suggère de décentraliser le secteur de l'insertion par l'activité économique (scénario proposé par le rapport déjà cité du CNIAE). Cette décentralisation permettra de donner au conseil général un instrument de plus, dont beaucoup s'accordent à reconnaître l'intérêt, dans l'élaboration de sa stratégie d'insertion, largement tournée désormais vers l'insertion professionnelle.
Conséquence logique de ce transfert, les commissions départementales d'insertion par l'activité économique (CDIAE) et les conseils départementaux d'insertion (CDI) pourraient être fusionnés , d'autant qu'ils sont en général très proches dans leur composition. Les CDI pourraient alors avoir un véritable rôle de repérage des projets de structures, de collecte des données, d'élaboration d'objectifs stratégiques et de suivi de résultats en matière d'insertion par l'économique.
Cependant, comme le souligne le rapport du CNIAE, la décentralisation doit se faire à budget équivalent , ce qui suppose une évaluation financière préalable partagée . Il existe en effet actuellement de nombreuses incertitudes sur le niveau de financement accordé par les collectivités territoriales (évolution des 17% attribués par les départements aux actions d'insertion, contribution des conseils régionaux, etc).
En outre, il conviendra que l'Etat fixe des objectifs minimaux de base et des critères d'évaluation , afin que la décentralisation ne conduise pas à augmenter les inégalités entre départements.
3. Un Etat garant de l'équité des politiques d'insertion
De nombreux intervenants se sont montrés attachés au rôle de l'Etat comme garant de l'équité des politiques d'insertion , en particulier à travers la fixation nationale des montants et des critères d'attribution des allocations d'insertion. M. Arnaud Vinsonneau, adjoint au directeur général, chargé des relations institutionnelles de l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes sanitaires et sociaux (UNIOPSS) a ainsi déclaré à la mission : « Je souhaite confirmer notre attachement à voir le montant du RMI être toujours fixé au niveau de l'Etat et non pas à l'échelle des territoires ».
La poursuite de la logique de la décentralisation proposée par la mission ne va pas à l'encontre de cette pérennité du rôle de garant de l'égalité joué par l'Etat. Au contraire, celui-ci pourrait se concentrer, à travers un renforcement de l'évaluation organisée autour d'un observatoire national, des DRASS et des DDASS , sur un rôle d'évaluation et de contrôle a posteriori de l'action des collectivités.
L'Etat pourrait aussi, comme la mission a pu l'observer au Danemark, susciter une émulation entre les collectivités locales en organisant une comparaison de leurs performances en termes d'insertion.
4. L'unification des organismes d'évaluation et de contrôle
De nombreux intervenants ont mis en exergue la nécessité d'améliorer la connaissance, d'une part des phénomènes de pauvreté eux-mêmes, d'autre part des politiques de lutte contre l'exclusion. Selon Mme Maestracci, présidente de la FNARS, « nous demandons de disposer d'un Observatoire national de la pauvreté qui soit doté de moyens et nous permette d'évaluer correctement les besoins de la population. Il nous semble que cette demande (...) constitue un préalable indispensable à toute politique publique de lutte contre la pauvreté. »
La mission suggère donc de renforcer l'ONPES , qui a l'intérêt d'être rattaché au CNLE, en lui attribuant des moyens d'expertise propre et en augmentant de manière importante son budget d'étude . Cette augmentation devrait être compensée par une diminution correspondante du financement des études des autres organismes consacrés au champ de l'exclusion. En effet, comme l'a souligné devant la mission M. Laurent Chambaud, inspecteur général des affaires sociales, « il serait mieux, selon moi, d'avoir une force de frappe importante en charge de l'observation de la pauvreté, basée sur des gens qualifiés et capables de travailler non seulement sur la pauvreté, mais aussi sur la grande précarité à travers toutes ses dimensions (générationnelle, territoriale, etc.) ».
Parallèlement, l'analyse des besoins sociaux, réalisée par les CCAS, pourrait constituer la base d'un travail de recueil des besoins au niveau local, systématiquement consolidé au niveau départemental , en donnant la parole aux personnes en situation de précarité.
Ce recueil permettrait de faire émerger des besoins inconnus des pouvoirs publics et de davantage construire les politiques à partir des territoires.
5. Mieux mobiliser les financements européens
Plusieurs intervenants auditionnés par la mission ont souligné la sous-consommation des crédits du fonds social européen (FSE) utilisables pour les politiques d'insertion sociale. Compte tenu des montants en jeu (l'objectif 3 est doté pour la France de 4,7 milliards d'euros), la mission souhaite qu'une réflexion soit menée par l'Etat pour simplifier l'attribution des crédits aux porteurs de projets afin d'arriver à une consommation totale de ceux-ci.
B. DÉVELOPPER LA CONTRACTUALISATION TERRITORIALE ET LA COORDINATION DES ACTEURS POUR SIMPLIFIER LES PARCOURS D'INSERTION
Les travaux de la mission lui ont permis de constater que les politiques sociales ont trop longtemps consisté en réponses sectorielles coûteuses, qui consistent à mettre en place une foule de dispositifs sociaux spécifiques qui stigmatisent les individus. Dans son rapport sur le développement social local 232 ( * ) , l'ODAS souligne ainsi que le développement social « ne doit pas être un traitement social, mais un traitement territorial visant au maintien dans la société de toutes les personnes » : c'est ainsi qu'il faut sortir d'une logique de dispositifs et aller vers la mobilisation des potentialités locales. Seule une contractualisation sur de nouvelles bases entre les acteurs de l'insertion pourra aboutir à cette mobilisation.
1. Développer la contractualisation
La mission a pu constater à quel point la multiplicité des acteurs suscite à son tour un besoin de coordination, qui aboutit lui-même à la création de nouvelles instances de concertation et d'animation. La complexité qui en résulte est telle, que, selon Julien Damon, rapporteur général du Grenelle de l'insertion « il ne s'agit plus de coordonner mais de simplifier »
Le fait que l'insertion soit éclatée entre trois niveaux au moins, ayant chacun son ressort (Région, département et bassin d'emploi), avec une organisation parallèle du service public de l'emploi, est la source d'une complexité incompressible. Comme la mission l'a constaté lors de son déplacement au Danemark, lorsqu'il n'existe quasiment qu'un seul niveau de collectivité territoriale (les communes) et qu'en outre les services locaux de l'agence pour l'emploi sont fusionnés avec les services municipaux, la simplicité est de mise.
Des auditions auxquelles la mission a procédé, il ne paraît pas réaliste de retenir l'option d'une simplification radicale et la contractualisation reste le seul moyen de mieux coordonner les politiques d'insertion. La contractualisation suppose un diagnostic des problèmes, recense les objectifs et les moyens nécessaires et prévoit un dispositif de suivi et d'évaluation. Elle doit également permettre d'engager des actions à long terme, l'ensemble des intervenants entendus par la mission ayant fortement insisté sur la nécessaire stabilité des dispositifs et des institutions , en particulier parce que les acteurs ont besoin de temps pour être connus et reconnus par le public en difficulté.
L'utilisation des termes de « contractualisation » et de « partenariat », en vogue depuis le milieu des années 80, est susceptible de recouvrir des réalités diverses, de la relation contractuelle d'égal à égal où chaque partenaire s'engage concrètement à la simple déclaration d'intention, en passant par la relation hiérarchique déguisée. La mission considère que les partenariats sont plus efficaces s'ils s'organisent autour d'un véritable chef de file , qui a la responsabilité des objectifs à atteindre, c'est-à-dire, dans le cas de l'insertion, du département.
La mission suggèrera donc de retenir trois niveaux de contractualisation (régional, départemental, bassin d'emploi) , le conseil général, en tant que chef de file, jouant le rôle de pivot de ce système :
- un contrat entre la région et les conseils généraux , élaboré par des conférences régionales de financeurs réunissant les conseils généraux, ayant élargi la négociation à la formation professionnelle de tous les publics en insertion et non seulement des titulaires d'un contrat aidé. Comme le département serait désormais le véritable chef de file de l'insertion, les PDI seraient les documents de référence sur les objectifs desquels le conseil régional aurait obligation de s'engager pour mobiliser les instruments de formation, de VAE et d'apprentissage nécessaires. Ce contrat pourrait être annexé au schéma régional d'aménagement et de développement du territoire (SRADT), ce qui permettrait de faire le lien avec le développement économique du territoire;
- un contrat entre tous les financeurs de l'insertion professionnelle (Etat, conseil général, conseil régional, communes et intercommunalités) au niveau départemental, conformément aux objectifs d'un PDI devenu opposable, définissant les moyens accordés aux différentes structures d'insertion professionnelle du département : missions locales, PLIE, IAE et contrats aidés, associations...) sur trois ou quatre ans ;
- un contrat territorial de l'insertion professionnelle entre le conseil général et les opérateurs de l'insertion professionnelle d'un bassin d'emploi, pour fixer les objectifs et les moyens des structures d'insertion professionnelle dans ce bassin. Il s'agirait, selon l'expression de Mme Establie, directrice de l'Alliance ville emploi, d' « un contrat de territorialisation qui porterait l'ensemble des politiques que chacun des acteurs voudrait développer ». Le bassin d'emploi, qui peut coïncider avec le territoire d'une municipalité ou d'un EPCI, et où le contact les partenaires économiques peut avoir lieu, paraît en effet être l'échelle pertinente pour l'animation de l'insertion professionnelle.
Cette convention désignerait en outre un opérateur par bassin d'emploi parmi les cocontractants (mission locale, PLIE, agence du nouvel opérateur ANPE/ASSEDIC, association d'insertion professionnelle, voire CCI ou opérateur privé reconnu pour sa compétence) pour l'animation de l'insertion professionnelle locale et l'entretien de réseaux d'entreprises susceptibles de prendre en charge les publics en difficulté. Il serait choisi par le conseil général en fonction des résultats déjà obtenus et de l'expérience acquise, et son action ferait l'objet d'une évaluation par le conseil général tous les deux ans, en fonction de laquelle son rôle serait confirmé ou au contraire transféré à une autre structure.
2. Assurer la fluidité des « parcours d'insertion » et limiter le nombre d'instances de coordination
La mission estime qu'il convient, tout en ayant le souci de réduire la complexité des dispositifs et des procédures, de ne pas verser dans l'obsession opposée du guichet unique . En effet, comme l'expérience des MDE l'a démontré, il est très difficile de créer de véritables guichets uniques réunissant la totalité des acteurs d'un secteur. En outre, certains acteurs ont une légitimité et une expérience telle qu'il est vain de vouloir les délocaliser pour les associer à d'autres dans de nouveaux lieux : il serait ainsi sans doute contre-productif que le nouvel opérateur issu de la fusion ANPE/ASSEDIC disperse ses moyens humains pour être présent dans des guichets uniques.
Plutôt que de créer de nouveaux guichets uniques, il parait préférable de développer les relations entre le nouvel opérateur, les PLIE et les missions locales, ce qui pourra être accompli dans le cadre des contrats de territoire évoqués ci-dessus . Les maisons de l'emploi actuelles resteraient des lieux permettant d'associer PLIE, missions locales et associations, que le nouvel opérateur pourrait actionner en tant que de besoin.
Il importe en revanche de mettre en exergue la notion de « parcours », et donc de s'assurer que chaque acteur connaisse sa place dans le dispositif départemental de l'insertion et toutes les autres structures qu'il peut mobiliser autour d'un cas particulier.
Plutôt que de créer un nouveau conseil ou comité pour assurer cette coordination et cette connaissance mutuelle, la mission suggère qu'il revienne à l'animateur au niveau du bassin d'emploi déjà évoqué , de s'assurer que les différentes structures ne fonctionnent pas de manière cloisonnée. Ce rôle serait défini dans le contrat de territorialisation et serait financé dans la convention des financeurs au niveau départemental .
De manière générale, il s'agit de favoriser les relations directes entre les acteurs plutôt que les instances de coordination. La mission suggère ainsi d'évaluer tous les deux ans le fonctionnement des différents comités ou commissions de concertation et de supprimer celles qui ne se sont pas réunies depuis plus d'un an, ou n'ont produit aucun résultat. Cette mesure devrait aboutir à une diminution progressive du nombre de ces instances. La DRASS pourrait être chargée de cette évaluation au niveau régional.
3. Rationaliser l'accompagnement des jeunes sans qualification
L'accompagnement des jeunes sans qualification à la sortie du système scolaire n'est pas systématique et est éclaté entre de nombreuses structures différentes : missions locales/ PAIO, MDE, PAEJ...Du fait de cette dispersion, comme l'a souligné devant la mission M. Martin Hirsch, haut commissaire aux solidarités actives, personne n'est responsable de la prise en charge des jeunes sortis sans qualification du système scolaire.
La mission suggère donc que les établissements scolaires travaillent systématiquement avec les missions locales en leur signalant les élèves qui quittent l'éducation sans qualification.
4. Mieux garantir le financement des associations
La mission souhaite que les circulaires de 2002 et 2007 sur le financement des associations soient plus largement appliquées , et que les collectivités locales s'en inspirent davantage. Les collectivités locales devraient être ainsi encouragées à signer systématiquement des conventions d'objectifs pluriannuelles avec les associations exerçant des missions dans le cadre des plans départementaux d'insertion, permettant une avance sur la subvention de 50 % , et avec l'utilisation du formulaire unique de subvention. De nombreuses collectivités, Conseils généraux ou communes, mettent déjà en place ce type de conventions pluriannuelles. Celles-ci doivent définir les objectifs à atteindre, partagés par l'association et la collectivité, et les actions à mettre en oeuvre sur plusieurs années, ainsi que les moyens accordés pour les réaliser. La durée de ces conventions devrait être de trois ou quatre ans, reconductible une fois.
Un cadre national de convention collectivité / associations du secteur de l'insertion pourrait être élaboré par les associations d'élus et les grands réseaux associatifs nationaux.
5. L'organisation interministérielle
La lutte contre la pauvreté implique de nombreux domaines de l'action gouvernementale. Le document de politique transversale (DPT) « inclusion sociale » regroupe ainsi des programmes qui concernent, outre la lutte contre l'exclusion au sens strict, le logement, la santé, l'aménagement du territoire, la rénovation urbaine, l'emploi, l'école, le sport, l'administration pénitentiaire...
Il résulte des travaux de la mission que la lutte contre l'exclusion ne saurait être considérée comme un secteur particulier, susceptible de relever d'objectifs et d'actions spécifiques, distincts de ceux des autres grandes politiques. En effet, une telle délimitation se traduit par une stigmatisation et un enfermement dans leur statut des publics en difficulté et par l'inefficacité des politiques menées. Au contraire, la lutte contre l'exclusion doit viser à faire bénéficier du droit commun ceux qui, du fait de leur histoire personnelle, s'en sont retrouvés exclus, et pour cela à introduire de manière transversale le souci de l'inclusion dans tous les domaines de l'action politique.
Or, une telle exigence doit être prise en compte au plus haut niveau, dans l'organisation ministérielle et celle de la haute administration. Certains intervenants auditionnés par la mission ont ainsi jugé préférable d'avoir un grand ministère regroupant au moins l'emploi et le social, ces deux branches se trouvant nécessairement au centre des politiques de lutte contre l'exclusion. Ainsi, selon Claude Alphandery, président du conseil national de l'insertion par l'activité économique, « nous sommes très attachés au lien existant entre l'économie et le social. Or ce lien est souvent mal perçu à différents niveaux, notamment celui de l'Etat. Les choses fonctionnaient mieux lorsqu'il existait un ministère de l'emploi et de la cohésion sociale ».
Cependant, le même intervenant a souligné également l'intérêt de rattacher l'emploi à l'économie. Il est ainsi difficile de fixer les limites d'un ministère qui disposerait de l'ensemble des directions nécessaires à la politique de lutte contre l'exclusion.
Plusieurs acteurs prônent donc plutôt un pilotage interministériel renforcé et une représentation au plus haut niveau du gouvernement. Ainsi, selon Laurent Chambaud, inspecteur général des affaires sociales, « l'essentiel pour moi passe par la mise en place d'un pilotage interministériel et, comme l'a préconisé le député M. Etienne Pinte, la création d'un poste de délégué général auprès du Premier ministre. »
Lors de son audition par la mission, M. Martin Hirsch a également souligné que son statut de haut commissaire placé directement auprès du Premier ministre permettait d' « afficher les politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion comme une priorité gouvernementale, d'adopter une approche transversale et de mobiliser l'ensemble des ministères concernés par ces politiques ».
La mission suggère en conséquence un renforcement de la coordination par le comité interministériel de lutte contre les exclusions (CILE) et le CNLE, et la pérennisation d'un responsable de la lutte contre l'exclusion placé auprès du Premier ministre .
|
Récapitulatif des propositions de la mission 1. Approfondir la décentralisation avec un Etat garant de l'équité des politiques d'insertion - mener une réflexion avec le comité des finances locales sur la création d'un nouvel impôt établi sur les mêmes bases que la CSG (compensé par une baisse de la fiscalité d'Etat); dans cette attente, assurer une compensation a posteriori des dépenses de RMI (pour les meilleurs efforts des départements); - associer systématiquement les conseils généraux aux décisions ayant pour effet d'augmenter directement ou indirectement leurs dépenses sociales; - rendre obligatoire la fourniture par les CAF et les caisses de MSA aux conseils généraux de justificatifs de dépenses plus complets ; rendre plus explicites les conventions signées entre les conseils généraux et ces organismes payeurs (avec la mention des délais de paiement, les modalités d'échanges de données, etc.); - tirer les conséquences du rôle de chef de file du département en réduisant à une seule les instances de coordination de l'Etat en matière sociale dans le département. Décentraliser la gouvernance de l'insertion par l'activité économique, après une évaluation précise et partagée des charges financières actuellement supportées par chacun des financeurs ; fusionner CDI et CDIAE ; enfin fixer des objectifs minimaux et des critères d'évaluation uniformes pour l'IAE; - améliorer l'évaluation des politiques d'action sociale en renforçant le rôle des DRASS dans ce domaine ; faire d'un ONPES doté de davantage de moyens l'unique organisme d'observation de la pauvreté et d'évaluation au niveau national; rendre obligatoire la consolidation par les conseils généraux de l'analyse des besoins sociaux réalisée par les CCAS ; - améliorer la consommation des crédits européens au titre du FSE en simplifiant les procédures ; 2. Développer la contractualisation territoriale et la coordination des acteurs pour faciliter la simplicité des parcours d'insertion - créer un contrat entre le conseil régional et les conseils généraux sur la formation des publics en insertion, élaboré par une conférence régionale des Départements, sur la base des orientations des plans départementaux d'insertion (PDI) ; - créer un contrat départemental entre tous les financeurs des politiques d'insertion professionnelle déterminant ces financements pour une durée de trois ou quatre ans ; - créer un contrat territorial d'insertion professionnelle entre le conseil général et les opérateurs de l'insertion professionnelle d'un bassin d'emploi, déterminant les objectifs et les moyens des structures d'insertion professionnelle pour trois ou quatre ans et désignant un animateur, qui fera l'objet d'une évaluation à mi-contrat ; - suspendre la création de nouvelles MDE et privilégier les relations entre le nouvel opérateur du service public de l'emploi et les autres structures d'insertion professionnelles; évaluer les instances de coordination existantes tous les deux ans en supprimant celles qui ne se sont pas réunies depuis plus d'un an ou n'ont produit aucun résultat ; - prévoir que les établissements scolaires et d'apprentissage signalent systématiquement aux missions locales les jeunes quittant sans formation ni qualification le système scolaire, pour que celles-ci puissent prendre contact avec eux ; - faire une véritable application des circulaires de 2002 et 2007 sur les associations et encourager les collectivités à faire de même avec un cadre conventionnel élaboré après négociation entre associations d'élus et grands réseaux associatifs ; - renforcer la coordination de la lutte contre l'exclusion en réunissant régulièrement le comité interministériel de lutte contre les exclusions (CILE); pérenniser une fonction de responsable de la lutte contre l'exclusion placé auprès du Premier ministre. |
*
* *
RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL DES PROPOSITIONS DE LA MISSION
|
1) Mieux mesurer la pauvreté et l'exclusion - Continuer le travail d'enrichissement de l'enquête revenus fiscaux afin que tous les revenus monétaires y soient pris en compte, notamment en rapprochant les bases de données fiscales et sociales actuellement disjointes ; - Élargir l'échantillon de cette enquête afin que soient connues de façon plus fiable les conditions de vie au plan local, et pour établir précisément les corrélations existant entre pauvreté, emploi, logement, éducation, etc. ; - Mieux connaître l'impact des politiques sociales locales sur les niveaux de vie ; - Améliorer la connaissance des trajectoires qui mènent à la pauvreté et à la persistance dans la pauvreté (suivi longitudinal) ; - Encourager une meilleure prise en compte, au plan européen, des dimensions qualitatives de la pauvreté, s'agissant notamment des difficultés en termes de conditions de vie ; - Encourager aussi, au plan européen, le calcul de variantes afin que l'ensemble des aspects des politiques fiscales et de redistribution puissent être pris en compte dans le calcul des niveaux de vie (notamment l'impact des services publics collectifs individualisables et des aides locales) ; - Améliorer la connaissance de la très grande pauvreté, en suivant notamment les préconisations de l'IGAS sur la coordination de l'observation statistique des personnes sans abri ; - Définir des indicateurs d'alerte publiables rapidement, afin de pouvoir infléchir les politiques conduites sur le fondement de remontées d'expériences des acteurs de terrain ; - Communiquer, non pas sur un indicateur central unique (la pauvreté ancrée dans le temps) mais de préférence sur un ensemble réduit d'indicateurs ; - Ne pas multiplier les grilles de lecture. 2) Améliorer la prise en charge et l'accès aux soins des personnes défavorisées - Développer les unités mobiles de prise en charge et généraliser les permanences d'accès aux soins de santé ; - Favoriser l'accès des bénéficiaires de la solidarité nationale à la CMU-c par le développement de l'affiliation automatique et l'étude systématique des droits lors de toute prise en charge ; - Revaloriser les plafonds d'accès à la CMU-c au niveau du seuil de pauvreté ; - Responsabiliser les bénéficiaires de la CMU et les médecins pour limiter les refus de soins. 3) Poursuivre les actions engagées en faveur de l'hébergement et du logement des ménages modestes - Responsabiliser les maires au travers de conventions d'objectifs conclues avec les associations de proximité visant la prise en charge de toute personne sans abri ; - Inciter les communes à produire plus de logements très sociaux par une meilleure reconnaissance des efforts consentis et en fixant à 30 % la part minimale qu'ils doivent représenter parmi les logements nouvellement construits ; - Libérer des logements dans le parc social au profit des ménages les plus défavorisés en limitant à 60 % la part des ménages éligibles et en développant des mesures incitatives à la mobilité vers le parc privé ; - Mettre en oeuvre dès que possible les mesures préconisées par la mission Pinte en faveur de la prévention des expulsions locatives ; - Mobiliser plus activement le parc privé à vocation sociale en renforçant la lutte contre l'habitat indigne et en recentrant les incitations financières et fiscales sur les logements socialement accessibles situés dans les zones tendues ; - Favoriser l'accession sociale à la propriété en intégrant dans le décompte des 20 % de logements sociaux les logements acquis par des ménages modestes. 4) Prévenir le surendettement et améliorer l'accès des personnes en difficultés au crédit et aux services bancaires - Garantir l'accès effectif de tous aux services bancaires ; - Prévenir le surendettement des ménages en difficultés en favorisant la médiation bancaire et en indexant l'enveloppe financière du PEAD sur l'évolution des prix des denrées alimentaires ; - Protéger les ménages emprunteurs du « malendettement » en privilégiant un accès accompagné au crédit ; - Favoriser le développement du microcrédit social. 5) Réformer le système de solidarité nationale - Simplifier le système et le rendre plus incitatif à la reprise d'activité grâce à l'intégration des « droits connexes » dans toute réforme des minima sociaux ; - Créer les conditions du succès du RSA en se laissant le temps de l'expérimentation et de l'évaluation ; - Recentrer les politiques d'insertion sur les personnes les plus éloignées de l'emploi ; - Évaluer le contrat d'autonomie expérimenté au profit des jeunes des ZUS dans la perspective de sa généralisation à l'ensemble des jeunes en difficultés. 6) Améliorer l'accompagnement des personnes en insertion - Poser le principe d'une personne ou d'un binôme référent assurant l'accompagnement social et professionnel pour toute personne en insertion ; - Favoriser le développement de formations polyvalentes des travailleurs sociaux ; - Définir de façon concertée des principes communs d'évaluation des professionnels de l'insertion ; - Intensifier les relations entre les entreprises du bassin d'emploi et les professionnels de l'insertion. 7) Confier une mission de promotion sociale à l'éducation nationale - Fixer des objectifs chiffrés en matière de réduction de l'échec scolaire, notamment s'agissant des élèves issus de milieux défavorisés, - Donner la possibilité aux établissements scolaires de passer des conventions de partenariat avec des entreprises implantées localement ; - Renforcer l'autonomie des établissements scolaires en matière de pédagogie, de gestion des ressources humaines et d'utilisation des moyens ; - Renforcer en conséquence les pouvoirs du chef d'établissement. 8) Élargir l'horizon des élèves par une orientation active - Instituer un stage en entreprise annuel pour l'ensemble des élèves de la quatrième à la seconde ; - Renforcer l'enseignement de la technologie au collège, en privilégiant notamment le travail manuel ; - Créer une fonction de professeur référent en orientation ; - Dissocier la fonction de conseiller d'orientation de celle de psychologue scolaire ; - Mettre en place des parcours modulaires dans les lycées professionnels. 9) Encourager les initiatives innovantes en matière éducative - Encourager le développement de l'EPIDe dans les secteurs où l'emploi est dynamique ; - Inciter l'EPIDe à se concentrer sur les élèves les plus en difficulté ; - Évaluer le coût d'un dispositif de soutien financier de maintien dans les études ; - Instituer des stages dans des entreprises ou dans les collectivités territoriales pour les enseignants. 10) Fixer des principes en matière d'insertion économique - Passer d'une logique administrative à une logique contractuelle, en obtenant l'adhésion de tous les acteurs à une stratégie d'insertion déclinant des objectifs, des moyens et les outils d'évaluation correspondants ; - Pour toute aide versée ou toute action mise en oeuvre, agir au plus près des publics visés, en fonction des caractéristiques et des besoins particuliers des personnes, et non de leurs statuts. 11) Renforcer la formation professionnelle en lien avec l'emploi- - Inciter les entreprises à mettre en place des instruments de formation adaptés au profil de leurs travailleurs les moins qualifiés ; - Rendre la formation des chômeurs obligatoire ; - Développer les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification ; - Rendre plus attractif le recours à la validation des acquis de l'expérience. 12) Soutenir les associations dans leur action pour l'insertion professionnelle - Mettre en place le chèque associatif ; - Créer un statut adapté à la vie en communauté pour les personnes qui ne souhaitent pas intégrer le monde de l'entreprise. 13) Mobiliser les entreprises - Réaffirmer la place des entreprises dans l'insertion ; - Renforcer les liens entre entreprise et IAE ; - Développer le tutorat et le parrainage. 14) Encourager le travail indépendant - Simplifier les conditions de création pour qu'il soit simple de créer et de cesser une activité économique indépendante ; - Simplifier le paiement des prélèvements obligatoires ; - Lever les barrières légales et réglementaires à la création d'entreprises indépendantes ; - Protéger le patrimoine personnel de l'auto entrepreneur. 15) Muscler l'insertion par l'activité économique - Améliorer la collecte de données statistiques et le suivi des performances ; - Généraliser et renforcer l'agrément des publics pour mieux les identifier ; - Simplifier le cadre d'emploi des salariés en insertion et l'unifier sur le modèle du CDD de droit commun, avec l'ensemble des droits sociaux afférents, en l'adaptant à la situation de certaines catégories de personnes sans emploi ; - Renforcer le cadre de gouvernance territoriale de l'IAE. 16) Renforcer l'efficacité du service public de l'emploi - Affirmer le principe de la vocation universelle du SPE qui devra accueillir tous les publics, y compris les jeunes et les bénéficiaires des minima sociaux, même lorsque les personnes concernées ne sont pas inscrites à l'ANPE ; - Accélérer la mise en oeuvre de la réforme du SPE ; - Veiller à établir des relations plus étroites entre les agences de l'ANPE et les structures sociales en charge de l'insertion. 17) Rendre plus opérants les contrats aidés et de professionnalisation - Fusionner l'ensemble des contrats aidés en un contrat unique d'insertion, ouvert à tous les publics et modulable en fonction des besoins du salarié et de l'employeur et permettant d'assurer une meilleure transition vers un emploi durable ; - Développer le contrat de professionnalisation au bénéfice des demandeurs d'emploi les plus éloignés du marché du travail que sont les adultes et les jeunes sans qualification. 18) Approfondir la décentralisation avec un Etat garant de l'équité des politiques d'insertion - Mener une réflexion avec le comité des finances locales sur la création d'un nouvel impôt établi sur les mêmes bases que la CSG (compensé par une baisse de la fiscalité d'Etat); dans cette perspective, assurer une compensation a posteriori des dépenses de RMI (pour les départements les plus actifs en ce domaine) ; - Associer systématiquement les conseils généraux aux décisions ayant pour effet d'augmenter directement ou indirectement leurs dépenses sociales ; - Rendre obligatoire la fourniture par les CAF et les caisses de MSA aux conseils généraux de justificatifs de dépenses plus complets ; rendre plus explicites les conventions signées entre les conseils généraux et ces organismes payeurs (avec la mention des délais de paiement, les modalités d'échanges de données, etc.) ; - Tirer les conséquences du rôle de chef de file du département en unifiant les instances de coordination de l'Etat en matière sociale dans le département. Décentraliser la gouvernance de l'insertion par l'activité économique, après une évaluation précise et partagée des charges financières actuellement supportées par chacun des financeurs ; fusionner CDI et CDIAE ; fixer des objectifs minimaux et des critères d'évaluation uniformes pour l'IAE ; - Améliorer l'évaluation des politiques d'action sociale en renforçant le rôle des DRASS dans ce domaine ; faire d'un ONPES doté de davantage de moyens l'unique organisme d'observation de la pauvreté et d'évaluation au niveau national; rendre obligatoire la consolidation par les conseils généraux de l'analyse des besoins sociaux réalisée par les CCAS ; - Rechercher la consommation intégrale des crédits européens au titre du FSE en simplifiant les procédures. 19) Développer la contractualisation territoriale et la coordination des acteurs pour simplifier les parcours d'insertion - Instituer un contrat entre le conseil régional et les conseils généraux sur la formation des publics en insertion, élaboré par une conférence régionale des départements, sur la base des orientations des plans départementaux d'insertion (PDI) ; - Créer un contrat départemental entre tous les financeurs des politiques d'insertion professionnelle programmant ces financements pour une durée de trois ou quatre ans ; - Instituer un contrat territorial d'insertion professionnelle entre le conseil général et les opérateurs de l'insertion professionnelle d'un bassin d'emploi, déterminant les objectifs et les moyens des structures d'insertion professionnelle pour trois ou quatre ans et désignant un animateur, qui fera l'objet d'une évaluation à mi-contrat ; - Suspendre la création de nouvelles maisons de l'emploi et privilégier les relations entre le nouvel opérateur du service public de l'emploi et les autres structures d'insertion professionnelles; évaluer les instances de coordination existantes tous les deux ans en supprimant celles qui ne se sont pas réunies depuis plus d'un an ou n'ont produit aucun résultat ; - Prévoir que les établissements scolaires et d'apprentissage signalent systématiquement aux missions locales les jeunes quittant sans formation ni qualification le système scolaire, pour que celles-ci puissent prendre contact avec eux ; - Appliquer les circulaires de 2002 et 2007 sur les associations et encourager les collectivités à faire de même avec un cadre conventionnel élaboré après négociation entre associations d'élus et grands réseaux associatifs ; - Renforcer la coordination de la lutte contre l'exclusion en réunissant régulièrement le comité interministériel de lutte contre les exclusions (CILE); pérenniser une fonction de responsable de la lutte contre l'exclusion auprès du Premier ministre. |
EXAMEN DU RAPPORT DE LA MISSION
Au cours de sa séance du mercredi 2 juillet 2008 sous la présidence de M. Christian Demuynck, président, la mission commune d'information sur les politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion a procédé à l'examen du rapport de M. Bernard Seillier, rapporteur.
A l'issue de l'exposé de M. Bernard Seillier, rapporteur, un large débat s'est engagé.
M. Charles Revet a d'abord souligné la nécessité de simplifier au maximum les dispositifs et la gouvernance des politiques d'insertion.
Il a ensuite insisté sur le caractère préoccupant des situations d'endettement de certains ménages, aggravées par la multiplication non contrôlée des crédits à la consommation. Evoquant les systèmes de crédits plus encadrés de certains pays européens, il a indiqué qu'il présenterait un amendement allant dans le sens d'une plus grande responsabilisation des organismes de crédit dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie. Il a estimé que ceux-ci devaient être sanctionnés lorsqu'ils ne respectent pas les règles de prudence tenant compte de la situation financière des ménages emprunteurs.
Rappelant les interventions décevantes des représentants du ministère de l'éducation nationale auditionnés par la mission, M. Charles Revet a estimé que la situation que l'on connaît où 150.000 jeunes sortent du système scolaire sans diplôme est inacceptable et que la rigidité du cadre éducatif ne permettait pas aux jeunes de s'épanouir à l'école, celle-ci devant s'appuyer davantage sur les motivations des élèves.
M. Paul Blanc s'est dit favorable à une généralisation du revenu de solidarité active (RSA) dans les délais annoncés par le Président de la République et le Haut-commissaire aux solidarités active, estimant qu'il y a une attente forte qu'on ne peut décevoir après l'échec du RMI. Il a souhaité que la proposition du rapport recommandant d'attendre au minimum deux ans avant de légiférer soit supprimée.
Enfin, rejoignant la position du rapporteur, il s'est dit attaché à la promotion des instruments de validation des acquis de l'expérience et au soutien à la création d'entreprise.
Mme Annie David s'est dite globalement en accord avec les orientations du rapport.
S'agissant des indicateurs de la pauvreté et de l'exclusion sociale, elle s'est inquiétée que la référence aux revenus médians ne dissimule le creusement des inégalités de niveaux de vie entre les plus riches et les plus pauvres.
Après avoir partagé le constat du rapporteur de l'échec du système éducatif, s'agissant des élèves sortant sans diplôme ni qualification, Mme Annie David s'est opposée à l'idée qu'une mission sociale soit imposée à l'école, laquelle ne peut pas se substituer à la société. Citant les travaux de Thomas Piketty sur l'impact positif de la baisse des effectifs dans les classes, elle a par ailleurs estimé que la solution ne résidait pas dans la suppression des postes, mais bien dans une augmentation des moyens attribués à l'école.
Elle s'est en outre inquiétée de la précarisation croissante de la situation des femmes exerçant une activité à temps partiel subi et des salariés faiblement rémunérés. Elle s'est également prononcée en faveur d'une meilleure couverture des soins par la CMU-c, s'inquiétant notamment des refus de soins aux patients qui en sont bénéficiaires. Elle a craint que de la restructuration de l'hôpital public ne résulte une dégradation des soins pour les personnes les plus démunies.
Partageant l'ensemble des constats du rapport, elle s'est dite néanmoins réservée sur certaines de ses propositions.
M. Alain Gournac s'est félicité, pour sa part, que le rapport affirme clairement que l'école ne joue pas son rôle dans la réduction de la pauvreté et dans la prévention de l'exclusion sociale. Il a estimé que l'éducation nationale avait trop longtemps ignoré sa mission sociale, notant en outre que les maires qui ont vocation à être prévenus en cas de déscolarisation d'un enfant ne le sont que trop rarement. Il s'est ensuite déclaré très favorable aux écoles de la deuxième chance, et a affirmé que la réduction du nombre d'élèves par classe n'était pas le seul facteur de l'amélioration des résultats scolaires, qui est liée à des causes plus complexes. Il a enfin émis le souhait que des suites concrètes soient données à ce rapport, regrettant par ailleurs qu'il n'existe pas, à ce jour, de mesure scientifique de la pauvreté.
Puis il a insisté sur le rôle essentiel de l'accompagnement pour lutter contre le non recours aux droits fondamentaux.
Il a souscrit aux propos de M. Charles Revet sur la responsabilité des sociétés de crédit dans les situations de surendettement des ménages, qui sont parfois à l'origine d'un basculement dans la pauvreté et l'exclusion.
Mme Annie Jarraud-Vergnolle a approuvé la démarche cohérente retenue par le rapporteur, privilégiant une approche globale et transversale des politiques de lutte contre la pauvreté.
S'agissant de la formation des demandeurs d'emploi, dont elle a rappelé qu'elle s'inscrivait dans le cadre de parcours personnalisés, elle a préconisé le passage d'une formation axée sur le savoir-faire et le savoir-être à une formation véritablement professionnalisante.
Concernant l'insertion par l'activité économique (IAE), elle a fait remarquer que l'agrément délivré par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) aux publics en recherche d'emploi était fondé sur des critères professionnels, alors que ceux qui en sont les plus éloignés présentaient des problématiques périphériques à l'emploi. Elle a également préconisé de caler les conventionnements des structures d'IAE sur l'année civile.
Enfin, elle a regretté que le rapport n'évoque pas les clauses d'insertion dans les marchés publics, et a recommandé, dans le cadre des contrats aidés, d'assouplir les contraintes administratives et de faire référence, pour chaque personne, à un projet professionnel cohérent.
Souscrivant à ces propos sur l'approche transversale du rapport, M. Jean Desessard a exprimé quelques points de désaccord concernant le RSA, craignant qu'il soit considéré par les entreprises comme une subvention publique en faveur du travail à temps partiel. Il a affirmé sa préférence pour un revenu d'existence universel versé à tous, y compris aux jeunes de moins de 25 ans, qui ne sont actuellement pas éligibles au RMI. Saluant les progrès que représenterait la création d'une allocation d'autonomie, il a néanmoins estimé nécessaire que la question des jeunes soit abordée de façon plus globale.
Par ailleurs, il a souligné le caractère relatif des indicateurs et jugé qu'il était important de connaître leurs limites. Le rapport entre le niveau de vie des 10 % les plus riches et celui de 10 % les plus pauvres, qui s'élève à 3,15 ne reflète pas, selon lui, l'ampleur des inégalités.
Il a ensuite rappelé l'importance des discriminations scolaires. Il a salué à cet égard l'analyse des causes de ces inégalités dans le rapport, qui met notamment en relief l'impact du milieu culturel. S'agissant de l'orientation vers les secteurs professionnels et de la valorisation du travail manuel, il a néanmoins regretté que le rapport n'ait pas été plus précis.
Se disant en désaccord avec le rapporteur sur les orientations prises par le Gouvernement dans la définition de l'offre raisonnable d'emploi, il a stigmatisé un système d'économie libéral basé sur la concurrence et laissant de côté les personnes insuffisamment productives.
Compte tenu de ces observations, il a précisé qu'il s'abstiendrait lors du vote sur le rapport.
Mme Brigitte Bout a insisté sur l'importance de l'accompagnement dans l'emploi, à travers des instruments tels que le parrainage. Après avoir estimé qu'un véritable accompagnement existait déjà dans l'enseignement professionnel, citant notamment l'existence de parrainages dans le secteur du BTP, elle s'est dite en accord avec les passages du rapport consacrés à la dignité de la personne qui ne peut souvent être retrouvée que dans le cadre d'un accompagnement. Enfin, elle s'est inquiétée de la réduction du niveau de vie des retraités touchés par la baisse progressive de leur revenu qui résulte de la réforme des retraites et de la dégradation du rapport entre retraités et actifs.
En réponse à MM. Charles Revet et Alain Gournac, M. Bernard Seillier, rapporteur, est convenu de la nécessité d'une vigilance accrue s'agissant du surendettement des ménages et de l'octroi des crédits à la consommation.
Sur la question scolaire, il a insisté sur le rôle et la formation des conseillers d'orientation ainsi que sur la réintroduction de l'apprentissage manuel à l'école. S'agissant de la mission sociale de l'école, il a proposé que la formule « mission de promotion sociale » soit retenue, estimant qu'elle correspondait mieux à l'esprit du rapport.
En réponse à M. Paul Blanc, il a estimé qu'il convenait de prendre le temps nécessaire pour aborder la réforme du système de solidarité nationale dans la perspective, plus large, d'une politique de redistribution des revenus, approche dont il a regretté qu'elle soit tombée en désuétude. Il a souhaité que les résultats de l'expérimentation soient évalués avant toute généralisation du RSA.
Convenant des problèmes soulevés par la généralisation du RSA, M. Paul Blanc a souligné les dangers du report de la généralisation du dispositif à une date ultérieure, qui pourrait être entendu comme une remise en cause de la réforme prévue.
Ayant rappelé son adhésion au principe même du RSA, M. Bernard Seillier, rapporteur, a souligné la nécessité de se laisser le temps de tirer les enseignements des expérimentations conduites actuellement dans une trentaine de départements volontaires. Il a fait valoir que la position exprimée par l'Assemblée des départements de France, dont il doit être tenu compte, allait dans ce sens.
M. Paul Blanc a estimé en effet raisonnable de légiférer sur le fondement des premiers résultats des expérimentations.
Sur la suggestion de M. Christian Demuynck, Président, la mission a finalement retenu la formulation précisant qu'il convenait de « créer les conditions du succès du RSA généralisé en se laissant le temps de l'expérimentation et de l'évaluation ».
Enfin, la mission a approuvé le titre du rapport proposé par M. Bernard Seillier, rapporteur - « Lutter contre la pauvreté et l'exclusion : une responsabilité à partager » - et en a adopté les conclusions , le groupe communiste républicain et citoyen s'abstenant ainsi que M. Jean Desessard, rattaché administrativement au groupe socialiste.
CONTRIBUTION DE MME ANNIE DAVID ET DE M. GUY FISCHER AU NOM DU GROUPE CRC
Bien que l'ampleur de la pauvreté varie selon l'approche retenue pour définir la pauvreté (monétaire ou par les conditions de vie) et le critère utilisé pour la mesurer, nous rejoignons aisément le constat qui est présenté aujourd'hui: si la pauvreté reste stable en France, son intensité s'aggrave, tandis que le nombre de « travailleurs pauvres » augmente, pour atteindre 7 % de l'ensemble des travailleurs, dont une grande majorité sont des femmes ! À cet égard, nous tenons à saluer le travail considérable de la mission, qui à travers ses nombreuses auditions, nous a permis d'appréhender la pauvreté de manière transversale et à travers ses aspects multidimensionnels. En effet, depuis le milieu du 20ème siècle, la pauvreté a changé de visage et ses causes se sont diversifiées, c'est pourquoi, comme l'indique le rapport nous devons lutter contre ce phénomène par une approche globale.
Les nombreuses propositions présentées dans ce rapport reflètent cette approche. Toutefois, si certaines nous semblent pertinentes, telles que celles qui consistent à faciliter l'accès à la CMU et à revaloriser ses plafonds, d'autres, ne nous semblent pas à la hauteur des enjeux, ni aller dans le bon sens ! Il en est ainsi, par exemple, des propositions relatives au logement. Pourquoi ne pas contraindre les communes à respecter la loi SRU, par des sanctions plus fermes ? Quant à la proposition qui consiste à intégrer dans le décompte des 20 % de logements sociaux les logements acquis par des ménages modestes, nous nous inscrivons, bien évidemment en faux, tant elle est un contresens !
En matière d'insertion, le RSA est présenté comme « la » réponse, or il s'inscrit précisément dans ce que nous avons toujours dénoncé comme une source de rupture entre les citoyens en tant qu'effet pervers de la décentralisation. Le Gouvernement entend, par ailleurs, financer ce dispositif par la suppression de la prime pour l'emploi attribuée à des salariés modestes mais imposables. Autrement dit, il instaure la solidarité entre les plus pauvres. Plus que de vives « réserves », nous nous opposons fermement à un tel financement injuste socialement et économiquement ! Quant à son efficacité, nous pensons, qu'à terme, ce dispositif institutionnalisera la précarité. Or, le rapport démontre que si l'emploi reste prégnant contre le basculement dans la pauvreté et l'exclusion sociale, il n'en n'est plus le garant. En effet, parmi les causes identifiées de la pauvreté, par la mission, le système économique libéral est cité en ce qu'il tend à devenir « une machine à produire de l'exclusion ». En effet, l'emploi a vu ses normes se dégrader considérablement depuis vingt ans avec le développement des emplois précaires, CDD, intérim, contrats aidés.... Une partie de l'accroissement de la pauvreté des travailleurs s'explique donc par la combinaison du relâchement de la norme d'emploi durable et à temps plein et du développement de l'emploi à bas salaire. Le SMIC est une garantie de rémunération horaire, et prévient donc de la pauvreté, mais parce qu'il est associé au CDI. Les choix politiques ces dernières années à travers les allègements de cotisations patronales ont encouragé la création d'emplois peu rémunérateurs et précaires et favorisé cette dégradation et précarisation. Or, le RSA, c'est la continuité de cette politique qui entraîne la paupérisation des travailleurs !
Il en est de même des choix politiques qui ont mis à mal nos structures de solidarité, et de protection sociale. Nous faisons référence, notamment aux franchises médicales et aux manques de moyens des hôpitaux, alors même que, comme l'indique parfaitement le rapport, les ménages les plus modestes ont un état de santé plus précaire.
Quant à l'école, il est vrai qu'elle ne joue plus son rôle d'ascenseur social, et bien qu'elle n'ait pas vocation à pallier les insuffisances de la société, elle peut véritablement être, un vecteur de réussite sociale. Mais les suppressions de postes successives décidées ces dernières années ne vont pas, là aussi, dans le bon sens !
Enfin, il nous semble qu'un aspect n'a pas été évoqué, celui des conséquences psychologiques de la pauvreté. Les impacts ne sont pas seulement d'ordre matériel et économique, ils affectent aussi la santé physique et mentale des individus, produisant des effets aussi importants que le stress, la détresse psychologique, l'isolement social, ainsi que l'augmentation de la violence conjugale et contre les enfants.
Pour conclure, si les nombreuses propositions présentées dans le rapport de la mission commune, reflètent l'important travail mené par la mission, nous doutons qu'elles arrivent à terme faute de moyens financiers. Tout au plus, feront-elles naître des espoirs mais sûrement beaucoup de déceptions. Car l'urgence aujourd'hui, c'est de lutter contre la précarité, en proposant un emploi stable et correctement rémunéré. C'est également de lutter contre l'exclusion, en permettant à ces millions de personnes d'accéder à un logement, aux soins et à une formation de qualité. C'est redonner, en somme, tout son sens à l'Etat social et solidaire.
Dans un pays aussi riche que le nôtre, il n'est pas acceptable que près de 12 % de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté européen, alors que pour certains économistes le redéploiement des ressources sociales dans le but de sortir tout le monde de la pauvreté ne coûterait que 13 milliards d'euros supplémentaires... à mettre en parallèle avec les 15 milliards d'euros offerts dans le cadre du paquet fiscal !
* 1 On compte aujourd'hui près de 50 divorces pour 100 mariages : en 2006, 276.000 mariages ont été célébrés et 140.000 divorces prononcés. En 2007, la moitié des enfants étaient issus d'un couple remarié, contre seulement 6 % en 1970...
* 2 Député d'Ille-et-Villaine de tendance catholique social, fondateur de la « Société charitable » et du journal « Les annales de la charité ». Il fit voter à partir de 1850 plusieurs lois sociales sur les logements insalubres, les caisses de retraites, le délit d'usure, l'assistance judiciaire, l'assistance hospitalière, les contrats d'apprentissage et prépara les décrets sur le mutualisme.
* 3 Le rapporteur a également entendu, à titre personnel, de nombreux spécialistes, dont M. Jean-Jacques Trégoat , directeur général de l'action sociale.
* 4 « Niveaux de vie et inégalités sociales », Jacques Freyssinet, Pascal Chevalier, Michel Dollé, Rapport d'un groupe de travail du Conseil national de l'information statistique (CNIS) en date de mars 2007, disponible à l'adresse : http://www.cnis.fr/ind_doc.htm .
* 5 Le déflateur utilisé pour calculer l'évolution du revenu disponible brut des ménages est l'indice des prix de la consommation finale des ménages, qui se distingue de l'indice des prix à la consommation (IPC), car il tient compte de l'autoconsommation, des avantages en nature et des loyers fictifs.
* 6 Voir: « L'évolution du pouvoir d'achat des ménages : mesure et perception », note de la Délégation du Sénat pour la planification (décembre 2006).
* 7 L'OCDE utilise dans ses travaux une échelle d'équivalence fondée sur la racine carrée du nombre d'individus du ménage. Cette échelle implique un accroissement des coûts pour chaque individu supplémentaire (de 41 % pour une personne, de 32 % pour deux personnes, de 27 % pour trois personnes) proche de ceux implicites à l'échelle dite de l'OCDE modifiée.
* 8 Rapport de la Commission «Mesure du pouvoir d'achat des ménages », présidée par Alain Quinet, Inspecteur général des finances (février 2008), disponible à l'adresse : http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000066/0000.pdf .
* 9 Henri Theil, Economics and information theory (1967)
* 10 Il s'agit des évolutions moyennes des niveaux de vie respectivement du premier décile et du dernier vingtile. Ce ne sont évidemment pas les mêmes individus que l'on retrouve dans ces catégories en 1996, 2002 et 2005, du fait notamment de l'évolution des revenus des personnes au cours du cycle de vie.
* 11 L'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale (ONPES) a été créé par la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre l'exclusion. Il a pour vocation de rassembler, d'analyser et de diffuser les données relatives à la pauvreté, et de faire réaliser des travaux d'étude en lien étroit avec le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (CNLE).
* 12 Les pensions de retraite sont comptées comme revenu avant transferts et non comme transferts sociaux.
* 13 Cet effet est néanmoins évalué dans : DREES « Pauvreté et transferts sociaux en Europe », Marc Cohen-Solal et Christian Loisy (n° 18 - juillet 2001).
* 14 Michael Förster et Marco Mira d'Ercole, « Income distribution and poverty in OECD countries in the second half of the 1990s », OECD Social, employment and migration working papers n° 22 (2005).
* 15 La « population à risque » est ici définie comme la population pauvre avant impôts et transferts.
* 16 « Imputation de revenus du patrimoine dans l'enquête revenus fiscaux : travaux menés pour l'année 2003 à partir de l'enquête Patrimoine », Alexandre Baclet (INSEE), in rapport précité du CNIS (annexe n° 6)
* 17 Cette estimation est réalisée par imputation aux ménages de l'ERF de revenus du patrimoine simulés économétriquement à partir de l'enquête Patrimoine. Les résultats obtenus sont ensuite recalés sur le patrimoine de la comptabilité nationale. Ce recalage est réalisé en multipliant les revenus du patrimoine simulés par le coefficient qui permet de retrouver une masse imputée égale à la masse équivalente de la comptabilité nationale, à taux de détention inchangé. Ainsi les détenteurs voient le montant qu'ils détiennent modifié de manière uniforme, alors qu'on peut légitiment supposer que la sous-estimation est d'autant plus forte que les montants de patrimoine sont élevés.
* 18 Allocation créée par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie
* 19 L'impact redistributif des impôts indirects en France, Gérard Forgeot et Christophe Starzec, Economie publique n°13 - 2003/2.
* 20 Marc Fleurbaey, Nicolas Herpin, Michel Martinez, Daniel Verger, « Mesurer la pauvreté » in Economie et Statistique n° 308-309-310 (1997)
* 21 Le seuil à 50 % de la médiane était privilégié en France avant l'adoption des indicateurs de Laeken (cf infra).
* 22 « Bas revenus, consommation restreinte ou faible bien-être : les approches statistiques de la pauvreté à l'épreuve des comparaisons internationales » Daniel Verger in Economie et Statistique n° 383-384-385 (2005)
* 23 Directive 14 de l'Office of Management and Budget (mai 1978). Placé auprès du Président des Etats-Unis, l'OMB a pour principale mission de préparer le budget fédéral.
* 24 « Loyers imputés et inégalités de niveaux de vie », J-C Driant et A. Jacquot, in Economie et Statistique, numéro spécial Logement, n°381-382 (2005).
* 25 François Marical, « En quoi la prise en compte des transferts liés à la santé modifie-t-elle l'appréciation du niveau de vie », France Portrait social 2007 (INSEE Références).
* 26 Voir Driant et Jacquot (2005), op cit.
* 27 Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques : « L'action sociale extralégale et facultative des départements », Études et Résultats n°537 (novembre 2006) ; « L'action sociale des communes de taille moyenne», Études et Résultats n° 530 (octobre 2006).
* 28 « Pauvreté d'existence, monétaire ou subjective sont distinctes », Stefan Lollivier, Daniel Verger, in Economie et Statistique n° 308-309-310 (1997)
* 29 Les statistiques sur les revenus et les conditions de vie des ménages (SRCV) sont la partie française du dispositif européen SILC (statistics on income and living conditions). Ce dispositif consiste en une enquête annuelle traditionnelle (suivi transversal) et un panel d'individus suivis pendant 9 années consécutives (suivi longitudinal). Ce projet européen, coordonné par Eurostat, est prévu par le règlement n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003. Il a été mis en place dans le cadre de la méthode ouverte de coordination sur l'inclusion sociale, qui a également conduit à l'élaboration des indicateurs de Laeken (cf. infra).
* 30 « Revenus et pauvretés depuis 1996 », Dominique Demailly et Emilie Raynaud in Le revenus et le patrimoine des ménages Édition 2006 (INSEE Références).
* 31 « Pauvreté relative et conditions de vie en France », Madior Fall et Daniel Verger in Economie et Statistiques n°s 383, 384, 385 (2005).
* 32 Dans cette étude, fondée sur les données du panel européen des ménages (supprimé depuis la création du dispositif SILC cf. supra), la pauvreté monétaire est définie par rapport au seuil de 50 % de la médiane des niveaux de vie. La pauvreté en conditions de vie est définie comme le cumul se sept indices de mauvaises conditions de vie. Les seuils sont définis pour que les populations des trois sous-ensembles de ménages pauvres soit à peu près égales.
* 33 « La coordination de l'observation statistique des personnes sans abri », rapport de Laurent Chambaud (IGAS), octobre 2007.
* 34 « Pour une meilleure connaissance des sans abri et de l'exclusion du logement », CNIS, 1996.
* 35 Institut national des études démographiques.
* 36 Les sans-domicile étant définis dans cette enquête comme les personnes qui ont passé la nuit précédant l'enquête dans un hébergement procuré par un organisme d'aide ou dans un lieu non prévu pour l'habitation, comme l'espace public.
* 37 Direction de la Recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES).
* 38 Fichier national des établissements sanitaires et sociaux.
* 39 « L'hébergement d'urgence dans les CHRS (résultats de l'enquête ES 2004), Etudes et Résultats n° 620 (janvier 2008).
* 40 Quant à la Banque Mondiale, elle utilise pour évaluer la situation des pays en développement deux seuils de pauvreté internationaux fixés en 1990 à respectivement 1 et 2 dollars par jour. Suite à une révision des tables de taux de change en parité de pouvoir d'achat en 1993, ces seuils sont en réalité de respectivement 1,08 et 2,15 US dollars par jour.
* 41 Cet indicateur fut dénommé BIP 40 par allusion au CAC 40 d'une part et au PIB d'autre part, dans le but de dénoncer la domination de ces deux indicateurs dans le débat public, au détriment des indicateurs sociaux.
* 42 Cf « Les travaux conduits au niveau européen sur les indicateurs sociaux de pauvreté » par Laurent Caussat, Michèle Lelièvre, Emmanuelle Nauze-Fichet, DREES, Communication au 11 ème colloque de l'Association de Comptabilité Nationale (janvier 2006).
* 43 Pour la France, voir le rapport sur les stratégies pour la protection sociale et l'inclusion sociale 2006-2008 en date du 15 septembre 2006, ainsi que le rapport d'actualisation 2007.
* 44 Depuis 2005, un rapport conjoint sur la protection sociale et l'inclusion sociale est publié annuellement. Il est soumis au Conseil européen de printemps.
* 45 Atkinson T., Cantillon B., Marlier E., Nolan B., 2002, «Social Indicators : The EU and Social Inclusion» Oxford University Press
* 46 « Travailler ensemble, travailler mieux : un nouveau cadre pour la coordination ouverte des politiques de protection sociale et d'inclusion sociale dans l'Union européenne », communication de la Commission en date du 22 décembre 2005.
* 47 « At-risk-of poverty rate » correspondant au taux de pauvreté monétaire français (seuil de 60 %).
* 48 Source : Commission européenne (2004), cité dans « La privation matérielle dans l'UE » d'Anne-Catherine Guio (Statistiques en bref, Eurostat, 21/05)
* 49 Il s'agit de la Hongrie, la Slovaquie, la Lettonie et la Lituanie. La Bulgarie et la Roumanie, qui ont adhéré à l'Union le 1 er janvier 2007, connaissent une situation plus grave puisque respectivement 56 % et 40 % de la population y déclare appartenir à un ménage ne pouvant s'offrir un repas composé de viande ou poisson tous les deux jours.
* 50 Règlement -cadre du Parlement européen et du Conseil n° 1177/2003
* 51 Le Comité de protection sociale (CPS) est un groupe de hauts fonctionnaires créé en 2000 pour former une plate-forme d'échange et de coopération entre la Commission européenne et les États membres en ce qui concerne la modernisation et l'amélioration des systèmes de protection sociale. Le travail de ce comité depuis sa création a été largement déterminé par le volet social de la stratégie de Lisbonne, dont le principal instrument est la méthode ouverte de coordination sur la protection sociale et l'inclusion sociale.
* 52 Cette annexe au projet de loi de finances est prévue par l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificatives pour 2005, complété par l'article 169 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.
* 53 Plus ou moins grand écart du revenu médian des personnes pauvres, exprimé en pourcentage, par rapport au seuil de pauvreté.
* 54 Part des individus ayant un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté pendant plusieurs années, par convention, pendant l'année courante et les deux des trois années précédentes.
* 55 Voir Tome 2, l'audition du 29 janvier 2008 de M. Bruno Tardieu et Mme Véronique Davienne.
* 56 Projet de principes directeurs « Extrême pauvreté et droits de l'homme : les droits des pauvres » - 21 août 2006, actuellement soumis au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.
* 57 Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.
* 58 Rapport du groupe présidé par Gilbert Lagouanelle et Christine Genet « Prévenir, pour mieux lutter contre l'exclusion » - janvier 2006.
* 59 Rapport général de synthèse du Grenelle de l'insertion - mai 2008.
* 60 Rapport de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale (2007-2008) présenté en mai 2008.
* 61 Figure parmi les onze indicateurs retenus par l'ONPES.
* 62 Figure parmi les onze indicateurs retenus par l'ONPES.
* 63 Drees, Etudes et résultats, « Situation sur le marché du travail et pauvreté monétaire » - n° 499, juin 2006.
* 64 Formalisée par Sophie Ponthieux (Insee) en 2007.
* 65 Conseil national de l'information statistique (CNIS), « niveaux de vie et territoires » - 2007.
* 66 Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.
* 67 Audition du 26 février 2008.
* 68 Drees, enquête réalisée au deuxième trimestre de 2006 auprès de 7 000 personnes allocataires de minima sociaux.
* 69 Constitué pour 60 % de l'indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers, pour 20 % de l'indice du coût de la construction et pour 20 % de l'indice des prix des travaux d'entretien et d'amélioration du logement, ce nouvel indice devait permettre un lissage des évolutions et une stabilisation des loyers afin de préserver le pouvoir d'achat des locataires.
* 70 L'article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février2008 pour le pouvoir d'achat.
* 71 Trois types d'aides : aide personnalisée au logement (APL), allocation logement à caractère social (ALS) et allocation de logement familiale (ALF).
* 72 Voir compte rendu du déplacement de la mission en Côte-d'Or, le 7 mai 2008.
* 73 Rapport 2006 pour le logement des défavorisés : « L'état du mal-logement en France ».
* 74 Créé par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dite « loi bancaire ».
* 75 Rapport annuel de 2005.
* 76 Conseil économique et social, Rapport présenté par Mme Pierrette Crosemarie sur le surendettement des particuliers, octobre 2007.
* 77 11,4 % des ménages déclarent ne pouvoir accéder au crédit alors qu'ils estiment pouvoir le supporter financièrement.
* 78 Peut se traduire en français, par « crédit renouvelable ».
* 79 Rapport précité (2007-2008).
* 80 Serge Paugam, La Disqualification sociale : essai sur la nouvelle pauvreté, PUF 2000.
* 81 Patrick Boulte, Individus en friche : essai sur la réparation de l'exclusion par la restauration du sujet, Desclée De Brouwer, février 1995.
* 82 Voir tome 2 : table ronde sur le logement et l'hébergement lors du déplacement à Lyon, le 30 avril 2008.
* 83 Rapport précité du CES.
* 84 Audition du 1 er avril.
* 85 « Minima sociaux : concilier équité et reprise d'activité » - Rapport d'information n° 334 (2004-2005) de Valérie Létard, déposé le 11 mai 2005.
* 86 Parmi lesquels une proposition de loi adoptée par le Sénat, le 23 janvier 2007 : Texte n° 51 (2006-2007) - Proposition de loi portant réforme des minima sociaux.
* 87 Voir plus loin le développement consacré à la question de l'autonomie des jeunes : C-4-b).
* 88 Pour une autonomie responsable et solidaire - Rapport remis au Premier ministre, 2002.
* 89 Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.
* 90 Article 56 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.
* 91 Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable.
* 92 A compter du 1 er octobre 2008, le plafond mensuel d'accès à la CMU sera de 731,16 euros suite à sa revalorisation annuelle, conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
* 93 L'instauration du chèque santé à compter du 1 er janvier 2008, en supprimant cette démarche, supprimera les cas de non-remboursement des cotisations ou de non-inscription à un organisme complémentaire.
* 94 Etude Legos , « Le non-recours à la CMU en population générale » - septembre 2006 ; Étude IRTS Ile-de-France, « Le non-recours à la CMU dans les foyers d'Ile-de-France » - 2006 ; Etude Odenore, « Le non-recours à la CMU des bénéficiaires du RMI » -2006.
* 95 Médecins du monde dispose de 21 centres de soins gratuits en France.
* 96 Audition du 20 mai 2008.
* 97 « Propositions pour une relance de la politique de l'hébergement et de l'accès au logement » -Rapport d'étape remis au Premier ministre le 29 janvier 2008.
* 98 Article L. 312-1 du code monétaire et financier.
* 99 Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
* 100 Rapport d'information n° 334 (2004-2005) précité sur les minima sociaux.
* 101 Haut Commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté - Dossier de présentation du projet de loi - juin 2007.
* 102 « Au possible nous sommes tenus. La nouvelle équation sociale. Quinze solutions pour combattre la pauvreté des enfants. » - avril 2005.
* 103 Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.
* 104 Audition du 28 mai 2008.
* 105 Loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 pour le retour à l'emploi et sur les droits et devoirs des bénéficiaires de minima sociaux.
* 106 Voir audition de M me Marie-Claire Carrère-Gée, présidente du Conseil d'orientation pour l'emploi, 27 mai 2008.
* 107 Audition du 13 mai 2008 de l'Assemblée des départements de France.
* 108 Voir notamment audition d'Alain Régnier, préfet délégué à la coordination de l'hébergement et de l'accès au logement des personnes sans abri ou mal logées, le 20 mai 2008.
* 109 « Dérouler les implications du droit au logement opposable » - mars 2008.
* 110 Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005de programmation pour la cohésion sociale.
* 111 Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
* 112 Actuellement d'un montant légèrement supérieur à 300 millions d'euros.
* 113 Audition du 15 avril 2008.
* 114 Avis du 23 octobre 2007 sur le rapport précité relatif au surendettement des ménages.
* 115 Voir sur ce sujet les auditions de Maria Nowak le 25 mars 2008 et de Jacques Attali, le 29 avril 2008.
* 116 Audition du COE du 27 mai 2008.
* 117 Avis du 21 mai 2008 sur les conditions de la réussite du revenu de solidarité active (RSA) : progressivité du taux de cumul du RSA et du salaire corrélativement à l'augmentation du temps de travail ; création d'un « RSA à deux étages », avec une part de la prestation qui serait versée sans limitation de durée et une part temporaire liée à la reprise d'emploi ; conditionner les allégements de charges des entreprises à la à la conclusion d'accords d'entreprise ou de branche relatifs au temps partiel.
* 118 Audition de M. Jean-Baptiste de Foucault du 26 février 2008.
* 119 Audition du Conseil national des missions locales du 19 février 2008.
* 120 Table ronde relative à l'implication des entreprises dans l'insertion professionnelle à Lyon le 30 avril 2008.
* 121 Miles Corak, Les enfants pauvres deviennent-ils des adultes pauvres ? Les enseignements pour les politiques publiques d'une comparaison internationale, Colloque, « Le devenir des enfants de familles défavorisées en France », 1 er avril 2004.
* 122 Les enfants pauvres sont une catégorie difficile à isoler. La seule source disponible permettant d'approcher la population des enfants pauvres est la tranche haute des boursiers de collèges et lycées qui correspond au plafond de ressources le plus faible. Mais les enquêtes plus qualitatives estiment que la moyenne nationale de 5 % de boursiers est particulièrement éloignée de la réalité des collèges les plus précarisés. La mission a donc choisi la plupart du temps de parler des enfants issus de familles pauvres.
* 123 Audition du 19 février 2008 de Mme Marie-Véronique Samama-Patte, chef du bureau de la formation professionnelle initiale, de l'apprentissage et de l'insertion à Direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO).
* 124 Rapport du Conseil emploi revenus cohésion sociale, Les enfants pauvres en France , 2004.
* 125 Jean-Paul Caille. « Qui sort sans qualification du système éducatif ? » Éducation et Formations , n° 57, juillet-septembre 2000.
* 126 Sylvain Broccolichi et Brigitte Larguèze. « Les sorties sans qualification », Éducation et Formations , 1996, n° 48.
* 127 Institutionnalisés par une circulaire de 1998, ces dispositifs censés lutter contre la déscolarisation et le décrochage ont vu le jour dès 1996, à l'initiative des acteurs scolaires. En 2000, un appel d'offres a été lancé sur la déscolarisation (cinq projets ont été financés dans le cadre de l'appel à projet par le ministère de l'éducation nationale, le ministère de la justice, le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles et la Délégation interministérielle à la ville et sept projets ont participé au réseau des chercheurs mis en place par le comité de pilotage).
* 128 Audition du 29 avril 2008.
* 129 Jean-Pierre Terrail, Ecole, l'enjeu démocratique , Paris, La Dispute, 2004, p. 80.
* 130 Rapport du Conseil, Emploi, Revenu, Cohésion sociale , Les enfants pauvres en France , 2004.
* 131 Marie Duru-Bellat. Les inégalités sociales à l'école . Genèse et mythes , Paris, PUF, 2002.
* 132 Marie Duru-Bellat, Les inégalités sociales à l'école, Genèse et mythes, PUF, éd. 2005.
* 133 Marie Duru-Bellat et Agnès van Zanten. Sociologie de l'école , Paris, PUF, 2 e éd., 1999 .
* 134 Eric Maurin. L'égalité des possibles. La nouvelle société française, Repid, 2002.
* 135 Mathias Millet et Daniel Thin, Rupture scolaire et déscolarisation des collégiens de milieux populaires : parcours et configurations , GRS, 2003.
* 136 Jean-Claude Chamboredon, La délinquance juvénile, essai de construction d'objet , Revue française de sociologie, XII-3, 1971, 179-180. Voir aussi l'étude très intéressante de Michel Duée sur « le chômage parental de longue durée et l'échec scolaire des enfants », Document de travail G2004/06, Insee, 2004.
* 137 Fabrice Murat et Thierry Rocher, La place du projet professionnel dans les inégalités de réussite scolaire à 15 ans , Insee, portrait social de la France 2002-2003.
* 138 Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, La reproduction, Éléments pour une théorie du système d'enseignement , Paris, Éditions de Minuit.
* 139 Martine Kherroubi, Jean-Paul Chanteau et Brigitte Larguèze, Exclusion sociale, exclusion scolaire , Les travaux de l'Observatoire, 2003-2004.
* 140 Des enquêtes régionales effectuées au début des années 2000 ont confirmé les résultats nationaux. Thierry Troncin, chercheur à l'Iredu, a mené une enquête dans 156 écoles de l'académie de Dijon et montré que les deux premières années de scolarisation élémentaire constituent un obstacle infranchissable pour un nombre important d'élèves, dont la plupart sont d'origine sociale défavorisée (représentant la moitié de la population des redoublants mais seulement un tiers de l'échantillon), puisqu'ils sont 15 % à être en retard en CE2.
* 141 Haut Conseil de l'éducation, L'école primaire , 2007.
* 142 Idem.
* 143 Le rapport précité des inspections générales préconise à cet égard qu'une priorité forte soit donnée au premier degré, parce que c'est là que se creusent les écarts les plus importants, c'est aussi à ce stade que les remèdes sont les plus efficaces ».
* 144 Le rapport des inspections générales précité indique que si les indicateurs sociaux et territoriaux sont largement utilisés pour la répartition des emplois d'enseignants, ainsi que pour la répartition des crédits pédagogiques et des fonds sociaux, l'éducation prioritaire, stricto sensu, n'est un critère d'attribution budgétaire que pour les indemnités obligatoirement versées et pour des emplois de vie scolaire. Les décisions de répartition des moyens ne rendent donc pas obligatoirement compte de la réalité de l'affectation finale de ces moyens, c'est donc par le constat a posteriori des dépenses faites que le surcoût de l'éducation prioritaire peut être estimé.
* 145 Les crédits sociaux sont répartis en fonction des difficultés socio-économiques, mais pas strictement en fonction du classement en éducation prioritaire. Il reste qu'ils se retrouvaient le plus généralement dans les ZEP. Il semble toutefois que la tendance soit à la baisse des fonds sociaux dans l'éducation prioritaire.
* 146 Note de la Cour des comptes sur la politique d'éducation prioritaire, 2005.
* 147 Jean-Paul Caille, Les collégiens de ZEP à la fin des années quatre-vingt-dix : caractéristiques des élèves et impact de la scolarisation en ZEP sur la réussite, Éducation et Formations, n° 61, octobre-décembre 2001.
* 148 Selon le rapport du CERC de 2004.
* 149 Audition du 19 février 2008 de M. Jean-Marie Lorenzi, chargé de mission auprès du délégué interministériel à l'orientation.
* 150 Dépêche de l'Agence Éducation Formation du 16 juin 2008.
* 151 Audition du 19 février 2008.
* 152 Audition du 19 février 2008.
* 153 Miles Corak, Les enfants pauvres deviennent-ils des adultes pauvres ?, op.cit.
* 154 La question de la pédagogie adaptée qui s'adresse autant aux élèves en difficulté qu'à ceux qui réussissent mieux est un débat récurrent complexe. En effet, si le cours magistral est davantage adapté aux élèves qui ont des facilités à conceptualiser, à savoir -en général- ceux issus des milieux aisés, s'adresser aux élèves pauvres ne doit pas signifier privilégier les tâches plus simples ou stéréotypées.
* 155 Jean-Michel Floch, Isabelle Hatrice, Les dispositifs d'aide, de soutien et d'insertion , Note d'information de la direction de la programmation et du développement (Dpd), janvier 2002 et Michèle Thaurel-Richard, Le suivi et le devenir des élèves accueillis en classe-relais : année scolaire 1999-2000 , Note d'information de la Dpd, février 2003.
* 156 Audition du 19 février 2008 de M. Patrick Chauvet, chef de bureau de l'orientation à la sous-direction de l'orientation, de l'adaptation scolaire et des actions éducatives.
* 157 M. Patrick Chauvet a précisé que 30 000 professeurs principaux ont déjà été mobilisés pour mettre en place les entretiens d'orientation et que les diplômés récemment sortis des instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) ont également reçu une formation à l'orientation, mais a reconnu que la réflexion en la matière restait encore embryonnaire.
* 158 Audition du 19 février 2008 de M. Jean-Marie Lenzi, chargé de mission auprès du délégué interministériel à l'orientation.
* 159 Comme c'est le cas aujourd'hui avec la filière Scientifique du lycée général que choisissent de nombreux bons élèves en dépit d'une préférence pour les matières littéraires ou économiques.
* 160 Rapport d'information de M. Bernard Seillier, fait au nom de la mission commune d'information sur le fonctionnement des dispositifs de formation professionnelle (n° 365 - 2006-2007) du 4 juillet 2007.
* 161 Audition du 13 mai 2008, de MM. Bruno Lacroix, président, et Jean Vanoye, premier vice-président du Conseil économique et social de la région Rhône-Alpes.
* 162 Lors de son déplacement en Bourgogne, la mission a constaté que la filière viticole avait su se structurer intelligemment : ainsi lycée viticole de Beaune offre-t-il une palette variée de formations allant de la culture de la vigne à l'oenologie, avec de réelles garanties de succès et de débouchés dans les domaines viticoles de la région.
* 163 Audition du 28 mai 2008 de M. Martin Hirsch, Haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté.
* 164 La loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense a donné une base législative à ce dispositif et l'a modifié sur des points précis (par exemple l'ouverture du dispositif à des jeunes ayant 22 ans révolus).
* 165 Audition du 26 février 2008 de M. Jean-Baptiste de Foucauld, président de Solidarités nouvelles face au chômage.
* 166 Audition du 29 avril 2008 de Mme Marie-Laure Meyer, conseillère régionale d'Ile-de-France, membre de la commission formation professionnelle et apprentissage de l'Association des régions de France (ARF).
* 167 Audition du 19 février 2008 de Mme Pierrette Catel, chargée de mission au Conseil national des missions locales.
* 168 On rappellera qu'au sens du BIT, un chômeur est une personne en âge de travailler (15 ans ou plus) répondant simultanément à trois conditions :
- être sans emploi, c'est à dire ne pas avoir travaillé, ne serait-ce qu'une heure, durant une semaine de référence ;
- être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours ;
- avoir cherché activement un emploi dans le mois précédent ou en avoir trouvé un qui commence dans moins de trois mois.
Cette définition exclue par conséquent les demandeurs d'emplois actuellement en stage de formation ou ceux qui ne recherchent qu'un emploi à temps partiel.
* 169 C'est-à-dire en comptant les départements d'outre-mer. A défaut, il descend à 7,2 %.
* 170 Un chômeur de longue durée est un actif au chômage depuis plus d'un an.
* 171 C'est-à-dire si l'on y ajoute les effectifs pris en charge par les politiques de l'insertion et non demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, les bénéficiaires de contrats aidés non inclus dans d'autres dispositifs d'insertion, les salariés des structures de l'insertion par l'activité économiques et les jeunes titulaires de CIVIS.
* 172 Le nombre de travailleurs pauvres diminue mais reste préoccupant, article publié par l'Observatoire des inégalités, octobre 2007.
* 173 Les travailleurs pauvres en France. De la pauvreté active à la solidarité active ?, Julien Damon, Futuribles , n° 333, 2007.
* 174 Jacques Cotta, 7 millions de travailleurs pauvres. La face cachée des temps modernes, Fayard, 2006.
* 175 Le revenu médian est le revenu qui partage exactement en deux la population, la moitié disposant d'un revenu plus élevé, l'autre moitié d'un revenu moins élevé.
* 176 Contre 50 %, on l'a vu, pour la définition nationale.
* 177 Marie-Cécile Cazenave, Onze millions de travailleurs pauvres en Europe ?, Connaissance de l'emploi, n° 36, novembre 2006 ; Laura Bardone, Anne-Catherine Guio, Pauvreté des travailleurs, Statistiques en bref, collection Population et conditions sociales, n° 5, 2005.
* 178 Bernadette de la Rochère, Les sans-domicile ne sont pas coupés de l'emploi, Insee Première, n° 925, 2003.
* 179 Sondage LH2 pour RMC, 5 janvier 2007.
* 180 Guillaume Huyez-Levrat, Le faux consensus sur l'emploi des seniors, Centre d'études de l'emploi, mai 2008, n° 44.
* 181 Les seniors franciliens : peu mobiles et souvent embauchés en CDD, Ile-de-France à la page, Insee, n° 285, octobre 2007.
* 182 Il ne s'agit pas de l'ensemble des 18-29 ans, dont une partie est scolarisée notamment.
* 183 La précarité des femmes sur le marché du travail, La lettre de l'OFCE, n°263, 30 juin 2005, s'inspirant du rapport de mission remis à Mme Nicole Ameline, ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, le 3 mars 2005.
* 184 En 2003, parmi les 4 millions d'actifs à temps partiel, 82 % sont des femmes.
* 185 La même année, parmi les 5 millions de salariés peu qualifiés, 61 % sont des femmes. Pareillement, parmi les employés non qualifiés, 78 % sont des femmes.
* 186 Des comités de chômeurs aux comités de liaison, Premières synthèses, Dares, mars 2002.
* 187 Sondage IPSOS réalisé du 16 au 17 avril 2004 parmi un échantillon de 1.010 personnes âgées de 15 ans et plus.
* 188 Plus précisément le Medef, la CGPME, la FNSEA, l'UPA, la CGT, la CFDT, la CFTC, l'UNSA et les 38 associations membres d'Alerte.
* 189 Les deux autres étant la fondation reconnue d'utilité publique et la fondation abritée.
* 190 La formation professionnelle des adultes : un système à la dérive, rapport de MM. Pierre Cahuc et André Zylberberg à la demande du Centre d'observation économique de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP), juillet 2006.
* 191 La formation continue, un objet de négociation au confluent des stratégies des entreprises et des besoins des salariés, Premières informations - Premières synthèses, Dares, avril 2008.
* 192 Trajectoires d'emploi précaire et formation continue, Coralie Perez et Gwenaëlle Thomas, Economie et statistiques, n° 388-389, 2005.
* 193 Voir sur ce point les développements consacrés par ailleurs aux problèmes de gouvernance.
* 194 Voir supra.
* 195 L'insertion par l'activité économique en 2005, DARES, informations premières, août 2007.
* 196 Lever les obstacles aux promesses de l'insertion par l'activité économique, rapport du Conseil national de l'insertion par l'activité économique au ministre chargé de l'emploi, juin 2007.
* 197 Voir infra.
* 198 L'insertion par l'économique : entre deux logiques parfois contradictoires, observatoire de l'ANPE, décembre 2006, n° 9.
* 199 Quelle efficacité des contrats aidés de la politique de l'emploi ?, rapport d'information n° 255 (2006-2007) de M. Serge Dassault, fait au nom de la commission des finances, février 2007 .
* 200 Le contrat de professionnalisation en 2006 : de plus en plus d'entrées dans le dispositif, DARES, Premières synthèses et informations, avril 2008.
* 201 Pour un contrat d'accompagnement généralisé, contrat de travail accompagné ou contrat de création accompagné, rapport de mission auprès de M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, fait par M. Bernard Seillier à M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, juillet 2003.
* 202 « RMI, le pari de l'insertion », rapport de la Commission nationale d'évaluation du Revenu minimum d'insertion, de P. Vanlerenberghe et P. Sauvage, la Documentation française, mars 1992.
* 203 Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle
* 204 Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions
* 205 Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 et loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001
* 206 Loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité
* 207 Créé par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
* 208 Créé par la loi 89-905 du 19 décembre 1989.
* 209 Loi du 23 juillet 1987 portant réforme de l'apprentissage, loi du 20 décembre 1993 relative à l'emploi et à la formation professionnelle, loi du 6 mai 1996 portant réforme de l'apprentissage, loi du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale.
* 210 Décret n° 94-1046 du 6 décembre 1994 relatif aux missions et attributions des directions régionales et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
* 211 Circulaire DGAS/PILE/PIA/2007/125 du 3 avril 2007 relative aÌ la mise en place des commissions départementales de la cohésion sociale.
* 212 Loi n°2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République.
* 213 Décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon.
* 214 RMI et insertion professionnelle : forces et faiblesses des partenariats », la lettre de l'ODAS, décembre 2007.
* 215 La décentralisation du RMI trois ans après, enquête auprès des CAF », Cyprien Avenel et Stéphane Donné, CNAF, octobre 2007.
* 216 Evaluation de la loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 décentralisant le RMI et créant le RMA », rapport RM 2006-173P, novembre 2006
* 217 « Le RMI, d'un transfert de gestion à un transfert de responsabilité », rapport d'information N°216 de M. Mercier fait au nom de l'observatoire de la décentralisation, 2005.
* 218 « Minima sociaux : concilier équité et reprise d'activité », Rapport n° 334 de Mme Valérie Letard fait au nom de la commission des affaires sociales, mai 2005.
* 219 « Les maires et le vivre ensemble », la lettre de l'ODAS, avril 2007.
* 220 « RMI et insertion professionnelle : force et faiblesses des partenariats », La lettre de l'ODAS, décembre 2007.
* 221 « Lever les obstacles à l'IAE », rapport du CNIAE, la documentation française, 2007.
* 222 Le CDIAE est une formation spécialisée de la CDEI, commission départementale de l'emploi et de l'insertion, créée à compter du 1 er juillet 2006 par l'Ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 modifiée par l'ordonnance n°2005-727 du 30 juin 2005 et placée sous l'autorité du Préfet.
* 223 « Contribution à la préparation de la convention tripartite entre l'Etat, l'Unedic et la nouvelle institution créée par la loi du 13 février 2008 », Jean-Marc Boulanger, IGAS, avril 2008
* 224 Circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l`Etat aux associations et Circulaire du 16 janvier 2007 relative aux subventions de l'Etat aux associations et aux conventions pluriannuelles d'objectifs.
* 225 Loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi
* 226 « Les maisons de l'emploi. Mission d'évaluation du dispositif. Rapport intermédiaire de la mission, Jean-Paul Anciaux.
* 227 Ordonnance n°2004-637 du 1 er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre; décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives ; décret 2006-672 du 8 juin relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif.
* 228 « Synthèse des bilans de la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions », IGAS, mai 2004
* 229 Circulaire N° DGS/2007/430 du 07 décembre 2007 relative au programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (PRAPS).
* 230 « Fiscalité et finances publiques locales : à la recherche d'une nouvelle donne », Philippe Valletoux, CES, 2006.
* 231 « Le RMI : d'un transfert de gestion à une décentralisation de responsabilité », rapport d'information n°316 du Sénat fait au nom de l'observatoire de la décentralisation, mai 2005.
* 232 « Développement social local : les voies de l'action au service du changement », les cahiers de l'ODAS, juin 2007.