TABLE-RONDE N° 2 - APPARTENANCES SOCIALES ET SOCIABILITÉS
Présidente : Renée Nicoux, sénatrice de la Creuse
Modératrice : Nadia Belrhomari, Public Sénat
Les mondes ruraux contemporains apparaissent socialement très diversifiés, l'activité agricole n'occupant qu'une minorité d'actifs. Aperçus de cette diversité sociale, au sein du monde agricole et en dehors.
1. Que deviennent les enfants
d'agriculteurs ?
Christophe Giraud - Jacques Rémy
(Université Paris 5) - (INRA)
Depuis le début des années 1960, le niveau scolaire des fils et des filles d'agriculteurs n'a cessé de progresser. Les enfants d'agriculteurs ont été la population qui a le plus modifié son comportement par rapport à l'école. Le niveau de formation des fils d'agriculteurs s'est accru plus vite et est devenu plus élevé que celui des enfants d'ouvrier ou d'employé 69 ( * ) . Mais les enfants d'agriculteurs ont adopté des stratégies tournées vers les formations techniques, jugées plus efficaces ou plus opérationnelles que les formations générales longues (Davaillon, 1998) 70 ( * ) .
Mais ce qui s'est le plus transformé c'est le rapport subjectif des familles et des individus à l'école :
Témoignage d'un petit agriculteur de Mayenne en 1975 sur la formation agricole de ses enfants : « C'est peut-être pas mauvais quoi, mais enfin c'est pas ça qui... Je crois qu'ils apprennent encore davantage chez eux »
(Champagne, 2002).
Témoignage à trente ans de distance d'un agriculteur de Vendée en GAEC (2007) : « Ce qui est bien c'est de passer par un bac pro, puis après de faire un BTS gestion par exemple. Gestion d'entreprise, c'est bien parce qu'après ça aide à regarder les cahiers, à lire un bilan... Parce que si le comptable vous dit : « Ah bah, ça va bien... », bah oui mais si vous savez pas lire votre bilan... »
(Alarcon, 2008)
Trois facteurs expliquent ces transformations dans les pratiques et les mentalités :
- la scolarisation prolongée des jeunes (passage de 14 à 16 ans depuis 1959) ;
- le renforcement dans les années 60 et 70 d'un système de formation agricole qui s'est aligné sur les diplômes de l'enseignement scolaire de l'éducation nationale (avec la création de diplômes comme le CAPA ou le BEPA, les brevets agricoles, BTSA...) ;
- une politique qui, à partir de 1974, a conditionné l'obtention des aides à l'installation (DJA, prêts bonifiés) à la détention d'un niveau de diplôme minimal 71 ( * ) .
L'école a aujourd'hui une double action sur les enfants d'agriculteurs : elle « acculture », c'est-à-dire apporte des connaissances générales qui rompent avec la clôture d'une certaine culture locale et professionnelle (elle « dépaysannise »), ce qui peut conduire les enfants « cultivés » à quitter le milieu agricole, le milieu rural ; en même temps elle « professionnalise » puisqu'elle est un instrument indispensable pour l'installation en agriculture.
Nous allons voir quelles ont été les conséquences de cette culture scolaire spécifique sur les trajectoires sociales des enfants d'agriculteurs (les positions) mais aussi sur l'appartenance sociale et culturelle de ceux-ci (la sociabilité et leur mode de vie). Nous traiterons en détail des trajectoires des fils (1 et 2) avant de passer plus rapidement à celles des filles (3) en nous concentrant notre attention pour chaque sexe sur la génération des personnes âgées de 40 à 49 ans, classe d'âge où l'appartenance professionnelle est relativement stabilisée.
a) L'école, créatrice de clivages à l'intérieur de l'agriculture
Indispensable à l'installation aidée de nouveaux agriculteurs, le diplôme est à la source de clivages profonds parmi les nouveaux installés. Il donne accès à certaines positions au sein du milieu agricole (a), de même qu'il donne accès à des univers sociaux et culturels très contrastés (b).
a) Le diplôme, en donnant accès aux aides à l'installation, apporte une dynamique très différente aux exploitations tenues par les diplômés et par les non-diplômés. Des données de 2003 72 ( * ) montrent que les premiers ont ainsi eu plus tendance que les seconds à se retrouver entre 30 et 50 ans à la tête d'exploitations de taille économique importante.
« En 2003, pour les agriculteurs fils d'exploitants sur petite et moyenne exploitation, âgés de 30 à 49 ans, les chances de devenir eux-mêmes exploitants sur grande exploitation passent de 51,2 % pour les fils pourvus au mieux d'un BEPC à 67,1 % pour ceux qui possèdent un diplôme supérieur ».
Ces perspectives économiques différentes basées sur la reconnaissance et l'adoubement de la profession et l'octroi d'aides financières expliquent pour partie les chances différenciées des fils d'agriculteurs de choisir la profession d'agriculteur selon leur niveau de diplôme 73 ( * ) . Les détenteurs d'un diplôme technique qui donne l'accès aux aides à l'installation sont plus enclins à choisir l'agriculture que les fils sans diplôme (ou peu diplômés) qui seront exclus de ces aides.
Choix de la profession d'agriculteur selon le niveau de diplôme des fils et des filles âgés de 40 à 49 ans ayant un parent agriculteur
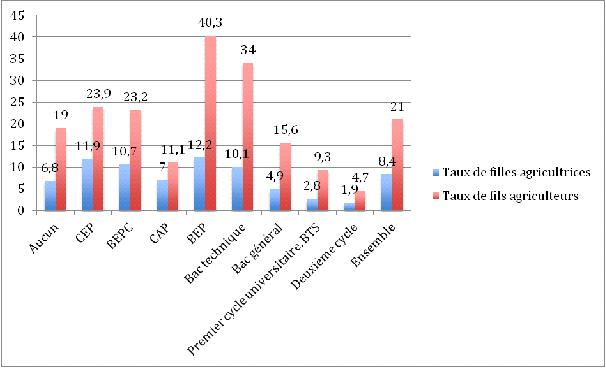
Source : EHF1999
Champ : Hommes et femmes âgés de 40 à 49 ans dont l'un des deux parents est agriculteur (ou ex-agriculteur).
Lecture : 19% des fils d'agriculteur âgés de 40 à 49 ans n'ayant aucun diplôme ont choisi la profession d'agriculteur.
Au fil des générations, le cas de fils d'agriculteurs qui ne réussissaient pas à l'école et devenaient agriculteurs « à défaut de mieux » apparaît de moins en moins fréquent. Les fils qui choisissent le plus souvent l'agriculture sont ceux qui « sont choisis » par l'agriculture, et ce choix est conditionné pour partie par la formation.
Le diplôme est donc central dans l'accès à l'agriculture et aux positions élevées dans la hiérarchie des exploitations agricoles.
Avec le contrôle de l'installation par la profession (Rémy, 1987) et le conditionnement des aides économiques de toutes sortes par le niveau de diplôme, il est possible d'évoquer la coexistence de deux « modes de reproduction » distincts en agriculture :
- un mode de reproduction familial, où la famille est au coeur de l'exploitation : on y travaille ensemble ; on transmet les connaissances, le métier en travaillant en famille ; on hérite surtout des biens familiaux... On reste dans une forte dépendance par rapport aux parents qui doivent décider à quel moment et dans quelles conditions ils transmettent leur patrimoine ;
- un mode de reproduction à composante scolaire : la famille a toujours un rôle important, mais l'école devient l'institution centrale qui donne, valide, certifie ces connaissances, ce qui d'une certaine façon relativise celles apportées par la famille, ainsi que l'autorité des ascendants. Dans ce mode de reproduction, on hérite certes des biens familiaux mais surtout on investit pour acquérir de nouvelles superficies, pour créer tel ou tel atelier sur les exploitations, en rapport au projet formulé lors de la préparation à l'installation. On s'endette auprès de la banque et on gagne ce faisant en indépendance vis-à-vis de ses parents (qui peuvent cependant se porter caution). Les individus sont moins étroitement définis par leur appartenance agricole et les conjointes choisies sont plus souvent éloignées socialement du milieu agricole que dans le mode de reproduction strictement familial.
b) D'un point de vue culturel, les agriculteurs « diplômés » disposent d'une socialisation et d'une expérience des contacts avec d'autres groupes sociaux, notamment lors des études agricoles (où une majorité d'enfants désormais n'est pas de milieu agricole), qui les rendent aptes à une sociabilité diversifiée. Témoin de cette nouvelle capacité à gérer les interactions avec des personnes venant d'autres groupes sociaux, les agriculteurs diplômés (et leur famille) ont plus tendance à développer sur leur exploitation des activités de diversification tournées vers les clients urbains (tourisme à la ferme, activité de vente directe).
D'un point de vue social, enfin les contacts des diplômés sont aussi plus diversifiés et moins limités à l'agriculture ou aux mondes populaires que ceux des non diplômés. Indicateur de ces nouvelles « aires de sociabilité », mais aussi de la valeur sociale des agriculteurs, les conjointes des diplômés font plus souvent partie des classes moyennes que les conjointes des non diplômés (qui appartiennent plus souvent aux mondes populaires des ouvriers ou employés, si elles n'ont pas suivi leur mari dans l'agriculture).
Deux fractions de l'agriculture se dessinent :
- celle des « diplômés » de l'agriculture qui possèdent une formation technique (agricole) élevée (Bac Pro, BTSA). C'est ce profil « formé » de fils d'agriculteurs qui a le plus tendance à choisir l'agriculture comme profession. Ils sont proches culturellement et socialement des milieux moyens salariés, mais ils ont une position sociale caractérisée par l'indépendance professionnelle et des capitaux économiques très élevés ;
- celle des « non diplômés » qui, encore nombreux, sortent du système scolaire avec un niveau de diplôme relativement faible. Ils choisissent moins souvent que les premiers l'agriculture mais constituent cependant une frange non négligeable des agriculteurs aujourd'hui. Pour eux, l'école n'était qu'un passage obligé, souvent mal vécu. Ils ont le sentiment assez net qu'« on apprend tout de même mieux en famille » 74 ( * ) , et sur le terrain (pendant les stages de formation) 75 ( * ) . Ces agriculteurs « peu formés » sont proches culturellement des milieux populaires et du milieu local dans lequel ils vivent. Leur position économique les situe plutôt à la tête de petites exploitations 76 ( * ) . On voit combien les deux modes de reproduction de l'agriculture sont aussi liés à une ouverture plus ou moins orientée vers les autres milieux sociaux de la société.
b) L'école, créatrice de clivages hors de l'agriculture
L'école génère également des clivages importants parmi les enfants qui ne choisissent pas professionnellement l'agriculture. L'école et ses titres scolaires conditionnent fortement les positions sociales des individus (a) mais aussi le milieu culturel dans lequel ils évoluent (b). Prenons ces deux caractéristiques tour à tour :
a) Du point de vue des positions occupées, l'école clive considérablement les trajectoires des enfants d'agriculteur. Deux populations se distinguent là encore : celle des enfants qui sont sortis sans diplôme ou avec un faible niveau scolaire et qui vont alors souvent rejoindre le monde ouvrier 77 ( * ) . Celle des enfants qui disposent d'un certain niveau de diplôme technique ou général (le niveau d'un bac technique) qui va leur permettre d'occuper des professions intermédiaires (parfois dans l'encadrement de l'agriculture : ils seront plus souvent que les autres techniciens ou agents de maîtrise) 78 ( * ) .
b) Du point de vue de l'univers culturel, les premiers restent proches du milieu agricole (et en tout cas des milieux populaires) : ils vivent plus souvent dans leur région d'enfance que les précédents et continuent à donner des coups de main dans le milieu agricole, voire à maintenir une double activité 79 ( * ) . Ils conservent plus facilement un ancrage fort dans une culture locale, paysanne ou populaire. Pour les seconds, la prise de distance par rapport au milieu agricole est plus nette : ils ont connu plus souvent une mobilité géographique. Cela ne conduit pas forcément à une rupture des liens avec l'agriculture. Des participations dans des sociétés agricoles peuvent perdurer en dépit de professions assez différentes.
c) Du côté des filles
Elles sont moins souvent agricultrices que les garçons 80 ( * ) car elles sont moins souvent construites comme des « successeures » (Barthez, 1982 ; Bessière, 2008). Les jeunes femmes ont également plus de mal à s'installer car elles héritent moins souvent que les garçons du capital productif professionnel (Barthez, 1994).
Cependant le profil scolaire des filles agricultrices quarantenaires diffère de celui des fils agriculteurs du même âge (cf. graphique ci-dessus) : pour ces filles, avoir un diplôme technique (comme le BEP) n'a pas plus favorisé le choix de l'agriculture qu'un diplôme de l'enseignement général court (CEP, BEPC).
Si l'impact du diplôme est moins net pour les filles de cette génération, c'est surtout parce qu'à la différence des fils, celles-ci entrent surtout dans le métier d'agricultrice par le mariage : en 2003, 46,5 % des filles d'agriculteur en couple avec un agriculteur se déclarent agricultrices contre 1,8 % des filles d'agriculteur en couple avec un homme qui n'est pas agriculteur. La composition du couple parental pèse également sur les choix des enfants : avoir deux parents agriculteurs prédispose plus fortement à une union avec un homme agriculteur qu'avoir un seul parent agriculteur. Avoir baigné dans une culture familiale pleinement agricole renforce donc le goût conjugal féminin pour ce milieu (Giraud, 2013).
Si les filles d'agriculteur continuent d'entrer dans la profession agricole par le mariage, le sens du travail conjugal sur les exploitations change cependant avec le développement de nouveaux statuts professionnels qui protègent mieux les conjointes (comme celui de « conjoint collaborateur ») ou avec les formes sociétaires d'exploitations agricoles qui permettent de donner à l'épouse un statut égal à celui d'un mari agriculteur. Toutefois, la majorité des jeunes compagnes choisissent de travailler en dehors de l'exploitation agricole du conjoint. Pour une conjointe d'agriculteur la pression normative pour épouser également le métier est moins pressante qu'il y a cinquante ans (Bessière, 2010). Devenir agricultrice aux côtés de son mari peut alors être vécu aujourd'hui davantage comme un choix que comme un destin 81 ( * ) .
Du côté des filles d'agriculteurs qui sortent de l'agriculture, le diplôme joue un rôle très important (comme pour les filles issues d'autres milieux sociaux). Le faible niveau de diplôme conduit à des positions peu élevées dans l'échelle sociale (employées de commerce, ouvrières, ouvrières agricoles, ou inactives qui représentent 77,3 % des filles d'agriculteurs sans diplôme âgées de 40 à 49 ans en 1999). Les diplômes courts de l'enseignement général ou technique (BEPC, CAP) favorisent plus que les autres diplômes des emplois dans le monde indépendant de l'artisanat, le commerce ou l'entreprise ou des employées de la fonction publique. Les diplômes plus élevés permettent l'accès à des emplois plus élevés (le niveau bac donne accès plus souvent aux professions intermédiaires administratives ou au monde des employées administratives ; le niveau université aux emplois les plus valorisés de cadres ou des professions intermédiaires de la fonction publique ou de la santé ou des techniciennes).
d) Conclusion
L'agriculture qui se dessine dans cette période de scolarisation prolongée est une agriculture particulièrement hétérogène socialement et culturellement :
- la première fraction, celle des diplômés, se trouve dans des conditions et avec des niveaux culturels qui la rapprochent des classes moyennes salariées : les diplômés ont suivi une formation longue à l'école qui les a mis en contact avec des enfants de milieux sociaux très variés. Ils sont donc plus facilement prêts à gérer des interactions avec des personnes des classes moyennes avec lesquelles ils partagent certains codes culturels ;
- la fraction des non-diplômés reste, elle, proche des milieux populaires. Peu scolarisée, porteuse d'une éducation essentiellement familiale portée par des familles avec deux parents agriculteurs, elle demeure aussi plus étroitement attachée à une culture populaire, agricole et locale qui tranche avec le groupe précédent 82 ( * ) . Du côté des fils qui ne choisissent pas l'agriculture, il y a aussi cette même opposition entre diplômés et peu diplômés. Enfin des circulations persistent entre ces petits agriculteurs et les fils qui ont choisi le monde ouvrier. Ces derniers peuvent conserver un « travail à côté » agricole ou prêter main-forte occasionnellement dans l'exploitation familiale.
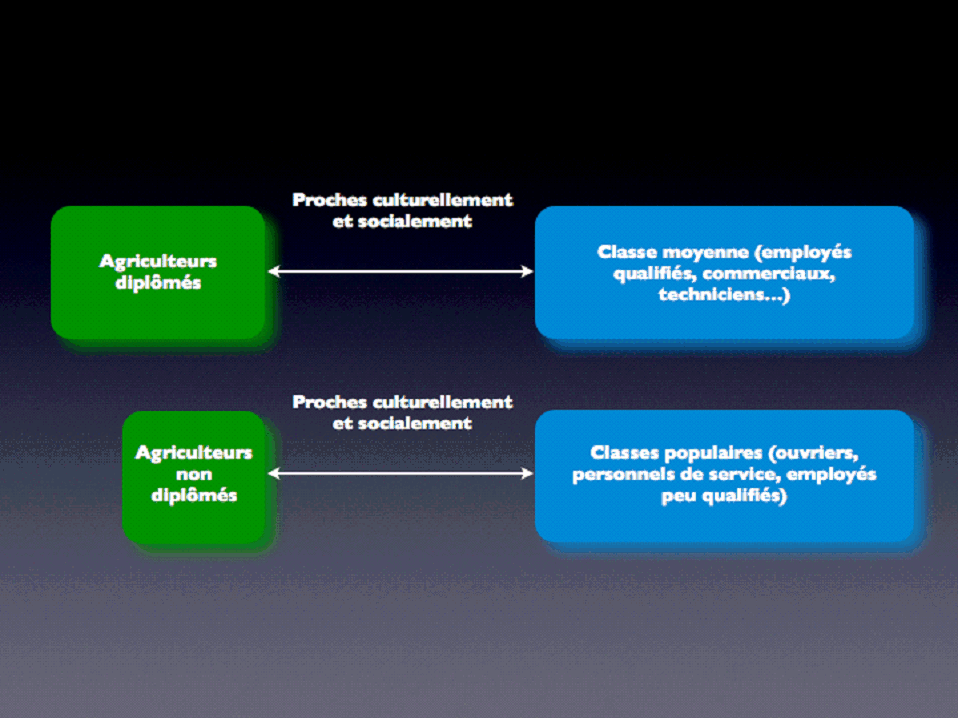
Cette présentation s'attache à exposer combien l'agriculture constitue un univers hétérogène dont les acteurs s'intègrent de manière très contrastée au reste de la société : la fraction des agriculteurs diplômés est proche des classes moyennes, et tire le meilleur parti des systèmes d'aide dans le cadre de la politique agricole commune, tandis que la fraction des agriculteurs peu diplômés s'inscrit dans un milieu local plus populaire et souffre d'un manque de reconnaissance des mêmes politiques agricoles.
Du côté des filles d'agriculteur, si les dernières études montrent que leur situation évolue fortement puisqu'elles accèdent plus souvent au monde agricole, comme les jeunes hommes, par la formation et l'installation professionnelle, indépendamment de tout projet conjugal (Dahache, 2012), si l'on considère l'ensemble de la population des filles (et plus particulièrement les quarantenaires), cette voie d'entrée dans la profession se révèle peu fréquentée et l'entrée par le mariage apparaît encore dominante.
|
Bibliographie : Alarcon L ., 2008, « `Maintenant, faut presque être ingénieur pour être agriculteur', Choix et usages des formations professionnelles agricoles dans deux familles d'agriculteurs », Revue d'études en agriculture et environnement , vol. 88, n°3, pp. 95-118. Barthez A ., 1982, Travail, Famille et agriculture , Paris, Economica. Barthez A ., 1994, « Le patrimoine foncier des agriculteurs vivant en couple », Agreste Analyses et Études Cahiers , n°17-18, mars, pp. 23-36. Bessière C. , 2010 , De génération en génération. Arrangement de famille dans les entreprises viticoles de Cognac , Paris, Raisons d'Agir, 215 p. Champagne P. , 2002, L'héritage refusé. La crise de la reproduction sociale de la paysannerie française 1950-2000 , Paris, Seuil, Points. Dahache S. , 2012, La féminisation de l'enseignement agricole , Paris, L'harmattan. Davaillon A. , 1998, « Parcours scolaires des élèves ruraux et des enfants d'agriculteurs : spécificités et évolutions », Education et formations , n°54, déc., pp. 97-107. Dufour A., Giraud C. , 2012, « Le travail dans les exploitations d'élevage bovin laitier est-il toujours conjugal ? », in Hostiou N., Dedieu B., Baumont R. (eds.), numéro « Travail en élevage », INRA-Productions animales , vol. 25, n°2, juin, pp. 169-180. Giraud C. , 2013, « Une distance sociale intime », in Boudjaaba F. (dir.), Au-delà de la terre. Famille, travail, formation et mobilités sociales en milieu rural (16ème-21ème siècles) , Rennes, PUR, à paraître. Laisney C. , 2012, « Les femmes dans le monde agricole », Analyse , Centre d'études et de prospective, n°38, mars, 4 p. Rémy J. , 1987, « La crise de la professionnalisation en agriculture : les enjeux de la lutte pour le contrôle du titre d'agriculteur », Sociologie du Travail , vol. 39, n°4, pp. 415-441. |
2. Les bouleversements des formes
d'appartenance au monde ouvrier vu du monde rural83
(
*
)
Nicolas Renahy
(INRA)
Les thèses de l'individualisation des sociétés occidentales, ou de l'exclusion de ceux qui resteraient en marge d'une vaste classe moyenne aux modes de vie homogénéisés, ont sans doute permis de sortir d'une grille de lecture rigide héritée du marxisme. Mais elles résistent aujourd'hui mal aux faits et sont vivement contredites par le renouvellement des études sur les inégalités sociales pensées en termes de stratification. Enquêtant la population ouvrière d'un village industriel de Bourgogne au cours des années 1990, l'auteur a pu mesurer tout autant la force socialisatrice continue du groupe ouvrier sur sa jeunesse que le lent processus de délitement de ses cadres de références, longtemps stabilisés autour d'une mono-industrie métallurgique, provoquant une crise dans la reproduction de ce monde ouvrier. C'est cette crise de reproduction qui est évoquée ici. Dans un premier temps sont explicitées les formes passées de la présence industrielle au village, qui n'a jamais été celle d'un bastion de la grande industrie - la population locale n'est pas structurellement différenciée de celle de son environnement rural immédiat. L'exemple d'une lignée familiale d'artisans montre pour finir l'étroit maillage entre usine et structures sociales plus classiquement rurales, favorisant la constitution d'un capital d'autochtonie, déclinaison populaire du capital social.
a) Introduction
Il n'est pas anodin que la sociologie repose aujourd'hui la question des frontières sociales, après avoir, au moins dans le champ académique français des années 1980 et 1990, été dominée par l'idée d'une « moyennisation » de la société. Les thèses de l'individualisation des sociétés occidentales, ou de l'exclusion de ceux qui resteraient en marge d'une vaste classe moyenne aux modes de vie homogénéisés, ont sans doute permis de sortir d'une grille de lecture rigide héritée du marxisme. Mais elles résistent aujourd'hui mal aux faits, et sont vivement contredites par le renouvellement des études sur les inégalités sociales pensées en terme de stratification (cf. par exemple Chauvel, 2001 ; Bouffartigue, 2004). De nombreuses recherches indiquent au contraire la recomposition de groupes sociaux relativement homogènes, et donc la persistance de frontières entre groupes, frontières sociales mais aussi spatiales (Beaud et Pialoux, 1999 ; Oberti et Préteceille, 2004 ; Pinçon et Pinçon-Charlot, 2007).
Enquêtant la population ouvrière d'un village industriel de Bourgogne au cours des années 1990, nous avons pu mesurer tout autant la force socialisatrice continue du groupe ouvrier (qui est aussi en l'espèce groupe résidentiel) sur sa jeunesse que le lent processus de délitement de ses cadres de références, longtemps stabilisés autour d'une mono-industrie métallurgique (Renahy, 2005). Depuis la fin des années 1970, avec la « restructuration » de l'industrie, le village de Foulange 84 ( * ) a non seulement perdu plus d'un tiers de ses habitants (de près de 1000 à un peu plus de 600), mais également sa singularité. Dans l'espace rural avoisinant, les Foulangeois se distinguaient en effet fortement de par « leur » usine de cuisinières, leur club de football prestigieux, leurs ouvriers politisés autour du Parti Communiste Français (PCF) et du syndicat CGT, mais aussi réunis par le paternalisme de « leur » famille patronale, dirigeant depuis sa maison bourgeoise entreprise et municipalité pendant plus d'un siècle (Renahy, 2008). Jusque dans l'habitat, avec trois cités ouvrières côtoyant les fermes (mais relativement distantes du « château » patronal...), et ces étonnants baraquements construits rapidement pour loger la dernière vague de travailleurs immigrés célibataires à la fin des années 1960. La fermeture de l'usine en 1981 a bien ensuite été compensée par l'arrivée de petites entreprises, dont l'une reprenant la production de cuisinières. Mais le faible volume de personnel réembauché et l'évolution du mode de gestion de la main d'oeuvre (disqualification de la « formation maison », élargissement du bassin de recrutement, besoin de nouvelles compétences) ont provoqué une crise dans la reproduction de ce monde ouvrier.
C'est de cette crise de reproduction que nous voudrions évoquer ici, ce qui nécessite dans un premier temps d'expliciter les formes passées de la présence industrielle au village. En regard de la majorité des enquêtes réalisées sur le monde ouvrier, celle que nous avons menée pendant une dizaine d'années n'a pas rencontré la population d'un grand « bastion », ou d'un « fief » de la grande industrie 85 ( * ) . L'usine de Foulange n'a jamais embauché plus de 400 salariés. Ce maximum, atteint entre la fin des années 1960 et le début des années 1970, a aussi correspondu au moment durant lequel les ouvriers ont sans doute été les plus politisés (sans que la commune n'apparaisse cependant comme un « bastion rouge » 86 ( * ) ). Mais la population locale n'est pour autant pas structurellement si différenciée de celle de son environnement rural immédiat. Certes les ouvriers constituent longtemps la majorité de la population, mais ils se trouvent mêlés aux agriculteurs et artisans. L'exemple d'une lignée familiale d'artisans nous montrera cet étroit maillage entre usine et structures sociales plus classiquement rurales, maillage donnant d'autant plus de poids à l'entreprise de cuisinières que celle-ci permettait l'intégration professionnelle de la plupart des enfants du village. Cette caractéristique d'une population à la fois ouvrière et rurale favorisa la constitution d'un capital d'autochtonie, déclinaison populaire du capital social (Retière, 2003) où l'appartenance locale devient une ressource, tant symbolique (le poids du patronyme qui, comme dans la paysannerie, donne une réputation) que pratique (notamment quand il s'agit de « trouver une place » honorable sur le marché du travail à un jeune de la famille).
Avec la crise industrielle qui débute à la fin des années 1970, ce capital d'autochtonie se trouve brutalement démonétisé. Et ce, de manière pérenne. Car malgré la relative reprise du marché de l'emploi industriel à Foulange au cours de la décennie 1990, la métallurgie ne permet plus l'intégration professionnelle que d'une minorité, qui a par ailleurs de plus en plus tendance à être recrutée à l'extérieur du village. Entre l'espace professionnel et l'espace résidentiel s'est opérée une disjonction, et la plupart des jeunes garçons du village - qui auparavant constituaient la force vive de l'usine - se sont détournés d'une industrie qui ne garantissait plus l'avenir. Tel Didier, dont nous étudierons le parcours professionnel haché, et pour qui le capital d'autochtonie constitue aujourd'hui plus un dernier recours d'accès à une honorabilité minimale qu'une réelle ressource.
b) Usine et village : un long maillage social
Les jeunes enquêtés de Foulange, qui sont nés dans les années 1970 (l'enquête se déroule principalement pendant la décennie 1990), sont issus d'une stabilisation relative des itinéraires des membres de la génération précédente. Leurs parents, peu qualifiés, sont entrés tôt dans la vie active du fait de la présence d'une usine paternaliste susceptible de les embaucher dès leur sortie de l'école au niveau du certificat d'études primaires, ils se sont mariés et ont eu leurs premiers enfants jeunes, souvent autour de 18-22 ans. Dans le même ordre d'idées, on remarque que c'est dans les années 1960 et 1970 qu'existent des fratries nombreuses ; les familles de cinq ou six enfants ou plus étant courantes. Ainsi, en période de stabilité économique, se projeter dans l'avenir, s'installer et procréer se fait plus aisément. Il se trouve par ailleurs que les années 1970 correspondent à une forme d'apogée de l'Etat social bâti dans l'après-guerre. Les familles ouvrières de Foulange sont par exemple assistées par la création d'un centre social dans le chef-lieu de canton en 1971. Le patronat local, qui avait précédé l'Etat dans ces pratiques d'assistance aux classes populaires, les prolongeait encore à cette période (l'usine installa par exemple un médecin de village à la fin des années 1960). La municipalité n'était pas en reste, puisque des années 1950 aux années 1970, elle fit venir l'Office Public départemental HLM dans la commune et lui fournit des terrains pour construire des pavillons locatifs, ou bien viabilisa des zones d'accession à la propriété individuelle. Bref, à tous points de vue (y compris en termes de politisation et d'accès à une conscience de classe), les années 1970 marquent une apogée pour ce « petit » monde ouvrier. Apogée qu'il faut situer de manière générationnelle : « toutes choses égales par ailleurs » et comme l'ensemble des français membres de leurs cohortes de naissance, les Foulangeois qui entrent sur le marché du travail dans les années 1960 et au début des années 1970 ont rencontré « un destin social inespéré » (Chauvel, 1998). A Foulange, ces destinées ont été régulées par la présence de l'usine Ribot, dans un contexte rural qui ne fut pas anodin.
L'analyse de la lignée familiale Doret permet d'illustrer de manière exemplaire cette singularité : le patronyme est présent et transmis au village depuis la fin du XVIII° siècle. Au début des années 1820, le fils d'un charpentier devient bourrelier 87 ( * ) . Les forges de Foulange n'embauchent alors que quelques dizaines d'ouvriers, et sont mêlées aux autres activités industrielles, artisanales ou commerciales. Au recensement de 1851, c'est ainsi toujours l'agriculture qui fait vivre la moitié des individus de la commune déclarant une profession, quand l'industrie et le commerce en concernent 35 %. Le bourrelier Doret forme son fils et lui transmet l'affaire en 1860, comme le fait celui-ci à destination de ses deux fils en 1890. L'aîné étant resté célibataire, c'est par le second que la transmission familiale s'effectue à sa mort en 1929, à destination de Pierre, l'aîné de ses deux fils. Au cours de l'entre-deux-guerres, les anciennes forges - elles aussi léguées de pères en fils au sein de la grande bourgeoisie Ribot (Renahy, 2008) - sont devenues une entreprise de cuisinières et de fourneaux relativement prospère, constituée en société anonyme en 1923, et qui centralise autour d'elle l'essentiel des activités de la commune. Pour la parentèle Doret, « faire ses partages » (Gollac, 2005) en famille ne semble dès lors pas poser de problèmes de transmission, puisque l'usine Ribot constitue une alternative professionnelle intéressante pour les enfants de la famille. Ainsi, Maurice Doret, le frère cadet de Pierre, est formé par l'usine Ribot. Il devient ajusteur et intègre la prestigieuse équipe d'entretien (qui s'occupe des machines de tous les ateliers, mais qui entretient également l'ensemble du parc de logements ouvriers que construit l'entreprise à cette période). De même, alors que jusqu'à présent l'ensemble des alliances matrimoniales contractées par la lignée Doret se faisait en direction de l'artisanat, l'usine apparaît à présent comme porteuse d'un marché matrimonial suffisamment honorable pour une parentèle d'artisans installée de longue date au village, et dont les chefs de famille se succèdent au conseil municipal depuis près d'un siècle. Ainsi, parmi les quatre soeurs de Pierre et Maurice, toutes mariées à Foulange entre 1919 et 1937, seule l'aînée épouse un artisan, l'un des maréchaux-ferrants du village. Les trois autres gendres sont tous salariés de l'industrie Ribot, mouleur, tôlier et ajusteur qui connaîtront par la suite une promotion professionnelle interne (l'un d'eux devenant contremaître). A la génération suivante, cette emprise de l'usine se prolonge, plutôt en direction de l'insertion professionnelle des jeunes cousins (majoritairement natifs des années 1930-40) : si seuls deux hommes feront toute leur carrière dans l'industrie locale, dix des quinze cousins commencent leur carrière en travaillant quelques temps à l'usine à la sortie de l'école, et quatre des onze cousines y sont sténodactylographes en début de vie active. Ensuite, les itinéraires se diversifient, mais nombre d'apparentés Doret migrent vers les villes de la région et leurs emplois dans le commerce, les services, et surtout la fonction publique (aide-soignante, gendarme, enseignants, employés de la sécurité sociale ou de mairie, etc.). Alors que la transmission de l'activité de bourrelier s'arrête avec Pierre - qui, à plus de 70 ans, a arrêté depuis longtemps la fabrication de harnais mais confectionne toujours quelques matelas jusqu'à sa mort en 1977 -, on perçoit que dans les années 1960, pour ses enfants comme pour toute une frange de la jeunesse villageoise, l'usine met le « pied à l'étrier » (Chauvel, 1998) et prépare une mobilité sociale bien souvent ascendante.
c) Paternalisme industriel et condition ouvrière
Du point de vue du système d'emploi local, ce phénomène correspond à une sortie intergénérationnelle progressive du paternalisme industriel. Si l'on décentre le regard des héritiers d'un petit artisanat pour observer les nombreux travailleurs arrivés comme manoeuvres à l'usine dans l'entre-deux-guerres (de Pologne ou d'Italie, mais aussi du monde rural environnant), on s'aperçoit que pour ceux qui sont restés au village et s'y sont mariés, l'entrée au bas de l'échelle professionnelle de l'usine Ribot (au moulage ou en fonderie) a pu signifier une accession des enfants aux emplois qualifiés de l'entreprise, puis une sortie du système usinier pour les petits-enfants. Ce processus inhérent à la manière dont les salariés d'une industrie paternaliste investissent les opportunités d'ascension sociale que celle-ci offre est aujourd'hui bien connu, il a été résumé par Jean-Pierre Terrail (1990) dans la formule « le paternalisme : le servir, s'en servir, s'en sortir », qui synthétise le rapport de trois générations successives.
Mais ce processus n'est pas atemporel. Ce que montre le cas de Foulange est qu'il correspond bien à des contextes historiques précis : l'entre-deux-guerres, les années d'après-guerre, puis les années 1960-1975 de pleine croissance et de finalisation de l'Etat social. Il est donc porté par des contextes nationaux successifs qui le favorisent, comme il sera clos par la crise économique prolongée. Il n'est par ailleurs pas généralisé, mais massif. S'il concerne une frange non négligeable de la population locale, des déclassements sociaux ont bien sûr pu être observés dans ces périodes. Son importance indique cependant une voie d'ascension sociale possible, que beaucoup vont emprunter quand d'autres s'éteignent, comme le vieil artisanat (tel qu'illustré par la lignée Doret), mais aussi bien sûr l'agriculture.
Au final, l'avènement de la « société salariale », que Robert Castel (1995) situe au milieu des années 1970, constitue également pour la population du village une forme d'apogée d'une condition ouvrière intégrée : un milieu social que l'on peut aisément intégrer mais dont on peut aussi sortir « par le haut », au sein duquel il est possible d'accéder à une forme d'indépendance à travers le logement individuel en pavillon (locatif ou en accession à la propriété), mais dont les schèmes de socialisation restent puissants, et s'expriment à travers de nombreux échanges (matrimoniaux bien sûr, mais aussi autour des sociabilités festives, d'un club de football, du « coup de main » donné lors de l'auto-construction, ou des cycles de dons et contre-dons que permettent la tenue de jardins potagers : Weber, 1989). En regard de cette réalité passée qui constitue le modèle dans lequel les vingtenaires des années 1990 ont été socialisés, ce qui frappe est l'immense difficulté, voire l'impossibilité à en reproduire les caractéristiques relevant d'un accès précoce à une situation honorable (salarié, parent, accédant à la propriété). Ce n'est qu'aujourd'hui, à l'âge de 30, 35 ans, que beaucoup finissent par stabiliser leur vie matrimoniale, par s'installer de manière réellement indépendante, et par procréer. Quand ils avaient entre 18 et 25 ans, ils étaient bien en situation de crise de reproduction sociale, incapables, parce que trop fragiles, de se projeter dans l'avenir sereinement, et ne pouvant que différer leur accès à l'indépendance face à un espace des possibles très restreint.
d) Didier Doret, l'instabilité malgré l'acquisition de « capacités »
Cette évolution ne rend pas seulement compte d'une simple diffusion de l'extension de l'âge de la jeunesse aux membres des classes populaires. Si l'on porte attention aux origines sociales, aux schèmes de socialisation et aux formes d'intégrations sociale et professionnelle de ces jeunes, on se rend compte qu'il s'agit plus profondément de bouleversements des modalités d'appartenance au groupe ouvrier, à la manière dont chacun s'y rattache et le reproduit.
Ainsi, l'un des points communs de ces enfants d'ouvriers qui restent au village 88 ( * ) après la sortie du système scolaire (ou revenus chez leurs parents après une première expérience professionnelle) est que leurs parents ont presque tous rencontrés une situation de chômage prolongé lorsque la vieille industrie a fermé ses portes en 1981. Cette perte d'emploi, si elle fut une « perte de soi » (Linhart et al, 2002) pour les licenciés, marqua aussi durablement leurs enfants. Dans un univers social où la légitimité et l'honneur découlent du « coup de main », de la manière avec laquelle on sait modifier une matière (à la fois savoir-faire acquis en apprentissage, peaufiné à l'usine, et don potentiel dans les interactions familiales et de voisinage), un licenciement signifie concrètement l'inaction. Pour les enfants qui ont connu leur père chômeur, c'est sans doute dans cette perte de sens initiale qu'il faut rechercher à la fois une profonde distanciation avec le monde de l'usine lorsqu'ils sont en âge d'y entrer, et en même temps une forme de nostalgie, rencontrée chez beaucoup de jeunes hommes, à l'égard de ces savoir-faire perdus.
L'expérience scolaire et professionnelle de Didier Doret illustre bien cette nostalgie, qui s'est exprimée pour lui par une volonté d'accumuler différentes expériences, de réaliser différents apprentissages (scolaires et « sur le tas »), et aussi de se raccrocher à une histoire familiale honorable, qui lui permette de donner du sens à son parcours. Didier est né en 1970, il est le premier des petits-enfants de Pierre Doret. Quand je réalise un entretien avec lui en novembre 2003, il habite seul dans la maison de son grand-père. Celle-ci appartient à l'une de ses tantes, une informaticienne urbaine qui le laisse y habiter car elle revient aujourd'hui rarement dans son village natal. Rencontré chez l'un des informateurs privilégiés de l'enquête, c'est en commençant à discuter de l'histoire de sa famille que je lui ai proposé de réaliser un entretien. Didier m'accueille volontiers sur cette base, car il a réalisé un arbre généalogique de son ascendance paternelle en questionnant ses aînés et à partir d'archives retrouvées dans le grenier de la maison, arbre que je peux l'aider à compléter grâce aux données recueillies en mairie. Il voue une admiration sans borne à ses aïeuls, détenteurs d'un savoir-faire aujourd'hui disparu, mais transmis sur quatre générations. Ainsi apparaît-il fasciné lorsqu'il découvre que le maréchal ferrant qui habitait en face de la maison était témoin au mariage de l'une de ses grandes tantes en 1927, et nostalgique lorsqu'il évoque la fin de vie de son grand-père (« jusqu'au bout, il a fait des matelas. Il ne faisait plus que ça, d'ailleurs, il vivotait ») par rapport à la période de l'entre-deux-guerres, où l'activité était intense (« le grand-père fournissait aussi l'usine en courroies »). Ainsi Didier se considère-t-il comme porteur d'un héritage familial :
« Mon grand-père, il avait fait comprendre à [ma tante] Françoise qu'il ne voulait pas que sa maison ait un autre nom. Parce que lui, il était déjà la quatrième génération de bourreliers. Donc ma tante, jusque là, respecte le vouloir de son père qui ne voulait pas qu'elle porte un autre nom. »
Cet attachement au nom a pour fondement l'expérience enfantine d'une proximité forte avec ses grands-parents paternels, proximité qui découle des difficultés à s'installer rencontrées par le couple de ses parents, de la « mauvaise ambiance » entre eux.
« Quand je suis né, mes parents n'avaient pas de maison. Ma première maison, c'est ici. Mes parents ont dû rester là deux ans avant de trouver une maison. Après j'étais avec mes parents à l'HLM. Mais bon, je sentais que ça n'allait pas, tu vois ? J'ai senti la mauvaise ambiance, j'ai voulu revenir vers mes grands parents. Et je suis revenu à l'âge de cinq ans. J'ai dû y être trois ans chez les parents. Je me rappelle, gamin, du fameux été 76, je me rappelle qu'il faisait super bon. Je dormais là avec mes grands parents, dans mon petit lit, et mon grand père qui faisait le matelas à côté. »
Les ressorts des difficultés parentales proviennent de l'instabilité professionnelle de son père, Jean-Paul - et aussi, sans doute, des naissances nombreuses et rapprochées, puisque Didier a quatre frères et soeurs, et que tous sont nés au rythme d'un enfant par an. Jean-Paul Doret, plombier, a débuté sa vie professionnelle au service d'entretien de l'usine de Foulange. Anticipant la fermeture de l'usine, il trouve un emploi chez un artisan des environs, qui lui-même finit par fermer sa petite entreprise. Jean-Paul accumule alors différents petits emplois (contrat aidé comme ouvrier d'entretien à la commune, intérim, etc.) et périodes de chômage. Avec trois années de « retard » à l'école, Didier quitte quant à lui le collège en sortie de classe de cinquième et entre en lycée technique pour recevoir une formation de fraiseur. Mais le travail du métal ne lui plaît pas, il apprend ensuite le métier de charpentier.
« Au départ, je suis mécanicien, mécanique générale. CAP de mécanique, fraiseur. Après j'ai fait une formation avec l'AFPA 89 ( * ) , ça fait un niveau 5, je suis charpentier. Comme un CAP-BEP de charpentier.
Le fraisage, ça ne m'a jamais plu. J'ai été balancé là-dedans. Par contre, après, j'ai trouvé que j'avais quelque chose avec le bois. Dans le fraisage, j'ai dû exercer trois mois, en intérim (...). Après l'armée, j'ai fait mon stage AFPA pendant huit mois. Pas de problèmes, j'ai eu mon diplôme. Et de là, je suis rentré en charpente. J'ai bossé en ville, à C..., pendant deux ans et demi. Après, j'ai eu un petit conflit avec la copine, donc j'ai quitté C... Bon, la charpente, c'est chouette, c'est un beau métier. Mais après, t'es exploité, quoi. T'es pas payé. Avant de faire un beau salaire, il t'en faut faire, des heures. »
« Mal payé », en conflit avec sa copine, Didier quitte donc rapidement le métier de charpentier, pour lequel il vient de se former. « Revenant à la maison », il trouve à 23 ans à travailler comme ouvrier dans la construction de centres équestres. Ce travail ne le satisfait pas, il continue à chercher un autre emploi. Au bout de dix-huit mois, il trouve ce qu'il appelle « la bonne boutique » : ouvrier dans l'horlogerie d'édifice (installation et entretien des horloges d'églises ou de salles de sport).
« J'étais comme un petit artisan. Simplement, je dépendais d'une grosse boutique. J'avais tout qui m'était fourni. Tu partais le lundi avec ton planning, démerdes-toi. T'avais tant d'entretiens à faire, t'avais des dépannages... A la fin, j'étais SAV 90 ( * ) , donc tu vois, pas une mauvaise place. Mais bon, onze départements, 1600 km en moyenne par semaine, tu ne vois pas le soleil, quoi ! Toute la semaine, t'es barré. C'est hôtel-restau, hôtel-restau... Alors au bout de sept ans, j'en avais marre. J'en avais marre ! C'est ça qui m'a fait arrêter. Parce que c'est vrai, je peux dire qu'au niveau salaire, je n'avais pas à me plaindre. J'étais pas loin des 10 000, ouais, ouais 91 ( * ) ! Avec véhicule fourni, pas de frais de gasoil, la bouffe pareil, tout m'était défrayé. Une bonne boutique. J'ai regretté un petit peu... Parce que pour retrouver ça, de nos jours... Il faudrait que je retourne les voir eux, mais je retrouverai pas des boîtes comme ça. Parce que maintenant... Ils vont embaucher des mecs qu'ont bac + 4, mais qui savent même pas tenir un marteau ! Non, mais ! Ils veulent des diplômes, des diplômes... Ca ne les intéresse plus des manoeuvres, des gens qu'ont appris par expérience. »
De ces extraits d'entretien ressortent un ensemble d'insatisfactions, mais aussi d'attachements. Afin de les décrypter, et en mettant l'itinéraire de Didier en perspective avec ceux d'autres jeunes hommes du village, analysons les différents bouleversements dans les appartenances sociales de ces jeunes ouvriers ruraux, bouleversements auxquels Didier fait référence.
e) Les bouleversements des formes de l'appartenance ouvrière
La première des appartenances qui a été profondément modifiée au cours des années 1980 et 1990 est celle professionnelle . Au moment où je le rencontre, Didier est sans activité stable depuis un an. A 33 ans, ayant quitté une « bonne place », il retrouve une insécurité qu'il n'avait pas connue depuis un moment. Il vient de terminer un contrat d'intérim dans une grande entreprise (Vivendi), en tant qu'électricien (« Tu sais, je suis électro sur le tas, sans diplôme »), et vit aussi du « black » (travail au noir). A travers son discours et l'expérience qu'il relate, on perçoit bien que Didier est quelqu'un qui sait faire valoir des compétences diverses d'ouvrier. Avoir « des capacités » est même justement pour lui un critère de distinction, qui devrait être mieux reconnu par les employeurs : « Etre payé à 7 000 francs ? Non, je préfère faire pour moi [c'est-à-dire : travailler au noir]. Et je crois que je suis pas le seul, aujourd'hui, à raisonner comme ça. Pour ceux qui ont des capacités ». Au cours de son parcours, Didier a appris à travailler le bois, le métal, la mécanique fine, l'électricité. Il est fier de ses savoir-faire, qu'il monnaye sur le marché du travail illégal, à défaut d'être reconnu sans avoir à « faire des heures » et être « tout le temps barré » sur le marché légal. La compétence ouvrière constitue donc toujours une valeur centrale de classement et de reconnaissance sociale. Mais contrairement aux générations précédentes d'ouvriers du village, elle n'est plus rattachée à une mono industrie métallurgique qui formait elle-même et pouvait absorber une large partie des demandes d'emploi dans les environs. Mieux vaut à présent accumuler différents savoir-faire mobilisables dans un espace professionnel géographiquement élargi que de trop s'attacher à une industrie singulière. En effet, avec la fermeture de l'usine en 1981, le secteur de la métallurgie s'est brutalement trouvé sinistré et, du jour au lendemain, ne constituait plus un avenir ni vraiment possible, ni enviable. Au-delà de Didier, qui a la particularité d'avoir été partiellement élevé par ses grands-parents artisans, de nombreux jeunes se sont tournés vers les filières de formation destinant au petit commerce ou à l'artisanat (majoritairement CAP de coiffure pour les filles, de maçonnerie, plâtrerie ou peinture pour les garçons). Une fois que les deux PME nouvellement installées dans le village ont commencé à embaucher plus de personnel, beaucoup ont hésité à y postuler tant l'usine a constitué un repoussoir tout au long de leur enfance et de leur scolarité. Si bien que, même pour ceux qui finissent par entrer à l'usine, la mobilité et l'instabilité professionnelles se sont imposées dans les parcours.
La deuxième, et sans doute la plus complexe des appartenances bouleversées au cours de ces années de crise, est l' appartenance familiale . On perçoit bien que pour Didier, la référence au père est détournée, concurrencée par celle du grand-père. Au-delà de l'expérience intime de Didier, ce type d'image paternelle - et de rapports sociaux qu'elle introduit - est récurrent chez les jeunes hommes rencontrés. Ici, elle prend la forme d'une opposition entre la formation première de Didier, un CAP de fraiseur qui renvoie à l'univers usinier auquel a appartenu son père et dans lequel on aurait voulu le « balancer », et celle de charpentier acquise à l'AFPA, qui fait référence au monde artisan. Mais beaucoup plus généralement, les jeunes interviewés ont toujours eu beaucoup de mal à parler de leur père. Ce pan de l'enquête a souvent rencontré une forme de déni , comme chez cet ouvrier d'usine de vingt ans qui explique sa distance aux « vieux » ouvriers ainsi : « les vieux, les plus de quarante ans quoi, comme mon père, ils se font manipuler ». Par le directeur d'atelier qui se jouerait de leur manque de culture (« il y en a pas beaucoup qui doivent bien écrire »), par l'ancienne usine qui les a un jour débauchés sans qu'ils aient un mot à dire, et sans qu'ils puissent faire autre chose que d'attendre qu'un nouvel employeur se présente, par le patron actuel qui « les a choisis », et qui sait bien ainsi « qu'ils ne bougeront jamais » (Renahy, 2005, pp. 116-121). Ce déni de la filiation paternelle pose d'autant plus vivement la question de l'appartenance familiale que celle-ci est, de fait, souvent prolongée tardivement. En effet, la dépendance à la maisonnée parentale reste forte lorsque l'accès au monde du travail est chaotique, lorsque l'accès à un logement indépendant est rendu difficile du fait de la pénurie d'offres sur le marché locatif dans cette campagne bourguignonne, lorsqu'enfin le marché matrimonial lui-même est devenu instable. Didier fait référence à un « petit conflit » qu'il a eu avec sa petite amie il y a plus de dix ans. Depuis, tout en continuant à se fréquenter, ils habitent chacun de leur côté, lui dans la maison familiale, elle à 25 km de là, dans la petite ville où elle travaille. A 35 ans, Didier n'a donc pas d'enfants, et prolonge un état de célibat. Le logement qu'il habite n'est meublé que de manière sommaire, de nombreux travaux sont entamés ou bien « à faire », tant la vieille maison de village n'a pas été réellement entretenue depuis des années. Ce genre de situation de report de la vie maritale et de la procréation n'est pas rare, et la seule différence de Didier par rapport à beaucoup de jeunes trentenaires rencontrés, c'est que lui ne vit pas au domicile de ses parents.
Dans ce contexte, c'est dès lors l'appartenance élective qui trouve le mieux à se prolonger. Elle constitue un espace d'accès à une autonomie relative. La perduration des relations de bande établies dans l'enfance ou l'adolescence constitue une forme de rempart ultime contre les crises d'appartenances professionnelles et familiales. En marge du marché du travail où il faut sans cesse prouver sa « motivation » ou son « autonomie » avant d'obtenir un « vrai contrat », fréquenter régulièrement les copains permet de maintenir une place stable au sein d'un espace de reconnaissance où l'on à rien à prouver.
Et comme cette appartenance élective s'établit en partie contre les parents, elle engendre une forte incompréhension entre générations, que la consommation de stupéfiants peut cristalliser et rendre visible, mais qui renvoie, nous l'avons vu, à un processus beaucoup plus global de fragmentation du groupe ouvrier 92 ( * ) .
f) Conclusion
Le fait que Didier s'attache depuis de nombreuses années à une maison familiale en mauvais état, qu'il ne restaure que marginalement et qui ne lui appartient pas, illustre cette démonétisation du capital d'autochtonie que nous évoquions en introduction. Héritier d'un patronyme d'artisans auparavant reconnus dans l'espace local, Didier tente de se raccrocher à ce qui n'est plus qu'un symbole. Contrairement à la majorité des membres de la génération précédente, il lui est impossible de valoriser ce capital, bâti sur l'accumulation en un même lieu de ressources provenant d'appartenances professionnelles, familiales et électives. Les crises connues par les deux premières ont donné beaucoup d'importance à l'appartenance élective, qui se prolonge à présent tardivement dans les parcours des jeunes ouvriers, mais ne peut favoriser une intégration et une reconnaissance professionnelles. Si bien que l'isolement géographique de Foulange par rapport aux principales villes des environs est aujourd'hui synonyme de relégation sociale. Les frontières sociales, mesurées ici en termes de mobilité intergénérationnelle, se sont rigidifiées en regard de la situation rencontrée à l'entrée sur le marché du travail trente ans auparavant. Lorsque les savoir-faire ouvriers localisés, tels que ceux qui ont été développés dans ce village pendant des décennies, ne trouvent plus à être transmis d'une génération à l'autre, les jeunes générations des membres des classes populaires éprouvent beaucoup plus de difficultés à « trouver une place », et la reconnaissance sociale qui l'accompagne.
|
Bibliographie Beaud et Pialoux , 1999, Retour sur la condition ouvrière. Enquête aux usines Peugeot de Sochaux Montbéliard, Paris, Fayard. Bouffartigue P. (dir.), 2004, Le retour des classes sociales. Inégalités, dominations, conflits, Paris, La Dispute. Castel R. , 1995, Les Métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Paris, Fayard. Chauvel L. , 1998, Le destin des générations : structure sociale et cohortes en France au XXe siècle, Paris, PUF. Chauvel L. , 2001, « Le retour des classes sociales », Revue de l'OFCE, n° 79, pp. 315-359. Gollac S., 2005, « Faire ses partages. Patrimoine professionnel et groupe de descendance », Terrain , n° 45, pp. 113-124. Linhart D. Rist B., Durand E. , 2002, Perte d'emploi, perte de soi, Erès, Ramonville St-Agne. Oberti M. et Préteceille E. , 2004, « Les classes moyennes et la ségrégation urbaine », Éducation et sociétés, vol 14, n° 2, pp. 135-153. Pinçon M. et Pinçon-Charlot M. , 2007, Les Ghettos du Gotha : Comment la bourgeoisie défend ses espaces, Paris, Seuil. Renahy N. , 2005, Les gars du coin. Enquête sur une jeunesse rurale, Paris, La Découverte. Renahy N. , 2008, « Une lignée patronale à la mairie. Genèse et vieillissement d'une domination personnalisée (1850-1970) », Politix , n° 83, pp. 75-103. Renahy N. , 2009, « «Les problèmes, ils restent pas où ils sont, ils viennent avec toi". Appartenance ouvrière et mobilité de précarité », Agora Débats/Jeunesses, n° 53, pp. 135-148. Retière J.-N. , 2003, « Autour de l'autochtonie. Réflexions sur la notion de capital social populaire », Politix, n° 63, pp. 121-143. Schwartz O. , 1990, Le monde privé des ouvriers. Hommes et femmes du Nord, Paris, PUF. Terrail J.-P. , 1990, Destins ouvriers. La fin d'une classe ?, Paris, PUF. Trotzier C. , 2005, « Vingt ans de trajectoire après un licenciement collectif », Revue économique , Vol. 56, n° 2, p. 257-275. Weber F. , 1989, Le travail à-côté. Etude d'ethnographie ouvrière, Paris, EHESS. |
3. Les effets politiques d'accession
à la propriété sur les territoires
périurbains : mixité sociale et racialisation des rapports
de voisinage
Anne Lambert
(Ecole normale supérieure)
Cette communication propose de revenir, à partir des Enquêtes nationales sur le logement de l'INSEE et d'une enquête ethnographique menée dans une commune périurbaine du Nord de l'Isère, située à 35 km à l'Est de Lyon, sur la représentation très largement répandue - et souvent négative - des territoires périurbains comme espace de peuplement homogène destiné à des ménages modestes et « blancs », en proie à un séparatisme culturel. Au contraire, l'enquête souligne la diversification sociale et ethnique du peuplement des lotissements, qui peut être très marquée selon les configurations locales. La hausse des prix dans les grandes agglomérations et les politiques de soutien à la propriété mises en oeuvre par les élus locaux contribuent à fixer sur place des habitants qui n'ont ni les mêmes trajectoires sociales, ni les mêmes perspectives de mobilité : des jeunes couples de classes moyennes issus des grands centres urbains, des ménages d'ouvriers des environs, des familles de cités HLM souvent originaires du Maghreb ou d'Afrique sub-saharienne. Cette évolution sociale et ethno-raciale du peuplement interroge dès lors la redéfinition des modes de cohabitation à l'échelle locale mais aussi, plus largement, le sens social de la propriété.
a) Introduction
Je vous remercie pour cette invitation. Je vais donc vous parler au cours de cette brève présentation des effets des politiques de soutien à la propriété sur le peuplement des territoires périurbains, en termes de milieu social et d'origine géographique (j'utilise également au cours de l'exposé le terme « origine ethnique » par commodité de langage, même si cela renvoie trop, me semble-t-il, à des dimensions socio-culturelles et anthropologiques 93 ( * ) ). Quels changements peut-on observer au cours de ces vingt dernières années concernant les dynamiques de peuplement des territoires périurbains ? Et dans quelle mesure la doxa aujourd'hui très répandue « du » périurbain comme refuge pour « petits blancs », hantés par la peur du déclassement et tentés par le vote FN, apparaît-elle vérifiée ? Autrement dit, qu'est-ce que l'enquête sociologique approfondie apporte à cette représentation relativement figée, qui associe un type d'espace, de peuplement et de mode de vie ?
Pour répondre à ces questions, je confronte deux niveaux d'analyse, qu'il faut d'ailleurs toujours tenir ensemble quand on fait de la sociologie urbaine : le national et le local. En effet, les politiques de logement et de soutien à la propriété sont décidées et définies au niveau national mais leur mise en oeuvre apparaît de plus en plus conditionnée par le vote de subventions municipales, par exemple dans le cadre du Pass Foncier. En outre, les élus jouent un rôle croissant en matière de politique urbaine (par le classement des terrains à bâtir, la délivrance du permis de construire, etc.) tandis que le marché immobilier fonctionne au niveau de territoires ou de bassins d'emploi relativement circonscrits. Les évolutions locales peuvent donc être dé-correlées de certaines évolutions nationales, saisies par les analyses statistiques, et inversement, invitant à faire un va-et-vient constant entre ces différentes échelles d'analyse.
Dans mon travail de thèse, je m'appuie sur les données de l'Enquête nationale sur le logement de l'INSEE, une très riche et grande enquête réalisée à périodicité régulière qui permet de connaître les conditions de logement en France métropolitaine et leurs évolutions. J'ai comparé les données de 1984 et de 2006 sous l'angle de l'habitat pavillonnaire (en construisant une nouvelle variable « ménages qui ont récemment fait construire une maison dans une commune périurbaine » en 1984 et en 2006). Je m'appuie également sur une enquête ethnographique approfondie réalisée dans une commune périurbaine du Nord de l'Isère, située à 35 km à l'Est de Lyon. Au cours de six séjours de terrain dans cette ancienne commune rurale en forte croissance, j'ai notamment pu suivre la construction d'un grand lotissement de 64 lots et son peuplement, que j'ai comparé avec un autre lotissement équivalent construit dans la commune à la fin des années 1970, et avec les données du recensement. Les entretiens biographiques que j'ai menés avec tous les habitants du nouveau lotissement ainsi qu'avec les élus m'ont en outre permis de saisir les logiques (sociales, économiques et politiques) qui sous-tendaient la mobilité résidentielle des ménages et la manière dont l'action publique, au niveau local comme au niveau national, avait influencé leurs trajectoires. On peut dès lors mettre en avant trois résultats principaux.
b) La spécialisation sociale des lotissements périurbains
Au niveau national, les lotissements périurbains se sont spécialisés dans l'accueil des classes populaires sous l'effet combiné de la hausse des prix immobiliers dans les centres urbains d'une part, et du ciblage des aides publiques sur l'accession et le secteur du neuf d'autre part. Ainsi, les Enquêtes logement de l'INSEE montrent que les classes populaires ont de plus en plus de difficultés à accéder à la propriété depuis le milieu des années 1980 (ce qui constitue un résultat connu). Mais pour ces dernières, l'achat d'une petite maison sur catalogue en périphérie apparaît de plus en plus comme la seule manière d'accéder à la propriété.
Cette évolution s'inscrit dans un contexte historique de plus long terme. En France, après un demi-siècle de diffusion de la propriété dans les couches populaires, l'essor du modèle de la propriété occupante marque un coup d'arrêt au milieu des années 1980 (en lien avec la montée du chômage et la lutte contre l'inflation), et peine à repartir après la crise économique et immobilière des années 1990 malgré la multiplication des dispositifs publics d'aide (Prêt à l'accession sociale, Prêt à taux zéro simple ou doublé, Pass Foncier, etc.). Le taux de propriétaires stagne ainsi autour de 57 % 94 ( * ) . La répartition des statuts d'occupation du logement selon la PCS de la personne de référence du ménage montre alors qu'en 2006, les ouvriers sont proportionnellement près de deux fois moins nombreux que les cadres à accéder à la propriété (17 % des ouvriers contre 30 % des cadres) - un écart qui s'est creusé depuis 1984. Aujourd'hui, seul un tiers des ouvriers est propriétaire de son logement contre 41 % des cadres, alors que la proportion de propriétaires parmi les ouvriers et les cadres était quasi similaire en 1984 (respectivement 22 % et 24 %). Mais surtout, les ouvriers sont deux fois plus nombreux que les cadres à « choisir » de faire construire une maison quand ils deviennent propriétaires, alors que les cadres se tournent nettement plus souvent vers l'ancien et s'établissent majoritairement en ville. La géographe Martine Berger l'a très bien montré pour le cas de l'Ile-de-France : plus on s'éloigne des centres urbains, plus la part des ouvriers, notamment des ouvriers peu qualifiés, augmente, dans des proportions inverses à celles des cadres et professions intellectuelles supérieures.
Dans l'ensemble, les ménages ouvriers sont ainsi surreprésentés dans les espaces ruraux et les couronnes périurbaines par rapport à leur part dans la population métropolitaine et représentent respectivement 28 % et 32 % des habitants des territoires ruraux et périurbains en 2006. Ce mouvement centrifuge et sélectif socialement risque de se renforcer puisqu'en 2006, deux-tiers des ouvriers qui « font construire » une maison, quel que soit le mode effectif de construction (promoteur, constructeur, artisanat, auto-construction), s'installent dans une commune rurale. Au contraire, les professions intermédiaires et les cadres, même s'ils vont un peu plus souvent qu'avant dans l'espace périurbain et ses franges rurales, parviennent à maintenir leur avantage relatif dans les communes centres.
L'autre grand apport de l'enquête statistique est de montrer que le repli des classes populaires sur la construction de maison en périphérie s'accompagne d'un coût financier croissant pour ces ménages. En effet, c'est pour les ouvriers et les employés que le coût d'accès à la propriété a le plus fortement augmenté entre 1984 et 2006 en comparaison des cadres et professions intermédiaires. Les Enquêtes logement permettent dès lors d'analyser finement l'évolution des conditions de financement des logements à travers une série d'indicateurs. Les ouvriers sont par exemple ceux qui connaissent la plus forte progression des durées d'emprunt alors que la part de ceux qui achètent comptant a, dans le même temps, augmenté à l'autre bout de l'échelle sociale. La part des ménages qui s'endettent sur plus de 20 ans est ainsi passée en moyenne nationale de 2 % à 19 % entre 1984 et 2006, et de 2 % à 29 % pour les seuls ouvriers, renchérissant du même coup le coût du crédit pour ces catégories. On peut encore noter que c'est pour les ouvriers que le crédit immobilier représente le plus grand nombre d'années de revenus : en 2006, les emprunts contractés pour la maison représentent 3,4 années de revenus pour les ouvriers, contre 2,5 pour les cadres. C'est aussi pour les ouvriers que l'âge moyen d'accès à la propriété a le plus fortement reculé passant de 36 ans à 40 ans, sans lien avec l'évolution de la structure démographique de ce groupe. On pourrait multiplier les indicateurs socio-économiques mais je m'arrête ici pour aborder la deuxième conclusion de ce travail - la diversification ethnique du peuplement des lotissements périurbains -, une évolution qui est concomitante à la première mais qui ne la recoupe qu'imparfaitement.
c) La diversification ethnique du peuplement des lotissements périurbains
En sociologie et dans les études urbaines plus largement, les espaces pavillonnaires ont été appréhendés par opposition au parc HLM, que les couches moyennes et les fractions stables des classes populaires d'origine française ont commencé à quitter dès la fin des années 1960 à mesure que se développaient le marché de la maison individuelle et les aides à l'accession. Ainsi, la question des « origines ethniques » dans les pavillons a longtemps constitué un impensé en lien avec la faiblesse historique des migrants dans les banlieues pavillonnaires, mais aussi en raison d'un certain aveuglement du questionnement sociologique en la matière 95 ( * ) . La prégnance du débat, en France, sur les « statistiques ethniques » a également constitué un obstacle méthodologique à la saisie des « origines ». Jusqu'en 1996, les Enquêtes logement ne recensent en effet que la nationalité des individus, introduisant pour la première fois une question sur leur pays de naissance en 1996, puis une question sur la nationalité et le pays de naissance de leurs parents en 2006.
Pour autant, les données nationales disponibles montrent que la part des ménages issus de l'immigration qui accèdent à la propriété pavillonnaire a augmenté depuis les années 1980 même si cette évolution est lente d'une part, et reste difficile à mesurer d'autre part, à cause de la nature même des données. Ainsi, tout type de logement confondu, il apparaît que la part des ménages immigrés qui accèdent à la propriété a augmenté entre 1992 et 2006, passant de 32 % à 39 % 96 ( * ) . Non négligeable, cette évolution est deux fois plus forte pour les ménages immigrés que pour l'ensemble des ménages à la même période, montrant que l'écart entre les immigrés et le reste de la population tend à se réduire en matière de statut d'occupation du logement. Concernant le marché de la maison individuelle, les immigrés comptent pour 8 % des « acquéreurs récents de maison neuve », ce qui représente environ 46 000 ménages en 2006. Si la part des immigrés qui achètent une maison neuve apparaît faible en moyenne relativement à la part des immigrés dans la population française, elle masque toutefois de fortes différences selon les pays d'origine : les immigrés du Maghreb, notamment d'Algérie, sont proportionnellement moins nombreux à « faire construire » que les ménages originaires du Portugal et, dans une moindre mesure, de Turquie.
Concernant les secondes générations, l'enquête Trajectoires et Origines de l'INSEE et l'INED réalisée en 2008 montre que le taux de propriétaires est, en moyenne, plus élevé que celui des immigrés malgré de fortes différences selon les pays d'origine. L'échantillon est toutefois trop faible pour effectuer des traitements plus fins à l'échelle des différents groupes, en croisant type de logement, de statut d'occupation et de quartier. C'est également sur cet obstacle que bute l'Enquête logement de 2006.
Toutefois, ces données cumulées, qui demandent donc à être complétées, contribuent à remettre en cause certaines représentations figées du rapport des immigrés au logement. Certes, les immigrés restent surreprésentés dans les grandes agglomérations (de plus de 200 000 habitants notamment) et dans le parc d'habitat social par rapport à la population dite « majoritaire » 97 ( * ) . Mais, comme tendent à le montrer certains travaux récents, en moyenne, les immigrés et encore plus leurs descendants habitent majoritairement dans des espaces où ils sont minoritaires, dans le parc privé de logement 98 ( * ) . En outre, si les ménages d'origine étrangère restent en moyenne sous-représentés dans l'ensemble du parc pavillonnaire, les données agrégées peuvent masquer, localement, des évolutions très marquées. C'est le cas de certaines communes du Nord de l'Isère qui voient les zones pavillonnaires nouvellement construites connaître une forte diversification ethnique sous l'effet, notamment, de l'évolution des dispositifs nationaux d'aide à l'accession, de la redéfinition des politiques locales de logement et de l'ancrage des communes dans un bassin d'emploi industriel.
d) Au niveau local, des évolutions très marquées
A Cleyzieu 99 ( * ) , la diversification ethno-raciale du peuplement des lotissements est particulièrement marquée pour trois raisons principales d'ordre historique, politique et conjoncturel :
- cette évolution tient tout d'abord à l'ancrage de la commune dans un bassin d'emploi industriel et à sa situation plus large dans l'espace régional. Dès les années 1920/1930, mais surtout à partir des années 1960, une importante main d'oeuvre italienne, portugaise et algérienne s'est en effet établie dans le bourg industriel voisin, pour pourvoir les emplois d'ouvriers et de manoeuvres dans les usines locales. La stabilité professionnelle et le renouvellement des générations ont alors favorisé localement des trajectoires résidentielles promotionnelles, le foncier étant moins cher dans ce secteur et, plus largement, dans l'Est lyonnais que dans l'Ouest et les Monts d'Or.
- la mise en place d'une vaste politique de construction et d'aménagement par le maire de Cleyzieu à partir des années 2000 a en outre favorisé la production en masse de terrains à bâtir. Ainsi, de nombreux terrains ont été ouverts à la construction, viabilisés et divisés en petits lots dans le cadre de ZAC ou de lotissements privés. Des terrains de 400 à 500 m 2 se vendent ainsi autour de 100 000 euros dans la commune à la fin des années 2000, auquel il faut rajouter 80 000 à 100 000 euros pour une maison d'entrée de gamme vendue sur catalogue. Ce faisant, les nouveaux programmes immobiliers deviennent accessibles à une partie des ménages stables de classes populaires.
- il faut aussi prendre en compte des effets proprement conjoncturels. La crise économique amorcée en 2008 suite aux subprimes et à la déstabilisation du système financier international semble avoir joué « en faveur » des ménages issus de l'immigration sur le marché du logement, au niveau local. En effet, devant la difficulté à commercialiser les lots nouvellement viabilisés, les promoteurs et élus locaux ont retiré certains critères architecturaux et de peuplement qu'ils avaient formulés au moment de l'établissement du projet, au début des années 2000 (l'idée était alors de faire des « lotissements à l'américaine » favorisant l'installation des classes moyennes urbaines dans la commune). Au contraire, pour favoriser le remplissage des nouveaux lotissements, les élus se sont saisis des nouveaux dispositifs d'aide à « l'accession sociale » et ont voté des subventions municipales permettant de solvabiliser des ménages plus modestes (Pass Foncier notamment). Ainsi, la nouvelle conjoncture économique a laissé moins de place aux pratiques discriminatoires des intermédiaires du logement et des élus comme le résume un ouvrier algérien de 52 ans, ancien locataire HLM, qui a acheté un petit pavillon sur catalogue dans la commune en 2010 après avoir tenté d'obtenir un crédit pendant près de 5 ans : « Quand tu veux acheter, il y a pas ni Blanc, ni Noir, ni Rouge, le lotisseur il voit que les sous, il te voit en euros ! Franchement, c'est plus dur de faire la demande pour les logements en mairie... ». A partir de 2009, se sont ainsi installés dans la deuxième tranche du lotissement des Blessays (dont nous avons pu suivre la construction) des ménages beaucoup plus divers du point de vue de leurs origines sociales et géographiques.
L'enquête ethnographique permet de saisir finement ces évolutions. Dans le lotissement des Blessays, les nouveaux propriétaires sont pour moitié des ménages d'ouvriers, ce qui représente une proportion importante relativement à la part des ouvriers dans la population française. Un tiers des ménages d'acquéreurs a également à sa tête un immigré ou un étranger 100 ( * ) , une proportion qui passe à plus de 40 % quand on intègre les secondes générations. Cette évolution constitue un réel changement en comparaison avec d'autres lotissements plus anciens de la commune, où la part des ménages immigrés était quasi nulle au moment de la commercialisation. L'analyse systématique des entretiens réalisés avec tous les acquéreurs du lotissement des Blessays a alors permis de dégager 3 types de trajectoires d'accédants, qui n'ont ni les mêmes propriétés sociales, ni le même rapport au logement :
- le premier groupe est constitué de ménages d'ouvriers biactifs, ancrés dans l'espace local et plus âgés en moyenne que le reste des acquéreurs. Ces ouvrier-e-s travaillent dans les industries métallurgiques, textiles ou automobiles du secteur. Ils/elles sont plus souvent issus de l'immigration algérienne et, dans une moindre mesure, marocaine et turque. Pour ce groupe d'acquéreurs, la maison constitue l'aboutissement de la trajectoire résidentielle et fait l'objet d'un soin particulier, étant plus souvent construite sur un mode artisanal comme dans cette famille d'ouvriers marocains où ce sont deux frères maçons qui ont pris en charge l'établissement des plans et le gros oeuvre.
- le deuxième groupe est constitué des familles venues des grandes cités HLM de la banlieue lyonnaise, et massivement issues de l'immigration africaine (Maghreb et Afrique subsaharienne). Ces ménages se sont saisis des dispositifs d'aide à l'accession à la propriété pour « faire construire » une maison dans l'Est lyonnais, les aides permettant de financer, pour certains, jusqu'à la moitié du coût d'achat du terrain et de la maison. Pour ces ménages, la maison représente une promotion résidentielle certaine mais déstabilise aussi fortement l'économie domestique en raison de l'éloignement géographique des réseaux de sociabilité et d'entraide qu'elle génère, et de la nouvelle pression budgétaire qu'elle implique. C'est en particulier pour les femmes peu qualifiées qui travaillaient dans le tertiaire (comme vendeuse, caissière, etc.) dans la première couronne lyonnaise que le coût de la mobilité résidentielle apparaît le plus élevé. Certaines ont ainsi renoncé au travail salarié pour se spécialiser dans le travail domestique, n'ayant pas les moyens d'externaliser la prise en charge des enfants.
- le troisième groupe d'acquéreurs est constitué des jeunes couples de professions intermédiaires et de cadres venus de Lyon, souvent sans enfants ou avec des enfants en bas âge, pour lesquels la maison est vue comme une étape résidentielle en attendant de trouver « mieux ». Ces couples passent d'avantage par les circuits privés de financement du logement (banques commerciales et mutualistes). Plus jeunes que les autres habitants, moins présents en journée du fait de leurs horaires de bureau, ces derniers tendent pourtant à imposer leurs normes sociales et résidentielles au sein du lotissement et disposent d'un fort « pouvoir résidentiel » sur la scène locale. Ils prennent par exemple en charge le travail de représentation des nouveaux habitants auprès des élus, organisent les fêtes de voisinage, etc.
Au quotidien, la proximité spatiale entre ces trois groupes d'habitants aux trajectoires et aux propriétés sociales fortement différenciées ne favorise pas, mécaniquement, le rapprochement des modes de vie mais apporte son lot de conflictualité - rappelant certaines conclusions établies par Jean-Claude Chamboredon et Madeleine Lemaire (1970) à propos des modes de cohabitation dans les grands ensembles d'habitat social de première génération. Des conflits éclatent par exemple régulièrement à propos de l'aménagement des jardins, de l'usage des parkings ou encore de la place des enfants dans le lotissement, qui sont liés à la confrontation de normes résidentielles et éducatives socialement situées. Toutefois, à la différence des deux sociologues précédents, les logiques d'identification raciale apparaissent nettement plus prégnantes dans les nouveaux lotissements. Les catégories ethno-raciales mobilisées, plus ou moins raffinées selon le degré de connaissance pratique de l'immigration (des « Noirs », aux « Camerounais », « Congolais »...), servent à identifier les voisins au quotidien, parfois davantage que le statut professionnel. Mais elles ne signifient pas systématiquement racisme et adhésion à une idéologie raciste, de sorte que l'on aurait tort de réduire l'ensemble des habitants de ces nouveaux lotissements à des électeurs potentiels du FN (le vote FN reposant lui-même sur des logiques complexes). Dans certains cas toutefois, les processus d'assignation identitaire sur la base de catégories ethno-raciales servent à altériser et à inférioriser certaines familles et groupes d'habitants dans l'espace local, recréant une hiérarchie largement indépendante des ressources socio-économiques et des statuts socio-professionnels des individus.
e) Conclusion
En conclusion, l'enquête montre que les lotissements périurbains constituent des espaces de mixité sociale et ethnique dont l'importance a été sous-estimée. Ces derniers contribuent à redéfinir les frontières entre groupes sociaux au sein de la société française, sur des fondements à la fois matériels et symboliques qui sont largement entremêlés comme le montre l'observation ethnographique et l'analyse des rapports de voisinage. Les conclusions de notre enquête font plus largement écho au travail de l'historienne Annie Fourcaut (2000), qui avait souligné le rôle spécifique des lotissements construits dans la banlieue parisienne dans l'entre-deux-guerres (qualifiés de « lotissements défectueux »). Dans un contexte de pénurie de logement et d'absence de politique patronale de logement pour les ouvriers, ces nouveaux lotissements avaient en effet massivement accueilli des migrants de l'intérieur (les « provinciaux ») et de l'extérieur (les « étrangers »), contribuant à créer une grande diversité de peuplement au niveau local.
|
Bibliographie Barth F. (1999), « Les groupes ethniques et leurs frontières », in Poutignat P. et Streiff-Fenart J. (dir.), Théories de l'ethnicité , Paris, PUF, 203-249. Beauchemin C., Hamel C. et Simon P. (dir.) (2010), Trajectoires et Origines. Enquête sur la diversité des populations en France. Premiers résultats , Paris, INED, Document de travail n°168. Chamboredon J.-C. et Lemaire M. (1970), « Proximité spatiale et distance sociale. Les grands ensembles et leur peuplement », Revue française de sociologie , 11 (1), 3-33. Fassin D. (2002), « L'invention française de la discrimination », Revue française de science politique , 52 (4), 395-415 Fourcaut A. (2000), La banlieue en morceaux. La crise des lotissements défectueux en France dans l'entre-deux-guerres , Grâne, Créaphis. Pan Ké Shon J.-L. et Scodellaro C. (2011), Discrimination au logement et ségrégation ethno-raciale en France , Paris, INED, Document de travail n°171 Préteceille E. (2009), « La ségrégation ethno-raciale a-t-elle augmenté dans la métropole parisienne? », Revue française de sociologie , 50 (3), 489-519 Safi M. (2009), « La dimension spatiale de l'intégration des populations immigrées (1968-1999) », Revue Française de Sociologie , 50 (3), 521-552 Simon P. (2008), « Les statistiques, les sciences sociales françaises et les rapports sociaux ethniques et de `race' Revue française de sociologie , 49 (1), 153-162. |
* 69 83% des fils d'agriculteurs nés avant 1940 ont quitté le système scolaire sans diplôme ou avec, au mieux, le CEP contre 59% seulement des hommes nés avant 1940. 8% des fils d'agriculteurs nés après 1970 sont sortis avec, au mieux, le seul CEP contre 12,3% des hommes de la même génération.
* 70 24,9% des fils d'agriculteurs nés après 1970 ont acquis un niveau de bac technologique, professionnel ou un brevet de technicien. 14,8% des hommes de moins de 30 ans sont dans ce cas. Les fils d'agriculteurs ont deux fois plus de chance que l'ensemble de la population d'accéder à ces diplômes des filières techniques longues. Et on sait aujourd'hui avec les premiers résultats du Recensement agricole 2010 que les BTS deviennent des diplômes de plus en plus prisés par les fils d'agriculteurs.
* 71 Le pourcentage de diplômés s'est accru au fur et à mesure de l'élévation du niveau exigé pour l'obtention des aides (passant du CAPA au bac professionnel gestion d'exploitation agricole).
* 72 Enquête Formation et Qualification Professionnelle (FQP) 2003 de l'INSEE.
* 73 Les diplômés : 51,7% des fils d'agriculteurs âgés de 40 à 49 ans en 1999 et titulaires d'un BEP, sont devenus agriculteurs. Les non-diplômés : 22,2% des fils d'agriculteurs âgés et de 40 à 49 ans et titulaires au mieux d'un BEPC ont choisi le métier d'agriculteur.
* 74 Il ne s'agit pas ici de laisser penser que les agriculteurs non-diplômés ne sont pas assez « doués » scolairement. C'est l'école qui ne fait pas sens. La transmission des compétences passant essentiellement par la famille. D'une certaine manière, c'était le sentiment dominant avant les années 1960 parmi les agriculteurs.
* 75 Nous forçons le trait au risque d'être schématique. Une frange des « diplômés » peut avoir le même sentiment et éprouver des difficultés scolaires importantes mais a pu mieux gérer sa scolarité par le choix de formations en alternance (en Maisons familiales rurales par exemple).
* 76 Notons toutefois que le clivage culturel n'oppose pas strictement les petits exploitants aux grands, mais qu'il traverse chaque catégorie d'exploitation.
* 77 Ainsi 43% des fils âgés de 40 à 49 ans sortis sans diplôme ou avec le CEP et 45,9% des titulaires d'un CAP ont un emploi d'ouvrier (plus particulièrement dans les emplois industriels de l'artisanat pour ces derniers) contre 31,6% de l'ensemble des fils de cette génération en moyenne.
* 78 Ainsi 30,9% des fils âgés de 40 à 49 ans disposant d'un bac professionnel ont une profession intermédiaire contre 15,3% des fils disposant d'un CAP.
* 79 Parmi les hommes de 40 à 49 ans en 2000 qui participent au travail dans les exploitations agricoles sans y être salariés, 30,1% déclarent une autre profession principale qu'agriculteurs.
* 80 Le recensement agricole de 2010 fait état d'un taux de 27% des chefs ou des coexploitants d'exploitations agricoles qui sont des femmes. Si l'évolution par rapport à 1970 est saisissante (le même taux n'était que de 8%), c'est essentiellement parce que les femmes de 1970 avaient un statut d'aide familial, de travailleur à titre gratuit. L'agriculture n'est pas plus « féminine » qu'il y a 40 ans comme on a pu l'entendre dans la presse récemment. Il faudrait plutôt dire qu'elle donne aujourd'hui plus souvent qu'avant un statut professionnel reconnu aux conjointes qui travaillent sur l'exploitation. En 2010 cependant, 62% des conjoints actifs sur l'exploitation et qui n'ont pas le statut de coexploitant sont des femmes (Laisney, 2012).
* 81 Et même un choix réversible s'il n'est pas satisfaisant pour la conjointe (Dufour, Giraud, 2012).
* 82 Il faudrait ajouter un troisième groupe qui est celui des agriculteurs sans ascendance familiale agricole qui représente, en 1999, environ 15% des agriculteurs.
* 83 Ce texte est la version légèrement remaniée de : N. Renahy, « Relégation au village. Sur la crise de reproduction du groupe ouvrier en milieu rural », SociologieS , Dossier « Frontières sociales, frontières culturelles, frontières techniques », mis en ligne le 27 décembre 2010.
* 84 Les noms de lieux et de personnes ont été modifiés.
* 85 Des premières enquêtes de sociologie industrielle dirigées par Alain Touraine à l'après-guerre aux plus récentes qui ont porté un nouveau regard sur le monde ouvrier dans les années 1990 (Schwartz, 1990 ; Beaud et Pialoux, 1999), ce sont surtout les sites d'implantation de la grande industrie automobile ou minière qui ont intéressé les sociologues.
* 86 Dans la commune, le vote à destination du PCF atteint 19 % des voix au premier tour des présidentielles de 1969, celui pour le PS 32 % en 1969 et 53 % en 1974.
* 87 Sources des données généalogiques : Etat civil et listes nominatives des recensements de la commune de Foulange ; enquête orale.
* 88 Ce point est important : une des limites (ou des caractéristiques) de l'enquête à base monographique est de ne prendre uniquement en compte la population restée sur place. On ne s'intéresse donc pas ici aux jeunes qui ont (massivement) quitté le village encore enfants, suite au licenciement de leurs parents, ni à ceux qui l'ont fait plus tard du fait d'une réussite scolaire ou d'une opportunité professionnelle. Certains « retours au village » ont cependant pu être observés vers l'âge de trente ans, ils sont généralement synonymes d'échecs professionnels ou matrimoniaux, et donnent à voir qu'il ne suffit pas de « bouger pour s'en sortir » (cf. Renahy, 2009). L'inégalité face à la réinsertion professionnelle suite à un licenciement collectif est par ailleurs excessivement genrée : cf. Trotzier, 2005.
* 89 Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes.
* 90 Employé du Service Après Vente.
* 91 10 000 Francs français, soit 1500 € environ.
* 92 Ce point mériterait un plus long développement. Ne pouvant le traiter ici, nous nous permettons de renvoyer à l'ouvrage Les gars du coin (Renahy, 2005), dans lequel sont mesurées les articulations problématiques des appartenances électives avec les sociabilités villageoises et usinières, mais aussi dans des domaines aussi divers que la politisation ou l'accès à une relation affective stable.
* 93 En effet, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est d'abord la trajectoire migratoire saisie à travers le pays de naissance des individus et de leurs parents. Dans le second temps de l'exposé, je suis davantage attentive à l'origine perçue et aux processus d'altérisation à l'oeuvre dans l'espace local, justifiant l'usage des termes « ethnique », « race » et « ethno-racial » dans une perspective à la fois relationnelle et constructiviste. Sur ce point, voir notamment le travail de l'anthropologue F. Barth (1969).
* 94 Ce taux était passé de 35 % en 1954 à 51 % en 1984. Mais la part des catégories populaires et des primo-accédants parmi les accédants récents diminue, au profit des ménages plus aisés et des multipropriétaires.
* 95 Sur ce point, voir notamment l'article de Didier Fassin (2002) ainsi que les travaux de Patrick Simon à l'INED.
* 96 Nous mobilisons ici les données de l'enquête Mobilité géographique et insertion sociale (MGIS) de l'INED (1992) et des Enquêtes logement de l'INSEE (1996, 2002 et 2006).
* 97 Avec 39% de propriétaires et 30% de locataires HLM en 2006, les ménages immigrés sont surreprésentés dans le parc locatif social et sous-représentés dans la propriété par rapport à leur poids dans la population française ; les proportions sont inverses pour les ménages non immigrés, qui comptent 59% de propriétaires.
* 98 Sur ces aspects, voir notamment le travail d'Edmond Préteceille (2009), de Jean-Louis Pan Ké Shon et Claire Scodellaro (2011) et de Mirna Safi (2009, 2011).
* 99 Nom anonymisé de la commune dans laquelle nous avons conduit l'enquête ethnographique.
* 100 Le terme fait référence au critère de la nationalité.







