RAPPORT D'INFORMATION N° 96 - PERSPECTIVES MACROECONOMIQUES A MOYEN TERME (1997-2002)
M. Bernard BARBIER
DELEGATION DU SENAT POUR LA PLANIFICATION - RAPPORT D'INFORMATION N° 96 - 1997/1998
Table des matières
- PRÉSENTATION
-
CHAPITRE I
PERSPECTIVES MACROÉCONOMIQUES À MOYEN TERME -
CHAPITRE II
QUESTIONS POUR L'ÉCONOMIE EUROPÉENNE -
CHAPITRE III
LA DURÉE DU TRAVAIL -
ANNEXE N° 1
UNE PROJECTION DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE
(1997-2002)- I. CONCEPTION GÉNÉRALE DE L'EXERCICE
- II. PRINCIPALES HYPOTHÈSES DE LA PROJECTION
- III. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS MACROÉCONOMIQUES
- IV. TENDANCES DES FINANCES PUBLIQUES
- ANNEXE N° 2
-
ANNEXE N° 3
LES DIFFICULTÉS DE MESURE ET DE COMPARAISON
DE LA DURÉE DU TRAVAIL
- A. LES PRINCIPAUX INDICATEURS DE LA DURÉE DU TRAVAIL EN FRANCE
- B. LES INCERTITUDES DE LA MESURE DE LA DURÉE DU TRAVAIL
- C. LA SIGNIFICATION DE LA DIMINUTION DE DURÉE DU TRAVAIL TEND À SE BROUILLER
- D. LA PERTINENCE DES INDICATEURS DE LA DURÉE DU TRAVAIL DES SEULS ACTIFS DOIT ÊTRE RELATIVISÉE
- E. LES COMPARAISONS INTERNATIONALES DE LA DURÉE DU TRAVAIL SONT DIFFICILES
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la délégation du Sénat pour la planification
(1)
sur les
perspectives macroéconomiques à moyen terme
(1997-2002),
Par M. Bernard BARBIER,
Sénateur.
(1) Cette délégation est composée de
: MM. Bernard Barbier,
président
; Bernard Hugo, Marcel
Lesbros, Georges Mouly, René Régnault,
vice-présidents
; Jacques Braconnier, Louis Minetti,
secrétaires
; Mme Janine Bardou, MM. Michel Charzat, Roger
Husson, Henri Le Breton, Daniel Percheron, Jean-Marie Poirier, Roger
Rinchet, Jean-Jacques Robert.
Prévisions et projections économiques -
Chômage -
Consommation - Cotisations sociales - Croissance - Déficit public -
Dépenses de santé - Dette publique - Dollar - Durée du
travail - Echanges extérieurs - Emploi - Finances sociales - Inflation -
Investissement - Modèles macroéconomiques - Politique
budgétaire - Population active - Productivité - Rapports
d'information - Salaires - Sécurité sociale - Taux de change -
Taux d'intérêt - Union économique et monétaire -
Rapports d'information.
PRÉSENTATION
Créée par la loi du 29 juillet 1982
portant réforme de la planification afin d'"
informer (le
Sénat) sur l'élaboration et l'exécution des
plans
" (article 2), la Délégation pour la
Planification a ainsi été conduite à analyser et à
discuter les travaux de prospective économique menés dans le
cadre de la planification, et à les confronter aux travaux
réalisés à la demande du Sénat.
Depuis l'abandon du XIe Plan et en l'absence, depuis lors, de Plan national, la
Délégation a poursuivi, avec l'accord du Président et du
Bureau du Sénat, sa mission d'information et a continué à
présenter des éléments de réflexion sur les
perspectives économiques à moyen terme, afin que le Sénat
puisse profiter des moyens modernes d'analyse économique et de
prévision.
Ce Rapport d'information vous soumet donc, comme les années
précédentes, quelques éléments de réflexion
et de synthèse de différents travaux de
projection
et de
simulation
réalisés à la demande du Service des
Etudes du Sénat, sous l'égide de la Délégation.
Ceux qui sont présentés dans le
premier chapitre
et
l'
annexe n° 1
ont été réalisés à
l'aide du modèle MOSAÏQUE de l'Observatoire français des
conjonctures économiques (OFCE). Ils concernent une projection de
l'économie française à l'horizon 2002.
Ils sont comparés aux prévisions à moyen terme de trois
autres organismes : le Bureau d'Informations et de Prévisions
Economiques (BIPE), l'Institut national de la Statistique et des Etudes
économiques (INSEE) et le Centre de Recherches pour l'expansion de
l'économie et le développement des entreprises (REXECODE).
Le
deuxième chapitre
et l'
annexe n° 2
évoquent des questions de politique économique en Europe à
la lumière des simulations réalisées à l'aide du
modèle mondial MIMOSA commun au Centre d'études prospectives et
d'informations internationales (CEPII) et à l'OFCE.
Enfin, le
troisième chapitre
et l'
annexe n° 3
sont consacrés à une analyse de l'évolution de la
durée du travail
et à un inventaire des différentes
questions qui se posent lorsqu'on simule, à l'aide de modèles
macroéconomiques, les effets d'une réduction de la durée
du travail.
CHAPITRE I
PERSPECTIVES MACROÉCONOMIQUES
À MOYEN TERME
I. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS D'UNE PROJECTION DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE À L'HORIZON 2002 (réalisée par l'OFCE)
L'Observatoire français des conjonctures
économiques (OFCE) a réalisé, à la demande du
Service des Etudes du Sénat, une
projection
de l'économie
française à l'horizon 2002, à l'aide de son modèle
macro-économique MOSAÏQUE (voir
Annexe n° 1
, page
63).
Cet exercice est de nature essentiellement
macroéconomique,
mais
il a été demandé aux experts de l'OFCE d'en tirer le
maximum d'indications sur l'évolution des
finances publiques.
Votre Délégation rappelle une nouvelle fois qu'en
présentant les principales conclusions de ces travaux, elle n'a d'autre
souci que de mettre à la disposition du Sénat une
illustration
- grâce à l'éclairage que peut donner
une projection à cinq ans - des choix et des questions de politique
économique, et de baliser ainsi les cheminements possibles de
l'économie française à l'horizon 2002.
A. LA DEMANDE ÉTRANGÈRE ET LES ÉCHANGES EXTÉRIEURS
1. L'environnement monétaire et international de l'économie française
Les résultats d'un exercice de projection
réalisé à l'aide d'un modèle macroéconomique
national sont étroitement
liés
aux
hypothèses
relatives aux taux de change, aux taux d'intérêt et à
la croissance des économies partenaires. Celles qui ont
été retenues par l'OFCE sont assez optimistes, du moins pour le
court terme
:
· Les auteurs de la projection ont tout d'abord considéré
que la hausse du
dollar
depuis son point bas de la mi-1995
n'obéissait ni à des mouvements à caractère
spéculatif, ni au décalage de conjoncture entre les Etats-Unis et
l'Europe, mais à une amélioration
fondamentale
de la
confiance des détenteurs mondiaux de capitaux dans la capacité de
l'économie américaine à rembourser ses dettes (en raison
notamment de la réduction structurelle du déficit public aux
Etats-Unis).
Ainsi sur l'ensemble de la période 1997-2002, le cours du dollar est
supposé s'établir en moyenne aux alentours de 6 francs, au
lieu de 5,30 francs au cours des six années
précédentes. Cette hypothèse a une incidence très
favorable sur la
compétitivité
et la croissance en Europe.
Une variante réalisée à l'aide du modèle MIMOSA,
présentée et discutée dans le
chapitre 2
de ce
rapport, montre qu'une dépréciation de 10 % des monnaies
européennes se traduit par une augmentation du taux de
croissance
de l'économie européenne comprise
entre 0,3 et
0,9 point pendant deux ans
(selon la réaction des
autorités monétaires à une accélération de
l'
inflation
consécutive à l'augmentation du prix des
produits importés).
· Par ailleurs, les taux d'intérêt à court terme
fluctueraient autour de 2 % en termes
réels
(c'est-à-dire les taux d'intérêt nominaux moins
l'inflation), sur l'ensemble de la période de projection. Les taux
d'intérêt réels à court terme seraient ainsi
inférieurs
au taux de croissance
potentiel
1(
*
)
des économies européennes, ce qui
correspondrait à une politique monétaire nettement plus
accommodante que celle qui a été suivie depuis le début
des années quatre-vingt-dix.
· Le ralentissement de l'
économie américaine,
que
nombre d'économistes prévoyaient pour 1997, n'interviendrait
véritablement qu'en 1999. Encore ce freinage de l'activité
serait-il d'ampleur modérée et de durée limitée
selon l'OFCE, contrairement aux épisodes de ralentissement cyclique que
l'économie américaine a connus par le passé. La croissance
des économies
européennes
, stimulée par la hausse
du dollar et soutenue par la reprise de leur demande intérieure,
s'
accélérerait significativement
en début de
période (+ 3,1 % en 1998 et + 2,9 % en 1999 pour la
moyenne européenne), avant de ralentir par la suite (+ 2 % en
moyenne de 2000 à 2002).
Au total, la
demande étrangère
adressée à la
France serait
soutenue
jusqu'en 1999 (+ 7,6 % par an en
moyenne), avant de ralentir en fin de période (+ 5,5 % de 2000
à 2002).
ENCADRÉ N° 1
QUEL IMPACT DES INCERTITUDES ASIATIQUES
SUR LA CROISSANCE EN
EUROPE ?
Pour schématiser les conséquences possibles
sur la croissance européenne, des récentes difficultés
apparues dans certains pays asiatiques jusqu'alors en forte expansion, on peut
décrire trois types d'enchaînements : effets d'un
ralentissement de la croissance économique en Asie, effet des
dévaluations des monnaies asiatiques, effets d'un affaiblissement du
dollar.
1. D'après une simulation, réalisée en 1996 à
l'aide du
modèle INTERLINK
de l'
OCDE
, le ralentissement
d'un point de pourcentage de la croissance en 1997 et 1998 dans les pays d'Asie
non membres de l'OCDE (à taux de change nominal et taux
d'intérêt fixes), a pour conséquence que le
niveau du
PIB
serait en 1998 plus faible de 0,2 % dans l'Union européenne
et aux Etats-Unis, et de 0,4 % au Japon.
L'impact sur l'économie française pourrait être proche de
la moyenne européenne : d'un côté, la France exporte
relativement peu vers l'Asie (en 1995, 32 milliards de francs vers le
Japon, et 87 milliards de francs vers les pays d'Asie en
développement rapide - Chine comprise -, soit respectivement
1,8 % et 4,8 % de nos exportations) ; de l'autre, nos
exportations (biens de consommation de luxe, services touristiques, biens
d'équipement de haute technologie) pourraient être
particulièrement sensibles aux variations du revenu réel dans les
pays d'Asie. Les crises de change en Asie pourraient donc avoir un impact
marqué sur certains secteurs (vins fins et spiritueux notamment).
2. La dévaluation des monnaies des économies dynamiques d'Asie
réduit la compétitivité des exportateurs européens.
Ainsi, selon l'OCDE, une dépréciation de 10 % des monnaies
de la Corée, de Hong-Kong, de Singapour, de Taïwan, de la Chine, de
l'Inde, de la Malaisie, des Philippines et de la Thaïlande
réduirait au bout de deux ans les exportations européennes de
1,5 % et le PIB européen de 0,3 %, ces effets s'inversant
toutefois dès la quatrième année, les pertes de
compétitivité étant peu à peu
récupérées.
3. Les crises de change en Asie tendent à affaiblir le dollar, ce qui
pénalise la reprise en Europe. En effet, le monde chinois d'un
côté (Chine, Hong-Kong, Singapour, Taïwan), et la
Thaïlande, la Corée, la Malaisie de l'autre, détenaient en
stock en 1996 respectivement, 300 et plus de 100 milliards de dollars de
réserves en devises, aux trois-quarts libellées en dollars, soit
un quart des réserves mondiales en dollars. Ces pays sont devenus les
premiers financeurs du déficit extérieur des Etats-Unis. La crise
de change en Asie entraîne des ventes de dollars par les pays dont les
monnaies sont attaquées d'une part, et hypothèque le financement
futur des déficits américains d'autre part, ce qui concourt
à déprécier le dollar.
Ces trois mécanismes pourraient toutefois être partiellement
compensés par une détente des taux d'intérêt au
niveau mondial : d'une part, la volatilité des marchés
d'actions entraînerait un report des investisseurs vers les
marchés d'obligations ; d'autre part, le ralentissement de la
croissance réduirait les tensions inflationnistes aux Etats-Unis ;
enfin, la fragilisation des systèmes bancaires et financiers inciterait
les autorités monétaires à détendre les taux
d'intérêt à court terme.
Au total, selon l'OCDE, l'effet négatif de la crise financière en
Asie du Sud-Est sur la croissance serait de l'ordre de 0,1 à
0,2 point en Europe et aux Etats-Unis, cette année et l'an
prochain, et le double au Japon.
2. Les échanges extérieurs : Quel excédent pour l'économie française ?
L'environnement monétaire et international, tel qu'il
vient d'être décrit, est très favorable à notre
commerce extérieur en
début de période :
- l'hypothèse d'une poursuite de la hausse du dollar entraîne une
amélioration de la compétitivité à l'exportation
(de l'ordre de 2,9 points par an en moyenne sur 1997 et 1998).
- le dynamisme de la demande adressée à la France par ses
partenaires en 1997 et 1998, entraîne une progression plus rapide des
exportations que celle des importations.
- il en résulte une
contribution
élevée des
échanges extérieurs à la croissance, surtout en
début de période : ceux-ci expliqueraient 1,6 point de
croissance en 1997 (pour une croissance totale de 2,1 %), 0,9 point
en 1998 (pour une croissance de 3,2 %) et 0,5 point en 1999 (pour une
croissance de 2,9 %).
L'
excédent commercial
passerait de 203 milliards de francs
en 1997 à 288 milliards de francs en 2002 (soit de 2,5 %
à 3 % du PIB) et la
capacité de financement
de la
Nation
s'accroîtrait : de 2,3 % du PIB en 1997 à
3,1 % en 2001.
L'augmentation des excédents commerciaux décrite par la
projection est-elle
réaliste ?
L'excédent commercial français, apparu au début des
années 90, a souvent été interprété
comme un " mauvais excédent ", c'est-à-dire un
excédent consécutif à une croissance de l'économie
française
inférieure
à celle de ses partenaires.
Effectivement, la France a connu un taux de croissance inférieur de
0,6 point à celui de l'ensemble de ses partenaires entre 1990 et
1996, ce qui pourrait expliquer que ses importations aient augmenté
moins rapidement que ses exportations.
Néanmoins, les résultats de la projection ainsi que des
simulations réalisées par l'INSEE (à l'aide de son
modèle AMADEUS)
2(
*
)
ne confirment pas ce
diagnostic. En effet, même en comblant son écart de croissance
avec ses principaux partenaires, la France continuerait, selon la projection de
l'OFCE, à dégager d'importants excédents. Ceux-ci iraient
même croissants à l'horizon 2002.
Semblable évolution est cependant liée à des
hypothèses
(hausse du dollar et dynamisme de la demande
étrangère), qui peuvent être mises en cause, comme l'a
montré la crise financière récente. Aussi, afin de
neutraliser l'effet sur le solde commercial d'hypothèses de cette
nature, l'INSEE a calculé une balance commerciale
"structurelle",
qui traduit en quelque sorte le
niveau structurel de
compétitivité
de l'économie française,
indépendamment des mouvements de change et du décalage
conjoncturel entre la France et ses partenaires de l'OCDE
3(
*
)
. L'INSEE évalue ainsi à
2 %
du PIB en 1996 l'excédent commercial
structurel
de la France. Ces
travaux, combinés aux résultats de la projection
réalisée par l'OFCE, appellent deux observations :
- cet excédent structurel traduit le
niveau élevé de
compétitivité
de l'économie française (niveau
de la compétitivité-prix, niveau de qualité des produits
et de la compétitivité hors-prix...) ;
- même si l'environnement monétaire et international de
l'économie française devenait
moins favorable
que celui
décrit par la projection de l'OFCE (en raison d'une baisse du dollar par
exemple), l'économie française
continuerait
à
dégager, sur le moyen terme, d'importants excédents
extérieurs.
Ces travaux dessinent donc une inversion durable de tendance depuis le
début des années 90 : l'économie française
accumule désormais des excédents par rapport au reste du monde.
D'un point de vue comptable, l'augmentation de la
capacité de
financement de la Nation
correspond à un
excédent
de
l'
épargne
nationale sur l'
investissement.
Ainsi, la projection de l'OFCE met-elle en évidence un
atout
pour
les prochaines années : la possibilité pour
l'économie française de croître
plus vite
que son
potentiel ou que ses partenaires sans buter sur des
contraintes de
financement.
Elle n'indique pas, en revanche, comment cet atout pourrait
être exploité...
B. LA DEMANDE INTÉRIEURE
1. Quelle reprise pour l'investissement des entreprises ?
La projection élaborée par l'OFCE décrit
un " cycle d'investissement " caractéristique d'une
période de reprise économique. Celui-ci serait cependant bref et
d'ampleur modérée. L'amélioration des perspectives de
débouchés en début de période entraîne un
redressement de l'investissement en 1998 et 1999 (respectivement
+ 3,4 % et + 3,7 %). Par la suite, le ralentissement de la
demande mondiale conjugué à une progression modérée
de la consommation se traduirait par une stabilisation de la progression de
l'investissement autour de 2 % par an en moyenne. La reprise de
l'investissement ainsi décrite est beaucoup moins dynamique que celle
qu'a connue l'économie française dans les périodes
précédentes de redémarrage de l'activité (en
particulier à la fin des années quatre-vingt).
Cependant, l'évolution de l'
endettement
des entreprises et les
conséquences de l'
unification monétaire
de l'Europe
constituent deux facteurs d'incertitude dont les modèles ne peuvent
guère rendre compte. Or, les économistes ne parviennent pas
à expliquer la faiblesse de l'investissement observée à
partir de 1992, à partir de ses deux déterminants
traditionnels dans les modèles, que sont l'évolution des
perspectives de
débouchés
et des
profits
anticipés par les entreprises. C'est pourquoi, il est parfois
avancé que l'excès d'endettement est à l'origine du
" sous-investissement " observé. Cette explication
semblerait
validée par des travaux économétriques récents de
l'INSEE
4(
*
)
. Ces mêmes travaux tendraient
à l'inverse à montrer que le désendettement
en
cours
des entreprises entraînerait une reprise de l'investissement
plus forte
que celle décrite par la projection de l'OFCE.
Par ailleurs, à moyen terme, l'unification monétaire de l'Europe
va modifier l'environnement des entreprises, et en particulier supprimer les
incertitudes sur les taux de change intra-européens
particulièrement évidentes depuis le début des
années quatre-vingt-dix. Il pourrait en résulter une modification
des comportements d'investissement des entreprises que les modèles
macroéconomiques ne peuvent pas prendre en compte.
2. Le revenu et la consommation des ménages
L'évolution du
pouvoir d'achat des
ménages
décrite par la projection est sensiblement plus
dynamique que celle enregistrée au cours de la période
récente : + 2 % par an en moyenne entre 1997 et 2002,
contre 1,6 % par an entre 1990 et 1996 (et + 0,1 % en 1996). La
même inflexion apparaît quand on compare ces résultats avec
ceux de la projection présentée l'année dernière
par votre Délégation, dans laquelle le revenu des ménages
ne progressait que de 1 % par an en moyenne sur le moyen terme.
Deux facteurs expliquent cette inflexion dans le scénario
1997-2002 :
- la progression du pouvoir d'achat du
salaire
par tête serait de
l'ordre de 1,5 % par an en moyenne (contre 0,1 % par an en moyenne
dans la projection réalisée l'année
dernière) : la baisse du chômage en début de
période renforcerait en effet les revendications salariales (relation
dite de " Phillips "), de telle sorte que l'évolution des
salaires serait
plus dynamique
qu'au cours des années
récentes ;
- aucun prélèvement nouveau sur les ménages n'est
nécessaire pour rééquilibrer les comptes sociaux (cf. p.
22).
On constate ainsi que l'accélération de la croissance en
début de période, impulsée par le dynamisme de la demande
étrangère et la hausse du dollar, entraîne en projection
des
enchaînements
macroéconomiques
favorables
au
revenu des ménages. En outre, comme leur taux d'épargne serait
stable sur le moyen terme, leur consommation évoluerait
parallèlement au pouvoir d'achat de leur revenu (soit + 2 %
par an en moyenne).
3. L'évolution des salaires : Quels enseignements des modèles ?
Le débat économique s'est récemment
focalisé sur l'évolution du
partage de la valeur
ajoutée
entre revenus du
travail
et revenus du
capital.
En effet, après avoir sensiblement augmenté au milieu des
années soixante-dix, la part des salaires dans la valeur ajoutée
a reculé au cours des années quatre-vingt, pour se stabiliser
depuis le début des années quatre-vingt-dix à un niveau
nettement inférieur à celui du début des années
soixante-dix.
Dans la projection à moyen terme de l'OFCE, le partage de la valeur
ajoutée se
stabilise
au niveau d'aujourd'hui, les salaires par
tête évoluant comme la productivité du travail
5(
*
)
.
A cet égard, on peut s'interroger sur les conséquences qu'aurait
un rééquilibrage du partage de la valeur ajoutée plus
favorable aux revenus du travail, ce qui correspond à une
évolution des salaires plus rapide que celle décrite par la
projection. Mais une simulation de cette nature n'a d'intérêt que
si elle est réalisée à l'aide d'un modèle
multinational,
qui permet de mettre en évidence les
phénomènes d'
interdépendance
entre
économies.
Deux
variantes de hausse des salaires en
France
et en
Europe
ont ainsi été
élaborées à l'aide du modèle mondial
MIMOSA
6(
*
)
.
Les principaux résultats de ces variantes (présentées dans
l'annexe n° 2, page 97) sont résumés
ci-après.
· Une hausse des salaires de 2 %
uniquement en France
exerce
des effets contradictoires :
- une augmentation de la consommation des ménages,
- une hausse du taux d'épargne des ménages en raison du
supplément d'inflation engendrée par la hausse des salaires
(" effet d'encaisse réelle "),
- une baisse de l'investissement des entreprises en raison de la baisse du taux
de marge,
- une dégradation de la compétitivité.
A court terme (un an), l'effet de l'augmentation de la consommation
l'emporte
légèrement :
le PIB augmente de 0,2 %.
Par la suite, les effets décrits ci-dessus se compensent et
l'impact
sur l'activité est nul.
Les effets sur le chômage sont en
conséquence
négligeables
7(
*
)
.
Ces résultats sont très peu différents de ceux des autres
modèles macroéconomiques français : effet
légèrement expansionniste ou nul à court terme, effet nul
ou légèrement restrictif au bout de deux à trois ans.
· Dans les enchaînements ainsi décrits, un rôle
majeur est joué par la dégradation de la
compétitivité :
compte tenu du degré
d'ouverture élevé des pays européens sur leurs partenaires
de l'Union, une hausse salariale limitée à un seul pays
pénalise fortement ses échanges extérieurs.
Par contre, l'économie européenne constituant un ensemble
peu
ouvert
sur l'extérieur, une hausse des salaires dans l'
ensemble
des pays européens
devrait avoir, semble-t-il a priori, des effets
expansionnistes
plus sensibles (les conséquences des pertes de
compétitivité de l'ensemble européen sont en effet plus
limitées). Pourtant, une simulation modélisée d'une hausse
des salaires (de 2 % du PIB)
dans l'ensemble de l'Union
européenne
ne confirme pas cette intuition. En effet, si la perte de
compétitivité a une incidence restrictive plus faible que dans
une variante " nationale ", l'impact inflationniste de la
hausse des
salaires entraîne une
augmentation des taux d'intérêt
par les Banques Centrales. Cette mesure limite l'effet expansionniste de
l'augmentation de la demande intérieure européenne. Finalement,
la hausse du
PIB
en Europe est donc
faible
(+ 0,2 %
à un an, + 0,4 % à trois ans et + 0,2 %
à cinq ans) et l'impact sur le chômage peu significatif
(- 0,1 point pour le taux de chômage au bout de deux ans
et pas d'effet à cinq ans).
· Ces simulations illustrent la
complexité
des liens entre
salaires, croissance et emploi. Des hausses de salaires (au-delà de
l'évolution de la productivité) n'auraient qu'une incidence
faible (ou nulle) sur la croissance alors que, par ailleurs, la tendance de
l'économie française à l'" enrichissement du contenu
en emplois de la croissance " serait compromise, en raison de
l'incitation
à substituer du capital au travail que constitue l'augmentation du
coût du travail.
Par ailleurs, les analyses sur la déformation du partage de la valeur
ajoutée au détriment des salaires s'appuient sur une
évolution
moyenne
du taux de marge des entreprises et ne prennent
pas en compte l'hétérogénéité des
situations, par secteurs d'activité ou selon la taille des entreprises.
Ainsi la déformation du partage de la valeur ajoutée au
bénéfice des revenus du capital a-t-elle été
particulièrement nette dans les
grandes entreprises
du secteur
industriel,
concourant ainsi à l'augmentation du niveau
moyen
du taux de marge dans l'ensemble de l'économie. Or les
grandes entreprises du secteur industriel sont celles qui
" économisent " le plus le facteur travail et substituent le
plus facilement du capital au travail : des hausses trop rapides ne
feraient qu'
accélérer
ce mouvement. Inversement, dans les
autres secteurs (
services
et surtout
bâtiment
) et dans les
petites entreprises, la situation financière est souvent beaucoup moins
favorable. Là aussi, des hausses trop rapides de salaires
interrompraient l'amélioration de l'emploi constatée dans ces
entreprises et ces secteurs depuis une dizaine d'années, explicable pour
partie par la modération du coût du travail.
L'évolution des salaires que décrit la projection de l'OFCE
semble ainsi obéir à un " bon équilibre " entre
des hausses salariales trop faibles qui brident dangereusement la demande et
des hausses trop fortes qui dégradent la compétitivité et
l'investissement et favorisent la substitution du capital au travail.
Les conclusions de cette projection sont ainsi moins pessimistes que celles qui
se dégageaient des exercices présentés les années
précédentes par votre Délégation. Sur le moyen
terme, l'économie française échapperait ainsi à ce
que les experts gouvernementaux, dans la note adressée aux participants
à la
Conférence nationale sur l'emploi, les salaires et le
temps du travail
du 10 octobre dernier, décrivent comme une
" faiblesse structurelle "
:
" En
période
de ralentissement, l'austérité salariale excessive pèse
sur la consommation et accentue la faiblesse de l'activité. En
période de reprise, il existe toujours le risque de voir les
salariés ayant un emploi essayer de rattraper de façon excessive
le manque à gagner des années de faible activité, alors
que la priorité devrait être accordée aux créations
d'emplois ".
ENCADRÉ N° 2
UNE SIMULATION DE LA HAUSSE DU SMIC
Le Centre d'Observation Economique (COE) de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Paris a réalisé, à l'aide du
modèle macroéconomique international OEF (Oxford Economics
Forecasting), des simulations qui évaluent l'impact en 1997 et 1998 de
la hausse du SMIC intervenue au 1er juillet 1997
1
.
Cette augmentation s'élève à 4 % -le "coup de pouce"
gouvernemental représente 2,3 %-, ce qui porte la hausse du SMIC en
pouvoir d'achat à 3,1 %.
La simulation retient deux hypothèses de diffusion de la hausse du
SMIC au taux de salaire horaire ouvrier (TSHO) et au salaire moyen. La
première suppose qu'une augmentation de 1 % du SMIC entraîne
une hausse du TSHO de l'ordre de 0,1 point. La seconde hypothèse
suppose un effet de diffusion double, soit 0,2 point. Enfin,
l'élasticité du salaire moyen au TSHO est proche de 1 (une
augmentation de 1 % du TSHO entraîne une hausse de 1 % du
salaire moyen).
Par ailleurs, le
coût pour les finances publiques
de la
réduction dégressive des cotisations patronales pour les salaires
inférieurs ou équivalents à 1,33 SMIC est accru de
6 milliards de francs :
la hausse du SMIC entraîne une
hausse du nombre de smicards, une hausse du nombre de salariés en
dessous du plafond de 1,33 SMIC et une hausse des salaires, donc de la
réduction de charges correspondante.
Quelle que soit l'hypothèse de diffusion retenue, les résultats
du tableau ci-dessous montrent les effets macroéconomiques à la
fois
réduits
et
contradictoires
de la hausse du SMIC.
On constate en effet que le PIB est au plus augmenté de 0,1 %. La
consommation des ménages est accrue en raison de l'évolution du
revenu réel. Mais la croissance du salaire moyen affecte les prix
à la consommation. Cette pression inflationniste réduit l'effet
positif sur l'activité et dégrade les gains de pouvoir d'achat.
L'emploi se contracte : la hausse du coût salarial, malgré
les allégements de charges existants, se traduit par une
accélération de la substitution
du capital au travail,
dont l'incidence négative sur l'emploi est supérieure à
l'incidence positive de l'augmentation de l'activité.
1. Voir "Modèles et diagnostics", COE, juillet et août 1997.
|
INCIDENCE MACROÉCONOMIQUE DE LA HAUSSE DU SMIC (N.B. Les chiffres sont donnés pour une hausse de 4 % au 1er juillet 1997, mais la hausse " délibérée ", c'est-à-dire allant au-delà de l'obligation légale, n'a été que de 2,3 %.) |
||||||
|
|
Hypothèse de diffusion 1 |
Hypothèse de diffusion 2 |
||||
|
Ecart en pourcentage sur les niveaux du : |
1997
|
1998 |
1997
|
1998 |
||
|
PIB
|
0,00
|
0,05
|
0,01
|
0,08
|
||
|
Emploi
|
- 0,04
|
- 0,04
|
- 0,09
|
- 0,11
|
||
|
Prix à la consommation |
0,03 |
0,22 |
0,07 |
0,56 |
||
|
Solde public (en % du PIB)
|
- 0,02
|
- 0,06
|
- 0,02
|
- 0,08
|
||
|
Source : COE avec le modèle macroéconométrique international OEF. |
||||||
4. La croissance, l'emploi et le chômage
Le profil de
croissance à moyen terme
de
l'économie française, décrit par la projection, peut
être décomposé en trois phases :
- un
redémarrage
de l'activité sur les années
1997
à
1999,
avec un taux de croissance du PIB de
2,1 % pour 1997, 3,2 % en 1998 et 2,9 % en 1999. Cette reprise
s'expliquerait par le dynamisme de l'environnement international,
l'amélioration de la compétitivité consécutive
à l'appréciation du dollar et des comportements de dépense
des entreprises plus vigoureux ;
- un ralentissement en 2000 et 2001 (avec respectivement 2,1 % et
2,3 % de croissance du PIB) en raison de la dégradation relative de
l'environnement international, d'une phase de dépréciation du
dollar et du ralentissement de l'investissement des entreprises. La
consommation des ménages se redresse
progressivement
et concourt
à la stabilisation de la croissance au-dessus de 2 % par an ;
- une accélération de la croissance
en fin de projection
(+ 2,5 % en 2002), liée à la reprise de l'activité
chez nos principaux partenaires.
· L'
emploi total
augmenterait de 0,5 % par an en moyenne
(soit 128.000 créations nettes d'emplois) ce qui représente
770.000 créations nettes
d'emplois de 1997 à 2002.
Ce résultat tient compte d'une hypothèse de création de
350.000 " emplois-jeunes " en trois ans dans le
secteur non
marchand, ce qui ne correspondrait cependant qu'à la
création
nette
de 280.000 emplois, l'OFCE faisant l'hypothèse que
20 % des emplois-jeunes auraient été créés
même en l'absence du dispositif incitatif contenu dans la loi du
16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour
l'emploi des jeunes.
Il faut souligner que les
gains de productivité
associés
à cette évolution de la croissance et de l'emploi sont
sensiblement
plus élevés
sur le moyen terme que ceux qui
ont été constatés au cours des dernières
années (+ 2 % par an de 1997 à 2002 contre 1,5 %
par an de 1990 à 1996). Cette évolution de la
productivité,
peu favorable
en projection à celle de
l'emploi, s'expliquerait par deux facteurs :
- la projection est marquée par deux périodes de reprise, au
cours desquelles les entreprises n'ajustent leurs effectifs qu'avec retard, ce
qui contribue à l'augmentation de la productivité moyenne sur la
période de projection ;
- la croissance est principalement tirée par les exportations en
début de période, ce qui profite au secteur industriel où
la productivité est la plus forte : il en résulte une
augmentation de la productivité moyenne dans l'ensemble de
l'économie.
· Selon l'hypothèse retenue par l'OFCE, les ressources en main
d'œuvre augmenteraient de 154.000 par an.
Toutefois, l'augmentation de l'emploi attirerait sur le marché du
travail des personnes jusqu'alors " découragées " de
telle sorte que la population active
effective
augmenterait de 170.000
par an.
Le
nombre de chômeurs
s'élèverait ainsi de 25.000
par an en moyenne sur la période 1998-2002.
Le
taux de chômage
baisserait de 12,5 % en 1997 à
12 % en 2000, mais
rejoindrait
son
niveau initial
en fin de
période.
· On peut ainsi considérer que, selon le modèle
MOSAÏQUE, le taux de
croissance potentiel
8(
*
)
de l'économie française se situe
autour de 2,5 %, puisque ce taux de croissance correspond sur le moyen
terme à une stabilisation du chômage.
C. LES FINANCES PUBLIQUES
Le modèle MOSAÏQUE de l'OFCE, utilisé pour réaliser cette projection, ne permet qu'une approche globale des finances publiques. Il a néanmoins été demandé aux experts de l'OFCE d'en tirer le maximum d'indications sur l'évolution détaillée des finances publiques (présentée dans l' annexe n° 1 ). Votre rapporteur s'attachera ci-après à celles qui lui paraissent les plus significatives.
1. Les hypothèses relatives aux dépenses
La définition des hypothèses sur
l'évolution des dépenses publiques présuppose :
- un
pronostic
sur l'orientation
délibérée
de la politique budgétaire et l'évolution des dépenses
publiques autres que les prestations sociales (masse salariale publique,
dépenses courantes et investissements des administrations) ;
- un
diagnostic
sur l'évolution
tendancielle
des
prestations sociales
, dont l'évolution à moyen terme est
plus difficile à maîtriser par les pouvoirs publics.
· Sur le premier point, les experts de l'OFCE ont retenu
l'hypothèse d'un ralentissement de l'évolution des
dépenses publiques
(
hors prestations sociales)
:
celles-ci progresseraient en francs constants de 2,5 % par an en moyenne
de 1997 à 2002, contre 2,8 % de 1990 à 1996.
Surtout, les dépenses publiques (hors prestations sociales)
augmenteraient en projection
comme
le PIB, alors que sur la
période 1990-1996, leur progression a été sensiblement
plus rapide que celle du PIB (2,8 % contre 1,2 %). Néanmoins
cette hypothèse d'augmentation des dépenses publiques traduit une
inflexion
par rapport aux contraintes imposées au cours des trois
dernières années (1995, 1996 et 1997). Ceci est
particulièrement vrai de l'évolution de la
masse salariale
publique
: l'OFCE a ainsi supposé que l'augmentation annuelle
moyenne des effectifs publics (+ 40.000 par an) se prolongerait à
l'horizon 2002 et que le pouvoir d'achat de l'indice brut des traitements de la
fonction publique augmenterait de 0,7 % par an en moyenne de 1998 à
2002 (après - 0,7 % en 1996 et 1997). La masse salariale publique
augmenterait ainsi en francs constants de 2,8 % par an en moyenne entre
1997 et 2002, contre 2,3 % par an de 1990 à 1996.
· L'évolution à moyen terme des
prestations
sociales
est conditionnée par la réponse à la question
suivante : le ralentissement très marqué de
l'évolution des
prestations maladie
en 1996 et 1997
(respectivement + 0,7 % et + 0,1 % en
pouvoir
d'achat
, contre 1,8 % par an en moyenne de 1990 à 1996)
sera-t-il durable ?
Dans les exercices réalisés les années
précédentes à la demande du Sénat
9(
*
)
, les
experts de l'OFCE avaient considéré
que les plans de maîtrise des dépenses de santé ne
modifiaient pas la tendance " lourde " de leur
taux
de
croissance
, même si leur effet immédiat sur le
niveau
de la dépense restait durablement acquis.
L'incidence de la dernière réforme (qui ne se limite pas à
une réduction des remboursements mais met en œuvre une nouvelle
politique de gestion des soins) sur l'augmentation des prestations-maladie en
1996 et 1997, a conduit l'OFCE à nuancer cette analyse.
Les auteurs de la projection ont ainsi examiné une
première
hypothèse d'évolution des dépenses
de santé à mi-chemin entre, d'une part les évolutions
récentes et l'objectif fixé par le projet de loi de financement
de la Sécurité sociale pour 1998 (+ 2,2 %
d'augmentation en
francs courants
) et, d'autre part, la tendance de
longue période. Sous cette hypothèse, l'augmentation des
prestations-maladie sur le moyen terme se stabiliserait autour de 1,4 %
par an en
francs constants
à partir de 1998.
Une
deuxième
hypothèse a également
été envisagée : elle suppose un retour des
dépenses de santé vers leur rythme de croissance tendanciel (soit
+ 2,5 % par an en francs constants à partir de 1999).
Dans la première hypothèse (ralentissement durable de
l'évolution des dépenses de santé), le pouvoir d'achat de
l'ensemble des prestations sociales augmenterait de
1,7 % par an
en
moyenne ; dans la seconde hypothèse (retour de la progression des
dépenses de santé vers leur rythme d'évolution
tendanciel), le pouvoir d'achat de l'ensemble des prestations sociales
augmenterait de
2 % par an
en moyenne.
2. L'équilibre à moyen terme des régimes sociaux
· Sous l'hypothèse d'un ralentissement durable
de l'évolution des dépenses de santé, l'augmentation
annuelle moyenne de l'ensemble des prestations sociales entre 1997 et 2002
(+ 3,3 % en valeur) serait inférieure en projection à
celle du PIB (3,7 % par an en valeur) et à celle des salaires (qui
évoluent en projection sensiblement comme le PIB), ce qui serait
favorable au
rééquilibrage progressif
des comptes sociaux.
Ainsi, l'équilibre à moyen terme des comptes sociaux serait
atteint
sans apport de recettes
supplémentaires.
· Une hypothèse de retour des dépenses de santé
vers leur rythme d'augmentation tendanciel aurait une incidence
défavorable
sur les comptes sociaux dont le solde serait
dégradé d'un montant égal à
0,2 % du
PIB
en 2002.
3. Le besoin de financement des administrations publiques et la dette publique
· Exprimé en pourcentage du PIB, le
besoin de
financement
des administrations publiques (au sens de la
comptabilité européenne)
se
réduit
en
projection de
0,1 point par
an, pour atteindre 2,7 % en 2002.
Le
tableau
figurant dans
l'encadré
ci-dessous
décrit la variation du déficit public et analyse les
différentes
contributions
à cette variation.
On peut en déduire que le déficit public exprimé en
pourcentage du PIB se réduirait en début de période
essentiellement grâce à l'accélération de la
croissance. En fin de période, le ralentissement de la croissance
entraîne une aggravation du ratio déficit public/PIB,
compensé toutefois par l'orientation de la politique budgétaire,
qui contient l'augmentation des dépenses à un rythme
inférieur à la croissance du PIB.
|
|
||||||||||
|
En % |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Ratio déficit / PIB (au sens de
Maastricht)
|
5,6 |
5,6 |
5,0 |
4,2 |
3,1 |
3,0 |
2,9 |
2,8 |
2,6 |
2,7 |
| Variation du ratio déficit/PIB (au sens de la Comptabilité nationale) par rapport à l'année précédente |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| dont : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| effet du taux de pression fiscale |
- 0,4 |
- 0,1 |
- 0,5 |
- 1,4 |
- 0,3 |
+0,1 |
+0,1 |
- 0,1 |
+0,1 |
+0,2 |
| effet de l'écart de croissance du PIB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| effet de l'écart de croissance des dépenses |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| effet des charges d'intérêt |
+0,3 |
+0,2 |
+0,3 |
+0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- 0,2 |
0,0 |
|
Source :Comptabilité nationale, prévisions OFCE, modèle MOSAÏQUE. |
||||||||||
|
La
première ligne
décrit
l'évolution du ratio déficit public/PIB au sens de la
Comptabilité européenne
. Pour les années 1997
à 2002, le résultat est celui de la projection
réalisée à l'aide du modèle MOSAÏQUE de l'OFCE.
|
||||||||||
Les lignes suivantes décrivent les
différentes
contributions
à la variation du ratio de déficit public,
mesuré au sens de la Comptabilité nationale. Un signe
-
traduit une contribution à la
réduction
du ratio de
déficit public. Une signe
+
traduit une contribution à
l'
augmentation
du déficit public.
La
troisième ligne
met en évidence l'incidence de
l'augmentation des
taux d'imposition
décidés en 1993,
1995, 1996 et 1997, sur la réduction du déficit public.
La
quatrième ligne
montre l'effet de la divergence entre la
croissance
effective
et la croissance
potentielle
de
l'économie française (évaluée ici à
2,5 % par an). Celle ligne permet d'analyser l'
incidence de la
conjoncture
sur le déficit public. Sur la période
1993-1997
, la croissance de l'économie française est
inférieure à son potentiel (excepté en 1994), ce qui
contribue à l'
augmentation
du déficit public (notamment en
1993). La croissance des années 1998 et 1999 résultant de la
projection de l'OFCE est favorable à la réduction du ratio de
déficit public. Le ralentissement en fin de période contribue au
contraire à son augmentation.
La
cinquième ligne
décrit l'effet de l'écart
entre l'évolution des dépenses publiques et la croissance
potentielle du PIB. C'est une façon d'apprécier l'incidence de
l'
orientation délibérée de la politique
budgétaire
. Une augmentation des dépenses publiques
inférieure à la croissance potentielle du PIB
(évaluée ici à 2,5 %), contribue ainsi à la
réduction
du ratio de déficit public. C'est le cas pour
toutes les années présentées dans le tableau, à
l'exception de 1993.
La
sixième ligne
montre enfin l'incidence de
l'évolution des
charges d'intérêt
. Celle-ci
contribue nettement à l'aggravation du ratio de déficit public de
1993 à 1996, en raison de l'augmentation de la dette publique et de la
hausse des taux d'intérêt. En projection (1997-2002), les charges
d'intérêt n'ont pratiquement pas d'incidence sur la variation du
ratio de déficit.
Il faut rappeler que ces calculs sont fortement tributaires de
l'évaluation de la croissance potentielle de l'économie
française. Celle qui est retenue ici (2,5 %) se situe à
l'extrémité haute de la fourchette des estimations de la
croissance potentielle.
· La
dette publique
, exprimée en pourcentage du PIB,
s'accroît
en projection de
0,7 point par an
, pour
atteindre 60 % en 2002.
Un déficit public inférieur à 3 % ne peut ainsi
être considéré comme un objectif de moyen terme
satisfaisant
pour l'économie française, dans la mesure
où il ne suffit pas à stabiliser le ratio de dette publique,
comme il conviendrait de le faire dans une période de
reprise
conjoncturelle.
Par rapport à la politique budgétaire simulée en
projection, le montant des mesures correctrices nécessaires pour
parvenir à stabiliser le ratio dette/PIB représenterait, selon le
modèle MOSAÏQUE, l'équivalent de
1,5 point
de
Contribution Sociale Généralisée. Un
prélèvement de ce montant (ou une réduction
équivalente des dépenses publiques) ramènerait le
déficit public en 2002 à 2,1 % du PIB
10(
*
)
.
· En plus des considérations macroéconomiques, il convient
d'avoir à l'esprit les effets de l'augmentation de l'endettement public
sur l'efficacité et l'équité du
système
fiscal.
L'accroissement de la dette publique se traduit
instantanément
par une
augmentation des créances
pour le même montant,
sous forme d'émission de titres de la dette publique. Si la dette
publique ne constitue pas de ce fait un "
report de charges sur les
générations futures
", elle opère
néanmoins une
redistribution
au profit des porteurs de la dette
publique. Lorsque les charges d'intérêt de la dette atteignent,
comme aujourd'hui, un montant supérieur à celui de l'impôt
sur le revenu, les réflexions sur l'évolution de la dette
publique ne peuvent donc s'abstraire de considérations sur
l'équité fiscale.
II. SYNTHÈSE COMPARATIVE DE DIFFÉRENTES PRÉVISIONS À MOYEN TERME
La projection de l'OFCE, telle qu'elle vient d'être
présentée constitue une extrapolation des tendances à
l'œuvre dans l'économie française, sur la base d'une
prolongation des comportements observés sur le passé. Cela peut
être considéré comme une limite de ce genre d'exercice,
dans la mesure où il pose plus de questions pour le moyen terme qu'il
n'apporte de réponses. Mais ceci obéit également à
ce que votre Rapporteur considère comme la finalité des
projections réalisées à l'aide de modèles. Ceux-ci
offrent en effet un cadre global où les évolutions et les
comportements macroéconomiques sont cohérents entre eux : en
cela, ils constituent à tout le moins un instrument d'analyse utile pour
les choix de politiques économiques.
Les travaux présentés ci-après procèdent d'une
autre logique et recourent à d'autres méthodes. Il s'agit des
prévisions de deux organismes dont le Service des Etudes suit
régulièrement les travaux : le
Bureau d'Informations et
de Prévisions économiques
(BIPE) et le
Centre de
Recherches pour l'expansion de l'économie et le développement des
entreprises
(REXECODE). Réalisées hors modèle et
" à dire d'expert ", elles sont résumées
ci-après.
Il paraît également utile de donner les conclusions d'une
projection réalisée à l'aide du modèle AMADEUS par
l'
INSEE
. Cet exercice présente en effet deux aspects
originaux :
- il explore les modalités d'un
rattrapage du déficit
d'activité
enregistré par l'économie française
au cours de la période de croissance faible des années 1990
à 1996 ;
- il repose sur diverses hypothèses favorables d'
inflexion des
comportements
observés sur la période récente et en
simule les effets.
A. LA PRÉVISION DE REXECODE
La prévision pour la période 1997-2001,
présentée par l'Institut de conjoncture REXECODE au printemps
dernier, se situe en terme de croissance au bas de la
" fourchette "
des prévisions nationales à moyen terme (cf. tableau
récapitulatif, page 32).
REXECODE confirme certes le diagnostic d'un
redémarrage
à
court terme de l'activité, en France comme dans la plupart des pays
européens. Celui-ci serait toutefois moins fort que dans les autres
prévisions. Dans la mesure en effet où la France - et l'Europe -
ne peut pas compter sur un environnement international beaucoup plus favorable
que celui observé récemment, l'accélération de la
croissance passe par un redressement de la demande intérieure. Si
celui-ci est assuré, il ne serait cependant pas particulièrement
vigoureux. La demande des ménages devrait être bridée par
le haut niveau des taux d'intérêt réels et par les effets
de la réduction des déficits publics, qui devrait s'accentuer
dans l'ensemble de l'Europe. Par ailleurs, les capacités de production
sont loin d'être saturées, ce qui n'est pas propice à une
forte reprise de l'investissement des entreprises.
A
moyen terme
, la France reviendrait sur un sentier de croissance de
2 % par an. Ce diagnostic s'appuie sur une réflexion relative au
régime de croissance
futur de l'ensemble des économies
européennes.
Dans les pays industrialisés, inflation, lutte contre l'inflation et
désinflation se sont succédé depuis une trentaine
d'années : l'inflation a aujourd'hui pratiquement disparu et le
contexte fortement concurrentiel des prochaines années ne conduit pas
à envisager une reprise de l'inflation. Ce contexte serait en Europe de
nature à lever la contrainte de la lutte contre l'inflation et à
permettre ainsi le retour d'une croissance plus forte. C'est ce qui conduit
REXECODE à avancer une prévision de croissance à moyen
terme (2 % par an pour la France et 2,2 % pour l'Union
européenne) jugée "
optimiste
", dans la mesure
où elle suppose une nette amélioration par rapport aux six
dernières années (+ 1,1 % par an pour la France entre
1990 et 1992, + 1,4 % pour l'Union européenne).
Néanmoins, la croissance ne retrouverait pas son rythme
d'évolution tendanciel de la période 1973-1990 (+ 2,3 %
par an pour la France comme pour l'Union européenne), encore moins celui
de la période 1960-1973 (+ 5,4 % par an pour l'Europe).
REXECODE identifie en effet
cinq facteurs
de nature à
brider
la croissance à moyen terme :
- le
vieillissement démographique
: le ralentissement de
l'augmentation de la population entraînerait un fléchissement
tendanciel de la croissance économique ; de plus, en termes de
demande, la population " en âge de premier équipement "
diminuera sensiblement au cours des cinq prochaines années ;
- la nécessité de
rééquilibrer
les
finances publiques
;
- le
niveau des taux d'intérêt réels
à long
terme qui, même s'ils devaient diminuer au cours des prochaines
années, resteraient néanmoins très supérieurs au
taux de croissance ;
- l'
avantage de compétitivité
en faveur de la zone
dollar ;
- l'absence de contrainte sur les capacités de production dans les
entreprises, qui ne concourt pas à une forte reprise de
l'
investissement
; de plus, l'atonie prolongée de
l'investissement aurait pour conséquence un vieillissement des
équipements productifs qui constitue une menace pour la
compétitivité européenne.
Enfin, la prévision de REXECODE décrit une très
légère baisse du taux de chômage, du même ordre que
celle enregistrée dans la projection de l'OFCE : de 12,6 % en
1997 à 12,4 % en 2001. Il s'agit certainement là d'un
résultat surprenant dans la mesure où la croissance n'est que de
2 % par an en moyenne, alors que l'OFCE parvient à un
résultat semblable pour le chômage avec une croissance de
2,5 % par an.
Ceci s'expliquerait par deux hypothèses retenues par REXECODE :
- une prolongation du
ralentissement tendanciel de la
productivité
du travail (1,6 % par an contre 2 % pour
l'OFCE), favorable à l'emploi (le taux de croissance au-delà
duquel l'économie française crée des emplois est ainsi
plus faible) ;
- une augmentation moins rapide de la
population active
disponible
(+ 100.000 par an contre + 154.000 par an selon l'OFCE).
B. LA PRÉVISION DU BIPE
Le taux de croissance annuel moyen dans la prévision
présentée par le BIPE au mois de septembre dernier
s'élève à 2,3 %.
Au-delà de cette évolution moyenne, cette prévision se
caractérise par un
profil très marqué
:
- forte croissance à
court terme
(+ 3,3 % en 1998 et
+ 3 % en 1999) favorisée par le dynamisme de l'économie
mondiale ;
- ralentissement en fin de période avec des taux de croissance
inférieurs à 2 % (+ 1,6 % en 2001 et
+ 1,8 % en 2002).
Si l'environnement international à moyen terme est, dans la
prévision du BIPE, beaucoup moins favorable que dans les autres
prévisions (fort ralentissement à partir de 1998 aux Etats-Unis
et de 2001 en Europe), l'évolution de la demande intérieure y est
par contre relativement soutenue. L'
investissement productif
connaîtrait une reprise plus marquée et plus longue que dans les
autres prévisions. Par ailleurs, la
consommation
des
ménages serait soutenue à moyen terme par la
baisse du taux
d'épargne
.
Le taux de chômage, enfin, baisserait de 12,5 % en 1997 à
9,8 % en 2002, ce qui correspond à 570.000 chômeurs de moins
en cinq ans. Mais, là aussi, ce résultat paraît reposer sur
des hypothèses favorables, telles que la poursuite de
" l'enrichissement du contenu en emplois " de la croissance
et une
progression de la population active effective (+ 120.000 par an) beaucoup
plus
ralentie
qu'au cours des années récentes.
C. LE SCÉNARIO RETENU PAR L'INSEE
L'INSEE a réalisé au mois de juin dernier une
projection à moyen terme (1997-2002) de l'économie
française qui explore les modalités d'un retour de la production
à sa tendance de long terme et d'une résorption des
déséquilibres du marché du travail.
Les deux premières années (1997-1998) correspondaient aux
prévisions officielles du Gouvernement du printemps dernier qui ont
été revues à la hausse depuis lors (de 2,8 % pour la
croissance en 1998 à 3 %). On ne présente donc ici que la
projection pour la période de moyen terme (1999-2002).
Celle-ci décrit une stabilisation de la croissance
légèrement au-dessous de 3 % à partir de 1999 et
jusqu'en 2001. Sur la période de moyen terme, la croissance annuelle
moyenne serait donc sensiblement plus élevée que dans les autres
prévisions (+ 2,8 %), ce qui permettrait de
résorber
les marges de croissance aujourd'hui
inutilisées
: le PIB se rapprocherait de son
niveau
potentiel.
Ce scénario juxtapose l'hypothèse d'une politique
budgétaire qui resterait restrictive et celle d'un environnement
international dynamique. Il retient des hypothèses cruciales sur
l'inflexion des comportements des agents privés (ménages et
entreprises) par rapport à ceux de la période 1990-1996 :
- Les conditions seraient favorables à un rattrapage de retard
accumulé en matière d'
investissement
depuis le
début des années 90 ; d'une part, l'achèvement du
processus d'unification monétaire en Europe contribuerait à
diminuer l'incertitude et à accroître la rentabilité
attendue de l'investissement ; d'autre part, "
l'excellente
situation financière
" (selon l'INSEE) des entreprises devrait
entraîner une baisse de leur
taux d'endettement
et une reprise de
l'investissement ; l'investissement des entreprises croîtrait ainsi
de 6 % par an en moyenne sur la période de moyen terme.
- Le taux d'
épargne
des ménages ne serait plus
poussé à la hausse par les facteurs qui, sur la période
récente, ont incité les ménages à la prudence en
matière de consommation : sensibilité accrue aux taux
d'intérêt, comportement de précaution face à
l'augmentation du chômage, inquiétude, enfin, liée à
la dégradation des finances publiques ; sur la période de
projection au contraire, la baisse du chômage et la réduction des
déficits publics seraient susceptibles de favoriser la consommation ;
selon ce scénario "
volontariste
", la consommation
des
ménages augmenterait de 2,5 % par an en moyenne de 1997 à
2002.
L'aspect le plus
marquant
de ce scénario réside
certainement dans l'évolution du
chômage
: le nombre
de chômeurs diminuerait certes, de 260 000 environ, mais le taux de
chômage baisserait peu : il serait de 11,6 % en 2002. Un
enseignement de cette projection, mis en exergue par les experts
gouvernementaux dans les documents remis aux participants à la
Conférence nationale sur les salaires, l'emploi et le temps de travail
du 10 octobre dernier, est ainsi que, "
compte tenu des
déséquilibres accumulés, le seul retour de la
croissance
(décrit par le scénario de l'INSEE)
ne
permettra probablement pas de rétablir une situation satisfaisante en
matière d'emploi au cours des prochaines années
".
Ce résultat s'expliquerait essentiellement, selon l'INSEE, par
l'accroissement substantiel de la
population en âge de travailler
à partir de 2000 (+ 200.000 personnes par an en moyenne), du fait
notamment du déséquilibre provoqué par le départ
à la retraite des
classes peu nombreuses
de la Deuxième
Guerre mondiale.
On peut en déduire que la
croissance potentielle
de
l'économie française est, en raison de cette abondance de facteur
travail sur la période de moyen terme, très certainement
supérieure à l'
évaluation
qu'en donne l'INSEE, soit
2,3 %.
Les principaux résultats des scénarios de moyen terme qui
viennent d'être présentés sont décrits dans le
tableau récapitulatif
ci-dessous.
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PRINCIPAUX SCÉNARIOS
MACROÉCONOMIQUES
DE MOYEN TERME
|
|
INSEE
|
REXECODE*
|
BIPE**
|
OFCE***
|
| TAUX ANNUELS MOYENS |
1997 - 2002 |
1997 - 2001 |
1997 - 2002 |
1997 - 2002 |
| VOLUMES (évolution en %) |
|
|
|
|
| PIB |
2,8 |
2,0 |
2,3 |
2,5 |
| Importations |
5,0 |
5,2 |
5,7 |
4,8 |
| Exportations |
5,3 |
5,8 |
5,6 |
5,4 |
| Consommations des ménages |
2,5 |
1,9 |
2,1 |
2,0 |
| Investissement des entreprises |
6,0 |
3,5 |
4,5 |
2,2 |
| Investissement logement |
- |
1,5 |
2,5 |
0,8
|
| PRIX (évolution en %) |
|
|
|
|
| PIB |
0,9 |
1,1 |
|
1,2 |
|
Prix à la consommation
|
1,0 |
1,4 |
2,1 |
1,6 |
| COMPTES DES MÉNAGES EN POUVOIR D'ACHAT |
|
|
|
|
| Revenu disponible brut (Evolution en %) |
|
|
|
|
|
Taux d'épargne moyen
(Niveau en %) |
|
|
|
|
|
EMPLOI SALARIÉ
(Evolution en %) |
|
|
|
|
|
EMPLOI TOTAL
(Evolution en %) |
|
|
|
|
|
TAUX DE CHÔMAGE
(Niveau en fin de période) |
|
|
|
|
* Centre de Recherches pour l'expansion de l'économie et le développement des entreprises.
** Bureau d'Informations et de Prévisions économiques.
*** Observatoire français des conjonctures économiques.
CHAPITRE II
QUESTIONS POUR L'ÉCONOMIE
EUROPÉENNE
Un scénario de l'
économie mondiale
à l'horizon 2005, élaboré à l'aide du modèle
multinational MIMOSA, a été présenté lors du
Colloque organisé au Sénat par votre Délégation le
20 mars 1997
11(
*
)
.
Un point marquant en est la faiblesse de la croissance à moyen terme
dans les pays européens. En effet, après une reprise cyclique
brève et d'ampleur modérée (+ 2,3 % de
croissance en 1997 et + 2,8 % en 1998), l'Union européenne
rejoindrait un sentier de croissance faible, autour de 2 % par an en
moyenne sur la période 1999-2005. Ainsi, en tenant compte des
évolutions enregistrées de 1990 à 1996, la croissance
annuelle moyenne des économies européennes sur la période
1990-2005 (+ 1,9 %) serait inférieure à sa
tendance
séculaire
.
Cette inflexion, à la fois durable et marquée, du rythme de la
croissance en Europe, alors que celle-ci se caractérise par ailleurs par
l'amélioration de certaines données macroéconomiques
fondamentales (bas niveau d'inflation, redressement de la santé
financière des entreprises, accumulation d'excédents
extérieurs), conduit à s'interroger sur les hypothèses qui
ont présidé à la réalisation de la projection
MIMOSA.
C'est pourquoi il a été demandé aux économistes en
charge de ce modèle de réaliser deux variantes autour de ce
scénario central :
· la première est une variante de
politique
économique
, qui simule l'impact de
politiques
budgétaires
qui, tout en respectant l'objectif de moyen terme de
réduction des déficits publics, seraient orientées dans un
sens plus favorable à la croissance ;
· la seconde est une variante d'
aléa
, qui évalue les
conséquences pour la croissance européenne d'une
modification
des parités
, vis-à-vis du reste du monde, des monnaies
participant au Système monétaire européen (et, à
terme, de l'euro).
Les résultats détaillés de ces simulations étant
présentés dans
l'Annexe n° 2
à ce
rapport, votre Rapporteur se contentera ci-dessous d'en présenter les
principales conclusions ainsi que les réflexions qui lui paraissent
pouvoir en être tirées.
I. LES POLITIQUES BUDGÉTAIRES
A. UNE VARIANTE DE BAISSE DES COTISATIONS SOCIALES DES SALARIÉS
Le scénario central réalisé à
l'aide du modèle MIMOSA retient l'hypothèse de la poursuite des
politiques d'assainissement budgétaire menées en Europe en
réaction à l'importante dégradation des soldes publics au
cours de la période 1991-1993. Celles-ci obéissent à la
fois à la nécessité de stabiliser les taux
d'
endettement
public (mesurés en pourcentage du PIB) et à
l'objectif de convergence budgétaire fixé par le Traité de
Maastricht.
On constate toutefois dans cette projection que les résultats obtenus en
termes de réduction des déficits publics sont notablement
inférieurs aux objectifs visés : la réduction
ex
post
des déficits publics (c'est-à-dire les
résultats
découlant des enchaînements décrits
par le modèle) est inférieure à l'évaluation faite
ex ante
de l'effort de redressement simulé dans le
scénario.
Ainsi, en Allemagne et en France, où les efforts de réduction des
déficits représentent 0,5 % du PIB, l'amélioration
à terme du solde public n'est que de 0,2 % du PIB. De même,
l'Italie réalise un effort d'ajustement budgétaire
équivalent à 2 % du PIB mais ne réduit à terme
son déficit que de 0,9 % du PIB.
En effet, la
baisse de l'activité
économique en Europe
induite par les politiques de redressement des finances publiques est d'autant
plus forte que celles-ci sont concomitantes : en retour, cette baisse de
l'activité obère les résultats des efforts mis en
œuvre et le solde public ne s'améliore pas autant
qu'espéré.
La variante présentée ci-dessous simule ainsi l'impact de
politiques budgétaires
a priori
moins restrictives en Europe,
afin d'observer notamment l'impact qu'elles auraient sur les soldes
budgétaires
ex post
.
La mesure analysée consiste en une
baisse des cotisations sociales
à la charge des salariés
, équivalente à
1 % du PIB dans tous les pays d'Europe, sans qu'aucune mesure de
compensation ne soit introduite
ex ante
pour compenser l'impact de la
mesure sur les déficits publics.
La variante retient l'hypothèse - conforme aux observations faites
sur le passé - que la baisse des cotisations salariés
entraîne une augmentation du même montant des salaires nets. Le
salaire net moyen augmente ainsi de 1,7 %. Le salaire brut étant
inchangé, la mesure n'a pas d'incidence sur le
coût du
travail
.
La mesure entraîne donc une augmentation du pouvoir d'achat des
ménages, de la consommation et de l'investissement logement des
ménages. Le modèle décrit ainsi une
accélération de la croissance en Europe, dont l'ampleur
dépend de la réaction des autorités monétaires.
Deux simulations ont ainsi été réalisées,
correspondant à deux hypothèses sur le comportement des banques
centrales européennes, ou de la Banque Centrale Européenne,
après l'unification monétaire.
· La première simulation suppose l'
absence de réaction
des autorités monétaires
face à la politique
budgétaire de relance de l'activité.
Sous cette hypothèse, le taux de
croissance
en Europe est
supérieur de
1,2 point par an pendant trois ans
au taux de
croissance dans le scénario de référence. Au terme de ces
trois années, la mesure n'a plus d'incidence sur le
taux de
croissance
, mais le
niveau
du PIB reste durablement supérieur
à celui du compte de référence (de 2,8 % au bout de
cinq ans).
Le
taux de chômage
baisse d'un
demi-point
chaque
année les trois premières années, et reste durablement
inférieur à celui du compte de référence (de
1,5 point au bout de cinq ans).
Enfin, les
déficits publics
en Europe s'accroissent d'un montant
équivalent à 0,6 % du PIB la première année,
consécutivement à la baisse des cotisations sociales. Par la
suite toutefois, l'accélération de l'activité
améliore les rentrées fiscales, de sorte que l'impact
ex
post
de la mesure sur le solde public est
positif
dès la
troisième année : le déficit public se réduit d'un
montant équivalent à 0,4 % du PIB par rapport au compte
central.
A court terme, le niveau des
prix
en Europe n'est pas affecté par
cette mesure. Par la suite, la hausse de l'inflation atteint 1 point par
an entre la deuxième et la cinquième année. Dans le
modèle MIMOSA en effet, comme dans la plupart des modèles
macroéconomiques, l'évolution des salaires est une fonction
inverse de la variation du chômage (relation dite de
" Phillips "). Ceci repose sur le constat empirique qu'une
baisse
(augmentation) du chômage renforce (atténue) les revendications
des salariés.
IMPACT D'UNE BAISSE DE 1 % DU PIB DES COTISATIONS
DES SALARIÉS EN EUROPE
TAUX D'INTÉRÊT
INCHANGÉS
|
Année |
1ère |
3ème |
5ème |
|
PIB
(1)
Union européenne dont : France Allemagne |
1,4
|
3,4
|
2,8
|
|
TAUX DE CHÔMAGE
(2)
Union européenne dont : France Allemagne |
- 0,4
|
- 1,5
|
- 1,5
|
|
SOLDE PUBLIC
(3)
Union européenne dont : France Allemagne |
- 0,6
|
+ 0,4
|
+ 0,4
|
|
PRIX DE LA CONSOMMATION
(1)
Union européenne dont : France Allemagne |
0,0
|
0,9
|
3,2
|
(2) Ecart en points de pourcentage par rapport au niveau du compte central.
(3) Ecart en pourcentage du PIB par rapport au niveau du compte central.
Source : Modèle MIMOSA (CEPII-OFCE).
· La deuxième simulation suppose que
les autorités
monétaires réagissent
par crainte d'une poussée
inflationniste consécutive à la mesure de relance
budgétaire. La réaction simulée correspond à celle
qui est incorporée dans le modèle MIMOSA : la Bundesbank
élève son taux d'intérêt à court terme de
0,5 point lorsque le taux de chômage baisse de 1 point et de
1,5 point lorsque l'inflation augmente de 1 point (relativement au
scénario de référence). Par ailleurs, les taux
d'intérêt à court terme des différents pays
participant au Système monétaire européen s'alignent sur
ceux de l'Allemagne (de telle sorte que la réaction serait
décrite dans les mêmes termes en régime d'union
monétaire).
Dans ces conditions, les taux d'intérêt à court terme en
Europe sont majorés de 1 point dès la deuxième
année et restent durablement supérieurs au niveau des taux
d'intérêt dans le compte de référence (de
1,1 point au bout de cinq ans). La hausse des taux d'intérêt
modère
l'impact expansionniste de la mesure de relance
budgétaire : la
croissance
s'accélère de
0,6 point par an en moyenne au cours des trois premières
années (contre 1,2 point par an dans le scénario avec des
taux d'intérêt inchangés) et le
taux de
chômage
baisse durablement de 0,8 point (contre 1,5 point
dans le scénario avec des taux d'intérêt inchangés).
Le
déficit public
est aggravé de 0,8 % du PIB la
première année, et de 0,5% du PIB les années suivantes
(alors qu'il se réduit de 0,4 % du PIB dans la simulation avec taux
d'intérêt inchangés).
Si cette simulation est moins favorable pour la croissance et le solde public,
la réaction des autorités monétaires permet
d'éviter tout supplément d'
inflation
les deux
premières années, puis de le limiter à 0,5 point par
an entre la troisième et la cinquième année.
IMPACT D'UNE BAISSE DE 1 % DU PIB DES COTISATIONS
DES SALARIÉS EN EUROPE
HAUSSE DES TAUX
D'INTÉRÊT
|
Année |
1ère |
3ème |
5ème |
|
PIB
(1)
Union européenne dont : France Allemagne |
1,1
|
1,7
|
1,6
|
|
TAUX DE CHÔMAGE
(2)
Union européenne dont : France Allemagne |
- 0,3
|
- 0,8
|
- 0,8
|
|
SOLDE PUBLIC
(3)
Union européenne dont : France Allemagne |
- 0,8
|
- 0,5
|
- 0,6
|
|
PRIX DE LA CONSOMMATION
(1)
Union européenne dont : France Allemagne |
- 0,1
|
0,2
|
1,2
|
|
TAUX D'INTÉRÊT
(2)
Union européenne |
0,4 |
1,2 |
1,1 |
(2) Ecart en points de pourcentage par rapport au niveau du compte central.
(3) Ecart en pourcentage du PIB par rapport au niveau du compte central.
Il ressort de ces deux simulations que l'impact d'un
allégement des cotisations des salariés en Europe dépend
autant de l'ampleur de la poussée inflationniste suscitée par
cette mesure que de la réaction des autorités monétaires.
Les auteurs de ces simulations soulignent toutefois que cette mesure ne
porterait pas "
le taux d'inflation européen au-delà de
3 % à l'horizon 2005, compte tenu de la désinflation
tendancielle sous-jacente dans le compte central
" et
"
que
les Banques centrales pourraient être plus accommodantes que normalement
dans la mesure où le taux d'inflation est inférieur à leur
objectif
". Ils concluent : "
Ceci conduit à
renforcer
la probabilité du premier scénario où les Banques
centrales n'augmentent pas leur taux d'intérêt
".
Si l'on accepte cette analyse, la mesure d'allégement des cotisations
salariés aurait, au moins sur les
trois premières
années
, un impact proche de celui que décrit la variante
à taux d'intérêt fixes (accélération de la
croissance de 1,2 point par an, baisse du taux de chômage de
1,5 point, sans coût pour les finances publiques au bout de trois
ans grâce à l'amélioration de l'activité).
B. QUELLES POLITIQUES BUDGÉTAIRES DANS UN CADRE EUROPÉEN ?
Les travaux présentés ci-dessus, grâce
à leur valeur illustrative, permettent de dégager quelques
enseignements sur les politiques économiques en Europe :
· Un modèle multinational tel que MIMOSA met clairement en
évidence l'interdépendance des économies
européennes. Compte tenu du degré d'ouverture sur
l'extérieur des pays européens, les politiques budgétaires
de relance de l'activité menées
isolément
sont
devenues partiellement inefficaces (l'impulsion de la demande par une relance
budgétaire est en effet " absorbée " par une
augmentation des importations). En revanche, compte tenu du faible degré
d'ouverture de l'Europe prise dans son ensemble, des politiques
budgétaires
concertées
de relance retrouvent une grande
partie de leur efficacité. En sens inverse, des politiques
budgétaires
restrictives
menées isolément
permettent effectivement de réduire le déficit public, pour un
coût modéré en termes de croissance. Cependant, lorsque des
politiques budgétaires restrictives sont menées de manière
concomitante en Europe, le ralentissement de la croissance qu'elles
entraînent est tel que la réduction
effective
des
déficits est très
inférieure
à celle qui
était attendue de l'
effort engagé.
· En matière de réduction des déficits publics, la
lecture " en creux " des travaux réalisés à
l'aide du modèle MIMOSA suggère que celle-ci sera autant
,
sinon plus, le
résultat
de l'accélération de la
croissance
que des restrictions budgétaires elles-mêmes.
· Enfin, la variante présentée ci-dessus montre que des
politiques budgétaires de relance concertées ne sont pleinement
efficaces que si ses
objectifs
sont
partagés
par les
autorités monétaires. Elle éclaire ainsi les enseignements
de la théorie économique, qui montre que la politique
économique est beaucoup plus efficace lorsque ses deux instruments
- politique budgétaire et politique monétaire -
poursuivent un
objectif commun
, que lorsqu'ils poursuivent exclusivement
des
objectifs séparés
(le soutien de l'activité par
la politique budgétaire et la stabilité des prix pour la
politique monétaire). Ainsi est illustrée la problématique
de la
coopération institutionnelle
, dans une Union
monétaire, entre les autorités monétaires et les
gouvernements pour parvenir à ce que les économistes appellent le
bon "
policy mix
" (c'est-à-dire le bon dosage des
politiques monétaire et budgétaire).
II. QUELLE VALEUR POUR L'EURO ?
Entre le 1er janvier 1996 et le mois d'octobre 1997
(c'est-à-dire avant la crise financière de la fin octobre), les
monnaies européennes se sont nettement dépréciées
par rapport au dollar : entre ces deux dates, le taux de change du dollar
par rapport au franc est en effet passé de 1 dollar pour
5,01 francs à 1 dollar pour 6 francs
12(
*
)
(soit une appréciation du dollar de 20 %,
ou une dépréciation du franc et des monnaies du Système
monétaire européen, de 16,5 %).
La monnaie américaine s'est ainsi rapprochée de ce que les
économistes considèrent comme la "
parité de
pouvoir d'achat
", c'est-à-dire la parité qui assure
l'
égalité des prix
entre les Etats-Unis et l'Europe, et de
ce que les exportateurs européens considèrent être le taux
de change " normal " du dollar.
Néanmoins, la réflexion sur le
taux de change
d'équilibre
du dollar ne peut se limiter à considérer
la
compétitivité relative
des Etats-Unis et de l'Europe.
Elle doit également intégrer les données
fondamentales
des économies, telles que leur capacité (ou
leur besoin) de financement, leur endettement extérieur ou leur taux
d'épargne global.
Dans cette perspective, le taux de change d'équilibre du dollar n'est
pas indifférent à la "
soutenabilité
"
à long terme de l'endettement extérieur des Etats-Unis, et se
situerait, au regard de ces critères, significativement
au-dessous
de la parité de pouvoir d'achat.
C'est pourquoi la projection de l'économie mondiale
réalisée par l'équipe responsable du modèle MIMOSA
au printemps dernier (c'est-à-dire au milieu de la phase
d'appréciation, lorsque le taux de change du dollar par rapport au franc
se situait autour de 5,60) retenait l'hypothèse d'une baisse du dollar,
à partir de 1998, et d'un retour vers un niveau d'équilibre
macroéconomique fondamental de 1 dollar = 5,25 francs.
Le maintien d'un rythme de croissance élevé aux Etats-Unis (qui a
conduit à réévaluer le potentiel de croissance à
moyen terme de l'économie américaine) ainsi que la
réduction du déficit public, incitent à réviser
cette analyse sur le " bon " taux de change du dollar. Un
niveau
d'
équilibre à moyen terme
du dollar proche de son
niveau actuel
serait en effet compatible avec la
" soutenabilité " de l'endettement extérieur
américain
13(
*
)
.
Ainsi la projection de l'économie française
présentée dans le chapitre 1 de ce rapport repose-t-elle sur
l'hypothèse d'un niveau d'équilibre à moyen terme du
dollar de 1 dollar = 5,96 francs.
Les termes du débat ainsi rappelés, votre Rapporteur a
jugé utile de présenter les conclusions d'une
simulation
,
réalisée à l'aide du modèle MIMOSA, de l'impact
d'une dépréciation de 10 % des monnaies européennes
(les résultats détaillés en sont présentés
dans l'
annexe n° 2
à ce rapport). Cet exercice permet
en particulier d'apprécier l'impact d'une modification des
parités des grandes monnaies sur la
répartition de la
croissance mondiale.
· Schématiquement, la dépréciation d'une monnaie se
traduit pour un pays (ou l'ensemble des pays européens dans le cas de
l'euro) par deux types d'effets :
- des gains de
compétitivité
à court terme qui
stimulent les exportations et freinent les importations ;
- une
hausse du prix
des importations, qui entraîne une hausse des
prix à la consommation et des salaires, ce qui tend à
limiter
les gains de compétitivité.
· Ces
effets " purs "
d'une
dépréciation monétaire sont évalués dans une
première variante technique (cf. tableau ci-après).
Le résultat est très favorable à
court terme
pour
la croissance et le chômage en Europe : l'accélération
de la croissance est de l'ordre de
0,9 point
par an les deux
premières années
et le taux de chômage en Europe est
inférieur de 1 point au bout de deux ans (par rapport à un
scénario sans dépréciation monétaire).
A moyen terme
, les effets positifs de la dépréciation sur
les échanges extérieurs sont limités par son incidence
inflationniste : l'inflation est en effet supérieure de
0,8 point par an pendant cinq ans. Au bout de cinq ans, le niveau du PIB
est majoré de 0,4 point seulement (par rapport à un
scénario de référence sans dépréciation) et
le taux de chômage est minoré de 0,4 point.
· Les enchaînements macroéconomiques consécutifs
à une dépréciation monétaire sont, dans la
réalité, plus
complexes
. En effet, la Banque centrale
réagit au choc inflationniste consécutif à la
dépréciation. Par ailleurs, les marchés financiers
anticipent que l'inflation entraînera une nouvelle
dépréciation.
Selon la fonction de réaction des autorités monétaires
incorporée dans le modèle MIMOSA, les taux d'intérêt
en Europe seraient majorés d'un point dès la première
année. Cette hausse des taux d'intérêt atténue
globalement l'impact expansionniste en Europe d'une dépréciation
de l'euro.
A court terme
, l'effet positif sur l'activité
européenne est nettement moindre : l'accélération de
la croissance les deux premières années est de l'ordre de
0,3 point par an
(contre 0,9 point dans la variante sans
hausse des taux d'intérêt). Le taux de chômage est
réduit de 0,3 point au bout de deux ans.
A moyen terme
, la
dépréciation continue de l'euro en renforce l'impact. Au bout de
cinq ans, le niveau du PIB européen est majoré de 0,7 %
(contre 0,4 % dans la variante avec taux d'intérêt et taux de
change fixes) et le taux de chômage est minoré de 0,3 point.
Impact d'une dépréciation de 10 % de
l'euro
|
Ecart en %
|
Taux de change et taux d'intérêt fixes |
Taux de change et taux d'intérêt endogènes |
||
|
Année |
2ème |
5ème |
2ème |
5ème |
| PIB |
|
|
|
|
| Etats-Unis |
- 0,1 |
- 0,3 |
- 0,1 |
- 0,2 |
| Japon |
- 0,6 |
- 0,8 |
- 0,7 |
- 0,9 |
| Union européenne |
1,9 |
0,4 |
0,6 |
0,7 |
| dont France |
1,6 |
- 0,6 |
0,4 |
0,1 |
| Allemagne |
2,6 |
0,9 |
0,9 |
1,1 |
| CHÔMAGE (1) |
|
|
|
|
| Union européenne |
- 0,8 |
- 0,4 |
- 0,3 |
- 0,4 |
| dont France |
- 0,6 |
- 0,1 |
- 0,2 |
- 0,1 |
| Allemagne |
- 1,5 |
- 1,1 |
- 0,5 |
- 0,8 |
| PRIX DE LA CONSOMMATION |
|
|
|
|
| Union européenne |
1,5 |
3,8 |
1,3 |
3,1 |
| dont France |
1,0 |
3,7 |
1,1 |
2,5 |
| Allemagne |
1,7 |
3,8 |
1,1 |
2,6 |
| TAUX D'INTÉRÊT A COURT TERME |
|
|
|
|
| TAUX DE CHANGE (2) |
|
|
|
|
| Union européenne |
10,0 |
10,0 |
10,3 |
12,1 |
(1) Ecarts en points de pourcentage.
(2) Un signe positif indique une appréciation du dollar.
Source : Modèle MIMOSA (CEPII-OFCE).
Le tableau ci-dessus présente les principaux résultats de
l'impact d'une dépréciation de 10 % de l'euro sous deux
hypothèses extrêmes
: en l'absence d'augmentation des
taux d'intérêt et avec un taux de change fixe après la
dépréciation, d'une part ; avec une hausse des taux
d'intérêt et une dépréciation continue du taux de
change, d'autre part. Compte tenu du bas niveau d'inflation et du fort niveau
de chômage en Europe, l'
effet inflationniste de
la
dépréciation du change, et donc la
réaction
de la
Banque Centrale Européenne, pourrait être
plus faible
que
ce que décrit la seconde variante. L'impact expansionniste d'une
dépréciation de 10 % de l'euro devrait ainsi être
probablement
plus proche des résultats de la variante à taux
d'intérêt fixe
.
Ces travaux appellent ainsi deux observations :
- Contrairement à l'opinion selon laquelle le taux de change de l'euro
aurait finalement peu d'incidence sur la croissance en Europe (compte tenu du
faible degré d'ouverture sur l'extérieur de l'économie
européenne prise dans son ensemble), ces variantes mettent en
évidence des effets sensibles sur l'activité et l'emploi en
Europe, et sur
la répartition de la croissance mondiale
entre les
Etats-Unis, le Japon et l'Europe.
- D'une manière qui ne concorde pas avec la façon dont est
évoquée la question du taux de change respectivement en France et
en Allemagne, ces simulations montrent qu'une dépréciation du
change a un impact
favorable
sur l'activité beaucoup plus fort en
Allemagne qu'en France (en raison d'un commerce extérieur allemand plus
orienté vers les échanges
extra-européens
et d'un
poids du secteur
industriel
dans l'économie plus important, ce
qui entraîne une plus forte sensibilité aux mouvements de
compétitivité).
Ces travaux ont enfin le mérite de rappeler que, comme la politique
économique en général, la politique de change ne saurait
être conduite en fonction d'un seul objectif. Ainsi, la stabilité
des prix à laquelle est vouée, par essence, une Banque centrale
indépendante, ne peut être le critère unique d'optimisation
du taux de change puisque celui-ci a une incidence décisive non
seulement sur les prix, mais aussi sur la croissance et l'emploi et, par voie
de conséquence, sur la situation des finances publiques. C'est pourquoi
les rédacteurs du Traité de Maastricht ont fait de la politique
de change un domaine pour ainsi dire " cogéré " par le
Conseil, la Commission et la Banque Centrale européenne, comme le montre
la rédaction complexe de l'article 109 du Traité relatif à
la Communauté européenne
14(
*
)
. Au
demeurant, la façon de concilier les différents objectifs
à prendre en compte ne peut pas s'inscrire dans un Traité. Il
n'en reste pas moins que cette question essentielle est à
l'arrière-plan des discussions relatives à la mise en place d'un
" Conseil de l'euro ".
CHAPITRE III
LA DURÉE DU TRAVAIL
I. QUELQUES ENSEIGNEMENTS DES COMPARAISONS INTERNATIONALES DE LA DURÉE DU TRAVAIL
L'établissement et l'interprétation des statistiques relatives à la durée du travail sont difficiles (voir Annexe n° 3 ). Il est toutefois possible d'en comparer les évolutions et de mettre à jour certaines spécificités de la France en matière de durée du travail.
A. LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES DE LA DURÉE DU TRAVAIL DANS LES PAYS INDUSTRIALISÉS
· Sur très
longue période
, la
durée du travail s'est réduite dans l'ensemble des pays
industrialisés, mais dans des proportions et selon des modalités
extrêmement variables. De même, la durée du travail tend
à se réduire dans les pays en développement rapide d'Asie.
Cette observation est cohérente avec le raisonnement
microéconomique selon lequel lorsque leur niveau de vie
s'élève, les salariés arbitrent de plus en plus en faveur
du temps libre plutôt que du
revenu
.
· En revanche, les pays industrialisés présentent depuis
1983 des évolutions très dissemblables de la durée du
travail. Ainsi la durée du travail s'est-elle accrue aux
États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande,
en raison notamment d'une augmentation des heures supplémentaires. La
durée du travail y atteint des niveaux relativement
élevés, cependant que les gains de productivité et la
croissance du pouvoir d'achat des salaires étaient
modérés. De même, la durée du travail a-t-elle
réaugmenté en Suède, à la faveur d'un repli du
travail à temps partiel. En revanche, la durée du travail s'est
sensiblement réduite, selon des modalités diverses, au Japon, en
Allemagne, en Norvège, en Espagne et aux Pays-Bas, en lien avec des
gains de productivité horaire élevés. Enfin, la
durée du travail s'est légèrement repliée en
Italie, en France (sous l'effet du développement du travail à
temps partiel), en Finlande (en raison d'une dégradation conjoncturelle
de l'activité) et en Belgique.
· Parallèlement, les
taux d'emploi
(rapport de la
population active occupée sur la population âgée de 15
à 64 ans) ont progressé dans la plupart des pays de l'OCDE, dans
des proportions parfois importantes (en particulier aux Pays-Bas). Font
notamment exception l'Espagne, l'Italie et la France, ces pays se
caractérisant par des durées du travail moyennes, une forte
concentration de l'emploi, une productivité horaire très
élevée, et un fort taux de chômage.
B. LA DURÉE DU TRAVAIL ET LE CHÔMAGE
· Il ne semble pas y avoir de
corrélation
significative
entre le niveau de la durée annuelle du travail et le
niveau du taux de chômage. En particulier, le taux de chômage est
très faible, aussi bien dans des pays où la durée annuelle
du travail est relativement élevée (États-Unis,
Royaume-Uni, Japon), que dans des pays où la durée annuelle du
travail est réduite (Pays-Bas, Norvège, Suisse).
· Pourtant le taux de chômage et
la durée du travail
sembleraient devoir
évoluer
en sens inverse l'un de l'autre. D'un
côté, il semble ainsi que la durée moyenne du travail tende
à augmenter lorsque le taux de chômage diminue (en raison d'une
sollicitation accrue des salariés en place) et lorsque les gains de
productivité -donc de salaire horaire- sont faibles (en raison de
l'aspiration des salariés à la hausse de leurs revenus, ce qui
pourrait être le cas des États-Unis et du Royaume-Uni). De
l'autre, le taux de chômage pourrait décroître lorsque le
contenu de la croissance en emplois
est accru par une réduction
de la durée du travail. Ainsi, les pays où la croissance de
l'emploi a été supérieure à 1 % par an sur la
période 1983-1995 se caractérisent, ou bien par des gains de
productivité horaire faibles (de l'ordre de 1 % par an aux
États-Unis), ou bien par une baisse de la durée du travail proche
de 1 % par an qui réduit d'autant la productivité par
tête (Pays-Bas, Japon).
· Au total, les relations entre la durée moyenne du travail, la
productivité horaire
du travail, la fréquence des
bas
salaires
et le
taux d'emploi
de la population d'âge actif
pourraient se schématiser de la manière suivante :
- Les
pays anglo-saxons
et le
Japon
mobilisent une fraction
importante -près des trois quarts- de la population en âge de
travailler. Toutefois, les salaires offerts à une partie des actifs sont
relativement faibles et la productivité horaire du travail est
réduite, ce qui requiert une durée du travail moyenne
élevée, mais permet des transferts sociaux plus faibles.
- A l'inverse, d'autres pays comme la Belgique, l'Espagne,
la
France
, l'Italie et, dans une moindre mesure, l'Allemagne, ne mobilisent
que la fraction la plus efficace de la population en âge de travailler
(le reste étant au chômage ou inactif). De ce fait, la proportion
des bas salaires est faible, la productivité horaire du travail est
élevée, ce qui permet une durée du travail moyenne faible,
mais requiert des transferts sociaux élevés.
Entre ces deux configurations extrêmes, qui correspondent à des
durées de travail moyennes par personne en âge de travailler
respectivement supérieure à 1200 heures par an et
inférieure à 1000 heures par an, la situation des
pays
scandinaves
apparaît médiane
15(
*
)
, tandis
que les
Pays-Bas
présentent une
évolution singulière, caractérisée par le dynamisme
de l'emploi et par la baisse rapide de la durée moyenne du travail par
actif occupé, en raison notamment du développement rapide du
travail à temps partiel.
C. L'ÉVOLUTION RÉCENTE DE LA DURÉE DU TRAVAIL EN FRANCE
· La
durée hebdomadaire moyenne
de
travail des salariés à
temps complet
place la France,
aussi bien pour les services que pour l'industrie, légèrement
au-dessus de la plupart des pays européens ayant une structure d'emploi
comparable, à l'exception notable du Royaume-Uni. Toutefois, selon les
données recensées par l'OCDE, la durée annuelle du travail
serait sensiblement plus élevée au Japon et aux États-Unis
qu'en France.
|
DURÉE MOYENNE DE
TRAVAIL PENDANT LA SEMAINE DE
RÉFÉRENCE
|
|||
|
Royaume-Uni |
43,9 |
Allemagne |
39,9 |
|
Espagne |
40,7 |
Pays-Bas |
39,5 |
|
UE à 15 |
40,3 |
Danemark |
38,9 |
|
France |
39,9 |
Belgique |
38,4 |
|
|
|
Italie |
38,4 |
Source : EUROSTAT
· Selon EUROSTAT, la France est, avec le Royaume-Uni, le seul grand pays
européen où la durée hebdomadaire de travail des
salariés à temps plein se soit
accrue
entre 1983 et 1995
(+ 0,2 heure par semaine). Cette évolution paradoxale (puisque la
durée moyenne de travail à temps plein a très
légèrement diminué pour la plupart des professions,
à l'exception notable des cadres) s'expliquerait par un effet de
structure : la part des cadres dans l'emploi total s'accroît, ce qui tend
à augmenter la durée moyenne du travail à temps plein.
· Parallèlement, la durée moyenne du travail des
salariés à temps partiel se serait accrue de près de
2 heures par semaine depuis 1982.
· Pourtant, la
durée moyenne du travail par actif
occupé
s'est réduite d'environ 4 % entre 1983 et 1995,
ce qui représente une évolution conforme à la moyenne
européenne. Ce nouveau paradoxe s'explique pour partie par la
légère diminution du nombre de travailleurs indépendants,
et surtout par l'augmentation de la part des
emplois à temps
partiel
, de 9,6 % en 1983 à 16 % en 1996.
Le développement du travail à temps partiel a d'ailleurs connu
une accélération sensible à partir de 1992, la part de
salariés à temps partiel augmentant de près de 1 %
par an, ce qui correspond à une baisse de la durée moyenne du
travail d'environ 0,4 % par an et aura permis de limiter les effets du
ralentissement de la croissance sur le chômage.
D. LES SPÉCIFICITÉS DE LA FRANCE EN MATIÈRE DE DURÉE DU TRAVAIL ET D'EMPLOI
1. La France ne se singularise plus par le contenu de sa
croissance en emplois.
· Le rythme de croissance à partir duquel l'économie
française crée des emplois s'inscrit dans la
moyenne des pays
industrialisés
: sur la période 1983-1995, il
s'établit en moyenne à 1,8 %, un niveau plus
élevé qu'aux Pays-Bas (1,0 %), aux États-Unis
(1,1 %) ou au Royaume-Uni (1,7 %), mais inférieur à
celui du Japon (2,1 %), de l'Allemagne (2,2 %) ou de l'Italie
(2,3 %).
Il convient d'ailleurs de rappeler que les écarts de gains de
productivité horaire résultent, pour une large part, de
différences d'importance de
l'
emploi agricole
. En effet,
l'agriculture est le secteur qui connaît les plus forts gains de
productivité horaire (de l'ordre de 6 % par an en France depuis
quinze ans), de sorte que les gains de productivité moyens d'une
économie sont d'autant plus élevés que le secteur agricole
représente une part importante de l'emploi.
· De plus, le seuil de croissance à partir duquel
l'économie française crée des emplois dans les secteurs
marchands aurait été récemment abaissé de 2 %
par an au cours des années 1980, à 1,5 % par an environ.
En premier lieu, les gains de
productivité horaire
auraient
légèrement ralenti selon deux mécanismes dont l'ampleur
respective est difficile à départager : d'un côté,
le ralentissement de la croissance tendrait spontanément à
ralentir " le
progrès technique
"
16(
*
)
, de l'autre les
allégements de charges
sociales sur les bas salaires ont favorisé le développement
d'
activités riches en emplois
. En second lieu,
l'accélération du développement du travail à
temps partiel
a accru le contenu en emplois de la production nationale
(ce qui, comptablement, réduit la
productivité par
tête
). Selon l'INSEE, l'impact de ce second mécanisme serait
plus important que celui du premier.
Au total, sans cette inflexion du lien entre croissance et emploi depuis 1992,
la France compterait aujourd'hui 300 000 emplois de moins.
· La hausse du
taux de chômage
depuis quinze ans
résulte donc moins des gains de productivité que de la
conjonction de l'atonie de la
croissance
(2,0 % par an sur la
période 1983-1995, contre 2,9 % aux États-Unis, 2,7 %
en Allemagne et aux Pays-Bas, 2,3 % au Royaume-Uni, et 2,1 % en
Italie) et de l'augmentation de la
population en âge
de travailler
(0,7 % par an en moyenne depuis 1980, contre 0,9 % aux
États-Unis, et aux Pays-Bas, et 0,7 % en Allemagne, mais 0,6 %
au Japon, 0,4 % en Italie et 0,3 % au Royaume-Uni).
2. La France se singularise par une faible durée du travail des
hommes sur le cycle de vie et par la concentration de l'activité sur les
salariés âgés de 25 à 50 ans.
· Compte tenu de l'augmentation du chômage et de la relative
faiblesse du taux d'activité, la
durée du travail
des
hommes sur l'
ensemble de la vie
serait en France l'une des plus faibles
des pays industrialisés :
DURÉE DU TRAVAIL SUR LE CYCLE DE VIE EN 1992
(en milliers d'heures)
|
|
Ensemble |
Hommes |
Femmes |
|
Japon
Etats-Unis Danemark Royaume-Uni Allemagne France Pays-Bas Italie Espagne Belgique |
71,1
|
66,5
|
49,4
|
Toutefois, l'écart de durée du travail entre
hommes et femmes sur l'ensemble de la vie est relativement réduit en
France, en raison d'une participation au marché du travail relativement
élevée pour les femmes ayant de jeunes enfants.
Au total, la durée de travail sur l'ensemble du cycle de vie se situe en
France à la médiane des grands pays industrialisés. Elle
représenterait
11 % de la vie éveillée
,
(14 % pour les hommes et 8 % pour les femmes, l'écart
s'expliquant en partie par le différentiel d'espérance de vie),
contre environ 70 % vers 1850. Cette durée de travail est toutefois
très concentrée
.
· En effet, les salariés âgés de 25-49 ans
occupent aujourd'hui près des
trois-quarts des emplois
, contre
53 % au début des années 1970, cette évolution
résultant de deux phénomènes concourants :
- En premier lieu, l'âge moyen de sortie de la vie active a
été réduit de 61,9 ans en 1977 à 59,3 ans
en 1985, puis à 59,0 ans en 1996, sous les effets conjugués
de l'abaissement de l'âge légal de la retraite et du
développement des
cessations anticipées d'activité
,
sous diverses modalités. Ce phénomène est toutefois
désormais limité par l'arrivée à la tranche
d'âge 55-59 ans des classes d'âge creuses.
- En second lieu, l'
âge
moyen d'entrée
dans la
vie active
, qui ne s'était accru que de dix mois entre 1969 et 1985,
a augmenté de plus de deux ans depuis cette date pour atteindre
21,6 ans. Le nombre de jeunes actifs de 15 à 24 ans s'est
ainsi réduit de 3,8 millions en 1985 à 2,4 millions en
1995. D'un côté, cette évolution peut être favorable,
puisque le niveau de formation des jeunes issus du système scolaire est
désormais parmi les plus élevés du monde. Cependant, elle
résulte également des
difficultés d'insertion
des
jeunes sur le marché du travail, ce retard à l'entrée dans
la vie active étant socialement et budgétairement
coûteux
.
Au total, la " durée moyenne de vie active " s'est
réduite de 40,9 ans en 1981 à 37,4 ans en 1996, alors
même que l'espérance de vie augmentait, cette évolution
étant commune à plusieurs pays européens, mais
particulièrement prononcée en France et en Belgique.
· La concentration de l'emploi sur les personnes âgées de
25 à 54 ans présente deux
inconvénients
. En
premier lieu, elle ralentit le développement du
capital humain
de
la Nation, en déclassant rapidement la formation initiale des jeunes qui
ne trouvent pas à s'employer et en se privant de l'expérience
accumulée par les salariés quinquagénaires. En second
lieu, elle est coûteuse et conduit à placer l'
âge de la
retraite
entre le marteau des déficits et l'enclume du
chômage : en effet, l'équilibre des régimes de
retraites nécessite à moyen terme une hausse de l'âge
effectif de départ en retraite, mais celle-ci conduirait, dans la
situation actuelle, à une hausse du chômage, c'est-à-dire
à un report des difficultés financières des régimes
de retraite vers l'assurance-chômage et la solidarité nationale.
C'est la raison pour laquelle de nombreux experts
17(
*
)
préconisent l'approfondissement de politiques
de nature à permettre un
redéploiement de la durée du
travail
sur le cycle de vie, en favorisant notamment les aller et retour
à tous les âges de la vie entre activité, temps de
formation et inactivité, via les congés-formation, les
années sabbatiques, la cessation programmée d'activité, le
compte épargne-temps, les congés parentaux
18(
*
)
,
etc.
· Enfin, en lien avec la concentration de l'activité et avec le
faible développement des services aux personnes, il semble que le niveau
de la
productivité horaire
soit en France l'un des plus
élevés au monde, après des économies très
spécialisées comme les Pays-Bas ou la Norvège, à
l'égal des Etats-Unis, et devant l'ensemble des autres grands pays
industrialisés.
PRODUCTIVITÉ HORAIRE DES ACTIFS OCCUPÉS,
EN PARITÉ DE POUVOIR D'ACHAT EN 1995
|
|
Productivité horaire
|
Productivité par
actif
|
|
France
Allemagne Etats-Unis Espagne Japon Royaume-Uni |
31,1
|
51
|
II. LES APPORTS DES MODÈLES MACROÉCONOMIQUES À L'ANALYSE DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
La quantité de travail rémunéré et
sa répartition parmi les personnes en âge de travailler sont des
variables
soumises à l'interaction de multiples facteurs
économiques et sociologiques : il ne s'agit pas de
" partager " un nombre donné d'heures de travail comme on
partage une galette d'une dimension donnée.
Toutefois, les politiques économiques exercent de fortes influences sur
ces variables, comme sur l'ensemble des autres variables de l'économie.
Ainsi la politique budgétaire ou la politique monétaire exercent,
comme les politiques de l'emploi, une influence sur le volume total de travail
rémunéré. Parallèlement, le droit du travail et de
la protection sociale (âge de la retraite, réglementation des
heures supplémentaires, assurance-vieillesse, etc.), les aides publiques
à diverses formes de retrait d'activité (préretraite,
congés-formation, congés parentaux), les incitations au
développement du temps partiel, etc., jusqu'à l'ouverture de
nouvelles crèches, ou de nouveaux sites universitaires, influent plus ou
moins directement sur la
distribution des temps
de travail, au prix
d'engagements parfois coûteux pour les finances publiques.
A condition d'être
efficace
, cette intervention publique peut
être jugée rationnelle, dès lors que la distribution
actuelle de la durée du travail paraît
sous-optimale
(selon
EUROSTAT, une majorité de salariés à temps plein
souhaiteraient travailler un peu moins, et une minorité souhaiterait
travailler un peu plus, cependant qu'une proportion importante de
salariés à temps partiel, d'inactifs, ainsi que l'immense
majorité des chômeurs souhaiteraient pouvoir travailler beaucoup
plus).
Toutefois, comme le soulignait un rapport de M. Pierre CABANES
19(
*
)
"
une politique
d'aménagement-réduction de la durée du travail comportant
une réduction significative de la durée effective du travail
suppose le respect de conditions strictes pour avoir les effets attendus sur
l'emploi et pour que ces effets soient durables :
- les
coûts unitaires de production
ne doivent pas augmenter ;
- la
capacité productive
de l'économie doit
augmenter ;
- l'équilibre des
finances publiques
prises dans leur ensemble ne
doit pas être dégradé
".
Il conviendrait d'ajouter que la réduction du temps de travail ne doit
pas diminuer la
demande globale
.
En illustrant les diverses interactions qui viennent d'être
brièvement évoquées, les modèles
macroéconomiques peuvent être utiles à la réflexion
et fournissent un éclairage pour les discussions entre partenaires
sociaux.
A. L'APPORT DES MODÈLES
Les modèles permettent d'apprécier de
manière cohérente l'influence des paramètres-clefs de la
réduction de la durée effective du travail :
l'évolution des gains de productivité du travail et du capital et
l'évolution des salaires horaires.
1. L'évolution des gains de productivité horaire du travail
· En l'absence de toute augmentation de la productivité horaire
du travail, une réduction de 10 % de la durée effective du
travail devrait s'accompagner d'une augmentation de 11,1 % de l'emploi,
pour que le PIB total soit maintenu
20(
*
)
.
· Toutefois, l'observation du passé et l'étude d'exemples
concrets suggèrent que la réduction de 10 % de la
durée effective du travail s'accompagne à moyen terme de gains de
productivité horaire
du travail de l'ordre de 2 à 5 %.
Les mécanismes
en sont ambigus
21(
*
)
: d'un côté, les gains de
productivité peuvent résulter de la réduction de la
fatigue, des défaillances, des accidents ou du petit
absentéisme ; de l'autre, la réduction du temps de travail
est le plus souvent associée à la réduction des temps de
pause et à une intensification du travail. L'importance de ces gains de
productivité potentiels est ainsi très variable selon les
secteurs : dans certaines entreprises, la réduction de la
durée du travail peut même, à salaire horaire constant,
entraîner une hausse des coûts
unitaires
en raison des
effets défavorables de l'intensification du travail (malfaçons)
ou des
coûts fixes de formation
et d'information du personnel.
· Pourtant, l'incidence d'une baisse de la durée du travail sur
la productivité horaire est une
question cruciale
. Elle
détermine en effet les évolutions de la durée
d'utilisation des équipements et des salaires horaires compatibles avec
la préservation des capacités de production et la
stabilité des coûts.
En premier lieu, si la productivité horaire n'est pas
améliorée, une baisse de la
durée d'utilisation des
équipements
entraînera une baisse de la production, une
diminution de la capacité à répondre à la demande
intérieure et étrangère, donc des tensions inflationnistes
et un freinage de l'activité.
En second lieu, si la productivité horaire augmente peu, une
augmentation des
salaires horaires
(non compensée par un
allégement des charges sociales) se traduirait par une augmentation des
coûts unitaires de production, entraînant une dégradation de
la compétitivité extérieure, et donc un ralentissement de
la
croissance.
· Mais, d'un autre côté, si les gains de
productivité horaire sont importants, les
créations
d'emplois
induites à court terme par la réduction de la
durée du travail seront réduites d'autant. Par exemple, les
simulations
effectuées en 1996 par la DARES
22(
*
)
d'une
réduction de 5 % de la
durée effective du travail
dans le secteur marchand,
conduisent
23(
*
)
:
- à 525.000 emplois créés sans gains de
productivité horaire,
- à 268.000 emplois créés avec des gains de
productivité horaire de 2 %,
- à 146.000 emplois avec des gains de productivité horaire de
2 % et une augmentation de moitié de la durée du travail des
temps partiels contraints.
2. L'évolution de la durée d'utilisation des
équipements et de la productivité du capital
· Pour que les
capacités de production
ne soient pas
amputées, il est nécessaire que la réduction de la
durée du travail n'entraîne pas de diminution de la durée
d'utilisation des équipements.
Si la réduction du temps de travail est associée à des
réorganisations
des modes de production de nature à
allonger
la durée d'utilisation du capital et donc à
améliorer sa productivité, les effets sur la croissance et
l'emploi en sont améliorés. En effet, l'augmentation de la
productivité du capital entraîne une augmentation de l'offre de
travail par les entreprises et une limitation des besoins en investissement de
capacité. Il en résulte un ralentissement de la hausse des prix,
une amélioration de la compétitivité et un soutien de la
consommation. De plus, l'augmentation de la productivité du capital
accroît sa profitabilité, ce qui, à moyen terme, stimule
l'
investissement de modernisation
.
· En pratique, le maintien ou l'accroissement de la durée
d'utilisation des équipements peut prendre la forme d'un
développement du
travail posté
(12,5 % des emplois)
dans les activités qui requièrent des équipements lourds,
d'un allongement des
horaires d'ouverture
dans les services (ce qui tend
à accroître la demande), ou d'une modulation des horaires (qui
permet de diminuer les coûts de gestion et d'
immobilisation du
capital
et des
stocks
).
· Ces évolutions sont toutefois limitées par les
coûts de réorganisation
des entreprises et par les
contraintes supplémentaires
qu'elles entraînent pour les
salariés (développement des horaires atypiques ou
irréguliers, travail en soirée ou en fin de semaine, etc.). Ceci
explique que la durée d'utilisation des équipements soit
relativement stable sur longue période et fortement liée à
des
modes de régulation sociale,
ce qui conduit en
général les experts à retenir l'hypothèse selon
laquelle une réduction de la durée du travail se traduirait au
mieux par une stabilité de la durée d'utilisation des
équipements.
3. L'évolution des salaires horaires
Sur la question résumée par les mots " compensation
salariale ", qui est cruciale pour l'évolution des coûts de
production des entreprises, quelques précisions méritent
d'être apportées.
En premier lieu, il n'est pas anormal que les gains de productivité
horaire liés à l'aménagement-réduction du temps de
travail donnent lieu à une augmentation des gains horaires des
salariés concernés. Au niveau microéconomique, cette
augmentation compense les
contraintes
induites pour les salariés
(intensification du travail notamment), sans dégrader les coûts de
production des entreprises. Au niveau macroéconomique, cette
évolution soutient la
demande
des ménages.
En second lieu, les résultats des modèles macroéconomiques
suggèrent que les effets de la réduction du temps de travail sur
l'emploi sont d'autant plus élevés que la
compensation
salariale initiale
est faible. Toutefois, la diminution du chômage
entraîne dans ce cas une évolution ultérieure des salaires
réels plus favorable aux travailleurs (" effet Phillips ").
C'est ainsi l'ensemble de l'
évolution finale
des salaires
(compensation initiale et hausses futures liées au
rééquilibrage du marché du travail) qui importe pour
évaluer les évolutions des coûts des entreprises et du
pouvoir d'achat des salariés.
· Au total, l'ensemble des simulations réalisées à
l'aide de modèles macroéconomiques suggère
néanmoins que la réduction du temps de travail est d'autant plus
créatrice d'emplois qu'elle s'accompagne d'une
modération
de la progression des
salaires
par tête.
En effet, en cas de
compensation salariale intégrale
, l'effet
dépressif de la hausse des coûts des entreprises (chute des
investissements, hausse des prix, pertes de compétitivité)
l'emporte sur l'effet de relance résultant de l'augmentation de la
consommation
, de sorte que les effets initiaux de la réduction du
temps de travail sur l'emploi sont réduits. Les effets
défavorables de cet enchaînement récessif seraient
d'ailleurs aggravés dans le cadre de l'
Union économique et
monétaire
, car les pertes de compétitivité n'y peuvent
être que très progressivement compensées, au prix d'une
politique salariale rigoureuse. A moyen terme, le maintien du niveau tendanciel
des salaires réels par tête se révélerait d'ailleurs
en partie un
leurre
, puisque la progression des salaires réels
serait ralentie par l'inflation.
SIMULATION DES EFFETS SUR L'EMPLOI AU BOUT DE CINQ ANS,
INDUITS PAR UNE RÉDUCTION DE 1 % CHAQUE ANNÉE
DE LA DURÉE MOYENNE DU TRAVAIL
|
Modèle |
Pas de compensation salariale initiale |
Avec compensation salariale |
| AMADEUS (INSEE) |
630 000 |
250 000 |
| HERMÈS (Ecole Centrale) |
510 000 |
430 000 |
| MOSAÏQUE (OFCE) |
720 000 |
620 000 |
· On remarquera enfin que la question de la
compensation salariale ne doit pas être examinée seulement du
point de vue des salariés en place.
Selon l'INSEE, la rémunération médiane des nouveaux
embauchés est inférieure de plus d'un quart à celle des
salariés en place : l'
embauche de nouveaux salariés
,
éventuellement liée à la réduction du temps de
travail, peut dès lors se traduire par une
baisse du coût moyen
du travail
.
Par ailleurs, selon les simulations de l'OFCE
24(
*
)
, l'amélioration de l'emploi et la baisse du
chômage consécutives à une baisse supposée
réussie de la durée du travail bénéficie aux
finances publiques : le
déficit public
serait ainsi
diminué, pour chaque heure de réduction du temps de travail
hebdomadaire effectif, d'un montant approximativement égal aux recettes
d'un point de cotisations employeurs. Si ces gains sont
" ristournés " aux entreprises et aux salariés qui
mettent en œuvre une réduction de travail assortie d'embauches,
une diminution de 10 % de la durée effective du travail permet
ainsi un
allégement autofinancé
de 1,2 % du
coût moyen du travail.
B. LES LIMITES DES MODÈLES
Les principales limites des modèles à l'analyse
des politiques de réduction du temps de travail résultent des
incertitudes relatives au lien entre durée légale et durée
effective du travail.
En effet, lorsque la
durée effective
du travail des
salariés à temps plein est supérieure à la
durée légale
, cette dernière joue le rôle
d'une "
force de rappel
" sur la durée effective en
raison du surcoût que représentent les
heures
supplémentaires
et de la référence que constitue la
durée légale du travail pour les négociations collectives.
Toutefois, la tendance de la durée effective à se rapprocher de
la durée légale est d'une intensité variable : la
durée du travail offerte moyenne s'était ainsi réduite en
1982 de près d'une heure en quelques mois, dans une conjoncture
dégradée, avec des effets décevants sur l'emploi.
Cependant, alors que la durée légale hebdomadaire avait
été fixée à 40 heures dès 1936, la
durée effective moyenne du travail n'a approché ce niveau
qu'à la fin des années 1970. La loi n'exerce en effet
"
qu'une influence indirecte sur la durée effective du travail
en fixant la durée légale, qui sert de référence
pour le calcul des heures supplémentaires, en imposant des plafonds pour
la durée effective journalière ou hebdomadaire du travail, ou en
limitant le volume total annuel des heures supplémentaires. Dans ce
cadre, les marges de variations des durées effectives demeurent
considérables
"
25(
*
)
.
Des simulations microéconomiques réalisées par la DARES
suggèrent que les directions d'entreprise et les représentants
des salariés pourraient chercher à
neutraliser
une
réduction de la durée légale du travail, en augmentant les
heures supplémentaires
ou en engageant des négociations
pour accroître l'horaire de travail des salariés à temps
partiel, notamment dans les services.
Plus généralement, la
dispersion
croissante des horaires
de travail (25 % des salariés disent travailler 39 heures,
35 % travailler moins et 40 % travailler plus), rendrait l'impact de
la baisse de la durée légale sur la
durée effective
particulièrement incertain.
Ainsi, les effets de l'abaissement à 35 heures par semaine de la
durée légale du travail annoncé par le Gouvernement
seraient très dépendants d'une éventuelle évolution
de la réglementation relative aux
heures supplémentaires
.
En effet, les salariés d'une entreprise assujettie à
l'abaissement de la durée légale à partir de l'an 2000,
pourraient a priori continuer de travailler 39 heures par semaine, sans autre
conséquence que la transformation des heures au-delà de la
35ème en " heures supplémentaires ", ce qui, dans
l'état actuel de la législation, en augmente de 25 % le
coût pour l'employeur. Au total, le coût nominal moyen du travail
serait ainsi accru de 2,56 %. Dans l'état actuel de la
réglementation, l'entreprise concernée devrait toutefois
solliciter, auprès de l'
inspection du travail
, une
dérogation pour dépasser le plafond annuel d'heures
supplémentaires, fixé à 130 heures par le
décret du 27 janvier 1982
26(
*
)
.
D'une certaine manière, la mise en œuvre de la réduction de
la durée effective du travail dans les entreprises qui pratiquent un
horaire hebdomadaire moyen supérieur ou égal à 37 heures
¾ (ce qui correspond à 35 heures par semaine + 130 heures
supplémentaires annuelles) dépendrait donc des instructions
données aux
directions départementales du travail
.
Enfin, la réduction de la durée légale du travail pourrait
ralentir le développement du travail
à temps partiel
, ce
phénomène contribuant à en limiter les effets sur la
durée moyenne du travail et sur l'emploi. En effet, l'ordonnance du
26 mars 1982 a limité le champ juridique du travail à
temps partiel aux durées inférieures à 80 % de la
durée légale ou conventionnelle. Dans ces conditions, à
législation inchangée, l'abaissement de la durée
légale du travail à 35 heures retirerait le
bénéfice des aides au travail à temps partiel pour les
emplois d'une durée comprise entre 28 et 32 heures ; ceux-ci
pourraient alors être pour partie convertis en emplois à temps
plein.
Au total, les conséquences d'une réduction de la durée
légale du travail dépendent très largement de
l'évolution concomitante du droit du travail, de son champ d'application
et de ses
modalités pratiques
de mise en œuvre dans chaque
entreprise, c'est-à-dire de considérations
micro-économiques et sociales que les modèles ne peuvent
évidemment prévoir.
De surcroît, le fonctionnement des modèles macroéconomiques
est essentiellement linéaire, c'est-à-dire que les effets d'une
réduction de la durée effective du travail de 10 % y sont le
double de ceux d'une réduction de 5 % et la moitié de ceux
d'une réduction de 20 %, sans que des
effets de seuil
puissent être pris en compte.
ANNEXE N° 1
UNE PROJECTION DE L'ÉCONOMIE
FRANÇAISE
(1997-2002)
SOMMAIRE
Pages
I. CONCEPTION GÉNÉRALE DE L'EXERCICE
59
II. PRINCIPALES HYPOTHÈSES DE LA PROJECTION
61
A. TAUX DE CHANGE ET TAUX D'INTÉRÊT 61
B. L'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 62
C. LES FINANCES PUBLIQUES 65
D. LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL 66
III. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS MACROÉCONOMIQUES
67
A. LES MÉNAGES 67
B. LES ENTREPRISES 70
C. LES ÉCHANGES EXTÉRIEURS 71
D. LA CROISSANCE 73
E. EMPLOI ET CHÔMAGE 75
F. LES PRIX 76
IV. TENDANCES DES FINANCES PUBLIQUES
77
A. LES RECETTES 77
B. L'ÉVOLUTION DES DÉPENSES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 78
1. La masse salariale
79
2. Les consommations intermédiaires
80
3. Les investissements publics
82
4. Les prestations sociales
83
a) Les prestations-maladie 83
b) Les prestations-vieillesse 85
c) Les prestations familiales et le Revenu Minimum d'Insertion 85
d) Les prestations-chômage 86
C. LE BESOIN DE FINANCEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 87
D. LES CHARGES D'INTÉRÊTS ET L'ENDETTEMENT 89
Cette note, établie par la Division des Etudes
macroéconomiques du Service des Etudes du Sénat, présente
les résultats d'une projection réalisée par l'Observatoire
français des conjonctures économiques (OFCE) à l'aide du
modèle MOSAÏQUE.
I. CONCEPTION GÉNÉRALE DE L'EXERCICE
· Cette projection de l'économie
française à l'horizon de cinq ans - 2002 en est le terme - a
été réalisée à l'aide du
modèle
MOSAÏQUE de l'Observatoire français des conjonctures
économiques. Elle est de nature essentiellement
macroéconomique
. Les experts de l'OFCE se sont attachés
toutefois à en tirer le maximum d'indications sur l'évolution des
finances publiques
(principalement au cours des années 1997, 1998
et 1999).
Si les résultats affichés pour les trois premières
années peuvent être considérés comme une
prévision
, les trois dernières années (2000 à
2002) ne décrivent certainement pas le scénario le plus
probable
, mais plutôt une extrapolation des tendances en cours. Il
s'agit ainsi d'
illustrer
, par une projection à cinq ans -et par
là, de mieux mettre en lumière- les questions et les choix devant
lesquels se trouvent aujourd'hui les responsables de la politique
économique.
· Dans le but de mettre à la disposition des Sénateurs une
telle " illustration ", la projection a
délibérément un caractère
tendanciel
que
l'on retrouve tant dans les évolutions macroéconomiques que dans
celles des finances publiques.
Concernant les
évolutions macroéconomiques
tout d'abord,
les auteurs de la projection ont choisi de prolonger autant que possible les
comportements des agents économiques tels qu'ils ont été
observés sur le passé et tels que les décrit le
modèle.
Ainsi l'annonce récente par le Gouvernement du dépôt d'un
projet de loi sur l'
abaissement
de la
durée hebdomadaire
légale du travail
de 39 heures à 35 heures, à
partir du 1er janvier 2000, n'est pas prise en compte dans la
projection. En effet, les modalités de mise en œuvre d'une
réduction de la durée du travail sont essentiellement de nature
microéconomique
(réorganisation du travail dans les
entreprises, accords salariaux, ...), de telle sorte que l'introduction en
projection d'une hypothèse de nature
macroéconomique
serait apparue tout à fait hasardeuse.
Il est logique dès lors que les évolutions
macroéconomiques décrivent un prolongement des tendances lourdes
à l'œuvre dans l'économie française.
Concernant les
finances publiques
par ailleurs, la projection tient
compte de la nécessité de leur redressement, afin de
maîtriser l'évolution de la dette publique et de satisfaire aux
critères fixés pour l'entrée dans la monnaie unique. Cela
se traduit globalement par une hypothèse de ralentissement de
l'évolution des dépenses publiques par rapport à leur
rythme de croissance de longue période. Les auteurs de la projection ont
toutefois considéré que la politique budgétaire ne
revêtirait pas au cours des cinq prochaines années la
même rigueur qu'en 1996 et 1997. Si l'hypothèse d'augmentation en
volume
de
l'ensemble
des dépenses publiques traduit certes
une inflexion par rapport à la tendance antérieure (+ 2,3 %
par an de 1997 à 2002 contre + 2,5 % par an de 1990 à 1996),
elle est toutefois sensiblement plus élevée que celle retenue,
les années précédentes, pour des exercices de même
nature. Par ailleurs, en raison de l'incertitude sur la maîtrise de
l'évolution des dépenses de santé, la projection a retenu
deux hypothèses alternatives : la première tient compte de
la nette inflexion observée en 1996 et 1997, par rapport au rythme de
croissance de longue période, et considère que ce ralentissement,
sans être aussi marqué qu'au cours des deux dernières
années, serait néanmoins
durable
; la seconde
hypothèse est celle d'un
retour
, à partir de 1999, vers
leur rythme
tendanciel
d'augmentation (soit 2,5 % par an en volume).
· La projection prend en compte la loi du 16 octobre 1997 relative au
développement d'activités pour l'emploi des jeunes et l'objectif
de création de
350 000 " emplois-jeunes "
dans
le
secteur non marchand.
Les auteurs de la projection ont toutefois considéré que les
créations nettes
d'emplois induites par le dispositif seraient
limitées à 80 % des embauches réalisées (soit
280 000 créations nettes
d'emplois en
trois ans
dans
le secteur non marchand) et que les 20 % restants seraient intervenus
même en l'absence de cette mesure (celle-ci générant un
" effet d'aubaine ").
· Enfin, jusqu'à la crise financière de la fin octobre
1997, le
dollar
s'était sensiblement
apprécié
en 1997 (de 13,7 % par rapport à la
moyenne de 1996), ce qui s'est traduit par un redressement de la
compétitivité
des pays européens, mouvement qui
devait se renforcer en 1998 selon les hypothèses retenues dans la
projection. Il en résulte, en projection, un fort dynamisme des
exportations et une amélioration des perspectives de croissance
à
court terme
. Cette reprise de l'activité suscite, selon
le modèle, des enchaînements économiques
favorables
(la baisse du chômage entraîne une évolution plus rapide des
salaires et du revenu des ménages, les contraintes d'ajustement des
finances publiques sont allégées par l'accélération
de l'activité...), de telle sorte que la croissance affichée en
projection (2,5 % par an en moyenne sur le moyen terme) est sensiblement
plus élevée que dans l'exercice de même nature
réalisé l'année dernière à la même
époque (2,1 % par an en moyenne).
II. PRINCIPALES HYPOTHÈSES DE LA PROJECTION
A. TAUX DE CHANGE ET TAUX D'INTÉRÊT
· Les auteurs de la projection ont retenu
l'hypothèse d'une mise en place de l'euro au 1er janvier 1999
avec tous les pays candidats (soit les quinze pays appartenant à l'Union
européenne, sauf le Royaume-Uni, le Danemark, la Grèce et la
Suède). La livre Sterling profiterait de la baisse du dollar en 1999,
pour retrouver un taux de change plus bas et plus conforme aux
" fondamentaux " de l'économie britannique.
La hausse du dollar depuis son point bas de la mi-95 ne paraît, selon
l'OFCE, réductible ni à un
aléa
spéculatif,
ni aux seuls déterminants conjoncturels (c'est-à-dire le
différentiel de croissance positif entre les Etats-Unis et l'Europe).
Elle s'appuierait essentiellement sur la
réduction structurelle du
déficit public
aux Etats-Unis, qui améliore la confiance des
détenteurs mondiaux de capitaux dans la capacité de
l'économie américaine à rembourser ses dettes. Sur
l'ensemble de la période 1997-2002, la parité du dollar est
supposée s'établir en moyenne à 1,78 deutsche mark
(soit 5,96 francs), au lieu de 1,58 au cours des six années
précédentes. Le scénario monétaire qui se dessine
depuis plus d'un an se
prolongerait
ainsi en projection, ce qui
réduirait le handicap de compétitivité
qui a
pesé sur l'Europe durant la première moitié des
années quatre-vingt-dix.
· La persistance d'un niveau élevé de chômage en
Europe, notamment en Allemagne, ainsi que l'absence de tensions salariales,
conduisent à envisager, en projection, un pilotage
monétaire
plus
souple
que par le passé. Les taux
d'intérêt à court terme fluctueraient autour de 2 % en
termes réels, sur l'ensemble de la période de projection. Les
taux d'intérêt nominaux à court terme augmenteraient
toutefois de près d'un point et demi en début de période
(phase de reprise cyclique en Europe), avant de refluer
légèrement par la suite.
HYPOTHÈSES DE TAUX DE CHANGE ET DE TAUX D'INTÉRÊT
|
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Taux d'intérêt courts
Etats Unis Japon Allemagne |
5,1
|
5,2
|
5,0
|
4,4
|
4,4
|
4,9
|
|
Taux d'intérêt longs
Etats Unis Japon Allemagne |
6,5
|
6,5
|
6,1
|
6,0
|
6,2
|
6,4
|
|
Taux de change
$/Yen $/DM Livre/DM FF/DM S/FF |
121
|
130
|
124
|
117
|
121
|
125
|
B. L'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
· La viabilité du scénario
monétaire décrit ci-dessus, suppose l'absence de dérapage
inflationniste de la croissance américaine. La persistance de la
croissance aux
Etats-Unis
jusqu'à la mi-98 ne pousserait pas
à l'extrême les tensions sur les capacités, dans une
économie qui a fortement accru son capital productif durant les
années passées. Elle repose sur le caractère accommodant
de la politique menée par les autorités monétaires
américaines.
Mais les auteurs de la projection ont supposé que la politique
monétaire prendrait un tournant suffisamment restrictif pour restreindre
l'activité avant que des tensions fortes ne surgissent sur le
marché du travail, et ne favorisent une inflation salariale. Cela
impliquerait que l'activité américaine se replie au tournant de
1998-1999. L'épisode de récession envisagé ici est
à la fois bref et d'ampleur réduite par rapport au passé,
confortant l'idée que le pilotage de la politique monétaire
instauré par la Banque centrale américaine ne devrait pas
éloigner fortement la croissance américaine de son potentiel.
Aucun déséquilibre structurel grave ne devrait par ailleurs
handicaper une reprise normale de l'activité à partir de
2000-2001 (absence de surendettement privé ou public en particulier).
· Les perspectives sont par contre beaucoup moins favorables au
Japon
, la croissance étant durablement installée sur un
sentier de moyen terme proche de 2 %.
· La croissance s'accélérerait en 1997 et en 1998 en
Europe
. Elle serait tirée en 1997 par l'extérieur,
à la fois du fait du dynamisme de la demande en provenance du reste du
monde, mais aussi grâce aux effets favorables de
l'
appréciation
du dollar sur la
compétitivité
-prix des produits européens. La reprise
de la demande entraînerait celle de l'investissement, qui serait ensuite
relayée par la consommation des ménages, grâce à une
certaine hausse de l'emploi et à une évolution
légèrement plus dynamique des salaires. Ainsi, la croissance
envisagée resterait relativement vigoureuse en 1998 et 1999. Elle
faciliterait le maintien des déficits publics sous la barre des trois
points de PIB. Toutefois, le dollar baisserait en 1999, ce qui freinerait la
croissance. La demande interne serait ralentie, principalement du fait de
l'investissement, tandis que la consommation des administrations et des
ménages serait moins bridée qu'au cours des dernières
années, grâce à l'amélioration des finances
publiques. Les ménages bénéficieraient d'une progression
des salaires un peu plus favorable, la plus forte croissance permettant une
certaine reprise des embauches.
A l'horizon de la prévision, les
prix
continueraient
d'évoluer à un rythme modéré. Ni le marché
du travail, ni celui des biens ne connaîtraient de tensions importantes.
L'évolution des taux de change contribuerait à la
modération des prix de la consommation en Europe.
· Concernant les
pays émergents
, les pays d'
Asie
en
développement connaîtraient une pause relative de leur croissance
en 1997-1998. D'une part, les politiques monétaires devraient être
moins accommodantes afin de freiner les tensions sur la demande interne et sur
les prix. D'autre part, la plus forte croissance dans la zone OCDE conduirait
à de moindres flux de capitaux vers les pays d'Asie en
développement, qu'au cours des années passées.
Après cette phase d'ajustement, ces derniers renoueraient avec des
rythmes de croissance plus soutenus, qui conduiraient à une progression
de leurs importations de produits manufacturés, à des rythmes
voisins de 10 % par an
27(
*
)
. Les
importations d'
Amérique Latine
suivraient en grande partie les
inflexions de la croissance américaine, du fait de l'intégration
commerciale croissante entre le nord et le sud de l'Amérique.
L'
Afrique
noire resterait une zone de faible croissance. Enfin, les
importations industrielles des pays d'
Europe de l'Est
croîtraient
à des rythmes de 8 % par an.
· La
demande mondiale
de produits manufacturés
adressée à la France croîtrait de plus de 7 % par an
de 1997 à 1999, ralentirait en 2000-2001 (respectivement 5,4 % et
4,7 %) et redeviendrait plus dynamique en 2002 (6,3 %), du fait de la
plus forte croissance chez nos principaux partenaires industriels.
PRINCIPALES HYPOTHÈSES D'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
|
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000-2002* |
|
ÉVOLUTION DU PIB EN %
- Union Européenne (1) - dont Allemagne - OCDE (1) - dont Etats-Unis - Demande mondiale adressée à la France (2) |
2,4
|
3,1
|
2,9
|
2,0
|
(1) Croissance des pays membres pondérée par la structure des exportations françaises.
(2) En produits manufacturés.
· Au total, le scénario qui vient d'être décrit paraît relativement prudent. Le schéma de reprise en Europe dépend à court terme d'une reprise de l'investissement dont l'ampleur est incertaine. Il est en effet possible qu'une plus forte reprise de la demande interne, en particulier de l'investissement des entreprises, ait lieu à l'horizon 1998. Cette reprise pourrait alors être freinée par une politique monétaire plus rigoureuse que celle envisagée en projection. En sens inverse, on pourrait assister à une baisse des taux d'intérêt longs en Europe, plus conforme aux évolutions habituelles de l'écart taux longs/taux courts. A l'horizon 2002, l'environnement européen est plus favorable que celui décrit par la projection réalisée pour le Sénat au printemps dernier à l'aide du modèle MIMOSA 28( * ) : l'hypothèse d'un dollar plus cher conduit en effet à envisager une croissance plus élevée à court terme, laquelle permet une détente des contraintes budgétaires.
C. LES FINANCES PUBLIQUES
L'évolution des finances publiques est
détaillée dans la quatrième partie de la note.
Les hypothèses retenues correspondent à un
ralentissement
des dépenses de l'ensemble des administrations publiques :
celles-ci ne progressent en volume que de 2,3 % par an en moyenne de 1997
à 2002 (sous l'hypothèse d'un ralentissement durable de
l'évolution des prestations maladie, cf. ci-dessous), contre 2,8 %
de 1990 à 1996. Cette orientation restrictive est toutefois
appliquée en projection avec moins de rigueur que depuis 1995. Ainsi les
auteurs de la projection ont-ils supposé une poursuite de l'augmentation
des
effectifs
de
l'ensemble
des administrations publiques au
même rythme qu'au cours des dix dernières années et
une évolution plus dynamique du
pouvoir d'achat
de
l'
indice
brut du traitement des fonctionnaires.
Pour l'
Etat
, les hypothèses relatives aux dépenses en 1998
correspondent aux dispositions du projet de loi de finances, soit une
stabilisation en
francs constants
. Par la suite, la norme
d'évolution des dépenses publiques identique à celle des
prix est maintenue. Les hypothèses en matière de recettes
tiennent compte des mesures contenues dans le projet de loi de finances pour
1998.
Les prestations-maladie ont progressé en volume de 0,7 % en 1996.
La prolongation des résultats observés au cours des premiers mois
de 1997 conduit à retenir une hypothèse de croissance en volume
de 0,1 % sur l'ensemble de l'année. Il apparaît ainsi que
l'évolution des prestations-maladie connaît une très nette
inflexion par rapport à leur taux de croissance de longue période
(2,5 % par an en moyenne de 1990 à 1996).
Compte tenu de l'incertitude sur le caractère durable du ralentissement
des prestations-maladie, les experts de l'OFCE ont étudié deux
hypothèses :
- dans la
première hypothèse
, le ralentissement
observé en 1996 et 1997 se
prolonge
sur le moyen terme, sans
être toutefois aussi marqué, et les prestations-maladie
progressent en volume de 1,4 % par an en moyenne entre 1997 et 2002 ;
- dans la
seconde hypothèse
, les prestations-maladie retrouvent,
à partir de 1999, leur évolution
tendancielle
et
augmentent en volume de 2,3 % par an en moyenne entre 1997 et 2002.
Dans la première hypothèse, l'ensemble des prestations
versées par les organismes de Sécurité sociale
progresserait ainsi en volume de 1,7 % par an en moyenne sur la
période de projection, contre 2,0 % dans la seconde
hypothèse.
D. LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL
L'évolution de la
productivité par
tête
(mesurée par le rapport de la valeur ajoutée aux
effectifs) s'élève en projection à 2 % par an en
moyenne.
Ainsi le mouvement de
ralentissement
de l'évolution
tendancielle
de la productivité par tête constaté
depuis 1990
29(
*
)
ne se poursuivrait-il
pas sur le moyen terme.
Deux éléments justifieraient cette hypothèse :
- la projection connaît deux phases de reprise marquées (1997-1998
et 2002) ; or, dans les périodes de reprise, les effectifs ne
s'adaptent qu'avec retard à l'évolution de l'activité, ce
qui entraîne une augmentation transitoire de la productivité
(" cycle de productivité ") ;
- la reprise de 1997-1998 est essentiellement tirée par les exportations
et, par conséquent, par le secteur
industriel
où les gains
de productivité sont structurellement plus élevés que dans
les services. Cette
déformation sectorielle
entraîne une
élévation de la moyenne de la productivité.
Inversement, dans le secteur des services, le ralentissement tendanciel de la
productivité se poursuivrait. L'OFCE considère en effet que le
développement du travail à temps partiel dans le secteur
tertiaire se prolongerait dans les prochaines années, bien qu'à
un rythme moins rapide. Il en résulterait une
baisse de la
durée moyenne
du travail de 0,2 % par an.
Comme cela a déjà été indiqué, la projection
ne cherche pas à simuler l'impact de la réduction de la
durée légale du travail de 39 heures à 35 heures
hebdomadaires.
Au total, les hypothèses retenues en matière de
productivité se traduisent par un
" appauvrissement " du
contenu en emplois
de la croissance par rapport aux évolutions
récentes. A ce titre, elles ne sont
pas favorables à
l'évolution de l'
emploi
en projection.
III. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS MACROÉCONOMIQUES
A. LES MÉNAGES
Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques du compte des ménages dans la projection.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉVOLUTION
DU COMPTE DES MÉNAGES
|
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000-2002* |
|
ÉVOLUTION EN POUVOIR D'ACHAT
(en
%)
- Masse salariale - Prestations sociales - Revenu disponible brut |
|
|
|
|
|
CONSOMMATION DES MÉNAGES
(en % et en volume
TAUX D'ÉPARGNE DES MÉNAGES (en points) |
0,7
|
1,6
|
1,8
|
2,2
|
· Après une stagnation en 1996, le pouvoir
d'achat du
revenu des ménages
accélère dans la
projection de manière progressive : + 1,2 % en 1997,
+ 1,6 % en 1998 puis + 2,1 % par an en moyenne entre 1999
et 2002. Trois facteurs expliqueraient cette évolution :
- la progression du
pouvoir d'achat du salaire par tête
(secteur
privé) serait de l'ordre de 1,5 % par an en moyenne entre 1997 et
2002, la baisse du chômage en début de période
renforçant les revendications salariales et se traduisant par une
évolution des salaires plus dynamique qu'au cours des années
récentes
30(
*
)
;
- l'augmentation de l'emploi entraîne une progression de la masse
salariale plus rapide que celle du salaire par tête (cf.
tableau
ci-après) ;
- enfin, malgré leur ralentissement dont la projection retient
l'hypothèse, les
prestations sociales
contribuent de
manière significative à la croissance du revenu des
ménages (pour 0,6 point par an en moyenne).
|
CONTRIBUTIONS A
LA
CROISSANCE DU POUVOIR D'ACHAT
|
|||||
|
MOYENNES ANNUELLES EN POINT DE POURCENTAGE |
1997 |
1998 |
1999 |
2000-2002 * |
|
|
Revenu
disponible
brut
|
1,2
|
1,6
|
2,1
|
2,1
|
|
* Contribution moyenne sur la période.
· L'évolution de la
consommation des ménages
dépend, outre la progression du revenu disponible brut qui vient
d'être décrite, de celle du taux d'épargne.
En projection, le comportement d'
épargne
des ménages
s'adapterait à l'évolution de leur revenu :
légère hausse en début de période (de 12,8 %
en 1996 à 13,2 % en 1997), consécutivement à
l'accélération de l'évolution de revenu,
légère baisse en fin de période lorsque la progression du
revenu ralentit. Ainsi la consommation des ménages progresserait-elle
moins rapidement que leur revenu en début de période et plus
rapidement en fin de période. Sur l'ensemble de la période de
projection cependant, la consommation évolue comme le revenu, soit
+ 2 % par an en moyenne.
B. LES ENTREPRISES
Les principales caractéristiques du compte des entreprises et l'évolution de l' investissement sont décrites dans le tableau ci-dessous.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉVOLUTION
DU COMPTE DES ENTREPRISES
|
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000-2002* |
|
RATIOS DU COMPTE DES ENTREPRISES
(niveaux
en points)
- Taux de marge 1 - Taux d'investissement 2 - Taux d'autofinancement 3 |
|
|
|
|
|
INVESTISSEMENT
(évolution
en volume et en %)
|
|
|
|
|
* Niveaux en 2002 et taux d'accroissement annuel moyen en volume pour l'investissement sur les années 2000, 2001 et 2002.
1 Taux de marge : Excédent brut d'exploitation / Valeur
ajoutée.
2 Taux d'investissement : Investissement / Valeur ajoutée.
3 Taux d'autofinancement : Epargne brute / Investissement.
La projection décrit un " cycle
d'investissement ", caractéristique d'une période de
reprise, d'ampleur cependant
modérée
et de
courte
durée
. L'amélioration des perspectives de
débouchés à l'exportation puis le regain de la
consommation entraînent un redressement de l'investissement en 1998 et
1999 (respectivement + 3,4 % et + 3,7 %). Par la suite, la
progression de l'investissement se stabilise autour de 2 % par an.
Il faut observer que le taux d'autofinancement - qui traduit la
capacité des entreprises à investir sans recours à
l'emprunt - reste supérieur à 100 %, ce qui, autrement
dit, signifie que la situation financière actuelle des entreprises leur
permettrait de financer une reprise plus forte de l'investissement.
C. LES ÉCHANGES EXTÉRIEURS
Dans une projection macroéconomique, l'évolution
des échanges extérieurs est principalement
déterminée par deux variables :
- la
compétitivité-prix
d'une part ;
- le
différentiel de croissance
entre la France et ses
partenaires d'autre part : si la croissance de la France est
inférieure à celle de ses partenaires, la demande
étrangère en produits français évoluera plus vite
que la demande française en produits étrangers
(indépendamment des mouvements de compétitivité).
Ces deux variables jouent de manière très
favorable
en
début de période
. Tout d'abord, la hausse du dollar en
1997 et 1998 (combinée à la modération relative des
coûts salariaux) entraîne une amélioration de la
compétitivité à l'exportation de 2,9 points par an en
moyenne sur ces deux années. Par ailleurs, le dynamisme de la demande
adressée à la France par ses partenaires en 1997 et, à un
degré moindre, en 1998, entraîne une progression des exportations
plus rapide que celle des importations.
Il en résulte une
contribution
très élevée
des échanges extérieurs à la croissance : ceux-ci
expliqueraient 1,6 point de croissance en 1997 (sur 2,1 % de
croissance totale) et 0,9 point en 1998 (sur 3,2 % de croissance
totale).
La contribution des échanges extérieurs à la croissance
est encore significative en 1999 (+ 0,5 point sur 2,9 % de
croissance), et beaucoup plus faible en fin de période
(+ 0,1 point en moyenne de 2000 à 2002) en raison de la baisse
du dollar retenue en projection et du ralentissement de la croissance chez nos
partenaires (en particulier aux Etats-Unis).
Ces évolutions se traduisent par un fort accroissement de la
capacité de financement de la Nation
(solde des opérations
courantes) qui passe de 2,3 % de PIB en 1997 à 3,2 % en 1999
et 3,1 % en 2001.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉVOLUTION
DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS
|
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000-2002* |
|
POURCENTAGE ANNUEL D'ACCROISSEMENT EN
VOLUME
- Demande étrangère de produits manufacturés - Exportations totales - Importations totales |
|
|
|
|
|
CONTRIBUTION DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS
À LA
CROISSANCE
(en points de PIB marchand) |
|
|
|
|
|
TAUX DE COUVERTURE EN VALEUR
(pourcentage
moyen sur la période
pour l'ensemble des biens et services)
|
|
|
|
|
|
SOLDE DES BIENS ET SERVICES
(en
milliards
de francs)
|
|
|
|
|
|
CAPACITÉ DE FINANCEMENT DE LA
NATION
(en % du PIB)
|
|
|
|
|
* Taux de croissance annuel moyen pour les années 2000, 2001 et 2002 ou niveaux en 2002.
D. LA CROISSANCE
L'évolution du PIB et de ses principales composantes est décrite dans le tableau ci-dessous :
ÉVOLUTION DU PIB ET DE SES PRINCIPALES COMPOSANTES
1997-2002
|
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000-2002* |
|
POURCENTAGE ANNUEL DE VARIATION
(en volume)
- PIB total - PIB marchand - Importations - Consommation des ménages - Investissement des entreprises - Investissement logement des ménages - Exportations - Variations des stocks ( contribution à la croissance en points de PIB) |
|
|
|
|
Le
profil
de croissance de l'économie
française décrit par la projection peut être
décomposé en trois phases :
- après le ralentissement en 1996, l'activité se redresse en 1997
(+ 2,1 %) et surtout en 1998 (+ 3,2 %) et 1999
(+ 2,9 %). Les taux de croissance ainsi affichés pour 1997 et
1998 sont peu différents de ceux retenus par le Gouvernement dans ses
hypothèses associées au projet de loi de finances pour
1998
et ceux des instituts de conjoncture indépendants.
Le redémarrage de l'activité s'expliquerait par le dynamisme de
l'environnement international, l'amélioration de la
compétitivité consécutive à l'appréciation
du dollar et le plus grand dynamisme des entreprises, avec un mouvement de
restockage et une reprise de l'investissement à partir de 1998.
La consommation des ménages se redresse progressivement, grâce
à l'amélioration de l'emploi et à une légère
accélération des salaires.
- En 2000 et 2001, l'environnement international se dégrade (en raison
notamment du ralentissement de l'économie américaine à
partir de 1999), le dollar connaît une nouvelle phase de
dépréciation, et l'investissement des entreprises ralentit. La
progression de la consommation des ménages (+ 2,1 % en 2000 et
+ 2,3 % en 2001) concourt toutefois à stabiliser la croissance
autour de 2 % par an (+ 1,9 % en 2000 et + 2,1 % en
2001).
- Un
retour
de l'économie française vers son sentier de
croissance
potentielle
, lié à la reprise de
l'activité chez nos principaux partenaires, s'opère en
fin de
projection
.
Le
tableau
ci-dessous décrit l'évolution des
contributions
à la croissance du PIB dans la projection.
CONTRIBUTIONS À LA CROISSANCE DU PIB (chiffres arrondis)
|
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000-2002* |
|
MOYENNES ANNUELLES (en points de
pourcentage du PIB)
- Consommation des ménages - Investissement logement des ménages - Investissement des entreprises - Dépenses des administrations - Variation des stocks Total de la demande intérieure Solde extérieur PIB marchand |
|
|
|
|
Deux éléments significatifs se
dégagent :
- les
échanges extérieurs
constituent
l'élément
déterminant
de la reprise de
l'activité en
début
de période (1997-1999) ;
- la
demande intérieure
se redresse progressivement et prend le
relais de la demande étrangère, de manière toutefois
insuffisamment dynamique pour empêcher le ralentissement observé
en fin de projection (2000-2002).
E. EMPLOI ET CHÔMAGE
Comme on l'a indiqué ci-dessus, l'hypothèse
retenue pour l'évolution de la productivité par tête
(+ 2 % par an) est plus élevée que la tendance
observée au cours des dernières années (+ 1,5 %
par an de 1990 à 1996).
Malgré cette hypothèse, la projection décrit une
progression de l'emploi total de 0,5 % par an en moyenne entre 1997 et
2002, soit
128 000 créations nettes d'emplois
par an,
ou encore 770 000 créations nettes d'emplois en six ans. Ce
résultat tient compte de la
création nette
de 280 000
" emplois-jeunes " en trois ans dans le secteur non
marchand.
L'OFCE retient par ailleurs une hypothèse d'augmentation de la
population active
potentielle
de 154 000 par an. L'évolution
de la population active
effective
peut toutefois sensiblement
différer de celle de la population active potentielle : en effet,
en période de ralentissement de l'activité, des actifs potentiels
peuvent renoncer à se présenter sur le marché du travail
(" travailleurs découragés ") ; inversement, en
période d'amélioration conjoncturelle, des personnes
jusque-là découragées se présentent sur le
marché du travail, entraînant ainsi une évolution de la
population active observée supérieure à celle de la
population active potentielle.
Ces phénomènes de "
flexion des taux
d'activité
", simulés par le modèle, se
traduisent en projection par une augmentation de la population active effective
de
170 000 par an
. Compte tenu de l'évolution plus faible de
l'emploi (128 000 créations nettes par an en moyenne), le nombre de
chômeurs augmente ainsi en moyenne dans la projection de 40 000 par
an environ sur la période 1997-2002.
Quant au
taux de chômage
, il baisserait transitoirement de
12,5 % en 1997 à 12 % en 2000, mais rejoindrait son niveau
initial en fin de période.
EMPLOI ET CHÔMAGE
|
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000-2002* |
|
ÉVOLUTION MOYENNE (en
milliers)
- Emploi total - Population active totale - Nombre de chômeurs - Taux de chômage ( au sens du BIT ) |
|
+ 177
|
+ 276
|
+ 104
|
F. LES PRIX
La projection confirme la tendance à la
désinflation de l'économie française. Le salaire par
tête ne progresse pas plus vite que la productivité, ce qui permet
aux entreprises de préserver leurs marges sans augmenter leurs prix.
Les prix du
PIB marchand
progressent ainsi en moyenne de 1,2 % par
an de 1997 à 2002 et les prix à la consommation de 1,6 % par
an (contre 2,2 % par an de 1990 à 1996).
IV. TENDANCES DES FINANCES PUBLIQUES
Un modèle macroéconomique tel que le
modèle MOSAÏQUE ne donne qu'une vision globale des finances
publiques : évolution de l'
ensemble de dépenses
des
administrations publiques, évolution des
grandes catégories de
recettes
et, enfin, évolution du
besoin de financement de
l'ensemble
des administrations publiques.
Toutefois, les experts de l'OFCE se sont attachés à en tirer un
maximum d'indications, notamment sur les questions suivantes :
- Quelle est l'
incidence
des évolutions
macroéconomiques
sur les
finances publiques
, en
particulier sur les conditions d'un
équilibre des finances
sociales
?
- Comment la contrainte générale de redressement des finances
publiques peut-elle s'appliquer aux diverses institutions publiques (Etat,
Sécurité sociale et collectivités locales en
particulier) ? Les experts sont ainsi conduits à avancer leurs
propres hypothèses
sur l'évolution
à moyen terme
des dépenses de l'Etat, ainsi que sur celles des prestations
sociales.
- Quelle est l'évolution du
besoin de financement
des
administrations publiques et celle de la
dette publique
qui en
résulte ?
A. LES RECETTES
La projection des recettes publiques est
réalisée à législation constante, compte tenu des
mesures annoncées par le Gouvernement et de celles récemment
votées ou actuellement discutées par le Parlement (loi portant
diverses mesures d'ordre fiscal et financier, projet de loi de financement de
la Sécurité Sociale pour 1998, projet de loi de finances pour
1998).
Il a ainsi été tenu compte, notamment, du transfert des
cotisations des salariés sur la Contribution Sociale
Généralisée. Cette réforme permet d'élargir
la base du prélèvement social, mais, dans la mesure où les
salaires
évoluent en projection sensiblement
comme le PIB,
elle serait
neutre
du point de vue de l'évolution du total
des recettes mesurée en pourcentage du PIB.
L'exercice suppose également une
stabilisation
de la TVA, des
taux de l'impôt sur les sociétés et des autres
impôts, aux niveaux atteints en 1998. En effet, l'évolution du
déficit public ne permettrait pas de revenir sur les majorations
d'impôt récemment intervenues. Ainsi l'augmentation de la
fiscalité sur les sociétés décidée par la
loi portant diverses mesures d'urgence à caractère fiscal et
financier est-elle maintenue en projection.
Les évolutions sont retracées dans le
tableau
ci-dessous.
ÉVOLUTION DES RECETTES DES ADMINISTRATIONS
En % de PIB
|
|
1996 |
1997 |
1998 |
2002 |
|
TVA Autres impôts indirects dont TIPP Impôt sur le revenu des ménages CSG et CRDS Impôt sur les sociétés Autres impôts sur le revenu et le patrimoine Cotisations employeurs * Cotisations salariés Cotisations non-salariés |
|
|
|
|
Sources : Comptes nationaux, Prévision
OFCE-Modèle MOSAÏQUE.
* Non corrigé des allégements de cotisations sur les bas
salaires.
B. L'ÉVOLUTION DES DÉPENSES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
La projection repose sur l'hypothèse d'un ralentissement global des dépenses des administrations publiques sur la période de projection (1997-2002) : la progression serait de 2,3 % par an en francs constants 31( * ) , à comparer à l'augmentation de 2,8 % constatée sur la période 1990-1996 (cf tableau ci-dessous).
ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE L'ENSEMBLE
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
(déflatées par le prix du PIB total)
(en %, par an)
|
|
1990-1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000-2002 |
|
ENSEMBLE DES DÉPENSES
en francs 1980 |
|
|
|
|
|
|
dont :
- Masse salariale - Consommations intermédiaires - Investissements - Prestations sociales |
2,6
|
1,2
|
3,1
|
3,3
|
2,4
|
1. La masse salariale
En ce qui concerne les
effectifs
des administrations
publiques (Etat, collectivités locales et hôpitaux), la projection
prolonge
l'évolution moyenne constatée depuis 1985, soit
une augmentation de 40.000 par an des emplois ordinaires. En outre les
emplois-jeunes du début de période accroîtraient au total
de 350.000 le nombre d'emplois dans les administrations. Dans ces conditions,
les effectifs des administrations augmenteraient de 1 % par an en moyenne
entre 1997 et 2002.
La projection retient l'hypothèse d'une progression moyenne de
0,7 % par an entre 1998 et 2002 du pouvoir d'achat de l'
indice
brut
des
traitements
de la fonction publique. Cela suppose en 1998 et 1999
une
compensation
pour moitié des pertes passées du
pouvoir d'achat de cet indice
(- 0,7 % en 1996 et en 1997).
Par la suite, le pouvoir d'achat du salaire moyen dans la fonction publique
augmenterait de 0,5 % par an.
Au total, la
masse salariale
publique augmenterait de
1,3 %
en
francs constants
32(
*
)
en 1997, et, en
moyenne de
2,8 %
par an de 1997 à 2002 (contre
2,3 %
par an de 1990 à 1996).
2. Les consommations intermédiaires
Pour l'ensemble des administrations publiques, la croissance
en volume des
consommations intermédiaires
(qui comprennent les
dépenses courantes
des administrations hors dépenses de
personnel, ainsi que les
dépenses militaires en capital
) serait
ramenée de 1,7 % par an en moyenne entre 1990 et 1996 à
1,4 %
par an de 1997 à 2002.
Pour les collectivités locales, ceci se traduirait par un ralentissement
important (de 4,4 % par an en volume de 1990 à 1996 à
2,7 % par an de 1997 à 2002).
Pour la Sécurité sociale, la croissance en volume de cette
catégorie de dépenses
33(
*
)
serait
ramenée à 1,6 % par an en moyenne de 1997 à 2002,
contre 3,3 % de 1990 à 1996.
Les consommations intermédiaires de l'Etat croîtraient de 1 %
en volume en 1998, puis se stabiliseraient à partir de 1999. Une
réduction plus importante des dépenses militaires permettrait
éventuellement des économies supplémentaires.
Le
graphique
ci-après permet de visualiser l'évolution
relative des consommations intermédiaires des trois agents publics.
On constate que la tendance au transfert des dépenses de l'Etat vers les
collectivités locales se poursuivrait et qu'en 2002, le volume des
consommations intermédiaires des collectivités locales
rejoindrait celui de l'Etat.
TAUX DE CROISSANCE DES CONSOMMATIONS INTERMÉDIAIRES
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
(Aux prix de 1980)
(en %, par an)
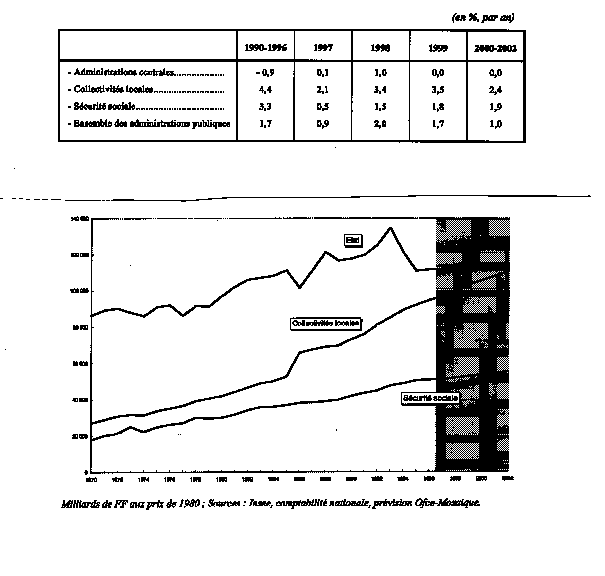
|
|
1990-1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000-2002 |
|
- Administrations centrales
- Collectivités locales - Sécurité sociale - Ensemble des administrations publiques |
- 0,9
|
0,1
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
3. Les investissements publics
En matière d'investissements publics (qui, au sens de la comptabilité nationale, ne comprennent pas les dépenses militaires d'équipement), l'hypothèse retenue est celle d'un ralentissement de leur progression en volume (cf. tableau et graphique ci-dessous). Au total, celle-ci atteindrait seulement 1,1 % par an en moyenne, soit un taux de croissance deux fois moins rapide que celui du PIB. Pour les collectivités locales, le taux de croissance serait très légèrement plus élevé que celui observé de 1990 à 1996. Pour l'Etat, l'augmentation en volume serait limitée à 0,5 % par an. Enfin, les investissements des administrations de Sécurité sociale (qui, dans les définitions de la comptabilité nationale, incluent les investissements hospitaliers) augmenteraient de 1 % par an en volume, soit un freinage marqué par rapport à la période 1990-1996.
TAUX DE CROISSANCE DES INVESTISSEMENTS DES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES
(Aux prix de 1980)
(en %, par an)
|
|
1991-1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 2002 |
|
- Administrations centrales
- Collectivités locales - Sécurité sociale (1) - Ensemble des administrations publiques |
- 1,3
|
- 0,5
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
(1) Ce concept inclut les hôpitaux.
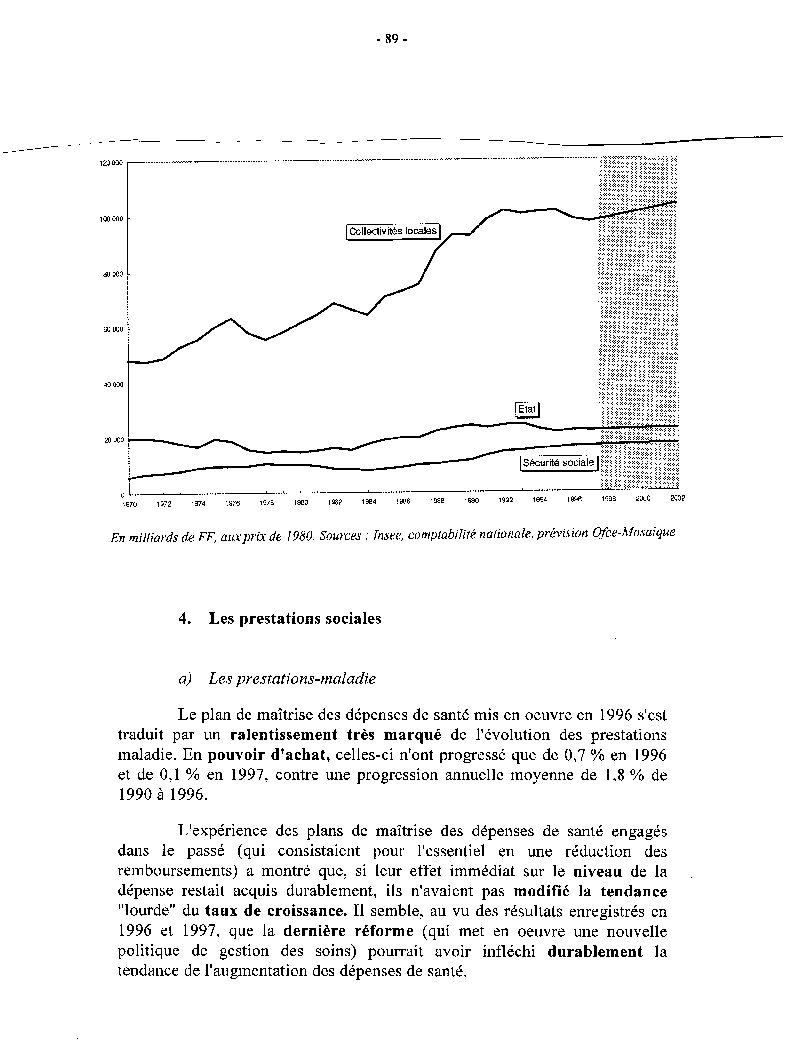
4. Les prestations sociales
a) Les prestations-maladie
Le plan de maîtrise des dépenses de santé
mis en œuvre en 1996 s'est traduit par un
ralentissement très
marqué
de l'évolution des prestations maladie. En
pouvoir
d'achat,
celles-ci n'ont progressé que de 0,7 % en 1996 et de
0,1 % en 1997, contre une progression annuelle moyenne de 1,8 % de
1990 à 1996.
L'expérience des plans de maîtrise des dépenses de
santé engagés dans le passé (qui consistaient pour
l'essentiel en une réduction des remboursements) a montré que, si
leur effet immédiat sur le
niveau
de la dépense restait
acquis durablement, ils n'avaient pas
modifié la tendance
"lourde" du
taux de croissance.
Il semble, au vu des
résultats enregistrés en 1996 et 1997, que la
dernière
réforme
(qui met en œuvre une nouvelle politique de gestion
des soins) pourrait avoir infléchi
durablement
la tendance de
l'augmentation des dépenses de santé.
Les auteurs de la projection en ont déduit une
première
hypothèse
selon laquelle la croissance des
prestations-maladie
se maintiendrait durablement autour de
1,4 %
par an en francs constants
à partir de 1998.
Cette hypothèse se situe à mi-chemin entre, d'une part, les
évolutions récentes et l'objectif fixé par le projet de
loi de financement de la Sécurité sociale pour 1998 (soit
2,2 % d'augmentation en
francs courants
) et, d'autre part, la
tendance de longue période.
Toutefois, compte tenu de l'incertitude qui s'attache à l'effet à
moyen terme de la réforme de 1996, une
hypothèse
alternative
de retour des dépenses de santé
vers leur rythme de croissance antérieur
a également
été envisagée (soit
+ 2,5 % par an
en
francs constants à partir de 1999).
TAUX DE CROISSANCE DES PRESTATIONS DE SANTÉ EN VOLUME
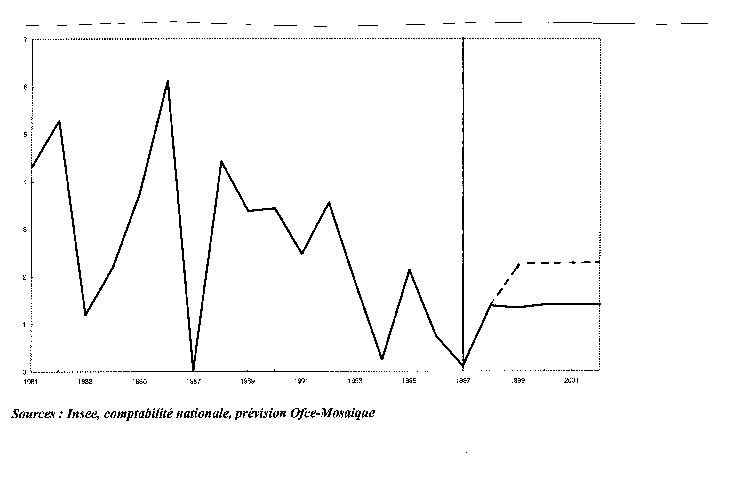
- en gras : Hypothèse de ralentissement durable de
l'évolution des dépenses de santé.
- tirets : retour des dépenses de santé vers leur rythme
tendanciel d'augmentation (à partir de 1999).
b) Les prestations-vieillesse
La pression démographique sur les régimes de
retraite connaîtrait un répit, avant la forte croissance du nombre
de retraités qui devrait intervenir à partir de 2005, du fait de
l'arrivée à l'âge de la retraite des classes nombreuses de
l'après-guerre.
Par ailleurs, la progression du montant unitaire des retraites resterait
faible, en raison des nouvelles modalités d'indexation (sur les prix) et
de la montée en charge progressive de la réforme du régime
général (allongement de la période de cotisation
nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein et modification
du calcul du salaire de référence
34(
*
)
).
Les mesures d'équilibrage décidées par les régimes
complémentaires (baisse du rendement) contribueraient à la
maîtrise de leurs dépenses.
Au total, l'augmentation en volume des
prestations vieillesse
serait
de
1,2 %
en
1997,
de
1,7 %
en
1998,
puis
de
2,1 %
par an en moyenne de
1999 à
2002
(contre 2,5 % par an en moyenne de 1990 à 1996).
c) Les prestations familiales et le Revenu Minimum d'Insertion
Après la mise sous conditions de ressources des
allocations familiales à partir de 1998, le pouvoir d'achat des
prestations par enfant de moins de vingt ans serait maintenu ce qui,
compte tenu du ralentissement démographique, entraînerait une
faible augmentation de la masse des allocations familiales.
Pour l'allocation-logement, la croissance serait plus rapide, sans
dépasser toutefois celle du PIB.
L'augmentation des dépenses au titre du Revenu Minimum
d'Insertion
35(
*
)
se prolongerait à un
rythme rapide, en raison du niveau élevé du chômage et du
fait que l'assurance-chômage ne prend plus en charge les titulaires
d'emplois précaires. Néanmoins, par rapport aux périodes
antérieures, on observerait un ralentissement de la croissance des
dépenses allouées au RMI.
L'ensemble
prestations familiales et dépenses pour le RMI
croîtrait ainsi en volume de
2,1 %
en
1997
, puis
de
0,9 % par an
en moyenne de 1998 à 2001 (après
2,4 % de 1990 à 1996).
d) Les prestations-chômage
L'évolution des prestations-chômage serait
influencée par deux facteurs contradictoires :
- l'évolution en projection du nombre de chômeurs : celui-ci
diminue en 1998 et 1999, avant d'augmenter à partir de 2000 ;
- la diminution de l'indemnité moyenne (qui résulterait notamment
de la non prise en charge par l'assurance-chômage des titulaires
d'emplois précaires).
Au total, les
prestations-chômage
progresseraient de
2,8 %
en volume en
1997
et
de
1,9 %
en
1998,
diminueraient
de
0,3 %
en
1999
et retrouveraient une
augmentation annuelle moyenne de 3,2 % de
2000 à 2002
(contre 4,7 % par an en moyenne de 1990 à 1996).
Comme l'indique le
tableau
récapitulatif ci-dessous, le pouvoir
d'achat de l'ensemble des prestations sociales augmente en projection de
1,7 % par an en moyenne, sous l'hypothèse d'un ralentissement
durable de l'évolution des dépenses de santé, et de
2 % par an sous l'hypothèse d'un retour de la progression des
dépenses de santé vers leur rythme d'évolution tendanciel.
Dans les deux cas toutefois, les prestations sociales progressent moins vite
que le PIB (+ 2,5 % par an en moyenne)
contrairement
à la
période 1990-1996 (+ 2,5 % pour les prestations sociales et
+ 1,2 % pour le PIB).
ÉVOLUTION DU POUVOIR D'ACHAT DES PRESTATIONS SOCIALES
|
|
1990-1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000-2002 * |
|
POURCENTAGE ANNUEL D'ACCROISSEMENT
|
|
|
|
|
|
|
-
Famille, logement et RMI
- Retraites - Chômage - Maladie (hypothèse 1**) - Maladie (hypothèse 2***) Total des prestations : - Hypothèse 1 - Hypothèse 2 |
2,4
|
2,1
|
0,4
|
0,6
|
1,2
|
* Taux d'accroissement annuel moyen entre 2000 et 2002.
** Hypothèse 1 : ralentissement durable de l'évolution des
dépenses de santé.
*** Hypothèse 2 : retour des dépenses de santé vers leur
rythme tendanciel d'augmentation (à partir de 1999).
C. LE BESOIN DE FINANCEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
Exprimé en pourcentage du PIB, le
besoin de
financement
des administrations publiques au sens de la
comptabilité européenne
(c'est-à-dire notamment
après prise en compte de la soulte FRANCE-TELECOM en 1997 et des coupons
courus sur les obligations d'Etat) se réduit
lentement
en
projection (de 0,1 point par an environ). Ce résultat correspond
à l'hypothèse de maîtrise durable des dépenses de
santé.
Dans l'hypothèse où le ralentissement actuellement
constaté des dépenses de santé ne se prolongerait pas, le
besoin de financement des administrations publiques ne se stabiliserait que
très légèrement en-dessous de 3 % du PIB à
l'horizon de la projection (cf
tableau
ci-dessous).
ÉVOLUTION DE LA CAPACITÉ DE FINANCEMENT
DES
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
(en % du PIB)
|
|
1997 |
1998 |
1999 |
2002 |
|
- Hypothèse 1* Présentation traditionnelle Au sens de la comptabilité européenne - Hypothèse 2** Présentation traditionnelle Au sens de la comptabilité européenne |
|
|
|
|
* Hypothèse 1 : Ralentissement durable de
l'évolution des dépenses de santé.
** Hypothèse 2 : Retour des dépenses de santé vers leur
rythme d'augmentation tendanciel (à partir de 1999).
Pour autant qu'il soit possible de passer de la nomenclature de la
Comptabilité nationale à celle de la Sécurité
sociale, les tendances
d'évolution
des
comptes sociaux
seraient les suivantes :
- sous l'hypothèse d'un ralentissement
durable
de la projection
des
dépenses de santé,
l'augmentation annuelle moyenne des
prestations sociales en valeur entre 1997 et 2002 (3,3 %) serait nettement
inférieure à celle du PIB (3,7 %) et à celle des
salaires (qui évoluent en projection sensiblement comme le PIB). Ces
évolutions s'avèrent donc favorables au
rééquilibrage progressif des comptes sociaux
sans
majoration des cotisations ;
- une hypothèse d'augmentation plus rapide des dépenses de
santé (+ 2,5 % par an en volume entre 1999 et 2002 au lieu de
1,4 % précédemment), aurait pour effet de
détériorer le solde des comptes sociaux d'un montant égal
à 0,1 % du PIB en 1999 et 2000, et 0,2 % du PIB en 2001 et
2002 (soit, en 2002, l'équivalent de
20 milliards de francs
1997 environ).
D. LES CHARGES D'INTÉRÊTS ET L'ENDETTEMENT
La
charge
nette des
intérêts
versés par les administrations publiques, mesurée en pourcentage
du PIB, ne diminuerait que très faiblement en projection : de
3,6 % en 1997 à 3,5 % en 2002.
En effet, l'incidence favorable de la baisse du taux d'intérêt
moyen sur la dette publique (de 7,7 % en 1997 à 6,4 % en 2002)
serait compensée par l'augmentation du niveau de la dette publique.
Le ratio dette publique/PIB progresserait de 0,7 point par an en moyenne,
pour atteindre 60 % en 2002. En effet, l'
excédent primaire
(c'est-à-dire le solde public hors charges d'intérêt)
dégagé à partir de 1997 serait
insuffisant
pour
permettre une
stabilisation
de ce ratio.
ANNEXE N° 2
CROISSANCE EN EUROPE :
QUELLES MARGES DE MANŒUVRE ?
Trois simulations réalisées par l'Equipe responsable du
modèle MIMOSA (CEPII - OFCE)
Introduction
A la suite de l'étude sur les " Perspectives de l'économie
mondiale à l'horizon 1995 ", présentée le 20 mars 1997 au
Colloque de la Délégation du Sénat pour la Planification
(voir Rapport du Sénat, n° 315, 1996-1997), l'équipe
Mimosa a réalisé, à la demande de la
Délégation, trois ensembles de variantes destinées
à illustrer l'impact sur la croissance et l'emploi en Europe, soit de
certaines options de politique économique, soit de certaines
incertitudes :
1. Des politiques budgétaires moins restrictives en Europe passant par
une baisse des cotisations salariés ;
2. Une hausse plus vive des salaires en France ou en Europe ;
3. Une dépréciation des monnaies européennes
Encadré: La formation des taux d'intérêt et des taux de
change dans MIMOSA
.
Le modèle MIMOSA peut fonctionner selon plusieurs régimes, tant
en ce qui concerne la formation des taux d'intérêt, que celle des
taux de change. En principe, les banques centrales des pays dominants
(Etats-Unis, Japon, Allemagne) élèvent leur taux
d'intérêt court de 0,5 point lorsque le taux de chômage
baisse de 1 point, et de 1,5 point lorsque l'inflation augmente de 1 point
relativement à la simulation de référence. Toutefois,
elles peuvent choisir de ne pas réagir et de maintenir fixe les taux
d'intérêt nominaux (stratégie dite accommodante). Les taux
d'intérêt longs sont indexés sur les taux courts courants.
En régime de SME, la Bundesbank ne tient compte que de la situation de
l'Allemagne ; les taux d'intérêt courts des différents pays
européens s'alignent sur ceux de l'Allemagne ; les taux de change des
pays européens sont stables par rapport au mark. En régime d'UEM,
la Banque Centrale Européenne tient compte de la situation de la moyenne
des pays de l'Euro ; les taux d'intérêt courts des
différents pays européens sont identiques.
Les taux de change sont déterminés par la parité des taux
d'intérêt. Le taux de change se fixe au niveau tel que le
différentiel de taux d'intérêt court entre deux monnaies
est égal à l'anticipation de dépréciation. Les
marchés anticipent une variation du taux de change égale à
une fraction de l'écart entre le taux de change courant et le taux de
change de référence correspondant au taux de change réel
initial : cette fraction est estimée à 1/3 en valeur annuelle.
Par exemple, si une année donnée, l'Europe a 1 point d'inflation
de moins que les Etats-Unis et que son taux d'intérêt augmente de
1 point (le taux américain restant fixe), l'Euro s'apprécie de
4 %, 1 % en raison de l'écart d'inflation, 3 % en raison
de l'écart de taux d'intérêt.
Si les taux d'intérêt nominaux sont maintenus fixes, les taux de
change varient comme les différences de taux d'inflation.
1. Des politiques budgétaires moins restrictives en Europe : une
baisse des cotisations sociales salariés
Une relance par la baisse des cotisations : quels enjeux ?
Nous nous proposons ici d'illustrer l'impact de politiques budgétaires
moins restrictives en Europe. Pour cela, nous avons choisi d'analyser une
baisse simultanée des cotisations sociales salariés. Une telle
mesure, allégeant la charge portant sur les ménages, est
susceptible de stimuler la consommation tout en contribuant à
rééquilibrer le système fiscal en faveur des revenus du
travail. Elle a l'avantage de stimuler directement un grand nombre des secteurs
de l'économie ; son impact expansionniste est plus fort que celui d'une
baisse de l'impôt sur le revenu car elle bénéficie à
plus de ménages et à des ménages moins aisés en
moyenne. Par contre, elle constituerait une rupture par rapport à
l'augmentation tendancielle du taux de cotisation salariés
observée au cours des vingt dernières années, en
particulier en France et en Italie (graphique 1).
Les prévisions les plus récentes amènent à penser
que les déficits publics de l'Allemagne, de la France ou de l'Italie
seraient compris entre 3 et 3,2 % du PIB en 1997 ; celui du Royaume-Uni
étant légèrement inférieur (2,8 %). Aussi, un
tel assouplissement de la politique budgétaire implique de s'affranchir
ex ante de la contrainte définie par les critères de Maastricht
et le pacte de Stabilité. Cet assouplissement devrait être
justifié par le niveau élevé du chômage dans
l'ensemble de l'UE et par le déficit de croissance accumulé par
les pays européens depuis le début des années 90.
Hypothèses de la simulation
La simulation présentée est une baisse des cotisations sociales
salariés d'un montant de 1 point de PIB dans tous les pays de l'UE. La
symétrie du choc étudié est destinée à
faciliter l'interprétation. Une autre possibilité aurait
été de définir une cible pour la politique
budgétaire - par exemple un relèvement du niveau maximal de
déficit public autorisé par le pacte de Stabilité - chaque
pays disposant alors d'une marge de manoeuvre différente pour sa
politique budgétaire.
La modélisation des salaires dans le modèle MIMOSA
36(
*
)
fait porter la négociation salariale sur la
rémunération brute, y compris cotisations salariés, mais
hors cotisations employeurs conformément à la pratique effective
et à ce qu'indiquent la plupart des études empiriques. Dès
lors, la baisse des cotisations employés est entièrement
absorbée par les salariés par une hausse des salaires nets.
Compte tenu de la part des salaires dans le PIB (55 % environ) la baisse
du taux de cotisations sociales envisagée ici conduit à une
augmentation ex ante de 1,7 % du salaire net moyen. Le salaire brut
étant inchangé, la mesure n'affecte pas ex ante le coût du
travail pour l'entreprise, ni le taux de chômage d'équilibre.
Si l'on considère une relance mise en oeuvre en 1998, le cadre
monétaire est susceptible d'être modifié au cours de la
période d'impact de la mesure, du fait de la mise en place de l'UEM.
Pour simplifier l'analyse, nous avons supposé ici que la politique
monétaire européenne fonctionne pendant toute la période
sur le mode en vigueur dans le SME (voir encadré).Deux simulations ont
été réalisées correspondant à deux
hypothèses sur le comportement des autorités monétaires
suite à la relance budgétaire. Dans la première, la
Bundesbank mène une politique monétaire accommodante : les taux
d'intérêt nominaux restent fixes. Dans ce cas, le taux de change
des monnaies européennes se déprécient comme le
différentiel d'inflation entre l'Allemagne et les Etats-Unis. Dans la
deuxième, la Bundesbank a son comportement usuel : elle augmente son
taux d'intérêt à la suite du choc. Aussi, si les monnaies
européennes se déprécient à moyen terme, elles
s'apprécient à court terme en raison des entrées de
capitaux induites par le niveau des taux d'intérêt.
Résultats
Les résultats des simulations sont présentés dans les
tableaux 1 et 2. Pour les évaluer, il faut tenir compte de la situation
économique telle qu'elle est décrite dans le compte central. Dans
la plupart des pays d'Europe, le taux d'inflation est actuellement
extrêmement bas, de l'ordre de 2% l'an en Allemagne, Belgique et
Pays-Bas, inférieur à 2% en Autriche, Espagne, France et Italie.
Il semble de plus que celui-ci ait atteint un plancher : en raison de l'inertie
nominale des salaires et des prix, on ne peut guère envisager de voir le
taux d'inflation diminuer encore même si le taux de chômage restait
à son niveau élevé. En sens inverse, une baisse du taux de
chômage devrait avoir un effet moins inflationniste que normalement. Les
taux d'intérêt sur le marché monétaire sont de
l'ordre de 3,5%. Là aussi, on peut penser que les Banques centrales
pourraient être plus accommodantes que normalement dans la mesure
où le taux d'inflation est inférieur à leur objectif. Ceci
conduit à renforcer la probabilité du premier scénario
où les Banques centrales n'augmentent pas leur taux
d'intérêt.
La baisse des cotisations salariales constitue un transfert de revenu, de un
point de PIB ex ante, des administrations publiques aux ménages.
L'accroissement du revenu disponible des ménages provoque une hausse
progressive de la consommation et de l'investissement logement qui atteint son
point culminant à 2-3 ans dans la plupart des pays européens.
Ainsi est amorcée la dynamique usuelle du multiplicateur : la croissance
s'accélère en Europe (de 1,2 point par an au cours des trois
premières années dans le scénario " taux
d'intérêt fixes ", de 0,6 point dans le scénario " taux
d'intérêt endogènes "). Le taux de chômage recule
durablement respectivement de 1,5 point et de 0,8 point dans le premier et le
second scénario.
La baisse des cotisations salariés étant entièrement
absorbée par la hausse du salaire net, la mesure n'engendre pas de
baisse des prix. A court terme, le niveau des prix est stable dans l'UE, mais
à 2-3 ans la baisse du chômage provoque des tensions sur les
salaires se traduisant par une hausse de l'inflation : celle-ci atteint 1 point
l'an entre la deuxième et la cinquième année dans le
scénario 1 ; 0,5 point l'an dans le scénario 2. Ces tensions ne
porteraient toutefois pas le taux d'inflation européen au-delà de
3 % à l'horizon 2005, compte tenu de la désinflation
tendancielle sous-jacente dans le compte central
37(
*
)
.
Dans le premier scénario, la dépréciation des monnaies
européennes vis-à-vis du dollar atteint 1 % l'an. Dans le
deuxième scénario, face à la baisse du chômage dans
un premier temps et à l'augmentation de l'inflation dans un second
temps, les banques centrales européennes augmentent les taux
d'intérêt. Cette hausse atteint 1 point au bout de deux ans, et
entraîne une appréciation des monnaies européennes (de
1,3 % à trois ans face au dollar et au yen). La hausse des taux
d'intérêt réels et celle du taux de change, en pesant sur
l'investissement, la consommation et le commerce extérieur, contribuent
à modérer l'impact expansionniste de la mesure.
Le déficit courant de l'UE se creuse de 0,3 point de PIB à trois
ans dans le deuxième scénario ; il reste longtemps stable dans le
premier en raison des gains de compétitivité de court-terme.
Cette dégradation des comptes extérieurs de l'UE n'est cependant
pas une source d'inquiétude : en effet, l'UE bénéficie en
1997 d'un excédent courant atteignant 1,4 % du PIB.
En raison de l'ampleur de l'effet multiplicateur provoqué par une
relance coordonnée en Europe, les rentrées fiscales
s'améliorent fortement. Dans le premier scénario, l'impact ex
post sur le solde public est positif dès la troisième
année et se stabilise à 0,4 point de PIB. Dans le second, le
déficit public se creuse légèrement, en raison d'une
croissance plus faible et de l'accroissement des charges d'intérêt
sur la dette publique. Le déficit des administrations publiques dans
l'UE est plus élevé de 0,8 point de PIB la première
année, et de 0,5 point les années suivantes.
Au total, si les autorités monétaires acceptent de ne pas
réagir, la mesure permet d'améliorer les finances publiques (de
0,5 point de PIB) et de réduire le chômage (de 1,5 point) au prix
d'une hausse de 1 point l'an de l'inflation. Si les autorités
monétaires réagissent, le chômage n'est réduit que
de 0,8 point, le solde public est dégradé (de 0,6 point de PIB),
mais l'inflation n'augmente que de 0,5 point.
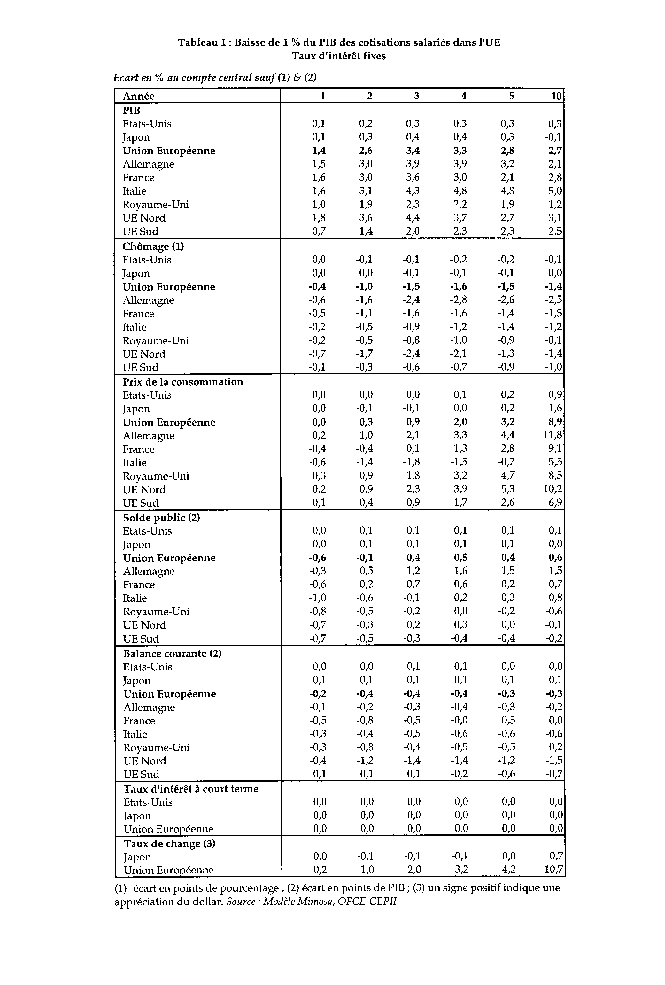
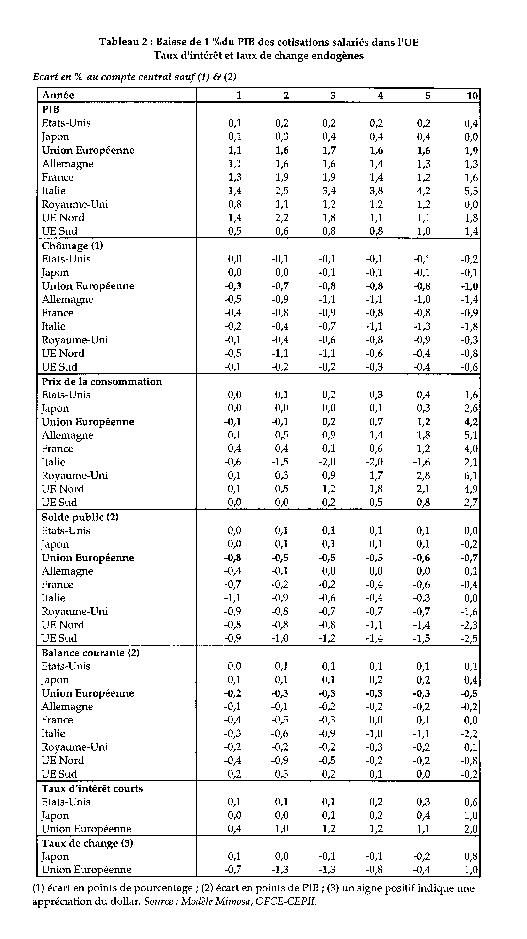
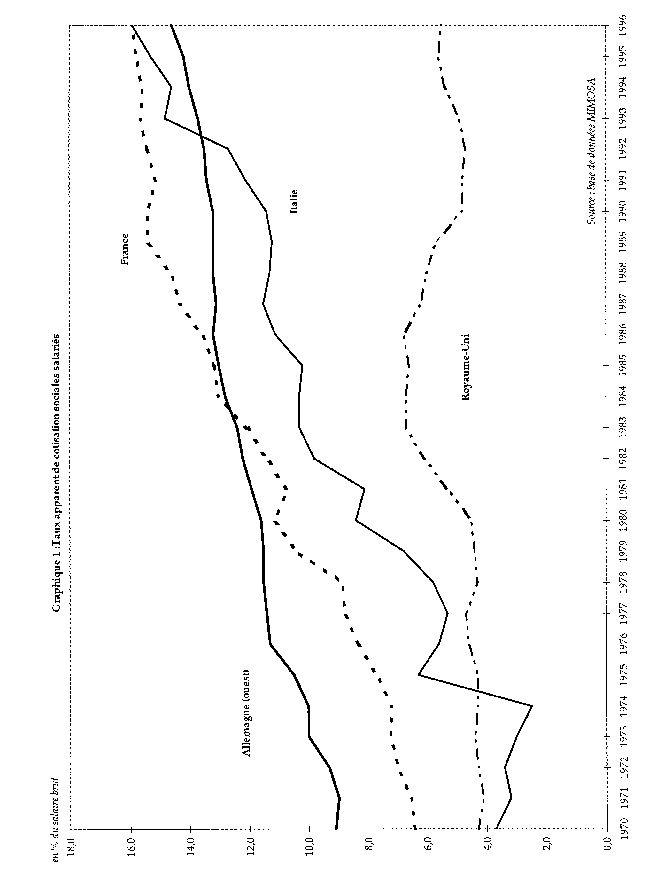
2. Une hausse des salaires en France et en Europe
Le niveau des salaires n'est certes pas une variable de politique
économique en France ou en Europe. Les pouvoirs publics ne peuvent fixer
que les salaires des fonctionnaires et parfois les salaires minimums ; or
l'évolution de ceux-ci ne peut socialement ou économiquement
s'éloigner nettement de celle de la moyenne des salaires fixés
par les négociations salariales ou les marchés. Cependant, il est
intéressant d'étudier les conséquences
macroéconomiques d'une hausse des salaires, en Europe ou dans un seul
pays, que celle-ci soit due à des mouvements sociaux ou à des
décisions de politiques économiques qui sont proches
macroéconomiquement d'une hausse des salaires (par exemple, hausse des
cotisations employeurs pour financer des hausses de prestations sociales).
Hausse des salaires en France
On suppose d'abord que le niveau des salaires augmente de 2 % uniquement
en France. La hausse des salaires exerce des effets contradictoires sur les
composantes de la demande interne en France. La hausse des revenus réels
des ménages accroît la consommation ; par contre la hausse des
prix, qu'engendre l'augmentation des coûts salariaux, se traduit par des
effets d'encaisse réelle qui obligent les ménages à
épargner. Au total, les effets revenus sur la consommation dominent les
effets d'encaisse réelle : la consommation augmente. L'investissement
privé subit un tassement du fait de la réduction des marges des
entreprises. L'inflation s'accroît de près de 0,5 point par an (le
niveau des prix est plus élevé de 2,4 % au bout de 5 ans)
avec un maximum de 0,8 point l'année où sont augmentés les
salaires. Les importations augmentent nettement en raison des pertes de
compétitivité et de la hausse de la demande interne, tandis que
les exportations se réduisent. La hausse du PIB est très faible
(0,2 % la première année, pratiquement rien par la suite) ;
les effets sur le chômage sont négligeables.
Evaluer les effets sur les taux d'intérêt et les taux de change de
la France d'une hausse des salaires en France dans le cadre du SME n'est
guère aisé. D'un côté certains pourraient croire que
la hausse des salaires ne permet pas à la France de maintenir fixe la
parité du Franc au sein dans la SME ; la hausse des salaires nuirait
à la crédibilité de la banque centrale , il y aurait des
anticipations de dépréciation qui obligerait la Banque de France
à fortement augmenter les taux d'intérêt. D'un autre point
de vue, la hausse des salaires ne dégradant pas trop les exportations et
les importations de la France, les tensions sur le Franc devraient être
limitées. Dans ce cas, la Banque de France peut maintenir un niveau de
taux d'intérêt proche de celui de la Bundesbank. C'est ce point de
vue que l'on a retenu. Dans ses conditions, le Franc reste stable et la France
connaît des pertes de compétitivité.
Une hausse simultanée des salaires en Europe
Si la hausse des salaires (toujours de 2 %) concerne tous les pays
européens, il faut distinguer le cas où la politique
monétaire est endogène du cas où les taux
d'intérêt nominaux restent fixes.
Dans le cas de taux d'intérêt fixes, le taux de change des
monnaies européennes se déprécie comme l'inflation en
Europe. La hausse des salaires dans toute l'Europe a un effet plus
expansionniste que dans les simulations d'une hausse limitée à la
France : à 3 ans le PIB est plus élevé de 1,1 %. Les
pertes de compétitivité sont annulées par la
dépréciation ; l'effet multiplicateur joue d'autant plus
fortement que l'Europe est une région relativement fermée. Par
contre, le niveau des prix est plus haut de 3,2 % à 5 ans ; ce
qui représente un surcroît d'inflation de 0,6 point par an. La
réduction du chômage est faible : en Europe la baisse du
chômage est au mieux de 0,4 point au bout de 3 ans. L'Italie et le
Royaume-Uni subissent, quant à eux, assez vite une légère
augmentation du chômage du fait de la substitution capital-travail : la
hausse des salaires incite les entreprises à réduire la demande
de travail et à augmenter la demande de capital. La balance courante se
dégrade légèrement de O,1 point. Le solde public
s'améliore en partie du fait de la baisse des taux
d'intérêt réels et du surcroît de croissance.
Si la politique monétaire est endogène, les effets sont fortement
altérés. La Bundesbank augmente les taux d'intérêt
courts de 0,6 à 0,7 point en raison de la baisse du chômage et de
la hausse de l'inflation. Malgré cette hausse des taux
d'intérêt par rapport aux Etats-Unis, les monnaies
européennes se déprécient (de 0,2 % la
première année à 1,7 % la 5è année).
Les marchés anticipent qu'à terme il faudra une
dépréciation pour garantir la compétitivité des
pays européens. Et c'est cet effet qui domine dès la
première année. Aussi les monnaies européennes se
déprécient très faiblement et cette
dépréciation s'accroît. La dépréciation est
toutefois plus faible que dans le scénario précédent.
Au total, la politique monétaire de la Bundesbank se traduit par une
hausse des taux d'intérêt qui vient limiter les effets de hausse
de la demande et la dépréciation des monnaies européennes,
ce qui limite l'inflation mais induit des pertes de
compétitivité. Le surcroît d'inflation n'est que de 0,4
point par an, par contre, la hausse du PIB n'est que de 0,4 % à 3
ans et la réduction du chômage n'est plus que de O,l %.
La hausse des salaires ne permet donc de réduire le chômage que si
la politique monétaire est accommodante, si elle accepte une hausse de
l'inflation et une dépréciation de la monnaie.
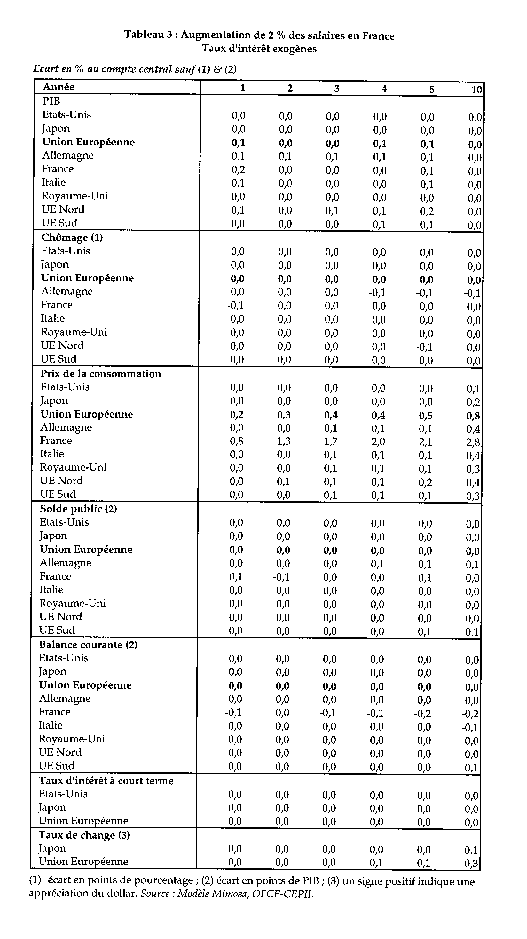
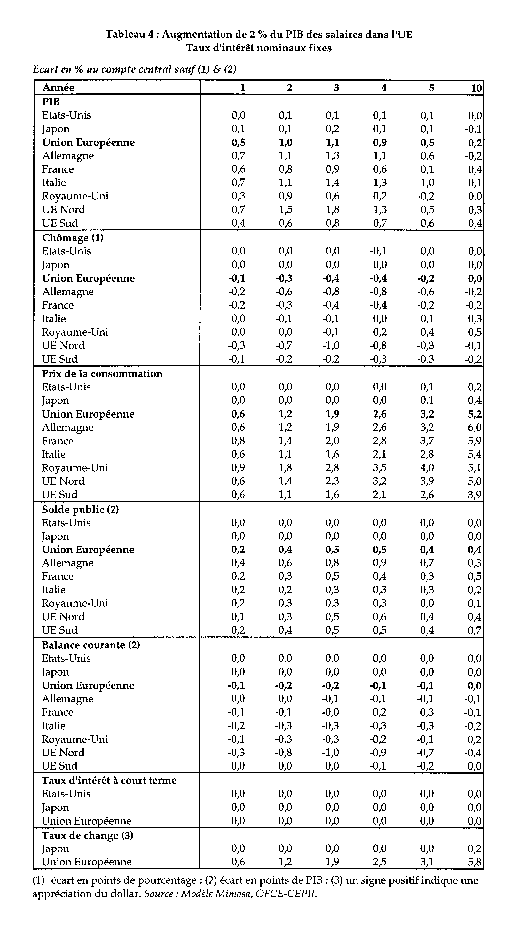
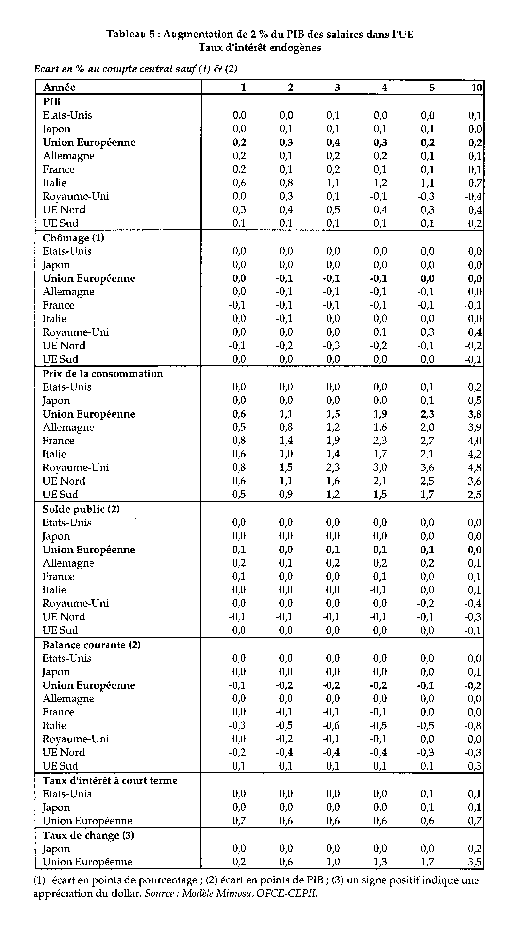
3. Une dépréciation des monnaies
européennes
Nous analysons ici les conséquences d'une dépréciation de
10 % des monnaies européennes vis-à-vis des autres monnaies.
Les variations de taux de change peuvent avoir des origines diverses. Elles
peuvent provenir par exemple soit d'une modification de la politique
monétaire, soit d'une modification des anticipations des marchés.
Dans le premier cas, une baisse des taux d'intérêt provoque une
dépréciation du taux de change. L'effet sur l'activité de
la baisse du taux de change est alors renforcé par la réduction
du taux d'intérêt. Mais il est ici difficile de distinguer
l'impact propre de la dépréciation. Dans le second cas, les
effets spécifiques du change sur l'économie sont mieux
isolés, puisqu'au départ seul le taux de change est
modifié. Les autorités monétaires peuvent toutefois
réagir en modifiant les taux d'intérêt. Ces derniers
rétro-agissent alors sur le taux de change. Afin d'appréhender
les mécanismes à l'oeuvre à la suite d'une
dépréciation de l'Euro, nous présentons deux variantes.
Dans la première, purement technique, les taux d'intérêt
nominaux restent inchangés ; les taux de change sont fixes après
la dépréciation. La variante permet donc d'étudier l'effet
pur de la dépréciation. Dans la seconde, les politiques
monétaires sont endogènes. La BCE fixe le taux court sur l'Euro
en fonction de l'évolution de l'inflation et du chômage de l'Union
monétaire ; le taux de change nominal évolue selon les
écarts de prix et de taux d'intérêt. L'hypothèse
technique faite ici est que la Grande-Bretagne reste en dehors de l'Euro (ainsi
que la Grèce, la Suède et le Danemark) ; par contre, la monnaie
de ces pays se déprécie comme l'Euro.
Une variante technique
Considérons tout d'abord le cas où les taux
d'intérêt nominaux restent fixes. La dépréciation de
l'Euro procure aux pays de l'UE des gains de compétitivité
à court terme qui stimulent leurs exportations et pèsent sur
leurs importations. L'augmentation de la demande satisfaite par les producteurs
européens conduit à un ajustement à la hausse des
capacités de production. L'investissement productif progresse fortement
les trois premières années. et le gain pour l'UE en termes de
production atteint un maximum au bout de trois ans (+I,9 %).
Par la suite, la diffusion de la hausse du prix des importations dans les
économies européennes tend à limiter les gains de
compétitivité. Les prix à la consommation sont plus
élevés d'environ 3,8 % au bout de 5 ans, soit une inflation
supérieure de près de 0,8 point par an. La hausse des prix de
l'UE et les baisses de prix aux Etats-Unis et au Japon limitent la
dépréciation du taux de change réel de l'Euro, qui n'est
plus que d'environ 5 % au bout de 5 ans. L'augmentation des exportations
de l'UE, qui atteint 3 % au bout de trois, n'est plus que de 0,9 % au
bout de 5 ans. La relance de l'activité entraîne une hausse des
importations à court terme (1,8 % à 3 ans), mais ensuite
l'effet-prix l'emporte de sorte qu'à 5 ans les importations baissent
légèrement (de 0,3 %). Au bout de 5 ans, le surplus de
production dans l'UE n'est plus que de 0,3 %, et il s'annule au bout de 10
ans.
Le ralentissement des exportations européennes est également
lié à la baisse de la production aux Etats-Unis et au Japon,
où la dépréciation de l'Euro a des effets inverses sur la
compétitivité. L'impact dépressif sur l'économie
américaine apparaît relativement limité à court
terme, si bien qu'au cours des trois premières années la
production mondiale augmente un peu (0,5 % à 3 ans). A plus long
terme, la dépréciation de l'Euro n'a pas d'impact sur le PIB
mondial.
Au total, l'impact d'une dépréciation de 10 % de l'Euro est
maximum au bout de trois ans. A cet horizon, le PIB de l'UE est plus important
de 1,8 %, et le taux de chômage est plus bas d'environ 1 point.
Enfin, le solde courant de l'UE s'améliore durablement de 0,3 point de
PIB, au détriment de ceux des Etats-Unis et du Japon (respectivement
pour 0, 1 et 0,2 point de PIB).
Lorsque les politiques monétaires et les taux de change sont
endogènes
Les banques centrales fixent les taux d'intérêt à court
terme en fonction de l'inflation et du chômage selon la règle
décrite précédemment. Par ailleurs, les marchés
anticipent que le taux de change réel de l'Euro s'est
déprécié de 10 %. L'inflation en Europe qui suit la
dépréciation de l'Euro se traduit donc par de nouvelles
dépréciations de l'Euro. La dépréciation de
10 % du taux de change nominal provoque donc une
dépréciation durable du taux de change réel.
Les autorités monétaires réagissent à l'effet
expansionniste en Europe et récessif aux Etats-Unis et au Japon :
dès la première année, le taux court européen
augmente de 1 point et le taux court américain baisse de 0,4 ; au Japon,
le taux court diminue très progressivement (de 1 point à terme).
L'action des banques centrales réduit sensiblement les effets sur
l'activité à court terme : le PIB européen n'augmente que
de 0,4 % au bout de trois ans.
Mais le taux de change subit deux forces contradictoires. D'une part,
l'évolution des taux d'intérêt tend à limiter la
dépréciation de l'Euro. D'autre part, les agents anticipent que,
compte tenu de la hausse des prix européens, l'Euro devra se
déprécier. Dès la deuxième année, c'est ce
dernier effet qui domine, si bien que l'impact positif sur la production
européenne est plus durable : le PIB de l'UE augmente de 0,6 % au
bout de 5 ans, et de 0,3 % à un horizon de 10 ans. De la même
manière, l'impact récessif chez les principaux partenaires
commerciaux est plus marqué à terme, notamment au Japon où
la forte baisse des prix entraîne l'appréciation continue du taux
de change nominal du yen.
Au total, la prise en compte de la politique monétaire atténue
l'impact d'une dépréciation de l'Euro. A court terme, l'effet
positif sur l'activité européenne est nettement moindre. Par
contre, la dépréciation continue du taux de change nominal de
l'Euro renforce l'impact de moyen terme. L'inflation est
légèrement plus forte en Europe ; l'amélioration du solde
extérieur est plus durable ; enfin, le solde public est moins
amélioré en raison de la hausse des taux d'intérêt.
L'Europe étant une zone relativement fermée, l'impact de son taux
de change sur son niveau d'activité et son inflation est réduite,
ce d'autant plus que la BCE réagit à une hausse de l'inflation.
Là encore, le bas niveau d'inflation et le fort niveau de chômage
en Europe actuellement permettent de penser que l'effet inflationniste sera
réduit et donc que la réaction de la BCE pourrait être
atténuée.
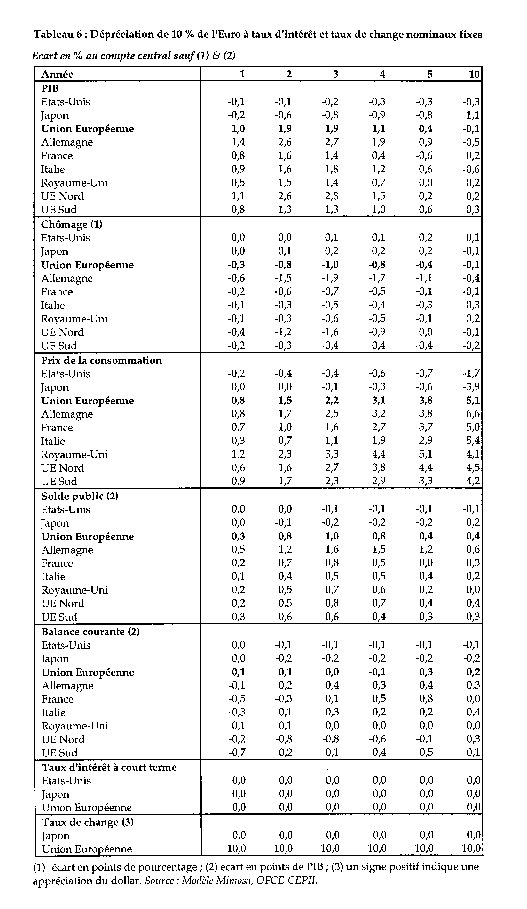
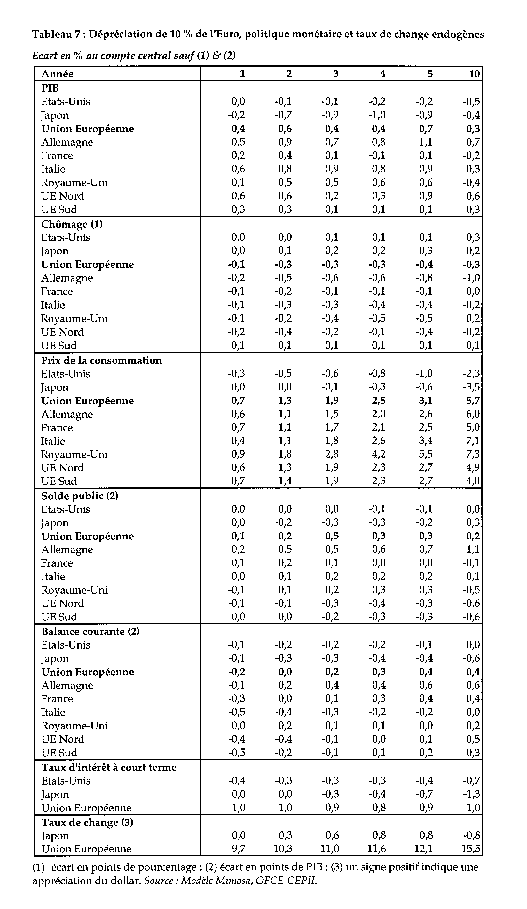
ANNEXE N° 3
LES DIFFICULTÉS DE
MESURE ET DE COMPARAISON
DE LA DURÉE DU TRAVAIL
A. LES PRINCIPAUX INDICATEURS DE LA DURÉE DU TRAVAIL EN FRANCE
· Dans le cadre de son enquête annuelle sur
l'emploi, l'INSEE demande aux personnes interrogées leur durée de
travail effective lors de la semaine précédant l'enquête,
ainsi que leur durée habituelle de travail.
Selon l'INSEE, la
durée habituelle
de travail des salariés
à temps complet, hors enseignants, s'établit ainsi à
41
h 05
par semaine
.
|
DURÉE
HEBDOMADAIRE HABITUELLE DE TRAVAIL EN 1995
|
||||
|
|
Salariés à temps complet |
Ensemble des salariés |
||
|
- Cadre, professions
intellectuelles
1
|
44,8
|
43,2
|
||
|
1. Hors
enseignants.
|
||||
Par ailleurs, la durée habituelle de travail moyenne
des agriculteurs exploitants serait identique à celle des artisans,
commerçants et chefs d'entreprise : 51,3 heures. Au total,
compte tenu des enseignants, la durée habituelle de travail des actifs
occupés était de 38,4 heures par semaine en 1995.
· A partir des résultats de l'enquête emploi et des
enquêtes du ministère de l'Emploi
38(
*
)
, les
comptables nationaux de l'INSEE élaborent
depuis 1970 des séries de
durée annuelle
du
travail :
- une
durée annuelle effective
, par branche, pour l'ensemble des
salariés
. Cette durée annuelle effective
s'établirait à
1529 heures
en 1996. Elle tient compte
du nombre de journées non travaillées pour cause de
congés, d'intempéries, de maladie ou de grève, ainsi que
du travail à temps partiel (l'adjonction des salariés à
temps partiel - 16 % de la population active en 1997 - faisant baisser
d'environ 8 % la durée effective annuelle moyenne) ;
- une
durée annuelle effective
pour l'ensemble des
actifs
(
1645 heures en 1996
). L'écart entre ce chiffre et le
précédent résulte notamment de l'adjonction des
indépendants, dont la durée de travail effective moyenne est plus
élevée, ainsi que de l'ajout d'une estimation du travail au noir.
B. LES INCERTITUDES DE LA MESURE DE LA DURÉE DU TRAVAIL
La mesure de la durée du travail est traditionnellement
délicate en raison notamment :
- des
variations conjoncturelles
de la durée du travail, sous les
effets du climat, de l'activité économique et du
calendrier
39(
*
)
;
- des difficultés de mesure des
heures supplémentaires
effectives, notamment pour les cadres et les salariés à temps
partiel. Celles-ci varient, en effet, du simple au double selon qu'est retenu
le point de vue des employeurs ou celui des salariés ;
- des difficultés de mesure du temps de travail des
indépendants
et de certaines professions, comme les enseignants
ou les professions pour lesquelles le code du travail a institué des
régimes d'équivalence en matière de durée du
travail pour tenir compte de périodes d'inactivité
(hôtellerie, transport routier, agriculture), si bien que le temps de
présence légal y est très nettement supérieur
à 39 heures.
· Par ailleurs, alors qu'on assistait jusqu'au début des
années 1980 à un double mouvement de
convergence
et
d'
uniformisation
de la durée hebdomadaire du travail autour de la
durée légale (ramenée de 40 heures à 39 heures
par semaine en 1982), cette évolution s'est inversée sous les
effets des
aspirations différenciées des salariés
,
comme du développement de nouvelles formes d'
organisation des
entreprises
. Plusieurs phénomènes concourent ainsi à
rendre la mesure de la durée du travail de plus en plus difficile :
- L'
individualisation
croissante des temps de travail, sous la forme
notamment du développement du travail à temps partiel, comme de
l'extension des horaires mobiles (23 % des salariés en 1995, contre
11 % en 1978) .
- Le développement progressif de la modulation et de l'annualisation du
temps de travail, qui se traduit par une irrégularité croissante
de la journée et de la semaine de travail.
- La
sensibilité
croissante de la durée du travail
effective à la conjoncture économique, via les heures
supplémentaires et un recours plus important au chômage
partiel
40(
*
)
.
- Le creusement des
disparités
de temps de travail entre les
différentes catégories de travailleurs. Entre 1985 et 1995 le
temps de travail habituel des cadres et des agents de maîtrise s'est
ainsi accru, tandis que celui des autres catégories professionnelles
tendait à se réduire, ce phénomène reflétant
l'inégale diffusion du temps partiel.
Au total, la part des actifs déclarant travailler plus de 45 heures
par semaine serait ainsi passée de 15,4 % en 1983 à
22,6 % en 1995, selon l'INSEE, cependant que la part des salariés
à temps partiel (moins de 32 heures hebdomadaires) dans l'emploi
total serait passée de 9,6 % en 1983 à 16 % en 1996. La
relative stabilité des durées du travail mesurées par
l'INSEE et la DARES
41(
*
)
dissimule donc des
situations individuelles de plus en plus hétérogènes, ce
qui tend à altérer la fiabilité et la signification des
indicateurs de la durée moyenne du travail.
C. LA SIGNIFICATION DE LA DIMINUTION DE DURÉE DU TRAVAIL TEND À SE BROUILLER
Historiquement, le concept de durée du travail est
lié au développement du salariat traditionnel,
c'est-à-dire du passage d'un travail orienté à la
tâche vers un travail mesuré par le temps et organisé selon
des horaires collectifs.
Ce concept est désormais brouillé par
l'interpénétration croissante entre travail et non-travail,
c'est-à-dire l'atténuation de la
frontière entre
travail et non-travail
à l'échelle de la semaine, de
l'année, comme de la vie, en raison du développement de la
formation professionnelle (incluse dans le temps de travail effectif), comme
des efforts d'autoformation des salariés (qui n'y sont pas inclus), des
stages, des astreintes (télétravail, travail sur appel, travail
fractionné), des formules de temps partagé (préretraite
progressive, temps partiel), etc.
Par ailleurs, les mesures actuelles de la durée du travail ne peuvent
rendre compte de l'importance du travail dans la vie des actifs. La
durée effective du travail ne prend ainsi pas en compte le travail
domestique, ni les
temps d'occupation induits
par le travail : temps
passé dans l'entreprise et non inclus dans le temps de travail effectif,
comme les pauses, l'habillage, etc., temps de transports
42(
*
)
.
Enfin, les statistiques synthétiques de la durée du travail ne
rendent pas compte de l'évolution de l'
intensité du
travail
, ni de celle des effets de l'
organisation
du travail, alors
que les enquêtes de l'INSEE et de la DARES, suggèrent " la
perception par les salariés d'une intensification du travail depuis le
milieu des années 1980 et plus généralement d'un
accroissement des contraintes de temps qui pèseraient sur eux, à
travers des délais à la fois précis et
serrés "
43(
*
)
. De même, les
statistiques relatives à l'étendue de la journée de
travail, qui mesure le temps passé entre le début et la fin de la
journée de travail, (pauses et temps du déjeuner inclus), et est
un indicateur du temps contraint par le travail, suggèrent que la part
des salariés ayant de longues journées augmente, surtout parmi
les cadres : pour 18 % d'entre eux l'étendue de la durée du
travail excédait 11 heures en 1991.
D. LA PERTINENCE DES INDICATEURS DE LA DURÉE DU TRAVAIL DES SEULS ACTIFS DOIT ÊTRE RELATIVISÉE
La durée hebdomadaire ou annuelle des seuls actifs
occupés reflète mal la
mobilisation des capacités de
travail
d'une Nation. En effet, les indicateurs actuels de la durée
du travail ne tiennent pas compte de la forme extrême de partage du
travail que constitue le chômage. De même, les pays occidentaux se
caractérisent par des écarts de
taux d'activité
(ratio population active/population en âge de travailler)
considérables -de 58 % en Italie à 80 % au Danemark-,
dont les indicateurs habituels de durée du travail ne rendent pas
compte. Pour évaluer la mobilisation des capacités de travail
d'une Nation, il est ainsi souhaitable de combiner les indications fournies par
la proportion de personnes en âge de travailler qui occupent
effectivement un emploi - le "
taux d'emploi
" - et
par leur
durée moyenne de travail (cf. tableau ci-après).
Par ailleurs l'augmentation de l'
espérance de vie
, la tendance
à l'allongement de la formation initiale, à la multiplication
d'itinéraires complexes en fin de vie active et le développement
de dispositifs favorisant à tous les âges des aller-retour entre
activité et non-activité (congé parental
d'éducation, compte épargne temps, congés de longue
durée, formations en alternance), invitent à appréhender
le temps de travail sur l'ensemble du
cycle de vie
. Le calcul et
l'interprétation des indicateurs du temps de travail sur l'ensemble du
cycle de vie sont toutefois extrêmement complexes, en raison des
effets de génération
. Par exemple, les nouveaux
retraités actuels sont le plus souvent entrés très jeunes
dans la vie active, cependant que les jeunes actifs d'aujourd'hui entreront
probablement en retraite à un âge plus avancé que leurs
aînés.
E. LES COMPARAISONS INTERNATIONALES DE LA DURÉE DU TRAVAIL SONT DIFFICILES
Alors que les instituts statistiques nationaux se sont
efforcés d'harmoniser leurs définitions du chômage, du PIB,
etc., il n'existe pas de
définition universelle
de la
durée du travail. Ainsi, les pauses, la formation, les temps syndicaux,
les astreintes, les heures supplémentaires, sont intégrés
de manière divergente dans les indicateurs de la durée du
travail, en fonction le plus souvent des spécificités des droits
du travail nationaux. En outre, les comparaisons internationales peuvent
être biaisées par des divergences de méthodologie
statistiques
44(
*
)
. Au total, l'OCDE, qui recense
des données nationales sur la durée du travail
présentées ci-après, précise que ces données
" visent à effectuer des comparaisons de tendance dans le temps ;
en revanche, à cause de la disparité des sources, elles ne
permettent pas des comparaisons en niveau "
45(
*
)
.
Toutefois, l'Office statistique des Communautés européennes,
EUROSTAT
, conduit des enquêtes sur les conditions de travail de
manière identique dans l'ensemble des pays de l'Union européenne,
et propose ainsi, pour ces pays, des estimations comparables de la durée
du travail, présentées ci-après.
· Par ailleurs, la diversité des durées du travail
observées reflète la diversité des réalités
institutionnelles, économiques et sociales selon des mécanismes
difficiles à appréhender.
Ainsi, la durée effective du travail est susceptible de variations
importantes au cours du
cycle économique
. De même, le
nombre de
congés maladie
déclarés varie dans les
pays de l'OCDE dans une proportion de 1 à 7 en fonction de
l'organisation des systèmes d'assurance maladie, la France se situant
sur ce point dans la moyenne. Enfin, la durée annuelle du travail
reflète très largement le poids relatif des différents
secteurs
dans l'économie
46(
*
)
, la
part de
l'emploi indépendant
47(
*
)
,
le développement de l'
emploi féminin
48(
*
)
, l'inégale diffusion du temps partiel, le
rôle de la formation en alternance, des préretraites partielles,
etc.
Au total, selon qu'on l'effectue sur la semaine, sur l'année ou sur
l'ensemble de la vie active, la comparaison internationale de la durée
du travail aboutit à des diagnostics différents. Il est donc
nécessaire de recourir à l'ensemble des indicateurs du
marché du travail recensés ci-après : taux
d'activité en fonction de l'âge, part de l'emploi à temps
partiel, taux de chômage, dispersion des temps de travail individuel,
temps de travail sur le cycle de vie, etc.
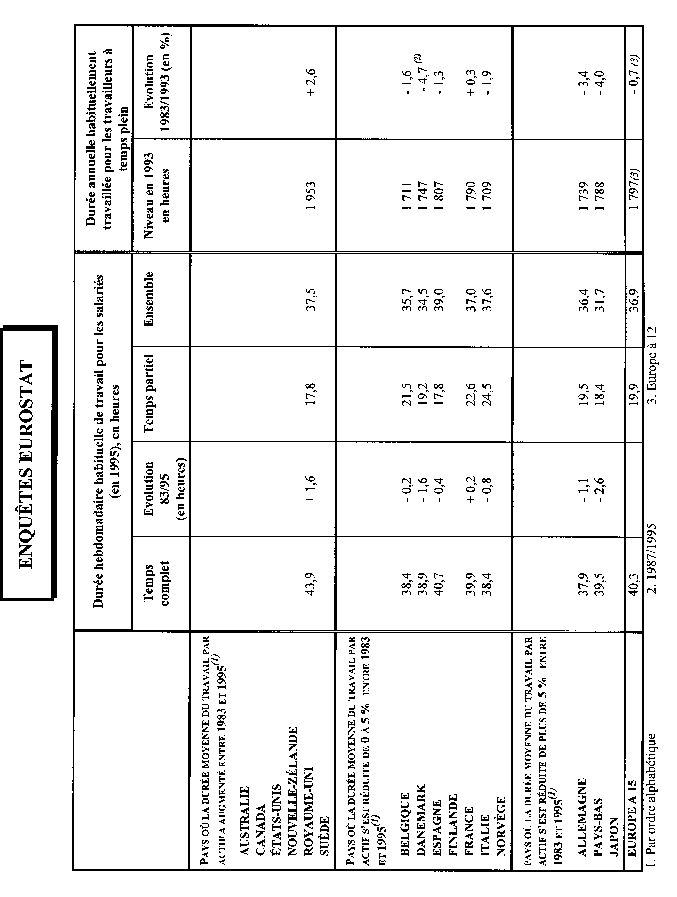
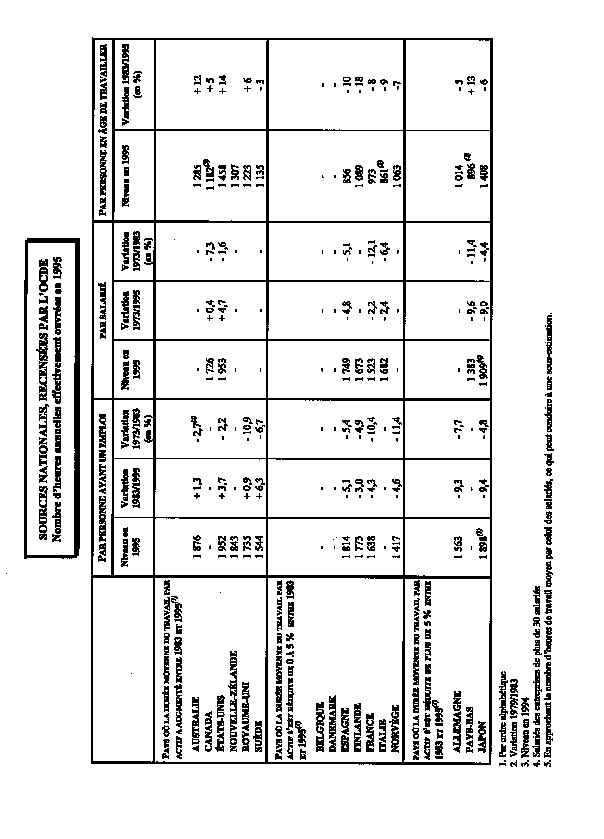
1
Le taux de croissance potentiel peut être
défini comme celui que peut " supporter " une économie
sans tensions inflationnistes.
2
Voir Note n° 29 du 22 mai 1997 du
Département des Etudes Economiques d'Ensemble de l'INSEE.
3
Il faudrait ajouter que l'INSEE calcule cette balance commerciale
structurelle en neutralisant les effets du dynamisme de la demande mondiale
adressée à la France, consécutif à
l'émergence des pays non industrialisés.
4
Voir note n° 31 du Département des Etudes
Economiques d'Ensemble du 22 mai 1997.
5
Il faut en effet rappeler, certes de manière approximative,
que lorsque le salaire par tête évolue comme la
productivité, la masse salariale totale (salaire par tête x
effectifs) évolue comme le PIB (productivité x effectifs) et le
partage de la valeur ajoutée est stabilisé.
6
Bien que les pouvoirs publics fixent les salaires
des fonctionnaires et les salaires minimums, les évolutions salariales
ne résultent pas de décisions de
politique économique
(sauf à imaginer une mesure de hausse des cotisations employeurs
servant à financer des augmentations de prestations sociales). Il est
cependant intéressant de simuler les effets des hausses de salaires
pouvant résulter des négociations salariales.
7
Encore le modèle ne met-il pas en évidence
d'accélération de la substitution du capital au travail en cas
d'augmentation des salaires. On peut donc supposer que les effets sur l'emploi
de la mesure seraient plus défavorables en réalité que ce
que décrit le modèle.
8
La croissance potentielle est définie ici comme celle
permettant la stabilisation du taux de chômage.
9
Voir notamment le Rapport d'information n° 65
SÉNAT (1995-1996) présenté par
M. Bernard BARBIER au nom de la Délégation pour la
Planification.
10
Comme le montre un calcul arithmétique rapide, le
déficit public qui stabilise le ratio dette/PIB est tel que
l'accroissement de la dette qu'il entraîne et l'accroissement du PIB sont
proportionnels au ratio initial dette/PIB. On calcule ainsi le déficit
stabilisant la dette, égal au taux de croissance en valeur du PIB (soit
3,7 % dans la projection) x le ratio de dette initial (soit 57 % en
1997) = 2,1 %.
11
Les actes de ce Colloque figurent dans le rapport
d'information SÉNAT (1996-1997) n° 315 "
Perspectives
de l'économie mondiale à l'horizon 2005
",
présenté au nom de la Délégation pour la
Planification par M. Bernard BARBIER.
12
Depuis la crise financière de la fin octobre, la
parité dollar/franc paraît se stabiliser autour de 5,75 F.
13
En effet, si le potentiel de croissance de l'économie
américaine est, en terme nominal, de 5 % (2,4 % de croissance
en volume, + 2,6 % d'inflation) l'endettement extérieur des
Etats-Unis peut être
stabilisé
sur la base du besoin du
financement actuel de l'économie américaine (soit 2 % du
PIB), donc du taux de change actuel du dollar. En effet si le
PIB = 100, la dette extérieure = 40, avec une croissane
nominale du PIB de 5 % et un besoin de financement de la Nation de
2 %, la dette extérieure devient
42
= 40 %.
105
14
Article 109, alinéa 2 :
"
En l'absence d'un système de taux de change vis-à-vis
d'une ou de plusieurs monnaies non communautaires au sens du paragraphe 1, le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée soit sur
recommandation de la Commission et après consultation de la BCE, soit
sur recommandation de la BCE, peut formuler les orientations
générales de politique de change vis-à-vis de ces
monnaies. Ces orientations générales n'affectent pas l'objectif
principal du SEBC, à savoir le maintien de la stabilité des
prix.
"
15
En effet, le Danemark, la Norvège et la
Suède se caractérisent par des taux d'emploi très
élevés (de 73,5 % à 75 %), la forte diffusion du
temps partiel, une productivité élevée et une durée
du travail par actif occupé relativement faible, ces
caractéristiques s'expliquant pour partie par une structure d'emploi
particulière (faible part de l'agriculture, prépondérance
des services et des industries à haute valeur ajoutée, importance
de l'emploi féminin).
16
Cf. sur ce point, le rapport du groupe de travail du Plan
présidé par notre collègue Joël BOURDIN
"
Démographie, développement économique et
finances publiques
", 1996.
17
Cf. notamment l'Avis du Conseil économique et social des
12-13 avril 1994, préconisant une gestion différente de
l'articulation entre les différentes périodes d'activité,
afin de les rendre moins étanches les unes aux autres, ou le rapport
publié en 1996 par l'OCDE "
Pour un vieillissement
actif
".
18
L'utilisation des congés parentaux demeure faible, de
l'ordre de 10 % des familles concernées, contre la
quasi-totalité des familles en Allemagne, en Finlande, en Norvège
et en Suède.
19
Rapport de Pierre CABANES sur l'aménagement
et la réduction du temps de travail en introduction à la
rencontre tripartite du 8 juillet 1996 (Gouvernement et partenaires
sociaux).
20
En effet, 100 salariés x 39 heures = 111 salariés
x 35 heures.
21
Cf. sur ce thème, Jacques FREYSSINET,
Le temps
de travail en miettes
, 1997.
22
Direction de l'Animation de la Recherche, des Etudes et
des Statistiques du ministère de l'Emploi et de la Solidarité
(Liaisons sociales Documents n° 67/96, 1996).
23
Sous l'hypothèse d'une augmentation de 20 % de la
durée moyenne du travail des salariés à
temps
partiel contraint.
24
Cf. Lettre de l'OFCE, juillet 1997.
25
Jacques FREYSSINET, Directeur de l'Institut de Recherches en
Economie Sociale, In
Le temps de travail en miettes,
1997.
26
En effet, 47 semaines x 4 heures égalent 168 heures.
27
La projection a été réalisée avant la
crise financière asiatique de la fin du mois d'octobre.
28
Voir Rapport d'information Sénat n° 315,
1996-1997, présenté au nom de la Délégation pour la
Planification par M. Bernard BARBIER.
29
Les gains de productivité annuels entre 1974 et 1989
étaient de 2,3 % en moyenne, puis de 1,5 % en moyenne entre
1990 et 1996.
30
On observe une relation inverse entre salaires et
niveau de chômage - ou " Courbe de Phillips " -
dans
tous les modèles macroéconomiques.
31 En prenant les prix du PIB comme déflateur.
32
En prenant les prix du PIB comme
déflateur.
33
Dans les définitions de la comptabilité nationale,
il s'agit essentiellement des dépenses
hospitalières hors
dépenses de personnel et d'investissement.
34
Ces mesures sont contenues dans la loi du 22 juillet 1993
sur la sauvegarde de la protection sociale.
35
Ces dépenses sont considérées en
Comptabilité nationale comme des prestations sociales. Il s'agit
toutefois de prestations sociales versées par l'Etat et non par les
organismes de Sécurité sociale.
36
Voir: Coquet B. et H. Le Bihan, 1996: " La boucle
prix-salaires dans MIMOSA ",
Document de travail MIMOSA
n° M-96-03,
novembre.
37
Voir: MIMOSA, 1997 : " La croissance est ailleurs
", in
Perspectives de l'économie mondiale à l'horizon 2005
,
Rapport du Sénat n °315, mars.
38
Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité
réalise chaque trimestre une enquête auprès des
établissements de plus de dix salariés des secteurs
marchands non agricoles sur l'activité et les conditions d'emploi de la
main-d'oeuvre, dite enquête ACEMO. Cette enquête permet d'estimer
une durée hebdomadaire " offerte " du travail, qui
représente d'une certaine manière le point de vue des employeurs
sur la durée du travail à temps complet des salariés non
cadres. Depuis 1983 cette durée hebdomadaire offerte est quasiment
stable à 39 heures par semaine, car cette statistique ne tient pas
compte du temps partiel et prend peu en compte l'impact de mécanismes
tels que le chômage partiel et les heures supplémentaires.
39
Par exemple, une année bissextile accroît la
durée du travail effective annuelle d'environ
0,3 %, cette
variation étant de même ordre de grandeur que l'évolution
tendancielle de la durée du travail
40
L'augmentation du nombre de journées de chômage
technique indemnisées de 2 millions en 1990 à
12 millions en 1993 s'est ainsi traduite par une baisse de près
d'une demi-heure par semaine de la durée effective du travail dans
l'industrie.
41
Direction de l'Animation de la Recherche, des Études et
des Statistiques du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité.
42
Selon les enquêtes de l'INSEE, ceux-ci seraient en
augmentation et représenteraient en moyenne 1 h 20 par jour en
Ile-de-France et 0 h 50 ailleurs.
43
"
La réduction du temps de travail
"
INSEE-Liaisons-Sociales-DARES, 1997.
44
Par exemple, un changement de méthode statistique de
référence a conduit l'OCDE à réviser en 1996 la
durée du travail aux États-Unis à la hausse de plus de
160 heures par an (+ 9 %).
45
OCDE,
Perspectives de l'emploi
, juillet 1997.
46
Ainsi, la durée habituelle moyenne du travail est
significativement plus longue dans l'agriculture (de 41,8 heures par
semaine en Italie, à 60,3 heures par semaine en Irlande
-48,4 heures pour la France en 1990 selon EUROSTAT) ce qui influence
d'autant plus la durée globale du travail que le poids de l'agriculture
dans l'emploi est élevé : la prise en compte de l'emploi agricole
augmente la durée moyenne du travail de 0,5 % en Italie, 0,6 %
au Royaume-Uni, 1,6 % en France et de 7 % en Irlande.
47
La part des emplois indépendants dans l'emploi total
varie de 1 à 4 en Europe (de 11 % en Allemagne à 48 %
en Grèce en 1990, la France se situant, avec 16 %,
légèrement en deçà de la moyenne européenne).
48
Selon une étude de la Direction de la Prévision,
"
Le temps de travail un concept de plus en plus
complexe
",
Yves GUEGANO, Économie et Prévision n° 115, 1994,
"
l'Italie affiche ainsi une durée hebdomadaire du travail
supérieure à la moyenne de l'Union européenne
principalement parce que l'emploi féminin y est très peu
développé : les hommes travaillent moins longtemps dans la
semaine qu'un Européen en moyenne, mais ils occupent plus de 65 %
des emplois, contre 60,7 % en moyenne dans l'Union européenne
à douze
".







