B. La dynamique Internet
1. Une cadence stupéfiante
Le rythme de développement d'Internet est véritablement phénoménal !
On connaissait la loi de Moore en vertu de laquelle la vitesse des microprocesseurs double tous les 18 mois. Internet fait mieux : le nombre de ses usagers double tous les ans. Il est, actuellement, de l'ordre d'une cinquantaine de millions de personnes. Il est bien évident, dans ce cas du téléphone, que plus un réseau est développé, plus son intérêt pour l'usager est grand. C'est le même cas pour Internet.
La quantité de contenus véhiculée par Internet se développe plus vite que l'évolution du nombre d'utilisateurs même sans aller jusqu'à souscrire à la loi de Metcalfe qui estime que cet intérêt est proportionnel au nombre des connexions bilatérales possibles, c'est-à-dire le carré du nombre d'usagers.
Comme le nombre de clients, le nombre de serveurs double, lui aussi, approximativement chaque année (il y en avait plus de 6,5 millions en juillet 1995, selon l'AFTEL). Mais certains indicateurs (nombre de domaines répertoriés, quantité de serveurs commerciaux...) font état d'une croissance, à certains égards, encore plus rapide.
2. Des défis relevés
Cet essor spectaculaire d'Internet conduit à des défis : :
• il faut éviter que les infrastructures soient saturées ;
• l'usager doit pouvoir gérer les masses de données disponibles.
• Sur le premier point ( adaptation de la contenance des structures du réseau ), le financement d'une multiplication par plus de 10.000 des capacités des grandes artères a pu être assuré (selon The Economist du 19 octobre 1996) par l'explosion du nombre d'abonnements.
L'efficacité de la méthode de transmission par paquets et l'amélioration des techniques de recherche des données (voir plus loin) ont contribué également à maîtriser le trafic. Il reste que le rythme de croissance de l'utilisation du réseau excède celui du progrès des capacités des composants des routeurs. Or, selon The Economist , c'est précisément aux intersections que se produisent les embouteillages.
Les universitaires américains et les grands opérateurs privés des États-Unis se réunissent le 22 janvier à San Francisco. Une centaine de structures universitaires sont impliquées et financent 25.000 dollars par an pendant 5 ans pour développer un nouveau système performant Internet 2 qui devrait voir le jour en 1998.
Plusieurs solutions (en partie déjà évoquées) sont possibles pour décongestionner le réseau :
• superposer aux infrastructures actuelles des superstructures à haut débit, dédiées aux applications les plus consommatrices de bande passante (réseaux de recherche, Intranet d'entreprises...). Le caractère fédérateur des protocoles de transport et de routages TCP/IP permettrait de relier ces super réseaux à Internet par des passerelles ;
• répartir sur un grand nombre de serveurs (serveurs miroirs locaux) les demandes les plus fréquentes ;
• substituer à l'actuel système d'abonnement forfaitaire une nouvelle tarification basée sur les coûts d'usage réels, les degrés de priorité du trafic ou la consommation en bits ;
• enfin, perfectionner le protocole d'Internet (IP) qui permet aux ordinateurs du monde entier de communiquer et d'échanger des données.
Dans son ouvrage Et Dieu créa Internet , Christian Huitema, Président de l'IAB (Internet Activities Board) annonce qu'une nouvelle version de ce protocole (IPv6) a été mise au point. Elle comporte à la fois des simplifications [27] et de nouvelles fonctions (en particulier en matière de sécurité) grâce à un quadruplent de la taille des adresses (désormais codées sur 128 bits).
• Le deuxième défi ( éviter la submersion de l'usager par le flot d'informations accessibles ) a pu également être relevé, grâce à de nouveaux langages et programmes informatiques :
• Tout d'abord, le langage HTML [28] permet de trouver des éléments recherchés, relatifs à un sujet donné, dans des bases de connaissance de la totalité des documents concernés. Ceci est rendu possible par une indexation à base de références ou mots clés, qui crée des liens associatifs entre fragments de différents ouvrages, donnant ainsi à l'utilisateur la possibilité d'aller chercher directement l'extrait qui l'intéresse et de passer très rapidement d'une donnée à une autre.
• Les navigateurs [29] . Ce sont des logiciels installés dans le terminal de l'utilisateur, pratiquent le langage HTML pour aller chercher ces informations dans différents serveurs. Les deux actuellement les plus utilisés et connus sont Navigator de Netscape (80 % du marché) et Explorer de Microsoft.
Les prochaines versions des logiciels de navigation devraient être encore enrichies de nouvelles fonctions d'administration, de sécurité et de travail de groupe.
• Les moteurs de recherche (ou glaneurs) sont capables de s'acquitter d'une tâche plus ardue que les navigateurs : trouver, pour y accéder, les adresses d'objets dont on connaît seulement le contenu.
Les deux plus connus sont Alta Vista , le plus puissant mis au point par Digital Equipment, et Yahoo , inventé par des étudiants de l'université de Stanford.
Alta Vista permet de fouiller 22 millions de sites au rythme de 30 pages par seconde (16 millions de pages indexées), ce qui lui permet de parcourir la totalité d'Internet en une dizaine de jours.
Il constitue ainsi un immense index des endroits où existent des références au thème de la recherche effectuée et procède ensuite à des interrogations pertinentes.
Yahoo , pour sa part, choisi par France Télécom, avait indexé, en septembre 1995, 60.000 sites classés en 10.000 catégories et cherche à affiner les techniques de questionnement de façon à en lever certaines ambiguïtés.
• Les agents intelligents constituent un perfectionnement ultime des procédés de recherche d'information. Comme on l'a vu, ce sont des sortes de robots informatiques capables de détecter des liens entre données (corrélations, évolutions,...) ou de les comparer afin d'éclairer des décisions (notamment commerciales). Il en existe aussi qui gèrent des messageries électroniques ou permettent de reconstituer des données (par exemple des images), à partir de certains de leurs éléments, afin d'économiser de la bande passante.
3. De nouveaux concepts
En même temps que foisonnent des logiciels facilitant l'utilisation des données, de nouveaux concepts émergent qui font d'Internet le lieu d'un profond bouleversement de l'informatique. Deux exemples en seront cités : l'apparition du nouveau langage de programmation Java et le triomphe qui lui est lié, des "techniques orientées objet".
• Java est un langage de programmation informatique mis au point par Sun Microsystems. Il permet notamment, en concurrence avec d'autres méthodes de programmation ( Active X de Microsoft [30] ou Shockwave de Macromedia...) de créer de petites applications ( applets en anglais) tendant à enrichir le contenu de pages WEB par des animations multimédia (ou à leur apporter d'autres améliorations). Mais, en fait, les conséquences en sont beaucoup plus profondes et peuvent se résumer ainsi :
• n'importe quel terminal peut exécuter des instructions écrites en langage Java (à condition d'avoir été muni d'un "interpréteur" adéquat) ;
• le programme Java sert d'intermédiaire entre le serveur et l'ordinateur du client ;
• les instructions sont transmises par l'intermédiaire du navigateur qui assure le téléchargement du logiciel d'application ;
• le programme n'a donc pas besoin d'être stocké dans le disque dur de l'ordinateur puisque son exécution est immédiate [31] ;
• en résumé, les applications sont téléchargées en même temps que les données et exécutées sur la machine de l'utilisateur.
On mesure les avantages et les bouleversements qui peuvent résulter de ces caractéristiques :
• Pour les entreprises , les inconvénients de l'hétérogénéité des matériels peuvent être surmontés moyennant une simple adaptation des logiciels d'application. Ces derniers sont centralisés au niveau du serveur (ce qui diminue les risques de piratage) et n'ont plus besoin d'être périodiquement renouvelés sur chaque terminal : Microsoft a du souci à se faire ! La réduction ainsi permise de la capacité de mémoire des ordinateurs personnels (plus besoin de disque dur) rend possible un abaissement de leur coût.
• Les particuliers peuvent, à la demande, se procurer sur le réseau, auprès de tout fournisseur, des logiciels "jetables".
La prise en compte de ces différents facteurs débouche sur des concepts tels que l'ordinateur de réseau ou une nouvelle informatique "réseau-centrique" (dans laquelle serveurs et navigateurs jouent le rôle essentiel) succédant à l'informatique répartie du type "client-serveur".
Cependant, ce modèle n'est pas le seul concevable. On peut envisager aussi un système dans lequel chaque utilisateur peut être à la fois client et serveur, programmes et données étant échangés bilatéralement -moyennant une allocation dynamique et variable de bande passante- et la persistance des données dépendant de l'application ( cf. numéro hors série d' Usine Nouvelle d'octobre 1996).
• Java est un langage "orienté objet" . Or, la technologie orientée objet, qui tend à se généraliser, marque une étape très importante dans l'évolution de l'informatique.
Dans le développement des logiciels, on est tout d'abord passé de méthodes empiriques ou artisanales à des méthodes structurées permettant, notamment, des applications partagées entre plusieurs utilisateurs et la mise au point de systèmes de gestion de données.
Victimes de leur complexité et des contraintes liées à leur hiérarchisation trop fonctionnelle, les méthodes structurées ont été remplacées par des méthodes objet qui ont sur elles de nombreux avantages :
• universalité des concepts utilisés pour classifier les connaissances, les objets, les données et leurs réalisations ;
• modularité, qui offre la possibilité de travailler, avec les mêmes applications, sur des systèmes d'exploitation ou dans des environnements matériels différents.
Les "objets", qui constituent les éléments de base de ces nouveaux systèmes (à la place des "données" et "fonctions" caractéristiques de leurs prédécesseurs), constituent des sortes de briques logiques pouvant être assemblées, comme dans un jeu de Lego et liées entre elles par des "héritages" ou des filiations (en botanique, par exemple, la classe "fleurs" hérite des propriétés de la catégorie "bulbes" ; bulbes, fleurs, fruits et légumes héritent de la propriété de la classe mère "graines"...).
Il en résulte :
• pour le client, des interfaces plus conviviales et une plus grande souplesse d'emploi...
• pour le serveur, une meilleure facilité d'exploitation, un coût réduit...
Les données et leur traitement peuvent être associées, ce qui permet les applications évoquées ci-dessus ( applets ) de Java .
L'approche "objet" est utilisée, par exemple :
• pour la constitution et la gestion de base de données (la classification automatique de concept, introduite par la logique de description, permettant d'améliorer les performances en la matière) ;
• pour simplifier l'adaptation des progiciels [32] à différents contextes en conception ou en gestion de production assistées par ordinateur (CAO, GPAO).
Le formidable succès d'Internet, facilité par les évolutions techniques qui viennent d'être décrites, explique l'effet d'attraction qu'il exerce sur presque tous les acteurs de l'informatique, des télécommunications, de l'électronique grand public et de l'audiovisuel.
4. Un effet d'attraction très fort
A la conférence d'ouverture d'un récent salon professionnel à Las Vegas, Bill Gates a déclaré : " Internet, c'est comme la ruée vers l'or et il y a de l'or " . Un autre intervenant a usé, pour sa part, du terme de "nouvelle frontière".
De fait, bien qu'il ne soit pas encore tout à fait rentré dans l'économie de marché, Internet suscite, en raison de sa formidable croissance et de la vague d'innovations technologiques qui la porte, à la fois des angoisses chez les champions de l'ordre établi et de fortes ambitions de la part de leurs challengers. Il représente ainsi à la fois des menaces et des opportunités, fait l'objet de convoitises ou de tentatives de récupération et se trouve au centre de toutes les stratégies.
L'enjeu est de déterminer si Internet se contentera d'être un fédérateur , ou s'il deviendra un intégrateur de réseaux et de technologies.
• Internet n'est pas encore totalement entré dans l'économie de marché pour des raisons qui ont déjà été examinées dans ce rapport et qui tiennent à ses modes de tarification (qui ne reflètent pas ses coûts réels) et à la sécurité encore imparfaite des transactions à distance, qui y freine le développement des services en ligne et du commerce électronique. Cette situation est cependant susceptible d'évoluer rapidement.
En attendant, l'essor d'Internet a déjà provoqué d'éclatants succès. On peut citer :
• Netscape , qui a réussi à prendre 85 % du marché des navigateurs. Son président, Jim Clark est devenu milliardaire en 18 mois (ce que Bill Gates avait mis 12 ans à accomplir !). Le chiffre d'affaires de la compagnie (75 millions de dollars) a été multiplié par cinq en un an. Sa capitalisation boursière de 2,3 milliards de dollars lui a permis, en payant sous forme d'actions nouvelles, d'acquérir Collabra Software, spécialiste du collecticiel (logiciels de conférence de groupe et de partage d'informations) et rivale de Lotus du groupe IBM (inventeur du fameux logiciel Notes de travail coopératif en réseau).
Les visées stratégiques de Netscape ont pour objet, non seulement le collecticiel, mais aussi le commerce électronique (association avec Mastercard, tandis que Visa s'est allié, dans ce domaine, à Microsoft).
C'est en offrant Navigator gratuitement sur le réseau que Netscape a conquis le marché correspondant. Il s'est rattrapé ensuite en faisant payer ses logiciels au niveau des serveurs.
Avec Sun Microsystems, Netscape ambitionne d'utiliser Internet pour concurrencer le monde du P.C. à la fois dans le domaine du logiciel (Microsoft), des composants (Intel) et des fabricants de serveurs et d'ordinateurs personnels (IBM, Compaq, Nec, etc...).
• Sun Microsystems , pour sa part, a annoncé pour le deuxième trimestre de 1996 un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars, en augmentation de plus de 20 % (+ 22,4 %) par rapport à l'année précédente. Les trois-quarts de ses revenus proviennent de la vente de stations de travail et de serveurs et une part infime seulement est liée, pour le moment, au langage Java . Le marché des serveurs est estimé à plus de 6 milliards de dollars en 1996. Sun fournit plus de 50 % de ceux qui sont utilisés sur Internet. Selon The Economist du 7 septembre 1996, la firme californienne envisage de se lancer elle-même dans la fabrication de microprocesseurs et contrôleurs Java , ce qui pourrait lui rapporter 15 milliards de dollars par an, soit autant que toutes ses autres activités réunies.
Avec Netscape et surtout Oracle (numéro 2 mondial du logiciel), Sun développe la stratégie de "l'ordinateur de réseau" (simple et bon marché) et d'une informatique "réseau-centrique", concept qui correspond déjà au Pippin lancé par Apple et que pourrait bien rallier aussi IBM (selon le président-directeur-général d'IBM Europe, Lucio Stanca, les données et les logiciels seront désormais situés dans les grands "serveurs" des réseaux et non plus dans les ordinateurs personnels).
La cible pourrait être d'abord les Intranet, réseaux internes d'entreprises construits sur le modèle d'Internet. D'autres marchés, déjà importants, sont en forte croissance ; ceux des :
• routeurs (contrôlé à 80 % par Cisco qui vient de conclure un accord avec le numéro un des P.C., Compaq) : de 6,5 milliards de dollars en 1995, les ventes devraient passer à 17 milliards en 1998. Le chiffre d'affaires de Cisco, fondée en 1984 par un couple de scientifiques de Stanford, est de 3 milliards de dollars en 1996 et sa capitalisation boursière de 35 milliards (le cours de l'action a été multiplié par plus de 80 depuis 1990) ;
• gestionnaires de sites Internet (logiciels, services et solutions matérielles intégrés) : 12 milliards de dollars aujourd'hui, 210 en l'an 2000 ;
• modems : le chiffre d'affaires du numéro un mondial, US Robotics (1,9 milliard de dollars) a pratiquement doublé depuis l'année dernière. La croissance des ventes continue à être soutenue aux États-Unis, pourtant déjà très équipés (+ 8,9 %), elle est forte en Europe (+ 30 % en Allemagne...).
Certains marchés, enfin, sont encore émergents, mais offrent des perspectives prometteuses :
• les fournisseurs d'accès : de 300 millions de dollars en 1995, leur chiffre d'affaires pourrait passer à 5 milliards en 2000. Celui d'Ascend, start-up californienne, est passé de 39 millions de dollars en 1994 à 600 millions en 1996, ce qui lui a permis de se diversifier dans la technologie des "routeurs" et dont la filiale en Europe vient de s'installer à Sophia Antipolis ;
• le commerce électronique : de 518 millions de dollars de ventes en 1996 à 6,6 milliards, selon Forrester Research, en 2000 ;
• la publicité : 312 millions de dollars en 1996, 5 milliards en 2000 ;
• les moteurs de recherche : la société californienne Verity, inventeur d'un moteur de recherche documentaire, a, par exemple, doublé son chiffre d'affaires cette année.
On comprend que de telles ambitions stratégiques et de tels succès ne laissent pas indifférents l' establishment . Pour les principaux acteurs en question du monde de l'informatique, des télécommunications, de l'électronique grand public, ou de l'audiovisuel, Internet peut d'ailleurs très bien ne pas représenter seulement une menace mais aussi des opportunités nouvelles à saisir.
Le phénomène Internet étant de toute façon irréversible, il serait vain de tenter de s'y opposer ou même de l'infléchir. Le mieux à faire est d'y être présent, de l'intégrer dans sa stratégie pour tenter de profiter de sa dynamique.
• Dans l'informatique tout d'abord, le premier à être menacé et à avoir révisé sa stratégie, a été Bill Gates, le patron de Microsoft . Celui-ci a montré qu'il prenait désormais Internet au sérieux (après l'avoir quelque peu dédaigné en raison de son caractère "non marchand"). Lors de la visite de l'Office à Seattle pour la préparation de ce rapport, il y a dix-huit mois, les centres d'intérêt de Microsoft restaient axés sur le réseau propriétaire Marvel ensuite dénommé Microsoft Network . Seule une petite équipe suivait les questions Internet.
Avec l'architecture client-serveur, le numéro un du logiciel n'avait pas trop de souci à se faire. L'essor d'Internet pouvait favoriser les ventes de P.C. dont 90 % étaient de type " wintel " (c'est-à-dire équipés de microprocesseurs Intel et de logiciels Windows conçus par Microsoft). En outre, du côté serveur, les progrès des composants pouvaient laisser espérer que des micro-ordinateurs, munis du logiciel Windows NT , viennent concurrencer les machines sous Unix ou dotées de logiciels IBM. Enfin, comme le faisait remarquer The Economist , dans son numéro du 17 août 1996, les intérêts que rapportaient à Microsoft le placement de ses liquidités (7 milliards de dollars) équivalaient à la totalité des revenus annuels de Netscape.
C'est sans doute la menace représentée par la stratégie "réseau-centrique" de Netscape et Sun qui a provoqué la vigoureuse réaction du géant de Seattle. Intégrant désormais pleinement Internet dans sa stratégie, Microsoft a pris les mesures suivantes :
• lancement en 1995 du navigateur Explorer (adopté par America On Line en 1996),
• introduction des protocoles TCP/IP dans Windows 95 ,
• intégration gratuite de fonctions WEB dans le logiciel serveur Windows NT ,
• compatibilité de MSN ( Microsoft Network ) avec le world wide web ,
• compatibilité avec Java d' Explorer et de Windows ,
• préparation d'une génération de micro-ordinateurs bon marché, concurrents des ordinateurs de réseau.
Ces actions ont été complétées par de nombreux rachats de Start-up et une prise de participation dans UUNET, l'un des principaux fournisseurs d'accès à Internet.
IBM , de son côté, a créé un nouveau service qui se consacre à la création de produits destinés à Internet et étudie une version de son collecticiel Notes spécialement adaptée au réseau des réseaux. Une mutation "réseau-centrique" d'entreprise d'IBM qui table sur l'informatique, conforme à la culture recentralisée partiellement.
• Les acteurs des télécommunications sont à la fois inquiétés et attirés par l'essor d'Internet.
• Inquiétés : la téléphonie sur Internet est possible (les logiciels correspondants se multiplient),
• Attirés, dans la mesure où il leur est possible de tirer parti de la dynamique d'Internet.
Pour les opérateurs de réseaux , en effet, de nouveaux modes de tarification du trafic, potentiellement plus rémunérateurs, finiront sans doute par s'imposer. Internet pourrait, d'autre part, provoquer une intensification de l'utilisation des RNIS (réseaux numériques à intégration de services), comme Numeris en France. Il suffit que l'évolution récente des prix, qui va dans le bon sens, se confirme pour que le nombre d'abonnés à Numeris augmentant, l'attractivité s'accélère (loi dite de Metcalfe).
Les opérateurs s'engagent aussi directement dans la vente d'accès ou les services en ligne, comme France Télécom, à l'instar de son partenaire Sprint, l'a fait.
Les fabricants , de leur côté, proposent des terminaux téléphoniques mobiles dotés de possibilités d'utiliser Internet (avec écrans, modems et même lecteurs de cartes à puce intégrés). Certains commencent déjà à le faire (Philips, Nokia, Motorola...). Ces nouvelles fonctions prolongeront la croissance exceptionnelle du marché correspondant et retarderont son arrivée à maturité et sa saturation.
Selon certaines estimations, dont fait état le magazine Business Week dans son numéro du 24 juin 1996, 22 % des équipements d'accès à Internet en l'an 2000 ne seront pas des ordinateurs personnels.
La convergence permise par le numérique, de l'informatique, des télécommunications et de l'audiovisuel permet d'envisager toutes sortes de produits hybrides donnant accès à Internet.
• L'électronique grand public peut, à l'évidence, profiter des techniques nouvelles et de l'engouement pour Internet, pour créer de nouveaux produits et augmenter ses ventes.
La cible, se sont la majorité des foyers dans le monde, même aux États-Unis, qui ne sont pas encore pourvus d'ordinateurs personnels. Soit ces personnes finiront par se rallier à l'informatique, devenue plus conviviale, et le P.C. multimédia détrônera le téléviseur, soit les caractéristiques des deux types d'appareils coexisteront, au sein d'un même appareil, le P.C.-T.V., dont le marché est estimé, par Frost & Sullivan, à 26 milliards de dollars en 2001.
Mais de récentes études de marché révèlent la préférence actuelle d'une majorité de consommateurs pour un accès à Internet par l'intermédiaire d'un téléviseur et d'une télécommande. C'est la raison pour laquelle apparaissent déjà sur le marché des " Web T.V.", produites par Sony et Philips, qui offrent un accès très convivial à Internet. Zenith, Philips et Mitsubishi ont également conçu des "Internet T.V." aux possibilités plus restreintes.
Le débat qui, il y a un an, opposait l'avenir de la télévision à celui de l'ordinateur est stérile Les offres techniques permise par le numérique évoluent si vite que les débats ou pronostics sont vite dépassés.
Il n'y aura pas plus de terminal unique que d'applications déterminantes (la fameuse " killer application "). Les besoins et les aspirations des individus et des groupes sont variés (travail, loisirs, distractions...) et s'expriment dans différentes situations (au bureau, à la maison dans diverses chambres, en déplacement...). La technologie permet de les satisfaire dans leur diversité, à travers les réseaux ou hors ligne.
Netscape Communication a d'ailleurs créé avec d'autres grands de l'informatique et de l'électronique (IBM, Oracle, NEC, Sony, Sega, Nintendo), une société nouvelle chargée de développer un logiciel pour toute une série de terminaux d'accès à Internet autres que le P.C. : télévisions, consoles de jeux, ordinateurs de réseau... Microsoft serait en train de mettre au point un produit similaire.
Déjà apparaissent sur le marché certains appareils hybrides, autres que le P.C.-T.V., pourvus d'un accès à Internet : consoles de jeux, téléphones (déjà évoqués), Diba Internet [33] , Pippin d'Apple (avec lecteur de CD-ROM), etc...
• Dans le secteur de l' audiovisuel aussi, Internet apparaît comme incontournable. Il peut intégrer les structures des réseaux actuels et représenter un nouveau moyen d'échanger ou de diffuser des contenus.
Les cablo-opérateurs, souvent lourdement endettés et peu bénéficiaires, voient dans Internet un moyen de rentabiliser leurs infrastructures. Ils peuvent offrir, en effet, aux usagers du réseau des réseaux des débits beaucoup plus élevés que ceux autorisés par le réseau téléphonique (10 Mbits au lieu de 28,8 kbits ou 128 kbits sur le RNIS, grâce à de nouveaux modems).
Mais si, comme on l'a vu, le contenu d'Internet peut aller à la télévision ( cf. WEB T.V. et Internet T.V.), l'inverse n'est pas encore possible. Il est certes permis de téléphoner ou d'écouter des émissions de radio sur Internet, grâce à des logiciels spécifiques, ou encore de regarder des images animées spécialement conçues pour ce réseau. Mais, on l'a vu, Internet n'est pas actuellement adapté à la transmission en temps réel de hauts débits tels que ceux qu'exige la télévision. De toute façon, il n'est pas conforme à la vocation essentiellement interactive du réseau des réseaux de servir de vecteur à un média diffusé (même à la demande).
Dans ces conditions, c'est surtout la visioconférence qui doit faire l'objet d'efforts particuliers. Deux protocoles, non incompatibles, sont proposés à cette fin, le RTP ( Real Time Protocol ) de l'IETF ( Internet Engineering Task Force ), adopté par Netscape et IBM, et le RSVP, soutenu par Sun et les fabricants de "routeurs" Cisco et Bay, qui repose, dans une perspective de commercialisation du réseau, sur la réservation préalable de la largeur de bande nécessaire à un échange d'images animées.
Le logiciel de compression inventé par Boulanger à Sophia Antipolis dans une start-up rachetée par la SAT, filiale de la SAGEM, en liaison avec Apple computer, permet des visioconférences sur Numéris très flexibles et sans réservation préalable.
De leur côté, Microsoft et US West ont témoigné de leur intérêt pour cette question en participant au capital de VDO NET, firme californienne spécialisée dans les logiciels de compression d'images transmises sur des lignes téléphoniques.
Internet exerce ainsi une attraction très forte sur tous les acteurs concernés. Ce phénomène s'accentuera avec sa commercialisation et la migration de réseaux propriétaires vers le réseau des réseaux.
5. Vers une commercialisation
Par "commercialisation" de l'Internet, il faut entendre son entrée plus complète dans la sphère de l'économie marchande (subsistera une partie "service public" du réseau, peut-être le projet Internet 2 évoqué plus haut et les réseaux de type Renater en France et leurs équivalents européens). Cette évolution présente au moins deux aspects :
• le développement du commerce électronique,
• un mode de tarification différents de l'utilisation des infrastructures.
Ces deux mouvements paraissent inéluctables et pourraient s'accélérer sous la double pression de l'ouverture à la concurrence des réseaux de télécommunication et de l'impatience de tous ceux qui voient dans le fantastique essor d'Internet des possibilités de gains considérables.
• Selon l'AFTEL [34] , le commerce électronique désigne, dans son acceptation la plus courante, le fait d'acheter et de vendre des informations, des produits et des services sur un réseau. Mais il faut y ajouter l'utilisation des réseaux par les entreprises dans le cadre de l'ensemble de leurs activités (fonctions administratives et financières, conception et production de biens et services, échanges avec leurs homologues...). "Réseau ouvert, mondial et peu coûteux, l'Internet est en mesure -selon l'AFTEL- d'accélérer de manière formidable le développement du commerce électronique." Il reste cependant à "sécuriser" ces activités d'un point de vue juridique et technique, par des moyens déjà présentés par ce rapport.
INTERNET ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Un cadre de référence
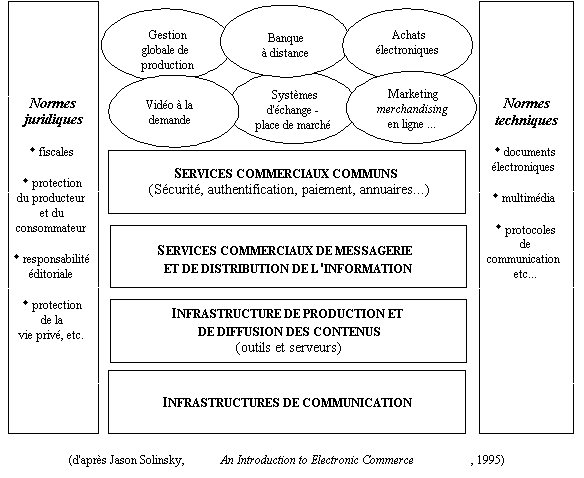
Mais Internet est d'ores et déjà un support du commerce électronique qui exerce un effet d'attraction sur les réseaux propriétaires déjà existants. Le succès du réseau des réseaux réside, on l'a vu, dans le caractère universel de ses normes. En tant qu'infrastructure de communication, il est susceptible de répondre de manière économique et performante aux besoins de la plupart des applications ouvertes de commerce.
Ses lacunes principales résident dans l'absence :
• d'annuaire exhaustif de ses ressources et de ses usagers,
• de protocole de sécurisation et d'authentification, et de système de paiement standardisé.
Concernant la sécurité, il est cependant possible, comme il a été montré, d'utiliser le cryptage PGP ( Pretty Good Privacy ). Mais, selon une enquête réalisée par le magazine Technologies internationales de l'ADIT [35] , près de 50 % des achats des entreprises à travers Internet en 1996 sont effectués sans recourir à des systèmes spécifiques de sécurisation.
Le nombre d'entreprises ayant commencé à utiliser le réseau en 1995 a augmenté de 400 % par rapport à 1994 (à cette date, seulement moins de 25 % d'entre elles étaient cependant concernées).
S'agissant des particuliers, 15 % des consommateurs américains ont déjà effectué des achats "en ligne" selon le cabinet IDC, et les utilisateurs de services commerciaux sur réseau devraient passer de 10 millions en 1995 à plus de 100 millions en 1997.
Selon l'enquête précitée de l'ADIT, le secteur de la consommation grand public est désormais arrivé en masse sur Internet alors qu'il y a deux ans à peine l'informatique prédominait encore (échanges de fichiers et de logiciels...). Les deux outils les plus utilisés commercialement sont le web par la quasi totalité des entreprises étudiées) et le courrier électronique ou " E-mail " (dans les trois quarts des cas).
Près de la moitié des entreprises étudiées emploient déjà le réseau Internet pour vendre leurs produits et services, notamment aux États-Unis. Peu d'entreprises gagnent pourtant directement, actuellement, de l'argent sur le réseau, l'activité la plus rentable semblant être la vente d'espaces publicitaires et surtout les effets induits par une information disponible au plan mondial. Ainsi, les hôteliers de la Côte d'Azur bénéficieront-ils très directement des serveurs Web existant. Par ailleurs, signalons que le serveur de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur a été classé n° 1 des services mondiaux en matière d'informations disponibles orientées clients pour des localisations d'entreprises par un évaluateur américain.
Internet constitue une vitrine et un moyen de promotion sans équivalent. Les activités de commerce électronique deviendront lucratives, si on en croit les estimations suivantes publiées par Business Week (numéro du 23 septembre 1996) :
| 1996 | 2000 | ||
|
• Montant des ventes
• Abonnements • Recettes publicitaires |
518 millions de $
120 millions de $ 312 millions de $ |
6,6 milliards de $
966 millions de $ 5 milliards de $ |
En outre, la notoriété des entreprises ou localités présentes font que, pour le secteur du tourisme qui, rappelons-le, est la principale des industries exportatrices françaises, la présence culturelle et informative touristique sur les réseaux est indispensable sous peine de ne plus exister. Le Comité régional du tourisme de la Côte d'Azur et certaines villes l'ont bien compris.
Devant la concurrence que le Net leur fait déjà subir, les principaux réseaux propriétaires ont décidé de le rallier. Ils demeurent cependant indépendants mais ont été contraints d'intégrer un accès à Internet dans leur offre de prestations. Ils adaptent en conséquence leurs outils logiciels pour les rendre compatibles avec le web et le langage HTML.
Avant de réaliser cette mutation, les principaux intéressés ont traversé une période difficile (pertes ou résultats en baisse, licenciements, fuite de la clientèle, diminution des recettes publicitaires...). Des alliances ont été conclues :
• Compuserve (filiale d'IBM) a créé avec Time Warner un service exclusif d'informations sur mesure ( Personal Edition ),
• America On Line (AOL) bénéficiera des logiciels clients et serveurs de Microsoft pour accéder au web .
France Télécom, de son côté, a créé des passerelles entre le web et le monde Minitel (accès, il est vrai malaisé, à Internet à partir du Minitel, mais surtout "cartes d'émulation" permettant à un micro-ordinateur de bénéficier des services Télétel et proposition d'une norme VEMMI compatible à la fois avec le vidéotex, TCP/IP et le web ).
Les conséquences, pour certains secteurs, sont capitales.
• Pour la presse, par exemple, dont les recettes sont assurées par la publicité (à proportion souvent de près de 50 %), les ventes au numéro et les abonnements, les coûts pourraient être réduits des deux tiers puisqu'il n'y aurait plus d'impression ni de reprographie. Le client ne paierait plus que les frais de communication et l'éditeur pourrait, au total, y gagner, la publicité suffisant désormais à couvrir ses dépenses.
• Les activités bancaires et financières représentent déjà près de 10 % de l'utilisation d'Internet par les entreprises d'après l'étude précitée de l'ADIT.
Pour les professionnels, les technologies de l'information représentent un outil indispensable qu'ils utilisent depuis longtemps (environ 100 milliards de dollars de dépenses annuelles selon The Economist ).
Des agences comme Reuters se sont spécialisées dans la transmission de données financières. Beaucoup de transactions, notamment les achats et ventes de devises, s'effectuent "en ligne". Les banques d'affaires multinationales se font communiquer directement toutes sortes de statistiques (cotations des valeurs, cours de change...) et les analysent à l'aide, comme on l'a vu, de logiciels de plus en plus sophistiqués, pour en tirer des conclusions et préparer leurs décisions.
Selon la lettre Stratégie Internet (numéro du 3 septembre 1996) "les banques américaines investissent en masse sur l'Internet, autant pour prendre place sur un marché émergent que dans le but de défendre leurs positions, menacées par les transactions directes entre consommateurs et commerçants" . 500 banques sont déjà présentes aux États-Unis sur le Net (contre 14 seulement en France). La première d'entre elles à avoir concentré entièrement ses activités sur ce réseau est la Security First Network Bank. Baybank, de son côté, a réussi en deux mois à attirer 10 % de sa clientèle (100.000 comptes) sur son site.
Une concurrence pourrait s'instaurer entre les cyberbanques et les intermédiaires financiers traditionnels (courtiers, conseils en investissements...), menacés par Internet, dès lors que leurs clients peuvent y avoir accès directement à toutes sortes de données et donc prendre leurs décisions et donner eux-mêmes leurs ordres.
Un autre effet d'Internet, signalé par Business Week (du 29 avril 1996), pourrait être d'influer sur les cours des principales bourses mondiales, voire d'y provoquer des paniques incontrôlées par la propagation de certaines nouvelles.
Au total, le chiffre en ligne mondial des services télématiques commerciaux était estimé par l'AFTEL à 73 milliards de francs en 1994, dont 40 pour les services en ligne mondiaux professionnels (bases de données financières, juridiques...).
Il est vraisemblable que le commerce électronique interentreprises se développera plus rapidement que celui concernant les particuliers.
6. Le vrai marché porteur : les contenus
Au total, le chiffre d'affaires des contenus (services en ligne, informations, commerce électronique) pourrait atteindre 10 milliards de dollars en 2000, dépassant de loin celui, actuellement le plus important, des équipements (2,5 milliards) et celui des services de réseau (5 milliards).
L'évolution serait ainsi la suivante :
| Marchés |
en l'an 2000
en milliards de $ |
en 1995
en millions de $ |
|
|
• Contenus
• Services de réseaux • Logiciels • Équipements |
10
5 4 2,5 |
50
300 250 500 |
7. La nécessaire évolution d'Internet
La caractéristique marquante de l'entrée d'Internet dans l'économie marchande devrait être une modification de la tarification de l'utilisation des infrastructures, et peut-être une séparation entre l'utilisation d'intérêt public (recherche, enseignement, culture, santé, etc.) et l'utilisation marchande encore que cette séparation soit très délicate.
La plupart des observateurs avertis de ces questions estiment que la situation actuelle ne durera pas. La tarification des communications sur Internet est indépendante tout à la fois de la distance et de la durée (du moins aux États-Unis où les communications sont gratuites ; en France, le prix est, depuis peu, celui d'une communication locale...).
Il n'est également pas tenu compte du débit, dans de nombreux cas, lorsque celui-ci ne dépasse pas celui d'une communication téléphonique normale (64 kbit/s). Généralement, cet élément n'intervient qu'au delà d'un certain seuil, mais il existe des systèmes forfaitaires. L'abonnement représente donc souvent l'essentiel de la dépense pour un particulier.
Internet est un système de communications bon marché dont la facturation ne reflète pas le coût réel, ce qui explique en grande partie son succès. La croissance exponentielle d'Internet est due à la simplicité de son mode de tarification autant qu'à l'efficacité de la transmission de données par paquets. Le coût de facturation est pour un opérateur télécom souvent plus cher que le coût de la transmission.
Pour un routeur d'une certaine capacité, le coût marginal de la connexion d'un client supplémentaire est quasiment nul. L'acheminement des communications Internet à travers le monde repose sur un système de troc entre grandes compagnies ou de location de liaisons spécialisées par de petits fournisseurs d'accès. Ces derniers sont souvent pénalisés par les coûts de ces liaisons.
Malgré les améliorations attendues de l'ATM et de la nouvelle version du protocole Internet (Ipv6), la situation ne saurait durer pour des raisons qui tiennent :
• à la nécessité pour les systèmes universitaires et de recherche, inventeurs et utilisateurs prioritaires et anciens d'Internet, de se déconnecter du secteur économique qui provoque une saturation qui dégrade un système de communication indispensable à la vitalité du dynamisme technologique et scientifique mondial ;
• à la croissance exponentielle du trafic ;
• à la nécessité de financer et d'amortir des dépenses d'augmentation des capacités des réseaux, dans un contexte, pour les opérateurs, qui est celui d'une ouverture à la concurrence pouvant déclencher une guerre des prix.
Mais quel système adopter ?
• une tarification au bit (comme les kilowatts/heure d'EDF) pénaliserait la transmission d'images qui apparaît comme la plus noble conquête du multimédia ;
• une tarification à la durée risquerait de freiner l'essor des services en ligne.
On peut imaginer un système de tarifs forfaitaires hiérarchisés en fonction du degré d'urgence des communications, donc avec des priorités d'accès. En tout état de cause, le paiement de droits d'utilisation davantage basés sur les coûts réels apparaît comme un moyen privilégié de maîtriser, de rationaliser et de discipliner le trafic.
Les usages du réseau à caractère de service public (éducation...) devront rester très bon marché. S'agissant des besoins de hauts débits de la recherche, il faudra développer les voies rapides particulières (réseaux de type RENATER, Super Janet ou VBNS) superposées et raccordées à Internet, ou éventuellement un Internet 2, qui serait la suite logique des utilisateurs qui, depuis vingt ans, grâce notamment à l' Internet Society . L'Internet Society est une association privée fonctionnant grâce à ses membres. Elle se réunit chaque année (Montréal juin 1996, Kuala Lumpur juin 1997). Elle forme des cartes des pays en voie de développement. Elle étudie les problèmes indépendamment de tout pouvoir public.
A noter, les réflexions du Consortium Internet piloté en Amérique par une équipe du Massachusetts Institut of Technology, en Europe, Afrique, Asie (sauf Japon), par une équipe de l'INRIA à Sophia Antipolis, au Japon par une équipe qui vient de se créer.
N'oublions pas que le phénomène Internet, même s'il est envahi par des applications marchandes, présente un avantage fantastique pour l'humanité par ses applications non marchandes. Nous avons vu, en particulier pour l'Europe, que des secteurs tels que la santé, l'éducation, la cohésion sociale, la sécurité, l'organisation des pouvoirs publics, étaient sans aucun doute possible, fondamentalement touchés par les inforoutes. La recherche n'est, en la matière, que la partie la plus visible de l'iceberg Internet-intérêt-général, même si elle est la plus dynamique.







