Rapport de l'office parlementaire d'évaluation de la législation n° 120 (2001-2002) de M. Jean-Jacques HYEST , fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, déposé le 5 décembre 2001
Disponible au format Acrobat (270 Koctets)
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
-
I. PRÉVENTION ET TRAITEMENT AMIABLE :
DES MÉCANISMES GLOBALEMENT SATISFAISANTS DONT L'UTILISATION DOIT
ÊTRE ENCOURAGÉE
-
A. UNE MISE EN oeUVRE TROP DISPARATE DES
MÉCANISMES DE PRÉVENTION ET DE TRAITEMENT AMIABLE DONT
L'EFFICACITÉ EST POURTANT AVÉRÉE
-
B. LA NÉCESSITÉ DE LEVER CERTAINS
OBSTACLES AU DÉVELOPPEMENT DE LA PRÉVENTION
-
C. DES AJUSTEMENTS DE NATURE À ENCOURAGER LE
RECOURS AUX PROCÉDURES AMIABLES
-
1. Les mécanismes de règlement
amiable en vigueur
-
2. Des ajustements de nature à
améliorer la cohérence du dispositif de règlement
amiable
-
3. Des mesures de nature à assurer une plus
grande transparence et à encourager le recours aux procédures de
traitement amiable
-
1. Les mécanismes de règlement
amiable en vigueur
-
A. UNE MISE EN oeUVRE TROP DISPARATE DES
MÉCANISMES DE PRÉVENTION ET DE TRAITEMENT AMIABLE DONT
L'EFFICACITÉ EST POURTANT AVÉRÉE
-
II. DES PROCÉDURES JUDICIAIRES
ESSENTIELLEMENT LIQUIDATIVES QUI CONDUISENT À S'INTERROGER SUR LA
PERTINENCE DU CRITÈRE D'OUVERTURE ET À ENVISAGER QUELQUES
ASSOUPLISSEMENTS
-
I. PRÉVENTION ET TRAITEMENT AMIABLE :
DES MÉCANISMES GLOBALEMENT SATISFAISANTS DONT L'UTILISATION DOIT
ÊTRE ENCOURAGÉE
-
EXAMEN DU RAPPORT PAR L'OFFICE
AU COURS DE SA RÉUNION DU 5 DÉCEMBRE 2001
-
ANNEXE 1
CAHIER DES CHARGES
-
ANNEXE 2
RAPPORT D'EXPERTISE
-
ANNEXE 3
LISTE DES AUDITIONS
EFFECTUÉES PAR LE RAPPORTEUR
|
N° 3451 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE |
N° 120 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002 |
|
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale |
Annexe au procès-verbal de la séance du |
|
le 5 décembre 2001 |
5 décembre 2001 |
OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION
DE LA LÉGISLATION
RAPPORT
sur
LA LÉGISLATION APPLICABLE EN MATIÈRE DE
PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS DES
ENTREPRISES,
par
M. Jean-Jacques HYEST,
Sénateur.
L'Office parlementaire d'évaluation de la législation est composé de : M. René Garrec, sénateur, président; M. Bernard Roman, député, premier vice-président; Mme Dinah Derycke, M. Patrice Gélard, sénateurs, M. Christophe Caresche, Mme Michèle Alliot-Marie, députés, vice-présidents ; M. Robert Bret, sénateur, M. François Sauvadet, député, secrétaires.
Membres de droit : MM . Alain Dufaut, Charles Guené, Daniel Goulet, Mme Annick Bocandé, M. Jacques Pelletier, sénateurs ; Mme Martine David, MM. René Galy-Dejean, Patrick Devedjian, Jacques Fleury, députés.
Membres désignés par les groupes : Mme Michèle André, MM. Robert Badinter, Jean-Jacques Hyest, Jean-René Lecerf, Jacques Mahéas, Bernard Saugey, sénateurs ; MM. Pierre Albertini, Georges Hage, Marc Dolez, Roger Franzoni, Dominique Perben, Henri Plagnol, André Vallini, députés.
|
Difficultés des entreprises. |
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Sur saisine de M. Jacques Larché, Président de la commission des Lois du Sénat, l'Office parlementaire d'évaluation de la législation a décidé, au début de l'année 1998, de dresser un bilan de la mise en oeuvre de la législation relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises.
A cet effet, et en application de l'article 6 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires introduit par la loi n° 96-516 du 14 juin 1996 qui prévoit que « l'office peut faire appel à des experts », l'Office a, sur la base d'un cahier des charges 1 ( * ) , confié la réalisation d'une étude à un collège de trois personnalités qualifiées : Mme Micheline Pasturel, magistrat à la Cour de Cassation, M. Yves Chaput, professeur d'université et M. Henri-Jacques Nougein, juge consulaire, tous trois spécialistes des procédures collectives.
Cette étude 2 ( * ) , élaborée dans les délais impartis, a été remise au rapporteur par les trois experts au début du mois de septembre 1998. Sa remise a précédé de quelques semaines la publication, au début du mois de décembre 1998, d'un document d'orientation préparatoire à la réforme des lois du 1 er mars 1984 et du 25 janvier 1985 relatives au traitement des difficultés des entreprises, document de travail émanant du ministère de la justice tendant à initier une réflexion sur les améliorations à apporter au droit des procédures collectives dans le cadre du vaste programme gouvernemental de réforme de la justice commerciale et de l'environnement juridique de l'entreprise présenté par le Garde des sceaux en conseil des ministres le 14 octobre 1998.
Depuis lors, le volet de ce programme consacré à la réforme de la juridiction consulaire et des professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises a pris le pas sur la réforme des procédures collectives dont tous s'accordent pourtant à reconnaître l'urgence. Trois projets de loi sont ainsi en cours de discussion devant le Parlement, leur première lecture devant l'Assemblée nationale ayant eu lieu les 28, 29 et 30 mars 2001. A cette occasion, l'Assemblée nationale a d'ailleurs introduit un certain nombre de modifications à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, tant il est vrai que ces différents sujets sont étroitement complémentaires et difficilement dissociables.
*
Après une brève mise en perspective de l'évolution des procédures relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises et sans prétendre proposer une analyse et un bilan de mise en oeuvre détaillés de chacun des plus de trois cents articles de loi applicables en la matière, votre rapporteur s'efforcera, en s'appuyant sur l'étude précitée et les observations recueillies auprès des personnes qu'il a entendues 3 ( * ) , de mettre en évidence les principaux dysfonctionnements de ces mécanismes et d'énoncer quelques orientations qui permettraient de renforcer leur efficacité.
INTRODUCTION
_____
Notre droit des procédures collectives est aujourd'hui fixé par la loi n° 84-148 du 1 er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, toutes deux remaniées en 1994 par la loi n° 94-475 du 10 juin relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises. Rappelons que ces dispositions sont désormais regroupées dans le livre VI du code de commerce issu de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, intitulé « Des difficultés des entreprises ».
Les mécanismes instaurés tentent de régir les conflits d'intérêts qui s'exacerbent lorsque les difficultés surgissent et s'aggravent, et de concilier au mieux les objectifs de sauvegarde de l'entreprise , de maintien de l'activité et de l'emploi et d' apurement du passif , c'est-à-dire de désintéressement des créanciers. Ces objectifs sont d'ailleurs énoncés à l'article 1 er de la loi du 25 janvier 1985 précitée.
Le régime applicable aux entreprises en difficultés s'articule autour d'une notion centrale , la cessation des paiements , qui se matérialise par l'impossibilité pour l'entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Au cours de la période précédant cette échéance critique et afin de tenter d'éviter sa survenance, la loi du 1 er mars 1984 prévoit des mécanismes d'alerte et s'efforce d'inciter les créanciers et le débiteur à s'entendre dans le cadre d'un règlement amiable. Lorsque intervient néanmoins la cessation des paiements, la phase judiciaire s'ouvre : la procédure collective est alors inéluctable. Au terme d'une période d'observation de six à vingt mois à compter du jugement d'ouverture, qui permet d'évaluer la gravité des difficultés et au cours de laquelle les poursuites individuelles sont en principe suspendues, le tribunal décide du redressement de l'entreprise (cession ou continuation) ou de sa liquidation.
L'évolution de la législation régissant les procédures collectives révèle un mouvement de balancier tentant d'ajuster un équilibre subtil entre la défense des intérêts des créanciers et la sauvegarde de l'entreprise . Partant du constat selon lequel les lois de 1984 et 1985 avaient imposé aux créanciers une discipline collective restreignant leurs droits sans parvenir à endiguer le flot des liquidations, l'objectif initial de redressement de l'entreprise et de préservation des emplois n'étant pas atteint, la réforme du 10 juin 1994 , outre de nombreux aménagements techniques, s'est articulée autour de quatre grands axes :
- l'amélioration de la prévention des défaillances, par un renforcement des moyens de détection des difficultés (obligation faite au Trésor et à l'URSSAF d'inscrire leur privilège lorsque les sommes dues excèdent un certain seuil ; renforcement des pouvoirs d'investigation du président du tribunal de commerce qui peut convoquer le dirigeant pour envisager les mesures propres à redresser la situation de l'entreprise confrontée à des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ; renforcement des obligations des commissaires aux comptes), par l'aménagement de la procédure de règlement amiable instituée par les articles 35 à 37 de la loi du 1 er mars 1984 (définition élargie des critères justifiant l'ouverture de la procédure : toute entreprise commerciale ou artisanale qui, sans être en cessation des paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté à ses possibilités) et par la consécration dans la loi de la pratique du mandat ad hoc ;
- la simplification et l'accélération des procédures avec, en particulier, l'institution d' une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation lorsque l'entreprise a cessé son activité ou lorsque son redressement est manifestement impossible ;
- la restauration des droits des créanciers (renforcement du contrôle de la procédure par les créanciers, confié à des contrôleurs désignés par le juge-commissaire ; en cas de continuation, durée du plan de règlement plafonnée à dix ans avec un premier paiement au cours de la première année ; extension du droit de provoquer la réouverture de la liquidation clôturée pour insuffisance d'actif ...), en particulier des créanciers titulaires de sûretés antérieures à l'ouverture de la procédure collective (possibilité d'obtenir du juge-commissaire, dès la période d'observation, un paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance contre la fourniture d'une garantie bancaire ; aménagement du dispositif de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 pour écarter la priorité de paiement reconnue aux créances nées de la poursuite de l'activité après le jugement d'ouverture au profit des créances privilégiées antérieures) et des fournisseurs de la période d'observation (principe de paiement comptant des créances nées de la poursuite de l'activité et autorisation de la poursuite de l'exécution des contrats que dans la mesure où des fonds suffisants seront disponibles pour financer les échéances ; réduction de trois à deux mois à compter du jugement d'ouverture du délai d'impayés de loyers permettant au bailleur de demander la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise) ;
- moralisation des cessions d'entreprises (interdiction faite aux dirigeants de l'entreprise en redressement et à leurs parents ou alliés de présenter une offre de reprise ; obligation de procéder à l'inventaire des biens de l'entreprise dès l'ouverture de la procédure ; aménagement des modalités de présentation des offres et en particulier instauration d'un délai de quinze jours entre leur réception par l'administrateur et l'audience du tribunal procédant à leur examen ; renforcement des obligations du cessionnaire dans la mise en oeuvre du plan de cession).
En dépit des nombreuses améliorations apportées par la loi du 10 juin 1994, loi empreinte de pragmatisme dont l'entrée en vigueur avait été différée au 1 er octobre, force est de constater que les résultats obtenus au cours des années qui ont suivi continuent à révéler une incapacité à organiser un redressement des entreprises en difficultés : comme l'a rappelé le Garde des Sceaux dans sa communication en conseil des ministres du 14 octobre 1998, 90 % des procédures aboutissent à une liquidation .
Selon l'annuaire statistique de la justice pour 1999 et pour 2000, l'évolution du nombre de plans de redressement judiciaire (plans de continuation et plans de cession) et de liquidations judiciaires prononcés par l'ensemble des tribunaux de commerce et des tribunaux de grande instance à compétence commerciale sur la période 1993-1999 est la suivante :
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
|
Plans de
|
6200 |
6475 |
8062 |
8605 |
7427 |
7140 |
6039 |
|
Liquidations |
49195 |
42964 |
46263 |
51810 |
52124 |
45787 |
42364 |
|
Total |
55395 |
49439 |
54325 |
60415 |
59551 |
52927 |
48403 |
|
Proportion de
|
88,8 % |
86,9 % |
85,2 % |
85,8 % |
87,5 % |
86,5 % |
87,5 % |
Ces données statistiques révèlent une recrudescence, à compter de 1995 et donc en dépit des améliorations apportées par la loi de 1994 au dispositif de prévention, de la proportion des décisions de liquidation. Cette proportion semble se stabiliser à un niveau élevé de l'ordre de 87 %.
Ces chiffres éloquents ne doivent cependant pas conduire à une conclusion hâtive condamnant dans sa globalité le dispositif procédural en vigueur : le droit des procédures collectives est en effet un droit complexe et éminemment conflictuel qui tend à aménager un juste équilibre entre les intérêts en présence, équilibre qu'il convient de préserver pour éviter de compromettre le financement de l'activité économique.
Sans oublier que le nombre important de défaillances d'entreprises enregistré chaque année en France est largement imputable à un environnement administratif et fiscal et à une évolution des modes de financement (faiblesse des fonds propres, importance croissante du crédit inter-entreprises favorisant les réactions en chaîne en cas de difficultés) 4 ( * ) qui accroissent la vulnérabilité des entreprises face à la concurrence internationale, il apparaît qu'un déclenchement plus précoce des procédures permettant de déceler et de traiter les difficultés rencontrées serait de nature à alléger ce bilan regrettable. L'intérêt convergent des différents protagonistes que sont le débiteur, l'entreprise et les créanciers, réside dans cette intervention en amont permettant au mieux de sauvegarder l'entreprise et au moins d'assurer un désintéressement honorable des créanciers avant que l'actif n'ait été totalement englouti .
Cette perspective pose la double question de l'efficacité des mécanismes de prévention des difficultés et des procédures de traitement amiable et de la pertinence du critère d'ouverture des procédures collectives , c'est-à-dire de la date de déclenchement de la phase judiciaire. Comme le fait valoir le rapport d'expertise, il paraît aujourd'hui nécessaire de modifier l'axe d'intervention en déplaçant le centre de gravité des procédures 5 ( * ) .
I. PRÉVENTION ET TRAITEMENT AMIABLE : DES MÉCANISMES GLOBALEMENT SATISFAISANTS DONT L'UTILISATION DOIT ÊTRE ENCOURAGÉE
Trop fréquemment, les mécanismes de prévention et même les chances d'organiser un règlement amiable sont tenus en échec par le caractère tardif du déclenchement de l'alerte .
Ainsi, en 1997, pour près de 60.000 défaillances d'entreprises enregistrées, environ 12.500 entretiens préventifs ont été organisés entre le dirigeant et le président du tribunal de commerce, 1.000 mandats ad hoc ont été ordonnés et 500 règlements amiables ont été ouverts 6 ( * ) . Quand, toutefois, elle est initiée, la démarche de prévention intervient à un moment où l'état de cessation des paiements, qui rend obligatoire l'engagement de la phase judiciaire, est déjà patent.
Pareil constat pourrait conduire à considérer comme inadaptée la procédure d'alerte et de règlement amiable résultant de la loi du 1 er mars 1984. Or, ces mécanismes ont prouvé leur efficacité là où ils ont effectivement été mis en oeuvre. Au-delà de quelques ajustements du dispositif juridique, leur mise en oeuvre doit donc être améliorée, généralisée et encouragée .
A. UNE MISE EN oeUVRE TROP DISPARATE DES MÉCANISMES DE PRÉVENTION ET DE TRAITEMENT AMIABLE DONT L'EFFICACITÉ EST POURTANT AVÉRÉE
1. Les mécanismes de prévention résultant de la loi du 1er mars 1984
Les articles 29 et 34 à 38 de la loi du 1 er mars 1984, telle que modifiée par la loi du 10 juin 1994 7 ( * ) , instaurent une procédure d'alerte à l'initiative du président du tribunal de commerce, consacrent la pratique du mandat ad hoc et organisent une procédure de règlement amiable sous l'égide d'un conciliateur.
L'alerte consiste à dépister le plus tôt possible les difficultés à partir d'une série d'indices et à faire prendre conscience aux dirigeants de la nécessité d'y remédier.
L'article 29 précité instaure une procédure en quatre phases diligentée par le commissaire aux comptes ayant relevé des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la personne morale. Au terme de la procédure et si l'alerte est restée infructueuse, c'est-à-dire lorsque les organes compétents n'ont pas pris les décisions nécessaires pour assurer cette continuité, le commissaire aux comptes saisit le président du tribunal de commerce. Notons que la portée de ces mécanismes d'alerte doit être relativisée dans la mesure où, sur les quelque 2.350.000 entreprises françaises, seules 200.000 environ sont dotées d'un commissaire aux comptes. En outre, le commissaire aux comptes ne peut que se borner à indiquer au président du tribunal que l'alerte a été déclenchée en vain car il n'est pas délié de son secret professionnel.
Afin de conférer à cette procédure d'alerte un caractère davantage opérationnel , il serait concevable de prévoir une information du président du tribunal par le commissaire aux comptes dès que les conditions de déclenchement de la deuxième phase tendant à provoquer une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'au terme du délai de quinze jours aucune réponse du dirigeant envisageant les mesures de redressement pertinentes n'est parvenue au commissaire aux comptes. Une telle possibilité offerte au commissaire aux comptes risque cependant d'inciter le dirigeant à occulter certaines difficultés ; aussi conviendrait-il de prévoir que ce signal d'alarme adressé au président du tribunal ne puisse être actionné qu'avec l'assentiment du dirigeant.
Plus efficace paraît être le rôle dévolu au président du tribunal de commerce amené à connaître des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation d'une entreprise. La source de son information est indifférente ; cependant, le greffe du tribunal constitue un relais essentiel car il est à même de signaler les inscriptions de sûretés, une perte d'actif social ou encore le défaut de dépôt des comptes annuels. En vertu de l'article 34 susvisé, le président a alors la faculté de convoquer le dirigeant afin d'envisager les mesures propres à redresser la situation de l'entreprise. A l'issue de cet entretien, il peut désigner un mandataire ad hoc dont il définit la mission si la situation n'est pas très préoccupante, inviter le chef d'entreprise à demander un règlement amiable sous l'égide d'un conciliateur pour remédier à une difficulté juridique, économique ou financière ou répondre à des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise, ou encore attirer l'attention du dirigeant sur la nécessité de déposer son bilan si l'état de cessation des paiements est déjà constitué. Dans le cadre du règlement amiable, le président peut prononcer une suspension provisoire des poursuites lorsqu'elle est de nature à faciliter la conclusion d'un accord ; toutefois, la publicité de cette mesure met fin à la confidentialité qui entoure la procédure de règlement amiable.
2. Un dispositif efficace mais peu utilisé en pratique
Le président du tribunal dispose de larges pouvoirs d'investigation pour déterminer la situation économique, sociale et financière de l'entreprise. L'efficacité de son intervention dépend toutefois étroitement de sa capacité à organiser son réseau d'information pour dépister les difficultés suffisamment en amont. La loi, en effet, ne définit pas les indices permettant de déceler l'apparition d'une situation préoccupante, n'organise pas l'activation de ces signaux d'alerte ni la collecte ou la transmission de l'information au président du tribunal : c'est à ce dernier d'organiser un système de veille.
L'efficacité du dispositif d'alerte prévu par la loi est ainsi subordonnée à la mise en oeuvre des moyens de détection pertinents. Certaines juridictions ont activement développé leur système de prévention : c'est le cas du tribunal de commerce de Paris qui, depuis 1996, a mis en place une structure adaptée permettant d'exploiter les informations recueillies par le greffe et de convoquer quelque 4.500 chefs d'entreprise chaque année, le taux de succès des procédures amiables engagées, mandats ad hoc et conciliations, étant élevé. Selon les statistiques du tribunal de commerce de Paris, la proportion des entreprises engagées dans une procédure collective consécutive à une procédure préventive s'établit à environ 30 % des dossiers.
S'il faut se féliciter des initiatives ainsi prises et du dynamisme de certains tribunaux pour développer la prévention, cette démarche est loin d'être généralisée . Or, cette disparité de mise en oeuvre des mécanismes de prévention ne saurait perdurer car elle cristallise une rupture d'égalité entre les justiciables.
B. LA NÉCESSITÉ DE LEVER CERTAINS OBSTACLES AU DÉVELOPPEMENT DE LA PRÉVENTION
1. Des freins structurels liés à l'organisation des tribunaux de commerce
L'absence de généralisation de l'activité de prévention , qui empêche la détection précoce des difficultés et conduit à ce que les procédures amiables prévues par la loi n'ont, bien souvent, pas lieu d'être engagées, s'explique en partie par la disparité des moyens dont disposent les tribunaux . Rappelons que la structure de prévention mise en place par le tribunal de commerce de Paris mobilise une trentaine de magistrats honoraires. La disparité des volumes de dossiers traitant des difficultés rencontrées par les entreprises constitue également un frein à cette généralisation dans la mesure où la mise en place d'un système de veille nécessite une certaine expérience pour définir les « clignotants » pertinents. La révision en cours de la carte judiciaire devrait permettre de créer les conditions de cette généralisation.
Par ailleurs, le greffe constitue un rouage essentiel du dispositif de prévention : convergent vers lui de nombreuses informations qui constituent autant d'indicateurs de la situation de l'entreprise : le défaut de publication des comptes sociaux, la perte d'une partie du capital, la publication des privilèges de l'URSSAF et du Trésor public, la publication des protêts ou des certificats de non paiement... Collecteur naturel de l'ensemble de ces indicateurs, le greffe apparaît comme le lieu privilégié pour organiser leur exploitation pour la bonne information du Président du tribunal. Or, en l'absence de toute référence dans la loi à ce rôle majeur qui doit être dévolu aux greffes, ce type de collaboration est loin d'être systématique. Il paraîtrait donc opportun d' intégrer l'activité de traitement des signaux d'alerte dans la définition de la mission des greffes et de prévoir une rémunération spécifique dans la mesure où cette tâche, comme le souligne le rapport d'expertise, doit être considérée comme faisant partie intégrante de l'activité de la juridiction.
2. La nécessité de responsabiliser les acteurs pour renforcer l'efficacité de la prévention
Afin de faciliter la collecte des données révélatrices de difficultés rencontrées par l'entreprise et de rendre possible un déclenchement de l'alerte le plus en amont possible, certaines modifications pourraient être envisagées, tendant à responsabiliser les acteurs détenteurs de ces informations .
Tout d'abord, et alors même que l'absence de dépôt des comptes sociaux au greffe est fréquemment en elle-même révélatrice de graves difficultés rencontrées par l'entreprise, ces documents comptables constituent un précieux outil pour évaluer l'état de santé de l'entreprise. La régularité de leur dépôt permet d'appréhender l'évolution de la situation et, le cas échéant, de déclencher une action préventive suffisamment en amont pour assurer son efficacité. Or, en dépit de l'obligation légale de dépôt pénalement sanctionnée 8 ( * ) , de nombreux chefs d'entreprise s'exonèrent de cette formalité, soit par crainte que les informations ainsi rendues publiques soient exploitées à des fins de concurrence déloyale par des entreprises étrangères non encore soumises à la même obligation 9 ( * ) , soit en cas de dégradation déjà avancée de la situation de leur entreprise, les comptes n'étant alors bien souvent plus tenus à jour 10 ( * ) . Il apparaît donc urgent de renforcer le dispositif afin de garantir un meilleur respect de cette obligation.
A cet effet, la Chancellerie envisage de charger le commissaire aux comptes de veiller au respect de cette formalité, de rappeler cette obligation au dirigeant en cas de manquement et, à défaut pour celui-ci de s'y conformer, de le signaler au président du tribunal et au parquet. Notons que cette mesure n'aurait qu'un impact réduit dans la mesure où les entreprises dotées d'un commissaire aux comptes sont en nombre limité. Il est par ailleurs proposé de créer un mécanisme de condamnation sous astreinte dans le cadre de la procédure de référé et de faire du défaut de dépôt des comptes un cas facultatif de sanction civile frappant le dirigeant en cas d'ouverture d'une procédure collective. La Chambre de commerce et d'industrie de Paris, tout en approuvant ces différentes solutions, suggère d'offrir au président du tribunal, en l'absence de dépôt des comptes annuels, la possibilité d'interroger l'expert-comptable de l'entreprise.
L'ensemble de ces mesures paraît de nature à garantir plus efficacement le respect d'une obligation légale essentielle à l'amélioration de la prévention. La convention d'action concertée pour la prévention des difficultés des entreprises conclue au mois de mai 1999 entre la Conférence générale des tribunaux de commerce, le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes préconise des sanctions encore plus radicales : mention portée sur l'extrait K bis, déchéance de l'accès aux aides et marchés publics, sanctions personnelles du dirigeant en cas de procédure collective ultérieure.
Les créanciers privilégiés tels que le Trésor public et les organismes sociaux constituent également une précieuse source d'information pour la cheville ouvrière de la prévention que constitue le greffe du tribunal. Cependant, ces administrations, bien placées pour constater les difficultés en amont, ne sont pas astreintes à les signaler.
Si la loi du 28 décembre 1966 a organisé la publicité des privilèges du Trésor par une inscription sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce, cette publicité n'est obligatoire, aux termes de l'article 1929 quater du code général des impôts tel que modifié par la loi du 10 juin 1994, qu'à compter du moment où, au dernier jour d'un trimestre civil, les sommes dues par un contribuable dépassent 80.000 francs. Dès lors, le Trésor ne peut exercer son privilège que si l'inscription a été régulièrement faite. En vertu de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale également introduit par la loi de 1994, le privilège des organismes sociaux sur les biens meubles du débiteur garantissant le paiement des cotisations fait l'objet d'une inscription dans les mêmes conditions de délai et de montant.
Si ces modifications résultant de la loi de 1994 constituent un progrès, il serait opportun de réduire le délai au terme duquel le tribunal est informé du défaut de paiement de ce type de créances. En effet, dans une proportion importante de procédures collectives, l'actif est totalement absorbé par les dettes fiscales et sociales au détriment des créanciers chirographaires, le débiteur en difficultés commençant très souvent par ne plus payer ses impôts et ses cotisations. Le privilège attaché aux créances du Trésor et de la Sécurité sociale n'incite pas ces organismes à réagir rapidement. Afin de remédier à cet effet pervers, et sans remettre en cause des privilèges fondés sur l'intérêt général lié à la défense des deniers publics, certaines mesures pourraient être envisagées, telles que l'obligation d'informer le président du tribunal de commerce de tout retard de paiement excédant trois mois de créances exigibles sanctionnée par la perte du privilège dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure collective, ou encore la réduction du seuil fixé en matière d'inscription.
Ces différentes mesures seraient de nature à organiser une meilleure coordination entre les divers acteurs susceptibles de jouer un rôle en matière de prévention , de faire converger de façon plus systématique et plus tôt vers le tribunal les données significatives sur l'évolution de la situation de l'entreprise et de rendre plus efficace la collecte de l'information.
3. Les autres mesures envisageables pour faciliter la détection des difficultés
Sans donner au président du tribunal de commerce des pouvoirs d'investigation qui pourraient être perçus comme inquisitoriaux et de nature à lui permettre de s'immiscer dans le fonctionnement d'une entreprise in bonis , il serait imaginable de permettre au président du tribunal d'effectuer les démarches prévues par le second alinéa de l'article 34 de la loi du 1 er mars 1984 11 ( * ) avant même la tenue de l'entretien avec le dirigeant convoqué pour envisager les mesures propres à redresser la situation. Cette modification, préconisée par le rapport d'expertise 12 ( * ) , ne doit cependant pas entrer en contradiction avec le secret des affaires. C'est pourquoi cette extension des pouvoirs du président paraît devoir rester liée à la convocation du chef d'entreprise : elle aurait pour objet de faciliter la collecte des informations pour la préparation de l'entretien.
Une possibilité de procéder à des investigations encore plus en amont pourrait cependant être ouverte au président du tribunal en cas de défaut de dépôt au greffe des comptes annuels.
Il conviendrait en outre, puisque seule une faible proportion d'entreprises est dotée d'un commissaire aux comptes, d'étendre aux experts comptables et aux centres de gestion agréés la liste des personnes et organismes susceptibles d'être interrogés par le président du tribunal de commerce.
Une autre suggestion formulée par le rapport d'expertise 13 ( * ) consiste à inscrire dans la loi l'obligation pour le président du tribunal de convoquer le dirigeant de l'entreprise qui connaît des difficultés, la décision de ne pas susciter cet entretien devant faire l'objet d'une ordonnance motivée communiquée au parquet. Dans le prolongement de cette proposition, le rapport mentionne qu'il serait alors possible de concevoir « qu'après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du tribunal aurait la faculté de nommer d'office un administrateur provisoire, dont la mission pourrait être rapidement stoppée s'il s'avérait que le silence du dirigeant n'était dû qu'à sa négligence ou son indifférence, tandis que la situation économique de l'entreprise ne justifierait pas de mesures particulières ».
Alors que cette dernière proposition conduit à s'interroger sur sa compatibilité avec le principe de la liberté du commerce, créer une obligation de convocation du dirigeant pour le président du tribunal se heurte à un problème de définition de ses contours et constituerait une mesure d'une opportunité discutable. En effet, il n'existe pas de critères légaux permettant d'apprécier la nécessité de déclencher l'alerte : instaurer une obligation de convoquer le chef d'entreprise suppose la définition de tels critères. Or, le législateur ne s'est jamais engagé dans cette voie car il est impossible de cibler a priori un critère déterminant : les difficultés sont généralement révélées par un cumul d'indicateurs ; en outre, les signaux d'alerte pertinents peuvent différer selon le secteur d'activité. Figer dans la loi un mécanisme de « scoring » risquerait d'introduire des rigidités inutiles et contre-productives ; cela serait susceptible d'induire une surcharge de travail pour les tribunaux allant à l'encontre de l'objectif poursuivi qui nécessite de ménager les conditions d'une réaction rapide de la cellule de veille. Il convient de ne pas alourdir les procédures et, au contraire, de préserver la souplesse et privilégier le pragmatisme en permettant au président du tribunal d'exercer pleinement sa capacité d'appréciation.
Le développement de la prévention passe également par la sensibilisation des chefs d'entreprise qui, souvent insuffisamment informés ou conseillés, en particulier dans les petites structures, nourrissent de vains espoirs sur l'évolution d'une situation déjà dégradée et, en définitive, réagissent trop tard. Dans certaines structures, le chef d'entreprise manque de visibilité faute d'une gestion prévisionnelle suffisante. Enfin, les risques de répercussion sur le patrimoine personnel pour les entrepreneurs individuels ou les dirigeants qui se sont portés caution de dettes professionnelles ou encore les réticences à s'adresser au juge, fût-il consulaire, pour solliciter une aide afin de déterminer les mesures de redressement qui s'imposent constituent autant de freins à un développement précoce, et donc efficace, de la prévention.
L'information prévisionnelle , qui permet de déceler très en amont les difficultés, n'est imposée par la loi que pour les entreprises ayant atteint une certaine dimension, celles qui emploient au moins 300 salariés ou dont le chiffre d'affaires hors taxes annuel est égal ou supérieur à 120 millions de francs.
Ces entreprises sont tenues d'établir « une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel ». Contrairement aux comptes annuels, ces documents prévisionnels ne sont pas publiés car ils contiennent des informations susceptibles de porter atteinte au crédit de l'entreprise ; seuls le comité d'entreprise, le commissaire aux comptes et, lorsqu'il en existe un, le conseil de surveillance, en ont communication. En outre, aucune sanction spécifique ne vient sanctionner la méconnaissance de cette obligation d'établir ces documents prévisionnels.
Dans les entreprises ne répondant pas aux critères susvisés, l'établissement d'une information prévisionnelle est facultatif et rarement pratiqué du fait de son coût et du manque de moyens et d'expérience des dirigeants. Les groupements de prévention agréés, institués par l'article 33 de la loi du 1 er mars 1984 14 ( * ) pour leur fournir une assistance technique comptable et financière et les aider à détecter les difficultés, n'ont pas connu le succès escompté en dépit de la confidentialité attachée à cette procédure. Sans doute la réticence de nombreux chefs d'entreprise s'explique-t-elle par la crainte que cette confidentialité, du fait des contacts multiples entre les groupements et les autorités publiques et d'une absence de responsabilité spécifique garantissant le secret, ne soit pas strictement respectée. Il faut en outre regretter que le recours à ces organismes n'ait été prévu qu'au bénéfice des entreprises constituées sous la forme d'une personne morale.
Ainsi, surtout dans les petites structures dépourvues de cellule de gestion et de conseil, le dirigeant éprouve souvent une grande solitude face aux difficultés qui se présentent . Vaincre cette solitude suppose de rendre accessible un interlocuteur qui ne serait pas perçu comme une instance de co-gestion susceptible de s'immiscer dans les affaires de l'entreprise et qui présenterait de solides garanties de confidentialité. Plusieurs orientations sont envisageables telles que la révision de la mission et des conditions d'intervention des groupements de prévention agréés, qui ont déjà une existence légale, ou la création d'un réseau de sociétés de conseil agréées constituées par des professionnels déjà rompus au secret des affaires et bénéficiant de la confiance des chefs d'entreprise, comme le suggère la Chambre de commerce et d'industrie de Paris 15 ( * ) .
Le rôle d'information des organismes consulaires tels que les chambres de commerce et les chambres de métiers, sur l'importance d'établir une gestion prévisionnelle, sur l'attitude à tenir à l'apparition des premières difficultés et sur les responsabilités encourues devrait également être développé à l'attention des chefs d'entreprise. Dans cette perspective, le CNPF, aujourd'hui le MEDEF, a publié en septembre 1997 un guide pratique à l'usage du chef d'entreprise sur la prévention. Notons, par ailleurs, qu'une convention d'action concertée pour la prévention des difficultés des entreprises, conclue au mois de mai 1999 entre la Conférence générale des tribunaux de commerce, le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, propose de créer dans les régions des centres d'information sur la prévention auxquels serait assignée la double mission d'informer les dirigeants d'entreprise sur les enjeux de la prévention et les procédures amiables qui sont à leur disposition et de constituer un observatoire régional des entreprises en difficultés.
Si ces diverses initiatives sont de nature à créer un environnement susceptible de briser le silence et de lutter contre l'inertie dans lesquels tend à s'enfermer le chef d'entreprise lorsque surviennent les difficultés, encore faut-il que celui-ci ait pris conscience suffisamment tôt de ces difficultés. Cela suppose la tenue d'une comptabilité prévisionnelle minimale qui, bien souvent, fait aujourd'hui défaut. Le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables suggère ainsi de proposer aux chefs d'entreprise d'intégrer dans leurs lettres de mission des mentions tendant à l'établissement de comptes prévisionnels et de plans de trésorerie à court terme, à la mise en place d'une batterie d'indicateurs permettant d'identifier les risques de dégradation et à alerter le dirigeant dès la perception des premiers signes 16 ( * ) . Le rapport d'expertise, quant à lui, fait un pas supplémentaire en proposant de créer une « obligation pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, d'établir annuellement un document de financement prévisionnel non soumis à publication, mais qui devrait obligatoirement être commenté par écrit par l'expert-comptable ou le centre de gestion agréé » 17 ( * ) .
S'il convient, pour renforcer l'efficacité de la détection des difficultés, de permettre au dirigeant de disposer des outils d'anticipation pertinents, cette démarche trouve cependant ses limites dans les coûts qu'elle induirait.
C. DES AJUSTEMENTS DE NATURE À ENCOURAGER LE RECOURS AUX PROCÉDURES AMIABLES
Le renforcement de la prévention par un dépistage plus systématique et plus précoce des difficultés des entreprises constitue une condition préalable et nécessaire pour favoriser le développement du règlement amiable . Celui-ci ne paraît en effet envisageable que lorsque la situation ne connaît pas une dégradation telle qu'elle se traduit par une crispation des conflits d'intérêts rendant impossible la définition d'un accord.
Encourager le recours aux mécanismes de règlement amiable suppose par ailleurs de procéder à certains ajustements pour opérer une distinction plus nette avec la procédure collective proprement dite et corriger certaines lacunes et incohérences du cadre légal en vigueur.
1. Les mécanismes de règlement amiable en vigueur
La loi du 1 er mars 1984 s'efforce de faciliter la conclusion de règlements amiables en offrant au chef d'entreprise la possibilité de demander au président du tribunal de désigner un conciliateur sous l'égide duquel des négociations seront menées avec les créanciers afin d'obtenir des délais de paiement et, éventuellement, des remises de dettes devant permettre le redressement de la situation.
Cette procédure est ouverte, en vertu de l'article 35, « à toute entreprise commerciale ou artisanale qui, sans être en cessation de paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise ». Si le butoir constitué par un état de cessation des paiements avéré est expressément rappelé, les conditions de recours à la procédure de conciliation sont définies de façon souple laissant une marge d'appréciation au président du tribunal qui peut, s'il estime les difficultés rencontrées mineures ou passagères, se borner à désigner un mandataire ad hoc .
En dépit de cette intervention de l'autorité juridictionnelle, le règlement amiable n'est pas une procédure de nature contentieuse : il s'agit d'une procédure de nature contractuelle placée sous le sceau de la confidentialité , gage de son efficacité. Seul le dirigeant de l'entreprise en difficultés peut en être l'initiateur : ni les créanciers extérieurs, ni les salariés, ni le ministère public ne peuvent solliciter son engagement ; le tribunal ne peut davantage se saisir d'office.
Lorsque la demande du dirigeant est recevable, le président du tribunal fait le point de la situation de l'entreprise pour évaluer ses chances de redressement. Il dispose à cet effet d'un large pouvoir d'investigation et peut charger un expert d'établir un rapport.
Si les conditions sont satisfaites, le président désigne un conciliateur pour une durée maximale de trois mois , ce délai étant susceptible d'une prolongation d'un mois . Aux termes de l'article 36 de la loi de 1984, ce dernier est investi de la double mission de « favoriser le fonctionnement de l'entreprise et de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers », mais il ne se substitue pas aux dirigeants dans la gestion de l'exploitation. Pendant la durée des pourparlers tendant à la définition de l'accord, il peut cependant demander la désignation d'un mandataire ad hoc ou d'un administrateur provisoire. Il peut en outre demander au président du tribunal la suspension provisoire des poursuites engagées contre le débiteur pour la durée de la mission, laquelle, lorsqu'elle est prononcée, ne bénéficie cependant pas aux cautions. Si le règlement amiable a un caractère collectif, il n'est opposable qu'aux créanciers qui ont accepté d'y participer. Cet effet relatif lié au caractère contractuel de l'accord disparaît cependant si le règlement amiable est homologué par le président du tribunal, l'homologation étant obligatoire dans le seul cas où tous les créanciers sont parties à l'accord, ce qui est rare. L'ordonnance d'homologation peut imposer des délais de paiement d'une durée maximale de deux ans aux créanciers qui n'ont pas participé au règlement amiable. L'homologation, comme le prononcé de la suspension provisoire des poursuites, met fin à la confidentialité de la procédure.
En cas d'inexécution des engagements souscrits aux termes de l'accord, le tribunal prononce la résolution de celui-ci et la déchéance des délais de paiement accordés. Cette résolution débouche alors bien souvent sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Si la loi de 1984 modifiée en 1994, en imaginant ces mécanismes, a eu pour ambition de promouvoir une démarche amiable de résolution des conflits d'intérêts et de redressement de la situation de l'entreprise et d'éviter, dans la mesure du possible, l'issue judiciaire, cet objectif est loin d'avoir été atteint . Cet échec tient, certes, à une efficacité insuffisante des techniques de prévention, mais également à des incohérences qui compromettent la pertinence des mécanismes de règlement amiable.
2. Des ajustements de nature à améliorer la cohérence du dispositif de règlement amiable
Les mécanismes de règlement amiable des difficultés des entreprises souffrent de quelques contradictions internes mais également d'un décalage avec la réalité qui conduit parfois à des détournements de procédure.
a) Résoudre certaines contradictions en distinguant plus nettement la démarche amiable de la phase judiciaire
Certains éléments de procédure tels que la possibilité de prononcer la suspension provisoire des poursuites ou la formalité de l'homologation de l'accord, introduits par le législateur pour inciter les créanciers à rechercher activement un terrain d'entente et pour conférer au protocole d'accord une autorité morale accrue, mettent fin à la confidentialité qui caractérise le règlement amiable, lequel répond à une logique purement contractuelle. Cette confidentialité est pourtant essentielle au succès de la phase amiable et sa remise en cause risque de précipiter la dégradation de la situation en portant atteinte au crédit de l'entreprise. Il convient donc de s'interroger sur l'opportunité de maintenir ces procédures qui constituent une intrusion de la logique judiciaire dans une démarche d'essence contractuelle fondée sur la confiance mutuelle.
Aux termes de la loi de 1994, le conciliateur , dont la mission est de favoriser le fonctionnement de l'entreprise et de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers, a seul la faculté de demander au président du tribunal de suspendre les poursuites . Après avoir recueilli l'avis des principaux créanciers, ce dernier peut ordonner cette suspension pour une durée n'excédant pas le terme de la mission du conciliateur. Dès lors, il est interdit au débiteur, à peine de nullité, d'acquitter le paiement d'une créance, sauf lorsqu'elle résulte d'un contrat de travail, née antérieurement à cette décision de suspension, de désintéresser les cautions, de faire un acte de disposition extérieur aux besoins de la gestion courante de l'entreprise ou de consentir une hypothèque ou un nantissement.
Si cet instrument de contrainte que constitue la possibilité de prononcer la suspension des poursuites traduit la volonté du législateur de donner les moyens au conciliateur et au président du tribunal d'inciter les créanciers à aboutir à un accord dans le délai imparti, la suspension effective des poursuites paraît difficilement compatible avec la nature contractuelle, fondée sur l'échange des consentements, du règlement amiable. Il faut cependant reconnaître que cette mesure est rarement prononcée et joue plutôt comme une arme de dissuasion .
Si l'on ne peut que partager le souci du législateur de 1994 de rechercher les moyens de favoriser un accord lorsque la situation de l'entreprise le permet encore, on doit s'interroger sur la pertinence de l'instrument de la suspension provisoire des poursuites qui conduit à une judiciarisation du règlement amiable . Le fait qu'elle soit rarement prononcée paraît révélateur des réticences du juge à rendre publiques les difficultés rencontrées par l'entreprise et de son souci de favoriser la discrétion propice au redressement de la situation.
Outre l'écueil de la publicité, corrélative de toute mesure de suspension des poursuites , cette procédure connaît une autre limite qui peut faire douter de son efficacité : contrairement à ce qui est prévu par l'article 55 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises 18 ( * ) , la suspension provisoire des poursuites prononcée dans le cadre d'un règlement amiable ne bénéficie pas aux cautions ; or, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, le chef d'entreprise individuelle ou le gérant d'EURL ou de SARL ou un membre de sa famille est fréquemment conduit à se porter caution des dettes professionnelles si bien qu'il aura intérêt à demander l'ouverture de la procédure judiciaire. Pour autant, et contrairement à ce qui est préconisé dans le rapport d'expertise 19 ( * ) , le bénéfice de la suspension provisoire des poursuites ne semble pas devoir être étendu aux cautions au stade de la phase amiable car, privant d'efficacité cette prise de garantie pour les créanciers, cela risquerait de provoquer un tarissement du crédit.
Dès lors, la possibilité de prononcer la suspension provisoire des poursuites ne paraît pas l'instrument le mieux adapté pour favoriser l'aboutissement de la procédure amiable . La nécessité de faire parfois pression sur des créanciers récalcitrants pourrait être satisfaite par la création d'une faculté nouvelle, à la seule diligence du débiteur, de provoquer l'ouverture anticipée du redressement judiciaire : cette procédure présenterait l'avantage d'assurer un meilleur respect de la distinction entre phase amiable et phase judiciaire.
Une autre ambiguïté de la loi du 1 er mars 1984 résulte de son article 36 qui organise l'homologation de l'accord amiable . En vertu de ces dispositions, l'homologation par le président du tribunal est obligatoire pour un accord conclu avec tous les créanciers ; il est alors déposé au greffe et devient donc public. En revanche, l'homologation correspond à une simple faculté du président du tribunal lorsque l'accord n'est conclu qu' avec les principaux créanciers et des délais de paiement peuvent alors être imposés aux créanciers qui n'ont pas participé à l'accord.
Cette disparité de traitement selon que l'accord est passé avec l'ensemble des créanciers ou seulement certains d'entre eux, l'expression maladroite de « principaux créanciers » ne désignant pas ceux dont le montant des créances serait le plus élevé, ne paraît pas justifiée. En effet, le défaut d'unanimité est de nature à rendre l'accord davantage suspect ; aussi cela conduit-il à s'interroger sur la nature et la portée de la procédure d'homologation.
Les parties à l'accord conçoivent généralement l'homologation comme une garantie d'honorabilité conférant à celui-ci une autorité morale accrue. Fréquemment, une clause est insérée dans l'accord pour faire de son homologation une condition exécutoire. Cette authentification, répondant à la logique selon laquelle le règlement amiable constitue une démarche contractuelle qui se déroule sous le regard de la justice, ne correspond cependant nullement à un brevet de régularité car, à ce stade de la procédure, le président du tribunal de dispose pas d'une information complète lui permettant, en particulier, d'apprécier avec certitude l'absence d'état de cessation des paiements. Il paraîtrait donc opportun de faire de l'homologation une simple faculté, en toutes hypothèses, et de préciser dans la loi qu'elle ne fait pas obstacle à l'application ultérieure, le cas échéant, des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relatives à la nullité des actes illicites passés au cours de la période suspecte .
b) Harmoniser les mécanismes légaux et la pratique
En 1994, le législateur a pris le soin de consacrer dans la loi 20 ( * ) une pratique courante des tribunaux de commerce en matière de traitement amiable des difficultés des entreprises : le mandat ad hoc . Ce mécanisme permet en principe au dirigeant de rechercher, avec l'assistance d'un mandataire désigné par le président du tribunal qui définit sa mission, les solutions propres à remédier à des difficultés mineures ou passagères. Sa mise en oeuvre est placée sous le sceau de la plus grande confidentialité. Les tribunaux de commerce les plus actifs en matière de développement de la prévention y ont fréquemment recours : le président du tribunal de commerce de Paris a ainsi évalué à un tiers la proportion des dossiers méritant d'être traités dans le cadre du mandat ad hoc 21 ( * ) .
Cependant, la procédure très souple du mandat ad hoc est bien souvent détournée de sa finalité initiale pour en faire, comme l'indique le rapport d'expertise 22 ( * ) , un « mandat ad hoc préparatoire » à la phase de conciliation. Cela permet de contourner le dispositif de l'article 35 de la loi du 1 er mars 1984 qui limite à trois mois, ou quatre mois en cas de prolongation, la durée de la mission du conciliateur dans le cadre de la procédure de règlement amiable.
S'il faut éviter que la procédure de règlement amiable ne se prolonge inutilement, ne constitue une démarche dilatoire pour repousser l'échéance de l'ouverture de la procédure collective, il convient de ne pas méconnaître la nécessité, pour pouvoir mener à bien des pourparlers relatifs à des dossiers parfois complexes, de disposer de délais suffisants ; or, le délai légal est dans certains cas un délai trop bref même si le butoir légal constitue un élément de contrainte incitant les créanciers et le débiteur à s'accorder rapidement.
Souplesse et discrétion constituant les deux gages de l'efficacité du mandat ad hoc , il convient de ne pas rigidifier ce mécanisme car cela ne manquerait pas de dissuader les chefs d'entreprise d'y avoir recours. Il serait en revanche envisageable d'allonger légèrement la durée maximale du règlement amiable pour permettre une évaluation plus fiable de la situation de l'entreprise et donner de meilleures chances à la conclusion d'un accord entre le débiteur et les créanciers. La durée de la prolongation, actuellement fixée à un mois, pourrait être portée à trois mois : le président du tribunal aurait ainsi la faculté de moduler la durée totale de la mission du conciliateur en fonction de chaque situation concrète sans avoir recours à l'artifice du mandat ad hoc préparatoire.
3. Des mesures de nature à assurer une plus grande transparence et à encourager le recours aux procédures de traitement amiable
Au-delà des ajustements susceptibles d'assurer une meilleure cohérence du dispositif existant, les mécanismes de traitement amiable des difficultés des entreprises pourraient voir leur crédibilité renforcée par une amélioration de leur transparence. Le rapport d'expertise envisage par ailleurs des mesures de nature à inciter le dirigeant à engager collectivement le dialogue avec les créanciers dans le cadre des procédures amiables et une ouverture du champ du règlement amiable aux cas de cession et de liquidation lorsque la situation permet encore le désintéressement des créanciers.
a) Améliorer la transparence sans compromettre la souplesse et la confidentialité qui caractérisent les mécanismes de traitement amiable
Afin de clarifier les conditions d'intervention du mandataire ad hoc et du conciliateur et de conforter leur crédibilité face aux critiques qui ont pu être formulées, le document de travail élaboré par la Chancellerie, dans la perspective de la réforme de la législation sur les procédures collectives, propose d'instaurer de nouvelles garanties pour assurer leur indépendance et d'accroître le rôle du parquet.
Il est tout d'abord envisagé de créer de nouvelles incompatibilités et d'imposer aux mandataires ad hoc et aux conciliateurs la souscription d'une assurance garantissant leur responsabilité civile professionnelle. Au cours des cinq années suivant la fin de l'exercice de son mandat un juge consulaire ne pourrait pas exercer les fonctions de mandataire ad hoc ou de conciliateur. De même, une incompatibilité temporaire de deux ans interdirait l'exercice de ces fonctions à toute personne ayant rempli une mission rémunérée pour le compte de l'entreprise concernée. Enfin, et alors que l'article 27 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 23 ( * ) relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise dispose que « la même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur puis de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises avant l'expiration d'un délai d'un an lorsqu'il s'agit d'une même entreprise », il serait prévu de recueillir l'avis du parquet avant toute nomination, comme organe de la procédure collective, d'un mandataire ad hoc ou d'un conciliateur .
Si ces mesures, dans leur principe, sont de nature à garantir que le mandataire de justice aura une vision objective de la situation et ne sera pas « trop engagé au profit des intérêts du débiteur », les délais prescrits paraissent cependant quelque peu excessifs comparés au délai d'un an résultant de l'article 27 de la loi du 25 janvier 1985 susvisé. Concernant l'incompatibilité entre ces fonctions et celles de juge consulaire en particulier, il semblerait en outre pertinent d'intégrer le fait que l'affaire en cause relève ou non du ressort du tribunal dans lequel le juge concerné exerçait ses fonctions.
Par ailleurs, la proposition de définir plus précisément dans la loi la mission du conciliateur en vue de la taxation de sa rémunération paraît d'une opportunité discutable. En effet, le législateur a volontairement défini de façon très large l'objet de cette mission 24 ( * ) , son contenu étant laissé à l'appréciation du président du tribunal qui statue en fonction de chaque situation concrète. Le succès des procédures amiables, lorsqu'elles sont mises en oeuvre, s'expliquant en grande partie par leur souplesse, il est impératif de ne pas introduire, par souci de précision, des rigidités dans le dispositif . Dès lors, et comme le fait valoir le rapport de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris 25 ( * ) , il apparaît délicat d'établir un barème de rémunération qui puisse s'appliquer à toutes les interventions, le principe amiable s'accommodant mal, au demeurant, d'un système d'honoraires imposés.
Notons qu'en vertu de l'article 37 de la loi du 1 er mars 1984 26 ( * ) il est déjà prévu que « le président du tribunal fixe en accord avec le demandeur les conditions de rémunération du conciliateur ». Afin de prévenir certaines dérives et de renforcer le contrôle des rémunérations perçues par ces mandataires, il serait cependant envisageable de prévoir qu'à défaut d'accord du débiteur ou en cas de dépassement survenant pendant le déroulement de la mission, le montant de la rémunération serait fixé par ordonnance du président du tribunal. Un contrôle de la rémunération du mandataire ad hoc par le président du tribunal pourrait également être prévu à l'occasion de la définition de la mission de celui-ci. Par ailleurs, et en dépit de l'absence de formalisme qui doit continuer à caractériser le mandat ad hoc , il paraîtrait justifié d'exiger du mandataire qu'il rende compte du déroulement de la mission qui lui a été confiée au président du tribunal qui l'a désigné.
S'agissant du parquet , s'il est concevable d'élargir ses possibilités d'intervention dans les procédures préventives, cela ne doit pas conduire à remettre en cause leur caractère largement informel, gage de leur efficacité.
Il convient à cet égard, afin de ne pas dissuader les chefs d'entreprise de recourir au mandat ad hoc , d'éviter une immixtion du parquet. Plus informelle que le règlement amiable, cette procédure doit rester dominée par la plus grande discrétion. Une exception pourrait cependant être admise pour les sociétés cotées, l'information du parquet étant alors justifiée par l'existence d'un intérêt public économique.
En revanche, certaines informations pourraient être rendues accessibles au parquet dans le cadre de la procédure de règlement amiable , en particulier celles lui permettant de s'assurer du respect des règles déontologiques ou de vérifier que l'entreprise ne se trouve pas en situation de cessation des paiements. Précisons qu'en vertu de l'article 38 du décret du 1 er mars 1985 pris pour l'application de la loi du 1 er mars 1984, l'ordonnance du président du tribunal statuant sur l'homologation de l'accord amiable est communiquée au procureur de la République.
Comme le suggère la Chambre de commerce et d'industrie de Paris 27 ( * ) , l'ensemble du dossier relatif au mandat ad hoc ou au règlement amiable pourrait être communiqué au parquet en cas d'ouverture ultérieure d'une procédure collective.
L'intervention du parquet dans les mécanismes de traitement amiable des difficultés des entreprises serait ainsi renforcée tout en demeurant strictement limitée afin de préserver le caractère informel et la confidentialité, gages d'efficacité, qui doit continuer à entourer ces procédures. Ce principe du secret, déjà inscrit dans les textes en ce qui concerne le règlement amiable 28 ( * ) , devrait d'ailleurs également être formellement mentionné dans la loi pour le mandat ad hoc .
b) Rendre les procédures amiables plus attractives et étendre leur champ d'application
Le rapport d'expertise 29 ( * ) envisage certaines mesures devant inciter le chef d'entreprise à recourir au règlement amiable et, par ailleurs, propose un dispositif très novateur tendant à instituer « un régime de liquidation ou de cession amiables de l'entreprise, sous contrôle judiciaire ».
(1) Les mesures proposées par le rapport d'expertise pour inciter le débiteur à recourir au règlement amiable
Afin de rendre le règlement amiable plus attractif, il est suggéré de prévoir que « l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires intervenant après échec, faute d'accord conclu avec les créanciers, d'un règlement amiable ou après résolution pour inexécution de l'accord résultant d'un règlement amiable ne pourra donner lieu à la fixation d'une date de cessation des paiements antérieure à l'un ou à l'autre de ces événements, sauf fraude ou mauvaise foi du débiteur ». Il fait valoir que le chef d'entreprise trouverait dans un tel dispositif « un avantage évident sur le plan personnel au regard d'une éventuelle action en paiement des dettes sociales ou tendant au prononcé de sanctions personnelles » et que « les tiers y trouveraient, quant à eux, également avantage au regard d'une éventuelle recherche de responsabilité pour soutien abusif (...) ainsi qu'au regard des dispositions sur les nullités de la période suspecte ».
Si ce type de dispositif est sans nul doute, à première vue, de nature à encourager vivement le chef d'entreprise à demander l'ouverture d'un règlement amiable et à favoriser la conclusion d'un accord, il semble qu'il présente également un certain nombre d'incertitudes et de risques.
Le dispositif envisage deux hypothèses : celle où la procédure de règlement amiable a été engagée mais a échoué et celle où, un accord amiable ayant été conclu, il fait l'objet d'une résiliation pour inexécution.
Dans l'hypothèse où la procédure de règlement amiable ne parviendrait pas à son terme , la date de la cessation des paiements déterminée par le tribunal ne pourrait remonter dans le temps avant celle où l'échec serait constaté. Cela aurait pour effet de limiter la durée de la période suspecte qui, correspondant à la période s'écoulant entre la cessation des paiements et le jugement d'ouverture de la procédure collective, est actuellement plafonnée à dix-huit mois par l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 30 ( * ) .
Or, l'échec peut être imputable aux créanciers comme au débiteur, l'imputabilité étant difficile à établir. Ce dernier ayant seul la faculté de demander l'ouverture d'un règlement amiable, le dispositif lui donne en conséquence la possibilité de se prémunir contre la remise en cause d'actes qui auraient été passés pendant les pourparlers menés en vue de la recherche d'un accord. Lorsque le conciliateur n'a pas demandé la désignation d'un mandataire ad hoc ou d'un administrateur judiciaire, chargés d'assister le dirigeant dans sa gestion ou de se substituer à lui, rôle qui ne peut être assumé par le conciliateur lui-même, les actes ainsi passés sont susceptibles d'aggraver la situation de l'entreprise et, en cas d'ouverture d'une procédure collective, de compromettre le redressement de l'entreprise au détriment, in fine , des tiers créanciers. Les tiers ne participant pas aux pourparlers paraissent exposés à un risque encore plus grand dès lors qu'en l'absence de suspension provisoire des poursuites prononcée par le président du tribunal à la demande du conciliateur les pourparlers restent secrets.
Sans commettre d'acte susceptible d'être ultérieurement qualifié de fraude, le débiteur peut être tenté d'utiliser la voie ainsi ouverte à des fins dilatoires ; en outre, sa mauvaise foi, qui l'empêcherait de bénéficier de la protection résultant de la limitation de l'antériorité de la période suspecte, risque de ne pas être aisée à prouver.
Par ailleurs, la détermination de la date du constat d'échec n'est pas évidente sauf à la faire coïncider avec le terme de la durée de la mission confiée au conciliateur pour rapprocher les parties. Enfin, on constate que bien souvent l'échec débouche sur le dépôt de bilan du fait de la survenance de l'état de cessation des paiements : en pareil cas, l'avantage offert par le dispositif s'annule, sauf à reconnaître que la cessation des paiements correspondait déjà à un état avéré, ce qui revient à légitimer le non respect de l'obligation de procéder au dépôt de bilan dans les quinze jours de la cessation des paiements.
Dans la seconde hypothèse , celle où une procédure collective serait ouverte après résolution pour inexécution de l'accord conclu dans le cadre du règlement amiable , la date de la cessation des paiements déterminée par le tribunal ne pourrait remonter dans le temps avant celle du prononcé par le tribunal de cette résolution.
Là encore, le plus souvent, la résolution constitue le prélude à l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire, soit que la résolution résulte de la non exécution d'un engagement financier tel que le non respect d'une échéance fixée par l'accord - l'ouverture de la procédure est alors obligatoire même lorsque le manquement n'est pas révélateur d'un état de cessation des paiements, ce qui est d'ailleurs rarement le cas -, soit que la résolution résulte d'un manquement d'une autre nature qui provoque la cessation des paiements - ce qui est fréquent car la résolution entraîne la déchéance de tous les délais de paiement prévus par le règlement amiable ou accordés par le tribunal. Ici aussi, fixer comme butoir la date du prononcé de la résolution paraît constituer en définitive un maigre avantage.
Pour cet ensemble de raisons, le dispositif proposé n'apparaît pas opportun.
Hormis ces mesures destinées à accroître le caractère attractif du règlement amiable , le rapport d'expertise suggère d'inciter le débiteur à y recourir en faisant de son refus, qui ne serait pas justifié par une « raison valable », une faute de gestion susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 31 ( * ) .
Cette proposition paraît peu compatible avec le caractère facultatif du recours à la procédure du règlement amiable, laissé à la seule diligence du débiteur. En effet, ni les créanciers extérieurs, ni les salariés, ni le ministère public ne peuvent intervenir et le tribunal ne peut pas se saisir d'office. Seules les entreprises agricoles connaissent un régime différent, les créanciers disposant d'un droit d'initiative concurrent (article L. 351-2 du code rural). Parler de refus supposerait que la proposition d'engager un règlement amiable puisse émaner d'une autre personne, et donc de modifier sur ce point le droit en vigueur.
Cependant, ériger le refus du débiteur qui ne serait pas dûment justifié en une faute de gestion reviendrait en réalité à faire du règlement amiable un préalable obligatoire . En outre, la notion de « raison valable » , susceptible de fonder valablement un refus, paraît d'une portée incertaine et constituerait une source d'insécurité juridique pour le débiteur, laissant en réalité toute latitude d'appréciation au juge. Cela est difficilement admissible lorsqu'on mesure les conséquences qui peuvent en résulter pour le débiteur.
Les différentes solutions préconisées par le rapport d'expertise pour rendre le recours à la procédure de règlement amiable plus attractif, de prime abord séduisantes, semblent donc en définitive devoir être écartées.
(2) Une solution novatrice : l'institution d'une procédure de cession ou de liquidation amiable sous contrôle judiciaire
Partant de l'idée selon laquelle « entre les choix exercés en toute liberté et indépendance par le débiteur ne connaissant pas de sérieuses difficultés et la nécessaire intervention judiciaire contraignante au cas de cessation des paiements, des degrés pouvaient être institués pour répondre aux situations révélées par la pratique », le rapport d'expertise fait valoir que « le surendettement d'une entreprise, sans atteindre le seuil comptable critique de la cessation des paiements (...), s'il compromet la continuité de l'exploitation, devrait permettre, à la demande du débiteur, par analogie avec le règlement amiable, l'ouverture d'une liquidation amiable sous contrôle judiciaire ou même une cession amiable d'entreprise, mais judiciairement contrôlée » 32 ( * ) .
Le critère caractérisant la situation de l'entreprise susceptible de faire l'objet d'une cession ou d'une liquidation amiables sous contrôle judiciaire serait identique à celui qui est retenu pour l'ouverture d'un règlement amiable : la constatation de besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise.
Le débiteur aurait ainsi la faculté de demander au tribunal de désigner « un mandataire qui l'assisterait ou même le représenterait pour planifier la liquidation ou la cession amiables de son entreprise et le paiement de ses créanciers », tous les créanciers devant être désintéressés .
Pareille proposition, qui ouvre de nouveaux horizons aux issues amiables lorsque la situation de l'entreprise n'est pas encore trop dégradée, tend à éviter le traumatisme attaché au dépôt de bilan pour le débiteur tout en préservant intégralement les intérêts des créanciers . Ces formules s'adresseraient, selon le rapport d'expertise, aux débiteurs de bonne foi « quelque peu dépassés par les événements » et auraient pour ambition de « modifier l'attitude des repreneurs potentiels qui, actuellement, attendent la déclaration de cessation des paiements pour se manifester quand ils ne la provoquent pas directement ou indirectement ».
• La liquidation amiable sous contrôle judiciaire :
Il existe aujourd'hui déjà une procédure de dissolution-liquidation des sociétés , s'appliquant dans les cas visés à l'article 1844-7 du code civil (expiration de la période pour laquelle la société a été constituée, extinction de son objet, annulation du contrat de société, dissolution anticipée décidée par les associés, dissolution prononcée par le tribunal pour justes motifs tels que l'inexécution de ses obligations par un associé ou la mésentente paralysant le fonctionnement de la société, dissolution demandée à la suite de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main, dissolution pour une cause prévue par les statuts) et dont le régime juridique est fixé par les articles 1844-8 et suivants du code civil et par les articles 390 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales désormais codifiée au livre II du code de commerce.
La durée des opérations de liquidation est limitée à trois ans ; le liquidateur, en principe nommé selon la procédure définie par les statuts ou, à défaut, par les associés ou encore par décision de justice, n'est pas nécessairement un mandataire de justice. Le liquidateur, qui se substitue aux organes de direction et exerce les pouvoirs de gestion et de représentation, dresse un inventaire de l'actif et du passif. Au fur et à mesure des opérations de liquidation, il règle les créanciers « au prix de la course », sans être tenu de respecter un ordre de priorité quelconque. L'état estimatif doit cependant lui permettre de vérifier que les fonds sont suffisants pour désintéresser tous les créanciers car si tel n'est pas le cas il doit procéder au dépôt de bilan. Lorsqu'il existe un boni de liquidation, il est en principe réparti entre les associés proportionnellement à leurs droits.
Cependant, le régime fiscal applicable en cas de dissolution d'une société prospère relevant de l'impôt sur les sociétés est très dissuasif ce qui conduit souvent à préférer une mise en hibernation : en effet, la société doit acquitter l'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat de liquidation, lequel prend en compte notamment la cession globale des stocks et la reprise des provisions antérieurement constituées, auquel il faut ajouter les plus-values sur cessions d'immobilisations ; elle doit également acquitter le précompte, au taux de 33,1/3 %, qui s'applique aux sommes non soumises à l'impôt sur les sociétés telles que les réserves de plus-values à long terme. En outre, le boni de liquidation est imposé comme les dividendes, avec application du régime de l'avoir fiscal.
A côté de ces procédures, le rapport d'expertise 33 ( * ) propose d'instituer une liquidation amiable sous contrôle judiciaire à la demande du débiteur lorsque les besoins ne peuvent être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise.
Le régime juridique applicable résulterait de la transposition des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et de celles du nouveau code de procédure civile (articles 1281-1 à 1281-12) pour les modalités de distribution des deniers.
Un ou plusieurs liquidateurs seraient désignés par le président du tribunal, seraient investis d'une mission de conseil, d'assistance, de gestion ou de représentation selon le cas et devraient dresser un inventaire estimatif de l'actif et du passif puis désintéresser les créanciers si les fonds sont suffisants. La durée des opérations serait limitée à trois mois, sauf prolongation accordée par le président du tribunal si la situation le justifie. La déclaration des créances devrait intervenir dans le délai d'un mois à compter de l'avis adressé aux créanciers, sous peine de déchéance du droit de participer à la distribution des deniers consignés, sans que cette déchéance ait pour effet d'éteindre la créance toujours susceptible d'être recouvrée par les procédures de droit commun. En cas de désaccord sur la répartition, après une tentative de conciliation, le juge pourrait être saisi, le jugement de répartition étant alors notifié à la Caisse des dépôts et consignations pour paiement des créanciers dans un délai de quinze jours.
Une telle proposition paraît séduisante dans la mesure où elle est de nature à préserver à la fois les intérêts du débiteur, qui n'aura pas à subir une procédure collective s'il prend l'initiative d'engager la procédure à un moment où la situation de l'entreprise est encore suffisamment saine, et ceux des créanciers qui, par hypothèse, doivent être intégralement désintéressés, la procédure se déroulant sous le contrôle du juge. En outre, à la différence de la procédure susvisée de dissolution-liquidation, son champ serait plus large : pourraient en bénéficier à la fois les personnes physiques et les personnes morales relevant de la loi du 25 janvier 1985 .
Son instauration suppose cependant que le coût fiscal d'une telle opération ne soit pas rédhibitoire : il conviendrait donc d'instaurer un régime d'imposition favorable, le rapport d'expertise faisant valoir à juste titre que « le manque à gagner immédiat serait largement compensé par la disparition de pertes en cascade ultérieurement déductibles du bénéfice imposable des partenaires de l'entreprise et l'apparition de créances fiscales sur le débiteur qui seraient réellement recouvrables ».
• La cession amiable judiciairement assistée :
La procédure de cession amiable judiciairement assistée proposée par le rapport d'expertise 34 ( * ) pourrait avoir pour objectif soit une restructuration de l'activité de l'entreprise soit sa cession globale à un moment où, bien qu'éprouvant des difficultés sérieuses susceptibles d'obérer son avenir, la société concernée est encore in bonis .
Si rien n'interdit à ce jour au chef d'entreprise se trouvant dans ce type de situation de céder une branche d'activité, une unité de production ou son fonds de commerce, une telle opération est rarement menée à bien en temps utile car celui-ci forge généralement l'espoir de redresser ladite situation, laisse s'écouler un temps précieux permettant le développement de la spirale de l'endettement et, outre les freins psychologiques favorisant l'inertie, redoute les difficultés qui jalonnent une telle entreprise souvent complexe.
Aussi le possible recours à un mandataire serait-il de nature à l'inciter à réagir plus tôt pour envisager une opération de cession. Ce professionnel pourrait être chargé d'assister le chef d'entreprise dans le but de faire le point de la situation de l'entreprise, de définir les mesures devant remédier aux difficultés rencontrées et de vérifier qu'elles permettent de désintéresser intégralement les créanciers , de susciter des offres de reprise, de négocier le contrat de cession et de veiller à sa mise en oeuvre.
Afin de garantir la transparence de la procédure, celle-ci se déroulerait sous le regard du juge , le débiteur restant cependant seul maître des décisions à prendre. Le juge pourrait être ainsi conduit, à la demande du débiteur ou de son mandataire, à veiller au caractère sérieux des offres ; il pourrait également contrôler que l'initiative prise par le débiteur ne constitue pas une manoeuvre dilatoire. Le recours à cette procédure n'étant possible, par hypothèse, que lorsque les mesures envisagées permettent le désintéressement complet des créanciers, cela justifie que le débiteur reste seul à prendre les décisions correspondantes, le principe de la liberté du commerce conservant dans ce contexte toute sa portée.
Le succès et l'efficacité d'une telle procédure, qui correspond d'ailleurs à une pratique développée par certaines juridictions commerciales les plus avancées en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises, seraient cependant subordonnés à la mise en place d'un véritable marché des offres de reprise dont la fluidité serait la meilleure garantie d'une réelle transparence. Comme cela a été préconisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris dans un rapport de 1997 élaboré par sa commission juridique 35 ( * ) en matière de procédures collectives, il paraîtrait nécessaire d'organiser un système centralisé de consultation des affaires à céder de nature à renforcer le jeu de la concurrence et à optimiser les conditions de reprise.
*
Outre le renforcement de la prévention et des mécanismes amiables, le traitement judiciaire des difficultés des entreprises appelle un certain nombre d'ajustements et de correctifs. En effet, essentiellement liquidatives, les procédures collectives ont bien souvent un coût et une durée disproportionnés eu égard à la situation en cause. Sans bouleverser l'équilibre défini en 1994, certaines clarifications pourraient permettre de mieux prendre en compte la réalité économique.
*
II. DES PROCÉDURES JUDICIAIRES ESSENTIELLEMENT LIQUIDATIVES QUI CONDUISENT À S'INTERROGER SUR LA PERTINENCE DU CRITÈRE D'OUVERTURE ET À ENVISAGER QUELQUES ASSOUPLISSEMENTS
Lorsque l'action préventive ou le règlement amiable n'ont pu être mis en oeuvre en temps utile ou que ces tentatives ont échoué pour aboutir à la cessation des paiements, la phase judiciaire prend le relais.
La matérialisation de la cessation des paiements, c'est-à-dire aux termes de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-1 du code de commerce « l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible », en constitue le facteur déclencheur ; sa déclaration au tribunal est obligatoire et incombe au débiteur dans un délai de quinze jours, le défaut de déclaration ou la déclaration tardive étant une cause de faillite personnelle en vertu de l'article 189-5° de la même loi (article L. 625-5 du code de commerce 36 ( * ) ).
La constatation de la cessation des paiements entraîne l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation. Le tribunal recherche si l'entreprise considérée relève du régime général ou du régime simplifié 37 ( * ) . En général, n'étant pas en mesure d'évaluer les chances de redressement de l'entreprise dès le jugement d'ouverture, le tribunal ouvre, à titre provisoire, un redressement judiciaire et ne se prononce sur son sort (plan de redressement avec continuation ou cession ; liquidation) qu'à l'issue de la période d'observation ayant permis d'établir un bilan économique et social de l'entreprise. Depuis la loi du 10 juin 1994 cependant, le tribunal peut prononcer immédiatement la liquidation lorsque l'entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible.
Notons que la procédure de liquidation immédiate est très fréquemment mise en oeuvre, sanctionnant le caractère irrémédiable de la situation de l'entreprise au jour du jugement d'ouverture : l'issue liquidative s'impose d'emblée. Plus généralement, la phase judiciaire se solde dans la très grande majorité des cas par une liquidation : les statistiques révèlent la pérennité du phénomène et les différentes réformes n'ont manifestement pas permis d'inverser la tendance ce qui conduit à s'interroger sur la pertinence du critère d'ouverture et sur la nécessité de différencier les procédures applicables, le caractère complexe et onéreux du régime en vigueur contrastant souvent avec la faiblesse des actifs.
A. LE CARACTÈRE ESSENTIELLEMENT LIQUIDATIF DES PROCÉDURES COLLECTIVES
L'annuaire statistique établi par le ministère de la justice révèle que le nombre de jugements d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires enregistré en 1998, de l'ordre de 50.000, correspond à celui enregistré au début de la décennie. Rappelons que ce nombre, stabilisé aux alentours de 10.000 jusqu'au premier choc pétrolier, a ensuite connu une forte progression et un mouvement d'accélération :
15.000 en 1975, 20.000 en 1980, 25.000 dès 1984, 30.000 en 1987, 35.000 en 1988, 40.000 en 1989 et plus de 50.000 en 1991.
Après un creux en 1994, le nombre de jugements d'ouverture a connu une progression continue pour atteindre un sommet en 1997 ; sur cette période, cette progression s'est cependant effectuée à un rythme annuel se réduisant de plus de moitié chaque année. 1998 marque une rupture dans cette évolution, avec une nette inversion de tendance qui se solde par une diminution substantielle en valeur absolue. Ce mouvement à la baisse fondé sur une amélioration de l'environnement économique s'est confirmé en 1999. Pour cette dernière année statistique disponible, la Chancellerie évalue à moins de 47.000 le nombre de jugements d'ouverture ou de liquidations immédiates, soit une baisse de 6,8 %.
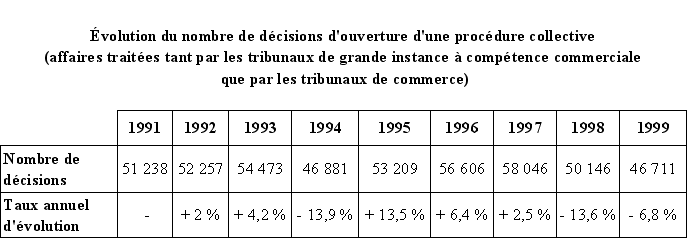
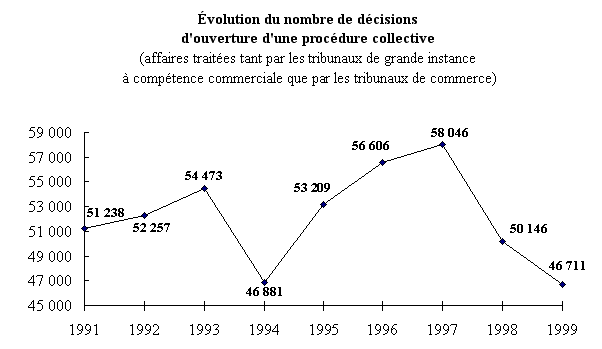
1. Des procédures concluant dans la très grande majorité des cas à la liquidation de l'entreprise
Depuis 1994, le nombre de plans de redressement prononcés oscille entre 6.000 et 8.600 par an. Sur cette période, les décisions concluant à la liquidation sont chaque année six à sept fois plus nombreuses que celles envisageant la survie de l'entreprise , le plan de redressement pouvant conduire à la continuation ou à la cession partielle ou totale de cette dernière. Notons qu'au début de la décennie, ce rapport était encore supérieur, s'établissant entre huit et dix : la tendance est donc à la réduction de l'écart, l'amélioration de l'environnement économique au cours des dernières années expliquant sans doute un renforcement des perspectives de redressement des entreprises en difficulté. Selon l'INSEE, le mouvement de réduction du nombre de défaillances d'entreprises jugées s'est poursuivi en 2000 mais une inversion de tendance se dessine depuis le printemps 2001, ce retournement affectant plus particulièrement les entreprises de plus de cinquante salariés.
Selon les données disponibles jusqu'en 1999, le nombre de décisions de liquidation demeure cependant massivement plus élevé que celui des plans de redressement, les procédures collectives continuant à revêtir un caractère essentiellement liquidatif. Ainsi en 1998 et 1999, la proportion de liquidations prononcées s'établit-elle respectivement à 86,5 % et 87,5 %, soit une légère décrue par rapport au début des années 1990 où ce ratio s'élevait à plus de 90 %.
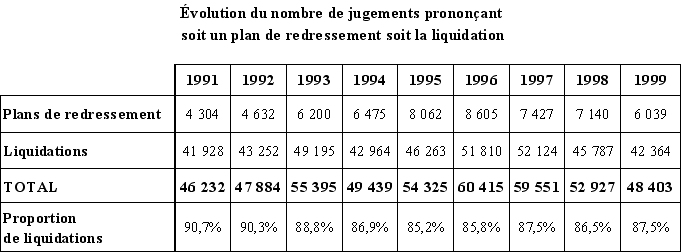
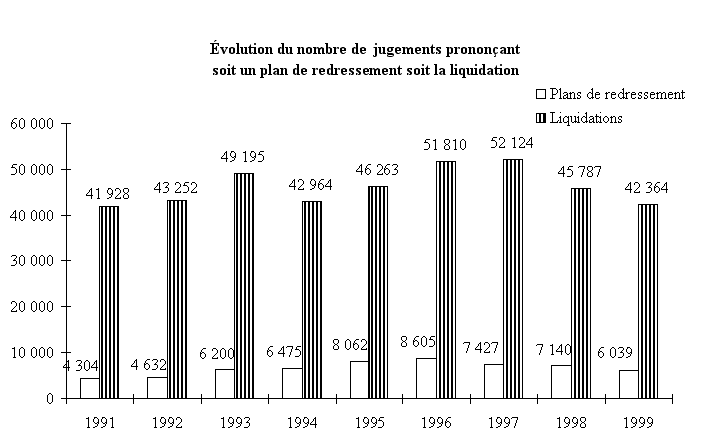
2. Une proportion de liquidations immédiates en constante augmentation
Le nombre global de liquidations prononcées chaque année, qui a augmenté de près de 10.000 de 1994 à 1997, a connu une nette décrue en 1998, corrélative de la forte baisse du nombre de jugements d'ouverture. Cette décrue s'est confirmée en 1999.
Cet ensemble des décisions de liquidation comprend les liquidations prononcées immédiatement et celles qui interviennent après une période dite « période d'observation » : la proportion des liquidations immédiates dans cet ensemble, stable au début de la décennie aux alentours de 50 %, n'a cessé d'augmenter depuis 1994, date d'instauration par le législateur d'une véritable procédure de liquidation immédiate entérinant une pratique bien établie et permettant d'éviter le simulacre consistant à ouvrir une période d'observation pour une durée purement symbolique 38 ( * ) .
La proportion de liquidations immédiates est ainsi passée de 51,3 % en 1994 à 72, 2 % en 1999.
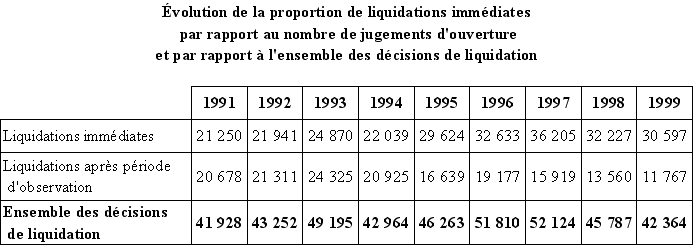
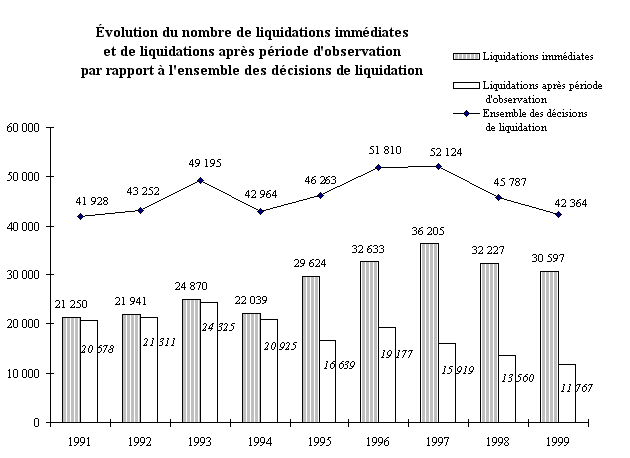
Notons que la proportion de liquidations immédiates par rapport aux décisions d'ouverture, de l'ordre de 41 % en 1991 a atteint plus de 65 % en 1999, selon un mouvement de progression continu. En 1999, près des deux tiers des décisions d'ouverture d'une procédure collective concluent ainsi à une liquidation immédiate, ce qui est considérable et illustre le caractère irrémédiable de la situation de la plupart des entreprises au moment du dépôt de bilan.
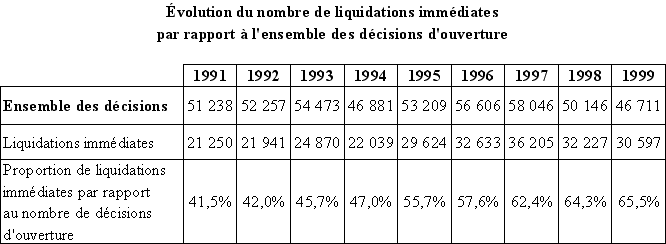
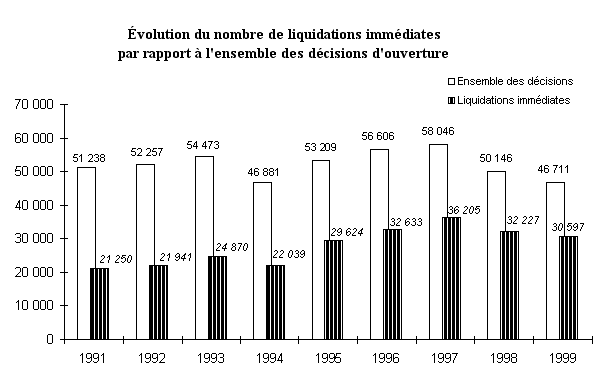
Ce constat du caractère essentiellement liquidatif des procédures collectives et de l'importance de la proportion de liquidations immédiates conduit à s'interroger sur la pertinence du moment auquel s'impose l'ouverture de la procédure. Outre la faiblesse des moyens de prévention mis en oeuvre, soulignée précédemment, il semble que la tardiveté de l'ouverture soit bien souvent de nature à compromettre toute chance de redressement, ce qui appelle une réflexion sur la pertinence du critère retenu par le législateur : « la cessation des paiements ».
B. L'ADAPTATION DU CRITÈRE D'OUVERTURE : UNE DÉMARCHE NÉCESSAIRE MAIS DÉLICATE
Découlant en apparence de façon mécanique d'une définition fondée sur une approche comptable, la détermination de la date de la cessation des paiements laisse place à une réelle marge d'appréciation et cette date est parfois en décalage avec la réalité économique.
1. La cessation des paiements : une définition apparemment claire et objective
La cessation des paiements constitue une notion clé des procédures collectives : son constat et sa déclaration en déclenchent l'ouverture. Par ailleurs, la fixation de la date de cessation des paiements, qui peut être reportée par décision du tribunal sans cependant pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture, est le point de départ de la période dite « suspecte » au cours de laquelle certains actes effectués en fraude des droits des créanciers peuvent être annulés. En outre, la notion de cessation des paiements est cruciale car elle contribue à la détermination du champ d'application du droit pénal des procédures collectives.
L'article 3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-1 du code de commerce, la définit comme « l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». En outre, un délai de quinze jours au plus est imparti au débiteur à compter de la cessation des paiements pour effectuer la déclaration devant le tribunal et demander l'ouverture de la procédure. Cette définition, empruntée à la jurisprudence de la Cour de Cassation, remontait à 1978 (Cass. Com., 14 février 1978).
La notion s'articule autour de trois critères juridico-comptables : l'impossibilité de faire face, le passif exigible, l'actif disponible.
Le « passif exigible » regroupe les dettes certaines, c'est-à-dire non contestées, liquides et exigibles. Il ne s'agit pas du passif exigible au sens strictement comptable dans la mesure où celui-ci inclut le passif à court terme, c'est-à-dire les dettes à échéance d'un an. Ici, la notion d'exigibilité implique de ne tenir compte ni des dettes dont le terme n'est pas survenu, ni des dettes dont la condition suspensive n'est pas réalisée. Les dettes concernées sont celles qui sont échues et susceptibles d'exécution forcée. Elles peuvent être de nature civile ou commerciale ; une dette personnelle telle qu'un impayé de loyer peut ainsi conduire au redressement judiciaire d'une entreprise individuelle.
La notion d'« actif disponible » est restrictive puisqu'elle ne recouvre que les sommes dont l'entreprise peut disposer sans délai, les sommes immédiatement mobilisables telles que les espèces détenues en caisse, les dépôts sur compte bancaire, les effets de commerce à vue et la réserve de crédit bancaire. En revanche, les immobilisations corporelles ou incorporelles, telles que les stocks et les créances détenues sur les clients de l'entreprise ne font pas partie de l'actif disponible. L'actif disponible est ainsi constitué de la trésorerie actuelle et potentielle (réserve de crédit) de l'entreprise.
L'expression « l'impossibilité de faire face » n'a pas de signification technique précise : la cessation des paiements résulte du simple fait pour le débiteur de ne pas s'acquitter de ses dettes ; il n'y a pas lieu de s'interroger sur le caractère intentionnel ou non de cette attitude du débiteur.
Ainsi explicitée, la notion de cessation des paiements paraît à la fois claire et empreinte d'objectivité. Notion spécifique au droit commercial, elle se distingue de celle d'insolvabilité du débiteur qui correspond à la situation dans laquelle le passif, dans sa globalité, dépasse l'actif. Sa mise en oeuvre est cependant moins évidente qu'il n'y paraît et son caractère statique masque parfois une certaine inadéquation aux réalités économiques nécessitant, de la part du juge commercial, une approche pragmatique.
2. Une objectivité apparente qui masque une certaine inadéquation aux réalités économiques
• Derrière une objectivité apparente des critères contribuant à la définition légale de la notion de cessation des paiements se dissimule une réalité jurisprudentielle qui en a atténué le caractère mécanique , l'aspect « couperet », pour éviter que dans certaines situations elle n'aboutisse à précipiter la chute de l'entreprise considérée plutôt que de favoriser son redressement. Par ailleurs, l'unicité de la définition est battue en brèche par les divergences d'interprétation entre la chambre commerciale et la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Faisant preuve de pragmatisme et avec le souci d'éviter les incohérences économiques les plus évidentes, la jurisprudence commerciale a introduit quelques assouplissements dans la définition de la cessation des paiements. Elle a tout d'abord intégré le fait que la définition repose sur des notions d'analyse financière devenues désuètes, en particulier celle du ratio de liquidité immédiate : toute gestion financière efficace ayant pour objectif l'élimination d'actifs financiers pas ou peu rémunérés se traduit par une minimisation des actifs immédiatement disponibles ; au ratio de liquidité immédiate doit donc être substitué un ratio de liquidité élargi permettant d'intégrer les ressources disponibles et réalisables de l'entreprise. Dans une décision du 17 juin 1997, la Cour de cassation a par ailleurs consacré la théorie de la « réserve de crédit », dont il convient de tenir compte pour évaluer l'actif disponible. Enfin, l'impossibilité pour le débiteur de faire face à ses engagements n'est pas considérée comme exclusive de l'obtention de délais de paiement ou d'un moratoire de ses créanciers.
L'unicité de définition de la cessation des paiements est également affaiblie par la jurisprudence de la chambre criminelle qui retient généralement une date distincte de celle fixée par le jugement de redressement judiciaire : ainsi, les éléments caractérisant la cessation des paiements diffèrent selon qu'il s'agit de l'ouverture de la procédure ou du prononcé de sanctions personnelles à l'encontre des dirigeants (Cass. Crim., 26 septembre 1996).
• La définition légale, par sa rigidité, risque par ailleurs de compromettre le bon déroulement des procédures préventives , mandat ad hoc ou règlement amiable.
En effet, dès que la présence d'un passif exigible insusceptible d'être couvert par l'actif disponible est constaté, les procédures préventives en cours doivent être interrompues, le mandataire ou le conciliateur devant en pareil cas recommander aux dirigeants de procéder sans délai à la déclaration de cessation des paiements. Il n'est pas rare que ces procédures, d'une durée généralement de trois mois mais souvent prolongées par le président du tribunal pour permettre d'aboutir à la signature d'un protocole ou d'un moratoire, achoppent sur ce constat. Inversement, nombre d'entreprises dont la situation répond à la définition de la cessation des paiements continuent à bénéficier du cadre de la prévention : l'inadéquation entre les perspectives de redressement, renforcées par la confidentialité attachée aux procédures préventives, et l'application stricte des critères légaux conduit ainsi souvent, en dépit des sanctions résultant d'un dépôt de bilan tardif, à ignorer ces derniers. La faculté ouverte au conciliateur par la loi du 1 er mars 1984 de solliciter du président du tribunal la suspension des poursuites à l'encontre des créanciers souligne d'ailleurs l'incohérence de la situation : une telle demande ne correspond-elle pas à une reconnaissance implicite de l'impossibilité pour l'entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ?
On constate donc que le caractère unitaire et objectif de la définition de la cessation des paiements reste largement fictif, la diversité des situations économiques s'accommodant difficilement d'une approche strictement normalisée et rigide.
3. L'adaptation du critère d'ouverture de la procédure judiciaire : une évolution nécessaire mais délicate
La démarche tendant à adapter les critères matérialisant la cessation des paiements pour une meilleure appréhension de la réalité des difficultés des entreprises emprunte une voie étroite entre deux impératifs : la préservation d'une certaine objectivité de la définition et de sa lisibilité par les chefs d'entreprise et les créanciers d'une part, une plus grande souplesse d'autre part permettant une prise en compte effective de la diversité des situations économiques.
Toute évolution de la définition de la cessation des paiements doit tout d'abord privilégier la lisibilité : il faut d'une part éviter que les créanciers ne se trouvent confrontés à l'impossibilité de rapporter la preuve d'une cessation des paiements de leur débiteur et, d'autre part, ne pas exposer les chefs d'entreprise à un risque accru d'engagement de leur responsabilité personnelle pour défaut de déclaration dans le délai légal qui est, rappelons-le, fort bref, puisqu'il est de quinze jours à compter de la matérialisation de la cessation des paiements.
• Sur la question du délai , il ne paraîtrait pas incongru d'en augmenter la durée afin d' instaurer un délai plus compatible avec les usages commerciaux en vigueur et de limiter les distorsions dans la définition de la cessation des paiements selon qu'elle est appréciée par le juge en vue de l'ouverture de la procédure ou pour l'application de sanctions personnelles.
Rappelons que ces sanctions sont particulièrement sévères puisque le défaut de déclaration dans les délais peut être considéré par le tribunal comme une faute de gestion justifiant une action en comblement du passif dès lors que le caractère tardif du dépôt de bilan a pu contribuer à l'insuffisance d'actif et qu'en vertu de l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 625-5 du code de commerce, le tribunal a la faculté de prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer du dirigeant qui a omis d'effectuer dans le délai imparti la déclaration de l'état de cessation des paiements.
La durée du délai actuel remonte à la loi du 4 mars 1889 qui contribua à l'adoucissement du droit de la faillite au 19 ème siècle en créant une procédure de liquidation judiciaire réservée aux commerçants malheureux et de bonne foi, les déchéances étant atténuées et le débiteur conservant l'administration de ses biens. Quinze jours étaient laissés au débiteur pour procéder aux formalités nécessaires auprès du tribunal.
Aujourd'hui , il paraît nécessaire de tenir compte de l'allongement des délais de paiement, l'entreprise pouvant se trouver, parfois de façon structurelle, confrontée à des difficultés de trésorerie sans que la gravité de la situation soit de nature à justifier un dépôt de bilan. Le délai de paiement client moyen pour les PME françaises s'établit ainsi à une soixantaine de jours.
Sans atteindre un tel délai, car il est préférable d'éviter d'augmenter à l'excès la durée minimale de la période dite « suspecte », c'est-à-dire celle qui s'étend entre la date de cessation des paiements et celle du jugement qui la constate, dans la mesure où les actes conclus à cette époque sont susceptibles d'annulation, la durée du délai imparti au débiteur pour effectuer la déclaration auprès du tribunal pourrait être raisonnablement doublée, et donc portée à 30 jours.
• Outre la question du délai, la définition de la cessation des paiements pourrait être assouplie en intégrant un nouveau critère, celui du « passif exigé », introduit par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 avril 1998 sans que, cependant, cet arrêt puisse être compris comme un revirement de jurisprudence, le souci de la haute juridiction étant manifestement en l'espèce d'éviter de pénaliser le débiteur de bonne foi dès lors que son créancier était disposé à lui faire crédit.
La référence au passif « exigible et exigé » éviterait le détour jurisprudentiel recourant à la notion d'offre de crédit. Elle contribuerait par ailleurs à clarifier la césure entre procédure amiable et phase judiciaire, opérant une mise en cohérence avec la suppression, dans le cadre des procédures préventives, de la suspension des poursuites.
L'ajout de cette précision concernant la qualification du passif à prendre en considération contribuerait à atténuer la rigueur de la notion actuelle de cessation des paiements et, par cet assouplissement, à la rendre plus conforme à la pratique des tribunaux de commerce qui intègrent dans leur appréciation le fait que certains créanciers acceptent de différer l'exigibilité de leur créance, accordent un moratoire. La modification aboutirait cependant à une réduction encore plus importante du périmètre du passif pris en compte puisque l'abstention des créanciers, leur négligence ou leur retard à réclamer leur dû aurait pour conséquence d'exclure dudit périmètre les créances correspondantes.
Comme cela ressort d'un commentaire de l'arrêt précité de la Cour de cassation du 28 avril 1998 39 ( * ) , « le critère du passif exigé permettrait d'éviter le risque d'une faillite virtuelle, à un moment où les créanciers du débiteur en difficulté n'ont pas encore pris l'initiative de poursuites, ce qui pourrait favoriser les procédures de prévention, telles que la désignation d'un mandataire ad hoc ou le déclenchement d'un règlement amiable. Les créanciers, dans ce cas, auraient moins à craindre que, par l'effet du report éventuel de la date de cessation des paiements jusqu'à dix-huit mois en amont, la phase amiable ne se retrouve comprise dans la période suspecte ».
Cette approche semble partagée par une étude de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris du 4 février 1999 sur la réforme du droit des entreprises en difficulté, élaborée au nom de la commission juridique par M. Jean Courtière. En vertu de cette étude, « ce qui doit avant tout différencier le traitement amiable du traitement judiciaire des difficultés, c'est la nécessité pour mener à bien le redressement de l'entreprise de voir ordonner l'arrêt des poursuites individuelles. Car de deux choses l'une : ou bien le débiteur peut continuer à financer la poursuite de son activité, il n'est pas poursuivi par ses créanciers et il peut mener à terme ses négociations et sa restructuration dans un cadre amiable et confidentiel ; ou bien, ceux-ci exigent leur dû et s'apprêtent à mettre en oeuvre des voies d'exécution et l'élaboration d'un plan en toute sérénité impose alors la prise de mesures exceptionnelles et publiques. Or, la seule définition qui rend compte de cette distinction est celle d'une entreprise dont l'actif disponible ne permet pas de faire face à son passif exigible et exigé. »
La même étude propose également d'assouplir la notion d' « actif » pris en compte pour la caractérisation de la cessation des paiements. Elle estime que « la notion d'actif disponible, aujourd'hui visée par la loi, est trop restrictive : elle occulte le reste des actifs circulants qui pourraient néanmoins être mobilisés rapidement par le débiteur pour faire face au passif (exemple, stocks et créances clients ). La cessation des paiements devrait donc être caractérisée lorsque l'entreprise ne peut, avec son actif circulant, faire face à son passif exigible et exigé. »
Si cette modernisation de la définition permet de dynamiser le critère d'ouverture de la procédure par une meilleure prise en compte de la réalité économique, sans doute ne présente-t-elle pas que des avantages. Cette définition ne risque-t-elle pas de provoquer un déclenchement encore plus tardif de la procédure ? Quelles seront concrètement les éléments matérialisant le fait qu'un élément du passif est non seulement exigible mais également exigé ? Cette nouvelle notion n'ouvre-t-elle pas une brèche dans le droit des obligations, l'exigibilité découlant aujourd'hui du seul engagement contractuel initial en tant que manifestation et accord de volonté ?
La voie est donc étroite pour aboutir à l'émergence d'une définition réduisant la contradiction entre normalisation souhaitable et souplesse nécessaire.
Outre la détermination d'un critère plus pertinent d'ouverture de la procédure, et toujours dans le but de mieux prendre en compte la réalité économique, pourrait être envisagé d'une part d'instaurer un mode d'ouverture anticipée de la procédure à la diligence du tribunal ou du débiteur et, d'autre part, un traitement spécifique pour les procédures impécunieuses.
C. UNE PLUS AMPLE GRADATION DES PROCÉDURES POUR UN TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
Toujours avec le souci d'élargir les possibilités d'agir suffisamment tôt face aux difficultés qui surgissent et par ailleurs d'éviter les procédures longues et dispendieuses lorsque la situation est résolument désespérée et devenue impécunieuse, une plus ample gradation des procédures pourrait être envisagée. Il s'agirait d'une part de permettre à certaines conditions une ouverture anticipée de la phase judiciaire et, d'autre part, d'instaurer une procédure allégée et accélérée pour les cas d'impécuniosité avérée ou lorsque les actifs sont inférieurs à un montant très faible.
1. Une possibilité d'ouverture anticipée de la procédure pour renforcer les chances de succès d'un redressement
Alors qu'à présent l'ouverture de la phase judiciaire est subordonnée au constat de la cessation des paiements, il s'agirait de permettre au débiteur de réagir et de se placer sous la protection du juge pour tenter d'éviter d'en arriver à cette extrémité à un moment où les perspectives sont très sombres mais où la situation n'est pas désespérée. L'objectif est de faire en sorte qu'à défaut d'avoir pu recourir utilement aux procédures amiables la cessation des paiements ne débouche, comme cela est presque systématique aujourd'hui, sur une liquidation avec clôture pour insuffisance d'actif. Permettre une ouverture anticipée contribuerait à revivifier la procédure de redressement et, dans les hypothèses où l'issue de la liquidation ne pourrait être évitée, à assurer un meilleur dédommagement des créanciers .
L'instauration d'une telle possibilité nécessite la détermination d'un nouveau critère d'ouverture , distinct de celui de la cessation des paiements .
L'étude d'expertise propose un choix entre deux critères : le fait que « la continuité de l'exploitation est définitivement compromise » ou celui que « la situation de l'entreprise conduit inéluctablement à la cessation des paiements » 40 ( * ) . Ces deux notions constituent des notions intermédiaires entre celle de la cessation des paiements qui déclenche l'ouverture de la phase judiciaire et celle relative aux « difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation » qui, aux termes de l'article 34 de la loi du 1 er mars 1984 devenu l'article L. 611-2 du code de commerce, ouvre au président du tribunal de commerce la faculté de convoquer le dirigeant pour envisager les mesures propres à redresser la situation, ou les notions visées à l'article 35 de cette même loi désormais codifié à l'article L. 611-3 du code de commerce commandant l'ouverture d'une procédure de règlement amiable, c'est-à-dire le fait d'éprouver « une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise ». Comme le souligne le rapport établi en février 1999 par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris 41 ( * ) , « on se rapprocherait opportunément des solutions retenues par certains droits étrangers » telles que « la notion d' insolvabilité imminente ou menaçante dans le nouveau code allemand ou celle d'entreprise menacée par des difficultés pouvant conduire à plus ou moins bref délai à une cessation des paiements en droit belge ».
L'étude fait valoir qu' « à ce stade, les chances de succès d'un plan de redressement de l'entreprise sont, sans nul doute, bien supérieures » et que « la liquidation judiciaire, lorsqu'il faut la prononcer, doit permettre un meilleur désintéressement des créanciers dans la mesure où (...) la période précédant immédiatement la cessation des paiements est généralement marquée par un accroissement spectaculaire du passif ».
Cette faculté nouvelle offerte au débiteur, lui permettant de bénéficier des garanties résultant de la procédure collective et en particulier de la suspension des poursuites, constituerait sans doute une forte incitation pour le chef d'entreprise à tenir une comptabilité prévisionnelle , bien utile pour prouver la réalité des difficultés rencontrées mais surtout de nature à l'éclairer suffisamment en amont, pour une meilleure prévention.
Cette nouvelle procédure devrait cependant être rigoureusement encadrée pour éviter tout détournement tendant à en faire une technique de gestion et un instrument de chantage vis-à-vis des créanciers. Il serait en particulier imaginable que cette procédure ne puisse être utilisée qu'après l'échec d'une tentative de règlement amiable, qu'elle fasse l'objet d'une enquête préalable et qu'elle se déroule sous le contrôle du parquet .
S'il convient de réviser le cadre des procédures collectives pour créer les outils destinés à renforcer la prévention, à favoriser les chances de redressement de l'entreprise et, lorsqu'elle est en définitive vouée à disparaître, à permettre le dédommagement effectif des créanciers, il apparaît également nécessaire d'opérer quelques simplifications par souci d'économie et pour un traitement plus rationnel et mieux adapté des difficultés des entreprises en état de cessation des paiements.
2. Remédier à la complexité et au coût de procédures qui n'atteignent pas les objectifs qui leur étaient assignés
Dans bien des cas, la lourdeur des procédures, leur durée et leur coût contrastent avec la limpidité de la situation et la faiblesse des enjeux, l'entreprise étant déjà exsangue lors de la déclaration de la cessation des paiements.
Ainsi, le rapport d'enquête sur l'organisation et le fonctionnement des tribunaux de commerce de juillet 1998 réalisé conjointement par l'Inspection générale des Finances et l'Inspection générale des Services judiciaires observe-t-il que « outre les liquidations judiciaires totalement ou presque totalement impécunieuses (c'est-à-dire, selon le mode de comptabilisation utilisé par les mandataires, les procédures dont le produit de réalisation des actifs ne permet pas le paiement du droit fixe de 15.000 F), soit 50 % des affaires, les procédures non impécunieuses mais pour lesquelles le produit de réalisation des actifs est inférieur à 50.000 F représentent 30 % de l'échantillon examiné. C'est donc près de 80 % du total des liquidations judiciaires qui ne produisent strictement aucune répartition au profit des créanciers (...) Il doit donc être mis un terme à l'absurdité économique résultant d'un dispositif qui, actuellement, engendre des frais de procédure non négligeables sans aucun résultat dans 80 % des affaires. Outre l'inutile encombrement des tribunaux et des mandataires de justice qui résulte du traitement de ces affaires, le coût de ces procédures en frais de procédure 42 ( * ) peut être évalué à au moins 500 MF annuel. » 43 ( * )
La mise en place d'une procédure de liquidation immédiate par la réforme de 1994 , évitant l'artifice de l'ouverture d'une période d'observation pour la clore immédiatement, révélait déjà une volonté de prendre en compte la réalité des situations. Rappelons que la proportion de liquidations immédiates rapportée au nombre global de liquidations prononcées s'est élevé à plus de 70 % en 1999 et que près des deux tiers des décisions d'ouverture concluent à une liquidation immédiate.
Cependant, malgré ce progrès législatif, tous s'accordent aujourd'hui sur la nécessité de franchir une étape supplémentaire en aménageant un traitement spécifique des affaires impécunieuses ou pour lesquelles les actifs correspondent à un montant très faible. Le rapport d'enquête se réfère au cas de l'Allemagne où une procédure de radiation administrative a été mise en place pour les affaires dans lesquelles aucune répartition au profit des créanciers ne paraît possible ; il précise qu'entre 1980 et 1990 cette procédure s'est appliquée à 78 % des affaires.
Cet exemple était déjà visé par le rapport intitulé « Propositions en vue d'une réforme de la loi n ° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises », présenté par M. Jean-Luc Vallens, conseiller à la cour d'appel de Colmar, au nom du groupe de travail mis en place à l'initiative de la Direction des Affaires civiles et du sceau du ministère de la justice 44 ( * ) . Ce rapport, publié en septembre 1993, soulignait qu'il convenait de « revenir à l'objectif premier de la procédure de liquidation judiciaire, qui est de désintéresser les créanciers de manière
collective par la réalisation d'actifs » et qu' « en l'absence d'actifs, l'ouverture de la procédure entraînait plusieurs conséquences néfastes :
« - des frais de justice inutiles, dont l'avance incombe au Trésor public (article 215 de la loi) ;
« - des diligences mal rémunérées pour les liquidateurs ;
« - une charge matérielle stérile pour les tribunaux ;
« - la libération définitive du débiteur de ses dettes (article 169 de la loi) d'autant plus injustifiée qu'il est souvent à l'origine de cette déconfiture ;
« - l'absence de tout règlement collectif des créanciers. »
Afin de tenir compte de ces observations et de tirer les conséquences d'un constat soulignant le caractère aberrant du traitement infligé à une proportion importante d'entreprises en difficulté, il serait envisagé, non d'instaurer un mécanisme de radiation administrative mais d'introduire une variante dans le régime de la liquidation judiciaire sans période d'observation, une procédure de liquidation très simplifiée et accélérée pour les entreprises à très faible actif .
Inscrire cette nouvelle modalité de liquidation dans le cadre juridique existant des procédures collectives paraît nécessaire pour éviter les fraudes : possibilité à tout moment de passer au régime normal, sanctions applicables en cas d'actifs dissimulés ... Une procédure de liquidation de ce type serait ouverte après un contrôle juridictionnel et une enquête préalable rapide . Emportant dessaisissement du débiteur, le jugement d'ouverture n'interromprait pas immédiatement les poursuites individuelles qui pourraient continuer à être exercées par les créanciers susceptibles d'obtenir un paiement « au prix de la course » pendant un délai de six mois. A l'issue dudit délai, les poursuites individuelles seraient interrompues et le liquidateur répartirait le produit de la vente des actifs résiduels au marc le franc.
Parallèlement à l'instauration de cette gradation en matière de procédure liquidative, une autre simplification consistant en une mise en cohérence des procédures prévues par la loi avec leur impact réel conduirait à supprimer la distinction entre régime général et régime simplifié .
Il apparaît en effet en pratique que le régime simplifié constitue le régime de droit commun et le régime général l'exception : selon l'annuaire statistique de la justice pour 2000, le régime général se serait appliqué à à peine plus de 2 % des liquidations judiciaires prononcées en 1999. Il s'agirait donc de ne plus appliquer tel ou tel régime selon le nombre de salariés employés par l'entreprise et le montant de son chiffre d'affaires annuel mais d'accorder au tribunal la faculté de désigner ou non un administrateur judiciaire selon la complexité du dossier. Rappelons qu'actuellement, si la procédure simplifiée peut toujours être convertie en procédure soumise au régime général par le tribunal, une entreprise atteignant les seuils d'application de la procédure normale est obligatoirement soumise à celle-ci, même lorsque sa liquidation n'entraîne aucune difficulté.
*
* *
Les études et enquêtes précédemment menées sur le régime juridique des procédures collectives et sa mise en oeuvre ayant consacré d'amples développements à la question de la transparence des procédures, votre rapporteur a fait le choix, au cours de la présente étude, de concentrer sa réflexion sur, d'une part, les possibilités d'améliorer la prévention et, d'autre part, la façon d'assurer une plus grande cohérence entre les mécanismes juridiques et la réalité des situations économiques auxquelles ils s'appliquent.
Les améliorations suggérées tendent à renforcer l'efficacité de ces mécanismes juridiques et à introduire une gradation dans les procédures de nature à permettre un traitement « sur mesure » des difficultés des entreprises. Le succès d'une telle réforme demeure cependant subordonné au renforcement et à l'harmonisation des moyens dont disposeront les tribunaux de commerce, en particulier pour la mise en oeuvre de la prévention.
* *
*
EXAMEN DU RAPPORT PAR L'OFFICE
AU COURS DE SA
RÉUNION DU 5 DÉCEMBRE 2001
Après l'exposé du rapporteur , plusieurs membres de l'Office sont intervenus.
Après que M. René Garrec, président , eut rappelé les règles applicables à l'adoption des conclusions d'un rapport par les membres de l'Office, M. Robert Badinter a évoqué l'oeuvre considérable accomplie par le Parlement lors de l'examen des textes devenus les lois de 1984 et 1985 fixant le régime des procédures collectives. Ayant à l'époque présenté le projet en tant que ministre de la justice, il a en particulier rendu hommage à la contribution du rapporteur du Sénat, M. Jacques Thyraud, et a souligné qu'une réforme de cette importance avait rarement fait l'objet d'un pareil effort de concertation.
Faisant valoir qu'une réforme de cette ampleur ne pouvait atteindre d'emblée la perfection, M. Robert Badinter a rappelé qu'il avait souhaité à l'époque qu'un rapport sur la mise en oeuvre de cette législation soit élaboré tous les cinq ans.
Après avoir estimé qu'une réforme cohérente des procédures collectives devrait passer par une révision de la législation applicable en matière de droit des sûretés, M. Robert Badinter a rappelé que dans l'esprit du législateur de 1985 l'objectif de sauvegarde de l'entreprise excluait toute idée d'acharnement thérapeutique et que, déjà à l'époque, les statistiques montraient qu'une part importante des actifs se volatilisaient dans des procédures longues et inutiles. Il a affirmé que prononcer la liquidation d'entreprises non viables nécessitait du courage et de la fermeté et a considéré que le raisonnement tenu par certains tendant à déduire d'une augmentation du nombre des liquidations un constat d'échec de la législation sur le traitement des difficultés des entreprises était erroné dans la mesure où l'élimination des entreprises non viables était inéluctable dans une économie de libre concurrence. Il a enfin estimé nécessaire d'encourager la création d'entreprises.
Exprimant son accord avec l'orientation du projet de rapport tendant à permettre une anticipation de l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation, M. Robert Badinter a estimé que la définition du critère à retenir serait néanmoins délicate et devrait faire l'objet d'une large concertation. Il s'est par ailleurs déclaré favorable à toute mesure permettant d'empêcher les entrepreneurs d'occulter les difficultés grevant la situation de leur entreprise, cette tendance à espérer un avenir meilleur étant largement répandue. Il a en outre approuvé le constat selon lequel les administrations du Trésor et de l'URSSAF n'étaient guère promptes à signaler les retards de paiement pourtant symptomatiques de situations dégradées. Il s'est enfin félicité que des réflexions constructives soient menées en vue d'améliorer l'efficacité de la législation sur les procédures collectives.
Après avoir souligné que la prévention des difficultés des entreprises souffrait d'un déficit de mise en oeuvre des mécanismes définis par la loi de 1984, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur , a estimé que ce constat posait la question de la révision de la carte judiciaire, de nombreux tribunaux de commerce n'atteignant pas la taille critique nécessaire. Il a fait valoir que les deux maux caractérisant et fragilisant les entreprises françaises étaient le manque de fonds propres et le recours au crédit inter-entreprises qui favorisait les réactions en chaîne.
Tout en se déclarant favorable au principe de la mise en place d'une procédure de liquidation amiable sous contrôle judiciaire, M. Robert Badinter a estimé que le cadre légal d'une telle procédure serait délicat à concevoir et mériterait une réflexion approfondie.
Evoquant l'exemple de la notion de cessation des paiements, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur , a souligné que le rapport d'évaluation avait pour objet de dresser des constats et de tracer des orientations qui devraient être affinées.
En réponse à M. Daniel Goulet qui s'interrogeait sur le point de savoir si les collectivités territoriales, qui figuraient souvent sur la liste des créanciers des entreprises en difficultés, ne devaient pas être davantage impliquées dans les procédures collectives, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur , a estimé que cette question posait le problème de fond de l'interventionnisme économique de ces collectivités. Approuvé par M. René Garrec , président, il a souligné qu'une prévention efficace nécessitait le respect de la confidentialité.
Evoquant un cas de liquidation dont il avait eu connaissance, M. Jacques Mahéas a estimé que la législation n'offrait pas de solutions suffisamment différenciées pour s'adapter à la diversité des situations et qu'elle devrait davantage distinguer entre les entreprises de main d'oeuvre et les autres. M. Robert Badinter a fait valoir que la loi de 1985 prévoyait déjà des solutions différenciées selon la taille de l'entreprise.
En réponse à M. Charles Guené qui estimait nécessaire de prévoir des mécanismes permettant de fédérer les énergies de tous les acteurs économiques pour améliorer l'efficacité de la prévention, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur , a rappelé que seules les grandes entreprises étaient dotées d'un commissaire aux comptes et que, par ailleurs, le secret s'imposait aux banques. Après avoir fustigé une nouvelle fois le manque de diligence des administrations financières dans les déclarations d'impayés, il a indiqué que, lorsqu'ils étaient effectivement mis en oeuvre, les mécanismes de prévention prévus par la loi étaient efficaces.
M. Bernard Roman, vice-président , a fait valoir qu'un juste équilibre devait être trouvé entre le thème de la prévention et les objectifs affichés de la loi de 1985, en particulier la protection de l'emploi et des salariés. Il a estimé nécessaire de prendre garde à ce que le souci de prévention ne prime pas sur les intérêts des salariés et a rappelé que ce débat avait surgi lors de l'examen des textes relatifs à la réforme de la justice commerciale et était omniprésent dans le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur , a observé que l'amélioration de la prévention et la création de procédures permettant d'anticiper sous le contrôle du juge et d'éviter la cessation des paiements ne pouvaient qu'être favorables à la préservation de l'emploi.
Constatant l'intensification des travaux d'évaluation des commissions permanentes dans le cadre de la mission de contrôle dévolue au Parlement, M. Bernard Roman, vice-président , s'est prononcé en faveur d'une meilleure articulation dans le temps entre le travail législatif et le travail d'évaluation.
A l'issu de ce débat, l'Office parlementaire d'évaluation de la législation a adopté les conclusions du rapporteur et a décidé que le rapport serait déposé sur le Bureau de chaque assemblée.
ANNEXE 1
CAHIER DES CHARGES
_____
Bilan de la législation applicable en
matière de prévention
et de traitement des difficultés
des entreprises :
*
Saisi par la commission des Lois du Sénat d'une demande tendant à dresser un bilan de la mise en oeuvre de l'ensemble de la législation relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, l'Office parlementaire d'évaluation de la législation a décidé, lors de sa réunion du 3 février 1998, de confier la réalisation de cette étude à un groupe de trois experts comprenant un juge consulaire, un magistrat de la Cour de Cassation et un professeur d'université.
L'article 6 quater de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, inséré par la loi n° 96-516 du 14 juin 1996, prévoit en effet que pour la réalisation des études, « l'Office peut faire appel à des experts » . L'article 8 du règlement intérieur de l'Office mentionne également cette possibilité qui, aux termes de l'article 9, nécessite l'élaboration d'un cahier des charges.
Le présent cahier des charges a ainsi pour objet de délimiter le champ de l'étude confiée au groupe d'experts ainsi que ses conditions de réalisation.
1) Le champ de l'étude
La loi n° 94-475 du 10 juin 1994 a modifié la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ainsi que la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, ces deux lois n'ayant pas atteint leurs objectifs initiaux qui étaient la préservation des emplois et le redressement de l'entreprise.
L'économie de la réforme de 1994 s'est articulée autour de quatre axes principaux :
- l'amélioration de la prévention des défaillances ;
- la simplification et l'accélération des procédures ;
- la restauration des droits des créanciers ;
- la moralisation des plans de cession.
Plus de trois années s'étant écoulées depuis l'entrée en vigueur de la loi, le moment semble venu de procéder à une évaluation des innovations introduites en 1994 dans les procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises et de mesurer l'efficacité globale de l'ensemble de la législation applicable en la matière.
Cette démarche paraît d'autant plus nécessaire que l'appréciation portée sur l'évolution des procédures collectives constitue un aspect important du débat en cours relatif à la réforme des tribunaux de commerce : elle est complémentaire de l'initiative prise par l'Assemblée nationale créant une commission d'enquête sur la situation des juridictions consulaires. L'efficacité des procédures, en matière de prévention tout particulièrement, dépend en effet étroitement des moyens dont dispose le tribunal compétent et de l'existence de garanties permettant de préserver la confidentialité des informations relatives à l'entreprise. Les difficultés susceptibles de menacer la survie de celle-ci doivent pouvoir être détectées et traitées le plus en amont possible. Or, il apparaît que sur l'ensemble des chefs d'entreprise convoqués à titre préventif à l'initiative du tribunal, une proportion importante des entreprises concernées se trouvent déjà en situation caractérisée de cessation des paiements.
Par ailleurs, l'importance des passifs déclarés est révélateur du caractère tardif des jugements d'ouverture dont découle, très fréquemment, l'impossibilité d'envisager le redressement de l'entreprise. Selon une étude de l'INSEE datant du mois de janvier dernier, la liquidation est prononcée dans plus de 90 % des cas, la défaillance se soldant ainsi dans la très grande majorité des cas par la disparition de l'entreprise.
Ce constat conduit à s'interroger sur la pertinence de la notion de cessation des paiements comme critère d'ouverture d'une procédure collective et sur les conditions de mise en oeuvre des mécanismes de prévention.
Hormis l'examen de cette question, l'évaluation pourrait permettre de déterminer les ajustements nécessaires à l'amélioration de l'efficacité des procédures existantes et à une meilleure articulation de ces procédures avec celles prévues par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, le caractère collectif de la procédure de liquidation étant en effet parfois mis à mal par les poursuites individuelles exercées par les titulaires de créances nées après l'ouverture de la procédure.
Le problème de la détection et du traitement des difficultés des entreprises devrait donc faire l'objet d'une approche globale, le champ d'investigation devant porter à la fois sur les procédures en vigueur mais aussi sur leurs conditions de mise en oeuvre et sur leur insertion dans l'ordonnancement juridique.
L'étude devra à la fois dresser un bilan critique du régime juridique applicable en matière de prévention des difficultés des entreprises et de mise en oeuvre des procédures collectives de redressement, de cession et de liquidation, et formuler une série de propositions tendant à améliorer leur pertinence et leur efficacité.
2) Les conditions de réalisation de l'étude : les délais
Compte tenu de l'étendue du champ de cette étude et de la complexité de la matière juridique concernée ainsi que des contraintes d'organisation des travaux liées au caractère collégial du groupe d'experts, l'Office parlementaire d'évaluation de la législation propose que l'étude lui soit remise au plus tard le 15 septembre 1998.
ANNEXE 2
RAPPORT D'EXPERTISE
_____
INTRODUCTION
Lors de sa réunion du 3 février 1998, l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, saisi par la Commission des lois du Sénat d'une demande tendant à dresser un bilan de la mise en oeuvre de l'ensemble de la législation relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, a décidé de confier la réalisation de cette étude à un groupe de travail composé d'un magistrat de la Cour de cassation, d'un juge consulaire et d'un professeur d'université.
Selon le cahier des charges dressé par l'Office, l'objectif poursuivi était de permettre de "déterminer les ajustements nécessaires à l'amélioration de l'efficacité des procédures existantes et à une meilleure articulation de ces procédures avec celles prévues par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, le caractère collectif des procédures de la loi n ° 85-98 du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires étant parfois mis à mal par les poursuites individuelles exercées par le titulaire des créances nées après l'ouverture de la procédure".
L'étude devait permettre à la fois de dresser un bilan critique du régime juridique applicable en matière de prévention des difficultés des entreprises et de mise en oeuvre des procédures de redressement ou de liquidation judiciaires et de formuler une série de propositions tendant à améliorer leur pertinence et leur efficacité.
POURQUOI CETTE ÉTUDE?
L'état des lieux, tel qu'il peut être dressé après douze années d'application du dispositif issu de la loi n ° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée par la loi n ° 94-475 du 10 juin 1994 et quatorze années d'application du dispositif issu de la loi n ° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, modifiée par la loi du 10 juin 1994 précitée, conduit à une série de constatations.
En ce qui concerne, tout d'abord, la mise en oeuvre de la loi du 1 er Mars 1984
Des résultats intéressants sont obtenus. Mais l'application des dispositions légales sur la prévention n'est pas généralisée, certains tribunaux n'en faisant pas ou peu usage, ce qui pose un problème d'inégalité entre les justiciables.
L'entretien avec le président révèle trop souvent un état de cessation des paiements déjà constitué rendant toute mesure préventive impossible. Son utilité est alors seulement de faire prendre conscience au chef d'entreprise de la nécessité de déposer sans tarder son bilan.
Lorsqu'il n'y a pas encore cessation des paiements mais seulement "difficulté juridique, économique ou financière " ou existence de "besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise" (article 35 de la loi du 1er mars 1984), se pose la question de la désignation d'un conciliateur, qui ne peut intervenir qu'à la demande du chef d'entreprise, en vue de la recherche d'un règlement amiable avec les créanciers. Le président peut aussi décider de recourir à un mandat ad hoc
En 1997, environ 1000 mandats ad hoc ont été ordonnés et 500 règlements amiables ouverts. Ces chiffres sont à rapprocher du nombre d'entreprises entendues dans le cadre d'entretiens préventifs, soit environ 12.500 pour la même année, et du nombre de dépôts de bilan, soit, environ 60.000.
C'est dire que l'activité préventive des tribunaux de commerce est très significative, même si elle peut être encore améliorée.
En ce qui concerne l'application de la loi n ° 85-98 du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires
Les résultats apparaissent, dans l'ensemble, décevants.
Selon les différentes statistiques disponibles, plus de 90 % des procédures ouvertes aboutissent à une liquidation judiciaire.
Le taux de réussite des plans de continuation, difficile à estimer exactement, reste, en tous les cas, très faible (2 à 3 % des procédures ouvertes).
La médiocrité de ces chiffres n'a pas de quoi surprendre. Elle ne semble pas devoir être imputée au dispositif légal, lequel apparaît globalement approprié au traitement judiciaire des entreprises en état de cessation des paiements, pour autant que celles-ci n'arrivent pas exsangues au jugement d'ouverture, ce qui est trop souvent le cas et explique, sans doute, la proportion très élevée de liquidations judiciaires dont la quasi-totalité sont clôturées pour insuffisance d'actif.
Aussi, la réflexion conduite dans le cadre de la présente étude n'a-t-elle pas pour objectif de remettre en cause les grands équilibres de la loi du 25 janvier 1985 au risque d'être inefficace dès lors qu'aucune amélioration fondamentale de la situation actuelle ne semble devoir être attendue de la modification d'un texte déjà remanié par la loi du 10 juin 1994.
Elle tend, pour l'essentiel, à définir un ensemble de mesures de nature à permettre à l'entreprise de résoudre ses difficultés avant d'atteindre le stade de l'ouverture de la procédure collective et, si celle-ci est inévitable, à rendre possible son déclenchement à un moment où le redressement peut encore raisonnablement être envisagé .
On ne peut, toutefois, préalablement, qu'attirer une fois de plus, l'attention sur le problème, signalé de manière récurrente, de l'insuffisance du capital social exigé par la loi pour la constitution d'une société commerciale et sur lequel il est souhaitable que le législateur se penche à nouveau.
On peut aussi s'interroger sur les effets pervers du crédit interentreprises, largement utilisé en France et qui s'avère singulièrement dévastateur en cas de défaillance de l'un des acteurs de la chaîne.
On doit, enfin, évoquer l'irritante question des groupes de sociétés, posée ici avec une acuité particulière dès lors que, s'agissant d'entreprises en difficulté, l'écart entre l'architecture parfois très complexe de structures juridiquement autonomes dotées de la personnalité morale et la réalité de leur unité économique, laquelle apparaît parfois difficile à établir, empêche l'appréhension globale de leur sauvetage.
En conclusion de ces observations préalables, il ressort que la réflexion doit privilégier une modification de l'axe d'intervention.
L'organisation actuelle des procédures s'articule autour de la notion de cessation des paiements et souffre, par rapport aux objectifs de sauvegarde de l'entreprise, de maintien de l'activité et de l'emploi et d'apurement du passif proclamés par la loi, d'une contradiction interne qui place l'ensemble de l'édifice en porte à faux.
Sans grands bouleversements de la législation, il semble que l'on pourrait obtenir une amélioration significative de la situation présente en déplaçant le centre de gravité des procédures, l'état de cessation des paiements et l'application du dispositif légal qui en résulte n'en constituant plus nécessairement l'élément central.
Cette remarque générale vaut naturellement dans le cadre d'une modification du traitement amiable et préventif (1ère partie).
Elle concerne également plusieurs aspects de la législation sur le redressement et la liquidation judiciaires, laquelle pourrait, en outre, être corrigée et améliorée sur certains points (2ème partie).
PREMIÈRE PARTIE :
LE TRAITEMENT
AMIABLE ET PREVENTIF
A) LES PRATIQUES ACTUELLES
1- Le contact préventif entre le "débiteur" et le président du tribunal de commerce ou son délégué, peut être provoqué par une démarche volontaire du chef d'entreprise.
Dans la pratique, ce cas de figure, même s'il est moins exceptionnel depuis quelques années, reste assez rare.
Le plus souvent, le chef d'entreprise est convoqué à partir d'un système de détection basé principalement sur l'exploitation des informations détenues par les greffes (inscriptions de privilèges des URSSAF et du Trésor public ; absence de dépôt des comptes sociaux ; perte de capital ; multiplication d'instances contentieuses ; demandes de report d'assemblées générales etc..).
Malgré une réelle efficacité, ces systèmes sont mis en oeuvre de manière très diverse d'un tribunal à l'autre et dépendent de la plus ou moins bonne volonté des greffes, lesquels entendent, parfois, facturer ces tâches au tribunal qui ne dispose pas d'un budget permettant de les rémunérer.
Quelle qu'en soit l'origine (volontaire ou forcée), les entretiens sont généralement bien perçus par les chefs d'entreprise qui ont, ainsi, l'occasion de "faire le point" devant un juge (président ou magistrat délégué) qui comprend leur problème et qui, tout en s'abstenant de leur donner des conseils, attire leur attention sur les risques de dégradation de la situation et sur les possibilités procédurales de les traiter.
L'expert comptable de l'entreprise est souvent convié à assister à cette rencontre.
2- A ce jour, l'issue de ces entretiens se limite malheureusement souvent au constat d'un état de cessation des paiements patent, avec rappel de l'obligation d'effectuer, dans les quinze jours, la déclaration prévue par la loi et de la possibilité pour le tribunal de se saisir d'office si besoin est.
Cette situation est moins négative qu'il n'y paraît.
Elle permet, en effet, de stopper le plus tôt possible l'hémorragie de l'entreprise qui ne peut survivre et de préserver son environnement en limitant le passif, dont on sait qu'il croît de manière considérable dans les mois et les semaines précédant la déclaration de cessation des paiements.
Cet aspect de la prévention explique pourquoi on peut difficilement confier à d'autres institutions que les juridictions ces actions préventives, puisque la préservation de l'environnement économique exige un pouvoir d'intervention assorti d'une certaine contrainte.
Cela n'exclut pas tout ce qui peut être très positivement fait, encore plus en amont, par les organismes professionnels, les chambres de commerce, les chambres des métiers, etc..
Dans d'autres cas, l'approche préventive permet d'envisager, avec le chef d'entreprise, la possibilité de mettre en oeuvre la procédure de règlement amiable dès lors que le nombre de créanciers est limité ou que l'essentiel du passif est concentré entre quelques créanciers.
Les présidents de tribunaux ont des pratiques assez diversifiées dans ce domaine selon qu'ils souhaitent, ou non, mener une politique volontariste en la matière.
Mais, dans tous les cas, on peut dire que la loi est contournée :
- dans les délais qu'elle prévoit, celui de 3 mois + 1 mois, qui concerne la durée de la mission du conciliateur (article 35, dernier alinéa, de la loi du 1er mars 1984) s'avérant parfois insuffisant et le règlement amiable étant, en ce cas, précédé d'un "mandat ad hoc préparatoire".
- dans les conditions d'ouverture du règlement amiable, les entreprises concernées étant fréquemment en état de cessation des paiements plus ou moins avéré.
Il s'agit souvent de situations difficiles, voire périlleuses, dans lesquelles le président de la juridiction assume une lourde responsabilité, mais l'expérience montre que c'est le prix à payer pour obtenir des résultats parfois exceptionnels en termes de préservation de richesses économiques et d'emplois.
On notera ici que, dans les tribunaux de commerce les plus actifs en matière de prévention, le nombre de dossiers résolus dans ce cadre devient équivalent à celui des plans de continuation arrêtés en vertu des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 .
Ces succès, très intéressants, restent néanmoins méconnus, car la confidentialité demeure une des clefs de la réussite de ces procédures.
3- L'impact des dispositions légales relatives à l'information que les commissaires aux comptes sont tenus, au terme d'une procédure en plusieurs phases, de délivrer au président du tribunal, en vertu de la loi du 1er mars 1984, est très limité.
Ces professionnels ont, dans l'ensemble, une approche extrêmement frileuse de l'obligation que le texte met à leur charge à un stade d'ailleurs très (et peut être trop) avancé de leur démarche.
Quoi qu'il en soit, il paraît illusoire d'attendre des commissaires aux comptes, rémunérés par les sociétés qu'ils contrôlent, une implication plus active dans la mise en oeuvre des dispositions légales sur la prévention. On verra, en revanche, qu'une prévention de nature comptable peut être utilement envisagée en amont.
4- En pratique, le président du tribunal utilise peu les pouvoirs d'investigation qu'il tient de l'article 34 de la loi du 1er mars 1984, car les informations nécessaires lui sont très généralement fournies spontanément par le chef d'entreprise ou ses conseils (avocat, expert-comptable).
De ce constat multiple, on peut retenir que les mécanismes légaux et réglementaires offrent aux responsables de juridictions les outils nécessaires à l'application d'un traitement préventif, notamment, à travers leur souplesse qui devra, en toute hypothèse, être préservée.
C'est leur mise en oeuvre qui peut être largement améliorée.
B) LES AMÉLIORATIONS A ENVISAGER
1° La détection des difficultés
Il importe de conserver un équilibre entre la nécessité d'informer le président du tribunal, qui doit être en mesure d'exercer la mission dont il est investi par la loi et le respect de l'indispensable liberté d'entreprendre et de gérer dans une économie de marché.
On doit cependant observer qu'il existe une importante différence d'efficacité entre l'investigation économique "publique" et celle effectuée par certaines entreprises spécialisées.
On est, en effet, surpris par le nombre impressionnant d'obstacles qui s'opposent, dans la pratique, au regroupement et à l'exploitation des informations détenues par les organismes publics et les administrations, alors que leur recoupement permettrait d ' améliorer considérablement la détection des difficultés des entreprises.
Cette situation est d'autant plus paradoxale que des sociétés privées parviennent, parallèlement, et à des fins purement mercantiles, à délivrer, dans ce domaine, des informations particulièrement fiables.
A titre d'exemples, on citera la très grande discrétion du Trésor public, une collaboration des URSSAF, ici très étroite et là quasi-inexistante, les difficultés rencontrées auprès des services de la banque de France pour obtenir la délivrance des informations dont ils disposent, l'absence de relations institutionnelles avec les cours régionales des comptes, les directions départementales du travail etc.
Il apparaît donc indispensable que, dans des conditions à définir, soit facilitée la circulation ou du moins la collecte de l'information, préalable nécessaire à son exploitation.
a) La recherche de l'information
Cet objectif peut être atteint, sur le plan pratique, par un encouragement fort au rapprochement des différentes institutions concernées et par une amélioration des conditions dans lesquelles l'information est recueillie.
PROPOSITION
Sur le plan législatif, il conviendrait de modifier le début du second alinéa de l'article 34 de la loi du 1er mars 1984 en substituant aux mots « A l'issue de cet entretien », les mots « A cet effet », on autoriserait ainsi la connaissance de l'information beaucoup plus en amont, facilitant grandement la détection des difficultés et permettant, en conséquence, des convocations et des entretiens plus précoces.
b) Le traitement de l'information
Le traitement global de ces éléments d'alerte serait effectué systématiquement avec l'assistance et la collaboration étroite des greffes, cette tâche devant être considérée comme faisant partie intégrante de l'activité de la juridiction et, en conséquence, spécifiquement rémunérée.
L'amélioration conséquente de la détection ainsi obtenue n'aurait d'effet réel que dans la mesure où toutes les juridictions compétentes en exploiteraient les résultats.
PROPOSITION
Afin de résoudre le risque d'inégalité entre les justiciables évoqué précédemment, on pourrait poser comme principe, par une simple modification de l'article 34 de la loi du 1er mars 1984, que le président du tribunal a, non pas la faculté, comme c'est actuellement le cas, mais l'obligation de convoquer les dirigeants de l'entreprise qui connaît les difficultés visées au texte précité.
Afin de ne pas surcharger inutilement les juridictions et de réserver les cas particuliers, le président pourrait, néanmoins, décider de ne pas convoquer telle ou telle entreprise par ordonnance motivée, laquelle serait communiquée au parquet .
Une telle approche préventive plus étendue suppose naturellement que le responsable de l'entreprise défère à la convocation qui lui est adressée.
L'expérience montre qu'il le fait généralement assez spontanément.
Il reste que les cas d'absence de réponse sont, a priori, les plus inquiétants.
PROPOSITION
Il serait possible, dans cette hypothèse, de prévoir qu'après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du tribunal aurait la faculté de nommer d'office un administrateur provisoire, dont la mission pourrait être rapidement stoppée s'il s'avérait que le silence du dirigeant n'était dû qu'à sa négligence ou son indifférence, tandis que la situation économique de l'entreprise ne justifierait pas de mesures particulières .
Mais la contrainte, si elle est nécessaire, ne peut être qu'un supplétif à une véritable action de prévention.
Il faut donc rechercher les moyens d'améliorer la démarche volontaire et, plus encore, de privilégier une vision renouvelée et élargie de la matière.
2° La généralisation de l'approche préventive
a) L'information du chef d'entreprise
L'inaction du chef d'entreprise devant l'accumulation des difficultés a de nombreuses causes, de nature psychologique ou patrimoniale, bien connues.
On ne saurait pourtant omettre, surtout dans les plus petites structures, une réelle méconnaissance de certains mécanismes, même simples, de gestion.
PROPOSITION
Une première mesure à finalité informative ayant, au surplus, valeur pédagogique, peut donc être proposée.
On a déjà indiqué les raisons qui incitent à douter de l'efficacité du mécanisme d'alerte des commissaires aux comptes dont, au demeurant, l'intervention est légalement limitée à un nombre restreint d'entreprises.
On peut, en revanche, souhaiter une implication beaucoup plus forte des experts-comptables.
Elle pourrait trouver son support dans l'obligation pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, d'établir annuellement un document de financement prévisionnel non soumis à publication, mais qui devrait obligatoirement être commenté par écrit par l'expert-comptable ou le centre de gestion agrée .
b) L'incitation du chef d'entreprise
Dans l'optique de l'élargissement de l'action préventive, on peut envisager plusieurs approches qui doivent être appréciées différemment.
Tout d'abord, il n'apparaît pas souhaitable de faire de la demande de désignation d'un conciliateur un préalable à l'ouverture de la procédure collective du débiteur commerçant ou artisan, comme c'est le cas pour les agriculteurs (article 4 de la loi du 25 janvier 1985).
Pas davantage il ne semble opportun de donner au président du tribunal le pouvoir de nommer d'office un conciliateur en dehors de toute demande du chef d'entreprise, dès lors que le succès de la prévention repose, au moins pour partie, sur la volonté de ce dernier et sur la relation de confiance qui doit s'établir entre le magistrat, le mandataire désigné par lui et le dirigeant.
Il est, par contre, nécessaire d'étudier les mesures propres à inciter ce dernier à se prêter de manière constructive à l ' examen de sa situation et à solliciter, si une issue amiable est envisageable, la mise en oeuvre des moyens procéduraux adaptés.
PROPOSITIONS
1-On peut, naturellement, "motiver" les démarches volontaires par des avantages fiscaux pour l'entreprise .
2-Il est également possible de prévoir que l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires intervenant après échec, faute d'accord conclu avec les créanciers, d'un règlement amiable ou après résolution pour inexécution de l'accord résultant d'un règlement amiable ne pourra donner lieu à la fixation d'une date de cessation des paiements antérieure à l'un ou l'autre de ces événements, sauf fraude ou mauvaise foi du débiteur.
Le chef d'entreprise y trouverait un avantage évident sur le plan personnel au regard d'une éventuelle action en paiement des dettes sociales ou tendant au prononcé de sanctions personnelles.
Les tiers y trouveraient, quant à eux, également avantage au regard d'une éventuelle recherche de responsabilité pour soutien abusif durant la période ainsi définie ainsi qu'au regard des dispositions sur les nullités de la période suspecte.
Une telle disposition serait, en outre, cohérente avec l'orientation principale de la réflexion qui consiste à modifier l'axe des interventions procédurales.
3-Enfin, le bénéfice de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, qui prévoit la suspension de toute action contre les cautions personnelles personnes physiques (jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire) devrait être étendu, moyennant les ajustements nécessaires, au cas d'ouverture d'un règlement amiable.
La philosophie de ce nouveau dispositif est clairement d'inciter le chef d'entreprise à épuiser toutes les voies amiables.
4-Dans cette optique, une implication plus forte du parquet n'apparaît pas opportune, mais une information plus systématique du ministère public peut être envisagée. Lorsque la disparition de l'entreprise est de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale, le ministère public participerait à la procédure.
Sous réserve de l'appréciation des tribunaux et des cours d'appel et du contrôle exercé par la Cour de cassation, il serait, en outre, logique de considérer que celui qui s'est refusé, sans raison valable, à la mise en oeuvre de ces procédures amiables a ainsi commis une faute de gestion susceptible d'engager éventuellement sa responsabilité sur le terrain de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985.
Si, malgré tout, le dirigeant estime nécessaire d'effectuer une déclaration de cessation des paiements, il conviendrait, afin de s'assurer que l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaires constitue la seule solution envisageable, de rendre obligatoire la procédure de l'article 13 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 en l'allégeant pour les cas les plus évidents.
Il ne s'agit naturellement pas de réinventer la période d'observation de la loi, mais de faire en sorte qu'avant l'ouverture de la procédure classique soient explorées toutes les voies permettant une issue amiable et, notamment, les possibilités de liquidation amiable ou de cession amiable.
Sur un plan pratique, on pourrait craindre que la mise en oeuvre de l'ensemble de ce dispositif préventif ne constitue une charge de travail très importante pour les juridictions, à travers la multiplication souhaitée des entretiens préventifs et des enquêtes préalables.
Il pourrait alors être envisagé de faire appel plus largement à des magistrats honoraires intervenant bénévolement sous le contrôle et l'autorité du président de la juridiction.
5- Enfin, dans le cadre du mandat ad hoc ou du règlement amiable, les pièces qui seraient éventuellement déposées au greffe ne sont pas communicables.
La prévention sous forme d'alertes étant maintenue et même développée, dans la chronologie des mesures successives, plusieurs orientations sont ensuite envisageables en fonction d'un interventionnisme plus ou moins anticipé des tribunaux jusqu'à la constatation de la cessation des paiements. Les rapporteurs ont estimé qu'entre les choix exercés en toute liberté et indépendance par le débiteur ne connaissant pas de sérieuses difficultés et la nécessaire intervention judiciaire contraignante au cas de cessation des paiements, des degrés pouvaient être institués pour répondre aux situations révélées par la pratique.
Lorsqu'apparaissent des besoins qui ne peuvent être couverts par un financement adapté aux possibilités de d'entreprise, le débiteur aurait la faculté de demander au tribunal de désigner un mandataire qui l'assisterait ou même le représenterait pour planifier la liquidation ou la cession amiables de son entreprise et le paiement de ses créanciers. Le débiteur n'étant alors ni en état de cessation des paiements ni insolvable, tous ses créanciers seraient désintéressés lors de cette cessation d'activité. Les procédures perdraient ainsi encore plus nettement leur caractère négatif s'agissant de débiteurs de bonne foi, mais quelque peu dépassés par les événements.
Ensuite, dans le cas où des difficultés seraient plus sérieuses, parce que la continuité de l'exploitation serait définitivement compromise ou bien parce que la situation de l'entreprise conduirait inéluctablement à un état de cessation des paiements, l'ouverture anticipée d'une véritable procédure collective pourrait être décidée soit à la demande du procureur de la République ou d'office soit par déclaration du débiteur ainsi qu'il sera exposé plus avant, tandis que seule la cessation des paiements serait le critère fondant la demande des créanciers.
Ce sont ces hypothèses qu'il convient de décrire.
C) LES INNOVATIONS
La liquidation d'une exploitation, a fortiori sa cession, ne sont pas nécessairement judiciaires. Des opérations amiables sans aucun contrôle préalable ou a posteriori sont licites dès lors que le débiteur n'est pas en état de cessation des paiements. Entre les solutions judiciaires et les solutions amiables une voie médiane est envisageable.
On soulignera le progrès essentiel que représenterait le fait de pouvoir modifier l'attitude des repreneurs potentiels qui, actuellement, attendent la déclaration de cessation des paiements pour se manifester quand ils ne la provoquent pas directement ou indirectement.
On sait que les personnes morales, notamment les sociétés, peuvent actuellement être l'objet de deux types de liquidation judiciaire :
- la liquidation judiciaire de la loi du 25 janvier 1985 au cas de cessation des paiements du débiteur ;
- la liquidation judiciaire de droit commun, en l'absence de cessation des paiements, en application de la loi du 24 juillet 1966, au cas de dissolution d'une société.
Le surendettement d'une entreprise, sans atteindre le seuil comptable critique de la cessation des paiements, c'est-à-dire de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, s'il compromet la continuité de l'exploitation, devrait permettre, à la demande du débiteur, par analogie avec le règlement amiable, l'ouverture d'une liquidation amiable sous contrôle judiciaire ou même une cession amiable d'entreprise, mais judiciairement contrôlée .
PROPOSITION
Il est proposé d'instituer un régime de liquidation ou de cession amiables de l'entreprise, sous contrôle judiciaire, avec intervention d'un mandataire.
Cette proposition ne sera donc pas confondue avec la simple radiation administrative, laquelle, tout au contraire, ne concerne que les entreprises qui ont perdu toute substance et supprime la garantie judiciaire.
En anticipant le déclenchement d'une procédure, on évitera une aggravation de la situation du débiteur, préjudiciable aux créanciers et, notamment, à l'intérêt général s'agissant du Trésor public ou des organismes d'assurances sociales.
La mesure supposerait même que soit envisagée une incitation fiscale en imposant moins lourdement les liquidations saines en comparaison des liquidations-faillites qui sont anormalement coûteuses pour la collectivité par les charges qu'elles génèrent.
L'apurement du passif se ferait, d'une part, en transposant le régime juridique de la loi du 24 juillet 1966 pour éviter les actions individuelles intempestives et, d'autre part, en s'inspirant du décret n° 96-740 du 14 août 1996 dont les dispositions ont été intégrées dans le chapitre V intitulé La distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution, titre II, livre III, du nouveau Code de procédure civile, sous les articles 1281-1 à 1281-12.
Ce régime de distribution aurait une portée plus large qu'en droit commun positif puisqu'il intéresse tous les débiteurs, personnes physiques ou personnes morales relevant de la loi du 25 janvier 1985.
Avant d'en aborder les modalités, seront décrits certains obstacles à la prévention et à la liquidation amiables d'une entreprise.
1°) Les obstacles fiscaux actuels
Une distinction existe fiscalement entre les personnes physiques et les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.
a) L'entreprise individuelle
Le fait pour un entrepreneur individuel de cesser toute activité entraîne l'exigibilité immédiate de tous les impôts qui trouvent leur origine dans l'exploitation. En raison de la reconnaissance patrimoniale de l'entreprise individuelle, la cessation d'activité peut dégager une plus-value taxable. En outre, s'il existe une exonération de plus-value pour les petites entreprises, l'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans.
Enfin, la cessation d'activité entraîne un reversement de T.V.A. au titre des immobilisations.
b) Les sociétés
Dissoudre une société de personnes a des conséquences voisines de la liquidation d'une entreprise individuelle. Le surcoût provient généralement de la vente des immobilisations avec l'imposition des plus-values qui, jusque là, étaient latentes.
La dissolution d'une société prospère relevant de l'impôt sur les sociétés (SA ou SARL) est une opération fiscalement coûteuse ; certaines sociétés ayant cessé toute activité renoncent à se dissoudre et demeurent en hibernation dans l'attente d'un régime plus favorable. On a pu assimiler la liquidation à un suicide fiscal 45 ( * ) . Les impôts à la charge de la société sont les suivants :
- l'impôt sur les sociétés, qui est calculé sur le résultat de liquidation, lequel prend en compte, notamment, la cession globale des stocks et la reprise des provisions antérieurement constituées ; il faut y ajouter les plus-values d'immobilisation (immeubles, fonds de commerce, matériel...) ;
- le précompte, qui s'applique sur les sommes qui n'ont pas été soumises à l'impôt sur les sociétés au taux normal (les réserves de plus-values à long terme par exemple) ou encore sur les réserves datant de plus de cinq ans.
Et s'il existe un régime de faveur applicable aux sociétés inactives (CGI, article 239 bis B), il est subordonné à un agrément administratif qui n'est accordé que rarement ; par ailleurs, il n'est qu'à moitié favorable puisque la société est imposée au taux de 19% sur la totalité des plus-values réalisées , tandis que les associés doivent acquitter un impôt forfaitaire de 15% sur le boni de liquidation.
PROPOSITION
Il devrait être envisageable d'appliquer un régime plus favorable au cas de liquidation avant la cessation des paiements lorsqu'elle a lieu sous contrôle judiciaire. Le manque à gagner immédiat serait largement compensé par la disparition de pertes en cascade ultérieurement déductibles du bénéfice imposable des partenaires de l'entreprise et l'apparition de créances fiscales sur le débiteur qui seraient réellement recouvrables .
2°) Le régime juridique
La cause d'ouverture pourrait être identique au critère retenu à l'article 35 de la loi du 1er mars 1984 : besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise. Les modalités de saisine pourraient être calquées sur celles de l'ouverture d'un règlement amiable (v. article 35-1 et 36 du décret du 1er mars 1985).
La liquidation pourrait consister à régler collectivement les créanciers, en s'inspirant tout simplement des articles 1281-1 à 1281-12 du nouveau Code de procédure civile sur la liquidation (a) et la distribution des deniers (b) ou même en organisant une cession amiable judiciairement assistée d'une branche d'activité (c)
a) La liquidation
PROPOSITION
La liquidation peut être organisée en combinant les solutions de la loi du 24 juillet 1966 et de son décret d'application du 23 mars 1967 et du nouveau Code de procédure civile.
Un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par le président du tribunal dans la décision d'ouverture.
Chaque liquidateur pourra, selon les préférences exprimées par le débiteur, soit conseiller, soit assister, soit même représenter, selon les modalités de droit commun du mandat, le débiteur, notamment dans ses relations avec les tiers.
Celui-ci n'étant, par définition, ni insolvable ni en état de cessation des paiements, le liquidateur paiera les créanciers sociaux , sans que la dissolution emporte de plein droit déchéance du terme. La décision de répartir les fonds doit être publiée dans un journal d'annonces légales. Le liquidateur devra conseiller, assister ou représenter le débiteur pour recouvrer les sommes dues et peut être conduit à réaliser tout ou partie de l'actif. Les affaires en cours ne continuent que pour les besoins de la liquidation, par exemple, liquider les stocks. A l'expiration d'un délai de trois mois, la liquidation ne sera poursuivie, sur décision du président du tribunal, que sur justification d'une durée nécessairement supérieure.
Dès sa nomination, le liquidateur pourrait, si le débiteur le souhaite, se substituer aux organes de direction qui perdent, dès lors, leurs pouvoirs de gestion et de représentation de l'entreprise (à l'exception des éléments du patrimoine personnel du débiteur, s'il s'agit d'une entreprise individuelle).
Le liquidateur doit présenter au président un état d'avancement des opérations.
Il commence par dresser un inventaire de l'actif et du passif. Ensuite, interviennent les opérations proprement dites de liquidation.
L'argent sert à désintéresser les créanciers de l'entreprise. Comme on serait hors procédure collective, le liquidateur pourrait ne pas être tenu, en théorie, de respecter un ordre quelconque ; il pourrait régler les créanciers au fur et à mesure qu'ils se présentent (prix de la course). Il paraît, cependant, indispensable qu'avant de procéder aux règlements, le liquidateur dresse un état estimatif en distinguant le passif privilégié et le passif chirographaire ; si les fonds sont suffisants, ce qui est l'hypothèse d'ouverture de la procédure, il désintéresse tous les créanciers ; dans le cas contraire, il procède à la déclaration de cessation des paiements ou en informe le président afin que le tribunal ordonne l'ouverture d'une procédure collective ou mette en place un règlement amiable afin de planifier l'apurement du passif, si la cessation des paiements n'est pas encore constatée.
En l'absence d'une liquidation judiciaire au sens de la loi du 25 janvier 1985, la personnalité morale d'une société ne devrait pas nécessairement disparaître.
b) La distribution des deniers
PROPOSITION
Pour la distribution des deniers, il est possible de s'inspirer du décret n° 96-740 du 14 août 1996, précité, inséré aux articles 1281-1 à 1281-12 du N.C.P.C.
L'une des particularités de ce décret est qu'il institue la personne chargée de la distribution séquestre des fonds. Cette fonction est subordonnée à l'existence de garanties de représentation de la somme mise en distribution (nouveau Code de procédure civile, article 1281-2). A défaut, la consignation des fonds sera ordonnée à la Caisse de dépôts et consignations (N.C.P.C., article1281-1, alinéa 2).
La rétribution de la personne chargée de la distribution est effectuée par prélèvements sur les fonds à répartir. Elle est supportée par les créanciers au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux (N.C.P.C., article 1281-11).
La caractéristique principale de cette nouvelle procédure est qu'elle se déroule essentiellement en marge de l'institution judiciaire. En effet, le juge n'est saisi qu'en dernière instance lorsqu'un créancier conteste le projet de répartition proposé et si aucune conciliation n'est possible.
La personne chargée de la distribution avise les créanciers d'avoir à déclarer leurs créances. Elle doit ensuite établir un projet de répartition amiable.
La déclaration des créances doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de l'avis adressé aux créanciers (N.C.P.C., article1281-3, alinéa 3).
Elle doit comporter un décompte des sommes réclamées en principal, intérêts et autres accessoires. Le cas échéant, elle mentionne les intérêts et sûretés attachés à la créance, tous documents justificatifs devant être joints (N.C.P.C., article 1281-3, alinéa 2).
A défaut de déclaration dans le délai d'un mois, le créancier est déchu du droit de participer à la distribution (N.C.P.C., article 1281-3, alinéa 3). Sa créance n'est pas éteinte. (Un équivalent d'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 serait écarté).
Le projet de répartition est notifié au débiteur et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (N.C.P.C., article1281-4). En l'absence de contestation, il devient définitif.
Les contestations sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne chargée de la distribution dans les quinze jours de la réception de la lettre de notification (N.C.P.C.; article 1281-4).
Une tentative de conciliation doit avoir lieu, sous l'égide de la personne chargée de la distribution, dans le mois de la première contestation (N.C.P.C.; article 1281-6).
Si les parties parviennent à un accord sur la répartition, il en est alors dressé acte par la personne chargée de la distribution et il est procédé au paiement dans les quinze jours, selon les règles applicables à la répartition amiable (N.C.P.C., article 1281-7, alinéa 2).
Au cas de désaccord, celui-ci est constaté par la personne chargée de la distribution (N.C.P.C., article 1281-8).
La partie la plus diligente peut saisir le juge sur le fondement du projet de répartition.
Le jugement de répartition est notifié à la Caisse des dépôts et consignations lorsqu'il est passé en force de chose jugée. Le paiement des créanciers doit intervenir dans le délai de quinze jours à compter de cette notification (N.C.P.C., article 1281-10).
En outre, le liquidateur doit rendre compte au président de l'accomplissement de sa mission par l'établissement d'un rapport. Le président constate la clôture de la liquidation après avoir statué sur la mission du liquidateur et l'approbation des comptes. La cession de tout ou partie de l'actif au liquidateur ou à ses employés ou à leurs conjoints, ascendants ou descendants est interdite. La violation de ces dispositions est pénalement sanctionnée. Est soumise à autorisation du président la cession de tout ou partie de l'actif à une personne qui ne serait pas indépendante du débiteur.
Les créanciers impayés parce qu'ils auraient été ignorés lors de la répartition amiable peuvent agir contre le débiteur selon le droit commun et engager, comme toute personne qui en serait victime, la responsabilité du liquidateur qui, par sa faute, leur aurait causé un préjudice.
Cette liquidation peut s'accompagner d'une restructuration de certains ensembles cessibles amiablement sous contrôle judiciaire prenant la forme d'une branche d'activité ou d'une unité de production.
c) La cession amiable judiciairement assistée
La cession d'une branche d'activité, d'une unité de production ou d'un fonds de commerce peut être aussi l'autre moyen pour un exploitant de cesser son exploitation et de payer ses créanciers.
La cession se présentera soit comme un transfert pur et simple de propriété soit, en outre, comme une opération de restructuration. On retrouve encore l'idée de planification doublée d'une recherche de moralisation.
Cette perspective légitime, comme pour la liquidation simple, l'intervention d'un mandataire sous l'égide du juge, à la fois pour organiser la conclusion du contrat et pour en surveiller l'exécution. Mais puisque l'objectif est, alors, de réinsérer l'entreprise ou l'activité qui en fait la substance dans le flux de la compétition économique, il est logique que la contrainte de la loi du marché soit pleinement prise en considération et qu'il n'y ait pas de décision imposée, à la différence du redressement judiciaire.
L'avantage par rapport au droit commun serait d'avoir un marché suivi par des mandataires compétents et de ne pas réserver leur rôle aux seules entreprises en difficultés.
Dès lors, des fichiers et des propositions constructives permettraient de tenir compte réellement des capacités de l'entreprise, de la valeur de ses actifs et pas seulement d'une réalisation tenant à l'échec de l'exploitant.
S'agissant de la période précontractuelle, l'objectif est de mettre en place un véritable marché organisé. L'objectif premier doit être de susciter des offres variées, leur nombre pouvant garantir que la cession ne provoquera pas des distorsions et offrira les meilleures chances de maintien de la valeur de l'entreprise dans la concurrence. Une telle préoccupation était déjà apparue pendant les débats relatifs à la loi de 1985.
Il avait été souligné que l'administrateur devait susciter les offres d'acquisition. Une telle tâche pourrait faire partie intégrante de la mission du mandataire amiable car il lui incomberait de rechercher avec le débiteur les solutions permettant le règlement total du passif et le maintien des emplois grâce à la cession. C'est pourquoi il est préconisé d'utiliser toute forme de publicité appropriée selon la nature et l'importance de l'affaire. Le mandataire, d'ailleurs, dans cette démarche, pourrait avoir recours à un certain nombre d'organismes spécialisés ayant pour objet de faciliter les opérations de reprise.
S'inspirant d'une analogie avec les mécanismes en vigueur sur les marchés d'instruments financiers, on peut dire que le tribunal ou le mandataire jouerait le rôle d'autorité de marché, en ce sens qu'il va s'assurer de la transparence du marché et du respect des règles de bonne conduite par chacun des intervenants.
Plus concrètement, le juge peut, à la demande du débiteur ou du mandataire, veiller au sérieux des offres qui lui sont soumises. Ce caractère s'apprécie non seulement dans la personne du candidat à la reprise, mais également relativement au prix proposé par ce possible repreneur. Cette préoccupation doit logiquement guider le juge. La cession, d'un point de vue purement économique, peut aboutir à deux résultats : la disparition de l'entreprise, en tant qu'acteur autonome du marché, si le repreneur est un concurrent, plus ou moins direct, ou bien, au contraire, l'arrivée d'un nouveau venu sur le marché en question.
Veiller à la qualité du repreneur ne suffit pas, il faut en plus s'assurer de la réalité du prix, voire, plus largement, de l'ensemble des contreparties assumées par le repreneur en échange de la cession.
PROPOSITION
Sauf accord d'un ou plusieurs créanciers, il faut mais il suffit que le prix payé contribue intégralement, avec les autres ressources du débiteur, en raison de l'unité patrimoniale, au paiement des créanciers. Ce qui n'est pas le cas du plan de cession d'un redressement judiciaire.
Le débiteur doit rester libre de sa décision, le juge n'ayant même pas à l'homologuer. Toutefois, l'information permet de mieux cerner les responsabilités au cas d'échec si le débiteur, notamment, se trouve ensuite en état de cessation des paiements alors que des propositions satisfaisantes et libératoires lui avaient été présentées et qu'il les ait refusées sans motif légitime.
Lorsque la cession est voulue par le débiteur, conseillé ou assisté ou encore représenté par le mandataire, la surveillance de l'exécution du contrat s'impose. Cette surveillance suppose de s'assurer que le débiteur n'aura pas trouvé dans ce mécanisme juridique un moyen de s'affranchir à bon compte de ses obligations à l'égard de ses créanciers. La cession amiable apparaît bien comme le prolongement de la procédure d'ordre amiable liquidative.
La présence et le regard du juge économique s'imposeront aussi longtemps que l'entreprise demeure en situation de surendettement, aussi longtemps que le repreneur ne s'est pas acquitté de l'ensemble de ses obligations à l'égard du vendeur et celui-ci à l'égard de ses créanciers.
PROPOSITION
La cession de l'entreprise peut être accompagnée de la procédure de déclaration de créances selon les modalités de la liquidation ci-dessus décrites et avec les mêmes conséquences en cas d'impossibilité de régler les créances exigées.
L'esprit demeure de ne pas imposer, mais seulement informer objectivement les parties, mettre le débiteur en face de ses responsabilités et lui rappeler précisément ses obligations et les moyens d'y faire face.
Cette fonction suppose que soit parfaitement déterminées les conditions pratiques de cette forme souple d'interventionnisme judiciaire sans que soient concurrencées les activités libérales indispensables des conseils, notamment juridiques, fiscaux ou financiers traditionnels de l'entreprise et des réseaux d'intermédiaires en vente d'entreprises. Le quasi-échec des groupements de prévention agréés étant significatif à cet égard.
Il ne saurait être question d'instituer une sorte de monopole ou de tutelle exercé par le service public de la justice à l'égard des professionnels, mais au contraire d'apporter un regard objectif facilitant la fluidité et le fonctionnement de ces marchés, par une simple assistance objective du débiteur.
Il s'agit donc de reconnaître officiellement des pratiques licites opportunément et spontanément développées par certaines juridictions pour en faciliter la généralisation plutôt que d'institutionnaliser des modalités rigides et contraignantes.
DEUXIÈME PARTIE : LE REDRESSEMENT
ET LA
LIQUIDATION JUDICIAIRES
L'amélioration de l'efficacité du dispositif actuel repose, de manière primordiale, sur l'anticipation de l'ouverture de la procédure collective. Se posent aussi des problèmes de coordination de ces procédures avec les dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. Enfin, on signalera quelques difficultés ou incohérences apparues dans la pratique à propos de certaines dispositions de la loi du 25 janvier 1985.
A) L'OUVERTURE ANTICIPÉE DU REDRESSEMENT OU DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRES
En l'état actuel des textes, l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaires est subordonnée à la constatation de l'état de cessation des paiements du débiteur, défini par l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 comme l'impossibilité pour celui-ci de faire face au passif exigible avec l'actif disponible c'est-à-dire, concrètement, l'arrêt du service de caisse, l'entreprise ne pouvant plus obtenir aucun crédit de son banquier (ou de ses fournisseurs). Comment, parvenue à cette phase ultime, l'entreprise, vidée de sa substance et atteinte dans ses oeuvres vives, pourrait-elle connaître d'autre issue qu'une liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d'actif ?
Or, il peut résulter des constatations effectuées relativement à la situation de l'entreprise que la continuité de l'exploitation est définitivement compromise , ou encore, que la situation de l'entreprise conduit inéluctablement à la cessation des paiements, notions intermédiaires entre la cessation des paiements telle que définie par l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 et les "difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation" (article 34 de la loi n ° 84-148 du 1er mars 1984) ou la difficulté juridique, économique ou financière" ou encore les besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise" (article 35 de la même loi).
A ce stade, les chances de succès d'un plan de redressement de l'entreprise sont, sans nul doute, bien supérieures. Et la liquidation judiciaire, lorsqu'il faut la prononcer, doit permettre un meilleur désintéressement des créanciers dans la mesure où, comme cela a déjà été indiqué, la période précédant immédiatement la cessation des paiements est généralement marquée par un accroissement spectaculaire du passif.
PROPOSITION
Il est proposé d'autoriser l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaires sur la base du critère ci-dessus dans l'une ou l'autre de ses formulations mais uniquement sur saisine d'office du tribunal ou encore sur saisine du tribunal par le procureur de la République ou par déclaration du débiteur, les créanciers devant toujours, quant à eux, établir l'état de cessation des paiements de celui-ci.
B ) LE RENVOI PAR LE JUGE-COMMISSAIRE A UNE FORMATION COLLEGIALE
Les pouvoirs du juge-commissaire sont ceux d'un juge unique. Il constitue à lui seul une juridiction dont la compétence est particulièrement étendue. Il est présent à toutes les étapes de la procédure et toutes les décisions de quelque importance, en dehors des plus graves qui appartiennent au tribunal, relèvent de son pouvoir juridictionnel ou requièrent à tout le moins son autorisation. Le juge-commissaire statue par voie d'ordonnances qui peuvent être frappées de recours devant le tribunal. Les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles ni d'opposition ni de tierce opposition ni d'appel ni de pourvoi en cassation, à l'exception de ceux statuant sur les revendications (article 173.1° de la loi de 1985). Toutefois, la voie de l'appel et celle du pourvoi en cassation ont été ouvertes au ministère public par l'article 173-1 de la loi à l'encontre des jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles 154,155 et 156 de la loi (réalisation des actifs dans la procédure de liquidation judiciaire).
L'accomplissement de la tâche ainsi confiée au juge-commissaire ne soulève généralement pas de difficultés particulières en dépit de sa lourdeur. Il peut pourtant se faire que, dans certaines circonstances, compte tenu de l'ampleur des enjeux économiques et sociaux en cause comme de la parcimonie avec laquelle sont mesurées les voies de recours, la décision à prendre semble, à celui qui est investi de la mission de juger seul, peser d'un poids trop lourd.
Dans ces hypothèses, exceptionnelles, le juge-commissaire devrait être autorisé à renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à l'instar de ce qui est prévu pour le juge des référés par l'article 487 du nouveau Code de procédure civile.
Il importerait alors, pour préserver le principe du double degré de juridiction, de prévoir la possibilité de former appel de ces décisions devant la cour d'appel.
PROPOSITION
Il est proposé de modifier l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 en y insérant la disposition suivante :
Le juge-commissaire a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date. L'ordonnance prise à cet effet est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.
Le recours contre la décision prise par la juridiction en formation collégiale est porté devant la cour d'appel
C) LA CONTINUATION DU BAIL COMMERCIAL EN COURS
L'article 37, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, relatif à la poursuite des contrats en cours, prévoit que lorsque la prestation (du débiteur) porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. L'alinéa 3 dispose qu'à défaut de paiement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit.
Une sanction aussi radicale est de nature à rendre très difficile, pour ne pas dire impossible, toute négociation en vue de la cession du fonds de commerce du débiteur avec le droit au bail qui en constitue l'élément essentiel, puisqu'il suffit d'un retard, si minime soit-il, dans le paiement d'une échéance pour que le juge-commissaire n'ait qu'à constater la résiliation de plein droit du contrat sur la demande de tout intéressé (article 61-1 du décret n ° 85-I388 du 27 décembre 1985). Comment, d'ailleurs, concilier cette disposition avec celle de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, selon lequel, à compter du jugement d'ouverture, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou la résiliation de plein droit du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers et des charges afférentes à une occupation postérieure audit jugement, cette action ne pouvant être introduite moins de deux mois après le jugement d'ouverture ?
PROPOSITION
Il apparaît, en conséquence, nécessaire de modifier l'article 37 en précisant que les dispositions de ce texte ne concernent pas le bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise, dont la résiliation pour non paiement des loyers est régie par le seul article 38.
D) L'ARTICULATION DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985 AVEC LA LOI n° 91-450 DU 9 JUILLET 1991. L'EXERCICE DES VOIES D'EXÉCUTION PAR LES CRÉANCIERS DE L'ARTICLE 40
Selon le premier alinéa de l'article 40, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie. En cas de cession totale ou lorsqu'elle ne sont pas payées à l'échéance en cas de continuation, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 752-15 du Code du travail. En cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles précités, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application de la loi n ° 51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement. Leur paiement se fait dans l'ordre prévu au dernier alinéa de l'article 40.
Il résulte de l'affirmation de principe énoncée au début de l'article 40 que les créanciers dont la créance a son origine postérieurement au jugement d'ouverture sont en droit d'exiger leur paiement intégral à l'échéance si l'administrateur ou le débiteur dispose des fonds nécessaires comme cela devrait, logiquement, toujours être le cas, eu égard aux conditions drastiques auxquelles l'article 37 soumet la poursuite des contrats. A défaut de paiement volontaire, ces créanciers peuvent, dans les conditions du droit commun, engager des poursuites en vue du paiement et exercer toute voie d'exécution. La jurisprudence de la Cour de cassation décide, en outre, que le classement prévu par l'article 40 ne constitue pas un obstacle aux poursuites, le paiement à l'échéance n'étant pas subordonné à l'existence entre les mains du mandataire de fonds suffisants pour assurer le respect de ce classement lequel, en définitive, ne trouve à s'appliquer qu'en cas de concours sur un bien déterminé.
Aux termes de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, l'acte de saisie (attribution) emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, la signification ultérieure d'autres saisies ne remettant pas en cause cette attribution. Il s'ensuit, selon un arrêt de la chambre commerciale en date du 11 février 1997, que tout créancier postérieur peut, lorsque sa créance, liquide et exigible, est constatée par un titre exécutoire, saisir certaines créances du débiteur et être, en qualité de premier saisissant, le premier payé, quel que soit l'ordre de sa créance, peu important, éventuellement, l'existence d'autres créances d'un rang préférable dans l'ordre de classement établi par l'article 40.
Cette situation doit-elle être corrigée ? Une réponse négative paraît s'imposer sous peine de compromettre le financement de la période d'observation, qui suppose la poursuite des contrats avec les fournisseurs et prestataires lesquels ne s'exécuteront que s'ils disposent, en cas de besoin, des outils procéduraux nécessaires pour se faire payer à l'échéance sans avoir à subir les attentes et aléas d'un classement qui peut donner lieu à contestation. On ajoutera que la mise en place d'un véritable système organisé de prévention sous contrôle judiciaire, en anticipant le sauvetage, aurait pour conséquence de réduire la fréquence des conflits entre l'objectif légal de sauvegarde de l'entreprise et la satisfaction, légitime, des intérêts des créanciers postérieurs.
Cependant, l'application des principes ci-dessus se trouve restreinte de manière significative dans la pratique par les dispositions de l'article 173 du décret n ° 85-1388 du 27 décembre 1985, aux termes duquel aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable. Dans un arrêt du 22 avril 1997, la chambre commerciale de la Cour de cassation a fait application de cette règle à un avis à tiers détenteur délivré au liquidateur, tiers saisi, pour obtenir l'attribution de sommes versées à ladite Caisse.
On observera 46 ( * ) que l'exclusion de toute procédure d'exécution sur les sommes susvisées, désormais applicable à l'égard de quiconque 47 ( * ) , est concomitante aux changements apportés aux modalités de fonctionnement des comptes relatifs aux procédures collectives.
Alors que, sous le régime antérieur à la loi du 25 janvier 1985, il existait des comptes de consignation ouverts au nom de l'affaire en règlement judiciaire ou en liquidation des biens et soumis à une procédure de réception et de restitution des sommes consignées, ainsi que des comptes de répartition affectés au paiement de dividendes aux créanciers admis, il n'y a plus désormais que des comptes de dépôt à vue (compte AGS, compte général, compte de répartition, compte à terme), non individualisés et fonctionnant sous la responsabilité des mandataires de justice qui en sont titulaires. La Caisse des dépôts et consignations n'est pas en situation d'individualiser les sommes appartenant à chaque procédure et n'est tenue à aucune surveillance particulière, à l'exception des contrôles applicables d'une manière générale aux comptes de dépôt à vue. Dans ces conditions, l'immunité renforcée prévue par l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 au profit des fonds déposés à la Caisse aurait, en quelque sorte, accompagné le mouvement.
Toujours est-il, d'une part, que la légalité de cette disposition est mise en doute au regard de l'article 14.1° de la loi du 9 juillet 1991 dès lors qu'il résulte de ce dernier texte que l'insaisissabilité de certains biens ne peut être prononcée que par la loi.
On doit craindre, d'autre part, qu'en réduisant sensiblement l'étendue des sommes susceptibles de faire l'objet de voies d'exécution de la part des créanciers de l'article 40, l'article 173 ne préjudicie, en définitive, au crédit de l'entreprise soumise à la procédure collective et à son redressement en incitant les créanciers de la période d'observation à exiger un paiement comptant.
Il convient, enfin, de signaler qu'il serait dans les intentions de la Chancellerie d'imposer, très prochainement, une gestion individualisée des comptes, procédure par procédure, ce qui est techniquement assez simple à réaliser.
PROPOSITION
Il y a lieu, en conséquence, d'envisager la suppression de la disposition contenue dans l'article 173 du décret du 27 décembre 1985.
E) LA SAISIE-ATTRIBUTION DES CRÉANCES A EXÉCUTION SUCCESSIVE
Il s'agit, cette fois, du recouvrement de créances ayant leur origine antérieurement au jugement d'ouverture et pour le paiement desquelles des saisies-attributions ont été pratiquées, avant ce jugement, sur des créances à exécution successive (loyers, salaires etc..) dont le débiteur était titulaire sur des tiers. L'effet d'attribution immédiate de la saisie continue-t-il de s'appliquer aux termes non encore échus, nonobstant l'ouverture de la procédure collective ? Un avis de la Cour de cassation en date du 16 décembre 1994 répond affirmativement. Une telle solution doit-elle être consacrée ?
L'article 13, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution prévoit que les saisies peuvent porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. L'article 43, alinéa 2, de la même loi dispose que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remet pas en cause l'effet d'attribution immédiate de l'acte de saisie-attribution. Enfin, l'article 69 du décret n ° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi précitée prescrit d'appliquer à la saisie des créances à exécution successive ses articles 55 à 68 qui fixent les conditions de mise en oeuvre de la saisie-attribution.
Cependant, aucune des dispositions précitées ne prévoit expressément que l'absence de remise en cause de l'effet d'attribution immédiate de la saisie par suite de l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires s'étend aux créances à exécution successive. Or, la règle du dessaisissement qui frappe, dès sa naissance, ne serait-ce qu'un instant de raison, et avant même qu'elle ne puisse être affectée par la saisie, la créance apparue après le jugement d'ouverture, devrait interdire, en l'absence de dérogation légale formulée en termes explicites, d'appliquer l'effet d'attribution immédiate à cette créance, indisponible dans le patrimoine du débiteur saisi.
Conforme aux règles d'ordre public de la législation sur les procédures collectives, la solution présente, en outre, l'avantage de corriger, en le limitant, l'effet dévastateur sur la consistance des actifs des saisies-attributions opérées sur des créances à exécution successive antérieurement au jugement d'ouverture.
PROPOSITION
Il est souhaitable que cette solution soit consacrée par une disposition expresse de la loi du 9 juillet 1991.
F) LA CESSION A DES TIERS (articles 21, alinéa 4 et 155, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985)
L'interdiction d'acquérir édictée par ces deux textes ne saurait être discutée dans son principe car elle constitue un facteur important de moralisation des procédures de cession.
On peut accessoirement s'interroger sur la différence de rédaction entre l'article 21 et l'article 155 dont une lecture stricte pourrait laisser entendre que l'acquisition par personne interposée serait admise dans le cadre de l'article 155, ce qui ne correspond sans doute pas à la volonté du législateur.
Plus fondamentalement, le dispositif légal engendre une réelle difficulté pratique lorsque le seul repreneur possible n'est pas un tiers au sens de l'article 21, alinéa 5, ce qui est le cas, par exemple, d'un administrateur de la société à céder.
Le souci, très légitime, d'éviter une collusion entre le débiteur et l'auteur de l'offre permettant d'effacer les dettes à travers une Accession arrangée peut, dans certains cas, conduire, par suite de la rigueur du texte, à empêcher la survie de l'entreprise et des emplois qui lui sont attachés, la seule issue légale étant la disparition de l'unité économique et la vente dispersée des actifs.
Ne pouvant se résoudre à cette situation et dès lors qu'aucune fraude ne peut être suspectée, les juridictions ont recours à des interprétations très audacieuses de la loi qui, même si elles se font sans opposition du parquet (qui se résout à fermer les yeux dans l'intérêt de l'entreprise), ne sont pas satisfaisantes.
Il serait donc opportun, à l'image de ce qui est prévu par l'article 21, alinéa 5, en faveur des entreprises agricoles, d'instituer également une faculté de dérogation pour les autre entreprises.
Mais, eu égard à son caractère exceptionnel, cette faculté devrait être conditionnée, comme en matière de location-gérance, par une demande expresse du parquet.
PROPOSITION
Il pourrait, ainsi, être rajouté aux articles 21 et 155 un alinéa disposant que :
Lorsqu'il s'agit d'une entreprise autre qu'une exploitation agricole, le tribunal peut, à la demande du procureur de la République, accorder une dérogation à cette interdiction .
Si l'on souhaite que soit plus clairement proclamée la finalité de cette dérogation, le texte pourrait, par référence à l'article 1 de la loi, être ainsi rédigé :
Lorsqu'il s'agit d'une entreprise autre qu'une exploitation agricole, le tribunal peut, lorsque la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif le justifient et à la demande du procureur de la République, accorder une dérogation à cette interdiction.
G) L'INTERDICTION POUR LES CONTRÔLEURS DE SE PORTER ACQUÉREURS DES BIENS DU DÉBITEUR
L'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 punit des peines prévues par l'article 314-2 du Code pénal Atout administrateur, représentant des créanciers, liquidateur, commissaire à l'exécution du plan ou toute autre personne, à l'exception des contrôleurs et des représentants des salariés qui, ayant participé à un titre quelconque à la procédure, se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, de biens du débiteur ou les utilise à son profit. La juridiction saisie prononce la nullité de l'acquisition et statue sur les dommages-intérêts qui seraient demandés.
Cette disposition, dont l'objet est de prévenir tout conflit d'intérêts et aussi toute suspicion vis-à-vis des professionnels qui interviennent dans le déroulement du redressement ou de la liquidation judiciaires,
participe à l'assainissement de la procédure collective. Dans une telle perspective, l'exception prévue en faveur des contrôleurs est critiquable. Ceux-ci sont, en effet, des créanciers chargés, pour la durée de la procédure, d'assister le représentant des créanciers ou le liquidateur dans ses fonctions relatives, notamment, à l'établissement du passif et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Bien qu'ils n'aient pas qualité pour représenter les créanciers, différentes dispositions leur permettent d'être informés ou consultés aux différents stades de la procédure et ils peuvent même prendre certaines initiatives susceptibles d'influer sur le cours de celle-ci (v. article 36, alinéa 1er et article 37, alinéa 3, de la loi de 1985), ce qui leur confère, par rapport aux autres candidats repreneurs, une position privilégiée de nature à autoriser bien des suppositions.
PROPOSITION
Il est donc proposé d'étendre aux contrôleurs l'interdiction d'acquérir les biens du débiteur prévue à l'article 207, en supprimant dans ce texte les mots des contrôleurs.
H) LA TRANSPARENCE DES OFFRES
La publicité des offres fait l'objet, dans la loi du 25 janvier 1985 et le décret d'application du 27 décembre 1985, d'un régime différent selon qu'il s'agit d'offres tendant à la présentation d'un plan pour l'entreprise en redressement judiciaire ou de la vente d'unités de production dans le cadre de la liquidation judiciaire d'une entreprise.
Dans le premier cas, il est prévu à l'article 32 du décret, dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994, que l'offre reçue par l'administrateur en application de l'article 21 de la loi est déposée au greffe. L'auteur de l'offre doit attester qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au quatrième alinéa de l'article 21 et, lorsqu'il est tenu de les établir, joindre ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels. Le troisième alinéa de l'article 32 susvisé dispose que « Sans préjudice des dispositions des article 25 et 83 de la loi précitée et 103-2 ci dessous, les offres et documents qui y sont joints ne sont communiqués qu'au juge-commissaire et au procureur de la République » . Il résulte de ce texte, ainsi que de l'article 144 de la loi de 1985, qu'ont également connaissance des offres, soit directement par la voie du greffe soit par l'intermédiaire de l'administrateur, le débiteur et les divers acteurs de la procédure. Mais le public et, par conséquent, les repreneurs potentiels ne sont informés que des caractéristiques essentielles des éléments d'actif qui pourront faire l'objet du plan ainsi que (du) délai pour le dépôt des offres aussitôt que celui-ci est fixé (article 32, alinéa 1er) et non pas de l'existence et du contenu des offres.
En revanche, lorsqu'il s'agit d'une vente d'unité de production, l'article 155, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 prévoit que l'offre est déposée au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance. Elle est communiquée au juge-commissaire.
Il y a donc transparence dans un cas et opacité dans l'autre, celle-ci prenant appui, semble-t-il, sur la crainte de surenchères de la part de repreneurs qui seraient décidés à se maintenir dans la course au prix de propositions dépassant leurs possibilités et faisant, dès lors peser un risque sérieux sur l'aboutissement du plan. Mais outre que la distinction ainsi faite, selon qu'il s'agit de céder tout ou partie de l'entreprise en redressement judiciaire ou une unité de production de l'entreprise en liquidation judiciaire, est difficilement justifiable sur le plan logique, il apparaît que le secret imposé dans le premier cas présente plus d'inconvénients que d'avantages en raison de l'espace qui est laissé à la fraude et à la suspicion, fondée ou non.
PROPOSITION
Il est donc souhaitable d'unifier le régime de publicité des offres en prévoyant, dans tous les cas, leur communication à tout intéressé.
I ) LA SITUATION DU DIRIGEANT DE FAIT AU REGARD DE LA SANCTION PERSONNELLE ENCOURUE POUR NON DÉCLARATION DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DANS LE DÉLAI LÉGAL
Seul le dirigeant de droit a qualité pour représenter la société vis-à-vis des tiers et, par conséquent, pour déclarer au greffe la cessation des paiements de la personne morale. Il est, dès lors, illogique de faire encourir la sanction de la faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer au dirigeant de fait, qui est sans qualité pour procéder à cette déclaration. Pourtant, l'application d'une sanction à ce dirigeant est juridiquement possible en l'état du renvoi opéré en termes généraux par l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 à toute personne mentionnée à l'article 185".
PROPOSITION
Une modification de l'article 189 dans le sens indiqué ci-dessus apparaît donc souhaitable .
J) L'APPEL DU MINISTÈRE PUBLIC PARTIE JOINTE CONTRE LES JUGEMENTS STATUANT EN MATIÈRE DE SANCTIONS PERSONNELLES
Sous le régime de la loi du 13 juillet 1967, le procureur de la République n'avait pas l'initiative de l'action tendant au prononcé de sanctions personnelles (faillite personnelle, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou seulement une personne morale), dans les cas prévus par la loi, contre les commerçants personnes physiques et les dirigeants sociaux de droit ou de fait. Il disposait, en revanche, du droit d'interjeter appel de la décision rendue.
En vertu de l'article 191 de la loi du 25 janvier 1985, le ministère public figure désormais au nombre des titulaires de l'action.
Lorsqu'il introduit l'instance, il a donc, dans celle-ci, le statut de partie principale avec tous les droits qui y sont attachés dont celui d'user des voies de recours.
Lorsque l'action est exercée par le tribunal se saisissant d'office ou par l'un des mandataires de justice énumérés à l'article 191, le ministère public, qui doit avoir communication de la procédure, figure à celle-ci comme partie jointe. Il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi (article 424 du nouveau Code de procédure civile),
ce qui ne le rend pas pour autant partie au procès. Il s'ensuit qu'il ne peut former ni appel, ni pourvoi en cassation, abstraction faite du cas original que constitue le pourvoi dans l'intérêt de la loi.
La loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires, sans doute animée par le souci d'un certain ordre public économique, a ouvert dans de nombreux cas la voie de l'appel et celle du recours en cassation au ministère public, même s'il n'a pas agi comme partie principale (articles 171, 174 et 175). Mais aucune disposition semblable ne figure dans la loi en ce qui concerne les jugements statuant sur les sanctions personnelles.
L'article 423 du nouveau Code de procédure civile, suivant lequel le ministère public (en dehors des cas spécifiés par la loi où il agit d'office) peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci , ouvre, certes, au procureur de la République la possibilité tant d'introduire l'action que d'exercer les voies de recours quand bien même il n'aurait été que partie jointe à l'instance initiale, mais à la condition que les faits dont il s'agit aient porté atteinte à l'ordre public.
Que la faillite personnelle, comme son démembrement l'interdiction de gérer, soit une mesure d'intérêt public , ainsi que l'énonce la chambre commerciale pour la distinguer des sanctions pénales, n'emporte pas que les décisions rendues en cette matière intéressent toujours et nécessairement l'ordre public. Pour ne prendre qu'un exemple, l'omission de déclarer la cessation des paiements, qui peut entraîner le prononcé de la faillite personnelle (article 189.5° de la loi du 25 janvier 1985), peut selon les circonstances qui l'ont entourée, apparaître comme ayant ou non lésé l'ordre public.
Il s'ensuit qu'en l'état actuel des textes, le recours du ministère public partie jointe contre une décision statuant en matière de sanction n'est recevable que si les faits soumis aux juges ont porté atteinte à l'ordre public. Ainsi en a décidé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 janvier 1998.
Cette situation n'est guère satisfaisante. Le régime des sanctions personnelles répond avant tout au souci d'écarter des relations commerciales les dirigeants malhonnêtes ou simplement incompétents.
PROPOSITION
Dans ce domaine, voisin du droit pénal, il est souhaitable que le parquet, qu'il ait ou non pris l'initiative de l'action, se voie reconnaître dans tous les cas, qu'il y ait ou non atteinte à l'ordre public, le droit d'exercer les voies de recours.
Il convient, à cet effet, d'envisager une modification de l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985.
-----------------------
Achevé à Paris, le 8 septembre 1998
ANNEXE 3
LISTE DES
AUDITIONS
EFFECTUÉES PAR LE RAPPORTEUR
les 26 juin, 1 er et 8 juillet 1999
_____
- La Conférence générale des tribunaux de commerce
- Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
- Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
- Le Président de la chambre commerciale de la Cour de cassation
- La Conférence des bâtonniers et le Conseil de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris
- La Compagnie nationale des commissaires aux comptes
- Le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables
- Le MEDEF
- La Chambre de commerce et d'industrie de Paris (commission juridique)
* 1 Document joint en annexe 1, page 55.
* 2 Rapport d'expertise, annexe 2, page 59.
* 3 Liste des organismes entendus jointe en annexe 3, page 89.
* 4 Selon l'étude publiée par l'INSEE au mois de janvier 1998 sur la défaillance d'entreprise, les difficultés financières déclenchant la procédure résultent de facteurs d'origines diverses : problèmes de débouchés (44,5 % des cas), erreurs stratégiques (16 %), coûts trop élevés (22 %), système d'information insuffisamment développé (27,3 %). Il peut aussi s'agir de problèmes spécifiquement financiers (42,7 %), financement propre insuffisant, difficultés de recouvrement, structure financière inadaptée ... Dans la plupart des cas, plusieurs causes se cumulent.
* 5 Rapport d'expertise, annexe 2, page 61.
* 6 Rapport d'expertise, annexe 2, page 60.
* 7 Ces dispositions figurent désormais aux articles L. 612-3 à et L. 611-2 à L. 611-6 du code de commerce.
* 8 Cette obligation résulte des articles 13-1, 44-1 et 293 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales pris en application de la loi 66-537 du 24 juillet 1966. Elle transpose en droit interne une exigence fixée par les directives 78.660 CEE du 25 juillet 1978 et 90.605 CEE du 8 novembre 1990. Le non-respect de cette obligation est constitutif d'une contravention de la cinquième classe : la peine d'amende encourue s'élève donc à 10.000 francs et à 20.000 francs en cas de récidive.
* 9 Une action en manquement pour défaut de transposition de l'obligation de publier les comptes annuels a abouti, au printemps 1986, à la condamnation de l'Italie, et en septembre 1998 à la condamnation de la République fédérale d'Allemagne.
* 10 Selon le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, 90 % des SARL et 60 % des SA engagées dans une procédure collective n'ont pas déposé leurs comptes au cours des deux années précédant le jugement d'ouverture.
* 11 En vertu de cette disposition, : « A l'issue de cet entretien, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. »
* 12 Rapport d'expertise, annexe 2, page 65.
* 13 Rapport d'expertise, annexe 2, page 66.
* 14 « Toute société commerciale ainsi que toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
« Ce groupement a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations comptables et financières que ceux-ci s'engagent à lui transmettre régulièrement.
« Lorsque le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le chef d'entreprise et peut lui proposer l'intervention d'un expert.
« A la diligence du représentant de l'Etat, les administrations compétentes prêtent leur concours aux groupements de prévention agréés. Les services de la Banque de France peuvent également, suivant des modalités prévues par convention, être appelés à formuler des avis sur la situation financière des entreprises adhérentes. Les groupements de prévention agréés peuvent bénéficier par ailleurs des aides directes ou indirectes des collectivités locales, notamment en application des articles 5, 48 et 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
« Les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure, notamment avec les établissements de crédit et les entreprises d'assurance, des conventions au profit de leurs adhérents. »
* 15 Rapport présenté par M. Jean Courtière au nom de la commission juridique, adopté par la CCIP le 4 février 1999, intitulé « Réforme du droit des entreprises en difficulté - Réaction au document d'orientation de la Chancellerie », page 14.
* 16 Convention d'action concertée pour la prévention des difficultés des entreprises conclue en mai 1999 entre la Conférence générale des tribunaux de commerce, le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
* 17 Rapport d'expertise, annexe 2, page 66.
* 18 Article 55 alinéa 2 : « Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnes physiques. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. ». Ces dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 621-48 du code de commerce.
* 19 Rapport d'expertise page 67.
* 20 Article 35 alinéa 1 de la loi du 1 er mars 1984, devenu l'article L. 611-3 du code de commerce.
* 21 Les petites affiches n° 137 du 13 novembre 1996, page 6.
* 22 Rapport d'expertise, annexe 2, page 63.
* 23 Ces dispositions figurent désormais à l'article L. 812-8 du code de commerce.
* 24 En vertu de l'article 35 de la loi du 1 er mars 1984, « le président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l'objet est de favoriser le fonctionnement de l'entreprise et de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers ».
* 25 Rapport précité, page 22.
* 26 Ces dispositions figurent désormais à l'article L. 611-5 du code de commerce.
* 27 Rapport de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris sur la réforme du droit des entreprises en difficulté, op. cit., page 24.
* 28 Aux termes de l'article 38 de la loi du 1 er mars 1984, « toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ».
* 29 Rapport d'expertise, annexe 2, pages 67 à 70.
* 30 Ces dispositions figurent désormais à l'article L. 621-7 du code de commerce.
* 31 Article 180 alinéa 1 er : « Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ». Cet article correspond désormais à l'article L. 624-3 du code de commerce.
* 32 Rapport d'expertise, annexe 2, page 70.
* 33 Rapport d'expertise, annexe 2, pages 70 et suivantes.
* 34 Rapport d'expertise, annexe 2, pages 75 à 77.
* 35 Rapport présenté par M. Jean Courtière au nom de la commission juridique et adopté en assemblée générale le 24 avril 1997 intitulé « Procédures collectives : améliorer les cessions d'actifs », pages 17 et suivantes.
* 36 Art. L. 625-5 - « A toute époque de la procédure, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 625-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
(...)
« 5° Avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements. »
* 37 Sont soumises à la procédure simplifiée les petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire celles qui emploient 50 salariés au plus et qui réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 20 millions de francs, ces deux critères étant cumulatifs. Cette procédure se caractérise par le fait que le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de l'entreprise, par une durée maximale de la période d'observation inférieure à celle du régime général (8 mois au lieu de 20) et par un accroissement des pouvoirs du débiteur et un élargissement des missions du juge commissaire et du représentant des créanciers, aucun administrateur n'étant généralement nommé.
* 38 Notons que l'annuaire statistique de la justice indique déjà le nombre de liquidations immédiates pour les années antérieures à 1994.
* 39 Article intitulé « Pour être pris en considération pour caractériser la cessation des paiements, le passif exigible doit-il avoir été exigé ? », Dalloz Affaires n° 131 du 24 septembre 1998, page 1487.
* 40 Rapport d'expertise, annexe 2, page 77.
* 41 Op. cit., page 31.
* 42 Les frais de procédure comprennent le coût des publications et des significations des décisions rendues, la rémunération des mandataires de justice ainsi que les frais annexes tels que les frais d'expertise, les frais d'inventaire, honoraires et dépens. Ils constituent des créances privilégiées prévues à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et sont payées par priorité avant les fournisseurs et les autres créanciers de l'entreprise, qu'il s'agisse de créances antérieures au jugement d'ouverture ou de créances postérieures.
* 43 Rapport susvisé page 80.
* 44 Rapport susvisé page 4.
* 45 V. Cozian et A. Viandier, Droit des sociétés, Litec, n 576 et s.
* 46 V. B. Soinne, Traité des procédures collectives, p. 949 et s.
* 47 Alors que l'article 84 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens réservait les droits du Trésor public en cas de recouvrement de l'exercice de ses poursuites individuelles pour ses créances privilégiées antérieures au jugement d'ouverture, ce qui pouvait inciter à étendre la solution aux créanciers postérieurs, également non soumis à la suspension des poursuites individuelles.







