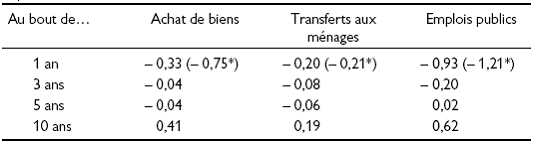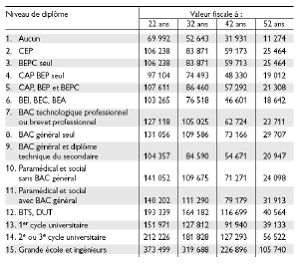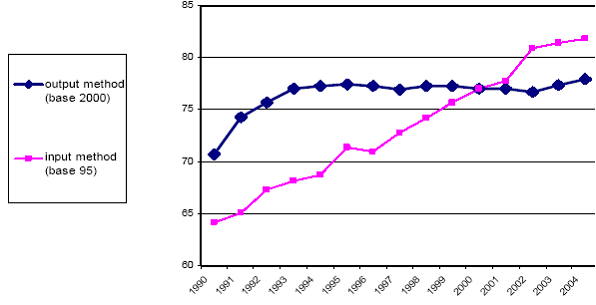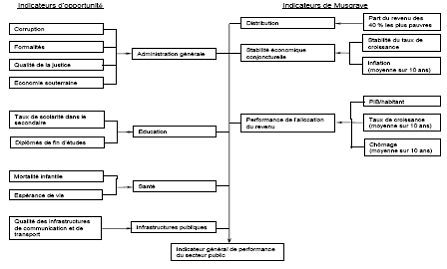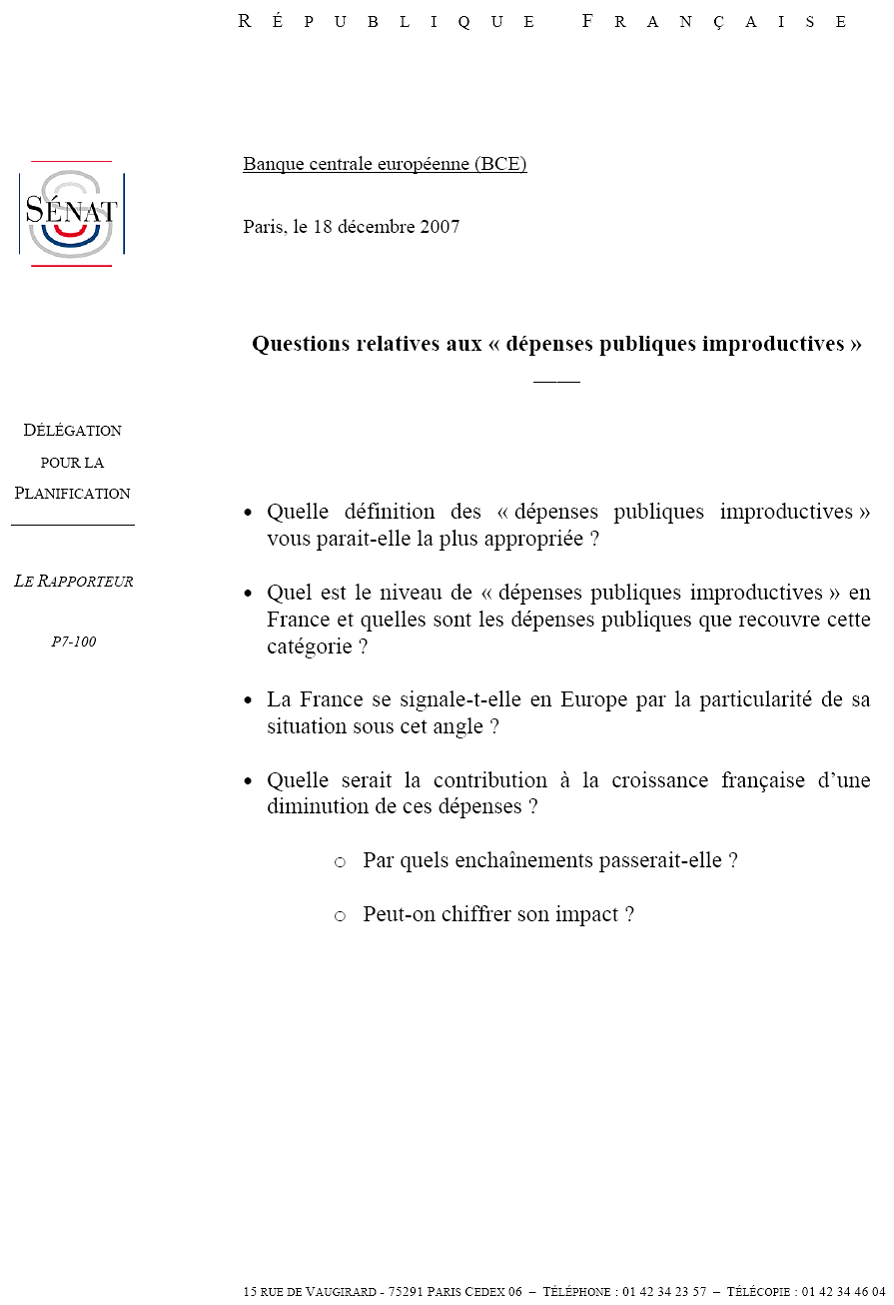Rapport d'information n° 441 (2007-2008) de M. Bernard ANGELS , fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification, déposé le 2 juillet 2008
Synthèse du rapport (130 Koctets)
Disponible au format Acrobat (3,7 Moctets)
-
RÉSUMÉ
-
PREMIÈRE QUESTION : LES DÉPENSES
PUBLIQUES INFLUENCENT-ELLES SIGNIFICATIVEMENT L'UTILISATION DES RESSOURCES
ÉCONOMIQUES ?
-
DEUXIÈME QUESTION : EXISTE-T-IL DES
LIENS NÉGATIFS ENTRE DÉPENSES PUBLIQUES, CROISSANCE
ÉCONOMIQUE ET BIEN-ÊTRE ?
-
I. LES ARGUMENTS THÉORIQUES SELON LESQUELS
LES DÉPENSES PUBLIQUES RÉDUIRAIENT STRUCTURELLEMENT LE RYTHME DE
LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE SONT INVÉRIFIABLES
CONCRÈTEMENT
-
II. LA CONTRIBUTION DES DÉPENSES PUBLIQUES
À LA RICHESSE ÉCONOMIQUE EST SYSTÉMATIQUEMENT
SOUS-ESTIMÉE
-
TROISIÈME QUESTION : QUE PEUT-ON DIRE
DE LA REDISTRIBUTIVITÉ DES DÉPENSES PUBLIQUES ?
-
PREMIÈRE QUESTION : LES DÉPENSES
PUBLIQUES INFLUENCENT-ELLES SIGNIFICATIVEMENT L'UTILISATION DES RESSOURCES
ÉCONOMIQUES ?
-
INTRODUCTION
-
PREMIÈRE PARTIE - LE NIVEAU DES
DÉPENSES PUBLIQUES : DES DIFFÉRENCES ENTRE PAYS MAIS PEU
D'EFFETS SUR L'UTILISATION GLOBALE DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES
-
CHAPITRE I - LES DÉPENSES PUBLIQUES, UNE
DIVERSITÉ À GÉOMÉTRIE VARIABLE
-
I. LE RÔLE PRINCIPAL DES TRANSFERTS DANS LES
NIVEAUX DES DÉPENSES PUBLIQUES ET LEURS ÉCARTS ENTRE PAYS
-
A. LA PLACE PRÉPONDÉRANTE DES
TRANSFERTS, EN LIEN AVEC L'IMPORTANCE DES DÉPENSES SOCIALES
-
B. DES DÉPENSES PUBLIQUES SOCIALES QUI
EXPLIQUENT UNE GRANDE PARTIE DES ÉCARTS DE NIVEAUX DE DÉPENSES
PUBLIQUES ENTRE PAYS DÉVELOPPÉS
-
C. CES DERNIÈRES ANNÉES, LES
DÉPENSES PUBLIQUES SOCIALES ONT ÉTÉ MOINS FLEXIBLES QUE
LES AUTRES
-
A. LA PLACE PRÉPONDÉRANTE DES
TRANSFERTS, EN LIEN AVEC L'IMPORTANCE DES DÉPENSES SOCIALES
-
II. DES DÉPENSES PUBLIQUES DE PRODUCTION DE
BIENS ET SERVICES, MINORITAIRES ET RELATIVEMENT HOMOGÈNES DANS LES PAYS
DÉVELOPPÉS
-
A. LES DÉPENSES PUBLIQUES CONSACRÉES
À LA PRODUCTION SONT MINORITAIRES ET RELATIVEMENT
HOMOGÈNES
-
B. LES DIFFÉRENTS POSTES DE DÉPENSES
LIÉES À LA PRODUCTION PUBLIQUE : DES COMBINAISONS
PRODUCTIVES VARIABLES
-
1. La consommation des administrations publiques,
une assez grande homogénéité mais quelques situations
atypiques
-
a) Un ralentissement de la croissance des
consommations publiques
-
b) Une relative homogénéité
des niveaux de consommations publiques mais quelques situations
singulières
-
c) Une assez grande
homogénéité des rémunérations publiques,
avec des exceptions notables...
-
d) ... dans un contexte où le poids
relatif de l'emploi public varie beaucoup
-
e) Une dispersion plus forte des consommations
intermédiaires
-
a) Un ralentissement de la croissance des
consommations publiques
-
2. L'investissement des administrations publiques,
une place réduite et diversifiée
-
1. La consommation des administrations publiques,
une assez grande homogénéité mais quelques situations
atypiques
-
C. EN FRANCE, UNE PRODUCTION PUBLIQUE FORTEMENT
UTILISATRICE D'UNE MAIN-D'oeUVRE RELATIVEMENT PEU
RÉMUNÉRÉE
-
A. LES DÉPENSES PUBLIQUES CONSACRÉES
À LA PRODUCTION SONT MINORITAIRES ET RELATIVEMENT
HOMOGÈNES
-
III. LA DÉCOMPOSITION FONCTIONNELLE DES
DÉPENSES PUBLIQUES : LA PRÉDOMINANCE DES FONCTIONS
NON-RÉGALIENNES
-
IV. LES DÉPENSES PUBLIQUES EN FRANCE,
MÊMES PRIORITÉS FONCTIONNELLES QU'AILLEURS MAIS UN NIVEAU
RELATIVEMENT PLUS ÉLEVÉ SURTOUT POUR LA PROTECTION SOCIALE
-
A. LA RÉPARTITION FONCTIONNELLE DES
DÉPENSES PUBLIQUES EN FRANCE
-
1. Une structure marquée, comme ailleurs,
par la prédominance de trois fonctions : protection sociale,
santé, éducation
-
2. Le renforcement de la place de la protection
sociale et de la santé
-
3. Une structure fonctionnelle des dépenses
publiques qui correspond à la primauté des dépenses de
transferts
-
1. Une structure marquée, comme ailleurs,
par la prédominance de trois fonctions : protection sociale,
santé, éducation
-
B. UN NIVEAU DE DÉPENSES PUBLIQUES
RELATIVEMENT ÉLEVÉ PRINCIPALEMENT DU FAIT DE LA PROTECTION
SOCIALE
-
A. LA RÉPARTITION FONCTIONNELLE DES
DÉPENSES PUBLIQUES EN FRANCE
-
I. LE RÔLE PRINCIPAL DES TRANSFERTS DANS LES
NIVEAUX DES DÉPENSES PUBLIQUES ET LEURS ÉCARTS ENTRE PAYS
-
CHAPITRE II - LA PROTECTION SOCIALE, DES NIVEAUX
TRÈS DIVERS DE DÉPENSES PUBLIQUES, MAIS, AU TOTAL, DES
PRÉLÈVEMENTS SUR LES RESSOURCES ÉCONOMIQUES PLUTÔT
HOMOGÈNES
-
I. LES DÉPENSES SOCIALES EN EUROPE, UNE
RÉALITÉ COMPLEXE ET UNE DISPERSION EN LIEN AVEC LA RICHESSE
ÉCONOMIQUE DES PAYS
-
A. DES ÉVOLUTIONS CONTRASTÉES
À TOUS POINTS DE VUE
-
1. Les dépenses publiques de protection
sociale en points de PIB : une stabilité globale, mais des
évolutions nationales très différenciées
-
2. Les dépenses privées de
protection sociale : un fort dynamisme
-
3. Une croissance contrastée des
dépenses relatives aux différents « risques »
sociaux
-
4. Des dynamiques nationales de protection sociale
par habitant très variables
-
1. Les dépenses publiques de protection
sociale en points de PIB : une stabilité globale, mais des
évolutions nationales très différenciées
-
B. UNE RELATIVE HOMOGÉNÉITÉ
DU POIDS DES DÉPENSES SOCIALES DANS LE PIB, MAIS UNE GRANDE
DIVERSITÉ SOUS L'ANGLE DE LA DÉPENSE SOCIALE PAR HABITANT
-
1. Une dispersion des dépenses sociales
dans le PIB qui s'est réduite
-
2. En revanche, une dispersion des dépenses
sociales par habitant qui, même si elle se réduit, reste
très forte
-
1. Une dispersion des dépenses sociales
dans le PIB qui s'est réduite
-
A. DES ÉVOLUTIONS CONTRASTÉES
À TOUS POINTS DE VUE
-
II. LES DÉPENSES SOCIALES DANS LES PAYS
DÉVELOPPÉS, DERRIÈRE LA DIVERSITÉ DES
DÉPENSES PUBLIQUES, UNE CERTAINE HOMOGÉNÉITÉ DES
RICHESSES TOTALES CONSACRÉES À LA PROTECTION SOCIALE
-
A. LE CHAMP DE L'ANALYSE DES DÉPENSES DE
PROTECTION SOCIALE DOIT ÊTRE ÉLARGI POUR EN SAISIR
RÉELLEMENT LES ENJEUX
-
B. LA PRISE EN COMPTE DES DÉPENSES
PRIVÉES DE PROTECTION SOCIALE RAPPROCHE LES
« MODÈLES » DES PAYS DE L'OCDE
-
C. CE RAPPROCHEMENT EST ENCORE ACCENTUÉ
QUAND ON RAISONNE EN DÉPENSES SOCIALES NETTES
-
1. Les dépenses publiques de protection
sociale nettes sont plus basses que les dépenses brutes
-
2. Les dépenses privées nettes
ajoutent à la protection sociale, mais très diversement selon les
pays
-
3. Les dépenses totales nettes de
protection sociale sont beaucoup plus homogènes que les dépenses
publiques brutes
-
1. Les dépenses publiques de protection
sociale nettes sont plus basses que les dépenses brutes
-
A. LE CHAMP DE L'ANALYSE DES DÉPENSES DE
PROTECTION SOCIALE DOIT ÊTRE ÉLARGI POUR EN SAISIR
RÉELLEMENT LES ENJEUX
-
III. LES PRINCIPALES CATÉGORIES DE
DÉPENSES SOCIALES : UNE HOMOGÉNÉITÉ DES
DÉPENSES TOTALES PLUS FORTE QUE CELLES DES SEULES DÉPENSES
PUBLIQUES
-
A. LES DÉPENSES DE RETRAITE
-
B. LE NIVEAU DES DÉPENSES PUBLIQUES DE
RETRAITE DÉTERMINE LARGEMENT LA PLACE RELATIVE DES DÉPENSES
PUBLIQUES SOCIALES ET DONC DES DÉPENSES PUBLIQUES
-
C. UN PANORAMA QUE MODIFIE LA PRISE EN COMPTE DES
RESSOURCES PRIVÉES CONSACRÉES À LA RETRAITE
-
D. LES DÉPENSES DE SANTÉ, UN
PANORAMA ASSEZ HÉTÉROCLITE MAIS UN NOYAU DUR DE PAYS
COMPARABLES
-
A. LES DÉPENSES DE RETRAITE
-
I. LES DÉPENSES SOCIALES EN EUROPE, UNE
RÉALITÉ COMPLEXE ET UNE DISPERSION EN LIEN AVEC LA RICHESSE
ÉCONOMIQUE DES PAYS
-
CHAPITRE III - LES DÉPENSES
D'ÉDUCATION, PRIMAUTÉ DES DÉPENSES PUBLIQUES,
DIVERSITÉ DES « MODÈLES », SINGULARITÉ
FRANÇAISE
-
I. GLOBALEMENT, UNE ASSEZ FORTE AUGMENTATION DE
L'EFFORT RELATIF EN FAVEUR DE L'ÉDUCATION
-
II. DES EFFORTS D'INVESTISSEMENT DANS
L'ENSEIGNEMENT, VARIABLES À DIFFÉRENTS POINTS DE VUE
-
A. SELON LE NIVEAU D'ENSEIGNEMENT
-
B. SELON LE PAYS
-
C. LE NIVEAU DES DÉPENSES PUBLIQUES JOUE UN
RÔLE SUR LE NIVEAU DE L'EFFORT D'ÉDUCATION, MAIS UN RÔLE QUI
N'EST, DE LOIN, PAS EXCLUSIF
-
A. SELON LE NIVEAU D'ENSEIGNEMENT
-
III. FOCUS SUR LA FRANCE : UN GROS EFFORT
CONSACRÉ À L'ENSEIGNEMENT MAIS DES SINGULARITÉS À
MÉDITER
-
A. UN EFFORT D'ENSEIGNEMENT COMPARATIVEMENT PLUS
ÉLEVÉ QU'AILLEURS COMPTE TENU DE LA RICHESSE PAR HABITANT
-
B. LES SINGULARITÉS
FRANÇAISES
-
C. UNE SITUATION QUI NE SEMBLE PAS RÉSULTER
DE FACTEURS SALARIAUX MAIS PLUTÔT D'ÉLÉMENTS
D'ORGANISATION
-
D. UN COÛT MOYEN ÉLEVÉ DONT
LES EFFETS SUR LA MASSE DES DÉPENSES SONT AMPLIFIÉS PAR LA
DÉMOGRAPHIE SCOLAIRE
-
A. UN EFFORT D'ENSEIGNEMENT COMPARATIVEMENT PLUS
ÉLEVÉ QU'AILLEURS COMPTE TENU DE LA RICHESSE PAR HABITANT
-
I. GLOBALEMENT, UNE ASSEZ FORTE AUGMENTATION DE
L'EFFORT RELATIF EN FAVEUR DE L'ÉDUCATION
-
CONCLUSION - LE NIVEAU DES DÉPENSES
PUBLIQUES, UN DÉTERMINANT MARGINAL DE L'UTILISATION DES RESSOURCES
ÉCONOMIQUES
-
I. UNE DISPERSION APPARENTE DES DÉPENSES
PUBLIQUES DE L'ORDRE DE 20 % DE LA MOYENNE DES DÉPENSES
PUBLIQUES
-
II. POUR LES DÉPENSES PRIVÉES, UNE
DISPERSION DE L'ORDRE DE 64 % DE LA MOYENNE DES DÉPENSES
PRIVÉES
-
III. DES PHÉNOMÈNES DE COMPENSATION
ET DES ÉCARTS MARGINAUX REPRÉSENTATIFS D'ÉLÉMENTS
DE CONTEXTE MAIS AUSSI DE CHOIX PLUS POLITIQUES
-
I. UNE DISPERSION APPARENTE DES DÉPENSES
PUBLIQUES DE L'ORDRE DE 20 % DE LA MOYENNE DES DÉPENSES
PUBLIQUES
-
DEUXIEME PARTIE - LES DÉPENSES PUBLIQUES
CONTRE LA CROISSANCE ET LE POUVOIR D'ACHAT ?
-
CHAPITRE I - LA BAISSE DES DÉPENSES
PUBLIQUES, SOURCE D'ACCÉLÉRATION À COURT TERME DE LA
CROISSANCE ÉCONOMIQUE ?
-
CHAPITRE II - METTRE LES DÉPENSES
PUBLIQUES AU SERVICE DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE STRUCTURELLE
-
I. LA CONTRIBUTION DES DÉPENSES PUBLIQUES
À LA CROISSANCE : POUR UN VRAI DÉBAT
-
II. LES DÉPENSES PUBLIQUES CONTRE
L'ÉPARGNE ET L'INVESTISSEMENT ? UNE PRÉOCCUPATION QUI
N'APPARAÎT PAS FONDÉE, AU CONTRAIRE
-
A. PAS DE CORRÉLATION NÉGATIVE ENTRE
DÉPENSES PUBLIQUES, ÉPARGNE, INVESTISSEMENT ET CROISSANCE
-
B. POUR NE PAS NÉGLIGER LA CONTRIBUTION DES
DÉPENSES PUBLIQUES À L'INVESTISSEMENT
-
1. Les messages contradictoires des
théories économiques...
-
2. ... appellent un dépassement pour
examiner les impacts empiriques des dépenses publiques sur le taux
d'épargne
-
3. La contribution des dépenses des
administrations publiques à l'épargne et à
l'investissement est sous-estimée notamment par la Comptabilité
nationale
-
4. Inversement, la contribution de
l'épargne privée à l'investissement national ne doit pas
être surestimée.
-
1. Les messages contradictoires des
théories économiques...
-
A. PAS DE CORRÉLATION NÉGATIVE ENTRE
DÉPENSES PUBLIQUES, ÉPARGNE, INVESTISSEMENT ET CROISSANCE
-
III. LES DÉPENSES PUBLIQUES DE TRANSFERTS
SOCIAUX CONTRE LA CROISSANCE ? SORTIR DU SLOGAN POUR AMÉLIORER
L'EFFICACITÉ DES POLITIQUES SOCIALES
-
A. LA RÉDUCTION DES DÉPENSES DE
RÉPARTITION, QUELLE FAISABILITÉ ?
-
B. QUEL IMPACT D'UNE RÉDUCTION DES
TRANSFERTS SOCIAUX ?
-
1. Des performances macroéconomiques
indépendantes du niveau de la protection sociale publique ?
-
2. Des points de vue empiriques qui globalement ne
confirment pas l'effet désincitatif des dépenses sociales
-
3. Retraites et taux d'activité
-
4. Enrichir les assurances et prestations sociales
d'une dimension qualitative
-
1. Des performances macroéconomiques
indépendantes du niveau de la protection sociale publique ?
-
A. LA RÉDUCTION DES DÉPENSES DE
RÉPARTITION, QUELLE FAISABILITÉ ?
-
I. LA CONTRIBUTION DES DÉPENSES PUBLIQUES
À LA CROISSANCE : POUR UN VRAI DÉBAT
-
CHAPITRE III - LES DÉPENSES PUBLIQUES
CONTRE LE POUVOIR D'ACHAT ? UN ARGUMENT QUI REPOSE SUR DES CONVENTIONS
STATISTIQUES FRAGILES
-
I. DES DÉPENSES PUBLIQUES,
CRÉATRICES DE RESSOURCES POUR LES MÉNAGES, NE SONT PAS PRISES EN
COMPTE EN TOTALITÉ COMME TELLES
-
II. TENTATIVES DE RÉESTIMATION DU POUVOIR
D'ACHAT DES MÉNAGES À PARTIR D'UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES
CONTREPARTIES DES DÉPENSES PUBLIQUES
-
III. LA CONTREPARTIE PRODUCTIVE DES
DÉPENSES PUBLIQUES EST SOUS-ESTIMÉE
-
I. DES DÉPENSES PUBLIQUES,
CRÉATRICES DE RESSOURCES POUR LES MÉNAGES, NE SONT PAS PRISES EN
COMPTE EN TOTALITÉ COMME TELLES
-
CONCLUSION
-
TROISIÈME PARTIE - LES DÉPENSES
PUBLIQUES AU SERVICE DE LA RÉDUCTION DES
INÉGALITÉS ?
-
CHAPITRE I - LES DÉPENSES D'ASSURANCES
SOCIALES
-
I. LES TRANSFERTS SOCIAUX MONÉTAIRES, UNE
CONTRIBUTION À LA RÉDUCTION DES INÉGALITÉS
TRÈS CONTRASTÉE SELON LES PAYS
-
II. DES DÉPENSES DE RETRAITE FAIBLEMENT
REDISTRIBUTIVES
-
A. AU SEIN D'UNE GÉNÉRATION
DONNÉE, UNE LÉGÈRE REDISTRIBUTIVITÉ AU PROFIT DES
MÉNAGES LES MOINS RICHES ET DES FEMMES
-
B. UNE REDISTRIBUTIVITÉ
MITIGÉE
-
C. LA QUESTION DE LA REDISTRIBUTION
INTERGÉNÉRATIONNELLE NE DOIT PAS ÊTRE TRAITÉE DE
FAÇON SIMPLISTE
-
A. AU SEIN D'UNE GÉNÉRATION
DONNÉE, UNE LÉGÈRE REDISTRIBUTIVITÉ AU PROFIT DES
MÉNAGES LES MOINS RICHES ET DES FEMMES
-
III. DES DÉPENSES DE SANTÉ AUX
PROPRIÉTÉS REDISTRIBUTIVES JUSTICIABLES DE JUGEMENTS
CONTRADICTOIRES SELON LE POINT DE VUE
-
I. LES TRANSFERTS SOCIAUX MONÉTAIRES, UNE
CONTRIBUTION À LA RÉDUCTION DES INÉGALITÉS
TRÈS CONTRASTÉE SELON LES PAYS
-
CHAPITRE II - LES DÉPENSES
D'ÉDUCATION
-
I. OBSERVATIONS LIMINAIRES
-
II. LA DÉPENSE PUBLIQUE D'ÉDUCATION
AU SERVICE D'UNE ÉDUCATION DE MASSE : RESSORT D'UNE
REDISTRIBUTIVITÉ PLUS APPARENTE QUE RÉELLE
-
A. LA DÉPENSE PUBLIQUE D'ÉDUCATION
EST PLUTÔT CONCENTRÉE AU BÉNÉFICE DES FAMILLES LES
MOINS AISÉES
-
B. MAIS, AU TOTAL, LA REDISTRIBUTIVITÉ DES
DÉPENSES PUBLIQUES D'ÉDUCATION APPARAÎT PLUTÔT FAIBLE
-
A. LA DÉPENSE PUBLIQUE D'ÉDUCATION
EST PLUTÔT CONCENTRÉE AU BÉNÉFICE DES FAMILLES LES
MOINS AISÉES
-
I. OBSERVATIONS LIMINAIRES
-
CONCLUSION - PROGRESSER VERS UNE MEILLEURE
CONTRIBUTION DES DÉPENSES PUBLIQUES À L'ÉGALITÉ DES
CHANCES
-
CONCLUSION GÉNÉRALE
-
EXAMEN EN DÉLÉGATION
-
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES ET
CONSULTÉES
-
ANNEXES
-
ANNEXE N° 1 - UN POINT DE VUE LONG SUR LES
DÉPENSES PUBLIQUES : L'ÉVOLUTION DES DÉPENSES
PUBLIQUES ENTRE 1960 ET 1990
-
I. ENTRE 1960 ET 1990, DANS LES PAYS DE L'OCDE,
UNE PROGRESSION DU POIDS RELATIF AU PIB DE TOUTES LES CATÉGORIES DE
DÉPENSES PUBLIQUES, EXCEPTÉ L'INVESTISSEMENT
-
II. LA CONSOMMATION DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES,
UNE VARIATION ET DES CHOIX FORTEMENT DIFFÉRENCIÉS DANS LE TEMPS
ET SELON LES PAYS
-
III. LES TRANSFERTS SOCIAUX : PREMIÈRE
CAUSE DE L'AUGMENTATION RELATIVE DES DÉPENSES PUBLIQUES
-
IV. UN DYNAMISME NUANCÉ DES
DÉPENSES PUBLIQUES D'INTÉRÊTS ET DE SUBVENTIONS
-
V. LE RECUL RELATIF DE L'INVESTISSEMENT DES
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
-
I. ENTRE 1960 ET 1990, DANS LES PAYS DE L'OCDE,
UNE PROGRESSION DU POIDS RELATIF AU PIB DE TOUTES LES CATÉGORIES DE
DÉPENSES PUBLIQUES, EXCEPTÉ L'INVESTISSEMENT
-
ANNEXE N° 2 - AVERTISSEMENTS DE
MÉTHODE
-
ANNEXE N° 3 - LA CLASSIFICATION DES
DÉPENSES PUBLIQUES PAR LA COMPTABILITÉ NATIONALE
-
ANNEXE N° 4 - LES DÉPENSES DE
PROTECTION SOCIALE : PROBLÈMES DE MESURE
-
ANNEXE N° 5 - LE « COIN
FISCALO-SOCIAL »
-
ANNEXE N° 6 - REVENUS DES
MÉNAGES : ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION
-
ANNEXE N° 7 - LES DÉPENSES DE
RETRAITE AUX ÉTATS-UNIS
-
ANNEXE N° 8 - LE SYSTÈME DE
SANTÉ AUX ÉTATS-UNIS
N° 441
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007-2008
|
Annexe au procès-verbal de la séance du 2 juillet 2008 |
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la délégation du Sénat pour la Planification (1) sur les dépenses publiques ,
Par M. Bernard ANGELS,
Sénateur.
|
(1) Cette délégation est composée de : M. Joël Bourdin, président ; M. Pierre André, Mme Évelyne Didier, MM. Joseph Kergueris, Jean-Pierre Plancade, vice-présidents ; MM. Yvon Collin, Claude Saunier, secrétaires ; MM. Bernard Angels, Gérard Bailly, Yves Fréville, Yves Krattinger, Philippe Leroy, Jean-Luc Miraux, Daniel Soulage . |
RÉSUMÉ
- Le présent rapport sur les « dépenses publiques » est parti de l'ambition de clarifier des questions évoquées trop superficiellement et avec une certaine confusion dans le débat public.
Au terme de ce travail parlementaire qui emprunte un peu aux travaux de recherche, on peut espérer que certaines idées reçues seront dissipées et que des choix publics importants, dont les implications sont souvent laissées dans l'ombre, seront mieux éclairés . Par ailleurs, il faudra explorer les pistes de réflexion ouvertes par un rapport qui, bien que « copieux », ne se veut surtout pas « définitif » ; et rester attentifs à ce qu'enfin, le vaste champ de réflexions qu'offrent les dépenses publiques fasse toute sa place à l'évaluation, qui doit succéder à l'incantation .
- Les attitudes des Français face aux dépenses publiques portent la marque des imprécisions des approches actuelles du sujet. Quand on les interroge sur le niveau global des dépenses publiques, ils le trouvent souvent trop élevé. Mais quand on les interroge sur chaque catégorie de dépenses publiques, c'est l'opinion inverse qui l'emporte en général.
En outre, on ne peut se défendre de l'impression que ces opinions, contradictoires, reposent sur des motivations qui ne sont pas complètement informées.
- Au demeurant, comment le niveau des dépenses publiques, qui mobilisent une fraction importante des ressources économiques (autour de 47 % en zone euro et plus de 53 % en France) n'inviterait-il pas a priori à renoncer aux facilités des références unitaires et globalisantes quand on veut décrire avec pertinence une réalité qu'on devine complexe ?
- D'ailleurs, l'effort entrepris dans le cadre du rapport pour présenter simplement ce que sont les dépenses publiques et pour identifier les grandes questions qu'elles posent afin d'apporter des éléments de réponse, a dû surmonter, hormis d'importantes difficultés conceptuelles, de très nombreux obstacles statistiques.
C'est un premier constat : il n'y a généralement pas de statistiques disponibles « sur étagère » pour effectuer des études économiques de fond sur les dépenses publiques. En bref, nous manquons de la boîte à outils qu'il faudrait et ceci témoigne à soi seul de la fragilité des « opinions » qui s'expriment en ce domaine.
Un deuxième constat est que les controverses sur les dépenses publiques sont vives mais plutôt stériles. Elles se résument trop souvent à stigmatiser le niveau général des dépenses publiques sans avoir, en général, de prolongements concrets.
Il y a là un paradoxe qui vient probablement en partie de ce que les questions économiques et sociales posées par les dépenses publiques ne sont pas clairement formulées.
Dans ce domaine, « la réponse précède la question » ; l'un des objectifs du rapport a été d'inverser cette séquence .
- Celui-ci s'ordonne autour de trois parties qui correspondent à trois grandes questions que pose, en fait, l'analyse économique des dépenses publiques :
- Première question : le niveau des dépenses publiques est-il un élément déterminant dans l'utilisation des ressources économiques d'un pays ?
- Deuxième question : le niveau des dépenses publiques influence-t-il, en tant que tel, la croissance économique et le niveau de vie ?
- Troisième question : les dépenses publiques ont-elles des effets redistributifs ?
- Avant d'examiner une à une ces questions, il faut développer un peu un constat primordial . Si, juridiquement et comptablement, les dépenses publiques renvoient à une réalité qui est dotée d'une identité à peu près simple, d'un point de vue économique , les dépenses publiques recouvrent des objets si différenciés qu'il est factice et, finalement, trompeur de les ranger sous une catégorie unique.
Il n'y a pas « les dépenses publiques », il y a différentes sortes de dépenses publiques .
Pour ordonner cette diversité, plusieurs typologies sont envisageables. Le rapport s'articule autour de la distinction entre les dépenses publiques de production et celles de transferts , parmi lesquelles les dépenses de protection sociale ont une place essentielle. Ces deux catégories de dépenses publiques correspondent, même si quelques recoupements les unissent partiellement, à des fonctions différentes de l'État .
Les dépenses de production recouvrent les moyens nécessaires à la fourniture des biens et services publics par l' État-producteur : santé, éducation, sécurité, défense... Elles financent les moyens de la production non marchande.
Les dépenses de transferts regroupent des subventions, la charge des intérêts de la dette publique et, principalement, les dépenses d'assurances sociales pour lesquelles le plus souvent l'État est gestionnaire d'assurances .
Il faut insister sur cette partition des dépenses publiques parce qu'elle a de fortes implications . Dans une proportion, estimée selon les pays entre 60 et 80 % d'entre elles, les dépenses publiques sociales correspondent à un simple lissage dans le temps de la perception de revenus individuels (cf. les dépenses de retraite et de santé).
Ainsi, sur un volet de dépenses publiques compris en France entre 18 et 24 points de PIB (34 à 45 % des dépenses publiques), la responsabilité de l'État se limite pour l'essentiel, à organiser des assurances individuelles qui trouvent alors satisfaction dans un cadre qui, pour être collectif, n'est pas le seul envisageable et n'est pas essentiellement « étatique ».
Au demeurant, dans les pays où l'État est en retrait de la gestion des risques, celle-ci mobilise des ressources comparables même si elles empruntent des voies différentes (voir la première question abordée dans le présent rapport).
QUELQUES ORDRES DE GRANDEUR
Au seuil de cet examen, quelques ordres de grandeur doivent être rappelés :
- Première observation : la prédominance des dépenses de « transfert » dans les dépenses publiques .
Quand on raisonne au niveau des grands pays de l'Europe , on observe que la prédominance des dépenses de transferts dans le total des dépenses publiques est nette.
Dans la zone euro , environ 60 % des dépenses publiques sont consacrées à des transferts , et les seules dépenses d' assurances sociales mobilisent près de 46 % du total des dépenses publiques.
STRUCTURE DES DÉPENSES PUBLIQUES EN EUROPE 1 (EN % DU TOTAL)
|
1995 |
2005 |
Variations
|
|
|
Consommations intermédiaires |
9,1 |
10,6 |
+1,5 |
|
Traitements publics |
20,6 |
21,9 |
+1,3 |
|
Intérêts |
10,2 |
6,3 |
-3,9 |
|
Subventions |
3,1 |
2,6 |
-0,5 |
|
Allocations sociales 2 |
41,1 |
45,9 |
+4,8 |
|
Autres (fonctionnement) |
3,0 |
4,7 |
+1,7 |
|
Transferts en capital |
7,9 |
2,7 |
-5,2 |
|
Investissements |
5,0 |
5,3 |
+0,3 |
|
Total |
100 |
100 |
0 |
1
Europe des 12 : zone euro.
2
Hors Santé.
Source : Commission européenne. Rapport sur les finances publiques dans l'Union européenne. 2006.
- Quand on convertit ces données en points de PIB , on observe que les dépenses publiques en zone euro représentaient en 2005, 47,5 % du PIB en moyenne, avec d'un côté des transferts égaux à 27,3 % du PIB , dont des assurances sociales pour 21,8 % du PIB , et, de l'autre, les dépenses publiques correspondant à la production non marchande pour 20,2 % du PIB .
LES DÉPENSES PUBLIQUES EN EUROPE
1
EN
2005
(en points de PIB total)
|
Consommations intermédiaires |
5,1 |
|
Traitements publics |
10,4 |
|
Intérêts |
3,1 |
|
Subventions |
1,1 |
|
Allocations sociales 2 |
21,8 |
|
Autres (fonctionnement) |
2,2 |
|
Transferts en capital |
1,3 |
|
Investissements |
2,5 |
|
Total |
47,5 |
1 Europe des 12 : zone euro.
2 Hors Santé.
Moyennant quelques nuances, on peut retenir que les dépenses publiques de production et les dépenses publiques d'assurances sociales représentent en Europe des ordres de grandeur comparables (à peu près à un cinquième du PIB chacune) .
Au niveau des 30 plus grands pays de l'OCDE , un même constat s'impose moyennant un équilibre un peu différent . Les transferts sont aussi légèrement majoritaires, mais la moyenne des dépenses publiques sociales est moins élevée (14,8 points de PIB contre 21,8 points en zone euro pour l'OCDE à 30 pays), ce qui se traduit par un niveau des dépenses publiques dans le PIB moins élevé. De leur côté, les dépenses publiques correspondant à la production non marchande atteignent un niveau moyen comparable à la zone euro : 20 points de PIB .
Pour résumer, au niveau de l'OCDE, comme c'est le cas dans la zone euro, la majorité des dépenses publiques sont des dépenses de transferts, mais leur prédominance est moins accusée sous l'effet de dépenses publiques sociales qui sont inférieures au niveau atteint en zone euro. En revanche, les dépenses publiques correspondant à des biens et services publics sont presque identiques dans les deux zones, constat qui tranche singulièrement avec l'idée répandue parfois d'un handicap pour l'Europe du fait du poids excessif des « prélèvements bureaucratiques » .
- Deuxième observation : l'analyse des dépenses publiques de production non marchande montre d'abord qu'elles sont majoritairement consacrées à des fonctions non-régaliennes , avec notamment une forte proportion des dépenses pour la santé et l'enseignement, si bien que les suggestions visant à « recentrer l'État sur ses fonctions régaliennes » apparaissent un peu irréelles.
Par ailleurs, il faut relever que ces dépenses sont, en Europe, pour un peu plus de la moitié (autour de 10 % du PIB) des dépenses directes de salaires publics, l'autre moitié étant constituée de consommations intermédiaires (5 points de PIB), d'investissements (2,5 points de PIB) et de dépenses diverses. La structure moyenne de la fonction de production des administrations publiques ne révèle pas de singularités fortes par rapport aux services privés . On peut incidemment relever que la masse salariale publique a beaucoup moins augmenté au cours des vingt ans écoulés que la masse salariale du secteur des services financiers et n'est qu'un peu supérieure à celle-ci (9 % de la masse salariale privée).
*
Le rapport commence par une première question : le niveau des dépenses publiques est-il une variable qui détermine significativement l'utilisation globale des ressources économiques ?
Cette interrogation est partie de l'idée de donner un peu de substance aux inquiétudes formulées du fait du niveau (« trop » ou « trop peu ») des dépenses publiques. On peut imaginer que ces affirmations récurrentes renvoient aux incidences du niveau des dépenses publiques sur l'utilisation des richesses économiques (leur « affectation » dans le jargon économique). Il est donc important d'examiner cette question avant celle de l' incidence des dépenses publiques sur la production des richesses économiques qui est la deuxième question abordée dans le présent rapport. Enfin, l'examen d'une troisième question , celle de la redistributivité des dépenses publiques , clôt le rapport.
PREMIÈRE QUESTION : LES DÉPENSES PUBLIQUES INFLUENCENT-ELLES SIGNIFICATIVEMENT L'UTILISATION DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES ?
Vue sur la longue durée (plusieurs siècles), la réponse à cette question semble évidente puisque l'augmentation séculaire des dépenses publiques a correspondu à l'essor de biens et services publics (santé, éducation...) autrefois marginaux.
De même, des expériences-limites, comme celles des pays du bloc soviétique, montrent que la collectivisation des ressources économiques peut influencer leur utilisation.
Mais, c'est dans un autre cadre qu'on raisonne ici, en examinant, pour les pays de l'OCDE en ce début de XXIème siècle, la question de savoir si la place qu'ils réservent aux dépenses publiques a des incidences significatives sur l'usage qu'ils font de leurs ressources.
- Les niveaux de dépenses publiques dans les pays de l'OCDE sont très diversifiés quand on les appréhende à partir de leur poids dans le PIB .
DÉPENSES PUBLIQUES RAPPORTÉES AU PIB EN 2004
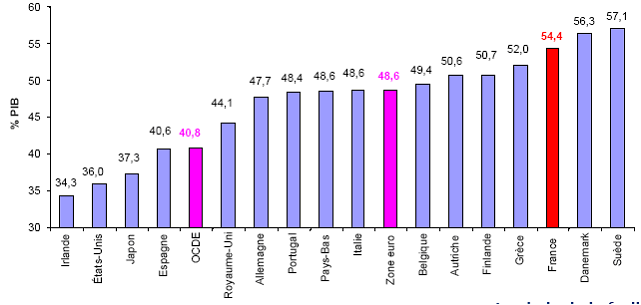
Source : OCDE
L' écart entre la France et les États-Unis atteint 18,4 points de PIB si bien que, pour que les États-Unis rattrapent le niveau des dépenses publiques en France, il leur faudrait augmenter leurs dépenses publiques de moitié.
L' écart-moyen entre quinze de principaux pays de l'OCDE, qui est un indice de dispersion permettant d'estimer si les situations nationales sont proches ou lointaines les unes des autres, s'élève à 7,9 points de PIB , soit environ 20 % du niveau moyen des dépenses publiques dans ces pays.
- La diversité des niveaux de dépenses publiques varie selon qu'on considère les dépenses sociales ou les dépenses de production. Elle est plus forte pour les premières que pour les secondes .
DÉPENSES PUBLIQUES RAPPORTÉES AU PIB EN 2004
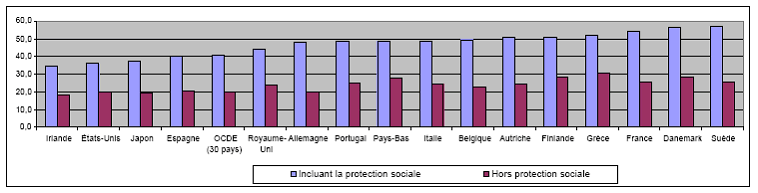
1. Y compris les services de santé
Source : OCDE
- Par exemple, pour 19 grands pays de l'OCDE , l'écart-type à la moyenne de dépenses publiques sociales (22,8 points de PIB), est de 4,7 points de PIB.
Pour les dépenses publiques de production, la dispersion est légèrement moins forte.
- Il est intéressant d'observer qu'au niveau de l'OCDE, pour les dépenses publiques sociales, les trois quarts de la dispersion entre pays s'expliquent par les dépenses de retraite qui représentent pourtant un peu moins que la moitié des dépenses publiques sociales.
Pour les deux grandes catégories de dépenses publiques (de protection sociale et de production), il est possible d'établir des classements par pays qui montrent, d'une part, l'existence de noyaux durs assez homogènes et, d'autre part, certaines singularités nationales fortes au regard de telle ou telle dépense.
On doit aussi souligner un constat qui oblige à renoncer à une idée reçue : les dépenses publiques correspondant aux activités de l'État - producteur de services publics - sont relativement plus importantes dans les principaux pays anglo-saxons que dans les pays européens .
LA PRODUCTION DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
(en points de PIB)
|
2001 |
2006 |
Évolution 2006/2001 |
|
|
Autriche |
15,2 |
15,0 |
- 0,2 |
|
Belgique |
16,7 |
17,1 |
+ 0,4 |
|
Canada |
22,2 |
22,4 |
+ 0,2 |
|
Danemark |
27,4 |
27,1 |
- 0,3 |
|
France |
20,9 |
21,1 |
+ 0,2 |
|
Irlande |
14,3 |
15,6 |
+ 1,3 |
|
Italie |
17,9 |
18,7 |
+ 0,8 |
|
Japon |
13,6 |
12,6 |
- 1,0 |
|
Pays-Bas |
18,9 |
19,1 |
+ 0,2 |
|
Portugal |
20,2 |
19,5 |
- 0,7 |
|
Espagne |
15,9 |
16,8 |
+ 0,9 |
|
Suède |
28,5 |
27,6 |
- 0,9 |
|
Royaume-Uni |
21,2 |
24,0 |
+ 2,8 |
|
États-Unis |
18,5 |
19,8 |
+ 1,3 |
|
Moyenne arithmétique simple |
19,0 |
19,3 |
+ 0,3 |
- S'agissant de la situation de la France , on observe que le niveau des dépenses publiques y est supérieur de 5,7 points de PIB par rapport à la moyenne de l'Europe des 25, soit 12,2 % de plus.
ÉCARTS ENTRE LE POIDS DES DÉPENSES
PUBLIQUES EN FRANCE ET EN EUROPE
1
PAR FONCTION
(2003)
|
En points de PIB |
En % par rapport
|
|
|
Protection sociale |
+ 2,9 |
+ 15,2 |
|
Services publics généraux |
+ 0,7 |
+ 10,4 |
|
Santé |
+ 0,8 |
+ 10,8 |
|
Enseignement |
+ 1,0 |
+ 25,5 |
|
Affaires économiques |
- 0,8 |
- 20,0 |
|
Défense |
+ 0,2 |
+ 11,8 |
|
Logement et équipements collectifs |
+ 0,8 |
+ 80,0 |
|
Loisirs, culture et culte |
+ 0,4 |
+ 40,0 |
|
Ordre et sécurité publics |
- 0,4 |
- 24,0 |
|
Protection de l'environnement |
+ 0,1 |
+ 14,3 |
|
Total |
5,7 |
+ 12,2 |
1 Europe à 25.
Ce sont les dépenses publiques de protection sociale (+ 2,9 points) qui expliquent la majeure partie du surplus de dépenses publiques que connaît la France .
Les autres fonctions contribuant significativement à cet écart sont : l'« Enseignement » ( + 1 point ), le « Logement et les Équipements collectifs » ( + 0,8 point ) et la « Santé » ( + 0,8 point ).
Quand on compare la France à quelques grands pays de développement économique comparable, on observe que la France , qui a une position singulière au regard de la protection sociale, se situe autour de la moyenne pour les dépenses publiques correspondant à la production non marchande .
APERÇUS DE QUELQUES ÉCARTS RELATIFS AUX
DÉPENSES PUBLIQUES REPRÉSENTATIVES DE LA PRODUCTION (HORS
SANTÉ) DE BIENS ET SERVICES
DANS DIFFÉRENTS PAYS EN 2004 (EN
POINTS DE PIB)
|
France |
Allemagne |
Italie |
Suède |
Royaume Uni |
États-Unis |
Moyenne |
Écarts France |
||
|
Moyenne des pays |
États-Unis |
||||||||
|
Dépenses publiques liées à la production non marchande |
23,7 |
18,6 |
23,9 |
24,5 |
20,5 |
22,7 |
22,3 |
+ 1,0 |
+ 1,4 |
|
Total dépenses publiques |
53,4 |
46,6 |
48,1 |
54,6 |
44,4 |
37,1 |
47,4 |
+ 6,0 |
+16,3 |
Pour ces dépenses, le niveau des « consommations publiques » , notion de comptabilité nationale qui regroupe les consommations intermédiaires (par exemple, l'électricité consommée) et les salaires publics n'est que très faiblement plus élevé en France que dans les autres pays développés .
ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS PUBLIQUES
DANS
LES PRINCIPAUX PAYS DE L'OCDE ENTRE 1995 ET 2006
(en % du PIB)
|
1995 |
2006 |
Variation
|
|||||
|
Consom-
|
Salaires |
Total |
Consom-
|
Salaires |
Total |
||
|
Autriche |
6,0 |
12,5 |
18,5 |
4,5 |
9,3 |
13,8 |
- 4,7 |
|
Belgique |
3,1 |
11,9 |
15,0 |
3,6 |
11,8 |
15,4 |
+ 0,4 |
|
Canada |
8,4 |
13,7 |
22,1 |
8,9 |
11,6 |
20,5 |
- 1,6 |
|
Danemark |
7,6 |
17,1 |
24,7 |
8,5 |
16,9 |
25,4 |
+ 0,7 |
|
Finlande |
8,8 |
15,1 |
23,9 |
9,2 |
13,4 |
22,6 |
- 1,3 |
|
France |
5,5 |
13,6 |
18,8 |
5,2 |
13,1 |
18,3 |
- 0,5 |
|
Allemagne |
4,1 |
8,8 |
12,9 |
4,2 |
7,2 |
11,4 |
- 1,5 |
|
Irlande |
5,6 |
10,1 |
15,7 |
5,0 |
9,7 |
14,7 |
- 1,0 |
|
Italie |
4,8 |
11,0 |
15,8 |
5,3 |
11,1 |
16,4 |
+ 0,6 |
|
Corée |
3,5 |
6,6 |
10,1 |
Nd |
Nd |
Nd |
Nd |
|
Luxembourg |
3,5 |
8,5 |
12,0 |
3,1 |
7,4 |
10,5 |
- 1,5 |
|
Pays-Bas |
6,6 |
10,6 |
17,2 |
7,2 |
9,4 |
16,6 |
- 0,6 |
|
Nouvelle-Zélande |
7,1 |
9,2 |
16,3 |
Nd |
Nd |
Nd |
Nd |
|
Norvège |
7,8 |
14,0 |
21,8 |
6,2 |
11,9 |
18,1 |
- 3,7 |
|
Portugal |
Nd |
Nd |
Nd |
4,1 |
13,6 |
17,7 |
Nd |
|
Espagne |
4,5 |
11,2 |
15,7 |
5,0 |
10,0 |
15,0 |
- 0,7 |
|
Suède |
10,8 |
16,4 |
27,2 |
9,5 |
15,3 |
24,8 |
- 2,4 |
|
Suisse |
3,7 |
8,4 |
12,1 |
Nd |
Nd |
Nd |
Nd |
|
Royaume-Uni |
9,2 |
10,7 |
19,9 |
11,7 |
11,4 |
23,1 |
+ 3,2 |
|
États-Unis |
7,2 |
10,4 |
17,6 |
8,4 |
10,1 |
18,5 |
+ 0,9 |
|
Moyenne arithmétique simple |
6,2 |
11,6 |
17,8 |
6,5 |
11,4 |
17,9 |
Nd |
Source : OCDE. Comptes nationaux. Comptes des administrations publiques.
De fait, si la France se caractérise par un niveau d'emplois publics relativement élevé , cette caractéristique ne trouve pas de prolongements à due proportion quand on observe les salaires publics .
Le poids de l'emploi public dans l'emploi total, qui a été constant entre 1993 et 2002, est supérieur en France de 5,3 points à ce qu'il est dans des pays comparables.
CLASSEMENT DES PRINCIPAUX PAYS DE L'OCDE
SELON LE
POIDS DE L'EMPLOI PUBLIC
(en % de l'emploi total)
|
Classement en 2002 |
Pays |
% Emploi public
|
Classement
|
Classement
|
Tendance
|
|
1 |
Suède |
30,0 |
1 |
1 |
diminution |
|
2 |
Danemark |
29,0 |
2 |
2 |
augmentation |
|
3 |
Finlande |
22,4 |
3 |
4 |
constant |
|
4 |
France |
21,2 |
4 |
5 |
constant |
|
5 |
Royaume-Uni |
17,8 |
5 |
3 |
diminution |
|
6 |
Portugal |
17,0 |
7 |
14 |
augmentation |
|
7 |
Belgique |
16,8 |
6 |
6 |
constant |
|
8 |
Luxembourg |
14,9 |
10 |
10 |
constant |
|
9 |
République Tchèque |
14,8 |
Nd |
Nd |
diminution |
|
10 |
États-Unis |
14,7 |
9 |
8 |
constant |
|
11 |
Italie |
14,4 |
8 |
7 |
diminution |
|
12 |
Espagne |
13,0 |
13 |
15 |
augmentation |
|
13 |
Autriche |
12,2 |
11 |
13 |
diminution |
|
14 |
Pologne |
12,1 |
Nd |
Nd |
diminution |
|
15 |
Grèce |
11,4 |
16 |
16 |
constant |
|
16 |
Irlande |
11,0 |
14 |
11 |
diminution |
|
17 |
Pays-Bas |
10,7 |
15 |
12 |
diminution |
|
18 |
Allemagne |
10,2 |
12 |
9 |
diminution |
|
19 |
Japon |
8,1 |
17 |
17 |
constant |
|
Moyenne (arithmétique simple) |
15,9 |
NS |
NS |
NS |
|
Source : OCDE (2003)
La France semble avoir une productivité par tête relativement faible dans le domaine de la production non marchande : égale à celle du Royaume-Uni mais inférieure à celle de l'Allemagne par exemple.
RAPPROCHEMENT DE LA PRODUCTION DES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES
ET DE L'EMPLOI PUBLIC
|
Production non marchande
1
A |
Emploi public
2
B |
Écarts
|
|
|
Suède |
32,9 |
30,0 |
- 2,9 |
|
Danemark |
30,4 |
29,0 |
- 1,4 |
|
France |
30,9 |
21,2 |
- 9,7 |
|
Royaume-Uni |
27,6 |
17,8 |
- 9,8 |
|
Belgique |
31,3 |
16,8 |
- 14,5 |
|
États-Unis |
29,9 |
14,7 |
- 15,2 |
|
Italie |
29,7 |
14,4 |
- 15,3 |
|
Espagne |
25,7 |
13,0 |
- 12,7 |
|
Autriche |
29,4 |
12,2 |
- 17,2 |
|
Allemagne |
24,7 |
10,2 |
- 14,5 |
|
Japon |
26,7 |
8,1 |
- 18,6 |
1 En 2004.
2 En 2002.
Note de lecture : dans la première colonne, on recense le niveau de la production non marchande des administrations publiques approchée par les dépenses publiques hors dépenses de protection sociale ; dans la deuxième, on indique le poids relatif de l'emploi public dans l'emploi total ; la troisième colonne relève les différences par pays entre le deuxième et le premier chiffre. Il s'agit plus d'indicateurs que de mesures précises, mais ils donnent un aperçu du contenu en emplois de la production non marchande publique. Plus il est faible (plus le nombre est élevé), moins le contenu en emplois de la production non marchande est fort.
On peut attribuer une partie importante de cette situation au développement relatif de la production non marchande : pour les pays considérés, on remarque que plus celle-ci occupe une place importante moins la productivité relative du secteur public est forte. Il est vraisemblable qu'on puisse faire un constat symétriquement inverse pour le secteur privé : quand celui-ci assume des fonctions ailleurs à la charge du secteur public, fonctions qui correspondent à des activités où la productivité du travail est structurellement faible, la productivité du secteur privé doit en être affectée.
Mais, surtout, on doit relever que les écarts concernant les salaires publics sont nettement moins importants que ceux relatifs à l'emploi public .
SITUATION DES PRINCIPAUX PAYS DE L'OCDE
AU REGARD
DES SALAIRES PUBLICS EN 2006
(en points de PIB)
|
Écart à la moyenne |
|
|
Autriche |
- 2,1 |
|
Belgique |
+ 0,4 |
|
Canada |
+ 0,2 |
|
Danemark |
+ 5,5 |
|
Finlande |
+ 2,0 |
|
France |
+ 1,7 |
|
Allemagne |
- 4,2 |
|
Irlande |
- 1,7 |
|
Italie |
- 0,3 |
|
Luxembourg |
- 4,0 |
|
Pays-Bas |
- 2,0 |
|
Norvège |
+ 0,5 |
|
Portugal |
+ 2,2 |
|
Espagne |
- 1,4 |
|
Suède |
+ 3,9 |
|
Royaume-Uni |
0 |
|
États-Unis |
- 1,3 |
|
Écart moyen à la moyenne |
1,95 |
Le poids des salaires publics n'est, en France, supérieur que de 1,7 points de PIB par rapport à la moyenne de 17 grands pays de l'OCDE.
La rémunération par tête est donc inférieure à la moyenne observée dans les pays développés.
- Si les pays diffèrent beaucoup au regard du niveau des dépenses publiques dans le PIB, les différences dans l'utilisation globale des ressources économiques sont nettement moins marquées .
Quand on ajoute les dépenses privées aux dépenses publiques recensées au titre des fonctions dans lesquelles celles-ci interviennent, les ressources économiques consacrées à chacune d'elles, de très disparates deviennent nettement plus homogènes.
|
MÉTHODE Les dépenses publiques sont réparties entre 10 fonctions répertoriées par la nomenclature internationale « classement des fonctions des administrations publiques (CFAP ou, en anglais, COFOG). Pour mesurer le total des ressources économiques consacrées à ces fonctions, on ajoute, quand les données disponibles le permettent, les dépenses privées aux dépenses publiques. |
Ce constat est renforcé, quand on ajoute en plus des dépenses privées, les dépenses fiscales (celles dont la compilation est disponible) et les effets de la fiscalité sur les revenus résultant du versement des dépenses publiques.
Dans le champ des dépenses sociales et pour quelques grands pays de l'OCDE, l'écart moyen à la moyenne passe de 4,8 (pour les seules dépenses publiques) à 3,8 points de PIB (pour la totalité des dépenses). Des pays situés très au-dessous de la moyenne sous l'angle des dépenses publiques à caractère social - les États-Unis (- 6,2 points de PIB), le Royaume-Uni (- 1,8 point de PIB) - se trouvent consacrer à la protection sociale des dépenses totales supérieures à la moyenne : États-Unis (+ 4,8 points de PIB), Royaume-Uni (+ 2,5 points de PIB).
Les dépenses de retraite jouent un rôle important dans ce processus d'homogénéisation puisque, souvent, quand les dépenses publiques de retraite sont relativement faibles, les dépenses privées sont, au contraire, relativement élevées.
POSITION DES PAYS SELON LE NIVEAU DES DÉPENSES
PUBLIQUES ET PRIVÉES
DE RETRAITE
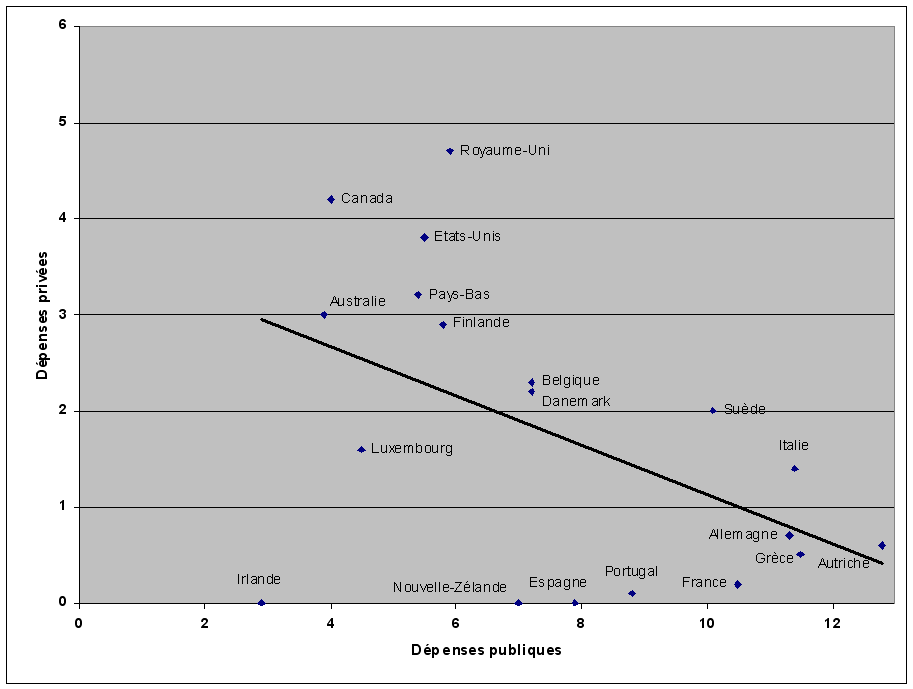
Il faut ajouter que les données utilisées pour apprécier le niveau d'homogénéité des dépenses sociales ne sont pas exhaustives, ce qui accentue sans doute les écarts apparents. En effet, ne sont prises en compte ni les dépenses familiales, ni une partie des dépenses fiscales, ni les prélèvements opérés à partir des patrimoines privés, toutes données qui semblent d'autant plus importantes que les couvertures publiques des risques sociaux sont moins développées.
Des observations analogues peuvent être faites dans le domaine de l'éducation .
DÉPENSES D'ÉDUCATION AU TITRE DES
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT EN 1999
(en % du
PIB)
|
Dépenses Publiques |
Dépenses Privées |
Dépenses totales |
|
|
Japon |
3,5 |
1,2 |
4,7 |
|
Grèce |
3,6 |
0,3 |
3,9 |
|
Turquie |
3,9 |
0 |
3,9 |
|
Corée |
4,1 |
2,7 |
6,8 |
|
Pays-Bas |
4,2 |
0,5 |
4,7 |
|
Irlande |
4,2 |
0,4 |
4,6 |
|
Slovaquie |
4,3 |
0,1 |
4,4 |
|
Allemagne |
4,3 |
1,2 |
5,5 |
|
Italie |
4,3 |
0,5 |
4,8 |
|
Royaume-Uni |
4,3 |
0,9 |
5,2 |
|
États-Unis |
4,9 |
1,6 |
6,5 |
|
Suisse |
5,4 |
0,5 |
5,9 |
|
Finlande |
5,7 |
0 |
5,7 |
|
France |
5,8 |
0,5 |
6,3 |
|
Autriche |
6,0 |
0,4 |
6,4 |
|
Danemark |
6,4 |
0,3 |
6,7 |
|
Suède |
6,5 |
0,2 |
6,7 |
|
Norvège |
6,5 |
0,1 |
6,6 |
Source : OCDE, DPD. Ministère de l'Éducation.
Globalement, la prise en compte des dépenses privées d'éducation égalise les situations.
*
* *
Au total, la dispersion des dépenses privées dans le domaine de la protection sociale et dans celui de l'éducation - inverse de celle des dépenses publiques - conduit à réduire significativement les effets de la dispersion des niveaux d'intervention publique sur l'utilisation globale des ressources économiques .
Il existe, en effet, un phénomène de vases communicants dont les États-Unis offrent un exemple particulièrement illustratif . On y consacre 6 points de PIB de moins qu'en moyenne aux dépenses publiques de protection sociale et d'éducation mais 7,5 points de PIB de plus aux dépenses privées. Au niveau de l'OCDE , la dispersion des dépenses publiques consacrées à ces fonctions est divisée par deux quand on considère les différents redressements explicités plus haut. Les pays consacrent finalement, à 8 % près (2,7 points de PIB), les mêmes ressources à ces fonctions. Cette marge de variation qui serait encore plus faible si un recensement plus exhaustif des moyens était disponible et qui doit être appréciée en tenant compte des écarts de situations économiques, notamment conjoncturels, ou de données physiques différenciées (les incidences de la démographie, par exemple), montre que le niveau des dépenses publiques n'est pas un déterminant majeur de l'utilisation du revenu national .
Le niveau relatif de développement économique est la variable qui apparaît essentielle .
PROTECTION SOCIALE ET PIB PAR TÊTE EN
PARITÉS DE POUVOIR D'ACHAT (PPA)
EN 2003
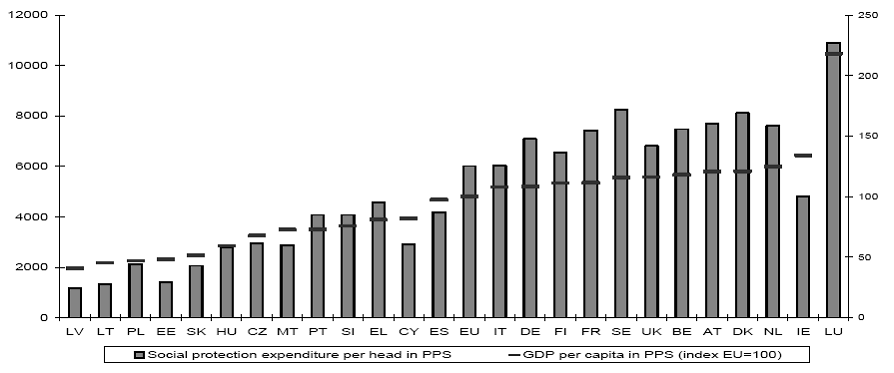
Protection sociale par tête en PPA PIB par tête en PPA
Source : EUROSTAT, SESPROS
Ces constats, souvent négligés au profit d'une dramatisation des enjeux associés au niveau des dépenses publiques, confirment l'existence d'une certaine homogénéité des aspirations des agents économiques et le rôle discriminant pour leur réalisation joué par la contrainte financière (ici le niveau de richesse d'un pays).
Ils ne doivent pas être mal interprétés :
- si, malgré des niveaux très différents de dépenses publiques, l'utilisation globale du revenu est plutôt homogène, le degré de l'intervention publique a des incidences sur les inégalités (cf. troisième partie du présent rapport) et les écarts subsistant entre pays quant à l'utilisation des ressources économiques sont, en partie, le résultat du rationnement que subissent certains agents du fait de la plus grande sélectivité des assurances et services publics dans certains pays ;
- l'équivalence globale des niveaux des ressources économiques allouées aux fonctions dans lesquelles se manifeste l'intervention publique ne dispense pas d'un examen et d'une évaluation systématiques de l'impact de chaque dépense publique notamment lorsque des situations singulières - dont certaines sont identifiées dans le rapport - sont constatées.
DEUXIÈME QUESTION : EXISTE-T-IL DES LIENS NÉGATIFS ENTRE DÉPENSES PUBLIQUES, CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET BIEN-ÊTRE ?
Cette question est envisagée, d'une part, dans une perspective de court terme et, d'autre part, d'un point de vue structurel .
- A court terme , la question est de savoir si une baisse des dépenses publiques exerce des effets favorables sur le rythme de croissance économique. Plusieurs arguments théoriques sont avancés en ce sens, mais les études statistiques n'en confirment généralement pas la validité empirique .
Sans doute peut-on relever l'existence de situations où une baisse importante et structurelle des dépenses publiques n'a pas provoqué de chute immédiate de l'activité économique mais, hormis que ces cas sont peu nombreux, l'absence d'effets négatifs sur la croissance a la plupart du temps tenu à des facteurs particuliers d'environnement (baisse des taux d'intérêt, commerce extérieur, ...).
Enfin, dans tous les pays où des réductions des dépenses publiques très fortes sont intervenues, les inégalités ont aussi fortement augmenté.
- Dans une perspective structurelle , l'idée que les dépenses publiques exerceraient des effets négatifs sur la croissance économique et le bien-être passe par deux arguments théoriques principaux et l'utilisation d'une série d'indicateurs couramment employés pour rendre compte des dépenses publiques (dans leur nature ou leur apport économique) ou pour mesurer le pouvoir d'achat.
Les arguments théoriques sont :
- l' impact a priori défavorable des dépenses publiques sur l'épargne, donc sur l'investissement et in fine sur la croissance économique ;
- leurs effets de distorsion , notamment du fait des incidences désincitatives liées à leurs propriétés redistributives.
Les indicateurs sont relatifs à l'appréciation :
- de l' investissement et des administrations publiques (la formation brute de capital fixe - FBCF - des administrations publiques, ou les crédits d'investissements) ;
- du pouvoir d'achat des ménages (le revenu disponible brut ; le « coin fiscalo-social ») ;
- des richesses créées (le produit intérieur brut - PIB).
I. LES ARGUMENTS THÉORIQUES SELON LESQUELS LES DÉPENSES PUBLIQUES RÉDUIRAIENT STRUCTURELLEMENT LE RYTHME DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE SONT INVÉRIFIABLES CONCRÈTEMENT
- L'argument de l'impact défavorable des dépenses publiques sur l'épargne et l'investissement peut être réfuté à partir de considérations, les unes empiriques, les autres théoriques.
La relation négative entre dépenses publiques et niveau de l'épargne n'est pas confirmée par les données empiriques.
|
DÉPENSES PUBLIQUES ET ÉPARGNE
|
|||
|
Dépenses publiques
|
Épargne nette
|
Épargne nationale
|
|
|
Corée |
28,1 |
4,7 |
34,8 |
|
Irlande |
33,7 |
Nd |
23,7 |
|
Australie |
35,1 |
-3,2 |
19,8 |
|
États-Unis |
36,4 |
1,8 |
13,0 |
|
Suisse |
36,6 |
9,3 |
32,9** |
|
Japon |
37,3 |
3,1 |
26,4** |
|
Espagne |
38,8 |
11,1* |
22,4 |
|
Nouvelle-Zélande |
39,2 |
Nd |
16,9 |
|
Canada |
39,9 |
1,4 |
23,1 |
|
Royaume-Uni |
44,0 |
4,3 |
14,8 |
|
Norvège |
45,9 |
9,6 |
33,5 |
|
Portugal |
46,4 |
10,1* |
15,1 |
|
Pays-Bas |
46,6 |
8,4 |
25,7 |
|
Allemagne |
47,0 |
10,5 |
20,9 |
|
Italie |
47,8 |
10,1 |
20,3 |
|
Grèce |
49,2 |
Nd |
15,7 |
|
Belgique |
49,6 |
11,0* |
23,5 |
|
Autriche |
50,1 |
9,0 |
19,8 |
|
Finlande |
51,2 |
2,7 |
24,3 |
|
France |
53,7 |
11,8 |
19,1 |
|
Danemark |
54,8 |
3,0* |
22,5 |
|
Suède |
56,7 |
8,5 |
22,8 |
* Épargne brute
** en 2003
En 2004, les États-Unis sont le pays où le taux d'épargne nationale est le plus faible (13 points de PIB, soit 6,1 Point de moins qu'en France) alors qu'ils appartiennent au groupe des pays où les dépenses publiques sont parmi les moins développées. La Suède où le ratio dépenses publiques/PIB excède de 21,6 points le même ratio en Australie, dispose d'une épargne nationale supérieure de 3 points.
Au demeurant, les liens entre le taux d'épargne d'un pays et son investissement ou le rythme de sa croissance économique sont loin d'être invariants.
|
TAUX D'ÉPARGNE, DÉPENSES PUBLIQUES ET CROISSANCE |
|||||
|
Dépenses publiques
|
Taux d'épargne net des ménages
|
Taux d'épargne 1995 - 2005 |
Croissance sur 10 ans
|
||
|
États-Unis |
34,8 |
- 0,4 |
15,5 |
3,3 |
|
|
Espagne |
38,2 |
2,2 |
22,4 |
3,7 |
|
|
Japon |
39,5 |
2,9 |
28,0 |
1,6 |
|
|
Royaume-Uni |
44,0 |
- 0,2 |
15,7 |
2,8 |
|
|
Pays-Bas |
45,4 |
6,5 |
26,7 |
2,6 |
|
|
Allemagne |
46,8 |
10,6 |
20,3 |
1,3 |
|
|
Italie |
48,1 |
10,6 |
21,0 |
1,3 |
|
|
France |
53,5 |
11,8 |
20,0 |
1,9 |
|
|
Danemark |
52,5 |
- 4,1 |
23,9 |
2,1 |
|
|
Suède |
56,0 |
7,9 |
21,8 |
2,7 |
|
Source : OFCE
Entre 1995 et 2005, les États-Unis et le Royaume-Uni ont connu une forte croissance malgré un très bas taux d'épargne. Au Japon, le fort taux d'épargne n'a pas empêché une croissance économique languissante.
L'épargne nationale n'est pas toujours un déterminant de la croissance. Par exemple, la croissance du Royaume-Uni est économe en capital, celle des États-Unis est favorisée par un financement extérieur abondant.
Sous un angle plus théorique , les approches de la croissance économique conduisent de plus en plus à lier le rythme de la productivité globale des facteurs (PGF), variable déterminante pour le rythme de la croissance, à plusieurs catégories de grandeurs économiques, qui ont pour particularité essentielle de relever le plus souvent de financements publics (la recherche, l'éducation, la santé...), donc d'être relativement « intenses » en dépenses publiques.
Les dépenses publiques intervenant dans ces domaines sont considérées, dans la théorie de la croissance endogène , comme contribuant à l'augmentation du capital humain, qui est un facteur de production.
Sans doute, faut-il reconnaître que les études empiriques conduites pour vérifier cette théorie donnent des résultats contradictoires. Mais, les performances de croissance économique réalisées par des pays où le niveau des dépenses publiques correspondant à la production non marchande sont supérieures à la moyenne (les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suède, le Danemark, le Canada) tendant à donner un certain poids à cette approche.
Au demeurant, elle inspire directement la fameuse « Stratégie de Lisbonne ».
Cela n'exempte pas de chercher à optimiser l'efficacité des dépenses publiques, mais cela invite à se départir de l'idée que les dépenses publiques sont, en elles-mêmes, contreproductives.
Le deuxième canal théorique de transmission négative des dépenses publiques sur la croissance viendrait de leurs propriétés désincitatives propres (c'est-à-dire sans considération de celles des impôts qui les financent). Sont particulièrement visées les dépenses sociales.
Cette approche n'est pas confirmée dans sa généralité.
Il faut d'abord rappeler ici que le niveau des dépenses publiques sociales ne détermine pas celui des dépenses sociales totales si bien qu'à supposer que les premières soient désincitatives, leur réduction pourrait être sans efficacité.
Par ailleurs, les indicateurs pertinents ne viennent pas étayer cette relation négative . Par exemple, le graphique ci-dessous qui croise, d'un côté, le niveau de la protection sociale publique et, de l'autre, l'écart entre la croissance observée et la croissance prévisible ne confirme pas l'existence d'une relation univoque entre ces grandeurs.
PERFORMANCE ÉCONOMIQUE 1 ET DÉPENSES PUBLIQUES DE PROTECTION SOCIALE
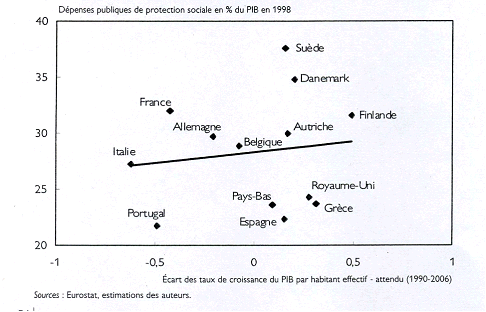
1 Écart entre le taux de croissance observé et le taux de croissance potentiel
Source : Revue de l'OFCE n° 104. Février 2008.
De même, les taux d'activité - qui mesurent la participation au marché du travail - ne sont pas corrélés avec le niveau des dépenses publiques sociales.
Ces constats ne doivent pas empêcher (au contraire) d'évaluer, sous un angle microéconomique, la portée de chaque mesure permettant de disposer de revenus en dehors de toute contribution à l'activité économique, ce qui implique des considérations plus riches que celles relatives à une seule composante incitative.
Il est, par exemple, sans doute important de mieux « activer » les dépenses relatives à la politique du marché du travail et de veiller à ce que les systèmes de pension ne découragent pas la poursuite de l'activité.
Mais, au total, rien ne vient étayer le constat que le niveau des dépenses publiques sociales réduirait en soi les opportunités de croissance.
On peut même renverser cette opinion :
- plusieurs dépenses sociales , en plus de réduire les risques de pauvreté, contribuent à entretenir le capital humain... (les dépenses de santé, les dépenses contribuant à lutter contre l'exclusion sociale qui implique aussi exclusion du marché du travail...),
- ... ou à le libérer (les dépenses de garde des enfants) ;
- la corrélation entre le niveau global des dépenses sociales (publiques et privées) et niveau de richesse est positive.
Enfin, dans une économie de plus en plus soumise à des chocs, le niveau des dépenses publiques sociales peut être déterminant pour les absorber dans des conditions sociales mais aussi économiques favorables (par exemple, la « flexisécurité » se traduit par un niveau comparativement élevé de dépenses publiques dans le domaine de la politique du marché du travail mais réduit les coûts d'ajustement économique).
II. LA CONTRIBUTION DES DÉPENSES PUBLIQUES À LA RICHESSE ÉCONOMIQUE EST SYSTÉMATIQUEMENT SOUS-ESTIMÉE
Quant à la question de l'impact défavorable des dépenses publiques sur le bien-être , cette relation négative repose, outre sur l'affirmation très contestable on l'a vu, que les dépenses publiques freinent, en elles-mêmes, la croissance, sur des indicateurs , qui donnent une idée fausse de la réalité en négligeant la contribution des biens et services collectifs au bien-être.
Tel est d'abord le cas de deux indicateurs d'usage courant pour mesurer le pouvoir d'achat des ménages : le revenu disponible brut des ménages d'un côté, le coin fiscalo-social de l'autre.
Dans les deux cas, le problème est le même : le revenu des ménages est amputé des prélèvements qu'ils subissent pour financer des services collectifs dont la contrepartie n'est pas reprise exhaustivement dans les ressources qui servent à mesurer leur richesse. Cette convention statistique conduit notamment à biaiser complètement les comparaisons de pouvoir d'achat entre des pays où les services publics sont inégalement développés au détriment de ceux où ils le sont plus particulièrement.
Mais, les problèmes de mesure de la contribution des dépenses publiques au bien-être s'étendent au-delà, jusqu'à la mesure du produit intérieur brut (le PIB).
La production non marchande est estimée à son coût de production et non en fonction des services réellement rendus.
Les méthodes d'appréciation plus qualitatives du volume de la valeur ajoutée correspondant à la partie non marchande de la production en sont à leur début et devraient recevoir un élan après l'heureuse initiative de M. le Président de la République d'enrichir la gamme des indicateurs de bien-être.
Enfin, il conviendrait de requalifier un grand nombre de dépenses publiques , qui sont considérées sur la base de principes comptables comme des dépenses correspondant à des consommations publiques, alors que, sur le plan économique , elles sont des dépenses d'investissement .
Tel est le cas en particulier des dépenses d'éducation, de santé, de recherche, ou pour l'environnement...
TROISIÈME QUESTION : QUE PEUT-ON DIRE DE LA REDISTRIBUTIVITÉ DES DÉPENSES PUBLIQUES ?
- La redistributivité de l'intervention publique est une question fondamentale , mais particulièrement ardue .
Fondamentale - d'ailleurs la redistributivité est une des trois grandes justifications de l'intervention publique (Richard Musgrave, 1959) avec l'orientation de l'utilisation des ressources économiques et la contribution à la croissance - puisque la redistributivité vise à produire un bien public en tant que tel, soit un bien que le marché ne produit pas spontanément et qui est susceptible d'améliorer le bien-être. Il ne s'agit pas seulement de répondre à un souci « compassionnel » mais de créer une situation économiquement gagnante.
Particulièrement ardue en ce sens que :
- la mesure des inégalités ne peut être univoque : elle dépend du point de vue adopté ;
- l'appréciation sur la portée redistributive de l'intervention publique, pose un problème symétrique : elle varie selon l'angle de vue choisi .
- Pourtant, la redistributivité des dépenses publiques est trop rarement étudiée , les débats sur la redistributivité se concentrant sur le système fiscal. Cette situation vient sans doute des difficultés techniques de mesure de la redistributivité des dépenses publiques, notamment de ce qu'une partie d'entre elles ne sont pas individualisables. Pourtant, aucun diagnostic solide sur la redistributivité de l'intervention publique ne peut être posé si on ne tient pas compte des propriétés redistributives de chacune de ses composantes . Des prélèvements fiscaux fortement redistributifs peuvent s'accompagner de l'absence de toute redistributivité collective si les dépenses qu'ils financent sont antiredistributives.
- Le premier constat du rapport est qu'il existe une forte corrélation positive entre le niveau des dépenses publiques et la réduction des inégalités monétaires .
Le graphique ci-dessous qui croise le niveau des prestations sociales publiques (hors pensions) et le taux de pauvreté (qui est l'expression la plus critique des inégalités) le montre avec éloquence.
TAUX DE PAUVRETÉ DES PERSONNES EN ÂGE DE
TRAVAILLER
ET DÉPENSES PUBLIQUES SOCIALES - 2000
(en points de PIB)
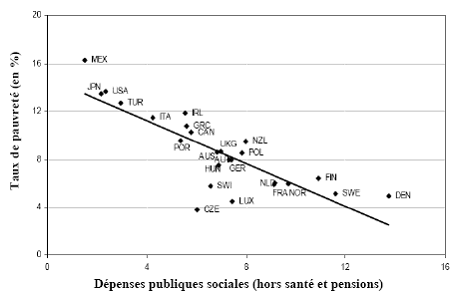
Note : Les dépenses publiques sociales ici prises en compte sont les dépenses publiques sociales hors santé et pensions. La pauvreté est définie relativement au seuil de la moitié du revenu disponible médian des ménages corrigé de leur composition.
Source : OCDE
On peut étendre ce constat du lien entre l'effet redistributif des dépenses publiques et leur niveau aux dépenses de retraite (voir le graphique ci-dessous), aux dépenses de santé et aux dépenses d'éducation .
TAUX DE PAUVRETÉ RELATIVE ET DÉPENSES DE
RETRAITE
DES RÉGIMES OBLIGATOIRES
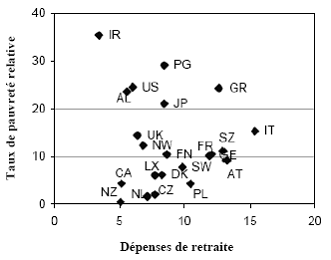
Source : OCDE
- Ce premier constat invite à une deuxième constatation : la redistributivité monétaire des dépenses publiques paraît étroitement corrélée avec leur universalité tandis que, paradoxalement, les pays dans lesquels les dépenses publiques sont très ciblées sur les populations en difficulté corrigent peu les inégalités .
Le ciblage des dépenses publiques s'accompagne souvent de prestations quantitativement modestes tandis que, dans les pays où les dépenses publiques résultent de systèmes de prestations ou de services publics plus universels, tout en étant moins concentrées sur les plus pauvres, elles exercent, de fait, un effet redistributif plus important.
Il est vraisemblable que cette constatation quantitative se prolonge sous un angle plus qualitatif , du moins dans une certaine mesure.
Ainsi, les interventions collectives ciblées sur les plus pauvres s'accompagneraient systématiquement de bénéfices quantitativement et qualitativement moins favorables que ceux des systèmes plus universalistes.
C'est probablement la différence la plus fondamentale qu'induit la diversité des niveaux de dépenses publiques entre pays développés.
- Troisième constat : en France, la redistributivité monétaire des dépenses publiques varie selon la catégorie envisagée .
Les prestations sociales en espèces hors pensions exercent une redistribution au profit des 20 % les plus pauvres comme le montre le tableau ci-dessous qui indique leur répartition en fonction du niveau de revenus.
DISTRIBUTION DES PRESTATIONS SOCIALES PAR QUINTILE (EN % DU TOTAL)
|
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
Q5 |
|
|
Prestations familiales
|
46,6 % |
24,0 % |
16,0 % |
11,1 % |
2,2 % |
|
Prestations familiales
|
31,2 % |
19,0 % |
17,5 % |
16,8 % |
15,5 % |
|
Total des prestations familiales |
35,5 % |
20,4 % |
17,1 % |
15,2 % |
11,8 % |
|
Allocations logement |
78,5 % |
17,1 % |
3,3 % |
0,8 % |
0,2 % |
|
Minima sociaux |
80,7 % |
11,8 % |
3,9 % |
2,2 % |
1,3 % |
|
Total allocations logement
|
79,6 % |
14,6 % |
3,6 % |
1,5 % |
0,7 % |
Lecture : en 2006, les personnes qui font partie du 1er quintile de niveau de vie ont bénéficié de 46,6 % du montant total des prestations familiales sous conditions de ressources.
Les dépenses publiques de retraite sont également redistributives, mais cette propriété est limitée aux trois premiers déciles de revenu ainsi que le révèle le tableau ci-dessous qui récapitule le rendement des cotisations sociales (rapport des prestations sur les cotisations) par fractions de revenu.
TAUX DE RENDEMENT INTERNE MÉDIANS PAR DÉCILE DE SALAIRE MOYEN PAR ANNÉE TRAVAILLÉE (EN %)
|
1e |
2e |
3e |
4e |
5e |
6e |
7e |
8e |
9e |
10e |
Ensemble |
|
|
Hommes |
2,9 |
2,8 |
2,8 |
2,9 |
2,8 |
2,6 |
3,0 |
2,7 |
2,6 |
2,7 |
2,8 |
|
Femmes |
6,5 |
5,2 |
4,8 |
4,0 |
3,8 |
3,7 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
4,0 |
|
Ensemble |
5,9 |
4,1 |
3,7 |
3,2 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
2,9 |
2,8 |
3,3 |
Lecture : déciles propres à chaque
groupe (ensemble, hommes, femmes).
Champ : individus mariés,
nés entre 1948 et 1960 et salariés du secteur privé.
Source : modèle de microsimulation Destinie, de
l'INSEE.
Les taux de rendement sont plus élevés pour les premiers déciles et surtout pour les femmes.
Les dépenses publiques de santé sont également redistributives quelle que soit la méthode utilisée pour tester leur redistributivité. Le gain de niveau de vie qu'elle procure est plus élevé en valeur absolue pour les 20 % de ménages les plus pauvres.
GAIN DE NIVEAU DE VIE INDUIT PAR LES DÉPENSES DE
SANTÉ,
SELON LE NIVEAU DE VIE
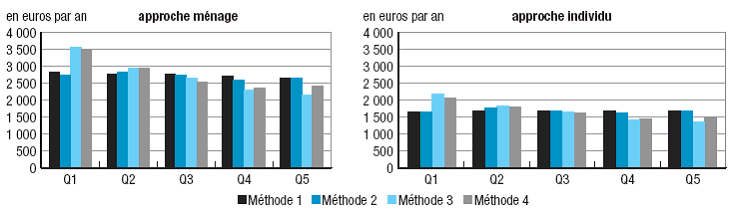
Lecture
: un ménage faisant partie des
20 % des ménages les plus modestes en termes de niveau de vie
(1
er
quintile : Q1) a un gain de niveau de vie de
2.800 euros.
Note
: les quintiles de niveau de vie sont
calculés sur la base des revenus avant imputation des dépenses de
santé.
Champ
: France métropolitaine, ensemble des
individus.
Source : « En quoi la prise en compte des transferts liés à la santé modifie-t-elle l'appréciation du niveau de vie ? », François Marical. France. Portrait social 2007. Insee.
Quant aux dépenses publiques d'éducation , elles exercent une redistribution au profit des familles appartenant aux premiers déciles de revenu (elle est particulièrement forte pour les familles du premier décile).
DÉPENSE PUBLIQUE D'ÉDUCATION PAR
FAMILLE
AYANT DES ENFANTS SCOLARISABLES
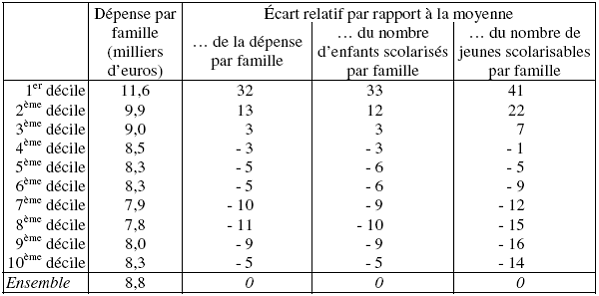
Note : déciles de revenu initial (hors revenu des enfants) par équivalent adulte.
Champ : familles dynastiques ayant au moins un enfant de 3 à 24 ans.
Sources : DPD ; Insee-DGI, enquête Revenus fiscaux 1997 (actualisée 2001), modèle Ines, calculs Insee.
Au total, même si les dépenses concernées ne totalisent que les deux tiers des dépenses publiques, on peut conclure que les dépenses publiques exercent globalement une redistribution monétaire mais qui ne « profite » vraiment qu'aux 20 % des ménages les plus démunis .
- Ce constat de redistributivité monétaire des dépenses publiques doit être complété par d' autres considérations qui conduisent à prendre une plus juste mesure des propriétés redistributives des dépenses publiques.
D'abord, une caractéristique importante des dépenses publiques en France est qu'elles profitent à tout le monde . Même si la répartition des dépenses publiques est un peu inégalitaire, au profit des plus démunis, le rapport entre ce qui revient aux plus pauvres et aux plus riches n'est pas très élevé. Par exemple, pour l'éducation, les familles du premier décile de revenu ne « profitent » que de 39,7 % de dépenses publiques de plus que les familles les plus riches, et celles-ci ont les mêmes avantages que celles disposant du revenu médian, c'est-à-dire le revenu au-dessous et au-dessus duquel se situent les deux moitiés de la population.
Ensuite, la redistributivité monétaire qu'on constate n'est souvent que la contrepartie de situations inverses de « handicaps » relatifs non monétaires , qui tout à la fois « expliquent » la situation de revenus des personnes et le niveau des dépenses publiques qui leur sont destinées.
Par exemple, pour les dépenses de santé, la concentration des dépenses publiques au profit des plus pauvres s'explique en grande partie par la proportion relative des plus âgés et des malades dans les personnes de revenus inférieurs.
Ainsi, la redistributivité monétaire égalise moins les niveaux de vie qu'elle ne compense des handicaps qui, en l'absence d'intervention publique, se traduiraient par une augmentation des inégalités et de la pauvreté . Elle est donc essentiellement préventive.
Enfin, le diagnostic sur la redistributivité monétaire des dépenses publiques peut parfois varier du tout au tout en fonction du point de vue adopté .
Pour les dépenses publiques de retraite , leur redistributivité est avérée quand on la mesure au niveau des individus mais elle est presque nulle quand on l'apprécie au niveau du couple puisque la première résulte de la situation des femmes.
TAUX DE RENDEMENT INTERNE MÉDIANS PAR
DÉCILE DE SALAIRE MOYEN
PAR ANNÉE TRAVAILLÉE DU COUPLE
(EN %)
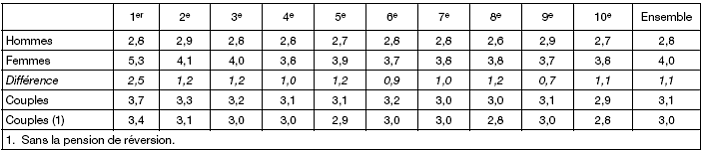
Champ : individus mariés, nés entre 1948
et 1960 et salariés du secteur privé.
Source :
modèle de microsimulation Destinie de l'Insee.
Elle ne concerne vraiment que le premier décile de revenu - à son profit - et le dernier - à son détriment .
Pour les dépenses publiques de santé , le constat de redistributivité doit faire place à un constat inverse d'anti-redistributivité quand on tient compte de l'extension limitée de la couverture publique. Les restes à charge des ménages représentent 5,4 % du revenu pour le premier décile et 0,8 % pour le décile de revenu le plus élevé.
LE RESTE À CHARGE DES MÉNAGES (INDICATEUR
EN NIVEAU) :
LES DÉPENSES DE SANTÉ DES MÉNAGES
DIMINUÉES DES PRESTATIONS REÇUES (APPROCHE « COMPTES DE
LA SANTÉ »)
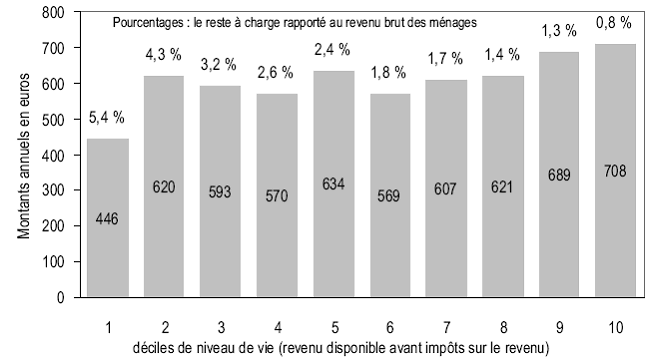
Sources : « L'assurance-maladie contribue-t-elle à redistribuer les revenus ? », Laurent Caussat, Sylvie Le Minez et Denis Raynaud. DREES, « Les dossiers solidarité et santé », n° 1, janvier-mars 2005.
Et, si on plaquait la structure de consommation médicale des ménages relevant du décile des revenus les plus élevés sur les ménages du premier décile - celui où les revenus sont les plus faibles -, le reste à charge de ces ménages s'élèverait à plus de 8 % de leur revenu (contre 5,4 % constatés), soit dix fois plus que ce qui reste à la charge des ménages les plus aisés.
Quant aux dépenses publiques d'éducation , si elles exercent un effet redistributif entre familles riches et pauvres, cet effet est beaucoup moins net au niveau qui compte vraiment, celui des enfants.
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ÉDUCATION PAR ENFANT
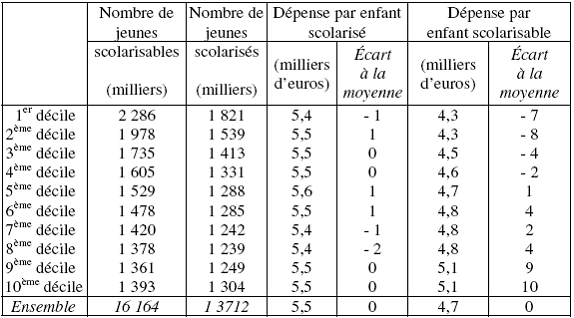
Note : déciles de revenu initial (hors revenu des enfants) par équivalent adulte.
Champ : familles dynastiques ayant au moins un enfant de 3 à 24 ans.
Sources : DPD ; Insee-DGI, enquête Revenus fiscaux 1997 (actualisée 2001), modèle Ines, calculs Insee.
La dépense par enfant scolarisable des familles pauvres est inférieure de 800 euros par an à celle des familles les plus riches.
- La redistributivité des dépenses publiques doit, enfin , être appréciée d'un point de vue plus qualitatif .
En liaison avec les caractéristiques de la redistributivité quantitative qui ont été exposées, on peut estimer que les dépenses publiques préviennent des processus de dégradation des situations individuelles : la pauvreté, l'absence d'éducation, le défaut d'accès aux soins... qui se traduirait par un creusement des inégalités.
Mais, elles contribuent insuffisamment à l'égalisation des chances et encore plus des conditions : les renoncements aux soins de même que les états de santé restent corrélés à la situation des revenus ; l'éducation de masse ne rime pas avec le diplôme pour tous et pas davantage avec l'égalisation des chances de suivre les mêmes parcours scolaires d'excellence.
Ces constats ne préjugent pas des solutions qu'il faudrait adopter pour prolonger sur un plan qualitatif l'apport des dépenses publiques sous l'angle de la redistributivité quantitative, mais ils représentent autant de défis pour améliorer l'efficacité des dépenses publiques.
Un accent particulier devrait être mis sur l'éducation compte tenu de l'implication des parcours scolaires sur les trajectoires socio-économiques et sur certaines dépenses publiques, notamment celles visant à assurer des minima vitaux.
INTRODUCTION
On parle si souvent des « dépenses publiques » que l'idée de leur consacrer un rapport peut paraître déconcertant. Ne sont-elles pas une des rares notions économiques dignes des attentions d'une opinion publique invitée par de fréquents sondages à exprimer ses avis sur le sujet ?
D'ailleurs, elles sont l'objet de l'attention de tous ceux (institutions comme les autorités européennes, économistes chargés de rapports...) qui se penchent sur le cours de l'économie et s'attachent aux finances publiques pour exercer leur surveillance ou leurs conseils.
Pour autant, les « dépenses publiques », dès qu'on cherche à les définir, échappent à l'évidence que paraît comporter la concentration de tant de discours, d'analyses, de pratiques. D'ailleurs, dès qu'on quitte le langage courant, la notion perd de son identité sémantique. Par exemple, le droit qui ne déteste rien tant que les notions floues et confuses ne les mentionnent pas comme telles. Il y est question de « crédits », de « dépenses engagées », de « dépenses des administrations publiques », jamais à la connaissance de votre rapporteur, de « dépenses publiques ».
Ainsi, si le mot appartient incontestablement au champ du discours, dès le stade de l'analyse, il ne se suffit plus à lui-même. Il n'est réellement compréhensible qu'accompagné de compléments qui restent trop souvent implicites.
Rester dans cet « implicite » ne peut satisfaire personne, surtout pas le Parlement, car, même si dans la structuration historique des démocraties parlementaires, les dépenses publiques n'ont pas le même rôle que le consentement à l'impôt, la définition de leur contour représente un enjeu politique de premier plan.
Cela, les parlementaires le savent bien puisqu'une partie importante de leur activité consiste à examiner le détail des dépenses publiques.
Mais, ils savent aussi que cet examen n'est pas toujours exhaustif - les dépenses fiscales ne leur sont pas toujours présentées avec la rigueur nécessaire - et qu'il est tributaire des supports qui en sont l'occasion : textes financiers ou à effets financiers qui morcèlent le point de vue, rapports qui, insistant sur un aspect en délaissent d'autres et, finalement, tronquent les problèmes à envisager...
Le présent rapport n'a évidemment pas la prétention de dépasser ces limites que les parlementaires connaissent et s'efforcent si bien de surmonter.
Il s'agit plus simplement d'aborder quelques grandes questions relatives à l'économie de la dépense publique , questions qui sont trop souvent traitées par prétérition alors qu'elles apparaissent fondamentales.
Trois questions sont envisagées - pour autant de parties - dans le présent rapport :
- quel est l'effet des dépenses publiques sur l'emploi des ressources économiques d'un pays ?
- quel est l'effet des dépenses publiques sur la croissance économique et, plus largement, sur le bien-être ?
- quel est l'effet des dépenses publiques sur la répartition du revenu national entre les individus ?
Ces trois interrogations sont assez proches, on le constate, de celles que le fondateur le plus célèbre de l'économie publique, Richard Musgrave, avait choisi de traiter, en 1959, dans « Une théorie des finances publiques » .
Cette proximité n'est pas le résultat d'une volonté de se caler a priori sur des travaux précurseurs. Elle témoigne plutôt de la permanence des problèmes théoriques.
La relative marginalisation dans le débat public de ces approches, nécessairement complexes, au profit de jugements de valeur plus simplistes, et la nécessité d'en renouveler l'analyse en raison des changements de contexte (la montée en charge des dépenses publiques, la mondialisation économique...) ont paru à votre rapporteur autant de justifications à un travail qui s'est révélé extrêmement difficile.
Car les ambitions de départ se sont heurtées à la rareté des données immédiatement utilisables et n'ont pas été secondées autant qu'on pourrait s'y attendre, compte tenu de l'importance du sujet, par l'abondance de la littérature disponible.
Il est heureux que des études de très grande qualité soient de plus en plus accessibles et que les comptables nationaux, surtout au niveau européen et de l'OCDE, s'efforcent de combler les vides.
Mais, il reste beaucoup à faire pour construire les statistiques que nécessite l'analyse rigoureuse d'une dimension pourtant majeure (40 % du PIB dans l'OCDE) des réalités économiques et sociales de notre temps.
Ces manques sont sans doute moins accidentels que le produit d'un temps où l'intervention publique trouvant, en soi, sa propre justification, les exigences de l'analyse n'exerçaient pas leurs effets en termes de production de données propres à les satisfaire.
Désormais, il en va tout autrement et la négligence n'est plus possible : elle entretient une critique sourde et aveugle, donc sans profit collectif.
La réflexion sur les dépenses publiques devrait - ce n'est pas une prévision, mais bien une recommandation - connaître un changement de dimension pour la porter au niveau qui, compte tenu de leur poids dans l'économie, devrait être la sienne et permettre de réaliser des choix informés.
Il convient de sortir de nos attitudes quelque peu « fétichistes » qui prêtent une attention exclusive au mot pour ses vertus magiques, et d'entrer dans le coeur du sujet, ou plutôt des sujets puisqu'aussi bien l'expression « la dépense publique » renvoie à une unité qui, factice, ne peut faire illusion.
Sans doute, les dépenses publiques sont-elles loin de représenter le plus puissant élément « aspirant » des ressources économiques des pays développés. Par exemple, le poids du secteur financier, apprécié à partir de la masse salariale qu'il mobilise a plus que doublé, entre 1960 et aujourd'hui, passant de 4 à 9 % de la totalité de la masse salariale privée.
Toutefois, en raison de leur niveau, mais aussi de leur nature, les dépenses publiques appellent un regain d'attention .
La première grande conclusion du présent rapport selon laquelle le niveau des dépenses publiques n'est pas une variable fondamentale à l'oeuvre dans les mécanismes de répartition globale des ressources économiques pourrait conduire à nuancer ce propos.
Mais, les deux autres grandes conclusions du rapport ajoutent au besoin de repérer plus finement les domaines dans lesquels, même marginalement, des études plus systématiques permettraient d'enrichir ce premier constat, en repérant les domaines dans lesquels on consacre trop, ou trop peu, de ressources économiques :
- l' influence des dépenses publiques sur la croissance économique et le niveau de la production ressort comme indéterminée quand on n'observe que leur niveau global mais est, sans doute, fortement liée à leur composition, au niveau le plus fin, et à leur efficacité ;
- l' impact redistributif des dépenses publiques, favorable sous un angle purement quantitatif , doit être très sérieusement nuancé quand on l'apprécie avec des critères plus qualitatifs .
En bref, tout invite à renoncer aux facilités de la généralisation.
D'une part, il n'y a pas une « dépense publique » mais des dépenses publiques, avec sans doute quelques grandes catégorisations possibles, mais aussi de très fortes particularités à chaque fois. Quoi de commun, par exemple, entre une retraite versée en contrepartie de cotisations préalables et la construction d'un pont ?
D'autre part, il n'y a pas de « magie » des dépenses publiques. Dans un contexte de rareté économique, mais aussi d'aspirations au bien-être, il faut pouvoir mesurer l'utilité nette des dépenses publiques. L'entreprise est considérable. Elle invite à un effort d'évaluation, en rupture avec tous les préjugés.
PREMIÈRE PARTIE - LE NIVEAU DES DÉPENSES PUBLIQUES : DES DIFFÉRENCES ENTRE PAYS MAIS PEU D'EFFETS SUR L'UTILISATION GLOBALE DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES
Le niveau des dépenses publiques a, historiquement, connu une très forte augmentation dans le monde développé .
Il est passé de 27,5 points de PIB en 1960 à 48,1 points en 1990 1 ( * ) . Après le pic du milieu des années 90, une baisse est intervenue mais qui semble aujourd'hui marquer le pas. Le niveau relatif des dépenses publiques est, avec 44 points de PIB en 2004 (moyenne arithmétique non pondérée de 24 pays de l'OCDE), très au-dessus de ce qu'il était en 1960.
La progression des dépenses publiques a été plus soutenue que la croissance économique , globalement et pour toutes les catégories de dépenses publiques, excepté l'investissement.
Cependant, dans les différentes formes d'interventions publiques, ce sont les transferts sociaux qui ont montré le plus grand dynamisme, devant la production de services publics au point qu'aujourd'hui, avec d'autres transferts, ils représentent près de 60 % des dépenses publiques totales.
Étant donné la nature de ces dépenses qui, pour la plupart, peuvent être assimilées à des dépenses d'assurance, on doit observer que la masse des dépenses publiques correspondant à la production de services publics par l'État (justice, défense, éducation...) s'élève, en réalité, à un peu moins de la moitié des dépenses publiques.
En bref, l'État tel qu'on se le représente souvent prélève environ un cinquième du PIB pour assurer ses productions (défense, sûreté, santé, éducation, infrastructures...) et non les quelque 44 % du PIB, que donne le rapprochement entre les dépenses publiques et le PIB dans vingt-quatre pays de l'OCDE.
Au cours du dernier demi-siècle, une convergence est intervenue entre les pays développés relativement à la place des dépenses publiques dans leur fonctionnement économique et social . Sans doute, les écarts absolus se sont-ils accrus mais leur valeur relative a été beaucoup réduite.
En 1960, l'écart moyen des pays par rapport à la moyenne excédait 20 %. En 1990, il n'était plus que de 13 % (soit le même niveau qu'en 2004). Autrement dit, en moyenne, les pays s'écartent de la moyenne du niveau des dépenses publiques dans le PIB de plus ou moins 13 % soit à peu près 6 points de PIB. Comme quelques pays divergent nettement, ces données moyennes sensibles, aux extrêmes, exagèrent les écarts et masquent une plus grande homogénéité des choix publics.
Cependant, des écarts subsistent et les questions abordées dans cette première partie consistent à s'interroger sur leurs effets :
- s'accompagnent-ils de modalités fondamentalement différentes d'allocation du revenu national ?
- manifestent-ils l'existence d'une préférence pour la gestion collective plutôt que pour la gestion privée ?
- provoquent-ils des dosages différenciés de la consommation, de l'épargne et de l'investissement ?
- modifient-ils les dynamiques du pouvoir d'achat des ménages ?
Toutes ces questions, ici abordées sous un angle global 2 ( * ) , reçoivent des réponses qui font fortement contraste avec les perceptions de l'opinion publique .
Sans doute, peut-on constater que l'augmentation des dépenses publiques a, sur longue durée, modifié les arbitrages dans l'utilisation des ressources économiques ou que des systèmes politiques faisant une place quasiment exclusive aux dépenses publiques ont pu s'accompagner de l'existence de structures d'emplois des richesses particulièrement typées.
Mais le propos du rapport est de comparer les pays économiquement développés du moment.
Et, la conclusion de cette première partie est que, sur la base d'analyses quantitatives, les niveaux relatifs des dépenses publiques ressortent comme ne modifiant pas significativement l'utilisation globale qui est faite des ressources économiques , les profils d'emploi des richesses économiques se révélant très semblables malgré des différences prononcées au regard des niveaux de dépenses publiques.
CHAPITRE I - LES DÉPENSES PUBLIQUES, UNE DIVERSITÉ À GÉOMÉTRIE VARIABLE
La catégorisation des dépenses publiques effectuée par la Comptabilité nationale, qui est essentiellement centrée sur les moyens plus que sur les politiques, ne donne pas une information complète sur la nature économique des dépenses publiques.
En outre, certaines classifications sont trompeuses . Tel est le cas de la formation brute de capital fixe qui est très loin de rendre compte de la contribution des dépenses publiques à l'investissement disponible 3 ( * ) .
Cependant , l' analyse des évolutions des dépenses publiques dans les cadres de la Comptabilité nationale conserve une réelle utilité pour appréhender certains aspects de la nature de ces dépenses publiques.
Elle permet notamment de prendre la mesure du partage entre leurs opérations de production et de répartition et de réunir des informations sur la fonction de production des administrations publiques, en précisant la combinaison des moyens qu'elles utilisent pour produire les biens et services publics.
|
PRÉCISIONS DE MÉTHODE - Dans la ligne des conventions de la Comptabilité nationale, l'OCDE propose un classement harmonisé des dépenses publiques en quatre composantes : - la consommation finale des administrations publiques ; - les transferts sociaux versés aux ménages ; - un ensemble composé des intérêts nets versés par les administrations publiques et des subventions aux entreprises ; - la « formation brute de capital fixe », qui comprend aussi les aides publiques à l'investissement . - Les principales composantes de la consommation finale des administrations publiques sont les rémunérations des agents publics , les « consommations intermédiaires », la consommation de capital fixe (amortissement des bâtiments et autres investissements utilisés par les administrations), les impôts indirects payés par les administrations elles-mêmes (moins les subventions reçues). La consommation publique correspond ainsi aux moyens mis en oeuvre pour le fonctionnement des administrations publiques dans leur activité de production ou de redistribution, à l' exception des dépenses d'investissement . L'essentiel de ces consommations est engagé dans les activités de production des administrations publiques (éducation, police, santé...), la gestion de la redistribution étant plus économe en consommation publique. - Les autres rubriques regroupent des dépenses que leur intitulé désigne clairement. Il faut, toutefois, insister sur le fait que les dépenses de « formation brute de capital fixe » regroupent les seules dépenses liées à l'acquisition de biens durables par les administrations publiques et non pas la totalité des dépenses par lesquelles les administrations publiques concourent à la production de biens durables, qui sont majoritairement imputées en consommation publique . |
Les insuffisances des données usuelles de la Comptabilité nationale ont fait naître un grand nombre de propositions et ont engendré quelques initiatives dont les prolongements ne sont pas encore achevés. Parmi celles-ci figure la constitution d'une classification fonctionnelle des dépenses publiques (voir annexe n°3) qui enrichit les données plus traditionnelles et dont on propose une analyse à la fin du présent chapitre.
Dans les pays de l'OCDE, les dépenses publiques sont majoritairement des dépenses sociales, qui, pour l'essentiel, sont la contrepartie de systèmes collectifs d'assurance .
Si on ajoute à ces dépenses les transferts économiques au titre des subventions et les intérêts versés par les administrations publiques du fait de la dette publique, c'est de près des deux tiers du total des dépenses publiques qu'on rend compte .
La part des dépenses publiques destinées à produire des biens et services est donc minoritaire et très concentrée . Elle va, pour plus de la moitié, à deux secteurs : la santé et l'éducation .
L' essentiel des différences existant entre les pays développés relativement au niveau relatif des dépenses publiques provient donc de l'ampleur des assurances sociales publiques qui influence largement les écarts de niveaux des dépenses publiques entre pays, en lien principalement avec les ressources consacrées aux retraites.
Sur les dépenses publiques hors protection sociale, les choix entre les pays de l'OCDE présentent un plus haut degré d'homogénéité .
Quant aux dépenses sociales, une modification du périmètre de l'intervention collective ne semble pas devoir exercer des effets radicaux sur l'allocation globale du revenu national, puisque , comme on le verra dans le chapitre suivant, les préférences des agents économiques en ce domaine, semblent homogènes dans les pays de développement comparable .
I. LE RÔLE PRINCIPAL DES TRANSFERTS DANS LES NIVEAUX DES DÉPENSES PUBLIQUES ET LEURS ÉCARTS ENTRE PAYS
Les dépenses publiques sont majoritairement consacrées à la fonction de répartition du revenu avec, par ailleurs, une prépondérance des transferts sociaux (retraites, assurance-chômage et maladie, allocations de logement...).
Cette prééminence est particulièrement prononcée dans les pays européens. Les dépenses publiques sociales, de loin les plus dynamiques sur très longue période (voir l'annexe n° 1), ont encore renforcé leur importance relative ces dix dernières années.
A. LA PLACE PRÉPONDÉRANTE DES TRANSFERTS, EN LIEN AVEC L'IMPORTANCE DES DÉPENSES SOCIALES
Quel que soit le groupe de pays pris en référence, les dépenses publiques de transfert sont majoritaires, du fait de l'importance des prestations sociales .
Mais, les dépenses publiques sont dans les pays extra-européens plutôt plus consacrées à produire des biens et services publics.
1. En Europe, une prépondérance très nette
En 2005 , la structure moyenne des dépenses publiques dans les pays de la zone euro est la suivante .
a) La structure des dépenses publiques en Europe
STRUCTURE DES DÉPENSES PUBLIQUES EN EUROPE 1 (EN %)
|
1995 |
2005 |
Variations
|
|
|
Consommations intermédiaires |
9,1 |
10,6 |
+1,5 |
|
Traitements publics |
20,6 |
21,9 |
+1,3 |
|
Intérêts |
10,2 |
6,3 |
-3,9 |
|
Subventions |
3,1 |
2,6 |
-0,5 |
|
Allocations sociales 2 |
41,1 |
45,9 |
+4,8 |
|
Autres (fonctionnement) |
3,0 |
4,7 |
+1,7 |
|
Transferts en capital |
7,9 |
2,7 |
-5,2 |
|
Investissements |
5,0 |
5,3 |
+0,3 |
|
Total |
100 |
100 |
0 |
1
Europe des 12 : zone euro.
2
Hors Santé.
Source : Commission européenne. Rapport sur les finances publiques dans l'Union européenne. 2006.
* Les dépenses de protection sociale au sens strict , c'est-à-dire hors dépenses de santé , représentent 40,1 % des dépenses publiques dans l' Union européenne à 25 .
Pour la zone euro, les dépenses publiques étant pour presque pour moitié (45,9 %) des dépenses sociales , avec les autres types de transferts (les subventions, les intérêts...), les dépenses dites de répartition représentent presque deux tiers du total ( 62,2 % ).
Les dépenses de fonctionnement et d'investissement , qui correspondent à la production des administrations publiques , avec 37,8 % , sont minoritaires . Les dépenses d'investissement absorbent environ 5 % du total (5,3 %). Les dépenses de traitement des agents publics (21,9 %) et les consommations intermédiaires (10,6 %) situent les dépenses publiques de fonctionnement à 32,5 % de l'ensemble des dépenses publiques .
Cet ordre de grandeur, un peu moins d'un tiers du total des dépenses publiques, situe mieux que l'ensemble des dépenses publiques, qui est pourtant souvent la référence dans les débats publics, les ressources mobilisées par l'État au service de ses productions propres .
b) Les dépenses publiques du point de vue de leur niveau dans le PIB
LES DÉPENSES PUBLIQUES EN EUROPE
1
EN
2005
(en points de PIB)
|
Consommations intermédiaires |
5,1 |
|
Traitements publics |
10,4 |
|
Intérêts |
3,1 |
|
Subventions |
1,1 |
|
Allocations sociales 2 |
21,8 |
|
Autres (fonctionnement) |
2,2 |
|
Transferts en capital |
1,3 |
|
Investissements |
2,5 |
|
Total |
47,5 |
1 Europe des 12 : zone euro.
2 Hors Santé.
En 2005, les Européens (Europe des 12) consacrent 21,8 % du PIB à des assurances sociales publiques et autour de 18 % de leur PIB à des dépenses nécessaires à la production de biens et services publics (dont 10,4 points de PIB à des salaires des agents directement employés par les administrations publiques et 2,5 points de PIB à des investissements ). Le reliquat ( 7,7 points de PIB ) est alloué à des transferts divers, dont 3,1 points à des dépenses d'intérêt .
Ce qu'il est convenu d'appeler le « train de vie de l'État » ou « la bureaucratie » est donc loin d'être appréhendé par le niveau général des dépenses publiques qui correspondent pour leur majorité à des assurances, certes gérées collectivement, mais qui relèvent pour l'essentiel de processus par lesquels les agents économiques étalent leur revenu individuel dans le temps.
2. Au niveau des pays de l'OCDE, une même prépondérance mais moins forte
* Si l'on élargit le point de vue aux grands pays de l'OCDE , la structure des dépenses publiques est un peu différente.
NIVEAU DES DÉPENSES PUBLIQUES PAR PRINCIPAUX POSTES DE DÉPENSES EN 2006 1
(en points de PIB)
|
Consommations
|
Salaires
|
Subventions |
Intérêts |
Prestations sociales |
FBCF |
Autres |
Total |
|
|
Autriche |
4,5 |
9,3 |
3,1 |
2,9 |
23,6 |
1,0 |
4,9 |
49,3 |
|
Belgique |
3,6 |
11,8 |
1,7 |
4,0 |
22,4 |
1,7 |
3,3 |
48,5 |
|
Canada |
8,9 |
11,5 |
1,1 |
4,3 |
9,9 |
2,8 |
0,8 |
39,3 |
|
Danemark |
8,6 |
16,9 |
2,2 |
2,2 |
16,7 |
1,9 |
3,2 |
51,7 |
|
France |
5,2 |
13,1 |
1,5 |
2,6 |
23,4 |
3,3 |
4,3 |
53,4 |
|
Allemagne |
4,2 |
7,2 |
1,1 |
2,8 |
25,8 |
1,4 |
2,9 |
45,4 |
|
Irlande |
5,0 |
9,7 |
0,5 |
1,0 |
11,0 |
3,7 |
3,3 |
34,2 |
|
Italie |
5,3 |
11,0 |
0,9 |
4,6 |
20,0 |
2,3 |
6,0 |
50,1 |
|
Japon |
3,3 |
6,2 |
0,6 |
2,4 |
17,7 |
3,2 |
2,6 |
36,0 |
|
Pays-Bas |
7,1 |
9,4 |
1,2 |
2,2 |
20,8 |
3,2 |
2,1 |
46,0 |
|
Portugal |
4,1 |
13,6 |
1,4 |
2,8 |
18,8 |
2,3 |
3,4 |
46,4 |
|
Espagne |
5,0 |
10,0 |
2,0 |
1,6 |
14,1 |
3,8 |
3,1 |
38,6 |
|
Suède |
9,5 |
15,3 |
1,5 |
1,8 |
19,3 |
3,1 |
3,8 |
54,3 |
|
Royaume-Uni |
11,7 |
11,4 |
0,7 |
2,1 |
12,9 |
1,9 |
3,9 |
44,6 |
|
États-Unis |
8,4 |
10,1 |
0,4 |
2,8 |
12,1 |
2,5 |
0,3 |
36,6 |
|
Zone euro |
5,0 |
10,2 |
1,2 |
2,9 |
21,5 |
2,5 |
3,8 |
47,1 |
|
Moyenne arithmétique |
6,5 |
11,1 |
1,5 |
2,7 |
17,9 |
2,5 |
3,1 |
45,0 |
1 Hors santé.
Source : OCDE. Comptes nationaux annuels. Comptes des administrations publiques.
Au niveau des principaux pays de l'OCDE, les dépenses publiques de protection sociale (hors santé) représentent une proportion du total des dépenses publiques moins élevée (39,8 % du total contre 45,6 % dans la zone euro) avec un poids dans le PIB inférieur (17,9 contre 21,5 points) . Cependant, si on ajoute à ces dépenses les autres transferts, le total des dépenses de distribution est légèrement majoritaire, comme dans la zone euro.
Mais, au total, dans ces pays :
- non seulement, la part des dépenses publiques correspondant à la production des biens et services est plus élevée,
- mais encore, le niveau de la production assurée par les administrations publiques (apprécié en points de PIB) est plus élevé que dans la zone euro .
Cette observation conduit à infirmer l'idée très répandue selon laquelle les pays européens se distingueraient généralement par un niveau très élevé de collectivisation de la production de biens et services .
*
* *
* Au total, la prédominance des fonctions d'assurance dans les dépenses publiques peut être à peu près partout constatée dans les pays de l'OCDE . Elle est particulièrement marquée en Allemagne où près de la moitié des dépenses publiques y sont consacrées. Elle est moins prononcée au niveau de l'OCDE qu'en Europe.
3. Une France à l'image de la situation en Europe
* En France, les dépenses publiques sont consacrées pour plus des 4/10 e à la couverture de risques sociaux : environ 44 % des dépenses publiques - pour une proportion de 23,4 % du PIB en 2005 .
* Si les dépenses d'assurances sociales collectives représentent l'essentiel des dépenses de transferts, d'autres dépenses publiques prennent place dans cette catégorie 4 ( * ) .
- Ces dépenses de transferts se distinguent nettement des transferts qu'implique la protection sociale . Contrairement à ceux-ci, qui sont très majoritairement contributifs 5 ( * ) , ils sont accordés sans cotisations préalables. Il s'agit donc de purs transferts et non, comme la plupart des dépenses de protection sociale , de la distribution de revenus différés .
Les dépenses publiques de transfert, autres que celles relevant de la protection sociale, s'élèvent en France à 135,1 milliards d'euros en 2005 6 ( * ) .
Au total, en France, l'ensemble des transferts et des intérêts couvrent 56,1 % des dépenses publiques en 2005, soit à peu près 30 points de PIB (29,9 points en 2005) .
LES DÉPENSES PUBLIQUES DE TRANSFERTS EN FRANCE (2005)
|
En niveau
|
En % du total |
En points
|
|
|
Subventions |
24,3 |
2,6 |
1,4 |
|
Prestations sociales |
402,9 |
43,8 |
23,4 |
|
Transferts courants |
50,2 |
5,4 |
2,9 |
|
Transferts en capital |
14,4 |
1,6 |
0,8 |
|
Intérêts imputés |
24,7 |
2,7 |
1,4 |
|
Total |
516,5 |
56,1 |
29,9 |
* Quant aux dépenses directement liées à la production des administrations publiques, elles représentent une proportion minoritaire dans l'ensemble des dépenses publiques avec 40,5 % :
- un peu moins du quart des dépenses (24,7 %) sont des « salaires publics », soit 13,2 points de PIB ;
- un peu moins d'un dixième (9,7 %) correspond à des consommations intermédiaires soit 5,2 points de PIB ;
- 6,1 % sont des dépenses de formation brute de capital fixe (3,3 points de PIB).
B. DES DÉPENSES PUBLIQUES SOCIALES QUI EXPLIQUENT UNE GRANDE PARTIE DES ÉCARTS DE NIVEAUX DE DÉPENSES PUBLIQUES ENTRE PAYS DÉVELOPPÉS
* Il existe un lien étroit entre le niveau général des dépenses publiques et la proportion prise en leur sein par les dépenses d'assurance sociale : plus la part des dépenses sociales est élevée, plus les dépenses publiques le sont elles-mêmes .
Le niveau des dépenses publiques sociales est la première variable explicative de la hiérarchie des pays au regard du niveau relatif des dépenses publiques .
- Les pays de l'OCDE où le niveau global des dépenses publiques est le plus bas sont aussi ceux où le poids des dépenses de protection sociale est le plus modeste, et vice-versa .
De fait, si les dépenses publiques rapportées au PIB présentent un panorama très différencié dans les principaux pays de l'OCDE, comme le montre le graphique ci-après, ...
DÉPENSES PUBLIQUES RAPPORTÉES AU PIB EN 2004
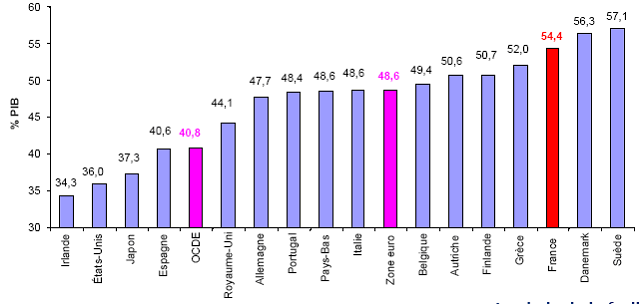
Source : OCDE
... hors protection sociale , le niveau des dépenses publiques ressort comme plus homogène ainsi qu'il apparaît visuellement dans le graphique ci-après.
DÉPENSES PUBLIQUES RAPPORTÉES AU PIB EN 2004
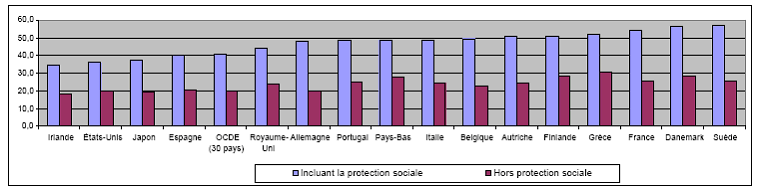
1. Y compris les services de santé
Source : OCDE
C. CES DERNIÈRES ANNÉES, LES DÉPENSES PUBLIQUES SOCIALES ONT ÉTÉ MOINS FLEXIBLES QUE LES AUTRES
Sur très longue période, c'est la montée en puissance des dépenses de protection sociale qui représente le fait marquant du partage du revenu dans les pays développés . Dans la période la plus récente, les dix dernières années, alors que les dépenses publiques ont été plutôt réduites, les dépenses de protection sociale ont résisté.
1. En points de PIB, une stabilité globale mais des évolutions nationales nuancées
* Entre 1995 et 2006 , le niveau relatif des prestations sociales a été globalement stabilisé dans le monde développé autour d'un cinquième du PIB.
ÉVOLUTION DES PRESTATIONS SOCIALES DANS LES PRINCIPAUX PAYS DE L'OCDE ENTRE 1995 ET 2006 1
(en % du PIB)
|
1995 |
2000 |
2006 |
Variation 2006-1995 |
|
|
Australie |
18,3 |
18,1 |
Nd |
- 0,2 (2000-1995) |
|
Autriche |
20,1 |
18,4 |
18,0 |
- 2,1 |
|
Belgique |
21,5 |
21,3 |
22,4 |
+ 0,9 |
|
Canada |
21,3 |
18,6 |
19,3 |
- 2,0 |
|
Danemark |
25,2 |
20,3 |
21,7 |
- 3,5 |
|
France |
23,7 |
22,9 |
23,7 |
0 |
|
Allemagne |
19,6 |
19,0 |
18,3 |
- 1,3 |
|
Irlande |
16,3 |
13,8 |
16,0 |
- 0,3 |
|
Italie |
18,0 |
18,4 |
20,3 |
+ 2,3 |
|
Luxembourg |
15,9 |
15,1 |
15,3 |
- 0,6 |
|
Pays-Bas |
23,8 |
22,0 |
25,4 |
+ 1,6 |
|
Norvège |
21,6 |
19,3 |
19,4 |
- 2,2 |
|
Espagne |
18,1 |
17,1 |
18,1 |
0 |
|
Suède |
26,7 |
26,0 |
26,1 |
- 0,6 |
|
Royaume-Uni |
19,6 |
18,8 |
21,9 |
+ 2,3 |
|
États-Unis |
15,3 |
14,4 |
16,0 |
+ 0,7 |
|
Zone euro |
20,3 |
19,8 |
20,3 |
0 |
|
Moyenne arithmétique simple |
20,3 |
19,0 |
20,1 |
- 0,2 |
1 Hors santé
Source : données OCDE retraitées.
Dans l'échantillon des seize pays mentionnés dans le tableau ci-dessus, cinq pays ont enregistré une hausse (en points de PIB) du niveau des dépenses publiques de protection sociale : États-Unis, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie et Belgique.
Les autres pays ont connu des réductions, parfois importantes (Autriche, Danemark, Norvège), sauf la France et l'Espagne où la stabilité l'a emporté.
Appréciée au niveau de la zone euro, l'évolution des dépenses publiques montre le dynamisme relatif des dépenses de protection sociale.
Entre 1995 et 2005, la place occupée par les dépenses publiques dans le PIB a diminué de 2,9 points de PIB 7 ( * ) . Le poids relatif au PIB des dépenses publiques d'investissement s'est stabilisé, mais plusieurs catégories de dépenses publiques ont connu une décrue. Les dépenses d'intérêt ont nettement reculé ainsi que les dépenses de transferts en capital, de 2,2 et 2,7 points respectivement. Les subventions, autres qu'en capital, ont aussi décliné . Le poste des traitements publics est resté stable .
POIDS DES DÉPENSES PUBLIQUES DANS LE PIB DANS
L'UNION EUROPÉENNE
1
ÉVOLUTION 1995-2005 (EN POINTS
DU PIB)
|
1995 |
2005 |
Variations
|
|
|
Consommations intermédiaires |
4,6 |
5,0 |
+ 0,4 |
|
Traitements publics |
10,4 |
10,4 |
0 |
|
Intérêts |
5,2 |
3,0 |
- 2,2 |
|
Subventions |
1,6 |
1,2 |
- 0,4 |
|
Allocations sociales |
20,7 |
21,8 |
+ 1,1 |
|
Autres |
1,4 |
2,3 |
+ 0,9 |
|
Transferts en capital |
4,0 |
1,3 |
- 2,7 |
|
Investissements |
2,5 |
2,5 |
0 |
|
Total |
50,4 |
47,5 |
- 2,9 |
1 Europe des 12
En revanche, les prestations sociales ont augmenté davantage que le PIB et leur prépondérance dans le total des dépenses publiques s'est renforcée.
ÉVOLUTION DES DÉPENSES PUBLIQUES EN
EUROPE
8
(
*
)
ENTRE 1995 ET
2005
(EN MILLIONS D'EUROS)
|
Dépenses publiques |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
Variation
9
(
*
)
|
|
Consommations intermédiaires |
267 121 |
279 119 |
281 759 |
285 249 |
304 445 |
320 102 |
333 995 |
355 671 |
369 094 |
385 428 |
404 338 |
4,2 % |
|
Traitements |
603 323 |
632 429 |
639 269 |
646 020 |
673 324 |
697 934 |
723 082 |
756 271 |
783 791 |
808 204 |
832 548 |
3,3 % |
|
Intérêts |
300 566 |
318 196 |
292 226 |
281 596 |
258 319 |
262 177 |
266 832 |
254 325 |
247 368 |
241 593 |
240 089 |
- 1,8 % |
|
Subventions |
91 784 |
92 652 |
86 587 |
93 491 |
97 129 |
97 145 |
99 900 |
101 745 |
101 712 |
99 217 |
97 984 |
0,06 % |
|
Allocations sociales |
1 204 727 |
1 275 314 |
1 291 667 |
1 317 435 |
1 370 896 |
1 417 313 |
1 482 377 |
1 570 930 |
1 641 132 |
1 694 285 |
1 746 784 |
3,8 % |
|
Autres |
87 648 |
97 401 |
99 610 |
114 717 |
123 518 |
132 408 |
139 049 |
145 870 |
159 781 |
168 125 |
179 333 |
7,4 % |
|
Transferts en capital |
233 434 |
72 512 |
68 937 |
78 577 |
84 055 |
83 942 |
97 267 |
97 664 |
102 939 |
102 130 |
102 633 |
- 4,5 % |
|
Investissements |
145 599 |
146 150 |
138 822 |
146 980 |
160 246 |
98 179 |
174 237 |
174 235 |
188 618 |
189 817 |
197 127 |
3,1 % |
|
TOTAL |
2 934 202 |
2 913 772 |
2 898 878 |
2 964 066 |
3 071 931 |
3 109 200 |
3 316 738 |
3 456 711 |
3 594 435 |
3 688 800 |
3 800 835 |
2,6 % |
Les États-Unis se distinguent par une augmentation du niveau des richesses consacrées à la protection sociale.
2. Partout, des croissances absolues des prestations sociales qui offrent un panorama différent de celui des accroissements relatifs
* Alors que, vues à travers leur poids relatif dans le PIB, les dépenses publiques de protection sociale se sont repliées dans plusieurs pays entre 1995 et 2006, aucun pays de l'échantillon n'a connu une décroissance réelle de ces dépenses .
La croissance des dépenses publiques de protection sociale a atteint 4 % en valeur dans la zone euro soit une progression en volume un peu au-dessus de 2 %.
CROISSANCE ANNUELLE EN VOLUME DES DÉPENSES
PUBLIQUES
DE PROTECTION SOCIALE ENTRE 1995 ET 2006
(en % d'augmentation)
|
Croissance |
Rang décroissant |
|
|
Autriche |
1,8 |
12 |
|
Belgique |
2,1 |
10 |
|
Canada |
1,5 |
13 |
|
Danemark |
0,3 |
15 |
|
France |
2,4 |
8 |
|
Allemagne |
0,9 |
14 |
|
Irlande |
6,3 |
1 |
|
Italie |
2,6 |
7 |
|
Luxembourg |
4,0 |
4 |
|
Pays-Bas |
4,0 |
4 |
|
Norvège |
4,6 |
2 |
|
Espagne |
4,3 |
3 |
|
Suède |
2,0 |
11 |
|
Royaume-Uni |
2,3 |
9 |
|
États-Unis |
3,0 |
6 |
* Le point de vue sur la croissance en volume des dépenses publiques de protection sociale offre un panorama différent de celui associé à la considération de leur niveau relatif dans le PIB. Celui-ci est « coloré » par des différentiels de croissance économique entre pays qui font passer pour rigoureux des pays en réalité généreux et, inversement, pour « prodigues » des pays plutôt mesurés.
Par exemple, alors qu'en Irlande l'équivalent en points de PIB des dépenses publiques sociales a diminué, le pays ressort comme le premier sous l'angle de l'augmentation réelle des dépenses de prestations sociales . Des constats analogues valent pour la Norvège ou l'Espagne.
Inversement, la France - malgré une stabilité des dépenses publiques sociales exprimées en points de PIB, qui la classe dans les pays plutôt « généreux » -, n'est qu'au huitième rang pour l'augmentation de ses dépenses en volume .
II. DES DÉPENSES PUBLIQUES DE PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES, MINORITAIRES ET RELATIVEMENT HOMOGÈNES DANS LES PAYS DÉVELOPPÉS
A côté de la fonction de répartition du revenu, les administrations publiques exercent une fonction de production (éducation santé, défense, sûreté, ...). Cette fonction mobilise une part minoritaire des dépenses publiques .
Alors que dans les pays de la zone euro , on constate globalement un tassement du niveau relatif de cette production, les pays extérieurs (Royaume-Uni, États-Unis...) montrent parfois des évolutions inverses .
Au total, il existe une homogénéité beaucoup plus forte pour cette catégorie de dépenses publiques que lorsqu'on considère l'ensemble des dépenses publiques.
A. LES DÉPENSES PUBLIQUES CONSACRÉES À LA PRODUCTION SONT MINORITAIRES ET RELATIVEMENT HOMOGÈNES
1. Des dépenses publiques qui représentent une fraction minoritaire du total
* Dans un échantillon représentatif de pays développés, un peu plus de 4/10e des dépenses publiques sont consacrés à la production de biens et services.
Le tableau ci-après rend compte de cette situation en partant des estimations de la production des administrations publiques qui, sans recouvrir strictement le champ des dépenses publiques consacrées à la production non marchande, en est une approximation acceptable et utile pour l'analyse économique.
PRODUCTION DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
DANS LES
PRINCIPAUX PAYS DE L'OCDE
ET PART DANS LE TOTAL DES DÉPENSES
PUBLIQUES - 2006
10
(
*
)
|
Production
|
Production publique rapportée au total
|
|
|
Autriche |
15,0 |
30,5 |
|
Belgique |
17,1 |
34,9 |
|
Canada |
22,4 |
56,7 |
|
Danemark |
27,0 |
52,8 |
|
Finlande |
24,9 |
51,3 |
|
France |
21,1 |
39,3 |
|
Allemagne |
12,9 |
28,3 |
|
Irlande |
15,6 |
45,9 |
|
Italie |
18,7 |
37,3 |
|
Luxembourg |
12,4 |
30,7 |
|
Pays-Bas |
19,1 |
40,9 |
|
Norvège |
19,9 |
49,0 |
|
Portugal |
19,5 |
42,3 |
|
Espagne |
16,7 |
43,4 |
|
Suède |
27,6 |
49,7 |
|
Royaume-Uni |
24,0 |
53,2 |
|
États-Unis |
19,8 |
54,4 |
|
Moyenne arithmétique |
19,6 |
43,6 |
Note de lecture : la première colonne indique le niveau de la production des administrations publiques en points de PIB ; la seconde colonne rapporte les données de la première au pourcentage des dépenses publiques totales dans le PIB. La production publique est principalement valorisée en fonction des coûts de production qui, à leur tour, sont essentiellement estimés à partir des dépenses publiques, hors transferts . Mais certaines dépenses publiques, celles liées à la défense notamment, ne sont pas comptées en production des administrations publiques. Cette convention comptable est d'ailleurs en voie de réforme. De plus, la FBCF n'est pas prise en totalité pour apprécier la production. En outre, certains coûts de production ne sont pas directement dérivés des dépenses publiques, en particulier la consommation de capital fixe. Tout ceci explique les différences entre les chiffres du tableau ci-dessus et les données mentionnées par ailleurs. Ainsi, l'estimation de la production publique n'est pas entièrement représentative du niveau des dépenses publiques hors transferts. Elle en est pourtant une bonne approximation.
Source : Base de données de l'OCDE. Comptes nationaux. Administrations publiques.
Regardée à partir des principaux pays de l'OCDE, la production publique a, en dix ans, légèrement renforcé sa place dans le total de la production (+ 0,3 point de PIB) principalement sous l'effet des évolutions intervenues au Royaume Uni et aux États-Unis.
LA PRODUCTION DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
(en points de PIB)
|
2001 |
2006 |
Évolution 2006/2001 |
|
|
Autriche |
15,2 |
15,0 |
- 0,2 |
|
Belgique |
16,7 |
17,1 |
+ 0,4 |
|
Canada |
22,2 |
22,4 |
+ 0,2 |
|
Danemark |
27,4 |
27,1 |
- 0,3 |
|
France |
20,9 |
21,1 |
+ 0,2 |
|
Allemagne |
13,4 |
12,9 |
- 0,5 |
|
Irlande |
14,3 |
15,6 |
+ 1,3 |
|
Italie |
17,9 |
18,7 |
+ 0,8 |
|
Japon |
13,6 |
12,6 |
- 1,0 |
|
Pays-Bas |
18,9 |
19,1 |
+ 0,2 |
|
Portugal |
20,2 |
19,5 |
- 0,7 |
|
Espagne |
15,9 |
16,8 |
+ 0,9 |
|
Suède |
28,5 |
27,6 |
- 0,9 |
|
Royaume-Uni |
21,2 |
24,0 |
+ 2,8 |
|
États-Unis |
18,5 |
19,8 |
+ 1,3 |
|
Moyenne arithmétique simple |
19,0 |
19,3 |
+ 0,3 |
* La France a suivi ce mouvement et la production de biens et services publics y représente l'équivalent de 39,3 % des dépenses publiques en 2006, au terme d'une augmentation de la production non marchande de 0,2 point de PIB par rapport à 2001.
2. Les dépenses publiques hors transferts sont plus homogènes que les dépenses publiques totales
Quand on excepte les rares pays nettement divergents (Autriche, Allemagne, Irlande, Luxembourg par le bas et le Danemark et la Suède par le haut), la différenciation internationale joue en ce domaine sur une plage de l' ordre de 4 points de PIB (contre un écart-type à la moyenne des dépenses publiques sociales de 6,2 points de PIB en 2003) qui peut être qualifiée d'assez étroite , d'autant que certaines approximations statistiques lui donnent, sans doute, une ampleur apparente plus élevée qu'elle ne doit être en réalité 11 ( * ) .
* Comparée à d'autres pays, la situation de la France révèle, sous l'angle de cette catégorie de dépenses publiques 12 ( * ) , des singularités moins accusées que lorsqu'on se concentre sur l'ensemble des dépenses publiques .
APERÇUS DE QUELQUES ÉCARTS RELATIFS AUX
DÉPENSES PUBLIQUES REPRÉSENTATIVES DE LA PRODUCTION (HORS
SANTÉ) DE BIENS ET SERVICES
DANS DIFFÉRENTS PAYS EN 2004 (EN
POINTS DE PIB)
|
France |
Allemagne |
Italie |
Suède |
Royaume Uni |
États-Unis |
Moyenne |
Écarts France |
||
|
Moyenne des pays |
États-Unis |
||||||||
|
Dépenses publiques liées à la production non marchande 1 |
23,7 |
18,6 |
23,9 |
24,5 |
20,5 |
22,7 |
22,3 |
+ 1,0 |
+ 1,4 |
|
Total dépenses publiques |
53,4 |
46,6 |
48,1 |
54,6 |
44,4 |
37,1 |
47,4 |
+ 6,0 |
+16,3 |
1 Seule une fraction, majoritaire au demeurant, de ces dépenses peut être considérée comme productrice de biens et services publics, ce qui explique que dans la ligne « total », le chiffre excède celui cité juste précédemment.
Avec un équivalent de 23,7 points de PIB de dépenses publiques consacré à la production de biens et services (hors santé), la France est à peu près à équidistance des États-Unis (1 point de PIB de plus consacré aux fonctions ici envisagées) et de la Suède (0,8 point de PIB de moins que ce pays) .
Alors que pour le total des dépenses publiques, la France enregistre un excédent de 6 points de PIB , qui reflète l'importance relative de la protection sociale publique 13 ( * ) , pour les dépenses publiques consacrées aux autres fonctions, l'écart avec les pays ici retenus n'est que de 1 point de PIB .
* Au total, l'importance relative des dépenses publiques constatée en France ne peut être attribuée à cette catégorie de dépenses publiques, surtout quand la comparaison est effectuée avec les pays anglo-saxons.
A propos de ces pays, il faut souligner que, contrairement à une idée reçue, les ressources économiques qu'ils consacrent à la production non marchande sont plus élevées qu'en Europe .
ÉCARTS DE DÉPENSES PUBLIQUES ENTRE LA
FRANCE
ET LE ROYAUME-UNI ET LES ÉTATS-UNIS EN 2004 (EN POINTS DE
PIB)
|
Avec les... |
...dépenses publiques totales |
...dépenses publiques de production des biens et services publics |
Autres 1 |
|
Royaume-Uni |
+ 9,0 |
+ 3,2 |
+ 5,8 |
|
États-Unis |
+ 16,3 |
+ 1,0 |
+ 15,3 |
1 Essentiellement des dépenses sociales.
B. LES DIFFÉRENTS POSTES DE DÉPENSES LIÉES À LA PRODUCTION PUBLIQUE : DES COMBINAISONS PRODUCTIVES VARIABLES
La production de biens et services publics nécessite des facteurs de production comme pour n'importe quelle activité de cette sorte.
Les consommations des administrations publiques en représentent le poste essentiel.
En lien avec la relative homogénéité des niveaux de production publique dans les pays de l'OCDE, le total des consommations publiques présente généralement des analogies.
Toutefois, outre que quelques pays se singularisent, les situations nationales offrent, qualitativement, une assez grande diversité :
- le niveau des emplois publics est variable et leur productivité également ;
- les rémunérations unitaires semblent assez différenciées ;
- des pays pratiquent plus que d'autres l'externalisation.
1. La consommation des administrations publiques, une assez grande homogénéité mais quelques situations atypiques
Les dépenses de consommation des administrations publiques ( 15,2 points de PIB dans la zone euro en 2006 et 17,6 points de PIB pour la moyenne des principaux pays de l'OCDE ), sont composées des salaires versés aux agents directement ou indirectement employés pour la production de biens et services publics et des consommations intermédiaires des administrations.
Elles représentent environ 39 % des dépenses publiques dans l'OCDE en 2006 (39,1 %).
Dans la zone euro , elles sont d'une moindre ampleur relative (du fait de l'importance plus grande des dépenses sociales) et s'élèvent à quelque 32,3 % des dépenses publiques en 2006 (21,6 % pour les salaires).
a) Un ralentissement de la croissance des consommations publiques
Les consommations publiques ont augmenté plus vite que le PIB jusqu'en 1982 , puis moins rapidement par la suite jusqu'au début des années 90 . Entre 1995 et 2006 , en moyenne, les consommations publiques ont augmenté parallèlement au PIB. Mais les disparités nationales ont été fortes.
ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS PUBLIQUES
DANS
LES PRINCIPAUX PAYS DE L'OCDE ENTRE 1995 ET 2006
(en % du PIB)
|
1995 |
2006 |
Variation
|
|||||
|
Consom-
|
Salaires |
Total |
Consom-
|
Salaires |
Total |
||
|
Autriche |
6,0 |
12,5 |
18,5 |
4,5 |
9,3 |
13,8 |
- 4,7 |
|
Belgique |
3,1 |
11,9 |
15,0 |
3,6 |
11,8 |
15,4 |
+ 0,4 |
|
Canada |
8,4 |
13,7 |
22,1 |
8,9 |
11,6 |
20,5 |
- 1,6 |
|
Danemark |
7,6 |
17,1 |
24,7 |
8,5 |
16,9 |
25,4 |
+ 0,7 |
|
Finlande |
8,8 |
15,1 |
23,9 |
9,2 |
13,4 |
22,6 |
- 1,3 |
|
France |
5,5 |
13,6 |
18,8 |
5,2 |
13,1 |
18,3 |
- 0,5 |
|
Allemagne |
4,1 |
8,8 |
12,9 |
4,2 |
7,2 |
11,4 |
- 1,5 |
|
Irlande |
5,6 |
10,1 |
15,7 |
5,0 |
9,7 |
14,7 |
- 1,0 |
|
Italie |
4,8 |
11,0 |
15,8 |
5,3 |
11,1 |
16,4 |
+ 0,6 |
|
Corée |
3,5 |
6,6 |
10,1 |
Nd |
Nd |
Nd |
Nd |
|
Luxembourg |
3,5 |
8,5 |
12,0 |
3,1 |
7,4 |
10,5 |
- 1,5 |
|
Pays-Bas |
6,6 |
10,6 |
17,2 |
7,2 |
9,4 |
16,6 |
- 0,6 |
|
Nouvelle-Zélande |
7,1 |
9,2 |
16,3 |
Nd |
Nd |
Nd |
Nd |
|
Norvège |
7,8 |
14,0 |
21,8 |
6,2 |
11,9 |
18,1 |
- 3,7 |
|
Portugal |
Nd |
Nd |
Nd |
4,1 |
13,6 |
17,7 |
Nd |
|
Espagne |
4,5 |
11,2 |
15,7 |
5,0 |
10,0 |
15,0 |
- 0,7 |
|
Suède |
10,8 |
16,4 |
27,2 |
9,5 |
15,3 |
24,8 |
- 2,4 |
|
Suisse |
3,7 |
8,4 |
12,1 |
Nd |
Nd |
Nd |
Nd |
|
Royaume-Uni |
9,2 |
10,7 |
19,9 |
11,7 |
11,4 |
23,1 |
+ 3,2 |
|
États-Unis |
7,2 |
10,4 |
17,6 |
8,4 |
10,1 |
18,5 |
+ 0,9 |
|
Moyenne arithmétique simple |
6,2 |
11,6 |
17,8 |
6,5 |
11,4 |
17,9 |
Nd |
Source : OCDE. Comptes nationaux. Comptes des administrations publiques.
- Dans quelques pays, un net repli intervient : l'Autriche, la Finlande, l'Allemagne, le Luxembourg, la Norvège et la Suède .
- Dans d'autres, c'est une augmentation qu'on relève : le Royaume-Uni ; les États-Unis .
- En France , il y a eu une légère diminution (- 0,5 point de PIB) de la place des consommations publiques dans le PIB qui témoigne qu'entre 1995 et 2006, les consommations intermédiaires et les salaires des agents publics ont évolué moins vite que le PIB 14 ( * ) .
b) Une relative homogénéité des niveaux de consommations publiques mais quelques situations singulières
Dans de nombreux pays, le niveau des consommations publiques est très proche.
Toutefois, l' écart moyen des pays par rapport à la moyenne s'élève à 3,4 points de PIB soit 19 % du niveau des consommations publiques , ce qui peut être considéré comme important. Cette situation est due à certains pays assez nettement excentrés.
SITUATION DES PRINCIPAUX PAYS DE L'OCDE
AU REGARD
DES CONSOMMATIONS PUBLIQUES EN 2006
(en points de PIB)
|
Écart à la moyenne |
|
|
Autriche |
- 4,1 |
|
Belgique |
- 2,5 |
|
Canada |
+ 2,6 |
|
Danemark |
+ 7,5 |
|
Finlande |
+ 4,7 |
|
France |
+ 0,4 |
|
Allemagne |
- 6,5 |
|
Irlande |
- 3,2 |
|
Italie |
- 1,5 |
|
Luxembourg |
- 7,4 |
|
Pays-Bas |
- 1,3 |
|
Norvège |
+ 0,2 |
|
Portugal |
- 0,2 |
|
Espagne |
- 2,9 |
|
Suède |
+ 6,9 |
|
Royaume-Uni |
+ 5,2 |
|
États-Unis |
+ 0,6 |
|
Écart moyen à la moyenne |
3,4 |
Quelques pays divergent nettement :
- par le haut : le Danemark, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ;
- par le bas : l'Autriche, l'Allemagne et le Luxembourg.
Le niveau des consommations publiques en France n'est que très légèrement supérieur à la moyenne (0,3 point de PIB au-delà).
c) Une assez grande homogénéité des rémunérations publiques, avec des exceptions notables...
- En 1990 , dans la plupart des pays examinés, les dépenses publiques de rémunérations étaient très proches de la valeur médiane (12,65 points de PIB), ce qui témoigne d'une grande convergence des différents pays.
Elles ne s'en éloignaient de plus de 1,5 point de PIB que dans quelques pays : par le bas , au Japon (7,1 points de PIB), ainsi qu'en Allemagne et aux Pays-Bas (9,8 points de PIB) ; par le haut , en Norvège (14,9 points de PIB) et au Danemark (18,3 points de PIB).
Quant à la France , avec 13,3 points de PIB consacrés aux rémunérations publiques, elle occupait, en 1990, la troisième place derrière le Danemark et la Norvège, mais se trouvait proche de la valeur médiane avec seulement 0,8 point de PIB au-delà de celle-ci.
- En 2006, la valeur moyenne des dépenses publiques liées aux rémunérations atteint 11,4 points de PIB . Les pays sont restés relativement homogènes. La valeur moyenne des écarts à la moyenne est de 1,95 point de PIB , et, en valeur relative, de 17,2 % de la moyenne , soit moins que pour l'ensemble des consommations publiques.
INDICATEURS DE SALAIRES PUBLICS
|
Poids des salaires publics dans le PIB
|
(A) rapporté à la production des administrations publiques |
|
|
Autriche |
9,6 |
32,6 |
|
Belgique |
12,1 |
38,7 |
|
Canada |
11,7 |
Nd |
|
Danemark |
17,8 |
58,5 |
|
France |
13,5 |
43,7 |
|
Allemagne |
7,9 |
32,0 |
|
Italie |
10,6 |
35,7 |
|
Japon |
6,7 |
25,1 |
|
Pays-Bas |
9,8 |
Nd |
|
Espagne |
10,0 |
38,9 |
|
Suède |
15,8 |
48,0 |
|
Royaume-Uni |
10,5 |
38,0 |
|
États-Unis |
10,2 |
34,1 |
|
Zone euro |
10,4 |
Nd |
|
Moyenne (hors Canada et Pays-Bas) |
11,4 |
-- |
SITUATION DES PRINCIPAUX PAYS DE L'OCDE
AU REGARD
DES SALAIRES PUBLICS EN 2006
(en points de PIB)
|
Écart à la moyenne |
|
|
Autriche |
- 2,1 |
|
Belgique |
+ 0,4 |
|
Canada |
+ 0,2 |
|
Danemark |
+ 5,5 |
|
Finlande |
+ 2,0 |
|
France |
+ 1,7 |
|
Allemagne |
- 4,2 |
|
Irlande |
- 1,7 |
|
Italie |
- 0,3 |
|
Luxembourg |
- 4,0 |
|
Pays-Bas |
- 2,0 |
|
Norvège |
+ 0,5 |
|
Portugal |
+ 2,2 |
|
Espagne |
- 1,4 |
|
Suède |
+ 3,9 |
|
Royaume-Uni |
0 |
|
États-Unis |
- 1,3 |
|
Écart moyen à la moyenne |
1,95 |
Huit pays sur dix-sept sont proches de cet écart moyen , mais cinq pays occupent une position plus de deux fois excentrée par rapport à lui :
- le Danemark, la Suède et le Royaume-Uni, les deux premiers pays s'écartant par le haut , le dernier se singularisant par la valeur exactement égale à la moyenne des salaires publics ;
- l'Allemagne et le Luxembourg par le bas .
d) ... dans un contexte où le poids relatif de l'emploi public varie beaucoup
La place de l'emploi public dans l'emploi total varie nettement dans les pays de l'OCDE.
CLASSEMENT DES PRINCIPAUX PAYS DE L'OCDE
SELON LE
POIDS DE L'EMPLOI PUBLIC
(en % de l'emploi total)
|
Classement en 2002 |
Pays |
% Emploi public
|
Classement
|
Classement
|
Tendance
|
|
1 |
Suède |
30,0 |
1 |
1 |
diminution |
|
2 |
Danemark |
29,0 |
2 |
2 |
augmentation |
|
3 |
Finlande |
22,4 |
3 |
4 |
constant |
|
4 |
France |
21,2 |
4 |
5 |
constant |
|
5 |
Royaume-Uni |
17,8 |
5 |
3 |
diminution |
|
6 |
Portugal |
17,0 |
7 |
14 |
augmentation |
|
7 |
Belgique |
16,8 |
6 |
6 |
constant |
|
8 |
Luxembourg |
14,9 |
10 |
10 |
constant |
|
9 |
République Tchèque |
14,8 |
Nd |
Nd |
diminution |
|
10 |
États-Unis |
14,7 |
9 |
8 |
constant |
|
11 |
Italie |
14,4 |
8 |
7 |
diminution |
|
12 |
Espagne |
13,0 |
13 |
15 |
augmentation |
|
13 |
Autriche |
12,2 |
11 |
13 |
diminution |
|
14 |
Pologne |
12,1 |
Nd |
Nd |
diminution |
|
15 |
Grèce |
11,4 |
16 |
16 |
constant |
|
16 |
Irlande |
11,0 |
14 |
11 |
diminution |
|
17 |
Pays-Bas |
10,7 |
15 |
12 |
diminution |
|
18 |
Allemagne |
10,2 |
12 |
9 |
diminution |
|
19 |
Japon |
8,1 |
17 |
17 |
constant |
|
Moyenne (arithmétique simple) |
15,9 |
NS |
NS |
NS |
|
Source : OCDE (2003)
* Pour ce qui est des évolutions observées depuis 1982, on note que, dans près de la moitié des pays (9) , une diminution de la part de l'emploi public est intervenue, tandis que dans sept autres pays, dont la France , cette part est restée constante . Finalement, elle n'aura augmenté qu'au Danemark, au Portugal et en Espagne.
Autour d'une moyenne de 15,9 % , sept pays se situent au-dessus et douze au-dessous avec des différences de très grande amplitude. Ainsi, le Japon est 7,8 points plus bas que la moyenne et la Suède 14,1 points au-dessus.
Pour la France , elle occupe le quatrième rang par ordre décroissant du niveau relatif de l'emploi public (21,2 % de l'emploi total) avec 5,3 points de pourcentage de plus que la moyenne, soit environ un tiers d'emploi publics de plus que celle-ci.
L'écart moyen à la moyenne s'élève à 5,1 points de pourcentage soit un écart relatif, conséquent, de près de 33 %, significatif d' une forte dispersion du poids relatif de l'emploi public .
* Le niveau moyen de rémunération des emplois publics diffère assez nettement dans les pays .
Globalement, les salaires publics mobilisent une proportion des ressources plus faible que leur part dans l'emploi total. Mais, les écarts entre ces deux données sont très différents selon les pays.
INDICE DE DISTANCE ENTRE LE POIDS DES SALAIRES PUBLICS
DANS LE PIB
ET LA PART DE L'EMPLOI PUBLIC DANS L'EMPLOI TOTAL
|
Autriche |
2,6 |
|
Belgique |
4,7 |
|
Danemark |
11,2 |
|
France |
7,7 |
|
Allemagne |
2,3 |
|
Italie |
3,8 |
|
Japon |
1,4 |
|
Pays-Bas |
0,9 |
|
Espagne |
3,0 |
|
Suède |
14,2 |
|
Royaume-Uni |
7,3 |
|
États-Unis |
4,5 |
Note de lecture : en Autriche, le poids des salaires publics dans le PIB est inférieur d'un indice de 2,6 au poids de l'emploi public dans le total des emplois ; en Suède, les salaires publics sont inférieurs au poids de l'emploi public de 14,2. Plus le niveau de l'indicateur est élevé moins le niveau relatif de l'emploi public se révèle déterminant sur le niveau relatif des salaires publics.
Les données mentionnées dans le tableau ci-dessus offrent une indication sur le lien entre le niveau relatif de l'emploi public dans un pays et celui des salaires publics. Plus leur valeur est élevée moins la quantité d'emplois détermine le coût des personnels publics. Ceci est équivalent à dire que le coût par emploi est d'autant plus faible que la valeur des données du tableau est élevée.
On constate par exemple que le nombre des emplois publics en Suède et en France - qui est élevé - est une variable moins déterminante du coût des personnels publics qu'en Allemagne ou au Japon.
* Même s'il convient de ne prendre les éléments du tableau ci-dessous que comme des indicateurs, on doit relever que, s'il existe généralement une corrélation entre le niveau de la production des administrations publiques et celui de l'emploi public, cette corrélation est plutôt lâche . La dispersion de la production est nettement moins forte que celle relative à la part de l'emploi public dans le total.
RAPPROCHEMENT DE LA PRODUCTION DES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES
ET DE L'EMPLOI PUBLIC
|
Production non marchande
1
A |
Emploi public
2
B |
Écarts
|
|
|
Suède |
32,9 |
30,0 |
- 2,9 |
|
Danemark |
30,4 |
29,0 |
- 1,4 |
|
France |
30,9 |
21,2 |
- 9,7 |
|
Royaume-Uni |
27,6 |
17,8 |
- 9,8 |
|
Belgique |
31,3 |
16,8 |
- 14,5 |
|
États-Unis |
29,9 |
14,7 |
- 15,2 |
|
Italie |
29,7 |
14,4 |
- 15,3 |
|
Espagne |
25,7 |
13,0 |
- 12,7 |
|
Autriche |
29,4 |
12,2 |
- 17,2 |
|
Allemagne |
24,7 |
10,2 |
- 14,5 |
|
Japon |
26,7 |
8,1 |
- 18,6 |
1 En 2004.
2 En 2002.
Note de lecture : dans la première colonne, on recense le niveau de la production non marchande des administrations publiques approchée par les dépenses publiques hors dépenses de protection sociale ; dans la deuxième, on indique le poids relatif de l'emploi public dans l'emploi total ; la troisième colonne relève les différences par pays entre le deuxième et le premier chiffre. Il s'agit plus d'indicateurs que de mesures précises, mais ils donnent un aperçu du contenu en emplois de la production non marchande publique. Plus il est faible (plus le nombre est élevé), moins le contenu en emplois de la production non marchande est fort.
Autrement dit, des pays ayant des niveaux de production publique analogue assurent cette production en mobilisant des fractions de l'emploi national qui sont très diversifiées .
Ainsi, en France et aux États-Unis, la production des administrations publiques ne diffère que de l'ordre de 1 point de PIB alors que la part de l'emploi public est plus élevée dans le premier pays de 6,5 points en pourcentage.
Il semble donc que la productivité de l'emploi public diffère assez nettement dans les pays concernés .
Toutefois, une telle conclusion ne peut être entièrement validée qu'après avoir considéré le niveau relatif des consommations intermédiaires. En effet, celles-ci peuvent recouvrir des prestations de services qui viennent se substituer à ceux rendus par les personnels .
e) Une dispersion plus forte des consommations intermédiaires
Le panorama des dépenses totales de consommation publique diffère de celui de sa composante salariale , avec notamment une dispersion des niveaux de consommation publique plus forte que celle des salaires publics .
Cette situation vient des consommations intermédiaires des administrations publiques qui sont plus différenciées .
CONSOMMATIONS INTERMÉDIAIRES - EN 2002
|
Niveau en points de PIB |
|
|
Autriche |
4,3 |
|
Belgique |
3,8 |
|
Canada |
8,8 |
|
Danemark |
8,4 |
|
France |
5,1 |
|
Allemagne |
4,1 |
|
Italie |
5,2 |
|
Japon |
3,5 |
|
Pays-Bas |
7,1 |
|
Espagne |
4,4 |
|
Suède |
10,0 |
|
Royaume-Uni |
10,5 |
|
États-Unis |
7,8 |
|
Zone euro |
4,9 |
|
Écart moyen à la moyenne
|
6,1 |
Appréciée pays par pays, la dispersion des consommations intermédiaires diffère parfois de celle de l'emploi public.
En effet, certains pays recourent davantage que d'autres à l'externalisation de fonctions autrement directement assurées par des agents publics.
SITUATION DES PRINCIPAUX PAYS DE L'OCDE
AU REGARD
DES CONSOMMATIONS INTERMÉDIAIRES
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES EN
2006
(en points de PIB)
|
Écart à la moyenne |
|
|
Autriche |
- 2,0 |
|
Belgique |
- 2,9 |
|
Canada |
+ 2,4 |
|
Danemark |
+ 2,0 |
|
Finlande |
+ 2,7 |
|
France |
- 1,3 |
|
Allemagne |
- 2,3 |
|
Irlande |
- 1,5 |
|
Italie |
- 1,2 |
|
Luxembourg |
- 3,4 |
|
Pays-Bas |
+ 0,7 |
|
Norvège |
- 0,3 |
|
Portugal |
- 2,4 |
|
Espagne |
- 1,5 |
|
Suède |
+ 3,0 |
|
Royaume-Uni |
+ 5,2 |
|
États-Unis |
+ 1,9 |
|
Moyenne |
2,05 |
Avec un écart moyen de 2,05 points de PIB, le niveau relatif des différences atteint près de 37 % ce qui témoigne d'un recours assez diversifié à des biens et services extérieurs dans les productions publiques des pays.
- Pour certains pays, le niveau relatif des consommations intermédiaires et des salaires va dans le même sens tandis que pour d'autres une compensation paraît intervenir. Ainsi, le dosage entre rémunérations publiques et consommations intermédiaires varie selon les pays. Aux Pays-Bas, le niveau des rémunérations publiques est relativement faible, au contraire, le montant des consommations intermédiaires est relativement élevé .
Ceci peut témoigner parfois d'une sorte d'arbitrage traduisant des choix d'externalisation plus ou moins forte des productions des administrations publiques.
2. L'investissement des administrations publiques, une place réduite et diversifiée
Entre 1995 et 2006, l'investissement des administrations publiques stagne globalement.
La France qui enregistre, pour sa part, un niveau relativement élevé d'investissement public, est un des rares pays où celui-ci augmente légèrement en glissement.
INVESTISSEMENTS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
DANS
LES PRINCIPAUX PAYS DE L'OCDE
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (FBCF) ET
ACQUISITIONS NETTES
(en % du PIB)
|
1995 |
2006 |
Variation
|
|||
|
A |
dont FBCF |
B |
dont FBCF |
||
|
Australie |
2,36 |
2,36 |
Nd |
- |
Nd |
|
Autriche |
2,82 |
3,0 |
0,82 |
1,06 |
- 2,7 |
|
Belgique |
1,8 |
1,91 |
1,56 |
1,68 |
- 0,14 |
|
Canada |
2,67 |
2,64 |
2,79 |
2,79 |
+ 0,12 |
|
Danemark |
1,74 |
1,77 |
1,81 |
1,92 |
- 0,07 |
|
Finlande |
2,81 |
2,68 |
2,27 |
2,44 |
- 0,54 |
|
France |
3,37 |
3,18 |
3,5 |
3,35 |
+ 0,13 |
|
Allemagne |
2,1 |
2,18 |
1,35 |
1,41 |
- 0,75 |
|
Irlande |
2,29 |
2,29 |
3,72 |
3,72 |
+ 1,43 |
|
Italie |
2,12 |
2,06 |
2,31 |
2,29 |
+ 0,19 |
|
Corée |
4,92 |
4,71 |
Nd |
Nd |
Nd |
|
Luxembourg |
3,88 |
3,84 |
4,35 |
3,98 |
+ 0,47 |
|
Pays-Bas |
2,86 |
3,16 |
2,82 |
3,26 |
0 |
|
Nouvelle-Zélande |
2,35 |
2,31 |
Nd |
Nd |
Nd |
|
Norvège |
3,17 |
3,17 |
2,58 |
2,7 |
- 0,59 |
|
Espagne |
3,82 |
3,73 |
3,74 |
3,76 |
- 0,08 |
|
Suède |
3,76 |
3,88 |
2,94 |
3,07 |
- 0,82 |
|
Suisse |
3,19 |
3,2 |
Nd |
Nd |
Nd |
|
Royaume-Uni |
2,0 |
2,02 |
1,78 |
1,85 |
- 0,22 |
|
États-Unis |
2,33 |
2,34 |
2,53 |
2,54 |
+ 0,20 |
C. EN FRANCE, UNE PRODUCTION PUBLIQUE FORTEMENT UTILISATRICE D'UNE MAIN-D'oeUVRE RELATIVEMENT PEU RÉMUNÉRÉE
Le niveau des consommations publiques en France est souvent stigmatisé comme particulièrement élevé dans le cadre d'observations plus générales sur l'importance des dépenses publiques dans notre pays.
Les données internationales observées dans le présent chapitre obligent à apporter de sérieuses nuances à ce point de vue .
Globalement, le niveau des consommations publiques n'est, en France, que très légèrement supérieur à ce qu'il est dans les pays les plus développés du monde . La France y consacre 18,3 % de son PIB contre 17,9 % pour ces pays, soit + 0,4 point. Elles représentent environ un tiers de nos dépenses publiques, soit moins que le niveau constaté dans l'OCDE.
Par ailleurs, ces consommations ont évolué moins vite que le PIB ces dix dernières années si bien que leur « poids » a été réduit de 0,5 point de PIB, contribuant majoritairement à la légère décrue des dépenses publiques constatée en France au cours de cette période.
Cette situation proche de la moyenne coexiste avec l'existence en France d' un niveau relatif des emplois publics dans le total de l'emploi particulièrement élevé puisque supérieur de 5,3 points à la moyenne des pays comparables. Mais, cet indicateur n'a pas de prolongements à due proportion dans le niveau relatif des salaires publics en France qui n'est supérieur que de 1,7 point à la moyenne européenne .
Cette discordance invite à quelques conclusions d'étape.
- La mesure du poids de l'emploi public à travers son niveau relatif dans l'emploi total est un indicateur imparfait.
Elle peut révéler ou non un développement excessif de l'emploi public en fonction des particularités propres des emplois publics et des emplois privés.
Le haut niveau de productivité des emplois privés en France, qui est une des particularités de notre pays révélée par les comparaisons internationales, joue, sans doute, de ce point de vue un rôle important. Il s'explique d'ailleurs sans doute par le fait qu'un certain nombre de secteurs où le niveau de productivité du travail est, structurellement, faible sont collectifs dans notre pays et privés dans d'autres.
Au demeurant, la productivité unitaire dans le secteur public ressort en France comme relativement faible.
- Ces caractéristiques ont un fort impact sur les salaires publics . Les emplois publics peuvent être relativement nombreux en France, la masse des salaires n'est pas supérieure à la moyenne à due proportion.
La faiblesse relative des salaires individuels compense l'effet quantité lié au nombre d'emplois publics. Elle n'est évidemment pas sans relation avec le niveau de la productivité des emplois publics.
Il n'est est pas moins vrai que les coûts salariaux sont plus élevés au total que dans le reste de l'OCDE , la différence étant plus particulièrement nette avec les pays de la zone euro . Mais, ce constat ne peut conduire à conclure que notre pays « gaspillerait » de ce fait des ressources .
- La France connaît un niveau de salaires publics supérieur de 1,7 point par rapport à la moyenne des pays européens et se trouve au cinquième rang avec un niveau relatif des salaires publics supérieur de 15 % par rapport à cette moyenne.
L'écart avec les seuls pays de la zone euro est plus élevé. Il atteint 2,7 points de PIB en 2005 avec des salaires publics de 13,3 points de PIB en France contre 10,6 points dans la zone euro.
SALAIRES PUBLICS BRUTS
ÉCARTS AVEC LA ZONE
EURO EN 2005
(en points de PIB)
|
France |
Zone euro |
Écart |
|
|
Défense et ordre public |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
|
Services publics généraux |
2,1 |
1,7 |
0,4 |
|
Enseignement |
4,3 |
3,4 |
0,9 |
|
Santé |
2,3 |
1,5 |
0,8 |
|
Autres |
2,6 |
2,0 |
0,6 |
|
Total |
13,3 |
10,6 |
2,7 |
Source : OCDE, Comptes nationaux, CFAP.
C'est pour l'enseignement et la santé que le supplément de salaires est le plus accusé en valeur relative par rapport à la zone euro.
- Est-ce à dire que cette situation révèlerait un gaspillage de ressources ?
Pour esquisser une réponse, il faut partir du constat que les écarts observés correspondent à un écart de production publique favorable à la France .
Pour dix pays de la zone euro, la moyenne de la production publique s'élève à 16,8 points de PIB quand, en France, elle est estimée à 21,1 points de PIB.
Le supplément de production publique en France est ainsi de 4,3 points de PIB, supérieur au supplément des salaires publics que connaît notre pays (qui n'est que de 2,7 points de PIB) .
Ainsi, le coût unitaire du travail dans le secteur public ressort comme particulièrement faible en France .
Tout en s'accordant sur ce constat, on pourrait cependant prétendre que le niveau globalement élevé des salaires publics témoignerait, en soi, d'une allocation excessive de moyens aux productions qui mobilisent ces emplois publics. Mais, cette conclusion serait hâtive.
En effet, il faut corriger les données sur lesquelles elle s'appuie, afin de tenir compte du taux de couverture des besoins par les administrations publiques qui varie sensiblement selon les pays, et considérer le niveau des ressources totales consacrées à ces fonctions.
Cette correction ne peut être entreprise pour l'ensemble des domaines d'intervention publique mais elle est possible pour deux postes de dépenses publiques : la santé et l'éducation (qui représentent un peu plus du quart des dépenses publiques et un peu plus de la moitié des dépenses publiques correspondant à la production des biens et services publics).
DÉPENSES PRIVÉES POUR QUELQUES FONCTIONS (EN POINTS DE PIB)
|
France |
Allemagne |
Pays-Bas |
États-Unis |
|
|
Santé |
2,3 |
2,7 |
3,3 |
7,7 |
|
Éducation |
0,5 |
0,9 |
0,4 |
2,1 |
|
Total |
2,8 |
3,6 |
3,7 |
9,8 |
Source : données OCDE.
Le tableau ci-dessus compare les dépenses privées de santé et d'éducation en France et dans quelques pays développés. La France connaît un niveau moins élevé des dépenses privées, à hauteur de 0,8 point de PIB par rapport à l'Allemagne, 0,9 par rapport aux Pays-Bas et 7 points de PIB par rapport aux États-Unis.
Ces écarts sont imputables pour une partie sans doute très importante à des salaires privés plus élevés qu'en France. Moyennant quelque approximation, on peut déduire ces écarts de ceux observés en matière de salaires publics entre ces pays et la France pour apprécier une éventuelle surconsommation des salaires publics.
ÉCARTS DES COÛTS SALARIAUX PAR
FONCTION
ENTRE LA FRANCE ET QUELQUES PAYS (EN POINTS DE PIB)
|
Écarts de salaires publics
|
Écarts de dépenses
privées*
|
Total |
|||||||
|
Allemagne |
Pays-Bas |
États-Unis |
Allemagne |
Pays-Bas |
États-Unis |
Allemagne |
Pays-Bas |
États-Unis |
|
|
France |
+ 5,6 |
+ 3,7 |
+ 3,3 |
- 0,8 |
- 0,9 |
- 7,0 |
+ 4,8 |
+ 2,8 |
- 3,7 |
* Dans les seuls deux domaines de la santé et de l'éducation.
L'intégration des coûts privés engagés pour satisfaire des besoins analogues à ceux couverts par les administrations publiques réduit les différences des coûts salariaux entre la France et l'Allemagne et les Pays-Bas , deux des pays européens où les coûts salariaux publics sont les plus bas. Avec les États-Unis, non seulement l'écart est réduit, mais encore il change de sens .
*
* *
Au total, il apparaît que seule une évaluation rigoureuse des processus de production publique combinée avec une évaluation de l'utilité des différents biens et services publics permettrait d'affirmer qu'il existe un excès de salaires publics dans l'économie française.
III. LA DÉCOMPOSITION FONCTIONNELLE DES DÉPENSES PUBLIQUES : LA PRÉDOMINANCE DES FONCTIONS NON-RÉGALIENNES
Depuis quelques années, les données traditionnelles de la Comptabilité nationale sont enrichies par la présentation des dépenses publiques selon une décomposition par fonction, en dix catégories d'intervention (voir l'encadré ci-dessous pour la méthode appliquée).
|
LA RÉPARTITION DES DÉPENSES PUBLIQUES PAR
FONCTION :
Les dépenses des administrations publiques sont ventilées suivant une nomenclature internationale définie dans le chapitre XVIII du système des comptes nationaux (SCN) de 1993 et révisée en 1999 : la COFOG (Classification of the Functions of Government). Cette nomenclature répartit les dépenses administrations publiques en dix catégories selon leur finalité. Aux difficultés inhérentes à la détermination des dépenses publiques, déjà abordées, s'ajoutent ici les problèmes de répartition des dépenses par fonction . Dans le cadre du présent rapport, on ne peut tous les énumérer (au demeurant, il n'en existe pas de recension systématique à la connaissance de votre rapporteur). Mais, on peut en fournir quelques exemples tirés de la littérature ou des entretiens de votre rapporteur. * Les dépenses d'intérêt de la dette , lorsque la finalité de ces dépenses ne peut être distinguée, sont comptabilisées dans la fonction « services publics généraux » alors que les intérêts payés par les administrations de sécurité sociale sont répartis entre santé et protection sociale. * L'affectation des dépenses de transfert (transferts courants ou en capital) est faite suivant la dépense qu'elle finance lorsqu'elle est connue. Dans le cas contraire, elle figure conventionnellement en « services publics généraux ». C'est le cas de la dotation globale de fonctionnement (DGF) versée par l'État aux collectivités locales. * Le partage entre dépenses de santé et de protection sociale est délicat et peut nuire à la comparabilité des résultats internationaux. Sont comptabilisés, dans les chiffres français : - en santé : les dépenses concernant la prise en charge des soins de santé, soit les prestations en nature ; - en protection sociale : les transferts en espèces aux ménages destinés à compenser les pertes de revenus dues à la maladie et aux accidents de travail (indemnités journalières). * Pour les dépenses consacrées à la Défense, un problème d'imputation des soutiens aux industries peut exister puisque certaines de ces interventions peuvent être classées dans le groupe des dépenses consacrées aux affaires économiques. * Les dépenses de recherche-développement sont tantôt classées dans le groupe des dépenses d'enseignement, tantôt dans d'autres catégories. La nomenclature de classement fonctionnel des dépenses publiques peut être sommairement présentée comme suit :
* la division intitulée
«
services généraux des administrations
publiques
» couvre les dépenses relatives aux organes
exécutifs et législatifs, aux affaires financières et
fiscales, aux affaires étrangères, à l'aide
économique extérieure, aux services
* la fonction « défense » couvre à la fois la défense militaire civile, l'aide militaire à l'étranger et la recherche et le développement expérimental dans le domaine de la défense nationale. * les dépenses consacrées à l' ordre et à la sécurité publics couvrent essentiellement les services de police et de protection contre l'incendie, les tribunaux et les prisons. * la catégorie « affaires économiques » couvre les programmes de soutien, les subventions et les dépenses d'infrastructure en faveur des industries extractives et manufacturières, de l'agriculture, du secteur énergétique, de la construction, des transports, des communications et des autres branches de service. * les dépenses consacrées à la protection de l'environnement regroupent essentiellement la gestion des déchets (y compris la gestion des eaux usées), la lutte contre la pollution, la préservation de la diversité biologique et la protection de la nature, ainsi que les dépenses de R&D correspondantes. * les dépenses consacrées aux logements et aux équipements collectifs couvrent la construction de logements, la mise à disposition d'équipements collectifs, l'alimentation en eau et l'éclairage public. Mais, les aides au logement octroyées aux ménages ne sont pas classées dans cette fonction mais dans la « protection sociale ». * les dépenses consacrées à la santé couvrent les dépenses des administrations publiques relatives aux produits médicaux, appareils et équipements médicaux, services ambulatoires, services hospitaliers, services de santé publique et R&D dans le domaine de la santé. * les dépenses consacrées à l' enseignement abritent les charges publiques liées aux différents niveaux d'enseignement (préprimaire, primaire, secondaire, supérieur non universitaire et universitaire), ainsi que les services d'enseignement non définis selon les degrés et les services subsidiaires. Elle couvre également la R&D réalisée dans le domaine enseignant. * les dépenses consacrées aux loisirs, à la culture et au culte sont les services récréatifs et sportifs, les services culturels, les services de radiodiffusion et d'édition, les services religieux et les autres services « communautaires ». * Enfin, la catégorie des dépenses de protection sociale regroupe les dépenses consacrées à la maladie et à l'invalidité, à la vieillesse, à la survie, à la famille et aux enfants, au chômage, au logement, aux autres formes d'exclusion sociale ainsi qu'à la R&D dans le domaine de la protection sociale. |
Le cumul des dépenses des fonctions « Protection sociale » et « Santé » regroupe plus de la moitié des dépenses publiques en Europe (53,5 %). Avec l'« Enseignement », l'ensemble représente plus de deux tiers des dépenses publiques .
L'intervention publique concerne donc principalement aujourd'hui des « fonctions non-régaliennes ». Ce phénomène général invite à considérer avec un certain scepticisme les recommandations de « recentrer » l'État sur ses fonctions régaliennes (justice, diplomatie, sécurité...) . Mais, en même temps, il explique pourquoi il existe entre pays des différences de degré d'intervention publique. En effet, dans ces domaines, il peut y avoir une certaine substituabilité entre dépenses publiques et dépenses privées 15 ( * ) .
COMPARAISON EUROPÉENNE DES STRUCTURES DE
DÉPENSES
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR FONCTION (EN % DU
TOTAL)
|
France |
UE25 |
Allemagne |
Espagne |
Italie |
Pologne |
Royaume Uni |
Suède |
|
|
Protection sociale |
41,2 |
40,1 |
46,5 |
33,9 |
37,2 |
42,7 |
37,3 |
42,4 |
|
Services publics généraux |
13,9 |
14,1 |
13,0 |
13,3 |
18,3 |
13,2 |
10,9 |
14,1 |
|
Santé |
13,5 |
13,4 |
13,4 |
13,6 |
13,1 |
9,7 |
15,5 |
12,4 |
|
Enseignement |
12,0 |
11,3 |
8,7 |
11,5 |
10,6 |
13,7 |
13,2 |
12,5 |
|
Affaires économiques |
6,0 |
8,4 |
8,1 |
11,2 |
8,5 |
7,4 |
6,7 |
8,4 |
|
Défense |
3,6 |
3,6 |
2,5 |
2,9 |
3,1 |
2,7 |
6,2 |
3,6 |
|
Logement et équip t . collectifs |
3,4 |
2,1 |
2,3 |
2,9 |
1,4 |
3,4 |
1,4 |
1,5 |
|
Loisirs, culture et culte |
2,6 |
2,1 |
1,4 |
3,7 |
1,9 |
2,0 |
1,4 |
1,9 |
|
Ordre et sécurité publics |
2,4 |
3,6 |
3,3 |
4,7 |
4,1 |
3,8 |
5,8 |
2,4 |
|
Protection de l'environnement |
1,4 |
1,3 |
0,8 |
2,3 |
1,8 |
1,4 |
1,6 |
0,8 |
|
Total |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
* De façon générale, la décomposition moyenne des dépenses publiques en Europe permet de constater hors dépenses de « Protection sociale » (40,1 % du total), la concentration des autres dépenses publiques dans trois catégories d'importance analogue : les « Services publics généraux » (14,1 % du total des dépenses publiques et 23,4 % des dépenses hors protection sociale), la « Santé » (respectivement 13,4 % et 22,4 %) et l'« Enseignement » (respectivement 11,3 % et 18,9 %).
Les dépenses dites d'« Affaires économiques » représentent un peu plus d'un dixième de l'ensemble des dépenses hors protection sociale (14 %) et la « Défense », 5,9 % des dépenses publiques.
ÉCARTS À LA STRUCTURE MOYENNE DES
DÉPENSES PUBLIQUES
DANS L'UNION EUROPÉENNE PAR FONCTION
(EN % DU TOTAL)
|
France |
Allemagne |
Espagne |
Italie |
Pologne |
Royaume Uni |
Suède |
|
|
Protection sociale |
+ 1,1 |
+ 6,4 |
- 6,2 |
- 2,9 |
+ 1,5 |
- 2,8 |
+ 1,2 |
|
Services publics généraux |
- 0,2 |
- 1,1 |
- 0,8 |
+ 4,2 |
- 0,9 |
- 3,2 |
0 |
|
Santé |
- 0,1 |
0 |
+ 0,2 |
- 0,3 |
- 3,7 |
+ 2,1 |
- 1,0 |
|
Enseignement |
+ 0,7 |
- 2,6 |
+ 0,2 |
- 0,7 |
+ 2,4 |
+ 1,9 |
+ 1,2 |
|
Affaires économiques |
- 2,4 |
- 0,3 |
+ 2,8 |
+ 0,1 |
- 1,0 |
- 1,7 |
0 |
|
Défense |
0 |
- 1,1 |
- 0,7 |
- 0,5 |
- 0,9 |
+ 2,6 |
0 |
|
Logement et équipements collectifs |
+ 1,3 |
+ 0,2 |
+ 0,8 |
- 0,7 |
+ 1,3 |
- 0,7 |
- 0,6 |
|
Loisirs, culture et culte |
+ 0,5 |
- 0,7 |
+ 1,6 |
- 0,2 |
- 0,1 |
- 0,7 |
- 0,2 |
|
Ordre et sécurité publics |
- 1,2 |
- 0,3 |
+ 1,1 |
+ 0,5 |
+ 0,2 |
+ 2,2 |
- 1,2 |
|
Protection Environnement |
+ 0,1 |
- 0,5 |
+ 1,0 |
+ 0,5 |
+ 0,1 |
+ 0,3 |
- 0,5 |
* Cette structure moyenne des dépenses publiques est largement partagée dans tous les pays de l'Union. Hors le champ de la protection sociale, la dispersion des choix d'intervention publique est faible .
Pour l'échantillon présenté ici, les écarts maximaux de 6,4 points (en plus) et 6,2 points (en moins) observés en Allemagne et en Espagne respectivement, relativement à la « Protection sociale » une fois écartés , les autres différences par rapport à la structure moyenne apparaissent minimes :
- le Royaume-Uni se singularise un peu, avec une plus faible proportion des dépenses publiques consacrées à la « Protection sociale » et aux « Services publics généraux » et, en contrepartie, davantage allouées à la « Santé », à la « Défense » et à « l'Ordre et à la Sécurité publics ». Encore peut-on supposer que ces différences proviennent, pour une part, de problèmes de classement purement statistiques entre dépenses de « Protection sociale » et de « Santé », et de « Services généraux », de « Défense » et d'« Ordre et de Sécurité publics » ;
- l'Allemagne se distingue par la proportion relativement faible de ses dépenses d'éducation dans l'ensemble (16,2 % du total des dépenses hors protection sociale contre 18,9 % en moyenne) ;
- l'Italie alloue relativement beaucoup de moyens aux services publics généraux, mais on sait que cette situation est en partie attribuable au niveau des dépenses d'intérêt.
* Au niveau de l'OCDE, on retrouve ces ordres de grandeur avec quelques nuances. Pour les principaux pays de l'OCDE, la protection sociale absorbe une proportion moins élevée ( 37,7 %) des dépenses publiques, la santé 14,3 % ( 52 % du total pour ces deux fonctions ). L' enseignement concentre environ 5,5 % du total des dépenses publiques soit 57,7 % des dépenses publiques pour ces trois catégories, soit moins que leur niveau relatif en Europe.
Malgré un niveau des dépenses publiques plus élevé que la moyenne, la France a une structure de ces dépenses publiques proche de la structure moyenne des dépenses publiques en Europe.
IV. LES DÉPENSES PUBLIQUES EN FRANCE, MÊMES PRIORITÉS FONCTIONNELLES QU'AILLEURS MAIS UN NIVEAU RELATIVEMENT PLUS ÉLEVÉ SURTOUT POUR LA PROTECTION SOCIALE
A. LA RÉPARTITION FONCTIONNELLE DES DÉPENSES PUBLIQUES EN FRANCE
1. Une structure marquée, comme ailleurs, par la prédominance de trois fonctions : protection sociale, santé, éducation
En France, la structure des dépenses publiques est marquée par la prédominance des dépenses de protection sociale : avec 22 points de PIB en 2003, elles représentent 41,2 % du total des dépenses publiques. Les dépenses de pensions s'élèvent à 58,2 % du total des dépenses publiques sociales, soit 12,8 points de PIB (voir le chapitre suivant pour une décomposition détaillée).
Les services publics généraux représentent 13,8 % du total des dépenses publiques et 7,4 points de PIB. Une partie importante ( 35,8 % en 2005) de ces dépenses provient du versement des intérêts , notamment de la dette publique. Les interventions publiques financées sous cette catégorie englobante sont très diversifiées : fonctionnement des organes exécutifs et législatifs, collecte de l'impôt... et ne mobilisent une par une qu'une modeste portion du total des dépenses publiques .
Au troisième rang , on trouve une fonction qui est, elle, homogène ; la santé avec 7,2 points de PIB en 2003, et 13,5 % du total des dépenses publiques .
Suivent les dépenses d'enseignement : 6,4 points de PIB en 2003, et 12 % des dépenses publiques .
Au total, les quatre catégories mentionnées ci-dessus représentent 80,5 % des dépenses publiques et un montant de ressources équivalent à 43 points de PIB .
Les six autres catégories d'intervention publique ne mobilisent qu'un peu moins de 20 % du total des dépenses publiques , soit 10,4 points de PIB en 2003.
Les dépenses publiques correspondant à la catégorie des « Affaires économiques » représentent le premier poste des dépenses publiques qui constituent ce reliquat, et le cinquième de l'ensemble des catégories d'intervention. Elles s'élèvent à 3,2 points de PIB et 6 % du total , mais une partie d'entre elles pourrait aussi bien relever d'autres fonctions comme celle liée à la compensation des exonérations de cotisations sociales versées aux caisses de sécurité sociale.
La défense , souvent présentée comme mobilisant une proportion considérable des dépenses publiques - elle était de fait, l'un des plus importants budgets de l'État - se révèle assez seconde dans ce panorama. En 2003, elle concentre 3,6 % du total des dépenses publiques, soit environ 1,9 point de PIB.
Les ressources consacrées à l'intervention publique pour couvrir les loisirs, la culture et les cultes ( 2,6 % du total des dépenses publiques et 1,4 point de PIB) sont légèrement supérieures à celles représentatives des nécessités de l'ordre et de la sécurité publics ( 2,4 % du total et 1,3 point de PIB).
Ces deux catégories sont devancées par les moyens publics consacrés aux « équipements » et au « logement » qui s'élèvent à 1,8 point de PIB, soit 3,4 % du total des dépenses publiques. Ces dépenses ne recouvrent pas l'ensemble de l'effort public réalisé pour le logement dont une partie est retracée dans la fonction de protection sociale et une autre dans les « affaires économiques ».
Enfin, la « protection de l'environnement » ferme la marche avec 0,8 point de PIB et 1,5 % du total des dépenses publiques .
2. Le renforcement de la place de la protection sociale et de la santé
L'évolution des différentes catégories de dépenses publiques a été différenciée au cours de la décennie 1995-2005.
ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DES
DÉPENSES PUBLIQUES PAR FONCTION
ENTRE 1995 ET 2005
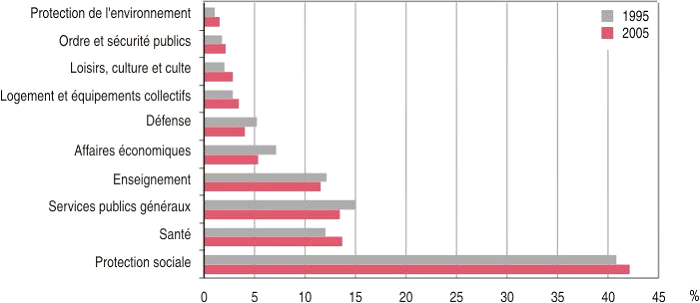
Source : INSEE, comptes nationaux base 2000
Leur répartition par fonction s'est légèrement déformée au profit de l'environnement, de l'ordre et de la sécurité publics, des loisirs, de la culture et des cultes, du logement et des équipements collectifs, de la santé et de la protection sociale et au détriment de la défense, des dépenses d'intervention économique, de l'éducation et des services publics généraux.
3. Une structure fonctionnelle des dépenses publiques qui correspond à la primauté des dépenses de transferts
Le croisement des données de la Comptabilité nationale traditionnelle relatives à la nature des dépenses publiques et de celles relatives aux domaines fonctionnels de l'intervention publique permet d'appréhender plus finement les moyens mobilisés par chaque catégorie de l'intervention publique.
RÉPARTITION DES DÉPENSES DES
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (APU)
PAR NATURE ET FONCTION EN 2005
(en %)
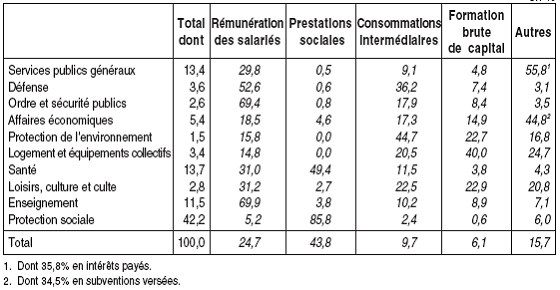
Source : INSEE, comptes nationaux base 2000
Dans les différentes fonctions exercées par les administrations publiques, les prestations sociales occupent une place majoritaire avec 43,8 % du total des dépenses publiques mobilisées. Comme une partie elle-même majoritaire du poste « Autres » est constituée de transferts, on retrouve la prédominance de l'activité de répartition du revenu dans le total des dépenses publiques .
Les salaires publics (24,7 % du total) occupent une place plus ou moins importante dans chaque fonction ; plus de la moitié de l'effort de défense y est consacrée ; dans l'enseignement et l'ordre et la sécurité publics, cette proportion tangente 70 %. Ce poste de dépenses est, en revanche, beaucoup moins sollicité dans les fonctions de « services publics généraux », de « santé » et de « loisirs, culture et cultes » avec un peu moins d'un tiers des moyens engagés.
B. UN NIVEAU DE DÉPENSES PUBLIQUES RELATIVEMENT ÉLEVÉ PRINCIPALEMENT DU FAIT DE LA PROTECTION SOCIALE
1. Un niveau de dépenses publiques relativement élevé...
a) Par rapport à l'Union européenne
Le poids des dépenses publiques est, en France , nettement supérieur à ce qu'il est dans l'Union européenne à 25. Avec 53,4 % du PIB en 2003 , la France occupait le quatrième rang dans un ensemble où, en moyenne , les dépenses publiques représentaient 47,6 % du PIB soit un surplus des dépenses publiques de 5,8 points de PIB . Les comparaisons établies dans le cadre de la seule Union européenne à 15 donnent des résultats du même ordre.
COMPARAISON EUROPÉENNE DES DÉPENSES DES
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
PAR FONCTION (2003) - EN POINTS DE PIB
|
France |
Rang |
UE
|
Allemagne |
Espagne |
Italie |
Pologne |
Royaume Uni |
Suède |
|
|
Protection sociale |
22,0 |
4 |
19,1 |
22,5 |
13,0 |
17,9 |
19,0 |
16,1 |
24,7 |
|
Services publics généraux |
7,4 |
11 |
6,7 |
6,3 |
5,1 |
8,8 |
5,9 |
4,7 |
8,2 |
|
Santé |
7,2 |
1 |
6,4 |
6,5 |
5,2 |
6,3 |
4,3 |
6,7 |
7,2 |
|
Enseignement |
6,4 |
6 |
5,4 |
4,2 |
4,4 |
5,1 |
6,1 |
5,7 |
7,3 |
|
Affaires économiques |
3,2 |
24 |
4,0 |
3,9 |
4,3 |
4,1 |
3,3 |
2,9 |
4,9 |
|
Défense |
1,9 |
5 |
1,7 |
1,2 |
1,1 |
1,5 |
1,2 |
2,7 |
2,1 |
|
Logement et équip t . collectifs |
1,8 |
3 |
1,0 |
1,1 |
1,1 |
0,7 |
1,5 |
0,6 |
0,9 |
|
Loisirs, culture et culte |
1,4 |
6 |
1,0 |
0,7 |
1,4 |
0,9 |
0,9 |
0,6 |
1,1 |
|
Ordre et sécurité publics |
1,3 |
22 |
1,7 |
1,6 |
1,8 |
2,0 |
1,7 |
2,5 |
1,4 |
|
Protection de l'environnement |
0,8 |
9 |
0,7 |
0,5 |
0,9 |
0,8 |
0,6 |
0,7 |
0,3 |
|
Total |
53,4 |
4 |
47,6 |
48,4 |
38,3 |
48,1 |
44,5 |
43,2 |
58,2 |
Source : Eurostat ; Insee, comptes nationaux base 2000.
b) Par rapport aux pays de l'OCDE
Par rapport aux pays de l'OCDE où les dépenses publiques sont les plus basses (hors le Japon), l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis..., la France connaît des dépenses publiques supérieures de l'ordre de 17 points de PIB , soit 1,5 fois le niveau de ces pays.
RÉPARTITION DES DÉPENSES PUBLIQUES PAR
FONCTION EN 2004
DANS LES PRINCIPAUX PAYS DE L'OCDE (EN % DU
PIB)
|
Autriche |
Belgique |
Danemark |
France |
Allemagne |
Irlande |
Italie |
Portugal |
Espagne |
Royaume-Uni |
Suède |
États-Unis |
Moyenne |
Écart France/
|
|
|
Protection sociale |
20,8 |
17,6 |
22,6 |
22,5 |
22,0 |
9,5 |
17,9 |
15,7 |
12,9 |
15,9 |
23,3 |
7,0 |
17,3 |
5,2 |
|
Santé |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,2 |
6,1 |
7,4 |
6,3 |
7,3 |
5,7 |
7,1 |
6,8 |
7,4 |
6,9 |
0,3 |
|
Éducation |
5,9 |
6,0 |
7,9 |
6,1 |
4,2 |
4,3 |
5,1 |
7,6 |
4,3 |
5,8 |
7,1 |
6,2 |
5,9 |
0,2 |
|
Services publics généraux |
7,0 |
8,9 |
6,8 |
7,3 |
6,1 |
3,7 |
8,8 |
6,8 |
4,7 |
4,9 |
7,5 |
4,9 |
6,5 |
0,8 |
|
Défense |
0,9 |
1,1 |
0,5 |
1,9 |
1,1 |
0,5 |
1,5 |
1,4 |
1,1 |
2,5 |
1,7 |
4,2 |
1,5 |
0,4 |
|
Ordre et sécurité |
1,4 |
1,6 |
1,0 |
1,4 |
1,6 |
1,5 |
2,0 |
2 |
1,8 |
2,6 |
1,3 |
2,1 |
1,7 |
- 0,3 |
|
Affaires économiques |
5,0 |
4,8 |
3,6 |
2,9 |
3,6 |
4,5 |
4,1 |
4,4 |
4,8 |
2,8 |
5 |
3,8 |
4,1 |
- 1,2 |
|
Environnement |
0,4 |
0,6 |
0,5 |
0,8 |
0,3 |
0,6 |
0,8 |
0,6 |
0,9 |
1,0 |
0,4 |
0,6 |
0,6 |
0,2 |
|
Logement et équipements collectifs |
0,5 |
0,3 |
0,6 |
1,8 |
1,1 |
1,4 |
0,7 |
0,6 |
0,8 |
0,9 |
0,4 |
0,6 |
0,8 |
1,0 |
|
Loisirs, culture et cultes |
1,0 |
1,3 |
1,6 |
1,5 |
0,6 |
0,5 |
0,9 |
1,1 |
1,4 |
0,9 |
1,1 |
0,3 |
1,0 |
0,5 |
|
Sous-total
|
29,1 |
31,6 |
30,5 |
30,9 |
24,7 |
24,4 |
30,2 |
31,8 |
25,6 |
27,6 |
31,3 |
30,1 |
29,0 |
1,9 |
|
TOTAL |
49,9 |
49,2 |
53,1 |
53,4 |
46,6 |
33,9 |
48,1 |
47,5 |
38,5 |
44,4 |
54,6 |
37,1 |
46,3 |
7,1 |
Source : OCDE. Comptes nationaux annuels. Comptes des administrations publiques.
2. ... principalement du fait de la protection sociale
Le tableau ci-après décompose, par fonction, les écarts entre les dépenses publiques en France et le niveau moyen européen en 2003.
ÉCARTS ENTRE LE POIDS DES DÉPENSES
PUBLIQUES EN FRANCE ET EN EUROPE
1
PAR FONCTION
(2003)
|
En points de PIB |
En % par rapport
|
|
|
Protection sociale |
+ 2,9 |
+ 15,2 |
|
Services publics généraux |
+ 0,7 |
+ 10,4 |
|
Santé |
+ 0,8 |
+ 10,8 |
|
Enseignement |
+ 1,0 |
+ 25,5 |
|
Affaires économiques |
- 0,8 |
- 20,0 |
|
Défense |
+ 0,2 |
+ 11,8 |
|
Logement et équipements collectifs |
+ 0,8 |
+ 80,0 |
|
Loisirs, culture et culte |
+ 0,4 |
+ 40,0 |
|
Ordre et sécurité publics |
- 0,4 |
- 24,0 |
|
Protection de l'environnement |
+ 0,1 |
+ 14,3 |
|
Total |
5,7 |
+ 12,2 |
1 Europe à 25.
Il montre que ce sont les dépenses publiques de protection sociale (+ 2,9 points) qui expliquent la majeure partie du surplus de dépenses publiques que connaît la France . Plus de la moitié du surplus de dépenses publiques de la France par rapport à la moyenne européenne provient de la fonction protection sociale 16 ( * ) .
Les autres fonctions contribuant significativement à cet écart sont : l'« Enseignement » ( + 1 point ), le « Logement et les Équipements collectifs » ( + 0,8 point ) et la « Santé » ( + 0,8 point ).
* Exprimés en pourcentage, ces écarts ressortent comme plus ou moins importants.
Au total, le poids des dépenses publiques en France est supérieur de 12,2 % par rapport à la moyenne en Europe .
La protection sociale concentre 15,2 % de dépenses publiques de plus que la moyenne européenne.
Pour trois autres postes , où la France se singularise par un niveau de dépenses publiques plus élevé que la moyenne, les écarts relatifs sont les suivants :
- pour l'« Éducation », où la France n'occupe que le sixième rang, la dépense est toutefois supérieure de 25 % à la moyenne européenne ;
- pour le « Logement et les Équipements collectifs » pour lesquels la France est au troisième rang, les dépenses publiques sont supérieures de 80 % à la moyenne (+0,8 point de PIB) ;
- enfin, pour la « Santé » à laquelle la France est le pays qui consacre le plus de dépenses publiques avec 0,8 point de PIB de plus que la moyenne, c'est environ 11 % de dépenses publiques en plus de la moyenne qu'on peut constater.
CHAPITRE II - LA PROTECTION SOCIALE, DES NIVEAUX TRÈS DIVERS DE DÉPENSES PUBLIQUES, MAIS, AU TOTAL, DES PRÉLÈVEMENTS SUR LES RESSOURCES ÉCONOMIQUES PLUTÔT HOMOGÈNES
Les dépenses publiques de protection sociale représentent partout dans les pays de l'OCDE le premier poste de dépenses publiques , et de très loin.
C'est aussi la catégorie de dépenses publiques au regard de laquelle on observe, à première vue, la plus grande dispersion entre les pays de l'OCDE et, même si cette dispersion y est moins accusée, entre les pays de la seule Union européenne .
Cependant, dans ce domaine, la vision change considérablement selon l'indicateur qu'on observe .
Par exemple, si la protection sociale publique mobilise une proportion du PIB relativement proche dans les différents pays de l'Union européenne , les dynamiques nationales ont été très différenciées ces dix dernières années tandis que les dépenses sociales par habitant atteignent, quant à elles, des niveaux très variables .
Surtout, une observation fondamentale s'impose. Si la diversité des situations sur le front des dépenses publiques de protection sociale est nettement accusée , cette diversité ne reflète pas un quelconque choix des agents économiques d'allouer plus ou moins de ressources à la protection contre les risques sociaux.
En effet, lorsqu'on ajoute aux dépenses publiques à finalité sociale, les dépenses privées de même destination dans tous les pays de l'OCDE les situations nationales, appréciées sous l'angle du niveau global du produit intérieur brut consacré à la protection sociale, se rapprochent beaucoup 17 ( * ) .
Les États-Unis offrent une illustration marquante de ce phénomène. Très au-dessous de la moyenne de l'OCDE pour les dépenses publiques sociales (18,4 points de PIB contre 21,4 points), ils passent au-dessus de cette moyenne pour l'ensemble des dépenses sociales (28,5 points de PIB contre 24,6 points de PIB).
I. LES DÉPENSES SOCIALES18 ( * ) EN EUROPE, UNE RÉALITÉ COMPLEXE ET UNE DISPERSION EN LIEN AVEC LA RICHESSE ÉCONOMIQUE DES PAYS
Globalement, les dépenses de protection sociale ont été stabilisées , entre 1992 et 2001 , dans l'Union européenne . Quand on envisage une autre période (1995-2005), l'enseignement est à peu près le même, malgré un léger déclin des dépenses publiques sociales.
Mais, les évolutions par pays ont été nettement différenciées .
Par ailleurs, la stabilité globale du poids des dépenses sociales dans le PIB s'est accompagnée dans tous les pays, sauf l'Espagne, l'Italie et la Suède, d'une élévation des dépenses sociales par habitant qui a pu , notamment au Royaume-Uni, être soutenue .
Dans ce contexte, malgré un rapprochement des situations , le niveau des dépenses de protection sociale par habitant exprimé en termes réels 19 ( * ) reste très diversifié dans l'Union européenne , à l'image des niveaux de richesse (globale) par habitant .
A. DES ÉVOLUTIONS CONTRASTÉES À TOUS POINTS DE VUE
- La considération de l'évolution des seules dépenses publiques de protection sociale en points de PIB fait ressortir une stabilité moyenne au cours de la période la plus récente (1995-2005) 20 ( * ) , avec toutefois quelques particularités nationales prononcées .
La baisse des dépenses publiques entre 1995 et 2001 a été partiellement compensée par l' augmentation du niveau des ressources privées allouées à la protection sociale .
- La variation des dépenses sociales par risque , toujours estimées à partir de leurs poids dans le PIB, a également été diversifiée et les singularités nationales sont fortes sous cet angle .
- Ces approches par niveau relatif des dépenses publiques sociales dans le PIB doivent être complétées par des mesures du dynamisme absolu des dépenses publiques sociales. Lorsqu'on s'intéresse à celui-ci, le panorama change beaucoup .
Plutôt qu'une stabilité des dépenses publiques sociales , c'est partout, ou presque, une augmentation des dépenses publiques sociales par habitant qu'on constate . Celle-ci est particulièrement forte dans des pays « assez inattendus » comme le Royaume-Uni, le Luxembourg ou l'Irlande.
Quand on corrige ce panorama pour tenir compte des écarts de prix et d'inflation entre pays européens, le palmarès des pays européens en termes d'évolution des dépenses sociales par habitant change un peu, les pays à faibles niveaux de prix gagnant quelques places sur l'échelle au détriment des pays dans la situation inverse, le Royaume-Uni notamment.
- Le dynamisme des dépenses sociales par habitant en France classe notre pays au dixième rang des quinze pays européens . Ce résultat est bien différent de l'image que donne l'augmentation du « poids » des dépenses publiques sociales dans le PIB, qui met la France au quatrième rang des pays de l'Union européenne.
1. Les dépenses publiques de protection sociale21 ( * ) en points de PIB : une stabilité globale, mais des évolutions nationales très différenciées
a) De 1995 à 2005 : une apparente stabilité
Les dépenses de protection sociale exprimées en points de PIB ont légèrement décliné dans l'Europe des Quinze, entre 1995 et 2001 (-1,3 point de PIB), pour se situer autour d'1/4 du PIB ( 24,5 points de PIB ) .
Au-delà, une certaine reprise est intervenue, les dépenses publiques de protection sociale gagnant 0,6 point de PIB entre 2002 et 2005 .
VARIATION DES DÉPENSES PUBLIQUES DE PROTECTION
SOCIALE - SANTÉ
ENTRE 1995 ET 2001) - EN POINTS DE PIB
|
Pays |
1995 |
1998 |
2001 |
Variation 2001/1995 |
|
UE-15 |
25,8 |
25,0 |
24,5 |
- 1,3 |
|
Belgique |
24,1 |
23,7 |
23,5 |
- 0,6 |
|
Danemark |
31,5 |
29,9 |
29,0 |
- 2,5 |
|
Allemagne |
27,1 |
27,8 |
27,8 |
+ 0,7 |
|
Grèce |
19,5 |
20,1 |
21,6 |
+ 2,1 |
|
Espagne |
20,0 |
18,8 |
17,9 |
- 2,1 |
|
France |
28,7 |
28,4 |
27,8 |
- 0,9 |
|
Irlande |
18,1 |
15,0 |
14,4 |
- 3,7 |
|
Italie |
23,6 |
23,3 |
23,7 |
+ 0,1 |
|
Luxembourg |
21,5 |
21,7 |
21,3 |
- 0,2 |
|
Pays-Bas |
24,1 |
21,6 |
20,6 |
- 3,5 |
|
Autriche |
29,6 |
28,9 |
26,9 |
- 2,7 |
|
Portugal |
17,8 |
18,2 |
19,5 |
+ 1,7 |
|
Finlande |
32,0 |
28,5 |
25,7 |
- 6,3 |
|
Suède |
32,8 |
29,1 |
29,7 |
- 3,1 |
|
Royaume-Uni |
23,0 |
21,1 |
21,4 |
- 1,6 |
Source : Eurostat
Au total, dans les pays européens, entre 1995 et 2005 , le poids des dépenses publiques de protection sociale aura été réduit de 0,2 point de PIB , situation assez inédite après des décennies de hausse, mais qui traduit plus une stabilité qu'une vraie décrue .
VARIATION DES DÉPENSES PUBLIQUES DE PROTECTION
SOCIALE - SANTÉ
ENTRE 2002 ET 2005 - EN POINTS DE PIB
|
Pays |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
Variation 2005/2002 |
|
UE-15 |
25,0 |
25,5 |
25,5 |
25,6 |
+ 0,6 |
|
Belgique |
24,0 |
24,8 |
24,9 |
24,7 |
+ 0,7 |
|
Danemark |
29,6 |
30,6 |
30,3 |
29,6 |
- |
|
Allemagne |
28,5 |
28,9 |
28,1 |
27,2 |
- 1,3 |
|
Grèce |
21,8 |
22,5 |
22,0 |
22,0 |
+ 0,2 |
|
Espagne |
18,2 |
18,1 |
18,8 |
18,6 |
+ 0,4 |
|
France |
28,4 |
29,2 |
29,4 |
29,6 |
+ 1,2 |
|
Irlande |
15,5 |
16,2 |
16,5 |
17,0 |
+ 1,5 |
|
Italie |
24,0 |
24,4 |
24,7 |
25,0 |
+ 1,0 |
|
Luxembourg |
21,9 |
22,6 |
22,8 |
22,6 |
+ 0,7 |
|
Pays-Bas |
21,3 |
22,2 |
22,1 |
21,6 |
+ 0,3 |
|
Autriche |
27,8 |
28,4 |
28,0 |
27,8 |
- |
|
Portugal |
20,2 |
21,5 |
22,2 |
23,0 |
+ 2,8 |
|
Finlande |
26,8 |
27,8 |
27,9 |
28,0 |
+ 1,2 |
|
Suède |
30,2 |
31,1 |
30,6 |
30,0 |
- 0,2 |
|
Royaume-Uni |
21,8 |
22,3 |
22,6 |
23,0 |
+ 1,2 |
Source : Eurostat
b) Mais, des évolutions nationales différenciées
Les évolutions par pays ont été toutefois contrastées.
VARIATION DES DÉPENSES PUBLIQUES DE PROTECTION
SOCIALE - SANTÉ
ENTRE 1995 ET 2005 - EN POINTS DE PIB
|
UE-15 |
- 0,2 |
|
Belgique |
+ 0,6 |
|
Danemark |
- 1,9 |
|
Allemagne |
+ 0,1 |
|
Grèce |
+ 2,5 |
|
Espagne |
- 1,4 |
|
France |
+ 0,9 |
|
Irlande |
- 1,1 |
|
Italie |
+ 1,4 |
|
Luxembourg |
+ 1,1 |
|
Pays-Bas |
- 2,5 |
|
Autriche |
- 1,8 |
|
Portugal |
+ 5,2 |
|
Finlande |
- 4,0 |
|
Suède |
- 2,8 |
|
Royaume-Uni |
0 |
- Dans quelques pays, la stabilité l'emporte : Allemagne, Royaume-Uni.
- Dans plusieurs pays , des baisses de grande ampleur interviennent (Suède, Danemark, Finlande, Pays-Bas, Autriche).
- Le Portugal et la Grèce , à l'inverse de l'Espagne, augmentent, au cours de la période, la part de leur PIB consacrée à la protection sociale.
- Il en va de même en France , en Italie et au Luxembourg , mais dans des proportions plus modérées .
2. Les dépenses privées de protection sociale : un fort dynamisme
Le tableau ci-après récapitule, pour la période 1992-2001, les évolutions de l'ensemble des dépenses de sécurité sociale et ajoute donc aux dépenses publiques identifiées ci-dessus les dépenses privées de protection sociale telles qu'elles sont prises en compte par le système statistique européen.
ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE PROTECTION
SOCIALE
(1992-2001) - EN POINTS DE PIB
|
Pays |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
Variation 1992/2001 |
Rang par ordre décroissant |
|
UE-15 |
27,7 |
28,7 |
28,5 |
28,2 |
28,4 |
28,0 |
27,5 |
27,4 |
27,3 |
27,5 |
- 0,2 |
NS |
|
Belgique |
27,7 |
29,3 |
28,7 |
28,1 |
28,6 |
27,9 |
27,6 |
27,3 |
26,8 |
27,5 |
- 0,2 |
6 |
|
Danemark |
30,3 |
31,9 |
32,8 |
32,2 |
31,4 |
30,4 |
30,2 |
30,0 |
29,2 |
29,5 |
- 0,8 |
9 |
|
Allemagne |
27,6 |
28,4 |
28,3 |
28,9 |
29,9 |
29,5 |
29,3 |
29,6 |
29,6 |
29,8 |
+ 2,2 |
3 |
|
Grèce |
21,2 |
22,0 |
22,1 |
22,3 |
22,9 |
23,3 |
24,2 |
25,5 |
26,3 |
27,2 |
+ 6,0 |
1 |
|
Espagne |
22,4 |
24,0 |
22,8 |
22,1 |
21,9 |
21,2 |
20,6 |
20,2 |
20,2 |
20,1 |
- 2,3 |
11 |
|
France |
29,3 |
30,7 |
30,5 |
30,7 |
31,0 |
30,8 |
30,5 |
30,2 |
29,8 |
30,0 |
+ 0,7 |
4 |
|
Irlande |
20,3 |
20,2 |
19,7 |
18,9 |
17,8 |
16,6 |
15,4 |
14,7 |
14,2 |
14,6 |
- 5,7 |
13 |
|
Italie |
26,2 |
26,4 |
26,0 |
24,8 |
24,8 |
25,5 |
25,0 |
25,2 |
25,2 |
25,6 |
- 0,6 |
6 |
|
Luxembourg |
22,5 |
23,3 |
22,9 |
23,7 |
24,1 |
22,8 |
21,7 |
21,7 |
20,3 |
21,2 |
- 1,3 |
10 |
|
Pays-Bas |
31,9 |
32,3 |
31,7 |
30,9 |
30,1 |
29,4 |
28,4 |
28,0 |
27,4 |
27,6 |
- 4,3 |
12 |
|
Autriche |
27,8 |
29,1 |
29,9 |
29,8 |
29,8 |
28,7 |
28,3 |
28,9 |
28,4 |
28,4 |
+ 0,6 |
5 |
|
Portugal |
18,4 |
21,0 |
21,3 |
22,1 |
21,2 |
21,4 |
22,1 |
22,6 |
23,0 |
23,9 |
+ 5,5 |
2 |
|
Finlande |
33,6 |
34,5 |
33,8 |
31,7 |
31,6 |
29,2 |
27,2 |
26,8 |
25,5 |
25,8 |
- 7,8 |
15 |
|
Suède |
37,1 |
38,2 |
36,7 |
34,6 |
33,9 |
33,0 |
32,2 |
31,8 |
30,7 |
31,3 |
- 5,8 |
14 |
|
Royaume-Uni |
27,9 |
29,0 |
28,6 |
28,2 |
28,0 |
27,5 |
26,9 |
26,4 |
27,1 |
27,2 |
- 0,7 |
8 |
Source : Statistiques sociales européennes. Commission européenne.
On observe que l' évolution des dépenses totales de sécurité sociale est différente de celle des seules dépenses publiques .
Pour la période de 1995 à 2001 , les dépenses totales se réduisent de 0,7 point de PIB, contre - 1,3 point de PIB pour les dépenses publiques.
Autrement dit, au cours de cette période , les dépenses privées de protection sociale ont augmenté, de 0,6 point de PIB .
ÉVOLUTION DES DÉPENSES PUBLIQUES ET
PRIVÉES DE SÉCURITÉ SOCIALE
1995-2001 - EN POINTS DE
PIB
|
Dépenses publiques |
Dépenses privées |
Total |
|
|
UE-15 |
- 1,3 |
+ 0,6 |
- 0,7 |
|
Belgique |
- 0,6 |
0 |
- 0,6 |
|
Danemark |
- 2,5 |
- 0,2 |
- 2,7 |
|
Allemagne |
+ 0,7 |
+ 0,2 |
+ 0,9 |
|
Grèce |
+ 2,1 |
+ 2,5 |
+ 4,6 |
|
Espagne |
- 2,1 |
+ 0,1 |
- 2,0 |
|
France |
- 0,9 |
+ 0,2 |
- 0,7 |
|
Irlande |
- 3,7 |
- 0,6 |
- 4,3 |
|
Italie |
+ 0,1 |
+ 0,7 |
+ 0,8 |
|
Luxembourg |
- 0,2 |
- 2,3 |
- 2,5 |
|
Pays-Bas |
- 3,5 |
+ 0,2 |
- 3,3 |
|
Autriche |
- 2,7 |
+ 1,3 |
- 1,4 |
|
Portugal |
+ 1,7 |
+ 0,1 |
+ 1,8 |
|
Finlande |
- 6,3 |
+ 0,4 |
- 5,9 |
|
Suède |
- 3,1 |
- 0,2 |
- 3,3 |
|
Royaume-Uni |
- 1,6 |
+ 0,6 |
- 1,0 |
Dans tous les pays où une baisse des dépenses publiques sociales est intervenue, soit les dépenses privées ont beaucoup moins diminué, soit elles ont augmenté (le Luxembourg excepté) .
3. Une croissance contrastée des dépenses relatives aux différents « risques » sociaux
a) Des évolutions variées selon les risques
En Europe, entre 1990 et 1999 , la croissance des dépenses sociales , exprimée en termes réels, a été variable selon les « risques » couverts .
CROISSANCE DES DÉPENSES SOCIALES PAR FONCTION
EN TERMES DE POUVOIR D'ACHAT, 1990-1999
(variation annuelle
en pourcentage)
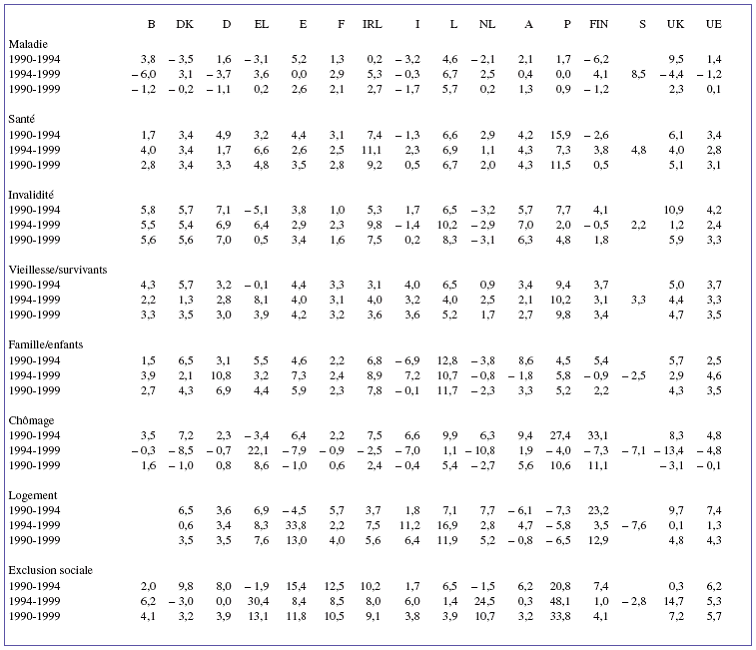
Source : La protection sociale en Europe 2001, Commission européenne
Quasiment nulle pour les dépenses d'indemnisation pour maladie ou pour chômage , elle a été d' une particulière ampleur s'agissant des dépenses liées à l'exclusion sociale (+ 5,7 % par an) et, à un moindre degré, pour le logement (+ 4,3 % par an).
Pour les autres dépenses sociales, la croissance s'est étagée entre 3,1 % (pour la santé) et 3,5 % (vieillesse et famille) .
b) De fortes particularités nationales
* Ces évolutions moyennes pour l'Union européenne, avec une inflexion du rythme d'évolution des dépenses sociales entre une première sous période (1990-1994) et sa suivante (1994-1999), se sont accompagnées d'une très grande diversité des situations nationales .
Appréciés par pays, les écarts à la moyenne de la croissance annuelle des dépenses, catégorie par catégorie, sont considérables .
ÉCARTS À LA MOYENNE ANNUELLE DES TAUX DE
CROISSANCE
DES DÉPENSES SOCIALES DANS L'UNION EUROPÉENNE,
ENTRE 1990-1999
(en points de croissance)
|
Maladie |
Santé |
Invalidité |
Vieillesse |
Famille |
Chômage |
Logement |
Exclusion sociale |
|
|
Belgique |
- 1,3 |
- 0,8 |
+ 2,3 |
- 0,2 |
- 0,8 |
+ 1,7 |
Nd |
- 1,6 |
|
Danemark |
- 0,3 |
+ 0,3 |
+ 2,3 |
0 |
+ 0,8 |
- 0,9 |
- 0,8 |
- 2,5 |
|
Allemagne |
- 1,2 |
+ 0,2 |
+ 3,7 |
- 0,5 |
+ 3,4 |
+ 0,9 |
- 0,8 |
- 1,8 |
|
Grèce |
+ 0,1 |
+ 1,7 |
- 2,8 |
+ 0,4 |
+ 0,9 |
+ 8,7 |
+ 3,3 |
+ 7,4 |
|
Espagne |
+ 2,7 |
+ 0,4 |
+ 0,1 |
+ 0,7 |
+ 2,4 |
- 0,9 |
+ 8,7 |
+ 6,1 |
|
France |
+ 2,0 |
- 0,3 |
- 1,7 |
- 0,3 |
- 1,2 |
+ 0,5 |
- 0,3 |
+ 4,8 |
|
Irlande |
+ 2,6 |
+ 6,1 |
+ 4,2 |
+ 0,1 |
+ 4,3 |
+ 2,5 |
+ 1,3 |
+ 3,4 |
|
Italie |
- 1,8 |
- 0,8 |
- 3,1 |
+ 0,1 |
- 3,6 |
- 0,3 |
+ 2,1 |
- 1,9 |
|
Luxembourg |
+ 5,6 |
+ 3,6 |
+ 5,0 |
+ 1,7 |
+ 8,2 |
+ 5,5 |
+ 7,6 |
- 1,8 |
|
Pays-Bas |
+ 0,3 |
- 0,9 |
- 6,4 |
- 1,8 |
- 5,8 |
- 2,8 |
+ 0,9 |
+ 5,0 |
|
Autriche |
+ 1,2 |
+ 1,2 |
+ 3,0 |
- 0,8 |
- 0,2 |
+ 5,7 |
- 5,1 |
- 2,5 |
|
Portugal |
+ 0,8 |
+ 8,4 |
- 1,5 |
+ 6,3 |
+ 1,7 |
+ 10,7 |
- 10,8 |
+ 28,1 |
|
Finlande |
- 1,3 |
- 2,6 |
- 1,5 |
- 0,1 |
- 1,3 |
+ 11,2 |
+ 8,6 |
- 1,6 |
|
Suède |
Nd |
Nd |
Nd |
Nd |
Nd |
Nd |
Nd |
Nd |
|
Royaume-Uni |
+ 2,2 |
+ 2,0 |
+ 2,6 |
+ 1,2 |
+ 0,8 |
- 3,0 |
+ 0,5 |
+ 1,5 |
Source : Commission européenne. Calculs de l'auteur.
* Hormis le cas particulier du Luxembourg qui, pour trois catégories (maladie, invalidité, famille) sur huit, est en tête des progressions, l' éventail des variations se déploie sur :
- 4,5 points pour la « maladie » entre la plus haute, l'Espagne (+ 2,7 points d'écarts à la croissance annuelle moyenne) et la plus basse, l'Italie (- 1,8 point) ;
-
11 points pour la
« santé »
(Portugal :
+ 8,4 points ;
Finlande :
- 2,6 points) ;
- 10,6 points pour l'« invalidité » (Irlande : + 4,2 points ; Pays-Bas : - 6,4 points) ;
- 8,1 points pour la « vieillesse » (Portugal : + 6,3 points ; Pays-Bas : - 1,8 points) ;
-
10,1 points pour la
« famille »
(Irlande :
+ 4,3 points ;
Pays-Bas :
- 5,8 points) ;
- 14,2 points pour le « chômage » (Finlande : + 11,2 points ; Royaume-Uni : - 3 points) ;
-
19,5 points pour le
« logement »
(Grèce :
+ 8,7 points ;
Portugal :
- 10,8 points) ;
- 30,6 points pour « l'exclusion sociale » (Portugal : + 28,1 points ; Danemark et Autriche : - 2,5 points).
* Dans cet ensemble, la France ressort avec une évolution inférieure à la moyenne dans cinq catégories de dépenses (santé, invalidité, vieillesse, famille et logement). Elle ne se détache par le haut que pour la maladie (+ 2 points), le chômage (+ 0,5 point) et l'exclusion sociale (+ 4,8 points).
RÉPARTITION DES DÉPENSES COURANTES DE PROTECTION SOCIALE PAR FONCTION, 1999
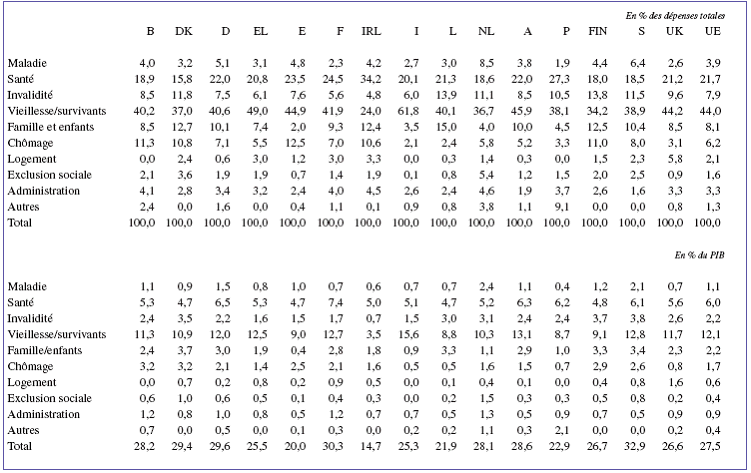
Source : La protection sociale en Europe 2001, Commission européenne
* La diversité des évolutions par risque et par pays , qui est plus accusée que celle des dynamiques nationales de la protection sociale globale, traduit l'existence de particularismes nationaux relatifs à la structure des risques sociaux qui, sans surprise, ressortent comme des variables explicatives importantes des dépenses sociales .
4. Des dynamiques nationales de protection sociale par habitant très variables
- L' analyse de la dynamique des dépenses de protection sociale, effectuée au regard de leur poids dans le PIB - qui débouche simplement sur des constats relatifs à l'évolution de la part du PIB allouée à des dépenses de protection sociale - ne permet pas de rendre compte de la variation des dépenses de protection sociale en elles-mêmes .
Avec une même augmentation de ces dépenses, deux pays qui connaissent des rythmes de croissance économique différents enregistreront des évolutions contrastées du poids des dépenses de protection sociale dans le PIB .
Pour appréhender la dynamique absolue des dépenses sociales , il faut donc se référer à d'autres données : les dépenses sociales par habitant ou, mieux encore, les dépenses sociales par habitant en parités de pouvoir d'achat, qui permettent des comparaisons internationales plus robustes.
a) Les dépenses sociales par habitant
Le tableau ci-après , qui récapitule les variations des dépenses de protection sociale par habitant, en monnaie constante, rend compte des évolutions en volume des dépenses de protection sociale .
De plus, l'approche par habitant présente le grand avantage d'analyser l'évolution des bénéfices sociaux individuels concrètement distribués en Europe .
ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE PROTECTION
SOCIALE PAR TÊTE
(1992-2001) - EN NIVEAU ET EN MONNAIE
CONSTANTE
|
Pays |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
Variation 1992/2001
|
Rang
|
|
EU-15 |
4 928 |
4 941 |
4 977 |
4 985 |
5 133 |
5 223 |
5 302 |
5 471 |
5 681 |
5 762 |
+ 1,7 |
NS |
|
Belgique |
5 105 |
5 559 |
5 702 |
5 867 |
5 889 |
5 740 |
5 809 |
5 981 |
5 976 |
6 115 |
+ 2,0 |
9 |
|
Danemark |
6 986 |
7 568 |
8 243 |
8 479 |
8 441 |
8 250 |
8 331 |
8 505 |
8 492 |
8 654 |
+ 2,4 |
5 |
|
Allemagne |
5 798 |
6 113 |
6 246 |
6 645 |
6 783 |
6 525 |
6 632 |
6 856 |
6 923 |
6 990 |
+ 2,1 |
8 |
|
Grèce |
2 194 |
2 054 |
1 950 |
1 917 |
1 987 |
2 091 |
2 113 |
2 345 |
2 452 |
2 599 |
+ 1,9 |
10 |
|
Espagne |
3 016 |
2 825 |
2 561 |
2 516 |
2 590 |
2 534 |
2 560 |
2 633 |
2 715 |
2 786 |
- 0,8 |
14 |
|
France |
5 485 |
5 877 |
5 986 |
6 131 |
6 235 |
6 179 |
6 325 |
6 487 |
6 555 |
6 692 |
+ 2,2 |
7 |
|
Irlande |
2 512 |
2 526 |
2 600 |
2 669 |
2 769 |
3 097 |
3 057 |
3 230 |
3 361 |
3 666 |
+ 4,3 |
4 |
|
Italie |
5 026 |
4 310 |
4 131 |
3 631 |
4 043 |
4 309 |
4 294 |
4 415 |
4 522 |
4 671 |
- 0,7 |
13 |
|
Luxembourg |
6 421 |
7 187 |
7 497 |
7 998 |
8 179 |
8 148 |
8 293 |
8 993 |
9 066 |
9 485 |
+ 4,4 |
3 |
|
Pays-Bas |
5 698 |
6 061 |
6 137 |
6 340 |
6 194 |
6 059 |
6 056 |
6 164 |
6 309 |
6 403 |
+ 1,3 |
11 |
|
Autriche |
5 571 |
6 040 |
6 375 |
6 657 |
6 619 |
6 276 |
6 399 |
6 747 |
6 795 |
6 830 |
+ 2,3 |
6 |
|
Portugal |
1 615 |
1 691 |
1 694 |
1 824 |
1 810 |
1 900 |
2 039 |
2 191 |
2 308 |
2 431 |
+ 4,6 |
2 |
|
Finlande |
5 885 |
5 123 |
5 629 |
6 159 |
6 136 |
6 014 |
5 876 |
5 935 |
5 918 |
6 047 |
+ 0,3 |
12 |
|
Suède |
9 057 |
7 835 |
7 719 |
7 439 |
8 100 |
7 926 |
7 767 |
8 112 |
8 524 |
7 940 |
- 1,3 |
15 |
|
Royaume-Uni |
4 286 |
4 298 |
4 418 |
4 175 |
4 363 |
5 237 |
5 449 |
5 678 |
6 546 |
6 611 |
+ 4,9 |
1 |
Source : Statistiques sociales européennes. Commission européenne. Calculs de l'auteur.
* Les dépenses sociales par habitant ont augmenté en moyenne annuelle, et en volume, de 1,7 % dans l'Europe des Quinze, entre 1992 et 2001 .
Alors qu'avec une analyse conduite à l'aune de leur poids dans le PIB, on observe que, dans la plupart des pays européens (10 pays sur 15), une diminution relative des dépenses de protection sociale s'est produite, seuls trois pays connaissent une diminution absolue des dépenses de protection sociale par habitant : l'Espagne, l'Italie et la Suède .
Dans les autres pays, la réduction du niveau relatif des dépenses sociales dans le PIB résulte d'un écart de croissance entre dépenses sociales et PIB .
Sans doute la croissance réelle des dépenses sociales par habitant a été moins forte que dans le passé et que celle du PIB par habitant. Mais , dans ces pays, il y a eu croissance réelle des bénéfices sociaux par habitant et non une diminution .
* Dans plusieurs pays où les dépenses de protection sociale exprimées en points de PIB ont été nettement réduites , les bénéfices sociaux par habitant ont, au contraire, augmenté , parfois sensiblement : les Pays-Bas, l'Irlande et le Luxembourg sont dans ce cas.
* Dans les grands pays européens :
- le Royaume-Uni se singularise par une forte augmentation - la plus forte de l'échantillon - de la dépense de protection sociale par habitant (+ 4,9 % par an) alors que, vues à travers leur poids dans le PIB, les dépenses de protection sociale apparaissent comme ayant diminué au Royaume-Uni au cours de la période examinée ;
- en France et en Allemagne, les rythmes de progression sont très proches (+ 2,2 % et + 2,1 % respectivement) mais, avec une augmentation du poids de la protection sociale dans le PIB plus forte en Allemagne qu'en France . Ce dernier phénomène traduit le différentiel de croissance à l'avantage de la France qui a caractérisé cette période. En Italie, les bénéfices sociaux par habitant ont été réduits.
* Au total, dans les dix pays qui ont connu une augmentation de la dépense sociale par habitant , celle-ci a été plus ou moins rapide .
- Six d'entre eux ( dont la France , avec + 0,5 points par an par rapport à la moyenne) ont enregistré une variation supérieure à la moyenne de moins de 1 point .
- Mais, quatre pays ont connu un rythme de croissance de la dépense publique sociale par habitant très supérieur :
- l' Irlande : 2,6 points au-dessus de la moyenne ;
- le Luxembourg : 2,7 points au-dessus de la moyenne ;
- le Portugal : 3,2 points au-dessus de la moyenne ;
- et le Royaume-Uni : 3,2 points au-dessus de la moyenne.
* Les trois pays qui ont vu décroître la dépense publique sociale par habitant ont accusé un net décrochage par rapport au rythme de croissance moyen.
Il s'agit de :
- l' Espagne : 2,5 points au-dessous de la moyenne ;
- l' Italie : 2,4 points au-dessous de la moyenne ;
- et la Suède : 3,2 points au-dessous de la moyenne.
Quant à la Finlande, avec un rythme de croissance inférieur de 1,4 point à la moyenne, elle a connu une quasi stagnation de sa dépense publique sociale par habitant .
*
* *
Ces données conduisent à plusieurs observations .
- La réduction des dépenses publiques sociales s'est accompagnée d'une augmentation des dépenses privées qui a limité le repli du poids des dépenses sociales dans le PIB.
- Si les dynamiques des dépenses de protection sociale ont été contrastées, elles ont abouti, dans la quasi-totalité des cas, à une augmentation des bénéfices sociaux par tête .
Le rythme de cette augmentation a été particulièrement soutenu dans les pays où la part du PIB consacrée à la protection sociale a pourtant décliné , excepté le Portugal.
Ce constat n'est pas le fruit du hasard : dans de nombreux pays où le niveau de la protection sociale dans le PIB a décru, cette évolution est venue du dynamisme de la croissance économique plus que de politiques de réduction des bénéfices sociaux publics. Lorsque de telles politiques ont été mises en oeuvre, les dépenses privées les ont souvent compensées.
- Les niveaux des dépenses sociales par habitant sont très inégaux en Europe.
Cependant, sur ce point, pour plus de pertinence, les comparaisons internationales doivent tenir compte des différences de prix entre les pays. En effet, à une même quantité monétaire correspondent des pouvoirs d'achat nationaux différents, puisque les niveaux de prix le sont eux-mêmes dans les différents pays. La méthode de la parité des pouvoirs d'achat permet de neutraliser ce biais.
b) Les dépenses sociales par habitant, en parités de pouvoirs d'achat22 ( * )
* Les données du tableau ci-dessous, en parités de pouvoirs d'achat, confirment l'existence d' écarts prononcés dans l'évolution des dépenses de protection sociale par habitant en Europe .
* Ils montrent aussi que la hiérarchie entre les pays est un peu modifiée quand on établit les comparaisons entre pays sur la base des parités de pouvoir d'achat .
ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE PROTECTION
SOCIALE PAR TÊTE
(1992-2001) - EN PARITÉS DE POUVOIR
D'ACHAT, EN NIVEAU ET EN %
|
Pays |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
Variation 1992/2001
|
Rang par ordre décroissant |
|
EU-15 |
4 505 |
4 673 |
4 840 |
4 985 |
5 254 |
5 436 |
5 589 |
5 840 |
6 175 |
6 405 |
+ 4,0 |
NS |
|
Belgique |
4 924 |
5 395 |
5 535 |
5 555 |
5 861 |
6 005 |
6 161 |
6 162 |
6 469 |
6 888 |
+ 3,8 |
9 |
|
Danemark |
5 288 |
5 829 |
6 462 |
6 654 |
6 970 |
7 029 |
7 187 |
7 524 |
7 672 |
7 805 |
+ 4,4 |
6 |
|
Allemagne |
5 007 |
5 128 |
5 422 |
5 728 |
6 093 |
6 313 |
6 453 |
6 846 |
7 268 |
7 329 |
+ 4,3 |
7 |
|
Grèce |
2 021 |
2 163 |
2 289 |
2 438 |
2 652 |
2 800 |
3 089 |
3 469 |
3 776 |
3 971 |
+ 7,8 |
1 |
|
Espagne |
2 802 |
3 025 |
2 939 |
3 005 |
3 167 |
3 245 |
3 269 |
3 489 |
3 702 |
3 867 |
+ 3,6 |
11 |
|
France |
5 218 |
5 380 |
5 472 |
5 661 |
5 838 |
5 961 |
6 154 |
6 449 |
6 876 |
7 266 |
+ 3,7 |
10 |
|
Irlande |
2 554 |
2 657 |
2 839 |
3 014 |
2 980 |
3 234 |
3 218 |
3 386 |
3 564 |
3 875 |
+ 4,7 |
4 |
|
Italie |
4 534 |
4 443 |
4 604 |
4 576 |
4 848 |
5 102 |
5 301 |
5 608 |
5 891 |
6 186 |
+ 3,5 |
12 |
|
Luxembourg |
6 542 |
7 214 |
7 442 |
7 898 |
8 288 |
8 495 |
8 690 |
9 643 |
10 106 |
10 559 |
+ 5,5 |
3 |
|
Pays-Bas |
5 418 |
5 580 |
5 736 |
5 974 |
6 079 |
6 432 |
6 671 |
6 826 |
6 905 |
7 392 |
+ 3,5 |
12 |
|
Autriche |
5 006 |
5 391 |
5 771 |
5 897 |
6 247 |
6 292 |
6 424 |
6 945 |
7 434 |
7 464 |
+ 4,5 |
5 |
|
Portugal |
1 874 |
2 207 |
2 394 |
2 585 |
2 605 |
2 891 |
3 064 |
3 289 |
3 369 |
3 644 |
+ 7,7 |
2 |
|
Finlande |
4 336 |
4 675 |
4 762 |
4 934 |
5 134 |
5 115 |
5 072 |
5 209 |
5 385 |
5 622 |
+ 2,9 |
14 |
|
Suède |
5 597 |
6 098 |
6 150 |
6 153 |
6 294 |
6 440 |
6 528 |
6 739 |
7 031 |
7 065 |
+ 2,6 |
15 |
|
Royaume-Uni |
4 312 |
4 511 |
4 634 |
4 629 |
5 019 |
5 278 |
5 442 |
5 464 |
5 935 |
6 181 |
+ 4,1 |
8 |
Source : Statistiques sociales européennes. Commission européenne. Calculs de l'auteur.
- Si plusieurs pays conservent leurs positions relatives, le niveau comparativement élevé des prix aux Pays-Bas, en France et au Royaume-Uni fait perdre quelques rangs à ces pays. Inversement, la Grèce et l'Espagne se classent mieux quand on corrige les données nominales par la méthode de la parité des pouvoirs d'achat.
RANG DES PAYS PAR ORDRE DÉCROISSANT DE LA VARIATION
|
Pays |
Dépenses sociales par habitant |
Dépenses sociales par habitant en pouvoir d'achat |
Différence de rang |
|
Royaume-Uni |
1 |
8 |
- 7 |
|
Portugal |
2 |
2 |
0 |
|
Luxembourg |
3 |
3 |
0 |
|
Irlande |
4 |
4 |
0 |
|
Danemark |
5 |
6 |
- 1 |
|
Autriche |
6 |
5 |
+ 1 |
|
France |
7 |
10 |
- 3 |
|
Allemagne |
8 |
7 |
+ 1 |
|
Belgique |
9 |
9 |
0 |
|
Grèce |
10 |
1 |
+ 9 |
|
Pays-Bas |
11 |
12 |
- 1 |
|
Finlande |
12 |
14 |
- 2 |
|
Italie |
13 |
12 |
+ 1 |
|
Espagne |
14 |
11 |
+ 3 |
|
Suède |
15 |
15 |
0 |
B. UNE RELATIVE HOMOGÉNÉITÉ DU POIDS DES DÉPENSES SOCIALES DANS LE PIB, MAIS UNE GRANDE DIVERSITÉ SOUS L'ANGLE DE LA DÉPENSE SOCIALE PAR HABITANT
Au terme de ces différentes évolutions, on doit souligner qu' en fonction de l'angle de vision, les niveaux de dépenses de protection sociale dans les différents pays de l'Union européenne apparaissent, ou homogènes, ou hétérogènes .
ÉCARTS À LA MOYENNE DE DIVERSES GRANDEURS
RELATIVES À LA PROTECTION SOCIALE EN EUROPE EN 2001
|
Dépenses
|
Évolution des dépenses
|
Dépenses
en valeur |
|
|
Belgique |
0 |
+ 0,3 |
+ 353 |
|
Danemark |
+ 2,0 |
+ 0,7 |
+ 2 892 |
|
Allemagne |
+ 2,3 |
+ 0,4 |
+ 1 228 |
|
Grèce |
- 0,3 |
+ 0,2 |
- 3 163 |
|
Espagne |
- 7,4 |
- 2,5 |
- 2 976 |
|
France |
+ 2,5 |
+ 0,5 |
+ 930 |
|
Irlande |
- 12,9 |
+ 2,6 |
- 2 096 |
|
Italie |
- 1,9 |
- 2,4 |
- 1 091 |
|
Luxembourg |
- 6,3 |
+ 2,7 |
+ 3 723 |
|
Pays-Bas |
+ 0,1 |
- 2,4 |
+ 641 |
|
Autriche |
+ 0,9 |
+ 0,6 |
+ 1 068 |
|
Portugal |
- 3,6 |
+ 2,9 |
- 3 331 |
|
Finlande |
- 1,7 |
- 1,4 |
- 285 |
|
Suède |
+ 3,8 |
- 3,0 |
+ 2 178 |
|
Royaume-Uni |
- 0,3 |
+ 3,2 |
+ 842 |
1 En points de croissance annuelle en termes réels, entre 1992 et 2001.
Autour d'une moyenne de 27,5 points de PIB du taux de redistribution sociale (comprenant les dépenses publiques et privées) dans l'Union européenne en 2001, la dispersion des situations nationales varie selon le point de vue .
La dispersion du niveau de protection sociale relativement au PIB est en voie de réduction .
Cette situation répond à l'idée intuitive qu'il existe une corrélation entre les dépenses sociales et le niveau de développement . Les pays européens étant comparativement de plus en plus homogènes sous cet angle, le niveau relatif au PIB de leurs dépenses sociales l'est également.
De fait, la corrélation entre dépenses sociales et niveau de développement économique est largement établie : en dépit de leur homogénéité relative, les pays européens connaissent des niveaux de richesse par habitant (le PIB par habitant) très différents et les niveaux absolus de dépenses sociales par habitant sont, à cette image, également très différents. Une corrélation robuste existe entre ces deux variables : plus la richesse par habitant est élevée, plus la dépense sociale par habitant l'est aussi .
1. Une dispersion des dépenses sociales dans le PIB qui s'est réduite
a) Une « plage de dispersion » de 5 points de PIB
* Hors quelques exceptions, par le bas (Espagne, Irlande, Luxembourg, Portugal), les dépenses sociales semblent homogènes quand on les envisage en points de PIB .
En 2001, hormis les pays précités et la Suède, qui se distingue, elle, par le haut, avec 3,8 points de PIB de plus que la moyenne, aucun pays ne s'écarte de celle-ci de plus de 2,5 points de PIB .
Ainsi, dans dix pays sur quinze , les dépenses sociales relatives au PIB ne s'écartent de la moyenne que de 9 % par le haut ou le bas .
* En outre, par rapport à 1992 , la dispersion mesurée par l'écart-type 23 ( * ) s'est réduite : l'écart-type recule de 0,6 point de PIB.
ÉCART À LA MOYENNE DES DÉPENSES DE
PROTECTION SOCIALE
1
DANS L'UNION EUROPÉENNE, EN 1999 (EN
POINTS DE PIB)
|
Maladie |
Santé |
Invalidité |
Vieillesse |
Famille |
Chômage |
Logement |
Exclusion sociale |
Adminis-tration |
Total |
|
|
Belgique |
0 |
- 0,7 |
+ 0,2 |
- 0,8 |
- 0,2 |
+ 1,5 |
- 0,6 |
+ 0,2 |
+ 0,3 |
+ 0,7 |
|
Danemark |
- 0,2 |
- 1,3 |
+ 1,3 |
- 1,2 |
+ 1,5 |
+ 1,5 |
- 0,1 |
+ 0,6 |
- 0,1 |
+ 1,9 |
|
Allemagne |
+ 0,4 |
+ 0,5 |
0 |
- 0,1 |
+ 0,8 |
+ 0,4 |
- 0,4 |
+ 0,2 |
+ 0,1 |
+ 2,1 |
|
Grèce |
- 0,3 |
- 0,7 |
- 0,6 |
+ 0,4 |
- 0,3 |
- 0,3 |
+ 0,2 |
+ 0,1 |
- 0,1 |
- 2,0 |
|
Espagne |
- 0,1 |
- 1,3 |
- 0,7 |
- 3,1 |
- 1,8 |
+ 0,8 |
- 0,4 |
- 0,3 |
- 0,4 |
- 7,5 |
|
France |
- 0,4 |
+ 1,4 |
- 0,5 |
+ 0,6 |
+ 0,6 |
+ 0,4 |
+ 0,3 |
0 |
+ 0,3 |
+ 2,8 |
|
Irlande |
- 0,5 |
- 1,0 |
- 1,5 |
- 8,6 |
- 0,4 |
- 0,1 |
- 0,1 |
- 0,1 |
- 0,2 |
- 12,8 |
|
Italie |
- 0,4 |
- 0,9 |
- 0,7 |
+ 3,5 |
- 1,3 |
- 1,2 |
- 0,6 |
- 0,4 |
- 0,2 |
- 2,2 |
|
Luxembourg |
- 0,4 |
- 1,3 |
+ 0,8 |
- 3,3 |
+ 1,1 |
- 1,2 |
- 0,5 |
- 0,2 |
- 0,4 |
- 5,7 |
|
Pays-Bas |
+ 1,3 |
- 0,8 |
+ 0,9 |
+ 1,8 |
- 1,1 |
- 0,1 |
- 0,2 |
+ 0,9 |
+ 0,4 |
+ 0,6 |
|
Autriche |
0 |
+ 0,3 |
+ 0,2 |
+ 1,0 |
+ 0,7 |
- 0,2 |
- 0,5 |
- 0,1 |
- 0,4 |
+ 1,1 |
|
Portugal |
- 0,7 |
+ 0,2 |
+ 0,2 |
- 3,7 |
- 1,2 |
- 1,0 |
- 0,6 |
- 0,1 |
0 |
- 4,6 |
|
Finlande |
+ 0,1 |
- 1,2 |
+ 1,5 |
- 2,0 |
- 1,1 |
+ 1,2 |
- 0,2 |
- 0,1 |
- 0,2 |
- 0,8 |
|
Suède |
+ 1,0 |
+ 0,1 |
+ 1,6 |
+ 0,7 |
+ 1,2 |
+ 0,9 |
+ 0,2 |
+ 0,4 |
+ 0,4 |
+ 5,4 |
|
Royaume-Uni |
- 0,4 |
- 0,4 |
+ 0,4 |
- 0,4 |
+ 0,1 |
- 0,9 |
+ 1,0 |
- 0,2 |
0 |
- 0,9 |
|
Moyenne |
1,1 |
6,0 |
2,2 |
12,1 |
2,2 |
1,7 |
0,6 |
0,4 |
0,9 |
27,2 |
1 Ensemble des dépenses sociales soit les dépenses publiques et les dépenses privées.
Note de lecture :
(sur fond gris) écart en
plus, le plus élevé ;
(sur fond bleu) écart en
moins, le plus élevé
Source : La protection sociale en Europe 2001, Commission européenne
Les pays se détachant par le bas sont, par ordre décroissant :
- l'Irlande (- 12,8 points) ;
- l'Espagne (- 7,5 points) ;
- le Luxembourg (- 5,7 points) ;
- le Portugal (- 4,6 points) ;
- l'Italie (- 2,2 points) ;
- la Grèce (- 2 points) ;
- le Royaume-Uni (- 0,9 point) ;
- la Finlande (- 0,8 point).
Les pays qui se détachent par le haut sont, par ordre croissant :
- les Pays-Bas (+ 0,6 point) ;
- la Belgique (+ 0,7 point) ;
- l'Autriche (+ 1,1 point) ;
- le Danemark (+ 1,9 point) ;
- l'Allemagne (+ 2,1 points) ;
- la France (+ 2,8 points) ;
- la Suède (+ 5,4 points).
* On peut relever que les écarts par le bas totalisent 36,5 points de PIB quand les écarts par le haut s'élèvent à 14,6 points de PIB.
Il y a, en effet, beaucoup de pays relativement « petits » dans la liste de ceux dans lesquels le taux de redistribution sociale est faible . Dès lors, même si les écarts constatés dans ces pays sont importants, ils comptent relativement peu au total.
b) Pour les quatre grands pays européens, une dispersion également modérée
* Pour les quatre grands pays européens, l'amplitude des situations est faible.
En 1999, la plage sur laquelle ils se situent représente l'équivalent de 5 points de PIB avec, aux deux extrêmes, l'Italie, 2,2 points de PIB au-dessous de la moyenne, et la France, 2,8 points de PIB au-dessus .
L'écart entre la France et le Royaume-Uni est de 3,7 points de PIB ; entre la France et l'Allemagne de 0,7 point.
- Il est intéressant de détailler la source des différences qui existent entre la France et les trois autres « grands » pays de l'Union européenne.
ÉCART ENTRE LA FRANCE ET LES TROIS AUTRES GRANDS
PAYS
DE L'UNION EUROPÉENNE, PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES
SOCIALES, EN 1999
(EN POINTS DE PIB)
|
Avec... |
Maladie |
Santé |
Invalidité |
Vieillesse |
Famille |
Chômage |
Logement |
Exclusion sociale |
Administration |
Total |
|
l'Italie |
0 |
+ 2,3 |
+ 0,2 |
- 2,9 |
+ 1,9 |
+ 1,6 |
+ 0,9 |
+ 0,4 |
+ 0,3 |
+ 5,0 |
|
l'Allemagne |
- 0,9 |
+ 0,9 |
- 0,5 |
+ 0,7 |
- 0,2 |
0 |
+ 0,7 |
- 0,2 |
+ 0,2 |
+ 0,7 |
|
le Royaume-Uni |
0 |
+ 1,8 |
- 0,9 |
+ 1,0 |
+ 0,5 |
+ 1,3 |
- 0,7 |
+ 0,2 |
+ 0,3 |
+ 3,7 |
1 Le total ne correspond pas à la somme des composantes car la rubrique « Autres » a été négligée.
Avec l'Italie , les écarts les plus significatifs sont, par le haut , les dépenses de santé , et en faveur des familles et des chômeurs , et par le bas , les dépenses de retraite , catégorie pour laquelle l'Italie et le pays le plus dépensier dans l'ensemble.
Avec l'Allemagne , ce sont les dépenses relatives au logement, à la santé et à la retraite qui font la différence.
Avec le Royaume-Uni , les différences les plus significatives , par le haut , viennent des dépenses de santé, de chômage et de retraite .
Ainsi, deux postes de dépenses sociales enregistrent des différences particulièrement notables en France, par le haut, la santé et le chômage.
2. En revanche, une dispersion des dépenses sociales par habitant qui, même si elle se réduit, reste très forte
a) Une grande diversité des niveaux de dépenses sociales par habitant...
* Quand on observe la dispersion des niveaux de dépense sociale par habitant dans les pays européens, on ne peut que constater à l'inverse que, si elle s'est réduite au cours de la période, elle reste élevée .
L'écart-type qui était de 2.363 euros en 1992 ne s'élevait plus qu'à 2.049 euros en 2001, mais c'est bien sous l'angle du niveau de la dépense publique de protection sociale par habitant que l'hétérogénéité entre les pays de l'Union européenne apparaît le plus .
Les écarts à la moyenne excédant 10 % sont la règle. Par le haut, ils concernent :
- le Danemark : + 50,2 % par rapport à la moyenne ;
- l'Allemagne : + 21,3 % par rapport à la moyenne ;
- la France : + 16,0 % par rapport à la moyenne ;
- le Luxembourg : + 64,6 % par rapport à la moyenne ;
- les Pays-Bas : + 11,1 % par rapport à la moyenne ;
- l'Autriche : + 18,5 % par rapport à la moyenne ;
- la Suède : + 37,8 % par rapport à la moyenne ;
- et le Royaume-Uni : + 14,7 % par rapport à la moyenne.
Les pays dont la dépense de protection sociale par habitant est inférieure de 10 % à la moyenne sont moins nombreux :
- la Grèce : 55 % au dessous de la moyenne ;
- l'Espagne : 51,7 % au dessous de la moyenne ;
- l'Irlande : 36,4 % au dessous de la moyenne ;
- l'Italie : 18,9 % au dessous de la moyenne ;
- et le Portugal : 57,8 % au dessous de la moyenne.
Deux pays sont situés à moins de 10 % de la valeur moyenne de la dépense publique sociale par habitant : la Belgique et la Finlande .
DÉPENSES SOCIALES PAR HABITANT EN 2001
|
Classement
|
Classement
|
Classement
|
|
|
Rang |
Rang |
Rang |
|
|
Belgique |
9 |
8 |
7 |
|
Danemark |
2 |
2 |
4 |
|
Allemagne |
4 |
5 |
3 |
|
Grèce |
14 |
11 |
8 |
|
Espagne |
13 |
14 |
14 |
|
France |
6 |
6 |
2 |
|
Irlande |
12 |
13 |
15 |
|
Italie |
11 |
12 |
11 |
|
Luxembourg |
1 |
1 |
13 |
|
Pays-Bas |
8 |
4 |
6 |
|
Autriche |
5 |
3 |
5 |
|
Portugal |
15 |
15 |
12 |
|
Finlande |
10 |
10 |
10 |
|
Suède |
3 |
7 |
1 |
|
Royaume-Uni |
7 |
9 |
8 |
Le rapport entre le pays le plus « généreux » - le Luxembourg - et le pays le plus « chiche » - le Portugal - est de 2,9.
Le point de vue offert par les dépenses sociales par habitant modifie le jugement sur la hiérarchie des systèmes sociaux. La France, deuxième sous l'angle du niveau des dépenses sociales dans le PIB, n'est plus que sixième avec ce critère.
b) ... en lien avec la dispersion des niveaux de richesse par habitant, mais cependant atténuée par rapport à celle-ci...
Cette hiérarchie épouse assez étroitement celle du classement des pays de l'Europe des Quinze au regard du PIB par habitant. Elle est cependant moins nette que celle-ci .
Le PIB par habitant en parités de pouvoir d'achat est, au Luxembourg, 3,5 fois plus élevé qu'au Portugal quand le rapport entre les deux pays pour les dépenses sociales par habitant est un peu inférieur à 2.
Ainsi, le niveau des dépenses sociales n'est pas strictement proportionnel à la richesse par habitant de chaque pays en Europe.
Mais , le graphique ci-après montre, malgré tout , l'existence d'une forte corrélation entre le niveau du PIB par habitant et le niveau des dépenses publiques dans le PIB.
DÉPENSES DE PROTECTION SOCIALE ET PIB PAR
HABITANT
DANS LES ÉTATS MEMBRES, 1999
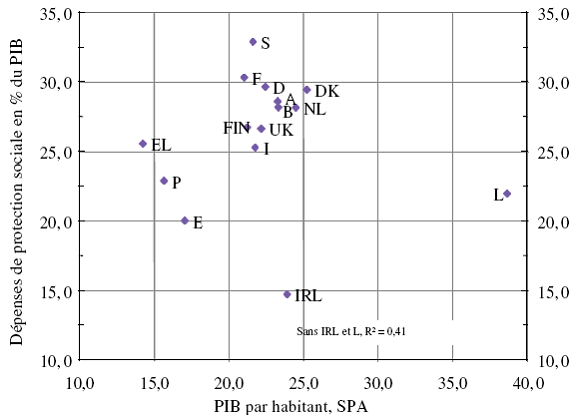
Source : La protection sociale en Europe 2001, Commission européenne
c) ... et avec des facteurs d'écarts plus ponctuels, variables selon la position des pays
Dans les pays européens où les dépenses sociales sont globalement faibles comparativement, c'est le faible niveau des dépenses publiques de retraite qui explique les écarts à la moyenne 24 ( * ) .
En revanche, pour les pays à protection sociale relativement élevée, le surplus de dépenses est dû à des différences plus diffuses . Dans ces pays, la couverture sociale publique est, risque par risque, plus forte, du moins pour une majorité des risques sociaux.
(1) Parmi les pays à faible protection sociale, la place relativement faible des dépenses de pension est essentielle
* Pour les pays dont le niveau des dépenses sociales se détache de 2 points de PIB et plus par le bas (Irlande, Espagne, Luxembourg, Portugal, Italie et Grèce), le décrochage est souvent majoritairement imputable aux dépenses de pension, qui peuvent être en retrait assez net par rapport à la moyenne.
Tel est le cas pour l' Irlande , l' Espagne , le Luxembourg et le Portugal . Pour ces pays, les écarts à la moyenne sont de plus de 3 points de PIB dans ce domaine (8,6 points pour l'Irlande) et rendent compte de la plus grande partie des écarts à la moyenne du ratio « dépenses publiques sociales/PIB » qu'ils extériorisent.
* Pour l'Italie, c'est une situation inverse qu'il faut observer puisqu'il s'agit du pays où le niveau relatif au PIB des dépenses de retraites est le plus élevé. Dans ce pays, c'est le cumul de petites différences à la moyenne sur l'ensemble des autres postes de dépenses sociales qui détermine sa position de pays où les dépenses publiques sociales se situent au-dessous de la moyenne européenne.
(2) Pour les pays à protection sociale élevée, des facteurs plus diffus
* S'agissant des pays où le niveau des dépenses sociales , exprimé en points de PIB, est supérieur à la moyenne de plus de 2 points (Suède, France, Allemagne), c'est l'addition d'écarts , généralement faibles , qui explique leur situation .
Seules la France pour les dépenses de santé, et la Suède, pour les dépenses liées à l'invalidité, se distinguent avec netteté de la dépense moyenne consacrée en Europe aux différentes catégories d'intervention sociale. Notre pays est d'ailleurs celui qui consacre le plus de moyens à la santé. Mais, c'est la seule catégorie de dépenses publiques sociales pour laquelle il détient le record.
* En moyenne, la structure des dépenses sociales dans l'Union européenne comprend pour près de la moitié (44 %) des dépenses de pension, un peu plus de 1/5e (21,7 %) des dépenses de santé et autour de 8 % des dépenses d'invalidité (7,9 %) et en faveur des familles (8,1 %).
Le reliquat, un peu moins d'1/5 e (18,3 %), regroupe les indemnités de chômage (6,2 %) et de maladie (3,9 %), les dépenses en faveur du logement (2,1 %) et de lutte contre l'exclusion sociale (1,6 %).
Plus de 77 % des dépenses sociales sont donc des dépenses de pensions et de santé au sens large (santé, indemnisation pour maladie et invalidité) .
ÉCART À LA STRUCTURE MOYENNE DES
DÉPENSES DE PROTECTION SOCIALE
DANS L'UNION EUROPÉENNE, EN
1999 (EN POINTS DE POURCENTAGE)
|
Maladie |
Santé |
Invalidité |
Vieillesse |
Famille |
Chômage |
Logement |
Exclusion sociale |
Adminis-tration |
|
|
Belgique |
+ 0,1 |
- 2,8 |
+ 0,6 |
- 3,8 |
+ 0,4 |
+ 5,1 |
- 2,1 |
+ 0,5 |
+ 0,8 |
|
Danemark |
- 0,7 |
- 5,9 |
- 3,9 |
- 7,0 |
+ 4,6 |
+ 4,6 |
+ 0,3 |
+ 2,0 |
- 0,5 |
|
Allemagne |
+ 1,2 |
+ 0,3 |
- 0,4 |
- 3,4 |
+ 2,0 |
+ 0,9 |
- 1,5 |
+ 0,3 |
+ 0,1 |
|
Grèce |
+ 0,9 |
+ 1,8 |
- 0,3 |
+ 0,9 |
- 6,1 |
+ 6,3 |
- 0,9 |
- 0,9 |
- 0,9 |
|
France |
- 1,6 |
+ 2,8 |
- 2,3 |
- 2,1 |
+ 1,2 |
+ 0,8 |
+ 0,9 |
- 0,2 |
+ 0,7 |
|
Irlande |
+ 0,3 |
+ 12,5 |
- 3,1 |
- 20,0 |
+ 4,3 |
+ 4,4 |
+ 1,2 |
+ 0,3 |
+ 1,2 |
|
Italie |
- 1,2 |
- 1,6 |
- 1,9 |
+ 17,8 |
- 4,6 |
- 4,1 |
- 2,1 |
- 1,5 |
- 0,7 |
|
Luxembourg |
- 0,9 |
- 0,4 |
+ 6,0 |
- 3,9 |
+ 6,9 |
- 3,8 |
- 1,8 |
- 0,8 |
- 0,9 |
|
Pays-Bas |
+ 4,6 |
- 3,1 |
+ 3,2 |
- 7,3 |
- 4,1 |
- 0,4 |
- 0,7 |
+ 3,8 |
+ 1,3 |
|
Autriche |
- 0,1 |
+ 0,3 |
+ 0,6 |
+ 1,9 |
+ 1,9 |
- 1,0 |
- 1,8 |
- 0,4 |
- 1,4 |
|
Portugal |
- 2,0 |
+ 5,6 |
+ 2,6 |
- 5,9 |
- 3,6 |
- 2,9 |
- 2,1 |
- 0,1 |
+ 0,4 |
|
Finlande |
+ 0,5 |
- 3,7 |
+ 5,9 |
- 9,8 |
+ 4,4 |
+ 4,8 |
- 0,6 |
+ 0,4 |
- 0,7 |
|
Suède |
+ 2,5 |
- 3,2 |
+ 3,6 |
- 5,1 |
+ 2,3 |
+ 1,8 |
+ 0,2 |
+ 0,9 |
- 1,7 |
|
Royaume-Uni |
- 1,3 |
- 0,5 |
+ 1,7 |
+ 0,2 |
+ 0,4 |
- 3,1 |
+ 3,7 |
- 0,7 |
0 |
Note de lecture :
(sur fond gris) écart en
plus, le plus élevé ;
(sur fond bleu) écart en
moins, le plus élevé
Source : La protection sociale en Europe 2001, Commission européenne. Calculs de l'auteur.
* Une certaine homogénéité existe entre les pays pour certaines catégories de dépenses sociales sous l'angle de la place que ces dépenses occupent dans l'ensemble.
Il en va ainsi d'abord pour les dépenses d'administration générale des systèmes sociaux. Elles présentent une faible corrélation avec le niveau d'intervention sociale mais, partout, elles représentent une faible part du total des dépenses. Par ailleurs, les dépenses de logement , de lutte contre l'exclusion sociale et d' indemnisation pour maladie sont relativement proches du point de vue de leur part dans l'ensemble.
En revanche, des écarts plus importants sont observables pour les dépenses de chômage , d' indemnisation de l'invalidité et d' actions en faveur des familles .
Enfin, les postes pour lesquels les différences entre pays sont les plus marquées sont les dépenses de santé et celles de retraites .
II. LES DÉPENSES SOCIALES DANS LES PAYS DÉVELOPPÉS, DERRIÈRE LA DIVERSITÉ DES DÉPENSES PUBLIQUES, UNE CERTAINE HOMOGÉNÉITÉ DES RICHESSES TOTALES CONSACRÉES À LA PROTECTION SOCIALE
L' hétérogénéité des niveaux de richesse allouée à la protection sociale dans les pays développés de l' OCDE , qui représentent un champ plus vaste que la seule Union européenne, parait très forte à l'aune des seules dépenses publiques sociales .
Se dégage ainsi une impression qui imprègne souvent le débat public : celle d'une certaine frilosité de l'Europe comparée au goût du risque des grands « modèles » extérieurs à son espace.
Mais, les données disponibles sur les dépenses fiscales et surtout sur les dépenses privées de sécurité sociale modifient considérablement ce paysage .
Quand on les ajoute aux dépenses publiques, la fraction de la richesse nationale dédiée à la protection sociale dans les pays de développement comparable révèle des préférences beaucoup plus homogènes .
Compte tenu des choix statistiques opérés, qui ne permettent pas d'effacer tous les effets des différences institutionnelles entre pays, on est conduit à estimer que les différences qui subsistent après intégration des dépenses sociales, usuellement omises dans le débat public, majorent encore les différences internationales par rapport aux situations réelles des pays.
En bref, le soi-disant contraste entre l'Europe et son environnement international de niveau de développement économique comparable au regard des risques sociaux n'a pas la réalité tangible qu'on lui prête .
Au-delà, le constat que, derrière la forte diversité du niveau des dépenses publiques sociales il existe une assez grande homogénéité des ressources économiques consacrées à la protection sociale, suggère quelques réflexions :
- il est en cohérence avec l'intuition selon laquelle il existe chez les agents économiques des « préférences » analogues ;
- il conduit à relativiser l'impact des choix d'organisation puisque le niveau des dépenses publiques ne détermine que « marginalement » le niveau des ressources économiques consacrées aux assurances sociales.
Toutefois, même marginales, des différences subsistent. Elles sont manifestement liées à des particularités de contexte : le taux de chômage, la proportion des personnes âgées... Mais, elles portent aussi, bien que résiduellement, la marque du développement relatif de l'intervention collective. Selon votre rapporteur, c'est la composante redistributive de celle-ci qui exerce là son influence.
Autrement dit, si les dépenses publiques sociales exercent un effet marginal sur le niveau des ressources économiques consacrées à la protection sociale, c'est principalement du fait de leurs propriétés redistributives.
A. LE CHAMP DE L'ANALYSE DES DÉPENSES DE PROTECTION SOCIALE DOIT ÊTRE ÉLARGI POUR EN SAISIR RÉELLEMENT LES ENJEUX
Le niveau des dépenses sociales et leur évolution, sont, malheureusement, généralement appréhendés sur la base de données relatives aux seules dépenses publiques et, qui plus est, aux seules dépenses publiques brutes.
Dans cette approche, elles ne sont corrigées ni des prélèvements obligatoires (que leurs bénéficiaires peuvent devoir supporter), ni de l'ensemble des dépenses fiscales qui peuvent tenir lieu d'avantages sociaux, et elles n'intègrent pas la totalité du revenu national destiné à la protection sociale puisque la plupart des ressources privées dont les agents bénéficient au titre de leur protection sociale individuelle sont ignorées .
1. Passer des dépenses publiques brutes aux dépenses publiques nettes
Le raisonnement en dépenses brutes est justifié pour les services collectifs en nature qui ne donnent pas lieu usuellement à la perception d'impôts ou de taxes 25 ( * ) et ne sont pas davantage pris en compte dans le revenu fiscal des utilisateurs.
En revanche , pour les dépenses publiques de transferts (subventions, prestations sociales en espèces...), il convient d'ajouter à la seule considération des dépenses brutes celle des dépenses nettes des impositions qu'elles peuvent supporter, afin de disposer d'une vue plus précise de leur impact et de données autorisant des comparaisons plus justes dans le temps ou entre pays.
En effet, plus la pression fiscale est forte sur de tels transferts, plus les transferts bruts doivent être élevés pour un même niveau de transferts nets .
Raisonner sur les seules dépenses publiques brutes, comme c'est l'usage dans le débat public, est par conséquent insuffisamment éclairant :
- quant aux avantages réellement procurés à leurs bénéficiaires par les dépenses de transferts ;
- et, symétriquement, sur la contribution réelle de la collectivité à la satisfaction des besoins.
En outre, comme les taux d'imposition varient selon les pays, ou dans le temps, le critère des dépenses publiques brutes conduit à exagérer la dispersion des niveaux d'intervention publique lorsqu'il est seul utilisé pour analyser celle-ci. De fait, les dépenses publiques nettes sont moins différenciées .
La référence aux dépenses publiques nettes, en plus de celles des dépenses publiques brutes, s'impose donc .
Elle n'est disponible que pour les seules dépenses publiques sociales, grâce à une base de données de l'OCDE destinée à compléter ses publications statistiques qui, d'ordinaire, ne recensent que les dépenses publiques brutes .
2. Intégrer les dépenses privées de protection sociale
Les données de l'OCDE offrent un autre avantage majeur : elles s'efforcent d'intégrer les dépenses privées à finalité sociale. Ainsi, elles fournissent une vue plus complète, et plus juste du montant des ressources économiques consacrées à la protection sociale.
Toutefois, il faut fortement déplorer les limites des conventions statistiques qui sont utilisées qui conduisent à occulter une partie importante des ressources privées allouées à la protection sociale .
Mais, en l'état, la publication de l'OCDE débouche déjà sur une image de la place des dépenses sociales qui est substantiellement différente de celle que procure son estimation à partir des seules dépenses publiques brutes .
L'intégration de certaines dépenses privées de protection sociale 26 ( * ) et la prise en compte de la fiscalité permettent de cerner plus précisément les bénéfices et les ressources réellement consacrées à la protection sociale que ne le font les données les plus usuellement utilisées dans le débat public.
A l'image initiale d'une grande diversité du niveau des ressources dédiées à la protection sociale, se substitue alors celle de choix nettement plus convergents, qui conduisent à s'interroger sur la portée du débat relatif au niveau des dépenses publiques sociales.
B. LA PRISE EN COMPTE DES DÉPENSES PRIVÉES DE PROTECTION SOCIALE RAPPROCHE LES « MODÈLES » DES PAYS DE L'OCDE
Alors que sur la base des seules dépenses publiques prévaut l'impression d'une grande dispersion des richesses allouées à des fins de protection sociale, l'inclusion des dépenses privées (celles prises en compte par l'OCDE) rapproche sensiblement des pays développés .
1. Une répartition des dépenses sociales entre sources privées et publiques qui varie
Les dépenses sociales telles qu'elles sont recensées par l'OCDE représentaient, en 2003 , 24,6 % du PIB .
Sans doute, pour l'essentiel ( 21,4 % du PIB ) s'agit-il de dépenses publiques, une part minoritaire ( 3,2 % du PIB et 13 % du total des dépenses sociales) étant constituée de dépenses privées 27 ( * ) .
Cependant, autour de cette moyenne, la répartition des dépenses sociales , entre sources publique et privée respectivement, diffère nettement selon le pays considéré .
Par exemple, alors qu'en France les dépenses privées de protection sociale se montent à l'équivalent de 2,7 points de PIB -, elles représentent au Royaume-Uni 6,8 points de PIB , 7,7 points aux Pays-Bas et plus de 10 points aux États-Unis (10,1 points du PIB en 2003).
DÉPENSES SOCIALES PUBLIQUES ET PRIVÉES
BRUTES - 2003*
(EN % DU PIB)
|
Pays |
Dépenses publiques |
(dont dépenses fiscales) |
Dépenses privées |
Total |
|
Suède |
31,3 |
0 |
3 |
34,3 |
|
France |
29,7 |
1 |
2,7 |
32,4 |
|
Allemagne |
29,4 |
2,1 |
3 |
32,4 |
|
Danemark |
27,6 |
0 |
2,5 |
30,1 |
|
Belgique |
27,1 |
0,6 |
3,9 |
31 |
|
Autriche |
26,1 |
0 |
2,1 |
28,2 |
|
Norvège |
25,2 |
0,1 |
2,6 |
27,8 |
|
Italie |
24,6 |
0,2 |
2,3 |
26,9 |
|
Finlande |
22,5 |
0 |
4,7 |
27,2 |
|
Pays-Bas |
21,6 |
0,7 |
7,7 |
29,3 |
|
OCDE-24 |
21,4 |
0,7 |
3,2 |
24,6 |
|
Royaume-Uni |
21,1 |
0,5 |
6,8 |
27,9 |
|
Espagne |
20,7 |
0,4 |
0,3 |
21 |
|
Islande |
18,7 |
2,1 |
5,1 |
23,8 |
|
Canada |
18,6 |
1,3 |
5,4 |
24 |
|
Japon |
18,5 |
0,8 |
3,3 |
21,8 |
|
États-Unis |
18,4 |
0,5 |
10,1 |
28,5 |
|
Australie |
18,2 |
0,3 |
4,4 |
22,6 |
|
Nouvelle Zélande |
18,1 |
0,1 |
7,7 |
25,8 |
|
Irlande |
16,3 |
0,4 |
0,5 |
16,8 |
|
Mexique |
7,7 |
0,9 |
0,2 |
7,9 |
|
Corée |
6,3 |
0,6 |
2,4 |
8,7 |
* Hors dépenses fiscales pour retraites, y compris les services de santé.
Source : OCDE (2005)
DISPERSION DES DÉPENSES SOCIALES PUBLIQUES ET PRIVÉES - EN 2003* (EN POINTS DE PIB)
|
Pays de l'OCDE |
Dépenses publiques |
Écart à la moyenne |
(dont dépenses fiscales) |
Dépenses privées |
Écart à la moyenne |
Total |
Écart à la moyenne |
|
Suède |
31,3 |
8,47 |
0 |
3 |
- 1,11 |
34,3 |
7,36 |
|
France |
29,7 |
6,87 |
1 |
2,7 |
- 1,41 |
32,4 |
5,46 |
|
Allemagne |
29,4 |
6,57 |
2,1 |
3 |
- 1,11 |
32,4 |
5,46 |
|
Danemark |
27,6 |
4,77 |
0 |
2,5 |
- 1,61 |
30,1 |
3,16 |
|
Belgique |
27,1 |
4,27 |
0,6 |
3,9 |
- 0,21 |
31,0 |
4,06 |
|
Autriche |
26,1 |
3,27 |
0 |
2,1 |
- 2,01 |
28,2 |
1,26 |
|
Norvège |
25,2 |
2,37 |
0,1 |
2,6 |
- 1,51 |
27,8 |
0,86 |
|
Italie |
24,6 |
1,77 |
0,2 |
2,3 |
- 1,81 |
26,9 |
- 0,04 |
|
Finlande |
22,5 |
- 0,33 |
0 |
4,7 |
0,59 |
27,2 |
0,26 |
|
Pays-Bas |
21,6 |
- 1,23 |
0,7 |
7,7 |
3,59 |
29,3 |
2,36 |
|
Royaume-Uni |
21,1 |
- 1,73 |
0,5 |
6,8 |
2,69 |
27,9 |
0,96 |
|
Espagne |
20,7 |
- 2,13 |
0,4 |
0,3 |
- 3,81 |
21,0 |
- 5,94 |
|
Islande |
18,7 |
- 4,13 |
2,1 |
5,1 |
0,99 |
23,8 |
- 3,14 |
|
Canada |
18,6 |
- 4,23 |
1,3 |
5,4 |
1,29 |
24,0 |
- 2,94 |
|
Japon |
18,5 |
- 4,33 |
0,8 |
3,3 |
- 0,81 |
21,8 |
- 5,14 |
|
États-Unis |
18,4 |
- 4,43 |
0,5 |
10,1 |
5,99 |
28,5 |
1,56 |
|
Australie |
18,2 |
- 4,63 |
0,3 |
4,4 |
0,29 |
22,6 |
- 4,34 |
|
Nouvelle Zélande |
18,1 |
- 4,73 |
0,1 |
7,7 |
3,59 |
25,8 |
- 1,14 |
|
Irlande |
16,3 |
- 6,53 |
0,4 |
0,5 |
- 3,61 |
16,8 |
- 10,14 |
|
Moyenne 28 ( * ) |
22,83 |
0,58 |
4,11 |
26,94 |
|||
|
Écart-type |
4,7 |
0,6 |
2,5 |
4,4 |
|||
|
Écart-type relatif |
20 % |
110 % |
62 % |
16 % |
* Hors dépenses fiscales pour retraites, y compris les services de santé.
2. Un effet de « vases communicants »
Tous les grands pays de l'OCDE (à l'exception de l'Espagne) qui, sous l'angle du poids des dépenses publiques sociales, sont situés au-dessous de la moyenne , sont, en revanche, au- dessus de la moyenne OCDE des dépenses sociales privées .
Pour les pays 29 ( * ) au-dessous de la moyenne des dépenses publiques sociales, le niveau moyen des dépenses privées de sécurité sociale s'élève à 5,4 points de PIB contre 3 points de PIB pour les pays au-dessus 30 ( * ) .
Ainsi il semble établi que, lorsque l'intervention collective en ce domaine est réduite , les agents recherchent auprès d'assurances privées la protection sociale que les systèmes publics ne leur fournissent pas en suffisance.
ÉCARTS À LA MOYENNE DES DÉPENSES
SOCIALES PAR CATÉGORIE
(PUBLIQUES / PRIVÉES) DANS QUELQUES
GRANDS PAYS DE L'OCDE - 2003
(EN % DU PIB)
|
Par rapport aux dépenses publiques
|
Pays |
Par rapport aux dépenses privées |
|
- 3,0 |
États-Unis |
+ 6,7 |
|
- 3,2 |
Australie |
+ 1,1 |
|
- 2,8 |
Canada |
+ 2,1 |
|
- 2,9 |
Japon |
+ 0,1 |
|
+ 0,2 |
Pays-Bas |
+ 4,5 |
3. L'inclusion des dépenses privées rapproche la situation des pays au regard du revenu national alloué à la protection sociale
a) Au niveau de l'OCDE
Au total, les écarts par rapport à la moyenne des dépenses sociales totales dans ces pays sont beaucoup plus faibles que quand on ne considère que les dépenses publiques .
Pour l'Australie, l'écart passe de
- 3,2 points à - 1,8 point ;
de - 2,9 points pour le Japon à
- 2,8 points et de - 2,8 points pour le Canada à
- 0,6 point.
Pour les États-Unis, l'écart change même de sens ; notablement au-dessous de la moyenne pour les dépenses publiques brutes de protection sociale, les États-Unis passent au-dessus (+ 3,9 points) de la moyenne pour l'ensemble des dépenses sociales .
Ainsi, la prise en compte des dépenses privées « homogénéise » les niveaux du revenu national consacré à la protection sociale .
b) Au niveau européen
Même s'agissant des grands pays de l'Union européenne, qui sont pourtant relativement homogènes du point de vue des dépenses publiques sociales, la prise en compte des dépenses sociales privées écrase les écarts, l'Italie seule faisant exception .
NIVEAU DE PROTECTION SOCIALE DANS QUATRE GRANDS PAYS
EUROPÉENS - 2003
(EN % DU PIB)
|
Pays |
Dépenses publiques |
Dépenses privées |
Total |
|||
|
% |
Écart à la moyenne |
% |
Écart à la moyenne |
% |
Écart à la moyenne |
|
|
France |
29,7 |
+ 3,5 |
2,7 |
- 1,0 |
32,4 |
+ 2,5 |
|
Allemagne |
29,4 |
+ 3,2 |
3,0 |
- 0,7 |
32,4 |
+ 2,5 |
|
Italie |
24,6 |
- 1,6 |
2,3 |
- 1,4 |
26,9 |
- 3,0 |
|
Royaume-Uni |
21,1 |
- 5,1 |
6,8 |
+ 3,1 |
27,9 |
- 2,0 |
|
Moyenne |
26,2 |
3,7 |
29,9 |
|||
La hiérarchie des quatre grands pays européens est modifiée quand les dépenses sociales d'origine privée sont prises en considération . L'Allemagne prend la tête des quatre pays, à égalité avec la France, et le Royaume-Uni le troisième rang, reléguant l'Italie en queue de peloton.
Les écarts en termes de revenu national alloué aux dépenses sociales en ressortent très réduits, du fait de l'importance particulière des besoins sociaux couverts par des dépenses privées au Royaume-Uni .
c) Pour la France
S'agissant de la France, son niveau de protection sociale publique brute, qui est le deuxième de l'OCDE (après la Suède), paraît très supérieur à beaucoup d'autres, quand on l'estime sur la base des seules dépenses publiques .
Il excède de 8,3 points de PIB la moyenne de l'OCDE, de 8,1 points de PIB le niveau néerlandais, et de 8,6 points de PIB le niveau du Royaume-Uni .
Les écarts avec les États-Unis , l' Australie , le Canada et le Japon , sont, respectivement, de 11,3 , 11,5 , 11,1 et 11,2 points de PIB.
Par rapport aux premiers pays, la France semble dépenser pour la protection sociale 1/3 de revenu en plus ; par rapport au second groupe de pays, le niveau atteint par la protection sociale en France semble de 60 % supérieur à ce qu'il est dans ces pays .
Ces rapports changent considérablement quand on envisage l'ensemble des dépenses sociales .
Les écarts avec les Pays-Bas et le Royaume-Uni tombent, respectivement, de 8,1 à 3,1 points de PIB et de 8,6 à 4,5 points de PIB. De la même manière, le poids de la protection sociale, qui apparaît 60 % plus élevé que celui des États-Unis sous l'angle des seules dépenses publiques, n'est plus supérieur que de 13,7 % quand les dépenses privées recensées par l'OCDE 31 ( * ) sont prises en compte.
*
* *
Au total, alors que la protection sociale semble mobiliser très inégalement les ressources économiques nationales quand elle est appréhendée sur la base des seules dépenses publiques, une réelle convergence entre pays de même niveau de développement se révèle quand les dépenses privées sont prises en considération.
De fait, celles-ci apparaissent souvent comme un substitut à des mécanismes publics limités qui, pour être économes en dépenses publiques, « contraignent » les agents à recourir à des systèmes privés de protection sociale .
Au demeurant, ce rapprochement des situations nationales déjà très important est probablement encore plus net dans la réalité .
La qualité des données concernant les dépenses publiques est inégale selon les pays. En particulier, les dépenses publiques locales, qui peuvent atteindre des niveaux importants, notamment dans les pays fédéraux, sont souvent mal recensées.
De même, les méthodes statistiques ne permettent pas de couvrir complètement les ressources privées consacrées à la protection sociale. Les conventions statistiques des bases de données SESPROS (Europe) et SOCX (OCDE), quoiqu'elles manifestent de réels progrès, conduisent à exclure une partie très importante du PIB que la protection sociale mobilise.
Non seulement de nombreuses initiatives privées caritatives sont exclues - elles peuvent représenter des montants très significatifs dans les pays où la culture du don est vivante - mais encore, et surtout, les garanties privées individuelles et leurs contreparties ne sont pas prises en compte . Il en va ainsi des assurances privées (type assurance-vie) et, plus généralement, de tous les produits de l'épargne individuelle .
Or, s'il serait certainement abusif de les prendre tous en compte, on ne peut non plus se satisfaire de leur exclusion systématique du champ des statistiques de protection sociale . L'un des mobiles de l'épargne est la recherche des garanties (l'épargne de précaution) ; lorsque les assurances collectives, qu'elles soient publiques ou privées, sont défaillantes, les agents recherchent souvent une protection individuelle (la situation de l'épargne en Chine en témoigne) ; surtout, les ressources correspondantes sont destinées, comme les autres dépenses de protection sociale, à couvrir des risques et non à rémunérer une activité économique .
Bien que déjà très significatifs d'une convergence réelle des revenus consacrés à la protection sociale dans les principaux pays de l'OCDE, les résultats présentés ici masquent donc une convergence qui, dans la réalité, est plus grande encore .
C. CE RAPPROCHEMENT EST ENCORE ACCENTUÉ QUAND ON RAISONNE EN DÉPENSES SOCIALES NETTES
Le jeu des prélèvements obligatoires (en moins, pour les impôts et cotisations sociales appliquées aux transferts sociaux ; en plus, pour les dépenses fiscales ayant un objectif social) 32 ( * ) rapproche encore les niveaux de ressources réellement consacrés à la protection sociale dans les différents pays .
COMPARAISON DES RATIOS DÉPENSES
PUBLIQUES/PIB
DANS LES PAYS DE L'OCDE
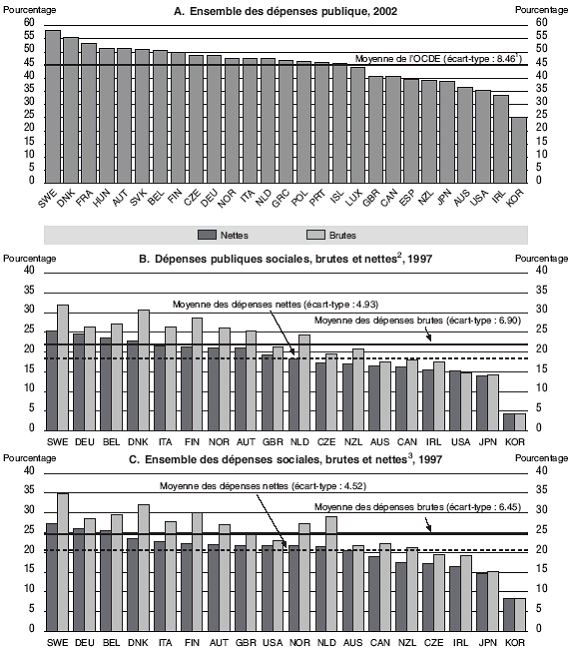
1
Les dépenses publiques sociales
nettes sont égales aux dépenses publiques sociales brutes
diminuées des impôts directs et cotisations sociales assis sur les
prestations publiques et des impôts indirects sur la consommation
privée financée par des transferts monétaires nets, et
augmentées des allègements d'impôts à
caractère social (hors retraites).
2
Écart-type a été calculé sur
la base des seules données des pays des parties B et C du
graphique.
3
L'ensemble des dépenses sociales englobe
les dépenses publiques sociales et les programmes privés qui ont
un but social et concourent au principe de répartition.
Source : OCDE ; Adema (2001)
* A partir des données des graphiques ci-dessus, on relève, en premier lieu, que la fiscalité réduit en moyenne le niveau de la protection sociale effective de près de cinq points de PIB .
Les dépenses sociales nettes ne représentent plus qu'un cinquième du PIB quand les dépenses brutes s'élevaient au quart .
* Par ailleurs, la dispersion des pays est très nettement atténuée alors même que tous les effets des allégements fiscaux ne sont pas pris en compte.
* Les écarts à la moyenne des dépenses sociales nettes dans l'OCDE sont significativement moins grands que les mêmes écarts mesurés à partir des seules dépenses brutes .
1. Les dépenses publiques de protection sociale nettes sont plus basses que les dépenses brutes
S'agissant des seules dépenses publiques de protection sociale ( 20,7 % du PIB ), elles ressortent réduites après application des prélèvements obligatoires .
Les dépenses publiques nettes s'élèvent à 18,2 % du PIB , soit 2,5 points de PIB de moins que les dépenses publiques brutes.
2. Les dépenses privées nettes ajoutent à la protection sociale, mais très diversement selon les pays
Les dépenses privées nettes ajoutent en moyenne 2,4 points de PIB aux ressources publiques nettes affectées à la protection sociale.
Mais, cette contribution est très diverse selon les pays .
Marginale dans les pays où les dépenses publiques sociales sont relativement élevées, elle peut être très forte dans certains des autres pays marqués par la faible place des dépenses publiques. Tel est le cas en Australie , au Canada , aux Pays-Bas, au Royaume-Uni , avec une contribution des dépenses privées volontaires nettes autour de 4 points de PIB , et, surtout, aux États-Unis avec 9,3 points de PIB .
3. Les dépenses totales nettes de protection sociale sont beaucoup plus homogènes que les dépenses publiques brutes
- Au total, la dispersion des situations nationales est notablement diminuée quand au lieu d'envisager les seules dépenses publiques brutes de sécurité sociale, on observe les dépenses totales nettes de sécurité sociale. L'écart-type pour les premiers s'élève à 6,9 points de PIB et pour les secondes à 4,52 points de PIB, soit une réduction d'un tiers de l'amplitude des ressources consacrées à la sécurité sociale 33 ( * ) .
- S'agissant de la France , le niveau de ses dépenses publiques brutes de protection sociale atteint 28,7 % du PIB. Il excède de 8,0 points de PIB la « moyenne OCDE ».
Mais les dépenses publiques nettes sont inférieures de 3,1 points de PIB aux dépenses brutes, si bien que l'écart avec la moyenne OCDE est réduit à 7,4 points de PIB, une fois pris en compte les prélèvements obligatoires.
La prise en compte des dépenses privées de protection sociale - qui atteint un niveau un peu supérieur à la moyenne de l'OCDE-24 (2,5 points de PIB contre 2,4 points) - laisse à peu près inchangé l'écart à la moyenne de l'OCDE. Pour l'ensemble des dépenses sociales nettes, elles s'élèvent en France à 28,1 points de PIB contre 28,7 points de PIB pour les seules dépenses publiques brutes. L'écart avec la moyenne de l'OCDE à 24 s'élève à 7,5 points de PIB.
* Quand on ne retient que les grands pays de l'OCDE de développement comparable - soit les 18 pays mentionnés dans les tableaux ci-dessus - et qu'on inclut les dépenses fiscales liées aux systèmes de pension, l'homogénéité des situations nationales apparaît beaucoup plus forte.
L'écart entre le niveau des ressources consacrées en France à la protection sociale et le niveau moyen observé pour ces 18 pays est de 5,2 points de PIB.
DES DÉPENSES PUBLIQUES SOCIALES BRUTES AUX
DÉPENSES PUBLIQUES SOCIALES NETTES DANS L'ENSEMBLE DE
L'OCDE
(en points de PIB, en 2003)
|
Australie |
Autriche |
Belgique |
Canada |
Danemark |
Finlande |
France |
Allemagne |
Irlande |
Italie |
Japon |
Pays-Bas |
Nouvelle Zélande |
Norvège |
Espagne |
Suède |
Royaume Uni |
États-Unis |
OCDE-24 |
||
|
1 |
Dépenses publiques brutes |
17,9 |
26,1 |
26,5 |
17,3 |
27,6 |
22,5 |
28,7 |
27,3 |
15,9 |
24,2 |
17,7 |
20,7 |
18,0 |
25,1 |
20,3 |
31,3 |
20,6 |
16,2 |
20,7 |
|
Prélèvements directs |
0,1 |
2,6 |
1,6 |
0,4 |
4,0 |
2,2 |
1,3 |
1,1 |
0,2 |
1,8 |
0,2 |
1,6 |
1,4 |
2,1 |
1,2 |
4,3 |
0,2 |
0,7 |
1,2 |
|
|
Taxes indirectes |
0,9 |
2,8 |
2,4 |
0,9 |
3,2 |
2,5 |
2,7 |
2,2 |
2,1 |
2,0 |
0,6 |
1,9 |
1,6 |
2,8 |
1,8 |
2,7 |
1,6 |
0,4 |
||
|
2 |
Dépenses publiques nettes
|
16,9 |
20,7 |
22,5 |
16,0 |
20,3 |
17,8 |
24,7 |
24,0 |
13,6 |
20,4 |
16,9 |
17,2 |
15,0 |
20,2 |
17,3 |
24,3 |
18,8 |
15,1 |
|
|
3 |
Dépenses fiscales sociales nettes |
0,3 |
0,0 |
0,5 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
1,9 |
0,3 |
0,2 |
1,7 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,4 |
0,0 |
0,1 |
2,1 |
0,2 |
|
4 |
Dépenses publiques nettes (2+3) |
17,2 |
20,7 |
13,0 |
17,2 |
20,4 |
17,8 |
25,6 |
25,9 |
13,9 |
20,6 |
17,6 |
17,5 |
15,1 |
20,3 |
17,6 |
24,3 |
18,9 |
17,2 |
18,2 |
|
5 |
Dépenses privées obligatoires brutes |
1,2 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
3,5 |
0,4 |
1,2 |
0,0 |
1,8 |
0,7 |
0,7 |
0,0 |
1,6 |
0,0 |
0,6 |
0,8 |
0,4 |
0,9 |
|
Prélèvements directs |
0,2 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,7 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
|
|
Taxes indirectes |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,7 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
||
|
6 |
Dép. privées obligatoires nettes |
0,9 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
2,1 |
0,3 |
0,6 |
0,0 |
1,5 |
0,6 |
0,4 |
0,0 |
0,9 |
0,0 |
0,3 |
0,7 |
0,4 |
0,6 |
|
7 |
Sous-total (4+6) |
18,1 |
21,2 |
23,0 |
17,2 |
20,4 |
19,9 |
25,9 |
26,5 |
13,9 |
22,1 |
18,2 |
17,9 |
15,1 |
21,2 |
18,6 |
24,6 |
19,6 |
17,6 |
18,8 |
|
Dépenses privées volontaires brutes |
3,2 |
1,2 |
3,9 |
5,4 |
2,3 |
1,2 |
2,3 |
1,8 |
0,5 |
0,5 |
2,6 |
7,0 |
0,5 |
1,0 |
0,3 |
2,4 |
6,0 |
9,7 |
2,3 |
|
|
Prélèvements directs |
0,3 |
0,1 |
0,3 |
0,7 |
0,7 |
0,3 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
1,1 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,5 |
0,4 |
0,6 |
0,2 |
|
|
Taxes indirectes |
0,2 |
0,1 |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
0,7 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,4 |
0,8 |
0,2 |
||
|
8 |
Dép. privées volontaires nettes |
2,7 |
1,0 |
3,1 |
4,3 |
1,2 |
0,7 |
2,2 |
1,6 |
0,5 |
0,4 |
2,3 |
5,2 |
0,5 |
0,6 |
0,3 |
1,5 |
4,8 |
8,9 |
1,9 |
|
9 |
Sous-total (6+8) |
3,6 |
1,5 |
3,1 |
4,3 |
1,3 |
2,8 |
2,5 |
2,2 |
0,5 |
1,9 |
2,9 |
5,6 |
0,5 |
1,5 |
0,3 |
1,8 |
5,5 |
9,3 |
2,4 |
|
10 |
Dépenses totales nettes |
20,8 |
22,2 |
26,1 |
21,5 |
21,6 |
20,6 |
28,1 |
28,1 |
14,4 |
22,5 |
20,5 |
23,6 |
15,6 |
21,7 |
17,9 |
26,1 |
24,4 |
26,5 |
20,6 |
|
Estimations pour mémoire |
||||||||||||||||||||
|
11 |
Dépenses fiscales de pensions
|
1,8 |
0,1 |
0,1 |
1,7 |
- |
0,1 |
0,0 |
0,8 |
1,9 |
0,0 |
0,6 |
- |
- |
0,7 |
0,2 |
0,0 |
1,0 |
1,2 |
- |
|
12 |
Taux de taxation indirecte |
10,1 |
17,0 |
15,2 |
12,4 |
27,5 |
23,5 |
16,2 |
13,8 |
23,5 |
13,3 |
6,4 |
17,5 |
12,1 |
24,6 |
14,8 |
22,3 |
15,4 |
4,7 |
16,5 |
|
13 |
Total (10 + 11) |
22,6 |
22,3 |
26,2 |
23,2 |
21,6 |
20,7 |
28,1 |
28,9 |
16,3 |
22,5 |
21,1 |
23,6 |
15,6 |
22,4 |
18,1 |
26,1 |
25,4 |
27,7 |
20,6 |
Source : OCDE. Base de données sur les
dépenses sociales.
DES DÉPENSES PUBLIQUES SOCIALES
BRUTES AUX DÉPENSES PUBLIQUES SOCIALES NETTES (2003)
ÉCARTS
À LA MOYENNE DES SEULS PAYS MENTIONNÉS
|
Australie |
Autriche |
Belgique |
Canada |
Danemark |
Finlande |
France |
Allemagne |
Irlande |
Italie |
Japon |
Pays-Bas |
Nouvelle Zélande |
Norvège |
Espagne |
Suède |
Royaume Uni |
États-Unis |
Moyenne arithmétique simple des pays |
Écart-type |
Écart-type relatif (écart type/ moyenne) 1 |
|
|
Dépenses publiques brutes |
17,9 |
26,1 |
26,5 |
17,3 |
27,6 |
22,5 |
28,7 |
27,3 |
15,9 |
24,2 |
17,7 |
20,7 |
18 |
25,1 |
20,3 |
31,3 |
20,6 |
16,2 |
22,4 |
4,79 |
21 % |
|
Écart à la moyenne |
-4,5 |
3,7 |
4,1 |
-5,1 |
5,2 |
0,1 |
6,3 |
4,9 |
-6,5 |
1,8 |
-4,7 |
-1,7 |
-4,4 |
2,7 |
-2,1 |
8,9 |
-1,8 |
-6,2 |
|||
|
Dépenses publiques nettes |
17,2 |
20,7 |
23 |
17,2 |
20,4 |
17,8 |
25,6 |
25,9 |
13,9 |
20,6 |
17,6 |
17,5 |
15,1 |
20,3 |
17,6 |
24,3 |
18,9 |
17,2 |
18,5 |
3,69 |
19 % |
|
Écart à la moyenne |
-2,6 |
0,9 |
3,2 |
-2,6 |
5,5 |
-2,0 |
5,8 |
6,1 |
-5,9 |
0,8 |
-2,2 |
-2,3 |
-4,7 |
0,5 |
-2,2 |
4,7 |
-0,9 |
-2,6 |
|||
|
Dépenses privées nettes |
3,6 |
1,5 |
3,1 |
4,3 |
1,3 |
2,8 |
2,5 |
2,2 |
0,5 |
1,9 |
2,9 |
5,6 |
0,5 |
1,5 |
0,3 |
1,8 |
5,5 |
9,3 |
2,8 |
2,18 |
80 % |
|
Écart à la moyenne |
0,9 |
-1,2 |
0,4 |
1,6 |
-1,4 |
0,1 |
-0,2 |
-0,5 |
-2,2 |
-0,8 |
0,2 |
2,9 |
-2,2 |
-2,1 |
-2,4 |
-1,2 |
2,1 |
6,2 |
|||
|
Dépenses totales 2 |
22,6 |
22,3 |
26,2 |
23,2 |
21,7 3 |
20,7 |
28,1 3 |
28,9 |
16,3 |
22,5 |
21,1 |
23,6 3 |
15,6 3 |
22,4 |
18,1 |
26,1 |
25,4 |
27,7 |
22,9 |
3,79 |
17 % |
|
Écart à la moyenne |
-0,3 |
-0,6 |
3,3 |
0,3 |
-1,3 |
-2,2 |
5,2 |
6,0 |
-6,6 |
-0,4 |
-1,8 |
0,7 |
-7,3 |
-0,5 |
-4,8 |
3,2 |
2,5 |
4,8 |
1 En % de la moyenne
2 Y compris les dépenses fiscales liées au système de pensions.
3 Aucune dépense fiscale liée au système de pensions n'a pu être recensée.
Source : OCDE. Base de données sur les dépenses sociales.
Quand on envisage les pays sous l'angle du niveau de ressources qu'ils consacrent à la protection sociale publique (moins de 21 % de leur PIB ; entre 21 % et le quart du PIB ; au-delà du quart du PIB), on relève une concentration de pays dans la catégorie la plus « économe » en dépenses publiques (9 sur 18), trois pays y consacrant environ entre le cinquième et le quart de leur PIB, et six pays, dont la France, se situant au-delà.
CLASSIFICATION DU NIVEAU DES PAYS
SELON LE
CRITÈRE DES DÉPENSES PUBLIQUES SOCIALES BRUTES
|
Pays |
Moyenne |
|
|
< 21 points de PIB |
Australie, Canada, Irlande, Japon, Nouvelle Zélande, États-Unis, Espagne, Royaume-Uni, Pays-Bas |
18,3 |
|
Entre 21 et 25 points de PIB |
Danemark, Finlande, Italie |
22,8 |
|
> 25 points de PIB |
Autriche, Belgique, Allemagne, Norvège, Suède, France |
27,5 |
La prise en compte de la totalité des dépenses sociales modifie sensiblement le panorama auquel certains associent l'existence de modèles sociaux différenciés, plus ou moins portés sur le risque .
|
LES QUATRE MODÈLES SOCIAUX SELON ESPING-ANDERSEN Selon le danois Esping-Andersen, on pourrait distinguer quatre modèles sociaux coexistant en Europe : - le modèle scandinave (social-démocrate) qui assure à tous les citoyens un niveau élevé et uniforme de protection sociale . La fiscalité est très forte , individualisée et redistributive. Les services sociaux sont facilement disponibles. Le système repose sur la coopération des partenaires sociaux. Les prestations publiques sont complétées par des prestations professionnelles, organisées par les partenaires sociaux et couvrant la quasi-totalité de la population. - le modèle libéral (ou anglo-saxon) qui insiste sur la responsabilité individuelle . Les prestations sociales sont faibles, ciblées sur les plus pauvres , en étant généralement soumises à des conditions de ressources. Les autres ménages doivent recourir à des systèmes d'assurances d'entreprise ou privées, favorisés par des dispositions fiscales. La fiscalité est relativement faible. - le modèle continental : avec une protection sociale organisée sur une base professionnelle qui vise à garantir le maintien du revenu salarial . Elle est financée par des cotisations employeurs et employés. Les partenaires sociaux jouent un rôle important dans les relations professionnelles et la gestion de la protection sociale. - le modèle méditerranéen : il est marqué par l'importance des prestations vieillesse, la survivance des solidarités familiales (les prestations familiales et d'assistance sont faibles). |
A chacun de ses modèles correspondrait un niveau donné de protection sociale. Mais, cette catégorisation, sans être invalidée, doit être nuancée quand on observe la part totale du revenu alloué à la protection sociale dans les différents pays.
CLASSIFICATION DES PAYS
SELON LE CRITÈRE DU
NIVEAU DES DÉPENSES SOCIALES TOTALES
|
Pays |
Moyenne |
|
|
< 21 points de PIB |
Irlande, Nouvelle Zélande, Espagne, Finlande |
17,7 |
|
Entre 21 et 25 points de PIB |
Australie, Autriche, Canada, Danemark, Italie, Japon, Pays-Bas, Norvège |
22,4 |
|
> 25 points de PIB |
Belgique, Suède, Royaume-Uni, États-Unis, France, Allemagne |
27,1 |
Quand on ajoute les flux privés du revenu national consacrés à la protection sociale, les pays mobilisant moins de 21 % de leur PIB à la protection sociale passent de 9 à 2 .
Les pays consacrant plus du quart de leur PIB à la protection sociale restent au nombre de six mais ce ne sont pas les mêmes. Le Royaume-Uni et les États-Unis entrent dans ce groupe dont sortent l'Autriche et la Norvège. Par ailleurs, les écarts au sein de ce groupe de pays diminuent beaucoup : l'Allemagne, pays le plus généreux de la catégorie, ne devance le Royaume-Uni, pays le moins dispendieux, que de 2,7 points de PIB contre un écart de 6,2 points de PIB entre la Suède et la Norvège, pays extrêmes du groupe consacrant le plus de ressources à la protection sociale publique.
Enfin, la plupart des pays consacrent entre un cinquième et un quart du PIB à la satisfaction des besoins sociaux (22,4 points de PIB en moyenne).
III. LES PRINCIPALES CATÉGORIES DE DÉPENSES SOCIALES : UNE HOMOGÉNÉITÉ DES DÉPENSES TOTALES PLUS FORTE QUE CELLES DES SEULES DÉPENSES PUBLIQUES
La structure moyenne des dépenses de protection sociale en Europe est marquée par la prédominance des dépenses de pensions (45,6 % du total) et de santé-invalidité (36,3 %) , soit plus des 4/5 e de l'ensemble de la protection sociale. Les autres dépenses concernent la famille (8 %), le chômage (6,6 %) et le logement et l'exclusion (3,5 %).
LA STRUCTURE DES DÉPENSES DE PROTECTION SOCIALE
EN EUROPE - 2003
(EN % DU TOTAL)
|
Pensions |
Maladie |
Invalidité |
Famille |
Chômage |
Logement |
|
|
Europe |
45,7 |
28,3 |
8,0 |
8,0 |
6,6 |
3,5 |
|
Belgique |
44,5 |
27,0 |
6,6 |
7,8 |
12,4 |
1,7 |
|
Danemark |
37,2 |
20,5 |
13,5 |
13,2 |
9,8 |
5,7 |
|
Allemagne |
42,9 |
27,7 |
7,8 |
10,5 |
8,6 |
2,5 |
|
Grèce |
50,8 |
26,5 |
5,1 |
7,3 |
5,7 |
4,6 |
|
Espagne |
43,8 |
30,7 |
7,4 |
3,0 |
13,3 |
1,7 |
|
France |
43,3 |
30,5 |
4,8 |
9,0 |
7,9 |
4,5 |
|
Irlande |
23,2 |
41,8 |
5,1 |
16,0 |
8,4 |
5,6 |
|
Italie |
61,8 |
25,7 |
6,4 |
4,1 |
1,8 |
0,2 |
|
Luxembourg |
37,2 |
24,8 |
13,4 |
17,7 |
4,2 |
2,8 |
|
Pays-Bas |
40,3 |
31,4 |
11,1 |
4,9 |
6,2 |
6,2 |
|
Autriche |
48,2 |
24,8 |
8,6 |
10,8 |
6,0 |
1,7 |
|
Portugal |
46,2 |
28,8 |
11,5 |
6,5 |
5,5 |
1,6 |
|
Finlande |
37,0 |
25,1 |
13,3 |
11,5 |
9,9 |
3,3 |
|
Suède |
40,1 |
26,3 |
14,2 |
9,5 |
5,9 |
4,0 |
|
Royaume-Uni |
44,9 |
29,6 |
9,4 |
6,9 |
2,7 |
6,5 |
Source : Eurostat - ESSPROS
Les différences nationales sont assez prononcées mais, risque par risque, les dépenses totales (dépenses publiques et dépenses privées) sont plus homogènes que les seules dépenses publiques.
A. LES DÉPENSES DE RETRAITE
1. Une forte augmentation des dépenses de retraite depuis 1980
* Une augmentation régulière des dépenses publiques de retraite est intervenue depuis 1980.
- Les retraites publiques dans l'OCDE sont en 2003 plus élevées en moyenne d'un tiers par rapport à leur niveau de 1980 .
LES DÉPENSES PUBLIQUES DE RETRAITE 1 (1980-2003) - EN POINTS DE PIB
|
Pays |
1980 |
1985 |
1990 |
1995 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Écarts 2003/1980 |
|
|
En points de PIB |
En % |
|||||||||
|
Australie |
3,1 |
3,0 |
3,4 |
4,0 |
4,2 |
3,8 |
3,8 |
3,9 |
+ 0,8 |
+ 25,8 |
|
Autriche |
10,0 |
11,0 |
11,3 |
12,3 |
12,4 |
12,6 |
12,8 |
12,8 |
+ 2,8 |
+ 28,0 |
|
Belgique |
5,9 |
6,3 |
6,5 |
7,0 |
6,9 |
7,0 |
7,1 |
7,2 |
+ 1,3 |
+ 22,0 |
|
Canada |
2,8 |
3,5 |
3,9 |
4,3 |
3,9 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
+ 1,2 |
+ 42,8 |
|
République tchèque |
- |
- |
5,2 |
6,4 |
7,8 |
7,8 |
7,9 |
7,8 |
+ 2,6 2 |
+ 50,0 |
|
Danemark |
7,0 |
6,9 |
7,3 |
8,4 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,2 |
+ 0,2 |
+ 2,9 |
|
Finlande |
5,1 |
7,1 |
7,1 |
6,0 |
5,3 |
5,4 |
5,6 |
5,8 |
+ 0,7 |
+ 13,7 |
|
France |
7,7 |
8,5 |
9,3 |
10,6 |
10,5 |
10,4 |
10,3 |
10,5 |
+ 2,8 |
+ 36,4 |
|
Allemagne |
10,0 |
10,1 |
9,6 |
10,4 |
10,8 |
10,9 |
11,1 |
11,3 |
+ 1,3 |
+ 13,0 |
|
Grèce |
5,1 |
8,0 |
10,5 |
10,3 |
11,3 |
12,0 |
11,6 |
11,5 |
+ 6,4 |
+ 2,2 |
|
Irlande |
4,5 |
4,7 |
3,2 |
2,9 |
2,6 |
2,7 |
2,8 |
Nd |
-- |
-- |
|
Italie |
7,2 |
9,0 |
8,3 |
9,4 |
11,2 |
11,1 |
11,3 |
11,4 |
+ 4,2 |
+ 58,3 |
|
Japon |
3,0 |
3,9 |
4,1 |
5,2 |
6,8 |
7,3 |
7,8 |
8,0 |
+ 5,0 |
x 2,7 |
|
Corée |
- |
- |
0,6 |
1,1 |
1,3 |
1,1 |
1,1 |
1,2 |
+ 0,6 1 |
x 2 |
|
Luxembourg |
6,7 |
6,3 |
8,7 |
9,4 |
7,2 |
4,0 |
4,3 |
4,5 |
- 2,2 |
- 32,9 |
|
Mexique |
- |
0,2 |
0,4 |
0,6 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
1,0 |
+ 0,6 1 |
x 5 |
|
Pays-Bas |
5,9 |
5,7 |
6,1 |
5,4 |
5,3 |
5,2 |
5,3 |
5,4 |
- 0,5 |
- 8,8 |
|
Nouvelle-Zélande |
6,8 |
7,4 |
7,2 |
5,6 |
4,9 |
4,6 |
4,5 |
4,4 |
- 2,4 |
- 35,2 |
|
Norvège |
5,1 |
5,5 |
7,2 |
7,1 |
6,5 |
6,7 |
6,9 |
7,0 |
+ 1,9 |
+ 37,3 |
|
Pologne |
- |
- |
4,2 |
7,7 |
9,9 |
10,8 |
11,2 |
11,4 |
+ 7,2 |
x 2,7 |
|
Portugal |
3,4 |
3,6 |
4,4 |
6,5 |
7,3 |
7,7 |
8,3 |
8,8 |
+ 5,4 |
x 2,6 |
|
Espagne |
4,6 |
5,8 |
7,2 |
8,3 |
8,2 |
8,0 |
7,9 |
7,9 |
+ 3,3 |
+ 1,7 |
|
Suède |
7,8 |
8,3 |
8,6 |
9,9 |
9,3 |
9,4 |
9,5 |
10,1 |
+ 2,3 |
+ 29,5 |
|
Suisse |
5,6 |
5,8 |
5,5 |
6,5 |
6,5 |
6,7 |
6,6 |
6,8 |
+ 1,2 |
+ 21,4 |
|
Royaume-Uni |
4,2 |
4,5 |
5,0 |
5,6 |
5,6 |
5,8 |
5,8 |
5,9 |
+ 1,7 |
+ 40,5 |
|
États-Unis |
5,3 |
5,4 |
5,2 |
5,4 |
5,2 |
5,2 |
5,4 |
5,5 |
+ 0,2 |
+ 3,8 |
|
OCDE - Total |
5,0 |
5,5 |
5,9 |
6,5 |
6,7 |
6,7 |
6,8 |
6,9 |
+ 1,9 |
+ 38,0 |
1 Hors survie 2 2003/1990
Elles sont supérieures de 1,9 point de PIB au niveau initial .
Il faut observer, incidemment, que cette augmentation est de l'ordre de grandeur exact de celle des dépenses publiques de retraite prévue à l'horizon 2030 pour notre pays .
On doit ainsi remarquer, afin de prendre la juste mesure des choses, que les pays de l'OCDE ont absorbé en 23 ans , sans dommages apparemment excessifs , un supplément de dépenses publiques de retraite analogue à celui auquel la France devra faire face à un horizon de 45 ans . Il est vrai que les perspectives de ralentissement de la croissance économique pourraient « compliquer » ce bouclage si elles se réalisaient.
- En France , la progression des dépenses publiques de retraite a atteint 36,4 % entre 1980 et 2003 , soit + 2,8 points de PIB . Le niveau relatif des dépenses publiques de retraite dans le PIB a ainsi augmenté nettement dans notre pays qui se classe de ce point de vue au septième rang des pays ici examinés (en pourcentage, la France n'occupe que le onzième rang).
Cependant, l'augmentation relative des dépenses publiques de retraite a été moins forte en France que celle de l'OCDE en moyenne.
Quatre pays seulement extériorisent un repli des dépenses publiques de retraite : l'Irlande (- 1,6 point du PIB et - 36,6 %), le Luxembourg (- 2,2 points de PIB et - 32,9 %), les Pays-Bas (- 0,5 point de PIB et - 8,8 %) et la Nouvelle-Zélande (- 2,4 points de PIB et - 35,3 %).
Sauf l'Irlande, où le niveau initial des dépenses publiques de retraite était inférieur à la moyenne, tous ces pays sont passés d'un niveau supérieur à la moyenne à un niveau inférieur entre 1980 et 2003.
2. Des dépenses publiques de retraite très diversifiées
a) En Europe
* En 2004, les dépenses publiques de retraite s'élèvent en moyenne , dans l'Union européenne , à 10,6 points de PIB , soit près de la moitié (45,7 %) des dépenses sociales.
Mais, le niveau des dépenses publiques de retraite varie considérablement selon les pays dans l'Union européenne .
LES DÉPENSES PUBLIQUES DE RETRAITE-SURVIE DANS
L'UNION EUROPÉENNE
EN 2004
1
|
Pays |
% du PIB |
Rang décroissant |
|
Belgique |
10,4 |
10 |
|
Danemark |
9,5 |
13 |
|
Allemagne |
11,4 |
5 |
|
Espagne |
8,6 |
14 |
|
France |
12,8 |
4 |
|
Irlande |
4,7 |
24 |
|
Italie |
14,2 |
1 |
|
Luxembourg |
10,0 |
12 |
|
Pays-Bas |
7,7 |
16 |
|
Autriche |
13,4 |
3 |
|
Portugal |
11,1 |
6 |
|
Finlande |
10,7 |
8 |
|
Suède |
10,6 |
9 |
|
Royaume-Uni |
6,6 |
23 |
|
Chypre |
6,9 |
19 |
|
République tchèque |
8,5 |
15 |
|
Estonie |
6,7 |
21 |
|
Hongrie |
10,4 |
10 |
|
Lituanie |
6,7 |
21 |
|
Lettonie |
6,8 |
20 |
|
Malte |
7,4 |
17 |
|
Pologne |
13,9 |
2 |
|
Slovaquie |
7,2 |
18 |
|
Slovénie |
11,0 |
7 |
|
EU-25 |
10,6 |
NS |
1 La moyenne a été calculée en excluant les pays pour lesquels les données ne sont pas disponibles.
* La dispersion des situations nationales apparaît donc forte , notamment du fait des nouveaux entrants qui, pour nombre d'entre eux, consacrent une part de leur PIB nettement plus modeste que la moyenne aux dépenses publiques de retraites.
Mais, même parmi les quinze anciens membres, on relève des différences sensibles, l'écart entre le pays le moins dépensier en la matière (hors l' Irlande ), le Royaume-Uni , avec 6,6 points de PIB consacrés aux dépenses publiques de retraite, et celui où celles-ci pèsent le plus lourdement , l' Italie , avec 14,2 points de PIB , atteignant 7,6 points de PIB , soit plus que du simple au double.
* La France se classe au quatrième rang des pays avec des dépenses publiques de retraite qui atteignent 12,8 points de PIB, soit 2,2 points de plus que la moyenne de l'Union européenne à 25 .
Elle n'est devancée que par l'Italie (+ 1,4 point de PIB) 34 ( * ) , la Pologne (+ 1,1 point de PIB) et l'Autriche (+ 0,6 point de PIB).
b) Au niveau de l'OCDE
* Appréciée au niveau des pays de l'OCDE, la dispersion des niveaux nationaux de dépenses publiques de retraite-survie présente une ampleur encore plus importante .
LES DÉPENSES PUBLIQUES DE RETRAITE-SURVIE DANS LES PAYS DE L'OCDE - 2003 (EN % DU PIB)
|
Pays |
% du PIB |
|
Australie |
4,1 |
|
Autriche |
13,2 |
|
Belgique |
9,3 |
|
Canada |
4,4 |
|
République tchèque |
8,0 |
|
Danemark |
7,2 |
|
Finlande |
6,4 |
|
France |
12,3 |
|
Allemagne |
11,7 |
|
Grèce |
12,3 |
|
Irlande |
3,7 |
|
Italie |
13,9 |
|
Japon |
9,3 |
|
Corée |
1,4 |
|
Luxembourg |
4,8 |
|
Mexique |
1,4 |
|
Pays-Bas |
5,5 |
|
Nouvelle-Zélande |
4,7 |
|
Norvège |
7,3 |
|
Pologne |
12,4 |
|
Portugal |
10,4 |
|
Espagne |
8,6 |
|
Suède |
10,8 |
|
Suisse |
7,2 |
|
Royaume-Uni |
6,1 |
|
États-Unis |
6,3 |
|
OCDE - Total |
7,7 |
Avec une moyenne de 7,7 points de PIB , les dépenses publiques dans ce domaine s'étagent en 2003, de 1,4 point de PIB au Mexique et en Corée à 13,9 points de PIB en Italie 35 ( * ) .
Dans les grands pays de l'OCDE hors Europe , les États-Unis, le Canada, l'Australie et le Japon, les dépenses publiques de retraite-survie sont partout inférieures à la moyenne européenne et à la moyenne de l'OCDE , le Japon faisant seul exception (9,3 points de PIB contre 7,7 points de PIB en moyenne pour l'OCDE).
B. LE NIVEAU DES DÉPENSES PUBLIQUES DE RETRAITE DÉTERMINE LARGEMENT LA PLACE RELATIVE DES DÉPENSES PUBLIQUES SOCIALES ET DONC DES DÉPENSES PUBLIQUES
* Le niveau relativement élevé des dépenses publiques brutes de retraite explique une grande partie de l'écart global entre les dépenses publiques sociales entre pays (et, du même coup, entre les niveaux relatifs atteints par l'ensemble des dépenses publiques).
Au total, pour l'échantillon de pays ici considérés, les dépenses publiques de retraite sont « responsables » de 75 % de l'écart observé relativement à la totalité des dépenses publiques sociales . Cette fraction excède de beaucoup le poids moyen des dépenses de retraite dans le total des dépenses publiques.
On peut en conclure que pour les autres postes de dépenses sociales, les différences constatées ont une incidence beaucoup plus faible sur les différences de niveau des dépenses publiques sociales dans les pays développés.
CONTRIBUTIONS DES DÉPENSES PUBLIQUES BRUTES DE
RETRAITE
À L'ÉCART DES DÉPENSES SOCIALES POUR LA
FRANCE
ET LES PRINCIPAUX PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE
(2004)
|
Avec... |
Écart global (A) 1 |
Écart pour les Retraites (B) |
B/A (en %) 2 |
|
Belgique |
+ 4,1 |
+ 1,6 |
39 |
|
Danemark |
+ 5,2 |
- 0,5 |
< 0 |
|
Allemagne |
+ 4,9 |
+ 4,0 |
81,6 |
|
Espagne |
- 2,1 |
+ 0,9 |
< 0 |
|
France |
+ 6,3 |
+ 4,6 |
73,0 |
|
Irlande |
- 6,5 |
- 4,0 |
61,5 |
|
Italie |
+ 1,8 |
+ 6,2 |
> 100 |
|
Pays-Bas |
- 1,7 |
- 2,2 |
> 100 |
|
Autriche |
+ 3,7 |
+ 5,5 |
> 100 |
|
Suède |
+ 8,9 |
- 0,5 |
< 0 |
|
Royaume-Uni |
- 1,8 |
- 1,6 |
88,9 |
|
États-Unis |
- 6,2 |
- 1,4 |
22,6 |
1
A la moyenne arithmétique
simple pour 26 pays de l'OCDE.
2
Contribution des dépenses
publiques de retraite à l'écart observé sur l'ensemble des
dépenses publiques sociales.
Note de lecture
: Le niveau relatif des
dépenses publiques sociales en Belgique excède de 4,1 points
de PIB le niveau moyen de l'OCDE tandis que pour les seules dépenses
publiques de retraite l'écart atteint 1,6 point de PIB. Cet
écart (troisième colonne) représente 39 % de
l'écart constaté en Belgique pour le total des dépenses
publiques sociales.
En Espagne, le niveau des dépenses publiques
sociales est plus bas que dans l'OCDE de 2,1 points de PIB malgré
des dépenses publiques de retraite plus élevées de
0,9 point de PIB ; il n'y a pas de contribution des dépenses
publiques de retraite aux « économies » que
réalise l'Espagne sur le front des dépenses publiques sociales
par rapport aux autres pays de l'OCDE ; au contraire, puisque les autres
dépenses publiques sociales font plus que compenser le niveau relatif
des dépenses publiques de retraite.
Pour la France, près des trois quarts (73 %) de l'écart à la moyenne des dépenses publiques sociales s'explique par le surplus de dépenses publiques de retraite par rapport à la moyenne des dépenses publiques de retraite en Europe.
* Compte tenu du rôle des dépenses publiques de protection sociale dans le niveau des dépenses publiques totales, on observe qu'une grande partie des différences entre pays du point de vue du taux d'intervention collective vient de la place des systèmes publics de retraite.
C. UN PANORAMA QUE MODIFIE LA PRISE EN COMPTE DES RESSOURCES PRIVÉES CONSACRÉES À LA RETRAITE
La prise en considération des dépenses privées de retraite modifie substantiellement le panorama offert par les seules dépenses publiques .
DÉPENSES TOTALES DE RETRAITE 1 (1980-2003) - EN POINTS DE PIB
|
1980 |
1990 |
2000 |
2003 |
Total écart 2003/1980 |
||||||||||
|
Publiques |
Privées |
Total |
Publiques |
Privées |
Total |
Publiques |
Privées |
Total |
Publiques |
Privées |
Total |
En pts PIB |
En % |
|
|
Australie |
3,0 |
0 |
3,0 |
3,4 |
0 |
3,4 |
4,2 |
3,9 |
8,1 |
3,9 |
3 |
6,9 |
+ 3,9 |
x 2,3 |
|
Autriche |
10,0 |
0,6 |
10,6 |
11,3 |
0,4 |
11,7 |
12,4 |
0,5 |
12,9 |
12,8 |
0,6 |
13,4 |
+ 2,8 |
26,4 |
|
Belgique |
5,9 |
0,3 |
6,2 |
6,5 |
0,8 |
7,3 |
6,9 |
1,5 |
8,4 |
7,2 |
2,3 |
9,5 |
+ 3,3 |
53,2 |
|
Canada |
2,8 |
1,4 |
4,2 |
3,9 |
2,6 |
6,5 |
3,9 |
4,0 |
7,9 |
4,0 |
4,2 |
8,2 |
+ 4,0 |
95,2 |
|
Danemark |
7,0 |
1,3 |
8,3 |
7,3 |
1,5 |
8,8 |
7,1 |
2,0 |
9,1 |
7,2 |
2,2 |
9,4 |
+ 1,4 |
13,2 |
|
Finlande |
5,1 |
0 |
5,1 |
7,1 |
0 |
7,1 |
5,3 |
2,5 |
7,8 |
5,8 |
2,9 |
8,7 |
+ 3,6 |
70,6 |
|
France |
7,7 |
0,2 |
7,9 |
9,3 |
0,2 |
9,5 |
10,5 |
0,2 |
10,7 |
10,5 |
0,2 |
10,7 |
+ 2,8 |
35,4 |
|
Allemagne |
10,0 |
0,5 |
10,5 |
9,6 |
0,6 |
10,2 |
10,8 |
0,7 |
11,5 |
11,3 |
0,7 |
12,0 |
+ 1,5 |
14,3 |
|
Grèce |
5,1 |
0 |
5,1 |
10,5 |
0,4 |
10,9 |
11,3 |
0,5 |
11,8 |
11,5 |
0,5 |
12,0 |
+ 6,9 |
x 2,4 |
|
Irlande |
4,5 |
1,0 |
- 5,5 |
3,2 |
0,9 |
4,1 |
2,6 |
0 |
2,6 |
2,9 |
0 |
2,9 |
- 2,8 |
- 47,3 |
|
Italie |
7,2 |
0,8 |
8,0 |
8,3 |
2,6 |
10,9 |
11,2 |
1,3 |
12,5 |
11,4 |
1,4 |
12,8 |
+ 2,8 |
61,0 |
|
Luxembourg |
6,7 |
0 |
6,7 |
8,7 |
0 |
8,7 |
7,2 |
0 |
7,2 |
4,5 |
1,6 |
6,1 |
- 0,6 |
- 9,0 |
|
Pays-Bas |
5,9 |
1,4 |
7,3 |
6,1 |
2,4 |
8,5 |
5,3 |
3,1 |
8,4 |
5,4 |
3,2 |
8,6 |
+ 1,3 |
17,8 |
|
Nouvelle-Zélande |
6,8 |
0 |
6,8 |
7,2 |
0 |
7,2 |
6,5 |
0 |
6,5 |
7,0 |
0 |
7,0 |
+ 0,2 |
2,9 |
|
Portugal |
3,4 |
0,2 |
3,6 |
4,4 |
0,2 |
4,6 |
7,3 |
0,2 |
7,5 |
8,8 |
0,1 |
8,9 |
+ 5,3 |
x 2,5 |
|
Espagne |
4,6 |
0 |
4,6 |
7,2 |
0 |
7,2 |
8,2 |
0 |
8,2 |
7,9 |
0 |
7,9 |
+ 3,3 |
71,7 |
|
Suède |
7,8 |
1,1 |
8,9 |
8,6 |
1,2 |
9,8 |
9,3 |
1,9 |
11,2 |
10,1 |
2,0 |
12,1 |
+ 3,2 |
35,9 |
|
Royaume-Uni |
4,2 |
2,3 |
6,5 |
5,0 |
3,9 |
8,9 |
5,6 |
5,8 |
11,4 |
5,9 |
4,7 |
10,6 |
+ 3,9 |
63,1 |
|
États-Unis |
5,3 |
1,3 |
6,6 |
5,2 |
2,7 |
7,9 |
5,2 |
3,8 |
9,0 |
5,5 |
3,8 |
9,3 |
+ 2,7 |
40,9 |
|
OCDE - Total |
5,0 |
0,5 |
5,5 |
5,9 |
1,0 |
6,9 |
6,7 |
1,6 |
8,3 |
6,9 |
1,7 |
8,6 |
+ 3,2 |
56,4 |
1 Hors survie
Les dépenses privées augmentent la part du PIB consacrée aux retraites de 1,7 point de PIB par rapport aux seules dépenses publiques (8,6 points de PIB contre 6,9 points).
1. La forte dynamique des dépenses privées de retraite
- Les dépenses privées de pension qui représentaient 0,5 point de PIB en 1980 ont beaucoup progressé depuis.
Elles ont plus que triplé contre une augmentation des dépenses publiques de 38 % .
Les dépenses privées de pension représentent en 2003 près d' un quart des dépenses publiques de retraite, contre un dixième en 1980 .
POURCENTAGE DES DÉPENSES PRIVÉES DE PENSION SUR DÉPENSES PUBLIQUES (EN %)
|
1980 |
2003 |
Variation
|
|
|
Australie |
0 |
76,9 |
+ 76,9 |
|
Autriche |
6 |
4,7 |
- 1,3 |
|
Belgique |
5 |
31,9 |
+ 26,9 |
|
Canada |
50 |
105 |
+ 55 |
|
Danemark |
20,2 |
30,5 |
+ 10,3 |
|
Finlande |
0 |
50 |
+ 50 |
|
France |
2,6 |
1,9 |
- 1,3 |
|
Allemagne |
5 |
6,1 |
+ 1,1 |
|
Grèce |
0 |
4,3 |
+ 4,3 |
|
Irlande |
22,2 |
0 |
- 22,2 |
|
Italie |
11,1 |
12,2 |
+ 1,1 |
|
Luxembourg |
0 |
35,6 |
+ 35,6 |
|
Pays-Bas |
23,7 |
59,3 |
+ 35,6 |
|
Nouvelle-Zélande |
0 |
0 |
0 |
|
Portugal |
5,9 |
1,1 |
- 4,8 |
|
Espagne |
0 |
0 |
0 |
|
Suède |
14,1 |
19,8 |
+ 5,7 |
|
Royaume-Uni |
54,8 |
79,7 |
+ 24,9 |
|
États-Unis |
24,5 |
69,1 |
+ 44,6 |
|
OCDE (moyenne) |
10 |
24,6 |
+ 14,6 |
Une partie parfois importante des dépenses privées de pension provient des fonds de pension.
PRESTATIONS PAYÉES PAR LES FONDS DE PENSION (EN % DU PIB)
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
|
Australie |
4,4 |
4,4 |
4,3 |
3,6 |
3,6 |
3,7 |
|
Autriche |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
Belgique |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
Canada |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,2 |
2,1 |
2,1 |
|
Danemark |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,7 |
0,5 |
0,5 |
|
Allemagne |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Islande |
2,9 |
3,2 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,5 |
|
Italie |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
Japon |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
Nd |
|
Corée |
Nd |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
|
Luxembourg |
Nd |
Nd |
Nd |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
|
Mexique |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
|
Pays-Bas |
3,0 |
3,1 |
3,2 |
3,4 |
3,5 |
Nd |
|
Nouvelle-Zélande |
2,2 |
2,0 |
1,8 |
1,4 |
1,3 |
1,5 |
|
Norvège |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
Portugal |
0,8 |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
Espagne |
0,4 |
0,5 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
|
Suisse |
4,8 |
4,9 |
5,2 |
5,3 |
5,4 |
5,5 |
|
Turquie |
Nd |
Nd |
Nd |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Royaume-Uni |
2,9 |
3,0 |
2,9 |
2,8 |
3,0 |
Nd |
La progression du rapport « dépenses privées/dépenses publiques » a été, en moyenne, de 14,6 points de pourcentage .
Elle a été nettement plus forte dans certains pays :
- Australie : + 76,9 points de pourcentage ;
- Belgique : + 26,9 points de pourcentage ;
- Canada : + 55 points de pourcentage ;
- Luxembourg : + 35,6 points de pourcentage ;
- Pays-Bas : + 35,6 points de pourcentage ;
- Royaume-Uni : + 24,9 points de pourcentage ;
- États-Unis : + 44,6 points de pourcentage.
Au total, les dépenses publiques de pension tiennent une place prédominante dans les systèmes de retraite , à l'exception du Canada.
Mais, les dépenses privées ont renforcé leur rôle. Alors qu'en 1980, il n'y avait qu'un pays où elles représentaient plus de la moitié des dépenses publiques de pension (le Royaume-Uni), elles excèdent désormais ce seuil dans un assez grand nombre de pays : l'Australie, le Canada, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les États-Unis.
- Ce renforcement du rôle moyen des dépenses privées de pension résulte d'évolutions nationales qui ont été très différenciées .
Sur fond d'augmentation générale du revenu alloué aux retraites, une sorte de reclassement s'est opéré. Dans tous les pays où les dépenses publiques de pension dans le PIB ont augmenté moins que la moyenne de l'OCDE, les dépenses privées ont augmenté davantage, excepté la Nouvelle-Zélande ou l'Allemagne, et vice-versa.
2. Des parts du revenu national consacré aux retraites finalement plus proches que ce qu'indique le poids des dépenses publiques de retraite
Au total, pour les dix-huit principaux pays de l'OCDE, la prise en compte des dépenses privées de pension réduit sensiblement la dispersion constatée à partir des seules dépenses publiques de pension .
L'écart-moyen à la moyenne passe de 2,4 points de PIB pour les seules dépenses publiques à 1,8 point de PIB pour le total des dépenses de retraite. En termes relatifs, ces écarts représentent 32 % de la moyenne pour les dépenses publiques de retraite et 18,7 % de la moyenne pour la totalité des dépenses de retraite . Encore faut-il souligner que ces données n'intègrent pas les produits du patrimoine individuel des agents qui représentent pourtant un prélèvement sur le PIB comme les autres revenus de remplacement versés aux retraités et qui rapprocheraient sans doute encore les situations nationales.
Le graphe ci-dessous montre l'existence d'une substituabilité entre les dépenses privées et les dépenses publiques de pension.
POSITION DES PAYS SELON LE NIVEAU DES DÉPENSES
PUBLIQUES ET PRIVÉES
DE RETRAITE
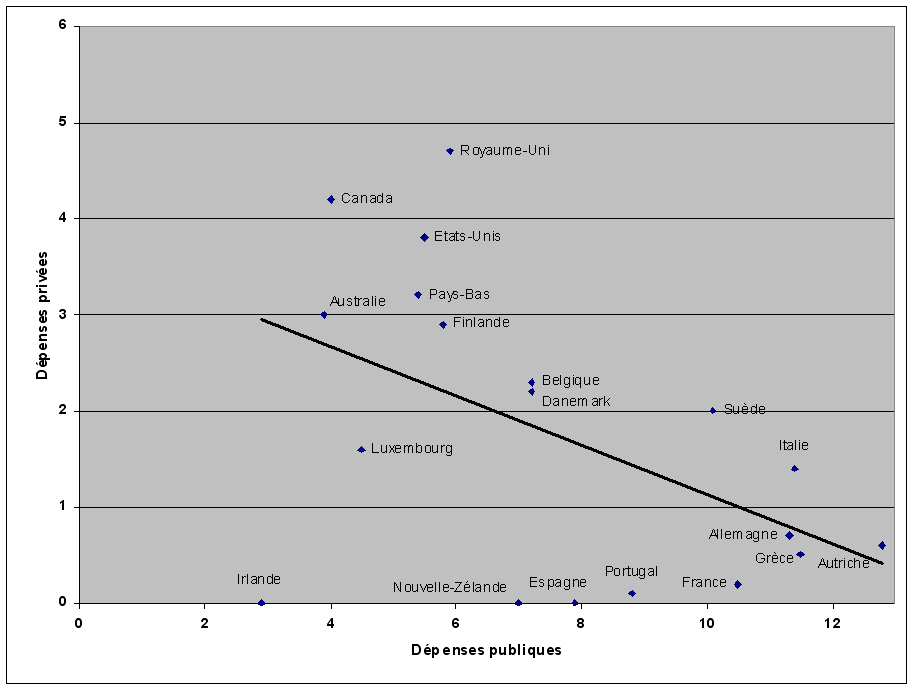
Une partie de ces écarts est, par ailleurs, attribuable à des taux de dépendance (rapport des inactifs âgés par rapport aux personnes d'âge actif) diversifiés.
RATIO DES PLUS DE 65 ANS AUX 15-64 ANS DANS QUELQUES PAYS (EN %)
|
1960 |
2000 |
2050 |
|
|
États-Unis |
15,0 |
18,9 |
35,5 |
|
Japon |
8,9 |
25,1 |
58,5 |
|
Allemagne |
17,1 |
24,1 |
48,7 |
|
France |
18,7 |
24,3 |
44,0 |
|
Italie |
14,1 |
26,9 |
65,7 |
|
Royaume-Uni |
18,0 |
25,0 |
42,3 |
|
Canada |
12,7 |
27,7 |
40,1 |
Source : Banque Mondiale.
Ainsi en 2000, le ratio de dépendance de la France pour les plus de 65 ans était supérieur de près de 30 % (28,6 %) à celui des États-Unis, soit très précisément le rapport entre le total des dépenses de retraite en France et dans ce pays.
Mais, en Italie, le surcroît de dépenses de retraite par rapport à la France ne s'expliquait que partiellement par un ratio de dépendance plus élevé.
D. LES DÉPENSES DE SANTÉ, UN PANORAMA ASSEZ HÉTÉROCLITE MAIS UN NOYAU DUR DE PAYS COMPARABLES
1. Une progression des dépenses publiques de santé dans l'OCDE, entre 1981 et 2002, plus soutenue qu'en France
* Entre 1981 et 2002, la dépense publique de santé a augmenté au taux moyen de 3,6 % en volume dans 30 pays de l'OCDE. En France, la croissance a été inférieure à cette moyenne avec 2,8 % .
Les pays où la progression a été la plus rapide sont pour l'essentiel des pays qui connaissaient un retard initial (le Mexique, le Portugal, la Turquie...). Mais, d'autres pays dans ce cas n'ont pas encore effectué ce rattrapage (la Hongrie, la République Slovaque...), tandis que dans plusieurs pays qui consacraient déjà d'importants efforts au domaine de la santé, la progression des dépenses a été rapide (États-Unis : 4,7 %, Suisse : 3,8 % ; Australie : 3,6 %).
* L'économie de la santé s'efforce de décomposer les progressions globales des dépenses de santé en trois grandes variables 36 ( * ) : l'âge, le revenu et un résidu, qui correspond notamment au progrès technique.
DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE DES
DÉPENSES PUBLIQUES DE SANTÉ
1
(1981 -
2002)
|
TOTAL |
EFFET
|
EFFET -
|
RÉSIDU |
|
|
Australie (1981-2001) |
3,6 |
0,4 |
1,8 |
1,4 |
|
Autriche |
2,2 |
0,1 |
2,1 |
0,0 |
|
Belgique (1995-2002) |
2,9 |
0,4 |
1,7 |
0,6 |
|
Canada |
2,6 |
0,4 |
1,7 |
0,6 |
|
République Tchèque (1993-2002) |
2,7 |
0,4 |
2,8 |
-0,4 |
|
Danemark |
1,3 |
0,1 |
1,7 |
-0,5 |
|
Finlande |
2,6 |
0,3 |
2,1 |
0,2 |
|
France |
2,8 |
0,2 |
1,6 |
1,0 |
|
Allemagne |
2,2 |
0,2 |
1,2 |
1,0 |
|
Grèce (1987-2002) |
3,4 |
0,4 |
1,3 |
0,8 |
|
Hongrie (1991-2002) |
1,5 |
0,3 |
2,8 |
-1,5 |
|
Islande |
3,5 |
0,1 |
1,5 |
1,9 |
|
Irlande |
3,9 |
0,1 |
4,9 |
-1,0 |
|
Italie (1988-2002) |
2,1 |
0,7 |
1,7 |
-0,1 |
|
Japon (1981-2001) |
3,8 |
0,4 |
2,2 |
1,1 |
|
Corée (1982-2002) |
10,1 |
1,4 |
6,1 |
2,4 |
|
Luxembourg (1981-2002) |
3,8 |
0,0 |
3,9 |
-0,1 |
|
Mexique (1990-2002) |
4,5 |
0,7 |
0,5 |
2,4 |
|
Pays-Bas (1981-2002) |
2,6 |
0,3 |
1,9 |
0,3 |
|
Nouvelle Zélande |
2,7 |
0,2 |
1,5 |
1,0 |
|
Norvège |
4,0 |
0,1 |
2,5 |
1,5 |
|
Pologne (1990-2002) |
3,1 |
0,5 |
3,2 |
-0,6 |
|
Portugal |
5,9 |
0,4 |
2,6 |
2,8 |
|
République Slovaque (1997-2002) |
2,1 |
0,5 |
4,2 |
-1,5 |
|
Espagne |
3,4 |
0,3 |
2,3 |
0,8 |
|
Suède |
1,5 |
0,1 |
1,7 |
-0,4 |
|
Suisse (1985-2002) |
3,8 |
0,2 |
0,8 |
2,9 |
|
Turquie (1984-2002) |
11,0 |
0,3 |
2,3 |
8,3 |
|
Royaume-Uni |
3,4 |
0,2 |
2,3 |
1,0 |
|
États-Unis |
4,7 |
0,1 |
2,0 |
2,6 |
|
Moyenne |
3,6 |
0,3 |
2,3 |
1,0 |
1
Dépenses publiques par tête
2
Sur la base d'une élasticité unitaire du
revenu
Source : OCDE Base de données Santé (2004), ENPRI-AGIR
L' effet-revenu , même si on considère que l'élasticité des dépenses publiques de santé au revenu n'est qu'unitaire 37 ( * ) , est déterminant . Ainsi, les écarts observés dans le rythme d'augmentation des dépenses publiques de santé entre pays reflètent majoritairement l'inégale croissance de ces pays . On observe que la France appartient au groupe de pays pour lesquels l'impact de la croissance économique sur les dépenses publiques de santé a été relativement faible, plus modéré qu'en moyenne.
L' effet-d'âge , qui traduit l'impact de la déformation de la pyramide des âges (vieillissement notamment) sur les dépenses de santé, aura été négligeable dans l'ensemble sur la période.
Le « résidu » explique 1 des 3,6 points de croissance annuelle des dépenses publiques de santé. Sa contribution peut sembler élevée, mais son chiffrage incertain empêche de faire entièrement sienne la conclusion à laquelle ce constat invite souvent : celui d'une amélioration qualitative des systèmes de santé. Une partie du « résidu » est certainement attribuable , du fait des limites de la convention posant une élasticité unitaire au revenu mentionné plus haut, à l'effet-revenu . Ainsi, le « résidu » correspond sans doute, en partie, à un élargissement quantitatif de la consommation de santé et à une augmentation des tarifs qui ne reflètent pas, en soi, d'amélioration qualitative des soins.
En France, le « résidu » est estimé à la valeur moyenne (1 %) prise par lui dans les pays de l'OCDE.
2. Une diversité de situations nationales sous l'angle de la couverture publique des dépenses de santé
La dépense totale de santé est fortement différenciée dans les pays de l'OCDE, principalement du fait de quelques situations atypiques.
Elle est sensiblement plus élevée que la seule dépense publique consacrée à cette fonction puisque les dépenses privées ajoutent près de 40 % de ressources au revenu alloué à cette fonction par les dépenses publiques.
Les taux de couverture des dépenses de santé par les financements publics sont très diversifiés. Au total, la dispersion des dépenses totales de santé est analogue à celle des dépenses publiques mais la hiérarchie des pays est assez sensiblement modifiée quand on considère la totalité des dépenses de santé plutôt que les seules dépenses publiques.
* En 2001 , sur un échantillon de 23 pays de l'OCDE , la dépense moyenne de santé 38 ( * ) atteignait 8,2 % .
DÉPENSES DE SANTÉ : SOURCES DE
FINANCEMENT PUBLIQUES ET PRIVÉES
Pourcentages de l'ensemble des
dépenses de santé, 2001
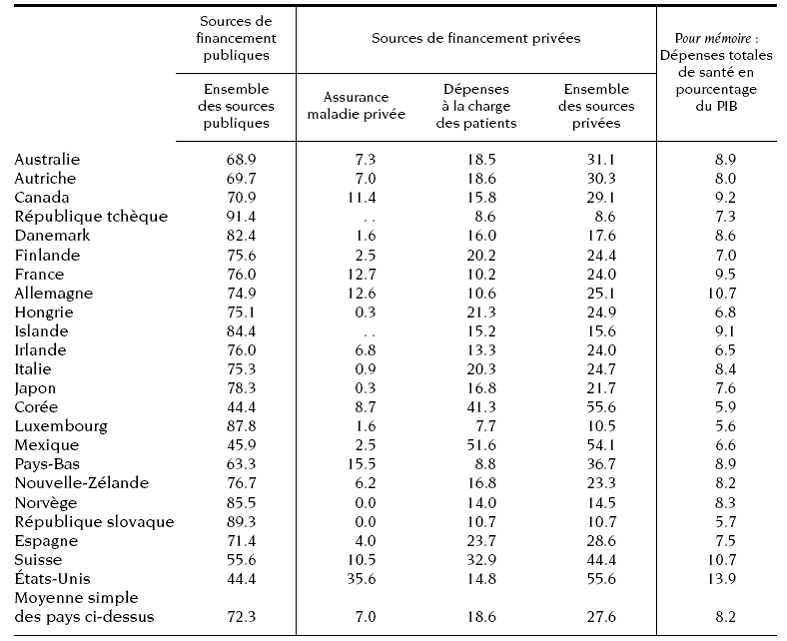
1 Les données sont celles de l'année 2000 pour l'Australie, l'Autriche, le Canada, la Corée, l'Islande, le Japon, le Luxembourg et la Suisse.
Source : Base de données de l'OCDE sur la santé, 2003.
La dispersion autour de cette moyenne est, certes, importante.
L'écart moyen s'élève à 1,37 point de PIB , soit un écart relatif de 16,8 % autour de la moyenne des dépenses de santé dans les pays sous revue.
C'est un chiffre élevé, mais qui s'explique par la situation de quelques pays atypiques . Par le haut , ce sont les États-Unis qui divergent le plus nettement, et de loin (+ 5,7 points de PIB par rapport à la moyenne). Mais l'importance de l'écart tient aussi au niveau comparativement bas des dépenses de santé dans plusieurs pays : Hongrie, Irlande, Corée, Luxembourg, Mexique, République slovaque, pour lesquels l'écart à la moyenne dépasse 1,4 point de PIB.
Mais, dans la plupart des pays , homogènes au regard de leur niveau de développement , les dépenses de santé s'étagent en une bande relativement étroite , entre 8 et 9,5 points de PIB. Ce dernier chiffre représente le niveau des dépenses de santé en France. Il est, notamment, proche de l'Allemagne (10,7 points de PIB) et des Pays-Bas (8,9 points de PIB).
* Les dépenses totales de santé se décomposent en des dépenses publiques et des dépenses privées .
- L' ensemble des sources de financement privé atteint en moyenne 39 ( * ) 27,6 % . Des écarts conséquents existent sous cet angle. La majorité du financement des dépenses de santé est privée aux États-Unis . En revanche, la part du financement privé est très faible en République Tchèque, mais aussi au Luxembourg. Dans la plupart des pays de l'Union européenne, elle oscille autour du quart de l'ensemble des dépenses .
DÉPENSES PRIVÉES DE SANTÉ (EN 2001)
|
Niveau
|
Rang décroissant |
Supplément
|
|
|
Australie |
2,7 |
6 |
44,3 |
|
Autriche |
2,4 |
9 |
42,8 |
|
Canada |
2,7 |
6 |
41,5 |
|
République Tchèque |
0,6 |
22 |
8,9 |
|
Danemark |
1,5 |
18 |
21,1 |
|
Finlande |
1,7 |
14 |
32,1 |
|
France |
2,3 |
11 |
31,9 |
|
Allemagne |
2,7 |
7 |
33,7 |
|
Hongrie |
1,7 |
14 |
33,3 |
|
Islande |
1,4 |
19 |
18,2 |
|
Irlande |
1,6 |
17 |
32,6 |
|
Italie |
2,1 |
13 |
33,3 |
|
Japon |
1,7 |
14 |
28,8 |
|
Corée |
3,3 |
4 |
12,7 |
|
Mexique |
3,6 |
3 |
12,0 |
|
Pays-Bas |
3,3 |
4 |
58,9 |
|
Nouvelle Zélande |
1,1 |
21 |
15,5 |
|
Norvège |
1,2 |
20 |
15,5 |
|
République Slovaque |
2,4 |
9 |
47,0 |
|
Espagne |
2,2 |
12 |
41,5 |
|
Suisse |
4,8 |
2 |
81,3 |
|
États-Unis |
7,7 |
1 |
124,2 |
|
Moyenne |
2,3 |
-- |
39,0 |
- Les dépenses publiques de santé s'élèvent, quant à elles, à 72,3 % du total, soit 5,9 points de PIB en moyenne dans l'OCDE. Leur dispersion est très forte . L'écart moyen atteint 0,99 point de PIB soit 16,8 % de moyenne.
DÉPENSES PUBLIQUES DE SANTÉ DANS LES PAYS DE L'OCDE - EN 2001
|
En % du PIB |
Rang décroissant |
|
|
Australie |
6,1 |
11 |
|
Autriche |
5,6 |
14 |
|
Canada |
6,5 |
8 |
|
République tchèque |
6,7 |
7 |
|
Danemark |
7,1 |
4 |
|
Finlande |
5,3 |
16 |
|
France |
7,2 |
3 |
|
Allemagne |
8,0 |
1 |
|
Hongrie |
5,1 |
19 |
|
Islande |
7,7 |
2 |
|
Irlande |
4,9 |
20 |
|
Italie |
6,3 |
9 |
|
Japon |
5,9 |
12 |
|
Corée |
2,6 |
22 |
|
Mexique |
3,0 |
21 |
|
Pays-Bas |
5,6 |
14 |
|
Nouvelle-Zélande |
7,1 |
4 |
|
Norvège |
7,1 |
4 |
|
République slovaque |
5,1 |
18 |
|
Espagne |
5,3 |
16 |
|
Suisse |
5,9 |
13 |
|
États-Unis |
6,2 |
10 |
|
Moyenne non pondérée |
5,9 |
NS |
Le niveau de l'intervention collective dans le domaine de la santé n'apparaît pas plus hétérogène que la part des ressources totales (publiques et privées) attribuées à la satisfaction des besoins de cette nature.
Mais, selon qu'on considère les seules dépenses publiques de l'ensemble des dépenses de santé, la position des pays est différente.
CLASSEMENT DES PAYS POUR LES DÉPENSES TOTALES DE
SANTÉ
PAR RAPPORT AUX SEULES DÉPENSES PUBLIQUES
(RANG)
|
Dépenses totales |
Dépenses publiques |
|
|
États-Unis |
1 |
10 |
|
Suisse |
2 |
13 |
|
Allemagne |
2 |
1 |
|
France |
4 |
3 |
|
Canada |
5 |
8 |
|
Islande |
6 |
2 |
|
Pays-Bas |
7 |
14 |
|
Australie |
7 |
11 |
|
Danemark |
9 |
4 |
|
Italie |
10 |
9 |
|
Norvège |
11 |
4 |
|
Nouvelle Zélande |
12 |
4 |
|
Autriche |
13 |
14 |
|
Japon |
13 |
12 |
|
Espagne |
15 |
16 |
|
République tchèque |
16 |
7 |
|
Finlande |
17 |
16 |
|
Hongrie |
17 |
19 |
|
Mexique |
19 |
21 |
|
Irlande |
20 |
20 |
|
Corée |
21 |
22 |
|
République slovaque |
22 |
18 |
* Comme on l'a observé à plusieurs reprises dans ce rapport, l'image donnée par le niveau relatif des dépenses dans le PIB n'est qu'une façon d'appréhender le niveau des dépenses de santé. Elle peut donner des impressions trompeuses quand les niveaux de richesse sont très différents. De fait, le Luxembourg qui occupe une place assez reculée dans la hiérarchie des dépenses de santé ainsi appréhendée ressort en fait comme le deuxième pays sous l'angle de la dépense de santé par habitant.
De même, sous ce dernier point de vue, la place de la France est un peu moins favorable.
3. Un panorama reflet, un peu déformé, du niveau de richesse par habitant
Il existe une relation forte entre le niveau des dépenses de santé et celui de la richesse par habitant. Plus celle-ci est importante, plus les dépenses de santé le sont également.
DÉPENSES DE SANTÉ ET REVENU NATIONAL PAR HABITANT EN 2004
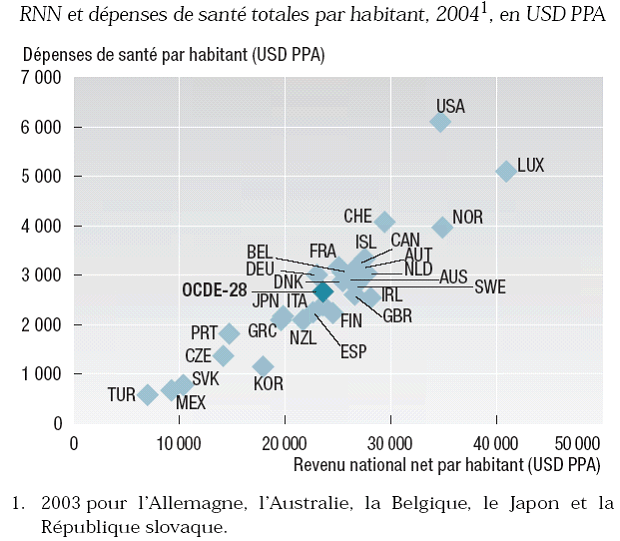
Source : Panorama de la Société : les indicateurs sociaux de l'OCDE. Édition 2006.
La corrélation n'est toutefois pas générale. Les États-Unis y échappent. En outre, elle n'est pas aussi étroite pour les pays les plus riches que pour les pays relativement pauvres avec, par exemple, en Allemagne, des dépenses de santé plus fortes qu'au Japon.
CHAPITRE III - LES DÉPENSES D'ÉDUCATION, PRIMAUTÉ DES DÉPENSES PUBLIQUES, DIVERSITÉ DES « MODÈLES », SINGULARITÉ FRANÇAISE
Dans les pays de l'OCDE , les dépenses totales consacrées à l'éducation ont représenté 5,9 % du PIB en 2002 , après une assez forte augmentation au cours des dernières années.
|
AVERTISSEMENT DE MÉTHODE
- Les dépenses recensées sont celles qui sont destinées à des établissements d'enseignement ayant une vocation pédagogique directe ou non. Elles comprennent les subventions publiques aux ménages mais seulement quand elles sont en lien avec des établissements d'enseignement. Les avantages annexes accordés aux étudiants - comme les aides au logement - ne sont pas pris en compte. De la même manière, les dépenses privées de soutien scolaire hors établissements d'enseignement sont exclues. Ainsi, les statistiques fournies minorent le revenu national réellement alloué à l'éducation, notamment lorsqu'il trouve sa source dans les revenus privés. Elles biaisent aussi les comparaisons internationales puisque le secteur « para-éducatif » est plus ou moins développé selon les pays. - Par ailleurs, le partage entre dépenses publiques et dépenses privées pose le problème classique du traitement des dépenses fiscales. Dans les pays les où les dépenses privées sont particulièrement développées, elles sont souvent la contrepartie d'avantages fiscaux. Ceux-ci ont le même impact sur les comptes publics vus à travers le solde public qu'un prélèvement suivi d'une dépense. Mais, l'intervention publique, quand elle prend la forme de dépenses fiscales, n'est pas systématiquement enregistrée en dépenses publiques. Le recours aux dépenses fiscales, qui est une forme d'intervention publique, minore le niveau des prélèvements obligatoires et des dépenses publiques par rapport au choix alternatif et équivalent 1 de prélever un impôt et de réaliser une dépense. 1. Du moins, pour ses effets sur le solde public, la dépense fiscale pouvant ne pas bénéficier aux mêmes individus. |
Ce sont les dépenses publiques qui financent l'essentiel de la production des services d'enseignement dans les pays de l'OCDE.
Mais, le rôle des dépenses privées est parfois important soit qu'elles compensent la faiblesse de l'intervention publique, soit qu'elles s'additionnent aux dépenses publiques pour porter les ressources consacrées à l'éducation à un plus haut niveau.
Au total, quand les dépenses privées sont prises en compte en plus des dépenses publiques, l'effort consacré à l'éducation apparaît, d'une part, plus homogène et, d'autre part, encore plus corrélé au niveau de la richesse par habitant qu'il ne l'est quand on considère les seules dépenses publiques .
I. GLOBALEMENT, UNE ASSEZ FORTE AUGMENTATION DE L'EFFORT RELATIF EN FAVEUR DE L'ÉDUCATION
Grâce à des dépenses publiques d'éducation dynamiques - alors que les dépenses privées l'ont été moins -, l' effort moyen en faveur de l'éducation a augmenté dans l'OCDE entre 1995 et 2003 .
Toutefois, les rythmes d'évolution des dépenses d'éducation ont été contrastés , avec quinze pays renforçant leur effort et dix le diminuant .
A. UNE CROISSANCE DES DÉPENSES D'ÉDUCATION PLUS FORTE QUE CELLE DU PIB
1. Une hausse des dépenses d'éducation due aux dépenses publiques
Les dépenses d'éducation ont augmenté davantage que le PIB entre 1995 et 2003 . Moyennant quelques approximations dues à la qualité des données disponibles, leur poids s'est accru de 0,5 point de PIB (soit environ 10 % du niveau initial), cette variation ayant été acquise entre 2000 et 2003.
Au cours de cette dernière période, ce sont les dépenses publiques d'éducation qui ont été le moteur de cette augmentation . Les dépenses privées d'éducation, qui avaient augmenté entre 1995 et 2000, sont, quant à elles, restées stables au-delà .
2. Des dépenses privées d'éducation pro-cycliques ?
Les évolutions différenciées des dépenses publiques et privées d'éducation conduisent à s'interroger sur l'existence d'une sensibilité plus forte des dépenses privées à la conjoncture .
Le constat de l'existence de dynamiques différentes, du moins à court terme, entre dépenses publiques et privées censées satisfaire un même besoin , qui s'appuie sur des données limitées, notamment au regard de la courte durée de la période couverte, pourrait témoigner , au moins dans le domaine de l'éducation, d'une certaine inertie des dépenses publiques , et, au contraire, d' une relation plus étroite entre les dépenses privées d'éducation et le rythme de la croissance économique .
Autrement dit, les dépenses privées d'éducation seraient cycliques et les dépenses publiques d'éducation plus indépendantes du cycle.
En effet, les années 1995-2003 ont été marquées par une phase de forte croissance économique suivie d'un ralentissement au-delà de 2000. Dans la première sous période, le poids des dépenses publiques d'éducation dans le PIB s'est replié pour augmenter après. Pour les dépenses privées, à la stabilité observée dans la période de forte croissance a succédé un déclin au moment du ralentissement de la croissance économique.
Si cette relation différente par rapport au cycle économique devait être structurelle, cela serait riche d'enseignements. Les dépenses d'éducation peuvent être considérées comme représentatives d'un effort d'augmentation du capital humain. Si cet effort se relâche dans les périodes d'inflexion du rythme de croissance, cela signifie que les cohortes alors en formation bénéficient moins que d'autres de cet investissement.
DÉPENSES AU TITRE DES ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT
EN POURCENTAGE DU PIB, TOUS NIVEAUX D'ENSEIGNEMENT
CONFONDUS
de sources publiques et privées, selon la
provenance des fonds et l'année
|
2003 |
2000 |
1995 |
|||||||
|
Dépenses publiques 1 |
Dépenses privées
|
Total |
Dépenses publiques 1 |
Dépenses privées
|
Total |
Dépenses publiques 1 |
Dépenses privées
|
Total |
|
|
Australie |
4,3 |
1,5 |
5,8 |
4,4 |
1,4 |
5,8 |
4,5 |
1,0 |
5,5 |
|
Autriche |
5,2 |
0,3 |
5,5 |
5,3 |
0,3 |
5,6 |
5,8 |
0,3 |
6,1 |
|
Belgique |
5,9 |
0,2 |
6,1 |
m |
m |
m |
m |
m |
m |
|
Canada 3 |
4,6 |
1,3 |
5,9 |
5,1 |
1,2 |
6,4 |
6,2 |
0,8 |
7,0 |
|
Rép. Tchèque |
4,3 |
0,4 |
4,7 |
3,8 |
0,4 |
4,3 |
4,8 |
0,3 |
5,1 |
|
Danemark |
6,7 |
0,3 |
7,0 |
6,4 |
0,3 |
6,6 |
6,0 |
0,2 |
6,2 |
|
Finlande |
6,0 |
0,1 |
6,1 |
5,6 |
0,1 |
5,7 |
6,2 |
0,1 |
6,3 |
|
France |
5,8 |
0,5 |
6,3 |
m |
m |
m |
m |
m |
m |
|
Allemagne |
4,4 |
0,9 |
5,3 |
4,2 |
1,0 |
5,2 |
4,4 |
0,9 |
5,4 |
|
Grèce |
4,0 |
0,2 |
4,2 |
3,7 |
0,2 |
4,0 |
2,9 |
0,1 |
3,0 |
|
Hongrie |
5,5 |
0,6 |
6,1 |
4,4 |
0,6 |
5,0 |
4,8 |
0,6 |
5,4 |
|
Islande |
7,5 |
0,5 |
8,0 |
5,6 |
0,5 |
6,1 |
m |
m |
m |
|
Irlande |
4,1 |
0,3 |
4,4 |
4,1 |
0,4 |
4,5 |
4,7 |
0,5 |
5,2 |
|
Italie |
4,6 |
0,4 |
5,1 |
4,5 |
0,4 |
4,9 |
4,8 |
m |
m |
|
Japon |
3,5 |
1,2 |
4,8 |
3,5 |
1,2 |
4,7 |
3,5 |
1,1 |
4,7 |
|
Corée |
4,6 |
2,9 |
7,5 |
3,9 |
2,5 |
6,4 |
m |
m |
m |
|
Mexique |
5,6 |
1,2 |
6,8 |
4,7 |
0,8 |
5,5 |
4,6 |
1,0 |
5,6 |
|
Pays-Bas |
4,6 |
0,4 |
5,0 |
4,2 |
0,4 |
4,5 |
4,4 |
0,2 |
4,7 |
|
Nouvelle-Zélande |
5,7 |
1,2 |
6,8 |
5,6 |
m |
m |
4,8 |
m |
m |
|
Norvège |
6,5 |
0,1 |
6,6 |
m |
m |
m |
6,8 |
0,4 |
7,1 |
|
Pologne |
5,8 |
0,7 |
6,4 |
4,9 |
0,2 |
5,1 |
5,3 |
m |
m |
|
Portugal |
5,8 |
0,1 |
5,9 |
5,6 |
0,1 |
5,7 |
5,3 |
0 |
5,3 |
|
Rép. Slovaque |
4,3 |
0,5 |
4,7 |
3,9 |
0,1 |
4,1 |
4,6 |
0,1 |
4,7 |
|
Espagne |
4,2 |
0,5 |
4,7 |
4,2 |
0,6 |
4,8 |
4,5 |
0,8 |
5,3 |
|
Suède |
6,5 |
0,2 |
6,7 |
6,2 |
0,2 |
6,4 |
6,1 |
0,1 |
6,2 |
|
Suisse |
6,0 |
0,6 |
6,5 |
5,2 |
0,4 |
5,6 |
5,3 |
M |
m |
|
Turquie (2002) |
3,6 |
0,1 |
3,7 |
3,4 |
0,0 |
3,4 |
2,3 |
0 |
2,3 |
|
Royaume-Uni |
5,1 |
1,0 |
6,1 |
4,5 |
0,7 |
5,2 |
4,8 |
0,7 |
5,5 |
|
États-Unis |
5,4 |
2,1 |
7,5 |
4,8 |
2,2 |
7,0 |
5,0 |
2,2 |
7,2 |
|
Moyenne non pondérée |
5,2 |
0,7 |
5,9 |
4,7 |
0,7 |
5,4 |
4,9 |
0,5 |
5,4 |
|
Moyenne de l'UE-19 |
5,2 |
0,4 |
5,6 |
~ |
~ |
~ |
~ |
~ |
~ |
1. Sont comprises les subventions publiques aux
ménages afférentes aux établissements d'enseignement ainsi
que les dépenses directes de sources internationales au titre des
établissements d'enseignement (hors formation continue).
2. Déduction faite des subventions publiques au titre des
établissements d'enseignement.
Source : OCDE
B. DES ÉVOLUTIONS DES DÉPENSES D'ENSEIGNEMENT VARIABLES SELON LES PAYS
L'évolution des dépenses d'enseignement a été variable dans les pays de l'OCDE.
1. Des variations contrastées de l'effort total d'éducation
Le tableau ci-dessous permet de recenser une augmentation de leur poids relatif au PIB dans 15 pays et une diminution dans 10 pays.
ÉVOLUTION DES DÉPENSES D'ÉDUCATION
DANS LES PAYS DE L'OCDE
1995-2003 (EN POINTS DE PIB)
|
Total |
Dépenses publiques |
Dépenses privées |
|
|
Australie |
+ 0,3 |
- 0,2 |
+ 0,5 |
|
Autriche |
- 0,6 |
- 0,6 |
0 |
|
Belgique |
ND |
ND |
ND |
|
Canada 1 |
- 1,1 |
- 1,6 |
+ 0,5 |
|
République Tchèque |
- 0,4 |
- 0,5 |
+ 0,1 |
|
Danemark |
- 0,8 |
+ 0,7 |
+ 0,1 |
|
Finlande |
- 0,2 |
- 0,2 |
0 |
|
Allemagne |
- 0,1 |
0 |
0 |
|
Grèce |
+ 1,2 |
+ 1,1 |
+ 0,1 |
|
Hongrie |
+ 0,7 |
+ 0,7 |
0 |
|
Islande 1 |
+ 1,9 |
+ 1,9 |
0 |
|
Irlande |
- 0,8 |
- 0,6 |
- 0,2 |
|
Italie 1 |
- 0,2 |
- 0,2 |
0 |
|
Japon |
+ 0,1 |
0 |
+ 0,1 |
|
Corée 1 |
+ 1,1 |
+ 0,7 |
+ 0,4 |
|
Mexique |
+ 1,2 |
+ 1,0 |
+ 0,2 |
|
Pays-Bas 1 |
+ 0,3 |
+ 0,2 |
+ 0,2 |
|
Nouvelle-Zélande |
ND |
0,7 |
ND |
|
Norvège |
- 0,5 |
- 0,3 |
- 0,2 |
|
Pologne 1 |
+ 1,3 |
+ 0,5 |
+ 0,5 |
|
Portugal |
+ 0,6 |
+ 0,5 |
+ 0,1 |
|
Rép. Slovaque |
0 |
- 0,3 |
+ 0,4 |
|
Espagne |
- 0,6 |
- 0,3 |
- 0,3 |
|
Suède |
+ 0,5 |
+ 0,4 |
+ 0,1 |
|
Suisse 1 |
+ 0,9 |
+ 0,7 |
+ 0,2 |
|
Turquie 1 |
+ 1,4 |
+ 1,3 |
+ 0,1 |
|
Royaume-Uni |
+ 0,6 |
+ 0,3 |
+ 0,3 |
|
États-Unis |
+ 0,3 |
+ 0,4 |
- 0,1 |
1. Certaines données comparent 2003 à l'année 2000 ce qui explique l'inégalité entre le chiffre total et l'addition des deux composantes de la dépense.
- Les pays dans lesquels l'accroissement des dépenses d'enseignement en points de PIB a été supérieur à la moyenne de l'OCDE sont au nombre de 10 : la Grèce, la Hongrie, l'Islande, la Corée, le Mexique, la Pologne, le Portugal, la Suisse, la Turquie et le Royaume-Uni.
Au terme de ce processus, la Hongrie, la Pologne et le Portugal se situent désormais au-dessus de la moyenne de l'OCDE pour les dépenses d'enseignement.
Ces résultats traduisent pour ces derniers pays un effort de rattrapage ; pour les autres, une accentuation d'un effort d'investissement dans l'enseignement qui les situaient déjà au-dessus de la moyenne.
- Les pays qui ont réduit l'effort destiné à l'enseignement - dix pays également : l'Autriche, le Canada, la République Tchèque, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, la Norvège et l'Espagne - sont pour certains, désormais, en retrait du niveau moyen des dépenses d'enseignement . Il en va ainsi de l' Autriche , de la République tchèque , de l' Allemagne , de l' Irlande , de l' Italie et de l' Espagne - le Canada qui dépassait de loin la moyenne en 1995 étant désormais juste à son niveau.
2. Des recompositions entre dépenses publiques et privées différenciées
* Dans les pays où la dépense d'enseignement en points de PIB a augmenté, deux modèles différents se dégagent :
- dans la plupart des cas, ce sont les dépenses publiques qui expliquent la quasi-totalité de la variation : Grèce, Hongrie, Islande, Mexique, Portugal, Turquie et Suisse sont dans ce cas ;
- toutefois, dans plusieurs pays - Corée, Pologne et Royaume-Uni - l'augmentation globale relève d'une addition de suppléments de dépenses publiques et privées quasiment analogues .
* Dans les pays où les dépenses publiques d'enseignement ont reculé, les dépenses privées n'ont généralement pas suivi ce déclin . Seules l'Irlande, la Norvège et l'Espagne font exception sous cet angle. Dans trois pays, les dépenses privées ont maintenu leur place dans le PIB ; dans quatre autres, la baisse du poids des dépenses publiques d'éducation s'est accompagnée d'une hausse de celui des dépenses privées. Au Canada, la très forte baisse des dépenses publiques consacrées à cette fonction (- 1,6 point de PIB) a été accompagnée par une augmentation importante de l'effort privé (+ 0,5 point de PIB) sans toutefois permettre de conserver la position relative du pays.
II. DES EFFORTS D'INVESTISSEMENT DANS L'ENSEIGNEMENT, VARIABLES À DIFFÉRENTS POINTS DE VUE
La répartition des dépenses d'enseignement n'est pas monotone .
Ces dépenses diffèrent selon le niveau d'enseignement, et selon le pays, ainsi que sous l'angle de leur répartition entre sources publiques et privées .
A. SELON LE NIVEAU D'ENSEIGNEMENT
L' enseignement non supérieur, concentre les deux tiers des dépenses totales d'éducation avec, en moyenne, 3,9 % du PIB .
L' enseignement supérieur bénéficie, quant à lui, d'un effort moyen de 1,4 % du PIB .
DÉPENSES AU TITRE DES ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT
EN POURCENTAGE DU PIB, SELON LE NIVEAU D'ENSEIGNEMENT
de sources publiques et privées, selon la provenance
des fonds et l'année
|
Primaire, secondaire et post-secondaire non tertiaire |
Tertiaire |
|||||||||
|
2003 |
2000 |
1995 |
2003 |
2000 |
1995 |
|||||
|
Dépenses publiques 1 |
Dépenses privées
|
Total |
Total |
Total |
Dépenses publiques 1 |
Dépenses privées
|
Total |
Total |
Total |
|
|
Australie |
3,4 |
0,7 |
4,1 |
4,1 |
3,7 |
0,8 |
0,8 |
1,5 |
1,5 |
1,7 |
|
Autriche |
3,7 |
0,1 |
3,8 |
4,0 |
4,2 |
1,1 |
0,1 |
1,1 |
1,0 |
1,2 |
|
Belgique |
4,0 |
0,1 |
4,1 |
m |
m |
1,2 |
0,1 |
1,3 |
m |
m |
|
Canada (2002) |
3,2 |
0,3 |
3,6 |
3,6 |
4,5 |
1,3 |
1,0 |
2,4 |
2,5 |
2,3 |
|
Rép. Tchèque |
2,9 |
0,2 |
3,1 |
2,8 |
3,7 |
0,9 |
0,2 |
1,1 |
0,8 |
1,0 |
|
Danemark |
4,1 |
0,1 |
4,3 |
4,1 |
4,0 |
1,7 |
0,1 |
1,8 |
1,6 |
1,6 |
|
Finlande |
3,9 |
n |
4,0 |
3,6 |
4,0 |
1,7 |
0,1 |
1,8 |
1,7 |
1,9 |
|
France |
4,0 |
0,3 |
4,3 |
m |
m |
1,1 |
0,2 |
1,3 |
m |
m |
|
Allemagne |
2,9 |
0,6 |
3,5 |
3,5 |
3,7 |
1,0 |
0,1 |
1,1 |
1,0 |
1,1 |
|
Grèce |
2,6 |
0,2 |
2,8 |
3,0 |
2,3 |
1,2 |
n |
1,3 |
0,9 |
0,8 |
|
Hongrie |
3,5 |
0,2 |
3,7 |
2,9 |
3,6 |
1,0 |
0,3 |
1,3 |
1,1 |
1,0 |
|
Islande |
5,2 |
n |
5,2 |
4,7 |
m |
1,1 |
0,1 |
1,2 |
0,9 |
m |
|
Irlande |
3,1 |
0,1 |
3,2 |
2,9 |
3,8 |
1,0 |
0,1 |
1,2 |
1,5 |
1,3 |
|
Italie |
3,5 |
0,1 |
3,6 |
3,3 |
m |
0,7 |
0,2 |
0,9 |
0,9 |
0,8 |
|
Japon |
2,7 |
0,3 |
3,0 |
2,9 |
3,0 |
0,5 |
0,8 |
1,3 |
1,1 |
1,0 |
|
Corée |
3,5 |
0,9 |
4,4 |
3,6 |
m |
0,6 |
2,0 |
2,6 |
2,3 |
m |
|
Luxembourg |
4,0 |
m |
m |
m |
m |
m |
m |
m |
m |
m |
|
Mexique |
3,8 |
0,7 |
4,5 |
3,8 |
4,0 |
0,9 |
0,4 |
1,3 |
1,0 |
1,1 |
|
Pays-Bas |
3,2 |
0,2 |
3,4 |
3,0 |
2,9 |
1,1 |
0,3 |
1,3 |
1,2 |
1,4 |
|
Nouvelle-Zélande |
4,5 |
0,5 |
4,9 |
m |
m |
0,9 |
0,6 |
1,5 |
m |
m |
|
Norvège |
4,6 |
m |
m |
3,8 |
4,3 |
1,5 |
0,1 |
1,5 |
1,3 |
1,7 |
|
Pologne |
4,2 |
0,1 |
4,4 |
3,6 |
3,6 |
1,0 |
0,5 |
1,5 |
0,9 |
0,8 |
|
Portugal |
4,2 |
n |
4,2 |
4,1 |
3,8 |
1,0 |
0,1 |
1,1 |
1,1 |
0,9 |
|
Rép. Slovaque |
2,8 |
0,3 |
3,1 |
2,7 |
3,1 |
0,8 |
0,1 |
0,9 |
0,8 |
0,8 |
|
Espagne |
2,8 |
0,2 |
3,0 |
3,2 |
3,8 |
0,9 |
0,3 |
1,2 |
1,1 |
1,0 |
|
Suède |
4,5 |
n |
4,5 |
4,3 |
4,2 |
1,6 |
0,2 |
1,8 |
1,6 |
1,6 |
|
Suisse |
4,0 |
0,6 |
4,6 |
4,3 |
m |
1,6 |
m |
m |
1,1 |
m |
|
Turquie (2002) |
2,5 |
0,1 |
2,6 |
2,4 |
1,7 |
1,1 |
0,1 |
1,1 |
1,0 |
0,7 |
|
Royaume-Uni |
4,0 |
0,6 |
4,6 |
3,8 |
3,9 |
0,8 |
0,3 |
1,1 |
1,0 |
1,2 |
|
États-Unis |
3,9 |
0,3 |
4,2 |
3,9 |
3,9 |
1,2 |
1,6 |
2,9 |
2,7 |
2,7 |
|
Moyenne non pondérée |
3,6 |
0,3 |
3,9 |
~ |
~ |
1,1 |
0,4 |
1,4 |
~ |
~ |
|
Moyenne de l'UE-19 |
3,6 |
0,2 |
3,8 |
~ |
~ |
1,1 |
0,2 |
1,3 |
~ |
~ |
1. Sont comprises les subventions publiques aux
ménages afférentes aux établissements d'enseignement ainsi
que les dépenses directes de sources internationales au titre des
établissements d'enseignement.
2. Déduction faite des
subventions publiques au titre des établissements d'enseignement.
Source : OCDE
- Mis à part quelques cas isolés, on relève que l'effort d'éducation , approché par la part du PIB investie dans l'éducation, est un peu plus homogène pour l'enseignement supérieur que pour les autres niveaux d'enseignement .
Pour ceux-ci, certains pays décrochent nettement par le bas . En revanche, certains pays dépensent plus que la moyenne. Les écarts, dans un sens comme dans l'autre, peuvent atteindre 1 point de PIB, soit environ ¼ de l'effort moyen.
Au total, pour l'enseignement non supérieur, l'écart-type s'élève à 0,68 point de PIB contre 0,49 point de PIB pour le supérieur.
Pour l'enseignement supérieur, seuls quelques pays se distinguent nettement, par le haut . La Corée , les États-Unis , le Canada et le Chili font un effort moyen supérieur de 90 % par rapport aux autres pays de l'OCDE. A l'effort de 1,4 % de PIB en faveur de l'enseignement supérieur, ils ajoutent 1,2 point de PIB en moyenne.
- Cependant, apprécié relativement au montant moyen des dépenses dans chaque catégorie d'enseignement, c'est bien dans le supérieur que la diversité des efforts est la plus grande . L'écart moyen y atteint 35 % de la moyenne des dépenses contre seulement 17 % dans le non supérieur.
B. SELON LE PAYS
Au total, la dépense d'éducation manifeste l'existence de situations nationales très contrastées.
DÉPENSES DESTINÉES AUX
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
EN POURCENTAGE DU PIB, TOUS NIVEAUX
D'ENSEIGNEMENT CONFONDUS
(1995 - 2003)*
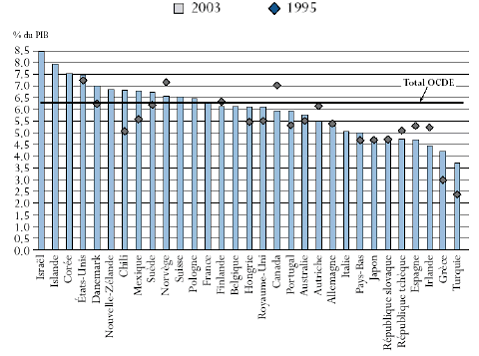
* La moyenne est une moyenne pondérée par les niveaux de PIB.
Le graphique prend en compte l'ensemble des dépenses directes et indirectes de sources publiques et privées. Les pays sont classés par ordre décroissant des dépenses publiques et privées destinées aux établissements d'enseignement en 2003.
Lecture : Les pays de l'OCDE consacrent (en moyenne pondérée par les niveaux de PIB) 6,3 % de leur PIB cumulé à leurs établissements d'enseignement. Entre 1995 et 2003, la croissance des dépenses d'éducation n'a pas suivi celle de la richesse nationale dans un tiers environ des 22 pays de l'OCDE et pays partenaires pour lesquels des données sont disponibles.
Source : Regards sur l'éducation. OCDE 2006. Tableau B2.1a.
Pour une moyenne de 6,3 points de PIB, les dépenses totales d'éducation sont comprises entre environ 4 points de PIB en Grèce et en Turquie et près de 7 points de PIB dans les pays scandinaves et en Amérique du Nord . Hormis la Corée du Sud, c'est désormais aux États-Unis que , selon les données de l'OCDE, la dépense d'éducation serait - hors Israël et Islande - la plus élevée ( 7,5 points de PIB ).
C. LE NIVEAU DES DÉPENSES PUBLIQUES JOUE UN RÔLE SUR LE NIVEAU DE L'EFFORT D'ÉDUCATION, MAIS UN RÔLE QUI N'EST, DE LOIN, PAS EXCLUSIF
L'effort public consacré à l'éducation joue globalement un rôle sur le total du revenu alloué à cette fonction. Mais ce rôle n'est pas déterminant , d'autres variables semblant plus décisives 40 ( * ) .
DÉPENSES DESTINÉES AUX
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
EN POURCENTAGE DU PIB (2003)
41
(
*
)
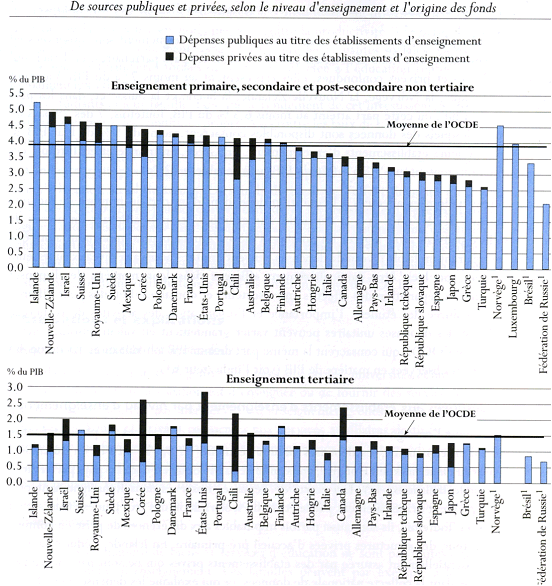
Source : Regards sur l'éducation. OCDE 2006.
1. Le rôle prépondérant des dépenses publiques
Même si la dépense totale d'éducation dans l'OCDE excède la seule dépense publique d'éducation , celle-ci est toujours , globalement, le mode de financement majoritaire .
Toutefois, des situations particulières conduisent à nuancer ce constat.
Les graphiques ci-après 42 ( * ) montrent que les parts relatives des financements publics et privés dans l'éducation varient nettement selon les pays.
PART RELATIVE DES FINANCEMENTS PUBLICS ET FINANCEMENTS
PRIVÉS
ALLOUÉS AUX ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT
1999 - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET POST-SECOND (HORS
SUPÉRIEUR)
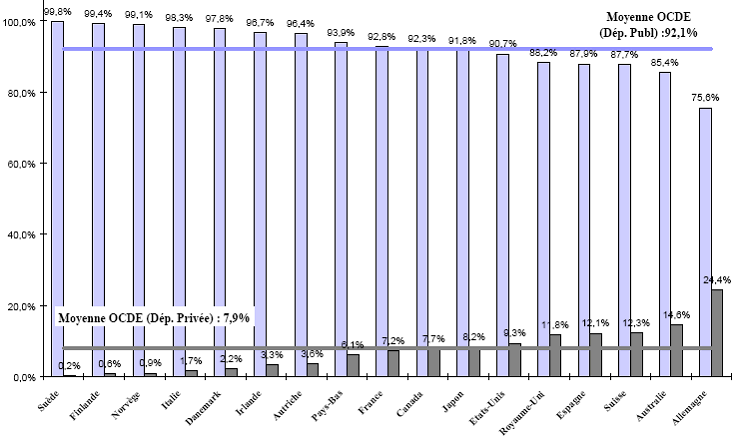
Source : OCDE. DPD. Ministère de l'Éducation.
PART RELATIVE DES FINANCEMENTS PUBLICS ET FINANCEMENTS
PRIVÉS
ALLOUÉS AUX ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT
1999 - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
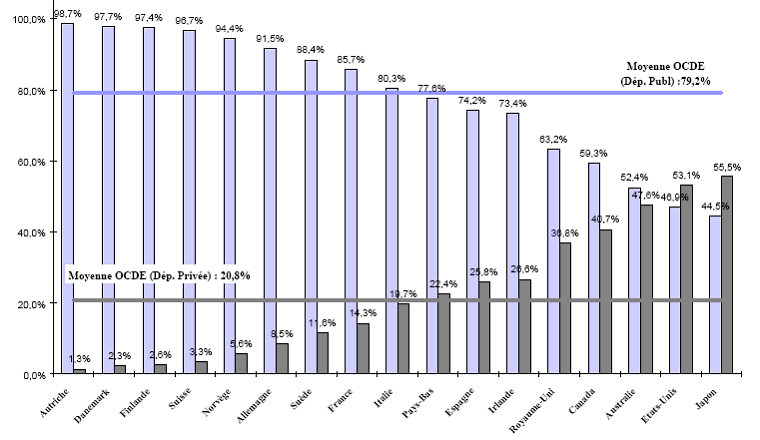 Source : OCDE. DPD.
Ministère de l'Éducation.
Source : OCDE. DPD.
Ministère de l'Éducation.
* Il reste que ce choix ne porte pas sur un volet très important de l'effort d'éducation. Le choix d'une plus ou moins grande intervention publique ne concerne pas l'ensemble du champ de l'enseignement. Les différences de situation sont pour l'essentiel attribuables aux modalités de financement de l'enseignement supérieur, qui sont très contrastées.
a) Un constat fort pour le non-supérieur
Pour l'enseignement non supérieur, il existe une dispersion mais elle est relativement peu importante . Autour d'une moyenne du financement public qui atteint 92,1 % , on peut relever des situations parfois tranchées avec, en particulier, une très forte particularité de l'Allemagne 43 ( * ) .
Marginal dans les pays scandinaves, en Italie et en Irlande, le financement privé du « non supérieur » atteint près du quart du total en Allemagne . Il est supérieur à la moyenne (7,9 % du total) aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais de relativement peu.
b) Des réalités plus nuancées dans le supérieur
- En revanche, pour l'enseignement supérieur , les contrastes sont beaucoup plus accusés . Le financement public y atteint une proportion très inférieure à ce qu'elle est dans le « non supérieur » ( 79,2 % du total ).
Cela résulte pour beaucoup du choix d'un nombre élevé de pays parmi les plus développés de l'OCDE de recourir à un système de financement mixte . Dans deux pays, Japon et États-Unis, le financement privé occupe même une part légèrement majoritaire .
|
POURQUOI LE FINANCEMENT DES PREMIERS CYCLES
L'origine essentiellement publique du financement de l'enseignement non supérieur et l'existence de modalités de financement plus contrastées pour le supérieur peuvent être considérées comme la traduction de principes théoriques de l'économie publique . En effet, pour les premiers niveaux d'enseignement, le financement public intervient en conformité avec l'idée que ces niveaux d'enseignement revêtent toutes les caractéristiques des biens publics. Ils dégagent de fortes externalités socio-économiques et, du fait des aléas des « carrières scolaires » et des risques liés à ces aléas, il existe, à ces niveaux, une difficulté pour chacun à envisager le rendement de son investissement éducatif individuel. Ainsi, sans intervention publique, il est à redouter qu'un sous-investissement ne se manifeste. En revanche, pour le supérieur, avec quelques importantes nuances liées aux niveaux variables des taux d'échec, les risques sont moindres et la capacité à formuler des perspectives personnelles de rendement de l'éducation sont plus importantes. Dans ces conditions, la capacité des agents privés à accaparer les bénéfices de leur investissement, plus grande que pour les premiers niveaux d'enseignement, rend moins nécessaire l'intervention publique. |
2. Des différences de dosage entre pays surtout dues à l'extension des dépenses privées
La dépense publique d'éducation s'élève en moyenne à 5,2 % du PIB contre 5,9 % pour la dépense totale 44 ( * ) . Elle représente donc près des 9/10e des dépenses totales d'éducation . L' effort privé ajoute quant à lui 0,7 point de PIB aux ressources publiques dépensées en ce domaine.
Mais, cette répartition moyenne ne doit pas occulter des choix nationaux très différenciés .
- L' écart moyen par rapport à la moyenne des dépenses publiques d'éducation est de 20 % en 2003 .
Les dépenses privées extériorisent des écarts beaucoup plus considérables , de l'ordre du simple au double .
Ainsi, l'homogénéité, déjà toute relative pour les dépenses publiques d'éducation, fait place à des particularismes nationaux considérables du point de vue de l'ampleur des dépenses privées.
- Au total, la situation des pays au regard de la dépense totale d'éducation diffère parfois de celle qui est la leur du point de vue des dépenses publiques d'éducation.
LES DÉPENSES D'ÉDUCATION - ÉCARTS À LA MOYENNE DE L'OCDE EN 2003
|
Dépenses Publiques |
Dépenses Privées |
Dépenses totales |
|
|
Australie |
- 0,9 |
+ 0,8 |
- 0,1 |
|
Autriche |
0 |
- 0,4 |
- 0,4 |
|
Belgique |
+ 0,7 |
- 0,5 |
+ 0,3 |
|
Canada |
- 0,6 |
+ 0,6 |
0 |
|
République tchèque |
- 0,9 |
- 0,3 |
- 1,2 |
|
Danemark |
+ 1,5 |
- 0,4 |
+ 1,1 |
|
Finlande |
+ 0,8 |
- 0,6 |
+ 0,2 |
|
France |
+ 0,6 |
- 0,2 |
+ 0,4 |
|
Allemagne |
- 0,8 |
+ 0,2 |
- 0,6 |
|
Grèce |
- 1,2 |
- 0,5 |
- 1,7 |
|
Hongrie |
+ 0,3 |
- 0,1 |
+ 0,2 |
|
Islande |
+ 2,3 |
- 0,2 |
+ 2,1 |
|
Irlande |
- 1,1 |
- 0,4 |
- 1,5 |
|
Italie |
- 0,6 |
- 0,3 |
- 0,8 |
|
Japon |
- 1,7 |
+ 0,5 |
- 1,1 |
|
Corée |
- 0,6 |
+ 2,2 |
+ 1,6 |
|
Luxembourg |
Nd |
Nd |
Nd |
|
Mexique |
+ 0,4 |
+ 0,5 |
+ 0,9 |
|
Pays-Bas |
- 0,6 |
- 0,3 |
- 0,9 |
|
Nouvelle-Zélande |
+ 0,5 |
+ 0,7 |
+ 0,9 |
|
Norvège |
+ 1,3 |
- 0,6 |
+ 0,7 |
|
Pologne |
+ 0,6 |
0 |
+ 0,5 |
|
Portugal |
+ 0,6 |
- 0,6 |
0 |
|
République slovaque |
- 0,9 |
- 0,2 |
- 1,2 |
|
Espagne |
- 1,0 |
- 0,2 |
- 1,2 |
|
Suède |
+ 1,3 |
- 0,5 |
+ 0,8 |
|
Suisse |
+ 0,8 |
- 0,1 |
+ 0,6 |
|
Turquie |
- 2,1 |
- 0,6 |
- 2,2 |
|
Royaume-Uni |
- 0,1 |
+ 0,3 |
+ 0,2 |
|
États-Unis |
+ 0,2 |
+ 1,4 |
+ 1,6 |
DÉPENSES D'ÉDUCATION AU TITRE DES
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT EN 1999
(en % du
PIB)
|
Dépenses Publiques |
Dépenses Privées |
Dépenses totales |
|
|
Japon |
3,5 |
1,2 |
4,7 |
|
Grèce |
3,6 |
0,3 |
3,9 |
|
Turquie |
3,9 |
0 |
3,9 |
|
Corée |
4,1 |
2,7 |
6,8 |
|
Pays-Bas |
4,2 |
0,5 |
4,7 |
|
Irlande |
4,2 |
0,4 |
4,6 |
|
Slovaquie |
4,3 |
0,1 |
4,4 |
|
Allemagne |
4,3 |
1,2 |
5,5 |
|
Italie |
4,3 |
0,5 |
4,8 |
|
Royaume-Uni |
4,3 |
0,9 |
5,2 |
|
États-Unis |
4,9 |
1,6 |
6,5 |
|
Suisse |
5,4 |
0,5 |
5,9 |
|
Finlande |
5,7 |
0 |
5,7 |
|
France |
5,8 |
0,5 |
6,3 |
|
Autriche |
6,0 |
0,4 |
6,4 |
|
Danemark |
6,4 |
0,3 |
6,7 |
|
Suède |
6,5 |
0,2 |
6,7 |
|
Norvège |
6,5 |
0,1 |
6,6 |
Source : OCDE, DPD. Ministère de l'Éducation.
Ainsi, en 1999, la Corée et les États-Unis appartenaient au groupe de tête des pays en matière de moyens totaux alloués à l'éducation , alors qu'ils en étaient assez loin au regard des seules dépenses publiques.
3. Des dépenses privées parfois alternatives, parfois complémentaires
- Dans plusieurs pays, il existe une relation inverse entre les différentes sources de financement .
Ainsi, en Australie, au Canada, en Allemagne, au Japon, en Corée et au Royaume-Uni, si les dépenses publiques en points de PIB se trouvent sous la moyenne, les dépenses privées sont au-dessus.
Inversement, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Hongrie, en Islande, en Norvège, au Portugal, en Suède et en Suisse, les dépenses privées sont situées plus bas que la moyenne tandis que les dépenses publiques l'excèdent.
- Mais, dans certains pays, les « scores » sont dans le même sens pour les deux catégories de dépenses :
- par le bas , pour la République Tchèque, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, la République slovaque, l'Espagne et la Turquie ;
- par le haut, pour le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis.
Dans ce dernier cas, les dépenses privées sont situées encore plus au-dessus de la moyenne que pour les dépenses publiques.
Quant à la France , elle est au huitième rang pour le niveau des dépenses publiques relatif au PIB - elle se situe au même rang que le Portugal et la Pologne -, au dixième rang pour le total des dépenses d'éducation dans l'OCDE et au treizième rang pour l'effort privé .
4. Des dépenses privées pas toujours synonymes d'effort des ménages
- Les dépenses privées d'éducation ne sont pas toujours des dépenses payées par les ménages.
RÉPARTITION DES DÉPENSES PUBLIQUES ET
PRIVÉES DESTINÉES AUX ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
(2003)
(selon le niveau d'enseignement)
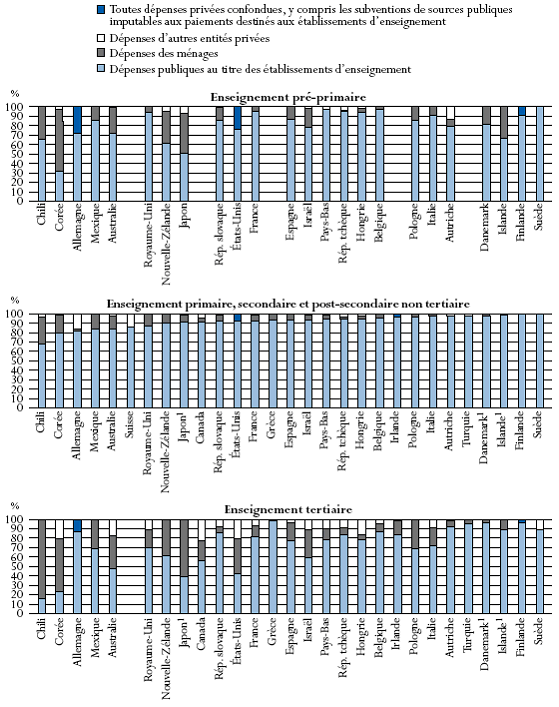
Source : Regards sur l'éducation. OCDE 2006. Graphique B3.2.
Par exemple, dans les deux premiers niveaux d'enseignement, les dépenses privées supportées par les ménages ne sont pas significatives en Allemagne et en Suisse, deux pays qui pourtant se singularisent par le niveau inhabituellement élevé du financement privé du non-supérieur.
Dans l'enseignement supérieur, les ménages sont plus fortement sollicités mais, dans certains pays (États-Unis, Canada, Royaume-Uni...) où le financement privé atteint une proportion élevée, d'autres entités contribuent beaucoup à financer l'enseignement supérieur. 45 ( * )
*
* *
Tous les pays où la dépense publique d'éducation est la plus importante comptent aussi parmi les pays où la dépense totale d'éducation est la plus élevée. Mais, pour faire partie de ce groupe de pays, il n'est pas toujours nécessaire d'entreprendre un effort public d'éducation du niveau de ces premiers pays. Dans quelques cas, rares il est vrai, le relais est pris par les dépenses privées .
III. FOCUS SUR LA FRANCE : UN GROS EFFORT CONSACRÉ À L'ENSEIGNEMENT MAIS DES SINGULARITÉS À MÉDITER
Notre pays consacre un effort important à l'enseignement .
Lorsqu'on l'apprécie par rapport à la moyenne de l'OCDE, celui-ci apparaît conforme à cette moyenne. Mais, au regard de son niveau relatif de PIB par habitant , notre pays fait, en réalité, un investissement plus important que nombre de pays .
Cet investissement présente toutefois des singularités marquées avec une concentration sur l'enseignement secondaire et avec un niveau de coût par élève sensiblement plus élevé qu'en moyenne pour ce niveau d'enseignement .
Cette particularité , qui ne semble pas tenir à une politique salariale plus généreuse , mais plutôt à des éléments d'organisation qui isolent notre pays dans l'ensemble de l'OCDE, est amplifiée au niveau de la masse des dépenses d'investissement par quelques caractéristiques de la démographie scolaire .
A. UN EFFORT D'ENSEIGNEMENT COMPARATIVEMENT PLUS ÉLEVÉ QU'AILLEURS COMPTE TENU DE LA RICHESSE PAR HABITANT
* Une variable explicative essentielle du niveau de l'effort d'éducation est le degré de développement du pays. En effet, il existe globalement une liaison positive entre le niveau de richesses des pays et le pourcentage du PIB consacré à l'éducation 46 ( * ) . Cette corrélation est plus robuste quand on envisage l' ensemble des dépenses d'éducation, plutôt que les seules dépenses publiques d'éducation ce qui montre qu'au-delà des particularités institutionnelles, une certaine homogénéité des préférences existe entre pays de même niveau de développement.
Cependant, cette corrélation n'est pas universelle, des pays décrochant par le haut ( la France ) ou par le bas (le Royaume-Uni , les Pays-Bas ).
1. La corrélation entre dépenses publiques d'éducation et richesse par habitant est moins forte que pour les dépenses totales d'éducation
* La corrélation est parfois assez lâche au regard des seules dépenses publiques.
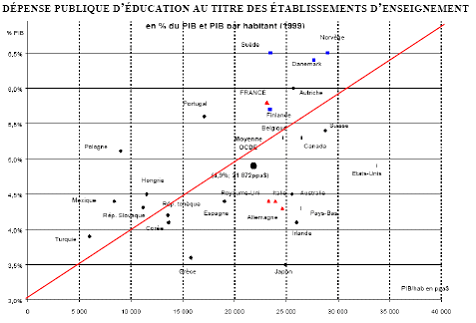
Source : OCDE. DPD. Ministère de l'Éducation.
Avec des niveaux de PIB par habitant analogues, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas consacrent moins de moyens publics à l'éducation que la France ou la Suède.
* En revanche, elle est plus étroite quand on considère l'ensemble des dépenses d'éducation .
DÉPENSE D'ÉDUCATION AU TITRE DES
ÉTABLISSEMENTS
EN % DU PIB ET PIB PAR HABITANT
(1999)
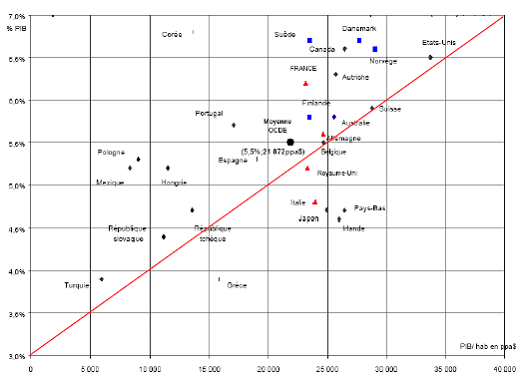
Note de lecture : dans l'échelle de gauche est mesuré le niveau de la dépense d'éducation dans le PIB tandis que l'échelle horizontale mesure le PIB par habitant corrigé des écarts de niveaux des prix.
Source : OCDE. DPD. Ministère de l'Éducation.
- La confrontation des graphiques ci-dessus montre que si la dépense publique d'éducation est liée à la richesse relative des pays, cette corrélation est encore plus forte pour la dépense totale d'éducation .
2. Toutefois, plus les pays sont riches plus l'éventail des dépenses publiques d'éducation s'ouvre
- La corrélation entre les dépenses publiques d'enseignement et la richesse est particulièrement établie lorsque les pays sont relativement pauvres.
Pour la dépense publique d'éducation au titre des établissements en pourcentage du PIB, sur les dix pays dont le PIB par tête est inférieur à la « Moyenne OCDE », seuls deux pays, le Portugal et la Pologne ont une dépense publique dont le pourcentage par rapport au PIB est supérieur à la « Moyenne OCDE ».
- En revanche, pour les pays relativement riches , la situation est plus contrastée .
Huit pays sur les dix-sept, dont le PIB par tête est supérieur à la moyenne, affectent à la dépense publique d'éducation un pourcentage supérieur à la moyenne de l'OCDE : la Norvège (6,5 %), la Suède (6,5 %), le Danemark (6,4 %), puis l'Autriche (6,0 %) et la France (5,8 %). Pour les autres (9 pays, dont l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni), l'observation contraire peut être formulée .
Tout se passe comme si, pour les pays relativement riches, un choix se présentait relativement au niveau de collectivisation de la dépense d'enseignement alors que pour les pays relativement moins développés la dépense publique représente un modèle plus dominant de financement.
Cette situation qui semble notamment due à la place plus importante de l'enseignement supérieur dans les pays riches, témoigne aussi de la diversification des modèles de financement de l'éducation dans ces pays et, sans doute, de la diversification correspondante de l'offre scolaire .
Ainsi, les progrès vers une éducation de masse , caractéristique des pays riches, s'accompagnent , selon toute vraisemblance, de différenciations alternatives qui résultent de la rencontre d'une demande privée et d'une offre probablement sélective .
B. LES SINGULARITÉS FRANÇAISES
1. Un coût moyen par élève supérieur en France...
* La dépense d'éducation nationale peut, par ailleurs, être décomposée en un couple « dépense moyenne par élève - masse des effectifs scolarisés », qui permet d'appréhender les variables déterminant le niveau d'effort consacré à l'éducation.
- La dépense moyenne par élève et par an - calculée en parités de pouvoir d'achat afin de neutraliser les écarts purement nominaux entre pays liés à des prix de niveaux différents -, est de 7.471 dollars par an quand on prend en compte l'ensemble du cursus de formation initiale.
Des différences importantes distinguent les pays entre eux .
Le coût moyen de l'enseignement en France , avec un peu plus de 7.800 dollars par élève , est plus élevé de 329 dollars , soit 4,5 % , que pour la moyenne de l'OCDE .
DÉPENSES ANNUELLES DESTINÉES AUX
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
PAR ÉLÈVE/ÉTUDIANT
ENTRE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET TERTIAIRE (2003)
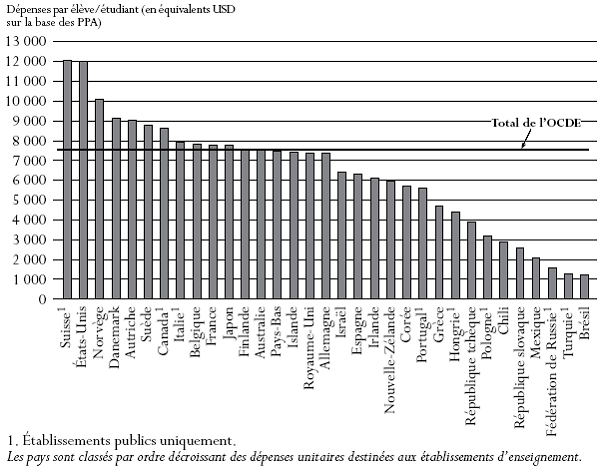
Ligne représentant le total de l'OCDE : 7.471 dollars.
Source : Regards sur l'éducation, OCDE 2006.
En revanche, quelques pays sont très au-delà de cette valeur moyenne : la Suisse et les États-Unis surtout, tandis que d'autres sont très en deçà (Espagne, Irlande, Nouvelle-Zélande, Portugal,...).
L' excédent de coût par élève observé en France contribue fortement à l'excès de la richesse nationale allouée à l'enseignement dans notre pays .
Celui-ci représente un effort supérieur de 6,8 % par rapport à ce que consacre, en moyenne, chaque pays de l'OCDE 47 ( * ) . Près des deux tiers de cet écart sont attribuables au niveau relativement plus élevé du coût moyen par élève en France .
2. ... en raison du secondaire
Les coûts moyens diffèrent sensiblement selon le niveau d'enseignement .
DÉPENSES ANNUELLES AU TITRE DES
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
PAR
ÉLÈVE/ÉTUDIANT, TOUS SERVICES CONFONDUS (2003)
(converties en équivalents dollars EU sur la base
des PPA pour le PIB,
selon le niveau d'enseignement, calculs fondés
sur des équivalents temps plein)
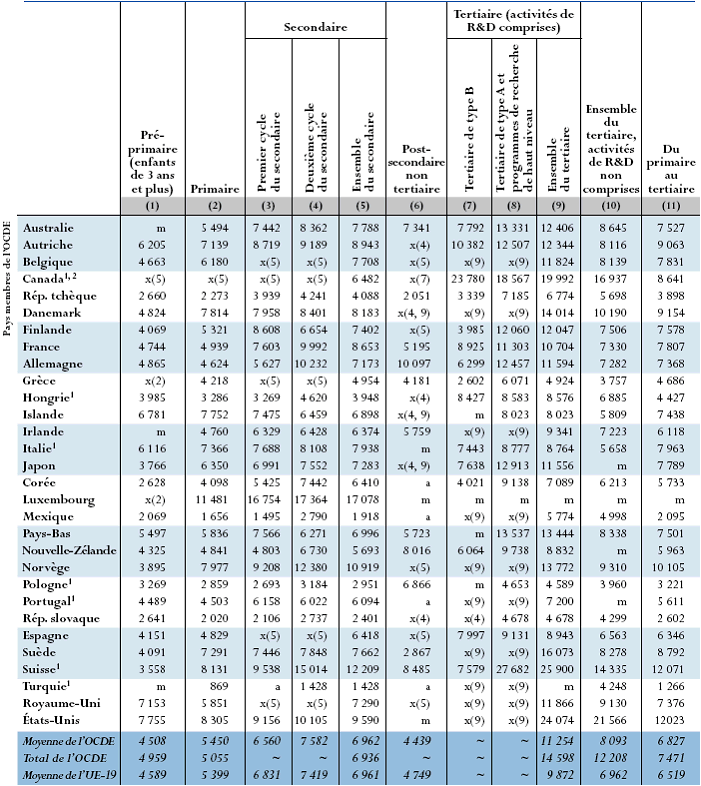
Source : OCDE
Pour la moyenne de l'OCDE, ils vont de 4.959 dollars dans le pré-primaire à 11.254 dollars dans le tertiaire en passant par 5.450 dollars dans le primaire et 6.962 dollars dans le secondaire .
Ils sont donc fortement croissants, une année de secondaire coûtant 1,27 année de primaire et une année de « supérieur » représentant 1,6 année de secondaire (1,8 fois la moyenne des coûts de deux années, l'une du primaire, l'autre du secondaire).
Décomposé par niveau d'enseignement, l'effort moyen par tête est, en France, inférieur à la moyenne de l'OCDE pour le primaire et le supérieur, et se situe au-delà pour l'enseignement secondaire.
COÛT PAR ÉLÈVE ET PAR NIVEAU
D'ENSEIGNEMENT
(en équivalents dollars EU, 2003)
|
Pays |
Primaire
|
1er cycle secondaire |
2ème cycle secondaire |
Ensemble secondaire
|
Supérieur
|
1 / 2 |
3 / 2 |
|
États-Unis |
8 305 |
9 159 |
10 105 |
9 590 |
24 074 |
0,87 |
2,5 |
|
Suède |
7 291 |
7 446 |
7 848 |
7 662 |
16 073 |
0,95 |
2,10 |
|
Royaume-Uni |
5 850 |
7 290 |
11 866 |
0,80 |
1,63 |
||
|
Finlande |
5 321 |
8 608 |
6 654 |
7 402 |
12 047 |
0,72 |
1,63 |
|
Japon |
6 350 |
6 991 |
7 552 |
7 283 |
11 556 |
0,87 |
1,59 |
|
Allemagne |
4 624 |
5 627 |
10 232 |
7 173 |
11 594 |
0,64 |
1,61 |
|
France |
4 939 |
7 603 |
9 992 |
8 653 |
10 704 |
0,57 |
1,24 |
|
Espagne |
4 829 |
6 418 |
8 943 |
0,75 |
1,39 |
||
|
Italie |
7 366 |
7 688 |
8 108 |
7 938 |
8 764 |
0,93 |
1,10 |
|
Moyenne OCDE |
5 450 |
6 560 |
7 582 |
6 962 |
11 254 |
0,78 |
1,62 |
Source : Regards sur l'éducation. OCDE 2006.
La France se singularise, en effet, par un coût moyen par élève du primaire d'à peu près 60 % (57 %) de celui de l'élève dans le secondaire, contre 78 % en moyenne, et par un coût relatif du supérieur de 124 %, contre 162 % en moyenne de l'OCDE par rapport à un élève du secondaire.
Le coût moyen d'un élève du secondaire est le deuxième le plus élevé (après celui des États-Unis) , et est supérieur de 1.691 dollars (24,3 % de plus) à celui constaté en moyenne dans l'OCDE .
Compte tenu des durées inégales des cursus dans chaque niveau d'éducation (5 années dans le primaire, 7 années dans le secondaire et 3 années dans le supérieur en données théoriques), le surcoût du secondaire observé en France a une responsabilité majeure dans le niveau relativement élevé des dépenses d'éducation dans notre pays .
*
* *
Si, le coût moyen par élève du secondaire était en France au niveau moyen de l'OCDE, le coût moyen par élève (apprécié de façon théorique pour tous les niveaux d'enseignement) s'établirait à 7.036 dollars contre 7.471 dollars en moyenne dans l'OCDE, soit 5,6 % plus bas alors qu'il est supérieur de 4,7 %.
C. UNE SITUATION QUI NE SEMBLE PAS RÉSULTER DE FACTEURS SALARIAUX MAIS PLUTÔT D'ÉLÉMENTS D'ORGANISATION
1. Apparemment pas de responsabilité des salaires
Les facteurs expliquant ce supplément de coûts ne semblent pas tenir à des éléments salariaux mais à des caractéristiques organisationnelles .
Les salaires des enseignants sont en France généralement moins élevés que dans l'OCDE excepté pour les enseignants atteignant l'échelon maximum de leur grade.
Les données disponibles ne permettent pas d'avoir l'entière certitude que les salaires individuels ne comptent pour rien dans le coût relativement élevé de l'enseignement secondaire en France puisque les profils de carrière pourraient différer dans les pays de l'OCDE. Toutefois, on doit relever que, même après quinze ans de carrière, les salaires moyens sont, en France, moins élevés qu'en moyenne, et dans des proportions importantes .
SALAIRES DES ENSEIGNANTS (2004)
(Salaire statutaire annuel des enseignants des
établissements publics,
en début de carrière,
après 15 ans d'exercice à l'échelon maximum, par niveau
d'enseignement, en équivalents dollars EU convertis sur la base des
PPA)
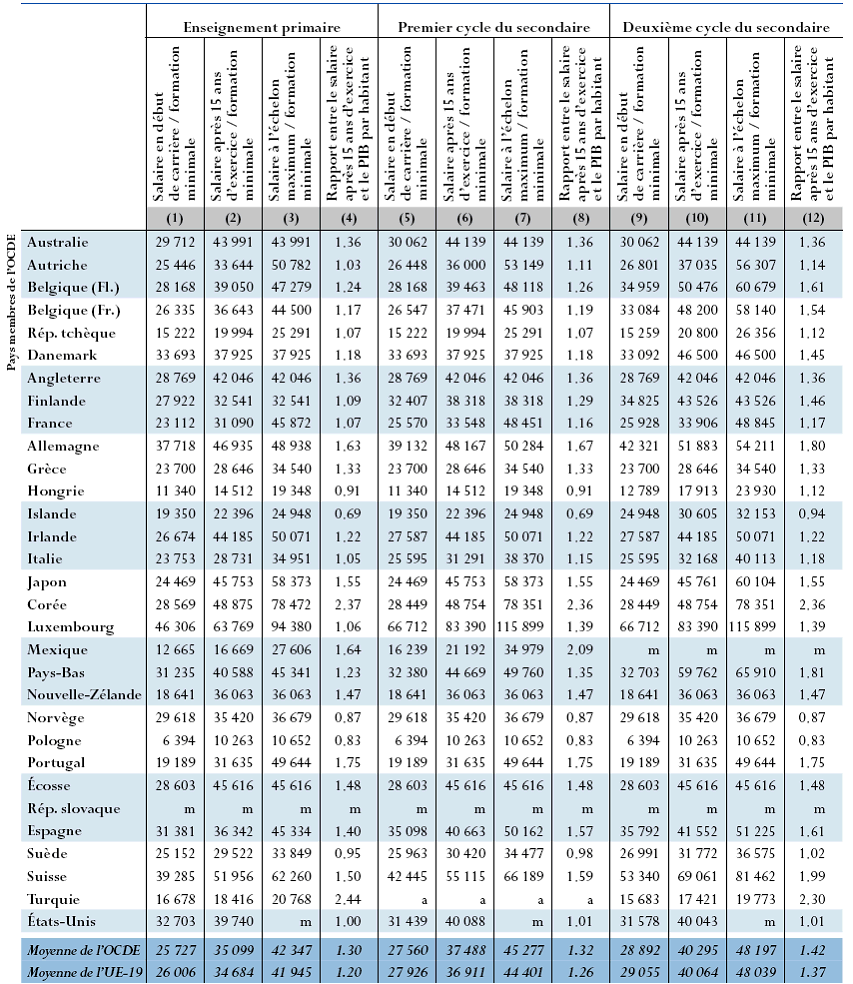
Source : OCDE
Le tableau ci-dessus montre également que le salaire moyen d'un enseignant français, comparé au PIB par habitant, qui donne une idée de la richesse par individu d'un pays, se situe dans une proportion entre 107 % (pour le primaire) et 117 % (pour le deuxième cycle du secondaire), quand, dans l'OCDE, ces rapports sont respectivement de 130 et 142 %.
Autrement dit, la situation salariale d'un enseignant est, en France, assez proche d'un salarié moyen et la situation française se différencie très nettement de celle de nombreux pays de l'OCDE comparables, qui réservent à leurs enseignants un sort salarial plus favorable .
Par exemple, en Allemagne , aux Pays-Bas et au Royaume-Uni , pays où, pourtant, les dépenses d'enseignement en proportion du PIB sont moins élevées qu'en France, les salaires sont très sensiblement supérieurs, et les enseignants disposent d'une situation relative (au reste des salariés) plus favorable .
Toutefois, le salaire par heure de service d'enseignement des enseignants du secondaire français semble beaucoup plus proche de la moyenne de l'OCDE compte tenu de la durée relativement faible de ce service en France.
2. ... mais plutôt d'éléments d'organisation
Des variables organisationnelles ressortent comme les causes du surcoût par élève de l'enseignement secondaire en France :
- Le nombre d'heures d'instruction dans l'enseignement public est sensiblement supérieur à la moyenne de l'OCDE. Les élèves finlandais 48 ( * ) , pourtant lauréats des évaluations internationales, reçoivent un volume d'heures inférieur de 25 % à celui que reçoivent les élèves français. Cette situation semble liée pour les lycées au nombre de matières enseignées, plus important que dans d'autres pays.
- Le service d'enseignement , l'un des plus élevés de l'OCDE pour l'enseignement primaire (900 heures en France contre 795 heures pour la moyenne de l'OCDE et 684 heures pour la Finlande) est, en revanche, l'un des plus faibles pour l'enseignement secondaire avec 600 heures contre une moyenne de l'OCDE à 660 heures.
- Les taux d'encadrement des élèves sont particulièrement élevés en France dans le secondaire.
NOMBRE D'ÉLÈVES/ÉTUDIANTS PAR
ENSEIGNANT PAR TYPE D'ÉTABLISSEMENT (2004)
Par niveau
d'enseignement, calculs fondés sur des équivalents temps
plein
|
Premier cycle du secondaire |
Deuxième cycle du secondaire |
Ensemble du secondaire |
||||||||||
|
Établissements privés, subventionnés par l'État |
Établissements privés, subventionnés par l'État |
Établissements privés, subventionnés par l'État |
||||||||||
|
Établissements publics |
Total des établissements privés |
Établissements privés, subventionnés par l'État |
Établissements privés Indépendants |
Établissements publics |
Total des établissements privés |
Établissements privés, subventionnés par l'État |
Établissements privés Indépendants |
Établissements publics |
Total des établissements privés |
Établissements privés, subventionnés par l'État |
Établissements privés Indépendants |
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
(11) |
(12) |
|
|
Australie 1 |
x(9) |
x(10) |
x(11) |
a |
x(9) |
x(10) |
x(11) |
a |
12,4 |
12,0 |
12,0 |
a |
|
Autriche |
10,3 |
12,1 |
x(2) |
x(2) |
10,9 |
12,0 |
x(6) |
x(6) |
10,5 |
12,0 |
x(10) |
x(10) |
|
Belgique 2 |
10,2 |
m |
10,9 |
m |
9,3 |
m |
9,1 |
m |
9,6 |
m |
9,7 |
m |
|
France |
13,8 |
15,3 |
15,3 |
16,7 |
9,5 |
12,6 |
11,1 |
16,7 |
11,6 |
13,7 |
13,2 |
16,7 |
|
Allemagne |
15,6 |
15,3 |
15,3 |
x(3) |
14,0 |
13,2 |
13,2 |
x(7) |
15,2 |
14,5 |
14,5 |
x(11) |
|
Italie |
10,3 |
9,0 |
a |
9,0 |
12,1 |
5,9 |
a |
5,9 |
11,3 |
6,6 |
a |
6,6 |
|
Japon 3 |
15,5 |
13,3 |
a |
13,3 |
12,5 |
15,1 |
a |
15,1 |
14,0 |
14,8 |
a |
14,8 |
|
Corée |
20,4 |
20,5 |
20,5 |
a |
15,0 |
16,7 |
16,7 |
a |
18,1 |
17,7 |
17,7 |
a |
|
Nouvelle-Zélande |
17,5 |
14,0 |
a |
14,0 |
15,0 |
7,2 |
10,4 |
4,4 |
16,3 |
8,1 |
10,4 |
6,5 |
|
Norvège 2 |
10,5 |
m |
m |
m |
9,6 |
m |
m |
m |
10,0 |
m |
m |
m |
|
Portugal |
9,7 |
12,2 |
13,8 |
10,5 |
7,6 |
6,1 |
8,2 |
5,6 |
8,6 |
7,7 |
10,8 |
6,5 |
|
Suède |
11,9 |
11,0 |
11,0 |
a |
13,9 |
14,7 |
14,7 |
a |
12,9 |
12,8 |
12,8 |
a |
|
Royaume-Uni 1 |
18,8 |
7,0 |
a |
7,1 |
13,1 |
7,9 |
7,3 |
7,9 |
15,7 |
7,5 |
7,3 |
7,6 |
|
États-Unis |
15,8 |
10,6 |
a |
10,6 |
16,6 |
11,6 |
a |
11,6 |
16,2 |
11,0 |
a |
11,0 |
|
Moyenne OCDE |
13,8 |
13,0 |
13,3 |
10,2 |
13,0 |
11,6 |
12,0 |
8,3 |
13,4 |
12,1 |
12,3 |
9,2 |
|
Moyenne UE-19 |
11,9 |
12,0 |
12,8 |
10,2 |
11,6 |
10,9 |
11,5 |
8,6 |
11,7 |
11,6 |
11,9 |
9,7 |
1. Ne comprend que la filière générale
pour les 1
er
et 2
e
cycles du secondaire.
2. Le
deuxième cycle de l'enseignement secondaire inclut l'enseignement
post-secondaire non tertiaire.
3. Le deuxième cycle de
l'enseignement secondaire inclut des programmes post-secondaires non
tertiaires. Source : OCDE
Le taux d'encadrement dans le secondaire est l'un des plus élevés de l'OCDE.
Le taux d'enseignement, généralement plus élevé dans les établissements publics que dans les établissements privés en France, met un enseignant face à 11,6 élèves dans notre pays dans le secondaire contre un enseignant pour 13,4 élèves en moyenne de l'OCDE .
On pourrait attribuer quelques vertus à cette particularité . Elle témoignerait d'un haut degré d'attention donnée aux élèves en France. Malheureusement, cette conclusion n'est pas celle qui convient . Les taux d'encadrement mentionnés mettent en relation les emplois budgétaires et les effectifs scolaires. Avec cette méthode, on ne rend pas compte de la réalité de l'accompagnement des élèves. D'ailleurs, le nombre d'élèves par classe (24 élèves dans les collèges) est bien plus élevé que le taux d'encadrement en France. En réalité, la multiplication des matières , les options nombreuses , l' existence sans doute d'un assez grand nombre d'enseignants sans affectation d'enseignement sont probablement en cause dans la « performance » française.
Le fort taux d'encadrement est une réalité budgétaire mais pas pleinement une réalité éducative .
On peut, à cet égard, citer l'ouvrage mentionné plus haut : « Notons que des pays à taille de classe identique dans les collèges (24 élèves en France, 24,7 en Allemagne et 22,5 au Royaume-Uni) ont des taux d'encadrement respectivement de l'enseignant pour 14,1, 13,9 et 17,1 élèves, ce qui montre le caractère relativement coûteux de notre organisation pédagogique. Notre taux d'encadrement est de 19,4 pour le primaire, contre 16,9 pour la moyenne des pays de l'OCDE , de 14,1 dans les collèges contre 13,7 et 10,3 en second cycle contre 12,7 pour la moyenne des pays de l'OCDE. C'est bien la diversité et la complexité du lycée et du lycée professionnel qui semblent être les facteurs discriminants du coût élevé du second cycle français. »
D. UN COÛT MOYEN ÉLEVÉ DONT LES EFFETS SUR LA MASSE DES DÉPENSES SONT AMPLIFIÉS PAR LA DÉMOGRAPHIE SCOLAIRE
Des données relatives au coût moyen par élève, on ne peut inférer la masse de l'effort d'éducation qu'en prenant en considération les effectifs .
On peut les décomposer en deux variables : la durée de présence pour chaque élève dans le système , et le nombre d'élèves scolarisés .
* Les durées des cursus éducatifs ne sont pas connues avec exactitude mais des données théoriques sont disponibles.
- Les données théoriques situent la France dans la moyenne .
En France, pour l'enseignement primaire et secondaire, la durée théorique ainsi que le coût moyen par élève sont proches de la moyenne de l'OCDE .
DÉPENSES AU TITRE DES ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT PAR ÉLÈVE
CUMULÉES SUR LA DURÉE
THÉORIQUE DES ÉTUDES PRIMAIRES OU SECONDAIRES (2003) -
Converties en équivalents dollars EU sur la base des PPA
pour le PIB,
selon le niveau d'enseignement
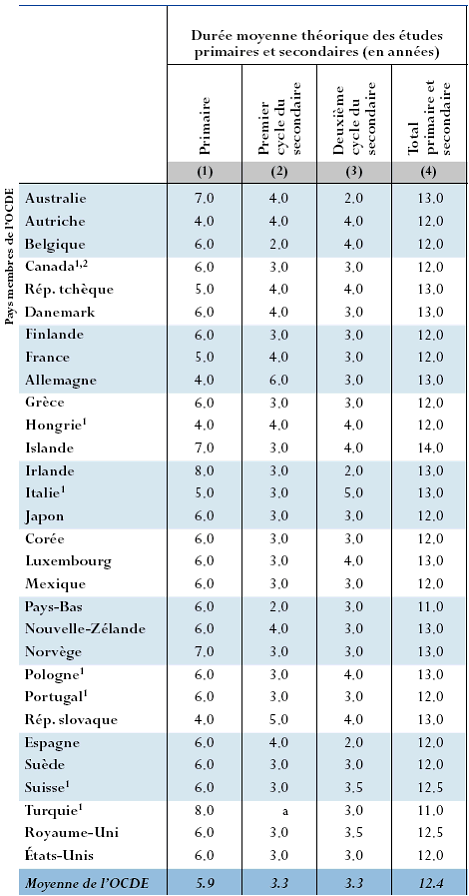
1. Établissements publics uniquement
2.
Année de référence : 2002.
3. Année de
référence : 2004.
Source : Regards sur l'éducation, OCDE 2006.
Il en va de même pour le tertiaire (le supérieur).
DÉPENSES AU TITRE DES ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT PAR ÉTUDIANT
CUMULÉES SUR LA DURÉE
THÉORIQUE DES ÉTUDES TERTIAIRES (2003)
Converties en équivalents dollars EU sur la base des
PPA pour le PIB,
selon le type de programme
|
Durée moyenne des études tertiaires (en années) |
|||
|
Tertiaire
|
Tertiaire de type A et programmes de recherche
|
Ensemble
|
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
|
|
Australie |
m |
2,87 |
2,87 |
|
Autriche |
2,78 |
5,60 |
5,30 |
|
Belgique |
2,41 |
3,67 |
2,99 |
|
Danemark |
2,10 |
3,84 |
3,70 |
|
Finlande |
a |
4,85 |
4,85 |
|
France |
3,00 |
4,74 |
4,02 |
|
Allemagne |
2,37 |
6,57 |
5,36 |
|
Grèce |
5,00 |
5,26 |
5,25 |
|
Islande |
1,96 |
2,84 |
2,68 |
|
Irlande |
2,21 |
4,02 |
3,24 |
|
Italie |
m |
5,14 |
5,01 |
|
Japon |
2,11 |
4,51 |
4,07 |
|
Corée |
2,07 |
4,22 |
3,43 |
|
Nouvelle-Zélande |
1,87 |
3,68 |
3,05 |
|
République slovaque |
2,47 |
3,90 |
3,82 |
|
Espagne |
2,15 |
5,54 |
4,66 |
|
Suède |
2,26 |
4,93 |
4,68 |
|
Suisse |
2,19 |
5,45 |
3,62 |
|
Turquie |
2,73 |
2,37 |
2,65 |
|
Royaume-Uni |
3,52 |
5,86 |
4,34 |
|
Moyenne de l'OCDE |
2,38 |
4,42 |
3,94 |
1. La durée moyenne des études tertiaires a
été calculée soit selon la méthode par chaîne
(CM), soit selon une formule d'approximation (AF).
2. La durée
moyenne des études tertiaires est estimée à partir d'une
méthodologie nationale.
3. Établissements publics
uniquement.
Source : Regards sur l'Education, OCDE 2006.
- Ces données ne sont toutefois que théoriques, et, la France se distingue par des caractéristiques importantes qui accroissent la durée individuelle des cursus et les coûts de l'enseignement : l' importance relative du redoublement et les heurts des parcours d'orientation .
S'agissant du redoublement, à 15 ans, 38 % des élèves ont redoublé une fois en France contre 13,4 % en moyenne dans l'OCDE.
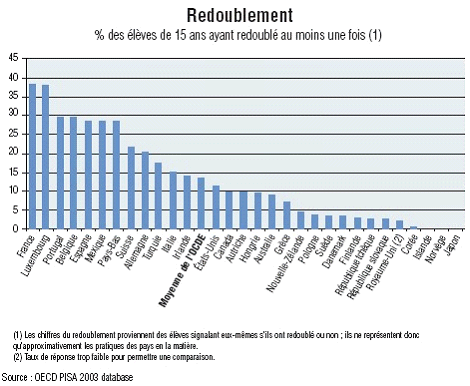
Source : OCDE. Pisa 2003.
* Quant aux effectifs , l'avantage démographique français avec une population jeune assez nombreuse ne joue pas dans le cadre de l'OCDE .
Ainsi, le niveau des personnes d'âge scolarisable en France, relativement plus faible qu'en moyenne dans l'OCDE, allège les dépenses d'éducation par rapport à une situation où la France aurait une population d'âge scolaire en ligne avec la moyenne de l'OCDE, pour un montant de 0,3 point de PIB.
IMPACT DE L'ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE SUR
LES DÉPENSES
DESTINÉES AUX ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT,
EXPRIMÉ EN POURCENTAGE DU PIB (2003)
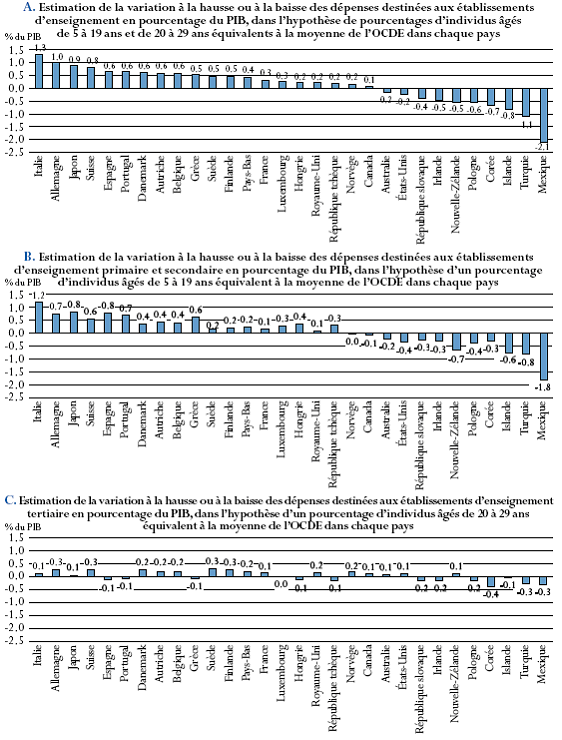
Source : Regards sur l'éducation. OCDE 2006.
Toutefois , à l' échelle de l'Europe , il faut relever que plusieurs pays européens connaissent sous cet angle une pression de la demande scolaire notablement inférieure .
L' Italie « économise » de ce fait 1 point de PIB de dépenses par rapport à notre pays et l' Allemagne 0,7 point de PIB .
Des circonstances démographiques expliquent ainsi plus de la moitié (51,9 %) de l'écart entre les dépenses d'éducation en France et en Allemagne, écart qui lui-même rend compte du quart de la différence de niveaux des dépenses publiques consacrées dans ces deux pays à la production des biens et services .
CONCLUSION - LE NIVEAU DES DÉPENSES PUBLIQUES, UN DÉTERMINANT MARGINAL DE L'UTILISATION DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES
L'ampleur des dépenses publiques dans les pays de l'OCDE, et même dans les seuls pays de l'Union européenne, est très différenciée.
Le poids des dépenses publiques dans le PIB va de 34,3 points en Irlande à 57,1 points en Suède avec une moyenne de 40,6 points de PIB dans l'OCDE .
Hormis l'Espagne et l'Irlande, tous les pays européens sont au-delà de cette moyenne, la moyenne des dépenses publiques étant dans la zone euro de 48,6 points de PIB (8 points de PIB au-dessus de la moyenne pour l'OCDE).
Les différences entre pays proviennent essentiellement des dépenses publiques de protection sociale , tandis que pour les dépenses que nécessite la production de biens et services publics, il y a davantage d'homogénéité.
En ce domaine 49 ( * ) , l'écart moyen entre quinze des principaux pays de l'OCDE s'élève à 3,5 points de PIB, alors que pour les dépenses publiques de protection sociale, la différence moyenne s'élève à 4,4 points de PIB, l'homogénéité relative des dépenses publiques de production étant plus forte quand on l'estime à partir d'une moyenne pondérée par les niveaux respectifs de richesse tandis que la diversité des niveaux de protection sociale publique est alors accentuée.
La nature des différences existant entre pays au regard de la protection sociale publique requiert parfois des approches prudentes et nuancées :
- l'identification des dépenses fiscales n'est pas complète alors que celles-ci sont apparemment très diversement mobilisées, les pays dans lesquels le niveau des dépenses publiques est relativement modeste étant aussi ceux qui, semble-t-il, y recourent le plus ;
- il n'y a pas une correspondance absolue entre le poids des dépenses publiques sociales dans le PIB et le niveau individuel de la protection sociale publique , si bien que, pour des pays dans lesquels la protection sociale publique paraît peu développée sous l'angle du niveau général des ressources qu'elle absorbe, la protection sociale publique par individu peut être, en réalité, comparativement élevée.
Quoiqu'il en soit, il ne faut pas associer aux écarts d'ampleur importante portant sur le niveau relatif des dépenses publiques une diversité entre pays des conditions d'affectation des richesses nationales .
On peut illustrer ce constat par l'exemple des dépenses de protection sociale et d'éducation.
Les dépenses publiques consacrées à l'éducation et à la protection sociale représentent en moyenne l' équivalent de 27,6 points de PIB en 2003 , soit près de deux tiers de la moyenne des dépenses publiques dans l'OCDE .
Les pays en question présentent des niveaux de dépenses publiques en ces domaines très différenciés .
Mais, quand on apprécie les ressources qu'ils leur consacrent en tenant compte des dépenses privées, les pays développés apparaissent beaucoup moins hétéroclites qu'homogènes.
En bref, le niveau des dépenses publiques dans le domaine de la protection sociale et de l'éducation ne ressort pas comme une variable déterminant l'ampleur des ressources économiques consacrées à ces deux fonctions .
Globalement, les dépenses publiques satisfont la majeure partie des besoins de protection sociale (y compris la santé) et d'éducation.
Mais, elles ne permettent pas de satisfaire l'ensemble des besoins exprimés par les agents dans ces deux domaines. Ceux-ci affectent l'équivalent de 4,3 points de PIB supplémentaires à cet effet , soit plus de 15 % du niveau des dépenses publiques si bien que, globalement, les dépenses d'éducation et de protection sociale s'élèvent, en moyenne, à 31,9 points de PIB.
Cela revient à dire qu'en moyenne, les dépenses publiques ne couvrent que 85 % des besoins dans les domaines de la protection sociale et de l'éducation, besoins appréciés à partir du total des dépenses qu'ils engendrent.
- Comme le confirme le tableau ci-dessous, les revenus alloués à l'éducation et à la protection sociale transitent pour près de 90 % (86,5 %) par des interventions collectives.
PARTS DU REVENU NATIONAL CONSACRÉES À
L'ÉDUCATION
ET À LA PROTECTION SOCIALE EN 2003
|
I - Dépenses publiques brutes |
II - Dépenses privées brutes |
Total
|
|||||
|
Éducation |
Protection sociale 1 |
Total |
Éducation |
Protection sociale |
Total |
||
|
Australie |
4,3 |
17,9 |
22,2 |
1,5 |
4,4 |
5,9 |
28,1 |
|
Autriche |
5,2 |
26,1 |
31,3 |
0,3 |
2,1 |
2,4 |
33,7 |
|
Belgique |
5,9 |
26,5 |
32,4 |
0,2 |
3,9 |
4,1 |
36,5 |
|
Canada |
4,6 |
17,3 |
21,9 |
1,3 |
5,4 |
6,7 |
28,6 |
|
Danemark |
6,7 |
27,6 |
34,3 |
0,3 |
2,5 |
2,8 |
37,1 |
|
Finlande |
6,0 |
22,5 |
28,5 |
0,1 |
4,7 |
4,8 |
33,3 |
|
France |
5,8 |
28,7 |
34,5 |
0,5 |
2,7 |
3,2 |
37,7 |
|
Allemagne |
4,4 |
27,3 |
31,7 |
0,9 |
3,0 |
3,9 |
35,6 |
|
Irlande |
4,1 |
15,9 |
20,0 |
0,3 |
0,5 |
0,8 |
20,8 |
|
Italie |
4,6 |
24,2 |
28,8 |
0,4 |
2,3 |
2,7 |
31,5 |
|
Japon |
3,5 |
17,7 |
21,2 |
1,2 |
3,3 |
4,5 |
25,7 |
|
Pays-Bas |
4,6 |
20,7 |
25,3 |
0,4 |
7,7 |
8,1 |
33,4 |
|
Nouvelle-Zélande |
5,7 |
18,0 |
23,7 |
1,2 |
0,5 |
1,7 |
25,4 |
|
Norvège |
6,5 |
25,1 |
31,7 |
0,1 |
2,6 |
2,7 |
34,4 |
|
Espagne |
4,2 |
20,3 |
24,5 |
0,5 |
0,3 |
0,8 |
25,3 |
|
Suède |
6,5 |
31,3 |
37,8 |
0,2 |
3,0 |
3,2 |
41,0 |
|
Royaume-Uni |
5,1 |
20,6 |
25,7 |
1,0 |
5,6 |
6,6 |
32,3 |
|
États-Unis |
5,4 |
16,2 |
21,6 |
2,1 |
9,7 |
11,8 |
33,4 |
|
Moyenne
|
5,2 |
22,4 |
27,6 |
0,7 |
3,6 |
4,3 |
31,9 |
1 Hors dépenses fiscales liées au système de pensions.
Les dépenses d'éducation avec 5,2 points de PIB représentent 18,8 % de ce total . Dans ce domaine, les dépenses publiques couvrent près de 90 % des besoins (88,1 %).
Pour les dépenses de protection sociale , qui représentent 81,2 % du total des dépenses considérées , les parts relatives des dépenses publiques et des dépenses privées sont du même ordre (86,1 % et 13,9 % respectivement) que pour l'éducation mais la place des dépenses privées est un peu plus importante que pour celle-ci.
|
I - Éducation |
II - Protection sociale |
Total
|
|||||
|
Dépenses publiques |
Dépenses privées |
Total |
Dépenses publiques |
Dépenses privées |
Total |
||
|
Australie |
4,3 |
1,5 |
5,8 |
17,9 |
4,4 |
22,3 |
28,1 |
|
Autriche |
5,2 |
0,3 |
5,5 |
26,1 |
2,1 |
28,2 |
33,7 |
|
Belgique |
5,9 |
0,2 |
6,1 |
26,5 |
3,9 |
30,4 |
36,5 |
|
Canada |
4,6 |
1,3 |
5,9 |
17,3 |
5,4 |
22,7 |
28,6 |
|
Danemark |
6,7 |
0,3 |
7,0 |
27,6 |
2,5 |
30,1 |
37,1 |
|
Finlande |
6,0 |
0,1 |
6,1 |
22,5 |
4,7 |
27,2 |
33,3 |
|
France |
5,8 |
0,5 |
6,3 |
28,7 |
2,7 |
31,4 |
37,7 |
|
Allemagne |
4,4 |
0,9 |
5,3 |
27,3 |
3,0 |
30,3 |
35,6 |
|
Irlande |
4,1 |
0,3 |
4,4 |
15,9 |
0,5 |
16,4 |
20,8 |
|
Italie |
4,6 |
0,4 |
5,0 |
24,2 |
2,3 |
26,5 |
31,5 |
|
Japon |
3,5 |
1,2 |
4,7 |
17,7 |
3,3 |
21,0 |
25,7 |
|
Pays-Bas |
4,6 |
0,4 |
5,0 |
20,7 |
7,7 |
28,4 |
33,4 |
|
Nouvelle-Zélande |
5,7 |
1,2 |
6,9 |
18,0 |
0,5 |
18,5 |
25,4 |
|
Norvège |
6,5 |
0,1 |
6,6 |
25,1 |
2,6 |
27,7 |
34,3 |
|
Espagne |
4,2 |
0,5 |
4,7 |
20,3 |
0,3 |
20,6 |
25,3 |
|
Suède |
6,5 |
0,2 |
6,7 |
31,3 |
3,0 |
34,3 |
41,0 |
|
Royaume-Uni |
5,1 |
1,0 |
6,1 |
20,6 |
5,6 |
26,2 |
32,3 |
|
États-Unis |
5,4 |
2,1 |
7,5 |
16,2 |
9,7 |
25,9 |
33,4 |
|
Moyenne non pondérée |
5,2 |
0,7 |
5,9 |
22,4 |
3,6 |
26,0 |
31,9 |
* Toutefois, ces données moyennes s'accompagnent d'une forte dispersion apparente des situations nationales quant au montant et à la répartition entre sources, privée ou publique, des moyens alloués aux deux fonctions .
ÉCARTS À LA MOYENNE EN FONCTION DE LA
NATURE DES DÉPENSES D'ÉDUCATION
ET DE PROTECTION SOCIALE (EN
POINTS DE PIB) - EN 2003
|
Dépenses publiques |
Dépenses privées |
|
|
Moyenne : 27,6 |
Moyenne : 4,3 |
|
|
Australie |
- 5,4 |
+ 1,6 |
|
Autriche |
+ 3,7 |
- 1,9 |
|
Belgique |
+ 4,8 |
- 0,2 |
|
Canada |
- 5,7 |
+ 2,4 |
|
Danemark |
+ 6,7 |
- 1,5 |
|
Finlande |
+ 0,9 |
+ 0,5 |
|
France |
+ 6,9 |
- 0,9 |
|
Allemagne |
+ 4,1 |
- 0,4 |
|
Irlande |
- 7,6 |
- 3,5 |
|
Italie |
+ 1,2 |
- 1,6 |
|
Japon |
- 6,4 |
+ 0,3 |
|
Pays-Bas |
- 2,3 |
+ 3,8 |
|
Nouvelle-Zélande |
- 3,9 |
- 2,6 |
|
Norvège |
+ 4,1 |
- 1,6 |
|
Espagne |
- 3,1 |
- 3,5 |
|
Suède |
+ 10,2 |
- 1,1 |
|
Royaume-Uni |
- 1,9 |
+ 2,3 |
|
États-Unis |
- 6,0 |
+ 7,5 |
L'écart pour les dépenses publiques entre le pays le plus « dépensier » (la Suède) et le moins « dépensier » (l'Irlande) s'élève à 17,8 points de PIB .
Pour les dépenses privées , cet écart est de 11 points de PIB (avec les États-Unis d'un côté et l'Espagne de l'autre).
- Cependant, lorsqu'on agrège les ressources publiques et privées consacrées à la protection sociale et à l'éducation dans les différents pays de l'OCDE, les différences entre pays ressortent très atténuées .
I. UNE DISPERSION APPARENTE50 ( * ) DES DÉPENSES PUBLIQUES DE L'ORDRE DE 20 % DE LA MOYENNE DES DÉPENSES PUBLIQUES
Pour les dépenses publiques, l'écart-type des pays par rapport à la moyenne de l'échantillon s'élève à 5,42 points de PIB , soit 20 % de la moyenne .
On peut relever que certains pays - ceux pour lesquels l'écart à la moyenne excède ces 5,42 points de PIB -, dont la France, divergent nettement .
LES PAYS DIVERGEANT EN MATIÈRE DE
DÉPENSES PUBLIQUES
D'ÉDUCATION ET DE PROTECTION SOCIALE -
(EN POINTS DE PIB)
|
En plus ... |
Écart à la moyenne des écarts |
En moins ... |
Écart à la moyenne des écarts |
|
Danemark |
+ 1,28 |
Japon |
- 0,98 |
|
France |
+ 1,48 |
Canada |
- 0,28 |
|
Suède |
+ 4,78 |
Irlande |
- 2,18 |
|
États-Unis |
- 0,58 |
Le nombre de pays divergeant nettement par le bas est plus élevé que leurs opposés, mais le total des écarts qu'ils extériorisent par rapport à l'écart moyen est plus faible.
Parmi ces pays, seule l'Irlande appartient à l'Europe tandis que tous les pays qui se singularisent par le poids élevé de leurs dépenses publiques dans les domaines ici envisagés sont européens .
Une fois éliminés de l'échantillon, les quatre pays les plus extrêmes 51 ( * ) (Danemark, Irlande, Suède et États-Unis), la valeur de l'écart-type recule à 4,4 points de PIB , soit 16 % de la moyenne .
Autrement dit, la position moyenne des pays au regard du niveau des dépenses publiques de protection sociale et d'éducation ne se trouve éloignée que de 16 % par rapport à cette moyenne.
Ainsi, s'agissant de deux catégories de dépenses publiques (la protection sociale et l'éducation) qui totalisent à peu près les deux tiers des dépenses publiques dans le monde développé, il faut considérer, qu'au-delà des écarts apparents, quand on compare des pays isolés, il existe une certaine convergence.
II. POUR LES DÉPENSES PRIVÉES, UNE DISPERSION DE L'ORDRE DE 64 % DE LA MOYENNE DES DÉPENSES PRIVÉES
- Pour les dépenses privées, la dispersion est plus modérée en valeur absolue . L'écart-type s'élève à 2,76 points de PIB .
Cependant , compte tenu de la valeur moyenne plus faible des dépenses privées consacrées à l'éducation et à la protection sociale (4,3 points de PIB), cet écart-type traduit une dispersion relative considérable des situations nationales . L'écart-type relatif (rapport de l'écart type à la moyenne) atteint 64 % de la moyenne .
LES PAYS NETTEMENT DIVERGENTS
EN MATIÈRE DE
DÉPENSES PRIVÉES D'ÉDUCATION ET DE PROTECTION SOCIALE
(EN POINTS DE PIB)
|
En plus... |
Écart à la moyenne des écarts |
En moins... |
Écart à la moyenne des écarts |
|
Pays-Bas |
+ 1,04 |
Irlande |
- 0,74 |
|
États-Unis |
+ 4,74 |
Espagne |
- 0,74 |
Deux pays enregistrent des dépenses privées nettement supérieures à la moyenne des écarts : les Pays-Bas et les États-Unis qui connaissent une situation exactement opposée au regard des dépenses publiques.
De même, deux pays divergent nettement par le bas : l' Irlande et l' Espagne .
La situation de l'Irlande apparaît singulière puisque c'est le seul pays qui diverge nettement dans la même direction, par le bas, tant pour les dépenses publiques que pour les dépenses privées d'éducation et de protection sociale .
III. DES PHÉNOMÈNES DE COMPENSATION ET DES ÉCARTS MARGINAUX REPRÉSENTATIFS D'ÉLÉMENTS DE CONTEXTE MAIS AUSSI DE CHOIX PLUS POLITIQUES
* Dans le domaine de la protection sociale et de l'éducation, la principale divergence entre les pays porte donc sur le niveau des dépenses privées .
Elle s'exprime avec une particulière force dans le domaine de la protection sociale, mais les niveaux des dépenses privées d'éducation apparaissent également diversifiés.
* Par comparaison, les choix concernant le degré de l'intervention publique sont plus homogènes malgré des écarts absolus plus élevés. C'est tout particulièrement le cas pour l'éducation mais la situation en matière de protection sociale est proche.
QUELQUES INDICATEURS DE DISPERSION DU REVENU
ALLOUÉ À L'ÉDUCATION ET DE PROTECTION SOCIALE
(EN
POINTS DE PIB)
|
Dépenses publiques |
Dépenses privées |
Total |
|||
|
Éducation |
Protection sociale |
Éducation |
Protection sociale |
||
|
Moyenne |
5,2 |
22,4 |
0,7 |
3,6 |
31,9 |
|
Écart-type |
0,94 |
4,79 |
0,57 |
2,44 |
5,24 |
|
Écart-type/moyenne |
0,18 |
0,21 |
0,82 |
0,68 |
0,16 |
* Dans le champ de la protection sociale, c'est le niveau des dépenses privées qui offre le plus de diversité. L'écart-type (2,44 points de PIB) est proche de la moyenne des dépenses privées de protection sociale (3,6 points de PIB), ce qui suggère qu'il existe une véritable diversité des pays au regard de la place réservée aux efforts privés de protection sociale .
- S'agissant des dépenses publiques de protection sociale , quand bien même l'indice de dispersion atteint un niveau absolu plus élevé (4,79 points de PIB), la moyenne relative des différences à la moyenne (21 %) est très nettement inférieure à ce qu'elle est pour les dépenses privées.
Cela accrédite l'observation que l'intervention collective est le mode dominant et, dans une certaine mesure, partagé d'organisation de la protection sociale , même si, par son ampleur, celle-ci admet des différences notables entre pays .
* S'agissant de l'éducation , des constats analogues interviennent. Les dépenses publiques d'éducation présentent une assez forte homogénéité même si elles admettent quelques différences notables puisqu'en moyenne les pays ajoutent ou retranchent environ 1 point de PIB (0,94) aux 5,2 points de PIB que les pays de l'OCDE consacrent à l'éducation, soit 18 % de cette moyenne.
Quant aux dépenses privées d'éducation, elles sont, comme pour la protection sociale, très différentes selon les pays, ce dont témoigne un écart-type relatif de 82 % de la moyenne de ces dépenses (0,57 point de PIB en valeur absolue pour une dépense moyenne de 0,7 point de PIB).
* La dispersion des dépenses privées dans le domaine de la protection sociale et dans celui de l'éducation conduit à réduire les effets de la dispersion des niveaux d'intervention publique sur la répartition des ressources économiques .
Il existe souvent, en effet, un phénomène de vases communicants dont les États-Unis offrent un exemple particulièrement illustratif . On y consacre 6 points de PIB de moins qu'en moyenne aux dépenses publiques de protection sociale et d'éducation mais 7,5 points de PIB de plus aux dépenses privées.
Dans certains cas toutefois, les écarts vont dans le même sens. Tel est surtout le cas pour des pays qui consacrent aussi peu de ressources publiques que privées à la protection sociale (Irlande, Espagne, Japon, Nouvelle-Zélande).
Mais, au total, une telle compensation intervient si bien que le niveau des dépenses publiques de protection sociale n'apparaît pas comme un déterminant majeur du niveau du revenu national alloué à la protection sociale .
Sous cet angle, le niveau relatif de développement économique est la variable qui apparaît essentielle .
Dans le domaine de l'éducation aussi, mais avec moins de netteté que pour la protection sociale, il existe des phénomènes de compensation entre interventions privées et publiques .
Toutefois, dans plusieurs pays, les écarts à la moyenne vont dans le même sens, qu'on considère les dépenses publiques ou les dépenses privées d'éducation. Parfois, pour la Grèce, l'Irlande, l'Italie ou l'Espagne, par exemple, cette situation correspond à une faiblesse relative des dépenses globales d'éducation. Dans d'autres cas, dépenses publiques et privées d'éducation se conjuguent pour conduire à une allocation du revenu à cette fonction supérieure à la moyenne. Tel est le cas aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande.
*
Quand on s'attache à la dispersion de
l'ensemble des dépenses
- publiques et
privées -
d'éducation et de protection
sociale
, l'écart type s'élève à
5,2 points de PIB
.
ÉCARTS À LA MOYENNE DES DÉPENSES
TOTALES D'ÉDUCATION
ET DE PROTECTION SOCIALE (EN POINTS DE PIB) - EN
2003
|
Moyenne |
31,9 |
|
Australie |
- 4,0 |
|
Autriche |
+ 1,8 |
|
Belgique |
+ 4,6 |
|
Canada |
- 3,3 |
|
Danemark |
+ 5,2 |
|
Finlande |
+ 1,4 |
|
France |
+ 5,8 |
|
Allemagne |
+ 3,7 |
|
Irlande |
- 11,1 |
|
Italie |
- 0,4 |
|
Japon |
- 6,2 |
|
Pays-Bas |
+ 1,5 |
|
Nouvelle-Zélande |
- 6,5 |
|
Norvège |
+ 2,5 |
|
Espagne |
- 6,6 |
|
Suède |
+ 9,1 |
|
Royaume-Uni |
+ 0,4 |
|
États-Unis |
+ 1,5 |
Cet écart-type est moins élevé en valeur absolue que celui relatif aux seules dépenses publiques. Surtout, il ne représente plus que 16 % de la moyenne de la totalité des dépenses consacrées à la protection sociale et à l'éducation contre 20 % pour les seules dépenses publiques.
La dispersion des pays au regard du total des ressources consacrées à la protection sociale et à l'éducation est moins forte que pour les seules dépenses publiques.
Quand on néglige les quatre pays les plus divergents (cités plus haut), l'écart tombe à 4,21 points de PIB , soit environ 13 % du total des ressources consacrées à ces deux domaines .
- Encore doit-on relever que ces écarts seraient encore réduits par la prise en compte :
- des dépenses fiscales - assimilables à des dépenses publiques - dont l'importance varie selon les pays, en fonction inverse, semble-t-il, du niveau relatif des dépenses publiques.
Ainsi, dans le seul domaine des pensions, l'OCDE relève que les dépenses fiscales s'étageaient, en 2001, entre 0 (pour la France) et 2,3 points de PIB (pour l'Irlande) ;
- et des effets de la fiscalité sur les dépenses publiques sociales effectives dont le rapport 2006 sur la protection sociale dans l'Union européenne rend compte par le graphique ci-après.
L'EFFET DES IMPÔTS SUR LES DÉPENSES
PUBLIQUES DE PROTECTION SOCIALE
DANS QUELQUES PAYS, EN 2001 - (EN POINTS DE
PIB)
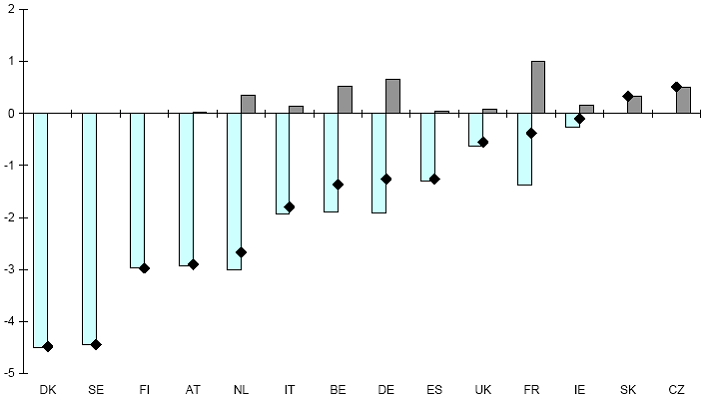
Impôts directs et cotisations Dépenses fiscales Total
Source : Commission européenne
Au demeurant, pour l'OCDE , l'écart moyen entre pays concernant les dépenses sociales publiques nettes des impôts et cotisations est de 2,7 points de PIB contre 4,2 points de PIB pour les dépenses sociales publiques brutes (- 1,5 point de PIB).
- Au total, il parait assez robuste d'estimer qu'en moyenne les pays développés consacrent à 2,7 points de PIB près les mêmes ressources à la protection sociale et à l'éducation contre un écart apparent de 5,42 points de PIB quand on apprécie la répartition du revenu alloué à ces deux importants domaines de l'intervention publique (les deux tiers des dépenses publiques dans l'OCDE) à partir des seules dépenses publiques brutes.
Compte tenu de la sensibilité de ces dépenses à la conjoncture économique, au niveau du développement économique et à des facteurs démographiques, la modicité de cette « plage de variation » montre qu'en dépit de choix assez différenciés dans les degrés de l'intervention publique, il existe, vues globalement, une grande homogénéité des conditions dans lesquelles les pays répartissent leurs revenus .
Cependant, les écarts résiduels qui subsistent traduisent certainement les effets, voulus ou non, de choix, politiques, concernant l'extension de l'intervention publique puisque ce sont généralement les pays dans lesquels celle-ci est plus importante qui consacrent aux fonctions dans lesquelles elle se déploie les ressources les plus élevées.
Il est raisonnable d'imaginer que dans les économies où l'intervention publique est plus limitée, certains agents sont incapables d'accéder aux biens et services qu'elle procure ailleurs, en raison de la contrainte financière qu'ils subissent.
Ainsi, l'excédent de dépenses publiques dans certains pays pourrait être attribué au coût de la redistributivité ce que semble confirmer l'analyse de l'impact des dépenses publiques sur la redistributivité (voir la troisième partie du présent rapport).
DEUXIEME PARTIE - LES DÉPENSES PUBLIQUES CONTRE LA CROISSANCE ET LE POUVOIR D'ACHAT ?
On avance parfois qu'un haut niveau de dépenses publiques pourrait influencer négativement l'épargne et réduire ainsi les ressources disponibles pour financer l'investissement. Ce déficit d'investissement engendrerait, à son tour, un déficit structurel de croissance.
De la même manière, un certain nombre de travaux veulent mettre en évidence une relation favorable entre réduction des dépenses publiques et croissance économique.
Ainsi, deux thèses cumulatives voudraient que les dépenses publiques soient systématiquement défavorables à la croissance et que leur diminution lui soit un adjuvant .
Enfin, quelques voix s'élèvent parfois pour affirmer que les dépenses publiques seraient un ennemi du pouvoir d'achat.
L'ensemble de ces points de vue s'appuie sur des approches théoriques qui ne semblent pas trouver de confirmation générale dans les faits. Plus préoccupant encore, ils conduisent à négliger certains aspects essentiels du débat qui méritent de susciter des choix d'intervention collective :
- l'efficacité économique est-elle en conflit avec les objectifs redistributifs auxquels peuvent concourir les dépenses publiques ?
- les dépenses publiques sont-elles efficacement au service de ces objectifs de redistribution, question abordée dans la deuxième partie du présent rapport ?
- est-il possible d'optimiser les performances économiques de la dépense publique ?
CHAPITRE I - LA BAISSE DES DÉPENSES PUBLIQUES, SOURCE D'ACCÉLÉRATION À COURT TERME DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ?
Les dépenses publiques constituent l' une des composantes des politiques budgétaires . Elles représentent un instrument de la stabilisation macroéconomique , qui est l'une des fonctions de l'État.
Le maniement des dépenses publiques prétend à une efficacité instrumentale, qui, toutefois, est remise en cause .
Cette contestation va jusqu'à recommander des politiques, qu'on peut qualifier d'antikeynésiennes. Elles prônent la réduction des dépenses publiques à des fins de relance de l'activité économique à court terme ou affirment que la diminution des dépenses publiques, loin d'exercer un impact défavorable sur la croissance économique, est susceptible d'augmenter le rythme de la croissance.
La contestation de l'efficacité d'une hausse des dépenses publiques comme instrument de relance de l'activité s'accompagne donc de recommandations au terme desquelles il faudrait, au contraire, réduire les dépenses publiques pour dynamiser durablement la croissance économique .
Dans une telle optique, une politique budgétaire théoriquement expansionniste aurait en fait des effets dépressifs sur le niveau de production et une politique budgétaire restrictive des effets expansionnistes structurellement mais aussi à court terme.
C'est cette relation de court terme qui est ici envisagée, le débat sur les effets plus structurels des dépenses publiques étant présenté dans la suite du présent chapitre.
Les approches théoriques associant diminution des dépenses publiques et accélération de la croissance ne semblent trouver que de rares confirmations empiriques.
I. LES DÉPENSES PUBLIQUES AU SERVICE DE LA STABILISATION CONJONCTURELLE, UNE REMISE EN CAUSE RADICALE...
A. LA CAPACITÉ STABILISATRICE DES DÉPENSES PUBLIQUES...
L'utilisation des dépenses publiques en vue d'une
stabilisation conjoncturelle se rattache aux théories
keynésiennes. Elles ont mis l'accent sur l'éventualité
d'épisodes de déséquilibres
52
(
*
)
économiques entre
l'offre et la demande, épisodes créateurs soit de déficit
de croissance et de chômage
- quand la demande se contracte en
deçà de l'offre disponible -, soit d'inflation - lorsque la
demande excède les capacités d'offre.
Les dépenses publiques étant, à côté de la consommation et de l'investissement des agents privés un élément de la demande globale , l'État, qui peut fixer leur montant, doit les augmenter quand la demande est insuffisante ou les réduire quand elle est excessive, cette dernière recommandation étant souvent passée sous silence par les critiques adressées aux théories keynésiennes.
En outre, ces approches font valoir qu'une augmentation des dépenses publiques, même si elle est financée par une hausse équivalente des impôts 53 ( * ) , donc sans recours à l'endettement, augmente le niveau de la production . Cet enchaînement, qui n'implique pas de dégradation du solde budgétaire, vient des différences d'effets liés à une augmentation des dépenses publiques d'un côté et des impôts de l'autre. La théorie estime que les premiers sont plus forts que les seconds 54 ( * ) .
Les dépenses publiques sont une composante de la demande globale. Celle-ci augmente lorsque les dépenses publiques s'accroissent. Les prélèvements destinés à financer l'augmentation des dépenses publiques réduisent la demande des agents qui les supportent, mais pas à due concurrence, puisqu'une partie des prélèvements concerne des revenus qui auraient été épargnés.
Ainsi, l'augmentation des dépenses publiques relance par elle-même la demande et par ce biais, l'activité économique .
Cette approche a fait l'objet d'une remise en question radicale.
B. ... OBJET D'UNE REMISE EN QUESTION THÉORIQUE RADICALE
Les critiques traditionnelles formulées à l'égard de la capacité des dépenses publiques à contrecarrer un ralentissement conjoncturel se sont trouvées amplifiées avec la formulation de la thèse inverse , selon laquelle une politique budgétaire restrictive aurait des effets économiques favorables .
Les effets positifs d'une politique budgétaire comportant une réduction des dépenses publiques passeraient par quatre canaux de transmission :
1) La baisse des dépenses publiques induirait une anticipation de baisse des impôts qui augmenterait le revenu anticipé des ménages. Les enchaînements suivants seraient à l'oeuvre : les agents consomment en fonction de leur revenu futur anticipé et leurs anticipations sur ce point sont favorablement influencées par les perspectives offertes par le desserrement de la contrainte budgétaire de l'État. Ces perspectives sont d'autant meilleures que la baisse des dépenses publiques est perçue comme permanente (Giavazzi et Pagano, 1990).
2) La baisse attendue des impôts entraînerait une anticipation d'augmentation de la production et du revenu , car les agents anticipent que les effets distorsifs de la fiscalité seront réduits . En raison de ces anticipations, la hausse de la consommation présente serait supérieure à la baisse initiale des dépenses publiques (Perotti, 1999).
3) La réduction de l'emploi public et la baisse anticipée de la taxation du travail entraîneraient une diminution des salaires, donc une hausse des profits des entreprises, ce qui favoriserait l'investissement (Alesina et al. , 2002).
4) La réduction des dépenses publiques créerait une anticipation de baisse durable des taux d'intérêt de court terme qui ferait baisser immédiatement les taux longs, et augmenterait l'investissement . Cette baisse des taux d'intérêt peut être induite par la perspective d'une demande plus faible ou d'une dette publique plus faible.
Pour que ces enchaînements théoriques soient à l'oeuvre , plusieurs hypothèses doivent être vérifiées .
Première hypothèse : la politique budgétaire n'a pas d'effet favorable à court/moyen terme. Le raisonnement se fait dans un cadre classique : la production est contrainte par l'offre et non par la demande .
Deuxième hypothèse : les agents anticipent la production future selon un schéma néoclassique où la production dépend négativement des impôts du fait de leur impact sur les conditions de l'offre (augmentation du prix des facteurs), au lieu de dépendre positivement des dépenses publiques.
Troisième hypothèse : les effets d'anticipation sont plus importants que les effets de liquidité . Une augmentation des dépenses publiques induit bien une hausse de la consommation des ménages contraints financièrement mais elle provoque aussi une baisse de celle des ménages non contraints. En effet, ceux-ci anticipent une hausse future des impôts lorsque les dépenses publiques augmentent et y associent une baisse de la production.
Quatrième hypothèse : les agents anticipent que la politique budgétaire future ne profitera pas des effets d'une hausse du PIB consécutive à une relance par la politique budgétaire actuelle. Autrement dit, la politique budgétaire ne crée pas des conditions économiques de son autofinancement.
Cinquième hypothèse : ainsi, la hausse constatée du déficit public provoque nécessairement une hausse de la pression fiscale dans les périodes futures pour cette dernière raison.
Sixième hypothèse : compte tenu du fait qu'elle rend nécessaire une hausse des impôts, la hausse des dépenses publiques réduit à terme la production potentielle .
II. ... À LA VÉRIFICATION EMPIRIQUE IMPOSSIBLE
La vérification empirique des nombreux présupposés nécessaires à la théorie des effets de relance des politiques budgétaires restrictives ne peut être apportée :
- rares sont les occurrences où de tels enchaînements se sont produits dans la réalité ;
- et les travaux disponibles ne permettent pas, le plus souvent, d'identifier avec certitude les forces à l'oeuvre lorsque les restrictions budgétaires ont été accompagnées d'une relance de l'activité économique.
En effet, l'existence d'épisodes où, malgré des réductions des dépenses publiques, la croissance économique s'est accélérée (ou du moins a résisté) ne suffit pas à démonter qu'il existe un lien de causalité entre ces deux phénomènes. Dans la plupart des cas, une variable tierce explique la corrélation .
A. DES ESTIMATIONS ÉCONOMÉTRIQUES PEU CONCLUANTES
Plusieurs études économétriques ont été consacrées à des cas de consolidation budgétaire afin d'identifier d'éventuels effets anti-keynésiens d'accélération de la croissance économique.
- Hjelm (2002) a analysé les impacts des contractions (expansions) budgétaires sur la consommation privée . L'auteur estime une fonction de consommation basée sur un panel de 19 pays de l'OCDE (1970-1977). Hjelm trouve que les contractions budgétaires génèrent des anticipations défavorables sur l'évolution du revenu futur, tandis que des expansions n'ont aucun effet restrictif sur la consommation (et parfois un effet positif). Toutes choses égales par ailleurs, la croissance de la consommation est plus faible dans les périodes de contractions budgétaires. Hjelm estime pourtant que la part des consommateurs contraints financièrement est très basse : entre 10 et 14 %, ce qui devrait induire des effets non keynésiens. Mais, selon ses résultats économétriques, les ménages non contraints financièrement n'anticipent pas la contrainte budgétaire de l'État, si bien qu'ils n'escomptent pas de baisses futures de prélèvements.
Enfin, l'auteur estime que les mouvements de taux de change jouent un rôle important dans les anticipations des consommateurs ce qui expliquerait les épisodes danois et irlandais souvent cités comme des exemples de consolidations budgétaires expansionnistes.
- Plus généralement, les modèles macroéconométriques ne comportent pas de relation de court terme anti-keynésienne , même lorsqu'ils comportent des paramètres susceptibles d'affecter l'efficacité des effets de relance des dépenses publiques 55 ( * ) . Mais, les effets d'une augmentation des dépenses publiques sont nuancés, comme le montre le tableau ci-dessous qui récapitule les effets sur la croissance économique à 1 an d'une augmentation des dépenses publiques égale à 1 point de PIB respectivement dans la zone euro et en France.
IMPACT LA PREMIÈRE ANNÉE D'UNE HAUSSE DE
1 %
DU PIB DE LA CONSOMMATION PUBLIQUE DURANT 1 AN
1
- (EN
POINTS DE PIB)
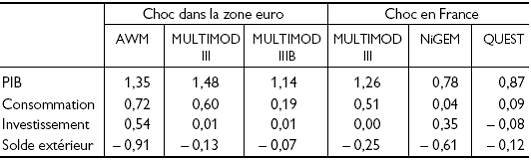
1 AWM est un modèle élaboré à la Banque centrale européenne ; MULTIMOD est le modèle macroéconométrique du Fonds monétaire international ; NIGEM a été développé par le National Institute of Economic and Social Research (NIESR) et QUEST est le modèle de la Commission européenne.
Source : Wallis (2004)
Dans tous les cas, à une augmentation des dépenses publiques correspond une augmentation de la production. Mais celle-ci est plus ou moins importante selon, d'abord, qu'elle intervient dans un ensemble économique ou pour un seul pays (ici la France) de cet ensemble et ensuite, selon le modèle employé.
L'effet d'une augmentation des dépenses publiques dans l'ensemble de la zone euro est plus favorable à la croissance que lorsque seule la France est concernée . Ce résultat est conforme à la théorie puisque, lorsqu'un seul pays est concerné, la relance par les dépenses publiques 56 ( * ) est en partie absorbée par ses partenaires commerciaux via une hausse induite des importations qui réduit leur effet sur la production nationale.
En outre, les modèles comportent des évaluations assez différentes du multiplicateur des dépenses publiques sur le PIB .
Pour la France, les estimations vont d'un multiplicateur inférieur à l'unité (NIGEM et QUEST) à un multiplicateur de 1,26. Lorsque le multiplicateur est inférieur à l'unité (mais positif), cela signifie que le PIB est augmenté d'une valeur inférieure à celle du supplément de dépenses publiques. Ainsi, avec le multiplicateur de QUEST (modèle de la Commission européenne) qui atteint 0,87, on associe à un supplément de dépenses publiques de 1 point de PIB une augmentation du PIB de 0,87 point de PIB seulement.
Dans les modèles où l'impact des dépenses publiques sur la croissance économique est inférieur à leur montant, les effets directs des dépenses publiques sur la production sont réduits un peu (QUEST) ou beaucoup (NIGEM) par la dégradation du commerce extérieur et ils ne sont pas amplifiés par les effets indirects liés à une relance de la consommation ou de l'investissement 57 ( * ) .
|
PROPRIÉTÉS DE QUELQUES MODÈLES ET
EFFETS
Dans les modèles sous revue, la relative rigidité de la demande domestique face à l'augmentation des dépenses publiques s'explique par les spécifications des équations de consommation. Dans ces modèles, un choc de revenu résultant d'une hausse des dépenses publiques est considéré comme transitoire . Comme les ménages consomment en fonction de leur « revenu permanent », c'est-à-dire de l'idée qu'ils se font de leur revenu structurel et de son évolution, des chocs transitoires de revenu n'ont aucun effet sur leur consommation. Seule leur épargne en est affectée, à la hausse. Les effets à long terme d'une augmentation des dépenses tels que les décrivent les modèles macroéconométriques sont encore moins favorables . A terme de cinq ans , les effets sont souvent, au mieux, nuls 58 ( * ) . |
|
EFFET À LONG TERME SUR LE PIB,
Source : Hemming, Kell et Mahfouz (2002) Et, dans plusieurs modèles et à plus long terme (10 ans), les résultats sont encore moins favorables : le niveau du PIB est inférieur à ce qu'il aurait été sans relance par les dépenses publiques . A contrario , la baisse des dépenses publiques n'a pas les effets récessifs attendus. Ainsi, dans le modèle QUEST de la Commission européenne, une baisse permanente des dépenses publiques de 1 point de PIB, qui, à court terme, provoque des effets dépressifs, est presque neutre à l'horizon de 5 ans. Elle devient favorable à la croissance au-delà, se traduisant par un supplément de production entre 0,19 point de PIB si elle prend la forme d'une réduction de transferts aux ménages, 0,41 point de PIB en cas de réduction des achats publics et 0,62 point de PIB lorsque la diminution des dépenses publiques provient d'une baisse des emplois publics.
EFFET D'UNE BAISSE PERMANENTE DES DÉPENSES
PUBLIQUES DE 1 % DU PIB
* Impact d'un choc temporaire d'une année.
|
Toutefois, d'autres modèles macroéconomiques , qui ne comportent pas les mêmes restrictions, donnent des estimations plus conformes aux conclusions théoriques keynésiennes .
HAUSSE PERMANENTE DE 1 POINT DE PIB DE LA CONSOMMATION
PUBLIQUE
DANS LES SERVICES DANS LE MODÈLE E-MOD
(Ecart en % au compte central)
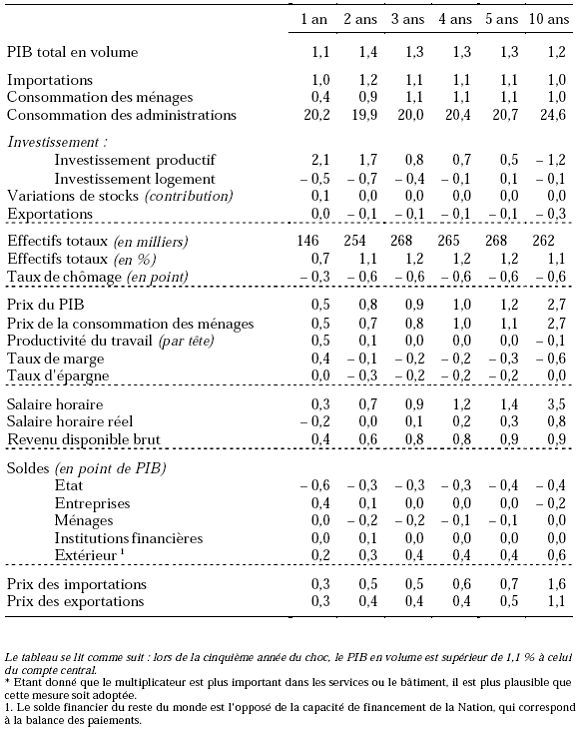
Source : OFCE
Ainsi, dans le modèle e-mod de l'OFCE, une augmentation permanente de 1 point de PIB du niveau de la consommation publique augmente la production d'un montant supérieur au choc des dépenses. Elle exerce un effet positif sur la consommation et l'investissement que la dégradation du commerce extérieur limite sans l'effacer.
Toute la question est alors de savoir quelles sont les spécifications des modèles les plus pertinentes.
Les travaux économétriques précités invitent à considérer avec une certaine précaution les équations de consommation qui neutralisent l'efficacité de la politique budgétaire en se fondant sur la perception par les ménages d'une future restriction budgétaire. Cette anticipation semble incertaine, d'autant qu'il est possible de montrer que, dans sa généralité, elle est erronée.
Les constatations empiriques vont dans le même sens.
B. DES ANALYSES STATISTIQUES AMBIGUËS
Un grand nombre d'études statistiques ont été consacrées aux politiques d'ajustement budgétaire.
Ces études, qui analysent les effets réels ex post des ajustements budgétaires, portent sur des épisodes de fort ajustement budgétaire (généralement mesurés par la variation d'un indicateur du type solde public primaire corrigé des variations cycliques ) 59 ( * ) et essaient de caractériser ceux ayant permis une baisse durable du ratio dette publique/PIB ou du déficit public.
Alesina et Perotti (1995) trouvent ainsi 68 épisodes de forts ajustements budgétaires, dont 14 sont considérés comme réussis (l'encadré ci-après donne la définition des épisodes réussis dans les différentes études).
|
LES CONSOLIDATIONS BUDGÉTAIRES
EXPANSIONNISTES :
Consolidation budgétaire Alesina et Perotti (1995) : « une consolidation budgétaire importante est supposée être intervenue une année donnée si le solde primaire corrigé des variations cycliques s'améliore de plus de 1,5 % du PIB ». Cour et al. (1996) : « une restriction de grande ampleur est une période d'amélioration continue du solde structurel primaire, incluant une sous-période d'au moins 2 points de PIB ou une période de deux années consécutives où il s'est amélioré d'au moins 1,5 point de PIB chaque année ». Alesina et Ardagna (1998) : « une période de consolidation budgétaire est une année où le solde primaire corrigé des variations cycliques s'améliore d'au moins 2 points de PIB ou une période de deux années consécutives où il s'est amélioré d'au moins 1,5 point du PIB chaque année ». OCDE (1996) : « un effort d'assainissement budgétaire est jugé important s'il se traduit par une amélioration du solde financier structurel d'au moins 3 points de PIB, réalisée sans interruption pendant plusieurs années consécutives ». Consolidation budgétaire expansionniste Cour et al. (1996) : « une période de resserrement budgétaire est expansionniste si le taux de croissance moyen du PIB en écart à celui du G7, corrigé de l'écart entre les taux de croissance potentielle, est positif sur l'ensemble de la période de consolidation ». Alesina et Ardagna (1998) : « une période de resserrement budgétaire est expansionniste si le taux de croissance moyen du PIB, en écart à celui du G7, dans la période de resserrement et les 2 années qui suivent est supérieure à la valeur moyenne de cette variable sur l'ensemble des épisodes de resserrement budgétaire ». Consolidation budgétaire réussie Alesina et Perotti (1995) : « une consolidation budgétaire est réussie une année donnée si, trois ans plus tard, le ratio dette brute/PIB a baissé d'au moins 5 points ». Alesina et Ardagna (1998) : « une période de resserrement budgétaire est réussie si (1) durant les 3 années qui suivent, le ratio solde primaire corrigé des variations cycliques/PIB est en moyenne au moins 2 points au-dessus de sa valeur l'année du resserrement, ou (2) si 3 ans après le resserrement, le ratio dette/PIB est 5 points en dessous de sa valeur de l'année du resserrement ». Alesina et al. (2002) : un épisode est expansionniste si « la croissance moyenne du PIB de l'année de l'ajustement budgétaire et des deux années suivantes est supérieure à celle des deux années précédentes ». |
Les consolidations budgétaires importantes sont généralement entreprises en période de forte croissance et se caractérisent par des effets keynésiens : elles entraînent une hausse du chômage l'année considérée et un ralentissement de la croissance les deux années suivantes.
La politique monétaire s'assouplit dans presque la moitié des épisodes considérés par l'OCDE (1996), une désinflation intervient dans trois quarts des cas, l'épargne nationale augmente et le solde de la balance courante s'améliore généralement, ce qui atténue l'effet dépressif des contractions budgétaires.
En ne considérant que les ajustements budgétaires réussis , ils se caractérisent par une diminution durable du ratio dette publique/PIB et, en moyenne, par une évolution inattendue de certains indicateurs macroéconomiques : accélération de la croissance, baisse du chômage, hausse de la part de l'investissement dans le PIB, baisse du coût unitaire du travail relativement aux autres pays (Alesina et Perotti, 1995, McDermott et Wescott, 1996, Alesina et al. 1998).
Les effets anti-keynésiens de la politique budgétaire sont alors évoqués pour expliquer la concomitance d'une politique de consolidation budgétaire et d'une amélioration de l'activité économique .
1. Le nombre de contractions budgétaires expansionnistes est relativement faible
LES ÉPISODES DE CONSOLIDATIONS BUDGÉTAIRES EXPANSIONNISTES
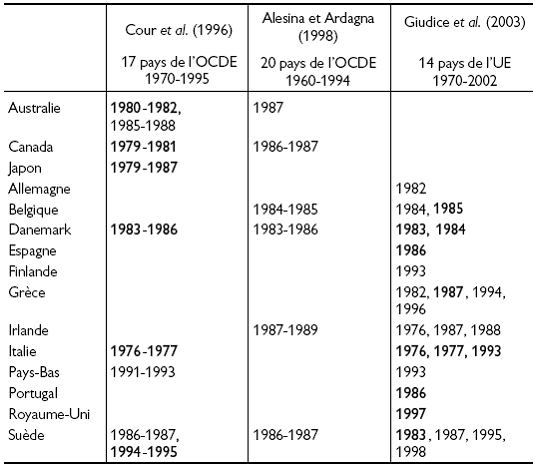
Sources : Alesina et Ardagna (1998), Cour et al. (1996), Giudice et al. (2003)
- Cour et al. (1996) trouvent 19 restrictions budgétaires de grande ampleur, dont 9 sont accompagnées d'une croissance significative du PIB du pays considéré 60 ( * ) .
- Alesina et Ardagna (1998) recensent 51 cas de forte consolidation budgétaire, dont 23 sont expansionnistes qui, en excluant des cas spécifiques et en groupant les périodes consécutives de consolidation, représentent 7 épisodes de consolidations budgétaires expansionnistes .
- Pour l'UE-14, Giudice et al. (2003) trouvent que sur 49 épisodes de consolidation , 24 sont expansionnistes . Ils définissent aussi des cas purs , pour lesquels l'expansion de l'activité n'est pas favorisée par une baisse des taux d'intérêt réels entre l'année précédant l'ajustement et celle le suivant. Giudice et al. retiennent 11 cas purs . 6 des 9 cas relevés par Cour et al. (1996) ne sont pas accompagnés d'un assouplissement des conditions monétaires et peuvent donc être considérés comme des cas purs (en gras dans le tableau).
Ainsi, le nombre d'épisodes de contractions budgétaires relevés par les différentes études est faible, comparé aux possibilités d'occurrence appréciées en multipliant le nombre de pays observés par le nombre des années d'observation.
Surtout, la proportion de ces épisodes qui furent expansionnistes est modeste et, plus encore, lorsqu'on s'intéresse à des cas où les conditions monétaires sont restées inchangées .
La conclusion principale à tirer de ces études est l'inverse de celles qu'elles entendent pourtant étayer : les contractions budgétaires sont majoritairement restrictives .
2. Pas de consensus sur les canaux de transmission
Il n'existe pas de consensus sur les canaux de transmission qui favorisent la croissance dans les épisodes de contraction budgétaire.
- Les études statistiques identifient rarement quels ont été les canaux de transmission des effets anti-keynésiens .
Cour et al. (1996) trouvent que l'effet de la consolidation budgétaire sur la consommation des ménages est plus grand que celui sur l'investissement dans 6 cas sur 9 l'année de la consolidation. Au contraire , Alesina et Ardagna (1998) comme Giudice et al. (2003) notent que, pendant ces épisodes, la consommation et l'investissement augmentent, mais que ce dernier croît bien davantage en moyenne pendant et après l'année de la contraction budgétaire. Alesina et Ardagna (1998) trouvent que les consolidations expansionnistes sont caractérisées par une élévation des profits, de l'investissement et de la croissance, par une baisse des salaires et par un taux d'intérêt réel à long terme plus faible que dans la moyenne des pays du G7.
- Les études ne s'accordent donc pas sur les canaux de transmission à la croissance économique des contractions budgétaires . Les dernières citées évoquent une relation du côté de l'offre, les premières du côté de la demande avec, tantôt, un impact prioritaire sur la consommation, tantôt, un effet de premier rang sur l'investissement.
Cette controverse sur les canaux de transmission est bien plus qu'un problème non résolu. C'est le témoignage de contradictions puisque les explications avancées ne sont pas cohérentes les unes avec les autres.
3. Un consensus sur les caractéristiques des ajustements expansionnistes très relatif...
Même si les interprétations sur les canaux de transmission des politiques de contraction budgétaire sont contradictoires, les études s'efforcent de dégager les caractéristiques favorisant les enchaînements expansionnistes des consolidations budgétaires.
Elles concernent la taille de l'ajustement, sa composition et la situation initiale des finances publiques.
Mais, sur ce point, c'est également la controverse qui l'emporte , même si, dans l'ensemble, les contractions budgétaires « expansionnistes » passent plutôt par une réduction des dépenses publiques que par une augmentation des impôts.
- Selon Alesina et Perotti ( 1995 ), les ajustements qui réussissent sont ceux qui comportent une forte baisse des transferts aux ménages et des salaires publics . Ceux qui échouent sont ceux qui reposent sur la hausse des impôts ou la baisse de l'investissement . Les premiers seraient plus facilement jugés irréversibles, amenant à anticiper une baisse des effets désincitatifs tandis que les seconds, temporaires, conduiraient à attendre plus d'effets désincitatifs et moins d'effets d'entraînement.
Toutefois, la question de l'utilité des transferts ou des emplois publics n'est pas posée et les auteurs ne discutent pas de la situation macroéconomique des pays au moment où ils entreprennent la contraction budgétaire .
- Alesina et Ardagna ( 1998 ) estiment la probabilité d'observer des effets expansionnistes des consolidations budgétaires selon la taille de l'ajustement et sa composition . Seule la composition importerait : cette probabilité serait plus forte quand les gouvernements réduisent les dépenses publiques, les transferts et les salaires publics , plus faible quand les gouvernements augmentent les impôts et réduisent l'investissement public.
- Giudice et al. ( 2003 ) parviennent aux mêmes conclusions et notent que les consolidations budgétaires expansionnistes commencent pendant des périodes où la croissance économique est inférieure à son potentiel . Ils concluent, en outre, à un fort effet des réductions de dépenses primaires 61 ( * ) sur la probabilité d'obtenir des effets expansionnistes des consolidations budgétaires , alors que le niveau initial de la dette publique n'aurait aucun effet .
- Au contraire, selon McDermott et Wescott ( 1996 ), la probabilité de succès est plus forte pour les ajustements survenus en période de forte croissance mondiale et pour ceux qui comportent des baisses de dépenses , en particulier des salaires, des dépenses publiques courantes ou des transferts. Les succès observés concernent essentiellement les petites économies (Irlande, Danemark, Norvège, Australie et Suède).
Au total, l'ensemble des études concluent que c'est la baisse des dépenses publiques qui peut avoir des effets favorables à l'activité économique dans les épisodes de restriction budgétaire .
Seul un tel processus serait perçu comme durablement favorable aux anticipations de revenu de long terme des agents privés, perception qui est le levier des effets économiques favorables de la contraction budgétaire. C'est cette interprétation qui conduit à recommander d'agir sur les dépenses publiques de fonctionnement ou de transferts plutôt que sur celles d'investissement public.
Mais, la caractérisation de la situation économique prévalant au moment où la politique est entreprise ne permet pas de préciser le choix du bon moment.
Ces conclusions appellent donc quelques observations .
4. ... qui ne résout pas tout
Hormis la conclusion relative à la composition des contractions budgétaires expansionnistes - la réduction des dépenses publiques plutôt que l'augmentation des recettes -, il n'y a pas de consensus sur les caractéristiques qui président à ces épisodes .
- Les conditions macroéconomiques des contractions budgétaires expansionnistes ne sont pas toujours suffisamment précisées .
Or, a priori , la nature des effets d'une variation des dépenses publiques sur la croissance à court terme dépend étroitement de la situation économique. Dans un équilibre économique marqué par une insuffisante demande et du chômage (situation où les recommandations keynésiennes s'appliquent), il est douteux que des contractions budgétaires soient expansionnistes. En revanche, dans un régime classique , d'insuffisance de capacités d'offre, que les contractions budgétaires puissent avoir des effets stabilisateurs n'est pas contesté par la théorie keynésienne.
En outre, un élément important doit être ajouté. La sensibilité de la croissance économique du pays concerné à son commerce extérieur doit être prise en compte . Par exemple, Lane et Perotti (2003) montrent qu'une politique budgétaire restrictive a d'autant plus de chance d'être expansionniste qu'elle s'accompagne de gains de compétitivité , soit par une dépréciation du taux de change, soit en induisant une baisse des salaires. Ce constat explique sans doute beaucoup pourquoi les petits pays très ouverts semblent, plus que les autres, présenter des situations de contractions budgétaires expansionnistes.
- Les études statistiques sont souvent des études en panel, où des chocs spécifiques favorables à la croissance (dépréciation du taux de change, assouplissement de la politique monétaire, effets de la libéralisation financière) ne sont pas pris en compte .
Selon Alesina et al. (1998), la réaction monétaire (dépréciation du taux de change ou assouplissement de la politique monétaire) ne contribue pas à expliquer les raisons du succès apparent des épisodes de consolidation budgétaire. Mais cet effet est pris explicitement en compte par Giudice et al. (2003), ce qui les amène à réduire nettement le nombre de consolidations budgétaires expansionnistes pures.
III. DE QUELQUES SITUATIONS CONCRÈTES
- L'idée que des politiques budgétaires pouvaient être assorties d'effets non keynésiens a, pour la première fois, été suggérée par Giavazzi et Pagano en 1990 au sujet des épisodes danois et irlandais survenus, le premier en 1983-1984, le second en 1987-1989. L'étude de la politique budgétaire suédoise de 1990-1994 a ajouté à cet argumentaire.
|
LES CAS DANOIS, IRLANDAIS ET SUÉDOIS Les épisodes de consolidations budgétaires expansionnistes les plus souvent cités sont le Danemark (en 1983-1984) et l' Irlande (1987-1989) ( Giavazzi et Pagano, 1990 ) tandis que la Suède (1990-1994) serait l'exemple type d'expansion budgétaire non keynésienne ( Giavazzi et Pagano, 1996 ), c'est-à-dire inefficace. - A la suite d'une forte détérioration des finances publiques, des politiques budgétaires restrictives ont été mises en place au Danemark et en Irlande . En même temps, la consommation et l'investissement privés ont fortement accéléré. Giavazzi et Pagano (1990) soulignent l'importance des ajustements de taux de change , de la politique monétaire et des effets de richesse mais considèrent que ces facteurs n'expliquent que partiellement le phénomène . A partir des estimations de fonctions de consommation pour chacun de ces deux pays, ils constatent que la consommation est significativement sous-estimée lors des resserrements budgétaires. Autrement dit, les consolidations budgétaires auraient modifié par elles-mêmes la dynamique de la consommation en l'augmentant. Ils expliquent cette situation par l' élévation du revenu permanent des consommateurs et par l'investissement privé qui aurait été un facteur déterminant de l'accélération de croissance. Cependant, ils ne trouvent aucune corrélation significative entre les erreurs d'estimation de leurs équations et les variations des dépenses publiques. En sens inverse, selon Creel (1998), le comportement de consommation au Danemark a de fortes caractéristiques keynésiennes, une fois la libéralisation financière prise en compte. Selon Bradley et Whelan (1997), la forte croissance en Irlande ne peut être expliquée par des mécanismes anti-keynésiens, mais plutôt par une forte croissance des exportations consécutive à l'accélération de la croissance mondiale entre 1987 et 1989 . - Dans le cas suédois , Giavazzi et Pagano (1996) identifient la période 1990-1994 comme exemple d'une expansion budgétaire ayant eu un effet de contraction sur l'activité globale . Cette période se restreint cependant à 1990-1993, la croissance étant vigoureuse en 1994. Le cas suédois se caractérise par une forte augmentation du déficit public à la suite de réductions d'impôt, accompagnée d'une chute de la consommation privée. Cependant, des spécificités extra-budgétaires semblent pouvoir expliquer le profil de la croissance en Suède . Les consommateurs suédois ont augmenté leur épargne en période de hausse du chômage. La chute des prix de l'immobilier a aussi pu contribuer à la faiblesse de la consommation. Par ailleurs l'épisode budgétaire concerné présentait lui aussi des particularités. La réforme fiscale n'a contribué que pour 1 point de PIB au creusement du déficit. La crise financière a augmenté l'incertitude sur les perspectives économiques et poussé les ménages à constituer une épargne de précaution ; les entreprises à retarder leurs investissements. Elle a surtout privé les ménages de financement, ce qui fut une des causes du ralentissement. |
- Le Royaume-Uni est également parfois mentionné comme fournissant l'exemple d'une contraction budgétaire suivie d'une accélération de la croissance. Mais, des facteurs exceptionnels non pris en compte dans les indicateurs de politique budgétaire peuvent expliquer cette situation.
|
L'EXEMPLE DU ROYAUME-UNI EN 1997 En 1997 , une politique budgétaire restrictive a été mise en place en période de croissance rapide alors que le taux de chômage était de 8 %. Par ailleurs, les taux d'intérêt ont été graduellement augmentés par la Banque d'Angleterre en 1997 (de 5,75 % en septembre 1996 à 7,5 % en janvier 1998). Cependant, les taux d'intérêt nominaux de long terme ont légèrement diminué, si bien qu'en moyenne les taux d'intérêt réels de court et de long terme n'ont que légèrement augmenté. Dans le même temps, le taux de change effectif réel de la livre s'est fortement apprécié. Les conditions monétaires ont donc été resserrées, permettant de considérer cette consolidation comme pure . Le resserrement de la politique budgétaire s'est traduit, entre 1996 et 1998, par une amélioration annuelle de 1,1 point de PIB du solde structurel, sans décélération de la croissance. C'est la consommation des ménages qui a constitué le principal moteur de la demande en 1997. Cependant, celle-ci a été impulsée par un facteur exceptionnel au début de 1997 : le versement de revenus exceptionnels suite au changement de statut des building societies et à la démutualisation des compagnies d'assurance-vie (36 milliards de livres, soit 6,5 % du revenu net annuel des ménages). |
- Plusieurs pays ont connu au cours de ces dernières années une réduction marquée de leurs dépenses publiques exprimées en points de PIB, dont une partie peut être attribuée à des mesures structurelles (l'autre, venant d'une croissance économique supérieure à son rythme potentiel pouvant être considérée comme conjoncturelle).
Généralement, il s'est agi de pays où le niveau initial des dépenses publiques était particulièrement élevé, excepté l'Irlande et le Canada.
La diminution des dépenses publiques a suivi des cheminements différenciés :
- à petits pas , en Autriche et, à un moindre degré, au Danemark et au Canada ;
- à grandes marches dans les autres pays, avec toutefois des ressauts parfois importants comme en Norvège notamment.
SÉQUENCES DE BAISSE DES DÉPENSES
PUBLIQUES DANS LES PAYS OÙ LE RATIO DÉPENSES PUBLIQUES/PIB A
ÉTÉ RÉDUIT DE PLUS DE 6 POINTS
ENTRE 1995 ET
2005
DÉPENSES PUBLIQUES
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2005 |
2005/1995 |
|
|
Autriche |
56,0 |
- 0,5 |
- 2,5 |
+ 0,4 |
- 0,2 |
- 0,8 |
- 0,6 |
- 0,1 |
+ 0,3 |
- 0,9 |
- 0,5 |
49,6 |
- 6,4 |
|
Canada |
48,5 |
- 1,9 |
- 2,3 |
+ 0,5 |
- 2,1 |
- 1,6 |
+ 0,9 |
- 0,7 |
- 0,4 |
- 1,0 |
- 0,6 |
39,9 |
- 8,6 |
|
Danemark |
59,5 |
+ 0,4 |
- 2,0 |
- 0,3 |
- 3,0 |
- 1,9 |
+ 0,6 |
+ 0,4 |
0 |
- 0,1 |
- 1,8 |
53,0 |
- 6,5 |
|
Finlande |
59,0 |
+ 0,3 |
- 3,3 |
- 3,6 |
- 0,6 |
- 3,0 |
0 |
+ 1,0 |
+ 1,1 |
+ 0,3 |
- 0,4 |
50,8 |
- 8,2 |
|
Irlande |
41,4 |
- 2,1 |
- 2,5 |
- 2,2 |
- 0,3 |
- 2,5 |
+ 1,6 |
+ 0,2 |
0 |
- 0,3 |
+ 0,9 |
34,0 |
- 7,4 |
|
Norvège |
51,5 |
- 2,5 |
- 1,8 |
+ 2,4 |
- 1,5 |
- 5,4 |
+ 1,6 |
+ 3,2 |
+ 1,0 |
- 2,6 |
- 3,0 |
42,9 |
- 8,6 |
|
Suède |
67,1 |
- 2,3 |
- 2,3 |
- 2,2 |
- 0,5 |
- 3,0 |
- 0,3 |
+ 1,4 |
+ 0,3 |
- 1,5 |
- 0,3 |
56,4 |
- 10,7 |
Note de lecture : à partir d'un niveau de dépenses publiques de 56 points de PIB en 1995, l'Autriche a rejoint un niveau de 49,6 points de PIB, soit - 6,4 points de PIB du ratio dépenses publiques sur PIB, en réduisant celui-ci de 0,5 point de PIB en 1996, 2,5 points de PIB en 1997, etc.
Source : OCDE. Calculs de l'auteur.
On relève que l'essentiel du processus de réduction des dépenses publiques dans le PIB intervient à la fin des années 90 , phase de très forte croissance économique (v. ci-après).
- La réduction des dépenses publiques s'est accompagnée d'une très nette augmentation des capacités de financement des administrations publiques .
A partir de déficits publics souvent élevés, les pays concernés sont généralement passés à des capacités de financement importantes, l'Autriche exceptée.
ÉVOLUTION DU SOLDE FINANCIER PUBLIC DES PAYS
OÙ LE RATIO DÉPENSES PUBLIQUES/PIB A ÉTÉ
RÉDUIT DE PLUS DE 6 POINTS
ENTRE 1995 ET 2005
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2005 |
2005/1995 |
|
|
Autriche |
- 5,7 |
+ 1,7 |
+ 2,2 |
- 0,6 |
+ 0,1 |
+ 0,7 |
+ 1,5 |
- 0,6 |
- 1,0 |
+ 0,2 |
- 0,4 |
- 1,6 |
+ 4,1 |
|
Canada |
- 5,3 |
+ 2,5 |
+ 3,0 |
- 0,1 |
+ 1,5 |
+1,3 |
- 2,2 |
- 0,8 |
+ 1,0 |
+ 0,7 |
+ 1,0 |
+ 1,7 |
+ 7,0 |
|
Danemark |
- 2,9 |
+ 1,0 |
+ 1,4 |
+ 0,5 |
+ 1,4 |
+ 0,9 |
- 1,1 |
- 1,0 |
- 0,3 |
+ 1,8 |
+ 2,3 |
+ 4,0 |
+ 6,9 |
|
Finlande |
- 3,8 |
+ 1,1 |
+ 1,7 |
+ 2,8 |
+ 0,6 |
+ 4,9 |
- 1,9 |
- 1,0 |
- 1,9 |
- 0,4 |
+ 0,5 |
+ 2,4 |
+ 6,2 |
|
Irlande |
- 2,1 |
+ 2,0 |
+ 1,6 |
+ 0,8 |
+ 0,1 |
+ 2,0 |
- 3,6 |
- 1,2 |
+ 0,6 |
+ 1,4 |
- 0,6 |
+ 1,0 |
+ 3,1 |
|
Norvège |
3,4 |
+ 3,1 |
+ 1,3 |
- 4,3 |
+ 2,7 |
+ 9,4 |
- 2,0 |
- 4,3 |
- 1,8 |
+ 4,2 |
+ 4,1 |
+ 15,5 |
+ 12,1 |
|
Suède |
- 6,9 |
+ 4,1 |
+ 1,8 |
+ 2,9 |
+ 0,4 |
+ 2,7 |
- 2,4 |
- 3,1 |
+ 0,3 |
+ 1,8 |
+ 1,1 |
+ 2,7 |
+ 9,6 |
Note de lecture : à partir d'un déficit public de 5,7 points de PIB en 1995, l'Autriche est passée à un déficit de 1,6 point de PIB en 2005 (soit une amélioration de sa capacité de financement de 4,1 points de PIB au cours de la période) en augmentant sa capacité de financement de 1,7 point de PIB en 1996 de 2,2 points de PIB en 1997, etc., malgré une réduction de cette capacité de financement de 1 point de PIB en 2003...
Source : OCDE. Calculs de l'auteur.
Toutefois, l'augmentation de la capacité de financement des administrations publiques a été généralement moins nette que celle qu'aurait dû produire la réduction des dépenses publiques .
En Autriche, au Canada, en Finlande, en Irlande et en Suède, la réduction des recettes publiques a pu compenser une partie des effets de la baisse des dépenses publiques sur la capacité de financement des administrations publiques et amortir le choc sur la croissance provoqué par la réduction des dépenses publiques. Cependant, au Danemark et en Norvège, les deux composantes de l'intervention publique sont allées dans le même sens.
ÉVOLUTION DES RECETTES PUBLIQUES DANS LES PAYS
OÙ LE RATIO DÉPENSES PUBLIQUES/PIB A ÉTÉ
RÉDUIT DE PLUS DE 6 POINTS
ENTRE 1995 ET 2005
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2005 |
2005/1995 |
|
|
Autriche |
50,3 |
+ 1,1 |
- 0,2 |
- 0,2 |
- 0,1 |
- 1,2 |
+ 1,0 |
- 0,7 |
- 0,7 |
- 0,5 |
- 0,9 |
47,9 |
- 2,4 |
|
Canada |
43,2 |
+ 0,6 |
+ 0,7 |
+ 0,5 |
- 0,6 |
+ 0,8 |
- 1,5 |
- 1,4 |
- 0,3 |
- 0,3 |
+ 0,4 |
41,0 |
- 2,2 |
|
Danemark |
56,7 |
+ 0,5 |
- 0,6 |
+ 0,2 |
+ 0,4 |
- 1,0 |
- 0,5 |
- 0,6 |
- 0,3 |
+ 1,7 |
+ 0,4 |
56,9 |
+ 0,2 |
|
Finlande |
55,2 |
+ 1,1 |
- 1,6 |
- 0,6 |
- 0,2 |
+ 2,0 |
- 1,9 |
+ 0,1 |
- 0,9 |
- 0,1 |
+ 0,1 |
53,2 |
- 2,0 |
|
Irlande |
39,3 |
- 0,1 |
- 0,9 |
- 1,6 |
- 0,2 |
- 0,5 |
- 2,0 |
- 1,0 |
+ 0,6 |
+ 1,2 |
+ 0,4 |
35,6 |
- 3,7 |
|
Norvège |
54,9 |
+ 0,7 |
- 1,6 |
- 1,9 |
- 1,2 |
+ 3,9 |
- 0,3 |
- 1,1 |
- 0,8 |
+ 0,8 |
+ 1,2 |
58,6 |
+ 3,7 |
|
Suède |
60,2 |
+ 1,9 |
- 0,6 |
+ 0,7 |
- 0,1 |
- 0,3 |
- 1,7 |
- 1,6 |
+ 0,5 |
+ 0,3 |
+ 0,8 |
59,1 |
- 1,1 |
Note de lecture : à partir d'un niveau de recettes publiques de 50,3 points de PIB en 1995, l'Autriche a rejoint un niveau de 47,9 points de PIB en 2005 (2,4 points de PIB de moins) en augmentant ses recettes publiques de 1,1 point de PIB en 1996 puis en les diminuant de 0,2 point en 1997, de 0,2 point de PIB en 1998, etc.
Source : OCDE. Calculs de l'auteur.
- Si on ne relève aucune corrélation nette entre réduction des dépenses publiques et détérioration des performances macroéconomiques, on ne note pas non plus d'amélioration de ces performances .
Le déficit de production du début de période (1995) est généralement plus faible en fin de période avec des améliorations parfois spectaculaires (la Finlande et la Norvège) sans qu'un lien de causalité puisse être établi de la réduction des dépenses publiques vers l'amélioration de la croissance économique. Des variables d'environnement ont pu jouer comme dans d'autres épisodes de baisse des dépenses publiques pour expliquer la résistance de l'économie. Celle-ci, à son tour, a exercé des effets favorables à la réduction des dépenses publiques dont une partie peut être attribuée à des facteurs conjoncturels.
Dans la majorité des pays, un déficit de production demeure en 2005, et les pays qui ont pratiqué une réduction importante des dépenses publiques sont restés sous leur potentiel de croissance au long de la période quand, à l'inverse, tous les pays européens où la politique budgétaire n'aura pas été restrictive auront dépassé leur potentiel au cours de la phase haute du cycle économique de cette période.
*
Au total, sous l'angle la croissance économique, ces pays auront amélioré leur position économique de départ sans pour autant généralement rejoindre leurs pleines capacités productives.
ÉCARTS DE PRODUCTION
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2005/1995 |
|
|
Autriche |
- 0,6 |
+ 0,3 |
- 0,3 |
+ 1,1 |
+ 0,9 |
+ 1,0 |
- 1,8 |
- 1,6 |
- 1,2 |
+ 0,2 |
- 0,2 |
+ 0,4 |
|
Canada |
- 2,2 |
- 1,5 |
+ 1,2 |
+ 0,8 |
+ 2,2 |
+ 2,1 |
- 1,2 |
+ 0,2 |
- 0,9 |
- 0,1 |
- 0,2 |
+ 2,0 |
|
Danemark |
- 0,1 |
+ 0,3 |
+ 0,7 |
- 0,3 |
0 |
0 |
+ 1,2 |
- 1,3 |
- 1,5 |
- 1,1 |
+ 0,1 |
+ 1,14 |
|
Finlande |
- 8,0 |
+ 1,7 |
+ 3,5 |
- 2,0 |
+ 0,6 |
+ 2,2 |
- 2,0 |
- 0,7 |
- 0,2 |
+ 0,9 |
- 0,5 |
+ 7,5 |
|
Irlande |
- 3,7 |
+ 0,5 |
+ 3,2 |
+ 0,5 |
+ 2,7 |
+ 1,6 |
- 0,7 |
- 0,8 |
- 1,3 |
- 0,8 |
- 0,7 |
+ 3,0 |
|
Norvège |
- 1,6 |
+ 1,4 |
+ 1,8 |
+ 1,4 |
+ 0,1 |
- 0,5 |
- 0,5 |
- 1,2 |
- 1,3 |
+ 0,9 |
+ 0,7 |
+ 2,3 |
|
Suède |
- 4,0 |
- 0,3 |
+ 0,9 |
+ 1,5 |
+ 1,9 |
+ 1,7 |
- 1,5 |
- 0,7 |
- 0,8 |
+ 0,6 |
+ 0,4 |
+ 4,4 |
Note de lecture : l'écart de production mesure la différence entre le niveau du PIB effectif et le niveau théorique du PIB qui pourrait être atteint si le plein emploi des facteurs de production était assuré compte tenu des gains de productivité de chaque économie. Lorsque l'écart de production est négatif, cela signifie que l'activité économique est sous son potentiel comme, par exemple, en Autriche, en 1995, où l'activité est inférieure de 0,6 point de PIB à ce qu'elle pourrait être compte tenu des capacités productives du pays.
Source : OCDE. Calculs de l'auteur.
CROISSANCE ÉCONOMIQUE EN VOLUME DANS LES PAYS
OÙ LE RATIO DÉPENSES PUBLIQUES/PIB A ÉTÉ
RÉDUIT DE PLUS DE 6 POINTS
ENTRE 1995 ET 2005
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
Moyenne annuelle 2005/1995 |
|
|
Autriche |
2,2 |
2,5 |
1,9 |
3,6 |
3,4 |
3,5 |
0,8 |
1,1 |
1,2 |
2,6 |
2,0 |
2,2 |
|
Canada |
2,8 |
1,6 |
4,2 |
4,1 |
5,5 |
5,2 |
1,8 |
3,1 |
2,0 |
2,9 |
2,9 |
3,3 |
|
Danemark |
3,1 |
2,8 |
3,2 |
2,2 |
2,6 |
3,5 |
0,7 |
0,5 |
0,7 |
1,9 |
3,1 |
2,2 |
|
Finlande |
3,5 |
3,6 |
6,2 |
4,9 |
3,4 |
5,2 |
1,0 |
2,1 |
2,4 |
3,5 |
2,2 |
3,4 |
|
Irlande |
9,6 |
8,3 |
11,7 |
8,6 |
10,7 |
9,2 |
6,2 |
6,1 |
4,4 |
4,5 |
4,6 |
7,6 |
|
Norvège |
4,4 |
5,3 |
5,2 |
2,6 |
2,1 |
2,8 |
2,7 |
1,1 |
1,1 |
3,1 |
2,3 |
3,0 |
|
Suède |
4,1 |
1,4 |
2,5 |
3,6 |
4,3 |
4,4 |
1,2 |
2,0 |
1,8 |
3,2 |
2,7 |
2,8 |
Source : OCDE. Calculs de l'auteur.
Après une croissance économique soutenue à la fin des années 90 correspondant à la phase haute du cycle économique mondial, qui a permis à la plupart de ces pays d'obtenir une activité économique au-dessus de leur potentiel, par conséquent une activité non soutenable, la croissance économique a ralenti pour revenir au-dessous du potentiel.
* Dans un certain nombre de ces pays, la vigueur de prix de production doit être soulignée. Dans la plupart d'entre eux, l'inflation a excédé 2 % l'an (soit un rythme supérieur à la cible de la BCE), et, en Irlande, et en Norvège, elle a été très supérieure.
Cette caractéristique a favorisé une forte croissance nominale du PIB, dont on rappelle qu'il constitue le dénominateur du ratio dépenses publiques/PIB, facilitant la diminution de ce ratio.
Au demeurant, dans les pays concernés, malgré la décrue du niveau relatif des dépenses publiques dans le PIB, la croissance en volume de certaines dépenses a pu être très élevée.
CROISSANCE ANNUELLE EN VOLUME DES DÉPENSES
PUBLIQUES
DE PROTECTION SOCIALE ENTRE 1995 ET 2006
(en % d'augmentation)
|
Croissance |
Rang décroissant |
|
|
Autriche |
1,8 |
12 |
|
Belgique |
2,1 |
10 |
|
Canada |
1,5 |
13 |
|
Danemark |
0,3 |
15 |
|
France |
2,4 |
8 |
|
Allemagne |
0,9 |
14 |
|
Irlande |
6,3 |
1 |
|
Italie |
2,6 |
7 |
|
Luxembourg |
4,0 |
4 |
|
Pays-Bas |
4,0 |
4 |
|
Norvège |
4,6 |
2 |
|
Espagne |
4,3 |
3 |
|
Suède |
2,0 |
11 |
|
Royaume-Uni |
2,3 |
9 |
|
États-Unis |
3,0 |
6 |
Ainsi, la Norvège qui est le deuxième pays pour la baisse du niveau relatif des dépenses publiques dans le PIB est aussi le deuxième pays dans le classement des pays par ordre décroissant d'augmentation réelle des dépenses publiques de protection sociale.
CROISSANCE ÉCONOMIQUE EN VALEUR DANS LES PAYS
OÙ LE RATIO DÉPENSES PUBLIQUES/PIB A ÉTÉ
RÉDUIT DE PLUS DE 6 POINTS
ENTRE 1995 ET 2005
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
Moyenne annuelle 2005/1995 |
|
|
Autriche |
4,2 |
3,5 |
2,0 |
3,8 |
4,0 |
5,2 |
2,6 |
2,2 |
2,6 |
4,6 |
4,1 |
3,5 |
|
Canada |
5,1 |
3,3 |
5,5 |
3,7 |
7,4 |
9,6 |
2,9 |
4,2 |
5,4 |
6,1 |
6,1 |
5,4 |
|
Danemark |
4,4 |
4,9 |
5,3 |
3,4 |
4,3 |
6,6 |
3,2 |
2,8 |
2,7 |
4,1 |
5,7 |
4,3 |
|
Finlande |
8,4 |
3,3 |
8,5 |
8,6 |
3,1 |
8,3 |
4,3 |
3,2 |
2,2 |
3,8 |
3,9 |
5,2 |
|
Irlande |
13,0 |
10,6 |
15,8 |
16,3 |
15,1 |
15,2 |
12,2 |
11,4 |
6,6 |
6,8 |
7,9 |
11,8 |
|
Norvège |
7,3 |
9,5 |
8,2 |
1,9 |
8,9 |
19,1 |
3,9 |
- 0,5 |
3,8 |
8,9 |
11,0 |
10,3 |
|
Suède |
7,6 |
2,3 |
4,1 |
4,3 |
5,5 |
5,8 |
3,2 |
3,6 |
3,7 |
4,6 |
3,9 |
4,4 |
Source : OCDE. Calculs de l'auteur.
- Pour autant, il faut conclure par une observation importante .
Excepté l'Irlande, tous les pays dans lesquels une diminution importante des dépenses publiques est intervenue ont connu une augmentation des inégalités de revenus .
Elle a été d'autant plus prononcée (Finlande, Suède) que la baisse du niveau des dépenses publiques a été plus forte.
ÉVOLUTION DES INÉGALITÉS DE REVENUS
|
Forte baisse |
Baisse moyenne |
Légère baisse |
Aucun changement |
Hausse légère |
Hausse moyenne |
Forte hausse |
|
|
- 12 % |
Entre -7%
|
Entre -2 et -7 % |
Compris entre +/- 2 % |
Entre +2
|
Entre +7 %
|
+ 12 % |
|
|
Du milieu des années 1970
|
Grèce |
Finlande Suède |
Canada |
Pays-Bas |
États-Unis |
Royaume-Uni |
|
|
Du milieu des années 1980
|
Espagne |
Australie Danemark |
Autriche Canada France Grèce Irlande |
Belgique Allemagne Luxembourg Japon Suède |
Rép. tchèque Finlande Hongrie Pays-Bas Norvège Portugal Royaume-Uni États-Unis |
Italie Mexique Nlle-Zélande Turquie |
|
|
Du milieu des années 1990
|
Mexique Turquie |
France Irlande Pologne |
Australie Rép. tchèque Allemagne Hongrie Italie Luxembourg Pays-Bas Nlle-Zélande Portugal États-Unis |
Autriche Canada Danemark Grèce Japon Norvège Royaume-Uni |
Finlande Suède |
Note : Il y a une forte variation des inégalités quand le coefficient de Gini évolue de plus de 12 %, variation modérée quand il évolue entre 7 et 12 %, variation faible au-dessous de 7 % ; pas de changement en deçà de 2 %.
Les résultats sont basés sur les évaluations du coefficient de Gini pour quatre années de référence qui peuvent varier parmi certains pays.
- « 2000 » : données de l'année 2000 dans tous les pays, excepté 1999 pour l'Australie, l'Autriche et la Grèce et 2001 pour l'Allemagne, le Luxembourg, la Nouvelle Zélande et la Suisse ; et 2002 pour la République tchèque, le Mexique et la Turquie ;
- « Milieu des années 1990 » équivaut à « 1995 », sauf : 1993 pour l'Autriche, 1994 pour l'Australie, le Danemark, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, le Japon, le Mexique et la Turquie et 1996 pour la République tchèque et la Nouvelle Zélande ;
- « Milieu des années 1980 » : 1983 pour l'Autriche, la Belgique, le Danemark et la Suède ; 1984 pour l'Australie, la France, l'Italie et le Mexique ; 1985 pour le Canada et la Norvège ; 1987 pour l'Irlande et la Turquie ; 1988 pour la Grèce et 1989 pour les États-Unis.
- la période de « mi-1980 à mi-1990 » se réfère au début des années 1990.
Source : DELSA/ELSA/WD/SEM(2005)1. OCDE.
CHAPITRE II - METTRE LES DÉPENSES PUBLIQUES AU SERVICE DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE STRUCTURELLE
Les liens entre les dépenses publiques et la croissance économique ne s'arrêtent pas à la question de la capacité des dépenses publiques à servir de variable d'ajustement à des déséquilibres affectant conjoncturellement le rythme de l'activité.
La place, plus ou moins importante, des dépenses publiques est porteuse d'enjeux plus structurels en ce sens qu'elle pourrait exercer une influence sur le régime de croissance. La question est de savoir si les dépenses publiques peuvent hausser le rythme de la croissance potentielle ou, au contraire, si elles l'infléchissent nécessairement, comme le prétendent certains au nom de deux arguments principaux :
- l'impact défavorable des dépenses publiques sur l'épargne ;
- l'effet de distorsion exercé par les dépenses publiques, résultant notamment des incidences désincitatives de la redistribution à laquelle elles concourent.
Sur le premier point , il n'existe pas de vérification empirique d'une relation constante entre le niveau de l'épargne et celui des dépenses publiques. Il faut ajouter que la contribution des dépenses publiques à l'investissement, très mal appréhendée du fait des conventions de la Comptabilité nationale, apparaît comme une variable décisive pour la croissance dans plusieurs approches.
Sur le second point , les arguments théoriques ne sont pas corroborés par les données agrégées, mais des doutes plus sérieux peuvent être formulés quand on s'intéresse à des données plus microéconomiques.
En amont, il est indispensable de présenter les controverses dans le cadre desquelles doit être aujourd'hui abordée la question de la relation entre les dépenses publiques et la croissance économique.
On peut s'étonner, compte tenu de l'acuité des discussions que suscite cette relation dans le monde, et au regard de l'importance pratique prise par l'intervention publique que le débat sur les dépenses publiques se réduise le plus souvent à la seule question du niveau relatif des dépenses publiques dans le PIB.
Il faut diversifier les indicateurs et revenir aux vraies questions pour vérifier si, dans les faits, les dépenses publiques, par leurs effets, permettent de vérifier les justifications qui sont au fondement de l'intervention publique :
- leur contribution à la stabilisation de court terme de l'activité économique, envisagée dans la première partie du présent chapitre ;
- leur portée redistributive qui sera examinée dans la deuxième partie du présent rapport ;
- leur apport en termes d'allocation du revenu au service de la maximisation des performances économiques, question qui est ici envisagée.
Il paraît nécessaire d'insister d'emblée sur un point. La stabilisation de la conjoncture par des politiques budgétaires contra-cycliques, à supposer qu'on leur prête toute leur efficacité, n'est pas sans conséquence sur les performances de croissance plus structurelles .
En effet, des performances économiques inférieures à la croissance potentielle ont un coût qui peut être durable .
Par exemple, le passage au chômage occasionne des coûts économiques structurels qui peuvent affecter le potentiel de croissance s'il se traduit par une déqualification des personnes privées d'emplois. De même, l'atrophie des recettes fiscales qui accompagne tout décrochage de la croissance par rapport au potentiel renforce la contrainte budgétaire et peut peser sur les dépenses publiques de « préparation de l'avenir ». Il en va évidemment de même pour les entreprises dont les investissements sont sensibles aux évolutions conjoncturelles.
Autrement dit, la question de la stabilisation conjoncturelle par la politique budgétaire n'est pas seulement une question d'efficacité économique à court terme. Elle engage les capacités structurelles de croissance économique.
Une conclusion s'impose donc. Si on croit que les politiques budgétaires sont efficaces et que les dépenses publiques peuvent contribuer à cette efficacité, le choix de normes des dépenses publiques, sans considération du contexte économique, n'est pas opportun.
I. LA CONTRIBUTION DES DÉPENSES PUBLIQUES À LA CROISSANCE : POUR UN VRAI DÉBAT
La pensée économique classique, depuis ses origines philosophiques à aujourd'hui, est traversée par l'idée que l'intervention publique exerce généralement des effets défavorables en réduisant le rythme de croissance.
Mais, cette tradition n'a jamais porté de condamnation absolue de l'intervention publique, sauf en certaines de ses composantes radicales, plutôt récentes. Au contraire, elle a jeté les bases théoriques de sa justification sans, il est vrai, en explorer totalement l'ampleur 62 ( * ) .
Longtemps, cette sorte « d'abstention intellectuelle » a prévalu, fondant des principes selon lesquels l'intervention publique devait être rare. Plus récemment, après la révolution keynésienne axée sur l'action conjoncturelle stabilisatrice de l'État, celui-ci s'est vu reconnaître un rôle déterminant plus structurel, sur le rythme de la croissance économique. En bref, l'exception est devenue la règle.
A. UNE INTERVENTION PUBLIQUE QUI N'EST JUSTIFIÉE QU'EXCEPTIONNELLEMENT DANS LA PENSÉE CLASSIQUE
1. Les deux piliers de la pensée classique jouent contre l'intervention publique
Dans les approches classiques, le rythme de croissance est le résultat du produit de l'augmentation de la population et de l'investissement compte tenu de leurs efficacités propres (leur productivité). Ces variations sont elles-mêmes tributaires des préférences des agents économiques (de leurs « utilités »).
C'est l' individu rationnel qui, in fine , est le dépositaire de la prospérité économique.
Dans un tel contexte, les dépenses publiques, réalisées par l'État, ne peuvent que troubler le jeu privé des agents économiques en dégradant leur productivité ou/et en réduisant les incitations qui les environnent à participer à la production. En bref, à supposer que les dépenses publiques puissent avoir quelques effets favorables ceux-ci doivent, au total, être appréhendés en fonction des distorsions qu'elles impliquent, qui ont toutes chances de l'emporter.
Ici, doit être ajoutée au modèle classique, qui souligne l'efficacité économique des choix des individus rationnels, un deuxième de ses piliers : la méfiance envers l'État , qui provient d'une analyse de l'État comme agent prédateur, qui, du fait de sa puissance peut accomplir ses desseins sans se plier aux saines règles de la concurrence qui transforment la confrontation des intérêts privés en source de progrès économiques.
Cette critique de l'État est au fondement de deux courants de pensée que tout oppose a priori , mais qui portent toutes deux une condamnation systématique de l'intervention publique : le marxisme radical et « l'Ecole du Public Choice », d'inspiration ultra-libérale et anti-étatique .
S'agissant du marxisme radical , la critique de la dépense publique prolonge l'analyse de l'État comme « comité exécutif de la bourgeoisie » . Les dépenses publiques, qui contribuent à entretenir l'appareil répressif de l'État (police, justice...), ont par ailleurs un rôle économique majeur dans la viabilisation du système capitaliste. Elles ont pour objet de relever le taux de profit des capitaux privés qui, sans elles, serait voué à une décroissance fatale au capitalisme.
Mais en exerçant ce rôle, l'État profite à une frange des classes sociales mais nullement à l'ensemble de la société.
S'agissant de « l' Ecole du Public Choice », (« l'Ecole de la décision publique »), la critique de la dépense publique qu'elle porte pousse à son summum l'inspiration anti-étatique des théories classiques libérales. L'État n'intervient que pour servir les intérêts propres à son être - la bureaucratie entendue au sens le plus large - et ses interventions créent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent.
A côté de la branche anti-étatiste absolue, le tronc du libéralisme classique a toujours comporté des rameaux portant des justifications à l'intervention publique.
2. Des motifs légitimant l'intervention publique
Les deux contestations radicales de l'intervention publique (et donc des dépenses publiques) contrastent avec les autres approches théoriques qui, toutes, fondent l'utilité économique des dépenses publiques.
Celles-ci se distinguent moins par leur nature, où le libéralisme des conceptions économiques prime, que par le degré de confiance accordée respectivement au marché et à l'intervention publique .
Les théoriciens libéraux historiques , de Locke à Adam Smith, qui ont pourtant consacré la primauté de l'individualisme et, donc du marché, préconisent que l'État intervienne, non seulement pour pallier les insuffisances du marché, mais aussi pour en corriger les excès .
Une fois justifiée l'intervention publique, il n'existe pas de véritable solution de continuité entre les différentes approches économiques, mais des nuances sur le degré des mérites de l'action de l'État .
a) Les insuffisances du marché sont la première et la plus célèbre des justifications apportées à l'intervention de l'État par les théoriciens libéraux
Ces insuffisances se révèlent face à trois grands types de situations :
- les biens collectifs (par opposition aux biens privés), qui ne peuvent être livrés correctement dans le cadre du marché. Leurs caractéristiques empêchent toute production par un agent privé, puisqu'il n'est pas possible de faire payer un prix pour leur consommation. En effet, avec ces biens sont associées deux propriétés qui ôtent au marché la faculté de les valoriser :
- la propriété de non-rivalité des consommateurs (ou d'indivisibilité) au terme de laquelle la quantité consommée par l'un ne diminue pas la quantité disponible pour les autres ;
- la propriété de non-exclusion des consommateurs selon laquelle on ne peut exclure un consommateur en lui réclamant un prix.
Le périmètre des biens collectifs n'est pas aisément déterminable et fait l'objet de controverses - v. infra -. La diplomatie en présente un exemple qui n'est guère contesté.
- l'existence d'externalités , c'est-à-dire d'effets positifs ou négatifs que le marché ne peut valoriser ou sanctionner. Dans le premier cas (celui des effets négatifs), il existe un risque de surproduction et la taxation est un instrument tutélaire qui permet d'ajouter aux coûts privés le coût des effets négatifs que le marché ne valorise pas spontanément (exemple de la pollution d'un bien libre de droits). Dans le second cas (celui des effets positifs), il existe au contraire un risque de sous-production puisque l'ensemble des bénéfices d'un bien ou d'un service n'est pas pris en compte par le marché. L' intervention publique est alors justifiée pour produire directement le bien en cause ou en subventionner la production (tel est le cas pour certains biens concourant à la santé publique, par exemple).
- l'existence de risques de marché qui ne sont pas à la portée d'un investisseur raisonnable.
Cette situation est décrite par Adam Smith dans les termes suivants : « Le troisième devoir du souverain consiste à ériger et maintenir des travaux publics qui, bien que du plus haut intérêt pour la société, sont d'une nature telle que le profit ne peut jamais couvrir la dépense d'un individu ou d'un petit nombre d'individus ; on ne doit donc pas s'attendre en conséquence à ce qu'ils les entreprennent ou les maintiennent. »
L'exemple cité, les travaux publics, et la référence à des investisseurs en petit nombre révèlent une réflexion marquée par son temps. Ils témoignent aussi d'un certain degré de contingence de cette troisième justification de l'intervention publique. Aujourd'hui, de nombreux travaux publics (les autoroutes, par exemple) peuvent être exécutés dans les conditions de marchés qui, par ailleurs, réunissent désormais autour de projets donnés des investisseurs en grand nombre, et donc capables de diviser leurs risques.
Toutefois, même si son contenu peut évoluer, il faut retenir l'idée que, dès l'origine, les économistes libéraux conçoivent que certaines productions, par les risques qu'elles comportent, ne se prêtent pas à des investissements privés de marché.
Dans ces conditions, il est nécessaire, si l'on juge souhaitable, qu'elles soient développées, qu'un investisseur échappant aux contraintes du marché se manifeste. Un tel investisseur ne peut être qu'un investisseur public agissant seul ou en concert avec des partenaires .
Les insuffisances du marché, ses lacunes, ne sont pas les seules justifications à l'intervention publique. Ses excès éventuels, qui relèvent de deux catégories distinctes, apportent à celle-ci une autre justification qu'on commente généralement moins, surtout la seconde .
b) Les excès du marché justifient aussi l'intervention publique
La première des catégories d'excès potentiels du marché comprend les situations où la concurrence n'est pas suffisamment garantie . Tel est le cas typique des situations de monopole ou de rentes . Dans ces hypothèses, les caractéristiques des activités de production - coûts marginaux décroissants, pouvoirs de marché excessifs - aboutissent à des solutions économiques éloignées de celles que produit un marché de concurrence pure et parfaite, avec, soit des prix trop élevés, soit des quantités produites trop faibles.
La seconde catégorie des excès de marché se rencontre avec les problèmes de répartition des richesses que peut engendrer son fonctionnement.
Pour les libéraux, la propriété privée qui s'exprime dans le droit reconnu aux individus de s'approprier des biens suppose la redistribution des produits de ces biens. L'État est fondé à intervenir à cette fin (Hobbes, Locke...).
Ce principe ne pose problème que par ses modalités d'exécution. Jusqu'à quel point l'intervention redistributive de l'État peut-elle aller ?
Deux limites sont posées : l' une concerne les objectifs de la redistribution limitées à la subsistance de ses bénéficiaires ; l' autre ménage ceux qui doivent l'acquitter ; ils ne doivent pas subir d'atteinte substantielle à leurs droits de propriété .
Si chacune des justifications apportées à l'intervention publique s'intègre dans un paradigme où la meilleure allocation des biens, qui garantit aussi la production optimale de ces biens, est généralement assurée par le marché, c'est leur portée qui fait débat. Elle varie selon les « sensibilités » 63 ( * ) et, de même, les avantages de l'intervention publique sont discutés.
Dans les faits, les bornes précises de l'intervention publique ont longtemps été négligées au profit d'une conception de principe qui a consacré l'idée d'exceptionnalité.
Mais, dans la période la plus récente, l'échec des modèles théoriques classiques de croissance économique à rendre compte des ressorts du développement a conduit à souligner les enjeux de l'intervention publique sous cet angle en lui prêtant (en particulier, aux dépenses publiques) un rôle favorable sur le niveau de la production et le rythme de la croissance.
B. LES DÉPENSES PUBLIQUES ADJUVANT MAJEUR DE LA CROISSANCE ?
Les modèles explicatifs de la croissance économique ne sont pas parvenus à rendre compte avec une suffisante précision des ressorts de la croissance, faisant ressortir l'existence d'une variable essentielle mais inexpliquée, nommée « productivité globale des facteurs ».
Les essais d'identification de cette productivité ont débouché sur plusieurs travaux, à la base de la théorie dite de « la croissance endogène » ( par opposition à la théorie traditionnelle qui l'attribuait à des facteurs exogènes , essentiellement non maîtrisables), faisant ressortir le rôle des dépenses publiques sur la croissance .
Même si les preuves empiriques de cette nouvelle approche sont discutées, certains faits stylisés suggèrent qu'il convient aujourd'hui, plutôt que d'en écarter systématiquement l'utilité, de progresser sur la connaissance du lien entre dépenses publiques et croissance économique.
1. L'échec des modèles classiques de croissance a débouché sur la consécration du rôle des dépenses publiques dans le rythme de la croissance
La croissance économique potentielle est expliquée dans les modèles classiques 64 ( * ) par la combinaison quantitative des facteurs travail et capital. Le taux de croissance est le produit du taux de croissance du travail et du capital à quoi s'ajoutent les gains de productivité globale des facteurs .
Celle-ci représente un résidu mesuré à partir des variations quantitatives des facteurs de production que sont le travail et le capital, mais qui n'est pas observé. N'étant pas observé, ce résidu est resté longtemps inexpliqué et, par conséquent, attribué à des événements aléatoires sur lesquels la maîtrise manque. Cette approche consacre la dimension en partie exogène de la croissance économique , résultat d'une causalité indéterminable et par conséquent sans utilité pour la politique économique. Ce résultat est apparu d'autant plus décevant que la productivité globale des facteurs a pu être rendue responsable d'une proportion considérable de la croissance économique, l'augmentation des quantités de travail et de capital étant loin de pouvoir rendre compte de la croissance réellement observée.
Face à la résignation manifestée par les résultats de cette approche exogène de la croissance économique , des tentatives d' endogénéisation 65 ( * ) de la productivité globale des facteurs sont apparues avec un certain retard puisqu'elles datent de la moitié des années 80 66 ( * ) .
Dans ces travaux, la productivité globale des facteurs ressort comme étroitement déterminée par les politiques publiques et, notamment, par les dépenses publiques . Les dépenses publiques productives peuvent augmenter non seulement le niveau de la production mais encore le rythme de croissance de l'économie.
Les mécanismes en cause relèvent fondamentalement de l'idée que les dépenses publiques permettent de produire des biens que le marché n'engendrerait pas ou pas suffisamment parce qu'il est impossible à un agent privé d'en rentabiliser la production.
Tel est le cas pour les biens publics ou les externalités que des domaines comme l'éducation ou la recherche caractérisent tout particulièrement.
On remarque que ces activités sont a priori à la base de progrès d'efficacité en produisant, en particulier, des innovations de produits ou de procédés qui permettent de démultiplier les effets de l'augmentation quantitative des facteurs de production sur la croissance économique 67 ( * ) .
2. Une confirmation empirique discutée mais une approche qui devrait occuper une place importante dans le débat sur les dépenses publiques
Les vérifications économétriques de l'impact structurel des dépenses publiques sur le rythme de la croissance économique ont donné des résultats contradictoires, les études réalisées plaidant les unes pour la théorie de la croissance endogène, les autres contre.
Dans les études qui ne montrent pas l'existence d'un effet des dépenses publiques sur le rythme de la croissance économique, la contribution des dépenses publiques productives n'est pourtant pas remise en cause. Mais, elle est contrebalancée par les effets défavorables de la taxation qui sert à financer ces dépenses. Celle-ci est considérée comme défavorable à la croissance notamment en ce qu'elle exerce un effet d'éviction sur des dépenses privées.
Mais, on raisonne alors sur deux hypothèses qu'il faut mentionner car elles le sont rarement :
- la première, que les dépenses privées auxquelles se substituent les dépenses publiques seraient aussi productives que celles-ci ;
- et la seconde, selon laquelle la productivité des dépenses privées ne serait pas influencée par les dépenses publiques, visées par les théoriciens de la croissance endogène, dont l'objet est précisément d'augmenter l'efficacité des dépenses privées.
Or, ni l'une ni l'autre de ces suppositions ne sont exemptes de fragilité :
- si on fait une différence entre les dépenses publiques productives, celles qui permettent d'améliorer l'efficacité des facteurs de production et les dépenses publiques improductives - celles qui n'augmentent pas les capacités d'offre - il faut appliquer cette distinction aux dépenses privées et alors il n'y a pas de raison d'exclure l'hypothèse où des dépenses publiques productives se substitueraient à des dépenses privées qui ne le sont pas. C'est d'ailleurs une des justifications théoriques de l'intervention de l'État que d'orienter les ressources rares vers des emplois qui permettent d'élever le rythme de la croissance économique ;
- par ailleurs, autre justification de l'intervention publique, des dépenses publiques sont nécessaires à la création d'un contexte économique plus favorable à la croissance que celui qui s'imposerait si ces dépenses n'étaient pas réalisées. Tel est le cas pour les dépenses qui permettent de diriger des ressources vers des emplois que l'utilité privée ne serait pas suffisante à promouvoir mais que l'utilité collective invite à développer : la santé, l'éducation, l'environnement, les biens au rendement aléatoire ou tellement différé que nul investisseur privé ne pourrait en assurer la production...
Ainsi, si les doutes quant aux effets structurels des dépenses publiques sur la croissance économique doivent retenir l'attention, il semblerait dangereux de les étendre au-delà de leur domaine de validité, qui se résume à la configuration où des dépenses publiques sans nul effet sur l'offre se substituent à des dépenses privées susceptibles d'augmenter le rythme structurel de la croissance économique .
Or, si on se rapporte aux données empiriques, force est de constater que cette substitution semble ne pas se produire :
- D'une part, comme on l'a fait observer dans la première partie du présent rapport, la diversité des niveaux de dépenses publiques dans les pays de développement économique comparables s'accompagne d'une assez forte homogénéité des modalités macroéconomiques d'allocation du revenu national.
- D'autre part, si on considère les taux d'investissements privés (soit le rapport entre l'investissement privé et la valeur ajoutée) dans ces pays, marqués pourtant par des différences importantes au regard du poids des dépenses publiques dans le PIB, en considérant qu'ils représentent un bon indicateur de la part du revenu alloué à des dépenses privées productives, on ne trouve pas de relations négatives entre dépenses publiques et investissements privés (voir ci-dessous).
En revanche, plusieurs faits stylisés, ou travaux économétriques, conduisent à souligner la contribution de différentes catégories de dépenses publiques à l'augmentation du rythme de croissance .
Un champ particulièrement significatif de cette relation est celui de la contribution des dépenses publiques à l' innovation et à la formation du capital humain (autrement dit l'éducation et la formation).
En ce qui concerne l' innovation , qu'il s'agisse des nouvelles technologies de l'information (l'informatique) ou de secteurs plus traditionnels (l'aéronautique, notamment), la contribution des dépenses publiques paraît essentielle au développement des branches à forte intensité technologique.
En ce qui concerne l'éducation, la plupart des travaux relatifs à la rentabilité économique de l'éducation, appréciée par individu, montrent que l'éducation est un investissement rentable .
Cette appréciation microéconomique pourrait ne pas avoir de prolongements sur le plan macroéconomique. Si l'on suppose que la fréquentation du système d'éducation est un « marqueur » individuel, son utilité pour les individus qui en bénéficient pourraient se payer par un handicap pour ceux qui en sont exclus et l'utilité collective serait alors nulle.
Cependant, les travaux se multiplient ces dernières années pour montrer que les dépenses d'éducation ont un rendement macroéconomique 68 ( * ) , et que celui-ci dépasse le rendement individuel de l'éducation . L'investissement éducatif est de plus en plus considéré comme l'un des moteurs essentiels de la croissance et, par ailleurs, comme l'un de ceux sur lesquels il est possible d'agir.
Depuis les travaux de Mincer (1974), la rentabilité privée (individu par individu) de l'investissement en éducation a reçu une formalisation débouchant sur des résultats qui l'attestent .
Soit un coût par individu du parcours scolaire égal au renoncement à une année de salaire, la méthode consiste à calculer, à partir du supplément de salaire futur qu'il touchera par rapport à un individu qui n'aurait pas supporté ce coût, quel est le rendement de son investissement en formation.
Selon les études, le rendement privé de l'éducation est compris entre 4,5 et 12 % selon les pays et la rentabilité de l'éducation varie au cours du temps et selon le niveau d'études : elle croît avec le nombre d'années d'études.
Le graphique n° 1 , ci-après, permet de visualiser les ressorts de ce résultat. Il indique les salaires des diplômés relativement à ceux des non-diplômés (exprimés en %) pour différents âges (22, 32, 42 et 52 ans) et pour 15 catégories de diplôme croissantes (la catégorie 1 regroupe les non diplômés ; la catégorie 15, les diplômés des grandes écoles).
GRAPHIQUE N° 1
SALAIRES RELATIFS EN FONCTION DE L'ÂGE ET DU DIPLÔME
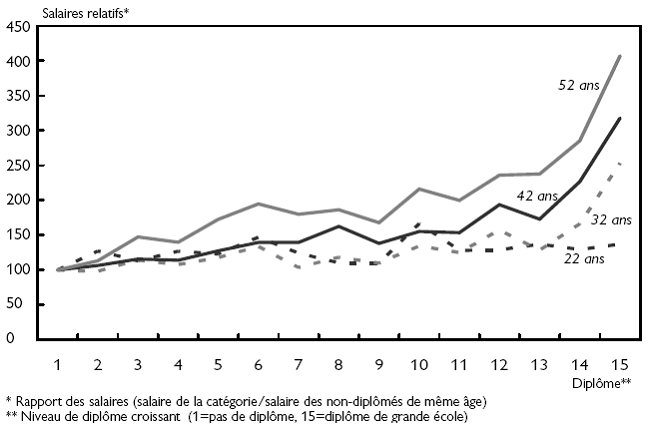
Sources : Revue de l'OFCE n° 97.
La différenciation salariale est d'autant plus forte que l'âge et l'écart de diplôme sont élevés.
Les résultats publiés par l'OCDE présentés ci-après confirment ces informations en prenant en plus en compte les coûts et opportunités liés à la poursuite des études. Du côté des coûts, le supplément de fiscalité à la charge des « plus scolarisés » est intégré ainsi que les frais de scolarité privés ; du côté des avantages, le moindre risque d'être au chômage.
TABLEAU N° XX
TAUX DE RENDEMENT INTERNES PRIVÉS DE
L'ÉDUCATION (1999-2000)
IMPACT DES REVENUS AVANT IMPÔTS (SELON
LA DURÉE DES ÉTUDES), DE LA FISCALITÉ, DU RISQUE
D'ÊTRE AU CHÔMAGE,
DES FRAIS DE SCOLARITÉ ET DES BOURSES
ET PRÊTS D'ÉTUDES
DANS LE DEUXIÈME CYCLE DE
L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DANS L'ENSEIGNEMENT TERTIAIRE, PAR
SEXE
(en points de pourcentage)
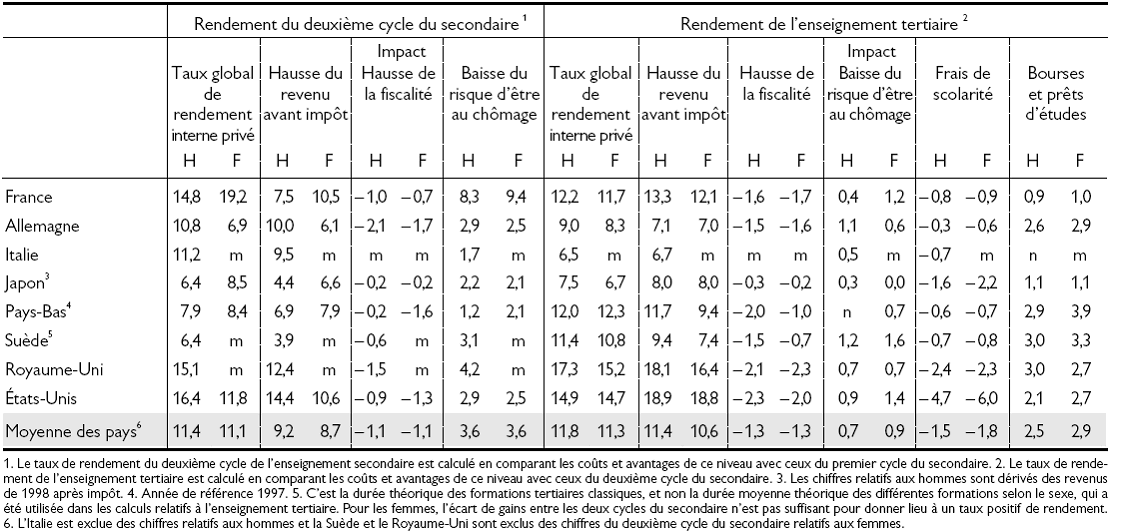
Source : OCDE
Le constat d'une rentabilité individuelle positive de l'éducation ne suffit pas à établir l'existence d'une rentabilité collective de la dépense d'éducation, mais les travaux qui concluent dans ce sens se multiplient .
Comme on l'a indiqué, les estimations de la rentabilité individuelle de l'éducation reposent sur la différenciation salariale existant entre des populations inégalement consommatrices de qualification et ne permettent pas de conclure à l'utilité collective de l'éducation . La seule conclusion robuste qu'on puisse en extraire est que les populations relativement plus formées réussissent à obtenir des salaires plus élevés que les autres . L'existence d'un gain collectif n'est pas démontrée par ces travaux.
La différenciation salariale sur laquelle ils se fondent n'équivaut pas au constat que les dépenses d'éducation augmentent globalement l'efficacité économique. Elle pourrait, soit ne refléter que des disparités naturelles dans les talents individuels, soit être le résultat d'une sorte « d'effet de marque » qui permettrait à ceux qui se sont donnés une image de marque par l'obtention d'un diplôme d'accéder à des niveaux de salaire supérieurs aux autres.
Face à ces objections, les travaux sur la rentabilité macroéconomique des dépenses d'éducation ont longtemps peiné à déboucher sur des résultats montrant que les dépenses d'éducation ont un effet sur la croissance économique.
Au demeurant, le « paradoxe des Trente Glorieuses », avec une plus forte croissance que depuis leur achèvement et des dépenses d'éducation moindres qu'aujourd'hui, soulève, empiriquement, le même problème.
- Il reste que la plupart des travaux décrivent désormais une influence positive de l'éducation sur la croissance dont le tableau ci-dessous donne quelques ordres de grandeur.
TAUX DE RENDEMENT ÉCONOMIQUE DE
L'ÉDUCATION (1999-2000)
TAUX DE RENDEMENT DU DEUXIÈME CYCLE DE
L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE L'ENSEIGNEMENT TERTIAIRE PAR SEXE (EN POINTS DE
PIB)
|
Rendement du deuxième cycle
|
Rendement du tertiaire 2 |
|||
|
Hommes |
Femmes |
Hommes |
Femmes |
|
|
France |
9,6 |
10,6 |
13,2 |
13,1 |
|
Allemagne |
10,2 |
6,0 |
6,5 |
6,9 |
|
Italie 3 |
8,4 |
m |
7,0 |
m |
|
Japon |
5,0 |
6,4 |
6,7 |
5,7 |
|
Pays-Bas |
6,2 |
7,8 |
10,0 |
6,3 |
|
Suède |
5,2 |
m |
7,5 |
5,7 |
|
Royaume-Uni |
12,9 |
m |
15,2 |
13,6 |
|
États-Unis |
13,2 |
9,6 |
13,7 |
12,3 |
1. Le taux de rendement du deuxième cycle de l'enseignement secondaire est calculé en comparant les coûts et avantages de ce niveau avec ceux du premier cycle du secondaire.
2. Le taux de rendement de l'enseignement tertiaire est calculé en comparant les coûts et avantages de ce niveau avec ceux du deuxième cycle du secondaire.
2. En Italie, l'échantillon relatif aux revenus des femmes n'est pas suffisamment important pour calculer des taux de rendement.
Source : OCDE
- Selon ces travaux, il existe un lien positif entre les dépenses d'éducation et la croissance économique .
Pour les pays mentionnés, qui appartiennent tous à l'OCDE, cette relation est d'autant plus étroite que l'investissement en éducation concerne le supérieur .
Cela ne signifie pas qu'il en aille toujours ainsi. Au contraire, il est intéressant de relever que ce dernier résultat dépend de la situation du pays par rapport à la « frontière technologique ». Celle-ci est définie par référence au pays où la productivité est la plus forte (les États-Unis, en général ; la Californie dans de nombreuses études). Plus les performances d'un pays s'en rapprochent, plus le rendement de l'éducation dépend d'un choix d'orientation de la dépense vers l'enseignement supérieur. A l'inverse, plus un pays est éloigné de la frontière technologique, moins il est opportun de concentrer l'éducation sur le supérieur.
Ce résultat est à mettre en relation avec les besoins relatifs des différents pays : celui qui est loin de la « frontière technologique » croît davantage par imitation que par innovation et, inversement, pour les pays proches de cette frontière. Or, le processus d'imitation requiert moins de « capital humain » que celui d'innovation.
Ces résultats n'épuisent pas totalement les questions relatives à l'influence des dépenses d'éducation sur la croissance .
- Une ancienne controverse demeure : quel est le sens de la causalité ? Est-ce l'éducation qui fait la croissance ou la croissance qui fait l'éducation ?
L' éducation est un de ces « biens supérieurs » dont le niveau de production et de consommation augmente à mesure que la richesse s'accroît. Sa croissance est plus rapide que celle de la richesse globale quand on dépasse un certain stade de développement. Dans ces conditions, il est difficile de ne pas reconnaître que le niveau de l'éducation est influencé par le niveau du PIB.
Cependant, cette influence ne « disqualifie » pas la causalité inverse , qui répond à l'intuition selon laquelle le niveau d'éducation conditionne la performance économique. Une étude récente 69 ( * ) obtient , au moyen d'une méthode ingénieuse, la démonstration des effets favorables sur la croissance économique des États américains d'une augmentation discrétionnaire des dépenses d'éducation .
- Par ailleurs, le rendement social de l'éducation n'est pas appréhendé par les études disponibles qui ne s'intéressent qu'à ses rendements macroéconomiques .
Les estimations des effets macroéconomiques de l'éducation telles que celles, précitées, de l'OCDE passent par l'identification des impacts des dépenses d'éducation sur le produit intérieur brut. On peut estimer qu'elles « capturent » certains effets indirects que l'éducation exerce sur la production des richesses mais qu'elles négligent un grand nombre de ses externalités, c'est-à-dire la plupart des incidences sociales qu'elle peut avoir : baisse de la criminalité violente, amélioration de la santé, renforcement de la cohésion sociale...
II. LES DÉPENSES PUBLIQUES CONTRE L'ÉPARGNE ET L'INVESTISSEMENT ? UNE PRÉOCCUPATION QUI N'APPARAÎT PAS FONDÉE, AU CONTRAIRE
Selon certaines approches, les pays à relativement faible niveau de dépenses publiques devraient disposer d'une épargne plus abondante que ceux où les dépenses publiques sont plus importantes, et inversement. Il devrait s'ensuivre que les dépenses publiques seraient défavorables à l'investissement et finalement à la croissance économique.
Les constats empiriques ne valident pas une telle approche .
Il n'existe, apparemment, aucune corrélation entre le niveau des dépenses publiques et le niveau de l'épargne nationale.
Il faut aller plus loin , et après avoir observé que les données usuelles de la Comptabilité nationale rendent très mal compte de la contribution des dépenses des administrations publiques à l'investissement, présenter les arguments qui placent les dépenses publiques au coeur des théories modernes de la croissance économique .
A. PAS DE CORRÉLATION NÉGATIVE ENTRE DÉPENSES PUBLIQUES, ÉPARGNE, INVESTISSEMENT ET CROISSANCE
1. En théorie, un effet négatif des dépenses publiques sur l'épargne...
Un pays où les dépenses publiques sont relativement élevées fait le choix d'une allocation de ses ressources économiques a priori plus propice à la consommation qu'à l'épargne.
Deux enchaînements seraient à l'oeuvre.
- Le premier est celui de la redistribution , qu'elle soit opérée par les transferts publics ou par les biens et services mis à disposition du public. Elle modifierait la répartition du revenu au bénéfice des agents ayant la plus forte propension à consommer.
- Le deuxième est celui de la production de biens et services par les administrations publiques . Fondamentalement, l'une des justifications essentielles de l'intervention publique est de fournir des biens et services qui, sans elle, ne seraient pas disponibles puisque le marché ne les produirait pas. Par cet effet d'offre, les dépenses publiques devraient augmenter la consommation globale et réduire l'épargne disponible.
On ajoute souvent à ces deux canaux un troisième . L'intervention publique réduirait les besoins d'épargne des agents économiques aux fins de financer l'accès aux biens et services produits par les administrations publiques. A défaut de l'intervention publique, ceux-ci ne seraient pas disponibles sans un effort d'épargne préalable des agents privés. Par exemple, en l'absence de production de services d'enseignement « gratuits » par les administrations publiques, il est probable que les ménages devraient réserver une partie de leur revenu pour financer l'accès à l'enseignement, comme ils le font avec l'épargne-logement pour accéder au logement.
De même, les systèmes de retraite par capitalisation gérés par les entreprises privées supposent une accumulation d'actifs qui nécessite un effort d'épargne auquel sont soustraits les individus affiliés à des régimes de retraite par répartition, considérés dans cet argumentaire comme essentiellement publics.
2. ... et donc sur la croissance économique
Cet effet défavorable sur l'épargne aurait des répercussions sur l'investissement et sur la croissance économique .
Les pays disposant d'un niveau d'épargne comparativement élevé devraient connaître un taux de croissance supérieur puisque plus d'épargne devrait permettre plus d'investissement et plus d'investissement déboucher sur plus de croissance économique.
A ces considérations théoriques, la réalité offre, apparemment, un démenti .
3. Les constats empiriques ne valident, apparemment, pas ces approches
|
DÉPENSES PUBLIQUES ET ÉPARGNE
|
|||
|
Dépenses publiques
|
Épargne nette
|
Épargne nationale
|
|
|
Corée |
28,1 |
4,7 |
34,8 |
|
Irlande |
33,7 |
Nd |
23,7 |
|
Australie |
35,1 |
-3,2 |
19,8 |
|
États-Unis |
36,4 |
1,8 |
13,0 |
|
Suisse |
36,6 |
9,3 |
32,9** |
|
Japon |
37,3 |
3,1 |
26,4** |
|
Espagne |
38,8 |
11,1* |
22,4 |
|
Nouvelle-Zélande |
39,2 |
Nd |
16,9 |
|
Canada |
39,9 |
1,4 |
23,1 |
|
Royaume-Uni |
44,0 |
4,3 |
14,8 |
|
Norvège |
45,9 |
9,6 |
33,5 |
|
Portugal |
46,4 |
10,1* |
15,1 |
|
Pays-Bas |
46,6 |
8,4 |
25,7 |
|
Allemagne |
47,0 |
10,5 |
20,9 |
|
Italie |
47,8 |
10,1 |
20,3 |
|
Grèce |
49,2 |
Nd |
15,7 |
|
Belgique |
49,6 |
11,0* |
23,5 |
|
Autriche |
50,1 |
9,0 |
19,8 |
|
Finlande |
51,2 |
2,7 |
24,3 |
|
France |
53,7 |
11,8 |
19,1 |
|
Danemark |
54,8 |
3,0* |
22,5 |
|
Suède |
56,7 |
8,5 |
22,8 |
* Épargne brute
** en 2003
Le tableau ci-dessus montre que le taux d'épargne national n'est pas corrélé au niveau des dépenses publiques . De la même manière, le taux d'épargne des ménages - qui n'est qu'un des déterminants du taux d'épargne national 70 ( * ) - semble sans lien avec le niveau des dépenses publiques.
En 2004, les États-Unis sont le pays où le taux d'épargne nationale est le plus faible (13 points de PIB, soit 6,1 point de moins qu'en France) alors qu'ils appartiennent au groupe des pays où les dépenses publiques sont parmi les moins développées. La Suède où le ratio dépenses publiques/PIB excède de 21,6 points le même ratio en Australie, dispose d'une épargne nationale supérieure de 3 points. La Corée , qui dispose du taux d'épargne nationale le plus élevé est, à l'inverse, le pays où les dépenses publiques sont les moins développées mais la Nouvelle-Zélande connaît un bas niveau d'épargne avec des dépenses publiques relativement basses.
Le tableau ci-après confirme ce constat et y ajoute celui que le lien entre le taux d'épargne d'un pays et le rythme de sa croissance économique est loin d'être invariant .
|
TAUX D'ÉPARGNE, DÉPENSES PUBLIQUES ET CROISSANCE |
|||||
|
Dépenses publiques
|
Taux d'épargne net des ménages
|
Taux d'épargne 1995 - 2005 |
Croissance sur 10 ans
|
||
|
États-Unis |
34,8 |
- 0,4 |
15,5 |
3,3 |
|
|
Espagne |
38,2 |
2,2 |
22,4 |
3,7 |
|
|
Japon |
39,5 |
2,9 |
28,0 |
1,6 |
|
|
Royaume-Uni |
44,0 |
- 0,2 |
15,7 |
2,8 |
|
|
Pays-Bas |
45,4 |
6,5 |
26,7 |
2,6 |
|
|
Allemagne |
46,8 |
10,6 |
20,3 |
1,3 |
|
|
Italie |
48,1 |
10,6 |
21,0 |
1,3 |
|
|
France |
53,5 |
11,8 |
20,0 |
1,9 |
|
|
Danemark |
52,5 |
- 4,1 |
23,9 |
2,1 |
|
|
Suède |
56,0 |
7,9 |
21,8 |
2,7 |
|
Source : OFCE
Entre 1995 et 2005, les États-Unis et le Royaume-Uni ont connu une forte croissance malgré un très bas taux d'épargne. Au Japon, le fort taux d'épargne n'a pas empêché une croissance économique languissante.
De nombreuses autres variables sont déterminantes pour la croissance économique.
En outre, l'épargne nationale n'est pas toujours un déterminant de la croissance . Par exemple, la croissance du Royaume-Uni est économe en capital, celle des États-Unis est favorisée par un financement extérieur abondant.
Il est manifeste que le taux d'épargne national est le résultat de variables beaucoup plus diversifiées que le seul poids des dépenses publiques dans le PIB.
Peut-on, pour autant, exclure toute causalité entre dépenses publiques et épargne ?
B. POUR NE PAS NÉGLIGER LA CONTRIBUTION DES DÉPENSES PUBLIQUES À L'INVESTISSEMENT
Sur des données générales et statiques, le constat de l'absence de causalité univoque entre dépenses publiques et épargne nationale s'impose, tout comme celui de l'absence de causalité entre dépenses publiques et épargne des agents privés.
Si on considère que la relation entre épargne, investissement et croissance est robuste, on peut être tenté d'induire de ce défaut de causalité l'absence de lien entre dépenses publiques, investissement et croissance.
Trois lois générales pourraient être énoncées :
- les dépenses publiques n'ont aucune influence sur le niveau de l'épargne d'un pays ;
- les dépenses publiques n'entretiennent donc aucun lien avec l'investissement ;
- finalement, le taux de croissance d'une économie est indifférent au niveau relatif qu'atteignent les dépenses publiques.
Ces conclusions auraient quelque chose de décevant à la fois pour l'esprit, puisqu'elles viendraient contredire tous les efforts théoriques réalisés pour établir une relation entre ces données, et pour l'action publique puisqu'elles la priveraient d'une large partie de ses fondements rationnels possibles. Le choix du niveau des dépenses publiques serait entièrement indifférent quant aux possibilités de croissance économique d'un pays.
Pour éviter ce désarroi, il faut dépasser des approches trop globales mais aussi requalifier des réalités dont la nature économique n'est que très imparfaitement restituée du fait des conventions statistiques et comptables en usage .
Ce travail doit d'abord évoquer la distinction d'une problématique de court terme et d'une approche plus structurelle .
La première s'interroge sur les effets conjoncturels - à court terme - d' une variation des dépenses publiques : en résulte-t-il ou non une variation de l'épargne ? Comme on l'a indiqué précédemment sur cette question, les controverses sont tranchées, certains estimant qu'une variation à la hausse des dépenses publiques augmente l'épargne privée, d'autres qu'il n'en va pas ainsi.
Dans une perspective plus structurelle , le débat est moins clairement clivé et est mené parfois à fronts renversés : ceux qui voient dans une augmentation des dépenses publiques la cause d'un accroissement à court terme de l'épargne privée estiment que, structurellement, plus le niveau des dépenses publiques est élevé, plus l'épargne privée est faible. Leurs adversaires défendent une position inverse.
Cette confrontation de points de vue doit dépasser l'abstraction dans laquelle ils sont exprimés pour examiner les effets concrets des dépenses publiques .
Cet examen suppose des évaluations rigoureuses qui se heurtent trop souvent à des données mal qualifiées. Un préalable serait donc d' opérer une requalification des dépenses publiques, par rapport à leur statut comptable usuel, pour mieux tenir compte de leur nature économique . Elle est impérative pour appréhender plus exactement l'apport des dépenses publiques à la croissance économique.
1. Les messages contradictoires des théories économiques...
a) Une controverse claire à court terme...
L'impact de court terme sur l'épargne d'une variation des dépenses publiques est-il nul ?
Les réponses des économistes à cette question sont très généralement négatives : il existe pour eux un lien entre dépenses publiques et taux d'épargne national. Mais , ils se divisent sur le sens de cette relation .
Pour certains, la relation entre une variation des dépenses publiques et le taux d'épargne va transitoirement dans le sens contraire, tandis que les autres défendent la thèse inverse.
Abordant l'effet d'une variation à la hausse des dépenses publiques , les théories néo-classiques lui attribuent des effets antikeynésiens. Loin de se réduire, le taux d' épargne des agents privés augmente dans une telle hypothèse, si bien que l'épargne nationale a tendance à renforcer sa part dans le revenu. Toutefois, comme celui-ci est inférieur à ce qu'il aurait été sans hausse des dépenses publiques, cette augmentation du taux d'épargne des ménages n'a pas les vertus attendues d'une élévation de l'épargne nationale. En particulier, elle ne se traduit pas par une hausse de la capacité de financement des investissements.
Au contraire , dans les approches keynésiennes , la dépense publique a le pouvoir en elle-même de réduire le taux d'épargne . C'est ce qui fonde les préconisations d'utiliser la dépense publique pour stabiliser l'économie. Une augmentation des dépenses publiques, même si elle est financée par une hausse équivalente des impôts 71 ( * ) , donc sans recours à l'endettement, augmente le niveau de la production. Cet enchaînement s'explique par la baisse du taux d'épargne national qui résulte d'une élévation nette du niveau de la demande :
- les dépenses publiques sont une composante de la demande globale. Celle-ci augmente lorsque les dépenses publiques s'accroissent, réduisant ainsi le taux d'épargne national ;
- les prélèvements destinés à financer l'augmentation des dépenses publiques réduisent la demande des agents qui les supportent mais pas à due concurrence puisqu'une partie des prélèvements concerne des revenus qui auraient été épargnés.
Ainsi, l'augmentation des dépenses publiques réduit par elle-même l'épargne nationale, du moins transitoirement .
Les travaux économétriques confortent
généralement ce résultat même si certaines
études entendent contester cette relation (voir ci-dessous pour un
exposé détaillé des effets des épisodes de forte
réduction des dépenses publiques). Ainsi, Giavazzi
et
al.
(2000) comparent la réaction des taux d'épargne
nationaux dans des périodes normales et dans des périodes
spécifiques. L'impact d'une hausse de 1 % des dépenses
publiques sur le taux d'épargne national serait en
situation
normale
de - 0,9 % à court terme (de
- 2,4 % à moyen terme) ; en
situation de
consolidation budgétaire
de - 0,6 % (de
- 1,34 % à moyen terme).
b) ... dont les termes se brouillent quand on considère le long terme
Ce clivage sur les effets de court terme des dépenses publiques est beaucoup moins présent quand le long terme est abordé . Le rôle des dépenses publiques sur le partage structurel entre consommation et épargne n'est pas réellement considéré par les économistes qui semblent ne pas s'intéresser directement à une question qui, pourtant, les divise fortement quand ils analysent le temps court.
On peut d'abord se demander pourquoi, si la relation établie à court terme qui attribue à une augmentation des dépenses publiques une hausse du taux d'épargne est vraie, on ne vérifie pas que des pays connaissant des niveaux différents de dépenses publiques n'ont pas systématiquement des taux d'épargne disparates.
La réponse à cette interrogation renvoie à l'idée que les comportements d'épargne sont déterminés par des préférences structurelles.
- En premier lieu, le théorème d'Haavelmo , qui repose sur une relation négative entre augmentation des dépenses publiques et taux d'épargne, n'est valide qu'à court terme . Une fois que le niveau de la production a augmenté suite à une hausse des dépenses publiques, les revenus supplémentaires distribués aux agents sont l'objet d'un arbitrage entre épargne et consommation qui répond à des comportements structurels.
Le taux d'épargne des agents antérieur à l'augmentation des dépenses publiques résulte d'une préférence structurelle et il doit augmenter après une baisse qui n'aura été que transitoire et due à l'augmentation de court terme du poids des dépenses publiques.
- En second lieu, les déterminants de l'épargne sont divers, et discutés, mais, lorsqu'on les envisage d'un point de vue structurel 72 ( * ) , ils ne comportent jamais de liaison univoque et directe avec les dépenses publiques .
Ce n'est qu'en empruntant des cheminements indirects qu'on suppose une telle relation, qui, en toute hypothèse, n'est jamais exclusive.
Tout invite donc à examiner l'impact des dépenses publiques sur le taux d'épargne en fonction de considérations concrètes relatives, d'une part, à la nature des dépenses publiques (consommation, investissement, transferts...), et, d'autre part, à leur effet sur le niveau et la distribution du revenu plutôt que d'attribuer abstraitement aux dépenses publiques un effet négatif sur le taux d'épargne comme le font les approches théoriques mentionnées plus haut.
On peut illustrer le bien-fondé d'analyses plus empiriques à partir de quelques exemples suivants.
2. ... appellent un dépassement pour examiner les impacts empiriques des dépenses publiques sur le taux d'épargne
a) L'argument selon lequel l'impact redistributif des dépenses publiques conduirait à abaisser le taux d'épargne global
Cet argument paraît fondé si l'on admet que le taux d'épargne national varie en raison de l'agrégation des taux d'épargne des individus. Alors la distribution du revenu national exerce un effet sur le niveau agrégé du taux d'épargne.
C'est, en effet, une observation empirique que de montrer que la propension à épargner augmente avec le revenu, les titulaires de bas revenus ayant tendance à les consommer intégralement. Ainsi, la distribution du revenu national peut influencer le taux d'épargne national.
|
Soit un revenu de 100, distribué également entre trois agents et une propension individuelle à consommer intégrale jusqu'à 33,3 et de 80 % au-delà, le taux d'épargne national est nul . Si le revenu est distribué inégalement et qu'un agent perçoit plus de 33,33 % du revenu, le taux d'épargne devient non-nul . |
Comme les dépenses publiques peuvent modifier la répartition du revenu, elles peuvent aussi par ce biais avoir un effet sur le taux d'épargne.
Mais, le sens et surtout l'ampleur de cet effet est suspendu à l'impact des dépenses publiques sur la distribution des propensions à épargner .
Les caractéristiques de la redistribution effectuée par les dépenses publiques peuvent être variables sous cet angle et seul un examen concret permet de décider l'effet de la redistribution sur les taux d'épargne.
Au demeurant, plus structurellement, si l'on admet que les dépenses publiques haussent durablement le niveau de la production et le rythme de croissance, une éventuelle baisse transitoire du taux d'épargne, se solde à long terme par un niveau plus élevé de l'épargne disponible.
b) L'argument selon lequel les dépenses publiques baisseraient les exigences d'épargne nécessaires pour accéder aux biens et garanties qu'elles apportent
En supposant que les dépenses publiques sont la contrepartie de prélèvements obligatoires et non d'un effort d'épargne - ce qui est vérifié globalement sauf dispositifs particuliers -, et que, dans les pays où les dépenses publiques sont moins élevées les agents ont les mêmes préférences, on remarque qu'il leur faut alors consentir un effort d'épargne préalable afin de financer leurs consommations à partir d'un patrimoine préconstitué.
Les fonds de pension, les assurances, l'épargne de précaution rendent compte de ce processus.
Ainsi, la propension à épargner devrait être théoriquement plus élevée dans les pays où les dépenses publiques occupent une moindre place dans la fourniture de biens et garanties aux agents .
Mais, il se trouve que les données empiriques contredisent cet enchaînement théorique . Les pays dans lesquels les assurances privées sont les plus développées et où les financements privés des services, collectivisés ailleurs, sont relativement importants n'ont pas des taux d'épargne plus élevés, au contraire.
Au demeurant, les équations explicatives du taux d'épargne ignorent généralement les facteurs institutionnels et ceux-ci doivent être vus en adoptant une démarche empirique.
Sous cet angle, plusieurs pistes pourraient conduire à ne pas exagérer leurs effets sur les taux d'épargne .
- Tout d'abord, la consommation du revenu représente un comportement premier , ce dont témoigne l'idée que l'épargne est un résidu.
Il n'est pas exclu que cette préférence pour la consommation conduise les ménages à ignorer les contraintes assurantielles, qui les conduiraient à augmenter leur effort d'épargne, même dans les pays où du fait de la place relativement faible des dépenses publiques elles sont de facto renforcées.
D'ailleurs, l'une des justifications essentielles à l'intervention publique est qu'elle exerce un rôle tutélaire de protection des agents contre leur imprévoyance.
- Concrètement ensuite, l'accès à des biens comme l'éducation ou la santé peuvent dans les pays où il n'est pas financé par des dépenses publiques (ou moins financé) être acquis en contrepartie d'une consommation du revenu ou d'un endettement supplémentaire . Dans ce dernier cas, l'effet sur le taux d'épargne est facialement négatif.
- Par ailleurs, l'obligation d'épargner n'équivaut pas à la capacité de le faire , et l'absence de financement public se traduit certainement par la privation d'un certain nombre de biens et garanties plutôt que par un effort d'épargne.
- Enfin, il semble que dans les pays où les fonds de pension remplacent les systèmes publics de répartition, le rendement de l'épargne soit structurellement plus élevé si bien que les contraintes d'épargne des agents relevant de deux systèmes, pourtant très différents, sont plus proches qu'on le pourrait envisager si les rendements de ces systèmes étaient semblables.
3. La contribution des dépenses des administrations publiques à l'épargne et à l'investissement est sous-estimée notamment par la Comptabilité nationale
Comptablement, les dépenses publiques sont composées d'emplois qui sont assimilés soit à des consommations intermédiaires ou finales, soit à des investissements .
Cette distinction répond à des concepts de la Comptabilité nationale qui vont dans le sens d'une minoration de la contribution des dépenses des administrations publiques à l'investissement.
Il n'est pas satisfaisant , au regard d'une conception économique pertinente de l'investissement, d'estimer l'apport des administrations publiques à l'investissement national à partir du seul concept comptable d'investissement réalisé par les administrations publiques .
En Comptabilité nationale, l'investissement , dénommé « formation brute de capital fixe (FBCF) », représente la valeur des biens durables acquis par les unités productrices résidentes afin d'être utilisés pendant au moins un an dans leur processus de production 73 ( * ) .
Tous les autres emplois des différents agents économiques relèvent, soit de la consommation au motif qu'ils doivent être renouvelés chaque année dans le cadre du processus de production, soit d'opérations de répartition de la valeur ajoutée retracées dans le compte d'exploitation ou dans le compte de revenu.
Il faut relever les insuffisances que présente la mesure de l'apport des administrations publiques à l'investissement national quand elle ne reprend que la FBCF des administrations publiques .
Pour le comprendre, il faut rappeler que, contrairement à une idée répandue, l'investissement ne désigne pas la production de biens d'investissement mais l'acquisition de tels biens 74 ( * ) .
Ainsi, la FBCF des administrations publiques ne mesure pas l'investissement produit par elles ; elle ne restitue que l'investissement qu'elles constituent au cours d'une année à partir de leurs ressources et afin d'être utilisé dans leur processus de production .
Une première observation doit souligner le particularisme des investissements des administrations publiques sur le plan économique . Si certains d'entre eux (le bâtiment du ministère des finances, une caserne...) n'ont pas pour vocation exclusive d'être mis à la disposition du public, d'autres (une route départementale, une école...) ont cette vocation.
Ainsi, la plupart des investissements des administrations publiques non seulement entrent dans leur processus de production mais encore profitent à d'autres agents économiques.
C'est probablement du fait de cette particularité qu'on a trop souvent tendance à assimiler l'investissement acquis par les administrations publiques à l'investissement qu'elles produisent.
Cela conduit à une seconde observation importante . L'approche précitée témoigne d'une confusion entre les moyens de production engagés par les administrations publiques et leur production elle-même.
Elle conduit le plus souvent à occulter la nature même de ce que produisent les administrations publiques et donc de la destination finale des ressources (endettement, dépenses publiques) mobilisées à cette fin. S'agit-il de biens et services aussitôt détruits que consommés, ou s'agit-il de biens et services à l'utilité durable ? Autrement dit, la production des administrations publiques relève t-elle de biens de consommation ou emprunte-t-elle aux biens d'équipement ?
A l'examen, une grande masse des dépenses publiques qui, au sens de la Comptabilité nationale ou de la comptabilité budgétaire, n'a pas pour contrepartie des investissements, et est donc traitée comme de la consommation, contribue cependant à accroître le capital de la Nation, notamment le capital humain .
Ces dépenses publiques sont donc à l'origine de la constitution d'un patrimoine immatériel , c'est-à-dire d'un stock de richesses qui sont incorporées durablement dans l'économie qui bénéficie des services que ces dépenses financent. Les dépenses d'éducation mais aussi les dépenses consacrées à la santé (ou à l'environnement) concourent à la formation d'un capital, généralement immatériel, mais durable. Il en va de même des dépenses de recherche-développement.
|
LA COMPTABILISATION DES DÉPENSES PUBLIQUES COMME SOURCE DE FINANCEMENT D'UN CAPITAL IMMATÉRIEL : LE CAS DE L'ÉDUCATION Les dépenses publiques d'éducation ont pour objectif d'augmenter le capital humain, autrement dit, plus prosaïquement, d'améliorer les capacités de leurs bénéficiaires. Elles sont ainsi à l'origine d'un patrimoine incorporel dont il faut évaluer la valeur . Deux méthodes sont disponibles : - l' estimation du patrimoine éducatif par le coût historique (1°) - l' estimation du patrimoine éducatif par le potentiel fiscal (2°) 1) L'estimation du patrimoine éducatif par le coût historique Dans cette méthode, la valeur du patrimoine éducatif s'obtient en ajoutant chaque année au stock existant les dépenses consacrées à l'éducation et en appliquant à ce stock un amortissement pour tenir compte de sa dépréciation . |
|
Sur la basse des seules dépenses publiques d'éducation 75 ( * ) , une étude de Thomas MELONIO et Xavier TIMBEAU dégage les résultats suivants pour la période 1971-2002.
L'ÉVOLUTION DU CAPITAL ÉDUCATIF
FRANÇAIS ENTRE 1971 ET 2002
Source : MELONIO et TIMBEAU, Revue de l'OFCE n° 97 Le capital éducatif engendré par les dépenses publiques - égal en 2002 à 140,6 points de PIB - aurait progressé de 60,1 points de PIB entre 1971 et 2002, avec une tendance au ralentissement de l'accumulation . Cette même méthode appliquée à l'horizon 2050 permet d'entrevoir une réduction de la valeur du patrimoine éducatif au-delà de 2022 (tableau ci-après) en raison surtout des facteurs démographiques qui conduiraient à limiter les nouvelles dépenses et à augmenter le taux de dépréciation du stock existant de capital.
PROJECTION DU CAPITAL ÉDUCATIF À
L'HORIZON 2050
Source : MELONIO et TIMBEAU, Revue de l'OFCE n° 97 |
|
Ces résultats sont cependant tributaires d'hypothèses prudentes comportant une stabilité du niveau de diplôme et du taux de scolarisation. La méthode d'estimation du patrimoine éducatif par les coûts historiques présente certaines limites dont, principalement, celles qui résultent de l'absence de prise en compte des performances qualitatives de l'éducation . Dans une méthode quantitative comme celle-ci, l'accumulation de dépenses peut toujours donner lieu à la constitution d'un actif, sous l'hypothèse de non dépréciation intégrale du service ou du bien, qui, par ailleurs, est d'autant plus valorisé que le niveau des dépenses qui le financent est élevé 76 ( * ) . Ce mécanisme n'est pas sans fondement mais il ne permet pas de prendre en compte l'utilité du patrimoine ainsi constitué qui représente pourtant sa vraie valeur. Celle-ci peut être moins élevée que ce qu'indique la méthode des coûts historiques, en cas de gaspillage par exemple, ou plus élevée si on considère que ce patrimoine a un rendement supérieur à l'unité. C'est pour tenter de combler, au moins partiellement, les lacunes de cette méthode qu'une autre modalité d'estimation du patrimoine éducatif est appliquée. 2) L'estimation du patrimoine éducatif par le potentiel fiscal Avec cette méthode, le patrimoine éducatif est valorisé à partir des recettes fiscales futures que les dépenses d'éducation sont supposées générer . Complexes 77 ( * ) , les méthodes employées consistent à isoler la contribution du capital éducatif à différentes assiettes fiscales puis à calculer les rendements fiscaux de l'éducation. En attribuant 38,8 % de la productivité de travail à l'éducation reçue - le reste se partageant entre l'habileté générale au travail et le capital productif matériel (le stock d'investissement) - on obtient des données sur la valeur fiscale des actifs en fonction de leur diplôme ( tableau ci-après ). |
|
VALEUR FISCALE NETTE DES ACTIFS FRANÇAIS
Source : MELONIO et TIMBEAU, Revue de l'OFCE n° 97 Il est alors possible de mesurer le patrimoine éducatif en appliquant cette grille à la structure réelle de la population active et en appliquant des taux de prélèvements obligatoires ( tableau ci-après ).
ESTIMATION DU CAPITAL ÉDUCATIF FRANÇAIS
DE 1971 À 2002
Source : MELONIO et TIMBEAU, Revue de l'OFCE n° 97 |
|
Le patrimoine éducatif est estimé à 151,8 points de PIB en 2002, en augmentation de 79,7 points par rapport à 1971 . En prenant un taux de prélèvements obligatoires réel en 2002 - inférieur au taux tendanciel - l'estimation du patrimoine éducatif est de 147,3 points de PIB. Les projections à 2050 laissent également présager une réduction de ce patrimoine à partir de 2012 ( tableau ci-après ).
ESTIMATION DU CAPITAL ÉDUCATIF FRANÇAIS
APRÈS 2002
Source : MELONIO et TIMBEAU, Revue de l'OFCE n° 97 3) Observations Les deux méthodes d'évaluation du patrimoine éducatif ici examinées donnent des résultats différents mais proches. L' inclusion au bilan des administrations publiques de l'actif immatériel constitué par le patrimoine éducatif rehausserait celui-ci de l'ordre de 140 points de PIB . Et, entre 1971 et 2002 , la valeur de cet actif aurait augmenté de quelque 60 points de PIB . On peut mettre en rapport la variation du patrimoine éducatif avec la variation de la dette publique . Entre 1980 et 2002, le patrimoine éducatif a augmenté de 39,4 points de PIB passant de 100,8 points de PIB à 140,2 points de PIB (estimation la plus basse de la valeur d'actif de l'éducation). Dans le même temps, la dette publique a augmenté de 37,2 points de PIB , passant de 21 à 58 points de PIB. Au cours de cette période, la dette publique a moins augmenté que le seul actif éducatif du pays . Ainsi, en admettant que les dépenses publiques d'éducation ont pour contrepartie un actif durable, on peut tirer la conclusion que l'augmentation de la dette publique a été inférieure à l'accroissement de la valeur de l'actif éducatif , résultat qui n'apparaît pas quand on juge que les dépenses publiques d'éducation n'ont aucune contrepartie durable et sont de pures dépenses de consommation. |
|
Dans une telle approche, les perspectives qu'offre la situation des finances publiques sont sensiblement modifiées : . la valeur nette du patrimoine public - valeur des actifs moins le passif - est supérieure d'au moins 140 points de PIB ; . les opérations courantes des administrations publiques dégagent des déficits publics inchangés mais ceux-ci résultent d'un effort d'investissement public susceptible de hausser la croissance potentielle de l'économie française, et non d'une impasse de financement de pures dépenses de fonctionnement . Il reste que ces approches sont suspendues à la démonstration que les dépenses publiques d'éducation ont un impact positif sur la croissance économique . Cette démonstration n'est apportée par aucune des deux méthodes d'estimation du patrimoine éducatif présentées ci-dessus. La simple incrémentation de dépenses publiques, même quand on procède à un amortissement pour tenir compte d'une éventuelle obsolescence du capital qu'elles financent, ne suffit pas à établir qu'elles ont pour contrepartie un capital productif. De son côté, la méthode du potentiel fiscal repose sur la seule considération qu'à des niveaux différenciés d'éducation correspondent des niveaux de salaires inégaux dont on déduit des assiettes fiscales plus ou moins élevées. Ce constat n'équivaut nullement à celui que les dépenses d'éducation ont dans l'absolu un impact fiscal favorable . Autrement dit, il ne signifie pas en soi que l'éducation offerte, et consommée, hausse les performances économiques d'un pay s. Il faut ainsi s'en remettre à des travaux portant sur l'impact macroéconomique de l'éducation pour valider la conclusion que les dépenses d'éducation sont à l'origine d'un actif ayant une rentabilité économique, travaux exposés plus loin dans le présent rapport 78 ( * ) . |
Les conventions comptables ignorent cette réalité économique .
De fait, les conventions de la Comptabilité nationale aboutissent à ce que la quasi-totalité de la production des administrations publiques est considérée comme ayant pour contrepartie de la consommation .
Ce traitement comptable brouille l'appréciation des dépenses publiques étant donné la nature économique d'une partie non négligeable de la production des administrations publiques, qui devrait conduire à classer les productions des services dont il s'agit dans la catégorie des investissements.
Si une telle option devait prévaloir, le niveau de la consommation en ressortirait réduit et mécaniquement, le taux d'épargne de la Nation serait plus élevé, ainsi que l'investissement comptabilisé .
Il est à tout le moins indispensable d'ajouter aux catégorisations comptables existantes des dépenses publiques une comptabilité économique adaptée à leur contribution réelle à la croissance économique.
4. Inversement, la contribution de l'épargne privée à l'investissement national ne doit pas être surestimée.
L'argument selon lequel la nécessité de se constituer un patrimoine préalable, dans les pays où les dépenses publiques ne permettent pas l'accès aux biens et garanties souhaités par les agents, favoriserait l'épargne et, partant, l'investissement doit être examiné concrètement, compte tenu du contexte de liberté des mouvements nationaux de capitaux.
Celle-ci implique que l'épargne puisse se placer où les perspectives de rendement sont les plus favorables compte tenu d'un contexte donné de risques.
Il est difficile de concilier cette situation avec l'idée trop simple selon laquelle le développement de l'épargne nationale rimerait avec celui de l'investissement territorialisé là où cette épargne se constitue .
Dans une économie mondialisée où les rendements du capital sont différenciés, la hausse du taux d'épargne des agents économiques d'un pays donné s'accompagne normalement de fuites dont témoignent l'internationalisation des actifs des fonds de pension et, plus globalement, des patrimoines financiers.
Face à ces réalités, les ressources que procurent les prélèvements obligatoires sont plus systématiquement dirigées vers des emplois territorialisés dans l'espace économique où ils sont pratiqués puisqu'ils financent des dépenses publiques qui sont quasi-exclusivement destinées à financer des projets nationaux.
Ce « fléchage » ne garantit pas la qualité économique de ces projets mais, du moins, qu'ils existent et qu'ils sont territorialisés là où l'épargne se constitue.
Ce constat, qui peut être vu comme celui d'une opportunité, invite à se concentrer sur la maximisation de l'utilité économique des dépenses publiques.
III. LES DÉPENSES PUBLIQUES DE TRANSFERTS SOCIAUX CONTRE LA CROISSANCE ? SORTIR DU SLOGAN POUR AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DES POLITIQUES SOCIALES
Les dépenses publiques interviennent dans le cadre de deux grandes fonctions exercées par l'État :
- la production de biens et services non marchands ;
- les opérations de répartition du revenu.
La première coïncide avec la fonction d'allocation du revenu, la seconde avec celle de distribution.
Les problématiques que posent ces deux fonctions sont différentes , quoiqu'elles ne puissent être absolument distinguées en ce qu'elles peuvent concourir à des objectifs communs.
L' allocation du revenu pose essentiellement le problème de la mesure de l' efficacité des productions non marchandes . On a évoqué précédemment les questions qu'il convient à ce propos d'examiner et qui, pour l'essentiel, intéressent le rendement économique des productions publiques.
Les opérations de répartition du revenu peuvent poser des problèmes de même nature dans la mesure où elles consistent à créer un bien public - une plus grande égalité - ou à offrir un service public - une meilleure assurance. Par ailleurs, la production de biens publics peut contribuer à ces objectifs. Mais les termes de la discussion peuvent être ici davantage spécifiés : les effets de la répartition , à supposer que ses objectifs soient atteints, favorisent-ils la dynamique de l'économie ou, au contraire, se traduisent-ils par moins de croissance ?
C'est cette dernière question qui est traitée dans cette sous-partie du présent rapport qui, dans sa seconde partie, s'interroge sur la question de la portée réelle de la redistributivité des dépenses publiques.
Dans le débat sur les dépenses publiques, les dépenses de répartition ont un statut à part, étant plus souvent décriées que les dépenses de production non marchande, dont on reconnaît traditionnellement la nécessité (il faut bien un « État-gendarme ») voire l'utilité (il s'agit malgré tout en soi d'une production qui, au demeurant, peut se justifier par les insuffisances du marché et en favoriser l'épanouissement).
Les dépenses publiques de répartition sont souvent présentées comme purement « compassionnelles » , sans effets sur l'efficacité économique et, au contraire, susceptibles de réduire le rythme potentiel de croissance par leurs prolongements désincitatifs.
C'est donc à les réduire qu'il faudrait s'attacher, ce qu'entendent démontrer la plupart des études produites pour accréditer la théorie des effets bénéfiques structurels des politiques budgétaires restrictives (v. plus haut dans le présent chapitre).
Exprimée ainsi, la critique des dépenses publiques de répartition apparaît excessivement abstraite , voire désincarnée.
Ses prolongements concrets ne sont d'ailleurs jamais clairement explicités, ni au stade de la faisabilité d'une politique de réduction des opérations de répartition du revenu, ni à celui de ses incidences.
A l'examen, la faisabilité d'une telle politique pose des problèmes fondamentaux, comme le montre le fait qu'elle représente une inversion des préférences des agents économiques par rapport à leurs tendances historiques , marquées par la hausse des protections sociales publiques.
Sans doute peut-on identifier des marges de manoeuvre , probablement assez modestes au regard de l'ampleur prise par les dépenses de répartition, mais il faut alors envisager l'ensemble des conséquences de leur exploitation, notamment au regard de l' égalité des conditions , et tout particulièrement, de la pauvreté .
Compte tenu des gains envisageables quand on observe des données globales, la réduction des dépenses de répartition ne saurait être un objectif posé dans des termes aussi généraux que ceux évoqués plus haut. C'est dépense par dépense qu'il faut envisager d'optimiser la répartition .
A. LA RÉDUCTION DES DÉPENSES DE RÉPARTITION, QUELLE FAISABILITÉ ?
A priori , les dépenses publiques de répartition qui représentent près de la moitié des dépenses publiques offrent un « vivier d'économies » d'autant plus intéressant que ces dépenses sont censées désinciter au travail.
Cependant, la réduction de ces dépenses représenterait une rupture forte avec la tendance historique d'élévation du niveau de la protection sociale et de sa place dans les économies et sociétés développées à mesure de leur expansion.
On pourrait objecter à cela que l'intensité de la protection sociale publique varie selon les pays. Pour s'en tenir aux grands pays occidentaux, elle mobilise entre 16,2 points de PIB aux États-Unis et 31,3 points de PIB en Suède (soit un écart de 15,1 points de PIB, presque du simple au double).
Mais, ces données sont loin de représenter les préférences pour la protection sociale des individus qui peuplent les pays développés.
Elles rendent compte principalement du degré selon lequel ces préférences transitent par les administrations publiques.
En effet, on a constaté que lorsqu'on ajoute à ces dépenses publiques, les dépenses privées des individus, manifestations directes de leurs choix, la protection sociale atteint dans les pays développés des niveaux très proches .
Les dépenses de protection sociale nettes totales sont par exemple supérieures aux États-Unis à ce qu'elles sont en Suède. L'écart entre les États-Unis et la France, qui s'élève à 12,5 points de PIB pour les dépenses publiques brutes (2003) tombe à 0,4 point de PIB pour l'ensemble des revenus correspondant aux garanties sociales.
En somme, la collectivisation des besoins de protection sociale est loin d'avoir toute l'influence qu'on lui prête sur le partage global du revenu.
Elle apparaît surtout comme un moyen différent de satisfaire des besoins analogues .
Dans ces conditions, une réduction des dépenses publiques de protection sociale n'aurait pas nécessairement pour effet de diminuer le revenu affecté aux assurances sociales puisqu'elle pourrait être compensée par une élévation du niveau des dépenses privées de sécurisation sociale.
Ce constat, cohérent avec des données socio-économiques et culturelles marquées par un haut degré d'homogénéité, et avec la prédominance dans les dépenses de répartition de flux correspondant à la répartition dans le temps du revenu individuel, ne peut toutefois se passer de quelques nuances, ni être interprété comme équivalent à une indifférence microéconomique des systèmes de couverture des besoins sociaux .
B. QUEL IMPACT D'UNE RÉDUCTION DES TRANSFERTS SOCIAUX ?
Il existe sans doute quelques marges de manoeuvre mais dont les conséquences de l'exploitation doivent être mesurées avec clarté
1. Des performances macroéconomiques indépendantes du niveau de la protection sociale publique ?
Le graphique ci-dessous montre qu'il n'existe pas de corrélation entre le niveau général des dépenses de protection sociale et les performances économiques.
PERFORMANCE ÉCONOMIQUE 1 ET DÉPENSES PUBLIQUES DE PROTECTION SOCIALE
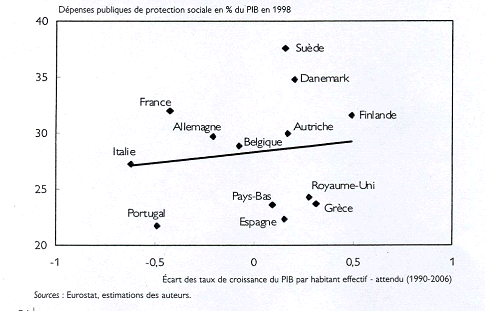
1 Écart entre le taux de croissance observé et le taux de croissance potentiel
Source : Revue de l'OFCE n° 104. Février 2008.
Avec des dépenses sociales supérieures de plus de 15 points à l'Espagne et de plus de 12 points par rapport au Royaume-Uni, la Suède réussit une performance proche de ces pays.
L'Italie, où les dépenses sociales sont plus basses qu'en France, est moins performante économiquement.
2. Des points de vue empiriques qui globalement ne confirment pas l'effet désincitatif des dépenses sociales
On associe théoriquement un haut niveau de protection sociale à des effets désincitatifs . Les garanties sociales permettraient de subsister sans travailler, donc sans participer à la production.
L'allocation du revenu national à des dépenses sociales suscite, de tradition, une polémique sur les effets de telles mesures sur l'offre de travail :
- pour les uns, les dépenses sociales ont des effets favorables en ce qu'elles permettent d'améliorer la qualité du travail offert ;
- pour les autres, elles comportent des incitations à l'oisiveté et réduisent indûment l'offre de travail.
Posée en des termes si généraux et tranchés, la discussion n'offre guère de perspectives de prolongements pratiques .
L'allocation d'un avantage indépendant de tout travail confère à son bénéficiaire le statut de « rentier » en ce sens que son revenu découle de l'exercice d'un droit qui n'est pas directement lié au travail. Les dépenses sociales sont la contrepartie de tels droits. Ainsi, par nature, elles permettent de dissocier le revenu de la fourniture d'un travail. Il faut relever que les dépenses sociales ne sont pas les seules modalités d'allocation du revenu national à présenter cette caractéristique. L'exercice de tout droit de propriété , autre que celui que les individus ont sur leur travail, donne lieu à la perception d'avantages économiques indépendamment de leur travail. Ainsi en va-t-il du droit de propriété sur un capital.
Même s'il existe des différences de nature entre « droits de propriété » et « droits sociaux », cette observation ne doit pas être négligée puisqu'il existe des liens entre ces deux types de droits. Tout comme les droits de propriété, les droits sociaux sont une composante du patrimoine des agents économiques qui les détiennent . Ces deux catégories de droits , qui sont d'ailleurs parfois imbriqués dans les organisations sociales nationales, permettent de percevoir une fraction du produit intérieur brut (voire du produit mondial lorsque ces droits portent sur des actifs situés à l'étranger).
Ces deux catégories de droits sont parfois conditionnées de façon similaire . L'acquisition d'un droit de propriété peut supposer une accumulation (l'épargne) comme pour les droits sociaux contributifs (les cotisations). Inversement, la solidarité , le plus souvent intergénérationnelle (l'héritage) pour les droits de propriété, et plutôt intragénérationnelle pour les droits sociaux, peut être à leur origine .
Les conditions de constitution des droits sociaux diffèrent cependant souvent de celles des droits de propriété par les limites temporelles qui leur sont fixées (les droits sociaux peuvent être constitués pour une période limitée) et par l'exigence fréquente de la survenance d'une situation de fait extérieure à la volonté de leurs titulaires . En particulier, hors les droits à pension, les droits sociaux sont la plupart conditionnés au constat d'une impossibilité pour leur titulaire de percevoir tout revenu (chômage, maladie...) ou un revenu décent (complément de revenu, famille...) à raison de sa situation de fait au regard du marché du travail.
* Les données microéconomiques disponibles n'apportent pas de confirmation globale de l'approche théorique selon laquelle la redistribution serait désincitative.
- S'agissant des taux d'activité , c'est-à-dire de la part de la population en âge de travailler qui, soit dotée d'un emploi soit chômeuse, participe au marché du travail, ils semblent sans lien évident avec le niveau relatif des dépenses sociales.
TAUX D'ACTIVITÉ (2005)
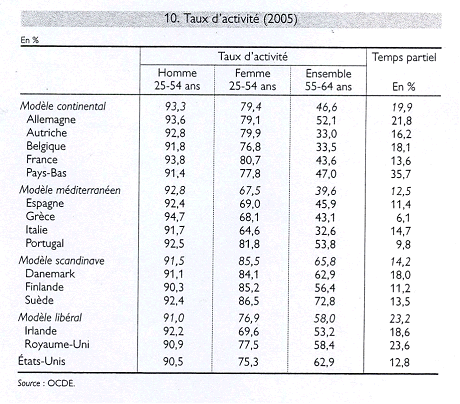
Pour les hommes âgés de 25 à 54 ans, les taux d'activité les plus élevés se constatent dans les pays dits du « modèle continental » où le niveau des dépenses publiques est relativement élevé alors que c'est dans les pays du « modèle libéral » qu'on observe les taux d'activité les plus bas.
Pour les femmes, de mêmes constats ressortent du tableau avec, en particulier, un taux d'activité maximal dans les pays scandinaves où le niveau des dépenses sociales est le plus élevé.
C'est encore dans le « modèle scandinave » que les taux d'activité sont les plus importants pour les personnes de 55 à 64 ans, tandis que c'est dans les pays du « modèle méditerranéen » où, pourtant, les dépenses publiques sociales sont les plus faibles que le taux d'activité de cette fraction de la population est le plus modeste.
- S'agissant des taux d'emploi , c'est-à-dire de la fraction de la population en âge de travailler qui est effectivement occupée, les constats relatifs aux taux d'activité doivent être nuancés.
TAUX D'EMPLOI ET TAUX DE CHÔMAGE EN EUROPE
(en %)
|
Taux d'emploi 2005 |
Taux de chômage |
||
|
Équivalent temps plein |
2006 |
||
|
Modèle continental |
65,3 |
60,2 |
8,1 |
|
Allemagne |
65,4 |
60,4 |
8,4 |
|
Autriche |
68,6 |
63,7 |
4,8 |
|
Belgique |
61,1 |
57,1 |
8,2 |
|
France |
63,1 |
59,7 |
9,4 |
|
Pays-Bas |
73,2 |
60,9 |
3,9 |
|
Modèle méditerranéen |
60,4 |
58,4 |
7,7 |
|
Espagne |
63,3 |
60,9 |
8,6 |
|
Grèce |
60,1 |
59,2 |
8,9 |
|
Italie |
57,6 |
55,5 |
6,8 |
|
Portugal |
67,5 |
65,6 |
7,7 |
|
Modèle scandinave |
72,4 |
67,7 |
6,3 |
|
Danemark |
75,9 |
69,4 |
3,9 |
|
Finlande |
68,4 |
65,3 |
7,7 |
|
Suède |
72,5 |
68,0 |
7,0 |
|
Modèle libéral |
71,4 |
65,3 |
5,2 |
|
Irlande |
67,6 |
64,6 |
4,4 |
|
Royaume-Uni |
71,7 |
65,4 |
5,3 |
|
États-Unis |
71,5 |
67,0 |
5,0 |
Sources : Eurostat, OCDE.
L'importance relative du taux d'activité est « payante » dans les pays scandinaves qui ont le plus haut niveau de taux d'emploi, mais elle a pour revers un niveau du taux du chômage qui n'est pas le meilleur de l'échantillon. Certaines personnes participant au marché du travail ne trouvent pas d'emploi dans un contexte marqué par une forte participation relative à ce marché.
Au Royaume-Uni et en Irlande où les taux d'activité ne sont pas particulièrement importants, les taux d'emploi sont plus satisfaisants du fait d'un taux de chômage peu élevé qui rapproche ces pays du plein emploi. C'est la situation inverse qui prévaut dans les pays du « modèle continental » et du « modèle méditerranéen ».
Mais, ces derniers résultats, à l'inverse de ceux relatifs au taux d'activité, qui mesurent directement les incitations en rendant compte de la participation au marché du travail, semblent difficilement pouvoir être attribués à un effet défavorable des dépenses publiques sociales.
En premier lieu, les bonnes performances en ce domaine sont partagées par des pays (scandinaves et anglo-saxons) où les dépenses publiques sociales sont très inégalement développées. Le même constat vaut pour les pays connaissant de mauvaises performances.
En second lieu, et surtout, il faudrait pour énoncer l'existence d'un lien entre dépenses publiques sociales, taux d'emploi et taux de chômage, imaginer que les personnes se présentant sur le marché du travail à la recherche d'un emploi pourraient, malgré le fait que cette démarche volontaire est plus fréquente dans les « pays continentaux », davantage préférer le chômage à l'emploi dans ces mêmes pays et, ce, dans des proportions significatives.
Rien ne vient accréditer cette supposition, les taux de chômage n'étant d'ailleurs jamais expliqués par ce soupçon dans les études économiques qui mettent, au contraire, en évidence leur sensibilité à des variables économiques lourdes comme le rythme de la croissance économique.
Au demeurant, le chômage varie considérablement en fonction du cycle alors que si une préférence pour le chômage devait exister, elle serait vraisemblablement structurelle .
De fait, il existerait bien une composante structurelle dans le chômage, mais celle-ci, dont l'évaluation est imprécise, voire conventionnelle, ne parait pas liée au niveau de protection sociale. Au demeurant, il est remarquable d'observer que des pays où la protection sociale individuelle, appréciée en parités de pouvoir d'achat, est comparativement élevée, se voient attribuer par les économistes des taux de chômage structurel plus faibles que d'autres, qui se trouvent dans une position moins favorable sous l'angle de la protection sociale individuelle.
3. Retraites et taux d'activité
En théorie, les systèmes de retraites publiques par répartition devraient ne pas avoir, par eux-mêmes, d'incidence sur le taux d'activité si les prestations étaient égales au montant des cotisations versées (en valeur actualisée) et si le taux d'intérêt était égal au taux de croissance de la masse salariale . Alors, en effet, les systèmes de pension ne devraient avoir aucun effet sur l'offre de main-d'oeuvre et sur la consommation sur toute la durée de la vie. Dans un tel régime, l'épargne individuelle serait réduite pendant la vie active d'un montant équivalent aux cotisations versées. Le taux d'épargne serait d'autant plus faible que les cotisations et les taux de remplacement seraient élevés, et inversement. Mais, globalement, les systèmes de pension ne représenteraient qu'une des modalités du lissage dans le temps des revenus et, à ce titre, ils n'exerceraient pas sur la décision de rester en activité une influence plus grande que celle attribuable à la constitution d'un patrimoine.
Dans la réalité, les régimes de retraite influent sur la distribution du revenu et de la richesse aussi bien entre les générations qu'au sein de celles-ci, engendrant ainsi des « effets de patrimoine » agissant sur la décision de départ à la retraite . Par exemple, l'introduction d'un régime de retraite par répartition, ou une augmentation inattendue du niveau des pensions, incomplètement compensée par un relèvement des cotisations, accroissent le patrimoine « retraite » net des travailleurs âgés. Cela stimule leur demande à la fois de consommation et de temps libre, les incitant à prendre leur retraite plus tôt.
Dans un sens inverse, dans le cas où le taux d'intérêt réel est supérieur au taux de croissance des salaires réels, le patrimoine retraite est plus faible dans un régime par répartition que dans un régime capitalisé. Par conséquent, l'existence d'un régime par répartition réduit la consommation et incite les travailleurs à prolonger leur vie active ou à un effort d'épargne particulier .
En bref, tout système de retraite est susceptible d'exercer des incitations à la cessation d'activité qui dépendent :
- du montant des pensions servies ;
- de l'imposition marginale implicite que comporte la poursuite d'une activité professionnelle ;
- de l'âge d'ouverture des droits.
Le premier détermine le niveau du revenu de remplacement disponible ; le second conduit à des arbitrages portant sur le rendement des droits à la retraite ; le troisième devrait, en tant que tel, être neutre pour les individus mais dans les faits, il ne l'est pas pour des raisons diverses (dont l'interdiction de poursuivre une activité après l'âge légal).
On peut imaginer a priori que plus le montant net des taux de remplacement (le rapport entre les pensions nettes de prélèvements et les revenus d'activité nets aussi) est élevé et plus l'âge d'ouverture des droits est précoce, plus le système de pensions invite à se retirer de l'activité. Or, sous ces divers angles, la France se situe plutôt dans les pays où les incitations au retrait de l'activité sont fortes même si les comparaisons internationales disponibles négligent certaines données essentielles qui conduisent à nuancer ce constat.
Sous l'angle de l'âge d'ouverture des droits à pension , les pays de l'OCDE sont dans une situation assez homogène.
ÂGE NORMAL D'OUVERTURE DES DROITS À PENSION DE RETRAITE
|
Hommes |
Femmes |
|||||||
|
1969 |
1979 |
1989 |
2003 |
1969 |
1979 |
1989 |
2003 |
|
|
Australie |
65 |
65 |
65 |
65 |
60 |
60 |
60 |
62,5 |
|
Autriche |
65 |
65 |
65 |
65 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
Belgique |
65 |
65 |
65 |
65 |
60 |
60 |
60 |
63 |
|
Canada |
66 |
65 |
65 |
65 |
66 |
65 |
65 |
65 |
|
Danemark |
67 |
67 |
67 |
65 |
67 |
67 |
67 |
65 |
|
Finlande |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
|
France |
65 |
65 |
60 |
60 |
65 |
65 |
60 |
60 |
|
Allemagne |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
|
Grèce |
60 |
60 |
65 |
65 |
55 |
55 |
60 |
65 |
|
Islande |
67 |
67 |
67 |
67 |
-- |
-- |
-- |
67 |
|
Irlande |
70 |
66 |
66 |
66 |
70 |
66 |
66 |
66 |
|
Italie |
60 |
60 |
60 |
65 |
55 |
55 |
55 |
65 |
|
Japon |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
|
Corée |
-- |
-- |
60 |
60 |
-- |
-- |
60 |
60 |
|
Luxembourg |
65 |
65 |
65 |
65 |
62 |
60 |
65 |
65 |
|
Pays-Bas |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
|
Norvège |
70 |
67 |
67 |
67 |
70 |
67 |
67 |
67 |
|
Nouvelle-Zélande |
65 |
60 |
60 |
65 |
65 |
60 |
60 |
65 |
|
Portugal |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
62 |
62 |
65 |
|
Espagne |
65 |
65 |
65 |
65 |
55 |
65 |
65 |
65 |
|
Suède |
67 |
65 |
65 |
65 |
67 |
65 |
65 |
65 |
|
Royaume-Uni |
65 |
65 |
65 |
65 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
États-Unis |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
Source : OCDE
L'âge d'ouverture est majoritairement fixé à 65 ans. Mais, la France se singularise, avec la Corée notamment, par un âge plus précoce.
Dans la majorité des pays de l'OCDE, l'âge normal de départ à la retraite est resté constant depuis la fin des années 60. Dans les pays où des changements sont intervenus, il a généralement baissé dans les années 70 et 80 avant d'augmenter dans quelques cas depuis le début des années 90.
S'agissant du montant des pensions , l'indicateur le plus fréquent est le taux de remplacement, qui est le rapport entre les prestations annuelles et la rémunération perçue juste avant le départ à la retraite.
Sur la base d'hypothèses simplificatrices, qu'il est nécessaire de poser compte tenu de la très grande complexité et hétérogénéité des systèmes, on peut faire le constat que les taux de remplacement anticipés ont augmenté dans une vaste majorité des pays de l'OCDE entre la fin des années 60 et la fin des années 80 .
TAUX DE REMPLACEMENT MOYENS ANTICIPÉS AU COURS
DES CINQ PROCHAINES ANNÉES DANS LES RÉGIMES DE RETRAITE - MOYENNE
DE SIX SITUATIONS
(TROIS NIVEAUX DE RÉMUNÉRATION ET DEUX
SITUATIONS DE FAMILLE)
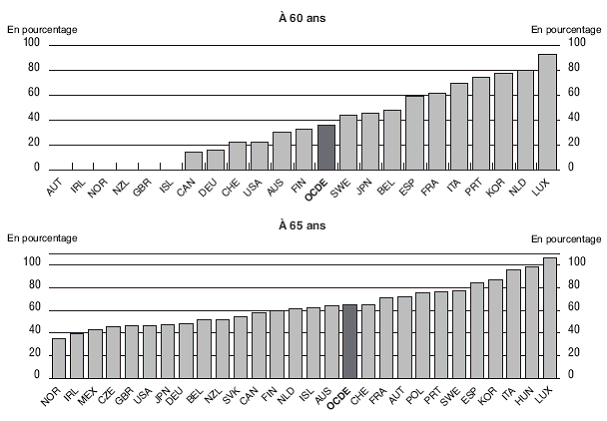
Note de lecture : en moyenne, dans l'OCDE, le taux de remplacement du salaire par la pension est de 38 % à 60 ans et de 62 % à 65 ans.
Source : OCDE
L'augmentation des taux de remplacement à 60 ans a été due essentiellement à une baisse de l'âge des préretraites, alors qu'à 65 ans, elle s'explique essentiellement par un relèvement des niveaux de pensions. En revanche, depuis le début des années 90, les taux de remplacement se sont stabilisés (à 65 ans) ou ont baissé (à 60 ans) .
Cependant, ces tendances générales masquent des différences marquées entre pays . Si les taux de remplacement anticipés sont restés assez stables dans certains pays ces trois dernières décennies, ils ont augmenté très sensiblement dans d'autres (Espagne, Finlande, Pays-Bas, Suède à 60 ans ; Espagne, Finlande, Suède et, dans une moindre mesure, Irlande et Norvège à 65 ans).
On relève ainsi que les taux de remplacement bruts moyens à 60 et 65 ans diffèrent sensiblement suivant les pays de l'OCDE. A 60 ans, ils s'échelonnent de zéro dans les pays où l'âge d'ouverture des droits est au moins de 65 ans (Autriche, Irlande, Islande, Norvège, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni) à plus de 70 % dans plusieurs pays (Corée, Espagne, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal). A 65 ans, ils s'échelonnent de moins de 40 % en Irlande et en Norvège à 100 % en Hongrie et au Luxembourg.
La France se caractérise par une situation plus favorable que la moyenne à 60 ans (taux de remplacement de 50 % contre 35 %) mais cet avantage relatif est nettement moindre dès 65 ans (taux de remplacement de 70 % contre 62 %) . Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Irlande présentent des taux de remplacement beaucoup plus faibles, de l'ordre de 20 points de moins que la moyenne.
En bref, comme pour la condition d'âge d'ouverture des droits à prestations, la France occupe une position plutôt moins incitative à la poursuite de l'activité que la moyenne au regard du niveau du taux de remplacement.
Mais, cette situation ne doit pas nécessairement être interprétée comme le signe que le système de retraite français comporterait des avantages si élevés qu'ils décourageraient de ce fait la poursuite de l'activité.
En premier lieu, la cessation d'activité se traduit par une baisse du revenu courant qui n'est jamais négligeable. En eux-mêmes, les systèmes de retraite ne peuvent être considérés comme comportant des incitations financières à la cessation d'activité. Ce n'est qu'à raison de l'arbitrage entre « pénibilité » du travail et réduction du revenu, que les systèmes de retraite peuvent contenir une incitation à l'inactivité. Mais d'autres mécanismes patrimoniaux ont aussi cet effet.
Il en va ainsi des revenus du patrimoine individuel qui ne sont pas pris en compte dans les comparaisons de taux de remplacement précitées, ce qui, compte tenu des arrangements institutionnels aux termes desquels certains pays favorisent l'épargne retraite plus que d'autres, tend sans doute à exagérer les différences internationales de taux de remplacement.
Mais, une autre variable très importante doit encore être prise en compte. La diversité des taux de remplacement pourrait être assez largement le résultat de performances très inégales d'inclusion des personnes dites « seniors » dans l'emploi . On doit remarquer que plus la situation de ces personnes est dégradée, plus les taux de remplacement sont facialement élevés. Ainsi, la désincitation au travail des « personnes d'un certain âge » pourrait être attribuée davantage à des conditions de salaire et d'emploi désincitatives qu'à une situation favorable des revenus de remplacement servis à eux.
Outre les taux de remplacement qu'offrent les régimes de retraite, il faut considérer leur neutralité actuarielle . Si elle n'est pas acquise, elle peut influencer le choix de rester en activité ou, au contraire, de se retirer du marché du travail.
Rester sur le marché de l'emploi une année de plus se traduit par la perte d'une année de prestations . Si le coût en termes de prestations perdues et de cotisations versées est exactement compensé par une hausse des pensions futures, on dit que le régime de retraite est « neutre » du point de vue actuariel, mais si ce coût n'est pas compensé, il y a alors un impôt implicite sur la poursuite de l'activité professionnelle .
Dans le premier cas, le régime de retraite ne comporte en lui-même aucune incitation particulière et l'arbitrage entre l'activité et la retraite dépend d'autres variables. Dans le second cas, la poursuite de l'activité réduit le rendement des droits à la retraite.
Il serait par conséquent souhaitable d'identifier l'existence d'éventuelles distorsions de cette nature afin de les éliminer pour réduire les incitations au retrait de l'emploi.
4. Enrichir les assurances et prestations sociales d'une dimension qualitative
Ainsi qu'on le constate dans la dernière partie du présent rapport, une partie importante des prestations sociales est concentrée sur les populations les plus défavorisées, même si notre pays a adopté un régime de protection sociale dont une des caractéristiques majeures est l'universalité.
Derrière ce principe, on peut cependant nuancer pour tenir compte des réalités socioéconomiques. Qualitativement, certaines dépenses publiques relèvent plutôt de l'assistance que de l'assurance, soit par leur nature même, soit à raison des conditions d'existence que connaissent leurs bénéficiaires.
La portée d'une même dépense publique ne peut être la même dans l'un et l'autre cas. Et pourtant, il semble que la protection sociale ignore souvent ces différenciations qualitatives dont la prise en compte semble conditionner l'efficacité de la couverture sociale.
Tout se passe trop souvent comme si le versement d'un revenu de remplacement ou de complément pouvait tenir lieu, à soi seul, d'une politique sociale.
C'est dans le domaine des politiques sociales portant sur le fonctionnement du marché du travail que les doutes sur une pareille façon de voir ont jusqu'à présent connu leur expression la plus achevée.
Les dépenses publiques directement liées au fonctionnement du marché du travail s'élevaient à 2,3 % du PIB de l'Union européenne en 2003 . Cette moyenne s'accompagne d'une dispersion assez nette. En outre, la répartition des dépenses entre les différents types de dépenses pour le marché du travail varie sensiblement.
DÉPENSES PUBLIQUES EN FAVEUR DES POLITIQUES DU
MARCHÉ DU TRAVAIL
EN POURCENTAGE DU PIB - 2003
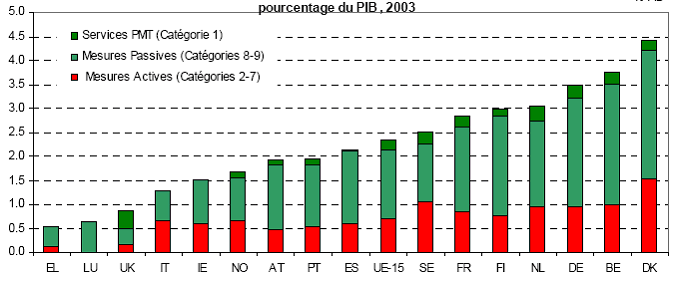
Source : EUROSTAT, Base de données des politiques du marché du travail, Juin 2005
|
MÉTHODES
- Les interventions recensées par Eurostat relèvent de plusieurs rubriques . Les dépenses liées au marché du travail sont ventilées en trois groupes principaux : - Services PMT : il s'agit des services généralement rendus par les organismes publics de l'emploi, auxquels les participants s'adressent pour rechercher un emploi, principalement des services de placement. - Mesures actives : les mesures actives comprennent les dispositifs qui ne sont pas dans le champ de la simple indemnisation. Elles incluent notamment les dispositifs de formation.
-
Mesures passives
: ce sont
des mesures fournissant des aides
- Les statistiques réunies par Eurostat pour rendre compte des dépenses consacrées au marché du travail reposent sur une conception plutôt restrictive des actions dont il s'agit . - Les dépenses retracées sont des dépenses publiques, ce qui exclut les dépenses privées . Celles-ci ne sont pourtant pas négligeables. Les dépenses de solidarité familiale peuvent se substituer ou compléter les systèmes d'indemnisation. C'est une des explications usuellement avancées pour expliquer la faiblesse relative de leur niveau dans les pays du Sud de l'Europe. De la même manière, les dépenses privées de recherche d'emploi ne sont pas retracées : elles peuvent être importantes qu'il s'agisse de dépenses de formation ou de dépenses d'information sur les emplois disponibles. Pourtant, le niveau des dépenses privées ne semble recensé nulle part. Cette lacune réduit la capacité à évaluer les dépenses publiques et à comparer les pays entre eux. - Par ailleurs, les dépenses publiques recensées par Eurostat comme liées directement au fonctionnement du marché du travail excluent un très grand nombre d'interventions pouvant influencer le marché du travail. Tel est le cas des mesures recensées dans le cadre de la politique de l'emploi. La frontière entre les deux politiques est pourtant ténue même si la politique de l'emploi mobilise des moyens plus diversifiés et plus importants. Les dépenses consacrées au marché du travail comportent des rubriques dédiées aux politiques d'incitations à l'embauche ou au partage de l'emploi lorsque les dépenses d'exonération de charges sociales sont ciblées. Les exonérations autour du SMIC ne sont pas prises en compte. De la même manière, les mesures d'incitation à la reprise d'un emploi, comme la prime pour l'emploi (PPE) française ou le dispositif anglais de Working Families Tax Credit (WFTC) sont exclues des politiques publiques du marché du travail. |
Les dépenses publiques liées au fonctionnement du marché du travail représentent une proportion relativement minime des dépenses de protection sociale.
Cependant, le niveau d'intervention publique est très variable dans ce domaine et les différences observées rendent compte d'une partie non négligeable des écarts de dépenses publiques sociales dans l'Union européenne.
Par exemple, l'écart entre la France et le Royaume-Uni de 6,6 points de PIB tombe à 4,6 points de PIB quand on « néglige » ces dépenses, dont le niveau est directement fonction du taux d'indemnisation mais aussi, et principalement, du taux de chômage.
L'écart à la moyenne s'étage entre + 2,1 points de PIB pour le pays dépensant le plus (le Danemark) et - 1,8 point de PIB pour le pays le plus économe en la matière (la Grèce). Le ratio des dépenses publiques consacrées à ce domaine entre le Danemark et la Grèce s'élève à 7,3 (pour un écart en points de PIB de 3,9), ce qui est considérable.
La valeur de ce ratio est encore plus importante lorsqu'on l'applique aux différentes catégories d'intervention. Les 2/3 des dépenses relèvent de la catégorie des dépenses passives qui représentent partout (sauf en Italie) la majorité des dépenses totales.
RÉPARTITION DES DÉPENSES DE POLITIQUE DU
MARCHÉ DU TRAVAIL
ENTRE LES MESURES ACTIVES ET PASSIVES
1998 ET
2003
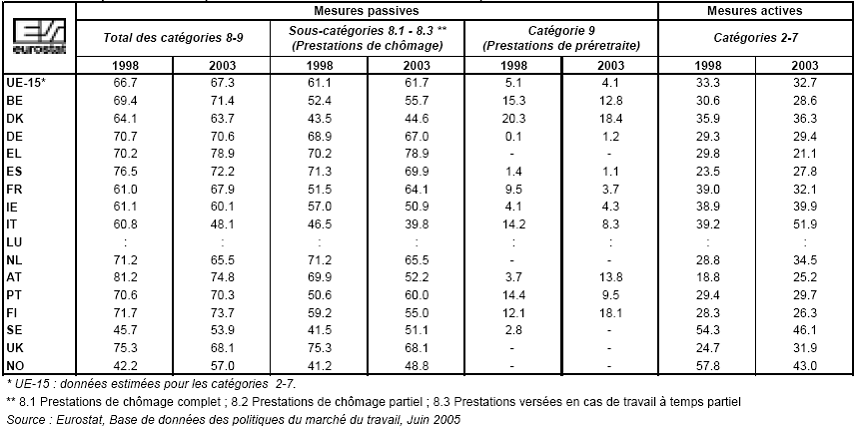
Il s'agit, pour l'essentiel, de dépenses de prestations de chômage , le reliquat étant des dépenses de préretraite.
Au vu des données ici réunies, les dépenses passives d'indemnisation semblent n'avoir pas rétrogradé entre 1998 et 2003, en dépit des recommandations visant à l'activation des dépenses de l'emploi et malgré la baisse du taux de chômage intervenue dans l'Union européenne entre 1998 et 2003 (-1,3 point soit de 9,3 % à 8 %).
STRUCTURE DES DÉPENSES
PUBLIQUES
CONSACRÉES AUX POLITIQUES DU MARCHÉ DU TRAVAIL
EN
POURCENTAGE DU PIB, 2003
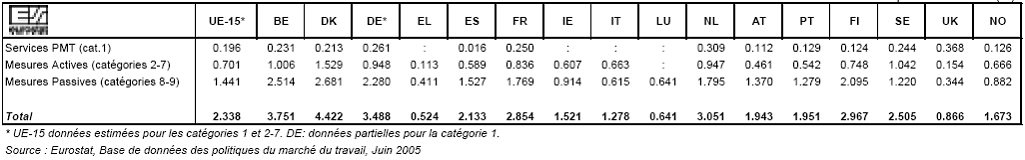
Lorsque les dépenses publiques consacrées au marché du travail sont faibles, l'essentiel peut être consacré aux indemnisations comme au Royaume-Uni ou en Grèce .
Cependant, des pays font un effort particulier pour que les dépenses d'indemnisation soient accompagnées de dépenses plus qualitatives .
Il s'agit souvent de pays dans lesquels les indemnités sont comparativement élevées .
Les dépenses actives ne se substituent pas aux indemnités ; elles les complètent et il semble donc un peu illusoire d'imaginer qu'elles puissent se traduire, à court terme, par une économie de dépenses publiques .
Mais, au regard de l'efficacité de l'intervention publique, le résultat est sans doute plus encourageant, même si la corrélation négative entre dépenses actives du marché du travail et taux de chômage - v. les données infra - n'est pas systématique et ne doit pas être considérée comme explicative.
TAUX DE CHÔMAGE DANS L'UNION EUROPÉENNE EN 2006
|
Nombre total de chômeurs
|
Taux de chômage (en %) |
|||
|
Ensemble |
Hommes |
Femmes |
||
|
Allemagne |
3 431,8 |
8,4 |
7,7 |
9,2 |
|
Autriche |
196,3 |
4,8 |
4,4 |
5,2 |
|
Belgique |
383,2 |
8,2 |
7,4 |
9,3 |
|
Chypre |
17,6 |
4,7 |
4,1 |
5,5 |
|
Danemark |
113,8 |
3,9 |
3,3 |
4,5 |
|
Espagne |
1 837,1 |
8,5 |
6,3 |
11,6 |
|
Estonie |
40,5 |
5,9 |
6,2 |
5,6 |
|
Finlande |
204,3 |
7,7 |
7,4 |
8,1 |
|
France métropolitaine |
2 629,3 |
9,4 |
8,6 |
10,4 |
|
Grèce |
434,5 |
8,9 |
5,6 |
13,6 |
|
Hongrie |
316,7 |
7,5 |
7,2 |
7,8 |
|
Irlande |
93,4 |
4,4 |
4,6 |
4,1 |
|
Italie |
1 673,4 |
6,8 |
5,4 |
8,8 |
|
Lettonie |
79,5 |
6,8 |
7,4 |
6,2 |
|
Lituanie |
89,4 |
5,6 |
5,8 |
5,4 |
|
Luxembourg |
9,7 |
4,7 |
3,5 |
6,2 |
|
Malte |
12,0 |
7,3 |
6,5 |
9,1 |
|
Pays-Bas |
335,7 |
3,9 |
3,5 |
4,4 |
|
Pologne |
2 344,3 |
13,8 |
13,0 |
14,9 |
|
Portugal |
427,8 |
7,7 |
6,5 |
9,0 |
|
République tchèque |
371,7 |
7,1 |
5,8 |
8,8 |
|
Royaume-Uni |
1 595,7 |
5,3 |
5,7 |
4,9 |
|
Slovaquie |
355,4 |
13,4 |
12,3 |
14,7 |
|
Slovénie |
60,8 |
6,0 |
4,9 |
7,2 |
|
Suède |
325,9 |
7,0 |
6,9 |
7,1 |
|
UE à 25 |
17 379,9 |
7,9 |
7,1 |
9,0 |
|
Bulgarie |
305,7 |
9,0 |
8,6 |
9,3 |
|
Roumanie |
728,4 |
7,3 |
8,2 |
6,1 |
|
UE à 27 |
18 414,0 |
7,9 |
7,1 |
8,8 |
Champ : données non désaisonnalisées et harmonisées, en moyenne annuelle.
Source : Eurostat, base de données (extraction en juin 2007).
En toute hypothèse, on pourrait s'inspirer dans d'autres secteurs de la couverture sociale de la démarche qualitative suivie dans le domaine des politiques du marché du travail .
CHAPITRE III - LES DÉPENSES PUBLIQUES CONTRE LE POUVOIR D'ACHAT ? UN ARGUMENT QUI REPOSE SUR DES CONVENTIONS STATISTIQUES FRAGILES
Le débat sur le pouvoir d'achat est parfois l'occasion de mettre en cause les dépenses publiques. Leur augmentation ou leur niveau nuirait au pouvoir d'achat des ménages. Une réduction des dépenses publiques aurait des effets bénéfiques sur celui-ci.
Il est difficile de trouver une explicitation de ces affirmations qui, pour être récurrentes, ne sont jamais accompagnées du « mode d'emploi » qui permettrait de les comprendre.
Toutefois, on peut imaginer deux sortes de fondements à l'appui de cette thèse :
- les dépenses publiques réduiraient la croissance économique en allouant le revenu de façon inefficace , ce qui aurait pour impact final de diminuer le pouvoir d'achat ;
- les dépenses publiques, en élevant le taux d'imposition, pèseraient sur le revenu des ménages .
Le premier argument, qui se résume à établir un lien négatif entre dépenses publiques et croissance économique, a été examiné en détail dans les parties précédentes du présent chapitre.
C'est au second qu'on souhaite consacrer quelques développements dans cette partie. En focalisant le projecteur sur les prélèvements obligatoires et en négligeant totalement leurs contreparties, cet argument traite les dépenses publiques comme si elles n'avaient aucun impact favorable sur le pouvoir d'achat.
Il faut dire d'emblée que cette thèse tire parti de ce que la relation entre dépenses publiques et pouvoir d'achat est rendue extrêmement confuse par l'emploi d'indicateurs qui en donnent des aperçus tronqués et peu clairs .
L'utilisation très fréquente de ces indicateurs dans le débat public - à savoir le « revenu disponible brut » des ménages, solde intermédiaire de la comptabilité nationale, et le « coin fiscalo-social » 79 ( * ) - oblige votre rapporteur à leur consacrer d'assez amples développements.
Les imperfections de ces indicateurs, qui sont les outils à partir desquels le pouvoir d'achat des ménages est apprécié et se trouve soutenue la thèse d'un effet défavorable des dépenses publiques sur le pouvoir d'achat, sont telles que des éclaircissements s'imposent. Ils montreront notamment qu'ils prennent très mal en compte l'apport des dépenses publiques au pouvoir d'achat.
On doit ainsi, dépassant ce constat d'insuffisance des instruments de mesure habituels, conclure des données plus pertinentes disponibles à une indifférence du niveau du pouvoir d'achat , vu globalement, et non catégorie sociale par catégorie sociale, au niveau des dépenses publiques, mais aussi à la nécessité d'envisager quelques méthodes propres à mieux appréhender la contribution des dépenses publiques au niveau de vie .
Les biais des indicateurs utilisés pour apprécier le pouvoir d'achat des ménages ont majoritairement pour effet de minorer la contribution des dépenses publiques à celui-ci.
Il en est toutefois un qui va dans le sens inverse en introduisant une rupture avec les règles habituellement appliquées pour mesurer le pouvoir d'achat. Il s'agit de l' intégration des dépenses publiques financées par emprunt et versés aux ménages dans les ressources à partir desquelles on estime leur pouvoir d'achat .
|
UNE APPLICATION ASYMÉTRIQUE DES CONVENTIONS DE LA COMPTABILITÉ NATIONALE PEUT CONDUIRE À SURESTIMER LE POUVOIR D'ACHAT DES MÉNAGES 1) Certaines ressources incluses dans le revenu disponible des ménages sont financées par l'emprunt La comptabilité nationale invite à appréhender le pouvoir d'achat du revenu courant des ménages à partir d'une grandeur - le revenu disponible brut des ménages . Par là, le choix est fait de se focaliser sur le revenu courant, choix fondé, sur l'idée que seul ce revenu peut vraiment être considéré comme significatif du point de vue économique. Il exclut de prendre en compte les ressources, considérées comme exceptionnelles, que les ménages retirent sporadiquement de leurs opérations financières : les ressources qu'ils peuvent tirer de leurs emprunts ne sont pas incluses dans le revenu disponible des ménage qui servent à mesurer leur pouvoir d'achat 1 . Mais, la logique de cette convention, n'est pas pleinement appliquée. En effet, dans la situation où les ménages bénéficient de ressources versées par des tiers, recourant à l'emprunt pour les leur attribuer, elle considère ces ressources comme courantes et les prend en considération pour apprécier le pouvoir d'achat des ménages, solution qui, on l'a vu, est exclue lorsque ceux-ci recourent eux-mêmes à l'endettement . Tel est le cas pour une partie des transferts des administrations publiques aux ménages dès lors que les administrations publiques sont en déficit et doivent faire appel aux emprunts publics. En bref, une partie plus ou moins importante du revenu des ménages peut correspondre à des ressources couvertes par l'emprunt qui, en toute logique, ne devraient pas être prises en compte pour mesurer le pouvoir d'achat des ménages. On peut ainsi dire que, dans certaines configurations, les dépenses publiques, loin de l'amputer, gonflent mécaniquement le pouvoir d'achat des ménages , ce qui peut conduire à des appréciations erronées, notamment dans le cadre de comparaisons de pouvoir d'achat, dans le temps et entre pays*.
1 Cette convention peut sembler justifiée par son fondement, mais la capacité d'extraire des ressources auprès du système bancaire pourrait aussi être considéré comme un élément à part entière du train de vie des ménages, d'autant qu'elle n'est pas uniformément distribuée dans la population. Il conviendrait ainsi de compléter les indicateurs de pouvoirs d'achat par des indicateurs de train de vie pour prendre en compte les données patrimoniales à côté des données concernant les seuls revenus courants. 2) Une incohérence comptable mais pas nécessairement économique - Le point de vue présenté ci-dessus montre l'existence d'une incohérence comptable dans les modalités habituelles d'appréciation du pouvoir d'achat. Mais on doit envisager si, d'un point de vue plus économique, cette dualité d'application peut être justifiée. La question est de savoir si, économiquement, on peut trouver quelque motif à exclure les emprunts directement contractés par les ménages du champ des ressources à partir desquelles on apprécie leur pouvoir d'achat, et dans le même temps à intégrer à ces ressources des moyens procurés aux ménages à partir de l'endettement d'une tierce personne (ici l'État). - Si tel était le cas, on pourrait trouver qu'à imputer systématiquement aux dépenses publiques la responsabilité d'être à la source de prélèvements obligatoires qui pèseraient sur le pouvoir d'achat, il existerait une première objection pour les dépenses publiques qui ne sont pas financées par l'impôt (mais par des recettes non fiscales ou par des emprunts publics, ressources qui ne sont pas déduites du revenu des agents). Pour estimer que les dépenses publiques financées par emprunt doivent être comptées comme toute autre dépense publique dont les ménages bénéficient à leur profit, on peut faire valoir que l'endettement de l'État n'est pas équivalent à l'endettement des ménages puisque seul le premier est engagé. En ce sens, on peut ajouter que c'est d'ailleurs une des fonctions essentielles de l'État que d'être un intermédiaire financier au service des agents économiques et que dans ce rôle, il est particulièrement providentiel puisque, non seulement il se substitue aux agents pour lever des emprunts (auxquels des agents n'auraient peut-être pas pu accéder), mais encore il les décharge de tout souci de remboursement. Cette façon de voir est trop simple cependant et il faut nuancer à partir de plusieurs hypothèses. - Dans l'hypothèse où les dépenses publiques sont couvertes par l'emprunt, des biens et services ou encore des ressources monétaires, sont mis à disposition des agents moyennant le coût de la dette. L'effet sur le pouvoir d'achat est, à court terme, favorable puisque les agents disposent de ressources qui, sans être gratuites, ne sont pas payées instantanément à leur coût total. Cependant, à long terme, le bilan des dépenses publiques ainsi financées est neutre, sauf si ces dépenses modifient la croissance économique, ou si elles sont structurellement financées par emprunt , ce qui peut arriver si l'État rembourse ses emprunts par d'autres emprunts. - Dans l'hypothèse où les dépenses publiques sont financées par des prélèvements obligatoires, la neutralité de leurs effets sur le pouvoir d'achat est instantanée . Ce qui est dépensé est immédiatement prélevé avec un impact global nul sur le pouvoir d'achat. L'impact à long terme des dépenses publiques sur le pouvoir d'achat dépend alors, comme quand les dépenses publiques sont financées par l'emprunt, de leur effet sur le régime de croissance économique . De cette typologie, on peut tirer quelques conclusions. - Le pouvoir d'achat au sens de la comptabilité nationale, c'est à dire la capacité de convertir un revenu courant en biens et services, n'est structurellement impacté par les dépenses publiques (globalement) qu'à la condition que celles-ci modifient le rythme de la croissance. On en revient alors au débat sur les effets des dépenses publiques sur la croissance économique et le bien-être. - Si l'on suppose que les dépenses publiques sont sans effets sur le rythme de croissance, les modalités de financement des dépenses publiques peuvent modifier le pouvoir d'achat de générations imbriquées en fonction du décalage dans le temps entre la mise à disposition de ressources des ménages et le financement de ces ressources . De ce point de vue des dépenses publiques financées par l'emprunt permettent d'améliorer le bien-être des générations actuelles, mais pas des générations à venir 80 ( * ) . - Une hausse permanente de l'endettement public permet de mettre à disposition des ressources économiques moyennant le seul paiement d'un intérêt . Mais, la soutenabilité d'une telle configuration est en cause si les dépenses publiques correspondantes n'augmentent pas le rythme de croissance . L'obsolescence des « biens » ainsi financés oblige à leur renouvellement et induit un endettement cumulatif, ou le recours à l'autofinancement pour les remplacer. Dans ce dernier sens, l'effet favorable sur le pouvoir d'achat aura été concentré sur une génération. * Au total, la mesure de la contribution des ressources acquises en contrepartie d'emprunts au pouvoir d'achat des ménages est peu satisfaisante : tantôt ces ressources sont systématiquement écartées de l'assiette de référence du pouvoir d'achat (celles directement octroyées aux ménages en contrepartie de leur endettement propre), tantôt elles sont prises en compte (du moins partiellement compte tenu des imperfections du revenu disponible des ménages exposées ci-après). A supposer que l'endettement public atteigne un niveau important, et qu'il serve à financer des transferts monétaires aux ménages, ces conventions comptables, à la cohérence discutable, peuvent conduire : - à gonfler le revenu disponible des ménages de ressources provenant en réalité de l'endettement, - et affecter la signification des comparaisons intertemporelles ou internationales, puisque les éléments pris en compte peuvent ne pas être homogènes. Il conviendrait de corriger ces incohérences et, à tout le moins, de mieux apprécier l'impact sur le pouvoir d'achat des ressources procurées aux ménages par l'emprunt qu'il soit directement contracté par eux ou non. * Lorsqu'un pays connaît un déficit public et qu'une partie des prestations en espèces ou en nature à destination des ménages est financée par l'emprunt, tout se passe comme si les administrations publiques s'endettent à la place des ménages. |
Cependant, les conventions statistiques utilisées pour apprécier le niveau de vie des ménages ont plutôt tendance à négliger la contribution des dépenses publiques.
Aussi peut-on affirmer que, dans les pays où le niveau des dépenses publiques est relativement élevé, le pouvoir d'achat des ménages est systématiquement sous-estimé . En effet, toute une série de dépenses publiques , qui servent à fournir des ressources aux ménages, ne sont pas comptabilisés comme telles.
Cette situation rend délicates les comparaisons internationales de pouvoir d'achat et les appréciations relatives à son évolution dans le temps.
I. DES DÉPENSES PUBLIQUES, CRÉATRICES DE RESSOURCES POUR LES MÉNAGES, NE SONT PAS PRISES EN COMPTE EN TOTALITÉ COMME TELLES
Si l'ensemble des prélèvements obligatoires directs (cotisations sociales, impôt sur le revenu) imposés aux ménages viennent en déduction de leur revenu, seules les dépenses publiques de transferts monétaires sont inscrites en ressources .
Les autres biens et services publics , qui peuvent être la contrepartie de prélèvements qu'ils acquittent, ne sont pas considérés comme des ressources des ménages.
|
EXEMPLE DE BIAIS DUS À LA NON PRISE EN COMPTE
Soit deux pays avec un revenu des ménages identique de 1 000 euros , l'un (PAYS X) dans lequel l'éducation est obligatoire et gratuite, financée par des prélèvements sur revenus ; l'autre (PAYS Y) dans lequel l'éducation est privée et payante (et de même coût que dans le premier). * Le revenu disponible des ménages du PAYS X sera de :
* Le revenu disponible des ménages du pays Y sera de :
Si les ménages des deux pays ont des préférences pour l'éducation identiques, la différence de pouvoir d'achat entre les deux pays est purement apparente. Supposons que le revenu de départ passe uniformément dans les deux pays à 1 100 euros et que le coût de l'éducation passe à 580 euros, * Le pouvoir d'achat du revenu disponible des ménages du PAYS X évolue comme suit :
Soit une augmentation relative de 4 % et une augmentation absolue de 20 € * Le pouvoir d'achat du revenu disponible des ménages du PAYS Y évolue comme suit :
Soit une augmentation relative de 10 % comme dans le PAYS X, mais une augmentation absolue de 100 €, soit le double du PAYS X Les comparaisons relatives et absolues de pouvoir d'achat perdent alors toute signification, si les préférences pour l'éducation (de consommation d'éducation) sont identiques. |
Cette convention introduit des biais importants dans les comparaisons internationales ou intertemporelles de pouvoir d'achat fondées sur la considération des revenus disponibles des ménages.
Elle altère aussi profondément la signification des « coins fiscalo-sociaux », indicateur souvent utilisé dans le débat public (voir annexe n° 5), pour montrer notamment que le niveau des prélèvements obligatoires ampute le pouvoir d'achat du revenu qui les subit .
Cette dernière conclusion, pour être apparemment juste dans le cadre de la Comptabilité nationale, ne l'est que parce que la Comptabilité nationale n'est pas parfaitement adaptée pour saisir la réalité du pouvoir d'achat des ménages .
De fait, les prélèvements à la charge des salariés ont des contreparties (celles qui ne prennent pas la forme des transferts monétaires versés aux ménages) ignorées par l'indicateur du « coin fiscalo-social » mais aussi, pour une partie d'entre elles, dans les ressources des ménages recensées dans leur revenu disponible brut . Tel est le cas des biens et services publics qui profitent aux ménages : sûreté, défense, justice, santé, éducation,...
Or, ces services, qui sont, soit manquants, soit payants quand les prélèvements obligatoires n'en assurent pas le financement, devraient être pris en compte dans les revenus courants des ménages pour avoir une plus juste idée de leur pouvoir d'achat.
Les comptables nationaux ont d'ailleurs cherché à combler cette lacune en ajoutant à la trop restrictive notion de revenu disponible brut un second concept « le revenu disponible ajusté » des ménages.
Celui-ci ajoute au revenu disponible brut les services publics dont la consommation est individualisable : l'enseignement, la santé pour l'essentiel. La correction entreprise n'est pas encore entièrement satisfaisante puisque des services et biens publics qui peuvent donner lieu à des dépenses privées lorsque l'intervention publique n'y pourvoit pas (la sûreté, l'environnement,...) sont omis. Mais il faut déjà reconnaître au revenu disponible ajusté des ménages la vertu d'être beaucoup plus représentatif que le revenu disponible brut du vrai pouvoir d'achat des ménages et de permettre des comparaisons plus exactes. Il reste à souhaiter que cette convention comptable internationale soit appliquée par tous les pays concernés et fasse l'objet de publications aussi systématiques que celles relatives au revenu disponible brut, notamment dans le cadre de l'OCDE, ce qui n'est pas encore le cas.
II. TENTATIVES DE RÉESTIMATION DU POUVOIR D'ACHAT DES MÉNAGES À PARTIR D'UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES CONTREPARTIES DES DÉPENSES PUBLIQUES
A. DU REVENU DISPONIBLE BRUT AU REVENU AJUSTÉ
Il est difficile en l'état de corriger pour tous les pays les informations données sur le pouvoir d'achat par les revenus disponibles bruts.
Toutefois, des tentatives de réestimation des pouvoirs d'achat peuvent être entreprises.
Les dépenses publiques au titre des services publics individualisables varient selon les pays .
Ces services représentent autour de 40 % du revenu des ménages en Suède et au Danemark, de 16 % à 18 % aux États-Unis, en Italie et au Royaume-Uni et autour de 22 % en Allemagne et en France .
DÉPENSES PUBLIQUES AU TITRE DE TRANSFERTS EN
NATURE
DANS LES PAYS DE L'OCDE EN 2000
(en pourcentage du revenu des ménages)
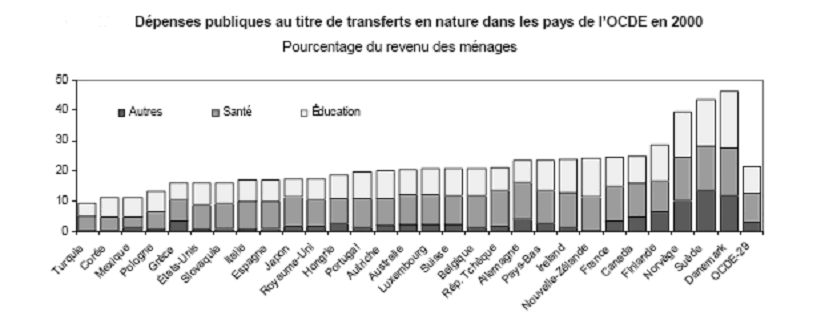 Source : OCDE
Source : OCDE
En moyenne , ces dépenses représentent l'équivalent de 21 % du revenu disponible des ménages . Environ 45 % de ces dépenses proviennent de la santé, 41 % des dépenses d'éducation et 14 % d'autres dépenses sociales (les services aux personnes âgées, la « dépendance », le logement et les politiques actives sur le marché du travail...).
Ainsi, le revenu disponible ajusté des ménages qui comprend, outre le revenu disponible brut des ménages, la contrepartie de leur consommation des services publics dont la consommation peut être individualisée est supérieur en moyenne, de plus de 20 % au revenu disponible brut des ménages .
On observe à quel point l'absence de prise en compte des services publics individualisables diminue artificiellement le revenu réel des ménages dans tous les pays. Par ailleurs, elle brouille les comparaisons internationales . En effet, ces services sont plus ou moins développés .
Dans les pays scandinaves, l'omission des services publics en cause a des effets si importants sur la perception du pouvoir d'achat à partir du revenu disponible brut des ménages qu'on peut dire que celle-ci n'a aucune signification réelle quant au véritable niveau de vie des ménages .
Pour les autres pays, les écarts entre « revenus disponibles » et « revenus disponibles ajustés » tournent autour d'un cinquième . Mais, les différences entre les revenus disponibles et les revenus ajustés dans les différents pays ne sont pas homogènes et la prise en compte des services publics dont la consommation est individualisable a parfois des effets significatifs.
Par exemple, le pouvoir d'achat est, en France, relevé de 5 points par rapport au pouvoir d'achat des États-Unis quand on réintègre les services publics individualisables .
B. LE « COIN FISCALO-SOCIAL », QUELLE SIGNIFICATION ?
Les malfaçons statistiques du revenu disponible se retrouvent amplifiées, dans l'indicateur dénommé « coin fiscalo-social » , qui est souvent utilisé dans les débats sur les incidences de l'intervention publique sur le pouvoir d'achat pour montrer que celle-ci réduit le pouvoir d'achat des ménages.
Cet indicateur ôte au revenu des ménages l'ensemble des prélèvements qu'ils acquittent mais fait l'impasse sur les transferts en nature et en espèces dont ils bénéficient et qui en sont la contrepartie .
Or, une mise en regard des « coins fiscalo-sociaux » bruts par pays et de l'équivalent-revenu des services publics que les prélèvements obligatoires sur les salaires financent, en tout ou partie, conduit à relativiser la signification des « coins fiscalo-sociaux » .
TAUX DE RESDISTRIBUTION APPARENTS DU « COIN
FISCALO-SOCIAL »
PAR LES SERVICES PUBLICS
INDIVIDUALISABLES
|
Pays |
Coin fiscalo-social 1 |
Transferts en nature 2 |
Ecarts |
|
|
(A) |
(B) |
B/A 3 |
A-B 4 |
|
|
Danemark |
41,4 |
45 |
108,7 |
- 3,6 |
|
Suède |
47,9 |
40 |
83,5 |
+ 7,9 |
|
Norvège |
37,3 |
38 |
101,9 |
- 0,7 |
|
Finlande |
44,6 |
27 |
60,5 |
+ 17,6 |
|
Canada |
31,6 |
22 |
69,6 |
+ 9,6 |
|
France |
50,1 |
22 |
43,9 |
+ 28,1 |
|
Nouvelle-Zélande |
20,6 |
21,5 |
104,4 |
_ 0,9 |
|
Irlande |
25,7 |
21 |
81,7 |
+ 4,7 |
|
Pays-Bas |
38,6 |
21 |
54,4 |
+ 17,6 |
|
Allemagne |
51,8 |
21 |
40,5 |
+ 30,8 |
|
Belgique |
55,4 |
20 |
36,1 |
+ 35,4 |
|
Suisse |
47,9 |
20 |
41,7 |
+ 27,9 |
|
Luxembourg |
35,3 |
20 |
56,7 |
+ 15,3 |
|
Australie |
28,3 |
19,8 |
70 |
+ 8,5 |
|
Autriche |
47,4 |
19,7 |
41,6 |
+ 27,7 |
|
Portugal |
36,2 |
19,5 |
53,9 |
+ 16,7 |
|
Royaume-Uni |
33,5 |
19 |
56,7 |
+ 14,5 |
|
Japon |
27,7 |
18,2 |
65,7 |
+ 9,5 |
|
Espagne |
39 |
18 |
46,1 |
+ 2,1 |
|
Italie |
45,4 |
18 |
39,6 |
+ 27,4 |
|
États-Unis |
29,1 |
17 |
58,4 |
+ 12,1 |
_______________
1 Impôt sur le revenu et cotisations sociales en pourcentage du coût salarial
2 Équivalent en pourcentage du revenu disponible
3 En pourcentage
4 En points
Dans le tableau ci-dessus, on met en regard du coin fiscalo-social la contrepartie des services publics individualisables en pourcentage du revenu disponible brut. La troisième colonne précise le rapport entre cette dernière valeur et celle des prélèvements pris en compte pour calculer les coins fiscalo-sociaux pour aboutir à un « taux de redistribution apparent » de ce dernier par les services publics dont la consommation est individualisable.
Le « taux apparent » de redistribution des prélèvements sur les ménages par quelques-unes des contreparties non prises en compte dans leur revenu dans cet indicateur (les seuls services publics dont la consommation est individualisable) excède systématiquement 40 %, sauf en Italie (39,6 %) et en Belgique (36,1 %).
Dans les pays scandinaves, l'effet revenu des services publics excède l'impact des prélèvements sur les salaires.
En France, il représente 43,9 % et, en Allemagne, 40,5 % du « coin fiscalo-social ».
Cette correction change en soi considérablement l'appréciation à laquelle la seule considération des coins fiscalo-sociaux conduit quant aux effets de l'intervention publique sur le niveau de vie des ménages.
Mais, les « taux apparents » de redistribution mentionnés dans la troisième colonne du tableau ci-dessus ne rendent pas encore complètement compte de la redistribution opérée par les dépenses publiques et il faut les corriger pour prendre l'exacte mesure de la redistribution aux ménages apportée par l'intervention publique et mesurer ainsi la portée des erreurs d'appréciation auxquelles conduisent certains indicateurs.
Les services publics individualisables bénéficient d'autres sources de financement (ce qui a tendance à exagérer la valeur du taux de redistribution), mais surtout les prélèvements qui composent le « coin » servent à financer d'autres interventions publiques que celles que recouvrent les transferts en nature ici comptabilisés : les transferts monétaires , les autres biens et services publics (sûreté, défense, environnement, administration générale...).
Il est, par conséquent, normal - compte tenu de leur méthode de construction - que dans les données du tableau ci-dessus, les transferts en nature ne couvrent qu'une partie des coins fiscalo-sociaux , d'autant que l'assiette du « coin fiscalo-social » est moins large que celle utilisée pour mesurer l'importance relative des transferts en nature qui est, elle, constituée de l'ensemble des revenus et non des seuls revenus salariaux.
En réalité, si on ajoutait aux revenus des ménages pris en compte pour calculer cet indicateur la totalité des avantages correspondant aux prélèvements déduits de leurs revenus salariaux, le prétendu coin fiscalo-social s'inverserait.
En effet, les prélèvements sur les revenus salariaux des ménages ne financent qu'une fraction des bénéfices publics en nature et en espèces qui leur sont attribués.
Au total, le coin fiscalo-social , contrairement à ce qui est trop souvent affirmé, ne rend nullement compte d'un quelconque effet de l'intervention publique sur le pouvoir d'achat des ménages.
Tout au plus, peut-on le considérer comme un indicateur du niveau relatif de la contribution des salariés au financement de ressources collectives, dont ils sont pour une part largement majoritaire, les bénéficiaires.
Il reste au fond une seule question . Si on constate, au niveau individuel, qu'il n'existe pas de correspondance entre les prélèvements subis et les avantages financés par ces prélèvements et consommés, ce qui, dans un système fiscal redistributif ne doit pas manquer de se vérifier, il devient probable que certains - les plus « contributifs » - cherchent à échapper à cette mécanique réductrice, pour eux, de revenus. Dans un monde où les frontières nationales s'effacent en partie, de tels phénomènes de nomadisme fiscal sont, en théorie, prévisibles. Le Sénat, dans plusieurs de ses excellents rapports, a tenté d'évaluer l'ampleur de ce phénomène dont l'actualité des faits divers - « l'évasion fiscale » au coeur de l'Europe - a rappelé récemment la réalité.
Ce n'est pas le sujet du présent rapport que de revenir sur cette question, et encore moins de proposer des solutions.
Il reste cependant à indiquer, à l'heure où le patriotisme économique est à la mode, que certains pays - les États-Unis notamment - savent donner à ce problème des réponses fiscales concrètes dont l'efficacité mériterait d'être appréciée.
III. LA CONTREPARTIE PRODUCTIVE DES DÉPENSES PUBLIQUES EST SOUS-ESTIMÉE
La prise en compte des dépenses publiques correspondant à des services publics dont la consommation est individualisable permet de corriger une lacune manifeste des approches dans lesquelles le pouvoir d'achat des ménages est apprécié sans considération de ces services publics.
Mais, cette correction n'est pas complètement satisfaisante :
- comme on l'a indiqué, certains services publics contribuant au bien-être des ménages restent ignorés ;
- par ailleurs, la méthode de valorisation des services publics demeure insatisfaisante .
Ce dernier problème pose une difficulté majeure puisqu'il jette un doute sur l'estimation de près d'un cinquième du PIB et qu'il trouble l'analyse de la contribution des dépenses publiques au bien-être .
A. UNE REMARQUE INCIDENTE
L' appréciation des dépenses publiques dans le débat politique, et , par conséquent, les conditions de formulation des choix d'allocation du revenu national, qui est une des fonctions majeures de la décision politique, ont longtemps été affectées par les présentations univoques conduisant à les considérer comme un indicateur satisfaisant de l'action publique .
Les concepteurs de la loi organique sur les lois de finances (la LOLF), c'est-à-dire les deux chambres du Parlement, ont manifesté qu'une telle approche des dépenses publiques était une erreur.
La LOLF appelle à les considérer pour ce qu'elles sont, des moyens au service des finalités de l'État. Elle invite à dépasser le stade de l'examen des seuls moyens pour le consacrer à celui de leur efficacité et de l'efficience des politiques publiques.
Cet appel à renouvellement des points de vue représente une ambition considérable, qui, en particulier, nécessiterait, outre un rehaussement des moyens du Parlement, et une diversification des méthodes pour apprécier au mieux la contribution des dépenses publiques aux différentes politiques publiques.
Sous cet angle, on peut estimer, par exemple, que le découpage par mission ou programme a sa justification, mais il devrait être accompagné d'évaluations plus transversales . L'approche par mission, qui reste privilégiée « surdétermine » l'appréciation de l'intervention publique. Elle incline à une appréciation gestionnaire et se révèle trop segmentée pour déboucher sur des évaluations plus stratégiques et des jugements entièrement cohérents.
A cet égard, des regroupements des moyens publics fondés sur d'autres cadres comptables que ceux de la comptabilité budgétaire pourraient utilement compléter les moyens à la disposition des « décideurs publics » .
L'utilisation des informations fournies par la comptabilité nationale relatives à la répartition des dépenses publiques, par nature ou par fonction, permettrait de compléter des points de vue centrés sur les dépenses de chacun des ministères , qui ne sont souvent qu'un des moyens de politiques plus complexes, ne serait-ce que par le nombre de leurs intervenants ou par la diversité de leurs moyens d'action.
Cependant, s'agissant des dépenses publiques, il conviendrait dans la logique de la LOLF de disposer d'informations plus complètes que celles qui sont aujourd'hui fournies par la comptabilité nationale .
Cette dernière observation conduit à revenir au problème de la valorisation des services publics non marchands, autrement dit de la partie de la production nationale qui correspond, à côté du PIB marchand, au PIB non-marchand .
B. COMMENT MIEUX MESURER LE PIB NON-MARCHAND ?
La production à prix courants des branches non-marchandes dans les comptes nationaux est évaluée par la somme des coûts . Les produits correspondants ne faisant, par définition, pas l'objet de transactions sur le marché (à la différence des branches marchandes), la production de ces branches ne peut pas être évaluée à partir des ventes.
Les coûts pris en compte sont depuis l'entrée en vigueur de la base 2000 de la Comptabilité nationale :
- la masse des rémunérations (salaires et cotisations sociales) ;
- les consommations intermédiaires que nécessite leur production ;
- les impôts et taxes liés à la production ;
- la consommation de capital fixe.
Hors la consommation de capital fixe (qui est calculée), ces coûts correspondent pour l'essentiel à des dépenses publiques .
Ainsi, la contribution des dépenses publiques 81 ( * ) à la production nationale est estimée , dans la comptabilité nationale,... au montant qu'elles atteignent . De même, la contrepartie productive de la variation des dépenses publiques est égale... à la variation de leur montant.
Avec une pareille méthode (dite « méthode basée sur l' input »), non seulement le volume de la production associée aux dépenses publiques ne peut être correctement apprécié, mais encore, l'évolution de cette production ne l'est pas. En effet, utiliser l'évolution du coût comme indicateur d'évolution des prix suppose qu'il n'y a pas de gains ou de perte de productivité des facteurs dont on mesure l'évolution des coûts.
C'est pourquoi une autre méthode a été proposée (méthode « basée sur l' output »). Il s'agit d' utiliser des indicateurs directs visant à estimer l'évolution réelle de la production au niveau le plus fin . Dans ce cas, on peut notamment estimer un indice de volume de la production non-marchande.
Historiquement, les méthodes employées pour estimer la production en volume de services non marchands associée aux dépenses publiques dans les comptes français ont varié. Dans un premier temps le caractère productif de ces activités n'était pas reconnu dans le système français, et on ne se préoccupait donc pas de partage volume-prix à propos de l'activité des administrations. Même lorsqu'on a commencé à évaluer une production non-marchande, en base 1971 82 ( * ) , le PIB « marchand » restait l'agrégat privilégié pour la mesure de la croissance ; le partage volume-prix de la production non-marchande était une question secondaire : pour déflater cette production, définie conventionnellement par ses coûts, il semblait naturel d'utiliser un indice de prix de ces mêmes coûts ; c'était donc la méthode « input » qui était utilisée. A l'époque, les branches non-marchandes étaient moins étendues, les hôpitaux étant considérés comme des services marchands (jusqu'à ce que leur mode de financement soit modifié par l'introduction des « dotations globales »). La base 1980 a innové en introduisant des indices de production directs pour la santé et l'éducation. Pour l'enseignement on utilisait comme indicateurs les effectifs ventilés en 12 types élémentaires d'enseignement. Avec la base 1995 on est cependant revenu à une méthode de type « input », les services individualisables n'étant plus traités différemment des autres services non-marchands.
Cependant dans le cadre de la préparation de la base 2000, et en raison des nouvelles recommandations internationales, on a commencé à se préoccuper de rechercher des méthodes donnant des indicateurs directs plus satisfaisants du point de vue de la prise en compte de la qualité et de l'évolution des pondérations.
La méthode « output » a été retenue pour les comptes nationaux français en base 2000. Elle a été introduite pour l'éducation non marchande dans les comptes publiés en mai 2005 et pour la santé non marchande dans ceux publiés en mai 2006 .
Le recours à une méthode de valorisation basée sur la production plutôt que sur les coûts de production peut avoir des incidences importantes comme le montre l'exemple de l'éducation non marchande.
|
SENSIBILITÉ DU VOLUME DE LA PRODUCTION NON
MARCHANDE
Les nouvelles évaluations conduisent à réviser à la baisse l'évolution du volume de la production d'éducation non marchande (cf. graphique) au cours de la période récente. En effet, l'évolution positive du volume en base 1995, quand la production était mesurée en fonction des coûts, traduisait l'augmentation des moyens mis en oeuvre, notamment l'amélioration de la qualification des enseignants et leur nombre. En base 2000, avec une évaluation de la production par les « output », la stagnation du volume constatée depuis 1996 est liée à l'évolution démographique (baisse des effectifs scolarisés dans certaines filières), non compensée par une augmentation de la fréquence de réussite aux examens ou un accès plus fréquent dans une classe de niveau supérieur. Le résultat garde un caractère conventionnel, lié à la manière encore fruste dont est appréhendé le volume d'éducation, en particulier l'effet qualité. Un travail d'harmonisation sur ce sujet est sans aucun doute nécessaire, sans lequel les comparaisons internationales, au sein de l'Union européenne elle-même, risquent d'être biaisées. ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION EN PRIX CHAÎNÉS EN BASE 95 ET BASE 2000 (en milliards d'euros, année 2000 comme année de référence)
|
Source : INSEE. Le partage volume-prix, base 2000. Michel Braibant.
Une généralisation de cette méthode permettrait :
- de mieux apprécier la contribution réelle des dépenses publiques à la production, et au bien-être ;
- et de réduire les biais de comparaison entre les niveaux de richesse par habitant entre pays, qui résultent de la variabilité de la production non-marchande .
CONCLUSION
Les relations entre les dépenses publiques et la croissance échappent à la simplification.
Les dépenses publiques sont bien loin d'être une catégorie unitaire. Elles sont elles-mêmes complexes et il n'y a qu'un point très ténu de recoupement entre une dépense de retraite et une dépense d'infrastructure.
En outre, les dépenses publiques penchent, pour certaines, du côté de la demande et, pour d'autres, du côté de l'offre sans que les effets des unes ou des autres ne s'arrêtent d'ailleurs à leur point d'application le plus immédiat, l'offre et la demande étant évidemment en interrelation.
Au total, les dépenses publiques et les dépenses privées ont sans doute beaucoup plus en commun au regard de la question de la croissance que des clivages habituels , mais vraisemblablement excessifs, ne le prétendent, du moins considérées sous un grand angle . Elles sont d'ailleurs pour une partie substituable.
Ce n'est évidemment pas à dire que les dépenses publiques puissent, ou doivent, se substituer complètement à des dépenses privées sans nul effet sur l'activité économique, ni l'inverse.
Mais, le niveau atteint par les dépenses publiques dans les pays développés ne confère pas d'actualité à cette perspective :
- il n'y a pas d'exemple de pays sans dépenses publiques ;
- il n'y en a pas davantage de pays où celles-ci représentent une modalité vraiment déterminante de l'affectation du revenu national.
La production non-marchande ne dépasse nulle part dans les pays développés un quart du PIB et les dépenses publiques sociales peuvent être considérées, globalement, comme une modalité parmi d'autres de couverture de risques sociaux qui mobilisent dans tous ces pays des ressources assez comparables.
Les différences dans les niveaux agrégés de dépenses publiques qui existent entre les pays développés sont sans doute importantes mais ces niveaux ne paraissent pas déterminer, en eux-mêmes , d'écarts significatifs de performances économiques globales.
Faut-il s'étonner de ce constat ? Votre rapporteur ne le pense pas.
En premier lieu, malgré leur éventuelle importance, les dépenses publiques ne sont qu'un élément parmi d'autres de la circulation des richesses qui crée et détermine la croissance économique, phénomène qui est lui-même influencé par de nombreuses autres variables. Les trajectoires économiques sont tributaires d'un très grand nombre d'équilibres plus ou moins indépendants des dépenses publiques et que celles-ci sont appelées avec plus ou moins d'urgence selon les « histoires économiques » nationales à influencer.
En second lieu, la première partie du présent rapport a montré qu' au-delà des divergences apparentes , qui caractérisent l'ampleur des dépenses publiques, il fallait relever des convergences plus grandes dans les modalités selon lesquelles le revenu national est globalement utilisé. Des résultats complètement contraires aux présentations habituelles sont apparus : par exemple, la production non marchande est, dans les trois pays anglo-saxons , les plus importants (les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada), à peu près équivalente à ce qu'elle est en France et supérieure à ce qu'elle est dans des pays comme l'Italie ou la Belgique.
Mais, de la relative indifférence des écarts internationaux de niveaux de dépenses publiques observés (écarts qui accentuent facialement des différences que la prise en compte des dépenses privées de protection sociale vient atténuer) peut-on conclure que les dépenses publiques n'ont aucun effet sur la croissance économique ?
Votre rapporteur ne le croit pas.
Il tient, au contraire, à mettre en garde contre les formules, qu'il juge simplistes, selon lesquelles la baisse des dépenses publiques serait la panacée pour améliorer les performances de croissance.
Dans le même temps, l'immobilisme ou le « toujours plus » ne sont pas non plus des principes admissibles.
L'idée selon laquelle la baisse des dépenses publiques serait une panacée pour davantage de croissance n'est valable, ni à court terme, ni structurellement .
A court terme , les études disponibles montrent que les épisodes de réduction des dépenses publiques sont généralement coûteux en croissance , sauf contexte particulier (v. le début du premier chapitre de la présente partie).
Mais, les problèmes les plus importants sont , bien sûr, ceux qu'offre une perspective structurelle . On pourrait, en effet, accepter des pertes transitoires d'activité économique, si, structurellement, on devait gagner de l'activité à réduire le niveau des dépenses publique.
Certaines études relayant des points de vue théoriques ne manquent pas d'incliner à cette conclusion.
Un document de travail présenté par la Banque centrale européenne (BCE), en 2003, qui se présente comme proposant une évaluation des performances et de l'efficience du secteur public dans 23 pays de l'OCDE illustre ce constat quasi épistémologique.
On en présente un résumé, en annexe, non pas tant pour la qualité des résultats obtenus, que parce qu'à partir de bonnes questions ce travail présente des défauts de méthode symptomatiques qui nuisent à la portée de la démarche.
|
L'EFFICACITÉ ET L'EFFICIENCE DU SECTEUR
PUBLIC
L'étude consiste d'abord à mesurer des indicateurs de performances de l'intervention publique . Sept indicateurs sont sélectionnés. Les quatre premiers ont pour ambition de rendre compte de la contribution des dépenses publiques au niveau général des atouts des pays considérés dans quatre domaines : l'administration générale, l'éducation, la santé et les infrastructures publiques. Les trois autres reprennent les justifications de l'intervention publique mises en évidence par Richard Musgrave : la répartition du revenu, la stabilisation conjoncturelle et l'allocation des ressources, pour mesurer l'efficacité de l'intervention publique sous ces trois angles. Ces différents indicateurs font l'objet d'évaluation à partir des indices socio-économiques énumérés ci-après. INDICATEUR DE PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC
|
|
Les indicateurs ne « capturent » pas seulement l'effet des dépenses publiques (certains sont influencés par la réglementation ou l'importance des dépenses privées) mais ils s'en veulent un reflet. Chaque indicateur se voit a priori attribuer un poids égal mais des variantes sont présentées selon des pondérations différentes. La valeur moyenne des indicateurs est ramenée à 1 ce qui facilite les comparaisons. Pour mesurer l'efficience du secteur public, les performances du secteur public sont ensuite mises en rapport avec les dépenses publiques engagées, soit globalement, soit par fonction (éducation, santé, transports...). Les dépenses publiques ainsi engagées sont considérées par les auteurs comme représentatives du coût d'opportunité que présente l'intervention publique. Enfin, les auteurs proposent une mesure du « gaspillage d'efficience » des différents secteurs publics nationaux. Il s'agit de définir une production maximale potentielle associée à un niveau de dépenses publiques et d'identifier l'écart entre cette performance maximale et la performance observée par le pays considéré 84 ( * ) . I. LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC DÉCROÎTRAIT AVEC LE NIVEAU DE L'INTERVENTION PUBLIQUELes performances des secteurs publics nationaux sont inégales, sans que les écarts soient généralement considérables. |
INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC - ANNÉE 2000
|
Pays |
Indicateurs par domaine d'intervention |
Indicateurs relatifs aux fonctions traditionnelles de l'État 1) |
Total
|
|||||
|
Administration |
Éducation |
Santé |
Équipement |
Redistribution |
Stabilité |
Performance
|
||
|
Australie |
1,17 |
1,02 |
0,94 |
1,00 |
0,87 |
1,31 |
1,00 |
1,04 |
|
Autriche |
1,21 |
1,00 |
0,98 |
1,10 |
1,22 |
1,28 |
1,01 |
1,12 |
|
Belgique |
0,73 |
1,00 |
0,94 |
0,91 |
1,17 |
1,10 |
0,83 |
0,95 |
|
Canada |
1,11 |
1,05 |
0,95 |
1,16 |
0,92 |
1,00 |
0,92 |
1,02 |
|
Danemark |
1,16 |
1,00 |
1,03 |
1,03 |
1,19 |
1,10 |
0,91 |
1,06 |
|
Finlande |
1,26 |
1,07 |
1,04 |
- |
1,18 |
0,75 |
0,73 |
1,01 |
|
France |
0,72 |
1,03 |
1,03 |
1,01 |
0,90 |
1,12 |
0,70 |
0,93 |
|
Allemagne |
1,02 |
0,98 |
1,01 |
1,01 |
0,98 |
0,91 |
0,81 |
0,96 |
|
Grèce |
0,60 |
0,94 |
0,93 |
0,81 |
0,97 |
0,55 |
0,69 |
0,78 |
|
Islande |
1,02 |
0,98 |
1,25 |
- |
- |
0,59 |
1,29 |
1,03 |
|
Irlande |
1,06 |
0,94 |
0,88 |
1,00 |
0,89 |
1,22 |
1,40 |
1,05 |
|
Italie |
0,52 |
0,96 |
0,93 |
0,84 |
1,10 |
0,76 |
0,69 |
0,83 |
|
Japon |
0,87 |
1,09 |
1,12 |
1,09 |
1,20 |
1,40 |
1,18 |
1,14 |
|
Luxembourg |
1,05 |
0,81 |
0,95 |
- |
- |
1,22 |
2,04 |
1,21 |
|
Pays-Bas |
1,16 |
1,04 |
0,97 |
1,09 |
1,00 |
1,42 |
1,06 |
1,11 |
|
Nouvelle Zélande |
1,18 |
1,03 |
0,89 |
- |
0,62 |
0,99 |
0,84 |
0,93 |
|
Norvège |
0,97 |
1,04 |
1,09 |
0,94 |
1,17 |
1,45 |
1,26 |
1,13 |
|
Portugal |
0,54 |
0,94 |
0,90 |
0,75 |
0,92 |
0,64 |
0,92 |
0,80 |
|
Espagne |
0,77 |
1,00 |
1,10 |
0,86 |
1,02 |
0,82 |
0,67 |
0,89 |
|
Suède |
1,16 |
1,07 |
1,19 |
1,10 |
1,17 |
0,69 |
0,91 |
1,04 |
|
Suisse |
1,32 |
0,97 |
1,14 |
1,23 |
0,95 |
0,79 |
1,09 |
1,07 |
|
Royaume-Uni |
1,00 |
1,05 |
0,91 |
0,99 |
0,79 |
0,78 |
0,84 |
0,91 |
|
États-Unis |
1,15 |
1,00 |
0,82 |
1,08 |
0,76 |
1,14 |
1,20 |
1,02 |
|
Moyenne |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
Petits Gouv. 2) |
1,11 |
1,01 |
0,98 |
1,08 |
0,94 |
1,17 |
1,17 |
1,07 |
|
Gouv. moyens 2) |
0,93 |
0,98 |
1,00 |
0,93 |
0,92 |
0,89 |
1,03 |
0,97 |
|
Gouv.importants2) |
0,99 |
1,02 |
1,01 |
1,01 |
1,12 |
1,03 |
0,85 |
1,01 |
|
UE 15 |
0,88 |
1,00 |
0,99 |
0,98 |
0,98 |
0,93 |
0,80 |
0,94 |
|
Zone Euro |
0,84 |
0,99 |
1,00 |
0,97 |
1,00 |
0,96 |
0,78 |
0,93 |
Source : Banque centrale européenne. Document de travail n° 242. Juillet 2003. Afonso, Schuknecht et Tanzi.
1) Les fonctions traditionnelles de l'État sont la
fonction de redistribution, de stabilisation et d'incitation. La
première est mesurée par la part de revenu des 40 % des
ménages les plus modestes ; la deuxième par la
stabilité de la croissance économique et la faiblesse de
l'inflation ; la troisième par la richesse par habitant, la
dynamique de la croissance économique et le taux de chômage.
2) Petits gouvernements : dépenses publiques <40 % du
PIB en 2000. Gouvernements moyens : dépenses publiques comprises
entre 40 % et 50 % du PIB en 2000. Gouvernements importants :
dépenses publiques >50 % du PIB en 2000.
|
S'agissant de la France , ses performances sont supérieures à la moyenne pour quatre des sept indicateurs : l'éducation, la santé, l'équipement et la stabilité conjoncturelle. Mais elle décroche nettement par le bas pour ce qui est de l' administration générale avec une efficacité inférieure de près de 30 % à la valeur moyenne, ainsi que pour les performances économiques (dans les mêmes proportions). Au regard de l'indicateur de redistribution , la France se situe aussi plus bas que la moyenne des pays. Les auteurs présentent des variantes avec des pondérations différentes et inégales des différents indicateurs. Le tableau ci-dessous en indique les résultats. Ils n'impliquent pas de modifications substantielles par rapport à l'exercice principal. |
|
INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC -
ANNÉE 2000
1) Pondération égale assignée à
chaque indicateur (1/7).
Source : BCE. Document de travail n° 242. Juillet 2003. Afonso, Schuknecht et Tanzi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La composition des préférences pour les différents aspects de l'intervention publique - qui peuvent varier selon la culture des pays - n'aurait donc pas d'effet significatif sur le niveau général des performances du secteur public. - Enfin, l'étude met en relief un lien entre le niveau d'efficacité du secteur public et la taille de l'intervention publique : moins celle-ci (mesurée par le niveau relatif des dépenses publiques mobilisées) est élevée plus les performances le seraient (et vice-versa ). Trois groupes de pays sont distingués selon l'ampleur des dépenses publiques : - les « petits gouvernements » avec des dépenses publiques en dessous de 40 % du PIB en 2000 ; - les « gouvernements moyens » entre 40 et 50 % du PIB ; - et les « gouvernements importants » au-dessus de 50 % du PIB. Les « petits gouvernements » sont les plus efficaces, et plus efficaces que la moyenne, sauf dans le domaine de la redistribution. Pour cet indicateur, ils sont devancés par les « gouvernements importants », qui atteignent un score général supérieur aux « gouvernements moyens ». Il n'y a que deux domaines dans lesquels les « gouvernements importants » se situent sous la moyenne : l'administration générale et les performances de l'allocation économique du revenu. II. LES PAYS SONT NETTEMENT PLUS DIFFÉRENTS SOUS L'ANGLE DE L'EFFICIENCE DE L'INTERVENTION PUBLIQUEAlors que, vus à travers les indicateurs de performance de l'intervention publique, il existe une relative homogénéité des pays de l'OCDE, l'étude conclut à des performances beaucoup plus contrastées sous l'angle de l'efficience . En lien avec la remarque selon laquelle les « petits gouvernements » connaîtraient des performances de l'intervention publique supérieures à la moyenne, les auteurs font ressortir les performances de ces pays en termes d'efficience, en croisant les indicateurs d'efficacité avec le niveau des dépenses publiques mobilisées. Elles seraient encore bien supérieures à ce qu'elles sont sous les auspices de l'efficacité. L'avantage relatif des « gouvernements importants » sur les « gouvernements moyens » sous ce dernier angle serait effacé quand l'efficience est prise en compte. |
INDICATEURS D'EFFICIENCE DU SECTEUR PUBLIC - ANNÉE 2000 1)
|
Pays |
Indicateurs par domaine d'intervention |
Indicateurs relatifs aux fonctions traditionnelles de l'État 2) |
Total
|
|||||
|
Administration |
Éducation |
Santé |
Équipement |
Redistribution |
Stabilité |
Performance
|
||
|
Australie |
1,21 |
1,06 |
1,05 |
1,05 |
1,80 |
1,59 |
1,22 |
1,28 |
|
Autriche |
1,22 |
0,93 |
1,07 |
0,98 |
0,93 |
1,17 |
0,92 |
1,03 |
|
Belgique |
0,64 |
0,96 |
0,85 |
1,11 |
0,71 |
0,87 |
0,65 |
0,83 |
|
Canada |
1,00 |
0,84 |
0,86 |
1,27 |
1,39 |
1,01 |
0,93 |
1,04 |
|
Danemark |
0,86 |
0,74 |
0,76 |
1,62 |
1,05 |
0,89 |
0,74 |
0,95 |
|
Finlande |
1,22 |
1,07 |
1,03 |
- |
1,19 |
0,79 |
0,77 |
1,01 |
|
France |
0,61 |
0,99 |
0,90 |
1,00 |
0,64 |
1,01 |
0,63 |
0,83 |
|
Allemagne |
1,01 |
1,09 |
0,93 |
1,27 |
0,85 |
0,88 |
0,78 |
0,97 |
|
Grèce |
0,79 |
2,25 |
1,05 |
0,87 |
1,04 |
0,61 |
0,78 |
1,06 |
|
Islande |
1,06 |
1,12 |
- |
- |
- |
0,65 |
1,42 |
0,85 |
|
Irlande |
1,10 |
0,90 |
0,88 |
0,96 |
0,90 |
1,20 |
1,38 |
1,05 |
|
Italie |
0,54 |
1,11 |
0,93 |
0,75 |
0,95 |
0,68 |
0,62 |
0,80 |
|
Japon |
1,25 |
1,12 |
1,34 |
0,68 |
1,60 |
1,99 |
1,68 |
1,38 |
|
Luxembourg |
1,10 |
0,88 |
0,98 |
- |
- |
1,19 |
1,99 |
1,23 |
|
Pays-Bas |
0,90 |
0,85 |
0,95 |
1,52 |
0,56 |
1,15 |
0,85 |
0,97 |
|
Nouvelle Zélande |
1,20 |
1,02 |
0,85 |
0,00 |
0,68 |
0,97 |
0,82 |
0,93 |
|
Norvège |
0,95 |
0,86 |
0,96 |
0,88 |
1,32 |
1,40 |
1,22 |
1,09 |
|
Portugal |
0,74 |
1,31 |
1,46 |
0,66 |
1,28 |
0,73 |
1,05 |
1,03 |
|
Espagne |
0,97 |
1,49 |
1,33 |
0,81 |
1,12 |
0,95 |
0,78 |
1,06 |
|
Suède |
0,81 |
0,75 |
0,83 |
1,19 |
0,94 |
0,51 |
0,68 |
0,82 |
|
Suisse |
1,86 |
1,01 |
1,21 |
1,07 |
1,68 |
1,05 |
1,45 |
1,33 |
|
Royaume-Uni |
0,94 |
1,10 |
1,01 |
1,68 |
0,98 |
0,84 |
0,91 |
1,06 |
|
États-Unis |
1,30 |
0,92 |
1,05 |
1,40 |
1,15 |
1,46 |
1,55 |
1,26 |
|
Moyenne |
1,01 |
1,06 |
1,01 |
1,09 |
1,08 |
1,03 |
1,04 |
1,04 |
|
Petits Gouv. 3) |
1,34 |
1,00 |
1,11 |
1,03 |
1,43 |
1,46 |
1,45 |
1,26 |
|
Gouv.moyens 3) |
0,98 |
1,19 |
1,05 |
1,06 |
1,08 |
0,92 |
1,07 |
1,03 |
|
Gouv.importants3) |
0,85 |
0,93 |
0,92 |
1,17 |
0,87 |
0,88 |
0,73 |
0,90 |
|
UE 15 |
0,84 |
1,09 |
0,97 |
1,18 |
0,87 |
0,88 |
0,77 |
0,94 |
|
Zone Euro |
0,82 |
1,11 |
0,97 |
1,06 |
0,84 |
0,90 |
0,74 |
0,92 |
Source : Banque centrale européenne. Document de travail n° 242. Juillet 2003. Afonso, Schuknecht et Tanzi.
1) Ces indicateurs rapportent les indicateurs de performance
du Tableau n° 1 aux dépenses publiques affectées aux
différents objectifs poursuivis.
2) Les fonctions traditionnelles de
l'État sont la fonction de redistribution, de stabilisation et
d'incitation. La première est mesurée par la part de revenu des
40 % des ménages les plus modestes ; la deuxième par la
stabilité de la croissance économique et la faiblesse de
l'inflation ; la troisième par la richesse par habitant, la
dynamique de la croissance économique et le taux de chômage.
3) Petits gouvernements : dépenses publiques <40 % du
PIB en 2000. Gouvernements moyens : dépenses publiques comprises
entre 40 % et 50 % du PIB en 2000. Gouvernements importants :
dépenses publiques >50 % du PIB en 2000.
|
Pour l'efficience aussi le point de vue ne change pas significativement en fonction de l'ordre des priorités accordé aux différents objectifs de l'intervention publique.
INDICATEURS D'EFFICIENCE DU SECTEUR PUBLIC -
ANNÉE 2000
1) Pondération égale assignée à
chaque indicateur (1/7).
Source : BCE. Document de travail n° 242. Juillet 2003. Afonso, Schuknecht et Tanzi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les pays les plus efficients sont généralement situés hors d'Europe (Australie, Japon, États-Unis) même si, en Europe, le Luxembourg et la Suisse sont des champions de l'efficience. III. DES PAYS DEVRAIENT ENTREPRENDRE DES EFFORTS POUR SE RAPPROCHER DE LA FRONTIÈRE DE L'EFFICIENCEA partir de la définition d'une « frontière de production », l'étude mesure l'écart séparant les pays des meilleurs résultats possibles. La « frontière de production » est construite à partir de l'identification des meilleurs résultats obtenus pour un niveau donné de dépenses publiques. Par un raisonnement inverse, elle permet de définir le niveau maximal des moyens à allouer quand un objectif donné de performance a été sélectionné. Les scores d'efficience peuvent donc être présentés alternativement pour les résultats obtenus (compte tenu des moyens dépensés) et pour les moyens dépensés (compte tenu des résultats obtenus).
SCORE D'EFFICIENCE DES DÉPENSES PUBLIQUES -
ANNÉE 2000
Les valeurs en gras correspondent aux pays situés sur la
« frontière de production ».
Source : BCE. Document de travail n° 242. Juillet 2003. Afonso, Schuknecht et Tanzi. Les pays de l'Union européenne pourraient obtenir les mêmes résultats en consacrant seulement 73 % des dépenses qu'ils réalisent s'ils étaient aussi efficients que les pays les plus efficients. Le tableau dit aussi dans les deux dernières colonnes qu'avec le niveau observé de dépenses, les performances de l'intervention publique sont à 82 % du niveau qui serait le leur s'ils étaient sur la « frontière de production ». De même que pour les autres indicateurs, l'étude conclut à l'existence de performances d'autant plus satisfaisantes que le niveau des dépenses publiques est faible. Les « gouvernements les plus importants » sont ceux qui sont les plus éloignés des meilleurs résultats possibles. La France occupe un rang très reculé dans le classement (20 ème sur 23 dans les deux cas). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les approches synthétiques des liens entre dépenses publiques, croissance et bien-être conduisent à des résultats fragiles. Elles s'appuient nécessairement sur des données à la solidité incertaine , et la démarche est sans portée parce qu'elle est rigoureusement incontrôlable.
De ce dernier point de vue, on peut s'interroger, par exemple, sur la capacité d'un indicateur à mesurer la qualité de l'administration d'un pays, même quand on prétend résumer celle-ci aux quatre critères retenus dans l'étude de la BCE, ou se demander pourquoi le secteur de la santé aux États-Unis est jugé si efficace ou efficient...
Inévitablement, les études qui suivent cette approche viennent se contredire.
Ainsi, dans son rapport relatif aux finances publiques dans l'Union économique et monétaire, publié en mai 2002, la Commission européenne s'est également attachée à développer un indicateur synthétique permettant d'apprécier la qualité de la dépense publique et ses conclusions sont à l'opposé de celles du document de travail de la BCE. Les dépenses publiques « de qualité » sont celles qui, par leur nature, sont susceptibles de soutenir la croissance et l'emploi .
Au vu de la littérature empirique sur le sujet, la Commission a réparti les dépenses publiques en quatre catégories , définies par référence à leur contribution à la croissance et à l'emploi :
- le paiement des intérêts de la dette est jugé être une dépense sans intérêt économique ;
- les dépenses de retraite et les dépenses de fonctionnement des administrations publiques ont un impact positif sur l'activité tant qu'elles restent modérées ; leur impact devient négatif si elles atteignent un niveau trop élevé ;
- les dépenses d'indemnisation du chômage , les dépenses consenties au titre de la politique familiale et de la politique du logement, les dépenses de lutte contre l'exclusion ont un impact positif sur la croissance si elles ne sont ni trop élevées, ni trop faibles . En effet, des dépenses trop faibles pourraient conduire à une détérioration de la qualité de la force de travail ; et des dépenses trop élevées risqueraient d'altérer le fonctionnement du marché de l'emploi, en créant des désincitations au travail ;
- les dépenses d'éducation, de santé, de recherche, et d'investissement, et les dépenses réalisées dans le cadre de politiques actives du marché du travail, sont considérées comme ayant toujours un impact positif sur la croissance et l'emploi . En théorie, ces dépenses devraient devenir inefficientes au-delà d'un certain seuil, mais la Commission estime que ce seuil est supérieur aux niveaux de dépenses effectivement observés dans les États membres de l'Union européenne.
Une fois ces critères d'évaluation posés, la Commission compare la « qualité » de la dépense publique dans les divers États membres. Les comparaisons sont effectuées à deux dates : en 1990, avant l'adoption du traité de Maastricht, et à la fin de la décennie, en 1998-99. Le choix de ces deux dates fait apparaître que le processus de consolidation budgétaire, qui s'est amorcé après l'adoption du traité de Maastricht, ne se serait pas accompagné d'une perte d'efficacité économique de la dépense publique (sauf en Grande-Bretagne et en Italie). En effet, cette analyse historique révèlerait que la qualité de la dépense publique des États européens se serait plutôt améliorée au cours de la décennie.
Par ailleurs, il ressort du classement de la Commission que la France est, à la fin des années 90, l'État membre qui bénéficie de la meilleure qualité de dépense publique . Ce bon résultat s'explique notamment par un haut niveau de dépenses d'éducation, de santé, d'investissement, et de recherche , et par la relative modestie des sommes versées au titre du paiement des intérêts de la dette. Notre système de protection sociale ne semble pas, en outre, être à l'origine de pertes majeures en termes d'efficacité économique .
Cette étude de la Commission présente un caractère novateur intéressant. La Commission appelle cependant l'attention sur les limites de la méthodologie suivie . En premier lieu, les critères définis pour évaluer la qualité de la dépense demeurent assez vagues , et reposent sur l'analyse d'études empiriques dont les résultats complexes sont rarement univoques. En second lieu, l'évaluation à laquelle procède la Commission ne prend pas en compte la qualité des prestations fournies par les administrations nationales ; le seul critère retenu est celui, quantitatif, du niveau des dépenses engagées par grand type de fonctions. Enfin, la composition « optimale » de la dépense publique peut fort bien varier d'un pays à un autre, notamment en raison des écarts de développement qui subsistent entre États membres.
DÉPENSE PUBLIQUE TOTALE
CLASSEMENT DES
ÉTATS EUROPÉENS À LA FIN DES ANNÉES 90 (EN POINTS
DE PIB)
|
Classement |
Niveau de dépense* |
|
France |
52,9 |
|
Allemagne |
48,4 |
|
Finlande |
49,4 |
|
Suède |
58,1 |
|
Autriche |
53,3 |
|
Pays-Bas |
46,7 |
|
Espagne |
40,0 |
|
Irlande |
33,1 |
|
Portugal |
45,3 |
|
Belgique |
49,7 |
|
Danemark |
54,5 |
|
Royaume-Uni |
39,3 |
|
Grèce |
48,3 |
|
Italie |
48,1 |
* Corrigé de l'écart de croissance en
pourcentage du PIB tendanciel.
Note : meilleur est le classement d'un
pays, meilleure est la composition de ses dépenses publiques par rapport
aux autres États membres.
Source : services de la
Commission
DÉPENSES PRIMAIRES
CLASSEMENT DES
ÉTATS EUROPÉENS À LA FIN DES ANNÉES 90 (EN POINTS
DE PIB)
|
Classement |
Niveau de dépense* |
|
France |
49,6 |
|
Allemagne |
45,0 |
|
Finlande |
46,6 |
|
Suède |
56,9 |
|
Autriche |
49,6 |
|
Belgique |
42,9 |
|
Pays-Bas |
42,8 |
|
Espagne |
36,7 |
|
Danemark |
50,3 |
|
Portugal |
42,1 |
|
Irlande |
31,0 |
|
Grèce |
41,3 |
|
Royaume-Uni |
36,5 |
|
Italie |
41,6 |
* Corrigé de l'écart de croissance en
pourcentage du PIB tendanciel.
Note : meilleur est le classement d'un
pays, meilleure est la composition de ses dépenses publiques par rapport
aux autres États membres.
Source : services de la
Commission
Votre rapporteur ne peut que partager les réserves formulées par la Commission sur ses propres travaux .
Elles invitent à préférer des approches plus réalistes , c'est-à-dire à recommander de résoudre les problèmes de connaissance plutôt que de les ignorer, et, une fois de plus, que l' évaluation des politiques publiques , dont les dépenses publiques sont un des instruments importants, fasse l'objet d'une relance dans notre pays, proposition faite de longue date par votre délégation mais qui n'a pas reçu le moindre début de concrétisation 85 ( * ) .
Longtemps considérée sous un angle purement quantitatif , selon lequel le niveau de la dépense publique était, pour les uns le gage d'une efficacité politique de l'État, ou du ministre concerné, pour les autres, un critère sûr d'insupportable étatisme, la dépense publique est, depuis peu, l'objet d'approches plus qualitatives , qui sans se substituer aux appréciations portant sur la quantité des moyens publics, essayent de les compléter.
La LOLF témoigne dans l'ordre juridique interne d'un renouvellement au terme duquel seul le résultat compte « la dépense publique devant être justifiée au premier euro », par le moyen du « contrôle et de l'évaluation », guidés tous deux par la confrontation entre les objectifs et les résultats de chacun des programmes budgétaires 86 ( * ) . L'ambition portée par la LOLF a été l'objet de travaux remarquables, particulièrement de la part de notre Commission des finances.
Cependant, le niveau d'examen qualitatif organisé par la LOLF n'est pas entièrement déterminé . Quelques ambiguïtés seront dissipées dans la pratique. Elles peuvent être résumées à partir du choix , qui n'est pas tranché , entre contrôle et évaluation . Étant entendu que ces deux modalités d'examen qualitatif de la dépense publique peuvent être cumulées, il semble que, de la capacité du système d'appréciation de la dépense publique porté par la LOLF à déboucher sur des pratiques d'évaluation dépendra étroitement son efficacité et sa portée .
Mais,
pour que le potentiel de la LOLF en termes
d'évaluation soit pleinement exploité, il est indispensable d'y
associer des modalités d'évaluation
de la qualité
de la dépense publique
autres que celles qui semblent
découler de son seul texte
et beaucoup plus ambitieuses
- démocratiques et participatives - que les exercices
d'autoévaluation auxquels se résume, trop souvent, selon votre
rapporteur les travaux en cours de révision générale des
politiques publiques (RGPP).
TROISIÈME PARTIE - LES DÉPENSES PUBLIQUES AU SERVICE DE LA RÉDUCTION DES INÉGALITÉS ?
L'une des trois justifications fondamentales de l'intervention publique réside dans sa contribution à la répartition du revenu et, particulièrement, à la réduction des inégalités économiques que peut engendrer le jeu spontané du marché.
* Il ne manque pas d'approches théoriques pour justifier un certain pessimisme quant aux propriétés redistributives de l'intervention publique et, partant, des dépenses publiques.
- La thèse développée par Anthony Downs dans « Une théorie économique de la démocratie » est que la priorité de tout parti politique étant d'être porté au pouvoir, les politiques publiques sont alors déterminées en fonction de leurs bénéfices électoraux.
Au regard de leur situation matérielle, les électeurs sont distribués, selon une loi gaussienne, dans une courbe en cloche. Autrement dit, le gros de l'électorat appartient aux classes moyennes , et il y a peu de très riches ou de très pauvres . Dans ces conditions, le gain électoral des politiques de redistribution est très faible , voire négatif si les classes moyennes sont appelées à les financer. La probabilité que les dépenses publiques soient redistributives est donc très faible.
- Les travaux de Gordon Tullock vont dans le même sens. Ils montrent qu'en théorie, une coalition majoritaire peut s'entendre pour redistribuer les revenus à son profit, au détriment des plus pauvres ou des plus riches.
* Ces thèses, marquées par un très grand formalisme, peuvent être facilement démenties, du moins partiellement, par d'autres arguments théoriques : le possible défaut de rationalité des décideurs, l'irréductibilité des divisions sociales à la seule position matérielle des membres du corps social, la révision à la hausse du bilan avantages-coûts d'une redistribution orientée vers les plus pauvres...
En outre, l'histoire montre empiriquement que la redistributivité de l'intervention publique varie nettement dans le temps et dans l'espace , invalidant ainsi l'idée d'un déterminisme absolu en ce domaine. Les pays même démocratiques à niveau élevé de pauvreté ne sont pas toujours, loin s'en faut (c'est même en général le contraire), ceux qui disposent de l'intervention publique la plus redistributive, alors même que les théories politiques de la redistribution inviteraient à le penser.
Il reste qu'on ne peut entièrement négliger ce que la redistributivité doit à certains états des équilibres sociopolitiques.
En dehors même des objectifs spécifiques de redistribution de différentes politiques publiques (politiques d'éducation, du logement...), on peut affirmer, sur un plan plus général, que le principe républicain d'égalité, notamment d'égalité devant le service public, peut être considéré comme comportant en soi une ambition redistributive . La fourniture de services collectifs à chacun apporte un avantage uniforme, mais d'autant plus appréciable que le revenu d'origine des bénéficiaires est bas.
Quoi qu'il en soit, la question de redistributivité de l'action publique, qui est, pour l'essentiel, étudiée du côté des prélèvements obligatoires ne saurait être cantonnée à ce seul versant de l'intervention publique.
L'ambition redistributive de l'intervention publique peut être motivée par des considérations sociales, voire sociétales, reflets de l'aversion, plus ou moins forte, qu'engendrent les inégalités ou la pauvreté et des craintes de dislocation sociale liée à ces phénomènes.
Mais, la lutte contre les inégalités et la pauvreté a aussi une motivation économique, non exempte d'ambiguïtés :
- d'un côté, l'inégalité est censée refléter l'apport de chacun au bien-être économique tandis que l'amélioration de la position des agents est conditionnée à des gains d'efficacité sanctionnés par le marché. Ainsi, l'inégalité est à la fois une « sanction naturelle » et une incitation permanente qui la rendent, sinon désirable, du moins cohérente avec les réalités économiques ;
- d'un autre côté, l'inégalité et la pauvreté peuvent être attribuables à des processus qui ne sont pas exclusivement d'ordre économique (et, ainsi, ne peuvent être corrigées par l'ordre économique) et peuvent, surtout, engendrer des coûts économiques qu'il convient de réduire. C'est tout particulièrement le cas des inégalités liées à la dégradation du capital humain, ou se traduisant par celle-ci, autrement dit des inégalités qui réduisent la capacité à contribuer à la croissance économique de façon satisfaisante et qui pèsent donc sur la croissance potentielle d'un pays.
Compte tenu de la place importante qu'occupe l'objectif de réduction des inégalités dans les justifications de l'intervention publique et de ce que, en ce domaine, il existe un choix à opérer en fonction des avantages plus ou moins grands associés à la baisse des inégalités, on pourrait s'attendre à ce que ce choix soit clairement explicité.
Cette explicitation serait d'ailleurs d'autant plus naturelle que, sous d'autres angles, le dosage des dépenses publiques n'a pas toute l'importance qu'on lui prête trop systématiquement. Par exemple, comme on l'a indiqué dans les développements antérieurs, le choix du niveau des dépenses publiques n'est pas une variable fondamentale des conditions macroéconomiques de l'allocation du revenu national.
Pourtant, en dehors de quelques domaines particuliers, où d'ailleurs l'objectif d'égalisation des conditions n'est formulée qu'assez globalement (l'éducation notamment), les politiques publiques ne sont généralement pas accompagnées d'indications précises sur leur contribution à cet objectif. On préfère mettre en valeur leur vocation universelle, en sous-entendant que celle-ci est en soi une garantie de réduction des inégalités, ou insister sur les gains individuels offerts par telle ou telle prestation.
Mais, de même qu'il manque aujourd'hui une politique précise de limitation des inégalités ou de la pauvreté 87 ( * ) , ces affichages ne font souvent que dissimuler le vide d'une évaluation sérieuse de la contribution des dispositifs en cause à la réduction des inégalités.
Il faut admettre que le problème de l'effet des dépenses publiques sur les inégalités et la pauvreté n'est pas simple.
Fondamentalement, la question est bien de savoir sur le plan social quelle est la distribution des bénéfices de l'action publique . Modifie-t-elle la répartition des avantages primaires des agents ? Si oui, dans quel sens ?
Cette question est riche en enjeux mais elle est aussi particulièrement complexe.
Pour illustrer ses enjeux, on peut, par exemple, indiquer que le constat de la progressivité du système de prélèvements obligatoires serait vidé de tout son sens en cas de progressivité analogue des avantages financés par eux. Dans un tel cas, l'intervention publique n'aurait aucun effet redistributif .
En bref, l'analyse de l'impact redistributif de l'intervention collective est suspendue à la réponse à une question qui n'est que trop rarement envisagée : celles des propriétés redistributives des dépenses publiques .
Pleine d'enjeux , cette question est aussi pleine de difficultés techniques et conceptuelles .
Techniquement, on observe qu' une grande masse des dépenses publiques donne naissance à des biens et services collectifs dont la consommation ne peut être individualisée de sorte qu'il est impossible d'en identifier la répartition des bénéfices.
Tel est le cas de la quasi-totalité des fonctions régaliennes (police, défense, prélèvements fiscaux...) assurées par les administrations publiques.
Pour ces dépenses, on pose souvent en hypothèse qu'elles ne modifient pas la distribution primaire du revenu et qu'elles sont donc neutres au regard de la redistribution . Si l'on admet cette hypothèse, le critère d'appréciation de la redistributivité de l'intervention publique est, tout entier, celui des modalités de financement. Si celles-ci sont redistributives, alors l'intervention publique dans ces domaines l'est elle aussi.
Il est cependant difficile de s'en tenir à cette hypothèse de neutralité .
Mais, la remise en question de cette convention se fait au nom de conceptions qui sont contraires , tantôt pour prétendre que ces dépenses sont antiredistributives, tantôt pour affirmer le contraire .
Le premier point de vue, celui de l'antiredistributivité, insiste sur l' idée que, même si chaque membre de la collectivité tire un bénéfice direct identique des interventions dont il s'agit 88 ( * ) , les bénéfices indirects ne sont pas équivalents - puisque déterminés par le niveau initial des avantages que viennent consolider ces interventions -. Dans cette optique, celles-ci représentent des assurances ou des garanties et leur valeur est directement liée à celle des choses qui sont garanties. Par exemple, la tranquillité publique - à laquelle concourent les dépenses publiques de sécurité - bénéficierait davantage à ceux qui ont des avantages supérieurs en leur offrant un avantage de jouissance ou de préservation de ces avantages d'une valeur plus grande que pour les autres couches de la population. Ce raisonnement est d'ailleurs étendu par certains à tout ou partie des interventions publiques, y compris celles qui sont évidemment redistributives.
Le second point de vue , contraire , celui de la redistributivité des dépenses publiques finançant des interventions publiques dont la jouissance n'est pas individualisable, part de l'idée que lesdites interventions créent des avantages auxquels les populations relativement défavorisées n'accèderaient pas, ou accèderaient moins, si l'intervention publique ne se manifestait pas .
Le raisonnement est schématiquement le suivant :
- les biens et services produits par l'intervention collective sont des « biens supérieurs », c'est-à-dire des biens et services qui sont relativement plus consommés quand ils sont offerts par le marché à mesure que le revenu s'élève ;
- la mise à disposition de tous de ces biens et services permet à des populations qui n'y auraient pas eu accès, si l'intervention collective ne s'était pas manifestée, d'en bénéficier ;
- l'accès à ces biens et services, et l'intervention publique qui le permet, opèrent donc en soi une redistribution, puisqu'ils élargissent la gamme des avantages disponibles aux couches sociales relativement défavorisées.
Ce raisonnement, assez abstrait, est suspendu à une condition importante : la capacité de produire les biens et services en question, en dehors de l'intervention collective et de les réserver à l'usage de leurs financeurs 89 ( * ) .
S'il n'est pas exclu que des dépenses privées interviennent dans le champ des dépenses régaliennes par excellence que sont, par exemple, l'ordre public ou l'exécution des décisions de justice, il est plus douteux qu'elles puissent avoir la même efficacité que des dépenses publiques correspondant à des services de police ou de justice plus universels.
Dans sa première partie, cette dernière observation tend à étayer l'idée d'une redistributivité des interventions publiques puisque les dépenses correspondantes profitent à tous, et non aux seuls financeurs, mais dans sa seconde partie, elle indique que des financeurs privés ne tireraient pas le même parti de dépenses privées censées leur réserver les bénéfices des services ainsi financés.
Dans le présent rapport, on ne tranche pas cette question ce qui est sans grand inconvénient puisque les dépenses publiques finançant des services collectifs de consommation non individualisables sont très minoritaires.
On s'intéresse, en revanche, aux dépenses de protection sociale et aux dépenses nécessaires à la production de services collectifs dont la consommation est individualisable (santé, éducation) qui représentent près des 7/10 èmes des dépenses publiques.
- L'analyse de leurs propriétés redistributives suppose d'en exposer les problèmes conceptuels , qui sont importants .
Les plus délicats sont les problèmes en rapport avec ceux qui viennent d'être évoqués. Les effets redistributifs de l'intervention publique ne s'arrêtent pas à l'impact direct des dépenses publiques sur la distribution des revenus. La redistribution est, en soi, une sorte de bien public qui sans doute passe par l'amélioration du sort des personnes les moins favorisées, mais engendre aussi des effets sur celles qu'elle ne favorise pas de façon immédiate. Le plus évident de ces effets indirects résulte des prélèvements nécessaires au financement des dépenses publiques redistributives. Dès lors que ceux-ci sont proportionnels au revenu, et a fortiori s'ils sont progressifs comme c'est généralement et globalement le cas, la redistribution opérée via les dépenses publiques a des incidences défavorables sur ceux qui en supportent le financement. Mais, à côté de ces dernières, il faut envisager des effets plus favorables. Quand la redistribution produit des conséquences heureuses, en élevant le potentiel de croissance économique, notamment par l'évitement de conflits sociaux dus au partage du revenu, les gains s'étendent aux individus qui pourtant n'en sont pas les bénéficiaires immédiats ou en supportent les coûts. Cet aspect de la question n'est que rarement pris en compte car une partie de ces bénéfices est quasiment impossible à chiffrer avec la précision minimale qui seule pourrait rendre utile cette opération de chiffrage.
Les autres difficultés conceptuelles de l'analyse de la redistributivité des dépenses publiques sont à la fois de plus d'enjeux et, heureusement, en théorie moins difficiles à surmonter.
L'approche de la redistributivité des dépenses publiques doit, à l'examen, soigneusement distinguer leurs effets quantitatifs de leurs incidences qualitatives .
Les dépenses publiques ont une traduction monétaire évidente quand il s'agit de transferts en espèces, et qu'il est possible de reconstituer en identifiant des équivalents monétaires quand il s'agit de prestations de services ou de biens collectifs consommés en nature.
On peut ainsi comparer la distribution des revenus avant et après dépenses publiques et mesurer si celles-ci modifient la répartition des revenus monétaires et dans quel sens.
De cette méthode quantitative, on conclut que les dépenses publiques sont, en France, plutôt redistributives .
Mais, cette conclusion n'épuise pas les questions que pose la redistributivité des dépenses publiques . Le propos de nombre de dépenses publiques dépasse le seul objectif de réduire les inégalités de revenus. Pour certaines dépenses publiques, celles qui sont destinées à détendre des contraintes monétaires restreignant la consommation de ceux qui les supportent, l'augmentation du revenu de leurs bénéficiaires peut être, en soi, un achèvement. Mais, une partie importante des dépenses publiques poursuit un objectif final différent, et plus ambitieux : celui d'égaliser les chances. Cet objectif peut bien passer par la distribution d'avantages dont leurs bénéficiaires seraient dépourvus sans intervention publique, il ne s'arrête pas à cette opération. Il s'agit, au-delà, de permettre aux familles de disposer d'un socle d'aisance aussi solide que les personnes seules, aux enfants issus de milieux relativement défavorisés de pouvoir accéder aux mêmes parcours scolaires d'excellence que les autres, aux malades de milieux modestes de fréquenter le même spécialiste que ceux plus riches pour disposer des mêmes perspectives de santé...
Or, sous cet angle, force est de reconnaître que le bilan de la redistributivité des dépenses publiques, globalement favorable quand il est dressé sur des données quantitatives est plus mitigé, voire défavorable .
La redistributivité monétaire ne s'accompagne pas d'une redistributivité des chances .
On ne saurait pourtant en conclure que les effets monétaires des dépenses publiques sont qualitativement nuls. Il est probable que les inégalités, quantitatives et qualitatives, seraient plus accusées sans l'intervention collective importante qui caractérise certains pays, dont la France.
Mais, c'est un défi majeur d'améliorer l'efficacité redistributive réelle des dépenses publiques non seulement pour leurs bénéficiaires mais aussi pour ceux qui supportent le financement de cette redistributivité .
CHAPITRE I - LES DÉPENSES D'ASSURANCES SOCIALES
I. LES TRANSFERTS SOCIAUX MONÉTAIRES, UNE CONTRIBUTION À LA RÉDUCTION DES INÉGALITÉS TRÈS CONTRASTÉE SELON LES PAYS
Les dépenses publiques correspondant aux prestations sociales en espèces 90 ( * ) réduisent dans tous les pays les inégalités de revenus.
Mais, la redistributivité des dépenses sociales varie selon les pays en raison directe du niveau des transferts publics, qui ressort comme une variable beaucoup plus déterminante que le ciblage des transferts sociaux sur les populations les moins pourvues .
Ce constat trouve des prolongements dans la situation des différents pays en termes de pauvreté. Les pays où celle-ci est la plus faible sont aussi les pays dans lesquels les dépenses publiques sociales sont les plus importantes .
A. APERÇU GÉNÉRAL
- De façon générale, les transferts sociaux occupent une place dans les ressources des ménages d'autant plus importante que ces ressources sont faibles.
DÉCOMPOSITION DU REVENU PRIMAIRE DES MÉNAGES (EN %)
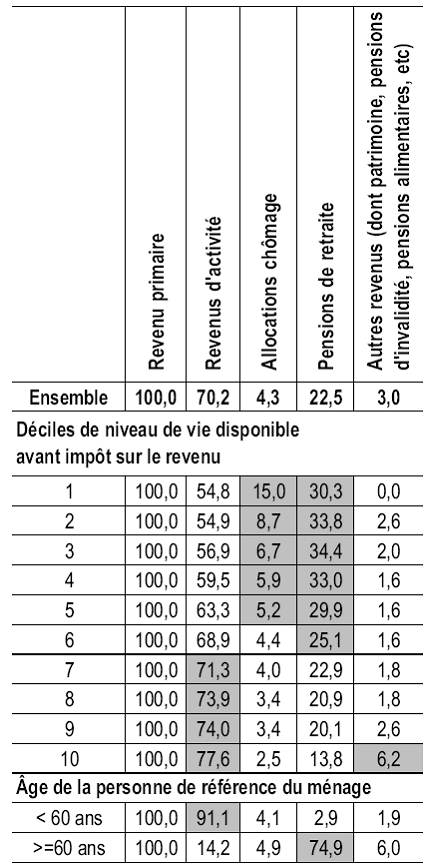
Source : Modèle de microsimulation Ines
(Drees-Insee),
enquête Revenus fiscaux 2001 (Insee-DGI)
actualisée 2002-2003, calculs Drees
En France, quatre ménages sur dix (les plus modestes) disposent de revenus d'activité inférieurs à 60 % du total de leurs ressources. Pour ces 40 % de ménages , les transferts sociaux 91 ( * ) représentent 39 % de leurs ressources .
En revanche, pour les 40 % des ménages les plus riches , ces prestations sociales représentent en moyenne 22,7 % de leurs ressources .
Si ces données permettent de se faire une idée de la contribution des transferts sociaux en espèces au niveau de vie des différentes catégories de la population, elles ne témoignent pas en elles-mêmes avec précision de l'impact redistributif de ces dépenses. Pour le mesurer plus finement, il faut apprécier la distribution des revenus avant et après transferts sociaux.
Cette mesure est généralement effectuée en partant de la distribution des revenus marchands - revenus du travail et du patrimoine - puis en appliquant à ceux-ci les transferts nets intervenant entre les ménages et les administrations publiques.
Cette méthode qui montre que les transferts sociaux nets exercent des effets égalisateurs n'est toutefois pas à même de rendre compte de la dimension redistributive des seules dépenses sociales puisqu'elle inclut l'effet des prélèvements obligatoires.
1. Les inégalités de revenus92 ( * ) varient nettement dans les pays de l'OCDE
Les inégalités de revenus diffèrent sensiblement dans les pays de l'OCDE .
COEFFICIENT DE GINI D'INÉGALITÉ DE REVENU DISPONIBLE, AUTOUR 2000
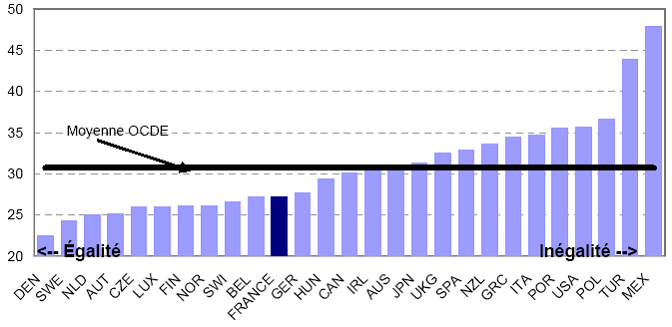
Source : OCDE
A partir de la moyenne de l'OCDE 93 ( * ) , les pays peuvent être regroupés en plusieurs catégories différentes :
- les pays où l'inégalité est faible , sur le graphique du Danemark à l'Allemagne (comprenant la France et la Belgique), avec un indicateur de Gini entre 22 et 27) ;
- les pays où elle oscille autour de la moyenne , entre la Hongrie et la Nouvelle-Zélande (indicateur de Gini entre 27 et 33), avec notamment le Japon , l' Espagne et le Royaume-Uni ;
- les pays où l'inégalité de la distribution des revenus est prononcée : il s'agit des pays les plus à droite du graphique (Mexique, Turquie, Pologne, États-Unis et plusieurs pays de l'Europe du Sud).
Les inégalités de revenus ici recensées concernent les revenus disponibles des ménages qui agrègent les différents éléments de ces revenus, soit les revenus marchands (salaires et revenus financiers) et les revenus non marchands nets (c'est-à-dire les prestations sociales en espèces moins les prélèvements obligatoires).
2. La contribution des transferts sociaux nets à la réduction des inégalités des revenus marchands varie aussi beaucoup
Les données disponibles séparément pour la distribution des revenus marchands et des revenus disponibles sont représentées dans le graphique ci-dessous. Elles permettent de mesurer l' impact sur les inégalités d'une fraction de l'intervention publique 94 ( * ) , celle qui transite par le versement des transferts sociaux en espèces, nets des prélèvements obligatoires supportés par les ménages.
- Les transferts sociaux nets réduisent partout les inégalités des revenus marchands .
COEFFICIENTS GINI POUR REVENUS MARCHANDS (VERT) ET DISPONIBLES (ROUGE), POUR LA POPULATION EN ÂGE DE TRAVAILLER, EN 2000
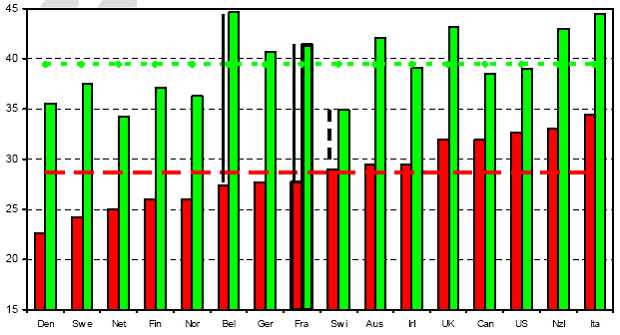
Source : OCDE
Le graphique (qui ne concerne que les personnes en âge de travailler) montre que, au sein de chaque pays, la dispersion des revenus marchands (salaires, revenus de patrimoine,...) est toujours plus forte que celle des revenus disponibles.
L'inégalité spontanée (celle des revenus marchands) est, en moyenne, supérieure de l'ordre de 40 % par rapport à l'inégalité après les transferts sociaux publics nets recensés ici.
- Mais, la contribution des transferts sociaux nets à la réduction des inégalités est plus ou moins forte selon les pays .
Selon le graphique ci-dessus de l'OCDE, l'inégalité des revenus marchands diffère sensiblement selon les pays .
Plusieurs pays sont au-dessus de la moyenne de l'OCDE : la Belgique, l'Allemagne, la France, l'Australie, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et l'Italie. Beaucoup de ces pays appartiennent à l'espace européen et les quatre grands pays de l'Union européenne figurent dans ce groupe .
A l'inverse, dans les pays nordiques et en Suisse , la répartition des revenus marchands serait nettement moins inégalitaire que pour la moyenne de l'OCDE.
Enfin, les pays d'Amérique du Nord (Canada, États-Unis) et l'Irlande sont un peu moins inégalitaires que la moyenne sous l'angle de la répartition des revenus marchands, même si dans ces pays les inégalités salariales sont plus fortes qu'en moyenne, du moins quand on observe les salariés à temps plein 95 ( * ) .
LES INÉGALITÉS SALARIALES DANS LES PAYS
DE L'OCDE
ACCROISSEMENT MODÉRÉ DE L'INÉGALITÉ
SALARIALE DANS LA MOITIÉ SUPÉRIEURE DE LA DISTRIBUTION,
STABILITÉ À LA MOITIE INFÉRIEURE
Écarts interdéciles, gains bruts des salariés à plein-temps
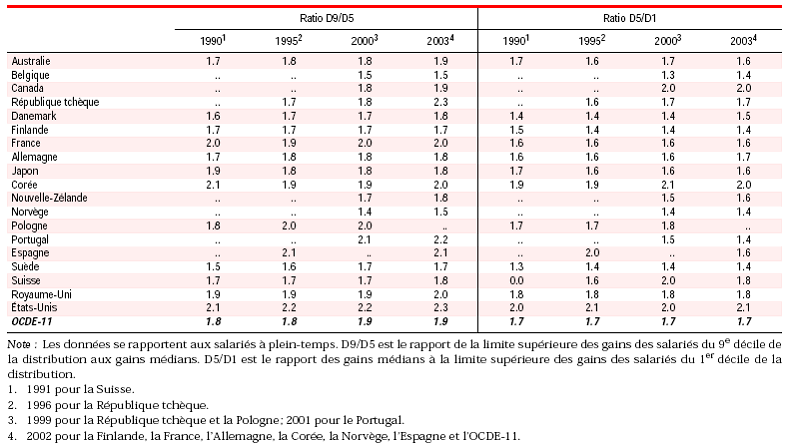
Source : Base de données de l'OCDE sur les revenus. EQ2. Inégalités de salaire.
- A partir de ces revenus marchands, on constate que la prise en compte des transferts sociaux nets (qui permet de passer des revenus marchands aux « revenus disponibles »), si elle diminue partout les inégalités, exerce cet effet de façon très inégale .
On remarque que les différences entre pays en termes d' inégalités de revenus disponibles ressortent comme plus fortes que pour les inégalités des revenus marchands . Autrement dit, les transferts sociaux nets diminuent les inégalités dans chaque pays, mais quand on compare les pays entre eux, ils apparaissent plus différents sous l'angle de l'égalité des revenus disponibles que sous celui des revenus marchands, ce qui dénote que l'intervention publique a des propriétés redistributives très différenciées selon le pays considéré .
CONTRIBUTION DES TRANSFERTS SOCIAUX NETS
À
LA DIMINUTION DU COEFFICIENT DE GINI (EN POINTS)
|
Danemark |
- 13 |
|
Suède |
- 13 |
|
Pays-Bas |
- 9 |
|
Finlande |
- 11 |
|
Norvège |
- 10 |
|
Belgique |
- 17 |
|
Allemagne |
- 14 |
|
France |
- 14 |
|
Suisse |
- 6 |
|
Australie |
- 14 |
|
Irlande |
- 10 |
|
Royaume-Uni |
- 11 |
|
Canada |
- 6 |
|
États-Unis |
- 6 |
|
Nouvelle-Zélande |
- 9 |
|
Italie |
- 10 |
|
Moyenne |
- 10,8 |
Pour les pays où les inégalités de revenus marchands sont relativement faibles, les transferts sociaux nets réduisent fortement ces inégalités, sauf en Suisse . Après transferts sociaux, tous ces pays (sauf la Suisse) sont très en deçà de l'indicateur moyen d'inégalité des revenus disponibles.
Pour les pays dans lesquels les revenus marchands sont distribués de façon très inégalitaires, les transferts sociaux nets diminuent aussi fortement cette inégalité .
Mais, au terme de ce processus, si pour certains d'entre eux (Belgique, France, Allemagne), les revenus disponibles sont alors moins inégalitairement distribués qu'en moyenne, ce n'est pas le cas pour d'autres (Australie, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Italie). Même sensiblement atténuée, l'inégalité des revenus disponibles excède pour ces derniers pays la moyenne.
Enfin, pour les pays d'Amérique du Nord et l'Irlande, les transferts sociaux nets réduisent des inégalités qui, au départ, sont au-dessus de la moyenne (mais moins que dans le groupe de pays précédent), mais ils débouchent sur une inégalité des revenus disponibles supérieure à la moyenne des inégalités de ces revenus .
- On observe que la portée égalisatrice des transferts sociaux nets est particulièrement forte dans les pays où les revenus marchands sont déjà relativement égaux et dans certains pays où, à l'inverse, ils sont très inégalement distribués . Ces derniers pays sont des pays d'Europe continentale (Allemagne, France et Belgique) dans laquelle l'Italie fait exception. Dans plusieurs pays aux inégalités primaires élevées (Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Italie), l'impact égalisateur, quoique fort, ne suffit pas pour rejoindre la situation de ces pays d'Europe continentale. Enfin, aux États-Unis, au Canada et en Suisse, les transferts sociaux nets ont un effet égalisateur moins prononcé qu'en moyenne .
*
* *
On a voulu donner ici un aperçu global des inégalités de revenu dans ces pays de l'OCDE et de la contribution des transferts sociaux nets à la réduction des inégalités. Mais, ces données ne permettent pas de mesurer avec précision la portée redistributive des dépenses publiques .
Les transferts sociaux nets pris en compte pour passer du revenu marchand au revenu disponible des ménages, même dans le champ limité qui est ici celui des personnes d'âge actif (les retraités ne sont pas inclus), comportent l'effet des prélèvements obligatoires sur la distribution des revenus (en plus de celui des seules dépenses publiques), et ne recensent pas la totalité des dépenses publiques. Sont notamment exclues les dépenses sociales en nature et les dépenses publiques non sociales (les dépenses de production de services publics et les transferts non sociaux).
Dans la suite du présent chapitre, on s'efforce de mesurer l'impact propre aux dépenses publiques de protection sociale (hors effet des prélèvements obligatoires). Le chapitre suivant est consacré, quant à lui, aux dépenses publiques de production de services publics individualisables.
B. LA CONTRIBUTION DES PRESTATIONS SOCIALES À LA RÉDUCTION DES INÉGALITÉS
Quelques données, malheureusement un peu éparses, permettent d'approcher la portée redistributive de certaines dépenses publiques correspondant à des transferts sociaux 96 ( * ) .
|
LES PRESTATIONS SOCIALES DONT LA REDISTRIBUTIVITÉ EST ÉTUDIÉE Ne sont concernés que les transferts monétaires (à l'exclusion des dépenses publiques concourant à la production de biens et services publics sociaux, comme la santé, voir chapitre ci-après), hors aides versées par les collectivités locales qui sont régies par une diversité des barèmes qui complique singulièrement l'analyse. Ne sont pas prises en compte les prestations assurancielles (retraites, assurance-maladie ou assurance-chômage) considérées comme correspondant plutôt à un transfert de revenu dans le temps opéré par un individu pour lui-même. Il s'agit d'une limite non négligeable puisque, comme on le montre plus loin, de tels transferts peuvent comporter une certaine redistributivité. Par conséquent, les prestations sociales ici envisagées sont principalement les prestations familiales , sans ou sous conditions de ressources, les aides au logement (ne sont pas prises en compte les aides à l'accession à la propriété), et les minima sociaux . Les développements ici présentés ne concernent que la France. * Les prestations sociales dont la redistributivité est ici étudiée sont : - les prestations familiales sans condition de ressources : allocations familiales, allocation de soutien familial, allocation d'éducation de l'enfant handicapé, complément de libre choix d'activité, aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et son complément, allocation de garde d'enfant à domicile, complément de libre choix de mode de garde et subventions publiques pour la garde d'enfants en crèches collectives et familiales ; - les prestations familiales sous conditions de ressources : complément familial, socle de la prestation d'accueil du jeune enfant, allocation pour parent isolé, allocation de rentrée scolaire, bourses du secondaire ; - les allocations de logement ; - les minima sociaux : revenu minimum d'insertion, minimum vieillesse, allocation supplémentaire d'invalidité, allocation pour adulte handicapé et ses compléments. |
EFFETS DES PRESTATIONS SOCIALES SUR LES INÉGALITÉS EN FRANCE (2006)
|
Montant par équivalent adulte, en euros |
Quintiles de niveau de vie avant redistribution |
Ensemble de la population |
||||
|
1er |
2e |
3e |
4e |
5e |
||
|
Revenu avant redistribution |
||||||
|
Montant par équivalent adulte |
6 980 |
13 570 |
18 500 |
24 610 |
44 270 |
21 580 |
|
Part dans le revenu net |
108,4 |
108,7 |
110,8 |
112,0 |
112,7 |
111,4 |
|
Prestations familiales sans condition de ressources |
||||||
|
Montant par équivalent adulte |
960 |
560 |
510 |
490 |
460 |
600 |
|
Part dans le revenu net |
14,9 |
4,5 |
3,1 |
2,2 |
1,2 |
3,1 |
|
Prestations familiales sous conditions de ressources et aides à la scolarité |
||||||
|
Montant par équivalent adulte |
540 |
270 |
180 |
120 |
20 |
230 |
|
Part dans le revenu net |
8,4 |
2,2 |
1,1 |
0,5 |
0,1 |
1,2 |
|
Aides au logement (location) |
||||||
|
Montant par équivalent adulte |
970 |
200 |
40 |
10 |
0 |
240 |
|
Part dans le revenu net |
15,1 |
1,6 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
|
Minima sociaux |
||||||
|
Montant par équivalent adulte |
800 |
130 |
40 |
20 |
10 |
200 |
|
Part dans le revenu net |
12,4 |
1,0 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
1,7 |
|
Total |
3 270 |
1 160 |
770 |
640 |
490 |
1 270 |
|
Revenus après prestations |
||||||
|
Montant par équivalent adulte |
10 250 |
14 730 |
19 270 |
25 250 |
44 760 |
22 850 |
Lecture : les individus du 5 e quintile (celui qui regroupe les 20 % des ménages ayant les ressources les plus élevées) ont perçu, en moyenne, 460 euros de prestations familiales sans conditions de ressources, ce qui a augmenté leur niveau de vie de 1,2 %.
Source : INSEE-DGI, enquête Revenus fiscaux 2004 (actualisée 2006), modèle Ines, calculs Drees et Insee.
* Les prestations sociales brutes se révèlent redistributives . Elles réduisent les inégalités monétaires de répartition du revenu.
Le revenu avant redistribution est nettement inégalitaire, le rapport entre le dernier quintile de revenu et le premier s'élevant à 6,3. Après versement des prestations sociales, ce rapport tombe à 4,4 .
Les prestations sociales représentent un montant de 3.270 euros par adulte relevant du plus bas quintile de revenu, 1.160 euros pour le deuxième et 770, 640 et 490 euros au-delà.
Le rapport entre les prestations sociales versées aux ménages du quintile inférieur et celles attribuées au quintile des revenus supérieurs est de 6,7 à contre-courant de la distribution du revenu avant distribution .
Les montants en cause sont cependant inférieurs à celui-ci et c'est pourquoi des écarts importants de revenus subsistent après prestations.
* Mais, la redistributivité des dépenses sociales n'est vraiment forte - voire perceptible - qu'au profit du premier quintile de revenu . Au-delà, la redistributivité est faible sinon inexistante.
Le bénéfice des prestations sociales est très concentré. Les membres du premier quintile absorbent, par exemple, 79 % des sommes versées au titre des minima sociaux et des allocations logement .
DISTRIBUTION DES PRESTATIONS SOCIALES PAR QUINTILE (EN % DU TOTAL)
|
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
Q5 |
|
|
Prestations familiales
|
46,6 % |
24,0 % |
16,0 % |
11,1 % |
2,2 % |
|
Prestations familiales
|
31,2 % |
19,0 % |
17,5 % |
16,8 % |
15,5 % |
|
Total des prestations familiales |
35,5 % |
20,4 % |
17,1 % |
15,2 % |
11,8 % |
|
Allocations logement |
78,5 % |
17,1 % |
3,3 % |
0,8 % |
0,2 % |
|
Minima sociaux |
80,7 % |
11,8 % |
3,9 % |
2,2 % |
1,3 % |
|
Total allocations logement
|
79,6 % |
14,6 % |
3,6 % |
1,5 % |
0,7 % |
Lecture : en 2006, les personnes qui font partie du 1er quintile de niveau de vie ont bénéficié de 46,6 % du montant total des prestations familiales sous conditions de ressources.
* Les prestations les plus redistributives sont les allocations de logement suivies des prestations familiales sans conditions de ressources 97 ( * ) . Les minima sociaux et les prestations sociales sous condition de ressources réalisent une moindre redistribution.
A ce propos, on peut remarquer que le « ciblage » des dépenses publiques n'est pas la variable la plus déterminante pour les effets redistributifs des prestations.
C. LA CONTRIBUTION DES TRANSFERTS SOCIAUX EN ESPÈCES À LA RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ
L'inégalité et la pauvreté sont étroitement liées l'une à l'autre ne serait-ce que parce que les indicateurs de pauvreté les plus traditionnels mesurent celle-ci de façon relative.
Dans ces conditions, même si des nuances doivent intervenir, il est conforme aux attentes de constater que dans les pays où l'intervention publique est relativement développée, la pauvreté ainsi mesurée est aussi relativement faible .
De fait, plus le niveau des dépenses publiques sociales est élevé, moins le taux de pauvreté (ici celui des personnes en âge de travailler) l'est .
TAUX DE PAUVRETÉ DES PERSONNES EN ÂGE DE
TRAVAILLER
ET DÉPENSES PUBLIQUES SOCIALES - 2000
(en points de PIB)
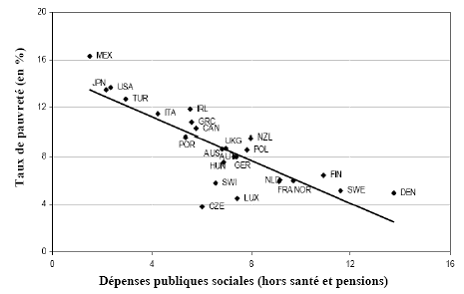
Note : Les dépenses publiques sociales ici prises en compte sont les dépenses publiques sociales hors santé et pensions. La pauvreté est définie relativement au seuil de la moitié du revenu disponible médian des ménages corrigé de leur composition.
Source : OCDE
Les pays situés le plus à gauche du graphique sont ceux dans lesquels le niveau des dépenses publiques sociales est relativement modéré. Les pays situés en haut du graphique sont ceux où le taux de pauvreté est relativement élevé. Il existe une forte corrélation de ce point de vue puisque les pays les plus à gauche du graphique sont aussi les pays où le taux de pauvreté est le plus important.
Inversement, de façon générale, les pays où le niveau des dépenses publiques sociales est le plus élevé sont aussi ceux où la proportion des pauvres est relativement faible .
On peut noter qu' il paraît exister une sorte de seuil minimum de pauvreté autour de 4 % de la population qui paraît résister aux effets d'une augmentation des dépenses publiques sociales. Ainsi, le contenu en réduction de la pauvreté des dépenses publiques sociales semble se réduire à mesure que celles-ci augmentent, venant buter sur le seuil mentionné ci-dessus.
Si la plupart des pays où le taux de pauvreté est élevé (au-delà de 12 %) sont extérieurs à l'Europe, l'Italie, l'Irlande et la Grèce - pays qui consacrent relativement peu de leurs richesses aux dépenses publiques sociales ici concernées - connaissent des taux élevés de pauvreté, de l'ordre de celui du Canada (environ 11 % de la population ).
Dans l'Union européenne, le taux de pauvreté diminue à mesure que les dépenses publiques sociales croissent . La pauvreté est plus importante au Royaume-Uni et en Allemagne (vers 8 % de la population ici considérée) qu'en France , en Suède ou au Danemark ( 6 % de la population ).
Une autre manière de rendre compte des ces réalités est de considérer le risque de pauvreté dans plusieurs situations :
- celle où il n'existerait pas de transferts sociaux ;
- la situation réellement observée compte tenu des transferts sociaux existants.
Selon le rapport de la Commission européenne sur la protection sociale et l'intégration sociale de 2006, le risque de pauvreté serait en l'absence de transferts sociaux de 26 points de pourcentage supérieur à ce qu'il est en réalité en moyenne (42 % contre 16 %) . Dans la réduction du risque de pauvreté, les pensions jouent un rôle important. En se fondant sur l'idée que leur sens est moins de réaliser une redistribution entre des catégories de personnes ayant des revenus différents que de lisser le revenu individuel tout au long de la vie, on peut les écarter de la mesure de l'effet des transferts sociaux internes de réduction du risque de pauvreté. Mais, même dans ce cas, ce risque est réduit significativement. Il passe de 25 à 16 %.
Le graphique ci-dessous montre que l'effet des transferts sociaux sur le risque de pauvreté varie selon le pays considéré de l'Union européenne .
L'IMPACT DES TRANSFERTS SOCIAUX
(AVEC OU SANS LES
PENSIONS SUR LE RISQUE DE PAUVRETÉ)
EN 2003 (EN POURCENTAGE DE
RÉDUCTION DU RISQUE DE PAUVRETÉ)
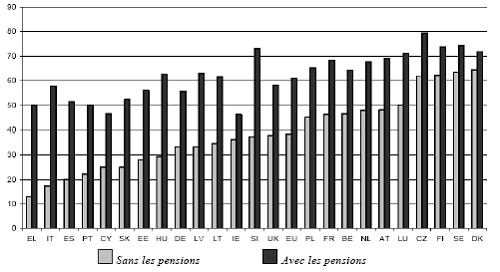
Source : Rapport conjoint sur la protection sociale et
l'inclusion sociale. 2006.
Commission européenne
Si on ne considère que l'effet des transferts sociaux hors pensions, les pays peuvent être rangés en quatre groupes dans l'ordre décroissant de la réduction du risque de pauvreté qu'ils exercent :
- les pays scandinaves (Finlande, Suède, Danemark) avec un abattement de plus de 60 % du risque de pauvreté ;
- les pays où cet abattement se situe entre 40 et 50 % comme la France , la Belgique , les Pays-Bas , l' Autriche ou le Luxembourg ;
- les pays où le risque de pauvreté n'est réduit qu'entre un tiers et 40 %, qui sont autour de la moyenne pour l'Union européenne (à 25 pays) : le Royaume-Uni , les pays baltes et l' Allemagne ;
- enfin, les pays où la diminution du risque de pauvreté attribuable aux transferts sociaux est très au-dessous de la moyenne de l'Union européenne : le Portugal , l' Espagne , l' Italie .
Cette hiérarchie est parallèle (sauf pour la République Tchèque) à celle du niveau atteint par les transferts sociaux ici considérés .
En revanche, il n'y a pas de corrélation nette entre le classement des pays effectué selon cet indicateur et celui réalisé en fonction de la part des dépenses sociales versées sous conditions de ressources dans le total des dépenses sociales.
LE POURCENTAGE DES TRANSFERTS SOCIAUX SOUS CONDITIONS
DE RESSOURCES
EN 2003 (PART DANS LE TOTAL DES TRANSFERTS
SOCIAUX)
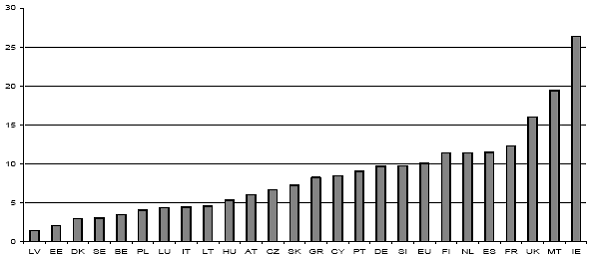
Source : Source : Rapport conjoint sur la protection sociale et l'inclusion sociale. 2006. Commission européenne.
En moyenne, le pourcentage des transferts sociaux versés sous conditions de ressources est d'ailleurs bas dans l'Union européenne (10 % du total). L'Irlande occupe une position singulière de ce point de vue et la France comme le Royaume-Uni sont un peu plus « sélectifs » que les autres pays.
Mais, si elle a sans doute un impact, la concentration des transferts sociaux n'exerce pas un effet discriminant entre pays sous l'angle de l'incidence de la redistribution sociale sur le risque de pauvreté.
Les pays dans lesquels la conditionnalité est quasi-absente (le Danemark, la Suède) sont les pays où le risque de pauvreté est le plus allégé par les transferts sociaux . A l'inverse, le Royaume-Uni où le niveau relatif des transferts sociaux sous conditions de ressources est élevé n'est pas particulièrement performant en ce domaine.
Dans les faits, le niveau absolu des transferts sociaux exerce un effet décisif et, dans les pays où celui-ci est faible, malgré le « ciblage » qui est alors souvent mis en oeuvre, les transferts sociaux ne contribuent que médiocrement à réduire le risque de pauvreté .
*
* *
Au total, les transferts publics monétaires sociaux 98 ( * ) , qui représentent en moyenne moins de la moitié des dépenses publiques sociales et un peu moins du quart de la totalité des dépenses publiques ont des propriétés redistributives importantes . Elles diminuent les inégalités et la pauvreté.
Mais, ces propriétés varient selon les pays, en raison directe du niveau de ces dépenses dont le poids dans le PIB est dans l'OCDE très différencié puisqu'il va de 2 à plus de 14 points de PIB .
En outre, à supposer qu'on puisse généraliser le constat réalisé pour la France d'une concentration des effets redistributifs de ces transferts sur les déciles de revenu les plus défavorisés , ce qui est une hypothèse raisonnable 99 ( * ) , on peut estimer que ce sont les catégories disposant des revenus les plus faibles (à un moment donné) qui bénéficient le plus de la redistributivité associée à cette catégorie (minoritaire) de dépenses publiques.
II. DES DÉPENSES DE RETRAITE FAIBLEMENT REDISTRIBUTIVES
En 2004 , les dépenses de retraite représentaient en France 12,8 % du PIB , soit près de deux tiers des dépenses (en espèces et en nature) de protection sociale hors santé et un quart environ du total des dépenses publiques .
Dans le débat sur le caractère redistributif des dépenses publiques, la question de la dimension redistributive du système de retraite est donc importante . Les dépenses publiques de retraite représentent, du moins en France, à peu près le même montant que les dépenses correspondant aux transferts sociaux en espèces examinées dans la précédente partie du présent chapitre.
Mais, c'est une question particulièrement complexe. Elle peut être abordée sous plusieurs angles différents, dont les deux principaux sont :
- la redistribution intragénérationnelle , qui conduit à se demander si les droits à retraite, que crée tout régime de retraite, s'accompagnent de transferts de revenu entre les titulaires appartenant à une même génération ;
- la redistribution inter-générationnelle qui amène à se demander si les générations différentes voient leur revenu modifié, en plus ou en moins, du fait de leur affiliation à un même régime de retraite.
L'appréciation de la redistributivité des systèmes de retraite est ici envisagée de façon extensive. Plutôt que de se borner à envisager les effets des seules dépenses publiques de retraite (qui ne sont qu'un des éléments de ces systèmes), on traite ici la question sous l'angle plus global des effets des différents systèmes mis en place (qu'ils impliquent des systèmes publics ou davantage l'initiative privée) pour assurer des revenus aux personnes en âge d'être retraitées sur la distribution des revenus de ces personnes.
Cette approche est justifiée par la diversité des systèmes permettant de couvrir le « risque viager », diversité grandissante à mesure que les différents « piliers de la retraite » (régimes obligatoires, régimes facultatifs collectifs ou individuels, épargne de précaution collective ou non...) s'empilent.
Au terme de cette exploration, plusieurs conclusions s'imposent :
- les « régimes universels » de retraite n'apparaissent redistributifs que pour quelques catégories seulement (les très pauvres, les femmes...) ;
- les « régimes à étages » semblent plus redistributifs , mais ce constat est largement apparent : si leur rendement est plus élevé pour les plus pauvres, les ressources qu'ils procurent sont souvent très faibles si bien que les inégalités entre retraités sont fortes avec des taux de pauvreté élevés ;
- en effet, quand les régimes publics ne sont pas universels, les ménages recourent à des garanties individuelles , dont le bénéfice est très inégalement réparti ;
- la redistributivité intergénérationnelle des systèmes de retraite est un sujet très complexe, qui disqualifie toutes les approches trop simplistes : fondamentalement, elle doit être appréciée comme un élément parmi d'autres, d'un bilan des relations entre générations prenant en compte l'ensemble du legs d'une génération à sa suivante.
A. AU SEIN D'UNE GÉNÉRATION DONNÉE, UNE LÉGÈRE REDISTRIBUTIVITÉ AU PROFIT DES MÉNAGES LES MOINS RICHES ET DES FEMMES
1. Méthodes
En ce qui concerne la redistribution intragénérationnelle , les travaux disponibles pour la France sont peu nombreux 100 ( * ) .
- La question de la redistributivité d'un système de retraite quand elle est abordée au sein d'une même génération ne peut pas être traitée exactement comme d'autres. On ne peut pas se contenter de définir la redistributivité de manière classique comme un mécanisme qui modifie la répartition primaire des revenus pour la simple raison qu'il n'y a pas synchronisation entre les impacts redistributifs du système et la perception des revenus primaires.
Pour un système de retraite, la redistribution intragénérationnelle se juge sur ses effets sur la répartition des revenus d'une même génération, appréciés sur l'ensemble du cycle de vie en se posant la question de savoir si l'affiliation à un système de retraite modifie ou non la répartition des revenus en question .
Dans ces conditions, on peut considérer comme redistributif un système de retraite qui comporte un rendement des cotisations décroissant avec le revenu .
Si le rapport entre cotisations et prestations est monotone quelque soit le niveau de revenu, ce qui se produit dans les systèmes exclusivement contributifs, et à la condition d'une uniformité des espérances de vie, alors le système de retraite ne comporte aucun effet redistributif.
A l'inverse, si les droits engendrés par l'affiliation au système de retraite sont déliés des cotisations et supérieurs pour les revenus relativement plus faibles, il y a redistributivité (sous la condition d'espérance de vie déjà mentionnée).
|
MÉTHODE
L'analyse de la redistributivité du système de retraite est conduite à partir de la comparaison des taux de rendement interne des cotisations de différentes catégories de population définies en fonction de leur niveau de salaire ou d'autres éléments caractéristiques de leur situation (sexe, situation conjugale,...). Le taux de rendement interne correspond au taux d'intérêt qui aurait rapporté les mêmes prestations à l'individu s'il avait placé ses cotisations sur un compte d'épargne . Il s'agit de la rémunération implicite des cotisations versées par les retraités à partir des prestations qu'ils reçoivent. Plus ce taux est élevé, plus la participation au système de retraite « rapporte ». S'il existe des différences de niveaux de taux de rendement interne pour les différents participants, cela signifie que le régime de retraite produit des avantages plus importants pour ceux qui ont un taux relativement élevé que pour ceux qui bénéficient d'un taux relativement faible. Par ailleurs, dans ce cadre, il y deux formes de redistributivité. Il y a redistributivé verticale si cette asymétrie profite aux personnes ayant eu des revenus relativement plus faibles , horizontale si cette situation discrimine des individus de même revenu mais différents sous d'autres angles . Enfin, il faut relever que l'ampleur de la redistributivité est suspendue à l'importance des prestations distribuées : un système fortement redistributif vu sous l'angle des taux de rendement interne (c'est-à-dire un système où les rendements des cotisations sont d'autant plus élevés que le niveau du revenu est faible) peut l'être plus faiblement qu'un autre, moins redistributif sous cet angle, si les prestations qu'il distribue sont dérisoires. |
- Encore faut-il déterminer quel est le champ pertinent pour apprécier la redistributivité du système de retraite.
Une approche par régime est excessivement réductrice . La diversité grandissante des régimes de retraite dans chaque pays, avec de plus en plus à côté des régimes de base d'autres régimes reposant davantage sur l'épargne des ménages, implique une diversification concomitante des systèmes nationaux.
Le niveau adéquat d'appréciation de la redistributivité est celui de la totalité des revenus des retraités et non celui du seul bilan des cotisations et des prestations correspondant à un régime de retraite donné .
- Cette approche de la redistributivité est purement intra-générationnelle. Elle ne résout pas la question de savoir si une génération voit ses revenus améliorés (ou détériorés) par rapport à une autre, du fait de l'existence d'un système de retraite. En outre, la redistributivité est appréciée au regard de la seule cohorte des retraités : les aspects redistributifs du système de financement des régimes de répartition qui sont à la charge d'autres générations, celles composées des actifs, ne sont pas abordés à l'encontre de ce qui se produit lorsqu'on se penche sur la redistributivité intergénérationnelle.
2. Du point de vue de la redistribution intragénérationnelle, le système de retraite français des salariés du secteur privé comporte des effets de redistribution au sein d'une génération donnée, mais qui sont modestes
Les résultats de l'étude ici prise comme référence montrent que le système de retraite des salariés du secteur privé, dans sa version antérieure à la réforme de 2003, comportait une certaine redistribution intragénérationnelle, verticale mais aussi horizontale 101 ( * ) .
Mais, cette redistributivité ressort comme particulièrement ciblée.
a) Appréciée au niveau de l'individu, une redistribution au profit des moins riches...
Au niveau individuel , les taux de rendement interne décroissent avec le décile de salaire moyen par année travaillée (voir les tableaux ci-après). Autrement dit, plus le salaire perçu pendant l'activité est élevé, moins le rendement des cotisations qui ont été versées est important.
Ainsi, le système public de retraite se révèle redistributif.
TAUX DE RENDEMENT INTERNE MÉDIANS PAR DÉCILE DE SALAIRE MOYEN PAR ANNÉE TRAVAILLÉE (EN %)
|
1e |
2e |
3e |
4e |
5e |
6e |
7e |
8e |
9e |
10e |
Ensemble |
|
|
Hommes |
2,9 |
2,8 |
2,8 |
2,9 |
2,8 |
2,6 |
3,0 |
2,7 |
2,6 |
2,7 |
2,8 |
|
Femmes |
6,5 |
5,2 |
4,8 |
4,0 |
3,8 |
3,7 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
4,0 |
|
Ensemble |
5,9 |
4,1 |
3,7 |
3,2 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
2,9 |
2,8 |
3,3 |
Lecture : déciles propres à chaque
groupe (ensemble, hommes, femmes).
Champ : individus mariés,
nés entre 1948 et 1960 et salariés du secteur privé.
Source : modèle de microsimulation Destinie, de
l'INSEE.
TAUX DE RENDEMENT INTERNE (TRI) MÉDIANS PAR QUINTILE DE SALAIRE MOYEN PAR ANNÉE TRAVAILLÉE (EN %)
|
Quintile de revenu |
1e |
2e |
3 e |
4e |
5e |
Ensemble |
|
TRI médian de l'ensemble |
4,9 |
3,5 |
3,1 |
3,1 |
2,9 |
3,3 |
|
Proportion d'hommes |
10 |
32 |
63 |
69 |
79 |
|
|
Proportion de femmes |
90 |
68 |
37 |
31 |
21 |
|
|
TRI médian des hommes |
3,1 |
2,9 |
2,8 |
2,9 |
2,7 |
2,8 |
|
TRI médian des femmes |
5,1 |
3,7 |
3,6 |
3,6 |
3,5 |
4,0 |
Lecture : quintiles sur l'ensemble des individus.
Champ : individus mariés, nés entre 1948 et 1960 et
salariés du secteur privé.
Source : modèle de microsimulation Destinie, de l'INSEE.
En considérant l'ensemble de la population , le taux de rendement des cotisations est de l'ordre de 3,2 % .
Pour les trois déciles de revenu les plus faibles , ce taux est supérieur à la moyenne (de 5,9 à 3,7 %). Le système de retraite n'est redistributif que pour eux, et le poids de la redistribution est partagé de façon à peu près uniforme entre le 5 ème et le 9 ème décile, le 10 ème décile ne supportant pas cette charge, du moins quand on apprécie la situation des couples.
Autrement dit, sauf pour les trois déciles les plus défavorisés, les dépenses publiques de retraite correspondent à un rendement homogène des cotisations, qui sont, à peu près, proportionnelles aux revenus d'activité.
En conséquence, pour l'essentiel, la redistributivité des dépenses publiques de retraite est très modérée .
b) ... et au profit des femmes
La portée redistributive des dépenses publiques de retraite provient, pour l'essentiel, de la forte redistributivité du système au profit des femmes .
En effet, les femmes bénéficient d'une redistribution de la part des hommes et, au sein de la population féminine, la redistribution verticale est plus marquée que pour la population masculine.
- La forte différence entre les taux de rendement des hommes et des femmes indique que celles-ci bénéficient d'une redistribution de la part des hommes. Quel que soit le niveau de salaires, leurs contributions extériorisent toujours des taux de rendement interne supérieurs à ceux des hommes . Globalement, le taux de rendement interne médian des hommes se situe à 2,8 %, contre 4 % pour les femmes .
Plusieurs facteurs semblent en cause :
- les femmes ont une espérance de vie supérieure à celles des hommes, si bien qu'elles bénéficient plus longtemps des prestations ;
- elles bénéficient plus fréquemment de majorations de durée non contributives .
- Par ailleurs, les femmes à bas salaires sont celles qui bénéficient le plus de la redistributivité du système de retraite (le taux de rendement interne atteint 5,1 % pour les femmes du premier quintile de revenu contre 3,1 % pour les hommes de ce quintile), du moins en l'état de ce système qui, dans son fonctionnement concret, reste marqué par les inégalités de conditions économiques et sociales entre hommes et femmes et par un écart dans les espérances de vie de deux sexes.
Pour les hommes, le profil des taux de rendement interne selon le décile de salaire n'est que légèrement décroissant et la redistribution verticale entre eux est faible. Les taux de rendement internes des femmes sont beaucoup plus décroissants en fonction du niveau de salaire . La forte redistribution verticale parmi les femmes s'expliquerait essentiellement par le profil décroissant des majorations de durée non contributives selon le niveau de salaire.
*
* *
En conclusion, à l' échelle des individus , l'essentiel de la faible redistribution des dépenses publiques de retraite a lieu des hommes vers les femmes et, parmi ces dernières, des plus hauts salaires vers les plus bas salaires .
c) Pour les couples, une faible redistributivité
Au niveau du couple , les transferts entre hommes et femmes voient leurs effets atténués.
Ainsi, lorsqu'on passe d'une approche par individu à une approche par couple , la redistribution que produit le régime de retraite apparaît encore moins marquée qu'au niveau des individus .
TAUX DE RENDEMENT INTERNE MÉDIANS PAR
DÉCILE DE SALAIRE MOYEN
PAR ANNÉE TRAVAILLÉE DU COUPLE
(EN %)
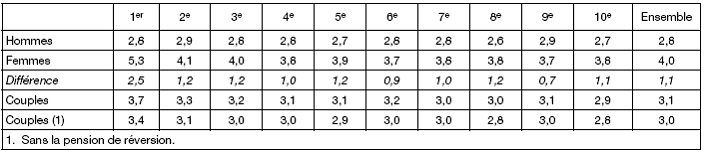
Champ : individus mariés, nés entre 1948
et 1960 et salariés du secteur privé.
Source :
modèle de microsimulation Destinie de l'Insee.
Elle ne concerne vraiment que le premier décile de revenu - à son profit - et le dernier - à son détriment .
d) Enfin, une redistributivité au profit des ménages avec enfants
La redistribution engendrée par le système de retraite comporte également une dimension horizontale , entre les personnes sans enfants et celles avec enfants , à l'avantage de ces dernières.
TAUX DE RENDEMENT INTERNE MÉDIANS EN FONCTION DU
NOMBRE D'ENFANTS
(EN %)
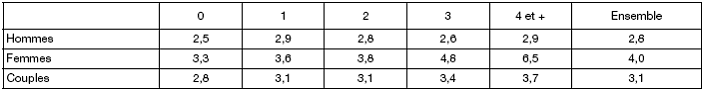
Champ : individus mariés, nés entre 1948
et 1960 et salariés du secteur privé.
Source :
modèle de microsimulation Destinie de l'Insee.
L'impact redistributif est maximal pour les femmes et s'accroît avec le nombre d'enfants . Pour les couples, il existe aussi mais il est moins sensible.
B. UNE REDISTRIBUTIVITÉ MITIGÉE
Les résultats des études basées sur la comparaison des taux de rendement interne par décile ne sont significatifs qu'autant que les systèmes étudiés couvrent une part importante des revenus des ménages.
Sous cette réserve 102 ( * ) , le système public français de retraite ressort comme modérément redistributif .
Mais, cette appréciation doit être accompagnée d'un jugement comparatif moins restrictif : relativement aux régimes non universels, faisant une place plus importante à des garanties privées , qui sont souvent antiredistributives, sa dimension « égalisatrice » est nettement plus forte .
1. Les limites d'une méthode
La méthode employée pour apprécier la redistributivité du système public de retraite par répartition - la comparaison des taux de rendement par décile de revenu - ne permet pas de mesurer complètement son effet redistributif.
La seule considération du taux de rendement des cotisations sociales n'embrasse les propriétés redistributives d'un régime de retraite que dans la mesure de la part des revenus d'activité et de retraite que le régime appréhende .
Ses résultats sont, en effet, centrés sur les propriétés redistributives du système de retraite considérées à partir d'une distribution des revenus limitée à la considération des seuls revenus soumis à cotisations, soit le plus souvent les salaires, en tout ou en partie.
Certes, les salaires représentent une partie majoritaire des revenus mais d'autres revenus, ceux de la propriété en particulier, pourraient être pris en compte pour apprécier les propriétés redistributives des systèmes de retraite.
La démarche de l'étude mentionnée plus haut témoigne de ces difficultés de méthode. Elle permet de montrer que les salariés ne profitent pas de la même manière des droits qu'engendre la participation aux régimes de retraite ici pris en compte. Elle conclut que cette asymétrie des avantages assure une certaine redistribution au profit des salariés les moins favorisés. Mais, même s'il est probable que cet aspect redistributif joue quand on prend en compte l'ensemble des revenus d'une génération, l'existence et l'ampleur de la redistribution opérée par le système ne sont pas précisément identifiées puisqu'il n'y a pas de précision sur l'étendue des revenus et des cotisations dont on estime les taux de rendement.
Avec cette méthode, du fait de ses limites, un système de retraite assurant aux seules personnes les plus pauvres un avantage non contributif, quelque modeste qu'il puisse être, sera jugé beaucoup plus redistributif qu'un mécanisme plus universel aux avantages beaucoup plus conséquents mais moins inégalement répartis.
2. Une redistributivité globalement faible...
Les pensions servies par le système de retraite ont permis de réduire considérablement le nombre des retraités en situation de pauvreté. Mais leur impact redistributif n'en est pas pour autant particulièrement élevé.
a) Une forte baisse de la pauvreté chez les retraités
Malgré la dégradation du niveau de vie relatif des retraités au cours de la dernière période, le taux de pauvreté des retraités a enregistré une baisse considérable entre 1975 et 1984 .
La proportion des retraités pauvres est quatre fois plus basse en 2001 (4 %) qu'en 1975 (16 %).
Pendant cette période, le taux de pauvreté des personnes d'âge actif n'a décliné que plus modérément.
|
TAUX DE PAUVRETÉ SELON L'ÂGE DU CHEF DE MÉNAGE |
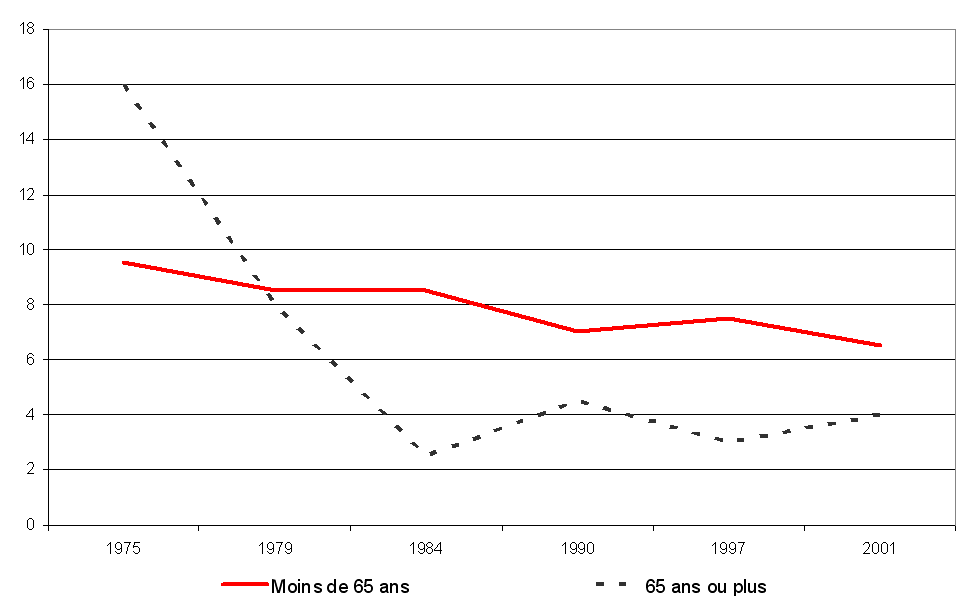
Source : INSEE-DGI, enquêtes « Revenus fiscaux ».
Ces évolutions résultent, d'une part, de la montée en charge des avantages non contributifs et de réformes qui, dans un premier temps, ont amélioré les conditions des retraités.
S'agissant des avantages non contributifs , la création en 1956 du minimum vieillesse 103 ( * ) et les revalorisations qu'il a connues jusqu'au début des années 80 ont permis d'améliorer nettement son pouvoir d'achat qui en 1983 atteint 2,7 fois celui de 1959. On relève que le minimum vieillesse bénéficie alors de revalorisations beaucoup plus conséquentes que le SMIC. Il en représente 68 % en 1983 contre 45 % du SMIC net en 1970.
|
INCIDENCE CUMULÉE DES REVALORISATIONS (EN MONNAIE CONSTANTE) |
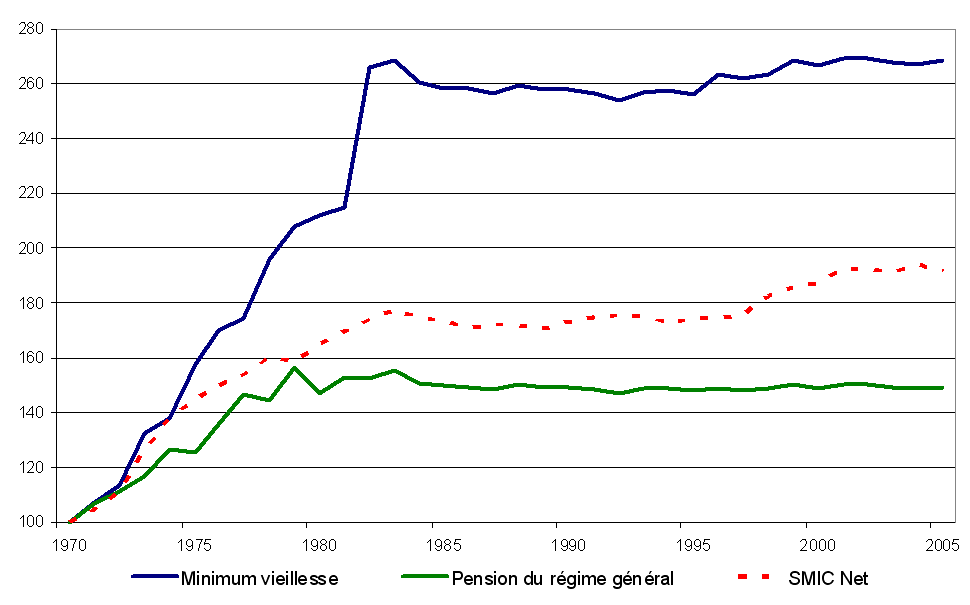
Source : Calculs d'après Kohler, 2004.
Lecture : Une retraite liquidée en 1970 avait bénéficié, en 1980, d'une revalorisation de 47 % par rapport à son pouvoir d'achat initial. Entre-temps, le pouvoir d'achat du minimum vieillesse avait été multiplié par 2,12.
Il faut additionner à ce processus, qui a vu se réduire le nombre de ses bénéficiaires (1,65 million en 1983 contre 2,55 millions en 1959), le cumul d'une amélioration du statut des retraités (la loi Boulin de 1971 porte le maximum de la pension de 40 à 50 % du salaire des dix meilleures années contre les dix dernières années auparavant) et des carrières salariales au cours des Trente glorieuses.
b) Une inégalité moins forte à la retraite que dans la vie active, indice de redistributivité du système
Au total, la distribution des revenus au sein de la population d'âge actif et des retraités, respectivement mesurée à travers le rapport interdécile entre les 10 % de ménages les plus riches et les plus pauvres dans chacune de ces deux catégories de population, a connu une homogénéisation relative plus forte chez les retraités que chez les personnes d'âge actif .
En outre, les inégalités observées au cours de l'âge actif sont moins prononcées quand les actifs prennent leur retraite.
|
RAPPORT INTERDÉCILE DES NIVEAUX DE VIE SELON L'ÂGE DU CHEF DE MÉNAGE |
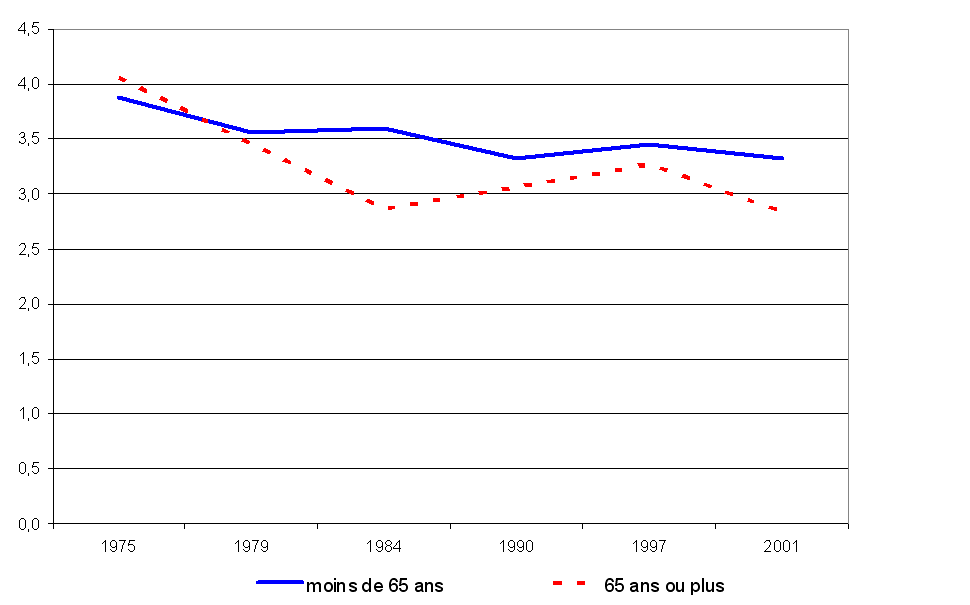
Source : INSEE-DGI, enquêtes « Revenus fiscaux ».
Autrement dit, les inégalités de l'âge actif se retrouvent mais moins accusées pour les retraités ce qui tend à établir le constat de la dimension redistributive, même modeste, du système de retraite français 104 ( * ) .
c) Une redistributivité qui repose essentiellement sur les avantages contributifs
Les facteurs de la redistributivité du système de retraite sont :
- l'existence d'un minimum contributif ;
- les avantages familiaux de durée ;
- et, dans un sens anti-redistributif, les différences d'espérance de vie.
- En ce qui concerne l'espérance de vie , elle est corrélée au niveau de salaire et au sexe . Comme les individus du même sexe à plus hauts salaires sont ceux qui vivent le plus longtemps, la différence de mortalité selon le niveau de salaire peut entraîner des effets anti-redistributifs entre individus du même sexe et entre couples.
Cependant, les femmes vivent plus longtemps que les hommes et perçoivent, en moyenne, des salaires moins élevés, si bien que ces différentiels de mortalité peuvent, au contraire, être à la source d'une redistribution.
Pour mesurer ce que la redistributivité du système doit aux différences d'espérance de vie, on teste les effets d'hypothèses de mortalité homogène. Ils modifient les écarts de taux de rendement entre retraités .
|
TAUX DE RENDEMENT INTERNE MÉDIANS PAR
DÉCILE DE SALAIRE MOYEN
|

Lecture : déciles propres à chaque
groupe (ensemble, homme, femmes).
Champ : individus mariés,
nés entre 1948 et 1960 et salariés du secteur privé.
Source : modèle de microsimulation Destinie de l'Insee.
Les résultats récapitulés ci-dessus montrent que la différence de mortalité entre déciles de revenu exerce des effets anti-redistributifs entre les hommes, mais d'ampleur relativement faible .
- En ce qui concerne le minimum contributif , il profite essentiellement aux femmes (28 % d'entre elles en sont bénéficiaires contre 3 % des hommes seulement), mais les couples en profitent aussi, bien que de façon moins nette. Si cet avantage n'existait pas, le système de retraite ne comporterait aucune redistribution vers les femmes et les couples à bas salaires .
- Enfin, les avantages familiaux de durée d'assurance et l' Assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) permettent d'augmenter les pensions de leurs bénéficiaires, les femmes essentiellement, de façon assez homogène pour les différents déciles. Dans cet ensemble, les majorations de durée d'assurance pour enfants exercent des effets moins marqués que l'AVPF.
d) Une redistributivité en panne ?
Les différentes évolutions relevées plus haut, qui toutes rendent compte de l'existence d'un effet redistributif dans le système français de retraite (redistribution entre retraités et actifs et au sein de la population des retraités), semblent interrompues depuis le milieu des années 80.
A partir de 1985, le taux de pauvreté des retraités remonte légèrement.
Par ailleurs, même si ce constat est discutable, selon certaines études, la France ressortait au milieu des années 90 comme le seul pays développé où la distribution des revenus des retraités par rapport à celle des actifs était plus inégalitaire .
|
RATIOS P
90
/P
10
* POUR LES
PERSONNES DE 65 ANS OU PLUS
|
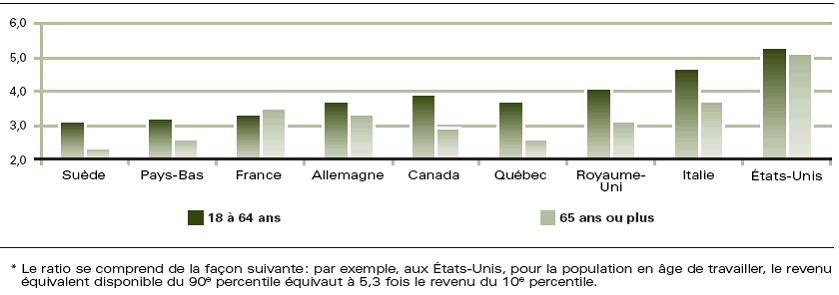
Source : RRQ (2004)
Il est vrai que cette inégalité est relativement faible, que le processus de réduction des inégalités entre retraités a, depuis, repris, et que les comparaisons entre pays sont fondées sur des données très hétérogènes à l'image de la très grande différenciation des types de revenus des personnes en âge d'être à la retraite dans les pays figurant dans le graphique (voir ci-dessous).
Enfin, les réformes intervenues en 1993 et 2003 pourraient augmenter les inégalités si la règle d'indexation des pensions, qui est désormais en principe de les ajuster en fonction des prix, devrait être rigoureusement appliquée 105 ( * ) .
3. ... mais plus forte que dans les systèmes non universels, par capitalisation
Même si la redistributivité du système de retraite français ne ressort pas comme particulièrement forte, il y a tout lieu de penser qu'elle est beaucoup plus effective que si le système de retraite était moins universel.
a) La capitalisation : un système théoriquement anti-redistributif
Dans les systèmes de retraite ménageant une large place aux choix individuels , sauf dispositions particulières d'effets contraires, il n'y a pas de redistribution verticale intra-générationnelle . Le choix de tels systèmes a, au contraire, presque systématiquement des incidences anti-redistributives .
L'anti-redistributivité provient alors des effets asymétriques de la liberté de choix conférée aux agents. Dans les systèmes non universels, l'État ne joue pas son rôle tutélaire et cet abandon, combiné à des capacités financières fortement différenciées de se garantir contre un risque futur, paraît s'accompagner d'une plus forte dispersion des revenus à l'âge de la retraite qu'au cours des périodes d'activité.
La question abordée ici est un peu différente 106 ( * ) : elle est celle de savoir si des régimes par capitalisation ne comportent pas, en soi, moins de redistribution que les régimes par répartition.
Dans les systèmes de retraite par capitalisation , l'absence de redistribution vient de ce que les droits sont proportionnels aux versements aux fonds. Ce lien de proportionnalité peut aussi se retrouver dans les régimes de retraite par répartition . Mais, dans ces régimes, il est plus facile d'introduire de la redistributivité . Dans les systèmes par répartition, les droits de retraite sont définis par des dispositions juridiques alors que dans les régimes de capitalisation, la constitution substantielle de droits de propriété est nécessaire. La redistributivité verticale implique alors, ou des subventions aux personnes de revenus relativement modestes destinées à les aider à cotiser, ou la définition de droits de propriété inégalitaires, préférentiels, au profit de ces mêmes catégories. Dans les faits, de telles dispositions sont très difficiles à mettre en oeuvre.
Du coup, la redistributivité est quasi-inexistante dans les régimes par capitalisation .
En pratique , ces régimes s'accompagnent d' une anti-redistributivité marquée pour des raisons assez faciles à prévoir.
En premier lieu, même si ce problème concerne aussi les régimes par répartition, les interruptions de carrière plus fréquentes pour les revenus les plus modestes, ont un impact particulièrement fort dans des régimes où le versement effectif et continu de contributions est une condition forte pour bénéficier des prestations . En bref, plus que dans les systèmes par répartition, la couverture des personnes est inégale au détriment des plus précaires.
Par ailleurs, les systèmes par capitalisation prévoient souvent un ajustement volontaire des contributions . Or, comme celles-ci sont représentatives d'une allocation de l' épargne individuelle à la couverture du risque viager et que les capacités d'épargne se réduisent à mesure que le revenu diminue , la distribution des droits individuels dans le cadre des fonds accentue les inégalités de revenu.
Enfin, les régimes par capitalisation s'accompagnent souvent d' avantages fiscaux qui, par hypothèse, profitent inégalement à la population . Seuls les assujettis à l'impôt, ceux qui disposent d'un revenu supérieur au seuil du revenu imposable, en bénéficient. Par ailleurs, il y a tout lieu de penser que ces avantages fiscaux (qui peuvent concerner les contributions ou/et les prestations) sont plus que proportionnels au revenu.
Evidemment, rien n'empêche théoriquement de construire des systèmes par capitalisation redistributifs. Mais, en pratique, cette possibilité théorique semble difficile à mettre en oeuvre . Elle ne correspond intrinsèquement pas à la logique de ces systèmes . Et, de ce fait, toute accentuation de la redistributivité des régimes par capitalisation risque de provoquer des fuites hors du système.
Au demeurant, les clauses dites « d'opting out » , c'est-à-dire de retrait, sont fréquentes dans les pays où des régimes par capitalisation obligatoires sont prévus. Elles représentent une faculté de s'exempter de participer à ces régimes, qui, dans les faits, semble prévue pour les catégories de revenu qui estimeraient profiter moins que leur dû de ces systèmes.
b) Une confirmation empirique
La comparaison des « quasi-taux de remplacement » dans les pays de l'OCDE paraît minimiser la portée pratique de ces analyses théoriques.
Mais, une étude approfondie des composantes des « quasi-taux de remplacement » donne du crédit à ces approches .
« QUASI-TAUX DE REMPLACEMENT » POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE 66 À 75 ANS
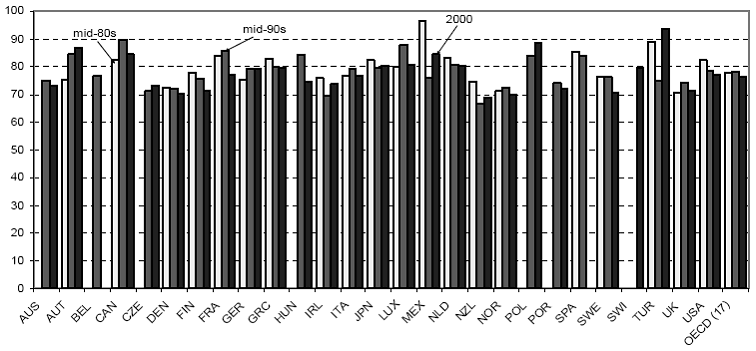
Note : les quasi-taux de remplacement comparent
l'ensemble des revenus
des personnes âgées de 66
à 75 ans avec ceux des personnes âgées de 51 à 65
ans.
Source : OCDE.
Le graphique ci-dessus donne une image plutôt homogène du niveau des « quasi-taux de remplacement » dans les pays de l'OCDE.
Mais, cet indicateur ne permet pas de conclure à l'équivalence des systèmes de retraite .
(1) Des taux de remplacement des régimes obligatoires très inégaux
De fait, l'image d'homogénéité donnée par le graphique s'accompagne d'une grande diversité des taux de remplacement des régimes obligatoires de retraite .
TAUX BRUT DE REMPLACEMENT DES RÉGIMES DE
RETRAITE OBLIGATOIRES,
EN POURCENTAGE DES DERNIERS SALAIRES BRUTS DES
HOMMES
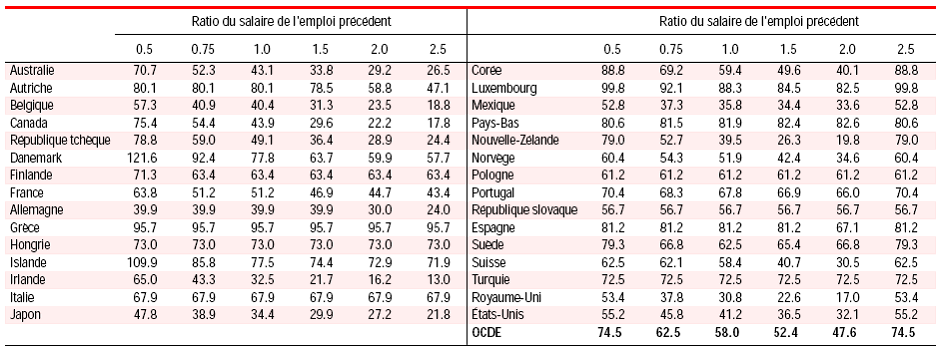
Note de lecture : au niveau de la moitié du
salaire moyen, les prestations vieillesse des régimes de retraite
obligatoires remplacent en moyenne 74,5 % comme au niveau de 2,5 fois
le salaire moyen dans l'OCDE.
Source : Panorama de la
société. Les indicateurs sociaux de l'OCDE. 2006.
Alors que le « quasi-taux de remplacement » est proche de 80 % dans l'OCDE, le taux de remplacement assuré par les régimes obligatoires de retraite ne s'élève qu'à 58 % au niveau du salaire moyen.
Il existe entre les pays de fortes disparités de position par rapport à cette situation moyenne.
Dans les pays non européens, les taux du remplacement sont beaucoup plus bas. En Europe, le Royaume-Uni assure un taux de remplacement également inférieur à la moyenne comme l'Allemagne et, à moindre degré, la France.
(2) Malgré une apparente redistributivité, des niveaux de remplacement très faibles dans les pays sans régime universel par répartition
Les taux de remplacement sont généralement décroissants ce qui confirme la dimension redistributive des régimes obligatoires de retraite. On peut observer que la baisse des taux de remplacement à mesure que le revenu augmente est particulièrement nette aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Ainsi, la concentration des dépenses des régimes de retraite obligatoires apparaît particulièrement forte dans ces pays, donnant l'image d'une forte redistributivité des systèmes de retraite .
Cependant, les taux de remplacement des régimes obligatoires de retraite dans les pays à régime de capitalisation apparaissent beaucoup plus faibles pour les bas revenus et les revenus intermédiaires que dans les autres pays , les Pays-Bas faisant exception.
Les données relatives aux régimes obligatoires doivent être complétées pour tenir compte des autres ressources des personnes en âge d'être retraitées.
Dans certains pays, les dépenses privées de pension occupent une place majoritaire .
L'image de forte redistributivité donnée par ces pays est trompeuse :
- elle reflète le ciblage des régimes obligatoires de retraite dans plusieurs de ces pays qui, ne couvrant qu'une partie souvent très réduite de la population, s'apparentent davantage à des systèmes de lutte contre l'exclusion 107 ( * ) qu'à des systèmes de retraite ;
- mais, elle s'efface dès que les revenus atteignent un niveau élevé, ce qui est conforme aux analyses selon lesquelles la segmentation des systèmes de retraite des pays sans régime universel de répartition implique des gains asymétriques, en faveur des plus riches .
Dans ce contexte, l'homogénéité des « quasi-taux de remplacement » nationaux dans l'OCDE doit beaucoup aux compléments de revenus que les ménages des pays où les systèmes obligatoires sont relativement peu développés tirent d'autres sources : la poursuite d'une activité ou les fruits de l'épargne individuelle .
La poursuite d'une activité professionnelle apparaît comme particulièrement nécessaire aux personnes âgées dans les pays où l'universalité des régimes de retraite n'est pas assurée .
REVENUS DES RETRAITÉS PAR ORIGINE (EN %)
|
Canada |
Allemagne |
Pays-Bas |
Norvège |
Suède |
Royaume-Uni |
États-Unis |
|
|
Ménages comptant un retraité entre 65 et 74 ans |
|||||||
|
Salaire |
20,1 |
17,5 |
5,3 |
28,2 |
14,9 |
18,9 |
39,2 |
|
Investissement 1 |
11,8 |
7,5 |
6,2 |
7,7 |
8,9 |
12,5 |
15,1 |
|
Pension de retraite 2 |
28,6 |
13,1 |
40,5 |
14,7 |
14,5 |
24,3 |
15,3 |
|
Prestations sociales 3 |
39,5 |
62,0 |
48,0 |
49,4 |
61,8 |
44,3 |
30,3 |
|
Ménages comptant un retraité de + de 75 ans |
|||||||
|
Salaire |
6,0 |
5,7 |
7,4 |
7,7 |
2,9 |
10,6 |
21,8 |
|
Investissement 1 |
17,1 |
9,0 |
5,6 |
9,7 |
8,3 |
11,9 |
18,9 |
|
Pension de retraite 2 |
28,8 |
16,1 |
33,3 |
15,2 |
11,8 |
19,7 |
16,6 |
|
Prestations sociales 3 |
48,1 |
69,3 |
53,7 |
67,4 |
76,9 |
57,1 |
42,7 |
1 Revenus du patrimoine individuel
2 Revenus du
deuxième pilier du système de retraite
3 Revenus du
système public de retraite
Source : Steven Prus et Robert Brown, 2006 « Income inequality over the Later-life course : A comparative analysis of seven OECD Countries », WP 435, Luxembourg Income Studies.
Quant aux fruits de l'épargne privée, il est assez vraisemblable qu'ils sont beaucoup plus dispersés que les bénéfices assurés par les régimes obligatoires de retraite . Ceux-ci sont liés à des revenus d'activité qui sont moins inégaux que l'accumulation patrimoniale.
(3) La confirmation par les taux de pauvreté
Au total, on observe que les taux de pauvreté sont généralement plus élevés dans les pays où les régimes de retraite obligatoires sont comparativement peu développés .
TAUX DE PAUVRETÉ RELATIVE ET DÉPENSES DE
RETRAITE
DES RÉGIMES OBLIGATOIRES
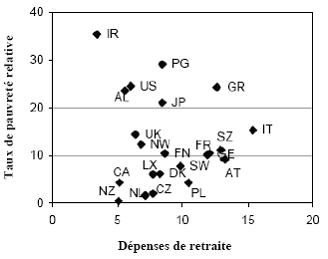
Source : OCDE
C. LA QUESTION DE LA REDISTRIBUTION INTERGÉNÉRATIONNELLE NE DOIT PAS ÊTRE TRAITÉE DE FAÇON SIMPLISTE
1. Des difficultés d'approche considérables
Tout système de retraite opère une redistribution entre les générations, des actifs vers les titulaires de droits à pension qui les exercent .
Comme telles, les dépenses publiques de retraite d'un système par répartition sont par nature redistributives entre les générations imbriquées qui y participent . Cette redistributivité s'exerce à partir d'un critère d' âge . Elle opère un transfert net des actifs vers les « inactifs ».
Mais, il en va de même des systèmes qui font une place plus ou moins grande à la capitalisation. Dans ce dernier cas, le patrimoine retraite sert de socle aux revenus des retraités qui représentent également un prélèvement sur le PIB et, par conséquent, sur les revenus attribuables aux actifs .
Cependant, on conviendra que le constat trivial de la redistributivité entre actifs et inactifs est loin d'épuiser la question, fort complexe , des propriétés redistributives intergénérationnelles des systèmes de retraite .
La question de la redistributivité intergénérationnelle doit être posée à partir de l'idée que les systèmes de retraite par répartition reposent sur une sorte d'équivalent de contrat entre générations .
Les actifs reçoivent, en échange de leurs transferts en faveur des retraités, la promesse d'être bénéficiaires à leur tour dans l'avenir de la contribution des générations futures au financement des retraites.
Tout se passe comme si les générations successives acquéraient des droits sur les générations qui les suivent (les générations futures) en échange de leur contribution au financement des pensions des générations passées (celles qui bénéficient du versement des prestations de retraite) .
Ce mécanisme peut conduire à poser un constat de redistribution intergénérationnelle s'il n'y a pas d'équivalence entre les droits des différentes générations . C'est dans ce sens que, compte tenu des perspectives démographiques d'une forte diminution du rapport actifs sur inactifs, la question est aujourd'hui posée, avec de plus en plus d'insistance, de la redistributivité intergénérationnelle du système et des dépenses de retraite.
Elle peut être résumée dans la perspective d'une augmentation du ratio des dépenses de retraite dans le PIB, autrement dit d'un alourdissement du prélèvement des inactifs sur les richesses crées par les actifs.
Certains associent à ces prévisions le constat d'une rupture d'égalité et souhaitent mettre en oeuvre dans le domaine des retraites un objectif de stricte égalité entre les générations.
Pourtant, le concept d'égalité des générations au regard des bénéfices nets du système de retraite n'est évident qu'en apparence , et il faut s'entendre sur un ou des critères précis pour lui donner une signification réelle.
Il faut relever d'emblée deux données importantes :
- l'augmentation prévisible du prélèvement des retraités n'est pas inédite, ni en soi, ni par son ampleur : les générations qui en seraient « responsables » ont supporté de tels événements ;
- la progression du prélèvement exercé par les retraités n'est pas équivalente à une révision à la baisse absolue des perspectives de pouvoir d'achat des actifs contrairement à ce qu'on peut parfois affirmer. D'une part, les perspectives de croissance qui servent de base aux simulations relatives aux retraites sont compatibles avec l'augmentation concomitante du poids des retraites et du pouvoir d'achat des actifs. D'autre part, s'il est vrai que par rapport à une situation inchangée, le pouvoir d'achat des actifs progresserait moins fortement, il faut prendre en compte la constitution des droits à pension auxquels leur ouvrent droit leurs cotisations.
Mais, au-delà, la question se pose de savoir ce que peut bien recouvrir l'objectif que les systèmes de retraite préservent l'égalité entre générations .
Cet objectif pose d'abord des problèmes conceptuels considérables.
Ainsi, si l'on s'intéresse au revenu , on pourra chercher à égaliser, pour toutes les générations, soit le taux de cotisation ou le taux de remplacement des revenus d'activité par les pensions, soit le niveau absolu des cotisations ou des pensions, soit le rapport entre cotisations versées et pensions reçues (le taux de rendement que chaque génération tire de ses cotisations). Chacun de ces critères conduit à des mesures nettement différentes .
De même, si l'on s'intéresse aux aspects non directement monétaires de la retraite, dira-t-on que le système est inégalitaire et entraîne une redistribution entre générations si toutes les générations ne bénéficient pas du même âge de départ à la retraite, ou si elles n'ont pas une durée homogène passée à la retraite, ou encore, si le rapport entre durée de retraite et durée d'activité n'est pas constant ?
Il pose, en second lieu, des problèmes non moins grands de faisabilité .
Les modifications du rapport démographique constituent une variable très lourde, c'est-à-dire une perspective susceptible d'influencer en profondeur le régime de la croissance économique , à la fois dans son rythme et dans les modalités de répartition du revenu.
Le vieillissement démographique doit, en théorie, ralentir les perspectives de croissance en altérant le potentiel de production en même temps qu'il introduit un équilibre différent des conditions de répartition du revenu.
Face à la puissance de ces phénomènes, toute réforme qui ne concernerait qu'un des aspects du partage du revenu entre retraités et actifs - par exemple, l'âge de liquidation des droits dans le régime par répartition - n'aura qu'une influence limitée.
C'est, plus globalement, qu'il faut traiter la question en se fixant un objectif, portant sur le niveau du prélèvement admissible exercé par les retraites et sur sa répartition entre eux .
Sous cet angle, le contrôle social de ce problème est certainement difficilement compatible avec une libéralisation complète des systèmes de prévoyance-retraite , sauf à imaginer que les prélèvements sur le revenu national dont ils seraient le socle fassent l'objet d'une active politique de redistribution.
2. Une redistributivité qui ne rime pas nécessairement avec iniquité
A cette question de redistributivité est souvent amalgamée une autre, pourtant différente : celle de l'équité intergénérationnelle du système des retraites . Les différentes générations cotisantes ne risquent-elles pas d'être victimes d'un marché de dupes, selon lequel elles auraient subi des prélèvements sur leurs revenus supérieurs aux droits exerçables en échange ?
La question de l'équité vue à travers l'égalité du traitement entre les générations ne peut être posée en des termes si généraux .
Il existe des difficultés majeures qui portent sur les termes de la comparaison . Cette question de l'équité devrait être abordée en considérant la situation des différentes générations et en prenant en compte la totalité de leur cycle de vie. Or, celle-ci est évidemment tributaire d'une multitude de transferts entre générations, monétaires : le taux d'épargne, l'effort d'investissement, les dépenses d'éducation... ou non : l'attention éducative, la prise en charge familiale des problèmes de vie....
L'équité du système de retraite du point de vue des générations serait assuré dès lors qu'il n'induirait pas de rupture au regard de leur revenu total actualisé .
Cette démarche est parfois délaissée au profit d'une comparaison à un instant donné de la situation respective des différentes classes d'âge. Cette comparaison est beaucoup plus aisée mais elle n'est pas éclairante.
Elle ne livre qu'un message partiel sur les effets, par génération, du régime de retraite.
3. Aperçus empiriques sur quelques aspects de l'équité intergénérationnelle
Si l' on examine l'équité intergénérationnelle instantanée, et sur la base du critère selon lequel le niveau de vie des actifs et des retraités devrait être identique, on observe qu'après de nets progrès entre 1975 et 1990, un reflux certain de la parité des niveaux de vie s'est produit au cours des années 90 .
Ce processus semble résulter pour beaucoup d'une sous-indexation des pensions par rapport aux salaires .
Il reste que la comparaison instantanée des niveaux de vie et une approche de l'équité reposant sur les seules données monétaires ne permettent pas d'appréhender le problème correctement comme on l'a indiqué précédemment.
Afin de mieux prendre en compte la totalité du cycle de vie , un critère d'égalité des rendements actuariels peut être examiné.
Le système de retraite serait équitable si chaque génération pouvait « récupérer » en fonction de ce qu'elle a donné, c'est-à-dire si le rendement des cotisations versées par chacune se révélait uniforme pour toutes les générations .
Juger de l'équité du système de retraite sous cet angle, conduirait à observer l'existence d'un problème structurel d'équité. Génération après génération, le taux de rendement actuariel des cotisations s'est modifié et est allé en se dégradant.
RENDEMENT ACTUARIEL PAR GÉNÉRATION
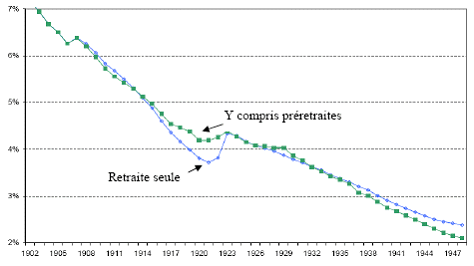
Source : Antoine Bozio, thèse EHESS
Les taux de rendement actuariels perçus par chaque génération depuis celle de 1902, calculé à partir de leurs efforts contributifs, ont nettement varié à la baisse .
Les générations anciennes ont reçu des actifs des prestations qui ont de beaucoup excédé leurs propres contributions. Au fur et à mesure que se succédaient les générations, ce transfert s'est amenuisé. Les générations successives ont connu des ratios « prestations assurées à elles/ cotisations versées par elles » qui ont diminué. Ce mouvement accrédite l'idée d'une redistribution des générations les plus neuves au profit des générations relativement plus anciennes.
Toutefois, il convient de se garder des interprétations erronées que risque d'engendrer des raisonnements conçus à partir du seul taux de rendement des cotisations-retraite .
Vue sous l'angle du taux de rendement des cotisations, la mise en place du régime de retraites par répartition a été très favorable aux premières générations puisque celles-ci n'avaient pas eu à cotiser beaucoup avant de bénéficier des pensions servies par le régime. Cependant, considéré d'un autre point de vue (la durée des retraites, l'ampleur des prestations), le régime a finalement apporté des avantages à ces générations qui ont été faibles. Corrélativement, la contribution des générations suivantes a alors peu amputé leur revenu.
Ainsi, dans une large mesure, la pente descendante de la courbe du graphique ci-dessus correspond à une maturation du système de retraite par répartition .
En régime de croisière , les rendements d'un tel système , à taux de remplacement et à âge de départ en retraite constants, tournent autour de la variation annuelle de la masse salariale corrigée de l'augmentation de l'espérance de vie .
Dans un tel contexte, les transferts entre génération tels qu'ils sont appréciés à partir du taux de rendement des cotisations varient à raison :
- du rythme de croissance ;
- de la variation de la durée de service des pensions (l'espérance de vie) ;
- d' éventuelles modifications institutionnelles ;
- et, dans une vision dynamique, de l'évolution du rapport démographique .
Entre 1975 et le milieu des années 80, le niveau de vie relatif des retraités 108 ( * ) s'est amélioré. La génération la plus jeune (celle des 65-69 ans) a davantage profité de ce mouvement général que les autres du fait de l'amélioration des taux de remplacement global (en lien avec des modifications institutionnelles des régimes et de celle des salaires servant d'assiettes à la liquidation des retraites (voir ci-après)).
Au-delà, la parité des niveaux de vie entre actifs et retraités a été altérée, une partie de ce processus pouvant être attribuée à des progressions importantes des salaires dans la phase haute du cycle de la fin des années 90.
|
NIVEAU DE VIE RELATIF DES MÉNAGES DE
RETRAITÉS
|
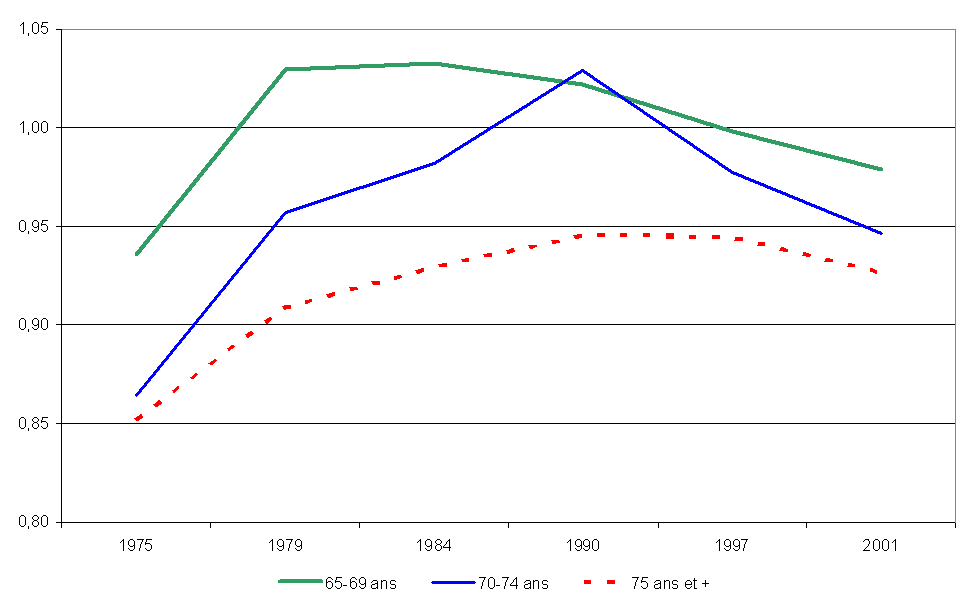
Source : INSEE-DGI, enquêtes « Revenus fiscaux ».
III. DES DÉPENSES DE SANTÉ AUX PROPRIÉTÉS REDISTRIBUTIVES JUSTICIABLES DE JUGEMENTS CONTRADICTOIRES SELON LE POINT DE VUE
L'appréciation des propriétés redistributives des dépenses publiques de santé illustre les difficultés conceptuelles que présente l'analyse de la redistributivité des dépenses publiques non monétaires (les dépenses publiques qui financent non des transferts mais des biens et services collectifs)
Les dépenses collectives de santé ont pour objectif principal d'assurer une solidarité entre les bien-portants et les malades, soit une redistribution horizontale. Elles n'ont pas pour objet de réduire la dispersion des revenus ce qui est l'objectif des mécanismes de redistribution verticale.
Il reste que, dans les faits, la poursuite d'un objectif de solidarité horizontale peut s'accompagner d'une redistribution des revenus si, après les prestations versées par le système public, l'échelle des revenus est plus étroite que celle des revenus avant prestations.
Lorsque la dépense publique ne consiste pas en un transfert financier mais qu'elle finance un service public, dont, toutefois, la consommation peut être individualisée, il est possible de traduire cette dernière en un équivalent monétaire.
On peut rapporter celui-ci au revenu de chaque consommateur pour mesurer un revenu augmenté de la consommation des dépenses publiques 109 ( * ) . On dit que les dépenses publiques sont redistributives quand la hiérarchie des revenus ainsi augmentés est moins forte que la hiérarchie des revenus primaires 110 ( * ) .
Dans une telle conception, la distribution des consommations de dépenses publiques peut être inégalitaire et croissante avec le revenu sans, pour autant, que le bilan redistributif des dépenses publiques apparaisse négatif. En effet, il suffit que la hiérarchie des consommations de dépenses publiques soit moins ouverte que celle des revenus primaires pour que les dépenses publiques aient un effet redistributif. Cependant, c'est de façon encore plus évidente, que des dépenses publiques qui croissent quand le revenu diminue sont à l'origine d'un phénomène de redistribution.
S'agissant des dépenses de santé, elles apparaissent indéniablement redistributives , du moins sur le strict plan monétaire, puisqu'elles participent de ce dernier processus.
En outre, d'autres modalités d'appréciation de la redistributivité du système renforcent cette appréciation.
Toutefois, plusieurs données, moins globales, conduisent à nuancer le constat d'une redistributivité du système public de santé :
- qualitativement, la redistributivité est loin d'être assurée ;
- quantitativement, les « restes à charge » des patients sont dégressifs et viennent atténuer le constat de la redistributivité du système.
A. UNE REDISTRIBUTIVITÉ VERTICALE APPAREMMENT TRÈS NETTE
1. Une redistributivité monétaire
Les dépenses de santé des ménages ainsi que les remboursements dont ils bénéficient de la part des organismes d'assurance-maladie 111 ( * ) décroissent à mesure que le revenu augmente (tableau ci-après). Cette propriété manifeste l'existence d'une redistributivité monétaire verticale.
MONTANTS ANNUELS MOYENS PAR MÉNAGE DE
DÉPENSES DE SOINS
ET DES REMBOURSEMENTS PERÇUS EN
2003
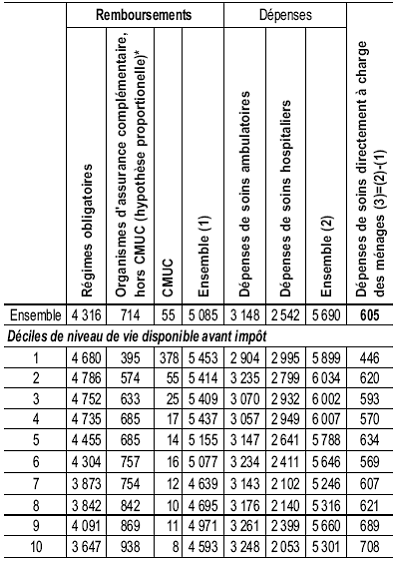
Sources : « L'assurance-maladie contribue-t-elle à redistribuer les revenus ? », Laurent Caussat, Sylvie Le Minez et Denis Raynaud. DREES, « Les dossiers solidarité et santé », n° 1, janvier-mars 2005.
Le montant annuel moyen des remboursements de soins s'élève à 5.453 euros par ménage appartenant aux 10 % les moins favorisés ; il est de 4.593 euros pour les 10 % situés en haut de l'échelle.
Pour les seuls régimes obligatoires , les remboursements s'étagent entre 4.680 euros par ménage du premier décile et 3.647 euros pour le dernier , soit 28,3 % de plus pour les moins favorisés.
Le tableau ci-dessus montre aussi l'importance de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) sans laquelle la couverture complémentaire ressortirait comme nettement anti-redistributive.
Quelle que soit la méthode d'imputation des dépenses publiques de santé aux ménages 112 ( * ) , le gain de niveau de vie imputable aux dépenses de santé est dégressif selon le revenu.
GAIN DE NIVEAU DE VIE INDUIT PAR LES DÉPENSES DE
SANTÉ,
SELON LE NIVEAU DE VIE

Lecture
: un ménage faisant partie des
20 % des ménages les plus modestes en termes de niveau de vie
(1
er
quintile : Q1) a un gain de niveau de vie de
2.800 euros.
Note
: les quintiles de niveau de vie sont
calculés sur la base des revenus avant imputation des dépenses de
santé.
Champ
: France métropolitaine, ensemble des
individus.
Source : « En quoi la prise en compte des transferts liés à la santé modifie-t-elle l'appréciation du niveau de vie ? », François Marical. France. Portrait social 2007. Insee.
Plus la méthode d'imputation des dépenses se rapproche de la consommation effective de soins, plus la redistributivité des dépenses publiques de santé ressort comme élevée.
Les ménages appartenant au premier quintile de revenu voient leur revenu disponible brut augmenté de 3.500 euros, contre environ 2.300 euros dans le dernier quintile. Pour les quintiles intermédiaires, l'apport est de 3.400 euros, 2.500 et 2.400 euros à mesure que le revenu progresse.
Ces deux premiers quintiles de revenus sont ceux qui bénéficient le plus de la redistributivité.
Mais, comme les « suppléments de revenu » mentionnés s'appliquent à des revenus primaires inégaux, on relève que l'effet du système d'assurance-maladie est fortement différencié sur les niveaux de vie de chaque quintile et sur les inégalités de niveau de vie.
EFFETS DES TRANSFERTS MONÉTAIRES ET DES
TRANSFERTS INDUITS
PAR LA SANTÉ SUR LE NIVEAU DE VIE
113
(
*
)
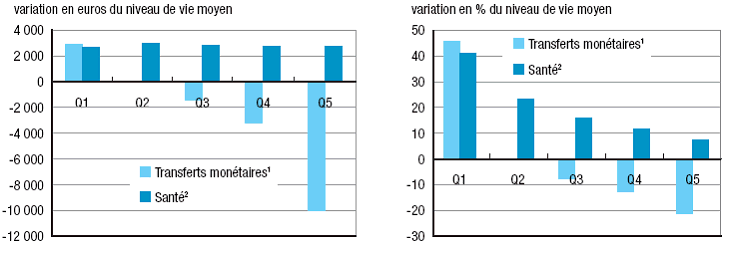
1. Prestations sociales et prélèvements à vocation redistributive.
2. La méthode 2 est utilisée pour l'imputation des dépenses de santé, selon une approche ménage.
Note : les personnes sont classées selon leur niveau de vie avant redistribution, chaque quintile regroupe 20 % de la population, ainsi le 1 er quintile (Q1) regroupe les 20 % des personnes les moins aisées. Pour calculer les effets des transferts sur les gains relatifs de niveau de vie en pourcentage du niveau de vie avant redistribution (graphique de droite), nous nous sommes limités aux personnes dont le niveau de vie avant redistribution est strictement positif.
Lecture : une personne dont le niveau de vie avant redistribution se situe dans les 20 % les moins élevés (1 er quintile : Q1), bénéficie en moyenne de 2.969 euros de gain de niveau de vie du fait des transferts monétaires. Les transferts monétaires ont pour effet d'augmenter de 46 % le niveau de vie moyen des personnes du 1 er quintile, par rapport au niveau de vie avant redistribution.
Champ : France métropolitaine, ménages ordinaires.
Source : « En quoi la prise en compte des transferts liés à la santé modifie-t-elle l'appréciation du niveau de vie ? », François Marical. France. Portrait social 2007. Insee.
La dispersion des prestations est influencée par celle des dépenses de soins , qui sont d'autant plus élevées que le revenu est faible - 5.899 euros pour les ménages du premier décile ; 5.301 euros pour ceux du décile supérieur -.
Mais elle est plus importante que celle des dépenses de soins ce qui rend compte de « taux de remboursement », qui jouent eux-mêmes inégalement dans un sens redistributif. Ils sont moins élevés quand on relève des classes de revenu les plus hautes pour des raisons institutionnelles diverses .
Ainsi, la redistributivité horizontale du système n'apparaît pas seule en cause dans les phénomènes de redistributivité verticale. Les arrangements institutionnels y contribuent aussi, sans qu'on puisse leur attribuer pour autant des vertus redistributives sans ambiguïtés ainsi qu'on l'indique.
2. Une redistributivité des conditions socio-économiques
La question des effets redistributifs des dépenses publiques de santé ne peut pas être appréhendée par les seules approches consistant à comparer l'échelle des revenus primaires et celle des revenus après versement des prestations publiques de santé.
La redistributivité de l'intervention publique doit prendre en compte deux phénomènes que ne permet pas d'appréhender une mesure strictement monétaire.
- Une dimension qualitative doit être explorée : celle de la distribution de l'accès aux services de santé.
La santé, comme d'autres champs de l'intervention publique, est un « bien supérieur » dont la consommation est d'autant plus élevée que le revenu est important 114 ( * ) . Pour des biens de cette nature, le consentement individuel à les payer semble plus faible pour les bas revenus que pour des revenus relativement plus élevés.
Ainsi, en l'absence d'une intervention collective, qui passe par l'organisation d'un système obligatoire de financement, il est probable que l'accès au bénéfice des soins serait beaucoup moins étendu qu'il ne l'est.
En somme, le système public de santé , par son existence même , peut être considéré comme produisant une plus grande égalité d'accès aux soins , en dehors même de toute considération sur la traduction monétaire du système pour les bénéficiaires différenciés par leurs niveaux respectifs de revenu.
Cette propriété redistributive du système n'a pas seulement une dimension horizontale ; elle opère également une redistribution verticale puisqu'elle égalise les conditions a priori de bien-être des individus.
Cependant, elle n'a pas tous les effets qualitatifs qu'on pourrait en espérer - v. infra .
- A son tour, cette propriété a toutes chances d'influer sur l'état de santé comparatif des personnes. L'égalisation d'accès aux soins trouve, selon toute vraisemblance, une traduction dans l'égalisation des conditions effectives de santé 115 ( * ) . Or, celles-ci sont une variable sans doute importante de la formation des revenus primaires. Autrement dit, une distribution moins inégalitaire des pathologies est susceptible de réduire l'amplitude des revenus primaires si la plus grande égalité d'accès aux soins améliore la condition des plus précaires .
B. UNE REDISTRIBUTIVITÉ MONÉTAIRE LIMITÉE ET PRINCIPALEMENT COMPENSATRICE
Plusieurs indices convergent donc pour établir que le système public de santé exerce des propriétés redistributives en améliorant le sort des ménages les plus modestes relativement à celui des bénéficiaires potentiels des plus favorisés.
Toutefois, des données moins globales conduisent à tempérer ce constat .
1. Incertitudes techniques
- Tout d'abord, le diagnostic de redistributivité du système repose sur des conventions nécessairement approximatives d'un point de vue technique . En particulier, la dépense par ménage dans chaque décile est estimée sur la base de la moyenne des dépenses constatées. Avec une telle méthode, on ne saisit pas les effets éventuels de concentration des dépenses à l'intérieur de chaque décile. La précision du diagnostic de redistributivité entre déciles de revenus en est nécessairement affectée.
Surtout, une partie importante de l'apparente « surconsommation » médicale des catégories à faibles revenus provient de leur recours à des soins hospitaliers. Or, la tarification des services hospitaliers n'est pas d'une telle précision et transparence qu'il soit certain que les imputations aux différentes catégories soient pertinentes. Pour le vérifier, il faudrait pouvoir disposer de profils de soins hospitaliers très détaillés et être sûr que les coûts relatifs à chaque type de soins soient correctement identifiés.
2. Des « restes à charge » anti-redistributifs qui réduisent l'égalisation de droits d'accès
* Par ailleurs, le constat de la redistributivité des dépenses publiques de santé reste cantonné au système public lui-même .
Celui-ci comporte des mécanismes redistributifs (moyennant des nuances qualitatives - v. infra ), mais ce diagnostic n'équivaut pas à un constat de redistributivité global du système de santé français.
Ce dernier constat est suspendu à l'étude de l'étendue du système public de santé. La redistributivité d'un système de prise en charge collective d'une consommation peut être très forte sans pour autant que ce système assure une péréquation globale, dès lors que la fraction de la consommation prise en charge est faible.
En ce qui concerne le système public de santé, on doit observer que, s'il couvre en France une part relativement élevée des dépenses, il laisse à la charge des ménages une fraction non négligeable de leurs dépenses .
DÉPENSES DE SANTÉ RESTANT À LA CHARGE DES MÉNAGES (EN % DU TOTAL) EN 2004
|
Royaume-Uni |
Japon |
France |
Allemagne |
Italie |
Canada |
États-Unis |
|
14 |
20 |
22 |
23 |
25 |
30 |
55 |
Source : OCDE ; dépenses non couvertes par les régimes publics obligatoires de Sécurité sociale
Cette fraction est beaucoup plus faible qu'aux États-Unis , où le système public de santé peut être jugé très fortement redistributif dans les limites de son intervention mais relève d'une appréciation radicalement contraire quand on examine son extension.
Toutefois, les 22 % des dépenses de santé restant à la charge des ménages 116 ( * ) conduisent à examiner les effets des limites posées à l'intervention du système public de santé sur les ménages appréhendés en fonction de leurs niveaux de revenu.
Sous cet angle, on observe que, si le « reste à charge » supporté par les ménages augmente en fonction de leur revenu , il représente une charge proportionnellement nettement plus lourde pour les revenus les plus faibles ( graphique ci-après ) 117 ( * ) .
LE RESTE À CHARGE DES MÉNAGES (INDICATEUR
EN NIVEAU) :
LES DÉPENSES DE SANTÉ DES MÉNAGES
DIMINUÉES DES PRESTATIONS REÇUES (APPROCHE « COMPTES DE
LA SANTÉ »)
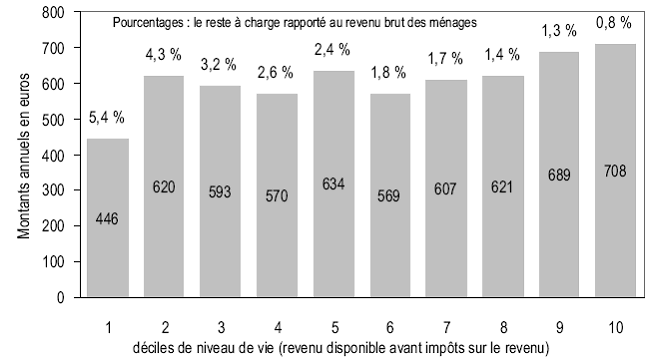
Sources : « L'assurance-maladie contribue-t-elle à redistribuer les revenus ? », Laurent Caussat, Sylvie Le Minez et Denis Raynaud. DREES, « Les dossiers solidarité et santé », n° 1, janvier-mars 2005.
Elle est de 5,4 % du revenu pour les ménages du premier décile et décroît pour se monter à 0,8 % pour ceux du dernier décile.
La répartition du « reste à charge » des ménages apparaît nettement anti-redistributive .
Traduisant les limites de l'extension de l'assurance-maladie publique, elle conduit à nuancer le constat de ses propriétés redistributives , nuances qui ne doivent pas être vues comme attribuables aux dépenses publiques de santé mais bien au champ limité qui est le leur.
Les limites de la redistributivité du système de santé français en lien avec l'ampleur de la couverture publique, pourraient d'ailleurs être sensiblement plus importantes que ce que montrent les chiffres précédents.
Il est probable que la contrainte budgétaire qui pèse particulièrement sur les revenus les plus faibles conduit à renoncer à des dépenses de santé, ou à certaines catégories d'entre-elles . De fait, la consommation de soins par les ménages relativement défavorisés apparaît typée par rapport à celle des autres ménages. Ils recourent davantage à l'hôpital et moins aux consultations de spécialistes, qui sont moins remboursées. C'est d'ailleurs pour cela que les taux de remboursement dont ils bénéficient sont plus élevés.
Si on plaquait la structure de consommation médicale des ménages relevant du décile des revenus les plus élevés sur les ménages du premier décile - celui où les revenus sont les plus faibles -, le reste à charge de ces ménages s'élèverait à plus de 8 % de leur revenu (contre 5,4 % constatés), soit dix fois plus que ce qui reste à la charge des ménages les plus aisés .
* Ces dernières observations conduisent à évoquer une nuance qualitative aux propriétés redistributives du système public de santé.
Il a été suggéré plus haut que ce système, par sa seule existence, pouvait être considéré comme redistributif sous l'angle des conditions d'accès aux soins : en son absence, il est probable que la répartition de l'accès aux soins serait plus inégalement répartie, ce que d'ailleurs confirment les exemples étrangers où le système public d'assurance est moins développé.
Il reste que l'extension du système public est en France variable selon les filières de soins si bien que l'égalisation des conditions d'accès aux soins qu'il engendre globalement s'accompagne de performances moins favorables sous cet angle quand certaines catégories d'offres médicales sont envisagées .
3. Une redistributivité principalement compensatrice
Enfin, on est fondé à affiner l'approche des propriétés redistributives du système public de prise en charge des dépenses de santé sur les revenus en s'efforçant de neutraliser les effets de la redistributivité horizontale du système sur sa redistributivité verticale pour savoir si des personnes ne se différenciant que sous l'angle de leurs revenus bénéficient de retours différenciés.
En effet, le niveau de revenu des ménages n'est pas indépendant du sexe ou de l'âge qui, eux-mêmes, influent sur l'état de santé - il décroît à mesure que celui-ci augmente - et l'état de santé des personnes n'est pas distribué de façon homogène dans la population - il est plutôt moins bon quand les revenus sont plus modestes (entre autres parce que les personnes âgées qui ont de plus faibles revenus sont aussi des personnes en état de santé relativement moins bon).
Une fois ces effets de structure neutralisés, la redistributivité du système est atténuée .
La redistributivité verticale des dépenses publiques de santé résulte, pour partie, de caractéristiques médicales et de la répartition très inégale de la consommation de soins entre individus du fait de caractéristiques indépendantes du revenu mais, pour partie aussi, elle est en lien avec le niveau relatif du revenu.
Ces constats sont attestés par les graphiques ci-dessous.
CONSOMMATION ANNUELLE DE SOINS SELON LE NIVEAU DE
VIE,
À ÂGE ET SEXE DONNÉS
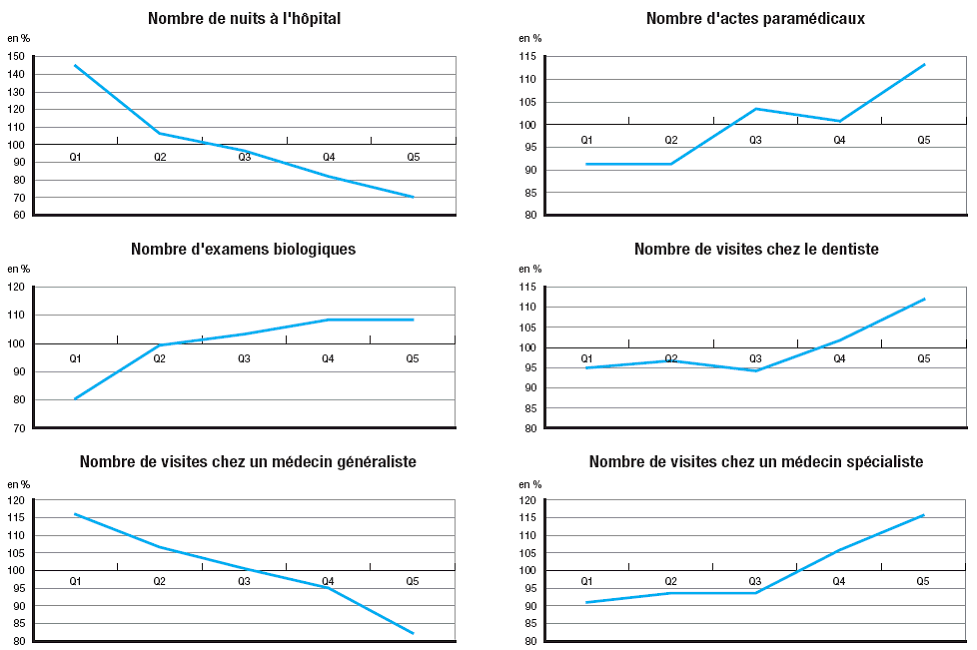
Lecture : en 2003, un individu faisant partie des 20 % des personnes les plus modestes en termes de niveau de vie (1 er quintile : Q1) passe en moyenne 45 % de nuits en plus à l'hôpital que la moyenne de la population de même sexe et de même groupe d'âge, tandis qu'un individu faisant partie des 20 % les plus aisés (5 e quintile : Q5) y passe en moyenne 30 % de nuits en moins.
Champ : France métropolitaine, ensemble des individus.
Source : « En quoi la prise en compte des transferts liés à la santé modifie-t-elle l'appréciation du niveau de vie ? », François Marical. France. Portrait social. 2007. Insee
Il apparaît en particulier que, si les personnes relativement modestes ont moins accès aux spécialistes et aux dentistes que les autres, elles ont beaucoup plus recours à des consultations des généralistes et aux services hospitaliers.
Les personnes de revenu modeste ont une perception 118 ( * ) de leur état de santé très différente des autres couches de la population. Et cette perception les conduit à une consommation médicale qui, à âges et sexes donnés, est plus élevée.
PERCEPTION DE L'ÉTAT DE SANTÉ SELON LE NIVEAU DE VIE
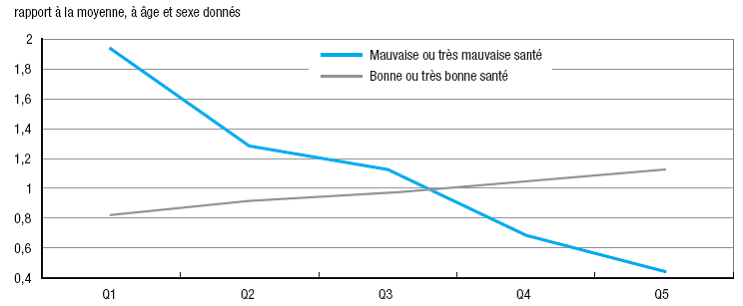
Lecture : en 2003, à âge et sexe donnés, un individu faisant partie des 20 % des personnes les plus modestes en termes de niveau de vie (1 er quintile : Q1) déclare 1,9 fois plus souvent que la moyenne être en mauvaise ou très mauvaise santé.
Champ : France métropolitaine, ensemble des individus.
Source : « En quoi la prise en compte des transferts liés à la santé modifie-t-elle l'appréciation du niveau de vie ? », François Marical. France. Portrait social. 2007. Insee
Le tableau ci-après permet de neutraliser ce qui revient aux facteurs d'âge et d'état de santé dans les dépenses de soins et les remboursements perçus par chaque quintile de revenu .
INDICES DES DÉPENSES MOYENNES DE SOINS DES
MÉNAGES
ET DES REMBOURSEMENTS MOYENS PERÇUS EN 2003,
CORRIGÉS DE LA STRUCTURE D'ÂGE ET DE L'ÉTAT DE
SANTÉ
(BASE 100 POUR LES DÉPENSES TOTALES BRUTES)
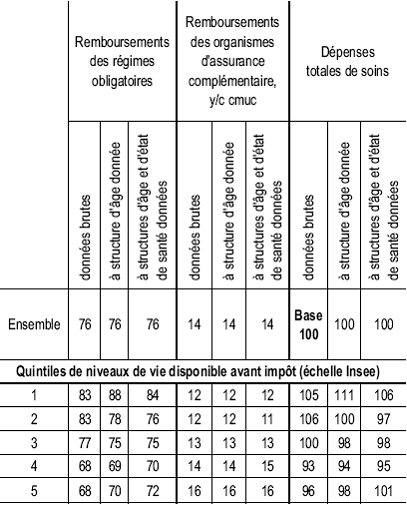
Note de lecture : la dernière colonne du tableau indique le niveau des dépenses de santé relatif de chaque quintile de revenu mesuré en neutralisant les facteurs « âge » et « état de santé » qui peuvent les singulariser quand on observe la réalité. Les personnes appartenant au premier quintile de niveau de vie ont une consommation totale de soins de 106 contre 100 pour l'ensemble de la population.
Sources : « L'assurance-maladie contribue-t-elle à redistribuer les revenus ? », Laurent Caussat, Sylvie Le Minez et Denis Raynaud. DREES, « Les dossiers solidarité et santé », n° 1, janvier-mars 2005.
Si dans chaque quintile , la distribution des états de santé était identique, avec la même pyramide des âges, les ménages les plus modestes présenteraient toujours les dépenses les plus élevées. Mais, ils seraient suivis des ménages du dernier quintile dont la faiblesse apparente des dépenses de soins vient de ce qu'il comporte une faible proportion de personnes âgées et des individus bénéficiant d'un meilleur état de santé à structure d'âge comparable.
Quant aux remboursements, ceux versés par l'assurance-maladie obligatoire restent décroissants avec le niveau de vie, mais la correction selon l'âge et l'état de santé atténue ce constat .
Le rapport entre les deux quintiles extrêmes (Q1/Q5) diminue un peu, passant de 1,22 à 1,17 grâce à la prise en compte du meilleur état de santé des ménages les plus favorisés.
Le rapport entre le deuxième et le dernier quintile diminue encore plus nettement.
Les remboursements versés par les assurances complémentaires restent croissants avec le niveau de vie, résultat qui confirme l'anti-redistributivité de ces remboursements.
Autrement dit, si la redistributivité verticale du système d'assurance-maladie publique est le reflet de comportements de demandes et de taux de remboursement allant dans le sens d'une concentration relative des dépenses publiques vers les moins riches, une partie de la redistributivité est le reflet de compositions différentes des différentes strates de la population sous l'angle de leurs expositions au risque-santé en lien avec des caractéristiques socio-démographiques.
Il serait ainsi sans doute un peu abusif d'évoquer une égalisation des niveaux de vie puisque celle-ci n'intervient pour une grande partie qu'à l'occasion d'une dégradation de l'état de santé, comme une sorte de réparation .
Par ailleurs, les approches instantanées de la redistribution verticale des dépenses de santé devraient être complétées par des études sur le cycle de vie . En effet, l'âge étant une composante majeure du risque et influant sur l'appartenance aux différentes couches de revenu, le constat d'une redistributivité verticale pourrait traduire pour beaucoup les effets d'un glissement des personnes vers des catégories de plus bas revenus, une fois un certain âge dépassé .
Des raisonnements analogues à ceux qui orientent les travaux sur la redistributivité des systèmes de retraite, en particulier la considération des taux de rendement des cotisations, devraient être conduits. Cela permettrait en outre de disposer d'une estimation des effets de redistribution entre générations.
4. Quelle redistributivité au regard des états de santé ?
Enfin, les constats nuancés sur la redistributivité réelle des dépenses publiques de santé invitent aussi à apprécier la redistributivité des états de santé à laquelle elles peuvent contribuer .
Pour avoir des certitudes en ce domaine, il faudrait disposer d'évaluations systématiques soigneuses. Globalement, des écarts importants semblent demeurer au regard des états de santé de la population, en lien avec le revenu. Ces écarts sont d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le système d'assurance-maladie opère une redistribution verticale. Mais, malgré ces vertus, celle-ci ne semble pas en mesure d'égaliser a due proportion les états de santé. Les enjeux d'une compréhension de cet état de fait sont importants.
Ils sont d'ailleurs partiellement financiers. Si le moindre recours aux soins des personnes favorisées tient sans doute à des conditions socio-économiques, il est aussi possible qu'il vienne des caractéristiques qualitatives de leur consommation médicale.
*
* *
Les nuances qu'il faut ajouter au diagnostic de redistributivité des dépenses publiques d'assurance-maladie ne viennent pas remettre en cause le constat qu'on peut en faire .
La solvabilisation de la demande médicale que favorise le système contribue à une égalisation des niveaux de vie, notamment en favorisant un accès plus égalitaire aux soins.
Toutefois, celui-ci est vulnérable à la perspective d'une augmentation des « restes à charge » et devrait être complété par des progrès à réaliser sur le plan qualitatif.
Mais, les propriétés redistributives d'un système collectif de santé sont peu contestables, notamment au regard des données suivantes .
Les graphiques ci-dessous, qui récapitulent les taux de couverture de l'assurance-maladie publique et assurances privées, montrent que les premiers sont systématiquement plus élevés que les seconds, même dans les pays où les assurances privées occupent une place importante .
COUVERTURE DE L'ASSURANCE MALADIE POUR UN ENSEMBLE DE
SERVICES
2005 (OU DERNIÈRE ANNÉE DISPONIBLE)
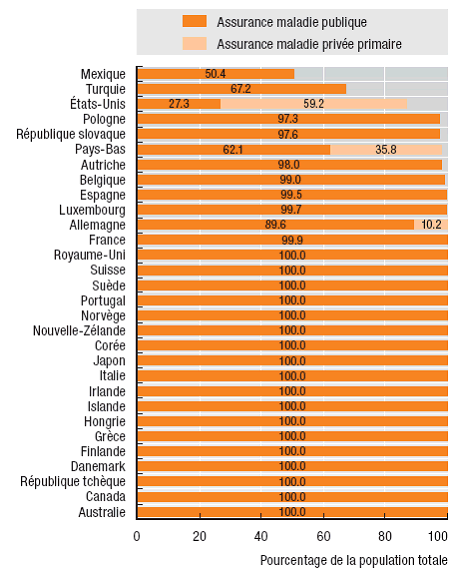
Source : OCDE. Panorama de la Santé 2007
POPULATION COUVERTE PAR UNE ASSURANCE MALADIE PRIVÉE
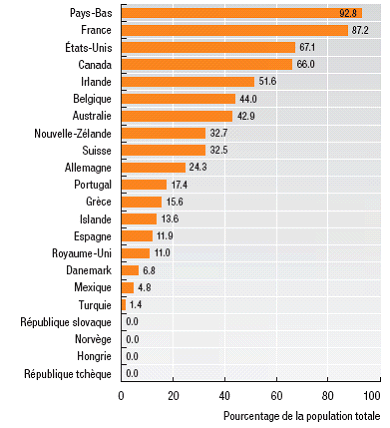
Source : OCDE. Panorama de la Santé 2007
Autrement dit, les systèmes de santé publics universels ont la grande vertu d'ouvrir l'accès aux soins à tous (ou presque).
De ce point de vue, il est tentant d'attribuer les performances globales très relatives du système de santé des États-Unis, pourtant le plus coûteux du monde, aux effets de sélection qu'implique une distribution très inégalitaire de l'accès aux soins qui se traduisent sans doute par une distribution très inégalitaire des états de santé .
CHAPITRE II - LES DÉPENSES D'ÉDUCATION
Les dépenses publiques d'éducation financent un service public qui n'est pas uniforme. Il existe, certes, une sorte de tronc commun qui concentre la plupart des dépenses. Mais, celles-ci sont, pour une partie non négligeable, éclatées en niveaux et en filières fort différenciées.
Ces caractéristiques compliquent le diagnostic sur la redistributivité opérée par les dépenses publiques d'éducation.
Si on se limitait au primaire et au secondaire, on conclurait sans erreur à l'existence d'une redistributivité monétaire quantitative de ces dépenses. Mais, la prise en compte du supérieur modifie la donne.
Plus encore, les aspects qualitatifs de la redistributivité des dépenses publiques d'éducation doivent être considérés. L'objectif principal d'un système public d'éducation n'est pas de réaliser une redistributivité monétaire quantitative. Celle-ci peut être un moyen au service de fins plus fondamentales, la formation (l'élévation du capital humain) et l'égalité des chances.
Sous ce dernier angle, le vrai test de la redistributivité des dépenses publiques est bien de vérifier que la redistributivité quantitative s'accompagne d'une égalisation des chances .
Or, sous cet angle, le bilan du système ne peut qu'être nuancé et cet impératif de nuance est encore plus grand relativement à l'égalité des conditions .
Cependant, tout comme dans d'autres domaines de l'intervention publique, on ne peut conclure de cette réserve à l'inefficacité des dépenses publiques sous l'angle de la redistribution .
Dans l'hypothèse où il n'y aurait pas d'intervention publique, il est largement acquis que la question de redistributivité ne serait pas même à envisager puisque l'enseignement de masse que tous les pays développés ou presque financent sur fonds publics ne serait qu'une virtualité.
Il
reste cependant qu'il faut améliorer les
performances des dépenses publiques en termes de redistributivité
effective
. Cette question ne sera évidemment pas traitée
dans le présent rapport. Seuls y seront évoqués les
travaux qui attribuent à l'existence d'un financement du
supérieur essentiellement public, les prétendues mauvaises
performances de ce niveau d'enseignement et proposent des solutions innovantes
pour y remédier. Bien qu'intéressants, ces travaux n'emportent
pas la conviction de votre rapporteur.
Il reste que les problèmes
posés sont réels et que les ambitions éducatives de la
Nation, si elles impliquent de dégager les moyens nécessaires,
justifient aussi que ceux-ci soient les plus efficaces possible.
I. OBSERVATIONS LIMINAIRES
A. UN OBJECTIF D'ÉGALITÉ DES CHANCES
Selon les statistiques du Ministère, la dépense publique d'éducation s'élevait, en 2004, en France, à 6,1 % du PIB , soit 11,4 % de l'ensemble des dépenses publiques .
La France a fait le choix, consacré par la loi (art. L111-11 du Code de l'éducation), d' attribuer à son service public d'éducation la mission de contribuer à l'égalité des chances .
Ce choix qui n'a rien d'évident dans son principe, puisqu'aussi bien les objectifs de l'éducation l'ont longtemps ignoré, n'est pas davantage très clair quant à sa substance, ni quant à ses prolongements.
Pour parvenir à instaurer l'égalité des chances, s'agit-il de promouvoir une égalité formelle ou une inégalité compensatrice visant à corriger les inégalités sociales de départ ? Jusqu'où aller ? Permettre un égal accès à l'école via sa gratuité, concentrer les moyens sur les populations les plus en difficulté, et lesquelles (les élèves en retard ou les élèves matériellement moins dotés que les autres ?) ? En bref, outre que le concept d'égalité des chances pose en soi des problèmes aigus que le présent rapport n'entend évidemment pas résoudre, les moyens d'y parvenir peuvent être également controversés .
Dans le présent rapport, il s'agit plutôt de répondre à la question de savoir si chacun « profite » de la même manière des dépenses publiques d'éducation ou, si en fonction de variables socio-économiques données, des inégalités apparaissent.
B. REDISTRIBUTION QUANTITATIVE, REDISTRIBUTION QUALITATIVE ?
* L' effort public alloué à l'éducation est inégalement réparti . Il est concentré sur les niveaux d'enseignement pour lesquels les taux de scolarisation sont les plus élevés .
Il est donc consacré , pour l'essentiel, à produire une éducation de masse dont, au moins financièrement, le bénéfice relatif est plus élevé à mesure qu'on descend dans l'échelle des revenus . Sous cet angle, la dépense publique d'éducation est apparemment nettement redistributive .
* Cette appréciation , qui est, pour l'essentiel, quantitative, doit , sur ce terrain même être nuancée et, par ailleurs, recevoir un complément plus qualitatif .
- En effet, il faut relever, tout d'abord , que l' effort public d'éducation comprend une partie non négligeable bénéficiant à une population restreinte , celle qui accède au niveau tertiaire d'éducation pour lequel les taux de scolarisation sont plus faibles et sont liés positivement aux conditions matérielles des étudiants et de leurs familles .
- En second lieu, les performances du système éducatif ne semblent pas telles qu'il corrige nettement les inégalités de départ .
Autrement dit, la redistributivité des dépenses publiques d'éducation, qui est globalement vérifiée sur le plan monétaire, ne l'est plus aussi nettement au regard des qualifications qu'elles permettent de dispenser .
II. LA DÉPENSE PUBLIQUE D'ÉDUCATION AU SERVICE D'UNE ÉDUCATION DE MASSE : RESSORT D'UNE REDISTRIBUTIVITÉ PLUS APPARENTE QUE RÉELLE
La concentration des dépenses publiques d'éducation sur les deux premiers niveaux - primaire et secondaire - du système d'éducation alliée à quelques caractéristiques démographiques plaident pour le constat d'une redistributivité quantitative apparente des dépenses publiques d'éducation.
A. LA DÉPENSE PUBLIQUE D'ÉDUCATION EST PLUTÔT CONCENTRÉE AU BÉNÉFICE DES FAMILLES LES MOINS AISÉES
Plusieurs variables jouent pour que la dépense publique d'éducation soit plutôt destinée aux familles les moins aisées.
1. Les effets de la concentration sur les premiers degrés d'éducation
* La dépense publique d'éducation est concentrée sur le premier et le second degré.
- La dépense intérieure d'éducation pour le premier degré s'élève à plus du quart du total .
DÉPENSE INTÉRIEURE D'ÉDUCATION
(DIE) POUR LE 1
ER
DEGRÉ
(en métropole
+ DOM)
|
1980 |
1990 |
2000 |
2003 |
2004 |
|
|
aux prix courants (en milliards d'euros) |
8,3 |
18,3 |
28,4 |
29,8 |
30,6 |
|
aux prix 2004 (en milliards d'euros) |
18,2 |
22,3 |
30,5 |
30,3 |
30,6 |
|
Part dans la DIE (en %) |
28,9 % |
26,9 % |
27,0 % |
26,3 % |
26,3 % |
|
Dépense moyenne par élève
|
2 580 |
3 260 |
4 600 |
4 590 |
4 600 |
|
Structure du financement initial (en %) |
|||||
|
État |
52,3 % |
53,4 % |
53,0 % |
||
|
. dont MEN 1 |
52,1 % |
53,2 % |
52,9 % |
||
|
Collectivités territoriales |
40,2 % |
39,4 % |
39,8 % |
||
|
Autres administrations publiques et CAF 2 |
2,4 % |
1,8 % |
1,8 % |
||
|
Entreprises |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
||
|
Ménages |
5,1 % |
5,5 % |
5,4 % |
||
* Les dépenses moyennes par élève n'ont été recalculées que pour la période 1999-2004
1 MEN : Ministère de l'éducation nationale
2 CAF : Caisses d'allocations familiales
Source : Ministère de l'Éducation Nationale - MEN-DEP
La dépense publique d'éducation pour le primaire représente près de 95 % de ce total, soit 28,9 milliards d'euros en 2004.
- S' agissant du second degré, la dépense d'éducation qui lui est allouée absorbe 45,4 % de l'ensemble .
DÉPENSE INTÉRIEURE D'ÉDUCATION
(DIE) POUR LE SECOND
DEGRÉ
1
(en métropole
+ DOM)
|
1980 |
1990 |
2000 |
2003 |
2004 |
|
|
aux prix courants (en milliards d'euros) |
12,8 |
30,7 |
47,9 |
51,6 |
52,7 |
|
aux prix 2004 (en milliards d'euros) |
28,2 |
37,6 |
51,4 |
52,4 |
52,7 |
|
Part dans la DIE (en %) |
44,9 |
45,2 |
45,4 |
45,5 |
45,4 |
|
Dépense moyenne par élève
2
|
5 150 |
6 260 |
8 260 |
8 460 |
8 530 |
|
Structure du financement initial (en %) 3 |
|||||
|
État |
72,8 |
71,5 |
70,8 |
||
|
. dont MEN 4 |
67,3 |
66,1 |
65,4 |
||
|
Collectivités territoriales |
15,1 |
16,0 |
17,0 |
||
|
Autres administrations publiques et CAF 5 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
||
|
Entreprises |
1,8 |
2,1 |
2,1 |
||
|
Ménages |
8,0 |
8,1 |
7,8 |
1 La dépense du second degré inclut maintenant l'apprentissage du niveau secondaire
2 Les dépenses moyennes par élève n'ont été recalculées que pour la période 1999-2004
3 Cette ventilation n'est possible qu'à partir de 1999
4 MEN : Ministère de l'éducation nationale
5 CAF : Caisses d'allocations familiales
Source : Ministère de l'Éducation Nationale - MEN-DEP
La dépense publique en représente une proportion qui, même si elle est un peu inférieure à ce qu'elle est pour le primaire, reste très fortement majoritaire avec 90,1 % du total . Elle s'élevait ainsi à 47,5 milliards d'euros en 2004.
Globalement, les dépenses publiques consacrées aux deux premiers niveaux d'éducation totalisent 82,7 % des dépenses publiques engagées dans le domaine de l'éducation (hors formation permanente).
* Pour l'essentiel , les dépenses publiques financent ainsi une éducation de masse à laquelle correspond, globalement l'obligation de scolarité jusqu'à 16 ans.
Compte tenu des taux de scolarisation aux âges de fréquentation des cursus primaire et secondaire, qui sont élevés et socialement assez homogènes, les dépenses publiques qui les financent profitent à tous , même si les taux de scolarité à 18 ans par catégorie sociale sont moins uniformes qu'à 16 ans (voir les tableaux ci-après).
LA SITUATION DES JEUNES ÂGÉS DE 16
ANS
(moyenne des années 2000 à 2002)

Note : les âges sont calculés en fonction des générations, par exemple, pour l'enquête Emploi de mars 2002, les jeunes âgés de 16 ans sont ceux de la génération 1985 (ils avaient 16 ans à la rentrée de septembre 2001).
Sources : INSEE, enquêtes Emploi ; calculs Cerc.
LA SCOLARISATION DES JEUNES À 18 ANS
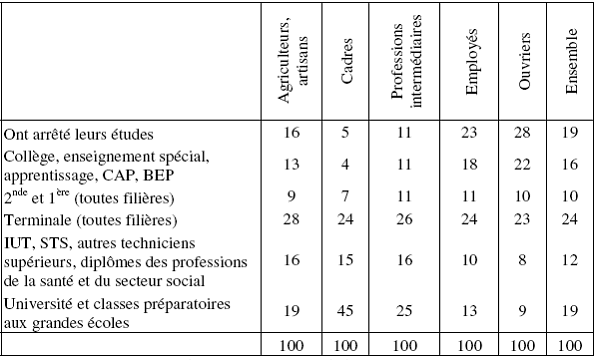
Note : les âges sont calculés en fonction des générations, par exemple, pour l'enquête Emploi de mars 2002, les jeunes âgés de 16 ans sont ceux de la génération 1985 (ils avaient 18 ans à la rentrée de septembre 2001).
Sources : INSEE, enquêtes Emploi ; calculs Cerc.
En 2004, selon les chiffres du Ministère de l'Education nationale, la dépense moyenne par élève s'élevait à 4.600 euros dans le primaire et à 8.530 euros dans le second degré .
Sous la réserve que la dépense effective ne soit pas trop différenciée selon les publics scolarisés, réserve qui semble vérifiée, on peut, à partir de cette moyenne, établir que, ne variant pas par rapport aux revenus des bénéficiaires (ou plutôt de leur famille), l'avantage procuré est relativement plus important pour les déciles les plus bas que pour les déciles les plus élevés .
Ainsi, même s'il n'est pas certain, malgré l'institution de zones d'éducation prioritaire (ZEP), que les dépenses publiques d'éducation soient dégressives avec le revenu, du moins paraît-il avéré qu'elles procurent un avantage relatif plus important pour les ménages les moins bien dotés .
Sous l'angle monétaire, elles sont donc à la base d'une redistribution d'autant moins discutable qu'en masse la répartition des élèves scolarisables par décile de revenu décroît avec celui-ci (tableau ci-après).
RÉPARTITION DES JEUNES SCOLARISABLES (EN MILLIERS)
|
1 er décile |
2 286 |
|
2 ème décile |
1 978 |
|
3 ème décile |
1 735 |
|
4 ème décile |
1 605 |
|
5 ème décile |
1 529 |
|
6 ème décile |
1 478 |
|
7 ème décile |
1 420 |
|
8 ème décile |
1 378 |
|
9 ème décile |
1 361 |
|
10 ème décile |
1 393 |
|
Ensemble |
16 164 |
Note : déciles de revenu initial par équivalent adulte (hors revenu des enfants).
Champ : familles dynastiques ayant au moins un enfant de 3 à 24 ans.
Source : INSEE
2. Une redistribution qui a pris de l'ampleur
L'augmentation de la dépense publique d'éducation ayant été plus rapide que celle du PIB, ces dépenses ont exercé un effet redistributif croissant.
DÉPENSES PUBLIQUES DE FORMATION INITIALE ET
PIB
(INDICES BASE 100 EN 1974)
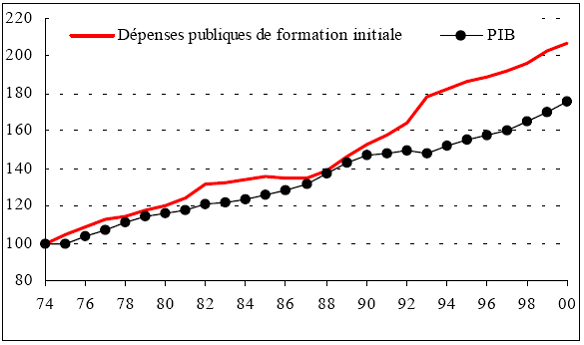
Note : dépenses en euros constants.
Champ : France métropolitaine.
Sources : comptes de l'éducation (DPD) ; calculs Cerc.
Ce constat vaut d'autant plus que les dépenses d'éducation les plus dynamiques ont été les dépenses correspondant à la mise en place d'un système éducatif de masse .
C'est, en effet, dans le primaire et le secondaire que la dépense par élève a le plus augmenté.
ÉVOLUTION DE LA DÉPENSE PUBLIQUE PAR
ÉLÈVE 1974-2000
(DÉPENSE PAR ÉLÈVE BASE
100 EN 1974, EN EUROS CONSTANTS)
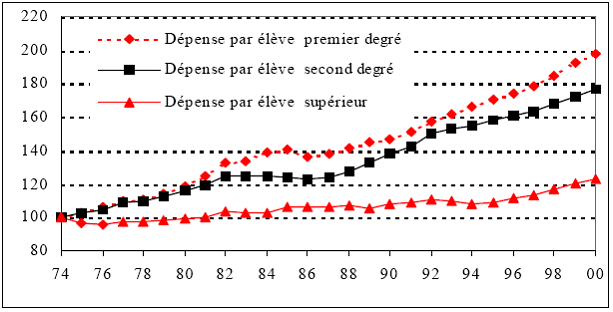
Source : comptes de l'éducation (DPD).
3. Une redistributivité quantitative probablement accentuée par des effets de structures, en particulier, familiales
a) La structure des coûts unitaires des filières du primaire et du secondaire : des effets indéterminés
Les coûts unitaires moyens par élève varient selon le niveau d'enseignement et, dans chaque cycle après le primaire, selon la filière concernée. Ces différences de coût doivent être prises en considération pour apprécier la redistributivité des dépenses publiques d'éducation.
La dépense unitaire moyenne par élève dépend du nombre d'heures d'enseignement par élève et du coût de ces heures lié aux différences de statuts des personnels enseignants. Elle est de 4.000 euros en maternelle , 4.600 euros dans le primaire et 8.530 euros dans le second degré .
Dans le second degré , les différences sont assez marquées selon les filières. La dépense par élève représente 6.750 euros dans le premier cycle (le collège) et 8.000 euros dans le second cycle général , 9.000 euros dans le second cycle professionnel et 10.000 euros dans le secondaire technologique . Elle vaut 4.190 euros environ pour l' apprentissage .
Il est difficile d'établir un bilan redistributif de ces écarts de coûts unitaires . Les élèves issus de familles aux revenus primaires relativement bas sont moins nombreux à accéder au second cycle du second degré et ils sont surreprésentés dans les filières d'apprentissage, ce qui réduit les transferts dont ils bénéficient. En revanche, ils sont relativement plus nombreux dans le second cycle professionnel et dans le secondaire technologique qui sont plus coûteux. Cette dernière situation va dans le sens d'une redistributivité des dépenses publiques d'éducation sans que le solde des deux phénomènes relevés ici puisse être établi précisément en l'état des données disponibles.
b) Les structures familiales, une caisse de résonance pour la redistributivité
Des caractéristiques socio-démographiques contribuent à ce que les dépenses publiques d'éducation apparaissent redistributives .
Les revenus des familles avec enfant sont plus faibles que la moyenne.
Les revenus sont croissants avec l'âge alors que le nombre d'enfants à charge obéit au phénomène inverse (le nombre d'enfants à charge tend à se réduire aux âges élevés).
En conséquence, les enfants scolarisables (et les dépenses d'éducation) tendent à se concentrer plutôt vers le bas de la distribution générale des revenus . Ainsi, 20 % des enfants de 3 à 24 ans vivent dans des familles du premier décile et les trois premiers déciles regroupent environ 46 % des enfants de 3 à 24 ans .
RÉPARTITION DU NOMBRE DES ENFANTS DE 3 À
24 ANS
AU SEIN DE L'ENSEMBLE DE LA POPULATION (EN % DU TOTAL
D'ENFANTS)
|
1 er décile |
20,5 |
|
2 ème décile |
14,1 |
|
3 ème décile |
11,2 |
|
4 ème décile |
9,9 |
|
5 ème décile |
8,9 |
|
6 ème décile |
8,0 |
|
7 ème décile |
7,6 |
|
8 ème décile |
6,7 |
|
9 ème décile |
6,5 |
|
10 ème décile |
6,4 |
Note : déciles de revenu initial (hors revenu des enfants) par équivalent adulte, calculés sur l'ensemble des familles dynastiques.
Sources : Insee-DGI, enquête Revenus fiscaux 1997 (actualisée 2001), modèle Ines, calculs Insee.
La distribution des revenus initiaux des familles susceptibles de bénéficier de dépenses d'éducation (familles avec des enfants entre 3 et 24 ans) est donc nettement décalée vers le bas par rapport à celle de la population générale des ménages. Au total, 50 % des familles se situent parmi les 40 % de l'ensemble des ménages ayant les revenus initiaux (par équivalent adulte) les plus faibles .
DISTRIBUTION DES REVENUS (PAR UNITÉ DE
CONSOMMATION)
DANS L'ENSEMBLE DE LA POPULATION
ET DANS LES FAMILLES AVEC
ENFANTS SCOLARISABLES
|
Déciles de population générale des familles |
Déciles des familles
|
|
|
1 |
5 869 |
4 541 |
|
2 |
8 637 |
7 066 |
|
3 |
10 881 |
9 088 |
|
4 |
13 040 |
11 157 |
|
5 |
15 198 |
13 163 |
|
6 |
17 561 |
15 456 |
|
7 |
20 431 |
18 132 |
|
8 |
24 398 |
21 645 |
|
9 |
31 786 |
28 505 |
Note : ce sont les limites des déciles de revenu qui figurent ici. Le revenu est le revenu initial (hors revenu des enfants) par équivalent adulte des familles dynastiques, en euros.
Sources : Insee-DGI, enquête Revenus fiscaux 1997 (actualisée 2001), modèle Ines, calculs Insee.
B. MAIS, AU TOTAL, LA REDISTRIBUTIVITÉ DES DÉPENSES PUBLIQUES D'ÉDUCATION APPARAÎT PLUTÔT FAIBLE
1. Une redistributivité qualitativement médiocre
La « massification » de l'enseignement primaire et secondaire s'accompagne de résultats qualitatifs nettement contrastés : la scolarité de masse n'a pas débouché sur le diplôme , ou la qualification, de masse , et les écarts dans les performances des élèves sont corrélés à des écarts d'origine sociale .
S' agissant du baccalauréat , alors qu'environ 70 % d'une génération atteignent la terminale, un peu plus de 60 % ont effectivement le bac, dont environ 32 % un bac général, 17 % un bac technique et 11 % un bac professionnel avec des disparités importantes entre catégories socioprofessionnelles . Près de 90 % des enfants de cadres obtiennent le diplôme contre environ 45 % des enfants d'ouvriers.
TAUX D'OBTENTION DU BACCALAURÉAT PAR GÉNÉRATION
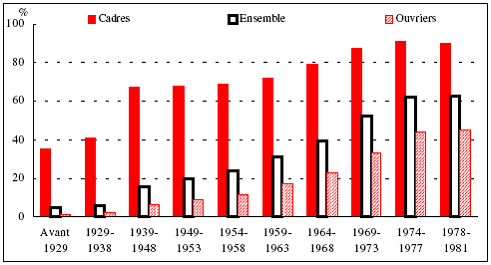
Sources : Duru-Bellat et Kieffer (2000) jusqu'aux générations 1959-1963 et enquêtes Emploi, Insee ; calculs Cerc.
Ces résultats inégaux s'accompagnent d' une forte détermination sociale en termes de fréquentation des différentes filières du secondaire avec une surreprésentation des enfants de cadres dans les terminales générales et des enfants d'ouvriers dans les terminales professionnelles.
Cette dernière sélection a une très forte incidence sur la poursuite du parcours de formation puisque, par exemple, si la quasi-totalité des bacheliers généraux et 83 % des bacheliers technologiques poursuivent leurs études, 70 % des bacheliers professionnels arrêtent les leurs.
Or, si on veut bien se reporter aux développements de la deuxième partie du présent rapport sur la différenciation salariale en fonction du niveau de diplôme et de la durée réelle des études, on relèvera que ces inégalités qualitatives ont des répercussions durables sur les revenus tout au long de la vie professionnelle de même, d'ailleurs, que sur d'autres composantes du statut social, comme, par exemple, le risque de chômage.
C'est dès le primaire que cette différenciation sociale des performances se met en place , si l'on en croit les tests d'évaluation réalisés à l'entrée du CE2 et à celle de 6 ème .
SCORES SELON L'ORIGINE SOCIALE DES ÉLÈVES À L'ENTRÉE EN CE2 ET EN 6 ÈME
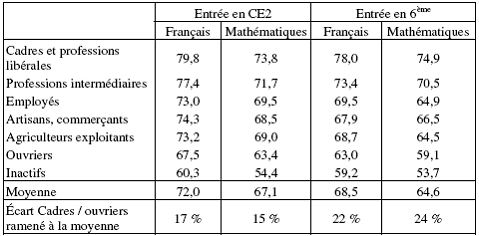
Note : scores obtenus à la rentrée de septembre 2000. Les protocoles d'évaluation reposent sur un nombre variable d'items (par exemple 94 items pour l'évaluation de français de CE2), les scores sont ici systématiquement ramenés à 100.
Sources : Andrieux, Dupé et Robin, 2001 et Andrieux, Brézillon et Chollet-Remvikos, 2001.
A partir d'écarts initiaux non négligeables (ceux mesurés en CE2), les écarts se creusent pendant le primaire, notamment en mathématiques.
Le « profit » tiré de l'enseignement de masse apparaît ainsi très inégalement réparti sur un plan qualitatif .
Pire encore, pour une proportion trop importante de chaque classe d'âge, il est, sinon nul, au moins si peu représentatif que le système scolaire se refuse à le reconnaître .
Ce constat s'applique aux 18 % de jeunes qui quittent l'école , soit sans qualification (6 %), soit sans CAP, BEP ou BAC .
*
* *
Au total, l'égalisation réelle des opportunités est très loin d'être à la hauteur de la redistributivité monétaire qu'impliquent, en apparence, les dépenses publiques d'éducation .
Au demeurant, la redistribution monétaire des dépenses publiques d'éducation est elle-même remise en cause quand on l'apprécie sous certains angles.
2. Une redistributivité quantitative sujette à des appréciations contrastées
a) Des dépenses publiques d'enseignement supérieur qui atténuent la redistributivité monétaire du système
La dépense intérieure d'éducation pour le supérieur est minoritaire : environ 17 % du total de la dépense d'éducation, et la dépense publique pour l'enseignement supérieur représente 17,4 % de la dépense publique totale d'éducation .
DÉPENSE INTÉRIEURE D'ÉDUCATION
(DIE) POUR LE SUPÉRIEUR
(en métropole +
DOM)
|
1980 |
1990 |
2000 |
2003 |
2004 |
|
|
aux prix courants (en milliards d'euros) |
4,2 |
11,2 |
17,7 |
19,3 |
19,7 |
|
aux prix 2004 (en milliards d'euros) |
9,2 |
13,6 |
19,0 |
19,6 |
19,7 |
|
Part dans la DIE (en %) |
14,6 % |
16,4 % |
16,8 % |
17,0 % |
16,9 % |
|
Dépense moyenne par élève
1
|
6 560 |
7 310 |
8 660 |
8 700 |
8 630 |
|
Structure du financement initial (en %) 2 |
|||||
|
État |
75,5 % |
75,3 % |
74,6 % |
||
|
. dont MEN 3 |
66,6 % |
65,7 % |
64,8 % |
||
|
Collectivités territoriales |
5,9 % |
5,6 % |
5,9 % |
||
|
Autres administrations publiques et CAF 4 |
1,2 % |
1,1 % |
1,1 % |
||
|
Entreprises |
5,8 % |
6,4 % |
6,4 % |
||
|
Ménages |
11,5 % |
11,6 % |
12,0 % |
1 Les dépenses moyennes par étudiant n'ont été recalculées que pour la période 1999-2004
2 Cette ventilation n'est possible qu'à partir de 1999
3 MEN : Ministère de l'éducation nationale
4 CAF : Caisses d'allocations familiales
Source : Ministère de l'Éducation Nationale - MEN-DEP
Cette situation est en relation avec la très forte chute des taux de scolarisation, une fois les deux premiers degrés d'enseignement passés .
En effet, le taux de scolarisation dans l'enseignement supérieur est nettement plus faible que jusqu'à l'âge de la scolarité obligatoire.
TAUX DE SCOLARISATION DANS LE SUPÉRIEUR
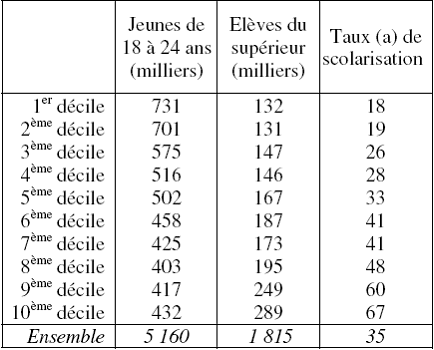
(a) le taux de scolarisation est apparent : c'est le rapport des effectifs dans le supérieur aux effectifs des jeunes âgés de 18 à 24 ans.
Champ : familles dynastiques ayant au moins un enfant de 3 à 24 ans.
Sources : DPD ; Insee-DGI, enquête Revenus fiscaux 1997 (actualisée 2001), modèle Ines, calculs Insee.
La durée de l'enseignement est également plus courte , ce qui va dans le même sens.
A l'inverse, le coût moyen par élève est globalement plus élevé que dans les phases antécédentes même si l'écart avec le second degré n'est pas très important.
Au total, la dépense publique d'enseignement supérieur bénéficie à une fraction de la population scolarisable minoritaire , et dont l'origine apparaît concentrée dans les fractions de revenu les plus élevées .
En effet, le taux de scolarisation dans le supérieur varie fortement selon le décile de revenu des familles (de 18 % pour le premier décile à 67 % pour le 10 ème décile). Jusqu'au 8 ème décile inclus, il est inférieur à la moitié des effectifs potentiellement concernés.
Autrement dit, 17,4 % de la dépense publique d'enseignement sont fortement concentrées sur les populations les plus favorisées , tout particulièrement les deux plus hauts déciles de revenu.
* En outre, l'évaluation de l'impact redistributif des dépenses publiques consacrées à l'enseignement supérieur doit prendre en compte la différenciation des coûts par filière.
Autour d'une moyenne des dépenses par étudiant de 8.630 euros , les différences entre filières du supérieur (Martinez, Ragoucy et Berreur, 2000 et 2001) sont marquées. Ainsi, les coûts valent encore 6.500 euros en Université , mais ils s'élèvent à 8.600 euros en Instituts universitaires de technologie (IUT) à 10.200 euros en section de technicien supérieur (STS), à 11.500 euros pour les formations d'ingénieurs universitaires et à 12.600 euros en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), soit un ratio de l'ordre de 2 entre la filière la plus coûteuse par étudiant (les CPGE) et la moins coûteuse (les Universités).
Au total, les différences de coûts par filière, cumulées sur l'ensemble de la scolarité sont importantes.
Des cas-types reconstituant les coûts théoriques (hors redoublements) de certaines formations éclairent la dispersion des dépenses totales.
Ainsi, aux coûts de l'année 2000 dans le secondaire, la dépense de formation d'un élève obtenant un BEP à 17 ans représente 78.000 euros environ pour l'ensemble de sa scolarité. Elle est environ de 96.000 euros pour un bac professionnel et de 85.500 euros pour un bac général ou technologique .
Dans le supérieur, pour un diplôme obtenu par un titulaire du bac général, elle est de 106.000 euros pour un BTS et de 103.000 euros pour un DUT , diplômes obtenus en deux ans ; pour une licence , obtenue en trois ans, de 105.000 euros ; pour un diplôme d'ingénieur universitaire (deux années de classes préparatoires et trois d'ingénieur universitaire), elle est de 145.500 euros environ . Au total, le rapport entre la formation individuelle la plus coûteuse et la moins coûteuse est de 1,9 .
b) Une redistributivité presque nulle de la dépense publique d'éducation là où elle serait la plus efficace, enfant par enfant
Appréciée au niveau des familles , les propriétés redistributives des dépenses publiques d'éducation sont apparemment vérifiées .
DÉPENSE PUBLIQUE D'ÉDUCATION PAR
FAMILLE
AYANT DES ENFANTS SCOLARISABLES

Note : déciles de revenu initial (hors revenu des enfants) par équivalent adulte.
Champ : familles dynastiques ayant au moins un enfant de 3 à 24 ans.
Sources : DPD ; Insee-DGI, enquête Revenus fiscaux 1997 (actualisée 2001), modèle Ines, calculs Insee.
Les familles du premier décile de revenu bénéficient d'une dépense supérieure de 32 % à la dépense moyenne. Comme cet avantage s'applique à des revenus plus bas, il exerce un effet redistributif relatif conséquent.
Toutefois, à partir du quatrième décile de revenu, la distribution des dépenses d'éducation est homogène, une famille du décile de population ayant les revenus les plus élevés percevant des avantages analogues à ceux des personnes relevant du décile médian.
Comme pour la plupart des autres dépenses publiques, la concentration des avantages sur les plus bas revenus - qui exerce des effets redistributifs - s'accompagne d'une « universalité » des services d'éducation qui tempère la redistributivité monétaire de l'ensemble.
Mais une remarque supplémentaire s'impose qui vient remettre en cause plus fondamentalement encore la redistributivité des dépenses publiques d'éducation .
Lorsqu'on apprécie la redistributivité des dépenses publiques d'éducation à partir du niveau des dépenses par enfant, ces dépenses apparaissent, ou légèrement redistributives (quand on les rapporte au nombre d'enfants scolarisés par ménage), ou anti-redistributives (quand elles sont mises en rapport avec le nombre d'enfants scolarisables). Les taux de scolarisation plus faibles pour les familles relativement modestes, particulièrement dans l'enseignement supérieur expliquent cette différence.
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ÉDUCATION PAR ENFANT
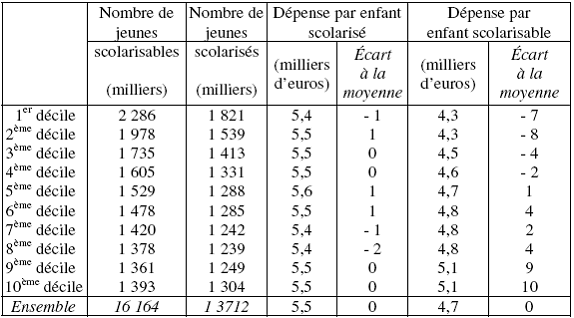
Note : déciles de revenu initial (hors revenu des enfants) par équivalent adulte.
Champ : familles dynastiques ayant au moins un enfant de 3 à 24 ans.
Sources : DPD ; Insee-DGI, enquête Revenus fiscaux 1997 (actualisée 2001), modèle Ines, calculs Insee.
Au total, les enfants des ménages relativement aisés « profitent », chacun, de dépenses publiques d'éducation supérieures à leurs homologues des catégories sociales de revenus inférieurs.
La redistributivité monétaire des dépenses publiques d'éducation au profit des familles ne s'accompagne pas d'une redistributivité générale des opportunités. Le maintien de fortes inégalités des chances devant l'éducation provoque à son tour de fortes inégalités quantitatives de la dépense publique d'éducation par enfant .
Ce constat devrait conduire à une réflexion en profondeur sur le montant, l'efficacité et l'équité de la dépense publique d'éducation, d'autant qu'une partie importante des dépenses publiques paraît impliquée par la nécessité de compenser des handicaps sociaux qui entretiennent des liens avec les performances scolaires .
CONCLUSION - PROGRESSER VERS UNE MEILLEURE CONTRIBUTION DES DÉPENSES PUBLIQUES À L'ÉGALITÉ DES CHANCES
Hormis les problèmes de méthode que pose la mesure de la redistributivité (certains indices sont très sensibles aux valeurs moyennes de la distribution), l'impact redistributif des dépenses publiques peut être apprécié très diversement, en fonction du regard qu'on porte .
En premier lieu , le diagnostic variera selon que l'on s'attache à la distribution des dépenses publiques dans la population ou à leurs effets sur la distribution des revenus .
Dans la première approche, on pourra juger fortement redistributifs les systèmes en fonction du degré de concentration des dépenses publiques. Plus les personnes à faible revenu se voient attribuer une proportion élevée des dépenses publiques, plus on pourra souligner la logique redistributive du système.
L'inconvénient majeur d'une telle approche est que ce constat peut masquer l'existence d'une faible redistributivité quand celle-ci est mesurée au niveau de la totalité des revenus. Tel est souvent le cas pour les systèmes où l'intervention publique peut être fortement concentrée mais d'une ampleur si faible que ses effets redistributifs sont finalement modestes.
En second lieu , les constats relatifs à la redistributivité quantitative , peuvent différer assez nettement de ceux concernant des aspects plus qualitatifs de la redistributivité qui peuvent pour certaines politiques (l'éducation, par exemple) représenter l'objectif réellement poursuivi.
Enfin, comme pour d'autres questions essentielles que posent les dépenses publiques, seule une évaluation rigoureuse de la contribution des dépenses publiques à la redistributivité permet de fonder un jugement pertinent et donc d'engendrer des décisions publiques adaptées .
Le souhait de votre rapporteur est donc que les quelques aperçus sur la question de la redistributivité des dépenses publiques données dans le présent rapport puissent donner lieu à des approfondissements systématiques puisqu'aussi bien la redistributivité des dépenses publiques est, en même temps qu'une des justifications principales de l'intervention publique, une condition fondamentale de leur efficacité .
Or, de ce point de vue, les travaux réalisés pour le présent rapport n'inclinent pas à dresser un bilan sans nuances .
Globalement , la composante redistributive des dépenses publiques ressort comme faiblement développée . Seules les personnes les plus défavorisées - celles qui appartiennent aux deux premiers déciles de revenu - paraissent bénéficier d'une redistribution quantitative appréciable . Il est difficile d'estimer la proportion des dépenses publiques par laquelle cette redistributivité transite , mais au vu de la concentration du phénomène sur les très bas revenus et de l'universalité des dépenses publiques, cette proportion est sans doute faible .
Surtout, cette redistributivité quantitative n'a pas tous les prolongements qualitatifs qu'on pourrait souhaiter et c'est même peut-être pour cette raison qu'elle joue un si grand rôle pour les personnes qu'elle concerne. C'est probablement aussi pour cela que certaines dépenses publiques ont une ampleur particulière.
Sous cet angle, il est un domaine qui présente des enjeux fondamentaux : celui de la formation initiale .
La France n'est pas le seul pays à connaître des problèmes aigus d'efficacité de l'investissement public d'éducation . Pour une frange beaucoup trop importante de la population scolarisable, cet investissement, pourtant coûteux, n'a pas de « retours » décents, notamment au regard de l'objectif d'égalisation des chances. Le fait que ce problème existe dans d'autres pays ne doit pas conduire à nous en accommoder, d'autant qu'à côté de cet échec insupportable, l'investissement public dans l'éducation connaît en France des performances qui doivent être améliorées comme l'enseignent les travaux de l'OCDE.
Les fortes inégalités des résultats scolaires modifient, et inversent le point de vue quantitatif sur l'efficacité redistributive des dépenses publiques d'éducation qui, même sur ce terrain purement quantitatif, appelle des nuances .
Compte tenu de leurs prolongements en termes de parcours économiques et sociaux, il est très probable que ces inégalités entretiennent une pression à la hausse sur les dépenses publiques sociales de compensation des handicaps socioéconomiques. Dans le même temps, elles réduisent le potentiel de croissance de l'économie française. Elles sont donc, en tous points, pénalisantes et ce doit être une priorité que de les réduire .
En l'état , il est, semble-t-il, impossible de donner une traduction quantitative de cet objectif . On ne peut arguer de ce que certains pays paraissent enregistrer de meilleures performances avec moins de moyens pour établir qu'il pourrait être atteint sans ressources supplémentaires. Les comparaisons internationales, pour être utiles, ne peuvent tenir lieu d'évaluations.
La situation de la France, du point de vue de son investissement public dans l'éducation, présente des caractéristiques particulières avec, notamment, des singularités dans les niveaux de dépenses par cycle d'enseignement. Ces singularités sont attribuées à des spécificités organisationnelles dans la littérature disponible sur ce sujet et votre rapporteur les mentionne. Cependant, d'autres variables sont peut-être en cause comme, par exemple, les nécessités de l'aménagement du territoire. Il est essentiel de le diagnostiquer afin que la question de l'amélioration de la qualité des dépenses publiques d'éducation soit « purgée » du soupçon permanent de gaspillage des ressources qui pèse sur elle et soit replacée au centre des préoccupations.
Elle le mérite, comme pour toutes les dépenses publiques qui concourent à la formation du « capital humain », c'est-à-dire de la capacité des personnes à contribuer efficacement à la prospérité, d'autant que ces dépenses permettent certainement de réduire d'autres dépenses publiques plus exclusivement « réparatrices ».
I. LES TRANSFERTS PUBLICS SOCIAUX
A. LES TRANSFERTS SOCIAUX119 ( * ), UN FORT IMPACT SUR LE NIVEAU DE LA PAUVRETÉ
Il existe une forte corrélation entre le niveau des dépenses publiques sociales (ici les dépenses hors pensions et services publics de santé) et le taux de pauvreté des personnes de 15 à 64 ans (population en âge de travailler).
TAUX DE PAUVRETÉ PARMI LA POPULATION EN ÂGE DE TRAVAILLER ET DÉPENSES SOCIALES - EN 2000
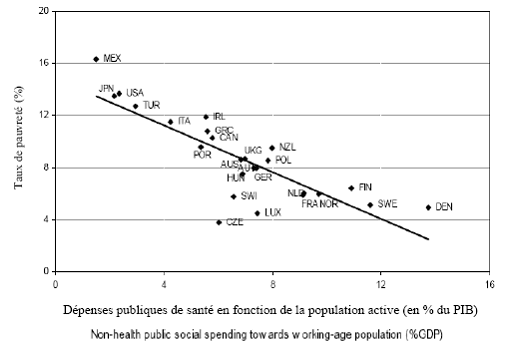
Plus les dépenses publiques de transferts sont élevées, moins le taux de pauvreté est important . Avec des transferts sociaux publics autour de 9 points de PIB en 2000, la France connaît une pauvreté autour de 6 % 120 ( * ) . L'Italie, qui consacre environ deux fois moins de ressources aux transferts sociaux publics, a un taux de pauvreté à peu près deux fois plus élevé.
Les pays situés au-dessous de la diagonale enregistrent des performances relatives sur le front de la pauvreté supérieures à la moyenne pour un niveau donné de dépenses publiques sociales. L'inverse est vrai pour les pays situés au-dessus de la diagonale.
Le graphique ci-dessus peut ne pas complètement rendre compte de la contribution des dépenses publiques sociales à la redistribution des revenus, mais il comporte des enseignements sans ambiguïté sur la relation entre le niveau de l'intervention publique et le niveau de la pauvreté .
B. LES TRANSFERTS PUBLICS SOCIAUX, UNE REDISTRIBUTIVITÉ AU PROFIT DES PLUS DÉMUNIS
Les transferts publics sociaux en espèces représentent quand on inclut les prestations de retraite la masse des dépenses publiques la plus importante : autour de 40 % du total des dépenses publiques en France.
Ces dépenses publiques couvrent des événements qui se traduisent par des réductions plus ou moins drastiques des revenus : la maladie (ici pour la partie correspondant aux indemnités journalières), la vieillesse, le chômage, la constitution d'une famille...
Leur objectif est de compenser ces événements plus ou moins aléatoires dans le cadre de systèmes qui empruntent à l'assurance mais s'affranchissent de la logique des assurances individuelles pour rejoindre des principes plus mutualistes.
Les « risques » couverts ne sont pas également distribués dans la population et, de ce fait, une partie importante de la redistributivité de ces dépenses provient de l'inégalité horizontale entre malades et bien portants, entre actifs et inactifs, entre célibataires et chargés de famille... Les dépenses publiques exercent alors une redistributivité horizontale c'est-à-dire sans lien direct avec l'état de revenu des personnes concernées par le système. Il se trouve toutefois que la survenance des risques concernés entraîne presque systématiquement une rupture dans la situation financière des bénéficiaires et qu'alors la redistributivité horizontale s'accompagne d'une redistributivité verticale (soit une redistributivité entre personnes de revenus différents) quand on tient compte des effets des événements en cause sur le revenu.
Cependant, même au regard de la redistributivité verticale au sens strict (celle qui n'intervient qu'à raison de l'inégalité de la distribution des revenus hors l'impact sur celle-ci de l'inégalité de la distribution des risques couverts), les transferts publics sociaux ne sont pas sans exercer d'effets.
Des dispositions peuvent jouer dans le sens d'une conditionnalité des prestations à un plafond de revenu - en France, elles sont peu développées -, des arrangements institutionnels peuvent améliorer le retour des cotisants les moins bien dotés, surtout l'universalité des prestations réduit en soi les écarts entre moins et plus riches.
Au total, hors retraites , les prestations sociales réduisent en France le rapport entre les 20 % les plus riches et les 20 % les moins riches, de 6,3 à 4,4 soit une réduction des inégalités de près de 30 % . Mais, cette redistributivité s'affaiblit au-delà du premier quintile de revenus, de sorte que l'écart entre le revenu du quintile le plus aisé et du deuxième quintile n'est déjà plus que faiblement modifié par les prestations.
La considération des retraites , qui représentent autour de la moitié des dépenses publiques de transferts sociaux, conforte ce diagnostic d'une redistributivité très ciblée .
Au sein d'une génération donnée, les rendements des cotisations sont dégressifs mais seulement dans la zone des plus faibles revenus. Après le troisième décile de revenus, les rendements sont approximativement égaux. Cela revient à dire que leurs cotisations rapportent autant à des personnes de revenus très différenciés et que le système n'est pas redistributif sinon pour les personnes les moins dotées. Situation conforme à la logique d'un système où les dépenses correspondent à un étalement dans le temps de l'utilisation du revenu individuel.
Au total, la redistributivité des prestations sociales publiques est sans doute quantitativement assez faible et ressort comme très concentrée sur les personnes les plus démunies, à une fraction desquelles elle permet d'échapper à la pauvreté .
Sous ces angles, la redistributivité des dépenses publiques apparaît largement compensatrice de handicaps socio-économiques auxquels elle n'apporte qu'assez peu de solutions structurelles.
La concentration des effets redistributifs des dépenses publiques sociales semble assez mal appréhendée par une fraction de l'opinion publique : celle qui correspond d'un côté aux réactions de satisfaction face à un État-Providence pour tous et chacun et de l'autre, au contraire, aux réactions hostiles liées à l'impression de subir des « spoliations » injustes .
Ces perceptions ne correspondent, pour l'essentiel, à aucune des réalités que découvre l'examen de la redistributivité de ces dépenses, même si les rendements des prélèvements obligatoires varient certainement selon l'appartenance à telle ou telle catégorie de revenus .
Il est probable qu'au-delà des effets des discours jouent beaucoup dans les perceptions, d'une part dans un sens favorable, l'universalité des dépenses sociales qui entretient le sentiment que « l'État est social pour tous 121 ( * ) » et, d'autre part dans l'autre sens, hormis l'impact de la fiscalité progressive sur quelques-uns, le décalage dans le temps entre les prélèvements obligatoires subis et les prestations reçues.
Ce dernier phénomène doit d'autant plus intervenir qu'une fraction des prélèvements obligatoires est redistribuée aux ménages sous la forme de biens et services publics qui, sans être individualisés aussi nettement qu'une prestation en espèce, représentent autant d'avantages en nature et dont on va maintenant examiner les propriétés redistributives.
II. LES DÉPENSES PUBLIQUES LIÉES AUX SERVICES PUBLICS INDIVIDUALISABLES
A. UNE CONTRIBUTION À LA RÉSORPTION DES INÉGALITÉS DE REVENU DE MÊME AMPLEUR QUE CELLE DES DÉPENSES SOCIALES EN ESPÈCES
Les services publics fournis aux ménages représentent un montant comparable à celui des transferts monétaires inclus dans le revenu disponible des ménages . Dans 11 pays de l'OCDE, les dépenses en transferts non monétaires sont même plus importantes que les transferts monétaires. On remarque aussi que les pays qui consacrent un effort important aux transferts monétaires consacrent, en général, également des ressources importantes à la fourniture de services aux ménages.
TRANSFERTS MONÉTAIRES ET SERVICES PUBLICS DANS
LES PAYS DE L'OCDE
EN 2000
Part des dépenses publiques bénéficiant aux ménages
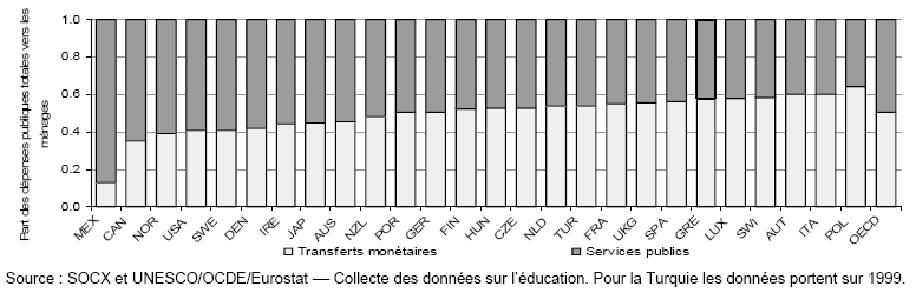
* Les dépenses publiques concourant à la production de services publics ressortent comme redistributives , sous l'angle de leurs effets sur la distribution monétaire des revenus, quand on évalue la redistributivité à partir du rapport entre les quintiles extrêmes de revenu .
Au niveau de l'OCDE, ce rapport est de 5,2 lorsqu'on envisage le revenu monétaire avant consommation desdits services publics. Après prise en compte des modifications implicites dues à la consommation gratuite des services publics dont la consommation est individualisable, le rapport inter-quintiles est significativement réduit puisqu'il tombe à 3,40 .
Pour la France , ce rapport passe de 4,04 à 2,59, ce qui représente une contribution à la réduction des inégalités quantitatives de revenus de même ampleur que celle des prestations publiques sociales en espèces.
Au niveau de l'ensemble OCDE, cet effet redistributif peut être visualisé à partir des graphiques ci-dessous qui montrent que l'impact d'une distribution plutôt uniforme des services collectifs sur les revenus les plus bas est nettement plus fort que pour les revenus élevés et qu'elle contribue ainsi à la réduction des inégalités de revenus .
IMPORTANCE DES SERVICES PUBLICS DANS LE REVENU DES
MÉNAGES,
MOYENNE OCDE
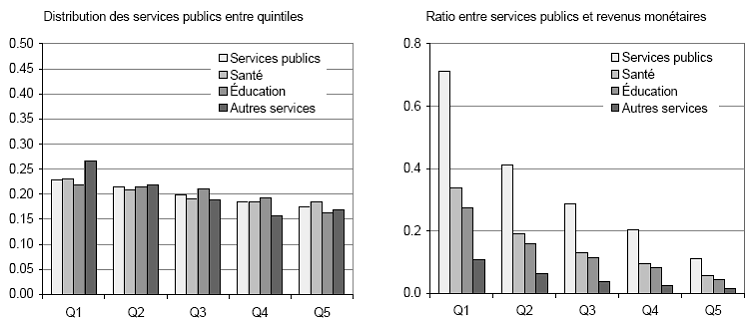
Source : OCDE
Dans le graphique de gauche, on observe que si le premier quintile de revenu « absorbe » une proportion relativement plus élevée des dépenses publiques de services publics que les autres, la distribution de ces dépenses n'est pas particulièrement concentré sur les plus bas revenus, autrement dit, qu'elle n'est pas significativement inégalitaire.
Le graphique de droite montre pourtant que, malgré cette répartition assez uniforme, l'impact sur le revenu des différents quintiles est très différencié.
* Le tableau ci-après indique que la dimension redistributive de ces dépenses publiques est principalement attribuable à certaines catégories de dépenses publiques, et varie selon les pays .
RAPPORT INTER-QUINTILES AVANT ET APRÈS
INTÉGRATION DES DÉPENSES
AU TITRE DE TOUS LES SERVICES
PUBLICS
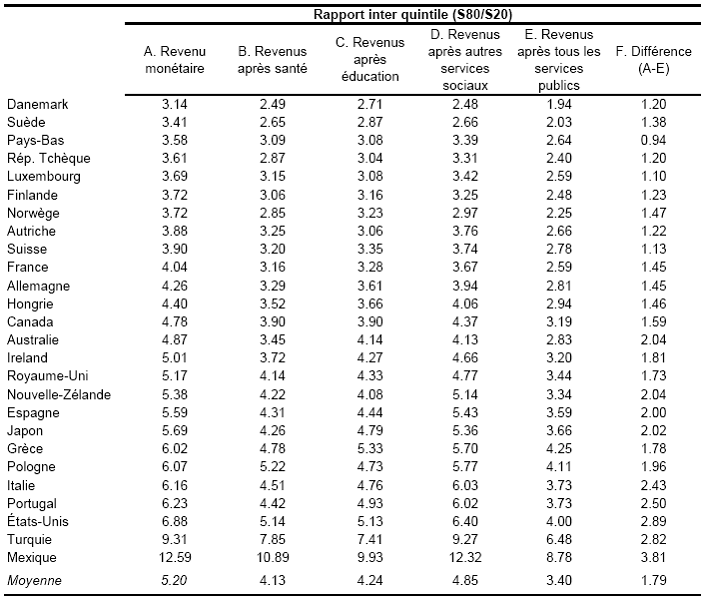
Source : OCDE
Le tableau suivant rend compte en détail de l'effet des dépenses publiques de services collectifs sur les différents niveaux de revenus dans l'OCDE.
RAPPORT ENTRE LES AVANTAGES FOURNIS PAR LES SERVICES PUBLICS ET LE REVENU DISPONIBLE DE CHAQUE QUINTILE DE REVENU
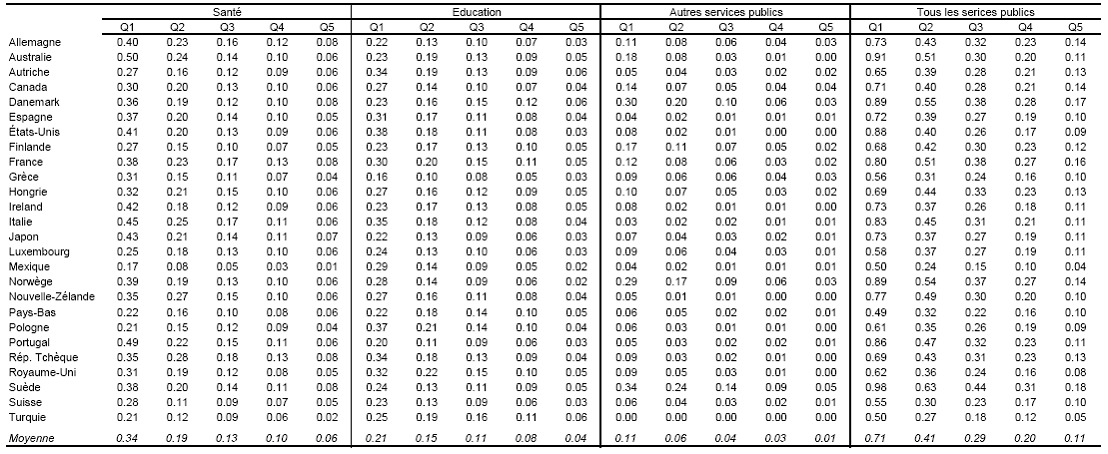
Source : OCDE
- Ce sont les dépenses de santé qui réduisent le plus l'inégalité inter-quintiles, de 1,07 point, suivies par les dépenses d'éducation (- 0,96 point) et les autres dépenses sociales en nature (- 0,35 point).
* La réduction de l'inégalité entre les quintiles extrêmes de revenu est très inégale selon les pays.
Elle se situe au-dessus de la moyenne dans les pays suivants : Mexique, Turquie, États-Unis , Portugal, Nouvelle-Zélande, Espagne, Japon , Italie , Australie.
Elle est inférieure à la moyenne , au Danemark , en Suède , en Allemagne , au Canada et au Royaume-Uni .
La France , avec une réduction de 1,45 point du rapport inter-quintiles appartient à ce dernier groupe de pays .
* On relève que la réduction des inégalités par les services publics est d'autant plus forte que les inégalités de départ le sont aussi .
Cette corrélation ne s'explique pas par un effort plus soutenu de réduction des inégalités dans les pays où les inégalités marchandes de départ sont élevées. Elle provient d'un effet plus mécanique .
Globalement, les dépenses publiques de services collectifs individualisables sont dans les faits réparties à peu près également entre les différents quintiles de revenus (voir le tableau ci-dessous).
DISTRIBUTION DES DÉPENSES PUBLIQUES
AU TITRE
DES SERVICES PUBLICS ENTRE QUINTILES
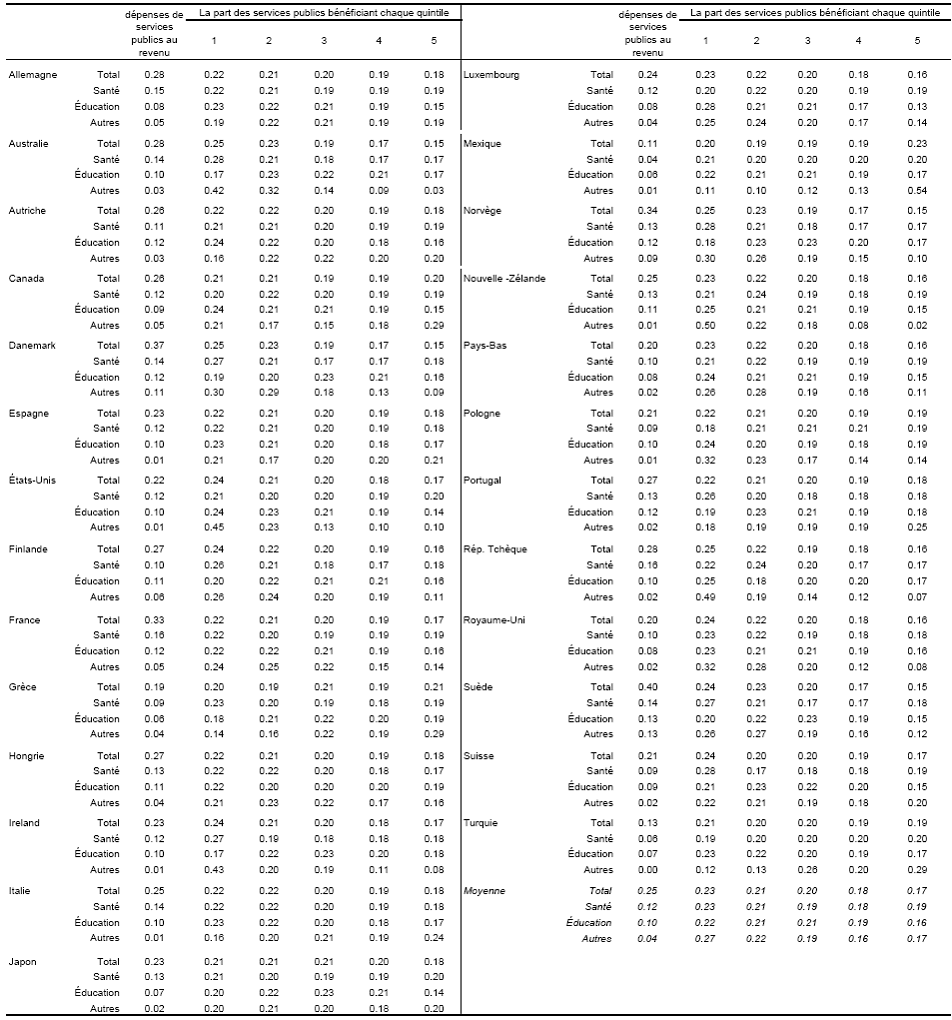
Note de lecture : en Allemagne, 22 % des dépenses publiques de services collectifs « reviennent » aux ménages du premier quintile de revenu, 21 % au deuxième, 20 % au troisième, 19 % au quatrième et 18 % au cinquième qui rassemble les 20 % des ménages ayant les revenus primaires les plus élevés.
Source : OCDE
Par exemple, entre les États-Unis où les dépenses publiques de services collectifs diminuent le rapport inter-quintiles de 2,89 points et la France où elles ne le diminuent que de 1,45 point, la répartition de ces dépenses par quintile est analogue.
RÉPARTITION PAR QUINTILE DES DÉPENSES
PUBLIQUES
DE SERVICES COLLECTIFS AUX ÉTATS-UNIS ET EN
FRANCE
(en % du total)
|
Quintiles |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
États-Unis (A) |
24 |
21 |
20 |
18 |
17 |
|
France (B) |
22 |
21 |
20 |
19 |
17 |
|
Écarts (B-A) |
- 2 |
0 |
0 |
+ 1 |
0 |
Toutefois, comme les revenus auxquels s'ajoutent ces dépenses sont beaucoup plus inégalement répartis aux États-Unis qu'en France (le rapport inter-quintiles, avant consommation des services collectifs, est de 6,88 aux États-Unis et de 4,04 en France), la distribution uniforme des avantages collectifs a un effet nettement plus fort sur les bas revenus aux États-Unis (et beaucoup moins sur les revenus élevés) qu'en France .
B. QUEL IMPACT SUR L'ÉGALISATION DES CHANCES ?
C'est une des justifications fondamentales de l'intervention collective que de contribuer à égaliser les chances et, sans doute aussi, de ce fait, les conditions .
De l'existence d'une redistributivité quantitative , on ne peut conclure , sans nuancer le propos, que cet objectif , dont les contours ne peuvent être dessinés sans quelques subtilités, est atteint .
On considère ici que l'égalisation des chances est atteinte lorsque l'intervention collective permet de rapprocher les conditions de bien-être des individus de sorte qu'ils puissent disposer d'opportunités plus égales dans le contexte socio-économique qui est le leur.
Au regard de cette définition, les dépenses publiques sous revue (santé, éducation...) réalisent par leur apport quantitatif, un rapprochement des conditions d'accès aux biens et services publics, et par conséquent, des niveaux de bien-être.
Mais, ce processus ne parait pas s'accompagner d'une égalisation aussi nette des opportunités socio-économiques pour les raisons suivantes :
- une partie importante de l'égalisation des niveaux de vie est plus apparente que réelle puisqu'elle se manifeste à l'occasion de « handicaps » qu'il s'agit de compenser : la dégradation de la santé avec l'âge, le lien entre présence d'enfants et faiblesse relative du revenu...
Il s'agit alors de contribuer au financement de besoins particuliers à des populations plutôt que d'égaliser les situations de personnes connaissant, à moyens différents, des besoins identiques.
On peut contrôler que la redistributivité est alors liée à ces besoins et non le résultat d'une ambition de réduction des inégalités verticales en mesurant que des personnes de revenus différents mais de situations identiques sous les autres angles disposent des mêmes avantages.
L'intervention publique est alors essentiellement compensatrice et évite un creusement des inégalités qui, sans elle, ne manquerait pas de se produire, mais elle ne contribue pas réellement à égaliser les opportunités ;
- la propriété de la redistributivité quantitative à se transformer en redistributivité qualitative paraît assez hypothétique. Cela résulte sans doute de l'observation mentionnée plus haut mais aussi de ce qu'il n'y a pas de concordance systématique entre un niveau quantitatif de consommation de service public et sa traduction qualitative :
- la capacité à tirer profit d'un même service est probablement asymétrique selon le revenu ;
- à une quotité monétaire donnée de service public peuvent correspondre des niveaux de qualité différents.
Finalement, la reproduction d'inégalités héritées ne « disqualifie » pas l'utilité redistributive des dépenses publiques mais semble montrer que celle-ci n'a pas toujours toute la traduction effective qu'on pourrait souhaiter .
CONCLUSION GÉNÉRALE
Votre rapporteur nourrit l'espoir qu'au terme de l'examen de quelques grandes questions relatives aux dépenses publiques que propose ce rapport, on puisse porter sur les dépenses publiques un autre regard et qu'aux approches dogmatiques succède l'envie d'analyser pour mieux comprendre.
En ce domaine l'état de nos savoirs invite à des attitudes modestes et ne soutient pas les discours péremptoires et manichéens.
Simplificateurs à outrance, ceux-ci obscurcissent plus qu'ils n'éclairent les questions que posent les dépenses publiques et, finalement, nuisent à la qualité de la décision publique.
En alimentant les fantasmes, en dramatisant les termes des choix publics, ces approches vont à rebours de la méthode qu'il faudrait suivre et qui doit tendre vers l'évaluation la plus rigoureuse, complète et transparente possible.
Le présent rapport exprime une défiance et une critique, qu'on espère argumentées, face à une série de jugements généraux et imprécis qui conduisent à des visions caricaturales pour, finalement, ignorer les vraies questions que posent les dépenses publiques.
Premier constat : si les dépenses publiques atteignent des niveaux très différents dans les pays développés, on ne peut associer à cette observation celle d'une égale diversité au regard de l'emploi des ressources économiques.
Autrement dit, quand on effectue des comparaisons internationales rigoureuses, le niveau de l'intervention publique n'est pas un déterminant essentiel de l'utilisation globale du revenu et un niveau comparativement élevé de dépenses publiques ne signifie hypertrophie ni de la production non-marchande, ni du souci de protection sociale.
Au demeurant, sauf peut-être pour la défense, il n'existe dans aucun pays, une fonction que couvre en totalité les dépenses publiques qui y sont consacrées. Dans chaque domaine, des dépenses privées s'ajoutent aux dépenses publiques.
Ces additions varient dans leur ampleur inversement au niveau des dépenses publiques, dans des conditions qui diffèrent selon les pays et selon la catégorie de besoins concernés (le complément apporté par les dépenses privées est plus important dans le domaine de la protection sociale et de la santé 122 ( * ) que dans des domaines comme la sécurité ou les services généraux d'administration).
Mais, au total, il existe une convergence dans le niveau des ressources consacrées à la satisfaction des besoins correspondant aux champs de l'intervention publique.
Ce résultat est finalement peu susceptible d'étonner même s'il contraste avec le sentiment de grande diversité qu'inspire la considération de dépenses publiques très inégales : il correspond à l'idée que les agents économiques ont des aspirations très semblables.
Il montre aussi que les « arrangements » institutionnels n'ont pas l'importance décisive qu'on leur prête dès lors qu'ils ne diffèrent pas, fondamentalement, dans leur nature.
Le déterminant principal de l'utilisation des richesses économiques est le niveau même de ces richesses.
Là aussi, comment s'en étonner vraiment ? Si les agents économiques ont des aspirations homogènes, les différenciations existantes proviennent de l'inégale capacité - financière notamment - à satisfaire ces aspirations. Or, la contrainte financière est directement tirée du niveau de richesses.
Rien de ce qui précède ne doit conduire à renoncer aux explications plus microéconomiques , à la fois pour rendre compte plus précisément du niveau des ressources consacrées à chaque fonction (à cet égard, il semble essentiel de progresser dans la détermination des volumes offerts, d'un côté, et des coûts, de l'autre) et pour identifier les progrès d'efficacité envisageables.
Si tel n'était pas l'objet du présent rapport, au fil de ces pages quelques problématiques d'amélioration ont été parfois envisagées. En ce sens, si l'approche comparative ne suffit jamais, elle peut offrir quelques indices qui peuvent orienter des enquêtes approfondies. La situation du coût par élève dans l'enseignement secondaire en France, tout comme le coût exorbitant des services de santé aux États-Unis en offrent des illustrations.
De même, si les comparaisons montrent que le niveau des dépenses publiques ne détermine pas le niveau des richesses allouées à telle ou telle fonction, elles suggèrent quelques nuances comme le montrent les quelques données ci-après relatives au secteur de la santé, mais dont les mécanismes pourraient aussi bien s'appliquer à l'éducation.
L'une des faiblesses attribuées aux productions publiques réside dans l'absence de mécanismes permettant de garantir une production adéquate aux besoins. Par hypothèse, les prix font défaut et ne peuvent donc pas jouer leurs rôles de révélateur de préférences, tant pour les consommateurs que les producteurs. En outre, il existerait un biais généralisé à la hausse des dépenses publiques dans la mesure où leurs prescripteurs pourraient retirer de cette hausse plus d'avantages que d'inconvénients.
Un tel mécanisme a été fréquemment mis en cause dans le cadre de l'assurance-maladie. En ôtant à cette expression tout sens péjoratif, certains économistes on fait valoir qu'il pourrait exister une sorte de « collusion » entre les prescripteurs et les patients sur qui, du fait de l'organisation collective du système d'assurance maladie, ne s'exercerait aucune incitation à se montrer économes des deniers qui ne sont pas les leurs. On retrouve un problème, classique en économie, d'aléa moral qui se manifeste dès qu'un agent économique n'est pas le « payeur » de ces actes.
Cette approche théorique ne semble pas devoir s'appliquer sans nuances au domaine de la santé.
En effet, lorsqu'on observe deux échantillons de pays regroupant, l'un, ceux où les contributions privées (assurance privée et dépenses à la charge des patients) sont supérieures à la moyenne des pays de l'OCDE, l'autre où elles sont inférieures, on remarque que le premier groupe de pays alloue davantage de ressources à la santé (et à la moyenne) que le second.
Il apparaît, en particulier, que l'obligation de recourir à des assurances privées ne joue pas systématiquement dans le sens d'une réduction des dépenses. Les pays dans lesquels le financement par les assurances privées est supérieur à la moyenne connaissent, globalement, des dépenses de santé supérieures aux autres.
COMPARAISON ENTRE LE NIVEAU DE CONTRIBUTION
PRIVÉE
ET LE NIVEAU DES DÉPENSES DE SANTÉ
DANS LES
PAYS OÙ LA PREMIÈRE EST
SUPÉRIEURE
À LA
MOYENNE
|
Pays |
Part du financement privé dans le total |
Niveau du total
|
|
Australie |
31,1 |
8,9 |
|
Autriche |
30,3 |
8,0 |
|
Canada |
29,1 |
9,2 |
|
Corée |
55,6 |
5,9 |
|
Mexique |
54,1 |
6,6 |
|
Pays-Bas |
36,7 |
8,9 |
|
Espagne |
28,6 |
7,5 |
|
Suisse |
44,4 |
10,7 |
|
États-Unis |
55,6 |
13,9 |
|
Moyenne OCDE |
27,6 |
8,8 |
COMPARAISON ENTRE LE NIVEAU DE CONTRIBUTION
PRIVÉE
ET LE NIVEAU DES DÉPENSES DE SANTÉ
DANS LES
PAYS OÙ LA PREMIÈRE EST
INFÉRIEURE
À LA
MOYENNE
|
Pays |
Part du financement privé dans le total |
Niveau du total
|
|
République Tchèque |
8,6 |
7,3 |
|
Danemark |
17,6 |
8,6 |
|
Finlande |
24,4 |
7,0 |
|
France |
24,0 |
9,5 |
|
Allemagne |
25,1 |
10,7 |
|
Hongrie |
24,9 |
6,8 |
|
Islande |
15,6 |
9,1 |
|
Irlande |
20,0 |
6,5 |
|
Italie |
24,7 |
8,4 |
|
Japon |
21,7 |
7,6 |
|
Luxembourg |
10,5 |
5,6 |
|
Nouvelle Zélande |
24,3 |
8,2 |
|
Norvège |
14,5 |
8,3 |
|
République Slovaque |
10,7 |
5,7 |
|
Moyenne OCDE |
27,6 |
7,2 |
Est-ce à dire que l'obligation de supporter tout ou partie du coût des consommations de santé est sans effet sur le niveau de celle-ci ?
La réponse est intuitivement négative et, de fait, il semble que le niveau de la contribution laissée à la charge des patients - celle qui n'est pas assurée - influence le niveau global des dépenses .
COMPARAISON ENTRE LE NIVEAU DE FINANCEMENT PAR DES
ASSURANCES PRIVÉES
ET LE NIVEAU DES DÉPENSES DE
SANTÉ
DANS LES PAYS OÙ LA PREMIÈRE EST
SUPÉRIEURE
À LA MOYENNE
|
Pays |
Part du financement
|
Niveau du total
|
|
Australie |
7 |
8,9 |
|
Canada |
11,4 |
9,2 |
|
France |
12,7 |
9,5 |
|
Allemagne |
12,6 |
10,7 |
|
Corée |
8,7 |
5,9 |
|
Pays-Bas |
15,5 |
8,9 |
|
Suisse |
10,5 |
10,7 |
|
États-Unis |
35,6 |
13,9 |
|
Moyenne OCDE |
14,25 |
9,7 |
COMPARAISON ENTRE LE NIVEAU DE FINANCEMENT PAR DES
ASSURANCES PRIVÉES
ET LE NIVEAU DES DÉPENSES DE
SANTÉ
DANS LES PAYS OÙ LA PREMIÈRE EST
INFÉRIEURE
À LA MOYENNE
|
Pays |
Part du financement
|
Niveau du total
|
|
Autriche |
7,0 |
8,0 |
|
Danemark |
1,6 |
8,6 |
|
Finlande |
2,5 |
7,0 |
|
Hongrie |
0,3 |
6,8 |
|
Irlande |
6,8 |
6,5 |
|
Japon |
0,3 |
7,6 |
|
Luxembourg |
1,6 |
5,6 |
|
Mexique |
2,5 |
6,6 |
|
Nouvelle Zélande |
6,2 |
8,2 |
|
Norvège |
0,0 |
8,3 |
|
Espagne |
4,0 |
7,5 |
|
Moyenne OCDE |
3,0 |
7,3 |
COMPARAISON ENTRE LE NIVEAU DE LA CONTRIBUTION
LAISSÉE À LA CHARGE
DES PATIENTS ET LE NIVEAU DES
DÉPENSES DE SANTÉ
DANS LES PAYS OÙ LA PREMIÈRE
EST
SUPÉRIEURE
À LA MOYENNE
|
Pays |
Part des dépenses
|
Niveau du total
|
|
Finlande |
20,7 |
7,0 |
|
Hongrie |
21,3 |
6,8 |
|
Italie |
20,3 |
8,4 |
|
Corée |
41,3 |
5,9 |
|
Mexique |
51,6 |
6,6 |
|
Espagne |
23,7 |
7,5 |
|
Suisse |
32,9 |
10,7 |
|
Moyenne |
30,2 |
7,6 |
COMPARAISON ENTRE LE NIVEAU DE LA CONTRIBUTION
LAISSÉE À LA CHARGE
DES PATIENTS ET LE NIVEAU DES
DÉPENSES DE SANTÉ
DANS LES PAYS OÙ LA PREMIÈRE
EST
INFÉRIEURE
À LA MOYENNE
|
Pays |
Part des dépenses
|
Niveau du total
|
|
Australie |
18,5 |
8,9 |
|
Canada |
15,8 |
9,2 |
|
République Tchèque |
8,6 |
7,3 |
|
Danemark |
16,0 |
8,6 |
|
France |
10,2 |
9,5 |
|
Allemagne |
10,6 |
10,7 |
|
Islande |
15,2 |
9,1 |
|
Irlande |
13,3 |
6,5 |
|
Japon |
16,8 |
7,6 |
|
Luxembourg |
7,7 |
5,6 |
|
Pays-Bas |
8,8 |
8,9 |
|
Nouvelle-Zélande |
16,8 |
8,2 |
|
Norvège |
14,0 |
8,3 |
|
République Slovaque |
10,7 |
7,5 |
|
États-Unis |
14,8 |
13,9 |
|
Moyenne |
13,2 |
8,7 |
On observe une certaine corrélation entre la contribution laissée à la charge des patients et le niveau des dépenses de santé : plus la première est élevée, plus la seconde est, relativement, faible et vice versa .
Il serait prématuré de conclure de cette corrélation à l'existence d'une relation de causalité d'autant que dans plusieurs cas (Italie, Suisse) quoique les coûts à la charge des patients soient très supérieurs à la moyenne, les dépenses de santé le sont aussi. On peut même relever quelques résultats remarquables comme le niveau relativement élevé des dépenses de santé dans des pays où le financement direct par les patients atteint des niveaux exceptionnels.
Il serait encore plus aventureux de faire une préconisation générale du développement des financements privés à côté des systèmes publics comme solution au problème d'optimisation de la production publique ou des prestations sociales.
Une telle voie pose un très grand nombre de problèmes économiques et de principe qu'on peut évoquer à partir de quelques réflexions sur l'opportunité d'amplifier la partie privée des assurances sociales.
La partie la plus importante des dépenses publiques correspond dans les pays de l'OCDE à des assurances contre des risques sociaux . C'est aussi pour ces dépenses publiques que la diversité des situations nationales est la plus forte au regard de leur niveau relatif.
Ces données conduisent à s'interroger sur l' opportunité d'une substitution entre systèmes privés et systèmes publics de protection sociale, particulièrement, dans les pays où les dépenses publiques atteignent un niveau élevé relativement aux autres.
L' argument principal est que, dans ces pays, la collectivisation des assurances sociales comporte en soi un effet d'augmentation de la fraction du revenu national qu'elles attraient . Un second argument est alors cité : la coexistence dans les systèmes publics d'assurance de deux logiques , celle de pure assurance à côté d'une logique de redistribution , qu'il serait possible de séparer, ce qui permettrait de limiter l'ampleur des systèmes publics de protection sociale, et, de ce fait, le risque précité.
De fait, la plupart des dépenses sociales relèvent d'une logique d'assurance contre les risques 123 ( * ) : la maladie, le chômage et même la vieillesse. Dans ce dernier cas, même s'il est sans doute plus justifié d'évoquer un mécanisme de report de salaires entre le temps de l'activité et celui de l'âge de la retraite (les pensions de retraite sont, à juste raison, qualifiées de revenus différés), un élément d'incertitude demeure dans la durée de survie, qui appelle assurance.
Dans ces conditions, on fait valoir que des systèmes d'assurances privées pourraient aussi bien intervenir que les systèmes publics . On pourrait ainsi réserver aux systèmes publics les domaines dans lesquels il est seul à pouvoir intervenir : la redistribution et les risques difficilement assurables par des assureurs privés.
Cette proposition est formulée dans le cadre d'une critique des systèmes publics d'assurance, qui sont présentés comme comportant, en soi, un mécanisme d'inflation des couvertures assurantielles (le risque d'aléa moral) .
Il existerait dans ces systèmes, du fait de la discordance entre le coût de l'assurance et ses « retours », un risque de voir les assurés augmenter les occurrences d'indemnisation par rapport à ce qui se produirait dans un état plus naturel, s'ils devaient subir personnellement les conséquences financières de leurs comportements.
Ainsi, en réservant les assurances aux seuls risques que ne peuvent pas prendre en charge les assurances privées, on serait assuré d'une plus grande autodiscipline des assurés.
Il reste que cette critique, ainsi que la voie de solution proposée - l'extension des assurances privées - ne sont pas sans faiblesses .
En premier lieu, les éventualités concrètes où les assurés modifieraient leurs comportements pour tirer parti des assurances qui les couvrent sont sans doute beaucoup plus rares que ne le laisse supposer la généralité de la critique . S'agissant de l'assurance-maladie ou contre le chômage, on peut difficilement penser qu'il est usuel de décider de tomber malade ou de devenir chômeur. Il en va de même pour l'assurance-retraite, le vieillissement n'étant pas encore complètement maîtrisable. Sans doute, peut-on repérer dans ces différents domaines quelques occasions concrètes de comportements excessifs : surconsommation médicale, durée de chômage voire mise en retraite pour ne pas « perdre ses droits ». Mais, outre que ces éventualités pourraient également se manifester dans le cadre d'assurances privées, leur quantification est souvent vague et des moyens existent pour essayer de limiter ces pratiques excessives.
Au total, il n'y a pas de raisons pour que les systèmes publics d'assurances se montrent moins efficaces pour lutter contre les abus, en recourant à des contrôles ou à des incitations financières (tickets modérateurs, franchises...).
On pourrait imaginer des incitations financières individuelles et de rapprocher des systèmes d'assurance privés, afin que le coût de l'assurance publique soit alors aussi individualisé que dans un système privé.
Mais une telle voie a ses limites. La logique des systèmes privés, fonctionnant en conformité avec les modèles théoriques, est que des demandes non frauduleuses soient insatisfaites du fait de la contrainte financière que subissent certains, ou parce que l'offre d'assurance du risque n'existe pas. Cette logique est évidemment bien différente de celle des systèmes publics ou mutualistes qui impliquent des solidarités.
En effet, en théorie, les assurances privées proposées dans un contexte de concurrence, ne peuvent offrir le cadre d'une telle redistribution. Par ailleurs, elles ne peuvent tout assurer et donc offrir la même profondeur de garanties qu'un système public.
Pour l'essentiel, une assurance privée ne peut pas proposer de contrats occasionnant des pertes structurelles, ce que réalisent les assureurs publics, par exemple dans le cadre des prestations non contributives. Si tel était le cas, ils devraient surfacturer d'autres contrats pour se couvrir contre ces pertes, ce qui ne manquerait pas de faire fuir les contractants concernés vers des concurrents. L'assureur privé ne peut faire autrement que tarifer ces offres en fonction du coût de la protection (et non des revenus comme le font en général les assureurs publics), tenir compte au plus près de ce coût c'est-à-dire moduler ses prix en fonction des facteurs de risques observables (parfois, la loi doit l'interdire) ou introduire des mécanismes de cette nature (clauses de bonus-malus ; offres séparées de contrats, les uns « tous risques », onéreux car couvrant les mauvais risques, les autres de couverture partielle).
A ces caractéristiques propres aux assurances privées, qui expliquent qu'elles ne se prêtent guère à des transferts redistributifs, s'en ajoutent d'autres qui les différencient aussi des assurances publiques : le prépaiement des coûts, à travers des primes calculées en fonction du coût du risque ; la durée limitée des couvertures offertes ; l'absence d'offres dans des domaines où l'assurance peut être manipulée par l'assuré (chômage par exemple).
De fait, l'extension des systèmes d'assurances privées, qui romprait avec une tendance historique à l'universalisation des assurances sociales, s'accompagne de discriminations dont témoignent les taux de pauvreté dans les pays où elle est le plus pratiquée.
Finalement, seules des évaluations rigoureuses semblent susceptibles d'inspirer des mécanismes réellement adaptés à l'optimisation de telle ou telle dépense publique . Elle passe sans doute par des processus de responsabilisation qui suppose notamment d'améliorer l'information des usagers sur les incidences de leurs choix 124 ( * ) .
Deuxième constat : les relations négatives entre les dépenses publiques, l'épargne, l'investissement, la croissance économique et le pouvoir d'achat ne résistent pas à l'examen empirique, lorsqu'elles prennent une tonalité générale.
Il y aurait sans doute beaucoup à gagner à accroître notre expertise en ce domaine plutôt qu'à consacrer des efforts à construire des schémas ou des argumentaires pro domo qui ne satisfont que les esprits indifférents aux exigences de l'analyse.
Hormis la nécessaire mise à niveau de nos indicateurs usuels de mesure du bien-être, qui devrait progresser grâce à la très louable initiative de M. le Président de la République d'approfondir la réflexion sur ce sujet, il faudrait mettre l'accent sur la connaissance de la contribution des dépenses publiques à la croissance potentielle.
En ce domaine, les effets désincitatifs des dépenses publiques semblent relever plutôt du fantasme que de l'expérience. De même, on ne peut être insensible à la contribution de l'éducation, de la santé, de la recherche, de la cohésion sociale à la croissance économique, toutes variables que sont le champ d'élection privilégié des dépenses publiques.
Reste bien entendu ici aussi à doser celles-ci afin que leur efficacité soit maximale.
C'est là encore l'affaire d'une évaluation rigoureuse.
Troisième constat : si le niveau des dépenses publiques n'est pas une variable déterminante sous l'angle de l'allocation globale des ressources économiques à tel ou tel emploi, il est beaucoup plus décisif au regard du niveau des inégalités et de la pauvreté monétaires sans toutefois avoir, qualitativement, des prolongements aussi positifs qu'il serait souhaitable .
Appréciée au niveau de l'OCDE, la redistributivité des dépenses publiques est une propriété avérée dont la portée quantitative dépend principalement du niveau des dépenses publiques.
Dans tous les cas, la redistributivité s'exerce essentiellement au profit des plus démunis. Mais, paradoxalement, elle est plus importante dans les « systèmes » universels que dans ceux où l'intervention publique est concentrée sur les populations les plus en difficultés parce que, dans le second cas, les dépenses publiques sont fréquemment très modestes.
On pourrait imaginer d'optimiser la redistributivité des dépenses publiques en retenant, des « systèmes » universels, le niveau de la redistributivité de l'intervention publique, et des « systèmes » sélectifs, la conditionnalité. Mais, il faudrait démontrer que la modicité des avantages distribués dans les seconds est le fruit d'un hasard (la concentration des prestations en espèces et en nature sur les plus démunis ne risque-t-elle pas de rimer avec un sous-développement structurel de ces prestations ?) et qu'il est indifférent pour la situation des personnes à revenus intermédiaires que l'intervention collective s'exerce au bénéfice de tous. Dans les faits, en France, les dépenses publiques, qui certes bénéficient relativement plus aux moins dotés, sont aussi accessibles aux personnes relativement mieux positionnées sur l'échelle des niveaux de vie.
Pour votre rapporteur, il est plus fécond de s'attacher à clarifier deux sujets fondamentaux :
- le premier correspond au choix des objectifs de réduction des inégalités et de la pauvreté , choix politique mais aussi économique, global mais aussi au coup par coup, national mais aussi régional (au sens du régionalisme économique mondial). Sous ce dernier angle, votre rapporteur estime qu'au-delà de l'énoncé global d'un objectif européen de « cohésion sociale », il est essentiel de déterminer des indicateurs communs aux pays de l'Union européenne et de progresser sur la voie d'un consensus réaliste quant aux moyens de les mettre en oeuvre ;
- le second concerne les moyens de transformer la redistributivité quantitative en une vraie « redistribution » des chances , et des conditions, de passer d'une redistributivité réparatrice à une redistributivité positive . Cette ambition est forte, mais elle est indispensable. Sans que cette voie soit la seule, elle passe sans doute par une plus grande effectivité des objectifs que nous nous sommes fixés dans le domaine de l'éducation, à savoir que celle-ci contribue réellement à l'égalité des chances.
Tournant le dos aux discours simplificateurs, il nous reste à poursuivre notre effort de compréhension d'une réalité qui, par ses enjeux économiques et sociaux, mérite des évaluations apaisées.
EXAMEN EN DÉLÉGATION
Au cours de sa réunion du mercredi 2 juillet 2008 , tenue sous la présidence de M. Joël Bourdin, président , la délégation pour la planification a procédé à l'examen du rapport d'information de M. Bernard Angels, rapporteur, sur l'économie des dépenses publiques.
M. Bernard Angels, rapporteur , a indiqué que le volume du rapport reflétait l'importance de la place des dépenses publiques (47 % du PIB en zone euro et plus de 53 % en France), mais surtout la complexité des réalités qu'elles recouvrent.
Il a alors mentionné un premier constat avec l'absence de statistiques disponibles « sur étagère » pour effectuer des études économiques de fond sur les dépenses publiques qui contribue sans doute à la fragilité des opinions qui s'expriment en ce domaine.
Puis, il a jugé qu'en lien avec cette situation, les controverses sur les dépenses publiques étaient vives mais généralement stériles, la réponse précédant trop souvent la question en la matière.
Il a souhaité développer un peu un constat fondamental. D'un point de vue économique, les dépenses publiques recouvrent des objets si différenciés qu'il est factice et, finalement, trompeur de les ranger sous une catégorie unique.
Il n'y a pas « les dépenses publiques », il y a différentes sortes de dépenses publiques.
Pour ordonner cette diversité, le rapport s'articule autour de la distinction entre les dépenses publiques de production et celles de transferts, parmi lesquelles les dépenses de protection sociale ont une place essentielle.
Ces deux catégories de dépenses publiques correspondent, à des fonctions complètement différentes de l'État.
Les dépenses de production recouvrent les moyens nécessaires à l'État-producteur : santé, éducation, sécurité, défense... Elles financent les moyens de la production non marchande.
Les dépenses de transferts regroupent des subventions, la charge des intérêts de la dette publique, et surtout les dépenses d'assurances sociales, qui témoignent d'un rôle plus passif de l'État, celui de gestionnaire d'assurances.
M. Bernard Angels, rapporteur , a alors indiqué quelques ordres de grandeur.
Premièrement, quand on raisonne au niveau de l'Europe, on observe que la prédominance des dépenses de transferts dans le total des dépenses publiques est nette.
Dans la zone euro, environ 60 % des dépenses publiques sont consacrées à des transferts, et les seules dépenses d'assurances sociales mobilisent près de 46 % du total des dépenses publiques.
Moyennant quelques nuances, on peut retenir que les dépenses publiques de production et les dépenses publiques d'assurances sociales représentent en Europe des ordres de grandeur comparables soit à peu près un cinquième du PIB chacune.
Au niveau des 30 plus grands pays de l'OCDE, un même constat s'impose moyennant un équilibre un peu différent. Les transferts sont aussi légèrement majoritaires, mais la moyenne des dépenses publiques sociales est moins élevée (15 points de PIB environ contre 21,8 points en zone euro), ce qui explique pourquoi, globalement, le niveau des dépenses publiques dans le PIB est moins élevé dans le cadre de l'OCDE car, de leur côté, les dépenses publiques correspondant à la production non marchande y atteignent un niveau moyen comparable à la zone euro autour de 20 points de PIB.
Ce dernier constat tranche singulièrement, a-t-il souligné, avec l'idée répandue des handicaps que subirait l'Europe du fait du poids excessif de ses structures bureaucratiques.
Deuxièmement, l'État producteur l'est partout, surtout de fonctions non-régaliennes (la santé, l'enseignement, ...), si bien que les suggestions visant à « recentrer l'État sur ses fonctions régaliennes » apparaissent un peu irréelles.
Enfin, la structure moyenne de la fonction de production des administrations publiques comporte pour moitié (10 points de PIB) des salaires publics. Sous cet angle, on ne révèle pas de singularités fortes par rapport aux services privés. A ce propos, on peut incidemment relever que la masse salariale publique, qui a beaucoup moins augmenté qu'elle au cours des vingt ans écoulés, n'est qu'un peu supérieure à la masse salariale du secteur des services financiers.
M. Bernard Angels, rapporteur , a alors exposé les conclusions de la première partie de son rapport consacré à la question de savoir si les dépenses publiques influencent significativement l'utilisation globale des ressources économiques, indiquant qu'au terme d'un examen attentif, on pouvait répondre négativement à cette interrogation.
Certes, les niveaux de dépenses publiques dans les pays de l'OCDE sont très diversifiés.
Par exemple, l'écart entre la France et les États-Unis atteint 18,4 points de PIB.
On peut affiner cette observation en montrant que la diversité des niveaux de dépenses publiques varie selon qu'on considère les dépenses sociales ou les dépenses de production. Elle est plus forte pour les premières que pour les secondes.
La situation de la France illustre ce constat. Le niveau des dépenses publiques y est supérieur de 5,7 points de PIB par rapport à la moyenne de l'Europe des 25, soit 12,2 % de plus et ce sont les dépenses publiques de protection sociale (+ 2,9 points) qui expliquent la majeure partie du surplus de dépenses publiques que connaît la France.
En revanche, quand on compare la France à quelques grands pays de développement économique comparable, on observe que, si elle a une position singulière au regard de la protection sociale, elle se situe autour de la moyenne pour les dépenses publiques correspondant à la production non marchande.
Pour ces dépenses, le niveau des « consommations publiques », notion de comptabilité nationale qui regroupe les consommations intermédiaires (par exemple, l'électricité consommée) et les salaires publics n'est que très faiblement plus élevé en France que dans les autres pays développés.
En effet, dans ce domaine, si la France se caractérise par un niveau d'emplois publics relativement élevé, cette caractéristique ne trouve pas de prolongements à due proportion quand on observe les salaires publics. Le poids de l'emploi public dans l'emploi total, qui a été constant entre 1993 et 2002, est supérieur en France de 5,3 points à ce qu'il est dans des pays comparables. Mais, on relève que les écarts concernant les salaires publics sont nettement moins importants que ceux relatifs à l'emploi public. Le poids des salaires publics n'est, en France, supérieur que de 1,7 point de PIB par rapport à la moyenne de 17 grands pays de l'OCDE, ce qui signifie que le coût par agent public est plus bas en France qu'en moyenne.
M. Bernard Angels, rapporteur , a alors souligné que si les pays diffèrent beaucoup au regard du niveau des dépenses publiques dans le PIB, les différences dans l'utilisation globale des ressources économiques sont nettement moins marquées, celle-ci se révélant globalement plutôt homogène.
Il a alors précisé la méthode suivie pour arriver à cette observation. Les dépenses publiques sont réparties entre dix fonctions répertoriées par une nomenclature internationale et, pour mesurer le total des ressources économiques consacrées à ces fonctions, on ajoute aux dépenses publiques, quand les données disponibles le permettent, les dépenses privées, la partie des dépenses fiscales dont la compilation est disponible, et les effets de la fiscalité sur les revenus résultant du versement des dépenses publiques.
Dans le champ des dépenses sociales et pour quelques grands pays de l'OCDE, l'écart moyen à la moyenne passe de 4,8 (pour les seules dépenses publiques) à 3,8 points de PIB (pour la totalité des dépenses). Des pays situés très au-dessous de la moyenne sous l'angle des dépenses publiques à caractère social - les États-Unis (- 6,2 points de PIB), le Royaume-Uni (- 1,8 point de PIB) - se trouvent consacrer à la protection sociale des dépenses totales supérieures à la moyenne : États-Unis (+ 4,8 points de PIB), Royaume-Uni (+ 2,5 points de PIB), une fois les dépenses privées prises en compte.
Des observations analogues peuvent être faites dans le domaine de l'éducation. Globalement, la prise en compte des dépenses privées d'éducation égalise les situations.
Il faut ajouter que les données utilisées pour apprécier le niveau d'homogénéité des dépenses publiques ne sont pas exhaustives, ce qui accentue sans doute les écarts apparents. En effet, on ne tient compte ni des dépenses familiales, ni d'une partie des dépenses fiscales, ni des prélèvements sur le revenu national opérés à partir des patrimoines privés, toutes données qui semblent d'autant plus importantes que les couvertures publiques des risques sociaux sont moins développées.
M. Bernard Angels, rapporteur , a alors indiqué qu'au total, on était conduit à relever des phénomènes de vases communicants entre dépenses publiques et privées, dont les États-Unis offrent un exemple particulièrement illustratif. On y consacre 6 points de PIB de moins qu'en moyenne aux dépenses publiques de protection sociale et d'éducation mais 7,5 points de PIB de plus aux dépenses privées.
Pour les pays de l'OCDE, pour l'éducation et la protection sociale, on passe d'un écart moyen à la moyenne de 5,4 points de PIB à un écart de l'ordre de 2,7 points de PIB, ce qui représente des choix homogènes à 8 % près contre des différences de l'ordre de 20 % sur le front des seules dépenses publiques.
On peut en conclure que le niveau des dépenses publiques n'est pas un déterminant majeur de l'utilisation globale du revenu national. Sous cet angle, les différences résiduelles entre pays sont directement corrélées avec le niveau relatif de développement économique, qui ressort comme une variable essentielle.
Ces constats conduisent à dédramatiser et à préciser les enjeux d'une réduction des dépenses publiques.
D'un côté, la réduction de la place des dépenses publiques n'aurait pas, structurellement, d'incidence majeure sur l'allocation et l'orientation des richesses économiques. Mais, de l'autre, elle rendrait plus sensible la contrainte financière subie par certains ménages.
Les comparaisons internationales confirment l'existence d'une grande homogénéité des aspirations des agents économiques.
Mais, elles invitent aussi à estimer que les écarts dans les profils d'utilisation des richesses économiques que connaissent les pays également développés, pour marginaux qu'ils soient, témoignent, outre d'éléments de contexte, notamment démographiques (taux de chômage, proportion des personnes âgées ou des jeunes en formation...), du degré d'accès des plus démunis aux services et prestations publics.
Ainsi, si, malgré des niveaux très différents de dépenses publiques, l'utilisation globale du revenu est plutôt homogène, le degré de l'intervention publique semble répondre à des choix implicites ou voulus relatifs au niveau des inégalités.
M. Bernard Angels, rapporteur , a toutefois insisté pour que ces constats ne soient pas mal interprétés : l'équivalence globale des niveaux des ressources économiques allouées aux fonctions dans lesquelles se manifeste l'intervention publique ne dispense pas d'une élucidation systématique des écarts relatifs à chaque catégorie de dépense publique, le rapport relevant en ce domaine quelques singularités françaises.
M. Bernard Angels, rapporteur , a alors abordé la deuxième partie de son rapport consacrée à la question des liens entre dépenses publiques, croissance économique, pouvoir d'achat et bien-être.
Cette question est envisagée, d'une part, dans une perspective de court terme et, d'autre part, d'un point de vue structurel.
A court terme, la question est de savoir si une baisse des dépenses publiques exerce des effets favorables sur le rythme de la croissance économique. Plusieurs arguments théoriques sont avancés en ce sens, mais les études statistiques et empiriques n'en confirment généralement pas la validité.
Dans une perspective structurelle, c'est l'idée que les dépenses publiques exerceraient des effets négatifs sur la croissance économique, le pouvoir d'achat et le bien-être qui doit être examinée. Elle passe par deux arguments théoriques principaux et l'utilisation d'une série d'indicateurs couramment employés mais trompeurs.
Les arguments théoriques sont l'impact a priori défavorable des dépenses publiques sur l'épargne, donc sur l'investissement et in fine sur la croissance économique et leurs effets de distorsion, notamment du fait des incidences « désincitatives » liées à leurs propriétés redistributives.
Quant à eux, les indicateurs sont relatifs à l'appréciation de l'investissement des administrations publiques, du pouvoir d'achat des ménages (le revenu disponible brut ; le « coin fiscalo-social »), et des richesses créées (le produit intérieur brut - PIB).
Les arguments théoriques selon lesquels les dépenses publiques réduiraient structurellement le rythme de la croissance économique sont invérifiables concrètement.
L'argument de l'impact défavorable des dépenses publiques sur l'épargne et l'investissement peut être réfuté à partir de considérations, les unes empiriques, les autres théoriques.
Empiriquement, on note l'absence de corrélation négative entre dépenses publiques et taux d'épargne.
En 2004, les États-Unis sont le pays où le taux d'épargne nationale est le plus faible (13 points de PIB, soit 6,1 point de moins qu'en France) alors qu'ils appartiennent au groupe des pays où les dépenses publiques sont parmi les moins développées. La Suède où le ratio dépenses publiques/PIB excède de 21,6 points le même ratio en Australie, dispose d'une épargne nationale supérieure de 3 points.
Sous un angle plus théorique, les approches modernes de la croissance économique (les théories de la croissance endogène) conduisent de plus en plus à lier le rythme de la productivité globale des facteurs (PGF), variable déterminante pour le rythme de la croissance, à plusieurs catégories de grandeurs économiques, qui ont pour particularité essentielle de relever le plus souvent de financements publics (la recherche, l'éducation, la santé...).
Sans doute, faut-il reconnaître que les études empiriques conduites pour vérifier cette théorie donnent des résultats contradictoires. Mais, les performances de croissance économique réalisées par des pays où le niveau des dépenses publiques correspondant à la production non marchande sont supérieures à la moyenne (les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suède, le Danemark, le Canada) tendent à donner un certain poids à cette approche, qui inspire directement la fameuse « Stratégie de Lisbonne » de l'Union européenne.
Le deuxième canal théorique de transmission négative des dépenses publiques sur la croissance viendrait de leurs propriétés « désincitatives ». Sont particulièrement visées les dépenses sociales.
Cette approche n'est pas confirmée dans sa généralité.
Il faut d'abord rappeler que le niveau des dépenses publiques sociales ne détermine pas celui des dépenses sociales totales si bien qu'à supposer que les premières soient « désincitatives », leur réduction pourrait être sans efficacité, les secondes prenant le relais.
Par ailleurs, les indicateurs pertinents ne confirment pas cette relation négative. Par exemple, quand on croise, d'un côté, le niveau de la protection sociale publique et, de l'autre, l'écart entre la croissance observée et la croissance prévisible, l'existence d'une relation univoque entre ces grandeurs n'est pas observable.
De même, les taux d'activité qui mesurent la participation au marché du travail ne sont pas corrélés avec le niveau des dépenses publiques sociales.
Au total, rien ne vient étayer l'affirmation globale que le niveau des dépenses publiques réduirait en soi les opportunités de croissance. On peut même renverser cette opinion.
Plusieurs dépenses sociales, en plus de réduire les risques de pauvreté, contribuent à entretenir le capital humain (les dépenses de santé, les dépenses contribuant à lutter contre l'exclusion sociale qui implique aussi exclusion du marché du travail...) ou à le libérer (les dépenses de garde des enfants).
La corrélation entre le niveau global des dépenses sociales (publiques et privées) et le niveau de richesse est positive.
Par ailleurs, dans une économie de plus en plus soumise à des chocs, le niveau des dépenses publiques sociales peut être déterminant pour les absorber dans des conditions sociales mais aussi économiques favorables. Par exemple, la « flexisécurité » se traduit par un niveau comparativement élevé de dépenses publiques dans le domaine de la politique du marché du travail mais réduit les coûts d'ajustement économique.
Il faut encore souligner que la contribution des dépenses publiques à la richesse économique est systématiquement sous-estimée par les indicateurs censés mesurer la production et le pouvoir d'achat.
La mise en évidence d'un impact défavorable des dépenses publiques sur le bien-être repose, outre sur l'affirmation indémontrable que les dépenses publiques freinent, en elles-mêmes, la croissance, sur des indicateurs, qui donnent une idée fausse de la réalité en négligeant la contribution des biens et services collectifs au bien-être.
Tel est d'abord le cas de deux indicateurs d'usage courant pour mesurer le pouvoir d'achat des ménages : le revenu disponible brut des ménages d'un côté, le coin fiscalo-social de l'autre.
Dans les deux cas, le problème est le même : ces indicateurs sont construits à partir d'un revenu des ménages amputé des prélèvements destinés à financer des services collectifs dont la contrepartie n'est pas reprise exhaustivement dans les ressources qui servent à mesurer leur richesse. Cette convention statistique conduit notamment à biaiser complètement les comparaisons de pouvoir d'achat entre des pays où les services publics sont inégalement développés au détriment de ceux où ils le sont plus particulièrement.
Mais, les problèmes de mesure de la contribution des dépenses publiques au bien-être s'étendent au-delà, jusqu'à la mesure du produit intérieur brut (le PIB). En effet, la production non marchande est estimée à son coût de production et non en fonction des services réellement rendus.
Enfin, il conviendrait de requalifier un grand nombre de dépenses publiques, qui sont considérées sur la base de principes comptables comme des dépenses correspondant à des consommations publiques, alors que, sur le plan économique, elles sont des dépenses d'investissement.
M. Bernard Angels, rapporteur , a alors exposé les conclusions correspondant à la troisième question abordée dans le rapport, celle relative à la redistributivité des dépenses publiques. En ce domaine, un premier constat est qu'il existe une forte corrélation positive entre le niveau des dépenses publiques et la réduction des inégalités monétaires.
Le niveau des prestations sociales publiques et le taux de pauvreté, qui est l'expression la plus critique des inégalités, sont corrélés négativement.
On peut élargir ce constat d'un lien positif entre l'effet redistributif des dépenses publiques et leur niveau, aux dépenses de retraite, aux dépenses de santé et aux dépenses d'éducation.
Ce premier constat invite à une deuxième constatation : la redistributivité monétaire des dépenses publiques paraît dépendre étroitement de leur universalité, tandis que, paradoxalement, les pays dans lesquels les dépenses publiques sont ciblées sur les populations en difficulté corrigent peu les inégalités.
Dans ce contexte, il faut relever un troisième constat : la redistributivité monétaire des dépenses publiques varie selon la catégorie envisagée.
En France, les prestations sociales en espèces hors pensions exercent une redistribution assez importante, au profit des 20 % les plus pauvres.
Les dépenses publiques de retraite sont également redistributives, mais cette propriété est plus restreinte et limitée aux trois premiers déciles de revenu.
Les dépenses publiques de santé sont également redistributives mais, là aussi, le gain de niveau de vie qu'elle procure est concentré, étant plus élevé en valeur absolue pour les 20 % de ménages les plus pauvres.
Quant aux dépenses publiques d'éducation, elles exercent une redistribution au profit des familles appartenant aux premiers déciles de revenu, qui est particulièrement forte pour les familles du premier décile.
Au total, même si les dépenses concernées ne totalisent que les deux tiers des dépenses publiques, on peut conclure que les dépenses publiques exercent globalement une redistribution monétaire mais qui ne « profite » vraiment qu'aux 20 % des ménages les plus démunis.
Toutefois, ce constat de redistributivité monétaire des dépenses publiques doit être complété par d'autres considérations qui conduisent à prendre une plus juste mesure des propriétés redistributives des dépenses publiques.
D'abord, une caractéristique essentielle des dépenses publiques en France est qu'elles profitent à tout le monde, constat trop souvent passé sous silence. Même si la répartition des dépenses publiques est un peu inégalitaire, au profit des plus démunis, la distance entre ce qui revient aux plus pauvres et aux plus riches est faible. Par exemple, les familles du premier décile de revenu ne profitent que de 39,7 % de dépenses publiques d'éducation de plus que les familles les plus riches et celles-ci ont les mêmes avantages que celles disposant du revenu médian (le revenu au-dessous et au-dessus duquel se situent les deux moitiés de la population), données à mettre en relation avec des inégalités de revenus primaires allant du simple au triple.
Ensuite, la redistributivité monétaire qu'on constate n'est souvent que la contrepartie de situations inverses de « handicaps » relatifs, non monétaires, qui tout à la fois expliquent la situation de revenus des personnes et le niveau des dépenses publiques qui leur sont destinées.
Par exemple, pour les dépenses de santé, la concentration des dépenses publiques au profit de plus pauvres s'explique en grande partie par le fait que les plus pauvres sont moins bien portants que les autres.
Ainsi, la redistributivité monétaire égalise moins les niveaux de vie qu'elle ne compense des handicaps qui, sans l'intervention publique, se traduiraient par un fort creusement des inégalités et une augmentation de la pauvreté.
Enfin, le diagnostic sur la redistributivité monétaire des dépenses publiques peut varier du tout au tout en fonction du point de vue adopté.
Pour les dépenses publiques de retraite, leur redistributivité est avérée quand on la mesure au niveau des individus mais elle est presque nulle quand on l'apprécie au niveau du couple puisque la première résulte encore beaucoup de la situation des femmes.
Pour les dépenses publiques de santé, le constat de redistributivité doit faire place à un constat inverse d'anti-redistributivité quand on tient compte de l'extension limitée de la couverture publique. Les restes à charge des ménages représentent 5,4 % du revenu pour le premier décile et 0,8 % pour le décile de revenu le plus élevé, données estimées avant la mise en oeuvre des franchises médicales.
Quant aux dépenses publiques d'éducation, si elles exercent un effet redistributif entre familles riches et pauvres, cet effet est beaucoup moins net au niveau qui compte vraiment, celui des enfants.
La dépense par enfant scolarisable des familles pauvres est inférieure de 800 euros par an à celle des familles les plus riches.
La redistributivité des dépenses publiques doit, enfin, être appréciée d'un point de vue plus qualitatif.
En liaison avec les caractéristiques de la redistributivité quantitative, on peut estimer que les dépenses publiques préviennent des processus de dégradation des situations individuelles (la pauvreté, l'absence d'éducation, le défaut d'accès aux soins...) qui se traduirait par une baisse des niveaux de vie des populations les plus « fragiles ». Mais, elles contribuent insuffisamment à l'égalisation des chances et encore plus des conditions. Les renoncements aux soins, de même que les états de santé restent fortement corrélés à la situation de revenus ; l'éducation de masse ne rime pas avec le diplôme pour tous et encore moins avec l'égalisation des chances de suivre les mêmes parcours scolaires d'excellence.
Ces constats ne préjugent pas des solutions qu'il faudrait adopter pour prolonger sur un plan qualitatif l'apport des dépenses publiques sous l'angle de la redistributivité quantitative, mais ils représentent autant de défis pour améliorer l'efficacité des dépenses publiques a estimé pour conclure M. Bernard Angels, rapporteur .
M. Joël Bourdin, président, a remercié le rapporteur pour l'importance de son travail, estimant qu'un point de vue international permettait de mieux appréhender les singularités de la situation de la France.
Il s'est associé aux analyses faisant ressortir la contribution des dépenses publiques à la croissance économique, estimant toutefois que l'essentiel en ce domaine était de trouver le point le plus proche de l'optimum, ce qui implique de redoubler les efforts d'évaluation de l'efficacité des politiques publiques. Evoquant l'effet des dépenses publiques sur l'épargne, il s'est demandé s'il ne fallait pas dépasser les constats du rapport pour tenir compte des variables locales susceptibles d'influencer le niveau des taux d'épargne nationaux.
Enfin, il a jugé de la plus haute importance de mesurer la contribution des dépenses publiques à la réduction des inégalités mais aussi de définir jusqu'à quel point elle doit s'exercer.
M. Bernard Angels, rapporteur , a estimé que le champ de l'éducation secondaire offrait un domaine particulièrement stratégique à l'évaluation des dépenses publiques. Il a insisté sur la démarche du rapport qui n'est pas de prescrire des choix politiques mais d'en éclairer les tenants et aboutissants.
Concernant la contribution des dépenses publiques à la réduction des inégalités, il a souligné que si elle était tangible, elle n'empêchait pas de constater que les dépenses publiques se traduisaient par des bénéfices assez également répartis entre les différentes catégories de revenu.
M. Joseph Kergueris a jugé salutaire la démarche du rapport estimant que sur des questions aussi importantes, il fallait accroître l'expertise dans un esprit général de modestie. Il a relevé l'intérêt du diagnostic sur les propriétés redistributives des dépenses publiques, notamment en ce qu'il rompt avec l'idée très répandue selon laquelle les classes moyennes ne « profiteraient » pas des interventions publiques.
La délégation a alors donné un avis favorable unanime à la publication du rapport d'information sur l'économie des dépenses publiques, de M. Bernard Angels, rapporteur.
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES ET CONSULTÉES
Votre rapporteur tient à remercier chaleureusement pour leurs contributions :
- M. Henri STERDYNIAK, OFCE 125 ( * ) , directeur du Département économie de la mondialisation
- M. Xavier TIMBEAU, OFCE, directeur du Département analyse et prévision
- M. Gérard CORNILLEAU, OFCE, directeur adjoint du Département des études économiques
- M. Jérôme CREEL, OFCE, directeur adjoint du Département des études économiques
- M. Éric CHARBONNIER, OCDE 126 ( * ) , directeur de la Division des indicateurs et des analyses à la Direction de l'éducation
- M. Willem ADEMA, OCDE, Direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales
- M. Maxime LADAIQUE, OCDE, Direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales
- M. Robert GARY-BOBO, professeur à l'Université PARIS I
- M. Alain TRANNOY, professeur à l'Université de Cergy-Pontoise, EHESS et GREQAM-IDEP de Marseille
- M. Didier BLANCHET, INSEE 127 ( * ) , Département des études économiques d'ensemble
- Mme Sylvie LE MINEZ, INSEE, administrateur à la Division redistribution et politiques sociales
- Mme Anne-Marie BROCAS, DREES 128 ( * ) , directrice
- M. Jean-Richard CYTERMANN, directeur adjoint à la DGRI 129 ( * ) du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
- Mme Michèle JACQUOT, Ministère de l'Éducation nationale, Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance
- Mme Christine RAGOUCY, Ministère de l'Éducation nationale, Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance
Les annexes n° 7 et 8 doivent beaucoup aux remarquables articles de MM. Raymond Van der Putten et Jean-Marc Lucas publiés par la revue « Conjoncture » de BNP Paribas.
En revanche, votre rapporteur regrette que le questionnaire suivant, adressé à M. le Président de la Banque centrale européenne (BCE), soit resté sans réponse.
|
|
ANNEXES
ANNEXE N° 1 - UN POINT DE VUE LONG SUR LES DÉPENSES PUBLIQUES : L'ÉVOLUTION DES DÉPENSES PUBLIQUES ENTRE 1960 ET 1990
Le niveau des dépenses publiques des pays développés a connu une augmentation très importante depuis 1960 jusqu'au milieu des années 90 où leur valeur moyenne pour les dix-huit pays de l'OCDE a connu un pic. Elles sont passées d'un peu plus d'un quart du PIB à un peu moins de la moitié .
Cette évolution est intervenue dans le contexte d'une forte croissance économique , mais l'accroissement des dépenses publiques a été presque deux fois plus important que l'essor des richesses créées dans ces pays. La valeur médiane de la multiplication des dépenses publiques - la moitié des pays se situant au dessus, l'autre moitié au-dessous - a été de 5 .
Le dynamisme absolu des dépenses publiques a été particulièrement fort dans la période de croissance très soutenue des années 60 . Au-delà du premier choc pétrolier et jusqu'en 1982, il s'est ralenti, mais très peu et c'est alors qu'exprimées en points de PIB les dépenses publiques ont le plus augmenté. Au-delà, le rythme d'augmentation des dépenses publiques s'est considérablement infléchi mais le niveau relatif des dépenses publiques dans le PIB s'est malgré tout accru, très modérément dans les faits.
En bref, autant le découplage entre la croissance économique et celle des dépenses publiques a été prononcé lorsque la première était soutenue, autant quand elle a ralenti le dynamisme des dépenses publiques a, avec un temps de retard, rejoint celui des richesses créées par les pays développés .
Parmi les dépenses publiques, hors l'investissement (au sens de la Comptabilité nationale qui en donne une image très contestable s'agissant des administrations publiques, comme le rappelle le présent rapport), si toutes les catégories ont progressé, la palme revient aux transferts sociaux .
Autrement dit, si la production non-marchande des administrations publiques a été développée (dans des domaines comme l'éducation ou la santé notamment) c'est surtout la redistribution qui a été renforcée .
Les dépenses de retraite ont connu un essor particulièrement important . Leur caractère assurantiel, qui concerne aussi de nombreux autres transferts sociaux, fait que la variable la plus conséquente de l'augmentation des dépenses publiques a été le développement du rôle assurantiel des administrations publiques . Or, dans ce rôle , sans être purement un intermédiaire, la sphère publique exerce une fonction partiellement analogue à celle de tout assureur quel que soit son statut .
I. ENTRE 1960 ET 1990, DANS LES PAYS DE L'OCDE, UNE PROGRESSION DU POIDS RELATIF AU PIB DE TOUTES LES CATÉGORIES DE DÉPENSES PUBLIQUES, EXCEPTÉ L'INVESTISSEMENT
- A l'exception de la FBCF, toutes les catégories de dépenses publiques ont progressé sur un rythme plus rapide que la croissance économique entre 1960 et 1990 . Ainsi, les dépenses publiques exprimées en points de PIB ont augmenté nettement.
VARIATIONS DE LA PART DE CHAQUE CATÉGORIE DE
DÉPENSES DANS LE PIB
ENTRE 1960 ET 1990 (EN POINTS DU
PIB)
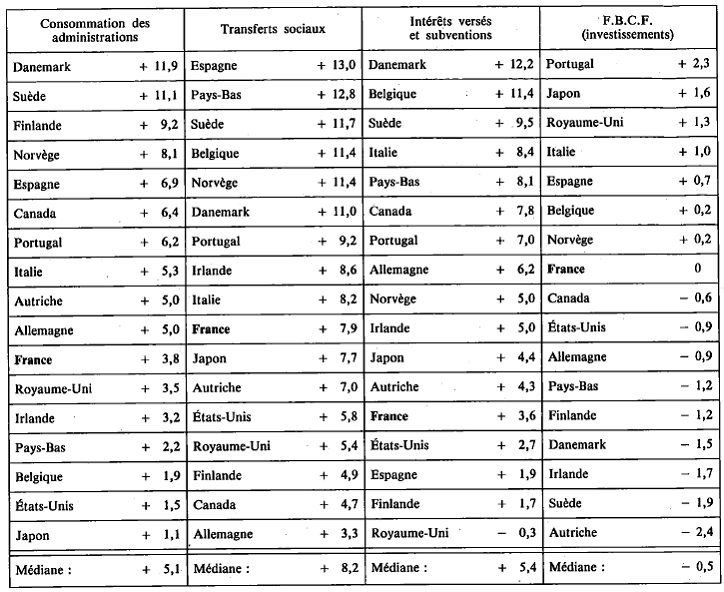
Source : Journal officiel n° 26, 1994
Au cours de la période, ce sont les transferts sociaux qui ont le plus augmenté ( + 8,2 points de PIB pour la variation médiane), suivis des intérêts et subventions ( + 5,4 points de PIB ) et des consommations publiques ( + 5,1 points de PIB ). La formation brute de capital fixe a légèrement rétrogradé (la baisse médiane a été de 0,5 point de PIB ).
La France se signale par une progression des dépenses publiques, relevant des trois premières catégories, inférieure à l'augmentation médiane , tandis que pour les dépenses de FBCF, on relève leur stabilité au cours de la période (contre une baisse de leur valeur médiane dans l'OCDE).
- L'expression des variations des dépenses publiques en points de PIB ne permettant pas de rendre compte de leurs augmentations en termes réels - la croissance du PIB a été variable dans les pays considérés -, on extériorise mieux la dynamique absolue des dépenses publiques en présentant leur croissance en volume 130 ( * ) .
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR DES DÉPENSES
PUBLIQUES EN « VOLUME »
(OU « EN TERMES
RÉELS ») ENTRE 1960 ET 1990 (EN POINTS DU PIB)
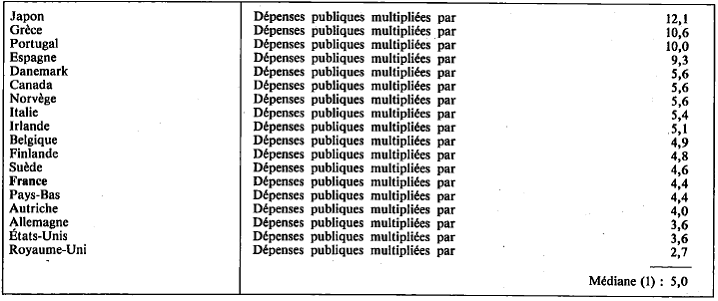
Source : Journal officiel n° 26, 1994
Certains pays qui, au vu de la variation des dépenses publiques en points de PIB apparaissent en queue de peloton (le Japon, l'Irlande, les États-Unis, et le Canada pour les transferts sociaux) occupent des positions plus élevées quand on apprécie l'augmentation en volume des dépenses publiques .
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR DE CHAQUE COMPOSANTE DES DÉPENSES PUBLIQUES EN « VOLUME » ENTRE 1960 ET 1990
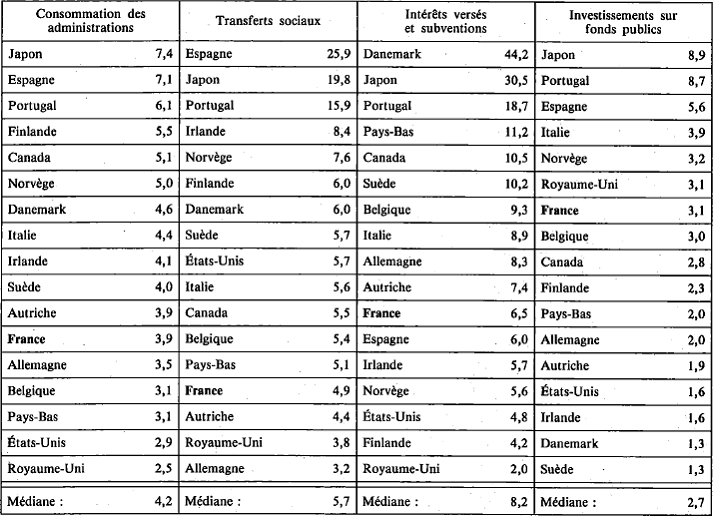
NB : un coefficient multiplicateur de 7,4 (cas du Japon, colonne « consommation des administrations » signifie que la consommation des administrations japonaises a été multiplié par 7,4 entre 1960 et 1990.
Source : Journal officiel n° 26, 1994
Si dans ces pays, la croissance économique a été plus forte que celle des dépenses publiques, freinant l'augmentation de leur part relative au PIB, la croissance des dépenses publiques a néanmoins été relativement forte elle aussi.
Par exemple, alors qu'en points de PIB, les transferts sociaux ont augmenté aux États-Unis et au Japon moins que l'accroissement médian, ils ont dans ces deux pays augmenté en termes réels très significativement : ils ont été multipliés par 5,7 aux États-Unis (soit comme l'accroissement médian et davantage qu'en France, où le multiplicateur n'a été que de 4,9) et, au Japon, par 19,8 - nettement plus que l'augmentation médiane.
II. LA CONSOMMATION DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, UNE VARIATION ET DES CHOIX FORTEMENT DIFFÉRENCIÉS DANS LE TEMPS ET SELON LES PAYS
La valeur médiane de la consommation des administrations publiques qui est composée principalement des consommations intermédiaires et des salaires publics - s'élevait à 13,1 points de PIB en 1960 et à 18 points de PIB trente ans plus tard (+ 4,9 points de PIB) .
Pour la France , l' augmentation globale du niveau des consommations des administrations publiques dans le PIB a été inférieure à la variation médiane ( + 3,8 points de PIB au cours de la période).
Les deux tiers des consommations publiques sont des salaires publics . La France a été en tête des variations de ce poste entre 1974 et 1982, mais au-delà, l'augmentation des salaires publics en France a été moins forte que la progression médiane.
A. ENTRE 1960 ET 1990, RENFORCEMENT PUIS DÉCRUE DU POIDS DE LA CONSOMMATION PUBLIQUE DANS LE PIB
- La consommation des administrations publiques a augmenté nettement plus vite que le PIB entre 1960 et 1974 et entre 1974 et 1982 , quoique avec un différentiel plus faible. Au-delà, le PIB s'est accru davantage si bien que le niveau relatif des consommations publiques (en points de PIB) a décliné entre 1982 et 1990 (- 1,2 point en valeur médiane) après une augmentation initiale de 6,1 points de PIB.
VARIATIONS DE LA PART DE LA CONSOMMATION DES
ADMINISTRATIONS
DANS LE PIB AU COURS DE TROIS PÉRIODES ENTRE 1960 ET
1990 (EN POINTS DU PIB)
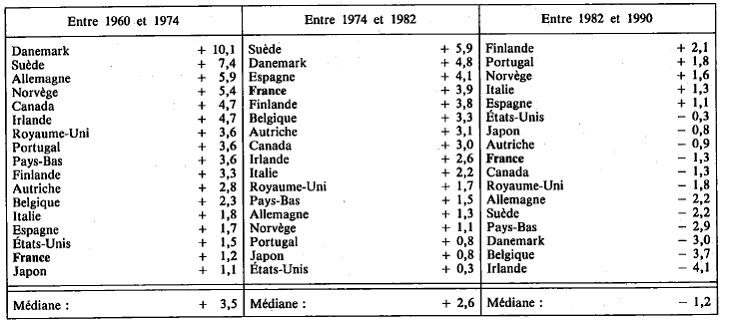
Source : Journal officiel n° 26, 1994
Très en deçà de l'évolution médiane jusqu'en 1974 (avec + 1,2 point de PIB contre + 3,5 points), la France a occupé la quatrième place pour la période 1974-1982 (+ 3,9 points de PIB contre + 2,6 points pour la valeur médiane) . Au-delà , le décrochage entre l'évolution des dépenses de consommation publique a été en ligne avec la médiane .
- Ce profil périodique se retrouve lorsqu'on considère l'évolution annuelle des dépenses de consommation des administrations en termes réels .
RYTHME ANNUEL D'ÉVOLUTION DU VOLUME DE LA
CONSOMMATION
DES ADMINISTRATIONS (EN %)
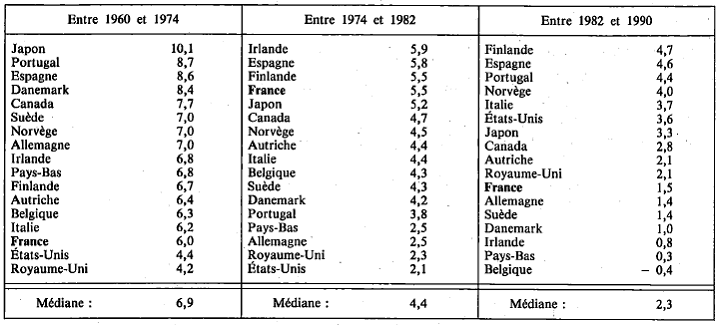
Source : Journal officiel n° 26, 1994
Leur croissance médiane se ralentit au cours du temps , de + 6,9 % à + 2,3 %.
Les situations particulières des États-Unis et du Royaume-Uni sont notables. Même si dans la dernière période (1982-1990) une certaine « normalisation » intervient, ces deux pays connaissent des augmentations très modérées de leurs « consommations publiques » dans la longue période, entre 1960 et 1982 . Au-delà, il semble qu'un certain rattrapage intervienne.
Pour la France , la dynamique des consommations publiques est inférieure à la moyenne jusqu'en 1974, assez nettement supérieure jusqu'en 1982 (+ 5,5 % contre + 4,4 %), puis à nouveau en deçà entre 1982 et 1990.
B. LA PART GÉNÉRALEMENT PRÉPONDÉRANTE DES RÉMUNÉRATIONS DANS LE TOTAL DE LA CONSOMMATION PUBLIQUE MAIS DES CHOIX PARFOIS ATYPIQUES
- Les consommations des administrations publiques se répartissent entre des dépenses de rémunérations publiques et des dépenses de consommations intermédiaires selon des proportions qui diffèrent nettement en fonction du pays.
PART DES RÉMUNÉRATIONS PUBLIQUES ET DES CONSOMMATIONS INTERMÉDIAIRES DANS LE PIB (EN % DU PIB 1990)
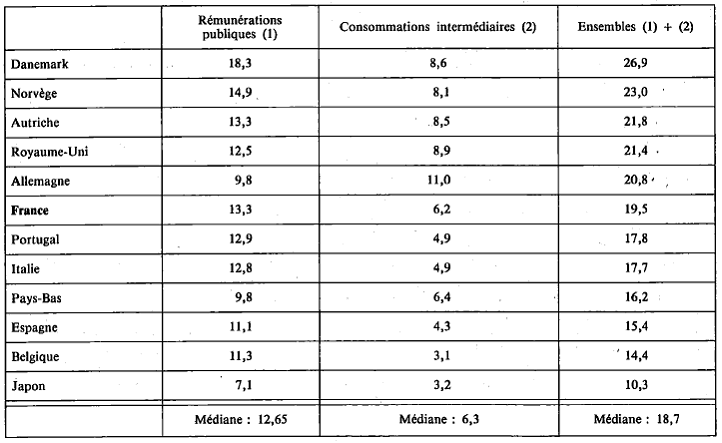
Source : Journal officiel n° 26, 1994
Pour un échantillon de pays plus limité que celui jusqu'ici examiné, on note que le poids médian des consommations publiques s'élèvaient, en 1990, à 18,7 points de PIB dont les 2/3 sont attribuables aux rémunérations publiques (12,7 points de PIB), le 1/3 restant relevant de consommations intermédiaires (6,3 points de PIB).
- Cette structure médiane est un héritage ancien. Depuis 1974, ce sont les consommations intermédiaires qui ont connu le rythme de croissance le plus rapide mais il a été très proche de celui des rémunérations.
RYTHMES MOYENS ANNUELS D'ÉVOLUTION DES RÉMUNÉRATIONS PUBLIQUES ET DES CONSOMMATIONS INTERMÉDIAIRES
(en %)
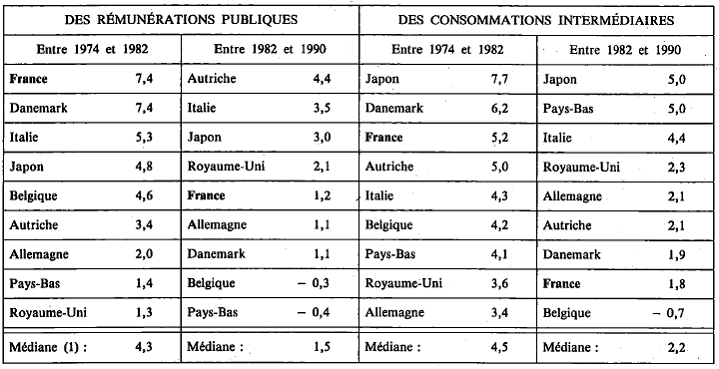
(1) La « médiane » des 9 pays a été prise, dans chaque colonne, égale à la moyenne des trois pays de rang 4, 5 et 6 (moyenne des « termes médians »).
Source : Journal officiel n° 26, 1994
- La France présente quelques singularités sous cet angle.
Entre 1974 et 1982 , la croissance annuelle des rémunérations publiques , la plus élevée de l'échantillon avec un écart à la médiane de 3,1 points, excède celle des consommations intermédiaires qui augmentent aussi sur un rythme particulièrement soutenu, de 5,2 % par an soit 0,7 point de plus que la médiane.
Au-delà, entre 1982 et 1990, le ralentissement de l'augmentation annuelle des rémunérations publiques est très net . Elles ne s'accroissent plus que de 1,2 % par an soit moins que le rythme de la médiane (+ 1,5 %) des pays étudiés. Les consommations intermédiaires décélèrent aussi (+ 1,8 %), au-dessous de la médiane (+ 2,2 %) mais progressent alors davantage que les dépenses publiques de rémunération.
III. LES TRANSFERTS SOCIAUX : PREMIÈRE CAUSE DE L'AUGMENTATION RELATIVE DES DÉPENSES PUBLIQUES
Le niveau relatif des transferts sociaux atteignaient 7,9 points de PIB en 1960 . En 1990 , il était de 16,2 points de PIB soit 8,3 points de plus et davantage qu'un doublement.
* Comme toujours pour les dépenses publiques, le panorama de l'évolution des transferts sociaux varie assez nettement selon le point de vue adopté .
- Exprimés en points de PIB , les transferts sociaux ont connu un renforcement, le premier en importance de toutes les catégories de dépenses publiques . Il est toutefois allé en ralentissant à partir de 1982 et, dans certains pays, un reflux a pu être observé.
- Quand on prend en compte la variation absolue des transferts sociaux , il n'est plus de pays où ce dernier phénomène de repli se constate. Les transferts sociaux s'accroissent constamment en volume , même si une nette décélération peut être relevée de sous-période en sous-période.
- Enfin, le palmarès des pays, en termes d'évolution absolue des transferts sociaux, diffère sensiblement par rapport à celui qui prend en compte leurs seules variations relatives au PIB .
1. Une croissance de la place des transferts sociaux dans le PIB qui va décélérant
- Comme on l'a indiqué, ce sont les transferts sociaux dont le poids dans le PIB a le plus augmenté au cours de la période 1960-1990.
Ce phénomène est allé se renforçant jusqu'en 1982 puis, entre 1982 et 1990, une certaine stabilisation est intervenue.
VARIATION DE LA PART DES TRANSFERTS SOCIAUX DANS LE PIB
AU COURS DE TROIS PÉRIODES, ENTRE 1960 ET 1990 (EN POINTS DE
PIB)
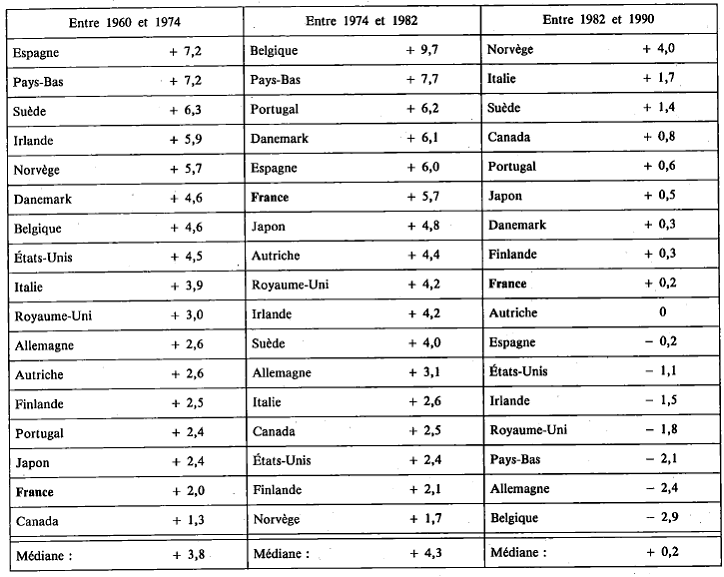
Source : Journal officiel n° 26, 1994
- Vus en points de PIB, les transferts sociaux ont , en France, progressé à peu près comme la médiane (7,9 points de PIB contre 8,3 points).
La période entre 1974 et 1982 offre une certaine singularité puisqu'alors le poids des transferts sociaux augmente plus en France que pour la médiane (+ 5,7 points de PIB contre + 4,3 points de PIB).
B. LES ENSEIGNEMENTS D'UNE APPROCHE PAR LA CROISSANCE EN VOLUME DES TRANSFERTS SOCIAUX
Comme pour les autres dépenses publiques, la prise en compte du dynamisme absolu des dépenses publiques liées aux transferts sociaux modifie le panorama offert par leur variation relative au PIB .
RYTHME MOYEN ANNUEL D'ÉVOLUTION DES TRANSFERTS SOCIAUX EN VOLUME
(en %)
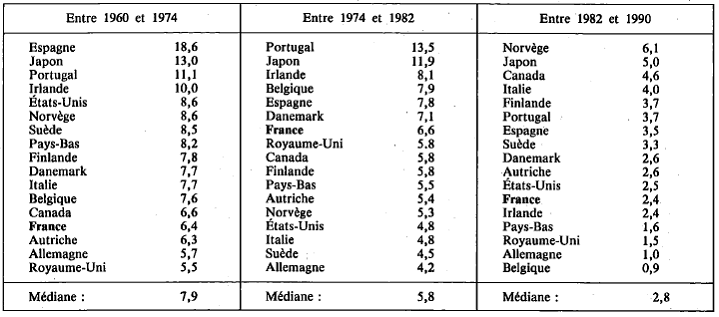
Source : Journal officiel n° 26, 1994
- Le rythme de croissance le plus rapide est atteint dans la période entre 1960 et 1974 (et non entre 1974 et 1982). Toutefois, le ralentissement observé entre 1974 et 1982 est moins prononcé que celui de la croissance économique, si bien que c'est dans cet intervalle que le poids des transferts sociaux s'accroît le plus.
- La hiérarchie des pays diffère aussi.
On relève, en particulier, la très forte progression des transferts sociaux au Japon et les places occupées par les États-Unis et l'Allemagne . Le rythme de croissance des transferts sociaux apparaît particulièrement modéré en Allemagne - située dans les derniers rangs et toujours très en deçà de la médiane. A l'inverse, les États-Unis, hors la période entre 1974 et 1982 , extériorisent une augmentation des transferts sociaux supérieure à celle observée en France .
IV. UN DYNAMISME NUANCÉ DES DÉPENSES PUBLIQUES D'INTÉRÊTS ET DE SUBVENTIONS
Les intérêts et subventions sont groupés dans une seconde catégorie retraçant les dépenses publiques de transferts : les transferts autres que sociaux.
Elle occupe une place seconde par rapport aux transferts sociaux avec un poids médian de 9,4 points de PIB en 1990 contre 16,2 points de PIB pour ces derniers.
- C'est également entre 1974 et 1982 que cette catégorie de dépenses publiques a le plus augmenté.
VARIATION DE LA PART DES
« INTÉRÊTS VERSÉS, SUBVENTIONS
ET AUTRES
TRANSFERTS » DANS LE PIB,
AU COURS DE TROIS PÉRIODES ENTRE
1960 ET 1990 - (EN POINTS DE PIB)
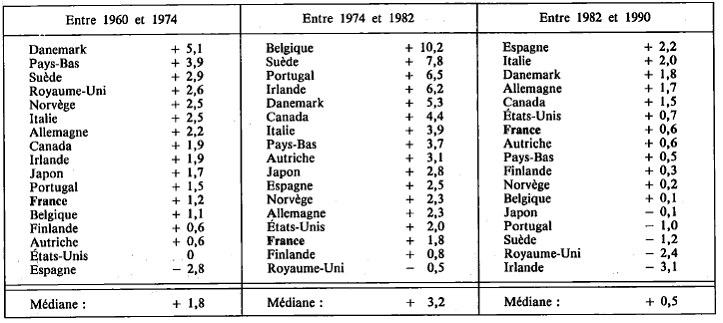
Source : Journal officiel n° 26, 1994
Ce constat vaut tant dans une appréciation relative (voir le tableau ci-dessus) qu'absolue (voir le tableau ci-dessous).
RYTHME MOYEN ANNUEL D'ÉVOLUTION DES
INTÉRÊTS, SUBVENTIONS
ET AUTRES TRANSFERTS ÉCONOMIQUES
EN VOLUME
(en %)
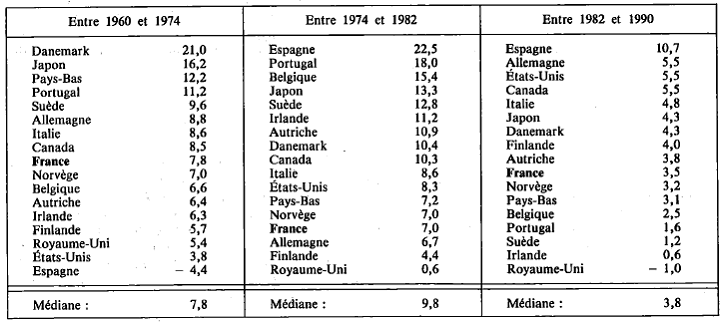
Source : Journal officiel n° 26, 1994
- Les dynamiques observées doivent plus à la progression des intérêts qu'à celle des subventions qui représentent pourtant le gros des dépenses en question .
RYTHMES D'ÉVOLUTION DES INTÉRÊTS
VERSÉS PAR LES ADMINISTRATIONS
(EN % PAR AN)
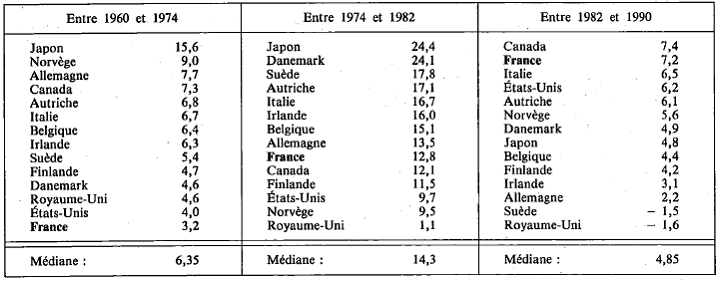
Source : Journal officiel n° 26, 1994
RYTHMES D'ÉVOLUTION DES SUBVENTIONS ET AUTRES
TRANSFERTS ÉCONOMIQUES VERSÉS PAR LES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES
(EN % PAR AN)
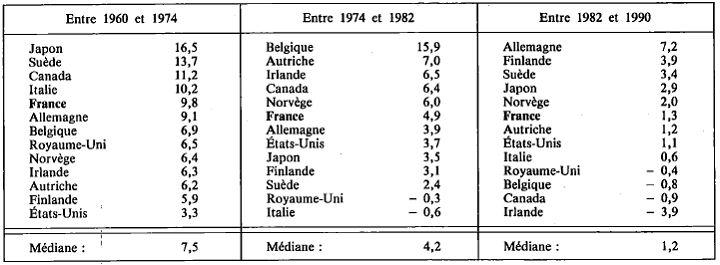
Source : Journal officiel n° 26, 1994
Plus modérée que celle des subventions entre 1960 et 1974, la croissance des dépenses d'intérêt a été nettement plus rapide au-delà, même si le différentiel s'est réduit après 1982 .
- La dispersion des évolutions par pays est particulièrement forte dans cette catégorie de dépenses . En outre, s'agissant des intérêts, les variations d'une période sur l'autre sont de grande ampleur. Cette dernière caractéristique peut être attribuée à la volatilité de la dette publique et de son coût dans des périodes où les niveaux d'endettement était si modérés qu'une petite variation nominale pouvait entraîner une forte évolution apparente.
L'accélération des dépenses d'intérêt en France est notable : au dernier rang entre 1960 et 1974, la France se retrouve au deuxième rang entre 1982 et 1990. Elle partage ce parcours avec les États-Unis alors que l'Allemagne connaît un itinéraire inverse. Ce dernier pays connaît, en revanche, une situation singulière en matière de subventions économiques. Leur rythme de croissance (+ 7,2 %) s'emballe entre 1982 et 1990, se détachant nettement par rapport à la médiane (+ 1,22 % par an). Au cours de cette période, celle-ci poursuit le ralentissement constaté entre 1974 et 1982 (+ 4,2 % l'an contre + 7,5 % auparavant).
- Ces évolutions semblent marquer une tendance au retrait de l'interventionnisme microéconomique dans la plupart des pays envisagés dès lors que les subventions économiques peuvent être considérées comme l'un des principaux instruments de ce type d'intervention publique .
Le réglage macroéconomique prend de plus en plus le pas sur le pilotage microéconomique, au cours des années 1960 à 1990, ce dont témoigne le différentiel de croissance constaté aux bénéfices des intérêts .
Ces tendances se poursuivent jusqu'à nos jours.
V. LE RECUL RELATIF DE L'INVESTISSEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
Le constat précédemment formulé peut, d'une certaine manière 131 ( * ) , être conforté par les évolutions du poids de la formation brute de capital fixe publique.
VARIATION DE LA PART DES INVESTISSEMENTS SUR FONDS
PUBLICS
DANS LE PIB AU COURS DE TROIS PÉRIODES ENTRE 1960 ET
1990
(EN POINTS DE PIB)
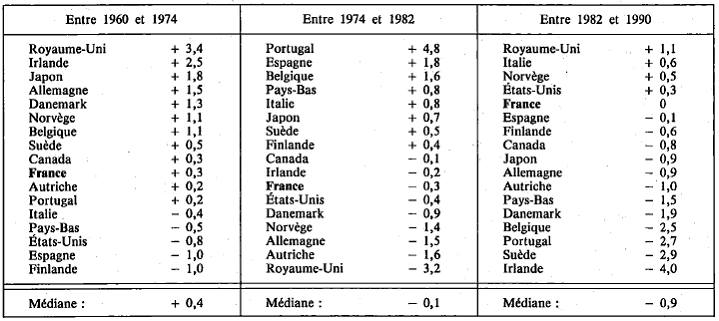
Source : Journal officiel n° 26, 1994
Évoluant un peu plus vite que le PIB entre 1960 et 1974 , l'investissement public a ralenti jusqu'à représenter la seule catégorie de dépenses publiques à enregistrer un repli en points de PIB (- 0,9 point entre 1982 et 1990).
Cette évolution se retrouve dans la décélération du rythme de croissance de l'investissement public .
RYTHME D'ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS
FINANCÉS SUR FONDS PUBLICS
(EN % PAR AN)
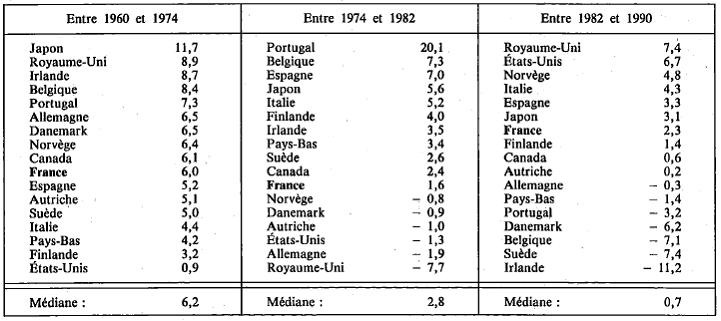
Source : Journal officiel n° 26, 1994
ANNEXE N° 2 - AVERTISSEMENTS DE MÉTHODE
Apprécier le niveau des dépenses publiques paraît être une tâche assez simple compte tenu de la multiplicité des mentions qui en sont faites ici ou là. Pourtant, quand on y regarde de près, cette opération est pleine de difficultés. Se posent tout d'abord des problèmes conceptuels qui peuvent être extrêmement ardus. En outre, le point de vue choisi se révèle souvent décisif quant au jugement qu'on porte sur tout ou partie des dépenses publiques.
1) Contrairement aux apparences, la notion de dépenses publiques se révèle très difficile à définir avec précision.
A priori , cette tâche est simple : les dépenses publiques sont considérées comme les dépenses d'une catégorie particulière d'agents, ceux qui constituent le secteur des administrations publiques, secteur défini par la Comptabilité nationale comme comprenant toutes les unités institutionnelles chargées de mettre en oeuvre les politiques publiques et de réguler la vie économique et sociale :
- qui sont des producteurs non marchands et dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective ;
- dont l'activité principale consiste à redistribuer le revenu et la richesse nationale.
Une caractéristique importante des administrations publiques est que la majeure partie de leurs ressources provient de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs.
En pratique, une unité institutionnelle doit être classée dans le secteur des administrations publiques si elle est à la fois :
- contrôlée par une administration (qui en détermine la politique générale) ;
- et non marchande (ses ventes couvrent moins de 50 % de ses coûts de production).
Le secteur des administrations publiques est, en France, subdivisé en trois sous-secteurs, selon le domaine de compétence, territorial (compétence nationale ou locale) ou social. Chaque sous-secteur est à son tour subdivisé en deux sous-ensembles, selon un critère de compétence générale ou plus spécialisée :
- l'administration publique centrale (APUC) :
- État
- Organismes divers d'administration centrale
- les administrations publiques locales (APUL) :
- Collectivités locales
- Organismes divers d'administration locale (ODAL)
- les administrations de sécurité sociale :
- Régimes d'assurance sociale
- Organismes dépendant des administrations de sécurité sociale (ODASS)
Ainsi, les choses sont apparemment simples : les dépenses publiques sont constituées de toutes les dépenses des unités relevant de ces sous-secteurs.
Cette définition comptable pose pourtant des problèmes considérables et beaucoup trop rarement commentés dès lors qu'on la met en regard d'une conception stricte des dépenses publiques.
Il ne s'agit pas ici d'évoquer les problèmes aussi récurrents que quelque peu techniques de savoir si telle entité doit être considérée comme entrant dans le champ des administrations publiques du fait de sa structure financière. Dans les faits, c'est à partir de cette question - celle du niveau relatif des ressources commerciales des organismes en cause (peut-on estimer qu'elles couvrent ou non la moitié des coûts de production ?) - que, dans le cadre de la procédure de surveillance du Pacte de stabilité et e croissance, la définition des administrations publiques, et donc des dépenses publiques, a suscité des problèmes.
Mais, quand on y regarde de plus près, cette question est secondaire par rapport aux difficultés de principe qui se présentent lorsqu'on souhaite appréhender ce que sont les dépenses publiques.
Fondamentalement, une dépense devient publique quand elle n'est pas décidée par un individu, seul ou en groupe, cas auquel elle est une dépense privée .
La définition sus-mentionnée que donne la Comptabilité nationale du secteur des administrations publiques porte la trace de cette conception puisque les administrations publiques y sont définies par la mise en oeuvre de politiques publiques . Ainsi, les dépenses publiques peuvent être considérées comme tributaires de politiques publiques, autrement dit comme des dépenses engagées dans le cadre de la mise en oeuvre de telles politiques. Dès lors qu'une dépense n'est pas suspendue à une décision publique, elle ne peut être qu'une dépense publique et se trouve classée dans la catégorie des dépenses privées.
On pourrait ainsi considérer qu'il existe une concordance exacte entre la définition de la Comptabilité nationale et une approche de la nature des dépenses publiques, comme tout ce qui échappe aux volontés privées.
Malheureusement, cette concordance est plus apparente que réelle du fait de l'existence de nombreuses dépenses réputées privées effectuées pourtant en application de politiques publiques et des doutes que fait naître dans certains cas l'application du critère de « mise en oeuvre des politiques publiques » et de contrôle par les administrations publiques.
En premier lieu, de nombreux cas où les dépenses sont réputées strictement privées alors qu'elles sont rendues nécessaires - voire obligatoires - par des politiques publiques se présentant à l'esprit . Les politiques publiques se traduisent souvent par des obligations de faire (notamment des obligations de s'assurer) qui nécessitent des engagements financiers. Que ceux-ci soient directement assumés par des personnes privées et ils sont classés en dépenses privées ; qu'ils le soient par l'intermédiaire d'administrations publiques et ils deviennent des dépenses publiques. Solution rien moins que satisfaisante puisque dans les deux cas la dépense procède d'une même obligation correspondant au même processus, à savoir la mise en oeuvre d'une politique publique.
En second lieu , l'application du critère de « dépenses mises en oeuvre dans le cadre de politiques publiques » contrôlées par des administrations publiques pose des problèmes de pertinence. S'agissant de la question du contrôle, le problème est un peu technique puisqu'il se pose principalement pour les dépenses réalisées en contrepartie de fonds de concours. Pour ces dépenses, le contrôle de l'administration dépensière peut apparaître assez théorique puisque les dépenses doivent être inscrites selon la volonté du donateur, qui peut être une personne privée. Dans ce cas, ces dépenses ne devraient pas être considérées comme publiques.
Un peu en lien avec ce problème, il faut surtout évoquer l'incidence problématique de l'application du critère de réalisation de la dépense dans le cadre de politiques publiques. Ce problème se pose particulièrement pour les dépenses d'assurance sociale.
Les administrations de sécurité sociale dont les dépenses sont considérées comme publiques et les régimes privés d'assurance sociale dont les dépenses sont réputées privées ont en commun de relever de l'assurance sociale, c'est-à-dire de couvrir des risques et besoins sociaux, au moyen de cotisations sociales reçues et de prestations sociales versées.
La différence entre eux a un caractère principalement institutionnel :
- les régimes de sécurité sociale ont un caractère obligatoire (en vertu de dispositions légales ou réglementaires) ;
- les pouvoirs publics sont responsables de la gestion de ces unités pour ce qui concerne la fixation ou l'approbation des cotisations ou des prestations.
Enfin, les régimes de sécurité sociale organisés par les pouvoirs publics couvrent la population tout entière ou d'importants sous-groupes de celle-ci.
C'est en raison de ces différences que les dépenses de ces organismes sont traitées différemment.
Ce traitement différencié pose toutefois des problèmes de fond . Au-delà de la question sans doute un peu formelle que pose le conditionnement de l'existence d'une politique publique à l'expression d'une obligation (les politiques publiques pratiquent aussi par incitations, notamment fiscales, et on pourrait reconnaître un caractère mixte aux dépenses effectuées à la suite de la mise en oeuvre de telles incitations), il faut admettre que les dépenses d'assurance sociale, ou plus généralement les dépenses correspondant à la mise en oeuvre de garantie contre la survenance de risques individuels, offrent une certaine unité, surtout quand elles interviennent dans le cadre de systèmes d'assurances collectives où le niveau des cotisations individuelles est délié du risque personnel, principalement dépendant des engagements financiers cumulés du système d'assurance et fixé sans considération de marges de profit.
2) Le recensement des dépenses publiques par la Comptabilité nationale laisse à désirer sur des points qui peuvent avoir une grande importance .
- En premier lieu , l' affectation de prélèvements obligatoires à des entités extérieures aux administrations publiques n'est pas enregistrée en dépenses publiques (pas plus que les dépenses de ces organismes, dès lors que leurs caractéristiques financières les font échapper à la catégorie des administrations publiques). Tel est le cas notamment pour les ressources transférées au budget des Communautés européennes, excepté la « Quatrième ressource » 132 ( * ) .
- Une autre difficulté , encore plus considérable, résulte des modalités d'enregistrement de certaines dispositions prévoyant la mise en oeuvre de crédits d'impôts ou d'exonérations de prélèvements.
Du point de vue des administrations publiques, il est équivalent de réaliser une dépense après avoir encaissé la recette correspondante ou de renoncer au bénéfice d'une recette . Symétriquement, pour un agent économique, le versement d'une subvention d'égal montant à un impôt acquitté par lui est strictement équivalent à la réduction d'un prélèvement qui lui était auparavant imposé.
En revanche, ces opérations ont des incidences différentes sur les dépenses publiques 133 ( * ) telles qu'elles sont recensées par la Comptabilité nationale. En effet, en général , les réductions fiscales ne sont pas enregistrées comme des dépenses publiques . Elles n'impactent le compte des administrations publiques que via leurs effets sur le niveau des recettes publiques et du solde public.
Le cas des crédits d'impôt offre une illustration éclairante des difficultés de mesure qu'engendre un tel choix .
On désigne sous le terme de crédit d'impôt un avantage fiscal concernant une sous-population de contribuables remplissant des conditions particulières. Le crédit d'impôt se traduit par une réduction du montant de l'impôt à payer compte tenu des règles fiscales en vigueur. Le crédit d'impôt peut prendre la forme d'un remboursement (versement effectif) au contribuable ou s'imputer directement sur l'impôt à payer, avec un versement complémentaire au contribuable si le crédit d'impôt dépasse l'impôt à payer dans le cas d'un crédit d'impôt dit récupérable.
L'OCDE et Eurostat considèrent que les crédits d'impôts récupérables viennent en déduction des impôts à payer tant qu'ils sont, contribuable par contribuable, inférieurs à ceux-ci. Ils ne sont comptés en dépenses de l'administration que pour la partie du montant qui est supérieure à l'impôt à payer . Le manuel de statistiques de finances publiques du FMI fait la même recommandation.
Ce choix revient à traiter différemment une même intervention publique, qui a les mêmes conséquences en termes de transferts entre la puissance publique et les autres agents économiques.
Dans certains cas, l'application de ces principes aboutit de plus à une complexité excessive.
Ainsi en va-t-il pour la prime pour l'emploi. La prime pour l'emploi, instaurée à compter de l'année 2001, est calculée en fonction des revenus d'activité du foyer fiscal, du nombre d'heures travaillées et de la composition du foyer, sur la base des déclarations figurant sur le formulaire d'imposition de l'impôt sur le revenu (IR), au sens strict du code général des impôts.
L'application des principes généraux devrait conduire à ce que la prime pour l'emploi soit enregistrée en dépenses dès qu'elle excède la quotité due au titre de l'impôt sur le revenu. Les comptables nationaux en ont décidé autrement.
Le traitement retenu dans les comptes nationaux a donc été le suivant : dès lors qu'elle ne dépasse pas, bénéficiaire par bénéficiaire, le montant de l'IR, augmenté de la CSG et de la CRDS déjà acquittées par le foyer fiscal, la prime pour l'emploi est censée venir en déduction de cette masse globale d'imposition. Seule, la partie de la prime pour l'emploi qui dépasse ce plafond (les contribuables étant considérés individuellement), est traitée par les comptables nationaux en prestations sociales.
Cette solution n'est certes pas sans logique. L'IR est considéré par les comptables nationaux, et assez généralement dans le grand public, comme une partie seulement de l'impôt sur le revenu des ménages, la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) prélevées à la source sur le salaire et sur d'autres revenus des ménages en constituant un autre étage.
Mais l'essentiel est bien que des décisions publiques destinées à modifier l'équilibre financier de leurs bénéficiaires, et qui se traduisent par un coût pour les administrations publiques (coût positif ou coût d'opportunité) ont, selon leurs modalités, des conséquences variables sur le niveau apparent des dépenses publiques.
Dans tous les pays, les régimes fiscaux prévoient des mécanismes exemptant de taxes certaines opérations ou certains redevables à raison de leur situation. Cependant, l'ampleur que prend le recours à ces mécanismes varie beaucoup selon les pays comme il varie dans le temps dans un même pays.
L'appréciation sur l'évolution des dépenses publiques et sur les niveaux comparés de dépenses entre pays est donc singulièrement compliquée par ce choix de méthode.
3) Le croisement de différentes approches statistiques est souvent nécessaire pour appréhender, le plus complètement possible, les dépenses publiques 134 ( * ) .
Ainsi, l'approche la plus courante qui consiste à rapporter le montant nominal des dépenses publiques à un équivalent en points de produit intérieur brut (PIB) est loin d'être entièrement satisfaisante . Elle présente, certes, avec l'avantage de la simplicité, l'intérêt de fournir une estimation approchée de la part des richesses créées dans une économie qui fait l'objet d'une allocation collective. Cependant, cette présentation statistique n'est pas exempte d'ambiguïtés et de faiblesses :
- l'estimation de la place de l'intervention collective dans une économie par le poids des dépenses publiques dans le PIB est ambiguë à deux titres . D'une part, les dépenses publiques, pouvant être financées par l'emprunt, cette mesure ne saurait être assimilée à un prélèvement direct sur la richesse nationale - assimilation qui est pourtant fréquente. D'autre part, une partie des dépenses publiques - celle qui est nécessaire à la production des biens et services par les administrations publiques - a une contrepartie directe en termes d'évaluation du PIB tandis qu'une autre - les opérations de pure répartition - n'accroît pas directement le PIB, si bien que, plus la composante productive des dépenses publiques est élevée moins le poids des dépenses publiques dans le PIB apparaît important 135 ( * ) ;
- avec la mesure des dépenses publiques en points de PIB, un problème de significativité existe du fait de l'éventuelle hétérogénéité des prix des deux grandeurs : ainsi une variation en plus ou en moins du niveau des dépenses publiques en points de PIB peut ne résulter que d'une évolution inégale des prix des deux variables et être sans signification quant à leurs volumes relatifs ; dans les comparaisons internationales de dépenses publiques, cette faiblesse a toutes chances de produite des effets trompeurs puisque les niveaux des prix entre pays sont souvent différenciés ;
- l'image que donne une variation des dépenses publiques en points de PIB d'une période à l'autre, ou d'un pays à l'autre, ne permet pas de saisir la dynamique propre aux dépenses publiques puisqu'elle est influencée par la variation du PIB ; ainsi, face à une même évolution des dépenses publiques, des trajectoires différenciées du PIB donnent des résultats contrastés.
L'interprétation de l'évolution des dépenses publiques peut en être affectée. Des pays dans lesquels les dépenses publiques sont très dynamiques peuvent paraître « maîtriser » leurs dépenses publiques dès lors que le PIB croît au moins aussi vite. Il est possible que cette interprétation soit économiquement fondée, mais il se peut aussi qu'elle ne le soit pas.
Il suffit pour s'en convaincre de considérer l'hypothèse où la croissance économique excède le potentiel de croissance de sorte que la vitesse de celle-ci, doive être considérée comme purement transitoire (et, peut-être, non soutenable). Dans un tel cas, le rythme d'évolution des dépenses publiques peut lui-même être en réalité justiciable d'une même appréciation. Il est donc prudent de toujours considérer le dynamisme absolu des dépenses publiques, en plus de leur variation en points de PIB .
- l'impact des dépenses publiques est très mal appréhendé par leur dénombrement en points de PIB ; ce dernier agrégat présente un caractère très global. Il est ainsi sans lien immédiat avec les variables, expliquant le niveau des dépenses publiques, qui sont très diversifiées elles-mêmes selon la catégorie de dépenses envisagées. L'information donnée par le poids de telle ou telle dépense publique dans le PIB, pauvre en soi, peut par ailleurs être trompeuse . Par exemple, à un niveau relativement élevé de dépenses publiques d'éducation dans le PIB peut correspondre un effort d'éducation par élève comparativement faible. Dans le domaine de la protection sociale, un poids élevé des dépenses des différents volets de l'intervention sociale peut s'accompagner d'un niveau unitaire des dépenses faible ou élevé en fonction du nombre de bénéficiaires ;
- enfin, les statistiques exprimant les dépenses publiques en points de PIB se réfèrent presque systématiquement à des dépenses publiques brutes ; or, à ces dépenses peuvent être appliquées des prélèvements obligatoires qu'il importe de prendre en compte pour estimer des interventions publiques nettes , démarche particulièrement utile quand on procède à des comparaisons internationales puisque les taux de prélèvements obligatoires sont divers d'un pays à l'autre.
*
* *
Dans le présent rapport, au prix d'une certaine complexification de la présentation, on s'efforce de diversifier les approches statistiques lorsque l'analyse le commande . Selon votre rapporteur, cet effort mériterait d'être repris systématiquement par les producteurs et les utilisateurs de statistiques relatives aux dépenses publiques afin d'améliorer la significativité des données et la comparabilité des situations nationales.
ANNEXE N° 3 - LA CLASSIFICATION DES DÉPENSES PUBLIQUES PAR LA COMPTABILITÉ NATIONALE
Le panorama des dépenses publiques peut être présenté selon plusieurs critères, qui donnent des points de vue très différents .
Les dépenses publiques trouvent accueil dans des cadres comptables diversifiés : la comptabilité budgétaire pour les dépenses de l'État et des collectivités territoriales ; la comptabilité publique ; le cadre des comptes de la sécurité sociale et la Comptabilité nationale .
Seule cette dernière donne une vision d'ensemble des dépenses publiques. Pourtant, elle le fait dans des conditions qui ne sont pas toujours satisfaisantes ou qui, en tout cas, peuvent être débattues. Des enrichissements de l'information donnée par la Comptabilité nationale sont souhaitables comme le précise le présent rapport. Certaines sont d'ailleurs en cours.
- Dans les cadres de la Comptabilité nationale , les dépenses des administrations publiques sont traitées , pour l'essentiel, comme les dépenses de n'importe quel autre agent , c'est-à-dire en fonction de la contrepartie de la dépense : formation brute de capital fixe - autrement dit, investissement - quand le bien acquis est durable, consommation lorsque l'achat, ou la rémunération, doit être renouvelé régulièrement, transferts quand il n'y a pas de contrepartie immédiate, opérations financières lorsque l'actif net des administrations publiques est concerné...
|
LA NOMENCLATURE DES DÉPENSES DES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES
Le classement des dépenses publiques effectué par la Comptabilité nationale repose sur une analyse des emplois des administrations publiques nécessaires à leur production : - les consommations intermédiaires représentent la valeur des biens, autres que durables, et des services consommés au cours de la période dans le processus courant de production ; - les traitements et salaires sont les rémunérations brutes du travail versées par les administrations publiques ; - les intérêts constituent la charge courante de l'endettement public (hors remboursement de la dette) ; - les subventions sont les sommes versées à des unités extérieures pour couvrir leurs besoins d'exploitation ; - les allocations sociales sont les transferts sociaux versés par les administrations publiques ; - les « transferts en capital » regroupent les aides à l'investissement qu'elles soient affectées ou non ; - les investissements sont la contrepartie des dépenses nécessaires à l'acquisition de biens durables (non consommés au cours de la période) ; - le poste « Autres » est un poste d'ajustement. Cette classification est adaptée à l'analyse différenciée des choix de fonctions des administrations publiques, d'un côté de production des biens et services publics, de l'autre de distribution de ressources aux autres agents. |
1) Cette classification, qui a ses justifications, n'est pas pleinement adaptée aux particularités des interventions publiques.
Alors que pour les agents privés la production est essentiellement destinée à se procurer des ressources , dont l'emploi sert à rémunérer les facteurs de production (travail, capital), pour les administrations publiques , outre que certains de leurs emplois (les transferts monétaires) sont déliés de toute production intermédiaire, la production vise essentiellement à mettre des ressources à disposition des usagers ou administrés (et non à en dégager).
Du fait de cette différence fondamentale, l'application des solutions de la Comptabilité nationale, pertinentes pour décrire les problèmes économiques que rencontrent les agents privés, pose un problème de lisibilité et de pertinence quand il s'agit de restituer les activités des administrations publiques.
En particulier, on traite des dépenses dont l'objectif est d'augmenter le capital de la Nation comme des dépenses de consommation , au motif qu'elles ne servent pas à l'acquisition de biens durables par les administrations publiques. Ce faisant, on oublie que, par ces dépenses, les administrations publiques produisent - ou veulent produire - des biens ce cette nature.
2) Elle ne permet pas d'identifier aisément les champs de l'intervention publique , ce qui est pourtant essentiel , puisqu' un des débats fondamentaux qui la concerne consiste à délimiter les domaines dans lesquels on peut recommander qu'elle se déploie .
L'appréciation de la nature et de l'impact économiques des dépenses publiques en est considérablement brouillée .
On ne différencie pas ce qui , dans la masse des dépenses publiques, relève de l'assurance , de la solidarité , ou de la production des biens et services , même si la distinction présentée par la Comptabilité nationale entre transferts et autres dépenses éclaire un peu cette analyse.
En bref, on ne voit pas très clair dans les domaines que les dépenses publiques irriguent et, du coup, la question de la justification de l'intervention publique soit n'est pas posée, soit est insoluble.
Dans cette perspective, on recourt souvent dans le présent rapport à une nomenclature qui a pour ambition de retracer les différentes allocations fonctionnelles de la dépense publique, la nomenclature COFOG .
3) La nomenclature de classement fonctionnel des administrations publiques (CFAP ou COFOG)
Cette dernière initiative peut être considérée comme particulièrement louable puisqu'elle permet d' espérer, pour l'avenir, une meilleure appréciation de la dimension économique des dépenses publiques .
Elle n'a pas encore reçu tous ses prolongements, au moment où est publié le présent rapport.
Les dépenses publiques sont classées par fonction dans le cadre d'une nomenclature internationale préparée par l'OCDE et adoptée dans le cadre des Nations Unies : la nomenclature COFOG (Classification of the functions of Government) . Il existe deux niveaux de nomenclature :
- les dépenses publiques sont réparties entre dix fonctions qui correspondent aux objectifs socioéconomiques que les administrations publiques s'efforcent d'atteindre ;
- chaque fonction est elle-même subdivisée en plusieurs sous-fonctions .
|
1 |
Administration générale |
|
1.1 |
Pouvoirs publics |
|
1.2 |
Aide économique internationale |
|
1.3 |
Services généraux |
|
1.4 |
Recherche fondamentale |
|
1.5 |
Recherche - développement |
|
1.6 |
Autres |
|
1.7 |
Dette publique |
|
1.8 |
Transferts entre administrations publiques |
|
2 |
Défense |
|
2.1 |
Militaire |
|
2.2 |
Civile |
|
2.3 |
Aide militaire internationale |
|
2.4 |
Recherche - développement |
|
2.5 |
Autres |
|
3 |
Ordre public et sécurité |
|
3.1 |
Police |
|
3.2 |
Services d'incendie |
|
3.3 |
Justice |
|
3.4 |
Prison |
|
3.5 |
Recherche - développement |
|
3.6 |
Autres |
|
4 |
Affaires économiques |
|
4.1 |
Affaires générales |
|
4.2 |
Agriculture |
|
4.3 |
Énergie |
|
4.4 |
Industrie |
|
4.5 |
Transport |
|
4.6 |
Communication |
|
4.7 |
Autres industries |
|
4.8 |
Recherche - développement |
|
4.9 |
Autres |
|
5 |
Environnement |
|
5.1 |
Déchets |
|
5.2 |
Eau |
|
5.3 |
Nuisances |
|
5.4 |
Biodiversité et paysages |
|
5.5 |
Recherche - développement |
|
5.6 |
Autres |
|
6 |
Logement et Équipements collectifs |
|
6.1 |
Logement |
|
6.2 |
Urbanisme |
|
6.3 |
Adduction d'eau |
|
6.4 |
Éclairage public |
|
6.5 |
Recherche - développement |
|
6.6 |
Autres |
|
7 |
Santé |
|
7.1 |
Médicaments et équipements |
|
7.2 |
Services ambulanciers |
|
7.3 |
Hôpitaux |
|
7.4 |
Services de Santé publique |
|
7.5 |
Recherche de Santé publique |
|
7.6 |
Autres |
|
8 |
Loisirs et culture |
|
8.1 |
Loisirs et sports |
|
8.2 |
Services culturels |
|
8.3 |
Communication |
|
8.4 |
Cultes |
|
8.5 |
Recherche - développement |
|
8.6 |
Autres |
|
9 |
Éducation |
|
9.1 |
Pré-Primaire et Primaire |
|
9.2 |
Secondaire |
|
9.3 |
Post-Secondaire |
|
9.4 |
Supérieur |
|
9.5 |
Éducation générale |
|
9.6 |
Subventions |
|
9.7 |
Recherche - développement |
|
9.8 |
Autres |
|
10 |
Protection sociale |
|
10.1 |
Handicap |
|
10.2 |
Pensions |
|
10.3 |
Reversions |
|
10.4 |
Famille et enfance |
|
10.5 |
Chômage |
|
10.6 |
Logement social |
|
10.7 |
Exclusion |
|
10.8 |
Recherche - développement |
|
10.9 |
Autres |
ANNEXE N° 4 - LES DÉPENSES DE PROTECTION SOCIALE : PROBLÈMES DE MESURE
- Les dépenses publiques consacrées à la protection sociale sont loin de rendre compte de la totalité des revenus alloués à cet objectif .
Il faut se féliciter que le système statistique européen, et les travaux de l'OCDE, aient tenté l' effort de mesurer plus exactement que les comptables nationaux ne le font habituellement (ils s'en tiennent aux dépenses publiques des administrations de sécurité sociale), l'ensemble des flux de revenu consacré à la protection sociale .
Ces efforts sont malheureusement insuffisants et inachevés . Précieux, ils ne permettent pas de combler entièrement les insuffisances des données recueillies pour mesurer le revenu consacré à la protection sociale dans les différents pays concernés.
On doit le regretter puisque l'objectif de tout système statistique devrait être de répondre aux exigences d'une analyse politique et sociale rigoureuse .
A. LE SYSTÈME EUROPÉEN DES STATISTIQUES INTÉGRÉES DE LA PROTECTION SOCIALE
Développé à la fin des années 70, le « Système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (SESPROS) vise à répondre au besoin d'un instrument spécifique d'observation statistique de la protection sociale des États membres de la Communauté .
Mais, le système SESPROS ne remplit qu'imparfaitement cet objectif .
- Il repose, certes, sur une définition des ressources consacrées à la protection sociale plus satisfaisante que celle que donne la seule considération des dépenses des administrations de sécurité sociale .
En particulier , les dépenses privées de protection sociale ne sont pas systématiquement exclues du champ statistique de SESPROS , qui, au contraire, s'efforce de les mesurer.
C'est un ajout considérable mais qui n'est pas complet puisque la définition de la protection sociale retenue par les statisticiens conduit à exclure de son champ une partie importante des revenus privés alloués par les agents économiques à cette fin .
En effet, la protection sociale y est définie comme toute intervention d' organismes publics ou privés destinée à alléger la charge que représente la survenance de certains risques ou besoins pour les ménages et les particuliers, à condition qu'elle n'ait pas de contrepartie, et ne relève pas de dispositions personnelles .
Du fait de cette définition, les données recensées dans le champ couvert par SESPROS sont incomplètes, ce qui conduit, en outre, à biaiser les comparaisons internationales.
- Tout d'abord, le champ des opérations prises en compte en incomplet. Les interventions recensées sont limitées aux :
- transferts en espèces aux personnes protégées,
- remboursements des dépenses à la charge des personnes protégées ;
- biens et services fournis directement aux personnes protégées.
Ces restrictions ne doivent s'appliquer qu'au système central puisque, les taux d'imposition préférentiels ou les réductions d'impôts destinés au secteur de la production, mais qui protègent indirectement les ménages étaient censés pouvoir donner lieu à des modules complémentaires . Dans les faits, ceux-ci semblent loin de les recenser de façon exhaustive.
Ainsi, les réductions de prélèvements obligatoires (les dépenses fiscales sociales ) qui sont parfois de grande ampleur , dans des domaines comme la politique du marché du travail (les exonérations de charges sociales, par exemple), de la protection sociale complémentaire (santé et pensions) ou de la politique familiale (quotient familial en France) ne sont pas systématiquement couvertes par le système statistique .
Deux conséquences découlent de cette lacune :
- les revenus alloués à la protection sociale sont minorés dans le système statistique par rapport à leur ampleur réelle ;
- comme les mécanismes de dépenses fiscales et sociales sont inégalement développés selon les pays, les comparaisons internationales fondées sur SESPROS ne sont pas pleinement significatives .
- Par ailleurs, le champ institutionnel couvert par le système statistique européen est lui-même trop réduit pour que l'ensemble des ressources économiques allouées à la protection sociale puisse être considéré comme décrit de façon satisfaisante par lui :
- La condition selon laquelle l'intervention doit provenir d'organismes publics ou privés exclut de la définition de la protection sociale tous les types de transferts directs de ressources entre ménages ou particuliers sous forme de dons, d'entraide familiale, etc., même si ces transferts sont destinés à protéger les bénéficiaires contre les risques ou besoins sociaux.
Cette exclusion n'est nullement négligeable . Les familles interviennent certainement de façon massive pour couvrir des besoins sociaux comme le logement, la baisse des ressources consécutive à des périodes de chômage, les soins de santé et... les besoins liés à la famille. S'agissant de cette dernière catégorie, n'explique-t-on pas les scores relativement bas d'activité féminine dans plusieurs pays européens par l'absence d'infrastructures de gardes d'enfants ou de prestations destinées à cet objet ? Cette approche implique que des ressources non monétaires sont allouées à des besoins qui, ailleurs, sont satisfaits par l'allocation de ressources monétaires.
Les difficultés statistiques de repérage et de quantification des transferts privés - qui, au surplus, n'ont pas toujours de traduction monétaire directe - sont considérables. Cependant, il conviendrait que le système statistique les affronte, et les surmonte, pour qu'il puisse prétendre rendre compte de façon fidèle du niveau des ressources allouées dans chaque pays à la protection sociale.
- Les données recensées par le système statistique excluent encore les dépenses réalisées dans le cadre de dispositions personnelles , même si leur objet, total ou partiel, est d'assurer une protection sociale à ceux qu'elles impliquent.
Cette conception de la protection sociale exclut du recensement statistique toute assurance prise à l'initiative de particuliers ou de ménages dans leur seul intérêt personnel. Par exemple, le transfert d'un capital ou d'une rente au titulaire d'une police d'assurance-vie privée n'est pas considéré comme une prestation de protection sociale.
Ces choix sont très discutables .
Il semble, en premier lieu, que cette règle soit d'application délicate. Dans le système SESPROS, des polices individuelles peuvent être considérées comme relevant de la protection sociale tandis que des polices collectives ne le sont pas.
Le critère de solidarité sociale permet, en théorie, de faire le tri. Une police d'assurance est incluse dans le champ d'application de SESPROS si elle est basée sur le principe de la solidarité sociale , qu'elle soit ou non souscrite à l'initiative de l'assuré. Une police d'assurance est fondée sur le principe de la solidarité sociale lorsque les cotisations à payer ne sont pas proportionnelles à l'exposition individuelle au risque des personnes protégées .
Sont des exemples d'assurances souvent basés sur le principe de la solidarité sociale :
- les régimes établis spécifiquement pour des personnes appartenant à la même profession ou branche ;
- l'assurance offerte par les mutuelles.
Mais, l'application de cette condition reposant sur un critère de solidarité est loin d'être absolue . Ainsi, il ne trouve pas à s'appliquer :
- lorsque les dispositions législatives ou réglementaires obligent certains groupes de la population à s'affilier à un régime d'assurance désigné , ou ;
- lorsque les travailleurs et les personnes à leur charge sont assurés au titre de conventions collectives salariales.
Dans ces deux cas, solidarité ou non, l'assurance est incluse dans le champ d'application de SESPROS .
En revanche, lorsque l'organisme d'assurance n'est pas organisé par la loi, le simple fait que la couverture soit rendue obligatoire par la loi (sans qu'un régime particulier ne soit précisé), ou qu'une police d'assurance remplace un régime public, ne suffit pas pour le classer comme protection sociale.
En bref, il existe une certaine confusion, d'autant plus regrettable que le recours à des assurances privées en complément de régimes de base tend à gagner du terrain faisant, en outre, l'objet parfois de dispositions fiscales favorables.
C'est ainsi, sur le fond, que les conventions de la base SESPROS apparaissent contestables . En choisissant de ne répertorier comme dépenses de protection sociale que les dépenses réalisées dans le cadre de système solidaires, les statisticiens ignorent l'ampleur des ressources allouées par les individus à la protection contre les risques que couvrent les organismes de protection sociale dont ils recensent les seules dépenses comme telles. Or, il y a tout lieu de penser que, moins celles-ci sont importantes , plus les premières le sont , du moins pour des pays de développement comparable.
Imaginer que cette relation - que le présent rapport ambitionne de vérifier - ne soit pas établie, c'est supposer que des individus appartenant à des ensembles économiques et sociaux analogues pourraient avoir une aversion différente pour les risques sociaux en fonction de l'existence d'organismes plus ou moins publics de protection sociale.
Le choix des statisticiens européens préjuge du dénouement de cette question en ne retraçant pas comme dépenses de protection sociale l'ensemble des assurances que les individus consacrent réellement à celle-ci, soit sous forme de contrats d'assurance individuels, soit sous forme d'épargne de précaution.
B. LA DÉPENSE SOCIALE NETTE VUE PAR L'OCDE
La base de données de l'OCDE sur les dépenses sociales nettes a elle-même une double ambition.
- D'une part , il s'agit d' additionner aux dépenses sociales publiques les dépenses sociales privées afin de mieux rendre compte de l'allocation du revenu national destinée aux besoins sociaux que lorsque les seules dépenses publiques sont prises en compte. Cet objectif n'est que partiellement atteint . En effet, le champ des dépenses sociales est circonscrit de façon très proche de celle qui est utilisée par les comptables européens pour la base SESPROS, si bien que les mêmes critiques que celles précédemment exprimées sur cette dernière, peuvent l'être à l'égard de l'étude de l'OCDE.
- D'autre part , il s'agit de prendre en compte les effets du système des prélèvements obligatoires sur les dépenses sociales .
Ceux-ci passent par trois canaux :
1) la taxation des prestations sociales (par exemple, l'impôt sur le revenu assis sur les pensions) ;
2) la taxation, via les impôts indirects, des biens et services consommés à partir des revenus sociaux ;
3) l'attribution d'avantages fiscaux, analogues à des prestations sociales ou destinés à stimuler la constitution de droits sociaux auprès du secteur privé.
Les deux premiers canaux aboutissent à minorer les avantages nets perçus par les bénéficiaires des dépenses sociales et à alléger le poids des ressources économiques réellement absorbés par la satisfaction des besoins sociaux. Le troisième, en revanche, augmente l'effort collectif destiné à celle-ci.
Toutefois, les difficultés de méthode pour estimer les dépenses fiscales , qui ont déjà été mentionnées, s'opposent à une couverture complète des dispositifs d'allègements fiscaux à finalité sociale dans le cadre des travaux de l'OCDE . Les problèmes de frontière entre ce qui constitue un régime fiscal de droit commun et un régime fiscal dérogatoire conduisent à des classements discutables. De même, le choix de la valorisation des avantages fiscaux entre les méthodes des « moins-values de recettes » et de « l'équivalent en dépenses » privilégie la première d'entre elles, ce qui conduit à minorer la valeur des dépenses fiscales à vocation sociale et à altérer la comparabilité des situations nationales entre les pays où un même avantage social est fourni via un allègement fiscal et ceux où il l'est via des dépenses. Enfin, certaines dépenses fiscales ayant un impact social évident ne sont pas prises en compte : la déductibilité des intérêts liés aux emprunts immobiliers quand, au contraire, les dépenses occasionnées par le « prêt à taux zéro » français le sont ; les déductions fiscales incitant à des garanties privées du risque vieillesse qui ne sont qu'estimées...
Dans l'ensemble, ces difficultés de méthode conduisent à minorer les dépenses sociales des pays qui recourent le plus à la dépense fiscale à vocation sociale dans l'architecture de leur protection sociale .
ANNEXE N° 5 - LE « COIN FISCALO-SOCIAL »
Le « coin fiscalo-social » mesure le poids des prélèvements obligatoires assis sur un revenu donné, en général le salaire. Cet indicateur est suffisamment utilisé dans certains argumentaires visant à souligner l'impact négatif des prélèvements obligatoires sur les salaires par leurs effets inflationnistes sur le coût du travail et, au contraire, déprimant sur le pouvoir d'achat, pour que quelques précisions soient ici apportées.
Il apparaît nettement différencié dans les pays de l'OCDE, tant du point de vue de ses évolutions que de celui de son niveau.
LE COIN FISCAL SUR LES SALAIRES
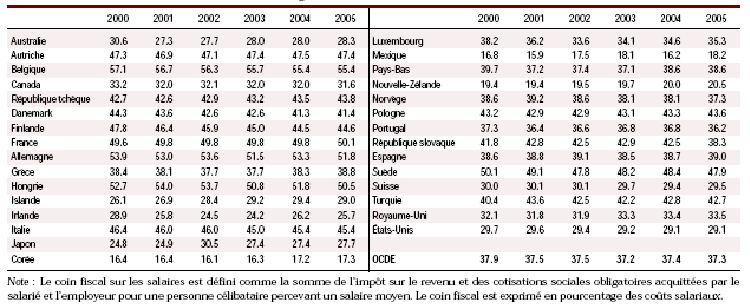
Source : OCDE - Panorama de la société - 2006
La somme de l'impôt sur le revenu et les cotisations sociales s'élève, en moyenne , au niveau du salaire moyen, à 37,3 % des coûts salariaux en 2005 . Les écarts à cette moyenne dans un sens ou dans un autre atteignent des niveaux élevés . Le Japon, la Corée, les États-Unis et, en Europe, le Royaume-Uni sont au-dessous de cette moyenne. Inversement, la France (+ 12,8 points), l'Allemagne (+ 14,5 points) et l'Italie (+ 8,1 points) sont au-dessus.
On peut observer incidemment que la composition du « coin » est variable.
GRANDES DIFFÉRENCES ENTRE LES PAYS
DANS LA
COMPOSITION DU COIN FISCAL SUR LES SALAIRES
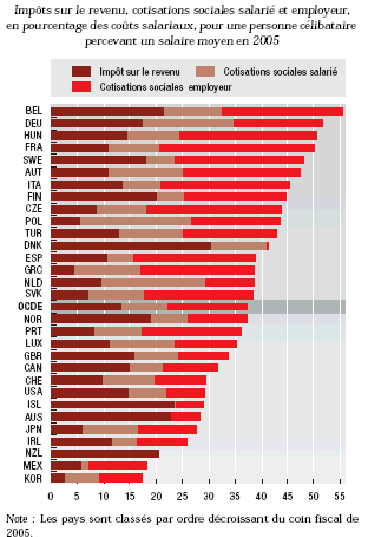
Source : OCDE (2006), Les impôts sur les salaires 2004-2005, OCDE, Paris
En moyenne, les cotisations sociales-employeur totalisent 41 % du coin, l'impôt sur le revenu 38 % et les cotisations-salarié 21 %.
Mais les parts respectives de ces différents prélèvements obligatoires varient considérablement, la France se distinguant par le haut niveau relatif des cotisations sociales employeur et salarié.
On induit des niveaux disparates du « coin fiscalo-social » deux conclusions qui, dans leur généralité, sont erronées : l'existence d'un lien direct entre le niveau des prélèvements obligatoires sur les salaires et le niveau du coût du travail (plus les premiers sont élevés plus le second le serait aussi) ; le constat d'une influence négative des prélèvements sur les salaires sur le pouvoir d'achat des ménages.
I. LE NIVEAU DES PRÉLÈVEMENTS ASSIS SUR LES SALAIRES N'EST PAS PRÉDICTIF DU NIVEAU DU COÛT DU TRAVAIL
- On prétend parfois que plus les prélèvements directs sur les salaires sont élevés, plus le coût du travail le serait aussi (et, finalement, moins la compétitivité-coût du pays serait bonne).
- Le graphique ci-après n'accrédite pas entièrement cette corrélation .
COÛT HORAIRE DE LA MAIN D'oeUVRE, ENSEMBLE DE
L'ÉCONOMIE
HORS SECTEUR NON MARCHAND, 2005
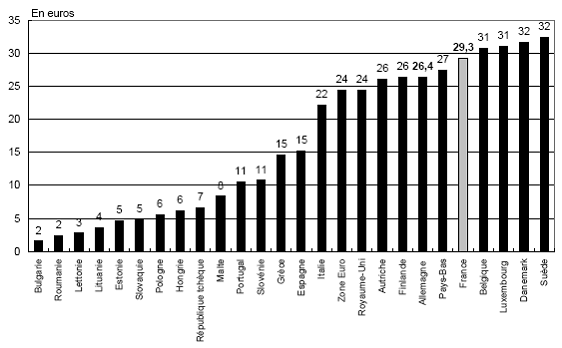 Source : Rapport sur
la TVA sociale de M. Eric Besson, secrétaire d'État chargé
de la Prospective et de l'évaluation des politiques publiques.
Source : Rapport sur
la TVA sociale de M. Eric Besson, secrétaire d'État chargé
de la Prospective et de l'évaluation des politiques publiques.
Ainsi, lorsqu'on observe le coût horaire brut , le coût horaire de la main d'oeuvre semble relativement élevé en France et en Belgique, tout comme l'est le « coin fiscalo-social ».
Mais, le Luxembourg et les Pays-Bas où le « coin » est relativement faible sont dans le même cas, tandis que l'Allemagne, qui a le deuxième « coin socialo-fiscal » le plus élevé, n'est que le septième pays en termes de coût salarial horaire, à quasi-égalité avec la Finlande pour laquelle les prélèvements fiscaux sur les salaires sont 10,4 points plus bas.
- Au constat de cette déconnexion relative entre le coût horaire du travail et les prélèvements obligatoires pesant sur les salaires, il faut ajouter que l'approche du coût du travail doit tenir compte de son efficacité. Le poids du « coin fiscalo-social », ainsi que le coût salarial brut ne peuvent être considérés sans adjoindre au raisonnement l'efficacité économique du travail lorsqu'on souhaite apprécier la compétitivité-coût des pays et son évolution.
Le coût horaire brut du travail n'est pas un indicateur de compétitivité usuellement admis .
Il présente l'inconvénient majeur de négliger l'efficacité du travail, mesurée par la productivité par heure travaillée.
Un exemple simple permet d'illustrer cette insuffisance. Soit deux entreprises fabriquant un même produit : dans l'une, l'entreprise A, il faut 1 heure pour finir la fabrication du produit ; dans l'autre, l'entreprise B, 2 heures sont nécessaires. Le coût du travail horaire et de 15 euros dans l'entreprise A et de 10 euros dans l'entreprise B. Le coût du travail horaire est supérieur dans l'entreprise A. Cependant, la compétitivité-coût y est meilleure, puisque le produit est fabriqué moyennant 15 euros (correspondant au coût d'une heure de travail) tandis que pour l'entreprise B, 20 euros doivent être engagés (10 euros x 2 heures).
C'est pourquoi l'appréciation de la compétitivité-coût est systématiquement conduite à l'aide d'un concept différent du coût horaire de travail : le coût salarial unitaire . Celui-ci tient compte des différences de productivité horaire du travail ce qui en fait le seul indicateur vraiment rigoureux de compétitivité salariale d'une économie.
Or, le diagnostic sur la compétitivité salariale change nettement quand on utilise ce dernier indicateur (voir tableau suivant) par rapport à ce que suggèrent les coûts salariaux pris indépendamment de l'efficacité du travail .
COÛTS UNITAIRE DE MAIN D'oeUVRE POUR L'ENSEMBLE
DE L'ÉCONOMIE
POURCENTAGE DE VARIATION
|
Moyenne
|
Moyenne
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
|
Australie |
4,2 |
2,0 |
3,0 |
4,5 |
3,7 |
2,3 |
|
Autriche |
3,3 |
0,3 |
-0,1 |
1,4 |
1,2 |
0,8 |
|
Belgique |
3,0 |
1,6 |
0,5 |
1,9 |
0,7 |
0,8 |
|
Canada |
3,5 |
1,4 |
1,3 |
2,4 |
3,0 |
3,0 |
|
Danemark |
3,5 |
2,3 |
1,5 |
0,1 |
0,8 |
2,3 |
|
Finlande |
4,3 |
1,6 |
1,0 |
2,3 |
1,0 |
1,5 |
|
France |
2,8 |
1,5 |
0,8 |
1,8 |
1,4 |
1,2 |
|
Allemagne |
1,4 |
0,4 |
-0,8 |
-1,5 |
-0,9 |
-0,3 |
|
Grèce |
16,2 |
5,8 |
7,8 |
3,5 |
3,6 |
3,7 |
|
Islande |
18,0 |
5,9 |
-0,6 |
4,5 |
5,7 |
6,1 |
|
Irlande |
2,8 |
1,8 |
2,3 |
5,4 |
3,0 |
2,5 |
|
Italie |
6,1 |
2,4 |
2,5 |
4,2 |
0,8 |
1,7 |
|
Japon |
1,4 |
-1,2 |
-3,4 |
-1,4 |
-0,8 |
0,3 |
|
Corée |
8,8 |
3,1 |
3,6 |
2,6 |
1,4 |
1,3 |
|
Luxembourg |
2,5 |
2,3 |
1,0 |
2,2 |
2,0 |
1,7 |
|
Pays-Bas |
1,6 |
2,8 |
-0,2 |
0,5 |
-0,6 |
0,5 |
|
Nouvelle-Zélande |
1,6 |
1,9 |
2,7 |
5,8 |
4,3 |
1,9 |
|
Norvège |
3,7 |
3,3 |
1,6 |
2,3 |
3,7 |
3,6 |
|
Pologne |
- |
9,9 |
-0,1 |
3,9 |
3,4 |
2,4 |
|
Portugal |
13,0 |
3,7 |
3,8 |
4,0 |
2,6 |
2,2 |
|
Espagne |
7,9 |
3,3 |
2,9 |
2,6 |
3,1 |
2,9 |
|
Suède |
5,7 |
2,1 |
-0,2 |
1,4 |
0,8 |
1,7 |
|
Suisse |
3,7 |
1,0 |
0,9 |
0,7 |
0,9 |
1,5 |
|
Royaume-Uni |
5,4 |
2,9 |
1,9 |
3,6 |
2,7 |
2,5 |
|
États-Unis |
2,9 |
2,1 |
1,5 |
2,9 |
2,3 |
2,6 |
|
Zone euro |
2,2 |
1,6 |
0,8 |
1,3 |
0,7 |
1,1 |
|
Total de l'OCDE |
5,5 |
3,1 |
1,1 |
2,1 |
1,6 |
1,8 |
Source : OCDE. Perspectives économiques. Juin 2006.
Appréciée sur longue période, l'évolution du coût unitaire de la main d'oeuvre 136 ( * ) ressort comme moins dynamique en France qu'en moyenne dans la zone euro au-delà de 1994 .
L'écart avec la moyenne de l'OCDE est encore plus important . Pour l'ensemble de l'économie, les coûts unitaires de main d'oeuvre ont augmenté en France de 2,8 % entre 1984 et 1993, contre 5,5 % dans l'OCDE, et de 1,5 % entre 1994 et 2003, contre 3,1 % dans l'OCDE .
Au cours des plus récentes années, l'évolution des coûts unitaires de main d'oeuvre est restée plus modérée en France que dans l'OCDE et dans la zone euro hors Allemagne .
COÛT HORAIRE DE LA MAIN-D'oeUVRE

Note : le coût unitaire est le coût par unité produite ; il peut être exprimé comme le ratio entre le coût salarial par heure de production et de la production par heure de travail (productivité horaire).
Source : OCDE. Rapport Besson sur la TVA sociale.
L'ensemble des données disponibles montrent d'ailleurs que l'Allemagne constitue ainsi une exception dans le concert européen, et même dans le monde développé . Avec le Japon, c'est le seul pays à connaître une variation négative continue de ses coûts salariaux unitaires dans les années récentes.
Au demeurant, il est sans doute anecdotique mais significatif d'observer que la Commission européenne, quand elle rend compte des évolutions salariales dans la zone euro, est désormais contrainte d'isoler l'Allemagne.
Dans ces conditions, il est difficile de se rallier à l'idée qu'il existerait une anomalie française au regard du coût du travail .
Il faut insister sur les singularités de la situation observée en Allemagne , pays dont les équilibres économiques et sociaux paraissent manifester le choix d'une politique de désinflation compétitive plutôt que sur le soi-disant « cas » français.
En toute hypothèse, on doit relever que le différentiel des coûts salariaux unitaires à la faveur de la France a été acquis alors même que le « coin fiscalo-social » augmentait dans notre pays et qu'il diminuait dans l'OCDE .
- Ainsi, dans leur diversité, les « coins fiscalo-sociaux » n'ont pas les effets qu'on leur prête en termes de coût du travail .
II. LES DÉPENSES PUBLIQUES NE S'ACCOMPAGNENT PAS D'UN NIVEAU DE VIE RÉDUIT MAIS D'UNE RÉPARTITION DIFFÉRENTE DE SES COMPOSANTES
Cette hétérogénéité des effets du coin fiscal sur les coûts salariaux peut s'expliquer par au moins deux phénomènes, dont le second est directement en rapport avec le problème de l'évaluation des contreparties des dépenses publiques sur le revenu des ménages dans l'appréciation du niveau de vie des salariés.
Premier phénomène : la valeur du coin fiscalo-social est sensible aux choix de financement de l'intervention publique qui influence à son tour le niveau des coûts salariaux. Les pays ont des structures fiscales différentes, certains recourant à la taxation directe des salaires quand d'autres ont des niveaux plus élevés d'imposition indirecte. Or si ces choix peuvent être neutres sur le coût du travail (dans les pays où les impôts indirects sont plus élevés les salaires le sont souvent aussi du fait de l'indexation des salaires sur les prix), ils ne le sont pas sur le poids du « coin fiscalo-social ». Dans les premiers pays, celui-ci est plus élevé que dans les seconds (d'autant que les salaires sont plus élevés dans ceux-ci en réponse au niveau des prix lui-même supérieur).
- De fait, la répartition des prélèvements obligatoires entre impôts directs et indirects et entre impôt sur le capital et sur les personnes variant d'un pays à l'autre, il existe une décorrélation entre les niveaux généraux des prélèvements obligatoires et la valeur relative du « coin fiscalo-social » sur les salaires .
DES PAYS OÙ LE COIN FISCAL SUR LES SALAIRES EST
ANALOGUE
PEUVENT PRÉSENTER DES CHARGES FISCALES TRÈS
DIFFÉRENTES
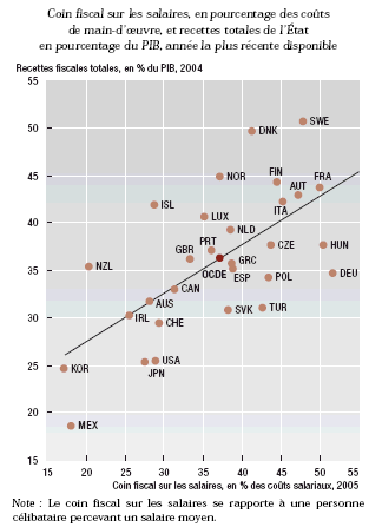
Source : OCDE (2006), Statistiques des recettes publiques 1966-2004, OCDE. Paris (www.oecd.org/ctp/impotssalaires), et OCDE (2006)
Avec un niveau de recettes fiscales presque identique à celui de l'Italie, la France connaît un « coin fiscalo-social » supérieur de 5 points à ce pays.
Et, l'Allemagne, malgré un niveau de prélèvements obligatoires sensiblement inférieur à celui de la France a un coin un peu supérieur à notre pays.
Au total, la diversité des niveaux relatifs des prélèvements sur les salaires n'équivaut pas à une égale diversité des coûts salariaux dans la mesure où il existe généralement un arbitrage entre salaires directs et prélèvements obligatoires assis sur ceux-ci.
Peut-on pour autant conclure que les pays dans lesquels les salaires directs sont affectés par la dynamique des prélèvements obligatoires, qui n'est évidemment pas indépendante de l'évolution des dépenses publiques, réservent à leurs ménages un plus faible pouvoir d'achat , autrement dit que les dépenses publiques pèsent sur le pouvoir d'achat ? La réponse à cette question est globalement négative en raison d'un second phénomène qui explique la déconnexion entre le niveau des « coins fiscalo-sociaux » et le coût du travail.
Second phénomène : l'arbitrage entre les salaires directs et les cotisations et impôts sur les revenus du travail n'est pas indépendant du niveau des contreparties financées par ces prélèvements, c'est-à-dire des dépenses publiques. Plus ces contreparties sont faibles plus souvent les salaires directs sont élevés. Cette configuration est somme toute naturelle puisque, dans un cas, les salariés « pré-payent » par les prélèvements qu'ils subissent les biens et services qu'ils doivent, dans l'autre cas, financer à partir de leur revenu.
In fine , le coût du travail peut connaître des structures différentes, avec plus ou moins de prélèvements obligatoires, la part occupée par ces derniers n'apparaît comme le déterminant principal de son niveau .
*
* *
Il y a là une explication supplémentaire au défaut de relation systématique entre le niveau du « coin fiscalo-social » et celui du coût du travail , mais aussi un motif à ne pas tirer de la constatation de la diversité des « coins fiscalo-sociaux » la conclusion, trop simpliste, selon laquelle le « coin fiscalo-social » réduirait le niveau de vie des salariés .
Il ne reste qu'un constat : celui que certains salariés contribuant davantage qu'ils ne « recevront » au cours de leur existence, supportent la solidarité dont d'autres « profitent ».
ANNEXE N° 6 - REVENUS DES MÉNAGES : ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION
Le niveau de vie d'un ménage est apprécié en rapportant le niveau du ménage au nombre d'unités de consommation qui le composent .
Selon l'échelle d'équivalence INSEE-OCDE, le premier adulte compte pour 1 unité de consommation, les autres individus du ménage âgés de plus de 14 ans comptent chacun pour 0,5 unité de consommation et les enfants âgés de moins de 14 ans représentent chacun 0,3 .
Des déciles de niveaux de vie sont estimés sur la population des ménages. La valeur du premier décile correspond au niveau de vie en dessous duquel se situent les 10 % des ménages les plus pauvres.
En général, ils sont appréciés en rapportant le revenu disponible avant impôt aux unités de consommation du ménage.
Mais d'autres échelles de revenus sont traditionnellement proposées :
1) Revenu primaire : il comprend les revenus d'activité et les revenus de remplacement (allocations chômage, pensions de retraite, indemnités pour maladie ou accident du travail) de même que les pensions alimentaires reçues et des revenus de patrimoine.
2) Revenu initial : il s'agit du revenu primaire auquel on rajoute les prélèvements sociaux-fiscaux à la source, à savoir la CRDS, la CSG déductible et la CSG imposable.
3) Revenu brut : il s'agit du revenu initial augmenté des cotisations directement à charge des ménages (maladie, retraite, chômage, etc.).
4) Revenu superbrut : il s'agit du revenu brut auquel on rajoute les cotisations patronales (ces cotisations patronales sont celles qui sont acquitées par les employeurs, elles sont donc nettes des allègements de charge).
5) Revenu disponible avant impôts : il s'agit du revenu primaire augmenté des prestations auxquelles ont droit les ménages (prestations familiales, minima sociaux et allocation logement pour les locataires).
6) Revenu disponible : il s'agit du revenu primaire augmenté des prestations et diminué des prélèvements directs auprès du ménage (impôt sur le revenu, y compris prime pour l'emploi et taxe d'habitation).
NIVEAUX DE VIE MOYENS EN 2003 SELON LE TYPE DE REVENU CONSIDÉRÉ
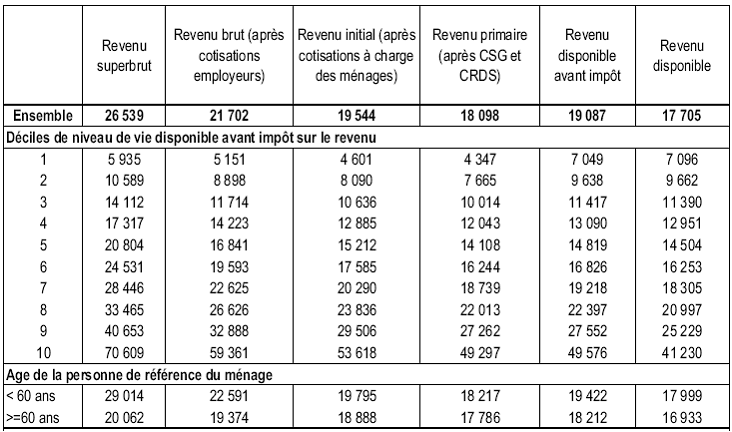
Source : Modèle de microsimulation Ines de la Drees et de l'Insee, enquête Revenus fiscaux 2001 Insee-DGI actualisée 2002-2003, calculs Drees
DÉCOMPOSITION DU REVENU SUPERBRUT
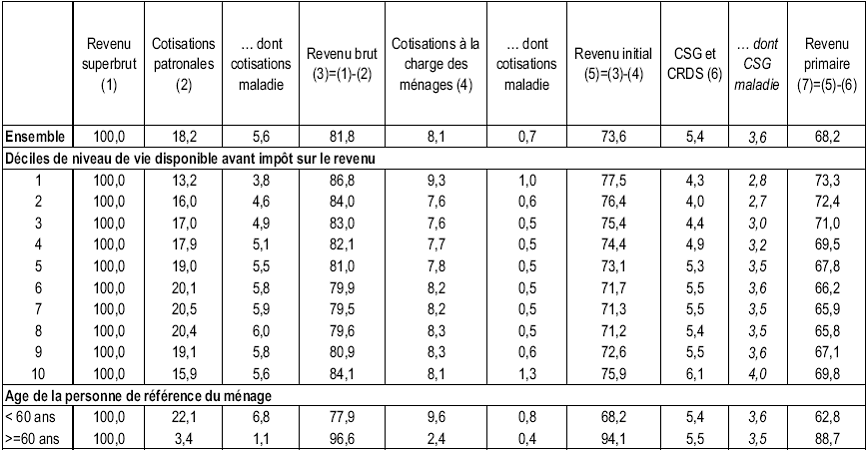
Source : Modèle de microsimulation Ines de la Drees et de l'Insee, enquête Revenus fiscaux 2001 Insee-DGI actualisée 2002-2003, calculs Drees
DÉCOMPOSITION DU REVENU BRUT
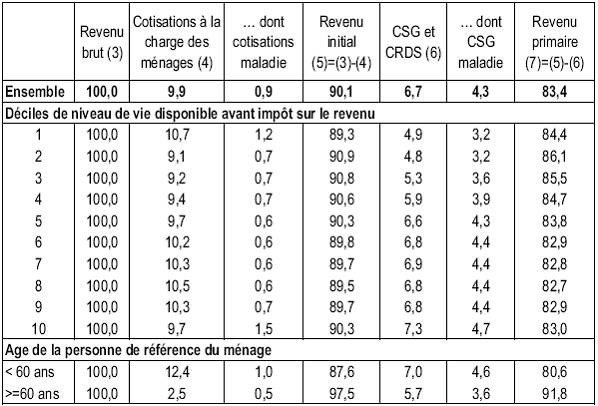
Source : Modèle de microsimulation Ines de la Drees et de l'Insee, enquête Revenus fiscaux 2001 Insee-DGI actualisée 2002-2003, calculs Drees
DÉCOMPOSITION DU REVENU PRIMAIRE
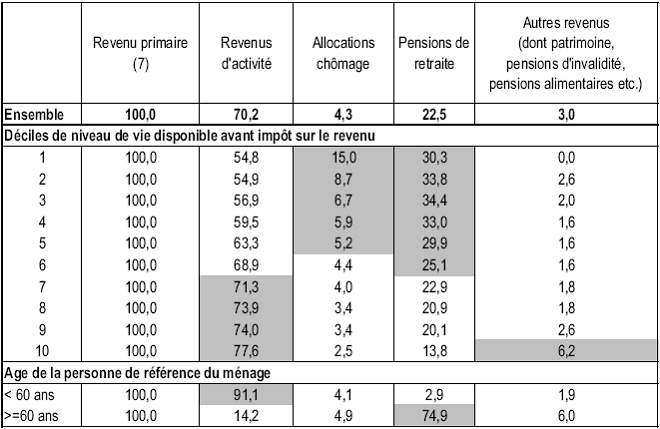
Source : Modèle de microsimulation Ines de la Drees et de l'Insee, enquête Revenus fiscaux 2001 Insee-DGI actualisée 2002-2003, calculs Drees
Plus récemment, les comptables nationaux se sont accordés pour combler une lacune des concepts traditionnels de revenu , liée à l'absence de prise en considération des services publics offerts aux ménages en contrepartie des prélèvements obligatoires. Il a semblé logique, malgré les difficultés conceptuelles importantes rencontrées, de compter ces services au rang des ressources des ménages. Cette solution s'imposait d'autant plus que les prélèvements obligatoires pour les ménages correspondant au financement de ces services étaient ôtés de leur revenu.
Il devrait être ainsi possible de disposer d'un « revenu disponible ajusté » des ménages. Toutefois, le recueil de ces données au niveau international n'est pas encore complètement réalisé et les services publics ainsi comptabilisés n'intègrent que les services dont la consommation est individualisable alors que les autres services publics ont également une utilité pour les ménages et peuvent donner lieu à des dépenses privées lorsqu'ils ne sont pas financés par des prélèvements obligatoires (autrement dit, leur fourniture par les administrations publiques exempte les ménages des dépenses correspondantes).
ANNEXE N° 7 - LES DÉPENSES DE RETRAITE AUX ÉTATS-UNIS
UN SYSTÈME ANTIREDISTRIBUTIF
I. UN SYSTÈME DE RETRAITE OÙ LES DÉPENSES PUBLIQUES NE COUVRENT QU'UNE FAIBLE PARTIE DES BESOINS
Le niveau des dépenses publiques de retraite
est, aux États-Unis,
nettement plus faible qu'en Europe avec
4,25 points de PIB
soit très nettement en
deçà du niveau moyen en Europe, de 12,1 points de
PIB
(-7,85 points de PIB sur un écart total de 10,7 points
de PIB avec la zone euro, soit près de trois quarts de cet
écart).
A. UN SYSTÈME À TROIS PILIERS
Le Social Security est le système public de retraite, par répartition, collectif et obligatoire. Il verse des prestations à environ 90 % des retraités américains. C'est le premier programme fédéral avec, en 2005, une charge pour l'État fédéral américain de 530 milliards de dollars , soit environ 25 % du budget fédéral et 4,25 % du PIB . Les prestations payées par ce régime sont perçues par 45,4 millions d'Américains, soit environ 15 % de la population . Cependant, seulement 28 millions d'entre eux sont des salariés à la retraite, 5 millions étant des salariés handicapés et le reste des membres de la famille d'un salarié à la retraite, invalide ou décédé.
Le poids des retraites dans le PIB excède très nettement le niveau des dépenses publiques du « Social Security ».
Le système de retraite américain comporte, en effet, trois piliers , et les dépenses du régime public ne rendent compte ni de l'effort public consacré aux retraites aux États-Unis - des exemptions fiscales favorisent le développement des autres piliers qui bénéficient, par ailleurs, du moins pour les fonds de pension d'entreprises, de « garanties » publiques -, ni de la « ponction » exercée sur le PIB par les retraités américains.
|
LES TROIS PILIERS DES REVENUS DES RETRAITÉS AMÉRICAINS
Le premier pilier : le régime
fédéral d'assurance vieillesse-invalidité
L'âge légal de départ à la retraite est de 65 ans (pour les personnes nées avant 1938), mais il a été repoussé progressivement de deux mois chaque fois, pour atteindre 66 ans pour les personnes nées en 1943. Il restera fixé à 66 ans pour les personnes nées entre 1944 et 1954, et progressera ensuite à nouveau pour celles nées entre 1955 et 1960 par incrément de deux mois, pour atteindre 67 ans pour les personnes nées en 1961 ou après. Il est possible de prendre sa retraite dès 62 ans en acceptant des prestations réduites de façon permanente (une décote de 22 % est appliquée pour ceux qui prennent leur retraite à 62 ans). Les prestations sont basées sur la rémunération, indexée sur l'inflation, perçue par le salarié au cours des 35 meilleures années (jusqu'au maximum imposable). Les taux de remplacement marginaux sont inversement proportionnels aux revenus validés , allant de 90 % pour la première tranche de revenus (jusqu'à 656 USD) à 32 % pour la deuxième (entre 656 USD et 3.995 USD) et 15 % pour la troisième (revenus supérieurs à 3.995 USD et jusqu'au maximum imposable). Le deuxième pilier : les régimes de retraite mis en place par les entreprises pour leurs employés Les employeurs du secteur privé mettent généralement en place des plans de retraite pour leurs salariés à temps plein . Ces régimes couvrent environ les deux tiers de la population active. Très peu de sociétés offrent des plans de retraite pour les salariés à temps partiel . a) Régimes de retraite agréés Les cotisations versées par l'employeur sont fiscalement déductibles au cours de l'exercice pendant lequel elles ont été versées, et le salarié n'est pas obligé de les intégrer dans son revenu imposable jusqu'à ce qu'il commence à les retirer du plan . Il existe trois types de régimes de retraite : les régimes à prestations définies, les régimes à cotisations définies et les régimes hybrides. En général, un régime à prestations définies verse une rente à partir du départ à la retraite, dont le montant dépend de la rémunération perçue par le salarié pendant sa carrière. Certains plans permettent une sortie en capital lors du départ à la retraite. L'employeur doit verser les cotisations nécessaires pour atteindre le montant déterminé de prestations. Les régimes à prestations déterminées du secteur privé sont garantis dans une certaine mesure par le Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC), un programme d'assurance fédéral couvrant en partie les prestations des retraités dont le régime fait défaut. |
|
Dans un régime à cotisations définies , l'employeur verse périodiquement des cotisations dont le montant est déterminé par le salaire de l'employé ou qui est identique à la cotisation retraite versée par le salarié sur son compte retraite. Le montant des prestations perçues à la retraite dépendra des cotisations versées et des pertes ou des gains enregistrés sur le compte retraite du salarié. Ces dernières années, de nombreuses entreprises ont converti leurs régimes à prestations déterminées en des régimes hybrides . b) Régimes de retraite non agréés Il s'agit de tous les régimes qui ne sont pas conformes aux dispositions de la section 401. Les employeurs ne bénéficient pas du traitement fiscal avantageux réservé aux régimes de retraite agréés, et les cotisations ne sont déductibles que lors de la liquidation des droits acquis par le salarié . Ces régimes ne sont pas agréés parce qu'ils ne sont pas proposés à tous les salariés. Ils servent en général à attirer des personnes ayant des compétences recherchées. Ils ne sont généralement ni garantis ni pré-financés (ce qui signifie que les actifs du fonds ne sont pas protégés contre les créanciers de l'entreprise si celle-ci connaît des difficultés ). Le troisième pilier : l'épargne personnelle |
B. LE PREMIER PILIER ASSURE UNE FAIBLE COUVERTURE DES BESOINS
Le régime fédéral d'assurance-vieillesse assure un taux de remplacement nettement plus faible aux États-Unis que pour la moyenne des pays de l'OCDE et, encore plus, de l'Union européenne .
|
TAUX DE REMPLACEMENT
|
||
|
Moitié du revenu moyen |
Revenu moyen |
|
|
Australie |
77,0 |
52,4 |
|
Canada |
89,4 |
57,1 |
|
France |
98,0 |
68,8 |
|
Allemagne |
61,7 |
71,8 |
|
Italie |
80,1 |
88,8 |
|
Japon |
80,1 |
59,1 |
|
Pologne |
69,6 |
69,7 |
|
Espagne |
88,7 |
88,3 |
|
Royaume-Uni |
78,4 |
47,6 |
|
États-Unis |
61,4 |
51,0 |
|
OCDE |
84,1 |
68,7 |
Source : OCDE 2005, Pensions at a Glance
C. ... ET N'EST REDISTRIBUTIF QUE DANS LE CADRE DE SES PROPRES DISPOSITIONS QUI SON EXTRÊMEMENT LIMITÉES
Le système est, en apparence, nettement redistributif : le taux de remplacement au niveau de la moitié du revenu moyen excède de plus de 10 points celui du revenu moyen. Cette particularité n'est pas propre au système américain. Dans l'ensemble, qu'ils soient d'inspiration beveridgienne ou bismarckienne (avec la notable exception de l'Allemagne), les systèmes de retraite apparaissent redistributifs.
Les particularités réglementaires du système américain (voir encadré) qui établit une dégressivité des droits à mesure que le revenu augmente contribuent à la redistributivité du régime public des retraites .
Pourtant, malgré cette apparence de redistributivité, la redistributivité réelle du système est très faible.
D. ... QUI LAISSENT PENDANT UN PROBLÈME AIGU DE PAUVRETÉ
Du fait de l'extension limitée du système de retraite et de ses caractéristiques, les personnes ayant perçu de bas salaires ne disposent que de droits à la retraite très faibles .
Les dispositions du filet de sécurité sous conditions de ressources ne représentent que 20 % du revenu moyen, alors que celles-ci sont proches de 30 % en moyenne dans les autres pays de l'OCDE.
Dans ces conditions, rien d'étonnant à ce que le régime fédéral d'assurance-vieillesse doive être complété.
II. LES DÉPENSES PRIVÉES DE RETRAITE
Les dépenses privées de retraite provenant des deux autres piliers du système (les fonds de pension et les produits de l'épargne personnelle) doublent le niveau du PIB consacré à l'assurance-vieillesse sans satisfaire vraiment les besoins.
A. LES FONDS DE PENSION
Dans les pays où les taux de remplacement assurés par les régimes de retraite obligatoires sont faibles, comme aux États-Unis, les régimes de retraite d'entreprise et les retraites complémentaires souscrites à titre privé se sont fortement développés .
La tâche d'estimer les revenus attraits par les retraités américains à ces deux titres est cependant malaisée. Il ne semble pas exister de chiffres permettant d'identifier la fraction du PIB que les droits accumulés dans les deux piliers privés du système américain de retraite permettent aux retraités américains de « ponctionner ».
On ne peut donc procéder que par approximations.
En pourcentage du PIB, les actifs des régimes de retraite américains sont parmi les plus importants dans le monde.
|
LES ACTIFS DES FONDS DE RETRAITE (2005) |
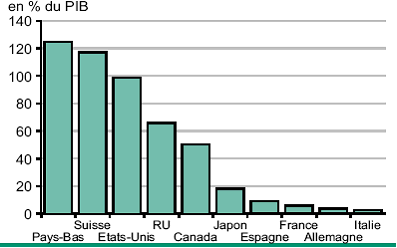
Source : OCDE
Une partie de ces actifs est constituée de titres financiers émis hors des États-Unis si bien qu'on ne peut totalement assimiler les revenus versés en contrepartie de ce patrimoine à une ponction des « retraités » des États-Unis sur le PIB national.
Le tableau ci-après indique que le revenu tiré de ces systèmes par un ménage résidant aux États-Unis et comportant au moins un retraité s'élève entre 15,3 et 16,6 % de son revenu total selon la classe d'age du ménage (entre 65 et 74 ans et au-delà de 75 ans respectivement).
Cette proportion est relativement élevée mais elle est moins importante que dans certains pays de l'OCDE où, comme aux États-Unis, la part des systèmes privés de pension est significative (Canada, Pays-Bas et Royaume-Uni).
Toutefois, ces revenus représentent environ 50 % des prestations publiques offertes par le système de base et ils contribuent comme tel à hausser le taux de remplacement moyen offert par le système de pension aux États-Unis.
B. L'ÉPARGNE INDIVIDUELLE
A ces actifs gérés collectivement dans le cadre de systèmes de prévoyance destinés à couvrir les besoins des retraités, il faut ajouter le produit de l'épargne privée détenue par les ménages comportant un retraité au moins.
Pour ce « troisième pilier » du système, les États-Unis ressortent en tête des pays de l'OCDE où les sources privées de financement de la retraite sont particulièrement développées .
Les ménages résidant aux États-Unis tirent de leur patrimoine individuel 15,1 % de leurs ressources (18,9 % pour les ménages au-delà de 75 ans) soit à peu près autant que du deuxième pilier du système (la moitié des ressources d'origine publique) et sensiblement plus que dans les autres pays ici recensés.
Ces revenus s'ajoutent aux revenus de remplacement du système public et du deuxième pilier (les fonds de pension pour l'essentiel) pour situer le « taux moyen de remplacement effectif 137 ( * ) » à un niveau qui doit être à peu près comparable à celui observée dans l'OCDE .
C. IN FINE, DES « DÉPENSES DE RETRAITE » TOTALES PROCHES DE LA MOYENNE DE L'OCDE
Ainsi moyennant une certaine approximation, on peut doubler les dépenses publiques de retraite (4,25 % du PIB) pour estimer l'ensemble des dépenses occasionnées par l'absence d'activité aux États-Unis.
Avec un total de 8,5 % du PIB, ces dépenses sont à peu près analogues à celles qu'occasionnent les systèmes publics de retraite dans l'OCDE (8,1 % en moyenne).
Elles sont toutefois en retrait par rapport aux dépenses de retraite observées dans l'Union européenne.
III. UN SYSTÈME DE RETRAITE GLOBALEMENT PEU REDISTRIBUTIF ET QUI ENGENDRE DE LA PAUVRETÉ
Le taux de remplacement offerts par les trois piliers du système de retraite semble, on l'a indiqué, se comparer avec celui des pays de l'OCDE où les régimes de retraite sont plutôt publics .
Cependant , ce taux est un taux estimé sur la base d'agrégats et ne rend compte que d'une situation moyenne .
Les caractéristiques du système de retraite américain , qui n'est universel que pour une partie minoritaire de ses engagements, laisse à penser que la distribution des revenus qu'il dispense est, au mieux, neutre au regard du critère de redistributivité et qu'il engendre des situations de pauvreté .
A. UN SYSTÈME AU MIEUX NON REDISTRIBUTIF
La redistributivité du système est probablement au mieux nulle. En fait, il y a tout lieu de soupçonner que le système est anti-redistributif pour des raisons expliquées ci-dessous.
Le premier pilier , le pilier public , est certes très nettement redistributif . Cependant, les deux autres piliers sont plutôt anti-redistributifs : les fonds de pension versent des prestations en lien avec les cotisations (excepté pour les fonds à prestations définies qui avantagent certains salariés quand les prestations sont prévues sur des bases trop optimistes) ; les produits de l'épargne individuelle sont probablement progressifs avec le revenu dès lors que la propension à épargner augmente avec le revenu.
L'essentiel des propriétés antiredistributives des deux derniers piliers du système vient de ce qu'ils ne sont pas universels. Leurs bénéfices, marqués par des inégalités, sont , pour une partie importante, liés à des contingences - la carrière professionnelle, le niveau de revenu - qu'elles amplifient .
Les systèmes privés de retraite se différencient des systèmes publics par un moindre degré de tutelle exercée par les pouvoirs publics : l'obligation d'assurance en est allégée ce qui renforce sans doute la liberté mais il est aussi notable que celle-ci ne profite pas également à tous .
B. UN SYSTÈME QUI PRODUIT DE LA PAUVRETÉ
De ces particularités, il résulte que non seulement le système de retraite des États-Unis est probablement globalement non (voire anti) redistributif, mais encore qu'il est à l'origine de phénomènes de pauvreté.
|
TAUX DE PAUVRETÉ RELATIF DES PERSONNES ÂGÉES (2000) |
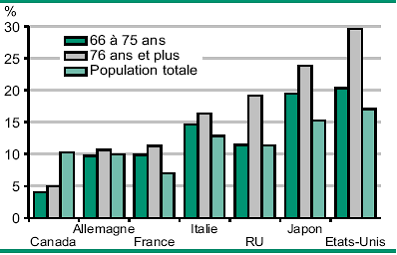
Source : OCDE
Une particularité très forte de la situation des retraités aux États-Unis doit être soulignée afin de saisir la dimension redistributive du système de prévoyance du « risque » de retraite dans ce pays : la très forte place qu'occupent les salaires dans l'équilibre financier des ménages comportant un retraité .
REVENUS DES RETRAITÉS PAR ORIGINE (EN %)
|
Canada |
Allemagne |
Pays-Bas |
Norvège |
Suède |
Royaume-Uni |
États-Unis |
|
|
Ménages comptant un retraité entre 65 et 74 ans |
|||||||
|
Salaire |
20,1 |
17,5 |
5,3 |
28,2 |
14,9 |
18,9 |
39,2 |
|
Investissement 1 |
11,8 |
7,5 |
6,2 |
7,7 |
8,9 |
12,5 |
15,1 |
|
Pension de retraite 2 |
28,6 |
13,1 |
40,5 |
14,7 |
14,5 |
24,3 |
15,3 |
|
Prestations sociales 3 |
39,5 |
62,0 |
48,0 |
49,4 |
61,8 |
44,3 |
30,3 |
|
Ménages comptant un retraité de + de 75 ans |
|||||||
|
Salaire |
6,0 |
5,7 |
7,4 |
7,7 |
2,9 |
10,6 |
21,8 |
|
Investissement 1 |
17,1 |
9,0 |
5,6 |
9,7 |
8,3 |
11,9 |
18,9 |
|
Pension de retraite 2 |
28,8 |
16,1 |
33,3 |
15,2 |
11,8 |
19,7 |
16,6 |
|
Prestations sociales 3 |
48,1 |
69,3 |
53,7 |
67,4 |
76,9 |
57,1 |
42,7 |
1 Revenus du patrimoine individuel
2 Revenus du
deuxième pilier du système de retraite
3 Revenus du
système public de retraite
Source : Steven Prus et Robert Brown, 2006 « Income inequality over the Later-life course : A comparative analysis of seven OECD Countries », WP 435, Luxembourg Income Studies.
Le premier pilier du système de retraite des États-Unis assure moins de la moitié des revenus des ménages comptant un retraité et que les deux autres piliers du système représentent environ un tiers de ces revenus , à peu près moitié-moitié.
Aussi, les ménages avec un retraité de 65 à 74 ans doivent compter sur les salaires d'activité pour environ 40 % de leur revenu.
Les prestations sociales , où figurent parmi d'autres allocations les pensions du régime public de retraite, ne représentent que moins d'un tiers de ce revenu , tandis que les pensions de retraite d'entreprise et les produits du patrimoine individuel forment un dernier tiers.
Ces chiffres incluent le salaire des conjoints qui peuvent ne pas être retraités. Ainsi, si on ne peut en déduire systématiquement que les retraités doivent maintenir une activité aux États-Unis pour compenser la faiblesse du niveau des prestations de vieillesse, il n'empêche que la comparaison avec les autres pays et le maintien pour les ménages comptant un retraité au-delà de 75 ans d'un niveau élevé de revenus salariaux confirment la contrainte financière que subissent globalement les ménages américains âgés, du fait du faible niveau de leurs retraites, ou du moins de certains d'entre eux.
Cette contrainte financière conduit à nuancer les conclusions auxquelles conduit le constat d'une relative homogénéité globale du niveau total des dépenses de retraite aux États-Unis et du taux de remplacement de ces systèmes avec le reste de l'OCDE.
Le développement des piliers privés de retraite profite sans doute beaucoup plus inégalement à la population que les systèmes publics ne le font .
Malgré un niveau total de dépenses de l'ordre de celui de l'OCDE, le système de retraite aux États-Unis s'accompagne, en effet, de performances sociales qui paraissent très inférieures aux autres pays, du moins sous l'angle de la pauvreté.
Le taux de pauvreté relatif des personnes âgées aux États-Unis en 2000 est à peu près le triple de ce qu'il est en France et en Allemagne .
ANNEXE N° 8 - LE SYSTÈME DE SANTÉ AUX ÉTATS-UNIS
La structure du système de santé des États-Unis réserve aux dépenses publiques de santé une part importante mais minoritaire .
L'assurance publique se limite aux populations les plus fragiles : les personnes âgées ou soufrant d'un handicap sont couvertes par le programme Medicare ; les ménages à bas revenus bénéficient du programme Medicaid .
Les dépenses publiques de santé recouvrent moins de la moitié des dépenses totales de santé (45,1 % en 2004 contre 73 % en moyenne dans l'OCDE).
Cette répartition a évolué et la part des dépenses publiques se rapproche de celle des dépenses privées du fait d'un mouvement de ciseaux qui est, pour beaucoup, dû à la baisse du taux de couverture assurée par le volet privé du système.
PART DES DÉPENSES DE SANTÉ
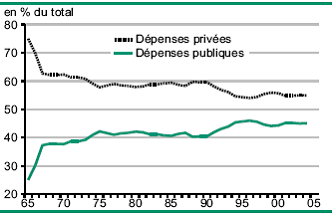
Source : CMS
MODES DE COUVERTURE SANTÉ
(EN % DE LA
POPULATION) EN 2005
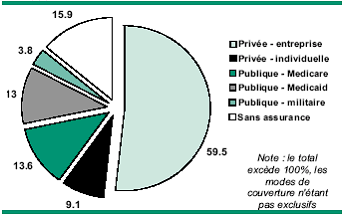
Source : Bureau of Census
D'ores et déjà, du fait du niveau important des dépenses totales de santé aux États-Unis, les financements publics y représentent une part du PIB voisine de celles des autres pays de l'OCDE (7,2 % en 2004).
Les autres dépenses de santé sont des dépenses privées mais dont le financement sollicite partiellement l'intervention publique .
Les ménages qui souhaitent bénéficier d'une couverture santé doivent contracter une assurance privée , directement ou dans le cadre de leur emploi . Dans la très grande majorité des cas (neuf fois sur dix), ces assurances sont souscrites par les entreprises , pour le bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et leurs familles.
La loi n'oblige pas les employeurs à proposer cette couverture, mais des incitations fiscales stimulantes existent dans ce sens. Les valeurs des primes sont déduites à la fois des salaires imposables des salariés et de la base de calcul des cotisations sociales 138 ( * ) . Les souscriptions directes d'assurances privées sont plus rares.
Au total, les financements par les assurances occupent une place plus importante aux États-Unis qu'ailleurs ( 35,1 % du total en 2004 ). Les frais directement assumés par les ménages représentent une fraction de plus en plus modeste ( 12,6 % des dépenses en 2004 ).
Quand on cumule les dépenses publiques et les dépenses privées de santé aux États-Unis, c'est environ 16 % du PIB des États-Unis qui apparaît consacré à la fonction santé, contre une moyenne de 9 % en 2003 pour les grands pays de l'OCDE.
Les dépenses par tête s'élèvent pour leur part à 6.100 dollars, contre seulement 2.500 dans l'ensemble de l'OCDE .
PIB PAR TÊTE ET DÉPENSES DE
SANTÉ
(EN USD, PPA) - 2003
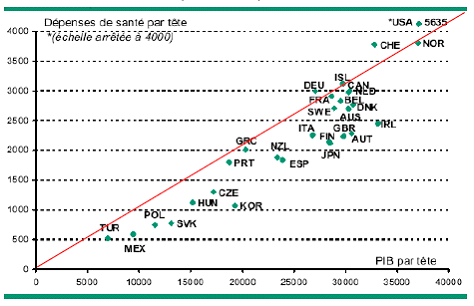
Source : OCDE
Ces données, qui témoignent d'une situation exceptionnelle, résultent d'une évolution des dépenses de santé particulièrement dynamique .
Entre 1965 et 2004 , le poids des dépenses de santé dans le PIB a augmenté de près de 10 points et a plus que doublé .
DÉPENSES DE SANTÉ
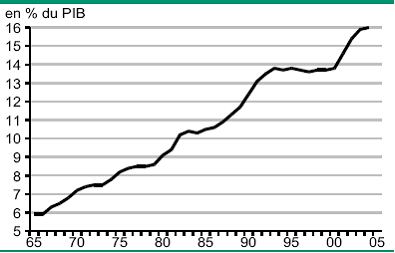
Sources : CMS, BEA
Les effectifs employés dans le secteur excèdent ceux de l'industrie manufacturière.
Ainsi, si la pression qu'exercent les dépenses publiques de santé sur le PIB est proche de la moyenne de l'OCDE, la pression totale des dépenses de santé est aux États-Unis sensiblement supérieure .
Si les dépenses privées de santé ne se traduisent pas en termes de prélèvements obligatoires 139 ( * ) , leur niveau et leur dynamique exercent des pressions financières fortes et croissantes sur les agents privés.
S' agissant des entreprises , elles se manifestent par l'importance des primes d'assurance acquittées .
ÉVOLUTION ANNUELLE DES PRIMES D'ASSURANCE-SANTÉ
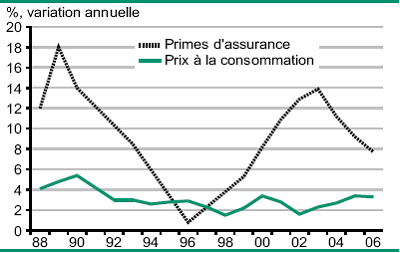
Sources : KFF-HRET, BLS
Selon l'enquête annuelle menée conjointement par la Kaiser Family Foundation (KFF) et le Health Research and Educational Trust (HRET), les primes d'assurances ont progressé de 7,7 % en 2006 et de plus de 10 % l'an entre 2001 et 2004 .
Il est à noter que les rythmes de progression des dépenses publiques et privées de santé observés sur longue période sont très proches . Depuis 1970, les premières augmentent de 10,6 % par an et les secondes de 9,7 % .
La forte augmentation des dépenses publiques de santé est due à la hausse du nombre d'inscrits - passés de 20 à 42 millions depuis 1970, soit + 2,3 % l'an - et, surtout, à celle du coût moyen par bénéficiaire .
Cette hausse emprunte donc pour une part à des mécanismes qui expliquent aussi celle des dépenses privées. La progression des dépenses publiques se nourrit par ailleurs, indirectement, de celle des tarifs privés, qui incite certaines personnes à cesser de souscrire une assurance pour se placer dans le cadre des programmes publics. Medicaid s'est ainsi fortement développé au cours des dernières années, au moment même où les taux de couverture par une assurance d'entreprise diminuaient. La sélection de fait opérée par les assurances privées entraîne un déport des charges vers le système public.
La distinction entre les volumes et les prix des soins montre que ce sont surtout les prix qui dopent les dépenses de santé . Alors que les visites chez les médecins ont diminué du début des années 1980 au milieu des années 1990, et que les séjours à l'hôpital sont plus courts que par le passé, l'indice des prix des soins médicaux a augmenté régulièrement plus vite que l'indice total des prix à la consommation , ou même que celui des prix des services, au cours des vingt-cinq dernières années. L'augmentation des prix des soins résulte, quant à elle, de plusieurs facteurs parmi lesquels les avancées techniques. Les dépenses par attaque cardiaque seraient ainsi passées de 12.000 dollars en 1984 à 22.000 dollars en 1998 (en termes réels).
PRIX À LA CONSOMMATION
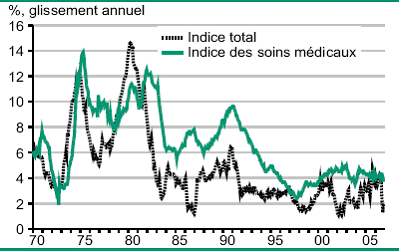
Source : BLS
Les perspectives des dépenses de santé sont nettement haussières . S'agissant des dépenses publiques, le Congressional Budget Office (CBO) a réalisé des projections à long terme, en retenant plusieurs hypothèses de croissance des dépenses de santé où les dépenses par bénéficiaire progressent de 2,5, 1 ou 0 point de pourcentage de plus que le PIB par habitant. Dans le cadre de l'hypothèse médiane, le coût de Medicare passerait de 2,7 % du PIB aujourd'hui à 8,6 % en 2050. Quant au coût total des deux programmes ( Medicare et Medicaid ), pour l'État fédéral , il passerait de 4,2 % du PIB actuellement à 12,6 % en 2050 . Dans le cadre de l'hypothèse la plus défavorable (qui ne l'est cependant pas plus que la tendance observée au cours des dernières décennies), les dépenses fédérales au titre de la santé atteindraient 21,9 % du PIB en 2050... soit légèrement plus que la totalité du budget fédéral actuel (20 %).
Les tendances en cours semblent difficilement soutenables .
Mais les solutions pour contenir la progression des dépenses publiques sont limitées : diminuer le nombre de bénéficiaires, la part des coûts pris en charge par le gouvernement fédéral, ou le coût total par bénéficiaire. A moins que des économies significatives ne soient dégagées grâce à une efficience accrue du système, de telles mesures entraîneraient des transferts de coûts vers les ménages, voire les assurances d'entreprise, ce qui ne réduirait pas la place occupée par la santé dans l'affectation du revenu national aux États-Unis .
En dépit de dépenses de santé particulièrement élevées, les performances sanitaires du système américain apparaissent relativement médiocres, au regard des grands critères usuels.
COMPARAISONS INTERNATIONALES (2004)
DES PERFORMANCES
APPARENTES DES SYSTÈMES DE SANTÉ
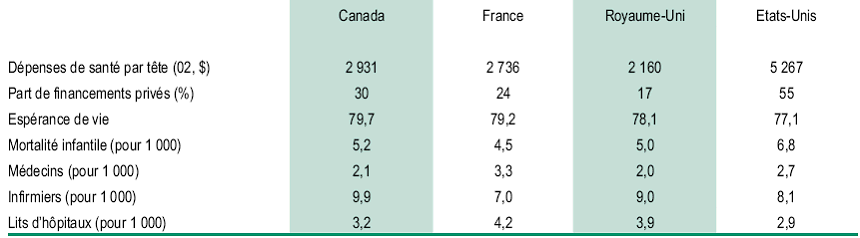
Source : OCDE
En termes d'espérance de vie à la naissance , en 2003, les États-Unis se positionnaient seulement au neuvième rang des pays de l'OCDE (sur un total de 30, en partant du bas), avec 77,2 années. Ce niveau est inférieur à la moyenne OCDE (77,8 années) et plus encore, à ceux constatés en France, au Canada, en Italie (plus de 79 années), au Japon ou en Espagne (plus de 80 années). La progression de l'espérance de vie constatée depuis le début des années 1960 aux États-Unis (+ 7,3 années) est de surcroît inférieure à celle enregistrée en moyenne au sein de l'OCDE (+ 9,3 années), les autres pays partant à l'origine de plus bas.
Le taux de mortalité infantile (6,9 pour mille en 2003, contre 5,7 pour mille au sein de l'OCDE) est peu satisfaisant . Enfin, il est à remarquer que les taux d'encadrement par des médecins ou des infirmières et le nombre de lits d'hôpitaux ne sont pas plus élevés qu'ailleurs .
Un problème majeur du système de santé américain réside dans la part non négligeable de la population qui ne dispose de couverture santé d'aucune sorte : 15,9 % en 2005, soit 47 millions de personnes . Cette proportion, qui a varié entre 12 % et 17 % au cours des deux dernières décennies, augmente depuis le début des années 2000.
PROPORTION DE LA POPULATION SANS COUVERTURE DE SANTÉ
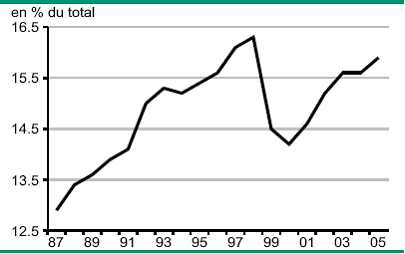
Source : Bureau of Census
Ainsi, malgré une progression très rapide de leur montant, les dépenses de santé ne peuvent s'expliquer par une augmentation de la proportion des personnes couvertes. Le système semble, au contraire, devenir de plus en plus sélectif .
Au demeurant, la progression du nombre de personnes sans assurance résulte en grande partie de la hausse du coût de la santé, et plus précisément de ses répercussions sur les couvertures santé d'entreprise 140 ( * ) . Ainsi, des différences notables de taux de couverture sont constatées entre le secteur public et le secteur privé, puis, au sein du secteur privé, entre grandes et petites entreprises . La couverture est moins fréquente dans le privé et, a fortiori , au sein des petites entreprises. Les changements et les pertes d'assurances santé sont par ailleurs fréquents, allant de pair avec les mouvements de main-d'oeuvre (ce qui contribue à gonfler les coûts de gestion des assurances santé privées).
Le système est donc loin d'être efficient. Il coûte plus cher que d'autres et ne donne pas de meilleurs résultats .
Par ailleurs, le système d'assurance privée aux États-Unis semble produire d'importants effets pervers. Sur le marché des biens et services , la hausse du coût de la santé est accusée de susciter des distorsions de concurrence entre les entreprises qui proposent des plans santé et les autres.
Cette critique rejoint celle assez traditionnelle, dans certains pays européens, de l'impact des cotisations sociales sur la compétitivité. Elle va un peu au-delà puisqu'elle met en évidence les effets distorsifs qui résultent de l'absence d'universalité du système de financement des besoins de santé. Son caractère non obligatoire renforce les griefs de ses détracteurs comme étant à l'origine d'une rupture d'égalité de concurrence. Cette critique vaut d'être notée car il est assez peu usuel de rencontrer une revendication visant à élever le niveau des prélèvements obligatoires pour assurer l'équilibre concurrentiel. Il reste à vérifier que les pratiques différenciées des entreprises en matière de couverture des besoins de santé sont sans effets sur les salaires primaires (nets des avantages santé offerts par les entreprises) que supportent les employeurs.
Dans l'hypothèse contraire, qui paraît la plus probable, la problématique du coin fiscalo-social que connaissent les pays à haut niveau de taux de prélèvements obligatoires serait largement partagée, mais sous une autre forme, par les pays où le financement des dépenses santé est privé.
S'agissant du fonctionnement et de l'organisation du marché du travail , le poids élevé des engagements de santé semble entraîner des pratiques distorsives.
Pour éviter un gonflement de la facture santé, les entreprises peuvent être amenées à privilégier les contrats de travail à temps partiel ou à durée déterminée , si les critères d'éligibilité à l'assurance d'entreprise excluent telle ou telle catégorie de salariés de l'adhésion au plan de l'entreprise. Dans le même cas, le système d'assurance entreprise peut avoir pour conséquence d' accroître la préférence relative des employeurs en faveur des heures supplémentaires , par rapport à l'embauche d'un nouveau salarié puisque cela permet « d'amortir » davantage la prime d'assurance santé, celle-ci constituant un coût fixe par salarié.
La hausse du coût de la santé conduit les entreprises à tenter de se dégager des charges qu'elles supportent au titre du financement des besoins de santé .
La baisse de la couverture des retraités est spectaculaire : 35 % des entreprises de plus de 200 salariés offrent une couverture santé à leurs retraités, contre 66 % en 1998. L'accroissement de la participation financière des salariés , qui représente traditionnellement une fraction relativement faible de la prime totale, ou bien le renforcement des critères d'éligibilité des salariés au plan de l'entreprise (ancienneté requise, type de contrat de travail, etc.) semble se produire. Ainsi, alors que 44 % des salariés couverts par une assurance santé d'entreprise ne contribuaient en rien à son financement au début des années 1980, ils n'étaient plus que 28 % dans ce cas en 1998.
Selon les données du « Bureau of Census », la progression de la part de la population sans couverture santé depuis le début de la décennie (de 14,2 % en 2000 à 15,9 % en 2005) reflète essentiellement la baisse du nombre de personnes couvertes par une assurance d'entreprise (de 63,6 % en 2000 à 59,5 % en 2005) - et, à un moindre degré, par une assurance privée individuelle, de 9,5 % à 9,1 % -, tandis que le taux de couverture « public » s'est au contraire accru (de 24,7 % en 2000 à 27,3 % en 2005).
Les États-Unis ont mis en oeuvre plusieurs réformes destinées à limiter la croissance des dépenses de santé. Ces réformes semblent s'être heurtées à de fortes réticences des patients et des praticiens, si fortes qu'elles ont été délaissées . Aujourd'hui, le thème de la réforme est toutefois de retour. Mais, les solutions proposées ne paraissent pas aller au fond des problèmes.
Dans les années 1990 , un contrôle accru des dépenses de santé a été recherché, par le biais du développement des réseaux de soins intégrés (« managed care »). Ce mouvement a pris la forme de différents types d'accords entre assurances entreprises, salariés et fournisseurs de soins, visant à freiner la hausse des coûts. La prépondérance des paiements à l'acte a diminué, au profit des réseaux de soins. Les plans de santé classiques qui représentaient encore plus de deux tiers des couvertures à la fin des années 1980 (73 % en 1988, selon l'enquête KFF/HRET) n'occupent désormais qu'une place marginale (3 %). Ce déploiement du « managed care » a été contemporain d'un ralentissement sensible des dépenses de santé . Entre 1993 et 2000, ces dernières ne se sont pas accru plus vite que le PIB.
Cependant, petit à petit, les contraintes liées à ces réseaux ont été de moins en moins bien acceptées , par les patients (rationnement des soins, moindre capacité de choix, remboursements partiels) comme par les médecins (prix contraints, pratique encadrée). En réponse, les compagnies d'assurance ont proposé des formules de couverture moins contraignantes, qui ont rencontré le succès. La part de santé dans le PIB a, dès lors, renoué avec une tendance à la hausse marquée, de 13,8 % en 2000 à 16,0 % en 2004, alors qu'elle était restée stable au cours des sept années précédentes (13,8 % en 1993 également).
Les diverses pistes de réformes aujourd'hui évoquées sont très variées : mise en place d'incitations visant à modifier le comportement des patients ou des praticiens ; refonte globale du système avec l'instauration d'un système de couverture universel public.
- Réformer les incitations
Cette voie repose sur l'idée que la hausse rapide des dépenses de santé s'explique largement par le peu d'incitations qu'ont les ménages à limiter leurs frais, en raison des protections fournies par les assurances . Les assurances peuvent être amenées à soutenir la hausse des coûts par différents biais : en encourageant un recours excessif aux soins ; en dissuadant les consommateurs de rechercher des fournisseurs moins chers (d'où une hausse du pouvoir de fixation des prix de ces derniers) ; en diminuant les incitations qu'on les laboratoires à développer des produits moins chers que ceux existants. La principale mesure évoquée dans ce contexte est la suppression des déductions fiscales liées aux plans santé d'entreprise. Le développement de l'offre d'assurances « low cost », moins coûteuses et moins protectrices, est également évoqué. La montée en puissance des comptes épargne santé s'inscrit dans ce cadre.
Cette approche a cependant des limites. Le fait que les dépenses de santé soient fortement concentrées sur une minorité d'individus (20 % des personnes sont à l'origine de 80 % des dépenses) suggère que le dynamisme des dépenses de santé n'est pas tant lié à un excès de consommation de soins de « routine » qu' aux traitements longs, modernes et coûteux (qui ne peuvent, sauf exceptions, être financés que par le biais d'une assurance).
L' amélioration du système d'incitations concerne aussi les praticiens . Ceux-ci ne sont également pas incités à limiter la hausse des coûts. Diverses formules de maîtrise médicalisée des dépenses de santé sont proposées à l'instar de celle développée dans le cadre des « réseaux de soin intégrés ». Elles tendent à lier la rémunération de l'offre aux performances, c'est-à-dire aux résultats obtenus dans le respect des meilleurs pratiques.
Les propositions alternatives visant à instituer un système de couverture universel et public sont fondées sur le constat que la fragmentation du système de soins américain est à l'origine de surcoûts , à différents titres. En premier lieu, les coûts administratifs y sont plus élevés que dans un système intégré (modification des populations prises en charge, dépenses liées à la volonté des entreprises de limiter l'anti-sélection). Par ailleurs, le risque existe que les parcours de soins soient moins efficaces, dans un système fragmenté. Enfin, les grands systèmes publics disposent d'une plus grande capacité de négociation vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques qu'un ensemble d'intervenants privés.
Ces justifications sont, pour l'essentiel, techniques : il s'agit de limiter les coûts de transaction ; d'accroître les économies d'échelle des producteurs de soins et de renforcer leur pouvoir de négociation à l'égard de leurs fournisseurs.
Il n'est pas certain qu'elles puissent avoir toute l'efficacité nécessaire puisqu' elles ignorent les coûts de pilotage qu'implique la gestion de systèmes d'offres très intégrés et ne couvrent pas , du moins implicitement, l'ensemble des variables déterminant le coût du système de santé .
* 1 Moyenne arithmétique de 18 pays de l'OCDE.
* 2 Dans la deuxième partie du rapport, on examine, en revanche, les implications micro-économiques des dépenses publiques.
* 3 Au demeurant, les comptables nationaux ne prétendent pas à cette ambition qui leur est souvent prêtée, à tort.
* 4 Ces autres dépenses ne sont pas toutes directement identifiables à partir de la nomenclature CFAP , qui est la seule à être informée avec exhaustivité par l'ensemble des pays. Seuls les transferts économiques sont individualisables à partir de la fonction « Affaires économiques » de cette nomenclature. En France, 5,4 % des dépenses publiques sont consacrées à des soutiens de cette nature. D'autres dépenses de transferts sont recensées dans des catégories qui incluent des dépenses différentes par leur nature : l'administration générale, l'environnement, le logement, les affaires culturelles et l'éducation.
* 5 Les prestations sociales regroupent les prestations d'assurance sociale et les prestations d'assistance sociale (RMI, ALS et APL, CMUC...) qui sont minoritaires dans l'ensemble.
* 6 Cette somme comprend les charges d'intérêt - pour 46,2 milliards d'euros (34,2 % de ces autres transferts) qu'il serait plus justifié d'imputer à chaque grande catégorie d'intervention publique à due proportion de son poids dans le total.
* 7 Ce, malgré une augmentation annuelle moyenne de 2,6 % reflétant des évolutions nationales contrastées.
* 8 Europe des 12
* 9 En % annuel
* 10 Le chiffrage de la production non marchande en Allemagne donne une image singulière par rapport à l'estimation du poids dans le PIB des dépenses publiques hors protection sociale qui invite à quelques précautions, mais semble résulter pour une partie significative du développement dans ce pays de la production non marchande externalisée. Celle-ci donne lieu à des dépenses publiques qui ne sont pas comptabilisées dans l'estimation de la production des administrations publiques mais qui y contribuent en fait.
* 11 Ainsi en va-t-il du fait que les dépenses d'administration incluent des charges d'intérêt qui sont plus ou moins élevées selon les pays, ou du fait de l'absence de prise en compte des dépenses fiscales, des crédits d'impôts notamment, qui jouent un rôle plus ou moins important dans le financement de certains services publics (éducation, santé).
* 12 Ici, les dépenses publiques liées à la production non marchande des administrations sont estimées par différence entre le total des dépenses publiques et les dépenses publiques recensées au titre de la protection sociale.
* 13 Y compris la santé.
* 14 Il est probable qu'un certain nombre d'évolutions aient conduit à des changements de périmètre mais le résultat demeure.
* 15 Substituabilité qui trouve à s'exercer dans les faits, ainsi qu'on le verra dans la suite de la présente partie et qui, pour relativiser les enjeux attachés au niveau relatif des dépenses publiques, en termes d'utilisation globale des richesses économiques, a des conséquences sur les situations respectives des agents économiques, notamment du point de vue de l'égalité.
* 16 Indépendamment de la santé.
* 17 Il va de soi que cette observation d'une égalisation globale des richesses totales destinées à la protection sociale n'équivaut pas à constater une indifférence des choix du dosage entre intervention collective et assurances sociales privées.
* 18 Les dépenses sociales ici considérées ajoutent aux dépenses de protection sociale telles que définies dans le premier chapitre, les dépenses liées à la production de santé.
* 19 Et en parité de pouvoir d'achat.
* 20 La baisse du niveau relatif des dépenses publiques de protection sociale entre 1995 et 2001 a été suivie d'une hausse entre 2002 et 2005.
* 21 Les dépenses publiques sociales ici examinées comprennent, outre les transferts sociaux, les dépenses de santé.
* 22 Le recours à la méthode des parités de pouvoir d'achat s'impose pour corriger les différences de niveaux de prix existant entre les pays dès lors qu'on souhaite disposer d'une vision permettant de comparer les bénéfices sociaux réels.
* 23 L'écart-type mesure la moyenne des écarts à la moyenne et représente un indice de dispersion des données d'un échantillon. Plus il est élevé, plus l'échantillon est dispersé. L'écart-type est sensible à l'existence de valeurs extrêmes. Dans l'échantillon des dépenses publiques sociales en Europe, il en existe (l'Irlande, le Portugal...) et elles concernent des pays dont le PIB n'est qu'une composante mineure du total. Si on exceptait ces cas particuliers, la dispersion des pays européens sous l'angle de leurs dépenses publiques de protection sociale serait sensiblement plus faible. En outre, le résultat obtenu serait plus significatif puisqu'il porterait sur des pays plus comparables par leurs caractéristiques économiques.
* 24 Dans la suite du présent chapitre, on aura l'occasion de montrer que tel est aussi le cas pour les écarts appréciés dans le champ plus vaste des pays de l'OCDE.
* 25 Il reste que la consommation privée de ces services peut bénéficier d'avantages fiscaux considérables qui ne sont pas recensés en dépenses publiques. Le secteur du logement offre un champ d'observations privilégié en ce domaine.
* 26 Sur ce point, des observations analogues à celles déjà mentionnées dans l'encadré relatif à la base de données européenne SESPROS peuvent être faites.
* 27 Les dépenses privées recensées par l'OCDE qui ne couvrent pas la totalité des flux de ressources économiques ayant pour finalité la protection sociale.
* 28 Moyenne arithmétique des 19 pays de l'OCDE
* 29 Hors Irlande, Mexique et Corée.
* 30 Hors Pays-Bas.
* 31 On rappelle que ce recensement n'est pas exhaustif, en particulier dans le domaine des retraites, et que ses lacunes minorent le montant des ressources nationales consacrées à la protection sociale dans les pays où les systèmes publics sont peu développés.
* 32 La méthode employée par l'OCDE ne permet pas de couvrir la totalité des dépenses fiscales. Par exemple, les dépenses fiscales correspondant aux allégements de prélèvements obligatoires consentis pour inciter les agents à constituer des régimes supplémentaires privés ne sont pas comptées, pas plus que la totalité des déductions fiscales pour le logement.
* 33 Ici, les dépenses fiscales de pension ne sont pas prises en compte.
* 34 L'écart avec l'Italie atteignait 2,9 points de PIB en 1999.
* 35 Données pour 2003. Les différences entre les données européennes et celles de l'OCDE s'expliquent par des décalages de date et quelques différences entre les méthodes statistiques employées.
* 36 D'autres décompositions sont envisageables.
* 37 C'est-à-dire que les dépenses de santé augmentent exactement comme le revenu, en l'espèce le PIB.
* 38 Il s'agit d'une moyenne simple, non pondérée par le poids de chaque pays dans le total.
* 39 Il s'agit d'une moyenne simple, non pondérée par le poids de chaque pays dans le total.
* 40 L'effort public en faveur de l'éducation est systématiquement sous-estimé et l'effort privé est, inversement, systématiquement surestimé du fait de la non prise en compte des « dépenses fiscales ».
* 41 Les moyennes sont des moyennes pondérées par les niveaux de PIB.
* 42 Extraits d'une présentation de Mme Christine Ragoucy de la direction de la programmation et du développement du Ministère de l'Education nationale
* 43 Le faible effort public d'éducation en Allemagne diminue le poids des dépenses publiques dans ce pays, de 1,4 point de PIB en 2003 par rapport à la France, ce qui représente un cinquième de l'écart entre les deux pays au regard du niveau relatif des dépenses publiques dans le PIB.
* 44 Ces estimations diffèrent de celles parfois mentionnées dans le présent chapitre. Elles portent sur une moyenne non pondérée par l'importance relative du PIB, quand les autres concernent des moyennes pondérées. Quand on utilise la seconde méthode, le niveau moyen des dépenses d'éducation est plus élevé parce que dans des pays les plus riches le poids relatif des dépenses d'éducation est supérieur.
* 45 L'effort privé est toujours surestimé puisque les avantages fiscaux souvent en oeuvre ne sont pas déduits des dépenses privées.
* 46 On verra plus loin dans le présent rapport que cette relation peut être considérée dans les deux sens.
* 47 Estimation calculée à partir de la moyenne arithmétique simple des dépenses nationales.
* 48 « Les choix budgétaires en matière d'éducation », Jean-Richard Cytermann. Pouvoir n° 122.
* 49 Production non-marchande hors santé.
* 50 Apparente puisqu'à ce stade les dépenses fiscales ne sont pas prises en compte.
* 51 Hors la France.
* 52 Ces épisodes étaient jusque là mis sur le compte d'une rigidité des prix par les économistes classiques pour lesquels l'essentiel était ainsi d'assurer qu'une flexion des prix rétablisse un équilibre transitoirement compromis.
* 53 Ainsi, selon le théorème d' Haavelmo , l'effet de stabilisation conjoncturelle se produit même à solde public inchangé.
* 54 Ce que les économistes traduisent quand ils affirment que le multiplicateur des dépenses publiques est supérieur au multiplicateur des impôts. Ce différentiel a pour conséquence que, quand on augmente les impôts d'un montant identique à celui de la hausse des dépenses publiques, l'effet récessif sur la demande privée de l'augmentation des prélèvements est plus faible que l'effet d'amplification qui résulte de la hausse des dépenses publiques.
* 55 Voir pour une présentation technique de ces paramètres « La coordination des politiques économiques en Europe. Le malaise avant la crise ? », MM. Joël Bourdin et Yvon Collin. Rapport n° 113 du 5 décembre 2007. Délégation du Sénat pour la planification.
* 56 Ou d'ailleurs par n'importe quelle autre composante de la demande qu'elle soit publique ou privée.
* 57 Même si dans NIGEM, on relève une accélération de l'investissement.
* 58 Ils peuvent être négatifs lorsqu'à la suite d'une élévation du rythme d'inflation causée par l'augmentation des dépenses publiques, les taux d'intérêt se tendent.
* 59 Il s'agit du solde structurel hors charges d'intérêts.
* 60 Une croissance économique supérieure à la moyenne du G7, corrigée de l'écart des croissances tendancielles sur la période 1971-1995.
* 61 Les dépenses publiques hors charges d'intérêt.
* 62 C'est d'ailleurs le débat sur celle-ci qui distingue souvent les forces politiques qui se placent dans le cadre du paradigme individualiste.
* 63 Ces divergences et discussions devraient être au fondement des débats sur les dépenses publiques plutôt que l'opposition idéologique, sans vrai fondement, qu'elles suscitent.
* 64 En particulier, dans le modèle de Solow.
* 65 L'endogénéisation consiste à sortir de l'idée que la productivité ne peut s'expliquer pour la relier à des variables économiques identifiables.
* 66 Romer (1986, 1990), Lucas (1988), Barro (1990), Rebelo (1991).
* 67 Une grande partie de la « Stratégie de Lisbonne » européenne repose sur ces analyses.
* 68 A ces rendements macroéconomiques, il faut certainement ajouter de nombreux et importants rendements sociaux qui, même si leur quantification est encore embryonnaire, doivent être mentionnés.
* 69 « Éducation supérieure et croissance : financement et gouvernance », par Philippe Aghion et Peter Howitt.
* 70 Mais un déterminant essentiel puisque les ménages ont structurellement une capacité de financement quand, pour les autres agents économiques, c'est la situation inverse qui prévaut.
* 71 Selon le théorème d'Haavelmo.
* 72 Par opposition au point de vue conjoncturel qui tient compte d'éventuels déséquilibres économiques.
* 73 Cette règle générale fait l'objet d'une exception pour les administrations publiques .
L'exception est relative aux biens durables acquis par les administrations militaires, considérés comme une consommation intermédiaire des administrations publiques, à l'exception des bâtiments destinés à loger les militaires de carrière.
Cette solution a pour effet de minorer beaucoup l'effort d'investissement public quand il est apprécié à partir des données de la Comptabilité nationale, puisque le ministère de la Défense est le premier investisseur public.
* 74 La somme des investissements des agents ne permet pas de mesurer le capital produit par un pays. Elle n'y est pas strictement équivalente puisque des investissements peuvent être acquis auprès du Reste du monde
* 75 La dépense intérieure d'éducation est plus importante puisqu'elle agrège aux dépenses publiques les dépenses réalisées par les agents privés.
* 76 Par ailleurs, avec une telle méthode, on fait l'hypothèse que les dépenses ont un rendement constant puisque toute unité de dépenses publiques a la même valeur monétaire sans que soit vérifié le réalisme de ce présupposé.
* 77 Par exemple, dans leur article de 1992, Mankiw, Romer et Weil appliquent le principe suivant : la part des salaires découlant de l'investissement en capital éducatif est égale au quotient de la différence entre le salaire moyen et le salaire minimum dans l'industrie sur le salaire moyen. D'autres mesures sont praticables, toutes passent par une comparaison entre les salaires des non diplômés et le salaire moyen.
* 78 Travaux qui montrent que l'investissement éducatif aurait un rendement positif, compris entre 5 et 12 %.
* 79 Le « coin fiscalo-social » est composé des prélèvements directs sur un revenu donné, généralement le revenu salarial.
* 80 Sauf, considération fondamentale, si les dépenses en question débouchent sur une augmentation de production.
* 81 Celles qui concourent à la production non-marchande, c'est-à-dire l'ensemble des dépenses publiques en dehors des transferts monétaires.
* 82 L'expression « in base... » suivie d'une année désigne les différentes règles appliquées à la comptabilité nationale au fil du temps.
* 83 Public sector efficiency : an international comparison. Working paper n° 242. Juillet 2003. Afonso, Schuknecht, Tanzi.
* 84 Cette méthode est censée permettre aussi de déterminer, compte tenu d'un objectif donné de performances, le niveau maximum de dépenses publiques qu'un pays efficace ne devrait pas dépasser.
* 85 « Placer l'évaluation des politiques publiques au coeur de la réforme de l'Etat ». Rapport n° 392 du 30 juin 2004, de MM. Joël Bourdin, Pierre André et Jean-Pierre Plancade.
* 86 Ceux-ci correspondent à des segments de l'action publique mobilisant des crédits budgétaires étatiques. Cette dernière condition montre assez que l'ensemble de l'action publique, et de ses moyens, n'est pas couverte par la LOLF.
* 87 De tels objectifs étaient essentiels dans les politiques des années 60 et du début des années 70, ainsi qu'en témoignent la « Great Society » des États-Unis ou la « Nouvelle société » à la française.
* 88 Hypothèse dans laquelle il y aurait un effet redistributif de ces dépenses puisque l'addition d'un même avantage à des revenus inégaux réduit l'écart entre revenus.
* 89 Financeurs qui, par hypothèse, seraient limités alors à la population réunissant un revenu suffisant pour souhaiter accéder à ces « biens et services supérieurs ».
* 90 Les prestations ici considérées n'incluent pas les transferts sociaux en nature, en particulier ceux liés à la santé, et excluent les pensions dont la redistributivité est examinée plus loin.
* 91 Ici les allocations de chômage et les pensions de retraite.
* 92 Les inégalités de revenus peuvent être approchées par un coefficient dit de « Gini », qui est d'autant plus élevé que l'inégalité est forte (il prend une valeur comprise entre 0 en cas de distribution complètement égalitaire des revenus et 100 lorsqu'une seule personne dispose de la totalité du revenu)
* 93 Qui correspond à une valeur moyenne du coefficient de Gini, de l'ordre de 30.
* 94 En effet, on doit se souvenir que le revenu disponible brut ne prend pas en compte la totalité des contreparties de la dépense publique. En sont exclus les services publics (ce qu'il est convenu d'appeler les transferts en nature).
* 95 La coexistence du constat d'inégalités salariales plus élevées pour les salariés à temps plein et d'inégalités de revenus marchands plus faibles dans les mêmes pays peut paraître étonnante. Elle pourrait s'expliquer par plusieurs considérations. Les champs de mesure des inégalités sont différents : les revenus marchands incluent d'autres revenus que les salaires (en particulier, ceux du patrimoine) dont la distribution peut compenser la dispersion observée sur les salaires ; l'importance prise par le temps partiel peut varier si bien que les inégalités de salaires à temps plein peuvent être plus élevées sans que les inégalités salariales totales le soient pour autant.
* 96 Les développements qui suivent sont principalement tirés de l'étude « 1996-2006 : 10 ans de réformes du système de redistribution ». Amar, Laïb, Marical et Mirouse.
* 97 Et non sous conditions de ressources. Celles-ci étant d'un montant nettement moindre que les prestations familiales sans conditions de ressources, leur impact redistributif est plus faible en dépit d'une concentration sur les plus bas revenus plus forte.
* 98 Hors les dépenses de retraite dont la redistributivité est examinée au chapitre suivant.
* 99 La France occupe un rang élevé dans la hiérarchie des pays établie selon le niveau des dépenses de transferts sociaux. Or, il semble que moins les transferts publics sociaux sont importants plus ils sont concentrés sur les plus bas revenus.
* 100 Les éléments présentés ici reprennent, pour l'essentiel, les résultats d'une étude portant sur l'impact redistributif du système de retraite des salariés du secteur privé avant sa réforme par la loi de 2003 : « La redistribution intragénérationnelle dans le système de retraite des salariés du privé : une approche par microsimulation », Emmanuelle Walraet et Alexandre Vincent. Économie et statistique, n° 366 (2003).
* 101 La redistribution est « verticale » quand le mécanisme qui en est à l'origine avantage les revenus les plus modestes. Elle est « horizontale » lorsque deux personnes de même revenu retirent des avantages inégaux à raison d'autres caractéristiques que leurs revenus.
* 102 Qui s'applique moins à la France où l'universalité du régime de retraite est plus forte qu'ailleurs.
* 103 Devenu depuis le 1 er janvier 2006 : « Allocation spécifique aux personnes âgées (ASPA) ».
* 104 Sauf à imaginer que tout le resserrement de la distribution des revenus soit dû aux autres revenus perçus par les retraités, ceux du patrimoine, ce qui est peu envisageable puisque les inégalités de patrimoine sont beaucoup plus fortes que celles relatives aux autres revenus.
* 105 Des coups de pouce peuvent intervenir, laissés à l'arbitrage des conférences triennales.
* 106 Il existe dans les faits un lien étroit entre le degré d'universalité des systèmes de retraite par répartition et le développement d'autres formules de garantie contre le risque viager comme la capitalisation. Plus le premier est fort moins les formules alternatives sont développées. Mais, en théorie, on peut imaginer des systèmes universels reposant sur la capitalisation ainsi que des systèmes non universels basés sur la répartition.
* 107 Avec des performances toutes relatives comme le montre le haut niveau des taux de pauvreté des personnes âgées dans la plupart de ces pays.
* 108 Niveau de vie relatif à celui des actifs. Le niveau de vie des ménages tient compte de la taille des ménages selon la clef de pondération usuelle (une unité de consommation pour le premier adulte, 0,5 pour les personnes au-delà de 14 ans, 0,3 pour les enfants de moins de 14 ans) et inclut l'ensemble de leurs ressources (y compris celles tirées de leur patrimoine), sauf les loyers fictifs - c'est-à-dire l'équivalent monétaire de leurs logements par les propriétaires occupants.
* 109 La formule la plus exacte serait la suivante : « ... augmenté de la consommation des services ou des biens financés par des dépenses publiques ».
* 110 C'est-à-dire des revenus considérés hors les avantages liés à la consommation des services ou des biens publics.
* 111 Les remboursements ne proviennent pas uniquement des régimes obligatoires d'assurance-maladie. Ceux-ci couvrent en moyenne 76 % des dépenses de santé. Les remboursements assurances complémentaires (dont la couverture maladie universelle complémentaire - CMUC) couvrent quant à eux 13,5 % des dépenses.
* 112 Les quatre méthodes sont respectivement : méthode 1 : l'attribution à chaque ménage (ou individu) d'un même montant de dépense correspondant à la dépense publique moyenne de santé ; méthode 2 : l'attribution d'un montant de dépenses de santé variant avec l'âge et le sexe ; méthode 3 : l'attribution d'un montant de dépense de santé différencié selon l'âge, le sexe et le niveau de vie ; méthode 4 : l'attribution d'une dépense de santé variant avec la consommation effective de soin.
* 113 Les quatre méthodes sont respectivement : méthode 1 : l'attribution à chaque ménage (ou individu) d'un même montant de dépense correspondant à la dépense publique moyenne de santé ; méthode 2 : l'attribution d'un montant de dépenses de santé variant avec l'âge et le sexe ; méthode 3 : l'attribution d'un montant de dépense de santé différencié selon l'âge, le sexe et le niveau de vie ; méthode 4 : l'attribution d'une dépense de santé variant avec la consommation effective de soin.
* 114 Cette observation paraît contredite par le constat que les dépenses de soins sont croissantes quand le revenu décroît. Mais, cette objection doit être écartée dès lors que le système de santé prévoit un remboursement des consommations de soins. La variable revenu doit se voir attribuer une influence certaine sur la consommation de santé comme le montrent plusieurs données : l'importance inégale des cas de renoncement aux soins selon le revenu ; le moindre recours aux soins les moins bien remboursés par les personnes de condition modeste...
* 115 Toutefois, celle-ci n'est pas totale puisque l'état de santé paraît systématiquement corrélé avec le niveau de revenu.
* 116 Dont une partie est couverte, mais inégalement selon les ménages, par des assurances complémentaires.
* 117 Ces estimations ne tiennent pas compte de l'introduction des « franchises médicales » qui compte tenu de la distribution des dépenses de santé en fonction du revenu ont des impacts antiredistributifs incontestables.
* 118 La perception plutôt que l'état de santé est ici utilisée par simplicité et par ses propriétés prédictives de la consommation médicale.
* 119 Hors retraite
* 120 Avec un seuil de pauvreté égal à 50 % de la médiane des niveaux de vie des ménages.
* 121 Sentiment qui correspond sans doute partiellement à une réalité, puisque l'Etat est un tuteur social pour tous, mais qu'on devrait plutôt formuler en disant que l'Etat est social à la place de chacun étant donné qu'une partie essentielle de son rôle est d'organiser et de gérer la répartition temporelle de l'utilisation de leur revenu par les individus.
* 122 Domaines dans lesquels les niveaux de dépenses publiques sont particulièrement dispersés.
* 123 La politique familiale n'échappe pas complètement à cette logique même si elle est plus nettement redistributrice qu'assurantielle.
* 124 Voir les réflexions en cours, notamment au sein de votre délégation pour la planification, sur l'évaluation des universités.
* 125 Observatoire français des conjonctures économiques.
* 126 Organisation de coopération et de développement économiques.
* 127 Institut national de la statistique et des études économiques.
* 128 Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.
* 129 Direction générale de la recherche et de l'innovation.
* 130 Même s'il y a tout lieu de penser que celle-ci n'est pas sans lien avec la croissance économique du pays concerné.
* 131 L'investissement des administrations publiques est très loin de rendre compte de la contribution des dépenses publiques à l'investissement économique qui, pour l'essentiel, est recensé dans les rubriques de dépenses dites de fonctionnement. Une fraction importante de l'augmentation du poids des dépenses publiques dans le PIB peut être attribuée à un effort renforcé des administrations publiques dans la production d'investissement économique.
* 132 Soit la contribution des Etats au budget européen assise sur le niveau de leur PIB.
* 133 Et sur le niveau apparent des prélèvements obligatoires.
* 134 C'est tout particulièrement vrai dans le cas des dépenses de protection sociale, surtout quand on analyse différentes situations nationales.
* 135 En effet, quand on rapporte les dépenses publiques nécessaires à la production du PIB, il y a neutralisation entre le numérateur et le dénominateur.
* 136 Rapport des coûts de main d'oeuvre par unités produites.
* 137 Soit le rapport entre l'ensemble des revenus non salariaux des retraités et des revenus d'activité.
* 138 Ces exemptions fiscales représenteraient 150 milliards de dollars, soit 1 point du PIB des États-Unis.
* 139 Au contraire, puisque les exemptions fiscales accordées aux entreprises contribuent à réduire le taux de prélèvements obligatoires, de 1 point de PIB.
* 140 Il est intéressant de le relever quand l'extension de l'assurance privée est parfois avancée comme une solution pour infléchir la progression des dépenses de santé.