5. Rémy PRUD'HOMME43 ( * ) : « Le biais anti-urbain dans les pays en développement »44 ( * )
Septembre 2008
Dans les pays développés, et en particulier en France, la crainte et la détestation de la ville ont nourri un courant intellectuel, médiatique et politique fort qui est assez bien connu. Ce qui l'est moins, mais qui n'est pas surprenant, c'est que ce courant a en quelque sorte déteint sur les pays en développement. La vision du développement, et en conséquence les politiques de développement et surtout d'aide au développement, témoignent du même biais anti-urbain. La Figure 1 présente schématiquement, pour les pays en développement, les liens entre l'idéologie anti-urbaine, les politiques des Etats et l'aide internationale.
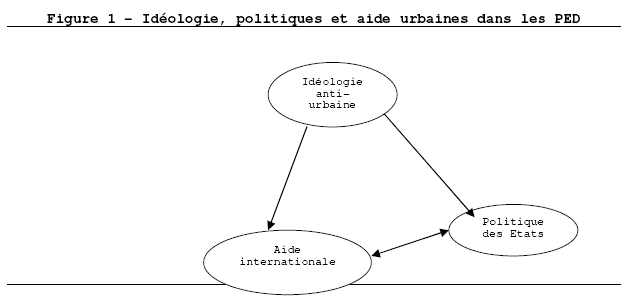
Cette brève communication explore ces thèmes sur un mode principalement économique, et montre combien, comment et pourquoi la ville a été largement absente des analyses du développement, des politiques des pays en développement et de l'aide internationale au développement.
La ville absente des théories du développement
Les politiques sont souvent (toujours, disait Keynes) inspirées par des corpus analytiques ou théoriques, sinon par des idéologies. Le domaine du développement économique n'a pas échappé à cette règle. Quelle a été la place de la ville dans les théories de la croissance ? Elle a été négligeable. Il serait sans doute excessif de parler ici d'idéologie anti-urbaine, mais la méfiance n'est jamais très loin de l'ignorance, ni le boycott de la méfiance.
L'intérêt des économistes pour la croissance et le développement est très récent, pour bizarre que cela puisse paraître. Certes, cet intérêt est au coeur de la pensée d'Adam Smith, à la fin du 18ème siècle. Il est déjà bien moins présent chez Ricardo ou chez Marx, qui se préoccupent surtout de répartition, dans la première moitié du 19ème siècle. Il va disparaître complètement avec Walras, Pareto, Marchal et même Keynes qui ne s'intéressent qu'à l'équilibre général et aux crises temporaires, jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale. La plus grande partie des hommes vivaient dans la misère, et les économistes ne se posaient pas la question de savoir pourquoi, ni comment les en sortir. A la conférence de Bretton Woods, en 1944, où l'on crée simultanément le FMI pour les monnaies et la Banque Mondiale pour le développement, ce qui compte surtout c'est le FMI. Keynes lui-même, qui joua à Bretton Woods un rôle éminent, écrit : « On a invité vingt-et-un pays [il cite la Colombie, les Philippines, le Pérou, l'Iran, etc.] qui n'ont clairement rien à contribuer et vont seulement nous embarrasser » ; il n'est pas loin de considérer le souci du développement et des pays qu'on n'appelle pas encore en voie de développement, qui justifie la Banque Mondiale, comme un caprice du Président Roosevelt.
La fin de la guerre marque cependant le début d'un intense effort de réflexions, d'analyses, et de théories sur les pays pauvres et sur la croissance. Les nouvelles institutions internationales, la Banque Mondiale et plus encore peut-être les Nations Unies, jouèrent un rôle crucial en envoyant dans ces pays des missions d'études puis des missions d'assistance technique (surtout à la planification, curieusement perçue comme une panacée) qui fournirent du grain à moudre aux théoriciens. En moins de vingt ans, des penseurs comme Albert Hirschman, Arthur Lewis, Gunnar Myrdal, Paul Rosenstein-Rodan, Raul Prebish ou Jan Tinbergen, qui avaient tous fait « du terrain », jetèrent les bases d'une théorie du développement3. Trente ans plus tard, la Banque Mondiale a eu la belle idée de demander à dix de ces « pionniers4 » d'écrire un article présentant et commentant leurs contributions de l'époque, et d'en faire un livre passionnant (Meier, 1984).
Au moins trois d'entre eux furent ultérieurement récompensés par un prix Nobel d'économie ; l'un d'eux, Gunnar Myrdall, a même obtenu deux prix Nobel : un prix Nobel de la paix et un prix Nobel d'économie. La liste inclut également Lord Bauer, Colin Clark, Walt Rostow, et Hans Singer. On notera qu'aucun véritable Américain ne figure dans cette liste (Hirschman et Rosenstein-Rodan sont bien devenus citoyens américains, mais ils étaient d'origine, de formation et de culture européennes).
Simultanément, principalement aux Etats-Unis, des auteurs comme Harrod, Domar, Solow développaient des théories de la croissance qui visaient les pays alors développés mais qui étaient suffisamment générales pour s'appliquer à des pays qui ne l'étaient pas. Paradoxalement, leur inspiration venait en partie de Keynes dont la théorie de la demande globale avait contribué à faire naître la comptabilité nationale et la notion de PIB (produit intérieur brut) qui permettait pour la première fois de mesurer la croissance.
Ces deux courants, cependant, furent totalement aspatiaux. Les concepts et les chiffres utilisés se rapportent uniquement à des pays. On s'intéresse au travail, au capital, à l'accumulation, à l'épargne, à la consommation, à l'investissement, aux importations, aux prix, à l'industrialisation, etc., jamais aux villes ou aux campagnes. Dans le livre de Meier (qui a un index), le mot « ville » n'apparaît pas, et le mot « urbanisation » est cité deux fois seulement, par Rosenstein-Rodan, et par Lewis, et ce dernier ne l'utilise que pour en dire : « c'est un processus coûteux ». Par contraste, le mot « agriculture » est cité près de cinquante fois. L'analyse des premiers manuels consacrés aux pays en développement (Lewis 1955, Bauer & Yamey 1957) conduit à la même conclusion.
D'une vision sans ville à une vision anti-ville, il n'y a qu'un pas, qui fut assez vite franchi. Pour être plus précis, ce fut une vison pro-campagne, ou plus exactement une vision pro-agriculture, qui prévalut. Tout y préparait les pays développés, les institutions internationales et (par un processus d'imitation) les pays en développement eux-mêmes.
Premièrement, il est vrai que la très grande majorité des travailleurs étaient dans les zones rurales et que l'essentiel de la production était réalisé dans ces zones. Le bon sens suggérait qu'il fallait d'abord faire porter l'effort sur cet essentiel-là, c'est-à-dire sur l'agriculture et la campagne. L'agent du développement, c'était l'ingénieur agronome. Chez René Dumont, le plus célèbre des « développementalistes » français, si « l'Afrique noire est mal partie » (1962), c'est parce qu'elle ne s'occupe pas assez de ses campagnes. Pour Myrdal dans son célèbre An Asian Drama (1968) si l'Asie peut s'en sortir --ce dont il doute fort-- c'est par une redistribution des terres agricoles5.
Le bon sens avait tort. En réalité, la productivité (la production par travailleur) des campagnes était bien plus faible que celle des villes. Un travailleur qui quittait la terre pour aller travailler en ville 5 et, soyons juste, par une planification de type soviétique : comme quoi les meilleurs esprits peuvent se tromper. 4 augmentait ipso facto sa production (et son revenu), et donc le PIB du pays. Le tableau 1 le montre d'une façon simplifiée mais suggestive. En T1, 80% des actifs sont dans les campagnes. Entre T1 et T2, 20% des actifs quittent la campagne pour aller dans les villes, où leur productivité est plus élevée, trois fois plus élevée par hypothèse. Le simple fait de cette migration a pour conséquence une augmentation de la production de près de 30%.
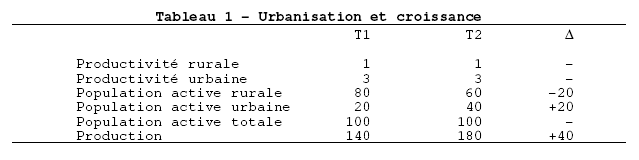
Bien entendu, on peut, et même on doit, compliquer ce modèle en prenant en compte une augmentation de la population et une augmentation des deux productivités, et aussi en considérant des productivités marginales plutôt que des productivités moyennes. Mais la conclusion n'en serait pas substantiellement affectée : l'urbanisation est un facteur de croissance. Les paysans pauvres qui abandonnent la campagne pour aller en ville, ont bien compris ce mécanisme. Les économistes du développement des années 1950-60 ne l'avaient pas compris. L'expérience l'a bien montré. Le développement économique des pays sans ressources a été celui de leurs villes. Les cas de Hong- Kong et Singapour, des villes-Etats, sont parlants et connus. Mais le développement rapide de la Corée, ou de la Thaïlande, est d'abord celui de Séoul, et de Bangkok.
Deuxièmement, la faim et la menace de la famine étaient alors des problèmes majeurs et concrets : en Afrique, en Chine, en Inde, au Brésil, la malnutrition était très répandue, et le souvenir de famines dévastatrices dans tous les esprits. Le livre célèbre de Josue de Castro, Géographie de la faim, date (en portugais) de 1946. La famine du Bengale en 1947 tue trois millions de personnes. La FAO (dont Josue de Castro fut directeur au début des années 50) apparaissait alors comme une institution bien plus importante que la Banque Mondiale. Beaucoup prévoyaient le développement et la généralisation des famines. Dans des pays comme la Corée (du Sud), où beaucoup des leaders avaient personnellement souffert de la faim, la production agricole avait un caractère presque sacré, et devait passer avant toute autre considération. Ce souci était très largement partagé, et explique en partie la focalisation des politiques de développement et d'aide sur la production agricole. Dans le même ordre d'idée, la peur de voir l'urbanisation consommer de la terre agricole et réduire la production était (et reste) très répandue.
En réalité ces craintes étaient très exagérées. La faim a largement et régulièrement reculé. Les famines ne sont plus guère aujourd'hui causées que par des guerres ou des politiques. Amartya Sen, prix Nobel d'économie, a d'ailleurs très bien montré dans un beau livre de 1981 que les famines indiennes étaient bien davantage dues aux inégalités provoquées par les mécanismes de distribution de la nourriture qu'au manque de nourriture à proprement parler -- qu'elles sont une affaire de villes autant qu'une affaire de campagne. La crainte nourrie par la consommation de terre agricole est également un fantasme : à l'exception de quelques zones d'Asie, comme Java par exemple, les espaces urbanisés représentent une part très faible des terres cultivables, sans commune mesure avec les progrès des rendements agricoles.
Ces grandes craintes ont cependant perduré, et perdurent encore dans l'esprit de beaucoup de décideurs ou d'électeurs. C'est ainsi par exemple qu'en 1968 Paul Erlich, dans The Population Bomb), prévoyaient pour les vingt années suivantes des centaines de millions de morts dues à la famine. L'absurdité de la thèse n'a pas empêché le livre d'avoir un retentissement mondial.
Troisièmement, il n'est pas interdit de penser que dans les années cinquante un certain nombre de décideurs, dans les pays développés, préféraient cantonner les pays en développement dans le rôle de fournisseurs de matières premières, notamment agricoles, plutôt que de les voir devenir des concurrents industriels. Il est vrai que beaucoup d'autres acteurs, à commencer par les institutions des Nations-Unies, notamment en Amérique Latine, influencés par l'expérience soviétique (alors très largement considérée comme un succès économique) prônaient l'industrialisation. Mais nombreux étaient ceux qui préféraient l'industrialisation dans les campagnes, ou dans les villes petites et moyennes, plutôt que dans les grands centres.
Toujours est-il que l'idée d'un développement d'abord axé sur l'agriculture et les campagnes a été, et reste en partie, largement dominante. De l'accélération du développement des campagnes au freinage du développement des villes, il n'y a pas loin. L'idéologie dominante n'a peut-être pas été directement anti-urbaine, mais elle l'a été indirectement, par son ignorance de la ville et par sa prédilection pour le rural.
La ville absente des politiques des Etats
Dans les vingt années qui suivent la fin de la guerre, la plupart des pays en développement qui n'étaient pas indépendants le deviennent. Les politiques qu'ils engagent sont bien entendu contraintes ou orientées par le poids du passé, parfois par des interventions des pays 6 riches, et dans le domaine qui nous concerne par les idées dominantes que l'on vient d'évoquer et par l'assistance internationale. Le fait est que ces politiques ont explicitement préféré la campagne à la ville, et freiné ou cherché à freiner l'urbanisation.
Cette attitude est particulièrement évidente dans les deux plus grands pays en développement : l'Inde et la Chine. Ghandi, le père fondateur de la démocratie indienne, était ouvertement et explicitement anti-urbain. Son idéal était le développement du village par le développement agricole et par l'industrialisation rurale. Le rouet en était le symbole. Tous les plans quinquennaux indiens ont donné la priorité au développement des zones rurales. Certes, cette tendance était combattue par l'attirance du modèle soviétique et de son industrie lourde, toujours forte en Inde. Mais, dans cette grande démocratie, le poids des électeurs ruraux pesait lourd, et influençait les choix. Ce phénomène continue de se vérifier. L'Inde est un pays où le pouvoir et les ressources sont concentrés au niveau des Etats, avec des collectivités locales faibles. En fait, la plupart des grandes villes sont constituées en « corporations », dirigées par des « commissioners » nommés par le gouvernement de l'Etat. C'est par exemple le cas à Bombay (maintenant Mumbai), où l'agglomération de 23 millions d'habitants se compose principalement de 4 ou 5 « corporations ». L'Etat du Maharasthra où se trouve Mumbai comprend 100 millions d'habitants, et l'intérêt politique du gouvernement du Maharasthra est de soigner d'abord ses électeurs qui sont en majorité ruraux. Les impôts prélevés à Mumbai servent donc à financer le développement de ces zones rurales plutôt que l'aménagement de Mumbai. La migration vers les villes était vue comme un mal à combattre ou du moins à prévenir. L'idée qu'on pouvait y parvenir en brimant les villes dominait. A Mumbai, par exemple, on a imposé des coefficients d'occupation des sols (rapport des surfaces construites sur une parcelle à la surface de cette parcelle) de 1, particulièrement bas, dans le but explicite d'empêcher les migrants de venir dans la ville : s'il n'y a pas de logements, les migrants ne pourront pas venir. Le résultat a été la dégradation des conditions de logement : Bombay, la ville la plus riche de l'Inde, est la ville où la surface bâtie par habitant est la plus petite (4 m2). Ces politiques n'ont pas empêché l'urbanisation, mais elles l'ont freiné. L'Inde, en dépit de quelques mégalopoles comme Mumbai, reste un pays relativement peu urbanisé. Le taux d'urbanisation reste inférieur à 30%.
Le cas de la Chine est également intéressant. Mao n'a pas accédé au pouvoir en s'appuyant sur le prolétariat urbain, mais bien à la suite d'une « longue marche » dans les campagnes chinoises, porté par une armée de paysans chinois. Il avait beau, à titre personnel, mépriser les paysans, il se méfiait également des urbains. La Chine a donc mis en oeuvre une politique anti-immigration urbaine particulièrement sévère. Cette politique a notamment reposé sur deux piliers : le système des youkous, et l'industrialisation rurale.
Chaque Chinois est titulaire d'un youkou ou carnet d'identité qui indique son lieu de naissance. En principe, il doit vivre et mourir là où il est né, un peu comme un serf attaché à sa glèbe. En pratique, le titulaire d'un youkou rural peut parfois obtenir l'autorisation, plus ou moins temporaire et révocable, de venir travailler dans une ville. Mais il y fait l'objet d'une discrimination considérable et officielle : certains métiers, par exemple, lui sont en droit et pas seulement en fait interdits ; l'accès aux écoles, gratuit pour les enfants dont les parents ont un youkou urbain, est payant pour les enfants dont les parents ont un youkou rural. En pratique aussi, un certain nombre de paysans vont illégalement dans les villes où ils sont comme des immigrés clandestins. Depuis une dizaine d'année, le système s'est assoupli sensiblement. Les villes, surtout les villes de l'Est et du Sud-Est qui ont besoin de main d'oeuvre, ont accordé plus généreusement des dérogations ou même des youkous urbains, et certaines ont réduit ou éliminé les discriminations. Le système a été décentralisé, mais il n'a jamais été formellement aboli.
Du temps de la planification, qui connut ses hauts fourneaux miniature, et peut être plus encore à partir de 1980 lorsque la Chine s'ouvre au capitalisme, la politique a mis l'accent sur l'industrialisation des campagnes. L'emploi dans les TVE (Township and Village Enterprises) passe de 28 millions en 1978 à 135 millions en 1998, pour décliner ensuite.
Ces politiques ont porté des fruits, en ce sens que la Chine, contrairement à une idée très répandue en Occident, est longtemps restée et reste encore un pays avec un taux d'urbanisation faible : 20% en 1980, un peu plus de 40% aujourd'hui. On y trouve des provinces de plus de 100 millions d'habitants avec des capitales de 3 ou 4 millions d'habitants seulement.
Le cas des Khmers rouges vidant Phnom-Penh de sa population est évidemment et heureusement un cas limite, et unique (encore que le nombre des personnes chassées de Ho-Chi Minh Ville n'a guère été inférieur au nombre des personnes chassées de Phnom-Penh). Mais il illustre ou caricature l'attitude anti-urbaine --ou si l'on préfère pro-rurale-- qui a prévalu dans la plupart des pays en développement. Dans beaucoup de pays d'Afrique ou d'Amérique Latine, cette attitude a été moins marquée qu'en Asie, ou mise en oeuvre avec moins de vigueur, et les taux d'urbanisation sont bien plus élevés. Mais cette urbanisation n'a nulle part été voulue et organisée ; elle a été au contraire partout subie.
Comme l'écrit Paul-François Yatta en conclusion d'un chapitre sur l'histoire des politiques et des pratiques urbaines en Afrique: « Force est de constater que le développement économique a été largement absent des politiques urbaines quand elles existent. Dans aucune de ces stratégies urbaines n'a été mis en oeuvre le nécessaire fonctionnement des villes pour une contribution optimum au développement économique national. [...] Les villes ont été le lieu de politiques d'éradication des manifestations « négatives » de l'urbanisation (pauvreté, criminalité, congestion, chômage, etc.), sans plus. C'est probablement ce qui explique pourquoi le financement de l'urbanisation en Afrique a, peut-être plus que partout ailleurs, souffert de l'effet « biais urbain » et ce au moment où les villes de ce continent subissent les pressions migratoires les plus fortes et ont donc le plus besoin d'investir » (Yatta 2006 p.99).
La ville absente des politiques d'aide au développement
Au cours des cinquante dernières années, les pays en développement ont bénéficié, de la part des pays riches, d'une assistance massive. William Easterly (2006, p. 11) qui porte un jugement critique sur cette assistance en évalue le montant cumulé à 2,3 trillions de dollars, à peu près le PIB de la France. Cette assistance qui prend de multiples formes (dons en nature ou en argent, prêts à taux réduit, assistance technique, etc.) provient principalement de trois sources. La première est l'aide bilatérale, accordée par les gouvernements des pays riches, qui ont généralement créé des agences spécifiques à cet effet : USAID aux Etats-Unis, GTZ en Allemagne, AFD en France, DFID en Grande Bretagne), CIDA au Canada, JICA au Japon, SIDA en Suède, DANIDA au Danemark, etc. La seconde est l'aide multilatérale, accordée par les institutions des Nations-Unies au niveau mondial ou régional : PNUD, Banque Mondiale, FMI, FAO (alimentation), OMS (santé), UNESCO (culture), ONUDI (industrie), PNUE (environnement), UN-Habitat (établissements humains), Banque Asiatique pour le Développement, Banque Interaméricaine pour le Développement, Banque Africaine de Développement, etc. La troisième est l'aide apportée par des centaines ONG nationales ou internationales, comme Médecins sans Frontières ou Oxfam. Une quatrième source se développe actuellement, sous le nom (en France) de coopération décentralisée : l'assistance apportée par des municipalités ou des régions de pays riches à des municipalités ou des régions de pays en développement ; mais son importance, mal recensée, reste encore faible.
Dans ce dispositif complexe, un rôle crucial est joué par la Banque Mondiale. Parce qu'elle pèse lourd en termes de budget, parce qu'elle est la moins politisée de toutes ces agences (recrutements et promotions s'y font au mérite, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des autres institutions), parce qu'elle a toujours accordé de l'importance aux idées, aux analyses, aux recherches et aux publications, la Banque Mondiale fait figure de leader. Elle fait plus que l'UNESCO en matière d'éducation ou plus que le PNUE en matière d'environnement, et probablement plus que la FAO en matière d'agriculture.
Il n'est pas facile d'apprécier la place de l'urbain dans tous ces programmes d'aide, mais on peut affirmer qu'elle est faible.
Tout d'abord, on note qu'au niveau multilatéral, il n'existe pratiquement pas d'institution spécialisée dans les villes. Ce qui y ressemble le plus est Habitat une institution des Nations-Unies située à Nairobi. Mais Habitat a toujours pris soin de souligner que son mandat concernait les « établissements humains » en général, y compris ceux qui sont dans les campagnes, plutôt que les villes. Et Habitat est toujours restée une petite institution, avec un personnel limité, des moyens faibles et un rôle effacé. Il y a une quinzaine d'années, Habitat a même failli disparaître, absorbée par le PNUE (également situé à Nairobi), et ne s'est sauvée que par l'organisation d'une conférence à grand spectacle sur les établissements humains (à Istambul, en 1996).
Dans les grandes institutions, l'urbain n'est pas ou est peu représenté dans les organigrammes et les structures. La Banque Mondiale, par exemple, est structurée en vice-présidences et régionales et thématiques, dont l'articulation a changé au cours des années. Actuellement, on a par exemple quatre viceprésidences thématiques qui reflètent les priorités de l'institution : développement soutenable, développement humain, réduction de la pauvreté, développement du secteur privé. Les vice-présidences régionales (Amérique Latine, par exemple), sont elles-mêmes structurées en sous-régions et en départements thématiques (agriculture, infrastructure, etc.). L'urbain a été largement absent de ces structures. Il y a bien eu un temps une division urbaine, à l'intérieur d'un département infrastructure, dans une vice-présidence générale, mais elle est restée modeste ; cette unité a été récemment déplacée dans un département intitulé : Fiscal, Economics and Urban Development, où elle n'aura sans doute pas une place centrale. Certaines des vice-présidences régionales ont également de petites unités urbaines. Mais globalement, l'urbain ne pèse pas bien lourd. Un système de référencement des agents de la Banque indique (en 2007)115 personnes affectées au secteur « urbain », contre 300 10 personnes affectées au secteur « agriculture et développement rural ».
L'urbain n'apparaît guère dans les objectifs de l'aide. Cela est vrai de l'aide multilatérale, plus vrai de l'aide bi-latérale, et encore plus vrai de l'aide des ONG. Pour la Banque Mondiale, les objectifs de l'aide sont précisés pays par pays tous les quatre ou cinq ans dans des documents de stratégie appelés CAS (Country Assistance Strategy), consultable sur internet. Prenons par exemple le CAS du Pakistan pour la période 2003-2005 -- qui concerne une aide d'environ 1 milliard de dollars par an. Il comporte trois grande priorités : (i) le renforcement de la stabilité macroéconomique et de l'efficacité publique, (ii) le renforcement du climat des investissements, et (iii) l'assistance aux politiques d'aide aux pauvres et aux femmes. Le texte indique explicitement que « le groupe Banque mondiale gardera un niveau bas d'engagement dans les domaines dans lesquels le client est peu réformateur (« reform-shy ») tels que le développement urbain ou le transport ». Pour l'aide bilatérale, on trouvera également un énoncé des priorités dans les rapports annuels que publient les agences. Le dernier rapport de DANIDA indique ainsi les cinq priorités de l'aide danoise : (i) les droits de l'homme, (ii) la stabilité et la sécurité, y compris la lutte contre le terrorisme, (iii) l'aide aux réfugiés et aux victimes des catastrophes, (iv) l'environnement et (v) le développement économique et social focalisé sur l'éducation et la santé.
Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les priorités de l'aide excluent largement l'urbain. Ces priorités reflètent à la fois la demande des pays pauvres et l'idéologie des pays riches. Les pays pauvres sont peu demandeurs, on l'a vu, de développement urbain. L'idéologie des pays riches ne fait pas grand cas du développement urbain. Les opinions publiques des pays riches n'en voient guère la nécessité ou l'intérêt. Elles sont au contraire très sensibilisés à des problèmes (qu'il ne s'agit pas ici de minimiser) comme l'environnement, les droits de l'homme, ou les catastrophes. Plus un pays riche reflète le demande de ses citoyens, plus il consacre son assistance à ces problèmes, et moins il la consacre au développement des villes des pays pauvres. Les gouvernements des pays scandinaves, très à l'écoute de leurs opinions, où la dépense publique est étroitement contrôlée par les Parlements, et qui sont d'ailleurs les plus généreux en matière d'aide au développement, sont naturellement ceux font le moins pour le développement urbain. Ce trait est poussé à la caricature dans le cas des ONG. Comme leurs ressources dépendent directement de la générosité de leurs donateurs, les ONG sont bien obligées, à peine de disparition, de faire porter leurs aide sur les secteurs qui correspondent aux priorités ou aux émotions de ces donateurs. Le développement urbain est11 de ce point de vue moins porteur que la protection de l'environnement ou la réparation des dommages d'un tsunami. En d'autres termes, plus les organisations d'assistance sont proches de l'opinion publique (certains diraient : démocratiques), et moins elles consacrent leurs ressources aux viles des pays en développement. La part de l'urbain est plus importante à l'AFD qu'à Médecins du Monde, et plus importante à la Banque Mondiale qu'à l'AFD. Mais elle est faible partout. Le rapport de politique de la Banque Mondiale de 2000 (World Bank 2000) estime que les opérations de prêts relatives à des opérations de développement urbain de la Banque ont représenté de 3 à 7% du total des prêts de la Banque au cours de la période 1970-2000. Même si ce pourcentage augmente actuellement, il est faible. Nous n'avons pas les chiffres comparables pour les autres institutions internationales et pour l'aide bilatérale ; mais tout porte à croire qu'ils seraient encore plus faibles.
On illustrera ce que ce propos peut avoir de général en prenant le cas de l'assistance à la Bolivie (Prud'homme et al. 2000). Le pays le plus pauvre de l'Amérique du Sud a longtemps été (depuis trois ans, la manne gazière dont il bénéficie a changé la donne) très dépendant de l'aide internationale (environ 100 millions de dollars par an), qui assurait une bonne partie des investissements publics, principalement par l'intermédiaire de trois « Fonds ». Environ 80% des ressources de ces fonds venaient de l'aide multilatérale (Banque Interaméricaine et Banque Mondiale). Les critères d'allocation sectorielle et géographique de ces fonds étaient décidés conjointement par le gouvernement et par les donneurs, mais le rôle de ces derniers et de leurs priorités était considérable. Où a été l'aide et à quoi a-t-elle servi ? La répartition sectorielle montre qu'elle a eu des objectifs sociaux plus qu'économiques : les trois secteurs sociaux que sont la santé, l'éducation et l'eau/assainissement ont représenté dans la période 1995-98 les trois-quarts des investissements totaux. Le développement urbain a compté pour 5%. Ces fonds n'ont pas contribué à renforcer les municipalités (ce qui est une façon de renforcer les villes) : les investissements réalisés l'ont été pour les municipalités plutôt que par elles. Enfin, un biais antiurbain dans les procédures d'allocation a conduit à un surinvestissement relatif dans les zones rurales et à un sous-investissement relatif (et absolu) dans les zones urbaines. Le tableau 2 le montre bien sur le cas des écoles. Les investissements en classes (au sens de bâtiments) ont tellement privilégié les zones rurales que l'équipement de ces zones est maintenant deux fois plus important (par élève) que l'équipement des villes. Plus la ville est grande, moins elle est équipée. La situation est d'autant plus absurde que les migrations campagnes-villes sont importantes en Bolivie, et aggravent d'année en année cette disparité considérable.
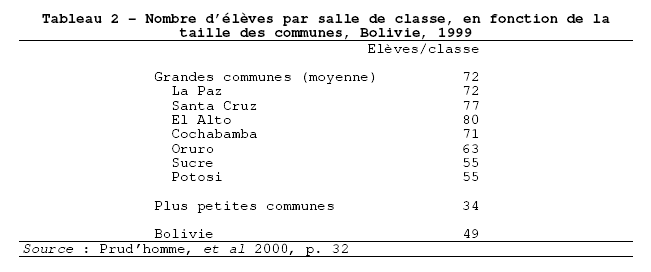
Deux observations peuvent être ajoutées. La première est que l'absence d'une prise en compte explicite et organisée des villes dans l'aide au développement ne signifie pas qu'aucune aide n'a été apportée aux habitants des villes. Dans la mesure où une part croissante de la population des pays en développement réside dans les villes, il va sans dire que des politiques d'aide à la santé, ou aux infrastructures, ou aux femmes, ou aux pauvres, bénéficient -- indirectement et involontairement en quelque sorte -- aux habitants des villes. La seconde est qu'il serait très excessif de dire que la Banque Mondiale a ignoré le développement urbain dans ses efforts de recherche et de réflexion. Sa production analytique est si considérable qu'elle n'a pas pu passer à côté d'un phénomène aussi important. Elle a par exemple joué dès les années 1970 un rôle pionnier dans la connaissance des finances locales des pays en développement qui a donné lieu au beau livre de Bahl et Linn (1992), et dans la réflexion sur la décentralisation. Un certain nombre de « documents de politique » ont été publiés, sur les transports urbains ou sur les problèmes fonciers, ou sur les problèmes urbains en général, notamment en 1991 et en 2000. La banque organise également depuis 2002 d'importants « symposiums de la recherche urbaine ». En fait, aucune autre institution internationale n'a réfléchi et produit autant sur la ville. Mais relativement à l'ensemble des analyses et des publications de la Banque, tout cela n'est pas grand chose. De plus, on peut presque dire que cet effort a été le fait d'individus agissant plus ou moins en franctireurs, plutôt que de l'institution dans son ensemble. Si l'on considère les contributions-phares de la Banque que sont les Rapports sur le Développement dans le Monde (RDM ou WDR en anglais), qui traitent en profondeur chaque année d'un thème (comme l'environnement ou la pauvreté), on voit que les politiques urbaines y occupent peu de place.
Entre autres, l'auteur a été invité comme « visiting research fellow » pour travailler sur ce thème (Prud'homme 1995)
Ces rapports, dont l'auteur principal était Johannes Linn, y était consacré7. Il faut attendre le rapport de 1999, dont l'auteur principal était Shahid Yusuf, pour voir un RDM donner une place importante -- le tiers -- au développement urbain. En trente ans, cela ne fait pas beaucoup.
Le RDM de 2009, préparé sous la direction d'Indermit Gil, marque sans doute une inflexion. Il est intitulé « Repenser la géographie économique » et consacré à la dimension spatiale du développement. Il ne peut pas ignorer le rôle positif des villes, et souligne au contraire l'importance de leur contribution reconnaissant explicitement qu' «aucun pays ne s'est développé sans s'appuyer sur la croissance de ses villes » (p. 48). On sent à le lire que cette reconnaissance a fait l'objet de débats internes à l'institution. Les rédacteurs apparaissent souvent sur la défensive, et se sentent obligés de répondre par avance à des critiques qui ont été ou qui seront formulées. Ils introduisent, par exemple, un encadré au titre éloquent : « les messages politiques de ce Rapport sont-ils anti-ruraux ? Non » (p. 200). Et se sentent obligés de préciser que « la migration vers la densité économique constitue une voie de sortie de la pauvreté tant pour ceux qui se déplacent effectivement que pour ceux qui restent derrière » (p. 48). Le message est un peut-être un peu tardif, mais il est assez clair.
Conclusion
La ville n'a pas seulement été mal-aimée dans les pays riches. Elle l'a aussi été dans les pays en développement. Les économistes qui ont, dans la période de l'après-guerre, jeté les bases des théories de la croissance, ont complètement ignoré le rôle potentiel des villes. Leurs analyses et leurs préconisations ont influencé, avec les préjugés anti-urbains ambiants, à la fois les politiques menées par les pays pauvres et l'aide que leur apportaient les pays riches. Le développement des pays pauvres en a sans doute été retardé. Le coût en souffrance et en misère des biais anti-urbains ainsi introduits par ces préjugés et ces analyses est difficile à estimer, mais il est sans doute considérable.
Avec le temps, au fur et à mesure que l'urbanisation progressait et qu'une part croissante - majoritaire dans beaucoup de pays du tiers-monde - de la population vivait dans des villes, ce préjugé anti-urbain s'est un peu atténué. Dans les organisations internationales et dans l'aide bilatérale l'ostracisme qui frappait les projets urbains a diminué. Mais il n'a pas disparu. En 2007, Mme Anna Tibaijuka, la responsable d'Habitat, qui a rang de Secrétaire Général Adjoint de l'ONU, parle encore « de l'urbanisation excessive des grandes villes » (qui serait selon elle « au coeur de la problématique du changement climatique »). Habitat, rappelons-le, est l'organisation des Nations-Unies chargée de l'urbain ! Et ce parti-pris anti-urbain continue sûrement à faire beaucoup de dégâts.
Références
Bahl, Roy & Johannes Linn. 1992. Urban Public Finance in Developing Countries. New York. Oxford University Press. 425p.
Bauer, Peter & Basil Yamey. 1957. The Economics of Under- Developed Countries. Chicago. The University of Chicago Press.271p (Cambridge Economic Handbooks)
Dumont, René. 1962. L'Afrique noire est mal partie. Paris. Le Seuil. 287p.
Easterly, William. 2006. The White Man's Burden. New York. The Penguin Press. 436p.
Lewis, Arthur. 1955. The Theory of Economic Growth. Homewood, Ill. Richard Irwin. 453p.
Meier, Gerald & Dudley Seers. 1984. Pioneers in Development. Washington & Oxford. The World Bank and Oxford University Press. 372p.
Prud'homme, Rémy , Hervé Huntzinger & Sonia Guelton. 2000. (rapport préparé pour la Banque Interaméricaine de Développement. Decentralization in Bolivia. Multigraphié. 77p.
Prud'homme, Rémy. 1995. The Dangers of Decentralization. The World Bank Research Observer, vol 10, n°2, pp.201-220
Yatta, François-Paul. 2006. Ville et développement économique en Afrique. Paris. Economica.313p.
* 43 Professeur émérite, Univ. Paris XII ( prudhomme@univ-paris12.fr
* 44 Communication au colloque « Ville mal aimée, ville à aimer », Cerisy, Juin 2007)







