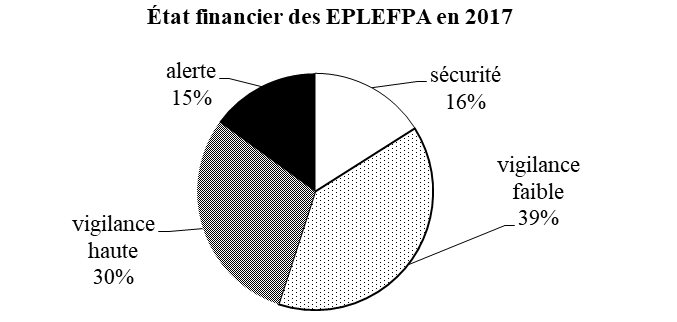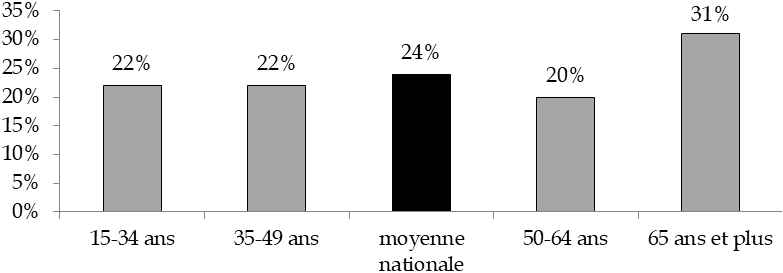Rapport d'information n° 667 (2019-2020) de Mme Catherine MORIN-DESAILLY , fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 22 juillet 2020
Disponible au format PDF (3,1 Moctets)
-
CONCLUSIONS DES GROUPES DE TRAVAIL CHARGÉS
D'ÉTUDIER LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE COVID-19
-
I. CRÉATION
-
A. PARER À L'URGENCE
-
B. FACILITER LA RELANCE DE L'ACTIVITÉ
-
C. AMÉLIORER L'EXERCICE DE LA
COMPÉTENCE CULTURELLE
-
A. PARER À L'URGENCE
-
II. PATRIMOINE
-
A. LE SPECTRE D'UNE CRISE DURABLEMENT
ANCRÉE
-
B. LES PRÉCONISATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL
POUR PRÉSERVER LA DYNAMIQUE EN MATIÈRE DE PROTECTION DU
PATRIMOINE
-
A. LE SPECTRE D'UNE CRISE DURABLEMENT
ANCRÉE
-
III. ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
-
A. LA DÉCISION DE ROUVRIR LES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET LES ÉCOLES À PARTIR DU 11 MAI
: UNE ANNONCE SURPRISE, AUX MODALITÉS DE MISE EN oeUVRE MAL
DÉFINIES, ÉLABORÉES SANS CONCERTATION
-
1. Une impression d'impréparation et
d'improvisation plus de 10 jours après l'annonce de cette
réouverture
-
2. Des scénarii de travail ne reposant pas
sur un avis scientifique
-
3. Une absence de réelle concertation
notamment avec les collectivités locales, partenaires essentiels du
scolaire et du périscolaire
-
4. De nombreuses questions demeurent auxquelles ne
répondent pas les dernières déclarations du ministre de
l'éducation nationale
-
1. Une impression d'impréparation et
d'improvisation plus de 10 jours après l'annonce de cette
réouverture
-
B. LES ONZE PRÉCONISATIONS DU GROUPE DE
TRAVAIL : UN RETOUR PROGRESSIF, CONCERTÉ ET
SÉCURISÉ
-
A. LA DÉCISION DE ROUVRIR LES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET LES ÉCOLES À PARTIR DU 11 MAI
: UNE ANNONCE SURPRISE, AUX MODALITÉS DE MISE EN oeUVRE MAL
DÉFINIES, ÉLABORÉES SANS CONCERTATION
-
IV. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
-
A. UNE GESTION DE LA CRISE GLOBALEMENT
RÉACTIVE ET CONCERTÉE
-
B. LES POINTS DE VIGILANCE DU GROUPE DE
TRAVAIL
-
C. LES PROPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES DU
GROUPE DE TRAVAIL
-
1. Soutenir les formations professionnalisantes et
accompagner les jeunes diplômés 2020 à s'insérer sur
le marché du travail
-
2. Financer le prolongement des contrats doctoraux
et postdoctoraux par une augmentation de la subvention pour charges de service
public des établissements publics d'enseignement supérieur et de
recherche
-
3. Encourager et adapter l'accueil des
étudiants internationaux
-
4. Mieux considérer les études de
santé
-
5. Réfléchir à un plan de
rénovation des bâtiments universitaires comme facteur de relance
économique
-
1. Soutenir les formations professionnalisantes et
accompagner les jeunes diplômés 2020 à s'insérer sur
le marché du travail
-
A. UNE GESTION DE LA CRISE GLOBALEMENT
RÉACTIVE ET CONCERTÉE
-
V. ENSEIGNEMENT AGRICOLE
-
A. ÉTAT DES LIEUX DE L'ENSEIGNEMENT
AGRICOLE
-
1. L'enseignement agricole fortement touché
par la crise de Covid-19 en raison de ses spécificités
-
2. Une forte mobilisation des « trois
familles de l'enseignement agricole » pour assurer la
continuité pédagogique des élèves
-
3. Préparer la reprise des cours avant les
vacances d'été
-
4. Apporter un soutien scolaire et permettre un
renforcement des apprentissages
-
1. L'enseignement agricole fortement touché
par la crise de Covid-19 en raison de ses spécificités
-
B. AGIR POUR ÉCLAIRCIR L'AVENIR DE
L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE ASSOMBRI PAR LA CRISE DE COVID-19
-
A. ÉTAT DES LIEUX DE L'ENSEIGNEMENT
AGRICOLE
-
VI. ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À
L'ÉTRANGER
-
A. LE RÉSEAU DE L'ENSEIGNEMENT
FRANÇAIS À L'ÉTRANGER CONFRONTÉ À LA PLUS
GRAVE CRISE DE SON HISTOIRE
-
1. La fermeture progressive de la
quasi-totalité des établissements et la mise en place de la
continuité pédagogique
-
2. Une continuité pédagogique
diversement perçue par les parents d'élèves
-
3. La remise en cause des frais de
scolarité dans un contexte de crise économique et sociale dans la
plupart des pays
-
4. Des établissements menacés de
grandes difficultés financières et d'une perte d'effectifs
-
1. La fermeture progressive de la
quasi-totalité des établissements et la mise en place de la
continuité pédagogique
-
B. LES MESURES DE SOUTIEN ANNONCÉES PAR LE
GOUVERNEMENT : UNE MÉTHODE CONTESTABLE, UN CONTENU ENCORE
FLOU
-
1. Des annonces avant la mise au point d'un plan
de soutien global au réseau : une stratégie de communication
plus que d'action
-
2. L'aménagement des bourses
scolaires : un dispositif satisfaisant, mais un calibrage
budgétaire à surveiller
-
3. L'avance de l'Agence France Trésor
à l'AEFE : un soutien indispensable, mais un support financier pas
acceptable en l'état
-
1. Des annonces avant la mise au point d'un plan
de soutien global au réseau : une stratégie de communication
plus que d'action
-
C. LES PROPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES DU
GROUPE DE TRAVAIL EN VUE DU PLAN DE SOUTIEN AU RÉSEAU
-
A. LE RÉSEAU DE L'ENSEIGNEMENT
FRANÇAIS À L'ÉTRANGER CONFRONTÉ À LA PLUS
GRAVE CRISE DE SON HISTOIRE
-
VII. RECHERCHE
-
A. UNE MOBILISATION EXCEPTIONNELLE DE LA
COMMUNAUTÉ DE RECHERCHE FRANÇAISE CONTRE LA COVID-19
-
B. LE MANQUE DE STRATÉGIE NATIONALE DE
RECHERCHE SUR LA COVID-19 ET L'ABSENCE DE STRUCTURE DE PILOTAGE UNIQUE
-
C. UNE CRISE RÉVÉLATRICE DES
CARENCES STRUCTURELLES DU SYSTÈME DE RECHERCHE FRANÇAIS
-
D. LA DÉMARCHE ET L'INTÉGRITÉ
SCIENTIFIQUES À L'ÉPREUVE MÉDIATIQUE
-
A. UNE MOBILISATION EXCEPTIONNELLE DE LA
COMMUNAUTÉ DE RECHERCHE FRANÇAISE CONTRE LA COVID-19
-
VIII. LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES
-
A. ANTICIPER LA REPRISE D'ACTIVITÉ
-
1. Pour les salles de cinéma, donner
rapidement de la visibilité sur la date de réouverture
-
2. Définir les conditions sanitaires de
reprise de l'activité
-
3. Rapidement définir les contours du fonds
d'indemnisation annoncé par le Président de la République
le 6 mai
-
4. Sécuriser juridiquement
l'activité en associant l'Etat, les compagnies d'assurance et les
collectivités locales
-
1. Pour les salles de cinéma, donner
rapidement de la visibilité sur la date de réouverture
-
B. COMPENSER L'IMPACT DE LA CRISE POUR
ÉVITER LA DÉBÂCLE
-
C. SE PROJETER DANS L'APRÈS
-
A. ANTICIPER LA REPRISE D'ACTIVITÉ
-
IX. MÉDIAS AUDIOVISUELS
-
A. UNE MOBILISATION DES MÉDIAS AUDIOVISUELS
PENDANT LA CRISE SANITAIRE À SALUER
-
B. DES ACTEURS FRANÇAIS DURABLEMENT
AFFAIBLIS FACE À DES CONCURRENTS ANGLO-SAXONS PORTÉS PAR LES
NOUVEAUX USAGES
-
1. Un secteur des médias durablement
affaibli par la crise sanitaire
-
a) « Une crise sans
précédent » pour les médias privés
-
b) Les incertitudes concernant l'avenir de France
Télévisions
-
c) Les difficultés propres à la
radio publique
-
d) La situation très précaire des
radios indépendantes et des télévisions locales
-
e) Un impact limité sur l'audiovisuel
extérieur
-
f) Le groupe Canal + « à la
croisée des chemins »
-
g) Un secteur de la production fortement
impacté par la crise sanitaire
-
a) « Une crise sans
précédent » pour les médias privés
-
2. Un certain retard dans la mobilisation des
soutiens publics aux médias
-
1. Un secteur des médias durablement
affaibli par la crise sanitaire
-
A. UNE MOBILISATION DES MÉDIAS AUDIOVISUELS
PENDANT LA CRISE SANITAIRE À SALUER
-
X. PRESSE
-
XI. SPORT
-
XII. JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE
-
A. LE SECTEUR ASSOCIATIF : UN ACTEUR ESSENTIEL DE
LA SOLIDARITÉ ET DU VIVRE ENSEMBLE, GRAND OUBLIÉ PAR LES POUVOIRS
PUBLICS PENDANT CETTE CRISE
-
B. LA CRISE DE COVID-19 A DÉMONTRÉ
PLUS QUE JAMAIS L'UTILITÉ DU SERVICE CIVIQUE
-
C. ENTRE ACTIVITÉ QUASI-NULLE DEPUIS
DÉBUT MARS ET FLOU SUR LA MISE EN PLACE DES COLONIES DE VACANCES
« STUDIEUSES » : LE SECTEUR DU TOURISME ASSOCIATIF
INQUIET POUR SON AVENIR
-
1. Classes vertes, colonies de vacances, formation
au BAFA : un arrêt brutal d'activité depuis le mois de mars
-
2. Une volonté politique de redynamiser les
colonies de vacances, mais de nombreuses questions demeurent
-
a) Des modalités de vacances en perte de
vitesse, remises à l'ordre du jour en raison de la crise de
Covid-19
-
b) Conditions sanitaires, prise en charge du
surcoût, encadrement : de trop nombreuses questions freinent la
relance des colonies de vacances
-
c) La nécessité de rassurer et de
convaincre les familles pour toucher le « public cible » et
redynamiser les colonies de vacances
-
a) Des modalités de vacances en perte de
vitesse, remises à l'ordre du jour en raison de la crise de
Covid-19
-
3. Les colonies de vacances « studieuses
» : un programme annoncé et mis en avant par le gouvernement mais
aux contours encore flous à moins de deux mois des vacances
d'été
-
1. Classes vertes, colonies de vacances, formation
au BAFA : un arrêt brutal d'activité depuis le mois de mars
-
D. PENSER L'APRÈS-CRISE
-
A. LE SECTEUR ASSOCIATIF : UN ACTEUR ESSENTIEL DE
LA SOLIDARITÉ ET DU VIVRE ENSEMBLE, GRAND OUBLIÉ PAR LES POUVOIRS
PUBLICS PENDANT CETTE CRISE
-
I. CRÉATION
-
1. TRAVAUX EN COMMISSION SUR LES
CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE LIÉE À
L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 SUR LES SECTEURS DE LA COMPÉTENCE
DE LA COMMISSION
-
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
-
ANNEXES
-
Auditions de Mme Frédérique Vidal,
ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation
-
Audition de M. Jean-Michel
Blanquer,
ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse
-
Audition de M. Franck Riester, ministre de
la culture
-
Audition de M. Christophe d'Enfert, directeur
scientifique de l'institut Pasteur
-
Audition de Mme Roxana Maracineanu, ministre des
sports
-
Audition de M. Didier Guillaume,
ministre de l'agriculture et de l'alimentation
-
Audition de M. Gabriel Attal,
secrétaire d'État auprès du ministre
de l'éducation nationale et de la jeunesse
-
Audition de M. Jean-Baptiste Lemoyne,
secrétaire d'État
auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères
-
Auditions de Mme Frédérique Vidal,
ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation
N° 667
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2019-2020
Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 juillet 2020
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) sur les notes de synthèse des groupes de travail sectoriels sur les conséquences de l' épidémie de Covid-19 ,
Par Mme Catherine MORIN-DESAILLY,
Sénatrice
(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Morin-Desailly , présidente ; M. Max Brisson, Mme Catherine Dumas, MM. Jacques Grosperrin, Antoine Karam, Mme Françoise Laborde, MM. Jean-Pierre Leleux, Jacques-Bernard Magner, Mme Colette Mélot, M. Pierre Ouzoulias, Mme Sylvie Robert , vice-présidents ; MM. Alain Dufaut, Claude Kern, Mme Claudine Lepage, M. Michel Savin , secrétaires ; MM. Maurice Antiste, David Assouline, Mmes Annick Billon, Maryvonne Blondin, Céline Boulay-Espéronnier, Marie-Thérèse Bruguière, Céline Brulin, M. Joseph Castelli, Mmes Laure Darcos, Nicole Duranton, M. André Gattolin, Mme Samia Ghali, MM. Abdallah Hassani, Jean-Raymond Hugonet, Mmes Mireille Jouve, Claudine Kauffmann, MM. Guy-Dominique Kennel, Laurent Lafon, Michel Laugier, Mme Vivette Lopez, MM. Jean-Jacques Lozach, Claude Malhuret, Christian Manable, Jean-Marie Mizzon, Mme Marie-Pierre Monier, MM. Philippe Nachbar, Olivier Paccaud, Stéphane Piednoir, Mme Sonia de la Provôté, MM. Damien Regnard, Bruno Retailleau, Jean-Yves Roux, Alain Schmitz, Mme Dominique Vérien .
AVANT-PROPOS
Réunie le mercredi 22 juillet, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a examiné le rapport de Mme Catherine Morin-Desailly autorisant la publication, au sein d'un seul et même document, de l'ensemble des travaux réalisés par les groupes de travail chargés d'étudier les conséquences de la crise sanitaire sur les secteurs relevant de leur compétence.
Ce document est le résultat d'un travail transpartisan, lancé le 14 avril par le bureau de la commission et achevé le 22 juin par la présentation devant cette dernière des travaux des groupes de travail consacrés aux secteurs de la « Création » et du « Patrimoine ». Dans l'intervalle, les douze groupes sectoriels, animés par les rapporteurs budgétaires des secteurs concernés et composés de représentants de chacun des groupes politiques de la commission, ont effectué plus de 80 auditions pour entendre près de 170 personnalités appartenant aux domaines de l'enseignement scolaire, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement agricole, de l'enseignement français à l'étranger, de la recherche, de la création, du patrimoine, du sport, de la jeunesse et de la vie associative, du livre et des industries culturelles, de la presse et des médias afin de rédiger les conclusions et les recommandations ici rassemblées.
Au fil de la publication de ces travaux, la commission a ainsi proposé aux différents ministres concernés des propositions concrètes dont certains n'ont pas manqué de s'inspirer dans la conduite de leurs politiques durant et après la période de confinement. La commission a ainsi activement participé aux débats entourant la définition et la publication, par les services du ministère de l'éducation nationale, du protocole sanitaire définissant les règles applicables aux établissements scolaires dans la perspective de leur réouverture annoncée à la surprise générale par le Président de la République.
Elle a également invité le ministère de la culture à mener à bien, dans des délais compatibles avec les attentes des acteurs du secteur, la transposition des directives européennes sur les services de médias audiovisuels (SMA), le droit d'auteur et « câble et satellite », finalement introduites par voie d'amendements dans le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (DDADUE), afin d'élargir l'assiette du financement de la création française dans cette période de crise.
Certaines autres propositions formulées par les différents groupes de travail sont venues par ailleurs enrichir le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020.
Parmi ces dispositions figure la mise en place d'un crédit d'impôt en faveur des dépenses de création destiné à soutenir les éditeurs de chaînes de télévision fragilisés par l'effondrement de leurs ressources publicitaires, l'instauration d'un fonds en faveur des festivals, la compensation des pertes subies par l'ensemble des opérateurs culturels au cours de l'année 2020 et la compensation des pertes de loyers enregistrées par les Crous suite aux difficultés financières rencontrées par les étudiants.
Mais au-delà des mesures législatives déjà adoptées, ces travaux visent également à donner aux membres de la commission des outils leur permettant de participer activement à la définition et à la mise en oeuvre du plan de relance présenté à l'automne par le gouvernement. Car de nombreux défis restent à relever dans les champs de compétences de la commission !
Cette crise a en effet révélé l'extrême fragilité des secteurs et des écosystèmes qui la concernent. L'économie de la création, des musées, de la presse, des festivals, des salles de spectacles et de cinéma, mais aussi celle des clubs, des associations sportives ou des colonies de vacances, privés de spectateurs, de lecteurs, de pratiquants, privés de recettes publicitaires, de mécénat ou de billetterie menace aujourd'hui de s'effondrer sans le soutien massif de l'État et des collectivités territoriales.
Certains secteurs devront ainsi faire évoluer leur modèle économique dans des conditions particulièrement difficiles. C'est le cas du secteur de la presse dont les difficultés financières sont aggravées par la crise que traverse son système de distribution.
D'autres secteurs sont condamnés à attendre la levée progressive des interdictions qui les touchent et développer des projets alternatifs pour pouvoir survivre.
Il s'agit bien entendu du spectacle vivant, des musées ou des salles de cinéma. Certaines personnalités auditionnées ont d'ailleurs insisté sur les réticences d'une partie des spectateurs à revenir dans les lieux dédiés à la culture, en particulier les lieux clos, laissant présager une reprise particulièrement lente de l'activité culturelle dans les mois à venir ainsi qu'une modification profonde des modalités de consommation des biens et des produits culturels par le public.
Il s'agit aussi, dans un tout autre registre, du secteur de la jeunesse et de la vie associative dont la situation sociale et économique s'avère particulièrement difficile. Les conséquences de la crise pourraient en effet se faire sentir non seulement sur la fréquentation des colonies de vacances mais aussi sur l'appétence des jeunes à s'engager dans le cadre des programmes de service civique ou universel.
D'autres secteurs devront quant à eux redéfinir leurs modalités de fonctionnement et de gouvernance afin de tirer les leçons de la crise, en particulier la recherche, dont l'organisation mériterait de gagner en lisibilité et en efficacité ou l'enseignement français à l'étranger, si important pour le rayonnement de la langue et de la culture françaises.
Si cette crise a révélé les fragilités économiques et les carences organisationnelles des secteurs relevant de la commission, elle a également mis en lumière de manière particulièrement crue la marginalisation de certains d'entre eux dans le débat public. C'est particulièrement vrai du sport, ce qui constitue un paradoxe au moment même où le pays est chargé d'organiser des Jeux Olympiques et où le caractère structurant des infrastructures sportives sur l'ensemble de notre territoire n'a jamais été aussi important.
Si l'on peut comprendre que les événements sportifs aient été différés, que les championnats aient été arrêtés, que les pratiques occasionnelles aient été fortement encadrées pour des raisons sanitaires au plus fort de la crise, il est regrettable qu'aucun travail de fond n'ait été entrepris durant la période par le gouvernement pour permettre aux clubs, aux fédérations, aux ligues et à l'ensemble du monde sportif de se trouver en état de marche dès la sortie du confinement.
Si le secteur du sport a été le grand oublié de cette période de crise, le secteur de la culture au sens large en ressort lui aussi affaibli. Il ne s'agit pas de sous-estimer les efforts réalisés par le gouvernement ; l'État a même beaucoup fait pour la culture comparé à ce qu'il a entrepris pour le sport depuis le début de la crise.
Sur le plan strictement budgétaire, l'adoption d'une année blanche pour les intermittents pour près de 950 millions d'euros, les 700 millions d'euros en faveur du spectacle vivant et de la musique enregistrée, les 320 millions d'euros destinés au soutien de l'industrie du cinéma et de l'image animée ou encore les 200 millions d'euros octroyés à la chaîne du livre ne sont pas quantité négligeable. Au total, près de 5 milliards d'euros ont été débloqués pour soutenir les acteurs du monde de la culture et des médias, ce dont on ne peut que se féliciter.
Mais la commission a néanmoins relevé des flottements voire des dysfonctionnements dans la manière dont la crise a été gérée au cours des mois écoulés.
D'une part, des pans entiers du secteur culturel ont estimé avoir été abandonnés. C'est le cas des arts visuels, secteur en souffrance, qui mériterait d'être restructuré. Pourquoi ne pas confier aux fonds régionaux d'art contemporain de nouvelle génération le soin de jouer un rôle d'animateur en ce domaine ? C'est aussi le cas des auteurs indépendants qui se considèrent comme les laissés pour compte de la crise. Il convient d'avancer au plus vite sur la définition d'un statut social pour ces artistes.
C'est enfin le cas des enseignements artistiques et des conservatoires tiraillés entre les compétences de l'État, chargé d'assurer la délivrance des diplômes, les cursus, la formation des enseignants et celles dévolues aux collectivités territoriales, chargées d'organiser les examens.
D'autre part, le ministère a manqué de réactivité pour traduire en acte les mesures annoncées. Ainsi ni le décret définissant le régime applicable aux intermittents ni les circulaires définissant les règles d'organisation des festivals en dessous de 5 000 personnes ou précisant les modalités de réouverture des établissements et d'autorisation de manifestations à compter de septembre n'ont été publiés plusieurs semaines après leur annonce. De même, les mesures prises pour le soutien des établissements publics de coopération culturelle n'ayant pas été autorisés à accéder au dispositif d'activité partielle ne sont toujours pas annoncées.
Enfin, le ministère a désespérément continué à fonctionner de façon verticale, sans réussir à engager de véritable mouvement de coordination avec les collectivités durant la période. Les CTC auraient pourtant pu constituer un outil à la main des préfets permettant d'organiser la concertation et l'articulation des fonds d'urgence des différentes collectivités. Il s'agit au final d'une opportunité manquée !
La commission espère qu'en ce domaine les annonces réalisées devant le Sénat par le Premier ministre jeudi 16 juillet concernant la nécessité d'associer étroitement les territoires dans la définition et la conduite des politiques publiques, trouvent une concrétisation non seulement en matière culturelle mais aussi en matière éducative ou sportive !
En effet, ces derniers mois ont permis de prendre conscience que si l'État doit sans doute continuer à jouer un rôle d'impulsion et de coordination dans les domaines de compétence de la commission, il est de plus en plus rarement en mesure d'agir seul. La gestion de la réouverture des établissements scolaires, des établissements culturels, des structures sportives n'a pu se faire dans de bonnes conditions que grâce à l'implication, dans leurs domaines de compétences, des collectivités territoriales. Celles-ci seront d'ailleurs à n'en pas douter les maillons essentiels de la reprise à venir.
CONCLUSIONS DES GROUPES DE TRAVAIL CHARGÉS D'ÉTUDIER LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE COVID-19
I. CRÉATION
Le groupe de travail « Création » de la commission de la culture animé par Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, socialiste et républicain) est composé de Maryvonne Blondin (Finistère, socialiste et républicain), Jean-Raymond Hugonet (Essonne, LR), Françoise Laborde (Haute-Garonne, RDSE), Vivette Lopez (Gard, LR) et Sonia de la Provôté (Calvados, UC).
Le groupe de travail « Création » a été mis en place à l'initiative du bureau de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat le mardi 14 avril 2020, afin d'examiner l'impact de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 sur le secteur de la création artistique et culturelle et de suivre sa gestion par le Gouvernement.
Alors que son modèle économique est, dès l'origine, fragile, le secteur de la création artistique et culturelle, majoritairement constitué de petites structures et d'établissements publics, a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Celle-ci a eu tendance à amplifier les difficultés préexistantes. Il s'agit pourtant d'un secteur non négligeable pour l'économie française. Le spectacle vivant et les arts visuels réalisaient respectivement 0,34 % et 0,19 % du PIB en 2017, d'après une étude du département des études, de la prospective et des statistiques du ministère de la culture parue en 2019. Leurs activités profitent très largement au secteur industriel et marchand, en particulier touristique, sur les territoires.
Le secteur de la création a été parmi les premiers touchés par la crise sanitaire du fait de l'interdiction progressive des rassemblements dès les premiers jours du mois de mars, avant que n'intervienne la fermeture définitive de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays à compter du 15 mars.
L'annulation des spectacles et des festivals, la fermeture des lieux d'exposition et des galeries d'art, la suspension des cours et des formations, l'arrêt des actions artistiques et culturelles à destination des publics spécifiques ont lourdement pesé à la fois sur les structures artistiques et culturelles et sur l'emploi. Le spectacle vivant et les arts visuels comptaient, avant la crise, plus de 200 000 actifs, avec une proportion plus importante de travailleurs indépendants par rapport au reste de la population active en France. Les artistes, en particulier, sont dans une situation extrêmement préoccupante.
Malgré la possibilité désormais ouverte d'une réouverture sous conditions de la plupart des établissements culturels, les perspectives de reprise de l'activité sont encore incertaines, l'accueil du public dans le respect des nouvelles exigences sanitaires engendrera nécessairement des coûts supplémentaires et le niveau de la fréquentation constitue une grande inconnue, comme en témoignent l'atonie persistante de la billetterie jusqu'à ce jour et les incertitudes entourant le mécénat.
Des premières estimations ont été réalisées par le secteur pour mieux appréhender l'impact de la crise sanitaire.
Une étude commandée par le PRODISS évalue à 590 millions d'euros la perte totale de chiffre d'affaires du spectacle vivant privé pour la seule période allant du 1 er mars au 31 mai 2020.
Une étude initiée et coordonnée par France Festivals, consacrée aux conséquences de l'annulation d'une majorité de festivals de la saison 2020 du fait de la crise sanitaire, évalue entre 383 et 535 millions d'euros les pertes sèches pour les festivals musicaux , et estime les pertes totales pour l'économie , du fait des retombées manquantes qu'auraient dû avoir ces festivals, entre 1,5 et 1,8 milliard d'euros . Par extrapolation, elle estime que les pertes pour les festivals en 2020, toutes disciplines confondues, pourraient s'établir entre 580 et 811 millions d'euros, et que les pertes totales pour l'économie pourraient se situer entre 2,3 et 2,6 milliards d'euros.
Pour sa part, le Président du Centre national de la musique a indiqué, lors d'une audition devant la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale le 27 mai, que les pertes de chiffres d'affaires et de revenus pour le spectacle vivant musical, toutes esthétiques confondues , pourraient atteindre entre 1,7 et 2 milliards d'euros en 2020 .
Un tel chiffrage se révèle plus délicat en ce qui concerne les arts visuels, dont le réseau de diffusion est majoritairement constitué de très petites structures. Les conséquences de la crise actuelle se manifesteront dans les mois et les années à venir. Mais, les premières enquêtes menées auprès des adhérents font apparaître des pertes considérables liées aux ressources tirées de leurs activités (billetterie, mécénat, vente de catalogues) et également, pour certaines d'entre elles, la remise en cause d'une partie de leurs subventions.
Les établissements publics et les structures subventionnées ne sont pas non plus épargnés par la crise, compte tenu des pertes de billetterie et de revenus qu'elles enregistrent également. Une partie d'entre eux n'est pas autorisée à accéder au dispositif d'activité partielle, ce qui pourrait avoir des répercussions sur leur capacité d'action dans les prochains mois. Le directeur de l'Opéra de Paris, Stéphane Lissner, confiait ainsi que son établissement était « à genoux », avec 45 millions d'euros de dettes suite aux annulations de représentations liées aux grèves et à l'épidémie de Covid-19 depuis le début de l'année.
Dans ce contexte, l'avenir de nombreuses structures est menacé, avec des conséquences potentiellement multiples, sur l'emploi des artistes, des techniciens, des travailleurs indépendants et des salariés, mais aussi sur l'accès à la culture, la diversité artistique, et le dynamisme et le rayonnement des territoires .
Le soutien renforcé des pouvoirs publics est plus que jamais urgent et impérieux pour préserver l'avenir de notre modèle culturel . Les collectivités publiques - État et certaines collectivités territoriales - ont mis en place plusieurs dispositifs depuis le début de la crise pour venir en aide au monde de la culture. Ils doivent cependant être encore adaptés et complétés pour atteindre véritablement leur objectif, tant perdurent un certain nombre de « trous dans la raquette », pour reprendre une expression employée à de nombreuses reprises au cours des derniers mois. Ils doivent également être abondés pour mieux répondre aux besoins et enjeux du secteur.
Le manque de connaissances autour de ce virus et le caractère inédit de cette crise peuvent bien sûr justifier des tâtonnements . Mais, trois mois après le début de cette crise, les acteurs culturels manquent toujours cruellement de visibilité pour anticiper, imaginer des formules permettant de limiter les pertes, reconstruire la programmation de l'été et de la prochaine saison et « se réinventer », selon le voeu formulé par le Président de la République dans son discours du 6 mai dernier. La reprise de l'activité ne peut pas se décréter du jour au lendemain, tant la culture est un secteur d'activités où l'essentiel du travail s'effectue en amont de la présentation au public (recherches, création, programmation, répétitions...).
C'est la raison pour laquelle un véritable plan de relance reste nécessaire pour favoriser la reprise de l'activité artistique. Les artistes et les structures culturelles ont besoin d'être accompagnés pour surmonter la période transitoire de reprise d'activité « en mode dégradé ». Le Président de la République avait dessiné des premières orientations concernant le plan de soutien pour la culture le 6 mai dernier, mais ses propositions n'ont pas encore trouvé de traduction juridique. Les dispositions contenues dans le troisième projet de loi de finances rectificative (PLFR 3) pour 2020 restent, en l'état, très en-deçà de ce qui était attendu et ne constituent aucunement un plan de relance global du secteur culturel. Elles devront impérativement être complétées.
Les acteurs culturels ont aujourd'hui besoin d'actes prouvant que leur place n'est pas reléguée à l'arrière-plan, comme l'a démontré leur incompréhension face aux règles d'un décret paru le 1 er juin, qui oblige à laisser vacant un siège sur deux dans les salles de spectacles, contrairement aux transports collectifs. Le groupe de travail est convaincu que la culture est essentielle à la vie de la Nation et conserve un rôle indispensable dans le « monde d'après » pour contribuer à l'émancipation des citoyens, à la cohésion sociale et à la vie des territoires. Il restera très attentif à ce qu'ils ne soient pas une variable d'ajustement dans les prochains mois.
A. PARER À L'URGENCE
1. Des mesures d'urgence nombreuses mais dont l'ensemble des acteurs culturels ne parviennent pas à bénéficier
a) Des mesures transversales fortes, mais souvent difficiles d'accès
Dès le début du mois d'avril, le Gouvernement a mis en place différentes mesures générales de soutien pour soutenir les entreprises pénalisées par l'interruption de leur activité économique du fait de la crise sanitaire, en particulier, le dispositif d'activité partielle, le report de paiement des échéances sociales et fiscales, le fonds de solidarité et des lignes de trésorerie bancaire auprès de BpiFrance.
Ces dispositifs ont depuis été complétés au mois de mai, compte tenu de la situation particulièrement difficile rencontrée par les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés, du tourisme, de l'événementiel, du sport et de la culture :
- le dispositif d'activité partielle, essentiel pour éviter des licenciements massifs à l'automne, a été maintenu avec une prise en charge de 100 % de l'indemnité pour ces secteurs jusqu'au 30 septembre 2020 ;
- le fonds de solidarité a été prolongé jusqu'à la fin de l'année 2020, le montant des aides accru et son bénéfice élargi, à compter du 1 er juin, aux entreprises jusqu'à 20 salariés (contre 10 précédemment) et présentant un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros (contre 1 million précédemment) ;
- les TPE et PME de ces secteurs sont exonérées des cotisations sociales au titre des périodes d'emploi de février à mai ;
- et les artistes-auteurs ont droit à une réduction forfaitaire de cotisations sociales d'un montant calculé en fonction de leurs revenus 2019.
Recommandation n° 1 : Réaliser une évaluation pour examiner l'opportunité de prolonger, pour le secteur culturel, jusqu'à la fin de l'année 2020 et éventuellement en 2021, l'ensemble des mesures générales de soutien mises en place par le Gouvernement, compte tenu des perspectives réduites d'activité pendant les mois à venir et des surcoûts générés par les contraintes sanitaires. Cette évaluation devrait reposer sur un bilan coûts/avantages en termes de survie des structures et de sauvegarde des emplois.
Compte tenu des critères d'octroi de ces aides, un certain nombre de structures culturelles n'ont cependant pas pu en bénéficier , malgré la volonté du ministère de la culture d'adapter, pour certaines structures, les critères d'accès. Le dispositif d'activité partielle a ainsi été ouvert aux associations, même subventionnées, et aux établissements publics à caractère industriel et commercial, sociétés d'économie mixte et sociétés publiques locales dont le produit de l'activité constitue la part majoritaire de leurs ressources. L'accès au fonds de solidarité a également été facilité pour les personnes dont les revenus ne sont ni linéaires, ni réguliers, à l'image des artistes, grâce à la possibilité d'apprécier l'existence d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % en avril 2020 en se fondant, non plus seulement sur le chiffre d'affaires perçu en avril 2019, mais également sur le chiffre d'affaires mensualisé de l'année précédente. Pour autant, les besoins de l'ensemble des acteurs culturels n'ont pas pu être satisfaits.
Le groupe de travail s'inquiète en particulier de l'impossibilité, pour les établissements publics, notamment les établissements publics de coopération culturelle (EPCC), dont le budget est majoritairement constitué de subventions, de pouvoir prétendre au dispositif d'activité partielle . Cette mesure devrait avoir de lourdes répercussions sur la santé de ces établissements, auxquels il a été demandé d'honorer les contrats de travail et de cession, y compris pour les représentations annulées pendant cette période. Cela signifie qu'il appartiendra aux collectivités territoriales de supporter l'intégralité du poids des charges de ces établissements, puisque ces derniers ne génèrent aucune recette à l'heure actuelle. Ces établissements financent l'essentiel de leurs projets sur la base de leurs ressources propres. Leur capacité à relancer une dynamique culturelle sur nos territoires dans les prochains mois devrait en être amoindrie.
La question du cumul des subventions et des aides d'État peut légitimement se poser, mais il est tout à fait possible de trouver des solutions pour concilier l'urgence de sauver les structures et la nécessaire bonne gestion et répartition des aides publiques. En tout état de cause, il semble essentiel que les règles s'appliquent indistinctement à l'ensemble de la filière professionnelle, sujette aux mêmes réalités économiques.
Recommandation n° 2 : Élargir le bénéfice du dispositif d'activité partielle aux salariés de droit privé de l'ensemble des structures culturelles, quelle que soit leur forme juridique.
b) Un soutien sectoriel globalement limité et inégal selon les secteurs
Pour compléter ces mesures transversales, le ministère de la culture a chargé le Centre national de la musique (CNM) et le Centre national des arts plastiques (CNAP) de jouer un rôle d'information auprès des professionnels de leur secteur respectif et de leur apporter un soutien.
À cette fin, plusieurs fonds de soutien sectoriels ont été mis en place :
- pour la filière musicale , un fonds de secours géré par le CNM destiné aux professionnels les plus fragilisés et aux artistes-auteurs, doté d'une première enveloppe de 11,5 millions d'euros , dont 10 millions d'euros financés par l'État et 1,5 million d'euros par les organismes de gestion collective ;
- pour le secteur du spectacle vivant non musical (théâtre privé, cabarets...), des aides d'urgence à hauteur de 5 millions d'euros destinées à répondre aux difficultés rencontrées, avec une attention particulière au maintien de l'emploi ;
- pour le secteur des arts plastiques , un fonds d'urgence géré par le CNAP et les DRAC, doté de 2 millions d'euros , principalement destiné aux galeries d'art, aux centres d'art labellisés et aux artistes-auteurs, même si les structures non labellisées des arts visuels ont également pu en bénéficier, ce qui constitue un élément nouveau et positif.
L'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) a également été chargé de soutenir les entreprises de la musique, du spectacle vivant et les galeries d'art impactées par l'épidémie en offrant notamment sa garantie financière et en octroyant des prêts de trésorerie et des prêts destinés à assurer la relance de l'activité. Ses capacités de prêt devraient être renforcées à hauteur de 85 millions d'euros par le PLFR 3 pour 2020, conformément aux annonces formulées par le Président de la République lors de son discours du 6 mai 2020.
Si ces diverses mesures ont été accueillies favorablement par les acteurs culturels, la dotation de ce plan d'urgence pour la culture a néanmoins été jugée nettement insuffisante par rapport à l'ampleur des besoins du secteur.
La répartition de ces crédits est par ailleurs très inégale, au détriment, une fois encore, de celui des arts visuels , en dépit du nombre de professionnels concernés par le dispositif. La fragilité économique initiale qui règne dans ce secteur et la grande précarité des artistes visuels, auraient pourtant justifié un soutien accru en leur faveur, au regard de son poids économique et de son rôle de vitrine de la France sur la scène internationale.
Recommandation n° 3 : Accentuer l'effort budgétaire et l'investissement en faveur des arts visuels.
Se pose, dans ce contexte, la question du déblocage de la réserve de précaution pour renforcer le soutien au monde de la culture. Aucun dégel, même partiel des crédits, n'a jusqu'ici été annoncé. Il serait pourtant indispensable pour accompagner les structures culturelles pendant la période transitoire qui s'ouvre avec la reprise de l'activité.
Recommandation n° 4 : Dégeler les crédits de la réserve de précaution en 2020.
2. Des artistes en danger
a) Des dispositions encore attendues en faveur des intermittents
Le soutien aux artistes et techniciens intermittents du spectacle est extrêmement attendu par l'ensemble de la profession afin d' assurer le maintien des talents et des compétences lorsque l'activité pourra reprendre pleinement .
Jusqu'ici, est seulement prévue une neutralisation de la période comprise entre le 1 er mars et, au plus tard, le 31 juillet 2020 pour le calcul de la période de référence ouvrant droit à assurance chômage et à droits sociaux pour les intermittents, ainsi que pour le calcul et le versement des indemnités au titre de l'assurance chômage pour les intermittents du spectacle et les salariés du secteur culturel en contrats courts.
Cette disposition se révèle toutefois insuffisante, dans la mesure où le printemps et l'été constituent souvent la période la plus propice pour permettre aux intermittents d'atteindre le compte de leurs heures. La commission de la culture l'avait d'ailleurs fait observer au ministre de la culture, Franck Riester, dès le 13 avril, lors de son audition. Le Président de la République a finalement annoncé, le 6 mai dernier, la prolongation d'une année des droits des intermittents « au-delà des six mois où leur activité aura été impossible ou très dégradée, c'est-à-dire jusqu'à fin août 2021 ».
Le décret n'a pas encore été publié à ce stade, mais l'un des articles de la loi relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui devrait être prochainement promulguée, autorise expressément le ministre chargé de l'emploi à prolonger les droits des intermittents jusqu'au 31 août 2021 au plus tard.
Recommandation n° 5 : Publier avant juillet le décret adaptant les droits des intermittents afin de concrétiser la promesse présidentielle et d'apporter aux artistes et techniciens du spectacle le plus rapidement possible de la visibilité sur leur avenir.
En revanche, cette disposition ne règlera pas le cas des nouveaux entrants dans le régime , qui espéraient réaliser pour la première fois leurs 507 heures au cours de l'année 2020. Le ministre de la culture avait évoqué, en avril, la possibilité de mettre en place des dispositifs d'accompagnement pour soutenir l'emploi artistique à l'issue de l'épidémie. La question d'un fonds de soutien pour accompagner les primo-entrants , pourrait à cet égard se poser, dans la mesure où il s'agirait d'un dispositif exceptionnel qui n'aurait pas vocation à être pérennisé.
Le futur décret devrait également relever le plafond des heures d'enseignement artistique pouvant être prises en compte dans le calcul des droits des intermittents, jusqu'ici limité à 70 heures pour les moins de 50 ans et à 120 heures pour les plus de 50 ans. Il s'agit d'une mesure indispensable pour permettre aux intermittents de compenser partiellement la perte d'activité qu'ils subissent cette année, en s'investissant davantage en matière d'éducation artistique et culturelle (EAC), autour des deux programmes lancés par le Gouvernement : les « vacances apprenantes », d'une part, et le « dispositif 2S2C » (Sport, santé, culture, civisme), d'autre part.
Le groupe de travail attire l'attention sur le fait que les artistes ne sont pas des animateurs et qu'il conviendra de veiller à ce que les activités proposées dans le cadre de ces programmes ne soient pas uniquement destinées à occuper les enfants de façon ludique afin de permettre à leurs parents de reprendre leur activité professionnelle.
Le lancement du « dispositif 2S2C » sans concertation préalable a surpris le monde culturel, compte tenu de la suspension de tous les projets d'EAC programmés depuis le mois de mars, malgré la réouverture des écoles depuis plus d'un mois.
Ce dispositif a pour effet de transférer la prise en charge de certaines obligations qui relèvent de l'éducation nationale vers les collectivités territoriales, ce qui soulève d'importantes questions. Compte tenu de son coût et du soutien modeste de l'État (110 euros maximum par journée de six heures), toutes les collectivités n'ont pas les moyens de le financer. Il présente donc le risque de créer une rupture d'égalité territoriale dans l'accès à ces enseignements . Il introduit également une forme de concurrence avec les activités qui étaient menées dans le cadre de l'EAC, au risque de leur porter préjudice.
Recommandation n° 6 : Mis en place dans des circonstances très particulières afin de pallier l'impossibilité pour les établissements scolaires d'accueillir tous les élèves volontaires du fait du protocole sanitaire, le dispositif 2S2C constitue un dispositif exceptionnel, qui n'a pas vocation à être pérennisé au regard des difficultés qu'il soulève.
b) La situation dramatique des artistes-auteurs
La crise sanitaire est venue fragiliser encore davantage la situation déjà très précaire des artistes-auteurs, dont les commandes et les engagements ont tous été annulés.
Malgré la demande de l'État que les engagements qui n'auraient pas pu se tenir soient néanmoins rémunérés, les artistes-auteurs peinent aujourd'hui, dans de nombreux cas, à obtenir cette rémunération . En principe, les règles de la comptabilité publique imposent le règlement des prestations sur la base du service fait .
L'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19 a assoupli cette clause pour faciliter le règlement des engagements contractés remis en cause du fait de la crise. De nombreuses structures, à commencer par les services de l'éducation nationale pour les projets prévus en milieu scolaire, continueraient à opposer soit cette règle, soit le cas de force majeure , pour justifier l'absence de rémunération des contrats.
Recommandation n° 7 : Transmettre une circulaire explicitant les assouplissements, applicables depuis le 12 mars 2020, apportés à la règle du service fait et leurs conséquences afin de faciliter le règlement rétroactif des prestations annulées depuis cette date.
Les mesures générales de soutien (fonds de solidarité, report des loyers et des factures) sont particulièrement difficiles d'accès en raison de leur inadaptation et de leur mauvais calibrage par rapport aux spécificités de leur secteur professionnel . Le cumul des mesures sectorielles avec les mesures générales n'est pas autorisé. Les carences dans le système de protection sociale des artistes-auteurs restent nombreuses, et le décret en cours de préparation les inquiète très fortement. Ces professionnels devraient néanmoins disposer d'une nouvelle mesure en leur faveur, inscrite à l'article 18 du projet de loi de finances pour 2020, de réduction forfaitaire de leurs cotisations sociales sur 2020.
Il n'en reste pas moins que les artistes-auteurs ont le sentiment que la crise sanitaire a mis une nouvelle fois en évidence le manque de prise en compte de leur réalité professionnelle et leur relégation à la marge des industries culturelles , déjà pointée du doigt il y a quelques mois par Bruno Racine dans son rapport, qui dénonçait la dégradation grandissante des conditions de vie des artistes-auteurs. D'ailleurs, il est impératif de relancer le débat sur les postulats et préconisations de ce rapport, malheureusement interrompu par la crise sanitaire. La problématique du statut des artistes-auteurs, ou plutôt de son absence, est plus que jamais d'actualité.
Ils s'étonnent ainsi du choix du Gouvernement de confier aux opérateurs de chacun des circuits de diffusion (CNAP, CNC, CNL, CNM) le soin de soutenir les artistes-auteurs, avec pour conséquence une approche en silo et un traitement différencié des artistes-auteurs selon leur discipline artistique , particulièrement préjudiciable aux artistes visuels et en décalage pour les artistes-auteurs pluridisciplinaires. Un fonds d'urgence commun à l'ensemble des artistes-auteurs aurait été une occasion de reconnaître l'apport essentiel de cette profession au monde de la culture, tout en garantissant que des critères identiques s'appliquent à tous les créateurs pour l'octroi des mesures de soutien.
Le soutien à ces professionnels apparaît d'autant plus essentiel qu'ils sont à la base de toute l'activité artistique et culturelle. Aucun plan, ni d'urgence, ni de relance, ne sera efficace s'il se concentre uniquement, soit sur les structures, soit sur les artistes, tant ils sont interdépendants.
Recommandation n° 8 : Faire de la mise en place du statut des artistes-auteurs une priorité absolue de l'année 2021, avec un calendrier et des objectifs clairs.
B. FACILITER LA RELANCE DE L'ACTIVITÉ
La relance de l'activité dans les secteurs du spectacle vivant et des arts visuels se concentre autour de trois principaux enjeux : la nécessaire visibilité sur les conditions entourant la reprise de l'activité, la question du retour des publics et le niveau du soutien public pour accompagner, dans un premier temps, les acteurs dans le contexte d'une reprise « en mode dégradé ».
1. Donner davantage de visibilité au monde de la culture
a) Poursuivre le travail amorcé en matière d'aide à la décision
Pour aider les professionnels à organiser la reprise de leurs activités, le ministère de la culture a publié, depuis le mois de mai, une série de guides de recommandations , sans valeur contraignante, pour aider les professionnels à organiser la reprise de leurs activités. Ces guides concernent :
- la reprise des activités artistiques dans le champ du spectacle vivant ;
- la reprise des ateliers d'artistes, des ateliers partagés et résidences et la gestion des collections ;
- la reprise d'activité des conservatoires classés et des lieux d'enseignements artistiques publics ;
- la reprise de l'accueil du public dans des espaces d'exposition ;
- la reprise des activités d'action culturelle et d'éducation artistique et culturelle ;
- la reprise d'activité et la réouverture des salles de spectacles.
Aucun guide n'est en revanche paru en ce qui concerne l'organisation des festivals cet été , alors que rien n'interdit, en principe, les rassemblements de moins de 5 000 personnes.
Sa publication dans les plus brefs délais est cruciale , comme base à la rédaction d'une circulaire à destination des préfets les éclairant sur les conditions qui doivent être réunies pour pouvoir autoriser le maintien d'un certain nombre de manifestations. De telles instructions sont indispensables pour :
- éviter de faire peser la responsabilité sur les organisateurs de festivals et les collectivités territoriales ;
- limiter les risques que des inégalités apparaissent entre les territoires en cas de libre appréciation laissée aux préfets ;
- empêcher que l'été 2020 ne se transforme en un été sans festivals.
Recommandation n° 9 : Publier dans les plus brefs délais un guide sur la reprise des activités des festivals et transmettre aux préfets une circulaire fixant des instructions claires sur les conditions d'autorisation des festivals de l'été 2020.
b) Des clarifications nécessaires et urgentes concernant les conditions d'activité
Des clarifications rapides apparaissent nécessaires concernant la rentrée de septembre , à l'heure où tous les établissements culturels sont en train de réorganiser leur programmation et leurs conditions d'accueil. Il est indispensable que des éléments soient apportés au moins deux mois à l'avance compte tenu des contraintes liées à la programmation. La question des jauges autorisées est également cruciale pour les entreprises du spectacle vivant, compte tenu de leur modèle économique.
Alors que les acteurs culturels ont été invités à privilégier le report à l'annulation des spectacles, des expositions, des résidences ou des manifestations pour garantir la rémunération des artistes et des indépendants, qui sont les premiers pénalisés par la crise, celui-ci se révèle être un exercice délicat en l'absence de toute visibilité . Le report des événements se heurte en outre à une série de difficultés :
- les contraintes de la programmation, avec un problème de disponibilité des artistes ou des oeuvres et d'engorgement des lieux ;
- le problème de la disponibilité du public ;
- les risques pesant sur la pérennité de certaines structures.
La décision de report a aussi une incidence sur la rémunération des artistes, qui se trouve nécessairement retardée.
La levée ou la prolongation de l'interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes doit être confirmée rapidement , afin que les festivals qui sont en train de prendre leurs dispositions pour un report éventuel à l'automne ne se retrouvent pas dans une situation identique à celle qu'ils ont connue il y a quelques mois si cette interdiction devait être maintenue. Les conséquences financières seraient alors désastreuses, alors que les festivals font déjà face au retrait de plusieurs de leurs mécènes.
Recommandation n° 10 : Apporter rapidement aux acteurs culturels des clarifications et de la visibilité concernant les conditions de réouverture des établissements et d'autorisation des manifestations à compter du mois de septembre 2020 pour leur permettre de mieux anticiper leurs prochaines saisons.
2. Encourager le retour des publics
a) Rétablir la confiance du public
Les acteurs culturels sont particulièrement inquiets de l'impact de l'épidémie sur la fréquentation de leurs établissements. Cette inquiétude est particulièrement vive pour les salles de spectacle ou les organisateurs de festivals, où la position statique du public pendant plusieurs heures peut avoir un effet dissuasif.
Un travail de pédagogie sera nécessaire dans les premières semaines pour rassurer le public sur les mesures de protection mises en place. L'adoption de chartes de bonne pratique ou la création d'un pictogramme national pour les établissements qui respectent les exigences sanitaires pourraient donner confiance au public.
b) Accompagner les efforts des acteurs culturels pour préparer et traverser l'après-crise
Le Président de la République a insisté, dans son discours du 6 mai, sur la créativité dont allait devoir faire preuve le secteur de la culture pour « se réinventer ». Le groupe de travail tient à souligner que les acteurs culturels n'ont jamais manqué d'imagination pour « se réinventer », ce caractère étant inhérent à leur activité.
Il tient à saluer les efforts réalisés ces derniers mois par les acteurs culturels pour proposer de nouvelles initiatives par le biais du numérique . Si elles étaient bienvenues dans le contexte de la crise sanitaire et pourraient se révéler positives pour toucher de nouveaux publics, ces initiatives ne remettent pas en cause le fait que la priorité doit rester celle de la rencontre physique avec une oeuvre ou un artiste. Elles posent également la question de leur monétisation , renvoyant à la nécessité de transposer rapidement en droit français les directives « SMA » et « droits d'auteur », tout en y associant étroitement le Parlement , comme la commission de la culture, de l'éducation et de la communication l'a d'ailleurs recommandé, sur la base des travaux du groupe de travail Covid-19 « Livre et industries culturelles », animé par Françoise Laborde.
Au-delà de ce travail législatif, des précisions restent attendues sur le niveau et les modalités de l'accompagnement par l'État des acteurs culturels pour faire évoluer leurs modèles.
3. Soutenir la relance de l'activité
a) Compléter les mesures d'urgence par un plan de relance immédiat pour la culture
Le groupe de travail estime qu'un plan de relance est nécessaire pour éviter que les effets de la crise ne continuent à peser durablement sur les emplois et les structures culturelles. L'activité dans le secteur culturel restera, en tout état de cause, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, à la fois partielle et dégradée.
Un accompagnement des structures dans la mise en place des mesures sanitaires, ainsi que la compensation des surcoûts et des pertes de billetterie qui en découlent permettraient d'atténuer l'impact de la reprise en mode dégradé pour les acteurs culturels.
Recommandation n° 11 : Mettre en place des aides pour soutenir les structures pendant la période où des mesures sanitaires liées à la lutte contre l'épidémie de Covid-19 continueront à s'imposer.
Compte tenu de la dégradation attendue des revenus des artistes-auteurs dans les prochains mois, du fait de la diminution de la vente de leurs oeuvres et des commandes qui leur sont habituellement passées depuis le mois de mars, des mesures complémentaires devraient être prises en leur faveur. Dans son discours du 6 mai, le Président de la République a évoqué la piste d'une relance de la commande publique , tout en souhaitant la destiner prioritairement aux artistes de moins de trente ans.
Un effort particulier en faveur du dispositif des résidences permettrait également de préserver la vitalité artistique.
D'autres pistes mériteraient d'être prises en considération s'agissant des artistes visuels, en particulier une application plus stricte du dispositif du 1 % artistique , dont l'efficacité est aujourd'hui réduite en raison de l'absence de sanctions lorsqu'il n'est pas respecté. Il pourrait constituer un levier de la relance pour les artistes visuels, compte tenu des mesures de soutien prévues dans le secteur du bâtiment et travaux publics (BTP). L'exonération de la TVA à l'importation pour les oeuvres produites à l'étranger par des artistes français , lors de séjours, résidences ou foires, fait également partie des dispositions attendues.
S'agissant du soutien aux entreprises du spectacle vivant, le renforcement et l'élargissement du crédit d'impôt sur le spectacle vivant, comme il fut réclamé lors de l'examen par le Sénat du projet de loi de finances pour 2020 , pourraient constituer une bouffée d'oxygène pour leur trésorerie, durement mise à mal par les pertes de recettes et l'arrêt de la billetterie. La commission de la culture souligne depuis plusieurs années l'intérêt de ce dispositif fiscal pour soutenir la création et la production de spectacles vivants musicaux et de variétés et l'importance de ses effets par rapport à son coût pour le budget de l'État.
Le groupe de travail regrette aussi la baisse significative des crédits du FONPEPS en 2020 , alors que cet outil aurait pu être adapté pour soutenir l'emploi artistique et les petites structures du spectacle.
Le groupe de travail regrette que tous ces sujets soient absents du PLFR 3 pour 2020 , démontrant que ce texte ne constitue nullement, en l'état, un plan de relance pour la culture . Ces sujets feront, à n'en pas douter, l'objet de débats parlementaires au plus tard à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2021, tant la plupart des effets de la crise sanitaire sur les structures ne se feront sentir qu'à l'automne, voire dans le courant de l'année 2021.
À cet égard, le groupe de travail se montre inquiet que des crédits toujours plus conséquents soient octroyés au développement du Pass culture , qui ne peut porter ses fruits en termes de démocratisation culturelle et de diversification des pratiques culturelles des jeunes sans un secteur culturel fort, dynamique et diversifié. Alors que l'expérimentation pourrait être élargie à des régions entières dans les prochains mois, une évaluation plus précise des résultats qualitatifs de cette politique mériterait d'être réalisée et rendue publique , en particulier en ce qui concerne la consommation des jeunes et la nature des offres majoritairement réservées pour chacune des disciplines. Il conviendra de mesurer les effets à long terme du confinement sur la nature des offres réservées, afin de s'assurer que la consommation des offres numériques ne prend pas définitivement le pas sur celle des offres physiques. La prochaine signature d'un contrat d'objectifs et de moyens entre la société Pass culture, l'État et la caisse des dépôts et consignations pourrait permettre de mieux cerner les objectifs assignés au Pass culture et les performances de cet outil.
Enfin, il s'avère essentiel de revenir sur les modalités de mise en oeuvre de certaines normes, certes légitimes, mais qui pèsent encore sur les acteurs culturels. La circulaire Collomb et le « décret-son » en sont des illustrations particulièrement probantes. Ces chantiers doivent être de nouveau ouverts et discutés avec l'ensemble des parties prenantes afin de parvenir à une solution satisfaisante qui ne pénalise pas les acteurs culturels, comme c'est malheureusement le cas aujourd'hui.
Recommandation n° 12 : Veiller à mettre en place des outils propices à la relance des secteurs de la création dès maintenant et dans le futur projet de loi de finances pour 2021 et réaliser d'ici l'automne une évaluation complète et qualitative des résultats du Pass culture.
b) La question du soutien aux festivals
Ø Créer un fonds de soutien spécifique en faveur des festivals pour répondre à la crise sanitaire
Une attention particulière doit être apportée à la question des festivals, déjà fragilisés avant la crise sanitaire par la hausse du montant des cachets et l'augmentation des coûts de sécurité au cours des dernières années, tandis que les soutiens publics et privés sont restés globalement stables, de même que les recettes de billetterie.
L'annulation d'une grande partie des festivals qui devaient se tenir pendant la saison 2020, en particulier les plus gros d'entre eux, du fait de l'interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes jusqu'au 31 août, devrait avoir des répercussions dramatiques, à la fois sur l'activité économique et sur l'emploi.
Si le ministre de la culture avait annoncé, à la suite du discours du Président de la République le 6 mai, la création d'un « fonds festival qui viendra soutenir le monde du festival », celui-ci n'a toujours pas vu le jour, alors que les premiers festivals de cette édition 2020 singulière pourraient se tenir dès le mois de juillet. Sa création ne figure pas dans le PLFR 3 pour 2020, déposé devant le bureau de l'Assemblée nationale le 10 juin. Ses crédits pourront difficilement être pris sur les 50 millions d'euros promis au CNM, dans la mesure où ce fonds ne peut pas être géré par ce seul opérateur, puisqu'il priverait de soutien tous les festivals qui ne sont pas musicaux.
La création de ce fonds revêt pourtant un enjeu majeur pour l'avenir des festivals , à la fois pour soutenir ceux contraints à l'annulation à surmonter ce cap difficile, pour aider ceux qui auront lieu à faire face au manque à gagner et aux surcoûts liés au protocole sanitaire, et pour accompagner ceux qui tentent de réinventer à la dernière minute leur édition 2020 pour éviter que l'été en France ne manque de vie et reste silencieux, faute de festivals.
Recommandation n° 13 : Mettre en place avant l'été un fonds de soutien aux festivals, comme annoncé par le Gouvernement le 6 mai dernier, et pérenniser la « cellule festivals ».
Ø Renforcer la politique de l'État en direction des festivals
Le soutien de l'État aux festivals a été recentré au cours de la dernière décennie, avec une réduction du nombre de festivals subventionnés. Malgré le travail réalisé en 2018 par Serge Kancel en matière de recensement des festivals, aucune suite n'a véritablement été donnée à sa mission jusqu'à présent. La connaissance des festivals reste encore très partielle , comme en témoignent les écarts concernant le nombre de festivals en France chaque année avancé par les uns et les autres (entre 2 500 et 6 000). L'absence d'une définition unanimement partagée du terme de festivals n'y est sans doute pas étrangère. Les retombées économiques des festivals et leur contribution à l'emploi et au dynamisme des territoires n'ont jamais été précisément mesurées.
Une observation plus fine de l'écosystème des festivals serait très utile pour adapter la politique de l'État en direction des festivals. La crise sanitaire peut en fournir l'occasion grâce, d'une part, aux liens renoués par les services déconcentrés du ministère de la culture avec des festivals avec lesquels la relation était distendue ou inexistante et, d'autre part, à la création au sein de l'administration centrale d'une cellule festivals qu'il serait justifié de pérenniser .
Compte tenu de la multiplicité des enjeux liés aux festivals et de leurs retombées nombreuses, le groupe de travail estime qu'il pourrait être bénéfique de développer une approche interministérielle sur la question des festivals , entre les ministères chargés de la culture, du tourisme, de l'économie, de la cohésion des territoires et de l'intérieur. Elle pourrait entraîner une nouvelle dynamique favorable à la relance, sous réserve que chaque ministère impliqué ait à coeur de soutenir avant tout l'effervescence des festivals.
Recommandation n° 14 : Approfondir la connaissance de l'écosystème des festivals et réorganiser la politique de l'État en faveur des festivals.
C. AMÉLIORER L'EXERCICE DE LA COMPÉTENCE CULTURELLE
La gestion de la crise sanitaire a mis en lumière la nécessité d' accroître le dialogue entre les différents acteurs de la culture.
Alors que l'article 3 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, pose le principe d'une élaboration conjointe des politiques culturelles entre l'État et les collectivités territoriales, en concertation avec les acteurs de la création artistique, les personnes que le groupe de travail a auditionnées ont déploré la faiblesse de la concertation à l'occasion de la crise sanitaire.
Il s'agit d'un point particulièrement problématique dans le contexte actuel, dans la mesure où c'est la responsabilité des collectivités territoriales ou des structures qui pourrait être engagée si des contaminations survenaient dans les établissements une fois l'activité reprise.
Le groupe de travail estime que les critiques formulées par les acteurs concernant, d'une part, le manque de visibilité sur les perspectives et les conditions de reprise de l'activité et, d'autre part, la multiplication des injonctions contradictoires auraient pu être atténuées grâce à un dialogue plus régulier entre les principaux acteurs de la vie culturelle. Des échanges continus autour des différents scenarii envisagés aurait permis aux acteurs de se sentir informés et de pouvoir mieux anticiper et préparer la reprise, dans un domaine dans lequel la programmation tient une place essentielle.
Se posent dès lors la question des outils pour faciliter ce dialogue , comme celle du renforcement de la structuration de certaines filières, préalable indispensable à des échanges féconds.
1. La nécessité d'une véritable co-construction des politiques culturelles avec les collectivités territoriales
a) Créer les conditions d'un dialogue équitable et opérationnel
Le dialogue entre l'État et les collectivités territoriales doit absolument être intensifié, afin de permettre aux collectivités publiques d'exercer véritablement conjointement, comme le prévoit l'article 103 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), la responsabilité en matière culturelle.
La commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat alerte à ce sujet depuis plusieurs années, déplorant les dysfonctionnements rencontrés par plusieurs commissions culture des conférences territoriales de l'action publique et l'absence d'outil efficace pour assurer la coordination des actions de l'État et des collectivités territoriales.
Face à la nécessité de mettre en place, au plus vite, un plan de relance très puissant en faveur du secteur de la création, la crise sanitaire a rendu le besoin d'un dialogue régulier encore plus impérieux .
Les collectivités territoriales, qui assument habituellement 80 % des dépenses culturelles, ont été particulièrement sollicitées ces derniers mois. Les structures culturelles se sont largement tournées vers elles pour parer à l'urgence. Les collectivités se sont globalement montrées réactives. De nombreuses collectivités, tous échelons confondus, ont veillé à maintenir le montant des subventions votées et à en anticiper le versement. Beaucoup ont par ailleurs mis en place des fonds de soutien spécifiques. L'instauration de ces différentes mesures s'est faite de manière indépendante, avec pour conséquence un accompagnement très variable des structures culturelles selon les territoires .
Les collectivités ne sont guère associées à la définition du cadre pour la reprise de l'activité ou du plan de relance pour le secteur . Alors qu'elles n'avaient pas été consultées pour la définition des premières orientations du plan de soutien pour la culture, le Président de la République ne les a mentionnées, dans son discours du 6 mai, que pour les inviter à abonder les dispositifs mis en place par le Gouvernement, ignorant les initiatives qu'elles ont prises de leur côté ces derniers mois, mais aussi les contraintes budgétaires auxquelles elles font face.
La crise sanitaire devrait en effet durablement peser sur leurs budgets . Leurs dépenses culturelles sont particulièrement élevées depuis le début de la crise avec, dans l'ensemble, le choix de maintenir les subventions, de régler les prestations des événements programmés annulés, et la nécessité, à terme, de compenser les pertes de recettes subies par les établissements publics du fait de l'interruption de l'activité. Le maintien en vigueur du « pacte de Cahors », qui lie un grand nombre d'entre elles financièrement à l'État en les obligeant à maintenir la croissance de leurs dépenses de fonctionnement dans la limite de 1,2 %, aurait pu constituer un frein pour leur permettre d'engager de nouvelles dépenses, tout en les privant totalement de la possibilité de mener à bien leurs propres initiatives. La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 en a heureusement suspendu l'application pour permettre aux collectivités territoriales de participer à l'effort de soutien et de relance, mais uniquement pour l'année 2020. Or, il est peu probable que le soutien public à la relance se limite à 2020 dans le domaine culturel. Il serait donc souhaitable de prolonger l'assouplissement des règles du « pacte de Cahors » à l'année 2021, au moins en ce qui concerne les dépenses culturelles.
Recommandation n° 15 : Maintenir en 2021 les dépenses culturelles des collectivités territoriales en dehors de l'application du « pacte de Cahors » afin de permettre aux collectivités territoriales de participer à la reprise de l'activité culturelle.
L'attitude de l'État à l'égard des collectivités territoriales en matière culturelle alimente chez elles un sentiment de frustration face à la faible confiance qui leur est accordée et à leurs marges de manoeuvre limitées . Si les collectivités territoriales se sont vues reconnaître un pouvoir de décision en matière de réouverture des écoles, elles doivent en revanche obtenir l'autorisation préalable du préfet pour la réouverture des établissements culturels.
Les collectivités territoriales ne veulent plus être réduites à un rôle de simple contributeur, estimant que leurs actions en matière culturelle mériteraient qu'elles soient traitées comme de véritables partenaires . Le report des élections municipales a sans doute contribué à fragiliser la position des communes au cours des derniers mois. L'organisation du second tour des élections municipales le samedi 28 juin 2020 devrait créer des conditions plus favorables pour renouveler le dialogue entre l'État et les collectivités territoriales en matière culturelle.
Les représentants des collectivités territoriales que le groupe de travail a entendus ont indiqué qu'ils attendaient de l'État qu'il édicte davantage de prescriptions générales et laisse les collectivités territoriales les mettre en oeuvre en les adaptant si nécessaire. Ils ont regretté les contrôles systématiques de l'État, en particulier a priori , sur l'action des collectivités territoriales, qu'ils jugeaient infantilisants et inutiles compte tenu des sanctions, soit juridiques, soit morales (avec le vote des administrés), auxquelles les collectivités faisaient face dans les cas où elles auraient mal agi ou auraient été défaillantes.
Dans le contexte de la crise sanitaire, ils ont fait part de leur souhait de voir l'État rapidement donner des indications très précises concernant les règles applicables à la reprise de l'activité et son calendrier, de manière à éviter que des informations contradictoires soient communiquées par différents services de l'État.
Recommandation n° 16 : Traiter les collectivités territoriales comme de vrais partenaires plutôt que comme de simples contributeurs financiers à la mise en oeuvre des politiques nationales définies par le Gouvernement.
La transformation, en octobre 2019, du Conseil des collectivités territoriales pour le développement culturel (CCTDC) en Conseil des territoires pour la culture (CTC) a permis de faciliter les échanges entre le ministère et les associations d'élus. Le ministre de la culture a pris l'initiative, dès le mois d'avril, de décliner ce dispositif au niveau territorial pour permettre aux collectivités publiques de débattre de la situation du secteur de la culture dans chacune des régions. Leurs réunions d'installation se sont généralement tenues dans le courant du mois de mai.
Pour autant, la composition de ces CTC régionaux , constitués de représentants d'associations d'élus du territoire sur le modèle du CTC national, ne leur permet pas de donner leur pleine mesure. D'une part, la présence de représentants d'associations d'élus présente le risque que les discussions portent essentiellement sur les grands principes, comme au niveau national, et ne soient pas suffisamment concrètes . D'autre part, la composition des CTC régionaux ne reflète pas les spécificités organisationnelles de chaque territoire en matière de culture. Les petites communes et intercommunalités, qui construisent au quotidien la culture dans les territoires, n'y sont pas correctement représentées.
Recommandation n° 17 : Faire évoluer la composition des CTC régionaux afin qu'ils ne se contentent pas de reproduire les échanges qui se tiennent déjà au niveau national, mais permettent d'enregistrer des avancées concrètes sur les actions à mener en matière culturelle sur le territoire concerné et la répartition des tâches entre les différentes collectivités publiques.
De ce fait, les CTC régionaux n'ont pas aujourd'hui un caractère véritablement plus opérationnel que les commissions culture des conférences territoriales de l'action publique (CTAP culture). Dans les régions dans lesquelles les CTAP culture étaient efficaces, comme la Bretagne, la mise en place des CTC pourrait même retarder le traitement de la situation d'urgence, du fait des délais inhérents à la mise en route de ce type d'instances. C'est l'une des raisons qui conduit aujourd'hui plusieurs élus bretons à proposer au ministre de la culture que le plan de relance en faveur de la culture dans leur région soit co-construit au sein de la CTAP culture, qui est dans cette région co-pilotée par la Région et l'État.
Recommandation n° 18 : Privilégier les instances les plus efficaces et opérationnelles en régions pour définir au plus vite la réponse des collectivités publiques à la crise sanitaire en matière culturelle.
b) Encourager le maintien des investissements des collectivités territoriales dans le champ culturel
Les acteurs culturels que le groupe de travail a auditionnés ont de nouveau manifesté la crainte d'un désengagement des collectivités territoriales dans les prochains mois, sous l'influence de deux principaux facteurs : d'une part, les alternances politiques suite aux élections municipales et, d'autre part, l'impact de la crise sanitaire sur les finances des collectivités territoriales, qui enregistrent à la fois une explosion de leurs dépenses et une baisse importante de leurs recettes. Cette crainte est d'autant plus élevée que la culture, étant une compétence partagée, est particulièrement sensible au désengagement d'une collectivité qui, par le signal envoyé, peut entraîner celui des autres.
Ce risque apparait effectivement crédible, comme en témoigne la décision de plusieurs collectivités de renoncer à l'octroi de subventions qu'elles avaient pourtant promises. Le soutien des collectivités territoriales est pourtant primordial pour permettre aux artistes et aux structures culturelles de surmonter la crise.
Plusieurs pistes sont régulièrement évoquées pour éviter les ravages liés au désengagement brutal d'une collectivité territoriale, comme assigner une compétence obligatoire en matière culturelle à certains échelons territoriaux ou désigner une collectivité chef de file. Elles auraient le mérite de faire émerger au niveau local un échelon plus puissant pour discuter avec l'État. Nos collègues, Antoine Karam et Sonia de la Provôté, auteurs il y a quelques mois d'un rapport sur les nouveaux territoires de la culture au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, ont toutefois montré que ces solutions comportent également des effets pervers, soit en privant les autres échelons d'intervenir si jamais l'échelon compétent n'exerçait pas sa compétence, soit en décourageant les autres échelons territoriaux de poursuivre leurs actions culturelles.
L'autre crainte exprimée par les acteurs culturels reste celle d'une décentralisation complète des politiques culturelles , au regard du danger qu'elle représenterait pour l'équité territoriale en matière d'accès à la culture. La future loi « 3 D », qui doit approfondir les processus de décentralisation et de déconcentration, tout en ménageant davantage de possibilités de différenciation, cristallise les inquiétudes si elle venait à autoriser les collectivités à s'écarter trop largement du cadre national, compte tenu du risque qu'un président d'exécutif local puisse avoir une vision de la culture différente de celle défendue jusqu'ici par l'État. C'est la raison pour laquelle il parait indispensable que l'État conserve à l'avenir a minima un rôle de garant de l'équité territoriale en matière culturelle , recouvrant à la fois un rôle de prescripteur et un rôle d'intervenant à titre subsidiaire. Les expérimentations en matière culturelle ne doivent pas être un moyen pour l'État de se décharger sur les collectivités de ses missions, au risque de creuser les inégalités à la fois entre les territoires ruraux et les territoires urbains, et selon le niveau de ressources des collectivités.
Dans ce souci d'équité territoriale, il serait bon que l'État contractualise avec les collectivités territoriales afin de les inciter à maintenir leurs financements en faveur de la culture et de définir les modalités d'articulation de leurs interventions. Ces formes de contractualisation ont déjà existé par le passé. Fin 2014, l'État avait mis en place des « pactes culturels » pour combattre la tentation des villes de réduire le montant des crédits qu'elles allouent à la culture. Abandonnés depuis, près d'une centaine de pactes avaient alors été conclus, pour une durée de trois ans, par l'État et une commune ou une intercommunalité sur la base d'un engagement respectif à maintenir le niveau de leurs subventions pendant cette période.
Recommandation n° 19 : Relancer l'idée de « pactes culturels » afin de conclure des contrats avec les collectivités territoriales pour éviter qu'elles ne se désengagent en matière culturelle dans les mois à venir et garantir ainsi une sanctuarisation des budgets des collectivités publiques consacrés à la culture.
2. Mieux prendre en compte les besoins des acteurs des filières du spectacle vivant et des arts visuels
a) Mobiliser et développer les outils existants
Les représentants des différentes filières que le groupe de travail a auditionnés se sont inquiétés des capacités financières qui resteraient à la disposition du CNM et du CNAP à l'issue de la crise pour poursuivre leurs missions et participer à la relance si leur dotation n'est pas de nouveau abondée, compte tenu de la manière dont leurs budgets sont sollicités pour répondre à la situation d'urgence.
Cette crainte était particulièrement vive en ce qui concerne le CNM, entré en fonction le 1 er janvier 2020 avec un budget déjà nettement inférieur aux demandes qui avaient été identifiées. L'abondement de 50 millions d'euros de ses ressources dans le cadre du PLFR 3 pour 2020 pourrait dissiper à court terme les inquiétudes. L' affectation à cet opérateur de nouvelles ressources fiscales , significatives et pérennes, demeure un enjeu majeur pour la filière, compte tenu des difficultés que pourrait rencontrer le CNM l'année prochaine du fait du rendement quasi nul de la taxe sur les spectacles en 2020, qui constitue l'une de ses principales modalités de financement. Il conviendrait que des dispositions soient prévues dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021.
Recommandation n° 20 : Veiller à ce que le CNM et le CNAP soient dotés de moyens suffisants pour poursuivre leurs activités non liées au soutien déployé dans le cadre de la crise.
Les personnes auditionnées ont, de manière unanime, jugé insuffisant le dialogue avec les services de l'État autour des conditions de reprise de l'activité et de la mise en place d'un plan de relance . Ils ont fait part de leur souhait que le Conseil national des professions du spectacle (CNPS) et le Conseil national des professions des arts visuels (CNPAV) soient davantage consultés en de pareilles circonstances sur les projets de décision relatifs à la reprise de l'activité, afin de mieux tenir compte des besoins et des contraintes rencontrés par la diversité des acteurs sur le terrain.
Recommandation n° 21 : Associer le CNPS et le CNPAV à l'élaboration des décisions concernant leur secteur respectif.
Ils ont également insisté sur l'importance d' associer les acteurs culturels dans les discussions menées au niveau régional entre l'État et les collectivités territoriales . Dans leur rapport consacré aux « nouveaux territoires de la culture », Antoine Karam et Sonia de la Provôté avaient eux-mêmes invité à « développer sur l'ensemble des territoires des instances de dialogue avec les acteurs culturels - soit au niveau des régions ou, notamment dans le cas où les disparités régionales sont trop fortes, au niveau des départements ». Ils indiquaient que de tels lieux pourraient être utiles afin de mieux identifier les enjeux au niveau local, de faciliter la structuration des filières et de satisfaire aux attentes d'une territorialisation accrue des politiques culturelles, en permettant d'impliquer les acteurs culturels à la définition des besoins et à l'élaboration des politiques culturelles à l'échelle du territoire.
S'il existe, dans le secteur du spectacle vivant, des comités régionaux du spectacle vivant (COREPS) qui réunissent les organisations professionnelles et les représentants de l'État, les collectivités territoriales et les organismes paritaires, il n'en est pas de même pour le secteur des arts visuels, dont l'instance nationale n'a été mise en place que depuis décembre 2018. La crise révèle une nouvelle fois le déficit de structuration de la filière des arts visuels , qui constitue aujourd'hui un obstacle à un dialogue institutionnalisé avec les représentants de la filière.
Recommandation n° 22 : Mobiliser davantage les COREPS au niveau régional pour instaurer un dialogue avec les acteurs de la filière du spectacle vivant permettant d'apporter une réponse efficace au niveau local.
b) Accorder davantage de moyens à la structuration de la filière des arts visuels
La faible structuration professionnelle du secteur des arts visuels constitue aujourd'hui un handicap pour garantir une correcte prise en compte des enjeux de cette filière au niveau national comme au niveau territorial.
Le manque de moyens aujourd'hui alloués au fonctionnement du CNPAV constitue cependant aujourd'hui un frein au bon fonctionnement de cette instance, auquel il conviendrait de remédier. Créé il y a seulement dix-huit mois, ce nouveau lieu d'échanges n'a pas jusqu'ici produit les résultats attendus, faute de moyens pour faciliter la structuration de la filière et répondre aux différents enjeux identifiés comme prioritaires. Les artistes visuels le regrettent d'autant plus que cette instance ne leur permettra pas, dans ces circonstances, de peser dans les débats législatifs à venir, tel le projet de loi « 3 D ». Le manque de moyens du CNPAV les prive également de modalités de concertation efficaces avec les collectivités territoriales.
L'élaboration des schémas d'orientation pour les arts visuels (SODAVI) constitue à l'heure actuelle une priorité pour déboucher sur la signature de contrats de filière, sur le modèle de celui conclu en Nouvelle-Aquitaine en 2018. Ils apparaissent comme les prémices à la création de structures de dialogue plus institutionnalisées entre l'État, les collectivités territoriales et les représentants de la filière des arts visuels au niveau territorial, à l'image des COREPS dans le secteur du spectacle vivant.
Recommandation n° 23 : Doter le CNPAV de moyens lui permettant de remplir correctement ses missions et faire en sorte que l'ensemble des régions soient dotées de SODAVI.
*
La culture n'a jamais été aussi vitale qu'aujourd'hui. Le secteur a été très durement touché par la crise du Covid-19. En conséquence, les membres du groupe de travail appellent à un véritable plan de relance en faveur du monde artistique et culturel afin de lui redonner confiance, visibilité et perspectives.
II. PATRIMOINE
Le groupe de travail « Patrimoine » de la commission de la culture animé par Alain Schmitz (Yvelines, LR) est composé de Catherine Dumas (Paris, LR), Jean-Pierre Leleux (Alpes-Maritimes, LR), Marie-Pierre Monier (Drôme, socialise et républicain), Sonia de la Provôté (Calvados, UC) et Dominique Vérien (Yonne, UC).
Le groupe de travail « Patrimoine » a été mis en place à l'initiative du bureau de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat le mardi 14 avril 2020, afin d'examiner l'impact de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 dans le domaine du patrimoine et de suivre sa gestion par le Gouvernement.
Il a consacré l'essentiel de ses travaux aux enjeux liés à la protection du patrimoine monumental , compte tenu des conséquences terribles de l'épidémie sur les chantiers de restauration du patrimoine. Il s'est également penché sur la situation des opérateurs du ministère de la culture dans le champ des patrimoines, au regard, d'une part, du rôle central joué par ces établissements dans la conservation, la valorisation et la diffusion du patrimoine au plus grand nombre et, d'autre part, de leur contribution au rayonnement de la France dans le domaine artistique et culturel.
Dans le cadre de ses travaux, il a auditionné Philippe Barbat, directeur général des patrimoines au ministère de la culture, Philippe Bélaval, président du Centre des monuments nationaux (CMN) et Chris Dercon, président de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais (RMN-GP).
Sur les questions relatives au patrimoine monumental stricto sensu , il a entendu Gilles de Laâge et Frédéric Létoffé, co-présidents du Groupement des entreprises de restauration des monuments historiques (GMH), Olivier de Lorgeril, président de la Demeure historique (DH), Philippe Toussaint, président des Vieilles Maisons françaises (VMF), Fabien Sénéchal, architecte des bâtiments de France à la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bretagne et président de l'Association nationale des architectes des bâtiments de France (ANABF), ainsi qu'Henry Masson, chef de la conservation régionale des monuments historiques à la DRAC de Bretagne.
Ces auditions lui ont permis de mesurer à quel point le secteur des patrimoines se retrouvait lui aussi considérablement affecté par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 en France, au risque de saper les efforts entrepris ces dernières années pour faire du patrimoine une « cause nationale », comme l'avait déclaré le Président de la République Emmanuel Macron lors d'une réception organisée le 31 mai 2018 en l'honneur des personnalités engagées pour le patrimoine.
La fermeture au public des musées et monuments comme l'interruption des chantiers de restauration ont des répercussions significatives sur l'emploi, les différentes filières économiques et l'accès à la culture . La reprise de l'activité n'est, aujourd'hui encore, que balbutiante et de nombreuses incertitudes demeurent sur les modalités de reprise d'un certain nombre d'activités. Dans ce contexte, le risque de faillites , susceptibles de déstabiliser durablement le secteur et de conduire à la disparition de nombreux savoir-faire , reste particulièrement important.
Les membres du groupe de travail sont convaincus que le patrimoine doit constituer l'un des axes du plan de relance .
D'une part, la relance du secteur du patrimoine répond à des enjeux économiques . Avant la crise, le patrimoine représentait, en chiffres d'affaires cumulés, près de 8 milliards d'euros, soit près de 1,4 % du PIB. Il s'agit d'un secteur essentiel au dynamisme économique de notre pays et à l'attractivité de nos territoires . Il participe à l'amélioration du cadre de vie des Français et constitue un atout déterminant pour accroître le potentiel de développement touristique de notre pays.
Ce n'est pas un hasard si le patrimoine a d'ailleurs constitué, après la crise économique de 2008 , l'une des quatre priorités du programme d'investissements qui avait été mis en place. 100 millions d'euros supplémentaires avaient alors été alloués pour des investissements dans le domaine de la culture et du patrimoine historique, au regard des effets attendus de ces financements à court et à long termes sur l'activité économique, l'emploi et le redressement du potentiel de la croissance économique.
D'autre part, les membres du groupe de travail estiment que le patrimoine peut constituer une réponse à la crise de confiance et à la perte de repères suscitées par la crise sanitaire actuelle. Il est un marqueur important de l'identité collective de la France, un objet de fierté et un trait d'union entre les Français. Aussi peut-il jouer un rôle significatif pour renforcer de manière concrète la cohésion entre les citoyens, au plus près des territoires, mais aussi, dans une certaine mesure, contribuer à « réenchanter » leur quotidien aujourd'hui bousculé.
Les recommandations que le groupe de travail a formulées visent à répondre à ces préoccupations. Celui-ci s'est efforcé de construire des propositions équilibrées et raisonnables au regard des fortes sollicitations dont nos finances publiques font déjà aujourd'hui l'objet. La plupart des propositions du groupe de travail correspondent à des recommandations formulées de longue date par la commission de la culture du Sénat, tant la crise sanitaire actuelle n'a, en fin de compte, fait qu'exacerber les difficultés rencontrées par ce secteur.
A. LE SPECTRE D'UNE CRISE DURABLEMENT ANCRÉE
1. De vives inquiétudes en matière de restauration des monuments historiques
a) Un impact économique atténué à court terme grâce aux aides d'urgence
Le ministère de la culture a rapidement mis en place une cellule d'écoute et d'information à l'intention des professionnels du patrimoine au sein des services du ministère afin de répondre au mieux à leurs demandes et à leurs interrogations.
Le groupe de travail tient à saluer les efforts du ministère de la culture pour adapter les critères d'octroi des mesures générales de soutien mises en place par le Gouvernement afin d'en faciliter l'accès aux entreprises et professionnels du patrimoine.
Les entreprises de restauration des monuments historiques ont confirmé avoir pu accéder aux dispositifs de soutien, ce qui leur avait permis de surmonter leurs problèmes de trésorerie à court terme. Elles ont également salué la célérité avec laquelle les factures pendantes avaient été réglées par les différentes collectivités publiques.
Les propriétaires d'un monument historique en société civile immobilière (SCI) ouvert au public ont, de leur côté, eu accès au fonds de solidarité, au dispositif du report de charges, ainsi qu'à celui de garantie des prêts par l'État.
La création d'un fonds de solidarité destiné aux professionnels des métiers d'art, directement géré par l'Institut national des métiers d'art, est encore à l'étude.
b) Une reprise des chantiers délicate
Malgré la publication, dès le 2 avril , d'un guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de construction destiné à faciliter la reprise progressive des chantiers, l'activité demeure, aujourd'hui encore, faible et considérablement ralentie.
Les raisons en sont nombreuses : refus de certains maîtres d'ouvrage, en particulier publics, d'autoriser la reprise du chantier en application d'un principe de précaution ; inquiétudes des entreprises de restauration sur leur capacité à garantir à leurs employés des conditions de travail suffisamment sécurisées ; difficultés financières de certaines entreprises ; pénurie de matières premières ; difficultés à coordonner les différents corps de métiers intervenant sur un même chantier...
De fait, la reprise se révèle plus aisée pour les petits chantiers ou pour ceux situés en zones rurales. Elle est également plus évidente pour les chantiers déjà soumis à des conditions de sécurité renforcées du fait, par exemple, d'un risque d'exposition au plomb. Elle s'avère en revanche terriblement complexe pour les chantiers situés dans des zones densément peuplées ou pour les chantiers en co-activité.
Comme pour l'ensemble du secteur de la construction, se pose la question de la prise en charge des surcoûts liés aux mesures sanitaires, qui atteindraient en moyenne 15 %, et aux retards que celles-ci entraîneront par rapport à la date prévue de livraison des travaux. L'ampleur des surcoûts et des retards dépend largement de la dimension des chantiers : plus le chantier est important et fait intervenir de multiples entreprises et corps de métiers, plus les surcoûts sont élevés et les retards significatifs.
Compte tenu de leurs faibles marges, les entreprises de restauration des monuments historiques indiquent ne pas être en mesure d'assumer ces surcoûts seules. Elles demandent que des consignes soient données au niveau national sur les modalités de leur répartition, afin d'éviter que cette question ne donne lieu à des tours de table interminables entre maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre et entreprises. Aucune décision n'a encore été prise à ce stade. Sans attendre, certaines DRAC ont fait le choix d' inclure ces surcoûts dans le montant de la dépense subventionnable , de manière à alléger leur poids pour les entreprises. Le groupe de travail estime que cette pratique mériterait d'être généralisée.
Lors de son audition par le groupe de travail, Gilles de Lâage, co-président du GMH, a indiqué que la mise en place à titre strictement temporaire d'assouplissements au temps de travail , une fois les risques liés à la propagation de l'épidémie levés, pourrait favoriser le rattrapage d'une partie du retard accumulé depuis le début de l'année et accroître le niveau d'activité de leurs entreprises. Les membres du groupe de travail sont partagés au sujet de cette proposition.
c) Des conséquences inéluctables à moyen terme
Le secteur de la restauration de patrimoine devrait se retrouver durablement impacté par l'épidémie de Covid-19. Les personnes que le groupe de travail a entendues ont estimé qu'un rattrapage de l'activité perdue pendant la période d'interruption serait impossible au regard du rythme ralenti auquel les chantiers reprennent.
Les perspectives d'activité d'ici la fin de l'année sont aujourd'hui réduites , compte tenu des retards pris dans la délivrance des autorisations d'urbanisme pendant la période de confinement et de l'absence d'ouverture du moindre appel d'offres depuis la mi-mars.
Deux facteurs supplémentaires attisent les inquiétudes :
- d'une part, le contexte électoral . Le renouvellement des équipes municipales peut entrainer des changements d'approche en matière culturelle et se traduire par l'abandon de plusieurs projets initiés par les équipes précédemment en place. Les craintes sont d'autant plus fortes dans le contexte économique actuel, où les finances des collectivités territoriales sont mises à rude épreuve. En outre, le report des élections municipales contribue à l'atonie actuelle et explique sans doute très largement l'absence de nouveaux appels d'offres au cours des dernières semaines ;
- d'autre part, la capacité des propriétaires privés à financer les travaux d'entretien ou de restauration qu'ils projetaient dans les mois à venir, en l'absence de recettes générées par leur activité d'ouverture au public. Le risque qu'ils décident de reporter ou de renoncer à ces travaux est aujourd'hui élevé.
Au regard de la fragilité des entreprises de restauration des monuments historiques qui préexistait à la crise sanitaire, le dépôt de bilan et la faillite d'un certain nombre d'entre elles apparaissent inévitables. Ils auraient des conséquences en cascade sur les chantiers en co-activité sur lesquelles elles intervenaient et sur la formation aux métiers du patrimoine, auxquels il convient d'être vigilant.
2. Une situation des opérateurs préoccupante
a) Une sévérité des dommages corrélée au taux des ressources propres au sein du budget de l'opérateur
La crise sanitaire n'a pas épargné les établissements publics, au premier rang desquels les principaux opérateurs de l'État. Ses conséquences sont particulièrement douloureuses pour les opérateurs dont le montant des ressources propres excède largement le montant des subventions qu'ils perçoivent. La RMN-GP, l'établissement public du château de Versailles, le musée Picasso, le musée du Louvre, le Centre des monuments nationaux ou le Musée d'Orsay sont des établissements dont le budget est majoritairement constitué par leurs ressources propres.
La fermeture des établissements se traduit par d'importants manques à gagner sur les différentes catégories de ressources propres , en particulier :
- la billetterie ;
- la médiation et les différents services aux visiteurs, par exemple les visites guidées, les ateliers, les audioguides ou les services de restauration gérés directement par les établissements ;
- la vente des publications et des produits dérivés du fait de la fermeture associée des librairies et boutiques, y compris, dans la majorité des cas, de la vente en ligne ;
- les activités culturelles annexes, à savoir les spectacles produits ou coproduits, les activités des auditoriums ou les recettes de formations ;
- les opérations de valorisation du domaine, qui recouvrent par exemple les redevances de concessions, les prises de vues et tournages, les locations d'espaces publicitaires ou les locations d'espaces pour de l'événementiel.
La demande répétée de l'État au cours des dernières années d'accroitre le niveau de leurs ressources propres les a rendus plus vulnérables face à ce type de crise.
b) Des risques persistants en dépit de la reprise programmée de l'activité
Même une fois le redémarrage complet de leurs activités possible, les opérateurs ne cachent pas leurs inquiétudes concernant leurs perspectives pour la fin de l'année 2020 et l'année 2021 en raison de deux incertitudes majeures.
Ø La première concerne la reprise de la fréquentation.
Même si le Premier ministre n'a pas exclu, lors de sa conférence de presse du 28 mai 2020, la possibilité d'une réouverture des frontières extérieures à l'Europe, en coordination avec les partenaires européens, le nombre de touristes étrangers susceptible de se rendre en France cet été sera sans doute extrêmement réduit, alors qu'ils constituent une part majoritaire des publics de plusieurs établissements. Le musée du Louvre, dont 80 % des visiteurs proviennent de l'étranger, s'attend à une fréquentation située à 30 % de son niveau habituel au moment de sa réouverture.
L'attention des établissements se focalise donc sur l'attitude qu'adopteront les visiteurs français , oscillant entre l'envie de renouer avec des pratiques culturelles et la peur de s'exposer au virus en fréquentant un lieu public. D'après les informations recueillies par le groupe de travail, le public se serait très largement montré au rendez-vous pour visiter les premiers monuments autorisés à rouvrir après la levée du confinement le 11 mai, mais la fréquentation aurait eu tendance à stagner ensuite. Des efforts de communication apparaissent donc indispensables pour rassurer les publics.
Ø La seconde porte sur les recettes de mécénat.
Les opérateurs anticipent une baisse des recettes liées au mécénat à compter du second semestre, sans être pour autant en mesure à ce stade d'en mesurer l'ampleur.
Plusieurs facteurs étayent ces craintes :
- un effet d'éviction créé par l'élan de générosité en faveur de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris . Cet effet a été particulièrement ressenti par le Centre des monuments nationaux, qui fait traditionnellement appel au mécénat pour financer partiellement un certain nombre d'opérations de restauration sur ses monuments ;
- la réduction de 60 % à 40 %, à compter de l'exercice 2020, de l'avantage fiscal accordé aux entreprises pour les versements effectués au titre du mécénat excédant 2 millions d'euros , en application de la nouvelle rédaction de l'article 238 bis du code général des impôts résultant de l'article 134 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- les difficultés financières des entreprises à la suite de la crise sanitaire ;
- la baisse de l'attractivité des actions de mécénat dans le domaine culturel dans le contexte de la crise sanitaire, où les entreprises privilégient en premier lieu les dons au profit des institutions sanitaires.
Ce sujet préoccupe également les associations de sauvegarde du patrimoine , comme la Fondation du patrimoine, qui financent une part croissante de leurs opérations par le biais de dons émanant des particuliers et des entreprises. Cette fondation anticipe une forte réduction de ses ressources liées au mécénat l'an prochain.
Dans ce contexte incertain, la direction générale des patrimoines du ministère de la culture a indiqué qu'elle évaluait à 400 millions d'euros le montant des pertes de ses opérateurs d'ici la fin de l'année 2020 .
B. LES PRÉCONISATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL POUR PRÉSERVER LA DYNAMIQUE EN MATIÈRE DE PROTECTION DU PATRIMOINE
1. Les questions relatives au budget de l'État
a) Un besoin impérieux de maintien des financements
Il apparaît primordial que le patrimoine ne serve pas de variable d'ajustement dans les prochains mois face aux besoins engendrés par la crise sanitaire, alors que nos monuments et nos musées sont essentiels à la relance, que ce soit en tant que vecteur d'émancipation pour les citoyens, que levier de cohésion ou que facteur de rayonnement de notre pays et d'attractivité de nos territoires. La disparition de la réserve parlementaire en 2017 prive aujourd'hui les acteurs du patrimoine d'un outil qui pouvait se révéler particulièrement efficace en de pareilles circonstances pour financer des opérations de restauration du patrimoine.
Ø Pas de coup de rabot sur les crédits du programme 175 dans le cadre d'une loi de finances rectificative pour 2020
Le constat dressé par le Gouvernement en novembre 2017 lors de l'adoption de la stratégie pluriannuelle en faveur du patrimoine reste toujours d'une grande actualité : l'absence de stabilité et de visibilité concernant les financements publics génère des incertitudes préjudiciables à l'accomplissement des projets de restauration, d'entretien et de valorisation du patrimoine, dans la mesure où ces initiatives ont besoin de s'inscrire dans la durée .
Pour ne pas casser l'intérêt grandissant pour la cause du patrimoine sous l'effet du lancement de la mission Bern et du Loto du patrimoine notamment, il est impératif de maintenir en place la stratégie pluriannuelle en faveur du patrimoine , qui comporte notamment l'engagement d'une sanctuarisation des crédits destinés au patrimoine monumental tout au long du quinquennat .
La tentation de réduire les crédits du programme 175 par le biais d'une loi de finances rectificative pour 2020 doit absolument être évitée, au regard des effets dramatiques qu'une telle réduction aurait sur toute une filière économique essentielle à nos territoires et sur l'état de notre patrimoine. Le dernier bilan sanitaire du patrimoine protégé, réalisé en 2018, a montré que les besoins de restauration restent importants : 23 % des immeubles sont en péril ou en mauvais état et seuls 35 % peuvent véritablement être considérés en bon état. Les moyens financiers inscrits en loi de finances initiale pour 2020 demeurent donc indispensables pour entretenir, restaurer et valoriser correctement nos monuments.
Ø Pérenniser le Loto du patrimoine en 2021
Depuis son lancement en 2018, le Loto du patrimoine a joué un rôle considérable pour améliorer la protection du petit patrimoine . Il a permis d'apporter des financements supplémentaires et de sensibiliser les Français à cette cause, tout en facilitant le recensement du patrimoine menacé.
La poursuite de ce dispositif l'année prochaine n'est toutefois pas garantie. La convention conclue entre le ministère de la culture et la Fondation du patrimoine en février 2018 ne prévoit l'organisation de l'opération que pour une durée de trois ans.
Compte tenu du caractère précieux de cet outil pour de nombreux territoires en particulier ruraux et de l'activité qu'il génère pour les entreprises spécialisées dans la restauration du patrimoine, il paraît fondamental de pérenniser le Loto du patrimoine ou, à tout le moins, de reconduire le dispositif pour une nouvelle période de trois ans .
Au regard de l'ampleur des besoins dans le domaine du patrimoine, il semblerait également important que l'État renonce définitivement aux taxes qu'il perçoit à la fois sur le tirage et les jeux de grattage du Loto du patrimoine afin de les réinjecter en faveur de la protection du patrimoine, comme il l'avait fait la première année de l'opération, en 2018.
Ø Différer à l'exercice 2022 l'entrée en vigueur des dispositions réduisant l'incitation au mécénat pour les grandes entreprises
Compte tenu des contraintes pesant sur les budgets publics et de la contribution désormais importante des acteurs privés au financement des actions de protection du patrimoine et des projets des établissements patrimoniaux, il serait souhaitable de reporter à 2022 l'entrée en vigueur des dispositions introduites par la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, qui réduisent l'avantage fiscal aux entreprises qui consentent des dons dans le cadre du mécénat au-delà de 2 millions d'euros.
Ce dispositif devrait en effet freiner le mécénat des grandes entreprises qui paraissent pourtant les plus à même de continuer à manifester leur générosité dans le contexte actuel, compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire sur les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises.
Ø Des efforts inévitables en 2021 en ce qui concerne les opérateurs
Le budget pour 2021 qui sera présenté à l'automne aura valeur de test pour se rendre compte la manière dont le Gouvernement entend associer le secteur du patrimoine au processus de relance. Dans ce contexte, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication se montrera très attentive aux crédits qui seront consacrés au patrimoine monumental et aux musées.
Même s'il paraît indispensable que les opérateurs poursuivent leurs efforts pour réduire leurs coûts de fonctionnement et examinent de quelle manière ils pourraient faire évoluer leur modèle de financement, une aide de l'État sur l'exercice 2021 apparait indispensable pour compenser une partie des pertes qu'ils auront subies au cours de l'année 2020 . En dépit de leur prochaine réouverture, les opérateurs continueront à accumuler des pertes au second semestre 2020 et, probablement encore, en 2021. Leurs réserves de trésorerie ne sont pas suffisantes pour leur permettre de poursuivre leur activité l'année prochaine sur les bases habituelles sans renfort de l'État. Allonger la durée des expositions ne permettra pas forcément de réaliser des économies, compte tenu des montants auxquels les oeuvres d'art sont prêtées, et renoncer à certaines grandes expositions aurait des conséquences immédiates sur le niveau de la fréquentation.
Les grands établissements doivent sans cesse se renouveler et se moderniser pour s'adapter aux attentes des publics, particulièrement exigeants. Les efforts réalisés au cours des dernières années ont permis à plusieurs établissements, y compris parmi les plus récents, tel le musée du quai Branly-Jacques Chirac, de figurer parmi les établissements les plus prestigieux et fréquentés dans le monde. Pour plusieurs d'entre eux, des retards ont déjà été accumulés ces dernières années dans la mise en oeuvre de leurs schémas directeurs ou, dans le cas du Centre des monuments nationaux, dans le lancement de plusieurs chantiers sur ses monuments, faute de moyens financiers suffisants. Il convient de prendre garde, au motif que la survie des opérateurs n'est pas véritablement menacée, à négliger de les accompagner face aux conséquences de cette crise, au risque que notre pays perde sa position de leader dans le domaine culturel , dont nous pourrions longtemps payer les conséquences économiques en termes d'attractivité touristique.
À cet égard, une attention particulière doit être portée à la question des budgets d'acquisition de nos musées , qui ont subi de fortes baisses au début de la décennie. Compte tenu des nombreuses annulations de foires d'art internationales dans plusieurs pays en raison de la crise sanitaire, la France pourrait opportunément revaloriser sa place sur le marché de l'art en décidant de maintenir ses principaux événements prévus à l'automne, sous réserve que les exigences sanitaires puissent être respectées.
b) Assurer la consommation des crédits destinés au patrimoine monumental en 2020 et veiller à maximiser leur efficience
Les crédits de l'État destinés au patrimoine monumental jouent un rôle déterminant pour soutenir la filière de la restauration . Leur consommation revêt donc une importance primordiale pour ce secteur. Elle accuse cette année des retards significatifs par rapport aux années précédentes. L' accélération du rythme de consommation revêt donc un enjeu majeur dans le contexte actuel.
Consciente de cet enjeu, la direction générale des patrimoines a indiqué que les DRAC auraient pour instruction de rattraper, d'ici décembre, les retards accumulés dans la consommation des crédits au cours du premier semestre. Afin de garantir une consommation intégrale des crédits au cours de l'année 2020, des crédits pourraient être redéployés entre les DRAC selon les besoins de financement dans chacune des régions - plusieurs cathédrales nécessitent des travaux de restauration. Une partie des crédits déconcentrés pourraient, par ailleurs, être transférée aux opérateurs nationaux afin de financer des opérations, jusqu'ici reportées faute de financements, qui avaient été identifiées dans le cadre des schémas directeurs des établissements ou qui concernent des monuments gérés par le Centre des monuments nationaux.
D' autres pistes mériteraient pourtant d'être prises en considération pour garantir une utilisation plus efficiente des crédits , tout en permettant le lancement rapide d'un certain nombre de chantiers.
Ø Privilégier les opérations pour lesquelles les crédits de l'État créent un effet de levier plutôt que les opérations qui portent sur les seuls monuments historiques appartenant à l'État
Même si l'on peut comprendre la tentation de l'État de consommer prioritairement les crédits pour des projets dont lui-même ou l'un de ses opérateurs assume la maîtrise d'ouvrage, il ne s'agit pas nécessairement des chantiers qui ont les plus fortes retombées , ni pour les entreprises de restauration du patrimoine dans leur ensemble, ni pour tous les territoires.
Les crédits investis par l'État pour subventionner des opérations portant sur des monuments historiques qui ne lui appartiennent pas profitent davantage aux entreprises de restauration des monuments historiques, dans la mesure où des subventions des collectivités territoriales, des aides d'associations de sauvegarde du patrimoine et/ou une prise en charge des travaux par les propriétaires privés s'ajoutent aux crédits de l'État. En outre, les collectivités territoriales et les propriétaires privés possèdent près de 95 % des monuments historiques.
C'est la raison pour laquelle il serait utile que les DRAC se mettent en relation avec les collectivités territoriales et les propriétaires privés pour identifier les chantiers qui pourraient être rapidement lancés.
À cette fin, des simplifications administratives pourraient être pertinentes afin de garantir que les projets puissent effectivement démarrer d'ici la fin de l'année : accélération du temps d'instruction des demandes d'urbanisme, report des délais pour éviter la caducité des autorisations ou des subventions.
Dans le même ordre d'idées, le groupe de travail estime que l'élargissement du champ géographique du label de la Fondation du patrimoine à l'ensemble des immeubles, bâtis et non bâtis, situés dans des communes de moins de 20 000 habitants , que l'article 1 er de la proposition de loi déposée par la sénatrice Dominique Vérien prévoit d'autoriser, serait de nature à créer un surcroît d'activité pour les entreprises de restauration du patrimoine. Ce label est en effet octroyé aux propriétaires qui s'engagent à réaliser des travaux de restauration sur un immeuble relevant du patrimoine non protégé et leur procure un avantage fiscal qui leur permet de déduire de son impôt une partie du montant des travaux. L'élargissement du champ géographique du label se révélerait efficace pour faciliter la relance de petits chantiers, facilement compatibles avec le respect des contraintes sanitaires.
Ø Instaurer, pour une période limitée, des mécanismes incitant les autres propriétaires de monuments historiques à lancer des opérations
Diverses mesures pourraient être mises en place pour faciliter la consommation des crédits, l'activité des entreprises de restauration et inciter les collectivités territoriales et les propriétaires privés à engager rapidement des opérations. Le groupe de travail estime qu'il serait pertinent de donner des instructions aux DRAC pour adapter certaines des règles et pratiques en vigueur à la situation exceptionnelle que nous connaissons. Ces adaptations pourraient s'appliquer de manière temporaire, pour une période n'excédant pas le terme de l'année 2021 .
• Augmenter le taux de subvention de l'État sur les immeubles protégés au titre des monuments historiques, ce qui impliquerait de relever le plafond maximal de subvention concernant les monuments inscrits
Le taux de subvention de l'État s'établit aujourd'hui en moyenne à 40 % pour les immeubles classés et à 15 % pour les immeubles inscrits au titre des monuments historiques. Face à l'impact économique de la crise sanitaire sur la situation financière des collectivités territoriales et des propriétaires privés, l'accroissement de la subvention de l'État pourrait constituer un levier important pour déclencher des opérations , dans la mesure où le coût de celles-ci s'en trouverait réduit pour leurs propriétaires.
Cette mesure répond à la même logique que celle qui a présidé à la création du Fonds incitatif et partenarial pour les monuments historiques des communes à faibles ressources (FIP) en 2018, à savoir susciter, par le biais d'une participation accrue de l'État au financement, de nouveaux projets ou permettre la réalisation de projets n'ayant pas pu trouver la totalité de leur financement à ce jour. Dans le cadre du FIP, la subvention de l'État peut être portée à 80 % s'il s'agit d'un immeuble classé et jusqu'à la limite légale de 40 % s'il s'agit d'un immeuble inscrit. Mais, le bénéfice du FIP est aujourd'hui limité aux immeubles en mauvais état ou en péril situés dans des communes à faibles ressources de moins de 10 000 habitants, sachant que les communes de moins de 2 000 habitants sont privilégiées. Il est également conditionné à une participation de la région représentant au moins 15 % du coût des travaux.
Dans le contexte actuel, le groupe de travail recommande d'ouvrir provisoirement la possibilité d'une participation accrue de l'État pour les immeubles en mauvais état ou en péril, sans autres conditions .
Il lui paraitrait également opportun de relever parallèlement le plafond de la subvention pour les immeubles inscrits, aujourd'hui fixé à 40 %. Les DRAC estiment en effet que ce plafond constitue à l'heure actuelle un frein pour leur permettre d'accompagner certains projets qui pourraient être rapidement lancés.
• Accroître la part des crédits alloués aux monuments appartenant à des propriétaires privés parmi les crédits destinés aux monuments qui n'appartiennent pas à l'État
Généralement, seuls 15 % des crédits déconcentrés destinés aux monuments qui n'appartiennent pas à l'État vont en direction des monuments qui appartiennent aux propriétaires privés, ce qui représente en 2020 environ 20 millions d'euros sur les quelques 130 millions d'euros inscrits en loi de finances initiale pour 2020 en faveur des monuments historiques hors État.
Du fait du report des élections municipales, les collectivités territoriales pourraient rencontrer des difficultés à consommer intégralement les crédits qui leur étaient destinés. Les propriétaires privés devraient être plus facilement en mesure de prendre la décision d'entreprendre des travaux dans les prochains mois . Dans ces conditions, il serait souhaitable qu'une partie des crédits initialement destinés à la restauration du patrimoine des collectivités territoriales soit réaffectée aux propriétaires privés de monuments historiques dont les travaux seraient prêts à être lancés, sous réserve qu'ils fassent appel à des entreprises qui disposent des compétences et des qualifications nécessaires pour garantir une restauration en bonne et due forme.
• Inclure les surcoûts de chantiers causés par les contraintes sanitaires dans le montant total de la dépense utilisé pour calculer le montant de la subvention de l'État
Les maîtres d'ouvrage et les entreprises sont aujourd'hui inquiets des surcoûts engendrés par les contraintes sanitaires, au point que certains chantiers initialement prévus pourraient être reportés à une date ultérieure dans l'attente d'un retour à la normale. Les maîtres d'ouvrage et les entreprises pourraient être partiellement rassurés si le montant des surcoûts pouvait être intégré dans le montant de la dépense subventionnable, ce qui permettrait d'en alléger le coût.
• Consacrer une part plus importante des crédits à l'entretien des monuments historiques
Si l'État réserve habituellement environ 15 % de ses crédits destinés aux monuments historiques à l'entretien de ceux-ci, il pourrait être pertinent de favoriser, dans les mois à venir, les chantiers d'entretien aux chantiers de restauration afin de faciliter la consommation intégrale des crédits inscrits au titre de l'année 2020. Il s'agit en effet de chantiers dont le lancement est à la fois plus facile et rapide , puisqu'ils ne nécessitent pas d'autorisation préalable. Ils pourraient procurer de l'activité aux entreprises de restauration de monuments historiques à travers tout le territoire.
La commission de la culture, de l'éducation et de la communication plaide, depuis plusieurs années, pour qu'une culture de l'entretien des monuments se mette véritablement en place dans notre pays. L'entretien régulier des monuments demeure le meilleur moyen d'éviter la survenance de situations de péril. Les pays qui ont mis en place une politique systématique d'entretien des monuments ont constaté des résultats au bout d'une dizaine d'années , avec une baisse sensible du nombre de monuments nécessitant des travaux de restauration. Au final, le surcoût initial de cette politique d'entretien régulier s'est révélé bénéfique en termes de finances publiques par la suite, les travaux de restauration étant beaucoup plus onéreux que les travaux d'entretien.
C'est pourquoi le groupe de travail estime qu'il serait judicieux de lancer une expérimentation en matière d'entretien des monuments historiques et que la crise sanitaire actuelle pourrait, en fin de compte, en fournir l'occasion.
2. Tirer les enseignements de cette crise au niveau des politiques de valorisation du patrimoine
a) Adapter certains discours aux contraintes de la situation sanitaire
Ø Communiquer en direction des publics
Même si les opérateurs devraient organiser leurs propres campagnes de communication pour inciter les visiteurs à fréquenter de nouveau leurs établissements, les services du ministère de la culture auront un rôle à jouer pour les accompagner afin que la crise puisse être surmontée le plus rapidement possible.
Deux axes de communication apparaissent essentiels :
- d'une part, rassurer les publics sur la nature des précautions sanitaires prises pour assurer leur accueil dans des conditions sécurisées ;
- d'autre part, éveiller ou raviver leur intérêt pour les visites, en insistant sur différents aspects, comme le plaisir de la découverte d'un lieu et de son histoire, l'enrichissement né de la confrontation avec une oeuvre ou un monument, la proximité géographique des établissements patrimoniaux ou encore le caractère convivial de ce type de sorties, compte tenu de la multiplicité des activités et services proposés.
La question des modalités d'organisation des visites guidées constitue également une question cruciale pour la relance de l'activité des opérateurs, tout en étant fondamentales pour l'activité des guides-conférenciers, une profession particulièrement affectée par la crise sanitaire actuelle.
Le groupe de travail estime qu' un soin tout particulier devrait être apporté cette année à l'organisation des manifestations culturelles nationales , telles que les Journées européennes du patrimoine (19-20 septembre) ou la Nuit européenne des musées (reportée au 14 novembre), afin que ces événements apportent un coup de projecteur plus puissant encore qu'habituellement sur le secteur des patrimoines et soient l'occasion de dynamiser leur relance.
Ø Conserver le concours des mécènes
Jusqu'alors très dynamiques, les ressources procurées par le mécénat aux établissements et associations oeuvrant dans le domaine culturel pourraient pâtir des conséquences de la crise sanitaire. Cette ressource est pourtant aujourd'hui indispensable au financement des actions dans le secteur des patrimoines (projets de restauration du patrimoine, enrichissement des collections, modernisation des espaces d'expositions...).
Il serait important que la mission mécénat noue rapidement un dialogue avec les mécènes qui investissaient jusqu'ici dans le champ des patrimoines, à commencer par les principaux bienfaiteurs de la vie culturelle membres du Club des mécènes de la culture, afin de s'assurer qu'ils maintiennent leurs engagements. Les DRAC auraient également un rôle à jouer au niveau local pour poursuivre la création de réseaux entre le monde de la culture et le monde de l'entreprise.
Le discours à l'attention des mécènes sera sans doute amené à évoluer, afin de faire valoir aux entreprises l'impact sur le renforcement de la cohésion sociale que pourrait avoir leur générosité en faveur des patrimoines.
b) L'occasion de répondre à des besoins précédemment identifiés, encore exacerbés par la crise
Ø Fournir davantage d'ingénierie aux propriétaires de monuments
Depuis 2008, les propriétaires publics ou privés de monuments exercent la pleine maîtrise d'ouvrage des travaux d'entretien ou de restauration qu'ils font exécuter et les DRAC n'ont plus la possibilité de se substituer à eux. Même si le code du patrimoine autorise ces dernières à apporter une assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO), l'usage de ce dispositif « reste très hétérogène sur le territoire », comme le constatait Philippe Nachbar dans son rapport pour avis sur le projet de loi de finances pour 2020. À l'exception de la région Bretagne, où une expérimentation en matière d'assistance à la maîtrise d'ouvrage par les services de l'État est menée, les DRAC n'exercent pratiquement plus cette mission, faute de moyens, même si les architectes des bâtiments de France (ABF), en particulier, continuent à dispenser des conseils techniques et administratifs lorsqu'ils sont sollicités en ce sens par les maîtres d'ouvrage.
Le manque d'ingénierie des petites communes et des propriétaires privés constitue un frein à la réalisation de nombreux projets . Cette difficulté pose particulièrement problème à l'heure actuelle, où le temps presse pour lancer des projets susceptibles d'aider les entreprises de restauration du patrimoine à surmonter la crise. Si les propriétaires de monuments historiques pouvaient accéder à une expertise en matière de travaux, la relance de l'activité pourrait en être facilitée. La DRAC de Bretagne a indiqué aux membres du groupe de travail qu'elle comptait justement utiliser le biais de l'AMO pour stimuler l'activité des entreprises sur son territoire.
Dans ce contexte, le groupe de travail estime opportun que , sur tous les territoires, les services de l'État reprennent leur mission d'AMO pour favoriser la relance de l'activité. Il pourrait en résulter également des effets positifs à plus long terme pour l'image des services déconcentrés sur le territoire et la qualité des relations entre les élus locaux et les ABF, en démontrant que cette profession n'a pas vocation à interdire la réalisation de projets, mais au contraire à mettre à disposition ses compétences scientifiques et techniques pour les accompagner.
Le groupe de travail est conscient que la reprise de cette mission représente un coût important pour l'État, puisqu'elle exige de pourvoir aux postes d'ABF vacants dans les différents départements et de remplacer les ingénieurs et techniciens qualifiés partis à la retraite au cours des dernières années. Il estime cependant ce coût proportionné à l'impératif de relance de l'activité et à l'enjeu de la préservation du patrimoine sur la durée, dont les ABF constituent un maillon central.
Familiers des enjeux urbanistiques, les départements pourraient trouver un intérêt à développer une expertise en matière d'ingénierie patrimoniale en faveur des petites communes et intercommunalités de leur périmètre géographique, afin de valoriser les territoires et de promouvoir la solidarité et la cohésion territoriales. Ils possèdent d'ailleurs déjà des services d'ingénierie pour remplir leur mission d'assistance technique en matière d'assainissement, de voirie, d'aménagement et d'habitat. Mais ces services proposent rarement une aide en matière patrimoniale et ne possèdent donc pas, aujourd'hui, les compétences requises pour venir en aide aux communes et intercommunalités sur le sujet. Par ailleurs, certains départements facturent le coût de ces services aux communes et aux intercommunalités auxquelles ils viennent en aide quand d'autres les offrent gratuitement. Par conséquent, il paraît difficilement envisageable de leur confier une compétence obligatoire sur ce sujet, compte tenu de leur manque de moyens financiers , sans prendre le risque de créer des inégalités territoriales. S'il était décidé de s'orienter dans cette voie, il faudrait absolument que l'État mette à la disposition des départements des moyens financiers pour leur permettre d'exercer convenablement cette nouvelle mission.
Ø Renforcer les liens entre culture et tourisme
En dépit du rôle incontesté de nos patrimoines dans le rayonnement et l'attractivité de notre pays, les liens entre culture et tourisme paraissent encore trop timides . Pourtant, nos patrimoines, en tant que vitrine de la France et de nos territoires, ont un impact direct sur le dynamisme économique. La restauration, la valorisation et la diffusion du patrimoine font partie intégrante d'une stratégie d'ensemble qui dépasse le seul champ des enjeux patrimoniaux pour englober l'attractivité des territoires et le rayonnement de la « destination France ».
Dans un rapport de mars 2017 consacré aux moyens d'améliorer la fréquentation touristique de la France à partir de nos patrimoines, Martin Malvy soulignait à juste titre qu'« accroître la fréquentation touristique ne dépend pas seulement du site, mais de l'histoire qu'il raconte ». Même si le ministère de la culture a pris l'initiative d'organiser, depuis maintenant trois ans, des « Rencontres du tourisme culturel » chaque année afin de renforcer la coopération entre les professionnels du tourisme et ceux de la culture, les interactions entre les ministères de la culture et du tourisme pourraient être encore renforcées .
La dimension économique et touristique du patrimoine n'est en effet véritablement traitée par aucun des deux ministères. En témoigne le fait que les critères d'octroi des aides au titre du plan de soutien au secteur du tourisme ne permettent pas, à ce stade, à l'ensemble des propriétaires et gestionnaires de monuments, quelle que soit leur forme juridique, de pouvoir y prétendre, puisque les aides accordées sont destinées aux seules entreprises. Plusieurs aides proposées par ce plan seraient pourtant utiles à l'ensemble d'entre eux dans le contexte actuel, telles que la prolongation du dispositif d'activité partielle, l'exonération des cotisations sociales pendant la période de fermeture et de très faible activité, ou l'accès au prêt garanti par l'État « saison » pour faire face aux difficultés susceptibles de survenir en fin de saison...
Alors que les Français devraient essentiellement passer leurs vacances cet été sur le territoire national, il est important d'éveiller leur intérêt pour le tourisme patrimonial, véritable alternative au tourisme balnéaire, compte tenu des incertitudes qui pèsent sur les modalités de séjour sur les plages dans le contexte sanitaire actuel. Le secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, a annoncé le lancement prochain d'une campagne d'information et de promotion, destinée à poursuivre le mouvement lancé par le collectif Patrimoine 2.0. avec l'initiative « Cet été, je visite la France ». Son besoin se fait particulièrement sentir pour venir en aide à ce secteur sinistré, dont les perspectives pour l'été sont mauvaises du fait de l'absence des touristes étrangers qui représentent généralement une bonne partie de leur fréquentation.
Ø Poursuivre les efforts pour mieux faire circuler les chefs d'oeuvre sur le territoire national
Face aux difficultés accrues pour faire venir des oeuvres de l'étranger, compte tenu du caractère mondial de la crise sanitaire, le groupe de travail estime qu'il serait opportun d' amplifier encore la politique de circulation des oeuvres sur le territoire national , à laquelle s'attelle la direction des musées de France depuis plusieurs années. Cette politique de mobilité croissante des oeuvres d'art pourrait avoir des effets positifs sur la relance de l'activité et le niveau de la fréquentation, tout en renforçant l'égalité d'accès à la culture à travers le territoire national.
c) Et demain, l'Europe du patrimoine ?
La stratégie pluriannuelle en faveur du patrimoine comporte un volet européen destiné à remédier à l'absence de stratégie coordonnée au niveau européen en matière de patrimoine. Elle évoque l'idée d'un « Grand tour » du patrimoine, mais peu d'avancées concrètes semblent avoir été enregistrées dans ce domaine depuis sa publication.
Le Conseil européen du 20 juin 2019 a pourtant reconnu que la culture et le patrimoine culturel était « au coeur de l'identité européenne », justifiant, à ce titre, des investissements de sa part.
Le groupe de travail s'interroge donc sur la possibilité d'utiliser le plan de relance de l'Union européenne en réponse à la crise sanitaire, s'il était effectivement validé par les États membres, pour amorcer une véritable stratégie européenne en matière de patrimoine.
III. ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
Le groupe de travail « Enseignement scolaire » de la commission de la culture animé par Jacques Grosperrin (Doubs, LR) est composé de Max Brisson (Pyrénées-Atlantiques, LR), Céline Brulin (Seine-Maritime, CRCE), Nicole Duranton (Eure, LR), Antoine Karam (Guyane, LREM-A), Laurent Lafon (Val-de-Marne, UC), Jacques Bernard Magner (Puy-de-Dôme, socialiste et républicain), Colette Mélot (Seine-et-Marne, Les indépendants -République et territoires), Marie-Pierre Monier (Drôme, socialiste et républicain) et Jean-Yves Roux (Alpes de Haute-Provence, RDSE).
Le groupe de travail « Enseignement scolaire » a été mis en place à l'initiative du bureau de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat le mardi 14 avril 2020, dès le lendemain de l'annonce par le Président de la République d'une réouverture des écoles et établissements scolaires à partir du 11 mai.
Ce groupe de travail a notamment auditionné des experts médicaux et scientifiques, des représentants des collectivités territoriales, des recteurs, des représentants de chefs d'établissement, d'enseignants des premier et second degrés, des représentants des parents d'élèves ou encore des directeurs d'école ayant participé à l'accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise. Il ressort des douze auditions qu'il a organisées et de ses travaux onze préconisations relatives aux modalités du retour des élèves en classe.
A. LA DÉCISION DE ROUVRIR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET LES ÉCOLES À PARTIR DU 11 MAI : UNE ANNONCE SURPRISE, AUX MODALITÉS DE MISE EN oeUVRE MAL DÉFINIES, ÉLABORÉES SANS CONCERTATION
1. Une impression d'impréparation et d'improvisation plus de 10 jours après l'annonce de cette réouverture
De très nombreuses personnes auditionnées ont fait part de leur surprise à l'annonce d'une réouverture des écoles à partir du 11 mai, qu'il s'agisse de personnes issues du monde médical ou de l'enseignement. Le retour des élèves en classe n'était ainsi pas évoqué lors des concertations au ministère de la santé. Il en est de même pour les discussions avec les syndicats dans les jours précédant le 13 avril : selon les informations transmises au groupe de travail, les hypothèses de reprise portaient plutôt sur juin voire septembre. C'est d'ailleurs le choix fait par d'autres pays européens comme le Portugal ou Malte dont les écoles resteront fermées jusqu'à la prochaine rentrée.
Alors que l'on attendait une définition par le ministère de l'éducation nationale d'un cadre national et d'une méthode (quels sont les objectifs du retour en classe, qu'attendre des huit semaines de cours en présentiel restantes, quels publics doivent être prioritaires...), les hypothèses de travail présentées mardi 21 avril devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale n'abordent pas ces points pourtant structurants. L'ensemble de la communauté éducative - personnels de l'éducation nationale, élèves, parents - et les élus locaux attendaient un discours présentant des objectifs et la méthode pour un retour à l'école à partir du 11 mai. Or, il semble au groupe de travail que ces déclarations sont plus de nature à être sources de questions que de réponses.
En outre, selon les informations transmises par plusieurs syndicats et représentants d'élus locaux contactés par le groupe de travail, ces hypothèses de travail ont, semble-t-il, été élaborées sans concertation préalable, alors même que le ministère avait indiqué vouloir co-construire les modalités de retour des élèves à l'école.
2. Des scénarii de travail ne reposant pas sur un avis scientifique
Alors que depuis le début du confinement, le gouvernement indique fonder ses décisions sur des avis scientifiques, les hypothèses de travail présentées mardi dépendent de préconisations sanitaires en cours de définition et non connues à ce jour. Dès lors, les déclinaisons opérationnelles qui pourraient en être faites risquent de reposer sur des fondations mouvantes. Ce sentiment de fragilité pour la population peut être d'autant plus renforcé que les avis scientifiques divergent en fonction des différentes instances et varient au fur et à mesure de la découverte de connaissances sur ce nouveau virus.
Des études scientifiques vont être lancées sous peu sur l'infectiosité des enfants. Le groupe de travail regrette que celles-ci n'aient pas débuté un peu plus tôt afin de pouvoir déjà disposer des premiers résultats. En effet, la question de la transmission du virus chez l'enfant et par l'enfant est un facteur essentiel de la définition du protocole sanitaire pour la reprise des cours.
3. Une absence de réelle concertation notamment avec les collectivités locales, partenaires essentiels du scolaire et du périscolaire
Le groupe de travail a été très surpris d'apprendre que ni l'Association des Maires de France, ni l'Assemblée des Départements de France ne semblaient avoir officiellement été contactées et associées à cette démarche de concertation. Or, le rôle des collectivités territoriales est fondamental pour une bonne marche de l'institution scolaire et les décisions qui vont être prises en matière de distanciation sociale et de respect des gestes barrières les concernent directement : nettoyage des locaux, transport scolaire, restauration scolaire, accueil périscolaire avant et après la classe, mais également le mercredi, mise à disposition de locaux supplémentaires pour un dédoublement des classes...
Le groupe de travail souligne avec force que les collectivités locales ne peuvent être considérées comme de simples prestataires de services à la disposition de l'éducation nationale ; elles doivent être associées aux réflexions. D'ailleurs, le groupe de travail rappelle que lors de sa conférence de presse du 19 avril, le Premier ministre a mis le couple « maire/préfet » au coeur du dispositif pour déterminer et mettre en oeuvre le futur plan, qui devra laisser une large place aux adaptations locales. Ce travail concerté est un prérequis nécessaire pour ne pas faire porter in fine sur les élus locaux, et notamment le maire, la responsabilité auprès de la population d'un non-accueil des élèves, de l'absence de cantine et d'activités périscolaires ou encore d'une restriction de l'offre de transport scolaire .
Aussi, le groupe de travail regrette l'élaboration de manière unilatérale par le ministère de l'éducation nationale des scénarii de travail présentés par Jean-Michel Blanquer, mardi 21 avril à l'Assemblée nationale, prévoyant que chaque jeune devra être soit en téléenseignement - comme c'est le cas actuellement -, soit en classe, soit en étude, soit dans des activités périscolaires, notamment au sein du nouveau programme 2S2C « Sport, Santé, Civisme et Culture ». Dans cette hypothèse, les communes seraient donc sollicitées pour la mise en place de ces nouveaux S2SC.
Certes, le ministre de l'éducation nationale a bien précisé lors de son intervention devant les députés qu'il s'agissait là de propositions de travail, soumises également à un protocole sanitaire en cours d'élaboration. Mais le groupe de travail note que l'aspect « piste de réflexion » risque de ne pas être perçu et ce scénario pris pour les modalités concrètes d'accueil des élèves à l'école par de nombreux concitoyens en attente de réponse sur le déconfinement.
Interrogée au lendemain de cette déclaration, l'Association des Maires de France a indiqué au groupe de travail ne pas avoir été au courant - ce qu'elle regrettait fortement. L'organisation des 2S2C, si cette proposition était retenue, devra se faire en dehors des salles de classe - utilisées au même moment. Des locaux dédiés devront alors être trouvés (gymnase, salles communales et intercommunales, ...). En outre, des agents des collectivités locales devront également être mis à disposition.
Cette absence de concertation semble généralisée : les syndicats des personnels de l'éducation nationale et fédérations d'élèves ont indiqué n'avoir eu aucun retour sur les contributions qu'ils avaient fait parvenir au ministère. De même, plusieurs d'entre eux ont indiqué n'avoir pas été informés, en amont de l'audition à l'Assemblée nationale du ministre de l'éducation nationale, des propositions et hypothèses de reprise des cours qui allaient être émises.
4. De nombreuses questions demeurent auxquelles ne répondent pas les dernières déclarations du ministre de l'éducation nationale
À moins de trois semaines de la date prévue de la réouverture des classes, de très nombreuses questions pratiques demeurent. En voici quelques-unes :
Ø Quel doit être l'objectif de ces cinq à huit semaines de cours restantes ?
Un consensus se dégage de l'ensemble des auditions. Il n'est pas possible au 11 mai de reprendre les cours comme si le confinement n'avait pas existé. Pour le groupe de travail, ces semaines de cours restantes doivent être mises à profit dans différents buts et notamment celui de renouer le lien entre l'élève, sa famille et l'école. Certains élèves ont quitté l'école depuis le 2 mars.
En outre, si un travail remarquable a été fait par l'ensemble des enseignants pour assurer un suivi pédagogique pendant ces semaines de confinement, certains élèves ont des difficultés d'accès à celui-ci (fracture numérique, absence de matériels adaptés...) Il s'agit ainsi de faire le point sur les apprentissages de l'élève , les difficultés qu'il a pu rencontrer dans ceux-ci pendant le confinement. Ce bilan ne doit toutefois pas faire l'objet « d'évaluations » administratives. Le groupe de travail a pleinement confiance dans les méthodologies des enseignants pour définir les besoins de chaque élève sans passer par un processus administratif unifié à l'échelle nationale.
Enfin, ce retour à l'école doit être une respiration , un début de « retour à la normalité », pour les élèves, notamment pour ceux pour lesquels la période de confinement a été difficile.
Ø Le respect des gestes barrières et la question des points d'eau
Comme l'a indiqué une des personnes auditionnées, « il va falloir faire de la distanciation sociale dans des lieux conçus pour faire du rapprochement social et du vivre-ensemble » . Un premier constat se dégage : il semble impossible de faire respecter les gestes barrières par les plus petits, qui ont besoin de contacts. Le prêt des jeux et les matériels pédagogiques mutualisés à l'échelle de la classe posent également problème.
La question des sanitaires et de l'accès à des points d'eau est également souvent revenue. Selon un sondage 1 ( * ) réalisé mi-mars par l'observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, 25 % des écoles n'ont pas de points d'eau en nombre suffisant. 75 % et 77 % des collèges et lycées estimaient également à cette période ne pas disposer de gel hydroalcoolique en quantité suffisante. Un des enseignants ayant participé à l'accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise expliquait exiger de ces élèves - et des adultes - de se laver quatre fois les mains par demi-journée.
Un cas concret de la problématique de
l'accès à des points d'eau
pour le respect des gestes
barrières
Une école de l'académie de Besançon accueille en temps ordinaire 410 élèves répartis en 27 classes, avec 12 sanitaires pour les filles et 12 pour les garçons sous le préau. Toutes les classes de CP et CE1 font moins de 15 élèves car elles sont déjà dédoublées et pourraient donc reprendre en présentiel. Même si la moitié seulement des élèves rentre, cela correspond quand même - en simplifiant et partant du principe que les effectifs comprennent autant de filles que de garçons - à près de 200 élèves, soit 12 points d'eau pour 100 filles et autant pour 100 garçons, tous se situant à un point unique sous le préau. Il n'y a pas d'autres points d'eau facilement accessibles dans le bâtiment, notamment dans les étages. Dans ces circonstances, il est inimaginable que chaque élève se lave trois fois les mains par demi-journée - soit une fois par heure.
Ø L'annonce de groupes de 15 élèves maximum par classe : une hypothèse de travail considérée comme trop élevée et faisant fi des différences de situation entre les établissements
Le chiffre de groupe de 15 élèves maximum est considéré comme trop élevé par de nombreuses personnes auditionnées et notamment les enseignants qui ont accueilli les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise. Ils considèrent ainsi que la taille des salles de classe ne permet pas l'accueil d'un tel nombre d'élèves. De plus, dans certains cas, le dédoublement des classes de CP et CE1 en zone d'éducation prioritaire s'est fait - faute de locaux supplémentaires disponibles - en réduisant la taille des salles de classe . Pour rappel, dans les pays où l'école a repris ou va reprendre, une distance minimale d'un à deux mètres est prévue entre deux bureaux d'élèves (Luxembourg, Allemagne, Danemark).
Ce plafond unique de 15 élèves par classe méconnait la diversité des établissements français . Au cours de ses auditions, le groupe de travail a dialogué avec des personnes travaillant dans des établissements allant de quelques classes à des cités scolaires accueillant plus de 2 000 élèves. Ainsi, une application stricte de cette limite de 15 élèves par classe dans un établissement de 80 classes fait se côtoyer dans un même bâtiment plus de 1 200 élèves auxquels s'ajoute le personnel de l'éducation nationale et des collectivités locales.
Le groupe de travail regrette que l'hypothèse de travail présentée par le ministre - fixant comme principe des groupes ne pouvant excéder 15 élèves pour toutes les écoles et établissements scolaires - n'ait pas pris suffisamment en compte, dans son élaboration, la réalité des territoires, les niveaux d'enseignement et les situations très différentes dans lesquelles se trouvent les écoles et les établissements scolaires, en termes de capacité d'accueil, de configuration, mais aussi de présence du virus sur le territoire .
Ø Une absence de recensement des moyens humains et matériels disponibles
L'un des facteurs conditionnant la reprise d'un accueil des élèves est directement lié à la disponibilité du personnel de l'éducation nationale, mais aussi des collectivités territoriales. Or, à ce jour, il n'a été procédé à aucun recensement du nombre d'enseignants qui ne pourront pas reprendre les cours en présentiel parce qu'ils font partie des personnes vulnérables ou ont dans leur foyer une personne vulnérable.
De même, l'accueil des enfants sur des temps périscolaires dépend des moyens humains dont disposeront les collectivités territoriales. Or, outre la problématique des agents faisant partie des personnes vulnérables, s'ajoute le fait qu'un certain nombre de communes ont fait le choix pendant le confinement de redéployer leurs personnels traditionnellement affectés dans les écoles sur d'autres secteurs, notamment dans les EPHAD.
Surtout, le groupe de travail s'étonne qu'à plusieurs reprises dans ses auditions, il a été mentionné l'absence de contact entre les agences régionales de santé et les autorités académiques, ainsi que d'un travail de recensement des besoins matériels de protection (gel hydroalcoolique, masques...). L'expérience des semaines passées a montré les délais importants que peuvent prendre certaines commandes et la nécessité d'une certaine anticipation.
En outre, il est désormais urgent pour le groupe de travail de définir clairement qui entre l'État, les collectivités locales voire les parents d'élèves achète quoi (masques, gel hydroalcoolique) et pour qui (personnel de l'éducation nationale, agents des collectivités locales ou intervenants du temps périscolaire, élèves).
Ø La gestion des temps entourant les moments pédagogiques : grande absente des réflexions nationales actuelles
L'organisation scolaire est complexe en France. Elle fait s'alterner des moments relevant de la compétence de l'éducation nationale et des moments relevant de celle des collectivités locales. Tel est le cas notamment des transports scolaires, de l'accueil et la garde des enfants le matin et le soir, de la restauration scolaire... Toutefois, pour les parents - et les enfants - l'école est une continuité qui commence et se termine avec le franchissement du portail du bâtiment scolaire voire aux portes du bus scolaire. Or le groupe de travail a constaté qu'aucune réflexion n'avait commencé sur les temps entourant les moments pédagogiques. Le ministère de l'éducation nationale se préoccupe de l'organisation du temps scolaire tandis que localement aucun travail ne peut commencer tant que le protocole sanitaire n'a pas été défini, laissant ainsi les élus locaux sans réponse face à leurs questionnements.
Ø La gestion des abords de l'école et des flux d'élèves à l'intérieur des établissements : éviter la création d'attroupements
Plusieurs personnes auditionnées, dont des experts scientifiques, ont attiré l'attention du groupe de travail sur la gestion des flux d'élèves dans l'enceinte scolaire - cours de récréation, présence des élèves dans les couloirs pendant les interclasses - mais également sur la gestion des abords de l'école . En effet, les débuts et fins de journée scolaires sont souvent des moments de convivialité devant le portail scolaire du fait des élèves qui stationnent, ainsi que, pour l'école primaire, des parents venant chercher leurs enfants. Une organisation doit être trouvée pour limiter les contacts entre les personnes. Cela peut passer par des horaires décalés en fonction des classes ou des niveaux, des restrictions à l'accompagnement des élèves dans les salles de cours - pour les plus petits. La configuration de certains établissements peut permettre des entrées multiples ou l'organisation d'un circuit pour éviter que les personnes ne se croisent. Toutefois, les autres contraintes s'appliquant à l'école - comme le plan vigipirate - doivent également être prises en considération .
De même, la circulation des élèves dans le bâtiment scolaire doit être repensée, par exemple en limitant dans le secondaire les changements par les élèves de classe entre deux cours, ou encore en échelonnant les récréations. L'installation de séparations physiques (barrières) est également une possibilité, mais ne doit pas se faire au détriment de la sécurité des personnes fréquentant le bâtiment scolaire (en cas d'évacuation incendie par exemple).
Cette thématique va conduire à des solutions personnalisées pour chaque établissement d'enseignement, nécessitant un temps de préparation .
Ø La restauration, les internats et les transports scolaires : une réflexion indispensable pour un retour des élèves en classe
Le groupe de travail constate qu'à chaque fois que ces thématiques ont été évoquées, aucune réponse n'a été apportée, alors même qu'elles sont profondément liées aux retours pratiques en cours des élèves, et peuvent même être pour certaines familles un argument de retour en cours. Elles sont également potentiellement génératrices de coûts supplémentaires pour les collectivités locales (extension des horaires d'ouverture de la restauration scolaire, dédoublement du nombre de bus scolaires).
L'exemple des élèves internes en Guyane est particulièrement représentatif de ces enjeux : l'ouverture de l'internat est le seul moyen pour eux de retrouver le chemin de l'école, d'autant plus qu'en raison de la fracture numérique, ils ont été pénalisés dans leurs suivis pédagogiques pendant le confinement.
Le comité scientifique Covid-19 a commencé ses travaux sur ces questions. Le groupe de travail ne peut que l'inviter à travailler avec les représentants des associations d'élus locaux sur toutes ces questions relevant de leurs compétences.
Ø La question de l'accueil des petites et moyennes sections de maternelle
Comme la quasi-unanimité des personnes auditionnées, le groupe de travail est sceptique sur la possibilité de faire revenir en présentiel les enfants des petites et moyennes sections de maternelle. En effet, pour ces enfants de 3 à 5 ans, les contacts sont multiples : échanges de jeux et de matériels scolaires entre enfants, nécessité de l'aide d'un adulte pour s'habiller, nécessité parfois de les réconforter... Le respect des gestes barrières semble très difficile. Quant au port d'un masque, y compris pédiatrique, aucun des intervenants ne l'estime possible.
Si un retour de ces élèves était maintenu, il ne pourrait se faire qu'en tout petit groupe. Pour rappel, les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire sont accueillis au maximum par groupe de cinq en maternelle.
B. LES ONZE PRÉCONISATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL : UN RETOUR PROGRESSIF, CONCERTÉ ET SÉCURISÉ
1. Deux prérequis indispensables : la définition rapide d'une méthodologie fondée sur des avis scientifiques et le lancement immédiat d'une réflexion concertée au niveau local associant les collectivités locales
Ø La définition rapide d'une méthodologie fondée sur des avis scientifiques puis déclinée en concertation avec l'ensemble des partenaires de la communauté éducative
Pour le groupe de travail, la mise en place d'un processus efficace et rassurant de reprise des cours nécessite une démarche en trois étapes :
• étape 1 : adopter un protocole sanitaire strict sur les activités scolaires et périscolaires, à la fois préventif et curatif, adapté aux spécificités de chaque niveau d'enseignement, et défini par les autorités sanitaires
Ce protocole doit notamment indiquer quelle stratégie adopter en cas de suspicion de Covid-19 chez un élève ou un adulte fréquentant l'établissement.
• étape 2 : à partir de ce protocole sanitaire, élaboration d'un cadre national d'organisation scolaire fixant les objectifs du retour en classe, en concertation avec les associations représentatives des collectivités locales, les organisations syndicales et les fédérations de parents d'élèves
Ce cadre national d'organisation scolaire semble particulièrement important au groupe de travail pour expliquer aux parents et aux élèves les raisons de ce retour en cours. En effet, les attentes des familles sont contradictoires ; nombre d'entre elles, inquiètes, ne comprennent pas cette décision. Un travail de pédagogie et d'explication est essentiel. Il est d'autant plus fondamental pour réussir à retrouver les élèves « perdus de vue », dont les établissements n'ont plus de nouvelles depuis plusieurs semaines. Si, selon les dernières estimations ministérielles, ce chiffre est au niveau national de 4 %, il peut être localement très élevé. Une directrice d'école a ainsi indiqué au groupe de travail que sur les 330 familles de l'école, 48 étaient muettes depuis le début du confinement, soit 20 % des effectifs. Ce taux est également élevé dans les lycées professionnels.
• étape 3 : déclinaison locale de ce cadre sous la responsabilité des préfets et des DASEN représentant les recteurs en fonction des spécificités territoriales infra-académiques voire des établissements
Les réactions aux propos ministériels et les nombreuses questions que se posent élus locaux, enseignants, chefs d'établissement et parents d'élèves montrent que l'organisation de la reprise de l'école doit se construire à l'échelon local afin de pouvoir conjuguer cadre national et spécificités locales.
Ø Engager dès à présent le travail de concertation au niveau local
Le groupe de travail fait le constat qu'il n'est pas possible d'attendre les annonces du plan de déconfinement général, qui devrait être publié à la fin du mois pour commencer à travailler à l'organisation pratique de la reprise des cours. En effet, il resterait moins d'une dizaine de jours pour élaborer le protocole opérationnel de reprise des cours.
L'implication du préfet et du DASEN sont nécessaires pour permettre une complémentarité des actions mais également garantir une harmonisation des démarches à l'échelle académique.
2. Les onze préconisations du groupe de travail articulées autour de trois idées forces
Sur la base des deux prérequis présentés supra , le groupe de travail émet onze préconisations articulées autour de trois idées forces : préparer la reprise des cours en présentiel ; accompagner les élèves et l'ensemble de la communauté pédagogique dans la fin du confinement tout en poursuivant la continuité pédagogique ; penser dès maintenant la rentrée scolaire 2020 afin de prendre en compte les effets du confinement sur les apprentissages des élèves.
• PRÉPARER LA REPRISE DES COURS EN PRÉSENTIEL DANS DE BONNES CONDITIONS
1. Prévoir une formation à la gestion de la crise sanitaire et aux gestes barrières pour les enseignants et l'ensemble du personnel des établissements d'enseignement
Cette formation, d'une journée, voire d'une demi-journée, parait nécessaire. En effet, les personnels présents dans les établissements d'enseignement ne sont pas des spécialistes de ces thématiques. Une telle formation permettrait de mettre en avant les points de vigilance à observer (comment éviter les attroupements, quelles réactions à adopter en cas de suspicion de Covid-19, où est déposé le virus - rampes, poignées de porte...) mais également de répondre à leurs interrogations. Pour le groupe de travail, l'ensemble des adultes participant à la vie de l'établissement doit être associé , y compris les personnels des collectivités locales car ils interviennent à des moments stratégiques (nettoyage, restauration...). Enfin, les AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap) pourraient également être conviés : le retour des enfants en situation de handicap à l'école doit être une priorité. Ce moment de formation, et de manière générale la prérentrée, doit être l'occasion d'examiner concrètement comment cet adulte va être intégré dans la salle de classe et comment le cas échéant adapter les gestes barrières.
2. Mettre en place une prérentrée d'une durée suffisante pour les enseignants et l'ensemble des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement, afin de confronter aux réalités de ces établissements l'ensemble du processus scolaire adapté aux préconisations sanitaires et de préparer pédagogiquement le retour des élèves
Lors de son audition devant l'Assemblée nationale, le ministre a annoncé que le 11 mai serait une journée de prérentrée. Le groupe de travail salue l'affirmation de ce principe. Toutefois, cette dernière doit être d'une durée suffisante pour d'une part aborder et mettre en place l'organisation pratique des locaux pour respecter les prérequis sanitaires - avec notamment la formation précédemment évoquée -, et d'autre part, permettre aux équipes pédagogiques de se retrouver et de préparer ensemble la reprise des cours. Ce temps de prérentrée doit notamment permettre de faire le point sur les difficultés qu'ont pu rencontrer certains élèves dans l'accès au suivi pédagogique, commencer à élaborer ensemble, sur la base des retours des élèves en suivi pédagogique à distance, le programme des apprentissages d'ici la fin de l'année, et préparer la rotation des différents petits groupes. Cette prérentrée doit également permettre de voir concrètement comment intégrer les enfants en situation de handicap et ceux à besoins particuliers dans les cours en présentiel. Aussi, la participation des AESH à ces journées permettrait de prendre en compte ces élèves tant du point de vue de l'organisation logistique, que de leur situation pédagogique à la fin du confinement.
La durée de cette prérentrée dépend bien évidemment de la taille des établissements d'enseignement et doit donc être décidée localement en lien avec le DASEN, mais il semble qu'une durée minimale de deux jours soit nécessaire : un premier jour consacré à l'organisation sanitaire, et le deuxième jour à l'organisation pédagogique.
• GARANTIR AUX ÉLÈVES ET À L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE LES CONDITIONS SANITAIRES REQUISES TOUT EN POURSUIVANT LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE
3. Mobiliser tous les acteurs de la santé scolaire pour accompagner les élèves, les personnels d'éducation et les parents, y compris psychologiquement
Le confinement a pu être une période difficile , tant pour les élèves, les personnels éducatifs que les parents. Le retour des directeurs d'école ayant accueilli des enfants de personnels soignants illustre cette nécessité d'une mobilisation des acteurs de la santé scolaire. Les enfants, même petits, ont senti que quelque chose se passait, par exemple par une limitation des contacts entre le parent soignant et les autres membres de la famille. D'autres, plus grands, sont conscients des risques que courent leurs parents du fait de leur métier.
En outre, élèves, personnels éducatifs et parents ont pu avoir des décès dans leurs familles.
Enfin, comme l'a rappelé le ministre de l'éducation nationale lors de son audition devant la commission de la culture du Sénat le 9 avril dernier, l'éducation nationale est ordinairement le premier vecteur de signalement des violences intrafamiliales.
4. Mettre en place un réseau médical pouvant intervenir de manière préventive et curative dans les établissements d'enseignement
Le groupe de travail est conscient des difficultés que rencontre la médecine scolaire depuis de nombreuses années . Dans cette période particulière, et pour pallier ce déficit, il lui semble opportun d'identifier localement un réseau de personnels médicaux à qui l'établissement pourrait faire appel, notamment pour faire passer des messages de prévention auprès des élèves et des adultes. Ce réseau a également un rôle à jouer en cas de suspicion de Covid-19 dans l'établissement, notamment pour pouvoir tester les personnes identifiées par le protocole sanitaire comme devant faire l'objet d'un dépistage.
5. Permettre un suivi pédagogique des élèves ne retournant pas en classe via le CNED et les autres supports (dispositif « nation apprenante », programmes dédiés sur Radio France et France Télévisions...), par exemple en s'appuyant sur les professeurs ne pouvant pas retourner en cours, afin d'éviter une double charge de travail pour les enseignants qui auront repris l'instruction en présentiel
Un élève pourra se trouver dans l'une des trois situations suivantes : suivi de cours en présentiel, suivi pédagogique à distance dans le cadre de la rotation des groupes, mais également poursuite du suivi pédagogique exclusivement à distance. C'est le cas notamment des élèves qui ne pourront pas retourner en cours pour des raisons de santé, ou parce qu'ils ont dans leur entourage des personnes à risque. Ces trois catégories d'élèves doivent pouvoir bénéficier d'une continuité pédagogique. Toutefois, la réouverture des écoles fait que de nombreux enseignants seront chargés de cours en présentiel. Dans ces conditions, il ne leur sera pas possible d'assurer à la fois le cours en présentiel, puis une fois la journée de classe finie celui pour les élèves suivant les cours à distance.
Les dispositifs de suivi pédagogique à distance doivent être maintenus et enrichis. Un système de coordination à l'échelle locale entre professeurs faisant cours en présentiel et ceux continuant à le faire à distance peut être imaginé.
Enfin, la situation des élèves, notamment de primaire, dont l'enseignant ne peut pas reprendre les cours en présentiel, ne doit pas être oubliée. Une réflexion doit être menée pour permettre à ces élèves privés d'un enseignant en présentiel, selon des modalités restant à définir, de retourner à l'école.
6. Faire preuve de souplesse dans l'obligation de scolarité en présentiel
Dans les circonstances actuelles, il apparait nécessaire au groupe de travail de faire preuve de souplesse dans l'obligation de scolarité en présentiel. Certaines familles, inquiètes, risquent de refuser que leurs enfants ne retournent à l'école. L'institution scolaire doit faire preuve de pédagogie pour essayer de rétablir le lien de confiance. En outre, le groupe de travail est conscient que forcer ces familles à remettre leur enfant à l'école serait au mieux inapplicable et au pire contreproductif car source de défiance envers l'institution scolaire pour le futur. Toutefois, en contrepartie de cette souplesse dans l'obligation de scolarité en présentiel, la famille doit s'engager à continuer de faire suivre à son enfant l'instruction à distance.
7. Fixer le cadre des activités périscolaires, répondant à un protocole sanitaire, en fonction des capacités et moyens des collectivités, maîtres d'ouvrage dans ce domaine
Dans le cadre des concertations locales, les collectivités définiront l'organisation des activités périscolaires - habituelles ou induites par la nouvelle organisation scolaire. Elles s'inscriront dans le cadre sanitaire défini au niveau national, et en fonction des capacités et des moyens humains dont elles disposent.
• PRENDRE EN COMPTE LES EFFETS DU CONFINEMENT SUR LES APPRENTISSAGES DES ÉLÈVES DANS LE CADRE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020
L'année 2019-2020 a été marquée par de nombreuses interruptions : grève des transports, puis blocage des lycées contre la réforme du bac et les E3C, réforme des retraites et enfin confinement. Certains élèves ont eu à peine une demi-année de cours et sont donc fortement pénalisés dans leurs apprentissages. Le groupe de travail estime nécessaire de prendre en compte dès à présent ces paramètres et préparer la rentrée 2020 en conséquence.
8. Établir un état des lieux par territoire et par voie de formation (générale, technique et professionnelle) du taux de décrochage scolaire afin de disposer d'une cartographie précise
Lors de son audition devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, le ministre de l'éducation nationale a annoncé un taux de décrocheurs de l'ordre de 4 % pour l'ensemble du territoire, mais avec localement des variations importantes . Ainsi, selon les estimations de son ministère, ce taux serait de 15 à 25 % dans les départements et territoires d'outre-mer. De même, certaines filières sont particulièrement touchées . C'est notamment le cas des filières professionnelles. Une cartographie précise de ce taux de décrochage est nécessaire afin de pouvoir cibler les filières et territoires les plus concernés dans la perspective de la rentrée 2020. En outre, cette cartographie doit également permettre, en recoupant les informations, d'identifier avec précision les zones dans lesquelles demeure une fracture numérique . C'est notamment le cas dans les outre-mer.
9. S'appuyer sur l'organisation de la scolarité obligatoire en cycles d'apprentissage pour construire les remises à niveau et les remédiations en matière d'acquisition des connaissances et des compétences
La scolarité en France de l'école maternelle jusqu'à la classe de troisième est découpée en cycle d'apprentissage de trois ans. Cette organisation en cycles a été créée pour prendre en compte les décalages d'apprentissage des enfants dus aux différences de maturité - chaque cycle constituant un ensemble cohérent d'acquisition de connaissances. Toutefois, cette notion de cycle reste trop peu utilisée au profit des apprentissages par année scolaire. Ainsi, chaque année, on constate une volonté de « finir le programme » avant les vacances d'été. La spécificité de l'année scolaire 2019-2020 et les lacunes dans les apprentissages qu'auront de nombreux enfants représentent l'occasion de mettre à profit cette organisation par cycle pour septembre, avec une pédagogie à cheval sur deux années scolaires à l'intérieur d'un cycle.
10. Construire pour la rentrée de septembre une adaptation des programmes et les modalités des remédiations afin de prendre en compte les lacunes dans les apprentissages induites par une année écourtée
Les programmes de la rentrée 2020 doivent intégrer les lacunes d'apprentissage des élèves, notamment de ceux qui passeront d'un cycle à un autre. Les premières semaines de cours jusqu'aux vacances de Toussaint, voire au-delà, doivent être considérées comme une période de transition et être utilisées pour voir les notions non étudiées et acquises lors de l'année scolaire 2019-2020.
Des arbitrages devront peut-être être faits sur le contenu des programmes. Il ne s'agit pas de supprimer des pans entiers, mais peut-être de les adapter, par exemple en les étudiants de manière plus synthétique. En outre, un travail de répétition des notions mal acquises et de remédiation de celles non étudiées doit être instauré. Dans cette optique, le groupe de travail salue la création de 1 248 postes supplémentaires dans l'enseignement primaire annoncés à la rentrée 2020. Il constate toutefois que ceux-ci n'ont pas encore été budgétés , y compris dans le projet de loi de finances rectificatives que le Parlement est en train d'examiner. Les besoins sont également à examiner au niveau du secondaire, à la lumière du nouveau contexte créé par le confinement.
11. Organiser à la fin du mois d'août un dispositif de soutien scolaire exceptionnel par son ampleur avec des enseignants volontaires, pour tous les élèves qui en ont besoin, quel que soit leur niveau de classe
Un dispositif de soutien scolaire existe déjà depuis plusieurs années, sous la forme de stage de réussite, pour remettre à niveau les élèves de CM2 avant leur entrée en sixième. De tels stages existent également au collège. Pour l'été 2020, le groupe de travail estime nécessaire que ces stages soient ouverts à tous les élèves qui le demandent - sans limitation du nombre d'inscrits - et pour tous les niveaux d'enseignement . Ce dispositif doit également être envisagé dans l'enseignement supérieur afin de soutenir les futurs étudiants qui n'auront pas eu une année de terminale complète.
IV. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Le groupe de travail « Enseignement supérieur » de la commission de la culture animé par Stéphane Piednoir (Maine-et-Loire, LR) est composé de Mireille Jouve (Bouches-du-Rhône, RDSE), Guy-Dominique Kennel (Bas-Rhin, LR), Laurent Lafon (Val-de-Marne, UC), Pierre Ouzoulias (Hauts-de-Seine, CRCE), Olivier Paccaud (Oise, LR), Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, socialiste et républicain).
Le groupe de travail « enseignement supérieur » a été mis en place à l'initiative du bureau de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat le mardi 14 avril 2020, dans l'objectif de suivre la gestion de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 pour le secteur de l'enseignement supérieur.
Ce groupe de travail a auditionné la Conférence des présidents d'université (CPU), la Conférence des doyens des facultés de médecine, la Conférence des grandes écoles (CGE), la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs (CDEFI), la cheffe de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche responsable du comité de pilotage chargé de réorganiser le calendrier des concours post-classes préparatoires, la présidente du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (Cnous). Trois grands thèmes ont constitué le fil conducteur de ces auditions : la continuité pédagogique, l'organisation des examens et des concours, l'accompagnement sanitaire et social des étudiants. Ce sont principalement sur ces sujets que le groupe de travail s'est attaché à dresser un constat et formuler des recommandations. Le groupe de travail a également tenu à mettre en exergue des problématiques complémentaires qui devront impérativement être traitées dans le cadre de la crise actuelle.
A. UNE GESTION DE LA CRISE GLOBALEMENT RÉACTIVE ET CONCERTÉE
La gestion de la crise sanitaire dans les établissements d'enseignement supérieur, tous fermés depuis le 16 mars dernier, s'est concentrée, dans les premières semaines, sur trois grandes priorités : la continuité pédagogique, la réorganisation des examens et des concours, le suivi sanitaire et social des étudiants.
De ses auditions, le groupe de travail dresse le constat d'une réponse globalement réactive et concertée de la part du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (Mesri), doublée d' une implication très forte des acteurs du secteur sur le terrain .
1. Un enseignement à distance mis en place dans l'urgence et appelé à durer
À l'annonce de la fermeture des établissements et de la mise en oeuvre du confinement, la continuité pédagogique est apparue comme une priorité absolue . Les établissements s'y sont attelés dans l'urgence, souvent sans y avoir été préparés. Ils ont dû, en un temps très compté, basculer d'un enseignement reposant sur le face-à-face pédagogique à un enseignement à distance requérant la maîtrise, par les enseignants et les étudiants, d'outils numériques jusqu'alors utilisés qu'en complément des méthodes d'enseignement et d'apprentissage traditionnelles. À ce sujet, le groupe de travail salue l'incroyable mobilisation et la capacité d'adaptation des équipes tant pédagogiques qu'administratives pour accompagner les étudiants dans ce passage au « tout virtuel ».
Afin d'aider les établissements dans leurs démarches, la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (Dgesip) a élaboré et mis à leur disposition un ensemble de fiches pratiques, régulièrement actualisées, sur l'environnement et les ressources d'enseignement à distance. Ce recueil, disponible sur le site de la direction générale 2 ( * ) , est un précieux outil d'accompagnement qu'il conviendra d'enrichir et de pérenniser.
Le groupe de travail estime que le basculement du présentiel vers le distanciel s'est relativement bien passé dans la mesure où il s'est opéré dans une situation contrainte . Les établissements ont fait preuve de réactivité, d'engagement et d'initiative pour assurer leur mission dans un contexte inédit. Il s'agit bien sûr là d' un constat général qui ne doit masquer ni la diversité des situations selon les structures, ni les difficultés rencontrées (cf. infra) .
La décision prise par l'exécutif de la non-reprise des cours en présentiel dans les établissements d'enseignement supérieur d'ici l'été, implique de facto une poursuite et une consolidation des nouvelles pratiques pédagogiques mises en oeuvre. Pour le groupe de travail, il y aura assurément un avant et un après crise du Covid-19 dans l'appropriation, par le supérieur, de l'enseignement à distance . La crise pourrait être un accélérateur d'évolution, certes subi, mais bénéfique pour l'avenir .
2. Une réorganisation nécessaire mais délicate des examens et des concours
Le maintien des épreuves de fin d'année , qu'il s'agisse d'examens ou de concours, constitue la garantie de la qualité des formations . À ce titre, toute neutralisation ou validation automatique de l'ensemble des enseignements est exclue. Mais les circonstances exceptionnelles actuelles obligent à adapter les modalités d'évaluation des connaissances. Tel est le sens de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 sur les modalités de déroulement des examens et concours, prise en application de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, et sur laquelle le groupe de travail, comme l'ensemble de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, a exercé sa mission de contrôle.
a) Les examens à l'Université
Traditionnellement, les mois d'avril et de mai sont synonymes, dans le monde universitaire, de périodes consacrées aux évaluations des étudiants, souvent sous forme d'examens sur table. Cette année, distanciation sociale oblige, les procédures sont à revoir.
La première préoccupation du Mesri, comme celle de nombre d'établissements, a été de maintenir le calendrier de l'année académique en cours , et de ne pas empiéter sur celui de la rentrée prochaine. De ce fait, les universités ont dû travailler rapidement à une réorganisation des épreuves, ce qui a représenté un travail colossal, mené formation par formation.
L'ordonnance du 27 mars leur permet , dans ce contexte d'urgence, et conformément au principe d'autonomie, de modifier et d'adapter leurs modalités de contrôle des connaissances , à condition d'en informer les étudiants au moins quinze jours avant l'examen. Dans un courrier en date du 20 avril 2020 adressé aux chefs d'établissements, la ministre les invite à procéder à de telles adaptations autant que nécessaire, dans le cadre de trois orientations : la réduction du recours aux épreuves en présentiel au profit d'évaluations à distance en utilisant le contrôle continu et/ou en mobilisant des travaux à domicile ; en cas de maintien d'épreuves en présentiel , d'une part, la nécessité de les organiser entre le 20 juin et le 7 août afin de limiter les perturbations sur l'année universitaire 2020-2021 et de prendre en compte les contraintes matérielles qui pèsent sur les étudiants, d'autre part, le respect de règles très strictes d'organisation pour assurer la sécurité sanitaire des étudiants et des personnels mobilisés.
Le groupe de travail approuve ces orientations de bon sens , justifiées par le caractère exceptionnel de la situation. Elles ont également le mérite de poser un cadre général et national, indispensable à une nécessaire harmonisation des pratiques, dans le respect de l'autonomie des universités .
b) Les concours post-baccalauréat et post-classes préparatoires
Alors que certaines écoles post-baccalauréat devaient organiser, dès le mois de mars, des épreuves écrites et/ou orales pour sélectionner leurs futurs étudiants, les ministres de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale ont annoncé, le 15 mars, que les concours post-baccalauréat étaient annulés et remplacés par des examens des dossiers . Les formations concernées sont nombreuses et diverses ; il s'agit de quelques écoles de commerce et d'ingénieurs, de certains brevets de technicien supérieur (BTS), de licences sélectives (double diplôme par exemple), de formations du paramédical (orthophoniste, orthoptiste...), de filières de l'art et du design. Avec cette décision, la sélection ne se fera qu'à partir du dossier de candidature enregistré sur Parcoursup. Le groupe de travail considère qu'il s'agit là de la moins mauvaise des solutions , compte tenu des incertitudes sur la possibilité de tenir, avant la fin du mois de juin, des concours réunissant parfois plusieurs centaines de candidats sur une durée conséquente.
La réorganisation des concours post-classes préparatoires , quant à elle, a été confiée à un comité de pilotage , dirigé par Caroline Pascale, cheffe de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Sa mission était de parvenir à une vision concertée et convergente des concours. L'absence de coordination aurait en effet présenté le risque de voir chaque école adopter sa propre stratégie, ce qui aurait nuit à la cohérence d'ensemble du système et, in fine , porté préjudice aux candidats.
Lors de son audition par le groupe de travail, Caroline Pascale a détaillé la méthode et la feuille de route du comité . La première a consisté en une concertation avec les écoles pour connaître leurs besoins et recueillir leurs propositions, puis en l'élaboration de différents scenarii soumis à l'arbitrage des ministres de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale. La seconde était guidée par quatre impératifs : une incidence minimale voire nulle sur la rentrée 2020, la préservation de l'ordre initial de passation des épreuves selon les écoles, la prise en compte des disparités dans les conditions de confinement des candidats, le maintien de la pause estivale tant pour les étudiants que pour les personnels mobilisés dans l'organisation des concours. À partir des échanges entre les écoles, deux scenarii ont émergé, l'un privilégiant un calendrier très étendu (du 8 juin au 20 août), l'autre, un calendrier plus ramassé (du 20 juin à fin juillet). C'est finalement sur ce deuxième scénario que s'est porté le choix des ministres. Le 17 avril, ces derniers ont annoncé que les concours auraient lieu du 20 juin au 7 août , la mobilisation de la première semaine d'août permettant aux équipes administratives et pédagogiques de finaliser leurs procédures de sélection.
Ce nouveau calendrier, concentré sur un peu plus d'un mois, emportait nécessairement d'arbitrer sur le maintien ou non des épreuves orales . Alors que certaines écoles, en particulier de commerce, avait déjà collectivement décidé de tirer un trait sur celles-ci, il est apparu que leur organisation en présentiel n'était pas compatible avec le calendrier choisi. Le passage au distanciel aurait, de son côté, représenté une opération beaucoup trop lourde. Pour ces raisons, la très grande majorité des écoles a décidé de renoncer aux épreuves orales et d'admettre leurs futurs étudiants sur la base des seules épreuves écrites.
Pour le groupe de travail, le comité de pilotage est une réussite car il a su faire émerger un consensus loin d'être acquis au départ . La logique collective a prévalu sur les comportements de « cavalier seul ». Il salue, à ce titre, le travail d'écoute et de synthèse remarquable effectué par Caroline Pascal et le sens des responsabilités des dirigeants des écoles.
Le groupe de travail considère que la suppression des épreuves orales était une décision difficile à prendre au regard de la plus-value qu'elles apportent dans le processus de sélection des candidats, mais qu'elle était rendue nécessaire par l'exceptionnalité de la situation . Il estime toutefois que cette décision ne doit en aucun cas être préfiguratrice d'une remise en cause des oraux à l'avenir. Il tient par ailleurs à alerter sur les probables conséquences de la suppression des épreuves orales , en particulier les entretiens de personnalité et de motivation, sur la composition de la cohorte 2020 des écoles, qui pourrait être moins en adéquation avec les profils recherchés . Les années de formation en école devraient cependant permettre de rectifier cette situation, d'autant que les étudiants recrutés après une classe préparatoire sont encore très jeunes.
S'agissant des concours externes de recrutement de l'éducation nationale , dont les épreuves écrites d'admissibilité n'ont pas pu avoir lieu du fait du confinement, et pour lesquels les épreuves orales d'admission ont été supprimées et remplacées par un oral de titularisation à l'issue de l'année de stage , le groupe de travail s'interroge sur la pertinence d'une telle mesure pour des personnes qui s'apprêtent à enseigner dès la rentrée prochaine . La suppression des oraux paraît, qui plus est, totalement incohérente pour certaines spécialités comme celle des langues vivantes.
3. Un accompagnement sanitaire et social des étudiants réactif et coordonné
a) Les premières mesures d'urgence
Les étudiants, au premier rang desquels les plus précaires, sont tout particulièrement affectés par les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19. Dès l'annonce du confinement, nombre de ceux logés en résidence étudiante ont souhaité légitimement rejoindre leurs familles de manière précitée. Ils y ont été encouragés par la décision du ministère d'autoriser le Cnous à prendre des mesures dérogatoires aux règles de gestion locative applicables aux résidences comme la levée du préavis de départ contractuel d'un mois et la suspension du loyer pour le mois d'avril, voire les mois suivants en cas de non-retour dans les logements.
D'autres étudiants ont décidé de rester dans leur résidence, par choix ou par absence de solution alternative. La première urgence a donc été de s'assurer de leur présence - certains ne s'étant pas signalés - et de s'enquérir de leur état de santé . Une campagne générale de recensement a été organisée au moyen d'envoi de messages téléphoniques et électroniques, d'opérations d'appels, d'actions de porte à porte. La présidente du Cnous a indiqué au groupe de travail que sur les 175 000 logements des Crous, environ 50 000 étudiants y avaient été confinés, leur pourcentage variant de 20 % à 50 % selon les structures. Ce recensement s'est accompagné de deux mesures corollaires : le renforcement du soutien psychologique via la possibilité de consultations à distance avec les assistantes sociales du réseau et la mise en place d'actions pour maintenir le lien avec les étudiants (distributions de colis alimentaires et de matériels, animations en ligne...) à l'initiative des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (Crous), mais aussi des associations étudiantes et des collectivités territoriales. Aucune résidence étudiante n'a été fermée et les services de première nécessité ont été maintenus (nettoyage des locaux, surveillance des lieux, distribution de repas).
Sur le plan sanitaire, la mobilisation , par décret ministériel 3 ( * ) , des services de santé universitaires (SSU) a été décisive pour assurer , en collaboration avec les Crous, les établissements d'enseignement supérieur, les agences régionales de santé (ARS) et les centres de santé de proximité, le suivi sanitaire des étudiants isolés et ceux confinés en résidences . La présidente du Cnous a indiqué au groupe de travail que, fin avril, le nombre d'étudiants malades du Covid-19 se chiffrait à une dizaine par académie et qu'aucun foyer épidémique n'était à déplorer dans les résidences étudiantes. Elle a toutefois noté la difficulté qu'il y avait parfois à faire respecter les gestes barrières par les étudiants.
Le groupe de travail salue la très forte mobilisation des personnels des Cnous, des Crous, des SSU, ainsi que des bénévoles associatifs, qui, en distanciel ou en présentiel, ont continué à assurer leurs missions dans un contexte très anxiogène. Il souligne également que ces circonstances exceptionnelles ont favorisé un travail collaboratif particulièrement précieux entre les différents acteurs du secteur, qu'il conviendra d'entretenir.
b) Les mesures de soutien financier aux étudiants
Sur le plan social, quatre leviers ont été activés pour venir en aide aux étudiants, qu'ils aient ou non été confinés en résidences étudiantes :
• les aides spécifiques d'urgence des Crous ont été abondées de 10 millions d'euros supplémentaires par le ministère. Les dossiers de demande ont été simplifiés et le montant maximum des aides augmenté, passant de 200 à 500 euros. Selon les informations communiquées par la présidente du Cnous lors de son audition, le nombre d'aides versées a été multiplié par deux en quelques semaines. S'il est encore trop tôt pour disposer d'une typologie exhaustive de l'usage de ces aides, 30 % d'entre elles étaient, dans les premières semaines, destinées à participer au paiement des loyers (des Crous ou du parc privé). La présidente du Cnous a également expliqué que les assistantes sociales des Crous travaillaient à partir de dossiers d'instruction simplifiés et sur le périmètre le plus large possible afin de couvrir le maximum d'étudiants dans des délais accélérés ;
• dans les universités, les ressources issues de la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) ont été mobilisées à hauteur de 80 millions d'euros pour soutenir les étudiants en difficulté, boursiers ou non, par le biais de nombreuses actions comme des épiceries solidaires, des chèques alimentaires ou des bons d'achat de matériel informatique pour le suivi des cours à distance ;
• s'agissant des bourses , la présidente du Cnous a indiqué au groupe de travail qu'elles avaient été versées dans les temps aux mois de mars et d'avril grâce à la continuité du service assuré par les personnels placés en télétravail. Se pose désormais la question d'un éventuel maintien du droit à bourse en juillet pour les étudiants qui seraient mobilisés par des examens ou des concours ; ce sujet est en cours d'étude au ministère. Les demandes de bourses pour la rentrée prochaine sont, quant à elles, en phase d'instruction ;
• enfin, le 4 avril dernier, le Premier ministre a annoncé au Sénat l'octroi d' une aide exceptionnelle aux jeunes de moins de 25 ans précaires ou modestes . Cette aide de 200 euros, qui sera versée en juin, concernera 800 000 jeunes, dont 400 000 étudiants boursiers ou non. Sont ciblés ceux ayant perdu leur travail ou leur stage gratifié en raison du confinement, les étudiants ultramarins boursiers ou non boursiers qui n'ont pas pu rentrer chez eux, ainsi que les jeunes de moins de 25 ans précaires ou modestes qui touchent l'aide personnalisée au logement (APL). Cette mesure ne sera pas cumulable avec d'autres dispositifs mis en place par le Gouvernement comme le chômage partiel ou l'aide aux autoentrepreneurs, et viendra en complément des bourses et des aides d'urgence. Sur ces non-possibilités de cumul, le groupe de travail demande à ce qu'une information très précise soit délivrée aux jeunes .
L'ensemble de ces aides constitue un premier filet de sécurité indispensable pour faire face aux répercussions économiques et sociales de la crise sur les étudiants. Le groupe de travail s'interroge cependant sur leur financement qui, à ce stade, demeure encore très flou ( cf. infra ).
B. LES POINTS DE VIGILANCE DU GROUPE DE TRAVAIL
Si la gestion de la crise par le ministère peut globalement être jugée satisfaisante, le groupe de travail appelle à la vigilance sur plusieurs sujets.
1. La transition entre le second degré et le supérieur à surveiller
En dépit de la crise, le calendrier de la procédure Parcoursup n'a pas été modifié , le ministère considérant que le fonctionnement entièrement dématérialisé de la plateforme n'était pas affecté par la fermeture des lycées. Le groupe de travail se veut plus prudent sur ce point, dans la mesure où le confinement a coïncidé avec la période de confirmation des voeux des lycéens. Il entend s'assurer, a posteriori , que la crise n'a vraiment eu aucune incidence sur la procédure cette année .
Par ailleurs, les bouleversements qu'aura connus l'année scolaire 2019-2020 (grèves liées à la réforme des retraites, fermeture des établissements, remplacement des épreuves du baccalauréat par du contrôle continu) auront inévitablement des conséquences sur le niveau des élèves quittant le second degré. Aussi, le groupe de travail estime qu'une période de remédiation en début de première année universitaire pourrait être utile pour éviter de mauvais résultats lors des premiers partiels et des taux d'échec qui repartiraient à la hausse en fin de première année.
2. Les limites de l'enseignement supérieur à distance
Quels que soient les efforts faits par les établissements pour mettre en ligne tout ou partie de leurs formations, une part non négligeable d'étudiants reste exclue de la continuité pédagogique pour des raisons principalement techniques, révélatrices de la fracture numérique (matériels inadéquats, forfaits téléphoniques et internet limités, zone blanche). Dès la deuxième semaine d'enseignement à distance, des établissements se sont aperçus qu'ils perdaient des étudiants, confrontés à des problèmes de connexion ou à l'épuisement de leur crédit internet. Des solutions temporaires ont pu être trouvées (prêt de matériel, bons d'achat), mais elles ne règlent pas le problème de fond des inégalités d'accès aux équipements numériques.
La crise aura ainsi eu le mérite de montrer que l'équipement informatique individuel des étudiants n'est pas de l'ordre du confort personnel, mais un élément important des conditions pédagogiques . Dans la continuité des propos tenus devant lui par le président de la CPU, le groupe de travail appelle les universités à se préoccuper davantage, à l'avenir, de la satisfaction de ce besoin .
La fracture est aussi sociale et financière . L'absence de cours en présentiel et l'arrêt des relations sociales au sein du collectif universitaire ou scolaire isolent davantage les étudiants décrocheurs ou financièrement fragiles. L'enseignement à distance agit ainsi comme un révélateur voire un amplificateur des inégalités .
En outre, la fermeture des bibliothèques universitaires a provoqué une rupture dans les habitudes d'apprentissage des étudiants. Le vide laissé est d'autant plus grand que ces espaces traditionnels de travail, de consultation et d'emprunt de documents sont aussi devenus d'importants lieux de vie, de loisirs, de détente et de rencontres.
Les difficultés liées à l'enseignement à distance n'épargnent évidemment pas les enseignants qui, dans l'urgence, et souvent sans y être préparés, ont dû adapter leurs pratiques. À cette transformation pédagogique, intellectuellement très exigeante, est venue s'ajouter une charge cognitive très importante liée à la nécessité de maintenir le lien avec les étudiants. La période de confinement s'est ainsi traduite par une charge de travail décuplée, une fatigabilité plus importante, une inquiétude sur la durée de cet enseignement en mode dégradé. Si les conditions de travail devraient s'améliorer avec la levée des contraintes liées au confinement, le groupe de travail entend rester attentif à l'évolution de l'enseignement à distance « déconfiné » .
3. Les enjeux posés par la réorganisation des examens et des concours
a) Les examens en distanciel : l'épineuse question de l'équité et de la surveillance
Alors que les établissements sont à peine sortis de la gestion de l'enseignement à distance, une autre urgence se pose à eux : comment organiser les examens de fin d'année, dans le cadre posé par la ministre ( cf. supra ) ? Faut-il maintenir toutes les épreuves ? Faut-il prendre davantage en compte le contrôle continu ? Sur quel périmètre faire porter l'évaluation des connaissances sachant qu'une partie de l'année a été complètement bouleversée ? Face à ces questions délicates, chaque école, chaque université essaye de construire sa propre solution, comme l'y autorise l'ordonnance du 27 mars 2020.
Mais toutes sont confrontées à deux écueils : l'équité entre les candidats et la surveillance des épreuves . L'utilisation d'outils d'examen à distance interroge en effet sur la façon d'assurer l'équité entre des candidats qui ne pas tous dotés d'équipements informatiques performants. Si, pendant une épreuve, un candidat est confronté à une rupture de connexion qui l'empêche de la terminer, devra-t-il la repasser à la session de rattrapage ? Quelle que soit la solution choisie, les établissements font face à des risques de recours . Certains syndicats étudiants ont d'ores et déjà prévenu qu'ils seront très attentifs aux moyens mis en oeuvre pour garantir l'équité entre les candidats.
L'organisation des examens en distanciel pose aussi la question des moyens de lutter contre la fraude . La Dgesip a mis à disposition des établissements une fiche recensant les solutions envisageables en matière de télésurveillance et les offres des fournisseurs. Mais les principaux systèmes existants 4 ( * ) sont loin d'être la panacée : ils sont matériellement compliqués à déployer pour de gros effectifs, ils sont souvent très coûteux, surtout, ils interrogent sur le plan du respect des libertés individuelles et de leur conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD) . Face au risque de dérives, le groupe de travail appelle à la plus grande vigilance sur l'utilisation de ces outils de surveillance en distanciel des candidats .
b) Les concours en présentiel : un défi en termes de logistique et de sécurité sanitaire
Après avoir trouvé un accord sur le nouveau calendrier des concours post-classes préparatoires, le comité de pilotage s'est attelé à l'organisation des épreuves écrites qui débuteront fin juin, dans un contexte sanitaire sans doute encore très tendu .
Caroline Pascal a fait part au groupe de travail des quatre grandes difficultés que cette mission nécessite de résoudre :
• le nombre et le choix des centres d'examens : avec les mesures de distanciation sociale et l'interdiction des grands rassemblements, il est impossible d'accueillir les candidats dans les conditions habituelles. Il faut donc envisager un doublement du nombre de salles et l'occupation de centres plus petits, permettant une meilleure prise en charge d'un nombre limité de candidats ; la réquisition des locaux de certaines universités est également une possibilité ;
• les modalités de passation et de surveillance des épreuves : la distanciation sociale impose aussi de prévoir des plages horaires plus longues pour éviter les attroupements à l'arrivée et au départ des candidats ; la mobilisation de retraités pour la surveillance des centres, comme cela se faisait habituellement, est exclue cette année : le recours à des étudiants rémunérés est une piste envisagée ;
• les mesures sanitaires : le port du masque par les candidats devrait être rendu obligatoire, le nettoyage des salles après chaque épreuve et la mise à disposition de gel hydroalcoolique sont des prérequis indispensables. Se pose aussi la question des mesures d'hygiène liées aux fournitures données aux candidats ;
• les déplacements des candidats : les mesures restrictives de déplacement imposent de revoir la cartographie des centres d'examens et de multiplier les centres de proximité afin d'éviter aux candidats de devoir changer de département ou de région pour passer les épreuves ;
• l'hébergement des candidats : les solutions d'hébergement traditionnelles (hôtels, location) ne sont pas mobilisables cette année : une réflexion est actuellement en cours entre le Mesri, les Crous, la CPU et les collectivités territoriales pour trouver des alternatives. Parmi celles-ci, sont évoquées la réquisition d'universités, de gymnases ou de centres de loisirs.
À cela s'ajoutent deux problématiques plus spécifiques , l'une liée au calendrier de déconfinement en outre-mer et aux conditions de passation des épreuves dans les centres d'examen à l'étranger.
c) La nécessaire clarification des moyens financiers destinés au suivi social des étudiants
Le groupe de travail appelle le ministère à une clarification rapide des moyens dédiés aux mesures d'aides aux étudiants, qui pourraient s'avérer sous-calibrés face à l'ampleur des besoins.
• l'enveloppe de 10 millions d'euros consacrée aux aides spécifiques d'urgence des Crous sera-t-elle suffisante alors que les difficultés financières rencontrées par les étudiants, notamment pour payer leur loyer, vont sans doute durer plusieurs mois ?
• si, comme le souhaite le groupe de travail, le droit à bourse est prolongé jusqu'en juillet pour les étudiants concernés par des examens ou des concours, comment et à quelle hauteur cette mesure sera-t-elle financée ?
• une nouvelle mobilisation de la CVEC sera-t-elle nécessaire , comme l'a laissé penser le président de la CPU lors de son audition ? En tout état de cause, le groupe de travail estime indispensable de faire le point sur les conditions d'utilisation de cette contribution, qui demeurent opaques . Il s'interroge aussi sur le soutien apporté aux étudiants des établissements non couverts par la CVEC comme les établissements privés ;
• la budgétisation de l'aide exceptionnelle à 160 millions d'euros est-elle conforme aux besoins du public ciblé ? Quand ces moyens seront-ils débloqués ?
Le groupe de travail pointe également les probables effets de seuil de ces aides qui pénaliseront les jeunes issus de classes moyennes , dont les familles ont des revenus supérieurs à la limite fixée pour en être bénéficiaire, mais qui vont pourtant devoir faire face à leurs propres difficultés financières (chômage partiel ou autre) tout en assumant la charge d'un étudiant pas encore inséré dans le monde du travail.
Par ailleurs, le groupe de travail s'inquiète des conséquences financières de la crise sur les Crous . D'après la présidente du Cnous, la diminution de leurs recettes d'exploitation, liées à la fermeture des restaurants universitaires et à la suspension des loyers, devrait s'élever à 200 millions d'euros. Cette perte considérable pourrait mettre en péril le réseau des Crous, dont le rôle est essentiel en cette période de crise.
Le groupe de travail plaide en conséquence pour un abondement de la subvention pour charges de service public des Crous , à due proportion des pertes subies.
Le prochain projet de loi de finances rectificatif sera l'occasion pour le groupe de travail d'interpeller le Gouvernement sur l'ensemble de ces sujets financiers et d'envisager le dépôt d'amendements .
C. LES PROPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES DU GROUPE DE TRAVAIL
Au-delà des trois grands dossiers sur lesquels s'est concentrée la gestion de la crise dans les premières semaines, le groupe de travail a identifié plusieurs sujets appelant des réponses urgentes .
1. Soutenir les formations professionnalisantes et accompagner les jeunes diplômés 2020 à s'insérer sur le marché du travail
En fragilisant les entreprises, la crise touche de plein fouet les formations professionnalisantes.
Pierre angulaire de ces formations et chemin le plus court vers l'emploi pour les jeunes diplômés, le stage en entreprise est le premier à être mis à mal . Il s'agit d'une source d'inquiétude majeure pour les étudiants, qui comptent sur cette première expérience professionnelle pour valoriser leur cursus, mais aussi souvent pour financer leurs études.
Le secteur de l'enseignement supérieur a vite pris la mesure des conséquences désastreuses du confinement sur le déroulement des stages. Dès le 19 mars, la Dgesip mettait en ligne ses recommandations aux établissements en la matière. Le 26 mars, c'était au tour de la commission des titres d'ingénieur (CTI) de donner ses lignes directrices aux écoles d'ingénieurs, les encourageant à identifier au cas par cas les adaptations à mettre en oeuvre.
Le groupe de travail encourage les établissements à faire preuve de souplesse et de flexibilité , en mettant au point de nouvelles modalités de stage, en décalant les calendriers, en signant des avenants aux contrats déjà établis.
La même inquiétude se pose pour le sort des alternants , dont la formation est basée sur le principe d'une période d'études suivie d'une période en entreprise, qu'ils soient en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation.
S'agissant des alternants en cours de contrat, les établissements et les entreprises ont fait preuve de réactivité en mettant en place une continuité pédagogique pour la partie études et en basculant en télétravail pour la partie en entreprise. Même s'ils parviennent à achever leur formation dans les prochains mois, ces jeunes vont cependant être confrontés à une insertion très difficile sur le marché du travail .
La situation devrait être encore plus compliquée pour les futurs alternants qui devront faire face à une diminution des offres de recrutement des entreprises . Les branches professionnelles n'ont d'ailleurs pas caché leur très grande inquiétude sur le risque d'enrayement de la dynamique de l'alternance.
Le groupe de travail appelle en conséquence à des mesures de soutien en faveur de l'alternance pour atténuer les effets de l'effondrement qui s'annonce .
Plus globalement, avec le spectre de la récession, le groupe de travail estime que c'est sur l'accompagnement vers l'emploi que vont devoir se focaliser les efforts pour ne pas faire des diplômés 2020 et ceux des années à venir des générations sacrifiées de la crise . Qui plus est, le soutien à l'emploi des jeunes diplômés est un important facteur de relance de l'économie . Plusieurs leviers sont envisageables, parmi lesquels des mesures incitatives à l'embauche sous forme d'allègements de charges sur les cotisations salariales et/ou patronales, des aides ciblées en faveur de la recherche d'emploi, des facilités pour le remboursement des prêts bancaires .
2. Financer le prolongement des contrats doctoraux et postdoctoraux par une augmentation de la subvention pour charges de service public des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche
Comme de nombreux secteurs, la recherche est durement éprouvée par la crise liée à l'épidémie de Covid-19. Un grand nombre de projets et de travaux de recherche sont ralentis voire arrêtés. La fermeture des établissements d'enseignement et de recherche, ainsi que le confinement, ont contraint de nombreux doctorants, chercheurs, techniciens, ingénieurs à interrompre leurs travaux expérimentaux en laboratoire - pour les sciences de la nature et les sciences formelles - ou à suspendre leurs recherches documentaires, leurs enquêtes et études de terrain - pour les sciences humaines et sociales.
Afin de tenir compte de ce contexte exceptionnel et de limiter ses effets négatifs sur les activités de recherche, le Mesri a annoncé la possibilité, pour les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, de prolonger les contrats doctoraux et postdoctoraux affectés par la crise . Cette mesure figure dans le projet de loi portant diverses dispositions urgentes qui sera examiné courant mai au Parlement.
Le groupe de travail salue cette mesure de soutien aux chercheurs à contrat à durée déterminée, mais s'interroge sur deux points :
• les critères d'octroi de la prolongation des contrats : à ce stade, aucune information n'a été délivrée sur les conditions dans lesquelles les doctorants et post-doctorants pourront solliciter une prolongation. Le groupe de travail appelle à élaborer des critères précis , aussi bien dans le champ des sciences de la nature et les sciences formelles, que dans celui des sciences humaines et sociales ;
• les conditions de financement des prolongations de contrats accordées : la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a assuré que les prolongations seront « soutenues financièrement par l'État » , mais sans donner davantage de précision. Il est dès lors à craindre qu'à terme, les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche soient contraints de les financer à budget constant.
C'est pourquoi le groupe de travail demande à ce que cette mesure soit rapidement budgétée par une augmentation, à due proportion, de la subvention pour charges de service public des établissements autorisés à la mettre en oeuvre .
3. Encourager et adapter l'accueil des étudiants internationaux
La crise sanitaire mondiale aura inévitablement des répercussions sur l'accueil des étudiants étrangers dans les établissements d'enseignement supérieur français. Les responsables des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs ont ainsi alerté le groupe de travail sur une très probable baisse des effectifs de ces étudiants à la rentrée prochaine .
À ce jour, les prévisions sont toutefois difficiles à affiner, d'une part, parce que la procédure d'inscription via la plateforme « Études en France » n'est pas close (elle le sera fin juin), d'autre part, parce que les mesures de restriction des mobilités prises par les pays évoluent régulièrement.
Quelle que soit l'ampleur du phénomène, celui-ci aura des conséquences financières pour les écoles qui accuseront une perte de recettes risquant de fragiliser leur modèle économique. À cela s'ajoute la fragilisation de certaines filières , notamment doctorales, qui fonctionnent aujourd'hui avec 50 % d'étudiants étrangers. C'est aussi le rayonnement et l'attractivité de l'enseignement supérieur à l'international qui est en jeu.
Conscient du problème à venir, le Mesri travaille avec le ministère de l'Europe et des affaires étrangères à l'élaboration d'une offre de formation à distance pour les étudiants internationaux, en s'appuyant sur les campus des établissements d'enseignement français à l'étranger.
Si la formation à distance est une voie à développer, le groupe de travail estime qu'elle ne pourra toutefois pas remplacer l'attractivité d'une formation en présentiel sur le territoire français .
C'est pourquoi il propose de :
- renforcer, au niveau des postes diplomatiques, la campagne de communication déjà lancée par Campus France pour encourager les étudiants internationaux à s'inscrire dans des cursus français ;
- envisager , au regard de l'état sanitaire en France et dans les pays d'origine des étudiants, des mobilités plus courtes, voire plus ciblées sur certaines zones géographiques ;
- simplifier les procédures d'obtention de visa pour les étudiants sélectionnés par les écoles :
- clarifier la question d'une éventuelle mise à l'isolement de ces étudiants à leur arrivée en France.
4. Mieux considérer les études de santé
Alors que la rentrée universitaire 2020-2021 doit marquer la première année de mise en oeuvre de la réforme des études de médecine, le secteur se trouve, depuis plusieurs mois, en première ligne dans la gestion de la crise du Covid-19.
Dans ce contexte, le groupe de travail considère que le report d'un an de l'entrée en vigueur de la réforme du deuxième cycle , décidé par les ministres de la santé et de l'enseignement supérieur, est un choix raisonnable .
Il fait en outre observer que la mobilisation exceptionnelle des personnels de santé montre , s'il en était besoin, l'urgence qu'il y a à revaloriser le statut et le niveau de rémunération des étudiants infirmiers et des étudiants en médecine ainsi que, plus globalement, de l'ensemble des professionnels de santé .
S'agissant des étudiants en médecine , le groupe de travail appelle à :
- l'assouplissement des critères de sélection pour les étudiants en Paces compte tenu des perturbations subies pendant l'année universitaire 2019-2020 ;
- la prise en compte, pour la validation des stages, du sens des responsabilités et du courage dont ont fait preuve les étudiants engagés volontaires au sein des hôpitaux pendant la crise, ainsi que l'attribution d'une prime exceptionnelle comme s'y est engagé le Gouvernement .
S'agissant des étudiants infirmiers et des étudiants techniciens de laboratoire , le groupe de travail demande à ce que leur mobilisation durant cette période soit également reconnue et qu'ils puissent eux aussi bénéficier d'une prime exceptionnelle .
5. Réfléchir à un plan de rénovation des bâtiments universitaires comme facteur de relance économique
Enfin, le groupe de travail estime que la rénovation énergétique des bâtiments universitaires, dossier trop longtemps négligé, devrait figurer parmi les principales mesures de relance de l'économie .
Une telle orientation serait, de plus, cohérente avec le futur plan de relance européen qui devrait faire de la rénovation énergétique l'une de ses priorités.
LES PRÉCONISATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL
LE PLAN DE DÉCONFINEMENT
DES
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Ce plan, valable de la période allant du 11 mai jusqu'à fin juillet, contient les recommandations suivantes :
- Le travail à distance doit être poursuivi autant que possible ;
- Les enseignements en présentiel à destination des étudiants ne pourront reprendre avant la rentrée universitaire 2020 ;
- Des modalités d'enseignement en présentiel peuvent être aménagées dans le seul cadre de la formation professionnelle et dans le respect des consignes sanitaires ;
- L'organisation des examens et des concours peuvent faire l'objet d'adaptations dans le cadre précédemment fixé par le ministère ;
- L'exercice d'activités administratives ou de recherche en présentiel est possible dans le respect des consignes sanitaires ;
- Les activités de services aux étudiants ou aux agents (par exemple, certains services assurés par les bibliothèques universitaires) peuvent rouvrir partiellement.
Il liste également l'ensemble des consignes sanitaires à appliquer dans les locaux accueillant personnels et usagers : respect des gestes barrières, opérations de nettoyage et de désinfection, fourniture de produits d'hygiène, ventilation des locaux, attitude à adopter en cas de suspicion d'infection, etc.
V. ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Le groupe de travail « Enseignement agricole » de la commission de la culture animé par Antoine Karam (Guyane, apparenté LREM) est composé d'Annick Billon (Vendée, UC), Maryvonne Blondin (Finistère, socialiste et républicain) et Michel Savin (Isère, LR).
Afin de suivre les conséquences de la crise de Covid-19 sur l'ensemble des secteurs relevant de la compétence de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, son Bureau a décidé le mardi 14 avril de créer 12 groupes de travail transpartisans et animés par le rapporteur pour avis des crédits en charge du secteur.
Dans ce cadre, le groupe de travail « Enseignement agricole » a auditionné les principaux acteurs de cette voie de formation : représentants de syndicats enseignants agricoles, du conseil national de l'enseignement agricole privé, de l'union nationale des maisons familiales rurales (MFR), de fédération de parents d'élèves scolarisés dans l'enseignement agricole. Il a également eu un échange avec Didier Guillaume, ministre de l'agriculture et de l'alimentation, dans le cadre de son audition par la commission de la culture le 7 mai dernier.
Il ressort de ces auditions 10 préconisations .
A. ÉTAT DES LIEUX DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
1. L'enseignement agricole fortement touché par la crise de Covid-19 en raison de ses spécificités
a) La spécificité des enseignements
L'enseignement agricole se caractérise par de nombreux cours « d'atelier » rendant difficile un enseignement à distance : les exemples sont multiples, mais on peut penser à des formations de la filière forêt-bois, l'élevage, les activités hippiques ou encore l'aménagement paysager.
Le groupe de travail souhaite rendre hommage à l'ensemble de la communauté éducative qui a su se mobiliser pour trouver des façons innovantes de poursuivre les apprentissages. Tel est le cas de cet enseignant de la filière cuisine-restauration qui proposait des cours en direct à ses élèves, de sa cuisine sur les différentes techniques culinaires. Toutefois, malgré cet investissement remarquable, les acquisitions pédagogiques en ont souffert .
b) Le rôle prépondérant des stages dans la pédagogie
L'enseignement agricole se distingue par la part importante jouée par les stages en entreprise. Si le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, en lien avec le ministère de l'éducation nationale et le ministère de l'enseignement supérieur, a rapidement précisé qu'aucun élève ne pourra être empêché de se présenter aux examens au motif qu'il n'a pas complété l'ensemble de ses périodes de stage pour cause de confinement, il n'en demeure pas moins que ce temps passé en entreprise représente un moment important de la formation, permettant de se familiariser aux pratiques professionnelles et participe fortement à l'employabilité de l'apprenant .
Dans la filière des services aux personnes, de nombreux élèves devaient effectuer leurs stages dans des EPHAD. Or les conditions sanitaires strictes applicables dans ces établissements les ont rendus impossibles. De même, pour la filière agro-alimentaire, alors que le ministre de l'agriculture a fait un appel aux volontaires pour participer aux travaux agricoles, les stages des élèves ont été annulés.
2. Une forte mobilisation des « trois familles de l'enseignement agricole » pour assurer la continuité pédagogique des élèves
À l'annonce de la fermeture des établissements d'enseignement, les « trois familles de l'enseignement agricole » - enseignement agricole public, enseignement agricole privé sous contrat et maisons familiales rurales (MFR) - se sont mobilisées afin d'assurer la continuité pédagogique des enseignements.
En outre, l'enseignement agricole s'est greffé sur le service Docaposte mis en place par la Poste, permettant aux enseignants d'envoyer par courrier leurs cours aux élèves et à ceux-ci de retourner gratuitement leurs devoirs. Certains établissements ont accompagné cet envoi d'un appel téléphonique, afin de s'assurer de la bonne compréhension du cours et fournir des informations complémentaires.
a) Enseignement agricole public
AgroSup Dijon, institut d'appui à l'enseignement technique agricole - et éditeur des ouvrages « Educagri », a mis à disposition des enseignants, élèves et étudiants les versions numériques des ouvrages. Au final, près de 75 % des manuels utilisés au lycée étaient disponibles en ligne.
Par ailleurs, au 24 mars, soit moins de 15 jours après la fermeture des établissements d'enseignement, quelque 12 700 enseignants avaient créé des classes virtuelles sur les 15 000 enseignants exerçant dans les lycées agricoles publics, soit près de 85 % - au rythme accéléré d'environ un millier créées chaque jour.
b) Enseignement agricole privé
En ce qui concerne l'enseignement agricole privé, ce dernier a pu s'appuyer sur son centre de formation continue, qui proposait déjà avant la crise de Covid-19 des formations en ligne. Il a ainsi été mis à contribution pour mettre en relation des enseignants et des intervenants avec des groupes de jeunes, qu'il s'agisse ou non de leurs classes. En outre, la quasi-totalité des établissements agricoles ont mis en place, seuls ou dans le cadre d'un collectif territorial, une plateforme numérique.
c) Maisons familiales rurales
Le réseau des maisons familiales rurales s'est également fortement mobilisé pour accompagner leurs élèves pendant toute cette période. Le nombre d'espaces numériques de travail a augmenté de façon exponentielle, passant de 1 000 comptes ouverts avant la crise à plus de 15 000 comptes.
d) Malgré un investissement de la communauté éducative, un décrochage de certains élèves
Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation estime à 5 % le nombre de décrocheurs pendant la période de confinement, c'est-à-dire d'élèves, dont les établissements d'enseignement agricole sont sans nouvelles .
Toutefois, un certain nombre d'élèves « non-décrocheurs » - pour reprendre la terminologie - ministérielle ont connu des difficultés pour suivre un enseignement régulier à distance, pour diverses raisons, notamment matériels et d'infrastructures. Comme l'a rappelé le secrétaire général du CNÉAP, 40 % des élèves accueillis dans les établissements de son réseau sont boursiers, avec les difficultés socio-économiques que cela implique.
Pour sa part, le SNETAP-FSU estime à 25 % le nombre d'élèves désengagés de leur scolarité (manque d'assiduité aux cours ou dans la remise des devoirs notamment).
3. Préparer la reprise des cours avant les vacances d'été
L'ensemble des personnes auditionnées, ainsi que le ministre ont exprimé le souhait d'une réouverture des établissements d'enseignement avant les vacances d'été : « le retour des élèves doit être l'occasion de les remotiver, de faire le point individuellement avec eux sur les problèmes rencontrés dans leurs familles mais aussi en entreprise [pour les apprentis qui sont restés en entreprise] », ou encore « nous n'imaginons pas terminer l'année scolaire sans revoir nos élèves » .
Lors de ses auditions, le groupe de travail a noté un certain nombre de critiques, regrettant que les décisions affectant l'éducation nationale s'appliquent de manière « unilatérale » à l'enseignement agricole. Tel a été le cas des annonces du ministre de l'éducation nationale le 3 avril dernier sur les conditions de passation du baccalauréat 2020.
Le groupe de travail appelle le ministère a précisé rapidement les conditions de réouverture des établissements d'enseignement agricoles - ceci après une concertation avec l'ensemble des acteurs.
Or, si elle semble s'être renforcée au niveau national depuis début mai - le ministre ayant indiqué une forte concertation notamment via les réunions du CHSCTM, du CHSCT et du CTM -, le groupe de travail a noté des difficultés de concertation et d'information au niveau local .
Plusieurs personnes auditionnées regrettent des contacts parfois difficiles avec les DRAAF (direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt). Certaines DRAAF ont diffusé des informations en cours de validation par les ministères entraînant ainsi de nombreuses questions sur le terrain.
Lors de son audition le 7 mai dernier, Didier Guillaume a indiqué que « le déconfinement ne sera réussi que s'il est progressif, à l'inverse du confinement qui a été brutal » . Le groupe de travail partage cette analyse tout en précisant, qu'il doit se faire au niveau local en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés : DRAAF, chefs d'établissements, enseignants et intervenants, parents d'élèves. À titre d'exemple, la situation est très différente entre une MFR accueillant simultanément en moyenne des groupes de 15 à 25 élèves et un établissement agricole de grande taille.
Cette reprise des cours nécessite également de travailler avec les représentants d'associations d'élus locaux sur les questions liées aux transports scolaires, à l'internat et à la restauration collective . L'enseignement agricole se distingue par un bassin de recrutement de ses élèves étendu. Le représentant de la PEEP Agri a indiqué au groupe de travail que certains élèves habitent à plus de 150 km de leurs établissements. Les problématiques des transports scolaires, d'internats - 50 % des apprenants sont internes, cette proportion pouvant atteindre 80 % dans certains établissements, contre une moyenne de 10 % d'internes dans l'éducation nationale - et de restauration collective - avec trois repas par jour à organiser - sont essentielles. Rouvrir les établissements sans internat, ni cantine n'a aucun sens.
Enfin, le groupe de travail salue la volonté du ministère de l'agriculture et de l'alimentation de disposer d' une circulaire propre à l'enseignement agricole sur la réouverture des établissements. Comme l'a souligné Didier Guillaume lors de son audition le 7 mai dernier, « mettre en place nos propres directives, circulaires et guides de bonnes pratiques » permet d'être « agiles, mobiles et réactifs » .
Préconisations :
- Prévoir la réouverture des établissements d'enseignement en concertation avec l'ensemble des acteurs locaux
- Travailler avec les représentants des associations d'élus sur les questions liées aux transports scolaires, internats et restauration collective
4. Apporter un soutien scolaire et permettre un renforcement des apprentissages
Afin d'apporter un soutien scolaire aux apprenants de l'enseignement agricole pendant les vacances d'été, le groupe de travail propose la mise en place du dispositif « école ouverte » dans les établissements concernés , tenant compte à la fois des matières spécifiques enseignées, mais également des contraintes inhérentes au bassin de recrutement de l'enseignement agricole (internat).
En outre, le ministère de l'éducation nationale a annoncé la mise en place d'un dispositif « école ouverte », renforcé pour cet été tant sur le nombre d'élèves accueillis que de niveaux de classe concernés. Le groupe de travail appelle à la mise en place rapide d'une réflexion visant à permettre d'accueillir des élèves de l'enseignement agricole dans des établissements de l'éducation nationale proches de chez eux, pour qu'ils puissent bénéficier d'un soutien scolaire dans les matières communes avec l'éducation nationale (mathématiques, français, physique-chimie, langues vivantes, ...).
Par ailleurs, il lui semble également nécessaire de revoir le schéma prévisionnel d'emplois pluriannuel. Celui-ci prévoit, sur la période 2019-2022 la suppression de 300 ETP, avec une accélération sur les années 2021 et 2022.
|
Année |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Suppression d'ETP |
- 50 |
- 60 |
- 80 |
- 70 |
Or, ces diminutions ont des effets immédiats sur l'enseignement délivré, d'autant plus que les effectifs ont connu à la rentrée 2019 une augmentation, après plus de 10 années d'érosion. Le gel des suppressions d'ETP prévues en 2021 permettrait de maintenir un encadrement des élèves en petits groupes, plus propices au soutien scolaire et à l'individualisation des besoins de chacun d'entre eux.
Préconisations :
- Réfléchir à un dispositif « école ouverte » mutualisé, notamment pour les matières communes entre l'enseignement agricole et éducation nationale, afin de permettre aux élèves de l'enseignement agricole domiciliés loin de leurs établissements de pouvoir disposer d'un soutien scolaire pendant les vacances d'été
- Revoir le schéma prévisionnel d'emploi pour mettre fin à la baisse du nombre d'ETP, afin de permettre un accompagnement des élèves en petits groupes
B. AGIR POUR ÉCLAIRCIR L'AVENIR DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE ASSOMBRI PAR LA CRISE DE COVID-19
1. Une crise aux conséquences financières lourdes qui appellent un soutien fort de l'État
La crise de Covid-19 a eu des conséquences financières importantes sur l'enseignement agricole. Le ministère estime ainsi à une centaine de millions d'euros les pertes financières pour l'ensemble de l'enseignement agricole. Pour sa part, le CNÉAP chiffre sa perte financière du début du confinement à fin mai entre 20 et 22 millions d'euros.
Les raisons de ces pertes financières sont plurielles :
- un remboursement aux familles de l'internat et de la restauration collective, alors même que certaines sociétés de restauration continuent à facturer les prestations ou certaines charges ;
- une fermeture des activités annexes des établissements : fermeture des crèches annexées aux lycées, des magasins de proximité, des cuisines centrales délivrant des repas à d'autres structures et des plateaux techniques loués à des producteurs locaux. Ces activités font partie intégrante des cinq missions que l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime donne aux établissements agricoles : l'animation et le développement des territoires, les activités de développement, d'expérimentation et d'innovation agricoles et agroalimentaires ;
- un soutien aux personnels sous contrat qui ne peuvent pas bénéficier du chômage partiel. Selon Didier Guillaume, le ministère a fait en sorte de n'arrêter aucun contrat. Pour leur part, les lycées agricoles privés sous contrat ont indiqué avoir maintenu le paiement des salaires de leurs personnels sans recours à l'activité partielle ni aux aides proposées par l'État.
Or, avant même la crise de Covid-19, la situation financière de plusieurs EPLEFPA (établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole) était sous surveillance, malgré une amélioration générale ces dernières années : 45 % d'entre eux étaient dans une situation financière difficile ou préoccupante en 2017.
Source : Note de service DGER/SDEDC/2018-298 du 17 avril 2018
La santé financière des établissements d'enseignement participe à l'attrait de cet enseignement envers les apprenants et leurs familles. En effet, comment attirer de nouveaux élèves ou étudiants si les exploitations agricoles liées aux établissements sont en difficulté financière ?
Par ailleurs, le groupe de travail souhaite souligner le rôle important des EPLEFPA dans l'animation des territoires : il s'agit d'ailleurs d'une des missions qui leur est confiée par l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime.
En outre, le groupe de travail rappelle que le ministre a annoncé en juillet 2019 un plan de requalification sur trois ans, pour 1 400 agents de catégorie 3 et la revalorisation des salaires des enseignants des établissements privés sous contrat pour les aligner sur les agents contractuels des établissements d'enseignement à gestion nationale. Ce plan participe à la nouvelle dynamique que le ministère souhaite donner à l'enseignement agricole : certains établissements éprouvent des difficultés pour recruter de nouveaux professeurs. Dans ces conditions, il est difficile de promouvoir une image valorisante de l'enseignement agricole auprès des élèves et de leurs familles. Dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, un montant supplémentaire de 2,13 millions d'euros a été alloué pour financer le plan de requalification et de revalorisation. Toutefois, les mesures d'application de ce dispositif n'ont pas encore été prises. Le groupe de travail appelle à un déblocage rapide de la situation.
Préconisations :
- Mettre en place un plan d'aide économique aux exploitations et établissements d'enseignement agricole pour les aider à faire face aux conséquences de la crise de Covid-19
- Prendre les mesures d'application du plan de requalification et de revalorisation salariale pour les agents contractuels et les enseignants de catégorie 3 de l'enseignement agricole privé sous contrat
2. Répondre aux nombreuses incertitudes qui pèsent sur la rentrée
a) Comment concilier distanciation physique et internat ?
50 % des apprenants de l'enseignement agricole sont internes. Dans le cadre de la reprise des cours, le protocole sanitaire diminue fortement le nombre d'internes pouvant être accueillis. En effet, comment gérer distanciation de 4 m² et accueil de 2 à 4 jeunes par chambre ? Actuellement, les établissements ne savent pas s'ils doivent accepter le même nombre d'inscriptions en internat ou un nombre plus faible. Or, pour nombre d'entre eux, l'internat fait partie à part entière du projet pédagogique . Lors de son audition, le ministre a présenté une position claire : « s'il nous faut diviser par deux, voire par trois, le nombre de lits, il faudra trouver d'autres modalités pour nos internes. En revanche, je tiens à le souligner : pour la rentrée 2020-2021, nous inscrivons tout le monde ». Toutefois, cette incertitude peut peser sur les familles et les élèves qui décident au final de s'orienter vers d'autres voies professionnelles. De même, en raison des nombreuses interrogations sur la circulation du virus et les conséquences de la vie en internat, certaines familles peuvent songer à désinscrire leurs enfants (ou ne pas les inscrire) pour se tourner vers des systèmes de formation différents.
Comme l'a indiqué une personne auditionnée, « il est important de rassurer les élèves et de leur rappeler qu'il n'est pas forcément dangereux de vivre ensemble ».
b) Des difficultés pour trouver un stage ou un apprentissage dans un contexte de crise économique ?
La crise de Covid-19 risque d'avoir des répercussions économiques importantes, notamment sur les petites entreprises. Or, ce sont souvent celles-ci, sur les territoires, qui accueillent des apprenants en stage ou en apprentissage. Si pour le moment, le ministère n'a pas constaté de baisse du nombre de stages, il est conscient que certaines entreprises prendront moins de stagiaires.
Dans ces conditions, le groupe de travail appelle à un assouplissement des conditions d'accès au statut scolaire alternant. Celui-ci présente l'avantage de permettre à un jeune qui n'a pas encore trouvé un contrat d'apprentissage de pouvoir quand même s'inscrire dans une formation, et commencer son année scolaire par des cours, dans l'attente de la signature de son contrat d'apprentissage. De telles formations sont déjà proposées par les MFR, avec un changement du statut de l'apprenant à partir du moment où ce dernier débute son apprentissage. Toutefois, le directeur et le président de l'union nationale des MFR ont indiqué que s'ils ont la possibilité de recourir au statut de scolaire alternant pour les formations de l'enseignement agricole, tel n'est pas le cas pour les élèves accueillis par les MFR dans le cadre des formations de l'éducation nationale.
c) Renforcer les liens entre les enseignements et les filières professionnelles
De nombreux élèves n'ont pas pu effectuer leurs périodes de formation en milieu professionnel, qui sont une partie intégrante du cursus scolaire : ainsi pour le bac professionnel agricole, les élèves doivent passer entre 18 et 22 semaines en formation en milieu professionnel. De même, certains élèves en formation certifiante n'ont pas pu passer leur contrôle en cours de formation (CCF). Lors de son audition, Didier Guillaume a indiqué que le ministère travaillait en lien avec les filières professionnelles pour que toutes les formations initiales et continues soient en adéquation avec les besoins des entreprises.
Le groupe de travail souhaite qu'une réflexion soit menée, en lien avec les chambres d'agriculture et les chambres de commerce et d'industrie, ainsi que les associations professionnelles, pour mobiliser de « jeunes professionnels » qui sont installés il y a peu, afin qu'ils puissent transmettre leurs compétences aux élèves à travers un retour d'expérience.
Préconisations :
- Rassurer les élèves, et leurs familles, quant à la préparation de la prochaine rentrée (obtention du diplôme en cours, organisation des concours, conditions d'accueil dans les établissements d'enseignement)
- Assouplir dès maintenant les conditions d'accès au statut scolaire alternant
- Organiser une large concertation avec les représentants professionnels pour préparer la prochaine rentrée
3. Relancer l'attractivité de la filière pour éviter une nouvelle diminution des effectifs
Après 10 ans d'érosion, les effectifs des apprenants ont connu une légère augmentation à la rentrée 2019. La campagne de promotion de l'enseignement agricole, « l'aventure du vivant » lancée à l'occasion du salon international de l'agriculture en février 2019, et la volonté des ministères de l'éducation nationale, et de l'agriculture et de l'alimentation de renforcer l'information et l'orientation vers l'enseignement agricole ont permis non seulement de stopper l'hémorragie affectant l'enseignement agricole moins - 3 000 élèves en septembre 2018 par rapport à la rentrée 2017 -, mais ont même suscité un rebond des inscriptions : + 3 000 élèves à la rentrée 2019 .
Or, cette dynamique risque d'être cassée par la crise de Covid-19. En effet, de nombreuses journées portes ouvertes prévues au printemps n'ont pas pu se tenir, même si les établissements ont fait preuve d'innovation pour informer les élèves et leurs familles, par des journées portes ouvertes virtuelles. D'autres ont mis en place des permanences téléphoniques et s'engagent à répondre rapidement aux questions posées.
De plus, l'enseignement agricole risque de souffrir du manque de conseil, d'information et d'orientation qui se font traditionnellement lors des conseils de classe des deuxième et troisième trimestres .
D'ailleurs, le conseil national de l'enseignement privé agricole estime une baisse potentielle de ses effectifs d'environ 15 % avec de très grande disparité entre les établissements, les régions ou les filières.
Or, l'enseignement agricole reste mal connu et beaucoup de familles et d'élèves ignorent qu'à peine un tiers des élèves inscrits dans les lycées agricoles se destine à des métiers en lien avec le secteur de l'agriculture. D'ailleurs, le groupe de travail regrette l'absence de mention de cette voie de formation - ou alors de manière trop succincte - dans les discours publics au cours de cette crise de Covid-19. Il pense notamment au discours du Président de la République ou du Premier ministre concernant le confinement puis la réouverture progressive des établissements d'enseignement, ou encore les annonces concernant les sessions du bac et des examens 2020.
Le groupe de travail appelle le gouvernement à lancer très rapidement une large campagne d'information et de communication en faveur de l'enseignement agricole.
Préconisation : relancer fortement l'information et la communication sur l'enseignement agricole
LES 10 PRÉCONISATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL « ENSEIGNEMENT AGRICOLE »
1. Prévoir la réouverture des établissements d'enseignement en concertation avec l'ensemble des acteurs locaux
2. Travailler avec les représentants des associations d'élus sur les questions liées aux transports scolaires, internats et restauration collective
3. Réfléchir à un dispositif « école ouverte » mutualisé, notamment pour les matières communes entre l'enseignement agricole et l'éducation nationale, afin de permettre aux élèves de l'enseignement agricole domiciliés loin de leurs établissements de pouvoir disposer d'un soutien scolaire pendant les vacances d'été
4. Revoir le schéma prévisionnel d'emploi pour mettre fin à la baisse du nombre d'ETP, afin de permettre un accompagnement des élèves en petits groupes
5. Mettre en place un plan d'aide économique aux exploitations et établissements d'enseignement agricole pour les aider à faire face aux conséquences de la crise de Covid-19
6. Prendre les décrets d'application du plan de requalification et de revalorisation salariale pour les agents contractuels et les enseignants de catégorie 3 de l'enseignement agricole privé sous contrat
7. Organiser une large concertation avec les représentants professionnels pour préparer la prochaine rentrée
8. Rassurer les élèves, et leurs familles, quant à la préparation de la prochaine rentrée (obtention du diplôme en cours, organisation des concours, conditions d'accueil dans les établissements d'enseignement)
9. Assouplir dès maintenant les conditions d'accès au statut scolaire alternant
10. Relancer fortement l'information et la communication sur l'enseignement agricole
VI. ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L'ÉTRANGER
Le groupe de travail « Action culturelle extérieure de l'État » de la commission de la culture animé par Claude Kern (Bas-Rhin, UC) est composé de Claudine Lepage (Français établis hors de France, socialiste et républicain) et Damien Regnard (Français établis hors de France, LR).
Le groupe de travail « Action culturelle extérieure » a été mis en place à l'initiative du bureau de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat le mardi 14 avril 2020, dans l'objectif de suivre la gestion de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 pour le secteur de l'action culturelle extérieure de l'État.
Ce groupe de travail a auditionné le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), la directrice de la culture, de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'Europe et des affaires étrangères, le président de la Fédération des associations de parents d'élèves des établissements d'enseignement français à l'étranger (Fapée), le directeur général de la Mission laïque française (MLF), une représentante du collectif « Avenir des lycées français du monde », et les représentants des syndicats d'enseignants et de personnels administratifs exerçant à l'étranger 5 ( * ) . Les conséquences de la crise pour les établissements du réseau de l'enseignement français à l'étranger et pour les familles qui y ont scolarisé leurs enfants ont constitué le fil conducteur de ces auditions. C'est donc sur ce sujet que le groupe de travail s'est attaché à dresser un constat et à formuler des recommandations.
A. LE RÉSEAU DE L'ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L'ÉTRANGER CONFRONTÉ À LA PLUS GRAVE CRISE DE SON HISTOIRE
1. La fermeture progressive de la quasi-totalité des établissements et la mise en place de la continuité pédagogique
Certains établissements d'enseignement français d'Asie, en Chine principalement, ont été les premiers, dès le mois de février, à être frappés par la crise liée à l'épidémie de Covid-19 et à être contraints de fermer. Au fur et à mesure de la progression du virus sur les autres continents, d'autres fermetures d'établissements ont été décidées par les ambassadeurs, en lien avec les autorités locales. Au pic de la crise sanitaire, courant avril, 99 % des 522 établissements que compte le réseau dans 139 pays avaient fermé leurs portes .
L'AEFE, l'opérateur de l'État en charge du fonctionnement de l'ensemble du réseau, s'est attaché immédiatement à mettre en place un dispositif de continuité pédagogique pour pallier la fermeture physique des établissements. Dès le 4 février, avec le soutien du Centre national d'enseignement à distance (Cned), les équipes de direction et les enseignants des lycées fermés en Asie ont développé, grâce à des supports informatiques, des modules pédagogiques pour permettre, autant que possible, aux élèves de continuer de travailler à distance. Ce dispositif, au départ expérimental, a ensuite été étendu aux autres établissements au fur et à mesure de leur fermeture respective. Toutes les équipes de direction des 522 établissements ont été destinataires d'un protocole pour le mettre en oeuvre.
La fin des cours en présentiel a marqué un véritable changement de logique pédagogique qui a obligé à mettre en place et à développer rapidement des outils d'enseignement et d'accompagnement en ligne. Ce défi s'est traduit par une mobilisation sans précédent des équipes de l'AEFE - inspecteurs, conseillers pédagogiques, enseignants formateurs - que le groupe de travail tient à saluer . Celles-ci ont élaboré un vade-mecum , constitué de fiches thématiques, pour aider les équipes de direction et les enseignants du réseau. Régulièrement actualisé, ce recueil en est aujourd'hui à sa quatrième version. 30 000 actions de soutien individuelles ou collectives ont également été menées par les enseignants formateurs pour améliorer l'offre éducative à distance.
La fermeture généralisée de tous les établissements et la mise en place de la continuité pédagogique ont également fait partie des premières mesures prises par la Mission laïque française (MLF) qui gère en propre 33 établissements et qui constitue, à ce titre, l'un des principaux opérateurs de l'enseignement français à l'étranger après l'AEFE.
2. Une continuité pédagogique diversement perçue par les parents d'élèves
Alors que 350 000 élèves parmi les 365 000 que compte le réseau ont bénéficié ou bénéficient encore d'une continuité pédagogique, la qualité de celle-ci est diversement appréciée par les parents .
Globalement, les efforts déployés par les équipes administratives et enseignantes, ainsi que la qualité de l'offre sont reconnus. Mais les appréciations sont très différentes d'une zone géographique à l'autre, d'un établissement à l'autre . Ainsi, au lycée français de Bruxelles, le taux de satisfaction atteint 70 %, alors qu'il est beaucoup plus bas en Espagne, au Maroc, en Tunisie ou au Vietnam, notamment chez les familles allophones.
Des auditions menées par le groupe de travail, il ressort que ce n'est pas tant le contenu de la nouvelle offre pédagogique qui est contesté, que le retour sur investissement . Certains parents considèrent en effet qu'ils n'en ont pas pour leur argent avec l'enseignement distanciel par rapport à l'enseignement présentiel. Ce sentiment de frustration est particulièrement perceptible chez les parents d'enfants scolarisés en maternelle, pour lesquels le suivi de la scolarité à la maison est souvent compliqué à mettre en oeuvre, ainsi que l'ont indiqué la déléguée du SNUIPP-FSU et le directeur de la MLF.
Les représentants des syndicats d'enseignants et de personnels administratifs ont également tous déploré les excès de certaines associations de parents d'élèves et de certains commentaires sur les réseaux sociaux. Localement, les tensions ont parfois été vives entre les différentes parties.
Comme l'a précisé la Fapée, cette dégradation du climat social s'explique aussi par le fait que cette situation, au départ temporaire, s'inscrit dans la durée. Les familles, au premier rang desquelles les familles allophones, ne sont pas armées pour accompagner, sur plusieurs mois, leurs enfants dans un apprentissage à distance.
3. La remise en cause des frais de scolarité dans un contexte de crise économique et sociale dans la plupart des pays
De nombreuses familles sont touchées de plein fouet par les conséquences économiques de la crise sanitaire . Certaines enregistrent une importante baisse de leurs revenus, tandis que d'autres sont confrontées à la perte de leur(s) emploi(s). La situation est particulièrement préoccupante dans les pays touristiques, où beaucoup de parents travaillent dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du voyage.
L'impossibilité pour ces familles d'assurer le paiement des frais de scolarité du troisième trimestre, doublée du sentiment que ces frais sont disproportionnés par rapport au service rendu à distance par les enseignants, a fait naître un mouvement de contestation, à coups de pétitions et de courriers, très actif dans certaines zones .
Face à cette « grogne grandissante » selon les termes de certaines associations de parents d'élèves, des établissements dotés d'une trésorerie suffisante ont décidé de mettre en place des mesures pour aider les familles les plus en difficulté (échelonnement des paiements, remise sur les frais de scolarité du troisième trimestre, attribution de bourses exceptionnelles, mobilisation de fonds de solidarité...).
De son côté, l'AEFE a adopté une position très ferme à l'égard des velléités de non-paiement ou de réduction des frais de scolarité . Comme l'a expliqué son directeur au groupe de travail, la multiplication des « ristournes » provoquerait un effet boule de neige d'un établissement à l'autre et entraînerait le réseau sur une voie dangereuse. À terme, c'est l'ensemble de son fonctionnement qui s'en trouverait menacé , celui-ci reposant entre 60 à 70 % sur les droits d'écolage. Pour le seul troisième trimestre, les frais de scolarité représentent une rentrée financière de 650 millions d'euros, tous établissements confondus (établissements en gestion directe, établissements conventionnés et établissements partenaires).
Consciente de la gravité de la situation et de la détresse de certaines familles, l'Agence a néanmoins demandé aux établissements d'accompagner tous les appels de frais de scolarité pour le troisième trimestre d'une note invitant les parents connaissant des difficultés à prendre contact avec les équipes administratives, charge ensuite à elles de proposer des mesures de soutien.
Le groupe de travail comprend la position de l'AEFE dans la mesure où le paiement des frais de scolarité est indispensable au fonctionnement du réseau et à sa survie dans le contexte de crise sans précédent qu'il traverse. Il appelle toutefois à faire preuve de souplesse dans l'étude des situations individuelles qui peuvent justifier l'octroi de facilités particulières .
Pour sa part, la MLF a adopté un plan d'aide en trois volets afin de répondre aux préoccupations des parents et préserver l'avenir de ses établissements : un échelonnement exceptionnel de la créance du 3 ème trimestre, l'attribution d'aides aux familles les plus en difficulté, un gel des droits de scolarité pour l'année 2020-2021.
4. Des établissements menacés de grandes difficultés financières et d'une perte d'effectifs
Si, à court terme, la crise menace les familles, à moyen terme, ce sont les établissements qui risquent d'être touchés . Les premiers à être concernés seront les petites structures qui ne disposent pas des ressources de trésorerie suffisantes pour faire face à la dégradation de la situation économique et sociale.
Le directeur de l'AEFE a assuré au groupe de travail qu'à ce jour, aucun établissement n'était dans une situation critique , tout en a alertant sur le risque d'emballement d'une mécanique récessive . C'est pourquoi il y a, selon lui, urgence à aider les familles à payer les droits de scolarité pour éviter, à terme, de fragiliser financièrement les établissements.
Le groupe de travail se montre moins optimiste car il a eu connaissance d'établissements d'ores et déjà confrontés à une situation financière très critique , par exemple l'école de Cuenca en Équateur qui scolarise 450 élèves.
Un autre effet collatéral de la crise est le risque d'une diminution des inscriptions à la rentrée prochaine . Les familles en difficultés, qu'elles soient françaises ou issues du pays d'accueil ou de pays tiers, pourraient en effet se tourner vers des solutions moins coûteuses que l'enseignement français comme le système public local ou le Cned.
Tous les acteurs du secteur auditionnés par le groupe de travail ont alerté sur cette probable évolution des comportements, qui ne serait toutefois pas identique selon les pays et les établissements. Pour le directeur de l'AEFE, le risque est « certain, coûteux, mais pas mesurable à ce stade » , la période d'inscription étant en cours. Il a indiqué qu'une évaluation pourra être faite en juin en comparant le taux de renouvellement des inscriptions avec celui de l'année passée.
Si cette prévision d'une réduction des effectifs se concrétisait, elle aurait évidemment des conséquences financières très graves sur les établissements . Certains pourraient ne pas s'en remettre et fermer.
De premières et prudentes estimations de l'Agence font état, sur l'année 2020, d'une baisse des ressources propres de 48 millions d'euros - soit 12 % de la totalité des recettes d'une année « normale » - pour les établissements en gestion directe (EGD), d'environ 80 millions d'euros pour les établissements conventionnés et de 100 à 120 millions d'euros pour les établissements partenaires.
C'est dans ce contexte financier très tendu que l'AEFE prépare , en lien avec ses tutelles, un budget rectificatif pour tenter de dégager des marges de manoeuvre. Celui-ci devrait être présenté au mois de juin au conseil d'administration de l'Agence.
De son côté, la MLF évalue le coût de la crise pour les établissements qu'elles gèrent en pleine responsabilité entre 39,8 millions et 44,3 millions d'euros , cette prévision intégrant une perte d'effectifs de 10 %, le paiement d'indemnités de licenciement consécutif à la rupture de contrats de personnels, le gel des droits de scolarité en 2020-2021, et le financement des mesures de solidarité en direction des familles les plus précaires.
B. LES MESURES DE SOUTIEN ANNONCÉES PAR LE GOUVERNEMENT : UNE MÉTHODE CONTESTABLE, UN CONTENU ENCORE FLOU
1. Des annonces avant la mise au point d'un plan de soutien global au réseau : une stratégie de communication plus que d'action
Le 30 avril 2020, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, ont annoncé, par communiqué de presse, deux mesures de soutien aux familles et aux établissements du réseau :
• un aménagement, « estimé » 6 ( * ) à 50 millions d'euros, du dispositif des bourses scolaires permettant de tenir compte de la situation des parents d'élèves français en 2020, en particulier d'une éventuelle baisse de revenus consécutive à la crise ;
• une avance, « d'un ordre de grandeur estimé » 7 ( * ) à 100 millions d'euros, de l'Agence France Trésor à l'AEFE pour soutenir financièrement les établissements du réseau, quel que soit leur statut, afin qu'eux-mêmes puissent venir en aide aux familles, de toute nationalité, confrontées à des difficultés financières.
Les sommes débloquées seront, selon les termes mêmes du communiqué de presse des ministres, « réévaluées plus précisément en juin » .
Le groupe de travail s'étonne de cette méthode qui consiste à annoncer des mesures, sans avoir au préalable bâti un plan d'action dressant le constat exhaustif de la situation et apportant des solutions précises et chiffrées . Il est clair que ces annonces ont eu pour objectif de calmer les familles dont le mécontentement va grandissant.
Concomitamment à la présentation de ces mesures, un plan de sauvegarde du réseau a été annoncé et est actuellement en cours de préparation au ministère de l'Europe et des affaires étrangères.
Si le groupe de travail salue cette initiative, il estime qu'il aurait été préférable de travailler préalablement à son élaboration plutôt que de recourir à des effets d'annonce.
2. L'aménagement des bourses scolaires : un dispositif satisfaisant, mais un calibrage budgétaire à surveiller
Pour les familles françaises en difficulté, l'accès au dispositif des bourses est élargi pour qu'un plus grand nombre puisse en bénéficier .
Celles dont la situation financière s'est dégradée dans les trois derniers mois peuvent ainsi déposer un recours gracieux auprès du service social de leur poste consulaire jusqu'au 29 mai 2020. Ce dispositif concerne à la fois les familles déjà allocataires d'une bourse, qui souhaitent une révision de la quotité, et les familles non encore boursières, toutes pouvant faire valoir l'évolution de leurs revenus financiers en 2020. Lors d'une séance extraordinaire, qui s'est tenue le 22 mai dernier, le conseil d'administration de l'Agence a porté le montant maximal de de ces remises gracieuses à 15 000 euros par famille 8 ( * ) . Le groupe de travail approuve la généralisation de cette possibilité de recours qui avait initialement été mise en place en Chine et en Vietnam .
Le dispositif des bourses pour l'année 2020-2021 est également assoupli pour tenir compte de la situation financière rencontrée en 2020 par les familles. Le calendrier des commissions consulaires d'examen a été revu pour permettre un traitement des dossiers jusqu'au 30 mai prochain.
L'ensemble des personnes auditionnées par le groupe de travail ont fait part de leur satisfaction par rapport à ces mesures. Ce consensus mérite d'être souligné . La Fapée a toutefois fait remarquer qu'il ne faudrait pas que l'augmentation du nombre de boursiers se traduise par une moindre prise en charge des familles déjà allocataires de bourses.
Tout en saluant ce coup de pouce en direction des familles, le groupe de travail s'interroge sur le montant annoncé de 50 millions d'euros qui pourrait s'avérer sous-calibré par rapport aux besoins de court terme (3 ème trimestre de l'année 2019-2020) et de moyen terme (année scolaire 2020-2021). Il précise que cette somme ne représente que la moitié de l'enveloppe annuelle destinée aux bourses. Une réévaluation régulière des besoins s'avèrera, selon lui, nécessaire.
Le groupe de travail souhaite en tout cas que cet abondement initial de 50 millions d'euros soit inscrit au prochain projet de loi de finances rectificative.
3. L'avance de l'Agence France Trésor à l'AEFE : un soutien indispensable, mais un support financier pas acceptable en l'état
À son annonce, cette deuxième mesure a provoqué de nombreuses réactions d'étonnement, d'incompréhension, voire de colère. Le dispositif choisi laisse en effet penser que l'AEFE sera obligée de rembourser les sommes avancées par l'Agence France Trésor. Or, pour l'ensemble des acteurs du réseau, comme pour le groupe de travail, ce système de solidarité à crédit est inconcevable , surtout en regard de la crise qu'a vécue l'AEFE en 2017 à la suite d'une coupe budgétaire de 33 millions d'euros 9 ( * ) .
Devant la vague de critiques suscitée par cette annonce pour le moins déconcertante faute d'être étayée, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a annoncé aux parlementaires représentant les Français de l'étranger que l'avance de l'Agence France Trésor pourrait être transformée en subvention à l'AEFE lors d'un prochain projet de loi de finances rectificative . Cette information a été confirmée par le secrétaire d'État en séance publique au Sénat lors de l'examen de la proposition de loi relative aux Français établis hors de France.
Cependant, l'AEFE considère - selon les informations qu'elle a transmises au groupe de travail - qu'elle devra rembourser à l'Agence France Trésor les sommes avancées , dans un délai qui sera fixé dans une convention signée entre les deux institutions.
La transformation de l'avance en subvention n'est donc pas acquise à ce stade .
Or pour le groupe de travail, demander à l'AEFE de rembourser les sommes prêtées pourrait l'entraîner dans une spirale financière ingérable, dont elle pourrait ne pas se remettre.
Le soutien financier à l'opérateur de l'État doit impérativement se traduire par un abondement du montant de sa subvention pour charges de service public. Il veillera, en conséquence, à ce que le prochain projet de loi de finances rectificative comporte une disposition en ce sens. À défaut, il se réserve la possibilité de déposer un amendement lors de l'examen du texte au Sénat.
Le groupe de travail demande également que le dispositif de soutien aux établissements homologués, qui pourra prendre la forme d'une aide en trésorerie directe ou d'un délai de paiement des charges dues à l'Agence, soit assorti de deux garanties :
- premièrement, la définition et l'application de critères d'octroi très stricts ;
- deuxièmement, une conditionnalité de l'aide à une gestion transparente des fonds reçus et à un suivi de leur utilisation , dont les modalités devront être définies dans la convention que chaque établissement demandeur devra passer avec l'AEFE.
En outre, le groupe de travail estime que l'aide qui pourra être apportée, sur décision de commissions locales 10 ( * ) , aux familles étrangères dans le cadre de ce dispositif devra impérativement reposer sur des critères sociaux , comme c'est le cas actuellement pour l'attribution des bourses aux familles françaises. Il va de soi que toutes les familles étrangères ne sont pas affectées de la même manière par la crise actuelle.
Enfin, le groupe de travail demande une clarification sur l'intégration ou non des structures du réseau FLAM 11 ( * ) dans ce dispositif .
C. LES PROPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES DU GROUPE DE TRAVAIL EN VUE DU PLAN DE SOUTIEN AU RÉSEAU
Le réseau de l'enseignement français à l'étranger constitue un atout exceptionnel pour le rayonnement de la langue, de la culture et de la diplomatie d'influence française .
Face à l'ampleur de la crise qu'il traverse, le groupe de travail estime qu'il y a urgence à agir, en apportant une réponse d'ensemble, coordonnée, ambitieuse et dotée de moyens adaptés.
C'est pourquoi, en vue du plan de sauvegarde annoncé par le Gouvernement, et au-delà des remarques qu'il a formulées sur les deux mesures annoncées le 30 avril dernier, le groupe de travail souhaite mettre en avant plusieurs recommandations complémentaires .
1. Réguler le niveau des frais de scolarité
Si le mouvement de contestation des frais de scolarité de ces dernières semaines est d'abord lié à une conjoncture exceptionnelle, il révèle aussi un problème structurel, celui du niveau de ces frais .
Le constat est bien connu : les montants moyens des frais de scolarité dans le réseau français, s'ils demeurent deux à trois fois inférieurs à ceux des autres systèmes scolaires internationaux, ont sensiblement augmenté au cours des dernières années . Entre 2012 et 2019 , ils sont ainsi passés de 4 290 euros à 5 658 euros en moyenne, soit une hausse de 31,9 % . En détaillant par statut d'établissement, pour l'année 2019-2020, les frais de scolarité par élève se sont élevés à 12 ( * ) :
• 4 584 euros en moyenne dans les établissements en gestion directe ;
• 6 042 euros en moyenne dans les établissements conventionnés ;
• 5 852 euros en moyenne dans les établissements partenaires.
Cette augmentation masque toutefois de grandes disparités selon les zones géographiques, le statut des établissements, et même selon la nationalité des élèves . Si la scolarité est gratuité dans certains établissements, pour des raisons essentiellement historiques (en Allemagne, par exemple), les frais peuvent atteindre plusieurs milliers voire plusieurs dizaines de milliers d'euros dans d'autres. L'écart est ainsi flagrant entre le lycée français de Tananarive, où la scolarité est inférieure à 10 000 euros et le lycée français de New York, où la scolarité se chiffre à plus de 30 000 euros. De plus, les modalités de détermination des frais de scolarité varient selon le statut de l'établissement : pour les EGD, les frais de scolarité sont déterminés par le directeur de l'AEFE, sur proposition de l'établissement ; pour les établissements conventionnés et partenaires, les frais de scolarité sont librement fixés. Enfin, les frais de scolarité peuvent être modulés en fonction de la nationalité des élèves. Ainsi, hors de l'Union européenne, les élèves de nationalité française sont parfois bénéficiaires de tarifs plus favorables que les élèves de nationalité étrangère.
La hausse des frais de scolarité doit aussi être mise en regard de la baisse de la part des crédits publics , composés de la subvention pour charges de service public et de l'aide à la scolarité (bourses), dans les recettes de l'AEFE. Aujourd'hui, les frais de scolarité assurent entre 60 % et 70 % du financement de l'AEFE, contre 52 % en 2012.
L'alourdissement de la charge que représente le paiement des frais de scolarité pour les familles, dont le caractère inégalitaire vient aggraver leur mécontentement, ne peut perdurer.
L'AEFE n'est certes pas en mesure d'imposer une égalité générale et absolue des frais de scolarité dans les établissements : elle n'agit en effet directement que sur les seuls établissements en gestion directe et, pour ceux-ci, doit tenir compte de situations locales souvent très diverses ou de contraintes extérieures (pédagogie, accueil des élèves).
Mais le groupe de travail estime que, conformément à l'article L. 452-2 du code de l'éducation qui prévoit que l'Agence veille « à la stabilisation des frais de scolarité », il est aujourd'hui indispensable de contenir leur inflation en gelant, à son niveau actuel, la participation des familles au financement du réseau .
2. Décider d'un moratoire sur le plan de développement du réseau
Lors de la présentation du « Plan Langue française et Plurilinguisme », le 20 mars 2018, le Président de la République avait annoncé l'objectif du doublement des effectifs scolarisés dans le réseau de l'enseignement français à l'étranger d'ici 2030 . Ces effectifs devraient ainsi passer de 350 000 à 700 000 en douze ans.
Pour atteindre cet objectif, un « Plan de développement de l'enseignement français à l'étranger » a été lancé le 3 octobre 2019 par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Ce plan repose principalement sur l'augmentation du nombre d'établissements homologués, au moyen d'un assouplissement des critères d'homologation.
Alors que la question de la survie de certains établissements se pose, la commission interministérielle d'homologation continue à siéger et à délivrer l'homologation à de nouvelles structures, ce que le groupe de travail juge totalement aberrant dans le contexte actuel.
Maintenir le projet d'expansion du réseau est, selon lui, déraisonnable et contradictoire. L'heure est en effet à une totale mobilisation pour le sauver et le pérenniser coûte que coûte face à une crise dont les conséquences risquent de s'inscrire dans la durée. Le groupe de travail appelle donc à un moratoire sur le plan de développement du réseau.
Sa demande s'appuie en outre sur une grande réticence à l'égard de l'assouplissement des critères d'homologation . Le groupe de travail considère, au contraire, qu'il convient de les rendre plus stricts afin de préserver la qualité de l'enseignement dispensé et la viabilité des structures composant le réseau.
3. Renouveler la confiance dans l'AEFE, tout en l'encourageant à une gestion transparente et rigoureuse
En cette période très troublée pour le réseau, le groupe de travail estime important de réaffirmer la fonction de colonne vertébrale assuré par l'AEFE . L'Agence a su réagir rapidement et pragmatiquement à l'urgence de la situation en mettant en place une continuité pédagogique et en accompagnant les personnels des établissements dans la gestion de la crise. Plusieurs syndicats d'enseignants auditionnés ont d'ailleurs loué un « dialogue social fluide » avec l'opérateur et un véritable effort de concertation.
Alors que l'année 2020 marque le 30 ème anniversaire de l'AEFE, dont la célébration a été reportée en raison du contexte actuel, le plan de sauvegarde du réseau est l'occasion de réaffirmer la confiance et le soutien qui lui sont accordés . L'Agence joue en effet un rôle fondamental au service des Français de l'étranger comme pour l'influence de la France dans le monde.
En retour, elle doit s'attacher à une gestion transparente et rigoureuse de ses missions , comme l'y ont incité la Cour des comptes dans une publication de 2017 13 ( * ) et la commission des finances du Sénat dans un rapport d'information de 2018 14 ( * ) .
4. Prévoir une procédure de suivi et d'évaluation du plan
Le groupe de travail demande qu'à l'occasion du lancement du plan de sauvegarde, soit mise en place une procédure de suivi et d'évaluation des mesures qu'il contient. Il lui semble important que l'ensemble des parties prenantes à ce plan puissent régulièrement être tenues au courant de son avancée et proposer, si nécessaire, des ajustements.
VII. RECHERCHE
Le groupe de travail « Recherche » de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication animé par Laure Darcos (Essonne, LR) est composé de Catherine Morin-Desailly (Seine-Maritime, UC), Pierre Ouzoulias (Hauts-de-Seine, CRCE), Stéphane Piednoir (Maine-et-Loire, LR) et Sonia de la Provôté (Calvados, UC).
Le groupe de travail « Recherche » a été mis en place à l'initiative du bureau de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat le mardi 14 avril 2020, dans l'objectif de suivre la gestion de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 pour le secteur de la recherche.
Ce groupe de travail a successivement auditionné par visioconférence :
• Christophe d'Enfert , directeur scientifique de l'Institut Pasteur 15 ( * ) ;
• François Trottein , chercheur au Centre d'infection et d'immunité de Lille (CNRS/Inserm/Institut Pasteur de Lille/Université de Lille/CHU Lille), président de la section 27 « Relations hôte-pathogène, immunologie, inflammation » du Comité national de la recherche scientifique ;
• Gilles Bloch , président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) ;
• Pascale Cossart , microbiologiste, membre de l'Académie des sciences, coordinatrice de la cellule de crise de l'Académie ; Dominique Costagliola , épidémiologiste, membre de l'Académie des sciences, membre de la cellule de crise de l'Académie ; Félix Rey , membre de l'Académie des sciences, membre de la cellule de crise de l'Académie, coordinateur du programme Corona à l'Institut Pasteur ;
• Florence Ader , infectiologue au service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Croix-Rousse des Hospices civils de Lyon, chercheuse au Centre international de recherche en infectiologie (CIRI), et coordinatrice de l'essai européen Discovery ; Vittoria Colizza , directrice de recherche à l'Institut Pierre Louis d'épidémiologie et de santé publique (Inserm/Sorbonne Université), spécialiste en modélisation des maladies infectieuses.
Au cours de ses auditions, le groupe de travail a approfondi les grandes problématiques qui sont au coeur de l'actualité des travaux de recherche sur la Covid-19, parmi lesquelles les essais thérapeutiques, la recherche de vaccins, le recours aux tests de dépistage, la modélisation de la propagation de l'épidémie. Ce n'est toutefois pas sous l'angle scientifique et technologique que le groupe de travail a choisi d'en rendre compte, mais principalement sous l'angle de la gouvernance du système de recherche et de la coordination entre les différentes structures impliquées .
A. UNE MOBILISATION EXCEPTIONNELLE DE LA COMMUNAUTÉ DE RECHERCHE FRANÇAISE CONTRE LA COVID-19
Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, toute la recherche française, des sciences du vivant aux sciences humaines et sociales en passant par les mathématiques, est mobilisée pour contenir l'expansion du virus, tester des traitements, tenter de trouver un vaccin et évaluer l'incidence sociale de cette crise.
Cet engagement total traduit la volonté et la détermination des chercheurs de répondre, par la science, à ce qui constitue la plus grave pandémie de l'histoire récente.
1. L'Inserm à la pointe de la recherche biomédicale
Dès la propagation du nouveau coronavirus Sars-Cov-2, l'Inserm, en tant qu'acteur de premier plan de la recherche biomédicale en France et à l'étranger, s'est mis en ordre de marche. À ce jour, une soixantaine de projets Covid-19 mobilisent environ 700 collaborateurs de l'Inserm. Ces projets couvrent un champ disciplinaire très large : diagnostic, clinique, thérapeutique, épidémiologique, mesures de prévention et de contrôle de l'infection en milieu de soins, physiopathologie de la maladie, recherche fondamentale, sciences humaines et sociales, éthique.
Parmi ces travaux figurent plusieurs essais de grande ampleur tels que :
• l'essai européen Discovery qui intègre, en France, 750 patients hospitalisés pour une infection Covid-19 dans un service de médecine ou de réanimation. Comme l'a indiqué l'instigatrice de l'essai, le professeur Florence Ader , au groupe de travail, celui-ci consiste à étudier cinq modalités de traitement attribuées de façon randomisée - c'est-à-dire de façon aléatoire - aux patients participants. L'objectif est de tester l'efficacité de plusieurs molécules de repositionnement 16 ( * ) et le degré de tolérance des patients, dans l'attente de la mise au point de médicaments de deuxième génération spécifiquement ciblés sur le Sars-Cov-2. Cet essai se déroule dans le cadre d'un partenariat très étroit entre l'Inserm et le réseau hospitalier ;
• l'étude Corimuno-19 dont le but est de tester plusieurs traitements, notamment des traitements immunomodulateurs, et de déterminer lesquels présentent le rapport bénéfice/risque le plus favorable chez les patients adultes hospitalisés ;
• l'essai Coviplasm qui consiste en la transfusion de plasma de patients guéris de la Covid-19, contenant des anticorps dirigés contre le virus, et qui pourrait transférer cette immunité à des patients souffrants ;
• l'étude EpiCOV dont l'objectif est de fournir, d'une part, une cartographie précise du statut immunitaire de la population (santé, conditions de vie, inégalités sociales), d'autre part, un suivi de la dynamique épidémique à court, moyen et long terme. Cette étude, qui s'effectue auprès de 200 000 volontaires représentatifs de la population nationale, s'appuie fortement sur les collectivités territoriales.
Le groupe de travail tient également à mentionner les travaux de l'équipe de l'Inserm menée par Vittoria Colizza - avec laquelle il s'est entretenu - en matière de modélisation de l'épidémie. Cette équipe a publié depuis janvier dernier, plusieurs études destinées à orienter les politiques de prévention et à améliorer la surveillance épidémique : une première sur le risque d'importation du virus depuis la Chine jusqu'en Europe, une deuxième sur la capacité du continent africain à répondre à une éventuelle pandémie, une troisième sur les caractéristiques de transmission du virus à partir de 300 cas détectés. L'équipe s'est aussi attachée à analyser l'impact du confinement sur la mobilité des populations, à modéliser les scénarii possibles de déconfinement et à mesurer l'incidence de la réouverture des écoles sur la capacité d'admission des services de réanimation.
Au-delà de ces travaux de recherche, l'Inserm mène de nombreuses autres actions : coordination du consortium REACTing ( cf. infra ), soutien aux structures de soin, mise à la disposition de son expertise aux décideurs publics, production et diffusion de connaissances scientifiques.
2. L'Institut Pasteur sur plusieurs fronts, dont celui très attendu de la vaccinologie
Comme l'a rappelé le directeur scientifique de l'Institut Pasteur, Christophe d'Enfert , devant la commission, la lutte contre les maladies émergentes est l'une des missions historiques et fondamentales de l'Institut Pasteur. C'est pourquoi, dès la première alerte, fin 2019, de l'apparition d'un nouveau coronavirus, puis de façon croissante, l'Institut a mobilisé toutes ses expertises et ses ressources pour lutter contre ce virus émergent et ses conséquences. À ce jour, 21 programmes de recherche scientifique sont en cours de réalisation à l'Institut Pasteur, impliquant près de 300 personnes .
Dans le cadre de leur mission de santé publique et de surveillance des virus grippaux et respiratoires , les équipes du centre national de référence (CNR) et de la cellule d'intervention biologique d'urgence (CIBU) de l'Institut Pasteur ont été sollicitées dès le mois de janvier pour proposer un diagnostic moléculaire de ce nouveau coronavirus. Les équipes du CNR ont ensuite réussi à concevoir et à valider un test moléculaire spécifique du Sars-Cov-2. Dans le prolongement de ces premiers travaux, le CNR a préparé le matériel pour séquencer les souches virales en collaboration avec la plateforme de microbiologie mutualisée de l'Institut Pasteur. Le 29 janvier 2020, l'Institut Pasteur a annoncé et publié la séquence du génome du coronavirus Sars-Cov-2 présent en France, puis le 31 janvier, l'isolement de cette souche, une première en Europe .
Dans l'objectif de promouvoir et coordonner ses programmes de recherche sur la Covid-19, l'Institut Pasteur a constitué dans le courant du mois de janvier une Task Force réunissant un petit groupe multidisciplinaire de scientifiques et les responsables des services supports concernés. Cette Task Force pilote aujourd'hui les équipes de l'Institut autour de six orientations scientifiques : le développement de tests diagnostiques, la recherche épidémiologique, la modélisation de l'épidémie, la connaissance du virus et sa pathogénèse, la recherche d'anticorps à potentiel thérapeutique, la recherche et le développement de candidats vaccins .
C'est bien sûr sur ce dernier axe que l'Institut Pasteur, fort de son expertise historique en vaccinologie, est particulièrement attendu. Trois projets sont actuellement en cours : le premier repose sur l'utilisation du vaccin de la rougeole comme vecteur d'un nouveau candidat vaccin contre le Sars-Cov-2, le deuxième vise à développer un candidat vaccin basé sur des vecteurs vaccinaux lentiviraux 17 ( * ) , le troisième consiste à évaluer l'immunogénicité (c'est-à-dire la capacité à induire une réaction immunitaire spécifique) et l'efficacité de candidats vaccins à base d'ADN. Comme l'a indiqué Christophe d'Enfert à la commission, les procédures de recherche accélérées - rendues possibles par l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19 - permettent d'envisager « le démarrage des essais cliniques en juillet prochain pour obtenir des résultats cliniques dans le courant du premier semestre de 2021 » .
3. De nombreuses autres structures de recherche engagées
L'Inserm et l'Institut Pasteur ne sont bien sûr pas les seules instances de recherche engagées sur le front de la lutte contre la Covid-19. Beaucoup d'autres le sont également, parmi lesquelles le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) - dont la communication, selon le groupe de travail, aurait mérité d'être plus visible -, l'Institut Curie , l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria) , l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) , l'Institut national d'études démographiques (Ined) .
La très forte mobilisation des centres hospitaliers universitaires (CHU) mérite aussi d'être soulignée. Ainsi que l'a rappelé le professeur Florence Ader au groupe de travail, les CHU sont des partenaires indispensables à l'activité de recherche .
À l'ensemble de ces structures et de leurs personnels, le groupe de travail souhaite témoigner son admiration et sa reconnaissance.
B. LE MANQUE DE STRATÉGIE NATIONALE DE RECHERCHE SUR LA COVID-19 ET L'ABSENCE DE STRUCTURE DE PILOTAGE UNIQUE
Dès le début de la pandémie de Covid-19, la communauté scientifique s'est mobilisée dans l'urgence, mais aussi dans la confusion. Plusieurs gouvernances ont vu le jour, avec la création du Conseil scientifique et du Comité analyse, recherche et expertise (Care), de nombreux appels à projets ont été lancés, donnant lieu à un afflux de propositions, différents canaux de financement ont été utilisés, en particulier l'Agence nationale de la recherche (ANR) et REACTing , le tout créant un certain désordre, préjudiciable à l'efficience de l'ensemble du système de recherche .
Pour le groupe de travail, une profonde correction de cette situation s'impose par la mise en place d'une stratégie coordonnée au niveau national et pilotée par une structure unique .
1. Une gouvernance et une expertise scientifique éclatées
Plusieurs instances participent à la structuration de l'effort de recherche et à l'expertise scientifique sur le nouveau coronavirus, sans toutefois que la répartition des rôles entre elles n'ait été préalablement réfléchie et définie.
Les deux premières existaient avant la crise et se sont donc immédiatement mobilisées. Il s'agit de REACTing et de l' ANR .
- Le consortium multidisciplinaire et multi-institutionnel REACTing 18 ( * ) , lancé par l'Inserm en 2013 sous l'égide de l'Alliance pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan), constitue aujourd'hui la principale structure de coordination des travaux de recherche sur la Covid-19 .
Depuis le début de la crise sanitaire, REACTing , piloté par l'Inserm, mène plusieurs actions :
• partage d'informations sur le nouveau coronavirus entre les acteurs de la recherche ;
• facilitation de la recherche clinique en encourageant les bonnes pratiques et la standardisation de la collecte des données au niveau européen, notamment à travers la publication d'une charte éthique ;
• financement de 20 projets de recherche , à impact immédiat, pour un montant global engagé d'un million d'euros ;
• recensement des études en cours au niveau national ;
• mise en relation des équipes de recherche pour créer des complémentarités et éviter les redondances ;
• échanges avec les ministères de la recherche et de la santé, ainsi qu'avec le comité Care ;
• actions de communication auprès des pouvoirs publics et du grand public.
- Structure nationale de pilotage des appels à projets de recherche, l'ANR a lancé, le 6 mars 2020, un appel à projets Flash 19 ( * ) , doté d'un budget initial de 3 millions d'euros, pour soutenir rapidement les équipes scientifiques mobilisées sur la Covid-19. Ce dispositif accéléré et allégé des procédures a permis d'annoncer, le 25 mars, un premier financement pour le démarrage de 44 projets urgents , ciblés sur les quatre priorités identifiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 20 ( * ) .
Au terme de son processus d'évaluation, l'ANR a sélectionné, pour financement immédiat, 86 projets de recherche couvrant un grand nombre de problématiques liées à la crise, et dressé une liste complémentaire de 40 projets. Grâce au fonds d'urgence mobilisé par le ministère de la recherche 21 ( * ) et l'engagement de la Fondation pour la recherche médicale (FRM), le budget consacré à ces projets est passé de 3 millions à 14,5 millions d'euros . D'autres financeurs, dont certaines régions 22 ( * ) , ont manifesté leur souhait de s'associer en complémentarité et d'apporter leur soutien directement à des projets sélectionnés.
Dans la continuité de l'appel à projets Flash Covid-19, un nouvel appel à projets RA-Covid-19 a été lancé le 16 avril par l'ANR. Ouvert en continu jusqu'au 28 octobre 2020, il est dédié à des travaux de recherche de court terme (3 à 12 mois) portant sur cinq priorités 23 ( * ) .
L'activation de ces procédures exceptionnelles de sélection et de financement des projets de recherche a indéniablement permis une plus grande réactivité, ce que le groupe de travail tient à saluer .
Deux autres structures ont vu le jour pendant la crise : le Conseil scientifique et le Comité analyse, recherche et expertise . Présentées comme complémentaires, elles ont pour mission d'éclairer la prise de décision publique par l'expertise scientifique .
- Créé le 10 mars 2020 et composé de onze membres, le Conseil scientifique est chargé d'accompagner les réflexions des autorités publiques sur les questions stratégiques liées à la gestion de l'épidémie. Il peut être saisi de sujets relatifs à la politique de santé publique dans le contexte de la crise (effet attendu des mesures de confinement, stratégie de dépistage, etc.). Ses conclusions sont rendues publiques.
- Instauré le 24 mars 2020 et composé de douze membres, le Comité analyse, recherche et expertise - dit Care - conseille plus spécifiquement les pouvoirs publics sur les innovations scientifiques, thérapeutiques et technologiques proposées par la communauté scientifique pour lutter contre la Covid-19 (tests diagnostiques, traitements, futurs vaccins, apport du numérique et de l'intelligence artificielle, etc.).
Plusieurs autres instances participent à l'expertise scientifique en cette période de crise sanitaire : l'Académie nationale de médecine, l'Académie des sciences, les sociétés savantes, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP), la Haute Autorité de santé (HAS), l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
Si chacune de ces institutions a toute légitimité à s'exprimer, l'absence d'organisation et de coordination entre elles a pu donner lieu à des messages au mieux désordonnés, au pire contradictoires . Ce constat du groupe de travail est également partagé par l'Académie nationale de médecine, l'Académie nationale de pharmacie et l'Académie vétérinaire de France qui ont publié un communiqué de presse commun en ce sens le 6 mai dernier 24 ( * ) .
Lors de son audition, l'épidémiologiste et académicienne Dominique Costagliola a, pour sa part, indiqué que les fiches scientifiques préparées par la cellule de crise de l'Académie des sciences à destination de Care et du Conseil scientifique n'avaient donné lieu qu'à un simple accusé de réception.
2. L'absence de régulation et de pilotage des projets de recherche sur la Covid-19
Au fur et à mesure de la progression de l'épidémie de Covid-19, de nombreux appels à projets ont été lancés pour promouvoir dans l'urgence des recherches sur la maladie et pour mettre au point des moyens diagnostiques et thérapeutiques appropriés. La très grande réactivité des chercheurs s'est traduite par une multiplication des propositions . Rien que pour le premier appel Flash de l'ANR, 270 projets éligibles ont été déposés. Ces initiatives n'ont toutefois fait l'objet d'aucun encadrement.
Devant le groupe de travail, le président-directeur général de l'Inserm, Gilles Bloch, a ainsi convenu que le nombre d'essais cliniques en cours au niveau national (45 pour 2 000 patients) était sans doute trop élevé - conduisant à un nombre limité de patients par essai - et qu' il existait une marge de progression en matière de régulation . Il a dressé un constat analogue s'agissant de la trentaine de travaux de recherche français consacrés au développement de vaccins (sur une centaine comptabilisée au niveau mondial). Ce vivier mériterait, selon lui, d'être priorisé.
Le groupe de travail note également une dispersion des financements sur un grand nombre de projets, alors qu' il aurait été plus pertinent de consacrer des montants plus élevés sur des projets bien ciblés .
Pour structurer la dynamique de recherche en cours et éviter les doublons, certaines institutions ont créé en leur sein des équipes de coordination - c'est le cas notamment de l'IRS qui a instauré un comité scientifique ad hoc -, d'autres se sont mises autour de la table pour identifier des complémentarités - par exemple, le CNRS et l'Inserm qui ont créé un groupe de travail, associant également la Conférence des présidents d'université (CPU), l'Ined, l'Inrae et l'IRD. Des fondations comme la Fondation pour la recherche médicale ou la Fondation de France ont également décidé de ne pas lancer de nouveaux appels à projets , mais de soutenir ceux retenus dans le cadre de l'appel Flash Covid-19. Certains sites universitaires comme l'Université de Paris-Saclay ou l'Université de Paris ont aussi choisi d'apporter leur soutien aux projets sélectionnés dans le cadre de l'appel de l'ANR.
Le groupe de travail juge ces initiatives de mise en réseau et de ralliement très positives, mais il estime cet élan encore insuffisant et regrette qu'aucune coordination au niveau national n'ait été organisée en amont. Comme l'a résumé Dominique Costagliola lors de son audition, « il a manqué une instance de réflexion et de coordination unique ».
Le temps de la recherche étant un temps long, le groupe de travail pense qu'il est encore possible de redresser le tir et demande qu'une structure de pilotage unique coordonne la recherche sur la Covid-19. Celle-ci serait chargée de la programmation et du lancement des appels à projets - qui devront couvrir l'ensemble des aspects de la pandémie (épidémiologie, facteurs de risque, formes cliniques, prévention, mécanismes physiopathologiques, essais thérapeutiques, vaccins, tests diagnostiques, santé numérique, sciences humaines et sociales, économie de la santé, éthique, etc.) -, de l'évaluation des propositions reçues et de l'attribution des moyens spécifiquement dédiés à la recherche sur le Sars-Cov-2.
L'Académie nationale de médecine, l'Académie nationale de pharmacie et l'Académie vétérinaire de France estiment, pour leur part, que cette fonction de pilotage devrait être assurée par Aviesan, soutenue par l'ANR, l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS) et le Programme hospitalier de recherche clinique (PHRC).
De son côté, la section 27 du Comité national de la recherche scientifique 25 ( * ) , dont le président François Trottein a été auditionné par le groupe de travail, plaide, dans une motion adoptée à l'unanimité le 6 avril 2020, pour la mise en place d' « un plan national Covid-19 et pathogènes respiratoires émergents » visant à renforcer la recherche fondamentale et à coordonner l'ensemble des acteurs concernés.
3. Une compétition entre les équipes de recherche à la fois stimulante et préjudiciable
L'émulation scientifique suscitée par la découverte du nouveau coronavirus et l'urgence à répondre aux défis de cette pandémie inédite est assurément saine et bénéfique ; elle permet un échange d'informations entre chercheurs et contribue à la mise au point de nouvelles pratiques qui enrichissent le travail scientifique. Alors que les étapes « reconnaissance, diagnostic, séquençage, isolement » avaient pris quatre ans et demi pour le virus du Sida, dans le cas du Sars-Cov-2, il n'aura fallu que quelques mois. Même si la comparaison a ses limites - les deux virus étant extrêmement différents -, toujours est-il que le processus s'est considérablement accéléré .
Le manque de coordination et de pilotage des initiatives de recherche engendre cependant des effets pervers , comme l'ont regretté plusieurs des scientifiques auditionnés par le groupe de travail : cacophonie des annonces, surenchère médiatique, mise en avant des intérêts personnels, développement de logiques d'image, importance des enjeux industriels et financiers, etc.
À cela s'ajoute une culture de recherche très pyramidale , sur laquelle a insisté le professeur Florence Ader lors de son audition. Cette caractéristique du système français ne facilite pas la coordination entre les différentes structures, à l'opposé du modèle anglo-saxon de « cluster » qui repose sur une véritable mise en réseau.
C. UNE CRISE RÉVÉLATRICE DES CARENCES STRUCTURELLES DU SYSTÈME DE RECHERCHE FRANÇAIS
1. Une recherche biomédicale trop longtemps délaissée
La recherche biomédicale est définie comme l'ensemble des recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques et médicales.
Dans un contexte de concurrence internationale croissante, la France n'a pas réussi à maintenir son rang en matière de recherche biomédicale 26 ( * ) . En biologie fondamentale , elle se place au 6 ème rang , à égalité avec le Canada, et représente 3,5 % des publications mondiales, derrière les États-Unis (26,9 %), la Chine (11,5 %), l'Allemagne (5,7 %), le Japon (5,2 %) et le Royaume-Uni (5,2 %). En recherche médicale , la France se situe au 7 ème rang de la production scientifique mondiale (3,4 % des publications), derrière les États-Unis (26,1 %), la Chine (8,1 %), le Royaume-Uni (6,1 %), le Japon (5,5 %), l'Allemagne (5,2 %) et l'Italie (4,3 %).
Plusieurs raisons expliquent ce décrochage , comme l'a montré la Cour des comptes dans un rapport 27 ( * ) remis à la commission des affaires sociales du Sénat en décembre 2017 : érosion et cloisonnement des financements alloués à ce domaine de recherche, carences stratégiques , essoufflement du modèle hospitalo-universitaire , dispersion des acteurs ...
L'épidémie de Covid-19 a fait ressurgir ce constat bien connu et mis en lumière les conséquences délétères de ce désengagement en matière de recherche biomédicale . Ainsi, les travaux de recherche sur les coronavirus ont considérablement été réduits il y a une quinzaine d'années en France, faute de financements et de programmation stratégique , alors qu'ils ont été poursuivis dans d'autres pays, notamment en Allemagne. Ce point a été soulevé au cours des auditions tant par le président de la section 27 du CNRS que par les représentants de l'Académie des sciences.
Pour le groupe de travail, la crise actuelle révèle la nécessité d'un réinvestissement budgétaire et stratégique en faveur de la recherche biomédicale afin que la France rattrape son retard au niveau international .
2. L'érosion constante des dotations de base des laboratoires de recherche
Le fonctionnement des laboratoires de recherche repose aujourd'hui sur deux sources de financement principales : les financements sur projets, qu'ils proviennent de l'ANR, de l'Union européenne, du Programme d'investissements d'avenir (PIA) ou de contrats avec les entreprises ou les collectivités territoriales, et les dotations dites « de base » c'est-à-dire les subventions pour charges de service public attribuées par l'État.
L'érosion continue des dotations de base depuis plusieurs années oblige les opérateurs de recherche à se tourner de plus en plus vers les financements sur projets . Ce type de financement est, certes, pertinent à plusieurs titres - il est source d'émulation pour les chercheurs, il permet de structurer les projets de recherche, il limite le « saupoudrage » des aides, il crée des possibilités en termes de débouché -, mais il n'est pas non plus exempt de désavantages : le temps passé par les chercheurs à préparer les dossiers de candidature réduit d'autant le temps consacré à leur recherche ; il est peu compatible avec la prise de risques ; il ne permet pas de mener des projets exploratoires .
Or certains pans de la recherche, comme ceux concernés par le nouveau coronavirus (recherche fondamentale, recherche médicale), sont particulièrement affectés par ces évolutions. Ce constat est très largement partagé au sein de la communauté scientifique.
Aussi, le groupe de travail estime indispensable de mettre un terme à la diminution constante des dotations de base des laboratoires de recherche et de rééquilibrer leur structure de financement entre ces dotations et les financements sur projets.
3. L'urgence d'une réforme globale de la recherche
La crise sanitaire a éclatée quelques semaines avant que le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR) soit, selon le calendrier annoncé par le Gouvernement, examiné en Conseil des ministres. La présentation de ce projet de loi, tant attendu par la communauté de recherche, avait cependant déjà été retardée à plusieurs reprises.
Avec l'épidémie de Covid-19, le monde de la recherche s'est retrouvé sous le feu des projecteurs : jamais il n'a été autant question de recherche dans les médias, le débat public, les discussions privées, que depuis la propagation du nouveau coronavirus.
C'est dans ce contexte exceptionnel que le Président de la République a promis, le 19 mars dernier, une augmentation de 5 milliards d'euros du budget de la recherche d'ici à 2030. Lors de son audition par la commission, le 6 avril, la ministre de la recherche a précisé que cet effort budgétaire serait amorcé dès l'année prochaine avec une augmentation de 400 millions d'euros inscrite au projet de loi de finances pour 2021.
À l'origine, il était prévu que la trajectoire de financement de la recherche soit portée et programmée par la LPPR. Mais la crise ayant suspendu l'examen de tous les grands projets de loi et confirmé l'importance de l'investissement dans la recherche, l'exécutif a choisi de communiquer rapidement sur une hausse du budget .
La LPPR ne devait toutefois pas se limiter à un volet financier, elle devait aussi traiter de sujets restés depuis trop longtemps en suspens comme l'organisation du système de recherche, le statut et de la carrière des chercheurs, le développement de la recherche partenariale. Le 7 juin dernier, un projet de texte comportant 24 articles, organisés en 5 titres 28 ( * ) , a été dévoilé dans la presse spécialisée. Il devrait être examiné par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) le 12 juin et en Conseil des ministres le 8 juillet. Cependant, à ce jour, aucune date d'inscription à l'agenda parlementaire n'est prévue.
Pour le groupe de travail, l'épidémie de Covid-19 confirme la nécessité d'une réforme globale de la recherche, qui tirerait les leçons de cette crise .
Plusieurs chantiers lui paraissent incontournables :
- amorcer une trajectoire financière ambitieuse qui permette d'atteindre l'objectif de 1 % du PIB consacré à la recherche publique ;
- définir des orientations stratégiques redonnant toute sa place à la recherche biomédicale ;
- clarifier la gouvernance du système ;
- rééquilibrer la structure de financement des laboratoires de recherche entre dotations de base et financements sur projets ;
- revaloriser très nettement la rémunération et le statut des chercheurs .
4. À très court terme, l'indispensable soutien aux doctorants et post-doctorants pénalisés par la crise
Avec la crise, beaucoup de projets et travaux de recherche sont ralentis voire arrêtés. La fermeture des établissements d'enseignement et de recherche, ainsi que le confinement, ont en effet contraint de nombreux doctorants, chercheurs, techniciens, ingénieurs à interrompre leurs travaux expérimentaux en laboratoire - pour les sciences de la nature et les sciences formelles - ou à suspendre leurs recherches documentaires, leurs enquêtes et études de terrain - pour les sciences humaines et sociales.
Afin de tenir compte de ce contexte exceptionnel et limiter ses effets négatifs sur les activités de recherche, la ministre a annoncé, le 23 avril dernier, la possibilité pour les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche de prolonger les contrats de leurs personnels en CDD, dont les doctorants et post-doctorants . Cette mesure figure au projet de loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19 actuellement en discussion au Parlement.
Si le groupe de travail salue cette initiative, il appelle à la plus grande vigilance sur plusieurs points :
• le nombre de doctorants et post-doctorants , dont les travaux ont été ou sont encore pénalisés par la crise, n'a fait l'objet d'aucun chiffrage officiel par le ministère ;
• toutes les filières de recherche ne sont pas affectées de la même manière : certaines ont pu rapidement reprendre leurs travaux, alors que d'autres sont durablement empêchées ;
• les critères de prolongation de ces contrats nécessitent d'être extrêmement précis afin d'éviter des disparités de traitement d'un établissement à l'autre et au sein d'un même établissement ;
• le financement de ce dispositif repose, en l'état, sur le budget à périmètre constant des établissements, ce qui n'est pas acceptable : après avoir indiqué que les prolongations de contrats seraient « soutenues financièrement par l'État » , sans davantage de précision, la ministre a annoncé que des discussions étaient en cours avec d'autres financeurs, dont les régions. Le groupe de travail sera très attentif aux modalités de financement qui devraient être prochainement précisées par circulaire .
D. LA DÉMARCHE ET L'INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUES À L'ÉPREUVE MÉDIATIQUE
Dans un contexte de très large couverture médiatique et de place grandissante des réseaux sociaux, l'émulation scientifique née de la lutte contre la Covid-19 a donné lieu à certaines dérives , que l'Académie nationale de médecine résume par ce constat sans appel 29 ( * ) : « trop de précipitation dans la communication, trop d'annonces prématurées, trop de discordes entre les équipes, trop de pressions de toutes sortes, mais pas assez de science ».
Le groupe de travail déplore à son tour ces excès qui vont à l'encontre de la démarche et de l'intégrité scientifiques, lesquelles exigent de la méthode, de la rigueur, de l'esprit critique et de la discrétion professionnelle. Le battage médiatique autour de l'hydroxychloroquine est particulièrement révélateur des manquements à ces règles et valeurs.
Le groupe de travail rappelle également que les scientifiques, sous respect du secret professionnel, ont un devoir d'information et de pédagogie à l'égard de l'ensemble des citoyens . En ces temps de crise sanitaire, il leur revient de promouvoir une communication de qualité à destination du grand public pour l'informer des recherches en cours sur la Covid-19. C'est notamment par cette voie que peuvent s'instaurer un dialogue et une relation de confiance entre les savants et la société.
Enfin, le groupe de travail regrette le traitement médiatique parfois peu rigoureux réservé à certains travaux de recherche . Il en est ainsi de l'essai Discovery qui a été accusé de ne pas produire de résultats assez rapidement, alors que son objectif à court terme n'est pas de trouver une molécule miracle, mais d'identifier les éventuels « signaux » - pour reprendre le terme employé par le professeur Florence Ader - émis par les molécules de repositionnement testées 30 ( * ) . Faut-il le rappeler, le temps de la recherche et de la science n'est pas celui de l'immédiateté des médias et des réseaux sociaux .
VIII. LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES
Le groupe de travail « Livre et Industries culturelles » de la commission de la culture animé par Françoise Laborde (Haute-Garonne, RDSE) est composé de Marie-Thérèse Bruguière (Hérault, LR), Laure Darcos (Essonne, LR), André Gattolin (Hauts-de-Seine, LREM), Michel Laugier (Yvelines, UC-A), Colette Mélot (Seine-et-Marne, Les indépendants - République et territoires) et Jean Marie Mizzon (Moselle, UC).
Des premières conclusions opérationnelles peuvent d'ores et déjà être tirées à court terme et moyen terme. Elles s'articulent autour d'un triptyque : anticiper , compenser , se projeter .
D'une manière générale, les mécanismes de solidarité mis en place ont plutôt bien fonctionné durant la période de confinement. Ainsi, la plupart des auteurs sont dorénavant couverts par le fonds de solidarité ou les fonds spécifiques mis en place avec le soutien de l'État (fonds SACD, fonds SACEM, fonds CNL, fonds SCAM..).
A contrario , la période a aussi révélé la logique très sectorielle des auteurs, pour lesquels un traitement par les organismes de gestion collective (OGC) a été largement privilégié, à la fois pour des raisons pratiques (elles disposent de fonds et d'infrastructures administratives), mais également de connaissance de leur « public ».
De la même manière, les mesures prises par le CNC ont permis d'éviter toute défaillance d'entreprise durant la période, alors même que la chaîne de production dans son ensemble s'est trouvée paralysée. Les grandes chaînes et les plateformes ont par ailleurs pris des engagements en faveur des auteurs.
À moyen terme, il sera nécessaire de dégager de nouveaux moyens financiers pour le secteur de la production, ce qui rend urgente la transposition des directives SMA et « droits d'auteur ».
A. ANTICIPER LA REPRISE D'ACTIVITÉ
La période de déconfinement a débuté le lundi 11 mai. Cette date, qui ne constitue en réalité qu'une étape pour certains services publics et certaines entreprises, doit marquer le début d'une clarification aux légitimes interrogations des acteurs du monde des industries culturelles.
Les entreprises sont d'ores et déjà tournées vers la reprise de l'activité, avec des problématiques à la fois proches mais différenciées suivant les secteurs. Les librairies ont rouvert dès le 11 mai, alors que les cinémas ne peuvent que difficilement se projeter.
La réussite de la sortie de confinement pose cependant la question de son anticipation .
1. Pour les salles de cinéma, donner rapidement de la visibilité sur la date de réouverture
Les professionnels estiment qu'il faut prévoir cinq semaines avant la reprise . Cette période est jugée nécessaire tout à la fois pour mettre en place les procédures spécifiques (voir plus bas), mais également, en lien avec les producteurs, planifier un calendrier de sortie qui ne soit ni vide, ni pléthorique.
À ce propos, il convient de souligner que les films qui auraient bénéficié des règles dérogatoires permettant de sortir en VOD après un bref passage en salle voire sans y passer, sont tout à fait fondés, s'ils le souhaitent, à revenir en salle.
De manière générale, le groupe de travail souhaite qu'un message clair et univoque soit porté sur la réouverture des salles, afin d'éviter qu'elles ne soient vides - ce qui accentuerait encore les difficultés des exploitants- ou qu'elles doivent fermer de nouveau si des cas de contamination y étaient enregistrés. Cela sera d'autant plus facile que des conditions sanitaires claires auront été posées et acceptées .
2. Définir les conditions sanitaires de reprise de l'activité
Cette problématique est commune à l'ensemble des commerces et des entreprises.
Dans le cas des librairies , le gouvernement avait indiqué qu'il reviendrait au SLF de définir les conditions sanitaires de réouverture. A ce propos, l'exemple allemand, où les librairies n'ont pas été fermées, avait servi d'exemple. Les librairies sont en effet des commerces particuliers, où les gens entrent, feuillètent et reposent les livres 31 ( * ) . Dès lors, le respect des gestes barrières suppose, par exemple, la mise à disposition de gel hydroalcoolique à l'entrée, le rappel de règles de base, voire la pose de vitre à la caisse. Le ministère de la Santé a validé le dispositif le 6 mai, ce qui était souhaité par la profession.
Le cinéma a pour sa part une expérience précoce, puisque les salles avaient appliqué des mesures de distanciation sociale une semaine avant le confinement. Il n'en reste pas moins que des règles claires doivent être arrêtées suffisamment tôt pour en rendre possible l'application à la date retenue.
Le groupe de travail estime que, dans tous les cas, il serait impératif que, sur le modèle du BTP, les règles arrêtées par les professionnels soient validées par les pouvoirs publics. Tel a été le cas pour les libraires dès le 6 mai par le ministère de la santé.
3. Rapidement définir les contours du fonds d'indemnisation annoncé par le Président de la République le 6 mai
Le Président de la République a annoncé le 6 mai dernier la mise en place d'un fonds d'indemnisation pour les tournages annulés ou retardés. Il serait abondé par l'État, les assureurs et les collectivités locales.
Le groupe de travail estime qu'il convient d'en définir très rapidement les contours et les modalités d'intervention.
4. Sécuriser juridiquement l'activité en associant l'Etat, les compagnies d'assurance et les collectivités locales
Les compagnies d'assurance ont refusé de compenser la perte d'activité liée au risque pandémique. L'absence actuelle de produit assurantielle couvrant ce risque pose cependant problème pour l'ensemble de l'économie. Dans le cas des industries culturelles, il sera ainsi risqué d'engager un tournage si aucune assurance ne prend en charge une suspension décidée pour des raisons sanitaires.
Le groupe de travail soutient les travaux actuellement menées par le gouvernement pour parvenir rapidement avec les compagnies d'assurance à une solution rendant possible une reprise d'activité sécurisée juridiquement et économiquement.
B. COMPENSER L'IMPACT DE LA CRISE POUR ÉVITER LA DÉBÂCLE
Les mesures de confinement ont entrainé un choc d'une ampleur inégalée pour certaines industries culturelles en lien direct avec le public, comme le cinéma, la librairie, mais également, à l'autre bout de la chaîne, pour les auteurs.
1. Prendre conscience que la relance passe par des mesures massives de compensation
Les premières estimations de perte évaluent ainsi la destruction de valeur due à la crise à 8 à 10 milliards d'euros pour les industries culturelles et créatives . Ces pertes sont pour une bonne partie irréversibles : les festivals déprogrammées ne pourront pas être organisés, des livres et des films ne pourront pas sortir, entrainant des revenus nuls pour les exploitants comme pour les auteurs.
Le groupe de travail prend acte de cet état de fait et s'inscrit dans une logique a minima de compensation, reconnaissant que des moyens publics considérables devront être attribués à des acteurs déjà fragilisés avant la crise, et dorénavant proches pour certains de la faillite. Cette mécanique doit associer étroitement l'État, les collectivités locales, qui se sont déjà beaucoup investis dans la matière, et le secteur privé.
L'ampleur de la compensation à verser doit naturellement être appréhendée dans un cadre plus large, tant l'ensemble des secteurs économiques a été impacté.
2. Prendre en compte la spécificité des industries culturelles
L'évaluation des pertes subies par secteur, hors mesures déjà prises, n'est pas encore achevée , et dépend de nombreuses hypothèses (comportements de consommation pendant une période de transition dont on ignore la durée, volonté de dépenser ou au contraire d'épargner face à un futur plus incertain..).
Pour autant, le groupe de travail attire l'attention sur certaines spécificités des industries culturelles qui, par bien des aspects, sont incompatibles avec la distanciation sociale, et qui justifient à elles-seules une attention particulière.
Certains secteurs ont pu fournir quelques estimations, très incertaines à ce stade.
Ainsi, le modèle des libraires est précisément celui d'une « flânerie » dans les rayons qui pourrait ne pas pouvoir reprendre à brève échéance. Le Syndicat de la librairie française (SLF) évalue les charges des libraires non prises en compte à 15 % du chiffre d'affaires, aujourd'hui financé par des fonds propres, soit une perte de 25 millions d'euros sur les deux mois de fermeture, qu'il faudrait compléter par une somme équivalente pour une activité réduite de 50 % pendant quatre mois, soit environ 50 millions d'euros .
Dans le domaine de la musique, la SACEM évalue sa perte à 250 millions d'euros , ses « clients » que sont les commerces étant pour l'immense majorité fermés et ne versant plus leur écot, soit environ 170 millions de droits qui ne seront pas versées aux auteurs.
Le CNC, qui prend une part active pour soutenir les entreprises du secteur, estime à 120 millions d'euros ses pertes, essentiellement en raison de l'arrêt de la perception de certaines taxes. Ce chiffre pourrait encore augmenter en fonction de la date de réouverture des salles de cinéma.
Le Centre national de la musique ne dispose pour sa part plus de ressources fiscales comme prévu dans le schéma initial, avec la suspension de la taxe sur le spectacle vivant. Le Président de la République a fort heureusement annoncé une dotation supplémentaire de 50 millions d'euros pour lui permettre d'exercer ses missions.
Ces données illustrent, selon le groupe de travail, l'ampleur des efforts budgétaires qu'il faudra très vraisemblablement consentir, simplement pour ne pas voir des pans entiers de l'économie française s'effondrer .
3. Tenir compte du décalage dans le temps
L'impact de la crise se fera durablement sentir, et durant plusieurs mois ou années. Par exemple, les libraires devront au mois de juin faire face à un « mur » de remboursement, correspondant aux reports consentis par les éditeurs pour les mois précédents et aux achats de nouveautés et le calendrier des sorties de livre sera bouleversé pour plusieurs mois (quelle « rentrée littéraire » par exemple ?). Les revenus des auteurs seront plus particulièrement affectés en 2021 , au moment d'une répartition des droits qui couvrira la période de confinement.
Le groupe de travail appelle donc les pouvoirs publics à considérer sur le temps long les effets de la crise, et à agir de manière concertée et massive le plus rapidement possible pour rassurer le secteur et conforter la viabilité de son modèle économique .
C. SE PROJETER DANS L'APRÈS
À plus long terme, il apparait que la crise du coronavirus a accentué des déséquilibres déjà existants et accéléré des évolutions . Dès lors, et au-delà d'une logique de relance immédiate et de compensation, le groupe de travail a jugé nécessaire de se projeter pour permettre à notre modèle de s'adapter et de sortir renforcé de cette période.
1. Reconduire les mesures de soutien transitoire et les renforcer
Les mesures provisoires prises notamment avec la loi du 23 mars 2020 ont permis au secteur de ne pas connaitre un effondrement. La situation étant pour encore longtemps loin de la normalité, il convient d'ores et déjà d'en prévoir et d'en annoncer prolongation, en particulier en ce qui concerne :
• la capacité des OGC à utiliser les crédits « AAC » pour venir en aide à leurs sociétaires (ordonnance du 27 mars 2020) ;
• les mesures dérogatoires de la chronologie des médias (article 17 de la loi du 23 mars 2020) ;
• organiser une sortie progressive des mesures de chômage partiel. Les différentes industries culturelles en contact avec le public ne pourront en effet pas retrouver un niveau d'activité comparable à la période précédente en quelques semaines.
2. Procéder rapidement à la transposition des directives SMA et droits d'auteur
Les seuls vainqueurs de la crise pourraient être les plateformes en ligne, qui ont bénéficié des mesures de confinement pour accélérer leur mainmise sur l'accès à l'information et à la culture.
Dès lors, il est plus urgent que jamais de transposer en droit français les directives précisément édictées au niveau européen pour permettre de faire participer les plateformes à la création française et européenne , d'améliorer la transparence des algorithmes et de renforcer le pouvoir de négociation des auteurs. La transposition des directives n'est cependant que la première étape, qui doit être suivie par des négociations complexes entre les différentes parties prenantes. Dès lors, pour que le nouveau système s'applique dès le début de l'année 2021, avec notamment une participation renforcée des plateformes à la création française et européenne, il est nécessaire que cette adoption intervienne le plus rapidement possible .
Une transposition rapide ne permettrait cependant un gain de temps que si, préalablement , les différentes parties prenantes, en particulier au niveau national, avaient suffisamment rapproché leur position pour que les négociations ne soient pas trop longues 32 ( * ) . Faute d'un tel rapprochement, la transposition ne permettrait aucun gain significatif, ne servant qu'à fournir un délai supplémentaire à ce que l'on peut qualifier de combat tactique et de « guerre de position ». Il appartient donc aux différents intervenants de se mettre au niveau des enjeux qu'impose la période.
Il sera également impératif de conforter les obligations de diffusion des oeuvres françaises et européennes sur les radios, en engageant les plateformes de streaming à mettre en valeur plus qu'elles ne le font ces productions dans le cadre de leur activité d'édition (playlist, radios en ligne..).
Le groupe de travail invite donc le gouvernement à inscrire très haut dans la liste des priorités la transposition des directives « SMA » et « droits d'auteur », sous la réserve expresse que les différentes parties prenantes soient tombées d'accord sur l'essentiel des dispositions.
3. Rééquilibrer les conditions de concurrence
En lien direct avec la précédente problématique, la période de confinement a également particulièrement bénéficié aux plateformes de livraison en ligne, notamment Amazon. S'il ne faut pas sous-estimer le service rendu à des millions de personnes par cet outil, notamment dans l'accès aux livres au moment de la fermeture des librairies, il pourra être utile de réfléchir à un meilleur équilibre des conditions de concurrence, par exemple :
• en réexaminant la manière dont Amazon détourne l'esprit de la loi en facturant pratiquement à zéro les frais de livraison alors que les librairies ne bénéficient que du tarif postal de droit commun ;
• en étudiant la possibilité d'une plateforme souveraine de téléchargement de livres numériques , en lien avec le réseau es librairies. Cela permettrait notamment d'améliorer la visibilité des éditeurs les plus modestes, aujourd'hui « écrasés » par les algorithmes.
Récapitulatif des préconisations du groupe de travail
1. Anticiper la reprise d'activité
ï Fixer le plus rapidement possible, et avec au moins cinq semaines d'avance, la date de réouverture des salles de cinéma et la conditionner à une validation explicite par les pouvoirs publics des conditions sanitaires établies par les organisations professionnelles représentatives, sur le modèle de la librairie et du BTP.
ï Définir les contours et les modalités d'intervention du fonds d'indemnisation annoncé par le Président de la République le 6 mai.
ï Avancer rapidement sur la question des assurances afin de permettre une reprise d'activité juridiquement sécurisée.
2. Compenser l'impact de la crise
ï Reconnaitre que les conditions spécifiques d'exercice de la plupart des industries culturelles les placent parmi les secteurs les plus vulnérables aux conséquences de la crise, et s'inscrire en conséquence dans une logique de compensation, en lien avec l'État, les collectivités locales et le secteur privé.
ï Inscrire ce soutien dans le temps long, pour tenir compte des effets différés de la crise, notamment sur les auteurs.
ï Donner rapidement des gages financiers au secteur pour rassurer les différents intervenants et conforter leur modèle économique.
3. Se projeter dans l'après
ï Reconduire les mesures de soutien provisoire, notamment les règles dérogatoires à la chronologie des médias, la faculté donnée aux organismes de gestion collective d'aider leurs membres et organiser une sortie « en sifflet » de la prise en charge par l'État du chômage partiel pour tenir compte d'une reprise d'activité progressive.
ï Procéder rapidement à la transposition des directives SMA et droit d'auteur telle que prévue dans le projet de loi audiovisuelle, afin de conforter les créateurs et de plus faire participer les plateformes de vidéo en ligne, sous condition d'une accélération préalable des négociations entre les parties prenantes et d'une large concertation.
ï Rétablir des conditions de concurrence équitable avec les plateformes de livraison en ligne.
IX. MÉDIAS AUDIOVISUELS
Le groupe de travail « médias audiovisuels » de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication animé par Jean-Pierre Leleux (Alpes-Maritimes, LR) est composé de Catherine Morin-Desailly (Seine-Maritine, UC), David Assouline (Paris, socialiste et républicain), André Gattolin (Hauts-de-Seine, LREM), Jean Raymond Hugonet (Essonne, LR) et Claude Malhuret (Allier, Les Indépendants).
Les médias audiovisuels ont été au rendez-vous de la crise sanitaire, il importe maintenant de faire qu'ils soient accompagnés afin de traverser la difficile période qui s'ouvre et qui les impacte gravement dans leur modèle économique.
Si les Français ont pu - depuis la mi-mars - continuer à accéder à une information de qualité et à des programmes attractifs, c'est grâce à l'existence d'un écosystème puissant qui associe les chaînes, les producteurs, les distributeurs et les professionnels (acteurs, techniciens, journalistes...). Cet écosystème est aujourd'hui gravement menacé et attend un vaste soutien public qui tarde encore à se concrétiser .
La crise sanitaire a eu des effets paradoxaux sur les entreprises du secteur audiovisuel. Les audiences des chaînes de la TNT ont très sensiblement augmenté ce qui leur a permis de renouer avec des performances qu'elles pensaient révolues. Les journaux télévisés (JT) ont ainsi retrouvé des audiences inconnues depuis une décennie, y compris auprès des jeunes, une catégorie qui semblait « perdue » pour la télévision linéaire gratuite. Ce retour de la fonction « fédérative » des médias « broadcast » s'explique par les particularités de la crise qui a incité les familles à partager des programmes familiaux et à se tenir informées.
Pour autant, ce retour en grâce de la télévision linéaire gratuite pourrait n'être que temporaire, il devra être confirmé à mesure que les jeunes reprendront le chemin des études et les plus âgés celui du travail. Les autres conséquences de la crise pourraient quant à elles être plus durables, qu'il s'agisse de l'augmentation des abonnements aux plateformes anglo-saxonnes - qui menace l'audience des chaînes historiques et Canal+ - et de l'évolution du marché publicitaire qui pourrait mettre du temps à se relever de l'« effondrement » intervenu au printemps 2020.
Si la mobilisation des médias audiovisuels pendant la phase critique de la crise sanitaire doit donc être saluée, il convient maintenant de ne pas sous-estimer les fragilités de ces acteurs qui font face à une concurrence sortie également renforcée de la crise sanitaire. Dans ce contexte, le groupe de travail considère que l'évolution du contexte intervenue depuis trois mois remet en cause les hypothèses mêmes sur lesquelles repose la politique en faveur des médias et qui ont permis de construire le projet de loi de réforme de l'audiovisuel ainsi que la trajectoire budgétaire 2022 concernant les sociétés de l'audiovisuel public.
Une « mise à jour » de la politique publique en faveur de l'audiovisuel est donc devenue nécessaire . Cette « mise à jour » doit être tout à la fois à la hauteur des enjeux que connaissent les différents médias et respectueuse des principes qui ont permis à ces mêmes acteurs de jouer leur rôle pendant cette crise.
A. UNE MOBILISATION DES MÉDIAS AUDIOVISUELS PENDANT LA CRISE SANITAIRE À SALUER
1. La très forte réactivité des médias tout au long de la crise sanitaire
Comme l'a indiqué Roch-Olivier Maistre lors de son audition par le groupe de travail 33 ( * ) : « les médias ont fait preuve d'une forte capacité d'adaptation et d'une forte résilience » pendant la crise sanitaire. La hausse de la durée de consommation de la télévision (jusque 4 h 49 par jour y compris pour les jeunes) témoigne du retour en grâce du média télévision qui a mieux résisté qu'on ne pouvait le craindre. Les audiences de la radio ont également progressé.
Dès les premiers jours de la crise, les médias ont adapté leurs grilles de programmes dans le cadre d'un dialogue conduit avec le CSA afin de « préserver les équilibres » . Le régulateur a été attentif à donner de la souplesse aux acteurs - notamment par rapport à leurs obligations conventionnelles - en fixant néanmoins des limites concernant par exemple les mutualisations entre chaînes généralistes et chaînes d'information en continu. Par ailleurs, plusieurs décisions importantes qui étaient en préparation ont été reportées 34 ( * ) par le CSA au mois de juillet 35 ( * ) afin de laisser aux acteurs concernés le temps de préparer leurs projets et aux membres du collège de les examiner.
La crise a également constitué un défi en termes d'organisation. Dès le 16 mars, le groupe France Télévisions et Radio France ont ainsi généralisé le télétravail. La présence des salariés sur les sites n'a pas dépassé 10 à 11 % des effectifs et a concerné les fonctions techniques ne pouvant être exercées à distance comme les régies. Le stock de masques des entreprises ayant été réquisitionné, il a fallu - comme dans toutes les autres entreprises françaises - plusieurs semaines pour pouvoir appliquer les mesures de distanciation et de protection adaptées.
a) La priorité donnée à l'information
Les grandes chaînes ont donné la priorité à l'information en allongeant la durée des journaux télévisés et en multipliant les sujets relatifs aux infox. Pour le président de TF1, Gilles Pélisson 36 ( * ) , le passage à des JT d'une heure a représenté l'équivalent de la réalisation d'un troisième JT chaque jour.
France Télévisions a, par ailleurs, multiplié les soirées « en direct » consacrées à la crise sanitaire et aux soignants. France 2 a, par ailleurs, mis en valeur la presse quotidienne régionale dans ses éditions de 13 heures et 20 heures, ce partenariat a constitué une initiative utile qu'il conviendrait sans doute de prolonger.
France Médias Monde (FMM) a également donné la priorité à l'information en insistant sur l'expertise et l'interactivité. La durée d'écoute de RFI a fortement augmenté en Ile-de-France a indiqué la présidente de FMM, Marie-Christine Saragosse, lors de son audition par le groupe de travail. Les visites sur les sites Internet du groupe ont été multipliées par trois tandis que France 24 a réalisé en 4 mois son audience de 2019.
b) Une programmation marquée par des contenus pédagogiques et patrimoniaux
Le groupe France Télévisions a été particulièrement réactif en changeant la programmation de la chaîne France 4. Lors de son audition par le groupe de travail, la présidente de France Télévisions a indiqué qu'il n'avait fallu que 48 heures pour développer avec l'éducation nationale des programmes éducatifs destinés aux enfants confinés à leur domicile.
Le groupe public a également programmé tous les après-midi des films du patrimoine français, le plus souvent issus du catalogue de Studio Canal comme l'a précisé au groupe de travail le président du directoire du groupe privé, Maxime Saada. France Télévisions a également élargi son partenariat avec la Comédie française afin de diffuser davantage de pièces de théâtre en soirée.
Radio France n'a pas été en reste pendant cette période. Lors de son audition par le groupe de travail, Sibyle Veil, a indiqué que son action avait visé tout à la fois à protéger les salariés et à assurer la continuité du service public. Chacune des antennes du groupe a joué son rôle, France Culture proposant chaque jour une soirée théâtre, France Bleu s'attachant à accompagner les personnes isolées... La présidente de Radio France s'est félicitée de la priorité donnée au numérique depuis plusieurs années qui a permis de rendre immédiatement accessibles de nombreux programmes sur Internet. Pour Sibyle Veil : « si la crise avait eu lieu il y a quelques années nous n'aurions pas pu mettre à disposition autant d'émissions conçues à distance ainsi que de grandes émissions « culte » patrimoniales » .
La présidente de Radio France s'est félicitée de la progression « phénoménale » des audiences du groupe en particulier sur Internet, celles de France Info ayant progressé de + 70 % en mars-avril. Elle voit dans ce succès le fait que « les Français se sont tournés vers des marques de confiance » dans cette période d'incertitude. Plus généralement, la crise sanitaire a mis en évidence le fait que les usages devenaient de plus en plus numériques y compris pour les publics les plus jeunes, les podcasts destinés à la jeunesse ayant obtenu d'excellentes audiences.
2. Les difficultés rencontrées par les médias au cours de la crise sanitaire
a) Les deux déceptions du service public en matière d'information
Le service public de l'audiovisuel a connu des réussites inégales sur le chapitre de l'information pendant la crise sanitaire. Si les audiences des JT de France Télévisions 37 ( * ) et celles des antennes proposant de l'information de Radio France ont connu la même croissance que celle des chaînes privées, il n'en a pas été de même de la chaîne d'information du service public Franceinfo.
Pour la semaine du 13 au 19 avril par exemple, on constate que les audiences cumulées de BFM TV, CNews et LCI ont augmenté respectivement de + 62,5 %, + 64,4 % et + 68,3 % par rapport à la moyenne de janvier-février 38 ( * ) . Alors que les deux plus petites chaînes d'information ont « surperformé » le leader BFM de plusieurs points en termes de progression d'audience (sans toutefois rattraper leur retard), force est de constater que Franceinfo a très significativement sous-performé les trois autres chaînes d'information privées avec une hausse limitée à + 47 %.
Interrogée sur les raisons de ce moindre succès de la chaîne publique d'information alors même que les performances de la radio et du site Internet étaient quant à elles satisfaisantes, Sibyle Veil a estimé lors de son audition 39 ( * ) par le groupe de travail que la chaîne publique restait mal positionnée dans la numérotation de la TNT et qu'elle connaissait un déficit de capacité de projection pour réaliser des reportages par rapport à BFM, ce qui la rendait moins attractive. Pour la présidente de Radio France, une nouvelle étape devra être conduite dans le développement de la chaîne d'information Franceinfo afin de développer ses capacités de reportage, notamment grâce à une mutualisation des équipes du service public.
Une seconde difficulté rencontrée par le service public pendant la crise sanitaire concerne les matinales communes à France 3 et France Bleu. La petite dizaine de matinales communes déjà lancées ont été arrêtées dès la mi-mars au moment où la grille de programmes de France 4 a été réorganisée pour proposer des programmes éducatifs et que les programmes d'animation ont été basculés sur France 3. Ces matinales ne reprendront pas avant la rentrée de septembre a expliqué la présidente de France Télévisions lors de son audition 40 ( * ) par le groupe de travail.
Le groupe de travail ne peut que regretter que les matinales communes à France 3 et France Bleu n'aient pas été mises au coeur de la stratégie éditoriale de France Télévisions pendant la période d'urgence sanitaire alors même qu'elles pouvaient constituer des outils précieux pour informer les Français au plus près , en particulier dans le Nord, le Sud-Est et l'Ile-de-France qui ont été durement touchés par la pandémie. Une réflexion pourrait être menée afin de faire de ces matinales communes un outil à part entière de l'information du public en cas de situation d'urgence comme c'est déjà le cas pour le réseau France Bleu.
b) La difficulté à garantir le pluralisme dans les médias
Concernant le respect du pluralisme dans l'information, les premiers jours de la crise ont donné lieu à une expression très importante - sinon souvent exclusive - de l'exécutif et de la majorité au détriment de l'opposition.
Pendant plusieurs semaines entre la mi-mars et la mi-avril, la règle édictée par le CSA d'une répartition du temps de parole entre 1/3 pour l'exécutif et 2/3 pour les autres formations politiques n'a, à l'évidence, pas été respectée. Saisis notamment par les parlementaires, le CSA est intervenu auprès des rédactions des chaînes à la mi-avril afin de leur demander de rétablir une plus grande équité. La situation est progressivement revenue « à la normale » au mois de mai.
Le groupe de travail estime qu'une réflexion pourrait être conduite afin de garantir un meilleur respect du pluralisme en temps de crise . L'état d'urgence ne constitue en effet pas une raison suffisante pour mettre entre parenthèses le fonctionnement de la démocratie. On peut estimer que c'est davantage l'absence de protocole à appliquer en ces circonstances qu'une volonté délibérée des médias de favoriser l'expression du Gouvernement qui peut expliquer les déséquilibres constatés. Un retour d'expérience pourrait être utile à réaliser.
B. DES ACTEURS FRANÇAIS DURABLEMENT AFFAIBLIS FACE À DES CONCURRENTS ANGLO-SAXONS PORTÉS PAR LES NOUVEAUX USAGES
La crise sanitaire a mis en évidence certains retards accumulés par les acteurs français ainsi que l'inadéquation de l'écosystème dans lequel ils évoluent. Elle a également jeté un doute sur l'adaptation des mesures prévues - ou non prévues - par la réforme de l'audiovisuel compte tenu d'un contexte concurrentiel durablement transformé. Au-delà des mesures immédiates de soutien qui sont nécessaires, c'est une nouvelle vision de l'évolution du secteur qui devient indispensable afin non plus d'adapter des dispositifs anciens mais de créer les conditions favorables à un contexte radicalement nouveau.
1. Un secteur des médias durablement affaibli par la crise sanitaire
a) « Une crise sans précédent » pour les médias privés
Le président de TF1 a estimé devant le groupe de travail que son groupe traversait une crise sans précédent. Certes l'audience a augmenté fortement au cours du confinement mais « cette audience n'a pas pu être monétisée ».
Le manque à gagner pour les chaînes privées est donc considérable, il pourrait représenter 300 à 400 M€ sur l'ensemble de l'année 2020 selon le président de TF1 ce qui représente un choc trois à quatre fois plus important que celui de la crise financière de 2008. Le groupe TF1 envisageait pour sa part une baisse de chiffre d'affaires comprise entre 50 et 60 % sur le deuxième trimestre et s'interrogeait sur le second semestre dans l'hypothèse où la reprise ne serait pas au rendez-vous.
Lors de son audition par le groupe de travail, le président du groupe M6, Nicolas de Tavernost, a indiqué que la gravité de la crise obligerait l'entreprise à réaliser une centaine de millions d'euros d'économies en 2020. Même si les audiences des chaînes du groupe ont augmenté, les recettes publicitaires ont fondu, jusque - 67 % en avril dernier.
Les présidents de TF1 et de M6 ont tous les deux souhaité mettre au débat la place de la publicité sur le service public audiovisuel . Après avoir observé que celle-ci ne représentait qu'environ 10 % des ressources de France Télévisions, ils ont appelé à une clarification du financement du service public . Au-delà du principe même du maintien de la publicité sur le service public, ils ont demandé à ce qu'une régulation effective de la politique tarifaire des régies de France Télévisions et Radio France soit instaurée pour les empêcher de « casser les prix » en période de crise 41 ( * ) .
b) Les incertitudes concernant l'avenir de France Télévisions
La situation du principal groupe de l'audiovisuel public est devenue quant à elle particulièrement complexe. Le report de l'examen de la réforme de l'audiovisuel public au Parlement devrait, a minima , retarder l'entrée en vigueur de la holding commune de plusieurs mois. Compte tenu des délais nécessaires à l'organisation de la transition, il n'est plus acquis que celle-ci aboutisse d'ici 2022. En conséquence, le mandat du prochain président de France Télévisions pourrait durer plus longtemps qu'escompté et tendre davantage vers un mandat de plein exercice . Le CSA a reporté son choix au mois de juillet 42 ( * ) et devra examiner les projets des candidats compte tenu d'un contexte financier devenu très incertain.
Lors de son audition par le groupe de travail, la présidente de France Télévisions a fait part des incertitudes économiques auxquelles le groupe était confronté. La perte de recettes de publicité était estimée à 40 M€ pour les seuls mois de mars à mai sans que les perspectives pour juin ne soient plus optimistes. Mais la vraie incertitude porte surtout sur le second semestre, le visage du résultat annuel étant appelé à changer radicalement selon qu'il y aura ou non une reprise de l'activité économique et donc une reprise du chiffre d'affaires publicitaire.
La direction du groupe est donc confrontée à une situation difficile. Alors que le ministère des finances a confirmé à plusieurs entreprises de l'audiovisuel public le maintien de la trajectoire financière de 2022, France Télévisions doit gérer tout à la fois le report de grands événements générateurs de publicité (Roland Garros, Tour de France, JO de Tokyo...) avec la nécessité de proposer des programmes de substitution, l'arrêt puis la reprise des tournages avec une hausse des coûts liée à l'adoption de protocoles sanitaires drastiques et, enfin, l'incertitude concernant l'avenir de France 4 et France Ô qui devaient arrêter leur diffusion hertzienne cet été.
Les marges de manoeuvre du groupe apparaissent dès lors restreintes d'autant que la montée en charge du plan de départs volontaires pourrait être contrariée par une baisse des départs pour « projet personnel » dans un contexte économique devenu particulièrement incertain.
Le projet de plateforme Salto qui était à l'origine de l'essentiel du déficit prévu en 2020 devrait, pour sa part, suivre son cours avec des perspectives de succès encore plus incertaines compte tenu du nouveau report de son lancement à l'automne, de la concurrence exacerbée de plusieurs plateformes attractives arrivées plus tôt 43 ( * ) et de la nécessité d'investir davantage dans des productions exclusives.
A défaut de bénéficier d'un soutien important de son actionnaire, le groupe France Télévisions devrait être confronté à la nécessité de choisir entre une forte aggravation de son déficit ou une baisse de ses dépenses sur ses principaux postes de charges.
c) Les difficultés propres à la radio publique
La crise sanitaire est intervenue alors que l'entreprise Radio France n'avait pas bouclé son accord de rupture conventionnelle collective (RCC) et alors que le chantier de rénovation de la Maison de la Radio se poursuivait toujours. L'entreprise a été directement impactée par la crise sanitaire du fait d'une baisse du chiffre d'affaires publicitaire et de l'arrêt des activités de concerts et de location de salles et de studio.
Cette baisse des ressources propres constitue un facteur de fragilité pour l'entreprise qui a connu deux grandes crises sociales au cours des cinq dernières années. Pour la présidente de Radio France, il existe un besoin de visibilité et de clarification concernant l'avenir de l'entreprise . En l'absence de remise en cause de la trajectoire financière, la baisse des ressources propres et le report des départs de salariés devraient dégrader les comptes sans que la suspension des travaux (et donc des dépenses afférentes) ne permettent de compenser.
Le coût de la crise est estimé entre 15 et 20 M€ sur l'année par la direction de Radio France qui a déjà acté de nouveaux retards sur le chantier de la Maison de la Radio et le report à l'automne du Plan de départs volontaires. Au-delà de l'éventuel déficit qui pourrait intervenir en 2020 en l'absence de contribution de l'actionnaire, se pose la question de l'adaptation du rythme de la mise en oeuvre de la trajectoire financière pour 2021 et 2022.
d) La situation très précaire des radios indépendantes et des télévisions locales
Les radios indépendantes ont été sévèrement touchées par la baisse des recettes publicitaires. Selon le président du SIRTI, Alain Liberty, auditionné par le groupe de travail : « trois radios sur quatre envisagent de supprimer des emplois » et la crise a agi « comme un accélérateur des problèmes préexistants » .
Les radios indépendantes se retrouvent aujourd'hui dans une situation périlleuse car elles vont devoir rembourser dans les années à venir les prêts souscrits avec la garantie de l'État. Le président du SIRTI n'a pas hésité à évoquer une « bombe à retardement » pour décrire la situation à venir. Les radios indépendantes sont le plus souvent des PME familiales confrontées à des problèmes de trésorerie. Selon le SIRTI, 38 % des dirigeants de ces petites entreprises estiment que l'existence de leur radio est menacée. Le SIRTI demande donc qu'en l'absence de mesure d'aide générale puissante du type « crédit d'impôt », les radios indépendantes puissent bénéficier d'annulations de charges sur au moins un trimestre.
Les télévisions locales connaissent les mêmes difficultés que les radios indépendantes. Alors que la charge de travail de leurs personnels a augmenté du fait de la forte demande d'information locale, ces chaînes ont subi une perte de chiffre d'affaires d'environ 20 %. Cette fragilité risque de se transmettre à l'ensemble de l'écosystème local de la production (baisse des commandes de documentaires et réduction des captations de spectacles vivants). Les conséquences sur l'emploi devaient également être importantes avec le non-renouvellement des CDD.
Les représentants des télévisions locales demandent donc à pouvoir bénéficier d'un plan de soutien qui pourrait prendre la forme soit d'exonérations des charges sociales patronales, soit l'instauration d'un taux de TVA à 0 % pour les contrats d'objectifs et de moyens (COM) signés avec les régions, soit la création d'un fonds d'aide pour prendre en charge tout ou partie de leurs frais de diffusion.
e) Un impact limité sur l'audiovisuel extérieur
France Médias Monde a fait face à une baisse de ses recettes publicitaires de - 1,6 M€ au cours des mois de mars et avril et a dû engager pour + 1,1 M€ de dépenses pour protéger les salariés (achats de masques, nettoyage des locaux, distanciation sociale sur les lieux de travail...). L'impact de la crise sur les comptes demeure donc raisonnable et la présidente de l'entreprise, Marie-Christine Saragosse, consciente des grandes difficultés que rencontrent d'autres médias, ne demande pas d'aide particulière.
Le plan de départs volontaires prévu pour 30 salariés a, par ailleurs été maintenu, avec pour conséquence la recherche de nouvelles synergies entre les rédactions arabophones.
f) Le groupe Canal + « à la croisée des chemins »
Le groupe Canal + a été pénalisé par le confinement du fait de la fermeture de la moitié environ de ses points de souscription (boutiques Orange, SFR, Bouygues ; magasins Darty, Fnac, Boulanger...). Malgré ces circonstances, Canal + continue à améliorer sa situation grâce notamment à de nombreux accords de distribution (Netflix, Disney +, Be In sport) et l'acquisition de nouveaux droits sportifs (Ligue des champions à partir de 2021).
Le président du directoire de Canal +, Maxime Saada, a déclaré lors de son audition par le groupe de travail qu'il restait nécessaire de rééquilibrer les conditions de la concurrence avec les plateformes. Il a appelé à une évolution de la règlementation concernant tant les droits attachés à la production que la fiscalité. Il a déploré que le taux de TVA appliqué aux abonnements soit passé en quelques années de 5,5 % à 7 % puis à 10 % aujourd'hui en estimant qu'il s'agissait d'un facteur important de perte de compétitivité pour le groupe. Il a appelé à un geste fort en termes de fiscalité pour renforcer l'ancrage français de Canal +.
g) Un secteur de la production fortement impacté par la crise sanitaire
Le secteur de la production a été plus fortement atteint que les chaînes. Les tournages ont, en effet, été arrêtés dès l'annonce du confinement et si certains tournages ont repris depuis la fin du mois de mai, ils ne concernent qu'une partie des formats (les séries quotidiennes et les émissions de plateau notamment) et s'accompagnent d'un protocole sanitaire très exigeant. Dans ces conditions, les chaînes risquent d'être confrontées à un problème quantitatif pour alimenter leurs grilles de programmes tandis que le coût de ces programmes est voué à augmenter pour tenir compte des nouvelles précautions sanitaires.
Lors de leur audition par le groupe de travail, les producteurs ont confirmé le diagnostic des chaînes. La présidente de Newen a ainsi évoqué un véritable « tsunami », expliquant que les 150 épisodes de fiction quotidienne qui n'avaient pas pu être tournés étaient définitivement perdus.
Le problème de la prise en charge du risque « Covid » par les assurances a été largement évoqué par les responsables auditionnés. Soit les assureurs refusent de prendre en charge ce risque soit la prime est tellement élevée qu'elle en devient dissuasive. Le groupe Newen a ainsi indiqué 44 ( * ) qu'il avait décidé de reprendre le tournage de ses séries quotidiennes comme « Plus belle la vie » sans être assuré, ce qui constitue un « énorme risque » selon ses responsables. Dans ces conditions, la mise en place du fonds de soutien du CNC annoncée par le ministère de la culture ainsi que le maintien du chômage partiel ont été considérés comme des dispositions essentielles.
Les responsables de Newen ont insisté lors de leur audition sur le rôle tout à fait essentiel des séries quotidiennes pour structurer l'économie de la profession. Le tournage des 260 épisodes d'une saison de « Plus belle la vie » mobilise environ 300 ETP par épisode, ce qui correspond à environ 1 500 personnes compte tenu des roulements. Le processus industriel mis en place permet à des centaines de jeunes de se former aux métiers de l'audiovisuel. Il était dans ces conditions indispensable de reprendre les tournages pour préserver toute une filière économique. Le groupe de production a donc créé un livre blanc consacré au déconfinement des tournages qui a pour objectif à la fois de rassurer l'ensemble des parties prenantes et de bien établir les responsabilités de chacun.
Le problème de la reprise des tournages a également été soulevé par le président de Mediawan, Pierre-Antoine Capton 45 ( * ) , qui a salué la mise en place d'un fonds de soutien doté de 50 M€ tout en regrettant que ce fonds ne puisse intervenir pour les coproductions européennes. Les émissions de flux comme « Le Grand échiquier » en sont également exclues alors même que les coûts de fabrication ont fortement augmenté.
Pierre-Antoine Capton a insisté sur le rôle du service public pour soutenir la filière de la production et sur la possibilité de faire des économies sur les tournages. Il a également évoqué la nécessité de donner plus de place à l'innovation dans les formats après avoir observé que les grandes chaînes ne mettaient aucune émission nouvelle de flux à l'antenne depuis de nombreuses années.
2. Un certain retard dans la mobilisation des soutiens publics aux médias
a) Des mesures de soutien ponctuelles indispensables qui tardent à arriver
Dès le mois de mars, les entreprises de médias ont averti qu'elles auraient besoin d'être aidées afin de pouvoir faire face aux conséquences de la crise économique sur leur modèle économique . Lors de son audition par le groupe de travail, le président du CSA a insisté sur la nécessité de « redonner de l'oxygène » au secteur en assouplissant la réglementation, en revisitant la trajectoire financière du service public et en engageant la transcription de la directive SMA...
Le groupe de travail ne peut que regretter que plus de deux mois après le début de la crise les décisions quant à d'éventuelles aides publiques à destination des médias soient encore à l'arbitrage et que le plus grand flou subsiste quant au périmètre, au montant et aux bénéficiaires d'un tel soutien. L'absence de débat public sur les mesures à adopter laisse également craindre que les décisions portent davantage la marque des actions de lobbying d'acteurs aux intérêts contradictoires que celle d'une vision assumée de l'avenir du secteur.
Au final, il semble que le soutien au secteur audiovisuel ne constitue pas aujourd'hui une priorité du Gouvernement . Si on peut comprendre que ce dernier porte une attention plus soutenue aux secteurs qui ont été en « première ligne », il convient de rappeler que le « poids » du secteur audiovisuel et de la production équivaut à celui de nombreux secteurs industriels plus traditionnels 46 ( * ) qui réussissent aujourd'hui à se faire entendre davantage.
b) Une clarification nécessaire du financement des médias audiovisuels
Concernant tout d'abord le financement des médias, la commission de la culture a répété depuis 2015 que la réforme des structures et de la gouvernance de l'audiovisuel public était inséparable de la réforme de son financement . La crise sanitaire est venue rappeler l'urgence d'une clarification et les inconvénients d'un financement mixte de l'audiovisuel public reposant très majoritairement sur une ressource publique mais également sur des recettes publicitaires (à hauteur d'environ 10 %).
Avec la chute de leurs revenus publicitaires (de 40 % en mars puis de 70 à 80 % au mois d'avril), les chaînes et les radios privées ont pris la mesure de la concurrence exercée par France Télévisions et Radio France sur le marché publicitaire. Les responsables de TF1 et de M6 ont regretté par ailleurs que les régies des deux sociétés publiques n'aient pas hésité à proposer des tarifs très attractifs à leurs annonceurs avec pour effet de renforcer la baisse de leurs propres revenus.
c) Des incohérences réglementaires à lever rapidement
Lors de son audition, le président du CSA, Roch-Olivier Maistre, a reconnu qu'il était paradoxal que les chaînes de télévision puissent faire de la publicité pour Netflix mais par pour les films qu'ils coproduisent. Il a également convenu qu'il pourrait être pertinent d'aller plus loin sur la publicité adressée.
Par ailleurs il apparaît aujourd'hui que le projet de loi de réforme de l'audiovisuel n'est sans doute pas allé assez loin sur la question de la régulation des données qui constitue pourtant « le nerf de la guerre » de la nouvelle économie des médias. Or les plateformes refusent toujours de rendre des comptes au régulateur de l'audiovisuel sur l'utilisation qu'elles font des données de leurs utilisateurs.
LES 10 PROPOSITIONS DU GROUPE DE TRAVAIL
I. REDONNER À LA POLITIQUE PUBLIQUE EN FAVEUR DU SECTEUR AUDIOVISUEL UN CARACTÈRE PRIORITAIRE
1. Accorder au secteur de l'audiovisuel le soutien correspondant à son poids économique et à son rôle démocratique et culturel
Le groupe de travail a constaté que, malgré une mobilisation précoce des acteurs du secteur des médias - dès le mois de mars -, les pouvoirs publics n'ont toujours pas élaboré de « plan d'action » global en sa faveur reposant sur une vision ambitieuse de l'avenir du secteur.
La crise sanitaire a pourtant mis en évidence que les dispositions de la loi audiovisuelle étaient insuffisantes pour assurer l'avenir des médias français. Le débat devrait donc moins porter - comme c'est le cas aujourd'hui - sur les moyens de mettre en oeuvre partiellement cette réforme et davantage sur la possibilité de dépasser le texte qui a été élaboré à l'automne dernier pour inclure d'autres dimensions essentielles qui étaient insuffisamment prises en compte (réforme de la CAP, modernisation de la réglementation de la production, allègement des contraintes imposées aux acteurs...).
Le secteur des médias ne peut pas être le « grand oublié » des plans de relance. L'écosystème des services médias audiovisuels est bouleversé et le retour à l'équilibre antérieur (si tant est qu'il y en eût un) est très peu probable. Les pouvoirs publics sont contraints à intervenir massivement et rapidement.
Le groupe de travail préconise donc qu'un véritable « plan d'actions » en faveur de l'audiovisuel et de la production soit élaboré comportant des mesures tant conjoncturelles que structurelles.
Des mesures à effet immédiat sont, en effet, nécessaires pour permettre aux entreprises de préserver leurs investissements et leurs moyens humains (outre des crédits d'impôts, des exonérations de taxes ou des aides concernant les frais de diffusion peuvent être envisagées), mais l'avenir du secteur repose aussi sur des mesures de plus long terme portant en particulier sur la réglementation du secteur pour rétablir des conditions de concurrence plus justes avec les plateformes anglo-saxonnes de vidéo par abonnement. Ce plan d'actions doit permettre de soutenir une filière économique - qui pèse autant que d'autres secteurs industriels comme l'automobile - mais également de préserver notre exception culturelle.
II. CONSOLIDER LE SERVICE PUBLIC DE L'AUDIOVISUEL
2. Assurer la pérennité du service public de l'audiovisuel en lui garantissant dans la durée des moyens suffisants
Les entreprises de l'audiovisuel public ont été au rendez-vous de la crise sanitaire en termes d'information, d'accès à la culture et au patrimoine cinématographique, et de programmes éducatifs et d'animation. Cette situation a renforcé l'intérêt de disposer d'un audiovisuel public puissant doté de moyens suffisants. Or le choix qui a été fait depuis 2017 de mettre l'audiovisuel « sous tension » budgétaire risque aujourd'hui de devenir contreproductif compte tenu des risques financiers qui menacent ces entreprises (baisse des ressources propres, hausse de nombreux coûts).
Le Gouvernement a défini une trajectoire financière de l'audiovisuel public qui prévoit une baisse de 190 M€ des moyens des sociétés de l'audiovisuel public sur la période 2018-2022. La mise en oeuvre de cette trajectoire financière a demandé des efforts importants de la part des entreprises concernées en particulier en 2019 et 2020. Les dirigeantes des entreprises publiques auditionnées par le groupe de travail n'ont pas demandé la remise en cause de cette trajectoire financière d'autant plus que cette perspective semble avoir été exclue par le ministère des Finances lors de plusieurs réunions menées en mai.
A défaut de remettre en cause - ou tout du moins de suspendre pour une certaine durée - cette trajectoire, le groupe de travail estime indispensable d'adapter les efforts demandés à la situation de chaque entreprise afin de tenir compte de la mobilisation exceptionnelle des personnels pendant la crise sanitaire et de la nécessité de préserver le niveau de qualité de l'offre de l'audiovisuel public.
Le groupe de travail estime, par ailleurs, qu'il ne serait pas souhaitable que les entreprises de l'audiovisuel public soient obligées de supporter des déficits importants en 2020 qui seraient la conséquence d'un non choix consistant pour l'actionnaire à ne pas augmenter leurs moyens et pour les entreprises à ne pas réduire leurs charges . Depuis 2015, les entreprises de l'audiovisuel public ont fait de gros efforts pour revenir vers des résultats équilibrés ; plus que jamais il convient de rappeler que le fait de « laisser filer les déficits » ne constitue ni une solution durable, ni une politique responsable.
3. Mener à son terme la réforme de l'audiovisuel public afin de favoriser les mutualisations, les économies et les projets innovants
La crise sanitaire a donné lieu à un renforcement des coopérations entre les entreprises de l'audiovisuel public (achat en commun de masques par exemple). Elle a aussi montré les limites de l'organisation actuelle puisque les matinales communes entre France 3 et France Bleu ont été arrêtées dès le début du confinement alors même qu'elles auraient pu jouer un rôle important pour informer les Français au plus près des territoires. Par ailleurs, les faibles performances de la chaîne publique Franceinfo ont également illustré les difficultés d'organisation de cette chaîne qui ne peut s'appuyer sur l'ensemble des moyens dont disposent le service public et la nécessité de renforcer les mutualisations.
Dans ces conditions, le regroupement des sociétés de l'audiovisuel public apparaît toujours comme une nécessité à la fois pour réaliser des économies de moyens et pour développer des offres véritablement communes notamment dans l'information et à travers le numérique.
4. Préserver la diffusion hertzienne de France 4 et sa programmation dédiée à la jeunesse et à l'éducation
Le désaccord exprimé par la commission de la culture lors de l'annonce de l'arrêt de la diffusion hertzienne de France 4 n'a pu qu'être renforcé par le repositionnement de la chaîne opéré par la direction du groupe public dès le début de la crise sanitaire et l'intérêt qu'a suscité cette nouvelle offre gratuite, accessible et pertinente.
Cette expérience a démontré que ce n'était pas l'existence d'une chaîne dédiée à la jeunesse qui devait se poser mais tout simplement sa ligne éditoriale et les moyens qui lui étaient dédiés .
France 4 a montré pendant la période de confinement son utilité sociale. Mais cette pérennisation doit se faire sous conditions claires : il ne s'agit toutefois pas de revenir à l'état ex-ante où les performances de France 4 en matière d'audience étaient modestes. Il s'agit de « construire un nouveau France 4 » sur les bases de ce qui a fait sa réussite récente : programmes éducatifs et divertissement pour les publics scolaires. Il faut un vrai cahier des charges pour le nouveau France 4.
Comme l'a expliqué Delphine Ernotte lors de son audition par le groupe de travail : « la mission éducative de France 4 est une question politique et non économique » même si le maintien de la diffusion hertzienne de cette chaîne aurait un coût estimé par la direction du groupe entre 10 et 15 M€.
Dans ces conditions, le groupe de travail ne peut que réitérer son souhait que le Gouvernement revienne sur sa décision de supprimer la diffusion hertzienne de France 4 .
III. ACCOMPAGNER LA RELANCE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR DES MÉDIAS DE MANIÈRE CIBLÉE
5. Adopter une mesure générale et temporaire de soutien aux investissements des éditeurs dans la production et dans l'information
L'ensemble des médias audiovisuels a été durement fragilisé par la crise sanitaire du fait de la baisse de leurs ressources propres. Si le choc a été amorti par la CAP pour les entreprises publiques et par les abonnements pour la télévision payante, il a été massif pour les grandes chaînes de télévisions et les radios privées financées quasi exclusivement par la publicité. Les chaînes locales et les radios indépendantes ont également été sévèrement fragilisées.
L'ensemble des acteurs ont défendu depuis le mois de mars la création d'un « crédit d'impôt communication » au bénéfice des annonceurs qui permettrait de dynamiser le chiffre d'affaires publicitaire des médias mais également de soutenir la reprise de la consommation, du fait de l'effet démultiplicateur de la publicité sur les ventes.
Le coût d'une telle mesure 47 ( * ) , même limitée dans sa durée d'application, constitue néanmoins un obstacle à son adoption. C'est pourquoi le groupe de travail préconise la mise en place d'un crédit d'impôt réservé aux éditeurs de programmes et ciblé sur leurs investissements dans la production et l'information . Cette mesure - plus ciblée qu'un crédit d'impôt ouvert à tous les annonceurs - pourrait s'appliquer pendant un an afin d'accompagner les acteurs tout au long de la reprise de l'activité et les inciter à augmenter leurs investissements dans la production et l'information, deux secteurs clé pour l'avenir de notre secteur audiovisuel. Une telle mesure devrait cependant être ciblée et ne pas exclure les programmes de flux 48 ( * ) et le divertissement qui constituent des secteurs importants. Il conviendrait toutefois d'exclure les achats de programmes étrangers extra-européens afin de préserver l'effet de « relance » d'une telle initiative.
6. Clarifier le modèle de financement de l'audiovisuel public et privé (réforme de la CAP, suppression progressive de la publicité sur le service public)
La crise a mis en évidence les fragilités intrinsèques du modèle économique du secteur de l'audiovisuel français. Elle a rendu difficilement supportable pour les chaînes hertziennes et les radios privées - financées quasiment uniquement par les recettes de publicité - la « ponction » opérée par France Télévisions et Radio France sur le marché publicitaire (à hauteur d'environ 400 M€ par an). Les médias privés ont, par ailleurs, regretté la politique tarifaire pratiquée par les régies publicitaires des deux sociétés publiques pendant la crise sanitaire qui aurait tiré les prix « vers le bas ».
Le groupe de travail estime impératif, dans ces conditions, de rouvrir dans le PLF 2021 le chantier du financement de l'audiovisuel public . La modernisation de la CAP constituait « l'angle mort » du projet de loi de réforme de l'audiovisuel déposé au Parlement alors même que la prévisibilité de ses ressources constitue aujourd'hui le fondement même de l'indépendance de tout service public de l'audiovisuel.
Il importe donc aujourd'hui de garantir à l'audiovisuel public des moyens pour assurer son indépendance dans la durée. Cet objectif ne pourra être atteint selon le groupe de travail que par la création d'une « nouvelle redevance » qui ne sera plus assise sur la détention d'un téléviseur mais sur le fait que tous les foyers ont aujourd'hui accès aux programmes de l'audiovisuel public sur tous les supports (postes de télévision et de radio, tablettes, ordinateurs, téléphones intelligents).
La crise sanitaire a également mis en évidence la nécessité de réduire la dépendance de l'audiovisuel public à la publicité sans pour autant diminuer ses moyens . C'est la raison pour laquelle le groupe de travail propose que la réforme de la CAP à travers la création d'une contribution universelle s'accompagne d'une mise à l'étude des possibilités de supprimer la publicité sur l'ensemble des antennes du service public. Ce processus pourrait être progressif et commencer par la suppression de la publicité le week-end afin de renforcer la spécificité des programmes. L'objectif pourrait être d'aboutir à la suppression totale de la publicité d'ici 2025, c'est-à-dire à la fin du mandat théorique du prochain président de France Télévisions. A cette date il conviendrait qu'une « nouvelle CAP », dont les critères essentiels (tarifs, redevables...) pourraient être définis par une commission indépendante, apporte les moyens suffisants aux entreprises de l'audiovisuel public.
7. Mettre à contribution les plateformes de vidéos par abonnement en transcrivant rapidement la directive SMA
Les industries culturelles sont parmi les secteurs les plus touchés par la crise du coronavirus. Dans le même temps, les grandes plateformes de vidéo à la demande comme Netflix, Amazon Prime et Disney + connaissent une expansion sans précédent. Il existe donc un déséquilibre inquiétant, au détriment des créateurs français et de notre diversité culturelle.
La transcription rapide de la directive « Services de médias audiovisuels » (SMA) permettrait à la fois de rétablir un équilibre entre les acteurs historiques et les nouveaux acteurs mais également de dynamiser l'investissement dans la production et de permettre le développement de cette filière.
Le groupe de travail demande donc que la transcription de cette directive intervienne dans les meilleurs délais et que le Parlement soit étroitement associé à la détermination des contreparties qui pourraient être accordées aux plateformes notamment au regard de la chronologie des médias .
Plusieurs dirigeants de chaînes se sont en effet inquiétés auprès du groupe de travail du risque qu'il pourrait y avoir que les plateformes se voient accorder un régime très favorable concernant la diffusion des films de cinéma. Or il serait paradoxal que la mise en oeuvre d'une disposition ayant pour but de développer la création française et européenne aboutisse à une nouvelle distorsion de concurrence au détriment des acteurs nationaux.
8. Préserver la diversité audiovisuelle en soutenant particulièrement les radios indépendantes et les télévisions locales
Les radios indépendantes et les télévisions locales ont été très durement pénalisées par les conséquences économiques de la crise sanitaire. Or elles ne disposent ni de la surface financière des grands groupes de médias privés qui éditent les chaînes nationales de la TNT, ni de la sécurité que représente le financement public de la CAP pour l'audiovisuel public.
Dans ces conditions, le groupe de travail estime nécessaire de prévoir une aide spécifique, au-delà de la mesure d'ordre général qu'il préconise, adaptée à la situation des radios indépendantes et des télévisions locales. Cette aide pourrait prendre la forme d'une prise en charge des frais de diffusion par un fonds public dédié pendant une durée suffisante, le cas échéant à travers un mécanisme dégressif dans le temps.
IV. PROMOUVOIR DES PROGRAMMES DE QUALITÉ ET ATTRACTIFS
9. Renforcer l'attractivité des chaînes d'information en continu
La crise sanitaire a démontré le caractère fondamental des programmes d'information tant privés que publics. Les « JT » des grandes chaînes ont retrouvé leurs audiences passées tandis que les chaînes d'information continu ont largement augmenté leurs audiences à l'exception de Franceinfo dont le format a démontré ses limites pour rendre compte d'une crise majeure.
Une information de qualité, fondée sur la vérification des faits, le pluralisme et une certaine impartialité n'a jamais été aussi importante pour préserver le fonctionnement de notre démocratie. Cette situation justifie d'aménager autant que nécessaire les conditions d'exercice des médias d'information. Le groupe de travail propose donc que les chaînes d'information de la TNT soient regroupées dans un « bloc unique » en réorganisant la numérotation. Les règles qui régissent les mutualisations au sein des groupes de médias possédant une chaîne d'information ont déjà été assouplies à l'initiative du CSA. Il semble cependant essentiel de donner un caractère pérenne au principe des mutualisations concernant l'information (en autorisant par exemple la codiffusion de programmes à la télévision comme c'est déjà le cas entre une radio et une télévision).
10. Assouplir la réglementation de la production afin de favoriser les investissements
La réforme de l'audiovisuel comportait trop peu de mesures visant à alléger les contraintes imposées aux chaînes de télévision. Les avancées relatives à la publicité sur le cinéma et à la publicité adressée étaient tellement encadrées que les chaînes s'interrogeaient sur la possibilité de les mettre en oeuvre. Concernant la réglementation de la production, la demande de nombreuses chaînes de pouvoir bénéficier de davantage de droits n'a pas reçu la réponse espérée.
La crise sanitaire devrait compliquer encore la situation puisque les obligations des chaînes étant calculées sur leur chiffre d'affaires, la baisse de ce dernier aura pour conséquence de réduire mécaniquement les obligations d'investissement des chaînes. Pourtant, les responsables de chaînes auditionnés ont tous affirmé que leur priorité était moins de réduire leur investissement que de pouvoir mieux les orienter en fonction des attentes du public.
Certains acteurs ont ainsi demandé de pouvoir fusionner les obligations des chaînes en matière de cinéma et de production audiovisuelle afin de permettre aux chaînes de financer plus de films ou plus de séries selon les moments. Sans aller jusqu'à une fusion totale des obligations, le groupe de travail propose de mettre à l'étude la possibilité de créer une « zone de souplesse » dans les obligations actuelles de financement. À côté de l'obligation de financer le cinéma et de l'obligation de financer la production audiovisuelle pourrait ainsi être créée une troisième obligation « mixte » permettant aux éditeurs de programmes de financer soit des films soit des séries en fonction de leurs projets. Une concertation pourrait être organisée entre les éditeurs et les producteurs afin de définir les engagements que pourraient prendre les chaînes afin de bénéficier de cette « clause de souplesse » ainsi que les conditions de suivi et d'évaluation de cet aménagement.
X. PRESSE
Le groupe de travail « Presse » de la commission de la culture animé par Michel Laugier (Yvelines, UC-A) est composé de David Assouline (Paris, socialiste et républicain), Max Brisson (Pyrénées-Atlantiques, LR) et Céline Brulin (Seine-Maritime, CRCE).
Le groupe de travail sur la presse a procédé à plusieurs auditions, qui ont toutes souligné les difficultés extrêmes du secteur. La presse est en effet aujourd'hui confrontée à trois défis, dont deux qui préexistaient à l'épisode actuel de confinement . Chacun justifierait une attention particulière des pouvoirs publics. Cumulés, ils constituent un risque mortel pour l'ensemble du secteur.
Tout d'abord, la transition numérique en cours depuis plusieurs années, peine à déboucher sur un équilibre économique viable . En dépit des efforts des titres pour concevoir et alimenter des sites internet et promouvoir les consultations en ligne payantes ou rémunérées par la publicité, l'habitude de la gratuité comme la captation massive de valeur opérée par les plateformes en ligne ont détérioré les comptes au point de mettre en danger l'existence de nombreuses publications. La loi du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, adoptée sur la base d'une proposition de loi sénatoriale de David Assouline, n'a pas encore pu produire ses fruits en raison de l'opposition ferme de Google et Facebook. La décision de l'Autorité de la Concurrence du 9 avril 2020, qui enjoint aux plateformes de négocier avec les éditeurs la rémunération qui leur est due, ainsi que les transpositions en cours dans le autres pays européens, pourrait dans les prochaines semaines permettre de déboucher sur une solution.
Ensuite, « l'éternelle question » de Presstalis s'est de nouveau imposée dans les débats . L'annonce du dépôt de bilan de l'entreprise, redoutée depuis plusieurs années, n'est qu'un épisode supplémentaire dans la lente chute d'un opérateur qui assure la distribution de toute la presse quotidienne nationale et d'une bonne partie de la presse magazine depuis 1947. Le vote de la loi du 18 octobre 2019 de modernisation de la distribution de la presse, dont le Sénat avait été saisi en premier lieu, offre un cadre adapté pour le futur, mais n'avait pas pour objet de solder le passif d'une entreprises qui a accumulé plus de 400 millions d'euros de dettes et survit depuis des années grâce à des transferts publics massifs et au soutien « à bout de bras » des grands éditeurs qui sont aussi ses actionnaires et qui paient aujourd'hui des errements de gestion dont ils sont, en partie au moins, comptables. La situation de Presstalis, qui aurait déjà des conséquences lourdes en période normale, atteint en temps de confinement des proportions encore plus problématiques pour la filière. Les éditeurs craignent de ne pouvoir récupérer les sommes en circulation et réduisent leur exposition en limitant les quantités livrées et en décalant les sorties de nouveautés, fragilisant d'autant toute la chaîne. Aucune des deux solutions de sauvetage aujourd'hui étudiées ne semble réaliser le large consensus entre toutes les parties prenantes souhaité par les pouvoirs publics pour s'engager financièrement.
Ainsi et enfin, les conséquences du confinement impactent durement un secteur déjà largement fragilisé . La diffusion a diminué de 20 % en moyenne, les recettes publicitaires de 80 %, ce qui devrait correspondre à une baisse sur l'année de 20 % à 30 %. Les activités de diversification dans l'évènementiel sont pour leur part au point mort. Les titres sont donc confrontés à une chute simultanée de l'ensemble de leurs sources de revenus. Cette situation est d'autant plus paradoxale que la fréquentation des sites a plus que doublé la première semaine de confinement et demeure à un niveau très élevé. Cependant, ce regain d'intérêt, signe au demeurant positif de la confiance que les Français accordent à leur presse, ne se traduit pas par des revenus suffisants, loin s'en faut.
Le groupe de travail, conscient de la situation sinistrée de la presse, appelle donc à une action de soutien concertée , qui ne se limite pas à des réponses purement conjoncturelles à la crise actuelle, mais offre également un cadre clair et stabilisé pour le monde « post-Covid ».
La principale difficulté sera de concilier des mesures nécessairement transitoires destinées à « passer le cap », et une politique plus structurelle qui vise à résoudre des faiblesses anciennes.
A. UN SOUTIEN FINANCIER URGENT
Comme l'ensemble des secteurs de l'économie, mais dans des proportions beaucoup plus modestes que, par exemple, l'aviation ou l'automobile, le secteur de la presse va nécessiter un soutien public important pour l'aider à dépasser une crise dont il n'est pas responsable.
1. Aider rapidement une presse exsangue
- Monter un fonds de soutien spécifique ou s'appuyer sur les outils déjà existants comme le Fonds stratégique pour apporter dès le prochain collectif budgétaire un soutien financier aux titres de presse.
- Concentrer sur la presse les campagnes de communication institutionnelle du gouvernement, de préférence aux plateformes numériques.
- Décaler le remboursement à La Poste des frais d'affranchissement de 30 jours pour soulager immédiatement la trésorerie des entreprises de presse.
- Organiser une sortie progressive du chômage partiel pour les entreprises de presse, afin de tenir compte d'un probable décalage dans la reprise de l'activité.
2. Utiliser l'outil fiscal
Plusieurs mesures fiscales destinées à soutenir la presse sont à l'étude, certaines évoquées dans le plan filière présenté par la presse IPG en avril 2019. Il n'appartient pas au groupe de travail de se prononcer en faveur de telle ou telle, faute notamment d'évaluations financières ou d'études d'impact, mais d'attirer l'attention sur leur intérêt renforcé dans la période actuelle, où l'outil fiscal présente l'avantage de pouvoir être mis en oeuvre rapidement et d'être immédiatement lisible pour les acteurs .
À ce titre, on peut mentionner :
Ø un crédit d'impôt sur les abonnements à la presse ;
Ø une TVA à 0 % sur les publications de presse, une mesure déjà appliquée en Belgique.
La question d'un crédit d'impôt spécifiquement destiné à relancer le marché de la publicité est plus complexe. Elle s'est imposée dans les débats et reçoit aujourd'hui un large soutien , qui dépasse le cadre de la presse puisque les médias audiovisuels sont également intéressés.
Sa mise en place doit cependant être précédée d'une réflexion sur plusieurs éléments constitutifs, qui en conditionneront la faisabilité et le coût, en particulier :
• sa durée, qui doit être limitée. La mesure est actuellement présentée comme transitoire, il pourrait être difficile d'y mettre un terme une fois adoptée, tant les dommages pour le secteur seront durables ;
• son champ : faut-il une mesure large qui rassemble tous les médias, au risque de la diluer et d'en faire profiter certains acteurs moins légitimes que d'autres, ou bien la resserrer sur les médias d'information - qu'il faudrait alors circonscrire, une telle définition n'existant pas dans notre droit- ? En tout état de cause, il faudra veiller à ce que cette mesure ne bénéficie pas en premier lieu aux grands vainqueurs de la période que sont les plateformes en ligne ;
• son mécanisme : faut-il une mesure ciblée sur les annonceurs , qui déduiraient alors une fraction des dépenses de publicité de leurs impôts, ou bien centrée directement sur les diffuseurs , suivant des modalités qui restent à définir ?
En tout état de cause, la définition de ces paramètres occasionnera sans nul doute des incompréhensions entre, d'un côté, les tenants de l'orthodoxie budgétaire et de l'autre, ceux d'un soutien massif, mais également au sein même de la profession , entre différents types de médias (presse écrite, télévision..) et au sein même des familles, où chacun estimera qu'il doit en bénéficier.
B. S'ATTAQUER ENFIN AUX DIFFICULTÉS STRUCTURELLES DE LA PRESSE
La commission de la culture poursuit depuis plusieurs années une action déterminée pour faire évoluer la législation en faveur de l'indépendance éditoriale , mais également économique de la presse, que ce soit en anticipant l'adoption de la directive sur les droits voisins des éditeurs et des agences de presse, que la France a été la première à transposer, ou en amendant en profondeur la loi sur la modernisation de la distribution.
Sur ces deux dossiers cependant, qui constituent les deux défis les plus structurels du secteur, il reste encore du chemin à parcourir, ce qui est rendu d'autant plus criant que la crise actuelle agit comme un révélateur de faiblesses plus anciennes.
Les deux orientations suivantes devraient donc être suivies.
1. Responsabiliser les acteurs du dossier « Presstalis »
Il faut conditionner toute aide supplémentaire de l'État à l'émergence d'une solution acceptée par une grande majorité des éditeurs et qui règle enfin pour les prochaines années la question de la distribution. Cette solution ne doit cependant pas reposer exclusivement sur des financements publics, mais faire contribuer les actionnaires. Il est regrettable de constater une nouvelle fois, ces derniers jours, l'incapacité des acteurs à élaborer une solution commune, chacun se renvoyant la responsabilité de la situation et de la crise. La non-distribution des quotidiens nationaux dans certaines régions constitue une épreuve supplémentaire dont la filière aurait pu se passer en cette période.
2. Durcir le rapport de force avec les grandes plateformes en ligne
Il faut soutenir, au besoin par de nouvelles dispositions législatives, les efforts des éditeurs pour obtenir des plateformes la juste rémunération de leurs publications, en application de la loi sur les droits voisins. L'attitude non coopérative de Google et Facebook semblait laisser peu d'espoir de parvenir à un compromis acceptable et conforme à la lettre et à l'esprit de la loi. Il est important de laisser une chance aux négociations qui vont être lancées suite à la décision de l'Autorité de la Concurrence, mais sans naïveté excessive. Les géants du numérique doivent absolument prendre conscience de la détermination des États, plus seulement européens, à faire valoir leur souveraineté.
Récapitulatif des préconisations du groupe de travail
ü Aider rapidement une presse exsangue
Ø Monter un fonds de soutien spécifique ou s'appuyer sur les outils déjà existants comme le Fonds stratégique pour apporter dès le prochain collectif budgétaire un soutien financier aux titres de presse.
Ø Décaler le remboursement à La Poste des frais d'affranchissement de 30 jours pour soulager immédiatement la trésorerie des entreprises de presse.
Ø Organiser une sortie progressive du chômage partiel pour les entreprises de presse, afin de tenir compte d'un probable décalage dans la reprise de l'activité.
Ø Concentrer sur la presse les campagnes de communication institutionnelle du gouvernement, de préférence aux plateformes numériques.
ü Utiliser l'outil fiscal
Différents dispositifs sont à examiner, mais aucun n'a pour l'heure fait l'objet d'évaluations précises de son coût et de son impact. L'outil fiscal présente cependant l'avantage de la souplesse et de la simplicité de mise en place.
Le crédit d'impôt « annonceurs » doit en particulier être délimité avec soin. Son adoption ne doit cependant pas être l'occasion d'accentuer les fractures entre médias et au sein même des grandes familles de presse. Par ailleurs, il doit faire l'objet d'évaluations précises et être borné dans le temps.
ü Responsabiliser les acteurs du dossier « Presstalis »
Conditionner toute aide supplémentaire de l'État à l'émergence d'une solution acceptée par une grande majorité des éditeurs. Cette solution ne doit cependant pas reposer exclusivement sur des financements publics, mais faire contribuer les actionnaires.
ü Durcir le rapport de force avec les grandes plateformes en ligne
Soutenir, au besoin par de nouvelles dispositions législatives, les efforts des éditeurs pour obtenir des plateformes la juste rémunération de leurs publications, en application de la loi sur les droits voisins.
XI. SPORT
Le groupe de travail « Sport » de la commission de la culture animé par Jean-Jacques Lozach (Creuse, socialiste et républicain) est composé de Céline Boulay-Espéronnier (Paris, LR), Nicole Duranton (Eure, LR), Mireille Jouve (Bouches-du-Rhône, RDSE), Antoine Karam (Guyane, LREM-A), Claude Kern (Bas-Rhin, UC), Michel Savin (Isère, LR).
Le groupe de travail « Sport » a été constitué en mars afin d'assurer le suivi de la crise sanitaire dans le secteur du sport, d'examiner les modalités du déconfinement et de réfléchir à des mesures permettant d'accompagner la relance économique de ce secteur.
Après avoir réalisé de nombreuses auditions par visioconférence, le groupe de travail a présenté ses conclusions accompagnées d'une dizaine de propositions le mercredi 17 juin 2020 devant la commission de la culture, de l'éducation et de la communication.
A. UNE MISE À L'ARRÊT DU SECTEUR DU SPORT PENDANT LA CRISE SANITAIRE AUX CONSÉQUENCES PARTICULIÈREMENT SÉVÈRES
1. Un secteur sportif très fortement impacté par la crise sanitaire
Lors de son audition par le groupe de travail, le président du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS), Philippe Diallo, a expliqué que la situation du sport amateur était différente de celle du sport professionnel, le sport amateur ayant plus de chance de « s'en sortir » que le sport professionnel qui dépend beaucoup des recettes de billetterie (volley, basket, handball) ou des droits audiovisuels (football, rugby). Il estime que la visibilité restera limitée en l'absence de reprise des compétitions.
Philippe Diallo a distingué la phase de la crise sanitaire de la dégradation de l'écosystème sportif qui est aujourd'hui encore à l'oeuvre. L'écosystème formé par les associations sportives et les entreprises du secteur sportif a subi un coup d'arrêt général dans le fonctionnement de ses structures et dans son activité de la mi-mars à la mi-mai.
Pour ce qui concerne les opérateurs économiques, les enquêtes réalisées par COSMOS 49 ( * ) et Union Sport & cycle montrent que plus de 84 % des structures ont suspendu leur activité pendant le confinement ; 54,6 % ont placé l'intégralité de leur personnel en activité partielle ; 76 % des industriels du secteur ont connu un arrêt total ou partiel de leur production et 70 % des entreprises du secteur affirment avoir mis leurs salariés en chômage partiel.
Lors de son audition par le groupe de travail, Patrick Wolff, le président de l'Association nationale des ligues de sport professionnel (ANLSP), a indiqué que toutes les compétitions avaient été arrêtées à l'issue du discours du Premier ministre du 28 avril à l'Assemblée nationale 50 ( * ) avec pour objectif de les reprendre en septembre.
Du point de vue de la pratique sportive, on dénombrait, dès mars 2020, près de 200 000 associations sportives à l'arrêt 51 ( * ) . Sur la décision des instances fédérales et des ligues professionnelles, il a été mis un terme aux championnats professionnels d'athlétisme, de handball, de volley-ball, de hockey et de football.
Les centres de formation des clubs professionnels ont suspendu leur activité. Le ministère des sports a lui-même décidé, dès mars 2020, de fermer l'ensemble des établissements placés sous sa tutelle (écoles CREPS, INSEP).
La crise sanitaire remet également en cause l'activité des organisateurs d'événements sportifs. Amaury sport organisation (ASO) a ainsi annulé une quarantaine d'événements internationaux (le semi-marathon et le marathon de Paris, l'épreuve cycliste Liège-Bastogne-Liège, le Tour de France à la Voile, etc.).
Lorsqu'ils n'ont pas été annulés, certains événements ont été reportés. C'est le cas du Tour de France cycliste qui aura lieu du 29 août au 20 septembre 2020. La FFT a pour sa part reporté le tournoi de Roland Garros du 20 septembre au 4 octobre 2020.
Comme l'a indiqué le président du syndicat Première Ligue, Bernard Caïazzo, au groupe de travail, cet arrêt des compétitions s'est accompagné d'un arrêt des recettes qui ne devraient pas repartir avant le mois d'août. Jean-Michel Aulas a insisté sur le fait que la France était plus touchée que les autres pays européens qui, pour la plupart, ont recommencé à jouer avec des protocoles sanitaires adaptés. Pour le président de l'Olympique Lyonnais (OL), la décision d'arrêter les championnats a créé une situation concurrentielle difficile et a accru la vulnérabilité des clubs français.
Un arrêt du championnat de Ligue 1 décidé sans concertation ?
Dans quelles conditions la décision d'arrêter la Ligue 1 a-t-elle été prise ? Le président du FC Nantes, Waldemar Kita, a indiqué au groupe de travail que jusqu'à la veille de l'annonce de la décision du Gouvernement, les clubs travaillaient encore avec des médecins à l'élaboration d'un protocole de reprise des compétitions. Bernard Caïazzo a indiqué que tous les présidents de clubs avaient été surpris par l'annonce du Premier ministre car « on était dans l'idée de reprendre les matchs » a-t-il encore ajouté. « Nous n'avons pas été associés à cette décision » a conclu le président de Première Ligue qui a expliqué qu'elle relevait de l'autorité du président de la FFF et du pouvoir de police générale du Premier ministre.
Il n'y a donc eu aucune concertation ni accord des clubs pour mettre un terme prématuré à la saison 2019/2020.
Le président de Première Ligue estime que la perte des clubs de football du fait de l'arrêt des matchs devrait s'établir entre 500 et 600 M€. Il indique par ailleurs que le mercato de juin devrait être perturbé et donc moins rapporter aux clubs. Un autre point d'inquiétude concerne la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) qui aurait annoncé ne pas avoir l'intention de revoir ses critères de contrôle des clubs au cours de la saison 2020/2021.
Pour Bernard Caïazzo, une reprise des matchs à huis-clos réduirait de facto les recettes de billetterie et de marketing et aurait un impact sur le montant des droits de retransmission télévisée, le « produit » football à huis clos étant dévalorisé, les diffuseurs ne manqueront pas de renégocier le tarif des droits. Cette baisse prévisible des recettes en cas de huis clos devrait par ailleurs coïncider avec le remboursement des prêts souscrits pendant la crise 52 ( * ) , accentuant ainsi un effet de ciseaux entre recettes et charges.
Les présidents de clubs auditionnés par le groupe de travail ont demandé à pouvoir bénéficier d'un soutien public pour faire face à la dégradation de leur situation. Ils ont demandé une baisse de leurs charges sociales, les plus élevées d'Europe, et le maintien du chômage partiel jusqu'à la reprise du championnat en neutralisant la période de reprise des entraînements qui ne génère pas de recettes. Ils ont également demandé la mise en place d'un crédit d'impôt « sponsoring » afin de compenser la perte des recettes de billetterie et de sponsoring estimée à 200 M€ sur la saison 2019/2020.
2. Une situation particulièrement délicate pour les collectivités territoriales
Lors de leur audition par le groupe de travail, les représentants de l'Association nationale des élus en charge du sport (ANDES) ont expliqué que l'attention des maires avait d'abord été concentrée sur la réouverture des écoles lors de la crise sanitaire, les questions relatives au sport étant donc reportées à plus tard.
Ils ont estimé par ailleurs que le sport devrait évoluer dans le cadre de l'après-crise et que de nombreuses incertitudes se faisaient jour concernant en particulier le maintien des emplois dans les associations sportives. L'ANDES a pour sa part réalisé un guide 53 ( * ) à destination des élus afin de les aider à avancer dans la réouverture des équipements sportifs. L'association a fait part de son inquiétude que les équipements sportifs soient négligés à l'avenir, les collectivités territoriales concentrant leur soutien sur les emplois dans les associations sportives.
Les représentants de l'ANDES ont ensuite plaidé pour que les efforts afin de faire rentrer le sport à l'école soient poursuivis afin notamment de lutter contre l'obésité.
Lors de leur audition par le groupe de travail, les représentants de l'Association nationale des directeurs et intervenants d'installations et des services des sports (ANDIISS) ont pour leur part indiqué qu'il avait fallu trois semaines afin de concevoir les différents guides nécessaires pour établir les protocoles de reprise de l'activité et qu'un des enjeux avait été de communiquer afin de les faire connaître de l'ensemble des élus.
Une des difficultés rencontrées par les collectivités territoriales dans la période de déconfinement tient aux incivilités qui se sont manifestées par de nombreuses intrusions sur des équipements sportifs toujours interdits d'accès. « On n'arrive pas à faire respecter les interdictions » a reconnu un des représentants de l'ANDIISS.
Les responsables des services des sports des collectivités territoriales ont également expliqué les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du dispositif 2S2C (Sport santé - culture civisme) avec l'éducation nationale qui n'est « quasiment pas mis en place » du fait notamment de différences culturelles entre les acteurs du sport et de l'éducation et des limites imposées dans l'accueil des élèves. Le financement du dispositif n'a pas été suffisamment précisé indique un représentant de l'ANDIISS exerçant à Bordeaux.
Concernant la réouverture des piscines qui s'est accélérée en juin, l'ANDIISS alerte sur la hausse des coûts puisque la fréquentation sera moindre et en appelle à une aide publique. La crainte existe qu'en cas de canicule les installations ne soient pas en mesure de jouer leur rôle pour accueillir suffisamment le public.
B. UNE SORTIE DE CRISE DANS LE SPORT COMPROMISE PAR LA PERSISTANCE DE FRAGILITÉS FINANCIÈRES ET ORGANISATIONNELLES
La crise que connaît le secteur du sport est profonde et durable. Lors de son audition 54 ( * ) par le groupe de travail, le directeur de cabinet de la ministre des sports, Karim Herida, a estimé les pertes financières du secteur sportif à une vingtaine de milliards d'euros et a indiqué que le Gouvernement préparait un plan de relance à destination des associations sportives. Le groupe de travail constate qu'à ce jour aucun plan de relance digne de ce nom n'a été présenté et mis en oeuvre. Alors que le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), Denis Masseglia, avait estimé le 12 mai que 20 % des clubs étaient en difficulté, le groupe de travail considère que cette proportion a sans nul doute significativement augmenté à la mi-juin.
Faute de véritable soutien de l'État, la situation des clubs amateurs et professionnels pourrait même s'aggraver à mesure que les dispositifs d'aides mis en place au début de la crise seront levés et que la crise économique pourrait prendre de l'ampleur avec une hausse prévisible du nombre de faillites d'entreprises et des licenciements, y compris dans le sport.
Pour Patrick Wolff, le président de l'ANLSP : « il va falloir au moins deux saisons pour rétablir la situation d'ici 2023/2024 et il sera difficile d'obtenir une aide jusque-là ». Le déconfinement dans le sport s'accompagne donc d'une grande incertitude et suscite un début d'inquiétude quant à la pérennité de nombreuses structures. De nombreux acteurs appellent donc de leurs voeux un « plan Marshall » pour le sport pour une durée de 3 à 4 ans.
1. Des aides de portée générale insuffisantes pour permettre au secteur du sport de passer le cap de la crise
Les associations sportives ont pu très vite bénéficier des dispositions adoptées par le Gouvernement à destination des entreprises qu'il s'agisse du report des charges sociales, du régime de l'activité partielle, du financement du chômage partiel, ainsi que la garantie apportée par l'État aux emprunts souscrits auprès des établissements bancaires.
Ces mesures ont été extrêmement précieuses pour permettre à toutes ces structures, souvent de petite taille, de supporter le choc d'un arrêt le plus souvent total de leur activité. Il n'est toutefois pas acquis que ces dispositions soient aujourd'hui suffisantes compte tenu des spécificités du secteur sportif.
Le déconfinement est, en effet, plus long à s'opérer dans le secteur du sport que dans la plupart des autres secteurs économiques. Pour mémoire, on peut en effet rappeler que de nombreuses restrictions de liberté qui frappent particulièrement les activités sportives sont encore en vigueur comme : le port du masque obligatoire dans certaines circonstances, certaines limitations locales de déplacement (l'utilisation des transports en commun reste soumise à autorisation en Ile-de-France), des restrictions de rassemblements 55 ( * ) , la fermeture des frontières (les réouvertures devraient être achevées en Europe à compter du 15 juin).
En somme, si la pratique sportive individuelle est largement redevenue possible depuis le 11 mai à l'exception de certaines activités 56 ( * ) , les sports collectifs demeurent contraints et le retour à la normale pour l'organisation des événements sportifs reste incertain. Le secteur du sport, qui a été plus impacté que beaucoup d'autres secteurs depuis le début de la crise sanitaire, continuera donc à subir les conséquences des précautions sanitaires plus longtemps que d'autres domaines d'activité qui ont déjà engagé le retour à la normale de leur activité.
Sur le plan de la pratique, le groupe de travail salue les efforts déployés par le ministère des sports et les fédérations afin de déterminer des protocoles adaptés à la reprise de chaque activité sportive. Un guide a même été diffusé qui recense l'ensemble des bonnes pratiques57 ( * ). D'autres guides ont également été réalisés qui s'adressent aux collectivités territoriales, aux sportifs de haut niveau et au corps médical intervenant dans le secteur sportif.
En dépit de ces efforts pour favoriser le déconfinement du sport, beaucoup trop de nuages continuent à obstruer l'horizon du secteur sportif, notamment professionnel. Comme l'a indiqué Patrick Wolff lors de son audition, si le football professionnel peut envisager de reprendre les compétitions en août à huis clos compte tenu du poids des droits télévisés dans ses recettes 58 ( * ) , ce n'est pas le cas des autres disciplines, notamment le rugby et les sports de salle, dont la majorité des recettes est issue de la billetterie et des recettes de marketing. Les clubs sont inquiets du maintien de leurs partenariats avec les sponsors et les collectivités territoriales dont les priorités pourraient changer à l'issue de la crise sanitaire.
Pour les présidents des ligues professionnelles, il est fondamental que les compétitions puissent reprendre normalement en septembre au plus tard.
2. Des difficultés structurelles accentuées par la crise sanitaire
Lors de son audition par le groupe de travail, le directeur de cabinet de la ministre des sports a indiqué que la crise devait être l'occasion de renforcer la place du sport dans la société et de repenser le modèle économique du sport. Il a également déclaré que la nouvelle Agence nationale du sport (ANS) présentait beaucoup d'intérêt pour répondre aux enjeux et qu'il fallait accélérer sa mise en oeuvre.
Le groupe de travail ne peut que souscrire à l'idée de repenser le modèle économique du sport. Pour autant la réalité de la situation des clubs reste très éloignée d'une telle idée. Leur affaiblissement financier est tel que le risque de prise de contrôle par des fonds d'investissement notamment chinois ne peut être exclu selon Patrick Wolff. Le risque existe aussi de perte de contrôle de l'organisation des compétitions pour les fédérations et les ligues professionnelles.
L'affaiblissement des clubs professionnels français risque par ailleurs d'être durable puisque les détenteurs des droits de retransmission télévisée ont déjà annoncé leur intention de renégocier le prix des contrats en cas de huis clos au motif que le spectacle proposé ne serait plus le même.
Une autre menace concerne le « trading » de joueurs qui constitue une source importante de revenus pour de nombreux clubs. La dégradation générale de la situation financière des clubs en Europe devrait inévitablement réduire l'attrait pour l'achat de joueurs français. Une telle perspective, si elle devait se confirmer, pourrait grandement fragiliser la politique de formation de nombreux clubs - notamment en deuxième division - qui ont bâti leur modèle économique autour de la formation et de la vente de joueurs.
LES 10 PROPOSITIONS DU GROUPE DE TRAVAIL
I. ACCÉLÉRER LES MESURES D'AIDES AU SECTEUR DU SPORT AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD
1. Mettre en place un plan global pour soutenir le secteur du sport à la rentrée de septembre 2020
Le secteur du sport a bénéficié des puissants dispositifs mis en place par l'État pour soutenir les entreprises et le secteur associatif pendant la crise sanitaire. A contrario le même secteur du sport a beaucoup souffert de la décision prise par l'État de mettre un terme, de manière prématurée, aux championnats professionnels. Ce grave préjudice - dont on ne mesure pas encore exactement l'étendue - justifie pleinement aujourd'hui que l'État s'engage à mobiliser des moyens particuliers pour aider les clubs victimes de la crise sanitaire et d'une décision unilatérale de la puissance publique.
Le groupe de travail considère que ces mesures doivent reposer sur le maintien pendant plusieurs mois encore des dispositifs généraux mis en place depuis le mois de mars (report des charges sociales, régime de l'activité partielle, financement du chômage partiel, garantie apportée par l'État aux emprunts souscrits auprès des établissements bancaires) et des aides spécifiques au secteur du sport.
Les aides spécifiques pourraient quant à elles porter sur la fiscalité propre au sport (« taxe Buffet ») mais également sur une aide à destination des jeunes pour encourager leur inscription dans des clubs, sur un assouplissement de la « loi Évin » et sur un accompagnement financier des athlètes français engagés dans la préparation des Jeux olympiques de Tokyo . Le groupe de travail souscrit également à la proposition faite par le groupe de suivi de l'application de l'état d'urgence sanitaire dans les domaines des sports et de la vie associative de l'Assemblée nationale 59 ( * ) de créer un fonds de soutien spécifique au bénéfice des associations et des clubs sportifs amateurs dans le cadre du plan de relance envisagé par le Gouvernement .
Le groupe de travail considère par ailleurs que ces nouvelles aides doivent s'accompagner de contreparties de la part du secteur sportif.
Les clubs pourraient, par exemple, pérenniser leur implication dans le dispositif 2S2C (Sport santé - culture civisme) afin de faire vivre le lien encore fragile qui a été créé entre les structures sportives et l'éducation nationale.
Les clubs pourraient également s'engager plus fortement dans la voie d'une maîtrise des salaires qui constituent un facteur de fragilisation du sport aux yeux de nos concitoyens dans le contexte économique dégradé que nous sommes appelés à connaître dans les prochains mois. Le problème des salaires excessifs concerne un petit nombre de sportifs d'un nombre restreint de disciplines qui ont en commun de bénéficier d'une forte exposition télévisée (football, rugby, tennis, vélo...). Toute régulation est compliquée par le fait que les sportifs sont mobiles et pourraient fuir le pays qui déciderait de limiter unilatéralement les salaires. C'est pourquoi une régulation des salaires devrait d'abord être recherchée au niveau européen.
Le groupe de travail rappelle cependant que la proposition n° 14 du rapport de février 2017 sur la gouvernance du football 60 ( * ) prévoyait d' « instituer un plafonnement de la masse salariale (« salary cap ») en Ligue 2 calculé en fonction du chiffre d'affaires de chaque club pour préserver la pérennité de chacun d'entre eux » .
Jamais sans doute il n'a été aussi nécessaire de concilier un effort de solidarité nationale envers le secteur du sport avec un engagement de ce dernier pour réguler l'inflation des salaires qui renforce la distance entre certains sportifs et la société.
II. SOUTENIR LES CLUBS POUR ACCROÎTRE LEUR RÉSILIENCE FACE À LA CRISE
2. Créer un crédit d'impôt dédié aux annonceurs dans le sport
La crise sanitaire a eu pour conséquence d'arrêter les compétitions et, par là-même, de supprimer la visibilité des annonceurs lors des compétitions sportives. Le risque est grand que ces annonceurs ne reviennent pas lors de la reprise des compétitions, ce qui aurait pour conséquence de réduire les ressources propres des clubs alors que ces dernières constituent un élément clé de l'amélioration de leur modèle économique.
Afin d'inciter les annonceurs du sport à maintenir leur implication dans le sport, le groupe de travail propose la création d'un crédit d'impôt « annonceurs » qui permettrait d'encourager l'achat d'espaces publicitaires dans les stades et sur les abords des compétitions . Ce dispositif pourrait, bien sûr, être intégré à un dispositif plus large concernant les annonceurs dans les médias audiovisuels et la presse tel qu'il a été soutenu par la commission de la culture lors de l'audition du ministre de la culture le 16 avril dernier 61 ( * ) . Mais à défaut de crédit d'impôt annonceurs d'application générale, le groupe de travail soutient une mesure plus limitée qui ne s'appliquerait qu'au secteur du sport.
3. Assouplir la loi Évin dans les enceintes sportives avec une évaluation en 2022
Dans un rapport publié le 22 février 2017 par la commission de la culture et consacré à la gouvernance du football 62 ( * ) , les rapporteurs, Jean-Jacques Lozach et Claude Kern, membres du présent groupe de travail, indiquaient déjà qu'une modification de la « loi Évin » autorisant la vente d'alcool dans les stades ainsi que la publicité pour certaines boissons alcoolisées permettrait de rapporter entre 30 et 50 M€ aux clubs professionnels.
Cette évolution de la législation a été jusqu'à présent contrariée par un débat légitime concernant les enjeux de santé publique. Une telle autorisation des boissons alcoolisées dans les stades ne présenterait-elle pas un risque pour la santé des spectateurs et pour la sécurité ? Si ce débat a pu être justifié lorsque la « loi Évin » a été adoptée, les circonstances ont changé du tout au tout depuis une vingtaine d'années. La violence dans les stades a été largement jugulée et le public canalisé. Les problèmes se concentrent aujourd'hui sur les abords des enceintes sportives où la consommation d'alcool n'est pas contrôlée, notamment les alcools du groupe 4, les plus nocifs 63 ( * ) .
Par ailleurs, le régime d'autorisation qui permet aux clubs de vendre de l'alcool dix fois par saison n'est pas satisfaisant. Pourquoi, en effet, limiter à dix ces exceptions si elles ne posent pas de difficulté ? Par ailleurs, le contrôle de ces exceptions apparaît pour le moins défaillant ce qui crée des inégalités entre les clubs qui ne sont pas acceptables.
Le groupe de travail propose donc d'autoriser la consommation dans les stades de certains alcools 64 ( * ) et certaines publicités pendant deux ans, jusqu'à la fin de la saison 2021/2022, et ensuite de réaliser une évaluation indépendante pour pérenniser ou non cette évolution . Un tel assouplissement doit permettre de favoriser le retour des supporteurs dans les stades lorsque les contraintes portant sur les grands rassemblements seront levées et d'aider économiquement les clubs.
4. Élaborer un mécanisme de garantie du paiement aux pour les collectivités territoriales des redevances d'occupation demandées aux clubs professionnels pour l'usage des enceintes sportives
Les collectivités territoriales restent propriétaires de la très grande majorité des infrastructures sportives locales qui sont louées aux clubs pour une durée variable. Dans le football, l'Olympique lyonnais (OL) est le seul club à être devenu propriétaire de son enceinte afin de conforter son modèle économique. A Paris, la ville a choisi la voie de la convention d'occupation du domaine public pour mettre le Parc des Princes à disposition du PSG. À Lens, un bail emphytéotique de 50 ans confère au club local toutes les prérogatives du propriétaire. Dans les autres villes, le stade est le plus souvent mis à disposition contre une redevance. Le calcul de cette redevance peut faire débat notamment lorsque le stade a fait l'objet d'une coûteuse rénovation ainsi que l'a montré la Cour des comptes 65 ( * ) à propos du stade Vélodrome utilisé par l'Olympique de Marseille.
Le contexte actuel pourrait amener certains clubs à se retrouver en difficulté pour s'acquitter de la redevance. Pour autant il semble peu justifié de suspendre le paiement de cette redevance ne serait-ce que pour des raisons d'équité en
Le groupe de travail propose donc qu'en cas de nouvelle dégradation de la situation des clubs, l'État, en lien avec la fédération et l'éventuelle ligue concernée, examine la possibilité de créer un dispositif de soutien mutualisé permettant - sur le modèle du prêt garanti par l'État (PGE) souscrit par la LFP 66 ( * ) - de soulager temporairement les clubs du poids des redevances pour la location de leurs enceintes sportives tout en préservant les collectivités territoriales.
5. Augmenter les moyens de l'ANS pour renforcer son action territoriale
Lors de la constitution de l'ANS, le mouvement sportif estimait les moyens alloués par l'État nécessaires à son fonctionnement entre 350 et 400 millions d'euros. L'enveloppe qui lui a été finalement allouée atteint péniblement les 284 millions d'euros sachant que l'Agence doit financer ses charges de fonctionnement sur son fonds de roulement (7 M€).
Cette somme de 284 millions d'euros correspond d'une part à une subvention de 137,6 millions d'euros en provenance du programme 219 et d'autre part à 146,4 millions d'euros issus du produit des taxes précédemment affectées au CNDS.
Le groupe de travail reste très attaché au principe selon lequel « le sport doit financer le sport » , ce principe n'est pas compatible avec le plafonnement par l'État des taxes affectées au sport. Au-delà de ce principe essentiel qui n'est plus respecté depuis de trop nombreuses années, les demandes d'aides financières par les clubs devraient fortement augmenter dans les mois à venir compte tenu de la crise économique et sociale annoncée. La nécessité de mettre en place un nouveau plan d'équipements sportifs n'est également pas contestée compte tenu du vieillissement des infrastructures. La hausse des revenus du secteur sportif doit également permettre de financer de nouveaux équipements, notamment en zone rurale et en Outre-mer.
Le groupe de travail propose en conséquence d'augmenter les moyens de l'ANS en lui affectant davantage de crédits issus du produit de la « taxe Buffet ». Pour rappel, cette taxe a été créée en 2000 avec l'objectif d'assurer une solidarité financière directe entre le sport professionnel, le sport amateur et le sport pour tous. Il s'agit d'une taxe de 5% assise sur le montant des droits audiovisuels des manifestations sportives dont l'organisateur est établi en France. Son affectation au CNDS et désormais à l'ANS est plafonnée depuis 2012.
Alors que les droits de diffusion sont appelés à connaître une très forte hausse à partir de 2020, le rendement de la « taxe Buffet » entre 2019 et 2020 devrait augmenter de 20,3 M€ pour atteindre un montant de 74,1 M€. La totalité de cette hausse devrait en l'état du droit actuel bénéficier au budget général de l'État, en contradiction avec l'objet même de cette taxe, créée spécifiquement pour assurer une redistribution interne au sport. Le groupe de travail propose donc que la totalité de l'accroissement du rendement de la « taxe Buffet » consécutif à la hausse des droits de retransmission télévisée soit affectée à l'ANS afin de répondre au défi de l'après-crise sanitaire.
Pour préserver l'activité des diffuseurs de droits sportifs et l'attractivité du « spectacle » sportif proposé par les ligues professionnelles, le groupe de travail souhaite que les dispositions prévues par la réforme de l'audiovisuel concernant la lutte contre le piratage soient reprises dans un prochain véhicule législatif, si possible celui qui aura la charge de transcrire la directive SMA. Une recrudescence du piratage est en effet à redouter compte tenu de la multiplication des diffuseurs de programmes sportifs et de la crise économique annoncée.
III. STABILISER L'ORGANISATION DU MOUVEMENT SPORTIF DANS LA PERSPECTIVE DES JO DE 2024
Les Jeux olympiques constitueront un rendez-vous essentiel qu'il convient de réussir tant au regard de l'accueil des participants venus du monde entier que des résultats que pourront obtenir les athlètes français. Concernant les infrastructures nécessaires à l'organisation des épreuves, le groupe de travail considère que la crise sanitaire renforce l'impératif de maîtrise des coûts et de réexamen permanent des choix effectués afin de tendre vers des jeux raisonnables et soutenables .
6. Mettre en place l'organisation territoriale de l'Agence nationale du sport au second semestre 2020
Les travaux menés dans le cadre de la mission d'information de la commission de la culture sur « les nouveaux territoires du sport » 67 ( * ) ont permis d'identifier tout l'intérêt que représente la nouvelle Agence nationale du sport (ANS) pour organiser une nouvelle gouvernance des politiques locales du sport .
Ce nouvel acteur qui se substitue au Centre national pour le développement du sport (CNDS) avec des compétences et des moyens nouveaux se veut également une réponse aux difficultés rencontrées au plan local pour instituer une gouvernance efficace entre les acteurs. Cependant, les modalités de fonctionnement de l'ANS demeuraient encore très incertaines quelques semaines seulement après son installation au printemps 2019 et beaucoup d'acteurs locaux auditionnés avaient alors indiqué leur crainte que la mise en oeuvre de la gouvernance locale soit reportée à plus tard.
Afin de ne pas perdre de temps, plusieurs membres de la commission de la culture ont saisi l'opportunité de l'examen du projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 déposé au Sénat le 12 juin 2019 afin de préciser les missions territoriales de la nouvelle Agence nationale du sport. Le texte, largement enrichi par le Sénat, a ainsi pu faire l'objet d'un accord en commission mixte paritaire le 23 juillet dernier et la loi, dont l'intitulé a été modifié pour faire référence à la création de l'ANS et à diverses dispositions relatives à l'organisation des jeux Olympiques et paralympiques de 2024, a été promulguée le 1 er août 2019.
Les modifications apportées à cette loi par le Sénat ont permis de définir les principes de la gouvernance territoriale de l'Agence nationale du sport avec la création au niveau régional d'une conférence régionale du sport et, selon les spécificités territoriales, de conférences des financeurs du sport . Des dispositions réglementaires devaient être adoptées afin de permettre la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions . Alors que le premier anniversaire de l'adoption de cette loi se profile, les décrets d'application mettant en oeuvre la gouvernance territoriale de l'ANS n'ont toujours pas été publiés. Le groupe de travail demande à ce que ces dispositions réglementaires soient maintenant publiées dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au cours du second semestre 2020. Il est urgent de pouvoir associer tous les acteurs locaux à la conduite des politiques territoriales du sport.
7. Adopter un moratoire sur la réforme des CTS jusqu'en 2024
La mission « flash » organisée par la commission de la culture sur l'avenir des conseillers techniques sportifs (CTS) a conclu 68 ( * ) à la nécessité de surseoir au transfert envisagé par le Gouvernement des CTS aux fédérations. Afin de prévenir toute tentative de passage en force, le Sénat a adopté en juin 2019 un amendement déposé à l'initiative de notre collègue Michel Savin, membre du groupe de travail, prévoyant d'exclure les CTS du transfert obligatoire prévu par l'alinéa 11 de l'article 28 du projet de loi pour la transformation de la fonction. Ce coup d'arrêt porté au projet de transfert des CTS faisait suite au lancement par la ministre des sports d'une mission de conciliation confiée à des tiers de confiance 69 ( * ) .
Or, avant même que cette mission ne rende ses conclusions, l'intégration des dépenses de personnel relatives aux CTS au sein du programme 219 à hauteur de 120,8 M€ a été perçue comme la poursuite du projet de transfert, puisque le programme 219 constitue le support naturel destiné à accueillir les crédits destinés à des fédérations sportives. La crise ouverte par l'annonce de l'extinction du corps et le transfert des cadres aux fédérations n'est toujours pas terminée. Elle menace même de se prolonger et de compromettre la préparation des Jeux olympiques de Tokyo reportés à l'été 2021.
Le groupe de travail considère indispensable de stabiliser la situation des CTS dans la perspective des prochaines échéances sportives majeures . La proposition des tiers de confiance consistant à « resserrer » le corps des CTS autour des directeurs techniques nationaux et des entraîneurs nationaux et à le doter d'une véritable fonction RH constitue une piste intéressante mais qui doit encore être étudiée et concertée. Dans ces conditions, le groupe de travail propose que la situation des CTS fasse l'objet d'un moratoire jusqu'à 2024 afin de leur permettre de préparer les Jeux olympiques de Paris dans les meilleures conditions. La réussite des Jeux ne pourra se faire sans apaisement, le groupe de travail appelle la ministre des sports à clarifier l'avenir des CTS dans les meilleurs délais.
IV. DÉVELOPPER LE SOUTIEN AUX SPORTIFS ET LES INCITATIONS À LA PRATIQUE SPORTIVE
La crise sanitaire a rebattu les cartes de la pratique sportive. Beaucoup de pratiquants ont substitué à leur pratique en club une pratique dématérialisée et/ou des exercices individuels. En matière de pratique sportive également, il n'y aura pas de « retour à la normale ». Les clubs devront repenser leur organisation et leur offre pour redevenir attractifs.
Le CNOSF a certes pris des initiatives pour permettre aux clubs d'affronter cette crise. Des aides directes ont été apportées, des initiatives de communication ont été engagées alors qu'une véritable stratégie numérique pour faire connaître les clubs a été mise en place. Le CNOSF a prévu également de faire la promotion de la « carte passerelle » 70 ( * ) à la rentrée de septembre afin de faire connaître aux jeunes la richesse des activités pratiquées dans les clubs près de chez eux.
Le « sport santé » constitue un autre terrain de développement pour les clubs . Le sport peut, sans aucun doute, jouer un rôle plus important pour accompagner les rémissions de nombreux patients, il pourrait surtout être plus largement conseillé dans une logique de prévention de certaines pathologies. Le développement du sport santé reste, toutefois, contraint par le manque de professionnels formés à ces pratiques. Aucun progrès significatif ne pourra donc être réalisé en matière de sport santé sans un accroissement du nombre de professionnels qualifiés.
Outre la question du sport santé, le groupe de travail propose de mettre l'accent sur l'accueil des jeunes, le soutien aux athlètes et le développement du sport féminin.
8. Créer un « Pass Sport » pour encourager les 14-20 ans à pratiquer un sport en club
L'idée de créer un « Pass Sport » sur le modèle du « Pass Culture » a été formulée à l'automne dernier lors du dernier débat budgétaire. Cette mesure visait, selon ses promoteurs, à lutter contre le décrochage sportif et la sédentarité des jeunes, et à démocratiser la pratique sportive. Il devait être destiné aux 14-20 ans, la tranche d'âge couvrant les trois principales périodes de décrochage de la pratique sportive observées chez les jeunes, en particulier les jeunes filles : la rentrée en classe de 4 ème (13-14 ans), le passage du collège au lycée (15-16 ans) et le passage dans l'enseignement supérieur (17-18 ans).
Ce « Pass Sport » consisterait en un crédit de 500 euros dédié à l'achat de licences, à l'achat de petit matériel (vêtements, chaussures...), à l'accès à des équipements sportifs (piscine, patinoire...) ainsi qu'à des animations sportives hors périodes scolaires.
Le groupe de travail estime que la création d'un tel « Pass Sport » apparaît aujourd'hui particulièrement pertinente dans le contexte de sortie de crise sanitaire et compte tenu de la nécessité de retisser un lien entre la jeunesse et les structures sportives.
9. Permettre à l'ANS d'aider financièrement les athlètes fragilisés par le report des Jeux olympiques de Tokyo
Le report des jeux Olympiques de Tokyo à l'été 2021 pourrait fragiliser d'autant plus les athlètes qui se préparent depuis plusieurs années à cette échéance qu'il devrait coïncider avec une dégradation de la conjoncture économique qui pourrait remettre en cause les engagements des entreprises en faveur du sport de haut niveau.
Faut-il rappeler que la situation d'athlète de haut niveau est souvent synonyme en France de précarité ? En 2016, la moitié de la délégation française envoyée aux Jeux Olympiques vivait ainsi en dessous du seuil de pauvreté, soit moins de 1 026 euros par mois. Le groupe de travail craint que la situation financière de nombreux athlètes de haut niveau se dégrade encore dans les prochains mois jusqu'à compromettre leurs performances - voire leur participation - aux Jeux de Tokyo.
Dans ces conditions, le groupe de travail soutient la proposition de l'ANS d'attribuer des bourses mensuelles pouvant aller jusqu'à 3 000 € (compte tenu des autres aides auxquelles ils sont éligibles) aux athlètes qui en feraient la demande. Un tel dispositif de soutien permettrait de soulager les athlètes concernés financièrement, mais également mentalement, pour leur permettre de se concentrer uniquement sur leur préparation sportive. Il constituerait un complément pertinent au dispositif du « pacte de performance » 71 ( * ) qui permet un accompagnement des athlètes de haut niveau par les entreprises.
10. Mobiliser des moyens en faveur du sport professionnel féminin afin de permettre aux clubs de mieux valoriser leurs infrastructures
Le développement du sport féminin se justifie par lui-même compte tenu de ses valeurs, des perspectives qu'il crée pour les sportives et de l'attente du public. Il constitue, par ailleurs, un facteur de développement économique pour les clubs qui peuvent ainsi mieux utiliser leurs infrastructures et donc rentabiliser plus rapidement leurs investissements dans les stades, les centres d'entraînement, les installations médicales...
Le groupe de travail appelle donc de ses voeux l'adoption de mesures ciblées en faveur du développement du sport féminin . Il rappelle notamment que la proposition n° 11 du rapport de la commission de la culture de février 2017 sur la gouvernance du football 72 ( * ) prévoyait d' « amener l'ensemble des clubs de Ligue 1 à créer une section féminine » . Le groupe de travail préconise de modifier l'article L. 333-3 du code du sport 73 ( * ) afin de permettre d'attribuer un bonus dans la répartition des droits audiovisuels aux clubs dotés d'une section féminine.
XII. JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE
Le groupe de travail « Jeunesse et vie associative » de la commission de la culture animé par Jacques-Bernard Magner (Puy de-Dôme, socialiste et républicain) est composé de Céline Boulay-Espéronnier (Paris, LR), Olivier Paccaud (Oise, LR), Dominique Vérien (Yonne, UC).
Afin de suivre les conséquences de la crise de Covid-19 sur l'ensemble des secteurs relevant de la compétence de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, son Bureau a décidé le mardi 14 avril de créer 12 groupes de travail transpartisans et animés par le rapporteur pour avis des crédits en charge du secteur.
Dans ce cadre, le groupe de travail « Jeunesse et vie associative » 74 ( * ) a souhaité procéder à une série d'auditions autour de trois thématiques : la situation sociale et économique du milieu associatif, les conséquences du Covid-19 sur le service civique, et enfin la mise en place de colonies de vacances « studieuses » annoncées par le gouvernement, afin d'accompagner les enfants à la suite du confinement.
Il ressort de ces auditions 14 préconisations .
A. LE SECTEUR ASSOCIATIF : UN ACTEUR ESSENTIEL DE LA SOLIDARITÉ ET DU VIVRE ENSEMBLE, GRAND OUBLIÉ PAR LES POUVOIRS PUBLICS PENDANT CETTE CRISE
1. Un acteur économique et social de premier rang
Actrices de proximité, de solidarité et de l'engagement, les associations participent pleinement à l'animation des territoires, au développement du lien social et à l'émancipation de chacun, dans tous les secteurs de la société : jeunesse, aide aux personnes âgées, sport, culture, urgence et besoins de première nécessité, ... On dénombre en France 1,5 million d'associations, mobilisant entre 16 à 20 millions de bénévoles. Témoin de cette vitalité associative, leur nombre a augmenté de 2,4 % par an entre 2011 et 2017.
Le secteur associatif représente également un acteur économique non négligeable : ce sont ainsi près de 1,8 million d'ETP qui travaillent dans les associations, soit près d'un salarié du secteur privé sur dix. Avec une hausse moyenne de 0,5 % des effectifs salariés par an entre 2011 et 2017, l'emploi associatif connaît une évolution plus dynamique que l'ensemble de l'emploi salarié privé depuis 2008. Enfin, le budget cumulé des associations représente 113 milliards d'euros, soit 4 % du PIB.
Ainsi, parallèlement à l'économie de marché, le secteur associatif alimente une économie dynamique du service, du lien social et du secteur non lucratif .
2. Un acteur confronté à la crise de Covid-19
a) Une mobilisation au coeur de la résilience des territoires
La crise sanitaire et le confinement ont entraîné une très forte mobilisation des associations agissant principalement dans le secteur social, caritative ou de la santé. Une envie de se mobiliser a également été constaté sur le terrain - au sein d'associations préexistantes de ces secteurs, mais également au sein d'autres associations, par exemple sportives, qui ont modifié leurs missions traditionnelles, ou encore par la création d'associations de fait. Cette mobilisation citoyenne et de proximité a participé à la résilience des territoires.
Le groupe de travail regrette toutefois que cette mobilisation reste invisible aux yeux des pouvoirs publics : à aucun moment, dans les discours du Président de la République ou du Premier ministre, le rôle des bénévoles n'a été salué - ni même évoqué. Il a pourtant été essentiel pour soutenir et soulager « la première ligne » impliquée dans la lutte contre le Covid-19. À titre d'exemple, depuis le 20 mars, chaque semaine le réseau de l'association des paralysés de France contacte par téléphone au moins 30 000 personnes isolées. Ces appels sont indispensables pour les personnes contactées : en dehors de la rupture de l'isolement - comme en témoigne l'allongement de la durée moyenne de ces appels au fur et à mesure que le confinement se prolonge -, ils permettent également de prendre connaissance et de répondre à leurs besoins de première nécessité (faire les courses, aller à la pharmacie, les accompagner pour leurs soins chez le kinésithérapeute,....). Toutes ces actions sont réalisées par des bénévoles qui donnent de leurs temps.
Préconisation : renforcer la reconnaissance de la Nation envers l'engagement citoyen
b) Des conséquences économiques importantes
65 % des associations ont mis l'intégralité de leurs activités en sommeil 75 ( * ) . Quant aux 30 % restantes, 23 % des associations ont connu une réduction significative de leurs activités. Certains secteurs comme le sport, ou la culture sont particulièrement touchés. 81 % des associations ont ainsi été contraintes d'annuler des évènements importants. Ce taux dépasse les 90 % dans le secteur de l'environnement et de la culture.
Selon le Mouvement associatif, on estime à 1,4 milliard d'euros les pertes de recettes d'activités pour le mois de mars. Près de 70 % des associations ont fait une demande de recours au chômage partiel . Enfin, près de 14 % des associations avait en mars moins de trois mois de trésorerie devant elles. Fait plus qu'inquiétant, ce taux atteignait 28 % pour les associations employeuses, et 40 % pour celles ayant plus de 10 salariés.
3. La spécificité du secteur associatif non prise en compte par les mesures de soutien économique
Certes, une série de mesures de soutien économique a été mis en place par le gouvernement. Toutefois, ces mesures méconnaissent la spécificité des associations et ne répondent donc que partiellement à leurs besoins.
a) Le prêt garanti par l'État
Par cette mesure, l'État s'engage à garantir jusqu'à 90 % du prêt bancaire accordé par une banque à une entreprise, qui respecte les conditions d'éligibilité.
Toutefois, l'application concrète de ces dispositions pour les associations a connu dans un premier temps un certain nombre d'obstacles. La doctrine de BPI France et le ministère des finances ne prenait en compte le chiffre d'affaires que sous l'angle des activités commerciales. Une mobilisation du mouvement associatif a permis de faire évoluer les critères pour les associations, afin d'élargir leur accessibilité à ce fonds. Le « chiffre d'affaires associatif » est désormais calculé en cumulant l'ensemble des ressources de l'association auxquelles sont retranchées les subventions et dons.
b) Le fonds de solidarité
Le fonds de solidarité doit permettre à toute entreprise dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à un million d'euros sur le dernier exercice clos, et dont le bénéfice annuel imposable est inférieur à 60 000 euros, de disposer d'une aide financière si elle a fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public, ou subi une perte de 50 % de son chiffre d'affaire en mars 2020 par rapport à mars 2019. Les associations concernées sont alors éligibles à une aide en deux volets : une première aide de 1 500 euros, et un deuxième volet d'aide complémentaire, compris entre 2 000 et 5 000 euros pour celles « qui bénéficient du premier volet ». Ce deuxième volet est géré par les régions.
En fonction des interprétations faites par les services régionaux des finances publiques, certaines associations se voient refuser l'accès à ce dispositif au motif qu'elles ne payent pas d'impôts commerciaux. Dans d'autres cas, il leur est demandé leur identifiant fiscal - alors qu'une association à but non lucrative n'en possède pas. Or, ce refus sur un critère pourtant non prévu par les textes ferme l'accès au premier volet, mais également aux fonds de soutien régionaux. De même, pour pouvoir bénéficier du report des charges, il faut être éligible au fonds de solidarité.
c) Les difficultés rencontrées par les associations non employeuses
Les associations non employeuses ne peuvent pas bénéficier des deux dispositifs précédemment évoqués , car elles ne sont pas considérées comme des entreprises. Or, beaucoup d'entre elles développent des activités économiques, sans disposer forcément de salariés. Leurs activités sont génératrices de charges (locaux par exemple). En l'état du droit, elles ne sont éligibles à aucune mesure d'aide.
d) Une remise en cause du modèle du financement par projet
Enfin, la crise a percuté violemment le modèle de financement des associations : très souvent, un financement ou une subvention n'est pas directement accordé à la structure associative, mais pour soutenir un projet. Une association est donc dépendante d'une grande variété de financeurs, tout arrêt d'un projet entraînant la perte du soutien de tel ou tel mécène. Des pertes importantes en termes de mécénat sont également à craindre dans les six prochains mois.
Votre groupe note toutefois avec satisfaction la parution le 6 mai 2020 d'une instruction du Premier ministre relative au maintien des subventions obtenues ou prévues par l'État ou l'un de ses opérateurs, même si l'association n'a pas pu, pour des raisons de force majeure, réaliser toute ou partie du projet. La circulaire précise néanmoins que cette mesure « ne peut pas aboutir à reconnaître systématiquement la force majeure qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas ». L'autorité administrative doit notamment vérifier que la situation résultant de la crise sanitaire actuelle « ne permette effectivement plus au bénéficiaire de la subvention de remplir les obligations liées à la subvention ».
Dans le prolongement de la charte des engagements réciproques signée en 2014 entre l'État, le Mouvement associatif et les collectivités territoriales, le groupe de travail souhaite que les associations d'élus s'engagent également dans le versement des subventions promises. Le maintien du partenariat financier est la première préoccupation et le premier besoin exprimé des associations. Un tel engagement au niveau national permettrait d'inciter l'ensemble des collectivités à s'inscrire dans une telle démarche et éviterait à une association, à devoir négocier seule, directement en bilatéral avec la collectivité locale, le maintien de sa subvention malgré l'impossibilité de mener à bien son projet. Un certain nombre de départements et de régions ont d'ailleurs fait savoir qu'ils maintiendraient les subventions promises.
Le groupe de travail préconise la création d'un fonds de soutien interministériel pour les associations en grande difficulté financière. Un certain nombre d'associations risque de devoir procéder à des licenciements, voire à fermer dans les mois à venir. Pour rappel, à la différence des entreprises, il n'existe pas pour les associations de procédure judiciaire de sauvegarde.
Enfin, depuis la loi de finances pour 2018 qui a tiré les conséquences de la loi pour une confiance dans la vie politique adoptée en septembre 2017, le fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) s'est vu confier une nouvelle mission : attribuer aux associations sur les territoires les fonds anciennement versés au titre de la réserve parlementaire. Or, le groupe de travail ne peut que constater que les sommes ainsi allouées restent fortement en dessous de ce que les associations percevaient au titre de la réserve parlementaire. Ce montant est en effet depuis 2018 de 25 millions d'euros par an pour la subvention de projets, bien loin des 52 millions d'euros de subventions attribuées auparavant aux associations.
Préconisations :
- Permettre aux associations non employeuses de bénéficier du report de charge et de l'accès aux fonds d'aide régionaux
- Encourager les associations représentant les collectivités locales à signer une charte, afin d'inciter l'ensemble des collectivités à maintenir le versement des subventions promises même si l'activité ne peut pas avoir lieu du fait de la crise sanitaire de Covid-19
- Réévaluer le FDVA dont les montants versés aux associations restent inférieurs à ceux précédemment alloués via la réserve parlementaire
- Mettre en place un fonds de soutien interministériel pour les associations en grande difficulté financière
B. LA CRISE DE COVID-19 A DÉMONTRÉ PLUS QUE JAMAIS L'UTILITÉ DU SERVICE CIVIQUE
1. Un acteur pleinement mobilisé qui a su s'adapter
a) Une volonté de maintenir les contrats malgré les conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement des missions
Le déroulement des missions des quelque 60 000 jeunes n'a pas été épargné par la crise sanitaire et le confinement qu'elle a imposé. Toutefois, afin de ne pas ajouter de la précarité et de l'incertitude à la situation de crise, l'agence nationale du service civique a pris la décision de maintenir le versement des indemnités et à demander aux structures d'accueil d'en faire de même pour les contrats . En affirmant le principe de la poursuite du contrat de service civique, cette démarche a contribué à la grande créativité et innovation dont ont fait preuve tant les jeunes que les structures d'accueil pour poursuivre leurs missions.
On peut distinguer trois cas :
• La poursuite d'une mission non touchée par les mesures prises pour lutter contre le Covid-19. C'est notamment le cas d'un certain nombre de missions d'urgence alimentaire et sociale. Toutefois, la structure a dû demander systématiquement l'accord express du jeune pour continuer à être sur le terrain.
• Les missions qui ont dû être interrompues . Dans ce cas, une nouvelle mission a pu être proposée au jeune - toujours avec son accord. 26 000 jeunes ont ainsi été redéployés , notamment sur des missions de terrain.
• Les missions qui se sont poursuivies, mais sous d'autres formes , notamment via l'outil numérique et téléphonique ainsi que les réseaux sociaux : aide aux devoirs, contacts avec les personnes âgées, éducation aux métiers et lutte contre les infox,...
Au-delà de la question des missions, la période de confinement a également été l'occasion pour chaque jeune, en lien avec son tuteur, de préparer son « projet d'avenir », ou encore de passer le PIX (certificat de compétences numériques).
b) Le service civique : un acteur essentiel de la réserve civique
Le 24 mars dernier, le gouvernement a lancé la plateforme solidaire « jeveuxaider.gouv.fr », « afin de permettre à tous ceux que le peuvent et qui le souhaitent de s'engager et de donner de leurs temps » pour limiter l'impact de la crise sociale.
À la demande explicite de l'agence nationale du service civique, un développement a été intégré afin de disposer d'une case « jeune en service civique », dans les profils des volontaires. Force est de constater que les jeunes en service civique ont répondu massivement à cet appel solidaire, créant ainsi un effet levier : sur les 350 000 inscrits sur cette plateforme, 50 000 sont des jeunes en service civique.
Cette crise a également démontré que le service civique favorise l'engagement des jeunes, puisque 50 000 des 60 000 jeunes en service civique se sont inscrits sur cette plateforme : bénéficier d'une formation civique et citoyenne, avoir été formé par ses tuteurs à la notion d'intérêt général semble ainsi favoriser l'engagement.
2. L'existence d'un certain nombre de freins budgétaires et réglementaires
Prévoir des missions de service civique en situation de crise fait partie de l'ADN même de ce dernier. On trouve parmi les neuf thématiques prioritaires d'action la notion de « crise et urgence ». Or, le redéploiement des jeunes vers de telles missions a entraîné des lourdeurs administratives et des incertitudes juridiques. En effet, pour pouvoir les intégrer dans la réserve civique, il a été nécessaire de signer des avenants, afin de les libérer de leurs missions initiales et leur permettre d'intégrer bénévolement la réserve civique. En outre, leur situation n'était pas la même selon la nouvelle structure d'accueil dans laquelle ils étaient bénévoles : État, collectivités territoriales, associations,... L'absence de statut juridique de réserve civique crée des problèmes de responsabilité et freine ainsi l'engagement.
Le groupe de travail note également que les missions vont reprendre sous des formes plus habituelles à partir de mi-mai voire début juin, soit précisément au moment où les contrats de la plupart des jeunes vont arriver à échéance. Plus problématique encore, les besoins risquent d'être en pleine expansion en juin, juillet et août (réouverture des EPHAD, soutien scolaire, colonies de vacances apprenantes), alors que traditionnellement, le nombre de missions commencées en juin, juillet et août est faible.
Aussi le groupe de travail note avec intérêt l'idée de prolonger de quelques semaines les contrats actuels - pour les jeunes et les structures d'accueil qui le souhaitent - afin d'inclure toute ou partie de la période estivale. Une telle disposition présente plusieurs avantages :
• elle permet aux structures de disposer de jeunes déjà formés, intégrés dans les structures et donc immédiatement opérationnels, à un moment où elles peuvent éprouver des difficultés à faire démarrer une nouvelle mission ;
• elle répond à une demande constante de mettre fin à la diminution moyenne constatée des durées des missions. Alors que ces dernières étaient encore de 8 mois il y a quelques années, elles sont désormais de 7,2 mois, incitant de moins en moins les structures à accueillir des jeunes en service civique, notamment des profils atypiques.
Le groupe de travail souligne néanmoins le fait que cette prolongation ne doit pas être automatique . En effet, certaines structures ferment pendant l'été, et il n'y aurait donc aucun sens de prolonger dans ce cas les missions. Par ailleurs, certains jeunes ne le souhaitent peut-être pas. Enfin, et surtout, la prolongation des contrats existants ne doit pas se faire au détriment de futurs jeunes en service civique qui verraient ainsi leurs contrats retardés, voire annulés.
Cette disposition n'est pas neutre budgétairement. Une prolongation de deux mois des 58 500 jeunes actuellement en service civique aurait un coût budgétaire de 94 millions d'euros - et de 141 millions d'euros pour une prolongation de trois mois. Toutefois, ces sommes représentent l'hypothèse haute de réflexion, le coût de cette mesure dépendant du nombre de jeunes et de structures souhaitant une prolongation des contrats.
Cette mesure exceptionnelle pourrait en outre être partiellement financée par un transfert de tout ou d'une partie du budget de 30 millions d'euros prévu pour le SNU . En effet, il semble difficile d'organiser cette année le stage de 15 jours de cohésion pour plusieurs raisons :
• les circonstances actuelles rendent peu concevables les mobilités fortes qu'entraîne ce stage - chaque jeune devant l'effectuer dans un département autre que son département d'origine, y compris pour les départements d'outre-mer - ainsi que la constitution de groupes, dans le respect de la distanciation sociale ;
• la temporalité de l'organisation de ce séjour : il semble difficile de l'envisager pendant les vacances d'été, les lieux d'accueil prévus - centres de loisirs, camps de vacances, auberge de jeunesse, .... - étant utilisés pour leurs usages premiers. Or, les vacances de la Toussaint semblent également peu propices : la très grande majorité des jeunes sera alors en classe de première, avec des épreuves de baccalauréat dès janvier (E3C) et un début d'année particulier en raison des conséquences du confinement sur les apprentissages aux deuxième et troisième trimestres de l'année scolaire 2019-2020.
Préconisations :
- Intégrer dans les contrats des jeunes en service civique la possibilité de les transférer - avec leurs accords - sur une mission urgente en cas de besoin
- Donner la possibilité juridique et les moyens budgétaires d'étendre de plusieurs semaines les contrats des jeunes en service civique qui le demandent, afin de permettre aux structures, en l'absence d'autres alternatives, de disposer de jeunes déjà formés, pour répondre aux besoins immédiats à la sortie du confinement
- Reporter, en raison des difficultés d'organisation nées de la crise de Covid-19, l'élargissement à l'ensemble des départements de l'expérimentation du SNU à 2021 et réallouer tout ou partie du budget dédié au service civique
C. ENTRE ACTIVITÉ QUASI-NULLE DEPUIS DÉBUT MARS ET FLOU SUR LA MISE EN PLACE DES COLONIES DE VACANCES « STUDIEUSES » : LE SECTEUR DU TOURISME ASSOCIATIF INQUIET POUR SON AVENIR
1. Classes vertes, colonies de vacances, formation au BAFA : un arrêt brutal d'activité depuis le mois de mars
a) Le secteur du tourisme associatif percuté de plein fouet par la crise de Covid-19
95 % de l'activité de classes vertes, 85 % des accueils collectifs de mineurs et 75 % des formations (notamment BAFA) sont à l'arrêt depuis mars. Les conséquences en termes de ressources humaines sont lourdes : ainsi, 70 % des salariés de l'UFCV sont en chômage partiel.
Pour l'activité en central de la Ligue de l'enseignement, à laquelle il faut ajouter les données des fédérations régionales, cet arrêt représente pour 11,7 millions d'euros de séjours scolaires vendus qui ont été annulés.
b) Des acteurs en danger de disparaître
On constate un taux d'inscription inférieur de 40 à 50 % par rapport à la même époque l'année dernière pour la période estivale. Or, la période d'inscription dans les colonies de vacances s'étend normalement de mi-mars à mai.
De nombreux acteurs du tourisme associatif, notamment les plus petits, s'interrogent sur leur capacité de survie. En effet, leur modèle économique est fondé sur une complémentarité d'activités entre accueils pendant les vacances et classes vertes de mi-février à fin août, leur permettant ainsi de tenir sur le dernier trimestre et la première partie du premier trimestre.
À titre d'exemple, 58 % des fédérations de la Ligue de l'Enseignement seront en grande difficulté, voire en rupture de trésorerie à la fin du mois de juin. L'UNAT, pour sa part, a indiqué, que contrairement aux années précédentes, il était impossible de commencer à préparer dès à présent le catalogue des séjours d'hiver, notamment parce que de nombreuses associations organisatrices ne savent pas si elles seront encore en capacité d'exister à la rentrée de septembre.
Un plan de soutien au tourisme d'un montant de 1,3 milliard d'euros a été annoncé par le gouvernement le 14 mai. Le groupe de travail salue cette initiative, ainsi que le maintien des financements de la CAF aux accueils collectifs de mineurs au même niveau que l'année précédente, malgré un nombre d'enfants accueillis dans ces structures quasi-nul en raison du confinement. Toutefois, le groupe de travail souligne que cette aide, versée aux structures d'accueil, ne concerne pas les organisateurs des colonies de vacances.
Préconisation : inclure dans le plan de soutien au tourisme le secteur du tourisme associatif et prendre en compte ses caractéristiques
2. Une volonté politique de redynamiser les colonies de vacances, mais de nombreuses questions demeurent
a) Des modalités de vacances en perte de vitesse, remises à l'ordre du jour en raison de la crise de Covid-19
Les colonies de vacances connaissent depuis plusieurs années une baisse majeure de fréquentation. Ainsi, un sondage de « la jeunesse en plein air » a montré que seul ¼ des enfants âgés de 8 à 12 ans étaient déjà partis en colonie de vacances. Alors qu'il y a une trentaine d'années, près de trois millions d'enfants partaient chaque année en colonie de vacances, ils ne sont désormais plus que 800 000.
La crise de Covid-19, et les annonces du gouvernement visant à instaurer des colonies de vacances « éducatives » ou « studieuses » ont permis de remettre à l'ordre du jour ce type de séjour, ce que le groupe de travail ne peut que saluer .
b) Conditions sanitaires, prise en charge du surcoût, encadrement : de trop nombreuses questions freinent la relance des colonies de vacances
La première d'entre elles concerne les conditions sanitaires à respecter. Celles-ci ne sont pas connues pour l'instant. Elles peuvent entraîner des surcoûts importants en termes de taux d'encadrement, de fréquence de nettoyage, de transport, de sécurité et tout simplement du nombre d'enfants pouvant être accueillis. Or, le prix d'un séjour est calculé au plus juste : de manière générale, pour ne pas être déficitaire, un séjour doit avoir un taux de remplissage de 80 à 85 %. Un tel taux ne pourra pas être atteint, s'il faut diviser par deux le nombre d'enfants accueillis. Le groupe de travail appelle l'État à prendre en charge tout ou partie de ce surcoût : en effet, les prestataires ne disposent souvent pas des moyens de le faire et sont réticents à le faire supporter aux familles, au moment même où les pouvoirs publics cherchent à dynamiser les colonies de vacances.
Un deuxième frein à court, mais aussi à moyen termes pour le développement des colonies de vacances doit être souligné : l'encadrement. Depuis la session de Pâques, les formations aux BAFA sont à l'arrêt . En outre, peu de stagiaires ont pu passer leurs stages pratiques. Quant à ceux qui ont pu le faire, ils ne sont pas diplômés car les jurys n'ont pas pu se réunir. Or, l'encadrement de jeunes en colonies de vacances, centres de loisirs ou classes vertes répond à des normes strictes en termes de ratio titulaire et de stagiaire du BAFA.
• 50 % de titulaires du BAFA (ou équivalent)
• 30 % de stagiaires BAFA (ou équivalent)
• 20 % de personnes non qualifiées
Préconisation : indiquer rapidement aux professionnels du secteur les conditions sanitaires à respecter pour l'organisation des séjours de mineurs cet été
c) La nécessité de rassurer et de convaincre les familles pour toucher le « public cible » et redynamiser les colonies de vacances
I l est important de rassurer et convaincre les familles d'inscrire leurs enfants en colonie de vacances, condition sine qua non pour dynamiser ces dernières. Des villes peuvent financer jusqu'à 90 à 95 % du coût de la colonie de vacances pour certains enfants. Or, chaque année, tout le budget alloué n'est pas dépensé : la question financière n'est pas le seul frein pour les familles. Les obstacles sont nombreux : freins cultuel, culturel, psychologique, la sécurité, l'encadrement.
Aujourd'hui, plus que jamais, un travail partenarial avec les travailleurs sociaux et les animateurs est nécessaire pour persuader les familles d'envoyer leurs enfants en colonies de vacances, d'autant plus que beaucoup d'entre elles hésitent déjà à remettre leurs enfants à l'école, dans un environnement pourtant familier. La définition rapide du protocole sanitaire applicable aux séjours et aux accueils collectifs de mineurs est nécessaire ; elle représente une étape indispensable pour rassurer les parents.
Enfin, un travail d'information et de communication à destination des enfants qui ne sont jamais partis en colonies de vacances et qui sont l'un des publics que les pouvoirs publics considèrent comme prioritaires , est indispensable.
3. Les colonies de vacances « studieuses » : un programme annoncé et mis en avant par le gouvernement mais aux contours encore flous à moins de deux mois des vacances d'été
Annoncées par le gouvernement comme réponse au confinement des élèves et à la rupture de la continuité pédagogique, des colonies de vacances « studieuses » doivent voir le jour pour la période estivale 2020. Le groupe de travail souhaite avant tout réaffirmer que par essence, toute colonie de vacances est éducative. Elle apprend à l'enfant la vie collective, à acquérir de nouvelles compétences autour d'activités culturelles et sportives.
Force est de constater que les organisateurs de séjours disposent de très peu d'informations sur le contenu et le cadre de ces colonies de vacances apprenantes ou studieuses. À moins de deux mois du début des vacances d'été, il est plus qu'urgent d'apporter des précisions sur ce dispositif. En effet, à l'exception de quelques-uns, très peu de prestataires proposent des séjours intégrant du soutien scolaire. Le projet pédagogique doit donc entièrement être repensé pour intégrer cette composante, et ceci en quelques semaines. Or, en temps ordinaire, la préparation de nouveau type de séjour se fait près d'un an à l'avance.
Mais de nombreux flous demeurent sur ce dispositif.
a) Quels objectifs pour ces séjours « apprenants » ?
S'agit-il de permettre à l'enfant de retrouver des repères , et confiance en soi, le remobiliser en vue de la reprise des cours en septembre, ou bien d'un soutien scolaire , avec des objectifs de progression à atteindre dans l'acquisition des compétences ?
b) Quel projet pédagogique ?
Si l'objectif premier est scolaire, se pose la question de l' organisation des enseignements (classe d'âge, groupe de niveau), des matières enseignées et du nombre d'heures. Or, les enfants ont besoin de sortir, de s'aérer après un confinement de plusieurs mois, ce « droit aux vacances » comme l'a indiqué le Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse devant la mission d'information sur l'impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l'épidémie de Coronavirus-Covid 19 de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, à l'origine, les colonies de vacances ont une vocation hygiéniste . Il serait regrettable que les colonies de vacances de l'été 2020 enferment les enfants entre les quatre murs d'une salle de classe.
c) Qui pour encadrer les enfants ?
Le confinement l'a rappelé, si besoin en était, à de nombreux parents : l'enseignement nécessite des compétences professionnelles propres, bien différentes de celle de l'animation. Dans ces conditions, une participation d'enseignants est-elle envisagée et sous quelle forme, d'autant que ces derniers seront déjà sollicités par l'éducation nationale pour la mise en place de stage de remise à niveau à la fin du mois d'août, après deux trimestres de forte mobilisation pour assurer la continuité pédagogique sous de nouvelles formes ? Si tel est le cas, par qui seront-ils payés : l'éducation nationale, l'organisateur du séjour ?
Enfin, le groupe de travail attire l'attention du gouvernement sur les effets pervers d'une labellisation . Un exemple précédent de label intitulé « génération camp colo », lancé en 2015-2016 n'a pas produit l'effet escompté : très lourd à mettre en place et dans des délais très contraints, il n'a au final profité qu'aux grandes structures, les seules capables de répondre dans les temps à cet appel à projet et accentuant ainsi l'écart entre les grandes et petites structures. Lors de son audition devant la commission de la culture, de l'éducation et de la communication le 13 mai dernier, Gabriel Attal a indiqué que la formule choisie serait au final plutôt l'organisation de séjours suivant un cahier des charges, qu'une labellisation.
D. PENSER L'APRÈS-CRISE
1. Tirer les enseignements de la crise en matière d'engagement citoyen
a) La crise de Covid-19 : révélatrice de quatre tendances de fond traversant le secteur associatif et le bénévolat
La crise sanitaire et le confinement qu'elle a entrainé a permis de mettre en lumière trois aspects majeurs de la vie associative et de l'engagement en France.
• Une prédominance des plus âgés dans les réseaux associatifs
La publication de l'INJEP de juillet 2019 sur les chiffres clés de la vie associative en2019 avait déjà mis en avant le poids élevé des seniors parmi les présidents d'association, mais surtout l'accentuation de cette tendance ces dernières années. Alors que les plus de 65 ans représentaient 32 % des présidents d'association, cette part est passée à 41 % en 2017. Cette hausse s'explique par une baisse de de la part des présidents d'association âgés de 56 à 64 ans (-3 points entre 2011 et 2017) et surtout par celle de la tranche d'âge 46-55 ans (-5 points entre 2011 et 2017).
Par ailleurs, les seniors sont très nombreux à s'engager. Près d'une personne de plus de 65 ans sur trois est bénévole dans une association .
Taux d'engagement associatif par tranche d'âge
Source : L'évolution de l'engagement bénévole associatif en France, de 2010 à 2019
Un certain nombre d'associations ont vu leurs actions difficiles à mettre en oeuvre du fait de l'indisponibilité de leurs bénévoles les plus âgés, personnes à risque face à cette maladie. Tel est le cas de plusieurs associations d'aide d'urgence qui ont fait appel à des jeunes en service civique, redéployés à cette occasion, pour la distribution de colis alimentaires ou d'autres activités de terrain.
• Une volonté de s'engager notamment chez les jeunes
L'élan de solidarité qui a traversé le pays a l'occasion de cette crise témoigne de l'engagement des Français . On a constaté sur le terrain une volonté supplémentaire de s'engager. Les associations indiquent avoir reçu deux fois plus de sollicitation de la part de bénévoles potentiels que d'habitude, notamment chez les femmes - elles représentent selon les associations les deux tiers, voire les trois quart des « nouveaux » bénévoles - et chez les jeunes. Dans ce dernier cas, cela confirme une tendance observée depuis quelques années : l'augmentation de la part des jeunes parmi les bénévoles. Si les moins de 35 ans représentaient 16 % des bénévoles en 2010, en 2019 leur part bondit à 22 %.
Aussi, pour le groupe de travail, le défi des associations n'est pas de rajeunir le profil des bénévoles, mais celui de l'intergénérationnel.
• La nécessité d'une animation de la vie associative pour permettre son développement
La vie associative, le fait associatif nécessitent d'être animés. Alors qu'il s'agit d'une mission essentielle afin de faire vivre l'association, attirer et intégrer de nouveaux bénévoles, cette tâche est trop souvent passée sous silence par manque de temps. En outre, la crise et le confinement ont fait prendre conscience aux associations que ces dernières avaient trop souvent des missions formatées, par habitude, mais aussi par souci d'efficacité. Renouveler les pratiques permet de renouveler le lien associatif.
En France, la problématique ne se situe pas du côté de l'envie de s'engager, mais de celui de l'offre , de la capacité des associations à faire des propositions diverses et attractives, et à accueillir de nouveaux bénévoles, prendre le temps de leur expliquer les enjeux d'une mission ainsi que les attentes.
Pour le groupe de travail, cette crise a révélé la nécessité de renforcer les logiques d'intermédiation, d'accompagnement des associations afin d'augmenter leurs capacités d'accueil de nouveaux bénévoles.
Préconisation : renforcer l'accompagnement des associations dans l'accueil de nouveaux bénévoles
b) L'usage des outils numérique pour le suivi des jeunes en service civique
L'un des freins au développement du service civique en milieu rural, outre la mobilité et l'hébergement est la difficulté à trouver une structure capable d'accompagner et d'encadrer un jeune ainsi que de lui proposer une mission à temps complet.
Le groupe de travail note avec intérêt l'expérience relayée par Gabriel Attal lors de son audition et relative à la possibilité pour plusieurs structures d'un territoire de se regrouper pour accueillir ensemble un volontaire . Surtout, le suivi et l'accompagnement des jeunes via les outils numériques mis en place, par nécessité, pendant la crise de Covid-19 et le confinement présentent une opportunité intéressante. En effet, l'un des problématiques rencontrées par de grandes associations faisant de l'intermédiation entre le jeune et une petite structure - et prenant notamment en charge les questions administratives, de formation et d'encadrement souvent trop lourdes à gérer pour une petite structure - est celui de la proximité géographique entre l'encadrant et le groupe de jeunes qu'il suit . À titre d'exemple, un encadrant d'Unis-Cité suit 20 volontaires qu'il rencontre régulièrement. Un tel modèle est difficilement transposable en zone rurale.
Aussi, il est important de faire le bilan du recours à ce suivi à distance, via la visioconférence. Si celui-ci s'avère concluant, une solution mixte alternant suivi régulier du jeune à distance grâce aux outils numériques et rencontres sur le terrain plus espacées pourrait être une solution pour développer le service civique en zone rurale.
Préconisation : encourager le développement du service civique en zone rurale, en tirant pleinement profit des outils numériques pour le suivi et l'encadrement du jeune
2. Renforcer le recours au service civique pour limiter le coût social de la crise de Covid-19 dans les mois à venir
Depuis sa création en 2010, le service civique a accueilli plus de 400 000 jeunes et a démontré à de nombreuses reprises sa capacité d'insertion dans la vie professionnelle. Le groupe de travail note avec intérêt les résultats de deux études de l'INJEP.
Dans une note publiée en décembre 2018 et intitulée Le service civique en chiffres, l'INJEP constatait une surreprésentation des personnes ni en emploi ni scolarisées parmi celles qui réalisent un service civique, par rapport à la population des 16-25 ans. En 2017, 45 % des volontaires étaient demandeurs d'emploi à leur entrée en service civique et 21 % inactifs non étudiants, contre respectivement 10 % et 9 % de l'ensemble des 16-25 ans. Ce constat a été confirmé par une très récente étude de mars 2020 de l'INJEP - Les volontaires en service civique : des parcours de formation et d'insertion variées - qui note que « le dispositif attire davantage des jeunes en réorientation, n'ayant pas terminé leurs études ou ayant obtenu des diplômes qui ne permettent pas une insertion professionnelle aisée ».
Surtout, le groupe de travail souhaite souligner deux résultats témoignant de l'efficacité du service civique dans l'insertion professionnelle :
• Parmi les volontaires classés par cette étude de mars 2020 dans la catégorie des « précaires » ayant déjà une expérience professionnelle 76 ( * ) , 47 % d'entre eux étaient en emploi six mois après la fin de leur mission ;
• Parmi les volontaires au chômage de longue durée et sans expérience professionnelle 77 ( * ) , 57 % n'était plus en recherche d'emploi six mois après la fin de leur mission.
Le groupe de travail rappelle également les résultats d'une étude 78 ( * ) réalisée par Unis-Cité sur l'impact économique du service civique : le retour sur investissement social global du service civique représente près de deux fois (1,92) l'investissement initial de l'État.
Or, la crise sanitaire va avoir des répercussions importantes en termes d'emploi mais également de décrochage scolaire. Dans ces conditions, le groupe de travail estime nécessaire d'augmenter le nombre de missions proposées en 2021 - avec un contrôle strict pour en vérifier la qualité tant sur le contenu que sur l'accompagnement du jeune -, d'autant plus que l'on constate déjà depuis plusieurs années un écart très important entre le nombre de demandes et le nombre de places disponibles : on dénombre ainsi une mission pour trois à quatre demandes.
Enfin, le groupe de travail s'interroge sur l'opportunité de récréer pour une période transitoire des emplois aidés limités au secteur associatif. Cette solution reprend une préconisation du rapport intitulé Réduction des emplois aidés : offrir une alternative crédible au secteur associatif, 79 ( * ) adopté à l'unanimité par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication laquelle proposait d'augmenter temporairement le volume des emplois aidés en les réservant aux association de moins de cinq salariés, avant de les réduire progressivement sur deux ans.
Préconisations :
- Augmenter les moyens budgétaires du service civique en 2021 afin de pouvoir proposer un plus grand nombre de missions pour redonner confiance aux jeunes décrocheurs du système scolaire ou en difficulté d'insertion professionnelle en raison de la crise de Covid-19
- Récréer pour une période transitoire des emplois aidés réservés au secteur associatif
LES 14 PRÉCONISATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL « JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE »
Prendre en compte la spécificité du secteur associatif
1. Permettre aux associations non employeuses de bénéficier du report de charge et de l'accès aux fonds d'aide régionaux
2. Encourager les associations représentant les collectivités locales à signer une charte, afin d'inciter l'ensemble des collectivités à maintenir le versement des subventions promises si l'activité ne peut pas avoir lieu du fait de la crise sanitaire de Covid-19
3. Réévaluer le FDVA dont les montants versés aux associations restent inférieurs à ceux précédemment alloués via la réserve parlementaire
4. Mettre en place un fonds de soutien interministériel pour les associations en grande difficulté financière
Se donner les moyens de redynamiser les colonies de vacances
5. Inclure dans le plan de soutien au tourisme le secteur du tourisme associatif et prendre en compte ses caractéristiques
6. Indiquer rapidement aux professionnels du secteur les conditions sanitaires à respecter pour l'organisation des séjours de mineurs cet été
Préparer l'immédiat après-crise
7. Donner la possibilité juridique et les moyens budgétaires d'étendre de plusieurs semaines les contrats des jeunes en service civique qui le demandent, afin de permettre aux structures, en l'absence d'autres alternatives, de disposer de jeunes déjà formés, pour répondre aux besoins immédiats à la sortie du confinement
8. Reporter, en raison des difficultés d'organisation nées de la crise de Covid-19, l'élargissement à l'ensemble des départements de l'expérimentation du SNU à 2021 et réallouer tout ou partie du budget dédié au service civique
9. Augmenter les moyens budgétaires du service civique en 2021 afin de pouvoir proposer un plus grand nombre de missions pour redonner confiance aux jeunes décrocheurs du système scolaire ou en difficulté d'insertion professionnelle en raison de la crise de Covid-19
10. Récréer pour une période transitoire des emplois aidés réservés au secteur associatif
Tirer tous les enseignements de la crise
11. Intégrer dans les contrats des jeunes en service civique la possibilité de les transférer - avec leurs accords - sur une mission urgente en cas de besoin
12. Renforcer l'accompagnement des associations dans l'accueil de nouveaux bénévoles
13. Encourager le développement du service civique en zone rurale, en tirant pleinement profit des outils numériques pour le suivi et l'encadrement du jeune
14. Renforcer la reconnaissance de la Nation envers l'engagement citoyen
1. TRAVAUX EN COMMISSION SUR LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE LIÉE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 SUR LES SECTEURS DE LA COMPÉTENCE DE LA COMMISSION
Presse
MERCREDI 20 MAI 2020
___________
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - L'ordre du jour de notre réunion appelle à présent la présentation des conclusions de quatre des douze groupes de travail créés par le bureau le 14 avril dernier et chargés d'étudier les conséquences de la crise sanitaire sur l'ensemble des secteurs d'activité relevant des compétences de notre commission.
Pour cette première séance de restitution, je donnerai la parole successivement à Michel Laugier pour le groupe « Presse », Françoise Laborde pour le groupe « Industries culturelles », Stéphane Piednoir pour le groupe de travail « Enseignement supérieur » et Jacques-Bernard Magner pour le groupe « Jeunesse et vie associative ».
Avant de leur céder la parole et de débattre ensemble de leurs préconisations, je tenais à remercier les animateurs et l'ensemble des membres des groupes pour leur disponibilité, leur assiduité et leur investissement au cours des semaines écoulées.
Le travail accompli par chacun est d'autant plus remarquable qu'il est transpartisan. Il mérite à présent d'être rendu public dans la perspective de l'examen des prochaines mesures d'urgence mais aussi et surtout du projet de loi de finances rectificative programmé en juin.
Je vous propose que chaque animateur procède dans un premier temps à la présentation des conclusions de son groupe de travail pendant une dizaine de minutes, son propos pouvant être bien entendu complété par les membres du groupe.
À l'issue de chaque présentation, nous pourrons échanger sur les propositions réalisées avant d'autoriser, de manière consensuelle, la mise en ligne de la note de synthèse sur la page internet de la commission.
Monsieur Laugier, vous avez à présent la parole pour le groupe de travail « Presse ».
M. Michel Laugier . - Le groupe de travail sur la presse est composé de Max Brisson, Céline Brulin et David Assouline. Je les remercie au passage pour la qualité de notre travail commun et de nos échanges durant cette période.
C'est un constat que nous allons tous partager dans nos secteurs respectifs, et au-delà, dans l'ensemble des commissions : la situation de la presse est critique. Pas dans toute la presse, certaines familles s'en sortant mieux que d'autres, notamment en fonction de leur plus ou moins grande dépendance à la publicité et de la part d'abonnements, mais dans une partie significative du secteur.
Le groupe de travail sur la presse a procédé à plusieurs auditions, qui ont ainsi toutes souligné les difficultés du secteur.
Cependant, si on observe les choses avec un peu de recul, on constate que la presse ne vit pas la crise unique de la Covid, mais trois crises simultanées qui, toutes ensemble, ne font que souligner ses faiblesses structurelles.
Tout d'abord, la transition numérique en cours peine à déboucher sur un équilibre économique viable. En dépit des efforts des titres pour concevoir et alimenter des sites internet et promouvoir les consultations en ligne payantes ou rémunérées par la publicité, l'habitude de la gratuité comme la captation massive de valeur opérée par les plateformes en ligne ont détérioré les comptes au point de mettre en danger l'existence de nombreuses publications. La loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, adoptée sur la base d'une proposition de loi sénatoriale de notre collègue David Assouline, n'a pas encore pu produire ses fruits en raison de l'opposition ferme de Google et Facebook. La décision de l'Autorité de la concurrence du 9 avril 2020, qui enjoint aux plateformes de négocier avec les éditeurs la rémunération qui leur est due, ainsi que les transpositions en cours dans les autres pays européens, pourrait cependant, dans les prochaines semaines, permettre de déboucher sur une solution, si l'on veut bien être optimiste.
Ensuite, « l'éternelle question » de Presstalis s'est de nouveau imposée dans les débats. Je ne reviens pas sur le feuilletonnage presque quotidien des annonces, alliances et revirements, on est plus dans « Games of Thrones » que dans une discussion sérieuse. Le vote de la loi d'octobre 2019 de modernisation de la distribution de la presse, dont nous avions été saisis en premier lieu, offre un cadre adapté pour le futur, mais n'a jamais eu pour objet de solder le passif financier, et oserais-je dire moral, d'une entreprise qui survit depuis des années grâce à des transferts publics massifs et au soutien « à bout de bras » des grands éditeurs qui sont aussi ses actionnaires et qui paient aujourd'hui des errements de gestion dont ils sont, en partie au moins, comptables. Dernièrement, et alors même que la situation syndicale semblait constructive, la grève portant sur la distribution des quotidiens nationaux dans certaines régions illustre la crispation d'un dossier qui attend maintenant son règlement judiciaire sans cesse repoussé. Pour résumer, nous sommes dans un marais, la seule certitude étant que la solution coûtera certainement cher, une nouvelle fois, à l'État.
Enfin, les conséquences du confinement impactent durement un secteur déjà largement fragilisé. La diffusion a diminué de 20 % en moyenne, les recettes publicitaires de 80 %. Les activités de diversification dans l'évènementiel sont pour leur part au point mort. Les titres sont donc confrontés à une chute simultanée de l'ensemble de leurs sources de revenus. Cette situation est d'autant plus paradoxale que la fréquentation des sites a plus que doublé la première semaine de confinement et demeure à un niveau très élevé. Cependant, ce regain d'intérêt, signe au demeurant positif de la confiance que les Français accordent à leur presse, ne se traduit pas par des revenus suffisants, loin s'en faut.
Il faut donc envisager, et appeler à une prise de conscience de ce triple étau qui enserre la presse, une action de soutien concertée, qui ne se limite pas à des réponses purement conjoncturelles à la crise actuelle, mais offre également un cadre clair et stabilisé pour le monde « post-Covid ».
Premièrement, un soutien financier urgent doit être envisagé.
Frappant un secteur déjà largement fragilisé, la crise de la Covid appelle un soutien financier d'ampleur. Si je parle « d'ampleur », c'est évidemment au regard du secteur, d'une taille finalement modeste par rapport à tant d'autres, je pense à l'aviation ou au transport. Cette aide peut prendre plusieurs formes.
Tout d'abord, il est possible de monter un fonds de soutien spécifique, mais aussi de s'appuyer sur les outils déjà existants comme le Fonds stratégique pour apporter dès le prochain collectif budgétaire un soutien financier aux titres de presse.
Ensuite, il est possible de concentrer sur la presse les campagnes de communication institutionnelle du Gouvernement, de préférence aux plateformes numériques. C'est une mesure finalement simple et, oserais-je dire, de souveraineté, un terme qui revient à la mode !
Enfin, et c'est plus complexe, il y a l'outil fiscal. Plusieurs mesures fiscales destinées à soutenir la presse sont à l'étude, certaines évoquées dans le plan filière présenté par la presse IPG (Information de politique générale) en avril 2019. Pour l'heure, nous ne disposons ni d'évaluations financières, ni d'études d'impact, sur des mesures comme un crédit d'impôt sur les abonnements à la presse, ou bien une TVA à 0 % sur les publications de presse, une mesure par ailleurs déjà appliquée en Belgique.
La question d'un crédit d'impôt spécifiquement destiné à relancer le marché de la publicité est plus complexe. Elle s'est imposée dans les débats et reçoit aujourd'hui un large soutien, qui dépasse le cadre de la presse puisque les médias audiovisuels sont également intéressés, ce que Jean-Pierre Leleux pourra nous confirmer.
Je note cependant deux types de problèmes.
Le premier est que si l'initiative semble soutenue par le ministère de la culture, elle ne l'est pas encore, loin s'en faut, par Bercy. Je peux comprendre au passage cette position : chaque secteur recherche activement à obtenir telle ou telle mesure.
Second problème, et d'après les échanges que nous avons eus, la mesure ne fait en réalité pas consensus sur ses contours, ni même sur sa pertinence, au sein même de la profession. Son champ est incertain : faut-il une mesure large qui rassemble tous les médias, au risque de la diluer et d'en faire profiter certains acteurs moins légitimes que d'autres, ou bien la resserrer sur les médias d'information - qu'il faudrait alors circonscrire, une telle définition n'existant pas dans notre droit - ? En tout état de cause, il faudra veiller à ce que cette mesure ne bénéficie pas en premier lieu aux grands vainqueurs de la période que sont les plateformes en ligne. Son mécanisme enfin n'est pas encore clair : faut-il une mesure ciblée sur les annonceurs, qui déduiraient alors une fraction des dépenses de publicité de leurs impôts, ou bien centrée directement sur les diffuseurs, suivant des modalités qui restent à définir ?
Comme vous le voyez, la définition de ces paramètres occasionnera sans nul doute des incompréhensions entre, d'un côté, les tenants de l'orthodoxie budgétaire et de l'autre, ceux d'un soutien massif, mais également au sein même de la profession, entre différents types de médias (presse écrite, télévision, radio...) et au sein même des familles, où chacun estimera qu'il doit en bénéficier.
Deuxièmement, il faut donc s'attaquer aux difficultés structurelles de la presse.
Notre commission mène depuis plusieurs années une action déterminée pour faire évoluer la législation en faveur de l'indépendance éditoriale, mais également économique de la presse, que ce soit en anticipant l'adoption de la directive sur les droits voisins, que la France a été la première à transposer, qu'en amendant en profondeur la loi sur la modernisation de la distribution.
Sur ces deux dossiers cependant, qui constituent les deux défis les plus structurels du secteur, il reste encore du chemin à parcourir, ce qui est rendu d'autant plus criant que la crise actuelle agit comme un révélateur de faiblesses plus anciennes.
Les deux orientations suivantes devraient donc être suivies.
Tout d'abord responsabiliser les acteurs du dossier « Presstalis ».
Nous assistons ces derniers jours à un véritable festival de déclarations, contre-déclarations et jeux de rôle. A la clé, cependant, il y a le sort de près de 1 000 salariés et la distribution de la presse dans le pays. Dans les jours prochains, les négociations devraient aboutir à une solution dont on connait déjà finalement les grandes lignes, à savoir la constitution d'une messagerie unique autour des MLP, messagerie à laquelle les quotidiens nationaux sous-traiteraient la distribution de leurs flux. La non-distribution des quotidiens nationaux dans certaines régions suite à une grève constitue une épreuve supplémentaire dont la filière aurait pu faire l'économie.
Il faut cependant conditionner toute aide supplémentaire de l'État à l'émergence d'une solution acceptée par une grande majorité des éditeurs et qui règle enfin pour les prochaines années la question de la distribution. Cette solution ne doit cependant pas reposer exclusivement sur des financements publics, mais faire contribuer les actionnaires.
Ensuite, il faut durcir le rapport de force avec les grandes plateformes en ligne.
Il est impératif de soutenir, au besoin par de nouvelles dispositions législatives, les efforts des éditeurs pour obtenir des plateformes la juste rémunération de leurs publications, en application de la loi sur les droits voisins. L'attitude non coopérative de Google et Facebook a été une première fois fragilisée par la prise de position récente de l'Australie qui a décidé d'imposer des droits voisins, ainsi que par la décision de l'Autorité de la concurrence, qui constitue une défaite pour les plateformes en leur imposant d'ouvrir sans tarder des négociations.
Il est de notre devoir, aujourd'hui, de poursuivre notre mobilisation et surtout, de maintenir une saine pression sur les géants du numérique.
Voilà, mes chers collègues, les principales conclusions de notre groupe de travail. La presse est plus que jamais nécessaire à notre équilibre démocratique, et doit être protégée, mais avec discernement !
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je vous remercie monsieur Laugier pour cet excellent rapport et invite à présent les autres membres du groupe de travail à prendre la parole. Souhaitent-ils s'exprimer ?
M. David Assouline . - Je salue à mon tour la qualité de ce rapport qui recense l'ensemble des problématiques du secteur. Il démontre que la situation est catastrophique et de surcroît sans perspectives très positives.
Les abonnements par internet ont augmenté - la mutation en cours s'en trouve ainsi accélérée - mais le problème majeur est que pour compenser les pertes financières, alourdies par les pertes publicitaires, il faudrait trois abonnements internet pour un abonnement « papier ». Nous en sommes loin.
Le secteur de la presse attend également beaucoup de l'application de la loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse. Je rappelle que sous l'injonction de l'Autorité de la concurrence, les négociations entre Google et les éditeurs de presse devraient enfin reprendre.
A défaut de résultats, faut-il durcir la loi, sachant que j'avais jusqu'à présent miser sur leur bonne volonté ? Et dans quelle mesure pourra-t-elle l'être sans atteindre par ricochet des sites beaucoup moins prédateurs ?
Il conviendrait de transposer sans tarder les autres articles de la directive relative aux droits d'auteur et aux droits voisins afin d'imposer aux plateformes de contribuer au financement de la création. Nous aurons donc l'occasion d'en discuter dans les semaines à venir. Cela est d'autant plus important aujourd'hui que les nouveaux moyens financiers de la presse sont représentés en grande partie par ces revenus du numérique.
La presse papier, et avec elle sa diffusion sur le territoire, représente dans notre pays un grand acquis démocratique et une garantie du pluralisme d'expression y compris politique. Sa disparition est en jeu.
M. Max Brisson . - Je tiens à remercier à mon tour Michel Laugier pour la qualité de son animation du groupe et pour celle de son rapport très fidèle à l'esprit de nos travaux.
J'avoue avoir été impressionné par l'ampleur de la crise. Le président du syndicat de la presse magazine a parlé d'un « infarctus Covid-19 sur un corps particulièrement malade et aux pathologies extrêmement nombreuses » et a communiqué les chiffres alarmants de la trésorerie du groupe Bayard presse. Je pense que nous devons alerter sur cet effondrement et insister sur l'urgence des mesures à prendre pour sauvegarder la trésorerie des principaux groupes de presse.
Le Gouvernement doit définir un modèle économique juste, qui ne bénéficie pas aux seuls prédateurs. Ce qui m'a surpris finalement, c'est que le constat est assez partagé. Les mesures à prendre obligent à des choix politiques forts et seront difficiles à mettre en oeuvre.
Nous devons poursuivre nos travaux pour continuer à être force de proposition.
M. André Gattolin . - Bravo pour ce rapport particulièrement intéressant. Je voudrais revenir sur quelques points soulevés par Michel Laugier. Concernant les aides à la presse, on se rend compte, au travers de la mission « remboursements et dégrèvements » qui représente le premier budget de l'État, que l'efficacité des crédits d'impôt est faible, surtout lorsqu'elle est généralisée.
Ainsi, le crédit d'impôt Annonceurs ne permettrait pas d'améliorer la trésorerie des quotidiens à très faibles ressources publicitaires, dont les revenus demeurent par définition presque exclusivement issus de la vente au numéro. L'exemple du Canard Enchaîné vient immédiatement à l'esprit.
Les crédits d'impôt n'ont de sens que s'ils sont ciblés. A l'instar du président du groupe M6, Nicolas de Tavernost, auditionné par le groupe de travail « médias audiovisuels » dirigé par Jean-Pierre Leleux, je crois beaucoup à un crédit d'impôt « éditeurs » plutôt qu' « annonceurs », auprès desquels le risque d'une déperdition en ligne est réel. Les plans médias vont-ils rester identiques ? Vont-ils considérer la presse ou son volume, et à l'intérieur de la presse ? Quelles versions privilégieront-ils, internet ou papier ?
Une analyse en profondeur est nécessaire. Personnellement, je crois plus aux aides aux personnes, à la condition qu'elles soient ciblées - les journalistes, les intermittents, etc. - qu'aux aides aux structures.
Enfin, concernant les plateformes, une approche globale du secteur de la culture me paraît primordiale, même si elle revêt des logiques différentes selon que l'on parle musique ou production audiovisuelle et filmique. Pourtant, la question des plateformes se pose tout aussi bien pour une plateforme souveraine pour la presse écrite que pour le livre et l'édition.
C'est un peu le sens du travail que je mène avec mon collègue, Jean-Marie Mizzon, sur le livre numérique. Si nous sommes sous la domination des grands opérateurs, nous serons à la fois évincés en termes de référencement et les supports seront aspirés en termes de marge.
Par exemple, l'idée d'une plateforme souveraine pour l'écrit ne serait-elle pas plus puissante à l'échelle francophone - France, Belgique, Suisse, Québec - qu'à l'échelle nationale ?
Considérons aussi ce qui se passe dans d'autres pays : certains dirigeants de grands groupes de presse refusent toute aide directe du Gouvernement, comme en Suisse avec le groupe Ringier Axel Springer ?
Le développement de plateformes s'accompagnera du problème des réseaux de distribution physique. Si on développe une plateforme d'abonnements et de consultations internet aussi bien de la presse écrite que des livres, quid des diffuseurs de presse ? Quid de la librairie ? Il faudrait articuler tout cela, pour parvenir à faire des propositions ni trop globales ni trop incantatoires.
M. Jean-Pierre Leleux . - Je salue à mon tour le rapport fort exhaustif qui vient d'être présenté par Michel Laugier. Je voudrais souligner deux points d'ordre général. Le premier porte, comme vous l'avez dit, sur la spécificité du secteur de la presse par rapport aux autres secteurs frappés par l'épidémie : il était déjà malade avant la crise laquelle lui assène le coup de grâce.
Et pour ce secteur également, l'enjeu n'est pas uniquement économique et social, il est démocratique. L'effondrement du pluralisme de la presse au travers des faillites qui risquent de s'ensuivre est un enjeu crucial dans les temps à venir. Ce premier point mérite une attention particulière.
Le deuxième point concerne les différentes mesures de soutien proposées. Elles sont légitimes, notamment dans le cas gravissime de Presstalis, mais elle m'inquiète de par leur volume non estimé, et ce dans tous les secteurs. Il me semble nécessaire et pragmatique de faire l'addition de ces mesures et d'estimer le volume de toutes les aides préconisées. Il en va de notre responsabilité budgétaire.
Plus particulièrement, je voudrais saluer l'initiative de l'audiovisuel public, et notamment France 2 qui chaque soir, au journal télévisé de 20 heures, invite un rédacteur en chef de la presse écrite pour promouvoir la lecture d'un journal particulier en présentant son édition du lendemain.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je vous remercie chers collègues pour ce travail. L'accélération de la digitalisation du monde évoquée par André Gattolin doit en effet nous projeter dans une large réflexion sur notre écosystème. Je pense que Françoise Laborde évoquera des problématiques similaires liées à la dépendance des plateformes qui sont aujourd'hui incontournables, dans le domaine de la culture en général et de notre économie en particulier.
Je suis tout à fait favorable à ce que nous menions une large réflexion sur ce sujet, tout secteur confondu, dont celui de l'audiovisuel, Jean-Pierre Leleux le sait bien. Face à ces grands bouleversements, nous devons être fermes face aux géants du numérique, faire appliquer les différentes directives et trouver des partenaires européens pour faire avancer notre cause. La réouverture de la directive e-commerce peut constituer une des solutions.
Dans mon département, les quotidiens écrits, pas seulement Paris Normandie, m'ont alertée ces derniers jours sur le fait qu'ils étaient au bord de la rupture. Les difficultés préexistantes s'accélèrent et nous sommes projetés dans le monde d'après avec un nouveau modèle économique à imaginer, plus vertueux, tout en tentant de sauver l'existant.
Je soutiens pleinement les conclusions du rapport.
Livre et industries culturelles
MERCREDI 20 MAI 2020
___________
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Au regard de ce que je viens d'évoquer et pour rester dans une certaine cohérence d'un point de vue diagnostic, j'aimerais que l'on aborde maintenant les industries culturelles. Je donne donc la parole à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde . - Notre groupe de travail a procédé à plusieurs auditions dans l'ensemble des secteurs des industries culturelles. Je remercie chaleureusement mes collègues - Marie-Thérèse Bruguière, Laure Darcos, Colette Mélot, Jean-Marie Mizzon, Michel Laugier et André Gattolin - pour la qualité de nos échanges et la richesse des questions posées aux différents intervenants.
Du fait des problématiques similaires au sein des différents secteurs, comme vient de le souligner notre présidente, j'ai transmis le rapport aux animateurs des autres groupes de travail.
Mon propos va tenir en trois points, qui sont autant d'impératifs pour le monde des industries culturelles : anticiper, compenser, se projeter.
Anticiper tout d'abord : la levée partielle du confinement depuis le lundi 11 mai ne signifie pas, vous le savez, la reprise du cours normal de nos vies. Cela est encore plus vrai dans le domaine des industries culturelles. Si les librairies ont pu ouvrir leurs portes, les salles de cinéma sont encore dans l'expectative et confrontées à un défi majeur.
Dès lors, et c'est sa première préconisation, le groupe de travail souhaite qu'un message clair et univoque soit porté sur la réouverture des salles, afin d'éviter qu'elles ne soient vides - ce qui accentuerait encore les difficultés des exploitants - ou qu'elles doivent fermer de nouveau si des cas de contamination y étaient enregistrés. Cela sera d'autant plus facile que des conditions sanitaires claires auront été posées et acceptées et surtout, que la décision aura été prise avec au moins cinq semaines d'avance. Cela implique également l'édiction, par les professionnels, de règles sanitaires claires, qui doivent être validées, comme cela a été le cas pour les librairies, par les pouvoirs publics.
Ensuite, du côté des tournages, le Président de la République a annoncé le 6 mai la mise en place d'un fonds d'indemnisation. Il est essentiel que ses contours et son financement, en lien avec les collectivités locales et les assurances, soient rapidement définis. De même, il faut encourager les travaux actuellement menés pour permettre aux tournages d'être assurés. Au passage, je pense que l'on peut souligner l'attitude décevante des assureurs sur l'ensemble de l'épisode, ils ne se sont clairement pas montrés à la hauteur et, là encore une réflexion devra avoir lieu.
Après l'épisode d'anticipation de la reprise d'activité, il est temps de passer à la compensation pour éviter la débâcle.
Les premières estimations de pertes évaluent la destruction de valeur due à la crise à 8 à 10 milliards d'euros pour les industries culturelles et créatives. Ces pertes sont pour une bonne partie irréversibles : les festivals déprogrammés ne pourront pas être organisés, des livres et des films ne pourront pas sortir, entraînant des revenus nuls pour les exploitants comme pour les auteurs.
La crise a des conséquences financières dramatiques pour toute la chaîne de valeur. Il faut fortement attirer l'attention sur ce fait, et prendre conscience que la relance passera tout d'abord par des mesures massives de compensation.
Ce cas n'est pas unique : le tourisme, l'aéronautique, l'automobile, tous vont recourir à des capitaux publics, dans des proportions d'ailleurs considérables - sept milliards d'euros pour Air France par exemple.
Il faut cependant prendre en compte la spécificité des industries culturelles, dont le coeur d'activité, qui est le contact, la création, les sorties, est spécifiquement fragilisé.
Pour donner un ordre d'idée : les libraires estiment les mesures nécessaires entre 40 et 50 millions d'euros jusqu'en septembre ; dans le domaine de la musique, la SACEM évalue sa perte à 250 millions d'euros, soit environ 170 millions de droits qui ne seront pas versés aux auteurs ; le CNC, qui prend une part active pour soutenir les entreprises du secteur, estime à 120 millions d'euros ses pertes, essentiellement en raison de l'arrêt de la perception de certaines taxes. Ce chiffre pourrait encore augmenter en fonction de la date de réouverture des salles de cinéma.
Pour lors, le Président de la République a annoncé une dotation de 50 millions d'euros au Centre national de la Musique, ce qu'il faut saluer pour cette institution portée sur les fonts baptismaux cette année, notamment suite au travail de notre commission et du rapporteur Jean-Raymond Hugonet.
Ces données encore très partielles illustrent, selon le groupe de travail, l'ampleur des efforts budgétaires qu'il faudra très vraisemblablement consentir, simplement pour ne pas voir des pans entiers de l'économie française s'effondrer.
Il faut également, en matière de soutien, tenir compte du décalage dans le temps de l'impact de la crise.
Il se fera durablement sentir durant plusieurs mois ou années. Par exemple, les revenus des auteurs et des ayants droits seront plus particulièrement affectés en 2021, au moment d'une répartition des droits qui couvrira la période de confinement.
Le groupe de travail appelle donc les pouvoirs publics à considérer sur le temps long les effets de la crise, et à agir de manière concertée et massive le plus rapidement possible pour rassurer le secteur et conforter la viabilité de son modèle économique.
Enfin, mon dernier point porte là où nous devons aussi intervenir : se projeter dans l'après.
Les mesures provisoires prises notamment avec la loi du 23 mars 2020 ont permis au secteur de ne pas connaître un effondrement. La situation étant pour encore longtemps loin de la normalité, il convient d'ores et déjà d'en prévoir et d'en annoncer la prolongation, en particulier en ce qui concerne la capacité des Organismes de gestion collective à utiliser les crédits d'action culturelle pour venir en aide à leurs sociétaires ou les mesures dérogatoires de la chronologie des médias.
Il faut aussi organiser une sortie progressive des mesures de chômage partiel. Les différentes industries culturelles en contact avec le public ne pourront en effet pas retrouver un niveau d'activité comparable à la période précédente en quelques semaines.
Plus fondamentalement, la crise du coronavirus a accentué des déséquilibres déjà existants et accéléré des évolutions. Je ne reviens pas sur le sujet très largement débattu dans notre commission, notamment sous l'impulsion de notre Présidente, de la place absolument menaçante prise par les géants du numérique, qui ont encore renforcé leur emprise. Je ne voudrais cependant pas adopter une attitude dogmatique : nous avons tous été heureux de pouvoir conserver un lien entre nous et avec nos familles par le biais des outils numériques, et nombre d'entre nous ont pu se détendre en profitant des plateformes en ligne. Simplement, il faut aussi prendre conscience que le revers de cette médaille peut être la captation de nos données et la constitution de monopole qui menacent à terme nos démocraties.
Il serait dès lors grand temps, probablement en lien avec nos collègues des autres commissions, de travailler à un rééquilibrage des conditions de concurrence, je pense par exemple aux tarifs postaux pour le livre, qui ne permettent pas aux libraires de lutter contre Amazon, ou bien à l'absence d'une plateforme souveraine de livres numériques, un sujet sur lequel travaillent nos collègues André Gattolin et Jean-Marie Mizzon.
Dans ce contexte particulier, il nous faut prendre position sur un élément déterminant pour la reprise du secteur à moyen terme. Comme vous le savez, la transposition des directives « Service Médias audiovisuel » (SMA) et « droits d'auteur » est prévue au titre premier du projet de loi « audiovisuel », avec une réforme de l'audiovisuel public et de l'ensemble de la régulation. La première de ces directives permet d'imposer aux plateformes en ligne des obligations d'investissement dans la production nationale et la diversité. Cet apport de financement serait d'autant plus utile que l'industrie souffre énormément, alors que les plateformes comme Netflix ont engrangé les succès.
Dès lors, la question d'une transposition rapide se pose, et est réclamée par l'ensemble de la profession. A ce stade, et compte tenu de son volume, il semble illusoire d'imaginer que l'examen du projet de loi puisse reprendre en l'état, car il occuperait la quasi-totalité de l'ordre du jour restant. Dès lors, l'idée d'une ordonnance de transposition des directives parait séduisante à beaucoup, mais ne peut que nous frustrer d'un débat que nous attendons tous depuis des années pour enrichir, compléter, améliorer le texte. Il y a là une ligne de crête complexe.
Voici ma position, que je soumets au débat : depuis près d'un an, la profession, je parle des producteurs, des chaînes, des réalisateurs, n'est pas capable de se mettre d'accord sur certains grands équilibres, qui sont en réalité autant de paramètres nécessaires avant d'aller mener les réelles négociations avec les grandes plateformes. Une accélération de la procédure législative ne permettrait donc de faire contribuer rapidement les plateformes que si les positions se sont rapprochées. Or l'exemple de l'interminable débat sur la chronologie de médias ne nous incite pas à l'optimisme quant à la capacité des professionnels à travailler ensemble... Dès lors, je pense que nous ne devrions accepter d'être d'une certaine manière privés d'un débat passionnant que si notre renoncement est utile à tous et permet, dès le 1 er janvier prochain, au nouveau système de se mettre en place. Telle est la position que je soumets à votre appréciation.
Voilà, mes chers collègues, les principaux enseignements que tire le groupe de travail de ses auditions. Nous mesurons bien l'ampleur du chemin à parcourir !
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je vous remercie pour cet excellent travail. Je vais à présent donner la parole aux membres du groupe.
Mme Colette Mélot . - Je tiens simplement à féliciter Françoise Laborde et les membres du groupe pour la qualité du travail accompli. Je souscris entièrement aux propos de Françoise Laborde.
Mme Laure Darcos . - J'ai pu assister à la moitié des auditions de ce groupe de travail auquel j'ai été ravie de participer et je souscris également aux propos de Françoise Laborde.
Je tiens à souligner que, dès le début du confinement, les industries culturelles ont été très réactives pour mettre en place un plan d'urgence, dans le secteur du livre, mais aussi avec la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD). Les organismes de gestion collective ont en effet été très présents auprès des auteurs et acteurs qu'ils représentent. Par contre, comme l'a dit David Assouline hier dans l'hémicycle, ils sont tous en attente d'un vrai plan de relance de la part du Gouvernement, à l'instar de celui proposé pour le tourisme, et il serait dramatique qu'il ne voie pas le jour.
En ce qui concerne le livre, que je connais particulièrement, le livre numérique, cher à André Gattolin, a été un palliatif, les éditeurs le confirment, uniquement pour les lecteurs déjà adeptes de cette pratique. La crise n'a pas ouvert de public supplémentaire et ce secteur continue de stagner. Rouvrir les librairies, en conformité avec la sécurité sanitaire, est donc essentiel, décision qui a provoqué de grands débats au sein du syndicat de la librairie française.
Je soutiens la proposition de Françoise Laborde, plébiscitée par les acteurs concernés, de voir le tarif postal Fréquencéo appliqué aux livres. Il est inadmissible qu'ils n'en aient pas bénéficié alors que d'autres secteurs ont pu l'utiliser, notamment de grands fournisseurs comme Amazon.
Je précise que la petite librairie du coin n'a pas les moyens de s'équiper en gels hydroalcooliques et en matériels sanitaires, indispensables pourtant dans un commerce où l'acheteur est amené à feuilleter et donc touché la marchandise. Certaines régions vont heureusement pouvoir les aider.
Je partage également l'avis relatif aux assurances, notamment pour les tournages, qui n'ont pu reprendre faute de garanties de la part des assureurs. Même chose pour les enregistrements musicaux, interrompus alors que les studios auraient pu être désinfectés, notamment par les artistes.
Je suis plus dubitative quant à la chronologie des médias et sur le retour dans les salles de cinéma. Autant les spectacles vivants et les livres sont dans notre ADN, autant je crains que le confinement ait habitué les gens à regarder les films en VOD. Beaucoup de professionnels du secteur estiment que le retour dans les salles de cinéma pourrait entrainer certaines réticences.
S'agissant de la chronologie des médias, je note que les acteurs du secteur ont jusqu'à présent toujours réussi à se mettre d'accord pour éviter que le Parlement ne se saisisse du sujet, même le couteau sous la gorge. Mais la situation aujourd'hui nous amènera peut-être à arbitrer vis-à-vis de certains acteurs du secteur, Netflix par exemple, Canal+ ayant l'air de vouloir se désengager complètement des financements à venir sur la production cinématographique, d'autant plus qu'ils risquent d'être rachetés par des Américains ou des Chinois.
Mme Françoise Laborde . - Je voudrais préciser que Canal+ ne réagit également que lorsque ses dirigeants ont le couteau sous la gorge, pour reprendre l'expression de Laure Darcos.
M. Michel Laugier . - Je salue l'excellent travail réalisé par ce groupe.
Pour revenir sur la question des mesures financières évoquée par Jean-Pierre Leleux, on va se heurter là aussi aux mêmes difficultés. Toute aide représente un coût et nécessite une estimation.
M. André Gattolin . - Je ne partage pas l'avis de Laure Darcos sur le fait que le livre numérique n'aurait été, pendant le confinement, qu'un palliatif.
J'auditionne beaucoup d'éditeurs actuellement, et Antoine Gallimard nous a fait part d'une progression de 40 % durant cette période. Le transfert du physique vers le numérique est lié aux pratiques des lecteurs c'est vrai, mais aussi au fait que les éditeurs, après avoir investi dans la numérisation des livres, s'en sont largement retirés depuis cinq ans. C'est parce que l'offre est limitée que le transfert est faible. L'inverse aurait cependant pour conséquence le risque de voir disparaître les petits éditeurs indépendants et surtout les petites librairies indépendantes.
Par ailleurs, je suis assez agacé d'entendre parler uniformément des plateformes : certaines sont pourtant monothématiques et d'autres plurithématiques. Concernant l'usage des données personnelles, il faut dissocier Netflix qui ne vend pas ses données personnelles, qu'il n'exploite qu'en interne conformément à sa charte, d'une société comme Amazon qui, au travers d'Amazon Prime, utilisent les données de son offre cinéma et de son offre marchande générale pour constituer une base de données globales.
En matière de plateforme souveraine, je rappelle que la première proposition remonte au rapport que j'avais réalisé avec Bruno Retailleau sur le jeu vidéo en 2013, où nous préconisions aux pouvoirs publics de créer une plateforme indépendante du jeu vidéo français ou francophone. C'était le seul moyen de résister à Steam, l'équivalent de Netflix, Apple ou Amazon dans le jeu vidéo, mais nous n'avons pas été suivis. J'appelle donc à plus de transversalité dans notre réflexion.
Je terminerai avec le cas du Centre national du cinéma (CNC) : le cinéma continue à être très bien financé. En comparaison, le système belge dépense moins d'argent et est beaucoup plus efficace aujourd'hui. Le CNC a fait des coupes sombres dans le domaine de la production audiovisuelle, cela nous a été dit par les représentants du groupe Newen : les séries sont moins financées ainsi que l'animation qui est pourtant l'un des grands secteurs de réussite dans l'exportation.
Le CNC préserve le cinéma, la directive SMA le lui permettra en bénéficiant de l'argent d'Amazon ou de Disney+ pour la production cinématographique. Mais il faut rester vigilant sur l'impact financier et sur la répartition du CNC pour soutenir les autres domaines.
Mme Laure Darcos . - Il est faux d'affirmer que les éditeurs se sont retirés de la numérisation : toute l'offre est maintenant simultanément proposée en papier et en numérique. J'ai exercé neuf ans dans ce secteur, les ventes numériques « plafonnent », on l'a constaté aux Etats-Unis.
Par contre, l'offre numérique progresse au niveau des prêts en bibliothèque ou médiathèque et a été davantage sollicitée durant le confinement, cela m'a été confirmé par les acteurs de ces structures. A l'achat, le livre numérique étant moins cher, la répercussion sur les ventes évoquée par Antoine Gallimard reste faible en termes de chiffres d'affaires. Le livre traditionnel a encore de beaux jours devant lui !
M. André Gattolin . - Mais je défends également le livre papier ! L'objet de mon étude est juste de comprendre pourquoi un secteur de la culture résiste à la numérisation,
Mme Sonia de la Provôté . - Mon intervention porte sur la question de l'animation qui vient d'être évoquée. Concernant le CNC, j'ai pu constater lors de nos auditions que l'animation et notamment l'animation française représente une part extrêmement importante des soutiens. Et j'ai eu des informations récentes démontrant qu'il s'agit d'un domaine où l'activité peut être maintenue, au niveau de la création comme au niveau de la production puisque les contraintes diffèrent de celles de la réalisation de films. Un certain nombre de studios sont en mesure de produire tout en respectant le protocole sanitaire.
Il me semble que ce domaine-là, où la France excelle, mériterait d'être accompagné, y compris dans le cadre d'un plan d'actions dans le domaine de la culture, à l'instar de celui pour le tourisme. Il représente un des facteurs de relance.
Quant au livre numérique, j'avais aussi entendu parler d'une augmentation de son accès, notamment chez Gallimard, mais le retour qui m'a été fait par les librairies qui ont rouvert dans mon département montre une présence accrue des clients. Il semble donc que la progression du livre numérique est plus une parenthèse que le fait d'un usage définitif en défaveur du livre papier.
M. David Assouline . - Françoise Laborde a soulevé dans son rapport une question que l'on aborde également dans notre groupe sur les médias audiovisuels, celle de la transposition de la directive afférente aux médias.
L'appréciation sur la conduite à tenir est selon moi la suivante : un grand débat semble compromis, la loi audiovisuelle est globalement enterrée, mais la question reste urgente et elle doit être traitée très rapidement, nous y avons tous intérêt.
La date du 1 er janvier, annoncée par le Président de la République, déroge aux dispositions de la directive qui spécifie une transposition en France d'ici le mois de septembre. Il nous faut rester sur ce mois de septembre pour qu'elle puisse effectivement être adoptée au 1 er janvier, on a pu le constater avec la loi que j'ai initiée sur les droits voisins, restée sans application un an après.
Plus la contribution des plateformes au financement des oeuvres audiovisuelles entre tardivement en application, plus nous aurons perdu de l'argent. Je suis prêt à soutenir l'adoption d'une ordonnance, le fait est assez rare, si et seulement si, en amont, nous sommes associés aux négociations, au sein des commissions des deux chambres, et avec toutes les forces politiques.
Ma seconde question porte sur l'animation et sur l'éventuelle fermeture de France 4. Faisant partie du conseil d'administration du CNC, je confirme que des initiatives ont eu lieu, notamment avec la SACD qui a ouvert un fonds de solidarité en faveur des auteurs.
Dans le cadre des auditions menées par le groupe de travail médias audiovisuels, Delphine Ernotte nous a indiqué que le ministre lui avait demandé de prévoir deux scénarios pour l'avenir de l'animation sur les chaînes du service public : l'un avec France 4, l'autre sans. Dès le lendemain, elle a envoyé les grilles de programmes correspondantes. Or, le ministre reporte de plusieurs semaines sa décision alors que la chaîne doit fermer dans onze semaines !
Serait-il envisageable que notre commission, représentée par notre présidente mais aussi par chacun de ses membres investis sur cette question de façon importante, interpelle publiquement le ministre pour lui demander le maintien France 4 ?
Ce serait un signal fort en direction de l'animation et de l'éducation des jeunes publics. Samia Ghali, maire adjointe à Marseille, m'a dit que dans certains quartiers de sa ville, où des élèves défavorisés sont dépourvus d'internet ou même d'ordinateurs, la chaîne a été un vecteur essentiel en matière d'éducation grâce aux cours qu'elle a diffusés dont la qualité a été constatée par tous.
Il nous faut à mon sens hausser le ton, non de manière vindicative, mais de façon à faire ressortir nos positions et peser dans la balance.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je partage cet avis sur France 4 et nous y reviendrons. Les problématiques qui viennent d'être soulevées correspondent à celles du groupe de travail sur les médias audiovisuels, je donne donc la parole à Jean-Pierre Leleux.
M. Jean-Pierre Leleux . - Le rapport présenté par Françoise Laborde, très exhaustif, met en exergue les passerelles qui existent entre les différents groupes de travail et j'adhère à votre suggestion, madame la présidente, de prévoir dans le rapport définitif une annexe réunissant les points transversaux traités par l'ensemble des groupes de travail.
Parmi ceux-ci, la reprise des tournages est un élément très important qui nécessite la création, comme l'a annoncé le Président de la République, d'un fonds auquel contribueraient les assureurs. Je partage en effet l'avis selon lequel ils sont défaillants, malgré les quelques centaines de millions d'euros qu'ils ont versés au fonds de solidarité globale. Il apparaît important que la création de ce fonds soit très rapidement engagée.
Cette reprise des tournages, que tous les producteurs et toutes les professions concernées souhaitent ardemment, inquiète du point de vue du chômage partiel. En effet, ils n'en bénéficieront plus à compter du 1 er juin prochain. Or, si une seule personne est contaminée par le Covid-19 sur un tournage, c'est tout le plateau qui s'arrête.
Je ne reviendrai pas sur la notion de crédit d'impôt, qui mérite d'être étudiée même si sa mise en oeuvre est difficile. La presse en attend beaucoup. Avec un encadrement judicieux, le crédit d'impôt annonceurs pourrait être proposé dans le cadre du plan de relance.
Je partage l'avis de David Assouline sur les points relatifs à la directive SMA et à France 4. L'urgence de la transposition de la directive SMA mérite peut être d'être traitée par ordonnance, aux conditions exposées, en s'assurant d'être associés à sa rédaction et à sa validation ultérieure. L'urgence de sa production est patente et attendue par tous les acteurs de l'audiovisuel et du cinéma.
Enfin, concernant France 4, la chaîne a manifesté son utilité lors de la période de confinement et, sous réserve d'un certain nombre d'améliorations, demeure nécessaire dans le paysage audiovisuel dédié à la pédagogie et aux enfants. Je suis donc favorable pour mener une forte action de pression en direction du Président de la République, car c'est bien au plus haut niveau de l'État que la suppression de cette chaîne a été décidée.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Avant de conclure, je donne la parole à Françoise Laborde qui souhaite peut-être réagir sur l'ensemble des propos formulés.
Mme Françoise Laborde . - J'ajouterai peu de choses. Les propos tenus font bien ressortir la nécessité d'une transversalité, nous en sommes tous conscients. Concernant la chronologie des médias et la transposition nous sommes d'accord sur leur urgence, et sur le fait d'y travailler de façon constructive et efficace. Avec ou sans ordonnance ? Cela reste un important sujet à traiter, comme celui du passage dans l'hémicycle et le travail en totale concertation comme conditions impératives.
Je voudrais aussi remercier tous les membres de la commission, car nous n'avons pas travaillé chacun dans notre coin, les préconisations transversales en sont la preuve. J'avais d'ailleurs transmis en amont nos conclusions à chaque animateur des groupes de travail.
Je suis entièrement d'accord pour mettre la pression sur le Président de la République qui me paraît en effet être le véritable interlocuteur.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je vous remercie. Notre conversation fait ressortir des sujets majeurs en résonnance avec les groupes de travail de notre commission mais aussi avec ceux d'autres commissions permanentes, comme celle des affaires économiques.
Vous avez évoqué la nécessité d'un rééquilibrage des règles de la concurrence ; il me paraît en fait qu'il faut avant tout les refonder, et ce au niveau européen. Aujourd'hui, les conditions du marché ne sont pas loyales et des abus de positions dominantes sont avérés.
André Gattolin a eu raison de souligner qu'il existe différentes sortes de plateformes et que l'on peut donc en promouvoir certaines, dès lors qu'elles respectent la protection des données. Nous espérons pour les autres, qu'elles finiront par verser à la création son juste dû, reverser une part de la valeur ajoutée captée par la circulation des contenus sur internet, s'acquitter de l'impôt, etc...
Concomitamment à la réouverture de la directive e-commerce, ces règles de la concurrence nécessitent d'être revues. Aujourd'hui, au niveau européen, dans des cas d'abus de positions dominantes, il n'existe pas de procédure de règlement des litiges, qui ne se règlent qu'après des années de procédures pour notifier les griefs et condamner certaines plateformes, comme Google. Ces mesures doivent d'ailleurs être définies en partenariat avec la commission des affaires économiques.
André Gattolin le sait car il faisait partie de la mission commune d'information sur la gouvernance d'internet dont j'étais rapporteure en 2015 : nous avions déjà énoncé tous les sujets et préconisations évoqués aujourd'hui. La régulation souhaitée se doit d'être offensive, pour voir appliquées les directives et ses transpositions, couplée à une politique industrielle puissante qui nous a fait défaut. Nous n'avons pas su investir dans les années 90, comme l'ont fait les Etats-Unis ou d'autres. La crise nous a fait prendre davantage conscience de cette situation, on a pu le constater avec l'épisode de l'application Covid-19.
J'ajoute que nous avons toujours bien travaillé avec la commission des affaires européennes. J'ai régulièrement des conversations sur ce sujet avec leur président, Jean Bizet, avec qui nous envisageons de reprendre un travail transversal, en lien encore une fois avec la commission des affaires économiques.
Par ailleurs, dans le cadre des plans d'urgence et d'accompagnement, voire de réflexions à la relance, le rôle des grandes collectivités territoriales n'a pas beaucoup été évoqué dans le rapport. Je rappelle que de par leurs compétences, les régions ont pris des mesures très importantes pour accompagner le secteur économique, y compris pour le secteur culturel. Il est vrai que les salles de cinéma et les librairies se situent entre les deux mais dans certaines régions, elles vont pouvoir bénéficier de l'accompagnement des dispositifs à la fois économiques et culturels.
La prise en charge des gels hydroalcooliques et autre matériel de protection sanitaire, évoquée par Laure Darcos, est aussi l'exemple de ce soutien régional, tout comme leur accompagnement pour la reprise des tournages, leurs fortes contributions à la production cinématographique, aux résidences d'écriture, etc. Il me paraît important de rendre justice aux collectivités que nous représentons en intégrant ce point au rapport.
Mme Françoise Laborde . - Ce rôle essentiel sera largement évoqué dans le rapport.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - D'autant que toutes nos régions, villes et intercommunalités, vont veiller à ce que nos salles de cinémas ne ferment pas, après tout le travail entrepris pour les numériser. Je rappelle d'ailleurs que le Sénat a été l'initiateur de cette loi qui a permis cette numérisation. Ce maillage a été exceptionnel et nous allons être très attentifs à la réouverture des salles et de nos librairies.
Pour ma part, j'ai regretté que les librairies ne restent pas ouvertes durant la période du confinement ; elles me paraissent être plus faciles à gérer qu'un grand supermarché. En contingentant les clients qui entraient, on aurait pu les maintenir ouvertes.
Mme Laure Darcos . - Bruno Le Maire l'a également dit !
Mme Françoise Laborde . - Malheureusement le syndicat des libraires a pris cette décision de fermeture, à notre grand étonnement.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je souhaite que l'on puisse maintenant énoncer des propositions fortes que notre commission pourrait faire.
Concernant France 4, nous nous sommes tous mobilisés dès l'annonce de sa suppression par Françoise Nyssens et lors d'un récent conseil d'administration de France télévisions, dont je fais partie, ce sujet a été à nouveau évoqué avec la présentation de la nouvelle grille liée à la période de confinement. Delphine Ernotte a précisé que « l'écran allait être noir le 9 août » et que cela ne dépendait pas d'elle.
Je partage la position de David Assouline et de Jean-Pierre Leleux à ce sujet : il faut lancer une action forte, peut-être une lettre au Président de la République. J'ai trouvé regrettable à l'époque qu'on annonce la suppression d'une chaîne sans réflexion cohérente sur l'impact de cette décision, notamment sur le bouquet de chaînes et sur toute la filière animation, comme l'a dit Sonia de la Provôté. Je ne veux pas m'appesantir sur le sujet mais je pense en effet qu'il faut agir de manière forte.
Je pense par ailleurs que la transposition des dispositions de la directive SMA doit être réalisée de manière urgente. J'ai été sollicitée par l'ARP, société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs, et nous les avons entendus avec Françoise Laborde. Ils militent quant à eux pour l'adoption d'une ordonnance.
Je vais demander au secrétariat de travailler sur le sujet. La chronologie des médias reste un sujet sensible. J'en veux pour preuve l'action qu'avait menée Jean-Pierre Leleux, dans le cadre de la loi LCAP au travers d'un amendement qui a permis de retrouver un équilibre entre distributeurs et producteurs s'agissant des droits.
J'avais moi-même émis un rapport sur ce sujet, bien avant que le ministère de la culture s'en empare, mais malheureusement les travaux du Sénat n'ont pas été considérés. La médiation a été relancée et les acteurs concernés, comme Canal+ ou les exploitants cinématographiques qui sont les plus durs en termes de négociations, en ont profité pour faire traîner les choses.
Il convient que les acteurs se rendent compte que l'heure n'est plus aux chicaneries mais à la solidarité, sous peine de voir le système entier s'effondrer face à la concurrence extra-européenne, représentée notamment par Disney.
Accepter que cela puisse se faire sous forme d'ordonnance pourrait être conditionné au fait que les acteurs de la chronologie des médias se mettent rapidement d'accord.
Nous avons des pistes d'intervention et de travail très intéressantes qui regroupent le diagnostic de plusieurs groupes de travail.
M. David Assouline . - Je propose de nous en tenir à réclamer une transposition rapide des directives. Si le Gouvernement envisage l'adoption d'une ordonnance, nous en négocierons les conditions le moment venu.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - En effet. Je souhaiterais avoir l'avis de Jean-Pierre Leleux sur la démarche à suivre.
M. Jean-Pierre Leleux . - Je suis par nature méfiant à l'égard des ordonnances et des lois d'habilitation. Mais si le Gouvernement nous associe à la rédaction du texte, nous pourrons en rediscuter.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je vous propose d'inviter le Gouvernement à transposer rapidement les dispositions de la directive.
Mme Françoise Laborde . - Je suis d'accord.
Enseignement supérieur
MERCREDI 20 MAI 2020
___________
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je donne maintenant la parole à Stéphane Piednoir qui va nous exposer la situation du secteur de l'enseignement supérieur.
M. Stéphane Piednoir . - Il me revient donc de vous rendre compte de cette partie des douze travaux herculéens de notre commission, preuve de la transversalité de ses prérogatives.
Le groupe de travail, que j'ai eu l'honneur d'animer, est composé de Mireille Jouve, Guy-Dominique Kennel, Laurent Lafon, Pierre Ouzoulias, Olivier Paccaud et Sylvie Robert. Il a mené un travail d'audition auprès des principaux acteurs du secteur, centré sur trois grandes problématiques : la continuité pédagogique, l'organisation des examens et des concours, l'accompagnement sanitaire et social des étudiants.
Fort de ces échanges et des remontées d'informations dont ses membres ont été destinataires dans leurs départements respectifs, il constate que la gestion de la crise sanitaire s'est caractérisée par une réponse globalement réactive et concertée de la part du ministère de l'enseignement supérieur.
S'agissant de la continuité pédagogique, apparue comme une priorité absolue, le groupe de travail salue l'incroyable mobilisation et la capacité d'adaptation des équipes tant pédagogiques qu'administratives pour accompagner les étudiants dans ce passage au « tout virtuel ». Ce constat ne doit évidemment pas masquer ni la diversité des situations ni les difficultés rencontrées.
Compte tenu de la fermeture des établissements jusqu'après l'été et des dernières déclarations de la ministre indiquant la poursuite d'un enseignement « hybride » à la rentrée de septembre, on peut s'attendre à une modification durable et en profondeur des pratiques pédagogiques, qui s'appuient davantage sur les outils numériques. J'ai eu l'occasion d'insister sur ce point lors du débat qui s'est tenu hier au Sénat, à l'initiative de notre commission.
S'agissant de l'organisation des examens et des concours, des adaptations étaient nécessaires au regard du contexte. La ministre a invité les universités, qui organisent traditionnellement des contrôles de connaissances au printemps, à procéder à des adaptations dans le cadre de trois orientations : la réduction du recours aux épreuves en présentiel ; en cas de maintien d'épreuves en présentiel, la nécessité de les organiser entre le 20 juin et le 7 août afin de limiter les perturbations sur l'année universitaire 2020-2021 ; le respect de règles très strictes d'organisation pour assurer la sécurité sanitaire des étudiants et des personnels mobilisés. Le groupe de travail approuve ces orientations qui posent un cadre général et national.
Le remplacement des concours post-baccalauréat par un examen des dossiers constitue sans doute la moins mauvaise des solutions en raison des protocoles sanitaires difficilement tenables, tout en préservant les chances de réussite des candidats.
Quant à la réorganisation des concours post-classes préparatoires, il faut saluer le bon travail du comité de pilotage, teinté d'un pragmatisme évident, pour parvenir à une vision concertée et convergente. Toutefois, la suppression des oraux d'admission, essentiels pour détecter les qualités et compétences des candidats, ne sera pas neutre sur les caractéristiques de la cohorte 2020 et devra être prise en compte durant le cursus en école.
S'agissant des concours externes de recrutement de l'éducation nationale, pour lesquels les épreuves orales d'admission ont été supprimées et remplacées par un oral de titularisation à l'issue de l'année de stage, le groupe de travail s'interroge sur la pertinence d'une telle mesure pour des personnes qui s'apprêtent à enseigner dès la rentrée prochaine.
Sur le volet sanitaire, la présidente du Cnous nous a indiqué qu'environ 50 000 étudiants avaient été confinés en résidence étudiante et qu'aucun foyer épidémique n'était à déplorer. Le groupe de travail salue la très forte mobilisation des personnels du Cnous, des Crous, des services de santé universitaires, des bénévoles associatifs, ainsi que des collectivités locales, qui ont continué à assurer leurs missions dans un contexte très anxiogène.
Sur le volet social, quatre leviers ont été activés pour venir en aide aux étudiants : les aides d'urgence des Crous ont été abondées de 10 millions d'euros ; les ressources issues de la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) ont été mobilisées à hauteur de 80 millions, à destination des étudiants boursiers ou non ; le versement de bourses a été effectué dans les temps : se pose maintenant la question de leur éventuel maintien en juillet ; l'aide exceptionnelle de 200 euros, annoncée par le Premier ministre concernera 800 000 jeunes ayant perdu leur stage ou leur emploi, les étudiants ultramarins et les jeunes précaires ou modestes.
Ce constat général dressé, le groupe de travail appelle à la vigilance sur les points suivants :
- la transition entre le second degré et le supérieur qui pourrait s'avérer plus compliquée, compte tenu des bouleversements de l'année scolaire 2019-2020 - la crise sanitaire bien sûr, mais aussi les manifestations des gilets jaunes et d'autres évènements sociaux de l'hiver dernier - ;
- les limites de l'enseignement supérieur à distance au regard de la fracture numérique qui prive une part non négligeable d'étudiants de la continuité pédagogique, pour des raisons principalement techniques ;
- la mise en place des examens en distanciel qui interroge tant sur le plan de l'équité entre les candidats que des modalités de surveillance à distance au regard du respect du règlement général sur la protection des données (RGPD) ;
- l'organisation des concours en présentiel qui pose un vrai défi en termes de nombre de centres d'examens, des modalités de surveillance, des mesures sanitaires, des déplacements et de l'hébergement des candidats ;
- la clarification des moyens dédiés aux mesures d'aide aux étudiants, qui pourraient s'avérer sous-calibrés face à l'ampleur des besoins ;
- les conséquences financières de la crise sur les Crous qui vont accuser une forte baisse de leurs recettes d'exploitation, du fait du gel des loyers pendant le confinement.
Le groupe de travail formule aussi sept préconisations complémentaires pour une gestion des effets de la crise à moyen terme :
- étudier la mise en place d'une période de remédiation en début de première année universitaire ;
- inciter les universités à se préoccuper davantage de l'équipement informatique individuel des étudiants ;
- soutenir les formations professionnalisantes et accompagner les jeunes diplômés 2020 à s'insérer sur le marché du travail déjà fortement dégradé, au moyen de mesures incitatives à l'embauche, d'aides ciblées en faveur de la recherche d'emploi, de facilités pour le remboursement des prêts bancaires ;
- financer le prolongement des contrats doctoraux et postdoctoraux, dont il faudra préciser les conditions d'octroi, par une augmentation de la subvention pour charges de service public des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
- encourager et adapter l'accueil des étudiants internationaux en communiquant davantage, en envisageant des mobilités plus courtes et plus ciblées, en simplifiant les procédures d'obtention de visa, en clarifiant la question d'une éventuelle mise à l'isolement de ces étudiants à leur arrivée ;
- mieux considérer les études de santé en assouplissant les critères de sélection en première année commune aux études de santé (Paces) pour cette année, en valorisant les stages effectués dans les services hospitaliers pendant la crise, en attribuant une prime exceptionnelle à l'ensemble des étudiants en médecine, étudiants infirmiers et étudiants techniciens de laboratoire mobilisés durant cette période ;
- réfléchir à la mise en place d'un plan ambitieux de rénovation des bâtiments universitaires comme facteur de relance économique.
Je tiens à remercier mes collègues qui ont participé aux auditions et qui ont nourri les conclusions de ce rapport de manière très consensuelle et très complémentaire.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Merci pour cette présentation très complète. Je vais maintenant donner la parole aux membres de ce groupe de travail.
M. Guy-Dominique Kennel . - Je remercie notre président de groupe dont vous aurez remarqué sa présentation synthétique et pédagogique.
Les auditions ont été très intéressantes et les préconisations émises, notamment pour la rentrée universitaire, mériteraient d'être mises en exergue auprès de la ministre en charge de l'enseignement supérieur. Les universités connaissent et vont encore connaître d'énormes problèmes, notamment au niveau sanitaire et social. D'un point de vue pédagogique, les cadrages réalisés et les préconisations empreintes de bon sens que nous faisons seront, je pense, probablement entendus.
J'ajoute que les difficultés sanitaires et sociales toucheront fortement les étudiants étrangers, qui sont assez nombreux - sur Strasbourg, ils représentent plus de 27 % des étudiants - et tous les étudiants en général. La crise a révélé un point inquiétant : la fracture existante entre les jeunes qui ont les moyens de pouvoir se procurer un certain nombre de supports et ceux qui ne les ont pas, qui doivent travailler pour se les procurer et donc consacrer moins de temps à leurs études. Nos préconisations à ce sujet nécessitent des moyens financiers supplémentaires, mais les étudiants en difficulté me paraissent constituer une priorité.
M. Laurent Lafon . - Je salue également le travail de rédaction et de présentation de Stéphane Piednoir qui restitue parfaitement nos constats et nos recommandations.
Si, dans le débat public, l'on a moins parlé du supérieur que du scolaire, c'est que la pédagogie par le numérique est plus facile pour des étudiants qui ont déjà l'habitude de ces outils. Or il connaît aussi de vraies problématiques dont deux que je souhaite souligner.
La première concerne l'orientation et plus particulièrement Parcoursup dont il a relativement peu été question, considérant sans doute qu'une plateforme numérique ne pouvait que continuer de fonctionner en cette période. Si cela est vrai techniquement, l'accompagnement dans la réflexion de l'élève de terminale par ses professeurs principaux, par le CIO ou lors des journées portes ouvertes, pour le guider dans ses choix, a été en revanche affecté par le confinement. Je crains que l'orientation des jeunes s'en trouve moins affinée que les années précédentes et qu'elle soit source pour eux de beaucoup de déceptions.
À cela s'ajoute un autre phénomène également évoqué, à savoir que les élèves de terminale ont vu leur année scolaire tronquée par la crise sanitaire et les différents mouvements sociaux et qu'ils vont se retrouver à la rentrée universitaire prochaine dans un environnement complètement différent auquel ils auront été mal préparés, et avec un certain retard scolaire. Une remédiation apparaît donc nécessaire pour tenter d'amoindrir l'augmentation du nombre d'échecs en première année qui pourraient en découler, qui sera perçu comme un échec personnel par les étudiants. Nous devons être attentifs à ce point de fragilité.
M. Pierre Ouzoulias . - Je remercie à mon tour Stéphane Piednoir pour avoir restitué avec autant de précisions notre travail commun. La crise exacerbe les dysfonctionnements mais lorsqu'on a l'habitude de travailler ensemble, ce qui avait déjà été le cas sur le dossier de suivi de Parcoursup, les méthodes de travail s'avèrent très efficaces en période de crise.
En ce qui concerne Parcoursup, je note que l'impossibilité de tenir des oraux a engendré un recours massif aux algorithmes pour trier les dossiers. Au regard de la décision du Conseil constitutionnel et de l'impératif de protection des libertés individuelles, il me paraît important de vérifier ce que ces algorithmes contiennent et de les rendre transparents.
En complément des propos tenus un peu plus tôt ce matin par notre collègue Jean-Pierre Leleux, relatifs au risque budgétaire, et dans le cadre de notre rôle de contrôle de l'utilisation des crédits votés, je précise que cette année, il a été constaté une faible consommation de certains crédits, notamment dans l'enseignement supérieur et la recherche, et une surconsommation d'autres. Nous avons besoin que le ministère fasse un bilan très précis des postes sur lesquels une rallonge substantielle sera nécessaire.
Je rappelle aussi l'enjeu majeur que représentent les thèses. Beaucoup d'étudiants ont été obligés d'arrêter la préparation de leurs thèses, faute d'accès aux bibliothèques et aux laboratoires. S'ils se trouvent dans l'incapacité de reprendre leur travail de thèse, on va continuer à perdre des docteurs et affaiblir l'influence de la recherche française dans le monde. Je regrette que dans le cadre de la loi, le ministère n'ait pas été capable de fournir une étude d'impact du nombre de docteurs arrêtés dans leurs travaux de recherche. Nous allons avoir besoin de poursuivre notre propre travail d'évaluation, initié par Stéphane Piednoir, pour mesurer l'ampleur des dégâts qui apparaissent d'ores et déjà considérables, aux dires de mes collègues. On ne redémarre pas aussi aisément certaines études, comme celles portant sur le vivant, qui nécessitent par exemple de reconstituer les cohortes d'animaux utilisés.
Les douze travaux d'Hercule ont été évoqués, je pense qu'il va nous falloir aussi rapporter les pommes d'or du jardin des Hespérides !
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Nous venons un peu d'anticiper sur le groupe de travail « Recherche » animé par Laure Darcos en évoquant cet arrêt de certaines recherches. Nous serons sans doute amenés à approfondir ce sujet ultérieurement. Je donne maintenant la parole à Sylvie Robert.
Mme Sylvie Robert . - Je m'associe aux compliments adressés à l'ensemble des membres du groupe de travail et souhaite vous soumettre trois réflexions.
La première concerne la question des examens passés en distanciel et des outils numériques de télésurveillance. Certaines universités n'ont en effet pas respecté le RGPD en la matière. Je vous informe que j'en ai saisi la CNIL et qu'une information va être publiée aujourd'hui. J'en ferai également une communication lors de la prochaine commission plénière de la CNIL pour rappeler qu'au regard du RGPD, les dispositifs de surveillance qui prennent le contrôle à distance de l'ordinateur personnel de l'étudiant ou ceux qui reposent - et c'est le plus grave - sur des traitements biométriques, ne sont pas admis. Il est important d'en informer les présidents d'université et leur rappeler que les étudiants sont en droit de refuser ces dispositifs ne reposant sur aucune base légale.
Ma deuxième réflexion porte sur la réactivité des collectivités territoriales et leur contribution importante à la question de l'enseignement supérieur, au niveau des logements étudiants notamment. Un recensement des aides d'urgence en faveur des étudiants octroyées par les régions me paraît important à réaliser, comme l'a déjà fait la Bretagne.
Enfin, je souhaite insister sur la précarisation assez importante de certains étudiants dont certains vont devoir - j'en ai eu l'écho récemment - abandonner leurs études pour des raisons économiques. La directrice du Cnous que nous avons auditionnée nous avait fait part de cette préoccupation et des moyens dont elle aimerait disposer pour compenser les millions qui ont été réinjectés en faveur de ces étudiants en grande précarité. Il nous faut rester vigilants à ce sujet et évaluer à la rentrée prochaine dans quelles conditions certains pourront ou pas reprendre leurs études.
Mme Mireille Jouve . - Je remercie également notre brillant rapporteur et tous mes collègues qui ont participé à ce groupe. Je pense que nous devons rester attentifs à ce que les étudiants, compte tenu des bouleversements qu'ils vivent, ne souffrent pas outre mesure de diplômes dévalorisés. Beaucoup d'entre eux vont devoir essayer d'intégrer un marché du travail profondément dégradé et devront donc pouvoir être soutenus.
En ce qui concerne le soutien financier et le suivi social des étudiants les plus précaires, même si les situations de chacun sont aussi singulières et nombreuses, ils nous ont paru être à la hauteur de l'enjeu, c'est en tout cas ce qu'il est ressorti de nos auditions.
Je crois également qu'il nous faut rester très vigilants sur les conditions dans lesquelles la procédure Parcoursup se déroule cette année. Le satisfecit affiché par le ministère pourrait peut-être être relativisé.
Nous demeurons en outre conscients que l'enseignement à distance, même si nos universités ont su faire preuve d'une grande capacité d'adaptation, demeure un amplificateur des inégalités existant entre les étudiants.
M. Jacques Grosperrin . - Je félicite Stéphane Piednoir et son équipe pour ce travail exceptionnel réalisé en peu de temps. Notre équipe, au sein du groupe de travail sur l'enseignement scolaire, a également abordé les problématiques liées à la continuité pédagogique, l'organisation et l'accompagnement sanitaire.
S'agissant de la continuité pédagogique, elle a pu se mettre en place, pas seulement grâce au fait que le numérique ne pose pas de souci aux étudiants, mais aussi parce qu'ils se sont fortement engagés, tout comme les professeurs.
Ma deuxième remarque concerne l'organisation des écrits des grandes écoles. La question a été posée hier au ministre de l'éducation nationale, mais il n'a pas pleinement répondu car cela concerne davantage sa collègue du supérieur. Certaines académies pensent faire passer ces concours à Paris, notamment du fait des consignes sanitaires à respecter et de la fermeture actuelle des lycées. Des réponses à ces difficultés-là ont-elles été apportées ?
Enfin, la Covid a modifié beaucoup de choses, dont l'abandon de l'année de césure. On a aussi le sentiment que pour certains étudiants, les universités de proximité ont joué peut-être un rôle plus important et qu'au travers de Parcoursup, les uns et les autres vont vouloir poursuivre leurs études dans des lieux plus sécurisants ou plus en lien avec le sanitaire et le social. En témoignent les 600 000 voeux formulés en direction des écoles d'infirmières et les quelques 250 000 pour la Paces.
Je terminerai par la question du travail de réhabilitation, voire d'évolution, à mener dans les résidences universitaires, dont l'état actuel ne facilite pas la vie de nos étudiants.
M. Max Brisson . - Je salue également la qualité du rapport présenté par Stéphane Piednoir. Je souhaite tout d'abord demander à notre rapporteur comment il analyse le fait qu'il y ait eu finalement peu de polémiques dans l'enseignement supérieur, contrairement à l'enseignement scolaire, où les tensions et angoisses ont été nombreuses. Est-ce dû à un système beaucoup plus déconcentré ou à l'autonomie des universités ?
Quant à la continuité pédagogique, fort justement saluée, il me semble malgré tout qu'il y a bien dû y avoir des pertes en ligne et des décrochages. Il ne peut y avoir autant de différences entre un étudiant de deuxième année de faculté et un élève de terminale. Hier, j'ai évoqué dans l'hémicycle devant Jean-Michel Blanquer, ces élèves pas forcément décrocheurs mais en perte de contact avec leurs enseignants alors qu'ils ne l'étaient pas en présentiel. A-t-on une idée des dégâts causés par cet enseignement à distance, jusqu'au niveau de la licence ?
Pour ce qui concerne les étudiants en master, beaucoup d'établissements pratiquent des stages en entreprises et leur configuration en distanciel - c'est-à-dire par le télétravail - a dû également provoqué des dégâts et à tout le moins une perte des connaissances fondamentales acquises dans le monde professionnel.
S'agissant des examens en distanciel, et au-delà du discours que tout le monde a voulu très positif, on peut se poser la question de la pertinence de certaines évaluations et donc de la fiabilité de la validation d'un certain nombre d'acquis, de connaissances et de compétences.
J'ai par ailleurs posé la question au ministre hier de la remédiation pour le scolaire, et elle me semble tout aussi importante pour le supérieur lorsqu'on accepte l'idée que, au-delà du décrochage, il y a malgré tout des connaissances qui ne seront pas acquises. Les établissements se préparent-ils à cette difficulté, dans le cadre d'une réflexion stratégique concertée ?
Mme Sonia de la Provôté . - Je souhaite rebondir sur le souhait qui vient d'être évoqué, d'avoir un bilan très précis du nombre d'étudiants décrocheurs, d'en évaluer les raisons ainsi que les professeurs pour lesquels la continuité pédagogique a été plus difficile à assurer - je pense aux Sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps), où le présentiel est indispensable. Un bilan objectif me paraît essentiel en vue des réévaluations des validations à la rentrée prochaine.
La priorité donnée aux études liées à la santé reste relative. Les chiffres 2020/2021 - + 47 places en médecine au niveau national, + 10 en dentaire, + 6 pour les sages-femmes et + 4 pour les pharmaciens - ne permettront pas de pallier les carences en accompagnement sanitaire sur le territoire.
A l'approche de la rentrée scolaire, et au regard du fait que les universités n'ont pas rouvert, un protocole sanitaire précis a-t-il été défini ? Car de nombreux établissements s'interrogent... Il serait souhaitable qu'il soit communiqué et mis en place avant fin juillet, ne serait-ce que pour rassurer les étudiants.
Quant à la CVEC, à l'aune de la crise sanitaire, il me paraît justifié d'en avoir un bilan et surtout d'avoir un certain nombre d'exigences sur son usage.
Enfin, concernant la précarisation, le fait que la situation économique va se compliquer, et qu'un nombre important d'étudiants travaillent pour pouvoir financer leurs études, un accompagnement financier supplémentaire apparaît primordial. Je rejoins l'avis de mes collègues sur ce volet social de la précarisation - pouvant conduire à l'abandon des études - qui risque de prendre une dimension particulièrement prégnante à la rentrée.
Mme Laure Darcos . - Merci pour ce brillant rapport. J'ai une remarque relative aux examens. Dans mon entourage personnel, j'ai eu connaissance d'élèves qui, pour répondre à un QCM en ligne en une heure, se sont tous connectés à Zoom pour s'échanger les réponses, ils vont donc tous avoir vingt sur vingt !
À l'inverse, l'examen de fin de première année de Paces va devoir être organisé en présentiel. Il s'agit d'un examen regroupant 900 candidats, tous très inquiets du fait que les examinateurs et surveillants de ces concours sont âgés de 55/60 ans - il s'avère très difficile d'en trouver de plus jeunes -, donc plus « à risque », et de l'organisation logistique. En effet, quelle salle va pouvoir accueillir 900 candidats permettant la distanciation obligatoire ? Et combien de temps faudra-t-il avant qu'ils soient tous installés en temps et en heure ?
Mme Françoise Laborde . - Je rejoins l'avis de mes collègues concernant Parcoursup et le fait que cela va être compliqué pour les étudiants qui étaient indécis dans leurs choix.
J'insiste sur les conditions d'examen en Paces, sujet qui fait beaucoup de remous dans mon département de Haute-Garonne. Pour toutes les raisons évoquées par Laure Darcos, mais aussi pour le fait que passer de nombreuses épreuves écrites à des QCM est très difficile à vivre. Je vais questionner à nouveau la ministre à ce sujet. Et comme vous tous, mon groupe a interpellé le ministère par rapport aux concours internes et externes des enseignants.
Enfin, je vais parler pour une fois des outre-mer, où pour certains concours, les élèves sont isolés dans des loges, car les épreuves écrites ne se déroulent pas aux mêmes heures qu'en métropole. Les résidences du Crous et internats étant fermés, les élèves ne pourront pas être isolés et ils passeront le concours en même temps que les autres, c'est-à-dire à trois heures du matin ! Je tenais à vous le signaler.
M. Stéphane Piednoir . - Je vais apporter quelques réponses aux questions qui viennent d'être posées.
Sur la question de l'organisation des examens en présentiel, souvent posée, et plus particulièrement pour les concours des grandes écoles, certaines académies envisageaient effectivement de ne pas les organiser dans les lycées habituels. Jean-Michel Blanquer a renvoyé cette question à son homologue de l'enseignement supérieur mais il n'empêche qu'elle relève bien de la réouverture des lycées, dont on ne connaît toujours pas la date.
Dans mon académie de Nantes, le recteur avait envisagé de supprimer tous les centres et d'envoyer les candidats sur Paris, ce qui en termes de transports, de logements et de coûts supplémentaires posait beaucoup de problèmes, notamment pour les boursiers fort nombreux de ces filières. Il a fait machine arrière mais je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les académies.
Concernant les épreuves en Paces et plus globalement pour les centres qui vont accueillir plusieurs centaines de candidats, il nous a été répondu qu'ils allaient être multipliés pour diviser les effectifs, permettant ainsi de réduire les temps d'attente pour entrer. Mais cela nécessite plus de surveillants, et si possible plus jeunes, ce qui va être très difficile à trouver. La question n'est donc pas réglée et les examens auront lieu dans un mois !
Sur l'absence de polémique évoquée par Max Brisson, il s'avère que le ministère a su prendre des décisions rapides, et notamment celles de ne pas ré-ouvrir. Les universités sont toutefois ouvertes à 50 % de leur capacité pour les activités autres que l'enseignement ; tous les cours ont été suspendus jusqu'à la rentrée de septembre. Les étudiants ont donc su très vite que l'année en présentiel était terminée, ce qui a coupé court aux interrogations qu'a dû par contre se poser l'enseignement scolaire quant à la date de réouverture des écoles.
Concernant la continuité pédagogique et le décrochage, nous ne disposons pas encore de remontées chiffrées, mais il est très probable qu'il y aura des décrocheurs, potentiellement en fin d'année scolaire universitaire. Les partiels ont pu donner toutefois des signaux d'alerte pour certains.
S'agissant de la vigilance sur la valeur des examens, je précise que la triche existe aussi en présentiel, selon des procédés ancestraux ! Zoom facilite cependant bien les choses. Et en même temps nous sommes coincés par ce refus des applications de surveillance des candidats lors des épreuves - certains logiciels peuvent scruter le visage d'un candidat et veiller à ce qu'il ne regarde pas ailleurs... La valeur du diplôme se testera de toute façon à la rentrée. Il en va donc aussi de la responsabilité des étudiants.
Sur l'évolution très relative du numerus clausus dans les filières de la santé, j'avais adressé un courrier à Frédérique Vidal pour demander sa réévaluation. En réalité, nous n'avons obtenu que 67 places supplémentaires à l'échelon national. Je regrette qu'un geste plus fort n'ait pas été fait en faveur des jeunes en Paces. Je rappelle que certaines académies, dont la mienne, organisaient cette année le PluriPass ; les oraux ayant été supprimés, l'admission en deuxième année va se faire uniquement sur les épreuves écrites. Certains candidats qui avaient basé leur réussite sur l'oral vont en pâtir. J'aurais aimé que la prise en compte de ces modifications passe par l'assouplissement du numerus clausus .
En ce qui concerne Parcoursup, la plateforme numérique a en effet fonctionné, mais l'accompagnement des candidats dans leur réflexion a pu être affecté.
Pour répondre à Françoise Laborde sur l'horaire de passation des épreuves en outre-mer, le numérique nous oblige à ce que les épreuves aient lieu simultanément. Les candidats concernés vont donc devoir se lever très tôt !
Enfin, s'agissant du protocole sanitaire évoqué par Sonia de la Prôvoté, il a été publié récemment et est accessible sur le site du ministère.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Merci beaucoup pour ces éléments de réponses. Je tiens à m'excuser auprès des membres du groupe de travail animé par Jacques-Bernard Magner, car nous avons été un peu gourmands en imaginant pouvoir passer quatre rapports en une matinée. Pour permettre de mettre en valeur les travaux du groupe « Jeunesse et vie associative », nous allons donc reporter, si vous en êtes d'accord, la restitution de leur rapport.
M. Jacques-Bernard Magner . - - Tout à fait.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je vous remercie tous pour votre participation active et rappelle que les groupes de travail n'ont pas vocation à se réunir pendant la réunion de commission du mercredi matin, à l'instar des groupes d'études.
Jeunesse et vie associative
MERCREDI 27 MAI 2020
___________
M. Jacques-Bernard Magner . - Le groupe de travail « jeunesse et vie associative » est composé de Mme Céline Boulay-Espéronnier, M. Olivier Paccaud, Mme Dominique Vérien, et moi-même. Nous avons procédé à une série d'auditions autour de trois thématiques : la situation sociale et économique du milieu associatif ; les conséquences du Covid-19 sur le service civique ; la mise en place de colonies de vacances studieuses annoncées par le Gouvernement, afin d'accompagner les enfants à la suite du confinement.
Le milieu associatif est un secteur social et économique de premier rang : les associations participent pleinement à l'animation de nos territoires et au développement du lien social. Il s'est pleinement mobilisé pour faire face à la crise, contribuant ainsi à la résilience des territoires.
Mais, et c'est une dimension trop souvent oubliée, le secteur associatif représente un acteur économique non négligeable. Près de 1,8 million de personnes travaillent ainsi dans les associations, soit un salarié du secteur privé sur dix, pour des emplois non délocalisables. À titre de comparaison, le secteur du tourisme, pour lequel le Gouvernement vient d'annoncer un plan de relance de 1,3 milliard d'euros, représente environ 2 millions d'emplois directs et indirects. Nous sommes donc sur des ordres de grandeur proches.
Or, comme dans de très nombreux autres domaines, les conséquences économiques sont importantes. Près de 70 % des associations ont déposé une demande de chômage partiel, près de 30 % des associations employeuses disposaient début avril de moins de trois mois de trésorerie, 81 % des associations ont été contraintes d'annuler des évènements importants, et les deux tiers d'entre elles ont même mis l'intégralité de leurs activités en sommeil.
Toutefois, le groupe de travail a pu constater que la spécificité du secteur associatif n'était pas toujours bien prise en compte dans les mesures de soutien de l'économie. Je prendrai l'exemple de l'accès au fonds de solidarité. Il permet normalement à toute entreprise, dont les associations, de disposer d'une aide financière si elle a fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public, ou a subi une perte de 50 % de son chiffre d'affaires en mars 2020 par rapport à mars 2019. Mais en fonction des interprétations faites par les services régionaux des finances publiques, certaines associations se voient refuser l'accès à ce dispositif, au motif qu'elles ne payent pas d'impôts commerciaux. Dans d'autres cas, il leur est demandé leur identifiant fiscal, alors qu'une association à but non lucratif n'en possède pas. Or ce refus ferme l'accès à ce fonds de solidarité, mais également à des fonds régionaux, qui s'appuient sur le fonds national en termes de critère d'éligibilité. Il faut être éligible au fonds national pour pouvoir disposer d'une aide supplémentaire de la part des régions.
Au moment où la crise sanitaire a éclaté, quelque 60 000 jeunes étaient en train d'effectuer une mission de service civique. Afin de ne pas ajouter de la précarité pour ces jeunes en plus de l'incertitude, l'agence du service civique a demandé aux structures de maintenir les contrats. Pour sa part, elle a maintenu le versement des indemnités. Cette démarche a contribué à la grande créativité et à l'innovation dont ont fait preuve tant les jeunes que les structures pour continuer les missions. Outre la poursuite de certaines missions sous d'autres formes, quelque 26 000 jeunes ont été redéployés sur des missions de terrain.
En outre, le service civique a été un acteur essentiel de la réserve civique, puisque sur les 350 000 inscrits de cette dernière, 50 000 étaient des jeunes en service civique. Bénéficier d'une formation civique et citoyenne, avoir été formé par ses tuteurs à la notion d'intérêt général favorisent l'engagement. Enfin, cette crise a révélé un certain nombre de freins juridiques sur lesquels il convient d'agir.
En ce qui concerne le secteur du tourisme associatif et l'organisation des colonies de vacances « studieuses », le constat économique est également grave. 95 % des activités de classes vertes, et 85 % des accueils collectifs de mineurs sont à l'arrêt depuis mars. Les taux de chômage partiel atteignent 70 % des effectifs de grandes fédérations organisatrices de séjours pour enfants. De nombreux acteurs s'interrogent sur leur capacité de survie. En effet, le modèle économique de nombreux acteurs est construit autour d'une complémentarité entre classes vertes et accueils d'enfants pendant les vacances, ce qui leur permet de passer les mois de novembre à février.
Le taux d'inscription en colonies de vacances est en chute libre, en baisse de 40 % à 50 % par rapport à la même époque l'année dernière. Or les mois de mars à mai correspondent précisément à la période d'inscription. Je mentionnerai également un point qui peut avoir un effet négatif à moyen terme. Les formations de brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA), les stages pratiques, ainsi que les jurys de diplôme n'ont pas pu avoir lieu ce printemps. Nous courrons donc le risque d'une pénurie d'encadrants à moyen terme.
Nous avons tous noté la volonté du Gouvernement de mettre en place des colonies de vacances studieuses. Or aujourd'hui, de très nombreuses questions demeurent. Les conditions sanitaires, la prise en charge du surcoût, les taux d'encadrement nécessaires, et le contenu de ces colonies de vacances studieuses. Il est plus qu'urgent de donner des indications claires sur l'ensemble de ces points. Cela contribuera d'ailleurs à rassurer et à convaincre les familles. Un certain nombre d'entre elles ont déjà dû mal à remettre leurs enfants à l'école, qui est pourtant un environnement familier. Qu'en sera-t-il des colonies ?
En outre, un travail partenarial, en lien avec les animateurs, les travailleurs sociaux et les associations est nécessaire pour convaincre les enfants et leurs familles de découvrir les colonies de vacances. La question budgétaire est loin d'être le seul frein. Les obstacles sont aussi culturels, cultuels, psychologiques, pour des questions d'encadrement ou de sécurité.
J'en viens maintenant aux quatorze préconisations du groupe de travail, regroupées autour de quatre axes. Les quatre préconisations du premier axe visent à prendre en compte la spécificité du secteur associatif :
- permettre aux associations non employeuses de bénéficier du report de charge et de l'accès aux fonds d'aide régionaux ;
- encourager les associations représentant les collectivités locales à signer une charte, afin d'inciter l'ensemble des collectivités à maintenir le versement des subventions promises si l'activité ne peut pas avoir lieu du fait de la crise sanitaire de Covid-19 ;
- réévaluer le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) dont les montants versés aux associations restent inférieurs à ceux précédemment alloués à travers la réserve parlementaire ;
- mettre en place un fonds de soutien interministériel pour les associations en grande difficulté financière.
Les préconisations du deuxième axe visent à garantir les moyens de redynamiser les colonies de vacances :
- inclure dans le plan de soutien au tourisme le secteur du tourisme associatif et prendre en compte ses caractéristiques ;
- indiquer rapidement aux professionnels du secteur les conditions sanitaires à respecter pour l'organisation des séjours de mineurs cet été.
Les préconisations du troisième axe visent à préparer l'immédiate après-crise :
- donner la possibilité juridique et les moyens budgétaires d'étendre de plusieurs semaines les contrats des jeunes en service civique qui le demandent, afin de permettre aux structures, en l'absence d'autres alternatives, de disposer de jeunes déjà formés, pour répondre aux besoins immédiats à la sortie du confinement ;
- reporter, en raison des difficultés d'organisation nées de la crise sanitaire, l'élargissement à l'ensemble des départements de l'expérimentation du service national universel (SNU) à 2021, et réallouer tout ou partie du budget dédié au service civique ;
- augmenter les moyens budgétaires du service civique en 2021, afin de pouvoir proposer un plus grand nombre de missions pour redonner confiance aux jeunes décrocheurs du système scolaire ou en difficulté d'insertion professionnelle en raison de la crise sanitaire. En effet, celle-ci aura des conséquences économiques et sociales importantes. Or le service civique a démontré son excellente capacité pour réinsérer professionnellement les jeunes. Une étude de mars 2020 de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP), sur les parcours de formation et d'insertion des jeunes en service civique, montre que 57 % des volontaires au chômage de longue durée et sans expérience professionnelle avant le début de leur mission n'étaient plus en recherche d'emploi six mois après sa fin ;
- récréer pour une période transitoire des emplois aidés, réservés au secteur associatif. Notre commission l'avait déjà proposé en 2017, dans le cadre d'un rapport intitulé « Réduction des emplois aidés : offrir une alternative crédible au secteur associatif ».
Enfin, le dernier axe de préconisations vise à tirer tous les enseignements de la crise :
- intégrer dans les contrats des jeunes en service civique la possibilité de les transférer, avec leurs accords, sur une mission urgente, en cas de besoin ;
- renforcer l'accompagnement des associations dans l'accueil de nouveaux bénévoles. En effet, il n'y a pas en France un problème de volontariat, mais d'offres, de la part des associations. Animer une association, accueillir de nouveaux bénévoles, penser de nouvelles missions nécessite du temps et des compétences, que n'ont pas toujours les associations, notamment les plus petites ;
- encourager le développement du service civique en zone rurale, en tirant pleinement profit des outils numériques pour le suivi et l'encadrement du jeune ;
- renforcer la reconnaissance de la Nation envers l'engagement citoyen. Je regrette à ce titre que ni le Premier ministre, ni le Président de la République n'aient salué, voire évoqué, le rôle des bénévoles dans leurs discours. Ceux-ci ont en effet joué un rôle essentiel pour soutenir « la première ligne » pendant la crise sanitaire.
Mme Céline Boulay-Espéronnier . - Nous avons mené des auditions passionnantes et variées, avec des acteurs très engagés. Le but du groupe était de tirer les enseignements de la crise, et de préparer l'immédiate après-crise. Nous avons rencontré des problématiques très différentes selon les associations, leur taille, et leur secteur d'activité.
Les appels au bénévolat se sont multipliés pendant cette crise, avec un fort écho dans la population. De nombreuses associations s'appuyant sur des forces vives gratuites, se retrouvent par ailleurs dans une situation précaire, alors même que bon nombre d'entre elles alimentent une économie dynamique, au service du lien social, et de l'animation du territoire. Elles représentent 4 % du produit intérieur brut (PIB), soit 113 milliards d'euros. Le Parisien faisait état d'un chiffre de 1 milliard d'euros de pertes. Il ne pourrait cependant s'agir que d'un montant provisoire, puisqu'il tient compte du manque à gagner sur les recettes d'activités, mais non des possibles baisses de subventions ou de mécénat des entreprises. Je songe notamment aux associations sportives, par exemple de rugby, qui dépendent largement du mécénat.
La crise a également révélé l'utilité et l'importance du service civique, et la nécessité de le développer en milieu rural, notamment grâce au numérique. Il existe un enjeu autour des décrocheurs scolaires et de l'insertion professionnelle. La volonté de s'engager est forte chez les jeunes, comme nous avons pu le constater lors de la crise.
La réserve citoyenne a 300 000 inscrits - dont 50 000 jeunes en service civique - pour 30 000 missions. Je m'en suis émue auprès du ministre, en soulignant que le nombre de missions était très insuffisant. De nombreux jeunes qui souhaitaient s'engager ont ainsi été laissés un peu de côté. L'un des enjeux de la sortie de crise est de parvenir à maintenir le capital d'engagement d'un grand nombre d'actifs. Enfin, le monde associatif a le sentiment d'être mal compris par les autorités politiques et administratives.
Je reviendrais maintenant sur quelques préconisations du rapport. La première d'entre elles est le fonds de soutien interministériel pour les associations en grande difficulté financière. À la différence des entreprises, il n'existe pas pour les associations de procédure judiciaire de sauvegarde. La crise a violemment percuté leur modèle de financement. Pour les toutes petites structures notamment, l'argent est essentiel. Elles disposent de peu de trésorerie, mais n'ont droit à aucune aide de l'État, car ce ne sont pas des entreprises à part entière. De même, elles ne disposent pas de fonds de solidarité, car elles ne disposent pas de plus de 60 000 euros de recettes par mois. Il s'agit d'un véritable problème. Une association sur cinq dispose de moins de trois mois de trésorerie, et la moitié d'entre elles de moins de six mois.
Par ailleurs, le rapport fait état de la nécessité de réévaluer le FDVA. Celui-ci s'est vu confier par la loi de finances 2018 une nouvelle mission : attribuer aux associations sur le territoire des fonds anciennement versés au titre de la réserve parlementaire. Or les sommes allouées apparaissent très en-deçà de ce que cette dernière pouvait allouer aux associations. C'est l'occasion de rappeler à quel point cette réserve parlementaire manque dans les territoires.
Une autre préconisation vise à renforcer la reconnaissance de la nation envers l'engagement citoyen. La reconnaissance des pouvoirs publics encourage en effet ce dernier. La crise a offert de nombreux exemples. Je citerai notamment la distribution alimentaire, ou encore l'écoute et la lutte contre les violences intrafamiliales. Cela pose la question de l'engagement bénévole et du civisme.
J'ai été interpellée par un article dans Le Journal du dimanche du 24 mai 2020 de M. Marcel Gauchet, qui souligne que les associations sont allées contre les deux injonctions du confinement, qui pourront avoir un impact durable dans la vie de nos sociétés : « méfiez-vous les uns des autres » ; « restez chez vous ». En cela, elles méritent la reconnaissance des pouvoirs publics.
Enfin, il a été largement question au sein du groupe des colonies de vacances, et de leur enjeu social et sociétal pour les familles fragilisées par la crise. J'ai également évoqué avec le ministre la question du scoutisme, qui l'avait beaucoup intéressé. Cette question est largement liée à celle des seuils des allocations familiales. M. Gabriel Attal a annoncé un plan global avant l'été pour l'emploi des jeunes, notamment pour éviter leur décrochage en lycées professionnels. Il vise également à renforcer leur comptage, et faciliter leur entrée sur le marché. Cela fera également l'objet d'un grand plan de relance européen. Il faudra y être attentif, car la proportion de jeunes en voie professionnelle en décrochage pendant le confinement est estimée à 15 %.
Il existe de nombreux sujets connexes, que nous n'aborderons pas ce matin. Je citerai néanmoins les emplois d'été, ou encore les jeunes créateurs en danger immédiat, qui devront être suivis par notre commission.
Mme Dominique Vérien . - Les associations ont été particulièrement utiles pendant cette crise. Je salue notamment dans notre département La Croix-Rouge, qui a réalisé un travail formidable pour lutter contre la précarité mais surtout contre l'isolement des habitants. Néanmoins, il existe un véritable besoin de renouvellement des générations. Pour ce faire, la formation et l'accompagnement sont indispensables. C'est la raison pour laquelle nous les avons intégrés dans nos préconisations.
Le fait que 50 000 jeunes sur 60 000 en service civique se soient engagés dans la réserve civique témoigne de son rôle important. Je salue donc l'annonce de M. Gabriel Attal, qui souhaite créer 10 000 missions en secteur rural. Nous avons constaté qu'y compris dans ces zones, il était possible de télétravailler. Or l'une des raisons pour lesquelles le service civique est peu développé en zones rurales tient aux difficultés d'encadrement. Il serait ainsi possible de régler ce problème grâce au numérique.
Enfin, l'annonce du plan général sur le tourisme social a finalement été décalée, à mon sens en raison des vacances apprenantes. Elles sont en effet difficiles à mettre en oeuvre. L'annonce devrait intervenir le 15 juin. Or, les vacances commencent début juillet, et les mettre en place en quinze jours risque de constituer un casse-tête pour toutes les associations et les professionnels. Par ailleurs, ceux-ci enregistrent tous une baisse des inscriptions. Comment sera-t-il possible d'envoyer davantage d'enfants dans ces colonies, en particulier ceux qui sont ciblés par le Gouvernement ? Cette date du 15 juin me semble trop tardive. Les professeurs participeront-ils à ces « colonies apprenantes » ? Il s'agit à mes yeux de la plus importante interrogation qui subsiste après les auditions.
M. Pierre Ouzoulias . - Je remercie les membres de ce groupe de travail, dont les recommandations sont fondamentales. D'un point de vue général, ces deux mois de confinement ont touché très cruellement le tissu social, et notamment la jeunesse. Sa fin, et peut-être celle de l'épidémie, nous oblige à retisser la trame indispensable de notre société. Depuis quelque temps, nous entendons tous les jours des annonces de plans d'urgences pour divers secteurs. Nous avons maintenant besoin d'une annonce forte, et d'un plan budgétaire détaillé, pour nous expliquer quels moyens seront mis en place pour sauver ce réseau, qui nous permet, au quotidien, de faire société. Il est essentiel de retisser ce lien. Je suis l'élu d'une ville populaire, et l'été va être très tendu d'un point de vue social. Si nous ne donnons pas aujourd'hui aux associations les moyens d'encadrer les jeunes, nous risquons de rencontrer d'importants problèmes dans les quartiers populaires.
M. Stéphane Piednoir . - Nous risquons une pénurie de titulaires de BAFA, en raison de la baisse du nombre de candidats. J'ai adressé un courrier au ministre de l'éducation nationale sur les taux réglementaires d'encadrement, pour les associations en lien avec la jeunesse, mais également périscolaires. Envisagez-vous une modification de ces taux pour faire face à cette pénurie ? Le nombre de titulaires du BAFA va être en baisse à la rentrée, car les personnes n'ont pas pu se former.
L'engouement des jeunes pour le service civique semble significatif. Le ministre a annoncé un effort supplémentaire pour augmenter le nombre d'offres. Je suis cependant moins favorable aux contrats aidés. Nous devons mener une action concertée sur l'insertion professionnelle des jeunes. Des annonces sont faites régulièrement, et un plan devrait être prochainement dévoilé. 700 000 jeunes arrivent sur le marché du travail dans un contexte extrêmement dégradé. Cela mérite un plan d'urgence.
Mme Annick Billon . - Cette crise sanitaire ne met-elle pas en relief un déficit de formation à l'intégration de gestion de crise ? Il serait à ce titre intéressant de réfléchir à des modules nouveaux dans l'encadrement, pour que les jeunes qui souhaitent s'engager soient en capacité de mettre des processus immédiatement en application, dans l'éventualité d'une nouvelle crise sanitaire.
Ma deuxième question porte sur l'allégement des conditions d'encadrement. La saison touristique sera extrêmement difficile, puisqu'elle commence deux mois plus tard qu'en temps normal. Ne serait-il pas imaginable, par exemple pour la surveillance de plages, de faire appel à ces jeunes qui ne pourront occuper des emplois saisonniers, et feront face à des conditions très difficiles à la rentrée universitaire ?
Mme Sonia de la Provôté . - Je vous remercie pour ce rapport, qui traite des sujets importants que sont le service civique et les colonies apprenantes. Le contenu de ces dernières reste à déterminer. L'impact de la crise sanitaire sur le monde associatif est évident, et sévère. Est-il possible de l'évaluer plus précisément, secteur par secteur ? Je songe aux petites associations de quartiers, ou aux associations communales, chargées de la vie citoyenne et du lien social. Elles vont particulièrement souffrir, car elles n'ont pas réussi à trouver leur place pendant le confinement. À partir d'aujourd'hui, elles seront néanmoins un élément majeur de la vie collective, dans des territoires où il nécessaire que des bénévoles s'emparent de ces sujets. Je pense notamment aux quartiers de la politique de la ville où leur rôle est essentiel, notamment en matière de repérage pour les familles et les enfants, qui aurait dû, mais n'ont pas réintégré l'école. Nous devrons nous appuyer sur elles, et elles devraient être prioritaires dans l'accompagnement.
Le FDVA a été mis en place depuis deux ans. Je n'arrive toujours pas à comprendre les critères qui gouvernent les choix de répartition financière d'une région ou d'un département à l'autre. Or nous avons besoin de critères. Nous devons également pouvoir comparer la somme allouée à celle qui était versée au titre de la réserve parlementaire. Cela nous permettra d'être plus précis dans l'accompagnement. Par ailleurs, je m'interroge sur les grands axes de répartition du FDVA. Certaines associations ne sont pas accompagnées quand d'autres le sont. Nous avons peut-être l'occasion d'exiger que des priorités soient définies.
M. Jacques-Bernard Magner . - Nos préconisations doivent être examinées sérieusement par le Gouvernement, car ces derniers mois ont mis en lumière les failles de notre système, et peuvent éclairer les mesures qui doivent être mises en place à l'avenir. Comme le disait M. Pierre Ouzoulias, les associations sont des amortisseurs sociaux dans les quartiers. Elles le sont également dans les zones rurales, où beaucoup prennent en charge des actions importantes. Lorsqu'existent un secteur associatif, et des bénévoles présents, de tous âges, les actions des pouvoirs publics ont pu être améliorées, et complétées.
Le secteur qui couvre les colonies de vacances est également en charge du périscolaire. Aujourd'hui existent des interrogations sur les possibilités d'animation, compte tenu du faible nombre de BAFA. Il est certes possible d'être formé en ligne sur la partie théorique, mais il est absolument nécessaire de recevoir une formation de terrain. Ces questions devront être pensées pour la sortie de crise. Un débat aura lieu au Sénat la semaine prochaine. La question des taux d'encadrement pourra alors être posée.
Les contrats aidés sont un recours pour les associations autre que financier. La mise à disposition quelques heures pendant une semaine de quelqu'un les aides à remplir leurs missions. Les contrats aidés représentent ainsi un avantage tant pour l'association que pour le jeune, qui peut ainsi obtenir une rémunération, et acquérir une expérience professionnelle. Nous avions d'ailleurs adopté cette recommandation à l'unanimité dans notre commission il y a deux ans.
Mme Annick Billon évoquait les nouveaux modules de formation à mettre en place. Je partage cet avis. Le BAFA en est un important. Il sera peut-être nécessaire d'élaborer des moyens de former plus rapidement, avec les techniques plus modernes que nous avons éprouvées au cours de ces derniers mois. Néanmoins, cette nécessité est également soumise à des problèmes de financement. L'argent dépensé dans certains secteurs peut donner envie au milieu associatif, qui n'est pas toujours doté à la hauteur des missions qu'il assure.
J'ai participé hier à une audioconférence avec la préfecture de mon département pour le financement de projets FDVA. Les critères ne sont en effet pas les mêmes dans tous les départements. Certes, les professionnels de la préfecture qui en sont en charge essaient de faire pour le mieux. Néanmoins, les associations sont insuffisamment informées de l'existence de ces dispositifs. La députée de ma circonscription a fait valoir que les moyens alloués étaient totalement inégaux selon les circonscriptions. Les associations de certains secteurs, qui ont l'habitude de monter des dossiers, peuvent disposer de moyens importants. D'autres secteurs en ont très peu, car les associations sont insuffisamment accompagnées pour constituer leurs dossiers. Il conviendrait ainsi d'accentuer les choix des critères des commissions qui s'occupent de répartir le FDVA. Ces dispositifs doivent également être mieux connus, même s'ils ne sont pas les seuls à pouvoir être sollicités. Nous proposons donc qu'une charte assure que les associations touchent leurs subventions, malgré l'annulation des activités en raison de la crise de Covid-19.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je remercie le groupe de travail au nom de toute la commission. Leur travail fera l'objet d'un communiqué de presse. Nous rebondirons sur l'ensemble de ces sujets dans les semaines qui viennent, à mesure que les colonies de vacances s'organisent, ainsi que les centres de loisirs. La reprise de la vie associative est un sujet important.
Action culturelle extérieure
MERCREDI 27 MAI 2020
___________
M. Claude Kern . - Le groupe de travail consacré à l'action culturelle extérieure de l'État, que j'ai eu l'honneur d'animer, est composé de Claudine Lepage et Damien Regnard. Je les remercie tous deux chaleureusement pour leur très grande implication et la qualité de nos échanges.
Nous avons choisi de concentrer nos premiers travaux sur la situation de l'enseignement français à l'étranger car la crise a révélé l'urgence à agir dans ce secteur. Nous avons d'ailleurs souhaité vous présenter nos conclusions avant l'audition de M. Jean-Baptiste Lemoyne cet après-midi, afin que notre commission puisse l'interroger en ayant à l'esprit nos constats et nos préconisations.
Le réseau est confronté à ce qui semble bien être la plus grave crise de son histoire, comme nous l'a indiqué le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) lui-même.
Les établissements d'enseignement français d'Asie ont été les premiers, dès février, à devoir fermer à cause de l'épidémie. Au pic de la crise sanitaire, courant avril, 99 % des 522 établissements que compte le réseau dans 139 pays avaient fermé leurs portes.
L'AEFE s'est immédiatement attaché à mettre en place un dispositif de continuité pédagogique pour permettre aux élèves de suivre leur scolarité à distance. Tous les personnels de l'Agence (inspecteurs, conseillers pédagogiques, enseignants formateurs) ont été mobilisés pour aider les équipes de direction et les équipes pédagogiques.
Alors que 350 000 élèves parmi les 365 000 que compte le réseau ont bénéficié ou bénéficient encore d'une continuité pédagogique, la qualité de celle-ci est diversement appréciée par les parents. Globalement, les efforts déployés sur place par les personnels, ainsi que la qualité de l'offre sont reconnus. Mais les appréciations sont très différentes d'une zone géographique et d'un établissement à l'autre.
Ce n'est pas tant le contenu de la nouvelle offre pédagogique qui est contesté, que le retour sur investissement. Certains parents considèrent en effet qu'ils n'en ont pas pour leur argent avec l'enseignement distanciel par rapport à l'enseignement présentiel. Cela est très perceptible chez les parents d'enfants de maternelle, et chez les familles allophones. Localement, les tensions ont parfois été vives entre les parents, ou les associations de parents, et les personnels des établissements.
C'est dans ce contexte tendu, aggravé par les conséquences économiques de la crise sur certaines familles, que s'est développé un mouvement de contestation des frais de scolarité, très actif dans certaines zones.
Face à cette contestation, certains établissements ont décidé, lorsque leur trésorerie le leur permettait, de mettre en place des mesures pour aider les familles les plus en difficulté (échelonnement des paiements, remise sur les frais de scolarité du troisième trimestre, attribution de bourses exceptionnelles, mobilisation de fonds de solidarité, etc.).
De son côté, l'AEFE a adopté une position très ferme à l'égard des velléités de non-paiement ou de réduction des frais de scolarité. Comme nous l'a expliqué son directeur, la multiplication des réductions de frais provoquerait un effet boule de neige d'un établissement à l'autre, et entraînerait le réseau sur une voie dangereuse. À terme, c'est l'ensemble de son fonctionnement qui s'en trouverait menacé, celui-ci reposant de 60 % à 70 % sur les droits d'écolage.
Nous comprenons la position de principe de l'Agence, mais nous appelons toutefois à une certaine souplesse dans l'étude des situations individuelles qui peuvent justifier l'octroi de facilités particulières.
Si les familles sont les premières victimes de la crise, les établissements sont à terme également menacés, en particulier les petites structures, qui ne disposent pas d'une trésorerie suffisante. Le directeur de l'AEFE a eu beau nous garantir qu'à ce jour, aucun établissement n'était dans un état critique, nous ne sommes pas aussi optimistes. Nous avons en effet eu écho de situations déjà très difficiles pour certains établissements.
Un autre effet collatéral de la crise est le risque d'une diminution des inscriptions à la rentrée prochaine. Les familles en difficultés, qu'elles soient françaises, issues du pays d'accueil ou de pays tiers, pourraient en effet se tourner vers des solutions moins coûteuses que l'enseignement français, comme le système public local ou le centre national d'enseignement à distance (CNED).
Si cette prévision se concrétisait, elle aurait évidemment des conséquences financières très graves sur les établissements. Certains pourraient être contraints de fermer. Les premières estimations de l'AEFE font état, sur l'année 2020, d'une baisse des ressources propres de 48 millions d'euros pour les établissements en gestion directe (EGD), d'environ 80 millions d'euros pour les établissements conventionnés, et de 100 à 120 millions d'euros pour les établissements partenaires.
Le 30 avril, M. Jean-Yves Le Drian, M. Gérald Darmanin, et M. Jean-Baptiste Lemoyne ont annoncé, par communiqué de presse, deux mesures de soutien aux familles et aux établissements du réseau :
- un aménagement, estimé à 50 millions d'euros, du dispositif des bourses scolaires permettant de tenir compte de la situation financière des parents d'élèves français en 2020 ;
- une avance, d'un ordre de grandeur estimé à 100 millions d'euros, de l'Agence France Trésor à l'AEFE, pour soutenir financièrement les établissements du réseau, quel que soit leur statut, afin qu'eux-mêmes puissent venir en aide aux familles, de toute nationalité, confrontées à des difficultés financières.
Les sommes débloquées seront, selon les termes mêmes du communiqué de presse des ministres, « réévaluées plus précisément en juin » .
Notre groupe s'étonne de cette méthode qui consiste à annoncer des mesures, sans avoir au préalable bâti un plan d'action dressant le constat exhaustif de la situation et apportant des solutions précises et chiffrées. Il est clair que ces annonces ont eu pour objectif de calmer les familles dont le mécontentement va grandissant.
Dans le même temps, un plan de sauvegarde du réseau a été annoncé et est en cours de préparation au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Cette initiative est certes nécessaire, mais nous estimons qu'il aurait été préférable de travailler préalablement à l'élaboration de ce plan d'ensemble, plutôt que de recourir à des effets d'annonce.
L'aménagement du dispositif des bourses scolaires repose sur un élargissement de son accès et un assouplissement de ses critères. Il s'agit d'une bonne mesure, qui fait d'ailleurs consensus parmi les acteurs du secteur. Nous sommes cependant plus circonspects sur sa budgétisation (50 millions d'euros annoncés) qui pourrait s'avérer sous-calibrée par rapport aux besoins de court terme et de moyen terme. Nous demandons également que cet abondement se concrétise rapidement dans un prochain projet de loi de finances rectificative.
L'avance de France Trésor à l'AEFE a, quant à elle, provoqué des réactions beaucoup plus vives. Le dispositif choisi laisse en effet penser que l'opérateur sera obligé de rembourser les sommes avancées par l'Agence France Trésor. Or pour l'ensemble des acteurs du réseau, comme pour notre groupe de travail, ce système de solidarité à crédit est inconcevable, surtout en regard de la crise qu'a vécue l'AEFE en 2017 à la suite d'une coupe budgétaire drastique de 33 millions d'euros.
Pour désamorcer la polémique naissante, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a annoncé aux parlementaires représentant les Français de l'étranger que l'avance de l'Agence France Trésor pourrait être transformée en subvention à l'AEFE lors d'un prochain projet de loi de finances rectificative. Cette information a été confirmée par son secrétaire d'État lors d'échanges bilatéraux, et lors du récent débat en séance publique au Sénat sur la proposition de projet de loi concernant les Français de l'étranger.
Cependant, à ce jour, nous n'avons, en dehors de ces promesses orales, aucune garantie sur l'effectivité de cette transformation. L'AEFE nous a confirmé qu'elle devra rembourser à l'Agence France Trésor les sommes avancées, selon des modalités fixées dans une convention entre les deux institutions.
Or, demander à l'AEFE de rembourser les sommes prêtées pourrait l'entraîner dans une spirale financière ingérable, dont elle pourrait ne pas se remettre. C'est pourquoi nous estimons que le soutien financier à l'opérateur de l'État doit impérativement se traduire par un abondement du montant de sa subvention pour charges de service public.
Nous souhaitons en outre que le dispositif de soutien aux établissements soit strictement conditionné à des critères d'attribution très précis, et à une gestion transparente des fonds reçus.
Nous sommes tous convaincus, au sein de cette commission, que le réseau de l'enseignement français à l'étranger constitue un atout exceptionnel pour le rayonnement de la langue, de la culture et de la diplomatie d'influence françaises.
Face à l'ampleur de la crise qu'il traverse, il y a urgence à agir, en apportant une réponse d'ensemble, coordonnée, ambitieuse et dotée de moyens adaptés.
Mes collègues et moi-même formulons plusieurs recommandations en ce sens :
- réguler le niveau des frais de scolarité qui n'ont cessé de croître depuis une dizaine d'années, et qui ont atteint un seuil limite d'acceptabilité ;
- décider d'un moratoire sur le plan de développement du réseau, voulu par le Président de la République, qui prévoit le doublement de ses effectifs d'ici 2030. Alors que la survie de certains établissements est en jeu, il est totalement incohérent de continuer à homologuer de nouvelles structures. L'heure doit être à une totale mobilisation pour sauver et pérenniser le réseau existant ;
- mettre un frein au mouvement d'assouplissement des critères d'homologation, qui nuit à l'équité entre les établissements de statuts différents, et qui risque de porter atteinte à la qualité de notre enseignement reconnu de par le monde ;
- renouveler la confiance dans l'AEFE, qui joue le rôle de colonne vertébrale du réseau, tout en l'encourageant à une gestion transparente et rigoureuse ;
- mettre en place une procédure de suivi et d'évaluation des mesures contenues dans le futur plan.
Mme Claudine Lepage . - Nous avons travaillé dans le consensus, aussi je partage les conclusions présentées. M. Jean-Yves Le Drian et M. Jean-Baptiste Lemoyne ont annoncé que tous les établissements, quel que soit leur statut, seraient soutenus. J'émets cependant une réserve : certains d'entre eux sont des établissements privés à but lucratif, dont la gestion n'est pas toujours transparente. Il est cependant difficile d'obtenir des informations chiffrées. L'agence doit ainsi exiger des justificatifs, et avoir un droit de regard sur leur gestion.
J'ai également une réticence à l'égard de l'assouplissement des critères d'homologation qui ont été mis en place pour développer le réseau. Il faut revenir à des fondamentaux. En effet, dans une même ville, de nouveaux établissements peuvent faire concurrence à ceux du réseau, ce qui n'est pas souhaitable. Récemment, une réunion de la commission d'homologation a débouché sur l'autorisation de 179 nouveaux établissements. Deux nouvelles réunions se tiendront en juillet et en octobre, ce qui donne une idée de cette marche forcenée en avant.
Enfin, il est actuellement demandé à l'AEFE de ventiler des prêts entre des établissements fragilisés par la crise. Il est clair que certains d'entre eux seront dans l'impossibilité de rembourser les prêts dans les délais impartis, sauf à augmenter les frais de scolarité, qu'il leur est par ailleurs demandé de maîtriser, afin de ne pas provoquer le départ des familles. Cette situation est ingérable, et ne pourra in fine qu'exacerber la colère des familles. Elle fragilisera encore l'AEFE, tenue responsable du flou sur la nature des 100 millions d'euros d'aide promis par les ministres. Il me semble qu'il est temps de clarifier la situation. Cette aide sera-t-elle une avance ou une subvention ?
M. Damien Regnard . - J'insisterai sur ce dernier point. Le message du Gouvernement n'est toujours pas clair. Pour l'heure, il s'agit d'une avance de l'Agence France Trésor à l'AEFE. Cette dernière souhaiterait la récupérer auprès des établissements. Ce seraient donc les parents d'élèves français, étrangers, de pays tiers ou de pays d'accueil, qui financeront cette avance. Nous souhaiterions des précisions supplémentaires, et nous les demanderons à M. Jean-Baptiste Lemoyne, car les réponses que nous obtenons diffèrent selon les interlocuteurs.
Face à ces inquiétudes, les parlementaires des Français établis hors de France ont été très sollicités depuis plusieurs semaines par les comités de gestion et les associations de parents d'élèves. Les taux de recouvrement pour le troisième trimestre sont très faibles. Les perspectives de réinscription pour la rentrée prochaine sont floues. L'inquiétude persiste. Les moyens mis à disposition permettraient de faire face à la crise qu'évoquait notre rapporteur sur les frais d'écolage du troisième trimestre, mais ne constitueraient en aucun cas une mesure sur l'année scolaire à venir. Notre groupe de travail devra donc exercer un suivi, à partir des remontées des ambassades et des services culturels dans chaque pays, qui permettront un état des lieux des établissements. Nous devrons également suivre l'utilisation de ces fonds, qui pour l'heure, d'après les informations dont nous disposons, demeurent assez vagues.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je vous remercie. Nous aurons l'occasion cet après-midi de poser directement ces questions à M. Jean-Baptiste Lemoyne. Nous traiterons de la partie sur l'action culturelle et les alliances françaises dans un autre temps. Nous mettrons l'accent sur la situation du réseau de l'enseignement français à l'étranger, dont nous entendons beaucoup parler. Je préside le groupe d'amitié France-Egypte, et les conseillers consulaires sur place ne cessent de m'alerter sur cette problématique. Une réponse appropriée revêt donc une certaine urgence.
M. Max Brisson . - Je souhaiterais saluer ce rapport, qui présente les dangers que court ce modèle sur le plan de sa pérennité économique. Je souhaiterais interroger le ministre plus particulièrement sur l'impact de la crise pour les élèves eux-mêmes. Nous devons nous interroger sur l'attractivité de ce modèle, pour l'avenir de notre système, et analyser la réalité de la pérennité des apprentissages pour des élèves qui ont fait confiance au système français, mais qui risquent de se trouver en grande difficulté.
Enseignement agricole
MERCREDI 3 JUIN 2020
___________
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - L'ordre du jour de notre réunion appelle à présent la présentation des conclusions du groupe de travail créé par le bureau le 14 avril dernier et chargé d'étudier les conséquences de la crise sanitaire sur l'enseignement agricole.
Je tiens à remercier les membres de ce groupe, animé par M. Antoine Karam - connecté depuis la Guyane - et à qui je donne maintenant la parole.
M. Antoine Karam . - Le groupe de travail est composé d'Annick Billon, Maryvonne Blondin et Michel Savin. En outre, j'ai invité les membres du groupe de travail « enseignement scolaire » présidé par Jacques Grosperrin à participer aux auditions.
Dans le cadre de nos travaux, nous avons auditionné des représentants de syndicats enseignants agricoles, du conseil national de l'enseignement agricole privé, de l'union nationale des maisons familiales rurales (MFR), de fédération de parents d'élèves scolarisés dans l'enseignement agricole. Il ressort de l'état des lieux que nous avons dressé 10 préconisations.
L'enseignement agricole a été très fortement touché par la crise de Covid-19 en raison de ses spécificités. Certains cours d'ateliers se prêtent difficilement à l'exercice du cours à distance : je pense aux formations d'aménagement paysager, des activités hippiques ou encore de l'élevage. Je souhaite rendre hommage à l'ensemble de la communauté éducative de l'enseignement agricole qui a su se mobiliser pour trouver des façons innovantes de poursuivre les apprentissages. Je pense notamment à cet enseignant de la filière restauration qui a proposé à ses élèves les cours de techniques culinaires, en se filmant depuis sa cuisine. Toutefois, malgré cet investissement remarquable, les apprentissages en ont souffert.
Autre spécificité de l'enseignement agricole profondément touché par la crise de Covid-19 : le rôle prépondérant joué par les stages. Certes, des mesures ont été prises pour que les élèves ne soient pas pénalisés pour passer les examens. Mais au-delà du diplôme, ces stages leur permettent de se familiariser aux pratiques professionnelles. Ils participent fortement à l'employabilité du jeune et sont une partie intégrante du projet pédagogique de l'enseignement agricole.
En outre, malgré cet investissement fort de la communauté éducative, 5 % des élèves ont décroché au sens du ministère, c'est-à-dire que les établissements n'ont pas de leurs nouvelles. Mais plus préoccupant, le SNETAP-FSU, syndicat enseignant agricole, estime à 25 % le nombre d'élèves qui se sont désengagés de leur scolarité, avec un manque d'assiduité dans les cours en ligne, ou dans la remise des devoirs.
Dans ces conditions, la réouverture des établissements avant l'été est demandée par toutes les personnes auditionnées. Elle doit être l'occasion de faire le point avec chaque élève individuellement. Toutefois, et ce sont nos deux premières préconisations, il est d'une part impératif de prévoir la réouverture des établissements en concertation avec l'ensemble des acteurs locaux. En effet, si le protocole sanitaire et le cadre global doivent être définis au niveau national, sa déclinaison doit être locale. La situation n'est pas du tout la même entre une MFR accueillant en temps normal entre 15 à 25 élèves de manière simultanée et un grand lycée agricole !
Par ailleurs, et il s'agit de notre deuxième préconisation, il est indispensable dans le cadre de cette réouverture de travailler avec les représentants des associations d'élus sur les questions liées aux transports scolaires, à l'internat et à la restauration collective. En effet, les établissements d'enseignement agricole ont traditionnellement un bassin de recrutement étendu. Certains élèves habitent à plus de 150 km de leur lycée. On dénombre d'ailleurs 50 % d'élèves internes dans l'enseignement agricole, cette proportion pouvant atteindre 80 % dans certains établissements. À titre de comparaison, il y a 10 % d'internes dans l'éducation nationale. Rouvrir les établissements sans internat, ni cantine n'aurait aucun sens. La réouverture des établissements d'enseignement agricole en juin doit en quelque sorte permettre une répétition pour être prêt à la rentrée de septembre 2020, si les mêmes restrictions sanitaires s'appliquent.
Par ailleurs, il est nécessaire d'apporter un soutien scolaire aux apprenants et de renforcer les apprentissages. Nous avons pour cela deux préconisations. Nous souhaitons que soit rapidement menée une réflexion entre le ministère de l'éducation nationale et le ministère de l'agriculture pour mettre en place un dispositif « école ouverte » mutualisé, notamment pour les matières communes, afin de permettre aux élèves de l'enseignement agricole domiciliés loin de leurs établissements de pouvoir disposer d'un soutien scolaire pendant les vacances d'été. Par ailleurs, dans le contexte actuel, il nous paraît opportun de revoir le schéma prévisionnel d'emploi pluriannuel pour mettre fin à la baisse du nombre d'équivalents temps plein (ETP), afin de permettre un accompagnement des élèves en petits groupes. Celui-ci prévoit, sur la période 2019-2022, la suppression de 300 ETP, avec une accélération sur les années 2021 et 2022. Il est ainsi prévu la suppression de 80 ETP à la rentrée 2020.
J'en viens maintenant à nos préconisations pour éclaircir l'avenir de l'enseignement agricole fortement assombri par la crise. En effet, celle-ci a eu des conséquences financières très lourdes. Le ministère estime à une centaine de millions d'euros les pertes financières pour l'ensemble de l'enseignement agricole. Or, avant même la crise de Covid-19, la situation financière de plusieurs établissements d'enseignement était sous surveillance. Ainsi, 46 % d'entre eux étaient en 2017 dans une situation financière d'alerte ou de vigilance forte. La santé financière des établissements d'enseignement participe à l'attrait de cet enseignement envers les apprenants et leurs familles. En effet, comment attirer de nouveaux élèves ou étudiants si les exploitations agricoles liées aux établissements sont en difficulté financière ? Aussi nous appelons à la mise en place d'un plan d'aide économique aux exploitations et établissements d'enseignement agricole pour les aider à faire face aux conséquences de la crise de Covid-19.
Par ailleurs, il devient désormais urgent de prendre les mesures d'application du plan de requalification et de revalorisation salariale pour les agents contractuels et les enseignants de catégorie 3 de l'enseignement agricole privé sous contrat. Le principe de ce plan a été adopté en juillet 2019, et une enveloppe de 2,13 millions d'euros a été votée dans la loi de finances pour 2020. Mais, les mesures d'application ne sont toujours pas prises ! Or certains établissements d'enseignement agricole peinent à recruter de nouveaux professeurs en l'absence de cette revalorisation !
Il faut désormais préparer la rentrée 2020. De nombreuses incertitudes pèsent sur le projet pédagogique de l'enseignement agricole : les conditions d'accueil dans les internats, la possibilité de trouver un stage ou un apprentissage dans un contexte de crise économique. Pour cela nous avons trois préconisations : il faut rassurer les élèves, et leurs familles, quant à la préparation de la prochaine rentrée (obtention du diplôme en cours, organisation des concours, conditions d'accueil dans les établissements d'enseignement).
Par ailleurs, nous préconisons l'assouplissement dès à présent du statut de scolaire alternant. Celui-ci présente l'avantage de permettre à un jeune qui n'a pas encore trouvé un contrat d'apprentissage de pouvoir quand même s'inscrire dans une formation, et commencer son année scolaire par des cours, dans l'attente de la signature de son contrat d'apprentissage. En effet, en raison des difficultés économiques que risquent de connaître de nombreuses entreprises, notamment les plus petites, il n'est pas sûr qu'elles souhaitent prendre en charge un apprenant en alternance ou en apprentissage. Or, en l'absence de ce contrat d'apprentissage, l'apprenant ne peut pas commencer sa formation, y compris la partie « scolaire ». Si le recours à ce statut est déjà possible pour certaines formations de l'enseignement agricole, ce n'est pas le cas pour les formations de l'éducation nationale dont certaines se font dans les établissements d'enseignement agricole.
Par ailleurs, nous souhaitons que soit organisée une large concertation avec les filières professionnelles pour préparer la prochaine rentrée. Il s'agirait notamment de mobiliser des « jeunes professionnels », installés depuis peu qui viendraient transmettre leurs compétences aux élèves à travers leurs retours d'expérience. Bien évidemment, les chambres consulaires doivent être associées à cette démarche.
Enfin, et il s'agit de notre dernière préconisation, il est urgent de relancer l'information et la communication sur l'enseignement agricole. Je regrette d'ailleurs que l'enseignement agricole ait été oublié ou mentionné de manière trop succincte dans la parole publique ces derniers mois. Je pense à l'annonce de la fermeture puis de la réouverture progressive des établissements, ou encore aux conditions de passation du baccalauréat et des examens en juin 2020.
La grande campagne de communication « l'aventure du vivant », et la mobilisation des ministères de l'agriculture et de l'éducation nationale ont permis non seulement de stopper l'hémorragie de la baisse des effectifs. Mais plus encore, elles ont permis pour la première fois en 10 ans, un rebond, avec 3 000 inscriptions supplémentaires à la rentrée de 2019. Or, cette dynamique risque d'être stoppée net : de nombreuses journées portes ouvertes n'ont pas pu se tenir, et le travail d'information qui a souvent lieu au moment des conseils de classe de deuxième et troisième trimestres s'est fait dans des conditions dégradées. Nous le savons : l'enseignement agricole est mal connu : à peine 1/3 de ses élèves se destine à des métiers en lien avec l'agriculture. Le réseau des lycées agricoles privés constate une chute de 15 % des inscriptions par rapport à la même époque l'année dernière.
Vous le savez, tout comme vous, je crois profondément dans l'enseignement agricole qui représente une voie de formation professionnelle d'excellence et d'insertion forte. Il serait dommage que la crise que nous avons connue mette à mal ce magnifique outil dont dispose notre pays pour former nos jeunes.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je vous remercie monsieur Karam pour cette présentation. Il me paraissait important que notre commission mette un coup de projecteur sur cette voie de formation. J'invite à présent les autres membres du groupe de travail à prendre la parole.
Mme Annick Billon . - Je vous remercie également, cher Antoine, pour cette présentation exhaustive de nos travaux.
Je regrette que la communication gouvernementale ait séparé l'enseignement agricole de l'enseignement général, confrontés pourtant aux mêmes problématiques. En bénéficiant des mêmes dispositifs, l'enseignement agricole aurait au moins pu échapper à l'invisibilité chronique dont il souffre, en dehors des périodes d'annonces médiatiques.
Concernant la réouverture des établissements agricoles, elle me paraît urgente car les élèves doivent, avant l'été, reprendre contact avec la vie scolaire, notamment les élèves décrocheurs qu'ils le soient par manque d'équipement informatique, de couverture numérique ou encore parce qu'ils se sont démobilisés. En outre, une MFR n'étant pas confrontée aux mêmes problématiques qu'un grand lycée, il me semble important que ces réouvertures se fassent « à la carte » et que chaque responsable d'établissement définisse son propre calendrier. Le soutien scolaire durant l'été me paraît aussi essentiel.
Je conclurai sur le statut scolaire alternant qui m'intéresse particulièrement. Faute d'avoir pu organiser des journées portes ouvertes traditionnelles, les établissements agricoles et les MFR ont souffert d'un certain manque de visibilité, qui a généré un déficit de visites et d'inscriptions. Des baisses d'effectifs sont à craindre - certaines sont déjà signalées - qui auront un impact considérable sur le personnel. Il est donc urgent de proposer dès maintenant, tout enseignement confondu, un assouplissement de ce statut scolaire alternant, permettant aux jeunes de s'inscrire même sans contrat d'apprentissage. J'ai d'ailleurs interpellé le ministre par une question d'actualité sur ce sujet.
Mme Maryvonne Blondin . - Je tiens à remercier mes collègues pour l'ambiance qui a régné au cours de ces auditions et Antoine Karam pour sa disponibilité malgré l'éloignement géographique et le décalage horaire.
Il me paraît important de différencier chaque établissement d'enseignement agricole : une MFR ne se gère pas de la même façon qu'un lycée agricole. Les projets pédagogiques recouvrent plusieurs volets : éducatif, social, économique.
Au sein d'un internat par exemple, les élèves apprennent la vie en collectivité. En outre, ils apprennent à développer des activités annexes, par exemple un réseau de ventes de leurs produits qui leur permet de mettre en oeuvre différentes techniques de commercialisation, en lien avec les producteurs locaux et la population locale. Cela génère des ressources propres qui donnent la possibilité aux établissements de financer d'autres projets. Or, on connaît la fragilité financière de ces établissements, qui risque d'être accentuée par la crise de Covid-19 et empêcher d'offrir aux élèves intéressés une formation à la rentrée 2020-2021.
Par ailleurs, les journées portes ouvertes, même si elles ont eu lieu de manière virtuelle, n'ont pas été suffisantes pour assurer l'abondement du recrutement des élèves.
Il a aussi été noté que l'environnement numérique ne s'est pas suffisamment développé et l'accès aux services de La Poste, mis en place par le ministère de l'éducation nationale, n'a malheureusement pas été simultané pour l'enseignement agricole.
Les transports représentent également une réelle inquiétude pour les chefs d'établissement.
Enfin, il ressort de nos auditions que cet enseignement n'a pas suffisamment été mis en avant par les publications du ministère, pourtant source de satisfaction pour beaucoup d'élèves et d'emplois, lesquels devraient se développer en ces temps où la production locale est mise en exergue.
M. André Gattolin . - Je félicite les membres du groupe de travail pour ce rapport très intéressant.
S'agissant des décrocheurs pendant la période de confinement, disposons-nous d'un état précis ? Ont-ils vraiment décroché de leur formation, ou bien certains se sont-ils portés volontaires pour répondre à l'appel lancé par le ministre pour aider aux travaux agricoles durant le confinement ? Si seul un tiers des élèves de l'enseignement agricole rejoint les entreprises agricoles, cela signifie que le risque de dispersion, voire de disparition, est effectivement important.
Je suis par ailleurs étonné que dans l'enseignement agricole, un contrat d'apprentissage en alternance doit être conclu dès le début de l'année scolaire. Dans l'enseignement supérieur, ces contrats peuvent être signés en cours d'année. Dans ce cas, la durée du contrat excède l'année d'obtention du diplôme. Il me semble important que cette souplesse existe aussi dans l'enseignement agricole.
M. Pierre Ouzoulias . - Je remercie Antoine Karam, notamment pour son attachement indéfectible à l'enseignement agricole qu'il vient de démontrer.
En préambule, je voudrais souligner le fait que cette crise a révélé les faiblesses structurelles de l'enseignement agricole, et comme l'a dit André Gattolin, le risque qu'il disparaisse. Des moyens importants sont nécessaires pour pallier les dysfonctionnements accentués par la crise actuelle.
Le bilan dressé par Antoine Karam est précis. Je souhaite insister sur deux points : la situation économique catastrophique des exploitations agricoles tout d'abord, fondamentales en termes d'enseignement et dont près de la moitié étaient en déficit avant la crise et certainement la totalité aujourd'hui. Un effort considérable du ministère de l'agriculture - qui souhaite exercer pleinement sa tutelle sur ces fermes - est attendu pour les sauver. Il est inconcevable que dans l'enseignement agricole, on puisse se satisfaire à la rentrée prochaine d'un enseignement uniquement théorique et délivré par Internet !
Second point, en lien avec le rapport précédemment présenté : le secteur de l'enseignement agricole est l'un des rares au sein duquel les responsables des collèges n'ont pas de statut. Soutenus par leurs syndicats, ils souhaitent simplement pouvoir intégrer les statuts existant dans l'éducation nationale. Les soutenir serait un signe fort de notre intérêt pour cet enseignement.
Je conclurai sur le souhait, très largement partagé, qu'une période de remise à niveau des élèves soit mise en place en amont de la rentrée prochaine. Ceci me paraît indispensable dans l'enseignement agricole, au risque encore une fois de le voir disparaître.
Mme Dominique Vérien . - Je souhaite revenir sur deux sujets dont des MFR m'ont fait part.
Le premier concerne les stagiaires placés sous la responsabilité du chef d'établissement, à l'inverse des apprentis placés sous la responsabilité du chef d'entreprise. Certains de ces élèves, n'ont pas suivi de stage, car le chef d'établissement n'a pas pu s'assurer que toutes les entreprises accueillant ces stagiaires respectent bien le protocole sanitaire. Le statut d'alternant ne pourrait-il pas inclure ces élèves stagiaires non apprentis en leur permettant de ne pas être sous la responsabilité du chef d'établissement ?
Le second point concerne le financement des MFR, lié au nombre d'élèves évalué en octobre. Or, et j'avais eu l'occasion de le dire au ministre de l'agriculture lors de son audition en mai dernier, et même si les portes ouvertes virtuelles n'ont pas eu le succès escompté, les MFR espèrent malgré tout que des élèves, non encore inscrits, s'inscrivent à l'automne. De ce fait, le comptage ne pourrait-il se faire en décembre plutôt qu'en octobre, permettant ainsi un financement incluant ces nouveaux élèves ?
L'enseignement agricole est un modèle composé de multiples filières, pas seulement agricoles, qui offre la possibilité aux élèves moins à l'aise dans le système proposé par l'éducation nationale de réussir brillamment.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Avant de conclure, je donne la parole à Antoine Karam pour qu'il apporte quelques réponses aux questions qui viennent d'être posées.
M. Antoine Karam . - Je souhaite avant tout remercier à nouveau mes collègues pour ce travail collectif, qui nous a permis de mieux comprendre et apprécier la situation. Outre les nombreux interlocuteurs mentionnés en introduction, nous avons aussi auditionné des ministres, et plus particulièrement celui de l'agriculture qui, malgré quelques garanties, n'a pu empêcher que certaines inquiétudes subsistent.
Ce rapport sera transmis à qui de droit, et notamment aux ministères et aux différentes personnes rencontrées, pour renforcer la qualité de ce travail dont le socle est de démontrer que l'enseignement agricole se situe bien au coeur de la formation de nos jeunes : il ne s'agit pas d'un strapontin de l'éducation nationale et je refuse toute dissociation entre éducation nationale et enseignement agricole.
Pour répondre à notre collègue, André Gattolin, au sujet de ces formations conditionnées par un stage en alternance en début d'année scolaire, nous allons interroger les directeurs d'établissements agricoles et étudier le moyen d'assouplir ce système en autorisant des signatures de contrat tout au long de l'année. Aujourd'hui, on constate des différences de statut entre les élèves.
Maryvonne Blondin a fort justement parlé des internats, qui accueillent je le rappelle 50 % des élèves de l'enseignement agricole, élèves organisés et faisant preuve d'imagination pour apporter de la vie à ces structures. S'agissant des difficultés financières, la situation continue de se dégrader. Le ministère a promis un geste fort, il faut maintenant le concrétiser. Des fermetures d'établissements sont en jeu, je le crains.
Je partage l'avis de Pierre Ouzoulias quant au fait que la crise sanitaire a révélé et mis en exergue les faiblesses structurelles de l'enseignement agricole. Dans le cadre de notre travail d'auditions mené depuis plusieurs années, ces faiblesses avaient cependant été annoncées, présageant déjà des fermetures d'exploitations agricoles. Comment les éviter, sinon par des mesures fortes prises par le ministère, à l'image de celles en faveur d'autres secteurs économiques ?
S'agissant de l'intégration aux statuts de l'éducation nationale, nous menons ce combat depuis de longues années, pour que le binôme éducation nationale/enseignement agricole soit définitivement reconnu. Travailler en complémentarité est le meilleur moyen de valoriser cet enseignement agricole, trop souvent considéré comme une « voie de garage ». Je pense que les deux ministres concernés - qui disent travailler de manière concertée, ce dont je me réjouis - en sont conscients puisqu'ils ont affirmé que de nombreuses passerelles existent entre ces deux filières de formation.
Il faut qu'au sein de notre commission, nous puissions aussi travailler en ce sens pour que nos jeunes, d'où qu'ils viennent, puissent bénéficier d'une éducation forte qui, ne l'oublions pas, est en mesure de leur permettre de trouver un emploi à la fin de leur cursus.
S'agissant du statut d'alternant, beaucoup d'élèves non apprentis rencontrent en effet des difficultés, notamment au niveau des entreprises. Vous avez tous insisté sur ce travail de communication à mener de manière constante, de façon à donner ses lettres de noblesse à l'enseignement agricole.
J'y crois profondément.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je vous remercie monsieur Karam ainsi que tous les membres de ce groupe de travail. Vos travaux ont bien sûr vocation à être poursuivis au sein de notre commission qui, je tiens à le rappeler, a toujours milité pour qu'aucune différentiation n'existe entre éducation nationale et enseignement agricole, et que chaque jeune, quel que soit son parcours, soit pris en considération. Notre collègue, Françoise Férat, longtemps rapporteure de ce secteur, en a été une fervente militante ainsi que tous les précédents présidents de notre commission.
Je note avec satisfaction que les ministres de l'agriculture, depuis que j'ai demandé à ce qu'ils soient auditionnés, répondent toujours présents, avec réactivité et enthousiasme.
Je souhaite enfin vous soumettre un sujet de réflexion : de par leurs compétences en matière d'enseignement mais aussi d'économie, les régions jouent un rôle au niveau des lycées, qu'ils soient traditionnels ou agricoles. Il serait intéressant que leurs interventions sur l'ensemble des dispositifs soient explorées, région par région.
Nous allons donc communiquer sur ces travaux, reflets de la réactivité de notre commission en cette période de crise sanitaire. Et dans le cadre de la prochaine rentrée ministérielle, nous auditionnerons à nouveau les ministres concernés pour insister sur l'importance de ces sujets.
Médias audiovisuels et Recherche
MERCREDI 10 JUIN 2020
___________
1) Médias audiovisuels
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - L'ordre du jour de notre réunion appelle à présent la présentation des conclusions de deux groupes de travail, créés par le bureau le 14 avril dernier, et chargés d'étudier les conséquences de la crise sanitaire sur les secteurs relevant de notre compétence. Il s'agit du groupe de travail sur le secteur des médias, animé par Jean-Pierre Leleux, et composé de David Assouline, Claude Malhuret, Jean-Raymond Hugonet, André Gattolin et moi-même. L'autre groupe porte sur le secteur de la recherche, est animé par Laure Darcos et est composé de Pierre Ouzoulias, Stéphane Piednoir et Sonia de la Provôté.
M. Jean-Pierre Leleux . - Madame la présidente, mes chers collègues, nous voici arrivés au terme de nos travaux dans le cadre de notre groupe de travail consacré aux médias audiovisuels.
Je tiens tout d'abord à vous remercier, madame la présidente, pour avoir pris l'initiative de sa création. Je remercie également mes collègues membres du groupe de travail. Outre vous-même, madame la Présidente, je pense à David Assouline, André Gattolin, Jean-Raymond Hugonet et Claude Malhuret.
Nous avons beaucoup auditionné depuis deux mois, les présidents des grandes chaînes (TF1, France Télévisions, M6, Canal+), les producteurs (Banijay, Newen et Mediawan), Radio France, France Médias Monde, mais aussi les radios indépendantes et les télévisions locales. Nous avons également échangé avec le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).
Tous ces échanges de grande qualité nous ont permis de nous faire une idée précise de la situation que traverse ce secteur. Cette perception s'est affinée dans le temps à mesure que nous sortions de l'urgence absolue de la crise sanitaire, pour entrer dans une période beaucoup plus incertaine d'évaluation de ses conséquences sur le plan économique et financier.
Sur la base de cet état des lieux, nous avons essayé d'élaborer un certain nombre de propositions. J'insiste sur le fait que ce rapport est un travail collectif. Il traduit des sensibilités différentes, et des priorités qui peuvent ne pas toujours se recouper. Pourtant, dans les circonstances présentes, je salue la volonté de chacun de formuler une réponse commune. Nous pensons qu'un plan de soutien à l'audiovisuel est nécessaire, mais nous ne le voyons toujours pas venir.
Dans la grave crise que nous connaissons, les médias n'ont pas été confinés, ils se sont au contraire mobilisés pour informer les Français, lutter contre les infoxs, les distraire, leur proposer de revoir les classiques de notre cinéma populaire sur France 2, ou les grands classiques sur Arte. Cette période a aussi été l'occasion d'innover, avec une nouvelle grille pour France 4, axée sur l'éducation, et la mise à disposition de la plateforme Educ'Arte gratuitement, qui a séduit près de 60 000 enseignants.
Le CSA a fait preuve d'une grande souplesse quant à l'application de la réglementation. Les obligations conventionnelles des chaînes ont été appréciées au cas par cas avec intelligence. Le président du groupe M6 a loué le fait que le CSA se soit comporté comme « un véritable partenaire » . Plusieurs décisions importantes, concernant notamment le renouvellement de l'autorisation d'émettre de Canal+, et la présidence de France Télévisions, ont été reportées à juillet par le régulateur. J'observe également que c'est en juillet que le Conseil de surveillance d'ARTE se prononcera sur le nom du successeur de Véronique Cayla à l'issue d'un inédit appel à candidatures.
L'état des lieux ne serait pas complet sans un hommage appuyé aux personnels de toutes les entreprises de médias, qui ont su basculer en quelques jours dans le télétravail. Chacun comprendra qu'il n'est pas évident de monter un sujet de radio ou de télévision depuis son domicile, d'autant plus que rares étaient les personnels équipés.
Leur implication doit être saluée. Aujourd'hui, le déconfinement est en route, et la présidente d'ARTE me disait hier que les personnels sont de plus en plus nombreux à vouloir revenir sur site. Nous entrons dans une nouvelle phase.
Un certain nombre de difficultés ont cependant été rencontrées. Toutes les entreprises de médias n'étaient pas prêtes à proposer une offre numérique abondante et de qualité. Comme nous l'a indiqué Sibyle Veil, présidente de Radio France : « si la crise avait eu lieu il y a quelques années nous n'aurions pas pu mettre à disposition autant d'émissions conçues à distance, ainsi que de grandes émissions ``cultes'' patrimoniales » .
Si Radio France et ARTE ont ainsi pu battre des records, respectivement sur sa plateforme de podcasts, et sur ses applications, on ne peut que regretter que le projet SALTO, du fait de ses multiples retards, n'ait pu bénéficier du formidable accélérateur de souscriptions qu'a constitué le confinement pour les services de vidéos par abonnement. Netflix a battu des records, et Disney + a réussi son lancement en France, mais SALTO risque d'arriver après la bataille.
Deux déceptions sont à signaler concernant le service public. La première concerne la chaîne France Info. Alors que BFM, CNews et LCI ont connu des audiences en progression de plus de 60 % (+68 % pour LCI), France info a dû se contenter de 47 % (chiffres de mi-avril). Nous avons interrogé Sibyle Veil sur cette contre-performance de la chaîne publique, alors que la radio et la plateforme France Info ont enregistré quant à elles d'excellents résultats. Pour la présidente de Radio France, la chaîne publique reste mal positionnée dans la numérotation de la TNT, et elle connaît « un déficit de capacité de projection pour réaliser des reportages par rapport à BFM » . Cela la rend moins attractive.
Cette situation est d'autant plus étonnante que le coût de cette chaîne reste assez mystérieux, comme le rappelait André Gattolin. Nos nombreuses demandes concernant le coût complet de la chaîne (direct et indirect, en prenant en compte les moyens de France Télévisions utilisés par la chaîne) sont toujours restées sans réponse. Certains professionnels estiment cependant ce coût à au moins 80 millions d'euros. Le ministère évalue quant à lui le coût direct à une trentaine de millions d'euros.
La seconde déception concerne l'arrêt des matinales communes à France 3 et France Bleu, décidé par France Télévisions dès le début du confinement, notamment pour pouvoir basculer la diffusion des dessins animés de France 4 à France 3. N'aurait-il pas été pertinent, au contraire, de multiplier ces matinales communes, pour informer les Français au plus près dans leurs territoires ? France Bleu a un rôle reconnu dans la gestion des crises, pourquoi ne pas avoir saisi cette circonstance pour permettre à France 3 de jouer un rôle similaire ?
Un dernier regret concerne l'ensemble des médias, et a trait au respect du pluralisme. De la mi-mars à la mi-avril, les antennes ont été surtout occupées par le Gouvernement et les membres de la majorité. Le CSA a reconnu que les règles de répartition du temps de parole n'avaient plus été respectées, et il a fallu une saisine des rédactions par le régulateur pour que la diversité politique redevienne la règle début mai.
Je ne souhaite pas polémiquer, c'est pour cela que j'accepte de considérer que les médias ont sans doute été pris au dépourvu, et se sont tournés vers ceux qui disposaient des informations. Mais la gestion de cette crise n'a sans doute pas été sans reproche, et les règles démocratiques ne doivent pas être confinées. On ne peut que souhaiter que le CSA se donne le temps d'un retour d'expérience, pour essayer de mieux garantir le pluralisme en temps de crise.
Notre groupe de travail s'est également intéressé à la situation économique et financière des médias. Nous avons demandé à chaque interlocuteur de nous faire un point précis de la situation. Celle-ci n'est pas bonne. Le président de TF1 nous a indiqué que la crise était « sans précédent », et que si les chaînes avaient connu de très belles audiences, celles-ci n'avaient pu être monétisées.
Avec la fermeture des usines et des magasins, avec la baisse très forte de la consommation du fait du confinement, la publicité s'est effondrée en mars et avril de 50 % à 70 %. Pour des médias qui ne vivent que des recettes publicitaires, la crise a eu un effet dramatique. C'est tout l'écosystème qui a été touché. Les tournages se sont arrêtés. Certains producteurs comme Banijay ont dû rapatrier des équipes entières de l'étranger à leurs frais.
Avec l'arrêt des tournages, les chaînes ont été privées rapidement de programmes frais, notamment de feuilletons quotidiens. Tous les métiers concernés par ces tournages ont été fragilisés.
Je rappelle par ailleurs que toutes les grandes manifestations sportives, comme les Jeux olympiques de Pékin, Roland Garros, ou le Tour de France ont été reportées, ou écourtées, comme le championnat de Ligue 1.
Une des conséquences de la pénurie de programmes a été l'augmentation de leurs prix de 20 % à 30 %, nous disait hier soir la présidente d'ARTE, sous la pression des plateformes américaines qui ont « siphonné » les catalogues européens.
Même le service public n'a pas été épargné par la crise. France Télévisions a perdu environ 40 millions d'euros de mars à mai en recettes publicitaires. Le report des grandes manifestations sportives devrait affecter le chiffre d'affaires publicitaire au second semestre. C'est, en fait, tout l'environnement du mandat du prochain président de France Télévisions qui est affecté, d'autant que le ministère des finances a laissé entendre que la trajectoire financière 2022 ne serait pas remise en cause.
Si pour France Médias Monde et ARTE les conséquences sont limitées, il n'en est pas de même pour Radio France, qui devra faire face à une perte de recettes publicitaires et de recettes de billetterie, sans parler d'un nouveau report du chantier de la Maison de la Radio. Pour France Télévisions, comme pour Radio France, des incertitudes ont émergé sur les plans de départs volontaires, qui doivent permettre d'alléger les charges de personnel de ces deux entreprises.
La situation des radios indépendantes et des télévisions locales est encore plus précaire, car elles ne peuvent s'appuyer ni sur la contribution à l'audiovisuel public (CAP) comme le service public ni sur la surface financière de grands groupes privés. Beaucoup craignent de ne pas survivre à la crise.
Tous les acteurs que nous avons auditionnés nous ont dit que leur sort dépendrait de l'intensité de la reprise au second semestre. Que la crise de la publicité se poursuive, et même les plus grands risquent de trébucher. Que l'activité reprenne, et ces entreprises pourront se projeter dans l'avenir, et accélérer leur transformation numérique.
Dans ces conditions, tous les acteurs se tournent depuis des semaines vers l'État pour obtenir un soutien. Nous avions été parmi les premiers à défendre auprès du ministre de la culture la création d'un crédit d'impôt pour les annonceurs. Or depuis deux mois, le ministère de la culture est d'une grande discrétion. Alors que de nombreux secteurs ont obtenu des plans de soutien massifs, l'audiovisuel, qui pèse le même poids que l'automobile, n'a rien obtenu, à part un fonds de soutien de 50 millions d'euros pour la production, dont la consommation n'a du reste pas commencé.
Or le temps presse, car les plateformes américaines ont pleinement profité de la situation pour accroître leur avantage.
Le Gouvernement réfléchit aujourd'hui à appliquer la réforme de l'audiovisuel par petits bouts, en commençant par la transcription de la directive sur les services de médias audiovisuels (SMA). Une des leçons de nos auditions est qu'il conviendrait au contraire de maintenir l'esprit d'une réforme globale, qui comblerait les nombreuses lacunes du texte actuel. Si celui-ci ne trouve pas beaucoup de défenseurs à l'heure de la préparation de la fin du quinquennat, n'est-ce pas justement parce qu'il ne permettait pas vraiment, ou suffisamment, de préparer l'avenir ?
Les différents membres du groupe de travail ne sont pas d'accord sur tout. Il existe des nuances entre nous, que nous assumons, notamment concernant le sort à réserver à la trajectoire financière 2022 du service public. Mais il est un point qui fait consensus, c'est la conviction qu'il faut définir une vraie ambition pour l'audiovisuel, qui permette de préserver un audiovisuel public fort, tout en permettant aux autres acteurs de jouer leur rôle.
Les dix propositions que je vais maintenant vous présenter succinctement, avant d'ouvrir le débat, sont d'abord des pistes. Elles doivent s'apprécier les unes par rapport aux autres, car si elles ne constituent pas un tout unique (chaque proposition pourrait être appliquée séparément), elles s'équilibrent en fait les unes les autres. Nous avons en effet le souci de préserver chaque acteur, tout en modernisant son environnement et en adaptant les règles.
La première proposition consiste donc à demander au Gouvernement un vrai plan d'action en faveur du secteur des médias et de l'audiovisuel. Il ne doit pas s'agir d'une simple mesure ou de quelques adaptations. Il faut à la fois des aides temporaires pour sauver les médias qui pourraient disparaître, notamment les radios indépendantes et les télévisions locales, mais aussi des mesures plus pérennes qui permettent de préparer l'avenir.
Les pistes 2, 3, 4 et 6 concernent le service public, dont le rôle est essentiel. Depuis trop longtemps, l'Etat actionnaire a renoncé à définir un cap, à faire des choix sur les objectifs, et à sanctuariser des moyens.
Dans notre rapport de 2015, nous avions été les premiers, avec André Gattolin, à proposer une réforme de la gouvernance de l'audiovisuel public, mais nous avions surtout demandé à réformer son financement, afin de conforter sa spécificité. Cet avis est personnel, et n'engage pas le groupe de travail, mais il me semble que la plus grande erreur d'appréciation du Gouvernement a été de prendre le problème à l'envers, en se focalisant sur la gouvernance, qui n'était pour nous qu'une conséquence.
C'est pour cela que notre sixième proposition concerne la réforme de la CAP, qui risque malheureusement de ne pas aboutir au cours du quinquennat. Cette réforme est une victime collatérale du report du projet de loi de réforme de l'audiovisuel. Or la réforme de la CAP en une taxe universelle est une condition indispensable du renforcement de l'indépendance du service public.
Avec une réforme à l'allemande, il est possible d'imaginer que suffisamment de moyens pourraient être dégagés pour réduire, voire supprimer, la publicité sur le service public, et donc renforcer sa spécificité. Nous évoquons d'ailleurs la piste d'une suppression de la publicité le week-end sur les antennes publiques dès que possible, et un objectif de suppression totale en 2025. C'est sur ce socle d'une nouvelle redevance qu'il aurait fallu, il me semble, construire la réforme.
Au lieu de cela, le Gouvernement a choisi de mettre les entreprises publiques sous tension budgétaire. A défaut d'une ambition qualitative et collective, nous avons donc eu une restriction quantitative individualisée pour chaque entreprise, la fameuse trajectoire financière.
Je sais que l'on m'a reproché à la fois de dénoncer cette approche comptable, et de ne pas m'y opposer formellement. Cette approche budgétaire constitue selon moi un pis-aller. Mais elle a au moins le mérite de mettre ces entreprises en mouvement, et de les obliger à s'interroger sur leur organisation, que de nombreux rapports de la Cour des comptes ont jugé coûteuse et inefficace.
C'est pour cela que la troisième proposition évoque la nécessité d'adapter la trajectoire à la situation de chaque entreprise. David Assouline aurait souhaité aller plus loin, en renonçant à son application. Je ne l'exclus pas, mais uniquement en dernier recours, et en rappelant que les entreprises ne le demandent pas. Mais nous sommes d'accord sur le fait qu'il ne faut pas faire de fétichisme budgétaire, sans renoncer pour autant au sérieux de la gestion.
La proposition 4 vise au maintien de la diffusion hertzienne de France 4, qui a démontré ses mérites pendant la crise. Je suis complètement d'accord avec André Gattolin sur le fait que ce maintien devrait s'accompagner d'une remise à plat de son cahier des charges. La ligne éditoriale de France 4 n'était pas claire. Le nouveau France 4 doit mettre le cap sur la jeunesse et l'éducation, sur tous les apprentissages, y compris les questions d'orientation.
La cinquième proposition concerne l'ensemble des médias, puisqu'elle vise à défendre l'idée d'une mesure d'aide générale au secteur. Nous avons entendu les réserves sur le crédit d'impôt pour les annonceurs. C'est pour cela que nous marquons notre préférence pour un crédit d'impôt ciblé sur les éditeurs, et leurs dépenses en faveur de la production, y compris le flux et l'information. Nous proposons que cette mesure dure un an, car la crise ne durera pas six mois.
La mesure 7 rappelle la nécessité de transcrire rapidement la directive SMA. C'est une mesure très importante pour soutenir le secteur de la production, et l'exception culturelle.
La proposition 8 concerne les radios indépendantes et les télévisions locales, qui sont véritablement menacées. Une mesure spécifique est ainsi nécessaire, telle par exemple qu'une une aide pour leurs frais de diffusion.
Les deux dernières propositions visent à préserver dans la durée une information et des programmes de qualité. Il n'y plus de raison que des chaînes d'information, et ceux qui les regardent, soient pénalisés par des questions de numérotation. Si l'on veut préserver l'information, il faut conforter toutes ces chaînes, et donc les rassembler dans un bloc. Les mutualisations entre ces chaînes et leurs groupes doivent aussi être pérennisées.
La dernière proposition est plus originale. Elle nécessiterait une vraie concertation, et a fait débat au sein du groupe de travail. Elle vise à permettre aux chaînes d'allouer une partie de leurs obligations de financement au cinéma, ou à la production audiovisuelle selon leurs projets. Cette zone de souplesse, ou couloir de flexibilité se glisserait entre les obligations relatives au financement du cinéma, et celles relatives à la production audiovisuelle, en prenant un peu sur chacune. Nos chaînes ont besoin de cette souplesse. Une telle évolution pourrait aussi s'inscrire dans le cadre de la modernisation nécessaire de la chronologie des médias, et de la négociation avec les plateformes. Un véritable New Deal audiovisuel est devenu indispensable.
Voilà, mes chers collègues, le fruit de nos auditions. Ce rapport rassemble des convictions anciennes, des rapprochements de points de vue entre nous, et quelques idées nouvelles, qui sont souvent la marque de fabrique de notre commission concernant l'évolution de ce secteur.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Cet exposé permet de poser la question de l'audiovisuel dans le contexte de la crise sanitaire, ainsi que celle de la création, qui lui est intrinsèquement associée.
M. David Assouline . - J'ai été frappé, au cours des auditions, par la grande réactivité des principaux médias français pendant cette crise. Celle-ci a notamment permis que les citoyens soient accompagnés et informés. Cela n'avait rien d'évident. Sibyle Veil a eu raison de dire qu'il y a quelques années, ce service n'aurait pu être aussi performant. La révolution numérique a permis cette réactivité. Je souhaite également saluer le personnel, qui pour partie travaillait à distance, mais également en présentiel, à l'instar des journalistes de terrain.
L'ensemble des propositions exposées est partagé. Nos échanges ont été soutenus pour ce rapport, car nous avons des différences d'appréciations. Ainsi, si je suis favorable au maintien d'une trajectoire financière, car je suis pour une gestion sérieuse, je m'oppose à ce que nous poursuivions sur une trajectoire de baisse, telle que le Gouvernement l'a imposée à l'audiovisuel public. Ces nuances sont rappelées dans le rapport. Néanmoins, nous nous accordons sur les mesures à prendre d'urgence, à travers un plan d'action et des moyens dédiés, tant pour le public que le privé.
De même, nous rappelons notre opposition à la fermeture de France 4, qui doit être effective le 9 août 2020. Il n'est du reste pas sérieux de ne pas communiquer sur ce point. Delphine Ernotte nous a indiqué que le ministre lui a demandé une grille de programmes dans l'hypothèse d'une poursuite de l'activité de la chaîne, ou les évolutions de l'offre dans l'hypothèse contraire. Le lendemain, Delphine Ernotte a pu lui remettre une grille. La réactivité d'un côté apparaît ainsi bien supérieure à celle de l'autre.
Pendant ce confinement, France 4 a démontré une utilité comme chaîne jeunesse éducative. J'ai reçu un nombre important de témoignages de sénateurs, qui soulignaient que dans des foyers où le nombre d'écrans était limité, France 4 avait permis de suivre des cours, grâce à une offre de valeur. Chaque foyer reçoit cette chaîne, et il n'existe pas de zone blanche ou grise en la matière. Tous ces points font consensus entre nous.
De même, la pérennité du financement de l'audiovisuel public est essentielle. Jean-Pierre Leleux doute que la réforme de la CAP puisse intervenir avant la fin du quinquennat. Néanmoins, je ne vois pas de lien direct entre celle-ci et le report du projet de loi de réforme de l'audiovisuel public. Il reste du temps dans ce quinquennat pour mettre en oeuvre une mesure consensuelle. Si une réforme comme celle des retraites a mis en lumière une forte division politique, la nécessité de la réforme de la CAP fait l'objet d'un consensus. Il n'est plus possible que ne s'en acquittent que les détenteurs téléviseurs, car cela crée une inégalité fiscale. Aujourd'hui, chacun reçoit ce service, mais seule une partie de la population le paie.
Je partage toutes les autres propositions. Il est positif que le service public ait été mis en avant, mais nous n'avons pas ignoré les difficultés des chaînes privées. Il s'agit d'un écosystème. Nous avons proposé des mesures à destination du secteur privé autres que le crédit d'impôt sur la publicité, dans la mesure où le Gouvernement pourrait s'y opposer. Nous proposons donc un crédit d'impôt sur l'investissement et la production.
M. André Gattolin . - Un élément évoqué par David Assouline me semble important. Il s'agit du lien entre la période que nous venons de traverser et le numérique. Nous sommes en effet peut-être entrés dans le troisième âge des relations des populations à internet. L'âge utopique de la gratuité et des gains de productivité a été suivi par l'âge dystopique de la mainmise de Google, Apple, Facebook, Amazon, et Microsoft (GAFAM), de l'accaparement des données personnelles, et de la surveillance généralisée. Pour les médias, comme pour de nombreux autres domaines, nous nous demandons ce qu'aurait pu être un confinement il y a vingt ans, sans numérique. Cela nous amènera peut-être à abandonner une vision idéologique et dialectique de la numérisation de la société, pour une vision plus équilibrée. La rédaction du Monde me disait récemment qu'elle s'interrogeait sur l'opportunité de conserver de vastes locaux. En effet, ses membres ont appris à travailler depuis chez eux, et de manière beaucoup plus efficace. L'un des effets positifs du confinement a du reste été le faible nombre d'invités sur les plateaux des chaînes d'information, permettant d'éviter une certaine cacophonie. Il est ainsi possible de s'exprimer de manière plus détaillée, et de répondre mieux aux questions.
Il sera donc urgent de dresser un véritable bilan de ce que cette période aura changé profondément dans la société. Les changements ont en effet concerné d'autres dimensions que celle du numérique, et je songe par exemple aux attentes vis-à-vis du service public. Celui-ci a retrouvé une certaine noblesse, cela a été notamment le cas pour France 4, en diffusant des programmes éducatifs. L'idée de dédier une chaîne à l'éducation est ancienne, mais celle-ci s'est heurtée à une absence de volonté, moins des pouvoirs publics, que des dirigeants des chaînes. Il est en effet plus aisé de proposer des chaînes de flux et de divertissement que de créer de véritables programmes. Si l'audience de ces derniers n'est en effet jamais considérable, ils touchent in fine des millions de personnes, à l'instar du service éducatif de la British Broadcasting Corporation (BBC), utilisé notamment en cours par les enseignants.
Il n'existe pas pour l'heure de grand plan de relance dédié au secteur audiovisuel, bien que de nouveaux plans soient annoncés tous les jours. Hier, il s'agissait du livre. Je ne jette pas la pierre au ministre de la culture, car il ne décide pas des budgets. Les annonces sur le livre ont hier été faites en commun avec le ministre de l'économie. Les demandes sont nombreuses en la matière, et des arbitrages ont lieu, mais il existe de véritables urgences.
L'une des questions essentielles, que nous avons évoquée lors de l'audition des responsables de Banijay, est celle de l'assurance des tournages. Si sur un tournage, une personne tombe malade, le risque de cluster est considérable, notamment pour la production privée. La production déléguée ne bénéficie en effet d'aucune garantie de la chaîne ni de l'Etat. Sans un fonds assurantiel qui lui permette de se protéger, le risque de faillite est important.
Le risque de faillite des entreprises est souvent évoqué, par exemple pour Air France ou Airbus. Or aucune chaîne aujourd'hui ne court ce risque. Il existe cependant pour les producteurs, et notamment pour les petits indépendants. Quant RTL perd 73 % de sa recette publicitaire sur les derniers mois, le grand groupe auquel elle appartient est capable d'encaisser ces pertes. Il n'en va pas de même pour les petites radios. Il faut donc traiter en priorité le risque de perte d'emplois, et de catastrophe immédiate.
Il convient ainsi de penser une réforme de l'audiovisuel de manière plus articulée, par rapport au bilan que nous pouvons tirer de cette crise. Je suis d'accord pour que France 4 continue, mais il convient de préciser son identité. Une chaîne jeunesse de 2 à 35 ans, comme aujourd'hui, n'a pas de sens. Une chaîne proposant des programmes éducatifs, et des divertissements à destination des 4 à 14 ans en aurait davantage. Il n'est pas possible de donner un blanc-seing à la direction de France Télévisions. L'identité de la chaîne doit être définie au préalable.
M. Jean-Raymond Hugonet . - Comme toujours en période de crise, il me semble essentiel de déterminer ce qui réunit les acteurs. Deux éléments me frappent. Tout d'abord, l'intégralité de ceux-ci se tourne vers l'Etat pour obtenir des moyens financiers. La culture apparaît comme le parent pauvre en la matière, à l'instar du sport.
Par ailleurs, la traditionnelle séparation entre privé et public a été intéressante à observer au cours de nos auditions. En effet, si les sentiments exprimés étaient différents, un certain nombre de ressentis étaient partagés par les acteurs. Le service public n'a par exemple pas pu recourir massivement au chômage partiel. Au contraire, le secteur privé a pu user de ce dispositif. De même, des acteurs de ce dernier ont pu tenir des propos assez radicaux, et je songe notamment à Nicolas de Tavernost, alors que ceux du secteur public apparaissaient plus nuancés.
L'Etat leur apporte un soutien, par exemple pour le financement des travaux de Radio France. Le retard pris en raison du Covid-19 aura un effet calendaire, mais également financier, puisque le coût augmentera de 50 millions à 60 millions d'euros. La crise a par ailleurs frappé Radio France au pire moment. Celle-ci sortait notamment d'excellents résultats, et avait réussi à s'inscrire dans une trajectoire de gestion saine. Elle avait également atteint des records d'audience, avant de connaître une grève de 63 jours. Lorsque la direction a finalement obtenu la signature de quatre syndicats sur cinq, la crise sanitaire a empêché la conclusion de l'accord, à quelques jours près. Aujourd'hui, Radio France a démontré son extrême réactivité devant la crise, mais devra reprendre des négociations difficiles avec les syndicats à la rentrée. Or lors du dernier conseil d'administration, la farouche opposition des représentants du personnel est apparue clairement.
En matière de trajectoire financière, l'Etat se limite aujourd'hui à des questions de gestion. Néanmoins, si la trésorerie de Radio France n'est pas atteinte pour l'heure, elle rencontrera des difficultés lors du budget 2021, en raison de l'inertie du déficit.
L'audition de Stéphane Courbit et François de Brugada, que nous avons menée hier, s'est avérée particulièrement intéressante en ce qui concerne les risques que court le secteur privé. Par exemple, si un tournage de 5 millions d'euros est arrêté, et que le produit n'est pas livré à l'acheteur, l'engagement de financement n'est pris en compte, ni par le client, ni par les assurances. Celles-ci en effet ont une tendance bien connue à n'assurer que des projets qui ne posent aucun problème. Le métier de producteur, qui est intrinsèquement à risque, rencontre ainsi de vives difficultés.
Les explications de Delphine Ernotte en ce qui concerne la spécificité des programmes de flux ne nous ont par ailleurs pas convaincus. Des produits sont achetés massivement à l'étranger, à travers des sociétés dérivées, alors que la France dispose de grands talents, qui ne parviennent pas à être exposés.
Enfin, l'absolue nécessité de la transposition de la directive SMA fait l'objet d'un consensus au sein du groupe. Nous demandons au ministre de la culture de clarifier ce point, au regard du report du projet de loi sur l'audiovisuel.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Toutes les propositions exposées me semblent pertinentes, et s'appuient sur un diagnostic précis. Je souscris à l'idée qu'un véritable plan d'action doit être exigé de la part du Gouvernement, pour un secteur dont le poids est plus important que celui de l'automobile. Les emplois qu'il crée sont non-délocalisables, et contribuent à l'exercice de la démocratie, à travers le pluralisme de l'information, dans un contexte de développement des infoxs. Il est ainsi absolument nécessaire de sanctuariser ce secteur. Par ailleurs, les chaînes privées contribuent également à l'enrichissement de la production cinématographique, en raison des obligations de soutien à la création.
Dans le cadre de ce plan d'action, le Gouvernement devra accroître la lisibilité de la réforme de l'audiovisuel à court et moyen terme. Il s'agit de savoir lesquels de ses éléments seront repris, si elle n'est pas intégralement présentée au Parlement. A ce titre, la transposition de la directive SMA apparaît nécessaire. Notre commission a rédigé un communiqué de presse il y a dix jours, qui a rencontré un certain écho. Il a notamment été repris par l'Assemblée nationale, qui a salué cette initiative. Il semblerait que le Gouvernement souhaite effectuer cette transposition par ordonnance. J'ai cependant rappelé au ministre de la culture que le Parlement souhaite être étroitement associé à cette étape indispensable. La crise a accéléré un certain nombre de mouvements, tels que la numérisation de la société, ou l'irruption des plateformes extraeuropéennes dans le paysage audiovisuel et cinématographique français. Cela rend d'autant plus urgente la transposition des décisions prises au niveau européen. Le financement de la création ne peut aujourd'hui passer que par une mise à contribution des plateformes.
La réforme de la CAP est évoquée de longue date. J'avais notamment rédigé un rapport en 2011 sur les financements de France Télévisions, dans lequel je soulignais la nécessité de cette réforme à l'heure du numérique, car l'assiette de la CAP ne correspondait déjà plus aux usages. Ceux-ci se sont depuis amplifiés. La CAP est ainsi profondément inégalitaire, puisque les personnes âgées regardent encore la télévision, et s'acquittent donc de la redevance, à la différence des catégories socioprofessionnelles supérieures (CSP+) qui utilisent des tablettes. Je rappelle que les pays voisins ont de longue date mis en oeuvre cette modernisation de l'assiette de la redevance.
En 2014, François Hollande annonçait lors d'un colloque au CSA une réforme de la CAP. Depuis cette date cependant, cette réforme a toujours été reportée. Cette crise constitue une opportunité en la matière. Il serait coupable de ne pas mettre en oeuvre cette réforme. Nous sommes en effet arrivés à un point critique. Cela permettrait de clarifier le modèle de financement de l'audiovisuel public. Il ne faudrait pas qu'une suppression de la publicité impacte négativement le budget de ces sociétés, et il faudra donc une réflexion sur le produit de la redevance. En Allemagne, la réforme a permis de dégager des moyens supplémentaires.
Je souhaiterais que nous écrivions un courrier au Président de la République sur l'avenir de France 4. Nous en avions acté le principe, à la faveur du rapport. Notre commission a été la première à demander un moratoire. France 4 devrait être une chaîne éducative pour la jeunesse. Depuis l'annonce de sa suppression, j'ai maintes fois interrogé le conseil d'administration de France Télévisions sur ce point. En réalité, cette suppression dépend de la tutelle, et non de la présidence de France Télévisions elle-même. Nous sommes donc dans l'attente, puisque la fermeture de la chaîne est toujours prévue pour le 9 août 2020.
Le modèle économique de SALTO n'est par ailleurs toujours pas stabilisé. Il n'a pas même été débattu au Parlement, ce qui aurait été légitime, puisqu'une partie du produit de la redevance lui sera destiné.
Mme Catherine Dumas . - Ce travail est passionnant, d'autant que ce groupe est pluriel. Je pense que la mission de service public pour la jeunesse de France 4 doit être confortée. Une lettre au Président de la République serait donc bienvenue.
Je souhaiterais interroger Jean-Pierre Leleux sur France Info. Au-delà du fait que la chaîne était mal positionnée en numérotation, j'ai cru comprendre que d'autres problèmes se posaient. Vous avez souligné les difficultés que vous avez rencontrées pour obtenir des informations quant à son coût. Pourriez-vous détailler ce point ?
Par ailleurs, les tournages constituent un véritable problème, humain et économique. Le nombre de personnes concernées est très important. Lorsqu'un tournage est arrêté, des coûts imprévus se révèlent. Il faudra donc reprendre ces tournages, obtenir de nouvelles autorisations administratives, et organiser les équipes dans le respect des mesures sanitaires. Auriez-vous des éléments sur les incidences humaines de cette question, notamment en termes de chômage ?
L'activité des doubleurs a par ailleurs été complètement interrompue par le confinement. Le chiffre d'affaires du marché du doublage est estimé à plus 100 millions d'euros, et est en hausse depuis deux ans. Comment ces métiers de postproduction vont-ils reprendre ? Ont-ils fait l'objet d'une aide spécifique ?
Mme Dominique Vérien . - France 4 a prouvé son utilité. De nombreux discours ont évoqué le monde d'après. Or la première décision du ministère a été d'appliquer une décision controversée du monde d'avant. J'avoue mon incompréhension.
J'aimerais également insister sur la question de la représentativité. Jean-Pierre Leleux évoquait le manque de pluralisme politique. Je souhaiterais pour ma part souligner le manque ahurissant de parité. La délégation aux droits des femmes a lancé un rapport sur la présence des femmes dans l'audiovisuel, et nous avons choisi d'y inclure un volet pandémie. Dans l'urgence se sont exprimés de vieux réflexes. Les caméras se sont dirigées vers des hommes puissants, c'est-à-dire de bons clients.
Il a fallu que des associations telles que le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE) s'en émeuvent pour que le CSA intervienne. Miracle, les chaînes ont alors trouvé des femmes. Certes, il ne s'agissait pas de chefs de service hospitalier, car il en manque. Mais ont trouvé à s'exprimer des femmes économistes, épidémiologistes, infirmières, ou psychologue. Ainsi, il convient de lutter encore pour la parité. Par ailleurs, le rapport du CSA que nous attendons devrait contenir un certain nombre de propositions, dont la création d'un guide des expertes. Celles-ci existent, mais sont moins visibles. Si elles sont répertoriées au préalable, leur présence sera facilitée.
Mme Céline Brulin . - Je voudrais revenir sur un aspect qui me semble essentiel. Jean-Pierre Leleux a souligné que les règles démocratiques ne doivent pas être confinées, ce que je partage pleinement. Je pense qu'il est d'autant plus important que des voix plurielles se fassent entendre dans le cadre d'une crise. De nombreux débats agitent notamment la communauté scientifique. Je ne suis pas qualifié pour y prendre part, aussi m'en abstiendrai-je, mais je ne suis pas certaine qu'ils soient toujours de meilleure tenue que les débats politiques. Si nous voulons redonner du crédit à la parole publique, nous avons cependant besoin que s'expriment des voix diverses, d'autant que de nombreuses questions se posent pour le monde d'après. Par définition, cela implique que soit questionnée en profondeur la société que nous souhaitons demain.
Je me retrouve également dans la nécessité d'un plan d'action et de soutien à l'audiovisuel. Il s'agit d'un secteur économique de poids, et nous ne pouvons en délaisser aucun. De plus, nous avons affaire à des concurrences redoutables à l'échelle internationale. Enfin, ce domaine n'est pas anodin, puisqu'il s'agit de la culture et de l'information. Je plaide également pour que les trajectoires de baisse de dépenses soient abandonnées, ou à tout le moins revues. Certains secteurs bénéficieront de diminutions de cotisations sociales, ce que je ne conteste pas. De gros efforts sont consentis, et je ne peux imaginer que l'audiovisuel public n'en bénéficie pas également.
La transposition de la directive SMA est urgente, et doit être intégrée dans le plan d'action. J'entends qu'elle pourrait être réalisée par ordonnance. Il apparaît cependant nécessaire d'établir des rapports de force extrêmement solides sur ces questions, et je ne crois pas qu'une ordonnance permette le rassemblement de toute la nation. Il en va de même pour la CAP. J'ai fait le deuil d'une réforme globale de l'audiovisuel, mais ces deux urgences pourront peut-être être concrétisées par d'autres véhicules législatifs.
Je partage absolument le propos de Dominique Vérien sur France 4. Enfin, je me félicite des nuances apportées dans le rapport à la revendication portée par les acteurs de l'audiovisuel et de la presse d'un crédit d'impôt pour les annonceurs. En effet, à l'examen, cette mesure comportait un certain nombre de dangers, à commencer par le fait que les gros annonceurs soutiennent avant tout les médias dont la diffusion est la plus importante. Cela ne constituerait donc pas un soutien efficace aux acteurs indépendants.
Mme Sonia de la Provôté . - Il m'a semblé que pour les questions sanitaires et scientifiques, le pluralisme n'était pas effectif. J'ai notamment constaté une surreprésentation des professeurs de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), comme s'il n'existait pas de compétences au sein des régions. Il devrait exister en la matière un souci de diversité, et de la qualité de l'information. Je peux témoigner du fait que le grand public a été quelque peu exaspéré de cette situation. En effet, la situation épidémique des territoires n'était pas identique à celle de Paris.
M. David Assouline . - Je ne suis pas opposé à la suppression de la publicité à terme sur l'audiovisuel public, à condition qu'une compensation soit apportée. La publicité, y compris avant 20 heures, représente une source de revenus très importante pour Radio France. Je me suis donc opposé à cette suppression tant qu'il n'existe pas une assurance de la compensation, qui permette que les budgets ne soient pas modifiés à chaque nouveau gouvernement, ou dès qu'une crise économique survient. La redevance est le seul système pérenne, et doit être calculée pour répondre aux besoins de l'audiovisuel public. Lorsque Nicolas Sarkozy a décidé de la suppression de la publicité après 20 heures sur France Télévisions, il avait été dit que celle-ci serait compensée à l'euro près. Or nous avons constaté qu'il n'en avait rien été, et cela a représenté un coût de plusieurs centaines de millions d'euros. Nous pouvons tous souhaiter une suppression, afin que le service public ne dépende plus du commerce. Mais pour qu'il ne soit pas totalement dépendant d'un gouvernement, il doit bénéficier d'un financement pérenne.
M. André Gattolin . - Sur la question du pluralisme pendant la crise, il serait intéressant d'interroger les chaînes. Des problèmes techniques ont pu se poser, notamment pour joindre des intervenants. J'ai par ailleurs suivi les relevés de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) et du CSA sur le temps de parole. Pendant ces deux mois, et notamment pendant les deux premières semaines du confinement, la parole gouvernementale a été surreprésentée, comme elle l'avait été lors de la crise des subprimes . Le gouvernement et la majorité avaient alors occupé 75 % du temps de parole pendant des mois. Il en a été de même lors des attentats. Dans ces périodes de crise, les médias se tournent vers l'exécutif. Il convient donc de relativiser ce déséquilibre, bien qu'il doive se résorber rapidement.
M. Jean-Pierre Leleux . - Dans la mesure où ce rapport n'était pas un rapport budgétaire, la diversité des avis qui se sont exprimés au sein du groupe de travail a pu être représentée. Nous avons ainsi pu évoquer un certain nombre de sujets, qui ne faisaient pas consensus.
Nous nous accordons cependant sur certains d'entre eux : la réforme de la CAP ; le choix du crédit d'impôt éditeur plutôt qu'annonceur ; le regret que le secteur de la culture ne souffre d'une image trop intellectuelle par rapport aux autres industries. La culture n'a jamais été considérée comme une industrie, avec les emplois et les échanges que cela implique. Il faudra donc le rappeler, lorsque nous demanderons un plan d'action global. La transposition de la directive SMA fait également l'objet d'un consensus.
Nous avons constaté que les performances de la chaîne télévisée de France Info avaient été moindres que celles des trois autres chaînes d'information. Cela s'explique par un positionnement défavorable de la numérotation. Néanmoins, LCI est placée juste avant France Info, et a réalisé 67 % d'audience en plus. La question des moyens a donc également été évoquée, car ceux de la chaîne publique d'information en continu sont sans doute moins importants que ceux des autres. Le manque de transparence sur les coûts a également été largement souligné. S'il existe un consensus sur l'importance d'une chaîne publique, des inquiétudes demeurent. Nous avons donc proposé davantage de transparence sur les coûts, afin de pouvoir accompagner davantage cette action. De même, nous avons demandé une évolution du positionnement sur la numérotation.
Les tournages reprennent progressivement, pour certains depuis fin mai. Néanmoins, si un acteur ou un technicien tombe malade sur un tournage, l'intégralité du plateau devra être confinée pendant un ou deux mois. Le risque est faible en termes d'occurrence, mais considérable en termes de coût. Les assureurs sollicités pour le fonds assurantiel n'ont pas encore répondu, mais l'Etat l'a déjà abondé à hauteur de 50 millions d'euros. Jamais un phénomène épidémique n'avait conduit à arrêter l'économie de la sorte. Or l'assurance est contractuelle, et n'est pas une mutualisation des risques. Les assureurs, qui ne sont pas des entreprises charitables, ont donc pu faire valoir que ce risque n'était pas couvert. Néanmoins, il est important qu'il soit désormais pris en compte.
Le CSA travaille beaucoup sur la question de la parité. Il est vrai que les médias audiovisuels ont longtemps été très masculins, dans la production, et dans la réalisation. Je constate cependant un progrès en la matière, et les productrices comme les réalisatrices sont de plus en plus nombreuses. Le CSA tient chaque année avec le Centre national du cinéma (CNC) le compte de la féminisation de ce secteur, qui est certes insuffisante, mais progresse.
Le CSA et nous-mêmes avons constaté le problème de pluralisme au début de la crise. Il était néanmoins compréhensible que les médias aillent chercher l'information auprès du ministère de la santé et de l'exécutif. Le constat d'un déséquilibre a cependant été fait au mois de mai, et le CSA a depuis fait le nécessaire. Un rééquilibrage a été constaté ultérieurement. Je partage cependant l'idée de l'importance encore accrue du pluralisme en temps de crise.
Je suis très engagé pour la suppression à terme de la publicité sur l'audiovisuel public. Il n'est pas possible de supprimer du jour au lendemain une grande partie de ses recettes, qui s'appuient sur la publicité. Ce serait un choc trop important. Il faut donc pouvoir compenser ces pertes, pour asseoir les recettes sur un mode pérenne, démocratique et juste. Néanmoins, comme le soulignent de nombreux rapports de la Cour des comptes, des optimisations doivent également être menées. Celles-ci sont accélérées par les coupes que l'Etat opère dans la redevance. Une assurance de la compensation complète du montant des revenus de la publicité risquerait d'entraîner un moindre effort en la matière. Ce débat doit cependant avoir lieu, car la différenciation de l'audiovisuel public dans le paysage global est une nécessité pour l'avenir.
Des ordonnances ont été évoquées pour mettre en oeuvre certaines des dispositions du projet de loi. Néanmoins, le Gouvernement a constaté que cela ne pouvait suffire. Outre la transposition de la directive SMA, il est également important de fusionner la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) et le CSA en une Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). De même, il convient de revoir les rapports entre producteurs et éditeurs. Aussi, un projet de loi réduit devrait être présenté. Le Parlement pourra ainsi débattre de ces questions. Il faudra cependant réfléchir au cadrage qui devra être réalisé pour les ordonnances prévues. Nous pourrons également aborder d'autres points, et rappeler un certain nombre de nos attentes, telles que le modèle global de l'audiovisuel privé par rapport au public. Le problème de la CAP doit également être réglé, et pourrait l'être dans le cadre d'une loi de finances.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Qu'on soit favorable ou non à la suppression de la publicité sur l'audiovisuel public, ce dernier a démontré son excellente réactivité à l'occasion de cette crise. Il est d'autant plus urgent de réformer la CAP. Pour ce qui est du financement de l'audiovisuel public, il convient de sortir du débat, et d'admettre la nécessité d'une autorité indépendante et extérieure, qui fixe le budget nécessaire, telle que le board de la BBC. Cela n'empêche pas de réaliser des efforts en termes de productivité et de gestion. Un rapport de la Cour des comptes le soulignait en 2011. Il n'est pas normal que des salariés de plus de 65 ans continuent à travailler à France Télévisions, avec des salaires extrêmement importants. Il convient notamment de laisser la place à de jeunes générations.
Nous devrons par ailleurs auditionner le CSA sur la question du pluralisme pendant cette crise, et de la parité.
2) Recherche
Mme Laure Darcos . - Madame la présidente, mes chers collègues, le groupe de travail consacré à la recherche, que j'ai eu l'honneur et le plaisir d'animer, est composé de vous-même, madame la présidente, Pierre Ouzoulias, Stéphane Piednoir et Sonia de la Provôté.
Au cours de nos auditions, nous avons bien sûr approfondi les grandes problématiques qui sont au coeur de l'actualité des travaux de recherche sur la Covid-19 : les essais thérapeutiques ; la recherche de vaccins ; le recours aux tests de dépistage ; la modélisation de la propagation de l'épidémie. Ce n'est toutefois pas sous l'angle scientifique et technologique que nous avons choisi d'en rendre compte, trois d'entre nous travaillant déjà sur ces aspects dans le cadre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST). Nous nous sommes au contraire penchés sur la gouvernance du système de recherche et la coordination entre les différentes structures impliquées.
Avant d'approfondir ce point, je souhaite rappeler que, depuis le début de l'épidémie de Covid-19, toute la recherche française, des sciences du vivant aux sciences humaines et sociales, en passant par les mathématiques, est mobilisée pour contenir l'expansion du virus, tester des traitements, tenter de trouver un vaccin et évaluer l'incidence sociale de cette crise. Cet engagement total traduit la volonté et la détermination de nos chercheurs de répondre, par la science, à ce qui constitue la plus grave pandémie de notre histoire récente.
À l'ensemble des structures de recherche impliquées - Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), Institut Pasteur, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (INRIA), Institut national d'études démographiques (INED), Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAAE), centres hospitaliers universitaires (CHU) - et de leurs personnels, nous tenons à témoigner notre profonde admiration et notre très grande reconnaissance.
Notre premier constat est celui du manque de stratégie nationale de recherche sur la Covid-19, et l'absence de structure de pilotage unique. Dès le début de la pandémie, la communauté scientifique s'est mobilisée dans l'urgence, mais aussi dans une certaine confusion.
Sa gouvernance ainsi que son expertise scientifique sont notamment apparues éclatées. De trop nombreuses instances participent à la structuration de l'effort de recherche et à l'éclairage scientifique de la prise de décision politique : le consortium REACTing ; l'Agence nationale de la recherche (ANR) ; le Conseil scientifique ; le Comité analyse, recherche et expertise (CARE) ; l'Académie nationale de médecine ; l'Académie des sciences ; les sociétés savantes ; le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) ; la Haute Autorité de santé (HAS) ; l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ; etc. Bien sûr, chacune de ces institutions a légitimité à s'exprimer, mais l'absence d'organisation et de coordination entre elles a donné lieu à des messages au mieux désordonnés, au pire contradictoires.
L'impression de confusion a ensuite été renforcée par l'absence de régulation et de pilotage des projets de recherche sur la Covid-19. La très grande réactivité des chercheurs s'est traduite par un afflux de propositions. Ces initiatives n'ont toutefois fait l'objet d'aucun encadrement. Ainsi, le nombre d'essais cliniques en cours au niveau national (45 pour 2 000 patients) est clairement trop élevé, ce qui limite le nombre de patients par essai. Le même constat peut être fait au sujet de la trentaine de travaux de recherche français consacrés au développement de vaccins, sur une centaine comptabilisée au niveau mondial. Cette multiplication des projets conduit en outre à une dispersion des financements, alors qu'il aurait été plus pertinent de consacrer des montants plus élevés sur des projets bien ciblés.
Le désordre constaté s'est enfin illustré par une très grande compétition entre les équipes. L'émulation entre chercheurs est évidemment saine et bénéfique, mais le manque de coordination et de pilotage engendre des effets pervers : cacophonie des annonces ; surenchère médiatique ; mise en avant des intérêts personnels ; développement de logiques d'image ; importance des enjeux industriels et financiers ; etc.
Au vu de cet état des lieux, notre groupe estime qu'il a clairement manqué une instance de réflexion et de coordination unique. Le temps de la recherche étant un temps long, il est encore possible de redresser le tir et de confier à une structure de pilotage unique la coordination de la recherche sur la Covid-19. Celle-ci serait chargée de la programmation et du lancement des appels à projets, qui doivent couvrir l'ensemble des aspects de la pandémie, de l'évaluation des propositions reçues, et de l'attribution des moyens spécifiquement dédiés à la recherche sur le Sars-Cov-2. Ce constat et cette recommandation sont partagés par des scientifiques de renom, et par des institutions comme l'Académie nationale de médecine ou la section 27 du Comité national de la recherche scientifique.
Notre deuxième conclusion est celle d'une crise révélatrice des carences structurelles du système de recherche français.
La première d'entre elles tient au manque criant d'investissement budgétaire et stratégique en faveur de la recherche biomédicale. La France n'a pas réussi à maintenir son rang, et est aujourd'hui largement devancée par des pays comme les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et l'Italie. Plusieurs raisons expliquent ce décrochage : érosion et cloisonnement des financements alloués à ce domaine de recherche ; carences stratégiques ; essoufflement du modèle hospitalo-universitaire, dispersion des acteurs. L'épidémie de Covid-19 a fait ressurgir ce constat bien connu, et mis en lumière les conséquences délétères de ce désengagement. Ainsi, les travaux de recherche sur les coronavirus ont été considérablement réduits il y a une quinzaine d'années en France, faute de financements et de programmation stratégique, alors qu'ils ont été poursuivis dans d'autres pays, notamment en Allemagne.
Notre groupe de travail appelle donc à un réinvestissement budgétaire et stratégique dans la recherche biomédicale, afin que la France rattrape son retard au niveau international. Pour ma part, cela fait des années que je me bats, au moment de l'examen du budget, pour que l'INSERM, qui est l'acteur de tout premier plan dans ce domaine, puisse bénéficier de crédits à la hauteur de ses projets de recherche.
La deuxième carence est l'érosion constante, depuis plusieurs années, des dotations de base des laboratoires de recherche. Cette évolution les oblige à se tourner de plus en plus vers les financements sur projets. Ce type de financement a bien sûr de nombreux atouts, mais il présente aussi des inconvénients. En particulier, il est peu compatible avec la prise de risque et ne permet pas de mener des projets exploratoires. Or certains pans de la recherche, comme ceux concernés par le nouveau coronavirus (recherche fondamentale, recherche médicale), ont besoin de mettre au point et d'expérimenter des pistes qui n'aboutiront pas forcément. Aussi, notre groupe juge indispensable de mettre un terme à la diminution constante des dotations de base des laboratoires de recherche, et de rééquilibrer leur structure de financement entre ces dotations et les financements sur projets.
Plus globalement, l'épidémie de Covid-19 confirme à nos yeux la nécessité d'une réforme globale de la recherche, qui tirerait les leçons de cette crise. Plusieurs chantiers nous paraissent incontournables :
- amorcer une trajectoire financière ambitieuse qui permette d'atteindre l'objectif de 1 % du produit intérieur brut (PIB) consacré à la recherche publique ;
- définir des orientations stratégiques redonnant toute sa place à la recherche biomédicale ;
- clarifier la gouvernance du système ;
- rééquilibrer la structure de financement des laboratoires de recherche entre dotations de base et financements sur projets ;
- revaloriser très nettement la rémunération et le statut des chercheurs.
Le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR), qui aurait dû être présenté ce printemps, a été ajourné, et nous ne savons pas quand il sera de nouveau inscrit au calendrier des réformes. Selon de récentes informations, un passage en Conseil des ministres début juillet serait néanmoins prévu. Quoi qu'il en soit, nous serons très vigilants à ce que la communauté de la recherche, qui a été sous le feu des projecteurs durant cette crise, ne soit pas encore une fois laissée de côté.
Nous soulevons également dans nos conclusions la problématique de la démarche et de l'intégrité scientifiques. Dans un contexte de très large couverture médiatique, et de place grandissante des réseaux sociaux, l'émulation scientifique née de la lutte contre la Covid-19 a donné lieu à certaines dérives : effets de communication ; annonces prématurées ; discordes entre les équipes. Notre groupe de travail déplore ces excès, qui vont à l'encontre de la démarche et de l'intégrité scientifiques, lesquelles exigent de la méthode, de la rigueur, de l'esprit critique et de la discrétion professionnelle. Le battage médiatique autour de l'hydroxychloroquine est particulièrement révélateur des manquements à ces règles et valeurs. Faut-il le rappeler, le temps de la recherche et de la science n'est pas celui de l'immédiateté des médias et des réseaux sociaux.
Parallèlement à nos travaux, la commission des affaires sociales auditionnait de nombreux chercheurs. Je regrette que nous n'ayons pu partager ces auditions, qui étaient très intéressantes. Il n'est en effet pas toujours évident qu'une même personnalité accepte d'être auditionnée plusieurs fois.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Rien n'empêche de nous rapprocher de la commission des affaires sociales, et de dresser un bilan commun, pour que le Sénat formule des propositions solides. Je suis très favorable au travail transcommission.
M. Pierre Ouzoulias . - Ce rapport fait l'objet d'un consensus au sein du groupe de travail. Les acteurs scientifiques que nous avons interrogés, qu'ils fassent partie d'organismes publics, d'académies ou de sociétés savantes, ont tous souligné un paradoxe terrible. Jamais auparavant la communauté nationale, dans son ensemble, n'avait demandé autant à la science, sur la compréhension du virus et de la pandémie, mais également en matière de solutions thérapeutiques. Pourtant, malgré cette attente, la recherche publique comme privée a démontré un certain nombre de dysfonctionnements, qui étaient connus, mais que la pandémie a exacerbés. Le rapport fournit une base juste et consensuelle pour un bilan et une remise à plat globale de notre système de recherche.
Notre commission a auditionné un chercheur, M. François Trottein, qui s'exprimait devant des parlementaires pour la première fois. Il nous a livré son expérience, en disant l'immense peine qu'il avait ressentie en s'apercevant que l'urgence n'avait pas fait disparaître toute la lourdeur bureaucratique, qui l'oblige à consacrer l'essentiel de son temps à trouver des financements plutôt qu'à la recherche. Il faisait ainsi face aux mêmes problèmes, alors qu'il aurait été nécessaire d'alléger énormément tout le dispositif, et sans doute de le centraliser au sein des grands organismes pour faciliter l'activité des chercheurs. Il nous a indiqué avoir passé une semaine à rédiger seul un appel à projets, temps qu'il n'a pu consacrer à la recherche de thérapies. Cet exemple est terrible, et révèle l'inadaptation de notre système pendant la crise. Il n'a ainsi pas pu répondre aux demandes de la communauté nationale.
Si la LPPR était examinée en conseil des ministres le 8 juillet 2020, il faudrait que soit imposé un certain nombre de mesures systémiques, sur la base du rapport de Laure Darcos. Ce qui nous est proposé aujourd'hui apparaît en effet très insuffisant au regard de ce que la crise a révélé. Je ne parle pas même des moyens budgétaires, car les problèmes vont bien au-delà.
Mme Sonia de la Provôté . - Je remercie Laure Darcos et l'ensemble des membres du groupe de travail pour la qualité du rapport.
La crise a en effet mis en lumière, avec beaucoup d'acuité, un certain nombre de carences en matière de recherche biomédicale qui ont empêché de bien réagir. Ce constat avait déjà été dressé par la commission d'enquête sur la pénurie de médicaments et de vaccins. La multiplicité des intervenants, des structures en charge du contrôle, et l'absence d'un pilotage unique ont entraîné des lenteurs, des dissensions, non seulement entre structures ou entre chercheurs, mais aussi entre Paris et la province. Le défaut manifeste de coordination, en particulier dans le cadre des essais thérapeutiques, ainsi que les tensions et carences d'hier se sont exprimés au cours de cette crise. Il est donc nécessaire de mettre en place un pilotage et une coordination qui laissent une place aux innovations et opportunités scientifiques. Dans le cadre de la future LPPR, la question de cette réorganisation, tout comme celle du financement de la recherche, se posent.
Par ailleurs, le manque de transparence a laissé place à toutes les suppositions, jetant souvent le doute et le discrédit sur les recherches en cours : l'épisode de l'hydroxychloroquine en est l'expression. L'éthique et la rigueur scientifiques ont été mises à mal. Nous avons assisté à des affrontements de personnes et de protocoles qui ont nui gravement à l'image même de la science. En ces temps d'immédiateté de l'information et de place grandissante des réseaux sociaux, souvent en substitut à la parole scientifique, il devient urgent de reprendre le chemin de la coordination et de la planification scientifiques.
Enfin, cette crise appelle plus que jamais à une coordination européenne en matière de recherche, qu'elle soit épidémiologique, biologique ou thérapeutique.
M. Stéphane Piednoir . - Les conclusions de ce rapport sont parfaitement consensuelles. Il était malheureusement presque risible de constater le faible nombre de personnes participant aux essais thérapeutiques. La recherche française ne ressort pas grandie de cet épisode. Elle a démontré tout ce qu'on ne souhaiterait pas voir, en matière de dispersion ou d'effets de communication. Cela ne sert ni la recherche, ni la science.
Des problèmes de fond se posent également. Nous ne sommes pas à la hauteur en matière de recherche biomédicale. Nous ne le sommes pas non plus au regard de l'érosion des dotations des laboratoires, et de la part importante des financements sur projets. Ce rapport sert de base à l'exposé des motifs de la LPPR, qui reprend notamment un objectif de 3 % du produit intérieur brut (PIB) consacré à la recherche, qui n'est pas atteint aujourd'hui. Nous n'en sommes en effet qu'à 2,19 %. Il y est également dit que la France décroche, que les chercheurs se consacrent trop à des tâches administratives, ou qu'il convient de réarmer notre système public de recherche.
En tant que scientifique de formation, je formule deux voeux. Le premier est que nous ne revivions pas ce type d'épisode, même en l'absence de consensus scientifique. Le second est que nous fassions davantage de pédagogie auprès des plus jeunes. Malgré la massification de la scolarisation et des études supérieures, le nombre de doctorants diminue, ce qui est dramatique. Il me semble que la cause principale de ce phénomène est le manque de pédagogie auprès des plus jeunes. Un lycéen ne sait pas ce que signifie la recherche. Apprendre ce qu'est une identité remarquable représente déjà pour lui un effort surhumain, aussi il ne peut concevoir ce que signifie la recherche en mathématiques.
Nous devons mobiliser l'ensemble de la communauté scientifique sur la LPPR. Mon regard sur cette dernière est peut-être moins sévère que celui de Pierre Ouzoulias. Une réforme systémique me semble en effet amorcée. Elle n'est cependant pas parfaite, aussi devrons-nous l'amender.
M. Laurent Lafon . - Les dysfonctionnements structurels déjà connus de la recherche éclatent de manière encore plus évidente à l'occasion d'une crise. Vous avez insisté sur la dispersion des financements, et la part sans doute excessive des financements sur projets. Il ne faut pas non plus occulter que la dispersion des financements est également liée à celle des structures. Le système de la recherche en France est très éclaté. Lorsqu'un problème de recherche se pose au niveau mondial, et exige des investissements lourds, cette organisation n'est pas la plus efficiente.
Est-il possible d'espérer remédier à ce problème de coordination par le CARE, créé par le Gouvernement ? Je suis assez dubitatif sur ce type de structures mises en place de manière ponctuelle, et qui ont du mal à s'imposer face à celles déjà existantes. Quel est le point de vue du groupe de travail en la matière ?
Par ailleurs, je pense que cette crise a démontré toute l'utilité de la fonction de chercheur. Il faudra parvenir à capitaliser sur cela, notamment à travers une revalorisation du métier. Stéphane Piednoir évoquait le travail à faire auprès des lycéens. D'autres pistes de ce type doivent être explorées, afin de mettre en lumière le caractère fondamental de la recherche dans une société, et en particulier dans une société du savoir.
Mme Laure Darcos . - A ce jour, nous ignorons toujours à quoi sert le CARE. Il ne sert ni à fédérer, ni à mutualiser l'ensemble des informations. J'ai énormément d'estime pour sa présidente, Françoise Barré-Sinoussi, qui a été auditionnée par la commission des affaires sociales. Je ne suis cependant pas sûre que le CARE ait réussi à s'imposer comme référent. Des problèmes d'ego se posent mais il était, à mon sens, possible de parvenir à une véritable complémentarité entre les membres des différentes instances de réflexion. Nous ferons face à d'autres épidémies, et nous devons tirer des leçons de celle-ci. Notre retard en matière de recherche biomédicale était criant depuis des années. Nous l'avions vu à propos du budget de l'INSERM, qui n'est pas dû au ministère de la Recherche. Je me bats depuis trois ans pour que le ministère de la Santé puisse également mettre en place un budget pour le biomédical.
Nous avons également constaté les manques criants de l'Union européenne. Les financements européens auraient dû permettre de fédérer de grands projets. Vous avez entendu les propos du président-directeur général (PDG) de Sanofi, qui a indiqué que les États-Unis, parce qu'ils financent l'entreprise, auraient la primeur du vaccin. Le Président de la République a rappelé que le vaccin serait universel. Néanmoins, les gros laboratoires privés financent les recherches actuelles. Il aurait à ce titre été intéressant de disposer du soutien de Bruxelles pour fédérer davantage de projets.
Le projet Discovery s'est fait torpiller par les médias. Il est mené par l'INSERM, notamment sur la molécule remdésivir. Ce projet devait débuter dans tous les grands pays européens, mais chacun a souhaité mettre en place ses propres expérimentations. S'il a donc pu bénéficier des 800 lits initialement prévus en France, seuls le Luxembourg et le Portugal y contribuent. Ce projet souhaite convaincre d'autres pays, mais espère surtout pouvoir disposer de financements européens qui permettraient une mise en commun de ses résultats avec le projet concurrent de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Solidarity.
Cela illustre le phénomène que j'évoquais, qui voit des acteurs travailler indépendamment sur de mêmes molécules. Le président de l'INSERM m'a rappelé qu'après la fin de l'embrasement médiatique, ses chercheurs continueraient à travailler. Ils seront donc en mesure de dire à la rentrée si cette molécule fonctionne, en attendant un vaccin qui n'arrivera sans doute pas avant 2021.
Il faudra partir du constat de ce rapport pour la LPPR. Le cabinet de la ministre a besoin de notre soutien vis-à-vis du ministère de l'Economie et des Finances, pour valoriser le budget de la recherche. Je doute que nous puissions trouver un créneau parlementaire avant la fin de l'année, aussi le projet de loi de finances (PLF) sera particulièrement important.
De la même façon que la crise aura contribué à revaloriser les métiers de soignants, les premiers métiers choisis sur Parcoursup étant ceux d'infirmiers, j'espère qu'elle aura suscité des vocations en matière de recherche, notamment chez les filles. Le fait de voir davantage de scientifiques femmes est mon cheval de bataille. Nous en avons du reste auditionnées beaucoup. J'espère que la crise incitera les jeunes à s'orienter vers ces métiers essentiels, qui sont très peu valorisés.
M. Jacques Grosperrin . - Je félicite Laure Darcos et ses collègues pour la grande qualité de leur travail.
Je souhaiterais avoir leur avis sur la gestion de la crise dans les écoles. N'est-ce pas le moment de desserrer le protocole sanitaire imposé ? Nous devons faire en sorte que le dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme ( 2S-2C ) ne soit pas la seule solution pour faire venir davantage d'enfants à l'école.
Mme Sylvie Robert . - Ce rapport vient à point nommé, avec le travail qui va s'engager sur la LPPR. Cette période a mis en lumière un paradoxe terrible. Nous avons plus que jamais besoin de la recherche. Or en raison d'effets de communication catastrophiques, son image a été altérée. La question de son attractivité deviendra encore plus essentielle pour la LPPR. Nous ne l'avions pas anticipé.
Par ailleurs, si la question budgétaire est importante, et j'espère que les efforts en la matière seront à la hauteur des ambitions de notre pays, c'est bien celle de la structuration qui a été mise en lumière. Ces dernières années, nous avons vu se déployer des injonctions paradoxales, entre la nécessité du temps long de la recherche, et la logique des appels à projets, qui mobilisent les équipes dans un temps très court.
La LPPR sera présentée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) ce vendredi. Son calendrier est cependant toujours inconnu, et je doute qu'elle puisse être débattue avant la fin de l'année. Il est donc quelque peu étonnant qu'elle soit présentée au CNESER, mais notre exigence et notre vigilance seront renforcées par votre rapport. Il manque aujourd'hui une vision stratégique pour la recherche, et cela sera au coeur de nos réflexions.
M. Jean-Raymond Hugonet . - Laure Darcos évoquait Sanofi, qui témoigne de l'incompréhension totale de notre pays vis-à-vis de la recherche et de ses mécanismes. De même, il s'agit d'une occasion inespérée, lamentablement ratée par l'Union européenne. Cette dernière aurait pu se saisir de ce sujet vital. Chacun s'enorgueillit que Sanofi est français. Or Sanofi ne l'est plus depuis longtemps. Il s'agit d'une belle construction française, que nous avons laissé partir, faute de moyens.
Je ne crois pas que les propos de son PDG constituent une erreur de communication. Il s'agit au contraire d'un pavé dans la mare. Les États-Unis disposent du Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), qui permet au Président des États-Unis de faire collaborer les plus grands laboratoires, et de les financer. Or nous ne sommes pas capables d'en faire autant en Europe, malgré le nombre très important de grands laboratoires dont nous disposons. L'Europe a raté l'occasion de montrer qu'elle pouvait rassembler.
Mme Laure Darcos . - L'OPECST a mené de nombreuses auditions, et nous sommes en train de rédiger une note sur le possible allégement des contraintes sanitaires pour les enfants. Il a en effet été démontré qu'ils sont dans le pire des cas asymptomatiques, et dans le meilleur des cas immunisés. Nous avons notamment auditionné des chercheurs de l'Institut Pasteur, qui travaillent à un vaccin contre la Covid-19 proche de celui contre la rougeole. Par les rhumes qu'ils se transmettent entre eux, les enfants pourraient être immunisés, mais il semblerait que le vaccin contre la rougeole ait également pu y contribuer.
La note de l'OPECST permettra peut-être de desserrer les contraintes sur les écoles. Néanmoins, avant la rentrée, se pose la question des colonies de vacances et des centres de loisirs. Le premier rapport que voulait sortir Gabriel Attal était beaucoup trop contraignant, et la plupart des centres de vacances ont été contraints d'annuler leur programme. C'est une catastrophe, alors qu'il faudrait permettre à ces jeunes, qui ont été confinés dans des conditions parfois difficiles, de partir en vacances.
Je partage l'avis de Sylvie Robert sur l'importance de la communication. J'ai reçu des centaines de sollicitations pour signer des pétitions en faveur du Dr Didier Raoult. Je n'ai rien contre cet homme, et peut-être que sa molécule a soigné de nombreux malades. Mais qui suis-je pour en juger, n'ayant pas même suivi d'études scientifiques ? J'ai été particulièrement agacée par tous les non scientifiques qui, pendant cette période, se sont crus autorisés à donner constamment des leçons.
Enfin, je souhaiterais terminer sur une note positive. Lorsque survient une crise de ce type, nous sommes capables de nous organiser pour des financements d'urgence. L'ANR a joué son rôle, avec des projets flash, qui ont permis des financements dans les quinze jours. Tous n'ont bien évidemment pas été retenus, mais au moins cinquante projets ont permis d'avancer sur des tests virologiques ou des vaccins.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je note que quel que soit le secteur dont notre commission a traité, la crise sanitaire a agi comme un accélérateur et un catalyseur des fragilités et des carences. Nous l'avons constaté pour le secteur de l'audiovisuel, et il en va de même pour celui de la recherche. Nous avions souligné un certain nombre de problèmes au cours de rapports budgétaires précédents, tels que la question des moyens, ou de la reconnaissance des chercheurs.
Il faut que ce rapport provoque un électrochoc, et nous devrons communiquer sur ce point. Notre absence de souveraineté sanitaire a largement été mise en lumière, et il en va de même pour les dysfonctionnements majeurs de la recherche française, dont l'histoire a été marquée par Louis Pasteur, ou Marie Curie.
Nous devrons donc communiquer sur la question de la gouvernance, sur celle des moyens, comme sur celles des valeurs. La confusion, et la problématique de l'intégrité scientifique, qui ont été soulevées, sont d'une évidence criante. Ces trois piliers pourraient constituer les apports du Sénat.
Sport
MERCREDI 17 JUIN 2020
___________
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - L'ordre du jour de notre réunion appelle à présent la présentation des conclusions du groupe de travail, créé par le bureau le 14 avril dernier, chargé d'étudier les conséquences de la crise sanitaire sur le secteur du sport. Il est composé de Mmes Céline Boulay-Espéronnier, Nicole Duranton et Mireille Jouve et de MM. Antoine Karam, Claude Kern et Michel Savin, et est présidé par notre collègue, Jean-Jacques Lozach, à qui je donne maintenant la parole.
M. Jean-Jacques Lozach . - Nous voici arrivés au terme de nos travaux dans le cadre de notre groupe de travail consacré au sport, lequel avait été constitué en mars afin d'assurer le suivi de la crise sanitaire dans le sport, d'examiner les modalités du déconfinement et de réfléchir à des mesures permettant d'accompagner la relance économique du secteur.
Notre constat à l'issue de deux mois d'auditions est sans appel : la situation du sport est grave et son avenir n'est pas assuré compte tenu des incertitudes qui demeurent.
Pour ce qui concerne les opérateurs économiques, les enquêtes réalisées par COSMOS et Union Sport & cycle montrent que plus de 84 % des structures ont suspendu leur activité pendant le confinement ; 54,6 % ont placé l'intégralité de leur personnel en activité partielle ; 76 % des industriels du secteur ont connu un arrêt total ou partiel de leur production et 70 % des entreprises du secteur affirment avoir mis leurs salariés en chômage partiel.
Sur le plan sportif, toutes les compétitions ont été arrêtées à l'issue du discours du Premier ministre du 28 avril à l'Assemblée nationale, avec la perspective d'une reprise en septembre. La crise sanitaire a remis également en cause l'activité des organisateurs d'événements sportifs. Des événements internationaux ont été annulés, d'autres ont été reportés, comme le Tour de France cycliste ou le tournoi de Roland Garros.
Le président du syndicat Première Ligue, Bernard Caïazzo, estime que la perte des clubs de football professionnel, du fait de l'arrêt des matchs, devrait s'établir entre 500 et 600 M€ - d'autres estimations évoquent même une perte qui pourrait représenter jusqu'à 900 M€. Une reprise des matchs à huis clos réduirait les recettes de billetterie et de marketing et aurait un impact sur le montant des droits de retransmission télévisée, le football à huis clos étant dévalorisé, les diffuseurs ne manqueront pas de renégocier le tarif des droits. La crise que connaît le secteur du sport est donc profonde et durable.
Le groupe de travail constate que, à ce jour, aucun plan de relance digne de ce nom n'a été présenté et mis en oeuvre. Il semble que la ministre s'apprête à demander un tel plan à Matignon. Le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), M. Denis Masseglia, avait estimé le 12 mai que 20 % des clubs étaient en difficulté, cette proportion a sans doute significativement augmenté à la mi-juin. Faute de véritable soutien de l'État, la situation des clubs amateurs et professionnels pourrait même s'aggraver avec la levée des dispositifs d'aides mis en place au début de la crise et la montée de la crise économique.
Le déconfinement dans le sport s'accompagne donc d'une grande incertitude et suscite un début d'inquiétude quant à la pérennité de nombreuses structures. Beaucoup d'acteurs appellent donc de leurs voeux un « plan Marshall » pour le sport pour une durée de trois à quatre ans.
Les associations sportives ont pu très vite bénéficier des dispositions adoptées par le Gouvernement à destination des entreprises. Ces mesures ont été extrêmement précieuses pour permettre à ces structures, souvent de petite taille, de supporter le choc d'un arrêt le plus souvent total de leur activité. Il n'est toutefois pas acquis qu'elles suffisent, car le déconfinement est plus long à s'opérer dans le secteur du sport.
Sur le plan de la pratique, le groupe de travail salue les efforts déployés par le ministère des sports et les fédérations afin de déterminer des protocoles adaptés à la reprise de chaque activité sportive. Toutefois, beaucoup trop de nuages continuent à obstruer l'horizon du secteur sportif, notamment professionnel. Si le football professionnel peut envisager de reprendre les compétitions en août à huis clos, compte tenu du poids des droits télévisés dans ses recettes, ce n'est pas le cas des autres disciplines, notamment du rugby et des sports de salle, dont la majorité des recettes est issue de la billetterie et des recettes de marketing. Les clubs sont inquiets, par ailleurs, quant au maintien de leurs partenariats avec les sponsors et les collectivités territoriales dont les priorités pourraient changer à l'issue de la crise sanitaire.
Pour les présidents des ligues professionnelles, il est fondamental que les compétitions puissent reprendre normalement en septembre au plus tard.
Le groupe de travail ne peut que souscrire à l'idée de repenser le modèle économique du sport que promeut le ministère des sports. Pour autant, la réalité de la situation des clubs reste très éloignée d'une telle démarche : l'urgence est d'adopter très vite des mesures pour passer la crise avant de songer à inventer le sport de demain.
A cette fin, le groupe de travail a élaboré dix propositions.
La première proposition est la suivante : mettre en place un plan global pour soutenir le secteur du sport à la rentrée de septembre 2020. Le secteur du sport a bénéficié des dispositifs mis en place par l'État pour soutenir les entreprises et le secteur associatif, mais a beaucoup souffert de la décision de mettre un terme de manière prématurée aux championnats professionnels. Ce grave préjudice, dont on ne mesure pas encore exactement l'étendue, justifie pleinement que l'État s'engage à mobiliser des moyens particuliers pour aider les clubs victimes de la crise sanitaire et d'une décision unilatérale de la puissance publique.
Ces mesures doivent reposer sur le maintien pendant plusieurs mois des dispositifs généraux mis en place depuis le mois de mars et sur des aides spécifiques au secteur du sport, lesquelles pourraient porter sur la fiscalité propre au secteur, mais également sur une aide à destination des jeunes pour encourager leur inscription dans des clubs, sur un assouplissement de la loi Évin et sur un accompagnement financier des athlètes français engagés dans la préparation des Jeux olympiques de Tokyo. Le groupe de travail souscrit également à la proposition faite par le groupe de suivi de l'application de l'état d'urgence sanitaire dans les domaines des sports et de la vie associative de l'Assemblée nationale de créer un fonds de soutien spécifique au bénéfice des associations et des clubs sportifs amateurs, dans le cadre du plan de relance envisagé par le Gouvernement.
Ces nouvelles aides doivent s'accompagner de contreparties de la part du secteur sportif. Les clubs pourraient, par exemple, pérenniser leur implication dans le dispositif sport santé-culture civisme (2S2C) afin de faire vivre le lien créé entre les structures sportives et l'éducation nationale. Les clubs pourraient également s'engager plus fortement dans la voie d'une maîtrise des salaires.
Notre deuxième proposition est de créer un crédit d'impôt dédié aux annonceurs dans le sport, afin de les inciter à maintenir leur implication. Ce dispositif permettrait d'encourager l'achat d'espaces dans publicitaires dans les stades et aux abords des compétitions. Il pourrait être intégré à une mesure plus large concernant les annonceurs dans les médias audiovisuels et la presse, qui a été soutenue par la commission de la culture.
Une troisième proposition est d'assouplir la loi Évin dans les enceintes sportives, avec une évaluation en 2022. Le régime d'autorisation qui permet aux clubs de vendre de l'alcool dix fois par saison n'est pas satisfaisant. Pourquoi limiter ces exceptions si elles ne posent pas de difficulté ? Par ailleurs, leur contrôle paraît pour le moins défaillant, donnant lieu à des inégalités entre les clubs. Le groupe de travail propose donc d'autoriser la consommation dans les stades de certains alcools et certaines publicités pendant deux ans, jusqu'à la fin de la saison 2021-2022, puis de réaliser une évaluation indépendante de cette évolution. Un tel assouplissement doit permettre de favoriser le retour des supporters dans les stades lorsque les contraintes portant sur les grands rassemblements seront levées et d'aider économiquement les clubs.
Quatrième proposition : élaborer un mécanisme de garantie du paiement aux collectivités territoriales des redevances d'occupation demandées aux clubs professionnels pour l'usage des enceintes sportives. En raison du contexte actuel, certains clubs pourraient éprouver des difficultés pour s'acquitter de cette redevance. Pour autant, il semble peu justifié d'en suspendre le paiement. Le groupe de travail propose donc que, en cas de nouvelle dégradation de la situation des clubs, l'État, en lien avec la fédération et l'éventuelle ligue concernée, examine la possibilité de créer un dispositif de soutien mutualisé permettant de soulager temporairement les clubs de ce poids tout en préservant les collectivités territoriales.
Cinquième proposition : augmenter les moyens de l'Agence nationale du sport (ANS) pour renforcer son action territoriale. Le groupe de travail reste très attaché au principe selon lequel le sport doit financer le sport, qui n'est pas compatible avec le plafonnement par l'État des taxes affectées au sport. Les demandes d'aides financières par les clubs devraient toutefois fortement augmenter dans les mois à venir, compte tenu de la crise économique et sociale annoncée. La nécessité de mettre en place un nouveau plan d'équipement sportif n'est également pas contestée, les 45 millions d'euros prévus à cet effet dans le budget de l'ANS étant très insuffisants. La hausse des revenus du secteur sportif doit enfin permettre de financer de nouveaux équipements, notamment en zone rurale et en outre-mer. Le groupe de travail propose en conséquence d'augmenter les moyens de l'ANS en lui affectant davantage de crédits issus du produit de la taxe Buffet. Pour ce faire, la totalité de l'accroissement du rendement de cette taxe consécutif à la hausse des droits de retransmission télévisée pourrait lui être affectée.
Sixième proposition : mettre en place l'organisation territoriale de l'Agence nationale du sport au second semestre 2020. Le groupe de travail souhaite que les dispositions réglementaires relatives à ce point soient publiées dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au cours du second semestre 2020. Il est urgent de pouvoir associer tous les acteurs locaux à la conduite des politiques territoriales du sport. De même, nous attendons toujours la publication des décrets d'application de la loi de 2019 relative à la création de l'ANS et à diverses dispositions relatives à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
Septième proposition : adopter un moratoire sur la réforme des conseillers techniques sportifs (CTS) jusqu'en 2024. Le groupe de travail considère indispensable de stabiliser la situation des CTS dans la perspective des prochaines échéances sportives majeures. La proposition des tiers de confiance consistant à resserrer le corps des CTS autour des directeurs techniques nationaux et des entraîneurs nationaux et à le doter d'une véritable fonction de gestion des ressources humaines constitue une piste intéressante, qui doit encore être étudiée. Dans ces conditions, le groupe de travail propose que la situation des CTS fasse l'objet d'un moratoire jusqu'à 2024 afin de leur permettre de préparer les Jeux olympiques de Paris dans les meilleures conditions. Il importe de mettre un terme à la polémique et de ne pas faire des économies sur le dos des CTS.
Abordons le soutien à apporter à la pratique sportive, dont la crise sanitaire a rebattu les cartes, beaucoup de pratiquants ayant substitué à leur pratique en club une pratique dématérialisée et/ou des exercices individuels. En la matière, il n'y aura pas non plus de retour à la normale. Les clubs devront repenser leur organisation et leur offre pour redevenir attractifs.
Le sport santé constitue un autre terrain de développement pour les clubs. Le sport peut jouer un rôle plus important pour accompagner les rémissions de nombreux patients, il pourrait surtout être plus largement conseillé dans une logique de prévention de certaines pathologies.
Outre la question du sport santé, le groupe de travail propose de mettre l'accent sur l'accueil des jeunes, le soutien aux athlètes et le développement du sport féminin.
Huitième proposition : créer un Pass sport pour encourager les jeunes de quatorze à vingt ans à pratiquer un sport en club. Ce dispositif consisterait en un crédit de 500 euros dédié à l'achat de licences, à l'acquisition de petit matériel, à l'accès à des équipements sportifs, ainsi qu'à des animations sportives en dehors des périodes scolaires. Cette création serait aujourd'hui particulièrement pertinente dans le contexte de sortie de crise sanitaire et compte tenu de la nécessité de retisser un lien entre la jeunesse et les structures sportives.
Neuvième proposition : permettre à l'ANS d'aider financièrement les athlètes fragilisés par le report des Jeux olympiques de Tokyo.
Faut-il rappeler que la situation d'athlète de haut niveau est souvent synonyme en France de précarité ? En 2016, la moitié de la délégation française envoyée aux Jeux olympiques vivait ainsi en dessous du seuil de pauvreté. Le groupe de travail craint que la situation financière de nombreux athlètes de haut niveau ne se dégrade encore dans les prochains mois, jusqu'à compromettre leurs performances, sinon leur participation, aux jeux de Tokyo. Dans ces conditions, nous soutenons la proposition de l'ANS d'attribuer des bourses mensuelles pouvant aller jusqu'à 3 000 euros aux athlètes qui en feraient la demande.
Dixième proposition : mobiliser des moyens en faveur du sport professionnel féminin afin de permettre aux clubs de mieux valoriser leurs infrastructures. Le développement du sport féminin se justifie par lui-même, compte tenu de ses valeurs, des perspectives qu'il crée pour les sportives et de l'attente du public. Il constitue, par ailleurs, un facteur de développement économique pour les clubs qui peuvent ainsi mieux utiliser leurs infrastructures et donc rentabiliser plus rapidement leurs investissements dans les stades, les centres d'entraînement, les installations médicales.
Telles sont, mes chers collègues, nos propositions qui sont les fruits de nos travaux. Il s'agit de propositions collectives qui poussent toutes dans le même sens. Je crois que la ministre des sports serait bien inspirée d'accorder son attention à ces propositions sénatoriales qui sont à la fois concertées, ambitieuses et cohérentes.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je vous remercie pour ces propositions extrêmement fortes. J'invite à présent les autres membres du groupe de travail à prendre la parole.
M. Claude Kern . - Je serai bref car l'exposé de notre rapporteur est le reflet exact et complet de nos travaux. Je le remercie pour son excellente gestion de notre groupe de travail ainsi que mes collègues pour leur assiduité, notamment celle de M. Karam malgré le décalage horaire.
Je soutiens pleinement les dix propositions exposées, sur lesquelles nous avons échangé jusqu'au dernier moment.
M. Antoine Karam . - Je suis favorable aux propositions du groupe de travail, qui vont dans le bon sens. Nous sommes des militants de la cause du sport et nous sommes en contact avec les sportifs sur le terrain, notamment avec les amateurs. De ce point de vue, je suis particulièrement sensible à la proposition du Pass sport. Lors de nos travaux sur l'enseignement scolaire et agricole, nous avions dû rassurer les parents sur les conditions d'accueil à la reprise des cours. Il en va de même s'agissant du sport : nous avons rencontré de graves difficultés, avec le décrochage de certains jeunes. En Guyane, un ancien footballeur professionnel a même construit son propre terrain pour maintenir ses joueurs en forme, ce que les autorités préfectorales n'ont pas apprécié.
Dans ce contexte, il faut donner des assurances sur les conditions de reprise. Le Pass sport est à ce titre une idée précieuse pour les associations, pour les jeunes, qui est de nature à instaurer un climat de confiance. C'est important, car nous avons besoin du sport, qui est un moyen de cohésion.
M. Michel Savin . - Je salue également la qualité de nos travaux et échanges, fort bien présidés par Jean-Jacques Lozach. Le secteur du sport a été, de façons multiples, très fortement déstabilisé par l'arrêt total de ses activités.
Il me paraît important de différencier le sport amateur, professionnel et de haut niveau. A cet égard, une certaine vigilance est de mise quant aux futures annonces du Gouvernement - qui se font attendre - sur la relance, notamment par rapport à la répartition et au volume des crédits accordés. Notre vigilance devra se porter également sur les collectivités territoriales, qui, au vu de leur situation financière actuelle, et de leur engagement vers le « sport pour tous » et les sports amateurs, vont nécessairement moins soutenir le sport professionnel.
Si je partage la grande majorité des propositions émises, je tiens à faire part - mes collègues du groupe de travail le savent - de mon désaccord sur celle relative aux CTS. L'idée d'un moratoire jusqu'en 2024 ne me semble pas correspondre à la mission « flash » conduite par notre commission en juin 2019 qui avait conduit à l'adoption d'un amendement empêchant tout transfert automatique des CTS en direction des fédérations. Nous avions mis en avant la volonté de voir l'ensemble des partenaires s'engager sur une réflexion rapide afin d'aboutir à une évolution de ce corps d'État. Il me semble plutôt urgent de revoir les missions et la répartition des CTS pour bien préparer les Jeux de Tokyo et surtout ceux de 2024. A défaut, leur avenir risque d'être très compliqué.
Mme Mireille Jouve . - Je souhaite revenir sur quelques préoccupations qui ressortent du rapport qui vient de nous être brillamment présenté. Le sport compte parmi les secteurs d'activité les plus durement impactés par la crise sanitaire. Cette mise à l'arrêt est notamment lourde de conséquences financières pour le sport professionnel, dont l'équilibre des recettes repose largement sur la billetterie ou les droits audiovisuels. Directement exposée à une décision unilatérale de la puissance publique, comme cela a été dit dans le rapport, cette filière devra faire l'objet d'une nécessaire attention des pouvoirs publics, même si dans le cas emblématique du football, nous devons garder à l'esprit que la question des difficultés salariales actuelles des clubs peut paraître bien inaudible pour un nombre croissant de Français en proie à de fortes difficultés sociales. La demande de contrepartie en matière de maîtrise des salaires portée par le groupe de travail nous apparaît donc très opportune.
Le sport amateur, même s'il n'évolue pas dans la même dimension, se trouve aujourd'hui tout aussi ébranlé. De nombreuses structures associatives s'interrogent sur leur pérennité ; elles n'ignorent pas que la crise économique va conduire de nombreux foyers à limiter leurs dépenses dans ce domaine. Nous mesurons tous pourtant l'apport de ces clubs en matière de structuration et de lien social, qu'il s'agisse de territoires ruraux ou urbains. Au-delà de l'accompagnement financier, nous devons redoubler d'effort dans nos incitations à la pratique sportive.
Les collectivités territoriales ont dû elles aussi prioriser leurs actions. Leur attention sur la question sportive a dû être temporairement différée, et s'inscrit dans une gestion post-crise. Tout en rencontrant elles-mêmes de fortes difficultés financières, elles vont devoir accompagner la remise en service de leurs équipements et soutenir les associations dont la pérennité des emplois nous apparaît prioritaire.
Concernant l'accueil en France des Jeux olympiques, les membres du groupe RDSE sont aussi favorables à la mise en place d'un moratoire sur le statut des CTS jusqu'en 2024.
Concernant la proposition tendant à un assouplissement temporaire de la loi Evin, sans nier le caractère exceptionnel des difficultés économiques qui se dressent devant nous, je pense qu'au sortir d'une crise sanitaire, il s'agit d'une perspective qu'il nous faudra aborder avec la plus grande vigilance.
Nous adhérons enfin pleinement à la mise en oeuvre d'un plan de relance global et en souhaitons une concrétisation très prochaine, compte tenu de la dégradation rapide de la situation des différents acteurs du secteur.
Mme Céline Boulay-Espéronnier . - Je remercie Jean-Jacques Lozach pour la manière avec laquelle il a animé ce groupe. Au cours de nos nombreuses auditions, j'ai été frappée de constater combien l'inquiétude était grande autour de tout l'écosystème sportif. Je citerai pêle-mêle les problématiques abordées : la mauvaise santé du sport professionnel, la difficile reprise des compétitions pour les supporters, les centres d'entraînement et les organisateurs d'événements sportifs, la situation concurrentielle avec les autres clubs européens, à l'image de nos entreprises, ...
Une inquiétude subsiste aussi sur les compétitions à huis clos, notamment pour le tournoi de Roland Garros. S'il ne devait pas reprendre dans sa forme habituelle, il serait intéressant qu'il puisse malgré tout avoir lieu, de nombreux petits clubs en dépendent.
Je reviens sur le chiffre encore plus catastrophique que prévu de l'Observatoire économique du sport, la BPCE, qui évalue désormais la perte financière à 24 milliards.
Pour terminer sur une note positive, cette même BPCE a insisté sur deux points intéressants : les plateformes « Weedoo-it sport » qui ont été plébiscitées pendant la crise sanitaire, et devraient continuer à séduire, et l'impact dont on a beaucoup parlé, notamment dans le rapport sur la montée des préoccupations individuelles pour la préservation du capital santé.
Je conclurai sur l'importance de relancer l'attrait du bénévolat en menant une réflexion sur un véritable statut du bénévole, et sur le focus fait dans nos travaux sur le sport féminin. Celui-ci a déjà fait l'objet d'un rapport, établi avec la délégation aux droits des femmes, qui faisait notamment référence au succès de la coupe du monde féminine de football sur lequel il était important de capitaliser. À terme, il me semble important de réfléchir au statut des joueuses professionnelles.
M. Jacques Grosperrin . - Je remercie Jean-Jacques Lozach et l'ensemble du groupe pour le travail accompli. Je souhaiterais simplement faire un focus sur les sports de combat et plus particulièrement sur le judo. Le fait qu'il n'y ait pas eu de reprise a généré pour nos clubs amateurs, qui accueillent beaucoup de pratiquants, un réel problème économique. Actuellement, en Belgique, les moins de 12 ans ont repris et la Fédération française de judo (FFJ) est prête, elle aussi, à permettre à nouveau cette pratique en respectant les conditions sanitaires en vigueur. Concernant les sportifs de haut niveau, la FFJ a pratiqué hier tous les tests possibles en matière de détection du virus et ils se sont tous révélés négatifs.
La concurrence mondiale est sévère : les autres pays ont continué l'entraînement. J'ai bien entendu les interrogations du rapporteur vis-à-vis de la ministre des sports, et j'aimerais avoir son avis, ainsi que celui de la commission, sur les conditions de cette reprise. Des échéances sportives approchent et si la France veut conserver son rang, il faut rouvrir les pratiques des sports de combat, et en l'occurrence celles du judo.
Mme Sylvie Robert . - Je remercie les membres de ce groupe de travail pour la qualité de leur rapport. Je souhaite concentrer mon intervention sur le sport amateur, fortement fragilisé. Les associations sportives sont dans l'incertitude quant à leur devenir, notamment en termes de ré-inscriptions à la rentrée prochaine et d'implication renouvelée ou pas des bénévoles, essentiels pour les faire fonctionner. Elles sont également inquiètent de l'aide financière apportée par l'État et par les collectivités territoriales
Selon moi, le dispositif 2S2C ne constitue pas une réponse à cette fragilisation, d'autant qu'il a vocation à disparaître dès le 22 juin prochain puisqu'il était fondé sur le fait d'accueillir des enfants ne pouvant l'être dans certaines collectivités.
Ma question porte, et je la relie à nos discussions sur les associations, avec entre autres notre collègue Jacques-Bernard Magner, sur les emplois aidés, car le mouvement sportif est en demande de ce dispositif. A-t-il été évoqué et ne constitue-t-il pas une réponse à la hauteur des enjeux actuels ?
M. Jean-Raymond Hugonet . - Je salue la qualité des travaux menés par le groupe de travail et à l'instar de M. Grosperrin qui a revêtu quelques instants le kimono, je souhaite chausser les crampons pour parler du football, qui m'est cher !
Il me semble important de rester très prudents et très sages quant aux conclusions portées sur la polémique, regrettable, provoquée par l'arrêt des championnats de football. Je pense pour ma part, et comme de nombreux Français, qu'il s'agissait d'une sage décision motivée par la santé des joueurs, et basée sur un sondage - bien sûr critiqué ! - de l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP).
Même si les joueurs avaient très envie de reprendre, ils savaient aussi que leur santé était en jeu et que leurs clubs étaient dans l'incapacité de respecter les consignes de sécurité sanitaire. Cette décision a permis d'acter les pertes sur la saison 2019/2020 mais surtout de pouvoir commencer la saison 2020/2021 dans les meilleures conditions, nous allons bientôt le constater. J'ajoute que l'inquiétude autour du football professionnel existait bien avant la crise du Covid-19 qui l'a juste renforcée.
Il faut reconnaître que le Gouvernement a tout de suite mis à disposition les fonds et prêts garantis d'État et bien évidemment les clubs qui étaient dans un état financier acceptable en ont profité, mais ceux qui étaient en situation précaire - la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a signalé des cas alarmants - le sont encore plus.
Par contre, je partage les conclusions du rapport - qui rejoignent d'ailleurs celles de la mission d'information conduite actuellement par Jean-Jacques Lozach, et le rapporteur Alain Fouché - quant au dysfonctionnement qu'a représenté le fait qu'un premier ministre stoppe, au travers d'un discours, une saison de championnat, en visant particulièrement celui du football. C'est la première fois dans l'histoire ! Cela ne relevait pourtant ni de ses compétences ni de son autorité mais de celles du président de la FFF. Cela a créé un trouble et je regrette que le football ait donné une triste image, au travers d'une polémique stérile, alors que la décision était à la base la bonne. Personne n'aurait accepté que les raisons commerciales l'emportent. Les matchs organisés sans supporters sont selon moi une insulte à ces supporters et un bien triste spectacle.
M. Max Brisson . - Je salue la qualité du rapport qui reflète, et j'en ai été étonné, la verticalité des décisions prises, ce qui en dit long sur le fonctionnement de notre Gouvernement et sur son rapport aux corps constitués, que sont en l'occurrence les ligues et fédérations.
J'ai aussi été surpris par les commentaires du président du CNOSF, au moment même où nous débattions dans l'hémicycle des amendements de notre collègue Michel Savin. Je les trouve déplacés vis-à-vis de la représentation nationale.
J'ajouterai que je reste surpris de la faiblesse du sport dans le débat public, en comparaison avec la culture. On a pu trouver parfois que le ministre de la culture avait du mal à se faire entendre en termes d'arbitrages interministériels, mais le silence des autorités sportives a été encore plus assourdissant ! L'économie du sport est pourtant tout aussi importante.
En ce qui concerne mon sport fétiche, le rugby, je souhaite que l'on se dirige vers des solutions différenciées dans la reprise des activités. L'idée d'un sport à huis clos n'a aucun sens si l'on veut assurer l'équilibre économique des clubs professionnels, avec ses conséquences sur le sport amateur. La coupure est récente dans l'histoire et est encore faible, la fédération de rugby réfléchit d'ailleurs à la création d'une division nationale sur le modèle de ce qui existe pour le football. Je souhaite qu'on laisse aux fédérations et ligues la possibilité d'un déconfinement moins vertical que le confinement l'a été.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je constate que ce rapport est essentiel et j'en salue la qualité. S'il y a eu deux secteurs qui ont été marginalisés pendant la période du confinement, c'est bien ceux de la culture et du sport. Je dirai même davantage encore pour le sport car la ministre a été particulièrement absente du débat public - c'est la raison pour laquelle je l'avais interpellée par courrier au nom de notre commission.
Si l'on peut comprendre que les événements culturels et sportifs aient été différés, un travail de fond restait possible, et il aurait permis, au sortir de la crise, d'être en bon état de marche. Autant pour le milieu culturel, on a vu quand même se succéder quelques mesures -l'année blanche en faveur des intermittents, le fonds de soutien pour le Centre national de la musique, le plan librairies, ... - autant on ne voit rien venir pour le sport. Vos propositions, cher Jean-Jacques, sont donc très appréciées ; certaines d'entre elles sont extrêmement fortes. Nous les ferons entendre auprès de la ministre des sports.
J'ajouterai quelques remarques. Concernant les collectivités territoriales, et le fait que leurs priorités pourraient changer à l'issue de la crise sanitaire, ce qui génère de fortes inquiétudes pour les clubs en termes de partenariats, que sait-on des actions de ces collectivités durant cette période de confinement ? Un état des lieux des plans de soutien a-t-il été fait ? Ce qui m'amène à la proposition sur la mise en place de l'organisation territoriale de l'ANS, qui n'est autre que celle dont nous débattrons dans l'hémicycle la semaine prochaine dans le cadre de l'application des lois. Je regrette que les décrets n'aient pas été publiés.
Concernant le dispositif 2S2C évoqué par Sylvie Robert, il serait souhaitable que les animateurs des groupes dont les secteurs sont concernés, la culture et le sport, travaillent ensemble sur cette question pour énoncer clairement notre position. Beaucoup de contestations émanent du milieu culturel quant au recours à ce système pour les professeurs d'EPS. J'y vois personnellement le retour, nouvelle formule, des activités rendues obligatoires des rythmes scolaires, transférées sur les collectivités territoriales. La commission doit se positionner sur cette question dont on n'a pas encore beaucoup débattu avec le ministre de la culture.
Enfin, sur le Pass Sport, serait-il financé par le ministère des sports, ou en partie par le Pass Culture ? Souhaitez-vous qu'il soit mis en place par certaines collectivités, comme certaines Régions l'ont fait pour le Pass Culture?
M. Jean-Jacques Lozach . - Je commencerai par le Pass Sport dont la proposition a déjà été transmise à la ministre des sports il y a plus d'un an maintenant et qui reste à ce jour sans réponse de sa part. Il reprend le modèle du Pass Culture avec une expérimentation sur un certain nombre de territoires mais reste indépendant de celui-ci. La période me semble propice à une relance de la réflexion.
Je partage l'avis de Jacques Grosperrin quant aux sports de combat, et je pense effectivement qu'il a été très déconcertant de constater à quel point les conditions sanitaires de la reprise variaient d'un pays à l'autre.
Pour objectiver les conséquences financières de la crise sanitaire sur le sport, je rappellerai que l'économie du sport dans notre pays, même si les estimations sont difficiles, représente entre 90 et 100 milliards d'euros, d'après des études réalisées en 1991 et en 1998 et prenant en compte toutes ses dimensions : sport amateur, professionnel et de haut niveau, les manifestations, le secteur commercial et toute la sphère associative. Aujourd'hui, la perte serait de l'ordre de 20 à 25 milliards d'euros, d'après la BPCE. L'impact s'avère donc très fort.
L'enjeu immédiat est la perte éventuelle de licenciés à la rentrée prochaine, avec la nécessité de maintenir en vie des milliers de clubs amateurs au bord de la disparition, et de maintenir aussi un niveau élevé de motivation de la part des bénévoles, problème souvent soulevé par les personnes auditionnées. N'oublions pas que cette crise a lieu à un moment particulier pour les petites associations qui organisent habituellement en mai ou juin des événements de nature à améliorer leurs recettes - kermesses, tournois, lotos, ...
Il est fondamental de permettre à ces clubs de proposer un accueil qui soit le plus pertinent dès septembre prochain. Cela rejoint la question des emplois sportifs qualifiés, la période de crise arrivant après une suppression très importante des emplois aidés, qui étaient souvent des emplois en phase de formation, en vue d'être qualifiés, et très souvent mutualisés.
Cette question des emplois aidés, qui renvoie au côté régalien du ministère des sports, doit absolument être privilégiée au cours des mois et années à venir. Beaucoup de nos interlocuteurs nous ont en effet dit que l'après Covid ne devait pas être simplement une reprise de l'avant Covid. Une prise de conscience de la nécessité de réorienter les priorités dans le domaine sportif s'avère indispensable et l'exemple type en est le sport santé. Celui-ci n'est pas seulement un sport sur ordonnance, suite à la loi Touraine de modernisation du système de santé. Or, seuls 10 millions d'euros y sont consacrés en France, en additionnant ministère des sports et ministère de la santé via les ARS. Cette loi, soyons clairs, n'est pas appliquée.
S'agissant les 2S2C, l'idée était de rapprocher l'école et les clubs, un fossé s'étant creusé entre le sport scolaire et le sport fédéral. Une volonté s'est concrétisée l'année dernière par le CNOSF, à travers une licence passerelle, prise en charge par le groupement sportif pour la rentrée de septembre et octobre prochains, afin de permettre à de jeunes élèves de tester leur volonté d'adhérer à différentes disciplines sportives. Or, le mouvement sportif s'est heurté à un silence complet du ministère de l'éducation nationale, qui n'a même pas accepté que l'information circule auprès des élèves et leurs parents. Le dispositif 2S2C permet de rétablir le contact et nous espérons qu'il se poursuive. Je conviens par contre que son application est très inégale d'un département à l'autre.
J'adhère également à ce sentiment de centralité qui a porté préjudice à l'efficacité des décisions publiques au début de la crise sanitaire.
En ce qui concerne les collectivités territoriales, certaines se sont engagées à maintenir leurs subventions en faveur des clubs mais cela méritera d'être vérifié lors de l'élaboration des budgets dans les semaines à venir.
Environ 40 % des personnes interrogées ont continué à pratiquer une activité physique pendant le confinement, et parmi elles 80 % souhaitent continuer et ce, plus seulement pour le dépassement de soi et la recherche de performances ; ce qui prédomine aujourd'hui ce sont le lien social, la santé, le bien-être et la convivialité. C'est pourquoi les clubs doivent se remettre en question pour répondre à ces nouvelles demandes sociales.
Pour exemple, un haut cadre technique a relativisé récemment l'importance des Jeux olympiques de 2024, et a affirmé, alors qu'il est très engagé dans leur préparation, que si l'on arrivait à développer le sport scolaire ou de santé dans notre pays, cela serait aussi important que les 30 ou 40 médailles escomptées. Ceci est révélateur d'une évolution de l'état d'esprit actuel au sortir de cette crise.
Je terminerai sur les moyens. Je suis convaincu que si l'on veut faire vivre l'héritage olympique, il va falloir augmenter d'au moins 100 millions par an le budget de l'ANS jusqu'en 2024. A défaut, on risque de passer à côté des ambitions affichées par l'État.
Le déplafonnement des taxes affectées - la « taxe Buffet », les paris sportifs en ligne et la Française des jeux - apparaît comme une des solutions car depuis 2017, la situation s'est totalement inversée. 77 % des taxes affectées étaient alors destinés au sport, aujourd'hui seuls 35 % reviennent au sport et 65 % à Bercy. Le taux de rendement de ces taxes affectées s'est donc dégradé et il apparaît nécessaire de débattre à nouveau sur ce déplafonnement.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Il apparaît en effet vraiment important de taper du poing sur la table. On a pu le constater lors du débat sur le modèle économique de l'audiovisuel qui a acté le détournement total des taxes affectées pour remplacer la publicité supprimée après 20 heures. Les proportions qui viennent d'être indiquées sont inadmissibles. L'esprit du vote en faveur de la création de ces taxes s'en trouve complètement dénaturé.
Je voudrais relayer les propos de Mme Duranton qui n'a pu se connecter dans de bonnes conditions à cette visioconférence : « Cette crise est l'occasion pour le monde du sport de s'interroger et de repenser son modèle. Au-delà des grands événements, le sport met aussi en jeu une vie sociale et associative qui s'érige comme l'un des piliers du « vivre ensemble ». Le sport a été le grand oublié durant cette crise. Il est temps de mener une vraie réflexion sur l'avenir du sport et peut-être en profiter pour arrêter la spirale infernale de l'argent, souhait souvent entendu lors de nos auditions. Les dix propositions sont essentielles, en espérant que la ministre des sports en tiendra compte puisque le Sénat a une fois de plus tiré la sonnette d'alarme et que la ministre a été absente durant cette crise. Il est temps qu'elle assume pleinement son rôle en préservant les collectivités territoriales ». Elle termine en remerciant tous les membres du groupe de travail.
En conclusion, un communiqué de presse va être préparé et devra être fort, à l'image des propositions faites qui réaffirment un certain nombre de principes votés au Sénat. On aura d'ailleurs beaucoup travaillé sur le sport ces trois dernières années et je salue les collègues qui se sont mobilisés sur ce sujet et qui ont permis de faire évoluer sa législation.
Le sport est en effet le grand oublié des préoccupations de cette crise, derrière le secteur de la culture ce qui n'est pas peu dire !
La commission a autorisé la mise en ligne de la note de synthèse du groupe de travail sur la page Internet de la commission.
Création et Patrimoine
Mercredi 24 juin 2020
___________
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - L'ordre du jour appelle à présent la présentation des conclusions de deux groupes de travail.
Le groupe de travail consacré au secteur de la création, animé par Sylvie Robert, était composé de Sonia de la Provôté, Françoise Laborde, Jean-Raymond Hugonet, Maryvonne Blondin et Vivette Lopez.
Le groupe de travail consacré au patrimoine, animé par Alain Schmitz, était quant à lui composé de Jean-Pierre Leleux, Sonia de la Provôté, Catherine Dumas, Marie-Pierre Monier et Dominique Vérien.
La parole est à Sylvie Robert, rapporteure du groupe de travail relatif au secteur de la création.
Mme Sylvie Robert . - Le secteur de la création artistique et culturelle a été l'un des premiers affectés par la crise sanitaire. Il est gravement touché.
Le spectacle vivant, comme les arts visuels, se trouvent aujourd'hui en grand danger, d'autant que la reprise d'une activité normale apparaît encore aussi lointaine qu'incertaine. Un exemple chiffré : le président du CMN évalue à près de 2 milliards d'euros les pertes pour 2020.
Il s'agit d'un secteur économique très fragile, qui comporte beaucoup de petites structures, des établissements publics, etc. La crise actuelle constitue un véritable danger pour l'emploi, la diversité artistique, le dynamisme et le rayonnement de nos territoires.
Le soutien renforcé des pouvoirs publics est plus que jamais urgent si l'on veut préserver notre modèle culturel. Or, les mesures d'urgence sont souvent incomplètes, insuffisantes et difficiles d'accès au regard des spécificités de ce secteur. Les acteurs culturels manquent encore cruellement de visibilité, trois mois après le début de la crise, pour s'organiser et préparer leur programmation.
Enfin, le troisième projet de loi de finances rectificative (PLFR3), que nous serons vraisemblablement amenés à travailler à partir de mi-juillet en séance, ne met nullement en place un plan de relance global du secteur culturel.
Nous avons travaillé autour de trois axes pour élaborer nos propositions : parer à l'urgence, faciliter la relance et améliorer l'exercice de la compétence culturelle.
S'agissant de l'urgence, nous avons identifié deux difficultés concernant les mesures transversales mises en place par le Gouvernement. Il s'agit tout d'abord de la durée des aides. L'activité partielle doit prendre fin le 30 septembre, le fonds de solidarité au plus tard le 31 décembre, et on sait que l'activité se poursuivra « en mode dégradé » bien au-delà de 2020.
En second lieu, certains acteurs culturels ne parviennent pas à en bénéficier car les critères d'octroi des aides ne sont pas adaptés à leurs spécificités. C'est particulièrement manifeste en ce qui concerne l'activité partielle Malgré nos interventions, les établissements publics, et singulièrement les établissements publics de coopération culturelle (EPCC), n'y ont pas droit, dès lors que les subventions constituent une part majoritaire de leurs budgets, alors même qu'ils remplissent les mêmes missions que d'autres structures. Il est étonnant de fonder cet accès sur la forme juridique des établissements et non sur les missions qu'ils remplissent.
J'en viens au soutien sectoriel. Le plan de 17 millions d'euros en faveur de la création, hors livres, a été jugé nettement insuffisant par rapport à l'ampleur des besoins du secteur. Par ailleurs, la répartition de ses crédits est très inégale et se fait malheureusement encore au détriment des arts visuels, d'où la nécessité d'accentuer l'effort budgétaire et l'investissement en leur faveur. Le dégel des crédits de la réserve de précaution pour 2020 serait une mesure importante pour compléter le soutien aux différents secteurs.
Quand on évoque l'urgence, on pense évidemment d'abord aux artistes. S'agissant des intermittents, le décret d'une année prolongeant leurs droits, promis par le Président de la République le 6 mai, n'est toujours pas paru.
Ce décret devrait également relever le plafond des heures d'enseignement artistique. Cette mesure est nécessaire pour permettre de participer aux vacances apprenantes et au dispositif 2S2C, que je souhaiterais voir demeurer exceptionnel. Je rappelle qu'il est pris sur le temps scolaire et a été pensé pour que le plus d'enfants possible puissent être accueillis après le 11 mai, faute de places suffisantes dans les écoles compte tenu des mesures sanitaires. Peu de collectivités l'ont mis en place du fait de la nécessité de financements complémentaires à la participation de l'Etat. Seules les collectivités qui en avaient les moyens ont pu l'organiser.
Pour ce qui est des artistes-auteurs, la situation est dramatique. Leur réalité professionnelle n'est toujours pas correctement prise en compte. Leur cas doit être traité de manière globale et non selon les disciplines artistiques.
Il convient également de faire en sorte que la clause de service fait puisse être totalement levée. Aucune circulaire expliquant les assouplissements apportés à cette clause depuis fin mars n'est jamais parue, et cela bloque le règlement des engagements annulés.
La crise actuelle révèle une nouvelle fois l'urgence à mettre en place le statut des artistes-auteurs. Aucun plan d'urgence ou de relance ne peut être aujourd'hui efficace s'il ne les concerne pas.
S'agissant de la relance, nous avons identifié trois enjeux principaux.
Il est en premier lieu urgent de donner davantage de visibilité au monde de la culture. À la différence d'autres activités culturelles, pour lesquelles le ministère de la culture a publié des guides de recommandations pour la reprise d'activité, il n'y a toujours pas de guide ni de circulaire concernant les règles d'organisation des festivals qui, en dessous de 5 000 personnes, sont laissées à la discrétion des collectivités et des préfets. Beaucoup se posent la question de savoir s'ils peuvent réunir 200, 300, voire 1 000 personnes. En l'absence de recommandations, la responsabilité est reportée sur les organisateurs, les collectivités, et les inégalités entre territoires vont s'accentuer.
Des clarifications rapides sont également nécessaires concernant les conditions de réouverture des établissements et d'autorisation de manifestations à compter de septembre prochain. Beaucoup de structures sont en train de revoir leur programmation, mais l'exercice est très délicat face à un tel flou. Certains festivals doivent avoir lieu, comme les Trans Musicales en décembre prochain. On ne sait si on peut les organiser. Or les organisateurs ont besoin d'être informés au minimum deux mois à l'avance. Il est essentiel que le ministre apporte de la visibilité au plus tard début juillet. Au-delà de cette date, leur modèle économique peut être très fragilisé.
Autre enjeu : le retour du public. Le ministère peut appuyer les démarches des établissements pour rassurer les participants, via l'adoption de chartes de bonnes pratiques ou la création d'un pictogramme national pour les établissements qui respectent les exigences sanitaires.
Je n'insiste pas sur la nécessité de transposer rapidement la directive européenne sur les services de médias audiovisuels (SMA) ni sur la demande du Président de la République de voir les établissements se « réinventer ».
Troisième enjeu : le soutien de l'Etat à la relance. Nous nous interrogeons sur le niveau et les modalités de l'accompagnement par l'État des acteurs culturels afin de faire évoluer les modèles. Le plan prévu par le PLFR3 est insuffisant. Il ne répond pas à beaucoup des demandes présentées par les différents secteurs comme l'accompagnement dans la mise en place des mesures sanitaires, ou la compensation des surcoûts et des pertes de billetterie qui en découlent. Aucune piste n'a été esquissée pour renforcer le soutien aux arts visuels (sanctions en cas de non-respect du dispositif du 1 % artistique, exonération de TVA à l'importation pour les oeuvres produites à l'étranger par des artistes français), au spectacle vivant (élargissement du crédit d'impôt pour le spectacle vivant) ou aux festivals (assouplissement de la circulaire Collomb sur les questions de sécurité). Le PLFR3, alors qu'il va traiter du tourisme, a oublié la culture !
Pendant ce temps, le Pass culture continue d'être déployé. Nous exigeons une évaluation des résultats qualitatifs de cette politique d'ici à la fin de l'année pour pouvoir fonder notre jugement sur un certain nombre d'éléments objectivés.
Quant au fonds de soutien spécifique en faveur des festivals, qui constituait une promesse du Gouvernement après le discours du Président de la République du 6 mai, il n'apparaît nulle part. Ses crédits pourront difficilement être pris sur les 50 millions d'euros promis au Centre national de la musique (CNM), dans la mesure où confier la gestion de ce fonds à ce seul opérateur conduirait à laisser de côté tous les festivals qui ne sont pas musicaux.
Une cellule d'accompagnement a été créée pour soutenir les festivals dans le contexte de la crise sanitaire. Nous avons auditionné son représentant, Bertrand Munin, mais il faudrait que son fonctionnement soit pérennisé. L'Etat doit améliorer ses connaissances sur les festivals, leurs retombées économiques. Il doit renforcer sa politique dans leur direction et cela justifierait de mettre en place une véritable démarche interministérielle.
Enfin, s'agissant de la compétence culturelle, la gestion de la crise sanitaire a mis en lumière la nécessité de développer le dialogue entre les différents acteurs de la culture. De vraies faiblesses sont apparues en matière de concertation. Des décisions ont été prises sans en informer les acteurs, qui ont découvert certaines mesures. Les collectivités ont par ailleurs souvent été mises au pied du mur et les petits festivals se retrouvent démunis.
Les collectivités territoriales ont cependant joué une nouvelle fois le rôle de partenaire de l'État en matière culturelle, aux côtés des acteurs du secteur. Beaucoup de régions ont annoncé la mise en place de plans de relance pour la culture, ce qui pose la question de la poursuite en 2021 des assouplissements à la règle du Pacte de Cahors. Malgré cela, les collectivités n'ont pas été associées à la définition du cadre pour la reprise de l'activité ou du plan de relance de l'État, ce qui montre la nécessité d'accroître le dialogue entre l'État et les collectivités.
Nous sommes un peu circonspects pour ce qui concerne la question des conseils des territoires pour la culture (CTC) déclinés au niveau régional pendant la crise. Nous ne sommes pas certains qu'ils se soient montré très efficaces dans le contexte actuel. Nous souhaiterions que leur composition évolue ou que les commissions culture des conférences territoriales de l'action publique pour la culture ou toutes autres instances territoriales puissent continuer à travailler parallèlement au plus près de ce secteur, en tout cas, pour celles qui fonctionnaient correctement jusqu'ici.
Cela permettra d'être plus réactif. Les acteurs culturels ont aujourd'hui deux craintes : d'une part, celle d'une décentralisation complète des politiques culturelles. Prenons toutefois garde que les collectivités ne prennent la décision de décentraliser dans le cadre de la prochaine loi 3D. Une vision globale est nécessaire. La Bretagne, par exemple, souhaite s'investir davantage en matière culturelle, mais cela doit se faire en concertation avec les services déconcentrés de l'État.
Leur seconde crainte, c'est que la crise sanitaire n'amène certaines municipalités, métropoles régionales ou communautés de communes à réduire les aides à la culture. L'effet domino serait terrible. Il faut demeurer vigilant à ce sujet. C'est ce qui nous conduit à plaider en faveur d'une relance rapide des pactes culturels.
La crise a enfin fait apparaître le besoin d'une plus large concertation avec les acteurs du secteur. J'attire également votre attention sur les arts visuels. La filière est peu structurée. Le Conseil national des professions des arts visuels (CNPAV) n'a pas les moyens de fonctionner. C'est un secteur extrêmement fragilisé. Il faut vraiment progresser sur ces sujets.
Les opérateurs nationaux comme le CNM ou le Centre national des arts plastiques (CNAP) doivent disposer de ressources suffisantes et pourquoi pas, dans le cas du CNM en particulier, même de nouvelles ressources pour poursuivre leurs missions une fois la crise passée.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente. - Voici un panorama extrêmement complet de la situation, et sans complaisance. J'apprécie le caractère très pointu de votre analyse et de l'état de lieux.
La parole est aux membres du groupe de travail.
Mme Sonia de la Provôté. - Je souscris totalement à ce rapport et à son ton direct.
On constate aujourd'hui un certain décalage entre la lenteur du ministère et l'angoisse croissante des acteurs sur le terrain. Même si le monde de la culture a bénéficié d'annonces du Président de la République le 6 mai, il y a encore peu de traduction concrète : les intermittents attendent toujours la parution du décret, la circulaire sur la clause du service fait n'a jamais été transmise et le PLFR3 comporte, somme toute, peu de mesures concernant la culture.
Heureusement, il y a les collectivités territoriales, tous échelons confondus, qui se sont engagées, se sont efforcées de maintenir leurs contributions et ont réuni les acteurs aux niveaux régional, départemental, intercommunal ou municipal. Il n'en reste pas moins que seul l'Etat peut fixer le cadre général et c'est pourquoi ses clarifications sont si attendues. Même si elle génère de la complexité, la compétence partagée est essentielle pour permettre à chacun de contribuer aux actions culturelles et d'accompagner les acteurs de la culture. C'est un enseignement de cette crise. D'où l'importance de la contractualisation entre les collectivités publiques pour apporter de la visibilité aux acteurs de terrain, qui en manquent cruellement.
En matière d'éducation artistique et culturelle (EAC), il est clair que les artistes ne sont pas des animateurs. Au demeurant, si la crise peut nous donner l'occasion de renforcer l'EAC, sous réserve que les artistes y occupent la place qui doit être la leur, ce peut être une bonne chose pour l'accès à la culture et pour mieux faire vivre la culture dans tous les territoires.
Mme Françoise Laborde . - Il existe une certaine complémentarité entre le rapport que je vous ai présenté il y a déjà quelques temps et celui-ci.
Je n'en dirai pas beaucoup plus que Sonia de la Provôté. Un certain nombre de promesses ont été faites au monde de la culture et à ses acteurs. Il est grand temps de les concrétiser.
Jean-Raymond Hugonet reviendra certainement sur le Pass culture. Avec la fermeture des établissements culturels pendant la crise, ses dépenses ont été moindres que programmés. Peut-être pourrait-on dégager une certaine somme, dans le PLFR3, au profit des acteurs culturels ?
En tout cas, la crise aura montré les vertus de la compétence partagée, au regard des nombreuses sollicitations dont ont fait l'objet les collectivités territoriales. Elles jouent un rôle essentiel en matière culturelle.
Je n'ai pas l'habitude de mélanger tourisme et culture, mais reconnaissons que l'annulation des festivals d'été sera un frein à la reprise du secteur touristique. Espérons que le Gouvernement en ait suffisamment conscience pour clarifier rapidement le cadre applicable à l'organisation des festivals.
Je partage toutes les préconisations de ce rapport et j'espère, même s'il n'est pas tendre, que le ministère les entendra, pour le plus grand bénéfice des artistes et de toute la filière.
M. Jean-Raymond Hugonet . - C'est comme si le Pass culture n'avait jamais autant progressé que durant la crise sanitaire. Compte tenu du haut niveau de sa dotation dans la loi de finances pour 2020, nous avions invité le ministre, lors de son audition le 16 avril, à transférer une partie de ses crédits pour soutenir le secteur culturel. Mais nous nous sommes vus opposer une fin de non-recevoir. Il est clair que le Pass culture constitue toujours une priorité présidentielle.
Damien Cuier, président de la société par action simplifiée qui encadre le Pass culture, nous a communiqué des informations au cours de son audition, et devrait prochainement ouvrir aux membres du groupe de travail un accès à l'application pour que nous puissions nous familiariser avec son contenu et son fonctionnement. Nous essaierons de vous tenir informés le plus souvent possible, de même que si de nouveaux élargissements de l'expérimentation devaient être décidés.
S'agissant des festivals, je dois dire que nous avons été saisis par le manque de connaissances précises du ministère en ce domaine. Personne ne sait véritablement combien notre pays en compte chaque année. J'espère que la « cellule festivals » mise en place à l'occasion de la crise sanitaire continuera à fonctionner une fois celle-ci écartée.
Je remercie Sylvie Robert d'avoir animé ce groupe. Nous avons auditionné nombre de responsables. Ce travail a été particulièrement intéressant. C'est pourquoi ce rapport est conséquent et sans concession.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente. - La parole est aux commissaires.
M. Pierre Ouzoulias. - Merci à Sylvie Robert et ses collègues pour la qualité de leur travail. Cela fait plusieurs fois, notamment au moment de la discussion budgétaire, que nous considérons unanimement que l'État n'a pas plus de doctrine en matière culturelle qu'en matière de relations avec les collectivités territoriales.
Malheureusement, la pandémie dans laquelle nous nous trouvons encore a exacerbé ce défaut de gestion du ministère de la culture. Cette compétence est aujourd'hui majoritairement exercée par les collectivités. Il est important que la commission de la culture du Sénat fasse prendre conscience à tous les acteurs qu'il faut faire évoluer le mode de relations entre l'État et les collectivités. L'État doit absolument aider ces dernières à préserver un réseau essentiel qui se trouve dans une situation dramatique.
Il faut que l'État fasse confiance aux collectivités et à leur capacité de relance de ce réseau. Malheureusement, la politique de transferts de charges et de compétences vers les collectivités se poursuit. Elle n'est ni raisonnée ni négociée. Je pense notamment au dispositif 2S2C. Ainsi, le rectorat de Versailles a informé les maires des Hauts-de-Seine qu'il faudra le pérenniser sans financement à partir de la rentrée de septembre, ce qui n'est absolument pas envisageable pour des raisons financières et d'organisation.
S'agissant du Pass culture, le département des Hauts-de-Seine a mis en place de façon très judicieuse un Pass culture qui repose essentiellement sur des réseaux déjà disponibles. Le département met maintenant à disposition des collégiens, jusqu'à l'âge de dix-huit ans, une somme qui leur permet d'aller vers les acteurs locaux et départementaux de la culture, ce qui me semble bien plus sain que le système national. Les Hauts-de-Seine, en raison de la sous-utilisation des crédits en 2020 liée à la fermeture des établissements à cause de la pandémie, les reportera intégralement sur 2021, ce qui permettra de relancer l'activité des acteurs locaux.
Je propose donc que l'argent consacré au Pass culture permette d'aider des départements comme la Vendée ou les Pays-de-Loire, par exemple, à financer leur dispositif, qui fonctionne et qui constitue un outil extrêmement utile pour permettre aux structures et aux réseaux locaux de se relancer après la crise. Ceci permettra de soutenir les collectivités et les opérateurs culturels locaux et pourrait constituer une nouvelle forme d'organisation de la culture en France.
M. Laurent Lafon. - J'adresse mes félicitations à Sylvie Robert et à l'ensemble du groupe pour ce rapport. Ce secteur est en grande difficulté depuis la crise sanitaire, il faut le dire.
Je formulerai cependant une remarque à propos du système 2S2C. Certes, il a été mis en place en urgence. Il est donc très perfectible. En revanche, je ne suis pas pour le rejeter de manière totale et définitive, notamment par rapport au monde de la culture. Il ouvre en effet des passerelles entre l'école et le milieu culturel. Dans une période où ce dernier a besoin d'ouverture, ce n'est pas inintéressant. Il n'est pas non plus mauvais pour l'école de décloisonner les intervenants, en particulier s'agissant du monde de la culture.
Je ne me fais pas un défenseur à tout prix de ce système, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait intérêt à rejeter l'idée de passerelle entre la culture et le monde scolaire.
M. Jean-Pierre Leleux. - L'objectif du groupe de travail est de mettre en oeuvre un certain nombre de mesures. Or l'examen nous démontre que le secteur culturel et celui de la création n'ont rien à voir avec les autres enjeux économiques du territoire. On a en effet affaire à des acteurs extrêmement divers. Il est donc très difficile de proposer des mesures généralistes dans un tel domaine. Je me demande donc s'il ne faut pas avoir une approche différenciée pour être juste et équitable.
Par ailleurs, le ministère de la culture est devenu, au fil des années, un guichet de soutien ponctuel qui saupoudre des aides multiples sans doctrine affirmée. Que fait-on pour le rayonnement culturel de la France ? Je ne dis pas que les aides sont inutiles, mais la distribution au coup par coup, avec des lobbies qui s'enchevêtrent, me paraît une voie complexe et injuste, sans ligne directrice.
M. Stéphane Piednoir . - Je félicite le groupe de travail, qui est cependant assez peu paritaire : Jean-Raymond Hugonet m'a semblé bien seul au milieu de ce collectif féminin très efficace !
Ma question concerne la presse gratuite d'information culturelle. J'ai été sollicité dans mon département par une douzaine de collectifs à ce sujet. La fermeture des salles de spectacles, l'annulation des festivals et l'arrêt quasi-total de l'activité culturelle et événementielle les a contraints à suspendre leur propre activité. Cela fait partie de l'effet domino que Sylvie Robert évoquait dans sa présentation. C'est pourtant un maillon essentiel de la chaîne. Y a-t-il une préconisation pour prolonger le chômage partiel dans ce secteur ?
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente. - Le domaine de la presse ne concerne pas vraiment le groupe de travail « Création ». Vous pourrez interroger Michel Laugier sur ce point.
La parole est à la rapporteure.
Mme Sylvie Robert . - On ne peut dire que le dispositif 2S2C ne bénéficie pas aux artistes. Mais, il a été mis en place dans un contexte particulier qui suppose l'intervention des collectivités sur le temps scolaire, ce qui constitue un vrai sujet en matière de rupture d'égalité territoriale. Toutes les collectivités ne peuvent l'assumer. Il y a une remise en cause de la mission régalienne du ministère de l'éducation nationale, ce qui pose, à mon sens, question en matière de transmission des connaissances.
Par ailleurs, il fait concurrence aux projets d'éducation artistique et culturelle (EAC), qui ont été brutalement arrêtés. Les artistes se sont retrouvés avec des contrats gelés. Il en va de même de l'éducation physique et sportive. Ce dispositif n'a donc pas vocation à être pérennisé car il est intervenu dans un contexte exceptionnel et pose une question de fond par rapport aux collectivités territoriales. Seules les collectivités qui ont les ressources internes suffisantes ont pu le mettre en place. Ma ville en fait partie. C'est un débat qu'il faudra avoir.
S'agissant du rôle de l'État, je pense que la loi 3D sera pour nous un bon moyen de traiter de la subsidiarité dans un contexte décentralisé plus poussé. Je partage le point de vue de Jean-Pierre Leleux à ce sujet.
Enfin, on verra comment les choses évoluent concernant le Pass culture. On ne peut adapter tous les dispositifs à chaque secteur. La présidente posait la question des 50 millions d'euros qui ont été attribués au CNM. Je ne puis vous dire où ils vont aller. Le Centre national du livre (CNL) et le CNAP sont en train de revoir leurs modalités d'intervention. Il serait intéressant d'étudier la façon dont ils ont revu leur dispositif. C'est un secteur fragile, à haute valeur ajoutée. Je suis étonnée qu'il soit délaissé.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Nous avions demandé au ministre de l'éducation nationale de veiller à ce que les artistes intervenant dans le cadre de l'EAC soient rémunérés. Avez-vous pu obtenir des précisions à ce sujet ?
Mme Sylvie Robert . - L'éducation nationale n'a rien réglé.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Le ministère de la culture a pourtant demandé qu'on y veille au début du confinement. Il a lui-même versé les subventions qui devaient l'être et réglé tous les services, même s'ils n'étaient pas accomplis.
Mme Sylvie Robert . - C'est ce qui justifie ma critique du dispositif 2S2C.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - L'État a fait des choses pour la culture comparé à ce qu'il fait pour le sport depuis le début de la crise. L'année blanche pour les intermittents ce n'est pas rien si le décret paraît. En Europe, c'est un système assez exceptionnel que celui de l'intermittence, qui permet d'assurer la vie de 60 % d'artistes et de 40 % de techniciens.
Nous avons, avec la commission des affaires sociales, aidé à rédiger l'amendement permettant l'inscription de cette prolongation dans la loi d'urgence.
50 millions d'euros sont attribués au CNM, même si on ne connaît pas les critères de répartition, et le plan librairie qui a été annoncé paraît plutôt ambitieux, mais le ministère a continué à fonctionner de façon verticale, en accordant un pouvoir discrétionnaire aux seuls préfets. Le ministre n'a pas engagé de mouvement de coordination. Le CTC a mis plus de trois mois à se réunir dans ma région, et encore pour une simple réunion d'information qui s'est révélée très formelle et n'a débouché sur aucun grand axe. Il pouvait constituer un outil à la main des préfets pour organiser la concertation et l'articulation des fonds d'urgence des différentes collectivités. L'État avait l'occasion de reprendre la main sur ces sujets, d'autant que je crois que les collectivités territoriales ont encore besoin de maturité avant de pouvoir animer la compétence partagée.
Les conférences territoriales de l'action publique (CTAP) ne fonctionnent pas partout. S'il n'existe pas un certain volontarisme, elles ont du mal à se mettre en place. Les collectivités n'y trouvent pas toujours le bon outil pour articuler leurs politiques publiques, certaines étant parfois jalouses de leurs prérogatives. L'État peut donc encore conserver un rôle de coordination, d'animation et d'impulsion, dans un cadre général qui peut être débattu avec les collectivités, qui continuent à apporter un financement à hauteur des deux tiers.
Sylvie Robert l'a dit, toutes les collectivités ont très rapidement mis en place un fonds d'urgence. Dans ma région, c'est le président qui a réuni tous les acteurs culturels. Si les collectivités territoriales n'avaient pas été là, les choses n'auraient pas été aussi simples.
Certains secteurs ont été par ailleurs totalement abandonnés. Sonia de la Provôté a rappelé la question des enseignements artistiques et des conservatoires. L'État garde la compétence sur la délivrance des diplômes, les cursus, la formation des enseignants, etc. Ce sont des établissements qui, comme les établissements scolaires, organisent chaque année des examens. Il aurait fallu avoir un vade-mecum des reports.
Frank Riester nous a affirmé que cela relevait des collectivités territoriales. Celles-ci estiment que c'est la responsabilité des ministères concernés du fait des protocoles qui doivent être mis en place. Quant aux associations de directeurs de ces établissements, elles pensent qu'elles ont été totalement abandonnées, ce qui n'est pas sans poser un réel problème.
Je remercie le groupe de travail d'avoir mis en avant la particularité des arts visuels, complètement délaissés. Le fonds dédié est ridiculement bas. C'est un secteur en souffrance, pour lequel il faut trouver une organisation pour structurer la filière dans les régions. Pourquoi ne pas confier aux fonds régionaux d'art contemporain (FRAC) de nouvelle génération le soin de jouer le rôle d'animateurs ?
Quant aux auteurs indépendants, ils estiment être les laissés pour compte de la crise. Il faut avancer sur la définition d'un statut social pour ces artistes.
Les mesures de chômage à temps partiel ne sont toujours pas débloquées dans les EPCC. J'avais adressé un courrier au Premier ministre à ce sujet. On nous dit qu'un fonds compensatoire sera créé. Il nous faudra le vérifier. Ces établissements tiennent le choc parce que les collectivités et l'État ont maintenu leurs subventions, mais que se passera-t-il au moment de la relance si les recettes de billetterie continuent à ne pas être au rendez-vous ?
Ces établissements sont extrêmement importants. C'est d'eux que dépend tout le maillage territorial des plus petits ensembles qui travaillent autour de ces différentes structures.
Il va falloir suivre les choses d'extrêmement près, en lien avec les grandes associations d'élus et les collectivités, qui sont en grande difficulté financière avec la hausse de leurs dépenses conjuguée à une baisse de leurs recettes.
La parole est à présent à Alain Schmitz concernant le groupe de travail relatif au secteur du patrimoine.
M. Alain Schmitz . - Madame la présidente, mes chers collègues, la presse s'en est assez peu fait l'écho ces dernières semaines, mais le secteur des patrimoines a été terriblement affecté par la crise sanitaire. Les personnes que Catherine Dumas, Jean-Pierre Leleux, Marie-Pierre Monier, Sonia de la Provôté, Dominique Vérien et moi-même avons entendues au cours des dernières semaines ont dressé un constat accablant de la situation.
Si le secteur des patrimoines n'était pas inclus dans le plan de relance - pire, si le patrimoine devait servir de variable d'ajustement dans les prochaines semaines pour faciliter le financement des besoins qui se font jour dans tous les domaines -, alors les difficultés actuelles pourraient muter en une crise profonde et durable.
Les mesures d'urgence mises en place par le Gouvernement ont permis d'atténuer l'impact économique à court terme de la crise s'agissant de la protection du patrimoine, mais la reprise de l'activité des entreprises de restauration des monuments historiques reste balbutiante. Les mesures de protection sanitaire qui doivent être mises en place ralentissent les chantiers et en renchérissent les coûts. L'activité perdue pourra difficilement être rattrapée. Les perspectives d'activité d'ici la fin de l'année sont réduites, compte tenu des retards pris dans la délivrance des autorisations d'urbanisme pendant la période de confinement et de l'absence d'ouverture du moindre appel d'offres depuis la mi-mars.
À cela s'ajoute le contexte électoral, qui ralentit les projets des collectivités quand il n'entraîne pas l'abandon de projets programmés par les équipes précédentes, ainsi que la situation financière des propriétaires privés, qui n'ont pas pu dégager de recettes en raison de la fermeture des monuments au public.
Dans ce contexte, des faillites d'entreprises de restauration de monuments historiques, déjà fragiles à la base, ne sont pas à exclure d'ici la fin 2020 ou le courant 2021, avec des répercussions inévitables sur l'activité, l'emploi et le maintien des savoir-faire.
S'agissant des musées, nous nous sommes intéressés à la situation des opérateurs - je fais ici référence à des établissements comme la Réunion des musées nationaux-Grand Palais, le château de Versailles, le musée Picasso, le musée du Louvre, le Centre des monuments nationaux ou le musée d'Orsay. Ils n'ont pas été épargnés par la crise sanitaire, tant s'en faut.
La demande répétée de l'État au cours des dernières années en faveur d'une augmentation de leurs ressources propres les a rendus particulièrement vulnérables face à l'arrêt de leurs activités. Tous les établissements que je viens de vous citer ont un budget majoritairement constitué par leurs ressources propres, certains allant jusqu'à 80 %.
Malgré la reprise progressive de leurs activités, les opérateurs continueront à accumuler les pertes dans les mois à venir en raison, d'une part, d'une moindre fréquentation et, d'autre part, d'une baisse très probable des recettes liées au mécénat. Même si leur survie n'est pas directement menacée, les pertes des opérateurs d'ici la fin de l'année sont évaluées à 400 millions d'euros.
Vous en conviendrez, cet état des lieux n'est guère réjouissant et des mesures complémentaires s'imposent. Mes collègues du groupe de travail et moi-même sommes convaincus que le patrimoine doit constituer l'un des axes du plan de relance.
On néglige trop souvent cette dimension, mais c'est d'abord un enjeu économique, car les patrimoines sont bien une filière économique à part entière. Ce secteur, qui pesait 1,4 % du PIB avant la crise, est essentiel au dynamisme économique et à l'attractivité de nos territoires. Il constitue un atout déterminant pour accroître le potentiel de développement touristique de notre pays.
Au-delà, le patrimoine est également un marqueur important de l'identité collective de la France, un objet de fierté et un trait d'union entre les Français. Il peut et doit donc être mobilisé pour répondre à la crise de confiance et à la perte de repères suscitée par la crise sanitaire actuelle.
Nous nous sommes efforcés de construire des propositions équilibrées et raisonnables au regard des fortes sollicitations dont nos finances publiques font déjà aujourd'hui l'objet. Pour le reste, vous verrez que beaucoup de nos préconisations correspondent en fait à des recommandations formulées de longue date par notre commission, la crise sanitaire n'ayant fait qu'exacerber les difficultés rencontrées par ce secteur.
Nous formulons quatre propositions en matière budgétaire.
Nous demandons en premier lieu que les financements prévus en 2020 soient maintenus. Ils sont essentiels pour ce secteur, qui a déjà subi de plein fouet la disparition de la réserve parlementaire en 2017. Autrement dit, pas de coup de rabot sur les crédits du programme 175. L'engagement pris par le Gouvernement en 2017 de sanctuariser les crédits destinés au patrimoine monumental tout au long du quinquennat dans le cadre de sa stratégie pluriannuelle en faveur du patrimoine ne doit pas être rompu. Les besoins de restauration restent importants : 23 % des monuments historiques sont en péril ou en mauvais état.
Deuxième proposition : pérenniser le loto du patrimoine ou, à tout le moins, reconduire ce dispositif pour une nouvelle période de trois ans, la convention actuelle n'allant pas en l'état au-delà de 2020.
Au regard de l'ampleur des besoins du secteur du patrimoine, nous nous permettons d'insister une nouvelle fois sur le fait qu'il est important que l'État renonce définitivement aux taxes qu'il perçoit sur le tirage et les jeux de grattage afin de les réinjecter dans la protection du patrimoine.
Troisième proposition : reporter à l'exercice 2022 l'entrée en vigueur des dispositions réduisant l'incitation au mécénat pour les grandes entreprises.
Les TPE et PME vont difficilement pouvoir maintenir le niveau de leur engagement en faveur de la culture compte tenu de l'impact de la crise. Autant éviter de freiner la générosité des grandes entreprises dans le contexte actuel, tant les financements privés sont devenus ces dernières années essentiels à la réalisation des actions de protection du patrimoine et des projets des établissements patrimoniaux.
Enfin, nous demandons la compensation au moins partielle des pertes des opérateurs dans le PLF pour 2021. Les réserves de trésorerie des opérateurs ne sont pas suffisantes pour leur permettre d'absorber les pertes enregistrées. Si nous voulons éviter que notre pays perde sa position de leader dans le domaine culturel, l'État devra nécessairement venir en renfort de ces établissements pour leur permettre de continuer à se renouveler et à se moderniser afin de répondre aux attentes des publics.
Il faudra aussi prêter une attention particulière aux budgets d'acquisition et amplifier la politique de circulation des oeuvres sur le territoire national, le prêt d'oeuvres au niveau international étant actuellement délicat.
Pour autant, les établissements doivent faire face à leurs responsabilités et poursuivre leurs efforts pour réduire les coûts de fonctionnement et examiner de quelle manière ils pourraient faire évoluer leur modèle de financement.
Nous formulons par ailleurs plusieurs propositions pour accroître le soutien à la filière de la restauration de patrimoine dans la seconde partie de l'année. Cette filière souffre, et la consommation des crédits inscrits en loi de finances pour 2020 en faveur du patrimoine monumental accuse des retards significatifs par rapport aux années précédentes.
Nous réclamons de faire en sorte que les crédits 2020 puissent être intégralement consommés de la manière la plus efficiente possible pour soutenir les entreprises de restauration des monuments historiques.
Le ministère de la culture affiche clairement sa volonté d'accélérer le rythme de consommation des crédits d'ici la fin de l'année, mais envisage de redéployer les crédits entre les DRAC pour financer la restauration de certaines cathédrales ou de transférer une partie des crédits déconcentrés vers les opérateurs nationaux comme Versailles, le Centre des monuments nationaux, le Louvre, etc., afin de financer des grandes opérations reportées jusqu'ici faute de financements. Bref, il devrait principalement s'agir de gros chantiers, géographiquement localisés.
Notre groupe de travail croit qu'il existe une autre manière de consommer les crédits pour maximiser les retombées, à la fois, pour les entreprises de restauration du patrimoine dans leur ensemble et pour tous les territoires. Il s'agit de privilégier les opérations portant sur des monuments historiques n'appartenant pas à l'État mais à des propriétaires privés, car les collectivités territoriales rencontreront sans doute des difficultés pour lancer beaucoup d'opérations d'ici la fin de l'année.
En effet, le soutien de l'État à ces opérations crée un effet de levier et génère plus d'activités et de chiffre d'affaires pour les entreprises, dans la mesure où des subventions des collectivités territoriales, des aides d'associations de sauvegarde du patrimoine et une prise en charge des travaux par les propriétaires privés viennent s'ajouter aux crédits de l'État.
Comment faire en sorte que de telles opérations soient lancées d'ici la fin de l'année ? D'abord en mobilisant les DRAC pour qu'elles fassent le tour des collectivités territoriales et des propriétaires privés afin d'identifier les chantiers qui pourraient être rapidement lancés. Ensuite en simplifiant certaines démarches administratives pour garantir que les projets puissent démarrer le plus rapidement possible, par exemple en accélérant le temps d'instruction des demandes d'urbanisme. Enfin en mettant en place différents mécanismes incitatifs.
Nous suggérons notamment d'appliquer pour une période limitée des assouplissements afin d'entreprendre un maximum d'opérations d'ici là. Nous plaidons en particulier pour l'augmentation du taux de subvention de l'État sur les immeubles protégés au titre des monuments historiques, le relèvement du plafond maximal de subvention concernant les monuments inscrits, l'augmentation de la part des crédits alloués aux monuments appartenant à des propriétaires privés parmi les crédits destinés aux monuments qui n'appartiennent pas à l'État, l'inclusion des surcoûts de chantiers causés par les contraintes sanitaires dans le montant total de la dépense utilisé pour calculer le montant de la subvention de l'État. Les surcoûts de chantier peuvent renchérir aujourd'hui le coût du chantier de 15 % à 20 %.
Plusieurs évolutions que notre commission défend régulièrement pourraient également contribuer à la relance de l'activité et mériteraient d'être rapidement mises en place. Elles sont au nombre de trois.
Il s'agit premièrement de l'élargissement du champ géographique du label de la Fondation du patrimoine à l'ensemble des immeubles situés dans des communes de moins de 20 000 habitants, que le Sénat avait voté dans le cadre de la proposition de loi de notre collègue Dominique Vérien. Cette proposition de loi n'étant toujours pas adoptée, pourquoi ne pas saisir l'opportunité du PLFR 3 pour l'entériner, puisque nos collègues députés y sont, eux aussi, favorables ?
La deuxième évolution concerne l'augmentation de la part des crédits consacrés chaque année à l'entretien des monuments historiques, dans la mesure où les travaux d'entretien sont des chantiers dont le lancement est à la fois plus facile et rapide, puisqu'ils ne nécessitent pas d'autorisation préalable. La crise sanitaire n'est-elle pas une occasion de lancer enfin une expérimentation en la matière ?
Troisième évolution : que les services de l'État fournissent une véritable assistance à la maîtrise d'ouvrage (AMO) dans toutes les régions. Nous ne nions pas que cette proposition représente un coût important, puisqu'elle exige de procéder à des recrutements de personnel, mais ce coût nous paraît proportionné à l'impératif de relance de l'activité et à l'enjeu de la préservation du patrimoine dans la durée.
Le manque d'ingénierie des petites communes et des propriétaires privés freine trop souvent la réalisation de nombreux projets. Il paraît difficile de confier cette mission aux départements sans risquer de créer des inégalités territoriales.
L'accomplissement de cette mission par les architectes des bâtiments de France (ABF) pourrait permettre d'améliorer la qualité de leurs relations avec les élus locaux, problème qui nous tient beaucoup à coeur.
Nous formulons enfin une proposition d'ordre général, commune à l'ensemble du secteur des patrimoines : il s'agit de renforcer les liens entre culture et tourisme - Sylvie Robert a longuement insisté sur ce point -, en particulier d'accroître les interactions entre les deux ministères.
La dimension économique et touristique du patrimoine n'est en effet véritablement traitée par aucun d'eux. C'est un vrai problème, qui contribue largement à ce que le patrimoine soit davantage perçu comme un coût que comme une chance. Pourtant, à la veille des vacances d'été, la promotion du tourisme patrimonial comme alternative au tourisme balnéaire est essentielle pour venir en aide à ce secteur sinistré. Je me félicite à ce sujet de la campagne intitulée Cet été, je visite la France lancée dans les médias.
Voici, mes chers collègues, la synthèse des conclusions du groupe de travail sur les patrimoines. Pour ouvrir un peu notre horizon, pourquoi ne pas demander qu'une proportion même infime du plan de relance de l'Union européenne en réponse à la crise sanitaire serve à amorcer une véritable stratégie européenne en matière de patrimoine ?
Je vous remercie.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente. - La parole est aux membres du groupe de travail.
Mme Dominique Vérien. - Je remercie notre rapporteur, qui a très fidèlement reproduit la conclusion de nos débats, en particulier concernant l'AMO pour les communes. Je trouve intéressant de proposer que les ABF portent celle-ci afin que nous n'ayons pas à revivre ce que nous avons connu avec la loi ELAN. S'ils accompagnent les communes dans leurs projets, ils seront forcément mieux acceptés par les élus et deviendront pour eux de vrais partenaires. Ce sera mieux pour tout le monde.
En Bretagne, c'est la DRAC qui a la charge de cette question. Il est bon de s'inspirer de ce qui fonctionne. Dans cette région, les subventions ont été augmentées pour tenir compte des surcoûts liés aux mesures de protection contre le coronavirus.
Il est important que le plan de relance inclut le patrimoine. En 2008, celui qui avait été mis en place a ainsi permis de réaliser des travaux sur la tour sarrasine de Saint-Sauveur-en-Puisaye, qu'une commune de moins de mille habitants n'aurait jamais pu réaliser. Cela a également permis aux entreprises locales du patrimoine de travailler.
Je ne peux qu'être favorable au développement de la culture et du tourisme, puisque c'est là notre source de développement, qu'il s'agisse du patrimoine ou d'écrivains comme Colette, etc. La question reste de savoir si l'on place le tourisme dans la culture ou dans l'économie. Cela ne permet pas forcément la même dynamique, mais la disparition d'un festival est un drame économique. Il faut donc admettre que culture et économie vont de pair.
Enfin, merci d'avoir fait référence à la proposition de loi sur l'extension du label de la Fondation du patrimoine aux communes comptant jusqu'à 20 000 habitants. J'espère que nous pourrons l'obtenir. Il semblerait que nous en prenions le chemin. J'en serai très heureuse, car nous ne verrons pas cette proposition de loi revenir avant le mois d'octobre, et je ne sais si je serai encore sénatrice à cette date.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente. - J'ai envoyé la semaine dernière un courrier au président du Sénat pour lui demander d'inscrire cette proposition de loi avant la fin de la session extraordinaire.
Mme Marie-Pierre Monier . - Je remercie le groupe de travail pour ses travaux, et je tiens à souligner la concertation et l'écoute qui ont présidé à nos échanges.
Il ne faudrait pas que le secteur du patrimoine serve de variable d'ajustement à la suite de la crise que nous sommes en train de vivre. Il est impératif que ce domaine fasse partie du plan de relance. C'est le sens de ce rapport.
Le patrimoine n'est pas négligeable sur le plan économique. Ce secteur contribue directement à la qualité du cadre de vie des Français. La préservation des sites et des monuments permet l'éducation de la jeunesse et la transmission. Nous avons cependant quelques inquiétudes sur la suite, étant donné les temps compliqués que l'on va connaître.
Je souscris bien sûr aux propositions qui ont été faites. J'espère que nous aurons l'oreille du Gouvernement. Je suis très attachée à l'articulation entre tourisme et patrimoine pour relancer la saison estivale. Les acteurs du patrimoine ne sauraient être évincés du plan de soutien au tourisme. C'est tout le territoire qui est concerné. Il est important de ne pas le négliger.
Le loto du patrimoine a permis de souligner l'attachement que les Français éprouvent pour leurs monuments. J'aimerais qu'on n'ait pas à ferrailler chaque année au sujet des taxes que l'Etat perçoit sur ce jeu et que notre avis soit partagé au plus haut de l'État.
Mme Sonia de la Provôté . - Je souhaite rappeler que la question de l'entretien du patrimoine est un sujet important. Autant le plan de relance porte sur des questions d'investissement, autant la question de l'entretien reste un sujet prégnant dans le fonctionnement local, au travers d'une programmation en lien avec les ABF, dont un certain nombre serait enchanté de pouvoir réaliser un suivi régulier de l'état et anticiper les choses sur les plans technique et financier.
Les petites entreprises locales interviennent dans l'entretien du patrimoine. Si des programmations existaient, on pourrait les faire intervenir bien plus rapidement que sur les gros chantiers, où les contraintes administratives sont plus importantes.
Par ailleurs, la question du mécénat inquiète beaucoup. Il faut essayer d'obtenir le report de l'entrée en vigueur des nouvelles règles concernant le mécénat des grandes entreprises. Pour les propriétaires privés, le sujet va s'imposer. La part du patrimoine est importante dans la relance du BTP. Elle permet aux petites entreprises de ce secteur de survivre. Sans ces chantiers, ces entreprises n'auront pas de commande. Il faut bien avoir conscience de cette situation.
Enfin, concernant l'AMO, la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales a auditionné récemment Stéphane Bern, dans le cadre du rapport que j'ai commis avec Michel Dagbert sur le patrimoine des communes. Stéphane Bern met lui aussi en évidence la carence de l'AMO, qui présente une grande fragilité. Depuis que l'État n'assure plus celle-ci, certains projets s'arrêtent en cours de route. Les maires ne peuvent jouer leur rôle dans le domaine patrimonial faute d'accompagnement, et on en paye les conséquences. C'est un sujet qu'il faut régler.
En Bretagne, c'est M. Masson, conservateur en chef des monuments historiques, qui a volontairement conservé cette compétence. C'est un cas unique en France. Tous les crédits de la région sont grâce à lui consommés.
M. Jean-Pierre Leleux . - Le débat démontre que ce groupe de travail a bien fonctionné.
Je veux insister sur l'importance que revêtirait, dans le cadre d'un plan de relance, la redynamisation des chantiers dans les territoires. Une des propositions du groupe de travail parmi les plus importantes pourrait être la sauvegarde des entreprises spécialisées dans le patrimoine et les mesures incitatives, qui flécheraient les crédits existants sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant aux collectivités territoriales et aux propriétaires privés, qui représentent pratiquement 95 % des monuments historiques. Il existe là des effets de levier majeur sur le plan culturel et sur celui de la préservation patrimoniale, mais également en matière de sauvegarde du monde économique spécialisé.
Je suggère, s'agissant du lien entre tourisme et patrimoine, une grande opération pilotée par l'État, avec le relais des DRAC, durant l'été : il s'agirait de trouver un chantier emblématique par département et d'organiser des journées portes ouvertes, sous le contrôle de l'État. Les entreprises spécialisées et les agents disposant d'un savoir-faire particulier pourraient expliquer au grand public le travail qu'ils font et l'intérêt que cela présente dans les territoires et les lieux touristiques.
J'insiste sur l'entretien des monuments historiques. Nous ne sommes guère mobilisés dans ce domaine, alors que d'autres pays, comme la Belgique ou l'Allemagne, bénéficient de dispositifs d'entretien. Quand on entretient bien un monument historique, on évite les coûts de restauration, bien plus élevés, qu'on aurait eu à financer sinon.
Je souscris à toutes ces propositions, et je félicite notre rapporteur.
J'ajoute, s'agissant de Notre-Dame de Paris, même si les problèmes de financement ne sont pas à l'ordre du jour, que la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture va se réunir le 9 juillet prochain pour rendre un avis. Nous avons demandé que celui-ci porte sur des propositions d'orientations architecturales.
Les architectes en chef des monuments historiques qui se sont penchés sur le sujet autour de Philippe Villeneuve vont faire des propositions sur plusieurs points, et la commission va devoir établir des recommandations notamment sur la charpente et la flèche de la cathédrale.
La commission est composée de personnalités très différentes. Le débat reste ouvert, mais la crise sanitaire a peut-être ramené le Président de la République à plus de sagesse en la matière.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente. - Le comité de suivi de la loi Notre-Dame a été installé cette semaine, à l'initiative de Vincent Éblé et de moi-même. Il s'est mis en place sous la présidence de Pierre Moscovici, Premier président de la Cour des comptes. Il se réunira tous les six mois. Le général Georgelin a insisté sur le fait qu'il faudra absolument recueillir l'avis de la Commission nationale de l'architecture et du patrimoine.
La parole est aux commissaires.
M. Pierre Ouzoulias. - Je remercie le rapporteur pour la qualité de sa présentation. Cette synthèse n'élude aucun domaine.
Je souhaiterais toutefois attirer votre attention sur l'INRAP, qui n'a quasiment pas travaillé durant la période de confinement et qui, comme tous les opérateurs de la culture, a vu ses recettes diminuer drastiquement. Elle sera, de l'avis de son président, en grande difficulté budgétaire à la rentrée de septembre.
Vous l'avez dit, la reprise des constructions va exercer une pression supplémentaire sur les opérateurs du patrimoine, et notamment sur l'INRAP. Il ne faudrait pas qu'un conflit naisse entre les collectivités porteuses des projets et l'INRAP, qui ne pourrait pas réaliser les opérations de fouilles faute de temps suffisant. Il faut y être attentif.
Patrick Devedjian, alors ministre du plan de relance 2008-2010, avait obtenu que l'INRAP se voie accorder des crédits, considérant qu'il fallait aider les opérateurs de l'archéologie à faire face aux demandes. Le patrimoine n'avait alors pas été oublié.
Ce n'est pas l'objectif de la loi de finances rectificative, mais on peut y parvenir à condition qu'il existe une volonté ministérielle forte.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente. - Le patrimoine regroupe beaucoup de PME, voire de grandes entreprises, et concerne donc l'économie. Le groupe de travail a-t-il évalué la participation des régions et des intercommunalités qui disposent de la compétence économique dans la mise en place des fonds d'urgence et d'accompagnement des entreprises en difficulté, en complément des dispositifs d'État ? Je pense aux artisans qui ont moins de deux employés. Ce qui a été fait en la matière mériterait d'être valorisé pour montrer que les collectivités territoriales ont joué pleinement leur rôle.
Par ailleurs, qu'en est-il des parcs et jardins qui ont dû fermer ? Avez-vous pu en tirer un bilan ?
Enfin, le patrimoine est très lié aux visites touristiques et concerne des métiers qui ne bénéficient pas du statut des intermittents du spectacle. Les guides conférenciers ont par exemple été touchés. Le groupe de travail a-t-il des éléments à ce sujet ?
M. Alain Schmitz . - Pour ce qui est de l'AMO, il s'agit en quelque sorte de réconcilier nos ABF avec les élus locaux. L'ABF n'est pas uniquement là pour défendre la doctrine du ministère de la culture. Il doit travailler main dans la main avec les élus. Les ABF détiennent un vrai savoir, qu'ils doivent transmettre à tous les élus locaux de façon constructive.
Je suis heureux de voir que Dominique Vérien, Marie-Pierre Monier et Sonia de la Provôté souhaitent travailler en étroite collaboration avec eux. La Bretagne est par ailleurs à l'honneur et nous montre l'exemple de ce qui doit être fait. La région a pris la décision d'intégrer le surcoût lié au coronavirus dans l'enveloppe globale de subventions allouées par l'État et s'est efforcée de relancer systématiquement les dossiers, tant concernant les collectivités territoriales que les particuliers.
Marie-Pierre Monier a souligné le rôle économique du patrimoine. Elle a rappelé que la filière représentait 8 milliards d'euros, soit 1,4 % du PIB, et a insisté sur le rôle que l'on devait avoir vis-à-vis de la jeunesse dans le cadre des visites des chantiers-écoles, qui permettent de susciter des vocations. Nous espérons que le chantier de Notre-Dame de Paris en sera un.
Un autre projet concerne la reconstruction de la flèche de la basilique de Saint-Denis. Beaucoup de pays nous envient ces vitrines de notre savoir-faire.
Sonia de la Provôté a mis l'accent sur la notion d'entretien. Cet entretien peut susciter beaucoup de travaux faciles à engager. La relance doit se faire par les DRAC. Je voudrais souligner que des départements sont très en pointe dans ce domaine, notamment les Yvelines, qui a lancé un carnet d'entretien des monuments historiques financé par le département. Celui-ci permet de connaître exactement l'état sanitaire des ouvrages et d'intervenir immédiatement si nécessaire, à un coût infiniment moindre.
L'écueil vient du fait que tous les départements ne sont pas logés à la même enseigne, faute de revenus. Certaines régions disposent en outre d'un grand nombre de monuments historiques. La Bretagne est en France la région qui en détient le plus. Cette notion d'entretien me semble donc importante. C'est là que la relance peut se faire le plus rapidement, Jean-Pierre Leleux a raison.
Par ailleurs, qui dit carnet d'entretien dit intervention des ABF. Ils seront donc tenus au courant et pourront établir une carte des travaux les plus urgents.
Jean-Pierre Leleux a insisté sur le fait qu'il est important de flécher les travaux des patrimoines appartenant aux collectivités territoriales et aux particuliers. Ces derniers ont parfois la possibilité d'engager des interventions. Il est important que l'État augmente le montant de ses participations. Actuellement, le taux de subvention de l'Etat s'établit en moyenne à 15 % pour les monuments inscrits et à 40 % pour les monuments classés. Nous souhaiterions qu'il puisse être porté, de façon très temporaire, a minima à 40 % pour les monuments inscrits et à 60 % voire 80 % pour les monuments classés, comme dans le cadre des opérations financées par le fonds incitatif et partenarial. Ces assouplissements pourraient débloquer des dossiers. Il faudrait faire valoir auprès des particuliers qu'il s'agit d'une opportunité unique et limitée dans le temps, afin d'inciter les uns et les autres à engager les travaux.
J'avais dit que le calendrier électoral était malheureusement venu se surajouter à la crise sanitaire : absence d'appels d'offres et de marchés publics, remise en cause d'opérations, même primées par le loto du patrimoine. Des maires nouvellement élus ont indiqué avoir d'autres priorités. À terme, il s'agit d'une remise en cause du mécénat fléché vers le patrimoine. Peut-être ira-t-il désormais plus facilement vers la recherche médicale, le social et moins vers le culturel.
Je rejoins la suggestion de Jean-Pierre Leleux d'un grand chantier emblématique à l'initiative des DRAC, qui permettrait de réaliser des chantiers-écoles afin de faire connaître les métiers du patrimoine. Il faudrait voir comment susciter l'intérêt du ministère de la culture pour lancer un chantier témoin.
Pierre Ouzoulias a raison : nous aurions dû penser à l'INRAP. Il est important que les opérateurs de l'archéologie ne soient pas oubliés. Merci de l'avoir rappelé. Nous aurions pu les auditionner, ce que nous n'avons pas fait. Dont acte.
Madame la présidente, vous avez soulevé plusieurs questions.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, les TPE et les PME sont celles qui ont le mieux résisté. Elles n'ont en effet pas eu les mêmes contraintes sanitaires que les grandes entreprises, qui ont pour la plupart suspendu les travaux. En revanche, les TPE d'une ou deux personnes ont pu continuer à travailler, même si cela ne signifie pas que leur état de santé soit bon.
Les parcs et jardins ont bien entendu été touchés par le défaut de billetterie. Les jardins remarquables, dont c'est la seule ressource, ont été encore plus impactés que les autres. Il en va de même des guides conférenciers. Certains journaux nationaux s'en sont fait l'écho. Ils n'ont pas été aidés. Ce sont souvent des professions libérales. Les offices de tourisme n'ayant pas fonctionné, ils se sont retrouvés au chômage technique dès le début du confinement.
En matière de patrimoine, le ministre de la culture a tenu à être présent lors de la réouverture du château de Breteuil, qui a la particularité d'accueillir plus de 100 000 visites scolaires. Il s'est également déplacé pour la réouverture du château de Versailles et des jardins. Malheureusement, en cette période, le château accueille habituellement près de 30 000 visiteurs par jour. Or les contraintes sanitaires limitent la visite à 4 000 personnes par jour, ce qui entraîne une chute très conséquente de la billetterie mais permet toutefois d'être en contact étroit avec les oeuvres présentées dans tous les monuments.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je suggère qu'on continue à approfondir les réflexions engagées par les deux groupes de travail et que l'on prévoie éventuellement des amendements de commission au moment du PLFR3.
M. Pierre Ouzoulias. - Il ne faudrait pas que le Parlement soit en effet dépossédé de sa capacité à contrôler l'action des services de l'État et l'utilisation des budgets, qui ont été mis à mal durant cette période.
Ces amendements pourraient être une façon pour le Parlement de se réinvestir dans la gestion budgétaire. J'y suis très favorable.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente. - Les ordonnances nous ont écartés des débats et nous ont empêchés d'intervenir, alors que nous avons accompli un travail incroyable. On pourrait au moins s'exprimer à cette occasion.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Action extérieure de la France
Mardi 28 avril 2020
- Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) : M. Olivier BROCHET , directeur, Mme Raphaëlle DUTERTRE , responsable des relations avec les élus.
Lundi 4 mai 2020
- Fédération des associations de parents d'élèves des établissements d'enseignement français à l'étranger : M. François NORMANT , président.
Mardi 5 mai 2020
- Ministère de l'Europe et des affaires étrangères : Mme Laurence AUER , directrice de la culture, de l'enseignement, de la recherche et du réseau.
- Mission laïque française (MLF) : M. Jean-Christophe DEBERRE , directeur général.
Jeudi 7 mai 2020
M. Patrick SOLDAT , secrétaire national, responsable des questions hors de France et COM, M. Serge FAURE , membre du Snpden Unsa HDF, Mme Clémence CHAUDIN , membre du Snuipp-Fsu HDF, Mme Pascale CANOVA , membre (Sgen Cfdt de l'étranger).
- Collectif Avenir des lycées français du monde : Mme Katia VELASCO , responsable.
Création
Jeudi 23 avril 2020
- France Festivals - Fédération française des festivals de musique et du spectacle vivant : Mme Alexandra BOBES , directrice, M. Paul FOURNIER , président.
Vendredi 24 avril 2020
- Syndicat national des producteurs, diffuseurs, festivals et salles de spectacle musical et de variété : M. Olivier DARBOIS , président, M. Jean-Paul ROLAND , délégué du comité festivals, Mme Malika SEGUINEAU , directrice générale, Mme Aline RENET , conseillère stratégique, directrice des relations institutionnelles.
Lundi 27 avril 2020
- ministère de la culture - direction générale de la création artistique : M. Bertrand MUNIN , sous-directeur de la diffusion artistique et des publics.
Jeudi 30 avril 2020
- USEP SV : M. Sébastien JUSTINE , directeur, M. Loïc LACHENAL , président, M. Olivier MICHEL , président, M. Frédéric MAURIN , président, Mme Cécile LE VAGUERESE-MARIE , présidente, M. Nicolas DUBOURG , président, Mme Laurence RAOUL , directrice déléguée.
Mercredi 6 mai 2020
- AUDIENS : M. Christian BECHON , directeur général d'Audiens care, M. Patrick BEZIER , président d'Audiens care, Mme Isabelle THIRION , directrice du développement social et individus, Mme Valérie VERDIER , attachée de direction à la direction générale, M. Léonidas KALOGEROPOULOS , président, M. Bertrand THAMIN , président, M. François BRICAIRE , infectiologue et membre de l'Académie de médecine.
Jeudi 14 mai 2020
Mme Claire BERNARD , conseillère culture, sport, jeunesse, santé, égalité femmes hommes, Mme Brigitte KLINKERT , vice-présidente de l'ADF, présidente du groupe « Culture et patrimoine », présidente du département du Haut-Rhin, Mme Nelly JACQUEMOT-DENIOT , responsable - département action sociale, éducative, sportive et culturelle, M. Olivier BIANCHI , co-président.
Vendredi 15 mai 2020
- Association des DRAC de France : M. Laurent ROTURIER , Président.
Mardi 19 mai 2020
- SAS Pass culture : M. Damien CUIER , Directeur.
Mercredi 20 mai 2020
M. Xavier MONTAGNON , Secrétaire général, Mme Julie BINET , Secrétaire générale, Mme Katerine LOUINEAU , Membre, Mme Michaëlle LOPEZ , co-présidente.
Patrimoine
Mardi 5 mai 2020
- Direction générale des patrimoines : M. Philippe BARBAT , directeur général des patrimoines, M. Jean-Michel LOYER-HASCOËT , adjoint au directeur général des patrimoines, chef de service chargé du patrimoine.
Lundi 11 mai 2020
- Réunion des musées nationaux et du Grand Palais (RMN-GP) : M. Chris DERCON , président, M. Christophe CHAUFFOUR , directeur général délégué adjoint, M. Emmanuel MARCOVITCH , directeur général délégué.
Lundi 18 mai 2020
- Association nationale des architectes des bâtiments de France : M. Fabien SENECHAL , président, M. Henry MASSON , président.
- Centre des monuments nationaux : M. Philippe BELAVAL , président.
- Groupement des entreprises de restauration de monuments historiques (GMH) : M. Gilles DE LAAGE , président, M. Frédéric LÉTOFFÉ , co-président.
Lundi 25 mai 2020
- La demeure historique : M. Olivier DE LORGERIL , président, M. Philippe TOUSSAINT , président.
Enseignement scolaire
Jeudi 16 avril 2020
- Conseil national de l'ordre des médecins : Dr Patrick BOUET , président.
Vendredi 17 avril 2020
- Conservatoire national des arts et métiers : M. Alain BAUER , professeur de criminologie.
- Académie Auvergne-Rhône-Alpes : M. Olivier DUGRIP , recteur.
- Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale - UNSA : M. Philippe VINCENT , secrétaire général.
- Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité : Mme Agnès LE BRUN , vice-présidente, maire de Morlaix.
- Académie de Créteil : M. Daniel AUVERLOT , recteur.
Lundi 20 avril 2020
- SNUIPP-FSU : M. Régis METZGER , co-secrétaire général, Mme Sophia CATELLA , Mme Sandrine MONIER .
- SNES-FSU : Mme Frédérique ROLET , secrétaire générale.
- Assemblée des départements de France-bis : M. Bruno FAURE , président de la commission politiques territoriales relatives aux politiques touristiques, culturelles, sportives, jeunesse, communication et marketing territorial à l'ADF).
Mardi 21 avril 2020
- Fédération des conseils de parents d'élèves : Mme Carla DUGAULT , présidente, M. Laurent ZAMECZKOWSKI .
Mercredi 22 avril 2020
- Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales : M. Jean-François DELFRAISSY , président.
Enseignement supérieur
Mercredi 22 avril 2020
- Conférence des présidents d'université : M. Gilles ROUSSEL , président, M. Kevin NEUVILLE , chargé des relations avec le Parlement.
Vendredi 24 avril 2020
- Conférence des doyens des facultés de médecine : M. Patrice DIOT , président.
Lundi 27 avril 2020
M. Laurent CHAMPANEY , vice-président, et directeur général de l'ENSAM et président de la commission amont de la CGE, M. Hughes BRUNET , délégué général, M. Jacques FAYOLLE , président, M. Emmanuel DUFLOS , vice-président.
Mardi 28 avril 2020
- IGESR : Mme Caroline PASCAL , cheffe de l'inspection générale.
Mercredi 29 avril 2020
- Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (Cnous) : Mme Dominique MARCHAND , directrice.
Enseignement technique agricole
Lundi 27 avril 2020
- SNETAP-FSU : M. Olivier BLEUNVEN , secrétaire général adjoint pédagogie vie scolaire, M. Frédéric CHASSAGNETTE , secrétaire général adjoint vie syndicale.
Mercredi 29 avril 2020
- Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation (UNMFREO) : M. Dominique RAVON , président, M. Roland GRIMAULT , directeur.
Jeudi 30 avril 2020
- Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) : Mme Gisèle BRUNAUD , responsable de la section PEEP AGRI.
Lundi 4 mai 2020
- Conseil national de l'enseignement agricole privé : M. Philippe POUSSIN , secrétaire général.
Jeunesse vie associative
Mardi 28 avril 2020
- Unis-Cité : Mme Marie TRELLU-KANE , présidente fondatrice.
- Agence du service civique : Mme Béatrice ANGRAND , présidente, M. David KNECHT , directeur général.
Jeudi 30 avril 2020
- Le Mouvement associatif : M. Philippe JAHSHAN , président, Mme Lucie SUCHET , responsable plaidoyer.
- France bénévolat : M. Hubert PENICAUD , vice-président.
Mercredi 6 mai 2020
- Vacances Voyages Loisirs : Mme Louise FENELON , directrice du projet éducatif, M. Jean-Baptiste KIEFFER , vice-président vie associative, jeunesse et engagement, M. Gauthier HERBOMEL , délégué régional Hauts-de-France, M. Michel MENARD , secrétaire général adjoint en charge des vacances.
Livre et industries culturelles
Mardi 21 avril 2020
- M. Pascal ROGARD , directeur général.
- Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) : M. Jean-Noël TRONC , directeur général.
Mercredi 22 avril 2020
- Syndicat de la librairie française (SLF) : M. Guillaume HUSSON , délégué général, M. Xavier MONI , président.
- Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) : M. Maxime BOUTRON , directeur financier et juridique, M. Olivier HENRARD , directeur général délégué.
Médias audiovisuels
Mardi 28 avril 2020
- Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) : M. Roch-Olivier MAISTRE , président, M. Guillaume BLANCHOT , directeur général, M. Yannick FAURE , directeur de cabinet.
Jeudi 30 avril 2020
- France Télévisions : Mme Delphine ERNOTTE-CUNCI , présidente-directrice générale, M. Francis DONNAT , secrétaire général, M. Christian VION , directeur général délégué à la gestion, à la production et aux moyens, Mme Juliette ROSSET-CAILLER , directrice des relations avec les pouvoirs publics.
Jeudi 7 mai 2020
- TF1 : M. Gilles PELISSON , président, Mme Peggy LE GOUVELLO , directrice des relations extérieures, M. Jean-Michel COUNILLON , secrétaire général.
- M6 : M. Nicolas DE TAVERNOST , président du directoire, Mme Karine BLOUET , secrétaire générale.
Jeudi 14 mai 2020
- Radio France : Mme Sibyle VEIL , présidente-directrice générale, M. Xavier DOMINO , secrétaire général, Mme Marie LHERMELIN , secrétaire générale adjointe, Mme Marie MESSAGE , directrice des opérations et des finances.
Mardi 19 mai 2020
- Groupe NEWEN : Mme Bibiane GODFROID , présidente, M. Romain BESSI , directeur général délégué, M. Guillaume DE MENTHON , directeur général adjoint, M. Jean-Michel COUNILLON , secrétaire général, Mme Nathalie LASNON , directrice des affaires réglementaires et concurrence au secrétariat général de TF1, Mme Peggy LE GOUVELLO , directrice des relations extérieures.
Mercredi 20 mai 2020
- France Médias Monde : Mme Marie-Christine SARAGOSSE , présidente directrice générale, M. Victor ROCARIES , directeur général en charge du pôle ressources, Mme Fanny BOYER , adjointe au directeur en charge des relations institutionnelles.
Lundi 25 mai 2020
- MEDIAWAN : M. Pierre-Antoine CAPTON , président.
Jeudi 28 mai 2020
- Syndicat des radios indépendantes : M. Alain LIBERTY , président, M. Kevin MOIGNOUX , secrétaire général, Mme Yéris NICOLAS , chargée de mission affaires juridiques et relations institutionnelles.
- Locales TV : M. Dominique RENAULD , co-président, directeur de Via Vosges, M. Fabrice SCHLOSSER , co-président, directeur de Canal 32, Mme Mylène RAMM , déléguée générale.
Mercredi 3 juin 2020
- GROUPE CANAL+ : M. Maxime SAADA , président du directoire, M. Christophe WITCHITZ , directeur des affaires publiques, M. Bruno RODRIGUEZ , chef de cabinet du président, Mme Amélie MEYNARD , responsable des affaires publiques.
Mardi 9 juin 2020
- LOV Group : M. Stéphane COURBIT , président, M. François DE BRUGADA , directeur.
- Arte France : Mme Véronique CAYLA , présidente, Mme Régine HATCHONDO , directrice générale, Mme Elsa COMBY , directrice du cabinet de la présidence, M. Benjamin AMALRIC , chargé des relations institutionnelles.
Jeudi 2 juillet 2020
- TF1 : M. Jean-Michel COUNILLON , secrétaire général, Mme Peggy LE GOUVELLO , directrice des relations extérieures, Mme Nathalie LASNON , directrice des affaires réglementaires et concurrence au secrétariat général de TF1, M. Christophe WITCHITZ , directeur des affaires publiques, Mme Amélie MEYNARD , responsable des affaires publiques, M. Benjamin AMALRIC , chargé des relations institutionnelles, Mme Elsa COMBY , directrice du cabinet de la présidence, Mme Marie GRAU-CHEVALLEREAU , directrice des affaires réglementaires M6, Mme Karine BLOUET , secrétaire générale, M. Francis DONNAT , secrétaire général, M. Juliette ROSSET-CAILLER , directrice des relations avec les pouvoirs publics.
Presse
Lundi 27 avril 2020
- Culture Presse : M. Daniel PANETTO , président.
Mardi 28 avril 2020
- Syndicat de la presse quotidienne régionale (SPQR) : M. Jean-Michel BAYLET , président.
Jeudi 30 avril 2020
- Groupe Les Echos/Le Parisien : M. Pierre LOUETTE , président-directeur général.
Vendredi 15 mai 2020
- Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM) : M. Alain AUGE , président.
Recherche
Lundi 4 mai 2020
- Centre national de la recherche scientifique (CNRS) : M. François TROTTEIN , président de la section 27.
- Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) : M. Gilles BLOCH , président-directeur général.
Mercredi 6 mai 2020
- Académie des sciences : M. Félix REY , membre, Mme Dominique COSTAGLIOLA , épidémiologiste, Mme Pascale COSSART , microbiologiste, coordinatrice de la cellule de crise.
Mardi 12 mai 2020
- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) : Mme Anne-Sophie ETZOL , chargée des relations institutionnelles, Mme Florence ADER , chercheuse, Mme Vittoria COLIZZA , chercheuse.
Sport
Jeudi 30 avril 2020
- Ministère des sports : M. Karim HÉRIDA , directeur de cabinet, M. Skander KARAA , conseiller spécial (relations avec le Parlement), M. Jean-Philippe REY , conseiller budgétaire et économie du sport, M. Sébastien MOREAU , conseiller spécial.
Mardi 5 mai 2020
- Association nationale des ligues de sport professionnel (ANLSP) : M. Patrick WOLFF , président, M. Frédéric BESNIER , directeur.
Jeudi 7 mai 2020
- Association nationale des élus en charge du sport : M. Marc SANCHEZ , président, M. Franck TISON , secrétaire général, M. Cyril CLOUP , directeur général, Mme Françoise COURTINE , secrétaire générale adjointe et adjointe au maire de Bourg-en-Bresse.
Mardi 12 mai 2020
- Comité national olympique et sportif français (CNOSF) : M. Denis MASSEGLIA , président, Mme Julie LAVET , directrice des relations institutionnelles.
Mercredi 13 mai 2020
- Syndicat Première ligue : M. Bernard CAÏAZZO , président, Mme Marie-Hélène PATRY , déléguée générale, M. Bruno BELGODERE , délégué général adjoint, M. Timothé DE ROMANCE , conseiller en affaires publiques, Mme Morgane DUVAL , directrice juridique, M. Jean-Michel AULAS , président, M. Kita WALDEMAR , président, M. Victoriano MELERO , secrétaire général.
Mercredi 20 mai 2020
- Association nationale des dirigeants et intervenants des installations des services des sports (ANDIIS) : M. Marco SENTEIN , président, M. Vincent DEBUSSCHERE , directeur des sports, M. Stéphane RIVAUD , directeur des sports.
Lundi 25 mai 2020
- Conseil social du mouvement sportif : M. Philippe DIALLO , président, M. Laurent MARTINI , délégué général, M. Thibaut AOUSTIN , chef de projet marketing développement territorial.
Vendredi 5 juin 2020
- Fondation du sport français : M. Thierry BRAILLARD , président.
Mercredi 10 juin 2020
- Ligue de football professionnel (LFP) : Mme Nathalie BOY DE LA TOUR , présidente, M. Julien TAIEB , directeur des affaires juridiques et publiques.
ANNEXES
Auditions de Mme Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Mercredi 1 er avril 2020
___________
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Merci de nous accorder ce temps d'échange, madame la ministre. Nous sommes réunis sous un format inédit, et restreint, mais chaque groupe politique est représenté à due proportion. En outre, participent à cette réunion les deux rapporteurs qui suivent pour notre commission l'activité de votre ministère.
Nous avons une pensée émue pour toutes les victimes du Covid-19, les malades, leurs familles, et nous adressons nos remerciements à l'ensemble du corps médical, aux soignants, mobilisés, ainsi qu'aux chercheurs, et à tous ceux qui luttent chaque jour contre cette épidémie.
En cette période de crise, nous pensons qu'il est plus important que jamais que notre commission poursuive sa mission de suivi et de contrôle de l'action gouvernementale. Nous vous remercions donc d'avoir accepté notre invitation et de vous être rendue disponible, alors que vous êtes très sollicitée en ce moment. Votre ministère est en effet en première ligne dans la lutte contre le coronavirus, qui nécessite des traitements thérapeutiques, des tests de dépistage et la mise au point d'un vaccin. Le Gouvernement a d'abord débloqué 8 millions d'euros en faveur de la recherche sur le Covid-19, avant d'annoncer la création d'un fonds d'urgence, doté de 50 millions d'euros, pour financer l'ensemble des projets de recherche portant sur ce virus.
Je propose que nous parlions d'abord de l'enseignement supérieur, qui doit s'organiser pour répondre aux urgences posées par la fermeture des établissements : mise en place de la continuité pédagogique, report et adaptation des examens et concours, suivi des étudiants confinés en résidence universitaire. Pouvez-vous nous apporter des précisions dans ce domaine ? Nos rapporteurs vous interrogeront ensuite, ainsi que nos collègues qui le souhaiteront. Puis, nous passerons à la recherche.
Mme Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation . - Merci d'avoir organisé cette rencontre par visioconférence. Mes pensées vont naturellement vers ceux qui, parmi vos collègues sénateurs et vos collaborateurs, sont atteints par le Covid-19.
Mon action en tant que ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est actuellement centrée sur trois priorités : soutenir la recherche ; garantir la continuité pédagogique, qu'il s'agisse des formations, des examens ou des concours ; accompagner nos étudiants dans cette crise, sur le plan tant sanitaire que social.
Les scientifiques, dans les centres de recherche, les universités et les centres hospitaliers universitaires (CHU), sont pleinement mobilisés. Plus d'une cinquantaine d'équipes de recherche travaillent sur ce virus, notamment au sein du consortium multidisciplinaire REACTing, piloté par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).
Dès le mois de février dernier, une vingtaine de projets de recherche ont été sélectionnés par REACTing. D'emblée, nous avons mobilisé 8 millions d'euros à cette fin. Il y a deux semaines, nous avons ajouté 50 millions d'euros à cette enveloppe afin de financer tous les projets utiles à la résolution de cette crise. Le réseau REACTing travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des équipes mobilisées au niveau européen. L'Europe joue un rôle important, notamment par l'ouverture d'appels à projets.
Les chercheurs travaillent sur les molécules antivirales qui nous permettront de traiter la maladie. Trouver une nouvelle molécule prendra nécessairement du temps ; c'est pourquoi ils travaillent principalement à réorienter des médicaments existants, c'est-à-dire à les tester selon des procédures rigoureuses afin de vérifier leur efficacité contre le virus. C'est ainsi que se déroulent actuellement six essais cliniques, dont l'essai clinique européen « Discovery », et des recherches sur des traitements préventifs pour les soignants.
Nous savons aujourd'hui que les formes les plus graves de Covid-19 entraînent des réactions immunitaires très fortes dans l'organisme. C'est pourquoi les chercheurs travaillent aussi sur des immunomodulateurs, qui calment la réponse immunitaire grâce à des anticorps monoclonaux : c'est l'objet de l'essai clinique « Corimmuno ».
L'enjeu est de permettre aux soignants de déterminer la meilleure des stratégies thérapeutiques sur la base de protocoles éprouvés et loin de toute analyse subjective.
La recherche est également mobilisée pour éclairer la décision publique. Un comité scientifique, présidé par le professeur Delfraissy, doit faire au Gouvernement des propositions relatives aux décisions de politiques publiques générales. Un comité d'analyse, de recherche et d'expertise, présidé par le professeur Barré-Sinoussi, est chargé de donner un avis scientifique sur les différents projets de traitements, de détection ou de tests, et d'analyser la littérature scientifique produite dans le monde. Nous avons d'ailleurs décidé de placer toutes nos données et tous nos résultats en accès ouvert, afin que l'ensemble de la communauté scientifique puisse en bénéficier. De plus en plus de pays font de même.
En parallèle, plusieurs projets conduits dans le cadre de REACTing ont vocation à mieux comprendre le virus, son histoire naturelle, ses modes de transmission, de l'animal vers l'homme, mais également au sein de la population. Des équipes en sciences humaines et sociales travaillent sur la diffusion territoriale du virus ou sur la propagation des fausses informations, dont les conséquences sanitaires peuvent être lourdes dans les circonstances actuelles.
Enfin, qu'il s'agisse de l'Institut Pasteur, de l'Inserm ou du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), de très nombreux laboratoires sont engagés dans la recherche d'un vaccin, sur lequel nous espérons réaliser les premiers tests d'ici à la fin de l'année. C'est fondamental pour de nombreuses régions du monde dans lesquelles le Covid-19 commence à se propager et qui auront besoin d'un vaccin efficace ; de plus, rien ne nous protège d'un retour saisonnier de l'épidémie.
La crise sanitaire que nous traversons illustre plus que jamais à quel point nous avons besoin de renforcer le lien entre la science et la société. Elle démontre aussi à quel point nous devons porter une ambition pour notre recherche scientifique. C'est d'ailleurs le fait que le consortium REACTing existe en continu, même en dehors de toute crise épidémique, qui nous a permis de mobiliser des équipes dès le mois de janvier, et de formuler les premières propositions de recherche dès le mois de février.
Le Président de la République a annoncé un effort budgétaire de 5 milliards d'euros pour notre recherche, en plus des 15 milliards d'euros qui y sont actuellement consacrés. Cela correspond à un flux d'investissement de 25 milliards d'euros sur les dix prochaines années.
Ma responsabilité, en tant que ministre, est aussi de veiller à la continuité du service public de l'enseignement supérieur. Dès le 13 février dernier, nous avons travaillé, avec les conférences d'établissements, les représentants du personnel et les organisations étudiantes, à chercher des solutions pour permettre aux étudiants de suivre leurs formations à distance.
Les établissements ont mobilisé leurs environnements numériques de travail afin de permettre aux enseignants de poursuivre leurs cours, d'envoyer du contenu écrit et de conserver le lien avec leurs étudiants, y compris en visioconférence, parfois à un rythme très soutenu. Nous avons également mis à disposition la plateforme Fun MOOC de manière à ce que les étudiants comme leurs enseignants puissent y trouver des ressources et des contenus, utiliser la plateforme pour donner des cours en ligne, ou y déposer des cours qui puissent être partagés entre plusieurs établissements. À ce jour, les remontées des conférences d'établissements sont plutôt positives et la bascule du présentiel vers le distanciel s'est bien passée.
Naturellement, les étudiants ne doivent pas être pénalisés par la situation actuelle et nous essayons de maintenir les grandes articulations du calendrier universitaire. À cette fin, vous avez habilité le Gouvernement, dans la loi d'urgence sanitaire, à prendre des ordonnances, notamment pour permettre aux écoles et aux universités de changer leurs modalités de contrôle des connaissances dans un cadre procédural plus souple. Cela nous permet de basculer les examens en ligne ou en contrôle continu, de reporter des concours et de neutraliser les notes de stage lorsque les étudiants n'ont pas pu terminer leur stage.
Vous avez été nombreux à être interpellés sur les questions liées aux examens nationaux, aux concours et au calendrier de Parcoursup.
Pour Parcoursup, changer le calendrier dans les circonstances actuelles susciterait surtout de la confusion. Le calendrier de la procédure nationale demeurera le même, mais nous traiterons avec bienveillance les dossiers qui devraient être finalisés après l'échéance du 2 avril pour les candidats qui seraient entravés parce qu'ils sont en zone blanche ou qu'ils ne disposeraient pas d'outils informatiques.
Les concours post-bac seront, pour l'essentiel, basculés en examen sur dossier via Parcoursup. La plateforme fonctionne, les équipes sont au travail et le calendrier de préparation de la prochaine rentrée sera tenu.
Pour les concours post-prépa et ceux qui sont organisés par les formations en santé, notamment la première année commune aux études de santé (Paces) et les examens classants nationaux (ECN), nous avons opté pour un report. En effets, ces concours ou examens nationaux nécessitent des épreuves écrites qui ne pourront pas être organisées de manière satisfaisante en avril et mai. J'ai confié à Caroline Pascal, la doyenne de notre inspection générale, la présidence d'un comité de pilotage chargé de réorganiser le calendrier et les modalités de ces concours, principalement en juin et juillet prochains. Nous afficherons dès que possible sur le site du ministère une information actualisée pour l'ensemble des candidats, chaque école se chargeant ensuite de donner des informations spécifiques.
Au-delà des questions pédagogiques, accompagner et soutenir les étudiants dans la crise actuelle, c'est aussi faire attention à leur santé. Le 13 mars dernier, nous avons invité tous les étudiants qui le pouvaient à regagner leur domicile familial, ou principal. Un grand nombre d'entre eux, néanmoins, se sont confinés au sein de leurs résidences étudiantes : ils sont un peu plus de 62 000 dans ce cas. Pour faire face à cette situation, notamment sur le plan sanitaire, j'ai pris un décret permettant aux services de santé des universités, en liaison avec les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (Crous), les rectorats, les agences régionales de santé (ARS) et les centres de santé de proximité, d'assurer le suivi sanitaire des étudiants restés en résidence étudiante. Il s'agit à la fois de les informer et d'identifier ceux qui seraient malades ou qui rencontreraient des problèmes de santé liés au Covid-19 ou à d'autres formes de pathologies. Nous avons mobilisé à cette fin les organisations étudiantes, les services de santé universitaires, mais aussi les étudiants en médecine. Une attention particulière est apportée à la prévention des risques psychosociaux pendant ces semaines de confinement.
Sur le plan social, nous avons pris des mesures pour accompagner les étudiants selon leur situation. Les étudiants salariés dont l'activité est suspendue du fait du confinement peuvent, comme tout salarié dans une situation identique, bénéficier de la mesure de chômage partiel mise en place par le ministère du travail. Les étudiants auto-entrepreneurs sont également éligibles aux dispositifs de soutien mis en oeuvre par le ministère de l'économie et des finances. Pour les étudiants qui sont attachés temporaires de vacation - ce sont souvent des doctorants -, leurs contrats seront maintenus, ainsi que leur paie, pendant toute la durée du confinement. Les bourses sur critères sociaux sont évidemment maintenues.
Plus largement, avec les conférences d'établissements, nous avons décidé de mettre le produit de la contribution vie étudiante et de campus (CVEC) à la disposition des établissements pour fournir des aides sociales aux étudiants qui en ont besoin, qu'ils soient déjà boursiers ou non. Que ce soit par la distribution de bons d'achat alimentaire ou électronique ou par des aides financières directes, nous souhaitons permettre à tous les étudiants qui en ont besoin de trouver un appui et une aide pendant la crise sanitaire. J'ai aussi déplafonné la part du Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes (FSDIE) pouvant financer des aides sociales. J'ai également décidé de redéployer 10 millions d'euros à destination des aides d'urgence opérées par les Crous. Ces aides pourront être ouvertes aux étudiants qui ont perdu leur gratification de stage ou qui ne sont pas concernés par le chômage partiel. Nous tâchons de travailler sur le périmètre le plus large possible, car aucun étudiant ne doit être laissé dans une situation difficile.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je propose que nous prenions les sujets les uns après les autres, et je donne donc d'abord la parole à MM. Stéphane Piednoir et Jacques Grosperrin, nos rapporteurs respectivement pour l'enseignement supérieur et la procédure Parcoursup.
M. Stéphane Piednoir . - Merci de participer à cette réunion, en ces circonstances particulières - les difficultés techniques que nous rencontrons montrent que le télétravail ne sera pas la panacée ! Si je souhaite saluer le rôle de l'exécutif en ces temps graves - pour répondre à l'urgence, le Gouvernement a dû prendre des mesures lourdes -, nous continuons à assumer notre rôle de contrôle en toute sérénité. Je voudrais également rendre hommage à l'ensemble de la communauté éducative, qui assure la continuité pédagogique malgré la fermeture de l'ensemble des établissements. Félicitons, enfin, l'engagement de nombreux étudiants en pharmacie ou médecine, dont certains se sont lancés dans la production de solution hydro-alcoolique !
Les concours post-prépa ont été reportés et les concours post-bac seront remplacés par des admissions sur dossier. Où en sont les travaux du comité de pilotage ?
Les dispositions de l'ordonnance sont applicables jusqu'au 31 décembre 2020. S'agit-il d'une précaution, ou anticipez-vous une rentrée fortement décalée ?
Un délai minimum de quinze jours est prévu dans l'ordonnance pour annoncer les nouvelles modalités des examens et concours aux étudiants. Le jugez-vous suffisant ?
L'absence de stage obligatoire sera-t-elle considérée avec bienveillance dans la validation des cursus ?
Pourriez-vous détailler les outils qui sont mis à la disposition des Crous pour recenser les étudiants qui sont dans le besoin, notamment ceux qui n'habitent pas en résidence universitaire ?
Peut-on craindre l'émergence de foyers d'épidémie au sein des résidences universitaires ?
M. Jacques Grosperrin . - Je m'associe pleinement aux remerciements et hommages de mon collègue.
Quelles seront les étapes de l'examen des dossiers à distance par les commissions d'examen des voeux ? N'y a-t-il pas un risque de donner plus d'importance à la phase de traitement automatisé des dossiers ?
Les concours post-bac seront remplacés par une sélection sur dossier. Les critères retenus seront-ils rendus publics ? Une telle sélection risque d'accentuer le poids des déterminismes sociaux.
Enfin, j'attire votre attention sur l'inquiétude des étudiants de master dont les stages sont supprimés ou décalés.
Mme Frédérique Vidal, ministre . - S'agissant du calendrier des concours, l'objectif est de reporter les épreuves prévues en avril et en mai en juin et en juillet. Le Gouvernement communiquera les dates et les modalités des concours dès que possible.
Nous espérons que la rentrée universitaire pourra se faire dans les meilleures conditions, mais il est impossible de l'affirmer aujourd'hui. La durée de validité de l'ordonnance est donc une sécurité.
Il est habituel de porter le calendrier et les modalités d'examen à la connaissance des étudiants au plus tard quinze jours avant l'organisation des épreuves. D'ailleurs, beaucoup d'étudiants ne connaissaient pas, avant la crise sanitaire, leurs dates d'examen. Par ailleurs, l'heure est plutôt à un allégement qu'à une complexification des épreuves.
S'agissant des stages qui n'ont pas pu être effectués, nous avons rédigé des fiches techniques à l'attention des établissements afin que l'ensemble des étudiants soient traités de la même façon. Certains stages seront considérés comme neutralisés, mais dans tous les cas, les étudiants ne seront pas pénalisés parce qu'ils n'auront pas pu faire leur stage dans les temps. Nous pourrons vous communiquer ces fiches.
Nous allons contacter l'ensemble des étudiants par mail pour que ceux qui sont restés confinés se signalent et puissent faire l'objet d'une attention particulière. Toutefois, les aides du Crous sont ouvertes à l'ensemble des étudiants, y compris à ceux qui sont retournés au domicile familial.
Nous n'avons pas, à ce stade, identifié de foyer épidémique au sein des résidences universitaires. L'immense majorité des jeunes de moins de 25 ans qui sont infectés n'ont pas de symptômes ou des symptômes peu graves, et bien souvent - c'est tout le problème - ils ne savent même pas qu'ils sont malades.
Les commissions d'examen des voeux se tiendront par visioconférence. Nous travaillons avec les écoles qui vont effectuer leur sélection sur dossier et non sur concours à la publication de leurs attendus et de leurs critères.
Les étudiants de master, comme l'ensemble des étudiants, ne peuvent pas faire leur stage. Des modalités particulières leur seront appliquées pour qu'ils puissent néanmoins valider leur année. Les fiches techniques que nous avons rédigées permettront que tous les étudiants soient traités de la même façon, et dans tous les cas, avec beaucoup de bienveillance.
Mme Sylvie Robert . - Au nom de mes collègues, je tiens à saluer à mon tour la mobilisation et l'engagement de la communauté éducative.
La communication est momentanément interrompue.
M. Laurent Lafon . - Selon vos dernières déclarations, certains examens pourraient être réalisés à distance avec télésurveillance, s'il n'y a aucun autre moyen. Mais quels contrôles seraient possibles pour éviter toute triche lorsque l'étudiant est seul derrière son écran ? Juridiquement, ne s'expose-t-on pas à des recours aboutissant à l'annulation des examens au nom du règlement général sur la protection des données (RGPD) ? Avez-vous interrogé la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à ce sujet ?
Savez-vous combien d'étudiants n'ont pas accès au réseau et ne peuvent suivre les cours ni passer leurs examens, qu'ils soient dans les zones blanches ou faute d'équipements informatiques ?
Mme Frédérique Vidal, ministre . - Réaliser des examens à distance avec télésurveillance est une possibilité offerte aux établissements ; nous les avons interrogés pour savoir s'ils souhaitaient le faire, sachant que ce serait réalisé par des entreprises autorisées à réaliser cette surveillance, par le biais de la caméra branchée sur l'ordinateur. Nous avons testé cette solution pour les examens nationaux blancs, car toutes les épreuves classantes nationales informatisées (ECNi) se font sur tablette. Or très peu d'établissements souhaitent choisir cette solution à distance, hormis si aucune autre possibilité n'est offerte.
Nous avons recommandé aux étudiants de rentrer chez eux, à moins que leur domicile ne soit situé dans une zone blanche, auquel cas il était préférable qu'ils restent logés sur leur lieu d'études pour continuer à suivre leurs enseignements. Je n'ai pas de remontées exhaustives sur le nombre d'élèves ayant des difficultés. Les étudiants ont parfois des problèmes pour accéder à des data importantes et des forfaits insuffisants. Nous travaillons avec les opérateurs pour étendre les forfaits et aider les étudiants à acheter du matériel informatique.
Il est habituellement très compliqué d'avoir une idée de l'assiduité des étudiants en temps normal, donc d'autant plus dans la situation actuelle... J'ai fait lever l'obligation d'assiduité pour les étudiants ayant une bourse sur critères sociaux. Nous interrogeons en permanence les établissements pour nous assurer de la continuité pédagogique. Désormais, nous n'avons quasiment plus de questions sur la manière de réaliser des cours à distance, mais nous travaillons à la préparation des examens ; nous prenons les questions les unes après les autres.
Mme Maryvonne Blondin . - Qu'en est-il du concours du Capes ? J'ai entendu dire qu'il serait reporté en octobre. Cela pose problème, alors que le nombre de candidats diminue encore de 7,8 % cette année.
Mme Frédérique Vidal, ministre . - Ce concours est organisé par la direction générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale. À ma connaissance, ces services travaillent sur un report du même type que les concours post-classe préparatoire, donc vers mai-juin, afin que les enseignants puissent être affectés à la prochaine rentrée. Je n'ai pas entendu parler d'un report en octobre.
M. Max Brisson . - Avec mes collègues, nous remercions la communauté universitaire pour sa mobilisation. Comment aider les bacheliers actuels, qui risquent d'être pénalisés par cette année particulière, notamment les élèves de terminale venant des milieux les plus modestes ? Ne pourriez-vous pas prévoir au début de l'année universitaire prochaine, en septembre ou en octobre, des modules de remise à niveau pour tenir compte de la réalité de l'enseignement reçu cette année en terminale ? Soyons positifs, et essayons de sortir par le haut de cette crise pour travailler différemment sur l'accueil des étudiants en première année de licence.
Mme Frédérique Vidal, ministre . - Nous gérons les problèmes les uns après les autres, mais nous essayons aussi d'anticiper. Évidemment, nous devrons aider les bacheliers les plus en difficulté à réussir leur rentrée au travers du dispositif « Oui, si » et des semaines de remédiation. Nous n'avons pas épuisé les budgets dédiés, qui pourront donc être mobilisés. L'éducation nationale a à coeur d'accompagner les élèves les plus en difficulté pour qu'ils aient le plus de chances de réussir l'année suivante.
Nous demandons énormément aux enseignants du primaire, du secondaire, aux enseignants-chercheurs, qui sont mobilisés comme jamais pour que les élèves continuent à être accompagnés pédagogiquement. Ce n'est pas très grave si la rentrée universitaire est décalée de quinze jours... Actuellement, nous sommes concentrés sur les cours en ligne et les examens. Les présidents d'université et des grandes écoles réfléchissent à la reprise d'activité. Il faudra y associer les enseignants-chercheurs, actuellement concentrés sur autre chose. Ce n'est pas encore le moment de leur demander de réfléchir aux cours de remise à niveau pour la rentrée. Tout est extrêmement difficile en ce moment ; saluons leur travail vraiment exceptionnel.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je vous remercie, Mme la ministre. Nous allons organiser une nouvelle réunion, dans de meilleures conditions techniques, sur le volet recherche.
Nous remercions toute la communauté scientifique, notamment les chercheurs dont nous avons bien besoin. Nous pensons aux soignants, aux étudiants en médecine, très mobilisés dès leur quatrième année, et pour lesquels cette période est l'épreuve du feu.
Nous pensons aussi à la communauté universitaire qui doit s'adapter à cette situation inédite tout en assurant la continuité pédagogique.
Audition de Mme Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Lundi 6 avril 2020
___________
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Cette deuxième partie de l'audition de Mme Vidal, commencée mercredi dernier, sera surtout consacrée à la recherche, mais nous reviendrons d'abord sur la situation de l'enseignement supérieur. Nous aimerions aussi savoir comment se déroule le processus Parcoursup cette année, au vu notamment de la décision que vient de rendre le Conseil constitutionnel à ce sujet.
Mme Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation . - Je veux pour commencer vous faire un bref exposé de la situation actuelle dans l'enseignement supérieur. Pour assurer la continuité pédagogique, l'immense majorité des établissements sont passés aux formations à distance. Quant aux examens, trois modalités seront retenues, en fonction des exigences de chaque formation : l'évaluation se fera le plus souvent par contrôle continu ou remise de dossiers ; pour certaines matières où des épreuves écrites sont nécessaires, on étudie la possibilité d'examens à distance ; enfin, dans les rares cas où une présence physique est indispensable, notamment dans les filières sportives, un report de ces épreuves est envisagé.
Pour ce qui est des concours, une proposition a été élaborée sous l'égide de Mme Caroline Pascal, doyenne de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. L'objectif est le report de toutes les épreuves écrites de ces concours. Le dispositif est presque prêt pour les épreuves de première année commune aux études de santé (Paces) et les épreuves classantes nationales (ECN) ; il est en cours de finalisation pour tous les concours de grandes écoles, d'écoles de commerce et d'écoles d'ingénieurs.
Concernant l'application Parcoursup, nous allons clôturer la phase de préinscription et de confirmation des voeux par les futurs étudiants. Nous avons fourni aux proviseurs et aux professeurs principaux la liste des élèves de terminale n'ayant confirmé aucun voeu, afin qu'ils puissent les contacter directement et, s'il s'agit d'un simple problème de connexion, prendre la main pour s'assurer que ces élèves ne soient pas exclus du dispositif. On le faisait déjà l'an dernier, mais cela revêt une importance toute particulière dans les circonstances actuelles. Le processus sera terminé au milieu de cette semaine ; les dossiers seront ensuite envoyés aux établissements.
J'en viens à la recherche. Plusieurs dispositifs ont été mis en place. Il est désormais possible pour les organismes de recherche d'abonder directement les laboratoires dont le rôle peut être essentiel dans la gestion de la crise du Covid-19. Des dispositifs spécifiques ont été ouverts, au-delà des financements attribués par le biais de REACTing à l'ensemble des organismes de recherche et, notamment, à l'alliance Aviesan. Des fonds sont attribués par l'Agence nationale de la recherche (ANR) au travers du dispositif Flash, qui permet un examen accéléré des dossiers. L'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS) est également impliquée afin de développer des programmes d'aide et d'analyse épidémiologique à destination des pays du Sud. Citons enfin les programmes hospitaliers de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP), qui dépendent du ministère de la santé. Au total, 50 millions d'euros ont déjà été débloqués pour soutenir l'ensemble de ces projets.
Les essais cliniques déclarés sont massifs, mais nous observons aussi beaucoup d'initiatives prises directement par les équipes médicales de recherche dans les centres hospitaliers universitaires (CHU). Nous essayons d'avoir une vision globale de ces actions. Le ministère de la santé nous transmet un maximum d'informations afin que nous disposions des résultats cliniques des différents traitements utilisés par les médecins.
En plus du conseil scientifique qui aide le Gouvernement et le Président de la République à formuler et mettre en oeuvre les politiques publiques annoncées, nous avons créé un comité chargé d'une mission d'expertise ; nous lui renvoyons toutes les demandes des laboratoires publics et privés en matière, notamment, de tests sérologiques. Nous lui avons aussi demandé un travail de veille internationale afin d'identifier, au fur et à mesure qu'ils apparaissent, les différents outils de diagnostic et de sérologie. Cette démarche est articulée au sein d'une cellule de crise interministérielle : nous travaillons avec des représentants des ministères de la santé et de l'économie pour sécuriser les besoins potentiels en réactifs et passer au plus vite les commandes nécessaires : n'oublions pas qu'une pression mondiale s'exerce sur ces produits.
Je veux enfin aborder la question de l'aide aux étudiants. Nous avons mis en place, au travers du service de santé universitaire et en liaison avec les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (Crous), un dispositif de surveillance sanitaire de ceux d'entre eux qui demeurent dans les cités universitaires. Nous avons également pris des dispositions pour qu'ils puissent être aidés financièrement, en particulier s'ils ont perdu les rémunérations qu'ils percevaient au titre d'un stage ou d'un emploi étudiant et ne bénéficient pas des dispositifs de chômage partiel ou d'aide aux auto-entrepreneurs mis en place par le ministère du travail.
Ces démarches sont organisées par les Crous, en liaison avec les associations étudiantes : des référents sont désignés dans chaque résidence ; au travers de groupes sur les réseaux sociaux, ils vérifient notamment, en lien avec les services de santé, qu'aucun des résidents ne présente de symptômes. Quelques cas de Covid-19 ont été identifiés dans les résidences universitaires ; ces étudiants sont systématiquement transférés dans des studios dotés de blocs sanitaires et de cuisines, de manière à ce qu'ils puissent rester à la fois confinés et approvisionnés. Heureusement, dans la plupart des cas, les symptômes connaissent vite une évolution satisfaisante, mais une surveillance constante est nécessaire. Le dispositif d'alerte élaboré par les Crous en lien avec les associations semble fonctionner, mais notre attention sur ce point demeure toute particulière.
Mme Sylvie Robert . - Nous devons rester vigilants quant aux conditions de vie de tous les étudiants : ceux qui demeurent dans les résidences universitaires, certes, mais aussi ceux du parc privé qui, confinés comme tout le monde, ont, pour beaucoup d'entre eux, perdu les petits boulots qui leur permettaient de vivre. Certains étudiants rencontrent des difficultés préoccupantes. Dans les résidences universitaires de ma région, je constate une vraie vigilance sanitaire et un repérage des étudiants en difficulté économique, mais je veux attirer votre attention sur leur extrême précarisation : certains étudiants peuvent même rencontrer des difficultés alimentaires. Nous devons trouver les outils nécessaires pour les accompagner au mieux.
Mme Frédérique Vidal, ministre . - L'objectif est que tous les étudiants soient dans le radar. Nous avons demandé aux établissements de leur envoyer des informations ; nous sommes aussi passés par les Crous, qui disposent des adresses et numéros de téléphone de tous les étudiants. Nous allons essayer de mettre en place, pour les étudiants résidant dans le parc privé, un système similaire à celui qui fonctionne dans les résidences universitaires : de petits groupes animés par un étudiant référent chargé de déterminer si certains rencontrent des difficultés particulières. Des aides spécifiques s'ajouteront à la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) pour venir en aide à tous, boursiers ou non : on sait en effet que ce sont les étudiants qui sont juste au-dessus du plafond des bourses, ou ne touchent qu'une petite bourse, qui dépendent le plus des emplois étudiants et souffrent donc le plus de leur disparition. Nous essayons en tout cas d'utiliser le plus possible les réseaux sociaux pour le signalement de difficultés au sein de groupes d'étudiants.
Mme Sylvie Robert . - Qu'en est-il des étudiants du programme Erasmus qui ont dû revenir en France ? Pourront-ils retourner dans leur pays d'accueil ? Comment le second semestre de cette année d'études sera-t-il validé ? Y aura-t-il une approche harmonisée à l'échelon européen, ou bien leur sort dépendra-t-il de conventions particulières par pays, voire par université ou école ?
Mme Frédérique Vidal, ministre . - La direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP) a produit des fiches afin d'offrir aux établissements des cadrages généraux et de proposer des solutions. Il est très peu probable que ces étudiants repartent cette année à l'étranger. Demain doit se tenir une première réunion entre ministres européens chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ; nous aurons des échanges sur ce sujet, afin d'harmoniser nos approches. Nous faisons passer aux établissements des messages de bienveillance : il faut que ces étudiants soient le moins pénalisés possible. Les étudiants étrangers rentrés de France chez eux bénéficient de l'enseignement à distance ; la réciproque n'est pas toujours vraie. Un bilan sera fait au niveau européen dans les jours qui viennent. Du moins, en France, tous les établissements savent que les dispositions prises dans l'ordonnance relative à l'organisation des examens et concours leur donnent toute latitude pour adapter, au bénéfice de l'étudiant, les modalités de contrôle des connaissances.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Pouvez-vous nous éclairer davantage sur Parcoursup ? Le Conseil constitutionnel a rendu une décision très attendue sur la nécessaire transparence des traitements algorithmiques utilisés pour le classement des dossiers de candidature. C'est d'ailleurs le sens d'un courrier que je vous avais adressé, à la suite des travaux de notre collègue Jacques Grosperrin sur le suivi de l'application de la loi sur l'orientation et la réussite des étudiants. Vous nous avez dit que le processus Parcoursup pour cette année est déjà bien avancé. Cette décision intéressante du Conseil constitutionnel reconnaît le principe du secret des délibérations, mais insiste sur la nécessité d'une meilleure communication des critères ayant présidé aux décisions. Au vu de cette décision, comment prenez-vous contact avec les établissements pour vous assurer qu'il y aura une véritable transparence sur ces critères, comme notre commission l'avait d'ailleurs déjà demandé ?
Mme Frédérique Vidal, ministre . - Je veux donner quelques chiffres sur Parcoursup. La phase de saisine et de confirmation des voeux est terminée. On relève plus de candidats et de voeux que l'année dernière, le système a fonctionné : 948 000 candidats ont confirmé au moins un voeu, - ils étaient environ 900 000 l'an dernier. 91,1 % des voeux et des sous-voeux sont confirmés, soit près d'un point de plus que l'an dernier. Cette hausse concerne tous les types de bacheliers : + 1,82 % pour les bacheliers généraux, + 2,26 % pour les bacheliers des voies technologiques et + 7,2 % pour les bacheliers professionnels. Le nombre de demandes de confirmation de voeux en réorientation augmente également. Les reprises d'études sont gérées à part, cette année, grâce à l'application Parcourplus ; celle-ci est utilisée par des candidats qui ont, pour 85 % d'entre eux, déjà exercé une activité professionnelle. Nous avons aussi vérifié l'absence de problèmes particuliers outre-mer, notamment en Guyane - 95 % ont confirmé au moins un voeu ; nous attendons des informations concernant Mayotte, seconde collectivité où des difficultés ont été rencontrées par le passé.
La décision du Conseil constitutionnel répond bien à une demande que vous aviez déjà formulée. Nous avons informé les établissements qu'ils devront expliquer la façon dont ils auront classé les étudiants, dans les filières sélectives, ou délivré les « Oui » et les « Oui si » dans les filières non sélectives. Chaque jury devra produire un compte rendu de ses délibérations et indiquer les critères utilisés. Pour leur faciliter la tâche, nous avons rédigé un modèle d'explication des critères que nous mettons à disposition des établissements dans le cadre de l'aide à la décision fournie dans Parcoursup ; chaque établissement pourra y ajouter les critères spécifiques qu'il emploie. Cela sera particulièrement important cette année au vu du nombre d'écoles qui sélectionneront exceptionnellement leurs étudiants, non par concours, mais sur dossier du fait des circonstances sanitaires. Le Conseil constitutionnel rappelle également que la procédure n'est pas complètement automatisée et qu'il faudra donc, à l'issue des délibérations, expliquer comment celles-ci se seront tenues et comment les classements auront été établis. Nous avons élaboré par anticipation les outils nécessaires ; quand un établissement utilise plutôt les siens, nous travaillons avec lui ; nous lui expliquons, désormais à distance et non plus in situ , comment rédiger les critères utilisés. C'est l'un des rôles de la cellule « Parcoursup ».
M. Jacques Grosperrin . - Que de temps perdu ! Cela fait un moment que le Sénat demande une telle transparence ; le Gouvernement aurait pu l'écouter. Maintenant, il doit s'y employer au moment même d'une crise majeure ! Les enseignants expriment une grande inquiétude quant à l'emploi des traitements algorithmiques. Chacun voit dans la décision du Conseil constitutionnel la justification de son propre point de vue, mais je regrette en tout cas le manque d'anticipation.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Évoquons à présent la recherche, secteur qui est au coeur de la crise sanitaire que nous subissons. Nous apportons notre soutien plein et entier à la communauté des chercheurs, très mobilisés en première ligne. L'attente est très forte sur les traitements thérapeutiques, les tests de dépistage et les vaccins sur lesquels travaillent nos chercheurs. Le moment est propice pour un premier bilan.
Mme Laure Darcos . - Une série de projets de recherche sur le Covid-19 a déjà été sélectionnée dans le cadre du consortium REACTing et du projet Flash de l'ANR ; une deuxième vague devrait suivre. Les moyens alloués par le Gouvernement à ces projets, déjà conséquents - 58 millions d'euros -, devront encore être ajustés en fonction des besoins. Quid des projets qui n'ont pas été retenus dans ces sélections, mais présentent un intérêt scientifique ? Comment pourront-ils bénéficier de financements ?
Vous affirmez que la loi d'urgence permet de simplifier et d'accélérer les procédures de recherche : comment cela se traduit-il ? Quelles adaptations sont prévues ? Le Comité analyse, recherche et expertise (CARE) présidé par Mme Barré-Sinoussi se prononce-t-il sur ces modifications de procédure ?
Quant aux essais thérapeutiques en cours, que se passera-t-il si l'une des molécules testées s'avère efficace ? Comment agira-t-on collectivement ? L'Institut Pasteur, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) travaillent d'arrache-pied sur des vaccins, mais aussi sur des tests de diagnostic et de sérologie, enjeux essentiels pour le déconfinement. Comment les décisions seront-elles prises entre les groupes de chercheurs et les différents comités ?
Cette crise montre qu'on a besoin d'une recherche française et européenne. Le Président de la République a annoncé une augmentation des moyens alloués à la recherche à hauteur de 5 milliards d'euros annuels sur dix ans. Ce n'est qu'un premier pas, encore insuffisant pour voir le budget de la recherche atteindre 1 % du PIB. En savez-vous un peu plus sur le devenir du projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche ? Verra-t-il bientôt le jour en dépit du calendrier parlementaire bouleversé des prochains mois, ou bien faudra-t-il passer par le projet de loi de finances pour 2021 pour faire adapter les premières mesures nécessaires en la matière ?
Mme Frédérique Vidal, ministre . - Le consortium REACTing, qui nous a permis de figurer parmi les premiers pays, dès février dernier, à proposer une réponse en termes de recherche, a reçu des financements destinés à l'amorçage de projets. Le principe est le même pour les appels Flash de l'ANR. Le comité scientifique de l'ANR a examiné les propositions et a estimé que quarante-quatre d'entre elles devaient être lancées, avec un financement immédiat. Pour les autres, des investigations supplémentaires sont nécessaires sur le plan de la solidité scientifique et de la bibliographie. Le pire en cette période serait de financer des recherches dont il a déjà été démontré qu'elles étaient inefficaces. Il ne s'agit pas d'un problème financier, puisque l'objectif est de soutenir tous les projets nécessaires : 65 % des projets REACTing sont financés et plus de 30 % de ceux de l'ANR.
Les organismes de recherche ont, sur leurs crédits de base, directement abondé plusieurs laboratoires dans lesquels des chercheurs travaillent sur ces sujets depuis longtemps et ont besoin de moyens supplémentaires. Quant aux projets présentés via les appels Flash de l'ANR, de l'ANRS et de REACTing, ce sont de nouvelles propositions de sujets de recherche.
Il faut donc distinguer les projets des équipes travaillant de longue date sur les coronavirus, financés par les organismes de recherche, et ceux de toute personne souhaitant proposer une idée nouvelle, lesquels sont soutenus dans le cadre des appels Flash de l'ANR ; enfin, les projets portant sur un nouveau protocole thérapeutique ou une nouvelle molécule attestée sont lancés par REACTing.
Nous essayons, au fur et à mesure que des molécules sont incluses dans les essais cliniques, de veiller à l'approvisionnement en matières premières ou en molécules elles-mêmes, si celles-ci ne sont pas fabriquées par des sociétés pharmaceutiques ayant au moins un laboratoire en France. La situation est très compliquée, car ces sujets sont mondiaux et tous les pays font de même. Pour cette raison, nous nous efforçons de mener un travail d'approvisionnement coordonné au niveau européen. C'est nécessaire, car, si nous commandons 10 000 doses d'un médicament tandis que les États-Unis en commandent 3 millions, nous passerons toujours derrière !
Même lorsque des commandes fermes sont passées, il arrive que les sociétés pharmaceutiques soient elles-mêmes en rupture de stock de plusieurs produits et nous annoncent des retards de livraison ; ce fut le cas pour certains tests. La tension mondiale sur les matières premières complique encore les choses.
S'agissant des tests sérologiques, que proposent de nombreuses compagnies étrangères et françaises, notamment des start-up, CARE examine leurs bases scientifiques et, si elles sont valides, un premier test, rapide, est fait sur des sérums de patients dans les CHU et laboratoires français. Les tests qui « passent » cette première étape sont transmis aux centres nationaux de référence (CNR), qui les valident définitivement.
Il faut être attentif, à la fois, à la spécificité - en effet, les coronavirus sont responsables de tous les rhumes de printemps - et à la sensibilité, en déterminant le nombre de faux positifs et de faux négatifs. Les premiers sont assez rares, mais les seconds peuvent exister puisque la réponse immunitaire de chaque individu est variable. Une analyse « macro » est faite sur place dans les CHU, puis une autre, plus complète, dans les CNR de Pasteur ou de Lyon. Nous envisageons d'habiliter certains CHU à faire ces tests complets, lesquels permettent de vérifier que les anticorps ainsi détectés sont protecteurs, c'est-à-dire capables de bloquer la propagation du virus dans des boîtes de culture. En effet, certains tests détectent des anticorps, mais il ne s'agit pas d'anticorps dits protecteurs. Cette manipulation prend trois ou quatre jours.
Plusieurs tests ayant déjà suivi ce processus de validation sont en cours de commande. Lorsqu'ils sont produits en France par des laboratoires ou des start-up, nous organisons la chaîne de production, travaillons avec le ministère de l'économie et des finances, notamment avec Mme Agnès Pannier-Runacher, qui est chargée de ce dossier, si nécessaire en réorientant des chaînes dédiées à d'autres types de tests, afin d'anticiper une phase industrielle.
Pour ce qui concerne les tests cliniques, CARE travaille sur un protocole-type, afin que tout hôpital ou tout médecin généraliste qui voudrait y participer puissent le faire en suivant une procédure normalisée. Cela permettra de conglomérer ensuite l'ensemble des résultats et de faire de la méta-analyse. Il y aura un protocole-type pour des essais en hôpital et un autre pour la médecine de ville.
J'en viens aux essais cliniques en cours. La première analyse consiste à examiner s'il est nécessaire d'arrêter une branche de ces essais parce qu'elle aurait des effets néfastes pour la santé. Pour l'instant, cela ne s'est pas produit. Les résultats sont envoyés à des statisticiens, qui établissent une analyse indépendante, dans le cadre d'une procédure qui est la plus rigoureuse possible sur le plan scientifique.
De nombreuses technologies émergent, que CARE est chargé de valider scientifiquement et qui sont financées directement. Sur la base des travaux disponibles dont la synthèse, faite par CARE, est transmise au conseil scientifique, celui-ci proposera des stratégies en matière de santé publique. Il est donc important, pour faire le lien, que des personnes siègent dans les deux instances.
S'agissant du financement de la recherche, le Président de la République a annoncé qu'y seraient consacrés 5 milliards d'euros supplémentaires par an. Aujourd'hui, 15 milliards d'euros par an sont investis dans ce domaine. Pour passer à 20 milliards annuels, des étapes successives sont prévues. Au total, 25 milliards d'euros seront investis sur dix ans.
Le Premier ministre me l'a confirmé ce matin : dès que le calendrier parlementaire le permettra, le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche sera soumis au Parlement. Il est néanmoins très important - c'est le sens de l'annonce du Président de la République - que nous puissions lancer les premiers investissements dès 2021, que la loi de programmation pluriannuelle de la recherche ait été votée ou pas. Nous prévoyons, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021, une première augmentation de 400 millions d'euros pour la mission interministérielle recherche et enseignement supérieur (Mires).
M. Pierre Ouzoulias . - Je suis heureux d'entendre que la décision du Conseil constitutionnel nous satisfait tous les deux. Les Sages nous réunissent !
L'Allemagne a engagé 3,5 milliards d'euros dès 2020 pour financer les équipements médicaux, la recherche d'un remède et d'un vaccin, et vient d'affecter 150 millions d'euros pour la constitution d'un réseau de recherche de médecine universitaire confié à l'équivalent du CHU de Berlin. La France a, quant à elle, débloqué 8 millions d'euros, et vous annoncez un fonds d'urgence doté de 50 millions : cet effort est un cran au-dessous de celui de nos voisins allemands.
Les laboratoires qui sont actuellement sur le front de la recherche insistent sur la nécessité de mettre aux normes leurs équipements et outils de recherche. Tandis qu'un laboratoire chinois travaillant sur le coronavirus dispose de deux cryomicroscopes électroniques valant chacun 5 millions d'euros, les laboratoires de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) en demandent depuis quatre ans un plus petit, valant 2 millions d'euros, sans réponse pour l'instant. Sans budget supplémentaire, il sera très difficile pour ces organismes de mettre leurs matériels à niveau, et donc de trouver des financements.
Je vous approuve sur la nécessité de faire une pleine confiance aux laboratoires, chercheurs et organismes de recherche, sans passer par les appels à projets, dans la situation actuelle d'urgence. Comment leur donner très rapidement les moyens de résoudre leurs problèmes d'équipements ?
Mme Frédérique Vidal, ministre . - Nous consacrons 4 milliards d'euros au déploiement du volet clinique et au développement de médicaments, que l'Allemagne finance à hauteur de 3,5 milliards. Nous sommes donc dans le même ordre de grandeur.
Pour ce qui est du financement de recherche, je rappelle que l'Allemagne comptabilise toujours en coûts complets, en incluant les salaires qui, chez nous, sont pris en charge par d'autres lignes. Les 50 millions d'euros dédiés au fonctionnement et à l'investissement que nous débloquons, sachant que 1 500 à 2 000 chercheurs travaillent sur le Covid-19, sont donc comparables aux crédits allemands dans ce domaine. Nous avons débloqué 8 millions d'euros début mars, puis 16 millions supplémentaires lors des dernières semaines. Nous réitérons ces opérations autant que de besoin.
L'acquisition de matériels est bien sûr nécessaire, mais il faut beaucoup de temps pour fabriquer, tester et calibrer un cryomicroscope. Il faudra le faire, et cela est prévu dans la future LPPR. En l'occurrence, ce n'est pas l'urgence du moment, d'autant qu'il y a un cryomicroscope tout à fait utilisable au sein du Centre commun de microscopie appliquée (CCMA), dans mon ancienne université - je connais donc bien le sujet.
Nous agissons dans deux directions différentes : le soutien immédiat et la préparation de l'avenir. Nous soutenons ainsi des programmes de recherche permettant de comprendre le fonctionnement du Covid-19 et d'augmenter la connaissance générale sur les coronavirus. Dans l'immédiat, l'urgence est au repositionnement de médicaments et de thérapies, aux essais cliniques et aux tests. Néanmoins, nous devons également accumuler des connaissances pour le long terme. Nous avons ainsi ouvert à travers l'ANR la possibilité de financer des projets à plus longue échéance.
On a trop négligé lors des trente dernières années l'accumulation de connaissances. La LPPR aura pour objet d'y remédier dans tous les champs disciplinaires, et pas seulement pour la santé. Nous aurons besoin, par exemple, de programmes de recherche de sociologie et d'anthropologie afin d'analyser les comportements en période de confinement ou lorsque le virus, ayant quitté l'Europe, continuera de sévir sur d'autres continents. Les projets financés relèvent donc pour un tiers des sciences humaines et sociales, dont le rôle est de penser et comprendre ces phénomènes. Il faut à la fois gérer l'urgence et respecter le temps de la recherche.
Mme Sonia de la Provôté . - L'épisode que nous traversons met en lumière la nécessité de mettre en cohérence tous les champs de la recherche, et nous constatons qu'il vous importe d'en trouver les voies et moyens. Le comité scientifique protocolise de façon adaptée à la situation et met en place une normalisation.
La LPPR devra trouver, hors des orientations majeures, des organismes institutionnels et des appels à projets, la façon de financer les projets et de s'irriguer de la connaissance produite par des équipes de recherche qui ont emprunté des chemins de traverse, mais qui étaient autrefois accompagnées sur le long terme. Rappelons que les grandes innovations ne sont pas toujours sorties des laboratoires les plus importants.
Comment saisir ces opportunités de la recherche « hors cadre » au travers de la LPPR et quelle part y sera dévolue ? On a reproché aux appels à projets d'être court-termistes, alors qu'une grande part de la recherche repose sur le temps long et les études multicentriques. Une cohorte, par exemple, sur le plan médical, ne s'étend pas sur cinq, mais sur vingt ans. Quelle en sera la traduction financière et organisationnelle ? Des comités scientifiques ne pourraient-ils pas être nommés, sur le modèle de CARE, pour recueillir la connaissance la plus exhaustive possible de la recherche française et mondiale, et associer recherches académique et hors cadre ?
Mme Frédérique Vidal, ministre . - Le budget actuel de la recherche s'élève à environ 15 milliards d'euros, mais 1,5 milliard seulement relève de l'ANR. Tout ne se fait donc pas sur la base d'appels à projets, loin de là. Certes, les salaires sont très faibles, mais la LPPR y remédiera. Quant à la politique de réinvestissement, s'agissant notamment du matériel, elle est perfectible. Il n'en reste pas moins que la France figure parmi les pays qui financent le plus la recherche hors-cadre. Ne confondons pas les appels à projets de l'ANR et la recherche finalisée. L'Agence finance aussi la recherche sur le Big Bang et les trous noirs ! Si la finalité de ces études n'est pas évidente, ces recherches n'en demeurent pas moins essentielles car elles apportent de la connaissance !
La veille est permanente sur la qualité scientifique de la recherche effectuée dans les laboratoires, sous l'autorité des conseils scientifiques des organismes et des universités. Dans la situation de crise que nous connaissons, après la première étape de sidération est venue celle de la mise en ébullition, dont nous devons tirer parti pour organiser et coordonner les initiatives. Il ne sert à rien que chacun ait des idées fabuleuses dans son coin, il faut s'associer pour aller plus vite.
Le rôle de CARE est d'assurer cette veille nationale et internationale. Ce comité, essentiel, est un instrument de guerre, qui fonctionne ainsi du fait du caractère exceptionnel de la période. L'organisation est énorme, mais la communauté des chercheurs ne demande qu'à participer. Ainsi, de même que des médecins acceptent de pratiquer des gestes infirmiers dans les services de réanimation, des sommités de la recherche fabriquent du gel hydroalcoolique...
Cela ne nous empêche pas de réfléchir, et nous le faisons depuis un an, à la question de l'investissement nécessaire dans la recherche en temps normal. Nous nous interrogeons ainsi sur l'identification plus rapide des laboratoires capables de fabriquer des primers pour la RT-PCR - Reverse transcriptase polymerase chain reaction . Il y a une tension mondiale sur les primers , mais aussi des synthétiseurs dans nos laboratoires : comment les réorienter ?
Les laboratoires ont aussi donné beaucoup de réactifs et de consommables aux hôpitaux, sans poser la question du remboursement. Il y a un élan ! Dans le même temps, des équipes espèrent être les premières au monde à comprendre comment fonctionne le virus. Le monde de la recherche est le mélange de ces deux démarches.
Mme Sonia de la Provôté . - Il ne s'agit pas de donner des ordres aux équipes et aux organismes, mais de mettre en place des protocoles de base, qui peuvent d'ailleurs être amendés. Dans le domaine de la santé, il est intéressant d'intégrer la médecine de ville. Cette approche pourrait être retenue pour d'autres sujets hors période « de guerre ». La constitution de comités ad hoc permettrait de mettre un coup d'accélérateur et d'assurer une veille dans maints domaines ainsi qu'une plus grande efficacité.
Mme Colette Mélot . - Tandis que les étudiants de Paces ont obtenu le report de leur concours, les candidats aux formations paramédicales ne sont pas traités de la même façon. Dans la filière orthophonie, le concours est remplacé par une sélection sur dossier. Or, cette admission, très sélective, nécessite en moyenne deux années d'une préparation spécifique souvent dispensée dans des établissements privés coûteux. Envisagez-vous un report du concours d'accès aux formations paramédicales ?
Mme Frédérique Vidal, ministre . - La décision a été prise de remplacer l'ensemble des concours post-bac, y compris dans la filière orthophonie, par une sélection sur dossier. En revanche, pour les concours de la Paces, de l'internat et post-préparatoires aux grandes écoles (post-CPGE), lesquels se déroulent après l'admission dans l'enseignement supérieur, les écrits ont été maintenus.
Cette décision a été précédée d'une discussion avec l'ensemble des écoles. Il fallait être clair pour les élèves et leurs familles. Nous avons essayé de sécuriser au maximum et de diminuer le stress pour tous. Oui, en cette année exceptionnelle, les admissions que vous avez mentionnées se feront sur dossier, un modèle que nous avons retenu depuis l'an dernier pour les concours aux instituts de formation en soins infirmiers (IFSI). Les coûts en ont d'ailleurs été réduits pour ces jeunes, qui n'ont plus à se déplacer dans la France entière pour passer les épreuves ; j'y vois une amélioration du système. Nous devrons en tirer des conclusions générales sur les frais de concours.
M. André Gattolin . - Je suis préoccupé par les plannings des semaines et des années à venir. On a évoqué la coordination européenne. Lors de la crise Ebola, il avait été décidé de lancer un grand chantier dans le cadre du programme Horizon Europe et les résultats avaient été intéressants. Au-delà du coronavirus, les risques sanitaires de ce type seront récurrents. Il faudra donc mettre en place des structures permanentes à l'échelle européenne afin d'être à la hauteur des États-continents, notamment les États-Unis.
Mme Frédérique Vidal, ministre . - Vous avez raison de souligner l'importance de la réaction européenne. REACTing, créé en 2011 après l'épidémie Zika, est membre d'un consortium européen de veille et de surveillance des épidémies. Ce réseau doit continuer à interagir et travailler même en dehors des périodes d'épidémie, et se mobiliser très rapidement lors d'épidémies pour mettre en place des protocoles de recherche et cliniques.
Il semble que la mobilisation et l'animation de ce réseau aient été moins actives dans les autres pays européens. En France, REACTing bénéficie chaque année de 500 000 euros pour agir au sein de ce consortium, ce qui nous a permis de lancer rapidement des essais cliniques. Nous avons ainsi été le premier pays à inclure des patients dans nos tests. Il faudra porter ce modèle au niveau européen.
L'Union européenne a ouvert un financement spécifique pour le Covid-19, à hauteur de 90 millions d'euros. Plusieurs fonds sont disponibles au niveau européen. Cela fera l'objet des discussions qu'auront demain les ministres de la recherche.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Merci, madame la ministre. Nous avons bien saisi votre réflexion et votre plan d'actions. Nous vous apportons tout notre soutien et restons très mobilisés sur ces sujets, notamment celui de la vie étudiante en cette période difficile de révision du baccalauréat et de l'orientation des bacheliers.
Notre commission est très mobilisée sur les problématiques de la recherche. Nous avons organisé des tables rondes avec des chercheurs éminents pour préparer l'avenir. Nous nous doutons que le calendrier parlementaire sera bouleversé, mais nous avons déjà commencé à travailler sur la LPPR. Toutes nos pensées vont à la communauté des chercheurs, des universitaires et des étudiants, aux médecins et à tous ceux qui prêtent main-forte dans les hôpitaux, ainsi qu'aux malades et à leurs familles.
Audition de M. Jean-Michel
Blanquer,
ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse
Jeudi 9 avril 2020
___________
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente. - Notre commission poursuit son travail de contrôle et d'information dans ce contexte de crise sanitaire. Après avoir auditionné Mme Frédérique Vidal par téléconférence en début de semaine, nous avons de nouveau recours à ce format pour auditionner M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Au nom de l'ensemble des membres de la commission, je vous remercie de vous être rendu disponible pour cette audition, monsieur le ministre, et d'avoir accepté de vous livrer à cet exercice un peu particulier. Cette audition, comme celle de lundi, fera l'objet d'un compte rendu qui sera publié au bulletin des commissions et mis en ligne sur le site du Sénat. J'ajoute qu'un journaliste de Public Sénat suit cette téléconférence.
Avant toute chose, je tiens à saluer la remarquable mobilisation des personnels de l'éducation nationale, les enseignants en particulier, pour assurer un suivi pédagogique et tenter de limiter les effets de la fermeture des établissements scolaires sur les apprentissages des élèves. Je salue également les familles qui, plus que jamais, sont des acteurs incontournables de la coéducation. Nous sommes tous conscients des difficultés que bon nombre d'entre elles rencontrent, dès lors que les parents doivent jongler entre télétravail et école à la maison.
Monsieur le ministre, à la suite de votre propos liminaire, nos rapporteurs vous interrogeront sur plusieurs thématiques qui nous mobilisent, comme la carte scolaire pour la rentrée 2020 ou la continuité pédagogique mise en place pour faire face à la fermeture des établissements.
Selon vous, dans quel état d'esprit se trouvent les personnels de l'éducation nationale et les élèves ? Pourriez-vous nous dire un mot de l'organisation des examens et de ses conséquences sur Parcoursup ? Par ailleurs, notre commission est très attentive à la question des établissements français à l'étranger et souhaiterait disposer d'informations à leur sujet. Enfin, vous connaissez mon attachement à la question du numérique à l'école. Pourriez-vous dresser un premier bilan du recours aux outils et enseignements numériques depuis le début de ce confinement ? Quels sont les points de vigilance dont vous pourriez nous faire part à cet égard ?
Afin de rendre cette téléconférence aussi dynamique que possible, après votre propos liminaire, monsieur le ministre, je donnerai d'abord la parole à nos rapporteurs, auxquels vous pourrez répondre en détail, avant de la laisser aux représentants des groupes politiques.
M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. - Je suis très heureux que cette audition puisse se tenir malgré les difficultés du moment. C'est précisément pour cela qu'il est bon que nous échangions et avancions ensemble. Les défis que nous aurons à relever requièrent une information partagée, une forme d'unité dans l'action et, bien sûr, un maximum de pragmatisme.
Je souhaite vous parler de l'une des missions prioritaires dont mon ministère doit s'acquitter, à savoir l'enseignement à distance.
Dans le cadre de la continuité pédagogique que nous cherchons à préserver dans cette période de crise, nous gardons évidemment à l'esprit les deux objectifs que nous nous assignons en temps normal, c'est-à-dire la hausse du niveau général des élèves, d'une part, et la lutte contre les inégalités, d'autre part. Dans les circonstances actuelles, ces objectifs sont particulièrement menacés : la non-fréquentation de l'école peut conduire à une baisse du niveau général, tandis que les inégalités peuvent s'accroître du seul fait que l'on renvoie chaque enfant à son environnement familial d'origine.
Cette crise révèle l'importance de l'école de la République, tant en ce qui concerne la socialisation des enfants que la lutte contre les injustices sociales. Ce contexte met en lumière le professionnalisme des personnels de l'éducation nationale. Chacun a pris conscience que le métier d'enseignant est indispensable et loin d'être facile à exercer : cette crise sera sans doute l'occasion de renforcer le prestige de cette profession au sein de la société.
Nous n'avons eu d'autre choix que d'organiser l'enseignement à distance dans des délais record. Pour ce faire, nous avons recouru à trois leviers.
Le premier instrument sur lequel nous avons pu compter est le Centre national d'enseignement à distance (CNED), particulier à la France, qui a contribué à la mise en place du dispositif « Ma classe à la maison », d'abord pour les élèves français de Chine, puis pour ceux de l'Oise, du Morbihan et du Haut-Rhin quelques semaines plus tard et, enfin, pour l'ensemble des élèves une fois les établissements fermés. Sur le plan pédagogique, les contenus étaient donc prêts au début du confinement. Sur le plan technique, si nous avons rencontré de grosses difficultés au démarrage, celles-ci ont rapidement été levées grâce aux collectivités locales qui, je le rappelle, sont responsables des environnements numériques de travail, et aux opérateurs.
Actuellement, 2,5 millions de familles sont connectées à « Ma classe à la maison », ce qui correspond à environ 400 000 professeurs. Ce chiffre est d'autant plus satisfaisant que l'on observe assez peu de problèmes techniques. Il s'agit d'un système de classe virtuelle intégrée, qui permet d'observer la progression des élèves de tout niveau, de la grande section de maternelle à la terminale, semaine après semaine. Ce support est évidemment gratuit, puisqu'il relève du service public de l'enseignement.
Le deuxième levier est celui des environnements numériques de travail. Très nombreux sont les enseignants ayant assez naturellement utilisé ces outils qui, je le rappelle, sont propres à chaque établissement.
Enfin, les enseignants ont souvent recours à ces technologies d'appoint que sont les mails et les plateformes de toute nature. Dans ce domaine, les professeurs font preuve de beaucoup de créativité. Même si je ne condamne pas ce troisième levier d'action, j'ai évidemment une préférence pour les deux premiers instruments : ils offrent en effet davantage de garanties, notamment en termes de protection des données personnelles, et contribuent à la fois au service public et à notre souveraineté dans le domaine pédagogique. À terme, il nous faudra réfléchir à la manière de faire en sorte que ces deux canaux s'imposent d'eux-mêmes. En tout cas, c'est une satisfaction, les enseignants et les élèves ont pu interagir.
Au cours de la première semaine suivant la fermeture des établissements scolaires, nous avons constaté beaucoup de volontarisme et une grande inventivité chez les personnels de l'éducation nationale. Je tiens à leur rendre hommage pour avoir joué le jeu dès le départ.
En parallèle, nous avons été confrontés au problème du calibrage de l'enseignement à distance : il ne faut donner ni « trop » ni « pas assez » de travail aux élèves. Ainsi, certaines familles nous ont rapidement fait observer qu'elles étaient submergées par la charge de travail. Nous avons rapidement cherché à réguler les « flux » pédagogiques en nous appuyant sur les recteurs - que je rencontre trois fois par semaine en visioconférence - et les corps d'inspection, ce qui a permis d'aboutir à une masse de travail plus équilibrée dans les jours suivants.
Pour autant, il faut veiller à ne pas laisser de « trous dans la raquette ». C'est le problème plus grave encore de ces élèves qui ne peuvent pas bénéficier des dispositifs de formation à distance. Assez rapidement, j'ai demandé que les recteurs, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale (Dasen) et les chefs d'établissement se mobilisent pour que chaque enfant « décrocheur » puisse être contacté par téléphone au moins une fois par semaine. Ce système a permis de joindre la plupart des familles, notamment parmi les plus défavorisées, même si on estime, selon les premières enquêtes, qu'il y aurait 5 % à 8 % d'élèves, des lycées professionnels notamment, qui ne seraient pas en mesure aujourd'hui de suivre le même enseignement que les autres.
Pour lutter contre la fracture numérique, le Gouvernement a engagé plusieurs actions.
Je pense évidemment aux prêts et aux dons de tablettes, parfois sur l'initiative spontanée des collectivités locales. Il s'agit d'un travail interministériel qui mobilise également Julien Denormandie et Adrien Taquet.
Je pense aussi à l'accord conclu avec La Poste pour que celle-ci imprime et envoie au domicile des élèves qui en auraient besoin des contenus pédagogiques élaborés par les enseignants, avec une enveloppe T pour la réponse, permettant un envoi gratuit pour la famille. Ce système novateur devrait porter ses fruits au cours des prochaines semaines.
Nous avons également lancé l'opération « Nation apprenante », qui incite les médias - audiovisuel public et privé, presse nationale et presse quotidienne régionale - à créer une « atmosphère » éducative en diffusant des contenus qui doivent avoir un rapport avec les programmes de l'éducation nationale, avec une validation par une cellule constituée d'inspecteurs. Le programme le plus emblématique est probablement celui de La Maison Lumni sur France 4. France Culture diffuse également des émissions à destination des élèves de première qui préparent l'oral du bac sur les oeuvres au programme. Je ne peux pas évoquer tous les projets en détail, mais je tiens à citer le réseau Canopé, qui contribue également à développer les ressources pédagogiques auprès des élèves. Le site Éduscol du ministère recense les ressources mises à disposition. Par ailleurs, il ne faut pas oublier la dimension internationale, puisque des échanges d'expériences ont lieu avec les autres ministres de l'Union européenne et ceux de la francophonie, ainsi qu'avec l'Unesco et l'OCDE. Ces comparaisons internationales doivent nous permettre de partager nos initiatives et de nous améliorer.
J'ai évoqué les enjeux auxquels nous devons faire face : la réussite pédagogique et l'inclusion sociale. Nous pouvons encore progresser, afin de ramener dans le circuit pédagogique l'ensemble des élèves, notamment ceux des lycées professionnels. Les gestes professionnels ne sont pas faciles à transmettre à distance. Là aussi, les professeurs font preuve de nombreuses initiatives.
Dernière chose, nous avons mis en place des dispositifs de soutien scolaire pour cette période de crise, mais aussi pour l'après-crise. Ainsi, le dispositif « Vacances apprenantes » permettra aux élèves qui le souhaitent, au cours de la seconde semaine des vacances de printemps, de bénéficier de six heures d'enseignement personnalisé à distance, par petit groupe de un à six élèves. Ce soutien sera proposé à tout élève qui en fait la demande. Il doit notamment permettre de raccrocher les élèves qui n'ont pas pu profiter de la continuité pédagogique dès le début du confinement. Nous développerons également des modules de soutien scolaire durant l'été. Enfin, nous envisageons de relancer les colonies de vacances sous une forme renouvelée durant la période estivale.
M. Jacques Grosperrin. - Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier d'avoir entendu les observations des sénateurs du groupe Les Républicains, ainsi que celles des membres du bureau de notre commission, au sujet de la carte scolaire, et ce d'autant qu'il était évidemment très compliqué pour vous de l'élaborer dans ce contexte de crise sanitaire.
Nous réclamions un moratoire, dans la mesure où la plupart des maires n'ont pas encore pris leurs fonctions. Or vous avez annoncé, il y a quelques jours, qu'il n'y aurait aucune fermeture de classes dans les communes de moins de 5 000 habitants. Il s'agit d'un symbole fort pour la ruralité, mais aussi d'une décision qui redonne le pouvoir décisionnel aux élus. Il faudra veiller à ne pas dresser les territoires les uns contre les autres, en particulier les zones rurales contre les zones urbaines, car ces dernières souffrent aussi.
Pourquoi avoir retenu ce seuil de 5 000 habitants, monsieur le ministre ? Chacun sait que l'Insee considère qu'une commune rurale est une unité urbaine de moins de 2 000 habitants.
Votre ministère a annoncé la création de 1 248 postes dans le premier degré, en plus de la création des 440 postes déjà prévus. Ces postes seront-ils créés par voie de concours ou ferez-vous appel à des contractuels ? Quelles seront les implications budgétaires de cette annonce ? Une redistribution des crédits entre les différentes actions et les différents programmes de la mission « Enseignement scolaire » est-elle prévue, ou s'agit-il d'une augmentation nette de postes ?
Alors que les priorités du Gouvernement dans le cadre du futur plan de sortie de crise iront certainement à la santé et à la reprise économique, nous nous interrogeons également sur la pérennité et la continuité d'un certain nombre de réformes. Je pense au dispositif « Plus de maîtres que de classes », qui n'a d'ailleurs pas démontré sa pleine efficacité, à l'école inclusive ou au dédoublement des classes.
Ma deuxième question porte sur la session du bac de septembre 2020. Nous avons compris que les notes obtenues dans le cadre du contrôle continu, à l'exception de celles qui sont recueillies au cours de la période de confinement, seront prises en compte aux premier et deuxième trimestres, voire au troisième. Quid de ces élèves, qui ont actuellement une moyenne ne leur permettant pas d'avoir le bac, alors qu'ils réussiraient, en intensifiant leurs efforts quelques semaines avant le bac - le fameux « bachotage » -, à décrocher leur diplôme ? Estimez-vous que le nombre de redoublants de terminale sera supérieur cette année, sachant qu'une augmentation du nombre de redoublants aura mathématiquement des répercussions sur l'organisation des classes et les emplois du temps des terminales à la rentrée 2020 ?
En temps normal, combien de candidats se présentent-ils à cette session ? Quelles sont les projections pour la session de septembre 2020 ? On peut penser que le nombre de candidats sera plus important. Dès lors, comment les chefs d'établissement concilieront-ils l'organisation de cette session du bac et la rentrée scolaire ?
M. Antoine Karam. - Monsieur le ministre, en tant que rapporteur pour avis des crédits de l'enseignement agricole, technique et professionnel, je souhaite vous interroger sur les difficultés spécifiques rencontrées par cet enseignement dans le cadre de certaines formations à distance. En effet, si l'enseignement à distance de certaines matières, comme les mathématiques ou encore l'histoire-géographie, est possible, il est beaucoup plus complexe à mettre en oeuvre pour les matières nécessitant des travaux pratiques. Je pense par exemple aux formations en menuiserie, en ébénisterie ou encore en horticulture. Comment faire en sorte que ces enseignements soient correctement assurés, tant sur le volet théorique que pratique ?
Ma deuxième question porte sur les diplômes certifiants. Les compétences sont évaluées via le contrôle en cours de formation (CCF). Les élèves passent ces contrôles lorsqu'ils atteignent le niveau de compétence technique nécessaire. Le CCF permet de certifier que l'élève en formation a bien acquis le geste technique, la compétence et le savoir-faire professionnel : il est donc essentiel pour leur employabilité. Or, cette année, il est prévu que, en l'absence d'évaluation en CCF, les notes seront obtenues à partir de celles du livret. Pour les entreprises, comment s'assurer que l'élève diplômé possédera bien le geste technique et non la seule connaissance théorique de ce dernier ? Comment garantir aux futurs diplômés que leur formation certifiante ne sera pas moins cotée sur le marché du travail que celle des autres années ?
Enfin, certains syndicats de l'enseignement agricole ont vivement réagi à vos annonces, car ils doutent d'une concertation effective entre votre ministère et celui de l'agriculture : pourriez-vous nous éclairer sur ce point et nous assurer que cette concertation a bien eu lieu entre les deux ministères ?
M. Claude Kern. - Je tiens également à saluer les enseignants pour leur contribution, leurs efforts et l'ingéniosité dont ils font preuve dans cette période exceptionnelle.
Monsieur le ministre, la crise que nous traversons affecte aussi les établissements d'enseignement français à l'étranger. Certains parents seront - ou sont déjà - confrontés à des difficultés pour payer les frais de scolarité. Or ceux-ci sont une source de financement essentielle pour les établissements du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE).
Quelles mesures avez-vous prises pour les aider à affronter cette situation ? Est-il envisageable que ces établissements puissent bénéficier du fonds de soutien créé pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ?
Je redoute l'effritement des effectifs du corps enseignant à l'étranger puisque, on le sait, de nombreux enseignants ont été rapatriés ou ont demandé leur rapatriement, et que certains d'entre eux ont même quitté leur poste sans prévenir leur hiérarchie ou l'ambassade dont ils dépendent. Quelles dispositions comptez-vous prendre en ce qui les concerne ? Surtout, comment comptez-vous compenser ce manque d'effectifs dans l'immédiat et à la reprise ?
Enfin, pour faire face à la fracture numérique, avez-vous imaginé des solutions de téléenseignement dans les pays où le réseau internet est peu développé ?
M. Jacques-Bernard Magner. - Monsieur le ministre, je voudrais vous faire part de ma satisfaction de vous avoir entendu parler du renouveau des colonies de vacances qui, on le sait, sont très utiles pour les enfants des couches populaires. Malgré ces circonstances malheureuses, il faut saisir l'occasion d'apporter notre soutien au réseau associatif.
En tant que rapporteur des crédits de la jeunesse et de la vie associative, je souhaite vous interroger sur l'organisation du service national universel (SNU) pour 2020.
En effet, la phase des quinze jours de cohésion des volontaires du SNU actuellement en classe de seconde devait se dérouler du 22 juin au 5 juillet. Comme chaque année, en raison du baccalauréat, ces élèves de seconde ne devaient plus avoir cours à cette période de l'année. Or vous avez annoncé que tous les lycéens auraient cours jusqu'au 4 juillet pour tenter de rattraper, au maximum, le retard dû à la période de confinement.
Nous comprenons cette décision, mais le recul de la fin effective de l'année scolaire a des conséquences directes sur le SNU. Nombre de jeunes concernés par le SNU devaient être logés pendant la phase de cohésion dans des centres d'accueils collectifs pour mineurs, à l'exemple des colonies de vacances ou des centres de loisirs. Or ceux-ci ne seront certainement pas libres après le 4 juillet. Pouvez-vous nous en dire plus sur les dates de la phase de cohésion ? On peut en effet raisonnablement penser que les centres devant les accueillir seront utilisés tout l'été.
En 2020, l'expérimentation du SNU devait être généralisée à l'ensemble des départements et concerner 30 000 jeunes. Ne pourrait-on pas annuler l'édition 2020 et reporter cette généralisation à l'année prochaine ? Cela permettrait de redistribuer des crédits, ce qui peut être utile dans le contexte actuel. Pour rappel, le SNU représente un coût estimé entre 30 et 45 millions d'euros en 2020.
M. Jean-Michel Blanquer, ministre. - Monsieur Grosperrin, nous avons dû revoir, de manière exceptionnelle, nos prévisions de rentrée en ce qui concerne la carte scolaire, mais nous l'avons fait dans une direction et un esprit qui ne font qu'accélérer la mise en oeuvre de notre politique : notre objectif est d'augmenter les moyens de l'enseignement primaire pour rattraper notre retard par rapport aux autres pays de l'OCDE. C'est pourquoi, rentrée après rentrée, nous investissons dans le primaire, en créant des postes, alors même que le nombre d'élèves diminue, notamment en milieu rural, ce qui nous oblige parfois à fermer des classes.
Le Président de la République s'est engagé l'année dernière à ne plus fermer d'écoles sans le consentement du maire, à dédoubler les classes de grande section de maternelle dans les zones REP (Réseaux d'éducation prioritaire) et REP + - le plus souvent en milieu urbain, mais parfois aussi en milieu rural - et à limiter à vingt-quatre élèves les effectifs des classes de grande section de maternelle, de CP et CE1 dans toute la France. L'objectif de non-fermeture d'écoles ne signifie pas qu'il n'y aura plus de fermetures de classes : celles-ci sont parfois nécessaires - ne serait-ce que pour des raisons d'équité - pour corriger les déséquilibres entre les territoires dus aux évolutions démographiques. Le gel des fermetures de classes est donc une mesure exceptionnelle qui vise à envoyer un message de soutien à tous les territoires.
N'opposons pas les territoires ruraux et les territoires urbains. La mesure ne concerne pas que les territoires ruraux, mais toutes les communes de moins de 5 000 habitants. On peut toujours discuter évidemment du seuil retenu, mais l'idée est, de manière pragmatique, de viser les petites communes, celles où le risque est de voir fermer des classes sans ouverture par ailleurs. Dans ces communes, aucune fermeture de classe ne pourra intervenir sans l'accord du maire. Dans les communes de plus de 5 000 habitants, nous prenons l'engagement - c'est nouveau - que le solde des ouvertures et des fermetures se traduira par une amélioration du taux d'encadrement. Ces communes sont donc aussi gagnantes.
Une tribune parue dans la presse dimanche dernier et signée par certains maires de Seine-Saint-Denis m'a beaucoup surpris, car elle émane de maires de communes où les taux d'encadrement ont augmenté, atteignant même des niveaux historiques. J'y ai répondu lors de la dernière séance des questions au Gouvernement à l'Assemblée nationale. Les créations de postes sont nombreuses en Seine-Saint-Denis, comme dans le reste de la France d'ailleurs, et, dans beaucoup de communes de ce département, le nombre d'élèves par classe sera inférieur à vingt à la rentrée. Je suis prêt à examiner toute situation où il n'y aurait pas une amélioration du taux d'encadrement dans une commune de plus de 5 000 habitants concernée par une fermeture de classe. Autant il était absurde de nous accuser de favoriser la ville par rapport aux campagnes, lorsque nous avons annoncé notre effort en faveur des zones REP et REP+, autant nous accuser maintenant de favoriser les campagnes par rapport aux villes n'a pas de sens ! Nous avons la même bienveillance pour toutes les parties de notre territoire. Nous nous ajustons en fonction des besoins.
Cela aboutit à des créations de postes que l'on pourra constater partout à la rentrée prochaine. Il s'agit de créations nettes qui se traduisent par des crédits supplémentaires, conformément à un arbitrage budgétaire du Premier ministre. Les concours de recrutement seront maintenus, même s'ils seront évidemment aménagés pour tenir compte des circonstances. Ils auront lieu en juin et juillet. Nous en arrêterons les modalités d'ici à la fin de la semaine. Nous aurons aussi recours, comme chaque année, aux concours spéciaux, sans doute avec une plus grande ampleur, notamment dans les académies de Versailles et de Créteil, les plus concernées par ces concours.
Je vous remercie d'avoir souligné que ces adaptations de la carte scolaire étaient, en partie, une réponse aux attentes du Sénat. J'avais en effet été interpellé au Sénat à ce sujet. Celui-ci a donc joué un rôle important, en accord avec le Gouvernement et l'Assemblée nationale. Toutefois, il ne s'agit pas d'un virage, mais plutôt d'une accentuation de notre politique pour créer des postes d'enseignants dans le premier degré, soutenir les REP et les REP+, ainsi que la ruralité, dans le cadre des contrats départementaux de ruralité, que connaît bien le sénateur Duran.
Vous m'avez aussi interrogé sur le baccalauréat et la session de septembre. Je ne reviens pas sur les motifs qui nous ont conduits à proposer cette formule cette année. La session de septembre est renforcée. Elle constitue un filet de sécurité et un point de repère. Le maintien de cette session finale constitue aussi la preuve que nous ne voulons pas en finir, à la faveur des circonstances exceptionnelles, avec la forme classique du baccalauréat. Son format évoluera en 2021, mais de manière équilibrée, avec 60 % de la note qui résultera du contrôle final et 40 % du contrôle continu. La crise n'entraîne donc pas d'évolution de notre doctrine, même si elle permet de montrer les vertus du contrôle continu.
La session de septembre sera organisée de façon classique, mais le nombre de candidats sera plus élevé puisqu'elle sera ouverte aux candidats libres et aux candidats dont la moyenne est inférieure à 8 sur 20 au contrôle continu, si le jury d'examen estime qu'ils ont fait preuve d'assiduité et de motivation. Pour mémoire, j'avais pris une mesure similaire l'an dernier lorsque j'avais reporté d'une semaine le brevet en raison de la canicule : à titre exceptionnel, les élèves qui n'avaient pu le passer avaient pu se présenter à la session de septembre. Il est probable que cette session commencera à la fin du mois d'août afin de ne pas trop perturber la rentrée. Je serai plus précis sur ces points au cours des prochains jours, notamment lorsque j'aurai consulté les organisations syndicales. Je ne pense pas que le nombre de redoublants augmentera. Le contrôle continu ne me semble pas plus sévère que l'examen final. Il aura peut-être, en revanche, un effet sur le nombre de mentions délivrées, qui risque de diminuer. Les jurys seront souverains et pourront améliorer les notes de certains élèves qui sont scolarisés dans des établissements qui notent plus sévèrement et qui auraient sans doute pu obtenir une mention si l'examen final avait été maintenu. Nous allons définir des repères objectivés pour permettre aux jurys de procéder aux harmonisations.
Monsieur Karam, l'annonce des modalités du baccalauréat a été précédée d'une concertation étroite avec le ministère de l'agriculture pour tenir compte des spécificités de l'enseignement agricole. Comme pour l'enseignement professionnel, la question est d'évaluer la transmission du geste technique dans le cadre d'un enseignement à distance. Les notes obtenues par le CCF seront prises en compte par les jurys. Par bienveillance envers les élèves, nous devrons avoir une moins grande exigence sur la durée du stage, puisque certains stages auront été interrompus. Le geste professionnel sera évalué sur la base des appréciations obtenues lorsqu'il aura pu être démontré avant la période de confinement, mais aussi après, je l'espère.
Je n'ai jamais affirmé que la rentrée aurait lieu le 4 mai. J'ai simplement dit que c'était le scénario qui avait ma préférence. Je continue à espérer que la reprise des cours pourra intervenir en mai : ce n'est pas une hypothèse impossible, mais nous sommes dépendants de l'évolution de l'épidémie et de l'avis des autorités sanitaires. Dans ce cas, les élèves pourront avoir des notes au troisième trimestre qui compteront pour le contrôle continu. Les notes obtenues pendant le confinement ne seront pas prises en compte pour ne pas accroître les inégalités, mais cela ne signifie pas que les élèves ne doivent pas travailler pendant cette période. Au contraire ! Cela les aidera à obtenir de meilleures notes au troisième trimestre. Nous avons supprimé l'épreuve terminale du baccalauréat qui devait avoir lieu en juin pour permettre aux élèves de retourner en classe à la fin de l'année et de rattraper, autant que possible, le retard. Si la rentrée est possible, les élèves auront classe jusqu'au 4 juillet et l'assiduité sera prise en compte pour l'obtention du diplôme.
Les élèves de l'enseignement agricole et professionnel, qui doivent faire la preuve qu'ils ont bien acquis certains gestes professionnels, pourront le faire au cours du troisième trimestre, si le retour au lycée est possible. Si tel n'est pas le cas, ils pourront être évalués sur la base de leur bulletin scolaire et du CCF. Ceux qui poursuivront leur scolarité en BTS pourront consolider leurs connaissances au début de la rentrée prochaine. J'en profite, à cet égard, pour indiquer qu'en début d'année les élèves, de tous les niveaux, seront évalués pour permettre une personnalisation des parcours et faciliter le rattrapage si besoin. Quant aux élèves qui partiront directement travailler en entreprise - une petite moitié d'entre eux -, notre relation avec les entreprises, dans un contexte économique particulier, devrait permettre de parvenir à une certaine fluidité entre les compétences acquises pendant la scolarité et les compétences mobilisées en entreprise, à l'image de ce qui se passe en période ordinaire.
Monsieur Kern, dès le début de la crise, Jean-Yves Le Drian et moi-même avons été très attentifs à la situation des établissements d'enseignement français à l'étranger. Nous avons même été parfois conduits à les fermer sans attendre que le pays d'accueil décide un confinement. Les lycées de l'AEFE, comme tous les lycées français, bénéficient du système d'enseignement à distance. C'est d'ailleurs en Chine que le dispositif « Ma classe à la maison » a été lancé en premier. Vous avez évoqué plusieurs facteurs de fragilisation des établissements liés à la crise ainsi que la problématique du retour des enseignants dans l'Hexagone. Nous travaillons avec l'AEFE et la Mission laïque française, en lien avec le ministère des affaires étrangères, pour permettre un retour à la normale et une reprise de poste dès la rentrée, en fonction des pays. Nous devrons aussi tirer les enseignements de la crise, notamment en ce qui concerne l'enseignement à distance. Celle-ci a révélé l'existence d'une fracture numérique. Nous travaillons avec les opérateurs de téléphonie pour pouvoir installer « Ma classe à la maison » sur les téléphones portables afin de surmonter les difficultés de connexion dans certains pays.
Monsieur Magner, il est évident que le SNU ne pourra se dérouler tel qu'il était initialement prévu. Nous devons travailler sur la base de scénarios en fonction de la date de fin de confinement. Je n'opposerai pas le SNU avec le service civique, car le SNU pourrait s'avérer utile dans la période actuelle. On pourrait ainsi imaginer des articulations nouvelles. Pourquoi ne pas autoriser des jeunes volontaires de 16 ans à participer, au titre du SNU, à des missions du service civique ? Il s'agit de pistes qui pourraient être mises en oeuvre, sinon dans l'immédiat, du moins dans la seconde partie de l'année ou en 2021. Le SNU semble en tout cas plus pertinent que jamais, même si ses modalités devront évidemment être adaptées en raison des circonstances : son objectif n'est-il pas de renforcer la résilience et de développer la capacité d'agir dans un tel contexte ?
Merci pour votre soutien sur les colonies de vacances. J'avais déjà évoqué la nécessité de leur donner un nouveau souffle. Les circonstances nous forcent à accélérer, selon des modalités que nous préciserons bientôt, en lien avec tous les acteurs, le monde associatif, l'éducation populaire, les collectivités locales, etc. Vos propositions seront aussi les bienvenues. Nous devons parvenir à augmenter le nombre d'enfants qui partent en colonie de vacances, pour des durées accrues, dans un cadre qualitatif meilleur, dans un rayon géographique qui ne soit pas trop éloigné du domicile, tant en raison des circonstances que pour des raisons écologiques et pour faciliter la découverte de l'environnement de la région. J'espère que les conditions sanitaires nous permettront de faire de belles choses cet été.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente. - Merci monsieur le ministre d'avoir souligné le rôle du Sénat sur la carte scolaire. Je vous avais écrit au nom du bureau de notre commission qui se réunit tous les lundis en cette période de crise. Nous avions eu un long débat sur le sujet. Vous nous avez répondu très rapidement et je vous en remercie.
Mme Françoise Laborde. - Monsieur le ministre, vous avez déjà répondu à plusieurs questions que je voulais vous poser, notamment sur la carte scolaire et le seuil des 5 000 habitants. Je veux attirer votre attention sur les réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased). On m'interroge beaucoup sur ce sujet, ainsi que sur les auxiliaires de vie scolaires (AVS) et les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) chargées d'intégrer les nouveaux enfants : pourront-elles se réunir ?
Vous avez évoqué la date de la rentrée et le soutien scolaire, sujet très important. Je veux aussi vous interroger sur l'articulation entre la session du baccalauréat de septembre et les inscriptions sur la plateforme Parcoursup. La session de septembre peut être utile pour les candidats libres ou ceux qui souhaitent profiter des vacances pour bachoter. Mais comment sera réalisée l'articulation avec Parcoursup ?
Vos réponses sur l'enseignement agricole ont été très claires. Le ministre de l'agriculture nous a d'ailleurs indiqué ce matin que vous aviez agi en étroite concertation.
Enfin, mon collègue Max Brisson et moi-même menons une réflexion sur les directeurs d'école. La situation actuelle illustre l'importance de leur mission. Il convient d'avancer sur la question de leur statut et de leur rémunération.
M. Laurent Lafon. - Vous avez annoncé le maintien des oraux du baccalauréat de français. Les modalités de déconfinement étant incertaines, est-ce définitif ?
Au sujet des colonies de vacances éducatives, pour la plupart associatives ou organisées par les collectivités, le flou entourant la fin du confinement ne permet pas de passer les commandes publiques, en particulier pour le mois de juillet. Il importe donc d'informer les maîtres d'oeuvre le plus rapidement possible.
M. Olivier Paccaud. - Nous avons salué la conscience professionnelle remarquable du corps enseignant, mais qu'en est-il des masques et des équipements de protection destinés aux professeurs volontaires ? Du matériel commence à être livré dans les écoles depuis quelques jours. Existe-t-il une doctrine claire en la matière au niveau de l'éducation nationale ?
Il existe deux catégories de « perdus » du confinement, dont le nombre est évalué entre 5 % et 10 % : les élèves souffrant de la fracture numérique et les élèves issus de milieux modestes. Certaines collectivités peuvent fournir du matériel. Vous avez évoqué la mise en place de stages de remise à niveau pendant les vacances de printemps. Or, ce sont principalement ces élèves en fracture numérique ou issus de milieux modestes et qui rencontrent des difficultés pour accéder à l'enseignement à distance qui en ont le plus besoin. L'éducation nationale prévoit-elle de mettre en place une politique spécifique en faveur de ces publics ?
Je veux également insister sur les élèves victimes de violences familiales, qui ne peuvent plus être signalés. Des actions sont-elles menées pour y remédier ?
Enfin, je me fais le porte-parole du sénateur Piednoir, qui demande de clarifier la situation des candidats libres ou hors contrat au baccalauréat.
M. Jean-Michel Blanquer, ministre. - Madame Laborde, le sort des élèves en situation de handicap ou à besoins particuliers est complexe dans la période actuelle. Les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) n'ont pas vocation à aller à domicile. Chaque élève est un cas particulier, et nous avons fait le maximum, avec Sophie Cluzel, pour que les familles se sentent soutenues. Des mesures de souplesse en matière de confinement sont accordées, notamment en faveur des enfants autistes. À la rentrée scolaire, nous aurons plus que jamais besoin des compétences psychologiques, notamment des Rased. Il convient de renforcer la mobilisation de ces compétences.
S'agissant des examens, les jurys de la session de juin-juillet peuvent se prononcer sur les candidats qui émanent d'une institution délivrant un livret scolaire. C'est valable pour l'enseignement public, l'enseignement privé sous contrat et hors contrat. Bien sûr, le jury sera juge de la qualité et du sérieux de ce livret. Cette crise est d'ailleurs l'occasion d'un rapprochement d'une partie du secteur hors contrat avec l'éducation nationale. Nous ne voulons léser aucun élève, être dans la bienveillance de tous envers tous ; les solutions les plus favorables pour passer les examens sont à chaque fois retenues. L'ouverture de la session de septembre aux candidats libres leur offre une solution. Celle-ci ne devrait pas être si chargée, les candidats libres inscrits au CNED possédant un livret scolaire.
Pour ce qui est de l'admission dans l'enseignement supérieur, les commissions rectorales permettront plus largement les ajustements nécessaires.
L'oral du baccalauréat de français, monsieur Lafon, est le seul examen terminal qui demeure, principalement parce qu'il ne fait pas l'objet d'un contrôle continu. Nous souhaitons également envoyer le signal du maintien d'un examen terminal du baccalauréat lorsque les conditions pratiques et sanitaires le permettent. Enfin, pour des raisons pédagogiques, nous incitons ainsi les élèves de première à continuer à travailler. Nous envoyons des signaux à la fois de non-stress et de travail. Bien entendu, si les conditions du retour à la normale après le confinement ne permettent pas d'organiser cet oral, nous pourrions retenir la note de contrôle continu en français ou organiser un oral au cours de l'année scolaire prochaine ; mais nous n'en sommes pas là. Nous avons en outre réduit le nombre de textes à préparer - 15 pour la voie générale, 12 pour la voie technique.
Pour ce qui est des colonies de vacances éducatives, nous souhaitons que la collaboration entre l'État et les collectivités locales permette un certain volontarisme. Les circonstances exceptionnelles autorisent des formes juridiques particulières.
Monsieur Paccaud, l'accueil des enfants de soignants est une préconisation de l'OMS (Organisation mondiale de la santé). Nous suivons les recommandations des autorités de santé concernant les gestes barrières, la distanciation ; c'est pourquoi les groupes sont limités à dix. Environ 30 000 enfants sont accueillis chaque jour. Le port du masque n'est pas considéré comme l'élément principal de protection dans ces circonstances. Néanmoins, dès lors que les masques sont en quantité suffisante pour les personnels soignants, l'éducation nationale en a commandé pour ses établissements.
Concernant les « perdus » du confinement, nous prenons des initiatives pour offrir ou prêter du matériel, en lien avec les collectivités locales et avec les associations, qui prendront une ampleur particulière pendant les vacances de printemps. Nous travaillons avec Julien Denormandie sur cette question, pour utiliser certains moyens au titre de la politique de la ville ou des Cités éducatives.
Nous avons pris à bras-le-corps, avec Adrien Taquet, la question des violences intrafamiliales, dont l'éducation nationale est ordinairement le premier vecteur de signalement. Dans « Ma classe à la maison » figure à présent un bandeau sur le 119 et une nouvelle campagne de sensibilisation a été lancée. Le personnel est appelé à se mobiliser au moindre soupçon.
Je rappelle pour finir qu'une foire aux questions est actualisée en permanence par une cellule de crise sur le site du ministère, les réponses qui y figurent ont valeur de circulaire.
Mme Marie-Pierre Monier. - Mme Claudine Lepage, dont je relaie la question, souhaite savoir si la session de septembre concerne aussi les candidats libres hors réseau de l'AEFE.
J'attire votre attention sur le cas des agriculteurs qui n'ont pas de solution de garde pour leurs enfants. Ceux-ci pourraient-ils être accueillis à l'école ?
Les AESH sont-ils au chômage partiel ? Qu'est-il prévu pour les familles bénéficiant habituellement de leur aide ? Certains, sur la base du volontariat, ont pu garder des élèves. Est-ce envisageable ?
Qu'en est-il du calendrier d'affectation au lycée Affelnet ?
L'école à la maison révèle les inégalités sociales et territoriales. Selon un sondage, 70 % des enseignants redoutent le décrochage des élèves fragiles. Dans la mesure où il est difficile d'aborder de nouvelles notions à distance, que prévoyez-vous à l'issue de la crise pour ces élèves décrocheurs ? Instaurerez-vous des cours spécifiques destinés aux élèves présentant le baccalauréat au rattrapage en septembre ?
Le travail, la mobilisation et l'implication des enseignants sont exemplaires, soulignés par tous. Le temps n'est-il pas venu, monsieur le ministre, de leur montrer notre reconnaissance à travers une véritable revalorisation salariale ? Nous saluons la création de postes adaptés dans le premier degré. Maintenez-vous la suppression de 400 postes dans le secondaire ? Enfin, qu'en est-il du statut des professeurs stagiaires et des affectations dans le second degré ?
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente. - J'élargis la question de Mme Monier sur l'accueil des enfants d'agriculteurs à celui des enfants des agents de La Poste, à l'origine de l'absentéisme souligné hier en audition par Philippe Wahl.
M. Max Brisson. - En dépit de la continuité pédagogique, en particulier pour les plus défavorisés, rien ne remplace l'école. Pour y remédier, vous avez annoncé des stages de remise à niveau pendant les vacances d'été et de printemps. Pouvez-vous nous en dire plus sur leur organisation, leur durée, leur public ? Le dispositif sera-t-il limité en raison de son coût ? Connaissez-vous le nombre d'élèves inscrits à ces stages en zone C et celui des enseignants mobilisés ?
Est-il prévu l'année prochaine une adaptation des progressions pour tenir compte des défauts d'apprentissage ? Les programmes étant désormais construits autour de la notion de cycle couvrant plusieurs années scolaires, n'est-ce pas le cadre approprié pour envisager les indispensables remédiations ?
Finalement, vous pourriez devenir, en ces circonstances douloureuses, le ministre de la reconquête pédagogique du mois de juin dans les lycées, d'une forte instillation de contrôle continu au baccalauréat et d'une scolarité par cycles plus ancrée.
Je conclus par une question de Laure Darcos : les livrets scolaires des établissements hors contrat, rarement numérisés, pourront-ils être consultés sur support papier par les jurys ?
Mme Céline Brulin. - Face à la crainte de l'accroissement des inégalités scolaires, nous saluons l'engagement remarquable des enseignants. Des mesures exceptionnelles doivent être prises. Si je me réjouis de l'annonce de créations de postes et de fermetures annulées en zones rurales, il ne faut pas oublier les milieux urbains. Je soutiens le principe de ne fermer aucune classe en éducation prioritaire. Dans mon département, mais il n'est pas le seul, les mesures d'ouverture et de fermeture conduisent à des effectifs de plus de 25 élèves par classe en éducation prioritaire, où les efforts devront pourtant être accrus. En outre, une réflexion au niveau de la commune du solde entre ouvertures et fermetures pour calculer le taux d'encadrement ignore les inégalités entre les quartiers. Il faudrait privilégier une approche quartier par quartier, voire école par école pour les corriger.
Enfin, concernant l'enseignement à distance, des consignes pédagogiques claires sont-elles données aux équipes de consolider les notions acquises, mais sans en aborder de nouvelles, afin de ne pas renforcer les inégalités scolaires ?
M. Damien Regnard. - Concernant les élèves des établissements d'Asie du Sud-Est passant le baccalauréat cette année, comment sera évalué le contrôle continu, dans la mesure où ils n'ont eu qu'un trimestre de cours ?
Plus de 99 % des établissements à l'étranger sont fermés, certains depuis fin janvier, et aucune réouverture n'est prévue avant la rentrée. Outre la crise sanitaire, ces pays subissent une crise économique considérable, ce qui menace l'équilibre financier des établissements français : à court terme, les parents ne peuvent plus faire face et estiment que l'enseignement à distance ne justifie pas les frais de scolarité demandés pour le deuxième et le troisième trimestres ; à moyen terme se dessine une baisse du nombre de nos ressortissants à l'étranger pour la rentrée prochaine, qui s'annonce donc très difficile, d'autant que nos établissements disposent au mieux de trois mois de trésorerie. J'ai déjà fait part de ce constat préoccupant au directeur de l'AEFE, M. Brochet, ainsi qu'au secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne. Les parents et les chefs d'établissement ont besoin d'être rassurés : le message que tout sera mis en oeuvre pour sauver le réseau doit leur être envoyé.
En attendant, nous nous mobilisons pour trouver des solutions : le sénateur del Picchia a déposé une proposition de loi suggérant de faire appel à la solidarité nationale. De mon côté, je souhaite vous interroger sur la faisabilité de certaines mesures de soutien.
Pour les communautés françaises uniquement, peut-on modifier le calcul des bourses en prenant en compte non pas l'année n-1, mais l'année n, avec un abondement important de l'enveloppe des bourses ?
Peut-on envisager la prise en charge des salaires par le ministère de l'éducation nationale pour les établissements gérés directement (EGD) par l'AEFE et les établissements conventionnés ? Pour les établissements partenaires, dans quelle mesure le code de l'éducation pourrait-il être assoupli pour permettre des subventions de fonctionnement ? Cela pourrait passer par des conventions temporaires avec ceux-ci.
Peut-on envisager la prise en charge par l'État des pensions civiles aujourd'hui réglées par l'AEFE et qui représentent 74 % de la masse salariale ?
Enfin, peut-on suspendre la participation à la rémunération des résidents (PRR) et la participation forfaitaire complémentaire (PFC) perçue par l'AEFE pour 2020 et 2021, ce qui permettrait aux établissements de dégager une trésorerie importante ?
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente. - Une autre question se posait concernant les enseignants affectés à l'étranger rentrés en France sans l'autorisation de leur hiérarchie. Leur situation va-t-elle être régularisée ?
M. Jean-Michel Blanquer, ministre. - Concernant les solutions d'accueil pour les enfants d'agriculteurs, j'approuve évidemment l'inspiration de la question de Mme Monier, mais ce qu'a ajouté madame la présidente au sujet des enfants des salariés de La Poste souligne la difficulté de la situation : de nombreuses professions pourraient légitimement demander à bénéficier du dispositif, mais si on accédait à leur demande, on finirait par rouvrir les écoles, en contradiction avec ce que nous prônons. Le dispositif a déjà été élargi aux enfants des membres des forces de sécurité intérieure, ce qui est déjà assez considérable, car cet accueil est ouvert du lundi au dimanche. Je ne dis pas que ce serait infaisable, mais ce serait ouvrir la boîte de Pandore, au risque de rendre la situation ingérable. À l'origine, je rappelle que nous avons suivi une recommandation de l'OMS visant à faciliter la disponibilité des personnels soignants.
S'agissant des AESH, ils ne sont pas au chômage partiel et continuent d'être rémunérés. L'objectif est qu'il puisse naturellement reprendre leur activité. Certains d'entre eux se sont portés volontaires pour participer aux dispositifs d'accueil et ils percevront à ce titre les primes prévues. Je tiens à signaler que le mécanisme de primes a été conçu postérieurement à l'appel au volontariat, les volontaires se sont donc manifestés spontanément et je tiens à leur rendre hommage.
S'agissant d'Affelnet, le calendrier normal devrait pouvoir être respecté, puisque le dispositif est conçu pour être totalement numérisé. La consigne donnée aux principaux de collège est donc que les professeurs principaux puissent être contactés par les élèves, de même que les conseillers d'orientation. L'objectif est de respecter les délais, afin que les affectations respectent les premiers voeux des familles, dans l'intérêt de tous.
Plusieurs d'entre vous ont demandé comment nous allions gérer les progressions et les éventuels retards dans les apprentissages. Dans cette période, le principe de base - qui est d'ailleurs universel, puisqu'il est appliqué par exemple au Japon ou en Corée du Sud - est la consolidation des savoirs déjà acquis, plutôt que la progression vers de nouvelles connaissances. On n'empêchera pas que certains élèves progressent rapidement dans cette période, parce que leur environnement familial est favorable, quand d'autres stagnent, voire régressent : on essaie de l'éviter, mais il faut être lucide. C'est pourquoi il faut prévoir des mécanismes de remédiation : c'est le sens des stages prévus pendant les vacances de printemps, à distance, et pendant les vacances d'été, en présentiel. Donc, les consignes pédagogiques pour la période actuelle sont claires et nous travaillons à une personnalisation de la remédiation - les mécanismes d'évaluation en début d'année scolaire, pour les élèves de CP, CE1, sixième et seconde, devraient nous y aider, mais nous allons mettre des outils à disposition des enseignants pour l'ensemble des classes. Sur le modèle de ce qui est prévu pour les élèves de CM2, nous étendrons à tous les niveaux de classe la possibilité de stage à la fin du mois d'août, voire pourquoi pas à d'autres moments. Certaines des colonies de vacances que nous proposerons auront également une dimension scolaire sur une petite partie de la journée, mais nous en sommes encore au stade de la réflexion.
En ce qui concerne la revalorisation salariale prévue pour 2021, je tiens à dire que la crise sanitaire ne doit pas avoir pour effet de retarder le traitement des grands dossiers engagés avant son déclenchement, surtout dans un contexte où la population française est amenée à constater le rôle fondamental joué par les enseignants dans notre pays. Nous travaillons donc à cette revalorisation salariale, en lien avec les organisations syndicales, même si nos derniers entretiens étaient plutôt concentrés sur le sujet des examens. Nous avons évidemment besoin de travailler au niveau gouvernemental pour voir plus précisément comment mettre en oeuvre cette revalorisation au vu des circonstances.
Les professeurs stagiaires ont vocation à être titularisés dans les temps. D'une manière générale, notre objectif est de ne pas faire perdre une année aux personnes concernées, qu'il s'agisse des élèves ou des enseignants. Nous aménageons les dispositifs, mais sans les retarder au-delà de l'année scolaire.
Monsieur Brisson, il est évidemment plus pertinent de raisonner à l'échelle d'un cycle concernant les apprentissages et le parcours des enfants doit être adapté à la situation. Nous devons effectivement illustrer cette année l'objectif de la reconquête du mois de juin, que nous nous étions préalablement fixé. Vous avez posé la question des livrets scolaires papier : les jurys statuent de plus en plus sur des livrets numérisés, mais rien ne s'oppose à la prise en compte d'un livret papier. J'en profite pour répondre à la question de Mme Lepage sur les candidats libres hors réseau AEFE : la doctrine est claire, le livret scolaire est le point de repère des jurys ; un candidat libre inscrit au CNED a un livret scolaire. En l'absence de livret scolaire, les candidats devront se présenter à la session de septembre.
Madame Brulin, les évolutions que nous préparons ne lèsent absolument pas les zones urbaines. Concernant l'éducation prioritaire, le nombre maximal de 25 élèves par classe reste la norme et je suis prêt à examiner les cas que vous pourrez me soumettre. Certains secteurs d'éducation prioritaire connaissent une très forte baisse démographique et un principe général de non-fermeture de classes n'aurait pas de sens, ne serait-ce qu'en termes d'équité vis-à-vis d'autres zones d'éducation prioritaire. En revanche, il me paraît faisable de garantir des seuils d'encadrement pour l'éducation prioritaire.
Monsieur Regnard, effectivement, les élèves d'Asie n'ont plus de cours depuis la fin janvier. La majorité d'entre eux se sont inscrits au CNED et ils pourront tous bénéficier des rattrapages nécessaires lorsque la classe reprendra. Je fais totalement confiance aux chefs d'établissement et à leurs équipes pour mettre en place toutes les remédiations nécessaires.
En ce qui concerne l'appui administratif et financier au réseau de l'AEFE, j'ai bien noté vos suggestions. Je vais travailler avec Jean-Yves Le Drian et Jean-Baptiste Lemoyne pour envisager comment soutenir ce réseau. N'ayez aucun doute : nous le considérons comme un joyau qui ne doit pas être abîmé par la crise actuelle. Notre créativité et notre volontarisme devront l'aider à passer le cap. L'ensemble des structures scolaires du monde connaît des difficultés actuellement, c'est peut-être une occasion pour notre réseau de s'affirmer. N'oublions pas que le Président de la République a fixé l'objectif d'augmenter le nombre d'élèves à l'étranger : il ne faut pas renoncer à cette ambition, tout en restant lucide sur les conditions matérielles et financières actuelles. Le ministère des affaires étrangères et le ministère de l'éducation nationale seront amenés prochainement à présenter leur stratégie dans ce domaine.
En conclusion, je tiens à vous informer que nous allons organiser des états généraux du numérique éducatif à la rentrée prochaine, probablement à Poitiers, après avoir organisé des consultations à l'échelle de chaque académie, de façon à tirer les enseignements de la période que nous venons de vivre. Je sais que ce sujet vous intéresse - vous y avez déjà consacré plusieurs rapports et vous ne manquerez pas de produire de nouvelles contributions à la lumière de l'expérience actuelle. L'idée, comme je viens de le dire pour l'AEFE, est d'envisager comment transformer un problème en une opportunité : on voit bien, dans la situation actuelle, que le fait d'avoir un service public national de l'éducation est une force qui permet, grâce à des outils comme le CNED ou Canopé, de développer des solutions à l'échelle nationale, mais aussi de la francophonie.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente. - Cette initiative est tout à fait bienvenue, monsieur le ministre. Vous connaissez ma mobilisation personnelle sur ce sujet : j'ai eu l'occasion de souligner le fait que les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (Inspé) devaient disposer de moyens pour former les formateurs sur ces questions numériques.
Avant de conclure définitivement, je vais redonner la parole à Jacques Grosperrin, puis à Antoine Karam, car je souhaite que nous évoquions la situation dans les outre-mer.
M. Jacques Grosperrin. - Après la période de clivage autour de la réforme du baccalauréat et de celle des retraites, nous assistons à une bonne réaction d'ensemble de la communauté éducative, qui s'est bien adaptée à la situation et sait le faire dans la durée. Nous vous rendons hommage, monsieur le ministre, pour votre action dans ce contexte inédit.
Certains spécialistes s'interrogent sur la possibilité de déconfiner les enfants et de les faire revenir à l'école ; dans la mesure où il faudrait que la population soit immunisée à 60 %, ils estiment que les parents d'enfants en maternelle, qui sont jeunes et en bonne santé, présentent moins de risques. En parlez-vous au niveau interministériel ?
M. Antoine Karam. - Dans les outre-mer, de nombreuses inquiétudes se sont exprimées quant à la continuité pédagogique et à l'aggravation des inégalités scolaires. Ces inquiétudes sont encore plus grandes pour les élèves des sites isolés, qui sont nombreux en Guyane. Monsieur le ministre connaît bien ce territoire où l'enseignement à distance se heurte à une couverture numérique totalement défaillante : les enfants des communes de l'intérieur sont particulièrement touchés. Peut-on envisager de permettre à ces enfants de reprendre tous les éléments du programme à leur retour en classe, puisque les vacances scolaires commencent ce soir ?
J'attire également votre attention sur la situation des enseignants métropolitains affectés sur notre territoire. Nombre d'entre eux souhaiteraient pouvoir rentrer dans l'Hexagone à l'occasion des vacances, en dépit des mesures de restriction des vols. Nous comprenons leur souhait, mais il faut absolument éviter les va-et-vient, étant entendu que l'ensemble des cas de coronavirus recensés dans les outre-mer ont été importés de l'Hexagone. Quel message le ministère entend-il leur adresser ?
M. Jean-Michel Blanquer, ministre. - Monsieur Grosperrin, nous devrons façonner notre doctrine du déconfinement dans les semaines qui viennent. Nous vivons une situation inédite et c'est sur la base, notamment, de comparaisons internationales que nous trouvons des solutions. Un travail interministériel est en cours ; bien évidemment, il suit très exactement les préconisations des autorités de santé. Je ne suis pas en situation de répondre précisément à votre question ; comme vous le savez, Jean Castex est chargé de la coordination interministérielle dans ce domaine. À l'issue de ces travaux, nous aurons une véritable doctrine du déconfinement.
Monsieur Karam, évidemment, nous devons nous adapter à la situation particulière de la Guyane, notamment en ce qui concerne les élèves isolés. Des expériences ont été faites avec des téléphones portables, mais leur portée est forcément limitée : les remises à niveau prévues lors des vacances de printemps seront donc très importantes. Quant aux professeurs originaires de métropole, j'ai été interrogé par le recteur : il convient évidemment de respecter les règles du confinement qui empêchent ce type de déplacement. Je comprends que les professeurs concernés vivent parfois des situations très difficiles, mais la règle du confinement s'impose. Ceux qui sont affectés dans des communes éloignées peuvent faire du soutien scolaire, sur le fameux « temps de six heures », en respectant les gestes barrières. J'ai conscience de la dureté de cette position, mais toute autre décision serait contraire aux directives des autorités de santé.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente. - Un dernier mot pour remercier votre ministère, tous ses personnels administratifs et enseignants, qui doivent faire face à une situation complexe. Je salue également le corps des Dasen avec lesquels les élus ont eu de nombreux contacts ces derniers jours, pour l'établissement de la carte scolaire : ils sont à l'écoute et ne ménagent pas leur temps. Nous sommes à vos côtés, parce que nous devons faire front ensemble, pour la crédibilité de l'éducation nationale, vis-à-vis des familles, mais aussi de ses 12 millions d'élèves.
Nous poursuivrons nos échanges avec vous, mais aussi avec Didier Guillaume, pour l'enseignement agricole, et avec Jean-Yves Le Drian, pour les établissements français à l'étranger.
M. Jean-Michel Blanquer, ministre. - Je vous remercie d'avoir salué le travail merveilleux réalisé par l'ensemble des personnels de l'éducation nationale dans cette période difficile. Si la situation actuelle permet de renforcer l'osmose entre l'éducation nationale et la société française, ce ne peut qu'être positif pour le pays.
Audition de M. Franck Riester, ministre de la culture
Jeudi 16 avril 2020
___________
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Après avoir entendu Frédérique Vidal et Jean-Michel Blanquer, notre commission poursuit cette semaine ses travaux de contrôle sur l'impact de la crise sanitaire dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Monsieur le ministre, au nom des membres de cette commission, mais aussi de tous les acteurs du secteur qui nous font part de leurs préoccupations, je tiens à vous remercier de vous présenter devant nous. Comme vous le savez, cette audition est ouverte à la presse et fera l'objet d'un compte rendu qui sera publié sur le site internet du Sénat.
La crise sanitaire du Covid-19 frappe particulièrement durement le monde culturel : salles de spectacle, musées, monuments, lieux d'exposition, festivals et galeries d'art sont fermés jusqu'à nouvel ordre et le resteront probablement bien au-delà des premières mesures de déconfinement. De plus, beaucoup d'actions culturelles et sociales ne peuvent avoir lieu à l'école et dans d'autres lieux. Cette situation est d'autant plus dramatique que, au-delà de la valeur ajoutée qui lui est propre, la culture est un secteur pivot de notre économie, qui fait vivre tant d'autres entreprises. Mais je n'oublie pas que les premières victimes de cette situation sont les créateurs - les artistes-auteurs -, qui font face à une diminution drastique, quand elle n'est pas totale, de leurs revenus. Ils méritent une attention particulière.
Il est nécessaire d'accompagner très étroitement ce secteur : d'abord, pour répondre à l'urgence actuelle ; ensuite, pour garantir les conditions d'une véritable relance lorsque l'activité pourra reprendre. Prenons garde à ne laisser personne de côté, ni à oublier des « trous dans la raquette », ce qui n'est pas évident dans un secteur où les acteurs présentent autant de spécificités, même les uns par rapport aux autres.
J'ajoute que les acteurs culturels ont besoin de visibilité et d'anticipation, essentielles dans un secteur où la programmation est au coeur de leur fonctionnement. Sur ce sujet, il subsiste encore beaucoup trop d'imprécisions. J'espère que cette audition sera l'occasion de lever certaines d'entre elles.
J'en viens aux médias.
Avec la crise, les Français, y compris les plus jeunes, retrouvent goût à regarder la télévision et à écouter la radio. Je souhaite rendre hommage à toutes les équipes des chaînes publiques et privées qui assurent une information de qualité et proposent également des divertissements, de la culture et de l'éducation. Jamais la chaîne de la connaissance, France 4, n'avait aussi bien justifié sa mission.
L'avenir des médias était au coeur de l'examen du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle, engagé à l'Assemblée nationale il y a un mois. Qu'adviendra-t-il du calendrier de cette loi ? Ce texte est-il menacé, comme on a pu le lire dernièrement dans la presse ? Plus fondamentalement, le projet de loi ne doit-il pas évoluer pour tenir compte des leçons de la crise sanitaire ?
En matière d'industries culturelles au sens large, la crise pourrait renforcer des tendances longues déjà à l'oeuvre, à commencer par la mainmise des grandes plateformes sur des pans entiers de notre créativité et de notre démocratie. La presse n'est plus consultée qu'en ligne, ce qui conforte la position de Google et Facebook, déjà prédateurs dans le marché publicitaire. Les films ne sont plus visionnés que sur les services de vidéo, largement dominés par Netflix, Amazon, Disney et d'autres. Or il faut assurer la survie de nos champions nationaux et européens et garantir que, dans le monde d'après, ils bénéficieront d'un cadre adapté à leur développement.
Après une présentation liminaire du ministre, nous aborderons successivement la création et le patrimoine, puis les médias et les industries culturelles. À chaque fois, nos rapporteurs pour les missions et programmes budgétaires relatifs à leurs domaines poseront des questions au ministre et, après les réponses de celui-ci, les orateurs des groupes politiques pourront à leur tour l'interroger.
M. Franck Riester, ministre de la culture. - J'accorde une grande importance à cette audition, qui me permet de répondre à vos interrogations. Je ne pourrai pas, au demeurant, apporter toutes les réponses, car cette crise est inédite, et les moyens d'en sortir le seront aussi. La situation invite à l'humilité et au pragmatisme.
Le Gouvernement a souhaité apporter une réponse rapide et massive à la crise, pour protéger nos compatriotes de ses conséquences par des mesures de portée générale : prêts garantis par l'État, accès au chômage partiel, fonds de solidarité, reports de charges et bien d'autres dispositifs encore. Avec Muriel Pénicaud, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et Christophe Castaner, sous l'autorité du Premier ministre, j'ai fait en sorte que les problématiques des structures et professionnels qui dépendent de mon ministère - artistes, intermittents, festivals et orchestres, qui constituent le tissu entrepreneurial et associatif - soient prises en compte. Nous avons ainsi obtenu que le fonds de solidarité, dont le montant a été porté de 1 milliard à 7 milliards d'euros, prenne en compte le caractère irrégulier de la rémunération des artistes-auteurs. Bruno Le Maire a accepté que, pour ces professionnels, la moyenne des revenus sur les douze derniers mois soit retenue, au lieu de la référence au mois correspondant de l'année précédente. Nous avons également mis en place des dispositifs spécifiques via le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), le Centre national de la musique (CNM), le Centre national du livre (CNL) et le Centre national des arts plastiques (CNAP), pour accompagner les plus petits acteurs du secteur, touchés de plein fouet par la crise.
À l'invitation du Président de la République, nous devons également préparer le déconfinement. Le fait qu'il sera probablement plus tardif pour le secteur de la culture justifie un plan de relance spécifique, qui sera élaboré en concertation avec Bruno Le Maire et Gérald Darmanin.
Au-delà des problèmes économiques et sociaux, il faut prendre en compte la dimension psychologique majeure de la crise, qui engendre des situations terribles. C'est pourquoi nous devons donner de l'espoir et imaginer le monde de la culture de demain. L'État, les collectivités territoriales, qui font un travail remarquable, le Parlement, en premier lieu le Sénat, toutes les forces vives de ce pays doivent se mobiliser pour la culture, qui n'est pas seulement une économie, mais un moyen de mieux vivre individuellement et collectivement, de se rassembler pour partager des émotions communes et de donner du sens à la relance de notre pays.
En répondant à vos questions, je détaillerai les leviers que nous comptons actionner à très court terme, notamment en faveur du théâtre privé, des pigistes, des associations, de l'audiovisuel, du cinéma ou des orchestres.
Mme Sylvie Robert. - L'annulation en cascade des festivals était attendue : le Président de la République l'a annoncée, indiquant que les festivals à public nombreux prévus avant la mi-juillet ne pourraient avoir lieu. Comment se matérialisera l'interdiction ? Les préfets prendront-ils des arrêtés ? Qu'en sera-t-il après la mi-juillet ? Comme la présidente de notre commission l'a souligné, les organisateurs ont avant tout besoin de visibilité et d'anticipation. Le Gouvernement doit nous indiquer s'il envisage une décision au niveau national, si la clause de force majeure sera activée pour protéger les organisateurs et si les collectivités territoriales seront accompagnées.
Dans un entretien donné ce matin, vous avez jeté un trouble en annonçant que certains « petits » festivals pourraient avoir lieu après le 11 mai : qu'est-ce qu'un petit festival et à qui appartiendra-t-il de le définir ? Y aura-t-il un cadrage national ou laisserez-vous à chaque territoire, via les directions régionales des affaires culturelles (DRAC), le soin de garantir la sécurité des artistes, des organisateurs et des publics ?
L'État a lancé des dispositifs pour aider la culture, mais les collectivités territoriales aussi, notamment les régions, avec les plans d'urgence, et les métropoles. Comment s'articuleront ces initiatives ?
Pouvez-vous confirmer que les dispositifs d'activité partielle sont cumulables avec les aides publiques ?
Enfin, concernant les services non faits, les ordonnances prises par le Gouvernement permettent que les subventions prévues au titre des projets culturels accompagnés par les collectivités territoriales et l'État soient versées. L'État-culture joue le jeu, les collectivités aussi même si certaines résistent. En revanche, nous avons été informés que le ministère de l'éducation nationale n'avait pas garanti aux artistes-auteurs intervenant en milieu scolaire qu'ils recevraient les subventions promises.
Je m'interroge sur la situation des artistes-auteurs, en particulier les artistes visuels. Sur les 2 millions d'euros versés au CNAP par le ministère, 500 000 euros iront aux artistes-auteurs, alors qu'ils représentent 70 % du total des artistes. Les arts visuels méritent un effort particulier, d'autant que les critères d'accès au fonds de solidarité et aux dispositifs de référence ont été élargis. La transition de leur régime social vers l'Urssaf aura-t-elle lieu en juin comme prévu ?
Je prends acte de l'annonce d'un plan de relance pour la culture et vous remercie du travail que vous avez mené avec Muriel Pénicaud pour les intermittents ; cependant, certaines questions demeurent en suspens, notamment pour les primo-entrants dans le régime. Les intermittents, qui souffrent beaucoup pendant cette période, feront-ils l'objet de dispositions complémentaires ?
M. Alain Schmitz . - J'interviens au nom de Philippe Nachbar, rapporteur pour avis des crédits du programme « Patrimoines », qui ne pouvait participer à cette réunion.
En ce 16 avril, nous revient en mémoire la sidération éprouvée voilà un an exactement devant Notre-Dame de Paris livrée aux flammes. Or l'épidémie a conduit à une nouvelle interruption du chantier de reconstruction. Quand les travaux reprendront-ils ? Les retards affecteront-ils le calendrier ? N'oublions pas non plus les autres chantiers de restauration à l'arrêt. Tout cela nourrit de vives inquiétudes autour des entreprises de restauration du patrimoine, un secteur très fragile. Comment allez-vous les accompagner ? Ne peut-on envisager dès aujourd'hui la mise en place d'un taux de TVA réduit sur les travaux de restauration ?
Il est à craindre que les crédits du programme 175, « Patrimoines », ne soient pas intégralement consommés en 2020. Peut-on accélérer le rythme de consommation au second semestre et relever le taux de participation de l'État aux projets de restauration des collectivités territoriales, quelle que soit leur taille ? Ce serait un bon moyen d'assurer la consommation des crédits, de soutenir les entreprises et d'accompagner les collectivités territoriales.
Enfin, nous sommes préoccupés par la situation des établissements culturels : musées, monuments, sites touristiques. Les petits musées, déjà fragiles, sont tout aussi touchés que les grands opérateurs, dont les ressources propres sont très supérieures aux subventions perçues ; or le manque à gagner pour eux en billetterie, en produits dérivés, en activités annexes comme en valorisation du patrimoine est considérable.
Nous sommes particulièrement inquiets de la situation du Centre des monuments nationaux (CMN), déjà fragile avant la crise, qui attendait beaucoup de l'ouverture prévue de l'Hôtel de la Marine. Prévoyez-vous un plan de soutien spécifique pour les établissements culturels relevant du programme 175 ou traiterez-vous ces établissements au cas par cas, et selon quels critères ?
M. Franck Riester, ministre. - Concernant les festivals, nous partageons l'émotion de nos compatriotes, des organisateurs, des artistes qui devaient se produire, des bénévoles et salariés face aux annulations. C'est un arrache-coeur pour notre pays, l'un des champions mondiaux des festivals ; nous avions tous l'habitude de nous rendre au cours du printemps et de l'été à ces rendez-vous, dont l'annulation est un choc collectif. Je mesure les conséquences financières directes et indirectes - pour le tourisme, les restaurants, les bars, les hôtels -, mais aussi sociales, humaines et psychologiques, car, pour de nombreux artistes, ce sont des semaines, des mois, voire des années de travail qui sont remis en cause.
À cela s'ajoute le fait que certains festivals comme Cannes ou Avignon sont des places de marché. Il faudra trouver une organisation différente cette année, en lien avec la direction de ces festivals, pour éviter que la saison ne soit sacrifiée. Avignon, en particulier, irrigue la vie culturelle de nos territoires.
Dans ces conditions, comment accompagner les festivals, soit dans leur transformation en événements plus compatibles avec les conditions sanitaires, soit dans leur maintien en l'état ?
Je commencerai par m'expliquer sur la notion de petit festival. Le Président de la République a annoncé que le déconfinement commencerait le 11 mai ; la restauration, l'hôtellerie, les arts et spectacles verront ce déconfinement plus étalé dans le temps que les autres secteurs d'activité. Les grands rassemblements, notamment les grands festivals prévus avant la mi-juillet, ne pourront se tenir. Certains festivals prévus après cette date seront peut-être annulés eux aussi : l'annulation des Vieilles Charrues, à Carhaix, a d'ores et déjà été annoncée par la direction du festival. En revanche, des festivals de dimensions plus modestes pourront peut-être se tenir avant la mi-juillet. Nous évaluerons dans les semaines qui viennent, en concertation avec les autorités de santé, les organisateurs, les artistes, les collectivités territoriales, la possibilité de les maintenir. Les normes sanitaires, la jauge, la configuration des lieux devront être déterminées, mais aucune réponse ne sera imposée depuis Paris au niveau national.
Nous avons deux obsessions : la sécurité des artistes, des techniciens, des organisateurs, du public et un retour aussi rapide que possible des artistes devant leur public. C'est pourquoi nous avons créé une cellule d'accompagnement des festivals, qui recensera les problématiques, évaluera les normes de sécurité, les mesures de distanciation sociale, les gestes barrières à adopter, etc. Ces éléments seront synthétisés, partagés avec les collectivités, remontés aux cellules interministérielles de crise pour trouver au cas par cas les meilleures solutions possibles. Une réponse uniforme serait en contradiction avec la diversité des festivals. Les dispositifs seront réévalués au fil du déconfinement.
Les collectivités territoriales ont joué le jeu de l'accompagnement financier et continueront de le faire ; l'État sera lui aussi au rendez-vous, sur le plan financier, mais aussi administratif, notamment pour faire en sorte qu'une annulation soit la moins brutale possible. L'accompagnement sera assuré en concertation avec le ministère de l'intérieur et les cellules interministérielles de crise, en lien avec les préfets départementaux. Si un festival prévu avant le 15 juillet satisfait aux normes de sécurité sanitaire, qui seront progressivement définies, que la faisabilité financière et opérationnelle est garantie, que les collectivités, organisateurs et artistes y sont favorables, il pourra avoir lieu.
Je travaille en permanence avec les collectivités : le 2 avril, j'ai réuni le Conseil des territoires pour la culture (CTC) et j'ai demandé aux DRAC d'organiser dans un délai de quinze jours des conseils locaux pour la culture dans leur territoire, pour que les décisions soient partagées au plus proche du terrain.
Je confirme que les entreprises et associations culturelles pourront bénéficier du dispositif de chômage partiel, même si elles reçoivent des subventions publiques.
Concernant le service non fait, vous avez rappelé, madame Robert, la doctrine de mon ministère. J'échange régulièrement avec mon collègue Jean-Michel Blanquer sur le sujet. Nous considérons que les engagements pris doivent être tenus par l'État, mais cela concerne aussi les grands opérateurs et grandes institutions majoritairement subventionnés par l'État. Je sais que les collectivités territoriales s'inscrivent elles aussi dans ce principe.
Le fonds réservé par le CNAP aux artistes-auteurs n'est qu'une première étape. Il n'a pas encore été intégralement utilisé : j'invite les artistes à se rapprocher du CNAP et à constituer des dossiers. Le fonds de solidarité peut lui aussi les accompagner, puisque les conditions d'accès ont été adaptées à leurs spécificités.
Nous n'oublions pas les intermittents qui n'ont pu effectuer le nombre minimal d'heures annuel à cause du confinement et des annulations. Nous travaillons avec le groupe de protection sociale Audiens à la création d'un fonds spécifique pour ce public, afin d'éviter, pour reprendre l'expression de Mme Morin-Desailly, les trous dans la raquette. Personne ne sera laissé de côté. Cette crise aura inévitablement des conséquences, mais elles doivent être les moins dures possibles. Nous mesurons notre chance de posséder, en France, des dispositifs pérennes de protection sociale en cas de crise. Le Gouvernement est mobilisé pour, coûte que coûte comme l'a dit le Président, amortir les conséquences pour le secteur culturel.
Le patrimoine, c'est un tissu de professionnels, propriétaires, bénévoles, artistes, institutions - musées, sites patrimoniaux, bibliothèques, archives, architectes -, un réseau exceptionnel touché de plein fouet par la crise. Nous veillerons à ce que les chantiers des monuments historiques reprennent le plus vite possible, mais avec toutes les garanties nécessaires à la protection de ceux qui y travaillent. Pour le chantier de Notre-Dame de Paris, la direction générale des patrimoines, les ministères du travail et de la transition écologique et solidaire, les organisations syndicales, l'établissement public, les représentants des entreprises travaillent à un cahier de préconisations. Une reprise de ce chantier emblématique pourrait avoir un effet d'entraînement sur celle des chantiers de restauration partout en France.
Monsieur Schmitz, il faut faire preuve de prudence quant à d'éventuelles réorientations budgétaires. Je ne peux dire dès aujourd'hui où des économies pourront être dégagées, d'autant que le ministère va mobiliser un important budget pour sortir de la crise, notamment en matière patrimoniale. Le plan de relance est en cours d'élaboration pour accompagner ce secteur très important au niveau territorial, puisqu'il nourrit l'activité du bâtiment, le tourisme, la restauration et l'hôtellerie.
Il n'y a pas de politique d'ensemble pour les établissements comme le CMN qui dépendent du ministère de la culture. J'étais en ligne aujourd'hui avec Jean-Luc Martinez, président-directeur de l'établissement public du musée du Louvre, et Catherine Pégard, présidente de l'établissement public du château de Versailles. Ces deux institutions accumulent des pertes très importantes. Il faudra travailler au cas par cas, en fonction de la situation et des modèles de financement.
Mme Catherine Dumas . - Les quatorzièmes Journées européennes des métiers d'art, prévues au mois de mars, devaient célébrer les artisans aux mains d'or. Comment l'Institut national des métiers d'art aidera-t-il ces trésors vivants que sont nos artisans, seuls ou dans une TPE ou PME ? Vous avez évoqué un plan d'aide.
Nous sommes très sollicités par les organisateurs de festivals, qui souffrent de l'incertitude et attendent de l'État des décisions sur la saison estivale. Beaucoup de mesures économiques et humaines doivent être prises au plus vite.
Mme Françoise Laborde . - Depuis un ou deux ans, les festivals ont eu à pâtir d'exigences préfectorales assez hétérogènes en matière de sécurité. À ces exigences en termes de sécurité « sécuritaire » viennent désormais s'ajouter des impératifs liés à la sécurité sanitaire. Sans cadre national, il y a un vrai danger pour les festivals. Les collectivités sont amenées à mettre en balance les enjeux culturels et touristiques et la gestion sanitaire. Compte tenu du principe de précaution, beaucoup de festivals petits, moyens ou gros ont déjà fait le choix de l'annulation.
Mme Colette Mélot . - Je souhaite insister sur les acteurs de la culture qui, n'étant ni salariés, ni intermittents, ni indépendants, ne bénéficient d'aucun dispositif d'aide. Ce sont en particulier les intermittents employés à titre dérogatoire et ceux qui relèvent des établissements publics en régie directe, notamment les orchestres ; les éditeurs, très durement touchés ; les jeunes musiciens qui voulaient entrer dans l'intermittence cette année. Toute la chaîne est menacée. Comment adapter aux professionnels de la culture les dispositifs d'urgence, notamment les délais de paiement des échéances sociales et fiscales ?
Mme Sonia de la Provôté . - La situation des petits musées est analogue à celle des petits festivals : certains pourraient rouvrir dès le 11 mai. Les questions qui se posent sont elles aussi les mêmes : y aura-t-il une jauge limite ? Il est nécessaire de fixer des critères afin d'éviter que le flou ne s'installe.
Quand rouvriront les conservatoires et écoles d'art ? Une partie de leur activité relève des collectivités, et non du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Quelle est la doctrine du ministère de la culture à ce sujet ? À quelle échéance les actions d'éducation artistique et culturelle reprendront-elles une fois les écoles rouvertes ?
Enfin, un bilan provisoire de l'état des chantiers patrimoniaux a-t-il été établi ? Pourquoi ne pas profiter de cette période pour mettre en place une programmation accélérée à destination des innombrables entreprises d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'oeuvre, ainsi que des collectivités ?
M. Jean-Raymond Hugonet . - Afin de renouveler le statut des intermittents, vous avez neutralisé la période allant du 15 mars à la fin du confinement dans le décompte des heures. Cependant, cette mesure n'a pas dissipé les inquiétudes : un grand nombre de spectacles prévus entre le 4 et le 15 mars ont été annulés après l'interdiction des rassemblements, et l'été sera lui aussi très perturbé ; or le printemps et l'été sont les périodes les plus propices au travail pour les intermittents.
Pouvez-vous envisager les mesures suivantes : prolonger d'un an les droits des intermittents, neutraliser la période de confinement pour ceux qui voulaient présenter leur première demande d'intermittence et, enfin, créer un fonds provisoire pour les intermittents, sur le modèle de celui de 2004-2005 créé après la modification des règles de l'assurance chômage en 2003 ?
Mme Sylvie Robert . - Ma collègue Marie-Pierre Monier m'a confié deux questions sur le patrimoine. Ce secteur, qui comprend en particulier les musées, fera-t-il l'objet d'un plan de soutien et de relance spécifique ? Comment le Gouvernement compte-t-il aider nos 10 000 guides-conférenciers, souvent non éligibles au chômage partiel ?
Je reviens sur les festivals, à la situation desquels je suis particulièrement sensible. Peut-on vraiment imaginer que, d'ici à la fin août, un festival de grande ampleur pourra se tenir ? Je n'en suis pas certaine. D'ailleurs, plusieurs pays européens, comme la Belgique, sont en train d'interdire ces grands rassemblements. Dès lors, un cadre national doit être instauré qui offre de la visibilité aux organisateurs et leur permette d'annuler sans difficulté. Vous savez dans quelles conditions le festival des Vieilles Charrues a pris sur lui, sans arrêté ni aucune autre disposition, de ne pas se tenir cette année.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Nombreux sont les festivals, petits et grands, à vivre des moments extrêmement difficiles - pas seulement dans le champ des musiques actuelles ; je pense au festival d'Avignon et au festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence.
M. Franck Riester, ministre. - Annuler tous les festivals jusqu'à la fin août serait sans doute plus facile. Les territoires ont une demande forte de visibilité et d'accompagnement, mais ils sont nombreux à attendre aussi de l'espoir : nombre d'élus et d'artistes aimeraient essayer de tenir leur festival, dans le respect des consignes du moment. Acceptons que cette question soit réglée au cas par cas.
Le Président de la République a offert une visibilité : les grands festivals seront annulés au moins jusqu'à la mi-juillet. Pour ce qui est des Vieilles Charrues, de longues discussions se sont tenues avec les organisateurs ; ils ont pris une décision, que nous allons accompagner sur le plan administratif.
Le Sénat ne peut pas attendre du Gouvernement qu'il impose des décisions unilatérales sans tenir compte des réalités de terrain. Nous proposons non pas une mesure nationale, mais une décision au cas par cas. Si, au vu des paramètres financiers et d'organisation, un festival espère pouvoir se maintenir, donnons aux organisateurs les moyens d'essayer. Au vu des modalités de déconfinement, il faudra voir quelles jauges permettent de garantir que les conditions de sécurité sanitaire peuvent être satisfaites : une fosse avec 3 000 personnes n'est pas imaginable, mais, dans le cadre d'un petit festival rural, un musicien pourrait peut-être jouer devant cinquante personnes respectant les consignes de sécurité, à commencer par l'espacement d'un mètre.
En somme, il s'agit de ménager une souplesse, sans prendre le moindre risque pour les artistes ni les publics et en faisant toujours preuve de compréhension à l'égard des festivals. Ainsi, l'État sera au rendez-vous pour soutenir Solidays, autour duquel un formidable élan s'organise. Plus largement, un référent spécialement chargé des festivals a été nommé au sein de chaque DRAC. Les CTC régionaux dont j'ai parlé doivent aussi s'approprier ces questions. Les préfets, en liaison avec les autres acteurs de l'État, s'efforceront d'accompagner les festivals aussi bien que possible.
Si certains festivals peuvent avoir lieu, tout le monde en sera heureux ; ceux qui ne pourront se tenir seront accompagnés.
S'agissant des musées et autres sites patrimoniaux, j'ai décidé de créer une cellule « Patrimoine », chargée de collecter toutes les interrogations. En liaison avec les collectivités territoriales, nous accompagnerons de notre mieux les différents acteurs. Musée par musée, il faudra apprécier les possibilités d'organisation des équipes et d'accueil des publics.
Madame Dumas, nous travaillons avec l'Institut national des métiers d'art sur un plan spécifique à ce secteur, dont la préparation avance bien, en partenariat avec les fondations partenaires ; je tiendrai le Sénat au courant des progrès dans ce domaine.
J'ajoute que les conservateurs-restaurateurs sont éligibles au fonds de solidarité de 7 milliards d'euros, lequel bénéficie aussi aux artistes-auteurs. Je suis très attentif à la mise en oeuvre opérationnelle de ce dispositif : pour ces derniers, j'ai moi-même constaté une difficulté sur le site de la direction générale des finances publiques (DGFiP), que nous avons levée en liaison avec le ministère des finances. De même, pour les intermittents du spectacle, nous avons résolu un problème de délai sur le site de Pôle emploi. Je tiens à aller jusqu'à ce niveau de détail, pour éviter tout hiatus entre les explications que je vous donne et le quotidien des personnes concernées.
Pour celles et ceux qui n'entrent pas dans le dispositif d'intermittence, madame Mélot, nous travaillons à mettre en place un fonds de professionnalisation.
Madame de la Provôté, pour les conservatoires comme pour les petits musées, il nous faut examiner avec les collectivités territoriales les modalités qui permettraient leur réouverture.
Plus généralement, je suis attaché à un cadre national en matière de politiques culturelles, mais l'adaptation aux territoires est nécessaire. On ne peut pas à la fois soutenir la décentralisation, ce qui est mon cas, et refuser aux préfets la souplesse qui permet de décider localement, en partenariat avec les acteurs.
En tout cas, croyez bien que, grâce au dispositif que nous avons instauré - cellule nationale et cellules régionales -, toutes les informations me parviennent. Je suis donc au fait de presque tous les problèmes spécifiques que rencontrent les acteurs de la culture.
Monsieur Hugonet, je vous confirme que celles et ceux dont les droits arrivent à échéance après le 1 er mars bénéficieront d'une prolongation pendant la période d'application des mesures de restriction d'activité. Pour l'instant, on considère que la crise sanitaire se terminera non pas le 11, mais le 31 mai ; dans le cadre de l'affinement du travail autour du déconfinement, on verra s'il convient de différer la fin de cette période de référence. Pour ce qui est d'une éventuelle prolongation d'un an, nous verrons s'il convient de l'intégrer dans le cadre du plan spécifique que nous élaborerons avec Gérald Darmanin et Bruno Le Maire.
S'agissant des travaux, si les programmes peuvent être accélérés dans le respect des règles patrimoniales et environnementales, nous y sommes favorables.
Quant aux guides-conférenciers, ils sont intégrés au dispositif des indépendants.
J'ajoute que, pour le spectacle vivant hors musique, soit essentiellement le théâtre privé non subventionné, nous sommes en train de finaliser, en liaison avec la Ville de Paris, un plan que l'État abondera à hauteur d'au moins 5 millions d'euros ; il sera géré par l'Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP). J'invite toutes les collectivités territoriales qui le souhaiteraient à s'y associer, car ce plan bénéficiera aux théâtres privés de l'ensemble du pays.
Enfin, après le succès de la plateforme #Culturecheznous, dont nous lancerons la semaine prochaine la deuxième phase, avec plus de 500 institutions et 700 projets, l'accès à la culture par le numérique sera l'une des dimensions du plan global de sauvegarde et de développement de la culture dans les semaines et les mois qui viennent. S'il est essentiel que le public retrouve, le moment venu, le contact physique avec les oeuvres et les artistes, nous pouvons tirer parti de cette période pour amplifier l'accès à la culture pour tous grâce au numérique.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - En effet, il faudra tirer tous les enseignements de la digitalisation accélérée de notre monde dans cette période.
S'agissant des festivals, vous avez insisté sur la prise de décision locale et la responsabilisation des acteurs de terrain, mais n'oublions pas que les grands festivals dépendent d'artistes internationaux, et qu'il n'est pas toujours possible de décider de manière autonome.
Par ailleurs, c'est en ce moment que les acteurs culturels travaillent à la reprise des saisons en septembre ou octobre. L'Académie de médecine allemande vient de préconiser la fermeture des salles pour une durée pouvant atteindre dix-huit mois. Plutôt que de nourrir de faux espoirs ou de laisser planer l'incertitude, essayons de renseigner les acteurs au plus tôt, quitte à envisager des reprises partielles.
Enfin, pouvez-vous nous confirmer que les aides pour le chômage partiel peuvent être cumulées avec les subventions pour charges fixes ? Il s'agit d'une préoccupation très importante des structures culturelles, lesquelles recourent d'ailleurs au chômage partiel de manière très responsable.
M. Franck Riester, ministre. - Même quand elles perçoivent des subventions, les associations ont accès au chômage partiel.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Quid des établissements publics de coopération culturelle (EPCC) ?
M. Franck Riester, ministre. - Le cumul n'est pas possible pour les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) lorsqu'ils perçoivent une majorité de subventions publiques, non plus que pour les entreprises publiques ; pour les EPCC, je pense qu'il l'est, mais je dois m'en assurer.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Au-delà de la forme juridique, associations et EPCC recouvrent une même réalité.
M. Franck Riester, ministre. - Par ailleurs, je suis d'accord avec vous sur la nécessité d'anticiper, mais les données sanitaires ne sont pas toujours évidentes. Nous y verrons plus clair quand les établissements nous auront transmis leurs problématiques autour de la mise en place des mesures de protection, notamment de distanciation. Nous examinerons avec les autorités sanitaires les moyens de maintenir un certain nombre de rassemblements publics.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Il serait bon que ce travail soit fait sous quinze jours, dans le cadre de la préparation du plan de déconfinement, car le temps presse.
M. Franck Riester, ministre. - Vous avez raison.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Nous passons aux questions sur les médias et les industries culturelles.
M. Jean-Pierre Leleux . - La crise sanitaire a eu un effet immédiat sur le marché publicitaire, donc sur les ressources de la presse écrite, des chaînes privées et, dans une moindre mesure, des chaînes publiques. La dégradation de la situation des comptes de ces entreprises, violente et durable, risque d'être fatale à certaines.
Pour faire face à cette situation inédite, les professionnels envisagent deux types de mesures. D'une part, un crédit d'impôt communication pourrait être instauré ; plafonné et limité dans le temps, il permettrait d'accompagner la reprise. Le Gouvernement est-il prêt à étudier le principe d'une telle aide ? Quand pourrait-elle entrer en vigueur ? D'autre part, les chaînes privées considèrent qu'il faut réinterroger le modèle de financement mixte de l'audiovisuel public, afin de réserver la publicité aux acteurs privés, dont elle est l'unique ressource. Entendez-vous cet argument ?
Par ailleurs, comment envisagez-vous la suite de la réforme de l'audiovisuel, dont la crise sanitaire a chamboulé le calendrier ? L'examen du projet de loi reprendra-t-il prochainement, éventuellement avec un périmètre modifié ? La crise ne justifie-t-elle pas d'aller plus loin, par exemple dans la modernisation réglementaire en matière de production et de publicité, que nombre d'acteurs trouvent un peu trop timorée ?
Notre commission a toujours considéré la réforme du financement de l'audiovisuel public comme une composante à part entière de la réforme audiovisuelle. Vous l'aviez annoncée pour 2021 au plus tard : ce calendrier est-il toujours d'actualité ou la réforme sera-t-elle reportée après 2022 ?
M. Michel Laugier. - Alors que la presse montre, dans le contexte de la crise, qu'elle est plus que jamais indispensable pour combattre la prolifération des fausses informations et messages douteux sur internet, l'augmentation du temps passé par nos concitoyens devant les médias d'information profite pour l'essentiel aux médias en ligne et versions web des publications, dont la fréquentation a doublé.
Avec une chute des ventes de 40 % et le quasi-tarissement des recettes publicitaires, la presse, notamment locale, voit ses ressources s'effondrer. Résultat : certains journaux menacent de faire faillite. De surcroît, Presstalis semble dans une situation désespérée. Sans parler du problème des abonnements : nous comptons sur vous pour obtenir du président de La Poste que l'amélioration se confirme en la matière.
Quelles aides permettraient-elles de soulager la presse à court et moyen terme ? Est-il envisageable d'attribuer plus rapidement les crédits inscrits en loi de finances ? Le collectif budgétaire les augmentera-t-il massivement ? J'apporte bien évidemment mon soutien à avec Jean-Pierre Leleux sur la nécessité d'un crédit d'impôt.
Par ailleurs, où en est-on dans le choix d'une solution pérenne pour Presstalis, alors que deux options restent sur la table ? Les assurances que vous avez données aux marchands de presse vont dans le bon sens, mais il faut aller plus loin pour régler un problème qui a trop longtemps duré et ainsi garantir la chaîne de distribution.
Mme Françoise Laborde . - Alors que, plus que jamais, lecture, musique et films font partie de notre quotidien, il est vital de préserver la richesse de notre culture.
Les auteurs forment une profession éclatée et fragilisée économiquement. Aujourd'hui, du fait de leurs conditions de rémunération spécifique, ils entrent difficilement dans les aides générales. Le choix a été fait de déléguer l'attribution des aides, notamment à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) et au Centre national du livre (CNL) : que deviendront ces dispositifs spécifiques si, comme vous l'avez annoncé, tous les auteurs sont couverts par le fonds de solidarité ?
Alors que le secteur du cinéma est à l'arrêt, toute la chaîne de production est touchée. L'article 17 de la loi du 23 mars 2020 assouplit de manière temporaire les règles de la chronologie des médias. D'autre part, le CNC a pris des mesures pour aider le secteur, mais au prix du creusement de son déficit, qui pourrait dépasser 100 millions d'euros, compte tenu aussi des baisses de recettes. Comment comptez-vous soutenir le redémarrage du cinéma et de la production ?
Enfin, je suppose que l'année de la BD sera étendue à 2021. D'ailleurs, dans le contexte actuel, nombre d'auteurs s'efforcent de mettre en valeur leur art, notamment par le biais de l'éducation nationale.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Dès l'annonce de la suppression de France 4, notre commission s'est mobilisée en faveur d'un moratoire, au nom notamment de la couverture du territoire. Or, depuis le début de la crise, cette fréquence est remarquablement utilisée par l'audiovisuel public, notamment à destination des enfants privés d'accès au numérique. Du coup, certains députés de la majorité se mettent à leur tour à plaider pour un moratoire. Que se passera-t-il après le 9 août ?
M. Franck Riester, ministre. - Vos interventions illustrent l'étendue des chantiers qui sont devant nous pour sauver le monde de la culture, de la presse, des médias et du cinéma. En particulier, la baisse des recettes publicitaires est dramatique - j'en parlais, plus tôt dans la journée, avec des représentants des radios associatives locales.
Dans ce contexte, notre tâche est colossale et nécessitera une grande énergie, dans l'union nationale. Je mesure l'attente d'une mobilisation de l'État, mais j'insiste sur la nécessité de nous serrer les coudes, dans un esprit constructif et de rassemblement, pour relever ces défis sans précédent dans un passé récent. La tâche sera difficile, mais vous pouvez compter sur moi pour travailler main dans la main avec vous, dans la transparence et l'écoute.
Nous étudions l'idée de créer un crédit d'impôt. Elle a du sens, d'autant que la publicité soutient la croissance. Reste que, de tels dispositifs, nombre de secteurs en demandent... Le Gouvernement et le Parlement devront faire les choix les plus opportuns sur l'utilisation des fonds mobilisés pour la relance, en prenant en compte toutes les problématiques dans l'esprit de responsabilité le plus large. En tout cas, il ne doit pas s'agir de déshabiller les uns pour habiller les autres, car tous les secteurs ont et auront besoin d'aide. Ainsi, si l'on retire à l'audiovisuel public une part de ses ressources, comment lui assurer les moyens de continuer à exercer ses missions, dont la crise actuelle met en lumière toute l'importance pour nos compatriotes, notamment en matière d'information, de culture et d'éducation ?
De fait, malgré la crise et les risques, les journalistes et tous les salariés des médias accomplissent un travail exceptionnel pour continuer à informer nos compatriotes. En particulier, l'audiovisuel public adapte ses grilles pour proposer à nos compatriotes des contenus éducatifs et culturels dans le contexte du confinement.
Que les dispositifs mis en place ne pénalisent personne : voilà quelle doit être notre ligne de conduite. C'est ce que j'explique aux professionnels qui viennent me trouver pour me proposer des solutions. C'est d'ailleurs dans cet esprit que, à la faveur du projet de loi sur la réforme de l'audiovisuel, j'avais proposé un assouplissement publicitaire visant à donner plus de moyens aux acteurs traditionnels, mais sans trop pénaliser les radios et la presse quotidienne régionale par rapport à la télévision ; l'ouverture de la publicité pour la grande distribution à la télévision les aurait trop défavorisées.
En somme, il s'agit de concevoir, dans le cadre d'un plan global pour toutes les activités de notre pays, des dispositifs sectoriels qui ne pénalisent pas certains au détriment des autres. Pour cela, il nous faudra être inventifs et courageux.
Le Président de la République l'a dit clairement : nous ne sortirons pas de la crise tels que nous y sommes entrés. Tous les projets de réforme seront donc réexaminés.
Néanmoins, les principaux objectifs du projet de loi sur la réforme de l'audiovisuel restent pertinents : mieux, il nous faut plus que jamais nous doter d'outils au service de notre souveraineté culturelle ! De même, il faut plus que jamais obliger les plateformes à financer la création et préparer la télévision linéaire de demain, étant entendu que, comme l'a rappelé Mme la présidente, la diffusion hertzienne garde toute sa pertinence et devra continuer d'être assurée dans de bonnes conditions de qualité.
Il est tout particulièrement nécessaire aussi d'améliorer l'efficacité de la régulation du secteur audiovisuel et des communications numériques pour mieux protéger les publics, notamment contre les propos haineux, la désinformation et le piratage. La création d'un groupe public, destinée à mieux prendre en compte la révolution des usages liée à la révolution numérique, reste, elle aussi, plus que jamais d'actualité pour relever les défis à venir, à travers notamment une réaffirmation des missions de service public.
Tous ces objectifs demeurant essentiels, le projet de loi sera examiné, mais selon un calendrier qui dépendra des priorités des différents secteurs d'activité. Bien sûr, nous intégrerons dans le texte des dispositions tenant compte de la crise et en tirant les conséquences. Je pense notamment à la mise en oeuvre effective du droit d'auteur et des droits voisins pour les journalistes et éditeurs de presse. Si les négociations avec Google n'avancent pas, peut-être faudra-t-il agir par la loi. Ainsi, le Gouvernement aborde le réexamen de ce projet de loi à l'aune de la crise dans un esprit constructif, tout en réaffirmant les objectifs initiaux du texte.
Nous avons vu à quel point France 4 a été réactive, offrant des contenus éducatifs particulièrement pertinents. Dans le cadre du réexamen de la réforme, j'ai demandé à Delphine Ernotte de présenter un pacte Jeunesse, au cas où la diffusion de France 4 serait interrompue le 9 août, mais aussi de proposer une grille théorique pour cette chaîne tenant compte des enseignements du confinement, afin de nourrir la réflexion du Gouvernement et du Parlement. Dans les semaines qui viennent, je reviendrai vers vous pour échanger sur la décision définitive que le Gouvernement sera amené à prendre.
La presse fait face à des difficultés depuis des années. Depuis que je suis ministre, je consacre à ce secteur beaucoup d'énergie, s'agissant notamment des droits voisins, une question sur laquelle David Assouline et l'ensemble du Sénat ont été moteurs ; je pense aussi à la modernisation de la loi Bichet.
Au côté des dirigeants de Presstalis, des coopératives et des éditeurs de presse, nous travaillons, avec Bruno Le Maire et ses services, à un projet de transformation de Presstalis qui garantisse l'accès à une presse pluraliste partout sur le territoire. La situation financière de cette entreprise est très grave, mais je m'efforce de prévenir toute rupture dans la distribution de la presse. Je me suis engagé à assurer aux marchands de journaux le versement de ce qui leur est dû ; nous avons transféré les fonds nécessaires à Presstalis, qui les versera dans les jours à venir.
Par ailleurs, nous accélérons le versement des aides à la presse pour soutenir la trésorerie des éditeurs. De façon générale, l'État accélère le versement de ses subventions partout où c'est possible.
Oui, nous devons accompagner les auteurs ! Le plan que j'ai décidé dans la foulée du rapport Racine prend aujourd'hui tout son sens et devra même être amplifié ; vous pouvez compter sur moi en la matière. L'État a été très réactif pour autoriser les organismes de gestion collective à utiliser les 25 % de rémunération pour copie privée et les irrépartissables pour financer des aides sociales au bénéfice des artistes-auteurs. Tous les auteurs ne pourront pas bénéficier du fonds de solidarité, mais nous veillerons à ce que tous soient pris en compte d'une manière ou d'une autre, par exemple via les opérateurs ou les organismes de gestion collective. Personne ne doit se trouver dans une situation désespérée.
S'agissant du cinéma, un plan de relance sera mis en place en liaison avec le CNC et tous les professionnels. Il faudra inciter le public à revenir dans les salles et favoriser une reprise rapide des tournages. La baisse des recettes publicitaires à la télévision entraînant une réduction des moyens du CNC, nous devrons réfléchir aux moyens d'accompagner la production cinématographique et audiovisuelle, afin que les investissements se poursuivent.
À ce stade, je ne suis pas en mesure d'évaluer le manque à gagner pour le CNC, mais il est sûr que nous devrons obliger les plateformes à investir dans la production et rechercher des financements complémentaires. Nous en reparlerons quand je vous présenterai le plan de relance de l'ensemble du secteur culturel.
Quant à l'accélération de la diffusion en vidéo à la demande (VOD) d'un certain nombre de films, il ne s'agit pas d'une remise en cause de la chronologie des médias de portée générale ; elle a été décidée spécifiquement pour certaines productions, en concertation avec les producteurs, les acteurs, les salles et le CNC.
Mme Céline Brulin. - Je veux évoquer la presse, dont la situation est extrêmement fragile. Chacun mesure bien les conséquences de la disparition de journaux, que ce soit sur un plan démocratique ou en termes de proximité. La presse quotidienne régionale souffre particulièrement - je pense à Paris-Normandie . Il ne faudrait pas laisser la porte plus grande ouverte encore aux géants du numérique ou à la diffusion de fausses nouvelles.
Vous avez salué la décision de l'Autorité de la concurrence sur les droits voisins. Avez-vous d'ores et déjà prévu un accompagnement spécifique des éditeurs de presse ? Les dizaines de millions d'euros en jeu constitueraient une bouffée d'oxygène pour la presse écrite.
L'Alliance, le syndicat de la presse d'information générale, vous a présenté il y a quelques mois un plan de mesures structurelles, dont certaines sont pertinentes en cette période de crise. Entendez-vous les mettre en oeuvre ?
Nos rapporteurs l'ont évoqué, certaines mesures doivent être prises immédiatement pour aider les journaux indépendants qui sont menacés. Je pense à des dispositions en matière de TVA, à l'augmentation des aides accordées aux journaux à faibles recettes publicitaires. Les aides du Fonds stratégique pour le développement de la presse sont aujourd'hui captées par Presstalis. Je plaide pour la nationalisation de cette société. Vous avez dit qu'il ne fallait pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, mais c'est ce qui se passe avec ce fonds.
Je finirai mon propos en ayant un mot pour les salariés du secteur de la presse, qui travaillent pour nous permettre de recevoir nos journaux, notamment les pigistes, qui sont encore davantage en situation de précarité.
M. André Gattolin . - Les plateformes numériques du film, les SVOD, rencontrent un grand succès. Depuis son lancement le 7 avril dernier, Disney + est l'application la plus téléchargée en France. La question de la contribution de ces plateformes à l'écosystème du film français est importante. En Allemagne, la directive Services de médias audiovisuels (SMA) devrait entrer en vigueur en septembre. Nous allons prendre du retard dans l'examen de la loi sur la réforme de l'audiovisuel : ne serait-il pas nécessaire de transposer cette directive d'ici à l'automne ?
Je m'intéresse au livre numérique - avec Jean-Marie Mizzon, j'ai été nommé corapporteur d'une mission sur le sujet - , qui rencontre dans notre pays une grande résistance des éditeurs et des lecteurs. Depuis le début du confinement, on assiste à une explosion du livre numérique.
Du côté de l'édition, Antoine Gallimard, interviewé ce matin sur une radio, indiquait que le chiffre d'affaires des éditeurs était en baisse de 30 %, ce qui représente une perte de 25 000 emplois directs et de 50 000 si l'on prend en compte tous les acteurs de la chaîne du livre.
La plupart des librairies, dont certaines étaient à bout de souffle, sont fermées. Existe-t-il un plan de réouverture de ces magasins, et dans quelles conditions ?
La condamnation récente d'Amazon pour des raisons sanitaires ne risque-t-elle pas de créer un précédent ? Si, demain, le livre numérique se développait - Antoine Gallimard évoquait une augmentation de 40 % de son offre numérique -, quel serait son système de distribution ? Serons-nous dépendants de plateformes numériques américaines ? Ne faudrait-il pas réfléchir dès maintenant à une plateforme souveraine, française ou européenne ?
M. David Assouline. - Je m'associe aux inquiétudes exprimées par mes collègues en cette période catastrophique pour de nombreux secteurs, notamment l'audiovisuel, le cinéma et la presse. Il faut faire, dans ces domaines, des efforts à la hauteur de ceux réalisés dans d'autres secteurs, car la situation sera durablement difficile.
Je vous demande d'annuler la trajectoire de réduction budgétaire qui a été imposée à l'audiovisuel public pour la période 2018-2022. Dans les deux années à venir, la poursuite de cette trajectoire ne pourra qu'entraîner une baisse de la qualité, dans un environnement qui sera plus concurrentiel puisque les ressources publicitaires seront réduites. Se priver de 1 euro de redevance, soit 30 millions d'euros, c'est-à-dire trois fois ce que représente le budget de France 4, a déjà conduit à une réduction du périmètre de l'audiovisuel public, notamment avec l'arrêt de cette chaîne. Pourtant, tout le monde est convaincu de l'utilité de France 4, comme l'ont montré les dernières semaines.
Il faut aussi desserrer l'étau sur Radio France. La qualité des programmes et les efforts des personnels nécessitent un arrêt du plan d'économies.
Si l'État peut s'endetter au point où il le fait aujourd'hui, en brisant tous les dogmes budgétaires pour répondre à la crise, il peut aussi agir pour France Télévisions.
Vous vous êtes engagé à faire appliquer la loi sur les droits voisins. Fort de cette décision de l'Autorité de la concurrence, pouvez-vous hausser le ton face à Google pour parvenir à un accord rapide ? Si le Gouvernement le souhaite, il peut définir dès la loi de finances, sans attendre l'examen de la loi sur la réforme de l'audiovisuel, le taux qui serait appliqué aux plateformes.
Face à l'urgence et à la nécessité, sortons de notre train-train quotidien et prenons ces décisions rapidement.
M. Jean-Raymond Hugonet . - On peut s'interroger sur l'impact de l'interruption des activités culturelles sur la consommation du pass culture et sur la capacité du ministère à évaluer correctement ce dispositif en 2020. On peut aussi douter de l'opportunité de procéder à de nouveaux élargissements de l'expérimentation. Ne pourrait-on pas plutôt transférer une partie des crédits alloués au pass culture, qui ne pourront être consommés cette année, à des besoins plus essentiels, comme le soutien aux structures culturelles frappées de plein fouet par l'arrêt de leurs activités ?
Radio France, qui est sortie de 63 jours d'une grève historique et très dure pour tomber dans la crise du Covid-19, a fait preuve d'une grande réactivité en déclenchant rapidement son plan de continuité d'activité, avec un engagement sans réserve des équipes. Information de qualité, contenus éducatifs, culture, musique et divertissements conservent toute leur place sur les antennes de Radio France pour garantir le lien social dont notre société a besoin. Avec la baisse de la contribution à l'audiovisuel public (CAP) avant même cette crise, vous avez choisi de placer Radio France sur une trajectoire économique sévère. Aujourd'hui, au lieu de maintenir une stratégie qui risque de s'avérer décalée et contre-productive, à l'heure de la reprise des négociations salariales et alors même que les recettes de la redevance se sont avérées en 2019 supérieures aux prévisions, ne serait-il pas temps d'envoyer un signal budgétaire positif ?
Mme Colette Mélot . - Je veux évoquer l'importance des quotas musicaux pour la création française. Vous avez récemment reçu un courrier de la part des radios privées demandant un moratoire sur le plafonnement des rotations. Les radios font face à une baisse importante de leurs revenus publicitaires. Toutefois, les professionnels de la musique s'inquiètent de voir les radios s'appuyer sur cette situation de crise pour reprendre des demandes anciennes, sans lien avec le Covid-19.
La crise ne doit pas servir d'échappatoire aux obligations de diffusion des auteurs et des artistes francophones, touchés de plein fouet. Leurs revenus sont lourdement grevés par l'annulation des spectacles et des séances d'enregistrement et par la chute des ventes ; les priver de droits d'auteur et de droits voisins revient à leur infliger une double peine.
Quelles suites entendez-vous donner aux demandes de ces professionnels ?
M. Franck Riester, ministre. - Nous le savons, la presse est dans une passe difficile. Je suis attentif tant à la situation globale du secteur qu'aux cas particuliers. J'ai par exemple suivi de près le dossier de France-Antilles , qui fait aujourd'hui l'objet d'un plan de reprise permettant d'envisager l'avenir avec davantage de sérénité. Je suis également le dossier de Paris-Normandie , dont la députée Agnès Firmin Le Bodo m'a saisi. Les préfets me remontent en permanence les problèmes - le préfet de Guadeloupe m'a ainsi saisi du problème des petites radios et télévisions locales guadeloupéennes.
Avec Bruno Le Maire, nous travaillons à un plan global pour la presse, qui intègrera le volet distribution avec Presstalis, mais aussi la question de la restructuration des imprimeries et la mise en place d'un fonds stratégique. Nous envisageons également de mettre en place des dispositifs fiscaux. Je vous présenterai ce plan dans les semaines qui viennent.
S'agissant des pigistes, les entreprises qui y ont recours pourront bénéficier du dispositif de chômage partiel à partir du moment où les pigistes auront fait trois piges dans l'année, dont deux durant les quatre derniers mois. Ces critères précis sont ceux exigés pour élire les représentants de ce corps professionnel. Les organisations syndicales, les entreprises et nous-mêmes avons estimé qu'il s'agissait d'un critère simple - nul besoin d'une carte de presse.
Je suis déterminé à faire appliquer la loi sur les droits voisins. La décision de l'Autorité de la concurrence est une bonne nouvelle. Sous réserve de la détermination d'un véhicule législatif adéquat, je n'exclus pas de renforcer notre législation sur ce point. Cela doit se faire en lien avec les éditeurs de presse, qui négocient avec les acteurs concernés, comme Google.
Toute la chaîne du livre est en crise. La solidarité entre les différents maillons apporte une première réponse : certains éditeurs ont renoncé à exiger des libraires le paiement à court terme de ce que ceux-ci leur devaient, pour ne pas leur imposer une pression financière. Nous souhaitons que les librairies fassent partie des commerces qui pourront rouvrir le 11 mai prochain. Un certain nombre d'entre elles ont organisé un service de retrait de commandes qui marche bien. Le déconfinement ne devra pas se faire dans la précipitation pour éviter toute prise de risque des libraires, de leurs équipes et des clients. Une préparation et un accompagnement seront nécessaires. Un dispositif a été mis en oeuvre par le CNL pour aider les artistes-auteurs, les libraires et les plus petits éditeurs. Par ailleurs, je suis favorable à ce que l'opération BD 2020 soit prolongée en 2021 - c'est une bonne idée !
La condamnation d'Amazon a été évoquée. Nous devrons nous assurer, avec les organisations syndicales et l'inspection du travail, que l'entreprise respecte bien les préconisations sanitaires avant la reprise des activités.
En ce qui concerne Radio France, je l'ai dit précédemment à propos des recettes publicitaires, il ne faut pas que des dispositifs spécifiques de sortie de crise viennent déshabiller Pierre pour habiller Paul. On ne peut pas supprimer la publicité dans l'audiovisuel public sans trouver de ressources complémentaires. Je ne retiens donc pas cette idée pour le moment.
La crise entraîne une baisse des recettes publicitaires de Radio France. Il faudra mettre en oeuvre un plan spécifique pour l'audiovisuel public qui tiendra compte du fait que ce secteur a su s'adapter en accomplissant, de façon exemplaire, des missions de service public. Je salue les équipes de Radio France et me félicite de son initiative pour soutenir la scène française musicale. Je ne peux pas vous dire dès maintenant quelle sera la nouvelle trajectoire budgétaire, alors que je ne connais pas encore les conséquences financières exactes de la crise.
Sur le pass culture, je vous invite à ne pas entrer dans un « boutiquage » budgétaire, en prenant des millions ici pour les mettre là. Le moment venu, une fois connues les conséquences budgétaires de la crise, je vous présenterai le plan d'urgence et le plan de relance que nous proposerons. J'entends votre message, mais la méthode proposée n'est pas la meilleure. Le plan de relance comprendra des leviers pour agir tant sur l'offre que sur la demande. Il faudra pousser les Français à aller au cinéma, à voir des spectacles. La demande peut être encouragée par des dispositifs comme le pass culture. Certes, celui-ci ne sera pas déployé comme nous l'avions prévu avant la crise, mais il faut, par exemple, donner la possibilité aux jeunes d'aller acheter des livres quand les librairies rouvriront grâce à ce dispositif : c'est un moyen de relancer le secteur. Donner des moyens aux jeunes - et aux moins jeunes d'ailleurs, car je veux que cet outil soit proposé demain à tous les Français - d'aller voir des spectacles me semble avoir du sens. Il faudra réévaluer le dispositif, peut-être pour l'accélérer. Nous avons déjà dû reculer la deuxième étape de l'expérimentation, qui devait commencer début avril, en raison du confinement. J'insiste, ne faisons pas de plomberie budgétaire et n'oublions pas d'agir sur la demande, et pas seulement sur l'offre, même si celle-ci est primordiale et prioritaire.
Sur les quotas, je suis favorable à ce qu'ils évoluent s'il y a un consensus entre les producteurs de musique et les radios. Les professionnels travaillent sur cette question en lien avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce qui devrait permettre de déboucher sur une issue positive.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Vous l'avez constaté, mes collègues sont extrêmement mobilisés sur toutes ces questions. Nous n'avons pas molli depuis le début de la crise.
Je vous remercie d'avoir évoqué les problématiques tant de l'Hexagone que de l'outre-mer, en particulier des Antilles. Des collègues ultramarins de notre commission nous écoutent, notamment Antoine Karam. Il est très important de se mobiliser pour chaque territoire.
Notre action doit reposer sur l'anticipation et la lisibilité, car c'est ce que nous demandent les acteurs. Il faut y ajouter la coordination : il est important de travailler de façon interministérielle sur chaque sujet. J'ai été frappée que les libraires aient tapé à la porte de M. Le Maire, mais il est évident que des dispositifs économiques peuvent aider certains secteurs de la culture. Il faut que Bercy comprenne comment fonctionne l'écosystème. La coordination doit aussi se faire entre l'État et les collectivités territoriales. Vous avez réuni le Conseil des territoires pour la culture, nous vous en remercions. Les conférences territoriales de l'action publique doivent aussi se tenir sur l'initiative des présidents de région en coordination avec les préfets, afin que les collectivités territoriales travaillent avec l'État déconcentré. Les dispositifs doivent se compléter pour le bénéfice de l'ensemble des acteurs, pour que personne ne soit laissé au bord du chemin.
J'insiste sur la nécessité que les établissements publics qui portent des projets culturels puissent, comme les associations, cumuler le dispositif du chômage partiel et les subventions. Les collectivités ont annoncé qu'elles continueraient à verser leurs subventions de fonctionnement. Cela permettait d'éviter que ces structures aient recours au fonds d'urgence, qui devrait être laissé aux structures labellisées et aux acteurs plus fragiles.
Le plan de relance est tout aussi important que le plan d'urgence. La commission est globalement très favorable à un crédit d'impôt communication. Nous pourrions travailler en concertation avec vous sur ce sujet.
Nous avons évoqué la presse. Je m'associe à l'attention portée à Paris-Normandie .
Les modèles économiques sont bouleversés par la crise. L'argent va se faire rare, nous allons entrer dans une période de récession. M. Hugonet a eu raison de poser une question, qui n'est pas taboue, sur le pass culture : il faut en faire le bilan, car d'autres dépenses sont peut-être plus urgentes pour sauver des structures essentielles pour la vie culturelle de notre pays.
La question de France 4, qui a été évoquée par MM. Leleux et Assouline, est importante, car, si la fréquence libérée était remise sur le marché, elle serait susceptible d'être attribuée à des acteurs privés. Or le « gâteau » publicitaire est aujourd'hui fragilisé. France 4 n'utilise pas cette ressource : c'est un argument en faveur du maintien de cette chaîne. Le moment est peut-être venu de clarifier les modèles économiques et de conduire la réforme de la CAP, même si ces points n'étaient pas prévus dans la loi sur la réforme de l'audiovisuel. Soyons inventifs !
Nous devons construire la société de demain en faisant preuve de vigilance pour que la culture garde toute sa place. Nous comprenons les priorités sociales, économiques et sanitaires, mais la culture nourrit l'économie, le social, la cohésion, le bien-être et, donc, la santé. Ne laissons pas la culture au bord du chemin, d'autant que ce secteur fragile, qui mérite autant d'attention que les autres, fait la renommée et la spécificité de notre pays. Vous pouvez compter sur nous : la représentation nationale doit prendre toute sa part de responsabilité dans cette crise.
Même si je suis contente d'avoir des outils numériques à l'heure actuelle, je rêve du moment où je retournerai dans une salle de spectacle, pour retrouver le plaisir de l'émotion partagée. La culture, c'est être ensemble !
M. Franck Riester, ministre. - Je rêve moi aussi de retourner dans une salle de cinéma ou de théâtre, mais également dans la salle de réunion de votre commission de la culture pour partager avec vous, en chair et en os, nos combats communs. Il nous faut de l'audace, de la transparence, de l'anticipation et de la détermination pour défendre la culture - je suis d'accord avec vous, madame la présidente.
Je conclurai par l'importance de la culture dans l'économie, dans les questions sociales et sociétales pour donner du sens à nos actions, pour avoir une vision non pas seulement matérielle, mais aussi sensible du monde. L'histoire nous montre que la sortie des crises se traduit toujours par un réinvestissement dans la culture. Après la Seconde Guerre mondiale, le CNC et le centre dramatique national de Colmar ont été créés ; après la grande dépression, Roosevelt a investi massivement dans la culture, grâce au New Deal .
Il faut aider les acteurs du secteur à traverser cette période de crise et à préparer des jours meilleurs. J'aurai besoin de vous tous, et vous pourrez compter sur moi.
Audition de M. Christophe d'Enfert, directeur scientifique de l'institut Pasteur
MERCREDI 22 AVRIL 2020
___________
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Dans le cadre de notre mission de suivi de la gestion de la crise liée au Covid-19, nous poursuivons ce matin nos travaux sur le secteur de la recherche, en auditionnant M. Christophe d'Enfert, professeur à l'institut Pasteur et directeur de l'unité biologie et pathogénicité fongiques.
Merci, monsieur le professeur, de vous être rendu disponible pour cette audition, très importante pour nous, alors que vous devez être extrêmement sollicité en cette période difficile. Je tiens une nouvelle fois à exprimer, au nom de tous les membres de cette commission, notre total soutien à la communauté des chercheurs et notre reconnaissance pour leur engagement exceptionnel.
La visite que nous avions effectuée de l'institut Pasteur de Paris avait été, pour nous, une découverte passionnante. Ce dernier, ainsi que les 32 instituts Pasteur du réseau international sont fortement mobilisés pour trouver des réponses à la pandémie de Covid-19. Dès janvier dernier, un groupe d'action, dit task force coronavirus , a été lancé pour coordonner les nouvelles recherches pasteuriennes sur cette maladie infectieuse. De nombreux autres projets, menés en partenariat ou avec le soutien d'organismes tiers, sont également en cours de validation.
Parmi les grands domaines sur lesquels s'exerce l'expertise de l'institut Pasteur, nous avons choisi de nous concentrer sur la recherche thérapeutique et les vaccins.
Après votre intervention liminaire, je donnerai la parole à Laure Darcos, notre rapporteure des crédits de la recherche, qui anime un groupe de travail ayant pour mission de suivre l'évolution du secteur de la recherche dans la période actuelle, puis aux membres des groupes politiques choisis par leurs pairs pour vous interroger.
M. Christophe d'Enfert, directeur scientifique de l'institut Pasteur . - Je vous remercie pour votre invitation, madame la présidente, et pour les mots de soutien que vous venez d'exprimer à l'égard des chercheurs. Depuis trois mois, la communauté des scientifiques fait effectivement preuve d'un engagement total pour tenter de trouver des solutions à cette pandémie. Le soutien des sénateurs et, plus largement, de nos gouvernants est important.
Je suis directeur scientifique de l'institut Pasteur depuis janvier 2020, après avoir occupé les fonctions de directeur de la technologie et des programmes scientifiques. Parallèlement, je dirige une unité de recherche s'intéressant aux champignons pathogènes de l'homme. J'ai eu d'autres expériences par le passé : professeur à l'école Polytechnique, responsable du secteur microbiologie, immunologie, et infection à l'Agence nationale de la recherche (ANR), directeur scientifique de l'institut de recherche technologique Bioaster.
L'institut Pasteur a été fondé en 1887 par Louis Pasteur pour promouvoir la vaccination contre la rage. Ce dernier l'a structuré autour de trois missions principales : la recherche sur les maladies infectieuses, plus largement les maladies ; la santé publique ; la formation. Une quatrième s'y est adjointe : le développement de l'innovation et le transfert technologique. Employant environ 2 800 personnes, dont 1 800 travaillent dans les laboratoires, l'institut comprend 12 départements de recherche, dont un de virologie, 135 entités de recherche et une vingtaine de plateformes technologiques et d'expérimentation animale.
Comment s'est-il organisé pour répondre à l'épidémie de Covid-19 ?
Sur le versant de la santé publique, l'institut Pasteur héberge des centres nationaux de référence (CNR). Parmi eux, le CNR chargé des infections respiratoires est dirigé par Sylvie van Der Werf.
L'une de ses missions est de proposer des tests de référence pour le diagnostic et le suivi des maladies virales. Le CNR a donc mis au point, dès janvier, le test qRT-PCR, un test moléculaire de diagnostic, qui a été partagé avec les centres français pouvant le réaliser, mais qui est aussi utilisé dans le cadre du CNR en lien avec la cellule d'intervention biologique d'urgence.
Le CNR s'est également impliqué dans le séquençage du génome du virus, qu'il a mis à disposition de la communauté scientifique après l'avoir isolé. Son périmètre d'action comprenant l'évaluation des tests moléculaires proposés par différentes entreprises, il a conduit un certain nombre de travaux sur ces tests commerciaux, avec rapports transmis aux autorités de santé et publiés. Enfin, il a contribué au développement de tests de sérologie de référence. Nous disposons dans ce domaine de tests et de panels de séra, qui peuvent nous permettre de qualifier d'autres tests soumis par les industriels.
Sur le versant de la recherche, ayant pris conscience, au cours de la deuxième quinzaine de janvier 2020, de la gravité de la crise et de la nécessité d'une structuration adéquate de notre recherche pour répondre aux défis qui se présentaient, nous avons mis en place une task force coronavirus . Placée sous la responsabilité du professeur Bruno Hoen et sous la mienne, cette cellule de coordination réunissant scientifiques et fonctions supports permet de gagner en efficacité et de bénéficier de financements sur la recherche Covid-19 - nos équipes ont ainsi tiré parti des appels à projets français ou européens. Nous avons déjà remonté des projets au Comité analyse, recherche et expertise (CARE) et continuons de le faire dans le cadre de cette task force . Par ce biais, nous assurons chaque semaine une animation scientifique destinée à toutes les équipes travaillant sur des projets en lien avec le Covid-19.
Aujourd'hui, plus de 250 chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels des services supports sont impliqués sur ce sujet, soit depuis chez eux, soit depuis notre campus, puisque cette activité est la seule que nous ayons laissée sur le campus pendant le confinement. Les dispositions prises par l'État concernant les procédures accélérées sur les manipulations d'organismes génétiquement modifiés (OGM) et sur les études cliniques sont très bénéfiques à l'avancée de nos recherches.
Pour évoquer l'état de ces recherches, j'en resterai aux thèmes choisis pour l'audition - vaccinologie et thérapeutique -, mais je répondrai aux éventuelles questions portant sur l'épidémiologie ou le diagnostic.
S'agissant de la vaccinologie, plusieurs projets sont menés. J'en citerai trois. Les deux premiers font appel à des virus atténués comme plateforme vaccinale. Des travaux conjoints sont ainsi menés par Christiane Gerke, Frédéric Tangy et Nicolas Escriou autour de la rougeole ; d'autres sont développés autour d'une plateforme lentivirale - donc de la famille du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) - par l'équipe de Pierre Charneau. Une autre approche est celle de la vaccination ADN, avec, notamment, les travaux développés par Étienne Simon-Lorière.
Tous ces projets avancent bien. Les différentes stratégies vaccinales sont actuellement testées chez l'animal, afin de pouvoir mettre en évidence l'induction d'une réponse immunitaire et la production d'anticorps, tout particulièrement d'anticorps neutralisants, essentiels pour bloquer l'infection à la suite de la vaccination. Nous espérons être en mesure de qualifier ces réponses vaccinales dans le courant du mois de mai, afin de nous engager vers des études cliniques.
S'agissant du domaine thérapeutique, les actions que nous menons s'inscrivent, pour l'essentiel d'entre elles, dans un plus long terme.
Nous avons mis en place une plateforme d'évaluation de molécules antivirales. Ce petit groupe de chercheurs teste, à partir d'idées soumises par des équipes industrielles ou académiques, l'efficacité antivirale de certaines molécules.
Nous travaillons aussi à l'identification de stratégies thérapeutiques permettant de bloquer l'entrée du virus, en particulier par le développement d'anticorps monoclonaux, d'inhibiteurs de la polymérase du virus ou de molécules susceptibles d'interférer sur les fonctions de l'hôte essentielles à la réplication du virus. Sur ce dernier point, j'aimerais mettre en avant notre collaboration avec l'université de San Francisco et le Mount Sinai Hospital à New York : elle nous a permis de repérer quelques molécules, soit disposant d'une autorisation de mise sur le marché (AMM), soit entrées en phase d'essais cliniques, qui peuvent présenter un intérêt thérapeutique. Enfin, depuis plus récemment, nous menons des projets sur la susceptibilité à l'infection, le possible neurotropisme du virus ou la réponse de l'hôte au cours de l'infection.
Nos chercheurs travaillent donc sur ce sujet sans répit, sept jours sur sept, pour proposer des solutions vaccinales ou thérapeutiques, mais aussi des approches quant au diagnostic et à la sérologie.
Nous sommes une fondation de recherche, je le rappelle, et c'est grâce à notre flexibilité que nous avons pu engager très rapidement certains projets. Je voudrais donc saluer la générosité publique, qui, au-delà des financements de l'État, nous fait vivre. Nous avons très rapidement lancé une campagne de soutien à l'institut Pasteur pour ses recherches sur le Covid-19, qui nous permet aujourd'hui de soutenir nos projets, ici comme au sein du réseau.
Il n'y a pas de réponse sans expertise. C'est aussi parce que l'institut Pasteur a bâti une très solide expertise en virologie, internationalement reconnue, notamment sur le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), ou sur le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) que nous pouvons être réactifs sur cette épidémie.
Je voudrais donc profiter de ce propos introductif pour dire combien il est important de soutenir la recherche fondamentale, même sur des sujets qui, sur le moment, ne paraissent pas prioritaires.
Par ailleurs, nos jeunes chercheurs ont continué à travailler pendant le confinement, mais dans des conditions qui ne sont pas les mêmes qu'habituellement. L'État devra les aider à rattraper le retard accumulé.
J'ai noté avec plaisir que plusieurs appels à projets lancés par l'ANR sur le Covid-19 présentaient des taux de succès très élevés : 30 %, au moins, contre 10 % à 12 % en temps normal. Maintenir de tels taux à l'avenir permettrait à la recherche française d'avancer plus efficacement !
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je réaffirme le soutien du Sénat à l'institut Pasteur. Dans le cadre des débats budgétaires, nous nous étions alarmés des dispositions prises sur le mécénat et fortement mobilisées sur le sujet. La chaîne Public Sénat vient également de programmer un excellent film sur l'institut Pasteur et la lutte contre la rage. C'est vous dire combien nous sommes attentifs à votre institut !
Mme Laure Darcos . - Je me joins aux remerciements de la présidente. Je souhaitais aussi évoquer notre combat pour le mécénat, dont elle vient de parler ; nous savons à quel point celui-ci est fondamental pour un institut comme le vôtre.
Cette crise doit faire comprendre la nécessité d'un plus fort investissement dans la recherche biomédicale. Je me bats depuis trois ans, par exemple, pour que le budget de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) soit augmenté pour tous les projets REACTing. J'espère que le Gouvernement entendra... Quant à votre remarque sur les projets lancés par l'ANR, j'espère aussi que nous continuerons sur cette lancée.
Pouvez-vous développer vos propos sur la piste d'un vaccin apparenté au vaccin contre la rougeole ? Si j'ai bien compris, on ne vaccine qu'une fois contre la rougeole. Peut-on d'ores et déjà envisager un vaccin permettant de se protéger sans crainte de mutations ?
Vous travaillez avec des centres et universités à l'étranger : université de Pittsburgh, Themis en Autriche, etc. Cela démontre une forte coopération internationale, au moment où, sur notre territoire, on perçoit des problèmes de gouvernance. On ne sait pas vraiment comment les établissements de recherche et les instances, comme le conseil scientifique présidé par le professeur Delfraissy ou le CARE piloté par madame Barré-Sinoussi, travaillent ensemble, comment se fait le partage de données... Pouvez-vous nous apporter des éclairages sur ce point ?
Vous avez été moins disert sur les traitements antiviraux. Participez-vous à certains projets de Discovery, l'essai clinique mis en place dans le cadre du consortium REACTing ?
Hier, vous avez annoncé que 6 % de la population française avait été atteinte par le virus, alors qu'un taux de 60 % serait nécessaire pour le rendre moins virulent. Quelles en seront les conséquences sur la pandémie ?
M. Christophe d'Enfert . - En matière de gouvernance, l'organisation s'est construite au fil de l'eau. Au démarrage de l'épidémie, la structure REACTing s'est vu confier la mission de coordonner la réponse de la France et plusieurs projets ont pu être lancés dans ce cadre. Puis, ont été instaurés le conseil scientifique et le CARE, dont les rôles sont clairement différents : le premier a pour fonction d'aider la Présidence de la République et le Gouvernement dans la prise de décisions sur la gestion de l'épidémie ; le second de contribuer à l'amélioration de la coordination de la recherche et à une prise en compte la plus rapide possible des initiatives issues du tissu de la recherche, académique ou industrielle. Il existe donc des procédures permettant de faire remonter au niveau du CARE des projets, qui font ensuite l'objet d'une réflexion menée conjointement par le comité et le consortium REACTing.
L'instauration du CARE a été une mesure essentielle. J'avais remarqué, voilà un certain temps, que les initiatives étaient nombreuses en France, mais que le manque de coordination entre ces projets engendrait un risque de redondance. Une certaine redondance peut être intéressante, car chacun développe une approche spécifique, mais il faut absolument un partage d'informations, d'où l'importance du travail de coordination de CARE. À l'avenir, cette mission devrait revenir à REACTing, pour la gestion d'éventuelles futures épidémies.
On a donc un peu peiné pour mettre en place l'organisation, mais elle commence aujourd'hui à s'éclaircir. Il faut maintenant voir comment CARE et REACTing donneront suite aux remontées d'informations et comment les subsides pour la recherche sur le Covid-19 seront utilisés.
Les projets de recherche sur un possible vaccin sont nombreux sur le plan mondial et le partage d'informations est très rapide. Des articles sont mis à disposition sur des sites comme celui du New York Times , de medRxiv ou de l'institut Pasteur - l'article concernant le taux de personnes attaquées par le virus en France, par exemple, a été mis en ligne et ouvert à la communauté scientifique avant toute évaluation par des pairs. Le partage d'informations se fait aussi via les réseaux sociaux.
Par ailleurs, des chartes de partage d'informations ont été signées, notamment par certains porteurs de projets vaccinaux. Certes, on ne peut pas empêcher une forme de concurrence entre projets, mais cela n'enlève rien à la volonté de tous de trouver rapidement une solution.
La manière dont les consortiums de recherche se mettent en place est souvent le reflet de l'histoire. Nos collaborations avec l'université de Pittsburgh ou la société de biotechnologie autrichienne Themis ont été mentionnées. Nous travaillons avec celle-ci sur la rougeole depuis plusieurs années ; on ne va pas changer les choses au moment où l'épidémie survient ! Pour une bonne collaboration, il faut une connaissance et une confiance mutuelles. D'ailleurs, certains autres projets européens qui ont été financés se fondent aussi sur des projets préexistants, ce qui me permet d'insister, à nouveau, sur l'importance de la recherche au niveau européen et du caractère bottom-up de la recherche.
L'institut Pasteur n'est pas impliqué dans le programme Discovery, mais il l'est dans l'étude Covidaxis, visant à évaluer des stratégies chimioprophylactiques de prévention de l'infection chez les personnels soignants. Cette étude, pilotée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Étienne, est en phase de démarrage. L'hydroxychloroquine sera évaluée dans un premier temps, suivie de la combinaison de deux antiviraux ciblant les protéases : le lopinavir et le ritonavir. De nouvelles molécules seront introduites au cours de l'étude. Celle-ci est intéressante à plusieurs titres, mais surtout parce qu'elle cible une population fortement exposée, ce qui permettra de travailler à sa protection tout en dégageant plus rapidement des résultats.
Enfin, avec 5,7 % des Français exposés au virus, nous sommes effectivement loin de l'immunité collective, qui serait atteinte avec un taux compris entre 60 % et 70 %. Si nous ne voulons pas que le déconfinement se traduise par une deuxième vague épidémique, nous devrons donc le mettre en oeuvre de manière progressive, en privilégiant le maintien du télétravail. Il faudra impérativement respecter les gestes barrières, la distanciation physique, et le port du masque devra être, autant que possible, systématique, en particulier dans les transports en commun et les environnements de travail.
Mme Marie-Pierre Monier . - Je garde aussi en tête notre visite de l'institut Pasteur, qui avait constitué un moment important, et la mobilisation autour de la problématique du mécénat.
Je lis et j'entends que les personnes ayant contracté le Covid-19 pourraient être ultérieurement recontaminées. Qu'en est-il d'un vaccin dans ce cas ? Au-delà des recherches sur les thérapies et les vaccins, travaillez-vous sur les modes de propagation du virus, par exemple sur sa survie sur certaines surfaces ? Vous avez indiqué mobiliser 250 personnes sur le sujet. Pourquoi ne pas en mobiliser plus, au vu de la complexité de la situation ? Y a-t-il eu mutation du virus par rapport à celui qui a circulé en Chine ? Vous n'avez pas mentionné, dans l'étude tout juste évoquée, l'association de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine chère au professeur Didier Raoult. Menez-vous des recherches sur celle-ci ?
Mme Sonia de la Provôté . - Ma première question porte sur le calendrier. Un délai de 18 à 24 mois a été évoqué pour la mise à disposition d'un vaccin. Selon vos propos dans la presse, il serait maintenant de 21 mois. Qu'en est-il précisément ?
Par ailleurs, la course mondiale au vaccin suscite des collaborations et des concurrences, ces dernières étant parfois de nature, l'institut Pasteur le sait bien, à modifier les règles du jeu. La Chine, devenue un intervenant de taille dans ce jeu concurrentiel, n'obéit pas toujours aux mêmes codes. Comment voyez-vous votre rôle et l'évolution de vos travaux dans un tel contexte ? Comment collaborez-vous avec des pays non européens, tout en préservant une partie de votre souveraineté ? Constatez-vous, à l'échelle européenne, une homogénéisation des stratégies, avec l'émergence d'une organisation qui pourrait nous conduire vers une souveraineté européenne ?
Le confinement donne lieu à des injonctions contradictoires. On met en place des mesures de prévention de la mortalité quand l'immunité collective est la solution ! Vous avez évoqué la nécessité d'un déconfinement progressif. Mais les données épidémiologiques nous font défaut pour pouvoir anticiper au mieux cette période. Les hommes sont-ils plus à risque que les femmes ? Les enfants sont-ils vraiment des vecteurs importants de la maladie ?
Enfin, le Sénat avait mis en place une mission d'information sur la pénurie de médicaments et de vaccins, dont les conclusions ont été rendues en septembre 2018. Mais la problématique est toujours d'actualité. Elle prend même un tour compliqué dès lors que l'on évoque les molécules à usage de réanimation ! À l'époque, des inquiétudes avaient été exprimées sur le devenir de l'institut Pasteur ou la protection de certaines cellules souches, et on voit bien, avec cette crise, à quel point il est stratégique d'avoir la main sur la production dans le secteur sanitaire. L'institut Pasteur réfléchit-il à une remise en cause de son organisation mondiale, en vue de réintroduire une production de vaccins en France et en Europe ?
M. Christophe d'Enfert . - La question de la maîtrise des outils de production, en particulier de production vaccinale ou médicamenteuse, relève de la politique nationale, plus que de celle de l'institut Pasteur. Il ne me revient donc pas d'y répondre - je pourrai le faire en tant que citoyen, mais vous ne m'avez pas invité pour cela.
En revanche, je peux évoquer la politique de l'institut Pasteur.
En tant que fondation de recherche, celui-ci n'est pas impliqué dans la production de médicaments ou de vaccins. Nous établissons, quand c'est nécessaire, des relations avec des industriels afin que nos innovations puissent être déployées auprès des populations avec le maximum d'efficacité. L'interaction avec l'industrie permet d'accélérer ce déploiement. Ce modèle ne doit pas être remis en cause et il ne faut pas réintégrer ces activités de production au niveau de l'institut Pasteur.
Nous disposons par ailleurs d'un réseau international, reconnu comme une véritable pépite. C'est grâce à lui, notamment, qu'un test de diagnostic mis au point à l'institut Pasteur de Hong Kong a pu être déployé rapidement en Asie du Sud-Est, mais aussi en Afrique de l'Ouest. L'internalisation de l'institut Pasteur doit donc être préservée.
S'agissant précisément du vaccin et de la persistance des anticorps, on s'interroge effectivement sur la durée nécessaire pour qu'une infection ayant induit une réponse immunitaire entraîne une production d'anticorps, sur la protection offerte par ces anticorps et sur leur persistance. Des travaux de recherche et des enquêtes sérologiques nous permettront d'apporter des réponses, mais nous n'en disposerons que dans le futur. Pour certains vaccins, comme celui contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, il faut trois injections initiales et plusieurs rappels pour établir une immunisation de longue durée. Mais, à l'heure actuelle, on ne sait pas ce qu'il en sera pour les vaccins développés contre le coronavirus.
Ce qui permet, par ailleurs, une réduction probable du délai d'obtention d'un vaccin, ce sont les procédures accélérées. Peut-être celles-ci n'étaient pas suffisamment en place au début de l'épidémie, ce qui a fait imaginer des phases d'essais cliniques allant de l'automne 2020 à l'automne 2021. On pense aujourd'hui qu'il sera possible de les démarrer en juillet et d'accélérer les phases 2 et 3 pour obtenir des résultats cliniques dans le courant du premier semestre de 2021. C'est ce que l'on peut espérer.
Oui, toute collaboration non européenne présente des risques. Cela doit probablement interroger l'Europe sur les modèles qu'elle a mis en place, mais, à nouveau, cela ne relève pas de mon rôle de commenter le sujet.
S'agissant de la propagation du virus, si l'institut Pasteur n'est pas concerné par des sujets comme sa propagation sur les surfaces, relevant plus de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), nous sommes impliqués dans des études épidémiologiques ayant pour objectif de comprendre sa propagation à l'échelle de la population : il s'agit d'études de modélisation ou d'études de sérologie en population.
Le confinement donne effectivement le sentiment d'injonctions contradictoires. Mais les modèles montrent toute son importance pour limiter la propagation de l'épidémie. Il nous a permis de réduire la pression sur les hôpitaux, donc d'améliorer la prise en charge des malades, et de revenir, dans une semaine ou deux, à un état épidémique équivalent à celui du 1er mars. Cela nous permettra de nous préparer pour mieux prendre en charge ce qui serait une deuxième phase épidémique, avec augmentation du nombre de tests, généralisation du port du masque, maintien des gestes barrières et de la distanciation physique.
D'après une étude de l' Imperial College de Londres, à la date du 28 mars, le confinement avait divisé par 2 500 le nombre de morts en France. C'est la raison pour laquelle il faut l'accepter, plutôt que de rêver d'une immunité collective. Il est vrai que les règles que nous allons devoir respecter dans les mois à venir permettront de limiter le nombre de morts au détriment de l'établissement d'une immunité collective, mais nous pouvons espérer qu'un vaccin sera disponible dans quelques mois, permettant alors d'obtenir une immunité collective artificielle.
Pour le moment, le virus mute relativement peu, ce qui est un bon signe sur le plan de la vaccination.
Je n'ai pas connaissance de travaux de l'institut Pasteur sur l'association promue par le professeur Didier Raoult. Mais, certaines études montrant que cette combinaison est associée à une augmentation des effets secondaires, une réflexion s'impose.
La différence entre les hommes et les femmes ou le fait que les enfants soient vecteurs sont des questions qui commencent à être étudiées. Les études de sérologie, en particulier, nous permettront d'avoir une meilleure connaissance sur la transmission du virus au sein des populations.
Enfin, 250 chercheurs mobilisés sur le sujet, c'est déjà beaucoup ! Tous les jours, de nouveaux chercheurs se joignent à ces équipes. Tous les jours, de nouvelles idées sont proposées. Mais la recherche fondamentale avance à un certain rythme et la multiplication d'intervenants n'aurait pas forcément un effet positif : ce qui compte, c'est d'avoir de bonnes idées et de réussir à les mettre en pratique le plus rapidement possible !
M. André Gattolin . - Je réitère les félicitations de mes collègues quant aux travaux de l'institut Pasteur.
Sur la question d'une coordination permanente en matière de recherche virologique ou pandémique, lors d'une récente audition, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation nous a annoncé un budget annuel de 500 000 euros pour REACTing, hors phase épidémique. Or, si ce type de pandémies devait se reproduire, il faudrait disposer de véritables budgets. Il faudrait même prévoir des programmes « monitoring » plus que « reacting ».
De nombreux travaux ont été réalisés sur la question de la transmission animale, avec certaines hypothèses émises sur les bouleversants écosystémiques. Les instituts Pasteur au Vietnam ou au Laos s'intéressent de près à ces hypothèses. Pouvez-vous nous en dire plus ?
On a beaucoup parlé de coopération internationale, notamment avec la Chine. Voilà deux mois, l'ambassadeur de Chine, qui respecte sans doute davantage les scientifiques que la représentation parlementaire dans ses propos, a visité l'institut Pasteur, lequel, dans un communiqué datant de novembre 2017, fait mention d'une collaboration entre lui-même, l'institut Mérieux et le fameux laboratoire P4 de la ville de Wuhan. Qu'en est-il vraiment ? Y a-t-il transparence, interactivité et équilibre dans nos collaborations avec la Chine ?
J'en viens à la polémique sur les retards de décision et la communication de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Trois semaines se sont écoulées entre la déclaration d'épidémie et celle de pandémie. Cela peut être délicat pour vous de vous exprimer sur ce point, mais ne pouvait-on faire mieux ?
M. Stéphane Piednoir . - Ma première interrogation porte sur la réouverture des écoles et, plus particulièrement, sur le degré de contagiosité des enfants. Leur système immunitaire en construction leur vaudrait d'être moins récepteurs. Cela ferait-il d'eux de moindres transmetteurs du virus, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle ? Pouvez-vous revenir, sans entrer dans les détails scientifiques, sur la spécificité de ce coronavirus ? Pourquoi est-il si virulent ? Des études sont-elles menées sur les conditions d'une possible extinction naturelle ? On parle beaucoup de la chaleur, qui intervient dans l'extinction du virus de la grippe saisonnière.
M. Christophe d'Enfert . - S'agissant du budget de REACTing hors phase épidémique, je pense que cette épidémie doit nous interroger rapidement, dans les mois à venir, sur notre organisation globale. Nous devons faire en sorte d'être mieux organisés au moment du déclenchement des épidémies, afin de disposer d'une recherche coordonnée et de capacités à évaluer rapidement des médicaments.
Ce sujet est en lien avec celui du bouleversement des écosystèmes. L'institut Pasteur mène effectivement des travaux en Asie du Sud-Est pour mieux comprendre les transmissions de ces coronavirus entre insectes, chauves-souris, petits animaux et hommes, et savoir dans quelle mesure ces connaissances pourraient nous aider à mieux prédire de futures épidémies. Il faudra réfléchir aux moyens d'apporter un soutien financier à ces équipes de terrain, mettant en oeuvre une biologie souvent considérée comme moins intéressante et ayant pourtant toute sa part dans notre compréhension de l'origine de ces épidémies.
La visite de l'ambassadeur de Chine avait pour but de témoigner de la reconnaissance de la diaspora chinoise en France à l'égard de l'institut Pasteur, pour son engagement dans la compréhension d'une épidémie alors très active sur le sol chinois.
Je n'entrerai pas dans le détail sur la problématique du laboratoire P4 de Wuhan : d'une part, à ma connaissance, l'institut Pasteur n'a pratiquement pas été impliqué dans sa mise en place ; d'autre part, s'il existe des interrogations quant aux dispositifs de sécurité de cet établissement, il n'y a aucune preuve de la rumeur selon laquelle le coronavirus aurait émergé d'un laboratoire chinois.
Quant à la transparence de la Chine sur l'ampleur de l'épidémie, le faible nombre de morts qui y sont comptabilisés soulève effectivement de nombreuses questions. L'histoire nous dira ce qu'il en est réellement. Selon un article paru aujourd'hui dans le New York Times, je crois, l'étude de la surmortalité dans les pays permettra, dans le futur, d'avoir une image de l'impact de l'épidémie bien plus nette que celle qui transparaît à travers les chiffres communiqués par les États.
Peut-être l'OMS a-t-elle tardé à annoncer une épidémie de portée mondiale, ou pandémie, mais je ne suis pas certain que cela aurait changé quoi que ce soit. A contrario , elle a envoyé des signaux très clairs sur les risques associés à cette pandémie et martelé des consignes pour que l'on teste. Or, on le voit, la pandémie a été contenue dans les pays ayant généralisé les tests. On peut donc regarder ce qu'a fait l'OMS, mais, dans ce cas, il faut aussi regarder la façon dont on a pris en charge l'épidémie.
N'étant pas spécialiste, je ne veux pas trop me prononcer sur la réouverture des écoles. La question de savoir si les enfants sont vecteurs ou pas suscite effectivement des interrogations. Des études vont probablement être mises en oeuvre sur la séroprévalence au sein de cette population et permettront de dégager des connaissances sur le sujet. Selon les premières informations dont je dispose, il ne semble pas que les enfants soient particulièrement vecteurs de la maladie, mais, à nouveau, je ne suis pas spécialiste du sujet.
S'agissant de la protection contre le virus, l'interrogation demeure. Nous avons des exemples rapportés, indiquant des possibilités de recontracter le virus. En l'absence de certitudes, il faut donc maintenir les gestes barrières et la distanciation physique.
En quoi ce virus est-il problématique ? Il présente, au niveau moléculaire, une très bonne adaptation entre sa protéine de surface, la protéine S, et le récepteur ACE2 situé à la surface de nos cellules, ce qui facilite son entrée dans celles-ci. C'est probablement ce qui le rend plus virulent.
On sait par ailleurs que les coronavirus sont sensibles à une hygrométrie et une température élevées, ce qui peut laisser envisager une baisse de l'épidémie durant la phase estivale, mais avec un rebond probable à l'automne ou en hiver. Mais, comme on en apprend tous les jours avec ce virus, il est encore difficile d'avancer des hypothèses sur la suite de l'épidémie.
Mme Céline Brulin . - Merci pour cet éclairage et, plus globalement, pour le travail mené par l'institut Pasteur. Je voudrais revenir sur la question qui nous taraude : la reprise de l'école. Vous évoquez des études épidémiologiques et sérologiques, notamment des études spécifiques aux enfants. Dans quel délai pouvons-nous espérer disposer d'informations plus précises ? Avant le 11 mai ? Dans la perspective de la rentrée prochaine ? L'institut Pasteur est-il associé à la réflexion sur la reprise de l'école ? Si certaines décisions sont bien appuyées par le conseil scientifique, il semble que, pour celle-ci, l'expertise scientifique n'a pas été complètement au rendez-vous !
Mme Colette Mélot . - J'ai, moi aussi, été impressionnée par la visite de l'institut Pasteur et je m'associe aux propos de mes collègues ayant exprimé nos remerciements et notre reconnaissance.
Au moment où la France va s'engager dans un déconfinement progressif, alors qu'une très faible part de sa population aurait été en contact avec le virus, avons-nous une estimation du nombre de personnes asymptomatiques et de leur degré de contagiosité ? Ce déconfinement apparaît comme une équation insoluble. Est-il utile de tester massivement la population ? À quel bilan devons-nous raisonnablement nous attendre dans les mois à venir, en l'absence de traitements efficaces ?
M. Christophe d'Enfert . - Il m'apparaît vraiment difficile de commenter la décision de reprise de l'école, qui est une décision politique, dûment informée par le conseil scientifique. J'ai compris que cette reprise serait extrêmement progressive et l'on peut penser que, au-delà même de cette stratégie, le degré d'acceptation des familles restreindra les effectifs dans les écoles.
Sur l'implication de l'institut Pasteur dans cette réflexion - j'ai cru entendre des doutes exprimés sur l'expertise présente au sein du conseil scientifique -, le professeur Arnaud Fontanet, spécialiste en épidémiologie, et le docteur Simon Cauchemez, spécialiste en modélisation des épidémies, tous deux travaillant à l'institut Pasteur, siègent dans cette instance. Ce dernier est donc totalement impliqué et appuie le Gouvernement dans sa stratégie de gestion de l'épidémie. J'imagine que mes collègues ont apporté leur expertise dans la décision de reprise de l'activité des écoles.
Je n'ai pas les chiffres en tête concernant les personnes asymptomatiques, mais celles-ci représentent un pourcentage non négligeable et sont susceptibles de propager le virus. Néanmoins, en termes sérologiques, elles ont en règle générale des réponses moins importantes que les personnes ayant été symptomatiques, ce qui indique qu'elles ont probablement porté moins de virus et, donc, été moins contagieuses.
Dès lors que l'on ne connaît pas avec certitude le lien entre séropositivité en anticorps et protection contre une infection par le virus, il serait dangereux d'envisager des tests de masse. On serait effectivement amenés à dire à certaines personnes qu'elles sont séropositives, sans pouvoir préciser si elles sont, ou non, protégées, et cela aurait pour effet induit de baisser la garde sur les gestes barrières, avec, derrière, un risque de reprise épidémique. En outre, les tests de diagnostic rapide, qui se présentent sous une forme similaire à celle des tests de grossesse, n'ont souvent pas des sensibilités et des spécificités suffisamment élevées pour que, dans un contexte de propagation peu importante, on puisse en tirer des informations pertinentes. Pour une campagne massive de tests, il faudrait donc, en plus, disposer de tests de diagnostic rapide avec des sensibilités et des spécificités les plus élevées possible.
Le bilan auquel il faut s'attendre est assez complexe à évaluer. À un moment donné, on a estimé que 60 % de la population mondiale serait touchée, soit 4 milliards de personnes. Le taux de mortalité avoisinant 2 % laissait donc envisager que 80 millions d'individus décéderaient du Covid-19, autour de 200 000 à 300 000 en France. Mais ces chiffres s'entendent sans différenciation entre pays, sans mesures de confinement et sans stratégie thérapeutique trouvée. Or, on le constate aujourd'hui, les méthodes de confinement, de distanciation et de gestes barrières permettent de limiter l'épidémie. Il est donc difficile de donner des chiffres.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Pourriez-vous nous préciser le travail des instituts Pasteur en Afrique ? Ce continent est, lui aussi, l'objet de toutes nos préoccupations.
Mme Mireille Jouve . - Par une étude rendue publique hier matin, l'institut Pasteur constate que, le nombre de Français ayant contracté la maladie restant trop faible, l'épidémie risque de connaître une reprise après le 11 mai. Le 2 avril dernier sur France 2, vous avanciez qu'avec les beaux jours la circulation du virus pourrait se réduire, tout en pointant un risque de résurgence à l'automne. Ce matin même, le professeur Raoult a évoqué une telle saisonnalité. Certains indicateurs confirment-ils cette hypothèse ?
Le Gouvernement a fixé un objectif de 500 000 tests de diagnostic hebdomadaires réalisés à compter du 11 mai prochain. Un recensement des capacités de dépistage a commencé, mais de nombreux laboratoires publics s'étonnent de ne pas être sollicités. Cette décision serait justifiée par la capacité des chercheurs à pouvoir établir des comptes rendus d'examen et rendre des résultats individuels. Quel regard portez-vous sur ce cloisonnement ?
M. Max Brisson . - Membre du groupe de travail que notre commission consacre au retour à l'école, j'ai noté vos réponses prudentes. Mais l'institut Pasteur a-t-il une connaissance de l'état sanitaire des enfants en âge d'être scolarisés ? Pourquoi ces classes d'âge sont-elles moins exposées au Covid-19 ? Sont-ils asymptomatiques, résistants au virus ? Ces éléments d'analyse nous permettraient d'apporter notre pierre au débat relatif à la réouverture des écoles.
La fiabilité des tests suscite la polémique. Ces derniers doivent-ils être concentrés sur les individus ayant été en contact avec des personnes contaminées ? Faut-il, au contraire, les déployer le plus largement possible ?
M. Christophe d'Enfert . - Au sujet du retour à l'école, je ne suis pas en mesure de vous éclairer, n'ayant pas suffisamment d'informations. Toutefois - on le constate clairement -, plus on est âgé, plus on risque de contracter la maladie avec une forte amplification virale. Les études de sérologie devraient nous apporter des informations quant au degré d'exposition des enfants. Ces derniers ne semblent pas être les vecteurs que l'on prédisait.
Un certain nombre de coronavirus sont saisonniers. Ils peuvent être sensibles à la chaleur ou à l'humidité. Dès lors, l'été favoriserait leur déclin, mais ce n'est qu'une hypothèse. On pourrait me rétorquer que le MERS circule dans des pays au climat chaud et sec.
J'ai beaucoup de respect pour le professeur Raoult, mais la chute du nombre de cas que l'on observe aujourd'hui me semble d'abord due au respect du confinement. Cela étant, je peux me tromper moi aussi.
Il faut bien distinguer les tests de diagnostic, pour lesquels l'objectif hebdomadaire de 500 000 a été fixé, et les tests de sérologie. Le CNR des virus des infections respiratoires et le CNR associé, à Lyon, dirigé par le professeur Bruno Lina, sont chargés d'évaluer, sur la base d'un étalon, l'efficacité de ces différents tests. À cette fin, ils rendent aux autorités de santé des rapports d'information. Pour ce qui concerne les tests de diagnostic, ces documents sont mis à disposition des médecins sur le site de la Société française de microbiologie (SFM). C'est sur ces résultats, établis par des structures indépendantes, qu'il faut se fonder pour décider ou non de l'utilisation d'un test.
Le fait de rendre un test est un acte médical ; le rendu des tests doit donc être mené sous le contrôle d'une autorité médicale. En mars dernier, la question du recours aux tests s'est posée ; leur disponibilité semblait alors limitée, du fait, probablement, de problématiques de production, une partie des réactifs n'étant pas fabriquée en Europe. Or cette question paraît résolue, si j'en crois le ministre des solidarités et de la santé et le Premier ministre.
Les laboratoires de ville et les laboratoires hospitaliers sont sans aucun doute en mesure de prendre en charge ces tests. Dans la phase de déconfinement, il est très important de faire ce qui a été fait au tout début de l'épidémie : tracer et tester les contacts dès qu'un nouveau cas est repéré. Cette information est nécessaire pour contenir le redémarrage de l'épidémie.
Enfin, le réseau des instituts Pasteur dispose d'un certain nombre de sites sur le continent africain, que ce soit au Maghreb, en Afrique de l'Ouest - Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon - ou à Madagascar. La collaboration au sein du réseau, qui vise à apporter des compétences et des moyens aux instituts situés en Afrique, se décline sous diverses formes : transferts technologiques depuis l'institut de Hong Kong pour le diagnostic ; transferts depuis les instituts de Paris et de Hong Kong pour la sérologie ; financement de projets de recherche en épidémiologie, dans les instituts Pasteur d'Afrique, par l'institut Pasteur de Paris ; soutien au ressourcement scientifique et technique.
Le but de cette solidarité, c'est que les instituts africains puissent contribuer localement à la lutte contre l'épidémie. En développant notre action à l'échelle internationale, nous sommes fidèles à la pensée exprimée par Louis Pasteur voilà plus de cent trente ans. Il faut assurer une prise en charge efficace de l'épidémie, partout sur la planète.
Mme Catherine Morin-Desailly , présidente. - Nous suivons de près le travail des instituts Pasteur - nous avons notamment visité l'institut de Hué, au Vietnam. Leur réputation, notamment en matière de virologie, s'appuie sur des moyens annuels dédiés, et, à ce titre, nous serons extrêmement vigilants lors des prochains débats budgétaires. La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation nous a annoncé un budget « recherche » augmenté de 400 millions d'euros en 2021. S'y ajoutent le plan d'urgence de 50 millions d'euros au titre du Covid-19, les 3 millions d'euros de l'appel à projets Flash de l'ANR et les fonds investis dans le projet REacting.
Nous resterons en lien avec vous pour nous assurer que vos recherches sont bel et bien financées. Vous portez nos espoirs : le confinement à vie n'est pas une solution...
M. Christophe d'Enfert . - Nous sommes bien d'accord !
Mme Catherine Morin-Desailly , présidente. - Nous sommes donc suspendus à vos travaux de recherche thérapeutique.
Enfin - Laure Darcos l'a souligné -, nous sommes très attentifs à la défiscalisation des dons dans le cadre du mécénat. À cet égard, votre fondation est en première ligne.
Nous exprimons à tous les chercheurs de l'institut Pasteur nos encouragements et notre gratitude.
Audition de Mme Roxana Maracineanu, ministre des sports
MARDI 5 MAI 2020
___________
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Nous accueillons aujourd'hui Mme Roxana Maracineanu, ministre des sports, pour une audition organisée en visio-conférence. Le secteur du sport est, avec ceux de la culture et de l'éducation, un des plus touchés par la crise sanitaire. Les stades et les salles de sport ont été fermés dès la mi-mars. Les athlètes ont été privés d'entraînement. Les contrôles antidopage sont, par ailleurs, beaucoup plus difficiles à mettre en oeuvre dans ces conditions, avec les inquiétudes que cela peut créer.
Plusieurs événements qui devaient se dérouler ce printemps ou cet été ont été reportés - je pense au tournoi de Roland-Garros, au Tour de France cycliste, à l'Euro 2020 et aux jeux Olympiques de Tokyo. Si les championnats amateurs ont été rapidement écourtés, il a fallu attendre la semaine dernière pour que, à l'initiative du Gouvernement, les championnats professionnels soient à leur tour définitivement interrompus pour la saison en cours. Cette situation n'est pas sans poser des questions d'insécurité juridique, qui ont amené le Gouvernement à préparer des projets de loi d'habilitation à légiférer par ordonnances. Vous aurez l'occasion, j'imagine, de nous en dire un mot.
Vous nous présenterez aussi l'action de votre ministère dans les différents moments de cette crise : la phase d'urgence, la phase de déconfinement qui devrait intervenir partiellement la semaine prochaine, puis le plan de soutien ou de relance à destination des acteurs, dont chacun d'entre nous est convaincu de la nécessité. Nous sommes très impatients de vous entendre. Nous sommes aussi très intéressés par le sport dans les territoires. Les élus locaux et les sénateurs sont très mobilisés sur ces sujets.
À l'issue de cette présentation, je donnerai la parole à notre rapporteur chargé des crédits du sport, notre collègue Jean-Jacques Lozach, auquel vous pourrez répondre en détail, puis aux orateurs désignés par chaque groupe politique. Je précise que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle fera l'objet d'un compte rendu publié sur le site du Sénat.
Mme Roxana Maracineanu, ministre des sports . - Je vous remercie de m'avoir conviée à cet échange, après plus de deux mois de crise et au lendemain de l'intervention du Premier ministre au Sénat. Je souhaite pouvoir aborder avec vous l'ensemble des actions du ministère des sports pour faire face au Covid-19, concrètement et en toute transparence. Je vous demande un regard tout à la fois critique et bienveillant. J'ai besoin de vos observations, de vos remarques, de vos questions et de vos propositions.
Pour que les mesures de précaution sanitaire indispensables à la réussite de ce déconfinement entrent dans le quotidien des Français, elles doivent être acceptées. Pour être acceptées, elles doivent être comprises. Pour être comprises, elles doivent être entendues. Nous devons les diffuser et les expliquer, et nous comptons sur vous pour cela. Il nous appartient aussi - et c'est tout l'intérêt de notre échange - de les préciser, de les affiner et de les rendre intelligibles. Chaque ministre y travaille dans son domaine.
Notre société tout entière doit faire bloc. Nous devons être solides et inventifs, sûrs de nos valeurs et de nos priorités. En tant qu'élus de la Nation, passionnés par le sport, vous avez un rôle important à jouer pour aider le sport à relever le plus grand challenge qu'il ait jamais eu à relever.
Ce défi, depuis le début de la crise, l'ensemble des acteurs du mouvement sportif en a pris la pleine mesure. Je tiens à souligner l'esprit de solidarité et de responsabilité qui l'a constamment guidé. Cela s'est traduit par l'affirmation forte et claire de la prééminence des principes de sécurité sanitaire sur la continuité de la pratique sportive. Un esprit d'unité et une véritable volonté de collaboration ont régné autour des réflexions et dispositifs mis en place par le ministère comme par les autres acteurs. Pourtant, ce n'était pas une évidence, car, à l'image de l'ensemble de la société, l'écosystème sportif est cruellement touché par la crise. Les conséquences sont désastreuses pour sa viabilité économique et les emplois qui en dépendent. Chaque club et association, chaque fédération, chaque sportif professionnel, chaque entreprise privée en a souffert et en souffre encore. Certains sont en péril.
Les agents de mon ministère ont été exemplaires, qu'il s'agisse des agents de la direction des sports, de nos services déconcentrés ou de nos établissements. Leur engagement, leur disponibilité et leur vision de l'intérêt général ont constitué des atouts capitaux dans la gestion de cette crise.
Alors que les conditions du confinement sont désormais posées, il est impératif de conserver cet état d'esprit. L'enjeu est de partager toutes les informations disponibles, tout particulièrement auprès de notre réseau de petites associations sportives. De ce point de vue, je veux insister sur le rôle central des collectivités territoriales, proches de ces petites associations qui maillent notre pays. Représentants des collectivités, vous jouez aussi un rôle essentiel. Je compte sur vous et suis prête, avec mes équipes, à continuer à échanger avec vous. Nous pourrions d'ailleurs envisager ensemble de nouvelles modalités pour le faciliter.
Pour gérer la crise, nous avons choisi une méthode collaborative. Dès le 25 février dernier, une cellule de crise quotidienne s'est réunie avec toutes les têtes de réseaux de la gouvernance du sport en France : le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), le Comité paralympique et sportif français (CPSF), le Comité d'organisation des jeux Olympiques (COJO), l'Association nationale des directeurs techniques nationaux (AsDTN), la direction interministérielle aux grands événements sportifs (Diges), le ministère de l'Europe et des affaires étrangères via l'ambassadrice pour le sport, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (Insep), la direction des sports, l'Agence nationale du sport (ANS) et les représentants des collectivités territoriales. Dans le même temps, le directeur des sports a engagé un plan strict de continuité de l'activité du ministère et entretenu un dialogue social étroit avec les représentants de ses agents.
Ce système de dialogue permanent nous a permis de réagir ensemble au gré des informations disponibles chaque jour et d'éviter les interventions cacophoniques ou contradictoires. La qualité de cette collaboration se fonde sur une confiance mutuelle, construite, depuis plus d'un an, au travers de l'ANS, avec les représentants de l'Association des maires de France (AMF), de l'Assemblée des départements de France (ADF), de Régions de France ou de France Urbaine. Nous pourrons évoquer, d'ailleurs à l'occasion de nos débats, à quel stade d'avancement en est la déclinaison territoriale de l'ANS.
Cette méthode collaborative a contribué à un pilotage transparent et partagé de toutes les problématiques qui ont émergé successivement. Elle a aussi permis de dégager très tôt trois principes directeurs : la primauté stricte des enjeux sanitaires sur les enjeux de continuité sportive ; le respect de la doctrine édictée par le ministère des solidarités et de la santé, sans chercher à développer une analyse sanitaire propre au ministère des sports ; et, enfin, la volonté de ne pas se substituer aux autorités préfectorales et locales, qui sont au plus près des réalités des territoires.
Dans un souci de brièveté, je n'évoquerai pas toutes les questions qui se posent à nous, comme les effets du report des jeux de Tokyo et ses éventuelles conséquences sur Paris 2024, ou encore les réformes qui étaient en gestation avant la crise, et qui sont au repos aujourd'hui : je pense notamment à la réforme de l'organisation territoriale de l'État ou aux cadres techniques sportifs. Nous y reviendrons, je pense, dans nos échanges.
J'aborderai rapidement la question de la gestion de la crise en phase de confinement, puis en phase de déconfinement, dans laquelle nous sommes, et enfin la préparation de l'après.
Grâce à la cellule de crise, nous avons pu répondre d'une même voix aux interrogations de toutes les fédérations, de centaines d'organisateurs d'événements sportifs et de dizaines de milliers de clubs.
Nous avons travaillé sport par sport, pratique par pratique, événement par événement. Nous avons aussi avancé sur de nombreuses autres dimensions. J'en détaillerai trois : l'accompagnement économique, la mise en place de dispositifs solidaires et la proposition d'offres aux Français pour faire du sport chez soi.
Les pertes du mouvement sportif sont estimées à ce stade à une vingtaine de milliards d'euros, mais ce chiffre est sans doute au-dessous de la réalité. J'ai veillé à ce que tout l'écosystème sportif bénéficie des dispositifs de soutien gouvernemental appliqués au monde économique : chômage partiel, exonérations et report de charges, prêts garantis par l'État par exemple. D'autres dispositifs de soutien sont encore en cours de réflexion.
Nous menons également un travail spécifique concernant la reprise et le soutien au sport professionnel, qui ne reprendra pas, au moins, avant août prochain. Je m'emploie beaucoup aussi à ce que les positions des diffuseurs de télévision et des ligues professionnelles se rapprochent. On note des progrès, car les positions étaient assez lointaines.
Nous avons aussi avancé sur le thème « sport et solidarité ». Nous avons mobilisé l'ensemble des ressources humaines de l'écosystème du sport, dès la mi-mars, pour des missions de solidarité, comme l'aide alimentaire par exemple. Il s'agit de nos 170 000 éducateurs sportifs et, sur la base du volontariat, des agents du ministère. Je tiens aussi à souligner la mobilisation de nombre de nos fédérations à nos côtés, comme la Fédération française de sauvetage et de secourisme, la Fédération française de tennis ou la Fédération française de football, qui ont mis certaines de leurs installations à disposition des sans-abri, ou des clubs comme l'Olympique de Marseille ou le Paris Saint-Germain. De même, l'Insep ou les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) ont mis à disposition leurs locaux pour soutenir l'activité de nos hôpitaux.
J'en viens à la promotion du sport à la maison. Cette période de confinement et de télétravail a démontré plus que jamais l'importance de l'activité sportive dans l'équilibre personnel de nos concitoyens, pour leur bien-être comme pour leur santé. Elle pose plus encore la question de la place accordée au sport dans notre société. Nous avons soutenu et promu de nombreuses offres de start-up qui proposaient gratuitement des contenus visant à aider à faire du sport à la maison. Le ministère a également créé sa propre plateforme bougezchezvous.fr. Toutes ces initiatives ont été et sont toujours, je crois, très utiles pour mieux vivre cette période difficile de confinement.
Avec Jean-Michel Blanquer, Gabriel Attal et le ministère de l'éducation nationale, nous sommes aussi en train d'envisager les voies et moyens qui permettraient aux écoles de bénéficier du tissu associatif sportif et des clubs pour la reprise progressive de l'école dans les prochains temps, dans le cadre d'un nouveau dispositif appelé « Sport, santé, culture, civisme » (2S2C). Les solutions devraient être trouvées très localement, mais cela semble à notre portée et à celle des collectivités.
Nous allons rentrer dans une phase nouvelle de la gestion de la crise : une première phase de déconfinement. La pratique sportive va reprendre à compter du 11 mai, progressivement, pour limiter les risques de contamination. J'ai proposé au Premier ministre une doctrine de reprise par étapes, qui autorise d'abord uniquement la reprise des activités individuelles extérieures. Ces activités devront respecter des critères de distanciation adaptés à chaque discipline : dix mètres d'écart entre les personnes pour un footing ou le vélo, un espace de quatre mètres carrés par personne et dans un périmètre de 100 kilomètres autour de chez soi. Jusqu'au 2 juin minimum, les rassemblements autorisés seront limités à dix personnes. La reprise des activités en espace intérieur et des sports collectifs ne sera envisagée que dans une seconde phase, selon l'évolution de la pandémie.
Le ministère des sports est en train d'établir une liste précise des activités autorisées, pour que chacun puisse savoir s'il peut pratiquer son sport favori et dans quelles conditions. Plusieurs guides pratiques sont en cours de préparation avec tous nos partenaires et devraient pouvoir être publiés dans les tout prochains jours. Il s'agira de guides précis, établis sport par sport, avec les fédérations, les ligues ou les clubs professionnels, ou par typologie d'équipements, en lien avec l'Association nationale des élus en charge du sport (Andes), et l'Association nationale des directeurs et intervenants d'installations et des services des sports (Andiiss). Il y aura aussi un guide à destination de nos sportifs de haut niveau, qui a été préparé avec la cellule haute performance, et un guide sanitaire et médical. Nous publierons aussi des précisions concernant la reprise du sport à l'école. Chacun de ces guides sera validé par les autorités sanitaires.
De manière générale, autoriser à nouveau la pratique des sports à contacts ou collectifs ne semble pas aujourd'hui compatible avec la doctrine sanitaire. Les compétitions sportives, y compris professionnelles, même à huis clos, resteront interdites, au moins jusqu'au mois d'août. Les manifestations sportives rassemblant plus 5 000 personnes sur un même lieu ne seront pas possibles non plus jusqu'à fin août ou début septembre 2020.
J'échange actuellement avec mes homologues européens pour améliorer notre coordination. Chaque pays a été touché de manière différente, impliquant des réponses adaptées, mais je crois beaucoup dans les vertus de ces échanges. Ils sont essentiels pour garantir la meilleure reprise pour tous de nos championnats nationaux et européens.
Nous sommes conscients des conséquences économiques lourdes générées par le caractère progressif du déconfinement. Cela paraît néanmoins indispensable pour qu'il soit efficace et pour éviter tout risque de reprise massive des contaminations.
En fonction de l'évolution concrète de la pandémie, il conviendra de revoir ces modalités, d'ici à la fin mai. D'ores et déjà, plusieurs pistes commencent à être envisagées. Je veux rappeler toutefois que les interdictions que j'ai évoquées jusqu'à août prochain sont, pour nous, des objectifs réalisables si la situation sanitaire s'améliore conformément à nos attentes. Il nous faut donc avoir l'humilité et l'honnêteté de dire que ce calendrier pourrait être repoussé, mais certainement pas avancé. Je serai évidemment pleinement à l'écoute de vos différentes interventions et de vos retours de terrain sur ces sujets.
Nous devons aussi nous projeter sur « l'après », d'envisager les pistes qui nous permettront de soutenir l'ensemble du mouvement sportif gravement touché dans la période. Le risque, que nous devrons collectivement surmonter, est celui de l'affaiblissement des associations sportives, de leur structure financière et de leurs emplois. Le risque est aussi celui de la baisse de l'engagement sportif à la reprise, des bénévoles comme des pratiquants.
Nous devons donc penser déjà à un plan de relance global et coordonné avec l'ensemble des acteurs, notamment les collectivités territoriales. Nous avons déjà engagé ce travail avec tous nos partenaires, en identifiant plusieurs thématiques stratégiques : le soutien à la pratique ; le soutien aux fédérations et aux clubs ; les déclinaisons territoriales et l'emploi ; la place des services de l'État, des établissements, de l'ANS, de la formation et du sport de haut niveau ; enfin, le soutien économique aux acteurs et au sport professionnel, grâce à la mobilisation de Bpifrance, de France Sport Expertise, ou de Business France.
Je souhaite vous associer au mieux à toutes nos réflexions autour de ce plan de relance, qui devra aussi faire l'objet d'aménagements législatifs et réglementaires. Après la première loi d'urgence du 23 mars 2020, de nombreuses ordonnances adoptées ont concerné le sport, sur les plans administratif, social ou financier. C'était indispensable pour aider nos associations et nos agents économiques. Une seconde loi d'urgence devrait permettre de sécuriser les décisions des fédérations et des ligues professionnelles face aux risques de contentieux en ce qui concerne l'arrêt de leurs compétitions 2019-2020, sans pour autant interdire d'éventuels recours. Enfin, un décret « sport » est également en préparation pour prendre en compte les évolutions réglementaires liées à la crise et au report des jeux de Tokyo de 2020 à 2021. Il concernera en particulier la possibilité pour les fédérations de décaler jusqu'au 30 avril 2021 le renouvellement de leurs instances dirigeantes.
Au-delà de ces évolutions, nous devons déjà nous projeter un peu plus loin pour penser au sport d'après la crise et approfondir nos réflexions sur la place qu'il devrait occuper dans notre société. Là, encore, j'aurai besoin de vous.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je vous remercie d'avoir rappelé que le sport regroupe à la fois le monde professionnel et la pratique amateur. Il s'ancre dans des territoires et les collectivités territoriales jouent un rôle important. Vous avez aussi souligné que le sport constitue un secteur économique, avec des enjeux financiers non négligeables, et l'interruption du versement des droits télévisés risque de le fragiliser.
Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais je dois vous quitter avant le terme de l'audition : je dois intervenir en séance, dans le cadre du débat sur la prolongation de l'état d'urgence. Je cède donc la présidence à M. Leleux.
- Présidence de M. Jean-Pierre Leleux, vice-président -
M. Jean-Jacques Lozach . - Merci, madame la ministre. Vous avez détaillé l'action de votre ministère et du Gouvernement. Le sport est fortement frappé par la crise. Les clubs et les associations sont victimes d'un effet ciseau, entre la baisse de leurs recettes et le maintien de leurs charges fixes. Dès lors, pourriez-vous nous en dire plus sur les priorités du plan de relance que vous envisagez et sur ses modalités de financement ?
Vous avez dressé le bilan de la loi instituant l'Agence nationale du sport, dont notre collègue Claude Kern était le rapporteur, mais beaucoup de décrets d'application ne sont pas encore parus, qui auraient facilité la déclinaison territoriale de l'agence. Ces décrets seront-ils bientôt publiés ?
Le sport professionnel semble riche, en particulier le football et le rugby, mais, avec la crise, il apparaît un petit peu comme un colosse aux pieds d'argile. Patrick Wolff, le président de l'association des ligues de sport professionnel, nous indiquait ce matin que les clubs pourraient tenir financièrement jusqu'à la fin du mois d'août, mais craignait des difficultés par la suite. Ne faudrait-il pas repenser le modèle, très inflationniste, du sport professionnel, qui semble vivre un petit peu au-dessus de ses moyens ?
Enfin, le débat est-il définitivement clos sur le calendrier de reprise et la possibilité d'organiser des événements sportifs à huis clos en août - je pense notamment aux finales de la Coupe de France de football ou de la Coupe de la Ligue ?
Mme Roxana Maracineanu, ministre . - Je veux rappeler l'importance de l'ANS, qui a permis la mise en place d'une gouvernance partagée, en associant tous les acteurs et, notamment, les collectivités territoriales. Les décrets que vous évoquez sont presque finalisés.
Le plan de relance devra s'articuler avec les actions entreprises à tous les niveaux : local, départemental, régional et national, mais aussi privé, car le sport bénéficie de financements de sources très diverses. Le ministère a pleinement défendu la place du sport. Celui-ci relève, en France, de la compétence de l'État, à la différence de certains de nos voisins. C'est ce qui nous a conduits, en toute connaissance de cause, à annoncer la suspension des compétitions. L'État jouera son rôle et nous serons attentifs à la déclinaison territoriale du plan de relance. Il s'agit de soutenir l'emploi, d'aider les petites associations tout comme le monde du sport professionnel. Les clubs souffrent de la perte des recettes de billetterie et de l'interruption du versement des droits de retransmission audiovisuelle, car les diffuseurs n'ont pas joué le jeu, alors que leurs charges fixes demeurent. Ils sont donc pris en étau. Les mesures que nous avons prises, en faveur du chômage partiel ou avec les prêts garantis, constituent une aide précieuse, mais elles ne pourront pas durer toujours.
La Ligue de football professionnel proposait de reprendre les compétitions le 13 juin, pour finir la saison le 3 août. Comme le Premier ministre l'a indiqué lors de la présentation de la stratégie de sortie du confinement, les saisons des sports professionnels, notamment celles de football ou de rugby, sont terminées. Cette décision était inéluctable dès lors que l'on veut respecter les mesures de prévention sanitaire, fondées sur la distanciation sociale, les gestes barrières et la limitation des déplacements. Il reste une incertitude pour l'organisation d'événements sportifs en août, qui peut être envisageable, avec un nombre limité de personnes, si l'évolution de l'épidémie est positive et que nous n'avons pas à redescendre d'une marche dans le confinement. Toutefois, quoi qu'il arrive, les événements qui regroupent plus de 5 000 spectateurs ne pourront se tenir avant septembre. Une inconnue tient aussi aux possibilités d'entraînement, car, avant de reprendre la compétition, les sportifs doivent pouvoir s'entraîner ensemble ; or, dans les conditions sanitaires actuelles, cela n'est pas possible. Cela vaut aussi pour les sports de contact.
Dans les sports individuels, en revanche, il sera possible de reprendre l'entraînement. C'était une mesure très attendue.
M. Michel Savin. - Les fédérations et les clubs amateurs craignent de voir le nombre de licenciés chuter l'année prochaine, de l'ordre de 5 à 10 %. Comment les soutenir ?
Le monde du sport de haut niveau est préoccupé par la baisse du nombre de contrôles antidopage. Quelles mesures allez-vous prendre pour rétablir ces contrôles ?
Vous avez évoqué l'association entre les collectivités territoriales et l'éducation nationale à travers le dispositif 2S2C. Le Premier ministre a annoncé des aides aux collectivités territoriales. Pourriez-vous nous donner des précisions à ce sujet ? De même, pourriez-vous nous donner des précisions sur le calendrier de réouverture des piscines, car les collectivités sont en train de recruter les maîtres-nageurs ?
Une ordonnance, en préparation, prévoit d'autoriser les clubs ou les organisateurs d'événements sportifs qui ont été annulés à proposer aux titulaires de billets ou d'abonnements des avoirs, au lieu de remboursements. Pourquoi ne pas instaurer plutôt un crédit d'impôt ? Cela soulagerait la trésorerie des clubs. Les recettes des clubs professionnels reposent essentiellement sur la billetterie, plus que sur les droits de retransmission audiovisuelle. Ils craignent une baisse du nombre de spectateurs à la rentrée. Là encore, quelles mesures envisagez-vous pour les soutenir ?
M. Claude Kern . - Je me permets de vous reposer la question de Jean-Pierre Leleux sur les décrets concernant le fonctionnement territorial de l'ANS, car vous n'y avez pas répondu : quand paraîtront-ils ? Allez-vous tenir compte de nos propositions ?
Vous avez rappelé l'importance économique du sport et le nombre d'emplois directs ou indirects induits. Les clubs rencontrent des difficultés financières à cause de la crise. Certes, le Gouvernement a mis en place des aides, mais celles-ci ne suffiront pas à compenser les pertes de recettes. Ne conviendrait-il pas d'envisager d'autres solutions, comme une baisse de la TVA, une baisse des charges ou un relèvement du plafond de la réduction d'impôt au titre des dépenses de mécénat dans le sport ou de sponsoring ?
Vous avez dit que le débat sur la date de la reprise était clos. Mais avant de pouvoir reprendre, les sportifs ont besoin de plusieurs semaines d'entraînement. Autant le confinement pouvait être brutal, autant la reprise de la compétition ne pourra être que progressive. L'Union des associations européennes de football (UEFA) envisage une reprise de la Ligue des champions en août. Le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, qui sont encore en course, risquent d'être pénalisés, alors que les clubs espagnols, italiens ou allemands auront déjà repris l'entraînement. De même, comment envisagez-vous la reprise pour les sports en salle, comme le basketball, le handball, ou le volleyball ?
M. Jacques-Bernard Magner . - J'aurai une critique et une question. Une critique, tout d'abord : pendant le confinement, le sport n'a pas eu la part qu'il méritait. On a privilégié la restriction. Il aurait certainement été possible de maintenir la pratique d'activités sportives individuelles, avec des conditions, mais la limitation de la pratique sportive à un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile était pour le moins ridicule et difficile à faire respecter !
Une proposition, ensuite. Pendant des années, les petits clubs et le monde amateur ont pu bénéficier d'emplois aidés. Mais la ministre du travail a eu la bonne idée de les supprimer... Le nouveau dispositif n'est pas adapté. Or on compte beaucoup sur le monde associatif lorsqu'il y a une crise. Aujourd'hui, les besoins sont énormes. Ne pourrait-on pas rétablir ces emplois aidés pour les collectivités territoriales et les associations sportives ?
Certains clubs professionnels et certaines fédérations disposent de moyens considérables grâce aux droits de retransmission audiovisuelle et mènent grand train, mais ne soutiennent guère le monde amateur. Comment comptez-vous aider ce dernier ?
Mme Roxana Maracineanu, ministre . - En ce qui concerne les associations, nous travaillons à un plan de relance, qui ne sera pas uniquement ministériel, mais qui sera réalisé en lien avec toutes les fédérations. Celles-ci ont tout à fait conscience que la situation des clubs amateurs est difficile. Monsieur Magner, je ne partage pas votre point de vue, car beaucoup de Français ont découvert le sport à l'occasion de cette crise. Le sport figurait d'ailleurs parmi les cinq exceptions de sortie autorisées - ce n'était pas le cas en Espagne ou en Italie. Le Premier ministre a insisté à plusieurs reprises sur l'importance de pratiquer un sport pour la santé. Cette reconnaissance du rôle du sport en termes de santé publique constitue un bon signal. L'enjeu aujourd'hui est de ramener le public vers les associations sportives, en surmontant la peur de la maladie. Nous devons travailler à une campagne nationale de communication en ce sens auprès du public, tout en déployant évidemment des aides pour soutenir les emplois ou contribuer aux frais de fonctionnement.
Une ordonnance est en préparation qui s'inspire du tourisme et autorise les organisateurs d'événements sportifs à proposer aux détenteurs de billets un avoir, au lieu d'un remboursement, afin de soulager leur trésorerie. Nous n'avons pas voulu aller jusqu'au cas des associations, laissant le soin aux fédérations de gérer la situation avec leurs licenciés. Je note avec intérêt votre proposition de crédit d'impôt et nous y réfléchirons avec attention. Les clubs dépendent aussi des financements privés. Or, ceux-ci risquent de diminuer avec la baisse des dépenses de publicité et de communication. C'est pourquoi nous sommes en train d'étudier avec Bercy des manières d'inciter les entreprises à maintenir leurs investissements dans le sport.
En ce qui concerne les équipements sportifs et les piscines, nous travaillons avec l'Andiiss et l'Andes à un plan de réouverture dès que les conditions sanitaires le permettront. Je sais très bien que la préparation physique ne suffit pas et que les nageurs de haut niveau ont besoin d'aller à la piscine pour s'entraîner et pouvoir exercer leur métier, au même titre que les autres professions, mais la réouverture des équipements dépendra de l'évolution de l'épidémie.
Le sport à l'école est important. C'est aussi une opportunité pour les associations de reprendre contact avec les jeunes et les familles. Son développement est au coeur du plan 2S2C sur lequel nous travaillons avec Jean-Michel Blanquer et Gabriel Attal. Nous comptons, d'ailleurs, sur vous aussi pour inciter les collectivités territoriales à rejoindre cette initiative. Nous avons même envisagé avec le mouvement sportif et les associations d'avancer la rentrée sportive, en prévoyant des vacances sportives dès le mois de juillet. Les enfants pourraient ainsi être accueillis dans des stages sportifs à la journée, parallèlement aux activités des centres de loisirs proposées par les collectivités territoriales. De même, les clubs et les associations sportives pourraient proposer des activités lors des colonies de vacances. D'habitude, les clubs s'arrêtent en juillet et en août. Il me semble que, cette année, leur activité devrait plutôt se prolonger. Profitons de l'initiative 2S2C pour nous mobiliser pour accueillir les enfants, avec un nombre d'adultes suffisant pour les encadrer et garantir le respect des normes sanitaires, afin que chacun puisse participer ou envoyer ses enfants en toute confiance.
Les fédérations de sports collectifs ont mis un terme aux saisons en cours. Les compétitions reprendront en septembre, si tout va bien. Certaines fédérations, comme la Fédération française de tennis, la Fédération française de football ou la Fédération française de cyclisme ont créé des fonds de solidarité en faveur du monde amateur. Nous appuyons ces initiatives. De même, l'ANS a maintenu toutes ses subventions et en facilite les modalités d'accès. Nous ne voulons pas non plus supprimer les aides aux organisateurs d'événements sportifs, même si ceux-ci ont dû être annulés.
En ce qui concerne les contrôles antidopage, nous avons rencontré des difficultés, car les personnels de l'Agence française de lutte contre le dopage ont été mobilisés pour faire face à la crise sanitaire. De plus, comme les compétitions ont été supprimées à cause du confinement, le nombre de contrôles a baissé mécaniquement, mais ceux-ci n'ont pas cessé et les sportifs doivent toujours transmettre leur localisation à l'agence. Nous poursuivons aussi notre effort de prévention. Nous avons ainsi préparé un guide spécifique pour le sport de haut niveau, qui explique clairement que le dopage est dangereux pour la santé.
Enfin, les décrets que vous évoquez devraient paraître avant l'été. Nous espérons pouvoir organiser des conférences régionales du sport à la rentrée, avec comme thématique prioritaire le plan de relance dans le sport.
M. Antoine Karam . - Madame la ministre, je vous parle depuis la Guyane. Les outre-mer ont beaucoup apporté au sport français, j'ai en particulier une pensée, que vous partagerez sans doute, pour Malia Metella, première vice-championne olympique de natation issue de l'outre-mer, ainsi que pour son frère Mehdy. Je suis moi-même adepte de sport amateur et je considère que le mouvement sportif est le premier parti de France !
Les associations sportives ont-elles bien bénéficié des dispositifs prévus au même titre que les entreprises en difficulté ? Beaucoup d'actions bénévoles ont été menées dans les clubs, comment s'assurer que ceux-ci ont bien été informés, afin qu'ils ne passent pas à côté des aides financières et organisationnelles auxquelles ils pourraient prétendre pour relancer leur activité dans les semaines qui viennent ? Le sport est en effet un facteur important de socialisation.
Mme Mireille Jouve . - Je partage les préoccupations de mes collègues quant au soutien aux clubs sportifs amateurs, à la baisse des subventions et à la disparition des emplois aidés.
S'agissant de la réouverture de certains équipements sportifs, l'équitation ou le golf se pratiquent dans un cadre spatial peu contraint permettant le respect de la distanciation sociale. La réouverture des parcours de golf et des centres équestres pourrait-elle être envisagée dès le 11 mai, afin de permettre à ces clubs de respirer financièrement ? La même question pourrait être posée à propos de la navigation de plaisance, des sports nautiques et d'autres activités encore.
M. Jean-Raymond Hugonet . - Madame la ministre, vous nous invitez à porter sur votre action un regard critique et bienveillant, je commencerai par la critique. Les propos que vous avez tenus le 22 avril, selon lesquels, par les temps qui courent, « le sport n'est pas prioritaire », étaient d'une grande maladresse, en particulier au vu de la diminution apparente de la surface de votre ministère. Vous avez, certes, rectifié le tir le 24 avril, mais le mal était fait. Pourtant, il n'y a pas de meilleur moment pour promouvoir le sport-santé, un axe important, auquel le Sénat est particulièrement attaché. L'occasion est inespérée : j'ai personnellement vu des gens qui ne couraient jamais s'y mettre. Pourquoi ne vous exprimez-vous pas plus à ce sujet ?
J'ai une pensée, en ce 5 mai, pour mes amis corses : ce jour-là, en 1992, des amateurs de football sont morts en assistant à un match. Pourquoi ne soutenez-vous pas plus Mme Nathalie Boy de la Tour, dans sa tentative de remettre un peu d'humanité dans ce sport populaire ? Les taux d'imposition du football professionnel ne sont pas à la hauteur de ce que celui-ci rapporte ; pourquoi ne vous entend-on pas militer pour plus de raison et de solidarité, en particulier au vu de ce que nous allons vivre après le Covid-19 ?
Mme Roxana Maracineanu, ministre . - La phrase que vous citez a été reprise par L'Équipe sans être remise en contexte ; répondant à une question sur Eurosport, j'ai dit que la santé primait la reprise des compétitions : la priorité, c'est la vie et la santé des athlètes et de nos concitoyens. Je l'assume particulièrement en ce 5 mai !
On connaît les vertus du sport spectacle professionnel, qui représente la quintessence du sport populaire et son rôle dans le quotidien des Français. Ce secteur dispose d'énormément de moyens. J'ai dit il y a deux jours, provoquant la colère de certains présidents de clubs, qu'il n'était pas normal que l'on ne soit pas plus précautionneux en matière d'investissement. Voyez : en un mois de crise, cet écosystème est à genoux. Ce n'est pas possible. Il faut remettre ce fonctionnement en question. Je discute avec Mme Nathalie Boy de la Tour tous les deux jours, les décisions prises le sont en concertation avec elle et avec les instances du football amateur comme professionnel.
Ce n'est pas facile : dans cette période où les médias sont à la recherche de sujets, ils ne parlent malheureusement que du spectacle et pas du sport-santé ou du sport-inclusion. Le contexte a permis au ministère des sports de sortir des tiroirs des éléments sur ces sujets, mais nous dépendons de l'espace médiatique pour le faire savoir ; or, même pendant cette période, c'est le sport professionnel qui intéresse les médias spécialisés, plutôt que des sujets comme la santé ou l'écologie, alors que les compétitions ne peuvent avoir lieu. C'est incroyable ! Il y a pourtant beaucoup d'autres thèmes à traiter. Nous y travaillons donc, même si nous ne parvenons pas toujours à en parler.
En outre, le déconfinement scolaire est prioritaire et je suis heureuse que le sport vienne, dans ce domaine, en soutien à l'éducation nationale. Je sais qu'Olivier Véran est convaincu par le thème du sport-santé, et nous l'évoquerons avec lui dès qu'il pourra souffler. Comme nous l'avions annoncé avec Agnès Buzyn, nous venons de lancer la deuxième vague de labellisation des maisons sport-santé. Notre engagement à terme est d'en ouvrir 500 - il est tenu - et nous mettons ainsi en réseau des acteurs qui feront du sport un véritable outil de santé publique pour aider les gens, physiquement comme mentalement.
Monsieur le sénateur Karam, je vous le confirme, je me suis battue pour que les associations soient nommément inscrites dans la loi, et c'est bien le cas. Il existe 380 000 associations sportives en France, je ne suis pas en mesure d'adresser un mail à chacune d'entre elles, nous misons sur la communication publique via les fédérations pour faire passer le message, et nous comptons également sur vous, parlementaires. Les associations ont accès au Fonds de solidarité, elles peuvent bénéficier du chômage partiel, de prêts garantis par l'État, et les travailleurs indépendants, les auto-entrepreneurs, peuvent être compensés des non-rentrées d'argent, voire du manque de chiffre d'affaires.
La reprise va être possible pour ces associations et les clubs sportifs, y compris pour ceux qui proposent des sports de contact. Il s'agira alors de proposer d'autres activités, conformes aux règles sanitaires, à leurs adhérents. Nous avons besoin que le monde associatif parvienne à restaurer du lien social, par groupes de plus en plus grands.
M. Michel Laugier . - Qu'en est-il du renouvellement des instances fédérales, repoussé en fin d'année ? Ne serait-il pas préférable de le programmer après les jeux Olympiques, soit vers l'automne 2021 ?
Pourriez-vous préciser l'aide au sport amateur et aux collectivités locales ? La période a donné lieu à des dépenses imprévues et à un manque de recettes, les budgets sont donc limités. En outre, le sport amateur repose également sur l'aide des entreprises locales, lesquelles vont également faire face à des problèmes financiers. Comment envisagez-vous la reprise dans ces conditions ?
Au vu de la cacophonie qui a accompagné la décision de mettre fin aux championnats, notamment de football, ne faudrait-il pas revoir la structure des instances ? Entre fédérations et ligues, il y en a peut-être une de trop.
Mme Céline Brulin . - Le dispositif 2S2C accompagne la reprise de l'école et le ministre, M. Blanquer, ainsi que les autorités académiques fondent beaucoup d'espoir dessus pour accueillir les enfants en petits groupes. Cependant, à chaque fois qu'il est évoqué, c'est pour solliciter l'aide des collectivités territoriales dans sa mise en oeuvre. Pouvez-vous préciser quels moyens votre ministère, en particulier, serait en mesure de déployer, en lien, par exemple, avec les clubs sportifs, lesquels pourraient ainsi relancer leur activité ?
En outre, j'espère trouver en vous une alliée pour obtenir la réouverture des plages. Je suis élue de Normandie, nous disposons de très grandes plages, avec des marées, il faudrait les rouvrir à la pratique sportive, car c'est possible sans créer d'attroupements, notamment à marée basse. Nous pouvons laisser cela à l'appréciation des maires, qui sauront en décider. Ce serait de bon sens : les parcs et les jardins publics seront ouverts, il serait incompréhensible que les plages ne le soient pas, d'autant plus que, dans ce cas, la limite de 100 kilomètres désavantagerait les habitants du littoral en excluant de larges territoires de la pratique sportive.
Enfin, tout le monde réfléchit au monde d'après, certains de mes collègues ont souhaité un plus grand ruissellement des ressources du sport professionnel vers le sport amateur. La pratique sportive s'est développée durant cette période de confinement, mais souvent derrière un écran, et cela pourrait donner lieu à des comportements nouveaux. À l'avenir, comment permettre aux clubs amateurs de prendre leur part de ces nouvelles activités ? Ne pourrait-on pas envisager de créer une plateforme publique proposant des activités en ligne en s'appuyant sur la richesse du tissu associatif de nos territoires ?
Mme Céline Boulay-Espéronnier . - Les salles de sport et de fitness ont fait preuve de beaucoup de créativité et d'adaptabilité pour fonctionner à distance au profit de leurs 6 millions d'adhérents, mais plusieurs patrons d'enseignes du secteur accusent les banques de traîner les pieds pour leur accorder des suppléments de trésorerie, alors même que les salariés ont bénéficié du chômage partiel et que les coachs sportifs indépendants ont été aidés par l'État. Pourriez-vous influer pour les aider ?
Je suis une élue parisienne et je vis à proximité du stade Roland-Garros. Ce tournoi permet à la Fédération française de tennis de financer les 8 000 clubs français. Vous avez annoncé que celui-ci ne pourrait se tenir fin septembre que s'il était possible d'autoriser alors la présence de public. Envisagez-vous de lui permettre de se dérouler à huis clos, le cas échéant, afin de limiter les dégâts ? Il est important qu'il se tienne coûte que coûte en raison de l'impact social et économique de ce sport, auquel je suis moi-même particulièrement attachée.
Enfin, l'organisation des jeux Olympiques de 2024 semble menacée, puisque l'on évoque un surcoût de plus de 3 milliards de dollars en raison du report d'un an des jeux de Tokyo.
Mme Colette Mélot . - Je reviens sur la question concernant la reprise des activités équestres, qui est restée sans réponse : comme d'autres secteurs, les poneys-clubs et les centres équestres ne peuvent recevoir de public en vertu du décret du 23 mars. Malgré les annonces autorisant les groupes de dix personnes en extérieur, ces structures demeurent dans l'expectative. Or, outre les activités équestres de plein air, les manèges revêtent des caractéristiques qui rendent possible le respect des règles sanitaires. À moins d'une semaine de l'échéance, pourriez-vous faire une annonce à ce sujet ?
S'agissant des salles de sport, elles connaissent une application très inégale des règles d'encadrement et des obligations d'hygiène et de sécurité. Les salles low cost , en particulier, fonctionnent sous statut simple de loueur d'espace et s'affranchissent des règles de sécurité. C'est alarmant, d'autant que la réouverture prochaine ne tient pas compte de ces différenciations réglementaires. Ne faudrait-il pas rehausser à long terme les obligations d'hygiène et de sécurité pour l'ensemble des salles et organiser une réouverture différenciée selon le nombre d'adhérents par mètre carré ?
Mme Roxana Maracineanu, ministre . - Monsieur le sénateur Laugier, le Premier ministre a annoncé la reprise individuelle du sport, amateur comme professionnel, parce que c'était simple : il suffisait d'aller au-delà de la règle du « un kilomètre » et d'élargir la limite de rassemblement à dix personnes. Il reste maintenant à prendre en compte les spécificités de chaque discipline. C'est un travail complexe que nous menons avec les représentants des différents sports : les 114 fédérations ont chacune été chargées, par avance, d'élaborer un guide spécifique. Elles étaient un peu perdues, car elles ne pouvaient pas se projeter sur une date, mais nous leur avons demandé d'y travailler.
Les sports avec animaux relèvent conjointement de mon ministère et du ministère de l'agriculture, qui a soutenu la filière de l'équitation, par exemple, pour tout ce qui concerne la nécessité de nourrir les animaux. Nous travaillons sur leur reprise. S'agissant des pratiques dans les grands espaces : montagnes, mer, lacs, plans d'eau, forêts, la question relève d'un arbitrage interministériel, car, dans les zones rouges, ces espaces resteront fermés, ou seront refermés. Selon le code couleur, il restera possible, pour les préfets, d'aller au-delà ou en deçà des préconisations. Nous étudions, par exemple, la possibilité de mettre en place des plages dynamiques, comme les parlementaires nous l'ont proposé, qui ne soient que des lieux de passage et non des endroits où déposer sa serviette, car il faut se battre contre le relâchement. Nous ne retrouverons pas le bien-vivre ensemble tout de suite.
Nous sommes toutefois conscients que les sportifs de haut niveau doivent pratiquer en mer, de même, les nageurs ont besoin, à défaut de piscines, d'avoir accès à des lacs, à des plans d'eau en plein air, voire à la mer.
La troisième étape sera l'ouverture des équipements au grand public, lorsque cela sera possible. Nous y travaillons, les sportifs, les associations et les fédérations de marche, d'équitation ou d'escalade, qui ont l'habitude des grands espaces, ont besoin d'être rassurés et nous sommes en contact avec eux. Je comprends leur impatience, mais cela ne revêt aucun caractère d'urgence, contrairement au déconfinement scolaire. Il s'agit de sortir progressivement du confinement afin d'éviter l'afflux de populations. Je vous rappelle que le sport est à la jonction entre plaisir, loisir, passion, et métier.
Concernant les salles de sport et de fitness, elles sont considérées comme les autres établissements recevant du public (ERP) et sont contrôlées. Malgré le caractère privé plus qu'associatif de ces structures, les agents de mon ministère ont vocation à opérer ces contrôles et ces salles ne pourront rouvrir qu'en respectant les règles que le secteur aura lui-même édictées. Comme les hôtels et les restaurants, ces établissements auront besoin d'un accompagnement plus important de l'État : ils sont inclus dans le plan de continuation économique jusqu'à la fin du mois de juin, qui prévoit un report de charges, voire une annulation des charges fiscales et patronales, dans des proportions qui vont au-delà de ce qui est prévu pour d'autres secteurs. Nous suivons cette situation de très près.
Vous m'interrogez sur Roland-Garros et sur les grands événements, comme les jeux Olympiques. Notez que les mesures qui s'imposeront pour l'organisation de ces derniers avaient déjà été prévues avant la crise, car nous avions conçu un projet inclusif, écologique et économique puisque 5 % seulement des équipements devront être construits. Il y aura sans doute des dépassements de coûts, mais la situation est contrôlée activement de manière collaborative par l'État et les collectivités territoriales concernées et les ajustements éventuellement nécessaires seront décidés conjointement. Le report des jeux de Tokyo et l'incertitude sur les compétitions à l'avenir sont inquiétants, nous faisons ce que nous pouvons pour rassurer les acteurs concernés.
À mon sens, Roland-Garros n'a de sens que si le public peut y assister. Si ce n'était pas possible, il faudrait au moins que les joueurs puissent s'entraîner, se rencontrer et voyager. Tous les scénarios sont à l'étude, mais ce sont les organisateurs qui ont proposé des reports tant que la tenue du tournoi en configuration classique n'était pas envisageable.
S'agissant du Tour de France, l'Union cycliste internationale (UCI) a annoncé un calendrier prévoyant des compétitions préparatoires en août. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que les compétitions puissent reprendre, avec pour priorité la sécurité des sportifs et en anticipant la reprise des entraînements en amont.
La date des élections fédérales a fait l'objet d'un consensus général de toutes les fédérations et du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et a été fixée au 30 avril de l'année prochaine. Nous pensions aussi que l'on nous proposerait de les tenir après les jeux Olympiques, mais nous avons apprécié cette décision commune comme un geste démocratique marquant l'attachement au respect des mandats et aux modalités d'élection. Les élections au CNOSF auront ainsi lieu au mois de juin ; l'ANS devra donc jouer pleinement son rôle pour assurer la continuité technique et sportive, dans la mesure où la gouvernance sera susceptible de changer quelques mois avant les jeux Olympiques, afin de garantir la stabilité des préparations comme des critères de sélection.
Je n'ai pas l'intention de m'immiscer dans la gouvernance des instances sportives, qui relève d'une réflexion commune à mener entre le sport professionnel, les clubs, la Fédération et la Ligue. Le lien est très fort entre le sport et l'État, je le réaffirme, ainsi qu'entre les ligues professionnelles et les fédérations. Ce sont ces dernières qui signent un contrat de subdélégation avec les ligues, lesquelles ne sont donc pas des entités privées et indépendantes : il existe bien un lien entre le sport professionnel et le monde amateur avec des modalités de redistribution financière et d'équité, dont on peut discuter. Le contexte est en effet propice à réfléchir à tout cela, et j'aurais préféré que les quelques mois de confinement permettent aux acteurs de se poser les bonnes questions plutôt que de se demander quel jour il fallait arrêter le championnat.
Enfin, en ce qui concerne le protocole 2S2C, nous avons mobilisé l'ANS pour réorienter des moyens vers l'éducation nationale ; les fédérations sont très intéressées, car elles recherchent depuis longtemps ce lien avec l'éducation nationale, et le mouvement sportif est très heureux d'y être associé. Les modalités de cette mobilisation feront l'objet de discussions avec les collectivités territoriales.
Audition de M. Didier Guillaume,
ministre de l'agriculture et de
l'alimentation
JEUDI 7 MAI 2020
___________
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Nous continuons notre série d'auditions consacrées à la crise sanitaire en accueillant aujourd'hui Didier Guillaume, ministre de l'agriculture et de l'alimentation, pour évoquer la situation de l'enseignement agricole.
Monsieur le ministre, vous le savez, notre commission est particulièrement attachée à cet enseignement. Il constitue un formidable outil pour les jeunes avec des taux d'insertion professionnelle que je souhaite une fois encore saluer : selon les derniers chiffres, le taux net d'emploi à trois ans après la fin de la formation initiale atteint 76 % chez les titulaires d'un CAP agricole, 82 % pour les titulaires d'un bac pro agricole et 90 % pour ceux titulaires d'un BTS agricole.
Surtout, les établissements de formation agricole sont des laboratoires d'innovation, ancrés dans nos territoires et acteurs de la proximité. Nous avons tous des exemples dans nos départements de lycées agricoles, de maisons familiales rurales dont nous sommes particulièrement fiers.
Toutefois, nous avons noté que ni le Président de la République, ni, plus récemment, le Premier ministre dans ses interventions devant l'Assemblée nationale ou le Sénat n'avaient évoqué la situation particulière des établissements d'enseignement agricole. Déjà, les précisions apportées début avril par Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale, sur les modalités du bac 2020, ont suscité de nombreuses critiques parmi les syndicats enseignants de la filière agricole. Ils dénonçaient une décision unilatérale de la part du ministère de l'éducation nationale s'imposant à l'enseignement agricole.
Pouvez-vous nous en dire plus sur l'état de la concertation avec les syndicats, tant au niveau national qu'au niveau régional ? Il semblerait qu'il y ait des difficultés au niveau local avec certaines directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Par ailleurs, pouvez-vous nous faire un état des lieux du suivi pédagogique des élèves pendant la période de confinement ? On parle de 5 à 8 % d'élèves en situation de décrochage dans l'éducation nationale, mais des taux plus élevés pour les lycées professionnels. Qu'en est-il dans l'enseignement agricole ? Quelles solutions ont été mises en place pour permettre cette continuité pédagogique pour les élèves qui ne pouvaient accéder à un enseignement numérique ?
Comment se prépare la réouverture des établissements agricoles et dans quelles conditions ? Les problématiques des transports scolaires, de la restauration et de l'internat y sont particulièrement importantes. Une date est-elle envisagée ?
Toujours dans le domaine de l'enseignement, mais cette fois-ci concernant le supérieur, comment vont se dérouler les concours d'accès aux écoles nationales d'agronomie, vétérinaires ou de paysage ?
Enfin, nous souhaiterions savoir comment la recherche en agriculture, par l'intermédiaire du nouvel Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae), se mobilise contre le Covid-19.
Monsieur le ministre, nous vous écoutons.
M. Didier Guillaume, ministre de l'agriculture et de l'alimentation . - Merci madame la présidente, mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous sur l'enseignement agricole et supérieur, aussi précisément que possible compte tenu des constantes évolutions.
La mise en place des mesures de déconfinement dans l'enseignement en général se fait dans le cadre de concertations avec Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale, et Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur. Personne ne comprendrait que chacun reste dans son silo ! Nous avons dans l'enseignement agricole 200 000 apprenants. Il y en a plus de 10 millions dans l'éducation nationale.
Nous travaillons ensemble avec Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal, mais nous menons parallèlement des réunions spécifiques avec l'ensemble des syndicats et les Directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) qui sont l'équivalent de nos recteurs. Le déconfinement ne sera réussi que s'il est progressif, à l'inverse du confinement qui a été brutal. Et je tiens à vous assurer, madame la présidente, que nous travaillons en bonne intelligence et en totale concertation, j'y suis très attaché.
Je vous précise que quelques membres de mon équipe assistent à cette visioconférence : Mme Chmitelin, la nouvelle directrice générale de l'enseignement et de la recherche (DGER) qui était précédemment ma directrice de cabinet, M. Bonaimé jusqu'alors conseiller en charge de l'enseignement agricole et maintenant directeur de cabinet adjoint, M. Ginez, mon nouveau conseiller pour l'enseignement agricole, la recherche, l'innovation et l'installation des jeunes qui était précédemment au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ainsi que Bénédicte Bergeaud, ma conseillère parlementaire.
Je tiens à saluer le travail accompli par les fonctionnaires de mon ministère, par toutes les personnes en « deuxième ligne » comme l'a évoqué le Président de la République, ainsi que le fort engagement de la « première ligne », représentée par l'ensemble de nos soignants et scientifiques, sans oublier les familles endeuillées et les personnes qui ont souffert.
La « deuxième ligne » a tenu parce que la production et l'ensemble de la filière alimentaire et agroalimentaire ont tenu mais aussi parce que l'enseignement agricole, supérieur et technique a mené ses missions essentielles en assurant la continuité pédagogique. Nos plus de 16 000 enseignants et intervenants n'ont pas failli, même si cela n'était pas simple - j'ai pu le constater lors des comités techniques ministériels qui réunissent les organisations syndicales et le secrétariat général du ministère. La DGER est en constante discussion avec les organisations syndicales.
Nos 138 363 élèves, nos 35 086 apprentis et nos 35 278 étudiants ont tenu.
L'enseignement agricole, une pépite dont je fais une priorité, a su s'adapter à cette crise, parce qu'il est agile. Il est un atout pour l'alimentation et l'agriculture, au moment où cette dernière n'a jamais été autant dans les discussions de nos concitoyens. Nous le savons, c'est par la formation, par l'enseignement technique agricole, la recherche et l'enseignement supérieur que nous y arriverons.
Il me semble important de ne pas oublier : en effet comme je le dis depuis dix ans, et je l'ai récemment rappelé lors d'une précédente audition, l'enseignement agricole perdait des effectifs. Or, si à la rentrée 2018/2019, il y avait 3 000 élèves en moins par rapport à l'année scolaire précédente, il y en a eu 3 000 de plus à la rentrée 2019/2020 ! Nous avons réussi notre pari, grâce à des orientations fortes lancées en totale concertation avec les cadres, les enseignants, les directeurs d'établissements, les collectivités, les élus et les professionnels.
Avant cette crise, j'avais lancé un certain nombre d'orientations pour changer cet enseignement agricole, non pas de fond en comble mais en termes qualitatifs. Nous avons d'abord lancé « L'aventure du vivant » qui a permis de « raccrocher » des élèves. Ils ont ainsi perçu l'enseignement agricole non plus comme un second choix mais comme un primo choix, permettant de leur assurer un travail et des métiers intéressants. La réforme des diplômes a aussi été un choix fort et je souhaite que la Direction générale de l'enseignement et de la recherche (DGER) continue d'y travailler. Nous avons voulu « enseigner pour produire autrement » ou plutôt « enseigner à produire autrement » parce que notre formation ne peut être déconnectée de la réalité.
Nous avons également beaucoup travaillé sur la refondation de l'enseignement vétérinaire, pour notamment pallier le manque de vétérinaires en zones rurales.
Enfin, nous avons fait évoluer la doctrine au sein du ministère avec la réforme, absolument indispensable, de la recherche et de l'enseignement supérieur en matière agricole et environnementale, qui s'est traduite par cette magnifique fusion de l'Inra et de l'Irstea, devenus Inrae, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, et avec le lancement du très beau chantier de regroupement des sites franciliens d'AgroParisTech et de l'Inra sur le campus Paris-Saclay.
Enfin, j'ai veillé à ce qu'il n'y ait aucune fermeture d'établissements ou de classes. Je ne fais pas de différence entre les trois familles de l'enseignement agricole, elles sont toutes indispensables. J'ai bien sûr la responsabilité de l'enseignement public mais l'enseignement privé ou les maisons familiales rurales (MFR) jouent aussi un rôle essentiel de maillage sur tout le territoire.
Nous avons souhaité repositionner la formation au plus près des attentes sociétales : la transition agroécologique, qui doit être enseignée et mieux enseignée, le bien-être animal, qui est une préoccupation forte, l'élargissement du champ des compétences transversales : le digital, le numérique, ...
Ces réformes, lancées il y a dix-huit mois, ont été percutées par la crise sanitaire actuelle mais je tiens à affirmer devant votre commission que celle-ci ne doit pas arrêter la dynamique réformatrice du ministère. L'enseignement agricole a su s'adapter, à la fois au niveau de la continuité pédagogique qui est une problématique essentielle, notamment pour les parents, mais aussi au niveau de la continuité productive de nos exploitations agricoles. Je crois que cette visioconférence est retransmise, je tiens donc à préciser que nos exploitations agricoles et nos fermes travaillent et que plus de 95 % des jeunes ont ainsi pu poursuivre leur formation pendant cette période.
Je veux à nouveau saluer la mobilisation sans faille de nos équipes, et contrer les critiques et dénigrements trop faciles envers les fonctionnaires, sur lesquels on peut s'appuyer pourtant en temps de crise. La DGER a fourni un travail remarquable pour permettre l'enseignement à distance, soit par internet - 12 000 classes virtuelles ont été ouvertes, ce qui est conséquent au regard de la taille de notre ministère - soit par les services de Docaposte. J'ai bien entendu les remarques émises par certains sénateurs sur le fonctionnement de La Poste durant cette crise, mais il n'empêche que leurs services ont permis de faciliter l'échange de documents entre les enseignants et les élèves en rupture numérique, souvent parce qu'ils résident en zones blanches, ou n'ont pas accès à internet.
En totale coordination avec les trois ministères concernés, une Foire aux questions a été mise en place sur internet pour répondre aux nombreux questionnements des jeunes : le passage du bac, la fin de leur stage, l'organisation de la rentrée dans le supérieur, ...
J'ai veillé à ce que l'enseignement agricole soit présent tout au long de cette crise, même si bien sûr certaines de ses spécificités empêchent l'apprentissage à distance, comme la partie service à la personne, notamment dans les MFR.
La mobilisation des écoles vétérinaires dans la réserve sanitaire pour contribuer à la santé de nos concitoyens, celle de nos laboratoires vétérinaires pour les tests et celle de certains de nos internats pour l'accueil des personnes sans domicile fixe et isolées, ont été des actions fortes de solidarité.
Cette crise ne sera pas sans impact sur les effectifs. Nous allons devoir y retravailler, recréer la dynamique que nous avions initiée comme par exemple relancer à la rentrée prochaine le tour de France des territoires, en utilisant le camion de l'Aventure du vivant qui devait aller au plus près des jeunes. L'impact est également social car, comme l'a dit le Président de la République, les conséquences de cette crise n'ont pas été les mêmes selon votre lieu de vie (maison ou appartement, zones rurales ou urbaines) et votre niveau d'équipement (internet, ...).
Je conclurai en rappelant que pour réussir, le déconfinement doit être progressif et être accepté par tous, effectué en coordination entre nos ministères précédemment cités mais également celui du travail en ce qui concerne nos Centres de formation des apprentis (CFA) et nos centres de formation professionnelle et de promotion agricole (Cfppa). Il doit aussi inclure, M. Karam sait que nous y veillerons, les territoires d'outre-mer.
Cette concertation devra également se faire en interne et tenir compte des spécificités, dont celles de nos lycées multi-pôles et multi-sites qui regroupent les Cfa, Cfppa, exploitations, centres équestres, ... ; l'internat par exemple représente 100 000 de nos 200 000 apprenants, soit 50 % d'entre eux, contre 10 % dans l'éducation nationale. Il faudra continuer de les loger en appliquant les mesures sanitaires, la sécurité des enseignants, des élèves et de tous les personnels étant une priorité. Il n'y aura pas de reprise des cours si la sécurité sanitaire ne peut pas être assurée.
Cette crise a révélé l'importance de la souveraineté alimentaire qui ne pourra se faire qu'avec le renouvellement des générations auxquelles nous devons donner des perspectives positives.
L'enseignement agricole doit continuer à jouer un rôle moteur pour l'économie et la population. Si nous sommes capables de jumeler formation, éducation, recherche avec compétitivité et innovation, et ce à tous les échelons, national, régional, local, et en concertation avec les enseignants et les syndicats, nous atteindrons notre objectif principal qui est de voir nos jeunes continuer à apprendre. Vous avez évoqué, madame la présidente, le taux de 5 % de décrocheurs : il nous faut impérativement le diminuer.
Nos lycées agricoles, techniques, les MFR, les CFA, vont donc ré-ouvrir progressivement et tranquillement, dans le cadre de la prévention et de la sécurité sanitaire, et nous suivrons individuellement tous ceux qui ne pourront être présents physiquement.
Je suis prêt à répondre à vos questions, en vous rappelant combien notre ministère, mon cabinet et la DGER sont à votre disposition madame la présidente ainsi qu'à celle des membres de votre commission.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je vous remercie monsieur le ministre pour ce propos liminaire complet. Je tiens à vous dire que notre commission a à coeur de suivre de très près les conséquences de cette crise sanitaire, secteur par secteur. Nous avons ainsi constitué un groupe de travail transpartisan, animé par notre collègue, Antoine Karam, qui auditionne et consulte, en lien avec votre ministère. Cette audition vise à approfondir le travail mené par ses membres qui partagent une passion commune pour l'enseignement agricole. Je donne donc la parole à Antoine Karam, avec nous depuis la Guyane.
M. Antoine Karam . - Je vous remercie, monsieur le ministre, au nom du groupe de travail que je pilote, pour l'ensemble des précisions que vous nous avez apportées.
J'en profite pour saluer l'ensemble de vos collaborateurs et collaboratrices et particulièrement M. Olivier Ginez, qui était il y a peu de temps encore en Guyane dans le cadre d'autres fonctions.
Ce groupe de travail sur l'enseignement agricole, mis en place à l'initiative de la présidente, a auditionné un certain nombre d'acteurs de l'enseignement agricole : des syndicats enseignants, des syndicats des personnels, des représentants de parents d'élèves, des MFR ou encore le Conseil national de l'enseignement agricole privé (CNEAP). Il en ressort une grande inquiétude pour l'avenir de l'enseignement agricole. Les établissements d'enseignement agricole connaissent des pertes financières importantes. Le CNEAP a ainsi évoqué une perte de 15 millions d'euros. Or, un certain nombre d'exploitations agricoles et d'établissements d'enseignement étaient déjà dans des situations financières compliquées avant même la crise de Covid-19.
À cela s'ajoutent des problèmes de recrutement des élèves : l'enseignement agricole est mal connu. Je sais que votre ministère y travaille pour y remédier. Les journées portes ouvertes, mais aussi l'orientation et l'information en fin d'année scolaire jouent un rôle fondamental pour faire découvrir cette voie d'enseignement. À peine un tiers des élèves inscrits dans les lycées agricoles se destine à des métiers en lien avec le secteur de l'agriculture ! Or, cette année, de nombreux établissements n'ont pas pu organiser de journées portes ouvertes et faire connaitre la diversité des formations proposées. Quant aux conseils de classe et à l'information des élèves, ils se font dans des conditions plus dégradées que les années précédentes.
Enfin, les familles hésitent à inscrire leurs enfants dans l'enseignement agricole, en raison des grandes incertitudes pesant sur leur projet pédagogique : je pense à la tenue des stages, mais aussi aux conditions logistiques d'accueil à la rentrée de septembre 2020. Les établissements ne savent pas si elles doivent accepter le même nombre d'inscription en internat ou bien un nombre plus faible.
Difficulté financière, interrogation sur le maintien du projet pédagogique dans des conditions satisfaisantes, moindre information sur cette filière : l'enseignement agricole est aujourd'hui en grande précarité. De ce constat découlent plusieurs questions :
Premièrement, à combien s'élèvent les pertes financières pour l'ensemble de l'enseignement agricole depuis le début du confinement ? Un soutien financier est-il prévu ? Il en va de l'attractivité de l'enseignement agricole : comment attirer des jeunes alors qu'au même moment l'exploitation agricole de l'établissement dépose le bilan ?
Deuxièmement, pour la première fois depuis de nombreuses années, on a constaté à la rentrée 2019 une augmentation du nombre d'élèves inscrits dans l'enseignement agricole, notamment en raison d'une action volontariste de votre ministère ainsi que du ministère de l'éducation nationale, que je salue. Or, cette dynamique risque d'être cassée. Quelles mesures vont être prises pour faire connaître l'enseignement agricole dans le contexte particulier actuel ?
Troisièmement, que pouvez-vous répondre aux chefs d'établissement et aux familles qui s'interrogent sur des questions logistiques très concrètes mais renvoyant directement au projet pédagogique des lycées agricoles : le maintien d'un nombre suffisant de lits en internat dans le respect des conditions sanitaires, les stages. Sur ce dernier point, votre ministère est-il en négociation avec les branches professionnelles et les entreprises pour permettre le retour des élèves, dans des conditions de formation et de protection satisfaisantes ?
Enfin, quatrième et dernière question : le Gouvernement s'était engagé à porter un plan de requalification et de revalorisation salariale pour les agents de catégorie 3 de l'enseignement agricole privé sous contrat. Revalorisation intégrée au budget lors de l'examen de la loi de finances pour 2020. Cependant, le décret de mise en oeuvre de ce plan n'a visiblement pas encore été pris. Pouvez-vous nous donner votre éclairage ?
M. Didier Guillaume, ministre de l'agriculture et de l'alimentation . - Je vous remercie, monsieur le rapporteur, pour ces questions très claires.
Les pertes financières pour l'ensemble de l'enseignement agricole depuis le début du confinement s'élèvent à une centaine de million d'euros.
Les Journées portes ouvertes (JPO) n'ont en effet pu avoir lieu mais les JPO virtuelles mises en place se sont très bien passées et ont permis d'informer nos jeunes le mieux possible.
En ce qui concerne les internats, chaque inscription pour l'année scolaire 2020/2021 sera prise en compte et nous ferons le point en septembre, nous ne pouvons le faire avant. S'il nous faut diviser par deux, voire par trois, le nombre de lits, il faudra trouver d'autres modalités pour nos internes. En revanche, je tiens à le souligner : pour la rentrée 2020-2021, nous inscrivons tout le monde.
Le problème qui s'est posé sur les stages et les apprentis a pu être décalé. Et nous travaillons bien sûr, monsieur Karam, en lien avec les filières professionnelles pour que toutes nos formations, initiales et continues, soient en adéquation avec elles.
S'agissant de la revalorisation financière, le Gouvernement s'y était engagé à travers la loi ASAP, mais celle-ci étant stoppée par la crise, la revalorisation est décalée mais ne doutons pas qu'elle sera mise en place dès que possible.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je vais maintenant donner successivement la parole à nos deux rapporteurs : Mme Laure Darcos pour la recherche, puis M. Stéphane Piednoir, pour l'enseignement supérieur.
Mme Laure Darcos . - Je souhaite insister, monsieur le ministre, sur le nouvel établissement public, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae), qui prend toute sa part dans les projets de recherche sur le Covid-19. Je voudrais que vous puissiez nous parler de cette fameuse protéine qui aurait été trouvée par un laboratoire américain et l'Inrae, démontrant la manière dont celle-ci infecte les cellules et génère ce coronavirus.
Je ne suis pas scientifique, et vous non plus monsieur le ministre, mais cela intéresse nos collègues et je suis fière de voir que l'Inrae contribue à la mobilisation de notre recherche et à cette course contre la montre pour trouver des solutions.
Par ailleurs, à titre personnel, je tenais à vous remercier car vous avez été le premier membre du Gouvernement à défendre les marchés et à dire qu'il fallait les ré-ouvrir, combat pour lequel je me suis beaucoup engagée, et qui a permis de desserrer un peu l'étau pour nos préfets.
M. Stéphane Piednoir . - J'ai quelques questions ciblées sur l'enseignement supérieur. Vous avez évoqué la continuité pédagogique : pouvez-vous nous faire état des difficultés éventuelles rencontrées par les étudiants dans l'enseignement agricole, pour lequel les aspects pratiques sont différents des autres enseignements ? En outre, comment l'interruption de certains stages va-t-elle être prise en compte pour la validation des bacs professionnels, la partie professionnelle étant essentielle dans ce diplôme ?
Pour les BTS agricoles, il a été convenu qu'ils soient évalués de manière continue. Avez-vous connaissance de réticences car c'est justement sur le dernier trimestre de l'année scolaire qu'étaient concentrées certaines pratiques ?
Dernière question sur le recrutement au sein de nos écoles d'agronomie ? Comment se passe-t-il, sachant qu'il existe des difficultés pour examiner les dossiers ? L'ensemble des établissements supérieurs ayant choisi de fermer leurs portes jusqu'en septembre, comment se réunissent les jurys ?
Je partage vos propos quant à la revalorisation du métier et au terme de primo choix que vous avez employé. Ne faudrait-il pas lancer une action de communication sur tous les métiers de l'agriculture pour favoriser l'augmentation des effectifs que vous avez évoquée ?
M. Didier Guillaume, ministre de l'agriculture et de l'alimentation . - Chère Laure Darcos, vous n'êtes pas scientifique mais vous connaissez beaucoup plus de choses que moi dans le domaine de la recherche ! Je suis dans l'impossibilité de vous répondre, mais je vais demander à M. Philippe Mauguin, le président-directeur général de l'Inrae, à l'issue de cette audition, de vous fournir des informations, qu'il faudrait peut-être insérer dans les Faq de notre site internet.
Nos laboratoires vétérinaires travaillent depuis longtemps sur la famille des coronavirus - et ces derniers sont nombreux ! -. Je pense notamment à l'École nationale vétérinaire de Toulouse, et ce n'est pas parce que leur ancienne directrice n'est autre que notre nouvelle directrice générale de l'enseignement et de la recherche ! Mme Chmitelin a mis en place un gros travail de partenariat avec l'Institut Pasteur sur la question de l'air ambiant dans certains locaux hospitaliers, notamment au CHU de Purpan, en lien avec l'Inserm. Je tiens également à citer l'action de l'École nationale vétérinaire d'Alfort dans le cadre du consortium de recherche REACTing.
Je sais d'ailleurs que vos connaissances, madame Darcos, sont telles que vous êtes en mesure de répondre beaucoup mieux que moi à vos questions, mais j'espère que mes réponses vous conviennent !
Je vous remercie, monsieur Piednoir, pour vos questions concrètes auxquelles je vais essayer de répondre tout aussi concrètement. Nos étudiants sont, comme nous, victimes de cette situation mais ils ne doivent pas l'être deux fois plus. Cela a engendré beaucoup de discussions, mais je me suis engagé, à partir du moment où certains élèves étaient en difficulté en terme de stage ou de validation de concours, à ce qu'ils ne soient pas empêchés d'obtenir leur diplôme. Ceci concerne également les BTS agricoles.
Concernant le recrutement pour l'enseignement supérieur et les concours d'accès à nos écoles, la directrice générale de l'enseignement supérieur et de la recherche m'a assuré que le nécessaire avait été fait pour s'adapter aux circonstances, à l'instar des autres concours d'accès aux grandes écoles. Pour exemple, les épreuves du concours A par voie principale après la classe préparatoire, qui réunissent plus de 3 000 candidats, sont devenues des épreuves uniquement écrites.
En revanche, pour les concours parallèles, ceux qui permettent une diversification des profils de recrutement - par exemple, devenir vétérinaire après avoir fait un BTS ou devenir ingénieur agronome par apprentissage -, soit environ 15 000 candidats répartis sur six concours, j'ai obtenu à ce que les entretiens de motivation soient maintenus en juillet, au besoin de manière dématérialisée. Ils jouent en effet un rôle très important pour recruter les futurs vétérinaires et ingénieurs sur des aptitudes et non sur des critères purement académiques.
En ce qui concerne la question de la communication sur les métiers de l'agriculture, nous avions amorcé une grande campagne et je tiens à vous assurer que nous la remettrons en place dès que possible. Cette crise aura au moins permis de mettre en évidence l'agriculture, souvent décriée, toutes les entreprises agroalimentaires, tous les métiers de l'agriculture et notamment ceux liés à la recherche et à l'innovation.
Au sein de mon ministère, sur les 1 000 dossiers qu'il faut gérer quotidiennement, le plus essentiel est l'avenir de nos jeunes, et pour reprendre l'expression du Président de la République, il faut « quoi qu'il en coûte » amener ces jeunes à avoir la meilleure formation possible aux métiers de demain.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Nous partageons votre avis sur cet enjeu pour les jeunes. Je vais maintenant donner la parole à notre rapporteur chargé de la jeunesse, M. Jacques-Bernard Magner, qui représente le groupe socialiste et républicain.
M. Jacques-Bernard Magner . - Monsieur le ministre, je tiens à vous féliciter pour la réussite de l'opération de soutien aux agriculteurs pour les récoltes que vous avez lancée. Il semblerait que cette réserve sollicitée en l'absence de main-d'oeuvre étrangère ait bien fonctionné. Le Service national universel (SNU) qu'on adosse souvent au secteur militaire, ne pourrait-il pas finalement être utilisé dans ce cadre-là pour nos structures agricoles ? Le Président a évoqué la difficulté alimentaire mais l'agriculture a tenu et a permis que cette période se passe plutôt bien, même si certains agriculteurs n'ont pu écouler toutes leurs marchandises.
Vous souhaitez à juste titre revaloriser l'image de l'enseignement agricole. Les jeunes y vont en effet le plus souvent car ils sont issus de familles d'agriculteurs. Pourtant il y a un certain nombre de métiers aujourd'hui en tension qui attendent des bras mais aussi des têtes car il faut une technicité importante pour être agriculteur. Donc, à la lumière de cette crise, à quelles solutions avez-vous pensé pour que les métiers agricoles soient promus ?
Enfin, s'agissant des stages, qui sont de plus en plus difficiles à trouver pour les apprentis faute d'un nombre suffisant de maîtres-formateurs, ne serait-il pas bon de créer un statut du scolaire alternant pour aider à la recherche de stages auprès des professionnels de l'agriculture et permettre aux jeunes de commencer une formation scolaire en attendant de trouver un contrat d'apprentissage?
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je vais prendre une série de questions après celles de M. Magner, si vous en êtes d'accord monsieur le ministre, et je vais donner la parole à Mme Vérien pour le groupe Union centriste.
Mme Dominique Vérien . - Monsieur le ministre, Vous parlez de pleine concertation mais les MFR, au moins dans mon département, ne l'ont pas ressenti comme tel. Elles ont même parfois reçu les instructions de votre ministère en même temps que les parents, ce qui a compliqué le fait de se préparer à leur répondre et à les rassurer. Quant aux difficultés de la rentrée, les élèves de ces structures sont parfois six par chambre. Enfin, les élèves des MFR sont parfois éloignés de la nation apprenante et ils ont plutôt besoin de choses pratiques et d'encadrement. J'espère que la concertation dont vous parlez tant va arranger la situation.
Je souhaite aussi parler des stagiaires, pas des apprentis qui, sous la coupe de leur maître de stage, sont sous la responsabilité de l'entreprise, mais des autres, ceux qui sont sous la responsabilité du chef d'établissement. Est-ce à lui de vérifier si l'accueil du stagiaire se fait dans le respect des conditions de sécurité sanitaire actuelles ?
Les portes ouvertes virtuelles réussies que vous avez évoquées n'ont pas été un grand succès pour les MFR. Elles ont donc assez peu d'inscriptions. Or, les financements attribués seront définis sur la base du nombre d'élèves au 1 er octobre. Ne pourrait-on pas décaler d'un ou deux mois ce décompte, car beaucoup de choix risquent d'évoluer en septembre, et ces financements sont importants pour éviter de se séparer de formateurs ?
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - J'en profite pour excuser Mme Billon qui devait intervenir également pour le groupe Union centriste. Je donne la parole à Mme Brulin, pour le groupe CRCE.
Mme Céline Brulin . - Monsieur le ministre, le Président de la République a annoncé le déconfinement au 11 mai le 13 avril dernier, et la communauté éducative a ressenti que les semaines qui ont suivi n'ont pas été suffisamment mises à profit pour préparer très concrètement la rentrée. Celle-ci devrait s'effectuer pour les lycées, selon l'annonce du Premier ministre, au-delà du 2 juin et commencerait probablement par les lycées professionnels, ce qui ne paraît pas incongru. Si cela inclut, comme nous le pensons au sein de notre groupe de travail, les lycées agricoles, nous disposons d'un peu plus de temps pour véritablement préparer cette rentrée.
Je rejoins les propos prononcés à l'instant : il y a un certain nombre d'acteurs qui ne se sentent pas suffisamment associés. Or certaines questions relatives aux lycées agricoles sont encore plus complexes que celles de l'éducation nationale, comme le décrochage qui semble plus important en cette période d'enseignement à distance.
Il y a aussi la question des internats que vous avez à juste titre évoquée : que faire, lorsque l'on sait que 50 % des élèves sont concernés, et qu'à la reprise éventuelle de juin ou septembre, on ne pourra pas tous les loger dans des chambres collectives ? Même chose pour les transports, les périmètres de recrutement des lycées agricoles étant très larges. Je pense aussi aux demandes qui s'expriment sur le gel des stages, cette question nécessite d'être tranchée même si je conçois que ce ne soit pas simple.
Enfin, deux derniers sujets et non des moindres : avant même la crise sanitaire, la question des seuils de dédoublement étaient souvent évoquée. Celle-ci se pose aujourd'hui avec encore plus d'acuité compte tenu des circonstances qui restreignent le nombre de personnes par groupe. Qu'en sera-t-il à la rentrée ? Et qu'avez-vous également prévu pour tous les emplois directement imputés sur les budgets des établissements et qui, parce que ce sont des contrats de droit public, ne bénéficient pas des mesures de chômage partiel ?
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - La question des transports renvoie aux régions, vous allez peut-être pouvoir nous en dire plus sur la construction de ce lien avec la collectivité en charge du transport scolaire ? Je donne maintenant la parole à M. Grosperrin, rapporteur des crédits « enseignement scolaire ».
M. Jacques Grosperrin . - La présidente l'a fort bien dit dans ces propos liminaires, l'enseignement agricole est un laboratoire d'innovations, souvent en avance. J'ai le sentiment que le public qu'il concerne est un peu plus fragile et que cet enseignement a été mis un peu plus en difficulté par le confinement ; il semble donc qu'il y ait plus de décrocheurs, certainement davantage que les 5 % annoncés. Pouvez-vous nous en dire plus sur la manière dont l'enseignement agricole s'est adapté vis-à-vis de ces décrocheurs ?
En ce qui concerne la question de la suppression des stages en entreprises, ont-ils été compensés ou rattrapés, cette expérience étant primordiale ? Comment se prépare le redémarrage des Cfppa ?
Le ministre de l'éducation nationale souhaitait faire reprendre les lycéens des classes à examen uniquement et les classes charnières. Certains demandent la suppression des épreuves de français. Quelle est votre position ?
Et enfin, s'agissant du recrutement au sein des MFR, une crainte existe pour les 4 e et 3 e car il semble que du fait du confinement, les futurs apprenants potentiels aient moins la possibilité de découvrir les formations proposées par les MFR et se retrouvent donc un peu « bloqués » dans le système d'enseignement de l'éducation nationale.
M. Jean-Yves Roux . - Merci monsieur le ministre pour vos propos préliminaires. Mes questions portent sur les lycées et formations supérieures agricoles de type BTS agricoles. Dans le plan de déconfinement présenté récemment au Sénat, il a été annoncé que l'ouverture des lycées ne serait décidée que fin mai et que l'enseignement professionnel serait prioritaire. Pouvez-vous nous en dire plus sur la validation ou non des années et cursus lorsque les stages n'ont pas pu se tenir et sur le report éventuel de ces stages en juillet ou septembre ?
Est-il envisageable que les étudiants à partir de 16 ans et surtout les apprentis, puissent effectuer des stages dès cet été ? Le cas échéant, comment sera-t-il possible de garantir la sécurité de tous et ainsi aider les petites exploitations à continuer de prendre des stagiaires et apprentis ? Ces exploitations _ vous les connaissez bien au niveau de la Drôme - n'auront pas les moyens sur le long terme de désinfecter et de procurer des masques et des solutions hydroalcooliques.
Mme Colette Mélot . - Merci monsieur le ministre pour toutes les précisions que vous nous avez apportées. Ma première question porte sur l'épreuve orale de français en première STAV (Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant). L'intersyndicale nous a récemment informés de sa demande de suppression de ces épreuves, les conditions de préparation compte tenu de l'épidémie ne permettant pas à l'ensemble des élèves d'aborder sereinement cette épreuve mise en place pour la première fois cette année. Quelle suite entendez-vous donner à cette demande ?
Ma deuxième question concerne la réouverture des CFA prévue le 11 mai. Or, nombre de ces centres occupent les locaux des lycées qui resteront quant à eux fermés, leur entretien étant placé sous la responsabilité des conseils régionaux. Comment sera assuré l'accueil des apprentis, des stagiaires et du personnel de ces centres dans le respect des protocoles sanitaires ?
Mme Maryvonne Blondin . - Je regrette, monsieur le ministre, que dans le protocole élaboré par l'éducation nationale, il n'y ait pas eu une fiche spécifique sur les établissements agricoles. L'internat fait véritablement partie du projet pédagogique de l'établissement agricole. Ce projet comporte à la fois un volet éducatif, de vie collective via l'internat, mais aussi un volet d'apprentissage de la vie économique : ces jeunes peuvent y développer un réseau de ventes de leurs produits qui leur permet de mettre en place différentes techniques de commercialisation, en lien avec les producteurs locaux et la population locale. Cela génère des ressources propres qui permettent aux établissements de financer d'autres projets. Or, on connait la fragilité financière de ces établissements, qui risque d'être accentuée par la crise de Covid-19.
Je voudrais également attirer votre attention sur la rentrée normalement prévue le 2 juin prochain pour ces élèves d'internat. Ils viennent de toute la France, selon les spécialités enseignées, et les transports représentent une réelle inquiétude pour les chefs d'établissement. Vont-ils devoir mettre en place une alternance hebdomadaire ?
Ma dernière question concerne l'arrêt des notes prévu pour le 10 juin, alors que la rentrée se ferait le 2 juin. Ne serait-il pas possible de le décaler ? Enfin, comme l'ont indiqué plusieurs de mes collègues, on constate sur le terrain une forte inquiétude pour la rentrée de septembre, notamment sur les effectifs : en effet, la visibilité et la valorisation de l'enseignement agricole ont été moins importantes, en particulier parce que les conseils de classe dans les collèges n'ont pas pu se tenir.
M. Max Brisson . - Je participe au groupe de travail animé par Antoine Karam, et cela m'a confirmé qu'il existe de formidables établissements d'enseignement agricole, toutes filières confondues, lieux d'innovations pédagogiques dont l'éducation nationale pourrait parfois s'inspirer.
Ma question porte sur des publics particuliers, très nombreux dans l'enseignement agricole, on ne le sait pas assez, à savoir les publics à besoins éducatifs particuliers, dont ceux en situation de handicap dont le nombre s'élève, selon les chiffres de votre ministère au 1 er janvier 2019, à près de 2 400. Comment la pédagogie a-t-elle été adaptée pour eux ? Comment s'organise la présence des AESH en classe dans ce contexte de limitation du nombre de personnes et de distanciation sociale ? L'école inclusive s'applique également dans l'enseignement agricole.
Concernant le retour vers l'école, le protocole mis en place par l'éducation nationale s'applique aussi aux établissements d'enseignement agricole. Il n'empêche qu'un particularisme fort existe, ne pourrait-on pas y réfléchir ? Et comme je l'ai déjà demandé à Jean-Michel Blanquer, quels seront les objectifs pédagogiques d'ici le 4 juillet ? Comment prépare-t-on la rentrée de septembre prochain, compte tenu de cette année scolaire écourtée ?
M. Didier Guillaume, ministre de l'agriculture et de l'alimentation . - Je vous remercie pour ces questions précises et concrètes. Tout d'abord, la rentrée de nos établissements est prévue dans un mois, ce qui nous laisse du temps pour préparer et ensuite observer l'évolution pour les premiers qui ouvriront, notamment au niveau des transports. Car rassurez-vous, mesdames et messieurs les sénateurs, nous y veillerons et nous ferons en sorte pour les internats que la distanciation sociale soit appliquée. La règle de base est le principe de précaution.
Pour répondre à plusieurs de vos questions, notamment à celle de Mme Blondin, je n'ai pas souhaité que l'on ait une circulaire commune avec l'éducation nationale. Notre enseignement est spécifique et, si les consignes sanitaires sont les mêmes pour tous les établissements d'enseignement, nous mettons en place nos propres directives, circulaires et guides de bonnes pratiques, pour pouvoir être agiles, mobiles et réactifs.
S'agissant des transports, nous travaillons en étroite collaboration avec les régions, associées à toutes nos réunions, et je remercie d'ailleurs M. Morin et M. Muselier qui l'a remplacé à la tête des Régions de France. Même s'il y a parfois des tiraillements, nous avons pour même objectif l'intérêt des jeunes.
En ce qui concerne les réunions de concertations, nous tenons à ce qu'il y en ait le plus possible. Nous en avons pour exemple tenu cinq cette semaine : CHSCTM, CHSCT, CTM,... Nous concertons le mieux et le plus possible.
Monsieur Jacques-Bernard Magner, merci d'avoir évoqué « l'armée de l'ombre » qui s'est levée pour aider les agriculteurs. Plus de 200 000 personnes se sont inscrites sur la plateforme, 15 000 ont travaillé, les conditions climatiques et les restrictions sur les périmètres de déplacement à respecter ne nous ont pas permis d'aller au-delà. M. Magner a aussi évoqué à juste titre le SNU comme support pour renouveler ce type d'actions. Actuellement, dans le cadre du Service national de la jeunesse (SNJ), il est possible que des jeunes en missions d'intérêt général puissent travailler en exploitations agricoles mais nous allons réfléchir à cette suggestion.
Nous partageons votre inquiétude quant à l'avenir des stages. Pour l'instant, le nombre de contrats de stage n'a pas baissé mais la crise va bien évidemment faire des dégâts dans tous les domaines. Certaines entreprises prendront certainement moins de stagiaires. Nous suivrons cela de près.
Madame Vérien, vous avez parlé de manque de concertation, mais nous n'en menons effectivement pas avec les 800 établissements ! Nous les menons avec toutes les fédérations, les représentants de l'UMFREO (Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation), charge à eux ensuite d'en référer à chaque MFR. Le ministère a édité ses propres guides de bonnes pratiques.
Par contre, lorsque vous parlez des élèves comme étant loin de la nation apprenante, je ne partage pas du tout cet avis et j'ai du mal avec cette stigmatisation. L'enseignement doit accueillir tous les enfants de la République et le rôle des MFR, que je soutiens, est justement d'intégrer ces élèves en difficulté. J'ai pu constater dans le cadre de mes fonctions d'élu départemental pendant plus de vingt ans, qu'un grand nombre de véritables décrocheurs reprenait goût à la vie professionnelle grâce aux MFR.
Je suis d'ailleurs le premier ministre de l'agriculture à avoir participé à la rentrée des classes des trois familles de l'enseignement agricole. Je ne fais pas de différence de traitement entre les enfants de la République.
Madame Vérien, je ne sais pas du tout ce qui vous permet d'affirmer que les journées portes ouvertes virtuelles des MFR n'ont pas été une réussite. Je ne partage pas cet avis. Par définition, elles ne pouvaient accueillir du monde ! Elles étaient virtuelles, nous n'avons pas eu le choix qu'il en soit autrement, et les retours que j'ai eus de la DGER, de mon cabinet et d'élus, sont très positifs quant au fait de les avoir maintenues de manière dématérialisée.
Je tiens à rassurer Mme Brulin : nous préparons bien évidemment la rentrée et nous ferons en sorte d'être prêts pour début juin. Cinq séances de concertation avec toutes les instances du ministère associant tous les acteurs sont prévues. Je n'ai vraiment pas le sentiment qu'il ne se soit rien passé depuis l'annonce du Président de la République du 13 avril, en tout cas les fonctionnaires de mon ministère travaillent 7 jours sur 7.
Nous allons maintenir les seuils de dédoublement car nous avons eu plus d'élèves et je veux saluer les enseignants car cela a été difficile à mettre en place.
Comme je l'ai indiqué à M. Karam, nous évaluons pour la partie enseignement de mon ministère le coût à cent millions d'euros. Cela inclut le soutien à nos personnes sous contrat qui n'ont pas pu bénéficier du chômage partiel. La situation était dramatique et nous avons fait en sorte de n'arrêter aucun contrat.
Monsieur Grosperrin, les données sur les décrocheurs proviennent des 800 établissements, compilées par la DGER. Je vous confirme que le taux d'élèves décrocheurs s'élève à 5 %.
Vous êtes nombreux à avoir évoqué les Cfppa et les CFA : dès le 11 mai, il est possible de les ouvrir même s'ils ne le seront sans doute pas tous. Il faut déconnecter la possibilité d'ouvrir les Cfppa de l'ouverture globale des lycées, et tenir compte des multi-sites et multi-pôles dont je parlais en introduction. Les Cfppa avec les CFA n'ouvriront bien sûr que si les conditions sanitaires le permettent, et si les instances locales se sont réunies.
M. Jean-Yves Roux évoquait la continuité pédagogique : l'enseignement agricole supérieur a fait le choix du maintien des stages en entreprises. Quant aux masques et solutions hydroalcooliques, ils seront fournis par l'État pour les collégiens des classes de 4 e et 3 e . Les lycéens devront venir avec leurs propres masques. Certaines régions ont annoncé qu'elles équiperaient les lycéens. Les gels hydroalcooliques seront mis à disposition de tous les apprenants et enseignants et les procédures seront précisées dans le cadre des guides de bonnes pratiques et d'une circulaire nationale émise par la DGER.
Madame Mélot, nous avons parlé avec Jean-Michel Blanquer de l'éventuelle suppression des épreuves orales de français pour les 1 ere STAV. Cette réflexion implique l'ouverture de tous les lycées, la cohérence de toutes les filières entre régions. Toutefois, pour l'instant, nous ne sommes pas favorables à leur suppression.
Madame Blondin, la fragilité financière des établissements est en effet bien réelle. Cette crise est terrible pour tous. Vous évoquiez aussi le fait de décaler les notes après le 10 juin. Cela ne sera pas possible car il faut respecter le calendrier de Parcoursup mais mon objectif et celui du Gouvernement est bien qu'aucun jeune ne soit pénalisé par cette crise.
Monsieur Brisson, je connais votre engagement en faveur de l'éducation inclusive qui est en effet très importante. Les situations sont plus ou moins compliquées suivant le handicap pour respecter au mieux la distanciation sociale, mais la priorité fixée à mes services est qu'il n'y ait pas là encore de double peine. Il va falloir faire en sorte que les jeunes handicapés puissent être accueillis. Les établissements d'enseignement agricole scolarisent environ 8 500 élèves à besoins éducatifs particuliers, parmi lesquels 4 916 bénéficient d'un Projet personnalisé de scolarisation (PPS). La Dger a mis en ligne dès le 20 mars des préconisations à destination des équipes éducatives ainsi qu'un appui pédagogique.
Les équipe pédagogiques s'en sont saisies et ont mis en place un contact hebdomadaire voire quotidien au téléphone avec un seul interlocuteur référent. La logique d'accompagnement du handicap se poursuivra selon la logique du déconfinement, soit dans l'établissement si le jeune ne présente aucune pathologie considérée facteur à risque, soit à distance.
Je rappelle que la reprise des lycées agricoles ne se fera en juin que si les conditions épidémiologiques le permettent. La décision sera prise fin mai. Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation se prépare donc à accueillir les jeunes dans ses 800 établissements. Nous ne prendrons de décisions qu'après avoir considéré la situation de chaque établissement, chaque région, chaque secteur. Je suis favorable, pour des raisons d'équité sociale, à ces réouvertures. Il faut rouvrir les établissements même si nos jeunes n'ont pas arrêté de travailler grâce au travail à distance et à Docaposte.
En lien avec le personnel enseignant et les organisations syndicales, nous allons tout faire pour mener à bien ce redémarrage. J'ai fixé un cap clair, celui de la réussite éducative et pour le suivre - en utilisant encore le langage marin - il faut que tout l'équipage soit à bord. Cet équipage est constitué de l'administration, des parlementaires, des élus des conseils d'administration, de l'ensemble des organisations syndicales, du personnel enseignant, mais aussi de l'ensemble du personnel des régions mis à disposition, comme les agents d'entretien, de restauration. Nous sommes tous dans le même navire et malgré la tempête qui s'est abattue sur nous, le navire France a tenu !
Malgré nos appréciations divergentes et nos débats politiques intenses, nous avons tous pour même objectif la réussite éducative de nos jeunes et le rayonnement de notre enseignement agricole. Nous devons tous ramer dans le même sens pour mener à bon port toute notre communauté éducative, les apprenants, les enseignants, les agents qui travaillent dans nos lycées et exploitations.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Merci monsieur le ministre, vous avez des propos toujours très enthousiastes et une belle force de conviction. Je vous souhaite donc le meilleur temps possible pour cette traversée sans trop de remous ! Nous restons extrêmement mobilisés sur ce sujet, d'autant que, vous l'avez compris, nous avons mis en place un groupe de travail animé par Antoine Karam que je remercie à nouveau. Je compte sur lui et l'ensemble des collègues de la commission pour poursuivre les travaux et être attentifs à ce bilan fin mai qui permettra la réouverture ou non des établissements début juin, c'est ce que je vous souhaite en tout cas.
Audition de M. Gabriel
Attal, secrétaire d'État auprès du ministre
de
l'éducation nationale et de la jeunesse
MERCREDI 13 MAI 2020
___________
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Monsieur le Ministre, nous vous remercions de votre disponibilité. Nous avons auditionné le ministre de l'éducation nationale, il y a quelques jours pour évoquer le sujet de l'école, de la jeunesse et du périscolaire. Ces sujets sont très importants pour notre commission. Aussi, nous nous réjouissons de pouvoir conclure notre cycle d'auditions des membres du gouvernement relatif à ces sujets avec vous.
Le secteur associatif est un acteur essentiel de la solidarité et du vivre-ensemble. On dénombre en France quelque 1,5 million d'associations, mobilisant entre 16 et 20 millions de bénévoles. Signe de cette vitalité associative, le nombre d'associations augmente chaque année de 2,4 %.
Les associations participent pleinement à l'animation de nos territoires et au développement du lien social. Face à la crise que nous traversons, les associations et les bénévoles ont su se mobiliser, parfois au-delà de leurs activités traditionnelles, renforçant la résilience des territoires et ont su créer une vraie créativité. Un exemple parmi tant d'autres : des associations sportives, privées d'entraînement ou de compétition, ont mis en place un système de livraison de courses pour des personnes fragiles.
Le secteur associatif est également un acteur économique : près d'un salarié du secteur privé sur dix est employé par une association. Or ce secteur a été très durement frappé par la crise. On estime à 1,4 milliard d'euros les pertes de recettes d'activités pour le mois de mars dernier. Près de 70 % des associations ont fait une demande de recours au chômage partiel ; 30 % des associations employeuses avaient, à cette même période, moins de trois mois de trésorerie devant elles.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer les mesures gouvernementales prises pour aider les associations ? On nous a signalé des difficultés pour accéder au fonds de solidarité, car Bercy demande l'identifiant fiscal - or les associations non lucratives n'en possèdent pas.
Par ailleurs, le Gouvernement a annoncé vouloir dynamiser les colonies de vacances. Ce secteur a été fortement frappé par la crise, avec l'annulation des classes vertes et le confinement pendant les vacances de printemps. Les vacances d'été approchent. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? De nombreuses incertitudes demeurent.
Enfin, le futur projet de loi contenant des mesures d'urgence comporte une demande d'habilitation relative à la réserve civique. Dans son avis sur le texte, le Conseil d'État a souligné que le Gouvernement ne donnait aucune justification à l'extension de cette réserve. Avant d'habiliter le Gouvernement, le législateur a besoin de connaître les raisons de cette demande.
À l'issue de votre intervention liminaire, je donnerai la parole à Jacques-Bernard Magner, notre rapporteur pour avis des crédits « jeunesse et vie associative », qui anime par ailleurs un groupe de travail sur la jeunesse et la relance de l'activité du secteur associatif.
Je précise que des journalistes suivent en direct cette audition, qui sera par ailleurs mise en ligne par Public Sénat.
M. Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse . - J'ai pu mesurer tout au long de cette crise à quel point il était précieux d'avoir les retours de terrain des élus et des parlementaires pour identifier les difficultés et les lever. Dans le contexte inédit que traverse notre pays, la mobilisation de tous est essentielle.
La vie associative est un secteur central par le lien social qu'elle permet, mais aussi pour des raisons économiques : 10 % du PIB et 1,5 million d'emplois qui sont, par principe, non-délocalisables. Comme les entreprises et l'ensemble des structures de droit privé, les associations ont été touchées par la crise du coronavirus. L'essentiel de leurs activités ont dû être suspendues du fait du confinement. Un certain nombre d'associations, celles de l'aide alimentaire et de la solidarité d'urgence, ont poursuivi leur activité, qui était vitale dans ce contexte.
Après l'annonce du confinement, ma première préoccupation a été de réunir les réseaux associatifs et d'identifier avec eux les difficultés. La première était d'ordre économique : qui dit confinement et suspension des activités dit perte de recettes et de cotisations. Cela pose aussi la question des subventions et du maintien des salariés.
J'ai très rapidement annoncé que tous les dispositifs de droit commun mis en place pour les entreprises seraient accessibles aux associations : chômage partiel, prêts garantis par l'État - qui permet de répondre aux difficultés de trésorerie que vous avez évoquées, Madame la Présidente dans votre propos liminaires, fonds de solidarité, report de charges et de loyers...
La question des subventions a été immédiatement posée, car nombre d'entre elles sont conditionnées à la tenue d'événements, qui n'ont pas pu se tenir. Les pouvoirs publics ont émis le souhait d'honorer les subventions. J'ai défendu et obtenu très tôt que les subventions de l'État qui avaient été décidées soient versées aux associations indépendamment de la tenue des projets qui y étaient liés. Je pense à Solidarité Sida, qui organise chaque année le festival Solidays. Elle recevra bien cette année de la part de l'État la subvention prévue, même si elle ne peut pas organiser son festival. Il en est de même pour de plus petites associations, notamment des associations environnementales qui organisent chaque printemps le décompte des espèces et reçoivent pour cela des subventions de l'Ademe. Elles n'ont pas pu réaliser ces activités cette année, mais les subventions sont maintenues.
Les associations s'interrogent également sur le maintien des subventions des collectivités locales. Au vue des échanges que j'ai eus avec les associations d'élus, il me semble que celles-ci ont émis le souhait de maintenir également les subventions des collectivités locales, ce que je ne peux que partager. Je profite de cette audition pour encourager les collectivités territoriales à maintenir les subventions prévues quand bien même les évènements ne peuvent pas se tenir.
La deuxième difficulté, pour les associations qui ont maintenu leur activité pendant le confinement, tient à l'âge moyen des bénévoles, souvent retraités. De nombreuses associations ont demandé à leurs bénévoles les plus âgés de rester chez eux pour ne pas s'exposer au virus : de ce fait, certains points de distribution n'ont pu ouvrir dans un premier temps. A titre d'exemple, les personnes de plus de 70 ans représentent un tiers des bénévoles des Restos du coeur. Cette situation m'a amené, en cohérence avec l'appel à la solidarité lancé par le Président de la République, à lancer la réserve civique, qui vise à mobiliser des Français qui en ont le temps, l'envie et la motivation autour de missions vitales pour le pays.
La réserve civique a connu un grand succès : plus de 300 000 Français se sont inscrits - plus que le nombre de missions disponibles. Un peu plus de 100 000 personnes ont été mobilisées dans une mission de la réserve civique, sur le terrain ou à distance.
L'article du projet de loi relatif à la réserve civique prévoit d'élargir l'éligibilité à l'ensemble des personnes morales qui exercent des missions de service public, notamment les sociétés anonymes à capitaux publics, le temps de l'urgence sanitaire ; c'est un dispositif cadré et borné dans le temps. Le problème s'est posé au moment du versement des minima sociaux, alors que La Poste connaissait des difficultés de fonctionnement : nous avons alors envisagé de mobiliser des volontaires de la réserve civique pour rappeler les consignes sanitaires de distanciation sociale et aider à la régulation dans les bureaux de poste. Or le droit ne le permettait pas. De même, il est impossible de mobiliser des volontaires pour participer à la distribution de masques dans les transports aux premiers jours du déconfinement. Avec cet article, l'État pourra dorénavant, en cas de reconfinement ou de nouvelle crise, mobiliser des volontaires pour venir en aide à des structures qui exercent des missions de service public, le temps de l'urgence sanitaire, même si celles-ci n'ont pas la nature juridique d'établissement public.
Deuxièmement, le confinement a eu un impact sur un certain nombre de jeunes, notamment en termes de précarité. Je pense aux étudiants ultramarins en métropole qui n'ont pu rentrer chez eux et pour qui la crise a représenté des coûts supplémentaires. Je pense aussi aux étudiants précaires, qui ont perdu leur job ou leur stage leur assurant un revenu, et n'ont plus eu accès au restaurant universitaire : ils se sont retrouvés avec moins de revenus et plus de frais. Je pense enfin à des jeunes précaires non étudiants. Tous ont besoin d'une aide financière pour passer ce moment difficile. Le Premier ministre a donc annoncé, devant le Sénat, le versement d'une aide d'urgence de 200 euros à 800 000 jeunes précaires de 18 à 25 ans, au début du mois de juin pour les étudiants et le 15 juin pour les autres. Sont concernés les jeunes touchant les APL. La plateforme permettant de solliciter cette aide exceptionnelle a été ouverte pour les étudiants sur le site www.étudiant.gouv.fr.
Le confinement a eu un impact sur les structures d'éducation populaire qui assurent le périscolaire, dont un certain nombre sont des associations. J'ai annoncé un certain nombre de mesures pour leur permettre de survivre à la crise. Les structures associatives d'accueil de loisirs sont financées en fonction du nombre d'enfants accueillis et du nombre de jours d'accueil. Or elles ont eu des coûts fixes à assumer pendant les semaines de fermeture... C'est pourquoi les caisses d'allocations familiales verseront à ces associations le même montant en 2020 qu'en 2019, quand bien même elles ont accueilli moins d'enfants, pour assurer la pérennité de leur financement.
Des mesures ont été prises pour soutenir les associations organisant des colonies de vacances, des classes de découvertes ou des voyages scolaires. Pour les colonies de vacances, nous leur avons donné la possibilité de proposer un avoir aux familles. Pour ce qui est des voyages scolaires, le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse a pris la perte à sa charge, puisqu'il a remboursé les familles qui s'étaient acquittées du coût d'un voyage scolaire n'ayant pu avoir lieu. Il s'agit bien évidemment de protéger les associations.
Pour cet été, la préoccupation sanitaire reste importante. Des annonces sont prévues le 2 juin prochain, deuxième étape du déconfinement, sur la question des vacances. Sans attendre cette date, Jean-Michel Blanquer et moi-même travaillons à ce que sera cet « été apprenant et culturel », comme l'a appelé le Président de la République, afin de permettre, avec les associations et les collectivités locales, à tous les enfants, notamment à ceux qui ont vécu un confinement difficile, de s'évader, de rencontrer d'autres enfants, de s'épanouir, mais également de rattraper un certain nombre d'apprentissages.
Chaque semaine, les acteurs sont réunis au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse pour travailler à une fusée à trois étages. Le premier étage, c'est un renforcement du dispositif « école ouverte », qui existe depuis plusieurs années. Ce dispositif permet d'accueillir des enfants dans les locaux de l'école le matin et d'organiser des activités en partenariat avec les accueils de loisirs l'après-midi ; le deuxième étage, c'est l'organisation de micro-séjours d'excursion proches du lieu de résidence, avec des activités de découvertes patrimoniales ou culturelles ou de type scoutisme dans un environnement champêtre ; le troisième, ce sont les colonies de vacances qu'il faut soutenir et développer massivement cet été si une plus grande mobilité et le regroupement d'enfants sont possibles. Certes, nous n'aurons les réponses à ces deux impératifs que début juin, mais nous travaillons d'ors et déjà à des pistes d'actions et à des annonces.
Troisièmement, l'engagement civique a lui aussi été touché par la crise. Au moment du confinement, 58 000 jeunes étaient en mission de service civique ; 20 000 d'entre eux ont pu poursuivre leur mission, car ils l'exerçaient dans des structures qui ont poursuivi leurs activités. Je pense aux associations de solidarité alimentaire. Les autres, notamment ceux qui étaient rattachés à des établissements scolaires ou à des associations qui ont suspendu leur activité, ont vu leur mission s'interrompre. Nous avons voulu permettre à ces jeunes de s'engager différemment pendant la crise. Ainsi, 50 000 jeunes du service civique ont rejoint la réserve civique, y compris des jeunes qui poursuivaient leur mission en service civique, pour pouvoir s'engager encore davantage.
La crise du coronavirus a également affecté le service national universel (SNU), qui avait amorcé cette année la deuxième phase de sa montée en puissance, après un premier accueil de 2 000 jeunes l'année dernière. Ce service national universel a une dimension particulièrement importante car il doit permettre à tous les jeunes de découvrir l'étendue des possibles pour être utiles à leurs pays et aux autres. En cette période où nous avons plus que jamais besoin de l'engagement des Français, et en particulier de celui des jeunes, il faut que le SNU puisse continuer à remplir son rôle. Nous l'avons adapté. Ainsi, le séjour de cohésion, impliquant une mobilité des jeunes et un regroupement dans des centres, qui devait avoir lieu fin juin, est reporté à l'automne, et la mission d'intérêt général, qui devait quant à elle se tenir à l'automne, aura lieu avant l'été, dans des associations et structures publiques particulièrement mobilisées dans la crise du coronavirus et du déconfinement. Le séjour de cohésion se tiendra quand les conditions sanitaires le permettront, mais nous nous fixons comme objectif de l'organiser aux vacances de la Toussaint.
Je précise que les 2 000 jeunes qui avaient accompli leur SNU l'année dernière se sont immédiatement mobilisés face à cette crise, avant même que nous ne les sollicitions. Preuve que cette expérience leur a permis de mesurer ce qu'ils pouvaient apporter à la Nation ! Un kit réalisé avec l'association Voisins solidaires leur a été adressé pour leur permettre de venir en aide aux personnes âgées ou en situation de handicap près de chez eux.
Cette crise est très dure pour le pays. Mais elle a aussi vu l'émergence d'un élan de solidarité, d'une entraide du quotidien, de voisinage, et a montré la capacité de résilience des bénévoles et des associations. Autant d'aspects réjouissants et positifs révélés par ce moment très difficile. Je ne doute pas que cela survivra au coronavirus et que cet esprit soufflera longtemps sur notre pays.
M. Jacques-Bernard Magner . - Avant tout, je souhaite saluer la mobilisation de l'ensemble des bénévoles, des jeunes en service civique et des associations qui se sont investis pour faire face à la crise sanitaire et sociale que nous traversons. Par leurs actions et leur dévouement, ils ont contribué au maintien, voire au renforcement du lien social. Surtout, ils ont soutenu et soulagé la « première ligne » impliquée dans la lutte contre la Covid-19. Aussi, je regrette que cette mobilisation reste encore invisible aux yeux des pouvoirs publics : ni le Président de la République ni le Premier ministre n'ont salué ni même évoqué le rôle des bénévoles. Or il me paraît essentiel de renforcer la reconnaissance de la Nation envers l'engagement citoyen.
Ma première question porte sur les mesures de soutien à l'économie pour les associations. Lors de nos auditions, un certain nombre de difficultés ont été évoquées. Les associations non-employeuses ont malgré tout des charges, par exemple des locaux, or elles n'ont accès ni aux prêts garantis par l'État, ni au fonds de solidarité, donc au report des charges. Quelles solutions peuvent leur être apportées ?
Vous connaissez mon attachement au service civique qui a maintenant dix ans. Au moment où les missions reprennent progressivement et où les besoins des structures augmentent, de nombreux jeunes vont arriver au terme de leur contrat de service civique. Plusieurs acteurs majeurs, dont l'Agence du service civique, plaident pour une prolongation de quelques mois des missions. Vous avez évoqué celles qui ont été prolongées ou transformées. Pour autant, on pourrait envisager que ces missions, qui durent en moyenne six à sept mois, puissent être prolongées jusqu'à la fin de l'été, car les besoins sont nombreux. Cela permettrait aux structures concernées de disposer de jeunes déjà formés, intégrés et opérationnels. Que pensez-vous de cette proposition, que vous avez notamment évoquée devant l'Assemblée nationale ?
De nombreux jeunes en service civique ont été redéployés sur des missions urgentes, non sans lourdeur administrative ni incertitude juridique. Pourrait-on prévoir d'intégrer dans les prochains contrats de service civique la possibilité de transférer ces jeunes, avec leur accord, sur une mission urgente en cas de besoin, et avec une couverture par l'État en cas de problème ? Le projet de loi à venir contient une demande d'habilitation ; il serait utile de développer la réserve civique, qui a montré son efficacité au cours de cette crise, même si le nombre de missions proposée était inférieur au nombre de volontaires.
On nous parle beaucoup des colonies de vacances « apprenantes ». Cela suscite de nombreuses interrogations chez les organismes concernés. À moins de deux mois des vacances d'été, il devient urgent de définir leur rôle : s'agit-il d'un soutien scolaire ? L'acquisition de connaissances relève des enseignants. Dans ces conditions, quel rôle pour l'éducation nationale dans ces colonies de vacances ? Si l'on apprend toujours beaucoup lors des colonies de vacances, elles ne sauraient être des lieux de soutien scolaire ou d'apprentissages scolaires par des non-professionnels de l'éducation.
Enfin, vous voulez maintenir dès cette année l'extension du SNU à l'ensemble des départements pour 30 000 jeunes. Il me paraît plus judicieux de la reporter à 2021, en consacrant au service civique les 30 millions d'euros de crédits budgétaires qui étaient affectés à cette fin.
M. Gabriel Attal, secrétaire d'État . - Comment le Gouvernement a-t-il soutenu les associations non-employeuses, qui n'ont par exemple pas bénéficié du chômage partiel ? Premièrement, par le report de charge, ouvert à toutes les associations. Deuxièmement, par le maintien des subventions, quand bien même les associations ne peuvent réaliser les activités prévues. Troisièmement, ces structures ont accès aux prêts garantis par l'État si elles ont une activité économique, même sans avoir de salariés.
Enfin, il existe le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA), qui a remplacé la réserve parlementaire. Le calendrier a suscité de nombreuses interrogations, puisque la crise du coronavirus est apparue au moment où les subventions avaient été fléchées par les commissions, mais pas encore actées et versées. J'ai demandé que le calendrier initial soit tenu voire accéléré, pour que les subventions soient versées avant l'été.
Sur le prolongement des missions du service civique, il faut regarder les besoins des structures accueillantes et agir au coup par coup : toutes n'ont pas d'activité pendant l'été. C'est le cas par exemple de l'éducation nationale. Par conséquent, prolonger par principe tous les contrats de service civique n'aurait pas grand sens. En outre, les missions ne se sont pas toutes interrompues. Les jeunes ont continué à recevoir leur indemnité de service civique, même s'ils étaient confinés et que leur activité avait été suspendue ; ils pouvaient demander à ne pas percevoir l'indemnité pendant le confinement et à reprendre leur mission à l'issue de celui-ci.
En outre, une telle décision risquerait de retarder ou d'empêcher l'arrivée de nouveaux jeunes en service civique qui était prévue dans ces structures. J'ai reçu une lettre ouverte de députés Les Républicains demandant la prolongation des missions de service civique, en précisant que cela reviendrait à annuler l'arrivée de nouveaux jeunes. Or ces jeunes ont prévu d'intégrer la réserve civique prochainement et se sont organisés en conséquence : il n'est pas question de leur retirer leur mission. Si certaines structures décident de prolonger les missions en cours, en plus d'accueillir de nouveaux jeunes cet été, cela aura un impact financier, qui est en cours d'examen dans le cadre des arbitrages budgétaires.
Je reviens sur la question de l'insécurité juridique sur le service civique. Nous avons voulu faire prendre aucun risque aux structures. D'où un flottement pendant les deux premières semaines, au cours desquelles les jeunes ont suspendu leur mission. La situation étant inédite, certaines dimensions n'avaient pas été anticipées par l'Agence du service civique. La solution retenue a consisté à faire signer aux jeunes et aux structures un avenant au contrat de service civique : cela a permis de débloquer les choses très vite. Pourquoi, en effet, ne pas intégrer d'emblée cette possibilité dans le contrat initial, comme vous le suggérez ? À la lumière de cette expérience, il faut pouvoir se montrer agile.
Je suis conscient des questions que se posent les acteurs et opérateurs des colonies de vacances, notamment sur le protocole sanitaire et sur la notion de vacances apprenantes et culturelles. Nous avons avec les principaux acteurs des échanges très nourris, pour établir une sorte de cahier des charges. Je ne parle pas forcément d'une labellisation.
Évidemment, une colonie de vacances, un centre de loisirs est toujours un moment d'apprentissage. Du fait du confinement, de nombreux enfants ont perdu un temps important d'apprentissage formel. Comment leur permettre de vivre cet été à la fois l'apprentissage non-formel auprès des associations et de bénéficier d'une forme de tutorat ou de rattrapage plus formel ? Cela peut passer par l'intervention d'enseignants volontaires, par l'utilisation par les associations de ressources produites par l'éducation nationale, par le recours à des modules ludiques élaborés par des associations. C'est l'idée exprimée par le Président de la République.
J'insiste sur l'importance du service national universel. Il n'est pas encore question de généralisation cette année. En 2020, le budget prévu pour le SNU s'élève à 30 millions d'euros, contre plus de 500 millions d'euros pour le service civique : un redéploiement budgétaire ne suffirait pas à faire la différence en matière de service civique. Prolonger le contrat de service civique de tous les jeunes de la durée du confinement, comme vous le proposez, aurait une incidence budgétaire de l'ordre de 150 millions d'euros. Il faut des ressources supplémentaires en propre pour le service civique. Pour ma part, je défends à la fois le service civique et le service national universel.
Mme Dominique Vérien . - Nos auditions ont mis en lumière la demande d'un service civique un peu plus long. Dans les faits, il était initialement de neuf mois ; sa durée moyenne est aujourd'hui plutôt de six mois ; il faudrait la porter à huit mois, afin qu'un véritable travail de fond puisse avoir lieu. Cela coûterait en effet environ 150 millions d'euros, mais le service civique offre un véritable service et ce n'est pas pour rien que 50 000 des 60 000 jeunes se sont engagés dans la réserve civique à l'occasion de cette crise.
Cette crise a également permis de constater qu'il était possible de bien travailler en visioconférence. Les territoires ruraux peinent à accueillir des services civiques, pour des raisons de logement mais aussi d'encadrement. Celui-ci se fait depuis la ville-centre, rendant difficile l'organisation de services civiques dans les campagnes. Or on voit que l'encadrement pourrait se faire à distance.
Les colonies de vacances de cet été viseraient en priorité les enfants ayant subi un confinement strict, sans accès à la Nation apprenante et à la continuité pédagogique. Comment toucher ce public cible ? Lorsque nous interrogeons les parents pour le retour à l'école sur la base du volontariat, un certain nombre d'entre eux ne répondent même pas. Nous constatons des décrochages, alors que ces familles sont prioritaires pour les colonies de vacances. Par ailleurs, qui paiera le surcoût lié au moindre nombre d'enfants et aux contraintes sanitaires ?
Mme Céline Boulay-Espéronnier . - L'un des enjeux de la sortie de crise sera de conserver le capital d'engagement qui s'est manifesté pendant le confinement. Seuls 100 000 des 300 000 personnes qui se sont inscrites sur la plateforme de la réserve civique ont pu se mobiliser. Qu'ont fait les autres ? Cela n'a-t-il pas créé une certaine frustration ?
En milieu urbain, où le confinement a été particulièrement difficile, il est urgent que les jeunes puissent retrouver une forme de socialisation, dans le respect des règles sanitaires, à travers des initiatives associatives. Pouvez-vous nous indiquer les activités que les associations, notamment sportives, sont en mesure de mettre en oeuvre ? Les activités autorisées dans le cadre périscolaire pourraient-elles rapidement l'être dans le cadre associatif, avec les mêmes gestes barrières ?
J'ai été interpellée sur la situation des logopèdes en stage d'équivalence pour pouvoir exercer la profession d'orthophoniste. Conformément au décret du 30 août 2013, la reconnaissance du diplôme est conditionnée à la réalisation d'un stage dont la durée est établie par la direction régionale de la jeunesse et des sports : entre 800 et 1 000 heures de pratiques sont en moyenne exigées, or nombre de stages ont été repoussés ou annulés en raison de la crise sanitaire, ce qui place les étudiants en situation de précarité, car, au cours de cette période, ils ne sont plus reconnus comme étudiants, stagiaires ou salariés et ne bénéficient d'aucune aide sociale ni d'aucun mécanisme de soutien économique. Compte tenu des besoins des patients sortant de réanimation, leur expertise paraît pourtant plus que jamais nécessaire. Est-il envisagé une suppression du nombre d'heures de stage prévu ?
Quid de la tenue des camps d'été pour les Scouts de France, qui comptent 160 000 adhérents, d'autant que ces structures ne pourront pas cette année bénéficier des centres d'accueil en plein air ? Elles ne dépendent pas de l'État et reçoivent très peu de subventions. Pour autant, elles ne doivent pas perdre d'argent ni d'adhérents.
M. Antoine Karam . - L'impact du confinement sur les apprentissages pose un véritable défi pour les vacances scolaires. J'ai noté avec intérêt la proposition de colonies de vacances « apprenantes ». Les conséquences économiques et sociales de cette crise touchent encore plus durement les familles les plus modestes ; il est donc important que les enfants les plus fragiles puissent bénéficier d'un enseignement lors de formes hybrides de séjour.
Monsieur le Ministre, vous connaissez bien mon territoire pour y être venu à plusieurs reprises. Dans les sites isolés, le téléenseignement s'est heurté à la fracture numérique, ce qui a provoqué le décrochage scolaire. Pouvez-vous nous assurer qu'il existera bien dans chaque département une offre de séjour apprenant ? La plateforme #jeveuxaider et le site www. covid19.reserve-civique.gouv.fr ont-ils vocation à soutenir localement l'organisation de ces séjours et l'ouverture des écoles ?
M. Pierre Ouzoulias . - Les colonies de vacances, nous y sommes tous passés ! Question de génération... C'est peut-être là que nous avons acquis notre engagement politique et notre engagement pour la collectivité.
Jean-Michel Blanquer et vous-même faites souvent allusion au programme du Conseil national de la résistance. Celui-ci, après le plan Langevin-Wallon, avait défini les colonies de vacances et fixé trois objectifs majeurs : premièrement, une oeuvre sociale ; deuxièmement, le moyen de développer une éducation populaire ; troisièmement, constituer un véritable service public rattaché au ministère de l'éducation nationale. J'aimerais que ce soit également votre ambition, mais il y a un problème de moyens. Comment restructurer ce qui a été trop déstructuré par le passé ? Quel est votre projet politique, au sens noble du terme, pour donner un contenu à ce qui pourrait être enseigné dans ces colonies de vacances ?
Il faut un cadrage national et mettre en place un service public de colonies de vacances.
M. Michel Savin . - La ministre des sports nous a indiqué que le Gouvernement travaillait sur un plan ambitieux de relance pour les associations. Pouvez-vous nous en préciser les grandes lignes ?
Un plan tourisme doté de plus de 1 milliard d'euros doit être présenté demain. Les colonies de vacances, qui font partie intégrante de l'économie touristique des territoires, en bénéficieront-elles ?
Les associations font face à d'importantes pertes de recettes en raison de l'annulation de nombreuses manifestations. Le mécénat, sur lequel nous avions travaillé ensemble, pourrait être une solution. Seriez-vous prêts à encourager entreprises et particuliers à soutenir le milieu associatif et à revoir à la hausse, même temporairement, les règles actuelles du mécénat ?
Mme Mireille Jouve . - Nous soulignons tous, depuis le début de la crise sanitaire, l'engagement remarquable des jeunes dans le cadre du service civique, notamment auprès de nos aînés.
Avant le début du confinement, plusieurs structures associatives ont attiré votre attention sur les difficultés qu'elles rencontrent à répondre à la demande croissante de service civique alors que leur niveau de ressources évolue de manière beaucoup plus modeste. Certaines redoutent également que les crédits du service civique connaissent une dynamique inverse de celle des crédits du SNU lors des prochains exercices budgétaires. J'espère que le Gouvernement restera attentif aux moyens alloués au service civique afin de ne pas compromettre la qualité des missions proposées et des formations dispensées dans ce cadre.
Mme Colette Mélot . - De nombreux centres de loisirs ouvrent de nouveau leurs portes, dans le respect du protocole national, lequel prévoit notamment des groupes d'enfants restreints et de fortes contraintes en matière de transport et de restauration. Le nombre de places est encore très limité, ce qui peut, au fil du temps, poser des problèmes aux familles.
Le ministre de l'éducation nationale a annoncé la mise en place de « vacances apprenantes », mais les organisateurs de colonies de vacances sont dans l'expectative. Vous nous avez dit qu'un cahier des charges était en cours d'élaboration. Je suis consciente des difficultés, mais les choses ne sont pas très claires : les centres ont pu rouvrir cette semaine dans certaines communes, mais pas dans d'autres, faute d'autorisation. Les collectivités ne semblent pas être bien informées.
De même, il serait bon d'accélérer les choses en ce qui concerne les colonies de vacances. Il est question de mini-séjours, soit de découverte du patrimoine, soit de type scoutisme, notamment dans les départements où l'on peut facilement emmener les enfants en forêt, comme en Seine-et-Marne. Des contacts ont-ils été pris avec les collectivités ? S'il faut rouvrir les écoles, les centres de loisirs et les accueils périscolaires, nous devons nous organiser et prévoir du personnel, notamment pour le ménage. À quelques semaines des vacances, les parents ne savent toujours pas si leurs enfants pourront aller en centre de loisirs ou en colonie et les collectivités locales, déjà bien occupées par la réouverture des établissements scolaires, ne savent toujours pas ce qu'on attend d'elles. Il ne faudrait pas prendre tout le monde au dépourvu au mois de juin...
Mme Sylvie Robert . - Nous avons salué, la semaine dernière, l'annonce du Premier ministre d'une aide de 200 euros pour 800 000 jeunes précaires ou modestes. Toutefois, lors de son audition, la directrice du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (Cnous) a souligné combien les situations de grande précarité se développaient chez les jeunes, et pas seulement chez les étudiants. Que pensez-vous de l'idée qui circule actuellement, d'un RSA, ou autre dispositif de ce genre, au bénéfice des moins de 25 ans ?
Nous constatons dans nos territoires la fragilité de beaucoup d'associations. En outre, de nombreux jeunes vont avoir de grandes difficultés à retrouver un emploi, faute d'avoir pu bénéficier d'un stage ou d'une expérience professionnelle ou pour des questions d'insertion plus prégnantes. Dans ce contexte d'après confinement, ne pensez-vous pas que le recours aux emplois aidés puisse être une réponse ?
Le Président de la République et le ministre de la culture ont récemment invité les artistes à être aux côtés des jeunes et à mettre en place des ateliers dans les écoles, en partenariat avec le ministère de l'éducation nationale, y compris durant les vacances. Ces ateliers d'éducation artistique et culturelle permettraient également de garantir quelques heures aux intermittents du spectacle, en sus des annonces du Président de la République. Les artistes et le milieu culturel sont-ils au coeur de votre réflexion pour l'été prochain ? Monsieur le Ministre, nous aimerions bien savoir comment bâtir cette saison d'été...
M. Laurent Lafon . - Nous comprenons bien qu'il n'est pas possible de soutenir toutes les associations. Les critères retenus permettent notamment de venir en aide à celles ayant une activité économique. Or les associations de l'économie sociale et solidaire (ESS) éprouvent des difficultés pour obtenir les prêts garantis par l'État ou une aide du fonds de solidarité en raison de leur montage financier, alors même qu'elles peuvent jouer un rôle important dans les mois à venir. Envisagez-vous une action spécifique en leur faveur ?
Vous avez indiqué que le calendrier du FDVA allait être accéléré pour que les crédits soient déboursés au plus vite. Envisagez-vous également de tenir compte des conséquences de la crise en termes de pertes de recettes ou de difficultés de trésorerie dans l'attribution des crédits du FDVA cette année ?
Comme Sylvie Robert, j'aimerais connaître votre point de vue sur l'instauration d'un RSA jeunes. De même, que pensez-vous d'un renforcement, demandé par de nombreuses associations de jeunesse, du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie (Pacea) ?
Avec la fermeture des frontières, un certain nombre de jeunes n'ont pu faire leur stage Erasmus. Or la règle interdit de faire deux mobilités Erasmus au cours d'un même cycle universitaire. Serait-il possible de la modifier exceptionnellement pour permettre à ces jeunes de partir l'année prochaine ?
M. Olivier Paccaud . - Monsieur le secrétaire d'État, vous avez dit que 2020 serait une année « pleine » pour le FDVA. Les grosses associations, qui ont pu bénéficier du chômage partiel, sont bien soutenues. Mais 2020 sera catastrophique pour les petites associations - celles, par exemple, qui tirent l'essentiel de leur financement de la brocante du village, qui n'aura pas lieu cette année. Peut-être recevront-elles une petite subvention de leur commune ou du département, voire quelques crédits du FDVA, si elles ont de la chance. Idéalement - rien n'interdit de rêver -, il faudrait revaloriser le FDVA. Vous nous avez dit qu'il correspondait à l'ancienne réserve parlementaire, mais le transfert s'est fait a minima ...
Par ailleurs, nous risquons d'avoir une promotion d'étudiants sacrifiée : ceux qui, au printemps, étaient en recherche de stage ou qui allaient en commencer un dans des entreprises qui n'auront plus les moyens de les accueillir. Il faudra que plan de relance ou le prochain projet de loi de finances rectificative tienne compte de cette situation.
Le Gouvernement, qui a déjà consenti des efforts très importants de plusieurs dizaines milliards d'euros, devrait aussi en faire un, conséquent, en faveur de la vie associative et de la jeunesse. Nos petites associations n'ont peut-être guère de poids économique, mais nous connaissons leur important rôle social. Elles ont besoin de ce soutien et je sais que vous saurez plaider auprès de Bercy pour qu'elles ne soient pas oubliées, non plus que nos jeunes, dans le futur plan de relance.
- Présidence de M. Jean-Pierre Leleux, vice-président -
M. Stéphane Piednoir . - Sans parler de génération sacrifiée, ce sont 700 000 étudiants, tous niveaux confondus, qui vont arriver sur un marché de l'emploi extrêmement dégradé. Toutefois, je ne partage pas forcément les solutions avancées par certains de mes collègues. Ne pourrait-on être un peu plus innovants pour à la fois inciter les jeunes à démarcher vraiment les entreprises et encourager les entreprises à les embaucher, plutôt que de recourir à « l'assistanat » ?
M. Jacques Grosperrin . - Pourrait-on faire évoluer le SNU ? Après les attentats du Bataclan, un module résilient de premiers secours avait été mis en place. Avec les stages de cohésion qui s'appuient sur les besoins de la société, ne pourrait-on donner une nouvelle orientation au SNU pour tenir compte de la pandémie ? Le déconfinement a entraîné un grand relâchement chez les jeunes. Ceux qui effectuent leur SNU pourraient agir via les réseaux sociaux, par exemple. Chacun sait que l'on apprend plus par ses pairs que par ses maîtres. Peut-être pourraient-ils également, bien que mineurs, accompagner la réouverture des écoles ?
Un mot de l'abondement financier du service civique par le SNU pour l'année 2020-2021. Le service civique a démontré son efficacité - Croix-Rouge, Ehpad, bibliothèques... Il peut encore faire beaucoup, notamment pour la rentrée scolaire 2020-2021, qui pourrait avoir lieu fin août, et durant le premier trimestre qui sera complètement différent de ceux que nous avons pu connaître. Nous avons besoin de cet appui fort.
M. Gabriel Attal, secrétaire d'État . - Madame Vérien, la durée moyenne d'une mission de service civique est désormais de 7,2 mois. Il faut faire preuve de pragmatisme : certains jeunes ont besoin de davantage de temps et certaines missions peuvent réclamer un investissement plus important. Il faut savoir s'adapter. L'association Unis-Cité, par exemple, va chercher les jeunes les plus éloignés des dispositifs : la nature des missions et l'objectif poursuivi impliquent des durées plus longues. Ne fixons pas de règle unique. Il me semble important de s'adapter aux réalités : certaines missions doivent être réduites, mais nous n'avons aucunement l'intention de réduire brutalement la durée de toutes les missions.
Le développement du service civique dans les territoires ruraux est l'un de mes objectifs prioritaires. Il faut d'abord une mobilisation politique de notre part et de celle de l'Agence du service civique. C'est la raison pour laquelle, dans l'agenda rural, nous avons réservé à la ruralité 10 000 missions de service civique par an. C'est un objectif ambitieux.
Se pose ensuite la question de l'animation territoriale. Il peut être compliqué, pour une petite association rurale, d'accueillir un jeune en service civique - ce sont des démarches, du tutorat... Il faut donc faciliter la création de collectifs. Dans les Hautes-Pyrénées, dans le pays d'Adour, des associations se sont regroupées au sein du collectif Rivages qui accueille les jeunes puis les met à disposition des associations, ce qui leur évite des formalités. Ce type de structure aidera les associations rurales à s'emparer du service civique.
Comment permettre aux enfants qui en ont le plus besoin de partir en colonie de vacances? Cette question est centrale et structurante depuis longtemps. Il y a trente ans, 4 millions d'enfants partaient chaque année en colonie ; aujourd'hui, ils sont environ 800 000. Après une forte mobilisation, notamment en termes de communication, le nombre d'enfants s'est légèrement accru l'année dernière, pour la première fois depuis dix ans. Il y a de l'espoir et nous comptons encore nous mobiliser cet été.
L'enjeu est d'abord financier : envoyer ses enfants en colonie a un coût. Il existe des dispositifs de soutien, notamment via les caisses d'allocation familiale, pour les familles dont le quotient familial n'excède pas 800 euros. Pour les autres, qui peuvent avoir du mal à joindre les deux bouts, il peut être difficile de faire partir un enfant. Nous devons développer des aides nouvelles et les cibler vers ces familles.
Se pose ensuite la question de l'investissement des associations. Monsieur Savin, la question sera abordée demain lors du comité interministériel consacré au tourisme dont je rapporterai la partie « tourisme social ». Nous envisageons des mesures financières très importantes pour aider les associations du tourisme social, et donc notamment aux associations qui portent des colonies de vacances, pour les encourager à investir dans leurs infrastructures.
Madame Boulay-Espéronnier, nous avons réduit volontairement le nombre de missions et leur nature durant la période de confinement. On ne pouvait pas à la fois demander aux Français de rester chez eux et les inciter à sortir à la moindre occasion pour s'engager. L'objectif de la réserve civique n'était pas tant de permettre à chaque Français de s'engager que d'assurer aux associations qui avaient besoin d'être soutenues les moyens de poursuivre leur activité. Il y avait donc moins de missions que de candidats. Tous les volontaires qui n'ont pu s'engager en présenciel ont pu télécharger, sur le site de la réserve civique, un kit réalisé en partenariat avec l'association Voisins Solidaires pour s'engager à l'échelle de leur immeuble, de leur rue, de leur village, et venir en aide à une personne vulnérable. Près de 400 000 personnes ont téléchargé ce kit, soit davantage que le nombre d'inscrits à la réserve civique. Nous avons reçu assez peu de messages de personnes n'ayant pu s'engager dans une mission. Je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de frustration.
Vous avez auditionné Roxana Maracineanu, je ne vais donc pas revenir en détail sur le protocole sanitaire pour la pratique sportive. Sports de combat, sports collectifs impliquant une proximité n'ont pu reprendre à ce jour. Seule l'évolution sanitaire permettra une reprise progressive de plus en plus large. Le 2 juin prochain, nous espérons pouvoir autoriser davantage de clubs sportifs à reprendre leur activité. Nous y travaillons.
Je ne suis pas en mesure de répondre à votre question sur les logopèdes orthophonistes, mais je m'engage à vous répondre directement, dès que je le pourrai.
Le scoutisme dépend peu de l'État, mais je crois profondément que l'État a beaucoup à apprendre du scoutisme. Nous pouvons nous en inspirer pour ce que nous proposerons aux jeunes cet été, et plus globalement pour des évolutions plus structurantes. Le scoutisme n'est pas qu'un mouvement ancien qui aurait gardé ses rituels d'antan, c'est aussi un laboratoire pédagogique qui propose des idées nouvelles, à l'instar d'autres associations populaires. C'est l'un des rares mouvements d'éducation populaire dont le nombre d'inscrits continue de croître. Nous avons beaucoup de choses à développer avec eux. Les scouts se posent aussi des questions sur l'organisation de leurs séjours, cet été. Nous travaillons avec eux pour établir un protocole sanitaire clair, mais il est difficile de respecter la distanciation quand on partage une tente... Nous allons les accompagner pour leur permettre d'organiser leurs séjours, car beaucoup de jeunes en auront besoin.
Monsieur Karam, l'application des dispositifs annoncés pour cet été dépend aussi des collectivités locales. Il me semble que la collectivité territoriale de Guyane a décidé de ne pas rouvrir les écoles avant septembre ; je ne suis donc pas sûr que le dispositif « École ouverte » puisse s'appliquer cet été. En revanche, les accueils de loisirs sont possibles et nous apporterons un soutien, y compris financier, à ceux qui s'engageront dans le dispositif des vacances apprenantes dont je souhaite qu'il se développe en Guyane.
Monsieur Ouzoulias, comme je l'ai souligné dès ma nomination, je suis favorable à une vraie politique publique de soutien aux mouvements d'éducation populaire et particulièrement aux départs en colonies de vacances. Cette crise va peut-être nous permettre de faire aboutir le travail que nous avions engagé. Certaines annonces auront probablement lieu demain concernant les investissements. Début juin, quand nous saurons s'il est possible ou non d'organiser des colonies, des mesures de soutien aux familles pourront être annoncées.
Les colonies de vacances sont portées par des associations, par des acteurs de l'éducation populaire. Je fais attention à leur autonomie, y compris pour les pratiques pédagogiques qu'elles développent. Vous avez parlé de « service public » des colonies de vacances, mais il me semble important qu'elles reposent sur des acteurs associatifs qui les font vivre et qui doivent être soutenus par les pouvoirs publics.
Je souhaite que le projet politique porté dans le cadre de ces vacances apprenantes soit le plus partagé possible et que l'État ou l'éducation nationale ne dessinent pas seuls un projet qu'ils imposeraient au secteur. C'est l'objectif des réunions régulières que nous tenons au ministère avec les principaux acteurs. Vous êtes le bienvenu si vous souhaitez y assister.
Monsieur Savin, je crois profondément que la vie associative aura un rôle central dans le rebond du pays. Elle permet du lien social, une éducation à la citoyenneté, au collectif. Mais elle représente aussi des emplois, un secteur économique. Nous travaillons à un plan de relance associatif sur trois axes. D'abord, la sauvegarde et le développement de l'emploi associatif. Il n'y aura pas de retour aux emplois aidés, car nous voulons professionnaliser les associations et leur permettre de maintenir des emplois dans la durée. On peut imaginer un dispositif dégressif de soutien à l'emploi pour faire l'amorce ; à l'association ensuite de développer des ressources propres ou du mécénat.
Le deuxième axe de travail porte sur la professionnalisation et la consolidation du projet associatif et de la forme associative.
Enfin, la question de l'investissement dans l'avenir est centrale - développer des fonds propres, obtenir des avances de trésorerie... Sur toutes ces questions, je suis preneur de vos propositions.
Nous encourageons le mécénat et la générosité de ceux qui en ont les moyens. Le Sénat a d'ailleurs récemment adopté un amendement, soutenu par le Gouvernement, à la loi « Coluche » qui porte de 500 à 1 000 euros le plafond des dons à une association d'aide alimentaire déductibles à 75 %. Nous avons besoin de cette générosité. Les entreprises ont montré leur capacité à s'engager : je pense à celles qui ont réorienté leur production pour fabriquer du gel hydroalcoolique, des masques ou des équipements de protection, mais aussi aux petites entreprises, aux artisans, aux commerçants, aux restaurateurs qui ont préparé des repas pour les soignants. Pour sortir de cette crise, nous avons aussi besoin d'un « Notre-Dame social » et d'un engagement très fort des grandes fortunes.
Madame Jouve, il est effectivement nécessaire de développer le service civique. On entend souvent qu'il faudrait augmenter le nombre de jeunes en mission ou le nombre de missions. Mais mon premier objectif est celui de la qualité des missions : le service civique doit offrir aux jeunes une expérience enrichissante qui leur donne envie de s'engager et qui développe leurs compétences. Cet objectif doit être notre boussole.
Je ne peux laisser penser que le service civique aurait été abandonné budgétairement par ce Gouvernement. Le budget du service civique était de 385 millions d'euros en loi de finances initiale pour 2017 ; de 508 millions en 2020, soit une augmentation de 68 %. L'engagement financier est et sera toujours là. Nous continuerons d'augmenter le budget de l'Agence du service civique, parce que nous croyons dans ce dispositif. Encore une fois, il n'y a pas de concurrence avec le SNU, ils sont complémentaires.
Madame Mélot, l'information des collectivités locales est essentielle. Si cette audition permet de faire passer des messages, je le fais bien volontiers. Un décret autorise tous les accueils de loisirs, dans toutes les collectivités, à rouvrir selon un protocole sanitaire différent de celui des établissements scolaires. Là aussi, élus et parlementaires peuvent nous aider à faire passer l'information, même si les services de l'État sont mobilisés localement.
Pour cet été, nous travaillons avec les associations d'élus à l'élaboration des dispositifs. Certaines communes ont déjà anticipé les choses : je me rends demain à Ris-Orangis qui a développé une offre nouvelle d'accueil des enfants. Nous aurons un enjeu particulier cet été : avec la fermeture des frontières hors Schengen, beaucoup des familles habitant les quartiers de la politique de la ville ne pourront retourner dans le pays d'origine de leurs familles pour les vacances, comme elles en ont l'habitude. Nous réfléchissons avec l'ensemble des acteurs à des solutions pour ces enfants.
Madame Robert, nous travaillons avec Frédérique Vidal sur la question de la précarité des jeunes, en particulier celle des étudiants. Comme vous l'avez rappelé, 800 000 jeunes vont percevoir une prime de 200 euros. La prime versée mi-mai aux familles modestes a aussi bénéficié indirectement à 350 000 jeunes de plus de 18 ans dont les parents ont bénéficié d'un supplément de 100 euros. Au total, près de 1,2 million de jeunes ont été concernés par les primes accordées aux plus précaires.
La question est structurelle, car la précarité des jeunes ne date pas d'aujourd'hui. Personnellement, et je sais qu'un certain nombre d'associations de jeunesse et de jeunes ne partagent pas cette opinion, je ne suis pas favorable à un RSA jeunes. Je considère que notre priorité consiste à garantir à tous les jeunes une formation et un emploi. Les pouvoirs publics n'ont pas été au rendez-vous de cet impératif depuis de nombreuses années. Le plan d'investissement dans les compétences de 15 milliards d'euros vise à offrir aux jeunes la perspective d'un emploi stable, qui leur plaise, pour lequel ils ont été formés.
À titre personnel toujours, je suis très sensible à l'idée développée par certains intellectuels, et qui fait son chemin dans d'autres pays, d'une dotation de départ en capital pour les jeunes. Nous demandons aux jeunes d'être entrepreneurs de leur propre métier, de leur propre vie. Mais encore faut-il se former, s'équiper, être mobile. Il faut pouvoir acheter une voiture, créer son activité en indépendant ou en auto-entrepreneur... Globaliser la somme des aides apportées aux jeunes pour la verser sous forme de dotation en capital permettrait à certains d'accomplir des projets et d'aller au bout de leurs ambitions. Ce n'est absolument pas une annonce, mais j'aimerais que nous réfléchissions à de telles solutions innovantes qui ont ma préférence.
MM. Paccaud et Piednoir ont aussi abordé la question de l'impact de cette crise sur l'emploi des jeunes. Les jeunes diplômés, ceux qui rentrent sur le marché du travail sont en général les premières victimes d'une crise économique. Nous suivons plusieurs pistes avec Bruno Le Maire, notamment celles d'une prime à l'embauche pour les entreprises qui recruteraient des jeunes ou des allégements de charges... Tout cela est en cours d'expertise. Je peux toutefois vous confirmer que cette question sera l'un des axes prioritaires des mesures de soutien à l'emploi du futur plan de relance.
Madame Robert, avec cette année blanche, le Président de la République a annoncé des mesures très fortes pour les intermittents. Il les a aussi invités à s'engager auprès de la jeunesse non seulement dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle que nous développons beaucoup, mais aussi à travers les dispositifs que nous mettrons en place cet été. Les services de l'éducation nationale en région travaillent avec les directions régionales des affaires culturelles pour mobiliser les artistes et les intermittents. Nous travaillons avec Jean-Michel Blanquer et Franck Riester à une plateforme de mise en relation des artistes, des intermittents et des établissements scolaires et associations d'éducation populaire.
Monsieur Lafon, l'économie sociale et solidaire (ESS) est un enjeu extrêmement important. Nous avons déjà mis en place un fonds de secours pour les associations de l'ESS de moins de trois salariés : elles bénéficient d'un accompagnement à l'emploi et d'une subvention de 5 000 euros. Elles peuvent bien évidemment bénéficier aussi des prêts garantis par l'État et du chômage partiel. Nous voulons faire reconnaître les associations comme de vrais acteurs économiques. Cette audition et votre intervention nous y aident, je vous en remercie.
Que la répartition des crédits du FDVA intègre un critère d'urgence et de sauvetage des petites associations particulièrement touchées par la crise me semble légitime et nécessaire. Au sein des commissions qui vont se réunir, les représentants du mouvement associatif et des élus locaux - et, je l'espère, bientôt des parlementaires - auront à coeur de les soutenir.
Nous avons prévu, dans le cadre du plan pauvreté, d'augmenter de 30 % le nombre de jeunes ayant accès au Pacea, que je soutiens totalement.
Nous souhaitons que les mobilités internationales reprennent dès que possible. Les jeunes qui n'ont pu en effectuer cette année, notamment via Erasmus, ne doivent pas être lésés. S'il faut faire évoluer un point du règlement, nous le ferons.
Vous avez raison, monsieur Paccaud, la dotation du FDVA ne correspond pas totalement à celle de la réserve parlementaire. Nous en avons déjà débattu. Des arbitrages budgétaires pourront avoir lieu dans le cadre du plan de rebond que le Gouvernement présentera prochainement. L'exemple d'une association qui perd une source de recettes avec l'annulation de la brocante du village souligne le rôle essentiel des collectivités locales. Elles doivent s'efforcer, comme le fait l'État, de maintenir leur subvention à ces petites associations.
Monsieur Grosperrin, faut-il faire évoluer le SNU pour prendre en compte les conséquences de cette pandémie ? J'y suis favorable. La question de la résilience est au coeur du SNU et les armées nous aident considérablement. Beaucoup a été fait dans la phase de préfiguration autour du secours aux personnes, des accidents, des catastrophes naturelles, des attentats terroristes. La question des pandémies nécessite un certain nombre de formations spécifiques, notamment pour permettre aux jeunes d'intervenir auprès d'autres jeunes. Nous allons travailler à faire évoluer le module du SNU. Je partage vos propos sur l'importance du service civique dans l'éducation nationale. Nous poursuivrons dans ce sens. Il me semble avoir répondu à toutes les questions.
Mme Sylvie Robert . - Vous ne m'avez pas répondu sur les emplois aidés, monsieur le Ministre.
M. Gabriel Attal, secrétaire d'État . - Nous n'envisageons pas un retour des emplois aidés. Les dispositifs de soutien à l'emploi des associations doivent leur permettre de devenir plus robustes et de ne pas dépendre uniquement d'une subvention. De manière plus générale, le Gouvernement travaille à garantir aux jeunes l'accès à des emplois stables, pérennes. Toutes les mesures que j'évoquais à l'instant, notamment un allégement de charges pour l'emploi de jeunes et les primes à l'embauche, tendent vers cet objectif. Aujourd'hui, il n'est pas prévu de recourir à des emplois aidés.
M. Jean-Pierre Leleux, vice-président . - Merci, monsieur le ministre d'avoir répondu en détail à nos questions. Je vous remercie de vous être plié à cet exercice avec l'engagement et l'enthousiasme qui sont les vôtres et qui font toujours plaisir à entendre.
Audition de M. Jean-Baptiste
Lemoyne, secrétaire d'État
auprès du ministre de
l'Europe et des affaires étrangères
MERCREDI 20 MAI 2020
___________
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - J'ouvre notre réunion de cet après-midi avec une certaine émotion car c'est la première fois, depuis deux mois et demi, que nous nous retrouvons en présentiel au Sénat. Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que les outils de travail à distance sont, certes très utiles, mais qu'ils ne remplaceront jamais les échanges humains.
Nous auditionnons à cette occasion M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, que je remercie chaleureusement, en votre nom à tous, d'avoir honoré notre invitation en venant jusqu'à nous.
Monsieur le secrétaire d'État, nous souhaitons vous entendre sur les conséquences de la crise sanitaire pour le réseau éducatif et culturel français à l'étranger, auquel, vous le savez, notre commission est très attachée.
Nous avons eu depuis quelques semaines des échanges avec le ministre de l'éducation nationale, M. Jean-Michel Blanquer, avec qui nous n'avons pas manqué d'aborder cette question. Il était cependant important que nous vous entendions.
Compte tenu de la situation, qui est préoccupante, nous avons souhaité mettre en place, mi-avril, un groupe de travail pour suivre la gestion de la crise dans ce secteur. Il est animé par notre rapporteur des crédits de l'action culturelle extérieure, M. Claude Kern, et composé de Mme Claudine Lepage et M. Damien Regnard. Ce groupe nous a ce matin présenté ses constats et recommandations concernant le réseau de l'enseignement français à l'étranger. Le panorama qu'il nous a dressé est, je dois dire, particulièrement sombre.
Le réseau traverse en effet l'une des plus graves crises de son histoire. Les familles sont touchées de plein fouet par les conséquences économiques de la crise sanitaire, et certaines d'entre elles considèrent que la continuité pédagogique n'est pas à la hauteur des frais de scolarité dont elles s'acquittent. Les établissements, en particulier ceux dotés d'une faible trésorerie, font face à de grandes difficultés financières, et courent le risque d'une probable perte d'effectifs à la rentrée prochaine. L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), qui fête cette année son trentième anniversaire, est très impliquée dans la gestion de cette crise, pour venir en aide aux établissements. Néanmoins, elle ne dispose sans doute pas de marges de manoeuvre budgétaires suffisantes.
Face à cette situation particulièrement dégradée, vous avez annoncé, le 30 avril dernier, deux mesures de soutien aux familles et aux établissements. Nous sommes impatients d'avoir des précisions à leur sujet car elles nous paraissent encore floues, surtout s'agissant de leurs modalités financières.
Un plan global de soutien au réseau est également en préparation au ministère. Pourriez-vous nous dire sur quelles pistes vous travaillez, et à quelle échéance ce plan sera présenté ?
Nous aimerions ensuite vous entendre sur la situation de notre réseau culturel car les instituts français et les alliances françaises sont eux aussi fortement ébranlés par cette crise, qui risque de s'inscrire dans la durée.
Je préside par ailleurs le groupe interparlementaire d'amitié France-Égypte, et je peux témoigner que le lycée du Caire fait également face à un certain nombre de problématiques. Tous ceux qui participent à ces groupes d'amitiés, en lien avec les pays du monde entier, font état de remontées comparables.
Après votre propos liminaire, notre rapporteur et ses collègues du groupe de travail vous interrogeront, puis je donnerai la parole aux intervenants de chaque groupe.
M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État . - Madame la présidente, je vous remercie pour cette audition.
Le réseau de l'enseignement français à l'étranger est très clairement un joyau national. Il s'agit d'un outil éducatif puisque ses établissements, aux quatre coins du monde, permettent aux Français établis hors de France de bénéficier de la promesse républicaine. J'ai moi-même été scolarisé dans ce réseau pendant plusieurs années.
Il s'agit par ailleurs d'un outil d'influence, en tant que premier lien entre les citoyens du monde et notre pays. Nous leur donnons là ce que nous avons de meilleur en nous, c'est-à-dire notre éducation. Tout cela milite pour faire du sauvetage de l'enseignement français à l'étranger une priorité.
La crise sanitaire constitue un choc sans précédent pour notre nation, dans tous les secteurs. Il faudra encore de longs mois pour que nous retrouvions notre vie d'avant, qui sera nécessairement quelque peu différente. Il ne faut pas oublier que les premiers touchés furent nos compatriotes établis en Asie, dès le mois de janvier 2020. Ils ont dû eux aussi affronter les craintes liées à la pandémie, et certains continueront à être exposés à ce virus, dans des pays dont le système de santé n'est parfois pas suffisant pour couvrir les besoins. Nous avons-nous-mêmes constaté à quel point cette lutte est impitoyable.
Le 30 avril dernier, avec MM. Jean-Yves Le Drian et Gérald Darmanin, nous avons présenté un plan de soutien massif à nos compatriotes établis hors de France, d'un montant de 220 millions d'euros. Il comprend tout d'abord un dispositif sanitaire, qui repose sur des capacités d'évacuation à chaque instant, grâce à trois aéronefs prépositionnés, et des capacités d'emport individuelles ou en petit groupe. Nous avons d'ores et déjà procédé à un certain nombre d'évacuations sanitaires. J'en profite pour saluer l'action de M. Damien Regnard, qui a été très investi pour traiter le cas d'un de nos compatriotes au Kenya touché par la Covid-19, et qui a dû être évacué vers La Réunion.
Le plan comporte ensuite un dispositif de soutien social, consistant en une aide sociale d'urgence. Nous avons calibré 50 millions d'euros pour apporter des aides ponctuelles à des Français qui rencontreraient des difficultés. Néanmoins, la part prépondérante de ce plan de soutien porte sur le réseau des établissements d'enseignement français à l'étranger. Elle comprend un volet « bourses », permettant de traiter la question des frais de scolarité pour cette année et l'année suivante. Un autre volet prévoit une avance de trésorerie à l'AEFE, pour que celle-ci puisse mettre à disposition des établissements des moyens leur permettant d'agir vis-à-vis des familles.
Il apparaît en effet nécessaire d'agir à trois niveaux, celui des établissements, des familles, et de l'agence elle-même. L'enseignement français à l'étranger comprend 522 établissements, qui se décomposent en trois grands types : 71 établissements en gestion directe (EGD) ; 66 établissements conventionnés ; 295 établissements partenaires. 375 000 élèves y sont scolarisés, dont les deux tiers sont étrangers, et un tiers constitué de nationaux. Ces communautés éducatives sont autant de « morceaux » de France, et les élèves étrangers y apprennent avec leurs camarades bien plus que la langue française, l'histoire ou les mathématiques. Un certain vivre-ensemble, au coeur de nos valeurs républicaines, y est en effet partagé. Cette question des valeurs est du reste très présente dans notre conception de l'homologation des établissements.
Le Président de la République avait souhaité donner un nouvel élan à cet enseignement français à l'étranger. Nous avons ainsi présenté à l'automne dernier avec MM. Jean-Michel Blanquer et Jean-Yves Le Drian un plan de développement, qui avait pour ambition de doubler le nombre d'élèves d'ici 2030. Il s'agissait de conforter et d'agrandir ce réseau. Aujourd'hui, il convient en premier lieu de sauver l'existant, sans néanmoins renoncer à nos objectifs de développement. Nous devons manier le microscope pour le court terme, et la longue-vue pour atteindre cet horizon ambitieux.
La campagne d'homologation 2019-2020 a connu une forte augmentation du nombre de premières demandes, et d'extension d'homologation, puisque 99 dossiers ont été présentés. Cela représente une hausse de 20 % par rapport à l'année passée, et de près de 60 % sur les trois dernières années. La dynamique était donc enclenchée. La procédure d'homologation avait été simplifiée, en abaissant le nombre de pièces demandées, ou en offrant la possibilité de postuler dès la première année d'ouverture. Cet élan n'avait cependant pas amoindri les hauts standards de qualité posés par le ministère de l'éducation nationale et de la Jeunesse.
Cette campagne a naturellement été affectée par la crise sanitaire. Des missions d'inspection sont dépêchées pour instruire les demandes. Sur les 99 dossiers, 42 missions n'ont pu être menées. Un dispositif alternatif a été mis en place, en portant le nombre de commissions interministérielles d'homologation d'une à trois. Une première s'est réunie le 19 mai 2020, et sera suivie par une deuxième en juillet, et une troisième en octobre. Nous espérons pouvoir reprendre, au fur et à mesure que l'épidémie se résorbe, ces missions d'inspection.
Notre ambition est à la fois d'apporter des réponses aux familles et aux établissements. La crise a entraîné la fermeture de leur presque totalité. Jusqu'à 520 écoles ont dû être fermées sur 522. Des perspectives d'amélioration se dessinent aujourd'hui, puisque 92 établissements ont rouvert, parfois partiellement. En particulier, 50 % des établissements situés en Europe ont pu le faire.
Il a fallu relever un défi sans précédent pour assurer la continuité pédagogique. Les ressources du Centre national d'enseignement à distance (CNED) ont été très précieuses pour ce faire. Elles ont été mises à disposition du réseau. L'AEFE a joué un rôle d'ensemblier du dispositif de continuité pédagogique, avec l'élaboration d'un vade-mecum très régulièrement actualisé. Cet outil s'est avéré très utile pour les chefs d'établissements. Je salue également la Mission laïque française (MLF), qui s'est appuyée sur sa plateforme de formation, le forum pédagogique, pour accompagner les enseignants dans la mise en oeuvre de l'accompagnement à distance. La MLF a un vrai savoir-faire en matière numérique, avec un certain nombre de pratiques pédagogiques très stimulantes.
La fermeture massive des établissements a eu des conséquences sur l'organisation des examens nationaux, tels que le baccalauréat, ou le diplôme national du brevet. Le baccalauréat de français doit faire l'objet d'annonces par le ministre de l'éducation nationale dans les prochains jours. Tous les candidats scolarisés dans les établissements français à l'étranger, homologués ou en cours d'homologation, seront évalués en contrôle continu, sur la base du livret scolaire, des notes obtenues au cours de l'année, jusqu'à la date du début du confinement en France.
Un bon dialogue interministériel et les échanges avec les acteurs du réseau ont permis de prendre en compte un certain nombre de spécificités locales. Les établissements d'Asie, qui ont fermé dès la mi-janvier, ont été autorisés à comptabiliser les notes entre cette date et la mi-mars. Nous avons également intégré dans ce système de contrôle continu des candidats individuels issus d'établissements ayant entrepris la démarche d'homologation, même si celle-ci n'était pas encore effective. Cette mesure était nécessaire pour témoigner de l'importance que nous accordons à l'homologation, et de la qualité des personnels engagés dans ce processus.
En revanche, les candidats issus d'établissements étrangers, n'ayant pas engagé de procédure d'homologation, devront passer les épreuves programmées au début de l'année scolaire 2020-2021, tout comme les candidats individuels. C'est sans doute regrettable pour certains jeunes, qui n'auront pas les résultats du baccalauréat avant l'été. Néanmoins, il était nécessaire de faire preuve de cohérence en ce qui concerne l'importance de l'homologation.
La crise sanitaire a affecté de très nombreuses familles françaises et étrangères. La baisse subite de leurs revenus les a parfois conduites à n'être plus en mesure de payer les frais de scolarité, notamment pour le troisième trimestre. Les établissements ont parfois octroyé aux familles les plus en difficulté des facilités de paiement, sous la forme d'échéanciers, ou en remboursant des frais annexes (restauration, transport).
Il existe également une incertitude sur les effectifs de la prochaine rentrée scolaire même si, à ce jour, il est difficile de faire une évaluation précise.
La trésorerie de certains établissements, notamment celle des plus petits, est par ailleurs soumise à certaines tensions, qui ne sont pas sans impact sur les recettes de l'AEFE. Cette dernière intègre en effet dans son budget les droits d'écolage perçu pour l'ensemble des EGD, la participation des résidents, et la participation financière complémentaire due par les EGD et les établissements conventionnés. A ces recettes s'ajoute également la contribution des 295 établissements partenaires au fonctionnement du réseau. La situation actuelle met donc en péril l'équilibre budgétaire de l'AEFE, qui a déjà consenti un certain nombre d'économies ces dernières années.
Dans ce contexte, nous avons souhaité mettre en oeuvre un certain nombre de mesures. Elles sont le fruit d'un travail avec les parties prenantes de l'enseignement français à l'étranger, et d'un dialogue avec des parlementaires et le président de l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE). Les partenaires sociaux ont également été consultés par mon cabinet. Parmi les souhaits souvent exprimés figuraient des demandes fortes en ce qui concerne les frais de scolarité. Le montant d'un trimestre d'écolage dans le réseau représente environ 650 millions d'euros. Une mesure de réduction de frais de scolarité, même symbolique, mais généralisée à tous les niveaux, et inconditionnelle, pèserait donc sur les établissements et l'agence. Aussi, nous avons décidé de mettre en place des dispositifs pour venir en aide aux familles qui rencontraient le plus de difficultés, tant françaises qu'étrangères. Il s'agit d'une condition sine qua non pour permettre à ces familles de maintenir leurs enfants dans notre réseau.
Ce plan d'urgence a pour principe de ne pas exclure des enfants en raison des difficultés économiques de leurs familles. Il convient également de ne pas écarter certains établissements du périmètre de ces aides. Quels que soient leurs statuts, nous souhaitions qu'ils puissent être accompagnés. Le programme 151 se voit ainsi abondé à hauteur de 50 millions d'euros sur l'aide à la scolarité. Les familles peuvent dès à présent déposer des recours gracieux, auprès de l'AEFE, pour obtenir une bourse. Ce recours est ouvert à la fois aux familles qui bénéficiaient déjà d'une bourse, et qui peuvent demander une révision de leur barème, mais également à celles qui n'en bénéficiaient pas, et qui peuvent à titre exceptionnel déposer une demande.
Nous avons pour l'heure reçu 3 800 recours. Pour qu'ils soient étudiés, les commissions locales des bourses ont été invitées à prendre en compte la situation économique des familles en 2020. D'habitude, elles se prononcent à partir des éléments de l'année précédente. Or la perte de revenus pouvant être subite, l'appréciation au regard des revenus actuels était importante. Un certain nombre d'assouplissements ont par ailleurs été apportés en ce qui concerne la prise en compte du patrimoine. Au Maroc, par exemple, 40 000 élèves sont scolarisés ; nous y avons reçu 500 demandes supplémentaires.
Pour soutenir la trésorerie des établissements, et que ceux-ci puissent eux-mêmes consentir des dispositifs d'aides aux familles étrangères que nous ne pouvons aider directement, nous avons acté, en accord avec le ministère de l'Action et des Comptes publics, le déblocage d'une avance de l'Agence France Trésor, à hauteur de 100 millions d'euros. Cette mesure est actuellement discutée par le conseil d'administration de l'AEFE, qui se déroule par voie électronique. Il doit se clore demain.
Afin de garantir que ces aides soient adaptées aux besoins des établissements, l'étude des dossiers fera l'objet d'une concertation, qui associe tous les acteurs de la communauté éducative, et nos ambassades. Le plan de développement de l'AEFE d'octobre 2019 faisait de l'ambassadeur un élément central. Nous tenons à ce que les ambassades jouent également ce rôle dans la mise en oeuvre de ces mesures d'urgence, même si l'AEFE, en qualité d'opérateur, instruit les demandes.
Notre préoccupation est de permettre aux EGD et aux établissements conventionnés de mettre en place un étalement des frais de scolarité, voire parfois de déposer des dossiers de remise gratuite. Les établissements partenaires ont par ailleurs été exemptés des frais de participation au fonctionnement du réseau, pour leur redonner des marges de manoeuvre. Le lien de ces derniers avec le réseau est d'une nature particulière. Pour pouvoir les aider directement, nous leur avons proposé la possibilité de solliciter un conventionnement temporaire. En effet, à la différence des EGD et des établissements conventionnés, ils n'ont pas une mission de service public. À travers ce conventionnement temporaire, nous souhaitons leur ouvrir la possibilité de solliciter des aides. Là aussi, il ne s'agit pas de nationalisation, mais de pragmatisme.
Les EGD et les établissements conventionnés pourront par ailleurs envisager de réduire les frais de scolarité du troisième trimestre pour les classes de maternelles, par exemple, dans une limite de 30 %. Ils pourront également limiter l'augmentation des frais de scolarité de l'année prochaine.
L'AEFE pourra soutenir ces mesures par cette avance de trésorerie délivrée par l'Agence France Trésor. M. Jean-Yves Le Drian et moi-même l'avons indiqué lorsque nous discutions de la proposition de loi relative aux Français de l'étranger, cette avance a vocation à être transformée en crédits budgétaires. Nous savons pouvoir compter sur le soutien des parlementaires en la matière.
Grâce à ce plan de soutien, nous sommes ainsi en mesure d'apporter une réponse globale car elle s'adresse à tous les établissements du réseau et à toutes les familles, françaises comme étrangères. Elle est également ciblée, dans la mesure où l'aide se fondera sur une analyse précise des besoins.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je vous remercie pour cet état des lieux très important sur l'enseignement français à l'étranger et l'AEFE. Par la suite, nous pourrons évoquer les instituts et les alliances françaises.
M. Claude Kern . - Nous avons constitué un groupe de travail, qui a consacré une première partie de ses travaux à la situation de l'enseignement français à l'étranger. Nous avons prévu de nous intéresser au secteur culturel dans une deuxième phase. L'objectif du groupe était de dresser des constats, mais également de formuler des propositions. Nous vous les soumettrons prochainement.
Dans cette commission, nous sommes tous convaincus de l'importance de ce réseau, et du fait qu'il constitue un atout exceptionnel pour le rayonnement de la langue, de la culture, et de la diplomatie d'influence françaises. Face à l'ampleur de la crise, il y a urgence à agir, en apportant une réponse d'ensemble, coordonnée, ambitieuse, et dotée de moyens adaptés.
Nous partageons votre constat, mais je vous soumettrai pour commencer deux questions. Notre groupe de travail s'étonne que les deux mesures de soutien aux familles et aux établissements aient été annoncées le 30 avril, dans des termes relativement flous, sans qu'un plan d'action dressant le constat exhaustif de la situation, et apportant des solutions précises et chiffrées, n'ait été bâti préalablement. Pourquoi cette méthode ?
Vous avez évoqué l'avance de l'Agence France Trésor à l'AEFE. Les 100 millions d'euros seront bienvenus. Mais le dispositif choisi laisse penser que l'opérateur sera obligé de rembourser les sommes avancées. Or pour l'ensemble des acteurs du réseau, comme pour notre groupe de travail, ce système de solidarité à crédit est inconcevable. M. Jean-Yves Le Drian et vous-même avez annoncé aux parlementaires représentant les Français établis hors de France que l'avance pourrait être transformée en subvention lors d'un prochain projet de loi de finances rectificative (PLFR). Vous avez confirmé cette information la semaine dernière au Sénat. Néanmoins, l'AEFE continue à considérer qu'il lui faudra rembourser les sommes avancées, selon des modalités fixées dans une convention entre les deux institutions. Demeurer sur cette position reporterait cette charge sur les parents, qui feront face à une augmentation des frais d'écolage. Quelle garantie autre qu'orale pouvez-vous apporter sur l'effectivité de cette transformation de l'avance en subvention ?
M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État . - L'absence d'un constat exhaustif lors de nos annonces, que je qualifierais plutôt de génériques que de floues, s'explique par le caractère d'urgence de la situation. Nous avons alloué immédiatement 50 millions d'euros de crédits d'aide sociale, auxquels s'ajoutent les 100 millions d'euros de l'avance de l'Agence France Trésor. Ces sommes ne seront peut-être pas intégralement utilisées, ou au contraire, peut-être sera-t-il nécessaire de les accroître. Il était important en tous les cas de pouvoir doter le réseau de ces moyens immédiatement.
Le PLFR-2 avait déjà été voté, aussi aucun train budgétaire ne permettait de prendre des mesures additionnelles. L'avance a permis d'apporter une réponse immédiate aux problèmes de trésorerie de l'AEFE, et par répercussion, à ceux d'un certain nombre d'établissements demandeurs. Je réaffirme notre total engagement pour obtenir la conversion de cette avance en crédits budgétaires. Cette solution est partagée par notre hiérarchie, au-delà de M. Jean-Yves Le Drian et moi-même. Des réponses seront apportées dans les prochains textes budgétaires, mais l'AEFE doit naturellement tenir compte de la situation qui prévaut juridiquement. Dès lors qu'elle contracte une avance, elle ne peut anticiper le vote d'une mesure législative, aussi s'accommode-t-elle de ce premier outil. Je précise que son taux est particulièrement bas, à 0,1 %.
M. Claude Kern . - Cet argent est annoncé, mais pouvez-vous nous dire quand il sera débloqué ? L'AEFE et les familles l'attendent en effet. Par ailleurs, le ministère de l'économie et des finances partage-t-il votre position ?
M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État . - Le conseil d'administration de l'AEFE qui se tient actuellement doit valider ce dispositif, et l'usage de ces avances. Il prendra fin demain à 10 heures. Cela ne nous a pas empêchés de communiquer auprès des établissements et des familles, comme en attestent les 4 000 recours déjà déposés. Si j'en crois les communications d'un certain nombre de parlementaires à l'issu de la réunion du 30 avril avec MM. Gérald Darmanin et Jean-Yves Le Drian, ces mesures étaient attendues, et ont été saluées. Il existe une convention entre l'AEFE et l'Agence France Trésor pour la mise à disposition de cette avance. Il n'y a donc pas d'ambiguïté juridique. Le ministre des Comptes publics assistait par ailleurs à cette réunion, et approuve cette mesure.
Mme Claudine Lepage . - Je souhaiterais commencer par vous remercier pour le rapatriement des 180 000 Français qui étaient bloqués un peu partout dans le monde. Cela mérite d'être salué.
Il me semble que le vote du conseil d'administration de l'AEFE qui se tient actuellement est délicat. Je ne fais pas partie de ceux qui souhaitent la mort de l'AEFE, bien au contraire. Néanmoins, il lui est demandé de ventiler des prêts entre des établissements fragilisés par la crise. Certains seront dans l'incapacité de les rembourser dans les délais impartis, sauf à augmenter les frais de scolarité, qu'on leur demande par ailleurs de maîtriser, afin de ne pas provoquer le départ des familles. Cette situation est difficilement gérable. Elle ne peut qu'exacerber la colère de ces dernières, et fragiliser l'AEFE, tenue pour responsable du flou sur la nature des 100 millions d'euros d'aides promise par les ministres. Il est donc difficile de voter la mise en oeuvre de ces avances.
Je suis en outre gênée que ce plan de sauvetage prévoie d'aider tous les établissements. Parmi les établissements partenaires figurent en effet un certain nombre d'établissements privés, dont la gestion est opaque. Il me semble problématique que l'État avance de l'argent sans bien savoir comment il sera utilisé. Il est souhaitable de les aider, à condition que leur gestion soit transparente.
Par ailleurs, vous avez évoqué la convention temporaire qu'ils pourraient être amenés à signer avec l'AEFE, au cas où ils ne pourraient pas rembourser. Nous avons entendu hier que les parents d'élèves étaient farouchement opposés à ce conventionnement temporaire. Les établissements le sont aussi. En effet, s'ils sont d'accord pour recevoir de l'argent de l'État français, il se refuse à signer quoi que ce soit avec lui. Cela me gêne.
Dans le cadre de la préparation du plan de soutien, notre groupe de travail demande que la question du niveau des frais de scolarité soit traitée. Ils n'ont en effet cessé de croître depuis des années, et atteignent aujourd'hui un seuil limite d'acceptabilité. La population susceptible de s'inscrire dans les écoles françaises n'est ainsi plus la même qu'auparavant. Peut-être faudrait-il réfléchir à un mécanisme de régulation, sans porter atteinte à la structure de financement du réseau. J'ai rédigé un rapport il y a quelques années sur cette question. Certaines propositions ont été regardées avec bienveillance à l'époque, d'autres non. Nous étions alors dans un ancien monde. Mais je crois que certaines d'entre elles restent d'actualité.
M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État . - Près de 190 000 Français bloqués hors de France ont pu revenir depuis la mi-mars. Nous nous souvenons tous au début de la crise, du nombre important d'appels en provenance du Maroc. Un certain nombre de dispositions avaient en effet été prises par les autorités marocaines, et beaucoup de Français souhaitaient pouvoir rentrer sur le territoire. Plus de 120 vols ont permis de faciliter le retour de 20 000 Français. Nous en sommes aujourd'hui à 200 vols depuis le Maroc.
Des situations similaires se sont aussi présentées dans la ville d'Iquitos, en Amazonie, aux Philippines, ou encore aux Fidji. Les parlementaires des Français établis hors de France ont été associés à ce travail, et ont signalé un certain nombre de cas. Nous poursuivons notre travail puisque nous avons obtenu le doublement des capacités pour le Maroc. Nous sommes ainsi passés de quatre vols hebdomadaires à huit. Une nouvelle compagnie, ASL Airlines, met également en place des vols depuis l'Algérie. Cela permettra d'apporter une réponse aux quelques milliers de Français qui en ont encore besoin. Un trafic maritime a également été mis en place pour rapatrier des détenteurs de camping-cars depuis Agadir, notamment. Un bateau a relié hier Tanger à la France.
La différence entre un établissement conventionné et un établissement partenaire tient précisément à ce que nous ne disposons pas de tous les éléments de gestion de ce dernier. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à ce que nos ambassadeurs apprécient la situation. Ils connaissent en effet le tissu social et éducatif. Cette appréciation nous permettra de déclencher des dispositifs de suivi et de soutien. Nous devons adopter une philosophie similaire à celle des prêts garantis par l'État (PGE). Le ministère de l'Économie et des Finances a notamment recommandé à un certain nombre de grandes entreprises de ne pas verser de dividendes. Nous pouvons considérer que le soutien est conditionné à la preuve que devront apporter les établissements d'avoir pris un certain nombre de mesures.
Même si le conventionnement temporaire a pu susciter des débats, il n'existe pas d'autre solution juridique. L'État ne peut aider une structure privée à l'étranger sans cette garantie. Il convient d'être pragmatique. Nous offrons cette possibilité, libre aux établissements de la solliciter.
Les parents prennent aujourd'hui en charge deux tiers des frais de scolarité. La subvention d'État se monte à 400 millions d'euros, auxquels s'ajoutent les 100 millions d'euros de bourses. C'est pourquoi, dans le plan de développement de l'enseignement français à l'étranger, je me suis battu pour accroître la participation des parents d'élèves au conseil d'administration de l'AEFE. L'idée est qu'ils passent de deux à quatre. Par ailleurs, j'ai demandé à ce que les conseils d'établissements où ils siègent puissent être saisis en amont des projets de budgets. Ces mesures seront appliquées à l'automne prochain. Qui paie a le droit d'être associé et informé des décisions. Je serai du reste intéressé par des mesures permettant de réguler ces frais de scolarité, tout en préservant les capacités d'action du réseau.
M. Damien Regnard . - Je tiens à vous remercier pour les échanges que nous avons eus au cours de ces dernières semaines sur les Français établis hors de France, et l'enseignement français à l'étranger. Je vous signale que notre compatriote rapatrié depuis le Kenya, après plusieurs semaines entre la vie et la mort, a pu revenir en métropole la semaine dernière, pour trois mois de rééducation.
Notre groupe a travaillé sur les nombreux défis auxquels notre réseau fait face. Parmi nos recommandations, je souhaiterais revenir sur deux points. Alors que la survie de nombreux établissements est en jeu, il nous semble aujourd'hui incohérent de poursuivre l'objectif de doublement du nombre des élèves d'ici 2030. L'heure doit être à une totale mobilisation pour sauver et pérenniser coûte que coûte le réseau existant. Cet outil de soft power diplomatique et de rayonnement doit être considéré comme un investissement, et non comme une charge.
De plus, nous savons que 35 demandes d'homologation seront examinées lors de la prochaine commission interministérielle du mois de juillet. Au-delà de la baisse d'exigence des critères qualitatifs d'homologation que nous regrettons, l'extension du réseau serait une charge financière supplémentaire, puisque ces établissements nouvellement homologués entreraient alors dans le plan de soutien financier décidé à la suite de la crise sanitaire et économique. C'est pourquoi nous souhaitons demander un moratoire sur le plan de développement du réseau. Cette possibilité fait-elle partie de vos scénarii de travail ? À défaut, envisagez-vous de reconsidérer l'assouplissement des critères d'homologation, qui nous semble à terme préjudiciable à la qualité de l'enseignement ?
M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État . - J'ai évoqué dans mon propos liminaire le fait qu'il ne fallait pas abandonner l'ambition d'accroître le nombre d'élèves scolarisés dans le réseau, à la fois dans les établissements existants, et parfois, dans des établissements que nous y intégrerons s'ils remplissent un certain nombre de critères. Il existe une croissance démographique dans certaines zones géographiques, où des pays se développent à grande vitesse. L'éducation est souvent un investissement pour les parents. Il serait dommage que nous laissions s'échapper cette opportunité d'offrir un accès à l'éducation à la française, et la capacité à accueillir plus tard ces élèves dans le supérieur. Naturellement, la priorité actuelle est le sauvetage du réseau. Néanmoins, nous devons avoir une vision large de la France. Ces deux objectifs sont conciliables, dans des temporalités différentes.
Par ailleurs, je souhaite redire que nous ne transigeons pas sur le contenu des critères d'homologation. Nous assouplissons un certain nombre de procédures administratives. Le ministère de l'éducation nationale est du reste très vigilant en la matière. Je souhaite concilier sauvetage et ambition. Il s'agit d'être conquérant.
M. Jacques Grosperrin . - Je souhaiterais revenir sur la question du baccalauréat. Il est indispensable que des réponses soient apportées aux familles. Des cellules pourraient-elles être chargées de répondre à leurs questions ?
Je voudrais revenir sur l'avenir du plan de développement de l'AEFE. L'agence fête cette année ses trente ans et avait, à cette occasion, proposé le thème du pari de l'éducation humaniste pour le programme Ambassadeurs en herbe. Certains projets devaient être récompensés au cours d'une rencontre internationale en mai 2020. Il s'agissait de faire de nos établissements des outils de diplomatie et d'influence. Les dossiers ont été rendus le 15 février, et une sélection est intervenue en mars. Qu'en est-il de ce projet ? 40 millions d'euros l'appuyaient.
M. Claude Malhuret . - Nous avons parlé des aides aux établissements d'enseignement français à l'étranger. Mais qu'en est-il des 250 établissements d'enseignement du français langue étrangère ? Ils sont extrêmement importants du point de vue économique, touristique, et pour la défense de la langue française et de la francophonie. Or ces établissements sont significativement pénalisés par la chute du nombre de voyages d'étrangers en France. Ils estiment ainsi à 90 % la chute de leurs enseignements et de leurs recettes. Des mesures d'aides sont-elles envisagées ? Bénéficieront-ils du dispositif de prolongation de l'activité partielle, comme le secteur du tourisme, et du report ou de l'annulation des charges patronales ? Un certain nombre d'entre eux risque en effet la faillite.
M. Max Brisson . - Je salue également votre travail pour rapatrier nos compatriotes, que j'ai pu constater pour certains habitants de mon département. Il en reste par ailleurs quatre au Maroc. Je salue également le travail du groupe sur les difficultés structurelles du réseau, auquel je suis attaché pour y avoir enseigné, avant même que l'AEFE n'existe.
Je souhaiterais vous interroger sur la situation des élèves du réseau, qui sont loin de ces considérations macroéconomiques, par ailleurs essentielles. Il existe, au niveau national, 4 % à 5 % de décrocheurs, et 20 % d'élèves qui se désengagent. Dans le réseau, quelle est l'ampleur de cette rupture vis-à-vis des apprentissages, par établissement ou secteur ? Je mesure à quel point les situations peuvent différer selon les pays, les établissements, et les populations qu'ils accueillent.
Par ailleurs, le ministre de l'éducation nationale essaie de mettre en place en France toutes les remédiations nécessaires pour la rentrée. L'AEFE s'y prépare-t-elle aussi, avec un calendrier décalé selon les zones géographiques ?
Enfin, malgré la crise du système, qui est antérieure à la crise sanitaire, la qualité pédagogique est un atout pour nos établissements. Vous avez évoqué les innovations qui pouvaient être mises en oeuvre, notamment à propos de la MLF. Ne sont-ce pas là des sources d'inspiration pour rénover notre système, et lui redonner l'attractivité qui assurait sa force par le passé ?
Mme Céline Brulin . - Quand les crédits que vous avez évoqués seront-ils formalisés ? Vous nous avez rassurés sur le fait que l'avance de l'Agence France Trésor serait transformée en ligne budgétaire. Un certain nombre d'autres mesures seront intégrées au projet de loi de finances (PLF) 2021, et non dans un PLFR. Or avec la part de plus en plus importante du financement des familles pour le réseau, et avec la crainte d'une diminution du nombre d'élèves, il me semble que ces mesures devraient être inscrites dans un PLFR.
Par ailleurs, les établissements rouvrent lorsque les pays où ils sont implantés rendent cela possible. Comment concevoir les remédiations nécessaires, avec des rythmes potentiellement très différents d'un établissement à l'autre ?
Mme Laure Darcos . - La crise va-t-elle compromettre certains financements des années croisées à venir des instituts français à l'étranger ? Remettra-t-elle en cause la politique culturelle extérieure ?
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Face à cette crise, un certain nombre de personnels d'éducation dits en postes à risque dans des lycées français ont regagné la métropole. Je souhaiterais savoir dans quelle proportion et avec quelles difficultés organisationnelles ? Je sais notamment que le proviseur du lycée du Caire a été contraint de rentrer en France.
M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État . - Notre choix, plutôt que de mettre en place une cellule d'information centralisée, a été de faire en sorte que les établissements soient des centres ressources et qu'ils informent les familles. Le principe de subsidiarité permet une agilité bien supérieure.
Le programme des Ambassadeurs en herbe est un concours de joute oratoire pour les élèves du réseau. Il était impossible de le mettre en place cette année. La plupart des événements prévus pour fêter les trente ans de l'AEFE ont dû être ajournés. Lorsque nous reviendrons à une situation plus normale, il pourra être souhaitable d'en reprogrammer certains. Nous sommes très attachés à ce type d'événements.
En ce qui concerne les alliances françaises sur le territoire national, les propos du Président de la République étaient très volontaristes pour le monde de la culture. Dans son allocution du 13 avril, il a précisé que le secteur du tourisme, de la culture, des sports et de l'événementiel devait bénéficier d'un traitement particulier. Par exemple, les différents domaines de la culture sont intégrés dans les exonérations de charges de mars à juin. Ce tableau sera soumis au Parlement, dans le PLFR-3, d'ici quelques jours. Ces secteurs continueront à bénéficier d'une activité partielle plus favorable que d'autres, et ce jusqu'à la fin de l'année.
En ce qui concerne les 800 alliances françaises dans le monde, 650 ont dû être fermées, à l'instar des 117 instituts culturels locaux. Quelques-uns de ces établissements commencent à rouvrir. Un certain nombre d'entre eux ont par ailleurs mis en place des mesures de continuité, grâce au numérique. De fait, les activités générant des recettes ont connu une certaine baisse (cours de langue, organisation d'examens et de certification).
Nous avons identifié une trentaine de postes en situation fragile, y compris au sein de certains établissements dans de grands pays (États-Unis, Chine, Japon, Turquie). Nous sommes très vigilants les concernant. Une dizaine d'autres fait l'objet d'une surveillance accrue, en Argentine, au Mexique, en Indonésie et au Vietnam. A l'inverse, quelques établissements ont fait preuve d'une belle résilience budgétaire, notamment en Afrique et dans certains pays européens. Nous avons commencé un recensement de leurs besoins. Tout sera fait pour que ces établissements passent le cap. Nous finalisons un certain nombre de mesures, dont nous pourrons rediscuter dans le courant du mois de juin.
Le directeur de l'AEFE serait plus en mesure de fournir des données sur le décrochage par établissement et par pays. Je collecterai cependant ces données, et vous les transmettrai dans une réponse écrite.
Nous sommes placés en concurrence avec d'autres systèmes d'enseignement. Des établissements anglophones se développent. Nous avons beaucoup d'atouts, mais nous ne devons pas renoncer, pour rester attractifs, à favoriser l'apprentissage d'autres langues. Le Président de la République, lorsqu'il avait évoqué son plan pour le développement de la francophonie, avait souligné l'importance du plurilinguisme. La France porte l'apprentissage de la deuxième langue dans un certain nombre d'enceintes, telles que l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). Le français est en effet bien placé pour être la deuxième langue choisie. Le plurilinguisme est un élément d'attractivité pour le réseau, comme le numérique, dont nous devons nous emparer pleinement.
L'AEFE dispose déjà d'une trésorerie, qui lui permet d'avancer des sommes aux établissements qui en ont besoin. Nous avons prévu l'avance pour pouvoir compléter ces montants. Ces avances seront disponibles au mois d'août, mais l'AEFE n'attend pas. Avec M. Jean-Yves Le Drian, nous portons cette position de la transformation en crédits budgétaires dans toutes les discussions interministérielles dédiées, notamment celle sur le PLFR-3. Une ventilation est possible entre celui-ci et d'autres mesures budgétaires pour 2021, mais l'idée est de sanctuariser cette somme le plus vite possible.
Les années croisées sont des moments très importants d'un point de vue culturel, mais également diplomatique. Il faut continuer au même rythme, tout en s'adaptant aux contraintes. L'année 2020 prévoyait une saison Africa. Je crois qu'il faut demeurer volontariste car en matière d'influence, nous avons pu constater que la crise était l'occasion pour un certain nombre de puissances émergentes de déployer davantage leur soft power .
Le nombre de professeurs ayant dû regagner la métropole est de l'ordre de quelques dizaines. La plupart du temps, ils ont contribué à la continuité pédagogique de là où ils se trouvaient. S'agissant des Français établis hors de France de façon pérenne, M. Jean-Yves Le Drian a indiqué qu'il leur fallait dans la mesure du possible demeurer à leur domicile. C'est pourquoi nous avons mis en place les dispositifs de soutien sanitaire et social, afin que ceux-ci puissent avoir accès à des soins appropriés en cas de problème, d'où le mécanisme d'évacuation fonctionnant en continu. L'idée est que les professeurs puissent dans la mesure du possible rester là où ils sont affectés. Je sais que le dialogue s'est enclenché naturellement entre ceux qui sont revenus, l'AEFE et leurs établissements. Mais leur nombre est relativement réduit.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Pouvez-vous approfondir la question des alliances françaises ?
M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État . - Il s'agit d'un travail en cours. Nous ne sommes pas au même degré d'avancement que pour l'enseignement français. Nous recensons les difficultés, avant de pouvoir élaborer les mesures d'accompagnement. Il serait à ce titre utile que la direction en charge de ce secteur au ministère puisse échanger avec votre commission.
Mme Catherine Dumas . - Qu'en est-il des étudiants qui ont l'habitude de suivre des stages à l'étranger ? Beaucoup en avaient prévu, y compris dans des lycées professionnels.
M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État . - Aujourd'hui, la mobilité vers l'extérieur est très entravée. Près de 180 pays ont encore mis des mesures restrictives à l'accès des Français sur leur sol. Le travail intra-européen avance. Des initiatives quelque peu unilatérales ont été prises ces derniers jours, mais l'appel à la coordination commence à être entendu. Le 15 juin constitue à ce titre une date pivot. Au sein de l'espace Schengen, la liberté de circulation reprendra un cours plus normal.
Un certain nombre de ces stages pouvaient avoir lieu hors d'Europe. La situation risque de demeurer complexe plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le principe qui prévaut aujourd'hui en Europe est celui du non-accès de ressortissants d'États tiers à l'espace Schengen. Il est valable jusqu'au 15 juin. Les discussions sont en cours, mais les ministres de l'Intérieur se réuniront le 5 juin. Il semblerait que les États européens souhaitent prolonger cette disposition pour quelques semaines. Cela a remis en cause un certain nombre de programmes, et nous devons parfois faciliter le retour d'étudiants français. Je songe par exemple à des étudiants en médecine en Roumanie, qui ont pu revenir la semaine dernière. Il est aujourd'hui important de temporiser sur ces déplacements lointains.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Vraisemblablement les musées, les bibliothèques et les médiathèques seront les premiers lieux de culture à rouvrir. La distanciation sociale et la régulation des flux des publics y sont en effet assez aisées. Certaines expositions sont cependant bloquées par les difficultés d'acheminement des oeuvres. Vos services travaillent-ils sur cette question ? Je songe notamment à l'exposition sur les Olmèques. Ces expositions seront-elles différées dans le temps ?
M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État . - Le sujet des musées concerne prioritairement M. Franck Riester. Néanmoins, vous avez raison de souligner qu'un certain nombre de musées a pu rouvrir. Naturellement, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères reste à leur disposition pour faciliter le transfert des oeuvres. Le flux des personnes a été entravé, mais celui des biens a pu continuer de manière assez soutenue. Je songe également à une exposition qui doit présenter des objets provenant du Tadjikistan au musée Guimet. Cela participe de cette logique d'influence, et j'ai bon espoir que nous puissions maintenir un programme dense.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Le Festival Normandie impressionniste doit accueillir des oeuvres notamment d'outre-Atlantique, et cela pose question. Ces manifestations sont censées reprendre, et nous comptons sur les services de votre ministère pour accompagner les transits sur place. Cela participera de la relance.
Par ailleurs, nous avons des contacts réguliers avec le délégué à la francophonie, M. Paul de Sinety, qui déplorait récemment que le ministère de l'Europe et des affaires étrangères ait lancé une opération nommée Marque France, dont la déclinaison était en anglais. Je m'en suis ouvert auprès de M. Jean-Yves Le Drian. Il est fâcheux que l'anglais soit choisi même dans des pays tels que le Brésil, l'Argentine et le Mexique, où la langue française est assez familière. Êtes-vous au courant de ce fait ?
M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État . - Ce sujet ne relève pas exclusivement du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, mais était interministériel. Les différentes marques concernent l'attractivité économique et le tourisme. Il est important qu'il puisse y avoir une déclinaison selon les supports. Je suis très attaché à ce que puisse exister, outre ces déclinaisons en anglais, un équivalent en français. Le Président de la République a souhaité qu'un événement soit organisé à Paris pour valoriser le rôle de la France en matière de gastronomie. Dans ce domaine également, la concurrence fait rage. À l'initiative du chef, M. Alain Ducasse, et de l'ambassadeur, M. Philippe Faure, un Paris food forum a pu avoir lieu. Je me suis battu pour que cet événement puisse avoir comme nom officiel celui de Forum de Paris pour la gastronomie et l'alimentation durable. Nous nous adressons cependant au monde entier, et des déclinaisons sont nécessaires. J'ai néanmoins veillé à ce que ces deux dimensions puissent coexister sur les documents, et que le français ne soit pas relégué. Sans intervention politique, l'anglais aurait peut-être été privilégié.
Nous fêtons le cinquantenaire de la francophonie institutionnelle. À Niamey en 1970, un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement ont signé ce pacte, qui a créé l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT). Celle-ci s'est par la suite transformée en Agence de la Francophonie, et en Organisation internationale de la Francophonie. La francophonie a cependant précédé sa version institutionnelle. Elle a commencé par de jeunes étudiants dans les années 1920, et s'est poursuivie avec des intellectuels et des écrivains. De ce point de vue, Mme Leïla Slimani est très engagée pour que nous puissions porter haut cette ambition, qui dans les jeunes générations, peut apparaître dépassée, ce qu'elle n'est naturellement pas. Elle est au contraire d'une grande modernité car le français est une langue qui permet de se retrouver.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je vous parlais en l'occurrence d'événements organisés dans des pays de langues latines, très proches du français, pour lesquelles la déclinaison de la Marque France se fait en anglais. Je trouve cela dommage.
M. Claude Kern . - Je partage votre position sur le plurilinguisme, mais pourquoi se battre pour que le français devienne la deuxième langue dans un certain nombre d'institutions, et non la première langue ? Je crois qu'il faut faire progresser la francophonie. Étant membre de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, je me bats systématiquement contre les Français qui présentent leurs rapports en anglais.
Je ne reprendrai pas tous les éléments que vous avez présentés sur l'avenir du réseau, mais je constate qu'il reste beaucoup de travail. L'objectif de doublement des effectifs d'élèves d'ici 2030, voulu par le Président de la République et fixé dans le plan de développement du réseau, me semble très difficile à atteindre. Je partage votre position : il faut avant tout sauver le réseau existant. J'avais déjà émis des doutes sur ce plan de développement lorsqu'il avait été annoncé, notamment sur la date fixée. Avant d'annoncer une autre date, il conviendra de faire un nouveau point. Comme nous pouvons craindre de nombreuses défections, cet objectif devra être sans doute revu.
Nous sommes dans l'attente du déblocage de l'avance, et nous souhaiterions disposer d'une date, même approximative, de présentation du PLFR-3.
M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État . - Un conseil des ministres doit se tenir le 10 juin, et traitera du PLFR-3.
J'adopte par ailleurs la même attitude que M. Claude Kern dans les conseils des ministres de l'Union européenne auxquels j'assiste. Je prends la parole en français. Notre représentant permanent auprès de l'Union européenne, il y a de cela quelques mois, avait du reste quitté une réunion, parce que les documents n'étaient pas disponibles en français. L'anglais n'est plus la langue officielle que d'un ou deux États de l'Union européenne après le Brexit. Nous travaillons à un plan avec Mme Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la Francophonie, afin de former un certain nombre de fonctionnaires européens et internationaux à l'usage du français. Sur la durée, depuis vingt ou trente ans, le français a en effet reculé avec les élargissements successifs.
Mme Laure Darcos . - Je pense que les organismes internationaux, et notamment la Commission européenne, accueillent de moins en moins de jeunes Français. Nous sommes donc confrontés à des anglo-saxons et des jeunes d'Europe de l'Est qui s'expriment tous en anglais.
M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État . - Je pense que la francophonie a de l'avenir. Je constate sur le territoire l'engagement associatif, par exemple la maison de la francophonie. Pour revenir sur le développement de l'enseignement français à l'étranger, et l'élan que le Président de la République avait impulsé pour 2030, l'idée était à la fois de renforcer les établissements existants et de favoriser l'émergence de nouveaux. Il ne s'agissait pas, lorsqu'un établissement nouveau ouvrait dans une ville où en existait déjà un autre, de prendre à l'un pour donner à l'autre. Nous avons donc demandé aux ambassadeurs de coordonner le développement du réseau. M. Olivier Poivre d'Arvor l'a fort bien fait en Tunisie. Il est important que puisse exister une certaine régulation, et nous assurer que la concurrence ne nuise pas au projet. Il s'agit de rester bien positionné dans un monde où de plus en plus de parents de jeunes de pays émergents sont prêts à investir dans l'éducation. Si nous conservons un effectif de même taille, arithmétiquement, nous perdons en influence.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Le rapport de Mme Claudine Lepage et de M. Louis Duvernois sur la francophonie avait formulé la recommandation que notre commission ne s'exprime qu'en français lorsqu'elle reçoit des délégations étrangères. Nous suivons cette règle, et nous faisons traduire, y compris quand nous nous déplaçons à l'étranger. Nous essayons d'être exemplaires en la matière.
M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État . - Le plurilinguisme doit s'exprimer à tous les niveaux. Si nous défendons le français sur la scène internationale, celui-ci doit également faire la place aux langues qui ont cours sur le sol français. Qui défend la francophonie doit également défendre les langues régionales. Il faut être cohérent, et nous ne devons pas faire preuve d'un impérialisme linguistique.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Notre commission défend la diversité culturelle, et l'exception culturelle. Pour nous, défendre le français, c'est défendre toutes les langues.
M. Max Brisson . - Je pense que si nous voulons que le français soit appris à l'étranger, nous devons également donner toute leur place aux autres langues sur notre territoire. Ce plurilinguisme vaut pour le système français à l'étranger, mais également en France, et est le seul moyen de sauver la place du français dans le monde.
Mme Catherine Dumas . - Les écoles françaises à l'étranger sont pionnières en la matière, puisque si l'enseignement y est en français, la langue du pays y est également enseignée, ainsi que l'anglais, et d'autres langues. Beaucoup d'élèves sortent de ces écoles en étant trilingues.
M. Max Brisson . - Le recul de l'espagnol comme première langue vivante est considérable dans mon département. L'anglais est appris à Bayonne, mais non l'espagnol. Il ne faut alors pas s'étonner que le français ne soit plus appris de l'autre côté de la frontière.
M. Claude Kern . - La situation est similaire en Alsace, où l'allemand est en net recul. Or les maisons-mères des grandes entreprises qui y sont installées sont allemandes. Elles demandent donc à ce que les jeunes recrutés sachent parler l'allemand. De même, de nombreux emplois ont du mal à être pourvus en Allemagne, faute d'un nombre suffisant de jeunes parlant la langue.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Nous allons conclure cette audition pour laquelle je vous remercie, M. le secrétaire d'État. Nous serons très vigilants dans la perspective du PLFR-3, sur la déclinaison de ce plan d'urgence. Nous continuerons avec notre groupe de travail à approfondir ces sujets. Aussi serons-nous sans doute amenés à vous entendre à nouveau, notamment sur le volet culturel.
* 1 Enquête menée du 11 au 15 mars 2020 recueillant des réponses de 6 184 écoles et 1 900 collèges et lycées.
* 2 https://services.dgesip.fr/fichiers/PlanContinuitePedagogiqueDGESIP_150420.pdf
* 3 Décret n° 2020-273 du 18 mars 2020 relatif aux missions des services de santé universitaires dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-19.
* 4 Premier dispositif : photos prises de manière aléatoire toutes les 45 secondes, charge ensuite à un algorithme d'intelligence artificielle d'analyser les captures pour identifier les suspicions de triche ; deuxième dispositif : captation vidéo de la totalité de l'examen, également avec un outil d'intelligence artificielle repérant les événements inattendus ; troisième dispositif : télé-examen par contrôle direct des postes informatiques des candidats par un ou plusieurs surveillants.
* 5 SNES-FSU, SNUIPP-FSU, SNPDEN-UNSA, SGEN-CFDT.
* 6 Terme extrait du communiqué de presse des ministres.
* 7 Expression extraite du communiqué de presse des ministres.
* 8 Ces remises, qui peuvent être accordées aux parents d'élèves scolarisés dans des établissements en gestion directe, doivent être liées aux conséquences de la pandémie et ne valent que pour les deuxième et troisième trimestres de l'année 2019-2020 pour les pays « de rythme nord, et pour les premier et deuxième trimestres 2020 pour les pays « de rythme sud ».
* 9 En 2017, l'annulation inattendue de 33 millions d'euros de la subvention versée à l'AEFE (environ 10 % du montant de la subvention qui aurait dû être versé au titre de 2017) a créé un traumatisme durable au sein du réseau. Pour faire face à cette situation, l'Agence a dû mettre en oeuvre des mesures de trésorerie et recourir à des mesures plus structurelles (fermeture de postes en 2018 (-180) et 2019 (-166) ; rehaussement de la participation financière complémentaire (PFC) due par les établissements en gestion directe et les établissements conventionnés de 6 % à 9 % des frais de scolarité en 2018, avant un retour à 7,5 % en 2019).
* 10 Ces commissions seront composées de représentants de la direction de l'établissement, de l'ambassade et d'élus au conseil d'établissement. Pour les établissements conventionnés, les commissions pour l'aide aux familles étrangères comprendront également les comités de gestion.
* 11 Le dispositif FLAM (Français LAngue Maternelle) vise à soutenir des associations qui proposent à des enfants français à l'étranger, dans un contexte extrascolaire, des activités autour de la pratique du français en tant que langue maternelle.
* 12 Données transmises par l'AEFE.
* 13 Cour des comptes, référé sur l'AEFE, juillet 2017.
* 14 Rapport d'information n° 689 (2017-2018) de MM. Vincent Delahaye et Rémi Féraud, fait au nom de la commission des finances, juillet 2018.
* 15 Audition réalisée dans le cadre de la commission réunie en plénière.
* 16 Remdesivir, lopinavir/ritonavir, lopinavir/ritonavir/interféron bêta, hydroxychloroquine.
* 17 L'intérêt des vecteurs lentiviraux vaccinaux réside dans leur grand potentiel d'induction de réponses immunitaires adaptatives durables.
* 18 REsearch and ACTion targeting emerging infectious disease. Associant des équipes et des laboratoires de grandes institutions de recherche (Inserm, Institut Pasteur, CNRS, Commissariat à l'énergie atomique (CEA), Institut de recherche pour le développement (IRD), Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad)...), ainsi que des CHU et des universités, il a pour mission de préparer, d'accélérer et de coordonner la recherche sur les maladies infectieuses émergentes pour prévenir et lutter contre les épidémies.
* 19 Instrument de financement spécifique de l'ANR, l'appel Flash s'appuie sur un dispositif accéléré qui permet de financer des recherches nécessitant l'acquisition d'informations et de données rares et permettant la production de résultats scientifiques inédits, en lien avec un évènement dont l'ampleur et la rareté sont exceptionnelles. La sélection et le financement sont réalisés dans un délai court, sans déroger aux principes d'évaluation par les pairs.
* 20 Études épidémiologiques et translationnelles : 11 projets ; physiopathogénie de la maladie (interactions virus-hôte et réponse immune) : 15 projets ; mesures de prévention et de contrôle de l'infection en milieu de soins et en milieux communautaires : 12 projets ; éthique - sciences humaines et sociales associées à la réponse : 6 projets.
* 21 Le 19 mars 2020, la ministre de la recherche a annoncé la création d'un fonds d'urgence de 50 millions d'euros en faveur de la recherche sur la Covid-19.
* 22 Pays de la Loire, Normandie, Grand Est, Occitanie, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.
* 23 Études épidémiologiques ; physiopathogénie de la maladie ; prévention et contrôle de l'infection ; éthique et dynamiques sociales ; enjeux globaux de l'épidémie Covid-19.
* 24 « Covid-19 : pour une coordination nationale et européenne de la recherche ».
* 25 Instance collective placée auprès du CNRS, le Comité national de la recherche scientifique (CoNRS) - composé du conseil scientifique, des conseils scientifiques d'institut, des sections spécialisées dans chacune des disciplines et des commissions interdisciplinaires - participe à l'élaboration de la politique scientifique de l'établissement, procède à l'analyse de la conjoncture et de ses perspectives, participe au recrutement et au suivi de la carrière des chercheurs ainsi qu'à celui de l'activité des unités de recherche.
* 26 L'évolution des résultats de la recherche biomédicale française peut être analysée à travers les différents indicateurs calculés par l'Observatoire des sciences et des techniques (OST) portant sur la recherche en biologie fondamentale et sur la recherche médicale.
* 27 Cour des comptes, « Le rôle des CHU dans l'enseignement supérieur et la recherche médicale », décembre 2017.
* 28 Titre I : programmation budgétaire ; titre II : mesures de ressources humaines ; titre III : mesures d'organisation de la recherche ; titre IV : diffusion de la recherche ; titre V : mesures de simplification et autres.
* 29 Communiqué de presse de l'Académie nationale de médecine, « Recherche clinique et Covid-19 : la science n'est pas une option », 8 mai 2020.
* 30 L'essai se poursuit avec un rythme d'inclusion de patients plus lent, en raison du ralentissement de l'épidémie. Les inclusions dans le bras hydroxychloroquine, interrompues le 3 juin, à la suite de la décision du DSMB (Data Safety Monitoring Board), devraient reprendre après le feu vert de l'Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM). En Europe, certains pays ont choisi de rejoindre l'essai Solidarity porté par l'OMS et dont Discovery est un essai fille. Des discussions sont également en cours avec l'Allemagne et le Portugal pour qu'ils rejoignent Discovery.
* 31 Au passage, il est permis de s'interroger sur les annonces du Premier ministre, qui a annoncé sans plus de précisions la levée du confinement pour les médiathèques, qui subissent les mêmes contraintes d'hygiène que les librairies.
* 32 La commission a été, à ce titre, particulièrement échaudée par les négociations interminables sur la chronologie des médias.
* 33 Le président du CSA, M. Roch-Olivier Maistre, a été auditionné le 28 avril 2020.
* 34 Le CSA a estimé qu'il était obligé de reporter les délais relatifs à ses décisions en préparation compte tenu des dispositions prévues par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.
* 35 Ces décisions concernent la nomination à la présidence de France Télévisions, le renouvellement de l'autorisation d'émettre de Canal + ainsi que le développement du DAB+.
* 36 Le président de TF1, Gilles Pélisson, a été auditionné par le groupe de travail le 7 mai 2020.
* 37 Lors de la semaine du 13 au 19 avril, le JT de TF1 a atteint une moyenne de 8,5 millions de téléspectateurs à 20 heures (+32 % par rapport à la moyenne de janvier et février) contre 6,9 millions de téléspectateurs (+38 %) pour le JT de France 2 de 20 heures. Sans rattraper son retard, le JT de France 2 a néanmoins surperformé celui de la première chaîne.
* 38 Source : « Hebdo de l'info » - les audiences de l'info semaine 16 du 13 au 19 avril 2020.
* 39 La présidente de Radio France, Sibyle Veil, a été auditionnée par le groupe de travail le 14 mai 2020.
* 40 La présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, a été auditionnée par le groupe de travail le 30 avril 2020.
* 41 Les présidents de TF1 et M6 ont également regretté que France Télévisions continue à les concurrencer sur l'acquisition de programmes américains en n'hésitant pas à surenchérir sur leurs propres offres d'achat, participant ainsi à la hausse des coûts de ces programmes et à leur affaiblissement.
* 42 La date de dépôt des candidatures a été repoussée par le CSA du 2 avril au 10 juillet et la décision de nomination qui devait intervenir avant le 5 mai 2020 sera finalement rendue au plus tard le 24 juillet 2020.
* 43 Dès son lancement le 7 avril 2020, Disney + s'est octroyée près d'un tiers de la consommation des plateformes de vidéo par abonnement.
* 44 La présidente du groupe Newen, Bibiane Godfroi, a été auditionnée par le groupe de travail le 19 mai 2020.
* 45 Le président de Mediawan, Pierre-Antoine Capton, a été auditionné par le groupe de travail le 25 mai 2020.
* 46 Le CNC rappelait déjà il y a quelques années que « les secteurs soutenus par le CNC génèrent une valeur ajoutée directe de 8,5 Md€ en 2012, soit une valeur équivalente à celle de l'industrie automobile (8,6 Md€ selon l'INSEE) et supérieure à celle de l'industrie pharmaceutique (6,4 Md€) ou encore à celle de la fabrication de textiles, l'industrie de l'habillement, l'industrie du cuir et de la chaussure (5,3 Md€) ».
* 47 Un chiffrage présenté au groupe de travail lors d'une des auditions évaluait le coût annuel de la disposition à 800 M€ dans l'hypothèse d'un crédit d'impôt de 20 % appliqué à un chiffre d'affaires d'achats d'espaces de 4 Mds€. Une application de la mesure sur un semestre nécessiterait tout de même de mobiliser 400 M€ avec un risque d'effet d'aubaine pour les annonceurs qui n'avaient pas prévu de renoncer à leur programme d'achats d'espaces au second semestre.
* 48 En France, les chaînes publiques comme privées sont assez frileuses et n'incitent pas à la création de nouveaux formats. Pour l'essentiel, notamment dans le service public, il s'agit de formats étrangers achetés et adaptés. France Télévisions dans ses nouveaux programmes de flux mis à l'antenne entre 2015 et 2020 ne compte que 29 % de programmes originaux contre 95 % pour la BBC au cours de la même période (Etude TOOCO 2020). Ce déficit de formats originaux a un double impact économique pour les chaînes : les droits de formats achetés à l'étranger représentent 7 à 10 % des coûts de production ; l'absence de formats propriétaires prive les chaînes et les producteurs d'une ressource de plus en plus stratégique (face à la baisse tendancielle des ressources publicitaires), celle des droits de commercialisation des formats vendus à l'étranger. Autre effet regrettable : cette situation bride la créativité des producteurs internes comme privés. Le crédit d'impôt consacré aux éditeurs pourrait ainsi intégrer dans son périmètre les innovations françaises en matière de programmes de flux.
* 49 Source : Conseil Social du Mouvement Sportif (CoSMoS), avril 2020.
* 50 https://www.vie-publique.fr/discours/274200-edouard-philippe-28042020-plan-de-deconfinement-covid
* 51 Enquête réalisée par la Centrale du Sport et le cercle de réflexion Sport et citoyenneté.
* 52 La Ligue a souscrit un PGE de 235 M€ gagé sur les futures recettes de retransmission télévisée.
* 53 http://www.andes.fr/279627/un-guide-de-recommandations-sur-les-equipements-sportifs-transmis-au-ministere-des-sports/
* 54 Audition du 5 mai 2020.
* 55 L'interdiction de rassemblements a d'abord concerné les groupes de plus de 1 000 personnes (le 8 mars), puis de 100 personnes (le 23 mars), et enfin de 10 personnes depuis le 11 mai. L'article 3 du décret du 31 mai ajoute qu'aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020.
* 56 La réouverture des piscines est effective depuis le 2 juin en zone « verte » et devrait intervenir le 22 juin en zone « orange ».
* 57 http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguidepratiquesalternatives.pdf
* 58 Les droits de retransmission télévisée représentent 85 % des recettes des clubs de Ligue 1 selon Patrick Wolff.
* 59 Ce groupe de suivi animé par Fabienne Colboc et Régis Juanico a présenté le bilan de ses travaux le 20 mai 2020.
* 60 https://www.senat.fr/rap/r16-437/r16-43714.html
* 61 https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200413/cult.html
* 62 https://www.senat.fr/rap/r16-437/r16-437.html
* 63 https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22379
* 64 Le groupe de travail propose de limiter cette expérimentation aux alcools du groupe 3 [boissons fermentées non distillées (vin, bière, cidre, poiré, hydromel) et vins doux naturels, crème de cassis, jus de fruits ou de légumes comportant jusqu'à 3° d'alcool, vin de liqueurs, apéritif à base de vin, liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises comprenant moins de 18° d'alcool].
* 65 https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-soutiens-publics-leuro-2016-en-france
* 66 https://www.lfp.fr/Articles/COMMUNIQUÉS/2020/05/04/communique-de-la-lfp
* 67 http://www.senat.fr/rap/r19-102/r19-102.html
* 68 https://www.senat.fr/rap/r18-585/r18-585-syn.pdf
* 69 http://www.sports.gouv.fr/presse/article/La-Ministre-des-sports-annonce-l-ouverture-d-une-grande-concertation
* 70 https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8215-a-la-dcouverte-du-sport-avec-la-carte-passerelle-.html
* 71 http://pactedeperformance.org
* 72 https://www.senat.fr/rap/r16-437/r16-437.html
* 73 Le dernier alinéa de l'article L. 333-3 du code sur sport prévoit en particulier que « Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la solidarité existant entre les sociétés, ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété. »
* 74 Le groupe de travail « Jeunesse et vie associative » de la commission de la culture est présidé par Jacques-Bernard Magner (Puy-de-Dôme, socialiste et républicain) et composé de Céline Boulay-Espéronnier (Paris, LR), Olivier Paccaud (Oise, LR), Dominique Vérien (Yonne, UC).
* 75 Enquête réalisée par le Mouvement associatif, Covid-19 : quels impacts sur votre association ?, enquête réalisée du 20 mars au 7 avril 2020, 16 175 réponses au 7 avril 2020.
* 76 « La quatrième catégorie est celle des « précaires » ayant déjà une expérience professionnelle. Pour ces volontaires, les études sont plus loin : 94 % des volontaires de la catégorie sont sortis des études l'année précédant leur mission ou avant. Les personnes qui ont eu des expériences professionnelles, le plus souvent en CDD, y sont très surreprésentées. La plupart ont recherché un emploi avant leur entrée en mission, pour une durée généralement entre 1 et 6 mois. Les personnes ayant été pour leur dernière année d'études dans le secondaire professionnel (CAP-BEP, Bac pro, sorties en cours d'études professionnelles sans diplôme) y sont plus nombreuses qu'en moyenne ».
* 77 Il s'agit « plutôt des chômeurs de longue durée et sans expérience professionnelle. Ils sont également une grande majorité à avoir terminé leurs études il y a plus d'un an (91 %), mais à la différence de la catégorie 4, 92 % n'ont eu aucune expérience professionnelle en 2 ans. Ils sont à la recherche d'un emploi depuis longtemps : 55 % le sont depuis plus d'un an, 18 % entre 6 mois et 1 an, 9 % ne savent pas ».
* 78 L'impact économique du service civique, étude de GoodWill-management, février 2019.
* 79 Rapport d'information n° 321 de MM. Alain Dufaut et Jacques-Bernard Magner, Réduction des emplois aidés : offrir une alternative crédible au secteur associatif, (2017-2018).