Actes du colloque : vers de nouvelles normes en droit de la responsabilité publique
Palais du Luxembourg, 11 et 12 mai 2001
Disponible au format Acrobat (13 Moctets)
-
AVANT-PROPOS
-
-I- L'ENCADREMENT GÉNÉRAL DU DROIT DE LA RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
-
Allocution d'ouverture
-
Allocution
-
La norme en droit de la responsabilité
-
La pratique de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
-
L'encadrement de la responsabilité en droit communautaire
-
L'encadrement constitutionnel de la responsabilité de la puissance publique
-
Allocution d'ouverture
-
-II- L'HÉTÉROGÉNÉITÉ DES NORMES EN DROIT INTERNE DE LA RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
-
La responsabilité pénale des décideurs publics locaux
-
La responsabilité des parcs, communes et communautés de communes
-
Existe-t-il une responsabilité de droit commun ?
-
Y a t-il une "subsidiarisation" dans le droit de la responsabilité administrative ?
-
Le dommage et le préjudice
-
Disparition, maintien ou réformation de la dualité de juridiction ?
-
La responsabilité pénale des décideurs publics locaux
-
- III - LES DILEMMES DE LA RESPONSABILITÉ
-
La responsabilité pénale du Président de la République : pour une autre interprétation de l'article 68 de la constitution
-
Responsabilité et principe de précaution
-
Responsabilité de l'administration et nouvelles activités de contrôle
-
Les dilemmes de la responsabilité internationale aujourd'hui
-
La responsabilité et les tiers au contrat administratif
-
À propos des catégories du droit de la responsabilité
-
La responsabilité pénale du Président de la République : pour une autre interprétation de l'article 68 de la constitution
-
- IV - La responsabilité est-elle dominée par l'éthique ?
AVANT-PROPOS
Sans conteste, il est vain de vouloir introduire des journées qui parleront d'elles-mêmes, tant furent riches les différentes interventions de nos collègues, toutes tendues vers la norme en Droit de la Responsabilité Publique.
Qu'il me soit simplement permis de les remercier, avec d'infinis égards.
Mon témoignage de reconnaissance ira aussi naturellement au Sénat qui nous a accueillis, toujours avec chaleur, au Ministère de l'Éducation Nationale et à l'Université de Paris 13 sans lesquels la publication n'aurait pu se faire.
Mais mon émotion part pour un autre monde. Il est dérisoire pour un modeste enseignant d'oser dire quelques mots du Doyen Vedel.
Pour tous ceux qui furent imprégnés par ses cours de Droit Administratif à la Faculté de Droit de Paris, où la finesse et l'élégance rivalisèrent avec la profondeur de l'esprit et qui ne virent d'autres destins, illusoires, que de tenter, fort maladroitement, de le suivre pour mieux le respecter, il restera le Maître. Sa voix pénétrante, et la puissance de ses écrits, feront tout l'Art du discours comme la pérennité de ses propositions.
Aussi, permettez-moi d'évoquer, en hommage, comme une indicible pensée, la carte par laquelle il acceptait, aussitôt, avec un humour sceptique dont rien ne saurait le départir, de présider une séance de ce Colloque.
G.D.
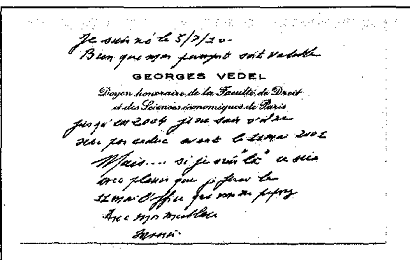
-I- L'ENCADREMENT GÉNÉRAL DU DROIT DE LA RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
Allocution d'ouverture
Par Monsieur Christian Poncelet,
Président du Sénat
Président de séance : Monsieur Pierre FAUCHON, vice président de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale du Sénat.
Mesdames et Messieurs les professeurs, Monsieur le représentant du président du Sénat - son directeur de cabinet Monsieur MEAR, que nous sommes heureux d'accueillir - Mesdames et Messieurs, nous allons donc ouvrir ce colloque que j'ai l'honneur, impressionnant d'ailleurs pour moi, de présider pour sa première demi-journée.
L'on sent une pointe de confusion. Je ne sais pas à quoi je dois cet honneur, mais en tout cas, je puis à tout le moins dire que je suis de ceux pour qui le mot même de responsabilité est peut être l'un des mots les plus éclairants que l'on puisse trouver dans notre droit. Soit qu'on le considère techniquement comme une source d'obligation, soit qu'on le considère, je dirais plutôt, politiquement comme le principe actif agissant dans les sociétés modernes, qu'il s'agisse de la vie privée ou a fortiori de la vie publique, qui va être le thème central de nos réflexions et des différentes communications qui vont se succéder.
Et qui vont s'ouvrir maintenant par l'intervention du président PONCELET, qui est retenu par des obligations en province, qui n'étaient pas prévues lorsqu'on a organisé ce colloque et imprimé le programme. Ce qui fait qu'on vous prie de l'excuser. Il a demandé à son directeur de cabinet, Monsieur Alain MEAR, de vous lire sa communication. À titre d'introduction, je lui donne la parole.
Monsieur Alain MEAR, représentant Monsieur le président du Sénat, Christian PONCELET
Merci Monsieur le président.
Monsieur le président de l'université de Paris 13, Monsieur le président Pierre FAUCHON, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs.
Monsieur Christian PONCELET, président du Sénat de la République, m'a chargé de vous présenter ses excuses de ne pas avoir pu honorer son engagement d'être parmi vous ce matin. Ses fonctions de président du Conseil général l'ont en effet impérieusement rappelé dans son beau département des Vosges, célèbre par sa ligne bleue. Il a souhaité que je vous donne lecture du message suivant afin de vous témoigner une nouvelle fois l'intérêt qu'il porte à vos travaux. C'est donc à partir de maintenant le président PONCELET qui parle par ma voix :
Chers amis, c'est avec un véritable plaisir qu'à la demande de Monsieur le professeur DARCY, j'ai accepté d'accueillir votre colloque au sein de cette belle maison. C'est en effet la vocation du Sénat, assemblée parlementaire à part entière et représentant constitutionnel des collectivités locales, mais aussi chambre de réflexions et de propositions, par nature ouverte sur l'avenir, d'accueillir des travaux de prospectives aussi riches et denses que promettent de l'être les vôtres. Permettre la tenue de débats de grande qualité constitue à mes yeux une part très importante de la mission qui incombe au Sénat et qui consiste à approfondir les questions, à ouvrir de nouveaux champs de réflexions, en un mot à nourrir le débat démocratique.
Je me réjouis qu'à l'occasion de ces deux journées, nos liens avec le monde de l'université puissent être renforcés. Je m'en félicite d'autant plus que l'université Paris 13 n'était pas jusqu'à présent, si j'ose dire, une habituée de notre assemblée. Je forme les voeux que cette rencontre soit le début, le prélude, d'échanges fructueux et réguliers entre nos deux institutions.
Vous avez choisi de traiter pendant ces deux journées de l'évolution du droit de la responsabilité publique. C'est un très vaste sujet, comme en témoigne d'ailleurs la durée de votre colloque, mais c'est également un sujet éminemment complexe puisque cette évolution est en train de se dessiner sous nos yeux. Sans vouloir traiter moi-même le sujet, ce dont je serais tout à fait incapable, je voudrais simplement vous livrer en quelques mots, les réflexions que le programme de vos travaux m'ont inspirées.
L'évolution du droit de la responsabilité de la puissance publique, depuis le début du XIX e siècle, se caractérise d'une part par un élargissement constant des cas de responsabilité et d'autre part par un assouplissement continu dans un sens favorable aux victimes des régimes de responsabilité mise en oeuvre. Pour reprendre le vocabulaire de votre collègue, Monsieur le professeur Michel PAILLET, qui doit intervenir cet après-midi, on peut dire que l'on est passé progressivement d'un système d'irresponsabilité atténuée - ce sont ses termes -à un mécanisme de responsabilité limitée pour parvenir à un régime de responsabilité épanouie.
En ce qui concerne les régimes de responsabilité, leur histoire est celle d'une objectivation progressive à travers, en premier lieu, le recul constant des fautes qualifiées pour les régimes fondés sur la faute simple et en second lieu de la multiplication, par la jurisprudence et le législateur, de présomptions de faute et de régimes de responsabilité sans faute, surtout ceux fondés sur un risque spécial de dommage. Cette évolution, qui fait une place croissante aux intérêts des victimes, a été, jusqu'à un certain temps, assez linéaire. Elle a en outre été voulue et maîtrisée par les deux acteurs traditionnels de la responsabilité administrative, à savoir la jurisprudence et le législateur national.
Il semble en revanche que, depuis 5 ou 10 ans, la responsabilité de la puissance publique subisse davantage qu'elle ne maîtrise d'autres influences. Il s'agit, à mon sens, en droit interne, d'une nette accélération de ce mouvement d'effacement des intérêts des administrations au profit de ceux des victimes. Il s'agit, sur le plan international, de l'apparition de sources nouvelles qui peuvent modifier ou perturber les règles classiques du droit interne.
En droit interne, tout d'abord, la libéralisation des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité administrative qui - on l'a vu - s'est traduite notamment par l'abandon de la faute lourde au profit de la faute simple, touche désormais des domaines que l'on aurait pu croire à l'abri de cette évolution en raison de leur nature quasi régalienne. Je pense aux activités de contrôle exercées par l'administration : contrôle de la transfusion sanguine en 1993, contrôle de la légalité des actes administratifs des collectivités locales mis en oeuvre par le préfet, soumis par une Cour administrative d'appel à la faute simple en 1999. Je pense également à la toute récente décision de la Cour de cassation qui a - elle aussi - soumis la responsabilité de l'État à une faute simple du fait des dysfonctionnements de l'activité des tribunaux judiciaires. Cette accélération correspond à la demande des justiciables dont la pression légitime est chaque jour plus forte. En caricaturant, je dirais que tout se passe comme si nos concitoyens supportaient aujourd'hui de plus en plus difficilement que la réparation d'un préjudice et à fortiori, d'un préjudice corporel, soit soumise à la moindre discussion. Dans ce contexte, il est clair que les mécanismes de la responsabilité qui demeurent fondés sur la recherche d'un point d'équilibre entre deux types d'intérêts et avec, en matière administrative, le souci de l'économie des deniers publics, ne peuvent plus toujours, en dépit de leur évolution, suffire à satisfaire la demande du corps social.
C'est pourquoi le législateur évince désormais de plus en plus fréquemment ces mécanismes au bénéfice, au profit, de systèmes fondés sur la garantie sociale, chaque fois qu'une catégorie de victime jugée particulièrement digne d'intérêt apparaît ne pas pouvoir obtenir de réparation selon les principes classiques de la responsabilité. C'est ainsi que ce sont multipliés depuis les années 70, les fonds d'indemnisations. De celui destiné à indemniser les victimes de certaines infractions pénales au fond consacré aux victimes de contamination transfusionnelle par le biais du sida, jusqu'à celui qui sera prochainement créé en matière d'aléas thérapeutiques, il en existe aujourd'hui une dizaine. L'exception n'aurait-elle pas tendance à devenir, sinon la règle, du moins un quasi réflexe ?
Il existe également une autre manifestation du contournement des règles de la responsabilité administrative et des juridictions qui l'appliquent, c'est le recours à la voie pénale chaque fois que le fait dommageable peut être qualifié d'infraction. Ce recours pénal permet en effet d'obtenir une résolution plus rapide et moins coûteuse que devant le juge administratif. S'il y a condamnation, la réponse obtenue est d'autant plus satisfaisante pour la victime qu'un certain nombre de juridictions pénales statuent alors également sur les intérêts civils sans renvoyer au tribunal administratif. Il faut bien reconnaître que s'il le faisait, ce serait assez incompréhensible pour le justiciable. La tendance devenue quasi systématique du recours au juge pénal a -je l'espère - trouvé une limite raisonnable dans la loi récente du 10 juillet 2000 votée sur la proposition de mon collègue et ami Pierre FAUCHON, ici présent, et que je salue.
Ces phénomènes jusqu'ici qualifiés de marginaux ou de complémentaires par rapport à la responsabilité de la puissance ne sont-ils pas devenus - dans une certaine mesure - de véritables concurrents qui contraignent la responsabilité administrative à des évolutions plus rapides qu'elle ne l'aurait initialement souhaité ? C'est une question que je me pose. L'irruption dans les débats juridiques relatifs à la responsabilité médicale et à la sécurité sanitaire de la notion d'éthique et surtout du principe de précaution est certainement la traduction la plus récente de cette demande de garantie sociale aujourd'hui omniprésente.
En droit international, la responsabilité de la puissance publique connaît également un certain bouleversement. L'action politique des gouvernants, traditionnellement insusceptible de poursuites devant un tribunal, l'est désormais devant les juridictions pénales, y compris les juridictions étrangères en cas de dommage causé à des ressortissants étrangers. C'est ainsi, par exemple, que des juges d'instructions français enquêtent sur des crimes commis au Rwanda sur des rwandais par des fonctionnaires ou des hommes politiques rwandais. C'est ainsi également qu'un juge espagnol a engagé des poursuites contre PINOCHET, sans parler de la création prochaine du Tribunal pénal international.
Si cet aspect du droit international n'a pas d'incidence directe sur notre droit interne de la responsabilité de la puissance publique, il n'en va pas de même pour le droit communautaire et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'existence du droit communautaire a conduit le Conseil d'État à admettre la responsabilité de l'État pour faute, pour ne pas avoir transposé une directive communautaire alors qu'il fondait jusqu'ici ses décisions sur une responsabilité sans faute en matière de convention internationale. Cet effet, assez limité pour l'instant, pourrait s'amplifier en raison de directives récentes ou à venir dans des domaines administratifs comme les marchés publics ou l'environnement.
Enfin, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pourrait, lorsque les droits civils sont en cause, avoir également certaines incidences. Je pense notamment à notre système juridictionnel reposant depuis 1790 sur une dualité de juridictions. L'article 6 de la Convention ne conduira-t-il pas un jour à s'interroger sur l'impartialité, entre guillemets, du juge administratif, c'est une autre question qui se pose ? L'action conjuguée de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg et du désir de nos concitoyens de voir disparaître tout privilège de juridiction, au sens non juridique du terme, ou tout régime dérogatoire au droit commun, n'est-elle pas de nature à remettre en cause l'autonomie du droit de la responsabilité administrative, voire la compétence des juridictions administratives ?
J'espère que ces propos, volontairement provocateurs, nourriront vos débats. Je souhaite que ces débats, que vos débats, soient très fructueux et je vous remercie très vivement de votre attention que j'ai trop longuement sollicitée.
Monsieur Pierre FAUCHON
Merci à Monsieur le président du Sénat et à son excellent interprète pour cette introduction qui, comme vous l'avez observé, n'est pas seulement un propos de politesse et un propos formel, mais il a brossé à grand trait, à trait juste et prospectif quelques fois, le panorama des travaux et des réflexions de ces deux journées.
Nous entrons maintenant dans le vif de notre sujet et c'est Monsieur le président de l'université Paris 13, Monsieur POUCHAIN qui va bien vouloir intervenir pour nous présenter les travaux. Monsieur le président, nous sommes heureux de vous accueillir et de vous donner la parole.
Allocution
de Monsieur Michel POUCHAIN,
président de l'Université Paris 13
Monsieur le président du Sénat, Monsieur le sénateur, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. Tout d'abord un grand remerciement à Monsieur le président du Sénat pour cette possibilité d'accueil et les conditions conviviales pour ces deux journées d'études et de travail. Je dirais aussi un grand merci au comité d'organisation de ce colloque, je pense tout particulièrement à mon collègue Gilles DARCY, mais également aux personnels administratifs de l'université Paris 13 ainsi qu'aux doctorants.
En tant qu'économiste, la responsabilité est d'abord un coût, fondé certes, mais c'est un coût ou, si vous préférez, c'est un seuil. La question est de savoir, dans un État de droit qui porte en lui comme un principe l'indemnisation des dommages que les personnes publiques occasionnent, où se fera le juste équilibre entre la légitime protection des victimes et la nécessaire garantie des intérêts de l'administration ? Jusqu'où doit s'étendre la socialisation des risques ? Tout est-il universellement digne de réparation ?
Les données se sont sans nul doute modifiées. Dominées par la faute, elles admettent par souci d'équité la responsabilité détachée de la faute, soit pour risque créé, soit pour rupture d'égalité devant les charges publiques. Et mis à part de très rares cas, la responsabilité s'est généralisée. La jurisprudence, et à titre exceptionnel la loi, veille à un réel reflet des moeurs. Si bien que l'on parle actuellement en doctrine d'une évolution qui, par touches successives, remettrait en cause certains principes régissant la responsabilité. Celle-ci passerait de la souplesse, par la recherche de l'équilibre, à une indemnisation tournée vers les victimes.
Toute recherche du concept exact de responsabilité doit embrasser l'ensemble de la réalité observable aussi bien en droit public qu'en droit privé. La grande question se pose de savoir si la notion s'épuise dans la même idée d'obligation de réparer le préjudice occasionné à autrui, ou si elle nécessite une référence quelconque à l'origine du dommage. Cette seconde perception aurait à coup sûr notre préférence. La responsabilité suppose une imputation à une action ou à une omission déterminable. Ne relève pas de cette idée, même si on les y a parfois implicitement inclus, les cas où l'indemnisation est totalement étrangère.
Même si l'on s'en tient au cas où la responsabilité de l'administration obéit aux seules règles du droit public, la question ne manquera pas de se poser du degré réel d'originalité de ce système par rapport à la responsabilité civile en droit privé. Et ce d'autant que les structures en sont identiques, qui exigent pour obtenir réparation de l'existence d'un préjudice, un fait dommageable et un lien causal unissant les deux, et qui opèrent une égale distinction entre responsabilité quasi délictuelle et responsabilité contractuelle, en assurant la primauté de cette dernière. En d'autres termes, toute mesure de la spécificité d'un droit administratif suppose l'évocation préalable de ce problème. Si elle a constitutionnalisé récemment la justice administrative, la France se tient en quelque sorte en dehors de la tendance qui consiste pour les pays européens à l'intégrer au sein du pouvoir judiciaire. Rien n'interdirait certes de penser que la loi peut passer telle ou telle de ses parties dans le giron du droit commun.
Mais nous n'en sommes pas là, tout concourt peut-être à une grande pérennité des règles de compétence. On le sait pourtant, la responsabilité publique présente par rapport à la responsabilité privée quelques traits d'originalité. Mis à part le net rapprochement des modes d'indemnisation, ces types de différences concernent essentiellement la place plus grande de la responsabilité objective, le rôle significatif de la place de la victime et de la nature de l'activité, l'attachement passionné à la notion - imprégnée de souplesse - de troubles dans les conditions d'existence, le fait que l'agent est mieux protégé par la faute de service que le préposé, la distinction opérée entre force majeure et cas fortuit, et enfin l'absence d'autorité de la chose jugée par le juge répressif sur le juge administratif. Cela traduit en fait une réelle plasticité des solutions et la large emprise d'un très grand pragmatisme. Je vous remercie.
Monsieur Pierre FAUCHON
Je vous remercie, Monsieur le président, d'avoir vous aussi brossé assez rapidement mais clairement les différents problèmes que nous allons aborder. J'ai noté au passage que vous n'excluez pas la possibilité pour le législateur de transférer certaines parties de la responsabilité dans ce que vous avez appelé le giron - dois-je dire maternel - du droit privé et des juridictions judiciaires. J'ai naturellement, en tant que législateur, pris bonne note au passage de ce qui était, sinon un encouragement, du moins une ouverture. Et bien nous allons maintenant entendre Monsieur le professeur MANIN, professeur à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dont la communication a pour titre : "La norme en droit de la responsabilité".
La norme en droit de la responsabilité
par Monsieur Philippe MANIN,
professeur à l'Université Paris 1
Merci, Monsieur le président. Mesdames, Messieurs, comme le titre du sujet que je dois traiter vous l'indique, je pense, suffisamment clairement, il s'agit d'un exposé de caractère très général : la norme en droit de la responsabilité. C'est d'ailleurs peut être pour cela que Gilles DARCY, concepteur et organisateur de ce colloque, s'est adressé à un non-spécialiste du droit de la responsabilité, pensant peut être qu'il valait mieux jeter un regard candide et peut être même naïf sur cette question. Et c'est ce non-spécialiste qui a eu l'audace et maintenant l'imprudence - il s'en rend compte - d'accepter cette demande.
Alors je me suis interrogé bien entendu, comme on doit le faire et comme on le conseille aux étudiants de le faire, sur le sens même du sujet qui m'était donné : la norme en droit de la responsabilité. J'ai d'abord fait une constatation sur le sens même du terme responsabilité telle qu'elle est vue dans ce colloque. J'ai constaté que le mot responsabilité était entendu ici dans un sens très large et qu'il ne s'agissait pas seulement de la responsabilité civile au sens où nous l'entendons traditionnellement - c'est à dire l'obligation de réparer un dommage que l'on a causé éventuellement par sa faute - mais que le colloque devait aussi porter sur la question de la responsabilité pénale, notamment de la responsabilité pénale des personnes physiques qui remplissent ou qui sont investis de certaines fonctions publiques, ce qui pose malgré tout des questions spécifiques, et aussi la question de la responsabilité pénale qui peut peser sur des personnes morales de droit public.
Évidemment, le caractère large du sens du terme responsabilité ne facilite pas la recherche de l'existence d'une norme, j'y reviendrais plus tard. Quant au mot "norme", et bien il est traditionnellement défini comme correspondant - et là je me réfère à des significations de la langue française courante et pas spécifiquement de la langue juridique - à un état habituel, ordinaire, régulier, conforme à la majorité des cas (c'est ce que dit le dictionnaire Robert ) , mais aussi ce qui doit être, lorsqu'il y a lieu d'apporter un jugement de valeur. Cependant pour les juristes, le mot norme renvoie aussi assez souvent à l'idée de source. Autrement dit, quand on se pose la question de savoir y'a t-il une norme, il me semble qu'est sous-entendue la question mais d'où vient la norme ? Et qui est habilité à poser la norme ?
Donc je voudrais commencer par quelques brefs propos sur cette idée que la norme provient de quelque chose et que nous devons essayer de savoir, en droit de la responsabilité, d'où elle provient, pour ensuite voir dans un deuxième temps, dans quelle mesure il existe une norme au sens où je l'ai rappelée, où je l'ai définie, en droit de la responsabilité.
I. Tout d'abord, d'où peut provenir la norme ? Qui est habilité ou qui, en fait, exprime ou pose les normes en droit de la responsabilité ? On peut dire beaucoup de monde, beaucoup de monde, mais respectons une hiérarchie.
Commençons par le plus haut, donc je dirais Dieu, ou les dieux, selon les conceptions que l'on peut avoir, qui modèle et qui imprime dans les esprits ce que peut-être, on pourrait appeler une sorte de droit naturel, de conception naturelle de la responsabilité. En dessous, se trouve peut-être le constituant. Le pouvoir constituant est certainement habilité à poser des normes en matière de responsabilité. Et je ferai allusion sur ce point, sans y insister car tout cela est évidemment très bien connu de vous, à la fameuse décision du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999 rendue à l'occasion du recours contre la loi relative au pacte civil de solidarité. Décision dans laquelle le Conseil, interprétant - et certains commentateurs ont dit de façon audacieuse - l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, a considéré que l'affirmation de la faculté d'agir en responsabilité met en oeuvre l'exigence constitutionnelle posée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme, dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Donc, l'origine de la norme en matière de responsabilité civile est donc là, constitutionnelle.
Mais il faut aussi tenir compte des régimes spéciaux de responsabilité, et notamment de responsabilité concernant certaines personnes, ou des personnes investies de fonctions publiques, qui se trouvent définies dans la Constitution et qui donc émane aussi du pouvoir constituant. Et puis, sous le constituant se trouve évidemment le législateur et le rôle du législateur en matière de définition des normes de responsabilité est évidemment incontestable. Je ne développerai pas longuement ce point, car il en sera question tout au long de ce colloque, mais on a rappelé dans l'introduction du président PONCELET que des régimes spéciaux de responsabilité, que la création de fond d'indemnisation notamment, émanent de la loi. Le législateur a un rôle éminent pour poser les normes de la responsabilité, plus encore peut être dans la société contemporaine, car il doit me semble t-il répondre à une pression de l'opinion qui cherche à obtenir réparation de dommages qui sont considérés comme particulièrement choquants, et notamment des dommages qui frappent par leur ampleur ou par leur caractère sériel. Et dans cette situation le législateur reste malgré tout celui qui est le mieux placé pour poser les normes.
Et puis bien sur il y a le juge. Alors c'est un débat traditionnel, mais à mon avis complètement dépassé, que celui qui consiste à se demander si le juge, qui doit régler des cas d'espèces, est habilité à poser des normes. C'est un débat dépassé parce que pour moi il est évident que le juge en fait pose des normes en matière de responsabilité, et cela est tout particulièrement évident lorsqu'il s'agit de la responsabilité des personnes publiques, puisque, après tout, la jurisprudence administrative s'est développée sans avoir de bases législatives.
Mais à ces acteurs traditionnels s'ajoutent, et là aussi il y a été fait allusion dans l'introduction du président PONCELET, des acteurs extérieurs à l'État. Je comprends qu'il va s'agir ici principalement de traiter de droit de la responsabilité dans le cadre français et de l'évolution du droit français. Or il est bien évident que le droit français subit, a subi, et continue de subir des influences qui viennent de l'extérieur, qui sont de plus en plus évidentes et de plus en plus fortes. On a fait allusion déjà au rôle du droit international public, mais il en sera question plus tard dans la communication de Madame STERN, le rôle du droit international public reste malgré tout relativement lointain. Et son influence sur l'évolution d'un droit comme le droit français n'est quand même pas une influence directe.
Il n'en va pas de même pour des droits qui sont issus de systèmes dits d'intégration. Alors j'aurais évidemment quelque mal à grouper ces différents systèmes d'intégration, et bien entendu tout le monde sait que je fais allusion là au système issu de la Convention européenne de protection des droits de l'homme et au système issu des traités instituant les Communautés européennes. Mais il y a au moins un point qui est incontestablement commun à ses deux systèmes, c'est que ce sont des systèmes qui ont été créés par des traités internationaux, nul ne le conteste, et que ces traités avaient, sinon comme objet, ou en tout cas ont eu pour effet de créer des droits directs pour les personnes. Et ces droits directs les personnes s'en servent. Ils s'en servent en faisant des recours devant les juges, juges spécialisés ou juges de droit commun. Et ils s'en servent notamment dans des litiges qui portent sur des problèmes de responsabilité. Et par-là même, ces systèmes ont été à l'origine d'une influence considérable sur l'évolution du droit de la responsabilité, et bien entendu la communication du juge COSTA et de mon collège CONSTANTINESCO feront toute la lumière sur ces questions. Donc voilà pour la question de l'origine traitée d'une façon extrêmement brève, bien entendu.
II. Venons-en au deuxième point qui est de savoir s'il existe une norme ou s'il doit exister une norme en matière de responsabilité. Je disais tout à l'heure que l'hétérogénéité, ou la largeur même du concept de responsabilité tel qu'il est entendu ici, ne favorise pas évidemment la recherche d'une norme. Peut-on parler d'une norme ou des normes ? Existe-t-il des points communs entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale ? Et puis on doit aussi s'interroger sur les liens qu'il peut y avoir entre la notion de personne publique et de puissance publique ?
Je remarque que dans le titre général du colloque, il est question de personnes publiques alors que dans le titre de la première journée il est question de puissance publique. Et donc, on peut se demander, si là encore, on peut trouver une norme qui s'applique aussi bien aux personnes publiques en général qu'à l'exercice de prérogative de puissance publique. Donc, je serai extrêmement prudent, évidemment, dans ce domaine et je me bornerai, d'ailleurs c'est un peu le rôle d'un exposé qui a malgré tout un caractère introductif, à poser des questions. Je pense que ce sera le rôle du colloque, et puis des conclusions, de répondre à ces questions. Alors je me limiterai à deux questions.
A. Première question : la norme en droit de la responsabilité n'est-elle pas aujourd'hui, ou ne tend-elle pas à devenir, que tout dommage doit être réparé, ou tout au moins, que tout doit être mis en oeuvre pour faire en sorte d'atteindre ce résultat, c'est à dire la réparation du dommage ? Autrement dit, l'on passerait d'une idée de recherche de la faute, qui est implicitement fondée sur l'idée de sanction, à l'idée que ce qui compte avant tout c'est que des personnes ont subi un dommage, qu'il est injuste en quelque sorte que ce dommage ait été subi et que par conséquent le dommage doit être réparé. L'intervention du législateur dans la création de fonds d'indemnisation, dans la création de régimes spéciaux de responsabilité qui sont de toute évidence très favorables aux victimes, va bien entendu dans ce sens.
Mais la jurisprudence administrative démontre aussi à l'évidence, je crois, le sens d'une telle évolution. On a fait allusion tout à l'heure dans l'introduction, à ce domaine intéressant de la responsabilité des services publics hospitaliers, qui est effectivement un domaine qui montre à l'évidence que le Conseil d'État et les juridictions administratives sont de plus en plus préoccupés par l'idée qu'il faut de toute façon assurer, ou presque de toute façon, assurer une réparation. Je ferai allusion par exemple à un arrêt certainement bien connu de vous qui a été rendu maintenant il y a quelques années, en 1993, par le Conseil d'État, dans une affaire BIANCHI, concernant un dommage causé par un acte médical. Arrêt dans lequel le Conseil d'État a posé le principe, avec des conditions quand même assez stricts, que le simple lien de causalité entre le dommage et le fait imputable au service hospitalier doit entraîner une obligation de réparation. Cet arrêt est assez significatif d'une jurisprudence qui me semble-t-il prend de plus en plus en, considération ce que l'on peut appeler une certaine équité. Équité entendue au sens de prise en cause des revendications des victimes qui se trouvent dans une situation de toute évidence injuste, qui ont subi un dommage anormal, un dommage grave, et qui pour cette raison doit être réparé. Évidemment, dans l'arrêt BIANCHI reste l'exigence du lien de causalité. Mais avec d'autres arrêts dans d'autres domaines, tel celui des dommages causés par les transfusions, et notamment les transfusions qui sont à l'origine des hépatites, la jurisprudence du Conseil d'État montre que même ce lien de causalité est interprété d'une façon particulièrement souple et particulièrement favorable, et que bien qu'on continue de le contester, au moins en doctrine, il n'y a pas seulement dans ces cas-là présomption de faute, on peut aller souvent jusqu'à parler de présomption de causalité.
B. La deuxième question que je poserai, et qui dans le fond est très liée à celle que je viens d'indiquer, est la suivante : la norme en droit de la responsabilité aujourd'hui n'est-elle pas précisément que doit disparaître tout régime protecteur de la responsabilité de la puissance publique ? Cette question a aussi été évoquée dans l'introduction de Monsieur le président PONCELET, et il est bien certain que quand on lit les commentaires sur l'évolution du droit de la responsabilité que font aujourd'hui les privatistes, et il faut toujours se reporter me semble-t-il en ce domaine aux études des privatistes, on constate que les tendances dominantes dégagées en matière d'évolution de la responsabilité civile des personnes privées sont tout à fait transposables à l'évolution de la responsabilité administrative.
Il reste, bien sûr, quelques différences, c'est évident. Le Conseil d'État a maintenu quelques écarts avec la jurisprudence de la Cour de cassation, mais dans l'ensemble - et le domaine de la responsabilité médicale fournirait là encore d'utiles exemples - on peut constater que le Conseil d'État a tendance à appliquer à des services publics hospitaliers les règles que la Cour de cassation applique aux actes médicaux privés. Donc, il y aurait une disparition de la spécificité de la responsabilité de la personne publique. Après tout, cette disparition, ou atténuation, de l'autonomie de la responsabilité de la personne publique a été admise au moins implicitement par le Conseil constitutionnel.
Rapprochons simplement les considérants de l'arrêt BLANCO de 1873, rappelant que la responsabilité qui peut incomber à l'État par le fait des personnes qu'il emploie dans les services publics ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil pour les rapports de particuliers à particuliers, cette prise de position vigoureuse, de ce qu'a dit le Conseil constitutionnel dans sa décision de 1987 - Conseil de la concurrence - de laquelle il résulte que finalement le noyau dur de la compétence administrative et d'un régime particulier applicable aux personnes publiques, c'est ce qui concerne l'annulation et la réformation des décisions prises dans l'exercice des prérogatives de puissances publiques. Les régimes de responsabilité ne font pas partie de ce noyau dur. Ils sont donc ouverts à l'influence du droit privé voire à une banalisation, une uniformisation et peut-être, comme cela a déjà été dit, ils sont peut-être voués à échapper à la compétence d'une juridiction spécifique. Peut être sont-ce là des propos, et en fait ce sont là des propos d'amateur, car j'ai indiqué que j'étais un amateur en droit de la responsabilité, d'amateur irresponsable et c'est pourquoi peut être il vaut mieux que j'arrête là mon propos. Merci monsieur le président.
Monsieur Pierre FAUCHON
Merci professeur d'avoir montré qu'il n'y a rien de tel que les amateurs pour poser les vrais problèmes et en termes qui nous interrogent beaucoup. Parmi les questions que vous avez posées, je relèverai particulièrement celle où vous vous êtes interrogé sur un certain effacement, non seulement de la notion de faute - ça c'est pratiquement acquis - mais même de l'exigence du lien de causalité, qui semble dilué dans une sorte de présomption de causalité.
Je formulerai la simple réflexion à titre personnel, et sans faire usage d'une autorité quelconque de présidence momentanée : il me semble que si on doit renoncer à la notion de causalité, alors on est plus du tout dans la responsabilité, on est dans des mécanismes de solidarité sociale qui peuvent être parfaitement légitime politiquement. Mais la notion de responsabilité, telle que nous la gérons, avec l'évolution que nous connaissons, comporte quand même des éléments qui me paraissent essentiels, et la notion de causalité entre sinon une faute sinon même un fait précis, mais tout de même un élément qui est à la source, me paraît-elle quand même la limite qui me semble difficile de franchir, si l'on veut rester dans une certaine clarté des notions juridiques.
Nous sommes là pour ça, en tout cas, n'est-ce pas ? Donc nous allons poursuivre, en entendant Monsieur le juge Jean-Paul COSTA. Sur l'une des pistes qui d'ailleurs vient d'être ouverte, puisqu'il va nous parler, en sa qualité déjuge à la Cour européenne des Droits de l'Homme et de Conseiller d'État, de la pratique de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Question dont vous n'ignorez pas qu'elle revêt une importance croissante, je dirais, non seulement de semaine en semaine, mais presque de jour en jour. Vous avez la parole Monsieur le juge.
La pratique de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
par Monsieur Jean Paul COSTA,
conseiller d'État
et juge à la Cour européenne des droits de l'homme
Merci beaucoup, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs deux petites remarques pour commencer. D'abord, je me rappelle simplement que j'ai eu beaucoup de plaisir à siéger avec vous à la C.A.D.A. lorsque nous en faisions parti l'un et l'autre. Ma deuxième remarque, c'est que, lorsque j'ai accepté, évidemment avec plaisir, la proposition de mon ami le professeur Gilles DARCY, je n'avais pas réalisé qu'ensuite je serai soumis aux affres de l'angoisse, parce qu'en essayant de traiter le sujet, j'ai eu l'impression - comme je le disais tout à l'heure à mon concitoyen le professeur Vlad CONSTANTINESCO - que la Convention européenne des droits de l'homme et la responsabilité de la puissance publique étaient deux mondes étanches qui n'avaient guère de communications.
Et c'est tellement vrai que dans les manuels ou dans les recueils de jurisprudence consacrés à notre Cour, on ne trouve pas ou très rarement le mot responsabilité. Mais évidemment, après l'angoisse et le stress, il y a le souci de s'y rattacher et j'ai essayé quand même de trouver des communications entre ces deux mondes apparemment étanches.
Alors, la Convention européenne des droits de l'homme et ses protocoles, comme vous le savez, définissent des droits et libertés garantis, et ces droits et libertés garantis comprennent un mécanisme à la fois externe et interne de contrôle : externe, par les États eux-mêmes en vertus du principe de subsidiarité, le mécanisme interne de contrôle ne venant que comme ultime recours. Je vais donc me placer à deux niveaux différents et j'examinerai d'abord le niveau du droit interne et ensuite celui du droit européen des droits de l'homme.
I PREMIER NIVEAU, LE DROIT INTERNE
Il me semble qu'on peut tirer de la Convention et de sa pratique les trois constations suivantes.
A. Premièrement, il n'existe AUCUN RÉGIME GÉNÉRAL DE RESPONSABILITÉ PUBLIQUE. Deuxièmement en revanche, les États sont tenus d'organiser leur propre responsabilité lorsqu'ils sont accusés de porter atteinte aux droits de l'homme et ils doivent soumettre la mise en jeu de cette responsabilité aux règles procédurales fixées par la Convention. Enfin, ces mêmes règles s'appliquent à la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique même en dehors des cas de violation des droits substantiels garantis par la Convention.
Premier point donc, l'absence d'une obligation générale de la responsabilité publique. Aucune stipulation de la Convention n'impose un principe général suivant lequel la puissance publique doit être responsable de ses actes en général. Si on définit la responsabilité, comme l'a fait d'ailleurs le professeur Philippe MANIN, comme l'obligation de répondre des dommages que l'on peut causer et d'en assumer les conséquences, on ne trouve aucun principe de ce type dans la Convention.
On pourrait bien sur implicitement le tirer de celui de la prééminence du droit, qui figure dans le préambule de la Convention et qui a été affirmé avec éclats dés 1975 par le célèbre arrêt Golder. Mais, à ma connaissance, aucun arrêt n'a tiré cette conséquence sur un plan général autre que celui de la protection des droits garantis. À cet égard, la Convention dans sa pratique n'énonce pas un principe aussi général que ne le fait l'article 19 de la Loi fondamentale allemande au terme duquel, je le rappelle, quiconque est lésé dans ses droits par la puissance publique dispose d'un recours juridictionnel.
En outre, il est des cas dans lesquels une véritable irresponsabilité de la puissance publique est admise par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est notamment le cas où la Cour estime qu'il n'y a pas de droit reconnu en droit interne, même de façon défendable. De nombreux arrêts vont en ce sens, je ne vais pas les citer tous : par exemple Benthem c/ Pays-Bas de 1985, Plattform "Ärtze für das leben" c/ Autriche de 1988 ou encore plus récemment Athanassoglou et autres c/ Suisse de l'an 2000, qui est un arrêt critiqué, et je le dis avec une certaine facilité, puisque j'étais dans la minorité et co-auteur d'une opinion dissidente.
Enfin, se pose la question des régimes d'exonération de responsabilité fondée sur le droit interne : arrêt Osman de 1998, ou deux arrêts rendus hier et importants : Z autres c/ Royaume-Uni et T.P. & K c/ Royaume-Uni. Soit des régimes d'immunité des États ou des organisations internationales fondés sur les relations internationales, voir par exemple les arrêts Beer & Regan et Waite & Kennnedy et c/ Allemagne de 1999 à propos de l'immunité de juridiction de l'Agence spatiale européenne, et des affaires pendantes très importantes et bien connues des internationalistes : Al-Adsani c/ Royaume-Uni, Mc Elhinney c/ Irlande et Forgaty c/ Royaume-Un, où les arrêts devraient être rendus dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Ces régimes d'exonération de responsabilité ou d'immunité sont évidemment difficilement conciliables avec un principe général de responsabilité, mais précisément, la Cour admet que le droit à un tribunal n'est pas un droit absolu, cela a été réaffirmé encore hier par l'arrêt T.P. & KM. c/ Royaume-Uni. Et vous le savez, la Cour exerce sur les limitations au droit d'accès à un tribunal un contrôle de proportionnalité.
Alors, si nous revenons de Strasbourg vers le reste de la France - si je puis dire - le problème des actes de Gouvernement en France se pose virtuellement. Est-ce que l'irresponsabilité de l'État pour les activités liées aux actes du Gouvernement est compatible avec le droit à un tribunal ou avec le droit à un recours effectif ? Je pose la question, mais il n'existe pas actuellement de réponses dans la jurisprudence de notre Cour.
B. Deuxième point, les États sont malgré tout obligés d'organiser UN RÉGIME INTERNE DE RESPONSABILITÉ à raison des dommages causés par une violation des droits et libertés conventionnels, et là encore c'est l'application du principe de subsidiarité. Cette obligation a été émise de façon solennelle par l'article 1 er de la Convention, elle est explicitée et renforcée à l'article 13, qui est un article parfois méconnu mais crucial et dont la jurisprudence a récemment élargi la portée, par exemple avec l'arrêt Kuala c/ Pologne de l'an 2000 et aussi avec les arrêts que je viens de citer notamment Z. et autres c/ Royaume-Uni, où la Cour a constaté une absence de violation de l'article 6 paragraphe 1, mais en revanche une violation de l'article 13.
Puis, bien sûr, il y a toutes sortes de règles corollaires qui vont dans le même sens. Par exemple la règle de l'épuisement des voies de recours internes, qui, bien connue en droit international public général, est une condition de recevabilité des requêtes. Elle est posée ou rappelée à l'article 35 de la Convention, mais elle est conditionnée selon la pratique de la Cour par l'effectivité et l'accessibilité de ces voies de recours. Dans de nombreux exemples, voir notamment : Akvavit et autres c/ Turquie, arrêt de 1996.
L'article 41 de la Convention sur la satisfaction équitable joue dés que, je cite le texte, "le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences d'une violation de la convention". Les règles de la radiation et du règlement amiable qui sont contenues dans les articles 37 et 38 de la Convention impliquent que l'État doit s'efforcer de réparer les conséquences des violations des droits de l'homme qui lui sont imputables.
Enfin dans la pratique, la Convention est maintenant incorporée en droit interne dans la quasi-majorité des États partis et elle est généralement reconnue d'effets directs même si sa place dans la hiérarchie des normes - on retrouve les normes - est variable d'un pays à l'autre. Elle est donc invocable et très largement invoquée devant les juridictions nationales elles-mêmes.
Qui plus est la responsabilité des États pour la violation des droits et libertés garantis par la Convention est soumise aux règles procédurales de celle-ci. L'article 6 paragraphe 1 définit les règles du procès équitable qui s'imposent aux juges nationaux pour autant cependant que cet article soit applicable. Vous savez qu'au fil des années la jurisprudence de la Cour a beaucoup élargie cette applicabilité, mais il y a encore des exceptions assez nombreuses, par exemple certains litiges de fonctions publiques, l'arrêt Pellegrin c/ France de 1999, les litiges en matière de droit des étrangers, Maaouia c/ France, 2000. Enfin en matière fiscale non pénale, il y a actuellement une affaire pendante, Ferrazzini c/ Italie, qui pose la question de savoir s'il faut étendre le champ d'application de l'article 6 au fiscal précisément non pénal et non pas au fiscal à coloration pénale, au sens de l'arrêt Bendenoun c/ France. On peut ajouter, en dehors de ces garanties procédurales, qu'une indemnisation insuffisante ou dérisoire pourrait être considérée par la Cour comme violant l'article 1 er du protocole additionnel, c'est à dire le respect du bien.
C. Troisième point, à ce premier niveau, mais je passerai plus rapidement,
L'APPLICATION DES RÈGLES PROCÉDURALES DE LA CONVENTION AFFECTÉ AFFECTE LA RESPONSABILITÉ PUBLIQUE EN DROIT INTERNE , au-delà même des cas dans lesquels sont violés les droits garantis par la Convention et ses protocoles. Lorsqu'il est applicable, l'article 6 paragraphe 1 est de portée très générale et il touche le régime juridictionnel de la responsabilité au-delà de cette violation. Nombreux sont les exemples si l'on prend le cas de requêtes contre la France : H. c/ France de 1989, X. c/ France de 1992 ou encore Mantovanelli c/ France de 1997, à propos précisément d'une responsabilité hospitalière engagée devant les juridictions administratives. L'article 6 va d'ailleurs bien au-delà de la responsabilité en matière de droits garantis par la Convention, puisqu'il s'applique non seulement à la responsabilité publique mais à la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire. Et l'exécution de décisions de justice elle-même fait partie des règles du procès, équitable comme l'a indiqué un arrêt relativement récent mais important : Hornsby c/ Grèce de 1997.
II. Je vais maintenant me placer au deuxième niveau, c'est à dire au niveau de la responsabilité de l'État devant le juge européen des droits de l'homme.
Cette responsabilité internationale de l'État est a fortiori limitée à la violation des droits et libertés conventionnels, la Convention fixe une compétence à la Cour qu'elle ne peut pas excéder. Trois problèmes principaux peuvent donc se poser : quelle est l'étendue de cette responsabilité internationale des États devant la Cour de Strasbourg ? Quelles sont les obligations qui pèsent sur l'État lors du procès devant la Cour européenne des droits de l'homme et à l'issue de celui-ci ? Enfin, quelles sont les limites à la responsabilité internationale de l'État.
A. Sur le premier point j'indiquerai que - à mon avis - L'ÉTENDUE DE CETTE RESPONSABILITÉ EST TRÈS LARGE. D'abord, le nombre de requérants éventuels est très large en dehors des requêtes inter-étatiques dont je ne parlerai pas ce matin. L'article 34 de la Convention donne une liste étendue des requérants potentiels : toutes personnes physiques, toute organisation non gouvernementale ou tout groupement de particuliers. Certes, il n'existe devant la Cour ni actio popularis ni auto-saisine mais le nombre virtuel, et hélas réel, des requérants est très élevé. La notion d'État responsable est, elle aussi, très large. N'importe quel organe de l'État peut engager sa responsabilité : exécutif, législateur, judiciaire, juge constitutionnel, collectivité décentralisée, et j'en passe. L'État peut même être responsable dans certains cas à raison d'agissements de particulier au non de principes comme celui des obligations positives de l'État, voir l'arrêt Artico c/ Italie de 1980, ou au nom de la théorie des effets vis à vis des tiers, ou Drittwirkung en allemand. Quant à la notion de juridiction de l'État dont relève les personnes au sens de l'article 1 er de la Convention, elle est aussi entendue largement. Cette juridiction couvre et englobe dans la responsabilité de l'État les agents diplomatiques ou les militaires stationnés à l'étranger. Depuis le célèbre arrêt Loizidou de 1995, on sait que si un État contrôle un autre territoire, il engage sa responsabilité dans ce territoire et je peux vous dire que, hier - là encore - le hasard fait bien les choses, nous avons rendu l'arrêt dans la célèbre et importante requête interétatique Chypre c/ Turquie qui réaffirme ce principe. Enfin, il y a l'effet de ricochet, bien connu depuis le célèbre arrêt Soering c/ Royaume-Uni de 1989 : la responsabilité du Royaume-Uni a été engagée en cas d'extradition vers un pays pourtant non parti à la Convention, les États-Unis, à cause des risques de violation de l'article 3 sur les traitements inhumains et dégradants.
B. Deuxième point, L'ÉTAT DÉFENDEUR EST SOUMIS À DES OBLIGATIONS PROCÉDURALES OU PROCESSUELLES, à la fois dans le procès et à l'issue de celui-ci. Dans le procès devant la Cour, il y a obligation de coopération des États. Par exemple l'article 34 de la Convention impose aux États de ne pas mettre d'entrave à l'exercice du droit de recours par des requérants. En outre, l'État doit se soumettre à la direction du procès par la Cour : respecter les délais de procédure, le principe du contradictoire, accepter la police de l'audience et bien d'autres points encore. En outre, en matière de preuves et de présomptions, et l'on retrouve les problèmes que nous avons déjà évoqué ce matin, la jurisprudence de la Cour a dégagé au nom des droits de l'homme des exceptions au principe suivant lequel, normalement, la charge de la preuve incombe au demandeur. Et par exemple, depuis l'arrêt Tomasi c/ France de 1992, il est admis que si une personne rentre en bon état de santé dans un commissariat de police par exemple, et en sort en mauvais état, ce n'est pas à cette personne de prouver que les agents des forces publiques lui ont causé ces mauvais traitements, c'est à l'État d'essayer de fournir des explications, et s'il n'y arrive pas il y a, disons, une présomption quasi irréfragable de responsabilité. De même si une enquête est menée par la Cour dans un État pour essayer de découvrir les faits et obtenir la vérité, cet État en vertu de l'article 38 de la Convention doit lui fournir toutes facilités nécessaires au bon déroulement de cette enquête. Reste le problème des mesures provisoires qui comme vous le savez ne sont pas prévues par la Convention elle même, mais sont contenues actuellement dans l'article 39 du règlement de la Cour. Bien entendu dans l'arrêt bien connu Cruz Varas et autres c/ Suède de 1991, la Cour a admis que faute d'obligation conventionnelle, les États n'étaient pas auteur de violation de la Convention s'ils ne respectaient pas les injonctions prises dans ce cadre. Mais ce même arrêt, et on l'oublie parfois, a considéré que cela constituait une circonstance aggravante d'autres violations de la Convention. Et actuellement nous avons, vous le savez, l'affaire pendante Öcalan c/ Turquie. Dans le cadre de cette affaire la Cour a enjoint à l'État turc de ne pas exécuter OCALAN, au moins tant que sa requête n'aurait pas été jugée sur le fond par la Cour, et la Turquie a obéi à cette injonction.
Il y a aussi des obligations des États à l'issue du procès devant la Cour : ce sont les obligations d'exécution des arrêts et de réparation des dommages constatés. L'article 41 de la Convention sur la satisfaction équitable prévoit une restitutio in integrum et/ou des indemnités, les deux pouvant se combiner. L'article 46 de la Convention fixe l'obligation pour les États d'exécuter les arrêts de la Cour et vous savez que le comité des ministres du Conseil de l'Europe, même depuis l'entrée en vigueur du protocole numéro 11, conserve un rôle important qui est de veiller à l'exécution des arrêts de la Cour, au besoin par des pressions de caractère politique. On peut citer enfin quelques exemples de conséquences d'arrêts de la Cour : on cite souvent la loi du 10 juillet 1991 en France sur les écoutes téléphoniques à la suite de la condamnation de la France dans deux affaires. Plus récemment, on peut citer le changement de pratique et de texte en Grande-Bretagne à la suite des affaires. Smith & Grady et Lustig-Prean & Beckett c/ Royaume-Uni, affaires dans lesquelles la Cour avait condamné le Royaume-Uni pour avoir révoqué des homosexuels de l'armée. Il y a la célèbre affaire Hakkar qui est à l'origine d'une des dispositions de la loi du 15 juin 2000 qui permet la réouverture des procès criminels lorsque les instances de Strasbourg ont trouvé une violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Tout récemment la loi PINTO en Italie, qui est entrée en vigueur le 18 avril 2001, s'efforce de mettre en place un mécanisme de satisfaction interne pour les victimes des innombrables dépassements du délai raisonnable en Italie. Et je remarque à cet égard qu'une récente jurisprudence de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, arrêt du 3 mars 2001, doit donner la possibilité d'interpréter l'article L. 781-1 1°) du Code de l'organisation judiciaire dans le sens que les personnes victimes de délai déraisonnable en France devraient pouvoir là aussi s'adresser d'abord à la justice nationale pour obtenir réparation.
Faut-il aller plus loin dans l'exécution des arrêts de la Cour ? Faut-il par exemple instituer un mécanisme d'astreinte ou d'injonction, cette fois conventionnel, par la voie d'un protocole à la Convention, je ne répondrai pas de façon catégorique mais la question est assez sérieusement envisagée.
C. Troisième point, LES LIMITES À LA RESPONSABILITÉ DES ÉTATS DEVANT LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. Ces limites sont soit purement procédurales, soit plus substantielles. Limites purement procédurales, il faut bien sûr que le requérant justifie de la qualité de victime, sinon nous retomberions dans le problème de l' actio popularis. Il faut que les voies de recours internes aient été épuisées pour que la requête soit recevable, mais nous avons vu que la jurisprudence de la Cour est assez sévère sur l'effectivité et l'accessibilité de ces voies de recours. Enfin il faut respecter le délai de six mois au-delà duquel la requête est tardive.
Les limites plus substantielles touchent à la compatibilité de la requête avec la Convention, soit ratione loci, soit ratione temporis, soit ratione personae, soit ratione materiae. Et là on touche à des problèmes souvent extrêmement importants et difficiles, même politiquement. Compétence ratione loti, c'est le problème de l'application territoriale de la Convention ou de certain de ses protocoles, et de l'exclusion de certains territoires. Mais le célèbre arrêt Matthews c/ Royaume-Uni de 1999 a montré, à propos de Gibraltar, que la Cour fait des efforts pour étendre cette application territoriale. Ratione temporis, l'exemple de la Russie et des pays de l'Europe de l'Est montre que beaucoup de violations des droits de l'homme ont été commises avant la ratification de la Convention par ces États et que bien sûr, à ce moment là, la requête doit être rejetée si ces faits sont antérieurs à la ratification. Compatibilité ratione personae, il y a de gros problèmes pendants devant notre Cour, ce sont les affaires " Senator Lines " et Bankovik et autres , qui concernent respectivement la mise en jeu de la responsabilité des quinze États membres de l'Union européenne et celle des dix-sept États membres de l'O.T.A.N., et nous aurons à résoudre la question suivante : est-ce que des États parties peuvent être tenus pour responsable en tant que membre d'organisations intergouvernementales auxquelles des violations des droits de l'homme sont imputées ? Dans l'affaire Bankovik il s'agit des bombardements de Belgrade par l'O.T.A.N. La question est tout à fait ouverte, car contrairement à ce que pensent certains commentateurs, à mon avis, l'arrêt Matthews dont j'ai parlé ne fournit pas de réponse certaine. Enfin, compatibilité ratione materiae, la compétence de la Cour peut être étendue, elle l'est, elle l'a été par des protocoles, elle peut être étendue aussi par ce que l'on appelle parfois l'interprétation dynamique de la Convention. C'est l'exemple du droit à l'environnement qui n'était évidemment pas prévu par les auteurs de la Convention en 1950, mais qui a été rattaché à l'article 8 sur le droit au respect de la vie privée et familiale, voir par exemple l'arrêt Lopes Ostra c/ Espagne. En sens inverse cette compétence peut être limitée, c'est le problème des réserves qui sont prévues à l'article 57 de la Convention. Mais en vertu à la fois de cet article lui-même et de l'article 32, la Cour contrôle ses réserves et parfois n'hésite pas à les invalider. Ce sont les exemples connus de l'arrêt Belilos c/ Suisse, arrêt de 1988, ou Gradinger c/Autriche, arrêt de 1995.
Pour conclure, je rappellerai que la Convention européenne des droits de l'homme a un aspect double que la pratique n'a fait que renforcer. Au premier chef elle constitue, comme je le disais au début, un monde clos sur lui-même géographiquement et matériellement, elle définit des droits, elle oblige les États parties à les respecter tout d'abord dans leur ordre interne, subsidiairement par le biais du contrôle d'un mécanisme juridictionnel instauré en son sein. Mais en même temps, comme la Cour européenne l'a dit, par exemple dans l'un des arrêts Loizidou, la Convention est un instrument constitutionnel de l'ordre européen des droits de l'homme et elle est fondée sur la prééminence du droit. Par conséquent, elle ne peut que pousser les États à développer leur régime de responsabilité, au-delà de la protection des seuls droits et libertés proclamés et garantis par la Convention, en le soumettant, en outre, le plus souvent aux règles procédurales de la Convention. Autrement dit, celle-ci et sa pratique vont dans le sens d'un recul des zones d'irresponsabilité de la puissance publique. La logique des droits de l'homme et celle des immunités de l'État est difficilement conciliable. Il ne faudrait toutefois pas en déduire que la Convention européenne des droits de l'homme constitue un traité, aux deux sens du terme, sur la responsabilité publique. Ce n'est ni son objet ni son rôle, et par exemple le point de savoir si un État doit être responsable sur le terrain de la faute, ou sur celui du risque ou en vertu de la loi, ressortit éminemment à la marge d'appréciation des États. De même, et je fais écho à l'introduction du président PONCELET, il me semble que ressortit à cette marge d'appréciation le système juridictionnel, moniste comme en Grande-Bretagne, dualiste comme en France ou pluraliste comme en Allemagne. Il y a donc encore dans l'espace européen des droits de l'homme place pour une liberté des États. Ils ont le choix des moyens, pourvu qu'ils s'acquittent de leur obligation de résultat : protéger les droits et libertés qu'ils se sont solennellement engagés à reconnaître.
Monsieur Pierre FAUCHON
Merci Monsieur le Juge pour cette communication tout à fait passionnante, structurée, étayée, très informée et très documentée. Tout à fait passionnante, puisqu'elle nous aide à prendre conscience d'une chose, que vous tous vous savez peut être mais que nous autres, responsables politiques, nous découvrons au fond progressivement, c'est l'importance grandissante et doublement novatrice de cette juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme.
Je retiens deux caractéristiques. La première, qui est tout à fait nouvelle par rapport à nos habitudes juridiques, c'est l'importance des notions qui relèvent au fond de l'équité. Nous sommes habitués au droit positif - un peu comme les romains qui connaissaient des procédures, et puis quand on n'était pas dans une bonne procédure, on n'avait pas beaucoup d'action. Maintenant - et on est habitué à cela - il y a les codes, il y a la jurisprudence et puis sorti de là, même s'il y a des situations choquantes, on ne sait pas quoi faire. Et là, tout soudain, un air nouveau souffle à partir des principes de la Convention de sauvegarde qui est un principe n'énumérant pas de normes précises, mais qui énumère des principes et des exigences de résultats qui relèvent au fond globalement de la notion d'équité. J'ai noté au passage le principe de proportionnalité, l'idée de traitement inhumain et dégradant, l'idée de procès équitable, l'idée de satisfaction équitable, l'idée de délai raisonnable, l'idée de droit à un environnement ; tout cela ce ne sont plus des normes juridiques précises avec des frontières nettes comme ce à quoi nous étions habitués mais ce sont des exigences, comme vous l'avez dit d'ailleurs, de résultats. Et donc des réintroductions d'exigence d'équité qui rajeunissent en quelque sorte toute notre réflexion juridique et la ramènent peut-être au fond aux sources du droit et de ce point de vue là, c'est tout à fait vivifiant et tout à fait saint me semble t-il.
Et puis alors, l'autre réflexion que je me fais c'est l'importance grandissante de l'autorité de cette juridiction. Dont on ne se rend pas bien compte dans le public : alors on est là encore en train de discuter si on fait telle ou telle avancée dans les institutions européennes, si on donne de l'efficacité à ceci ou cela ; personne ne songe que par la voie de la Cour de Luxembourg déjà, d'ailleurs, et par l'autorité de la Cour de Strasbourg, s'exerce un pouvoir judiciaire qui est un véritable pouvoir qui lui est efficace, qui lui porte ses fruits et je vous proposerai presque de répéter votre conclusion qui ferait sursauter ici ou là bien des politiques. Je l'ai noté hâtivement, il me semble que vous avez dit, il y a encore une place pour la liberté des États. Merci pour eux, dans le contexte des discussions actuelles sur la Constitution de l'Europe, on est heureux de savoir, et d'aucun seront heureux de savoir, qu'il y a encore une place pour la liberté des États. Mais vous avez ajouté à condition qu'ils obtiennent les résultats qu'on attend d'eux - ou quelque chose comme ça, je résume votre pensée. Voilà qui nous ouvre un panorama totalement nouveau et qui vient nous confirmer une vérité qui est ancienne parce que nous avions appris que c'était les légistes qui avaient fait la France depuis Philippe Le Bel, et bien je crois que les légistes sont en train de faire l'Europe, eux prudemment, discrètement mais sûrement et très efficacement. Là aussi c'est un fait auquel il convient de prendre conscience, et qui est beaucoup plus facile de comprendre à partir de votre intervention. Ce dont je vous remercie.
Nous allons avoir le plaisir d'entendre maintenant le professeur Vlad CONSTANTINESCO, professeur à l'Université Strasbourg 3 Robert Schuman, qui va nous parler de l'encadrement de la responsabilité en droit communautaire et nous allons revenir là au droit positif le plus tangible pour nous.
L'encadrement de la responsabilité en droit communautaire
par Monsieur Vlad CONSTANTINESCO,
professeur à l'Université Strasbourg 3
"ubijus, ibi remedium"
"Equity will not suffer a wrong to be without a remedy "
"If the Plaintiff has a Right, he must, of necessity,
have a means to vindicate and maintain it, and a
Remedy if he is injured in the exercise or enjoyment of
it, and it is a vain thing to imagine a Right without a
Remedy : for want of Right and want of Remedies are
reciprocal." Holt C.J. in Ashby v. White (1703)
Une thèse récemment publiée 1 ( * ) souligne dans son titre les influences réciproques du droit communautaire et du droit national en matière de responsabilité publique extra contractuelle. Tel est bien sans doute le bilan que l'on doit retirer, avec l'auteur, de l'examen de ces deux droits : leur interaction, sous l'impulsion de la Cour de justice, a contribué à poser, tant au plan communautaire qu'au plan national, un principe général et à forger un régime largement commun de responsabilité, puisqu'il vise aussi bien la Communauté européennes que ses États membres agissant dans le cadre des obligations communautaires qui pèsent sur eux.
Ainsi, par une sorte de phénomène de "capillarité" juridique et judiciaire, après avoir d'abord enserré ce " pouvoir public commun " , qu'est, pour la Cour, la Communauté européenne, ces règles et principes, posés par le juge communautaire, ont aussi fini par devenir communs en déployant leurs effets à l'égard des États membres, agissant dans le champ d'application du droit communautaire. Ne pourra-t-on pas en déduire que les puissances publiques européennes, qu'elles soient communautaire ou nationales, se trouvent maintenant assujetties, en matière de responsabilité extra contractuelle, à une sorte de jus commune ? 2 ( * )
Le sujet de cette communication ne porte que sur un moment (ou sur le résultat) de ce jeu d'influences réciproques : l'encadrement de la responsabilité en droit communautaire. Mais la formulation de ce thème est loin d'être univoque, et on peut hésiter sur ce qu'il recouvre : de quelle responsabilité s'agira-t-il ici ? de celle de la Communauté ? ou de celle des États membres ? Celle de la Communauté étant à l'évidence "encadrée" par le droit communautaire 1 ( * ) , on privilégiera le cas où c'est la responsabilité de l'État membre qui est susceptible d'être engagée, et ce devant les tribunaux nationaux, lorsque le dommage dont il est demandé réparation est causé par la violation d'une obligation communautaire dont il est redevable.
En second lieu, il faut observer que le sens du terme encadrement est incertain, sinon trompeur : son premier usage, en tout cas, ne semble pas juridique 2 ( * ) . En général, le terme d' encadrement désigne le fait de fixer des limites, l'action d'entourer d'un cadre. Transposé dans le langage juridique, le terme pourrait désigner les limites à l'exercice d'une compétence et renverrait alors à une situation de compétence liée, sous tendue par l'existence d'un rapport hiérarchique.
Dans l'acception reconnue en droit communautaire, la notion d' encadrement répond à une situation dans laquelle, s'agissant de la responsabilité de la puissance publique pour violation du droit communautaire, la compétence de principe pour en juger et pour réparer les dommages causés reviendrait aux autorités nationales, mais selon des préceptes, des lignes directrices, arrêtés au niveau communautaire. La notion d' encadrement désignera donc une certaine relation entre le droit communautaire et les droits des États membres, dans un domaine spécifique, ici celui de la responsabilité de l'État pour violation d'une obligation communautaire. La question sera de savoir comment s'opère ce partage des tâches entre les deux niveaux afin de déterminer ce qui revient exactement à chacun d'entre eux. On pressent, à ce stade, le lien privilégié que la notion d' encadrement aura avec celle de primauté du droit communautaire. On pressent aussi qu'elle pourra conduire à substituer une forme d'unité de régime à la diversité des régimes nationaux de responsabilité de la puissance publique... Le droit communautaire pourrait être alors l'instrument de l'avènement d'un jus commune européen en matière de responsabilité publique, si l'on veut bien accepter cette notion contestée 1 ( * ) .
Si la notion d'encadrement pourrait ainsi conduire à l'unité du droit applicable, que subsistera-t-il du principe de l' autonomie institutionnelle et procédurale 2 ( * ) dont l'existence témoigne justement de la réalité et de la diversité des droits nationaux au sein de la Communauté ? De prime abord, ces deux notions paraissent antinomiques. Selon le principe d'autonomie institutionnelle , 3 ( * ) il appartiendrait, par principe, aux instances nationales de poser les règles de fond et de procédure relatives à la réparation des dommages causés par l'inobservation du droit communautaire, sous réserve du respect de quelques principes établis au niveau communautaire, ces principes étant posés dans le but premier d'aboutir à l'effectivité des recours nationaux et à l'absence de discrimination entre les différentes voies de droit nationales, qu'elles soient ou non consacrées à permettre de faire valoir des droits conférés par le droit communautaire. Ainsi que la Cour l'a dit pour droit, dans son arrêt fondateur en la matière :
"(...) en l'absence d'une réglementation communautaire, c'est dans le cadre du droit national de la responsabilité qu'il incombe à l'État de réparer les conséquences du préjudice causé par la violation d'une obligation communautaire" 4 ( * )
Il s'établirait dès lors une répartition des rôles, la compétence essentielle et substantielle relevant en ce domaine des États membres, les instances communautaires ne possédant qu'une compétence limitée à la fixation de quelques règles générales, "encadrant" les compétences des États membres.
Cette répartition des tâches entre le droit communautaire et le droit national ne procède pas d'une disposition du traité, mais de l'interprétation donnée par la Cour de justice et de l'évolution de sa jurisprudence. Cette évolution, on le sait, a été lente et progressive 1 ( * ) , mais a fini par conduire à des transformations profondes des régimes nationaux de responsabilité de la puissance publique. Elle fait partie du mouvement qui place sous influence communautaire des pans entiers des droits nationaux : la communautarisation des branches du droit national entraîne non seulement un remodelage des régimes juridiques nationaux mais bouleverse aussi les concepts et notions opératoires nationales dont la signification originale se transforme, jusqu'à aboutir parfois à une véritable "perte d'identité" 2 ( * ) .
En effet le droit communautaire de la responsabilité des États membres au regard du droit communautaire -- tel que formulé par la jurisprudence de la Cour -- a renouvelé en profondeur les règles nationales relatives à la mise en oeuvre de la responsabilité de la puissance publique. La Cour a prescrit en effet aux États membres de donner plein effet à la constatation de l'existence d'un dommage causé par la violation d'une obligation communautaire, sous la forme d'une voie de droit appropriée et effective ouverte devant leurs propres juridictions nationales aux victimes en vue d'assurer la réparation du dommage subi.
Ainsi, si on retient la notion d' encadrement pour décrire la relation qu'entretiennent droit communautaire et droits nationaux s'agissant de définir le principe, les conditions et le régime de la responsabilité de l'État pour violation du droit communautaire, il convient, dans un premier temps, de se demander quels peuvent en être, en droit communautaire, les fondements, ce qui conduit à en rechercher les sources. (I)
Dans un second temps, il sera nécessaire d'envisager la portée de cet encadrement : le droit national de la responsabilité publique subit, de son fait, des aménagements et des évolutions, voire sans doute des mutations indiscutables, qui l'affectent en profondeur, et dont il conviendra de prendre la mesure, tout au moins en France 3 ( * ) . (II)
I.- LES SOURCES DE L'ENCADREMENT DE LA RESPONSABILITÉ EN DROIT COMMUNAUTAIRE
Le principe d'une responsabilité des États membres pour violation d'une obligation communautaire n'est pas formulé - directement ou indirectement -dans les traités, pas plus que dans le droit communautaire dérivé. (A)
Peut-on alors parler d'une "lacune" du droit communautaire qui autoriserait la Cour, au titre de sa compétence d'interprétation, à dégager un tel principe ? (B)
A L'ABSENCE DE DÉTERMINATION `CONSTITUTIONNELLE' OU `LEGISLATIVE' DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT AU REGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE
La sphère de validité du droit communautaire doit normalement se calquer sur l'étendue des compétences de la Communauté 1 ( * ) . Or la matière du régime juridique de la responsabilité de l'État semble, prima facie, relever du champ des compétences étatiques. C'est du moins ce que le principe d'attribution des compétences, rappelé par le traité de Maastricht sur l'Union européenne 2 ( * ) , semble pouvoir suggérer, à contrario.
Le traité instituant la Communauté européenne ne comporte pas, en effet, de disposition conférant explicitement compétence aux institutions de la Communauté pour adopter des règles relatives au régime juridique de la responsabilité de l'État, lorsqu'est en cause un dommage causé par une violation d'une obligation communautaire. 3 ( * ) Un élément de confirmation peut être trouvé dans le fait que les art. 235 ( ex 178) et 288, alinéa 2 ( ex 215) du traité instituant la CE établissent le principe de la responsabilité de la Communauté, la Cour étant compétente pour en définir le régime et les modalités. 4 ( * ) En créant une entité nouvelle, il était logique que ce soit sa responsabilité éventuelle que les États membres aient au premier chef et exclusivement prévue 1 ( * ) . Ces dispositions confirment à contrario que la matière de la responsabilité de l'État, en connexion avec le droit communautaire, se trouve bien dans le champ des compétences nationales, ce qui devrait exclure, à première vue, sauf révision des traités ou intervention de normes de droit dérivé 2 ( * ) , la compétence communautaire.
Le Gouvernement allemand, dans ses observations présentées à la Cour dans les affaires Brasserie du Pêcheur et Factortame 3 ( * ) avait d'ailleurs expressément soulevé ce point. Le Gouvernement allemand soutenait qu'une obligation générale de réparation à la charge des États membres pour violation du droit communautaire, dont la Cour avait auparavant constaté l'existence dans l'arrêt Francovitch / Bonifaci, ne pouvait résulter, compte tenu de la répartition des compétences entre la Communauté et ses États membres, que d'une initiative législative des institutions de la Communauté ou d'une révision formelle des traités. Cet argument pouvait d'autant plus espérer prospérer que, depuis ces arrêts, le principe de l'attribution des compétences avait été expressément introduit dans le traité. Mais la Cour y répondra de la manière suivante :
"(...) En l'absence, dans le traité, de dispositions réglant de façon expresse et précise les conséquences des violations du droit communautaire par les États membres, il appartient à la Cour, dans l'exercice de la mission que lui confère l'article 164 du traité d' assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application du traité, de statuer sur une telle question selon les méthodes d' interprétation généralement admises, notamment en ayant recours aux principes fondamentaux du système juridique communautaire et, le cas échéant, à des principes généraux communs aux systèmes juridiques des États membres." (point 27)
Car on ne doit pas oublier que le principe d'attribution des compétences lui-même, (comme du reste l'ensemble du droit communautaire originaire ou dérivé) est interprété et mis en oeuvre par la Cour de justice, à laquelle le traité a conféré une compétence exclusive d'interprétation, les États membres ayant renoncé au profit de cette institution à leur compétence authentique d'interprétation. C'est donc vers la jurisprudence de la Cour qu'il faut se tourner pour observer comment elle a pu dégager les fondements de cet encadrement de la responsabilité des États membres.
B - LA COMPÉTENCE D'INTERPRÉTATION DE LA CJCE
Il ne s'agit pas ici de relater dans le détail, le mouvement jurisprudentiel qui a conduit la Cour à affirmer le principe de la responsabilité de l'État, mais simplement de synthétiser le déroulement des prises de position de la Cour : on remarquera alors que celles-ci ont été dues, à titre principal, à la conjonction de deux procédures juridictionnelles originales, propres au droit communautaire : le recours en constatation de manquement et le renvoi préjudiciel, et de plusieurs principes fondamentaux propres à l'ordre juridique communautaire, dont, au premier chef, le principe de primauté.
C'est cette combinaison de facteurs qui a permis à la Cour d'établir le principe de la responsabilité de l'État membre pour violation du droit communautaire,(l) avant de définir ultérieurement les modalités d'ouverture du droit à réparation.(2)
Ce faisant, la Cour est-elle entrée sur le terrain du comblement d'une lacune, en exerçant une compétence `constituante' ou est-elle demeurée dans les limites de sa compétence d'interprétation ? (3)
1. les prises de position de la Cour
- le recours en constatation de manquement autorise la Cour à constater l'existence d'un manquement de l'État à une obligation communautaire : le fait que l'arrêt constatant le manquement présente un caractère déclaratoire (en ce sens que le juge communautaire ne peut de sa propre autorité, annuler ou priver d'effet une disposition nationale constitutive de manquement) a pu faire penser qu'il incombait exclusivement à l'État de prendre les mesures (positives ou négatives) impliquées par cet arrêt de la Cour. Un examen attentif de la jurisprudence de la Cour 1 ( * ) montre que lé juge communautaire n'a pas hésité à préciser, dans une jurisprudence parfois qualifiée de "pédagogique", quelles conséquences devaient être tirées, par les ordres juridiques nationaux, d'une constatation de manquement. L'"élimination effective des manquements et de leurs conséquences passées et futures" 2 ( * ) constitue ainsi la base à partir de laquelle a pu se construire aussi bien l'imposition à l'État la répétition de sommes indûment perçues au regard du droit communautaire, que le principe de la responsabilité de l'État pour violation du droit communautaire, deux situations liées à l'inobservation du droit communautaire, judiciairement constatées. Sans doute, la constatation d'un manquement n'est-elle pas une condition préalable à l'engagement de la responsabilité de l'État membre devant ses tribunaux nationaux 3 ( * ) , mais un tel arrêt : "(...) fournit au requérant un titre en ce qu'il établit avec autorité de chose jugée cette violation. " 1 ( * ) Le renvoi préjudiciel est la procédure grâce à laquelle un dialogue continu a pu s'établir entre les juridictions nationales et la Cour, dont l'importance n'est plus à souligner dans la définition et la mise au point de concepts clés du droit communautaire, comme la primauté et l'effet direct. En l'espèce, l'arrêt Francovitch / Bonifaci est issu d'une telle procédure : le raisonnement qui y est à l'oeuvre s'inscrit dans la continuité et la logique de la jurisprudence préjudicielle. On se permettra d'en reproduire les passages essentiels, suffisamment clairs :
"(...) 32/ Il y a lieu de rappeler également que, ainsi qu'il découle d' une jurisprudence constante, il incombe aux juridictions nationales chargées d'appliquer, dans le cadre de leurs compétences, les dispositions du droit communautaire, d'assurer le plein effet de ces normes et de protéger les droits qu'elles confèrent aux particuliers (voir, notamment, les arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal, point 16, 106/77, Rec. p. 629, et du 19 juin 1990, Factortame, point 19, C-213/89, Rec. p. 1-2433)
33/ Il y a lieu de constater que la pleine efficacité des normes communautaires serait mise en cause et la protection des droits qu'elles reconnaissent serait affaiblie si les particuliers n'avaient pas la possibilité d'obtenir réparation lorsque leurs droits sont lésés par une violation du droit communautaire imputable à un État membre.
34 / La possibilité de réparation à charge de l'État membre est particulièrement indispensable lorsque, comme en l'espèce, le plein effet des normes communautaires est subordonné à la condition d'une action de la part de l'État et que, par conséquent, les particuliers ne peuvent pas, à défaut d'une telle action, faire valoir devant les juridictions nationales les droits qui leur sont reconnus par le droit communautaire.
35/ Il en résulte que le principe de la responsabilité de l'État pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire qui lui sont imputables est inhérent au système du traité.
36 / L'obligation, pour les États membres, de réparer ces dommages trouve également son fondement dans l'article 5 du traité, en vertu duquel les États membres sont tenus de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du droit communautaire. Or, parmi ces obligations se trouve celle d'effacer les conséquences illicites d'une violation du droit communautaire (voir, en ce qui concerne la disposition analogue de l'article 86 du traité CECA, l'arrêt du 16 décembre 1960, Humblet, 6/60, Rec. p. 1125).
37 / Il résulte de tout ce qui précède que le droit communautaire impose le principe selon lequel les États membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui leur sont imputables. (...)"
- la primauté du droit communautaire est, enfin, l'ultime élément majeur qui permet de saisir comment s'ordonnent les fondements du principe de responsabilité de l'État. La situation des espèces Francovitch / Bonifaci montre que l'obligation contenue dans la directive du Conseil 1 ( * ) , dont la non exécution par l'Italie était en cause, ne se prêtait pas à produire un effet direct. Dès lors, les requérants au principal ne pouvaient s'en prévaloir, après l'expiration du délai imparti, devant leurs juridictions nationales. Le principe de la responsabilité de l'État se déduit alors de la primauté du droit communautaire. Ce principe offre alors un substitut à l'impossibilité pour les particuliers de : "(...) faire valoir devant les juridictions nationales les droits qui leur sont reconnus par le droit communautaire." (point 34, in fine). Comme on l'a souligné, l'obligation pour les États membres de réparer les préjudices nés de la violation du droit communautaire" (...) est une conséquence directe du principe de primauté du droit communautaire sur le droit national " 2 ( * )
On s'accordera aussi pour constater qu'en dehors de ces trois éléments, le raisonnement de la Cour mentionne aussi d'autres traits pertinents du droit communautaire, qui résultent notamment de sa jurisprudence : ainsi doit-on signaler, parmi la ratio decidendi de ces arrêts, les principes de l' unité, de l'uniformité et d' effectivité du droit communautaire, ainsi que les principes du droit au juge et de loyauté communautaire. Tous ces principes, additionnés et amalgamés, certainement convergents, qui configurent au fond ce que l'on nomme la spécificité du droit communautaire, concourent à justifier que le droit communautaire "impose le principe" de la responsabilité de l'État.
2. les modalités d'ouverture du droit à réparation
En posant le principe de la responsabilité de l'État pour violation du droit communautaire devant ses propres tribunaux, la Cour, saisie par les juridictions nationales, s'est trouvée devant la tache délicate d'avoir à construire les éléments essentiels du régime communautaire de la responsabilité de l'État pour violation du droit communautaire. Pour réaliser cette tache, la Cour ne partait pas sans modèles : en premier lieu, sa propre jurisprudence, notamment celle rendue dans le cadre des art. 235 ( ex 178) et 288, alinéa 2 ( ex 215) T CE, mais aussi celle relative au remboursement de sommes illégalement perçues au regard du droit communautaire. En second lieu, les régimes de responsabilité de l'État législateur, que certains États membres connaissent, ont pu exercer une influence déterminante sur les conditions de la responsabilité de l'État. Ainsi, l'encadrement communautaire tel qu'il est dicté par les conditions imposées par la Cour aux État membres se trouve être en réalité le résultat d'un jeu d'influences croisées, parmi lesquelles celles des droits nationaux ne sont pas les moindres.
Comme l'observe la Cour, 1 ( * ) les conditions de mise en oeuvre de cette responsabilité sont liées à la nature de la violation qui est à l'origine du préjudice dont il est demandé réparation. L'arrêt Francovitch / Bonifaci, puis l'arrêt Brasserie du Pêcheur / Factortame, de l'autre, qui vont préciser, à quelques années d'intervalle, ces conditions, ne sont en effet pas exactement relatives aux mêmes types de violation du droit communautaire. Or celles-ci peuvent résulter soit de l' abstention de l'État ( Francovitch / Bonifaci, Brasserie du Pêcheur ) , soit de son action délibérée ( Factortame ) 2 ( * ) : en l'occurrence, les actions et les omissions qui sont à l'origine des dommages procèdent du législateur. Cette circonstance permettra à la Cour de dégager les principes communautaires encadrant cette forme particulière de responsabilité qu'est celle de l'État-législateur. On abordera successivement ces deux étapes de cette jurisprudence communautaire.
· L'abstention peut consister d'abord en l'absence de mesures législatives nationales de transposition d'une directive (
Francovitch / Bonifaci
)
3
(
*
)
. Dans le cas de la non exécution de la directive, le juge communautaire a entendu réagir en offrant une protection effective aux victimes d'un préjudice causé par une telle violation du droit communautaire, dans une configuration juridique où les conditions de la reconnaissance de l'effet direct étaient exclues du fait de la nature des obligations prescrites par cet acte
4
(
*
)
.
À cet effet, la Cour a déterminé, dans l'arrêt Francovitch / Bonifaci que la responsabilité de l'État était subordonnée à trois conditions de fond :
"(...) 39/ Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un État membre méconnaît l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 189, troisième alinéa, du traité, de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre le résultat prescrit par une directive, la pleine efficacité de cette norme de droit communautaire impose un droit à réparation dès lors que trois conditions sont réunies ;
40/ La première de ces conditions est que le résultat prescrit par la directive comporte l'attribution de droits au profit de particuliers. La deuxième condition est que le contenu de ces droits puisse être identifié sur la base des dispositions de la directive. Enfin, la troisième condition est l'existence d'un lien de causalité entre la violation de l'obligation qui incombe à l'État et le dommage subi par les personnes lésées 1 ( * ) .
41/ Ces conditions sont suffisantes pour engendrer au profit des particuliers un droit à obtenir réparation, qui trouve directement son fondement dans le droit communautaire. (...)"
Ces trois conditions de fond s'inspirent-elles, comme on l'a dit 2 ( * ) , de la Schutznormtheorie qui avait, en son temps fourni le fondement de l'action en réparation d'un dommage causé par une institution de la Communauté ? Elles indiquent bien, en tout cas, que le droit des particuliers à obtenir réparation du préjudice causé par la violation d'une obligation communautaire procède de l'atteinte à un droit issu de l'obligation en cause elle-même.
La première condition doit-elle être comprise comme exigeant que la norme communautaire attributive de droits aux particuliers soit d'effet direct ? Ce n'est pas ainsi que l'on doit interpréter la jurisprudence Francovitch / Bonifaci : il suffit que la disposition en cause ait eu pour but de garantir un droit à un cercle déterminé de personnes. Mais à contrario, toute violation d'une disposition d'effet direct entraînera bien entendu aussi la responsabilité de l'État : l'arrêt Brasserie du Pêcheur / Factortame le montrera :
"(...) 20/ Il est, en effet, de jurisprudence constante que la faculté offerte aux justiciables d'invoquer devant les juridictions nationales les dispositions directement applicables du traité ne constitue qu'une garantie minimale et ne suffit pas à assurer à elle seule l'application pleine et complète du traité (voir, notamment, arrêts du 15 octobre 1986, Commission/Italie, 168/85, Rec. p. 2945, point 11; du 26 février 1991, Commission/Italie, C-120/88, Rec. p. I-621, point 10, et du 26 février 1991, Commission/Espagne, C-119/89, Rec. p. I-641, point 9). Destinée à faire prévaloir l'application de dispositions de droit communautaire à l'encontre de dispositions nationales, cette faculté n'est pas de nature, dans tous les cas, à assurer au particulier le bénéfice des droits que lui confère le droit communautaire et notamment à éviter qu'il ne subisse un préjudice du fait d'une violation de ce droit imputable à un État membre. Or, ainsi qu'il découle de l'arrêt Francovich e.a., précité, point 33, la pleine efficacité du droit communautaire serait mise en cause si les particuliers n'avaient pas la possibilité d'obtenir réparation lorsque leurs droits ont été lésés par une violation du droit communautaire."
Si les conditions de fond de l'engagement de la responsabilité de l'État relèvent ainsi d'une détermination communautaire, les modalités concrètes (juridictionnelles et procédurales) de la réparation relèveront, elles, du droit des État membres : c'est ce partage des fonctions que l'on peut désigner comme le premier élément de l'encadrement de la responsabilité de l'État par le droit communautaire
"(...) 42/ en l'absence d'une réglementation communautaire, c'est à l'ordre juridique interne de chaque État membre qu' il appartient de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la pleine sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire (voir les arrêts suivants : du 22 janvier 1976, Russo, 60/75, Rec. p. 45; du 16 février 1976, Rewe, 33/76, Rec. p. 1989 ; du 7 juillet 1981, Rewe, 158/80, Rec. p. 1805)"
Ce partage, toutefois, ne renvoie pas à une compétence nationale discrétionnaire : la Cour, fidèle à sa jurisprudence sur la répétition de l'indu, fixe en effet des limites à l'exercice de cette compétence nationale : c'est le second élément de l'encadrement :
"43/ (...) les conditions, de fond et de forme, fixées par les diverses législations nationales en matière de réparation des dommages ne sauraient être moins favorables que celles qui concernent des réclamations semblables de nature interne et ne sauraient être aménagées de manière à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'obtention de la réparation (voir, en ce qui concerne la matière analogue du remboursement de taxes perçues en violation du droit communautaire, notamment l'arrêt du 9 novembre 1983, San Giorgio, 199/82, Rec. p. 3595)."
Ainsi, le régime national de la réparation, en cas de violation du droit communautaire, ne doit pas être moins favorable que celui applicable à des actions analogues fondées sur la violation du droit interne et les modalités de l'action nationale ne doivent pas être aménagées de façon à rendre impossible ou trop difficile l'obtention de la réparation. Les voies de droit issues du droit communautaire devront donc offrir les mêmes garanties d'accès et d'effectivité que les voies de droit nationales équivalentes : c'est ce qu'on nomme parfois le principe d'équivalence (qui n'est au fond que le principe de non discrimination, mais pris à rebours, en partant des conditions offertes par le droit national pour les instances nationales).
L'arrêt Brasserie du Pêcheur / Factortame intéresse également une hypothèse de responsabilité du fait de la loi. Dans ces espèces, la violation du droit communautaire résulte aussi du législateur national, qu'il ait omis d'abroger ou de modifier une loi contraire au droit communautaire (Brasserie), soit qu'il ait adopté une loi qui lui est contraire (Factortame).
En droit interne, la responsabilité du fait des lois présente généralement un caractère exceptionnel : là où elle existe, est entourée de conditions strictes, qui ne sont que le reflet de la majesté de la loi, que celle-ci se fonde sur la souveraineté du Parlement (comme au Royaume-Uni), ou sur la conception de la loi comme expression de la volonté générale (comme le veut la tradition française).
La fonction éminemment politique de l'institution parlementaire dans les systèmes de Gouvernement des États membres conduit à ce que le législateur dispose, par principe, d'un large pouvoir d'appréciation que les conditions d'engagement de sa responsabilité, lorsqu'elle existe, doivent respecter et ménager 1 ( * ) . L'existence d'une telle responsabilité présente cependant, selon les termes du professeur CHAPUS : " (...) une valeur exemplaire en faisant apparaître que même l'exercice de la souveraineté peut être pour l'État une source d'obligations, " 2 ( * ) Ceci explique que ses fondements soient le plus souvent recherchés dans une responsabilité sans faute, basée sur la rupture de l'égalité devant les charges publiques et attestée par l'exigence d'un préjudice anormal et spécial.
Prenant appui sur le droit communautaire 3 ( * ) , le droit comparé, et le droit international 4 ( * ) , la Cour de justice reconnaît :
"(...) le principe selon lequel les États membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui leur sont imputables est applicable lorsque le manquement reproché est attribué au législateur national."
Cette vision unitaire de l'obligation de réparer à la charge de l'État qui commet un préjudice en manquant à ses obligations est d'ailleurs le motif déterminant de l'arrêt, puisque la Cour va transposer à la responsabilité de l'État les conditions qu'elle a elle-même dégagées s'agissant de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, dont seul le principe était prévu par le traité. Ces conditions sont fixées depuis l'arrêt du 2 décembre 1971, Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt . 5 ( * ) La Cour y avait indiqué que :
"(...) s'agissant d'un acte normatif qui implique des choix de politique économique, cette responsabilité de la Communauté pour le préjudice que des particuliers auraient subi par l'effet de cet acte ne saurait être engagée, compte tenu des dispositions de l'article 215, alinéa 2, du traité, qu'en présence d'une violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers ;(...)"
La prise en considération de la nécessité de protéger le législateur communautaire a conduit la Cour à préciser, dans un arrêt du 25 mai 1978, HNL e.a / Conseil et Commission 1 ( * ) de manière restrictive, ce qu'il fallait entendre par une violation suffisamment caractérisée :
"(...) dans un contexte normatif caractérisé par l'existence d'un large pouvoir d'appréciation, indispensable à la mise en oeuvre d'une politique communautaire, la responsabilité de la Communauté ne peut être engagée que si l'institution concernée a méconnu de manière manifeste et grave les limites qui s'imposent à l'exercice de ses pouvoirs (...)"
Sans doute incombera-t-il aux juridictions nationales d'apprécier cette condition, s'agissant d'actions ou d'omissions des autorités nationales, selon les différents paramètres à sa disposition : clarté, précision de la norme violée, marge d'appréciation qu'elle contient, élément conscient voire intentionnel de la violation, erreur de droit etc.... 2 ( * ) Mais l'encadrement de la juridiction communautaire est ici sensible : on peut déduire de la jurisprudence que constitue une violation suffisamment caractérisée une violation commise en pleine connaissance de cause, notamment parce que le juge communautaire l'aurait au préalable constatée, par la voie préjudicielle soit dans le cadre d'un recours en manquement. De même, la non transposition d'une directive est, en elle-même, une violation qui donnera lieu à l'engagement de la responsabilité de l'État. 3 ( * )
L'analogie entre une telle situation et celle du législateur national justifie que la Cour étende ces conditions à la situation de droit interne née d'un dommage causé par le législateur national en violation du droit communautaire, unifiant ainsi la matière de la responsabilité de la puissance publique, quelque soit le niveau auquel agit un pouvoir public légiférant doté d'un pouvoir d'appréciation :
"(...) 50/ Il apparaît donc que, dans les deux cas d'espèce, les législateurs allemand et du Royaume-Uni étaient confrontés à des situations comportant des choix comparables à ceux opérés par les institutions communautaires lors de l'adoption d'actes normatifs relevant d'une politique communautaire.
51/ Dans de telles circonstances, un droit à réparation est reconnu par le droit communautaire dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir que la règle de droit violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation soit suffisamment caractérisée, enfin, qu'il existe un lien de causalité direct entre la violation de l'obligation qui incombe à l'État et le dommage subi par les personnes lésées. (...)"
L'examen des deux espèces faisait apparaître que les conditions de la responsabilité de l'État pour violation du droit communautaire par le biais d'une législation nationale comportaient, dans le droit allemand comme dans le droit anglais, des limites qui risquaient de compromettre l'efficacité de la protection juridictionnelle des particuliers. La condition imposée par le droit allemand en cas de violation par une loi de dispositions nationales d'un rang supérieur, entendait subordonner la réparation au fait que l'acte ou l'omission du législateur visait une situation individuelle, tandis que le droit anglais imposait, pour que soit mise en cause la responsabilité de la puissance publique, d'apporter la preuve d'un abus de pouvoir dans l'exercice d'une fonction publique ( misfeasance in public office ), lequel abus n'est pas concevable dans le chef du législateur. La Cour a écarté le recours à ces limites 1 ( * ) et rappelé les termes de sa jurisprudence Francovitch / Bonifaci selon lesquels les conditions imposées par le droit national :
"(...) ne sauraient être moins favorables que celles qui concernent des réclamations semblables de nature interne ni aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'obtention de la réparation. (...)"
3. Peut-on, enfin, considérer que la Cour est allée au-delà de sa compétence d'interprétation pour exercer une compétence de caractère constituant ?
Ce n'est pas le lieu, ici, de reprendre et de traiter la question du pouvoir normatif de la jurisprudence et de son interférence avec celui du pouvoir constituant, particulièrement en droit communautaire. On voudrait plus simplement tenter d'éclairer comment la Cour a pu surmonter le caveat formulé par le Gouvernement allemand et qui semblait prima facie pertinent : la reconnaissance d'un tel droit à réparation par voie prétorienne pouvait en effet paraître incompatible avec la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres, comme avec l'équilibre institutionnel instauré par le traité.
L'explication que l'on peut proposer tiendrait dans la convergence des principes structurels du droit communautaire, dominés par celui de primauté, opérée par la Cour. 2 ( * ) On a déjà rencontré ces principes à l'oeuvre, spécialement dans l'arrêt Francovitch / Bonifaci : le travail du juge consiste à établir entre eux une convergence, à les focaliser et à déduire d'eux un principe impliqué, celui d'un droit à la réparation, directement issu du droit communautaire, en cas de préjudice causé par une violation par l'État d'une obligation communautaire, principe sans lesquels les autres ne seraient pas effectifs.
Par ailleurs, le juge a remarqué, dans l'arrêt Brasserie du Pêcheur / Factortame que les régimes nationaux de la responsabilité de l'État législateur, comme le régime de la responsabilité de la Communauté, avaient eux aussi été conçus et promus par les juges, en l'absence de détermination constitutionnelle ou législative : la convergence des méthodes complète alors celle des principes...
Si cette double convergence a pu être affirmée c'est sans doute parce que, comme l'a justement relevé le professeur VANDERSANDEN, "la responsabilité de l'État est une idée générale du droit " 1 ( * ) , inscrite peu à peu en tant que telle, dans les patrimoines juridiques nationaux avant de devenir un élément du patrimoine juridique commun européen, avec la Convention européenne des droits de l'homme d'abord, dont le droit communautaire ne fait que développer le présupposé : l'instauration d'un contrôle juridictionnel international de toutes les activités de l'État, complémentaire et incitateur du perfectionnement des contrôles juridictionnels internes.
II- LES CONSÉQUENCES DE L'ENCADREMENT : LES MUTATIONS DES RÉGIMES NATIONAUX DE RESPONSABILITÉ PUBLIQUE
Ni les droits des États membres, ni les juges nationaux ne vivent désormais en vase clos : la libre circulation organisée par les traités communautaires s'étend aussi aux notions et concepts juridiques. Ceux-ci font l'objet d'un véritable processus de fertilisation croisée, ainsi qu'en témoigne l'édification de principes et règles par lesquelles le droit communautaire, formulé par la Cour de justice, forgé à partir des droits nationaux, détermine en retour le régime national de la responsabilité de l'État pour violation du droit communautaire, que les juges nationaux auront à mettre en oeuvre.
La jurisprudence de la Cour est un message adressé aux droits nationaux, et tout particulièrement à leurs juges : comme pour l'effet direct ou la primauté, c'est à eux qu'il appartiendra de le relayer et de lui donner une suite opérationnelle, à l'occasion des litiges dont ils seront saisis en cas de dommage causé par une violation du droit communautaire. Le dialogue entre juges est certainement plus efficace pour assurer l'effet utile du droit communautaire que ne pourraient l'être des réformes législatives, voire constitutionnelles. En tous cas, sans l'acceptation des juges nationaux, les exhortations du juge communautaire ne pourraient s'enraciner durablement. L'étude de la portée de l'encadrement communautaire devra évidemment être attentive aux réactions des juridictions nationales. 2 ( * )
L'examen de la portée de cet encadrement communautaire met précisément en évidence la nécessité de dépasser cette notion : sous l'influence du droit communautaire, s'opère en réalité une mutation du droit interne qui affecte aussi bien la fonction du juge national (A) que le statut de la loi en droit interne (B)
A- LA MUTATION DE L'OFFICE DU JUGE NATIONAL
En dépit de l'autonomie institutionnelle dont elles disposent en principe, les juridictions nationales voient progressivement leurs conditions d'organisation et de fonctionnement placées sous les réquisitions du juge communautaire : issues de la nécessité de protéger la pleine efficacité des normes communautaires et de garantir l'entière effectivité des droits que le droit communautaire reconnaît aux particuliers, deux exigences d'une " Communauté de droit " 1 ( * ) ,celles-ci retentissent inévitablement sur l'organisation et la gestion des recours offerts par les droits internes, transformant le cadre dans lequel le juge national exerce ses fonctions. L'encadrement communautaire affecte le cadre institutionnel et procédural national dans lequel s'exercent les fonctions juridictionnelles.
Ces exigences se matérialisent sous la forme de ce que l'on nomme 2 ( * ) le principe d'équivalence (les conditions établies par les droits nationaux concernant la réparation des dommages ne peuvent être moins favorables que celles qui concernent les réclamations semblables de droit interne 3 ( * ) ) et le principe d'effectivité (les conditions nationales ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la réparation 4 ( * ) )
Mais la réduction du champ de l'autonomie institutionnelle nationale procède également de l'aménagement, voire de la création de voies de droit répondant à aux exigences posées par le droit communautaire. À vrai dire, cette conséquence n'est pas spécifique à la responsabilité de l'État pour violation du droit communautaire : la Cour a déjà, par le passé, indiqué au juge national l'obligation de laisser inappliquée la norme interne contraire au droit communautaire 5 ( * ) , prescrit le droit à un juge compétent 6 ( * ) , accordé au juge national des référés le droit d'ordonner des mesures provisoires, même si celles-ci, s'agissant de suspendre l'exécution d'une loi, ne sont pas autorisées par le droit national, 7 ( * ) ou d'injonctions adressées à l'administration, 8 ( * ) ou encore reconnu à un juge national la compétence de surseoir à l'exécution d'un acte administratif fondé sur un règlement communautaire dont la validité est contestée devant la Cour elle-même. 9 ( * ) La panoplie des instruments juridictionnels nationaux s'est ainsi enrichie sous l'influence du droit communautaire. 1 ( * )
Ceci confirme que le juge national est juge communautaire de droit commun : en cette qualité, le droit communautaire lui octroie un titre à juger, distinct de celui que lui confère le droit national et qui le complète. Le doyen BOULOUIS le constatait déjà : " Il est impossible de dissocier la source du droit et le titre du juge, dès lors que l'on affirme se trouver dans un système intégré se traduisant par l'existence d'un véritable ordre juridique. " 2 ( * )
La reconnaissance du principe de la responsabilité de l'État pour violation du droit communautaire, qui trouve directement son fondement dans le droit communautaire, assorti de ses corollaires et l'obligation de réparer le préjudice qui en découle font subir une mutation de taille aux droits nationaux, spécialement lorsque la source du dommage et de la violation réside dans l'action ou l'omission du législateur national : c'est sur cet aspect que se concentreront les développements ultérieurs, car c'est sans doute dans ce domaine que l'impact du droit communautaire est le plus important et le plus discuté.
B- LA MUTATION DU STATUT DE LA LOI EN DROIT INTERNE
On a pu pendant longtemps enseigner en droit français que les dommages imputables aux lois avaient pour fondement indiscuté, s'agissant de la responsabilité de la puissance publique, le principe de l'égalité devant les charges publiques, car la loi ne peut jamais constituer par elle-même une faute 3 ( * ) . C'est cette présomption irréfragable (ou cette fiction juridique), que le droit communautaire contribue à reconstruire, sinon à déconstruire, en la transformant peu à peu et non sans réticences, en une présomption simple, devant supporter désormais la preuve contraire.
La solution traditionnelle avait certes le double mérite 4 ( * ) de ne pas exclure le principe de la responsabilité de l'État législateur, élément de l'État de droit, et de rendre, en même temps, assez difficiles, donc plutôt rares, les hypothèses concrètes d'engagement de la responsabilité de l'État législateur, la preuve d'un dommage anormal et spécial n'étant pas facile à établir. Mais les développements. de la jurisprudence communautaire ont obligé à renouveler l'approche des solutions traditionnellement apportés à la question de la responsabilité de l'État du fait des lois, même si le débat ouvert demeure spéculatif par rapport à des positions jurisprudentielles nationales qui attestent d'une certaine difficulté à enregistrer les conséquences attendues de la jurisprudence communautaire, au point que l'interrogation que formulait D. SIMON en 1992 1 ( * ) conserve toute sa pertinence et son actualité, à savoir : "(...) si le régime de la responsabilité du fait des lois est de nature à satisfaire aux exigences résultant de la primauté du droit communautaire "
Les espèces dans lesquelles le juge administratif a eu à connaître de situations qui pouvaient donner naissance à la responsabilité de l'État du fait de lois méconnaissant une obligation communautaire se marquent par une volonté de ne pas répondre directement à la question de fond : quel fondement donner et quel régime accorder à la responsabilité du fait d'une loi contraire au droit communautaire ? L'embarras qui parcourt la jurisprudence 2 ( * ) , depuis l'arrêt Alivar 3 ( * ) , en passant par l'arrêt Arizona Tobacco 4 ( * ) et jusqu'aux arrêts Dangeville 5 ( * ) s'explique peut-être par la difficulté d'abandonner, dans ce cadre, une responsabilité sans faute pour une responsabilité d'où la faute du législateur peut difficilement être bannie.
L'analyse détaillée de ces arrêts et d'autres encore a été abondamment faite par la doctrine, à laquelle on renverra. Ce qui frappe, c'est que le juge y manifeste la volonté de raisonner exclusivement dans un cadre national, dans des situations où est pourtant en cause la violation du droit communautaire par le législateur, au prix, parfois, de constructions et de raisonnements souvent qualifiés d' habiles, voire d'"acrobatiques". 6 ( * )
Par ailleurs il a souvent été relevé que la responsabilité sans faute n'était guère adaptée aux situations où le droit communautaire était mis en cause. 7 ( * ) Exclu en principe en matière de droit économique, ce fondement de la responsabilité publique ne s'accorde pas avec le caractère largement économique du droit communautaire et n'est peut être pas entièrement compatible avec les principes d'équivalence et d'effectivité posés par la Cour, l'indemnisation du préjudice étant subordonné à des conditions la rendant difficile, voire impossible. Il ne semble pas non plus adapté à des situations où sont en cause non pas le vote d'une nouvelle loi (ou l'amendement d'une loi antérieure) mais l'absence de loi (encore que l'absence de loi de transposition laisse intact le droit antérieur, pas nécessairement conforme à la directive à transposer).
En revanche, reconnaître une responsabilité pour faute en cas de violation législative du droit communautaire, aboutirait à autoriser le juge administratif à censurer la loi, ce que son statut comme sa mission lui interdisent. 1 ( * )
Ni la responsabilité sans faute, ni la responsabilité fondée sur la faute ne semblent donc, pour des motifs croisés (inadaptation de la responsabilité sans faute au droit communautaire / inadaptation de la responsabilité pour faute à la conception française de la loi) convenir pour sanctionner les manquements du législateur à une obligation communautaire. Cette situation de "conflit négatif" ne pourrait cependant perdurer sans affecter à terme et l'autorité du droit communautaire et la crédibilité du juge administratif.
Pour ces raisons, certains ont estimé devoir se tourner vers une interprétation des exigences du droit communautaire, qui n'imposerait pas de choisir l'une des branches de l'alternative, mais qui autoriserait à parler, pour qualifier la condition essentielle imposée par le droit communautaire à la réparation des dommages causés par le législateur, (à savoir : " la violation suffisamment caractérisé ", selon la formule de la Cour) d'une " faute objective " ou à définir cette faute là comme : " la violation d'une obligation préexistante" . Comme on l'a dit : " (...) c'est bien la violation du droit communautaire qui, par elle-même, détermine l'obligation de réparer, et non l'intention de l'auteur de la mesure interne illicite " 2 ( * )
Cependant, une telle volonté d'objectiviser la violation du droit communautaire, qui a le mérite de ne pas déboucher sur la mise en cause de l'intention du législateur, ne pourrait guère s'appliquer aux situations où la méconnaissance d'une obligation communautaire par le législateur serait consciente et délibérée, et particulièrement dans le cas où un manquement aurait été constaté par la Cour... 3 ( * )
La condition de violation suffisamment caractérisée s'entend des hypothèses où les autorités législatives nationales (ou communautaires) disposent d'un large pouvoir d'appréciation : on doit alors se demander si, par exemple, la transposition d'une directive suppose vraiment une large marge d'appréciation ou si elle ne répond pas plutôt à l'exercice d'une compétence liée ? en d'autres termes, comment la non-transposition de directive pourrait-elle être alors qualifiée de violation suffisamment caractérisée si elle ne résulte pas d'un large pouvoir d'appréciation, mais de l'exercice d'une compétence liée ? ( Francovich / Bonifaci ) De même, lorsque le législateur légifère dans un domaine (composition des denrées alimentaires) couvert par les prohibitions de l'art. 28 (ex. 30) T CE, dispose-t-il véritablement d'un large pouvoir d'appréciation ? ( Brasserie / Factortame ) . Comme pour la transposition d'une directive, on peut en douter...
On veut dire par là que la Cour fait entrer sous le couvert d'une notion qu'elle veut objective des situations qui ne révèlent pas tant l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire que celui d'une compétence liée : dans ce cas-là, n'est-on pas contraint, logiquement, de quitter le terrain de la faute `objective' du législateur pour se replier sur celui de la faute `subjective' commise lors de l'édiction de la loi ? Au fond, la faute ne demeure-elle pas le seul fondement qui soit cohérent avec les hypothèses, finalement fréquentes, de compétence liée du législateur national au regard du droit communautaire ?
L'encadrement communautaire de la responsabilité traduirait alors la mutation d'une compétence discrétionnaire du législateur national, en une compétence devenue " communautairement " liée dans le champ d'application du droit communautaire.
L'encadrement communautaire n'est évidemment pas le seul facteur qui affecte la conception traditionnelle de la loi en France : le contrôle de constitutionnalité ainsi que le contrôle de conventionalité, au titre de la Convention européenne des droits de l'homme, font que la loi n'est plus l'acte incontestable du souverain : son avènement à l'ordre juridique dépendra de sa conformité à la constitution, tandis que, durant toute son existence, sa conformité aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme et du droit communautaire tel qu'interprété par la Cour de justice, pourra être mesurée par des juridictions auxquelles l'ordre juridique français a accepté de se subordonner. L'encadrement communautaire ne serait ainsi qu'une forme particulière de ce phénomène général qu'est l'internationalisation des droits nationaux, (texte arrêté au 11 juin 2001, sous réserve de quelques compléments de bibliographie plus récents)
[Éléments de bibliographie : W. Berg : Haftung der Gemeinschaft und ihrer Bediensten, (commentaire de l'art. 288, ex 215), in J. Schwarze : EU-Kommentar, Baden Baden Nomos Verlag 2001, p. 2277 (ample bibliographie, principalement allemande et anglaise) ; N. Dantonel-Cor : La violation de la norme communautaire et la responsabilité extra contractuelle de l'État, RTDE 1998, 75 (du même auteur : La mise en jeu de la responsabilité de l'État français pour violation du droit communautaire, RTDE 1995 p. 471 ; L. Dubouis : La responsabilité de l'État pour les dommages causés aux particuliers par la violation du droit communautaire, RFDA 1992 p. 425 ; L. Goffin : À propos des principes régissant la responsabilité extra contractuelle des États membres en cas de violation du droit communautaire, CDE 1997, 531 ; J-M. Favret : Les influences réciproques du droit communautaire et du droit national de le responsabilité publique extra contractuelle, Paris Pedone 2000 (ample bibliographie). J-F. Flauss : Frankreich, in J. Schwarze (Hrsg.) : Das Verwaltungsrecht unter europäischem Einfluâ Zur Konvergenz der Mitgliedstaatlichen Verwaltungsrechtsordnungen in der europäischen Union, Baden Baden Nomos Verlag 1995, p. 31. O. Léonard de Juvigny : V° Responsabilité (des États membres), Encyclopédie Dalioz de Droit communautaire, III, 1997 (ample bibliographie) ; A. Rigaux : L'arrêt Brasserie du Pêcheur / Factortame : le roi peut mal faire en droit communautaire, Europe, mai 1996 Chron. 5 ; D. Simon : Droit communautaire et responsabilité de la puissance publique : glissements progressifs ou révolution tranquille ?, AJDA 1993 p. 237; D. Simon : La responsabilité de l'État saisie par le droit communautaire - La jurisprudence Brasserie du Pêcheur, Factortame, British Telecom, Hedley Lomas...., AJDA 1996 p. 489 ; D. Simon : Le système juridique communautaire, Paris PUF 1998, p. 300 (ample bibliographie sur le thème) ; G Vandersanden et M. Dony : La responsabilité des États membres en cas de violation du droit communautaire. Études de droit comparé, Bruxelles 1997, Bruylant.; W. Van Gerven : La jurisprudence récente de la CJCE dans le domaine de la responsabilité extracontractuelle. Vers un jus commune européen ? in Université Panthéon-Assas (Paris II) Institut des Hautes Études Internationales. Cours et Travaux, Paris Pedone 1998 p. 61. Cl. Weisse-Marchal : Le droit communautaire et la responsabilité extra contractuelle des États membres : principe et mise en oeuvre, thèse Metz, 1996; Fl. Zampini : La responsabilité de l'État du fait du droit communautaire, thèse Lyon III, 1992]
Monsieur Pierre FAUCHON
Merci Monsieur le Professeur pour cette communication tout à fait substantielle et très bien structurée. Je ne ferai pas de commentaires - très brefs - si ce n'est pour dire qu'une fois de plus nous voyons, comme je le disais tout à l'heure après votre exposé Monsieur Costa, que les juristes construisent l'Europe et lui donnent une force qui va peut-être très au loin de ce que pensent les politiques. Surtout lorsque - comme vous nous l'avez rappelé - nous sommes dans un domaine où ils n'y avaient pas tellement pensé et où il a fallu que les éminents magistrats, d'ailleurs, de la Cour européenne de justice prennent conscience pleinement de leur responsabilité, de leur autorité, pour rendre effectives des dispositions qui sans eux seraient peut-être restées un peu lettre morte. Nous allons maintenant alors focaliser encore plus et descendre du niveau européen - si j'ose dire - descendre ou monter, je ne sais pas, selon la philosophie de chacun, à l'hexagone et entendre Monsieur Robert ETIEN, maître de conférences à l'université de Paris 13, nous parler de l'encadrement, toujours l'encadrement, de la responsabilité en droit constitutionnel. Je suppose qu'il s'agit du droit constitutionnel français, c'est pourquoi j'ai parlé de focalisation.
L'encadrement constitutionnel de la responsabilité de la puissance publique
par Monsieur Robert ETIEN,
maître de conférences à l'Université Paris 13
Ce matin, j'ai un peu l'impression à entendre les précédents orateurs que nous sommes nombreux à subir ce que j'appellerai : "le syndrome Darcy". Celui ci se caractérise de manière très simple. Nous avons tout naturellement et avec enthousiasme, généralement par amitié, accepté la proposition de Gilles Darcy de participer à ce colloque, mais c'est au moment même d'intervenir que nous nous rendons compte de la difficulté de la tâche à accomplir, compte tenu de la qualité du colloque, du choix de ses intervenants et du sujet imposé qui apparaît intraitable... Pour ma part j'ajouterai que le thème qui doit être abordé, sous d'autres formes a déjà été étudié par d'éminents spécialistes de la question. Pour simplement retenir les personnes qui interviennent dans le cadre de ce colloque : Madame Latournerie et les professeurs Beaud, Moreau, Paillet et tant d'autres... Toutes ces considérations m'amènent à plaider coupable et à demander l'indulgence du jury... oh pardon ! l'indulgence de la salle et à remercier Gilles Darcy pour sa confiance...
Pour le Doyen Vedel : "L'administration et le droit administratif ne peuvent, ni d'un point de vue pédagogique, ni d'un point de vue théorique, se définir de façon autonome. C'est en partant de la constitution que leur définition peut-être donnée." 1 ( * ) Par cette entrée en matière de son manuel de droit administratif consacrée aux bases constitutionnelles du droit administratif, le Doyen Vedel montre de manière irréversible la place prépondérante du droit constitutionnel au sein du droit public. 2 ( * )
L'encadrement constitutionnel de la responsabilité de la puissance publique (thème de cette intervention) est de première importance et il le reste aujourd'hui malgré les effets de la mondialisation juridique et de l'européanisation des normes (thème des dernières interventions) 3 ( * ). Si apparemment "l'encadrement constitutionnel" n'est pas une notion particulièrement opératoire en droit public, il convient en quelques mots de préciser ce qu'il faut entendre par cette formulation, de même faudra-t-il tenter de définir la responsabilité de la puissance publique.
L'encadrement, c'est un peu "ce qui entoure", c'est "la charpente", il est souvent perçu comme "le cadre général" une sorte de "première approche" de "première esquisse", il situe le sujet, ce sont : "les bases", "les sources" 1 ( * ) . L'aspect constitutionnel sera ici abordé à partir de la définition classique du droit constitutionnel à savoir : "un droit qui fait partie du droit public, qui concerne les règles juridiques d'organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics, qui est la transcription juridique de la vie politique puisqu'il fixe les règles du jeux de la compétition, du débat et des compétences des différentes autorités politiques, et détermine aussi les fondements de la société et les principes qui doivent la régir" 2 ( * ) .
Les définitions multiples 3 ( * ) , l'origine du terme responsabilité 4 ( * ) , l'étymologie grecque 5 ( * ) , montrent que le principe de responsabilité s'impose très tôt 6 ( * ) , qu'il est lié à l'obligation de réparer le préjudice occasionné à autrui, que son fondement à l'origine est avant tout moral 7 ( * ) , et qu'il révèle le thème de la culpabilité. La responsabilité de l'administration qui donnera naissance à la responsabilité administrative, est affirmée dans le célèbre arrêt Blanco du 8 février 1873 8 ( * ) , mais pour ce qui concerne la responsabilité de la puissance publique en droit constitutionnel les choses sont plus complexes.
"L'encadrement de la responsabilité de la puissance publique en droit constitutionnel" connaît un curieux paradoxe : 1) La responsabilité y apparaît limitée et réduite et en même temps, 2) La place de la responsabilité y est déterminante.
1. La responsabilité en droit constitutionnel semble occuper une place limitée.
Quelques exemples illustrent ce propos. L'enseignement du droit constitutionnel en première année de DEUG de droit ne concerne que très peu le sujet de la responsabilité, les manuels de droit constitutionnel font très rarement référence à ces thèmes 1 ( * ) , les sources constitutionnelles qui ont trait à la responsabilité sont réduites. La constitution du 4 octobre 1958 n'évoque que très rarement le terme de "responsabilité". À ma connaissance 8 fois seulement : à propos de la responsabilité du Gouvernement et du Premier ministre et en particulier en matière de défense nationale 2 ( * ) , de la responsabilité politique du Gouvernement à l'article 49 3 ( * ) , et évidemment de la responsabilité du chef de l'État 4 ( * ) et des ministres 5 ( * ) . Le terme ne figure pas dans la déclaration de 1789, même s'il peut apparaître explicitement dans certains articles 6 ( * ) et ne se trouve pas non plus dans le préambule de 1946. Les efforts méritoires du Conseil constitutionnel pour dégager des sources constitutionnelles concernant la responsabilité ne sont pas toujours convaincants 7 ( * ) .
2. L'évolution de nos démocraties contemporaines tend à montrer la place grandissante et la manifestation de plus en plus emblématique de la responsabilité comme vecteur essentiel de nos sociétés, c'est à dire comme partie intégrante du "constitutionnalisme 8 ( * )" et de "l'État de droit 9 ( * ) " qui sont aujourd'hui les deux figures de proue à la fois du renouveau du droit constitutionnel et des fondements de nos sociétés. Dans une société ordonnancée où le droit a une place privilégiée, la responsabilité des acteurs de la vie politique devient déterminante 1 ( * )0 . De même les nécessités de la transparence et du développement des mécanismes de contrôle poussent à accorder une place de premier choix à la responsabilité.
Des responsabilités multiples de par leur nature apparaissent ; la responsabilité civile, la responsabilité pénale, la responsabilité administrative... sans que cette liste soit exhaustive... De même que tout acteur de la vie publique a une responsabilité qui peut-être différente. Au sommet de l'État le Président de la République, le Gouvernement, le Parlement et les parlementaires, la Justice et les magistrats, les élus locaux, le Peuple, l'Administration (les membres des cabinets, les directeurs d'établissements), le Citoyen.
Toute une série de questions se posent à propos de ce thème :
Qu'est ce qui doit faire partie de l'encadrement constitutionnel ? Qu'est ce qui ne doit pas en faire partie ? Doit-on multiplier les formes de responsabilités ? Doit-on prendre en compte la qualité des acteurs ? Faut-il en protéger certaines autorités et pas d'autres ? Faut-il uniformiser ou au contraire diversifier les. Responsabilités ? Toutes les responsabilités doivent-elles être constitutionnalisées ? Faut-il pour qu'il y ait responsabilité une sanction ? et dans ce cas devant quelle autorité ? le juge, le peuple, l'histoire.... Une diversité de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Les récentes constitutionnalisations, comme la révision du 27 juillet 1993 à propos de la responsabilité des ministres ou encore la décision du conseil constitutionnel du 20 janvier 1999 sur la responsabilité du chef de l'État poussent à une certaine prudence.
Le constat qui s'impose est simple on assiste à une apparente régression de l'encadrement constitutionnel de la puissance publique (I) tout en soulignant le nécessaire renouveau de l'encadrement de la responsabilité de la puissance publique (II)
I- L'APPARENTÉ RÉGRESSION DE L'ENCADREMENT CONSTITUTIONNEL DE LA RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
La doctrine évoque la régression, en constatant l'inefficacité de la mise en cause de la responsabilité de la puissance publique 1 ( * ) . Cette régression provient de deux phénomènes distincts : La pénalisation de la responsabilité des gouvernants 2 ( * ) et la volonté de généraliser la responsabilité citoyenne face à la diversité des formes de responsabilité de la puissance publique.
A - LA PÉNALISATION DE LA RESPONSABILITÉ DES GOUVERNANTS
De nombreuses études sous des formulations différentes "criminalisation" plutôt que "pénalisation" ont décrit ce phénomène. Celui-ci provient du déclin de la responsabilité politique et de la valorisation de la responsabilité pénale.
1. Le déclin de la responsabilité politique
À l'origine de la formation du régime représentatif existe la responsabilité politique, caractéristique des régimes parlementaires 1 ( * ) . Celle ci est notamment marquée par la mise en responsabilité du Gouvernement qui peut-être renversé par les techniques classiques de la question de confiance et de la motion de censure. Aujourd'hui, après l'éphémère mise en application de la responsabilité de 1962 2 ( * ) avec pour conséquence le renforcement de l'exécutif, cette responsabilité ne joue plus 3 ( * ) . D'une manière générale, tout a été fait pour renforcer la cohérence majoritaire 4 ( * ) .
Pour la responsabilité politique du chef de l'État, le passage de la Monarchie à la République aurait pu tout naturellement s'accompagner d'une mise en place d'une véritable responsabilité politique du Président de la République 5 ( * ) . En fait pas du tout et bien au contraire, le principe de l'irresponsabilité du chef de l'État a été maintenu et tout naturellement la V ème République l'a conforté 6 ( * ) . Dans la pratique le Doyen VEDEL montre que là aussi les expériences sont éphémères deux cas seulement peuvent être évoqués : la dissolution du 30 mai 1968 et le départ du Général de Gaulle à la suite du référendum négatif du 27 avril 1969 7 ( * ) .
Il existe une véritable convergence entre l'inefficacité de la mise en oeuvre de la responsabilité du Gouvernement et l'irresponsabilité de fait du Président de la République 8 ( * ) . La principale difficulté dans le thème de la responsabilité des gouvernants a été d'essayer de rendre compatible deux objectifs qui en fait ne le sont pas : Assurer une mise en responsabilité efficace tout en protégeant les gouvernants. Les affaires du sang contaminé 9 et la tentative de mise en
accusation du Président de la République 1 ( * ) apparaissent dans toute leur dimension comme des échecs. Le constituant de 1993 et le Conseil constitutionnel en 1999 ont eu de bonnes intentions en voulant passer d'une responsabilité effective à une responsabilité efficace 2 ( * ) .
L'obsolescence de la responsabilité politique a entraîné un transfert du côté de la responsabilité pénale à l'égard des membres du Gouvernement avec la création de la Cour de Justice de la République 3 ( * ) qui a à la fois une composition parlementaire et qui est une Juridiction pénale 4 ( * ) . L'immunité flagrante, avec le privilège de juridiction de la Haute Cour de justice pour la responsabilité pénale du Président de la République 5 ( * ) a définitivement mis un terme à toute forme de responsabilité du Président de la République pendant la durée de son mandat 6 ( * ) .
Face à cette situation de déclin de la responsabilité politique on a cherché à mettre en place une responsabilité plus efficace par le biais de la responsabilité pénale 7 ( * ) .
2. La valorisation de la responsabilité pénale
Tout d'abord il s'agit d'un mouvement général du droit qui dans tous les secteurs se généralise. La pénalisation apparaît sous toutes ses formes comme gage d'efficacité, par la sanction encourue, par la simplicité de la relation entre l'acte incriminé et la sanction pénale, par la procédure pénale qui a la fois présente des garanties et des formes satisfaisantes 8 ( * ) . Ainsi toutes les branches du droit se pénalisent-elles. Le droit constitutionnel se pénalise 9 ( * ) , le droit administratif se pénalise 1 ( * )0 , le droit des affaires se pénalise, le droit européen se pénalise...
Ce mouvement est particulièrement sensible à l'égard de la responsabilité des hommes politiques. Il est approprié à une demande du peuple qui souhaite que soit sanctionné tout manquement d'un homme politique. La distanciation naturelle entre le peuple et les hommes politiques favorise toute forme de responsabilité pénale qui apparaît plus crédible et la sanction plus efficace et plus juste. La responsabilité pénale sert alors d'exorcisme permettant d'occulter les défaillances du social et du politique, ce que le professeur André DEMICHEL 1 ( * ) appelle : "le droit pénal en marche arrière". Il existe dans l'inconscient de chacun une sorte d'esprit revanchard qui souhaite remettre à sa juste place : "ces princes qui nous gouvernent".
L'ensemble du dispositif constitutionnel va confirmer cette valorisation de la responsabilité pénale, mais en même temps, va prouver ses limites.
La responsabilité du chef de l'État dans la constitution de 1958 est prévu par les articles 67 et 68 de la constitution du 4 octobre 1958 2 ( * ) . L'article 68 précise que : "le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblés statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ;il est jugé par la Haute Cour de justice". L'article 67 précise la composition parlementaire de la Haute Cour de Justice 3 ( * ) .
La responsabilité pénale des membres du Gouvernement est prévue par le titre X de la constitution aux articles 68-1, 68-2,68-3, à la suite de la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993. Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés 4 ( * ) par la Cour de Justice de la République composée à la fois de parlementaires et de magistrats de la Cour de cassation 5 ( * ) .
Désormais la seule responsabilité à l'égard du chef de l'État et des membres du Gouvernement est une responsabilité pénale qui se révèle inexistante pour le Président de la République et inefficace pour les membres du Gouvernement. L'inexistence de responsabilités du chef de l'État pendant la durée de son mandat se trouve renforcée et devient une sorte d'impunité suite à la décision du conseil constitutionnel du 22 janvier 1999 6 ( * ) , l'inefficacité de la mise en oeuvre de la responsabilité pénale des membres du Gouvernement se révèle à propos des rares affaires où des ministres sont impliqués et particulièrement dans le cas de l'affaire du sang contaminé 7 ( * ) . est alors facile de comprendre qu'il puisse y avoir un mouvement en faveur de la généralisation de la responsabilité citoyenne.
B - LA GÉNÉRALISATION DE LA RESPONSABILITÉ CITOYENNE
La généralisation de la responsabilité citoyenne est du à de multiples raisons, il convient de s'interroger sur son contenu.
1. Les causes de ce mouvement
La constitutionnalisation de la responsabilité de la puissance publique s'est heurtée à la segmentation des formes de responsabilités tant en ce qui concerne les caractéristiques de ces responsabilités, qu'à la diversité de traitement des acteurs devant être soumis à ces responsabilités. Du coup cette extrême complexité a développé "un flou artistique" dans lequel il est très difficile de se retrouver.
Pour les différentes formes de responsabilité, la responsabilité de la puissance publique peut être soumise à la responsabilité civile, la responsabilité pénale, la responsabilité administrative 1 ( * ) , la responsabilité internationale, la responsabilité européenne 2 ( * ) , et pourquoi pas la responsabilité citoyenne, la responsabilité devant l'histoire, la responsabilité devant le peuple, la responsabilité devant l'opinion publique 3 ( * ) .
Pour les personnes susceptibles d'être mises en responsabilité, la diversité des traitements favorise à la fois un incompréhension générale et une grande inefficacité : Le Président de la République qui bénéficie d'une immunité voir d'une véritable impunité pendant la durée de son mandat avec le privilège de juridiction de la Haute Cour de Justice 4 ( * ) , le Gouvernement qui reste responsable politiquement en théorie devant l'Assemblée nationale, même si cette responsabilité dans les faits ne joue plus 5 ( * ) , et dont les membres sont responsables pénalement devant la Cour de Justice de la République 6 ( * ) selon une procédure spécifique, 7 ( * ) les parlementaires qui bénéficient d'une immunité parlementaire qui peut-être levée par le bureau de leur assemblée 8 ( * ) , les élus locaux qui ont vu leur responsabilité s'étendre en matière pénale 9 ( * ) , les membres des cabinets et des administrations soumis à la responsabilité civile, administrative et pénale, les juges placés sous l'autorité et la protection du Conseil Supérieur de la Magistrature et de leur hiérarchie... 1 ( * )
Cette diversité amène nécessairement une uniformisation qui doit tenir compte de deux paramètres : l'efficacité et la compréhension globale.
2. Le contenu de la responsabilité citoyenne
Ce qualificatif, ne plaît pas toujours, tant il est vrai qu'il recèle une connotation historique et culturelle qui tend à dénaturer toute véritable signification.
Pourtant les choses sont simples : face à la diversité des situations de responsabilités, ne faut-il pas uniformiser et simplifier ? dans ce cas une seule et unique responsabilité pourrait être envisagée : la responsabilité citoyenne. Celle ci se définit à la fois par une situation qui correspond à celle d'individus actifs qui participent à la gestion et à la vie de la société, mais aussi à une généralisation par l'attribut et le statut accordés à l'ensemble de ces personnes 2 ( * ) .
Il s'agirait dans ce cas de considérer que les hommes politiques doivent être des citoyens comme les autres, ne doivent pas bénéficier de privilèges de juridictions et doivent être responsables au même titre que les autres devant les juridictions de droit commun selon des procédures ordinaires, que l'administration, elle aussi, ne devrait bénéficier ni d'un privilège de juridiction, ni d'une responsabilité spécifique, que les magistrats devraient être eux aussi soumis aux juridictions de droit commun. Cette uniformisation et cette simplification aurait au moins le mérite de rendre la réalité plus compréhensible, plus justifiable et sans aucun doute plus efficace. Sur la terminologie peut-être que l'expression "responsabilité de droit commun" 3 ( * ) serait sans doute plus appropriée 4 ( * ) .
Un autre argument pourrait en outre être évoqué : Si la diversité des responsabilités a pu apparaître bénéfique au cours de l'histoire et a permis une certaine efficacité 5 ( * ) , en revanche aujourd'hui les choses ont changé. Cette trop grande multiplicité entraîne complexité et incohérence.
L'ensemble de ces aspects montre la nécessité d'un véritable renouveau de l'encadrement de la responsabilité de la puissance publique.
II - LE NÉCESSAIRE RENOUVEAU DE L'ENCADREMENT CONSTITUTIONNEL DE LA RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
Aujourd'hui il faut à tout prix renouveler l'encadrement de la responsabilité de la puissance publique en droit constitutionnel. Pour cela, il faut intégrer la responsabilité de la puissance publique aux valeurs constitutionnelles et en faire une des caractéristiques de nos démocraties, un des piliers de notre État de droit et une des vertus du constitutionnalisme. Deux étapes successives doivent être envisagées : tout d'abord en finir avec les vieux débats : inscription formelle ou non dans la constitution et responsabilité spécifique-responsabilité de droit commun, ensuite entreprendre une réforme d'envergure qui corresponde à un véritable plaidoyer en faveur d'une nouvelle forme de responsabilité : la responsabilité constitutionnelle
A - EN FINIR AVEC LES VIEUX DEBATS
Trop longtemps les débats n'ont pas permis d'avancer en matière de responsabilité de la puissance publique, aujourd'hui ils devraient être dépassés, tant en ce qui concerne le problème de la responsabilité spécifique des gouvernants que celui de la transcription formelle de la responsabilité dans la constitution.
1. La question de la responsabilité spécifique des Gouvernants
La question de la responsabilité spécifique des Gouvernants ne se pose plus aujourd'hui de la même manière qu'auparavant. La protection des élus n'a plus du tout la même signification. Hier il fallait les protéger contre l'arbitraire pour permettre l'expression de la liberté d'opinion afin de garantir le développement de la démocratie. Aujourd'hui ces mesures apparaissent comme des sortes de privilèges qui permettent de masquer la réalité et de rendre les hommes politiques irresponsables et non sujet à condamnation.
La demande du peuple en démocratie, la nécessité de la transparence, impliquent une amélioration du rapport entre les citoyens et la classe politique. Celui ci doit passer par un véritable rapprochement qui doit permettre de réduire cette distanciation 1 ( * ) . Les élus doivent être dans le principe traités comme des citoyens à part entière et jugés par des tribunaux de droit commun. La crédibilité des actions politiques va s'en trouver renforcée. Les implications citoyennes devraient progresser. Du côté des élus, les explications seront plus claires, plus compréhensibles et éviteront des situations complexes où l'homme politique ne peut plus se justifier ni se défendre 2 ( * ) .
2. La transcription formelle dans la constitution
Il n'est pas obligatoire de constitutionnaliser formellement, la responsabilité de la puissance publique à partir du moment où la constitutionnalisation matérielle s'impose. Les exemples européens et étrangers 1 ( * ) montrent que la responsabilité peut-être traitée de manière efficace, sans être explicitement mentionné dans un texte constitutionnel 2 ( * ) . La constitutionnalisation de 1993 apparaît aujourd'hui comme un véritable échec même si les intentions de départ étaient louables 3 ( * ) .
Un grand texte général devrait consacrer le principe en démocratie de la responsabilité de tout citoyen, et de toute autorité au service de la collectivité publique qu'il s'agisse d'autorités politiques, parlementaires, administratives, ou judiciaires 4 ( * ) . Pour le Président de la République une protection particulière compte tenu de sa fonction serait sans doute dans le principe nécessaire, mais pour le Gouvernement, les parlementaires, les élus locaux l'administration, les juges, les citoyens, la responsabilité devant les juridictions répressives ordinaires et les juridictions de droit commun devrait être la règle.
B - PLAIDOYER POUR : " UNE RESPONSABILITÉ CONSTITUTIONNELLE "
L'encadrement constitutionnel n'est pas un accessoire, il est essentiel. L'insatisfaction de la classe politique, le mécontentement des citoyens, les critiques de la doctrine, la multiplicité des formes de responsabilité en la matière, la complexité de la mise en jeu des diverses responsabilités, en un mot l'inefficacité de la responsabilité de la puissance publique, plaide en faveur d'une réforme d'envergure en la matière. "La responsabilité constitutionnelle" doit permettre de synthétiser et de regrouper toutes les formes de responsabilité, et en même temps de rétablir un lien déjà bien entamé entre gouvernants et gouvernés 5 ( * ) . Le choix est grand et le renouveau doit entraîner clarification et simplicité. Celui-ci tourne autour de deux axes principaux : la revalorisation de la responsabilité politique et la nécessité d'une responsabilité réelle de la puissance publique à tous les niveaux.
1. La revalorisation de la responsabilité politique
Dans un premier temps il faut banaliser la responsabilité pénale. La responsabilité pénale ne peut-être la panacée, elle n'est en fait que facilité. Son efficacité due à son caractère répressif n'est qu'apparente 1 ( * ) . Une sanction pénale n'entraîne pas obligatoirement une sanction politique, quelque fois cela peut même être le contraire 2 ( * ) : une sanction pénale peut avoir pour un élu des aspects positifs avec par exemple ce que l'on peut appeler : "la prime à la casserole" 3 ( * ) . Elle ne peut-être qu'accessoire 4 ( * ) , alors qu'aujourd'hui pour des raisons de commodité, et de procédure elle est prioritaire.
Les techniques de responsabilité politique prévues sont inopérantes, l'effet majoritaire, les consignes de votes, les pratiques institutionnelles les ont délibérément réduites à néant 5 ( * ) . Des mesures doivent être mentionnées dans la constitution pour que cette responsabilité politique reprenne la place qu'elle n'aurait jamais du perdre. Toute une série de mesures peuvent se révéler efficaces 6 ( * ) . L'imagination de la doctrine est grande en l'espèce 7 ( * ) . Il faut sans aucun doute réinventer et reconstruire la responsabilité à partir des techniques proposées : blâmes, valorisation des commissions parlementaires 8 ( * ) , technique de recall 9 ( * ) , doivent être examinées.
Revaloriser les comportements citoyens des hommes politiques 1 ( * )0 , considérer que tout homme doit être respectueux des règles, mais aussi multiplier les contrôles du Parlement et lui accorder une place réelle pour en faire un véritable organisme de contrôle 1 ( * )1 . La responsabilité politique doit aussi être perçue de manière plus vaste. Ce n'est pas seulement l'échec du référendum de 1969, c'est aussi la dissolution de 1981 même si le risque est contrôlé, c'est encore l'acceptation de la cohabitation en 1986 par MITTERRAND pour rebondir et être mieux élu en 1988. La responsabilité n'a sans doute pas disparue, mais elle revêt d'autres aspects, 1 ( * )2 signe des temps peut-être moins glorieux 1 ( * ) . Les hommes politiques choisissent en outre souvent la facilité. Ils acceptent par exemple la responsabilité pénale, mais refuse paradoxalement la responsabilité politique, comme par exemple la jurisprudence Bérégovoy-Balladur qui pousse un ministre à la démission lorsqu'il est simplement mis en examen 2 ( * ) .
2. La nécessité d'une réelle responsabilité constitutionnelle de la puissance publique
Nous l'avons évoqué à plusieurs reprises, il faut uniformiser et simplifier les mises en jeu de la responsabilité publique. Il est tout à fait anormal qu'il puisse exister une véritable impunité du chef de l'État durant son mandat et qu'une fois celui ci terminé, il soit susceptible de toutes formes de condamnations. La responsabilité des membres du Gouvernement est inopérante, le principe de l'immunité parlementaire contestable, la responsabilité des élus locaux trop sévère et en même temps inefficace, la responsabilité des magistrats inexistante, la responsabilité de l'administration réduite. La responsabilité pénale ne peut en aucune manière être le substitut d'une responsabilité politique apparemment défaillante. La multiplication des formes de responsabilité n'est pas la meilleure solution. La responsabilité constitutionnelle doit englober et unifier toutes les formes de responsabilités.
Il faut envisager une responsabilité constitutionnelle de la puissance publique, qui aurait pour objet de réactualiser, uniformiser et rendre efficace une responsabilité qui à force de se former au fur et à mesure par des couches successives devient inopérante et obsolète. Il faut revigorer les fondements de la démocratie : Le Parlement expression de la souveraineté nationale doit redevenir l'instrument d'un contrôle efficace qu'il aurait du toujours rester. L'exécutif doit retrouver toute sa plénitude par des actions et des engagements qui tout naturellement doivent être contrôlés plus fréquemment par les citoyens en dehors des élections. Le judiciaire dans son indépendance doit exercer totalement sa fonction à tous les niveaux, lui aussi doit rendre des comptes. Le peuple, les médias, la conscience collective, les valeurs fondamentales de notre société : l'humanisme, la démocratie le respect des droits et libertés fondamentales, la liberté d'expression tout cela doit permettre de retrouver les vertus du constitutionnalisme et de l'État de droit.
Monsieur Pierre FAUCHON
Merci beaucoup Monsieur pour ses vues très prospectives et dans lesquelles vous n'avez pas hésité à aborder des problèmes qui ont, évidemment, des connotations et des contenus politiques très actuels et très brûlants. Mais nous sommes, ici, entre juristes et il est bien naturel que nous les traitions dans le langage et en les réintégrant dans la problématique juridique qui est la nôtre, en toute sérénité, on ne peut que s'en réjouir. En vous écoutant, je pensais à la réflexion de POPPER que je trouve très frappante, disant que le vrai critère, la pierre de touche de la démocratie, ce n'est pas tant la désignation des dirigeants que la possibilité de les remplacer, donc que leur responsabilité est finalement politique. Et en vous entendant, je pense que si POPPER vivait maintenant, cinquante ans après ses études, il serait peut-être tenté à dire que l'autre pierre de touche, peut-être la plus moderne, c'est la possibilité de mettre en cause la responsabilité des dirigeants, qui est l'aspect nouveau, je crois, de la vie publique, vous l'avez démontré, je vous en remercie.
-II- L'HÉTÉROGÉNÉITÉ DES NORMES EN DROIT INTERNE DE LA RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
La responsabilité pénale des décideurs publics locaux
par Monsieur Pierre FAUCHON,
vice président de la commission des Lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel,
du règlement et d'administration générale du Sénat
Président de séance : Monsieur le Doyen Georges VEDEL, de l'Académie française.
Je ne sais pas par quelle invocation je dois commencer. Je dois dire, messieurs les présidents, qu'en énonçant des titres aussi prestigieux, je suis étonné d'être moi-même un président en ce moment. Permettez-moi, par conséquent, très simplement, de saluer tous ceux qui sont là et qui vont travailler pour nous et avec nous.
Je voudrais présenter mes excuses de ne pas avoir été présent à la séance de ce matin, mais les dernières années de la vie sont les plus encombrées parce qu'il faut en finir, tout arrive à temps, et par conséquent, c'est bien connu, comme j'avais souvent l'occasion de le dire, la retraite c'est le moment où on a le plus de vacances, alors excusez de la visite d'un surmené qui n'a pas pu venir ce matin.
C'est dommage, c'est dommage parce que le thème arrêté par nos collègues universitaires en liaison avec les instances parlementaires est extrêmement intéressant et extrêmement actuel. Parce qu'il est assez mouvant. Ce ne sont pas des peintures que l'on peut faire ni même des instantanés, c'est un film qu'il faut arriver à enregistrer. Et j'ose dire que quelqu'un de ma génération et de ma situation accueille avec beaucoup d'appétit ce genre de réunion. Pourquoi ? Réfléchissez à ce qu'est la vie d'un professeur en activité. Il passe son temps à se tenir au courant. Pourquoi ? Parce qu'il a dans ses auditoires des étudiants ou des étudiantes qui sont rejetons de parlementaires, de membres du Conseil d'État, de très hautes notabilités, et qui reviennent en disant : "papa, tu n'es pas au courant de...". D'un autre côté il ne peut pas oublier, parce qu'il interroge aux examens, il doit bien se souvenir si telle bêtise qu'il entend proférer, il ne l'a pas lui-même proférée dans son cours. Donc une vigilance de tous les instants. Mais à partir du moment où l'universitaire est à la retraite, il est en roue libre. Oh ! Il ne fait pas d'efforts pour oublier, ça vient tout seul. Et il ne fait pas d'effort pour acquérir, même s'il a gardé présent à l'esprit le recueil des décisions du Conseil constitutionnel ou du Conseil d'État ou de telle revue juridique savante. Il n'y apporte pas l'ire, l'acharnement qu'il y mettait autrefois pour être au courant au moment où le cours commence. Tiens ! Une nouveauté, il en passe tellement. Il attendra que la nouveauté soit, elle, effacée par une autre nouveauté. Ceci créé une ambiance de scepticisme à la fois, comment dirai-je, anti-universitaire d'abord et antirépublicaine d'autre part. Parce que l'on a l'air d'être porté par un temps, l'on a l'air d'être inscrit dans une facilité d'être, peut être tout simplement transporté par la providence, et l'on s'aperçoit qu'il n'était pas besoin de tant de précaution. D'autant plus que le bilan que l'on fait s'aperçoit que l'on obtient toujours quelque chose de bon, comme souvent, que l'on n'a pas cherché, et qu'on a jamais réussi à atteindre ce que l'on voulait.
Je m'excuse de ses propos d'un scepticisme total qui n'ont aucun rapport avec l'objet de cette réunion, mais qui me donne le plaisir de prendre contact avec vous et, si vous le permettez, pour que vous n'ayez pas perdu votre après-midi, je vais passer à l'ordre du jour.
L'ordre du jour appelle, si je comprends bien d'abord, des témoignages, dont le premier est celui de Monsieur le président, de la vice-présidence de la commission des Lois constitutionnelles du Sénat, Monsieur Pierre Fauchon, sur le thème : "La responsabilité pénale des décideurs publics locaux".
Monsieur Pierre FAUCHON
Monsieur le doyen, cher doyen, merci de me donner la parole et permettez-moi de ne pas commencer ce témoignage - ce n'est pas une communication, c'est un simple témoignage - sans vous rendre hommage, sans vous rendre l'hommage que nous vous devons tous. Pour tout ce que vous apportez, avez apporté et continuez d'apporter à notre vie publique ; cela fait beaucoup de choses que je n'énumérerai pas. Cela en ferait trop, mais je dirai tout de même que - et c'est encore plus vrai quand on est parlementaire - vous êtes l'un des, sinon le grand clarificateur de notre problématique politique, vous apportez dans tous vos commentaires, vos articles et vos réflexions, une clarté qui manque le plus souvent dans cette matière. Et c'est donc à cette capacité de clarification que je tenais à rendre hommage, me souvenant du mot de La Bruyère selon lequel avec les diamants et les perles, l'esprit de discernement est ce qui est de plus rare et de plus précieux dans le monde. Merci de ce que vous nous avez apporté de clarification.
Mon témoignage doit porter, selon l'intitulé auquel je vais essayer de me conformer, sur la loi à laquelle on donne communément mon nom, parce qu'il est difficile de l'appeler de son vrai nom, qui est la loi de la réforme des délits non intentionnels - loi du 10 juillet de l'année dernière - que l'on appelle improprement loi sur les responsabilités des décideurs publics, que l'on appelle ici des décideurs publics locaux.
Disons immédiatement que cette loi ne concerne pas que les décideurs publics locaux, elle concerne toutes les personnes qui sont susceptibles de poursuite pénale pour des délits d'imprudence ou de négligence. Alors, on en a parlé beaucoup - et naturellement comme élu local je suis peut-être plus informé que d'autres et plus sensible que d'autres à la situation particulière des élus locaux mis en poursuite pour des faits d'imprudence ou de négligence - il ne s'agit naturellement pas de la délinquance volontaire mais de délits d'imprudence ou de négligence. Mais ce dont je vais vous parler concerne aussi bien les décideurs locaux que les préfets, les directeurs d'hôpitaux dans leur responsabilité, les directeurs de colonies de vacances, les responsables de centre d'activités de plein air, où les risques par définition sont un peu plus nombreux qu'ailleurs, et même d'un simple particulier parce qu'il n'y pas de différence de nature profonde entre un enfant qui hélas se brise une vertèbre en plongeant dans une piscine publique parce qu'il n'y a pas assez d'eau dans la piscine et qu'on n'a pas mis la pancarte pour signaler que le plongeon était interdit, et le même enfant qui plongera dans une piscine privée chez un particulier et qui n'aura pas été averti des mêmes dangers et qui hélas recevra les mêmes blessures. C'est le même problème, c'est un problème de délit d'imprudence ou de négligence ayant causé le décès ou l'incapacité à cet enfant.
C'est un problème, vous le savez, qui a défrayé la chronique avec un certain nombre d'affaires spectaculaires - j'ai trop peu de temps pour les évoquer -mais nous avons été en quelque sorte provoqués à nous interroger sur la multiplication de poursuites et éventuellement de condamnations, qui donnaient l'impression d'être des poursuites et des condamnations tout à fait artificielles. Elles étaient pratiquement fondées sur le raisonnement assez sommaire qui est le suivant : un accident s'est produit, si telle autorité ou telle personne n'avait pas pris telle ou telle disposition qu'elle devait prendre parce qu'elle doit prendre toutes les dispositions de nature à éviter cet accident, cet accident ne se serait probablement pas produit et dans ces conditions il y a un lien de causalité suffisant entre le fait qu'on n'ait pas pris telle ou telle disposition ou qu'on a pris des dispositions qui ne suffisaient pas. Ce lien de causalité suffit à considérer que le délit d'imprudence, ou d'homicide ou de blessure par imprudence ou négligence, se trouve constitué. Et c'est ainsi que, selon la formule du juriste, des poussières de fautes ont pu conduire à des condamnations, qui apparaissent comme tout à fait artificielles et tout de même quelque peu excessives. Et naturellement, elles sont alimentées par cette recherche du bouc émissaire qui caractérise notre vie publique.
Il nous a semblé qu'il fallait donc agir, et agir à la racine du mal. Agir à la racine du mal, c'était découvrir ou redécouvrir que depuis prés d'un siècle, depuis un arrêt du Tribunal des conflits de 1912, on a pris l'habitude de confondre et d'assimiler la faute civile et la faute pénale, sans s'apercevoir qu'il y avait une grande différence entre la faute civile et pénale, l'imprudence faute civile et l'imprudence faute pénale. L'imprudence faute civile est retenue parce qu'elle fonde l'obligation de réparer le résultat, le dommage causé par cette imprudence, vieux principe que l'on trouve déjà dans le droit romain : c'est donc une atteinte portée aux intérêts d'un ou de plusieurs particuliers qui sont les victimes. La faute pénale, au contraire, toute différente, est en réalité une atteinte portée aux valeurs de la société. Et c'est ce qui justifie la poursuite pénale, la mise en oeuvre des procédures pénales et les condamnations pénales, qui sont tout autre que les condamnations civiles. Puisque à l'égard des premières elles ne sont pas infamantes, d'abord, et deuxièmement, elles peuvent être couvertes par des systèmes d'assurances, alors que les condamnations pénales - évidemment quand c'est une peine de prison mais même si c'est une amende - ne sont pas couvertes par les assurances. Il y a un coté infamant naturellement pour les gens qui sont poursuivis et, le seul fait de comparaître sur les bancs de la correctionnelle, comme on dit côte à côte avec des délinquants de droit commun, est évidemment quelque chose de très préjudiciable.
Il fallait donc essayer de faire quelque chose et d'atteindre à la base cette confusion des deux fautes. Il fallait aussi rappeler, en ce qui concerne la faute pénale, qu'il y a tout de même un principe fondamental dans notre code pénal, qui a été rappelé d'ailleurs dans le nouveau code pénal, c'est qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre. Et que donc dans les délits où il n'y a pas d'intention délictueuse - et c'est le cas des délits d'imprudence ou de négligence - il n'y a évidemment pas eu la volonté de provoquer l'accident. Ces délits là théoriquement ne devraient pas exister, mais il faut pour des raisons de sécurité publique instituer les délits d'imprudence ou de négligence, de manière à nous obliger tous à un comportement plus prudent et plus diligent, naturellement en matière de circulation mais aussi dans tous les autres domaines qui peuvent être l'occasion d'accident.
Et c'est une seconde préoccupation qui nous a guidés dans cette démarche. Cette démarche nous a conduit tout simplement à mettre fin à la confusion de la faute civile et de la faute pénale, en donnant de la faute pénale une définition spécifique, une définition particulière soulignant son caractère pénal et permettant définitivement de la distinguer de la faute civile et de faire en sorte qu'il ne suffirait plus de n'importe quelle imprudence ou négligence, même tout à fait théorique, pour qu'il y ait une condamnation pénale. Cela suffit pour une condamnation civile. Mais pour qu'il y ait une condamnation pénale, il faut que cette faute ait un certain degré - dont on a discuté, sur la rédaction, on peut naturellement varier - un certain degré de gravité qui implique la conscience du danger que l'on fait courir ou contre lequel on n'a pas pris les mesures adaptées. Quelque chose qui rapproche et qui soit un peu intermédiaire entre le délit totalement in-intentionnel et le délit intentionnel, dans la mesure où l'élément intentionnel réside dans le fait qu'on n'ignore pas qu'on fait courir un danger, qu'on n'ignore pas qu'il y a un certain danger, qu'on le fait et qu'il y a un certain risque.
Alors, dans cette démarche, nous avons abouti à un texte que je vous lirai tout à l'heure, brièvement, et j'essaye - ce n'est qu'un témoignage - de ne pas entrer dans le détail, vous ne m'en voudrez pas. Par cette démarche nous avons vu qu'il fallait apporter un certain nombre de distinctions qui étaient inévitables.
La première, c'est que cette démarche nous l'avons faite uniquement pour les personnes physiques et non pas pour la responsabilité pénale des personnes morales. Car il y a maintenant, depuis le nouveau code, une responsabilité pénale des personnes morales, qui est une notion tout à fait nouvelle. Évidemment un peu théorique et un peu surprenante, et encore d'ailleurs assez souvent critiquée, mais enfin elle s'établit dans la jurisprudence, elle fait son chemin et elle ne provoque pas les mêmes inconvénients, parce qu'une personne morale n'est pas assise sur les bancs de la correctionnelle et ne fait pas de prison ; et donc le problème en termes humains, en termes concrets, ne se posait pas du tout de la même façon. Et c'était un autre problème -j'en dirai deux mots tout à l'heure - parce qu'il est peut être, au fond, ce problème, plus proche du thème général du colloque que celui ce dont je vous parle, qui est donc celui de la responsabilité pénale des personnes physiques.
Seconde réflexion, il nous a semblé qu'on ne pouvait pas ignorer ou faire un texte qui aurait ignoré la fréquence des accidents de la circulation dans notre pays - puisque vous savez que c'est un des vices typiquement français - et que dans ce domaine il m'a semblé spécialement, puisque je suis à l'origine de la proposition de loi, qu'il ne fallait pas courir le risque, je dirais, d'abaisser la protection dans le domaine des accidents de la circulation. Et qu'il était donc raisonnable d'admettre qu'en matière d'accidents de la circulation, il ne fallait pas toucher au droit actuel qui fait que la moindre des fautes peut justifier une condamnation, parce qu'il n'y a pas de doutes que pour le pilote d'une automobile la crainte du gendarme reste tout de même le meilleur des avertissements. D'où la difficulté, car il était difficile de faire une loi dont on aurait dit : elle ne s'appliquera pas aux accidents de la circulation. Parce que, alors là, c'était vraiment procéder d'une manière catégorielle qui aurait certainement choqué les juristes que vous êtes. Il nous a semblé qu'il y a une distinction qu'on pouvait introduire entre les hypothèses où l'intervention de l'agent dont la responsabilité est recherchée et le dommage, prend la forme d'un lien de causalité direct ou indirect. Je prends un exemple concret d'un accident, malheureusement, très fréquent : la chute du poteau de basket. Le poteau de basket tombe alors qu'il y a un match et provoque souvent de très graves blessures et mêmes des décès d'enfants. S'il s'agit d'un poteau de basket qui a été poussé par le camion, disons peut être, de la friteuse le jour de la fête, le camion a poussé le poteau de basket donc le conducteur du camion a une relation directe avec le dommage. Mais s'il s'agit simplement de dire que le poteau de basket était vermoulu, que la commune ne s'en était pas aperçue, ou que les responsables de l'activité sportive auraient du quelquefois, éventuellement des années auparavant, prévenir ce risque ou qu'ils auraient du inspecter tous les poteaux de basket avant chaque match etc., on est dans une hypothèse de relation indirecte. Et les accidents de la circulation sont presque toujours des hypothèses de causalité directe et c'est pourquoi en disant que notre loi ne s'appliquerait qu'au lien de causalité indirecte nous touchions presque tous les cas de responsabilité dont j'ai parlé tout à l'heure, mais nous ne touchions pas la plupart des accidents de la circulation. Et c'est la raison pour laquelle j'ai cru devoir introduire cette distinction qui, j'en ai d'ailleurs été un peu surpris, naturellement, est un élément de complication dans l'application de la loi et on s'en aperçoit dés maintenant tous les jours. Mais finalement, elle a été adoptée successivement par le Sénat, l'Assemblée, le gouvernement, de sorte qu'elle est restée dans le texte. Il s'agit donc des personnes physiques lorsqu'il y a une relation de causalité [in]directe avec le dommage.
Et à partir de là, la définition à laquelle nous avons abouti - je vais vous la lire simplement sans la commenter outre mesure, ça serait trop long - est la suivante : les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris tes mesures permettant de l'éviter - c'est toujours l'action et l'abstention - sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité (manifestement délibéré ce qui implique une certaine conscience de ce que l'on fait) prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée (c'est là le mot essentiel, ça n'est plus n'importe quelle faute, ça n'est plus la moindre imprudence ou la moindre négligence, c'est une faute caractérisée) et en outre qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer. Il y a donc soit la violation manifestement délibérée d'un texte, soit le fait d'avoir commis une faute caractérisée et qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité qu'on ne pouvait ignorer.
Je vous passe le détail de la mise au point de ce texte, car il y a eu un premier texte dans ma proposition, ensuite un second texte voté par le Sénat, ensuite un troisième texte voté par l'Assemblée, des rencontres naturellement entre les rapporteurs des deux assemblées, l'intervention du Gouvernement et de ses conseillers pour aboutir à ce texte final. Je n'entre pas - ça serait trop long -dans le détail de ces discussions, le texte est ce qu'il est, il est maintenant livré à la jurisprudence et d'ores et déjà, on voit bien qu'il a été bien reçu finalement. Contrairement à ce que beaucoup de sceptiques avaient cru pouvoir prédire, la jurisprudence, qui probablement était un peu gênée de prononcer des condamnations tout à fait automatiques et artificielles dont j'ai parlé tout à l'heure, a immédiatement appliqué ce texte. Et nous avons maintenant une série de décisions dans lesquelles on distingue bien et on dit en ce qui concerne l'élu : relation indirecte, il n'y a pas de faute caractérisée, donc il n'est pas responsable (encore que la commune, elle, qui n'est pas visée - personne morale - reste responsable sur le plan civil et éventuellement sur le plan pénal, je vous en dirai un mot dans un instant). Je prends un exemple concret qui est celui du Drac - sans citer d'autres jurisprudences - la terrible affaire du Drac, qui avait été jugée par la Cour d'appel, soumise à la Cour de cassation. Compte tenu de l'intervention de la loi nouvelle, la Cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt précédent qui avait été rendu sous l'empire de l'ancienne législation, mais l'a annulé, l'a renvoyé devant la même juridiction pour revoir les circonstances de l'affaire à la lumière de la loi nouvelle. Et vous avez appris peut être comme moi-même à la radio, ce matin, hier soir, que l'affaire est en cours actuellement et que le parquet a considéré que dans cette affaire, il y avait vraiment une responsabilité de la personne qui avait conduit les enfants dans le lit du Drac, probablement parce qu'il a considéré qu'il y avait une relation directe entre le fait de conduire les enfants et de les exposer à l'inondation qui a lieu. Il a donc demandé sa condamnation (on en est là, simplement, il n'y a pas de décisions). Mais en ce qui concerne le directeur de l'école, qui n'a évidemment qu'une relation indirecte avec ce qui c'est passé, le parquet n'a pas requis de condamnation, faisant ainsi application-je ne rentre pas dans les circonstances de fait, je ne les connais pas suffisamment - manifestement application du schéma juridique que je viens de vous exposer. Voilà, pour l'essentiel, quelle est cette loi sur les délits non-intentionnels qui devrait amener encore une fois un meilleur discernement, je crois, dans les condamnations.
J'ajouterai une réflexion qui correspond mieux peut être aux débats qui font l'objet de ce colloque, si intéressant depuis ce matin, qui continuera de l'être pendant deux jours. Et je félicite au passage ceux qui ont réussi à mettre sur pied un colloque d'une telle tenue et d'une telle importance. Nous nous sommes posés au passage le problème de la responsabilité des personnes morales et spécialement des collectivités locales. Et ça a donné lieu à des débats dont je vais vous parler un peu - si on m'accorde encore deux ou trois minutes - parce qu'encore une fois il cadre mieux avec l'objet de vos réflexions.
Actuellement, nous avons un texte qui est l'article 121-2 du code pénal qui dit ceci : "Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de convention de délégation de service public." Susceptibles de faire l'objet de convention de délégation de service public, c'est-à-dire que dans le domaine où s'exerce la souveraineté, la puissance publique, le pouvoir de police des maires qui ne peut pas faire l'objet de délégation, là il n'y a pas de responsabilité pénale. Alors que dans le domaine où il peut y avoir délégation : l'organisation d'activités sportives ou autre que l'on peut très bien sous-traiter à un club, à une association ou à un organisme commercial, la délégation est possible et dans ce cas là, la responsabilité pénale de la personne morale est possible et fait l'objet d'ailleurs de décisions en vertus de cet article du code pénal. Nous nous sommes posés la question de savoir ce que signifiait cette distinction au regard, disons, de la conscience actuelle entre les activités délégables et non-délégables. Prenons un exemple d'activité de police : une course de taureau est organisée assez fréquemment dans les villes du sud de la France et donne lieu à des accidents. On reproche au maire de ne pas avoir pris des précautions en vertu de son pouvoir de police et comme le pouvoir de police n'est pas délégable, et bien, il n'y a pas de possibilité de responsabilité pénale de la commune.
Ces distinctions nous avaient paru à nous quelque peu artificielles. Elles avaient surtout paru artificielles à la commission qui avait été créée à la même époque par le Gouvernement et qui porte communément le nom de Monsieur Massot, le conseiller d'État, qu'on appelle la commission Massot. On a dit quelque fois, par erreur, que les travaux de cette commission étaient à l'origine de la proposition de loi que je viens de présenter. Ce n'est pas exact puisque le rapport de la commission est arrivé trois mois après le dépôt de la proposition de loi. Cependant, naturellement, cela a enrichi la réflexion et cela a enrichi la réflexion dans les deux assemblées, réflexion qui, elle, a été postérieure au dépôt de ce rapport. Or cette commission est allée très loin - et ceci va peut être plus spécialement intéresser le doyen Vedel - dans l'appréciation de la responsabilité des collectivités locales, pénale bien entendu, et éventuellement de l'État, puisqu'elle a considéré d'une part qu'en ce qui concerne les collectivités locales, il n'y avait plus lieu de faire de distinction entre les compétences délégables et les compétences non-délégables et que pour toutes activités des collectivités locales, la responsabilité pénale pouvait être engagée. Mais la commission est même allée plus loin et en dépit de l'opposition de son président, a décidé de lever le tabou de la non-responsabilité pénale de l'État.
Parce qu'actuellement, on ne voit pas très bien l'État français condamné pour un délit, n'est ce pas... ? Ce n'est pas très facile, je dirai même, à concevoir. Et donc, la commission Massot passant outre cette difficulté, des hommes aussi importants que l'ancien maire de Lille, Monsieur Maurois, et dans nos débats, Monsieur Badinter, qui est un juriste réputé, avaient dit : effectivement, au regard de la conscience moderne de l'État de droit, pourquoi l'État ne serait pas condamné, si il a, lui aussi, par imprudence ou négligence, commis le délit ayant provoqué la mort ou les blessures de quelqu'un. Et c'était les conclusions de la commission Massot, désavoué par le président à titre personnel, mais exposé tout de même par lui dans son rapport. Alors fort de ce soutien moral, nous n'étions pas allés jusqu'à proposer de proclamer la culpabilité éventuelle ou la possibilité de poursuivre pénalement l'État. Toutefois, nous étions allés tout de même jusqu'à proposer, jusqu'à voter au Sénat la suppression pour les collectivités locales de la distinction entre les activités délégables et les activités non-délégables, distinction encore une fois qui donne lieu à des difficultés de jurisprudence épouvantables. Dans l'affaire du Drac par exemple, il s'agit d'une activité qui est en un sens délégable, puisqu'elle était déléguée à une association par la commune, mais on a dit qu'elle était par nature non délégable : parce qu'elle se rattachait à l'enseignement - cette promenade était une activité para-scolaire qui se rattachait à l'enseignement - et que l'enseignement est, paraît-il, une activité non-délégable de l'État. Et bien, il n'y avait pas de responsabilité possible de la ville (c'était la ville en l'occurrence qui était concernée). Et on voit bien que la distinction est en pratique extrêmement difficile à justifier concrètement sur le terrain et à l'égard des gens qui sont victimes de tels événements. Donc, nous avions voté ici la suppression de cette distinction.
Je dois dire que nous avions voté contre l'avis du Gouvernement et que l'offensive gouvernementale s'est faite mieux entendre à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, ce qui d'ailleurs évidemment n'a rien de surprenant. Et à l'Assemblée Nationale, on a supprimé cette extension aux activités délégables que nous avions voté et on a rétabli le texte du Code pénal tel que je vous l'ai lu tout à l'heure. Quand la question est revenue devant nous au Sénat, il nous a semblé que ceci ouvrait un débat qui dépassait l'objet de la proposition. C'était un autre débat, qui touchait d'ailleurs par contiguïté le problème de la compétence - car dans ces affaires de responsabilité de la puissance publique, on tombe tout de suite sur les problèmes de partage des compétences entre les deux ordres de juridictions, on y échappe pas - problème de compétence qui touchait l'éventuelle responsabilité de l'État. On entrait donc en réalité dans une problématique qui était tout à fait distincte de celle dans laquelle se situait la proposition de loi dont je vous ai parlé et donc nous nous sommes ralliés à la position de l'Assemblée, et nous avons renoncé à modifier le système de responsabilité pénale des personnes morales.
Voilà quel est le témoignage que je pouvais vous apporter sur cette affaire. Il me semble qu'il pourra résulter de notre réforme le statu quo pour la responsabilité pénale des personnes morales et peut être une appréciation de la responsabilité des autres personnes, des personnes physiques, plus conforme à l'idée qu'on peut se faire - me semble t-il - d'un état de droit. Je vous remercie.
Monsieur le Doyen Georges VEDEL
Monsieur le président merci de cet exposé à la fois lumineux et subtil qui a nous a placés un peu dans les coulisses de la préparation de la loi plus minutieuse qu'on ne l'imagine quelquefois d'après les compte-rendus des débats parlementaires. Avec évidemment tout un tas de réflexion pour les juristes, dont une qui est évidente, c'est qu'à un certain moment, quoi qu'on en fasse, l'on en revient au juge. Entre la culpa levissima - la très légère faute - la faute inexcusable, la faute lourde, la faute caractérisée, il n'y a que des nuances sémantiques. Des nuances logiques il n'y en a pas, et c'est finalement le juge dans, à la fois sa science et son sens des comparaisons, et également son désir de justice, qui sera l'arbitre et tout est bien comme cela : de bonnes lois, de bons juges, de bons justiciables, c'est la grâce que nous nous souhaitons tous. Si vous le voulez bien, je vais donner tout de suite la parole à Monsieur le président SIGNE, qui doit nous parler de la responsabilité des parcs, communes et communautés de communes. Le temps est clément, je vous donne la parole Monsieur le président.
La responsabilité des parcs, communes et communautés de communes
par Monsieur René-Pierre SIGNÉ,
Sénateur-maire
et Président du Parc naturel régional du Morvan
Comment dire à la fois la gêne et le plaisir que je ressens à m'exprimer devant vous aujourd'hui. La gêne provient du fait que mes connaissances juridiques sont peu de choses comparées à l'encyclopédisme des autres invités. Le plaisir vient pour sa part du fait que cette gêne est loin de constituer une contrainte désagréable, bien au contraire. C'est un honneur pour moi d'être présent. Sachez seulement que mon intervention sera celle d'un non-juriste, statut qui représente sans doute pour les organisateurs de ce colloque une curiosité en soi et qui justifie ma présence ici.
Qu'est-ce qu'un politique peut en effet dire à propos de la « responsabilité » à des juristes ? Le Président FAUCHON vient à l'instant de dépeindre les rapports parfois délicats entre le politique et la responsabilité surtout lorsque celle-ci devient pénale. Permettez-moi d'y ajouter quelques mots pour remarquer que les affaires mettant en cause la responsabilité pénale d'un élu pour un délit non intentionnel se déroulent la plupart du temps dans les communes rurales. Ce n'est pas très surprenant sachant qu'elles sont très vulnérables disposant de très peu de moyens matériels et humains.
Je n'aborderai que la responsabilité politique, qui, faut-il le souligner est la première qui nous occupe, nous politiques, celle qui s'appuie sur le premier juge de France : le peuple ; et sa sanction : le vote. Mettons-la de côté, pour aujourd'hui en tout cas, pour nous concentrer sur les normes de la responsabilité publique, mettons aussi de côté la responsabilité morale qui oblige à répondre devant sa conscience. Comme notre responsabilité repose souvent sur la notion de faute, le préjudice est souvent difficile à réparer et à effacer de notre souvenir.
On ne peut que se féliciter de la constante extension de la responsabilité publique. Cet élargissement a comporté plusieurs étapes et la responsabilité des agents publics a fini par engager la responsabilité de l'administration qui les emploie. En outre, cette administration n'est plus seulement l'État mais aussi, le cas échéant, une collectivité locale ou un établissement public. Il en résulte que le juriste doit se résigner à la diversité des sens et des contextes du mot « responsabilité ». S'y résigner mais la connaître et donc l'ordonner en catégories logiques.
Pour ce qui concerne la responsabilité des communes, je ne veux rendre compte que des éléments renvoyant à la responsabilité des communes et de leur groupement. L'intercommunalité, considérée comme une tendance de fond de la réforme de l'organisation territoriale de notre pays, est en effet lourde de potentialité de changement pour le régime de la responsabilité publique. Force est de constater que le modèle jacobin centralisé avec son architecture hiérarchique est plus clair du point de vue de l'attribution de la responsabilité qu'un modèle décentralisé et qui, de plus, est innovateur. L'administration locale en France comporte trois niveaux de collectivités territoriales : la commune, le département et la région, ce qui est assez simple. Mais le regroupement des communes en syndicats, districts ou communautés vient quelque peu compliquer la donne.
Commençons par le commencement, par la commune en somme, maillon de base et unité spatiale de référence, où l'on apprend beaucoup. L'article L. 2123-31 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dit que les communes sont « responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions ». La responsabilité de la commune connaît une limite en cas de faute de la victime. L'article L. 2253-5 du CGCT considérant la participation au capital de sociétés anonymes indique que « la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants ». L'article L. 2216-3 du même code souligne pour sa part qu'en cas de dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis par attroupements l'État peut exercer une « action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée ». On le voit, la responsabilité de la commune est variable.
Mais la responsabilité, le plus souvent requise, tient aux incidents ou accidents survenus sur les lieux, dans les locaux, en utilisant les structures de la commune. En cas de poursuite, la collectivité est représentée par son maire qui la représente ès qualité et engage sa responsabilité en son nom. Dans quelques cas rares, le maire peut être incriminé lui-même, sa responsabilité personnelle étant engagée. Dans tous les cas, qu'il représente ou non la commune, sa responsabilité peut devenir culpabilité.
Si aux yeux de nos concitoyens, le maire est l'élu le plus apprécié, il est aussi le plus proche, celui qui ne peut se dérober. Il est le responsable de proximité, corvéable à merci, il n'aspire pas à être justiciable à merci, bien qu'il soit un justiciable comme les autres et ne prétende pas bénéficier de traitement de faveur.
Le maire est collaborateur de la justice, il connaît beaucoup de choses qui se passent dans sa commune, ses écoles ou ses locaux. Quelle est l'obligation exacte à laquelle il est tenu ? Quelle en est la portée ? Quelles conséquences peut-on en tirer ?
Sans évoquer le délit de favoritisme dans la passation des marchés, conclusion qui s'impose vite avec ce terrible corollaire que « le résultat présuppose l'intention » et la gestion de fait, construction purement jurisprudentielle constatée pour des fautes qui paraissaient bien visuelles aux élus.
La loi Fauchon intervient là puisqu'elle traite de la responsabilité des élus. Je l'évoque d'abord pour dire qu'elle a apporté un peu de sérénité aux élus, effrayés par leurs responsabilités depuis qu'on a eu la fâcheuse tendance de glisser du civil au pénal. Les progrès apportés par ce texte sont importants et méritent d'être soulignés. En premier lieu, les responsables indirects d'un dommage ne le seront pénalement que lorsque sera apportée la preuve qu'ils ont commis une faute qualifiée. Ensuite, le juge peut prononcer une relaxe sur le plan pénal mais une condamnation sur le terrain de la responsabilité civile.
La spécificité des PNR par rapport aux autres espaces protégés réside non seulement dans la complémentarité entre les objectifs de préservation du patrimoine et ceux de développement de territoires habités, mais aussi dans le caractère négocié de ses objectifs et des moyens que se sont donnés les partenaires (communes, région, département et État) à travers le contrat qu'est la Charte du Parc. À signaler tout de même que les Parcs n'ont pas de pouvoirs contraignants simplement des pouvoirs d'éducation, de pédagogie, de conseils, de suivi, et même la loi paysagère n'a pas pourvu les Parcs régionaux de pouvoirs de contrainte qui auraient été d'ailleurs mal acceptés. J'ajoute aussi qu'il faut bien entendre responsabilité comme l'obligation générale de répondre des conséquences de ses actes, ce qui n'a rien à voir avec les compétences. Je dois dire que la confusion se fait souvent au regard de nos concitoyens pour porter des accusations d'incurie. Compétence n'est pas responsabilité même si en exerçant la compétence on acquiert la responsabilité.
Les actions du PNR sont arrêtées et mises en oeuvre par son organisme de gestion qui est en général un établissement public de collectivités territoriales. Si chaque signataire de la Charte reste maître de ses décisions sur le territoire du parc, il est toutefois engagé par la Charte qu'il a négociée. La responsabilité de l'organisme de gestion du PNR est de veiller au respect de la Charte pour chacun de ses signataires. En effet, si une décision d'un signataire de la Charte ou d'un service de l'État impliqué n'est pas conforme à la Charte, son organisme de gestion est appelé à intervenir. Tous les partenaires, y compris l'État, sont tenus de respecter les orientations et d'appliquer les mesures définies par la Charte dans l'exercice de leurs compétences respectives.
Il existe un certain nombre de réglementations particulières : mesures spécifiques de gestion sur certaines zones du parc, maîtrise de la publicité) interdiction de la circulation des véhicules motorisés de loisirs dans les espaces naturels qui peuvent être de la compétence de l'État (classement des sites, réserves naturelles) ou des communes (par exemple : arrêtés municipaux, dispositions en matière de construction... ).
Un mot sur le cas de chevauchement d'un Pays et d'un PNR. Il convient peut être d'abord de définir ce qu'est un pays : projet de développement durable porté par des communes ou des groupements de communes sur un territoire cohérent. Il est matérialisé lui aussi par une charte et exprime un projet de territoire répondant aux objectifs de développement durable. C'est dire que nous retrouvons souvent les mêmes préoccupations et les mêmes objectifs entre Pays et Parcs. Pourtant la possibilité de chevauchement est bien autorisée mais soumise à plusieurs conditions. D'abord, c'est le cas le plus général, est reconnue l'antériorité du Parc régional, ensuite « la convention de partage des rôles » doit être approuvée et signée par le Parc et les communes qui appartiennent simultanément au Parc et au Pays. Elle est annexée à la charte du Pays, soumise à délibération des communes ; elle est aussi annexée à la charte du Parc. La convention doit définir, pour les parties communes, les missions respectivement confiées aux organismes de gestion du Parc et du Pays et notamment les domaines d'action pour lesquelles le Parc aura vocation exclusive à assurer la cohérence des actions programmées de l'État et des. collectivités territoriales sur ces parties communes. Un EPCI à fiscalité propre ayant approuvé une charte de pays est totalement inclus dans son périmètre mais il peut n'être inclus que partiellement dans un Parc et ne pas être membre de son syndicat mixte. On voit que les choses ne sont pas très simples.
***
Venons-en pour finir à ce qui représente à mes yeux le plus intéressant au regard de ce qui nous occupe, je veux parler de l'intercommunalité et de ses conséquences sur la responsabilité publique. La loi du 12 juillet 1999 dédiée au renforcement et la simplification de la coopération intercommunale n'évacue pas pour autant, et malgré son intitulé, la complexité croissante du maillage institutionnel de notre territoire.
Il existe en fait un certain flou statutaire. Contrairement aux communes dotées d'une compétence générale pour traiter les affaires revêtant un intérêt communal, les communautés de communes sont des groupements à compétence spécialisée limitée par leurs statuts dont la rédaction nécessite une grande vigilance. Il se trouve que les communautés de communes, EPCI à fiscalité propre, exercent de plein droit les compétences concernant l'aménagement de l'espace et les actions de développement économique, plus, au minimum, une compétence facultative. Les 2 compétences obligatoires sont assez vastes pour qu'y soient englobés beaucoup d'actions et beaucoup de projets, ce qui n'est pas pour simplifier les choses et le principe de spécialité statutaire est souvent appliqué de manière incertaine. Les débordements de compétences sont sources d'incertitudes juridiques. En somme quand le partage des compétences est de moins en moins précis, celui des responsabilités entre communes et entre groupements de communes perd aussi en précision. Chacun est normalement responsable de ce pour quoi il est compétent ou de ce qu'il croît être inclus dans ses compétences. En conséquence, le flou des compétences entraîne le flou des responsabilités.
Je vous l'ai dit en ouverture, mais vous avez pu sans mal le vérifier à maintes reprises depuis, je ne suis pas juriste, néanmoins il y a un principe de droit qui me paraît clair c'est que le transfert de compétence entraîne transfert de responsabilité. Les blocs de compétences, peut être se dissolvent-ils au fil des approfondissements de la décentralisation ? Le centralisme, manifestement excessif, qui a eu cours si longtemps et qui enserrant les communes et toutes les collectivités dans un carcan devenu insupportable, avait l'avantage, comme toute mauvaise chose à quelquefois un bon côté, de délimiter nettement avec simplicité et clarté, les frontières des compétences. Et plus, il y avait un contrôle à priori de l'État qui n'était pas non plus sans conséquences.
Je ne dis pas pour autant que je regrette la centralisation et je pense même que la décentralisation est à revoir, à ajuster, à élargir mais dans le même temps que soient mieux définies les compétences en évitant les transferts souvent imposés et mal compensés. Mais ceci est une autre histoire totalement hors sujet.
Monsieur le Doyen Georges VEDEL
Merci Monsieur le président. C'est véritablement très instructif, non seulement pour des professeurs mais pour de simples citoyens, que de voir démonter devant eux les problèmes, les soucis, les tâtonnements et les réussites des élus qui sont attelés à leurs tâches pour nous, et on a un sentiment de gratitude que je vous exprime bien volontiers, Monsieur le président. Si vous le voulez bien nous allons maintenant passer à un autre genre de rapport, puisqu'il ne s'agit plus de témoignages mais d'une étude juridique, certainement d'une autre caractéristique, qui incontestablement va se présenter à nous comme une énigme. C'est le rapport de Monsieur PAILLET sur le sujet : "Existe-t-il une responsabilité de droit commun ?". Chacun de ces mots, sauf peut-être "existe", pose un problème de définition, mais nous l'écoutons avec beaucoup de curiosité.
Existe-t-il une responsabilité de droit commun ?
par Monsieur Michel PAILLET,
professeur à l'Université de Toulon et du Var
1. Le thème qui m'a été confié repose à priori sur un paradoxe. En effet, s'inscrivant dans une après-midi consacrée à « l'hétérogénéité des normes en droit interne de la responsabilité de la puissance publique », il est au contraire sous-tendu par l'idée qu'il serait possible de ramener le pluriel au singulier, la diversité à l'unité. Car le propre du droit commun, que l'on oppose habituellement aux droits spéciaux, c'est de s'appliquer par principe à l'ensemble des situations juridiques qu'il concerne à l'exception de celles pour lesquelles il en est expressément disposé autrement. Or, nul n'ignore que depuis l'arrête Blanco (Trib. Confl. 8 févr. 1873, Rec. 1 er suppl. p. 61 concl. David) systématisant avec éclat les apports de l'arrêt Rotschild (CE 6 déc. 1855, Rec. p. 707) « la responsabilité qui peut incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil pour les rapports de particulier à particulier » ; et l'arrêt ajoute que cette responsabilité « a ses règles spéciales... ». C'est donc sur une récusation sinon initiale du moins ancienne du droit civil de la responsabilité comme droit commun englobant la responsabilité des personnes publiques que celle-ci a été fondée, dans un contexte contentieux de concurrence entre les ordres de juridictions. Encore qu'une part non négligeable de cette responsabilité soit en réalité soumise au droit privé et à la compétence judiciaire (en ce sens, notamment R Drago, « Principes généraux de la responsabilité », Rép. Resp. puiss. publ. , Dalloz, n° 18 et s. ), ce qu'on appelle habituellement par commodité la responsabilité administrative pour désigner la responsabilité civile, c'est à dire pécuniaire, des collectivités publiques et de leurs agents, a ainsi été placée sous le signe du particularisme, et la doctrine a célébré longtemps à ce titre son autonomie foncière, même si elle est revenue aujourd'hui à une vision plus modérée et relativiste. Le droit commun dont il sera question c'est donc en réalité historiquement un droit spécial par rapport au droit civil/ droit commun.
2. Ceci posé, reste à envisager la possibilité que cette variété de responsabilité soit dans son ensemble soumise à un schéma unique qui en constituerait, dans des limites forcément plus étroites, le droit commun. Mais cette deuxième perspective se heurte immédiatement à un certain nombre d'objections, parce que même dans ce contexte plus étroit, la responsabilité publique est parcourue de lignes de fracture qui altèrent son unicité. C'est ainsi tout d'abord que l'on ne saurait négliger l'importance que revêt la distinction de la responsabilité extra-contractuelle et de la responsabilité contractuelle : leur caractère largement exclusifs l'une de l'autre et l'absorption de la première par la seconde (CE 22 déc. 1922 Lassus, RD publ. 19 23 p. 427 concl. Corneille ; également : CE 1er déc. 1978 Berezowski, D. 1978 p. 45 note L. Richer) font qu'il est difficile de les ramener l'une à l'autre pour les englober comme de simples variétés d'un ensemble unique. Alors même qu'elles opèrent toutes deux selon le schéma binaire classique responsabilité pour faute/sans faute, ce n'est pas sans raisons que la doctrine disjoint généralement leur examen pour rattacher la responsabilité contractuelle à l'étude des contrats, sans aller, comme c'est parfois le cas en droit privé, jusqu'à nier l'existence même d'une responsabilité contractuelle.
3- Un deuxième clivage, plus décisif encore, joue également un rôle perturbateur fort : c'est celui qui naît de l'opposition entre d'une part les régimes de responsabilité issus d'une intervention législative et d'autre part celui construit par le juge administratif dans la postérité de l'arrêt Blanco. Pour des raisons diverses dont a parfaitement rendu compte Mme BRECHON-MOULENES ( Les régimes législatifs de responsabilité publique, LGDJ 1974 et Rép. puiss. publ. Dalloz précité, V° Régimes législatifs spéciaux d'indemnisation relevant de la juridiction judiciaire), et qui tiennent essentiellement à la volonté conjoncturelle d'écarter la compétence de la juridiction administrative, d'élargir la responsabilité publique ou d'aménager la réparation, le législateur a en effet multiplié les dérogations à ce qui apparaît par contraste comme le droit commun de la responsabilité administrative. Et il arrive que le législateur renvoie lui même explicitement au droit commun pour les questions qu'il n'a pas déterminées : ainsi par exemple la loi du 8 juillet 1983 réformant le Code du service national écarte l'exclusivité du forfait de pension pour les appelés du contingent qui pourront espérer une réparation complémentaire « calculée selon les règles du droit commun ». Il y a là un nouveau paradoxe, puisqu'en droit civil le législateur est d'abord intervenu pour fixer le cadre général de la responsabilité que le juge a pour mission d'appliquer et qui constitue le droit commun de la matière, quitte à le compléter ici ou là par des lois spéciales. En droit administratif la perspective est inversée : en parallèle du Code civil, le législateur révolutionnaire n'a pas jeté les bases de la responsabilité publique. Duguit, l'avait déjà observé : « si l'on parcourt les constitutions et les lois françaises de l'époque révolutionnaire, si fortement imprégnées du concept de souveraineté et de la doctrine individualiste, on ne trouve pas un seul texte qui consacre la responsabilité de l'État » ( Traité de droit constitutionnel, tome 3 p. 462). Le droit civil/droit commun d'origine législative ayant été, comme on l'a vu, écarté par le Tribunal des conflits et le Conseil d'État, il ne restait plus à celui-ci qu'à inventer quasiment de toutes pièces ce qui devait devenir le droit commun de la responsabilité publique par opposition aux régimes spéciaux d'origine législative dont le nombre élevé mais la disparité n'a jamais menacé la cohérence. Ainsi, quand Raymond Odent dans son Cours de contentieux administratif (dernière édition 1976/1981 p. 1329 et s.), qui figure toujours en bonne place dans les bibliothèques des juridictions administratives, envisage « le droit commun de la responsabilité de la puissance publique », il entend présenter « l'oeuvre purement prétorienne de la jurisprudence » (p. 1351), par opposition aux « régimes spéciaux de réparation ».
4. Pour répondre à la question posée, on pourrait donc dire qu'au premier degré l'existence d'un droit commun de la responsabilité publique se comprend d'abord comme un renvoi aux règles ou aux principes généraux qui structurent la responsabilité publique en dehors de toute référence à « ces petites lopins, de formes et de couleurs différentes » qui selon le Doyen VEDEL figurent « les régimes législatifs de responsabilité publique » (préface à la thèse précitée de Mme BRECHON-MOULENES), lesquels s'opposent donc au « large espace d'un seul tenant » que forme ce droit commun (I).
5. Mais, si on réduit le champ de vision à la seule responsabilité publique d'origine prétorienne, de façon à scruter son contenu avec davantage de précision, au-delà des constantes que constituent le préjudice et le lien de causalité, l'attention se focalise naturellement sur l'importance qu'il faut porter aux variables, c'est à dire aux différents faits générateurs de responsabilité. Traditionnellement, comme en témoignent les propos de cet important auteur classique que fut Paul DUEZ, on considérait sans contestes que « la théorie de la faute du service public... constitue le droit commun de la matière de la responsabilité de la puissance publique » (in La responsabilité de la puissance ( en dehors du contrat ) , 2 e éd. 1938 p. 26). C'est la même conception qu'exprime aujourd'hui M. CHAPUS dans son manuel lorsqu'il écrit 60 ans plus tard qu' « en principe la responsabilité de la puissance publique est une responsabilité pour faute » ( Droit administratif général, tome 1, n° 1450, 13 e éd.). Au second degré, si l'on peut dire, c'est la faute du service public qui constitue ainsi le droit commun de la responsabilité publique, proposition dont il convient d'envisager les incidences (II).
I - LE DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITÉ AU PREMIER DEGRÉ : RÉGIME JURISPRUDENTIEL DE BASE ET RÉGIMES LÉGISLATIFS SPÉCIAUX
6. Ayant répudié l'anti-modèle que constituait le Code civil, au nom de la nécessité d'appliquer à la responsabilité publique des « règles spéciales », le juge administratif se condamnait lui même à inventer une nouvelle règle du jeu. Et c'est bien ce qu'il fit par touches successives pour aboutir à une construction d'ensemble, à une sorte de régime de base destiné à s'appliquer en l'absence de texte spécial. L'existence de tels textes, de plus en plus nombreux au fil du temps, a dans ce contexte toujours posé des problèmes de frontières ou de relations qui méritent d'être évoqués (A) et l'on doit aussi s'attarder un instant sur le processus de création de ce droit commun appelé à jouer en quelque sorte par défaut et en réalité à titre principal (B).
A - LES RELATIONS DU DROIT COMMUN ET DU DROIT SPÉCIAL : LA DIALECTIQUE DE LA LOI ET DU JUGE
7- L'intervention de la loi en matière de responsabilité publique était naturelle avant 1958 elle n'a rien d'étonnant depuis puisque en tant que responsabilité civile, cette responsabilité publique est évidemment rattachable « aux principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales » (art. 34 Constitution).
Ainsi en ont jugé le Conseil d'État CE ass. 7 déc. 1962 Association des forces motrices autonomes, Rec. p. 464 ; également CE ass. 5 juil. 1985 Confédération générale du travail, Rec. p. 217) et le Conseil constitutionnel (Décision n° 80-116 L du 24 oct. 1980 Rec. p. 68 et Décision n° 92-171 L du 17 déc. 1992, Rec. p. 123). Tout récemment, le Conseil d'État a été conduit, pour sauver la légalité du décret du 13 juillet 2000 « instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites », à considérer que ce décret n'entre pas dans le champ d'application de l'article 34 dès lors qu' « il ne modifie pas les conditions dans lesquelles les personnes qui s'y croient fondées peuvent engager des actions en responsabilité contre l'État » (CE sect. 6 avril 2001 M Pelletier et autres, req. n° 224945, AJDA 2001 p. 448 et Chr. M. Guyomar et P. Collin) et qu'il se contente de prévoir les conditions d'attribution d'une « prestation financière » dont la nature demeure ambiguë (voir en contrepoint les conclusions de S. AUSTRY qui proposait de contourner la difficulté en faisant reposer le décret sur le principe général de responsabilité de l'État du fait des crimes contre l'humanité, proposition que le Conseil n'a pas souhaité valider expressément). Il y a là une confirmation du caractère législatif des règles de la responsabilité publique de droit commun, que le Conseil avait déjà exprimé autrement dans un arrêt Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (CE 27 nov. 1985, Dr. adm. 1986 n° 62) en faisant référence aux « principes applicables en la matière en l'absence de disposition législative y dérogeant » (V. également a contrario CE sect. 12 juin 1981 CH de Lisieux, Rec, p. 262 concl. M. Moreau).
8- Vis à vis des lois édictant des dispositions spéciales intéressant la responsabilité publique, le juge administratif a eu une position finalement assez ambiguë ou en tout cas fluctuante. Rendant compte des rapports entre les solutions législatives et « le droit commun de la responsabilité administrative », DUEZ expliquait que « lorsqu'un texte, gouverne la responsabilité, le Conseil d'État veut éviter toute cause de friction avec le législateur : il estime que le domaine régi par la loi est définitivement soustrait à l'action de sa jurisprudence originale » (op. précité p. 275). Dans le même sens R. Odent écrivait que « toute disposition législative instituant un régime plus ou moins complet de réparation... est considérée comme réglant définitivement... la matière qui échappe alors au droit commun de la responsabilité de la puissance publique » (Cours précité p. 1336) Mais l'attitude du juge n'est peut être plus uniquement faite de « prudente réserve » (P. Duez, ibidem) à l'égard du Parlement, et plus près de nous Mme BRECHON-MOULENES a démontré que le juge administratif, dans l'interprétation de la volonté du législateur, s'emploie à la « sauvegarde des principes du droit public de la responsabilité publique » (Rép. Puiss. publ. Dalloz précitée n °36). On peut donner deux exemples récents de cette façon de faire.
9- Le premier exemple est tiré de l'application de la loi du 31 déc. 1991 créant un fonds d'indemnisation des victimes du virus du SIDA : s'est posée la question de la cohabitation possible entre cette procédure spéciale et les règles du droit commun de la responsabilité. Or le Conseil d'État, contrairement à l'attitude en parallèle de la Cour de cassation (Cass. civ. 26 janv. 1994 M. Bellet RFD adm. 1994 p. 572) a admis que l'offre du fonds ne rend pas irrecevable une action dirigée contre une collectivité publique (CE avis. 15 oct. 1993 consorts Jezequel et Vallée, RFD adm, 1994 p. 553 concl. P. Frydman). Confirmant ce point de vue, le Conseil a ainsi jugé dans un arrêt Rabotin « qu'en versant au requérant une indemnité en application de l'article 47 de la loi du 31 déc. 1991, le Fonds d'indemnisation n'a pas fait droit à la sommation de payer adressée par la victime à l'État, sur le fondement des règles de droit commun de la responsabilité » et a donc réservé la possibilité d'user de celle-ci (CE 24 mars 1995, req. n° 155234). Il faut noter que la loi du 23 déc. 2000 relative au financement de la sécurité sociale pour 2001 institue un régime comparable mais non pas identique au bénéfice des victimes de l'amiante ; son article 53 crée à cet effet un fonds spécialisé et prévoit cette fois expressément que « l'acceptation de l'offre du Fonds... vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute action juridictionnelle future en réparation du même préjudice », disposition que le Conseil constitutionnel a considéré ne pas porter atteinte au « droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen » (Décision n° 2000-43 7 DC du 19 déc. 2000 ; V. Chr. GUETTIER, « L'État face aux contaminations liées à l'amiante », AJDA 2001 p. 529). Le législateur a donc délibérément choisi d'écarter dans ce cas les ressources offertes par le droit commun.
10- Le deuxième exemple intéresse le forfait de pension. Le juge administratif a traditionnellement, et ce depuis le début du siècle dernier (CE 12 janv. 1906 Paillotin, Rec. p. 36) exclu la possibilité que les victimes des collectivités publiques qui disposent par ailleurs d'un régime législatif de pensions relevant des mêmes collectivités puissent leur réclamer le bénéfice du droit commun de la responsabilité. Et le juge est allé dans un premier temps, animé par un souci de protection des deniers publics, au-delà de la lettre des textes institutifs des régimes de pension. Au point que la loi elle même, dans un hommage au droit jurisprudentiel, ait admis s'agissant des appelés du contingent (art. 62 du Code du service national) que ceux-ci « puissent... obtenir de l'État, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi calculée selon les règles du droit commun ». Mais en dehors de cette exception, la règle restait que la possibilité d'attribution d'une pension suffit à écarter le jeu du droit commun (CE 22 oct. 1986 Mlle Joseph, Rec, T. p. 591). Cependant très récemment, le Conseil d'État a admis non de renverser sa jurisprudence mais de la faire évoluer pour admettre qu'un agent public soigné à la suite d'un accident de service dans un hôpital dépendant de son employeur puisse réclamer une indemnisation complémentaire de sa pension « selon les règles du droit commun » (CE sect. 15 déc. 2000 M. Castanet ; Mme Bernard, AJDA 2001 p. 158 Chr. M. Guyomar et P. Collin). Cette évolution est peut-être annonciatrice d'un revirement plus ample à venir ou d'une réforme législative, et illustre la liberté encadrée dont dispose le juge à l'égard du maniement du droit commun en regard du droit législatif spécial.
11- Il y a donc ainsi dans le déplacement conjoncturel des frontières du droit législatif et du droit jurisprudentiel une sorte de dialectique de la loi et du juge qui fait fluctuer le champ d'application du droit commun de la responsabilité, le juge tantôt s'abritant derrière la loi tantôt s'efforçant de la contourner à travers une stratégie d'évitement profitant aux victimes. La politique jurisprudentielle menée par le juge administratif à cet égard est à rapprocher du processus de création du droit commun.
B - LE PROCESSUS DE CRÉATION DU DROIT COMMUN
12- Il est à mettre en perspective avec la diversification des sources du droit de la responsabilité administrative (sur laquelle voir en dernier lieu J. Moreau, « L'évolution des sources du droit de la responsabilité administrative », Mél. Terré, 1999 p. 719) qui tend pourrait-on penser à placer le juge administratif en situation de concurrence et à réduire la liberté dont il dispose traditionnellement pour forger le droit commun de la responsabilité publique, mais en même temps à lui ouvrir de nouvelles pistes pour faire évoluer ce droit.
13- Longtemps le juge administratif a eu pour rival mais aussi comme principale référence le juge judiciaire, juge parallèle de la responsabilité privée sur la base de la loi et plus ou moins enclin à se faire juge de la responsabilité publique. Il était tout naturel à la fois de s'en inspirer et de s'en démarquer. Des travaux précieux, à commencer par la thèse de René Chapus ( Responsabilités publique et responsabilité privée. Les influences réciproques des jurisprudences administrative et judiciaire, LGDJ 1957) ont souligné l'existence d'influences réciproques et démontré que la première source d'inspiration du droit commun de la responsabilité publique a certainement été la responsabilité privée. Un seul exemple significatif - on sait bien qu'en matière de responsabilité des constructeurs de droit public le juge administratif applique les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil relatifs à la garantie décennale (jurisprudence CE ass. 2 févr. 1973 Trannoy, Rec. p. 95 concl. M. Rougevin-Baville). D'un autre côté, on sait aussi que le juge judiciaire a reconnu l'existence de « règles de droit public » qu'il applique parfois (Cass. civ. 23 nov. 1956 Trésor Public c/ Giry, RD publ. 1958.298 note M. Waline) et même de « principes régissant la responsabilité de la puissance publique » (Cass. civ. 10 juin 1986 consorts Pourcel, RFD adm. 1987. 92 note J. Buisson ; également Cass. civ. 30 janv. 1996 Morand c/ Agent judiciaire du Trésor, RFD adm. 1997.1301 note P. Bon), principes dont l'utilisation a suscité quelques « surprises » aux yeux des observateurs de droit public (P. Weil, « À propos de l'application par les tribunaux judiciaires des règles du droit public ou les surprises de la jurisprudence Giry », Mél. Eisenmann, 1975, p. 379). Aujourd'hui, saisi de questions similaires, chaque ordre de juridiction n'est nullement indifférent à ce qu'a jugé l'autre, ce qui induit des rapprochements, comme avec la jurisprudence sur l'obligation d'information des malades (CE sect. 5 janv. 2000 consorts Telle, AJDA 2000.13 7 Chr. M. Guyomar et P. Collin, Cass. l ère civ. 7 oct. 1998 Mme C c/ Clinique du Parc, JCP 1998, 11, 10179 concl. Jerry Sainte-Rose), ou une émulation qui n'est pas forcément saine (à propos de l'enfant-préjudice : CE sect. 14 févr. 1997 CHR de Nice c/ époux Quarez, Rec. p. 44 concl. V. Pécresse ; Cass. ass. plén. 17 nov. 2000 époux X, D. 2001 p. 332 note D. Mazeaud et p. 336 note P Jourdain).
14- Aujourd'hui aussi d'autres influences s'exercent, avec une effectivité variable. Celle du Conseil constitutionnel, relativement récente n'est pas la plus décisive. Sans aller jusqu'à poser, comme l'a fait le professeur Moreau que « les sources constitutionnelles du droit de la responsabilité administrative sont fort mineures » (art. précité p. 724 ; voir également T. Larzul, Juriscl Adm. Fasc. n° 1452), on constate que le Conseil s'est pour l'essentiel contenté de reprendre à son compte et de confirmer, en les hissant à la dignité constitutionnelle, des principes déjà bien ancrés dans la jurisprudence administrative. Ainsi a-t-il jugé, confirmant la jurisprudence Laruelle/Delville (CE ass. 28 juil. 1951 Rec. p. 464) que « l'État répond des fautes commises par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions » (Décision n° 82-162 DC des 19/20 juil. 1983, Rec. p. 49). De même a-t-il consacré la possibilité d'une « réparation sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité de tous devant les charges publiques » (Décision n° 89-254 DC du 4 juil. 1989, Rec. p. 46) que le Conseil d'État avait lui même utilisé de longue date pour justifier certaines solutions de responsabilité sans faute (notamment CE 30 nov. 1923 Couitéas, D. 1923. 3. 59 concl. Rivet). La jurisprudence constitutionnelle n'a pas en tout cas pour l'heure sur le terrain de la responsabilité publique représenté une contrainte forte pour le juge administratif Rappelons d'ailleurs qu'aux yeux du juge constitutionnel le juge administratif n'est même pas le juge obligé de la responsabilité publique (Décision n° 224 DC du 23 janv. 1987 Conseil de la concurrence, Rec. p. 8). Mais on peut considérer que par cet effet de confirmation, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a contribué à asseoir davantage le droit commun de la responsabilité publique.
15- Plus significative certainement est la pression qui découle de l'insertion du système juridique français dans un contexte international régional à double dimension, communautaire et européenne. Avec la première, le Conseil d'État a subi depuis 1991 l'influence de la Cour de justice des communautés européennes qui a fait du principe de responsabilité un élément fondamental de l'effectivité du droit communautaire (arrêts 19 nov. 1991 Francovitch et Bonifaci, AJDA 1992 p. 143 ; 5 mars 1996 Brasserie du Pêcheur, RFD adm. 1996 p. 583 note L. Dubouis ; 8 oct. 1996 Dillenhofer, AJDA 1997 p. 344). Antérieurement l'arrêt Alivar (CE ass. 23 mars 1984, RTD europ. 1984 p. 341 concl. R. Denoix de Saint Marc), retenant la responsabilité de l'État « sur le fondement de la responsabilité sans faute » pour préjudice anormal et spécial après que l'État français ait été condamné pour manquement par la Cour de justice, marquait la volonté du Conseil d'État de rester maître de sa jurisprudence sur la responsabilité publique, au prix d'une certaine perte de cohérence de celle-ci (voir la note de B. Genevois à l'AJDA 1984 p. 396). Un autre arrêt d'Assemblée intervenu le 28 févr. 1992 dans l'affaire Société Arizona Tobacco Products ( AJDA 1993 p. 210 concl. M. Laroque) est venu ensuite remettre sur ses pieds le droit commun de la responsabilité administrative qui tend à assimiler illégalité et faute. Mais demeure imparfaitement résolu le problème du statut de la responsabilité du fait des lois dans l'optique du respect du droit communautaire : à la traditionnelle responsabilité sans faute (CE ass. 14 janv. 1938 Société des produits laitiers La Fleurette, Rec, p. 25, D. 1938. 3. 41 concl. Roujou), bien plus théorique que réelle (par ex. CE 21 oct. 1998 Plan, RFD adm. 1998.565 note P. Bon), pourrait se substituer ou s'ajouter la responsabilité pour faute. Cela dût-il faire encore scandale aux yeux de certains, il n'est plus aberrant de considérer qu'une loi contraire à une norme internationale, qui plus est communautaire, est constitutive d'une faute : la Cour administrative d'appel de Paris (arrêt du 1er juil. 1992 Société Jacques Dangeville, Rec. p. 558 ; arrêt cassé pour des raisons procédurales par CE ass. 30 oct. 1996 Société Jacques Dangeville, RFD adm. 1997 p. 1056 concl. G. Goulard) a contourné le mot en évoquant « une situation illicite », mais annoncé une révision remarquable du droit commun de la responsabilité publique à laquelle le droit communautaire n'est pas étranger.
16- L'influence potentielle du système de la convention européenne des droits de l'homme sur le droit commun de la responsabilité publique (sur laquelle voir spécialement H. Muscat, Le droit français de la responsabilité publique face au droit européen, thèse Paris XI 1999) a été de son côté récemment illustrée par la jurisprudence Bitouzet (CE sect. 3 juil. 1998, AJDA 1998 p. 570 Chr. F. Raynaud et P. Fombeur) qui a permis au juge administratif de limiter les effets du principe de non indemnisation des servitudes administratives posé par l'article L. 160-5 du Code de l'urbanisme, en se livrant à une lecture constructive de ses dispositions en liaison avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH tel qu'interprété par la Cour européenne. L'arrêt pose que l'article L. 160-5 « ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où... ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ». On aperçoit dans ce cas de figure original que le droit commun resurgit en marge du droit législatif spécial grâce à l'interaction entre droit européen et droit français.
17- C'est donc la convergence de ces différents apports, leur intégration dans un ensemble cohérent qui constitue le droit commun de la responsabilité publique. Il n'est évidemment pas envisageable de rendre compte de l'intégralité de son contenu, car cela reviendrait à exposer l'ensemble des données intéressant le préjudice, le lien de causalité et la réparation. Mais il n'est pas impossible en revanche, en se consacrant aux seuls faits générateurs de responsabilité, de mettre en lumière ce qui est en quelque sorte le droit commun au second degré ou si l'on préfère le droit commun du droit commun, c'est à dire la faute du service public.
II - LE DROIT COMMUN AU SECOND DEGRÉ : LA FAUTE DU SERVICE PUBLIC.
18- Dans la structure de la responsabilité publique, la faute n'occupe peut être pas la place la plus spectaculaire. Les esprits sont plus facilement marqués par l'audace que manifeste apparemment l'utilisation de la responsabilité sans faute, et celle-ci, avec son domaine propre, appartient tout autant au droit commun jurisprudentiel (par ex. CE avis 20 févr. 1998 Société Études et constructions de sièges pour l'automobile, AJDA 1998 p. 1029 note I. Poirot-Mazères). Pourtant, la faute tient un rang singulier et central dans l'histoire de la responsabilité administrative. Aux lendemains immédiats de l'arrêt Blanco il n'est pas encore question de faute des personnes publiques pour les activités de puissance publique : dans son commentaire de l'arrêt Lepreux (CE 13 janv. 1899, S. 1900. III, 1 note Hauriou) Maurice Hauriou répudie la « théorie des fautes », trop marquée par ses origines civilistes et se prononce en faveur d'une « théorie de l'accident administratif » en liaison avec « l'égalité qui doit régner devant les charges publiques ou devant les services publics ». Mais à partir des arrêts Tomaso-Greco et Auxerrre (CE 10 févr. et 17 févr. 1905 S. 1905, III, 113), Hauriou va contribuer à dégager une théorie de la faute du service public, cette « locution digne d'attention » que l'on doit à Teissier dans ses conclusions sur l'arrêt Le Berre (CE 29 mai 1903, Rec. p. 414). Depuis, la doctrine a tiré de l'observation de la jurisprudence la conclusion que la faute du service public représente incontestablement le droit commun de la responsabilité publique (voir notamment la thèse de Mme Deguergue, Jurisprudence et doctrine dans l'élaboration du droit de la responsabilité administrative, LGDJ 1993). « Le poids de la faute dans la responsabilité administrative », pour reprendre le titre d'une étude suggestive de Mme Llorens-Fraysse parue en 1987 (in Droits n°°5 p. 65), demeure considérable et en tout cas dominant quantitativement et même, ce qui mérite davantage attention, qualitativement et qui justifie que l'on s'interroge sur les raisons de cette importance (A) avant de se demander si la faute constitue ou non un horizon indépassable (B).
A - LES RAISONS DU SUCCÈS DE LA FAUTE
1.
19- Historiquement, la faute du service public a d'abord permis de régler efficacement la question de l'imputabilité personnelle de la responsabilité dans le jeu des relations triangulaires entre la victime, l'agent et la collectivité publique dont il dépend. Le glissement progressif du fait de service à la faute de service qui s'effectue dans la première moitié du XXème siècle (schématiquement de l'arrêt Anguet de 1911 à l'arrêt Mimeur de 1949) permet d'effacer la responsabilité de l'agent derrière celle du service sans abandonner la compétence de la juridiction administrative et en adéquation avec ce que G Vedel a appelé « le climat même de notre Administration, centralisée et hiérarchisée, dans laquelle le fonctionnaire est considéré comme la pièce anonyme d'un mécanisme » (G. Vedel et P. Delvolvé, Droit administratif tome 1, 1992, p. 567). Ce schéma a ses mérites, mais aussi l'inconvénient sérieux d'une déresponsabilisation individuelle sur le terrain pécuniaire qui fait résurgence avec le développement de ce que Paul Ricoeur a appelé « une reculpabilisation des auteurs identifiés de dommages » sur le terrain pénal.
2.
20- La notion même de faute du service public a été récusée par une partie de la doctrine pour son anthropomorphisme et pour son caractère artificiel dés lors qu'il lui paraissait inacceptable qu'une personne morale puisse commettre des fautes (en dernier lieu R. Drago, Rép. Resp. puiss. publ. V° Responsabilité (principes généraux de la), Dalloz 1999). Cette doctrine s'est refusée à y voir un fondement possible de la responsabilité publique et l'a réduite à l'état de simple condition de la responsabilité (en ce sens les écrits de M. Waline et Ch. Eisenmann ). Pourtant, ainsi qu'a pu l'écrire René Chapus, « une telle responsabilité est... celle dont le fondement est le moins susceptible de contestation. Sa justification est aussi naturelle que possible : rien n'est plus normal qu'on soit responsable des conséquences de ses propres fautes ou des fautes commises par les personnes dont on doit répondre » (in Droit administratif général 1, n° 1450, Montchrestien 13 ème éd.). Et l'on peut rappeler que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 octobre 1982 (Décision n° 82-144 DC, D. 1983, p, 189 note F. Luchaire) a considéré que « nul n'ayant le droit de nuire à autrui, en principe tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », même si cette décision intéresse la responsabilité des personnes privées (Voir également la décision n° 99-419 DC du 9 nov. 1999, RDP 2000 p. 203 note Ph. Blachère et J. B. Seube). La définition de la faute du service public a été originellement centrée sur « le fonctionnement à faux » du service public, elle oscille aujourd'hui entre deux pôles : soit elle est présentée comme la violation d'une obligation administrative, soit comme l'atteinte aux droits des administrés. Cette variété particulière de faute a en tout cas ceci de commun avec la faute civiliste qu'elle suppose un jugement de valeur parce qu'elle est appréhendée comme « une violation réprouvée de la norme » selon la formule de l'auteur récente d'une thèse consacrée à un Essai d'une théorie générale de la responsabilité en droit administratif M. Sébastien GOUHIER (thèse Le Mans 2000 p. 324).
3.
21- Cette conception principalement objective et concrète de la faute du service public a permis sa très grande adaptabilité à l'évolution des missions administratives : il n'est pratiquement pas d'activité des personnes publiques qui échappe à son emprise, et la référence à la « faute de nature à engager la responsabilité » permet au juge administratif d'apprécier avec réalisme mais sans indulgence superflue la marche de la machine administrative, en découvrant si besoin est ce que Mme Lochak a appelé « de nouveaux gisements de fautes » (« Réflexion sur les fonctions sociales de la responsabilité administrative à la lumière des récents développements de la jurisprudence et de la législation », in Le droit administratif en mouvement, PUF/CURAPP, 1993). Les modulations que permettait le recours à la gradation des fautes ont joué dans le même sens et apporté au juge (et à l'administration) une marge de manoeuvre supplémentaire. Le recul assez rapide et spectaculaire de l'exigence de faute lourde depuis une petite dizaine d'années, avec cependant quelques rares points de résistance comme celui récemment marqué en matière de contrôle de légalité (CE sect. 21 juin 2000 ministre de l'Équipement c/ crie de Roquebrune Cap Martin, RDP 2000 p. 1257 concl. L. Touvet, CE 6 oct. 2000 ministre de l'intérieur c/ crie de Saint-Florent, AJDA 2001 p. 201 note M. Cliquennois), va dans le sens d'une certaine banalisation de la faute du service public. On ne doit pas s'en offusquer, mais comprendre que le juge, selon la formule du commissaire du Gouvernement Hubert Légal, « ne peut être indifférent à l'évolution de la sensibilité de ses concitoyens » (concl. Sur CE Ass. 10 avr. 1992, M et Mme V, AJDA 1992 p. 360) aux yeux desquels la faute lourde était devenue un privilège inacceptable de l'administration. Ce n'est pas pour autant que le juge soit dépourvu de toute marge de manoeuvre dans l'appréciation de la faute, puisqu'il lui appartient d'apprécier à la fois le contenu des obligations administratives, qui sont loin d'être entièrement déterminées par des textes, et les conditions dans lesquelles l'intervention administrative a produit le dommage.
4.
22- La raréfaction de la faute lourde permet ainsi d'atténuer la critique sous- jacente à toute responsabilité pour faute, à savoir que l'exigence correspondante sert à protéger les deniers publics (ce qui n'est pas complètement illégitime) et constitue un frein illégitime à une prise en compte satisfaisante du sort des victimes, d'autant que le poids de la preuve de la faute repose en principe sur celui qui l'invoque. Mais on sait aussi qu'outre l'existence de présomptions de faute, particulièrement développées lorsque la preuve est particulièrement difficile à rapporter comme en matière de responsabilité hospitalière ou de travaux publics (Voir spécialement la thèse de Mme Llorens-Fraysse, La présomption de faute dans le contentieux administratif de la responsabilité, LGDJ 1985) le juge administratif sait d'une manière plus générale répartir la charge de la preuve d'une façon équilibrée (Voir B. Pacteau, Rép. Cont. Adm. V° Preuve, Dalloz 1995). Cependant il est bien vrai qu'en contrepoint la responsabilité sans faute a des allures plus généreuses et peut se parer du manteau élégant de la solidarité, et on peut donc s'interroger sur le point de savoir si la faute du service public est destinée à demeurer un horizon indépassable.
B - LA FAUTE CONSTITUE-T-ELLE UN HORIZON INDÉPASSABLE ?
23- On a pu récemment en droit privé rappeler « l'impossible divorce de la faute et de la responsabilité civile » (C. Radé, D. 1998 Chr. p. 301). Observant de son côté l'évolution du droit commun de la responsabilité publique, la doctrine administrativiste (Voir spécialement C. Debouy, « Le droit français de la responsabilité administrative : métamorphose ou permanence ? », CJEG 1997 p. 327) relève avec des sentiments mélangés mais généralement favorables les progrès de la responsabilité sans faute. Un seul exemple suffira à cet égard, celui de la responsabilité hospitalière : alors que la faute y était encore il y a moins de 10 ans inexpugnable, depuis 1990 plusieurs décisions remarquées ont mis fin à l'ostracisme frappant la responsabilité sans faute (CAA Lyon 21 déc. 1990 Gomez, JCP 1993 11, 21698 note J. Moreau ; CE ass. 3 avr. 1993 Bianchi, Rec. p. 127 concl. S. Daël ; CE 26 mai 1995, N'Guyen 1 Pavan et Jouan, RFD adm. 1995.748 concl. S. Daël). Cela n'empêche pas Gilles Darcy d'évoquer en la matière « le rêve indicible d'une responsabilité dénuée de faute » (in « La responsabilité des établissements publics hospitaliers », Petites affiches 22 sept. 1999) pour signifier que la dispense de faute n'a qu'un rôle subsidiaire.
1.
24- Il est dans ces conditions assez paradoxal que d'un point de vue procédural la responsabilité pour faute ne soit pas considérée comme étant un moyen d'ordre public (CE 4 nov. 1970 sieur Boyer, AJDA 1971 p. 305; CE 7 nov. 1969 Dame veuve Agussol, Rec. p. 482 ; CE 18 nov. 1988 Dlle Coirier, AJDA 1989 p. 141) alors qu'à l'inverse la responsabilité sans faute l'est (CE 28 mars 1918 Regnault-Desroziers, RDP 1919 concl. Corneille ; CE ass. 10 févr. 1961 consorts Chauche, Rec. p. 108 ; CE sect. 29 nov. 1974 Époux Gevrey, Rec. p. 599 concl. Bertrand ). Car, dès lors que les moyens d'ordre public sont considérés comme « déterminés jurisprudentiellement en fonction de l'importance attachée à la censure de certains comportements » (R. Chapus, Droit du contentieux administratif, 8ème éd. n° 932 ; dans le même sens R. Odent disait du moyen d'ordre public que « c'est l'importance de cette question qui légitime son examen d'office », Cours précité p. 1205 ; voir également : J Moreau, « La cause de la demande en justice dans le contentieux de la responsabilité administratif de la responsabilité extracontractuelle », Mél. Stassinopoulos, 1974 p. 77 ; F. Colly, « Aspects de la notion de cause juridique de la demande dans le contentieux administratif de pleine juridiction », RFD adm. 1987 p. 786), on peut se demander la raison d'être d'une situation contentieuse qui défie la logique (que Mme Deguergue a récemment proposé d'inverser : note sous CE 27 oct. 2000 CH de Seclin, AJDA 2001 p. 307). Plusieurs explications sont possibles : on peut penser avec C. Debouy (in Les moyens d'ordre public dans la procédure administrative contentieuse, PUF 1980) que la responsabilité sans faute étant une responsabilité d'équité, il est logique qu'au cas où il relève l'existence d'un préjudice anormal le juge puisse engager de lui même la responsabilité sans faute ; on peut aussi avancer l'idée que la charge de la preuve pesant naturellement sur le requérant qui l'invoque, il n'appartient pas au juge de se substituer à lui (en ce sens M. Deguergue, note précitée) ; on peut enfin considérer que le juge ne se croit pas en droit de critiquer de lui même l'administration (dont il reste proche) à travers l'admission spontanée de la faute, alors qu'aucune prévention de ce genre ne le freine s'agissant d'une responsabilité n'impliquant aucun jugement de valeur. Il faut noter de toutes façons que le fait que la responsabilité pour faute n'ait pas un caractère d'ordre public permet à la victime de revenir ultérieurement devant le même juge sans se heurter à l'autorité de la chose jugée, et donc de faire triompher le droit commun, alors qu'il en va différemment avec la responsabilité sans faute qui est supposée avoir été implicitement envisagée (arrêt Gevrey précité ; CE 18 nov. 1995 époux Sauvi, Rec. p. 503).
25- Quoiqu'il en soit sur le terrain procédural, la faute du service public dont on célèbre périodiquement le déclin puis la résistance voire le renouveau, conserve un rôle central qui à notre sens ne doit pas disparaître, spécialement dans l'optique du développement d'un droit commun de la responsabilité.
2.
26- La responsabilité pour faute est en effet celle qui possède la plus grande capacité à remplir une gamme étendue de fonctions. Avec la fonction réparatrice, la reconnaissance de la faute du service public permet tout d'abord à la victime que soit réparé le préjudice subi, sans qu'aucun argument patrimonial tiré du désir de protéger les deniers publics puisse justifier une minoration de l'indemnité. De ce point de vue d'ailleurs, la responsabilité pour faute est supérieure aux formes de responsabilité sans faute qui supposent que soit seulement réparé le préjudice dépassant un certain seuil (préjudice excédant les inconvénients de voisinage préjudice anormal et spécial).
27- Elle assure également une fonction qui n'appartient qu'à elle, la fonction sanctionnatrice. L'idée d'une telle fonction a longtemps été rejetée par la doctrine, notamment par Charles Eisenmann (« Sur le degré d'originalité du régime de la responsabilité extra-contractuelle des personnes publiques », JCP 1949, I, 742 et 751). Mais aujourd'hui, elle est mieux acceptée, et l'admission partielle d'une responsabilité pénale des personnes publiques ne peut que contribuer à cette acceptation. Christophe GUETTIER a fait observer à juste titre que la stigmatisation des comportements fautifs de l'administration passe par la réduction des cas d'impunité à laquelle correspond le développement de nouvelles hypothèses de fautes et par la condamnation dans certains cas au paiement de dommages et intérêts symboliques (in La responsabilité administrative, LGDJ 1996, p. 176 et s.). Il s'agit là d'une fonction d'autant plus importante que dans le contexte actuel les victime réclament non seulement une réparation pécuniaire mais aussi cette stigmatisation du responsable, fut-elle symbolique et d'essence plus psychologique que réelle.
28- La fonction de contrôle n'est pas moins importante : elle implique d'une part que le juge puisse, sur un terrain complémentaire de la légalité, s'assurer des limites de l'action administrative qu'il contribue ainsi à fixer, mais aussi d'autre part que par une rétroaction naturelle, la condamnation d'un comportement critiquable incite le responsable à éviter sa réédition. Autrement dit, la fonction de contrôle s'accompagne d'une fonction essentielle de prévention, justement destinée à responsabiliser les auteurs potentiels de dommages. En ce sens Maurice Hauriou en 1905 remarquait que « la théorie des risques a un côté immoral, en ce qu'elle présente les accidents comme étant des conséquences inévitables de l'entreprise : à ce point de vue elle est très inférieure à la théorie de la faute, qui les présente au contraire comme étant des conséquences évitables » (note sous CE 10 et 17 févr. 1905 Tomaso Gréco et Auxerre, S. 1905, III, 113). Les interrogations actuelles sur les effets potentiels du principe de précaution s'inscrivent dans cette perspective. Plusieurs auteurs spécialistes de droit de l'environnement, particulièrement Mme Martine REMOND-GOUILLOUD et M. Gilles MARTIN considèrent que par l'appel à « une éthique de la prudence » (M. REMOND-GOUILLOUD, « Le risque de l'incertain, : la responsabilité face aux avancées de la science », La vie des sciences, comptes rendus, série générale, t. 10, 1993 n° 4 p. 431), le développement du principe pourrait amener la consécration d'une faute « renouvelée et élargie » avec « la mise au premier plan de la fonction de moralisation des comportements sociaux » (G. MARTIN, « Principe de précaution et responsabilités », in Les transformations de la régulation juridique, LGDJ 1998, p. 419) qui vaudrait aussi bien pour la responsabilité publique que pour la responsabilité privée. Mais il ne s'agit là que d'une anticipation. On peut relever cependant dans ce sens que le Conseil d'État avec un arrêt Boudin (CE 30 juil. 1997, D. 1999, IR p. 59 obs. p. Bon et D. de Béchillon) a admis à propos de mesures ministérielles ayant pour objet de mettre en garde le public contre des produits dont la consommation présente un risque grave pour la santé que « de telles mesures, eu égard à l'objectif de protection de la santé publique qu'elles poursuivent, ne peuvent ouvrir droit à indemnisation que si elles sont constitutives d'une faute » (Voir également et dans un sens différent : A. Rouyère, « L'exigence de précaution saisie par le juge. Réflexions inspirées par quelques arrêts récents du Conseil d'État », RFD adm. 2000 p. 266).
3.
29- La faute du service public, participant du langage universel de l'illicite, conserve ainsi un bel avenir devant elle au sein d'un droit jurisprudentiel qui demeure le droit commun de la responsabilité publique. Les dimensions de celui-ci sont appelées à s'étendre aujourd'hui aux frontières de la communauté de droit, comme en témoigne l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne récemment adoptée à Nice qui déclare que « toute personne a droit à la réparation par la Communauté des dommages causés par les institutions ou leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres ». Mais en parallèle de cet effort de construction d'un espace juridique unifié de la responsabilité se multiplient aussi des régimes d'indemnisation qui entendent faire endosser par des mécanismes collectifs partiellement ou totalement publics tout ou partie de la charge découlant de malheurs privés (Voir M. Sousse, « La responsabilité administrative entre régulation et réglementation », in Les transformations ... précité p. 359). C'est ainsi la responsabilité entendue comme l'obligation de répondre ou au moins de réparer qui se trouve concurrencée ou remplacée par des mécanismes qui tendent à compenser et à soulager, faisant perdre à la responsabilité son rôle de procédé d'indemnisation de droit commun. Mais c'est là une autre évolution.
Monsieur le Doyen Georges VEDEL
Merci beaucoup mon cher collègue. Je ne pense pas que les organisateurs de cette rencontre aient voulu tendre un piège. Pourtant, la question qui vous était posée paraissait impliquer quelque chose comme cela. Mais vous vous en êtes magnifiquement tiré : vous avez répondu à la question posée - vous n'avez pas répondu par un oui ou par un non - mais vous avez répondu par une formule très circonstanciée et nous en tirons certainement beaucoup plus de clarté.
Il faut dire que cette période dans les cinquante dernières années, si vous voulez le demi-siècle qui a précédé, a été évidemment une grande période de mise au point du droit de la responsabilité, à la fois par le perfectionnement interne de la jurisprudence, spécialement celle du Conseil d'État, et le développement de techniques qui ont posé des problèmes nouveaux. Je me rappelle que la carrière d'un professeur de droit qui dirige des thèse était jalonnée justement de temps en temps par de très belles thèses qui apparaissaient et qui à la distance - tout en leur gardant la sympathie qu'elle méritait et qu'elle mérite toujours - témoignaient essentiellement d'un refus très sage de vouloir faire du simplisme en matière de droit de la responsabilité et en matière de droit d'une façon générale. Je vois encore Madame BRECHON-MOULENES qui se trouvait en présence du problème d'essayer de tirer quelque chose de l'abondance des régimes législatifs particuliers en matière de responsabilité et qui très honnêtement, loyalement, disait : il y a cette classification, elle est jolie, elle tient bien, mais ce n'est pas comme cela. Le réel était fragmenté, le réel n'était pas rationnel. Et je vois encore Pierre DELVOLVE, l'autre thèse à peu près de la même époque, qui se trouvait aux prises avec le principe d'égalité devant les charges publiques et qui avait la tentation - fréquente à l'époque - de dire : mais l'égalité devant les charges publiques est une notion de droit constitutionnel et l'emporterait sur toute autre forme de réparation fondée sur un simple principe civiliste ou administrativiste, qui aurait été la faute. Pas du tout : il y avait deux responsabilités qui ne s'ajustaient pas parfaitement l'une l'autre et il fallait les prendre telles qu'elles étaient. Et je crois que leur président de thèse, qui quelquefois, voulant un peu que l'on avance, suggérait des explications un peu synthétiques, un peu plus élevées, à ce moment se rappelait ce que son président de thèse lui avait dit un jour (et qui était bien mérité) dans une très vaste synthèse qui était tentée - il y avait quelques lacunes - et le président de thèse en question - oh je peux le dire c'était notre cher Robert CHARLIER - avait dit : Monsieur, songez à ceci : c'est que vous résumez admirablement tout d'une façon très rapide, mais si on monte assez haut on confond tout.
Et je sais que dans ce développement où on a mis en cause non naturellement pas les auteurs de thèse mais les auteurs et surtout le juge et même le législateur, dans un très grand nombre de cas, tout s'est fait d'un pas qui n'était peut être pas très rationnel mais qui finalement nous a doté d'un système de responsabilité supportable. Ceci dit, je ne dis pas qu'il n'y ait pas des progrès à faire, mais enfin peut être le temps est-il prématuré.
Y a t-il une "subsidiarisation" dans le droit de la responsabilité administrative ?
par Madame Maryse DEGUERGUE,
professeur à l'Université Paris 1
Dès l'abord, nous devons confesser une crainte : celle de devoir réfléchir sur un barbarisme, dont les guillemets de l'intitulé du sujet semblent attester.... Le bon usage de la langue française eût sans doute imposé de limiter la réflexion à la subsidiarité de la responsabilité administrative. Aussi convient-il de déterminer d'abord les sens de la subsidiarité avant de tenter de saisir celui de la subsidiarisation. Pour ce faire, il faut remarquer en premier lieu que le substantif "subsidiarité" est moins utilisé que l'adjectif "subsidiaire" et que l'adverbe "subsidiairement". C'est sans doute que l'essence est moins accessible que les sens, les significations.
L'étymologie latine explique parfaitement les deux sens actuels de l'adjectif "subsidiaire" :
- "subsidium" en latin désignait un impôt, une aide financière que le peuple payait pour subvenir aux besoins occasionnels de l'État. "Subsidium" a donné d'une part le substantif "subside" qu'aujourd'hui, par un curieux retournement de tendance, l'État donne aux plus démunis et d'autre part l'adjectif "subsidiaire", doté de deux sens.
- "subsidiaire" désigne la qualité de ce qui est secondaire et s'oppose ainsi à principal, mais il exprime aussi l'idée de complément, de supplément, de renfort pour pallier une insuffisance 1 ( * ) .
En droit, il est remarquable que ces deux sens de l'adjectif "subsidiaire" peuvent, soit se rejoindre, soit paradoxalement s'opposer.
En effet, une compétence subsidiaire est à la fois secondaire et complémentaire. En procédure, la production d'un moyen ou de conclusions subsidiaires revêt aussi ces deux significations.
En revanche, le passage du qualificatif "subsidiaire" au substantif "subsidiarité" montre que les deux sens peuvent s'opposer, notamment lorsque la subsidiarité est érigée en principe. De fait, comme principe, la subsidiarité n'est pas secondaire, elle est au contraire primaire, fondatrice de l'agencement des rapports sociaux.
ainsi, dans un État démocratique, le principe de subsidiarité laisse aux individus et aux groupes une sphère de liberté principale par rapport à la puissance étatique.
- de même, dans un État fédéral, le principe de subsidiarité est premier et laisse aux États membres des sphères de compétences en propre qu'ils n'exercent pas secondairement 1 ( * ) .
- enfin, dans le cadre de l'Union européenne, le principe de subsidiarité 2 ( * ) n'est pas seulement une clé de répartition technique des compétences partagées entre la Communauté et les États membres. C'est surtout un principe fondateur qui réserve une part nécessaire de souveraineté à ces derniers, sans laquelle leur consentement n'aurait peut-être pas été donné 3 ( * ) .
Ces trop longues explications sur la subsidiarité permettent néanmoins de mieux comprendre toute l'ambiguïté de la "subsidiarisation". Deux particularités semblent la caractériser : d'abord, "la subsidiarisation" semble désigner l'évolution de quelque chose qui tend à devenir subsidiaire ; ensuite, c'est un phénomène qui se mesure en termes d'influence entre deux corps de règles et qui tend à révéler un rapport de domination et d'infériorisation. Il apparaît donc que, d'essence "doctrinale" 4 ( * ) le principe de subsidiarité est ontologique, alors que la subsidiarisation relève plutôt de la phénoménologie.
Or, réfléchir à la subsidiarité dans le droit de la responsabilité administrative aurait conduit à rappeler des règles bien connues et d'ailleurs peu nombreuses, à savoir que la responsabilité de l'administration est subsidiaire, en cas de défaillance d'un entrepreneur de travaux publics ou d'un concessionnaire dans la réparation des dommages qu'il a causés, règle étendue à tous les organismes privés chargés d'un service public et qui se révèlent insolvables 5 ( * ) .
Mais poser la question de savoir s'il y a une subsidiarisation dans le droit de la responsabilité administrative laisse poindre un double sentiment de crainte, relatif à la stabilité des normes de la responsabilité administrative, entendue ici comme la responsabilité applicable à l'administration et appliquée essentiellement par le juge administratif 6 ( * ) . La première crainte est d'ordre historique et récurrente dans le débat droit public-droit privé : la responsabilité des personnes publiques ne serait-elle plus administrative que subsidiairement ? Autrement dit, cette responsabilité, longtemps assimilée à celle de la puissance publique, tend-elle à être investie par d'autres règles que celles découlant des arrêts fondateurs Blanco et Pelletier ? La seconde crainte est d'ordre politique, intéressant l'équilibre que le juge administratif s'est efforcé de maintenir entre les intérêts en présence et par conséquent entre les différents régimes de responsabilité, plus ou moins protecteurs des victimes et des personnes publiques débitrices. Cette dernière crainte conduit à poser la question de savoir s'il y aurait, dans le droit actuel de la responsabilité administrative, une ou plusieurs notions ou catégories dominantes qui tendraient à la subsidiarisation des autres.
Ces deux craintes exigent d'élargir quelque peu le sujet, car elles conduisent à envisager d'abord la subsidiarisation de la responsabilité administrative avant d'étudier la subsidiarisation dans la responsabilité administrative, cette dernière question n'étant concevable que si est établie préalablement l'absence de subsidiarisation du corps de règles que constitue la responsabilité administrative.
I- SUR LA SUBSIDIARISATION DU DROIT DE LA RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE
L'éventualité de la subsidiarisation de la responsabilité administrative se pose légitimement depuis que le Conseil constitutionnel a garanti constitutionnellement au juge administratif le contentieux de l'annulation et de la réformation des actes administratifs, mais pas le contentieux de la responsabilité administrative 1 ( * ) . Une épée de Damoclès est donc suspendue au-dessus de l'oeuvre prétorienne du juge administratif dans le domaine de la responsabilité des personnes publiques : le législateur pourrait transférer, sans méconnaître aucun principe de valeur constitutionnelle, des pans entiers de cette responsabilité au juge judiciaire, lequel soumettrait les personnes publiques à une responsabilité privée, à l'instar des régimes législatifs relatifs à la réparation des dommages causés par les véhicules ou des accidents scolaires. Par ailleurs, confronté depuis deux décennies à une nouvelle catégorie de risques collectifs ou sériels, et non plus individuels comme par le passé, le juge administratif a déjà laissé le législateur mettre en place un système de garantie de ces risques, faisant jouer les mécanismes de la solidarité plutôt que ceux de la responsabilité administrative.
Dès lors la subsidiarisation de la responsabilité administrative peut revêtir, sous l'action du législateur, deux modalités différentes, qui ne sont d'ailleurs pas exclusives l'une de l'autre : l'extension de la responsabilité privée et la restriction de la responsabilité administrative au profit de la garantie.
A- LA SUBSIDIARISATION PAR EXTENSION DE LA RESPONSABILITÉ PRIVÉE
Comme on le sait, le législateur a largement dérogé dans le passé au principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, simplement inscrit dans des textes révolutionnaires à portée législative. Les lois du 5 avril 1937 et du 31 décembre 1957 sont emblématiques de la subsidiarisation de la responsabilité administrative, en ce que celle-ci est secondaire et complémentaire par rapport à la responsabilité privée, lorsque la cause déterminante d'un dommage ne se trouve ni dans la faute d'un enseignant, ni dans le fait d'un véhicule quelconque.
Y a-t-il aujourd'hui un risque de subsidiarisation comparable sous l'effet de régimes législatifs de responsabilité qui prévoiraient la compétence judiciaire et, plus ou moins explicitement, l'application des règles de la responsabilité privée ? Nous ne le pensons pas pour trois raisons essentielles :
- premièrement, dans une stratégie de protection de sa compétence juridictionnelle, le juge administratif réduit le plus possible les divergences jurisprudentielles avec la juridiction judiciaire, afin d'assurer l'égalité de traitement des victimes et de ne pas provoquer une réaction du législateur qui viendrait rétablir une égalité rompue, comme il l'a fait en 1957 au profit des victimes d'accidents causés par des véhicules.
Ainsi, l'adoption du régime de la présomption de faute de la personne publique, qui a la garde d'un pupille de l'Assistance publique ou d'un mineur faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative 1 ( * ) , s'explique par la volonté du juge administratif de ne pas créer de disparité avec les solutions admises par les juridictions judiciaires sur le fondement de l'article 1384 - qui vont même, elles, jusqu'à la présomption de responsabilité. La même volonté d'alignement de la jurisprudence administrative sur la jurisprudence judiciaire explique aussi que récemment le Conseil d'État ait enfin accepté la transmission aux héritiers du droit à réparation de tous les dommages, même de ceux attachés à la personne du défunt, et ait assoupli la règle draconienne du forfait de pension applicable aux fonctionnaires, dès lors que les conséquences dommageables d'un accident du travail ont été amplifiées par une faute ultérieure de la personne publique employeur 2 ( * ) .
- deuxièmement, le souci de préserver son pouvoir normatif pousse le juge administratif à innover avant le législateur, d'autant plus facilement qu'il est saisi de cas particuliers. Or, cette capacité d'innovation semble être le meilleur rempart contre un transfert de compétence juridictionnelle et une subsidiarisation de la responsabilité administrative. À preuve, la consécration par le Conseil d'État du risque thérapeutique dès 1993, lequel suscite actuellement la discussion d'un projet de loi devant le Parlement, uniquement pour faire pièce à la résistance de la Cour de cassation qui refuse de consacrer cette nouvelle hypothèse de risque 1 ( * ) et qui, de ce fait, malmène l'égalité de traitement des victimes d'un dommage identique, qu'il soit subi à l'hôpital public ou dans une clinique privée. Dans le même ordre d'idées, le juge administratif admet implicitement l'existence d'un risque de développement, susceptible d'apparaître dans l'avenir à la faveur des avancées de la connaissance scientifique, lorsqu'il se réfère aux " mesures de précaution qui s'imposent en matière de protection de la santé publique " 2 ( * ) , hors du domaine de l'environnement où la loi consacre expressément le principe de précaution.
- la troisième raison pour laquelle la subsidiarisation de la responsabilité administrative par l'extension de la responsabilité privée nous paraît peu probable tient à l'attitude des juridictions judiciaires elles-mêmes.
En effet, elles considèrent les règles de la responsabilité administrative comme "des règles du droit public" suffisamment générales pour devoir être appliquées pour combler les lacunes du droit civil en matière de responsabilité des services publics judiciaires. Certes, la fameuse jurisprudence Giry peut être interprétée comme appliquant "subsidiairement" le droit, de la responsabilité administrative. Cependant, ses prolongements tendent plutôt à prouver que les juridictions judiciaires perçoivent les règles de la responsabilité administrative qu'elles appliquent comme fondées sur "les principes régissant la responsabilité de la puissance publique et notamment le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques" 3 ( * ) .
Or, des principes ne peuvent être subsidiaires ou frappés de subsidiarisation, car ce qui est premier et principal ne peut pas être secondaire.
De fait, et en dehors même de la responsabilité du service public judiciaire, les juridictions judiciaires ont été amenées à appliquer tous les concepts du droit de la responsabilité administrative : la distinction entre la faute personnelle et la faute de service, la responsabilité pour risque, la théorie du cumul des responsabilités et l'indemnisation sans faute des préjudices anormaux et spéciaux 4 ( * ) . L'ordre judiciaire lui-même ne conçoit donc pas - ou ne conçoit plus- la subsidiarisation de la responsabilité administrative, sans doute parce que le caractère dérogatoire au droit commun qu'on se plaisait à lui reconnaître est largement dépassé.
Cependant, la pénalisation de la société et des relations administratives pourrait faire penser que la recherche de la responsabilité pénale des personnes publiques, de leurs agents et des élus renvoie la responsabilité civile de ceux-ci dans le giron des juridictions judiciaires. Malgré la réalité et l'ampleur de la banalisation de la responsabilité pénale, il ne semble pas qu'elle tende à subsidiariser la responsabilité administrative. En effet, il convient de rappeler qu'en ce qui concerne les personnes morales de droit public, la responsabilité pénale de l'État est exclue et celle des collectivités locales réduite essentiellement à la passation des marchés publics et des délégations de service publics, domaines où la responsabilité administrative quasi-délictuelle est embryonnaire, sauf, pour le candidat au contrat avec l'administration, à plaider la perte de chance d'obtenir le marché 1 ( * ) . En ce qui concerne les personnes physiques, la mise en cause de leur responsabilité pénale, d'ailleurs fortement réduite par le vote de deux lois successives 2 ( * ) , recouvre les hypothèses de fautes d'imprudence ou de négligence particulièrement lourdes, traditionnellement qualifiées de personnelles, ce qui constitue déjà en soi un chef de compétence judiciaire. Néanmoins, il ne faut pas exclure qu'une conception restrictive de la faute personnelle excluant la faute lourde (voir infra) tende à préserver la compétence administrative, qui serait alors court-circuitée par l'action pénale devant le juge judiciaire. Quoi qu'il en soit, du seul point de vue de la réparation pécuniaire des dommages, la perspective de disposer d'un débiteur solvable incitera toujours les victimes à attraire la personne morale publique devant les tribunaux administratifs, si bien que le mouvement de pénalisation ne devrait pas s'accompagner d'une subsidiarisation de la responsabilité administrative.
La subsidiarisation de la responsabilité administrative par extension de la responsabilité privée étant écartée, peut-on craindre cette évolution par restriction de la responsabilité administrative au profit de la garantie ?
B - LA SUBSIDIARISATION PAR RESTRICTION DE LA RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE AU PROFIT DE LA GARANTIE
La doctrine a parfaitement expliqué que, dès lors que l'indemnisation d'un préjudice peut être obtenue d'un payeur toujours solvable, abstraction faite de l'idée de causalité et d'imputabilité du dommage à son auteur réel, la responsabilité - qui signifie originairement répondre de ses actes - s'efface au profit de l'idée de garantie des risques 1 ( * ) .
Le fondement de cette garantie peut être trouvé dans l'ancienne idée de socialisation des risques, relayée depuis 1946 par la solidarité qui n'est d'ailleurs pas nationale, comme l'indique le Préambule, mais sociale, c'est-à-dire étendue aux étrangers vivant sur le territoire français. Quant au financement de cette garantie, il reflète parfaitement l'idée de solidarité concrétisée par l'institution de fonds d'indemnisation 2 ( * ) , abondes par l'assurance ou le budget de l'État ou par une combinaison de ces deux sources, et qui sont chargés, aujourd'hui de l'indemnisation des victimes d'attentats, d'infractions pénales ou de contaminations transfusionnelles, peut-être demain de l'indemnisation de l'aléa thérapeutique.
Cette technique des fonds d'indemnisation pose précisément la question de la subsidiarité et de la subsidiarisation. Ainsi, le Fonds de garantie automobile intervient de manière subsidiaire, car le risque d'accident est assurable et c'est d'abord à l'assureur que la victime doit s'adresser pour voir réparé son préjudice. En revanche, les fonds indemnisant les victimes d'attentats et les victimes d'une contamination par le virus du sida suite à une transfusion sanguine sont directement débiteurs de l'indemnisation à l'égard des victimes, qui ont vocation à s'adresser prioritairement aux fonds plutôt qu'au juge. Ces derniers posent donc la question de la subsidiarisation de la responsabilité administrative, lorsque les victimes bénéficiant de cette garantie estiment leur préjudice insuffisamment ou incomplètement réparé et s'adressent en dernier recours au juge.
Or, précisément dans ces deux cas de figure, on voit nettement que la responsabilité administrative est en voie de subsidiarisation, tantôt parce qu'elle n'intervient que secondairement, tantôt parce qu'elle ne s'applique qu'en complément du régime législatif d'indemnisation instaurant le fonds.
- ainsi, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions doit accorder à celles-ci une indemnisation intégrale 3 ( * ) . Les règles de la responsabilité administrative ne sont dès lors applicables que subsidiairement, au sens de secondairement, si toutes les conditions posées par le législateur ne sont pas remplies, ce qui empêche le mécanisme législatif de jouer.
- Par ailleurs, le fonds d'indemnisation des victimes du sida doit également assurer à celles-ci une réparation intégrale de leurs préjudices. Mais on comprend la difficulté à évaluer et à réparer la perspective d'une mort prochaine. C'est la raison pour laquelle le Conseil d'État a admis la possibilité de cumuler le système légal d'indemnisation et le système jurisprudentiel de réparation, à condition toutefois que le juge déduise des dommages-intérêts, auxquels l'État sera condamné, la somme offerte par le fonds et acceptée par la victime 1 ( * ) .
On voit donc que dans cette hypothèse aussi les règles de la responsabilité administrative sont subsidiaires, en ce qu'elles interviennent de manière complémentaire, lorsque l'application du régime législatif d'indemnisation ne suffit pas à assurer la réparation intégrale des préjudices subis.
L'indemnisation de l'aléa thérapeutique par un fonds de garantie ne peut que conforter ce phénomène de subsidiarisation. Il peut même tendre à l'absorption de la responsabilité pour risque thérapeutique, voire pour faute médicale, si la loi n'indemnise pas seulement l'aléa, mais aussi le risque médical, entendu comme toute aggravation anormale de l'état de santé antérieure du malade résultant soit d'une faute, soit de conséquences inexplicables et inconnues 2 ( * ) .
Ceci dit, il faut admettre qu'il n'y a pas une totale subsidiarisation du droit de la responsabilité administrative du fait de la progression de la garantie sociale. Cette évolution se superpose au système existant de la responsabilité administrative, sans s'y substituer ni le marginaliser. Sinon l'interrogation sur la subsidiarisation dans ce droit n'aurait pas de sens.
II - SUR LA SUBSIDIARISATION DANS LE DROIT DE LA RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE
L'une des conséquences du principe de subsidiarité, si l'on admet qu'il sous-tende le phénomène de subsidiarisation, est la recherche d'un équilibre entre un pouvoir central et un pouvoir local 3 ( * ) , autrement dit entre un centre et une périphérie. Dans le droit de la responsabilité administrative, la question de la subsidiarisation conduit à se demander s'il n'existe pas un centre, ou un noyau dur de règles principales, et une périphérie de règles satellites qui tendraient à devenir secondaires.
A - LE CENTRE DU DROIT DE LA RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE
Au centre de la responsabilité administrative, émergent deux concepts primaires, la faute et le risque, qui permettent d'aborder la question posée de deux manières : l'une, classique, recoupe l'interrogation de la subsidiarité du risque par rapport à la faute, l'autre, plus actuelle, doit rechercher si, au sein des notions "mères" que sont le risque et la faute, certaines notions "filles" ne subissent pas le phénomène étudié.
Tout d'abord, le problème de la subsidiarité du risque par rapport à la faute, pour classique qu'il soit, nous paraît, à la réflexion, mal posé 4 ( * ) . En effet, le risque n'est ni secondaire - il se développe même constamment dans la responsabilité civile de droit privé -, ni complémentaire de la faute - puisque leur champ d'application respectif est différent -. En réalité, l'idée que la doctrine veut exprimer en parlant de la subsidiarité du risque par rapport à la faute est que cette dernière est le droit commun de la responsabilité administrative, alors que le risque demeure un régime d'exception, même s'il présente les deux versants toujours fertiles du risque danger et du risque profit. Mais que le risque demeure - ou doive demeurer, car en la matière le dogmatisme côtoie de près le positivisme - un régime d'exception ne signifie pas pour autant qu'il soit ou secondaire ou complémentaire par rapport à la faute.
Le juge l'entend bien ainsi, puisqu'il considère que seule la responsabilité sans faute, pour risque ou pour rupture de l'égalité devant les charges publiques, est un moyen d'ordre public en procédure administrative contentieuse 1 ( * ) . Or, l'ordre public en procédure traduit aussi une règle qui s'impose avec une force particulière, ce qui va directement à rencontre d'un prétendu caractère subsidiaire du risque.
Ensuite, le problème de la subsidiarisation de notions "filles" au sein des notions "mères" que sont la faute et le risque apparaît bien réel au moins à trois égards ;
- la subsidiarisation de la faute lourde par rapport à la faute " de nature à " est évidente, même si la faute lourde réapparaît sporadiquement pour l'engagement de la responsabilité des services publics dont l'activité à l'origine du dommage est considérée comme d'exécution particulièrement difficile 2 ( * ) . Aussi la franchise de responsabilité laissée par le juge à l'administration s'amenuise-t-elle, marquant ainsi la progression du droit à réparation comme droit fondamental des victimes. La subsidiarisation de la faute lourde s'accompagne alors d'une subsidiarisation, non pas de la responsabilité administrative, mais de l'irresponsabilité administrative.
- de la même façon, la subsidiarisation de la faute personnelle par rapport à la faute de service est tout aussi patente. Depuis une décision du Tribunal des conflits de 1998, il est même entendu que, quelle que soit sa gravité, une faute commise dans l'exercice des fonctions et sans la recherche d'un intérêt personnel, ne peut pas être considérée comme personnelle 3 ( * ) . Le phénomène de subsidiarisation de la faute personnelle réduit donc celle-ci à deux catégories au lieu de trois, à savoir la faute commise en dehors du service et sans lien avec lui et la faute commise dans l'exercice des fonctions et animée par un intérêt personnel.
- Enfin, la subsidiarisation, au sein de la responsabilité sans faute, de la responsabilité du fait des lois à l'origine d'une rupture de l'égalité devant les charges publiques au détriment d'un citoyen, est réelle au point qu'on peut toujours parler, sans excès de langage, d'irresponsabilité du législateur. On connaît, à cet égard, le rôle pervers joué par l'intérêt général et qui explique largement cette subsidiarisation : d'un côté, l'intérêt général permet d'admettre en principe la responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques, car la mesure légale sacrifie les intérêts particuliers d'un citoyen sur l'autel de l'intérêt général ; d'un autre côté, l'intérêt général qui anime l'objet même de la loi fait supposer au juge que le législateur a entendu exclure la responsabilité de l'État à raison des conséquences dommageables de la loi 1 ( * ) .
On pourra objecter que la responsabilité du fait des lois n'est pas une responsabilité administrative, au sens donné précédemment. Mais, dans le contexte européen, il n'est pas inconcevable de voir le législateur national comme l'exécutif des institutions communautaires et de sanctionner, par la reconnaissance d'une faute 2 ( * ) , les manquements à ses obligations communautaires, notamment à celle de transposition des directives. En ce sens, il est remarquable que la subsidiarisation de la responsabilité du fait des lois s'opère au profit de la responsabilité du fait des règlements, lorsque la remontée de la loi au règlement d'application, comme source du dommage, est possible 3 ( * ) . À défaut de pouvoir le faire, on ignore combien de temps encore la Haute Assemblée pourra se retrancher derrière des artifices de procédure, alors qu'une juridiction d'appel n'avait pas manqué de dénoncer "la situation créée " par l'incompatibilité de la loi fiscale française avec une directive communautaire 4 ( * ) . La censure de l'administration est certes moins périlleuse pour le juge administratif que la censure du législateur, dont il peut toujours craindre - on l'a vu - les atteintes au principe de séparation des autorités administrative et judiciaire.
Si l'on considère donc le centre de la responsabilité administrative, les deux pôles de la faute et du risque ne paraissent pas subir le phénomène étudié, alors que certaines des notions et catégories dérivées de ces concepts le subissent incontestablement, peut-être parce qu'elles n'existent que par opposition à une autre dans le cadre de distinctions (faute lourde-faute simple ; faute personnelle-faute de service ; responsabilité du fait des lois et du fait des règlements), là où le rapport de domination d'une notion sur une autre s'exerce nécessairement plus facilement.
Si l'on examine maintenant la périphérie de la responsabilité administrative, la subsidiarisation dans ce droit pose la question de savoir si certaines règles deviennent secondaires.
B/ La périphérie du droit de la responsabilité administrative
Il est difficile de répondre à la question de savoir s'il y a effectivement une périphérie dans le corps de règles de la responsabilité administrative, car on ne conçoit pas que les conditions du dommage et du lien de causalité soient reléguées en dehors du centre de la responsabilité administrative et deviennent secondaires.
Tout au plus peut-on constater un affaiblissement de certains caractères du dommage. La certitude de celui-ci est affectée par la reconnaissance de plus en plus fréquente d'une perte de chance, en tant que préjudice indemnisable, qui conduit le juge à opérer un calcul de probabilités sur la réalisation d'une chance au profit de la victime qui déplore sa perte 1 ( * ) . Le caractère direct du dommage est aussi affecté par le relâchement du lien de causalité, puisque des présomptions de causalité sont apparues à la faveur des accidents médicaux puis des préjudices de contamination. Toutefois, le juge administratif maintient plus fermement que la Cour de cassation la condition du lien de causalité à l'occasion des demandes d'indemnisation des handicaps introduites au nom de l'enfant, alors qu'ils n'ont été révélés qu'à la naissance de l'enfant et n'avaient pas été décelés lors d'un diagnostic prénatal 2 ( * ) .
Mais ces quelques évolutions à la marge ne permettent pas de conclure à une subsidiarisation de certaines règles de la responsabilité administrative qui autoriserait à parler de périphérie. Il ne semble d'ailleurs pas souhaitable que les conditions du dommage et du lien de causalité deviennent en quelque sorte les accessoires des faits générateurs de responsabilité, sous peine de réhabiliter le caractère primitivement sanctionnateur de celle-ci et de lui faire perdre toute identité vis à vis d'autres techniques de réparation, comme l'assurance et la garantie.
La structure ternaire de la responsabilité a peut-être empêché l'anoblissement du contentieux de la responsabilité administrative, tant il est vrai que la recherche de l'équilibre des intérêts en présence, requérant subtilité et précaution, se laisse malaisément enfermer dans une logique binaire 1 ( * ) et peut même parfois défier toute logique. Mais la complexité du droit administratif contemporain et son imprégnation de droit économique et de droit privé épousent davantage la tendance au flou fonctionnel des catégories juridiques de la responsabilité administrative que la symétrie des distinctions tranchées.
Finalement, l'évolution étudiée est discrète : elle ne concerne que des notions ou catégories dérivées (faute lourde, faute personnelle, responsabilité du fait des fois) qui présentent toutes la particularité de desservir la compétence du juge administratif, soit par la vision rétrograde que la première donne de la responsabilité administrative, soit par la compétence naturelle que la deuxième confère au juge judiciaire, soit encore par la réserve traditionnelle que les lois suscitent chez le juge administratif. Et l'absence de subsidiarisation du droit de la responsabilité administrative traduit bien la sophistication de l'ensemble du droit de la protection des personnes qui ne peut se satisfaire de réductions et de simplifications.
Faut-il pour autant déplorer, comme l'a fait un auteur privatiste, le caractère tentaculaire de la responsabilité de la puissance publique, qui obéirait à des principes trop éloignés de ceux du droit privé - ce qui est, soit dit en passant, un coup de chapeau à l'autonomie !-, et qui démontrerait selon lui " combien les erreurs historiques peuvent être lourdes de conséquences " 2 ( * ) ? Nous ne le pensons pas, car si la subsidiarisation dans le droit de la responsabilité administrative est marginale, elle ne suppose pas à l'inverse une tendance à l'impérialisme de ce droit. La réflexion sur la dualité de juridiction peut bien être constamment remise sur le métier, elle file un travail de Pénélope tant que le droit administratif ne tend pas à devenir " subsidiaire " !
Monsieur le Doyen Georges VEDEL
Je vous remercie Madame, et ce que je tiens à dire, de votre dissection de la subsidiarité-subsidiarisation, c'est que le sujet... n'était pas subsidiaire. Merci.
Alors, si vous le voulez bien, nous allons entendre Monsieur le professeur PONTIER sur un sujet qui ne comporte pas de point d'interrogation, contrairement aux précédents. En effet "le dommage et le préjudice" n'est pas suivi de point d'interrogation sur "le dommage", sur "le préjudice", et surtout sur le "et" qui les unirait. Cher collègue, je vous donne la parole.
Le dommage et le préjudice
par Monsieur Jean-Marie PONTIER,
professeur à l'Université Aix-Marseille 3
On pourrait résumer l'évolution sur un siècle en parlant de passage de la responsabilité au préjudice. Cela ne signifie pas qu'il a pu y avoir ou qu'il pourrait y avoir responsabilité sans préjudice. Le préjudice demeure aujourd'hui comme hier une condition de la responsabilité. Une décision, même illégale, ne peut être source de responsabilité si elle ne cause pas de préjudice 1 ( * ) . Cela ne signifie pas non plus que la responsabilité aurait moins d'importance qu'elle n'en eut, ce serait plutôt l'inverse : la responsabilité de l'administration peut plus facilement être engagée qu'autrefois, et elle gagne des champs nouveaux. Mais en évoquant ce passage on veut mettre en lumière les points suivants.
Dans la conception (et dans la présentation) traditionnelle de la responsabilité telle que le juge l'a progressivement dégagée, l'accent est plus mis sur la responsabilité que sur le préjudice. En d'autres termes, l'élaboration d'une responsabilité de l'administration ne se justifie pas seulement et, peut-être pas d'abord, par le souci d'indemniser les victimes de dommages administratifs. Une autre préoccupation est très présente, celle de sanctionner les violations du droit qui résultent de comportements fautifs. En ce sens, ainsi que plusieurs auteurs l'ont fait remarquer, la responsabilité est une des conséquences du principe de juridicité de l'action administrative. Donc au départ, et à la différence du droit civil, le système de responsabilité est plus moralisateur qu'indemnitaire. Il fallait certes réparer, il fallait surtout sanctionner les conséquences d'un comportement ou d'un acte. C'est pourquoi on peut parler de responsabilité sanctionnatrice pour caractériser cette étape de la responsabilité.
La préoccupation de moralisation, de sanction, n'a évidemment pas disparu, mais elle a tendance à céder la première place à la réparation. Ce qui importe aujourd'hui aux victimes, c'est moins la sanction de l'administration que la réparation des dommages qu'ils subissent. Ce déplacement s'explique à la fois par la place prise par la victime dans notre réflexion et par le développement du contentieux. Pour des raisons tenant à des événements historiques comme à un approfondissement de la réflexion, nous avons progressivement pris conscience que la victime n'était pas seulement un acteur auquel on était bien obligé de s'intéresser un peu, mais le coeur de la responsabilité. C'est bien d'abord pour la victime qu'existe une responsabilité de l'administration. Par ailleurs, le contentieux indemnitaire s'est développé parce que les citoyens hésitent moins qu'avant à s'adresser à l'administration et au juge pour leur demander de réparer un dommage qu'ils estiment avoir subi du fait d'un comportement administratif. D'une certaine manière on peut parler d'une "démocratisation" qui a conduit à se préoccuper de la victime plus qu'on ne le faisait jusque là.
Un autre déplacement de la responsabilité porte sur les différents préjudices réparés par le juge. La distinction se faisait traditionnellement entre le dommage patrimonial et le dommage non patrimonial. Aujourd'hui elle tendrait plutôt à s'opérer, comme cela est le cas en droit privé, entre le dommage corporel et le dommage matériel. D'ailleurs le législateur lui-même consacre cette distinction, comme dans la loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité des produits défectueux. Il y a plus qu'une nuance dans cette évolution, qui n'est pas seulement terminologique. Ce qu'elle exprime c'est ce que l'on pourrait appeler l'avènement ou la montée de la personne dans le contentieux de la responsabilité. Certes, il est toujours possible de citer des exemples de reconnaissance de responsabilité qui témoignent, de la part du juge, d'une attention à la personne, notamment à travers la réparation du préjudice moral bien avant que ne soit réparée la douleur morale. Mais ces cas étaient peu nombreux, ils ne pouvaient être considérés comme significatifs. À l'inverse, aujourd'hui, ce qui est caractéristique, dans le contentieux de la responsabilité, c'est l'importance des demandes de réparation de dommages corporels, en particulier à la suite d'hospitalisation ou d'interventions chirurgicales 1 ( * ) .
Deux questions terminologiques doivent enfin être rappelées. Elles tiennent à la dualité de termes utilisés. On parle de dommage, mais aussi de préjudice. S'agit-il de la même notion ? Plusieurs positions se sont affirmées sur ce sujet. Pour les uns, il n'existe aucune différence entre le dommage et le préjudice, ces deux termes pouvant être utilisés indifféremment 2 ( * ) . D'assez nombreux auteurs font une différence entre ces deux termes. Mais certains n'en tirent aucune conséquence, se contentent d'observer que la notion de dommage est plus large que la notion de préjudice 3 ( * ) . D'autres en tirent des conséquences juridiques, mais qui n'ont pas la même portée selon les auteurs. La plupart des auteurs s'en tiennent à la responsabilité. Même parmi eux, les points de vue ne sont pas les mêmes quant à la portée de la distinction 4 ( * ) . Le juge administratif ne semble pas faire de distinction entre le dommage et le préjudice bien que, selon certains auteurs, il recourrait cependant à cette distinction 1 ( * ) . On conçoit assez facilement, avec certains auteurs, qu'un dommage peut exister objectivement sans provoquer subjectivement de préjudice 2 ( * ) .
Une seconde précision terminologique est relative à la distinction entre la réparation et l'indemnisation. L'analyse courante consiste à dire que ces termes sont équivalents, désignent la même action. Mais la distinction comporte un intérêt. La réparation renvoie d'abord à la responsabilité, selon l'article 1382 du Code civil qui est le socle de la responsabilité 3 ( * ) . L'indemnisation est ce à quoi se ramène souvent la réparation, parce que celle-ci se fait en argent et que la restitutio in integrum est impossible, sauf cas particulier 4 ( * ) .
Ainsi, et inévitablement, le préjudice renvoie à la réparation, ou à l'exigence de réparation. L'évolution observée à la période contemporaine peut être résumée par deux traits. Il s'agit, d'une part, d'une admission de plus en plus grande du préjudice indemnisable (I) et, d'autre part, de la recherche d'une véritable réparation (II).
I - L'ADMISSION DE PLUS EN PLUS LARGE DU PRÉJUDICE INDEMNISABLE
L'un des constats qui se dégage de l'évolution du droit de la responsabilité est celui d'une admission de plus en plus grande des préjudices susceptibles de donner lieu à réparation. Mais cette extension n'est pas, en l'état actuel de droit, indéfinie, il demeure des limites à cette admission.
A - L'EXTENSION DES CATÉGORIES DE PRÉJUDICES INDEMNISABLES
Les préjudices donnant lieu à indemnisation sont de plus en plus nombreux. L'extension est notable à un double point de vue, par l'élargissement des catégories de personnes pouvant prétendre à réparation de leur préjudice et par extension des situations considérées comme pouvant être dommageables.
1. L'extension des catégories de personnes pouvant prétendre à réparation de leur préjudice
Il n'y a pas eu de révolution en ce domaine, seulement une évolution mais qui est suffisamment significative pour pouvoir être relevée. On retiendra trois illustrations de cette évolution.
a) Les préjudices subis par les personnes publiques
Dire qu'une personne publique peut subir un préjudice du fait d'une autre personne publique et voir son préjudice réparé de ce fait n'a certes rien de révolutionnaire : à partir du moment où l'on admet qu'une personne publique peut causer un préjudice et être rendue responsable de ce dernier, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'une personne publique puisse elle-même subir un préjudice. Ce qui importe, c'est le principe de responsabilité des personnes publiques, ce n'est pas la nature juridique de la personne qui subit le préjudice. Le préjudice n'est pas substantiellement différent selon qu'il est subi par une personne publique ou une personne privée. Mais si cela est indéniable, il convient d'apporter deux précisions qui mettent en valeur cette catégorie de préjudices. D'une part, cette hypothèse qui nous paraît "naturelle" aujourd'hui ne l'était pas au départ. Lorsqu'est élaboré le principe de responsabilité des personnes publiques, c'est avant tout, pour ne pas, dire exclusivement, à la responsabilité des personnes publiques à l'égard des personnes privées que l'on pense. L'idée qu'une personne publique puisse causer un préjudice à une autre personne publique n'effleure guère les esprits. D'autre part, certaines décisions de jurisprudence sont particulièrement intéressantes en ce qu'elles reconnaissent une responsabilité de l'État à l'égard des collectivités locales. En arrière plan de cette reconnaissance de responsabilité, c'est une certaine égalité des collectivités qui se trouve consacrée. Cette idée n'allait pas de soi en un temps où les collectivités locales étaient frappées d'une incapacité qui impliquait, de façon tout aussi naturelle, une prise en charge par l'État. La faute lourde dans l'exercice de la tutelle était précisément l'un des cas d'engagement de la responsabilité de l'État. Aujourd'hui il en est tout différemment puisque la responsabilité de l'État à l'égard d'une collectivité peut être engagée contractuellement.
L'illustration la plus remarquable en est fournie par les contrats de plan État-régions. Le Conseil d'État avait reconnu la nature contractuelle à ces accords 1 ( * ) , bien qu'avec une réserve certaine 1 ( * ) . Mais l'on attend une décision au plein contentieux tirant les conséquences de ces engagements contractuels. Ce n'est pas encore le cas, mais le juge administratif a en revanche reconnu l'État responsable du non-respect d'engagements qu'il avait pris à l'égard de collectivités territoriales et qui avaient entraîné, de la part de ces dernières, des dépenses. Ainsi, en abandonnant le projet de liaison fluviale Saône-Rhin qui était un élément du projet Rhin-Rhône, l'État a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la région Alsace. Le préjudice de cette dernière est constitué par les dépenses qu'elle avait engagées au titre de la réalisation de cette liaison et alors que, souligne le juge, l'aménagement d'une partie de la voie navigable (la "section Niffer-Mulhouse") conserve un intérêt économique pour la région 2 ( * ) . L'abandon de cette liaison a également entraîné la responsabilité de l'État à l'égard d'une commune. Bien que l'État n'ait commis aucune faute celle-ci subit un "préjudice particulier", en raison de l'incidence de l'abandon du projet Saône-Rhin dont la commune n'avait contribué à financer les travaux de mise à grand gabarit que dans la perspective de la réalisation de l'ensemble du projet de liaison Saône-Rhin 3 ( * ) .
Il est d'autres hypothèses de préjudices indemnisables résultant de la mise en jeu de la responsabilité de l'État à raison de l'exercice de son pouvoir fiscal à l'égard des collectivités locales 4 ( * ) . La responsabilité peut de même être engagée de la part d'un établissement public à raison des dommages causés à une entreprise publique 5 ( * ) .
b) Les préjudices subis par les proches
Les dommages subis par les victimes peuvent avoir des incidences sur d'autres personnes, en particulier les proches. En droit civil, on parle volontiers, pour qualifier ces préjudices, de "préjudices réfléchis". "Il ne s'agit pas de préjudices indirects, mais de préjudices personnels pour ceux qui les invoquent tels que les frais, la perte de revenus, les troubles dans les conditions d'existence, le préjudice d'affection qui peuvent leur être causés par le décès ou les blessures d'un membre de leur famille" 1 ( * ) . La jurisprudence traditionnelle était restrictive. On déduisait de l'affirmation selon laquelle un dommage qui n'atteint qu'une situation de fait la conséquence qu'en cas de dommage corporel, et notamment d'un accident mortel, seules les personnes envers lesquelles la victime était tenue à une obligation alimentaire pouvaient se prévaloir d'un préjudice réparable. Ainsi que le faisait valoir R. Odent en 1971, cette solution était beaucoup trop rigide car "elle confondait systématiquement la notion de droit à indemnité et celle de droit à pension alimentaire, c'est-à-dire le droit reconnu et établi par un texte législatif. Rien n'imposait cette assimilation et, sans renoncer à exiger des demandeurs la justification d'un droit lésé, on pouvait donner à cette notion de droit lésé une assise plus large" 2 ( * ) . Mais malgré cette atténuation seuls le conjoint (qu'il soit l'époux légitime ou, depuis la décision Dame Muësser de 1978, le concubin) seuls les ascendants et descendants directs se voyaient reconnaître, avec réserve, la possibilité de demander réparation d'un préjudice indemnisable.
Mais un assouplissement est intervenu et, désormais, les collatéraux peuvent se prévaloir d'un préjudice et demander la réparation de ce dernier. Ce préjudice sera, le plus souvent, un préjudice moral. Tel est le cas, par exemple, du préjudice subi par un requérant du fait du décès de son frère au cours d'un exercice de saut en parachute organisé par l'armée et qui révèle une faute dans l'organisation de cette activité 3 ( * ) ou encore de celui éprouvé par le frère et les soeurs mineurs de la victime celle-ci, âgée de onze ans, étant décédée des suites d'une hypothermie maligne provoquée par l'anesthésie générale pratiquée pour traiter une fracture 4 ( * ) . On remarque, d'ailleurs, que si les indemnités demeurent d'un montant modique, ce dernier peut ne pas être seulement symbolique 5 ( * ) .
2. La plus grande prise en considération de la personne
Il s'est produit un déplacement d'accent de la jurisprudence indemnitaire par l'attention plus grande portée aux personnes et la consécration plus fréquente de la réparation. En simplifiant quelque peu on pourrait parler d'un passage des choses aux personnes. Cette valorisation des personnes apparaît à travers la reconnaissance de la souffrance comme à travers la prise en compte de l'atteinte à l'intégrité physique.
a) La souffrance comme préjudice
Dans la jurisprudence traditionnelle la souffrance n'est guère prise en compte par elle-même, elle n'est pas reconnue comme élément du préjudice, ou très rarement. Bonnard se situait bien dans cette perspective traditionnelle lorsqu'il faisait valoir que ce n'était pas la sensation subjective qui était indemnisée, la douleur n'était réparée, faisait-il valoir, que parce qu'elle implique "une diminution de la personnalité de la victime du fait de la prostration physique dans laquelle elle est plongée" 1 ( * ) . Or on peut penser que cette analyse de Bonnard ne rend plus compte de la jurisprudence, celle-ci retient la souffrance comme un préjudice, et un préjudice indemnisable.
On ne reviendra pas ici sur la douleur morale éprouvée par les proches de la victime du fait du décès de cette dernière. La reconnaissance de cette douleur, sa réparation, datent de quarante ans, sont un fait acquis même s'il y a lieu de rappeler que ce ne fut pas réticences fortes de la part du juge. La seule question qui se pose, rétrospectivement, est de savoir s'il s'agissait d'une véritable opposition du juge à la réparation de la douleur morale procédant d'une position métaphysique ou d'une simple conséquence de la distinction que faisait le juge entre les dommages objectivement évaluables en argent et, donc, indemnisables, et ceux qui n'étaient pas évaluables en argent. Quoi qu'il en soit, le débat n'a plus aujourd'hui qu'un caractère historique.
Mais l'aspect le plus intéressant dans l'évolution de la jurisprudence est celui qui concerne les "douleurs" ou les "souffrances physiques" éprouvées par la victime. La jurisprudence de ces dernières années conduit à faire trois observations. En premier lieu le juge relève de plus en plus souvent, pour ne pas dire systématiquement, la souffrance comme chef de préjudice. Tantôt il parle de la douleur éprouvée par la victime, et tantôt des souffrances endurées, mais il s'agit d'une même notion, qui est celle de souffrance physique. En deuxième lieu, non seulement la souffrance physique est prise en compte en elle-même, mais elle est même réparée parfois de manière distincte et peut constituer le seul chef de préjudice. Ainsi, dans une affaire où un diagnostic plus précoce n'aurait pas modifié l'évolution de l'état de santé de la victime et où cette dernière ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l'IPP dont elle reste atteinte, elle n'est en droit d'obtenir réparation que "du préjudice résultant pour elle de la prolongation de ses souffrances physiques provoquées par le retard de diagnostic" et eu égard à "l'intensité" et au "signalement répété" de ces souffrances la Cour augmentant la somme que lui avait attribuée le TA 2 ( * ) . En troisième lieu, le juge fait souvent référence à l'échelle des souffrances qui a été établie par le corps médical et précise que les souffrances ont été chiffrées, par exemple, à 5 sur l'échelle de 7, Lorsque ces références ne figurent pas, le juge qualifie la souffrance de "faible", "moyenne", ou "importante" (ou "très importante"). Cela montre que, d'une part, le juge éprouve beaucoup moins d'hésitations qu'auparavant à retenir un préjudice qu'en d'autres temps il aurait écarté parce que non évaluable ou trop "subjectif, mais aussi, d'autre part, les experts sont souvent sollicités, le juge s'en remettant le plus souvent à leur appréciation. En quatrième lieu, enfin, le juge regroupe assez fréquemment les souffrances physiques avec le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément dans la catégorie, classique, elle, et commode, des troubles de toute nature dans les conditions d'existence. Une Cour déclare aussi que la victime "a enduré des douleurs importantes et subi un préjudice esthétique chiffré à trois sur sept (...) souffrait de troubles et de difficultés dans les domaines urinaires et sexuel" et déclare "qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ses troubles dans les conditions d'existence en les fixant à la somme de 91 469,41 Euros" 1 ( * ) .
b) L'atteinte à l'intégrité physique résultant d'actes médicaux
Il ne s'agit évidemment pas ici d'évoquer l'abandon de la faute lourde en matière de responsabilité médicale. S'il traduit une évolution importante de la jurisprudence, il touche au système de responsabilité et non au préjudice. Ce dernier est en revanche au coeur de deux évolutions jurisprudentielles récentes.
La première de ces évolutions concerne les conséquences dommageables d'un acte médical comportant des risques exceptionnels. C'est ce que l'on a appelé la jurisprudence Gomez-Bianchi. Dans l'affaire Gomez l'intéressé, après avoir subi une intervention chirurgicale selon une nouvelle méthode, a été atteint d'une paraplégie des membres inférieurs. Aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre des praticiens 2 ( * ) .
La Cour de Lyon a innové en affirmant que "l'utilisation d'une thérapeutique nouvelle crée, lorsque ses conséquences ne sont pas encore entièrement connues, un risque spécial pour les malades qui en sont l'objet ; que, lorsque le recours à une telle thérapeutique ne s'impose pas pour des raisons vitales, les complications exceptionnelles et anormalement graves qui en sont la conséquence directe engagent, même en l'absence de faute, la responsabilité du service public hospitalier" 3 ( * ) .
Dans l'affaire Bianchi, l'intéressé, entré dans un établissement hospitalier pour y subir une artériographie, s'était trouvé atteint de tétraplégie consécutive à l'anesthésie. Il ne s'agissait plus, comme dans le cas précédent, d'une thérapeutique nouvelle, mais d'une anesthésie pour laquelle aucune faute n'avait été commise puisqu'il s'agissait d'un risque lié à l'anesthésie elle-même. L'Assemblée du contentieux, appelée à se prononcer, a reconnu la responsabilité de l'établissement en décidant que "lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité 1 ( * ) . La jurisprudence Bianchi a été précisée, en même temps qu'étendue, par la décision Hôpital Joseph-Imbert d'Arles 2 ( * ) selon laquelle la solution de la jurisprudence Bianchi, d'une part, s'applique aux patients et pas seulement aux malades 3 ( * ) , d'autre part s'applique à l'anesthésie générale, qui n'est pas un acte médical mais accompagne celui-ci.
Trois remarques peuvent être tirées, s'agissant du préjudice, de la jurisprudence précitée. En premier lieu, et c'est surtout ce que l'on est tenté de retenir, des préjudices qui n'étaient pas indemnisables auparavant parce qu'il était exigé une faute pour que la responsabilité fût consacrée, le sont désormais. Et il est clair que c'est bien l'étendue du préjudice qui est à l'origine de cette solution. "L'Assemblée semble en fait avoir surtout été sensible à des considérations d'équité", font valoir certains commentateurs 4 ( * ) . Mais, en deuxième lieu, le préjudice doit, pour pouvoir être répare, présenter un caractère "d'extrême gravité", il doit être tout à fait exceptionnel, comme le risque qui, par sa réalisation, en est la cause. "Une telle notion a pour effet d'introduire une gradation au sein des préjudices susceptibles d'entraîner la responsabilité sans faute de l'administration : en principe un dommage anormal et spécial est suffisant ; mais, dans le cas particulier des activités médicales, un préjudice exceptionnellement anormal est requis" 5 ( * ) . En troisième lieu, de ce fait, la part de dommages devant normalement rester à la charge de la victime sera plus élevée dans ce régime que dans les autres cas de responsabilité sans faute.
La seconde évolution résulte de la jurisprudence Telle. Le Conseil d'État déclare que "lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation" 1 ( * ) . Cette solution manifeste une inflexion de la jurisprudence antérieure quant à la détermination du préjudice indemnisable. Jusque là le juge assimilait le préjudice à l'ensemble du dommage résultant de l'accident 2 ( * ) . Mais cette solution n'était pas entièrement satisfaisante car "Si l'on conçoit assez aisément que le défaut d'information n'est pas dépourvu de tout lieu avec le préjudice, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ignorance du risque par le patient et l'accident subi semble douteuse. Cela revient, en quelque sorte, à supposer que le patient aurait nécessairement refusé l'intervention et qu'il se serait ainsi soustrait de manière certaine au risque qu'il encourait. Un tel raisonnement peut éventuellement être suivi pour des interventions de confort, mais pas dans le cas, par exemple, d'une intervention dont la non-réalisation affecterait le pronostic vital du patient. Le préjudice réellement subi par le patient se limite à l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé, par la faute du médecin, de prendre sa décision en toute connaissance de cause" 3 ( * ) . À la suite de la Cour de cassation qui a distingué entre le dommage et le préjudice, ce dernier étant "la perte de chance d'échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé, perte qui constitue un préjudice distinct des atteintes corporelles" 4 ( * ) , le Conseil d'État retient donc "la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé", la réparation de cette perte de chance étant fixée "à une fraction des différents chefs de préjudice subis" 5 ( * ) . En d'autres termes, ce n'est plus l'intégralité du dommage qui est réparée, mais le préjudice qui résulte de la perte d'une chance de se soustraire à un risque du fait de la faute du médecin, ce qui conduit le juge à procéder d'un calcul de probabilités 6 .
B - LES LIMITES À L'ACCEPTATION DU PRÉJUDICE INDEMNISABLE
À supposer que le préjudice existe bien, il n'est pas nécessairement réparable, ou il n'est pas nécessairement entièrement réparable, même si une décision, une action ou une inaction de l'administration en est à l'origine. Des limites existent donc, qui peuvent d'ailleurs évoluer dans le temps, et qui tiennent à ce que le préjudice indemnisable peut n'être qu'une partie du préjudice subi et, de manière plus limitative encore, à ce que tout préjudice subi n'est pas un préjudice indemnisable.
1. Le préjudice indemnisable peut ne représenter qu'une partie du préjudice subi
Le préjudice tel qu'il a été subi par la victime ne coïncide pas nécessairement avec le préjudice indemnisable. Même si on laisse de côté l'évaluation de certains préjudices, comme le préjudice moral, où l'indemnisation accordée par le juge correspond rarement au préjudice tel qu'il est ressenti subjectivement par la victime, tout le préjudice, tel qu'il pourrait être évalué "objectivement" (si cela est possible) ne donne pas lieu à une indemnisation. Les limites qui sont ainsi apportées sont de trois ordres.
a) Les limites tenant au système de responsabilité
À partir du moment où un dommage est causé par l'administration, que ce fait ou cette décision est considéré comme susceptible d'engager la responsabilité de celle-ci, qu'il existe bien un lien de causalité, etc., ce dommage doit être réparé. On parle alors du principe de la réparation intégrale du préjudice, qui impose "que les dommages-intérêts soient exactement ajustés à l'étendue et à la valeur du préjudice à réparer" 1 ( * ) , ce que l'on traduit également en disant que la victime ne doit être ni appauvrie, ni enrichie à la suite du dommage qu'elle a subi. Toutefois, et indépendamment des limites citées ci-après, il est difficile de parler de "réparation intégrale" dans la mesure où la victime ne se trouve pas replacée dans sa situation antérieure et où elle aura rarement le sentiment d'avoir obtenu effectivement une telle réparation. C'est pourquoi celle-ci se transforme nécessairement en une indemnisation considérée comme plus ou moins satisfaisante par la victime.
Un certain nombre de faits peuvent également avoir pour effet de limiter le préjudice indemnisé parce qu'ils réduisent la responsabilité de l'administration 2 ( * ) . Le fait de la victime est le facteur le plus fréquent de limitation de responsabilité et, par conséquent, du préjudice effectivement indemnisé. Le fait de la victime est souvent représenté par une faute de celle-ci. Le juge se livre à une double appréciation qui se prête mal à une quelconque systématisation. D'une part, il apprécie discrétionnairement si le comportement de la victime a constitué ou non une faute. Il faut tenir compte ici à la fois de la situation, de la connaissance que la victime pouvait avoir des risques d'accidents qu'elle encourait par son comportement, de l'âge de la victime, etc. D'autre part, s'il y a faute, le juge apprécie dans quelle mesure cette faute de la victime atténue la responsabilité de l'administration. Une solution simple consiste à laisser la moitié du préjudice à la charge de la victime, mais on peut trouver d'autres appréciations, du tiers ou des deux-tiers, en fonction des circonstances. Une toute autre situation, sans qu'il y ait nécessairement de faute de la victime, est celle dans laquelle l'administration ne fait qu'aggraver un dommage que, de toutes façons, la victime aurait subi. Dans ce cas, le préjudice indemnisable est uniquement celui qui résulte de l'aggravation dont l'administration est à l'origine. Là encore, et inévitablement, le partage entre le dommage qui serait tout de même produit et celui qui s'est réalisé du fait de l'action ou de l'inaction de l'administration résulte d'une appréciation du juge.
Enfin et surtout, si l'on s'en tient `à la présentation classique du droit de la responsabilité, le principe de la réparation intégrale ne joue que si l'on trouve dans le cadre d'une responsabilité pour faute. Dans le cas d'une responsabilité sans faute - certains auteurs précisent même : d'une responsabilité sans faute fondée sur la rupture d'égalité devant les charges publiques -, la responsabilité n'est engagée que si le dommage est spécial et anormal, le préjudice n'étant réparé que pour la partie du préjudice qui dépasse ce seuil d'anormalité. Toutefois on constate des divergences d'analyse de la jurisprudence au sein de la doctrine. Certains auteurs considèrent que l'anormalité du préjudice est toujours une condition d'engagement de la responsabilité publique, qu'il s'agisse d'une responsabilité pour faute ou d'une responsabilité sans faute 1 ( * ) . S'agissant de dommages matériels, l'indemnisation serait fonction de l'anormalité de la situation dommageable, quelles que soient les conditions d'engagement de la responsabilité. "L'anormalité n'apparaît pas comme un élément quantitatif mais comme ce que la victime ne doit pas supporter sans contrepartie dans les circonstances de l'affaire" 2 ( * ) . En revanche la question ne se pose pas dans les mêmes termes pour les dommages corporels.
b) L'anormalité du préjudice comme condition de réparation des dommages
Sans entrer dans le débat relatif au point de savoir si l'anormalité du dommage est une condition d'engagement de la responsabilité administrative dans tous les systèmes de responsabilité ou seulement dans les cas (ou certains cas) de responsabilité sans faute, soulignons seulement cette évidence que, dans un certain nombre d'hypothèses, le dommage, pour pouvoir être réparé, doit être un dommage anormal. La question de l'étendue de l'exigence n'est cependant pas sans conséquence pour notre propos. Certains auteurs croient en effet pouvoir déduire de la jurisprudence que la véritable distinction à retenir est celle entre les dommages matériels et les dommages corporels. Et l'on peut suivre facilement un commissaire du Gouvernement selon lequel "les dommages corporels sont anormaux par nature" 3 ( * ) .
L'anormalité du préjudice joue comme un facteur de limitation de la réparation de ce dernier. Mais la doctrine interprète différemment le sens de cette exigence d'anormalité. Certains, rejoignant la doctrine civiliste, estiment que le préjudice suppose une atteinte à un droit lato sensu ; mais, pour être réparable, cette atteinte au droit doit être particulièrement grave. Ainsi F.-P. Bénoit écrit que "les rapports de l'auteur d'un dommage et de la victime ne sont pas autre chose (...) que des rapports obligation-sanction : la responsabilité de l'auteur du dommage est la sanction d'un droit reconnu à la victime" 1 ( * ) . Mais d'autres auteurs analysent l'anormalité du dommage à travers ses conséquences pour la victime : "en réalité, pour le juge administratif, le dommage anormal est non pas un dommage qui n'aurait pas dû arriver, mais simplement, et la nuance est importante, un dommage qui n'a pas à être supporté par la personne qui en a été victime, qui excède ce qu'elle doit prendre en charge" 2 ( * ) . Le préjudice réparé est seulement celui qui excède ce que la victime doit normalement supporter du fait de la vie en société.
Une évolution plus récente concerne l'anormalité avec l'apparition de l'exigence d'un préjudice anormalement grave. Dans la décision Bianchi (ainsi que toute la jurisprudence qui en a découlé) le juge retient la responsabilité du service public hospitalier si l'exécution de l'acte est la cause directe de "dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité". Cette exigence "d'extrême gravité" du dommage est nouvelle et crée un échelonnement dans l'anormalité des préjudices. La notion de dommage d'une extrême gravité suppose en effet "un préjudice hors du commun, exceptionnellement grave. Une telle notion a pour effet d'introduire une gradation au sein des préjudices susceptibles d'entraîner la responsabilité sans faute de l'administration" 3 ( * ) , 44. La conséquence est que la part de dommages demeurant à la charge de la victime va être plus élevée ici que dans le cas d'exigence de préjudice "simplement" anormal et, à fortiori, que dans les cas où cette exigence n'existe pas et où il y a, sous les réserves exprimées précédemment, une véritable réparation "intégrale".
Ainsi, d'un côté il y a extension du champ du préjudice indemnisable, dans la mesure où le juge reconnaît l'existence de ce dernier dans un nombre plus étendu d'hypothèses mais, d'un autre côté, il y a rétraction de la substance du préjudice indemnisable dans la mesure où ce dernier représente une partie plus réduite que dans les autres hypothèses du préjudice subi.
c) Les préjudices partiellement réparés en raison de l'existence d'une indemnisation forfaitaire
Lorsqu'un agent public subit un dommage à l'occasion du fonctionnement du service qui l'emploie et qu'il existe un régime de pension, ce dernier s'oppose à ce que le service employeur puisse être condamné à verser à l'agent une indemnité complémentaire par l'application des règles jurisprudentielles de la responsabilité administrative. Telle est la règle dite du "forfait à pension" applicable aux agents de l'administration. Cette règle ne résulte pas directement d'une loi mais d'une interprétation d'une loi de 1831 par le Conseil d'État, d'abord par un avis, puis au contentieux 1 ( * ) . Lorsque s'applique ce régime, et ainsi que sa dénomination l'indique, l'agent public ne peut prétendre à une réparation intégrale du préjudice qu'il subit, il peut seulement prétendre au montant de l'indemnisation fixée par le régime de pension applicable, indemnisation qui est "tarifée".
F.-P. Bénoit a bien résumé l'évolution de la signification du forfait à pension : "Ce système de réparation forfaitaire constituait jadis, alors que la responsabilité administrative était inexistante, une faveur pour les agents publics. De là l'expression usuelle : "bénéficier" d'un régime de pension. De nos jours au contraire, alors que le principe de la responsabilité administrative est largement admis, le système des pensions d'invalidité constitue une faveur pour l'Administration en limitant singulièrement ses obligations à l'égard de ses agents dans la plupart des cas : c'est l'Administration qui, désormais, bénéficie du régime des pensions d'invalidité" 2 ( * ) .
Depuis que ces lignes ont été écrites la situation n'a fait que s'aggraver, la limitation figée du forfait à pension s'opposant aux avancées de la responsabilité jurisprudentielle du droit commun. Les commentateurs de récentes décisions du juge peuvent parler, à juste titre, "d'iniquités" pour qualifier ces écarts 3 ( * ) : jusqu'aux récentes décisions du Conseil d'État du 15 décembre 2000, un agent hospitalier victime d'un accident de service et s'estimant victime d'une faute médicale ne pouvait intenter une action complémentaire du forfait à pension devant le juge s'il s'était soigné à l'hôpital qui l'emploie, mais était recevable dans son action s'il avait été soigné dans un autre établissement... ; un fonctionnaire de l'État victime d'un accident de scooter en se rendant sur son lieu de travail ne peut rechercher la responsabilité de l'État à raison du mauvais entretien de la voie, si celle-ci est une route nationale, alors qu'il peut engager une telle action si la voie était à statut départemental ou communal... 4 ( * ) . Et chacun connaît l'avantage dont pourrait bénéficier la concubine par rapport à l'épouse légitime du fait du forfait de pension, la seconde devant se contenter du forfait à pension qui lui est opposable, tandis que la première pourrait engager une action en responsabilité (et obtenir une réparation intégrale). Les commentateurs de l'AJDA précités sont justifiés à parler "d'ubuesques disparités" 5 ( * ) .
Dans deux décisions du 15 décembre 2000 le Conseil d'État a apporté une correction à l'automaticité de la règle du forfait. Dans l'une, le juge a estimé qu'un élève gendarme victime d'une chute de motocyclette au cours du service a pu exercer à rencontre de l'État dont dépend l'hôpital militaire où il a été soigné une action en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des soins qui lui ait été dispensés dans cet établissement 1 ( * ) . Dans l'autre, le juge a déclaré que la circonstance que les conséquences dommageables des soins dispensés à un agent hospitalier de l'État qui l'emploie à la suite d'un accident de service ne sont pas détachables de cet accident en ce qu'ils ouvrent droit à l'allocation temporaire d'invalidité prévue par les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il estime que les soins ont été dispensés dans des conditions de nature à engager, selon les règles du droit commun, la responsabilité du service hospitalier, exerce à rencontre de l'État une action tendant au versement d'une indemnité complémentaire assurant la réparation intégrale de ce chef de préjudice 2 ( * ) ". Cependant on peut regretter que le juge ne soit pas allé plus loin et, sans aligner le régime des fonctionnaires sur celui des salariés du secteur privé - ce qui n'aurait sans doute pas été souhaitable - ne procède pas à une nouvelle lecture de la loi de 1831, à laquelle l'invitait son commissaire du Gouvernement 3 ( * ) .
2. Tout préjudice subi n'est pas un préjudice indemnisable
Que le préjudice indemnisable ne corresponde pas toujours au préjudice subi est facilement compréhensible : il existe toute une série de situations dans lesquelles si le préjudice existe, ce n'est pas un préjudice indemnisable. Tel est le cas naturellement, sans qu'il y ait besoin d'y insister, des situations illicites 4 ( * ) , des situations précaires 5 ( * ) , ou encore des simples tolérances 6 ( * ) , ou encore de la situation "à laquelle la victime s'est sciemment exposée" 7 ( * ) . Plus problématique est le refus de la prise en compte du préjudice, soit par des textes, soit par la jurisprudence.
a) Les préjudices non susceptibles de donner lieu à réparation en vertu de textes
On sait, depuis quelques affaires célèbres, que des lois comme des conventions internationales peuvent être source de préjudices. Le principe de réparabilité de ces derniers est acquis, si certaines conditions très restrictives sont réunies 1 ( * ) ". Parmi ces conditions figure naturellement la non-exclusion de la réparation par le texte. Or soit de manière explicite, soit de manière implicite, certaines lois excluent toute réparation de préjudice qui peut être causé. Cette exclusion appelle deux remarques.
En premier lieu, les lois qui sont cause de préjudices pour un certain nombre de personnes et qui excluent toute possibilité de réparation ne sont pas aussi rares qu'on pourrait le penser. La loi du 13 avril 1946, dite loi Marthe Richard, ordonnant la fermeture des maisons de tolérance, exclut de manière explicite toute indemnisation des préjudices. De manière tout aussi explicite la loi du 17 janvier 1989 dispose en son article 16 que la validation de certaines décisions n'ouvre pas droit à réparation. Le plus souvent le refus d'indemnisation est implicite et résulte d'une interprétation du texte par le juge. Ainsi, selon le juge, en prévoyant que l'acquisition par l'État d'un objet proposé à l'exportation se ferait au prix fixé par l'exportateur, la loi du 23 juin 1941 a entendu exclure toute indemnisation du propriétaire auquel une telle acquisition légalement décidée causera un préjudice 2 ( * ) . De même, en égard à la législation monétaire "le préjudice résultant de la perte de valeur de la monnaie n'est pas de ceux qui peuvent ouvrir droit à indemnité" 3 ( * ) . Ou encore, la loi du 29 octobre 1974 ayant eu pour objet, notamment, d'interdire à raison de la pénurie toute publicité de nature à favoriser la consommation d'énergie, un règlement pris sur le fondement de cette loi et prohibant tout éclairage à caractère luxueux sur la voie publique ne peut engager la responsabilité de l'État 4 ( * ) . Il résulte de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature que le législateur a entendu exclure la responsabilité de l'État à raison des conséquences que ce texte a pu comporter pour l'activité professionnelle de taxidermiste 5 ( * ) . Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux que le législateur a entendu exclure toute indemnisation des sociétés dont l'activité se rattache à la fabrication ou au commerce de ces appareils 1 ( * ) . Les servitudes résultant de l'installation de lignes téléphoniques n'ouvrent pas droit à indemnité en vertu de l'article L. 51 du Code des P et T 2 ( * ) . Mais l'exclusion la plus générale est évidemment celle des servitudes d'urbanisme qui, en vertu de l'article L. 160-5 du Code de l'urbanisme, "n'ouvrent aucun droit à indemnité".
Ces exclusions de réparation ne sont pas négligeables, car les préjudices peuvent être très importants (comme, par exemple, dans le cas d'une interdiction de construire) et amènent à s'interroger à la fois sur les finalités poursuivies et sur la constitutionnalité de ces refus d'indemniser. S'agissant des premières on présume que la loi intervient dans un intérêt général et que c'est au nom de ce dernier qu'est refusée toute réparation du préjudice. Mais encor convient-il de préciser cet intérêt général. Et si, pour un certain nombre de lois précitées, cet intérêt général, s'il n'est pas indiscutable, est acceptable parce que le consensus peut s'établir sur l'existence de cet intérêt général, dans d'autres cas et, notamment en ce qui concerne les servitudes d'urbanisme, il est clair que le principe de non-indemnisation "obéit à des considérations principalement financières" 3 ( * ) . L'intérêt financier peut certes être un intérêt général, mais qui ne possède pas la noblesse d'autres finalités et peut donc plus facilement donner lieu à contestation. Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, que l'on puisse s'interroger sur la conformité de certaines de ces exclusions, soit à la Constitution 4 ( * ) soit à la Convention européenne des droits de l'homme 5 ( * ) .
b) Les préjudices non susceptibles de donner lieu à réparation en vertu de la jurisprudence
Dans trois séries d'hypothèses, d'inégale importance, le juge ne retient pas le préjudice indemnisable.
La première hypothèse, qui a donné lieu à un contentieux peu abondant, est celle des mesures gracieuses. Une mesure gracieuse "ne saurait ouvrir droit à une indemnité" 6 ( * ) . Selon M. Paillet "cette solution renvoie à la question plus vaste de savoir si l'existence d'un préjudice est ou non conditionnée par l'atteinte d'un droit" 7 ( * ) . La question a été examinée à propos d'actes illégaux mais justifiés au fond. Selon le juge la faute commise dans ce cas ne peut engager la responsabilité de l'administration. Certains ont vu dans cette solution l'application de la distinction entre le dommage et le préjudice : il y a dommage mais il n'y a pas préjudice indemnisable parce que la victime ne peut invoquer aucun droit subjectif.
Une deuxième hypothèse, tout aussi classique mais qui, à l'inverse de la précédente, se réalise relativement fréquemment, est celle des dommages, considérés par le juge comme insusceptibles de réparation, qui sont liés à des "modifications apportées à la circulation générale" et qui résultent "soit de changements effectués dans l'assiette ou dans la direction des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles" 1 ( * ) . Bien que certains tempéraments aient été apportés à cette règle, le principe demeure celui de préjudices non indemnisables, et l'on ne voit guère d'autre justification à cette solution que celle de la protection des deniers publics 2 ( * ) .
La troisième série d'hypothèses est celle qui, actuellement, soulève le plus d'interrogations et, éventuellement, suscite les passions, c'est celle de la réparation de préjudices liés à la naissance et, plus largement, à la vie. La question, liée aux progrès des techniques médicales et chirurgicales, peut être brutalement posée de la manière suivante : la vie peut-elle être considérée, dans certains cas, comme un préjudice réparable ?
La question s'est présentée en termes de principe devant le juge à propos d'une demande de réparation pour le préjudice que la mère estimait avoir subi du fait de la naissance de son enfant à la suite de l'échec de l'avortement demandé par elle (dans les conditions prévues par la loi, faut-il le préciser). La question de la réparabilité portait, non sur les charges qu'impliquait l'éducation de l'enfant, mais sur les conséquences, les "troubles" qu'entraînait la naissance de l'enfant. Le commissaire du Gouvernement déclarait, devant le Conseil d'État : "Ce qui est indemnisable, selon nous, c'est non la charge de l'enfant, mais les difficultés particulières tant psychologiques que matérielles que la mère rencontre (...) pour assumer cette charge" 3 ( * ) . La question de principe est donc bien celle de "l'enfant-préjudice". La réponse donnée par le Conseil d'État (et contraire aux conclusions de son commissaire du gouvernement) est également analysée comme une réponse de principe. Selon le juge la naissance d'un enfant, en conséquence de l'échec de l'avortement demandé par la mère, "n'est pas génératrice d'un préjudice de nature à ouvrir à la mère un droit à réparation" 4 ( * ) . Cependant, et très prudemment, le juge réservait "des circonstances ou une situation particulières" que la mère aurait pu invoquer. Ces circonstances se sont présentées dans une hypothèse similaire d'échec de l'avortement demandé mais où (malheureusement assez logiquement) l'enfant est né avec un handicap à la suite des lésions provoquées par l'IVG ayant échoué. Le juge a accepté de réparer le préjudice invoqué par la mère 1 ( * ) . La décision du Conseil d'État de 1982 a été étendue par le TA de Strasbourg à la naissance d'un enfant en conséquence de l'échec d'une opération de stérilisation 2 ( * ) . Cette position du Conseil d'État est présentée par certains comme "l'exact contre-pied" de la position adoptée récemment par la Cour de Cassation, et dont les médias se sont largement fait l'écho 3 ( * ) . Il n'est pas certain, cependant, que les positions des deux juges soient aussi éloignées qu'on l'a prétendu. Même si la position du Conseil d'État demeure, dans son principe, celle énoncée dans la décision Mlle R..., elle est beaucoup plus nuancée et, d'une certaine manière, ambiguë, qu'il n'y paraît. Dans la décision du Conseil d'État de 1997 4 ( * ) , ce qui n'est pas retenu, c'est le lien de causalité. Mais, si l'on s'en tient au préjudice, ainsi que l'écrit, B. Mathieu "Le caractère elliptique de la formule (du juge) masque l'apport essentiel de cette décision : la naissance d'un enfant handicapé peut représenter, pour ses parents, un préjudice" 5 ( * )
Cette jurisprudence ouvre la voie à toute une série de préjudices à propos desquels le juge sera amené à dire s'ils sont indemnisables ou non.
II - LA RECHERCHE D'UNE VÉRITABLE RÉPARATION
La réalité du préjudice implique, hormis les atténuations et les exceptions précédemment évoquées, l'idée de réparation. Mais, de même que l'on a pu noter une ambiguïté sur le dommage et le préjudice, une similaire ambiguïté apparaît dans la réparation : les juridictions statuent "sur la réparation" tout en parlant de préjudice indemnisable. Bien qu'il y ait un flottement quant à l'utilisation, largement substituable, de ces deux termes, on peut relever une double différence. D'une part, ainsi que le relevait déjà Littré dans sa définition de l'indemnisation, la compensation qu'apporte celle-ci n'indique pas qu'elle soit égale au dommage. D'autre part la réparation implique, outre le dédommagement, au moins l'idée de satisfaction pour une offense, un tort, elle conserve, à l'arrière-plan, un plan moral de pénitence. Et l'un des traits du préjudice aujourd'hui est que les victimes entendent bien obtenir une réparation et non pas seulement une indemnisation. C'est ce que manifestent les lois qui entendent réparer un dommage comme la sollicitation des citoyens à l'égard des pouvoirs publics pour consacrer une réparation dans des domaines nouveaux.
A - UNE RÉPARATION QUI N'EST PLUS SEULEMENT JURISPRUDENTIELLE
Historiquement, la réparation des préjudices subis par les victimes s'inscrit dans la théorie de la responsabilité telle qu'elle a été dégagée progressivement par le juge. C'est ce dernier qui indique au législateur la voie à suivre, comme le montre la célèbre affaire Cames qui contribuera à l'adoption de la première grande loi sur la réparation des accidents de travail. Mais la perspective est totalement différente aujourd'hui. Le législateur adopte des lois pour réparer des dommages non réparés ou jugés insuffisamment réparés par les juges. Cette réparation est moins originale par ses formes que par ses caractères.
1. Les formes de la réparation non jurisprudentielle
Face aux dommages qui atteignent les citoyens et connaissent un certain retentissement médiatique, les pouvoirs publics se préoccupent de réparer mais à travers deux attitudes, très différentes : tantôt ils affirment clairement et ostensiblement la volonté de réparer, tantôt ils procèdent de manière discrète comme S'ils étaient gênés de l'avouer.
a) La réparation proclamée : les lois de réparation
La réparation législative est bien une caractéristique de notre temps. On ne saurait objecter que dans le passé, déjà, le législateur a voulu réparer des dommages subis par les citoyens 1 ( * ) car les lois antérieures ont bien précisé qu'il ne s'agissait que de secours, bénévolement accordés par la nation, ces secours exprimant une conception qui n'est plus la nôtre aujourd'hui 2 ( * ) .
Les lois prévoyant des mesures d'indemnisation ou de réparation sont nombreuses 3 ( * ) mais il serait inexact de voir la même signification et de trouver la même portée à ces différents textes. Sur ce plan des changements importants sont intervenus. Les lois de réparation "anciennes" sont réservées, restrictives, méfiantes, en définitive, à l'égard de la réparation. La loi de 1964 sur la responsabilité de l'État à raison des conséquences dommageables des vaccinations obligatoires en est une bonne illustration. D'abord le législateur a tardé à intervenir, puisque, depuis plusieurs années, le juge refusait, malgré des tentatives vouées à l'échec, de réparer de tels dommages 4 ( * ) . Ensuite, en intervenant, le législateur ne faisait que réparer une injustice profondément choquante puisque les préjudices (graves) étaient liés à l'obligation, à laquelle étaient soumis les parents, de faire vacciner leurs enfants (notamment la vaccination antivariolique), cette vaccination conditionnant l'admission des enfants à l'école. Enfin cette législation était bien timide puisque la responsabilité de l'État ne jouait que dans le cas où la vaccination était effectuée dans un centre agréé. L'exigence était absurde, car elle aboutissait à une nouvelle injustice en faisant une distinction entre les préjudices résultant de vaccinations effectuées dans des centres agréés, réparables, et les autres, qui ne l'étaient pas. Et il fallut attendre encore onze ans (avec la loi du 26 mai 1975) pour que cette condition soit supprimée.
Les législations d'aujourd'hui expriment beaucoup mieux la volonté du législateur de réparer ce qui est ressenti comme des dommages inacceptables. Deux législations sont aujourd'hui l'application de ces préoccupations, mais d'autres verront probablement le jour dans l'avenir.
La première de ces législations est la loi du 9 septembre 1986 indemnisant les victimes d'attentats terroristes 1 ( * ) . Le terrorisme est une manifestation de violence qui revient cycliquement dans l'histoire, et si aucun pays n'est est exempt, certains tels que la France y sont plus particulièrement exposés en raison de leur histoire, de leurs engagements internationaux, du rôle que notre pays entend tenir dans le monde. Le terrorisme est source de dommages, il crée des victimes qui subissent un lourd préjudice. Le terrorisme que l'on qualifie à tort "d'aveugle" choisit précisément ses victimes, des personnes par définition étrangères à la cause (s'il y en a une) poursuivie par les terroristes. Lorsque se produisent de tels attentats avec des victimes, les pouvoirs publics sont généralement impuissants à faire triompher la justice, c'est-à-dire à arrêter les terroristes. Le sont-ils que ces derniers ne peuvent évidemment pas assurer le dédommagement des préjudices qu'ils ont causé. La responsabilité de l'État ne peut être engagée car, le plus souvent, les autorités publiques n'ont commis aucune faute, ont mis tout en oeuvre pour éviter la survenance de ces attentats. Face à ces préjudices que l'on ne pouvait guère réparer par les voies traditionnelles, face à ce sentiment d'iniquité ressenti par des victimes ne pouvant obtenir réparation, le législateur s'est décidé, après bien des hésitations, à adopter le 9 septembre 1986 une loi prévoyant une réparation des dommages causés par les attentats terroristes 2 ( * ) .
La seconde loi est une loi DDOS du 31 décembre 1991 qui met en place un dispositif d'indemnisation au profit de toutes les victimes contaminées par le Sida lors d'une transfusion sanguine. L'émotion provoquée dans l'opinion par la contamination de personnes transfusées qui se voyaient transmettre la mort alors qu'elles en attendaient la vie a entraîné l'intervention du législateur. Celle-ci est d'autant plus remarquable que, contrairement au cas précédent, des procédures devant les juridictions étaient possibles, et l'on peut même recenser à peu près tous les cas de figure puisque aussi bien les juridictions judiciaires (et, parmi elles, tant les juridictions civiles que les juridictions répressives) que les juridictions administratives ont été saisies et, s'agissant de ces dernières, la responsabilité des personnes publiques a été aussi bien une responsabilité pour faute qu'une responsabilité sans faute. Mais il est apparu au législateur que l'indemnisation que les victimes étaient susceptibles d'obtenir par des actions en justice n'était pas suffisante, donc pas satisfaisante. C'est ce qui explique le vote de la loi précitée 1 ( * ) . Cette loi est particulièrement remarquable, de notre point de vue, parce qu'elle énonce un véritable droit à réparation au profit des victimes, que ce droit est un droit à une réparation "intégrale", que la loi ne distingue pas entre le préjudice subi et le préjudice indemnisable.
b) La réparation administrative
La réparation administrative est celle qui est décidée, fixée, attribuée, par une autorité autre que l'autorité juridictionnelle ou l'autorité législative. Cette forme de réparation est beaucoup plus fréquente qu'il n'y paraît mais elle est beaucoup moins "voyante" que les autres, ce qui explique peut-être que l'on en parle moins. Elle pourrait même être la règle, si l'administration reconnaissait systématiquement les prétentions des demandeurs. On ne peut oublier que la victime doit d'abord demander à l'administration la réparation de son préjudice et que ce n'est qu'en cas de refus qu'elle s'adresse au juge pour faire reconnaître l'existence de ce préjudice.
Le règlement administratif des préjudices consiste pour l'administration à s'entendre avec les victimes, à leur proposer une indemnisation. Ces victimes, si elles s'estiment satisfaites, s'engagent à ne pas intenter de recours juridictionnel pour faire reconnaître la responsabilité de l'administration. Certes, l'on sait que cette renonciation n'a aucune valeur juridique. Les victimes peuvent toujours, nonobstant tous les engagements qu'elles ont pris, intenter un recours en indemnité. Toutefois, l'expérience montre que la plupart des personnes auxquelles il est proposé un arrangement amiable l'acceptent et n'intentent pas, ensuite, de recours en responsabilité, soit que l'indemnisation les satisfasse, soit qu'elles se croient tenues par l'engagement qu'elles ont pris auprès de l'autorité administrative. En tout état de cause, cela diminue le nombre de recours.
La réparation administrative contractuelle présente peut-être des avantages pour la victime (au moins celui de n'avoir pas à engager une action contre l'administration), mais en a, à coup sûr, pour l'administration : la mise en cause de sa responsabilité devant le juge, pour cette dernière, n'est pas seulement juridictionnelle, elle présente toujours nécessairement un aspect moral. La condamnation juridictionnelle de l'administration est la reconnaissance que cette dernière n'a pas agi selon un schéma de comportement idéal. Or, l'administration, en tant que corps, est soucieuse de la préservation de l'image d'une institution garante du bon droit, protectrice de l'intérêt général. La condamnation est d'autant plus mal ressentie lorsqu'elle connaît un certain retentissement dans l'opinion, ce qui est précisément le cas pour les préjudices corporels, résultats d'actes médicaux.
Il est extrêmement difficile d'apprécier la réparation administrative par rapport aux reconnaissances de responsabilité par le juge. On est tenté de dire, un peu rapidement, que si le contentieux est la pathologie de l'action administrative, il ne représente qu'une petite partie de celle-ci, il n'est que la partie émergée de l'iceberg. Cependant, il faut se garder de conclure trop vite, rien ne dit que l'augmentation des recours en indemnité en matière médicale, que l'on constate au contentieux, est le signe d'une augmentation encore plus grande des dommages subis et des réparations consentis par l'administration à l'amiable. On sait simplement que dans la plupart des hôpitaux il existe des commissions de conciliation chargées de prévenir le contentieux en proposant, éventuellement aux victimes, une indemnisation. À l'échelon national, les pouvoirs publics ont également préféré une indemnisation par voie contractuelle aux personnes ayant contracté la maladie de Creutzfeldt-Jakob à la suite d'un traitement aux hormones de croissance. Il est vrai que le nombre de cas était relativement limité, ce qui a évité la médiatisation du problème 1 ( * ) ". Il n'en serait probablement plus de même si VESB donnait lieu à un grand nombre de cas de nv MCJ d'ici quelques années 2 ( * ) . De même, les hépatites C post-transfusionnelles pourraient, éventuellement, devenir un problème de santé majeur obligeant les autorités administratives à renoncer à la réparation administrative pour une réparation législative, ce qui change les caractères de la réparation.
À côté de cette réparation on trouve une autre forme, celle de la transaction. Celle-ci peut s'appliquer à de nouveaux domaines, mais il est intéressant de constater que de plus en plus d'établissements hospitaliers y ont recours, le code de la santé publique prévoyant cette possibilité 3 ( * ) ". La transaction est un contrat entre l'établissement et une personne estimant avoir subi un préjudice du chef du premier 4 ( * ) . Les transactions en matière de préjudice hospitalier illustrent plutôt la première hypothèse de l'article 2044 du CC (terminer une contestation née) car la seconde hypothèse impliquerait un engagement hasardeux des fonds publics. La transaction intervient donc en fait à la suite d'un litige né d'une réclamation d'une victime, porté devant le juge et où le principe de la responsabilité de l'établissement hospitalier ne fait pas de doutes. L'administration va donc reconnaître le principe de sa responsabilité et proposer à la victime une indemnisation. Celle-ci sera peut-être inférieure à celle qu'aurait prononcée le juge (d'où l'intérêt de l'administration à la proposer) mais la victime peut trouver intérêt à cette offre parce que l'indemnisation sera plus rapide et évitera les tracas d'un procès. C'est bien le préjudice et non la responsabilité (puisque celle-ci est considérée comme établie) qui fonde la transaction en matière de dommages hospitaliers. Les établissements hospitaliers suivent une procédure codifiée faisant intervenir le service juridique de l'établissement, le médecin expert et l'assureur.
2. Les caractères de la réparation
Dans le droit administratif classique de la responsabilité l'obligation de réparation est une conséquence de la reconnaissance de responsabilité, principalement de la responsabilité pour faute. La nouveauté est la reconnaissance d'une réparation pouvant exister sans responsabilité, ce qui soulève la question du fondement d'une telle réparation.
a) Une réparation qui peut exister sans responsabilité
Dans le droit commun de la responsabilité, la réparation ou l'indemnisation est la conséquence de la responsabilité. Celle-là n'est possible que si celle-ci est reconnue, quel que soit le système de responsabilité dans lequel on se place. Si, en l'absence de préjudice, il ne peut y avoir de responsabilité et, donc, d'indemnisation, inversement et également, l'indemnisation n'existe pas en dehors de la responsabilité, elle n'est qu'un effet de cette dernière, les situations dommageables contemporaines montrent que cette liaison n'est plus toujours obligée, ce qui démontre le déplacement d'intérêt de la responsabilité vers le préjudice.
Dans les systèmes de réparation non jurisprudentiels, la responsabilité n'a pas nécessairement d'incidence sur la réparation. C'est ce qui résulte d'un certain nombre de lois qui organisent une réparation de certains dommages. Tel est le cas de la loi du 1 er juillet 1964 précitée sur les dommages résultant de vaccinations obligatoires. L'injustice du préjudice subi du fait de ces vaccinations, et alors que le juge administratif, même en se plaçant sur le terrain de la présomption de faute lourde, n'arrivait pas à réparer était telle que le législateur a estimé indispensable d'intervenir. La loi dispose que la réparation de tout dommage imputable directement à une vaccination obligatoire est supportée par l'État, ce dernier étant, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage 1 ( * ) , il y a donc réparation du préjudice quelle que soit la cause du dommage, en raison du risque que représentent les vaccinations (en fait essentiellement la vaccination antivariolique, qui n'est plus d'ailleurs, aujourd'hui, obligatoire). Il se peut qu'il n'y ait aucune faute. L'objectif est de réparer les préjudices quelle que soit la responsabilité retenue.
Le législateur va parfois plus loin, en décidant de réparer un dommage déterminé, tout en excluant la responsabilité de la puissance publique. Cette position peut surprendre parce que, traditionnellement, la réparation est liée à la responsabilité, et que l'on peut avoir du mal à accepter cette idée. Cependant, rien n'exclut que la puissance publique puisse venir en aide à des victimes d'un dommage dans la réalisation duquel elle ne porte aucune responsabilité. Il convient, peut-être, de mettre à part les dommages dans la réalisation desquels on ne peut mettre en cause l'activité de l'homme. Dans le cas des catastrophes qualifiées de "naturelles" (et en excluant toutes les hypothèses de causalité entre les activités administratives et la production ou l'aggravation du dommage), les pouvoirs publics ne peuvent demeurer indifférents face à la détresse qui frappe un certain nombre de citoyens. C'est pourquoi, depuis longtemps, des aides sont attribuées aux victimes par les autorités publiques en cas de survenance de telles calamités. Mais chaque fois que le législateur est ainsi intervenu pour venir en aide à une partie de la population touchée par le malheur, il a précisé qu'il s'agissait de secours attribués librement. On ne se trouve donc pas dans une hypothèse d'indemnisation, encore moins dans le cadre d'une volonté de réparation.
En revanche, dans deux cas au moins, on peut parler d'indemnisation sans responsabilité. Il s'agit, en premier lieu, de l'indemnisation des victimes d'attentats terroristes, par la loi du 9 septembre 1986 1 ( * ) . La responsabilité de l'État dans la survenance de ces attentats et dans la production des dommages est à écarter 2 ( * ) , sauf à considérer par exemple - mais il s'agit alors de jugements politiques et non plus de droit - que la politique menée par la France est à la source (et la cause politique ) des attentats et des préjudices qui en découlent. Quoi qu'il en soit, le législateur a écarté toute responsabilité de l'État tout en décidant de réparer les dommages causés aux personnes. Il s'agit, en second lieu, de la réparation des dommages subis par les polytransfusés contaminés par le virus du SIDA 3 ( * ) . La loi du 31 décembre 1991 entend réparer les "préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang". La loi ne se prononce pas sur la responsabilité de l'État. Elle ne l'exclut pas, elle ne la reconnaît pas non plus. Une certaine ambiguïté semble donc subsister sur ce point. Il convient de rappeler que la reconnaissance de responsabilité par le juge, tant judiciaire qu'administratif, n'implique aucunement une reconnaissance de responsabilité de l'État par la loi. Celle-ci est tout à fait indépendante des procédures juridictionnelles engagées par ailleurs 1 ( * ) . Mais le fait que la loi se réfère à la solidarité nationale semble permettre de trancher en faveur de l'exclusion de responsabilité.
b) Les fondements de la réparation sans responsabilité
Déjà, lorsque l'on se situe dans le cadre, classique, de la responsabilité, la question du ou des fondements de cette dernière n'a pas manqué d'être posée dès lors qu'il s'agit d'une responsabilité sans faute. La multiplicité des réflexions et la diversité des réponses montrent l'importance de la difficulté. Cette dernière est évidemment accrue à partir du moment où une indemnisation qui dépasse le simple secours est attribuée aux victimes. Sur quoi une telle indemnisation est-elle fondée ? Plusieurs réponses ont été apportées dont aucune n'est vraiment incontestée ni n'épuise le débat.
Un premier fondement, largement invoqué, et qui paraît constituer une réponse intellectuellement satisfaisante est celui de la solidarité nationale. Celle-ci serait le fondement de la réparation décidée par les pouvoirs publics en dehors de toute responsabilité, en particulier des réparations législatives. Si l'on fait abstraction du solidarisme de L. Bourgeois, qui est plus une idéologie politique qu'un fondement juridique, l'idée de solidarité nationale est évoquée pour la première fois avec force par Carré de Malberg pour réparer les dommages consécutifs à la Première guerre mondiale. Le grand juriste souhaite en 1915 que la loi qui doit être adoptée sur la réparation des dommages de guerre dégage "comme un élément de jus novum", l'idée de "la solidarité nationale qui unit entre eux tous les Français" 2 ( * ) . Le principe de solidarité nationale est inscrit dans le Préambule de 1946 et a donc valeur constitutionnelle. Il reste à déterminer son champ d'application et sa portée, ce qui est beaucoup moins évident. Le juge administratif s'est refusé à l'utiliser, estimant que la formulation était trop vague pour que l'on puisse en tirer une règle juridique 3 ( * ) . Le législateur, dont c'est effectivement le rôle, n'a pas hésité, lui, à utiliser le principe de solidarité nationale et en faire le fondement de l'indemnisation. Deux lois sont notamment citées en ce sens, la loi relative à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et, de manière plus explicite encore, la loi relative à l'indemnisation des victimes contaminées par le virus du Sida 4 ( * ) .
Ceci étant, il convient d'ajouter trois remarques. En premier lieu, le principe de solidarité nationale continue de soulever des interrogations et des réserves, certains persistant à y voir plus un principe idéologique ou politique que juridique. Il faut reconnaître que la tendance des groupes sociaux à évoquer à tout propos (et, parfois, hors de propos) le principe de solidarité nationale ne contribue guère à éclairer ou éclaircir le débat. En deuxième lieu, toutes les lois d'indemnisation de dommages ne se réfèrent pas à la solidarité nationale, ce ne sont que quelques rares lois pour lesquelles la solidarité nationale est incontestablement le fondement de la réparation. En troisième lieu, enfin, le Préambule lui-même limite le champ d'application de la solidarité nationale. Tous les dommages pour lesquels interviennent des mesures législatives ou administratives ne sont donc pas susceptibles de relever de la solidarité nationale.
C'est pourquoi des auteurs ont cherché d'autres fondements à la réparation. Certains ont cru trouver un fondement dans la garantie sociale qui serait la contrepartie du "risque social" 1 ( * ) . La garantie sociale emporte des conséquences différentes de celles produites par la solidarité nationale. Cette dernière implique plutôt une réparation assurée par les finances publiques, c'est-à-dire par le budget de l'État. La garantie sociale fait nécessairement une part relativement importante à l'assurance et c'est le cas tout particulièrement pour les catastrophes naturelles 2 ( * ) . Il n'est donc pas indifférent que le fondement soit plutôt la solidarité nationale ou la garantie sociale, ces deux fondements étant beaucoup plus complémentaires qu'opposés. Par ailleurs le principe de garantie sociale encourt les mêmes reproches que la solidarité nationale. Enfin, si l'on en croit certains auteurs, un autre fondement pourrait être trouvé, et expliquerait, peut-être, la jurisprudence Bianchi. Ce fondement serait "à chercher dans la création d'une sorte de droit d'indemnisation à base humanitaire" 3 ( * ) 99. Mais on peut éprouver une certaine perplexité et faire preuve d'une réserve encore plus certaine devant un fondement de ce type tant ce droit "à base humanitaire" pourrait être étiré dans tous les sens et justifier toutes sortes d'indemnisation alors que, déjà, une pression de plus en plus grande se manifeste en faveur d'une réparation toujours plus étendue.
B - UNE RÉPARATION DE PLUS EN PLUS SOLLICITÉE
Les temps ont vraiment changé, dans ce domaine comme dans les autres. Plutôt que de se résigner ou d'implorer les dieux, les hommes, dans un pays tel que le nôtre, préfèrent s'adresser aux autorités. Et parce que les dommages sont potentiellement de plus en plus nombreux, la demande de réparation se fait de plus en plus forte.
1. Des dommages potentiellement de plus en plus nombreux et ressentis comme des préjudices
C'est un fait difficilement niable que la vie moderne est à la source de nouveaux dommages potentiels, dommages qui sont également mal supportés par les victimes.
a) Des dommages potentiellement multipliés
Les sociétés développées ont vu disparaître des maux qui, pendant des siècles, frappaient de terreur les hommes, en particulier certaines épidémies. L'augmentation spectaculaire de l'espérance de vie à la naissance, qui se poursuit, est un signe tangible de l'amélioration de la condition de vie des hommes. Mais si les "cavaliers du malheur" ont été vaincus, les sociétés contemporaines sont à l'origine de nouveaux risques qui peuvent être à la source de nouveaux préjudices. On peut retenir brièvement trois facteurs de risques.
Un premier facteur d'augmentation des dommages est, banalement, l'intervention des pouvoirs publics. On peut certes présumer que cette intervention se fait dans le but d'améliorer la condition et la vie des citoyens. Mais même si cela est indéniable, il est rare qu'une action ait seulement des effets favorables, elle comporte généralement aussi des inconvénients. Et même si le "bilan coûts- avantages" est favorable à la collectivité, il se peut que quelques personnes subissent de ce fait un préjudice. C'est le cas en particulier des travaux publics. Outre les inconvénients que la jurisprudence a qualifiés de "normaux" qu'ils provoquent au voisinage, outre les accidents dus aux travaux publics et aux ouvrages publics, qui fournissent une part non négligeable du contentieux, il y a tous les autres inconvénients qu'ils résultent de la réalisation des travaux publics ou de la présence d'ouvrages publics. Les citoyens demandent désormais réparation de préjudices tenant au bruit, aux odeurs, à la vue résultant, selon eux, de la présence de certains équipements 1 ( * ) . Il convient de remarquer, au passage, que si les citoyens souhaitent, voire exigent, de pouvoir bénéficier de ces équipements publics, en revanche, ils ne veulent pas en supporter les inconvénients (parfois importants). En témoigne la difficulté pour choisir le site d'un nouvel aéroport ou encore, dans une grande ville face de France, la vaine quête d'un site pour la création d'une usine de traitement des ordures ménagères, nécessaire mais dont personne ne veut près de chez soi.
Un deuxième facteur d'aggravation des risques, sur lequel il n'y a pas lieu d'insister, mais il convient de rappeler, est représenté par les nouveaux modes d'intervention de l'administration. Dans un certain nombre de domaines (on pense naturellement aux nouvelles méthodes pénitentiaires ou psychiatriques, mais il y a également le cas, par exemple, de toutes les expérimentations biomédicales) les modes d'intervention ont évolué. Si ces modes présentent des avantages, réels ou potentiels, pour les intéressés, ils créent également des risques, soit pour ces derniers (expérimentations biomédicales) soit pour les autres. En cas de dommages se pose inévitablement la question de leur responsabilité.
Un troisième facteur de dommages encore moins maîtrisable est représenté par le progrès technique. Sans reprendre les refrains habituels sur le progrès on peut faire deux brèves observations. D'une part et, notamment, parce qu'il multiplie la puissance de l'homme, le progrès est facteur de risque : un transformateur est, par lui-même, dangereux. Il en est de même des matériaux nouveaux que nous fournit le progrès : leur innocuité ou leur toxicité n'apparaît souvent pas immédiatement. Ainsi, pendant des années, l'amiante a été considéré comme un isolant remarquable pour les constructions et un matériau permettant d'améliorer le freinage des véhicules, avant que l'on s'aperçoive qu'il pouvait être la cause d'une maladie respiratoire chronique (l'asbestose) et, plus gravement encore, d'un cancer de la plèvre dont le pronostic est généralement défavorable (le mésothéliome). Dans ce dernier cas les dommages sont tels qu'en dehors des actions en justice intentées par les intéressés 1 ( * ) des mesures spécifiques ont été adoptées. Mais, d'autre part, il faut se garder de l'illusion qu'il serait possible de trouver des procédés, des matériaux, des produits, qui ne présenteraient aucun risque, le "risque zéro" n'existant nulle part, selon une formule connue, et cela quelles que soient les précautions que l'on prenne. Ainsi par exemple les éoliennes, présentées comme une source d'énergie écologique, outre qu'elles ne peuvent pas concurrencer véritablement (dans un pays tel que le nôtre) l'énergie nucléaire, abîment le paysage et, si elles sont nombreuses, peuvent affecter le climat 2 ( * ) . Et, pour prendre un autre exemple, il n'est pas certain que les pots catalytiques, coûteux et imposés par la réglementation pour les véhicules neufs, soient sans effets sur l'environnement 3 ( * ) W3.
b) Des dommages de moins en moins supportés
Les risques auxquels nous sommes soumis sont sans doute plus diffus que les risques traditionnels mais, quels qu'ils soient, ils sont de moins en moins bien supportés par les citoyens. Trois explications peuvent être proposées.
En premier lieu, les hommes de notre temps refusent de plus en plus l'explication de la fatalité à laquelle, pendant des siècles, on a recouru. Cette attitude va de pair avec la confiance dans le progrès. Malgré les désillusions de ce dernier, et même s'il ne peut apporter le bonheur, les hommes en attendent d'apporter des solutions à un certain nombre de leurs difficultés. Cela vaut particulièrement, depuis quelques années, pour les dommages résultant des éléments naturels, notamment les inondations (mais ce fut vrai également pour les incendies). L'argumentation, peut-être simpliste, du citoyen moyen est la suivante : à l'heure où l'homme a été capable d'aller sur la lune et envisage d'aller sur les autres planètes (au moins sur Mars), où il est possible de cloner des êtres vivants, il est incompréhensible que l'on ne puisse se prémunir contre la violence de la nature. Le changement (éventuel) de climat ne convainc guère les victimes et celles-ci ont volontiers tendance à accuser les pouvoirs publics d'incompétence ou/et d'incurie. Et tout état de cause elles exigent un dédommagement.
En deuxième lieu, dans certains domaines tel que le domaine médical les hommes de l'art font appel à de nouvelles techniques, de nouveaux procédés qui sont conçus pour apporter des améliorations, pour procurer plus d'efficacité à une intervention et qui aboutissent parfois à aggraver le dommage ou à créer un dommage beaucoup plus grave que celui qui devait être réparé. C'est ce que constatent les juges dans les différentes affaires où ils relèvent que le recours à une nouvelle technique d'investigation ou une nouvelle thérapeutique a entraîné la "perte d'une chance" d'avoir conservé leur intégrité physique pour les intéressés. La disproportion entre l'attente d'un soulagement ou d'une guérison et la réalité d'un dommage très grave explique la revendication des victimes.
En troisième lieu, enfin, se trouve la conviction, de plus en plus répandue, que le préjudice doit être réparé et que, s'il ne peut l'être, une indemnisation doit intervenir. Certains seront peut-être tentés d'y voir une tendance française à s'en remettre à l'État pour tout ce qui va mai, une expression d'une déresponsabilisation des individus, de la "société assurantielle", etc. Mais, quelles que soient les explications, le fait est que les individus acceptent mal l'idée qu'un préjudice qu'ils subissent ne soit pas réparé ou indemnisé. Et il est impossible aux autorités politiques de ne pas tenir compte de cette attente, de ne pas la prendre en compte. Cette demande des citoyens ne porte plus sur une satisfaction de principe, comme autrefois, mais sur une véritable réparation.
2. La demande d'obtention d'une véritable indemnisation
Faute de pouvoir obtenir ce qui serait une vraie réparation, les victimes veulent obtenir une véritable indemnisation. C'est dire que cette dernière doit être financièrement significative mais aussi qu'il existe une attente pour une certaine cohérence dans le montant des indemnisations accordées par le juge administratif et par le juge judiciaire.
La question du montant de l'indemnisation ne se pose vraiment que pour le préjudice personnel, qu'il s'agisse du préjudice corporel ou de la douleur morale. En ce qui concerne les préjudices matériels, même si les victimes peuvent ne pas êtres satisfaites par les barèmes appliqués (le taux de vétusté, par exemple) 1 ( * ) les règles ne donnent guère lieu à contestations doctrinales 1 ( * ) .
En ce qui concerne la souffrance physique, les juges indemnisent, le plus souvent, en se référant à une échelle établie par les experts et qui va généralement de 1 à 7. Certains préfèrent, au vu du dossier, qualifier la douleur de faible, moyenne, importante ou très importante, et fixent le montant de l'indemnité en conséquence. Les sommes attribuées varient considérablement parce que, d'abord, les situations dont différentes et que le juge se détermine en fonction de l'espèce, dont l'arrêt ne permet pas de connaître toutes les données 2 ( * ) , ensuite, le juge conserve un pouvoir d'appréciation qui fait qu'on peut le trouver plus ou moins "généreux", enfin, ainsi que le rappellent les arrêts, "aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, ne s'opposent à ce qu'un tribunal fixe globalement l'indemnité due pour deux ou trois chefs de préjudice, alors même qu'ils auraient été évalués de manière séparée par la victime, à condition de ne pas dépasser le total des sommes sollicitées" 3 ( * ) . À titre d'exemple, la CAA de Nantes a fixé à 10.671,43 l'indemnisation de souffrances physiques qualifiées d'importantes 4 ( * ) et à 4.573,47 l'indemnisation de souffrances qualifiées de moyennes 5 ( * ) .
C'est en ce qui concerne la douleur morale que des évolutions significatives ont eu lieu en matière d'indemnisation. Bien qu'ayant reconnu la douleur morale le juge administratif, c'est-à-dire le Conseil d'État, se montrait plus que mesuré dans l'indemnisation, qui était surtout de principe et se montait à 762,25 ou 914,69. L'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence ne compensait que partiellement cette faiblesse de l'indemnisation 6 ( * ) . Désormais le montant de la réparation au titre de la douleur morale est d'un montant beaucoup plus raisonnable 7 ( * ) .
CONCLUSION
Reste le problème de l'équivalence de la réparation, selon que la victime intente son action (ou doit intenter son action) devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire. Traditionnellement ce dernier était considéré comme plus généreux que le juge administratif. Mais cela est de moins en moins vrai, ou appelle des nuances importantes selon les moyens invoqués, selon que l'on se trouve en première instance ou en appel. Il n'est pas toujours aisé de comparer les réparations, du fait de chefs de réparation particuliers (comme, par exemple, les "troubles dans les conditions d'existence" en droit administratif). Ceci étant, il est effectivement de moins en moins compréhensible, et donc de moins en moins admissible, pour les victimes, que la réparation soit différente selon que l'on se trouve devant le juge administratif ou le juge judiciaire. L'un et l'autre sont d'ailleurs conscients de cette exigence et tentent de rapprocher les montants de réparation qu'ils accordent aux victimes.
Monsieur le Doyen Georges VEDEL
Merci beaucoup mon cher collègue. Vous avez parfaitement éclairé la question et vous avez amorcé le problème de vocabulaire sur les mots "préjudice" et "dommage", sans vous y engager totalement, mais nous aurons tout à l'heure une discussion probablement. Si vous le permettez la dernière intervention, mais non la moins importante et la moins intéressante, est celle de notre collègue GUETTIER, professeur à l'université du Mans. Et alors là c'est vraiment un point d'interrogation qui assortit la question : "Disparition, maintien ou réformation de la dualité de juridiction ?". Vous avez la parole.
Disparition, maintien ou réformation de la dualité de juridiction ?
par Monsieur Christophe GUETTIER,
professeur à l'Université du Maine
"Disparition, maintien ou réformation de la dualité de juridiction ?". Si l'on s'interroge sur le sujet, c'est que la dualité de juridiction pour connaître du contentieux de la responsabilité présente des inconvénients auxquels on pourrait essayer de remédier soit en envisageant à l'extrême sa disparition pure et simple, soit en optant à l'inverse pour son maintien, mais à la condition que son architecture soit éventuellement reconsidérée.
Il est vrai que la responsabilité administrative remplit d'abord et avant tout une éminente fonction de réparation, ce qui la rapproche singulièrement de la responsabilité civile. Or, non seulement la nature de la fonction assurée par ces deux types de responsabilité est comparable, mais le raisonnement qui doit être tenu dans les deux cas pour permettre la réparation des dommages causés à une victime inclut à chaque fois les mêmes éléments caractéristiques : il faut effectivement prouver l'existence d'un préjudice, lui trouver un fait générateur et établir un lien de causalité entre les deux. Du fait de cette double similitude, est-il bien raisonnable de cultiver l'originalité jusqu'à soumettre à deux ordres de juridiction distincts le contentieux de la responsabilité civile et le contentieux de la responsabilité administrative ? Ne serait-il pas plus simple, tout particulièrement pour les requérants, de confier tout le traitement du contentieux de la responsabilité réparatrice à un seul et même juge ?
Il est vrai que le dualisme de juridiction à la française est bien critiquable lorsqu'il conduit en particulier à des divergences de jurisprudence entre les deux ordres de juridiction sur des sujets voisins. Ainsi, par exemple, est-il équitable d'appliquer des règles de responsabilité différentes à la victime d'un accident médical selon que ce dernier se produit à l'hôpital ou dans une clinique privée ? Peut-on accepter que l'évaluation de dommages de même ordre diffère parfois dans d'importantes proportions selon qu'elle est faite par le juge civil ou le juge administratif ? La légitimité de tels écarts ne saute jamais aux yeux. Or, ces fausses notes ont parfois de l'écho au delà de nos frontières. Ainsi, il arrive que les contrariétés de jugement entre les deux ordres de juridiction soient parfois montrées du doigt par la Cour européenne des droits de l'homme, comme en ce qui a concerné, par exemple, l'articulation entre les procédures juridictionnelles et l'intervention du fonds d'indemnisation des victimes de contaminations transfusionnelles par le VIH. En l'espèce, les solutions qui avaient été dégagées par la Cour de cassation pour l'application de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 s'opposaient à celles retenues par le Conseil d'État. La complexité des règles résultant de la coexistence de ces deux jurisprudences et l'incertitude en découlant ont alors conduit la Cour européenne des droits de l'homme à condamner la France à plusieurs reprises pour insuffisante clarté des textes relatifs aux possibilités de recours 1 ( * ) .
Après un état des lieux aussi accablant, on aurait pu croire que l'espérance de vie du dualisme de juridiction ne pouvait être que très courte en la matière. Pourtant, force est de constater que le contentieux de la responsabilité n'a jamais fait l'objet d'une quelconque tentative de remise en ordre d'ensemble. En France, le fait institutionnel est l'objet d'une véritable approche boulimique qui déroute bien des observateurs étrangers. Que l'on songe, par exemple, à l'organisation administrative du territoire et à cette multitude de collectivités locales de niveaux différents, phénomène unique en son genre en Europe 2 ( * ) .
On ne s'étonnera pas vraiment que le dualisme de juridiction dans le contentieux de la responsabilité n'ait pas été et n'est toujours pas actuellement l'objet d'un vif débat. Ni la doctrine, ni même les praticiens ne revendiquent à haute et forte voix la suppression de cette originalité française. D'ailleurs, quel ordre de juridiction serait bénéficiaire de l'établissement d'un bloc de compétence ? Le juge judiciaire, sans doute. N'est-ce pas effectivement jusqu'à présent dans cette direction qu'a été opéré la quasi totalité des regroupements de compétence en matière de responsabilité de la puissance publique ? Quel est le fondement d'une telle politique ? L'antériorité de la justice judiciaire sur la justice administrative ? Peut-être aussi le sentiment que la justice administrative continue toujours à sentir un peu le soufre en France.
En tout cas, que l'actualité de notre sujet ne soit pas brûlante 3 ( * ) est une opportunité qu'il convient de saisir pour réfléchir sereinement à la question de l'éventuelle abolition de la dualité de juridiction s'agissant du contentieux de la responsabilité. Il est effectivement toujours préférable d'éviter de réformer dans l'urgence.
Mais, de lege ferenda, à quel niveau normatif devrait se situer une telle réforme ? Sur ce point, la jurisprudence du Conseil constitutionnel nous fournit une réponse claire. En effet, le Conseil constitutionnel a montré la voie à suivre dans sa décision du 23 janvier 1987 relative au Conseil de la concurrence 1 ( * ) . Une simple réforme législative devrait suffire. En effet, selon le Conseil constitutionnel, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, qui domine le régime de la répartition de la compétence entre les deux ordres de juridiction, n'a de valeur constitutionnelle que dans la mesure où il se confond avec le principe réservant au juge administratif l'annulation et la réformation des décisions de la puissance publique. Pour le reste, il a seulement valeur législative. Ainsi, le législateur pourrait transférer aux tribunaux judiciaires des contentieux tel celui de la réparation des dommages causés par la puissance publique.
L'établissement d'un bloc de compétence au profit du juge judiciaire pour connaître de tout le contentieux de la responsabilité est ainsi rendu possible. Mais toute la difficulté consiste ensuite à savoir si une telle réforme est bien souhaitable. Des arguments forts militent certes en ce sens, d'autant plus que, comme nous l'observerons dans un premier temps, les bases sur lesquelles repose la dualité de juridiction dans le contentieux de la responsabilité sont bien fragiles ( I ). Toutefois, nous ne nous rallierons pas à une solution aussi radicale. En effet, il nous semble qu'au fond ce débat sur la dualité est aujourd'hui largement dépassé. Les véritables problèmes sont ailleurs. C'est sur ce point qu'il conviendra de s'expliquer dans un second temps (II).
I- LES BASES DE LA DUALITÉ DE JURIDICTION DANS LE CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITÉ SONT FRAGILES
Le Professeur Jacques CHEVALLIER a démontré que la loi des 16 et 24 août 1790, en affirmant la séparation des fonctions judiciaires et des fonctions administratives, n'avait pas voulu interdire aux tribunaux de juger l'administration, mais seulement de. faire oeuvre d'administration. En cela elle tendait moins à les empêcher de s'opposer à l'administration que de se substituer à elle 2 ( * ). En fait, l'article 13 du titre II de cette loi voulait éviter que ne se reproduisent les abus des parlements qui consistaient à prendre des règlements de police et à citer des agents du roi, notamment pour leur donner des instructions. Il cantonnait donc les tribunaux judiciaires dans la solution des litiges. Mais il ne leur interdisait pas expressément de connaître des litiges intéressant l'administration.
On le sait, ce n'est pas cette interprétation qui a été seulement retenue par la suite. Pour des raisons tenant à la profonde méfiance que lui inspiraient de longue date les tribunaux judiciaires, le pouvoir politique préféra écarter la compétence de ces derniers pour connaître des actions engagées contre l'administration. Il mit alors en place un ordre de juridiction, proche de lui, spécialisé dans le jugement des affaires administratives. C'est donc ainsi que la juridiction administrative s'est vue confier le contentieux des actes et comportements de l'administration dans le but d'en assurer un développement mieux maîtrisé.
Cette opération ne s'est pas faite sans heurts. Ainsi, s'agissant en particulier du contentieux de la responsabilité de la puissance publique, les deux ordres de juridiction ont multiplié les querelles de partage de compétence pendant une bonne partie du XIX e siècle. Or, ce qui frappe lorsque l'on observe la façon dont ces conflits ont été résolus, c'est le décalage entre le dogmatisme des intentions affichées initialement (A) et le pragmatisme qui a prévalu dans le choix des solutions adoptées ultérieurement (B), aussi bien par le juge administratif lui-même que par le législateur.
A- LE DOGMATISME DES INTENTIONS AFFICHÉES INITIALEMENT
Si la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique suppose, comme la responsabilité de droit privé, un fait dommageable, un préjudice réparable, un lien de causalité et une personne responsable, son régime juridique n'est pas celui du Code civil, mais procède d'une inspiration autonome dont le juge administratif a été à l'origine, à compter de la fin du XIX e siècle, dans des termes qui, alors, ne faisaient pas place au doute : " Considérant que la responsabilité qui peut incomber à l'État, pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu' `il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil ". Ainsi, dans la fameuse décision Blanco, rendue le 8 février 1873 1 ( * ) , le Tribunal des conflits écarta délibérément le droit civil comme source générale de la responsabilité administrative 2 ( * ) . Il mit également fin à une longue controverse sur la question de savoir quel ordre de juridiction devait connaître des litiges relatifs à la mise en cause la responsabilité de l'administration en prenant clairement parti en faveur du juge administratif.
De là a découlé l'application à la puissance publique de règles juridiques spécifiques et dérogatoires au droit civil. Le juge administratif s'y est employé avec constance. Au fond, pourquoi ? Pour deux raisons principales et étroitement imbriquées. D'une part, il s'est agi pour lui de chercher à préserver l'intérêt général, qui a été posé en France comme différent par nature des intérêts particuliers contre la pression desquels il doit être protégé en permanence 3 ( * ) (1). D'autre part, ce faisant, le juge administratif a bien perçu également l'intérêt pour lui d'affirmer sa compétence pour connaître du contentieux de la responsabilité administrative : mieux asseoir une légitimité au départ mal assurée du fait de sa proximité du pouvoir politique. C'est effectivement en s'attachant à entretenir la spécificité des règles applicables dans ce contentieux qu'il a pu progressivement accréditer l'idée que la compétence du juge judiciaire en la matière était inappropriée comparée à la sienne (2). De là le ton péremptoire du Tribunal des conflits dans sa décision Blanco, véritable décision de combat.
1. La nécessité de préserver l'intérêt général a exigé le recours à un régime de responsabilité spécifique pour la puissance publique
La préservation de l'intérêt général est effectivement apparue comme l'épine dorsale des politiques jurisprudentielles développées par le juge administratif dans le contentieux de la responsabilité de la puissance publique. Cette démarche volontariste l'a ainsi conduit à dégager des règles marquées par le sceau du particularisme, qu'elles concernent l'administration auteur du dommage ou l'administré victime de ce dommage.
Prenons, entre autres, l'exemple de la faute lourde, qui n'a pas vraiment son équivalent en droit civil de la responsabilité. Il a été démontré comment cette notion a eu pour fonction de protéger certaines activités administratives contre toute tentative d'engagement de responsabilité trop systématique. En fait, le recours à la faute lourde a permis d'éviter de désacraliser l'ascendant qu'exerce la puissance publique sur la société civile. En quelque sorte, le Conseil d'État a jugé qu'il n'était pas acceptable que le roi soit nu. On ne s'étonnera donc pas de constater que l'abandon de la faute lourde qui est en cours depuis le début des années quatre-vingt-dix dans la jurisprudence administrative ne s'est pas généralisé. En effet, d'une part, son exigence reste maintenue à l'égard des activités administratives les plus directement liées aux attributions régaliennes de l'État, comme la justice, le fisc ou encore le contrôle de l'État sur les collectivités décentralisées 1 ( * ) . Mais on relève par ailleurs que là où la faute lourde a disparu récemment, cela ne semble pas s'être traduit par de moindres exigences de la part du juge administratif dans l'établissement du caractère fautif du fait générateur. Sur ce dernier point, il a été observé que le passage de la faute lourde à la faute non qualifiée paraît souvent plus formel que réel, le juge persistant à prendre en compte les difficultés des activités concernées 2 ( * ) .
Nous sommes bien là en présence de politiques jurisprudentielles tout à fait caractéristiques de ce que peut produire le juge administratif dans sa prise en compte de l'intérêt général pour définir les régimes de responsabilité applicables à la puissance publique auteur du dommage. Or, parce que l'intérêt général occupe ainsi une place centrale, il est clair qu'il n'est pas sans avoir d'incidence sur la victime elle-même qui subit le dommage. Le traitement de la demande en réparation qu'elle adresse au juge administratif est effectivement affecté par cette présence, ce qui là encore explique les solutions particulières apportées en droit administratif.
Si, à l'égard de la victime, la fonction réparatrice de la responsabilité est souvent mise en avant et permet de rapprocher la responsabilité administrative de la responsabilité civile au point d'ailleurs que l'on a pu qualifier la responsabilité administrative de responsabilité " civile " 1 ( * ) , force est de constater que cette fonction masque en fait d'autres réalités qui sont liées au système administratif et qui introduisent des éléments de différenciation marqués entre les deux responsabilités. On constate effectivement que dans l'arbitrage entre l'intérêt général et les intérêts particuliers auquel il procède, le juge administratif cherche toujours à assurer la primauté du premier. Dès lors, la victime peut voir ses intérêts propres sacrifiés sur cet autel de l'intérêt général. C'est le cas, par exemple, dans la jurisprudence du Conseil d'État sur le principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme, prévu à l'article L. 160-5 du Code de l'urbanisme.
On le sait, en l'espèce, des limites existent au principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme. Globalement, elles sont au nombre de trois : primo, seuls les dommages causés par l'institution légale d'une servitude sont insusceptibles de réparation ; secundo, de nombreuses servitudes légales donnent lieu au versement d'une somme d'argent compensatoire, soit parce qu'elles ne relèvent pas du Code de l'urbanisme, soit parce qu'elles font l'objet d'un traitement spécial au sein de ce code 2 ( * ) ; tertio, l'article L. 160-5 lui-même prévoit son propre système d'exceptions ("l'atteinte à des droits acquis" et "la modification de l'état antérieur des lieux"). Mais il n'est pas certain que cela suffise à satisfaire aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme 3 ( * ) .
Dans le doute, le Conseil d'État a préféré fabriquer les conditions de l'harmonie des normes européenne et française dans le cadre d'une démarche créative particulièrement originale dans un arrêt Bitouzet du 3 juillet 1998 4 ( * ) . Dans cet arrêt, le Conseil d'État a effectivement jugé que l'article L. 160-5 du Code de l'urbanisme "ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi".
Au premier plan, la lecture très directive du Conseil d'État lui permet d'affirmer l'entière compatibilité du principe d'une non-indemnisation des servitudes avec la Convention européenne des droits de l'homme. Mais au second plan, l'arrêt Bitouzet construit, par lui-même, la compatibilité de la loi et du traité là où elle apparaissait incertaine. En ajoutant à l'édifice préexistant une aile bâtie de fond en comble à l'aide de matériaux directement transposés du vocabulaire et des catégories de pensée de la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil d'État a bel et bien fabriqué les conditions d'une harmonie qui n'aurait pas régné sans lui. Bref, avant toutes choses, il s'agissait d'écarter le risque d'une condamnation, par la Cour européenne, d'un article L. 160-5 trop oublieux des "cas exceptionnels où (survient) une charge exorbitante et hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi". Ainsi, en imposant juridiquement une lecture officielle du Code de l'urbanisme qui soit de nature à le conformer aux exigences posées par la Cour, le Conseil d'État a, avant tout, visé à désarmer cette dernière.
Toutefois, au-delà de ces enjeux, la question demeure quand même de savoir si l'adjonction de ce codicille jurisprudentiel modifie profondément les capacités objectives d'indemnisation des propriétaires affectés par une servitude d'urbanisme. "L'exorbitance" de la charge semble devoir n'apparaître que dans des cas rarissimes. La terminologie employée par le Conseil d'État excède les limites ordinaires qu'évoque la notion d'un préjudice dit "anormal". En outre, l'emploi de la locution cumulative "ainsi que" pour relier, dans la composition du dommage, le contenu de la servitude et les conditions de son institution, donne à penser que l'existence d'une contrainte juridique très forte ne suffira pas à ouvrir la porte de l'indemnité. Il faudra aussi que cette contrainte ait été mise en place dans des conditions et/ou dans un contexte intrinsèquement préjudiciable. En fait, le plus souvent, l'apparition de la charge inacceptable risque surtout de signaler la proximité de quelque chose d'illicite dans le processus d'institution de la servitude (On peut penser, par exemple, à un détournement de pouvoir commis dans le zonage d'un plan local d'urbanisme). Mais, dans ce cas précis, le bel échafaudage mis en place par l'arrêt Bitouzet n'ajoute absolument rien au droit antérieur, puisque l'illégalité d'une servitude est depuis longtemps réparable comme fautive selon les règles du droit administratif commun, ou compensée par le juge de l'expropriation au titre du dol 1 ( * ) .
Cet exemple montre comment finalement la primauté de l'intérêt général peut conduire à faire jouer à la responsabilité administrative une fonction singulière que nous pouvons qualifier de "sacrificielle" à l'égard des victimes 2 ( * ). Ces diverses solutions jurisprudentielles dont nous venons de faire état manifestent ainsi la part d'autonomie que possède le droit administratif de la responsabilité. Mais si le régime de responsabilité applicable à la puissance publique possède de la sorte un réel degré de spécificité, cela tient également au fait que le juge administratif avait besoin de pouvoir le revendiquer haut et fort pour justifier sa compétence dans un domaine sur lequel son monopole n'avait rien de naturel.
On constate effectivement que le recours à un tel régime spécifique a été instrumentalisé pour renforcer la légitimité du juge administratif lui-même.
2. Le recours à un régime de responsabilité spécifique pour la puissance publique a contribué à renforcer la légitimité du juge administratif
Faire juger l'administration par le juge judiciaire, n'était-ce pas courir le risque qu'il lui appliquât le droit commun ? L'intervention d'un juge particulièrement au fait des réalités administratives en raison de ses propres origines fut donc considérée comme un préalable nécessaire. La définition d'un droit spécifique a ainsi été indissociablement liée à la compétence d'un ordre juridictionnel spécialisé. Tel fut l'apport majeur de la fameuse décision Blanco, qui liait la compétence du juge et le fond du droit applicable. Au delà de ces considérations d'opportunité, la dualité de juridiction dans le contentieux de la responsabilité s'est alors trouvée justifiée de façon objective. Mais on peut aller plus loin et affirmer que si le juge administratif s'est efforcé avec constance d'entretenir la spécificité des règles applicables, cela a tenu au fait qu'il a pu puiser là les ressources nécessaires pour fonder la légitimité de ses propres interventions. L'intérêt de la puissance publique et du juge administratif se sont ainsi confondus. Cependant, il a fallu que le Conseil d'État livre sans cesse bataille pour autonomiser le plus possible le droit de la responsabilité applicable à la puissance publique. Il y est progressivement parvenu en poursuivant une double démarche ; tantôt en adoptant des concepts inusités en droit civil, tantôt en rejetant les régimes déjà appliqués en droit civil.
L'adoption de concepts inusités en droit civil. Pour marquer son territoire, le juge administratif a effectivement cherché à développer le particularisme de la responsabilité administrative en recourant à des concepts originaux sans équivalent en droit civil.
Ainsi, par exemple, du moins pour certains auteurs, le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, tel qu'il est prévu à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 s'est vu reconnaître une portée générale, fondant l'ensemble de la responsabilité publique 1 ( * ) . Le fondement de l'obligation de réparer résiderait ainsi, en droit administratif, dans l'anormalité d'une atteinte excessive au principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, que cette anormalité se situe au niveau du fait générateur (responsabilité pour faute) ou bien du préjudice (responsabilité sans faute). Si cette opinion reste parfois contestée en doctrine 2 ( * ) , il n'en demeure pas moins que le juge administratif fait expressément mention dudit principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques dans certains régimes de responsabilité sans faute 1 ( * ) , à propos de dommages particuliers subis dans l'intérêt général, où il apparaît comme sans équivalent dans le contentieux judiciaire. En l'espèce, le juge administratif a effectivement mis en place de façon originale des régimes de réparation qui font la part entre ce qui est inhérent à toute forme de vie en collectivité et ce qui s'analyse en une atteinte excessive supportée dans l'intérêt de tous.
De même, le concept de service public a permis au juge administratif de s'approprier des territoires élargis. L'examen du régime de la responsabilité administrative dans son ensemble révèle que le service public a effectivement joué un véritable rôle structurant, tout particulièrement à travers la faute de service, qui constitue le droit commun de la responsabilité administrative 2 ( * ) et qui a donné son assise à l'autonomie des règles en cause 3 ( * ) . C'est sur son fondement que le juge administratif a pu construire ce régime. En effet, au lendemain de la décision Blanco, rendue au début de l'année 1873, la compétence du juge administratif et l'application d'un régime de responsabilité dérogatoire au droit commun auraient pu se limiter à l'hypothèse de la " faute de service " entendue seulement au sens de faute anonyme, celle dont l'auteur n'aurait pas été identifié. En revanche, lorsque la " faute du service " peut être attribuée à tel ou tel agent, ne devait-on pas considérer que dans ce cas le litige oppose un particulier victime et un agent personne physique, ce qui aurait dû justifier l'intervention du juge judiciaire et l'application d'un régime de droit commun ? Autrement dit, la " faute incarnée " ne devait-elle pas subir un traitement ordinaire ? Le Tribunal des conflits ne l'entendit pas ainsi. Bien au contraire. Quelques mois après avoir statué dans l'affaire Blanco, il se prononça dans une affaire Pelletier 4 ( * ) dans un sens tout à fait favorable au juge administratif. La primauté du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16 et 24 août 1790, le conduisit à interdire aux tribunaux judiciaires de connaître de l'activité administrative sous couvert d'une action intentée contre un agent y prenant part. Seuls des faits personnels, totalement détachables du service, étaient susceptibles d'engager la responsabilité des agents devant les juridictions civiles. Cette interprétation large de la faute de service ne fut jamais remise en cause ultérieurement. Outre qu'elle permet de procurer un débiteur solvable à la victime, elle protège aussi l'agent, dont la responsabilité n'est pas engagée en cas de faute de service. Mais surtout elle cantonne le juge judiciaire dans le traitement de litiges très exceptionnels, la puissance publique étant assurée de relever largement de son juge "naturel".
Le rejet des régimes appliqués en droit civil. Pour défendre son territoire, le juge administratif s'est par ailleurs refusé de se référer à certains régimes spécifiques de droit civil de la responsabilité, comme la responsabilité du fait des choses ou la responsabilité du fait d'autrui. En effet, bien qu'en doctrine d'importants travaux de recherche aient relativisé sérieusement la thèse de l'autonomie des règles de la responsabilité administrative 1 ( * ) , des études ont depuis permis de démontrer que la responsabilité administrative restait bien une responsabilité atypique et qu'il ne saurait exister en droit administratif ni de responsabilité du fait des choses ni de responsabilité du fait d'autrui, au sens où on l'entend en droit privé.
En effet, outre que les manuels ne font aucunement allusion à un quelconque principe de responsabilité administrative du fait des choses, ni comme théorie juridique, ni même comme simple rubrique, l'analyse de la jurisprudence du Conseil d'État montre qu'à l'évidence les dommages causés par des choses ne donnent pas lieu à un traitement particulier. En effet, la responsabilité susceptible d'être encourue par l'administration à l'occasion de l'emploi de choses mobilières ou immobilières ne présente pas de réelle unité, ni même de véritable spécificité 2 ( * ) .
De même, le droit administratif ignore très largement les principes qui gouvernent la responsabilité du fait d'autrui en droit civil 3 ( * ) . Il faudrait certes réserver l'application particulière que fait le juge administratif de la théorie du "cumul de responsabilité" 4 ( * ) . En effet, le Conseil d'État a jugé que la responsabilité de l'administration peut être engagée malgré l'absence de toute référence à la notion de faute de service, dès lors que la faute personnelle de l'agent est commise dans le service ou même plus simplement lorsqu'elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service 5 ( * ) . Dans ce dernier cas, la faute personnelle peut être commise en dehors du service mais pendant le temps du service 6 ( * ) ; elle peut être également accomplie en dehors même du temps de service 7 ( * ) . Toutefois, ces cas de figure restent très marginaux du fait du déclin général de la faute personnelle au profit de la faute de service. Quant aux autres hypothèses parfois invoquées pour étayer la thèse de l'existence d'une théorie de la responsabilité administrative du fait d'autrui, force est de constater qu'elles ne correspondent pas à un tel cas de figure, qu'il s'agisse de la faute de service ou de la jurisprudence administrative sur la responsabilité de l'État pour "risque spécial" causé aux tiers à l'occasion du recours à des méthodes libérales de rééducation et de soins, qui obéissent à des logiques propres 1 ( * ) .
On le voit, le juge administratif a fait là oeuvre militante. L'édiction de règles dérogatoires au droit civil de la responsabilité s'est inscrite dans le cadre d'une démarche volontariste qui n'a fait que traduire des intentions de départ particulièrement tranchées. Or, l'opération aurait-elle manqué son but ? On ne peut en effet qu'être étonné par l'écart qui sépare les intentions catégoriques affichées initialement et les solutions baroques finalement retenues en droit positif.
B- LE PRAGMATISME DES SOLUTIONS ADOPTÉES ULTÉRIEUREMENT
La répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction paraît réglée selon des considérations qui échappent parfois à une logique rigoureuse. Que l'on songe par exemple à la compétence juridictionnelle pour connaître des dommages causés par des attroupements ou rassemblements. D'abord confié aux tribunaux judiciaires, ce contentieux a été transféré par simple opportunité à la juridiction administrative avec l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986.
Il est vrai que la source du droit applicable en la matière est double : pour partie législative et pour l'essentiel jurisprudentielle. Or, ces deux sources classiques ont entretenu entre elles à certaines époques des relations conflictuelles 2 ( * ) qui ont conduit à l'adoption de solutions parfois extrêmes. Ainsi, le juge administratif n'a-t-il pas écarté dès le départ le Code civil, donc la loi, comme source générale de la responsabilité administrative 3 ( * ) ? En outre, des régimes législatifs de responsabilité de l'administration ne sont-ils pas intervenus pour prévoir la compétence du juge judiciaire en la substituant à celle, de principe, de la juridiction administrative 4 ( * ) ? De là le côté "jardin à l'anglaise" que présente la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction dans le contentieux de la responsabilité de la puissance publique.
Le tableau ne serait pas complet si l'on n'y ajoutait pas les différentes hypothèses dans lesquelles des principes constitutionnels viennent de temps en temps ajouter une touche de couleur supplémentaire, comme le principe de l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle. Se trouve ainsi fondée, entre autres, la compétence du juge judiciaire pour connaître de la responsabilité de l'État en raison des préjudices causés par des décisions préfectorales "d'hospitalisation d'office" dans un établissement psychiatrique de personnes dont les "troubles mentaux" compromettent "l'ordre public ou la sûreté des personnes" 1 ( * ) .
Dans ces conditions, on comprendra qu'il soit particulièrement difficile d'essayer de systématiser en ce domaine. D'ailleurs, pour charger encore un peu plus la barque, il peut être fait mention du cas des organismes privés participant à l'action administrative. En ce qui concerne le contentieux de la responsabilité lié à leurs actes ou comportements, la prise en compte du critère organique aurait eu le mérite de simplifier la situation en rendant le juge judiciaire seul compétent à raison de la nature de l'organisme en cause. Ce n'est toutefois pas la solution qui a été retenue en jurisprudence. Le choix en faveur du critère matériel qui a été fait présente certes l'avantage de permettre au juge administratif de conserver un oeil sur ces démembrements de l'administration. Mais son maniement n'est guère aisé car l'exercice d'une fonction administrative n'est pas suffisant. En effet, le juge administratif n'est compétent qu'à la condition que le dommage trouve sa source dans la mise en oeuvre d'un élément exorbitant du droit commun à l'occasion de l'exercice de cette fonction administrative 2 ( * ) . En pratique, cela n'a rien d'évident.
Le pragmatisme qui anime ces différentes solutions est quelque peu déroutant. Un traitement synthétique de la situation nous conduit à constater la complexité du système car non seulement les deux ordres de juridiction peuvent connaître du contentieux de la responsabilité de la puissance publique, mais le droit appliqué au litige peut être tantôt le droit administratif ou tantôt le droit civil. Le croisement de la compétence et du fond donne ainsi lieu à pas moins de quatre combinaisons possibles. Un quadrille bipolaire en quelque sorte.
Premier cas de figure : La responsabilité de l'administration peut être jugée par le juge administratif qui lui applique alors en principe les règles de droit public.
Il arrive même que la compétence de la juridiction administrative s'exerce pour des litiges opposant des personnes privées entre elles qui se voient alors soumises à de telles règles. La loi du 28 pluviôse an VIII en donne une illustration ancienne à propos des dommages causés par les entrepreneurs de travaux publics 1 ( * ) . Il en va de même en cas de mise en jeu de la responsabilité des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public lorsque le litige trouve son origine dans la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique (cf. supra). Il est vrai qu'il s'agit là d'une application du principe selon lequel la compétence suit le fond car si le juge administratif est compétent en l'espèce cela tient au fait que c'est un régime administratif qui est en cause.
Deuxième cas de figure : Lorsque le juge administratif statue sur la responsabilité de l'administration, il lui applique aussi, bien que plus occasionnellement, quelques règles de droit privé, comme par exemple certaines techniques d'indemnisation du préjudice 2 ( * ) . Dans la décision Blanco (préc), le Tribunal des conflits avait certes cherché à exclure le droit civil pour résoudre les litiges nés des dommages causés par la puissance publique. Or, avec le recul, ce rejet en bloc est loin d'avoir été pratiqué de façon systématique. Le droit privé a bien eu sa part d'influence dans la construction de la responsabilité administrative. D'ailleurs, si, à l'origine, chacun des deux ordres de juridiction a élaboré ses propres techniques, il était inévitable qu'il fût influencé par les pratiques de l'autre et qu'il tendît à s'en rapprocher si elles lui paraissaient plus équitables. En fait, c'est fréquemment en faveur de la jurisprudence judiciaire, mieux connue des praticiens du droit et réputée plus généreuse pour les victimes, que la pression des avocats et des commentateurs voire des pouvoirs publics eux-mêmes s'est exercée sur le juge administratif. C'est ainsi que le principe de la liaison de la compétence et du fond n'a pas empêché le Conseil d'État de recourir le cas échéant à des dispositions du Code civil, comme par exemple les articles 1153 et 1154 sur les intérêts moratoires et compensatoires et sur leur capitalisation, ou aux principes dont s'inspirent certaines dispositions du Code civil, comme par exemple les articles 1792 et 2270 du Code civil sur la responsabilité décennale 3 ( * ) .
Troisième cas de figure : La responsabilité de la puissance peut également être engagée devant le juge judiciaire qui lui applique en principe les règles de droit privé - comme dans le cas des accidents causés par des véhicules administratifs. En l'espèce, revenant sur la jurisprudence Blanco (précit.), le législateur, par la loi du 31 décembre 1957 relative aux accidents causés par des véhicules, non seulement retira au juge administratif pour le transférer aux juridictions judiciaires 1 ( * ) le contentieux des dommages causés par un "véhicule quelconque" 2 ( * ) , mais il précisa que les tribunaux judiciaires devaient statuer "conformément aux règles du droit civil". Ce bloc de compétence n'a toutefois pas simplifié la situation car la compétence de la juridiction administrative est susceptible de resurgir dès lors, par exemple, que l'accident peut être imputé à un défaut d'entretien de la voie publique 3 ( * ) . En fait, les règles normales de compétence réapparaissent si les actions en responsabilité sont engagées sur un fondement autre que celui visé par la loi du 31 décembre 1957, même si le dommage est partiellement imputable à un véhicule. C'est ainsi, par exemple, que la juridiction administrative reste compétente pour connaître de la faute commise dans l'organisation du service, nonobstant l'imputabilité du dommage à un véhicule 4 ( * ) .
Quatrième cas de figure : Le juge judiciaire est aussi susceptible d'appliquer à la puissance publique les règles de droit public. Il lui arrive effectivement de traiter globalement le contentieux dont il a à connaître selon les principes même du droit administratif et de se poser alors en véritable juge administratif 5 ( * ) On assiste ainsi à une dissociation de la compétence et du fond qui permet de consacrer, au-dessus de la dualité des autorités contentieuses, l'unité fondamentale des principes juridiques.
En matière de responsabilité extracontractuelle, la jurisprudence Giry illustre une telle référence explicite à la jurisprudence administrative à propos du régime applicable aux actions en responsabilité dirigées contre l'État du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice judiciaire 6 ( * ) . Issue en 1952 d'un jugement du Tribunal civil de la Seine et consacrée quatre ans plus tard par la Cour de cassation 7 ( * ) , cette jurisprudence, qui fait appel (et parfois dans les visas mêmes des jugements et arrêts qui la constituent) aux "principes régissant la responsabilité de la puissance publique", se résume dans la formule, énoncée par la Cour de cassation, selon laquelle, les dispositions du Code civil étant inapplicables au règlement des litiges mettant en cause la puissance publique, les tribunaux ont "le pouvoir et le devoir de se référer (...) aux règles du droit public". Ainsi, dans l'affaire Giry, la Cour de cassation jugea que les tribunaux judiciaires devaient appliquer aux faits de l'espèce le principe selon lequel la responsabilité de l'administration est engagée sans faute à l'égard de ses collaborateurs occasionnels 1 ( * ) .
Cette solution a sa logique. En effet, en matière de dommage causé lors d'une opération de police judiciaire, la compétence du juge judiciaire ne se justifie pas par le souci de soumettre au droit privé une activité de service public. Lorsque l'État exerce sa mission de police judiciaire, il ne se comporte pas comme un particulier. Il se manifeste au contraire en tant que puissance publique. L'État doit, dès lors, être soumis au régime de la responsabilité de la puissance publique, quel que soit le juge compétent.
Il apparaît ainsi que le droit de la responsabilité applicable à l'administration est conçu largement comme un "droit-caméléon" qui prend la couleur du milieu ambiant : la responsabilité est civile si l'activité administrative est gouvernée par le droit privé, comme par exemple dans le cadre des services publics industriels et commerciaux ; la responsabilité est en revanche administrative si le dommage est né à l'occasion d'un acte ou d'un comportement exorbitant du droit privé, comme par exemple à propos du régime applicable aux actions en responsabilité dirigées contre l'État du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice judiciaire.
Pour simplifier, n'aurait-on pas dû chercher à faire en sorte que la responsabilité de l'administration soit toujours considérée comme une responsabilité administrative dont seul le juge administratif peut connaître ? Force est de constater que cette solution n'a pas été retenue ni par le juge ni par le législateur. Et l'on sait que le Conseil constitutionnel ne l'a pas fait figurer au nombre des "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République" dans sa décision précitée du 23 janvier 1987. La raison profonde de cette situation nous semble tenir à la conception même que l'on a eue en France de cette responsabilité administrative qui est un régime résiduel. Lorsque l'on dit que ce régime est dérogatoire au droit privé, cela signifie en fait qu'il est exceptionnel, limité à un champ d'application stricte - qui fut d'ailleurs très largement celui des activités de l'État-gendarme souverain au XIX ème siècle, alors que les collectivités locales étaient censées n'accomplir que des actes de gestion ordinaire dont elles devaient rendre compte devant le juge judiciaire. Par la suite, le droit de la responsabilité de la puissance publique s'est étendu au delà de son cadre d'origine précisément lorsque l'on a assisté à une pénétration de la puissance publique à la fois dans le droit des collectivités locales et également à la faveur du mouvement qui a consisté à associer des organismes de droit privé à l'action administrative en leur confiant l'usage de prérogatives de puissance publique. Mais malgré cette expansion, le droit de la responsabilité administrative appliqué à la puissance publique est resté un régime résiduel car, d'une part, les institutions administratives ont largement emprunté au droit privé dans le cadre des activités de l'État-providence, et, d'autre part, dans le même temps le droit civil de la responsabilité s'est développé dans d'importantes proportions, à la faveur notamment du développement de l'assurance. En volume, la part respective du droit civil et du droit administratif de la responsabilité est restée sensiblement la même. La responsabilité de droit public a toujours été et demeure un îlot d'administrativité dans un océan de droit privé. Il n'y avait aucune raison impérieuse d'en généraliser le régime.
Mais si des règles spéciales sont ainsi appliquées en partie à l'administration, on peut s'interroger sur le point de savoir s'il convient encore de les maintenir ? Autrement dit, y aurait-il péril à traiter l'administration comme un simple particulier ? Après tout, même la dogmatique décision Blanco ne serait plus rendue aujourd'hui comme elle l'a été en 1873, du fait notamment des principes posés par la loi du 31 décembre 1957 sur les accidents causés par les véhicules. Mais c'est tout le problème de la légitimité du droit administratif en général qui est ainsi posé et dont l'évocation dépasse le cadre de notre étude.
Si l'on opte alors pour le maintien d'un droit administratif de la responsabilité - ce qui n'a rien de scandaleux dans une "Administration de droit" - on pourrait alors imaginer d'en confier l'application au seul juge judiciaire. Cette solution n'est pas en soi irréaliste quand on sait que le juge judiciaire fait déjà parfois application de règles de droit public, comme nous l'avons vu plus haut. Mais sa culture et sa connaissance du milieu administratif, sans oublier sa disponibilité, le mettent-elles en mesure de juger en connaissance de cause ? Déplacer la ligne de partage des compétences entre les deux ordres de juridiction est une chose. Rendre viable à tout point de vue le système qui en résulte en est une autre. Or, il nous semble que le dualisme de juridiction a une vertu : c'est qu'il est source d'imagination. Le docteur Giry aurait-il été indemnisé de son préjudice si le juge judiciaire n'avait pas fait application de la théorie administrativiste du collaborateur bénévole ? Monsieur Bianchi aurait-il obtenu satisfaction si le juge judiciaire et non le juge administratif avait connu de sa demande en réparation des très graves dommages que lui avait causés l'accident médical survenu au cours d'un examen radiologique à l'hôpital 1 ( * ) ? À trop vouloir faire dans le rationnel, on risque peut-être d'assécher les gisements de créativité que la dualité de juridiction a produits. Sous ce dernier aspect, il nous semble que le bilan coût-avantages de cette originalité française reste globalement positif.
On l'aura compris, nous ne sommes pas favorable à la disparition du dualisme juridictionnel dans le domaine de la responsabilité de la puissance publique.
Nous sommes plutôt enclins au maintien de ce choeur à deux voix. Il y aurait d'ailleurs sans doute un effet "domino" si on voulait le remettre en cause ici. Petite cause, grands effets ! Il n'est peut-être pas sûr que cela en vaille la peine. D'autant plus que le débat sur la dualité nous paraît aujourd'hui quelque peu dépassé, comme certains signes nous invitent à le penser.
II- LE DÉBAT SUR LA DUALITÉ DE JURIDICTION DANS LE CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITÉ EST DÉPASSÉ
En France, l'existence d'une juridiction administrative a essentiellement un fondement historique. Elle remonte à l'Ancien Régime. La Révolution ne l'a pas écartée. L'Empire l'a systématisée. La République l'a définitivement établie. Elle est maintenant reconnue au niveau constitutionnel. Comme l'affirme le Professeur Pierre DELVOLVE, "La juridiction administrative s'insère trop profondément dans le système administratif français pour que sa mise en cause n'ébranle pas tout l'édifice. Seule une révolution pourrait l'abattre" 1 ( * ) . Et même en une telle circonstance, on sait que vouloir faire table rase du passé peut se révéler être une belle utopie sans lendemain.
D'ailleurs, les ratés de la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction à propos du contentieux de la responsabilité de la puissance publique ne nous semblent pas si fréquents qu'ils révéleraient l'existence de dysfonctionnements majeurs auxquels il faudrait mettre fin d'urgence. Le nombre de décisions émanant du Tribunal des conflits n'a rien de significatif en l'espèce. Ensuite, si l'on voulait instaurer un bloc de compétence homogène au profit du juge judiciaire, il n'est pas du tout sûr que toutes les difficultés disparaîtraient comme par enchantement. Les délais de jugement n'en seraient probablement pas réduits de façon substantielle. En outre, sur le fond, il n'y a pas de raisons objectives pour considérer que le juge judiciaire serait nécessairement plus compréhensif à l'égard des victimes que le juge administratif lorsqu'est en cause l'administration. Le débat sur l'abolition du dualisme de juridiction nous semble parfois tenir un peu du procès d'intention que le contexte actuel de victimisation du droit contribue sans doute à durcir singulièrement.
En fait, l'examen de la jurisprudence tant administrative que civile la plus récente montre qu'en ce qui concerne le droit de la responsabilité les deux ordres de juridiction se rapprochent de façon de plus en plus intéressante là où la comparaison est possible (A). Cet aspect positif tend déjà à réduire l'impact des arguments qui militent en faveur de l'abolition de la dualité de juridiction. Des esprits grincheux pourraient certes considérer que de tels rapprochements jurisprudentiels devraient justement inciter à aller au bout de leur logique, à savoir l'unification du contentieux après l'unité de la règle. Mais, ne s'agit-il pas là d'un combat d'arrière-garde ? Il nous semble en effet que le coeur du problème est ailleurs. En matière de responsabilité comme en bien d'autres domaines, la régulation des rapports de droit n'est pas seulement l'oeuvre du juge. Elle doit être d'abord celle du législateur. Or, celui-ci n'aurait-il pas une fâcheuse tendance à s'en remettre un peu trop souvent au juge, soit par insouciance, soit par intérêt ? Force est de constater qu'il n'est pas rare que le législateur se rende politiquement coupable "d'incompétence négative", ce qui n'est peut-être pas pour rien dans le développement d'un rapport de force entre l'autorité judiciaire et le pouvoir politique qui s'opère de plus en plus au profit de la première. Le droit de la responsabilité administrative n'est-il pas l'oeuvre du seul juge administratif dans ses principes directeurs ? Or, aujourd'hui, le véritable débat n'est peut-être pas tant celui qui tourne autour de la question du maintien ou non du dualisme de juridiction, mais plutôt celui qui est relatif au problème de la délimitation exacte de la sphère d'intervention du juge quel qu'il soit et du législateur (B).
A- LA TENDANCE À L'HARMONISATION DES SOLUTIONS JURISPRUDENTIELLES
On constate effectivement que les jurisprudences administrative et judiciaire ont tendance à se rapprocher sur certains points dans le contentieux de la responsabilité. Ce qui traduit l'unité de certains principes juridiques en droit de la responsabilité par delà la dualité des autorités contentieuses, même si, comme le rappelle fort justement le Professeur René CHAPUS, il ne faut pas "que soit perdue de vue l'importance de ce par quoi se traduisent l'originalité et l'autonomie respectives des deux droits coexistants" 1 ( * ) . En fait, ces facteurs d'unité ne remettent pas en cause le principe autonomiste fondamental de l'arrêt Blanco, qui continue à dominer l'état du droit, et l'on peut même se demander s'ils ne sont pas la nécessaire contrepartie pour que la légitimité du droit spécifique qui régit l'administration et son contentieux n'en soit que mieux assurée. En tout cas, ce qui est remarquable, c'est que les rapprochements se font dans les deux sens : le juge civil n'hésite pas parfois à emprunter au droit administratif et réciproquement.
1. Tout d'abord, on constate en effet que le juge judiciaire peut rechercher dans les solutions déjà dégagées par le juge administratif des sources d'inspiration pour le droit civil de la responsabilité.
Ainsi, par exemple, s'agissant de la responsabilité des institutions privées ayant la garde d'un malade mental, elle doit être engagée, depuis l'arrêt Blieck, rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 29 mars 1991 2 ( * ) , sur la même base - la responsabilité sans faute - qu'en droit public, dès lors que le malade bénéficie, dans le cadre des nouvelles techniques de traitement des maladies mentales, d'une autorisation temporaire de sortie. Ce faisant, la Cour de cassation s'est directement inspirée de la jurisprudence administrative et notamment de l'arrêt Département de la Moselle, rendu par la section du contentieux du Conseil d'État le 13 juillet 1967 1 ( * ) .
De même 2 ( * ) , on a pu voir dans la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation issue de l'arrêt Costedoat c/ Girard et autres, rendu par l'assemblée plénière le 25 février 2000 3 ( * ) comme un rapprochement avec certaines solutions déjà admises dans le contentieux administratif de la responsabilité. En considérant que "n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant", la Cour de cassation n'aurait-elle pas repris à son compte la théorie administrativiste dite du "cumul de responsabilité" avec la "faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service" 4 ( * ) ? Effectivement, malgré le caractère elliptique de la motivation de l'arrêt, ce modèle administratif a peut-être servi de référence, la "faute personnelle" appelant le maintien de la responsabilité du commettant vis-à-vis des personnes lésées dans tous les cas où elle ne constitue pas un "abus de fonction". Toutefois, dans un tel cas de figure, le schéma de droit administratif laisse subsister la responsabilité de l'administration au profit des victimes tout en autorisant le recours contre l'agent fautif. Or, la décision de l'assemblée plénière du 25 février 2000 semble s'écarter de la solution de droit public sur ce dernier point en paraissant vouloir faire incomber la responsabilité désormais, dans la plupart des cas, définitivement au seul commettant, sans possibilité de recours contre le préposé. Dès lors, si emprunt au droit administratif il y a, ce serait plutôt du côté de la responsabilité sans faute de l'administration du fait de ses agents qu'il faudrait tenter la comparaison.
2. Le juge administratif peut également s'inspirer de solutions déjà consacrées par le juge judiciaire
Le phénomène n'est pas nouveau. On se souvient par exemple que le Conseil d'État s'est obstiné pendant longtemps à ne pas réparer la douleur morale, jusqu'au jour où cette solution n'a plus paru tenable au regard des avancées du juge judiciaire sur le sujet 1 ( * ) .
Mais au delà de ce cas d'espèce, de véritables politiques jurisprudentielles ont été mises en oeuvre par le juge administratif visant à opérer certains rapprochements avec des solutions de droit privé. Plusieurs considérations différentes le guident alors. Pour l'essentiel, ces rapprochements sont justifiés tantôt par la nature de la question posée au juge administratif tantôt par la nature du contentieux en cause.
La nature de la question posée au juge administratif. Il arrive que certaines questions soulevées devant le juge administratif, qui relèvent au premier chef du droit public dans la mesure où il s'agit de déterminer la responsabilité d'une personne publique, soient fortement teintées de droit civil, ce qui peut alors justifier des traitements identiques. On peut illustrer ce cas de figure en donnant l'exemple d'un rapprochement récent de la jurisprudence administrative des solutions déjà adoptées par le juge judiciaire à propos de la patrimonialisation du droit à réparation des préjudices personnels subis par la victime.
En effet, par un arrêt en date du 29 mars 2000, le Conseil d'État a admis que les héritiers puissent exercer une action tendant à l'indemnisation de ces préjudices 2 ( * ) . En l'espèce, le Conseil d'État a considéré qu'une cour administrative d'appel ne commet aucune erreur de droit en jugeant que le droit à réparation des préjudices tant matériels que personnels subis par la victime, contaminée par le virus de l'hépatite C lors d'une transfusion sanguine, est entré dans le patrimoine de ses héritiers alors même que la victime n'avait, avant son décès, introduit aucune action tendant à la réparation de ces préjudices. En effet, le droit à réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Dans cette affaire, reprenant la solution du juge d'appel, le Conseil d'État s'est ainsi aligné sur la position adoptée antérieurement par la Cour de Cassation 1 ( * ) . Après avoir nié cette patrimonialisation 2 ( * ) , le Conseil d'État a ainsi consacré l'évolution qui se dessinait favorablement en ce sens depuis plusieurs années au sein de diverses cours administratives d'appel 3 ( * ).
Toutefois, depuis longtemps déjà, il était admis sans difficulté aussi bien par la Cour de cassation 4 ( * ) que par le Conseil d'État 5 ( * ) , que les héritiers disposent d'une action successorale en réparation lorsque sont en jeu des dommages patrimoniaux. En effet, le préjudice subi par la victime (dommage matériel à un bien, perte de revenus, etc.) affectant son patrimoine, il se répercute ensuite sur les héritiers qui se voient transmettre un patrimoine réduit d'autant. Il est alors également normal que les héritiers puissent poursuivre l'action que la victime aurait intentée si celle-ci meurt en cours d'instance 6 ( * ) . En revanche, la situation est à priori toute autre pour les préjudices non économiques, telle que la douleur morale. On s'accorde à dire que les héritiers ne peuvent recueillir que les droits qui entrent dans le patrimoine du défunt, car seuls ces droits sont transmissibles 7 ( * ) ; dès lors, les droits personnels, attachés à la personne même de la victime, ne sauraient être transmissibles. Il résulte de ce raisonnement que l'action en réparation des préjudices personnels ne se "transmet pas héréditairement" 8 ( * ) et qu'elle s'éteint avec le décès de la victime.
Certes, la Cour de cassation a rapidement admis que lorsque le de cujus a lui-même initié l'action en réparation de son vivant, ses héritiers peuvent la continuer après sa mort 9 ( * ). Dans un arrêt de 1971 Association "Jeunesse et reconstruction" (précit.), le Conseil d'État a clairement adopté la même position, notamment à propos des souffrances physiques 1 ( * )0 . Certes, ce sont les héritiers qui bénéficieront de l'indemnité, mais ce qui importe c'est que la victime a manifesté sa volonté d'engager une action, de telle sorte que le droit à réparation n'est plus virtuel, il est devenu parfait, la victime ayant "qualité pour opérer cette remarquable transformation d'un préjudice extrapatrimonial en droit patrimonial" 1 ( * ) . Par ailleurs, refuser aux héritiers le droit de poursuivre l'action reviendrait à subordonner le versement de l'indemnité à la date du décès de la victime. Au total, la transmissibilité limitée qu'autorise le juge paraît justifiée et de nature à établir un certain équilibre entre des exigences contradictoires.
Le Conseil d'État vient donc de décider d'aller plus loin en estimant que le droit à réparation de la victime, quelle que soit la nature du dommage, est "entré dans son patrimoine avant son décès". Ce faisant, il a, d'une part, pratiquement repris mot pour mot la formule de la Cour de cassation qui dans ses arrêts de 1976 affirmait que "le droit à réparation du dommage éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers", d'autre part, rejeté la conception selon laquelle le droit à réparation des préjudices personnels ne tombe dans le patrimoine de la victime qu'au moment de la liquidation de l'indemnité. En fait, si les souffrances constituent un dommage extra-patrimonial, le droit à réparation de ce dommage, qui naît à la date de l'accident, est un droit au versement d'une somme d'argent. C'est un droit pécuniaire, inclus dans le patrimoine de la victime et transmis avec lui à ses héritiers 2 ( * ) . Il convient donc de distinguer entre la souffrance, qui est incontestablement personnelle, donc extra-patrimoniale, et le droit à réparation qui, lui, est patrimonial. Ce qui entre dans le patrimoine des héritiers ce n'est pas la souffrance, mais le droit à réparation d'un préjudice effectivement subi par la victime, lequel naît à la date de l'accident. À partir du moment où la victime peut en réclamer le paiement, la créance de ce prix tombe bien dans son patrimoine, pour constituer un des éléments qui le composent. En succédant au patrimoine, l'héritier en reçoit tous les éléments, y compris le droit à réparation de la douleur endurée par le de cujus avant son décès.
On le sait, cette position de la Cour de cassation ne fait pas l'unanimité en doctrine 3 ( * ) . Mais pour le juge, qu'il soit judiciaire ou administratif, cette transmissibilité absolue est sans doute à mettre en rapport avec l'idée que l'indemnisation est peut-être finalement le seul moyen de faire prendre conscience de sa responsabilité à l'auteur de l'acte dommageable.
Il faut donc prendre acte de ce rapprochement entre les deux ordres de juridiction. Il est vrai qu'une telle convergence reste souhaitable dès lors que surgit une question commune à la responsabilité des personnes publiques et des personnes privées, car il est difficilement acceptable que les victimes ou leurs héritiers connaissent un sort plus ou moins avantageux selon que leur action relève de la compétence du juge administratif ou du juge judiciaire.
La nature du contentieux en cause. La volonté d'introduire davantage de cohérence dans un "contentieux mixte", c'est-à-dire partagé entre les deux ordres de juridiction, peut également conduire le juge administratif à s'aligner sur des positions antérieures de la juridiction judiciaire. Deux catégories d'exemples permettent d'illustrer cette politique jurisprudentielle. Le premier exemple est tiré du contentieux des contraventions de voirie ; le second exemple est relatif au contentieux de la responsabilité médicale.
Premier exemple : Dans le contentieux des contraventions de voirie. Lorsqu'un dommage causé au domaine public ferroviaire est constitutif d'une contravention de grande voirie, l'administration doit-elle en demander réparation au propriétaire du véhicule à l'origine de l'atteinte, alors que celle-ci a été portée par des malfaiteurs au moyen dudit véhicule ? Telle était la question qui était posée au Conseil d'État et à laquelle il a répondu dans l'arrêt ministre de l'équipement, des transports et du logement c/ M. Chevallier du 5 juillet 2000 1 ( * ) .
Les atteintes portées à l'intégrité ou à l'affectation de dépendances du domaine public peuvent être à l'origine de contraventions de grande voirie, qui sont des infractions matérielles, sauf texte contraire. "L'intention coupable" n'est donc pas requise. Il suffit que la matérialité des faits soit établie. Si elle l'est, la personne poursuivie ne pourra pas faire obstacle aux condamnations qu'elle encourt ou en limiter la sévérité en faisant valoir que l'atteinte portée au domaine public est due, en tout ou partie, à une faute de l'administration ou au fait d'un tiers. Toutefois, il a toujours été admis que la personne poursuivie peut faire échec à la poursuite en apportant la preuve que l'atteinte portée au domaine public est exclusivement due à un cas de force majeure ou à des faits assimilables à un cas de force majeure 2 ( * ) . Il en va ainsi lorsqu'un dommage est causé au domaine public par un véhicule volé et que son propriétaire établit qu'il a pris toutes les précautions nécessaires pour éviter le vol 3 ( * ) . Toutefois, si le propriétaire n'établit pas qu'il a pris de telles précautions, il n'est pas exonéré ; ce qui est souvent le cas car la preuve est difficile à rapporter.
Cette solution tranchait avec celle adoptée de longue date par les juridictions judiciaires. À l'origine, ces dernières se sont bien interrogé sur le point de savoir si, en cas d'accident causé par le voleur au volant d'une automobile volée, il était possible de poursuivre le propriétaire en qualité de gardien de l'automobile, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1 er , du Code civil, ce qui aurait permis de faire jouer son assurance au profit des victimes, ou s'il fallait considérer le voleur comme le seul gardien, ce qui conduisait à priver la victime de tout espoir sérieux de réparation, le voleur étant le plus souvent non identifié ou insolvable. Une controverse s'éleva ainsi entre, d'un côté, les partisans de la responsabilité du propriétaire, qui défendaient la thèse de la "garde juridique", laquelle tendait à lier la qualité de gardien à l'existence du droit de propriété sur la chose, et, de l'autre côté, ceux qui défendaient la thèse de la " garde matérielle ", laquelle subordonnait la qualité de gardien à l'exercice effectif des pouvoirs sur la chose au moment du dommage 1 ( * ) . Le débat fut tranché en 1941 à l'occasion de la célèbre affaire Franck c. Connot lorsque les Chambres réunies 2 ( * ) posèrent le principe que le propriétaire d'un véhicule volé, privé de l'usage, de la direction et du contrôle du véhicule, n'en a plus la garde. La responsabilité de l'article 1384, alinéa 1 er , est ici liée au contrôle extérieur de la chose. En cas de vol du véhicule, la garde est perdue par le propriétaire et acquise par le voleur qui est seul à avoir la maîtrise sur la chose et donc à pouvoir éviter le dommage 3 ( * ) .
C'est la solution que vient de retenir le Conseil d'État dans son arrêt de section du 5 juillet 2000 (précité) en jugeant "que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage". Et le Conseil d'État de préciser que "le propriétaire d'un véhicule volé, dès lors qu'il n'a plus la garde de ce véhicule, ne peut par suite être tenu pour l'auteur de la contravention de grande voirie causée par ce véhicule".
En l'espèce, le Conseil d'État s'est ainsi aligné sur la jurisprudence judiciaire, ce qui donne d'ailleurs davantage de cohérence au traitement de l'imputabilité des dommages dans le contentieux des contraventions de voirie. En effet, il convient désormais de considérer que lorsqu'un dommage constitutif d'une contravention de grande voirie est imputé à une chose, comme entre autres un véhicule, le propriétaire ne peut être poursuivi qu'à la condition qu'il en ait la garde ; or, il en va déjà pareillement lorsque les dommages sont causés par des voitures volées au domaine public routier qui est soumis au régime des contraventions de voirie routière relevant de la compétence du juge judiciaire.
Deuxième exemple : Dans le contentieux de la responsabilité médicale. La politique jurisprudentielle de rapprochement des solutions judiciaires entreprise par le Conseil d'État dont nous venons de faire état est également perceptible en ce qui concerne tout particulièrement la portée de l'obligation d'information à l'hôpital et l'utilisation de la notion de perte de chance dans le contentieux de la responsabilité médicale où le Conseil d'État est venu récemment se rallier à la position de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 5 janvier 2000 4 ( * ) .
Sur le terrain de la responsabilité pour manquement à l'obligation d'information : Le 5 janvier 2000, le Conseil d'État a affirmé dans un considérant de principe que l'on retrouve dans les deux arrêts que "lorsque l'acte médical envisagé, même accompli dans les règles de l'art, comporte des risques connus de décès et d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation". Le Conseil d'État s'est ici, dans l'ensemble, aligné sur les positions adoptées, ces dernières années, par la Cour de cassation, en les appliquant à l'hôpital public. Il est vrai que le patient ait recours au secteur privé ou qu'il utilise l'hôpital public, il doit avoir droit à la même information d'autant plus que les devoirs du médecin sont précisés par le même texte, l'article 35 du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant Code de déontologie médicale 1 ( * ) .
Le Conseil d'État a ainsi admis que l'obligation porte sur tout risque grave, même si sa réalisation est exceptionnelle, ce qui est une innovation par rapport à sa jurisprudence antérieure qui, tout comme d'ailleurs celle de la Cour de cassation jusqu'en 1998 2 ( * ) , distinguait entre les risques normalement prévisibles et les risques exceptionnels, les premiers faisant seuls l'objet d'une information obligatoire 3 ( * ) . Cette jurisprudence était principalement justifiée par le souci de ne pas nuire à l'efficacité des traitements par l'accroissement de l'anxiété des malades et de ne pas dissuader ceux-ci de se soumettre à des soins ou à des examens par ailleurs hautement souhaitables. Toutefois, le maintien de cette solution était difficilement justifiable s'agissant de risques, certes exceptionnels, mais d'une certaine gravité, d'autant plus que l'appréciation du caractère exceptionnel d'un risque posait de nombreuses difficultés pratiques.
Le ralliement à la position de la Cour de cassation est d'autant plus net que le Conseil d'État admet les mêmes dérogations que celles qu'a énumérées la première Chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts du 7 octobre 1998 4 ( * ) . Il reconnaît en effet que l'obligation d'information est écartée " en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé " 5 ( * ) . Cette unité de la jurisprudence est tout à fait opportune s'agissant d'obligations déontologiques qui s'appliquent à une même profession, et dès lors qu'aucun impératif propre au secteur public hospitalier n'imposait au Conseil d'État de retenir une solution différente, une divergence des deux Hautes Cours sur les règles applicables aurait été très préjudiciable et difficilement compréhensible.
Il faut souligner également, bien que, sur ce point, la motivation soit moins explicite, que le Conseil d'État a nettement fait peser sur l'hôpital, débiteur du devoir d'information, la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation. Dans l'affaire Guilbot, il a en effet admis "qu'en se fondant, pour estimer que le praticien avait omis de fournir l'information, sur le fait que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris n'établissait pas que l'intéressé avait été informé du risque de l'intervention, la cour administrative d'appel n'avait pas commis d'erreur de droit". Dans l'affaire Telle, il a affirmé que "le document produit par les Hospices civils de Lyon n'était pas de nature à établir que les praticiens se sont acquittés de leur obligation d'information". Ici encore, on constate la similitude des positions de deux juridictions, puisque la Cour de cassation a solennellement pris parti, le 25 février 1997, par l'arrêt Hédreul 1 ( * ) , en faveur de l'attribution de la charge de la preuve au débiteur 2 ( * ) .
Enfin, la dernière innovation - mais non la moindre - des deux arrêts du Conseil d'État en date du 5 janvier 2000 consiste dans l'application qu'ils font de la notion de "perte de chance" à la responsabilité de l'hôpital pour manquement à l'obligation d'information et la conséquence qu'ils en tirent quant à l'ampleur de cette responsabilité. En effet, jusqu'à présent, si le Conseil d'État n'ignorait pas la notion de " perte d'une chance ", il ne semblait pas l'appliquer à la responsabilité hospitalière 3 ( * ). En cas de manquement à une obligation du médecin, il s'interrogeait donc sur la causalité entre cette faute et le dommage et, selon qu'il l'admettait ou non, il jugeait que la demande de réparation devait être accueillie ou rejetée pour le tout 4 ( * ) . En revanche, en cas de doute sur la causalité, le juge administratif ne prononçait presque jamais 5 ( * ) de condamnation à réparer partiellement le dommage en se fondant sur la perte d'une chance. Sur ce point encore, la Cour de cassation, qui admet couramment cette solution depuis la fin des années 60 1 ( * ) , a visiblement influencé le Conseil d'État 2 ( * ) .
Ainsi, dans le domaine de l'information du malade, où rien ne justifiait des solutions différentes, les arrêts du Conseil d'État du 5 janvier 2000 ont fait disparaître les discordances entre la jurisprudence administrative et judiciaire.
On voit bien comment à travers ces quelques exemples le droit civil et le droit administratif de la responsabilité s'intègrent dans un ordre juridique unitaire. Si des différences subsistent logiquement là où les règles en cause restent étrangères les unes aux autres, les points communs sur le fond tendent malgré tout à se multiplier progressivement. Les juges s'écoutent de plus en plus. Il est vrai que dans les deux cas leur contribution à l'élaboration des règles en vigueur est tout à fait essentielle. Cet aspect n'est d'ailleurs pas sans faire problème. On sait quel a été le rôle de la juridiction administrative dans la mise en place des principes directeurs de la responsabilité administrative. Quant au juge civil, on connaît également la part prépondérante qu'il a prise dans la découverte de principes de responsabilité à partir parfois d'une interprétation-création de certaines dispositions du Code civil. Le législateur quant à lui semble souvent s'être satisfait de tels errements qu'il a laissé se poursuivre. De là ce tableau très impressionniste du droit de la responsabilité aussi bien administrative que civile. Plus grave, face aux exigences de plus en plus fortes de l'opinion publique en faveur d'une indemnisation accrue des victimes de toutes sortes, on peut se demander parfois si le partage des compétences entre le juge et le législateur épouse correctement les contours de la séparation des pouvoirs. Le problème n'est plus ici celui du dualisme ou du monisme de juridiction, mais celui du partage des rôles entre le juge et le législateur.
B - LA RECHERCHE D'UNE NOUVELLE RÉPARTITION DES COMPÉTENCES
Le juge est dans son rôle lorsqu'il procède à la régulation des rapports de droit. Mais le choix du mode de régulation lui appartient-il ? Le phénomène de victimisation du droit de la responsabilité illustre cette problématique. De plus en plus, les victimes recherchent avant tout plus un débiteur d'indemnités qu'un responsable. Cette exigence modifie le contenu de la demande qui n'est plus tournée vers la réparation mais vers l'indemnisation. En même temps s'opère un saut qualitatif important, en particulier lorsque se réalisent certains risques collectifs graves : on passe insensiblement du terrain de la responsabilité à celui de la solidarité. N'est-ce pas alors plutôt au législateur qu'il revient ici d'intervenir ?
Dans un tel cas de figure, la démarche légitime qui s'impose nous semble devoir être celle qui consiste à requérir une telle intervention, comme cela a été le cas récemment en ce qui concerne l'indemnisation des victimes de l'amiante. En l'espèce, le nombre potentiellement important de victimes, la difficulté parfois pour celles-ci de retrouver l'auteur de leur dommage 1 ( * ) et le risque peut-être de se voir reprocher par la Cour européenne des droits de l'homme la durée excessive des procédures juridictionnelles eu égard au mal qui mine ces victimes ont conduit l'État à réfléchir à un mécanisme d'indemnisation fondé sur la solidarité. Par étapes successives, depuis 1999, un effort particulier a été entrepris par les pouvoirs publics en direction des victimes de l'amiante. C'est ainsi, par exemple, que la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 (art. 41) a créé un fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA), financé par un reversement de l'État d'un pourcentage du produit du droit de consommation sur les tabacs et une contribution de la branche accidents du travail de la sécurité sociale 2 ( * ) . Allant plus loin l'année suivante, les pouvoirs publics ont pris l'initiative de réparer les préjudices causés par l'amiante dans le cadre du travail (maladies professionnelles) ou dans le cadre environnemental. Ils se sont ainsi orientés vers la création d'un nouveau fonds d'indemnisation spécifique au bénéfice des victimes de l'amiante 3 ( * ) . En effet, parmi les mesures diverses qui figurent dans la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 relative au financement de la sécurité sociale pour 2001 4 ( * ) , on relève à l'article 53 l'amélioration du dispositif d'indemnisation des personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante 5 ( * ) ou qui" ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante" 6 ( * ) , ainsi que de leurs ayants droit, d'une part, par l'admission à obtenir "réparation intégrale de leurs préjudices", et, d'autre part, par la création d'un fonds d'indemnisation dont la mission est de réparer ces préjudices 1 ( * ) .
Mais ce passage de témoin entre le juge et le législateur tarde parfois à se mettre en place. Deux exemples nous permettent d'illustrer cette situation : celui de l'indemnisation de "l'aléa thérapeutique" et celui de l'indemnisation des enfants nés porteurs d'un handicap lié à leur patrimoine génétique mais non détecté au cours de la grossesse à la suite d'une faute médicale.
·
L'indemnisation de "l'aléa thérapeutique"
Il résulte des arrêts du Conseil d'État Bianchi, du 9 avril 1993 2 ( * ) , et Hôpital Joseph Imbert d'Arles, du 3 novembre 1997 3 ( * ) , que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement d'un patient 4 ( * ) présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée sans faute de celui-ci si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité 5 ( * ) .
Abordant la question de savoir si une indemnisation peut être accordée à un patient, victime d'un dommage accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, en dehors de toute faute du praticien, le Conseil d'État a donc admis la réparation de "l'aléa thérapeutique", il est vrai sous certaines conditions très strictes, alors que la Cour de cassation ne semble pas encore prête à franchir le pas, comme l'atteste encore un arrêt récent de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 novembre 2000 qui juge que la réparation des conséquences de la survenance d'un " aléa thérapeutique " n'entre pas dans le champ des obligations que le contrat médical met à la charge du médecin 1 ( * ) . Ne faudrait-il pas mettre un terme à cette différence de traitement selon que le patient est soigné dans le secteur public ou dans le secteur libéral ?
Il est vrai que les règles de la responsabilité en vigueur en droit administratif autorisent des audaces que ne permettent peut-être pas les règles de droit civil. En droit civil de la responsabilité, l'obligation de moyens du médecin 2 ( * ) n'est écartée qu'exceptionnellement au profit d'une obligation de sécurité de résultat, qui est l'obligation par laquelle le médecin s'engage personnellement à un résultat précis et déterminé. En effet, cette obligation semble pour l'instant se limiter à la fourniture de produits sanguins 3 ( * ) et de prothèses médicales 4 ( * ) , ainsi qu'au domaine des infections nosocomiales 5 ( * ) ou encore à propos des matériels utilisés pour les actes médicaux d'investigation ou de soins 6 ( * ) . Pour l'heure, la Cour de cassation semble vouloir rester prudente en cherchant à préserver autant que possible le principe et le domaine de l'obligation de moyens du médecin. Ce rejet de la responsabilité sans faute s'explique sans doute par une différenciation même des critères de la responsabilité médicale et hospitalière.
Alors que la responsabilité civile du médecin est en principe subordonnée à l'existence préalable d'un contrat, à la différence de ce qui se passe en droit public hospitalier où le patient est en situation légale et réglementaire, seul le dommage d'une exceptionnelle gravité est reconnu par le Conseil d'État alors que les juges civils ignorent toute distinction quant à la gravité du dommage réparable. La Cour de cassation peut sans doute redouter une dérive incontrôlable et une rupture des équilibres dans le droit jurisprudentiel de la responsabilité médicale, les patients ayant intérêt à ne se placer que sur le terrain de "l'aléa thérapeutique" pour obtenir une réparation aussi intégrale que s'ils démontraient une faute. Des difficultés seraient sans doute à craindre du côté de l'assurance et l'on peut penser que les praticiens eux-mêmes développeraient d'extrêmes réticences pour s'engager dans des spécialités à risque.
En revanche, dans le secteur public, le problème ne se pose pas dans ces termes. Il faut dire en effet que les très sévères conditions mises à l'indemnisation de "l'aléa thérapeutique" par le juge administratif font que la jurisprudence Bianchi n'a pu bénéficier réellement à des victimes que dans un nombre très limité de cas depuis 1993 1 ( * ) , ce qui la rend économiquement gérable. D'ailleurs, dans la mesure du possible, il est préférable pour le patient, devant le juge administratif, de se placer sur le terrain de la faute pour qu'il soit indemnisé de l'intégralité de son préjudice.
On peut alors se demander si au fond la question de "l'aléa thérapeutique" n'entre pas plutôt dans un domaine qu'il incombe au législateur de réglementer 2 ( * ) .
·
L'indemnisation des enfants nés porteurs d'un handicap lié à leur patrimoine génétique mais non détecté au cours de la grossesse à la suite d'une faute médicale
Lorsque l'enfant naît handicapé ou mal formé, les juridictions administratives et judiciaires ne font pas obstacle à reconnaître un droit des parents et de l'enfant à être indemnisés si, par exemple, l'enfant naît handicapé du fait d'une tentative d'avortement qui a échoué, le traumatisme causé au foetus ayant entraîné l'amputation d'une jambe après la naissance 3 ( * ) . En revanche, le Conseil d'État, comme la Cour de cassation, refusaient de considérer comme constitutive d'un préjudice réparable la naissance d'un enfant en bonne santé mais non désiré 4 ( * ) . Autrement dit, il pouvait résulter de cette jurisprudence comme une sorte de postulat selon lequel une naissance ne peut jamais constituer par elle-même un préjudice réparable. C'est cette position de principe que le Conseil d'État n'a pas hésité à remettre en cause en 1997 dans l'arrêt CHR de Nice c/ Époux Quarez (à propos de la naissance d'un enfant mongolien) 1 ( * ) , tout comme l'avait fait peu avant la Cour de cassation elle-même dans un arrêt du 26 mars 1996 2 ( * ) . En effet, en cas d'erreur de diagnostic, l'action de l'administration n'est pas à l'origine de la maladie incurable. Elle ne l'a pas non plus aggravée, ni n'a diminué les chances de sa guérison. Dans ces conditions, le préjudice imputable à la faute commise que l'on veut sanctionner ne peut pas se situer ailleurs que dans le principe même de la naissance de l'enfant. Reste alors à établir le lien de causalité. Or, sur ce point, les positions du Conseil d'État et de la Cour de cassation divergent en partie selon que la demande en réparation émane des parents ou de l'enfant lui-même.
S'agissant tout d'abord des parents, l'approche des deux hautes juridictions est comparable. Elle n'est toutefois pas exempte de toute critique. En effet, admettre leur indemnisation, cela revient à estimer qu'ils auraient nécessairement décidé de mettre fin à la grossesse s'ils avaient été correctement informés de la maladie dont souffrait l'enfant à naître. Cela n'est pas établi de façon toujours évidente. Après tout, la liberté de choix de la mère lui permettant de se rétracter, on ne saura jamais ce qu'elle aurait finalement décidé. On peut alors se demander si à l'occasion de la réparation du préjudice subi par les parents, le juge n'a pas fait preuve d'une certaine souplesse sur l'appréciation du rapport de causalité dans la mesure où il se trouvait en présence de faits gravement inexcusables.
Quant à la situation réservée à l'enfant, elle donne lieu à une approche différente selon l'ordre de juridiction considéré. Pour la Cour de cassation 3 ( * ) , l'indemnisation du préjudice d'un enfant né atteint de graves troubles neurologiques doit être prononcée en réponse à la faute conjointe d'un médecin et d'un laboratoire d'analyses médicales qui avaient, par erreur, déclaré négatifs les résultats d'un test de recherche des anticorps de la rubéole chez une femme enceinte alors que cette dernière avait indiscutablement contracté cette maladie 1 ( * ) . En revanche, le Conseil d'État refuse d'indemniser son préjudice personnel. En effet, "Considérant qu'en décidant qu'il existait un lien de causalité direct entre la faute commise (...) à l'occasion de l'amniocentèse et le préjudice résultant pour le jeune Mathieu de la trisomie dont il est atteint, alors qu'il n'est pas établi (...) que l'infirmité dont souffre l'enfant et qui est inhérente à son patrimoine génétique, aurait été consécutive à cette amniocentèse, la cour administrative d'appel (...) a entaché sa décision d'une erreur de droit".
La position du Conseil d'État revient à distinguer ici deux types de préjudices dont un enfant handicapé pourrait demander réparation dans un cas comme celui-ci : à savoir le fait d'être handicapé et le fait d'être né. Le Conseil d'État s'est situé sur le premier terrain : le handicap de l'enfant n'est imputable qu'à une maladie génétique, incurable, et dans l'origine de laquelle la faute de l'hôpital ne prend absolument aucune part. L'absence de relation de causalité permettait ainsi au Conseil d'État d'apporter une solution logique à la question posée. En revanche, il n'a pas voulu prendre parti sur la question ô combien délicate de savoir si l'on peut se plaindre d'être né 2 ( * ) . Pourtant, il est bien établi par le Conseil d'État lui-même que la faute de l'hôpital a bien causé la naissance de l'enfant et que cette naissance inflige aux parents le dommage dont ils vont pouvoir obtenir réparation. Autrement dit, pour le Conseil d'État l'existence du lien de causalité entre la faute et la naissance de l'enfant est bien tenue pour irrévocablement acquise. Si l'enfant n'est pas indemnisé, à la différence de ses parents, c'est que pour le juge administratif, il n'est pas admis qu'une personne puisse chercher à obtenir en justice à être indemnisée de sa propre existence.
La Cour de cassation a peut-être surtout eu le souci de permettre à l'enfant de vivre, au moins matériellement, "sans être abandonné aux aléas d'aides familiales, privées ou publiques" 3 ( * ) . Mais sa solution, solennellement réaffirmée, le 17 novembre 2000, dans l'affaire Perruche, n'est pas satisfaisante à plus d'un titre. Tout d'abord, sur le plan juridique, il est difficile de fonder une causalité juridique entre l'erreur de diagnostic (qui a eu pour conséquence de priver Mme Perruche de son droit à avorter) et le handicap de l'enfant, en l'absence de toute causalité matérielle entre la faute et le dommage (la cause du dommage subi par l'enfant réside dans la contamination du foetus par la rubéole) 1 ( * ) . Par ailleurs, si l'on s'interroge sur le préjudice réparable que subit un enfant né handicapé, on constate que son droit subjectif lésé ne peut être ni le droit de naître en parfaite santé, qui n'existe pas en l'état actuel de la science médicale, ni le droit de ne pas naître, car la personne humaine ne possède pas le moindre droit à l'égard d'un phénomène qui échappe totalement, et par nature, à l'emprise de sa volonté 2 ( * ) . En fait, l'enfant ne peut se prévaloir en l'espèce d'un quelconque droit propre lésé. Force est donc de constater que pour l'indemniser malgré tout, son préjudice a été rattaché au fait que sa mère a été privée de la possibilité d'interrompre sa grossesse pour les motifs établis par la loi. Cela ne revient-il pas à permettre à l'enfant d'invoquer la lésion d'un droit (celui d'avorter) qui n'est pas le sien, mais qui est celui de sa mère ? Enfin, on peut s'interroger sur le conflit d'intérêts posé par la représentation de l'enfant handicapé par ses parents : en effet, comment admettre que des parents puissent, au nom de leur enfant, plaider que ce dernier mérite d'être indemnisé parce qu'il n'a pas pu être supprimé avant de naître ?
Dans ces conditions, on peut se demander s'il n'y a pas là matière à légiférer. À l'automne 2000, lorsque la Cour de cassation a fait droit à la demande d'indemnisation formulée au nom de leur enfant par les parents de Nicolas Perruche, né gravement handicapé à la suite d'une rubéole contractée par sa mère pendant sa grossesse et non diagnostiquée par le médecin, un vif débat s'est ouvert et l'hypothèse d'une intervention du législateur pour le trancher lui-même a été évoquée. Un amendement visant à interdire "l'indemnisation du fait de la naissance" avait été rejeté par l'Assemblée nationale, mais il avait été adopté par le Sénat, le 28 mars suivant, dans le cadre de la discussion d'un projet de loi sur la modernisation sociale. Mais cette initiative est restée sans suite.
Au fond, tout le problème ne provient-il pas du fait que la prise en charge du handicap par la solidarité nationale est insuffisante 3 ( * ) et que les parents n'ont parfois pas d'autre solution que de se retourner vers la justice pour obtenir une indemnisation au nom de leur enfant 4 ( * ) ?
Les problèmes de droit sont d'abord des problèmes de société, c'est-à-dire des problèmes politiques. On aurait tort de l'oublier.
Monsieur le Doyen Georges VEDEL
Merci beaucoup mon cher collègue d'avoir traité ce sujet, qui était difficile, à la fois pour le centrer sur les problèmes de responsabilité et pour l'actualiser par rapport à une controverse qui, naturellement, a des arguments éternels - dont vous trouverez d'ailleurs toute la discussion dans la thèse de Just LUCHET sur l'arrêt Blanco - mais votre génération, dieux merci pour vous, n'en fait peut-être pas sa lecture quotidienne.
- III - LES DILEMMES DE LA RESPONSABILITÉ
La responsabilité pénale du Président de la République : pour une autre interprétation de l'article 68 de la constitution
par Monsieur Olivier BEAUD,
professeur à l'Université Paris 2
Président de séance : Monsieur Pierre DELVOLVE
Mesdames, Messieurs, nous reprenons les travaux que vous avez entamés hier et largement d'ailleurs, développés, au cours des deux séances dont je sais qu'elles ont été particulièrement riches et nourries. Les séances d'aujourd'hui ne sont pas moins riches et nourries, si j'en juge par le programme qui vous a été distribué et que vous avez sous les yeux. Nous avons ce matin cinq orateurs, cinq thèmes, autour de la formule : "Les dilemmes de la responsabilité ?"
Je dois dire que lorsque notre collègue et ami DARCY m'a demandé de présider cette séance sous l'intitulé "Les dilemmes de la responsabilité ?", je me suis interrogé sur le sens même de cette expression. C'était pour moi un dilemme...
Et pour mieux comprendre le sens de cette formule je me suis reporté au Grand Robert, je veux dire le grand dictionnaire Robert. Qui nous donne une définition du dilemme : raisonnement dont la majeure contient une alternative à deux ou plusieurs termes et dont les mineurs montrent que chaque cas de l'alternative implique la même conclusion. Vous avez compris, c'est la définition donnée du point de vue philosophique, dans le vocabulaire philosophique. Une définition un peu plus simple que, par extension, le vocabulaire admet, dilemme : alternative contenant deux propositions contraires ou contradictoires et entre lesquelles on est mis en demeure de choisir.
Mais la définition du dilemme qui renvoie à l'alternative soulève une nouvelle difficulté, puisque le mot alternative aujourd'hui est employé dans des conditions qui en dénaturent le sens puisqu'on entend parfois : "il n'y a pas d'autres alternatives". Ce qui est un contresens : l'alternative, et alors là je poursuis avec le dictionnaire, l'alternative étant la succession de deux choses qui reviennent tour à tour - comme dans le courant alternatif - ou encore en dehors de l'électricité, la situation dans laquelle on a le choix qu'entre deux partis possibles.
Alors, je comprends un peu mieux ce que notre collègue DARCY a voulu mettre en valeur dans la matinée d'aujourd'hui. Les dilemmes de la responsabilité, les choix que les juristes, les politiques ont à opérer entre deux solutions, qui peuvent être contraires, contradictoires, et dans les solutions du droit positif, les choix de la jurisprudence, du législateur puisque celui-ci aussi bien aménage certains systèmes de responsabilité, peuvent être liés à des contradictions, internes ou inhérentes au régime de responsabilité.
Déjà hier, certains aspects de cette contradiction vous sont apparus. Ils vont apparaître ce matin dans les différents thèmes que notre ami DARCY a placé sous l'intitulé "Les dilemmes". Heureusement qu'il y a les dilemmes pour les réunir, car à-priori, je ne voyais pas de lien très étroit entre la responsabilité pénale du Président de la République, le principe de précaution, la responsabilité due aux activités de contrôle, les tiers au contrat administratif et la responsabilité, les catégories du droit de la responsabilité. Au fond c'est peut-être à propos des catégories du droit de la responsabilité que les dilemmes, que les alternatives, sont peut-être les plus évidentes.
Mais finalement, lorsque je reprends les différents thèmes de ce matin, alors les dilemmes apparaissent : responsabilité pénale du Président de la République, ou responsabilité politique ? Responsabilité et principe de précaution ? Principe de précaution, thème à la mode, mais qui au-delà de la mode souligne les transformations de notre société et les transformations des politiques qui doivent être menées pour "prévenir". Et je pense à la police - le principe de précaution m'a toujours fait penser à la police, mais cela vous nous le direz, va au-delà de la police. En tout cas cela ramène à la responsabilité. La responsabilité due aux activités de contrôle ? Le dilemme entre la responsabilité qui pèse sur celui qui est contrôlé et la responsabilité qui pèse sur celui qui contrôle du fait des autorités. Il y a un dilemme, Monsieur GAUDEMET le lèvera.
Je n'ai ici évoqué que les trois premiers thèmes qui vont faire l'objet de la première partie de cette séance de ce matin. Pour les traiter, des orfèvres.
Professeur Olivier BEAUD : "La responsabilité pénale du Président de la République". La puissance de l'État, ce fut son chef-d'oeuvre, en attendant les autres. Puissance de l'État, où la puissance de l'auteur s'est déjà manifestée. Et à propos de la responsabilité pénale du Président de la République, il a sur l'affaire du sang contaminée écrit des propos vifs, vigoureux, remettant exactement, me semble-t-il, en place les différentes perspectives dans cette douloureuse affaire. La question se déplace avec la responsabilité du Président la République en des termes qui n'ont rien à voir avec l'actualité, puisqu'il s'agit d'une question d'ordre général que les aléas de la vie politique ne doivent pas affecter lorsqu'ils sont traités dans une enceinte à caractère universitaire, même si nous sommes au Sénat.
"Responsabilité et principe de précaution". Madame ROUYERE a écrit sur le principe de précaution des études, notamment dans les meilleures revues, qui ont bien mis en valeur les innovations que ce principe apporte à notre conception, à notre approche du droit, et en matière de responsabilité de nouvelles difficultés sont nées de l'apparition, en tout cas de l'apparition de la formule, du principe de précaution.
S'agissant de la responsabilité due aux activités de contrôle, Monsieur GAUDEMET, dont les travaux - et pas simplement en matière de responsabilité - ont toujours, dans la ligne de ses maîtres et de ceux qu'il a si brillamment continué, été particulièrement éclairant, et je suis heureux qu'il soit ici ce matin même s'il avait des raisons de ne pas être parmi nous. Merci beaucoup d'être venu malgré ces raisons.
Voilà annoncés les thèmes qui vont être traités. Vous les connaissez déjà d'ailleurs. Je n'ai fait que broder autour de formules qui sont inscrites dans le programme. Je crois que les délais sont déjà dépassés. Il faut par conséquent que je me taise pour donner la parole à celui qui doit traiter du premier sujet, mon collègue Olivier BEAUD : "La responsabilité pénale du Président de la République : le retour de la méthode exégétique en droit constitutionnel". Cher collègue, vous avez la parole.
Monsieur Olivier BEAUD 1 ( * )
La controverse sur une éventuelle responsabilité pénale de l'actuel Président de la République pour des faits commis antérieurement à l'exercice de ses fonctions paraît close depuis que la Cour de cassation, réunie, en Assemblée plénière, a tranché ce point de droit dans son arrêt du 10 octobre 2001. Elle a interprété l'article 68 de la Constitution comme mettant le Président de la République à l'abri de poursuites pénales ou d'actes d'instruction "pendant la durée de son mandat", tout en estimant incompétente la Haute Cour pour juger d'éventuelles infractions commises en dehors de l'exercice de ces fonctions.
Au lieu de proposer un commentaire de cet arrêt 2 ( * ) , nous proposons d'analyser la façon dont la doctrine constitutionnelle a examiné ce problème constitutionnel inédit. Une telle démarche pourrait surprendre. Même si l'on considère que "les disputes abstraites de la doctrine doivent (..) servir de fil conducteur pour ceux qui auront à supposer le droit lorsqu'il n'est pas encore bien établi" 3 ( * ) , celles-ci néanmoins ne perdent-elles pas tout intérêt lorsque le droit positif est fixé par les tribunaux ? Pourquoi devrait-on préférer l'étude de la doctrine à celle de la jurisprudence ? Tout simplement parce que l'un des rôles de la doctrine est - ou plutôt devrait - non seulement d'éclairer la jurisprudence, mais aussi de la critiquer. Et pour la critiquer, il faut quelquefois, - mais pas toujours - passer par une évaluation de la doctrine lorsque celle-ci a fixé les cadres de la discussion juridique, comme c'est le cas en l'espèce 4 ( * ) .
Peut-on, cependant, évoquer "la" doctrine quand on sait qu'elle est apparue divisée sur la résolution de ce cas juridique ? 1 ( * ) Elle s'est partagée entre les auteurs qui reconnaissent au président une immunité limitée, c'est-à-dire relative, et les auteurs qui lui prêtent une immunité générale c'est-à-dire absolue Dans le premier cas, le chef de l'État serait soustrait pour les actes répréhensibles commis dans l'exercice des fonctions, à l'action des juridictions répressives ordinaires et serait passible de la seule Haute Cour, mais en revanche, il serait soumis aux juridictions pénales de droit commun pour des actes délictueux ou dommageables commis en dehors de ses fonctions. Dans le second cas/ thèse dite de l'immunité absolue, qui semble majoritaire en doctrine, le Président de la République jouirait d'une immunité absolue, lui permettant de se soustraire (du moins pendant la durée de son mandat) à toute forme de poursuite ou instruction par lesdites juridictions, pour tous les faits, qu'ils soient commis en-dehors ou dans ses fonctions. Toutefois, la Haute Cour serait compétente, si elle était saisie, pour juger les actes commis antérieurement à la prise de ses fonctions. Position qui suit ou anticipe - c'est selon - la fameuse petite phrase du Conseil constitutionnel. Le président jouirait d'un privilège de juridiction analogue à ceux dont jouissaient les membres du Gouvernement avant la révision de 1993. Cette position revient à combiner deux exigences contradictoires : "le Président de la République n'est pas irresponsable ; conformément au principe d'égalité, il peut être poursuivi pour tous les actes qui ne sont pas fiés à l'exercice des fonctions, mais, conformément au principe de séparation des pouvoirs, il ne peut l'être que par les Assemblées" 2 ( * ) . On notera, en passant, que la Cour de cassation n'a validé entièrement aucune de ces deux thèses puisque, si elle a reconnu une immunité au président dans ce cas concret (contre la thèse de l'immunité relative), elle a refusé d'admettre la compétence de la Haute Cour (contre la thèse de l'immunité absolue).
Malgré l'existence de cette opposition, nous voudrions souligner le caractère homogène de la doctrine constitutionnelle dans sa manière d'envisager ce problème juridique. Elle a, le plus souvent, focalisé son attention sur le statut juridictionnel du président, sans rattacher cette question à celle du statut présidentiel sous la Vème République. Mais surtout, elle a fondé son opinion sur la seule interprétation de l'article 68 de la Constitution qui serait censée résoudre cette énigme juridique. De ce point de vue, elle nous semble critiquable car elle reste prisonnière de ce que Bruce Ackerman appelle "l'hyper-textualisme", c'est-à-dire cette croyance selon laquelle la réponse à tout problème constitutionnel se trouverait nécessairement dans une disposition de la Constitution écrite, c'est-à-dire dans un texte constitutionnel. Selon notre hypothèse, en procédant ainsi, la doctrine "flirte" dangereusement avec la méthode exégétique, ou pour être plus précis avec la caricature de cette méthode qu'on a dessinée à la fin du XXème siècle. Elle s'expose alors à la vigoureuse critique adressée, jadis, par Henry Nézard à ceux qui voulaient transposer cette méthode (prise ainsi dans son sens péjoratif), c'est-à-dire des techniques de droit civil dans le droit constitutionnel 1 ( * ) ; il leur objectait que les lois constitutionnelles de 1875 ne formaient pas un Code constitutionnel, analogue à un Code civil. Mais, même si l'on prend cette fois la méthode exégétique dans son sens noble et originel, on rappellera qu'elle suppose un texte digne d'être ainsi commenté. Or, comme l'a rappelé Philippe Rémy, aux yeux des juristes civilistes du XIXème siècle, si "le Code civil mérite l'exégèse", en revanche "toutes les ""lois"` n'appellent pas l'exégèse" 2 ( * ) : c'est le cas pour le Code de la sécurité sociale, ou pour le Code de la route et, encore -c'est nous qui l'ajoutons - pour la Constitution. Affirmer que "la Constitution ne mérite pas l'exégèse" pourrait sembler blasphématoire à certains, mais des raisons à la fois conjoncturelles et structurelles incitent à le penser. La raison circonstancielle tient à l'écriture de la Constitution de 1958, dont la -qualité a été souvent contestée. Faut-il rappeler ici le jugement féroce de René Capitant selon lequel le texte de la Constitution de 1958 est le "texte le plus mal rédigé de notre histoire constitutionnelle, inférieur même à la Constitution de 1946 3 ( * ) ? Ce qui est particulièrement vrai pour l'article 68, dont la rédaction est issue d'un "bricolage" effectué à partir de collage de textes constitutionnels antérieurs, et à partir duquel il est difficile de tirer des leçons, même en s'appuyant sur la lecture des travaux préparatoires. Mais plus encore, des raisons structurelles interdisent d'interpréter la Constitution de façon exégétique. Parmi d'autres auteurs, Böckenförde réfute la thèse herméneutique classique selon laquelle la "constitution doit être interprétée selon les mêmes méthodes que la loi" tout en reconnaissant qu'une telle thèse peut s'appuyer sur l'idée que "la transcription de la constitution dans la forme de la loi est une conquête de l'État de droit et la base de son évidence et de sa stabilité" 4 ( * ) . Cette transposition de la méthode herméneutique de Savigny au droit constitutionnel se heurte cependant à une objection fondamentale : malgré des ressemblances formelles, la Constitution n'équivaut pas à une loi. En effet, à la différence de la loi, "la Constitution, du point de vue de son élaboration conceptuelle-normative, est incomplète et fragmentaire" 5 ( * ) . On laissera ici de côté la solution que le juriste allemand propose et qui consiste à adosser toute théorie de l'interprétation sur "une théorie de la constitution" 1 ( * ) , afin d'évoquer l'idée suivante : la doctrine française, dans son immense majorité, continue à croire en la validité de la méthode herméneutique classique. L'un des buts de cet article est de dénoncer cette croyance dépassée en examinant un cas concret sur lequel il nous faut revenir maintenant.
En rédigeant le Titre IX de la Constitution sur la Haute Cour, les constituants de 1958 ont prévu, à l'origine, que le Président de la République et les membres du Gouvernement pouvaient être jugés par une Haute Cour. Celle-ci est, selon l'article 67 de la Constitution, une juridiction composée, à parité entre les deux chambres, de parlementaires élus par leurs pairs, et elle est saisie par une procédure de mise en accusation nécessitant un vote identique (au scrutin public et à la majorité absolue) des deux assemblées. Depuis la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993, qui a abrogé l'alinéa 2 de l'article 68 et qui a créé la Cour de justice de la République, seul le chef de l'État est passible de la Haute Cour selon les modalités prévues par cet article.. Celui-ci débute par une première phrase ainsi formulée : "Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison". On a longuement discuté de la question de savoir si cette première phrase était ou non séparable de la seconde. Nous voudrions ici proposer ici une autre interprétation qui repose sur une double démarche. La première est de partir d'un commentaire de la formule restrictive - "n'est responsable (J que" dans le cas de haute trahison. Par l'exclusion qu'elle contient, elle nous indique que, selon la lettre de cet article 68, le président est, il titre principal, irresponsable politiquement, et, à titre d'exception, responsable pour le seul cas de "haute trahison". D'où notre première proposition : le sens et la portée de cet article 68 résident moins dans l'exception qu'elle affirme, c'est-à-dire un cas limité de responsabilité présidentielle pour haute trahison, que dans le principe qui la sous-tend : celui de l'irresponsabilité présidentielle. La seconde démarche consiste à se demander quelle est la nature de cette responsabilité dans le cas de cette "exception de haute trahison" 2 ( * ) comme l'appelait Marcel Prélot. La doctrine dominante a pris soin d'éviter cette question embarrassante, tout en faisant comme si cette responsabilité était implicitement, mais nécessairement, de nature pénale. Notre seconde proposition est autre : la responsabilité exceptionnelle du chef de l'État prévue par l'article 68 est de nature politique qui la fait basculer dans la catégorie de la justice politique. En affirmant ceci, nous ne prétendons nullement à l'originalité car Marcel Prélot avait déjà expliqué que cette exception à l'irresponsabilité politique (était) habillée en responsabilité pénale 3 ( * ) . Il s'agit seulement de réévaluer la portée de l'article 68 en l'interprétant en fonction du schéma principe/ exception, et donc du couple irresponsabilité politique (principe) et responsabilité du président (exception).
Ce premier infléchissement du raisonnement est complété par un second qui porte sur les concepts ici en jeu à propos du statut pénal du président. Au lieu de raisonner principalement en termes d'immunité 1 ( * ) , nous proposons de revenir sur le terrain constitutionnel en appliquant au président les deux notions distinctes d'irresponsabilité et d'inviolabilité, en prenant pour modèle le droit des immunités parlementaires (cf. art. 26 Const.). La loi fondamentale allemande effectue une telle dissociation 2 ( * ) . Guy Carcassonne l'a fait aussi en envisageant la protection du président dans le cadre plus global des immunités politiques 3 ( * ) . Pierre-Olivier Caille propose une définition opératoire de ces notions : par "inviolabilité présidentielle", il faut entendre "la protection dont bénéficie le chef de l'État à l'égard des poursuites fondées sur ces actes extérieurs à ses fonctions et par "irresponsabilité présidentielle", l'obstacle à sa mise en cause en raison des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions" 4 ( * ) . L'un des intérêts juridiques de cette distinction tient à ce que si l'irresponsabilité présidentielle vaut encore après la cessation du mandat public, l'inviolabilité cesse une fois le mandat expiré. Appliquant cette distinction conceptuelle au cas d'espèce, nous soutenons que l'article 68 régit la question de la responsabilité (ou de l'irresponsabilité) du chef de l'État, et non pas celle de son inviolabilité 5 ( * ) - ce qui revient à soutenir que le "cas Chirac" ne peut être résolu en se fondant sur l'article 68 de la Constitution (I, et II). Il nous restera, ensuite, à montrer comment et pourquoi la Constitution de la Vème République consacre la solution d'une inviolabilité présidentielle (III) .
I- L'ARTICLE 68 DE LA CONSTITUTION ET LA DELICATE MISE EN OEUVRE DE L'IRRESPONSABILITÉ POLITIQUE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Dans la mesure où il consacre le principe d'irresponsabilité politique du Président, l'article 68 est interprété comme s'inscrivant "dans la tradition du statut du Chef de l'État parlementaire" 1 ( * ) . Toutefois, ce principe a un passé plus riche, puisqu'il se rattache à la règle traditionnelle de l'irresponsabilité du chef de l'État, et surtout une validité friable, compte-tenu d'une pratique souvent contraire.
A - L'HISTOIRE CONTRASTÉE DE L'IRRESPONSABILITÉ POLITIQUE DU CHEF DE L'ÉTAT OU L'ABSENCE DE TRADITION CONSTITUTIONNELLE EN LA MATIÈRE
On sait que l'origine de cette règle d'inviolabilité du chef de l'État remonte à la constitution anglaise et à sa fameuse formule : " The King can do no wrong " (le Roi ne peut mal faire). On en déduit que cette règle est d'essence monarchique, et on évoque même, de nos jours, pour la décrire, une espèce de "divinisation monarchique de la République" 2 ( * ) . Toutefois, une brève histoire constitutionnelle incite à davantage de prudence. Sous la Troisième République, les bons auteurs avaient relevé l'ambivalence de cette formule royale. Ainsi, s'appuyant sur l'opinion de la doctrine anglaise, c'est-à-dire sur celle de Dicey, Adhémar Esmein dégageait les deux implications pratiques de cette règle coutumière à l'égard du monarque d'une part, aucune "cour de justice ne peut connaître des actes qu'il accomplit alors même qu'ils constitueraient des crimes de droit commun, ils sont couverts par cette présomption irréfragable ". Si la "reine, dit le professeur Dicey, tuait de sa propre main le Premier ministre, aucun tribunal ne pourrait connaître de cet acte." D'autre part, "de la même présomption légale résulte une autre règle très importante : aucune personne ne peut invoquer un ordre du roi pour justifier l'acte illégal qu'elle a commis elle-même ; un pareil ordre en droit n'a pas d'existence". 3 ( * ) Depuis, la présentation de cette maxime par la doctrine constitutionnelle anglaise n'a pas varié puisqu'elle continue à l'interpréter, d'une part, comme conférant une immunité juridictionnelle absolue du monarque pour les actes illégaux (délictuels le cas échéant) commis dans l'exercice des fonctions et, d'autre, part, comme interdisant aux ministres d'invoquer à titre d'excuse légale, un ordre du monarque. Il s'agit d'une immunité personnelle et réelle qui semble découler des pouvoirs particuliers englobés sous le terme de Prérogative de la Couronne et de la Royauté ( The Crown and the Royal Prerogative 4 ( * ) ) .
Cette dualité ne peut s'expliquer que par une évolution de la signification de la règle d'irresponsabilité du monarque. Comme l'a montré Denis Baranger 5 ( * ) , cette maxime ne doit plus, depuis l'apparition du constitutionnalisme en Angleterre (1689), être interprétée dans le sens absolutiste antérieur marqué par une conception organique du pouvoir qui conférait au Roi une irresponsabilité juridique, même s'il avait commis des abus de pouvoir manifestes. Cette maxime a été retournée dans un sens libéral en devenant le moyen de rendre responsables les serviteurs du Roi. Certes, celui-ci demeure irresponsable, mais c'est afin de rendre responsables ses ministres. De symbole de la puissance royale, la maxime the King can do no wrong est devenue la manifestation d'une impuissance politique, le résultat du basculement du centre de gravité du pouvoir, d'abord vers le Parlement, ensuite vers le Cabinet 1 ( * ) . Ce changement de signification traduit un phénomène capital qui est l'émergence de la responsabilité ministérielle, et de son corollaire, le régime parlementaire. Par ce seul exemple, on voit qu'une, maxime apparemment simple comme "le Roi ne peut mal faire" tire sa signification d'un contexte constitutionnel donné, historiquement situé, et qu'on ne peut certainement pas, sauf à simplifier drastiquement les choses, la présenter uniquement comme une règle d'essence monarchique.
En franchissant la Manche, cette règle de l'irresponsabilité du chef de l'État a été jetée dans le contexte constitutionnel français, dont elle a épousé les vicissitudes, de sorte qu'il faudrait être bien téméraire pour l'élever au rang de tradition constitutionnelle. Elle a été contemporaine, en France, de la naissance de la monarchie constitutionnelle sous la Révolution française. Elle est donc apparue avant la formation du régime parlementaire dans notre pays. Dans la Constitution de 1791, constitution matricielle du droit public français, elle apparaît dans la formule : la "personne du roi est inviolable et sacrée" (art. 2, Titre III, chap. 2, sect. 1) C'est évidemment une concession des révolutionnaires à la monarchie et à Louis XVI. Mais, inversement, les révolutionnaires obtenaient une limitation conséquente de cette "inviolabilité" royale par l'introduction du mécanisme de l'abdication légale. Les trois cas envisagés - refus de prêter serment, concours à une insurrection armée, et fuite du Roi - correspondaient à des cas de trahison envers la nation, des crimes de lèse-nation. Dans ces trois hypothèses, le roi perdait de iure le bénéfice de sa protection, et redevenait un membre de "la classe des citoyens" qui pouvait "être accusé et jugé comme eux pour les actes postérieurs à son abdication" (art. 8, Titre III, chap. II, sect. 1ère). La règle de "l'inviolabilité" royale correspondait donc à la nature de compromis de cette Constitution, qui transigeait difficilement entre les principes de l'Ancien Régime, et les nouveaux principes révolutionnaires de la Constituante, l'exigence constitutionnaliste. Ce compromis a éclaté avec la fuite du Roi et son arrestation à Varennes.
Après l'intermède napoléonien, cette règle réapparaît inchangée lors de l'épisode de la Restauration et de la Monarchie de juillet. L'article 13 de la Charte du 4 juin 1814 et l'article 12 de la Charte du 14 août 1830 dispose : "La personne du roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au roi seul appartient la puissance exécutive". On aurait tort d'attribuer à cette règle une signification équivalente à celle qu'elle possédait sous la Constitution de 1791, et une signification identique dans les deux Chartes. En effet, le passage de la Révolution à ses deux régimes a été accompagné par l'importation du régime parlementaire qui a eu pour effet d'effacer le rôle du chef de l'État, aboutissant à l'instauration d'une "monarchie limitée" (S. Riais). Ensuite, les deux chartes de 1814 et de 1830, différent entre elles, en raison du changement dynastique qui a transformé le chef d'État en "Roi des français" (préambule Charte 1830) et qui a accéléra la transformation d'une "monarchie limitée" en une "monarchie parlementaire". De ce point de vue, les observateurs les plus lucides, Benjamin Constant en tête, ont compris que l'apparition de la responsabilité des ministres permettait de distinguer le "pouvoir ministériel" du "pouvoir royal" 1 ( * ) .
C'est donc en réalité cette règle de l'irresponsabilité du chef de l'État, dans un régime parlementaire qui est transposée sous la III ème République. Dans les lois constitutionnelles, le Président de la République a chaussé les bottes du roi constitutionnel, mais, comme on voudrait ici le montrer, son irresponsabilité n'a jamais pu être institutionnalisée.
L'irresponsabilité du chef de l'État dans un régime parlementaire comme celui de la IIIème République signifie essentiellement que le Président de la République n'a pas à rendre compte de ses actes devant le Parlement. La doctrine classique traduisait cette idée par analogie avec la responsabilité ministérielle en considérant que le Président de la République était, en droit, irrévocable par le Parlement. Cette règle a sa cohérence dans un régime parlementaire dans la mesure où "la conduite générale des affaires de la nation" y est attribuée aux membres du gouvernement. Le régime politique français empruntait donc la voie anglaise : la responsabilité qui dans tout régime constitutionnel doit être "proportionnée au pouvoir" 2 ( * ) , était imputable aux ministres solidairement et collectivement (au Gouvernement donc), et non pas au chef de l'État. Par là se marquait la différence majeures entre un régime parlementaire, et un régime présidentiel où il n'y a pas de responsabilité ministérielle. Cette règle de l'irresponsabilité politique a, dès cette époque, trois corollaires constitutionnels. Le premier est l'existence du contreseing qui fait endosser la responsabilité des actes du chef de l'État aux véritables autorités "responsables" que sont le chef de Gouvernement et les ministres. En prévoyant que tous les actes du président (sauf ceux nommant ou révoquant les ministres) doivent être contresignés par un des ministres, la loi constitutionnelle du 25 février 1873 (art. 3) contenait une "précaution formaliste pour qu'ils [ces actes du Président] soient couverts par la responsabilité ministérielle" 3 ( * ) . Dans la logique du régime parlementaire, le contreseing ministériel atteste du basculement du centre de gravité du pouvoir du chef de l'État vers la représentation nationale. La seconde traduction institutionnelle de l'irresponsabilité du chef de l'État est la règle selon laquelle il ne dispose pas du droit d'entrée au Parlement, à la différence des membres du gouvernement, de sorte qu'il est contraint de communiquer avec les chambres uniquement par message (art. 6 loi du 16 juillet 1875). Sous la IIIème République, Joseph Barthélémy avait établi ce lien intrinsèque entre le droit de message et l'irresponsabilité présidentielle. Enfin, selon la dernière règle considérée comme coutumière "le Président de la République ne doit pas être mis en cause dans le débat politique" 1 ( * ) .
La question se pose néanmoins de savoir si ce schéma constitutionnel a fonctionné dans la pratique. Pour ceux qui estiment que l'irresponsabilité présidentielle fait partie d'une tradition constitutionnelle républicaine, la réponse affirmative ne fait aucun doute. Ils s'appuient sur les textes des Constitutions qui leur donnent apparemment raison. Ainsi, l'article 6 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 opposait la responsabilité politique des ministres à l'irresponsabilité de principe du président sauf cas de "haute trahison" 2 ( * ) , tandis que l'article 42 de la Constitution de 1946, imitait cette conception restrictive de la responsabilité politique du Président de la République 3 ( * ) . Vu sous ce seul angle littérale, l'article 68 de la Constitution de 1958 poursuivrait cette sorte de tradition constitutionnelle. Mais en comparant seulement les dispositions constitutionnelles française relatives à la responsabilité du Président de la République depuis 1875, la doctrine oublie d'examiner la pratique constitutionnelle et fausse l'histoire constitutionnelle. En effet, la IIIème République fournit un cas classique d'involution de la règle de l'irresponsabilité présidentielle. Àl'origine, comme le rappelait Joseph Barthélémy, elle répondait, avec le septennat et la dissolution, à la préoccupation des constituants de "faire du Président de la République autre chose que le serviteur obéissant du Parlement" 4 ( * ) . Ils escomptaient que bénéficiant de cette irresponsabilité, le président "pourrait avec indépendance exercer ses attributions" 5 ( * ) qui étaient importantes en raison de la facture plutôt "orléaniste" des lois constitutionnelles de 1875. Toutefois, ce calcul établi en vue d'instaurer un parlementarisme dualiste a été démenti par les faits. À partir de 1879, de la démission de Mac-Mahon, le Parlement a dominé les autres institutions, et en particulier le Président de la République. Ce dernier, de chef orléaniste, devint une simple "magistrature d'influence". Sous le seul angle de la responsabilité, les précédents de la démission de Mac Mahon, de Casimir Périer, et plus tard, d'Alexandre Millerand poussés à la démission par un Parlement qui usa de la technique du "refus de concours" pour s'opposer victorieusement à leur velléité d'indépendance. Une partie de la doctrine constitutionnelle en déduisit que le président était révocable par le Parlement. Elle traduisait, en théorie, cette idée, par la thèse selon laquelle il était un "agent" de l'État, et non pas un "représentant". De ce point de vue, Carré de Malberg rendait compte de cette évolution de la pratique, et non pas de la lettre de la Constitution, lorsqu'il analysait l'irresponsabilité présidentielle comme étant "bien moins un privilège établi en faveur du président et destiné à assurer sa stabilité ou son indépendance, qu'une garantie prise contre lui à l'effet d'exclure de sa part toute prétention ou tentation d'entretenir une action gouvernementale personnelle et indépendante" 1 ( * ) 3 4. Loin d'être le symbole d'une puissance absolue, comme pouvait l'être l'irresponsabilité d'un monarque absolu, l'irresponsabilité du président était devenue le signe de son impuissance, la preuve qu'il n'avait plus de "force politique" 2 ( * ) .
Ainsi reconstruite, l'évolution de l'irresponsabilité présidentielle sous la IIIème République révèle que, contrairement à une interprétation hâtive, cette disposition constitutionnelle n'a pas de signification univoque, mais recouvre en fait deux significations opposées. D'un côté, la lettre de la Constitution prévoit effectivement une irresponsabilité qui est conçue comme le corollaire d'une présidence dessinée sur le modèle de l'orléanisme, et qui de ce fait, est en contradiction avec l'idéal républicain. Ceci témoigne de ce que cette Constitution de 1875 était un compromis - intenable - entre républicains et monarchistes. Joseph-Barthélémy a perçu le vice initial de cette construction qui affectait le statut présidentiel : "Les constituants ce 1875 voulaient un pouvoir exécutif fort ; ils savaient qu'en le faisant irresponsable, ils l'affaibliraient et cependant ils l'ont fait irresponsable" 3 ( * ) . D'un autre côté, et à l'opposé de la lettre de la Constitution, la pratique constitutionnelle a enregistré l'émergence d'une responsabilité présidentielle devant le Parlement, qui a accompagné le glissement vers le républicanisme (1877-1879) et vers le triomphe de la souveraineté parlementaire 4 ( * ) . Cette dualité de la règle (irresponsabilité, puis responsabilité) est compréhensible uniquement d'un point de vue historique. Pour l'expliquer en constitutionnaliste, il faut admettre, avec Joseph Barthélémy ou René Capitant, qu'une grande partie de la constitution écrite de la IIIème République a été abrogée par une "constitution coutumière" 5 ( * ) , qui a métamorphosé le régime parlementaire initial en un "parlementarisme absolu" ou en un "régime d'assemblée".
Résumons : il est impossible de déduire du droit constitutionnel de la Troisième l'existence d'une quelconque "tradition républicaine" qui aurait consacré l'irresponsabilité politique du Président de la République. Paradoxalement, le même constat peut être effectué pour la Vème République, où malgré la césure que constitue l'émergence de ce régime par rapport aux régimes républicains antérieurs, le principe de l'irresponsabilité présidentielle a conservé une semblable dualité entre lettre et pratique.
B- L'IRRESPONSABILITÉ PRÉSIDENTIELLE SOUS LA VÈME RÉPUBLIQUE : ENTRE TEXTE ET PRATIQUE
La lettre de l'article 68 exclut la responsabilité politique du Président, comme on l'a vu plus haut. Cette irresponsabilité politique signifie constitutionnellement que, à la différence du Gouvernement (art. 49 et art. 50 C), le président est irrévocable par le Parlement, du moins en principe. Mais elle implique aussi d'autres règles - les corollaires - qui ne sont pas entièrement identiques à ceux des IIIème et IVème Républiques. Cela tient à la place différente qu'occupe le contreseing dans l'architecture initiale de la Constitution de 1958. On retrouve certes la règle traditionnelle selon laquelle le président n'a pas le droit de pénétrer dans l'enceinte du Parlement, avec lequel il doit communiquer uniquement par message. Ce droit de message, qui figure à l'article 18 de la Constitution, a reconnu un regain dans la pratique avec les cohabitations. Lors de la première cohabitation (1986-1988), c'est par voie de message que le président Mitterrand a fixé le sens de sa politique constitutionnelle. Par ailleurs, la règle considérée comme coutumière qui interdit de mettre en cause le président dans les débats politiques a été, indirectement reconnue par l'article 18 puisque les messages du Président de la République lus au Parlement "ne donnent lieu à aucun débat" 1 ( * ) . Elle est concrétisée juridiquement dans le règlement intérieur des assemblées qui prévoit une sanction disciplinaire pour tout parlementaire qui "s'est rendu coupable d'injures, de provocation ou menaces envers le Président de la République, le Premier ministres, et les membres du Gouvernement et les Assemblées" 2 ( * ) .
Cependant, le problème particulier qui se pose sous la Vème République résulte de ce que l'irresponsabilité attribuée par la Constitution au président est en porte-à-faux avec le reste des autres dispositions. En effet, à la lecture du texte constitutionnel, "nul ne peut contester que la Ve République a délibérément fait coexister une "`action gouvernementale personnelle et indépendante" du chef de l'État "avec la réaffirmation, cependant de son irresponsabilité, à peu près totale, y compris politique"3 ( * ). Il y avait quelque inconséquence à, d'un côté, conférer un véritable pouvoir actif au président, disposant notamment de "pouvoirs propres" (référendum, dissolution, dictature romaine de l'article 16, et saisine du Conseil constitutionnel) dispensés du contreseing ministériel par l'article 19 et, de l'autre, à lui attribuer l'irresponsabilité : l'équilibre entre le pouvoir et la responsabilité était rompu au profit du premier. Cette contradiction initiale est pointée par Stéphane Riais lorsqu'il observe : "Puisque l'une des fonctions du contreseing est de favoriser l'endossement de la responsabilité afférente à l'acte d'une autorité irresponsable, sa suppression a pour conséquence de laisser subsister la responsabilité à la charge du signataire. La notion de pouvoir propre subvertit ainsi la logique parlementaire classique et remet en cause la possibilité juridique et pratique d'une irresponsabilité du chef de l'État depuis 1958." 1 ( * )
Mais, la pratique gaullienne a levé cette contradiction en la dénouant en faveur de la responsabilité politique du président, de sorte que le texte constitutionnel (art. 68) a été totalement contredit par la pratique politique. Trois prérogatives ont permis au président d'engager sa responsabilité : d'abord, la dissolution, considérée comme un appel au peuple, passible de sanction, ensuite, l'élection présidentielle (après 1962 évidemment) lorsque le président sortant s'y présente, enfin le référendum lorsque le président décide de poser la question de confiance au pays. On sait d'ailleurs que c'est à la suite de la désapprobation populaire de 1969 que le général de Gaulle quitta le pouvoir. Les observateurs de la Vème République "gaulliste" ont noté que le glissement du pouvoir vers le chef de l'État, attesté par la pratique gaullienne et le renforcement de sa légitimité par l'élection au suffrage universel direct, était difficilement conciliable "avec un statut d'irresponsabilité." 2 ( * )
Si la doctrine s'accorde sur ce constat, elle est en revanche, divisée sur le point de savoir si cette responsabilité du président qui s'est dégagée de la pratique et en marge des textes constitutionnels, pouvait être considérée comme une véritable responsabilité politique 3 ( * ) . La réponse à la question dépend évidemment de la manière dont on apprécie l'effectivité de la règle en droit constitutionnel et dont on répond à la question de savoir si la pratique politique peut créer une règle constitutionnelle. La doctrine majoritaire a plutôt tendance à analyser l'émergence de cette responsabilité présidentielle comme un cas topique de divorce entre la règle et la pratique - divorce non sanctionnée en raison de l'ineffectivité relative du droit constitutionnel. "Malgré la lettre contraire de l'article 68, - écrivent Bidégaray, et Emeri - on éprouve le sentiment que le Président de la République devient politiquement responsable de la politique qu'il a décidée" 4 ( * ) . Elle se retranche surtout derrière l'absence de mécanismes propres de responsabilité du chef de l'État pour dénier toute validité juridique à cette pratique constitutionnelle. Attachée à une lecture strictement exégétique du texte constitutionnel, elle refuse d'admettre qu'un principe constitutionnel, comme celui de la responsabilité politique, détermine une pratique paraconstitutionnelle qui vide de son sens l'article 68, et le principe d'irresponsabilité politique qu'il fixe.
Mais, d'autres membres de la doctrine ont essayé de justifier, en constitutionnaliste, cette évolution faisant du président une autorité politique responsable devant le peuple. Celle-ci serait conforme à l'esprit démocratique du régime, et légitimée par certaines dispositions de la Constitution (art. 5, art. 6, art. 11, art. 12, par exemple). Le principe de la responsabilité politique devrait donc prévaloir sur la lecture "légaliste" ou exégétique de la Constitution ; en d'autres termes, l'article 68 n'est pas un obstacle à la naissance de cette responsabilité présidentielle qui correspond mieux à l'esprit du régime. Telle est, en particulier, la doctrine énoncée notamment par René Capitant, pour la réforme de 1962 aurait rendu inévitable la mise en jeu de la responsabilité politique du président non pas devant le Parlement, mais devant le peuple 1 ( * ) . À la différence de la Monarchie de juillet, le régime de la Vème République se caractériserait non seulement par le fait que cette élection démocratique du Président de la République, mais surtout par sa responsabilité devant le peuple. Or, celle-ci, selon lui, ne se limite pas au moment des élections, mais elle est permanente comme l'attesterait la possibilité d'une mise en accusation de l'article 68 de la Constitution (v. infra ),et d'une "démission forcée" du président à la suite d'un conflit entre l'assemblée et le chef de l'État tranché par un arbitrage populaire. Cet ajout est capital car on peut objecter à la thèse de la responsabilité politique du président que ce dernier est le seul à engager sa responsabilité, et que personne ne peut le contraindre à la voir engagée. Ce serait la différence majeure avec la responsabilité politique ministérielle dans laquelle le Parlement peut, de son propre mouvement, censurer le Gouvernement. En prévoyant ces deux facultés, Capitant entend parer cette objection.
Le retour de l'irresponsabilité - Cependant la pratique constitutionnelle ultérieure a grandement divergé de la pratique gaullienne. La Vème République a connu, de 1968 à 1986, un tournant, celui du "présidentialisme majoritaire", qui a combiné l'omnipotence présidentielle avec l'irresponsabilité. Quoique devenu gouvernant actif, le Président de la République n'est plus considéré par les successeurs du général de Gaulle (Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand) comme étant politiquement responsable devant le peuple. Le sort des scrutins électoraux ou des votations n'engage plus le destin politique du Président. Il n'est pas alors étonnant que la pratique constitutionnelle de l'article 68 ait épousé les contours de cette nouvelle politique, et a connu un regain d'application. Alors qu'on pensait que l'implication plus ou moins forte du Président de la République dans la vie politique française allait rendre ineffective la règle interdisant aux parlementaires de le mettre publiquement en cause, cette règle est curieusement redevenue effective (sanctionnée) depuis que le président n'engage plus sa responsabilité politique. Deux précédents le montrent. Le premier eut lieu en 1984, lorsque trois députés de l'opposition (d'Aubert, Madelin, et Toubon) mirent en cause le passé vichyste du président Mitterrand ; ils furent sanctionnés par le bureau de l'assemblée qui leur infligea une sanction de censure. Le second épisode est celui de l'affaire dite des "avions renifleurs" (1984) qui, du point de vue de la pratique constitutionnelle de l'article 68, est instructif. L'ancien Président de la République (Giscard d'Estaing) s'adressa à son successeur (Mitterrand) pour lui demander s'il était tenu de déférer à une convocation pour audition devant une commission d'enquête parlementaire, une telle convocation lui semblant contraire au principe d'irresponsabilité politique du Président 1 ( * ) . Le nouveau président dispensa son prédécesseur de cette audition au nom " d'une longue et constante tradition républicaine et parlementaire " 2 ( * ) , Apparemment, cette interprétation authentique de la Constitution semble conforme à l'idée que l'article 68 vise à empêcher la mise en cause d'un Président de la République devant le Parlement. Elle se contente d'étendre le bénéfice de cette irresponsabilité présidentielle prévue aux anciens Présidents de la République. Le plus intéressant réside néanmoins dans la légitimation, c'est-à-dire l'invocation de "la tradition républicaine et parlementaire". On a vu certes qu'une telle tradition n'existe pas (v. supra ), mais surtout, elle ne saurait être utilement invoquée que si le président faisait office de chef d'État selon la tradition parlementaire, c'est-à-dire s'il ne gouvernait pas. Or, elle est ici invoquée à un moment où le Président de la République gouverne, c'est-à-dire à l'époque de la Vème "néo-présidentialiste" d'après 1969. Autrement dit, le plus contestable tient à ce double discours : "Voyez mes ailes, je suis Président-gouvernant (art. 5), mais voyez mon corps, je suis chef d'État irresponsable (art. 68)".
La cohabitation - Sous l'angle de la responsabilité présidentielle, la cohabitation a renforcé cette lecture de l'article 68 en termes d'irresponsabilité politique, mais avec peut-être davantage de cohérence institutionnelle. La cohabitation signifie, vu du point de vue de l'institution présidentielle, qu'un président au pouvoir estime qu'il peut rester au pouvoir, alors même que "sa" majorité parlementaire a perdu les élections législatives. Autrement dit, le président ne se considère pas comme désapprouvé par le peuple. Théorisée une première fois par Valéry Giscard d'Estaing, mise en pratique par François Mitterrand à deux reprises (1986-1988 ; 1993-1995), cette doctrine a connu son apogée avec Jacques Chirac qui est resté à la tête de l'Exécutif après l'échec de sa dissolution (1997). Or, c'est à l'occasion de cette "longue cohabitation" (1995-2002 vraisemblablement) que l'on assiste à une résurgence imprévue de l'article 68 dans le débat constitutionnel.
Deux interprétations de ce phénomène sont possibles. Selon la première, la cohabitation rétablit, dans une certaine mesure, une cohérence institutionnelle puisque le président n'étant plus le véritable chef de l'Exécutif, son irresponsabilité politique redevient le corollaire de son impuissance - ou de sa quasi-impuissance (car il faut garder à l'esprit ses pouvoirs en matière de relations internationales et en matière militaire). Dès lors, l'irresponsabilité politique du chef de l'État reconquiert son sens constitutionnel propre au régime parlementaire, (v. supra ). C'est un bouclier qui protège le président et la dignité de la fonction contre d'éventuelles attaques de la majorité. N'est-ce pas ce que signifie le rappel à l'ordre (sanction disciplinaire prévue à l'article 71 du règlement de l'A.N.) adressé au député vert, Noël Mamère, lorsqu'il accusa, en séance publique (le 30 mai 2000), le Président de la République en exercice d'avoir "couvert" des pratiques de fraude électorale à Paris remontant à 1977 ? Le président de l'Assemblée, M. Raymond Forni (PS) estima de tels propos "inacceptables", et "contraires à la tradition républicaine régissant le fonctionnement de notre Assemblée, selon laquelle le chef de l'État ne saurait dans cette enceinte, de quelque manière que ce soit, faire l'objet d'imputation à caractère personnel".
Mais, il peut y avoir une seconde interprétation fort différente. On peut se demander si le fait que la haute trahison resurgit aujourd'hui n'est pas un effet pervers et impensé de la très longue cohabitation (3° cohabitation) qui aggrave la crise de la responsabilité politique. En effet, on ne peut plus sanctionner le président en sanctionnant le Premier ministre (motion de censure de 1962) tandis que la sanction électorale (dissolution ratée de 1997) n'a eu aucune conséquence sur le président. La situation est du point de vue de la morale politique, fort insatisfaisante : un président, qui ne démissionne pas après la défaite de sa majorité en 1997, est, en quelque sorte, "récompensé" par l'immunité que lui confère sa fonction, alors qu'il aurait pu être sanctionné politiquement (par une sorte de "refus de concours"). Puisque la responsabilité politique est en panne 1 ( * ) et que la morale politique est en berne, on saisit la seule arme qui reste : l'arme politico-pénale de la haute trahison. L'article 68 renaît cette fois pour tenter d'engager la responsabilité pénale du président. Cette interprétation nous paraît la plus fondée.
Pourtant, - et c'est là tout le problème - la Haute Cour n'est pas l'institution adéquate pour juger pénalement le Président de la République pour des faits commis antérieurement à ses fonctions.
II - LA HAUTE TRAHISON : RESPONSABILITÉ PÉNALE OU JUSTICE POLITIQUE ?
Si le principe formulé par l'article 68 est l'irresponsabilité politique du président devant le Parlement, il reste à qualifier "l'exception de haute trahison", c'est-à-dire à répondre à la question suivante : la responsabilité du Président de la République pour cas de haute trahison, est-elle une responsabilité de nature politique ou de nature pénale ? Cette question avait provoqué dans la doctrine constitutionnelle classique une controverse entre les partisans de chaque opinion, la "pénaliste" ou la "politique", qui reposait sur une divergence relative à la nature de la Haute Cour, et en dernier ressort, sur la philosophie du droit constitutionnel.
Selon la première opinion, minoritaire exprimée par Léon Duguit, la procédure devant la Haute Cour ne serait pas assimilable à la procédure l'impeachment, pour deux raisons complémentaires : d'une part, l ' impeachment à l'anglaise est devenu obsolète en France depuis que celle-ci connaît un régime parlementaire, et, d'autre part, l'impeachment à l'américaine est inapproprié, car il s'agit d'une responsabilité politique du Président, prohibée par les lois constitutionnelles de 1875. La thèse du doyen de Bordeaux repose sur la conviction que la responsabilité pénale pour haute trahison prévue par le texte constitutionnel est une véritable responsabilité pénale, par conséquence "soumise au principe primordial de l'art. 8 de la Déclaration des droits de 1789 ; nulle peine sans une loi qui l'établit" 1 ( * ) . La responsabilité pénale est donc une alternative à l'irresponsabilité politique 2 ( * ) , dans la mesure où cette conception pénaliste ou légaliste de la Haute Cour est fondée sur l'idée que les dispositions relatives à la Haute Cour sont tout simplement "des textes de droit pénal" 3 ( * ) 3. Le primat de l'État de droit détermine alors l'application à la Constitution des règles de droit pénal.
Toutefois, cette conception dite "légaliste" n'a jamais pu l'emporter face à l'autre conception, dite "constitutionnaliste", qui autorise la dérogation à des principes de l'État de droit afin de sauvegarder l'autonomie du droit constitutionnel par rapport au droit pénal. Selon cette dernière conception, la responsabilité du Président de la République devant la Haute Cour pour haute trahison est une responsabilité exceptionnelle de nature politique (et non pénale) qui, selon une formule suggestive d'Esmein, vise à "rendre efficace, par une mesure extrême, la responsabilité ministérielle. 4 ( * ) ". Une telle conception, dominante dans la doctrine de la IIème République, est partagée par la majorité de la doctrine de la Vème République : de René Capitant qui interprète l'exception de haute trahison comme "une motion de censure, prononcée dans des formes particulièrement solennelles" 5 ( * ) au Doyen Vedel, observant qu'une telle institution "relève quand même plus de l'impeachment que de la poursuite pénale ordinaire." 6 ( * ) .
Mais, la nature de cette responsabilité pour haute trahison mérite aussi d'être examinée à partir d'une étude des notions-clé de haute trahison et de Haute Cour, qui façonnent l'article 68. D'ailleurs, toute interprétation de l'article 68 aurait dû commencer par une interrogation préalable sur le sens et la nature de cette institution particulière qu'on appelle "Haute Cour" qui donne son intitulé au Titre IX de la Constitution, duquel relève l'article 68 de la Constitution, et qui est censée juger le président Or, non seulement, la doctrine constitutionnelle y a consacré des développements fort succincts dans son commentaire de l'article 68, mais surtout, elle a feint d'ignorer que la Haute Cour de justice, telle qu'elle est aménagée par l'article 68, est une institution typique de la justice politique, qui n'a jamais été la méthode adéquate dans un État de droit pour résoudre les cas de responsabilité pénale ordinaire 1 ( * ) 57. Selon la thèse ici avancée, cette exception de haute trahison ne peut pas être qualifiée de responsabilité pénale.
A- LA HAUTE TRAHISON COMME NOTION DE DROIT CONSTITUTIONNEL
La doctrine est gênée par cette notion de haute trahison, qui fait partie de ces notion floues ou indéterminées qui parsèment le droit public (ordre public, intérêt général, etc..) et qui est difficile à appréhender à cause de son caractère mixte, de sa nature politico-pénale. En outre, elle embarrasse la doctrine car elle "n'a été définie ni par la Constitution, ni par la loi, ni même par la jurisprudence car il n'existe aucun précédent en la matière" 2 ( * ) . Quand le constitutionnaliste n'a plus aujourd'hui la ressource de s'appuyer sur la jurisprudence pour penser son objet, il croit que ce n'est plus un objet juridique. Faut-il pourtant rappeler que les ouvrages classiques du droit constitutionnel ont été écrits en France et à l'étranger, avant l'existence de juridictions constitutionnelles ? 3 ( * ) Rien n'interdit pourtant de tenter d'élucider le sens d'une expression mentionnée, à plusieurs reprises, dans certaines constitutions françaises et étrangères, et jadis commentée par la doctrine classique.
Selon une première démarche qui semble revêtir la forme d'une pirouette rhétorique, mais qui est bien plus profonde, la haute trahison ne peut être définie que de manière purement nominaliste : elle correspond à "tout acte que la Haute Cour de justice régulièrement saisie, aura jugé tel." 4 ( * ) La haute trahison, c'est ce qu'en dit la Haute Cour. On doit la définir formellement - c'est-à-dire par l'interprétation que veut bien lui donner librement l'organe d'interprétation authentique -, parce qu'en réalité, une définition matérielle (par son objet) est impossible. Il faudrait donc admettre, au nom de cette théorie réaliste de l'interprétation, que n'importe quel délit ou crime reproché à un président en exercice, même s'il a été commis antérieurement à ces fonctions, peut entrer dans la catégorie constitutionnelle de "haute trahison".
Certes, un tel argument révèle ses limites quand on envisage les conséquences concrètes qu'il entraîne. Il faudrait mobiliser la Haute Cour pour juger le président pour des infractions qui seraient, par exemple, vénielles. Ce qui reviendrait, souvent, à écraser une mouche avec un marteau. Sous la IIIème République, Joseph Barthélémy avait ironisé sur le caractère disproportionné d'une telle procédure. Mais d'autres arguments, moins pragmatiques, peuvent aussi être avancés à son encontre. L'un d'entre eux serait de soutenir que la haute trahison doit inclure non pas un délit, mais un "crime", et plus particulièrement aussi un crime d'une extrême gravité. À l'appui de cette idée, l'on pourrait citer la doctrine constitutionnelle classique qui évoquait constamment le "crime de haute trahison", comme s'il allait de soi que l'équivalent pénal de cette notion était un crime et non pas un délit. Toutefois, sur ce point, l'histoire constitutionnelle des États-Unis fournit un contre-exemple utile à méditer. L'opinion selon laquelle l'impeachment devait être réservée aux graves infractions (great offences) ne s'est jamais imposée dans les faits 1 ( * ) alors qu'elle répondait à l'intention du constituant qui voulait limiter les cas de mise en accusation à des infractions gravissimes, à des "hauts crimes et délits". Or, selon une pratique constitutionnelle constante, depuis le précédent Andrew Johnson jusqu'au récent cas Clinton, les autorités politiques détiennent un pouvoir illimité pour qualifier les faits.
L'exemple américain de l'impeachment semblerait donc renforcer la thèse accordant à l'organe authentique d'interprétation le droit de faire dire ce qu'il veut au texte de la Constitution. Toutefois, le "cas Chirac" contient un élément particulier qui s'oppose à ce qu'on lui applique cette thèse. Cet élément tient à ce que les infractions reprochés au président actuellement en exercice sont nécessairement réputés avoir été commis en-dehors des fonctions, parce qu'elles ont été commises antérieurement à la prise de ses fonctions. Par conséquent, et contrairement à ce qui a été prétendu par certains 2 ( * ) , la distinction entre les délits commis en dehors des fonctions et ceux commis pendant l'exercice des fonctions, structure ce cas juridique. Quel est sa conséquence sur la qualification juridique de la "haute trahison" ? Si les délits reprochés au président ont été commis en-dehors de ses fonctions, et si la "haute trahison" présuppose des actes commis pendant l'exercice des fonctions (comme l'indique la lettre de l'article 68), il apparaît impossible d'associer ces deux éléments dissemblables, c'est-à-dire de subsumer la catégorie des premiers sous la catégorie de la seconde. L'opération de subsomption juridique ne fonctionne pas en raison du décalage temporel entre les faits litigieux et l'infraction prévue pour la saisine de la Haute Cour.
Elle ne fonctionne pas, sauf cependant à imaginer que le refus de la part du président en exercice de déférer à une convocation d'un juge d'instruction pour témoigner serait constitutif d'une grave entrave à l'exercice de la justice, et pourrait potentiellement être considérée comme un acte de haute trahison. Certains ont suggéré, implicitement, cette idée 1 ( * ) . Cependant, deux arguments vont en sens contraire. D'une part, tant que la question de l'immunité n'était pas tranchée, il était difficile de prouver que l'attitude du président était une entrave, puisqu'elle pouvait être interprétée comme une soumission de sa part à son statut constitutionnel de président. D'autre part, l'argument selon lequel un président qui aurait commis un délit antérieur serait accusé de violer la Constitution parce qu'il ne déférerait pas aux injonctions de la justice concernant ce délit antérieur, était précisément celui employé par le redoutable procureur spécial Kenneth Starr, dans l'affaire Clinton. Il est permis de penser que ce précédent est plutôt malheureux et qu'il doit rester un précédent valable pour les seuls États-Unis 2 ( * ) .
Si l'on refuse ces définitions de la haute trahison commandées par une acception purement formelle et par une théorie plus ou moins "réaliste" de l'interprétation, il ne reste comme autre solution que définir la haute trahison par son objet. Ainsi la définissent ceux qui considèrent qu'elle constitue une "violation grave et délibérée de la Constitution" 3 ( * ) , ou une "attaque contre la Constitution" ou si l'on veut une "agression" [ Angriffl ] , ou encore, dans un sens restrictif, une entreprise visant " à changer la constitution par la violence" 4 ( * ) . Une telle conception peut s'appuyer sur une série de dispositions constitutionnelles et sur la tradition doctrinale.
En effet, les textes constitutionnels ne sont pas inutiles à consulter pour tenter de comprendre le sens de cette notion. La définition matérielle figure dans l'article 68 de la Constitution de 1848 qui propose une élucidation de la notion de haute trahison : Toute mesure par laquelle le Président de la République dissout l'Assemblée nationale, la proroge ou met obstacle à l'exercice de son mandat, est un crime de haute trahison. Par ce seul fait, le président est déchu de ses fonctions ; les citoyens sont tenus de lui refuser obéissance ; le Pouvoir exécutif passe de plein droit à l'Assemblée nationale." Cet article de la Constitution, dont on examinera plus loin l'effectivité, révèle l'idée d'une "entrave aux fonctionnement régulier du pouvoir législatif qui est au coeur même de la notion 5 ( * ) et qui inspire l'article 90 de l'actuelle Constitution Italienne 1 ( * ) qui met sur le même plan la notion de "haute trahison" et "l'attentat à la Constitution".
La doctrine constitutionnelle sous la IIIème République éclaire utilement la notion de haute trahison. Duguit la critiquait vigoureusement car, n'étant pas prévu par le code pénal, elle était contraire au principe de légalité des délits et des peines. Ses adversaires estimaient, cependant, que la Haute Cour n'était pas liée par le principe de légalité des délits et des peines, plus particulièrement depuis l'arrêt Malvy et que la haute trahison, était une notion constitutionnelle, à l'opposé de la trahison, simple notion pénale 2 ( * ) . Esmein synthétisait la doctrine majoritaire en déclarant que la loi constitutionnelle du 25 février, par ce cas de haute trahison (art. 6), avait "en vue une répression politique, plutôt que légale" 3 ( * ) . Sur ce dernier point, cette conception non pénaliste domine encore la doctrine constitutionnelle sous la Ve République pour qui la haute trahison demeure davantage une incrimination politique qu'une infraction pénale, faute de référence à "une incrimination de droit commun" 4 ( * ) . Elle se caractérise par l'idée "d'un manquement aux devoirs de la charge" 5 ( * ) . "La haute trahison peut (..) intervenir dans le cas concret d'un différend grave entre le Parlement et le président. Il n'est pas besoin que le président soit un criminel de droit commun pour être poursuivi. Il suffit qu'il ait une position politique le plaçant en antagonisme déclaré et profond avec les autres représentants de la Nation" 6 ( * ) . Elle tend donc à instaurer une responsabilité politique et exceptionnelle (politico-pénale ou "criminelle politique", disait Hauriou) fort différente de la responsabilité pénale de droit commun à laquelle aspirait Duguit.
Il ressort de ce qui précède que la notion constitutionnelle de haute trahison sert à désigner une protection spéciale de la Constitution 7 ( * ) . On y recourt, en dernière instance, lorsqu'il s'agit, dans l'urgence, de prendre une mesure de salut public afin de parer la menace résultant d'une grave violation de la Constitution par l'Exécutif. À cet égard, elle ressemble aux circonstances exceptionnelles de l'article 16 de la Constitution de 1958 : c'est une hypothèse dont on espère qu'elle ne se produira jamais. Cette "sanction politique" aux violations éventuelles de la Constitution 8 ( * ) correspond à l'éventualité d'un moment de forte tension entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Un tel contexte conduit le juriste à être sceptique sur l'effectivité de cette notion, comme l'atteste le fameux précédent français du 2 décembre 1851. Le coup d'État réussi par Louis-Napoléon Bonaparte réalise précisément cette éventualité que l'article 68 voulait justement parer. Certes, trois cent députés signèrent une motion d'accusation du Président, où ils estimaient réalisés les éléments constitutifs du crime de haute trahison. Mais cette motion ne fut qu'un baroud d'honneur. Ayant sûrement à l'esprit ce précédent malheureux, le juriste italien Emmanuele Orlando notait le caractère irréaliste ou inapplicable de la disposition de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 : "un président contre lequel on arrive à adresser une mise en accusation et qui reste encore en fonctions a, ou bien fait un coup d'État, ou bien est poussé à le faire. (..) Une hypothèse de ce genre présuppose un état de révolution, dans lequel l'efficacité du droit existant est nulle ou pour le moins suspecte". Et il ajoutait plus loin : "cette disposition [sur la mise en accusation] contient une déclaration de principe sans contenu effectif ; on comprend que l'existence d'une mise en accusation contre le chef de l'État provoque un état de crise ; mais chacun voit, en pratique, qu'avant que la Chambre puisse mettre en état d'accusation le président pour le renvoyer devant la Chambre haute, le président devra choisir entre se démettre ou se rebeller ; la rébellion s'appelle coup d'État, la démission, faisant cesser la qualité d'organe souverain, élimine l'obstacle de l'inviolabilité." 1 ( * ) . Par cette observation, Orlando résumait parfaitement le dilemme insoluble que pose le cas de haute trahison.
On a compris que la haute trahison est l'infraction juridico-politique inventée pour se débarrasser d'un chef de l'État qui aurait gravement abusé de ses fonctions. Aux États-Unis, son équivalent, qui est la procédure d'impeachment est quelquefois opératoire car le régime est présidentiel, et non parlementaire, de sorte que l'impeachment fait partie de ces fameux checks and balances inventés par les Pères fondateurs. En revanche, dans les régimes parlementaires, où l'on peut se débarrasser des gouvernants en censurant le Gouvernement, le problème de la révocabilité du chef de l'État est toujours apparu comme relativement secondaire. Son maintien dans la constitution peut être interprété comme un reste des époques troublées où, en France du moins, les Assemblées craignaient un coup d'État orchestré par chef de l'État.
B - LA HAUTE COUR OU LA RÉSURGENCE DE LA JUSTICE POLITIQUE
Puisque les dispositions relatives à la Haute Cour figurant dans la Constitution de la Vème République n'ont guère innové par rapport à la tradition constitutionnelle et qu'en outre, elles n'ont pas varié depuis 1958, on peut interpréter cette institution comme le faisait la doctrine classique de la IIIème République. Celle-ci estimait qu'elle faisait office de justice politique 1 ( * ) . C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Duguit attaquait si violemment cette institution : "elle viole - clamait-il - le principe de l'égalité de tous devant la loi" et elle constitue non seulement "une juridiction extraordinaire" mais aussi "une véritable tache dans notre constitution républicaine" 2 ( * ) . Mais, cette interprétation en termes de justice politique éclaire aussi la Haute Cour de la Vème République. Un des membres du Comité consultatif constitutionnel tint à rappeler cette liaison douteuse entre Haute Cour et justice politique en déclarant notamment : "Qu'on le veuille ou non, la Haute Cour de justice est tout de même une juridiction politique. Ce ne sont pas des juges, ce sont des hommes politiques qui essaient de juger, il faut bien le reconnaître" 3 ( * ) . La saisine est restée purement politique (art. 68), la composition de la Haute Cour est également politique (art. 67) et la personne qu'elle peut juger de nos jours est un homme politique. Il n'est alors guère étonnant de constater que la doctrine constitutionnelle qualifiait la Haute Cour de justice politique et éprouvait les mêmes réserves devant cette institution spéciale qui avait fait beaucoup jaser à propos de l'affaire Malvy. Commentant l'article 68, Jacques Cadart observait : "Ce système de justice politique est contestable comme toute forme de justice politique qui, bien souvent, ressemble plus à un règlement de compte entre rivaux qu'à une justice véritable" 4 ( * ) .
Mais tout autant que les opinions doctrinales, les précédents éclairent l'institution de la Haute Cour sous la Vème République. Dans son arrêt du 5 février 1993, relatif à l'affaire du sang contaminé, la commission d'instruction de la Haute Cour (composée de magistrats de la Cour de cassation) a examiné la nature de cette institution ambiguë. Elle s'est tirée de la difficulté en la qualifiant de "Juridiction pénale de nature constitutionnelle, obéissant à des règles de saisine et de compétence et de fonctionnement exorbitantes du droit commun" 5 ( * ) . La qualité rhétorique de cette définition, proche d'un oxymore, n'interdit pas d'observer qu'une telle qualification est typiquement "pénaliste". En effet, vue sous l'angle du droit pénal, la Haute Cour est une juridiction spéciale qui déroge aux juridictions de droit commun. Mais, vue sous l'angle du droit constitutionnel, la Haute Cour est une juridiction politique, ce qui est -on l'avoue - un autre oxymore 6 ( * ) . Son régime juridique jouit d'une large autonomie par rapport à la procédure pénale de droit commun. On a déjà noté sa composition politique et le caractère particulier de son fondement de compétence (haute trahison). La commission d'instruction a ajouté à cette description plusieurs autres singularités : elle obéit "à des règles de saisine et de compétence et de fonctionnement exorbitantes du droit commun". Ses arrêts "ne sont susceptibles ni d'appel, ni de pourvoi en cassation" et les actes de la commission d'instruction sont sans recours".
Toutefois, le plus instructif dans son régime juridique est sans doute la notion de mise en accusation qui est distincte de la mise en mouvement de l'action publique par le Parquet. Sous la Vème République, sa spécificité a été soulignée à plusieurs reprises. Selon les termes de l'article 25 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 sur la Haute Cour de justice, la commission d'instruction "apprécie s'il y a preuve suffisante de l'existence des faits énoncés dans la résolution de mise en accusation, mais non la qualification de ces faits". À l'opposé du cas des membres du Gouvernement (avant 1993) où le renvoi devant la Haute Cour par la Commission était une simple faculté, il est obligatoire pour ce qui concerne le Président de la République. Cette saisine obligatoire montre qu'on est en présence "d'une véritable mise en accusation" 1 ( * ) 83, c'est-à-dire d'un jugement d'opportunité politique dans lequel les considérations juridiques sont réduites à la portion congrue. Mais, même pour le cas des membres du Gouvernement, la nature éminemment politique de l'accusation a été soulignée dans les deux affaires, Carrefour du Développement et sang contaminé, ayant donné lieu à une jurisprudence de la Commission d'instruction. Dans la première affaire, cette dernière a non seulement considéré que la résolution de renvoi de l'ancien ministre valait implicitement mainlevée de l'immunité parlementaire, mais aussi qu'elle constituait "l'expression de la volonté souveraine du Parlement... Elle s'analyse, au regard de la procédure pénale, comme une décision mettant en mouvement l'action publique contre ce parlementaire nommément désigné" 2 ( * ) . L'analogie avec la procédure pénale est métaphorique ; au regard du droit constitutionnel, une mise en accusation est un acte de souveraineté du Parlement, qui n'a rien de commun avec l'action publique de type classique. C'est d'ailleurs ce que la Commission d'instruction a rappelé, dans la seconde affaire, celle du sang contaminé, de la manière la plus claire : "l'action publique exercée par les assemblées législatives n'est pas celle prévue par l'article 1 du Code de procédure pénale." 3 ( * ) . Dans sa réponse au député Montebourg, le procureur de la République de Nanterre a parfaitement décrit cette singularité procédurale : "les textes qui régissent cette Haute Cour instaurent un mode original de poursuite et de jugement, sans aucun équivalent dans notre organisation judiciaire". Il a aussi rappelé le fondement de cette spécificité de la mise en accusation : "c'est dans le seul principe de sa légitimité venue du peuple souverain que le Parlement puise son pouvoir d'auto-saisine en vue d'exercer son contrôle" 4 ( * ) .
De ce point de vue, la doctrine constitutionnelle n'a pas suffisamment médité l'arrêt de la Commission d'instruction de la Haute Cour du 5 février 1993. Le problème juridique qui s'y posait était de savoir si des poursuites pénales intentées contre des médecins, à propos de contamination du virus du SIDA, pouvaient interrompre la prescription à l'égard des trois membres du Gouvernement mis en accusation par les deux Chambres. La Commission d'instruction a estimé que les actes d'une procédure d'instruction ordinaire n'avaient pas d'effet interruptif sur une procédure parallèle menée devant la Haute Cour, et elle a donc considéré comme étant prescrits les délits en cause. En principe, la règle en matière de prescription est celle de l'effet réel, c'est-à-dire qu'elle opère "in rem", a un effet absolu et concerne toutes les personnes impliquées dans la commission des faits. Autrement dit, la prescription est interrompue même à l'égard des personnes qui ne sont pas impliquées dans l'acte d'instruction et de poursuite. Mais, ici, les magistrats ont préféré adopter la solution exceptionnelle qui confère à la prescription un effet "personnel". Les pénalistes ont interprété cet arrêt comme marquant le triomphe de la thèse du caractère "personnel" de la prescription sur son caractère "réel" 1 ( * ) . Toutefois, le constitutionnaliste retiendra surtout que la thèse du caractère "réel" défendue par le Procureur général reposait sur le principe d'égalité devant la loi pénale ; celui-ci aurait interdit, relativement à la prescription, de faire un sort aux ministres différent de celui réservé à leurs collaborateurs. Or, la Commission d'instruction n'a pas suivi cette thèse, et elle a admis une exception au principe d'égalité devant la loi puisqu'elle a étendu aux ministres de la jurisprudence relative aux parlementaires qui, depuis un revirement de jurisprudence datant de 1965, bénéficiaient de la thèse du caractère "personnel" de la prescription qui dissociait le cas du parlementaire d'autres personnes impliquées dans la commission du même délit 2 ( * ) .
Si l'on n'était pas encore convaincu du fait que la Haute Cour est un "ordre de juridiction particulier" (J. Foyer) - qu'elle possède une autonomie constitutionnelle il faudrait ajouter, à titre d'autre élément de preuve, la totale étanchéité des procédures de droit commun devant des juridictions ordinaires et de mise en accusation devant la Haute Cour qui a été révélée par la récente passe d'armes entre le remuant député Montebourg et le procureur de la République de Nanterre (M. Bot). Le premier, qui visait l'objectif tout à fait louable de lutter contre la prescription de délits éventuellement commis par le Président de la République, a cherché à obtenir du second la production de pièces relatives à l'une des instructions concernant Jacques Chirac. Il estimait que le secret de l'instruction ne pouvait pas lui être opposé en tant que parlementaire, c'est-à-dire en tant qu'autorité de poursuite, et surtout que ses pièces étaient indispensables pour la rédaction de "l'énoncé sommaire des faits reprochés" exigé pour une motion de mise en accusation du Président. Pour fonder sa requête, il s'appuyait sur la jurisprudence criminelle relative aux règles en matière de communication des pièces extraites d'un dossier répressif en cours. Raisonnant par analogie, il estime que cette jurisprudence devrait être appliquée "à un parlementaire chargé par la Constitution de mettre en mouvement l'action publique contre le chef de l'État et soucieux d'assurer la continuité de poursuites pénales bloquées pour incompétence des juridictions de droit commun" 1 ( * ) . Il considérait donc implicitement que la procédure de droit commun et la procédure de mise en accusation étaient de nature identique, qu'il n'y avait donc pas là deux ordres de juridiction différents, et enfin qu'un parlementaire, désireux comme lui, de mettre en accusation un président en exercice pourrait faire office de Parquet et mettre en mouvement "l'action publique" 2 ( * ) . La requête du député a été sèchement rejetée par le Procureur qui a défendu l'idée, somme toute classique, de l'autonomie constitutionnelle de la procédure de la mise en accusation. Deux points de son argumentation méritent d'être relevés. D'une part, "le déclenchement des poursuites et leur délimitation" n'appartiennent pas à un parlementaire, pris isolément, mais aux "seules Assemblées parlementaires, Sénat et Assemblée nationale, statuant par un vote identique et à la majorité absolue des membres les composant" 3 ( * ) . Autrement dit, la saisine de la Haute Cour est une compétence qui appartient exclusivement à une unité collective, le Parlement, et non pas à ses membres ut singuli. D'autre part, la séparation des pouvoirs interdit cette transmission : il faut comprendre par là que la Haute Cour est une émanation du Parlement, et que ses compétences ne sont en rien subordonnées, ou dépendantes, des mesures prises par l'institution judiciaire. Les deux précédents - affaire Carrefour du développement et du sang contaminé - vont en ce sens. Ainsi, il a été décidé, dans cette dernière affaire, que la transmission par le Garde des Sceaux à la Haute Cour d'une ordonnance rendue par un juge d'instruction ne pouvait, en aucun cas, être considérée - selon l'actuel président de l'Assemblée nationale - "comme un préalable, à fortiori comme une étape de la procédure". 4 ( * )
Ces précédents relatifs à la Haute Cour, qui sont tous convergents, révèlent que la procédure devant la Haute Cour est une procédure à la fois autonome de droit constitutionnel et exorbitante du droit pénal commun. Certes, on peut objecter que les progrès de l'État de droit depuis une dizaine d'années ont rangé la Haute Cour au niveau des "résidus" constitutionnels. D'un côté, l'évolution récente du droit international témoigne d'une réaction convergente et hostile à l'existence d'immunités accordées aux gouvernants, et plus particulièrement au chef de l'État. Renouant avec l'idée qui présidait à la formation du tribunal de Nuremberg, les statuts conventionnels de plusieurs tribunaux pénaux internationaux, ad hoc (Ruanda, Bosnie) ou permanent (Cour pénale internationale) excluent du bénéfice de l'immunité "un chef de l'État qui les aurait commis dans l'exercice de ses fonctions des crimes très graves (par ex. crimes contre l'humanité, génocide) "des crimes internationaux contraires aux exigences de la conscience universelle" selon l'expression de la Cour d'appel de Paris 1 ( * ) . Par ailleurs, la jurisprudence de la Chambre des Lords dans l'affaire Pinochet, où était mis en cause un ancien chef d'État, a étendu la liste de ces crimes, non couverts par l'immunité, en y ajoutant le cas de la torture. Il n'en reste pas moins qu'en dépit de ces évolutions récentes, les chefs d'État en exercice conservent une immunité pénale de principe, comme le prouve l'arrêt Khadafi 2 ( * ) . D'un autre côté, en droit interne, la naissance de la Cour de justice de la République (1993) était destinée à mettre fin à une sorte d'impunité des membres du Gouvernement en facilitant leur jugement, par cette Cour particulière, pour des crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Les juridictions répressives de droit commun restent compétentes pour ce qui concerne les actes commis en dehors des fonctions.
Mais,- et c'est à notre avis un argument absolument décisif - en dépit de la création de la Cour de justice de la République et de la Cour pénale internationale et de leurs implications juridiques, le statut juridique de la responsabilité présidentielle devant la Haute Cour n'a pas été modifié 3 ( * ) . On peut toujours arguer d'une éventuelle contrariété de son statut avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme 4 ( * ) ,. mais sans pouvoir contredire l'analyse ici proposée selon laquelle son statut juridique est celui d'une juridiction politique. Dès lors, il ne reste qu'à souscrire à l'opinion suivante du Doyen Vedel : "si l'évolution de la responsabilité pénale des ministres s'est, par les textes constitutionnels de 1946, 1958, et 1993, faite dans le sens d'un rapprochement avec le droit commun, l'autonomie de la justice politique persiste pour le chef de l'État" 5 ( * ) .
Si cette analyse est exacte, on perçoit la contradiction dans laquelle tombent les partisans de la mise en accusation du chef de l'État devant la Haute Cour pour des infractions antérieures à la prise de fonctions. D'un côté, ils brandissent l'étendard du principe d'égalité devant la loi et de l'État de droit pour contester radicalement l'idée même d'un "privilège de juridiction" accordé au Président. Mais, de l'autre, pour réaliser cette égalité devant la loi, c'est-à-dire pour renvoyer le président en exercice devant la justice, ils se résignaient, compte-tenu de la jurisprudence constitutionnelle, à user de la procédure de mise en accusation devant la Haute Cour. Ainsi, ils recouraient à un moyen contraire à l'État de droit pour faire triompher les principes de celui-ci. En excluant la compétence de la Haute Cour pour des faits extérieurs aux fonctions du président, la Cour de cassation a donc sobrement rappelé le sens constitutionnel de la Haute Cour, institution d'exception pour périodes exceptionnelles. À notre avis, elle a eu raison de le faire 1 ( * ) . Et ceux qui voudraient contourner cet arrêt de la Cassation en tentant d'engager une saisine de la Haute Cour, tomberaient dans la même contradiction que celle ici dévoilée.
III- DE L'INVIOLABILITÉ PRÉSIDENTIELLE ET DU RAPPORT ENTRE DROIT CONSTITUTIONNEL ET THÉORIE DE L'ÉTAT
Il ressort des précédents développements que le problème d'une éventuelle responsabilité pénale du Président de la République pour des délits commis avant son entrée en fonctions ne peut être résolu par l'interprétation de l'article 68 (fût-elle discrètement ou ouvertement "constructive"). Ou si on le fait, comme la doctrine majoritaire, le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation, c'est au prix d'un arbitraire excessif dans l'interprétation de la Constitution, et donc d'une violation des principes sur lesquels repose un État de droit. Ce qui revient donc à affirmer que la question de l'inviolabilité n'est pas régie par l'article 68. Mais alors comment peut-elle être résolue ? La réponse se trouve, de manière diffuse dans d'autres dispositions de la Constitution et dans les principes de droit public qui leur sont sous-jacents. Autrement dit, cette règle de l'inviolabilité ne figure pas explicitement dans une disposition écrite de la Constitution de la Vème République, mais elle existe néanmoins en droit constitutionnel car elle découle inévitablement de règles écrites de cette Constitution et de principes constitutionnels qui structurent cette Constitution. Au risque de surprendre, une telle assertion nous paraît moins arbitraire que celle qui revient pour le juriste à jouer au ventriloque en faisant dire à cet article 68 ce qu'il ne peut pas signifier. Pour le démontrer, nous reconstruirons le raisonnement qui conduit à admettre une telle inviolabilité présidentielle et nous la justifierons, en outre, par le lien intrinsèque existant entre ce type d'immunité et la notion d'État.
A - L'INVIOLABILITÉ PRÉSIDENTIELLE, UNE IMMUNITÉ POLITIQUE ET CONSTITUTIONNELLE
Il faut, comme nous y invite Guy Carcassonne, penser la question de l'immunité présidentielle en se référant aux "schémas les plus classiques du droit constitutionnel", c'est-à-dire au modèle des immunités parlementaires 2 ( * ) . C'est ce que n'a d'ailleurs pas fait la Cour de cassation dans son arrêt du 10 octobre 2001, puisqu'elle omet l'article 26 parmi les dispositions de la Constitution qu'elle cite, (qu'elle "rapproche" de l'art. 68). En effet, le droit constitutionnel des immunités parlementaires est la clé qui permet de déchiffrer le droit des immunités politiques, et de fonder l'inviolabilité présidentielle. Il faut pour cela combiner le raisonnement par analogie avec le raisonnement à fortiori. Ce raisonnement, qui a été considéré par les partisans de la justiciabilité comme le "meilleur argument" 1 ( * ) de leurs adversaires, paraît difficilement réfutable.
Qu'est-ce qui fonde ici le raisonnement par analogie ? Tout simplement le fait que les parlementaires et le président sont deux types de gouvernants élus par le peuple. Dès lors, "le sort fait à tous les représentants du peuple est régi par des logiques impérieuses et identiques : par delà les différences de modalités, justifiées par les différences de fonction, les immunités protégeant le mandat parlementaire trouvent leur pendant dans les immunités protégeant le mandat présidentiel. Toutes, dès lors, peuvent s'adosser ainsi aux principes les mieux établis de notre droit public" 2 ( * ) . Ainsi, l'immunité, qu'elle soit parlementaire ou présidentielle, procède du statut d'élu du peuple et de la nécessité de protéger tout titulaire d'un mandat électoral, pendant la durée de son mandat contre des actions qui viendraient à remettre en cause ce mandat. En outre, ce raisonnement par analogie entre président et parlementaires est légitime au regard des précédents constitutionnels puisque la Commission d'instruction de la Haute Cour du 5 février 1993 (v. supra, § 2) a elle-même procédé par une analogie, mais cette foi entre parlementaires et ministre, pour répondre à la question de prescription des délits. Analogie qui a conduit Jean Pradel à observer que cet arrêt est "tout à fait fondé au regard du droit constitutionnel" 3 ( * ) . Quelle meilleure preuve - de droit positif (celui d'avant 1993) - pour démontrer que l'inviolabilité parlementaire est le modèle des immunités politiques ou des "garanties constitutionnelles" par rapport auquel s'ordonnent les autres types de protections politiques !
Ce raisonnement par analogie est d'autant plus convaincant qu'il est doublé et renforcé par un raisonnement à fortiori : la protection juridictionnelle qui est accordée aux parlementaires, même restreinte depuis la révision de 1995 (art. 26 C), vaut non seulement aussi pour les membres du Gouvernement mais à fortiori pour le chef de l'État. En effet, on voit mal comment à la lecture de la Constitution de 1958, on pourrait accorder une protection au président qui serait moindre que celle des membres du gouvernement. Ceux-ci demeurent protégés des poursuites ordinaires, même dans le cadre moins protecteur de la Cour de justice de la République (art. 68-1 relative à la Cour de justice de la République). Le code de procédure pénale enregistre, lui aussi, un certain type de protection en requérant l'autorisation du Conseil des ministres pour une éventuelle audition comme témoin des. ministres. Quant à la Constitution elle ne manque pas de dispositions qui impliquent la reconnaissance d'une "garantie constitutionnelle" au président si l'on veut qu'il soit l'organe politique qui, "par son arbitrage, assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics", tout en étant aussi "le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités (art. 5 Const). De même, son élection démocratique implique qu'il doit, d'abord et avant tout, rendre des comptes aux citoyens.
C'est probablement la raison pour laquelle la Cour de cassation a tenu à se référer avec insistance à l'article 3 de la Constitution relative à la souveraineté du peuple.
Mais ces considérations, qui semblent tirées seulement des dispositions écrites de la Constitution, sont en réalité, sous-tendues par deux principe non-écrits qui structurent la Constitution de 1958. Le premier de ces principes, c'est le principe démocratique. Une telle affirmation peut sembler paradoxale, tant on a entendu l'argument selon lequel la protection spéciale dont jouirait le président pour les actes qui sont dépourvus de tout lien avec sa fonction serait de nature monarchique (donc anti-démocratique) 1 ( * ) . Mais, d'une part, l'inviolabilité cesse avec la détention du mandat présidentiel, et n'a pas ce caractère viager propre à la monarchie. D'autre part, et surtout, l'inviolabilité protège le Président, c'est-à-dire la fonction présidentielle contre la fonction judiciaire. On s'accordera avec Guy Carcassonne pour s'inquiéter des conséquences qui adviendraient si l'on reconnaissait aux juges répressifs la faculté de juger pénalement le président en exercice pour des faits commis antérieurement à sa prise de fonctions. Ce serait alors confier un pouvoir excessif à la justice pénale, à laquelle on dénie toute légitimité pour prétendre "déstabiliser n'importe quel ministre" 2 ( * ) . Ainsi posé, le problème constitutionnel acquiert toute sa densité : le "cas Chirac" est une variation nouvelle sur un thème récurrent qui est le conflit opposant, depuis quelques années, les "pouvoirs politiques" au "pouvoir juridique" (Hauriou), c'est-à-dire les gouvernants aux juges judiciaires qui se sont, pour quelques-uns d'entre eux, auto-proclamés représentants de la société civile (des citoyens) et qui, au nom d'un droit pénal très élastique, entendent contrôler la vertu des gouvernants. En refusant qu'un juge d'instruction puisse entendre le président comme témoin (contre sa volonté) ou puisse le mettre en examen, la Cour de cassation a défendu la fonction présidentielle contre la fonction judiciaire en avançant un argument très classique en démocratie : la supériorité de légitimité d'une autorité élue sur une autorité non élue. Pour s'opposer à une telle conception, il faut être prêt à donner à la démocratie un tout autre sens, et estimer, par exemple, que les juges d'instruction français, non élus jusqu'à plus informé, sont des porte-parole légitimes du peuple français. Ce n'est pas la position ni d'une partie de la doctrine, ni visiblement de la Cour de cassation, et en tout cas, certainement pas la nôtre 3 ( * ) . Ainsi, c'est le principe démocratique, comme principe politique, qui prévaut ici sur le principe de l'État de droit selon lequel il faudrait une rigoureuse égalité des citoyens devant la loi. La démocratie, comme principe, élève le simple citoyen au rang de président, ce dont le droit constitutionnel doit rendre compte en lui conférant des prérogatives, voire des "privilèges". Mais, l'application du même principe démocratique peut ramener le même président au rang de simple citoyen lorsqu'il perd les élections, et le rendre alors justiciable comme les autres citoyens.
À ce principe démocratique, il faut ajouter comme autre principe structurant le principe de continuité de l'État. C'est à ce principe auquel songeait le conseiller-rapporteur Roman, lorsque, s'appuyant sur l'opinion d'une partie de la doctrine, il faisait observer : "il est raisonnable que le Président de la République soit à l'abri de poursuives intempestives qui empêcheraient l'exercice normal de son mandat, et notamment des pouvoirs que lui confère l'article 5 de la Constitution (..). Il semble même permis d'affirmer que c'est indispensable : imaginerait-on que, dans une situation de crise grave, le chef de l'État doive se soumettre à un mandat d'amener décerné par un juge d'instruction ?" 1 ( * ) Dans cette affirmation, on entendrait presque l'écho de cette remarque du juriste italien Orlando s'étonnant qu'on puisse envisager que le président de la IIIème République reçoive les ambassadeurs à la prison de la Santé. De ce point de vue, l'inviolabilité présidentielle est une technique juridique destinée à assurer l'autonomie de la Présidence (et non de l'homme qui occupe cette fonction) par rapport aux autres pouvoirs. C'est une garantie particulière censée protéger un représentant de l'État contre l'action d'un autre représentant de l'État. Bien que cet argument de la continuité de l'État ne figure pas dans la décision de la Cour de cassation, il est décisif à ses yeux. Par là se marque une différence très nette avec l'arrêt Clinton v. Jones de la Cour suprême où la majorité des juges avait affirmé, sans sourciller, que le procès civil intenté contre le président en activité ne perturbait pas le fonctionnement de l'État 2 ( * ) .
À cette argumentation, on peut néanmoins répliquer par le fait que la Cour de cassation a soigneusement évité de s'appuyer sur les principes constitutionnels pour, au contraire, s'accrocher comme à une bouée, à l'article 68 duquel elle a "rapproché" d'autres dispositions de la Constitution. Mais, cette démarche du juge peut ne pas emporter la conviction du constitutionnaliste. En réalité, seules les autres dispositions qu'on a associées à l'article 68 étaient - avec l'article 26 - juridiquement relevantes pour éclairer le cas d'espèce. Mais, surtout la Cour de cassation raisonne dans le droit fil de la jurisprudence judiciaire qui a érigé au rang de dogme méthodologique la référence aux textes. C'est à cette tradition à laquelle se réfère très explicitement le conseiller-rapporteur Roman lorsqu'il a écarté l'application du principe de séparation des pouvoirs parce que "les juridictions de l'ordre judiciaire, obligées de motiver leurs décisions par référence directe aux textes, n'usent qu'avec précaution" 3 ( * ) 8 des principes constitutionnels. On sait que cette contrainte de se référer aux textes conduit la Haute Assemblée à préférer l'exception d'inconventionnalité à l'exception d'inconstitutionnalité au motif qu'il serait plus sûr de se référer à des textes supra-nationaux (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, traités) qu'à des principes constitutionnels 1 ( * ) . Mais, le constitutionnaliste n'est pas obligé de raisonner comme la Cour de cassation, ni même d'ailleurs comme le Conseil constitutionnel. Il peut, et même il doit, derrière les dispositions constitutionnelles voir les "principes" s'il ne veut pas "être un juriste, exégétique, formaliste, étriqué dans le commentaire des articles" 2 ( * ) . En l'occurrence, la référence aux principes constitutionnels permet de fonder solidement le raisonnement analogique et à fortiori qui conduit à inférer de l'existence d'immunités (ou de protections) parlementaires et ministérielles, celle d'une forme d'immunité présidentielle : son inviolabilité. En admettant que la résolution de ce cas juridique n'est pas donnée par le texte de la Constitution de 1958, on présuppose que la Constitution et le texte constitutionnel ne sont pas nécessairement identiques. D'autres constitutionnalistes l'ont expliqué depuis longtemps. Et à ceux qui émettraient des réserves d'ordre politique (libéral) sur une telle façon de procéder, il suffit de les renvoyer à la lecture de la décision de la Cour suprême Clinton v . Jones, dans laquelle la Cour ne mentionne nulle part la disposition de la Constitution relative à l'impeachment (Art. 11, Sect. IV), et examine la question de l'immunité civile du président des États-Unis uniquement en fonction d'une interprétation du "principe" de la séparation des pouvoirs.
B - LE DROIT DES IMMUNITÉS : EXCEPTION OU DROIT COMMUN ?
Dans cette querelle sur la responsabilité pénale du Président de la République, la doctrine constitutionnelle a, dans sa majorité, préféré utiliser le terme d'immunité plutôt que ceux d'irresponsabilité et d'inviolabilité. À la différence de la doctrine internationaliste 3 ( * ) , elle s'est peu intéressée à la dogmatique juridique de l'immunité. Lorsqu'elle s'y est essayé, elle a délaissé l'acception historique du mot d'immunité qui désignait "une exemption de charge" (du latin immunitas ),et qui prit à Rome la forme d'une exemption fiscale et, au Moyen Age, de "l'ensemble des libertés de l'Église" vis-à-vis de l'État 4 ( * ) . Elle l'a définie comme étant une exception au droit commun, en reprenant ainsi la définition du Grand Larousse Encyclopédique : "le droit de bénéficier d'une dérogation à la loi commune" 5 ( * ) . Cette définition se rapproche de la conception pénaliste d'après laquelle, étant une exception par rapport au principe d'égalité devant la loi pénale, l'immunité, ne se présume pas en droit pénal et ne s'applique donc pas, sauf texte exprès 6 ( * ) , ce qui implique "une interprétation pénale restrictive plutôt qu'extensive." 1 ( * ) On comprend alors qu'un tel raisonnement conduit à dénier toute immunité au Président de la République dans le cadre d'actes commis en-dehors de ses fonctions : l'article 68 n'ayant pas statué expressément sur cette question, la présomption joue en faveur de l'absence d'immunité. La question se pose cependant de savoir si ce raisonnement pénaliste, qui a d'ailleurs toute sa valeur dans l'orbite du droit pénal, doit valoir dans le domaine du droit constitutionnel. Nous ne le pensons pas 2 ( * ) 116.
En effet, cette conception qui présente l'immunité comme le résultat d'une dérogation au droit commun n'est pas satisfaisante pour plusieurs raisons. D'abord, en raison de son caractère vague, elle ne permet pas de distinguer juridiquement l'immunité de la grâce ou de l'amnistie qui sont des institutions résultant, elles aussi, d'une dérogation. Ensuite, une telle attitude postule une unicité de la notion d'immunité qui n'existe pas, car sa signification est diffractée selon, les secteurs juridiques où elle opère. Par exemple, on n'analyse pas juridiquement de la même manière les immunités parlementaires selon qu'on les observe du point de vue du droit constitutionnel ou du droit pénal 3 ( * ) . Enfin et surtout, la réduction du problème de l'immunité à celui d'une "exception" au droit commun" - c'est-à-dire en clair au principe d'égalité devant la loi pénale - prédétermine la solution juridique vers laquelle on tend. C'est ainsi que procède Bruno Genevois lorsqu'il expose le problème juridique soulevé par l'immunité présidentielle dans les termes suivants "La question essentielle, écrit-il, est de savoir si le particularisme, inhérent au régime des immunités et la part de dérogation aux règles de droit commun qu'il comporte, conserve des justifications suffisamment solides." 4 ( * ) Un tel point de départ accule évidemment les partisans de l'immunité à la défensive puisqu'il leur incombe la charge de la preuve.
Mais justement, une telle conception introduit à la grande question qui est posée par les immunités politiques, et pas seulement par l'inviolabilité présidentielle : celle de savoir si ces immunités doivent être interprétées systématiquement comme des exceptions au droit commun, ou bien si au contraire, loin de les percevoir comme une sorte de jus singulare, il ne faudrait pas les considérer comme relevant d'un jus commune, celui du droit constitutionnel, considéré comme le droit des rapports entre gouvernants et gouvernés 5 ( * ) . Or, il est clair que les partisans de la justiciabilité du président ont opté pour la première conception, soit parce qu'ils estiment qu'une telle interprétation découle du fait qu'il s'agit d'une immunité pénale - ce qui est réducteur -, soit parce qu'ils fondent cette nature "exceptionnelle" de l'immunité présidentielle sur le principe d'égalité devant la loi (pénale) qui serait consubstantielle à l'idée d'État de droit. Ayant déjà contesté un tel raisonnement pour ce qui concerne la responsabilité pénale des membres du gouvernement, on se contentera ici d'ajouter deux éléments à l'argumentation antérieure. Le premier est tiré de l'étude précitée d'Orlando soutenant la thèse que les immunités politiques, sont en droit public, du jus commune. Il y polémiquait avec Léon Duguit, s'étonnant qu'un juriste aussi éminent puisse soutenir "qu'un ordre démocratique devrait admettre qu'un quelconque juge d'instruction ait la faculté d'arrêter et d'emprisonner le chef de l'État !" 2 ( * ) - ce qui confirme l'opposition entre le point de vue de "l'État de droit" et le point de vue de "l'État". D'autre part, le droit international public renforce cette même thèse car les immunités y apparaissent comme un principe autonome 3 ( * ) 122, ainsi que l'atteste Georges Scelle, pourtant peu suspect de tolérance à l'égard des gouvernants, en les qualifiant de " garanties internationales" 4 ( * ) . Elles sont, non pas un quelconque droit subjectif des gouvernants, mais le produit d'un droit objectif, du droit international public.
Si, dans ce débat relatif à la responsabilité pénale du Président de la République, la doctrine constitutionnelle française n'a pas soulevé la question de la nature juridique des immunités politique -jus singulare/jus commune -, c'est à notre avis parce qu'elle a déconnecté le droit constitutionnel de la théorie de l'État. Ce que ne faisait pas la doctrine constitutionnelle classique et ce que ne fait pas toujours pas - mais pour combien de temps encore ? - la doctrine internationaliste. La première soutenait l'idée de l'inviolabilité du Président de la République au motif qu'elle était "une qualité inséparable de l'organe souverain" redevable "d'un droit commun, et non d'un droit d'exception" 5 ( * ) . Ainsi, c'est la nature des organes d'État qui déterminait, en dernière instance, le statut juridique des immunités politiques à la question plus générale. Quant à la doctrine internationaliste, elle continue à expliquer que les immunités accordées aux agents étatiques se justifient par la nécessité de protéger l'État, c'est-à-dire de protéger les agents de l'État étranger d'initiatives de l'État d'accueil agissant par voie judiciaire. "Même s'ils sont personnels, quant à leur assiette, - note J. Combacau - les privilèges qui leur sont accordés sont fonctionnels, quant à leur motif, c'est-à-dire déterminés par la fonction des bénéficiaires ; par delà les individus, c'est toujours l'État qu'ils protègent, et leurs exigences se mesurent à celle de la souveraineté du sujet international duquel ils dépendent." 1 ( * ) . L'immunité est alors une "inviolabilité personnelle et réelle" 2 ( * ) .
Les implications de cette conception se laissent aisément percevoir. La distinction, entre la fonction et la personne à propos de l'inviolabilité présidentielle qui a été constamment avancée pour fonder la thèse de la justiciabilité du Président de la République 3 ( * ) , s'avère intenable dans la pratique, comme nous l'enseigne le droit international. En outre, et surtout, l'inviolabilité présidentielle obéit à la même logique institutionnelle que l'ensemble des immunités : ce sont des "privilèges (qui) ont en commun de n'être pas érigés au bénéfice de la personne, mais d'assurer la protection de la fonction ou de la mission." 4 ( * ) Il pourrait paraître choquant à beaucoup d'esprits que, dans ce cas concret, l'inviolabilité serve moins à protéger la fonction présidentielle contre l'activité de la justice pénale qui pourrait entraver son action, qu'à conférer de facto, l'impunité à un homme, le président en charge de la fonction. Mais, le juriste ne pourra manquer d'observer que l'enjeu de ce "casus" juridique dépasse une personne singulière, et embrasse ici une institution : la Présidence de la République, et la relation étroite qu'elle entretient avec la conduite de l'État. L'inviolabilité protège ici l'institution présidentielle, et non pas le président Chirac ; et ceux qui aujourd'hui clament contre "l'intouchable", seront peut-être les premiers à invoquer l'inviolabilité, lorsque "l'intouchable", ne sera plus la même personne. Cette incapacité à réfléchir à la distance qui sépare un individu et les fonctions qu'ils occupent c'est-à-dire celle qui sépare la personne de la fonction, témoigne de ce que l'opinion publique n'a pas toujours le sens des institutions. Mais le rôle de la doctrine n'est-il pas, aussi, celui de former cette opinion publique aux subtilités de l'art juridique et à son utilité sociale ?
En creusant certains problèmes impliqués par le débat constitutionnel sur la responsabilité pénale du Président de la République, on aura compris que la reconnaissance au président d'une inviolabilité est liée à son statut de représentant de l'État. L'opposition entre les partisans des immunités politiques et leurs adversaires recoupe une vieille opposition entre les partisans de la souveraineté et ses adversaires, et en fin de compte, entre deux conceptions différentes du droit constitutionnel : d'un côté, un droit constitutionnel "étatiste", et celle d'un droit constitutionnel "libéral" fondé sur la défense inconditionnelle de l'État de droit. Au regard de la première conception et même qu'au regard d'une théorie de l'État démocratique, il est tout à fait fondé de penser que la Constitution de la Vème République contient la règle de l'inviolabilité présidentielle. La seconde conception estime le contraire en faisant prévaloir sur toute autre considération le principe d'égalité devant la loi. Mais, pour finir, cette doctrine qui invoque l'État de droit 1 ( * ) pour s'opposer à cette inviolabilité paraît bien mal armée pour répondre à l'objection suivante : "La dialectique du droit et de la puissance, non plus que du droit et de l'État ne sont pas réfléchies dans le concept de l'État de droit. Si l'on prend l'État de droit non pas (seulement) comme une partie, mais bien pour le tout de l'ordre étatique ; il naît une pensée "introvertie" de l'État de droit, qui laisse de côté les conditions de possibilité de ce même État de droit." 2 ( * ) . Le lecteur aura compris qu'au regard d'une certaine conception du droit constitutionnel, l'arrêt de la Cour de cassation n'est, somme toute, pas si mal venu.
Monsieur Pierre DELVOLVE
Cher collègue, votre exposé a comporté beaucoup de choses dont je voudrais retenir quelques passages, simplement.
Vous avez d'abord dit que les professeurs n'avaient pas le temps de travailler, vous venez de faire la preuve contraire.
Vous avez ensuite dit que les précédents auxquels on peut se référer sont des précédents explosifs. Je crois que votre exposé lui même est explosif, corrosif.
Vous avez ensuite dit que les administrativistes étaient trop au coeur de l'analyse constitutionnelle et que l'on avait transposé de manière indue les analyses du droit administratif dans le droit constitutionnel et dans la jurisprudence constitutionnelle. J'ai souvenir, au lendemain de la décision fameuse du 23 janvier 1987 d'une conversation d'ailleurs dans les salons de ce monument, le Sénat, où le président JEANNEAU commentant dans des propos familiers cette décision, disait : mais cette décision, ce ne sont plus les sources constitutionnelles du droit administratif, ce sont les sources administratives du droit constitutionnel. Et l'on pourrait continuer dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel à trouver des illustrations de l'utilisation des méthodes du droit administratif, de concepts du droit administratif. Le Doyen VEDEL a écrit des choses à ce sujet : l'erreur manifeste d'appréciation, la proportionnalité. Il me semble que ce sont des notions que l'on connaît en droit administratif et que la jurisprudence constitutionnelle a reprise.
Et vous avez repris vous même dans votre analyse, pour terminer, des éléments du droit administratif, mais qui sont à la charnière du droit constitutionnel : le principe de continuité de l'État, le principe de continuité des services publics, et je citerai un arrêt fameux à bien des titres, et qui m'est cher, Syndicat régional des quotidiens d'Algérie, qui justifie les pouvoirs d'un Gouvernement démissionnaire par le principe de continuité de l'État. Vous n'avez pas fait autre chose dans votre conclusion que de vous référer au principe de continuité de l'État. Y-a-t-il là un dilemme, y-a-t-il là une contradiction ? Si oui, nous sommes au coeur des propos de ce matin : les dilemmes de la responsabilité.
Il revient maintenant à Madame ROUYERE de nous parler de « Responsabilité et principe de précaution ».
Responsabilité et principe de précaution
par Madame Aude ROUYÈRE,
professeur à l'Université Bordeaux 4
Renouant au présent le proche au non visible
Je sais la terre aveuglément silencieuse
En son tumulte outrepassé.
Combien peu discernable
Est ce qui germe au loin derrière la clarté,
Rosace noire de l'errance !
Pierre TORREILLES - Territoire du prédateur 1 ( * )
Se protéger de l'inconnu sans motif connu ou reconnu. Agir ou ne pas agir selon les interrogations, énigmes, silences, délivrés par l'état des sciences et des techniques. Voilà la singulière attitude à laquelle nous convie le principe de précaution. Singulière pour tout un chacun, en ce que, même sans inclination pour la mise en danger de soi, le risque fait partie de l'existence. Singulière pour l'analyse juridique, en ce que le droit est une entreprise de formalisation du réel en catégories auxquelles on fait produire des conséquences connues et prévisibles à partir d'un raisonnement construit, non pas sur des probabilités d'hypothèses 2 ( * ) mais, au minimum, sur des hypothèses tenues 3 ( * ) pour acquises.
Il faut pourtant bien en convenir, le thème de la précaution émaille le discours juridique 4 ( * ) , ouvrant ainsi les perspectives d'un renouvellement des critères de la décision. La signification de la règle de précaution n'est pas arrêtée, ni même élucidée. La doctrine 1 ( * ) , les juges 2 ( * ) , les acteurs institutionnels eux-mêmes 3 ( * ) ont abondamment investi cette question sans en extraire une norme de comportement claire. La précaution imposerait une attitude face à l'incertain plus qu'une action déterminée. La prescription reste indécise et vertigineuse. On se bornera à rappeler que selon les termes de la loi du 2 février 1995, le principe de précaution est celui selon lequel "... l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ". Cet énoncé ouvre un spectre d'acceptions selon une gradation allant de la précaution intégrale, en vertu de laquelle l'absence de certitudes sur l'innocuité justifie l'adoption de mesures pouvant prendre la forme du moratoire, jusqu'à la précaution édulcorée -ou prévention renforcée-visant les cas d'absence de certitudes sur un risque concevable et consistant en une protection adaptée à celui-ci 1 ( * ) .
La précaution est-elle une nouvelle norme en droit de la responsabilité publique 2 ( * ) ? Notre réponse sera équivoque, spéculative, évidemment non définitive... La "prudence" qui sied à la réflexion, en droit et sur le droit, devient ici garde-fou, tant les potentialités normatives de la règle sont variées, tant les juges sont embarrassés et peu loquaces, tant les attentes sociales sont affirmées et peu préparées aux rudes conséquences de cette exigence 3 ( * ) .
Commençons par un retour aux fondements éthiques du principe de responsabilité. Celui-ci repose sur un pôle juridique institutionnel et sur un pôle subjectif intériorisé lié à un ordre moral 4 ( * ) . Les repères matériels et temporels ne sont pas identiques de telle sorte que chaque pôle forme une référence propre.
La responsabilité juridique circonscrit la question de la responsabilité dans un cadre fini destiné à vider le conflit. Elle ne peut -et ne prétend pas- épuiser la responsabilité subjective qui, elle, s'étire sur des normes non juridicisées. Or, cet espace non approprié par l'ordre du droit alimente inquiétude et frustration. L'avancée du droit est souhaitée comme un supplément d'âme dans un système de valeur dominé par l'impératif utilitaire. Il est invité à reconnaître et à traiter cette incertitude et ces errements dans l'action qui troublent les consciences sans y trouver un statut axiologique clair. Qu'il les capture et les enferme dans les cases du discours juridique et surviendra alors l'illusion de leur maîtrise. La promotion d'une norme juridique de précaution porte en elle ce projet d'élargissement de la responsabilité juridique. Car, tôt ou tard, le seul affichage du principe sera impuissant à absorber l'angoisse qu'engendre l'emballement de la science et des technologies 1 ( * ) .
Il n'est donc pas excessif d'évoquer l'idée d'une tension exercée sur la responsabilité juridique par l'émergence de la règle de précaution. Mais ce phénomène ne se manifeste pas directement. En effet, il nous semble que la responsabilité juridique offre une résistance conceptuelle à l'accueil d'une norme de précaution. Il apparaît, en même temps, que les éléments de ce mécanisme travaillent pour accorder à l'incertitude un rôle moteur. L'éthique de précaution, en voie de juridicisation, imprime sa portée sur le droit en pesant sur le maniement de ses catégories constitutives. En d'autres termes, la précaution ne joue pas (encore ?) en droit de la responsabilité 2 ( * ) mais fait jouer les articulations du raisonnement juridique qui l'anime.
I- UNE RÉSISTANCE CONCEPTUELLE À L'ACCUEIL D'UNE NORME DE PRÉCAUTION
À priori, et comme cela a été fortement soutenu par une partie de la doctrine 3 ( * ) , la règle de précaution appelle, en tant que prescription de comportement, une responsabilité pour faute. Dans le cadre de cette supposition 4 ( * ) , la voie de l'indemnisation se révèle semée d'embûches. D'une part, parce que pour fixer la consistance d'une faute de défaut de précaution, il faudrait disposer de quelques repères quant à sa signification positive. D'autre part, parce que la teneur de cette faute ne peut être déterminée sans tenir compte des caractéristiques des décideurs susceptibles de subir son imputation. Or l'identification de ces derniers fait débat. Faut-il partir d'une définition de l'exigence de précaution et tracer en fonction d'elle le cercle des acteurs visés, ou bien évaluer l'exigence de précaution en fonction de la qualité de ceux qui, d'emblée, sont considérés comme destinataires de la norme. Irrésolues et porteuses de dilemmes, ces questions révèlent la difficulté à intégrer la norme de précaution dans la configuration de la responsabilité juridique.
A - L'INSAISISSABLE FAUTE DE DÉFAUT DE PRÉCAUTION
La sanction juridique d'une obligation de précaution formalisée en un encadrement des comportements est simple. La norme de précaution assimilée et retranscrite par des procédures placées en amont de l'action, offre une lisibilité totale au juge 1 ( * ) . Les décisions sont soumises à des contraintes donnant place au temps, à l'expertise, parfois à l'opinion dissidente. Le contrôle s'opère de façon mécanique, essentiellement dans le cadre de la légalité externe et du contentieux de la réparation lié à une illégalité. C'est en ce sens, mais en celui-ci seulement, que l'émergence du principe de précaution peut impliquer une extension de la responsabilité pour faute. Cette hypothèse ne présente pas de difficulté particulière et donc pas d'intérêt pour notre réflexion.
Il n'en est pas de même s'il s'agit de concevoir la teneur et les contours de l'exigence de précaution hors du sentier balisé des règles de forme et de procédure. L'exercice, périlleux, impose au juge de cerner les critères de ce manquement parmi les controverses dont procède la demande de précaution. La faute de défaut de précaution demeure insaisissable mais tend à hanter, en trompe l'oeil, les raisonnements juridictionnels.
- Le paradoxe qui affecte l'exercice du contrôle de légalité en contexte de précaution livre une première illustration des difficultés que le juge doit affronter. L'incertitude a la propriété de limiter le contrôle du juge administratif, par nécessité et conformément à la politique qu'il a fixé en présence de considérations techniques 2 ( * ) . Mais ce contrôle, limité aux erreurs grossières de qualification juridique, trahit la norme qui ne peut être approchée qu'au prix d'un effort d'approfondissement visant à traquer des erreurs échappant à l'évidence 3 ( * ) . L'établissement -de la faute de défaut de précaution obéit aux mêmes contraintes. Il faut identifier le manquement à l'obligation de précaution, c'est à dire à une manière d'appréhender l'incertitude, à une posture intellectuelle plutôt qu'à une obligation de faire. L'erreur de départ pourrait tenir au fait, en situation de risque, de ne pas valider provisoirement une hypothèse non infirmée même si elle n'est pas démontrée 4 ( * ) . On pourrait même la relever lorsque la situation de risque n'est pas posée. De là, se déploie une palette de mesures de protection dont le contenu ne peut être fixé qu'au cas par cas. L'établissement final de la faute porte sur le comportement adopté dans sa totalité, de l'analyse des données au choix de la mesure s'il y a lieu.
La période de référence conditionne fortement l'établissement du manquement à l'obligation de précaution. En principe il s'agit du moment de l'action, de telle sorte que seules les connaissances acquises à cet instant sont susceptibles de servir de base à la recherche de la faute. Cette démarche impose une acrobatie intellectuelle consistant à faire totalement abstraction, au moment du jugement, de ce que l'on a appris, le plus souvent par la survenance brutale du dommage, et ce, afin d'éviter toute rétroactivité du raisonnement de causalité 1 ( * ) . Le niveau des connaissances prises en référence de l'action est aussi un facteur central du jugement. Ayant eu à préciser, dans le cadre du risque de développement, la notion de connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation d'un produit 2 ( * ) , la Cour de justice des communautés européennes souligne qu'il ne s'agit pas de l'état des connaissances dont le producteur était ou pouvait être concrètement ou subjectivement informé, mais de l'état objectif des connaissances scientifiques et techniques pertinentes dont le producteur est présumé être informé, dans la mesure où ces connaissances étaient accessibles au moment de la mise en circulation du produit 3 ( * ) . On peut imaginer de retenir cette approche objective pour apprécier un comportement en termes de précaution 4 ( * ) . Mais il reste alors à déterminer le critère de pertinence des informations diffusées et plus encore, en matière de précaution, de l'absence d'information ou des incertitudes révélées, en négatif, par ce savoir "officiel" 5 ( * ) . La position du défendeur, demeure en tout état de cause, singulièrement inconfortable. Car, face à un dommage réalisé, la démonstration qu'il était légitime de ne pas soupçonner le risque ou de ne pas le percevoir suffisamment pour adopter un comportement de précaution est quasiment vouée à l'échec. Et même si la charge de la preuve pèse sur le demandeur, il lui sera toujours moins difficile de jouer sur l'évaluation du savoir à la lumière de ce qui est acquis depuis le moment de l'action pour fonder sa demande. Enfin, le contexte d'incertitude dont procède l'exigence de précaution affecte le rapport coût/ bénéfice de l'action. Sur ce point, la loi de 1995 sur le renforcement de la protection de l'environnement a choisi le parti de la prudence en visant "un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable" 1 ( * ) .
- Quelques solutions jurisprudentielles, pourraient, par un effet de trompe l'oeil, donner l'impression d'avoir surmonté ces écueils.
La plus connue et la plus emblématique de celles-ci est la décision du Conseil d'État du 9 avril 1993 2 ( * ) , mettant en cause la responsabilité de l'État en matière de police sanitaire dans l'affaire du sang contaminé. L'illusion d'une responsabilité de l'État pour défaut de précaution a été entretenue par les remarquables conclusions du commissaire du Gouvernement H. LEGAL renfermant notamment cette idée, précédemment évoquée, qu'"... en situation de risque une hypothèse non infirmée devrait être tenue, provisoirement, pour valide, même si elle n'est pas formellement démontrée". Mais, en réalité, le Conseil d'État n'a pas tiré les conséquences de ce précepte du point de vue de la détermination du point de départ de la période fautive, la date retenue étant nettement postérieure à la période d'établissement du risque de contamination. La faute sanctionnée est alors plus proche d'un défaut de prévention que d'une authentique précaution. Une telle réserve s'explique, peut-être, par le refus d'imposer rétroactivement à l'État de nouvelles normes de comportements en matière de police sanitaire, et par le souci conjoint d'indiquer par les motifs de la décision et les conclusions de H. LEGAL ce qu'elles devront être à l'avenir 3 ( * ) . Elles restent d'ailleurs mystérieuses, la décision ne livrant pas de mode d'emploi, et en particulier pas le seuil d'indices à partir duquel l'État était tenu d'agir en précaution, ni les modalités de cette politique.
Un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 18 octobre 2001 fait naître la même question dans le cadre du contentieux de l'amiante. La Cour confirme le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mai 2000 déclarant l'État responsable du fait d'un décès en rapport avec une affection liée à l'inhalation de fibres d'amiante durant une période allant de 1957 à 1973, c'est à dire quatre ans avant le décret du 17 août 1977, premier texte limitant la concentration moyenne en amiante que pouvait inhaler chaque jour un ouvrier. La Cour constate que le risque lié à l'inhalation de fibres d'amiante a été mis en évidence en 1906 et précisé en 1930, et que le caractère cancérigène de ce matériau a été établi en Angleterre dès le milieu des années cinquante. La Cour en déduit que, dès cette époque, les pouvoirs publics ne pouvaient plus ignorer ces risques, et en conclut que "la responsabilité de l'État pouvait être engagée du fait de ses carences dans la prévention des risques liés à l'exposition professionnelle aux poussières d'amiante". 1 ( * ) Si elle est satisfaisante pour les requérants, cette solution ne consacre d'obligation, au vu des dates retenues, que face à un risque avéré 2 ( * ) . L'affirmation de la Cour semble même retenir la responsabilité de l'État du fait de ces acquis, ce qui, à contrario, pourrait l'exclure en cas de doute.
Un autre jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mai 2000 portant aussi sur le contentieux des dommages liés à l'amiante apporte un élément supplémentaire de réflexion 3 ( * ) . Est en cause dans ces affaires le temps pris par l'État pour transposer deux directives fixant des normes plus strictes de concentration moyenne en amiante inhalable, et ce, alors même que la transposition est intervenue avant expiration du délai officiel. Le tribunal juge que "eu égard à l'existence des directives, il ne peut être soutenu (...) que les pouvoirs publics français n'avaient pas connaissance du risque que faisait courir aux personnes exposées le maintien de la réglementation en vigueur " et qu'il en résulte que "... le retard mis par l'État pour adapter la réglementation de protection des salariés aux risques encourus est fautif et de nature à engager sa responsabilité". Ce jugement a été perçu comme appliquant l'idée que "l'adoption de directives communautaires ne permet plus à l'État d'invoquer l'incertitude scientifique pour justifier une méconnaissance du principe de précaution" 4 ( * ) . La déduction nous paraît contestable parce que l'incertitude ne dispense pas du comportement de précaution mais en est, au contraire, l'indication, et parce qu'en l'espèce, l'obligation résulte d'une information acquise comme certaine et imposant à ce titre une simple prévention. Mais on comprend toutefois l'effet que peut produire un tel raisonnement du juge en ce qu'il revient à dire que l'hypothèse acquise du risque, ici par une nouvelle directive fixant des normes sanitaires plus sévères, ne laisse plus de champ même temporel au doute. Et cette solution est d'autant plus intéressante qu'elle vise la révélation d'une information nouvelle et donc renvoie à cette notion délicate de connaissances scientifiques et techniques servant de référence au critère de l'action et donc du comportement fautif.
B - LA DÉTERMINATION CONTROVERSÉE DES DESTINATAIRES DE LA NORME DE PRÉCAUTION
La question procède de la dimension politique du principe. Elle a nourri les débats les plus virulents, faute de consensus sur l'ampleur du bouleversement que doit provoquer, via le droit, cette éthique de la décision. La controverse s'est enflée de toutes sortes d'arguments tirés de la lettre ou de l'esprit des textes, de la nécessité ou du réalisme. Elle suit son cours 1 ( * ) ... tandis que le principe de précaution initie des attentes nouvelles ou formalise des exigences déjà intégrées dans les comportements, indépendamment du caractère étatique de l'action qui est en cause.
- Incontestablement, les textes qui énoncent la règle de précaution lui réservent un sort ambigu : au plus cantonné à la décision publique, au moins limité à l'inspiration d'une politique de gestion des risques. Mais ce carcan ne permet pas de préjuger la teneur de la norme qui en est extraite. Il est toujours loisible au juge, au gré d'une référence formelle ou implicite à la précaution, d'étendre les filets de la prescription. L'hypothèse d'une soumission des décideurs privés (ou publics dans le cadre d'activités de prestations industrielles ou commerciales) à l'exigence de précaution n'est ainsi pas dépourvue de pertinence.
Le champ d'application du principe de précaution semble être délimité par la portée juridique qui lui a été initialement attribuée 2 ( * ) . La manière dont la loi du 2 février 1995 le met en scène 3 ( * ) contribue à lui dénier toute applicabilité directe et à le ravaler au rang de principe d'inspiration du législateur dans le domaine de l'environnement Cette formulation n'a pas été un obstacle à la reconnaissance de l'invocabilité directe de la règle contre des décisions administratives 4 ( * ) , mais elle cautionnerait l'idée que seul l'État 5 ( * ) pourrait être débiteur de cette exigence 6 ( * ) . En prolongement de ces analyses, l'extension de la norme de précaution à l'action privée est perçue comme non opportune car susceptible de dénaturer la responsabilité civile en créant un quasi droit à réparation au profit de la victime 7 ( * ) .
Contre cette lecture littérale des textes, se développe un argumentaire construit sur le constat, réaliste, que le sort d'une règle ne lie pas le destin de la norme qu'elle renferme. La lettre des textes n'est pas un rempart contre une extension de celle-ci à des destinataires non visés. Tout est affaire de volonté de la part des autorités habilitées à sanctionner l'application de la règle, et il n'est pas exclu que celle-ci ne manque pas du côté des juges. Le rapport Kourilski-Viney se place sur un plan de politique jurisprudentielle et défend résolument un élargissement du cercle des décideurs visés par la norme de précaution. L'approche se veut pragmatique et cerne donc le champ de l'exigence en fonction de ses hypothèses d'application : "toute personne qui a le pouvoir de déclencher ou d'arrêter une activité susceptible de présenter un risque pour autrui " est visée 1 ( * ) . De même, dans sa communication sur le recours au principe de précaution 2 ( * ) , la Commission des Communautés Européennes constate l'extension du champ d'application du principe de précaution au delà du strict domaine de l'environnement 3 ( * ) .
Certes, on peut s'émouvoir de ce qu'une telle exigence soit ainsi diffusée comme critère de l'action : O. GODARD affirme ainsi qu'il est difficile pour le non-juriste, tel qu'il se définit, "de comprendre que le juge puisse s'opposer formellement aux dispositions explicitement inscrites dans un texte de loi sans que cela résulte de l'application d'une norme de droit supérieure " 4 ( * ) . Mais, il suffit d'examiner les apports de la réflexion théorique à l'analyse de l'acte d'interprétation et de les croiser avec l'étude du droit positif dans quelque domaine que ce soit, pour en vérifier la solidité. Il est d'ailleurs d'ores et déjà acquis que le juge peut contraindre à la précaution sans manier la règle, de même qu'il évoque la précaution pour imposer une simple prévention. Par une lecture fonctionnelle du principe, le cercle des destinataires s'élargit et place le contentieux de la réparation sur le terrain du droit privé. Ainsi, malgré la réserve du législateur et les doutes quant à la portée du principe, l'exigence de précaution imprègne les esprits et affecte ouvertement ou de manière plus insidieuse les repères de l'action 5 ( * ) .
- La controverse gagne à être abordée à partir d'une réflexion plus concrète sur la capacité des acteurs étatiques à exercer leur pouvoir de précaution. Car le vrai défi que pose le principe de précaution -et auquel n'échappe pas la norme qu'on lui fait produire- est l'identification, parmi les différents protagonistes d'une activité ou d'une innovation comportant une hypothèse de risque, de ceux qui sont les plus aptes à répondre à cette exigence.
Or, il faut bien admettre que savoir et pouvoir ne sont pas nécessairement coordonnés. Le détenteur du savoir qui fonde le comportement de précaution n'a pas toujours vocation à cette démarche et l'État, qui en a la compétence, n'en détient pas forcément les moyens. La décision étatique, qu'elle soit législative ou réglementaire, dispose d'une force de frappe ambivalente. Dotée d'une autorité et d'une capacité d'harmonisation indéniables, elle est subordonnée à l'acquisition de l'information puis à un processus d'adoption lourd et jalonné d'arbitrages. Dans ces conditions, l'action, si elle survient, a toutes chances d'être édulcorée et tardive donc située dans un contexte qui n'est plus de précaution du fait de la confirmation ou de l'infirmation de l'hypothèse de risque pressentie. De son côté, la décision émanant de celui qui conduit l'action a l'avantage de pouvoir être ciblée, donc plus rapide, plus adaptée et au total plus efficiente 1 ( * ) . Mais, pour être concevable, elle doit croiser ou au moins ne pas compromettre radicalement l'innovation, la production et dans une mesure variable la rationalité économique de l'arbitrage effectué. Il serait absurde de demander aux industriels et même aux scientifiques de s'ériger en pures autorités de police.
Au vu de ces contraintes, il est vrai qu'une répartition stricte des rôles permet de contenir le potentiel de "désordre" initié par le principe de précaution 2 ( * ) . C'est à l'État d'assumer la politique de précaution, c'est à lui de définir les seuils et le contenu de la précaution 3 ( * ) , les acteurs privés étant simplement tenus de respecter et mettre en oeuvre ces règles. Mais ce partage des tâches, clair et rassurant pour le secteur privé, ne résiste pas à l'épreuve des faits en matière de perception des risques inédits. La précaution se joue face à une information précoce, souvent encore à peine formée, simple hypothèse ou même seulement intuition. Et si les scientifiques, les industriels, les médecins n'ont pas les armes d'une politique de précaution, ils ont le privilège du savoir et donc du doute. C'est entre leur mains que se loge la capacité de réaction et d'anticipation, le reste n'étant que la reprise de cet acquis. Il faut donc imaginer de faire peser la norme de précaution sur les décideurs possédant le savoir le plus affûté et le plus actualisé sans attendre que l'État ait réagi. Sauf à rejeter le bouleversement induit par la précaution- la légitimité de ce refus restant par ailleurs à débattre- tout autre discours sur la concrétisation du principe paraît bien théorique. L'affaire du sang contaminé apporte la démonstration de cette dissociation du savoir et du pouvoir. Bien des praticiens, possédant l'idée pionnière du risque, ont pris des mesures visant à éviter les contaminations avant que l'État n'intervienne sur la base de connaissances établies. Le Conseil d'État a respecté cette chronologie en liant l'établissement de la faute de l'État à cet acquis, ne faisant peser à sa charge qu'une obligation de prévention 4 ( * ) . Un médecin peut-il adopter les même paramètres d'action c'est à dire attendre la confirmation du risque pour prémunir ses patients contre celui-ci ? La réponse, évidemment négative, résulte d'une obligation déontologique de prudence qui intègre, traditionnellement, l'idée de précaution. La Cour administrative d'appel de Paris rappelle, par un arrêt du 12 novembre 1999 X/APHP 5 ( * ) , cette règle de comportement. Il s'agit de la prescription de produits sanguins concentrés non chauffés entre le 18 et le 20 septembre 1984 à un hémophile hors situation d'urgence. Un parallèle s'impose avec l'arrêt du Conseil d'État de 1993 6 ( * ) qui établit la responsabilité de l'État pour carence fautive en matière de réglementation de la transfusion sanguine pour la période allant du 22 novembre 1984 au 20 octobre 1985. Dans l'affaire jugée par la Cour administrative d'appel de Paris, les transfusions ont donc été réalisées avant la date retenue comme point de départ de la mise en cause de l'État par le Conseil d'État. Néanmoins, la Cour administrative d'appel de Paris retient la responsabilité de l'hôpital, considérant que les milieux médicaux étaient informés dès janvier 1983 de l'existence d'un risque, et prenant acte de ce que l'article 9 du Code de déontologie, en vigueur au moment des faits, prévoit qu'il faut limiter les prescriptions à ce qui est nécessaire et qu'il faut s'interdire de faire courir au patient un risque injustifié 1 ( * ) . La responsabilité de l'État au titre de ses pouvoirs de police sanitaire et la responsabilité de l'hôpital pour un acte de prescription médicale ne reposent donc pas sur les mêmes critères. Et si on admet la responsabilité de l'État du fait d'actes médicaux quand on ne l'admet pas encore du fait d'actes de police sanitaire, c'est bien parce que le médecin, en prise directe avec la connaissance du risque, doit en tirer immédiatement, c'est à dire plus tôt que l'État dans ses pouvoirs de police, des conséquences concrètes. Même si l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, en fondant sa décision sur une information relative au risque datant de janvier 1983, ne consacre pas une exigence de précaution et ne nous dit pas si le médecin eut été en faute dès l'émergence de la seule hypothèse du risque, il conserve à nos yeux son intérêt. Il nous démontre, en effet, que le niveau d'exigence que l'on peut imposer aux décideurs, en l'occurrence aux médecins 2 ( * ) , est plus élevé que celui dont on investit l'État dans le cadre de ses pouvoirs de police. Lorsque cette exigence sera de précaution, tout porte à croire qu'elle visera d'abord ceux qui savent, et détiennent à ce titre le véritable pouvoir de précaution.
II- UNE ADAPTATION DU RAISONNEMENT JURIDIQUE À L'INCERTITUDE
Notre scepticisme quant à la sanction d'une norme de précaution en droit de la responsabilité va de pair avec la conviction que l'éthique qu'elle prône affecte profondément la politique du juge en ce domaine. L'attraction exercée par la règle doit beaucoup à cette dualité : on croit en avoir cerné le contenu- ou l'absence de contenu-, avoir évalué son potentiel normatif, pouvoir affirmer que le bouleversement des critères juridiques de l'action n'est pas installé et n'est pas près de l'être. La réflexion semble finalement fort éloignée des rives d'un droit positif qui ne pose pas ses fondations sur le terrain mou de simples probabilités d'hypothèses... Et puis, on observe une succession d'inflexions, de glissements voire de ruptures dans les raisonnements qui structurent la responsabilité juridique, sans justification flagrante mais comme à la faveur d'une transformation progressive du regard porté, en droit, sur l'incertain. Au fond, que la norme soit directement invocable ou qu'elle ne le soit pas à rencontre des décisions et actions privées ou publiques, il apparaît que la précaution 1 ( * ) a modifié le statut de l'incertitude dans le raisonnement juridique, tant du point de vue de son appréhension que de ses conséquences. Les textes, de plus en plus nombreux, qui interviennent dans le domaine environnemental ou sanitaire organisent un verrouillage procédural de la décision en contexte d'incertitude qui constitue sans doute la traduction normative la plus tangible du principe de précaution. On s'en tiendra, ici, à l'analyse des propriétés inductives -ce que l'incertitude implique- et déductive -ce que l'incertitude permet de tenir pour acquis- en droit de la réparation. La précaution est-elle, en ce sens, une nouvelle norme de la responsabilité juridique ? Non, parce que cet effet prescriptif n'est pas attribuable à une règle de droit formellement identifiée et invocable. Oui, dans la mesure où la solution de droit en est affectée, au terme d'un raisonnement qui, surdéterminé par le principe de précaution, donne une portée authentique à l'incertain. Mais si le droit à réparation gagne du terrain, il n'est pas évident que le risque en perde simultanément. Il en cédera si le dilemme classique de la responsabilité civile -prévenir ou réparer- est résolu. Manifestement, la précaution incite à une conciliation de ces fonctions.
A - LA RÉCEPTION DE L `INCERTITUDE
Si le principe de précaution n'est pas retranscrit comme norme du droit de la responsabilité, il en inspire le fonctionnement. Le projet de mise en ordre que poursuit l'entreprise juridique est précédé, compromis ou perturbé par l'incertitude. Le travail juridictionnel doit en passer par renonciation de données modelées et calibrées à l'emporte pièce d'une catégorie. Traditionnellement, l'incertitude ne pourra fonder une demande de réparation que si, matière première entre les mains du juge, elle se prête à cette mise en forme. Le principal apport du principe juridique de précaution et des réflexions philosophique, scientifique et sociale qui ont accompagné son apparition, est d'avoir répandu l'idée que l'incertitude -voire l'ignorance-, peut être matière à droit(s) et non pas seulement matière du droit. Elle entre dans l'ordre du droit en tant que catégorie propre à la qualification et acquiert ainsi une place dans la construction des enchaînements qu'il met en scène.
On constate ainsi que l'incertitude est progressivement assumée comme fondement de la responsabilité. Elle est aussi intégrée dans un raisonnement de causalité qui s'étire et s'affine, autant que nécessaire, afin de relier des faits n'ayant parfois entre eux qu'un rapport apparent de superposition.
- Sous les traits de la présomption de faute ou du risque, l'incertitude entre, sans dénaturation, dans le raisonnement juridique. L'extension de ces fondements, anciens mais d'application délimitée, à l'activité scientifique ou médicale nous semble procéder pour une part non négligeable de la diffusion de la précaution
La présomption de faute est un instrument de saisie constructive de l'incertain. Son application dans l'hypothèse de la responsabilité hospitalière du fait d'une infection en offre l'illustration. Le doute porte formellement sur l'existence d'une faute ayant permis l'infection. La présomption a la propriété de décharger la victime de l'établissement d'une faute que l'on considère comme révélée par le dommage. Déjà réduite par ce raisonnement, l'incertitude est anéantie en raison du caractère quasiment irrecevable de la preuve contraire. Il importe peu que certaines infections aient été contractées avant l'entrée à l'hôpital, ou qu'une proportion d'infections nosocomiales soit irréductible en l'état actuel de l'art médical : il faut réparer. Le raisonnement du juge gomme toutes les considérations qui pourraient renverser la présomption et donc retourner le doute contre la victime. Cette part de fiction dans l'invocation des catégories 1 ( * ) , conduit à une objectivation quasi intégrale d'une responsabilité subjective. Que reste t-il de l'incertitude initiale au terme de cette lecture des faits ? Rien en apparence. Mais, sous le voile transparent de la présomption, on la retrouve intacte et comme livrée aux yeux de tous, en gage de la bonne volonté d'un juge qui force la réalité pour servir l'équité. Ainsi, dans l'arrêt COHEN 2 ( * ) , le Conseil d'État juge qu'alors qu'aucune faute lourde médicale notamment en matière d'asepsie ne peut être reprochée aux praticiens qui ont exécuté l'examen et l'intervention, le fait qu'une telle infection ait pu néanmoins se produire révèle une faute dans l'organisation du service hospitalier à qui il incombe de fournir au personnel médical un matériel et des produits stériles. Presque spontanée en l'espèce, la déduction peut être davantage dirigée, comme cela apparaît dans l'arrêt du Conseil d'État du 31 mars 1999 CPAM du Vaucluse 3 ( * ) posant, qu'alors même que les médecins n'auraient commis aucune faute notamment en matière d'asepsie et qu'une telle infection (introduction accidentelle de staphylocoques dorés lors d'une intervention de prothèse de hanche) se produirait dans une proportion non négligeable des interventions du même type, le fait que cette infection ait pu néanmoins se produire alors que rien ne permet de présumer que la patiente aurait été porteuse d'un foyer infectieux avant l'intervention, révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'établissement. De même, dans le cas d'une contamination par le virus de l'hépatite B, le Conseil d'État, dans une affaire jugée le 31 mars 1999 AP à Marseille 4 ( * ) , privilégie une cause, parmi d'autres quasi équivalentes, et démontre ainsi qu'il peut outrepasser l'incertitude en établissant un lien de causalité direct entre l'usage de seringues soumises à un protocole de stérilisation -mais non à usage unique et donc présumées mal stérilisées- et la contamination par le virus de l'hépatite B 5 ( * ) . Il convient de souligner que dans ce cas, rien ne permet d'exclure que le patient ait contracté son hépatite ailleurs qu'à l'hôpital 1 ( * ) . Ainsi, qu'elle découle des faits ou qu'elle soit posée comme telle, la présomption de faute fixe les contours d'une hypothèse afin d'offrir un point d'appui au mécanisme de la responsabilité. Une preuve contraire certaine doit pouvoir renverser la présomption et ruiner le fondement fautif invoqué par la victime. Mais on sait toutefois que cette démonstration presque impossible est finalement secondaire au regard d'un dommage tenu aujourd'hui pour intolérable. La réparation tend donc à être systématisée grâce à la mutation de la présomption de faute en une présomption de responsabilité 2 ( * ) .
Le développement du risque comme fondement de la responsabilité publique médicale exprime, lui aussi, une volonté d'accorder à l'incertitude une portée formalisée. Ici encore on y décèle l'effet indirect ou par ricochet de la précaution. Même si la signification de la règle n'est pas arrêtée -entre traitement du risque perçu mais non démontré et exigence d'une innocuité garantie- celle-ci a gravé dans les esprits le mythe du "risque zéro". Sa force, soutenue par les révélations de périls sanitaires et alimentaires, modifie la perception des silences et des controverses scientifiques. Faute de pouvoir exiger des décideurs qu'ils débusquent et maîtrisent tous les risques, il leur est demandé d'assurer la réparation des dommages qui en résultent. À l'instar d'une conception intégrale de la précaution, la prise de risque est inacceptable. La responsabilité sans faute répond à cette lecture du risque, selon des modalités plus ou moins strictes. Les cas de responsabilité objective de droit privé rejetant la portée exonératoire du risque de développement en incarnent une version particulièrement exigeante 3 ( * ) . La jurisprudence administrative relative à la réparation des dommages liés à la réalisation d'un risque non maîtrisé en matière médicale, procède de cet effet dérivé de l'exigence de précaution. On en rappellera brièvement les étapes majeures. La Cour administrative d'appel de Lyon admet dans l'arrêt Gomez du 21 décembre 1990 4 ( * ) la responsabilité sans faute de l'hôpital du fait de la réalisation d'un risque spécial lié à l'utilisation d'une thérapeutique nouvelle dont les conséquences ne sont pas entièrement connues. Le Conseil d'État retient en 1993 dans l'arrêt Bianchi 5 ( * ) , la responsabilité sans faute de l'hôpital du fait d'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade à la condition que cet acte présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle, qu'il n'y ait aucune raison de penser que le patient y soit particulièrement exposé, et que l'exécution de cet acte soit directement à l'origine de dommages d'une extrême gravité et sans rapport avec l'état initial du patient ou son évolution prévisible 1 ( * ) . Par un arrêt du 27 octobre 2000 Centre hospitalier de Seclin 2 ( * ) , le Conseil d'État semble avoir introduit un assouplissement de la condition de la non-prédisposition du patient, qui corroborerait sa volonté de faire réparer la réalisation d'un risque débordant du cadre de l'aléa. Hormis le fait que la solution apportée par cet arrêt nous semble déjà contenue dans les termes de l'arrêt Bianchi, cette décision confirme, s'il en était besoin, que la fonction de la responsabilité fondée sur le risque est ici de "ratisser large", c'est à dire jusqu'au risque maîtrisable mais non maîtrisé, à la frontière de la faute. Le développement en droit privé de la responsabilité d'une obligation de sécurité résultat, en matière d'infections nosocomiales 3 ( * ) , du fait du matériel utilisé pour l'exécution d'un acte médical 4 ( * ) , ou encore par exemple du fait des produits fournis au patient par la clinique 5 ( * ) , procède d'une même volonté. C'est, en termes de réparation, la traduction de toutes les acceptions de la règle de précaution.
-Le lien de causalité, fil conducteur du raisonnement en droit de la responsabilité, est mis à l'épreuve dès que l'élément générateur du dommage est dilué par la pluralité des faits et/ou par l'incertitude entourant leur contribution au dommage. Ici encore, la présomption permet de fixer l'image et de tendre ce fil. Elle est, en particulier, exploitée dans des mécanismes de responsabilité fondée sur le risque. Tous les moyens sont ainsi conjugués pour saisir cette incertitude "au carré" : l'incertitude inhérente à la réalisation du risque - risque de contamination par le virus de l'hépatite C par exemple- étant croisée avec l'incertitude portant sur le facteur de risque -transfusion ou rapports sexuels ou soins dentaires...- ayant produit le dommage. Les rouages de la responsabilité jouent et s'adaptent afin de conférer à l'incertitude une véritable fonctionnalité. Considérons la responsabilité de l'hôpital en tant que gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine articulée sur une présomption de causalité dans le cadre d'une responsabilité fondée sur le risque 6 ( * ) . La présomption porte sur le lien de causalité qui unit la transfusion et la contamination. Cette présomption de causalité ne peut en principe céder que face à une preuve contraire c'est à dire la démonstration et non la simple présomption qu'un autre fait est à l'origine du dommage 1 ( * ) . Le principal intérêt de cette jurisprudence, au regard de notre réflexion, réside dans la manière dont le juge traite les faits : il considère les incertitudes qui pèsent sur son raisonnement avec pragmatisme, adaptant l'étirement, et donc l'amoindrissement, du lien de causalité admissible aux caractères de l'infection qui est en cause. En clair, la causalité est plus facilement retenue à la suite d'une transfusion si la contamination est au VIH 2 ( * ) que si elle est à l'hépatite C 3 ( * ) , la présomption étant dosée en fonction des modes de la transmission du virus. Il demeure toutefois que la survenance de controverses scientifiques incite le juge à poser la présomption au service du moindre doute 4 ( * ) .
B - LA CONCILIATION DES FONCTIONS DE LA RESPONSABILITÉ
Enfin et toujours, il faut s'interroger sur les finalités que peut servir un mécanisme de responsabilité civile. L'élargissement du droit à réparation, fonction première, est favorisé par le recours à un fondement objectif permettant de surmonter l'écueil que constitue l'établissement de la faute. L'incitation des acteurs à élaborer des stratégies d'évitement du dommage, fonction seconde, est, d'abord et probablement de la façon la plus tangible, assurée par l'encadrement procédural de la décision 1 ( * ) et les conséquences contentieuses qui en découlent. Elle trouverait néanmoins aussi un appui au sein d'un principe de responsabilité fondé sur la norme de précaution. L'alternative faute/risque expose de façon radicale les priorités retenues par le juge ou le législateur en droit de la responsabilité. Mais les données du problème sont en réalité moins tranchées. Si la réalisation d'un risque dommageable ne laisse pas grand champ à un débat sur le bien fondé de la réparation, il faut en même temps admettre la vanité d'une prise en charge financière 2 ( * ) n'offrant pas la restitution de l'état antérieur. Et la voie est ainsi ouverte à une réflexion législative et doctrinale qui tente d'organiser les régimes de responsabilité sans faute de telle sorte qu'ils n'abdiquent pas leur dimension préventive 3 ( * ) . Le contexte de précaution appelle ce défi mais ne le simplifie pas. Le caractère potentiel de risques, encourus de surcroît sur une échelle de temps de grande ampleur, désamorce quelque peu la force dissuasive de la responsabilité juridique
- En matière d'environnement, domaine d'origine de la règle de précaution, les échéances de survenance des dommages s'étendent vers l'inconnu tout en permettant d'envisager le pire c'est à dire l'irréversible. Il y a dans la logique de précaution une démesure étrangère à nos prudents dispositifs de responsabilité 4 ( * ) . À moins d'admettre, au prix d'une rupture avec les canons du droit de la responsabilité civile, une réparation déconnectée de la réalisation du dommage et fondée sur la négligence d'une hypothèse de risque -donc sur la contribution à la persistance voire à l'embellie de celui-ci-, il faut bien reconnaître que la réparation d'un dommage signe un échec de la politique de précaution. Ainsi, seule une sanction juridique de la prise de risque par un raisonnement de perte de chance indépendant de sa réalisation et à fortiori du dommage c'est à dire du constat de la chance perdue, pourrait donner une portée à l'exigence de précaution.
- La responsabilité fondée sur le risque peut avoir un effet ab initio sur le traitement de celui-ci en obligeant les acteurs à internaliser des coûts auxquels ils ont peu de possibilités de se soustraire. Même atténuée, quand les acteurs ré-externalisent ce coût en le répercutant sur les consommateurs ou sur l'assurance, la charge est maintenue sous la forme d'une perte de marché et d'une hausse des cours de l'assurance. La fermeture des voies d'exonération de la responsabilité participe à cette fonction préventive de la responsabilité pour risque.
En ce sens, l'exigence de précaution est de nature à orienter, à partir d'une modification des attentes de comportement en situation d'incertitude, l'appréciation des éléments constitutifs de la force majeure que sont l'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité. La reconnaissance de l'extériorité sera peut-être plus stricte. En impliquant le décideur à l'égard de l'incertain dans le but de peser sur la survenance de l'événement, le comportement de précaution abolit sa situation d'extériorité. Le glissement s'opère au profit d'une conception plus large du cas fortuit, réduisant, de ce fait, les cas d'exonération de la responsabilité pour risque. De même, l'imprévisibilité sera plus difficilement établie si une simple hypothèse de risque, même très faiblement probable, tenait lieu de référence tant qu'elle n'est pas réfutée. L'événement raisonnablement absolument inattendu deviendrait encore plus rare. Enfin, l'irrésistibilité c'est à dire le caractère imparable ou inévitable sera un argument d'autant moins recevable que le décideur est tenu de bloquer par des mesures de précaution le déroulement d'un processus, qui, plus avancé, serait incontrôlable 1 ( * ) ,
La corrélation susceptible de s'instaurer entre le principe de précaution et l'exonération pour risque ou incertitude 2 ( * ) de développement est plus complexe. Entendu comme le défaut d'un produit que le producteur n'a pas pu soupçonner en l'état des connaissances scientifiques et techniques objectivement accessibles à sa connaissance au moment de la mise en circulation du produit, le risque de développement ne vise pas un défaut du produit mais sa connaissance. Le risque est donc celui "... qu'un défaut se manifeste là où on ne pouvait pas le penser, et donc aussi un risque de l'imputation de la charge des conséquences dommageables du défaut" 3 ( * ) . L'imputation sera rétroactive, et non pas seulement rétrospective, en ce qu'elle suppose d'ajouter aux données qui ont déterminé l'action des informations ignorées au moment de celle-ci et de construire l'imputation à partir d'elles. L'hypothèse du risque de développement vise un contexte se situant au-delà de celui de la précaution : il ne s'agit plus de raisonner à partir d'une hypothèse de risque dont la probabilité de pertinence est indéfinie mais dans une absence d'incertitude du fait que le risque n'est même pas imaginé. On peut ainsi considérer que le risque de développement n'est pas susceptible de convoquer le principe de précaution. On doit même admettre que la démonstration d'une attitude de précaution soutient logiquement l'obtention d'une exonération de responsabilité en cas de risque de développement. C'est parce qu'il aurait appliqué une approche raisonnable de précaution que le producteur pourrait faire valoir que le risque n'était vraiment pas perceptible. Mais on peut estimer aussi que le principe de précaution justifie le maintien de la responsabilité en cas de risque de développement 1 ( * ) . Le souci d'assurer la réparation du dommage étant doublé d'une interprétation extrémiste du principe de précaution qui affirme le risque dès lors que l'innocuité d'un produit ou d'une activité n'est pas positivement démontrée. Ceci revenant à considérer que ne pas avoir pris de mesures particulières de protection dans le cas où "l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit... n'a pas permis de déceler l'existence du défaut" 2 ( * ) constitue un manquement à l'obligation, en cas "d'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment" de ne pas "retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un dommage...". Admettre qu'un comportement de précaution puisse appuyer une demande d'exonération pour risque de développement nous paraît tout de même plus conforme à une conception réaliste et opératoire de l'exigence de précaution. Sous cet angle, la norme de précaution confère une dimension préventive à la responsabilité en incitant le décideur à ne pas perdre cette voie d'exonération 3 ( * ) . Au contraire, une mise en oeuvre systématique de sa responsabilité ruinerait toute velléité de modification des critères de son action et pourrait encourager une sous-traitance de l'innovation délocalisée dans des systèmes juridiques moins contraignants.
On le constate, la sanction d'une norme de précaution par le droit de la responsabilité civile reviendrait à consacrer un bouleversement des critères de l'action outrepassant largement l'état du consensus social sur la question. Désirée plus qu'assumée, la précaution trouve dans les textes juridiques et les décisions juridictionnelles une forme d'existence incantatoire qui n'appelle pas nécessairement de concrétisation. En revanche l'idée de précaution opère un travail fondateur sur la perception de l'action en situation d'incertitude. Le droit de la responsabilité apparaît à la fois comme la cible et le transcripteur de cette inflexion. Les victimes des risques réalisés seront, à l'avenir, des acteurs déterminants de cette transformation. Ils contribueront avec le juge à tracer les contours de leur propre liberté et de leurs droits face à l'incertain. Si le choix du risque n'est pas raisonnable, la précaution l'est encore moins. Cela n'exclut pas que l'un et l'autre puissent être raisonnes.
Monsieur Pierre DELVOLVE
Madame, cet exposé extrêmement riche, est source de vertiges, voire d'angoisses. Angoisse juridique, angoisse métaphysique peut-être.
Angoisse juridique parce ce que vous avez montré combien les données les plus établies du droit de la responsabilité et même de la légalité se trouvaient ébranlées par le développement du principe de précaution. Vous avez souligné, cela a été votre développement ultime, combien le renouvellement du droit de la responsabilité pouvait être le débouché de ce principe de précaution. Mais en même temps vous avez montré qu'un certain nombre d'éléments du droit positif actuel étaient susceptibles d'être utilisés. Il y a un ébranlement des données essentielles sur lesquelles nous avons fondé nos enseignements, sur lesquelles le droit administratif de la responsabilité, le droit civil de la responsabilité se sont bâtis qui pour l'avenir est source, en tout cas pour moi, d'un certain nombre d'angoisses.
Mais vous avez terminé, et tout votre exposé y est lié, par la considération du risque. Le risque que les uns font prendre aux autres, le risque que les consommateurs eux-mêmes, les usagers eux-mêmes, prennent en adoptant un certain nombre de comportements - et c'est là que je passe de l'angoisse juridique, au fond elle n'est pas très importante, à l'angoisse métaphysique. Finalement, toute vie est un risque. Vivre c'est risquer. Un auteur a écrit un jour : le risque de naître, le risque de vivre. En entrant même dans le Sénat, nous courons un risque. On ne sait pas quelle marche insuffisante va nous faire trébucher, quelques fois brutalement. Alors le principe de précaution se rapporte à des événements autrement important que le simple accident qui nous fait tomber dans un couloir. Cependant, le principe de précaution qui apparaît comme tellement nouveau - il est nouveau compte tenu de l'ampleur des risques que le développement scientifique et technique nous fait courir - au fond, est-il tellement nouveau ? Et peut-on, prendre des précautions qui indéfiniment nous protègent de tout aléa ? Non. L'aléa est inhérent à la vie.
Je déborde peut-être les propos juridiques qui doivent être tenus dans cette enceinte. Je déborde mon temps de parole mais je ne suis pas le seul. Nous devrions avoir déjà achevé la première partie de cette séance. Monsieur le Professeur GAUDEMET va nous parler de la responsabilité due aux activités de contrôle et des dilemmes que cette responsabilité fait apparaître. Vous avez la parole.
Responsabilité de l'administration et nouvelles activités de contrôle
par Monsieur Yves GAUDEMET,
professeur à l'Université Paris 2
Le contrôle administratif s'étend à mesure que l'administration recule. La dilection pour l'initiative privée, la volonté d'en libérer le mouvement s'accompagnent d'un nécessaire mais parfois pesant contrôle de la puissance publique ; pas de liberté des prix sans un contrôle des ententes et abus de domination ; pas de liberté financière sans un contrôle des opérations de bourses ; pas de liberté dans les télécommunications sans une "régulation" de ce marché ; pas de libertés individuelles sans un contrôle des fichiers informatisés ; et, pourrait-on dire, pas de libertés des collectivités locales sans un contrôle de la légalité de leurs actes.
À mesure qu'elle retient son bras pour agir, l'administration multiplie les procédures pour contrôler. Le contrôle se développe et sa physionomie change. Qu'en est-il de la responsabilité qui, du fait des ces contrôles, peut peser sur l'administration ?
La jurisprudence a depuis longtemps saisi la matière et elle s'est généralement arrêtée à un système de responsabilité pour faute lourde en matière de contrôle administratif. C'est, disait-on -et nous y reviendrons- que le contrôle est en lui -même un exercice difficile et qui ne doit pas entreprendre sur la liberté de principe des personnes ou des organismes contrôlés, à raison de quoi doit être préservée cette "franchise de responsabilité" (la formule est de M. Chapus) que signifie le système de responsabilité pour faute lourde.
Le propos est ici de d'apprécier cette solution classique à l'aune de deux évolutions qui parcourent, l'une les formes du contrôle, l'autre le droit de la responsabilité administrative. Et l'on constatera que le système de responsabilité pour faute lourde est bien toujours celui qui convient à la matière.
Le contrôle administratif a changé de visage. Plus difficile souvent que par le passé à distinguer des activités d'administration, il est largement le fait d'autorités nouvelles, parfois à mi-chemin de la juridiction.
Il s'agit des autorités administratives indépendantes dont chaque mois passé, ou presque, augmente la catégorie d'une unité ; on sait avec quelle habileté consommée, celles-ci s'emploient à mêler le contrôle, la recommandation, la régulation quand ce n'est pas de simple "pédagogie administrative" qu'il s'agit.
Il s'agit aussi de formes nouvelles de contrôle : celui confié aux chambres régionales des comptes et, bien sur, le contrôle de légalité du préfet sur les actes des collectivités locales.
Quant au droit actuel de la responsabilité administrative - et c'est le second facteur d'évolution -, il est tout entier parcouru par un vaste courant d'abandon de la faute lourde : souvent considérée comme une survivance là où elle est encore exigée, la faute lourde serait condamnée à disparaître comme est disparue dans les années 60 la faute d'une particulière gravité 1 ( * ) . L'histoire de la faute lourde est - a-t-on pu dire (R. Chapus) - celle de son recul.
Dans cette perspective, le système traditionnel de responsabilité pour faute lourde des services de contrôle ne doit-il pas être abandonné pour celui de la faute simple ? Personnellement, je ne pense pas : le système actuel de la jurisprudence est cohérent et garde sa valeur si on le ramène aux principes qui le fondent ; il reste bien adapté à la responsabilité de l'administration du fait de ses activités de contrôle malgré la diversification de celles-ci. Au bénéfice d'une explication et de quelques propositions, et au risque de décevoir les talentueux organisateurs de notre Colloque, il me paraît possible d'écarter de notre matière la perspective de nouvelles nonnes de responsabilité.
I - EXPLICATION
Le droit actuel, dans notre matière, est présenté comme consacrant à titre principal un système de responsabilité pour faute lourde, avec quelques "exceptions" ou cas particuliers régis par la faute simple (A). En réalité principe et exceptions s'expliquent et se justifient par une même considération, celle de la liberté d'action, de la marge de manoeuvre que l'on veut laisser à l'organisme contrôlé, et, sur le terrain de la responsabilité, c'est bien le système de la faute lourde qui traduit le mieux ces considérations (B).
A - LA JURISPRUDENCE a historiquement consacré le principe selon lequel les activités de contrôle exercées par les personnes publiques, au premier rang desquelles l'État, s'engagent la responsabilité de celles-ci que lorsque qu'une faute lourde leur est imputable.
1. Cette solution, non moins traditionnellement, été appliquée à l'ensemble des activités de contrôle
S'agissant des activités de tutelle sur les collectivités locale et les établissements publics, l'arrêt de principe généralement cité est celui du 29 mars 1946, Caisse départementale d'assurances sociales de Meurthe-et-Mosellle (Rec. Lebon p. 63) rendu dans la célèbre affaire Stavisky. Dès cette époque, un second arrêt du 24 juin 1949, Commune de Champigny-sur-Marne (Rec. Lebon p. 493) indique que ce système de responsabilité pour faute lourde vaut pour la responsabilité encourue tant à l'égard des tiers que vis-à-vis de la collectivité sous tutelle.
Dans les années qui suivent la solution est constamment reprise, tant à l'égard des établissements publics qu'à l'égard des collectivités territoriales, aussi bien pour la tutelle administrative que pour la tutelle financière. Encore dans un arrêt du 29 avril 1987, École Notre-Dame de Kernitron (Rec. Lebon p. 161), le conseil d'État annule un jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 février 1985 pour avoir décidé que la responsabilité de l'État du fait de la tutelle financière qu'il exerce sur les collectivités locales pouvait être engagée pour faute simple, au motif que les lois de décentralisation avaient simplifié les termes de cette tutelle financière.
En dehors du domaine de la tutelle sur les collectivités et établissements publics, le système de faute lourde est appliqué comme principe aux contrôles exercés par l'État sur les institutions de droit privé : caisses de sécurité sociale (CE 10 juillet 1957, ministre du travail, Rec. Lebon p. 467) ; banques et établissements financiers (CE 22 juin 1984, Société Pierre et Cristal, Rec. Lebon p. 731 - CAA Paris 19 décembre 1995, Kechchian, Rec. Lebon p. 671) ; maisons de la culture constituées en associations (CAA Lyon 28 novembre 1991, Société Christian Juin, Rec. Lebon p. 588) ; sociétés mutualistes (CE 23 décembre 1981, Andlauer, Rec. Lebon p. 487). Et, alors même que, par le fait de la loi, le contentieux correspondant est transféré au juge judiciaire, celui-ci conserve le système de la responsabilité pour faute lourde ; ainsi pour la responsabilité encourue par l'État du fait des décisions de la commission des opérations de bourses (CAA de Paris 6 avril 1994, Mizon c/ Agent judiciaire du Trésor, Dalloz 1994 p. 511).
C'est encore la seule faute lourde qui engage la responsabilité de l'État du fait d'une défaillance dans le contrôle de la navigation aérienne (CE 21 novembre 1994, Société Gerling-Honzern, Rec. Lebon p. 380) ou encore pour le contrôle des carrières (CE 24 mars 1986, Veuve Thiémard, Rec. Lebon p. 179).
Enfin on rappellera que sous l'empire de la législation qui subordonnait le licenciement pour motif économique à une autorisation de l'inspecteur du travail, seule une faute lourde de ce dernier était susceptible d'engager la responsabilité de l'État, tant à l'égard des salariés que de l'employeur. La même solution a été maintenue par la suite (CE 5 juillet 1999, Mme Dagot, n° 181746).
On est ainsi en présence d'une jurisprudence qui présente le mérite de la cohérence et de la clarté : l'ensemble des activités de contrôle de l'administration ne peuvent être mises en cause, sur le terrain de la responsabilité, qu' au titre de la faute lourde, et cela sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les réclamants ni les modalités des différentes contrôles.
2. Il est vrai que cet état du droit a pu sembler récemment ébranlé.
Attentifs à l'évolution de la jurisprudence qui, s'agissant cette fois non pas des activités de contrôle mais de nombreux secteurs d'activités de gestion de l'administration, abandonne peu à peu l'exigence de la faute lourde et admet que la responsabilité soit engagée au titre d'une faute simple ou encore d'une faute ordinaire, nombre de commentateurs ont estimé qu'une évolution de même sens devait affecter le droit de la responsabilité du fait des activités de contrôle.
Et on a mis en avant certains arrêts qui pouvaient en effet apparaître comme annonciateurs d'une telle évolution.
On a fait observer ainsi que, s'agissant de la responsabilité de l'État du fait du contrôle des activités de transfusion sanguine, il était désormais jugé qu'une faute simple suffisait à engager la responsabilité de l'autorité de contrôle (CE 9 avril 1993, D ..., Rec. Lebon p. 110). De même, pour le licenciement des salariés protégés soumis au contrôle de l'inspecteur du travail, la faute simple de celui-ci permet d'engager la responsabilité de l'État vis-à-vis de l'employeur comme vis-à-vis du salarié.
On a relevé encore que la cour administrative d'appel de Paris, dans deux décisions de 1999, avait retenu la responsabilité pour faute simple de la commission bancaire dans le premier cas, de la commission de contrôle des assurances dans le second, au titre des contrôles administratifs confiés à celles-ci (CAA Paris 30 mars 1999, El Shikh - 13 juillet 1999, Groupe Dentressangle, AJDA 1999, p. 951). Mais, comme on le verra, le conseil d'État a depuis censuré cette solution.
Enfin, infirmant un jugement du tribunal administratif de Bastia, la cour administrative d'appel de Marseille avait, également en 1999, admis que la responsabilité de l'État au titre du contrôle de légalité et budgétaire qu'il exerce sur les communes soit engagée sur le terrain de la faute simple (CAA Marseille 21 janvier 1999, Commune de Saint-Florent, RFDA 1999 p. 1032). Là encore, l'arrêt a été censuré par le conseil d'État qui a maintenu l'exigence de la démonstration d'une faute lourde
Pourtant, et surtout tant que n'étaient pas intervenues ces décisions de censure du conseil d'État, on a pu légitimement se demander si la multiplication des hypothèses où seule la faute simple est recherchée n'était pas annonciatrice d'un abandon de la faute lourde pour l'ensemble des activités de contrôle, rejoignant de ce fait une évolution générale du droit de la responsabilité administrative. Illustrant cette analyse, Monsieur Chapus intitule ainsi les deux paragraphes successifs qu'il consacre à ces questions, le premier, "De l'exigence de la faute lourde..." et le second "... à la suffisance d'une faute simple" ( Droit administratif général, tome 1, n. 1473-1 et s.).
Avant cependant de savoir s'il convient de rallier ce courant d'abandon de la faute lourde dans le domaine des contrôles administratifs, il faut s'interroger sur les considérations qui la fondent historiquement et s'assurer que la jurisprudence est bien aussi résolument engagée dans le sens de cet abandon ; or rien n'est moins certain.
B QUELS SONT EN EFFETS LES PRINCIPES ?
1. On a traditionnellement cherché des justifications à la jurisprudence non moins traditionnelle qui subordonne à la démonstration d'une faute lourde la responsabilité de l'administration dans le cadre des activités de contrôle qui lui sont confiées.
C'est ainsi qu'on a fait valoir notamment, comme on l'a fait en général pour justifier l'exigence d'une faute lourde, que l'activité en question, celle du contrôle, présentait des difficultés particulières eu égard à ses caractéristiques propres et aux moyens dont l'administration dispose en fait pour l'exercer. On trouve encore les éléments de cette analyse dans certaines conclusions récentes de commissaires du gouvernement, voire dans les arrêts.
Pourtant cette explication ne saurait convaincre. Du jour, en effet, où l'exigence de la faute lourde a été abandonnée par exemple pour la responsabilité en matière d'actes médicaux ou encore pour les services d'aide médicale d'urgence (SAMU) et de placement d'office des malades mentaux, ou bien encore pour le fonctionnement des services de lutte contre l'incendie ou des services d'assistance en mer, toutes activités qui présentent autrement de difficulté que l'exercice du contrôle administratif, il n'est pas possible de soutenir que c'est la prise en compte du degré de difficulté d'exercice de ces activités qui justifie l'exigence de la faute lourde.
Et d'ailleurs, pour les contrôles administratifs qui sont essentiellement des contrôles sur pièces, ceux-ci ne présentent aucune difficulté technique particulière ; ils peuvent seulement être rendus plus difficiles par manque de moyens, cette insuffisance des moyens matériels et humains du contrôle étant par elle-même fautive au regard de l'obligation de faire fonctionner les services publics.
C'est donc ailleurs qu'il faut chercher la justification d'une responsabilité limitée à la faute lourde pour les activités de contrôle : cette justification tient toute entière, selon moi, dans le souci de ne pas confondre le contrôle et la gestion administrative, de laisser à l'auteur de l'acte une liberté suffisante que le contrôle ne doit pas entraver ; et de borner l'intervention du contrôleur à la périphérie de cette action. Il faut reconnaître à l'administration une marge d'action, libre, "en franchise de responsabilité" et c'est, techniquement, le système de la faute lourde qui, faisant reculer le seuil de responsabilité, le permet. Ainsi comprise l'exigence de la faute lourde trouve sa justification spécifique dans le caractère propre des activités de contrôle et la volonté, encore une fois, de ne pas "confisquer" la responsabilité du contrôlé par celle du contrôleur.
C'est en effet finalement, non pas le contrôle, mais la situation qui résulte du contrôle ou de l'absence de contrôle qui est source de préjudice, donc de responsabilité ; et cette responsabilité pèse au premier chef sur celui qui administre, celui qui a la maîtrise directe de la situation. Le contrôleur ne peut être recherché que si, par un comportement déficient au regard même de ce qu'est un contrôle administratif, il a eu une part à la situation dommageable.
2. Si l'on raisonne ainsi, la jurisprudence qu'on a analysée auparavant dans son apparente complexité, se comprend mieux, y compris les exceptions apportées à l'exigence de la faute lourde. Elle repose en effet sur une appréciation spécifique, dans chaque cas, des rapports du contrôleur et du contrôlé ; et ce n'est que lorsque le premier, de par la loi, dépasse le contrôle pour développer une action qui est en réalité d'instruction ou de substitution, de type hiérarchique, que l'exigence de la faute lourde est écartée au bénéfice de la seule faute simple ; au contraire, lorsque c'est bien de contrôle - et seulement de contrôle - qu'il s'agit, la responsabilité du contrôleur suppose la démonstration d'une faute lourde.
C'est qu'en effet le principe, dans la jurisprudence, est que le contrôle ne doit pas se confondre avec l'action. Dès lors le contrôleur - mais à la condition qu'il reste un contrôleur - bénéficie de la franchise de la responsabilité que lui assure la faute lourde ; celle-ci apparaît consubstantielle aux activités de contrôle. En revanche, lorsque, de par la volonté de la loi, l'intervention administrative va au-delà d'un contrôle, qu'elle prend une tournure quasi hiérarchique, que le contrôleur est directement comptable de la pertinence et de la régularité de l'action administrative en cause, on comprend que le juge, sur le terrain de la responsabilité, en tire la conséquence qu'une faute simple suffit.
La jurisprudence est bien dans le sens de cette distinction. Ainsi en matière de contrôle de la transfusion sanguine, le conseil d'État prend soin de justifier l'engagement de la responsabilité de l'administration pour faute simple "tant par l'étendue des pouvoirs" qui lui sont confiés à cet effet que par "les buts en vue desquels ces pouvoirs lui ont été attribués" (CE 9 avril 1993, Mme D.... AJDA 1993, p. 344). Ainsi encore en matière de contrôle du licenciement des salariés protégés, l'adoption du système de faute simple ne se justifie que par le commandement de la loi d'assurer à ceux-ci une "protection exceptionnelle" qui va au-delà d'un simple contrôle.
Dans toutes ces hypothèses, il ne s'agit plus seulement d'un contrôle ; l'objectif recherché est d'encadrer étroitement l'action administrative concernée ; le contrôleur se confond avec le gestionnaire et, pour l'un comme pour l'autre, la responsabilité est engagée pour faute simple.
Et c'est la même analyse que consacre finalement le conseil d'État pour censurer la position de la cour administrative d'appel de Paris qui, dans les deux décisions déjà citées de 1999 El Shikh et Groupe Dentressangle, retenait la responsabilité de la commission bancaire et celle de la commission de contrôle des assurances pour faute simple à raison des mesures de contrôle administratif prises par ces deux autorités. Cette solution ne se justifiait pas, si l'on veut bien considérer que ces deux autorités administratives indépendantes ne doivent intervenir que dans le respect de l'initiative propre des banques, établissements financiers ou compagnies d'assurances qu'elles contrôlent 1 ( * ) . Ce sont des principes analogues qui, finalement, s'imposent également aujourd'hui pour le contrôle de l'État sur les collectivités locales.
Ajoutons enfin que cette distinction entre le véritable contrôle et la quasi-substitution d'action s'exprime aussi d'une autre façon dans la jurisprudence. Lorsqu'il s'agit d'une véritable activité de contrôle et qu'une liberté de principe est laissée à l'organisme contrôlé, la mise en cause du contrôleur sera souvent le fait du contrôlé, et non pas des tiers ; c'est que, pour les tiers, il n'y a pas de causalité directe entre le préjudice qu'ils subissent et l'effectivité du contrôle : ce préjudice est en réalité le fait de l'organisme contrôlé. Et c'est précisément parce qu'il est exposé à la réparation du préjudice causé par lui que l'organisme contrôlé, à son tour, mettra en cause la responsabilité du contrôleur pour d'avoir pas su le prémunir utilement contre l'irrégularité que comportait l'action administrative en cause. On comprend aussi pourquoi, dans cette configuration contentieuse, le juge laisse souvent une part de responsabilité à la charge de l'organisme contrôlé qui vient se plaindre d'avoir été mal contrôlé ou pas contrôlé.
En revanche lorsque le contrôle se confond pratiquement, dans les conséquences qu'il comporte, avec le fait de l'organisme contrôlé -hypothèse dans laquelle la responsabilité du contrôle peut être engagée pour faute simple-l'action en responsabilité sera le plus souvent le fait de tiers qui confondent légitimement, dans la réparation qu'ils recherchent, le fait du contrôleur et celui de l'organisme contrôlé.
Tout conduit ainsi à considérer que la jurisprudence traditionnelle mérite d'être maintenue et confirmée, solidement appuyée sur cette considération que la responsabilité des activités de contrôle doit bénéficier de la franchise de responsabilité qu'assure la faute lourde, traduction en la matière de la nécessaire liberté d'action des organismes contrôlés. Ce n'est que dans le cas où la loi exige qu'on aille en réalité au-delà du contrôle que la faute simple peut être admise.
II - PROPOSITION
C'est fort de ces enseignements et, finalement, de la confirmation de la pertinence de la jurisprudence traditionnelle relative à la responsabilité de l'administration du fait de ses activités de contrôle que l'on peut aborder les aspects nouveaux de celui-ci. Au premier rang de ces questions nouvelles -et les seules que j'aborderai- : la responsabilité de l'État du fait du contrôle de légalité et budgétaire des collectivités locales, et celle de la responsabilité de l'État du fait des contrôles confiés aux différentes autorités administratives indépendantes.
A - CONSIDÉRONS D'ABORD LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ET BUDGÉTAIRE DES COLLECTIVITÉS LOCALES
1. Après une période d'incertitudes, la jurisprudence s'oriente aujourd'hui vers un système de faute lourde, cette faute lourde ne se déduisant pas du seul fait que le préfet da pas déféré, mais supposant une réelle carence dans l'exercice du contrôle, sous toutes ses formes, que le préfet exerce sur l'action locale.
Sans doute le fait que le préfet ait été saisi d'une demande de déférer et qu'il n'y ait pas donné suite, alors que l'annulation ultérieure de l'acte local confirme que celui-ci était illégal, peut constituer une circonstance caractérisant la gravité de la faute ; mais, dans tous les cas, c'est à une appréciation in concreto qu'on doit se livrer pour apprécier l'existence d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'État.
Ces solutions ne se sont pas dégagées sans hésitation. Un jugement du tribunal administratif de Bastia (TA Bastia, 3 juillet 1997, Commune de Saint-Florent et a., Les petites affiches, 10 janv. 1998, p. 34, concl. Ph. Chiavérini) a d'abord eu à connaître de l'action des communes, regroupées au sein d'un syndicat à vocation multiple, qui demandaient réparation à l'État du préjudice résultant pour elles de la mise à leur charge du passif de cet établissement public, en faisant valoir que la situation désastreuse de celui-ci résultait de la négligence de l'État dans l'exercice du contrôle de légalité. Le tribunal administratif analyse les faits et relève une "insuffisance tant du contrôle de légalité des actes du syndicat que du contrôle budgétaire", qu'il estime être, en l'espèce, constitutive d'une faute lourde, "seule susceptible d'engager la responsabilité de l'État en matière de contrôles de légalité et budgétaire". Ainsi une part de responsabilité est imputée à l'État "qui a laissé faire ".
En appel de ce jugement, la cour administrative d'appel de Marseille a à son tour relevé dans le comportement du représentant de l'État, au titre du contrôle de légalité, une "faute de nature à" engager la responsabilisé de l'État envers les communes réclamantes et a confirmé la démarche "globale" et in concreto permettant d'apprécier cette responsabilité (CAA Marseille, 21 janv. 1999, ministre de l'intérieur c/ Commune de Sain-Florent, Rev. gén. coll. terr. 1999, n° 4, p. 99, concl. J. Ch. Duchon-Doris, AJDA 1999 p. 279). Dans ses conclusions, le commissaire du Gouvernement insiste à juste titre sur le lien de cette question avec celle, plus générale, de la compétence liée ou de la faculté du préfet dans l'exercice de sa compétence de déférer, et il conclut nettement sur ce point que "le déféré préfectoral est, non pas une obligation, mais une simple faculté." Mais, curieusement, il en tire cette conséquence, sur le régime de responsabilité, que doit être retenue, non pas la faute lourde comme l'avait jugé le tribunal administratif de Bastia, mais la faute simple : l'arrêt, pour sa part, constate une "faute de nature à... ", formule dont on sait toute l'ambiguïté.
L'État s'étant pourvu en cassation à l'encontre de cet arrêt, le conseil d'État, par une décision du 6 octobre 2000, ministre de l'intérieur c/ Commune de Saint-Florent (AJDA 200 1, p. 20 1, note M. Cliquenois ; D. adm. 2000, n. 243), revient à l'exigence de la faute lourde, seule susceptible d'engager la responsabilité de l'État au titre du contrôle de légalité ; mais il considère que les faits mêmes qualifiés par la cour administrative d'appel de faute simple sont également constitutifs d'une faute lourde : "le préfet de Haute-Corse, en s'abstenant pendant trois années consécutives de déférer au tribunal administratif neuf délibérations dont l'illégalité ressortait avec évidence des pièces qui lui étaient transmises et dont les conséquences financières étaient graves pour les communes concernées, a commis, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, dans l'exercice du contrôle de légalité qui lui incombait, une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'État" ; cependant que les communes et le syndicat réclamant avaient également commis des fautes qui venaient en déduction de celle de l'État.
Une autre décision est également venue consacrer l'exigence de la faute lourde pour engager la responsabilité de l'État au titre du contrôle de légalité. Dans un contentieux d'urbanisme concernant la commune de Roquebrune-Cap-martin, le conseil d'État a affirmé que "la circonstance que le préfet s'est abstenu de déférer au tribunal administratif le plan d'occupation des sols de la commune sur le fondement duquel a été délivré le permis de construire litigieux, ne revêt pas le caractère d'une faute lourde, seule de nature à engager en pareil cas la responsabilité de l'État envers la commune" (CE 21 juin, 2000, Ministre de l'équipement, des transports et du logement c/ Commune de Roquebrune-Cap-Martin, chron. P. Bon, RFDA 2000, p. 1096 - Voir aussi TA Versailles, 3 déc. 1998, Commune d'Athis-Mons c/ État, BJCA 1999, p. 639).
2. Ces solutions, telles qu'aujourd'hui arbitrées par le conseil d'État, sont bien celles qui conviennent. Mais on gagnerait à être plus précis sur leur justification de fond : ce qui, en la matière, justifie une responsabilité limitée à la faute lourde, ce ne sont pas les difficultés particulières que comporterait, en l'état, l'exercice du contrôle de légalité. C'est bel et bien cette considération, propre au droit de la responsabilité du fait d'un contrôle administratif, qu'une certaine liberté d'action doit être laissée à l'organisme contrôlé, de telle sorte que l'instance de contrôle ne se substitue pas à lui, qu'elle garde à son égard une nécessaire distance, autrement dit qu'elle soit, par construction, imparfaite et limitée à une simple surveillance. C'est pour ce motif et pour ce motif uniquement que la jurisprudence a traditionnellement fait prévaloir un système de faute lourde en matière de responsabilité du fait des activités de contrôle. Ce système n'est pas en voie d'abandon et ne doit pas être abandonné.
Il est naturel qu'il s'applique notamment au contrôle de légalité sur les communes. Cela se relie en effet au fait que le contrôle de légalité des lois de 1982, bien que mettant en oeuvre une exigence constitutionnelle, a été compris et interprété librement par la jurisprudence : le refus de déférer n'est pas susceptible de recours en annulation ; le préfet a la "faculté" et non pas l'obligation de déférer ; il peut se désister du déféré d'abord formé par lui parce qu'il jugeait l'acte illégal. Dans de récentes conclusions, un commissaire du Gouvernement (H. Savoie) est allé jusqu'à s'exprimer en ces termes : "Le préfet est l'arbitre des intérêts généraux et peut estimer, dans certaines circonstances, que l'intérêt général sera mieux préservé enfermant les yeux sur une illégalité minime ou sans conséquence plutôt que de provoquer des tensions, des coûts ou des retards en recherchant une application stricte de la légalité", de telle sorte qu'il faut des circonstances particulières, constitutives d'une faute lourde pour que la responsabilité de l'État soit engagée (inaction du préfet alors que l'illégalité est "flagrante, évidente, certaine et lourde de conséquences" (concl. ss, l'arrêt Roquebrune-Cap-Martin, précit, citées par P. Bon in RFDA 2000, p. 1103).
Bref le contrôle de légalité est, par la force des choses et par la construction de la jurisprudence, un contrôle lâche, relativement souple ; il laisse une large liberté d'action aux collectivités locales ; et cela se traduit par une "franchise de responsabilité" de l'État au titre de ce contrôle. De la sorte, le système de la faute lourde s'applique normalement 1 ( * ) .
B - QU'EN EST-IL MAINTENANT DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ACTIVITÉS DE CONTRÔLE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, observation faite d'emblée que la question est vraisemblablement appelée à prendre une grande importance pratique dans le proche avenir ?
1. Les autorités administratives indépendantes, qui prolifèrent aujourd'hui, ont été largement dotées d'attributions de contrôle, parfois noyées sous le vocable flou et plus large de régulation. On peut d'ailleurs se demander, à la suite du dernier rapport public du conseil d'État et de l'étude qu'il consacre aux autorités administratives indépendantes, si la régulation ne développe pas une nouvelle théorie du contrôle largement entendu ; il s'agit, selon certains auteurs, de "produire des normes destinées à discipliner un secteur déterminé",... "de développer l'action des mécanismes correcteurs qui maintiennent un système en existence" (J.B. Auby - M. Crozier) ; pour le rapport du Conseil d'État, "on attend de la régulation qu'elle mette fin en permanence aux comportements déviants ou susceptibles d'affecter les équilibres du système et plus encore, si possible, qu'elle les prévienne".
Or, pour être désormais des organes majeurs du contrôle, les autorités administratives indépendantes, si nombreuses soient-elles, n'existent pas : je veux dire par là qu'elles n'ont pas de personnalité juridique propre et qu'elles font partie de l'État. Ainsi donc, sur le terrain de la responsabilité, c'est l'État et l'État seul qui doit répondre des activités de contrôle qu'elles développent. Et ceci n'est pas sans paradoxe, si l'on veut bien considérer que, sur le plan politique, les autorités indépendantes sont apparues comme un moyen de limiter l'État, de donner une autre légitimité aux interventions en cause ; et que donc l'autorité indépendante, d'une certaine façon, se construit contre l'État dans sa facture classique ; avec en tous les cas ce résultat que ledit État est dépourvu de tout moyen d'action sur elle. Responsable du fait de l'autorité indépendante, l'État ne peut agir sur elle, puisque précisément elle est une autorité indépendante.
On devra prendre garde à cet égard à la tendance doctrinale qui s'exprime de plus en plus et qui voudrait aller dans le sens de l'accentuation de l'autonomie des autorités administratives indépendantes par rapport à l'État, tout en gardant l'appartenance de celles-là à celui-ci (voir par exemple, à propos de la commission de régulation de l'électricité, l'article de T. Tuot, CJEG 2001, p. 51). Affranchies déjà de la responsabilité politique qui est celle des organes classiques de l'État, les autorités administratives indépendantes se trouveraient également libérées de toute responsabilité juridique directe, quels que soient les termes de leur action et le caractère éventuellement dommageable de celles-ci. On rejoint là un des dangers du droit moderne de la régulation confié aux autorités administratives indépendantes ; ce "droit mou" qui ne donne pas prise au contentieux ne doit pas devenir l'expression d'une forme d'arbitraire de la part d'autorités qui ne trouvent finalement de légitimité que, précisément, dans leur indépendance.
2. Car la mise en cause de la responsabilité de l'État du fait des contrôles des autorités indépendantes n'est pas une question d'école ; elle pourrait prendre une certaine importance dans l'avenir.
Si en effet les textes institutifs de ces autorités indépendantes, qui organisent uniquement les recours en annulation et en réformation contre les décisions prises par celles-ci, sont silencieux sur les actions en responsabilité, ces dernières sont disponibles de plein droit, et les principes généraux applicables en matière de contrôle devraient naturellement gouverner ces recours.
Il est vrai qu'à ce jour la responsabilité des autorités administratives indépendantes est encore assez rarement mise en cause. Mais on peut, sans risque de se tromper, prévoir que les temps vont changer.
Et la tâche du juge dans cette configuration particulière, pour n'être pas facile, doit s'ordonner autour du système de la faute lourde conservée de l'ancien contentieux de la responsabilité du fait des activités de contrôle 1 ( * ) ; du moins devrait-il en être ainsi lorsque la loi a bien limité l'intervention de l'autorité en cause à une fonction de contrôle ; ce qui exclut toutes les hypothèses d'injonction ou de substitution.
Et c'est ce que le conseil d'État a fort opportunément rappelé, dans un récent arrêt d'assemblée qui vient annuler l'arrêt déjà cité de la cour administrative d'appel de paris pour avoir lui-même admis la responsabilité de l'État pour faute simple de la commission bancaire : « considérant que la responsabilité de l'État pour les fautes commises par la commission bancaire dans l'exercice de sa mission de surveillance et de contrôle des établissements de crédit ne se substitue pas à celle de ces établissements vis-à-vis, notamment, de leurs déposants ; que dès lors, et eu égard à la nature des pouvoirs qui sont dévolus à la commission bancaire, la responsabilité que peut encourir l'État pour les dommages causés par les insuffisances ou les carences de celle-ci dans l'exercice de sa mission ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde » (CE 30 nov. 2001, Min. éco. Fin. CI Kechichian et a., CJEG 2002, concl. M. Seban ; D. adm. 2002, n. 58; AJDA 2002, p. 133) ; rappelant notamment les solutions des principaux droits étrangers, mais aussi les principes traditionnels du droit français en la matière, le commissaire du Gouvernement avait souhaité que ceux-ci soient adoptés et confirmés en l'espèce.
Peut-on ajouter en terminant que, d'une façon générale, ces solutions conformes à la jurisprudence traditionnelle seraient d'autant mieux assurées si, dans la formulation, on se décidait à abandonner la référence mal venue à la faute lourde ou à la faute simple.
Le fait même que, dans le contentieux Commune de Saint-Florent qui a été rappelé ci-dessus, une même carence dans le contrôle de légalité ait été considérée comme une faute simple par la cour administrative d'appel puis comme une faute lourde par le conseil d'État montre bien qu'il s'agit d'une appréciation in concreto pour répondre à la question de savoir si le comportement administratif est, dans les circonstances de l'espèce, "de nature à" engager la responsabilité de l'administration ; point n'est besoin de passer par la qualification faussement objective de faute lourde ou de faute simple.
Surtout la responsabilité pour faute lourde laisse toujours le sentiment désagréable que des fautes peuvent rester sans conséquence financière pour leurs auteurs, alors même qu'ils ont mal agi, et dès lors que la faute en question n'est pas caractérisée comme lourde. Il serait plus satisfaisant de considérer qu'en deçà d'un certain seuil, il n'y a en réalité pas de comportement fautif ; et que, tout simplement, la faute se détermine et sa caractérise différemment selon les activités de l'administration.
Monsieur Pierre DELVOLVE
Nous vous remercions pour cet exposé d'une parfaite clarté et qui est au coeur du thème du dilemme de la responsabilité. Et notamment, après avoir justifié, au moins dans certaines hypothèses, l'exigence de la faute lourde, vous aboutissez à la conclusion qu'au fond il faudrait abandonner la qualification de la faute lourde, puisque aussi bien une faute a pu être qualifiée dans certains cas de simple par une juridiction et de lourde par une autre, alors qu'il s'agit exactement du même comportement.
Et alors, s'agissant des autorités administratives indépendantes qui sont dans le collimateur du dernier rapport du Conseil d'État et dans le vôtre aussi, vous avez mis en évidence un dilemme encore - le titre de cette matinée se trouve justifié, mes angoisses, pour reprendre un terme déjà utilisé, sont levées : ces autorités qui n'ont pas de personnalité juridique, qui peuvent engager la responsabilité de l'État, qui exercent un contrôle, par conséquent vont engager la responsabilité de l'État sur le fondement de la faute lourde tant qu'on n'aura pas abandonné cette exigence. Mais il n'y a pas de contrôle de l'État sur ces autorités administratives indépendantes, ce qui soulève tout un problème non plus simplement de droit mais de science administrative, de science politique, d'organisation de l'État, d'unité de l'État. Et je crois que c'est cette idée là qui était au coeur du rapport, du récent rapport du Conseil d'État.
Vous avez employé une formule qui rejoint l'exposé précédent, celle de précaution. Principe de précaution qui remet en cause les données et les fondements de la responsabilité. Précaution que les autorités de contrôle doivent prendre elles-mêmes, précaution que l'État doit prendre à l'égard des autorités de contrôle.
Les dilemmes de la responsabilité internationale aujourd'hui
par Madame Brigitte STERN,
professeur à l'Université Paris 1 * ( * )
Tous les ordres juridiques connaissent l'institution de la responsabilité, définie comme le fait pour un sujet de droit de répondre de ses actes, lorsque ceux-ci aboutissent à une rupture de l'ordre juridique ou éventuellement de l'équilibre matériel prévu par celui-ci. L'ordre juridique international ne fait pas exception à la règle et connaît donc, bien entendu, cette institution, sous le nom de responsabilité internationale. Mais en raison des spécificités de la communauté internationale, composée de sujets souverains, la responsabilité internationale a des caractéristiques propres, que je vais essayer de mettre en évidence dans ma contribution.
INTRODUCTION :
DÉLIMITATION ET MISE EN PERSPECTIVE DU SUJET
Avant de parler de l'encadrement de la responsabilité en droit international public, il convient peut-être " d'encadrer " le sujet, c'est-à-dire de préciser ce qu'à mon avis il recouvre et ce qu'il ne recouvre pas.
J'exclurai tout d'abord ce que l'on appelle la responsabilité pénale internationale : celle-ci ne concerne pas les États, mais les individus, y compris les gouvernants, qui se sont rendus coupables de certaines violations graves de règles fondamentales du droit humanitaire ou des droits de l'homme. Le Tribunal de Nuremberg a rappelé que "(c)e sont des hommes, et non des entités abstraites, qui commettent des crimes dont la répression s'impose, comme sanction du droit international" 1 ( * ) , pour justifier la poursuite des officiels nazis et non de l'État allemand.
Ce n'est cependant pas parce que la responsabilité pénale internationale ne serait pas incluse dans le sujet qui m'a été confié - elle en relève en partie 1 ( * ) -que je ne la traiterai pas, mais parce que l'importance des développements récents dans ce domaine a conduit à en faire le thème d'une autre contribution, consacrée à la responsabilité internationale des gouvernants 2 ( * ) .
Je ne parlerai que brièvement ensuite de ce que seuls des internationalistes sont capables d'inventer, à savoir ce qu'ils ont appelé d'un vocable poétique, la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables résultant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, ou encore d'activités ni licites, ni illicites, c'est-à-dire ce que l'on nomme plus communément la responsabilité pour risque.
L'étude de la codification dans ce domaine a débuté à la Commission du droit international (CDI ci-après) en 1978, et s'est très vite enlisée dans des débats sans fin sur la définition des activités qui ne sont pas interdites par le droit international 3 ( * ) . Devant l'impasse des travaux, un Groupe de travail a été mis sur pied pour tenter de débloquer les choses. Les conclusions auxquelles il est parvenu sont que, et je cite, " la portée et la teneur du sujet demeuraient floues, en raison, par exemple, des difficultés d'ordre conceptuel et théorique concernant l'intitulé... du sujet" 1 ( * ) . Celui-ci a donc été revu, et la CDI, tout en considérant qu'elle devrait à terme examiner aussi bien les questions de prévention que celles de responsabilité, a dans un premier temps décidé de poursuivre ses travaux sous le sous-titre de " Prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses". 2 ( * ) Le sujet est donc considérablement réduit et réorienté, la responsabilité ne se trouvant plus au centre des préoccupations.
Que peut-on dire cependant de la responsabilité pour risque telle qu'elle se dessine en droit international public ? Qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas de principe coutumier général reconnaissant une responsabilité objective en droit international. Une telle responsabilité pour faits licites "suppose que la société... ait une homogénéité suffisante pour que les notions de justice, d'équilibre, de solidarité, d'égalité devant les charges ou devant la mauvaise fortune... y soient reçues... En droit international, rien de tel, bien sûr ; la responsabilité pour faits licites n'y est donc admise qu'à titre exceptionnel, et sur la base de textes précis, en particulier relatifs à la responsabilité du fait des choses et activités dangereuses" 3 ( * ) .
Mais s'il n'y a pas de règle coutumière générale en la matière, un certain nombre de règles conventionnelles se sont développées : plus précisément, il existe plusieurs conventions internationales prévoyant une telle responsabilité pour risque, mais celle-ci, à une exception près, est à la charge des opérateurs économiques engagés dans les activités dangereuses et non à la charge des États. 4 ( * ) Un seul traité, celui sur la responsabilité internationale pour les dommages lancés par les engins spatiaux permet de mettre en cause la responsabilité internationale - au sens du droit international public - de l'État de lancement, sans qu'une faute soit prouvée.
Cet aspect de la responsabilité sera donc également écarté de mon propos, car le droit international public joue ici un rôle au niveau de la source des normes, sans contenir - si ce n'est marginalement - de normes applicables aux relations entre les sujets du droit international public, à savoir essentiellement les États.
Reste donc le coeur du sujet, la responsabilité internationale pour fait illicite. Des lames de fond majeures ont complètement bouleversé le paysage traditionnel de la responsabilité internationale. Si je m'étais adressé à vous il y a trente ans, les choses auraient été bien différentes : d'abord j'aurais eu 30 de moins, ce qui tout en n'étant pas pertinent pour mon sujet, aurait été très agréable ; ensuite, j'aurais été jeune agrégée venant de terminer sa thèse sur "Le préjudice dans la théorie de la responsabilité internationale" 1 ( * ) , et mes idées auraient été bien plus claires et pertinentes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, eh bien, j'ai perdu mes belles certitudes de jeunesse et je ne sais plus trop comment vous présenter la responsabilité internationale.
L'organisateur de ce colloque, mon collègue et ami Gilles Darcy avec lequel je partage une vieille complicité, n'est pas le premier à avoir cherché à "encadrer" la responsabilité internationale. À vrai dire la communauté internationale peine depuis plus de 70 ans pour codifier les règles de la responsabilité internationale, c'est-à-dire tenter de dégager un minimum de règles gouvernant la responsabilité des États, mais du fait des enjeux en cause, la codification n'a pas abouti à l'adoption d'une convention internationale.
Elle a pourtant été entreprise dès 1930, sous la forme d'une tentative de codification des règles relatives à la responsabilité internationale pour dommages causés à la personne ou aux biens des étrangers. Cette tentative a tourné court, parce que plutôt que de codifier les conséquences de la violation des règles, on a cherché à préciser le contenu des règles concernant le traitement des étrangers. La même erreur d'optique a été recommencée après la guerre, lorsque la CDI a repris la codification de la responsabilité des États à l'égard des étrangers : de 1957 à 1962, le rapporteur spécial Garcia Amador a présenté six rapports, sans que les choses ne progressent vraiment.
Le tournant a eu lieu en 1963, avec la nomination d'Ago comme rapporteur spécial : sous son égide, un changement d'orientation crucial a eu lieu, avec la claire distinction qu'il a faite entre les règles primaires concernant les obligations des États et les règles secondaires relatives à la responsabilité qui résulte de la violation des règles primaires 2 ( * ) .
Depuis cette date, la CDI s'est concentrée sur la codification et le développement progressif (ou d'ailleurs plus que progressif) 3 ( * ) des règles secondaires, sur lesquelles on espérait que les États se mettraient plus facilement d'accord.
Malgré cette limitation aux mécanismes techniques de la responsabilité internationale, les choses ont progressé très lentement :
- 1963-1976, 8 rapports présentés par Ago ;
- 1976-1986, 7 rapports présentés par Riphagen ;
- 1986-1996, 8 rapports présentés par Arangio-Ruiz 4 ( * ) ;
- 1996-2001, 3 rapports présentés par Crawford.
Les résultats d'étape ont été les suivants : l'adoption de la première partie de 35 articles sur l'origine de la responsabilité en première lecture en 1980 1 ( * ) , un projet complet d'articles sur la responsabilité des États, de 60 articles plus deux annexes, adopté en première lecture le 12 juillet 1996 2 ( * ) ; un nouveau projet complet d'articles, de 59 articles, adopté en deuxième lecture le 21 août 2000 3 ( * ) . Dès sa prise de fonction, le rapporteur spécial actuel avait déclaré son intention de terminer cette longue marche en 2001, sans que l'on sache à ce moment là si le résultat de tant d'efforts serait une simple déclaration ou une convention. On sait que c'est la première solution qui l'a finalement emporté 4 ( * ) , même si l'avenir est préservé, ainsi qu'il ressort de la recommandation adoptée par la CDI à la fin des travaux sur la responsabilité internationale :
"À sa 2709e séance, le 9 août 2001, la Commission a décidé, conformément à l'article 23 de son Statut de recommander à l'Assemblée générale de prendre acte du projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite dans une résolution, et d'annexer le projet d'articles à la résolution.
La Commission a décidé également de recommander que l'Assemblée générale envisage la possibilité, à un stade ultérieur et compte tenu de l'importance du sujet, de convoquer une conférence internationale de plénipotentiaires pour examiner le projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite en vue de la conclusion d'une convention sur ce sujet. La Commission a estimé que la question du règlement des différends pourrait être traitée par la Conférence internationale susmentionnée, si celle-ci considérait, qu'il faudrait prévoir un mécanisme juridique de règlement des différends dans le cadre du projet d'articles" 5 ( * ) .
Les résultats sont donc à ce jour un peu décevants, même si, comme l'a souligné le membre français de la CDI, il y a au moins un aspect positif, à savoir que "(l)a codification du droit de la responsabilité internationale entreprise par la Commission du droit international depuis le milieu des années 1950 a été l'occasion d'une réflexion sans précédent sur le concept même de responsabilité internationale" 6 ( * ) .
C'est à cette réflexion que je voudrais vous faire participer. En commençant par une interrogation : pourquoi tant de difficultés à se mettre d'accord sur les principes de base de la responsabilité ?
Pour répondre à cette question complexe, le mieux est peut-être de repartir de la définition classique de la responsabilité internationale, pour arriver à donner la mesure des bouleversements récents : selon la définition du Dictionnaire Basdevant, la responsabilité internationale se définit en effet, comme "l'obligation incombant selon le droit international, à l'État auquel est imputable un acte ou une omission contraire à ses obligations internationales, d'en fournir réparation à l'État qui en a été victime en lui-même ou dans la personne ou les biens de ses ressortissants" 1 ( * ) .
Cette définition soulève un problème classique, qui est celui de l'imputation d'actes nécessairement commis par des personnes physiques à la personne morale que constitue l'État. Si la CDI n'a fait dans ce domaine que codifier des règles coutumières bien établies et qui n'étaient guère contestées, ainsi que cela ressort des débats, ces questions ont donné lieu à un certain nombre d'applications récentes dans des affaires importantes, qui ont permis de préciser les contours de l'imputation de certains actes à l'État (I).
Mais des débats autrement plus fondamentaux ont cours sur d'autres aspects de la responsabilité internationale. Comme il ressort de la définition classique 2 ( * ) , la responsabilité reposait sur les "trois piliers" que sont le fait illicite, le dommage et le lien de causalité. En regard, on peut citer la définition qu'en donne le projet actuel de la CDI, en précisant que cet article 1 n'a pas été modifié depuis le début des travaux : "Tout fait internationalement illicite d'un État engage sa responsabilité internationale". Il n'est plus fait mention ni du dommage, ni du lien de causalité.
Des trois piliers, deux ont disparu du projet de codification, ce qui évidemment met les choses dans une toute autre perspective. Il y a là une volonté de faire naître la responsabilité dès lors que l'ordre juridique international est violé, autrement dit d'introduire un certain contentieux de la légalité par le biais de l'institution de la responsabilité internationale. Bien qu'il ne soit pas possible d'examiner ici, tous les tenants et les aboutissants de cette nouvelle orientation de la responsabilité internationale, je voudrais insister sur deux aspects particulièrement controversés : l'un qui est la volonté de mettre en oeuvre cette légalité internationale par l'introduction de la notion de crime international, sous ce vocable ou un autre (II) ; l'autre qui est la volonté d'élargir les conséquences de la responsabilité internationale au delà de la réparation et d'y inclure les contre-mesures pour la rendre plus effective (III).
En d'autres termes, les innovations principales du projet sont d'avoir tenté de diversifier la responsabilité internationale en introduisant différentes catégories d'actes illicites d'une part, et d'avoir fait le choix d'une conception extensive de la responsabilité internationale d'autre part. Ces deux nouveautés ont donné lieu à d'intenses controverses.
I - LE PROBLÈME CLASSIQUE DE L'IMPUTATION
Les États ne peuvent agir que par l'intermédiaire de personnes physiques qui entretiennent avec eux certaines relations. L'État souverain ne va être considéré comme responsable que des actes qui sont suffisamment liés à lui, à sa souveraineté, pour qu'il ait à répondre de leurs conséquences. L'étendue de l'imputabilité de certains actes à l'État va donc épouser les contours de sa souveraineté.
1. Les règles d'imputation
Ne pose aucun problème l'imputation à l'État des actes de tous ses agents et organes, des collectivités territoriales ou démembrements, des entités publiques ou privées exerçant des prérogatives de puissance publique, même s'ils agissent ultra vires, dès lors qu'ils sont apparus comme agissant è s qualité. Ne pose pas non plus de problème l'imputation à un État des actes des fonctionnaires de fait, ou de ceux de révolutionnaires victorieux qui se sont installés au pouvoir. Enfin, n'est guère controversé le fait que l'État doit assumer les conséquences d'actes de personnes privées qu'il avait l'obligation d'empêcher ou de punir, mais il s'agit alors moins d'imputer à l'État des actes de particuliers que de le rendre responsable de sa propre violation d'une obligation de due diligence 1 ( * ) qui lui incombe en vertu du droit international 2 ( * ) .
Mais l'État peut également être considéré responsable des actions de certaines personnes privées ou groupes extérieurs à la structure étatique, et n'étant pas habilitées à exercer des prérogatives de puissance publique, si d'une façon ou d'une autre ces personnes ou ces groupes peuvent être considérés comme agissant pour son compte. Différentes hypothèses peuvent se rencontrer dans lesquelles des particuliers sont considérés comme agissant pour le compte de l'État :
- il en est ainsi si l'État, en les reprenant explicitement ou implicitement à son compte, fait siennes en les approuvant à posteriori les actions de certaines personnes ou de certains groupes ;
- il en est ainsi également si l'État contrôle entièrement ces personnes ou groupes de personnes et peut donc être considéré comme ayant donné un aval à priori à leurs actes. Ce test du contrôle a donné lieu à d'âpres débats dans la jurisprudence récente.
2. Quelques exemples jurisprudentiels
La première hypothèse peut être illustrée par l'affaire du Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran. On sait que des "militants" ont pris d'assaut l'ambassade américaine à Téhéran, le 4 novembre 1979. La Cour internationale de Justice (CIJ) saisie de la question de la responsabilité de l'Iran pour cette atteinte grossière à l'inviolabilité diplomatique, a considéré que le jour de la prise de l'ambassade, on ne pouvait considérer que les militants agissaient au nom de l'Iran. Mais très vite, les autorités iraniennes en approuvant l'action des militants, en ont assumé la responsabilité internationale : "L'ayatollah Khomeini et d'autres organes de l'État iranien ayant approuvé ces faits et décidé de les perpétuer, l'occupation continue de l'ambassade et la détention persistante des otages ont pris le caractère d'actes dudit État." 1 ( * )
La question du contrôle a été au coeur de deux autres affaires importantes, l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci devant la CIJ et l'affaire Tadic devant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY).
L'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua illustre parfaitement les difficultés soulevées par la détermination de l'étendue du contrôle justifiant l'imputation ou, pour utiliser une formule anglo-saxonne aujourd'hui plus en cours "l'attribution" des actes de personnes privées à l'État : si les actes des UCLA (Unilaterally Controlled Latino Assets), individus isolés recevant leurs instructions et leur rémunération des Américains ont été attribués sans difficulté aux États-Unis, il n'en est pas allé de même des actes des contras, malgré leur très forte dépendance à l'égard du soutien américain : "la Cour tient... pour établi que les autorités des États-Unis ont dans une large mesure financé, entraîné, équipé, armé et organisé" les forces contras. Pourtant leurs actes n'ont pas été imputés aux États-Unis : "Malgré les subsides importants et les autres formes d'assistance que leur fournissent les États-Unis, il n'est pas clairement établi que ceux-ci exercent en fait sur les contras dans toutes leurs activités une autorité telle qu'on puisse considérer les contras comme agissant en leur nom." 2 ( * ) Et la CIJ de préciser : "... même prépondérante ou décisive, la participation des États-Unis à l'organisation, à la formation, au financement et à l'approvisionnent des contras, à la sélection de leurs objectifs militaires ou paramilitaires et à la planification de toutes leurs opérations demeure insuffisante en elle-même, d'après les informations dont la Cour dispose, pour que puissent être attribués aux États-Unis les actes commis par les contras au cours de leurs opérations militaires ou paramilitaires au Nicaragua. Toutes ces modalités de participation des États-Unis qui viennent d'être mentionnées, et même le contrôle général exercé par eux sur une force extrêmement dépendante à leur égard, ne signifierait pas par eux-mêmes, sans preuve complémentaire, que les États-Unis aient ordonné ou imposé la perpétration d'actes contraires aux droits de l'homme ou au droit humanitaire allégués par l'État demandeur" 1 ( * ) . Pour que des actes de groupes d'individus soient attribués à l'État, il faut donc, selon la CIJ, d'une part un contrôle général de l'État sur le groupe, d'autre part un ordre particulier ou une injonction précise de commettre les actes controversés.
L'utilisation de critères aussi stricts a donné lieu à d'intenses débats dans l'affaire Tadic 2 ( * ) , notamment en première instance entre la majorité de la Chambre et sa Présidente, dissidente.
La question de l'imputation d'actes de l'armée des Serbes de Bosnie à la République fédérale de Yougoslavie (RFY), outre les problèmes de responsabilité éventuelle de la RFY qu'elle pouvait soulever dans d'autres enceintes, était centrale pour la qualification du conflit en cours en Bosnie comme conflit international ou non international, ce qui, on le sait, entraîne un régime de protection différent pour les protagonistes.
Pour démontrer que l'armée de la Republika Srbska n'était pas contrôlée par l'armée yougoslave c'est-à-dire la RFY, les juges de la majorité ont appliqué rigoureusement le test dégagé par la CIJ dans l'affaire du Nicaragua et ont considéré que l'armée des Serbes de Bosnie n'était pas à l'égard de Belgrade dans une dépendance telle que tous ses actes pouvaient être imputés à la RFY : selon la Chambre, il y avait une importante dépendance, y compris financière, puisqu'un certain nombre d'officiers de l'armée de la Republika Srbska étaient payés par la RFY, dépendance qui pouvait aller jusqu'à une aide directe de l'armée yougoslave ; mais cela indiquait simplement d'après les juges de la majorité, une coordination entre les deux armées, une similitude d'objectifs, et non une utilisation par la RFY de "son potentiel de contrôle" sur l'armée des Serbes de Bosnie, pour les différents actes commis par elle. La présidente Mme Mc Donald a rédigé une opinion dissidente dans laquelle elle soutient au contraire que tous les éléments étaient réunis pour que l'armée de la Republika Srbska - qui n'était que la continuation de l'armée yougoslave après la déclaration d'indépendance de la Bosnie - soit considérée comme agissant au nom de la RFY : selon ses termes, "(r)estaient les mêmes armes, le même matériel, les mêmes officiers, les mêmes commandants, en grande partie les mêmes troupes, les mêmes centres de logistique, les mêmes fournisseurs, la même infrastructure, la même source de paiements, les mêmes buts et missions, les mêmes tactiques et les mêmes opérations. Plus important encore, l'objectif demeurait le même : créer un État serbe ethniquement pur en unissant les Serbes" 3 ( * ) .
La Chambre d'appel dans une décision extrêmement motivée a donné raison à la Présidente, mais en suivant un autre raisonnement qu'elle, et a donc considéré que l'armée bosno-serbe devait être considérée comme contrôlée par l'armée yougoslave, et donc la FRY. La Chambre d'appel critique la position de la CIJ dans l'affaire du Nicaragua, considérant que celle ci est "contraire à la logique même de tout le système de droit international sur la responsabilité des États" 1 ( * ) . Cette logique c'est de rendre l'État responsable de tout ce qu'il contrôle en droit ou en fait :
"D'une manière générale, on peut dire que l'ensemble des règles du droit international régissant la responsabilité des États est basé sur une conception réaliste de la responsabilité, qui ignore le formalisme juridique et vise à garantir que les États qui confient des fonctions à des individus ou des groupes d'individus répondent de leurs actions, même quand ces derniers ne suivent pas leurs instructions" 2 ( * ) .
Si, à la limite, la nécessité d'un contrôle sur chacun des actes de l'entité contrôlée de facto peut être admise pour les individus isolés ou rassemblés en groupes informels, il en va différemment pour le contrôle sur un groupe militaire ou para-militaire hiérarchiquement organisé : un contrôle global suffit, sans qu'il soit nécessaire de prouver que des ordres spécifiques ont été donnés pour chaque action (il s'agissait ici des exactions commises dans la région de Prijedor par l'armée bosno-serbe) entreprise par ce groupe. Selon la Chambre d'appel :
"Pour imputer la responsabilité d'actes commis par des groupes militaires ou paramilitaires à un État, il faut établir que ce dernier exerce un contrôle global sur le groupe, non seulement en l'équipant et le finançant, mais également en coordonnant ou en prêtant son concours à la planification d'ensemble de ses activités militaires. Ce n'est qu'à cette condition que la responsabilité internationale de l'État pourra être engagée à raison des agissements illégaux du groupe. Il n'est cependant pas nécessaire d'exiger de plus que l'État ait donné, soit au chef du groupe soit à ses membres, des instructions ou directives pour commettre certains actes spécifiques contraires au droit international" 3 ( * ) .
Appliquant ce test aux faits de l'affaire, la Chambre d'appel a conclu qu'il fallait considérer l'armée de la Republika Srbska comme contrôlée par la RFY 4 ( * ) , ce qui faisait du conflit en Bosnie-Herzégovine un conflit international, et permettait donc la poursuite de Tadic pour violations graves des conventions de Genève, c'est-à-dire crimes de guerre.
II- LES DILEMMES POSES PAR LA NOTION DE CRIME INTERNATIONAL DE L'ÉTAT
Dans la mise en oeuvre du contrôle de légalité effectué par le biais de la responsabilité internationale, s'est développée dans les dernières années, notamment dans le cadre de la CDI, l'idée qu'il y a des règles plus ou moins importantes et donc une hiérarchie objective dans les violations du droit international qui peuvent être commises par les États.
1. L'introduction de la distinction entre les crimes et les délits
C'est l'origine de la fameuse distinction entre les crimes et les délits posée dans le célèbre article 19 du projet de la CDI, version 1996, dont le § 2 énonce :
"Le fait internationalement illicite qui résulte d'une violation par un État d'une obligation si essentielle pour la sauvegarde d'intérêts fondamentaux de la communauté internationale que sa violation est reconnue comme un crime par cette communauté dans son ensemble constitue un crime international."
Les exemples de " crimes internationaux " donnés dans ce même article 19 concernent les atteintes à la paix internationale, au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à la sauvegarde de l'être humain dans ce qu'il a d'irréductible, à la préservation de l'environnement humain. Cette liste des crimes internationaux de l'État présente des similitudes certaines avec les " crimes de droit international ", dont peuvent être reconnus responsables les individus, que la CDI codifie par ailleurs sous l'intitulé général de "Code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité". Il est bien précisé que cette liste n'est pas exhaustive, mais simplement donnée à titre d'illustration. Cette introduction de la notion de crime international traduit sans aucun doute un "mouvement vers plus d'éthique" dans l'ordre international. 1 ( * ) Il est incontesté qu'il y a des actes plus ou moins graves, plus ou moins attentatoires aux valeurs de la société internationale :
"Personne ne contestera que tous les actes illicites n'ont pas la même gravité : qui ne ressent qu'il n'y a pas grand chose en commun, sinon la qualification juridique aujourd'hui encore donnée en droit positif, entre une violation mineure [ou même majeure] d'un traité de commerce et un génocide ?" 2 ( * )
Traditionnellement, il n'y avait aucune différentiation de la responsabilité internationale, ni selon la source de la norme violée - conventionnelle ou coutumière - ni selon la nature de la norme violée - c'est-à-dire sa plus ou moins grande importance pour le maintien de l'ordre juridique. On sait par contre que les droits internes différencient clairement deux sortes de responsabilité selon la nature de la norme violée : responsabilité civile entraînant une obligation de réparer, responsabilité pénale entraînant l'application d'une peine.
C'est incontestablement ce genre d'analyse qui est à l'origine de la distinction qui avait été retenue par la CDI, à la suite des propositions d'Ago. Pour lui, une simple réparation n'est pas suffisante pour les actes les plus attentatoires aux valeurs de la société internationale : "l'obligation de réparer... se propose de réaliser la situation qui aurait existé si le délit n'avait pas été commis. C'est donc une simple fonction de réintégration ou de compensation qui lui ressort... La sanction est d'une nature tout à fait différente... Elle a au contraire une nature afflictive ou répressive." 1 ( * ) C'est cette idée d'une sanction venant s'ajouter à la réparation lorsqu'il y a commission d'un crime international qu'Ago a essayé de faire adopter par la CDI, ainsi qu'il l'explique dans un de ses rapports : "Jusqu'ici... la responsabilité se définissait essentiellement comme une responsabilité civile. Or il s'agit de savoir s'il ne se dégage pas de l'ensemble des fait internationalement illicites, une catégorie de faits dont la nature et les conséquences peuvent être différentes, des faits pour lesquels il est notamment impensable de se satisfaire d'une simple réparation. C'est le cas, par exemple, de certains crimes internationaux comme la violation de certaines obligations essentielles au maintien de la paix, l'agression notamment ou, dans d'autres domaines, le génocide." 2 ( * )
2. L'évolution des conséquences tirées de l'existence d'un crime international
Au départ, Ago semble donc avoir lancé son idée avec en arrière plan celle de responsabilité pénale de l'État.
Mais lorsque sa proposition d'article 19 a été discutée et adoptée en 1976 (à l'unanimité, il faut le rappeler), on parlait seulement d'une responsabilité " différente " pour les crimes - de celle encourue pour les délits internationaux - sans que celle-ci soit qualifiée de pénale, la différence venant notamment du fait qu'en cas de crime, c'est la communauté toute entière qui est atteinte, et que pourrait donc être envisagée soit une réaction collective au crime, soit une réaction possible de tous les États, qui pourraient prendre des contre-mesures qui s'ajouteraient à la réparation due en cas de simple fait illicite. L'idée d'une responsabilité pénale ou même simplement différente a cependant petit à petit été abandonnée, face aux réticences des États à l'idée d'être passibles d'une sanction internationale pour crime commis. Les États souverains, en effet, trop réticents à l'idée qu'ils puissent encourir une "punition", tout en acceptant dans le projet de la CDI la distinction des crimes et des délits, n'en ont guère tiré de conséquences décisives.
En 1996, lors des débats sur les conséquences des crimes, les mesures supplémentaires envisagées, même si certaines peuvent avoir une connotation afflictive ou punitive n'avaient aucune dimension pénale, et l'on pourrait même dire qu'elles ne mettent pas en oeuvre une responsabilité différente de la responsabilité pour délit, seulement une responsabilité de même nature légèrement aggravée, ce qui obère considérablement l'intérêt de la distinction proposée.
L'intérêt de la distinction de différentes catégories de violations du droit introduite par le projet de la CDI paraît en effet plus que limité quand à la différentiation des conséquences qui en sont tirées relativement au contenu de la responsabilité encourue.
Les "conséquences supplémentaires" résultant d'un crime international, c'est-à-dire s'ajoutant aux conséquences d'une "simple" violation du droit, sont précisées aux articles 52 et 53 du projet de la CDI de 1996. L'article 52 se penche sur les obligations pouvant être mises à la charge de l'État criminel, l'article 53 sur les obligations de comportement des autres États face à l'État qui a commis un crime international.
La première conséquence d'un crime international, (article 52 a) est qu'en cas de réparation sous forme de restitutio in integrum, celle-ci peut, contrairement à ce qui se passe en cas de "simple" violation du droit international, imposer "une charge hors de toute proportion avec l'avantage que l'État lésé gagnerait en obtenant la restitution en nature plutôt qu'une indemnisation", et "menacer sérieusement l'indépendance politique ou la stabilité économique de l'État" qui a commis le crime international.
La seconde conséquence d'un crime international, (article 52 b) est qu'en cas de demande de satisfaction, l'octroi d'une telle mesure peut, contrairement à ce qui se passe en cas de "simple" violation du droit international, "porter atteinte à la dignité de l'État" qui a commis le crime international, en vertu de l'idée qu'il a déjà renoncé à toute dignité en commettant précisément un crime international.
Enfin, face à un État criminel, les autres États ont certaines obligations de comportement, qui paraissent assez vagues : ne pas reconnaître la situation créée par le crime (article 53 a), ne pas prêter assistance à l'État criminel (article 53 b), coopérer avec les autres États pour remplir les deux obligations précédentes (article 53 c), ainsi que pour appliquer les mesures visant à éliminer le crime (article 53 d).
Il n'y a pas là de propositions extrêmement révolutionnaires. Qui plus est, ces propositions s'appliquent peu ou prou dès qu'il y a une violation grave d'une règle internationale.
Selon un auteur, "(d)e très fortes raisons, tant théoriques que pratiques, militent en faveur du maintien de la distinction entre deux catégories distinctes de faits internationalement illicites, même si l'on peut, dans le détail, éprouver quelque doute sur le bien-fondé des dispositions adoptées par la Commission, qu'il s'agisse des exemples donnés au paragraphe 3 de l'article 19 et dont elle a cru devoir assortir sa définition, de la terminologie retenue, dont la connotation pénaliste est trompeuse, ou des conséquences que la deuxième partie du projet tire de cette nécessaire distinction... le régime juridique des crimes envisagé par les articles 51 à 53 prête le flanc à la critique 1 ( * ) , au point d'ailleurs que, si l'on devait s'en tenir à ces dispositions, on pourrait s'interroger sur la pertinence de la distinction entre les crimes et délits." 1 ( * )
3. L'abandon récent du terme de crime, mais non de l'idée qu'il recouvre
Face aux réticences de nombreux États, le dernier rapporteur spécial a proposé dans le projet 2000 d'écarter la notion de crime international, trop connotée pénalement, pour parler de "violations graves d'obligations essentielles envers la communauté internationale".
En réalité, comme le souligne le membre américain de la CDI, M. Rosenstock, "l'article 19 ne fait guère que refléter le climat et l'atmosphère politiques des années 60 et 70" 2 ( * ) , où il avait été adopté à l'unanimité.
Le nouvel article 41 du projet de mai 2001 est un modèle de "langage-ONU" :
"1. Le présent chapitre s'applique à la responsabilité internationale découlant d'un fait internationalement illicite qui constitue une violation grave par un État d'une obligation internationale envers la communauté internationale dans son ensemble et essentielle pour la protection de ses intérêts fondamentaux.
2. La violation d'une telle obligation est grave si elle dénote que l'État responsable s'est abstenu de façon flagrante ou systématique d'exécuter l'obligation, risquant de causer une atteinte substantielle aux intérêts fondamentaux protégés par celle-ci."
Les conditions d'existence de ce qui était qualifié de crime international n'apparaissent plus très clairement : il semblerait qu'il faille de façon cumulative que la violation soit grave, qu'elle viole une règle erga omnes, mais seulement si cette règle erga omnes est essentielle pour la protection des intérêts fondamentaux de la communauté internationale dans son ensemble : ne serait-ce pas là une façon de dire, sans le dire, que l'ancien crime international est désormais défini comme une violation grave d'une norme de jus cogens ? On peut s'étonner que ne soit retenue qu'une violation grave du jus cogens, toute violation d'une règle de jus cogens me semblant par définition grave. Mais là où la surprise est totale, c'est lorsqu'il est dit qu'une violation est grave si elle "risque" de causer une atteinte aux intérêts fondamentaux protégés par l'obligation violée, ce qui laisse supposer qu'il y a des violations du jus cogens qui n'ont pas un tel effet et qui seraient donc traitées comme un fait illicite quelconque.
Mais la version de mai 2001 n'était guère plus satisfaisante sur le plan des conséquences tirées de ces violations graves d'obligations essentielles envers la communauté internationale dans son ensemble. Outre que sont reprises les vagues obligations de l'ancien article 53, finalement dans son dernier état, ce qu'ont trouvé les membres de la CDI, en cas de violation grave d'obligations dues à la communauté internationale dans son ensemble, c'est l'idée du payement de "dommages et intérêts correspondant à la gravité de la violation" 1 ( * ) , c'est-à-dire des dommages et intérêts punitifs, ce qui personnellement me semble à la fois inadapté et dérisoire : tant d'années pour arriver à faire suivre le crime d'un État d'une "indemnité" !
Ces critiques ont eu pour conséquence une nouvelle modification dans le sens de la sobriété mais aussi de la banalisation ;
L'article 40 définitivement adopté se lit ainsi :
"1. Le présent chapitre s'applique à la responsabilité internationale qui résulte d'une violation grave par l'État d'une obligation découlant d'une norme impérative du droit international général.
2. La violation d'une telle obligation est grave si elle dénote de la part de l'État responsable un manquement flagrant ou systématique à l'exécution de l'obligation."
Ce qui était le crime international est donc devenu une violation du jus cogens. Et les conséquences particulières prévues à l'article 41 dans sa version définitive ne le sont pas : les dommages et intérêts punitifs n'ont pas été conservés, mais les seules conséquences explicites sont que "(l)es États doivent coopérer pour mettre fin aux violations graves des normes de jus cogens et ne doivent pas reconnaître la situation née de cette violation.
L'idée de responsabilité pénale des États, sous-jacente - au moins à l'origine -à cette distinction, a donc été abandonnée en cours de route ; si cela s'est produit, c'est que son introduction "suppose une société plus intégrée que ne l'est la collectivité des États, et surtout assez centralisée pour dégager des organes aptes à y occuper le rôle que joue en droit interne l'appareil répressif de l'État." 2 ( * )
4. Quelques réflexions sur la responsabilité pénale des États
En supposant que l'on veuille conserver la notion de crime international, qui après tout fait sens, que faut-il penser d'une éventuelle responsabilité pénale des États ?
De nombreux États sont évidemment très hostiles à cette idée.
Certains sont hostiles à l'idée de responsabilité pénale de l'État, du fait de la difficulté à trouver des sanctions pénales. C'est ainsi que le délégué des États-Unis à la Sixième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré en 1983 que "(l)a notion nouvelle de responsabilité pénale de l'État n'a aucun sens..." ajoutant : "c'est une idée ahurissante que d'envisager de mettre en prison un État ou de punir de quelqu'autre façon un État" 1 ( * ) . Plus récemment, en 1998, la France, elle aussi très hostile à l'idée de responsabilité pénale des États, a indiqué que c'était une notion qui se contredit elle-même : en effet l'État" seul titulaire du droit de punir, ne saurait se punir lui-même. On voit mal qui, dans une société de plus de 180 États, détenteurs du droit de punir, pourrait sanctionner pénalement les détenteurs de la souveraineté" 2 ( * ) .
Qui plus est, plusieurs États ont invoqué le développement du droit international pénal à l'égard des individus pour défendre l'inutilité du développement d'une responsabilité pénale des États, voire ont prédit un possible effet pervers d'un tel développement sur les avancées réalisées au plan de la responsabilité pénale individuelle !
Ainsi par exemple, l'Autriche affirme t-elle que "les efforts visant à créer une Cour criminelle internationale en vue d'empêcher et de réprimer les actes criminels commis par des individus et par des organes d'un État, permet peut-être mieux que la criminalisation du comportement des États de lutter efficacement contre les violations graves de normes fondamentales du droit international, telles que les droits de l'homme et le droit humanitaire" 3 ( * ) . Dans le même sens, les États-Unis déclarent que "(b)ien que certains observateurs estiment que la responsabilité pénale de l'État et celle de l'individu peuvent coexister, un individu auteur d'un crime pourrait aller jusqu'à se décharger d'une partie de sa responsabilité sur l'État en invoquant les dispositions relatives aux crimes d'État" 4 ( * ) . L'Irlande également, constatant le développement positif de la responsabilité pénale internationale des individus, déclare craindre que "l'attribution d'une responsabilité pénale aux États risque de l'affaiblir, voire d'entraver la dynamique nécessaire à la création d'une cour criminelle internationale" 5 ( * ) . La France abonde dans le même sens, puisqu'elle considère que la création des tribunaux pénaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, comme de la future CPI "qui mettent l'accent sur la responsabilité pénale des individus, font perdre de sa substance à une logique de répression pénale des États" 6 ( * ) .
Nul doute qu'il y ait là une certaine hypocrisie des États, pour qui tous les arguments sont bons pour se soustraire à la responsabilité pénale, mais en même temps, ces remarques soulèvent de vrais problèmes.
S'il y a quelqu'excès dans les dénonciations par les États de la responsabilité pénale qui pourrait leur être reconnue, elles n'en témoignent pas moins de certaines difficultés qui sont de deux ordres : d'une part, la difficulté de trouver une instance susceptible de décider d'éventuelles sanctions pénales de façon objective ; d'autre part, la difficulté non moins grande de trouver des sanctions véritablement adaptées pour punir des États considérés comme criminels.
Pour ce qui est de la mise en oeuvre des sanctions pénales, le problème n'est guère différent de celui de la mise en oeuvre du droit international en général, même si l'absence de mécanisme objectif et susceptible de traiter également tous les États est plus choquante dans ce qui serait le domaine pénal que dans les autres domaines. On pourrait évidemment songer au Conseil de sécurité déjà chargé de la sanction des violations de la paix et de la sécurité internationales ou des menaces à cette paix - qui est un des crimes envisagés dans l'ancien article 19 - dans le cadre du Chapitre VII. Mais, outre qu'il faudrait pour cela une révision de la Charte de l'ONU, ce que peu d'États sont prêts à envisager, craignant de jouer les apprentis sorciers, on voit bien que d'une part, les Cinq Grands ne seraient jamais susceptibles d'être mis en cause sur le plan pénal du fait de l'existence du veto, et que d'autre part, l'existence de cet organe ne garantit pas toujours une parfaite objectivité, comme en témoigne le refus obstiné des États-Unis de lever les sanctions contre l'Irak, en vigueur depuis 1992.
Si l'on voulait vraiment introduire l'idée de crime international, il conviendrait de prévoir, pour les faits ainsi qualifiés, de véritables sanctions décidées par des autorités internationales investies pour ce faire, et non pas ces fausses "sanctions" que sont les contre-mesures. La République tchèque, par exemple, favorable à la distinction des crimes et des délits, est cependant consciente que n'a pas encore été dégagé un véritable système permettant d'en gérer les conséquences et déclare qu "(à) plus long terme, un régime viable de responsabilité pour les crimes n'est sans doute pas idéalement concevable sans développement d'un mécanisme approprié de sa mise en oeuvre" 1 ( * ) .
Mais à supposer même que l'on trouve miraculeusement une instance objective et s'appliquant à tous, reste ouverte, et difficile à résoudre, la nature des sanctions envisageables.
On sait que le projet de 1996 avait prévu des sanctions supplémentaires en matière de crimes totalement dérisoires. Comme indiqué précédemment, le projet de mai 2000 n'était guère plus satisfaisant, peut-être même au contraire, puisqu'il reprenait les faibles idées de 1996 et leur ajoutait une indemnité fonction de la gravité de l'acte ! Et la solution finale est un retour à une quasi-absence de conséquences supplémentaires pour la violation d'une norme de jus cogens.
D'autres idées ont été lancées ici et là : une forme de châtiment pourrait consister à imposer à l'État une lourde charge financière. On a même pu songer à la possibilité d'ôter à l'État une partie de son territoire. Une idée originale a également été proposée récemment par un professeur japonais 2 ( * ) , à savoir que lorsqu'un État a commis un crime, il a l'obligation de changer sa structure de Gouvernement.
On peut également, par analogie encore une fois avec ce qui se passe en cas d'atteinte à la paix et la sécurité internationales, songer à imposer à l'État des sanctions économiques. Mais ni les réparations imposées à l'Allemagne à la suite de la première et de la seconde guerres mondiales pour la punir de ses agressions, ni les sanctions imposées à l'Irak ne semblent des solutions satisfaisantes qu'il conviendrait de pendre pour modèle. Outre que ces sanctions frappent le peuple plus que "l'État", elles ont le plus souvent pour résultat de conforter un régime criminel. On arrive à un paradoxe qui est que la sanction contre l'État pris dans sa globalité pourrait éventuellement avoir un sens dans le cas des États démocratiques ou dans des États où le Gouvernement criminel est arrivé au pouvoir par les processus démocratiques (on songe à l'Allemagne nazi par exemple), mais aucun dans le cas d'États non démocratiques qui commettent précisément des crimes contre leur propre population (on songe par exemple à l'Irak ou au Cambodge).
En conclusion, il est possible de dire que la distinction entre le crime et le délit, entraînant à la fois des conséquences réparatrices et des conséquences afflictives lorsqu'est commis un crime international, a un certain sens et oeuvre en faveur d'une plus grande "moralisation" du droit international. Mais en l'absence de sanctions collectives, ou de conséquences convaincantes, le recours aux sanctions décentralisées que sont les contre-mesures, qui résulte de la conception extensive de la responsabilité internationale également adoptée par Ago, pour "punir" les crimes internationaux, ne paraît pas pouvoir remplir cette fonction.
III - LES DILEMMES POSES PAR LES CONTRE-MESURES
En effet, pour pallier les déficiences de la mise en oeuvre de la responsabilité internationale - qui n'est qu'un des aspects particuliers des difficultés de mise en oeuvre du droit international en général, - les États ont de tout temps eu recours à ce que l'on appelait traditionnellement des sanctions, comprenant à la fois des mesures de rétorsion et des mesures de représailles, et que l'on appelle aujourd'hui des contre-mesures. Plutôt que d'en prendre acte comme d'un phénomène extérieur aux mécanismes de la responsabilité internationale, la CDI en a fait un élément de la mise en oeuvre de celle-ci.
1. Une conception élargie de la responsabilité
Pour ce faire, la CDI a opéré un choix entre deux conceptions de la responsabilité internationale, en retenant dans son projet la conception la plus large.
Dans la conception étroite, qui est la conception classique, la responsabilité internationale c'était l'obligation mise à la charge de l'État auteur d'une violation du droit de réparer les conséquences dommageables de cette violation subies par un État dont les droits ont été atteints.
Aujourd'hui, est de fait retenue la définition large proposée par Ago, selon laquelle la responsabilité internationale désigne :
"toutes les formes de relations juridiques nouvelles qui peuvent naître en droit international du fait illicite d'un État, que ces relations se limitent à un rapport entre État auteur du fait illicite et État directement lésé, ou qu'elles s'étendent aussi à d'autres sujets du droit international, et qu'elles soient centrées autour de l'obligation pour l'État coupable de rétablir l'État lésé dans son droit et de réparer le préjudice causé, ou pour d'autres sujets d'infliger à l'État coupable une sanction autorisée par le droit international." 1 ( * )
Conception large donc de la responsabilité internationale qui n'est pas exclusivement analysée dans un cadre bilatéral, mais aussi qui ne se résout pas exclusivement en une obligation de réparer, mais intègre aussi les contre-mesures.
Autrement dit, les contre-mesures, que l'on considérait généralement comme des "sanctions", utilisables au lieu et place de la responsabilité internationale, ont été intégrées dans son fonctionnement, ce qui leur confère une légitimité qui n'était pas nécessairement souhaitable. Comme le soulignait Paul Reuter, bien des difficultés rencontrées par la codification entreprise résultent du "caractère très extensif de la notion de responsabilité retenue." 2 ( * )
L'idée est donc que les États sont autorisés à réagir à un acte illicite par un autre acte illicite et que cette réponse, cette contre-mesure, qui serait en soi illicite perd ce caractère - ou plutôt ne l'acquière pas - si elle est adoptée en réponse à un acte internationalement illicite 3 ( * ) . Il est admis que pour que son caractère illicite disparaisse - ou n'apparaisse pas -, la contre-mesure doit traditionnellement remplir certaines conditions : être précédée d'une demande de rétablissement de l'ordre juridique violé ; être une réponse à un acte illicite -ce qui implique que l'acte initial soit bien une violation du droit et que la réponse soit dirigée contre l'auteur de l'acte illicite et non un autre sujet de droit ; être proportionnée à l'acte illicite initial ; ne pas entraîner d'atteinte au droit d'un tiers, sous peine de conserver son caractère illicite à l'égard de celui-ci ; être retirée en cas de cessation de l'acte illicite initial, ce qui implique notamment l'interdiction des contre-mesures punitives.
Dans le projet de la CDI de 1996, les contre-mesures sont enserrées dans un certain nombre de procédures devant être suivies ex ante (prévues au chapitre III de la deuxième partie) et de procédures de règlement des différends applicables ex post (prévues dans la troisième partie).
En effet, lorsqu'un État adopte des contre-mesures, qui seront presque automatiquement dénoncées par l'État auteur de l'acte initial invoqué pour justifier ces contre-mesures, il avait d'abord une obligation de négocier (article 48), puis au bout de trois mois une obligation de se soumettre à une procédure de conciliation si l'autre partie en prend l'initiative (article 55), puis dans les six mois à partir de l'adoption de la contre-mesure, une obligation de se soumettre à un arbitrage si la partie à l'égard de laquelle il a pris ces contre-mesures soumet unilatéralement - comme le projet lui en donne le droit (article 58) - à un tribunal arbitral mis sur pied en annexe du projet, le différend qui les oppose sur la licéité des contre-mesures. Il y a là un montage dont l'effet aurait pu, s'il avait été retenu, de court-circuiter la CIJ dans un assez grand nombre de situations. Simplement, in fine, en cas de désaccord sur la validité de la sentence rendu par ce tribunal arbitral, la CIJ aurait pu être amenée à intervenir, pour confirmer la validité de la sentence ou la déclarer nulle en totalité ou en partie (article 60).
À la base de cette construction assez peu réaliste, il y avait pourtant une idée juste : à savoir qu'à l'heure actuelle, l'utilisation par les États de contre-mesures - et l'on sait qu'ils ne s'en privent pas - est totalement incontrôlée, et qu'il pourrait aller dans le sens d'une meilleure application du droit international, d'instaurer un système d'évaluation de la licéité d'une contre-mesure, ce qui ferait d'ailleurs "tache d'huile" en ce qui concerne le contrôle par une instance juridictionnelle ou arbitrale internationale, des actes des États, puisqu'une telle appréciation exige aussi la qualification de l'acte illicite initial invoqué.
Il est certain que la création d'une telle obligation tertiaire à la charge de l'État auteur de l'acte illicite, implique en regard un droit pour l'État victime, le droit d'adopter des contre-mesures pour faire respecter le droit international, droit qui serait lui-même contrôlé par les instances internationales. En quoi cette obligation tertiaire - et le droit lui correspondant - sont-ils plus efficaces que l'obligation primaire ou l'obligation secondaire qu'elle est censée supplanter ? La réponse est évidente : l'obligation tertiaire est différente des deux précédentes en ce qu'elle s'accompagne d'un droit de l'État d'agir unilatéralement contre l'État récalcitrant.
Reste donc uniquement l'évidente légitimation conférée aux contre-mesures, par leur prise en compte dans le projet, sans aucune véritable contrainte sur leur utilisation 1 ( * ) . Personnellement, la légitimation me semble l'emporter sur le contrôle, dont la complexité et l'irréalisme présagent l'inefficacité. Si le projet avait abouti, un État n'aurait certes pu utiliser de contre-mesure qu'après avoir négocié avec l'auteur de l'acte illicite, qui par définition a déjà refusé que sa responsabilité ne soit mise en oeuvre. Les contre-mesures risquent de manquer leur objectif, si elles ne sont adoptées qu'après des négociations. D'où la nécessité ressentie par la CDI "d'inventer" des "contre-mesures conservatoires".
S'il adopte finalement des contre-mesures, l'État auteur de celles-ci se voit pris dans un engrenage des plus complexes.
L'irréalisme et la lourdeur des mécanismes ont conduit à son abandon dans le projet de 2000 : il en résulte donc une bénédiction donnée à l'utilisation des contre-mesures sans qu'aucun contrôle sur celle-ci ne soit mis sur pied : cette solution introduit une grande incertitude, avec le rôle prédominant donné aux actes unilatéraux adoptés par les États les plus puissants, rôle que certains ont fort justement décrit comme "l'universalisation de la qualité pour agir en contre-mesures" 1 ( * ) .
Dans la mesure où cette évolution allait de pair avec l'introduction de la notion de crime, on conçoit aisément que si l'une des conséquences de l'existence d'un crime international - aujourd'hui d'une violation grave du jus cogens - est que sa perpétration lèse tous les États, il en résulte qu'en cas de crime -aujourd'hui en cas de violation grave du jus cogens - tous les États vont être habilités à prendre des contre-mesures.
Cette extension virtuelle des contre-mesures a fini par inquiéter les membres de la CDI : aussi, dans les dernières propositions, le caractère exceptionnel 2 ( * ) des contre-mesures a-t-il été souligné, comme leur caractère bilatéral.
2. Les États et la doctrine face à cette évolution
Les États sont partagés face à cette nouvelle approche. Pour les uns, il est souhaitable d'intégrer les contre-mesures dans la théorie de la responsabilité internationale. On ne s'étonnera pas de la déclaration des États-Unis dans leur commentaire du projet : "Nous sommes satisfaits de trouver à l'article 30 le reflet de l'idée dorénavant admise que `les contre-mesures' [ont] une place dans tout régime juridique de la responsabilité des États" 3 ( * ) . Mais s'ils sont favorables aux contre-mesures, ils veulent pouvoir s'en servir sans limitations. Aussi sont-ils hostiles à l'entreprise de la CDI de tenter de canaliser et contrôler les contre-mesures : pour eux, "l'ensemble du chapitre III [du projet de 1996] limite de manière inacceptable l'utilisation et la finalité des contre-mesures en imposant des restrictions que rien ne justifie en droit international coutumier" 4 ( * ) . Qui plus est, ils ont une conception particulière de la proportionnalité. Pour eux, considérer que la contre-mesure doit être fondée sur une évaluation du dommage et éventuellement de la gravité du fait qui en est l'origine, ne correspond pas au droit positif. Ils estiment 5 ( * ) , pour leur part que "(l)e droit coutumier reconnaît qu'une réponse d'un degré de gravité plus élevé que le fait qui l'a provoquée peut s'imposer dans certaines circonstances pour amener l'État en faute à honorer ses obligations" 1 ( * ) . Étrange conception de la proportionnalité : que les États craignent les mesures unilatérales américaines ! Cette volonté d'utiliser sans entrave le droit à des actions unilatérales va très loin, puisque les États-Unis critiquent même l'alinéa d) de l'article 50 relatif aux contre-mesures interdites qui prévoit qu'un État lésé ne doit pas recourir à titre de contre-mesure à un "comportement qui déroge aux droits de l'homme fondamentaux", en regrettant que cet alinéa ne précise pas ce qu'il faut entendre par "déroger" ou par droits de l'homme "fondamentaux" 2 ( * ) .
Cet engouement pour les mesures unilatérales n'est pas partagé par tous. Pour d'autres États, au contraire, les contre-mesures sont un mal nécessaire, -d'ailleurs déjà soumis à des restrictions coutumières - mais qu'il ne convient pas d'institutionnaliser.
Le Danemark, par exemple, s'exprimant au nom des pays nordiques tient à souligner que "les contre-mesures ne devraient pas avoir un caractère de sanction, mais plutôt être considérées comme un recours visant à inciter l'État fautif à rentrer dans le chemin de la légalité... Il faudrait toujours avoir à l'esprit que cette institution juridique favorise les pays puissants qui, dans la plupart des cas sont les seuls à disposer de moyens leur permettant de recourir à des contre-mesures pour défendre leurs intérêts" 3 ( * ) .
Les mêmes débats se retrouvent dans la doctrine. Si l'on considère que les contre-mesures tendent au rétablissement de l'ordre juridique violé, on conçoit que leur finalité s'inscrit dans celle de la responsabilité internationale. Par ailleurs, le mécanisme de la protection diplomatique, qui est par essence un mécanisme de mise en oeuvre de la responsabilité internationale, a toujours été étudié en même temps qu'elle. Il ne paraît donc pas inadmissible de considérer les contre-mesures comme une des techniques - peut-être à titre d'obligation tertiaire - de mise en oeuvre de la responsabilité internationale, bien qu'elles ne puissent être analysées, à notre avis, comme une conséquence de celle-ci.
Le point de départ de la CDI est que les contre-mesures sont admises par le droit international coutumier, tant leur pratique est fréquente. Bien qu'elles traduisent les faiblesses du droit international par leur caractère décentralisé, ces contre-mesures peuvent jouer un rôle dans l'application du droit international qu'elles ont pour but d'"encourager". Face à ces constatations, le mieux est, selon la CDI, d'essayer de centraliser le contrôle international sur ces mesures unilatérales adoptées par les États.
Comme le souligne un chroniqueur attentif des travaux de la CDI : "Les débats ont clairement fait sortir à quel point les contre-mesures reflétaient l'imperfection de la société internationale dans laquelle les États forts avaient la possibilité de faire appliquer les contre-mesures pour défendre leurs intérêts -et se faire ainsi justice à eux-mêmes - alors que les États faibles ne pouvaient guère espérer exercer une même pression sur les États puissants. Dans cette optique, admettre les contre-mesures apparaît comme constitutif d'une certaine régression du droit international." 1 ( * ) . À l'inverse, certains ont pu soutenir que puisque les contre-mesures existent, autant essayer de les contrôler : "il est infiniment préférable de tenter de réglementer l'usage qui peut être fait de la puissance en réponse à un fait internationalement illicite que de la laisser produire des effets en dehors de la sphère du droit 2 ( * ) . Le seul problème est que s'il y a eu un temps des velléités de contrôle sur les contre-mesures, ce contrôle a disparu de la déclaration finale.
CONCLUSION
La responsabilité internationale est prise dans les tourments de la lente gestation de la communauté internationale. Considérée traditionnellement comme un outil de régulation des relations bilatérales entre les États, elle tend à être utilisée de plus en plus pour assurer le respect d'un minimum essentiel d'ordre juridique international dans la communauté internationale, ordre juridique international dont tous les États sont les garants. Cette contribution a tenté de faire part des difficultés et interrogations qu'entraîne nécessairement une mutation aussi profonde.
Monsieur Pierre DELVOLVE :
Mesdames, Messieurs, nos travaux vont nous conduire à entendre deux de mes jeunes collègues : Madame FOLLIOT-LALLIOT, qui fut même mon étudiante, et Monsieur de BECHILLON, qui fut premier au concours d'agrégation en 1998 par un jury auquel je participais et, l'un et l'autre, j'ai pu apprécier à des titres divers la qualité de leurs travaux. Vous allez apprécier la qualité de leurs propos. Madame FOLLIOT-LALLIOT va d'abord vous parler des tiers au contrat administratif et la responsabilité. C'est la grande maîtresse, pour ne pas dire la grande prêtresse, du contentieux des contrats. Il y a là un élément particulier dans le sujet qu'elle va traiter. Je lui donne la parole.
La responsabilité et les tiers au contrat administratif
par Madame Laurence FOLLIOT-LALLIOT,
professeur à l'Université Paris 13
La diversification des contrats, aussi bien civils qu'administratifs, la multiplication des obligations qu'ils engendrent en tant que sources potentielles de responsabilités ainsi que l'hétérogénéité croissante de la catégorie des tiers sont aujourd'hui des réalités qui obligent à repenser l'effet du contrat au-delà des seules parties contractantes. On note à cet égard un regain d'intérêt de la doctrine civiliste française pour cette question ces dernières années 1 ( * ) et du législateur français 2 ( * ) ainsi que des exemples de droit étranger qui ont proposé des solutions innovantes 3 ( * ) .
Longtemps l'analyse dominante, à partir de la rédaction du célèbre article 1165 du Code civil suivant lequel : " les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 " (ce dernier étant relatif à la stipulation pour autrui), estimait que le débat n'avait pas lieu d'être. Aussi les deux termes "tiers" et "contrat" paraissaient-ils devoir s'exclure irrémédiablement l'un l'autre.
H. Battifol a cependant remarqué qu'" une des évolutions les plus marquantes de la matière au XIX e siècle a été le développement continu des effets des contrats à l'égard des tiers " 4 ( * ) . Accompagnant ce mouvement, des approches doctrinales plus nuancées se multiplièrent au XX e siècle, notamment de la part d'auteurs civilistes qui approfondirent l'analyse de l'opposabilité du contrat 5 ( * ) .
Ils permirent de distinguer la force obligatoire du contrat à l'égard des tiers, qui commande à ces derniers de le respecter 1 ( * ) sous peine d'engager leur responsabilité délictuelle 2 ( * ) , de l'opposabilité du contrat par les tiers envers les parties, c'est-à-dire en tant qu'élément de preuve, voire de source de responsabilité. Aussi le contrat s'est-il ouvert sur l'extérieur et l'on peut aujourd'hui s'accorder à différencier "ses effets internes" de ses "effets externes " 3 ( * ) .
Mais il est intéressant de noter que tous les systèmes juridiques ne sont pas parvenus à cette conclusion et qu'ils n'ont pas nécessairement emprunté les mêmes explications théoriques pour parvenir à ce résultat. Qu'en est-il du point de vue du droit administratif français ? En excluant totalement les tiers de l'accès au juge du contrat, les solutions jurisprudentielles ont initialement tiré la conséquence contentieuse la plus stricte du principe de l'effet relatif du contrat. Contrairement aux solutions du droit civil, au moins dans l'hypothèse de nullités absolues, les tiers ne pouvaient donc en théorie ni demander au juge administratif de prononcer la nullité du contrat, ni invoquer la violation de ses clauses. Cependant, le particularisme du contrat administratif a finalement rendu cette position intenable, car ce contrat a " un but de service public. Il n'est donc, par hypothèse, pas conclu pour produire un effet égoïste vis-à-vis de l'administration ; il a en vue un intérêt collectif. Un contrat administratif dont est titulaire une personne administrative déterminée, doit, en réalité, avoir effet vis-à-vis de tout le public intéressé à la gestion du service auquel se rapporte ce contrat " 4 ( * ) . Puisque la porte du juge du contrat leur était fermée, les tiers sont entrés... par la fenêtre du juge de l'excès de pouvoir. Ce faisant, le contentieux de l'annulation du contrat, ou à tout le moins de certaines de ses clauses, a détourné l'attention de la recherche d'une responsabilité du fait des conditions d'exécution du contrat. Or il n'est pas certain qu'aujourd'hui le symbolisme de l'annulation de l'acte illégal constitue une réparation toujours suffisante aux yeux des plaideurs.
Dans cette perspective, la comparaison des solutions tirées du droit civil et du droit administratif s'avère riche d'enseignements. À l'instar du juge judiciaire, le juge administratif se trouve en effet confronté au même problème de l'identification du tiers intéressé par le contrat (I) avant de déterminer le régime de responsabilité dont il pourra bénéficier (II). Cependant les chemins empruntés ne sont pas identiques. Pour élargir les conditions d'engagement de la responsabilité du fait du contrat l'approche privatiste conduit au dépassement des obligations inscrites dans le contrat, tandis que le droit administratif recherche l'éventuelle double nature de certaines de ses clauses.
I - L'IDENTIFICATION DU TIERS AU CONTRAT
Cette tentative d'identification du tiers, terme polysémique, dont l'emploi a été généralisé par Pothier, aurait pu s'intituler "à la recherche du tiers inconnu" tant cette notion plurielle recouvre une mosaïque de situations diverses en matière contractuelle. " Déterminer avec exactitude les tiers qui peuvent se prévaloir du contrat administratif ou s'élever contre les irrégularités qu `il contient, nous semble être le problème dont la solution dans l'avenir, justifierait le plus de progrès de la théorie du contrat administratif " soulignait G. Péquignot 1 ( * ) . Une tâche qui se révèle délicate face à des catégories fuyantes, évolutives, puisqu'elles varient d'un contrat à l'autre 2 ( * ) . Non seulement chaque contrat définit ses tiers -on devient tiers par le seul effet de la volonté d'autrui-mais cette définition se construit dans le temps puisque les tiers au moment de la formation du contrat ne seront pas nécessairement identiques aux tiers lors de son exécution ou de sa terminaison. À la distinction traditionnelle entre les tiers concernés par le contrat et les penitus extranei qui lui sont totalement étrangers, il convient par conséquent de substituer une approche plus affinée à partir de l'implication du contrat, comme le suggérait G. Durry 3 ( * ) . Peut-être pourrait-on parler, pour reprendre une approche chère aux publicistes, d'une "échelle d'extranéité " des tiers par rapport au contrat ?
Déjà l'analyse privatiste a permis de distinguer, dans l'ensemble indistinct des tiers, les créanciers chirographaires, les représentants dans l'hypothèse d'un mandat, les ayants-cause à titre particulier, ou encore les "contractants extrêmes " dans les groupes de contrats 4 ( * ) . Ce faisant, l'approche privatiste privilégiait l'identification de catégories conférant qualité pour agir en justice. Démarche que l'on retrouve lorsque la doctrine s'est interrogée sur le point de savoir si, par un dépassement de l'autonomie de la volonté du fait de la loi, certains tiers ne pouvaient acquérir la qualité de partie au contrat 5 ( * ) .
De son côté, le juge administratif a également appréhendé le tiers au contrat administratif à travers des catégories spécifiques, telles que celle du candidat déçu à l'attribution d'un contrat public, celle de l'usager du service public conventionnellement délégué ou des participants à une opération de travail public (architecte, sous-traitants). Mais il a aussi, plus rarement, fait appel à la théorie de la stipulation pour autrui pour élargir les conditions d'application de la responsabilité contractuelle. Ce qui traduit une indétermination des frontières entre la notion de partie et celle de tiers.
Afin d'identifier les véritables tiers au contrat (B), ces deux approches doivent écarter un ensemble hétéroclite, celui des "faux tiers", qui regroupe aussi bien de pseudo-contractants que des substituts à ces derniers (A).
A - " LES FAUX-TIERS " = PSEUDO-CONTRACTANTS ET SUBSTITUTS DES CONTRACTANTS
La présentation renouvelée de la notion de tiers a surtout visé à identifier ce que l'on pourrait appeler des "pseudo-contractants", c'est-à-dire des personnes qui entretiennent des liens tels avec le contrat qu'elles vont en réalité pouvoir être assimilées à des contractants. Doivent également être signalés les tiers "substituts de contractants", c'est-à-dire des plaideurs qui pourront agir à leur place. Loin de préciser la notion de tiers, ces catégories viennent surtout compléter celle des parties au contrat, moyennant certains aménagements du principe de son effet relatif
1. Pseudo-contractants
À la suite d'une cession, d'une donation ou d'un échange, les ayants-cause à titre particulier ou universel remplacent purement et simplement l'une des parties, puisqu'ils deviennent propriétaires de la chose et qu'ils pourront revendiquer les droits, accessoires de la chose, nés du contrat. Le droit administratif 1 ( * ) , comme le droit civil 2 ( * ) , appliquent à cet égard la même solution pour les actions incorporées à la chose immobilière. Il faudra veiller à la transmission effective de la totalité des droits : celle-ci ne sera pas réalisée dans l'hypothèse d'une vente partielle ou d'une simple affectation de l'ouvrage 3 ( * ) , et elle pourra être différée lorsqu'il existe une délégation de maîtrise d'ouvrage 4 ( * ) .
En revanche, si le Conseil d'État reconnaît à i'acquéreur d'une chose mobilière l'action en garantie des vices cachés 5 ( * ) , la cession d'un bien meuble n'a pas pour effet de transmettre automatiquement les garanties contractuelles 6 ( * ) , sauf si une stipulation pour autrui figure expressément dans le contrat de vente.
Dans ce contexte, les qualités de parties et de tiers évoluent et alternent en fonction de l'instant juridique par rapport au temps contractuel 7 ( * ) . Ces différentes analyses pour novatrices qu'elles soient n'aboutissent finalement qu'à élargir la qualité de partie, sans préciser pour autant celle du tiers.
2. Les tiers-substituts des contractants
II s'agit encore d'une configuration à écarter rapidement puisque des tiers exercent en ce cas des actions contractuelles en lieu et place des contractants soit en invoquant une stipulation pour autrui, soit en exerçant une action oblique.
À partir de l'article 1121 du Code civil suivant lequel " On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter ", le droit civil a progressivement forgé la stipulation pour autrui en tant qu'instrument de création d'une obligation contractuelle au profit de certains tiers 1 ( * ) . Le juge administratif 2 ( * ) s'en inspira clairement 3 ( * ) en 1927 au profit des usagers et des employés du contractant de l'administration 4 ( * ) , puis en 1938 en faveur d'une personne publique 5 ( * ) . Ainsi peuvent être déclarées recevables des actions intentées devant le juge, administratif ou judiciaire, du contrat par des tiers sur le fondement d'une stipulation pour autrui. Il reste que son usage s'avère plus que modeste dans la jurisprudence administrative 6 ( * ) , alors que le droit civil a considérablement enrichi la notion en considérant que non seulement la stipulation pour autrui peut faire naître des droits au profit des tiers 7 ( * ) mais qu'elle peut éventuellement leur imposer des obligations 8 ( * ) , ce qui illustre encore la proximité entre les notions de tiers et de partie au contrat.
L'action oblique, qui permet au créancier d'agir au nom et pour le compte du débiteur est également reconnue par le juge judiciaire et par le juge administratif, ce dernier se référant expressément à l'article 1166 du Code civil. Elle peut être utilisée par un salarié qui réclame, à la place de son entreprise, les sommes dues par la personne publique contractante 1 ( * ) ou par une banque ayant reçu un marché en nantissement 2 ( * ) . F. Llorens remarque cependant, " qu'il n'en reste pas moins que le créancier ne fait que représenter son débiteur et qu'il n'y a, de ce fait, qu'une dérogation apparente au principe de l'effet relatif des contrats ". Un classement dans la catégorie de ce que l'on a appelé les substituts du contractant s'impose par conséquent.
L'action directe déroge à la précédente puisqu'elle " permet à un créancier, à l'inverse de l'action indirecte, de poursuivre en son nom et pour son propre compte, le tiers débiteur de son débiteur " 3 ( * ) . En principe de nature exclusivement légale, telle l'action reconnue au sous-traitant par la loi du 31 décembre 1975 ou celle de la victime d'un dommage contre l'assureur du responsable 4 ( * ) , elle peut aussi avoir un fondement jurisprudentiel voire conventionnel, telle l'action du sous-acquéreur d'une chose. Dans tous les cas, elle offre une solution d'équité à la victime.
Les cautions pourront se retrouver subrogées dans les droits du contractant de la personne publique. Mais aujourd'hui, les banques, en particulier, n'hésitent plus à mettre en cause directement la responsabilité de la personne publique si le comportement de celle-ci les a incitées à accepter des cessions de créance qui ne seront finalement pas honorées 5 ( * ) .
Enfin, dernière illustration de cette catégorie hétéroclite des "substituts du contractant" qui contourne les règles de recevabilité des actions contractuelles, le contribuable bénéficiant d'une autorisation de plaider pourra agir en lieu et place de sa collectivité locale.
B - LES "TIERS INTÉRESSÉS"
Se démarquant des penitus extranei et des faux-tiers, ces tiers intéressés constituent un ensemble disparate de requérants pour lesquels les juges reconnaissent un intérêt à agir suffisant pour engager une procédure de mise en jeu de la responsabilité extra-contractuelle des parties. Le contrat est à leur égard plus qu'un simple fait juridique puisque ses conditions de passation ou d'exécution peuvent être génératrices d'un dommage.
1. Les tiers à la passation du contrat
Dans cette première hypothèse, le dommage résulte davantage d'une atteinte à la légalité des conditions de passation que d'une violation des clauses du contrat puisqu'il n'est, par définition, pas encore conclu. La confluence des règles de légalité et des dommages liés à la négociation conventionnelle s'exprime cependant, en contentieux administratif, par la compétence complémentaire, voire concurrente, du juge de l'excès de pouvoir, du juge du référé pré-contractuel, du juge de la responsabilité extra-contractuelle et du juge du contrat.
Les concurrents
Derrière les contentieux "phare" du recours pour excès de pouvoir et du référé pré-contractuel, la responsabilité extra-contractuelle de l'administration du fait des opérations pré-contractuelles est mise en cause, notamment par les candidats malheureux, lors de l'attribution de marchés 1 ( * ) et de concessions 2 ( * ) , voire plus largement de conventions de délégation de service public. On retiendra par exemple ces dernières années, la condamnation de l'État pour faute dans la procédure d'attribution du contrat de construction et d'exploitation du Grand Stade, malgré l'intervention d'une loi de validation 3 ( * ) . En s'appuyant sur la violation du principe de confiance légitime, le Tribunal de l ère instance des Communautés Européennes a également condamné le Parlement européen qui " a fait naître chez son contractant envisagé la conviction d'obtenir un marché et a de surcroît incité ce dernier à engager des investissements irréversibles " 4 ( * ) .
Les espèces relatives à cette responsabilité extra-contractuelle concernent majoritairement la mise en cause de l'administration, mais on doit signaler que le retrait des offres présentées par les candidats engage également leur responsabilité 5 ( * ) . Le droit privé connaît pareillement de cette responsabilité précontractuelle 6 ( * ) , organisée autour de la notion de faute 7 ( * ) .
"Les gardiens de la légalité"
Une expression commode afin de désigner les tiers qui veillent au respect de la légalité par les autorités, notamment locales, lorsqu'il s'agit de passation des contrats administratifs, telles qu'une association dont l'objet social va être affecté par le contrat qui doit être conclu 1 ( * ) ou le conseiller municipal qui attaque les conditions d'attribution d'un contrat par sa commune 2 ( * ) .
2. Les tiers intéressés par l'exécution du contrat
La multitude des dommages potentiels favorise ici plus qu'ailleurs l'éclatement de la notion de tiers au contrat. Pourtant on peut tenter de les regrouper en cercles concentriques en proposant d'isoler les partenaires au contrat (a), les participants à son exécution (b), les usagers (c) et enfin les autres victimes de dommages liés à l'exécution défectueuse des contrats (d).
a) Les partenaires
Aujourd'hui s'ajoutent aux contrats administratifs "classiques" (marchés publics, conventions de délégation de service public, engagements d'agents publics, occupation du domaine public, pour ne citer que les principaux) de nouveaux mécanismes contractuels qui manifestent un recours au contrat comme mode de décision négociée des politiques publiques. Cette alternative à la décision unilatérale se développe considérablement, non seulement entre les personnes publiques (contrats de plan État-Région, contrats de ville) mais également au sein de celles-ci (contrats de service). La qualification hésitante de certains de ces accords (contrats locaux de sécurité par exemple) ne saurait occulter la réalité d'une nouvelle source de responsabilités. Elle implique d'identifier précisément les participants au processus de négociation afin de départager les "co-parties" des tiers concernés par l'exécution 3 ( * ) , tels que des collectivités infra-régionales impliquées dans un contrat d'agglomération ou un contrat de pays victimes de l'inexécution d'un contrat État-Région.
b) Les participants à l'exécution
Divers intervenants peuvent concourir à l'exécution du contrat. Tantôt qualifiés de "participants" par le droit administratif ou de "contractants extrêmes" par le droit civil, il sont impliqués plus ou moins directement dans un "contrat complexe" ou "groupe de contrats", mais n'entretiennent pas nécessairement entre eux de rapports contractuels. L'opération de construction en fournit un exemple topique avec la présence du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre, du mandataire, du bureau d'étude, de l'architecte, des sous-traitants ou encore des fournisseurs. Témoignant de la difficulté à préciser ces rapports de responsabilité, les solutions des deux ordres de juridiction ont varié.
Pour les dommages subis par les participants du fait de l'un d'entre eux.
Le juge administratif considère traditionnellement qu'en l'absence d'une des conditions requises pour le paiement direct ou l'action directe organisés par la loi, le sous-traitant victime d'un dommage, qui n'est lié par aucun contrat avec la personne publique maître de l'ouvrage, ne pourra se fonder que sur la responsabilité quasi-délictuelle de cette dernière 1 ( * ) . De même la personne publique pour le compte de laquelle le contrat secondaire a été conclu entre deux entreprises ne pourra s'en prévaloir 2 ( * ) .
Sur la même question, la jurisprudence civile a subi ces dernières années des évolutions notables. Alors qu'elle se fondait également sur la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle, en 1986 puis en 1988, la Première chambre civile a décidé que " dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en réparation de tous ceux qui n `ont souffert du dommage que parce qu'ils avaient un lien avec le contrat initial " 3 ( * ) . Cependant, dans un arrêt Besse du 12 juillet 1991 4 ( * ) , la Chambre Plénière de la Cour de cassation a formellement rejeté le caractère contractuel de l'action du maître de l'ouvrage contre un sous-traitant. Les sous-traitants qui ont exécuté une partie voire la totalité de l'ouvrage ne sont pas tenus par une responsabilité décennale mais seulement par une responsabilité délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage. Cette solution ne s'applique pas aux groupes translatifs de propriété, par conséquent l'action du sous-acquéreur ou du maître de l'ouvrage contre le fabricant repose toujours sur la responsabilité contractuelle 5 ( * ) , car les obligations contractuelles se trouvent incorporées à la chose 6 ( * ) .
Pour la répartition finale de la charge de l'indemnisation dans l'hypothèse de dommages causés aux tiers (appel en garantie)
Alors que le droit civil considère que "la faute dommageable doit être examinée en elle-même, indépendamment des rapports contractuels qui lient le constructeur poursuivi au maître de l'ouvrage" 1 ( * ) et applique ainsi le régime de la responsabilité quasi-délictuelle, le droit administratif distingue selon que le dommage subi par le tiers s'est produit avant la réception des travaux ou après. Dans le premier cas, il y a lieu de faire application de la responsabilité contractuelle, dans le second du régime de la responsabilité décennale 2 ( * ) . Mais il pèse sur la personne publique une présomption de responsabilité puisqu'une fois condamnée à indemniser le tiers, elle ne pourra ensuite se retourner contre l'entrepreneur fautif que si les conditions d'engagement de la responsabilité décennale de ce dernier sont réunies.
Par ailleurs, depuis l'arrêt du Conseil d'État Commune de Voreppe, du 30 juin 1999, le maître de l'ouvrage ne peut plus appeler en garantie le sous-traitant 3 ( * ) , puisque " seules les personnes ayant passé avec le maître de l'ouvrage un contrat de louage d'ouvrage peuvent être condamnées à réparer les conséquences dommageables d'un vice de cet ouvrage imputable à sa conception ou à son exécution " 4 ( * ) . Cette solution rendue sur les conclusions contraires de Mme Bergeal et contre cinq arrêts de Cours administratives d'appel manifeste la volonté du Conseil de faire prévaloir la responsabilité contractuelle sur la responsabilité quasi-délictuelle. Elle complique cependant la tâche du maître de l'ouvrage qui ne pourra se retourner directement contre les tiers fautifs mais pourra seulement poursuivre l'entrepreneur principal.
c) Les usagers
Tiers au contrat administratif, puisqu'ils n'y ont pas expressément consenti, les usagers constituent cependant une catégorie bien identifiable dans la mesure où le contrat, particulièrement la convention de délégation de service public, a, en principe, été conclu pour satisfaire leurs besoins. L'étude de la notion de service public avait déjà permis au début du XX e siècle d'identifier le particularisme de ces tiers lésés par les conditions d'exécution du service. Restait à trouver une justification de leur intérêt à agir, et partant de la recevabilité de leur recours, alors qu'ils entendaient se fonder sur la mauvaise exécution des clauses du contrat de concession et attaquer l'inaction de la personne publique concédante. Un temps tentées par l'appel à la notion de stipulation pour autrui 5 ( * ) , la jurisprudence et la doctrine se tournèrent résolument vers la requalification des clauses du contrat : contractuelles entre les parties mais réglementaires, pour certaines d'entre elles, à l'égard des usagers. Ce fut la solution retenue par l'arrêt Croix-de-Séguey-Tivoli 1 ( * ) qui avait permis au Doyen Duguit d'assurer la défense des utilisateurs d'une ligne de tramways mécontents de la fréquence des dessertes assurées par le concessionnaire. L'administration engage par conséquent sa responsabilité extra-contractuelle pour faute lorsqu'elle n'a pas veillé à ce que son contractant respecte les termes du contrat 2 ( * ) . Ce qui permet aux tiers usagers de réclamer l'exécution des clauses organisant le service, et à défaut des dommages et intérêts 3 ( * ) .
d) Les victimes de l'exécution du contrat
Il convient d'analyser cette catégorie indistincte à travers le prisme de la nature du dommage subi par le tiers au contrat en isolant les dommages accidentels, en particulier corporels. La détachabilité évidente de ces dommages du contexte contractuel explique que cette catégorie de tiers ait traditionnellement bénéficié d'un régime particulier. Pour des raisons historiques, le juge administratif s'est particulièrement intéressé au sort des victimes de dommages de travaux publics et, là peut-être plus qu'ailleurs, il s'est efforcé d'isoler le fait générateur du dommage d'un éventuel contexte contractuel afin d'appliquer au tiers victime un régime de responsabilité sans faute. Aussi, lorsqu'un tiers (passant, voisin) est victime d'une opération de travail public ou des modalités de fonctionnement d'un ouvrage public, il peut évidemment poursuivre le constructeur (entrepreneur, architecte...), mais il peut également choisir de rechercher directement la responsabilité du maître de l'ouvrage ou assigner le maître de l'ouvrage et le constructeur à titre solidaire 4 ( * ) . Cette faculté de choix est reconnue aussi bien par le droit administratif que par le droit civil 5 ( * ) . En revanche, le problème de la répartition finale de la charge indemnitaire connaît des réponses différentes qui ont été examinées supra.
En-dehors du régime particulier des travaux publics 6 ( * ), le droit administratif s'est peu intéressé aux victimes de l'exécution défectueuse des contrats publics soit parce que la compétence revenait au juge judiciaire dans un litige opposant deux personnes privées, soit parce que lorsque la victime recherchait la responsabilité de l'administration, l'application systématique des régimes de responsabilité extra-contractuelle occultait la relation entre le contrat et le tiers victime.
De son côté, le droit civil a développé une jurisprudence tout aussi compréhensive à l'égard des tiers victimes de dommages accidentels, en particulier corporels, dont le fait générateur trouvait son origine dans un contrat. Il a même élargi la catégorie des tiers concernés en admettant l'action en responsabilité délictuelle des victimes "par ricochet" liées à la partie contractante qui a subi un dommage principal du fait de l'inexécution de son contrat. Cette jurisprudence trouve particulièrement à s'appliquer dans le domaine de la responsabilité médicale. Par un arrêt du 18 juillet 2000 1 ( * ) , rendu à propos de l'action en responsabilité délictuelle menée par les ayants droit d'une patiente d'un hôpital psychiatrique qui s'était suicidée après un défaut de surveillance, se trouve désormais consacré un principe général du droit de la responsabilité suivant lequel la victime par ricochet peut se prévaloir de la faute contractuelle qui lui cause un préjudice, sans avoir à rapporter d'autre preuve. Le Rapport de la Cour de cassation pour l'année 2000 a d'ailleurs salué cette "décision simplificatrice". Et l'Assemblée Plénière en a fait une application particulièrement remarquée 2 ( * ) dans l'affaire Perruche en consacrant le droit d'un enfant né gravement handicapé à recevoir une indemnisation du fait des " fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Mme Perruche (qui) avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse " 3 ( * ) .
Mais la jurisprudence civile ne s'est pas arrêtée là, puisqu'elle applique le même principe à des tiers victimes principales d'autres types de dommages. Elle a ainsi consacré progressivement un droit général des tiers à invoquer l'exécution défectueuse d'un contrat lorsqu'elle leur a causé un dommage 4 ( * ) , qui permet de mettre en oeuvre la responsabilité délictuelle du débiteur de l'obligation inexécutée. Déclinée dans de nombreux domaines, il justifie l'action des tiers victimes d'un défaut de la chose ou d'une prestation de service défectueuse 5 ( * ) . Sur ce point, la différence entre les solutions partielles du droit administratif et la solution de principe du droit civil est irréductible.
Au terme de cette présentation rapide, il apparaît clairement que la dichotomie classique entre les parties au contrat et les "tiers" mériterait d'être approfondie afin de dégager un éventail nuancé des situations juridiques créées par le contrat. Ainsi, par exemple, le fournisseur, l'architecte, l'assureur, ou encore l'usager gravitent autour de la sphère contractuelle et se trouvent plus ou moins affectés par ses effets. Entre les penitus extranei et les parties, il y a place pour des positions intermédiaires, de surcroît sujettes à évolution suivant le temps contractuel. Reste à vérifier si l'éclatement de la notion de tiers peut être compensé par l'unité du droit de la responsabilité applicable.
II - LA RESPONSABILITÉ DE L'ADMINISTRATION DU FAIT DU DOMMAGE CAUSE AU TIERS PAR L'EXÉCUTION DU CONTRAT : UN CONTENTIEUX BIEN DÉFINI
Deux certitudes bien établies jalonnent la matière : d'une part les parties ne peuvent invoquer que la responsabilité contractuelle, d'autre part, à contrario, les tiers ne peuvent se placer que sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle. Pour sa part, le droit civil a posé le principe de primauté de la responsabilité contractuelle pour les parties dès 1890 mais Philippe Terneyre signale que la doctrine se réfère surtout à un arrêt du 11 janvier 1922, 1 ( * ) . La solution identique du droit public se rattache, quant à elle, à un arrêt Lefebvre de 1891 2 ( * ) . Les deux interdisent toute option à la partie victime de la mauvaise exécution du contrat, par application de la règle dite du non-cumul de responsabilités.
Mais c'est ici la solution opposée qui en résulte qui nous intéresse. Autrement dit le principe exactement symétrique au précédent selon lequel les tiers au contrat ne peuvent que se fonder sur la responsabilité extra-contractuelle des parties. À cet égard, le régime applicable aux tiers au contrat est un régime mixte qui emprunte à la responsabilité contractuelle son appréciation de la faute (B) mais qui est mis en oeuvre par le juge de la responsabilité extra-contractuelle (A).
A- L'ACTION EN RESPONSABILITÉ DU TIERS AU CONTRAT.
Tel un miroir, les règles applicables à ce contentieux sont l'exact reflet opposé de celles qui caractérisent le contentieux contractuel.
1. Compétence du juge
Compte tenu des règles de compétences, le juge de la responsabilité extra-contractuelle du fait d'un contrat n'est pas nécessairement le juge du contrat. Une disjonction de compétence peut tout d'abord être observée dans l'hypothèse d'un contrat de droit privé assortie d'une mise en oeuvre de la responsabilité extra-contractuelle de l'administration devant le juge administratif 3 ( * ) . Mais à l'intérieur même de la juridiction administrative, les règles de la compétence matérielle et territoriale conduisent à différencier le juge du contrat du juge de la responsabilité extra-contractuelle née du contrat ; l'inexécution du contrat ne permettant pas aux tiers de réclamer une indemnité au juge du contrat dans la mesure où ils sont sans qualité pour le saisir 1 ( * ) .
Simple volet de la responsabilité extra-contractuelle de l'administration, le contentieux indemnitaire, résultant des dommages causés aux tiers par les conditions de passation ou d'exécution d'un contrat, présente la particularité de permettre au juge du plein contentieux ordinaire de connaître du système contractuel, parce que le contrat constitue ici le fait générateur du dommage.
2. Recevabilité du recours
Si en contentieux administratif, l'action en responsabilité peut servir dans certains cas de substitut à l'action en annulation, elles partagent les mêmes règles de recevabilité tenant à la qualité du requérant et à son intérêt à agir.
Au moment de la passation du contrat, les candidats présentent soit un recours en indemnisation après avoir obtenu l'annulation sur recours pour excès de pouvoir d'un acte précontractuel 2 ( * ) , soit une requête en indemnisation, jointe à une requête en annulation pour excès de pouvoir 3 ( * ) , soit, enfin, un recours simultané en indemnisation et en annulation devant le juge du plein contentieux 4 ( * ) .
Une fois le contrat conclu, les tiers ne peuvent en principe obtenir l'annulation ou le constat de nullité d'un contrat. Ils peuvent seulement, et depuis une décision récente, obtenir du juge de l'exécution qu'il contraigne l'administration à saisir le juge du contrat afin que ce dernier en prononce éventuellement la nullité 5 ( * ) . Seul l'effet particulier de certains contrats tels que le contrat de recrutement d'un agent public permet depuis peu de temps à un tiers d'en obtenir directement l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir 6 ( * ) .
Le particularisme de la situation des usagers retient traditionnellement l'attention lors de l'examen de la recevabilité des recours en contentieux contractuel. Victimes d'un dommage matériel ou corporel, en particulier à l'occasion de l'exécution de travaux publics, ils bénéficieront de l'application du régime de la responsabilité pour faute présumée de la personne publique. En revanche, s'ils s'estiment être victimes d'un dommage que l'on peut qualifier de "collatéral" à l'exécution du contrat administratif (retard, nuisances, coût excessif, etc.), ils ne peuvent atteindre directement le contrat, mais ils sont néanmoins recevables, depuis la jurisprudence Croix-de-Seguey-Tivoli précitée, à invoquer la violation de ses clauses qui présentent un caractère réglementaire et ainsi obtenir l'annulation d'un acte de l'administration qui les a méconnues.
Satisfaisante au regard des droits des usagers, cette solution repose toutefois sur un examen parfois délicat du recours qui ne peut se fonder que sur des clauses réglementaires 1 ( * ) . Même si la catégorie de ces dernières à tendance à s'étoffer, la frontière reste cependant incertaine, comme en témoigne l'arrêt d'Assemblée du 9 octobre 1996, Mme Wajs et M. Monnier 2 ( * ) . En l'espèce, le recours pour excès de pouvoir d'un usager contre le décret approuvant le cahier des charges d'une concession d'autoroute à raison de l'illégalité de certaines de ses clauses financières a été jugé recevable alors que ces clauses sont traditionnellement considérées comme contractuelles 3 ( * ) . Ayant pour objet de régler les rapports entre les parties, elles sont en effet distinctes des clauses relatives aux tarifs de la concession expressément réglementaires 4 ( * ) . Elles illustrent une troisième catégorie de clauses car selon le Commissaire du Gouvernement Combrexelle : " il existe des clauses dans les cahiers des charges qui sans avoir pour objet l'organisation et le fonctionnement du service affectent celui-ci et la situation des tiers. Si ces clauses se rattachent à la définition des relations contractuelles entre les parties, elles n `intéressent pas seulement ces dernières. Le tiers, dès lors qu'il justifie d'un intérêt suffisant, doit pouvoir contester ces clauses s'il estime qu'elles ont été édictées en méconnaissance du droit applicable ". Ce n'est plus tant le caractère préétabli de la clause (ainsi celles portant sur l'organisation du service seraient définitivement réglementaires) que l'atteinte qu'elle porte au cas par cas aux intérêts de l'usager qui justifie le recours. Précisément dans cette espèce, M. Combrexelle considère que : " les clauses financières sont de nature à affecter les droits et intérêts des usagers dès lors qu `il existe en droit, un lien étroit et nécessaire entre ces charges et le montant des péages ". Or lesdites clauses mettaient à la charge du concessionnaire les frais de fonctionnement des effectifs de gendarmerie affectés à la surveillance des autoroutes. L'arrêt ne mentionne d'ailleurs que la qualité d'usager du requérant, sans qualifier expressément les clauses concernées.
L'exigence du caractère réglementaire des clauses a cependant été réaffirmée la même année mais au profit d'un nouvel élargissement de la recevabilité des recours exercés par les tiers. Le recours pour excès de pouvoir était en effet dirigé non contre un acte détachable, comme dans l'arrêt ci-dessus, mais directement contre le contrat 1 ( * ) . Véritable cheval de Troie du juge de l'excès de pouvoir pour pénétrer dans l'espace contractuel, la notion de clause réglementaire a encore une fois servi à élargir les conditions de la recevabilité du recours des tiers au contrat administratif ; il ne faudrait pas qu'ensuite elle la limite excessivement.
L'engouement de ces dernières années pour la délégation conventionnelle des services publics pourrait en effet se traduire par un réveil de cette voie d'action. Toutefois, ce contentieux n'intéresse que la relation entre l'usager et la personne publique alors que la contestation du comportement du contractant de celle-ci soulève d'autres difficultés, notamment lorsque le service public est industriel et commercial ce qui a pour effet de placer l'usager dans une situation de droit privé 2 ( * ) . La responsabilité de la personne publique ne sera que subsidiaire, à fortiori s'il existe un lien contractuel secondaire entre l'usager et le fournisseur du service. Mais, compte tenu des évolutions récentes de la jurisprudence judiciaire relevées supra, le traitement des usagers d'un service public industriel et commercial ou d'un service public administratif, victimes de l'exécution défectueuse de la convention de délégation de service public, pourrait se différencier considérablement.
Sur le plan de la technique contentieuse, on retiendra que les recours des tiers, devant les deux juridictions, sont dispensés de respecter la procédure contractuelle de la mise en demeure préalable. Pour les litiges intéressant les participants à une opération de construction, le juge administratif a, de surcroît, admis une dérogation manifeste au principe de l'effet relatif du contrat en fixant le point de départ de la garantie décennale à une date unique pour l'ensemble des constructeurs 3 ( * ) .
3. Fonds du recours
Le juge administratif estime à l'heure actuelle que seul le non respect d'une clause réglementaire ou qui avait été établie dans l'intérêt des tiers pourra être poursuivi. Les termes de l'arrêt Latty sont, sur ce point, particulièrement édifiants : " si cette convention qui a seulement pour objet l'exploitation d'un établissement commercial appartenant à la commune et le cahier des charges qui lui est annexé contiennent des clauses ayant pour objet de soumettre à l'autorisation du maire toute modification des locaux et de permettre à la municipalité d'en prononcer à tout moment la résiliation, notamment en cas de non-respect du cahier des charges, ces clauses n `ont pas été stipulées dans l'intérêt des voisins de l'établissement en cause ; (...) par suite, le sieur L., tiers à ce contrat, ne peut se prévaloir des obligations qu'il imposait aux parties qui l'ont signé pour dénoncer dans la carence du maire une faute engageant envers lui la responsabilité quasi-délictuelle de la commune " 1 ( * ) . En cas de retard, par exemple, le juge peut estimer que les délais d'exécution n'ont été stipulés que dans l'intérêt des parties et ne sauraient donc justifier le versement de dommages et intérêts au profit des tiers 2 ( * ) . Cet arrêt ne fait que confirmer une jurisprudence très ancienne selon laquelle un cas de retard dans l'exécution du contrat pouvait permettre aux tiers de réclamer une indemnité, mais seulement dans la mesure où ces tiers " ne peuvent avoir plus de droits que la compagnie elle-même qui, seule, a été partie dans les traités passés avec l'État " 3 ( * ) .
Comme il n'existe pas en droit administratif, en-dehors de la réalisation d'un dommage accidentel, de principe général de responsabilité vis-à-vis des tiers victimes de la mauvaise exécution d'un contrat, il appartient au requérant de rattacher sa demande à la violation de clauses particulières. Si la doctrine et la jurisprudence administratives se sont dégagées du formalisme excessif de la stipulation pour autrui en développant un nouveau fondement à l'action des tiers au contrat tiré de la violation des clauses réglementaires, il n'est pas certain que ce fondement soit toujours opérationnel. Après l'avoir ouvert, il pourrait conduire à enfermer le contentieux de la responsabilité extra-contractuelle du fait des contrats administratifs.
B - CARACTÉRISTIQUE DU RÉGIME DU RESPONSABILITÉ APPLICABLE AU TIERS AU CONTRAT
On signalera que les deux jurisprudences estiment inopposables aux tiers les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité 4 ( * ) . De plus, à la différence des parties au contrat, les tiers ne peuvent prétendre qu'à une réparation indemnitaire, aussi bien d'après les solutions de la jurisprudence judiciaire que d'après celles de la jurisprudence administrative.
Le tiers sollicite l'application d'un régime de responsabilité extra-contractuelle, plus spécifiquement qualifiée de délictuelle par le droit civil (1). Il s'agit d'une responsabilité pour faute dans la plupart des cas, ce qui soulève la question de l'appréciation de cette faute (2).
1. Cause juridique de la demande
À l'égard des concurrents, la faute se détache parfaitement du contrat puisqu'elle naît de l'illégalité commise lors de la procédure de passation du contrat 5 ( * ) . Auparavant, seul le requérant ayant conclu le contrat pouvait prétendre à l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice, y compris le bénéfice manqué. Depuis 1970, l'illégalité de l'acte précontractuel permet au candidat malheureux d'obtenir au surplus l'indemnisation du manque à gagner 1 ( * ) . La demande en indemnisation se fonde principalement, dans cette hypothèse, sur le préjudice résultant de la perte d'une chance " sérieuse " 2 ( * ) qui exclut le préjudice éventuel. Le juge doit ainsi estimer si, en dépit de l'illégalité commise, " dans les circonstances de l'affaire ", l'entreprise présentait les garanties suffisantes, pour espérer l'emporter 3 ( * ) , et si elle s'était conformée aux exigences du cahier des charges de l'attribution du marché 4 ( * ) . Cela oblige pratiquement le juge administratif à substituer son appréciation des mérites des candidats à celle de l'administration.
En l'absence d'une des conditions requises pour le paiement direct organisé par la loi, les sous-traitants tirent de l'existence du contrat initial la possibilité d'intenter une action en responsabilité quasi-délictuelle pour faute de l'administration 5 ( * ) . Le juge peut estimer que la personne publique maître de l'ouvrage, suffisamment informée de l'existence du sous-traitant, commet ainsi une faute si elle n'a pas veillé à sa régularisation 6 ( * ) . Ces conclusions ne peuvent cependant être présentées pour la première fois en appel 7 ( * ) . De surcroît, le partage des fautes, le plus souvent imputables conjointement au sous-traitant et à l'entrepreneur, conduit le juge à diminuer le montant de l'indemnité versée 8 ( * ) .
Le dommage résultant des conditions d'exécution du contrat doit être distingué du préjudice causé au tiers du fait de l'existence même du contrat, tel que l'inventeur qui s'estime spolié par l'objet d'un contrat de concession 9 ( * ) . Sur ce point, il faut notamment remarquer que l'administration verra sa responsabilité extra-contractuelle engagée sans faute, comme l'a déjà jugé le Conseil d'État à propos de la responsabilité de l'État du fait d'une convention internationale sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques 1 ( * )0 . Ces hypothèses sont à distinguer des précédentes où les conditions d'exécution du contrat engagent la responsabilité extra-contractuelle de la personne publique sur la base d'une faute.
2. Nature de la faute
À l'origine, la jurisprudence civile s'efforçait de constater l'existence d'une faute délictuelle indépendante de la faute contractuelle. Elle obligeait la victime à démontrer l'existence d'une faute au regard des articles 1382 et s. du Code civil et à rapporter la preuve d'un manquement à une règle générale qui dépassait la portée du seul contrat 1 ( * ) . Extrêmement rigoureux, ce principe céda peu à peu la place à une appréciation plus souple de la détachabilité de la faute délictuelle, jusqu'à permettre à certains auteurs de considérer qu'aujourd'hui " toute faute contractuelle est délictuelle au regard des tiers étrangers au contrat " 2 ( * ). La constatation du seul fait dommageable suffit 3 ( * ) . Aussi la même faute se dédouble-t-elle en fonction de la qualité de la victime, évoquant la figure classique du cumul de responsabilité, et permet alors une variété infinie de fautes délictuelles imputables à l'exécution d'un contrat. Si cette solution se conçoit aisément lorsque l'auteur a manqué à un devoir élémentaire de prudence ou de sécurité, exigé par une règle générale 4 ( * ) , elle conduit cependant le juge à rechercher, souvent dans l'énoncé des obligations du contrat, les raisons du fait générateur du dommage délictuel. Tout se passe comme si le glissement de responsabilité résultait de la nature du dommage 5 ( * ) .
La doctrine civiliste propose aujourd'hui plusieurs fondements, qui ne sont pas d'ailleurs exclusifs les uns des autres, qui pourraient être combinés pour justifier les actions en responsabilité des tiers :
- un fondement légal direct (responsabilité du fait des produits défectueux),
- un fondement légal indirect à travers l'interprétation jurisprudentielles des articles du Code civil et la découverte d'obligations générales (de sûreté, de prudence) qui accompagneraient nécessairement le contrat,
l'approche en termes de groupe de contrats,
- un principe général suivant lequel toute faute contractuelle devient délictuelle à l'égard des tiers.
Ce dernier point soulève cependant des réticences et des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour dénoncer l'insécurité de la situation contractuelle qui en résulte. D'aucuns proposent donc de revenir à une appréciation plus circonstanciée de la faute contractuelle à l'origine du dommage, notamment en distinguant selon la nature des obligations méconnues 1 ( * ) . Ce qui n'est pas sans rappeler l'approche dualiste utilisée pour apprécier les recours des usagers en matière de contrats administratifs.
Bien que beaucoup moins catégorique, la jurisprudence administrative semble emprunter le même chemin. Dans l'hypothèse d'un dommage matériel causé au tiers, l'absorption de la faute contractuelle par la faute délictuelle est évidente, comme l'attestent les solutions retenues dans l'hypothèse de dommages de travaux publics, cependant il semble que le juge administratif soit beaucoup plus hésitant à identifier une faute dans les autres cas de figure 2 ( * ) . Pourtant le raisonnement mené dans l'examen des actions en garantie ou des actions récursoires, à fortiori lorsqu'est mise en oeuvre la responsabilité décennale, repose implicitement sur l'examen des manquements aux obligations contractuelles 3 ( * ) .
CONCLUSION
Cette brève incursion aux frontières du contrat, dans cette zone grise que l'on pourrait appeler le " no man's land contractuel", envisagée sous l'angle de l'opposabilité du contrat par les tiers, rappelle la subtilité des régimes de responsabilité applicables aux parties contractantes. Parce que la responsabilité contractuelle suppose que coïncident entre les parties au contrat le temps contractuel et l'espace contractuel, il suffit en effet que l'un de ces éléments fasse défaut pour que la responsabilité contractuelle disparaisse à son tour et que resurgisse la responsabilité extra-contractuelle 4 ( * ) . Une responsabilité extra-contractuelle entre les parties contractantes qui est loin d'être monolithique puisqu'elle se décline en responsabilité pré-contractuelle, quasi-contractuelle ou post-contractuelle. Et nous rejoindrons la proposition de G. Viney qui suggère de qualifier de " para-contractuelle " la responsabilité d'une des parties contractantes lorsqu'elle commet une faute extra-contractuelle à l'égard de l'autre partie pendant l'exécution du contrat. Qu'elles concernent les tiers ou les parties, toutes ces variantes des régimes de responsabilité applicables à la périphérie du contrat concourent à enrichir paradoxalement... l'étude de la responsabilité extra-contractuelle.
Monsieur Pierre DELVOLVE
Madame, vous avez dit que ces questions sont délicates, en terminant. Elles le sont effectivement. Elles le sont compte tenu de la position du tiers par rapport au contrat administratif, elles le sont compte tenu de l'hétérogénéité même de la catégorie des contrats administratifs. Et le mot "catégorie" sera développé tout à l'heure par notre ami BECHILLON.
Mais je crois que, s'agissant des contrats administratifs, il y a une différence radicale entre ceux qui se bornent à déterminer des rapports entre l'administration et son cocontractant, tel le marché de fourniture - s'il comporte des clauses exorbitantes du droit commun - et le contrat qui confie au cocontractant une mission de service public au profit des tiers, des usagers. Qui sont des tiers par rapport au contrat mais qui ne sont pas des tiers par rapport à la prestation qui fait l'objet du contrat. Et je crois que, fondamentalement, la distinction entre ces deux catégories de contrat - et il faudrait encore sans doute introduire des nuances et des sous-distinctions - que cette distinction est fondamentale pour comprendre dans quelle mesure un tiers peut engager la responsabilité, soit de l'administration, soit éventuellement de son cocontractant.
À cela s'ajoute la considération que le contrat, même si le tiers par définition n'y est pas partie, constitue en toute hypothèse un événement juridique, une donnée qui ne provoque pas de lien contractuel avec les tiers, mais une donnée qui par rapport au tiers, qu'il soit usager ou non dans toute hypothèse de contrat, une donnée dont le tiers doit tenir compte, y compris lorsque le contrat ne lui nuit pas et à fortiori lorsque le contrat lui nuit et détermine des effets négatifs à son égard. Et il est possible que l'administration en concluant un contrat avec une partie méconnaisse les droits d'un tiers -je pense par exemple au droit de propriétés intellectuelles qui pourrait être violé par les clauses d'un contrat conclu entre une personne publique et une entreprise - le tiers peut se prévaloir alors d'une responsabilité, extra-contractuelle bien entendue, tenant à la méconnaissance des droits qu'il peut tenir d'une autre source que celle du contrat.
Je crois qu'il y a une hétérogénéité de la situation, que vous avez mise en valeur, et une hétérogénéité des résultats : le tiers n'a jamais accès - et vous l'avez dit -au contentieux contractuel d'un contrat auquel il n'est pas partie. Et vous avez évoqué des clauses, comme dans l'affaire Cayzeele ou Madame Wajs, qui dans le contrat sont susceptibles d'avoir des effets sur le tiers et dont le tiers soit peut se prévaloir, soit peut attaquer, mais ces clauses, précisément, ce ne sont pas des clauses contractuelles. Ce sont des clauses réglementaires et c'est ce qui justifie la recevabilité du recours pour excès de pouvoir à leur encontre et leur invocation à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir.
Donc le tiers ici n'est plus dans une situation par rapport à un contrat, il est dans une situation par rapport à un règlement, ce qui change les données de la solution.
Le sujet est un sujet difficile, un sujet délicat. Les solutions de la jurisprudence sont nuancées : je me rappelle dans mon emballement à la suite de l'affaire Cayzeele avoir dit que c'était l'ouverture d'une voie permettant le recours pour excès de pouvoir contre le contrat tout entier. Je me suis fait sèchement rabattre par le vice-président du Conseil d'État dans une lettre, pas publiquement, et je crois qu'il avait raison. Et pour ma part, me disait-il, je ne suis pas prêt de suivre la voie que vous avez ouverte. Effectivement. Quelques temps après, j'ai du mettre un bémol dans le commentaire de l'arrêt Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, où là la limite du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle a été nettement soulignée.
Il n'en reste pas moins que par la voie du recours pour excès de pouvoir contre certaines clauses du contrat, ces clauses ne sont pas des clauses contractuelles, même si elles ont une origine conventionnelle. Et c'est ce qui est important dans le contrat, et c'est à nous de faire la distinction de ce qui est contrat et de ce qui est convention : la convention à effet réglementaire, à contenu réglementaire et le contrat qui ne comporte que des stipulations. Et ce n'est pas par hasard si dans l'arrêt Cayzeele il est parlé de dispositions et non pas de stipulations : la rigueur de la rédaction est parfaite (elle ne l'est pas toujours), là elle est parfaite. Et je crois que c'est là toute l'ambiguïté des contrats administratifs et de leurs effets sur les tiers : c'est que certains contrats administratifs ne sont pas véritablement à l'égard des tiers des contrats.
Voilà quelques propos que je me suis permis d'ajouter, Madame, à votre exposé qui était tout à fait riche et intéressant. Mais vous voyez que cela suscite la réflexion et nous aurons l'occasion encore d'en reparler dans la discussion qui suivra l'exposé que nous allons entendre maintenant de Monsieur de BÉCHILLON : "À propos des catégories du droit de la responsabilité". Quelle ouverture vous avez, quelle liberté vous avez, "À propos de", cela vous permet de dire ce que vous voulez.
À propos des catégories du droit de la responsabilité
par Monsieur Denys de BÉCHILLON,
professeur à l'Université de Pau
La quasi-totalité du débat sur la responsabilité porte aujourd'hui sur l'évolution et le destin des catégories juridiques. Pêle-mêle : le déclin de la faute lourde au bénéfice de la faute simple ; la possible inversion de la tendance qui a longtemps abouti à un déclin général de l'exigence de faute au profit du risque ; la part respective de présomption et de preuve que connaît la responsabilité pour faute ; la submersion de la responsabilité politique par la responsabilité pénale ; la submersion corrélative et plus générale du droit public par le droit privé commun ; la compétition des fondements, légaux, jurisprudentiels ou contractuels de la responsabilité ; la vraie nature de chacun de ces fondements, s'agissant notamment du contrat, etc. Tout, à l'évidence, se passe comme si le thème de l'évolution du droit de la responsabilité, que tout le monde dit gigantesque, se résumait en une campagne de redistribution générale des catégories et des qualifications conceptuelles des régimes juridiques.
La question que je me pose est de savoir comment nous devons appréhender ce phénomène. En termes plus choisis, je suggère de nous interroger sur la manière dont une science du Droit qui se voudrait tout à la fois fine et authentiquement positiviste doit considérer ce thème du changement en Droit de la responsabilité, et donc ce thème des catégories.
Une première solution -- qui est d'ailleurs la plus évidente -- consiste bien sûr à continuer dans la même voie et à choisir de comprendre les causes de cette redistribution. Par exemple, on pourrait choisir d'analyser les phénomènes de convergence des droits privé et public de la responsabilité en invoquant, selon les cas, la demande sociale -- celle qui ne comprend pas ou plus qu'un malade à l'hôpital public soit différemment et moins bien traité sur le plan indemnitaire, que le malade d'une clinique privée qui aurait subi le même dommage -- ou les phénomènes d'harmonisation plus ou moins forcés que suppose, notamment, l'européanisation du Droit de la responsabilité -- l'affaire des produits défectueux constituant à cet égard un exemple saisissant --, ou encore les rapports de stratégie compétitive des différents ordres de juridiction, sans doute de plus en plus soucieux de valoriser leur image respective de gardien optimal du Droit, etc.
Une deuxième solution, d'ailleurs immédiatement corrélative, consisterait à vérifier l'existence et l'ampleur de ces translations de catégories, assez nettement différenciées. On pourrait ainsi chercher à contester la profondeur du mouvement en montrant, par exemple, que les changements de terminologie ne s'accompagnent pas forcément de changements de régime réels. C'est -- simple illustration -- ce que l'on pourrait dire du passage de la faute lourde à la faute dite médicale si l'on arrivait à prouver que le nombre de cas de mise en jeu effective de la responsabilité de la puissance publique n'a pas sensiblement varié depuis que ce changement a été décidé, et d'où l'on déduirait décidément que ladite faute médicale n'est certainement pas une faute simple, mais bien toujours une faute qualifiée, correspondant à des activités délicates, et, comme telles, difficiles à qualifier aisément de fautives ... On pourrait encore s'efforcer de montrer -- c'est une variante -- que l'irruption de catégories nouvelles, comme le glissement relatif des catégories, ne produit pas nécessairement d'effets pratiques considérables. Me Thiriez avait très bien montré que la jurisprudence Bianchi ne servait pas à grand chose, parce que les juridictions administratives en limitaient l'application à des cas très exceptionnels, et la chose est effectivement très parlante 1 ( * ) .
Toutes ces voies sont évidemment utiles et nécessaires. Mais je crois qu'elles n'épuisent pourtant pas la question. Et ce, parce qu'elles ont en commun d'adopter un même postulat, ou plus exactement un même angle de vue, consistant à partir des catégories juridiques elles-mêmes pour en apprécier le destin. Or, d'une certaine manière, cela revient à accepter l'idée que ce sont bien ces catégories qui sont structurantes, et donc qu'il convient forcément d'aborder la question de la responsabilité à partir des règles du droit de la responsabilité, ou plus exactement encore, à partir des représentations et des classifications de ces règles qu'opère la dogmatique juridique.
Or il me semble que ce point de vue est partiel. Qu'il est, comme tel, assez déformant. Et que nous gagnerions à lui juxtaposer un autre regard -- celui du point de vue de l'acteur requérant -- pour épouser mieux notre sujet.
Pour ce faire, je souhaiterais, plutôt que de théoriser de manière trop abstraite, nous inviter à un petit exercice de casuistique, consistant à analyser deux arrêts assez récents du Conseil d'État sous l'angle que je souhaiterais promouvoir, et à m'efforcer d'en tirer ensuite quelques réflexions un peu plus reculées sur ce thème des catégories.
I - UN PEU DE CASUISTIQUE
Considérons l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 16 nov. 1998 dans une affaire Mlle Reynier 2 ( * ) . Victime d'une chute de cheval et se plaignant de douleurs au mollet et au genou, la requérante fut admise en urgence au Centre hospitalier de Brive. Une radio est effectuée, qui permet de conclure à l'absence de lésion osseuse. La malade est orientée vers le service de médecine générale, avec d'autant plus de facilité qu'une certaine attention est prêtée à son (prétendu ?) état dépressif.
Ce n'est que deux jours plus tard que sa douleur persistante à la jambe est sérieusement prise en compte. Elle fait l'objet d'une consultation chirurgicale, d'où résulte un diagnostic du syndrome des loges -- une sorte d'hypercompression des nerfs et des vaisseaux par l'effet d'un oedème -- lequel débouche tout de suite sur l'intervention idoine. Mais il est déjà trop tard pour que toutes ses chances de complète récupération soient effectivement préservées. L'intéressée souffre d'importantes séquelles.
Établissant, sur le terrain de la causalité, que les chances de complète guérison de la requérante ont bien été compromises par le retard de quarante-huit heures avec lequel son syndrome des loges a été diagnostiqué, le Conseil d'État conclut à l'indemnisation de l'ensemble de ses troubles, considérant qu'une faute dans l'organisation du service a bien été commise, alors " qu `un diagnostic rapide aurait conservé ses chances de récupération totale ". L'indemnisation s'ensuit.
Réfléchissons à cette catégorisation. De quelle faute "d'organisation" s'agit-il ? Pas d'un simple retard dans l'administration de soins ou dans la présentation du malade à un médecin, comme il est classique (Cf. par ex. CE, 12 déc. 1941 Hôpital civil d'Antibes, Rec. CE p. 218) : Mlle Reynier avait bien été vue rapidement par un médecin, comme le reconnaît l'hôpital lui-même, qui proteste expressément, dans sa défense, de la difficulté pour un praticien généraliste de diagnostiquer le syndrome des loges.
C'est donc bien d'une faute dans l'orientation diagnostique qu'il s'agit, c'est-à-dire d'une faute commise par un médecin dans l'exercice de son art, lorsqu'il n'a pas la présence d'esprit d'évoquer la possibilité d'une affection non décelable par lui, mais dont la vraisemblance est suffisante pour qu'il soit nécessaire de faire lever le doute par un spécialiste. Il s'agit donc bien, en clair, d' une faute médicale. C'est indiscutablement un médecin, dans l'exercice d'une des ces attributions proprement médicale qu'il est, selon la nomenclature, le seul à pouvoir exercer, qui avait orienté Mlle Reynier en médecine générale, et encore un autre (voire le même), agissant toujours en cette qualité singulière, qui n'avait pas jugé utile de la présenter à un chirurgien pour écarter la possibilité d'une affection qu'il pourrait ne pas voir ou ne pas connaître (puisque la persistance de la douleur devait l'y inciter).
Le service s'est-il révélé mal organisé ? Oui, mais seulement en ceci que ses médecins y ont manqué à leurs obligations, strictement médicales, de célérité et de pertinence dans le diagnostic. Le régime de responsabilité " normalement " applicable aurait donc dû être celui que le droit administratif réserve en principe à la faute médicale. On peut s'en assurer au vu des nombreux arrêts où, dans des cas très similaires, le Conseil d'État a exigé la réalisation d'une faute lourde -- avant l'arrêt ép. V. -- et d'une faute médicale après (par ex, CE 10 nov. 1976 André Philippe, CE, 14 janv. 1984, Vigouroux et autres, CE, 8 déc. 1989, Mme Caro, etc.).
On retrouve ici le point de vue de l'acteur. Mlle Reynier n'aurait pas forcément obtenu gain de cause si elle avait recherché l'indemnisation sur le fondement de la faute médicale proprement dite : on sait bien qu'il est infiniment plus difficile de rechercher la réparation d'un dommage sur le terrain d'une faute médicale que sur le terrain d'une faute dans l'organisation le fonctionnement du service public.
Le maniement orthodoxe des catégories aurait donc du conduire la requérante à rechercher la responsabilité de l'hôpital sur le fondement de la faute médicale, et non pas sur celui de la faute d'organisation, et à courir le risque très probable de ne pas y obtenir gain de cause. Or c'est justement ce qu'elle n'a pas fait, et c'est même pour cela qu'elle a bénéficié d'une indemnité.
D'où la leçon : d'évidence, les catégories ne sont pas vraies ou fausses. Et elles ne déterminent pas, à elles seules, le droit applicable. Elles sont autant de ressources que les acteurs manient au mieux de leurs intérêts.
En l'espèce, l'intérêt bien compris du requérant consistait à tenter une opération de classification sans doute discutable, mais parfaitement conforme à son intérêt immédiat. Et cet intérêt a manifestement rencontré celui du juge au cas d'espèce, qui s'est laissé convaincre de la nécessité de cette entorse à l'orthodoxie, sans doute moins gênante pour lui qu'une discussion du cas à l'intérieur du carcan de la faute médicale.
Quoi qu'il en soit, cela montre bien une chose : un requérant, quel qu'il soit, ne recherche jamais, pour elles-mêmes, l'exactitude ou la pureté dans ses opérations de qualification et de classification, et ce tout simplement parce que ce n'est pas son problème. Il recherche un effet, une fin, et se donne tous les moyens de maniement des règles et catégories qu'il trouve pour y parvenir. Les questions apparemment les plus techniques, les plus froides et les plus procédurales ne sont pas plus neutres que les autres. Bien au contraire. Ce sont même celles sur lesquelles un raisonnement finaliste a le plus de prise, parce qu'elles possèdent généralement des effets radicaux.
Les catégories juridiques ne sont pas la cage de fer de la raison juridique. Elles sont instrumentalisables, comme n'importe quelle règle, entre les mains des acteurs. Il existe donc forcément une logique du maniement des catégories qui n'épouse pas la logique intrinsèque de ces catégories. Nous mutilerions la connaissance juridique à ne pas le voir. Mais c'est très largement ce que nous faisons en omettant de considérer ce point de vue de l'acteur que j'essaie ici de mettre en évidence.
Analysons maintenant un autre arrêt, également rendu par le Conseil d'État, le 31 mars 1999, Assistance publique à Marseille 1 ( * ) . Une personne présente les symptômes d'une hépatite B trois mois après avoir subi une intervention chirurgicale. À quelles conditions lui est-il possible de tenir l'hôpital pour responsable de l'infection dont elle souffre ? Le malade était-il atteint par ce virus avant son entrée à l'hôpital ? Le bilan biologique effectué avant son opération prouve que non. Une transfusion a-t-elle été pratiquée ? Rien ne permet de le penser. Il faut donc se tourner vers l'hypothèse d'une contamination par l'emploi de matériel non stérile -- le risque de transmission de l'hépatite B par cette voie étant bien connu.
Mais quel matériel incriminer ? Pas celui dont a usé l'infirmière lors des soins postopératoires, puisqu'il est établi (par elle) et non contesté (par le défendeur) qu'elle a seulement employé des seringues à usage unique. Reste donc à incriminer le matériel de l'hôpital. Le virus de l'hépatite B peut se transmettre lorsque le personnel soignant n'utilise pas de seringues à usage unique -- une stérilisation imparfaite pouvant échouer à éradiquer le virus. Or les piqûres pratiquées sur le requérant ne l'ont pas toutes été avec de tels moyens, même si les seringues réutilisables employées avaient bien été stérilisées.
Un lien direct de causalité est ainsi présumé entre l'usage de ces seringues et la contamination. Arrêtons-nous un instant sur cette présomption du rôle causal de la seringue. Elle coupe court à de nombreux aspects du débat sur la genèse "réelle" du dommage. Car rien ne permet d'exclure que le patient ait contracté autrement son hépatite (par voie sexuelle, à l'occasion d'autres soins, chez le dentiste, par le truchement de matériel chirurgical mal stérilisé -- puisqu'il y a eu opération -- etc.), mais justement : toute la fonction du mécanisme vise à éviter ces casuistiques. D'ailleurs, selon toute probabilité, on aurait présumé quand même le rôle causal des soins si l'incrimination d'un vecteur précis n'avait pas été possible. Une mise en cause du matériel chirurgical aurait notamment pu avoir lieu même si l'hôpital n'avait utilisé que des seringues à usage unique (ce qui a déjà été jugé, CE 19 février 1992 Musset, s'agissant de l'introduction accidentelle d'un staphylocoque doré à l'occasion d'une arthrographie de la hanche, qui a fait présumer la faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service alors même que la seringue et l'aiguille employées ne recevaient qu'un usage unique). Et l'on aurait même pu se passer totalement de désigner les voies physiques de la transmission du virus, puisque l'arrêt CE, 9 déc. 1988 Cohen, en posant l'obligation faite à l'hôpital de fournir toujours un matériel et des produits stériles, permet que sa responsabilité soit engagée lorsque les circonstances exactes de la contamination ne sont pas du tout connues.
Tout cela se comprend très bien : si l'idée dominante est bien de réparer comme anormaux tous les dommages causés par des affections " acquises dans un établissement de soin ", il importe peu que l'on sache pour de bon ce qui les a causés, ni surtout les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu être évités.
Il faut même aller plus loin : c'est la caractéristique éminente de nombre d'infections nosocomiales, surtout bactériennes, que d'échapper à toute prévention : germes résistants, sélectionnés par la pression antibiotique, population à immunité affaiblie, localisation délicate des "réservoirs" microbiens (dans les gaines d'aération, l'eau de lavage des mains, etc.), quasi impossibilité matérielle de l'asepsie complète, à fortiori dans certaines structures anciennes et mal adaptées, etc. La lutte engagée dans tous les hôpitaux, notamment au travers de l'institution des CLIN repose sur le constat de cette difficulté et la généralisation d'une culture de la prophylaxie propre à parer au mieux à ce qui ne peut jamais être complètement évité 1 ( * ) .
Quoi qu'il en soit, une fois le lien de causalité établi, le juge doit fonder la responsabilité de la puissance publique. C'est, de nouveau, un mécanisme de présomption qui va permettre de parvenir à ce résultat : celui, parfaitement classique en milieu hospitalier, qui consiste à déduire la faute du préjudice pour tout ce qui ne relève pas de l'acte médical proprement dit. Ainsi que l'enseigne l'arrêt Cohen (préc.), c'est " le fait qu'une telle infection ait pu se produire [qui] révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ". Et l'on ne voit plus très bien dans quel cas il pourrait en aller autrement : un postulat à peu près indestructible veut que l'on ne doive plus contracter à l'hôpital une maladie dont on ne souffrait pas en y entrant sans tirer de la survenance de ce dommage un droit à réparation. Sous cet angle, l'arrêt ici rapporté s'inscrit donc dans une ligne jurisprudentielle stable et classique.
Son principal intérêt réside plutôt ailleurs, dans la comparaison qu'il suscite avec la jurisprudence récente de la Cour de cassation qui, à peu près en même temps, a décidé de soumettre les infections nosocomiales à un régime de responsabilité déterminé par une obligation contractuelle dite " de sécurité de résultat ". (1 e Chambre civile de la Cour de cassation, trois arrêts du 29 juin 1999 ( CPAM de la Seine St Denis c/ Henry et autres, Aebi c/ Marek et autres, Follet c/ Friquet et autres )
En point d'orgue d'une évolution accélérée depuis 1996, la Cour de cassation a donc abandonné -- dans ce domaine -- l'obligation de moyens et impose aux structures de santé privées, comme aux simples praticiens de cabinet, de répondre de tous les cas d'infection nosocomiale, jusques et y compris contractés ailleurs que dans une salle d'opération ou d'accouchement.
Revenons donc à notre problème de catégories. Théoriquement parlant, le paysage du droit de la responsabilité en matière de dommages nosocomiaux est aujourd'hui structuré par une distinction claire : 1) la réparation s'opère, pour un dommage causé à l'hôpital public, devant le juge administratif, sur le fondement d'une présomption de faute dans le contexte statutaire (et donc délictuel ou quasi délictuel) normalement applicable à l'usager d'un service public administratif ; 2) elle s'effectue, pour un dommage causé dans une clinique privée, devant le juge judiciaire, sur le fondement d'une obligation (contractuelle) de sécurité de résultat constitutive d'une présomption de responsabilité.
Toujours de ce même point de vue théorique, cette opposition emporte surtout que l'hôpital public pourrait se libérer de son obligation en prouvant l'existence d'un cas de force majeure, d'une cause étrangère ou d'une absence de faute de sa part, alors que la clinique privée ne pourrait échapper à sa responsabilité qu'à la seule condition d'établir la cause étrangère ou la force majeure, la démonstration d'une absence de faute étant totalement inopérante. Présomption de faute ici, présomption de responsabilité là. En termes de distinction des catégories juridiques, ce n'est pas rien.
Adoptons de nouveau le point de vue de. l'acteur, et demandons-nous quelle traduction effective ce clivage fort peut avoir dans sa situation juridique.
Il n'y en a aucune. De ce point de vue, la situation indemnitaire réelle de la victime d'une infection nosocomiale avérée est aujourd'hui la même dans tous les cas de figure. Pourquoi ? Simplement parce que la différence à priori la plus notoire entre les deux catégories consiste dans le fait qu'il est en principe possible de se dégager d'une présomption de faute en prouvant que l'on n'a pas commis de faute, alors que l'on ne peut pas en faire autant avec une présomption de responsabilité. Et que cette différence est absolument abolie en pratique.
En effet, devant le juge administratif, la preuve de l'absence de faute est impossible à apporter indépendamment d'une destruction du lien de causalité -- et donc de la mise en évidence d'une cause étrangère. Empiriquement, c'est la conséquence immédiate de l'idée -- du juge administratif --, selon laquelle c'est le dommage qui, par lui-même, fait présumer la faute.
L'hôpital pourrait-il montrer qu'il a tout mis en oeuvre pour assurer une prophylaxie parfaite ? Pourrait-il justifier d'avoir respecté toutes les consignes, pris toutes les précautions ? Justement pas. Le mécanisme mis en place avec l'arrêt Cohen vise exactement à contourner ce genre de défense : le dommage prouve le manquement même et surtout lorsque l'on ne comprend pas du tout les raisons pour lesquelles le dommage a pu se produire.
Par voie de conséquence, le débiteur de cette obligation ne peut jamais s'exonérer autrement qu'en démontrant que le dommage a bien été causé ailleurs ou autrement -- autrement dit : qu'il a été produit par une cause étrangère, et donc que l'hôpital ne saurait être responsable faute d'implication causale dans la genèse du dommage.
Or une clinique privée s'exonérerait exactement de la même manière, aujourd'hui, de son obligation de sécurité de résultat devant le juge judiciaire : lorsqu'il n'y a pas de lien de causalité entre le fait de la clinique et le dommage, il n'y a tout simplement pas de responsabilité du tout. Même dans ce cas. La distinction des catégories paraît donc dépourvue de la moindre traduction pratique.
Mais il s'agit peut-être d'un effet d'illusion. On pourrait parfaitement soutenir que ce brouillage ne tient pas au caractère inopérant des catégories juridiques, mais à la mauvaise compréhension de leur véritable nature. Si l'on y pense bien, le système mis en place par le Conseil d'État n'a rien à voir avec une présomption de faute : c'est une présomption de responsabilité qui ne dit simplement pas son nom. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'on ne trouve pas de différence palpable avec le droit privé. Cela se démontre même très bien : la Cour de cassation avait pratiqué, en matière d'infection nosocomiale, une "vraie" présomption de faute entre 1996 et 1999. "Vraie" en ce sens qu'elle s'analysait en un renversement de la charge de la preuve, et qu'elle permettait donc au débiteur de se dégager de sa responsabilité en établissant qu'il avait bien respecté tous les protocoles d'asepsie (Civ 1 e 21 mai 1996, Bonnici c/ Clinique Bouchard, Bull, Civ. 1. n°° 219). Mais forcément, pour parvenir à ce résultat, la Cour ne postulait pas du tout que le dommage établissait par lui-même la faute de la clinique. À contrario, donc, puisque, en vertu de la jurisprudence Cohen, un hôpital public ne peut se dégager de sa responsabilité en prouvant qu'il n'a pas commis de faute, c'est que le droit qui lui est applicable postule sa responsabilité, et non pas sa faute. Le Droit privé et le Droit public de l'infection nosocomiale relèveraient donc d'un même régime de présomption de responsabilité ou d'obligation inconditionnelle de sécurité de résultat, l'un d'entre eux faisant simplement l'objet d'une mauvaise dénomination La vérité ontologique des catégories serait donc parfaitement préservée par-delà les mots.
Reste que cela ne marche pas. Parce que, si l'analyse qui précède est la bonne, il faut se demander ce qui distingue ce régime présomption de responsabilité, ou de responsabilité pour faute irréfragablement présumée, d'un régime de responsabilité sans faute. Et l'on risque fort de ne rien trouver : les conditions d'engagement sont les mêmes (un fait, un dommage, un lien), et les conditions d'exonération aussi : la force majeure ou la cause étrangère (i.e : la destruction du lien de causalité, c'est à dire de la condition même d'une responsabilité -- et ce qui la différencie d'une assurance).
Or, si ces catégories sont effectivement repliées l'une sur l'autre, il faut franchement se demander :
1) pourquoi nous tenons tant à penser que la responsabilité sans faute et la responsabilité pour faute appartiennent à des univers radicalement différents, voire paradigmatiquement opposés ?
2) pourquoi il se vérifie que les juges n'appréhendent pas du tout ces catégories de la même manière, la responsabilité pour faute présumée fonctionnant à priori très facilement, alors que les résistances à l'emploi d'une responsabilité sans faute qui dit son nom sont gigantesques : encore une fois, la jurisprudence Bianchi ne fonctionne à peu près pas, et la Cour de cassation vient même de s'offrir le luxe de ne pas l'étendre "officiellement" au droit privé de la responsabilité 1 ( * ) .
Décidément, le malaise est plus profond qu'il n'y parait, et le hiatus entre les catégories scolastiques du droit et la "réalité" de la pratique de ces catégories dans le chef des acteurs, extrêmement profond.
II - UN PEU DE RECUL
Ce qui précède, me semble-t-il, conduit à plaider contre l'empire des catégories dans la discussion juridique au sujet de la responsabilité et de son évolution. Plus exactement, cela conduit à plaider contre la focalisation du débat sur cette seule question du devenir des catégories.
On vient déjà de voir que cette tendance ne donnait pas de bons résultats puisqu'il en résulte une vision mutilée du phénomène juridique : partielle, parcellaire et, en toute hypothèse, appauvrie. On vient de voir aussi et surtout que l'obnubilation du regard par la considération des seules catégories aboutissait à déformer la réalité empirique du phénomène contentieux. Si l'on poussait à son terme cette critique en actualisant une célèbre métaphore weberienne 2 ( * ) , on pourrait dire que le juriste qui prétendrait observer complètement le Droit de la responsabilité en le faisant par le seul truchement des catégories dogmatiques se trouverait un peu dans la position d'un chroniqueur qui prétendrait analyser la partie historique de Kasparov contre Deep blue en s'interrogeant seulement sur le point de savoir si les deux protagonistes ont bien respecté (ou non) la règle du jeu d'échecs. Et il n'est pas utile d'insister sur le fait qu'il s'agit là d'une manière très sûre de ne pas comprendre ce qui se passe dans le jeu.
Je crois qu'il faut donc sortir de ce positionnement exclusivement scolastique, et s'affranchir de la fétichisation des catégories qu'il suppose.
Mais c'est très difficile. Et ce pour plusieurs raisons. La première est que cela va contre nos habitudes, notre pente, et à peu près tout ce que nous avons appris. Sans aucun doute, un affranchissement de cette sorte ne peut aller sans un inconfortable sentiment d'étrangeté. Car le regard sur l'acteur est un regard de type sociologique. Or ce type de regard est exactement celui que les facultés de Droit ont refusé d'adopter pour établir leur spécificité (et dans une large mesure, avec elle, la spécificité de la science du Droit). En quoi elles ont d'ailleurs -- et probablement sans le savoir -- donné une certaine expression à la perspective kelsénienne selon laquelle la science (pure) du Droit se constitue avant tout pour lutter contre la sociologie. Autrement dit, ce monde n'est donc pas le nôtre. Et nous ne nous y sentons pas très bien.
Une deuxième raison est que nous aurions -- dans une certaine mesure -- raison de ne pas nous y sentir bien, et donc de nous défier de la sociologie : nous n'y sommes, en effet, pas formés, et nous n'avons jamais reçu -- institutionnellement s'entend -- l'équipement qu'il faut pour la pratiquer nous-mêmes. Il serait donc extrêmement dangereux (bien que malheureusement très répandu) de croire et de faire croire que notre qualité de juristes nous fonde à priori à savoir produire de la bonne sociologie ou de la bonne anthropologie. Il y aurait beaucoup à dire, sous ce rapport, au sujet de l'invocation contemporaine de "catégories anthropologiques fondatrices" dans le discours ne certains juristes universitaires. Bref, je crois que nous devons pratiquer l'ascèse et garder une certaine retenue en ce qui concerne notre éventuelle tentation de statuer ex cathedra sur tous les problèmes que pose le Droit.
Une troisième raison tient à ce que toute tentative d'évasion du monde strict des catégories raisonne plus ou moins à la manière d'une trahison. Les juristes ont pour métier de fabriquer et de faire vivre des fictions, lesquelles sont indispensables pour traduire le réel en autre chose, sans quoi ce même monde réel ne serait pas appréhendable par le Droit. Il y va de notre identité et de notre fonction sociale que de savoir vivre dans ces catégories. D'où l'inconvenance d'en sortir.
Une quatrième raison est que cette trahison tient même lieu d'une sorte de suicide dans le monde scolastique. Car célébrer ces catégories du Droit, c'est en fait, et forcément, célébrer des catégories forgées par la science du Droit, et donc entretenir une sorte de révérence à l'égard de notre histoire -- celle des théories et des systèmes de taxinomie universitaires. Sous cet angle, la fétichisation des catégories contribue inévitablement à entretenir notre foi collective au sujet de ce que nous apportons au monde, et de l'importance de ce que nous y apportons. Une authentique blessure accompagne inévitablement l'abandon, même partiel, de notre attention exclusive pour la vie des catégories. Et nul n'aime véritablement cela.
Je crois cependant qu'il faut accepter cette blessure et affronter ces difficultés, parce que notre trop absolue fascination pour le jeu des catégories présente de graves inconvénients.
Un premier inconvénient vient de ce que cette posture scolastique est épistémologiquement intenable. Nous risquons en effet toujours de perdre de vue, à ne pas entretenir de flamme critique à ce propos, le caractère fondamentalement construit, artefactuel, artificiel de ces catégories : le fait qu'elles sont intégralement issues d'un travail de la raison (scientifique), et donc qu'elles ne se confondent pas avec la "réalité" de ce qu'elles cherchent à systématiser -- ladite "réalité" des règles et verdicts du droit, soit dit par parenthèse, n'étant elle-même pas autrement constituée que part l'artifice humain. Sous ce rapport, en tout cas, l'obnubilation par les catégories installe le juriste sur la même pente que celle qui ferait prendre à un physicien les lois de sa science pour des lois de la nature : l'inverse exact de tout ce qu'enseigne l'épistémologie moderne.
Un deuxième inconvénient vient de ce que la fétichisation des catégories aboutit, au moins potentiellement, à l'adoption d'une posture éthiquement très fragile dans la discussion juridique. Car cette attitude aboutit à réifier des concepts, à transformer en choses du monde empirique des constructions de l'esprit. Et cela ne peut aller sans entretenir l'illusion que ces prétendues choses ont une "nature", une essence, dont le savant serait, par construction, capable d'une connaissance vraie. Or nous avons, me semble-t-il, un impérieux besoin de nous éloigner de cette pente. Car la menace est grande, si l'on dorme à croire qu'il peut exister une connaissance vraie du Droit, que cette vérité se transforme en valeur, car il est forcément mal, pour un savant, de méconnaître ou de travestir ce qui est. La porte s'ouvre ainsi à la constitution d'une cléricature, d'une caste de connaisseurs de la justesse sur le Droit, que rien n'empêche de procéder par excommunication des non-détenteurs de cette vérité dont ils sont tout à la fois les fabricants et les gardiens. L'impossibilité même d'une science commence peut-être là. À fortiori dans un univers -- juridique -- où tout -- autorisons-nous cet essentialisme-là -- doit s'offrir par principe à la discussion. Je crois donc que nous devons apprendre à nous défier suffisamment des catégories.
Monsieur Pierre DELVOLVE
J'ai retrouvé dans cet exposé toute la finesse d'analyse et toute l'élégance de la forme qui ont tellement séduit le précédent jury du concours d'agrégation. J'ai eu peur un instant lorsque vous avez d'abord démoli les catégories. Lorsque ensuite vous en avez exposé la nécessité, j'ai été rassuré. Nous avons besoin de catégories pour nous même, pour nos enseignements, pour nos jugements, mais les catégories sont des moyens de classer les choses et les normes. Et elles sont utilisées - et vous l'avez souligné - selon les cas, selon les besoins.
Et en vous écoutant je retrouvais encore les lignes tracées par notre maître, présent hier, les notions fonctionnelles en droit administratif. Et les catégories, ce sont des instruments qui remplissent des fonctions pour répondre à des besoins, qui sont utilisés par le juge selon les cas. Vous avez cité cet exemple ou le juge s'est référé à la faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier alors qu'il s'agissait d'une faute médicale. C'est un instrument dont il se sert pour répondre à une demande, une demande sociale.
Nous ne sommes pas sociologues, et vous l'avez souligné. La science du droit se distingue de la sociologie, mais le droit doit répondre à une demande sociale et je me rappelle les conclusions de Monsieur LEGAL, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure dans l'affaire Époux V, où la demande sociale est particulièrement mise en valeur par l'auteur pour contribuer à l'évolution de la jurisprudence de telle sorte que l'on abandonne l'exigence de la faute lourde ou du degré lourd de la faute en matière chirurgicale ou médicale.
Les catégories sont des constructions de l'esprit, leur utilisation sont des manifestations de l'instrumentalisation du droit, mais dans tous les cas, pour répondre à une demande sociale. Les réponses peuvent être différentes et le cas des infections nosocomiales est particulièrement révélateur. Le Conseil d'État règle la question d'une certaine manière, la Cour de cassation la règle d'une autre manière. Mais finalement, le résultat, c'est l'indemnisation de la victime dans des hypothèses où le bon sens conduit à considérer qu'on ne peut pas admettre qu'une personne entrée à l'hôpital ou à la clinique sans aucun aspect pouvant faire comprendre qu'il en ressorte ensuite avec une maladie bien plus importante que celle qui l'a fait entrer à l'hôpital. La Cour de cassation utilise un instrument. Le Conseil d'État en utilise un autre. Le résultat est parallèle, il n'est pas identique.
Question : le résultat est-il satisfaisant ? C'est là je crois le véritable problème. C'est une des questions que je pose.
- IV - La responsabilité est-elle dominée par l'éthique ?
Recherche sur les fondements méta-éthiques de la responsabilité
par Monsieur Jean-Arnaud MAZÈRES,
professeur à l'Université Toulouse 1
Président de séance : Monsieur Yves GAUDEMET
Le thème de cet après-midi, "La responsabilité est-elle dominée par l'éthique ?", est un thème ambitieux, ambition à laquelle ajoute encore le point d'interrogation qui complète cet intitulé. Je ne sais pas si je réussirai ex post l'exercice que notre collègue DELVOLVE a magnifiquement réussi, c'est-à-dire de donner son unité à l'ensemble de ces interventions. À priori, les thèmes sont à la fois dispersés, ambitieux et larges : la théorie du droit, le droit international public * ( * ) , la responsabilité hospitalière largement entendue, et puis l'éthique et l'esthétique. Mais je pense que, là encore, de ces communications et de nos débats viendront l'unité que nous avons pu observer ce matin. Finalement à partir du moment où le débat s'élève, tout s'élève. Je céderai ensuite la place au Doyen HELIN pour animer la table ronde, qui doit répondre à toute une série d'interrogations là aussi très ambitieuses. Et bien évidemment Monsieur le professeur MOREAU présentera ensuite sous sa propre présidence, car il y aurait tout à fait indécence à ce que je reste à cette table, le rapport de synthèse qui nous permettra de garder le souvenir déjà très riche de ce colloque. Alors je vous propose de commencer tout de suite.
Monsieur Jean-Arnaud MAZÈRES
Longtemps enfermée dans le monde clos des prétoires et des débats techniques, la responsabilité est devenue depuis quelques années bien plus qu'une notion juridique : un thème médiatique jeté en pâture aux réactions instinctives d'une opinion publique d'autant plus apte à s'égarer que son information est à la fois théâtralisée et banalisée.
Au sein de la doctrine juridique elle-même, la question de la responsabilité a connu un déplacement significatif : le terrain traditionnel des règles positives est aujourd'hui largement dépassé par des prises de position souvent passionnées mettant en cause les errements des gouvernants et des juges sur des questions fondamentales comme les droits de l'homme ou la dignité de la personne humaine. L'État de droit tel qu'il est entendu aujourd'hui ouvre non seulement de nouveaux champs à l'engagement de la responsabilité des personnes publiques ou privées, mais donne plus encore à celle-ci une dimension fondamentale inconnue jusqu'alors 1 ( * ) .
Cette situation trouve d'ailleurs ses racines au-delà de la sphère proprement juridique : on a vu, ces dernières années, émerger une conception véritablement nouvelle de la responsabilité des politiques qui s'érige progressivement sur les ruines d'une responsabilité politique 2 ( * ) , de type essentiellement parlementaire, que les nouvelles conceptions de la gouvernance contemporaine semblent avoir reléguées dans un passé définitivement révolu. La responsabilité civile ou pénale, circonscrite longtemps dans le champ de la société dite "civile", semble aujourd'hui effectivement pénétré celui d'une société politique comme pour compenser l'éloignement ressenti à son égard par les citoyens.
Et au-delà même du politique, le thème de la responsabilité articulé à celui de l'éthique tend à envahir le champ de ce que l'on pourrait appeler la pensée contemporaine, qu'il s'agisse de prises de position philosophiques ou de thèmes générés et véhiculés par les figures nouvelles de l'idéologie 3 ( * ) .
En fait, notre époque connaît à cet égard un mouvement très significatif. Face aux nouvelles formes de l'agir humain engendrées par les sciences, la technologie mais aussi la politique contemporaines, les exigences de l'éthique tendent à se déployer dans de multiples secteurs, sans que cette notion soit d'ailleurs clairement définie 1 ( * ) .
Mais l'éthique étant ainsi devenue une notion ancrée dans notre société, et au-delà de ses multiples manifestations, son fondement restant problématique, elle connaît une sorte de repli empirique et institutionnel vers la notion connexe de responsabilité. C'est le mouvement que relève, pour le suivre d'ailleurs, le philosophe Paul RICOEUR : plutôt que de s'attacher "à la question très controversée... du fondement de l'éthique", il propose de retenir l'idée de responsabilité qui lui paraît "constituer le point focal des convictions susceptibles d'entraîner un large consensus" 2 ( * ) .
Mais ce glissement d'une notion à l'autre n'est pas sans équivoque : faute de s'entendre sur un fondement de l'éthique, on la saisit instrumentalisée par la responsabilité, ce qui revient en définitive à admettre paradoxalement que ne pouvant être elle-même valablement fondée, l'éthique pourrait en revanche être établie comme fondatrice de la responsabilité. Et c'est bien l'éthique, en effet, qui depuis quelques décennies a envahi le champ des fondements de la responsabilité, au détriment de toute autre interrogation. Et cette "conquête" dont on a pu voir les effets pervers dans les "affaires" les plus connues (les interprétations les plus fréquentes de la jurisprudence PERRUCHE sont, on l'a déjà relevé, significatives à cet égard), a été d'autant plus facile que la question des fondements théoriques et philosophiques de la responsabilité n'a guère, dans le même temps, attiré l'attention de la pensée juridique dominante.
Le droit de la responsabilité publique ou privée est aujourd'hui un complexe très élaboré de principes, de règles et de techniques qui ont à la fois la rigueur d'un système et la souplesse d'un ensemble empiriquement et progressivement établi. Mais on ne peut que constater que ce droit n'a pas vraiment fait l'objet d'une réflexion fondamentale telle qu'elle existe en d'autres domaines, spécialement celui des actes juridiques.
En droit public, en particulier, c'est à peine que commence à se dessiner une réflexion constitutive d'une théorie générale des obligations 3 ( * ) qui semble mal s'accommoder avec les conceptions dominantes davantage orientées vers la question des relations objectives entre les normes. La petite place qu'occupe l'étude de la responsabilité dans le système kelsénien est significative 4 ( * ) . Et, dans notre pays, alors que Charles EISENMANN ne consacrait, dans l'impressionnant ensemble de ses enseignements, qu'un seul cours en 1953-1954 à la responsabilité, rares sont aujourd'hui les études fondamentalistes sur ce champ pourtant essentiel du droit 1 ( * ) .
Mais ce n'est pas seulement pour avoir naturellement occupé un terrain délaissé par d'autres perspectives que l'éthique a acquis ainsi une position dominante dans les fondements de la responsabilité. C'est aussi que celle-ci s'est trouvée d'abord constituée sur une notion à laquelle les constructions savantes de la doctrine et de la jurisprudence n'ont pu enlever sa nature première : la notion de faute, dont les racines dans la morale et l'éthique 2 ( * ) relèvent de l'évidence.
Sans doute la notion de faute, née du droit privé et adapté à sa logique, fait en droit public de la responsabilité l'objet de sérieux débats, et il est clair qu'elle y a une place à la fois particulière et limitée. Pourtant la faute demeure une justification toujours effective de l'engagement de la responsabilité des personnes publiques comme des personnes privée, et l'enracinement qu'elle implique dans le domaine de l'éthique demeure dès lors lui aussi toujours effectif.
De cet enracinement cependant émerge une nouvelle équivoque - ou plutôt un autre aspect de l'ambiguïté fondamentale du rapport entre éthique et responsabilité, auquel fait effectivement écho la trop célèbre opposition entre responsabilité et culpabilité.
Or si la responsabilité signifie que, lorsqu'un dommage est causé à une personne, l'on droit répondre de ce dommage vis à vis de celui à qui il a été causé en le réparant, la culpabilité met, elle, en oeuvre une situation et des relations très différentes. Au-delà du rapport intersubjectif (qui au plan de la responsabilité est réglé par la réparation), la culpabilité met l'individu en relation avec un système objectif de normes morales et/ou juridiques auquel son comportement fautif a porté atteinte : ici ce n'est pas le rapport d'individu à individu qui est en cause à la suite de la faute ; mais en quelque sorte l'atteinte, par l'agissement fautif, au lien fondamental pour lequel se constitue et se perpétue une collectivité déterminée qu'elle soit sociale, morale, ou même religieuse (la collectivité ayant alors une transcendance divine). Et alors que la responsabilité entraîne la réparation, la culpabilité génère la punition et éventuellement le pardon - l'une et l'autre de ces notions étant de nature très profondément différente de la réparation, comme l'a si bien montré V. JANKELEVITCH 3 ( * ) .
Il reste vrai pourtant qu'il existe entre ces deux registres, exprimés l'un et l'autre par le même vocable de "faute", une irréductible connivence. Et sans doute faut-il qu'il en soit ainsi ; car détachée de tout fondement moral la responsabilité ne serait plus que le domaine du froid calcul des intérêts pris en charge par des mécanismes d'assurance.
Mais comme l'a souvent rappelé Hannah ARENDT, il faut si l'on veut établir une relation entre deux notions ou deux phénomènes, d'abord les distinguer, pour ensuite éventuellement les relier.
Et c'est bien en ces termes que devrait être, semble-t-il, envisagée la question de la relation entre l'éthique et la responsabilité.
La première démarche dans cette perspective, pour tenter de saisir les fondements de la responsabilité face à un envahissement ambiguë et parfois pervers de l'éthique - d'une éthique souvent en collusion avec des idéologies inavouées, pourrait se donner pour objectif de départ ce qui, dans ces fondements se trouve en deçà ou au delà de l'éthique. Là, quelques concepts essentiels sont à l'oeuvre. Ceux d'imputabilité, de causalité et de vérité notamment, dès lors qu'ils sont élucidés, et que leur place au fondement de la responsabilité est clarifiée, permettent non seulement de mieux en comprendre l'essence même mais aussi de la mettre en oeuvre, dans des cas concrets, d'une manière plus juste et plus opératoire.
Mais il faut sans doute aller plus loin : non seulement replacer l'éthique dans un ensemble plus large qui laisse place à d'autres interrogations déterminantes à la base de la responsabilité ; mais encore repenser, face aux nouveaux aspects de l'agir humain, la conception traditionnelle de l'éthique dans son rapport à la responsabilité. Ici, en suivant la voie ouverte par les recherches de Paul RICOEUR, Hans JONAS, Emmanuel LEVINAS, Gilles LIPOVETSKY et quelques autres, il s'agirait de tenter la définition d'une nouvelle éthique, fondée non plus sur la dynamique de l'action et du progrès, dont on accepte ensuite de payer éventuellement le prix de la réparation, mais sur l'attention portée aux conséquences possibles de son action, sur la prudence, la précaution, la vigilance quant aux conséquences possibles de son action sur le monde et sur les autres. Une responsabilité de type nouveau devrait se dégager de ces perspectives, orientée non plus vers la réparation, mais (au sens qu'à parfois le terme lui même de responsabilité) vers la préparation consciente et éclairée (on pourrait dire effectivement "responsable") de l'action qui se trouve envisagée.
Et, comme on le voit aujourd'hui avec les mésaventures d'un principe de précaution vidé de son sens par l'utilisation chaotique qui en est faite, la difficulté sera, à coup sûr, de donner à cette conception nouvelle de la responsabilité des cadres juridiques suffisamment précis et opératoires.
***
Cette seconde démarche devant faire l'objet d'une étude ultérieure, les pages qui vont suivre sont consacrées à la première, et l'on cherchera seulement ici à dégager quelques orientations élémentaires sur ce que l'on peut appeler (à défaut de mieux) les fondements méta-éthiques de la responsabilité.
En se situant sur ce qui paraît bien être un axe majeur de la philosophie générale, mais qui est aussi en cause dans l'appréhension de la responsabilité en termes juridiques, on voudrait adopter successivement deux perspectives. Il s'agit d'abord de dégager les fondements de la responsabilité juridique dans sa relation avec la philosophie de l'action : la question majeure est ici celle de l'imputabilité, liée comme on tentera le montrer à celle de la causalité (I).
On envisagera ensuite les relations complexes qui se trouvent établies entre responsabilité et vérité , sur un plan qui est celui de la détermination de la responsabilité dans une perspective qui est alors celle d'une philosophie de la connaissance (II).
I- LES FONDEMENTS DANS LA THÉORIE DE L'ACTION : RESPONSABILITÉ ET IMPUTABILITÉ
Dans la logique d'une théorie de l'action, la question essentielle me semble bien être celle de savoir qui doit répondre d'une action ? à qui l'attribuer ? sur qui doit peser l'obligation de réparer ?
Si l'on recherche les fondements à partir desquels ces questions peuvent être formulées et des réponses données, on est d'abord sans doute conduit à retenir des fondements de nature éthique ou morale. Là on juge un comportement, et c'est de l'appréciation de ce comportement que dépendra la réponses à la question "qui doit répondre ?".
C'est la logique de la responsabilité civile, celles des articles 1382 et s. du code civil. Mais aussi la logique de la responsabilité administrative qui a d'abord été établie sur la faute - et la faute, comme l'a montré Ch. EISENMANN et à sa suite R. CHAPUS, renvoie nécessairement à un auteur 1 ( * ) .
La faute est donc le passage, le fil rouge qui fait remonter l'action à la personne. Et cet ancrage premier dans la faute nous fait retrouver l'ambiguïté, déjà soulignée, d'une notion qui est à la fois juridique et éthique ou morale.
Peut-on échapper à cette ambiguïté et dégager ici un fondement de la responsabilité qui soit en deçà ou au delà de l'éthique ?
Dans sa "Théorie pure du Droit", KELSEN paraît ouvrir la voie à une réponse dans cette direction. KELSEN aborde la question de la responsabilité en s'attachant à la notion essentielle d'obligation et il s'efforce d'éclaircir les rapports entre l'obligation juridique et la responsabilité juridique, unies d'un lien essentiel et cependant distinctes. L'obligation est celle d'une "conduite conforme au droit" ; la responsabilité découle d'une "conduite contraire au droit", ce n'est donc plus exactement une obligation. Par ailleurs, il faut distinguer, selon KELSEN, l'obligation et la sanction "acte de contrainte qu'une norme attache à une certaine conduite dont le contraire est par là même juridiquement prescrit". La sanction est donc au fondement de "deux obligations : l'obligation de ne pas infliger un dommage, obligation principale ; et l'obligation de réparer le dommage irrégulièrement causé, obligation substitut, de remplacement, qui prend la place de l'obligation principale lorsque celle-ci a été violée. L'obligation de réparer le dommage n'est pas une sanction ; elle est cette obligation supplétive" 1 ( * ) .
Cette conception normativiste de la responsabilité est une démarche intéressante dans le découplage entre droit et morale dont il est question ici.
Mais la voie principale de ce mouvement n'est sans doute pas de cette direction. Elle serait davantage à rechercher du côté d'une notion qui n'est pas inconnue des juristes, qui leur est même familière, mais dont ils n'ont pas saisi peut être toutes les implications au niveau d'un fondement de la responsabilité : la notion d'imputabilité.
C'est Paul RICOEUR qui, dans une étude essentielle "le concept de responsabilité" 2 ( * ) , ouvre cette perspective en affirmant d'emblée : " Dans l'imputation réside un rapport primitif à l'obligation... " . Rapport primitif c'est à dire premier et fondateur - ou dit autrement, un rapport qui est à l'origine de l'obligation de réparer.
Que faut-il entendre par là ?
Le Dictionnaire de Trévoux (1771) semble donner la définition la plus claire et complète de la notion d'imputation : "Imputer une action à quelqu'un, c'est la lui attribuer comme à son véritable auteur, la mettre... sur son compte, et l'en rendre responsable".
RICOEUR, qui cite cette définition, relève à juste titre qu'elle fait apparaître essentiellement le lien entre une action et son auteur, et que ce lien est saisi par "la métaphore du compte" (conforme d'ailleurs à l'étymologie : putore signifie calculer). Rien donc ici qui se réfère à une quelconque idée morale, à une perspective éthique. Nous sommes bien en quelque sorte en amont de l'éthique. Dans cette perspective "pré-éthique" et première de l'obligation de réparer, la question de l'imputabilité paraît soulever deux questions importantes.
Il faut d'abord se demander, au delà des expressions métaphoriques, en quoi consiste exactement cette attribution d'une action à un auteur, que peut-elle être, en dehors du fondement traditionnel éthique qui est le sien.
Ici on peut sans doute retenir un concept élaboré par un théoricien du langage, P. STRAWSON, dans son ouvrage "Les individus" ("Individuals" 1955, traduction française Seuil. 1973) : le concept "description" (A).
D'autre part, on peut s'interroger sur le rapport qui s'établit entre cette action imputée à un auteur et son résultat dont il devra rendre compte : c'est la question de la causalité, qui nous place davantage au centre de la théorie de l'action (B).
A- IMPUTABILITÉ ET ASCRIPTION
Il convient d'abord d'indiquer que le terme d'"ascription" utilisé par des auteurs français comme P. RICOEUR 1 ( * ) ou J.M. Ferry 2 ( * ) est emprunté au vocabulaire anglo-saxon, et trouve son étymologie dans le mot latin "ascriptio". Ascription renvoie au verbe "to aseribe" qui signifie attribuer (ou assigner) dans le sens ou l'on attribue un fait, un comportement à une cause ou à une source.
En fait, il semble bien que ce soit la doctrine juridique qui ait d'abord mis en avant ce concept, et spécialement L.A. Hart dont on sait l'importance qu'il attachait à la séparation du droit et de la morale 3 ( * ) et qui fonde justement sur l'ascription son analyse de la responsabilité dans une étude dont RICOEUR rappelle l'importance : "The Ascription of Responsability and Règlements" 4 ( * ) . Mais c'est P. STRAWSON qui, dans le cadre de la théorie du langage, va donner au terme d'"ascription" une signification à la fois générale et précise, susceptible ensuite de rejaillir sur l'analyse juridique.
Comme l'indique le titre de son ouvrage, l'étude de Strawson constitue une théorie générale des notions de "personne" et d'"individu", au centre de laquelle se trouve l'identification de ces notions à ce qu'il appelle " les particuliers de base " . Que faut-il entendre par là ?
Le problème soulevé par STRAWSON n'est en fait pas nouveau : il s'agit de comprendre le sens véritable de l'ambiguïté bien connue de la notion de personne qui oscille entre la généralité d'une personne déterminée qui est une personne ou comme le note p. RICOEUR 5 ( * ) : "Comment passer de l'individu quelconque à l'individu que nous sommes chacun ?", de la "mêmeté" à l'ipséité ? C'est la notion de "particulier de base"qui constitue ce passage.
Il s'agit pour P. STRAWSON, d'une note de schéma qui, indépendamment de l'expérience que l'on peut avoir de la multitude des individus, définit un sujet transcendantal, au sens kantien du terme comme le relève justement P. RICOEUR 6 ( * ) . En soi, ce recours à un schéma transcendantal n'est sans doute pas foncièrement original : la notion de personne ou celle de sujet de droit forgés par la pensée juridique relèvent d'une conception au moins parallèle. Mais alors que ces notions sont des abstractions idéales, figées et immuables dans leur généralité, le "particulier de base" se trouve défini à partir d'un ensemble de prédicats déterminés qui lui sont attribués ; et ces prédicats eux-mêmes, attribués à la personne, la définissent à partir des conditions de possibilité de l'action qui lui est attribuable. C'est cette attribution, et cette attribution en terme d'action et d'expériences, constitutive de la personne, que p. STRAWSON nomme "ascription". L'appartenance des individus à un schéma unique qui nous contient et nous caractérise, se trouve ainsi déplacée d'un fondement de type ontologique à un fondement se rattachant à l'action, de type praxéologique ; la "mêmeté" de l'individu ne s'oppose plus à l'ipséité comme abstraction, mais comme schéma commun, concrétisé par sa nature empirique et spatio-temporelle.
Sans qu'il soit possible ici d'entrer dans les éléments complexes de l'analyse de STRAWSON, il n'est pas sans intérêt d'indiquer sommairement quels sont ces prédicats attributifs qui concrétisent la personne comme particulier de base : ces prédicats modifient assez profondément en effet les conditions dans lesquelles est envisagée l'imputation d'une responsabilité à une personne déterminée.
D'abord, le schème spatio-temporel défini par STRAWSON l'amène à considérer que les particuliers de base sont, en premier lieu, des corps : la notion de personne prend corps, au sens propre du terme ; elle a un corps, elle est un corps. Et cet élément corporel est un aspect essentiel de la mêmeté concrète sur laquelle repose la notion de particulier de base car elle permet de dépasser le solipsisme des représentations mentales.
Ensuite, deux sortes de prédicat peuvent être attribués à la personne pour sa détermination : des prédicats physiques (un tel mesure 1,80 m.) et des prédicats psychiques (un tel pense à un film qu'il vient de voir). Et c'est la même personne, indissociablement esprit et corps, pour laquelle nous formulons ces deux types de constat 1 ( * ) .
Enfin, et à l'opposé de la tradition d'ailleurs débattu du relativisme attribué aux sophistes 2 ( * ) , les prédicats psychiques conservent un même sens qu'ils soient identifiés comme les miens ou attribués à d'autres que moi. Comme l'explique RICOEUR lorsqu'il commente ce point : "Les états mentaux sont certes toujours ceux de quelqu'un ; mais ce quelqu'un peut être moi, toi, lui quiconque" 3 ( * ) .
Tel est, schématiquement, la structure générale de la théorie de l'ascription. Son intérêt, dans la réflexion ici tentée sur les fondements théoriques de la responsabilité au travers de la notion d'imputabilité, est de constituer une théorie de la personne à laquelle l'imputation fait remonter, plus complexe et plus riche que celle adoptée par la dogmatique juridique classique.
Dans le domaine de la responsabilité, le standard du comportement du "bon père de famille" sous-jacent à la responsabilité civile, celui de "l'homme avec ses faiblesses" de la responsabilité administrative n'ont pas à l'évidence, pour saisir la personne sur laquelle pèsera l'obligation de réparer, une telle densité heuristique, faute de trouver comme avec l'ascription un fondement dans une théorie de l'action.
Mais surtout la théorie de l'ascription a l'intérêt comme le relève justement encore p. RICOEUR d'identifier la personne susceptible d'être concernée par l'imputation " sans considération du rapport à l'obligation morale, et du seul point de vue de la référence identifiante à des particuliers de base". Cette théorie peut être considérée effectivement comme une tentative pour " démoraliser la notion d'imputatio " 1 ( * ) , pour opérer à ce stade un véritable découplage entre le droit de la responsabilité et la morale.
C'est dans cette même perspective que peut être envisagée le second volet de l'investigation ici engagée sur la notion d'imputabilité : l'identification de la personne doit se prolonger effectivement par l'établissement du rapport à son action et au résultat de celle-ci. La notion de causalité nous paraît, à ce stade, permettre une recherche normalement neutre de la mise en oeuvre de la responsabilité.
B - IMPUTABILITÉ ET CAUSALITÉ
Cette relation entre imputabilité et causalité soulève, au delà du droit de la responsabilité, des interrogations essentielles pour la pensée juridique. Mais la perspective qui sera ici adoptée, dans cette sorte d'amont de la responsabilité où nous nous trouvons, est particulière, et le champ de notre investigation doit être d'emblée précisée 2 ( * ) .
Le binôme causalité-imputation est effectivement, on le sait, l'une des articulations majeures de la théorie normativiste de H. KELSEN : c'est sur elle que se trouve établi l'opposition entre loi naturelle et loi juridique 3 ( * ) et entre les sciences causales et les sciences normatives 1 ( * ) . Les développements consacrés par KELSEN à ces questions sont bien connus, et il n'est pas nécessaire ici d'y consacrer un nouveau commentaire. On se référera pourtant à eux afin de mieux situer le rapport différent entre ces deux principes que notre analyse va tenter de faire apparaître.
KELSEN, pour fonder et justifier sa thèse sa théorie normativiste, fait ressortir, en quelques pages d'une grande densité, l'opposition essentielle entre causalité et imputation autour desquels s'organisent deux types bien distincts de démarches scientifiques. Sa conception est très nettement indiquée lorsqu'il écrit : "La distinction entre l'imputation et la causalité consiste... en ceci que la relation entre condition et conséquence qui est exposée dans une loi morale ou dans une loi juridique est établie par une norme posée par l'homme, alors que la relation qui est énoncée dans la loi naturelle entre la condition-cause et la suite-effet est, elle indépendante de toute semblable intervention" 2 ( * ) . Cette "entière moralisation et juridicisation de l'imputation" 3 ( * ) établit une sorte de ligne de démarcation entre celle-ci et causalité qui obéit à une toute autre logique -cette logique étant dès lors évacuée de la réflexion sur les fondements juridiques de la responsabilité.
Or, si l'on recherche ces fondements dans une perspective qui justement, et à l'inverse de KELSEN, se situe en deçà de toute question morale ou éthique, la relation entre causalité et imputation doit être saisie non plus dans leur opposition mais dans leur articulation : la causalité n'est plus en dehors de la problématique des fondements de la responsabilité, elle est au contraire dans sa relation problématique avec l'imputation, au centre de cette problématique.
Dans cette perspective, la question de l'imputabilité est d'abord, comme on l'a vu, celle de l'identification de la personne qui est l'auteur d'une action, du sujet qui devra en répondre et éventuellement la réparer. Mais, au delà de cette démarche identifiante de la personne à laquelle on peut assigner une action, l'imputation en implique une autre qui est celle de la détermination de cette personne, c'est-à-dire l'établissement de son rôle exact dans le processus de la responsabilité qui se trouve engagé. En d'autres termes, la question apparemment simple "qui est la personne susceptible d'être responsable ?" doit être posée à deux niveaux superposés : d'abord, quelle est cette personne à qui attribuer l'action dont il devra être répondu ? Cette action, ensuite, est-elle bien celle dont il devra être répondu par cette personne ?
Cette seconde interrogation situe l'investigation sur le plan de la recherche causale ; et dans cette hypothèse, la question de la causalité ne s'oppose pas à celle l'imputabilité, mais au contraire celle-ci contient celle là : la recherche de la causalité est un aspect de celle l'imputabilité, elle en est le second et nécessaire moment 4 ( * ) .
La notion de causalité se trouve alors saisie dans le contexte général du pouvoir d'agir ou du pouvoir de faire des hommes, elle s'intègre dans une théorie de l'action humaine. Mais, ainsi rapportée à des comportements humais, la causalité n'en reste pas moins une question qui met en cause aussi les mouvements de la nature, les déterminations physiques qui viennent s'imbriquer dans l'action des individus, et en compliquer ou en obscurcir la trame.
Or, comme le relève P. RICOEUR, on "ne dispose d'aucun concept propre à l'action humaine qui distingue le pouvoir faire humain du principe intérieur au mouvement physique" 1 ( * ) . Cette question, RICOEUR le rappelle, était déjà en suspens chez ARISTOTE lorsque dans l'"Éthique à Nicomaque", il s'interroge sur la liberté des actions humaines 2 ( * ) . Et sans doute observe-t-il alors que "celles de mes actions qui ont leur principe en nous dépendent, elles aussi, de nous et sont volontaires". Mais à ce qui dépend de nous se mêlent aussi les déterminations qui résultent soit des mouvements de la nature, soit de l'action des autres hommes 3 ( * ) .
Et ce fut sans doute une des premières manifestations de l'émancipation de l'homme que d'accepter, comme un aspect de sa finitude, les aléas découlant de l'enchevêtrement de la trame causale de ses actes. Comme le rappelle KELSEN, la notion de causalité ne semble pas avoir été admise dans la pensée originelle des hommes, pour laquelle "la condition et la conséquence sont unies l'une à l'autre, non selon le principe de causalité mais selon le principe d'imputation" 4 ( * ) : le cours des événements est interprétée alors comme le résultat de la bonne ou de la mauvaise conduite des hommes 5 ( * ) .
Ce qui paraît certain c'est que dans, dans la pensée des anciens grecs, les phénomènes naturels ne se distinguaient pas des agissements humains, les uns et les autres étant placés sous la dépendance de la volonté (mais aussi parfois des caprices) des dieux 6 ( * ) . De ce constat, résulterait, selon KELSEN, que le principe de causalité avait pris naissance dans celui de rétribution (Vergeltung) qui, dans le sillage de la notion d'imputation, signifie que "la conduite irrégulière est liée à une peine, et la conduite régulière à une récompense" 1 ( * ) .
Sans engager ici un débat sur cette question, on peut cependant se demander si KELSEN, pour conforter et en quelque sorte enraciner historiquement sa conception normativiste, ne déforme pas la pensée grecque ancienne dans le sens de ce qui serait, selon lui, une confusion entre causalité et rétribution. Il est vrai que la connaissance rationnelle, émergeant à partir du VIe siècle avant J,-C, trouve ses origines dans la religieuse et mythique de la Grèce archaïque 2 ( * ) . Mais que cette pensée soit, du simple fait qu'elle ait une détermination supra-humaine, de nature normativiste et adopte alors une conception de la causalité-rétribution, c'est sans doute en rétrécissant sérieusement la portée. En fait les choses semblent plus complexes. Si certaines divinités, comme les Erinyes, décident de l'harmonie du monde en même temps qu'elles châtient les crimes des hommes, il ne faut pas oublier qu'elles appartiennent à l'ordre mythique grec originel et constituent des forces primitives et sauvages, auxquelles se soumettent même les dieux apparus plus tard ; leur prêter un rôle "normatif quant au comportement des humains est sans doute commettre un anachronisme : l'intervention des Erinyes relève de la malédiction plus que de la régulation 3 ( * ) . Et il en va de même pour Némésis qui agit plus par vengeance que par justice ou rétribution du bien et du mal. Dans le monde multiple, complexe et évolutif de la mythologie grecque, les mobiles des dieux sont plutôt la colère, la jalousie, la vengeance, la ruse, le caprice qu'une volonté de justice. Quant à l'idée de destin, sa figure originaire chez les anciens grecs (moira) semblait bien être établie indépendamment des comportements humains ; et dans l'épopée homérique le rôle des Moires (les trois Parques qui filent la destinée humaine) est incontestablement étranger à tout principe de rétribution 4 ( * ) . Et c'est vers le IVe siècle avant J.-C. qu'apparaît une idée du destin - et donc de la causalité - non plus fondée sur le mythe, mais rationnelle et liée au déterminisme scientifique : la "moira" mythique fait place à l'"ananké" qui renvoie à l'idée de nécessité 5 ( * ) et donc à ce que l'on pourrait considérer comme le germe d'une représentation moderne de la causalité.
Cette conception rationnelle ne va pas, pour autant, clarifier la question que pose fondamentalement le principe de causalité. Cette question est celle de la confrontation, déjà évoquée par ARISTOTE entre la causalité libre et la causalité naturelle, confrontation dont KANT, dans la Critique de la raison pure fait la substance de la troisième "antinomie cosmologique" de sa dialectique transcendantale 1 ( * ) . Abordant le "troisième conflit des idées transcendantales", KANT pose ainsi les termes de l'antinomie :
- Thèse : "la causalité selon les lois de la nature n'est pas la seule dont puissent être dérivés les phénomènes du monde. Il est encore nécessaire d'admettre une causalité libre pour l'explication de ces phénomènes".
- Antithèse : "Il n'y a pas de liberté mais tout arrive dans le monde uniquement selon les lois de la nature".
L'antinomie ainsi présentée par KANT a une structure et des implications complexes et le rapport qu'elle établit entre les notions de causalité et celle d'imputabilité n'apparaît pas de manière immédiate.
La difficulté tient d'abord à ce que la causalité selon les lois de la nature entraîne vers un enchaînement infini et indéfini des causes 2 ( * ) , alors qu'en même temps, "il faut admettre une causalité par laquelle quelque chose arrive sans que la cause y soit déterminée en remontant plus haut par une autre cause antérieure suivant les lois nécessaires, c'est-à-dire une spontanéité absolue des causes, capable de commencer par elle-même une série de phénomènes qui se déroulera selon les lois de la nature..." 3 ( * ) .
Ainsi "la liberté transcendantale est opposée à la loi de la causalité" 4 ( * ) ; alors que "l'enchaînement et l'ordre des évènements du monde" ne peut être cherché que dans la nature, la liberté apparaît comme un affranchissement de cette contrainte ; et ainsi "nature et liberté transcendantale diffèrent entre elles comme conformité aux lois et affranchissement des lois", et s'opposent en définitive une causalité "toujours conditionnée" qui traduit l'ordre universel du monde, et une "causalité inconditionnée" qui commence à agir d'elle-même, mais qui est en même temps "aveugle" en ce qu'"elle brise le fil conducteur des règles qui rend seul possible une expérience universellement liée" 5 ( * ) .
C'est dans le noeud même de cette antinomie que KANT fait émerger la notion d'imputabilité. Face à l'enchaînement inéluctable des causes naturelles, surgit "l'idée transcendantale de liberté" qui constitue, écrit KANT, "le concept de la spontanéité absolue de l'action, comme le fondement de l'imputabilité de cette action" 6 ( * ) . La question est alors de savoir, dans la perspective qui est alors celle d'une critique de la raison pure "s'il faut admettre un pouvoir capable de commencer par lui-même une série de choses ou d'états successifs". Et la seule réponse possible, à ce stade, est qu'il faut "nous contenter, dans la causalité qui a lieu suivant les lois naturelles de reconnaître a priori qu'une causalité de ce genre doit être supposée ". Et ce n'est que dans la remarque terminale sur la troisième antinomie que KANT ouvre une voie qu'il empruntera par la suite : si l'on admet cette possibilité, si l'on fait cette supposition d'une "faculté transcendantale de la liberté pour commencer les changements du monde, ce pouvoir ne devrait être, du moins, qu'en dehors du monde " 1 ( * ) .
Que faut-il entendre par là ? Le monde, soumis à "l'enchaînement des phénomènes qui se déterminent nécessairement les uns les autres suivant des lois universelles" est celui de ce que KANT appelle les "substances" qui constituent la nature : ce sont ces substances qui ne peuvent être modifiées par l'influence de la liberté, car alors le "jeu des phénomènes qui serait uniforme et régulier d'après la simple nature, serait aussi troublé et rendu incohérent" 2 ( * ) .
Ce n'est en fait que dans la seconde Critique, et dans son "Introduction à la Métaphysique des moeurs" 3 ( * ) que KANT dépasse l'antinomie entre la loi et la liberté, par l'opposition qu'il établit alors entre la personne et la chose qui était en germe dans la remarque finale précitée. Et là apparaît, dans une position enfin centrale, la notion d'imputabilité, et donc de responsabilité. En effet, comme l'écrit Simone GOYARD-FABRE 4 ( * ) : "c'est, très précisément, la possibilité de l'imputation d'une action, explicable seulement par son union à la libre volonté de l'agent, qui fait toute la différence entre la personne et la chose, laquelle est, à l'évidence, dépourvue de liberté". Une personne, écrit KANT, "est un sujet dont les actions sont susceptibles d'imputation", et elle "ne peut être soumise à d'autres lois qu'à celle qu'elle se donne à elle-même" ; alors que "la chose est ce qui n'est susceptible d'aucune imputation. Tout objet du libre-arbitre qui manque lui-même de liberté, s'appelle donc chose (res corporalis)" 5 ( * ) .
Cette séparation entre la chose et la personne qui permet dans le cadre de la métaphysique des moeurs de surmonter la troisième antinomie de la raison pure appellerait bien des observations qui dépassent le champ de cette étude. On notera seulement comment la notion de personne est posée par KANT en termes de liberté et d'autonomie en ce qu'elle échappe aux déterminations de la nature et en ce qu'elle est placée hors du monde : cette conception idéaliste de la personne, qui s'affirme et s'affirme seulement comme personne que par opposition au "monde", aux réalités matérielles, va être le fondement même de la notion de sujet de droit tel qu'il sera adopté par la dogmatique juridique dominante.
Ce qui est à retenir ici cependant, c'est que la liberté essentielle de la personne se trouve liée à la possibilité de l'imputation, et dès lors à la responsabilité. Et comme le montre bien S. GOYARD-FABRE 6 ( * ) KANT, à partir de cette corrélation, va progressivement distinguer la responsabilité morale et la responsabilité juridique, la première renvoyant à la subjectivité intérieure de l'agent, la seconde à l'existence objective d'une législation qui lui est extérieure 1 ( * ) .
Mais, qu'elle soit morale ou juridique, la trilogie kantienne liberté -imputabilité - responsabilité doit être saisie non pas en surplomb des antinomies de la causalité, mais en relation avec celle-ci, comme surgissement d'une possibilité humaine à partir de la trame obscure et déterminée des faits du monde. Comme l'écrit P. RICOEUR, "il faut en passer par le choc des causalités et tenter une phénoménologie de leur enchaînement" ; et il ajoute "ce qui se donne alors à penser, ce sont des phénomènes comme l'initiative, l'intervention où se laisse surprendre l'immixtion de l'agent de l'action dans le cours du monde, immixtion qui cause effectivement des changements dans le monde" 2 ( * ) .
C'est donc en définitive la présence et l'émergence d'un " pouvoir agir " au sein de l'imbrication d'un ensemble complexe de causalités qui doit retenir l'attention dans la recherche des fondements de la responsabilité : causalité et imputabilité ne sont pas à saisir dans une relation d'antinomie, mais comme le fondement complexe de ce "pouvoir", au sens arendtien du terme qui est la source même de la responsabilité.
***
Ces considérations, présentées ici de manière très générale et qui peuvent sembler très abstraite, ne sont pas semble-t-il sans être au fondement de questions très concrètes qu'elles peuvent aider à mieux appréhender. On en donnera un seul exemple sur un sujet qui n'a pas fini de défrayer la chronique médiatico-doctrinale - celui de l'affaire Perruche à laquelle il a été déjà fait allusion. Dans de très lumineux développements qu'Olivier CAYLA a consacré, aux côtés de Yann THOMAS, à cette affaire, on voit bien comment l'émergence de ce "pouvoir agir" au sein de l'imbrication physique d'un enchevêtrement de causalité permet de ne pas rabattre la notion juridique de causalité telle qu'on la retient dans le droit de la responsabilité administrative sur la notion scientifique ou logique de causalité.
Mais des implications concrètes de ces fondements méta-éthiques de la responsabilité peuvent aussi apparaître à un autre niveau, qui relève des rapports complexes mais naturellement déterminants entre la vérité et la responsabilité.
II - LES FONDEMENTS DANS LA THÉORIE DE LA CONNAISSANCE : RESPONSABILITÉ ET VÉRITÉ
Le rapprochement de ces deux notions de responsabilité et de vérité peut a priori paraître surprenant, tant les questions soulevées par chacune d'elles semblent être différentes et même éloignées. On l'a dit, la responsabilité se situe habituellement dans le champ normatif de la morale et du droit, la vérité étant de son côté la question clé des interrogations épistémologiques et de la théorie de la connaissance. Un rapport peut-il cependant être établi entre responsabilité et vérité ? Dans l'affirmative, quelle serait la nature de ce rapport, et surtout quel serait son intérêt pour une réflexion sur les fondements théoriques de la responsabilité ?
Cette démarche est d'autant plus problématique que la question de la vérité est l'une des plus complexes et des plus débattues de la philosophie, au point que sa pertinence même est parfois sérieusement mise en doute. On se rappelle la boutade de KANT, pour qui cette question est en elle-même "extravagante et susceptible de porter un imprudent à des réponses absurdes, et donner ainsi le spectacle ridicule de deux hommes dont l'un (comme disaient les Anciens) trait le bouc pendant que l'autre présente un tamis" 1 ( * ) . Et si l'on se hasarde à une incursion dans ce champ miné dans l'espoir d'éclairer les fondements théoriques de la responsabilité, on se heurte effectivement d'emblée à de sérieuses difficultés.
Outre le fait que la notion de vérité s'appréhende de manière différente selon les domaines de la connaissance, il apparaît vite que sa définition communément admise, c'est-à-dire la conformité au réel, soulève de nombreuses incertitudes.
Ce sont d'abord ces difficultés que l'on examinera sommairement, en faisant ressortir que, dans la conception classique, un principe de séparation du véritatif et du normatif s'impose et verrouille toute possibilité de lien entre responsabilité et vérité (A). Ce lien ne peut apparaître qu'avec les conceptions qui établissent en amont une relation entre véritatif et normatif. La première étape sur cette voie est, dans le sillage de KANT, la démarche de RICOEUR qui donne à la vérité une dimension anthropologique (B). Mais c'est seulement la conception généalogique de la vérité retenue, dans le prolongement des fulgurantes intuitions de NIETZSCHE, par Michel FOUCAULT, qui permet de faire apparaître la vérité comme élément à la fois fondatif et constitutif de la responsabilité (C).
A - LES INCERTITUDES DE LA VÉRITÉ ET LA SÉPARATION DU VÉRITATIF ET DU NORMATIF
Les incertitudes souvent relevées quant à la vérité sont dues, d'abord, à la confusion si souvent faite entre le vrai et le réel. Un objet extérieur (cette lampe qui est sur ma table de travail) est bien réel, mais il ne viendrait à l'esprit de personne de dire qu'il est "vrai" : il est simplement réel, c'est-à-dire effectivement existant. Et la question de la vérité n'apparaît que si est exprimé un jugement par lequel la pensée établit une relation ave le réel, formule une assertion qui met le réel en situation (cette lampe est bien là, devant moi). Le vrai n'est pas une représentation du réel, car comme le remarque DESCARTES dans la Troisième Médiation Métaphysique, une chimère n'est ni vraie ni fausse en ce qu'elle est une pure idée, et les idées quelles qu'elles soient "si on les considère seulement en elles-mêmes et qu'on ne les rapporte point à quelque chose, ne peuvent, à proprement parler, être fausses" 1 ( * ) .
Mais si on admet cela, une nouvelle difficulté apparaît. Car si l'on considère que la vérité est la conformité de la pensée avec le réel, comment savoir si le réel qui n'est qu'une représentation de la pensée, est lui-même vrai ; comment savoir si notre définition de la vérité est vraie ? Cette aporie du rapport de la pensée au réel, du mot à la chose, miroitement de l'idée sur elle même où la chose se perd dans l'infini (comme la fleur mallarméenne "absente de tous les bouquets") nous est donnée à voir dans la célèbre tableau de MAGRITTE "La trahison des images". Comme l'a bien montré Michel FOUCAULT 2 ( * ) , le paradoxe de ce tableau (qui, on le rappelle, représente une pipe avec une inscription indiquant "ceci n'est pas une pipe") n'est pas essentiellement l'opposition entre ce qui semble une contre-vérité ou au contraire une vérité évidente (le dessin d'une pipe n'est pas une pipe), mais résulte du fait que la phrase "ceci n'est pas une pipe" est-elle même un dessin de mots, qu'elle constitue une représentation picturale, une "image de mots" que le peinte a intégré dans son tableau : "la pipe représentée, écrit Michel FOUCAULT, est dessinée de la même main et avec la même plume que les lettres du texte : elle prolonge l'écriture plus qu'elle ne vient l'illustrer et combler son défaut", de telle manière que le texte n'est jamais "qu'une représentation dessinée" 3 ( * ) .
Ainsi lorsqu' est abordée la question de la vérité, "c'est toujours la même question lancinante qui est posée : la vérité n'es telle qu'un redoublement impossible, inutile ou suspect de la réalité ?" 4 ( * ) . Et faute de pouvoir répondre à cette question, faute d'atteindre au concept même de vérité, on peut tenter de dégager dans l'histoire de la pensée, les conceptions qui en ont été adoptées. Traditionnellement on oppose deux types de conceptions. La conception scientifique ou objective de la vérité est celle qui résulte de l'adéquation d'une affirmation à une réalité, adéquation empiriquement vérifiable : c'est le réel, objectif, qui livre le vrai et le faux. La conception philosophique, ou subjective, fait dépendre la vérité de l'appréhension du réel par la pensée qui a une faculté déterminée de connaissance : dans la perspective kantienne, la vérité ne peut être définie par son contenu et sa conformité à un réel problématique, mais dans son accord avec les lois de l'entendement, et les facultés conditionnées de celui-ci ; ici l'universel n'est pas l'objet et reconnu comme tel par tous, mais la forme même de l'esprit humain. Et la philosophie occidentale établit, sur ces bases, le sujet comme fondement de toute connaissance, comme origine unique de la naissance de la vérité.
C'est bien cette perspective qui est celle de KELSEN lorsqu'il situe dans sa "Théorie pure du droit", la science vis à vis du droit 1 ( * ) . L'opposition, aujourd'hui classique, établie entre les "normes juridiques" et les "propositions de droit" relève à l'évidence d'une conception traditionnelle de la vérité lorsqu'elle établit une stricte ligne de démarcation entre les uns et les autres, la question du vrai et du faux ne se posant que pour les secondes 2 ( * ) . Plus tard, dans la "Théorie générale des normes", KELSEN aborde plus directement la question de la vérité ; au chapitre 45 ("La vérité d'un énoncé et la justesse d'un comportement") il écrit : "un énoncé est vrai s'il est conforme à son objet, et dans le cas le plus fréquent, le cas de l'énoncé sur un fait de la réalité, si l'énoncé est conforme à la réalité qui constitue l'objet de l'énoncé et à laquelle se réfère l'énoncé" 3 ( * ) . Et la distinction qu'il fait entre la "vérité matérielle" et la "vérité logico-formelle" (pour laquelle il se réfère explicitement à KANT) est exactement celle de la philosophies traditionnelle 4 ( * ) . Même perspective chez RAWLS dès le début de sa "Théorie de la Justice", ou se trouve instauré le même clivage : "La justice est, écrit-il, la première vertu des institutions sociales, comme la vérité l'est des théories" 5 ( * ) ; ou encore (et l'on pourrait multiplier les exemples) chez Michel V1LLEY : "le vrai, concordance des mots et des choses. Ou le juste, fin du droit, proportion équitable entre personnes et choses" 6 ( * ) .
Et ce qui est intéressant pour la pensée juridique, c'est que cette mise en cause en analysant les liens possibles entre le véritatif et le normatif, ouvre de nouvelles perspectives dans l'appréhension du rapport du droit à la vérité. On ne peut ici qu'évoquer brièvement certains aspects de ce mouvement dont l'importance est sans doute sous-estimée.
Si l'on met à part les conceptions des moralistes anglais qui adoptent directement l'idée d'une vérité morale, on peut retenir, on l'a dit, deux courants qui, à des titres différents concernent la question des fondements de la responsabilité juridique : on s'attachera d'abord à la réflexion conduite sur cette question par P. RICOEUR qui adopte, on va le voir, une conception anthropologique de la vérité.
B - LA CONCEPTION ANTHROPOLOGIQUE DE LA RELATION ENTRE LE VÉRITATIF ET LE NORMATIF : L'ÉMERGENCE DE LA RESPONSABILITÉ
Paul RICOEUR, rompt avec la conception classique de séparation entre le prescriptif et le descriptif, mais demeure attaché à une philosophie du sujet comme générateur du rapport de vérité. Très significatif à cet égard est le texte intitulé "Justice et vérité" 1 ( * ) dans lequel, après avoir pensé la justice et la vérité "l'une sans l'autre", l'auteur s'attache à "les penser sous le mode de la présupposition réciproque ou croisée" 2 ( * ) . Si effectivement RICOEUR reconnaît, dans un premier stade de son analyse, "la suprématie du juste dans le champ pratique", il fait apparaître ensuite "l'implication du vrai dans le juste" et "l'intersection du point de vue véritatif et du point d vue normatif" 3 ( * ) . Car, si la notion de justice ne s'identifie pas à la norme et au droit, son champ étant beaucoup plus étendu, elle est cependant au sommet d'une sorte de progression ascendante qui intègre la norme et le droit ; cette progression "partant d'une approche téléologique guidée par l'idée du vivre bien, traverse l'approche déontologique où dominent la norme, l'obligation, l'interdiction, la procédure et achève son parcours au plan de la sagesse pratique qui est celui de la phronesis, de la prudence en tant qu'art de la décision équitable dans des situations d'incertitude et de conflit..." 4 ( * ) . Après avoir ainsi en quelque sorte positionné le droit et la justice, RICOEUR recherche leur dimension véritative dans une direction située dans le prolongement de l'anthropologie kantienne. "C'est, écrit-il, du côté des présuppositions anthropologiques de l'entrée en morale qu'il faut porter le regard. Ces présuppositions sont celles en vertu desquelles l'homme est tenu pour un être susceptible de recevoir l'injonction du juste. Il s'agit donc d'assertions portant sur ce que l'homme est quant à son mode d'être, e qu'il lui faut être s'il doit être un sujet accessible à une problématique morale, juridique ou politique..." 5 ( * ) . Retrouvant la notion kantienne d'imputabilité, par laquelle "l'homme fait arriver des choses dans le monde", RICOEUR s'attache alors à montrer qu'aux trois niveaux du téléologique, du déontologique et du prudentiel correspondent "trois modalités de la vérité". Schématiquement (on ne peut ici donner son développement à cette pensée si dense), au téléologique répond l'idée de capacité de l'homme ; au déontologique celle d' impersonnalité, la capacité d'accéder à la norme formelle et universelle, et d'adopter ainsi un point de vue impersonnel ; au prudentiel enfin répond la notion de convenance dans laquelle la vérité s'élargit à l'idée "de la certitude selon laquelle dans cette situation, cette décision est la meilleure, la seule chose à faire". Et RICOEUR, de manière très significative, parvient à cette notion en s'appuyant sur l'analyse du jugement judiciaire qui, selon lui, consiste à adapter l'un à l'autre deux processus parallèles d'interprétation : l'interprétation des fiats survenus et l'interprétation de la norme. L'idée d'adéquation qui est centrale dans la problématique de la vérité se retrouve ici sous une modalité adaptée au milieu spécifique de l'action. Et c'est peut-être en ce sens que peut être compris le célèbre adage de la tradition juridique "res judicata pro veritate habetur".
À moins que le fondement de cette vérité ne soit pas, ou pas seulement, anthropologique, mais qu'il ait une dimension conventionnelle - plus même une dimension institutionnelle qui ferait alors venir, dans une perspective généalogique, l'histoire sur la scène occupée jusqu'alors par le seul sujet.
C- LA CONCEPTION GÉNÉALOGIQUE DU VÉRITATIF, SOCLE FONDATIF ET CONSTITUTIF DE LA RESPONSABILITÉ
C'est dans un sens nouveau, et en prenant en compte lui aussi la sphère judiciaire et juridique, que Michel FOUCAULT aborde la question de la relation entre la vérité et le droit. Dans une série de conférences données à Rio de Janeiro en 1973, FOUCAULT va, sous l'intitulé "La vérité et les formes juridiques" 1 ( * ) , tenter d'appréhender la question de la vérité selon une perspective nouvelle, située dans le mouvement de critique du sujet humain par l'histoire qu'il avait engagé quelques années auparavant avec "Les mots et les choses". Dans ces conférences de 1973, FOUCAULT met l'accent sur une approche de la vérité générée par les pratiques sociales et institutionnelles, et plus spécifiquement par la pratique juridique.
Effectivement, s'il y a un bien "deux histoires de la vérité", ce ne sont pas celles retenues par la philosophie traditionnelle. Il faut, plutôt, à l'opposé d'une "histoire interne de la vérité, l'histoire d'une vérité qui se corrige à partir de ses propres principes de régulation," habituellement retenue, prendre en compte une "histoire externe, extérieure, de la vérité". Celle-ci permet de voir "qu'il existe dans la société, ou du moins dans nos sociétés, plusieurs autres lieux où la vérité se forme, où un certain nombre de règles du jeu sont définies - règle du jeu d'après lesquelles on voit naître certaines formes de subjectivité, certains domaines d'objet, certains types de savoir" 2 ( * ) . Et ces lieux où la vérité se forme selon des modalités nouvelles ne se situent plus dans le champ de l'histoire de sciences ou de l'épistémologie, mais dans celui de certaines pratiques institutionnelles, et plus spécialement selon Michel FOUCAULT dans "les pratiques judiciaires, la manière selon laquelle, entre les hommes, on arbitre entre les torts et les responsabilités" 3 ( * ) .
FOUCAULT pose ainsi la question du droit, et de sa pratique comme mode de. création d'une vérité, comme forme d'institution de types nouveaux de "relations entre l'homme et la vérité".
Et dans cette perspective nouvelle, FOUCAULT opère un véritable déplacement du champ de l'étude. La question n'est pas seulement pour lui de faire apparaître comment le droit, contrairement aux conceptions dominantes, serait créateur de vérité, cette vérité de la norme se trouvant alors établie sur des éléments de nature sociale (force et idéologie) dont il a d'ailleurs analysé les déterminations. Elle est aussi, et en amont, de s'attacher à montrer comment la pratique du droit consiste, dan des champs et selon des méthodes appropriées, à une recherche de la vérité, et que cette recherche même donne à la vérité des fondements propres, détachés de la connaissance du sujet, et objectivement situés dans la sphère sociale. Les conceptions classiques (y compris celle de RICOEUR) font de la vérité une sorte de parousie : or, la vérité n'apparaît pas, n'est pas découverte, elle se cherche, et c'est la manière dont, au sein même du social, elle est recherchée, qui en détermine la nature.
On voit quel est l'intérêt de la démarche de FOUCAULT dans l'interrogation qui est ici la nôtre sur la vérité comme fondement de la responsabilité au plan juridique. Sans doute pourrait-on objecter que la recherche de la vérité permettant de dégager et d'engager la responsabilité relève d'une démarche qui n'est pas proprement juridique, en ce qu'elle se situe dans le domaine des faits et des événements : on serait ici en quelque sorte en amont du droit, comme il en est ainsi également dans la recherche du lien de causalité selon les diverses voies dont il a été précédemment question.
Pourtant cette objection ne tient pas. La question de la relation des faits au droit est, il est vrai, longuement et depuis longtemps débattu 1 ( * ) . Mais, sans entrer ici dans le débat de fond, on peut rappeler que cette question reçoit aujourd'hui, en droit administratif, des solutions positives bien établies : au niveau où l'on se place ici, c'est-à-dire celui de la pratique juridique, le fait est bien un élément constituant de cette norme qu'est l'acte juridictionnel, la question de l'opposition fondamentale du sein et du sollen se situe à un niveau différent, celui de la définition de la norme comme cela ressort de la controverse sur ce point entre KELSEN et Alf ROSS 2 ( * ) . Cela dit, dans le contentieux de l'excès de pouvoir, le juge contrôle, on le sait depuis l'arrêt Camino de 1916, l'exactitude matérielle des faits, car comme on a pu l'écrire "si une décision ne peut être juridiquement fonde que sur un fait, l'absence de ce fait empêche cette décision de correspondre au droit" 3 ( * ) . Dans le contentieux du recours en cassation, on sait aussi depuis l'arrêt Moineau en 1945 4 ( * ) que le Conseil d'État (à la différence de la Cour de cassation) contrôle la matérialité des faits dès lors qu'il peut la faire ressortir des pièces du dossier. Et cette détermination du droit par les faits est plus nette encore, à l'évidence, dans le contentieux de la responsabilité.
La recherche de la vérité est donc bien partie intégrante de la pratique juridique dont la décision juridictionnelle est l'aboutissement. À ce niveau la "sagesse pratique" selon l'expression de P. RICOEUR, il faut saisir une situation complexe d'interprétation des faits et du droit.
La démarche syllogistique souvent prêtée au juge n'est que l'image emblématique et simplifiée de ce complexe, dans lequel il faut sans doute voir - si l'on suit sur ce point les analyses de DWORKIN 5 ( * ) et de RICOEUR 1 ( * ) - "deux processus parallèles d'interprétation : l'interprétation des faits survenus, laquelle est en dernier ressort d'ordre narratif, et l'interprétation de la norme quant à la question de savoir sous quelle formulation, au prix de quelle extension, voire de quelle invention elle est susceptible de coller aux faits". Et ces deux niveaux d'interprétation - narratif et juridique - se répondent jusqu'au point où la vérité recherchée du fait s'équilibre avec le contenu juridique recherché de la norme (point que DWORKIN nomme le "fit") 2 ( * ) .
C'est dans cette perspective, préalablement définie, qu'il faut aborder la recherche de Michel FOUCAULT concernant l'établissement de la vérité à partir de ce qu'il appelle les "formes juridiques".
À ce stade, cependant, il faut sans doute encore préciser un point. Notre objectif, dans cette recherche, paraît être à l'opposé de celui de FOUCAULT : pour lui, c'est la vérité qui est l'objet de son analyse, et les formes juridiques sont les moyens de donner à cet objet un fondement nouveau. À l'inverse, ce qui est recherché ici, c'est le rôle que la vérité peut avoir comme fondement de la responsabilité ; ou plus concrètement, en quoi la quête de la vérité est un moment essentiel de compréhension de la responsabilité telle qu'elle est juridiquement entendue. Mais il est clair, même si cela n'apparaît pas immédiatement, que l'on ne peut retenir la vérité comme fondement de la responsabilité que si celle là n'est pas dans un rapport d'extériorité ou d'hétéronomie vis à vis du droit. Si l'on veut saisir la place et le rôle de la vérité dans la formation de la responsabilité telle que l'entend le droit, il faut d'abord qu'elle ne soit pas totalement étrangère au champ juridique, et que l'on renonce donc à la séparation généralement admise du normatif et du véritatif. Le fondement de la vérité dans les formes juridiques lui permet ainsi, réversiblement, d'être considérée comme un élément constitutif de la responsabilité telle que le droit la construit.
Cela admis, la force heuristique du texte de Michel FOUCAULT pour la réflexion juridique ne fait pas de doute si l'on veut bien suivre le mouvement de ce nouvel examen du véritatif et du normatif
Et pour en saisir toute la portée il faut d'abord remonter, comme l'auteur nous y conduit, à l'oeuvre de NIETZCHE, et à sa profonde remise en cause des fondements traditionnels de la connaissance.
En s'appuyant sur quelques textes significatifs 3 ( * ) , FOUCAULT rappelle que pour NIETSZCHE la connaissance n'a pas d'origine ( Ursprung ), qu'elle est seulement une invention ( Enfindung ) ; ce qui signifie que la connaissance n'a pas sa source dans le sujet humain, dans ce qui serait originairement sa faculté et sa volonté de connaître : "la connaissance, écrit FOUCAULT expliquant NIETZSCHE, n'est absolument pas inscrite dans la nature humaine... elle est simplement le résultat du jeu, de l'affrontement, de la jonction, de la lutte et du compromis entre les instincts. C'est parce que les instincts se rencontrent, se battent, et arrivent finalement à la fin de leurs batailles, à un compromis que quelque chose se produit. Le quelque chose est la connaissance" 1 ( * ) .
Dans cette perspective c'est une double rupture qui se trouve opérée : la première entre la connaissance et le monde ("la connaissance n'a pas d'affinité avec le monde à connaître") ; la seconde entre la connaissance et le sujet, le "sujet dans son unité et sa souveraineté".
NIETZSCHE livre ici, écrit M. FOUCAULT, des "éléments qui mettent à notre disposition un modèle pour une analyse historique de ce que j'appellerais la politique de la vérité" : ce modèle révèle "la formation d'un certain nombre de domaines de savoir à partir des rapports de force et des relations politiques dans la société". À partir de là FOUCAULT est conduit à poser l'hypothèse selon laquelle "les conditions politiques, économiques d'existence ne sont pas un voile ou un obstacle pour le sujet de connaissance, mais ce à travers quoi se forment les sujets de connaissance, et donc les relations de vérité" 2 ( * ) . Et le dévoilement de ces conditions génératrices de la vérité - alors que celle-ci, dans la pensée classique, est au contraire appréhendée par opposition à elles -permet à FOUCAULT de livrer son objectif fondamental : "... nous cherchons à faire apparaître qui, dans l'histoire de notre culture, est resté jusqu'à maintenant le plus caché, le plus occulté, le plus profondément investi : les relations du pouvoir" 3 ( * ) .
C'est dans cette structure générale qu'est envisagée la relation entre la vérité et les formes juridiques, entre vérité et responsabilité.
L'émergence de ce lien, FOUCAULT le situe dans le monde grec ancien, dans l'oeuvre d'HOMÈRE d'abord, dans les tragédies de SOPHOCLE ensuite, en particulier dans cette oeuvre vertigineuse qu'est OEdipe Roi. Et ce qui est en cause ici c'est le mouvement essentiel par lequel s'opère un déplacement de renonciation de la vérité "d'un discours de type prophétique et prescriptif vers un autre discours d'ordre rétrospectif, non plus de l'ordre de la prophétie mais du témoignage" 4 ( * ) .
Effectivement dans l'un des premiers textes où est abordée, dans une procédure de type judiciaire, la question de la vérité, celle-ci résulte non du témoignage, mis de la confrontation des adversaires à une "épreuve" de type religieux qui permettra de désigner celui qui dit vrai : il s'agit, dans l' Iliade, du récit différend opposant Antiloque et Ménélas lors des jeux organisés au moment de la mort de Patrode 1 ( * ) .
Mais c'est essentiellement dans OEdipe Roi que le déplacement dans le mode d'établissement de la vérité apparaît en plaine lumière. Nous renvoyons ici à l'analyse détaillée que Michel FOUCAULT fait de la tragédie de SOPHOCLE : la trame en est entièrement tissée par ce passage d'une vérité prophétique et révélée sur le meurtre de Laïos qui, dans la seconde scène, es tirée par le devin Tirésias 2 ( * ) , à une vérité progressivement et inéluctablement établie par l'enquête d'OEdipe, l'examen des faits et le recoupement des témoignages.
Et ainsi OEdipe, d'abord présenté comme un héros (c'est lui qui a délivré Thèbes de la sphinge meurtrière), puis comme roi (ou selon le mot grec, tyran) va perdre ses deux attributs de gloire mythique et de pouvoir souverain à mesure qu'il devient celui qui sait, qui par ce savoir est conduit vers la vérité. Sans doute OEdipe a-t-il d'abord résolu l'énigme de la sphinge, et là comme le relève FOUCAULT "pour désigner son monde de savoir, il se dit celui qui a trouvé" 3 ( * ) . Mais (et sur ce point nous divergeons peut être de FOUCAULT), le savoir qu'il va tragiquement acquérir tout au long de l'action est d'une autre nature. Il faut se rappeler que l'énigme de la Sphinge était que cet animal qui se déplaçait à quatre, deux, puis trois pattes était l'homme, l'homme défini et spécifié par sa faculté de marcher : or, justement, on le sait, OEdipe comme son nom l'indique est celui qui a les pieds enflés, qui est atteint de boiterie 4 ( * ) . Métaphoriquement et symboliquement, il est donc celui qui "sait" sur les pieds. Son destin originel(avoir été suspendu par les pieds lorsqu'il a été abandonné dans la forêt du Cithéron) déterminait en quelque sorte le savoir qui allait lui permettre de résoudre le problème posé par la sphinge 5 ( * ) . En bref, c'est un savoir qui s'intègre dans un ensemble prophétique, alors que le savoir vers lequel OEdipe va fatalement cheminer sur sa propre culpabilité est établi sure les procédés modernes de la découverte de la vérité - "la vérité selon les formes juridiques".
À ce stade, le rapport de la vérité à la responsabilité paraît s'établir sur une double ligne, selon un schéma qui pourrait bien être la matrice de l'évolution de ce rapport jusqu'à notre époque. Cette vérité, nouvellement fondée, va se constituer d'abord comme fondement, ensuite comme mode d'établissement de la responsabilité.
Au premier égard, la tragédie de SOPHOCLE marque le moment où la vérité trouve son fondement au delà d'un pouvoir qui jusqu'alors la générait, qu'il soit prophétique ou politique. Dans la scène du premier épisode où Tirésias arrive guidé par un enfant et révèle à OEdipe qu'il est l'assassin de son père, la vérité est fondée sur le pouvoir prophétique du devin ; et lorsque (vers 380 et s.) OEdipe s'en prend à Créon qui aurait, par ambition personnelle, acheté la parole de Tirésias, la vérité est traversée par les impératifs du pouvoir politique. Mais ces deux fondements traditionnels vont se déchirer par l'émergence d'une vérité établie sur la raison et le témoignage de simples bergers dont la parole l'emporte sur celle des devins et des tyrans. De ce point de vue, comme l'écrit très justement Michel FOUCAULT, " OEdipe Roi est une espèce de résumé de l'histoire du droit grec. Cette dramatisation de l'histoire du droit grec nous présente un résumé de l'une des grandes conquêtes de la démocratie athénienne ; l'histoire du processus à travers lequel le peuple sort emparé du droit de juger, du droit de dire la vérité, d'opposer la vérité à ses propres maîtres, de juger ceux qui le gouvernent". La se trouve, lointain mais incontestable, le germe de ce qui permettra, à l'époque moderne, l'émergence d'une responsabilité de la puissance publique.
Mais au second égard (et dans une perspective ici plus épistémologique que politique) le texte de SOPHOCLE institue aussi une relation nouvelle au mode d'établissement de la vérité, et donc de la responsabilité qui découlera de son dévoilement. Se trouve mise en place, en effet, une forme déterminée de la découverte judiciaire ou juridique de la vérité qui s'ouvre sur de nouveaux savoirs : la vérité désormais est recherchée par des moyens mettant en oeuvre un ensemble de connaissance ne relevant plus du mythe mais de la raison 1 ( * ) . M. FOUCAULT est très explicite sur ce point lorsqu'il note qu'il y a là "la matrice, le modèle à partir duquel une série d'autres avoirs - philosophiques, rhétoriques et empiriques - ont pu se développer et caractériser la pensée grecque" 2 ( * ) .
En fait, plus subtilement encore, c'est un double mouvement réversible qui semble alors se manifester : la vérité recherchée dans les formes juridiques est institutive d'un mode d'établissement de cette vérité dans les autres champs du savoir ; et en même temps, la vérité établie dans cette série d'autres savoirs est génératrice de celle constituée dans le champ des formes juridiques. Dans ce rapport réversible, ce qui est en jeu, comme le montre bien là encore Michel FOUCAULT, c'est l'élaboration des "formes traditionnelles de la preuve et de la démonstration" qui vont se développer et circuler dans le droit comme dans la philosophie et les sciences. C'est aussi dans ce champ ouvert que va se constituer l'art de persuader avec toutes les règles de la rhétorique. Et c'est encore dans ce champ, l'émergence de ce nouveau type de connaissance découlant du témoignage et de l'enquête, que vont utiliser les juristes et avec eux les historiens, les géographes, les naturalistes, en un ensemble de savoirs rationnels "qu'Aristote va totaliser et rendre encyclopédique" 1 ( * ) .
Ainsi peut-on effectivement considérer qu'il s'est constitué à ce moment là une sorte de socle fondatif et constitutif de la notion moderne de responsabilité. Et ce socle, on le voit, n'a pas une nature morale ou éthique ; mais comme le montre l'analyse généalogique de Michel FOUCAULT, une structure épistémologique, elle même déterminée par des forces socio-politiques. Et dans cette perspective généalogique, la responsabilité de la puissance publique apparaît dans une relation bien différente avec la responsabilité privée que celle habituellement mise à jour. S'il est vrai que la première a bien difficilement et tardivement émergé d'une situation solidement ancrée d'irresponsabilité ("le Roi ne peut mal faire"), plus secrètement, et en deçà de la question de la vérité, ce sont pourtant des racines politiques que l'on peut mettre à jour dans les tréfonds de la notion même de responsabilité.
Monsieur Yves GAUDEMET
Merci beaucoup pour ce passionnant exposé. Vous avez su nous dire beaucoup de choses finalement, en respectant, même en deçà, le temps imparti par notre organisateur. Alors, Gilles DARCY a réussi aussi cet exploit, dont nous nous réjouissons tous, de faire venir le professeur DUBOUIS, ce qu'il ne fait pas assez souvent, selon nous. Merci beaucoup d'être là. Et nous connaissons tous ce que vous avez écrit sur ces questions de responsabilité, notamment dans le domaine hospitalier et médical. Nous allons vous écouter avec beaucoup d'intérêt.
La responsabilité, l'établissement hospitalier et le corps humain
par Monsieur Louis DUBOUIS,
professeur à l'Université Aix-Marseille 3
Le corps humain s'avère un sujet d'exploration aussi complexe pour le juriste qu'il l'est pour le médecin ou le scientifique.
On a parfois avancé que les juristes seraient les premiers responsables de cette situation, ayant attendu la fin du XXe siècle pour découvrir le corps humain. Le constat ne vaut guère s'agissant du droit de la responsabilité qui interdit d'ignorer le problème de la réparation du dommage corporel. À preuve les grands arrêts du droit de la responsabilité administrative qui de l'arrêt Blanco à l'arrêt Bianchi en passant par les arrêts Cames, Tomaso Grecco et combien d'autres, concernent les victimes de blessures. Aussi bien est-il acquis depuis longtemps que le préjudice corporel est indemnisable. Mais il est vrai que longtemps l'attention s'est focalisée sur les questions que soulèvent les modalités de la réparation : date d'évaluation du préjudice (C.E., 21 mars 1947, Compagnie générale des eaux et Dame Veuve Aubry, Rec. p. 122), méthodes d'évaluation, modalités d'évaluation. Ce fut suffisant pour que l'on perçoive que le corps humain dispose d'un statut particulier dans le droit de la responsabilité. Ce n'est pas à la mesure de la question qui fait l'objet de la présente étude.
Car la question posée, tout aussi complexe que les précédentes, présente une toute autre ampleur. Elle trouve son origine dans l'antinomie qui caractérise l'activité hospitalière au regard du régime de la responsabilité. Centrée sur les soins prodigués au corps humain, y compris au cas de maladie mentale, l'activité hospitalière a pour contrepartie inéluctable les atteintes qui sont infligées volontairement à ce corps et les risques d'atteintes involontaires, les unes comme les autres pouvant être graves, voire mortels. Quel régime de responsabilité convient pour ce type d'activité, donc pour les établissements hospitaliers 1 ( * ) ? Plus précisément, puisque tel est le thème de la demi-journée dans laquelle prend place cette communication, ce régime est-il ou sera-t-il dominé par l'éthique et, en ce cas, par quelles normes éthiques ?
La réponse dépend d'abord de la conception que nous nous faisons de l'éthique. Il serait trop long et largement inopérant de rouvrir le débat sur les relations entre éthique et morale. Que l'on nous permette de nous rallier à ceux qui pensent que l'éthique se réfère aux valeurs qui constituent le fondement de la moral et qu'elle est l'exigence à partit de laquelle nous déterminons nos actions. Il reste encore à déterminer à quelle éthique nous nous référons lorsque nous la confrontons à la responsabilité hospitalière. S'agit-il de la société, de celle des patients, de l'éthique hospitalière ? En toute hypothèse il devrait s'agir de l'éthique que consacre le droit, donc concernant les services publics de soins hospitaliers, celle que concourent à définir le législateur et le juge administratif... dans un dialogue permanent avec le juge judiciaire.
En deuxième lieu, les règles adoptées doivent prendre en compte la grande diversité des actions conduites sur le corps humain dans les services hospitaliers. À l'hôpital le corps est soigné, certes ; il est également utilisé, manipulé, mis au monde, "fabriqué". Certaines interventions conduisent, du reste, à s'interroger sur la définition du corps humain. Sans doute est-il le corps de la personne physique, l'organisme humain. Mais à partir de quel moment et jusqu'à quel moment ? L'embryon, le foetus, le cadavre se rattachent-ils à la catégorie du corps humain ?
La réponse à la relation entre l'éthique et la responsabilité hospitalière est, enfin, conditionnée par la conception que nous nous faisons d'une autre relation, celle qui unit la corps humain à la personne. Aujourd'hui le débat séculaire entre "matérialistes" et "spiritualistes" est profondément renouvelé par les dernières avancés scientifiques. Celles-ci ne nous imposent-elles pas de modifier notre vision traditionnelle selon laquelle le corps humain est la personne humaine elle-même ? Oui, avancent avec conviction ceux qui estiment que l'utilisation de plus en plus fréquente de parcelles du corps (sang, sperme, ovocytes, organes) va de pair avec le statut de "chose". Non, rétorquent ceux qui estiment que même si la pensée est la produit d'un flux de molécules, ce support matériel ne signifie pas qu'elle se réduise à un phénomène neuronal.
Il est heureux que le juriste puisse prendre position sur le droit applicable au corps humain sans avoir nécessairement à prendre parti dans ce débat. Car, quelle que soit la conception adoptée, le corps humain s'impose comme le "truchement nécessaire", selon l'expression d'Yvonne Lambert-Faivre 1 ( * ) , de toute vie professionnelle, sociale, spirituelle, donc de toute expression de l'activité de la personne humaine. Aussi une exigence domine-t-elle l'évolution du droit de la responsabilité hospitalière comme celle d'autres branches du droit : le respect de l'intégrité du corps humain.
En principe, donc, toute atteinte à l'intégrité du corps constitue une atteinte grave à la personne humaine (I) et, en conséquence, le préjudice qu'elle entraîne doit être indemnisé. Mais, la personne humaine si elle constitue une "individualité biologique", ainsi que l'affirme Jean Bernard, ne s'identifie pas totalement au corps, ne se réduit pas à ce dernier. Elle incarne une valeur ou plutôt une somme de valeurs éthiques dont le principe fondateur, tel que l'énonce le droit actuel, est la dignité de la personne humaine. D'où une dissociation nécessaire entre atteinte à l'intégrité du corps et atteinte à la personne (II), susceptible de conduire à une toute autre perspective d'évolution du droit de la santé.
I - L'ATTEINTE À L'INTÉGRITÉ DU CORPS, ATTEINTE À LA PERSONNE
Si "je suis mon corps" (Gabriel Marcel), toute atteinte à ce corps se révèle attentatoire au premier de mes droits, celui du respect de mon corps. Tel est bien le principe consacré depuis la loi du 29 juillet 1994 par l'article 16-1 du Code civil : "Chacun a droit au respect de son corps" et par l'article 16-3 qui prescrit toute atteinte à l'intégrité du corps humain hors nécessité thérapeutique pour la personne.
Dans une société marquée par la "victimisation", la conséquence est que peu à peu gagne la règle selon laquelle tout dommage corporel doit être indemnisé, d'où les avancées incessantes du droit à réparation qui semblent conduire vers une éthique de la séparation.
A- LES AVANCÉES DU DROIT À RÉPARATION
L'évolution jurisprudentielle et législative de la responsabilité hospitalière est si connue 1 ( * ) que l'on se bornera à rappeler brièvement les aspects les plus significatifs.
Il y a un peu plus d'un demi-siècle, le juge administratif, à l'instar du juge judiciaire, n'indemnisait le dommage corporel consécutif à une activité de soins que si la victime établissait l'existence d'un lien de causalité entre ce dommage et une action (ou inaction) fautive.
L'indemnisation de la perte de chance de guérison a assoupli le lien de causalité au point de le transformer en absence de non causalité (C.E., 24 avril 1964, Centre hospitalier de Voiron, Rec. p. 253). Elle n'aboutit certes pas à indemniser un dommage incertain ou virtuel, mais entraîne la réparation d'un dommage réel dès qu'un lien de causalité virtuel l'unit à l'acte de soins. Tout ce que l'on peut dire en pareil cas est que sans le comportement du médecin le dommage ne se serait peut être pas produit. Par exemple, si le diagnostic exact avait été posé plus tôt, le malade ne serait peut être pas décédé. Il s'agit d'une sorte de causalité négative. Elle conditionne également l'indemnisation du défaut d'information, se retournant en ce cas fort logiquement contre la victime. (C.E., 5 janvier 2000, A.P.-H.P. de Paris, Cts Telle, deux arrêts) 2 ( * ) .
L'assouplissement le plus marqué est celui qui a porté sur les caractéristiques de l'acte dommageable. Au départ la victime devait démontrer que cet acte constituait une faute. Et l'existence de celle-ci était appréciée par le juge compte tenu des difficultés de l'activité médicale, d'où l'exigence de la faute lourde pour les actes médicaux et en tous domaines l'appréciation portée compte tenu des moyens dont disposait le service (C.E., 13 novembre 1981, Centre hospitalier d'Évreux, Rec. p. 903 ; 20 janvier 1989, Centre hospitalier de Compiègne, Rec. p. 910).
De cet édifice juridique aucun élément n'est demeuré intact.
Depuis l'arrêt Époux V du 10 avril 1992 1 ( * ) , toute faute est susceptible d'engager la responsabilité de l'hôpital. Surtout, la jurisprudence fait peser sur ce dernier des obligations de plus en plus nombreuses et rigoureuse, faisant largement fi des moyens qui sont réellement à sa disposition. L'obligation d'informer la patient de tous les risques graves, même s'ils sont exceptionnels, constitue une illustration marquante. Elle se révèle d'autant plus rigoureuse que le juge opère très largement un renversement de la charge de la preuve. Ce dernier est systématique, s'agissant de l'obligation d'informer la patient. Il est, dans d'autres cas, la conséquence des présomptions de faute qui jouent lorsque le dommage apparaît sans lien avec les conséquences normales de l'acte pratiqué comme dans l'hypothèse de l'infection nosocomiale (C.E., 14 juin 1991, Maalem, Rec. p. 1185, 31 mars 1999, A.P. de Marseille, Rec. p. 114).
Sur le plan des principes le renversement de perspective le plus marquant réside dans l'admission de la responsabilité sans faute. Il pourrait passer comme présentant une portée limitée si l'on sen tenait à la jurisprudence Gomez (C.A.A. Lyon, 21 décembre 1990 2 ( * ) ) et Bianchi (C.E., 9 avril 1993 3 ( * ) ).
Innovation majeure, sans doute, mais dont les applications ne peuvent qu'être exceptionnelles compte tenu notamment des conditions relatives à l'anormalité et à la gravité du préjudice. Mais il convient d'y ajouter le champ étendu de la responsabilité du fait des choses qui couvre les dommages causés par le matériel utilisé et, surtout, par les produits administrés au patient ainsi que l'a illustré l'affaire du sang contaminé (CE., 25 mai 1995, Cts N'Guyen, M. Jouan, Cts Pavan, trois arrêts, Rec. p. 221).
La législateur a confirmé et même amplifié ce mouvement en instituant de larges domaines de responsabilité sans faute.
Il a agi parfois sous l'impulsion du droit européen. Ainsi en transposant la directive 85/374 du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des législations des États membres de la Communauté européenne en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. Fournisseur - ou, parfois, fabriquant - de produits, l'hôpital ne peut s'exonérer que s'il établit la responsabilité de la victime, la conformité à une règle impérative ou, encore, la risque de développement (sauf en ce qui concerne le corps humain ou les produits issus de celui-ci). Et ce régime de responsabilité, s'il est aujourd'hui inscrit dans le Code civil (art. 1386-1 et s.), s'applique aux hôpitaux publics (C.J.C.E., 10 mai 2001, Veedfald, C-203/99, Rec. p. 1-3569).
On serait tenté d'englober dans ce mouvement toutes les lois qui ont permis à la victime d'être indemnisée sans avoir à établir l'existence d'une faute. Cependant il convient d'écarter celles qui, pour une action conduite au sein de l'hôpital, font porter le poids de l'indemnisation sur une tierce personne, souvent un fonds national ou office national. Elles relèvent d'une autre logique (infra B). Demeure alors d'abord la loi Huriet-Sérusclat du 20 décembre 1988, relative à la protection des personnes qui se prêtent à une recherche biomédicale. Elle institue une responsabilité sans faute lorsque l'expérimentation ne présente aucun bénéfice direct pour la victime (C.S.P., art. L. 1142-3). Cette responsabilité pèse sur l'hôpital lorsque celui-ci est le promoteur de l'essai. On peut ranger dans la même catégorie la "responsabilité" sans faute imposée à l'établissement français du sang à l'égard des risques encourus par les donneurs (C.S.P., art. L. 1222-9).
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, si elle maintient qu'en principe la responsabilité des professionnels et des établissements de soins est fondé sur la faute, consacre la régime de la responsabilité sans faute que la jurisprudence judiciaire avait institué à l'égard des infections nosocomiales. Sur ce point, depuis les trois arrêts rendus par la 1 re chambre civile le 29 juin 1999 1 ( * ) , la Cour de cassation se montrait plus exigeante que le Conseil d'État qui s'en tenait à la présomption de faute (C.E., 31 mars 1999, A.P. de Marseille, préc). Désormais, la responsabilité sans faute s'applique à tous les établissements hospitaliers, publics aussi bien que privés. À dire vrai, cette avancée est peut être plus marquante au niveau des principes que de la condition effective des victimes. Mais la loi du 4 mars 2002 apporte plus encore en ce qu'elle confirme l'orientation de la responsabilité hospitalière vers une éthique de la sécurité.
B - L'ORIENTATION VERS UNE ÉTHIQUE DE LA SÉCURITÉ
L'évolution de la responsabilité hospitalière conduit, en effet, à se demander si ne s'impose pas peu à peu une obligation de non atteinte à l'intégrité corporelle, mis à part les actes nécessaires au traitement accomplis avec le consentement. Il s'agirait d'une obligation de sécurité, se traduisant lorsqu'elle n'a pas été respectée par l'indemnisation automatique de la victime, dont la confrontation aux exigences éthiques suscite deux séries de questions.
1. La mise en oeuvre de l'obligation de sécurité doit-elle relever de la responsabilité pour faute ou de la responsabilité sans faute ? Même si l'indemnisation est en toute hypothèse acquise, les conséquences de l'action en responsabilité ne seront pas identiques pour les personnels soignants et les établissements de soins.
La réponse qui semble s'imposer a priori est la préférence pour le régime de la responsabilité sans faute dès lors que l'on entend garantir au patient un droit à la sécurité absolue. Apparaît alors la consécration d'un principe éthique nouveau, le principe de "sécurité-résultat". Son étendue, cependant, pose problème. Au nom du principe tout dommage infligé - autre que celui qui résulte nécessairement de l'intervention acceptée - doit être réparé. Doit-il en aller de même pour le dommage résultant de la non-guérison ? Ce n'est pas dans la logique du principe, mais il ne faut pas exclure que se produisent des déviations en ce sens.
Éviter ces dérives tout en aboutissant quant au reste à des résultats très proches de ceux qu'induit le principe de sécurité-résultat pourrait être l'un des avantages conduisant à accorder la préférence au principe de précaution. Principe que l'on qualifierait plus justement d'hyperprécaution tant il va au delà de l'obligation de prudence 1 ( * ) dans la mesure où il impose de tenir compte de risques dont la réalisation est souvent incertaine dès lors que le dommage redouté est grave. On ne reprendra pas ici la controverse sur le point de savoir si le principe de précaution s'appliquant à la responsabilité diminue ou accroît le domaine de la responsabilité pour faute 2 ( * ) . Il nous semble que la seconde conception s'inscrit mieux dans la logique du principe. Le fait même que le dommage se soit réalisé ne prouve-t-il pas que toutes les précautions nécessaires n'ont pas été prises, donc l'existence d'un comportement fautif ?
2. Mais les tenants de la faute ou du risque sont peut être en voie d'être dépossédés de leur terrain de controverse, dans la mesure où la réparation des dommages causés par les établissements hospitaliers abandonnent le terrain de la responsabilité au profit de celui de la garantie. Le principe qui s'impose alors est celui de l'assurance-solidarité : le dommage est indemnisé non plus par le responsable mais par un tiers, l'État ou le fonds de garantie ou de solidarité qui en est plus ou moins l'incarnation financière.
Cette éthique de la solidarité (solidarité nationale) devant le malheur que représente l'atteinte grave à l'intégrité corporelle imprègne de plus en plus profondément notre droit. Des préjudices causés par les vaccinations obligatoires (loi du 26 mai 1975 élargissant la responsabilité admise par la loi du 1 er juillet 1964, C.S.P. art. L. 3111-9) aux ravages consécutifs à la contamination par le V.I.H. lors d'une transfusion sanguine ou injection de produits dérivés du sang (loi du 31 décembre 1991, C.S.P. art. L. 3122-1 et s.), l'avancée était déjà considérable.
La loi du 4 mars 2002 va très au-delà en posant le principe de l'indemnisation de l'aléa thérapeutique 3 ( * ) lorsque le préjudice imputable à l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins a au "pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présente un caractère de gravité" supérieur au taux d'incapacité permanente (I.I.P.) qui sera fixé par décret et que l'on s'attend à être de 25 %. Pour le V.I.H. l'indemnisation est assurée par le Fonds d'indemnisation créé par la loi du 31 décembre 1991. L'indemnisation de l'aléa thérapeutique incombe à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à qui l'État a, de plus, transféré la réparation des accidents consécutifs aux vaccinations obligatoires (C.S.P., art. L. 3111-9).
Des dispositifs de solidarité d'une telle ampleur ne peuvent être institués que par le législateur, les juridictions tant judiciaires qu'administratives se récusant à juste titre 1 ( * ) . Et l'on comprend que celui-ci ait longuement hésité s'agissant d'indemniser l'aléa thérapeutique dont les contours seront difficiles à déterminer et dont la charge financière considérable qui pèsera sur les régimes de sécurité sociale apparaît des plus délicats à évaluer et, vraisemblablement, à contenir. À cela s'ajoute, sur le plan de l'éthique hospitalière, le risque exprimé par certains que, en dépit des actions subrogatoires au cas de faute, l'indemnisation par l'Office n'induise un certain assoupissement de la vigilance des personnels.
II - LA DISSOCIATION ENTRE L'ATTEINTE À L'INTÉGRITÉ DU CORPS ET L'ATTEINTE À LA PERSONNE
La personne humaine, ni ne se conçoit sans le corps, ni ne se limite à celui-ci. La dignité de la personne humaine s'incarne dans des valeurs éthiques autres que le respect de l'intégrité du corps. D'où, si elle constitue l'exception, une dissociation entre atteinte au corps et atteinte à la personne qui altère le schéma précédent. Cette dissociation peut jouer dans les deux sens. Soit le corps humain devient l'instrument de l'atteinte à la dignité de la personne auquel la responsabilité de l'hôpital sera engagée quand bien même il n'y a pas eu atteinte à l'intégrité corporelle. Soit l'atteinte à l'intégrité du corps trouve une justification dans le respect de la dignité de la personne, donc ne sera pas indemnisé.
A - LE CORPS HUMAIN, INSTRUMENT D'UNE ATTEINTE INDEMNISABLE À LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE
Cette situation est susceptible de se rencontrer dans une série d'hypothèses.
Certaines se réalisent assez fréquemment sans, il est vrai, engendrer toujours un préjudice grave. Il en va ainsi de l'atteinte à la vie privée. La violation du secret médical ne porte pas atteinte à l'intégrité du corps ; elle n'en est pas moins préjudiciable au patient et engage la responsabilité de l'hôpital. Le plus souvent seule la responsabilité disciplinaire du soignant est mise en jeu devant le juge administratif. Mais il n'est pas exclu qu'une indemnité ait été versée à la victime. Au reste, les décisions rendues en matière disciplinaire sont particulièrement significatives du primat accordé à l'éthique, ce dernier l'emportant même sur le consentement du patient. Ainsi le Conseil d'État a-t-il confirmé la sanction infligée à un médecin qui avait, avec le consentement de l'intéressé, permis à un journaliste de photographier une de ses patientes dans son cabinet et de publier cette photographie (C.E., 28 mai 1999, Torjemann, Rec. p. 159).
Dans certains cas le juge se fonde directement sur l'atteinte à la dignité de la personne humaine pour juger le comportement répréhensible, ce qui implique que si un préjudice a été commis il recevra réparation. Le gynécologue qui filme à leur insu des patientes même dans un but de recherche scientifique, porte "atteinte à la dignité" de ces personnes (C.E., 8 décembre 2000, Drai). Une faute du même ordre serait imputable à des services qui participeraient à la réalisation d'une "maternité de substitution", ainsi que cela résulte implicitement de la jurisprudence Association les Cigognes (CE., 22 janvier 1988) 1 ( * ) .
Le statut du cadavre pose un problème particulier. Le cadavre n'est plus le corps humain ; il en est la dépouille. Cependant le Conseil d'État a rappelé dans l'arrêt Milhaud 2 ( * ) que "les principes déontologiques fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine, qui s'imposent au médecin dans ses rapports avec son patient ne cessent pas de s'appliquer à la mort de celui-ci". Ce qui en l'espèce visait à protéger le cadavre contre des atteintes illicites à son intégrité, puisqu'effectuées hors des prescriptions légales et sans consentement de la famille, aboutirait également à la condamnation d'une atteinte à la vie privée résultant de la publication d'une photographie du cadavre.
B - ATTEINTE À L'INTÉGRITÉ CORPORELLE NON INDEMNISÉE PARCE QUE JUSTIFIÉE PAR LE RESPECT DÛ À LA PERSONNE
Se peut-il que le respect de la personne humaine, de sa dignité, conduise à refuser l'indemnisation du préjudice causé par l'atteinte à l'intégrité corporelle ? Le droit français l'a admis dans certains cas, non toujours sans hésitation il faut en convenir.
C'est le principe qui régit aussi bien le don d'organe ou de sang que la participation du "volontaire sain" à une expérimentation sans bénéfice direct pour lui. Autre chose est la réparation du préjudice que pourrait causer ce don au donneur ou l'expérimentation à celui qui s'y prête.
Autre chose également, du moins si l'on se conforme à la lettre et à l'esprit de la loi, la compensation accordée pour indemniser les contraintes dommageables auxquelles l'intéressé a consenti en se prêtant à une expérimentation sans bénéfice direct pour lu (C.S.P., art. L. 1124-2).
Le respect de la dignité de toute vie humaine, si difficile soit-elle, est le principe qui a finalement fait triompher le refus de réparer le préjudice résultant pour l'intéressé de la naissance avec un handicap. Faut-il rappeler que ce fut le fondement de l'opposition entre la jurisprudence Époux Quarez 1 ( * ) et la jurisprudence Perruche 2 ( * ) , ainsi que de l'article "anti-Perruche" 3 ( * ) contenu dans la loi du 4 mars 2002, selon laquelle "Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance" mais doit pouvoir compter sur la "solidarité nationale". Plus délicate apparaît la solution lorsque au delà du respect de l'intégrité du corps, s'opposent deux normes éthiques. Tel est le cas lorsque les médecins passent outre le refus de transfusion sanguine parce qu'ils jugent cette transgression de la volonté du patient absolument indispensable à la survie de l'intéressé. Dans les arrêts qu'elle a rendus le 9 juin 1998 4 ( * ) (Mme Donyoh ; Mme Senanayake) la Cour administrative d'appel de Paris considérait que "l'obligation faite au médecin de toujours respecter la volonté du malade en état de s'exprimer". Si elle puise son fondement dans les principes d'inviolabilité et d'intégrité du corps humain ultérieurement repris par le législateur aux articles 16-1 et 16-3 du Code civil, n'en trouve pas moins sa limite dans l'obligation qu'a également le médecin, conformément à la finalité de son activité, de protéger la santé, c'est à dire en dernier ressort la vie elle même de l'individu. Comment trancher entre deux valeurs éthiques aussi essentielles au respect de la personne, le respect des convictions religieuses et le respect du droit à la vie ? On sait que le Conseil d'État, sans approuver le considérant ci-dessus rappelé, n'en refuse pas moins d'engager la responsabilité (disciplinaire en l'occurrence) du médecin en présence d'une situation aussi "extrême" (C.E., 26 octobre 2001, Mme X) 5 ( * ) . Peut être convient-il de se rappeler que la confrontation entre éthique des patients et éthique des soignants, si souvent convergentes, risque d'engendrer ce type de problème.
CONCLUSION
Évoquer de semblables questions force à admettre que l'évolution du droit de la responsabilité hospitalière est, et sera, beaucoup plus complexe encore qu'on ne le conçoit souvent. Nombre de questions ne sont pas résolus ou le sont pas encore de façon satisfaisante. Les considérations d'ordre économique et celles qui tiennent aux caractéristiques de l'activité de soins pèsent très lourd.
Néanmoins il semble acquis que cette évolution sera fortement imprégné par l'exigence éthique. Quitte à observer que se développe une double dynamique. L'une incite à réparer tout dommage, fût ce en abandonnant non seulement la responsabilité pour faute mais encore le cadre juridique de la responsabilité au profit de celui de la solidarité donc de la garantie. Subsiste cependant l'autre dynamique qui, se fondant elle aussi sur l'éthique, invite à maintenir au moins un espace à la responsabilité pour faute, la faute contre l'éthique. Accorder à chacune sa juste part ne sera pas aisé.
Monsieur Yves GAUDEMET
Je crois Monsieur, après vous avoir entendu, que je suis l'interprète de tous vos auditeurs, en vous disant notre admiration et que tout commentaire serait superflu. Nous avons vraiment été impressionnés de l'élégance et en même temps de la compétence avec laquelle vous abordiez ce sujet éminemment difficile et encore une fois je crois que tout commentaire amoindrirait les remerciements et l'admiration que je veux vous exprimer au nom de tout votre auditoire.
L'aléa médical
par Monsieur Jean-Pierre DUPRAT,
professeur à l'Université Bordeaux 4 * ( * )
Du fait de l'évolution jurisprudentielle récente dans le domaine de la responsabilité médicale, trois séries de problèmes sont débattus de manière privilégiée : l'étendue de l'information devant être délivrée au patient par le médecin, l'unification des solutions dégagées par les deux ordres de juridiction, s'agissant de la réparation des différents dommages subis à la suite d'un acte médical et, en relation avec ce problème, la détermination du fondement de la responsabilité dans un souci d'équité, quand il s'agit d'un accident.
Sur le terrain de l'information, une succession d'arrêts a conduit à stabiliser les solutions admises, dans le sens d'une extension des exigences, puisque le Conseil d'État a retenu que la survenance exceptionnelle d'un risque ne dispense pas de l'obligation d'information 1 ( * ) , le Commissaire du Gouvernement renvoyant à la théorie de la Cour de cassation de la perte de chance quant à l'établissement du lien de causalité 2 ( * ) . Toutefois, cette dernière s'efforce de préserver le médecin d'une charge excessive, par exemple en affirmant qu'il "n'est pas tenu de réussir à convaincre son patient du danger de l'acte médical qu'il demande" 3 ( * ) .
Dans ses divers aspects, la responsabilité médicale est le théâtre d'un jeu de miroirs, les cours suprêmes se renvoyant l'une à l'autre les solutions dégagées sur la base des techniques qui leur sont propres 1 ( * ) . Afin d'accélérer l'unification des solutions, une proposition de loi a même été déposée, visant à conférer au juge judiciaire la compétence exclusive pour connaître des actions en justice mettant en cause des établissements publics de santé 2 ( * ) . Pour aider à résoudre le problème difficile du risque médical, l'Inspection générale des services judiciaires et l'Inspection générale des affaires sociales proposèrent la création d'un fonds des accidents médicaux graves non fautifs 3 ( * ) .
De manière récurrente, les juges furent confrontés à la détermination du fondement de la responsabilité et aux implications que comporte le choix d'une réparation sur la base du risque, spécialement dans le cas d'événements de caractère épidémique, comme la propagation transfusionnelle du virus du VIH ou de l'hépatite c. Or, les avancées jurisprudentielles, dans le cas des risques individuels et non pas sériels, se produisirent après des échecs répétés d'initiatives de caractère législatif. En effet, il n'existe que des modalités limitées de réparation sur la base d'un texte : vaccinations obligatoires, avec la loi modifié du 1 er juillet 1964 (art. L. 3111-1 et s. CSP), don du sang, lorsque le dommage est subi par le donneur (loi du 2 août 1961, art. L. 1222-9 CSP), expérimentation sans bénéfice individuel direct avec la loi du 23 janvier 1990 modifiant celle du 20 décembre 1988 (art. L. 1121-7). Reste donc en suspens l'adoption d'un texte général assurant la réparation du risque médical.
Le caractère mouvant de la terminologie exprime de manière significative des interrogations quant au contenu à donner à la notion d'aléa médical 4 ( * ) et donc aux conséquences financières qui en dépendent sur le terrain de la réparation, ce qui conduit souvent à une objectivation de la responsabilité en matière médicale 5 ( * ) . Furent retenues successivement les expressions d'accident sanitaire ou thérapeutique, d'aléa thérapeutique, de risque médical et d'accident médical. Pour sa part, Mme LAMBERT-FAIVRE consacre la notion de risque médical 6 ( * ) . Si nous rejoignons cet auteur pour substituer le qualificatif médical à celui de thérapeutique, car ce dernier écarterait les actes diagnostiques, de recherche ou de prévention, le terme d'aléa nous paraît à conserver en raison de son fort contenu évocateur, même si une partie des effets visés ne sont pas totalement imprévisibles, comme cela transparaît de la jurisprudence BIANCHI. En outre, la notion d'aléa médical souligne de manière heureuse la rupture avec toute faute de la part de la conduite du médecin. De sorte que l'aléa médical renvoie à l'idée de fatalité, ainsi que le souligne M. CHABAS, employant d'ailleurs la terminologie ancienne d'aléa thérapeutique 1 ( * ) , de même que continue de le faire la Cour de cassation dans l'arrêt commenté 2 ( * ) .
L'étymologie qui renvoie au jeu de dés exprime bien cette idée de hasard dans la survenance de l'accident, même si l'existence d'une probabilité peut se constater, car ce qui importe c'est le caractère aléatoire pour la victime, l'imprévisibilité qui fonde la réparation sur le risque.
Cet élément central rend compte de la condition essentielle mise à la réparation sur cette base que représente l'absence de toute faute de la part du praticien. Toutefois, les solutions jurisprudentielles comportent des limites importantes qui rendent l'application de la solution dégagée par le Conseil d'État par l'arrêt BIANCHI restreintes, conduisant à rappeler ainsi le rôle essentiel que doit tenir la législation dans ce domaine.
I- L'ALEA MÉDICAL : UN ÉVÈNEMENT DOMMAGEABLE EXCLUSIF DE TOUTE FAUTE.
S'agissant de l'hôpital public, le Conseil d'État se détermine par rapport à l'idée de rupture de l'égalité devant les charges publiques 3 ( * ) , ce qui n'implique nécessairement que des risques individuels et non sériels, dans la mesure où prévaut une exigence de spécialité dans la détermination du dommage subi 4 ( * ) , afin de distinguer la responsabilité de la solidarité, dimension que nous évoquerons à propos d'une intervention du législateur.
Le système de responsabilité retenu dans le cas de l'aléa médical conduit à jumeler, au rejet de la faute, l'anormalité du préjudice subi, deux éléments qui se fondent dans l'idée de risque.
A- L'EXCLUSION DES COMPORTEMENTS FAUTIFS PAR LA JURISPRUDENCE.
Pour l'exercice libéral de la médecine, la relation contractuelle débouche logiquement sur l'idée de faute quand l'obligation contractuelle reste inaccomplie, ce qui est parfaitement compatible avec l'idée d'une obligation de moyens, fut-elle assortie dans certains cas d'une obligation de sécurité de résultat, comme pour la fourniture de sang par les centres de transfusion sanguine. La jurisprudence administrative, en dépit des apparences, a consolidé, par l'abandon même de la condition de la faute lourde, le fondement de la faute dans le cas de l'acte médical. C'est donc par référence à cette assise commune que se particularise l'aléa médical. S'il ne s'agit pas de déresponsabiliser les médecins, évolution que redoute le Conseil d'État avec le passage à un système qui reposerait tout entier sur le risque 1 ( * ) , il convient pourtant de faire sienne cette observation de M. EWALD, selon qui "... la médecine moderne, celle que nous pratiquons, qui rend des service tels qu'elle reste de fait plébiscitée par ses destinataires, est aussi une médecine dangereuse" 2 ( * ) . C'est donc la prise en compte de cet aspect qui, à défaut d'une législation appropriée, conduit le juge à retenir des cas de responsabilité sans faute, qui relèvent d'une logique d'aléa médical.
1. La distinction entre obligation de sécurité de résultat et aléa médical en exercice libéral.
Pour la juridiction judiciaire, alors que se trouve en cause une relation de caractère contractuel entre le patient et son médecin, une extension de la réparation passait par le rattachement de l'aléa médical à l'obligation accessoire de sécurité de résultat. Or, dans une affaire DESTANDAU-TOURNEUR, la première Chambre civile vient d'exclure de manière explicite des obligations contractuelles du médecin l'aléa médical : "... la réparation de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont le médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient" 3 ( * ) . Ce faisant, elle retient une des options présentée par M. SARGOS, qui évoquait les lourdes conséquences financières, pour le corps médical, de la solution qui consisterait à imposer au praticien une réparation sur la base du risque. Sur un terrain plus théorique, admettre cette possibilité aurait considérablement affaibli le système traditionnel de la responsabilité médicale fondée sur la faute, et donc le cadre d'une obligation de moyens.
Contrairement à certaines critiques avancées 4 ( * ) , l'extension réalisée par la Cour de cassation de la responsabilité, en se fondant sur une obligation de sécurité de résultat, accessoirement à l'obligation découlant du contrat médical, ne perturbe donc pas vraiment globalement le système de responsabilité établi sur la faute contractuelle. Au contraire, le refus d'étendre à l'aléa médical une telle obligation consolide les mécanismes d'ensemble de la responsabilité pour faute. M. le Conseiller SARGOS a clairement indiqué les enjeux, par référence à la différence induite du fait des techniques auxquelles recourent les deux ordres juridictionnels. Dans son rapport, il souligne ainsi les particularités qui existent entre l'obligation de sécurité de résultat, retenue par la Cour de cassation et l'aléa médical. En effet, la perfection visée dans le premier cas ne s'applique qu'à des situations précisément déterminées : port d'une prothèse, infections nosocomiales, utilisation de dispositifs médicaux de l'article L. 5211-1 1 ( * ) . À l'origine du dommage se trouve donc une défaillance du matériel ou du système de désinfection, alors qu'avec l'aléa survient un véritable cas fortuit, de même que l'obligation de résultat ne pèse pas sur l'acte médical lui même, mais sur le matériel ou les produits utilisés 2 ( * ) .
La clarification introduite par l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2000 met ainsi un terme aux différentes tentatives faites par plusieurs cours d'appel pour étendre l'obligation de résultat à l'aléa thérapeutique. Une tentative de cette nature fut ainsi réalisée par la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 15 janvier 1999, sur la base de l'arrêt BIANCHI du Conseil d'État : "le chirurgien a ainsi une obligation de sécurité qui l'oblige à réparer le dommage causé à son patient par un acte chirurgical nécessaire au traitement, même en l'absence de faute, lorsque le dommage est sans rapport avec l'état antérieur du patient, ni avec l'évolution prévisible de cet état" 3 ( * ) . Par son champ d'application, l'obligation accessoire de sécurité de résultat, même si elle met en oeuvre un système de responsabilité sans faute, renforce paradoxalement le fondement même de la faute s'agissant de l'acte médical proprement dit. Comme le relève Mme Lambert-Faivre, l'aléa "thérapeutique" joue le rôle du cas fortuit exonératoire, selon la caractérisation retenue par la Cour de cassation, dans l'affaire DESTANDAU-TOURNEUR, qui mentionne la survenance "en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé..." 4 ( * ) . Mais au regard de la solution consacrée par le Conseil d'État, la Cour de cassation établit bien une séparation nette entre un système de responsabilité pour faute, applicable à l'acte médical, sauf fait exonératoire et la responsabilité sans faute liée à des dommages provoqués par des matériaux ou produits utilisés par le médecin 5 ( * ) . Dans le premier cas, l'exonération de responsabilité résulte du caractère imprévisible et non maîtrisable de l'événement dommageable, donc de son irrésistibilité. Dans le contexte de l'arrêt, l'aléa "thérapeutique" n'est alors envisagé que de manière restrictive, par opposition à l'idée d'accident médical, ce qui soulève une fois encore le problème de la définition, qu'élude d'ailleurs la Cour de cassation, ainsi que le relevait M. DUBOUIS.
2. Faute, erreur, et aléa médical.
Chaque ordre juridictionnel s'efforce de consacrer des solutions conformes à l'équité, ce qui provoque d'ailleurs un rapprochement entre les deux ordres de juridictions, qui se constate aussi sur le terrain de l'information délivrée au patient, en jouant d'ailleurs d'un mouvement de bascule entre la recherche de l'aléa et l'obligation d'information. Il est vrai que les techniques juridiques mobilisées s'avèrent difficilement adaptables à l'objet médical et nécessitent des montages parfois complexes, comme l'est celui qui met en rapport l'obligation accessoire de sécurité de résultat et l'obligation conventionnelle du médecin, dans le prolongement de la jurisprudence Mercier, s'agissant de l'exercice libéral. Semblablement, A. DEMICHEL a montré, pour les deux ordres juridictionnels, les difficultés théoriques engendrées par la notion de perte de chance 1 ( * ) . Cependant, le fait que l'engagement de responsabilité mettant en cause un acte médical repose principalement sur la faute contribue à donner son unité et sa légitimité à l'ensemble du système, évitant ainsi le risque de déresponsabilisation de la profession évoqué ci-dessus, et auquel faisait référence le Conseil d'État dans son rapport sur le Droit de la santé. Chaque système de responsabilité comporte donc une épine dorsale qui en fortifie la consistance générale.
Dans le cadre de la médecine libérale, l'évolution a placé avec constance au premier rang la faute contractuelle, assortie de l'obligation de moyens 2 ( * ) , tandis que dans la décennie écoulée le Conseil d'État a simplifié et renforcé le dispositif de la responsabilité hospitalière du fait d'une faute simple commise à l'occasion d'un acte médical. Le commissaire du Gouvernement rappelait d'ailleurs cet objectif quand il s'efforçait de justifier la solution proposée, en analysant la portée de la qualification : "Il s'agit.... de faire passer la limite de la responsabilité pécuniaire de l'établissement entre d'un côté l'erreur isolée, la maladresse légère minimale explicable par une situation d'urgence - disons l'erreur non fautive - et de l'autre côté la faute, c'est à dire l'option ou le geste clairement contraire aux règles de l'art" 3 ( * ) .
Ce propos pose clairement la question de la distinction entre la faute et l'erreur médicale excusable, qui nous ramène à la logique de l'arrêt Mercier et de l'obligation de moyens. Plusieurs dispositions du Code de déontologie médicale insistent sur le niveau de connaissances auquel est tenu le médecin, en particulier l'article 32 qui se réfère à des soins "fondés sur les données acquises de la science". De même, l'article 33, s'agissant du diagnostic, fait obligation de recourir aux "méthodes scientifiques les mieux adaptées".
Derrière ces devoirs formulés en termes généraux, comme les décisions jurisprudentielles ayant eu à trancher des litiges relatifs à des erreurs médicales, se trouvent en cause des standards, correspondant à l'exercice normal de la médecine, tel que défini, par exemple, par les conférences de consensus. Bien qu'un arrêt de la CAA de Paris du 26 février 1998 (CHG Léon Binet de Provins) ait dénié tout pouvoir normatif à de telles conférences et donc une nature correspondante aux conclusions retenues, sans que soit résolue par ailleurs la question de la nature d'autres standards, comme les références, les bonnes pratiques et recommandations, ces différents documents concrétisent le contenu des données acquises ou actuelles de la science. Toutefois, spécialement lorsqu'il s'agit de l'exercice libéral, le juge garde souvent présent à l'esprit les conséquences pécuniaires des décisions à rendre 1 ( * ) . Ainsi intervient une distinction entre l'erreur proprement dite et les circonstances de son intervention, qui vont jouer le rôle d'un fait exonératoire. La tendance actuelle est, cependant, à retenir de manière plus radicale l'erreur en la considérant comme fautive, tout particulièrement dans le cas de la jurisprudence émise par la Cour de cassation. Longtemps, la distinction entre faute lourde et faute simple, dans le régime de la responsabilité hospitalière, avait pu conduire à minimiser la portée de certaines erreurs commises par le médecin. N'étaient retenus que les manquements faisant apparaître une véritable carence, l'exemple caricatural consistant dans l'oubli de corps étrangers dans l'organisme du patient, à la suite d'une intervention chirurgicale, lorsque celle-ci était pratiquée dans des conditions normales 2 ( * ) . De même, l'erreur de diagnostic ne devenait véritablement fautive que lorsque l'examen pratiqué s'était révélé être insuffisant, par contre l'absence de qualification de faute lourde dans le cas d'une simple erreur exonérait le médecin de sa responsabilité.
S'agissant du juge judiciaire, la maladresse ou négligence a pu être sanctionnée, à la fois au civil et au pénal, particulièrement lorsqu'il s'agissait d'un examen pratiqué sans nécessité. La responsabilité pénale est engagée lorsque la négligence se trouve associée à l'imprudence. Mais, ainsi que le relève Mme Ferrari, "l'erreur due à une compétence médicale médiocre ne constitue pas une imprudence ou une négligence" 3 ( * ) , seul le diagnostic "aberrant" représente une faute sanctionnée. Le juge administratif a retenu pour sa part une distinction comparable 4 ( * ) .
Or, les développements récents de la jurisprudence de la Cour de cassation paraît traduire une exigence renforcée quant à la sûreté exigée de l'acte médical, que l'on a pu particulariser par un "accomplissement qui présente des difficultés sérieuses et requiert des connaissances spéciales au prix d'études prolongées" 5 ( * ) . Ainsi deux arrêts du 23 mai 2000 (Le Sou médical et Dame Romme) ont-ils retenu la faute médicale à l'occasion de maladresses commises par un stomatologiste, provoquant le traumatisme d'un nerf sub-lingual et d'un chirurgien ayant sectionné une artère, alors que le patient ne présentait aucune anomalie 6 ( * ) , il prolonge ainsi la solution consacrée par la Cour de cassation, à propos du décès par hémorragie d'un patient à la suite d'une perforation d'une artère sous-clavière : "... la blessure... avait été le fait du chirurgien, de sorte que sa responsabilité était engagée..." 7 ( * ) . Ces décisions contribuent à renforcer la ligne séparant la faute, mais également l'erreur ou la maladresse, de l'aléa véritable. Cet aspect se trouve d'ailleurs particulièrement affirmé avec un autre arrêt de la Cour de cassation, du 30 septembre 1997, affirmant que "toute maladresse d'un praticien engage sa responsabilité et est par là même exclusive de la notion de risque inhérent à un acte médical" 1 ( * ) . Selon cette solution, l'erreur ou la maladresse reçoit une connotation fautive, sous réserve de la tolérance retenue dans le domaine du diagnostic.
L'aléa peut alors sans inconvénient majeur être assimilé à un risque et son approximation terminologique ne comporte pas d'effets négatifs quant aux solutions jurisprudentielles, dès lors qu'il apparaît que ce risque est l'aspect infortuné de l'aléa 2 ( * ) . Mais le caractère d'imprévisibilité qui s'attache à la réalisation de l'aléa, dans un cas déterminé, nécessite que soit mise en relief l'anormalité du préjudice.
B - L'ANORMALITÉ EXTRÊMEMENT GRAVE DU PRÉJUDICE ET LES CONDITIONS RESTRICTIVES D'APPLICATION DE LA JURISPRUDENCE BIANCHI.
Une rapide étude de l'application de la solution dégagée par le Conseil d'État dans l'arrêt d'Assemblée du 9 avril 1993 3 ( * ) , assurant la réparation d'un aléa médical, montre la modicité de la postérité de cet arrêt, d'autant que la Cour de cassation l'a écarté avec sa décision du 8 novembre 2000. Cette situation apparaît comme l'effet du cumul des conditions initialement retenues dans l'arrêt Bianchi.
1. La sévérités des conditions imposées à la réparation de l'aléa
La succession de deux arrêts retenant une responsabilité pour risque, dans le cas d'une thérapeutique présentant un caractère expérimental (CAA de Lyon, 21 décembre 1990-Gomez), puis d'un accident exceptionnel survenu à l'occasion d'une artériographie (arrêt Bianchi) firent penser à un mouvement favorable à la reconnaissance d'une responsabilité sans faute en matière médicale, à la charge de l'hôpital public, consacrant ainsi une attitude favorable à la réparation de l'aléa. Or, le cumul des conditions posés par le Conseil d'État rendait cette ouverture de porté restreinte 4 ( * ) .
Se référant à l'évolution de la responsabilité hospitalière et du caractère trop disparate et inopérant en l'espèce de la technique de la présomption de faute, le commissaire du Gouvernement dessinait ainsi l'épure générale de la solution p. 190. La rédaction de l'arrêt soulève des critiques que la lecture du rapport permet d'écarter, en particulier il convient de relever le passage par lequel M. Sargos explique le souci d'écarter "une certaine dérive", à propos des maladresses chirurgicales, les juridictions les considérant trop facilement comme relevant d'un "aléa exclusif de toute responsabilité".
proposée, sur la base des études déjà réalisées, en définissant donc le risque "thérapeutique" comme le "risque dont la survenance est exceptionnelle au regard du risque habituel du traitement, sans lien avec l'état de santé de la victime, et ayant des conséquences d'une gravité hors du commun" 1 ( * ) . Dans l'explicitation des conditions à une réparation sur la base de la responsabilité sans faute, M. Daël, particularise une fois encore la nature du préjudice : il "doit d'abord être extrêmement grave, hors du commun". Au regard des effets secondaires produits par les médicaments ou les traitements, il précise que "le degré de gravité ne peut être que très élevé". Au détours d'une phrase, il rejette d'ailleurs le risque sériel, car le préjudice ne doit être "supporté que par un nombre infime de victimes". Il s'agit donc d'une condition de spécialité renforcée qui ne vise que des victimes individuelles.
Sur le point de l'applicabilité de la solution au secteur libéral, le principe de solidarité sous-jacent, qui fonde le raisonnement de M. Daël, implique que le mécanisme de responsabilité retenu ne puisse jouer que dans le cadre hospitalier.
Mais l'élément le moins favorable à un développement de la jurisprudence Bianchi apparaît avec une condition sur laquelle le commissaire de gouvernement, quoique plus rapide, est cependant ferme : "... les conséquences de l'acte doivent pouvoir se détacher aux yeux du juge de celle de l'état initial du malade. La disproportion doit éclater entre cet état et les conséquences du remède, l'accident doit avoir créé une situation entièrement nouvelle, dont la thérapeutique est la véritable cause" 2 ( * ) .
Sur cette base, le Conseil d'État a donc énoncé sept conditions cumulatives, si l'on détache chacun des éléments énoncés : il faut un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement, qu'il présente un risque connu, mais de réalisation exceptionnelle, auquel il paraît que le malade n'y est pas "particulièrement exposé", que l'exécution de cet acte soit la cause directe du dommage, que ce dernier soit sans rapport avec l'état initial du patient, ni avec son évolution prévisible et qu'il présente "un caractère d'extrême gravité". Ce rappel des termes de l'arrêt n'a pour objet que de souligner à nouveau des exigences dont la satisfaction ne pourra intervenir que de manière exceptionnelle.
2. Une postérité restreinte
Ainsi déterminée, la jurisprudence Bianchi fut confirmée ultérieurement. D'abord à propos d'un décès intervenant à la suite d'une anesthésie générale, nécessaire à la réalisation d'une circoncision 3 ( * ) , les juridictions concernées ont repris à la rédaction de l'arrêt Bianchi, bien que certains auteurs aient décelé une application bienveillante, l'appréciation portant sur le caractère nécessaire de l'anesthésie et non sur la réalisation d'un acte de nature religieuse, considéré alors comme revêtant un caractère médical, malgré l'absence évidente d'une dimension thérapeutique, ce qui amena le juge à remplacer le vocable de "malade", par celui "patient" 1 ( * ) .
Une affaire récente, Centre hospitalier de Seclin, mettant en cause l'administration d'un produit pour la réalisation d'une anesthésie ayant entraîné un décès, paraît plus complexe au regard de ce qui fut un barrage particulièrement efficace au développement de la jurisprudence Bianchi, l'exposition à un risque du fait d'une prédisposition organique du malade. Le conseil distingue l'état que révèle l'accomplissement d'examens pré-opératoires et l'utilisation antérieure d'un même produit pour en déduire l'absence d'une telle prédisposition, alors que les examens post-opératoires montrèrent l'existence de cette dernière à la survenance d'un risque thérapeutique. Selon Mme Deguergue, le "dynamisme de cette décision, ne cantonnera pas longtemps la responsabilité pour risque thérapeutique dans un rôle subsidiaire" 2 ( * ) . Cette appréciation nous semble excessive, car ce qui est en cause concerne la situation pré-opératoire et l'accomplissement des examens que requièrent les connaissances actuelles de la science. En l'espèce, le précédent d'une anesthésie réalisée sans problème constituait un antécédent normalement pris en compte. Il ne nous semble pas que la légère ouverture pratiquée par le Conseil d'État soit une source d'extension du nombre des réparations effectuées sur la base d'une responsabilité sans faute. Généralement, l'accident thérapeutique présentant un rapport avec l'état du patient est prévisible et l'obligation relève ici de l'information du patient par le médecin. Ces situations expliquent la rareté des décisions favorables retenues par les cours administratives d'appel et la jurisprudence Centre hospitalier de Seclin ne nous paraît pas de nature à élargir considérablement les cas de réparation. À cet égard, la réponse négative de la Cour de cassation, avec l'arrêt Destandau-Tourneur, légèrement antérieure à l'arrêt du Conseil d'État ne peut permettre une évolution divergente trop affirmée, même si la solidarité est appelée à opérer par le biais de l'hôpital, dans le cas d'une responsabilité administrative 3 ( * ) .
Au delà de l'incidence de l'arrêt Bianchi sur la réparation sans faute de l'aléa médical, il convient d'observer également les effets indirects que cette jurisprudence a pu produire sur des aspects latéraux. Par exemple, le renforcement de l'obligation d'information du patient nous semble découler directement de la sévérité des conditions posées à la réparation de l'aléa. Ainsi, le libellé retenu par le Conseil d'État dans l'arrêt Telle est explicite : "la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation" 4 ( * ) . La rédaction retenue par le Conseil d'État est d'ailleurs proche de celle de la Cour de cassation dans l'arrêt Mme C.
- Clinique du Parc du 7 novembre 1998 1 ( * ) . Également, se situent dans la même logique, les tentatives de cours d'appel destinées à intégrer des cas relevant d'un aléa médical au mécanisme de l'obligation accessoire de sécurité de résultat.
Les avancées prudentes de la jurisprudence ne résolvent pas vraiment les difficultés apparues, principalement lorsque sont en cause des risques sériels, la réparation des dommages ayant dû faire intervenir la technique de fonds d'indemnisation, donc une solution législative. Celle-ci devrait dans la perspective d'adoption d'un texte de loi particulier, s'attacher surtout aux risques individuels, un grand nombre de cas relevant des risques sériels pouvant être traités sur la base de la loi du 19 mai 1998. Bien que la cas de la contamination par l'hépatite C puisse également être traité par un texte particulier, il resterait à vérifier les solutions relatives à l'indemnisation de l'aléa au regard des divergences jurisprudentielles.
II - LES INCERTITUDES DE LA PRISE EN COMPTE LÉGISLATIVE DE L'ALÉA MÉDICAL.
La plus immédiate réside dans le nombre relativement élevé des projets ou propositions visant à indemniser l'aléa médical, alors qu'aucun n'a jamais abouti 2 ( * ) . Normalement, cette question est actuellement retenue par les autorités gouvernementales et un projet de loi devrait être déposé à l'automne 2001 3 ( * ) . Ce faisant, un prolongement serait assuré aux réflexions entreprises par l'IGAS et l'IGS en 1999 4 ( * ) , même si les solutions concrètes en diffèrent et la relance de la discussion peut désormais s'appuyer sur les débats qui se déroulent parallèlement à l'étranger, particulièrement en Belgique 5 ( * ) . Surtout face aux tergiversations en ce domaine, le vote récent d'une proposition de loi déposée par M. Huriet contribue utilement à dégager des perspectives précises, marquées par une approche plus stricte du problème, notamment par l'exclusion de tout risque sériel, comme celui découlant d'une contamination par l'hépatite C., ce qui est une garantie de limitation de l'incidence financière de la réparation ainsi assurée 6 ( * ) .
Afin de rendre plus apparente la diversité des positions adoptées sur cette question douloureuse de l'aléa médical, il convient d'abord de retenir les propositions relatives à la nature du préjudice qui serait indemnisé, puis de montrer la diversité des solutions financières envisagées, fonds d'indemnisation, recours à l'assurance, sécurité sociale... Cette dernière dimension déterminant largement la consécration législative de la réparation de l'aléa médical, telle qu'elle est envisagée par les textes les plus récents 1 ( * ) .
A- LE PRÉJUDICE INDEMNISABLE : UN ACCIDENT MÉDICAL GRAVE ET NON FAUTIF
Si le développement rapide des connaissances scientifiques peut rendre obsolètes des dispositifs législatifs trop précis, il convient que la fixation d'un cadre général soit, cependant, utile et qu'il comporte des options claires 2 ( * ) . Les divergences terminologiques déjà évoquées ne sont d'ailleurs pas sans conséquence sur la charge financière liée à la réparation, alors même que les connaissances statistiques en la matière se révèlent fragiles 3 ( * ) . Mais la détermination du préjudice indemnisable est appelée à tenir largement compte de la jurisprudence établie et à mettre un terme aux divergences de solutions retenues par chacune des juridictions suprêmes sur ce point particulier, notamment du fait du récent arrêt de la Cour de cassation.
1. La nécessité d'une séparation tranchée d'avec l'acte médical fautif
Nous avons observé que la pertinence de la notion d'aléa médical se trouve largement conditionnée par le caractère non fautif de l'acte mis en cause, ce sont souvent des nécessités de gestion pratique des risques de la part des organismes d'assurances qui expliquent la prise en compte à la fois de l'accident fautif et non fautif, comme le montre clairement le projet de la Fédération française des sociétés d'assurances 4 ( * ) . En même temps, se trouveraient ainsi résolues, au dire, des représentants de cet organisme, les difficultés concrètes d'une discrimination entre acte fautif et aléa médical stricto sensu, bien que le problème puisse réapparaître dans l'aménagement de l'action récursoire s'agissant du premier.
Dans les différents projets analysés par M. Ewald, se signalent des éléments majeurs qui ont été consacrés ensuite par la jurisprudence, surtout administrative, du fait de la décision Bianchi. Ces textes préconisaient en effet de ne retenir qu'un dommage anormal, caractérisé par son imprévisibilité, d'une survenance exceptionnelle et sa gravité, le problème se posant alors de la nature cumulative ou non de ces différentes caractéristiques 5 ( * ) . Au delà les modalités d'examen du recours, comme de la réparation, répondaient à une grande variété selon les propositions considérées.
Ultérieurement, d'autres propositions reposaient fréquemment sur la prise en compte exclusive d'un acte médical non fautif, en relation avec un mode de réparation faisant intervenir un fonds d'indemnisation sur la base du principe de solidarité. Un avant-projet présenté par M. Kouchner, à la suite du dépôt du rapport Ewald, de même que les orientations retenues par M. Douste-Blazy, en 1993, reposaient sur ces principes, même si pouvait se trouver évoqué également le cas des accidents fautifs 1 ( * ) . On observera d'ailleurs que la jurisprudence des cours administratives d'appel illustraient fréquemment ce caractère d'exception, par l'indication chiffrée de la proportion des incidents au regard des cas traités par les médecins 2 ( * ) .
Parmi les propositions les plus récentes, malgré des divergences sur l'approche procédurale et les modalités de la réparation, prévaut également un traitement propre aux préjudices anormaux. Ainsi, la proposition de M. Evin distingue entre ces derniers, qui relèvent d'une indemnisation par un fonds spécial, tandis que les accidents liés à des actes médicaux fautifs seraient du ressort de la juridiction 3 ( * ) . Sur la base de mécanismes proches, une proposition de M. Serrou avait adopté une logique semblable 4 ( * ) .
Le rapport conjoint présenté en 1999 par l'IGAS et l'IGSJ sépare le cas des risques sériels de celui des risques individuels, réservant au premier un traitement particulier par application de la loi sur les produits défectueux. Les accidents non fautifs graves y sont définis comme étant à l'origine d'une IPP égale ou supérieure à 50 % et le principe de la réparation intégrale par un fonds d'indemnisation était également retenu. Le rapport séparait ce type d'accidents de ceux qualifiés de "non graves" n'ayant pas leur source dans une faute, qui seraient réparés par une assurance personnelle de la victime 5 ( * ) .
Plusieurs pays étrangers ont déjà réussi à appliquer un traitement particulier aux accidents médicaux, en particulier en Europe du Nord. Il est d'ailleurs intéressant d'observer que la modalité retenue par certains pays Scandinaves vise à réduire au maximum le coût de la transaction 6 ( * ) , mais il convient de rappeler que dans un pays comme la Suède le corps médical est généralement salarié, ce qui induit des logiques différentes d'un système mixte comme c'est le cas en France. Pour la Belgique, la réflexion en cours trouve sa cause dans les difficultés éprouvées par certains spécialistes à obtenir une couverture des risques par une compagnie d'assurances. Ainsi, les modalités envisagées de la réparation conditionnent largement l'architecture du système d'indemnisation de l'aléa médical.
2. Les modalités procédurales et indemnitaires
Les réflexions conduites sur la réparation de l'aléa médical se placent souvent du côté du patient afin de mettre en avant les exigences du principe de solidarité. Mais parfois elle renvoie à des situations de fait, propre à la profession médicale, notamment à la l'assurabilité du risque comme nous venons de l'évoquer. La résiliation des contrats à l'initiative des assurances laisserait, en Belgique, 2000 praticiens sans couverture de leur responsabilité professionnelle. Des difficultés semblables se rencontrent en France pour certaines spécialités, comme la gynécologie-obstétrique, et l'anesthésie-réanimation. Dans un tel contexte, il semble peu réaliste de se tourner vers les assureurs pour mettre en oeuvre un système de réparation de l'aléa médical, sauf à augmenter fortement les primes d'assurance et donc les coûts des prestations médicales supportées ultimement par l'assurance maladie, en dépit des mécanismes régulateurs. S'impose donc une logique de réparation par l'intermédiaire d'un fonds d'indemnisation, certains auteurs ayant même envisagés de constituer un ensemble large, prenant appui sur les mécanismes du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme 1 ( * ) .
Ainsi que l'explique M. Pontier, la réparation collective, au nom de la solidarité nationale, est à la fois subsidiaire et nécessaire 2 ( * ) . La nature des risques concernés fait d'ailleurs préférer cette technique à celle de la réparation sur crédits budgétaires. Mais outre le quantum de l'indemnité versée, importent surtout les conditions de mise en oeuvre de la réparation, afin de préserver les conditions que nous avons posées comme cardinales, celles de la réparation intégrale du préjudice subi du fait d'un véritable aléa médical, à la fois non fautif et d'une exceptionnelle gravité, les autres cas relevant d'une logique d'assurance, malgré les difficultés éprouvées par certaines spécialités.
Or se dégage l'idée, retenue dans plusieurs propositions, de faire intervenir, de manière préalable, une instance consultative chargée de retenir ou non la qualification d'aléa médical et d'attribuer ainsi le dossier soit au fonds d'indemnisation, soit à la juridiction compétente 3 ( * ) . Le rapport de l'IGAS et de l'IGSJ se rattache à cette logique, bien que la procédure soit plus complexe du fait de l'intervention préliminaire d'une commission régionale ou interrégionale d'expertise qui oriente éventuellement la réparation par le fonds, l'offre d'indemnité étant établie par une commission nationale d'indemnisation, la juridiction compétente pouvant être saisie afin de se prononcer sur la qualification de l'accident médical 1 ( * ) .
Ces quelques rappels visent à constituer un arrière plan destiné à mieux apprécier les initiatives nouvelles, principalement la proposition de loi présentée par M. Huriet, votée par le Sénat.
B - LA PROPOSITION DE M. HURIET ET LES LINEAMENTS D'UN PROJET ANNONCE
Devant les nombreux reports d'une éventuelle discussion de propositions ou projets de loi en la matière et sans doute aussi en raison du retard pris quant au dépôt du projet de loi destiné à modifier les lois bioéthiques, M. Huriet a déposé une proposition de loi, qui a été adopté par le Sénat dans sa séance du 26 avril 2001 2 ( * ) . Au cours de celle-ci, M. Kouchner a pu réaffirmer la volonté du Gouvernement de faire débattre par le Parlement un projet de loi qui devrait être entériné par la Conseil des ministres avant les vacances prochaines 3 ( * ) . Il est donc intéressant de confronter les lignes de la proposition et les critiques adressées à celle-ci par le ministre.
1. La volonté simplificatrice de la proposition de loi 4 ( * )
Il convient de saluer tout d'abord le progrès terminologique que représente la consécration de l'expression "aléa médical", car elle recouvre l'ensemble des actes de la pratique médicale, notamment de nature diagnostique ou thérapeutique. Il serait vain de vouloir donner dans un texte l'énumération de ces actes, car le progrès médical implique des évolutions de la pratique, de même qu'il paraît difficile de caractériser le degré de gravité et de normalité du dommage causé, au delà des règles fixées par la jurisprudence. À cet égard, l'article 1 er de la proposition ne fait que synthétiser les conditions découlant précisément de la jurisprudence Bianchi de même, les compétences établies de chacun des ordres juridictionnels ne sont pas modifiés 5 ( * ) et la proposition maintient le principe de l'intervention préalable du juge pour fixer le montant du préjudice, sans qu'un plafond soit établi à la réparation, comme pouvait le prévoir la Fédération des assureurs. À cet égard, le recours fréquent à des barèmes pour le juge permet, avec le concours d'experts, de discriminer entre les dommages afin de déterminer ceux qui correspondent aux effets d'un véritable aléa médical. Le régime des infections nosocomiales est aligné sur celui de la responsabilité sans faute, avec imputation de la réparation aux établissements concernés, mais, élément semble-t-il restrictif, les organismes sociaux ne peuvent se retourner contre un établissement que sur la base de la faute prouvée 1 ( * )
Toutefois, la véritable originalité de la proposition réside dans la réparation intégrale du dommage par l'assurance maladie et l'organisation d'un collège de l'expertise en responsabilité médicale. M. Huriet voit dans le premier élément une cause majeure de simplification du dispositif, par rapport aux divers projets reposant sur un fonds d'indemnisation, estimant qu'il éviterait les lenteurs d'une procédure reposant sur l'intervention d'un fonds ou d'une commission de réparation. Comme la caractérisation de l'aléa dépend des rapports d'expertise et que des critiques sont souvent formulées en ce domaine, la création d'un collège chargé de sélectionner les experts en responsabilité, par leur inscription sur une liste nationale, viserait à garantir l'objectivité de cette désignation. Dans cet organisme, une représentation différenciée notamment par la participation de magistrats et d'associations de malades, devrait permettre d'éviter une trop grande proximité avec les spécialistes concernés. En outre, un second mécanisme est introduit avec la création d'une commission régionale ou interrégionale de conciliation, afin de favoriser le règlement amiable des litiges et donc les transactions entre usagers, professionnels et établissements de soin, mais uniquement dans le cas d'actes fautifs. Dans le même esprit, une disposition rend obligatoire l'assurance professionnelle pour les médecins, les sages femmes et les établissements de santé.
Cette proposition a rencontré des critiques émanant du ministre chargé de la santé qui peuvent aider à dégager quelques uns des traits du projet gouvernemental.
2. Les critiques ministérielles et l'empreinte d'un projet à venir
Bien que M. Kouchner n'ait pas dévoilé, à l'occasion de ce débat, le contenu de l'avant-projet, tel qu'accepté par le Premier ministre, quelques précisions apportées permettent d'apercevoir quelques uns des traits saillants. Alors que M. Huriet ne traite pas, volontairement, des risques sériels, surtout dans le cas de contamination par l'hépatite C, le ministre le lui reproche et en fait un des apports du texte gouvernemental 2 ( * ) .
En outre, la dimension juridictionnelle de la proposition est vivement critiquée, pour en venir à une solution plus classique reposant sur un fonds d'indemnisation 3 ( * ) , lequel devrait prendre en charge à côté de l'indemnisation de l'aléa, les frais d'expertise et, apparemment, certains aspects de la responsabilité du fait des produits. Également, revient l'idée d'une alimentation diversifiée du fonds d'indemnisation, avec notamment une participation des assureurs, en complément de l'apport assuré par l'assurance maladie. Devraient également être précisés les seuils de déclenchement de la réparation par le fonds.
Toutefois, un propos reste d'une compréhension plus incertaine, s'agissant de l'évocation du rôle attribué à une commission. En effet, un dispositif semblable avait déjà été imaginé dans la proposition Evin de 1998, qui lui faisait déjà jouer un rôle d'assistance et d'aiguillage des demandes, soit vers un fonds, pour un acte non fautif, soit vers le juge dans l'autre cas. Or, M. Kouchner évoque "un dispositif national et régional", qui pourrait annoncer une organisation consultative à deux niveaux.
Contrairement à certains auteurs, nous ne pensons donc pas que l'effort déployé par les juridictions pour prendre en compte l'équité dans le traitement de problèmes humains difficiles soit une source d'incohérence juridique, au delà du problème structurel du dualisme juridictionnel et, élément non négligeable, de la divergence des solutions concernant la réparation de l'aléa médical. Néanmoins, la perception par l'environnement social rend nécessaire une simplification des mécanismes que seul un texte législatif est à même d'apporter, résolvant du même coup le problème de l'harmonisation des solutions quant à la réparation de cet aléa médical. C'est dire l'intérêt qui va s'attacher à la présentation du prochain projet de loi devant intervenir en ce domaine.
Éthique et esthétique
par Madame Jacqueline MORAND-DEVILLER ,
professeur à l'Université Paris 1
Sujet ambitieux, sujet défi - sinon provocateur dans une rencontre de juristes consacrée à la responsabilité. Non-sujet pourrait-on dire car non-droit dans la mesure où la notion de faute et de préjudice esthétique n'ont pour l'instant guère reçu de réponses ne suscitant d'ailleurs que peu de questions.
Mais l'ambition appelle la modestie, le défi survient pour être relevé, l'insuffisance du questionnement oblige à son affermissement et l'indécision des réponses ne peut que stimuler la recherche et le débat.
Seront donc présentés ici de libres propos, modestes variations sur des concepts où se sont exercés les plus beaux esprits. Et l'on osera enfermer ces notions sublimes et vagabondes, comme les "semelles de vent" d'un Rimbaud, en obéissant à une construction binaire traditionnelle - esthétique du "construit" face à un donné insaisissable - qui pourrait ordonner la réflexion autour de deux postulats :
- L'esthétique au service de l'éthique les sources de la légalité
- L'éthique au service de l'esthétique les fondements de la responsabilité
I - L'ESTHÉTIQUE AU SERVICE DE L'ÉTHIQUE :
L'ENRICHISSEMENT DES SOURCES DE LA LÉGALITÉ
Parce que la finalité esthétique, en sa fonction socialisée, a pris une place de plus en plus importante dans les aspirations contemporaines, elle donne une dimension nouvelle aux préoccupations éthiques et au droit qui les consacre. Une question sera liminairement évoquée, celle des relations entre éthique et esthétique.
1. Éthique et esthétique
" Pulchrum in ordine " : le Beau est beau en soi. La Beauté est souveraine en son royaume, elle n'est belle qu'en son miroir, vérité enseignée à la Sorbonne par les philosophes dès le XIIIème siècle et épousée par un des maîtres du droit privé : Gérard Cornu pour qui la Beauté " n'a nul besoin du droit, ni de la morale, ni de la religion : elle s'en moque 1 ( * ) ".
Le même jugement pourrait être appliqué à l'éthique, son ordre ne dépend pas de l'esthétique, il n'a pas besoin d'elle, il a son propre système de valeurs.
Mais une fois rappelé cette indépendance des disciplines, propre à stimuler leur créativité, force est de reconnaître les analogies et les liens.
L'union du Beau et du juste est célébrée depuis les origines de l'homme-pensant et bien audacieux celui qui pourrait dire quelle question fut posée la première : celle de la sensibilité au Beau ou celle du sentiment de la justice.
Est-il besoin de citer Platon cherchant à unir beauté et excellence morale pour bâtir une Cité idéale où les philosophes et les citoyens - c'est à dire une aristocratie - gouverneraient à partir d'Idées, perçues d'instinct par les sens comme susceptibles de faire régner la justice. Aristote perpétuera cette démarche en mettant la morale et l'esthétique au service de la politique afin de réconcilier les tensions à l'intérieur de l'homme et des sociétés.
L'union sera peut-être moins sacrée mais plus opérationnelle lorsque l'éthique remplacera la morale, par une sorte de "pudeur" au regard du caractère archaïque et de la mauvaise réputation de la morale, selon le propos malicieux de G. Vedel, ironisant : "Tout comme les concierges sont devenues gardiennes, la morale est devenue éthique" 1 ( * )
L'esthétique, quant à elle, s'était distinguée de la Beauté et s'était érigée en discipline autonome qui ne prétendait plus être une théorie du Beau mais une science de la sensibilité. Comme on insistait, par ailleurs, sur le plaisir désintéressé poursuivi par l'esthétique, le champ d'application de la discipline pouvait s'élargir en dépassant les seules oeuvres de l'art dues au talent des hommes pour s'appliquer aussi aux beautés naturelles.
La promotion du droit positif par rapport au droit naturel encourage l'émancipation du juste par rapport à la morale, de l'esthétique par rapport au Beau et leur appréhension par le droit, lequel ne répugne pas à poursuivre de nobles idéaux, à condition cependant qu'ils ne soient pas indicibles. La règle de droit, même coutumière, même implicite, doit garder les pieds sur terre et n'est pas à l'aise dans le surréaliste ou le surnaturel.
L'éthique s'est glissée avec aisance dans les règles et les comportements juridiques, lesquels ont tout à gagner à cette sublimation irradiant leur austérité et leur technicité. Mais à trop vouloir éviter l'orgueilleuse morale on n'a cessé de multiplier à la fois les éthiques, flanquées des étiquettes les plus diverses : éthique médicale, bioéthique, éthique de l'entreprise des affaires... et les Comités de sages ou prétendus tels, au risque que cette " valse des éthiques " 2 ( * ) ne galvaude et ne compromette les fins premières. L'éthique serait devenue un "produit", "un investissement", "un paravent pour dissimuler une morale dont on a peur"Jugements excessifs mais qui ont le mérite d'introduire un débat.
L'arrivée de l'esthétique dans les sciences juridiques fut beaucoup plus discrète. Le droit ne la rechercha pas, la considérant plutôt avec méfiance sinon suspicion. La méfiance appelle la méfiance et l'esthétique s'est habituée à rester sur ses gardes et à se méfier... non pas du droit mais des juristes. Car même dissociée du Beau indicible, même humble en ce qu'elle se refuse à revendiquer des critères de reconnaissance, elle doit - à la différence de l'éthique - se préserver vigilamment des pièges sournois où l'on veut l'attirer en l'accusant d'être rebelle à tout discours logique rationnel, puisque fondée sur la perception sensible et conduite à verser irrésistiblement dans la subjectivité.
2. Objectivité et universalité
L'esthétique ne manque pas de moyens pour éviter les chausses-trappes où on veut l'entraîner. Elle peut revendiquer la plus magistrale des démonstrations, à laquelle bien peu ont osé répliquer : celle de Kant, ramassée dans la célèbre formule " Est beau ce qui plait universellement et sans concept " 1 ( * ) .
Si le jugement de goût est subjectif, il est susceptible d'être partagé et de réfléchir, a priori, d'autres jugements identiques et désintéressés. Comme il y a un Bien commun, il y a un sens esthétique commun, lequel peut être mis au service du Bien commun. Philosophes et juristes ne chercheront ni à définir le Beau, ni à donner des critères de reconnaissance à l'esthétique - au risque de verser dans une esthétique officielle désastreuse. Ils tenteront de dégager ce sens commun esthétique, tel qu'il apparaît, d'emblée, avec ses particularismes dans chaque civilisation et chaque société.
L'illustration la plus éclatante de cette "neutralité" de l'esthétique - et aussi de l'éthique, est leur démocratisation. Elles sont devenues des aspirations largement sinon unanimement partagées. Paix des consciences (l'éthique), trouble délicieux des sens (l'esthétique), l'une et l'autre satisfont des besoins innés chez l'homme. Honneur des États (éthique), harmonie sociale (esthétique) l'une et l'autre répondent aux aspirations des sociétés. La Déclaration des droits de l'homme a fait une large place aux éthiques, elle n'a pas osé - on peut le regretter - accueillir le droit au bonheur, droit fondateur de l'esthétique.
Démocratisée, ces aspirations peuvent et doivent être saisies par le droit, outil apte à révéler leur existence. La méthode et les outils de recherche, on le sait, révèlent souvent l'objet : le microbe n'est devenu objet de science que lorsque le microscope a été inventé. Mais le microbe n'avait pas attendu Pasteur pour exister. L'esthétique n'a d'existence intellectuelle que grâce aux recherches des philosophes, elle n'a d'existence sociale que grâce aux observations des juristes et des politiques. Elle n'en a pas moins toujours existé.
Cette démocratisation de l'esthétique lui permet d'enrichir l'éthique. Perçue comme une aspiration vitale du plus grand nombre, elle inspire de plus en plus la règle de droit. Et les normes qu'elle suscite sont proches de normes éthiques, d'une part par des valeurs communes d'ordre et d'harmonie, d'autre part par leur caractère de normes incitatives plus qu'impératives : la morale commande, l'éthique recommande, la morale est un impératif catégorique, on agit par devoir - l'éthique est un impératif hypothétique, on agit par prudence. Paul Ricoeur a clairement systématisé cette distinction en proposant " de réserver le terme d'éthique à l'ordre du bien et celui de la morale à l'ordre de l'obligation " 1 ( * ) . Ces appréciations conviennent fort bien à l'esthétique qui elle aussi recommande plus que commande et en appelle plus à la prudence qu'à la contrainte.
L'entrée en force de l'esthétique dans le droit s'observe en analysant la place qu'elle occupe dans les textes : de plus en plus l'esthétique est "décrétée".
3. L'esthétique décrétée
N'en déplaise aux esprits chagrins et étroits qui osèrent jeter l'anathème en proclamant de manière téméraire que "l'esthétique ne se décrète pas", l'esthétique est bel et bien décrétée, comme le prouve la place qu'elle occupe sereinement dans de nombreux textes, intervenus en matière d'urbanisme et d'environnement, ses domaines de prédilection. Et il n'est qu'à se fier à ce jugement du Stagirite, tout aussi péremptoire et définitif que celui de Kant ; " Le Beau et le Juste sont d'interprétation si vaste et si susceptible d'erreur qu'ils ne paraissent avoir d'être que grâce à la loi et non par un effet de la nature " 2 ( * ) .
Le législateur français n'a pas été jusqu'à consacrer la Beauté en tant que telle, comme l'a fait son homologue italien qui, à plusieurs reprises, a adopté des textes sur les "beautés naturelles", " bellezze naturale " 3 ( * ) . La loi française est plus neutre, traitant des sites et des paysages, encore que... Il y a 3/4 de siècles, la loi dite Cornudet du 14 mars 1919, qui pour la première fois prévoyait une planification urbaine, envisageait des "projets d'aménagement, d 'embellissement et d'extension des villes", et l'on peut regretter que les nombreuses et bavardes lois d'urbanisme et d'aménagement ultérieures n'aient pas inscrit cette préoccupation à leur fronton.
À défaut d'une consécration solennelle, l'esthétique occupe une place de choix dans de nombreuses lois. Point effrayé par ce qui n'a rien d'audacieux après tout, le législateur fait souvent référence à l'esthétique soit expressément, soit implicitement.
L'esthétique est expressément présente dans la loi du 4 août 1962 sur les secteurs sauvegardés, les plans de sauvegarde et de mise en valeur étant réservés aux zones présentant "un caractère historique esthétique ", dans la loi du 7 janvier 1983 sur les ZPPAUP ( zones de protection de patrimoine architectural, urbain et paysager ) qui fait reposer les mesures de protection sur des " motifs esthétiques ou historiques ". On retrouve l'expression à l'article 7 de la loi montagne du 9 janvier 1985 lorsqu est évoquée la mise en valeur de certains sites "à des fins esthétiques", et à l'article R 123-18 du code de l'urbanisme lequel, lorsqu'il traite des zones naturelles des plans d'urbanisme, déclare qu'elles doivent être protégées "en raison de leur intérêt, notamment d'un point de vue esthétique". Cette présentation est loin d'être exhaustive.
Quant au nombre des dispositions législatives et réglementaires qui imposent son respect sans retenir expressément l'expression, il n'a cessé de croître.
On ne peut manquer de citer les bonnes vieilles lois sur les monuments historiques (lois de 1887 et surtout 1913), et sur les sites (1906 et surtout 1930), esthétique certes élitiste, singulière, tournée vers le passé mais qui a vite évolué vers une conception démocratisée du patrimoine, lequel est, ici et là, proclamé "commun". Le patrimoine architectural n'accueille plus seulement les chefs d'oeuvres et les monuments isolés mais le patrimoine dit "mineur" : lieux de mémoire, patrimoine rural, industriel... ce qui n'enlève rien à sa valeur. La protection juridique s'élargit aux "abords" des monuments (loi de 1943) et l'on parle aussi désormais du patrimoine urbain ou naturel, démocratisation du patrimoine qui, paradoxalement, pourrait affaiblir sa protection.
En effet, si la règle de droit peut rester générale quant aux finalités à poursuivre, elle doit rechercher la précision quant aux moyens de leur mise en oeuvre. La protection de l'esthétique n'a rien à gagner à une extension racoleuse du concept - la même observation s'applique à l'éthique. L'esthétique, par exemple, ne doit pas être confondue avec l'environnement et l'on comprend aisément que la loi "paysage" du 8 janvier 1993 n'envisage de ne protéger par des "directives" 1 ( * ) que les "territoires remarquables par leur intérêt paysager".
Les sources les plus efficaces de la légalité esthétique se trouvent dans plusieurs articles du Code de l'urbanisme imposant à celui qui sollicite un permis de construire de respecter certaines obligations. L'article considéré comme le plus esthétique du Code est sans doute l' article R 111-21, disposition introduite en 1976, période où l'environnement commence son irrésistible progression. Il demande à l'administration, lorsqu'elle instruit un permis de construire, de prendre en compte le " caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels et urbains ", recommandation qui ne saurait être assimilée à un voeu pieu : de fait, après une période de timidité, le juge administratif n'a pas hésité à annuler des permis pour non-respect de cet article et il ne s'agissait pas seulement de menus projets 2 ( * ) .
La fermeté du juge s'exprimera avec une égale conviction lorsqu'il s'agira d'interpréter certaines dispositions de la loi littoral du 8 janvier 1986 et de qualifier de "remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel" certains sites, ce qui interdit les constructions autres que les "aménagements légers". On mesure ici les conséquences et les enjeux - pour les aménageurs et les constructeurs - d'une légalité esthétique, même si elle est seulement incitative, encore que, nul ne l'ignore, l'exigence de "compatibilité", moins forte que celle de conformité, est aussi assortie de sanctions.
Cette promotion de l'esthétique par les textes et la jurisprudence, qui pourrait presque donner lieu à un " Code de déontologie esthétique " à l'usage des élus, des fonctionnaires, des aménageurs et des architectes, est devenue une des manifestations de l'éthique contemporaine. L'esthétique, comme source de la légalité n'en est plus à ses balbutiements. Différente est sa situation au regard de la responsabilité et c'est alors que l'éthique pourrait venir à son secours, incitant ceux qui ont le devoir de mettre en oeuvre la normativité esthétique à adopter un comportement plus déterminé sinon sévère au nom d'une éthique de l'esthétique, délicate, certes, à formaliser.
II - L'ÉTHIQUE AU SERVICE DE L'ESTHÉTIQUE : LES FONDEMENTS DE LA RESPONSABILITÉ
Existe-il une faute fondée sur le non respect de l'esthétique ? La responsabilité peut-elle être engagée sans faute ? Existe-t-il des sanctions et des réparations adaptées au préjudice esthétique ? Comment qualifier et évaluer ce préjudice ? Comment apporter la preuve des liens de causalité ? À ces questions délicates 1 ( * ) , il ne sera apporté que des éléments sommaires de réflexion.
On ne s'aventurera pas sur les chemins tortueux d'une éventuelle responsabilité pénale pour crime ou délit contre la beauté. Même si l'on sait que dans l'ancienne Chine la peine de mort était prévue pour l'architecte dont l'oeuvre était accusée de laideur, même si un récent livre s'intitule, de manière provocatrice : " Faut-il pendre les architectes ? " 2 ( * ) , ceux-ci sont fort heureusement préservés de la vindicte impériale ou populaire même si leurs constructions sont particulièrement disgracieuses. Il n'est pas question non plus d'entrer dans la querelle où certains se complaisent, qui les conduit à faire l'apologie de la laideur, laquelle aurait le mérite, en choquant, d'émoustiller aussi la sensibilité. Taine a sur ce sujet un jugement frappé du bon sens : " Sans doute le laid est beau, mais le beau est encore plus beau ".
On se limitera à des réflexions sur les fondements de la responsabilité : faute ou absence de faute et sur les caractères que présente la faute en ce domaine si singulier de l'esthétique.
1. Responsabilité sans faute
Référence peut être faite à deux régimes spécifiques. L'un est de la compétence du juge judiciaire : c'est celui des inconvénients anormaux de voisinage ; l'autre est de la compétence du juge administratif c'est celui des dommages permanents causés par des travaux ou un ouvrage public.
Les deux condition de spécialité (aisée à démontrer en raison de la notion de voisinage) et d' anormalité (difficilement admise) sont requises.
La principale difficulté est de définir les nuisances occasionnant ces troubles anormaux. Le juge, lorsqu'il a à apprécier les "nuisances visuelles", (désormais expressément visées dans le Code de l'environnement), préfère s'en tenir aux notions traditionnelles et plus réalistes de "privation de vue, d'ensoleillement ou de lumière sans aller jusqu'à invoquer un préjudice esthétique".
Une évolution se dessine cependant et on trouve ici et là des décisions où le juge accepte d'indemniser un trouble purement visuel, né de la seule présence d'un ouvrage. S'agissant, par exemple, d'une usine d'incinération des ordures ménagères, la nuisance, qui a causé la dépréciation de valeur d'une propriété, résulte du "volume et de l'aspect" de l'ouvrage 1 ( * ) , sans qu'il soit besoin d'invoquer d'autres nuisances, telles les fumées ou le bruit.... L'analyse de la jurisprudence judiciaire confirme cette tendance, qui reste d'application trop exceptionnelle.
L'indemnisation du préjudice esthétique a fait récemment de nouveaux progrès lorsque les grandes entreprises, chargées de construire les infrastructures, dites linéaires, destinées au transport des personnes, des marchandises ou de l'énergie, ont décidé, en s'achetant une conduite, de la prendre en charge. Ces réseaux sont de grands consommateurs d'espace (près de 2 % du territoire, estime-t-on) et après une période de tolérance sinon d'indifférence devant des installations pourtant fort agressives, les réformes sont enfin intervenues.
Le législateur a prévu diverses mesures destinées à protéger les paysages - et les propriétés privées - de la présence fâcheuse de ces installations dont l'agressivité est reconnue, puisque le remède a été trouvé dans leur dissimulation : le projet d'enfouissement des lignes électriques de moyenne tension. Par ailleurs, la responsabilité sans faute est implicitement reconnue et il n'est nul besoin de solliciter le juge pour une indemnisation : le Protocole conclu en 1992 entre l'État et EDF prévoit un système quasi automatique d'indemnisation pour la dépréciation des propriétés riveraines des lignes de haute tension 2 ( * ) . L'éthique est ainsi mise au service de l'esthétique puisque ce Protocole est qualifié de "Code de bonne conduite".
En dépit de ces avancées, la responsabilité sans faute devrait rester d'application exceptionnelle alors que la responsabilité pour faute pourrait se développer, dans la mesure où elle sera la suite logique d'une illégalité considérée comme fautive et que ces illégalités sont destinées à croître.
2. L'illégalité fautive
Le juge civil est conduit à traiter du préjudice esthétique dans deux domaines spécifiques : le droit d'auteur et la chirurgie esthétique . Dans ce dernier cas, le comportement fautif est trouvé dans le manquement du médecin à son devoir d'information , ici particulièrement étendu car le risque encouru ne doit pas être disproportionné par rapport aux avantages escomptés : amélioration, souvent douteuse, des traits du visage ou des lignes du corps.
Le juge administratif , quant à lui, fait souvent de l'esthétique sans le savoir -qu'on nous pardonne cette ironie respectueuse - c'est à dire qu'il se refuse à donner à l'esthétique une place de choix au sein de l'intérêt général mais que par des voies quelque peu détournées il sanctionne les outrages que les activités administratives lui font subir.
Il répugne encore à reconnaître l'existence d'un ordre public esthétique. Le débat est trop connu pour que l'on s'y attarde. L'esthétique peut faire l'objet de police spéciales, telle celle de l'affichage, mais elle n'est pas une composante de l'ordre public, objet de la police générale. Si, en 1927, le doyen Paul Duez se réjouissait d'un mouvement de jurisprudence, "récent et timide", tendant à faire pénétrer la protection de l'esthétique parmi les buts de police administrative, il devrait constater que 3/4 de siècle plus tard cet élan frileux a été frappé d'immobilisme.
Il n'est pas interdit de penser que les temps sont venus de faire évoluer la jurisprudence - au demeurant limitée : affaires de cimetières - hostile aux interventions esthétiques des maires dans l'exercice de leur pouvoir de police. Rien ne l'interdit puisque les trois piliers traditionnels de la police administrative ne sont pas énoncés de manière limitative (cf. "le notamment") et que le quatrième pilier : le "bon ordre" aurait tout à gagner à être aussi perçu comme un "bel ordre".
Le juge administratif est cependant irrésistiblement conduit à traiter des manquements à l'obligation esthétique lorsque, à la suite d'une annulation pour illégalité - laquelle est le plus souvent fautive - il est saisi d'une requête en responsabilité. Son appréciation du manquement à l'esthétique est déterminante et il ne peut échapper à ce jugement de valeurs puisque - raisonnement d'une désarmante simplicité - il a l'obligation de faire application de textes qui, comme il vient d'être dit, traitent de plus en plus de cette question.
Sa mission d'interprétation des textes sera particulièrement délicate car pour traiter d'une matière aussi souple, fluide et indéfinissable, la norme doit en emprunter les traits. Mais le juge administratif, qui est beaucoup plus que la "bouche de la loi", s'est habitué à qualifier juridiquement des faits au regard de critères aussi souples que l'" insertion harmonieuse dans l'environnement ", le caractère " remarquable " d'un site, la " rareté " d'un objet ou d'un paysage. Face à un pouvoir largement discrétionnaire de l'administration, il s'est doté de l'arme de l'erreur manifeste d'appréciation et, quand il dresse un bilan à l'occasion d'une déclaration d'utilité publique, la composante esthétique pèse parfois lourd dans la balance des intérêts à prendre en compte.
Ses jugements sont des jugements de bon sens, il recherche le raisonnable plus que le rationnel qui n'existe guère en ces domaines. S'agissant des jugements de goût, il s'adresse aux spécialistes.
Et il y aurait beaucoup à dire sur ces experts de l'esthétique architecturale que sont, en particulier, les architectes en chef des monuments historiques, corporation fermée, dont les membres peu nombreux ( une cinquantaine ), disposent d'un statut privilégié et d'un monopole - dont celui du goût - dans la réalisation des travaux effectués sur les monuments. Sans mettre en question leurs compétences et la nécessité de leur existence, il semble urgent de démocratiser leurs pouvoirs, renforcer leur nombre et leurs responsabilités.
De cette prise de position du juge sur la légalité d'un acte administratif au regard du respect des normes esthétiques dépend non seulement le sort de cet acte mais l'éventuelle reconnaissance de la responsabilité de l'administration. La faute sera trouvée dans l'illégalité commise, le lien entre l'illégalité et le préjudice est aisé à établir et l'évaluation de ce dernier peut donner lieu à de très fortes indemnités : le contentieux des ZAC est là pour le prouver. S'il ne s'agit pas d'un préjudice esthétique mais d'un préjudice économique, il s'agit bien d'une faute esthétique.
***
Il est temps pour finir de faire quelques propositions. Celle d'abord de voir l'esthétique, inséparable de la prudence à l'égard de toute définition a priori du Beau, devenir une composante à part entière de l'intérêt général, marquant ainsi l'indissoluble lien entre sens commun esthétique et Bien commun 1 ( * ) .
Celle aussi de voir s'affermir le lien entre le manquement au devoir d'esthétique et la responsabilité. On a dit la place occupée par le doute, l'incertitude et la prudence dans la recherche du sens commun esthétique. Doit-on aller jusqu'à introduire ici aussi le principe de précaution ? Ce serait sans doute prendre un trop grand risque.
Celle de voir les responsables politiques, plus et mieux inspirés par les préoccupations esthétiques... et éthiques naturellement. Il y va non seulement de la paix de leur conscience mais de leur intérêt, face à une revendication de plus en plus forte de leur électeurs : l'évidence selon laquelle l'écologie sert l'économie et selon laquelle le combat pour l'esthétique d'une ville ou d'un site sert à la réélection commence à s'imposer.
Quant aux choix esthétiques, ils se donneront comme méthode celle qui convient à la plupart des prises de décision politiques et administratives : transparence (bonne information des citoyens sur les projets mettant en cause leur cadre de vie), motivation (explication claire des réalisations projetées), concertation et débat. L'esthétique démocratisée repose sur un consensus majoritaire .
Si les éthiques contemporaines ont tant progressé, c'est parce qu'elles ont été traduites en "droits fondamentaux" dont la violation est juridiquement sanctionnée. Il faut alors souhaiter que l'esthétique puisse aussi être traduite en droits fondamentaux, tâche délicate s'il en est, exaltante aussi. L'éthique contemporaine vient ainsi au secours de l'esthétique contemporaine en imposant aux responsables des règles de bonne conduite. Se réfugier derrière le risque de subjectivité est céder à une certaine lâcheté et ne se conçoit que dans des systèmes repliés sur eux-mêmes, technocratiques sinon autoritaires.
Et que l'on nous permet, d'en appeler aux artistes et à leur naturelle démesure, pour conclure avec Flaubert emporté sans doute par une humeur d'exaspération à l'égard des convenances : " Est moral qui est Beau. Un point c'est tout. "
Monsieur Yves GAUDEMET
Merci beaucoup pour ce très bel exposé, son élégance, mais aussi pour votre engagement : présidente de l'Association française de droit de l'urbanisme, mais aussi la militante contre l'installation des forains aux Tuileries. C'est un combat que vous continuez. Au fond, j'ai cru comprendre que vous ne seriez pas hostile à ce que l'esthétique intégrât l'éthique.
Synthèse générale
Monsieur Jean-Claude HELIN * ( * )
Mesdames, Messieurs, il faut féliciter les courageux qui restent un samedi après-midi écouter un débat et dire que l'exercice - mais je crois que chacun d'entre nous en était convaincu - est particulièrement difficile. Et doublement, parce que l'on a l'impression que compte tenu de la richesse des débats, que tout a été dit déjà et qu'il est difficile de rajouter des choses originales, et puis il est également difficile parce que le temps qui nous est imparti doit respecter deux choses : à la fois l'intérêt soutenu que nous devons au public qui reste et dans le même temps la possibilité pour le rapporteur de synthèse de faire son rapport.
Je ne sais pas si je dois remercier - et je le ferai sous bénéfice d'inventaire -Gilles DARCY, sauf d'une chose, la qualité des personnalités dont il m'a entouré pour parler aujourd'hui de ce thème qui a été défini comme nouveaux champs, nouvelles interrogations sur le droit de la responsabilité, et de le faire en permettant d'avoir comme intervenants des personnalités issues des milieux juridictionnels, de l'université, mais avec des champs disciplinaires différents. Je serai gré à Madame LATOURNERIE d'avoir accepté, au nom du Conseil d'État, de dire au fond son expérience de magistrat sur ce point ; à Florence BELLIVIER d'exprimer un point de vue de juriste de droit privé sur ces questions, et de dire quelles sont les interrogations qu'en droit privé également on se pose sur l'évolution du droit de la responsabilité. Car ce qui me paraît caractériser aujourd'hui l'intérêt de nos réflexions c'est qu'un peu partout, et en tout cas en droit interne, aussi bien en droit public qu'en droit privé, il y a de multiples questions posées au droit de la responsabilité. Et puis d'avoir un point de vue de politiste, celui qu'exprimera Hélène THOMAS, et celui d'une de nos collègues de droit public que tout le monde connaît et dont on apprécie les travaux, c'est Danièle LOCHAK.
Madame Danièle LOCHAK
Responsabilité, assurance, solidarité : quelles articulations ?
Je voudrais tenter de montrer comment ces trois notions : "responsabilité", "assurance", "solidarité", s'articulent entre elles. Dans un premier temps, je rappellerai en quoi elles se distinguent les unes des autres et comment on peut caractériser, sur la base de ces trois notions, trois grands "paradigmes", trois modèles idéal-typiques de mise en jeu de la responsabilité (entendue ici au sens large 1 ( * ) ).
Dans un second temps, je m'attacherai à montrer qu'entre ces modèles les frontières ne sont pas étanches, que l'on passe imperceptiblement de l'un à l'autre, et qu'en pratique les systèmes d'indemnisation empruntent souvent à plusieurs modèles à la fois.
Le tableau reproduit ci-après s'efforce de rendre compte de ces distinctions, de ces oppositions, de ces passages.
|
RESPONSABILITÉ |
ASSURANCE |
SOLIDARITÉ |
|||
|
Niveau politique Principe de régulation sociale = Fonction |
Punition [des auteurs] + dissuader des causer des dommages |
Indemnisation [des victimes] = garantir la sécurité |
Redistribution |
||
|
Niveau philosophique Principe D'imputabilité = Fondement |
Faute----> |
S'assurer contre les fautes = Converties en risques |
----> Risque ----> |
Mutualisation des risques |
--> Équité, égalité |
|
Niveau technique Procédures Juridiques = Mécanismes |
auteur fautif _ victime |
auteur _ assurer _ cotisation _ assureur _ victime |
Obligation de s'assurer |
Collectivité auteurs # victimes |
|
1. Trois idéal-types
Le mot "responsabilité" désigne au moins "trois niveaux de réalité", note avec justesse François Ewald, qui rappelle que les mécanismes de mise en jeu de la responsabilité ne relèvent pas de la simple technique juridique, mais qu'ils reflètent aussi une certaine conception du lien social, une certaine façon de penser et d'organiser les rapports sociaux. Il distingue le niveau politique, où la responsabilité désigne un principe général de régulation sociale, un niveau juridique ou technique, où le mot désigne l'ensemble des procédures qui organisent les actions en dommages et intérêts, un niveau philosophique enfin, où l'objectif est d'expliquer pourquoi un acte, un événement ou un dommage est imputable à quelqu'un 1 ( * ) .
Cette grille d'analyse, que nous reprenons en l'adaptant un peu, nous paraît féconde en ce qu'elle permet de repérer un certain nombre d'oppositions pertinentes. Elle conduit non seulement à élargir la réflexion sur la responsabilité au-delà des questions de technique juridique, mais aussi à distinguer, comme l'avait suggéré l'un des premiers Charles Eisenmann 2 ( * ), la question des fonctions de la responsabilité de celle de ses fondements.
· Soit d'abord le
niveau politique,
où, nous dit Ewald, la responsabilité désigne un principe général de régulation sociale. La question qu'il faut se poser est ici celle
des fins,
des objectifs poursuivis par le législateur ou le juge lorsqu'il impose une obligation de réparer. Il s'agit, en d'autres termes, de saisir les
fonctions
de la responsabilité.
Ces fonctions ou ces fins sont de trois ordres : 1. punir les auteurs des dommages, et le cas échéant les dissuader d'en commettre d'autres ; soulager les victimes en les indemnisant et donner aux victimes potentielles de dommages l'assurance que ceux-ci, s'ils surviennent, seront réparés ; rétablir l'égalité au sein de la collectivité en instaurant une solidarité entre ceux qui ont été victimes d'un dommage et les autres.
· Soit, en second lieu, le
niveau philosophique
qui conduit à poser la question "au nom de quoi ?", ou encore : qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui commande de réparer tel dommage ? C'est la question du
fondement
de la réparation.
Ce fondement peut être : 1. la faute commise ; 2. le risque (celui qu'on fait courir par son activité) ; 3. l'équité (ou encore le sentiment qu'il serait anormal de laisser la victime supporter seule un dommage).
· Soit enfin le
niveau juridique ou technique :
il s'agit ici des différents
mécanismes ou procédures par lesquels il est possible d'obtenir des dommages-
intérêts. Très concrètement, les questions seront du type : qui paie et à qui ?
Plusieurs scénarios sont possibles : 1. l'auteur du fait dommageable indemnise lui-même et directement la victime ; 2. l'assureur à qui l'auteur du dommage a versé des cotisations, paie des dommages et intérêts à la victime ; 3. la collectivité répare le dommage aux lieu et place de son auteur - si tant est que le dommage soit imputable à un auteur et que cet auteur soit individualisable.
On peut, sur la base de ces différents éléments, distinguer trois idéal-types ou encore trois "paradigmes" selon lesquels s'organise la mise en jeu de la responsabilité -- au sens large où on l'a défini plus haut (le mot "responsabilité" étant utilisé alternativement soit dans cette acception large, soit dans une acception plus étroite pour désigner l'un des modèles ou paradigmes par opposition aux deux autres). Ce terme de "paradigme" est emprunté lui aussi à François Ewald, qui l'utilise pour opposer trait pour trait le paradigme de la responsabilité classique, fondé sur la faute, au paradigme de la solidarité, caractéristique de la société "assurancielle" et de l'État providence, fondé sur le risque 1 ( * ) .
Tout les oppose, dit-il : -- la conception du dommage, rapporté à une donnée subjective, la faute, dans le premier cas, objectivé comme accident et appréhendé comme risque dans l'autre ; -- le but premier, qui est de punir le coupable dans un cas, d'indemniser la victime, dans l'autre ; -- la répartition de la charge pécuniaire, appréhendée en termes moraux d'un côté, en termes économiques de l'autre ; -- l'accent mis respectivement sur la cause ou sur les conséquences du dommage, enfin.
On peut reprendre et affiner ces oppositions en distinguant le paradigme de l'assurance du paradigme de la solidarité. On a ainsi d'abord le paradigme classique de la responsabilité, fondé sur la faute, dont la fonction principale est de punir et dissuader, et qui met face à face, dans le mécanisme de réparation, l'auteur du dommage et sa victime. Le paradigme assuranciel, lui, est fondé sur le risque, sa fonction première est d'indemniser les victimes, et dans le mécanisme de réparation l'assureur apparaît comme un intermédiaire entre l'auteur et la victime du dommage. Enfin, le paradigme de la solidarité, fondé sur l'équité, poursuit le rétablissement de l'égalité par un mécanisme de redistribution aménagé et géré par les représentants de la collectivité excluant toute interaction entre les auteurs du dommage - à supposer même qu'ils soient déterminables - et les victimes de ce dommage.
Mais ces trois idéal-types ne se retrouvent pas toujours de façon aussi pure et aussi tranchée dans la réalité : il y a des passerelles, des hybridations, les systèmes d'indemnisation empruntent parfois simultanément à l'un et à l'autre.
2. Passerelles et hybridations
La frontière qui reste à priori la plus étanche est celle qui sépare le modèle classique de la responsabilité des deux autres, entre lesquels la frontière est à l'inverse beaucoup plus floue. Ce qui les différencie foncièrement du premier, c'est la dissociation qu'ils instaurent entre responsabilité et culpabilité : pour reprendre une formule désormais célèbre, le passage du paradigme de la responsabilité au paradigme assuranciel implique qu'on peut désormais être responsable sans être coupable. Ce sont ces
a) Responsabilité et assurance : la faute convertie en risque
Pour autant, on ne saurait opposer sans nuance les deux modèles d'engagement de la responsabilité fondés l'un sur la faute, l'autre sur le risque, et cela pour deux raisons au moins.
La première raison, la plus évidente, est d'ordre pratique : car c'est bien le développement de l'assurance qui a rendu possible le développement spectaculaire de la responsabilité civile -- par le biais, surtout, de la responsabilité du fait des choses et de la responsabilité du fait d'autrui, certes, mais il s'agit bien encore de responsabilité pour faute ; et réciproquement le développement de la responsabilité civile a stimulé le développement de l'assurance. Le développement du mécanisme de l'assurance est donc la fois cause et effet du développement de la responsabilité civile ; l'une se nourrit de l'autre, comme le montre Yvonne Flour 1 ( * ) , puisque le besoin toujours croissant de réparation eût été d'un poids insupportable sans la soupape de l'assurance, tandis que celle-ci dénature la responsabilité civile et en favorise l'expansion puisque, quelle que soit la gravité de ses fautes, le responsable assuré ne supporte pas les conséquences pécuniaires du dommage.
Constater cela, c'est précisément énoncer la seconde raison qui interdit de tracer une frontière étanche entre les deux systèmes d'indemnisation : on passe en effet imperceptiblement de l'un à l'autre lorsque l'auteur potentiel de dommages s'assure contre ses propres fautes ou celles de ses préposés -- ce qui revient à convertir les fautes... en risques.
Et ceci contribue à inverser le processus classique de détermination de la responsabilité, la responsabilité devenant, selon la formule de François Ewald, "une fonction de l'indemnisation" : autrement dit, l'objectif étant d'indemniser la victime, on imagine à partir de cet objectif, par une démarche téléologique, des régimes d'imputation adéquats, sans quitter nécessairement le terrain de la responsabilité pour faute, mais en développant par exemple des systèmes de présomption de faute qui tiennent compte de l'existence des mécanismes d'assurance.
b) Assurance et solidarité : de la mutualisation à la socialisation de risques
L'opposition entre les mécanismes d'assurance et les mécanismes de solidarité est également des plus classiques : elle dépasse du reste le cadre de la réflexion sur la responsabilité. Ainsi, dans le domaine de la protection sociale, il est courant d'opposer la sécurité sociale, fondée sur l'assurance, à l'aide sociale, fondée sur la solidarité, ou encore les prestations contributives, qui, étant la contrepartie de cotisations, relèveraient donc de l'assurance, aux prestations non contributives, financées par l'impôt, qui relèveraient de la solidarité.
Cette opposition fondée sur la provenance des ressources est aujourd'hui remise en cause par le fait qu'une part croissante des prestations de sécurité sociale ne sont plus assises sur des cotisations mais financées par l'impôt (la CSG notamment), de sorte que la question du financement par l'impôt ou les cotisations sociales n'est plus un critère de distinction véritablement pertinent.
Plus généralement, tous ceux qui se sont intéressés à l'émergence de l'État providence et au traitement de la "question sociale" -- Jacques Donzelot 1 ( * ) , Pierre Rosanvallon 2 ( * ) , François Ewald 3 ( * ) ... -- ont bien montré qu'on ne pouvait pas opposer assurance et solidarité dès lors que l'assurance a été l'instrument de la solidarité : la technique assurancielle a servi à réaliser l'objectif de solidarité, elle a servi de "main invisible" de la solidarité, surtout à partir du moment où l'assurance est devenue obligatoire.
L'État providence, rappelle Rosanvallon, s'est historiquement développé sur la base d'un système assuranciel dans lequel les garanties sociales ont été liées à la mise en place d'assurances obligatoires couvrant les principaux "risques" de l'existence (la maladie, le chômage, la retraite, l'invalidité...). L'État providence peut ainsi être défini comme l'assureur universel, à travers lequel s'opère la mutualisation des risques ; et cette mutualisation des risques est porteuse de solidarité puisque, en déplaçant la charge des accidents sur la société, elle assure un nouvel équilibre entre riches et pauvres, producteurs et consommateurs, malades et bien portants...
Les prestations compensent la survenance des risques lorsque ceux-ci se concrétisent : elles garantissent la sécurité (fonction première du paradigme assuranciel) en même temps qu'elles remplissent une fonction de redistribution (fonction première du paradigme de la solidarité). L'obligation de s'assurer efface la frontière et opère le passage entre l'assurance, définie comme la mutualisation des risques, et la solidarité, qui implique et repose sur la "socialisation des risques".
***
De plus en plus nombreux sont aujourd'hui les dispositifs mis en place au nom de la solidarité nationale, reflétant une demande croissante de socialisation des risques. L'analyse de ces dispositifs législatifs existants fait apparaître la difficulté d'opter clairement, sur le plan technique, pour un système fondé soit sur la responsabilité, soit sur l'assurance, soit sur la solidarité, de sorte qu'ils constituent pour la plupart des systèmes hybrides.
Les raisons de ces hésitations ne sont pas seulement techniques. Le regard porté sur l'évolution de la responsabilité publique depuis un siècle pourrait faire pronostiquer une extension toujours croissante du dispositif de solidarité : le seuil d'acceptation du "mauvais sort", le seuil de tolérance aux inégalités devant la maladie, l'accident, la mort se sont abaissés au point qu'on conçoit de moins en moins qu'un dommage reste sans réparation, alors même que la "responsabilité" ne peut en être imputée à quiconque. Mais, en sens inverse, on constate le souci croissant de "responsabiliser" les acteurs sociaux, qui implique de les sanctionner le cas échéant. Ce souci rencontre le besoin des victimes, lorsque les dommages subis atteignent un certain seuil de gravité, d'obtenir la désignation et la punition des responsables sans se contenter d'une indemnisation : il est impossible de comprendre le déroulement de l'affaire du sang contaminé sans intégrer cette variable psychologique et passionnelle.
On touche ici du doigt toute l'ambivalence du droit de la responsabilité publique dont on veut faire l'instrument de deux principes de justice bien différents, sinon antinomiques : la justice commutative sur laquelle se règle le système de la réparation ; la justice distributive dont s'inspire l'idée de solidarité.
Monsieur Jean-Claude HELIN
Merci, chère collègue, pour toutes ces précisions. Nous avons promis au professeur MOREAU de lui laisser le temps nécessaire pour son rapport de synthèse. Je voudrais tout simplement profiter des deux ou trois minutes qui restent pour user et abuser d'un privilège qui est celui d'un animateur de table ronde. Il y a quelques questions qui ont été posées pour lesquelles je n'ai évidemment pas de réponses, mais on a abordé très souvent dans les débats depuis deux jours la question de l'équité. L'équité a toujours été envisagée du côté de la victime, mais est-ce que l'équité n'a qu'un sens ? Est-ce que c'est vraiment un progrès d'indemniser systématiquement les victimes ? Est-ce que l'équité, par exemple lorsqu'il s'agit de faire contribuer la collectivité, c'est à dire le contribuable, et notamment je pense au contribuable local, avec toute la jurisprudence sur la collaboration occasionnelle du service public, ne pose pas un certain nombre de questions et notamment, est-ce que nous n'avons pas une obligation, nous, de réfléchir à la question de l'équité ?
Par ailleurs, je me dis que dans tous les systèmes, et on l'a entendu depuis deux jours, dés le XIX ème siècle, on a fait fonctionner le droit de la responsabilité sur trois piliers : la faute, le préjudice, le lien de causalité. Mais aujourd'hui on est en train de solliciter chacun de ces éléments de telle façon que finalement, la conception même du droit de la responsabilité viendrait à en être modifiée. Alors est-ce qu'on peut faire produire au mécanisme de la responsabilité plus qu'il ne doit produire et est-ce qu'il faut dire, là ça relève de la responsabilité, là d'autres mécanismes qui sont les mécanismes de solidarité sociale. Cependant, à ce moment là, il faut résonner différemment, probablement en tout cas il faut résonner différemment : qui doit décider ? Est-ce que c'est au juge, tout seul dans son coin en sollicitant chacun des éléments, de dire : il y a un impératif d'indemnisation à satisfaire ? Je suis enfin frappé par le fait que du côté des politiques, comme du côté des juges, il y a une question, apparemment, et je crois que c'est un fait : il y a une demande d'indemnisation, tout préjudice doit être indemnisé de façon très forte, le professeur DUBOUIS l'a rappelé tout à l'heure. Toutefois, faut-il y résister ? Nous avions une vielle tradition en droit administratif qui consistait à dire : après tout il y a des sujétions qui sont à poser au nom de la vie en collectivité et ces suggestions nous imposent un certain nombre de contraintes. Au-delà d'un certain seuil, il y aura indemnisation, au-dessous, il n'y aura pas indemnisation. Et je me dis, après tout, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à cette situation dans laquelle la sollicitation de droit de la responsabilité est telle que, finalement, on fait prévaloir une logique d'indemnisation en faisant perdre au fond toutes ces caractéristiques au droit de la responsabilité. Au point que, quand je dois enseigner le droit de la responsabilité même à des étudiants de deuxième année, je ressens aujourd'hui beaucoup de malaise sur ce point. Alors, sur des questions qui n'apportent sans doute pas de réponses immédiates ou qui mériterait sans doute des interrogations, ou un nouveau colloque, mais je suis très frappé de voir que, aussi bien en droit privé où la responsabilité est plus fondamentalement, on va dire, personnelle, qu'en droit public où elle est fondamentalement institutionnelle, où elle a basculé dans l'institutionnel, et bien, on a les mêmes interrogations. Mais en revanche, on parvient souvent au même résultat par des voies différentes. Alors pourquoi ? Et ça je n'ai pas de réponses. Permettez moi de m'excuser d'avoir finalement abusé du temps que je m'étais accordé mais surtout pour laisser maintenant la parole à celui que nous attendons tous, le professeur Jacques MOREAU pour son rapport de synthèse. Merci d'avoir écouté l'ensemble de cette table ronde.
Rapport de synthèse de Jacques MOREAU
Mes chers amis, je dois faire ce rapport de synthèse. Je le dois, je dois cette obligation, à l'amitié de Gilles DARCY qui, par une sorte de cadeau empoisonné comme il sait en faire, m'avait demandé de faire un rapport de synthèse. Mais je ne savais pas que, d'abord, la table ronde porterait sur des thèmes inconnus et je ne savais pas qu'un certain nombre de modifications serait opéré dans le déroulement des communications. Je ne savais surtout pas le contenu de chacune de ces communications, puisqu'il n'y a pas eu dépôt à l'organisateur du colloque même d'un plan, même d'un résumé. Autrement dit, j'ai à faire un rapport de synthèse de manière un petit peu délicate puisque je devais y penser avant de connaître véritablement son contenu. Et voilà pourquoi, plutôt que d'essayer de résumer une vingtaine de communications en à peu près une demi-heure, ce qui serait vraiment totalement impossible, je vais plutôt vous proposer de prendre le plan du déroulement du colloque et puis éventuellement le critiquer, comme je vais le faire en vous proposant une sorte de visite guidée - puisque nous sommes ici dans un monument historique, me semble-t-il.
Une visite guidée un petit peu spéciale, un petit peu particulière quand même puisque je ne citerai aucun nom propre, c'est à dire que nous allons passer d'un couloir à un autre, d'une salle à une autre, sans du tout préciser quelque détail concret que ce soit. C'est donc quelque chose qui ressemblerait peut être à un film de Godard auquel je vous demande de participer.
Alors l'apparence extérieure ultra classique, deux parties, deux autres parties, rien à redire semble t-il, ce sont les 4 demi-journées de notre colloque avec comme thème central - c'est évident - la responsabilité, mais avec tout de suite un obstacle sur lequel vous avez buté comme moi : le mot encadrement n'a aucun sens. Et il est tout à fait évident, qu'avant de rentrer ici, hier matin, vous ne saviez pas plus que moi quel allait être le contenu des cinq premiers exposés qui portaient sur ou qui avaient comme sous-titres l'encadrement de la responsabilité. Alors ici, heureusement, l'un des premiers orateurs nous a dits : encadrement c'est finalement un terme, non pas esthétique, mais artistique. On encadre une gravure, on encadre un tableau et il nous a proposés - j'accepte tout à fait cette proposition - d'estimer que l'encadrement du droit de la responsabilité pouvait être considérer comme étude des sources du droit de la responsabilité. Et en effet, vous verrez à nouveau le dépliant, matière par matière : droit international, droit européen, droit communautaire, droit administratif, droit constitutionnel. Tout n'y est pas passé, parce que les organisateurs du colloque ont complètement oublié le droit financier, mais enfin, je passe rapidement.
On s'est demandé quelles étaient les sources de chacun des chapitres du droit public de la responsabilité. Très vite ce beau projet a été abandonné et on en est passé - on n'est pas resté à l'examen des sources - à l'étude du régime de la responsabilité, quelques fois sous des angles relativement précis. Rappelez-vous des discussions sur droit commun-subsidiarité, ça j'arrive à le prononcer -subsidiarisation c'est beaucoup plus difficile - ou bien le débat classique sur dommage et préjudice. Ici, il ne s'agit plus du tout d'encadrement, il ne s'agit plus du tout de source du droit de la responsabilité. Et on nous a fait porter le chapeau en disant que c'était la diversité des sources de la responsabilité qui expliquait que l'on glisse finalement des sources à l'étude du régime.
Jusqu'alors, on marche sur un sol à peu près solide, mais nous sommes arrivés ce matin devant un certain nombre sinon d'impasses du moins de questions sans réponses, qui étaient les fameux dilemmes traduits comme alternatives du droit de la responsabilité.
Alors, je ne reprendrai pas le contenu de chacun de ces éléments, mais vous voyez que dans ce massif - je n'allais pas dire désordonné, mais luxuriant - qui a été celui des communications depuis deux jours, une première grande allée ; je la traduirai sous la forme d'un axe vertical, descendant : on va des sources au régime et au dilemme, c'est dire peut être aux apories du droit de la responsabilité.
C'est là je crois un premier chemin, c'est là une première avenue. Mais aujourd'hui et cet après-midi avait été prévu par les organisateurs du colloque ce que l'on pourrait appeler un dégagement, disons un axe - que j'appellerai cette fois oblique, un axe ascendant, un axe oblique et ascendant, c'est possible - qui consiste à partir des règles, que nous avions étudiées et qui nous avaient été présentées dans les différentes communications, pour parvenir à une interrogation qu'on pourrait appeler axiologique, une interrogation sur les valeurs.
Ici, une fois encore, les organisateurs du colloque ont un peu réduit l'intérêt des thèmes qu'il suggérait puisqu'il n'y avait comme valeur que l'éthique et en fait, une démonstration nous en a été faite brillamment tout à l'heure, il n'y a pas que l'éthique. Il y a l'éthique et certainement l'esthétique et peut être encore d'autres valeurs, l'évocation du terme solidarité est apparue à la fin de la table ronde heureusement.
Donc, vous le voyez, après avoir examiné les problèmes de droit positif, les organisateurs du colloque, sans inviter de sociologues, sans inviter de véritables philosophes - sauf s'il en existe dans les facultés de droit, ce dont je doute - ce sont quand même interrogés sur une dimension quasi philosophique du droit de la responsabilité. C'est bien ainsi, ils ne pouvaient pas échapper à cette obligation parce que s'il existe un chapitre du droit où les rapports entre le droit et la morale sont particulièrement forts, particulièrement intenses, c'est évidement la responsabilité. Rappelez-vous l'étymologie du terme, cela pose nécessairement un problème de valeur : est-ce que c'est l'individu ? Est-ce que c'est la collectivité ? Est-ce que c'est le groupe qui va répondre ? Et répondre de quoi ? Et répondre en face des conditions de la responsabilité qui avait été évoqué précédemment... ? L'examen de ce genre de problème - la responsabilité et les valeurs, la responsabilité et l'éthique - d'une importance si considérable qu'il n'est pas besoin de les souligner, a, vous en avez été frappé comme moi, été en quelque sorte centré de manière quasi naturelle sur les problèmes de santé, sur les problèmes hospitaliers, sur le problème du corps humain. Comme si ce chapitre particulier du droit de la responsabilité, ce chapitre, on l'appellera responsabilité hospitalière ou responsabilité médicale, peu importe (que l'on pourra étendre d'ailleurs à la responsabilité face au corps humain dans son ensemble), est en quelque sorte aujourd'hui même, car mon propos n'aurait pas pu être tenu il y a dix ans, encore moins il y a vingt ans, le révélateur des dilemmes que nous avions vu auparavant. Et aussi de cette interrogation morale, de cette interrogation axiologique, dont je suis en train de vous parler.
Ainsi, nécessairement, comme complément de cette première revue (source, diversification des sources, complexification des régimes, dilemmes), nous aboutissons à une ouverture vers les valeurs et ceci à travers un exemple -j'ai du mal à utiliser le terme que les politistes affectionnent tant, mais lâchons le -le paradigme de la responsabilité médicale ou de la responsabilité hospitalière.
Si je m'arrêtais là, d'abord j'aurais beaucoup appauvri le colloque en lui-même, et puis j'aurais dessiné une figure singulière avec un axe vertical descendant et un axe oblique ascendant ; vous voyez bien qu'il manque un troisième morceau, c'est tout à fait évident. Et ce troisième morceau, c'est tout naturellement un axe horizontal qui va me semble t-il nous permettre, non pas de découvrir de véritables nouveautés, mais de dépasser un certain nombre de particularités qui avaient été mises en évidence hier comme aujourd'hui.
Premier constat, il existe des chapitres juxtaposés du droit de la responsabilité, du droit de la responsabilité en droit public. On en a examiné quatre ou cinq, il y en a peut être six ou sept, mais de toute manière la collection est incomplète puisqu'on ne peut pas faire l'économie du droit privé notamment. Et ce qui me frappe, c'est que ces compartiments du droit de la responsabilité, que l'on présente du fait des coupures de nos disciplines universitaires comme séparées par des cloisons étanches, ces différents compartiments sont en fait étroitement interdépendants les uns des autres. Je dirais si vous voulez qu'il y a une sorte de logique des vases communicants qui fait que lorsque dans un certain système de droit à une époque déterminée, on a vidé un compartiment - songez à la responsabilité personnelle des fonctionnaires et des élus locaux (la responsabilité civile) - il est tout à fait évident que par un phénomène qui doit s'appeler homéostatique, cette responsabilité va devoir remplir au même moment et pour répondre à la demande sociale, pour répondre aux besoins de la société, un autre compartiment, qui est à l'évidence le droit pénal.
Alors, ce que je retiens de ce colloque et de la richesse incroyable des idées qui ont été développées dans les différentes communications, c'est probablement cela : d'abord l'interdépendance des différents aspects de la responsabilité en droit, en droit français ou en droit public français si l'on veut un petit peu réduire le champ de nos réflexions.
Au-delà de cette première banalité qui était l'interdépendance des différentes branches du droit, il y a quand même un phénomène que révèle notre colloque et nos études du jour, c'est la part de plus en plus lourde du droit pénal dans notre système juridique. Ce n'est - là encore - pas une découverte, mais je crois que nous ne nous sommes peut être pas suffisamment interrogés sur la signification de cette pénalisation contemporaine du droit, et il m'est difficile de vous livrer ma réponse personnelle, mais je me demande sérieusement si ce n'est pas une régression et si ce n'est pas un retour à la société primitive. D'autres que moi peuvent parfaitement ne pas partager mon point de vue, mais je crois si vous voulez que c'est une des interrogations que - en droit public - la responsabilité pose aujourd'hui : quelle signification donner - étant entendu que les règles techniques se comprennent d'elles-mêmes - quelle signification donner à cette sur-pénalisation que l'on voit apparaître sous des formes d'ailleurs tout à fait différentes. On aurait vu des illustrations, j'allais dire amusantes, disons intéressantes, en droit financier, mais qui apparaissent aussi bien en droit international avec cette responsabilité du gouvernant plutôt que de l'État. On en voit des exemples par les interrogations que posent le droit constitutionnel aujourd'hui et bien entendu ce que peut nous enseigner par exemple le droit des collectivités locales.
C'était dans cet axe horizontal, si vous voulez, le deuxième élément qui constituait cet axe, disons une deuxième tige que je voudrais tresser avec vous. Rassurez-vous, il n'y en a plus qu'une qui manque ; cela serait peut être - et là encore c'est une banalité - l'extraordinaire généralisation, l'extraordinaire élargissement de la responsabilité. Alors, ce phénomène a été étudié admirablement sous différentes facettes depuis hier matin. On nous a dit par exemple qu'il y avait des catégories et qu'on jouait des catégories. On a dit et on a répété sous des angles tout à fait divers que tout système de responsabilité se composait au moins de trois éléments : le fait dommageable, le lien de causalité et le dommage. Et puis on a montré des responsabilités sans dommage, des responsabilités sans causalité, j'allais dire des responsabilités sans fait dommageable. Ce qui veut dire que, en effet, et le président de la table ronde en parlait tout à l'heure, les éléments auxquels nous sommes habitués sont des éléments qui se distendent et sur lesquels une réflexion critique à la fois sur chaque élément et sur l'ensemble des trois éléments me paraît devoir être approfondie si l'on ne veut pas perdre le sens du mot responsabilité, si on ne veut pas confondre les mécanismes de responsabilité avec toute indemnisation, avec toute assurance, avec toute application de l'idée solidarité. Voilà tout simplement les choses très simples que je voulais vous rappeler.
Avant de quitter cette tribune, je voudrais d'abord remercier l'institution sénatoriale, son président, les sénateurs qui nous ont livré leur témoignage et une liste de personnes que Gilles DARCY m'a donnée et que je vais lire : Madame LEPOULTIER, Madame HAMOT, Madame PATRIGEON, Madame BOURDEROTTE, Madame DIALLO, Monsieur MULARD, Monsieur ROUILLER, Monsieur ZARCA, Monsieur THOMAS, Monsieur SCHALLER, Monsieur BOUTEILLER, qui sont invités au cocktail, comme vous tous. Voyez, c'est la récompense de m'avoir écouté. Donc un remerciement pour le président du Sénat, pour l'institution sénatoriale et pour tous les membres du sénat qui nous ont offert et permis d'occuper ce cadre incomparable pendant deux jours.
Je voudrais y associer l'université de Paris 13 et les nombreux enseignants de Paris 13 qui de manière discrète - je ne dis pas invisible mais discrète - nous ont facilité la tâche, notamment la tâche d'arriver ici sans se perdre grâce à une signalisation tout à fait efficace - même moi je ne me suis pas perdu - et d'autre part qui nous ont facilité, je crois, des contacts extérieurs si nous devions en avoir pendant ces deux jours.
Et puis, mon dernier mot, et je demanderai à l'assemblée de se lever pour lui faire une ovation, c'est de remercier l'organisateur infatigable de ce colloque qu'a été Gilles DARCY. Sans lui, ce colloque comme la guerre de Troie, n'aurait pas eu lieu.
Imprimé, pour le Sénat, par Reprotechnique - Paris
Colloque organisé par l'université Paris 13 avec le soutien du Sénat et du ministère de l'Éducation nationale, sous le haut patronage de M. Christian Poncelet, président du Sénat.
La réelle interrogation sur l'avenir du droit de la responsabilité publique domine tous les débats présents dans la théorie du droit, du droit international ou européen, et du droit interne qui demeure fort subtil. Est-il possible de dépasser ces probables hésitations pour accéder aux normes nouvelles applicables à l'ensemble des hypothèses soulevées ?
C'est la question à laquelle tentent de répondre Mmes et MM. Olivier Beaud, Denys de Béchillon, Vlad Constantinesco, Jean-Paul Costa, Maryse Deguergue, Pierre Delvolvé, Louis Dubouis, Jean-Pierre Duprat, Robert Etien, Pierre Fauchon, Laurence Folliot-Lalliot, Yves Gaudemet, Christophe Guettier, Jean-Claude Hélin, Danièle Lochak, Philippe Manin, Jean-Arnaud Mazères, Jacques Moreau, Jacqueline Morand-Deviler, Michel Paillet, Christian Poncelet, Jean-Marie Pontier, Michel Pouchain, Aude Rouyère. René-Pierre Signe, Brigitte Stern et Georges Vedel (†).
Avec la participation de Gilles Darcy, Alain Delcamp, Francine Demichel, Cécile Bourderotte, Julien Bouteiller, Marie-Laure Diallo, Sylvain Mulard François Rouille, Sébastien Schaller, Christophe Thomas et Alexis Zarca.
Ce volume s'inscrit dans la série de publications destinées à rendre compte des manifestations et colloques institutionnels organisés par le Sénat ainsi que, le cas échéant, par ses commissions ou délégations.
Cette collection est l'expression de la volonté d'ouverture du Sénat. Elle a pour vocation de mieux faire connaître son activité de réflexion et sa force de proposition.
* 1 Il s'agit de celle de M. J-M. FAVRET : Les influences réciproques du droit communautaire et du droit national de la responsabilité publique extra contractuelle, Paris Pedone 2000.
* 2 La notion de jus commune doit être maniée avec précaution. Certains auteurs s'en sont fait les thuriféraires, qu'il s'agisse de considérer le jus commune européenne, de lege lata ou de lege ferenda. Beaucoup, en tous cas, observent une tendance vers l'émergence de principes communs s'imposant aux droits nationaux, ce qui serait particulièrement le cas en matière de responsabilité extra contractuelle. Voir par exemple, W. VAN GERVEN et al. : Torts, Oxford, Hart, 1998. Pour une attitude plus sceptique à l'égard du jus commune européen, dans ce domaine là, voir le compte-rendu critique de ce livre, et des présupposés méthodologiques sur lesquels il s'appuie, par P. LEGRAND, The Cambridge Law Journal, Volume 58 [1999], p. 439.
* 1 On n'examinera donc pas ici, du moins à titre principal, les hypothèses de responsabilité de la Communauté pour acte normatif impliquant des choix de politique économique, ni les cas où la responsabilité extra contractuelle de la Communauté pourrait être engagée à l'occasion d'un dommage commis par un fonctionnaire ou un agent de la Communauté. Notons que les solutions dégagées par la Cour dans le premier cas seront reprises par elle lors de l'élaboration de la solution apportée à l'hypothèse de la responsabilité de l'État au regard d'une violation du droit communautaire. Voir pour ces hypothèses les analyses précises de J. RIDEAU et F. PICOD : Code des procédures juridictionnelles de l'Union européenne, Paris Litec 2002, p. 343 s.
* 2 Le dictionnaire de la langue française par E. Littré (Paris, Hachette, 1881, tome 2, p. 1366) note des significations architecturale, artistique et militaire de ce terme, mais pas de sens juridique ou judiciaire.
* 1 Cf. W VAN GERVEN : La jurisprudence récente de la CJCE dans le domaine de la responsabilité extracontractuelle. Vers un jus commune européen ? in Université Panthéon- Assas (Paris II) Institut des Hautes Études Internationales. Cours et Travaux, Paris Pedone 1998, passim.
* 2 Le professeur J. RIDEAU observait : "La mise en oeuvre du droit communautaire est conditionnée par l'attitude des pouvoirs publics nationaux. Elle dépend, en premier lieu, de la volonté des Législatifs et des exécutifs étatiques, et, d'une manière plus générale, de l'ensemble des autorités nationales, de respecter les obligations communautaires souscrites par l'État en mettant en oeuvre les règles européennes ou en s'abstenant de porter atteinte à leur application. C'est à travers les règles d'organisation de chaque système juridictionnel national, que l'effet direct et la primauté du droit communautaire pourront trouver leur consécration à l'intérieur des différentes voies de droit et selon les hypothèses procédurales dans lesquelles le droit communautaire est appelé à s'appliquer, selon le principe de l'autonomie institutionnelle, souvent qualifié d'autonomie judiciaire ou procédurale en ce qui concerne les juridictions, qui anime la jurisprudence de la Cour." in J. RIDEAU et F. PICOD : Code de Procédures communautaires, Paris Litec 1995 p. 134
* 3 On peut considérer que le principe d'autonomie est une forme ou une application du principe de subsidiarité.
* 4 19 novembre 1991, Francovitch et Bonifaci c. Italie, aff. C-6/90 et C-9/90, Rec. p. 1-5357 (alinéa 43). JCP 1992 II 21783, note A. BARAV, JCP éd. E 1992 I 123, obs. D. SIMON, L. DUBOUIS : La responsabilité de l'État pour les dommages causés aux particuliers par la violation du droit communautaire, RFDA 1992 p. 1, F. SCHOCKWEILER : La responsabilité de l'autorité nationale, en cas de violation du droit communautaire, RTDE 1992 p. 27.
* 1 La doctrine considère que le mouvement jurisprudentiel conduisant à la définition communautaire des conditions d'engagement de la responsabilité de l'État pour violation du droit communautaire débute avec l'arrêt de la Cour du 16 décembre 1960, Humblet, aff. 6/60, Rec, p. 1146 ou la Cour avait indiqué - de manière incidente, il est vrai - que si elle : "(...) constate dans un arrêt qu'un acte législatif ou administratif émanant des autorités d'un État membre est contraire au droit communautaire, cet État est obligé aussi bien de rapporter l'acte dont il s'agit, que de réparer les effets illicites qu'il a pu produire." (c'est nous qui soulignons). Le principe de cette responsabilité est donc posé depuis plus de 40 ans ! il était à l'époque fondé sur l'art. 86 T CECA, disposition équivalente à celle de l'art. 10 T CE (anc. art 5 T CE)
* 2 Expression de J-F. FLAUSS : Frankreich, in J. SCHWARZE (Hrsg.) : Das Verwaltungsrecht unter europäischem Einflup. Zur Konvergenz der Mitgliedstaatlichen Verwaltungsrechtsordnungen in der enropatschen Union, Baden Baden, Nomos Verlag 1995, p. 31.
* 3 Le cadre de cette contribution ne permet de se livrer à un examen des différents droits des États membres. On trouvera, dans les références bibliographiques, des indications permettant d'accéder à une information comparative.
* 1 Voir notre thèse : Compétences et pouvoirs dans les Communautés européennes. Contribution à l'étude de la nature juridique des Communautés, Paris LGDJ, 1974. On complètera par la lecture de la thèse de V. MICHEL : Recherches sur les compétences communautaires, Paris - 1,2000.
* 2 art. 5 T CE (ex art. 3 B) "La Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité.", disposition introduite par le traité sur l'Union (1992), donc postérieurement à l'arrêt Francovitch / Bonifaci (1991).
* 3 Pas plus que leurs prédécesseurs, les négociateurs du traité sur l'Union n'ont cru nécessaire d'inscrire une telle disposition dans le traité de Maastricht, alors que la question leur avait été soumise. Cf. les conclusions de l'Avocat général Ph. LEGER sous l'arrêt de la Cour de justice du 23 mai 1996, Hedley Lomas, Aff. C-5/94, Rec. I- 2553 point 52, cité par O. LEONARD DE JUV1GNY, V° Responsabilité (des États membres), Encyclopédie Dalloz de Droit communautaire, III, 1997 n° I.
* 4 L'art. 288 T CE renvoie aux " principes généraux communs aux droits des États membres " : les principes développés par la Cour concernant les conditions d'engagement de la responsabilité extra contractuelle de la Communauté s'appuient donc sur un examen et une comparaison entre les droits nationaux : ce régime communautaire, on le verra, influencera les conditions dégagées par la Cour pour ce qui est de la responsabilité des États membres au regard du droit communautaire. Il y a ici un véritable jeu d'influences croisées entre le droit national et le droit communautaire, qui relativise (ou nuance) la notion d ' encadrement dans ce qu'elle pourrait avoir d'unilatéral.
* 1 Comme le remarquait le juge P. PESCATORE, la seule préoccupation des auteurs des traités a été "(...) de soumettre à un régime de responsabilité juridique l'entité nouvelle qu'ils s'apprêtaient à créer, c'est à dire la Communauté." in La responsabilité des États membres en cas de manquement aux règles communautaires, II Foro Padano, oct. 1972, n° 10.
* 2 S'agissant de la base juridique pertinente pour une telle intervention " législative", on peut songer aux dispositions concernant le rapprochement des législations (art. 94 et 95 T CE = ex art. 100 et 100 A) ou à l'art. 308 T CE (ex art. 235).
* 3 Arrêt de la Cour du 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur SA contre Bundesrepublik Deutschland et The Queen contre Secretary of State for Transport, ex parte : Factortame Ltd et autres. Affaires jointes C-46/93 et C-48/93. Recueil 1996 p. 1-1029. Voir le point 24 de l'arrêt :" (...) Le Gouvernement allemand soutient en outre qu'un droit général à réparation pour les particuliers ne pourrait être consacré que par voie législative et que la reconnaissance d' un tel droit par voie prétorienne serait incompatible avec la répartition des compétences entre les institutions de la Communauté et les États membres, et avec l'équilibre institutionnel instauré par le traité ; "
* 1 Cf. D. SIMON : v° Recours en constatation de manquement, in C. GAVALDA et R. KOVAR, Répertoire Dalloz de droit communautaire, II, 1992 n° 120, 128, 134.
* 2 Arrêt du 12 juillet 1976, Commission c. /Allemagne, aff. 70/72, point 13, Rec. p. 813.
* 3 Ainsi que la Cour le constatera expressément dans l'arrêt Brasserie du Pêcheur / Factortame (point 95) : "(...) subordonner la réparation du dommage à l'exigence d' une constatation préalable par la Cour d' un manquement au droit communautaire imputable à un État membre serait contraire au principe d' effectivité du droit communautaire, dès lors qu'elle exclurait tout droit à réparation tant que le manquement présumé n' a pas fait l'objet d' un recours introduit par la Commission en vertu de l'article 169 du traité et d'une condamnation par la Cour. Or, les droits au profit de particuliers, découlant des dispositions communautaires ayant un effet direct dans l'ordre interne des États membres, ne sauraient dépendre de l'appréciation par la Commission de l'opportunité d' agir au titre de l'article 169 du traité à l'encontre d'un État membre ni du prononcé par la Cour d' un éventuel arrêt de manquement (en ce sens, arrêt du 14 décembre 1982, Waterkeyn e.a., 314/81, 315/81, 316/81 et 83/82, Rec. p. 4337, point 16)"
* 1 D. SIMON, op. cit. n° 135. Adde J. RIDEAU, Droit institutionnel de l'Union européenne, Paris LGDJ, 1999 p. 742 : " (...) l'existence d'un arrêt de manquement ne fait que souligner l'obligation pour le juge national d'accorder la réparation du dommage causé, alors qu'en l'absence d'un arrêt en manquement, il appartiendra à la juridiction nationale d'établir préalablement cette violation, en utilisant éventuellement la voie préjudicielle. "
* 1 directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur ( JO CE n° L 283, p. 23).
* 2 D. SIMON : Droit communautaire et responsabilité de la puissance publique : glissements progressifs ou révolution tranquille ? , AJDA 1993 p. 237.
* 1 arrêt Francovitch / Bonifaci, précités, point 38 : "Si la responsabilité de l'État est ainsi imposée par le droit communautaire, les conditions dans lesquelles celle-ci ouvre un droit à réparation dépendent de la nature de la violation du droit communautaire qui est à l'origine du dommage causé."
* 2 Les espèces Brasserie du Pêcheur / Factortame ayant été jointes au fond, et ayant fait l'objet d'un même arrêt, on les examinera ensemble. Une autre raison de les examiner ensemble est qu'elles ont trait à la responsabilité de l'État du fait de lois.
* 3 ou bien dans le maintien d'une législation nationale déclarée contraire au droit communautaire par la Cour de justice elle-même ( Brasserie du Pêcheur ) .
* 4 L'admission dans ce cas du principe de la responsabilité permet de pallier l'inertie que l'État pourrait opposer en se fondant sur l'absence d'effet direct de la directive à transposer.
* 1 C'est nous qui soulignons.
* 2 D. SIMON, art. cit. JCP, éd. E 1992.I. 123, n° 13.
* 1 La lecture des conclusions de l'avocat-général LEGER, sous l'arrêt de la Cour du 23 mai 1996, Hedley Lomas, aff. C-5/94, Rec. p. I-2553, (point 95) permet de parcourir et de confronter la manière dont les États membres organisent la responsabilité du fait des lois
* 2 Droit administratif général, I, Paris Montchrestien, 1998, n° 1306.
* 3 Il s'agit de l' ex art. 215 (art. 228) T CE qui reconnaît, selon la Cour : "29. (...) le principe général connu dans les ordres juridiques des États membres, selon lequel une action ou omission illégale entraîne l'obligation de réparer le préjudice causé. Cette disposition fait apparaître également l'obligation, pour les pouvoirs publics, de réparer les dommages causés dans l'exercice de leurs fonctions.", mais aussi de la jurisprudence en matière de manquement qui considère traditionnellement qu'un manquement est imputable à l'État quelque soit la nature de l'organe qui en est l'auteur, même s'il s'agit d'une institution constitutionnellement indépendante.
* 4 On sait que la responsabilité internationale de l'État est par principe engagée quel que soit l'organe de l'État qui a causé le dommage.
* 5 Rec. p. 975.
* 1 Aff. jointes 83/76, 94/76, 4/77, 15/77 et 40/77, Rec. p. 1209, points 5 et 6.
* 2 Cf. D. SIMON : Le système juridique communautaire, op. cit. p. 304.
* 3 8 octobre 1996, Dillenkoffer, aff. C-178/94, C-179/91, C-188/94 à C-190/94 Rec. p. 1-1029.
* 1 Comme elle a également écarté l'argument selon lequel il conviendrait de subordonner la réparation du préjudice à l'existence d'une faute intentionnelle ou de négligence dans le chef de l'organe étatique auquel le manquement est imputable, (point 75) Certains ont pu comprendre ceci comme une préférence pour les régimes de responsabilité sans faute, particulièrement dans le cadre de la responsabilité du fait des lois.
* 2 Nous avons déjà esquissé cette explication, d'une manière plus générale. Voir notre article : The ECJ as Law -Maker : Praeter aut Contra Legem ? in D. O'KEEFE and A. BAVASSO : Liber Amicorum in Honour of Lord SLYNN of HADLEY, Judicial Review in European Union Law, Kluwer Law International, The Hague, 2000, vol. I p. 73.
* 1 Op. cit. p. 5.
* 2 Il ne peut être question, sauf exception, de rendre compte ici des réactions des juridictions de chaque État membre. Pour un examen comparatif, limité à l'Allemagne, au Royaume-Uni, à la Belgique, à la France, à l'Espagne et à l'Italie, voir G. VANDERSANDEN et M. DONY, op. cit. passim.
* 1 relevé par D. SIMON : Droit communautaire et responsabilité de la puissance publique...art. cit. AJDA 1993, p. 238.
* 2 Voir J-M. FAVRET, op. cit. p. 260.
* 3 arrêt Francovitch / Bonifaci, point 43.
* 4 ibid. point 43.
* 5 9 mars 1978, Simmenthal, aff. 106/77, Rec. p. 629.
* 6 5 mai 1986, Johnston, aff. 222/84, Rec. p. 1651.
* 7 9 juin 1990, Factortame (I), aff. C-213/89, Rec. I-2433.
* 8 9 novembre 1995, Atlanta, aff. C-465/93, Rec.I-3761.
* 9 21 février 1991, Zuckerfabrik Soest, aff. jointes C-143/88 et C-92/89, Rec. I-415.
* 1 On peut soutenir qu'une loi comme celle du 9 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative (J.O. du 9 février 1995, p. 2175) qui reconnaît au juge administratif des pouvoirs d'injonction à rencontre de l'administration, doit quelque chose à la jurisprudence communautaire. Cf J-M. FAVRET, op. cit. p. 268.
* 2 dans son commentaire de l'arrêt Simmenthal, AJDA 1978 p. 326.
* 3 Voir par exemple, M. ROUGEVIN-BAVILLE, R. DENOIX de SAINT MARC et D. LABETOULLE : Leçons de droit administratif, Paris, Hachette, 1989 p. 352.
* 4 On peut ajouter que l'engagement d'une telle responsabilité sans faute permettait aussi d'écarter la notion de faute, dont la conception classique de la loi s'accommode mal. La responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges publique présente un caractère objectif, mais il faut rappeler qu'elle est subordonnée à la volonté du législateur de ne pas exclure toute indemnisation : cette condition n'est-elle pourtant pas l'indice d'un élément subjectif ?
* 1 Le Conseil d'État et les directives communautaires... RTDE 1992 p. 281
* 2 Relevé de manière détaillée et convaincante par J.M. FAVRET auquel on renverra : op. cit, p. 290 s.
* 3 CE 23 mars 1984, AJDA 1984 p. 386
* 4 CE 28 février 1992, Rec. p. 80
* 5 CAA de Paris 1 er juillet 1992, JCP éd. E II n° 357 ; CE 30 octobre 1996, AJDA 1996 p. 1044
* 6 Appréciation de G. VANDERSANDEN et M. DONY, op. cit. p. 264 à propos de l'arrêt Arizona Tobacco où l'imputation de la violation du droit communautaire échoit à l'autorité administrative alors qu'elle applique une loi non conforme à la directive que la loi devait transposer, le fait générateur de la responsabilité de l'État ayant été considéré comme détachable de la loi elle-même.
* 7 R. KOVAR : Le Conseil d'État et le droit communautaire : des progrès mais peut mieux faire, D. 1992 Chron. P. 207/212
* 1 On se souvient que le même argument avait été utilisé pour éviter d'avoir à admettre la possibilité pour le juge administratif d'écarter la loi postérieure contraire au droit communautaire, avant l'arrêt Nicolo...
* 2 J-M. FAVRET : op. cit. p. 359
* 3 Dans l'arrêt du 28 octobre 1999 rendu par la House of Lords, ([1999] 4 All E. R. 906 et [1999] 3 C.M.L.R. 597), qui constitue le 5 e épisode de l'affaire Factortame, Lord SLYNN of HADLEY se pose cette question : " Can it be said, even if the Act was deliberatly adopted, it was an unintentionai and `excusable' breach which should prevent what was done being `a sufficiently serions breach' in that it was a manifest and grave disregard of the limits of the United Kingdom's discretion ?" , avant de conclure que le Royaume-Uni a violé ses obligations communautaires de manière suffisamment sérieuse permettant aux requérants d'obtenir des dommages intérêts pour le préjudice directement causé par cette violation. Le droit anglais des Torts s'est ainsi enrichi d'un nouveau cas d'ouverture : le breach of Community obligations. On doit admirer la plasticité de la Common Law qui a su surmonter l'obstacle de la souveraineté du Parlement.
* 1 G. VEDEL : "Droit administratif" PUF (coll. Themis) ou encore : "Les bases constitutionnelles du droit administratif" EDCE, n° 8, p. 21 et s.
* 2 Même Charles EISENMANN dans ses enseignements, tout en critiquant le thème des bases constitutionnelles évoqué par le Doyen VEDEL, et sans reconnaître une quelconque primauté d'un droit par rapport à un autre, acceptait le principe de la place prépondérante du droit constitutionnel au sein du droit public.
Ch. EISENMANN "cours de doctorat" Université Paris 1 1973, ou encore : "la théorie des bases constitutionnelles en droit administratif" RDP, 1972 p. 1345.
* 3 J.P. COSTA : "La pratique de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales",", V. CONSTANTINESCO : " L'encadrement de la responsabilité en droit communautaire "
* 1 Le terme : "encadrement" est souvent utilisé en droit, mais rarement défini.
* 2 Pour reprendre la définition de notre manuel : "Initiation au droit public" Ellipses 1998 p. 10
* 3 Sur la définition de la responsabilité cf. le remarquable développement : "Responsabilité du terme aux concepts" G. DARCY : "La responsabilité de l'administration" Dalloz (collection connaissance du droit) 1996 p. 7 à 13.
* 4 Sur l'origine du terme responsabilité, il convient de faire référence au mot latin : "respondere" qui signifie : "répondre de" J. HENRIOT, La responsabilité, Encyclopédia Universalis, T XIV, 1972.
* 5 Sur ce point, la responsabilité chez les grecs était liée aux "libations" qu'ils pratiquaient en répandant et buvant le vin en hommage aux dieux afin de ratifier certains actes.
* 6 M. VILLEY :"Esquisse historique sur le mot responsable" p. 45 "la responsabilité" APD, t. 22, 1977.
* 7 Sur l'évolution des fondements moraux du principe de responsabilité cf. G. VINEY : "Vocabulaire fondamental du droit", APD t. 35, 1990.
* 8 Annoncé par l'arrêt Rothchild de 1855 (CE, 6 décembre 1855, Rec., p. 707) le principe d'un régime de responsabilité spécifique de l'administration est consacré par l'arrêt Blanco en 1873 (TC, 1er février 1873, GAJA n° 1, Rec Lachaume, p. 12).
* 1 Les très récents débats sur le thème de la responsabilité du Président de la République semblent atténuer cette absence.
* 2 Article 20 dernier alinéa (Le Gouvernement) "...est responsable devant le parlement..." article 21 : (le Premier ministre) "est responsable de la défense nationale..."
* 3 Le Premier ministre...engage.. la responsabilité du Gouvernement..." alinéa 1..."L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement..." alinéa 2..." Le Premier ministre peut... engager la responsabilité du Gouvernement... "alinéa 3.
* 4 Article 68 : "Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison..."
* 5 Titre X de la constitution : "De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement", article 68-1 : "Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables..."
* 6 Les articles 13, 15 et 17 de la déclaration de 1789 évoquent implicitement la notion de responsabilité. Sur ce point cf. M.A. LATOURNERIE : "Responsabilité publique et Constitution", mélanges Chapus, 1992, p. 353.
* 7 Décision du 22 janvier 1999, "Cour pénale internationale".
* 8 Sur le constitutionnalisme les principaux ouvrages de droit constitutionnel soulignent la place prépondérante dans nos sociétés démocratiques de la norme constitutionnelle et la nécessité d'un contrôle de constitutionnalité.
* 9 Sur l'État de droit :J. CHEVALLIER : "l'État de droit"1994.
* 10 Cf. Sous la direction de Philippe SEGUR le remarquable ouvrage intitulé : "Gouvernants : quelle responsabilité ?" éd. "L'harmattan"2000 (collection logiques juridiques).
* 1 Voir sur ce point par exemple : O. BEAUD, J.M. BLANQUER, "Comment réintroduire une responsabilité des gouvernants sous la Vème République ?" in O. BEAUD, J.M. BLANQUER (sous la direction) "La responsabilité des Gouvernants" Descartes et Cie, 1999
* 2 A. GARAPON, D. SALAS : "La République pénalisée" Hachette (Questions de société)
J. VIGUIER "la criminalisation de la responsabilité politique" in "Gouvernants quelle responsabilité ?" op.cit. p. 163
* 1 C. BIDEGARAY, C. EMERI, : "La responsabilité politique", Dalloz, (Coll. Connaissance du droit) 1998
P. SEGUR : "La responsabilité politique", Coll. "Que sais-je ?" P.U.F., 1998
* 2 Motion de censure qui fut adoptée le 5 octobre 1962 et qui eut pour but de renverser le Gouvernement POMPIDOU à la suite de la volonté du Général DE GAULLE de réviser la constitution par le biais de l'article 11.
* 3 Depuis 1962 l'Assemblée nationale n'a jamais renversé le Gouvernement.
* 4 La Vème République a instauré des techniques de "parlementarisme rationalisé" qui permettent d'éviter l'instabilité gouvernementale. Le scrutin majoritaire à deux tours pour l'élection des députés conforte cette orientation majoritaire.
* 5 P. AVRIL : "Pouvoir et responsabilité" Mélanges Burdeau L.G.D.J., 1977, p. 10
* 6 CL. EMERI : "De l'irresponsabilité présidentielle" pouvoirs, n° 41, 1987, P ; 1341.
* 7 En 1968 le Général DE GAULLE décide de dissoudre l'Assemblée nationale au moment même où il se retrouve "en phase" avec le peuple français. En 1969 son départ provient davantage de l'usure du pouvoir, de la complexité du contenu du texte à adopter et surtout de son engagement à démissionner si le référendum est négatif.
* 8 J. ROSSETTO : "À propos de la responsabilité pénale de l'exécutif sous la Vème République : l'indispensable responsabilité politique", Mélange P. AVRIL, 2001, p. 401
32 O. BEAUD : "Le traitement constitutionnel de l'affaire du sang contaminé. Réflexions critiques sur la criminalisation de la responsabilité des ministres et sur la criminalisation du droit constitutionnel" "Revue du droit public" 1997 p. 1012 et : "Le sang contaminé. Essai critique sur la criminalisation de la responsabilité des gouvernants" P.U.F.(Coll. Béhémoth), 1999
* 1 Tentative du député A. MONTEBOURG à propos de la question d'emplois fictifs à la mairie de Paris.
* 2 La réforme constitutionnelle vient à la suite des propositions de la commission VEDEL qui adopte cette perspective.
* 3 B. MATHIEU, Th. RENOUX et A. ROUX, "La Cour de Justice de la République" P.U.F. (que sais je ?) 1995.
* 4 A.MOREAU : "La haute trahison du président de la République sous la Vème République" R.D.P., p. 1341
* 5 Décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1999.
* 6 La Cours de cassation dans son arrêt du 10 octobre 2001 va encore plus loin que le Conseil constitutionnel puisqu'elle indique qu'aucun magistrat ne pourra convoquer M. J. CHIRAC tant que celui ci occupera les fonctions de Président de la République.
* 7 Ph. CHRESTIA : "Responsabilité politique et responsabilité pénale : entre fléau de la balance et fléau de société" R.D.P. mai juin 2000 p. 739.
* 8 Les caractéristiques mêmes du droit pénal : sa procédure rapide et efficace, sa sanction sans équivoque favorisent sa mise en application.
* 9 O. BEAUD op. cit. note 32
* 10 J. VTRET : "La responsabilité de l'administration et de ses agents à l'épreuve du droit pénal contemporain", A.J.D.A., 1995, p. 763.
* 1 A. DEMICHEL : "Droit administratif" P.U.F.
* 2 G. CARCASSONNE : "Le Président de la République et le juge pénal", mélanges Ph. Ardant 1999 p. 289
* 3 Article 67 de la constitution de 1958 : "... Elle est composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées. Elle élit son président parmi ses membres..."
* 4 La Cour de Justice de la République juge les membres du Gouvernement. Elle peut-être saisie par le procureur général près la cour de cassation : soit d'office sur avis conforme de la commission des requêtes, soit à la suite de la demande d'une personne qui se prétend lésée par un délit commis par un membre du Gouvernement qui a saisi la commission de requêtes.
* 5 Article 68-2 de la constitution : "La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la cour de cassation, dont l'un préside la cour de justice de la République..."
* 6 Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999, traité portant statut de la Cour pénale internationale, JO, 24 janvier 1999, p. 1317 ets.
* 7 O. BEAUD op.cit.
* 1 M. PAILLET : "Vers un renouveau des sources de la responsabilité administrative en droit français", Études offertes à J.M. AUBY, Dalloz, 1992, p. 259.
* 2 G. DARCY op. cit.
* 3 Ces dernières sont évidemment dans la pratique les références réelles en matière de responsabilité.
* 4 Solution décidée par le Conseil constitutionnel à la suite de la décision du 22 janvier 1999.
* 5 Cf. nos raisonnements antérieurs.
* 6 D. COHEN : "Une cour forcément impartiale" "Le Monde" 9 février 1999.
* 7 Articles 68-1,68-2 et 68-3 du titre X de la constitution du 4 octobre 1958.
* 8 Article 26 alinéa 1 : "Aucun membre du Parlement ne peut-être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions..." sur ce point H.ISAR :"immunités parlementaires ou impunités parlementaires ?" "R.F.D.C."1994, p. 675.
* 9 Article 21-3 du Code pénal et article L 2123-34 du Code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de la loi du 13 mai 1996 qui a renforcé la responsabilité pénale des élus locaux.
* 1 Les magistrats sont placés sous l'autorité du Conseil supérieur de la magistrature (article 65 de la constitution) qui est compétent en matière de nomination et qui statue comme conseil de discipline des magistrats du siège et qui donne son avis pour les nominations et les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet.
* 2 Pour reprendre la conception classique de la citoyenneté liée à la participation de la personne à la vie de la cité.
* 3 Cf. sur ce point dans le cadre de ce colloque la communication de M. PAILLET sur : "la responsabilité de droit commun"
* 4 La responsabilité de droit commun met en relief la nécessaire uniformisation des régimes de responsabilité en droit public.
* 5 La responsabilité administrative par exemple a permis de mettre en valeur, certains aspects qui n'auraient pu l'être. Paradoxalement la protection des justiciables est quelquefois plus grande en cas de responsabilité administrative.
* 1 Cf. C. BIDEGARAY et C. EMERI :"La responsabilité politique", Dalloz (coll. Connaissance du monde) op. cit. p. 124 et suiv.
* 2 Curieuse situation que celle d'un Président de la République qui avoue compte tenu de la législation en vigueur ne pas pouvoir se défendre devant les juridictions.
* 1 Il n'est pas dans la tradition constitutionnelle des États Européens de prévoir en détail la responsabilité politique et pénale du chef de l'État et des membres du Gouvernement seuls les principes sont évoqués. J.P. MAURY "Dispositions constitutionnelles et étrangères la responsabilité politique" in "Gouvernants quelle responsabilité ?" sous la direction de Ph. SEGUR op. cit. p. 293
* 2 Les exemples abondent en ce sens et la France fait plutôt sur ce point exception.
* 3 Voir par exemple l'attitude de François MITTERRAND qui considère que les ministres dans l'affaire du sang contaminé ne peuvent bénéficier d'une quelconque impunité.
* 4 Celui ci pourrait figurer dans les premiers articles de la constitution de 1958. Dans l'objectif d'une constitution fédérale européenne, il serait bon que ce principe puisse être mentionné dans le texte constitutionnel de référence.
* 5 O. BEAUD, J.M. BLANQUER : "Comment réintroduire une responsabilité des gouvernants sous la Vème République ?" in O. BEAUD J.M. BLANQUER (sous la direction), "La responsabilité des gouvernants" Descartes et cie, 1999.
* 1 La condamnation à des peines d'emprisonnement pour des élus ne résout pas le problème de fond concernant la corruption.
* 2 La généralisation de mises en examen et de sanctions pénales pour les élus peut apparaître particulièrement négative.
* 3 La prime à la casserole" consisterait pour un élu, à une sorte de passage obligé, la nécessité d'une condamnation pénale qui lui donnerait une certaine notoriété, une certaine envergure.
* 4 En fait la responsabilité pénale a pris le pas sur la responsabilité politique, car cette dernière est inefficace, le meilleur exemple en est la pratique de la responsabilité politique du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale
* 5 Pour ce qui concerne l'efficacité de la responsabilité politique du Gouvernement article 49 alinéa 1, 2, et 3. de la constitution du 4 octobre 1958.
* 6 V. sur ce point les propositions d'O. BEAUD.
* 7 AJAUBERT : "Les réformes de la responsabilité politique" in "Gouvernants quelle responsabilité ?"op. cit. p. 261.
* 8 Propositions faites par O. DUHAMEL et G. VEDEL : "Le pénal et le politique" "le monde" 3 mars 1999.
* 9 Ph. SEGUR : "Qu'est ce que la responsabilité politique ?"R.D.P., 1999-6 p. 1599 et suiv.
* 10 V. sur ce point toutes les analyses sur : "un retour de l'éthique en politique".
* 11 Sur la revalorisation du Parlement, la doctrine semble être unanime.
* 12 Les hommes politiques apparaissent aujourd'hui moins désintéressés, semble-t-il"Ils s'accrochent davantage au pouvoir et veulent y rester"
* 1 Qu'aurait fait De GAULLE en 1997 à la suite d'une dissolution défavorable ?
* 2 Cette jurisprudence bien admise au départ a montré ses limites.
* 1 Sur ces deux sens, voir J.M. PONTIER, La subsidiarité en droit administratif, RDP 1986, p. 1515, notamment p. 1517-18.
* 1 Cl. LECLERCQ, L'État fédéral, Dalloz, coll. Connaissance du droit, 1997, p. 3 et s.
* 2 Énoncé à l'article 3 B du Traité de Maastricht du 7 février 1992 et retranscrit dans le nouvel article 5 de la version consolidée du Traité instituant la Communauté européenne en ces termes : " Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire ".
* 3 En ce sens, Commentaire article par article des traités UE et CE, dir. Ph. LEGER, Helbing § Lichtenhahn, Dalloz, Bruylant, 2000, p. 175.
* 4 J.M. PONTIER, op. cit., p. 1534.
* 5 Sur ces hypothèses, voir J.M. PONTIER, op. cit., p. 1527 à 1530.
* 6 Au sens où l'entend J. MOREAU, La responsabilité administrative, QSJ n° 2292, PUF, 1995, p. 21-22
* 1 DC, 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence, GDCC n° 43.
* 1 Respectivement CE, 19 oct. 1990, Ingremeau, Rec. CE, p. 284 et CAA Bordeaux, 2 fév. 1998, Cts Fraticola, RDP 1998, p. 579, concl. Péano.
* 2 Respectivement CE, S., 29 mars 2000, APHP, RFDA 2000, p. 850, concl. Chauvaux ; JCP 2000, II, 10360, note Derrien et CE, S., 15 déc. 2000, Mme Bernard, RFDA 2001, p. 283.
* 1 Civ. l ère , 8 nov. 2000, Bull. civ. I, n° 287 qui décide que la réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient.
* 2 Voir par exemple, CE, 28 juil. 2000, Assoc. FO Consommateurs, RFDA 2000, p. 1153 et les arrêts cités dans notre contribution au colloque de Dijon sur le principe de précaution, in RJE, n° spécial 2000, p. 105.
* 3 Appliquant plus récemment l'arrêt Giry du 23 nov. 1956, GAJA n° 90, voir Civ. l ère , 10 juin 1986, Cts Pourcel, JCP 1986, II, 20683, rapport Sargos ; RFDA 1987, p. 92, note J. Buisson et Civ. l ère , 30 janv. 1996, Morand c/ Agent judiciaire du Trésor, JCP 1996, II, 22608, rapport Sargos ; RDP 1997, p. 235, note J.M. Auby ; D. 1997, 83, note A. Legrand ; G.P. 23-24 avril 1997, doctr. p. 26, concl. Sainte-Rose ; RFDA 1997, p. 1301, note p. Bon et CA Paris, 3 déc. 1997, Morand, RFDA 1999, p. 399, note p. Bon.
* 4 A. VAN LANG, Juge judiciaire et droit administratif, LGDJ, BDP t. 183, 1996, p. 176 à 184.
* 1 Ce fut le cas dans l'attribution de la concession du Stade de France : CE, 30 juin 1999, Sarfati, Rec. CE, p. 222 qui rejette la requête au motif que le préjudice allégué n'est pas certain, le requérant étant dépourvu de toute chance d'obtenir le contrat de concession du Grand Stade.
* 2 Loi du 13 mai 1996, laquelle imposait l'appréciation in concreto des faits d'imprudence et de négligence compte tenu de la nature des missions et des fonctions des décideurs publics, de leurs compétences ainsi que des pouvoirs et moyens dont ils disposaient, et loi du 10 juillet 2000, laquelle repose sur une distinction entre le caractère direct ou indirect de l'imprudence ou de la négligence, cause du dommage et requiert la faute caractérisée dans le second cas. Voir le commentaire de J.H. ROBERT à l'AJDA 2000, p. 924.
* 1 Sur cette évolution, voir J.M. PONTIER, Sida, de la responsabilité à la garantie sociale, RFDA 1992, p. 533 et M. SOUSSE, La notion de réparation de dommages en droit administratif français, LGDJ, BDPt. 174, 1994.
* 2 Sur la technique des fonds de garantie, voir M. SOUSSE, op. cit., p. 104 à 108.
* 3 T.S. RENOUX et A. ROUX, Responsabilité de l'État et droits des victimes d'actes de terrorisme, AJDA 1993, p. 75.
* 1 Avis du CE, 15 oct. 1993, Cts Jezequel et Vallée, Rec. CE, p. 280
* 2 Définition particulièrement extensive de l'aléa thérapeutique donnée par une proposition de loi du 6 février 1998.
* 3 J.M PONTIER, op. cit., p. 1536.
* 4 Même si nous l'avons posé ailleurs, Jurisprudence et doctrine dans l'élaboration du droit de la responsabilité administrative, LGDJ, 1994, BDP t. 171, p. 706 à 715.
* 1 R. CHAPUS, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 8 ème éd., 1999, p. 719.
* 2 Ainsi en matière de police et de contrôle fiscal et encore récemment pour l'exercice par le préfet du contrôle de légalité des actes des collectivités locales : CE, 6 oct. 2000, ministre de l'Intérieur c/ Cne de Saint-Florent, RFDA 2000, p. 1356.
* 3 TC, 19 oct. 1998, Préfet du Tarn, D. 1999, 127, note O. Gohin, à propos de la falsification d'un plan d'occupation des sols par un fonctionnaire communal.
* 1 Parmi une jurisprudence constante, voir récemment CE, 21 janv. 1998, ministre de l'Environnement c/ Plan, RFDA 1998, p. 565, note p. Bon.
* 2 Cette responsabilité pour faute du législateur n'empêcherait pas de maintenir la responsabilité sans faute du fait des lois prises en dehors du cas de transposition ou d'application des normes communautaires. Sur cette dissociation de deux régimes en matière de responsabilité du fait des lois, voir notre article, Le contentieux de la responsabilité : politique jurisprudentielle et jurisprudence politique, AJDA 1995, n° spécial, p. 211, voir p. 226.
* 3 CE, Ass., 28 fév. 1992, Rothmans, Philip Morris, Rec. CE, p. 78 ; AJDA 1992, p. 210, concl. M. Laroque et p. 329, chron. Maugué et Schwartz ; RFDA 1992, p. 425, note L. Dubouis ; JCP 1992, II, 21859, note G. Teboul ; RDP 1992, p. 1480, note F. Fines ; Europe, avril 1992, p. 1, note D. Simon ; D. 1992, chr. p. 207 de R. Kovar.
* 4 CAA Paris, 1 er juil. 1992, Sté Jacques Dangeville, Rec. CE, p. 558 ; AJDA 1992, p. 768, obs. X. Prétot ; Dr. Fiscal 1992, n° 1665, concl. Bernault ; Europe, déc. 1992, note D. Simon. Arrêt annulé par CE, S., 30 oct. 1996, ministre du Budget c/ Sté Jacques Dangeville, RFDA 1997, p. 1056, concl. Goulard, qui ne prend pas position sur le fond et rejette la requête en recourant à un artifice de procédure, tiré de l'autorité de la chose jugée au fiscal.
* 1 Sur cette question, voir notre article, La perte de chance en droit administratif, in L'égalité des chances (dir. G. Koubi, G.J. Guglielmi), La Découverte, Coll. Recherches, 2000, p. 197.
* 2 CE, S., 14 fév. 1997, CHR de Nice, Rec. CE, p. 44 ; RFDA 1997, p. 374, concl. V. Pécresse, note B. Mathieu ; AJDA 1997, p. 430, chr. Chauvaux et Girardot ; RDP 1997, p. 1139, note J.M. Auby et p. 1147, note J. Waline ; JCP 1997, II, 22828, note J. Moreau ; JCP 1997, 11, 4025, note G. Viney.
* 1 Laquelle caractérise largement le droit administratif dans son ensemble : voir D. TRUCHET, La structure du droit administratif peut-elle demeurer binaire ?, Clés pour le siècle, Dalloz, 2000, p. 443.
* 2 Ch. LARROUMET, L'indemnisation de l'aléa thérapeutique, D. 1999, chr. p. 33.
* 1 8 janv. 65 Liesenfelt, p. 14 ; 20 fév. 74, Min. dévelop. industriel et scientifique, Ste Alpha-service, p. 120 ; 4 juin76, Desforets p. 301.
* 1 Les infections nosocomiales, qui donnent lieu régulièrement à des actions en responsabilité, sont beaucoup plus nombreuses qu'auparavant, d'une part parce qu'on les détecte mieux, d'autre part parce que les malades passent souvent par plusieurs services.
* 2 V. par ex. R. Chapus selon lequel "il n'y a aucune différence à faire entre ces termes" (Responsabilité publique et responsabilité privée. Les influences réciproques des jurisprudences administrative et judiciaire, thèse Paris, 1952, p. 400).
* 3 C.-A. Colliard, Le préjudice dans la responsabilité administrative, thèse, Dalloz, 1938, p. 9-10.
* 4 Le premier auteur à avoir donné une véritable portée à la distinction entre le dommage et le préjudice est F.-P. Bénoit selon lequel "le dommage est un fait : c'est toute atteinte à l'intégrité d'une chose, d'une personne, d'une activité ou d'une situation" ; il possède un caractère objectif en ce sens qu'il est "perceptible indépendamment de l'idée que peut s'en faire la personne qui en est victime et des conséquences diverses qu'il peut avoir pour elle". Le préjudice est "constitué par un ensemble d'éléments qui apparaissent comme les diverses conséquences découlant du dommage à l'égard de la victime de celui-ci" (Essai sur les conditions de la responsabilité en droit public et privé, problèmes de causalité et d'imputabilité), JCP 1957, 1, 1351.
* 1 Selon C. Emeri, "le juge, sans effectuer la distinction entre le dommage, y a recours quand même" (De la responsabilité de l'Administration à l'égard de ses collaborateurs, LGDJ 1966, p. 273). Pour M. Paillet la distinction dommage/préjudice "paraît particulièrement utile pour éclairer un délicat problème, celui de l'existence d'un droit lésé" (La faute du service public en droit administratif français, LGDJ, BDP, 1980 n° 204). V. également G. Darcy, La responsabilité administrative, Dalloz Connaissance du Droit et M. Deguergue, Jurisprudence et doctrine dans l'élaboration du droit de la responsabilité administrative LGDJ 1993.
* 2 C'est le cas d'une mesure illégale qui n'a aucune conséquence. Ainsi que l'écrit M. Paillet, "Dans ces affaires il est clair que le requérant a subi un dommage, c'est-à-dire que la décision illégale l'a objectivement défavorisé, mais il n'a pas subi de préjudice parce que sa situation n'a pas été réellement aggravée à partir du moment où il ne pouvait prétendre se voir garantir une situation plus favorable que celle qui a finalement découlé de la décision illégale" (op. cit. § 205, p. 181).
* 3 Selon cet article 1382 "tout fait quelconque, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer".
* 4 Ainsi "si les notions d'indemnisation et de réparation peuvent être confondues sur le terrain du résultat, c'est-à-dire l'étendue de la réparation, elles continuent à s'opposer sur le terrain des moyens", la distinction détermine "le système de compensation des préjudices applicable" (M. Sousse, La notion de réparation de dommages en droit administratif français, op. cit., p. 9).
* 1 Cela peut paraître normal dans la mesure où la loi les qualifiait expressément de contrats. Mais le Conseil d'État éprouvait quelques réticences à admettre la réalité de contrats entre l'État et les collectivités locales, ce qui peut expliquer à la fois par la rédaction assez peu contractuelle des documents mais également par une certaine propension du Conseil d'État à considérer que l'État est seul à incarner véritablement l'intérêt général et peut modifier à tout moment ces actes.
* 1 Ainsi, après la décision Ass. 8 janv. 1988 ministre chargé du Plan et de l'Aménagement du territoire contre CU de Strasbourg et autres, Rec. 3, RFDA 1988.25, concl. S. Daël, le Conseil d'État rend la décision restrictive du 25 oct. 1996 Assoc. Estuaire-Ecologie, RFDA 1997. 339, concl. J.-H. Stahl.
* 2 Par une lettre du 19 avril 1990 le préfet de la région Alsace avait fait connaître au président du conseil régional que le coût des travaux de mise à grand gabarit de la "section Niffer-Mulhouse" était évalué à 453 millions de francs, que le plan de financement prévoyait une participation des collectivités locales concernées égale à 20 % de ce coût et que cette participation serait considérée comme un "à-valoir" à réintroduire dans le financement global de la liaison Rhin-Rhône CE 15 nov. 2000, Région Alsace, req. n° 207 146.
* 3 CE 15 nov. 2000, Commune de Morschwiller-le-Bas, req. n° 207 418.
* 4 En l'espèce il s'agissait de la répartition du droit fixe de patente d'une usine d'EDF entre deux communes, l'administration n'ayant pas respecté les articles 1379 et 1459 du CGI dans leur rédaction applicable au cours des années dont s'agissait et le tarif des patentes figurant en annexe à ce code. CE sect. 7 fev. 1986, ministre du budget c/ Commune de Tallard, req. n° 236 02.
* 5 Ainsi de la responsabilité de GDF à l'égard de la SNCF à raison de travaux d'installation d'une canalisation de gaz dans la plate-forme d'une voie ferrée ayant provoqué une brèche importante sous les rails, CE 18 fev. 1987, Sté Emery et Gaz de France, req. n° 512 83.
* 1 R. Chapelard, Le préjudice indemnisable dans la responsabilité extra-contractuelle de la puissance publique, Thèse Droit Grenoble 1981, p. 64.
* 2 R. Odent, Contentieux administratif, Les cours de droit 1971, p. 1534.
* 3 CE 25 nov. 1988, Gordien, req. n° 46645.
* 4 CE 27 oct. 2000, Centre hospitalier de Seclin, req. n° 208 640.
* 5 Ce montant peut être de l'ordre de 304,90 à 457,35 Euros mais peut se monter à 4 573,47 Euros, pour chacun des frères et soeurs, dans la décision Centre hospitalier de Seclin, précitée, 5 335,72 pour la soeur d'un jeune homme plongé dans un coma végétatif sans issue (CAA Nantes 10 fev. 1994, Consorts Alix et CHR de Rennes, Rec.616).
* 1 R. Bonnard, note sous CE 24 avr. 1942, Morell, RDP 1943 p. 80 et s.
* 2 CAA Nantes 3e ch., 18 nov. 1999, Mme Dominique Vorilhon, req. n° 95 NT 00 588.
* 1 CAA Paris 3e ch., 26 janv. 1999, CPAM de Paris, Mme Cosse, Chopin, Merlin c/ Assistance publique -Hôpitaux de Paris, req. n° 97 PA 01823, 97 PA 02144, 97 PA 02232. V. aussi, par ex, l'arrêt qui indemnise les "troubles de toute nature (... ) subis dans ses conditions d'existence (...) y compris le préjudice d'agrément et sexuel", CAA Nancy, 3e ch., 6 avr. 2000, Hospices civils de Lyon c/ M et Mme Didienne et CPAM de Mulhouse, req. n° 95 NC 01994 et n° 97 NC 00308.
* 2 La maladie dont souffrait le sieur Gomez justifiait, selon l'expertise, le recours à la méthode, nouvelle, qui fut utilisée. Les risques liés à ce type d'intervention étaient mal connus à l'époque en raison du faible nombre d'opérations effectuées.
* 3 CAA Lyon 21 déc. 1990, Cons. Gomez, Rec. 498, AJDA 1991 p. 126, chron. J.-P. Jouguelet et F. Loloum, D. 1991, SC p. 292, obs. p. Bon et p. Terneyre, G. Pal 21 juil. 1991, note D. Chabanol, JCP 1991, n° 21698, note J. Moreau, RDSS 1991 p. 258, note R.-G. Medouze, RFDA 1991 p. 466, obs. C. B.
* 1 CE Ass. 9 avr. 1993 Bianchi, Rec. 17, concl S. Daël, AJDA 1993 p. 349, chron. C. Maugué et G. Touvet, D. 1994, SC, p. 65, obs. p. Bon et p. Terneyre, JCP 1993, 1, n° 3700, chron. E. Picard, JCP 1993 n° 22061, note J. Moreau, LPA 13 juin 1994, p. 15, note H. Pauliat, RDP 1993, p. 1059, note M. Paillet.
* 2 CE Sect 3 nov. 1997, Hôpital Joseph-lmbert d'Arles c/ Mme Mehraz, Rec. 412, AJDA p. 959, chron. T.- X. Girardot et F. Raynaud, D 1998 p. 146, note p. Chrestia, D. 1999, SC, p. 45, obs. p. Bon et D. de Béchillon, DA 1998, n° 32, obs. C. Esper, JCP, I, n° 165, chron. J. Petit, JCP 1998, n° 10016, note J. Moreau, LPA janv. 1998, n° 4, note P.-A. Lecoq, n° 12 note S. Alloiteau, RDP 1998, p. 891, note J.-M. Auby.
* 3 Le jeune Bianchi n'était pas malade, puisqu'il se trouvait dans l'établissement hospitalier afin d'y subir une opération de circoncision rituelle pratiquée sous anesthésie générale. Le commissaire du Gouvernement a proposé à la section de Conseil d'État, qui l'a suivi, de remplacer le terme de "malade" de la première condition de la décision Bianchi par le terme de "patient".
* 4 Chron. C. Maugüé et L. Touvet, précitée, p. 352.
* 5 Chron. L. Touvet, précitée, p. 352.
* 1 CE Sect. 5 janv. 2000, Cons. Telle, AJDA 2000, chron p. 137 et, du même jour, CE Sect. 5 janv. 2000, Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
* 2 CE 17 fev. 1988, CHR de Nancy, Req. n° 71974.
* 3 M. Guyomar et p. Collin, chron. de jurisprudence précitée, p. 141.
* 4 Cass. l ère civ. 7 fév. 1990, Bull, cass., 1, n° 39.
* 5 V., sur la notion de "perte de chance", M. Deguergue, La perte de chance en droit administratif français in L'égalité des chances, La découverte, 2000, p. 197.
* 1 R. Chapus, Droit administratif général, t. 1 Montchrestien, 14e éd. 2000, p. 1234, § 1425.
* 2 On laisse ici de côté le cas fortuit, dont certains auteurs estiment même qu'il n'existe pas en tant que cause distincte d'atténuation ou d'exonération de responsabilité parce qu'il ne fait qu'exprimer les hésitations du juge. En tout état de cause il est si rare qu'il ne mérite guère d'être retenu ici.
* 1 V., M. Waline, Préface de thèse de G.-C. Henriot, Le dommage anormal, thèse Droit, Paris 1960.
* 2 R. Chapelard, thèse précitée, p. 225.
* 3 Rougevin-Baville, concl. sur CE Sect. 2juin 1972, Sté les Vedettes blanches, D. 1974, p. 260.
* 1 F.-P. Bénoit, Le droit administratif français, Dalloz 1968, § 1250 ; Le régime et le fondement de la responsabilité de la puissance publique, JCP 1954, 1, 1178, n° 36 ; V. également J.-C. Mélin, Faute de service et de préjudice dans le contentieux de la responsabilité pour illégalité, thèse Droit, Nantes, 1969, p. 458 ; G. Soulier, Réflexions sur l'évolution et l'avenir du droit de la responsabilité de la puissance publique, RDP, 1969, p. l039.
* 2 43 p. Amselek, La responsabilité sans faute des personnes publiques d'après la jurisprudence administrative, Mél. Eisenmann, LGDJ, 1975, p. 249.
* 3 C. Maugüé et L. Touvet, chron. de jurisprudence administrative, AJDA 1993 p. 336 et s., p. 352.
* 1 Avis des sections réunies des finances et de la législation du 1 er juillet 1905, décision du 12 janvier 1906, Paillotin, Rec. 36.
* 2 F.-P. Bénoit, Le Droit administratif français, op. cit., § 1280 p. 705 ; V. également, du même auteur, Forfait de pension et droit commun de la responsabilité administrative, JCP 1956 1. 1290 et 1291 bis et, de C. Emeri, La responsabilité de l'administration à l'égard de ses collaborateurs, LGDJ 1966.
* 3 M. Guyomar et p. Collin, chron. de jurisprudence administrative, AJDA 2001 p. 143 et s, p. 159, à propos des décisions M. Castanet et Mme Bernard, du 15 décembre 2000.
* 4 Exemple cité par D. Chauvaux dans ses concl. sur les deux affaires du 15 déc. 2000 précitées.
* 5 M. Guyomar et p. Collin, chron. précitée, p. 160.
* 1 CE Sect. 15 déc. 2000, M. Castanet, req. n° 214 065. L'élève gendarme avait été victime d'une chute de motocyclette ayant entraîné une fracture du col du fémur gauche et avait gardé de cet accident des séquelles qu'il imputait à des fautes commises par l'hôpital à l'occasion de la réduction de sa fracture par ostéosynthèse. Le ministère de la défense opposait à la demande de l'intéressé le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
* 2 CE Sect. 15 déc. 2000, Mme Bernard, V. les commentaires précités de M. Guyomar et p. Collin à l'AJDA.
* 3 L'explication proposée à la solution retenue serait le refus du Conseil d'État de faire oeuvre de législateur, dans la mesure où l'on considère habituellement que ce dernier s'est "approprié" l'interprétation faite par le juge de la loi de 1831. Elle ne convainc pas vraiment, car le juge, en d'autres circonstances, a fait preuve de plus d'audace...
* 4 Tel est le cas d'une occupation illégale du domaine public, d'une exploitation non autorisée, d'une construction sans permis, etc. Mais, ainsi que l'écrit M. Paillet, "on perçoit une certaine tendance jurisprudentielle à n'écarter toute indemnité que si l'illicéité est en relation avec le préjudice" (La responsabilité administrative, op. cit., § 461, p. 208. V. les ex. cités par cet auteur).
* 5 Il s'agit principalement de l'occupation du domaine public. Le non-renouvellement de l'autorisation d'occuper une dépendance domaniale n'ouvre droit à aucune indemnité, sauf texte contraire. V. par ex. CE Ass. 29 mars 1968, Ville de Bordeaux c/ Sté Menneret, Rec.217.
* 6 V. par ex. le refus d'attribuer une indemnité à des personnes qui exploitaient une champignonnière dont l'accès a été interdit CE 6 fév. 1987 Époux Babin, req. n° 64 509.
* 7 CE 10 juill. 1996 Meunier, rec. 286, RDP 1997 p. 246 concl. J.-H. Stahl. V. Les ex. cités par R. Chapus in Droit administratif général, t. 1, op. cit., § 1422 p. 1230.
* 1 Elles sont si restrictives que, s'agissant des conventions internationales, on ne peut citer, jusqu'à présent, qu'une seule application de la mise en jeu de la responsabilité dans la décision du CE Sect. 29 oct. 1976, Dame Burgat, Rec. 452, RDP 1977 p. 213, concl. J. Massot, AJDA 1977 p. 30, chron. M. Nauwelaers et L. Fabius, Clunet 1977 p. 630, note G. Burdeau, D 1978 p. 76, note C.-L. Vier et F. Lamoureux, JCP 1977, n° 18 606, note F. Julien-Laferrière.
* 2 CE 3 avr. 1987, Corn. Heugel, Rec. 119, AJDA 1987 p. 534, concl. S. Hubac et p. 700 chron. M. Azibert et M. de Boisdeffre, LPA 30 sept. 1987, p. 11, note F. Moderne. Cette loi de 1941 a été remplacée par une loi du 31 déc. 1992 plus libérale pour les propriétaires d'objets d'art mais moins protectrice de ces derniers.
* 3 CE 10 nov. 1989, Ville de Lyon, RDP 1990, p. 1195 ; CE 19 mai 1965, Lassausse, Rec. 289.
* 4 CE 29 oct. 1984, Sté Claude Publicité, req. n° 40 204.
* 5 CE 14 déc. 1984, R ouillon, Rec. 423.
* 1 CE 11 juill. 1990, Sté Stambouli, Rec. 214, D 1991, SC, p. 286, obs. p. Bon et p. Terneyre.
* 2 CE 11 janv. 1986, Herrenschmidt ; le préjudice résultant "des travaux de construction de la ligne et de son entretien" peut, lui, donner lieu à réparation.
* 3 M. Paillet, La responsabilité administrative, op-cit, § 455 p. 204.
* 4 C'est le cas pour l'article L. 51 du code des P et T depuis la décision du Conseil constitutionnel du 13 déc. 1985.
* 5 S'agissant des servitudes d'urbanisme V. pour ces interrogations CE Sect. 3 juill. 1998, Bitouzet, Rec. 288, concl. R. Abraham, AJDA 1998 p. 570, chron. F. Raynaud et p. Fombeur ; R. Abraham, RFDA 1990, p. 1063, F. Bouyssou, D. 1984, chron., p. 231 ; F. Sudre, D. 1988, chron., p. 71.
* 6 CE 27 mars 1987, Ville de Tarbes c/ Mme di Constanzo, Rec. 111, AJDA 1987, p. 556, obs. X. Prétot, D. 1988, SC, p. 58, obs. F. Moderne et p. Bon. Il s'agissait, en l'espèce, d'un refus d'inscrire un adulte comme auditeur dans une école de musique.
* 7 M. Paillet, La responsabilité administrative, op. cit., § 458, p. 206.
* 1 CE 28 mai 1965, Époux Tebaldini, Rec. 304, concl. G. Braibant, AJDA 1965, p. 340, chron. M. Puybasset et J.-P. Puissochet ; CE Sect. 2 juin 1972, Sté Les Vedettes blanches, Rec. 414, AJDA 1972, p. 347, chron. D. Labetoulle et p. Cabanes, D. 1974, p. 260, concl. M. Rougevin-Baville, RDP 1972, p. 497, note M. Waline.
* 2 Les "modifications apportées à la circulation générale", motivées, généralement, par une préoccupation d'amélioration du réseau, sont très nombreuses chaque année, et le renversement du principe entraînerait probablement une charge assez lourde pour les finances publiques, peut-être, d'ailleurs, surtout, les finances communales et départementales.
* 3 M. Pinault, concl. sur CE Ass. 2 juill. 1982 Mlle R .... RDSS 1983, p. 95.
* 4 CE Ass. 2 juill. 1982, Mlle R.... Rec. 266, AJDA 1983, p. 206, obs. JC, D. 1984, p. 435, note J.-B. d'Onorio, D. 1984, IR, p. 21, chron. F. Moderne et p. Bon, Gaz. Pal. 1983. 1. 193, note F. Moderne.
* 1 CE 27 sept. 1989, Mme Karl, Rec. 176, AJDA 1989, p. 776, chron. E. Honorat et E. Baptiste, D., SC, p. 299, obs. p. Bon et p. Terneyre, D. 1991, p. 80, note M. Verpeaux, Gaz. Pal. 1990, 1, p. 19, conc. M. Fornacciari, RFDA 1991, p. 316, obs. p. Delvolvé et, p. 325, note M.-P. Deswarte.
* 2 TA Strasbourg 21 avr. 1994, Mme M., c/ Hospices civiles de Colmar, RFDA 1995, p. 1223, concl. J. Martinez. V. aussi, à propos de malformations d'un enfant à sa naissance, alors que les parents avaient demandé une échographie qui n'avait rien révélé, et qui demandaient réparation du fait de la faute lourde qui, selon eux, aurait été commise et leur aurait fait écarter l'IVG qu'ils avaient envisagée, la note, longue et fouillée, de G. Darcy, AJDA 1991, p. 217.
* 3 Cass. plén. 17 nov. 2000, Perruche, JCP 2000. II. 10438, note F. Chabas.
* 4 CE Sect. 14 fév. 1997, CHR de Nice cl époux Quarez, RFDA 1997, p. 374, concl. V. Pécresse, p. 382 note B. Mathieu.
* 5 B. Mathieu, note sous CE 14 fév. 1997, précitée.
* 1 On met à part le cas très particulier des dommages de guerre que le législateur entend réparer. Mais l'on observera, d'une part qu'il s'agit pour lui beaucoup plus d'une nécessité que d'une libre volonté de réparer, d'autre part, et surtout, que ces lois relatives aux dommages de guerre reposent (notamment celles du 26 décembre 1914 et du 17 avril 1919) sur l'idée de responsabilité et de culpabilité de l'adversaire c'est-à-dire de l'Allemagne.
* 2 V., pour éclairer cette notion de secours très différente de la réparation que nous trouvons dans les lois actuelles J.-M. Pontier, Les calamités publiques, Berger-Levrault, 1980.
* 3 V. C. Bréchon-Moulènes, Les régimes législatifs de responsabilité publique, LGDJ 1974.
* 4 Le système de présomption de faute lourde, retenu dans l'affaire Dejous, de 1958, était vain dans la mesure où l'administration pouvait facilement démontrer qu'elle n'avait commis aucune faute puisque les dommages tenaient, non aux conditions de la vaccination, mais à la vaccination elle-même.
* 1 Loi n° 86-1020 du 9 sept. 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'État, J.O. 10 sept. 1986, modifiée et complétée par la loi n° 86-1322 du 31 déc. 1986 V. T. Renoux, L'indemnisation publique des victimes d'attentats, Economica, PUAM, 1988
* 2 Sur cette loi V. T. Renoux, L'indemnisation publique des victimes d'attentats, Economica, PUAM 1988.
* 1 Sur cette loi et le mécanisme d'indemnisation prévu V. J.-M. Pontier, L'indemnisation des victimes contaminées par le virus du Sida, ALD, 12 mars 1992, p. 35.
* 1 V. nos remarques in J-M Pontier, La prise en charge collective de l'aléa thérapeutique. L'État et les fonds de garanties, in L'indemnisation de l'aléa thérapeutique, sous la dir. de D. Truchet, Sirey 1994, p. 73 et s.
* 2 Le temps d'incubation de cette variante de la maladie de Creutzfeld-jakob peut être d'une dizaine, voire de plusieurs dizaines d'années, et, s'agissant de la Grande-Bretagne qui, semble-t-il, devrait être la plus touchée, la fourchette va de 2000 cas à 100 000.
* 3 Selon l'article L. 714-4 de ce code "le conseil d'administration délibère sur (...) 16°. Les actions judiciaires et les transactions".
* 4 Selon l'article 2044 du Code civil : "la transaction est un contrat pour lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître"
* 1 Sur cette loi v. R. Savatier, Responsabilité de l'État dans les accidents de vaccination obligatoire reconnus imparables, Mél. Waline, LGDJ 1974, LU, p. 751 et s.
* 1 Sur cette loi v. T. Renoux, L'indemnisation publique des victimes d'attentats, 1987 ; L'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, RFDA 1987 p. 909 ; v. également J-M. Pontier, Le législateur, l'assureur et la victime, RFDA 1986 p. 98.
* 2 Ainsi que le reconnaît, par exemple, le juge dans une affaire telle que CE Sect. 29 avr. 1987 cons. Yener et cons. Erez, Rec. 151, AJ 1987, p. 450, chron. M. Azibert et M. de Boisdeffre, D 1988, SC, p. 53, obs. F. Moderne et p. Bon, RFDA 1987, p. 643, concl. M. Fornacciari.
* 3 Sur cette loi v. J-M. Pontier, L'indemnisation des victimes contaminées par le virus du SIDA, ALD 12 mars 1992, p. 35 et s.
* 1 En revanche, l'inverse n'est pas vrai : les juridictions, en particulier administratives, tiennent compte, dans l'indemnisation des victimes, des sommes déjà perçues par ces dernières au titre du Fonds d'indemnisation créé par la loi.
* 2 R. Carré de Malberg, Du fondement du droit à la réparation intégrale pour les victimes de dommages de guerre, publications du CNARIDG, fax. H, juin 1915, p. 13 V. les commentaires de J.-M. Pontier in Les calamités publiques, op. cit.
* 3 V. sur ce point J.-M. Pontier, De la solidarité nationale, RDP 1983, p. 899 ; v. également le commentaire de l'alinéa 12, précité.
* 4 J.-M. Pontier, L'indemnisation des victimes contaminées par le virus du Sida, ALD 12 mars 1992, p. 35 ; V. également, plus largement, la bibliographie citée précédemment
* 1 Celui-ci étant à distinguer du risque-profit et du risque créé V. sur ce point p. Delvolvé, Le principe d'égalité devant les charges publiques, LGDJ 1969, § 439, p. 286.
* 2 V. J.-M. Pontier, Le législateur, l'assureur et la victime, RFDA 1986, p. 98 ; C. Guettier, Indemnisation des victimes de catastrophes naturelles et socialisation du risque, Rev. gén. du droit assurances, 1997, p. 672.
* 3 F. Ewald, Philosophies de l'indemnisation de l'aléa thérapeutique, précité, p. 35 et s., p. 39. Selon cet auteur c'est le point de vue qu'aurait soutenu le commissaire du Gouvernement dans l'affaire Bianchi, M. Combarnous.
* 1 Le cas des aéroports est bien connu, mais il y a eu aussi, par exemple, des demandes d'indemnisation à raison des dommages provoqués par la proximité d'une centrale nucléaire. Dans ce dernier cas le juge a accepté de réparer le préjudice résultant du bruit, mais non de la vue de la centrale et des panaches de fumée s'élevant de celle-ci. V. CE 2 oct. 1987, EDF c/ Mme Spire, Rec. 302, AJDA 1988, p. 239, obs. X. Prétot, CJEG 1987 p. 898, concl. E. Guillaume, note D. Delpirou V. également CE 5 avr. 1991, Épx Docquet-Chassaing, RDP 1991 p. 1444.
* 1 Les effets dangereux pour la santé de l'amiante ont été perçus assez tôt, les mesures d'interdiction de l'amiante et de "désamiantage" ont été prises tardivement.
* 2 Lorsqu'il y a, ce qui est fréquent, des "micro-climats". Mais cela vaut également pour une autoroute ou un barrage.
* 3 S'ils suppriment les émissions de plombs, on a relevé une augmentation très importante de la teneur en rhodium et en palladium dans l'atmosphère, sans que l'on puisse dire quels en seront les effets.
* 1 V. les ex. précis et intéressants donnés par L.-M. Boucraut, La réparation des atteintes aux biens dans le contentieux des responsabilités civile et administrative, Gaz. Pal. - Litec 1993.
* 1 On laisse ici de côté le problème de la date d'évaluation du préjudice, qui n'est plus aujourd'hui qu'un problème technique.
* 2 Ainsi, par exemple, dans le cas d'une victime, décédée depuis, ayant enduré "des douleurs importantes et subi un préjudice esthétique chiffré à 3 sur 7" et qui "souffrait de troubles moteurs et de difficultés dans les domaines urinaire et sexuel" le juge a apprécié l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence à la somme de 91469,41 E au sein de laquelle 3 048,98 constituent la part d'indemnité de caractère personnel (CAA Paris 3 e ch. CPAM, Mmes Cosse, Chopin, Merlin c/ Assitance publique - Hôpitaux de Paris 26 janv. 1999 req. n° 97 PA01823, 97 PA 02144, 97 PA 02232) tandis que dans une autre affaire l'indemnité pour souffrances endurées a été fixée à 1524,49 et les troubles dans les conditions d'existence à 19 818,37 (CAA Marseille 3 e ch. 18 janv. 1999, Département du Var, req. n° 96 MA 00773, 98 MA00905).
* 3 CAA Nancy 3e ch. 29 avr 1997, M. Claude Domenech c/ Centre hospitalier de Creil, req. n° 94 NC 00368, 95 NC 00488.
* 4 CAA Nantes 3e ch. 27 avr. 2000, Centre hospitalier de Vire c/ Mme Jacqueline Maouche, req. n° 96 NT00143, 97 NT 00512, 99 NT 02293.
* 5 CAA Nantes 2 e ch. 26 avr. 2000, M. Bruno Vah, M. Michel Vah, Mme Bernadette Vah c/ CPAM d'Indre-et-Loire et commune de Saint-Branchs, req. n° 97 NT 01433, 99 NT 00140, 99 NT 00173.
* 6 On a fait valoir quelquefois que si le montant de la réparation au titre de la douleur morale était faible il était compensé par les TCE pour lesquels le juge se serait montré plus généreux
* 7 À titre d'exemple, après le décès d'une victime suite à un incendie, le père de celle-ci a obtenu, au titre de la douleur morale, une somme de 15 244, 90, ses demi-frères ont obtenu chacun 3 811,23 et sa demi-soeur, âgée de 8 mois seulement au moment des faits, une somme de 762,25 (CE 29 déc. 1999, Communauté urbaine de Lille, req. n° 197502.
* 1 CEDH, 4 décembre 1995, RFDA 1996, p. 574 ; 30 octobre 1998 ; RDP 1999, p. 888, obs. C. Hugon. Sur les divers - et complexes - problèmes posés par la coexistence de ces différents acteurs et les divergences de jurisprudence enregistrées à ce propos devant les juridictions administratives, judiciaires et européennes, v. M. Dreifuss, "L'indemnisation des victimes du sida à l'épreuve du dualisme juridictionnel", RFDA 1996, p. 561 ; C Moniolle, "Responsabilité et indemnisation à l'égard des personnes contaminées par le virus du sida lors de transfusions sanguines", R.D. sanit. soc. 1999, p. 91 ; E. Savatier, "Le principe indemnitaire à l'épreuve des jurisprudences civile et administrative. À propos de l'indemnisation des victimes des transfusions sanguines", JCP 1999, I, 125 ; v. égal. obs. p. Bon et Ph. Terneyre, sous CE, avis, 15 octobre 1993, Cts Jézequel, D. 1994, somm., p. 359.
* 2 C. Guettier, Institutions administratives, Dalloz, coll. "Cours", 2000, § 11.
* 3 D'ailleurs, la réforme de la juridiction administrative par la loi du 31 décembre 1987, en créant notamment les cours administratives d'appel, n'allait pas dans le sens d'une abolition à court terme du dualisme de juridiction dans le contentieux de la responsabilité de la puissance publique.
* 1 CC, décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence, Rec., p. 8 ; L. Favoreu et L. Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 9 ème éd., Dalloz, 1997, n° 41 ; M. Long et autres, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative (GAJA), 12 ème éd., Dalloz, 1999, n° 103.
* 2 J. Chevallier, "Du principe de séparation au principe de dualité", RFDA 1990, p. 712 ; du même auteur, L'élaboration historique du principe de séparation de la juridiction administrative et de l'administration active, 1968.
* 1 Leb., 1 er supplément, p. 61, concl. David ; GAJA n° 1 ; J.-F. Lachaume, Les grandes décisions de la jurisprudence. Droit administratif, 12 ème éd., PUF, coll. "Thémis", 1999, p. 16.
* 2 Déjà, en 1855, le Conseil d'État, agissant comme juge des conflits de compétence, avait considéré que les rapports, droits et obligations résultant du fonctionnement des services publics de l'État ne pouvaient "être réglés selon les principes et les dispositions du seul droit civil ", en ajoutant que seuls l'administration et le juge administratif devaient en apprécier les conditions et la nature ; v. CE confl., 6 décembre 1855, Rotschild, Leb., p. 705.
* 3 J. Chevallier, L'État, Dalloz, coll. " Connaissance du droit ", 1999, p. 18
* 1 C. Guettier, "Responsabilité et droit administratif", in Droit de la responsabilité et des contrats, par Ph. le Tourneau et L. Cadiet, Dalloz Action, 2000/2001, n° 215. V. égal. : CE, 6 octobre 2000, ministre de l'intérieur c/ Commune de Saint-Florent et autres, Petites Affiches 2001, n° 132, p. 15, note C. Guettier : " Considérant que les carences de l'État dans l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locales prévu par les dispositions (...) de la loi du 2 mars 1982 ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'État que si elles constituent une faute lourde ".
* 2 C. Guettier, " Responsabilité administrative et responsabilité civile : destins croisés ", Rev. Responsabilité civile et Assurances, n° Hors-série, 2001, p. 30 et s., notam. p. 32.
* 1 R. Chapus, Droit administratif général, tome 1, 15 ème éd., Montchrestien, 2001, n° 1408.
* 2 Par ex., la servitude de passage le long du littoral de l'art. L. 160-7 du Code de l'urbanisme.
* 3 F. Sudre, Droit international et européen des droits de l'homme, 3 ème éd., PUF, 1997, n° 170 et s.
* 4 CE, sect., 3 juillet 1998, Bitouzet, CJEG 1998, p. 441, concl. R. Abraham ; AJDA 1998, p. 570, chron. F. Raynaud et p. Fombeur ; RFDA 1999, p. 841, note D. de Béchillon.
* 1 R. Hostiou, " La non-indemnisation des servitudes d'urbanisme", AJDA, 1993, n° spécial, p. 27 et s., notam. p. 29 et biblio. citée note 20.
* 2 C. Guettier, "Responsabilité et droit administratif", in Droit de la responsabilité et des contrats, par Ph. le Tourneau et L. Cadiet, Dalloz Action, 2000/2001, n° 224 et s.
* 1 V., par ex., R. Odent, Contentieux administratif, Les cours de droit, fasc. IV ; A. de Laubadère, J .-C. Venezia et Y. Gaudemet, Traité de droit administratif, LGDJ, 1984, p. 744 ; M. Rougevin-Baville, "Responsabilité sans faute", in Rép. Dalloz de Responsabilité de la puissance publique, n° 289 et s.
* 2 V. C. Guettier, " Responsabilité et droit administratif", in Droit de la responsabilité et des contrats, par Ph. le Tourneau et L. Cadiet, Dalloz Action, 2000/2001, n° 126.
* 1 R. Chapus, Droit administratif général, t. 1, 15 ème éd., Montchrestien, 2001, n° 1506 et s.
* 2 L. Richer, La faute du service public, Economica, 1978 ; M. Paillet, La faute du service public en droit administratif français, LGDJ, BDP, t. 136, 1980.
* 3 La formule "faute du service public" apparaît en 1904 (CE, 1 er juillet 1904, Nivaggioni, Leb., p. 536) ; elle sera reprise l'année suivante dans un arrêt remarqué car était en cause un service de police (CE, 10 février 1905 Tomaso Grecco, Leb., p. 139, concl. Romieu ; GAJA n°15).
* 4 TC, 30 juillet 1873, Pelletier, Leb., p. 117, concl. David ; GAJA n° 2.
* 1 V., par ex., R. Chapus, Responsabilité publique et responsabilité privée. Les influences réciproques des jurisprudences administrative et judiciaire, LGDJ, 1954 ; C. Eisenmann, "Sur le degré d'originalité du régime de la responsabilité extra-contractuelle des personnes publiques", JCP 1949, I, 742.
* 2 A. de Laubadère, "Le problème de la responsabilité du fait des choses en droit administratif français", Études et Documents du Conseil d'État, 1959, n° 13, p. 29 ; C. Guettier, "Un principe général de responsabilité du fait des choses est-il réellement nécessaire ? Le point de vue du publiciste ", in La responsabilité du fait des choses. Réflexions autour d'un centenaire, sous la direction de F. Leduc, Economica, 1997, p. 121 ; C. Guettier, " Responsabilité et droit administratif", in Droit de lu responsabilité et des contrats, par Ph. le Tourneau et L. Cadiet, Dalloz Action, 2000/2001, n° 145 et s.
* 3 p. Delvolvé, " La responsabilité du fait d'autrui en droit administratif", Mélanges G. Marty, Université des sciences sociales de Toulouse, 1978, p. 407 ; C. Guettier, note sous CE, sect., 5 décembre 1997, ministre de la Justice c/ M. Pelle, RFDA 1998, p. 575.
* 4 R. Chapus, Droit administratif général, tome I, 15 ème éd., Montchrestien, 2001, n° 1532 ; C. Guettier, Droit administratif 2 ème éd., Montchrestien, coll. " Focus Droit ", 2000, p. 76.
* 5 CE, ass., 18 novembre 1949, Dlle Mimeur, Leb., p. 492 ; GAJA n° 70.
* 6 CE, ass., 18 novembre 1949, Dlle Mimeur, précit.
* 7 CE, ass., 26 octobre 1973, Sadoudi, Leb., p. 603.
* 1 C. Guettier, "Responsabilité et droit administratif", in Droit de la responsabilité et des contrats, par Ph. le Tourneau et L. Cadiet, Dalloz Action, 2000/2001, n° 151 et s. ; C. Guettier, " Existe-t-il une responsabilité administrative du fait d'autrui ? ", Rev. Responsabilité civile et Assurances, n° Hors Série, nov. 2000, p. 41.
* 2 V. M. Paillet, "Vers un renouveau des sources de la responsabilité administrative en droit français", in Mélanges J.-M. Auby, Dalloz, 1992, p. 260.
* 3 V. la position de principe du Conseil d'État et du Tribunal des conflits respectivement dans les décisions Rotschild (1855) et Blanco (1873) préc.
* 4 Pour des raisons de bonne administration de la justice ou encore de simple opportunité voire sans raison apparente, la compétence administrative a ainsi été remise en cause partiellement. V., par ex., loi du 5 avril 1937 sur la responsabilité civile des membres de l'enseignement public ; loi du 31 décembre 1957 sur les accidents de véhicules ; art. 17, loi du 30 octobre 1968 (modifiée) relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ; art. 38 de la loi du 20 décembre 1988 et art. 46 de la loi du 23 janvier 1990 sur les préjudices résultant de recherches biomédicales effectuées dans des institutions publiques ; v. égal. C. Bréchon-Moulènes, "Régimes législatifs spéciaux d'indemnisation relevant de la juridiction judiciaire", in Rép. Dalloz, Responsabilité de la puissance publique.
* 1 En l'espèce, un bloc de compétence au profit du juge judiciaire a même été constitué. En effet, celui-ci est désormais seul compétent pour statuer sur les conséquences dommageables de l'ensemble des irrégularités entachant une mesure de placement d'office quelle qu'en soit la nature, et ce, même si l'illégalité a affecté la régularité formelle de la décision, et a donc été constatée par le juge administratif, v. TC, 17 février 1997, Préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, Dr. adm. 1997, n° 138, note M. Paillet ; v. égal. C. Guettier, " Responsabilité et droit administratif", in Droit de la responsabilité et des contrats, par Ph. le Tourneau et L. Cadiet, Dalloz Action, 2000/2001, n° 367. Pour d'autres exemples, C. Guettier, ibid., n° 368 et s.
* 2 CE, sect., 13 octobre 1978, Association départementale pour l'aménagement des structures agricoles du Rhône, Leb., p. 368 ; RDP 1979, p. 908, concl. Galabert et p. 899, n. J. Robert ; AJDA 1979, I, p. 22, chron. O. Dutheillet de Lamothe et Y. Robineau ; D. 78, IR, 481, obs. p. Delvolvé ; D. 1979, p. 249, note p. Amselek et J. Waline ; TC, 6 novembre 1978, Bernardi c/ Association hospitalière Sainte-Marie, Leb., p. 652 ; TC, 25 janvier 1982, Mme Cailloux c/ CONSUEL, Leb., p. 449, concl. D. Labetoulle ; CE, 23 mars 1983, SA Bureau Veritas, Leb., p. 134 ; D. 1984, IR, 345, obs. F. Moderne et p. Bon.
* 1 Laferrière présente le "travail public" comme "le véritable auteur du dommage", qu'il ait été exécuté par l'administration ou par un entrepreneur ; v. Traité de la juridiction administrative, t. 2, 2 ème éd., 1887, p. 159.
* 2 C. Guettier, "Responsabilité et droit administratif", in Droit de la responsabilité et des contrats, par Ph. le Tourneau et L. Cadiet, Dalloz Action, 2000/2001, n° 142.
* 3 De même, le Conseil d'État a jugé que l'action oblique, prévue par les dispositions de l'article 1166 du Code civil, peut éventuellement fonder une action contre l'État à raison d'un engagement que celui-ci se serait abstenu de tenir vis-à-vis de l'employeur du requérant ; v. CE, 20 octobre 2000 , M. Perreau, req. n° 192851, Petites Affiches 2001, n° 132, p. 22, obs. C. Guettier : le salarié d'une société demandait à ce que l'État soit condamné à lui payer une somme d'argent au titre des indemnités prévues par un accord d'entreprise, à la suite de son licenciement par son employeur.
* 1 En effet, la juridiction administrative étant'apparue comme plus restrictive à l'égard des victimes que les juges judiciaires, le législateur décida alors de transférer à l'ordre judiciaire tout le contentieux des dommages occasionnés par des véhicules ; v. C. Debbasch, Droit administratif, 6 ème éd., Economica, 2002, p. 558.
* 2 Jusqu'à l'intervention de cette loi, la compétence des tribunaux judiciaires en matière de dommages causés par un véhicule appartenant à une personne publique ou utilisé pour un usage administratif obéissait aux règles générales. En effet, la juridiction judiciaire pouvait déjà intervenir dans deux hypothèses : d'une part, lorsque l'action était exercée contre l'agent administratif auteur du dommage, cet agent ayant commis une faute personnelle ; d'autre part, lorsque le service public dans l'exécution duquel s'était produit le dommage était soumis en principe à un régime juridique de droit privé, ce qui justifiait alors la compétence judiciaire en matière de responsabilité (comme, par ex., à propos des services publics industriels et commerciaux). Dans les autres cas, en revanche, la compétence appartenait à la juridiction administrative.
* 3 TC, 1 er juillet 1988, CPAM de Saône-et-Loire, Dr. adm. 1988, n° 484.
* 4 CE, 18 novembre 1994, M et Mme Sauvi, AJDA 1995, p. 253, obs. X. Prétot.
* 5 R. Drago, " Le juge judiciaire, juge administratif", RFDA 1990, p. 757.
* 6 En application de la jurisprudence Préfet de la Guyane (TC, 27 novembre 1952, Leb., p. 642 ; JCP 1953, II, 7598, note G. Vedel ; GAJA n° 78), les litiges relatifs à l'organisation même du service public de la justice judiciaire relèvent de la compétence du juge administratif tandis que le juge judiciaire est compétent pour ceux relatifs à son fonctionnement.
* 7 Cass. 2 ème civ., 23 novembre 1956, Trésor public c/ Giry, Bull, civ., II, n° 407 ; AJDA 1957, 2, p. 91, chron. J. Fournier et G. Braibant ; D. 1957, p. 34, concl. Lemoine ; JCP 1956, II, 9681, note p. Esmein ; RDP 1958, p. 298, note M. Waline ; GAJA n° 85.
* 1 Par référence à la jurisprudence administrative issue de l'arrêt Commune de Saint-Priest-la-Plaine (CE, ass., 22 novembre 1946, GAJA n° 64). Pour une extension de cette jurisprudence par la Cour de cassation à un collaborateur potentiel du service public de la justice judiciaire, et non plus seulement à un collaborateur " requis ", comme dans l'affaire Giry (précit.), v. Cass., l ère civ., 30 janvier 1996, Morand c/ Agent judiciaire du Trésor, RFDA 1997, p. 1301, note p. Bon (sur l'épilogue de cette affaire, v. CA Paris, 3 décembre 1997, Morand cf Agent judiciaire du Trésor, RFDA 1999, p. 399, obs. p. Bon).
* 1 CE, Ass., 9 avril 1993, Bianchi, Leb., p. 127, concl. S. Daël.
* 1 p. Delvolvé, " Paradoxes du (ou paradoxes sur le) principe de séparation des autorités administrative et judiciaire ", Mélanges René Chapus, Montchrestien, 1992, p. 145.
* 1 R. Chapus, "Dualité de juridictions et unité de l'ordre juridique", RFDA 1990, p. 743.
* 2 Cass., ass. plén., 29 mars 1991, Association des centres éducatifs du Limousin c/ Consorts Blieck, JCP 1991, II, 21673, concl. D.-H. Dontenwille, note J. Ghestin ; D. 1991, J., p. 324, note C. Larroumet ; Gaz. Pal. 1992, 2, J., p. 513, note F. Chabas ; Defrénois 1991, p. 729, note J -L. Aubert ; RTD civ. 1991, 541, note p. Jourdain ; Resp. civ. et assurances, avril 1991, n° 9, chron. H. Groutel : un jeune handicapé mental, placé dans un centre d'aide par le travail, géré par une association, met le feu à une forêt ; l'Assemblée plénière, opérant un revirement de la jurisprudence civile, décide que l'association doit répondre des agissements du handicapé sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1 er , du Code civil. V. égal. G. Viney, "Vers un élargissement de la catégorie des "personnes dont on doit répondre" : la porte entrouverte sur une nouvelle interprétation de l'article 1384, al. 1 er , du Code civil", D. 1991, chron., p. 157.
* 1 Leb., p. 341.
* 2 Comme le juge administratif qui l'a devancé, le juge civil admet aussi parfois la responsabilité pour "défaut d'organisation ou de fonctionnement" d'une personne morale, et retient une " faute " de cette dernière lorsqu'il constate qu'un défaut de structure a permis la réalisation d'un dommage alors même que, dans sa sphère d'activité, chacun des individus ayant agi pour le compte de l'entreprise a rempli ses obligations. Pour une application récente en droit civil, v. Cass., l ère civ., 15 décembre 1999, SA Clinique générale d'Annecy ci S., Bull. civ., 1, n° 351 ; JCP 2000, I, 241, chron. G. Viney.
* 3 Cass., ass. plén., 25 février 2000, Costedoat c/ Girard et autres, JCP 2000, II, 10295, concl. R. Kessous, note M. Billiau ; Resp. civ. et assurances, mai 2000, chron. n° 11, par H. Groutel ; JCP 2000, I, 241, chron. G. Viney ; Dr. et patrimoine, mai 2000, p. 107, obs. F. Chabas ; D. 2000, J., p. 673, note Ph. Brun.
* 4 La faute personnelle d'un agent public peut engager la responsabilité de l'administration dès lors qu'elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service ; v. C. Guettier, Droit administratif, 2 ème éd., Montchrestien, coll. "Focus Droit", 2000, p. 76.
* 1 CE, ass., 24 novembre 1961, Letisserand, Leb., p. 661 ; GAJA n° 90. Alors que les tribunaux judiciaires procédaient à cette évaluation depuis longtemps, le Conseil d'État s'est opposé à la réparation des souffrances physiques et de la douleur morale, considérées comme " in susceptibles d'évaluation pécuniaire ". Il est d'abord revenu sur ce refus en ce qui concerne les souffrances physiques, mais en subordonnant l'indemnisation à leur caractère d'exceptionnelle gravité (CE, 24 avril 1942, Morell, Leb., p. 136). L'exigence a été abandonnée à compter de l'arrêt Commune de Grigny de 1958 (CE, sect., 6 juin 1958, Commune de Grigny, Leb., p. 322). En revanche, le Conseil d'État est resté plus longtemps attaché à son refus intéressant la douleur morale, parce qu'à la considération de l'inévaluabilité pécuniaire s'ajoutait celle (inexprimée) que les "larmes ne se monnaient pas", c'est-à-dire qu'il est immoral de tirer profit de l'atteinte aux sentiments d'affection. En dépit des critiques d'une doctrine presque unanime, il devait, contrairement aux conclusions du commissaire du gouvernement, confirmer solennellement son refus en 1954 (CE, ass., 29 octobre 1954, Bondurand, Leb., p. 565 ; D. 1954, p. 767, concl. L. Fougère, note A. de Laubadère). Il s'est enfin résigné à modifier sa façon de voir en 1961, à l'occasion de l'affaire Letisserand (précit.) . Toutefois, ultérieurement, sa position initiale a continué à se manifester plusieurs années durant par une sous-évaluation de la douleur morale.
* 2 CE, sect., 29 mars 2000, Assistance publique - Hôpitaux de Paris, D. 2000, J., p. 563, note A ; Bourrel ; JCP 2000, II, 10360, note A. Derrien ; CE, 27 octobre 2000, Assistance publique - Hôpitaux de Paris, Petites Affiches 2001, n° 132, p. 19, obs. C. Guettier.
* 1 Cass., ch. mixte, 30 avril 1976, Époux Wattelet c/ Petitcorps et Cts Goubeaux c/ Alizan, D. 1977, J., p. 185, note M. Contamine-Raynaud ; RTD civ. 1976, p. 556, note G. Durry : est admise la transmissibilité du droit à réparation tant du pretium doloris que du pretium affectionis. Toutefois, dans un premier temps, des divergences sont apparues entre la Chambre civile de la Cour de cassation, qui avait admis la patrimonialisation dès 1943 (Cass., civ., 18 janvier 1943, Charpin c/ Vve Le Bardonnet, D. 1943, J., p. 45, note L. Mazeaud), et la Chambre criminelle qui s'y opposait (Cass. Crim., 24 avril 1958, Bull. crim. n° 341 ; 28 janvier 1960, Cts Le Dantec, D. 1960, J., p. 574).
* 2 CE, 29 janvier 1971, Association "Jeunesse et reconstruction ", Leb., p. 81 ; AJDA 1971, p. 279, chron. D. Labetoulle et p. Cabanes ; RDP 1971, p. 1473, note M. Waline : le préjudice subi par une personne, en raison de ses souffrances, ne peut, " en l'absence de toute action introduite par elle avant son décès, ouvrir droit à réparation au profit des ayants droit ".
* 3 V., par ex., CAA Nantes, 22 février 1989, Centre hospitalier régional d'Orléans c/ Fichon, Leb., p. 300 ; AJDA 1989, p. 276, note J. Arrighi de Casanova ; CAA Paris, 20 juin 1989, Mme Viroulet, Leb., p. 322 ; Petites Affiches 1989, n° 15, p. 15, concl. J. Arrighi de Casanova ; CAA Bordeaux, 1 er août 1995, Cts Dupouy, Leb., T., p. 1035 ; CAA Paris, 12 février 1998, Cts Peltier, AJDA 1998, p. 234, obs. M. Heers.
* 4 Cass., 10 avril 1922, Compagnie générale des omnibus c/ Veuve Sanson, S. 1924, 1, p. 153, note p. Esmein.
* 5 CE, 17 juillet 1950, Mouret, Leb., p. 447.
* 6 Cass. Civ., 24 novembre 1942, Gaz. Pal. 1943, 1, p. 50.
* 7 Y. Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel. Systèmes d'indemnisation, 3 ème éd., Précis Dalloz, 1996, n° 159.
* 8 R. Savatier, "Le dommage mortel et ses conséquences au point de vue de la responsabilité civile", RTD civ. 1938, p. 187, n°7.
* 9 Cass. Req., 3 mars 1937, S. 1937, 1, p. 241.
* 10 Le Conseil d'État avait déjà consacré cette solution à propos du préjudice d'affection : CE, 9 juillet 1969, Consorts Gojat, Leb., p. 37! ; 2 juillet 1971, SNCF c/ Époux Le Piver, Leb.,
* 1 R. Savatier, op. cit.
* 2 V. les conclusions du commissaire du Gouvernement D. Chauvaux sur cette affaire Assistance publique - Hôpitaux de Paris c/ Consorts Jacquié, RFDA 2000, p. 850.
* 3 V., par ex., Y. Chartier, "La réparation du préjudice", D. 1996, chron., p. 74-75 ; Y. Lambert-Faivre, " Le droit du dommage corporel ", D. 1990, chron., p. 174 p. 505. Cette solution permet aux héritiers de ne pas subir les lenteurs de la justice et de ne pas être privés de l'indemnité qu'aurait touchée la victime - et qui serait ensuite entrée dans leur patrimoine - si elle était décédée après le jugement.
* 1 CE, sect., 5 juillet 2000, ministre de l'équipement, des transports et du logement c/ M. Chevallier, AJDA 2000, p. 857 et p. 800, chron. M. Guyomar et p. Collin ; RDP 2001, p. 382, obs. C. Guettier.
* 2 R. Chapus, Droit administratif général, tome 2, 15 ème éd., Montchrestien, 2001, n° 531.
* 3 CE, 15 mai 1987, Delval, Leb., p. 728 ; Dr. adm. 1987, n° 414.
* 1 V. notam. H. Mazeaud, " En attendant l'arrêt des Chambres réunies : garde matérielle et garde juridique ", D.H. 1937, chron., p. 45.
* 2 Ch. réunies, 2 décembre 1941, D.C. 1942, p. 25, note G. Ripert.
* 3 G. Viney et p. Jourdain, Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité, 2 ème éd., LGDJ, 1998, n° 687.
* 4 CE, sect., 5 janvier 2000, Cts Telle c/ Hospices civils de Lyon et Assistance publique-Hôpitaux de Paris cf Guilbot (2 arrêts), RFDA 2000, p. 641, concl. D. Chauvaux et p. 654, note p. Bon ; RDP 2001, p. 412, obs. C. Guettier.
* 1 Selon le premier alinéa duquel, " le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il propose " ; v. égal. art. L. 710-2 du Code de la santé publique selon lequel, " dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens des établissements (de santé publics ou privés) assurent l'information des personnes soignées ".
* 2 V., par ex., Cass., l ère civ., 19 avril 1988, Bull. civ. I, n° 107 ;Cass., l ère civ., 3 janvier 1991, Bull. civ., I, n°5.
* 3 V. CE, sect, 14 février 1997, CHR de Nice, Leb., p. 44, concl. V. Pécresse ; JCP 1997, II, 22828, note J. Moreau.
* 4 Cass., l ère civ., 7 octobre 1998 (2 arrêts), Bull, civ., 1, n° 287, p. 199 et n° 291, p. 202 ; JCP 1998, II, 10179, concl. J. Sainte-Rose, note p. Sargos ; RTD civ. 1999, p. 111, obs. p. Jourdain ; JCP 1999, 1, 147, obs. G. Viney ; v. égal., dans le même sens, Cass., l ère civ., 15 juillet 1999, D. 1999, Somm., p. 393, obs. J. Penneau.
* 5 L'arrêt Guilbot du 9 juin 1998 de l'assemblée plénière de la Cour administrative d'appel de Paris avait anticipé ce revirement de jurisprudence ; RFDA 2000, p. 636, concl. E, Corouge.
* 1 Cass., l ère civ., 25 février 1997, Hédreu, Bull, civ., I, n° 75, p. 49 ; Gaz. Pal. 1997, J., p. 274, rapport p. Sargos et note J. Guigue ; RTD civ. 1997, p. 434, obs. p. Jourdain ; Defrénois 1997, p. 751, obs. J.-L. Aubert ; JCP 1997, I, 4025, obs. G. Viney ; RD san. et soc. 1997, p. 288, note L. Dubouis ; Rev. gén. des assur. 1997, p. 852, obs. Ph. Rémy.
* 2 La preuve de cette information peut être faite "par tous moyens", notamment par un "ensemble de présomptions au sens de l'article 1353 du Code civil" ; v. Cass., l ère civ., 14 octobre 1997, Guyomar c/ Lelay, Bull. civ. 1, n° 278, p. 188 ; JCP 1997, II, 22942, rapport p. Sargos ; JCP 1997, I, 4068, chron. G. Viney. Mais, le devoir d'information n'entraîne pas celui de convaincre du risque révélé ; v. Cass., l ère civ., 18 janvier 2000, Laurent c/ Sanchez, JCP 2000, I, 243, n° 25, chron. G. Viney.
* 3 En vérité, comme l'observe le Professeur Maryse Deguergue, la "perte de chance" existe depuis longtemps dans les sentences du juge administratif. En fait, l'occultation relative de ce chef de préjudice indemnisable devant le juge administratif peut s'expliquer notamment par l'ordre de considération suivant : " par sa communauté d'esprit et son identité phénoménologique avec la perte de chance en droit privé, ce préjudice particulier dessert la thèse de l'autonomie de la responsabilité administrative, chère à la doctrine publiciste" ; M. Deguergue, " La perte de chance en droit administratif", in L'égalité des chances, sous la direction de G. Koubi et G. Guglielmi, La découverte, 2000, p. 197.
* 4 V., par ex., CE, 17 février 1988, Centre hospitalier régional de Nancy, req. n° 71974, et CE, 19 mars 1997, M. Meynial et Mme Girard, req. n° 147173, arrêts cités par J. Guigue et C. Esper, Gaz. Pal. 1997, p. 1352. Certes, une réparation intégrale du préjudice était généreuse pour la victime. Mais elle était exagérément simplificatrice du point de vue de l'analyse du lien de causalité car elle postulait que, si le malade avait été informé des risques de l'opération, il l'aurait refusée de telle sorte que le défaut d'information était considéré comme la cause directe du dommage subi alors qu'en pratique la situation peut être beaucoup plus complexe.
* 5 J. Moreau dans sa note précitée au JCP 2000, II, 10271, signale cependant un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 9 juillet 1991 qui a consacré cette solution.
* 1 V. notam. Cass., l ère civ., 17 novembre 1969, JCP 1970, II, 16507, note R. Savatier ; 7 février 1990, Bull, civ., I, n° 39 ; D. 1991, Somm., p. 183, obs. J. Penneau ; 16 juillet 1991, Bull, civ., I, n° 248. En effet, le médecin doit expliquer au malade les risques qu'il y a à intervenir et ceux qu'il y a à ne pas intervenir. S'il ne défère pas à l'obligation d'information, il ne permet pas au malade de choisir entre l'acceptation et le refus de l'intervention et, dans le cas où cette dernière poserait un problème, prive le malade de la chance d'avoir refusé l'acte dommageable.
* 2 S'agissant des conséquences de l'appel à la notion de "perte de chance" sur l'ampleur de la réparation, le Conseil d'État a apporté une précision intéressante : il ne se contente pas en effet d'affirmer que la "perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis", il ajoute que cette fraction doit être calculée en tenant compte " du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention et, d'autre part, ceux qui étaient encourus en cas de renoncement à ce traitement " (pour une application de cette méthode de calcul, v. arrêt Telle, précit.). Le Conseil d'État propose ainsi aux juges du fond de moduler l'indemnisation pour perte d'une chance en fonction du caractère plus ou moins nécessaire de l'opération.
* 1 Les facteurs temps et espace rendent parfois difficile la recherche de l'auteur du dommage. Ce qui peut être le cas, entre autres, pour certains artisans (électriciens, plombiers, chauffagistes), qui ont pu être en contact occasionnellement avec de l'amiante dans le cadre de leur activité professionnelle.
* 2 La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (art. 40) a également amélioré les conditions dans lesquelles peuvent être reconnues les maladies professionnelles liées à l'amiante en prévoyant une levée de la forclusion jusqu'au 27 décembre 2001 (ce délai résulte de l'article 35 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000) pour l'ensemble des maladies liées à l'amiante constatées depuis le 1 er janvier 1947, alors que le principe est que la déclaration d'une maladie professionnelle par les victimes doit intervenir deux ans au plus après que le diagnostic de l'affection a été établi.
* 3 J. Hardy, "La création d'un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante", JCP 2001, Ed. Entreprise et Affaires, n° 14, p. 605 ; v. égal. C. Guettier, "L'État face aux contaminations liées à l'amiante", AJDA 2001, p. 529.
* 4 JO 24 décembre 2000, p. 20558.
* 5 Il peut s'agir soit de travailleurs relevant du régime général de sécurité sociale, soit de fonctionnaires sous statut relevant du Code des pensions civiles et militaires d'invalidité.
* 6 Cette formule très large permet de recouvrir, d'une part, les personnes atteintes par l'amiante pour un motif professionnel mais qui ne relèvent ni du régime général de sécurité sociale ni du Code des pensions (artisans non affiliés volontairement à la branche accidents du travail -maladies professionnelles du régime général), d'autre part, les personnes victimes de l'amiante dans un environnement non professionnel (usagers d'un service public, etc.), ainsi que les personnes de nationalité étrangère qui auraient été exposées à l'amiante durant un séjour en France.
* 1 Ce fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a fait l'objet du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, JO 24 octobre 2001, p. 16741.
* 2 CE, ass., 9 avril 1993, Bianchi, Leb., 127, concl. S. Daël ; AJDA 1993, p. 344, chron. C. Maugüé et L. Touvet ; JCP 1993, II, 22061, note J. Moreau ; RDP 1993, p. 1099, note M. Paillet ; D. 1994, Somm., p. 65, obs. p. Bon et Ph. Terneyre.
* 3 CE, sect., 3 novembre 1997, Hôpital Joseph Imbert d'Arles, RFDA 1998, p. 90, concl. V. Pécresse ; AJDA 1997, p. 959, chron. T.-X. Girardot et F. Raynaud ; JCP 1998, II, 10016, note J. Moreau ; RDP 1998, p. 891, note J.-M. Auby.
* 4 Comme, par exemple, une anesthésie pratiquée lors d'une intervention, même dépourvue de fin thérapeutique, tel qu'une circoncision motivée par des raisons religieuses ; v. l'arrêt Hôpital Joseph Imbert d'Arles, précit.
* 5 L'accident médical pourrait peut-être correspondre à la survenance d'un " cas fortuit ". Mais on sait qu'en droit administratif celui-ci n'est de toute façon pas exonératoire lorsque le défendeur encourt une responsabilité sans faute.
* 1 V. Cass., l ère civ., 8 novembre 2000, JCP 2001, I, 340, chron. G. Viney ; D. 2001, SC, p. 2236, obs. D. Mazeaud ; v. égal. C. Larroumet, "L'indemnisation de l'aléa thérapeutique", D. 1999, Chron., p. 33 ; p. Sargos, "L'aléa thérapeutique devant le juge judiciaire", JCP 2000, éd. G., I, 202 ; G. Viney et p. Jourdain, "L'indemnisation des accidents médicaux : que peut faire la Cour de cassation ?", JCP 1997, I, 4016.
* 2 Cass., l ère civ., 20 mai 1936, Dr Nicolas c/ Époux Mercier, D. p. 1936, 1, p. 88, concl. Matter, rapp. Josserand et note E. P.
* 3 Cass., l ère civ., 12 avril 1995, JCP 1995, II, 22467, note p. Jourdain ; Dr. et patr. janv. 1996, p. 97, obs. F. Chabas.
* 4 Cass., l ère civ., 15 novembre 1988, Gaz. Pal. 1989, 1, Panor. Cass, p. 12 ; Bull. civ. 1, n° 319 ; Cass, 1 ère civ., 17 octobre 1995, Dr. et patr. Mai 1996, n° 1352, obs. F. Chabas ; CA Paris, 10 décembre 1999, D. 2000, IR, p. 37.
* 5 Cass., l ère civ., 29 juin 1999 (3 espèces), JCP 1999, II, 10138, rapp. p. Sargos ; D. 1999, J, p. 559, note D. Thouvenin ; RTD civ. 1999, p. 841, obs. p. Jourdain ; Dr. et patr. oct. 1999, p. 107, obs. F. Chabas ; Defrénois 1999, p. 994, obs. D. Mazeaud ; D. 1999, Somm, p. 395, obs. J. Penneau.
* 6 Cass., l ère civ., 9 novembre 1999, Dr. et patr. 2000, p. 97, n° 2496, obs. F. Chabas ; D. 2000, J, p. 117, note p. Jourdain. En outre, plus récemment, la Cour de cassation a jugé que le contrat d'hospitalisation et de soins liant un patient à un établissement de santé privé met à la charge de ce dernier, sans préjudice de son recours en garantie, une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les produits, tels les médicaments, qu'il fournit ; v. Cass, l ère civ, 7 novembre 2000, D. 2001, SC, p. 2236, obs. D. Mazeaud : à propos de brûlures occasionnées par des produits désinfectants appliqués à un patient lors d'une intervention chirurgicale.
* 1 Pour des applications positives récentes de la jurisprudence Blanchi, v. CE, 27 octobre 2000, Centre hospitalier de Seclin et Centre hospitalier d'Aubagne (2 arrêts), Petites Affiches 2001, n° 132, p. 18, obs. C. Guettier.
* 2 L'indemnisation des accidents médicaux a fait l'objet en France de nombreuses initiatives législatives depuis plusieurs années. Aucune n'a abouti à ce jour. Peut-être en ira-t-il différemment du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dont l'un des titres est précisément relatif à la "réparation des risques sanitaires" ; v. projet de loi n° 3258 (2001).
* 3 V. respectivement CE, 27 septembre 1989, Mme K... c/ CPAM de la Marne, Leb., p. 176 ; Gaz. Pal. 1990, 2, p. 421, concl. Fornacciari ; AJDA 1989, p. 776, chron. E. Honorat et E. Baptiste ; RFDA 1991, p. 325, note R. Deswarte ; D. 1990, Somm., p. 298, obs. p. Bon et Ph. Terneyre, et Cass., l ère civ., 26 mars 1996, Bull. civ. I, n° 155 ; RTD civ. 1996, p. 623, obs. p. Jourdain ; JCP 1996, I, 3985, obs. G. Viney ; D. 1997, J., p. 35, note J. Roche-Dahan et Somm. p. 322, obs. J. Penneau.
* 4 V. CE, ass., 2 juillet 1982, Dlle R., Leb., p. 260 ; Gaz. Pal. 1983, 1, p. 193, note F. Moderne ; D. 1984, J., p. 425, note J.-B. d'Onorio ; Cass. l ère civ., 25 juin 1991, Bull. civ. I, n° 213 ; D. 1991, J., p. 566, note Ph. le Tourneau.
* 1 CE, sect., 14 février 1997, CHR de Nice c/ Époux Quarez, Leb., p. 44, concl. V. Pécresse ; RFDA 1997, p. 382, note B. Mathieu ; AJDA 1997, p. 430, chron. D. Chauvaux et T.-X. Girardot ; JCP 1997, II, 22828, note J. Moreau ; RDP 1997, p. 1139, note J.-M. Auby et J. Waline ; D. 1997, Somm., p. 322, obs. J. Penneau.
* 2 Cass., l ère civ., 26 mars 1996, Époux Z ... c/ Y... et autres, D. 1997, J., p. 36, note J. Roche-Dahan.
* 3 La Cour de cassation avait solennellement fait droit à une demande de réparation étroitement comparable à celle des époux Quarez à l'occasion d'un arrêt du 26 mars 1996 (Cass., l ère civ., 26 mars 1996, Époux Z... c/ Y... et autres, D. 1997, J., p. 36, note J. Roche-Dahan), solution rappelée dans un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation rendu le 17 novembre 2000, à propos de l'affaire Perruche abondamment commentée (v. notam. D. 2001, J, p. 332, note D. Mazeaud et p. 336, note p. Jourdain) et confirmée depuis (v. Cass., ass. plén., 28 novembre 2001, req. n° 00-14.248 : indemnisation d'un jeune enfant atteint d'une trisomie 21 qui n'avait pas été détectée pendant la grossesse de sa mère à la suite d'une faute médicale ; le préjudice de l'enfant n'étant pas constitué par une perte de chance mais par son handicap, la réparation de ce préjudice doit être intégrale. Entre temps, par trois arrêts du 13 juillet 2001, la Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de réaffirmer le " principe " selon lequel l'enfant né avec un handicap devait être indemnisé dès lors qu'en raison d'une faute médicale sa mère n'a pu recourir à l'avortement afin d'éviter sa naissance, sous réserve cependant que, lorsque la mère n'a pu avorter pour un motif dit "thérapeutique" (désormais " médical " depuis la loi n° 2001 -588 du 4 juillet 2001 ), les conditions prescrites à cet effet par la loi (art. L. 2213-1 du Code de la santé publique) soient réunies.
* 1 L'attendu principal de cette décision rendue le 26 mars 1996 (précit.) pouvait au surplus prendre valeur de principe : la responsabilité du corps médical était engagée parce qu'il était " constaté que les parents avaient marqué leur volonté, en cas de rubéole, de provoquer une interruption de grossesse et (parce que) les fautes commises les avaient faussement induits dans la croyance que la mère était immunisée ". D'où il résultait selon la Cour que " ces fautes étaient génératrices du dommage subi par l'enfant du fait de la rubéole de sa mère ".
* 2 La cour d'appel d'Orléans, désignée comme cour de renvoi dans l'affaire dont avait eu à connaître la Cour de cassation le 26 mars 1996 (arrêt précit.), a toutefois jugé que " si un être humain est titulaire de droits dès sa conception, il n'en possède pas pour autant celui de naître ou de ne pas naître, de vivre ou de ne pas vivre ; qu'ainsi, sa naissance ou la suppression de sa vie, ne peut pas être considérée comme une chance ou comme une malchance dont il peut tirer des conséquences juridiques " ; CA Orléans, ch. sol., 5 février 1999, Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français et a. c/ Époux Perruche et a., req. n° 96/01079.
* 3 Selon les propos de M. Sargos, rapporteur dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt précité de l'assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 17 novembre 2000 (JCP 2000, II, n° 10438). Selon M. Sargos, " la position du Conseil d'État, qui alloue en réalité aux parents l'indemnisation due à l'enfant (...), comporte (...) l'inconvénient d'un risque de dilapidation, en particulier si le couple se disloque ou abandonne l'enfant (...). Et dans l'hypothèse où les parents meurent avant d'avoir pu agir, la solution " camouflée " de la réparation du préjudice de l'enfant à travers ses parents n'est même plus possible. Imagine-t-on l'enfant handicapé venir réclamer en sa qualité d'héritier de ses parents la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de son handicap alors que lui, victime directe et immédiate, n'aurait personnellement droit à rien ? ".
* 1 La Cour de cassation a fait ici application de la théorie de l'équivalence des conditions : est cause d'un événement un antécédent en l'absence duquel cet événement ne se serait pas produit. Or, si la mère de l'enfant avait été correctement informée, l'enfant ne serait pas né et il n'y aurait pas eu d'affaire Perruche. Sous cet aspect, l'arrêt serait-il plus acceptable ?
* 2 Dans un avis rendu public le 15 juin 2001, le Comité consultatif national d'éthique a considéré que "la reconnaissance d'un droit de l'enfant à ne pas naître dans certaines conditions (...) risquerait de faire peser sur les parents, les professionnels du diagnostic prénatal et les obstétriciens une pression normative d'essence eugénique".
* 3 Pour l'heure, avec "l'action de vie dommageable", la prise en charge des enfants concernés est transférée vers les praticiens et l'assurance privée.
* 4 En outre, comme elle s'en est expliquée dans son Rapport pour l'année 2000, la Cour de cassation a considéré que l'indemnisation des parents seuls reste soumise à des aléas (séparation ou décès des parents par exemple), qui ne permettent pas d'être certain que l'enfant en sera le réel bénéficiaire sa vie durant. Aussi, " la défense de son intérêt, comme la présentation de la dignité de ses conditions de vie future paraissent mieux assurées par l'attribution d'une indemnisation qui lui soit propre ".
* 1 Nous remercions vivement Patrick Wachsmann de ses observations aussi judicieuses que critiques sur une première version de ce texte. Nous tenons aussi à remercier Pierre-Olivier Caille, qui achève une thèse sur la question de l'immunité pénale du Président de la République, d'avoir eu la gentillesse de nous communiquer différents documents, fort utiles pour la préparation de cet article.
* 2 C. Cass. Ass. plén. Breisacher, 10. X.2001. Cf. les observations d'Olivier Jouanjan et de Patrick Wachsmann, RFDA, novembre-décembre 2001, p. 1169.
* 3 P.-H. Prélot, "Le perdreau mort. L'irresponsabilité du Président de la République : inviolabilité personnelle, immunité fonctionnelle, privilège de juridiction ?" Chronique Dalloz, 2001, p. 949.
* 4 Les rapports et conclusions du conseiller rapporteur Roman et de l'avocat général de Gouttes dans l'arrêt précité à la Cour de cassation fourmillent de références à la doctrine constitutionnelle. Osons une remarque cependant : ces hauts magistrats ont fait un usage indifférencié de la doctrine, mettant sur le même plan des articles de qualité, disons, fort variable...
* 1 Un bon résumé des diverses positions figure dans le débat animé parla revue Pouvoirs autour de Ph. Ardant, G. Carcassonne, D. Chagnollaud, D. Rousseau, G. Vedel, Pouvoirs, n° 92, (2000), pp. 61 s. Parmi les juristes qui ont pris part à la controverse, on ajoutera de façon non exhaustive : R. Badinter, 0. Duhamel ( Le pouvoir politique en France, Paris, Seuil coll. Points, 1993, pp. 161), B. Genevois (dans quatre articles de la décision du Conseil : "Le Conseil constitutionnel et le droit pénal international", RFDA, mars-avril 1999, p. 511 et s. "Le Conseil constitutionnel et le droit pénal international. Quelques observations complémentaires", RFDA,, juillet-août 1999, p. 511) ; "Les immunités prévues par la Constitution et le contrôle juridictionnel", RFDA, 15 (3), 2001, pp. 511 et s ; et le dernier, "Immunités constitutionnelles et privilèges de juridiction", (rapport au Congrès de droit constitutionnel à paraître - nous lui sommes très reconnaissant de cet envoi) et enfin, p. Avril, "L interprétation littérale de l'article 68 de la Constitution", RFDA, juillet-août 1999, p. 716.
* 2 M. Troper, "Comment décident les juges constitutionnels", Le Monde, 13.11. 1999.
* 1 "De la méthode d'enseignement du droit constitutionnel", in Mélanges Raymond Carré de Malberg, Paris, Sirey, 1933, p. 383.
* 2 "Éloge de l'Exégèse", in Droits, n° 1 (1985). p. 122.
* 3 Préface à L. Hamon, De Gaulle et la République, Paris, 1958, repris in R. Capitant Ecrits constitutionnels, Paris, CNRS, 1982, p. 362.
* 4 "Bilan critique des méthodes d'interprétation de la Constitution" in E. W. Böckenförde, Le droit, l'État et la constitution démocratiques, (présentation et trad. 0. Jouanjan) Paris-Bruxelles, LGDJ et Storya, 2000, p. 225.
* 5 Loc. cil, p. 227. Avec dans la même page, une explication très convaincante de cette différence
* 1 Loc. cit. p. 246.
* 2 L'expression est de M. Prélot J. Boulouis, Institutions politiques, Dalloz, n° 460, p. 703.
* 3 Ibid. n o 460, p. 704
* 1 La place nous manque pour démontrer que l'immunité est seulement une conséquence, sur le plan pénal, de l'inviolabilité présidentielle. Il y a un rapport logique de prévalence de la règle constitutionnelle sur la règle pénale, que l'on pourrait illustrer à partir de la jurisprudence criminelle sur les immunités parlementaires.
* 2 Elle consacre deux articles distincts à l'inviolabilité du Président de la République fédérale (art. 60 al.4) et à sa responsabilité politico-pénale (art. 61).
* 3 Celles-ci - écrit-il - "comportent deux volets. D'une part, l'irresponsabilité qui couvre l'exercice du mandat : pour les parlementaires, celui-ci est décrit par les opinions et votes", pour le président par le renvoi plus général (sauf haute trahison) aux actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. D'autre part, l'inviolabilité qui est proportionnée à ce qu'exige la protection du mandat et non de celui qui l'occupe : levée d'immunité pour les parlementaires, mise en accusation par les deux assemblées pour le chef de l'État." G. Carcassonne, "Le Président de la République française et le juge pénal", Mélanges Philippe Ardant, Paris, LGDJ 1999, pp. 283-284. Cet article est, selon nous, l'un des plus importants écrits sur le sujet. Nous divergeons cependant de l'opinion qui y est émise relativement à la compétence de la Haute Cour (v. infra II) et de cette interprétation de la mise en accusation comme mainlevée de l'immunité présidentielle.
* 4 Dans son "Rapport" pour une candidature au prix Saint-Simon de la faculté de droit de Lille, nov. 2000.
* 5 Notre analyse converge en partie celle faite récemment par Olivier Camy, "La controverse de l'article 68. Aspects théologiques", RDP, 2001, n° 3, p. 813. Mais, nous divergeons de son explication du phénomène, qui confère une place trop importante aux considérations de théorie du droit (plus particulièrement à la théorie de Kelsen), et de sa tentative, osée, de résoudre le cas juridique par une utilisation-transposition de la théorie des "deux corps du roi".
* 1 M. Prélot J. Boulouis, op cit., n° 459, p. 703.
* 2 Conclusions de l'avocat général de Gouttes, sous C. Cass. Ass. plén. Breisacher, 10. X. 2001.
* 3 Éléments, de droit constitutionnel français et comparé, Paris, Larose, 2 e éd. 1899, pp. 82-83.
* 4 V. notamment Wade and Philips, Constitutional Law, (1931). p. 66 ; De Smith, R. Brazier, Constitutional Law, 6th, Penguin Books, p. 128.
* 5 Dans sa thèse, Parlementarisme des origines, Paris, PUF, coll. Léviathan, 1999.
* 1 Esmein a très bien décrit ce processus parallèle qui affecte le pouvoir et la responsabilité dans l'avènement du régime parlementaire, anglais. V. Éléments 2 e éd., p. 81.
* 1 La différence est essentielle et fondamentale, entre l'autorité responsable et l'autorité investie de l'inviolabilité." Principes de politique, chap. 2, in OEuvres, Paris, Gallimard, coll. Pléiade, 1957 p. 1079.
* 2 A. Prévost-Paradol, La France nouvelle, 3 e éd., 1868, rééd. Paris, Garnier, (préface p. Guiral), 1981, p. 195.
* 3 A. Esmein, Éléments. (2e éd.) p. 572.
* 1 J. Massot La Présidence de la République en France. Vingt ans d'élection au suffrage universel 1965-1985, Paris, Documentation française, 1986, p. 24.
* 2 Les ministres sont solidairement responsables devant les Chambres, de la politique générale du gouvernement, et, individuellement de leurs actes personnels. Le Président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison. "
* 3 Art 42 - "Le Président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison. Il peut être mis en accusation par l'Assemblée nationale et renvoyé devant la haute Cour dans les conditions prévues à l'article 57 ci-dessus." (l'article 57 étant relatif à la responsabilité pénale des ministres).
* 4 Le rôle du pouvoir exécutif dans les Républiques modernes, Paris, Giard et Brière, 1906, p. 657.
* 5 Ibid. p. 661.
* 1 R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l'État, [1920], CNRS, rééd. 1962, t. II, p. 401, n° 406.
* 2 La remarque est de G. Jèze, dans sa subtile Chronique parue à la RDP, 1913, p. 114, et p. 126.
* 3 Le rôle du pouvoir exécutif, p. 662.
* 4 Il y a donc peu d'intérêt à avancer que les Chambres ne peuvent pas révoquer le Président de la République ; elles l'annulent. (..) La pratique est venue montrer que si le Président de la République tient ses fonctions du Parlement il ne peut les conserver qu'avec son assentiment." Ibid. p. 656.
* 5 Joseph Barthélémy cite un précédent parlementaire fort intéressant le cas d'un le général Billot, invoqua, lors d'un débat au Sénat (en 1905), le droit de demander une nouvelle délibération qui était attribué par les lois constitutionnelles au chef de l'État ; le président du Sénat refusa qu'on fît intervenir le chef de l'État dans le débat parlementaire. Commentaire de Barthélémy : "Le président du Sénat (..) a cru bon de porter atteinte au droit de parole d'un orateur en invoquant la Constitution coutumière contre la Constitution écrite." Ibid. p. 679. Il écrivait aussi : "On voit combien profondément a été bouleversé et cela sans qu'il ait été besoin de révision formelle, la Constitution à esprit monarchique de 1875." Ibid. p. 697.
* 1 J. Massot La Présidence de la République, p. 24.
* 2 L'article 73 du règlement de l'Assemblée nationale, et l'article 95 du Sénat prévoient, dans ce cas, la censure avec exclusion temporaire. La sanction ne peut être que disciplinaire, car le député est protégé par la règle de l'irresponsabilité parlementaire (art. 26. al. 1) pour les opinions émises à la tribune.
* 3 G. Carcassonne, loc. cit., p. 279
* 1 La Présidence de la République, 1° éd. PUF, 1981, p. 93.
* 2 Institutions politiques, n°° 461, p. 705.
* 3 Pro : P, Avril, "Pouvoir et responsabilité ", in Le Pouvoir. Mélanges offerts à Georges Burdeau, Paris, LGDJ, 1977, p. 9 ; Contra : Ph. Ségur, La responsabilité politique, PUF, coll. Que-sais-je, 1997.
* 4 La Constitution en France de 1789 à nos jours, Paris, A. Colin, p. 272.
* 1 Dans la constitution de 1958, "le président et la majorité parlementaire doivent marcher de concert". Et ce concert n'est pas garanti seulement par des checks and balances, mais de "façon plus positive, plus dynamique, par l'obligation faite à chacun d'eux de gouverner en accord avec la volonté populaire". "L'aménagement du pouvoir exécutif et la question du Chef de l'État'", Encyclopédie française, tome X, (1964) in Écrits constitutionnels, Paris, CNRS, 1982, p. 398. Dans le même sens, l'observation selon laquelle la réforme sur l'élection au suffrage universel direct vient "renforcer sa prééminence et démanteler à peu près complètement le principe d'irresponsabilité", Cl. Emeri, "De l'irresponsabilité présidentielle", Pouvoirs, n°41 (1987), p. 138
* 1 Lettre du 10 août 1984, citée par D. Maus, Les grands textes de la pratique institutionnelle de la Vème République, Paris, Documentation française, 1995, p. 361.
* 2 "Il me paraît clair que, en vertu d'une longue et constante tradition républicaine et parlementaire, confirmée par la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment par ses articles 18 et 68 premier alinéa, la responsabilité du Président de la République ne peut être mise en cause devant le Parlement. Cette immunité s'applique au Président de la République non seulement pendant toute la durée des fonctions, mais également au-delà pour les faits qui se sont produits pendant qu'il les exerçait."
* 1 Pour un constat très critique, v. l'essai de B François, Misère de la Vème République, Paris, Denoël, 2001, pp. 75 et s.
* 1 Manuel de droit constitutionnel, Paris, Fontemoing, 1907, p. 961.
* 2 Ibid. , p . 1048.
* 3 Traité de droit constitutionnel, Paris, de Boccard, t. IV, 2 e éd., 1924, p. 483.
* 4 Esmein, 8 e éd. 1928 t. 2, p. 291. V. dans un sens proche, M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, Paris, Sirey, (1° éd. p. 511, 2° éd. p. 414-415)..J. Barthélémy, P. Duez, Traité de droit constitutionnel, 1° éd., Paris, Sirey, 1926, p. 523.
* 5 "La distinction du chef d'État et du chef de Gouvernement" (1963) in Écrits constitutionnels, p. 396.
* 6 Pouvoirs, n°° 92, p. 74.
* 1 Le Doyen Vedel est l'un des rares auteurs à avoir signalé cette résurgence de la justice politique " (..) La justice politique reprend place dans l'actualité avec les controverses sur le statut du Président de la République au regard du droit pénal et de la procédure pénale." Pouvoirs n°° 92, p. 73.
* 2 F. Hamon, M. Troper, Droit constitutionnel, 19 e éd. Paris, LGDJ, 1999, p. 734.
* 3 Comme le fait observer E.W. Böckenförde, loc. cit. p. 225.
* 4 G. Carcassonne, La Constitution, Paris, Seuil, coll. Points, 1993, p. 278. Dans le même sens, mais implicitement, M. Troper, "Comment les juges constitutionnels décident".
* 1 Article 11, S Section IV -"Le président, le Vice-président et tous les fonctionnaires civils des États-Unis seront destitués de leurs fonctions sur mise en accusation (impeachment) et condamnation pour trahison, corruption ou autres hauts crimes et délits (Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors)." (trad. Riais, in Textes constitutionnels étrangers, PUF).
* 2 Contra : G. Carcassonne qui considère inapplicable la distinction entre actes commis "en-dehors des fonction", et actes commis pendant l'exercice des fonctions ("Le Président de la République française et le juge, pénal, pp. 280-282) en se fondant notamment sur la jurisprudence de la Chambre criminelle de 1963. D'une part, la jurisprudence la Cour de cassation a évolué sur ce point (v. pour une confirmation de cette évolution jurisprudentielle, Cass. Crim. 16.11.2000 ; Dalloz 2001 p. 660, note V. Bück) et ne permet certainement pas de justifier cette opinion. D'autre part, le statut des immunités du chef de l'État et des agents diplomatiques en droit international public est fondé sur cette distinction entre les types d'actes que le juge est amené à préciser à chaque cas. C'est donc une distinction juridique pertinente, et très usitée dans toutes les branches du droit.
* 1 R. Badinter, "président et témoin", Le Monde 17-18.XII.2000 qui évoque à mots couverts l'idée d'un refus de. concours du président à l'administration de la justice.
* 2 V. sur ce point E. Zoller, De Nixon à Clinton. Malentendus transatlantiques, Paris, PUF, coll. Béhémoth, 1999 (en conclusion).
* 3 C. Schmitt, Théorie de la Constitution, (1928) trad. fr., Paris, PUF, coll. Léviathan, 1993, p. 734, et p. 258.
* 4 Ibid. p. 258.
* 5 A. Moreau, "La notion de haute trahison sous la Constitution de la Veme République", RDP, 1986, p. 1571.
* 1 "Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de haute trahison ou d'attentat à la Constitution".
* 2 Celle-là "est un crime essentiellement politique ; en fait, ce qui est visé, c'est la tentative de coup d'État c'est-à-dire la haute trahison vis-à-vis des institutions constitutionnelles, bien plutôt que la trahison au point de vue patriotique" M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, 2 e éd. (1929) rééd. CNRS, 1965, p. 415.
* 3 Esmein, Nézard, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, 7 e éd., Sirey, 1921, pp. 205-206.
* 4 G. Vedel, "Débat" in Pouvoirs, n°° 92, p. 74.
* 5 A. Moreau, "La notion de haute trahison...", p. 1579. et ce manquement est défini par "l'entrave au fonctionnement régulier du pouvoir législatif (p. 1578).
* 6 M. Prélot Institutions politiques et droit constitutionnel, 3 e éd., 1963, pp. 640-641.
* 7 "On définit des délits comme la haute trahison ou la trahison de la patrie pour protéger l'existence politique, et non les formalités prévues pour les révisions constitutionnelles ou n'importe quelles autres obligations et règlements." C. Schmitt, op. cit., pp. 259-260.
* 8 B. Chantebout oppose cette "sanction politique" à la procédure normale de la "sanction juridique" de la Constitution, mise en oeuvre par le contrôle de constitutionnalité des lois, Droit constitutionnel et institutions politiques, 18 e éd., Paris, A. Colin, p. 00.
* 1 "Immunità parlamentari ed organi sovrani", (1933), in E. Orlando, Diritto pubblico générale. Scritti varii (18811940) coordinati in sistema, Milano, Giuffré, 1940, p. 491. Ce remarquable article, - dont nous devons la lecture à P.O. Caille - éclaire la question des immunités parlementaires par la théorie générale de l'État Il n'y a pas, du moins à notre connaissance, meilleur article sur la question en langue française.
* 1 V. pour une explicitation, notre article : "Du double écueil de la criminalisation de la responsabilité et de lajustice politique", RDP, 1999, n°°2, pp. 419 et s. (not. pp. 421 s.).
* 2 Manuel de droit constitutionnel, (1907), pp. 947-948.
* 3 M. Mignot. Séance du 1er août 1958, in Documents pour servir à l'histoire de l'élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, Paris, Doc. française, t. II, 1988, p. 140.
* 4 J. Cadart Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 1975, t. II, p. 809.
* 5 Arrêt Com. Instr. HCJ du 5.II.1993, Dalloz, 1993, p. 262.
* 6 C'est en tout cas ainsi que l'a qualifiée, sans fards, le procureur de la République de Nanterre dans sa réponse à une demande du député Arnaud Montebourg : "la Haute Cour constitue(..) au sein plein et non péjoratif du terme, une juridiction politique". Lettre du 2 avril 2001 au procureur de Nanterre (M. Bot) in Internet http ://www.liberation.com/chirac/actu/doc6.htIm .
* 1 P. Desmottes, La responsabilité pénale des ministres en régime parlementaire français, Paris, LGDJ, 1968, p. 266.
* 2 Source : B. Mathieu, "La Haute Cour de justice et la responsabilité pénale des ministres ou comment se servir d'un sabre de bois. À propos de l'arrêt du 4 avril 1990 de la commission d'instruction de la Haute Cour de justice" in RFDC, 1990, 4, pp. 735 et s.
* 3 Arrêt Corn. Instr. HCJ du 5.II, 1993, Dalloz, 1993, p. 262.
* 4 Lettre précitée du 2 avril 2001, p. 6.
* 1 V. la note savante de J. Pradel, Dalloz, 1993, p. 263.
* 2 Cass. Crim 14.1.1965, Bull. Crim. n°17 ; Cass. Crim. 14.VI.1979, Bull. Crim. n°209 ; D. 1979.657, note D. Mayer et F. Jullien-Laferrière ; Gaz Pal. 1980.1.78, note P.L.G.
* 1 Lettre de Arnaud Montebourg au procureur de la République Mercredi 28 février 2001, in Internet : www.lemonde.fr .
* 2 Pour le député, "les textes constitutionnels et organiques font des députés, l'autorité de mise en mouvement de l'action publique [sic] à travers la proposition de résolution tendant à la mise en accusation du Président de la République.
* 3 Lettre précitée du 2 avril 2001, p. 6.
* 4 M. Forni, cité par le procureur Bot dans sa lettre précitée p. 6. Et le procureur de s'étonner, non sans ironie, qu'un député participe ainsi à l'abaissement de l'institution parlementaire (cette demande aurait " un aspect réducteur pour le Parlement").
* 1 Arrêt publié dans la RGDIP, 2001 (n° 2), p. 475.
* 2 La Chambre criminelle de la Cour de cassation note que le droit international public reconnaît le "principe de l'immunité de juridiction des chefs d'État Cass. Crim. 13.III.2001, Khadafi, (RGDIP, 2001 (n° 2), p. 474.
* 3 Comme le notent judicieusement F. Hamon et M. Troper, Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 1999, p. 738.
* 4 V. B. Genevois, "Immunités constitutionnelles et privilèges de juridiction". Le droit interne affirmer cette compatibilité : la Commission d'instruction de la Haute Cour dans son arrêt du 5 mars 1993 estime que "la mise en accusation prévue par les deux premiers textes n'est pas incompatible avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lorsqu'aux termes de l'article 6-2 de la dite convention, "toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie". V. en outre la note de A. Maron (Droit pénal mars 1993, p. 5) dubitative sur ce contrôle juridictionnel de conventionnalité. Contra : P. Wachsman, article dans RFDA, novembre-décembre 2001, p. 1169.
* 5 Pouvoirs, n°° 92, p. 74. Italiques mis par nous-même.
* 1 Contra : P. Avril, J. Gicquel, "Ombres et lumières de la Constitution", Les Petites Affiches, 30.X.2001, pp. 11 et s.
* 2 "Le Président de la République française et le juge pénal", pp. 283-284.
* 1 R. Badinter, "La responsabilité pénale du Président de la République" Mélanges Patrice Géiard, Montchrestien, 2000., p. 157.
* 2 G. Carcassonne, loc. cit., p. 284.
* 3 Note sous HCJ Com. instr., 5.II.1993, Dalloz 1993, p. 264.
* 1 Telle est notamment l'opinion défendue avec constance par Dominique Chagnollaud : "Le chef de l'État répond donc pénalement des infractions détachables de sa fonction, sans même bénéficier d'un privilège de juridiction. Si tel n'était pas le cas, il serait alors, à l'image du monarque inviolable, (..)." In "La responsabilité pénale d'un président citoyen", Libération, 7.IX.1998.
* 2 Loc. cit. p. 285.
* 3 Nous nous permettons sur ce point de renvoyer à notre article, "L'émergence d'un pouvoir judiciaire sous la Vème République - un constat critique" à paraître dans Esprit février 2002. Le récent acquittement de D. Strauss-Kahn semble confirmer certaines de nos analyses antérieures, et laisse penser que certains juges d'instruction ont une conception plutôt "militante" de leur métier, et difficilement compatible avec le respect de l'État de droit qu'ils invoquent pourtant constamment.
* 1 Rapport précité, n°°5.2.2.2.
* 2 V. cependant l'opinion dissidente du juge Breyer qui montrait avec force que le procès intenté à Clinton était de nature à nuire au bon fonctionnement du Gouvernement américain.
* 3 Rapport précité, 5.2.2.2. Italiques mis par nous-même.
* 1 V. les références dans V. Champeil-Desplats, Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, Paris, Economica, PU AM, 2001, p. 184.
* 2 Ces expressions de R.Capitant servaient à louer la méthode de Carré de Malberg : "L'oeuvre juridique de Raymond Carré de Malberg", Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique, 17, n° 1-2, p. 88.
* 3 V. pour une étude récente, M. Cosnard, La soumission des États aux tribunaux internes. Face à la théorie des immunités, Paris, Pédone, 1996, avec une étude sur la notion d'immunité, pp. 31 et s.
* 4 Le Bras, L'immunité réelle, thèse droit Paris, 1920, p. 9.
* 5 Définition reprise à son compte par B. Genevois dans son article "Les immunités prévues par la Constitution et le contrôle juridictionnel", RFDA, 15 (3), mai-juin 2001, p. 511.
* 6 V. ici Ph. Conte, "L'immunité pénale des membres du Gouvernement et l'article 68-1 de la Constitution" Dalloz, 1999, pp. 209-210 ; et "Brèves remarques d'un pénaliste", RDP, 1999, pp. 401-408.
* 1 R. Badinter toc. cit. p. 154.
* 2 V. notre point de vue dans un article intitulé, "La responsabilité "pénale" du Président de la République est une question de droit constitutionnel", et publié dans Libération, 8.1.2001, sous le titre "La Constitution fait force de loi".
* 3 V. sur ce point, J.-B. Herzog, "Les immunités parlementaires en droit comparé", Revue internationale d'histoire politique et constitutionnelle, 1956, t. VI, p. 84, et quelques indications rapides dans R. Merle, A. Vitu, Traité de droit criminel, 4° éd. Paris, Cujas, t. I, p. 51.
* 4 "Immunités constitutionnelles et privilèges de juridiction", p. 3. Mis en caractères gras par l'auteur.
* 5 E. Orlando, loc. cit., p. 463.
* 1 V. Le sang contaminé. Essai critique sur la criminalisation de la responsabilité des gouvernants, Paris, PUF, 1999.
2 Loc. cit. p. 492.
* 3 L'un des "enseignements" de l'arrêt Khadafi de la Cour de cassation - a-t-on écrit - tient à ce que l'immunité de juridiction pénale du chef d'État en exercice a valeur de principe, et que la présomption joue en ce sens. F1. Poirat, note sous Cass Crim 13.III.200l , Khadafi RGDIP, 2001, p. 479.
* 4 G. Scelle, Droit international public, Paris, Montchrestien, 1946, p. 452.
* 5 E. Orlando, loc. cit., p. 496.
* 1 in J. Combacau, S. Sur, Droit international public, 4° éd., Paris, Montchrestien, 1999, p. 237.
* 2 Ibid.p. 245.
* 3 Le président jouirait d'une immunité "fonctionnelle", et non d'une immunité "personnelle". Dès lors, les délits qu'on lui reproche étant commis en-dehors de l'exercice de sa fonction, il ne peut plus bénéficier d'une immunité.
* 4 J.B. Herzog, loc. cit., p. 73.
* 1 Sans connaître d'ailleurs forcément la polysémie du terme : v. sur ce point la Somme suivante : 0. Jouanjan (dir.) Figures de l'État de droit. Le Rechtstaat dans l'histoire intellectuelle et constitutionnelle de l'Allemagne, Presses Universitaires de Strasbourg, 2001.
* 2 E.W. Böckenförde, "Naissance et développement de la notion d'État de droit" in E.W. Böckenförde, op. cit., p. 147.
* 1 P.TORREILLES. Territoire du prédateur. Poème en cinq chants. Gallimard 1984.
* 2 A propos de ia distinction entre prévention et précaution, le rapport KOURISLKY-VINEY prend soin de souligner que les probabilités contenues dans ces deux notions ne sont pas de même nature : dans le cas de la précaution il s'agit de la probabilité que l'hypothèse du risque soit exacte alors que dans le cas de la prévention, la dangerosité est établie et il s'agit de la probabilité de l'accident. P.KOURILSKI, G.VINEY, "Le principe de précaution " Ed O. Jacob 2000.
* 3 Ces hypothèses peuvent être tenues pour acquises de façon relatives, comme dans le cas d'une présomption réfragable. Mais l'objet de la présomption est justement, en situation de non certitude, d'offrir un point d'ancrage aux conséquences que le raisonnement juridique a pour fonction de dérouler, cf infra.
* 4 Pour les textes, voir notamment la déclaration ministérielle de la Troisième Conférence internationale sur la protection de la mer du Nord de 1990, la Déclaration de Rio sur l'Environnement et le Développement de juin 1992 principe 15, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques conclue à New York en juin 1992, la Convention d'Oslo et de Paris pour la prévention de la pollution marine de septembre 1992, l'article 130 R 2 (désormais art 174-2 dans le cadre du Traité d'Amsterdam) du traité de Rome modifié par le Traité sur l'Union européenne, l'article 1 er de la loi n°°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (article L. 200-1 du Code rural, le principe figure désormais dans le Code de l'environnement).
* 1 La bibliographie relative au principe de précaution est très volumineuse et toujours en expansion. Outre le rapport de P. KOURISLKY et G. VINEY précité, on retiendra sur la notion : L. BAGHESTANI-PERREY, "Le principe de précaution : nouveau principe fondamental régissant les rapports entre le droit et la science ", Dalloz 1999 Chron p. 457 et suiv, L. BOY. "La référence au principe de précaution et l'émergence de nouveaux modes de régulation", LPA 8/1/1997, "La nature juridique du principe de précaution", Natures, Sciences, société, 7(3)Elsevier, p. 71, "Le principe de précaution, de la morale au droit", La Recherche, (326)p. 86, C. CANS. "Le principe de précaution, nouvel élément du contrôle de légalité", RFDA 1999 p. 750 et suiv, JS. CAYLA. " Le principe de précaution, fondement de la sécurité sanitaire", RDSS, 34 (3), 1998, S. CHARBONNEAU. "Principe de développement contre principe de précaution ", NSS1998, vol 6 n°3 p. 45 et suiv, F. CHAUMET et F. EWALD. "Petite bibliothèque d'actualité. Autour de la précaution " in Risques n°°11-1992 p.99 et suiv, H. COUSY, "À propos de la notion de précaution", Risques 21-1995 p. 149 et suiv, F. EWALD. "Philosophie de la précaution ", Année sociologique 1996, 46 n°2, p. 383 et suiv, en collaboration avec C. GOLLIER et N de SADELEER, "Le principe de précaution", Que sais-je ? N° 3596 2001, H. JONAS. Le principe responsabilité. Une étape pour la civilisation technologique. Paris, Ed Le cerf, collection Passages 1990, C. GIRAUD. "Le droit et le principe de précaution : leçons d'Australie", RJE 1/1997 p. 21 et suiv, sous la direction de O. GODARD, Le principe de précaution dans la conduite des affaires humaines, Editions de la Maison des sciences de l'homme, Paris 1997, au sein de cet ouvrage on retiendra plus particulièrement : O. GODARD. " L'ambivalence de la précaution et la transformation des rapports entre science et décision ", p. 37 et suiv et MA. HERMITTE. " Le principe de précaution à la lumière du drame de la transfusion sanguine en France" p. 179 et suiv, O. GODARD. " Le principe de précaution, entre débats et gestion des crises " Regards sur l'actualité septembre-octobre 2001 p. 33 et suiv, L. GONZALEZ VAQUE, L. EHRING et C. JACQUET op. cit. supra, C. HUGLO. " Le nouveau régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, une application du principe de précaution ? ", La lettre des juristes d'affaire (LJA), 2/6/1998, P. LASCOUMES. "La précaution comme anticipation des risques résiduels et hybridation de la responsabilité ", Année sociologique 1996,46 n°2, p. 359 et suiv, "La précaution, un nouveau standard de jugement", revue Esprit, octobre 1997, p. 129, GJ. MARTIN. " Précaution et évolution du droit" Dalloz 1995, chron. p.299 et suiv, P. MARTIN-BIDOU, "Le principe de précaution en droit international de l'environnement", RGDI IP 1999, p. 631 et suiv, A. ROUYERE, "L'exigence de précaution saisie par le juge. Réflexions inspirées par quelques arrêts récents du Conseil d'État " RFDA 2000, p. 266 et suiv, N de SADELEER, "Les principes du pollueur payeur, de prévention et de précaution ", Bruylant Bruxelles 1999, "Les avatars du principe de précaution en droit public. Effet de mode ou révolution silencieuse ?", RFDA 2001 p. 548 et suiv, N. TREICH. "Vers une théorie économique de la précaution ? " in Risques, n°32-97.
Le Conseil de l'environnement d'Electricité de France a élaboré en mai 2001 une étude sur le principe de précaution publiée aux CJEG en Octobre 2001.
* 2 Voir parmi les commentaires de l'arrêt du Conseil d'État du 25 septembre 1998 Association Greenpeace France req n°°194348 consacrant l'invocabilité du principe de précaution à l'appui d'une demande de sursis à exécution : J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, " Le principe de précaution et le maïs transgénique devant le Conseil d'État" DA 1999, chron 11, J. LEONE, "Les OGM à l'épreuve du principe de précaution", LPA 18/8/1999, p. 12 et suiv, J. de MALAFOSSE, " Sursis à l'exécution de l'arrêté ministériel introduisant en France trois variétés de " maïs génétiquement modifié ", JCP G 1998, II, 10216, voir aussi du même auteur "Guérilla sur le front du maïs transgénique ", Lettre JC de l'environnement, Janv 1999, M.REMOND-GOUILLOUD, " Les OGM au Conseil d'État " Gaz Pal 23/1/1999 p. 13 et suiv, R. ROMI, " La valeur, la nature et l'influence du principe de précaution", LPA 16/8/1999, p. 12 et suiv.
* 3 Voir la communication de la Commission européenne sur le recours au principe de précaution du 2 février 2000, COM (2000) 1 final. Cette communication a donné lieu à l'adoption d'une résolution du Conseil présentée au sommet de Nice du 7 décembre 2000 ainsi que d'une résolution du Parlement européen du 14 décembre 2000.
* 1 Cf notre étude précitée.
* 2 Parmi les études consacrées à la place du principe de précaution en droit de la responsabilité un numéro spécial de la Revue Juridique de l'Environnement de l'année 2000 assure la publication des contributions présentées au colloque de l'Université de Bourgogne organisé à Dijon en avril 2000 sur "La décision publique et le droit de la responsabilité face au principe de précaution ".
Voir aussi JP. DESIDERI "La précaution en droit privé " Dalloz, chron p. 238 et suiv, F. EWALD "La précaution, une responsabilité de l'État", Le Monde 11 mars 2000, A. GUEGAN "L'apport du principe de précaution au droit de la responsabilité civile ", RJE 2/2000 p. 147 et suiv, P. JOURDAIN " Principe de précaution et responsabilité civile " LPA 30/11/2000, n°°239, p. 51 et suiv, Y. LAMBERT-FAIVRE "L'éthique de la responsabilité " RTDC 1998 p. 2 et suiv, G.J. MARTIN "La mise en oeuvre du principe de précaution et la renaissance de la responsabilité pour faute ", JCP Entreprise et affaires, Cahiers de droit de l'entreprise 1999 n°l, p. 3 et suiv, M. REMOND-GOUILLOU, "Le risque de l'incertain : la responsabilité face aux avancées de la science", La vie des sciences, comptes rendus, série générale, t. 10, 1993, n°°4, p. 431.
* 3 L'exemple des téléphones portables suffit à illustrer ce hiatus entre la demande sociale de précaution retranscrite par le discours public et la réticence des citoyens à adopter des comportements de précaution. L'hypothèse du risque associé à l'usage des téléphones portables est aujourd'hui avancée par des études scientifiques reconnues et diffusées (cf. notamment Le Monde 18 mai 2000 p. 14 "Les interrogations scientifiques sur l'innocuité des téléphones portables relancées. L'hebdomadaire "Nature " publie une étude sur les effets biologiques observés sur le ver de terre " JY. NAU.), mais il ne semble pas que cette information ait incité de manière significative leurs utilisateurs à y renoncer, pas plus que cela n'a entraîné de politique publique de prise en compte de cette hypothèse de risque.
* 4 O. ABEL, "La responsabilité incertaine " Esprit, nov. 1994.
* 1 H. JONAS, op. cit. supra.
* 2 Notre réflexion sera centrée sur la responsabilité publique mais se situe nécessairement dans le cadre général de la responsabilité civile.
* 3 Notamment GJ MARTIN. " La mise en oeuvre du principe de précaution et la renaissance de la responsabilité pour faute ", op. cit. supra, et du même auteur "Précaution et évolution du droit " op. cit. supra.
* 4 Contra voir notamment A. GUEGAN " L'apport du principe de précaution au droit de la responsabilité civile ", op. cit. supra.
* 1 Voir par exemple, la loi n°°98-535 du 1 er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme. JO 2 juillet 1998 p. 10056 et suiv.
* 2 Cf. les conclusions de J.H.STAHL sur l'arrêt du Conseil d'État du 25 septembre 1998 Association Greenpeace France Req n°°194348.
* 3 On relève d'ailleurs que la politique du juge en la matière est essentiellement guidée par le pragmatisme. Le contrôle minimum s'applique à des décisions de précaution, tandis que le contrôle de mesures suspectées de manquer à l'exigence de précaution s'inscrit dans le cadre du contrôle normal ou renforcé qui est pratiqué à l'égard de ce type de mesure. Le raisonnement de précaution est, en quelque sorte, inclus dans un contrôle dont l'intensité a été déterminée par ailleurs, mais qu'il peut servir.
* 4 Cf. les conclusions du commissaire du Gouvernement H.LEGAL sur CE 9 avril 1993 D., G..., B-, rec 100, RFDA 1993, p. 583 et suiv
* 1 C'est cette rétroactivité qui fait tant redouter le risque de développement : Cf. F.EWALD, "La véritable nature du risque de développement", Risques 1993, n°°14. p 9 et suiv, C.GOLLIER, "Le risque de développement est-il assurable ?", Risques 1993, n°14, p. 50.
* 2 La directive du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux, prévoit que le producteur doit pouvoir se libérer de sa responsabilité s'il prouve l'existence de certains faits qui le déchargent et notamment que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit n'a pas permis de déceler l'existence du défaut.
Sur la transposition de la directive par le droit français cf. la Loi n°°98-389 du 19 mai 1998, JO du 21 mai 1998.
* 3 CJCE 29 mai 1997 Commission des Communautés européennes c Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord. D 1998 jup p. 488 note A.PENNEAU.
* 4 Sur les rapports entre principe de précaution et risque de développement, cf. infra.
* 5 Comme le note A.PENNEAU, op. cit. p. 493 : " Ce qui est accessible est, par hypothèse, ce qui a d'abord été diffusé. Mais, tout ce qui l'a été n'entre pas dans l'état des connaissances puisqu'interfère le critère de la pertinence qui introduit un jugement sur la qualité et donc la véracité du savoir considéré. De cette façon, une opinion isolée pourrait faire partie de l'état de l'art et, ni la reconnaissance commune, ni la notoriété n'en sont des conditions. Mais cette opinion, comme toutes les autres, ne sera partie intégrante de l'état de l'art que si elle repose sur une argumentation solide, élaborée à partir d'une expérimentation elle-même conforme aux règles de l'art relatives à cette étape de la recherche scientifique et technique. "
* 1 Sur la notion d'irréversibilité cf. Revue Juridique de l'Environnement N° spécial, "L'irréversibilité" 1998.
* 2 CE, Ass 9 avril 1993, D..., G..., B..., rec 100... Conclusions H. LEGAL précitées.
* 3 Pour une analyse plus détaillée de cette affaire du point de vue de la précaution il est intéressant de lire l'analyse de MA. HERMITTE dans son ouvrage Le sang et le Droit, Essai sur la transfusion sanguine. Ed du seuil, 1996, p. 303 et suiv.
Ce point est davantage détaillé dans notre étude " L'exigence de précaution saisie par le juge ? " op. cit. supra.
* 1 CAA de Marseille Ministre de l'Emploi et de la solidarité 18 octobre 2001 n°°00MA01665.
* 2 Il reste donc à savoir avant 1977, à partir de quand il y aurait faute de défaut de précaution, puis à partir de quand, dès avant 1977, il y aurait faute de défaut de prévention.
* 3 TA Marseille 30 mai 2000 Botella n°°97-5988 et Xueref n°°97-3662, note E. SAULNIER, Europe janvier 2001 p. 7, C.ESPER, DA février 2001 p. 32.
* 4 Cf. E. SAULNIER, op. cit. supra.
* 1 Cf. O. GODARD, " Le principe de précaution, un principe politique d'action ", RJE 2000 numéro spécial Le principe de précaution.
* 2 Cet argument est avancé par les pourfendeurs de l'hypothèse de l'application directe à l'action privée (ou publique). Cf. O. GODARD, op. cit. supra.
* 3 Sur ce point on se reportera aux études générales sur le principe. Rappelons simplement que le principe figure dans le préambule de la loi au sein d'un énoncé sinueux érigeant le principe en source d'inspiration du législateur.
* 4 Cf. les études précitées sur le principe.
* 5 Ou des décideurs institutionnels supra nationaux du fait de l'insertion du principe dans le traité de l'union européenne
* 6 Cf. F. EWALD, "La précaution, une responsabilité de l'État", LM 11 mars 2000, O. GODARD, op. cit. supra.
* 7 Cf. notamment JP. DESIDERI, op. cit. p. 240.
* 1 Rapport Kourilski-Viney, op. cit. p. 143.
* 2 Op. cit. supra.
* 3 Selon la Commission ce champ couvre "les circonstances particulières où les données scientifiques sont insuffisantes, peu concluantes ou incertaines, mais où, selon des indications découlant d'une évaluation scientifique objective et préliminaire, il y a des motifs raisonnables de s'inquiéter de ce que les effets potentiellement dangereux sur l'environnement et la santé humaine, animale ou végétale, soient incompatibles avec le niveau choisi de protection. "
* 4 Cf. O. GODARD, "Le principe de précaution, un principe politique d'action ", op. cit. supra, p. 129.
* 5 Cf. infra.
* 1 Même si elle n'est pas exemptée, elle aussi, d'un certain nombre d'étapes et de transactions internes
* 2 Cf. notamment JP. DESIDERI, op. cit. p. 240 : " La logique interdit de transposer dans les relations privées le scénario du pire... par lequel une hypothèse non infirmée devrait être provisoirement tenue pour valide, même si elle n'est pas démontrée ".
Cf. F. EWALD, op. cit. supra.
* 3 Il appartiendra à l'État de déterminer le "risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement", les " mesures effectives et proportionnées ", le "coût économiquement acceptable "
* 4 Cf. supra.
* 5 CAA de Paris 12 novembre 1999 Consorts Heliot n°°97PA03242.
* 6 CE Ass 9/4/1993 D..., G..., B..., Rec 100, cf. supra.
* 1 On admettra qu'en l'espèce la prescription de transfusion n'était pas vitale : la Cour juge en effet que compte tenu de l'absence d'urgence, du caractère modéré de l'hémophilie et des traitements de substitution possibles, il y a faute engageant la responsabilité de l'hôpital. On remarquera simplement que l'usage des téléphones portables n'obéit pas, dans la majorité des cas, à un impératif d'ordre vital...
* 2 Ceci ne signifie pas que le médecin est tenu de mettre en oeuvre le dernier savoir connu : La Cour de Cassation 1ère Civ a jugé dans un arrêt du 6 juin 2000 Pocheron Peschaud et a (JCP 2001 II 10447) que le moyen qui se réfère à la notion erronée de données actuelles de la science est inopérant, l'obligation pesant sur un médecin étant de donner à son patient des soins conformes aux données acquises de la science. Cette restriction de l'exigence pourrait être comprise comme un refus de soumettre les praticiens à une obligation de moyen de précaution.
* 1 C'est à dire l'éthique, ou l'idée ou peut-être seulement l'angoisse de précaution.
* 1 Cf. la communication de D. de BECHILLON.
* 2 CE 9/12/1988 Cohen Rec 431
* 3 CE 31 mars 1999 CPAM du Vaucluse n°°181735
* 4 CE 31/3/1999 AP à Marseille n°°181709
* 5 En outre, même si on ne pouvait incriminer ces seringues, il semble bien que la présomption de faute serait tout de même appliquée, cf. CE 19/2/1992 Musset RDP 1993 p. 253 : mise en cause du matériel de l'hôpital alors même que le recours à des seringues à usage unique était établi
* 1 Cf. P. BON et D. de BECHILLON, chronique Responsabilité de la puissance publique, D. 2000 jup p. 241.
* 2 Cette affirmation ne permet pas de préjuger le volume d'un contentieux qui semble toutefois très inférieur à ce que l'on a pu imaginer au lendemain des arrêts fondateurs de cette jurisprudence.
* 3 Cf. PH. KOURILSKI et G. VINEY, " Le principe de précaution ", op. cit. p 18I et suiv.
* 4 CAA de Lyon 21 décembre 1990, consorts Gomez, rec 498. La réparation est subordonnée, en outre, à la condition que le recours à cette méthode n'ait pas été imposé par des raisons vitales et que les conséquences dommageables directes de cette méthode aient eu un caractère exceptionnel et anormalement grave.
* 5 CE Ass 9 avril 1993 Bianchi rec 127.
À comparer avec l'arrêt de la Cour de Cassation 1° chbre civ 8 novembre 2000 jugeant que la réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient. JCP 2001 II 10493 Rapp P. SARGOS, note F. CHABAS.
* 1 Jurisprudence appliquée ensuite à un acte d'anesthésie nécessité par un acte n'ayant pas une finalité thérapeutique : CE Sect 3 novembre 1997 Hôpital Joseph Imbert d'Arles rec 412. Pour un bilan relatif à l'application de cette jurisprudence, cf. F. THIRIEZ, "La jurisprudence Bianchi : symbole ou réalité ? " DA janvier 2001 p. 9.
* 2 CE 27 octobre 2000 Centre hospitalier de Seclin Req n°°208640 AJDA mars 2001 p. 307 Note M. DEGUERGUE.
Dans cette affaire le patient présentait une prédisposition rare à la réalisation du risque, non décelable lors du bilan préopératoire et qui n'a été révélée que par des examens effectués après l'intervention.
* 3 Cour de cassation 1° chbre civ 29 juin 1999
* 4 Cour de cassation 1° chbre civ 9 novembre 1999
* 5 Cour de Cassation 1 ° chbre civ 7 novembre 2000
* 6 CE Ass 26/5/1995 N'Guyen, Jouan, Pavan, Rec 221 et 222
* 1 C'est la démarche retenue par le Fonds d'indemnisation en matière de contamination transfusionnelle par le VIH qui fait jouer la présomption de causalité à la lettre et ne la renverse pas sur la base d'une simple présomption contraire.
Cette rigueur n'est cependant pas toujours adoptée par le juge comme en témoigne l'apparition de solutions jurisprudentielles ponctuelles admettant que la présomption d'une autre causalité puisse renverser la présomption initiale chargeant l'hôpital ( notamment Cour de Cass 14/1/1998 chbre civile Bull civ II 17 : La Cour admet le renversement de la présomption par l'effet d'un ensemble de présomptions graves précises et concordantes visant une femme transfusée à une date où les risques étaient limités et dont le mari était toxicomane et contaminé). Cette orientation pourrait se développer, au-delà de ce cas d'espèce bien particulier, dans la mesure où la transfusion est de plus en plus sécurisée.
* 2 On dispose d'un ensemble de décisions émanant de cours administratives d'appel admettant un lien de causalité entre la transfusion et la contamination :
en l'absence d'autres modes de contamination propres à la victime (CAA Paris 23/2/1999 Parisot Shames Bertin Req 98 PA 00384, 98 PA 00377, 97 PA 01725).
en considérant qu'aucun fait survenu depuis la transfusion ne pouvait expliquer la contamination (CAA Lyon 6/3/1997 Caisse primaire d'assurance maladie du Var)
en constatant l'absence de preuve de l'innocuité du sang (CAA Paris 12/2/1998 Cts Peltier Jacquié et Ledun)
* 3 Aucune cause n'est clairement identifiable dans 30 % des cas de contamination.
Les données ne sont pas strictement comparables à celles de la contamination par le VIH, dans la mesure où le virus de l'hépatite C est plus facilement et plus couramment transmissible. Le juge paraît plus exigeant dans la mise en oeuvre de la présomption de causalité :
Le fait qu'un des donneurs se révéle contaminé et que des symptômes hépatiques soient apparus peu après la transfusion suffisent, en l'absence de tout autre facteur sérieux de risque, à établir la causalité (CAA de Lyon CAA Lyon 17/9/1998 Mme Forax Req 96 LY 00337).
Le fait que l'hépatite soit survenue rapidement après transfusion et que tous les donneurs n'aient pas été retrouvés donc que la preuve de l'innocuité de la transfusion n'ait pas été établie, permet d'admettre le lien de causalité (CAA Nantes 11/3/1999 Florendeau Req 97NT01415).
Le fait qu'il n'y ait pas de preuve positive de l'innocuité du sang administré et l'absence de tout autre facteur sérieux de risque et ce, alors même qu'il s'est écoulé un long délai entre la transfusion en cause et l'apparition de symptômes hépatiques, conduisent à admettre la causalité (TA Grenoble 21/2/2000 M Syord).
* 4 La Cour d'appel de Versailles a condamné le 2/5/2001 le laboratoire SKB (Smithkline Beecham) à indemniser deux femmes souffrant de sclérose en plaque apparues en 1994 et 1995 quelques semaines après avoir été vaccinées contre l'hépatite B. La cour a estimé que s'il n'est pas contestable que la preuve scientifique certaine d'une relation entre la vaccination et l'apparition de la maladie n'est pas rapportée, la coïncidence chronologique entre la vaccination et la survenance de la sclérose en plaque associée au fait que la démonstration de la totale innocuité du vaccin n'avait pas été apportée permettait de condamner le fabricant.
* 1 Sur cette question voir notamment C. THIBIERGE, " Libres propos sur l'évolution du droit de la responsabilité. (Vers un élargissement de la fonction de la responsabilité civile ?) ", RTDC 1999 p. 561 et suiv.
* 2 " La vraie interrogation porte sur la détermination du débiteur ultime de la charge qui a été créée : assureur, fonds de garantie, État....
* 3 Cf. notamment rapport sur le principe de précaution, op. cit. p. 184.
* 4 Voir par exemple le dispositif de la loi n°°98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux ( JO du 21 mai 1998, p. 7744) : art 8 ( art 1386-16 Code civil : " Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice. "
art 19 de la loi ( art 1386-17) : " L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un déali de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur "
* 1 Cette appréciation pouvant être tempérée par des considérations économiques.
* 2 Le terme "risque" est inadéquat, puisqu'aucune donnée scientifique ne permet de le saisir et de le mesurer. L'incertitude de développement, formule proposée par C. GOLLIER, traduit mieux les caractères du phénomène désigné : C. GOLLIER, " Le risque de développement est-il assurable ?", op. cit. supra.
* 3 Cf. F. EWALD, "La véritable nature du risque de développement", op. cit. supra.
* 1 Cf. en ce sens Y. LAMBERT FAIVRE, "L'éthique de la responsabilité" RTDC 1998 p. 10.
* 2 Formulation contenue dans la directive de 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.
* 3 Le souci du décideur étant aiguisé en cas de refus de prise en charge du risque de développement par les assureurs.
* 1 ... à l'origine la jurisprudence distinguait même la faute simple, la faute lourde, la faute manifeste et d'une particulière gravité et la faute assimilable au dol.
* 1 ... les décisions de la cour d'appel de Paris conservaient cependant l'exigence de la faute lourde pour les activités juridictionnelles - qui pourraient être largement entendues - de ces organismes.
* 1 En revanche - et très logiquement - la faute simple suffit lorsque la compétence de l'autorité administrative est liée ; par ex. en matière d'inscription d'office au budget communal, la faute simple peut engager la responsabilité de l'État : CE 10 nov. 1999, Sté de gestion du port de Campoloro, RFDA 2000, p. 1107.
* 1 CE 12 fév. 1960, Kaufmann, Rec. Lebon p. 107, à propos de la commission bancaire ; CE 22 juin 1984, Sté Pierre et Cristal, Rec. Lebon p. 731, à propos de la COB ; CE 14 février 1973, Association diocésaine d'Agen, Rec. Lebon p. 141, à propos du conseil national du crédit ;...
* * Madame le professeur Brigitte STERN a présenté sa communication le 12 mai 2001, l'après-midi, sous la présidence de Monsieur le professeur Yves GAUDEMET. Il nous a semblé préférable de présenter celle-ci sous la présidence de Monsieur le professeur Pierre DELVOVE. Nous les remercions tous infiniment.
* 1 Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, 1948, vol. 22, p. 466.
* 1 En réalité, il convient de distinguer ici la responsabilité pénale internationale des individus fondée sur des incriminations, ou à tout le moins des qualifications, internationales, mais dont la répression est laissée aux tribunaux nationaux (selon le principe " aut judicare, aut dedere", et éventuellement sur la base de la compétence universelle), et la responsabilité pénale internationale des individus pouvant également être mise en oeuvre devant une juridiction internationale.
Dans la première catégorie, l'aspect international vient du fondement de la responsabilité, ainsi que de l'instauration d'une compétence universelle permettant à tout État de poursuivre les coupables : on peut citer ici notamment, la responsabilité pour piraterie, traite d'esclaves, trafic de stupéfiants, interférence illicite avec l'aviation civile internationale, terrorisme. Au sens strict, on est ici dans le domaine du droit pénal international, dont une partie seulement des sources est dans le droit international public.
Dans la seconde catégorie, on songe aux principes de Nuremberg repris dans la résolution 95 (1) du 11 décembre 1946 de l'Assemblée générale, condamnant les crimes contre la paix, les crimes de guerre, et les crimes contre l'humanité, aux violations graves des Conventions de Genève de 1949, aux actes de génocide condamnés par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948. Cette responsabilité pénale internationale individuelle a été mise en oeuvre par les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, et est actuellement mise en oeuvre par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie crée par les résolutions 808 (1993) du 22 février 1993 et 827 (1993) du 25 mai 1993 du Conseil de sécurité et le Tribunal pénal international pour le Rwanda crée par la résolution 955 du 8 novembre 1994 du même Conseil de sécurité. Le point d'orgue de cette répression internationale étant la création - encore virtuelle, mais il faut l'espérer pour peu de temps - de la Cour pénale internationale dont le Statut a été adopté le 18juillet 1998, à la fin d'une conférence internationale réunie sous les auspices de l'ONU. On est ici dans le domaine du droit international pénal, qui relève exclusivement du droit international public.
* 2 Présentée par Hervé Ascencio, l'un des éditeurs d'un gros ouvrage récemment publié, voir Hervé Ascensio, Emmanuel Decaux et Alain Pellet, Droit international pénal, CEDIN Paris X, Paris, Pedone, 2000, 1053 pages.
* 3 De 1978 à 1984, le premier rapporteur spécial, Quentin-Baxter a présenté 5 rapports ; de 1985 à 1996, son remplaçant, M. Barboza a présenté 12 rapports.
* 1 Premier rapport de Rao (voir note suivante), Doc. A/CN.4/487, p. 5, par. 6.
* 2 Les travaux ont été confiés à un nouveau Rapporteur spécial, M. Pemmaraju Sreenivasa Rao.
* 3 Jean Combacau, Serge Sur, Droit international public, Paris, Montchrestien, 2001, 5° éd, p. 545.
* 4 La prise en compte de certains risques catastrophiques a été à l'origine, par exemple, de l'adoption de conventions internationales en matière de dommages causés par les centrales nucléaires, les plates-formes pétrolières ou le transport par navires des hydrocarbures. Ces conventions prévoient une responsabilité objective de l'opérateur de la centrale ou de la plate forme ou du propriétaire du navire, et ne mettent éventuellement en cause un État qu'en tant qu'acteur économique privé, ce qui signifie que l'on sort de la sphère de la responsabilité internationale de droit public.
* 1 Brigitte Bollecker-Stern, Le préjudice dans la théorie de la responsabilité internationale, Paris, Pedone, 1973, (Préface de Paul Reuter).
* 2 Selon une distinction introduite par H. HART, in The Concept of Law, Oxford, Clarendon Press, 1984, p. 77.
* 3 Comme l'a déclaré l'Autriche dans ses commentaires sur le projet de 1996, " (d)urant ces dernières années, les travaux en question ont été quelque peu ralentis par une série de propositions trop ambitieuses qui avaient peu de chances d'emporter l'adhésion d'un grand nombre d'États ", Commentaires et observations reçus des Gouvernements, 25 mars 1998, Doc. A/CN.4/488, p. l9.
* 4 Ce dernier ayant démissionné au cours de la session de 1996 de la CDI.
* 1 ACDI, 1980, Vol. 2, Deuxième partie, pp. 29 et svtes.
* 2 Voir rapport de la Commission du droit international à l'Assemblée générale de 1996, AG, Doc. off., 51° session, Suppl., N° 10, A/51/10
* 3 Doc. A/CN.4/L.600*.
* 4 Texte de la déclaration définitivement adoptée, Rapport de la Commission du droit international à l'Assemblée générale de 2001, AG, Doc. off., 53° session, Suppl., N° 10, A/56/10, pp. 45-60.
* 5 Ibid., pp. 43-44.
* 6 Alain Pellet, " Vive le crime ! Remarques sur les degrés de l'illicite en droit international ", Le droit international à l'aube du XXIe siècle. Réflexions de codificateurs, Pub. UN, 1997, p. 289.
* 1 Dictionnaire de la terminologie du droit international, Paris, Sirey, 1960, p. 541.
* 2 Cette idée de base selon laquelle la violation du droit entraîne à la charge de l'État auteur de la violation, l'obligation d'en réparer les conséquences dommageables, a été clairement affirmée par la Cour permanente de Justice internationale dans l'affaire de l'Usine de Chorzow, où elle déclare : "C'est un principe du droit international, voire une conception générale du droit, que toute violation du droit comporte l'obligation de réparer", 16 décembre 1927, CPJI Rec., Série A, n°°13, p. 29.
* 1 L'exemple classique est l'obligation de protéger les ambassades étrangères.
* 2 Dans le même sens, voir Jean Combacau : "... ce qui, sur le plan des faits, apparaissait comme une "activité" du particulier, devient pertinent en droit en tant que "passivité" de l'État ; ce dont il est responsable, ce n'est donc pas du fait d'autrui, qui par définition, ne saurait lui être imputé, mais de son propre fait, qui s'analyse en une omission : la responsabilité est ici la sanction de l'"obligation de diligence" (ou de vigilance) que le droit international met à la charge de l'État.", Droit international public, op. cit. note 3, p. 540.
* 1 CIJ Rec. 1980, § 74, p. 29.
* 2 CIJ Rec. 1986, § 108 et 109, p. 62.
* 1 Ibid., § 115, p. 64.
* 2 Procureur c/ Dusko Tadic, Jugement du 7 mai 1997 ; Jugement de la Chambre d'appel du 15 juillet 1999.
* 3 Opinion dissidente, p. 5, § 7.
* 1 Jugement de la Chambre d'appel du 15 juillet 1999, § 116.
* 2 Id., § 121.
* 3 Id, § 131.
* 4 La Chambre d'appel voit une confirmation de son raisonnement dans le fait que la RFY a signé les accords de Dayton au nom de la Republika Srbska, car cela met en évidence "les véritables structures de pouvoir", id, § 157.
* 1 Brigitte Stern, "Conclusions générales", La responsabilité dans le système international, Paris, Pedone, 1991, p. 324.
* 2 Ibid., p. 326.
* 1 Roberto Ago, "Le délit international", RCADI, 1939-II-68, p. 525.
* 2 ACDI, 1973, vol. I, § 9, p. 6. Le mécanisme de sanctions coercitives et militaires prévues par le chapitre VII de la Charte de l'ONU, en cas de violation d'une obligation essentielle des États, à savoir l'obligation de non recours à l'emploi de la force ou à la menace d'emploi de la force, était sans doute une de ses sources d'inspiration
* 1 En réalité, de nombreuses critiques peuvent être faites à l'égard de l'approche de la CDI : le caractère très contestable d'un amalgame entre des actes tels que le génocide et des atteintes à l'environnement ; le caractère totalement indéterminé et imprévisible de ce que la communauté internationale, à un moment donné, reconnaît comme crime international et les modalités de cette reconnaissance ; le fait qu'ainsi qu'il résulte du commentaire de la CDI le crime international ne se confond ni avec les obligations erga omnes, ni même avec les normes du jus cogens, ce qui évidemment est une source de confusion supplémentaire ; le fait que la qualification de crime est laissée à l'appréciation de l'État lésé ; enfin, et c'est sans doute la critique majeure, l'absence de véritables différences dans les conséquences tirées de la qualification d'un acte comme crime ou comme délit.
* 1 Alain Pellet, "Remarques sur une révolution inachevée. Le projet d'articles de la CDI sur la responsabilité des États", AFDI 1996, p. 13 et p. 16.
* 2 "An International Criminal Responsibility of States ?" in International Law on the Eve of the Twenty-first Century. Views from the International Law Commission, UN Pub., 1997, p. 267.
* 1 Ibid, pp. 19-20.
* 2 Jean Combacau in Droit international public, op. cit. note 3, p. 518.
* 1 Doc. A/C.6/38/SR.17, § 67.
* 2 Commentaires et observations reçus des Gouvernements, 25 mars 1998, Doc. A/CN.4/488, p. 58.
* 3 Ibid, p. 54.
* 4 Ibid, p. 57.
* 5 Ibid, p. 62.
* 6 Ibid, p. 69.
* 1 Commentaires et observations reçus des Gouvernements, 25 mars 1998, Doc. A/CN.4/488, p. 147.
* 2 Kyoji Kawasaki, "The Content and Implementation of the International Responsibility of States : Some Remarks on the Draft Articles on State Responsibility Adopted by the ILC'S Drafting Committee in 2000 ", Hitoshubashi J. of Law and Pol., vol. 29 février 2001, p. 40. Il suggère de rédiger un article sur les conséquences du crime international de la façon suivante : " A State responsible for the internationally wrongful act is under an obligation.... To change radically the responsible Government structure as appropriate assurances and guaranties of non-repetition, because the circumstances so require, if an international responsibility arises from an internationally wrongful act that constitutes a serious breach by a State of an obligation owed to the international community as a whole and essential for the protection of its fundamental interests ".
* 1 ACDI, 1975, vol. II, p. 178.
* 2 "Trois observations sur la codification de la responsabilité internationale des États", in Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement, Mélanges Virally, Paris, Pedone, 1991, p. 389.
* 3 Voir notamment, affaire de Naulilaa, 31 juillet 1928, RSA, vol. II, p. 1025.
* 1 Comme celles qui peuvent exister dans le cadre du mécanisme de règlement des différends de l'OMC.
* 1 Denis Alland, Justice privée et ordre juridique international. Étude théorique des contre-mesures en droit international public, Paris, Pedone, 1994, p. 371.
* 2 L'article 50 du projet 2000 dispose que "... l'État lésé ne peut prendre des contre-mesures... que pour inciter... ", ce qui montre bien ce caractère exceptionnel. Rapport du Comité de rédaction, 25 août 2000, Doc. A/CN.4/SR.2662, p. 29. On peut comparer avec l'article 47 du projet 1996 prévoyant simplement que "(l)a prise de contre-mesures est soumise aux conditions et restrictions énoncées dans les articles 48 à 50".
* 3 Commentaires et observations reçus des gouvernements, 25 mars 1998, Doc. A/CN.4/488, pp. 87-88.
* 4 Ibid., p. 24.
* 5 Voir également la déclaration du Représentant américain, selon laquelle les États-Unis voient dans les contre-mesures un "moyen d'encourager la légalité internationale" (devant la Sixième Commission, 1996).
* 1 Commentaires et observations reçus des gouvernements, 25 mars 1998, Doc. A/CN.4/488, p. 135.
* 2 Ibid., p. 140.
* 3 Ibid, p. 124.
* 1 Yves Daudet, AFD/ 1994, p. 591-592.
* 2 Alain Pellet, "Remarques sur une révolution..." op. cit. note 1, p. 21.
* 1 Par exemple : J.-L Aubert, "À propos d'une distinction renouvelée des parties et des tiers", RTDC 1993, p. 263 ; J. Ghestin, "La distinction des parties et des tiers", JCP 1992, 1, 3628 et "Nouvelles propositions pour un renouvellement de la distinction des parties et des tiers", RTDC 1994, p. 777 ; C. Guelfucci-Thibierge, "De l'élargissement de la notion de partie au contrat... à l'extension de la portée du principe de l'effet relatif, RTDC 1994, p. 275 ou encore Ph. Delmas Saint-Hilaire, Le tiers à l'acte juridique, thèse, Bib. de droit privé, LGDJ, 2000.
* 2 Loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux dont le régime ne distingue plus entre les parties et les tiers.
* 3 Ex. en Grande-Bretagne " Contracts (Rights of Third Parties) " (Loi sur les Contrats (droits des tiers) de 1999 ; en droit colombien, la loi du 5 août 1998 permet une action populaire pour défendre des droits collectifs tels que "la défense du patrimoine public", "l'accès aux services publics" ou encore "la réalisation des ouvrages et immeubles en accord avec les normes juridiques", droits qui peuvent donc être éventuellement violés par les conditions d'existence ou d'exécution d'un contrat administratif.
* 4 La crise du contrat et sa portée ", Arch. de phil. du droit, 1968, n°°13, p. 17.
* 5 R. Savatier, Le prétendu principe de l'effet relatif des contrats, RTD Civ. 1934, p. 525 ; A. Weill, La relativité des conventions en droit privé français, thèse, Strasbourg, 1938 ; S. Calastreng, La relativité des conventions, thèse Toulouse, 1939 ; Sur cette évolution, voir F. Bertrand, L'opposabilité du contrat aux tiers, thèse dact., Paris II, 1979.
* 1 F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civ. Les obligations, Précis Dalloz, 7 ème éd., 1999, évoquent "une obligation de ne pas faire, celle de respecter la situation née du contrat. L'opposabilité de la situation contractuelle aux tiers apparaît le complément nécessaire de la force obligatoire du contrat".
* 2 G. Viney, Traité de droit civil, Introduction à la responsabilité, 2 ème éd. 1995, LGDJ, p. 367, n°°202 et s.
* 3 Marcel Fontaine, "Les effets "internes" et les effets "externes" des contrats", Rapport Belge, in Les effets du contrat à l'égard des tiers, comparaisons franco-belges, ss la direction de M. Fontaine et de J. Ghestin, LGDJ, 1992, p. 40 et s.
* 4 Péquignot, Théorie générale du contrat administratif, Pédone, 1945, p. 547 ; voir également Hauriou, note sous l'arrêt Prévet, S. 1902.III.73.
* 1 Théorie générale du contrat administratif, Pédone, 1945, p. 548.
* 2 Hauriou, note sous l'arrêt Prévet, S. 1902, 3, 73 ; J. Georgel s'était intéressé à la question dans un fascicule du Juris Classeur Droit administratif, malheureusement aujourd'hui retiré.
* 3 RTDC 1969, p. 776.
* 4 F. Terré, Ph. Simpler, Y. Lequette, les Obligations, 7 ème éd. 1999, Dalloz, p. 455, n°°472 et s.
*
5
Voir les articles de 1992 à 1994 cités ci-dessus et Ph. Delmas Saint-Hilaire, thèse précitée,
p. 23.
* 1 F. Llorens, Contrat d'entreprise et marché de travaux publics, LGDJ, 1981, p. 236 ; F. Moderne, "Les rapports entre responsabilité contractuelle, responsabilité décennale et responsabilité extra-contractuelle à propos des travaux publics de reconstruction", D.S. 1971 chron. p. 267.
* 2 Ex. pour le contrat d'entreprise Civ. 1ère 28 novembre 1967 Bull. I, n°°348 p. 260 ; Cass. civ., 26 mai 1992, Bull. III, p. 168.
* 3 CE 10 juill. 1987, bureau d'aide sociale de la ville de Paris, R., p. 265 ; CE 30 déc. 1998, Soc laitière de Bellevue, req. n°°159.297, BJCP, n°°4, p. 385.
* 4 F. Moderne, Responsabilité des constructeurs (droit public) Données de base - Source, Dalloz Construction 1998 sous la direction de Ph. Malinvaud, p. 1243 et s., spé. n°°7931.
* 5 CE 17 fév. 1967, Sieurs Hardy et Fourgassié, RDP 1967, p. 805.
* 6 CAA Bordeaux, 2 juin 1997, SARL Guy Couach, Rec.tab., p. 937.
* 7 J. L. Aubert, À propos d'une distinction renouvelée des parties et des tiers, RTDC 1993, p. 277, n°°55.
* 1 J. Ghestin - M. Billiau - C. Jamin, Traité de droit civil, Les effets du contrat, LGDJ, 200!, p. 1034 et s.
* 2 M.-P. Deswarte-Julien, La stipulation pour autrui en droit administratif, th. Paris 1970 et les références citées par A. de Laubadère, F. Moderne et P. Delvolvé, Traité des contrats administratifs, T. I, LGDJ, 1983, n°°790.
* 3 De Laubadère, Contrats, T. II n°°511 p. 90 et s.
* 4 CE 22 juillet 1927, Syndicat des employés des secteurs électriques de la Seine, D. 1928. 3. 41, note Waline : " Le différend ne pouvait être porté devant le juge du contrat que par ceux qui, étant parties à ce contrat, étaient en mesure d'exciper d'une méconnaissance de leurs droits contractuels, c'est-à-dire soit par le concédant, soit par le concessionnaire, soit enfin par les usagers et les agents au profit desquels les clauses litigieuses ont été insérées dans les conventions ".
* 5 CE 17 juin 1938, Chemin de fer de la Camargue, D. 1940. 3. 5, concl. Lagrange : " L'État se fonde sur les clauses insérées à son profit dans le traité. Ainsi la créance dont l'État entend se prévaloir se rattache directement à l'exécution du contrat de concession ; c'est par suite au conseil de préfecture qu'il appartenait de statuer sur le litige dont s'agit ".
* 6 CE 23 juin 1976, Sieur Latty, Rec. p. 329 ; CE 22 janvier 1986, Ste Bois Sciés manufacturés, Rec. p. 12 ; AJDA 1986, 333 obs. J.C., D 1986 - IR - 427 note Ph. Temeyre et Ph. Terneyre, La responsabilité contractuelle des personnes publiques en droit administratif, Economica, 1989, p. 49.
* 7 Sans que l'acceptation préalable du bénéficiaire soit requise : Civ. I, 19 déc. 2000, Bull., I, n°333, p. 215.
* 8 À condition qu'il y ait eu acceptation préalable : v. J. Ghestin - M. Billiau - C. Jamin, Etudes comparées franco-belges, p. 396 et s.
* 1 CE 21 juin 1957, Dupuy, Rec., p. 411, ;AJDA 1957. 1. 49, concl. Chardeau ; AJDA 1957. II. 335, note Sillard et chrn. Fournier et Braibant.
* 2 CE 25 juin 1957, Banque commerciale privée et entreprise Techno-Tramo, Rec., p. 412 ; AJDA 1957. II. 335, chrn. Fournier et Braibant.
* 3 Ch. Jamin, " Brèves réflexions sur un mécanismes correcteur : l'action directe en droit français ", comparaisons franco-belges, p. 264 ; J. Ghestin - M. Billiau - C. Jamin, Traité de droit civil, Les effets du contrat, LGDJ, 2001, p. 1163 et s.
* 4 art. L. 124-3 du Code des assurances.
* 5 CE 6 déc. 1999, Ville de Marseille, BJCP, n°°9, p. 110, concl. H. Savoie.
* 1 Sur adjudication : CE 13 mai 1970, Ronti, Rec., p. 322 ou sur appel d'offres : CE 10 janv. 1986, Sté des Travaux du Midi, Rec. tab., p. 701.
* 2 CE 21 sept. 1992, Cne. de Bagnols-sur-Cèze c/ S.A.R.L. Alpha Ambulances, Rec. tab., p. 1105.
* 3 CE 30 juin 1999, M. Sarfati, BJCP, n°°7, p. 640.
* 4 17 déc. 1998, Embassy Limousines et services c/ Parlement européen, T., 203/96 ; BJCP n°°4, p. 386 : mais à la différence des solutions françaises, l'entreprise ne peut prétendre qu'à l'indemnisation des dépenses engagées et non des bénéfices manques.
* 5 CE 29 mars 1912, Frot c/ l'État, Rec, p. 467.
* 6 R. Saleilles, "De la responsabilité précontractuelle. À propos d'une étude nouvelle sur la matière", RTDC 1907, p. 697.
* 7 J. Schmidt, "La sanction de la faute précontractuelle", RTDC 1974, p. 47. C. Guelfucci-Thibierge constate à cet égard que " la définition générale et abstraite propre à la responsabilité délictuelle convient parfaitement à la faute précontractuelle " (C. Guelfucci-Thibierge, Nullité, restitutions et responsabilité, LGDJ, 1992, p. 199, n°°338.
* 1 CE 21 juin 1999, Assoc. Synd. Autorisée du grand canal de la ville de Briançon, BJCP, n°°7, p. 640.
* 2 CAA Paris, 7 juill. 19099, M. Henri Sécail, concl. Ch. Lambert, BJCP, n°°8, p. 26.
* 3 Traité des contrats administratifs, précité, p. 789, n°°787. - La notion de tiers au regard de la structure de l'administration.
* 1 CE 7 nov. 1980, S.A. Schmid-Valanciennes, Rec., p. 416 ; M.P. 1981, n°°178, p. 41, concl. D. Labetouile ; D. 1981.IR.115, obs. P. Delvolvé ; CE 9 mars 1984, J.-C. Havé, AJDA 1984, p. 400, note B. Sablier et J.-E. Caro.
* 2 CE 27 janv. 1984, Ville d'Avignon c. sieur Da Costa Nunes, Légisoft. CE 27 janv. 1984, Ville d'Avignon c. sieur Da Costa Nunes, Légisoft
* 3 Civ. I, 21 juin 1988, Bull. Civ. I, n°°202, p. 141.
* 4 Ass.plèn. 12 juillet 1991, D. 1991, 549 note J. Ghestin ; J.-L. Aubert, obs. som. 321 ; A. Bénabent, obs. D 1992, som. 119 ; G. Viney, note, J.CP. 1991, II, 21743 ; Ch. Larroumet, éd. E p. 279 ; concl. Mounier, RJDA 1991, 583 et p. 590 rapport P. Leclercq, J.-L. Aubert, note, Defrénois 1991, 130 ; P. Jourdain, obs., RTDC 1991, 750 ; J. Mestre, obs. RTDC 1992, 90. V. aussi, M. Baccache, La relativité des conventions et les groupes de contrat, thèse, n°°324 ; Ch. Larroumet, "L'effet relatif des contrats et la négation d'une action nécessairement contractuelle dans les ensembles contractuels" J.C.P. 1991 1 3531 ; Ch. Jamin, "Une restauration de l'effet relatif des contrats" D. 1991, 257, P. Jourdain "La nature de la responsabilité civile dans les chaînes de contrats après l'arrêt d'Assemblée plénière du 12 juillet 1991" D. 1992, chrn. p. 149.
* 5 M. Bacache, La relativité des conventions et les groupes de contrats, LGDJ, 1996.
* 6 Solution vue supra
* 1 F. Moderne, "La responsabilité des constructeurs (droit public) Données de base-sources", précité, n°°7923, p. 1248 qui cite : C. Cass, 3 ème Ch. civ., 29 janv. 1992, Bull. civ. III, n°°30, p. 17.
* 2 F. Llorens, thèse précitée, p. 64 !.
* 3 Illustrant la jurisprudence antérieure : CE 29 avr. 1987, Sieparg, Rec., p. 163 ; AJDA 1987, II, n°87, concl. Roux.
* 4 CE 30 juin 1999, Commune de Voreppe, BJCP 1999, n°°7, p. 595, concl. C. Bergeal.
* 5 R. Odent, conclusions sous CE 5 mai 1943, Cie Générale des Eaux, D. 1944, J., p. 121 ; et les références citées par le Traité des contrats administratifs, n°°792, p. 794.
* 1 CE 21 déc. 1906, Synd. des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Séguey-Tivoli, D. 1907.3.41, concl. Romieu ; S. 1907.3.33, note Hauriou ;GAJA, p. 102.
* 2 CE Sect. 7 nov. 1958, Sté "Électricité et eaux de Madagascar" et territoire de Madagascar c/ sieur Nicola ; concl. Heumann, Rec., 530.
* 3 P. Delvolvé, " Responsabilité contractuelle ", Encyclopédie Dalloz, Responsabilité de la puissance publique, n°°51.
* 4 CE Sect. 27 nov. 1987, Sté provençale d'équipement, Rec, p. 383, RFDA 1988, concl. M. Fornacciari, étude F. Moderne.
* 5 Cass. civ. 30 juin 1902, D., 1907.1.436.
* 6 Pour un exemple récent : CE 11 décembre 2000, Mme Agofroy et autres, RFDA 2001, p.1277, concl. S. Austry à propos d'un incendie subi par des occupants du domaine public.
* 1 Civ. 1., 18 juillet 2000, Bull. n°°221.
* 2 Pour une autre application plus récente : CCass. Civ. l, 13 février 2001, pourvoi n°°R 99.13-589 : le tiers peut également invoquer la faute dans l'exécution d'une obligation contractuelle de sécurité de résultat.
* 3 Cass. Ass. Plén. 17 nov. 2000, Bull. n°°9, rapport Sargos, concl. Sainte-Rose, BICC, n°°526, p. 3. Sur ce point la divergence d'approche du Conseil d'État transparaît dans l'arrêt Carrez du 14 février 1997 (Rec, p. 44 ; RFDA 1997, p. 374, concl. V. Pécresse, note B. Mathieu), puisqu'il n'envisage pas la relation entre les parents et l'hôpital sous l'angle contractuel.
* 4 G. Viney, Introduction à la responsabilité, précité, p. 386 et s.
* 5 G. Viney, ibid, n°211 et 212.
* 1 La responsabilité contractuelle des personnes publiques en droit administratif, précité, p. 21
* 2 CE 20 nov. 1891, Rec, p. 685, D. 1893, V, n°°601.
* 3 À l'inverse, on rappellera que lorsque le litige oppose un usager, ou un candidat-usager à un service public industriel et commercial, le bloc de compétence reconnu au juge judiciaire fait même obstacle à l'effet attractif de la notion de travail public : T.C. 17 octobre 1966, Dame Veuve Canasse, Rec, p. 834 ; D. 1967, J., p. 252, note Durupty ; J.C.P. 1966, II, p. 14899, conclusions Dutheillet de Lamothe.
* 1 CE 1er oct. 1993, Sté en participation "Le pool des actionnaires de Bormes-les-Mimosas", req. n°°54.661, Lexis.
* 2 Recours de candidats ayant été illégalement exclus de l'autorisation de soumissionner : CE 24 juin 1959, Sieur Hamon, Rec., p. 394 ; CE Sect. 13 mai 1970, Sieur Monti c/ cne. de Ranspach, Rec., p. 322. Recours d'un candidat réclamant une indemnité pour les frais engagés au cours d'une adjudication qui a été déclarée irrégulière par le Conseil d'État : CE 8 janv. 1968, Sieur Cournu, Rec, p. 19.
* 3 TA de Nice, 17 mars 1961, Sté des Etts Crovetto, Rec, p. 778.
* 4 CE 29 nov. 1866, Gris, Rec, p. 1085 ; CE 13 mai 1987, Sté "Wanner Isofi Isolation", Rec, p. 171. ; CE 1er avr. 1994, S.A. Etts J. Richard Ducros, RFDA 1994, p. 620, rubrique Ph. Terneyre.
* 5 CE Sect. 7 oct. 1994, Époux Lopez, AJDA 1994, p. 867 chron. L. Touvet et J.H. Stahl ; RFDA 1994, p. 1090, concl. R. Shwartz, p. 1098, note D. Pouyaud. Dans une affaire similaire de vente relevant du droit privé, le juge a toutefois rejeté la demande d'astreinte, estimant qu'en engageant une action devant les juridictions judiciaires afin d'obtenir l'annulation de la vente, " la commune doit être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif " (CE 26 mai 1995, Minvielle, Rec, p. 220).
* 6 CE 30 oct. 1998, Ville de Lisieux, RFDA 1999, p. 128, concl, Stahl ; JCP 1999, II, 10045, note Haïm ; AJDA 1998, p. 1041, chron. Fombeur et Raynaud.
* 1 Traité des contrats administratifs, précité, p. 789, n°°787.
* 2 CE Ass. 9 oct. 1996, Mme Wajs et Monnier, Rec., p. 387 ; CJEG 1997, p. 52 et RFDA 1997, p. 726 concl. Combrexelle ; AJDA 1996, p. 973, chron. Cauvaux et Girardot ; JCP 1997, II, p. 22777, note Peyrical.
* 3 CE 3 juill. 1988, Min de la défense c/ Cofiroute, Rec, p. 246.
* 4 Concl. Odent sous CE 5 mai 1943, Compagnie générale des eaux, D. 1944, J., p. 121.
* 1 CE Ass. 1 er juill. 1996, Cayzeele, Rec., p. 274 ; AJDA 1996, p. 732, chron. Chauvaux et Girardot ; CJEG 1996, p. 382, note Ph. Terneyre ; RFDA 1997, p. 89, note p. Delvolvé : En l'espèce le tiers était un propriétaire d'un appartement situé dans une copropriété qui s'était vue imposer, par le contrat conclu entre la collectivité locale et l'entreprise chargée du ramassage, une certaine dimension des poubelles utilisées.
* 2 CE 13 oct. 1961, Companon-Rey, AJDA 1962, p. 98, concl. Heumann ; T.C. 17 déc. 1962, Dame Bertrand, AJDA 1963, p. 105 et 88, chron. Gentot et Fourré.
* 3 CE 25 avr. 1969, Derobert, Rec, p. 230.
* 1 CE 23 juin 1976, Latty, Cne. de Vaux-sur-mer, Rec., p. 329. Voir également CE 1 er mars 1991, Pabion, Rec., p. 69 et L. Richer, Droit des contrats administratifs, 2 ème éd., LGDJ, 1999, p. 201.
* 2 CE 15 fév. 1961, Goumy, Rec. tab., p. 1092. CE 15 fév. 1961, Goumy, Rec. tab., p. 1092
* 3 CE 11 mai 1838, Compagnie des 4 canaux c/ Min. des trav. publics, Rec, p. 258.
* 4 CE 13 mars 1963, Sté Deromedi, Rec, p. 160.
* 5 CE 17 mars 1989, Ville de Paris c/ Sté Sodevam, AJDA 1989, p. 475, concl. B. Stirn.
* 1 CE Sect. 13 mai 1970, Sieur Monti c/ cne. de Ranspach, Rec, p. 322 : " l'intéressé a droit, par suite, à une indemnité calculée non pas d'après le montant des frais exposés pour l'établissement de la soumission, mais d'après celui du manque à gagner constaté en fait ".
* 2 CE 26 mars 1980, Centre hosp. de Seclin, Rec. tab., p. 787 ; M.P. 1981, n°°176, p. 24, concl. Mme Latournerie ; CE 13 mai 1987, Sté "Wanner Isofi Isolation", Rec, p. 171 ; CE 9 déc. 1987, Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres, Rec, p. 404 ; M.P. 1989, n°°239, p. 20, concl. Mme Hubac ; CE 7 juill. 1999, Sté Atek, BJCP, n°°8, p. 68.
* 3 CE 4 juin 1976, Desforets, Rec, p. 301 ; CE 13 juin 1978, Sté O.L.G.E.M.A., Rec tab., p. 794. CE 4 juin 1976, Desforets, Rec, p. 301 ; CE 13 juin 1978, Sté O.L.G.E.M.A., Rec tab., p. 794
* 4 CE 8 fév. 1901, Cne. de St-Pierre c/ sieur Riotteau, Rec, p. 148.
* 5 CE 7 nov. 1980, S.A. Schmid-Valenciennes, Rec, p. 416 ; M.P., 1981, n°°178, p. 41, concl. D. Labetoulle ; D., 1981 IR.115, obs. p. Delvolvé ; CE 9 mars 1984, J.-C. Havé, AJDA 1984, p. 400, note B. Sablier et J.-E. Caro
* 6 CAA Bordeaux 5 fév. 1996, Sté Sarec, M.P., n°°8/95-96, p. 24.
* 7 CAA de Nantes 16 mars 1994, S.A. Barillec, req. n°°91NT00689, Lexis.
* 8 CE 13 juin 1986, O.P.H.L.M. du Pas-de-Calais c/ Sté Franki Fondations France, AJDA 1986, p. 505, note B. Sablier et J.-E. Caro ; Quot.jur., 23 août 1986, p. 2 , note F. Moderne ; D. 1986.IR.424, note Ph. Terneyre.
* 9 CE 18 mai 1889, Reinach, Soubeyran et autres c/ Sté des recherches houillères de Lubière et Rilhac, Rec., 570, concl. Gauwain, p. 571.
* 10 CE Ass. 30 mars 1966, Cie générale d'énergie radio-électrique, Rec, p. 257.
* 1 M. Bacache, thèse précitée, p. 18.
* 2 F. Terré, Ph. Simler, Y.Lequette, Droit civ. Les obligations, Précis Dalloz, 7 ème éd., 1999. p. 453, n°°470, en citant : Cass. soc, 21 mars 1972, JCP 1972.11.17236 note Saint-Jours, RTDC 1973, p. 128, Durry ; Cass. com., 16 janvier 1973, Bull. civ. IV n°°28, p. 22 ; Cass l ère civ 15 déc. 1998, Contrats, conc, consom. 1999 n°°37, obs. L. Leveneur, Defrénois 1999.745, D. Mazeaud ; voir particulièrement : Durry, RTDC 1968, p. 365 ; RTDC 1971, p. 143 ; RTDC 1974, p. 815.
* 3 Cass. civ l ère 21 nov. 1978, JCP 79, II, 19033 ; Cass. com 17 fev. 1981, JCP 81, IV, 157, ou lorsque des cautions se prévalent d'une convention passée entre la banque créancière et une autre banque (Cass. com 22 oct. 1991 ; Bull IV n°°302, p. 209.
* 4 Cass. Civ. 217 mai 1995, RTDC 1995, p. 896 obs. p. Jourdain.
* 5 M. Baccache, thèse précitée, p. 86.
* 1 P. Jourdain, RTDC 1992, p. 567, propose d'opposer les obligations générales " qui imposent un comportement de nature à éviter de causer des dommages à autrui " et celles " plus spécifiquement contractuelles " ; G. Viney, préc, n°°215, p. 402.
* 2 Pour un exemple récent CE 11 décembre 2000, Mme Agofroy et autres, RFDA 2001, p. 1277, concl. S. Austry : victimes de l'incendie de leurs locaux professionnels, les occupants du domaine public sont fondés à rechercher directement la responsabilité de l'administration concédante en raison de l'insolvabilité de la société concessionnaire avec laquelle ils avaient contracté. La faute lourde contractuelle commise par la société qui n'avait pas respecté lesexigences de son contrat conclu avec la ville de Paris, peut être invoquée par les tiers et justifier leur droit à indemnité.
* 3 F. Llorens, thèse précitée, p. 644.
* 4 Ph. Terneyre, thèse précitée, p. 54.
* 1 La jurisprudence Bianchi : symbole ou réalité ?, Droit administratif, janvier 2001, p. 9
* 2 Cf. D. 2000 S.C, p. 241 sq. et notre note, dont s'inspire la présente analyse.
* 1 Cf. D. 2000 S.C, p. 241 sq. et notre note, dont s'inspire la présente analyse.
* 1 Tout de même une certaine importance est-elle accordée à un paramètre d'ordre temporel. C'est en effet " compte tenu du délai entre l'hospitalisation de M. D. et l'apparition des symptômes de l'hépatite B " et, " en l'absence de tout autre élément invoqué par l'Assistance publique à Marseille et ayant pu concourir à la réalisation du dommage" que " la contamination [...] doit être imputée aux traitements effectués à l'hôpital Sainte-Marguerite ". Selon toute probabilité, cette présomption se serait donc diluée -- peut-être jusqu'à disparaître -- si un laps de temps beaucoup plus long s'était écoulé entre l'hospitalisation et l'apparition des troubles. Mais cette réserve appelle une certaine circonspection. Car si le délai moyen d'incubation de l'hépatite B est bien connu, l'on sait aussi qu'un portage asymptomatique du virus peut avoir lieu, qui ouvre la possibilité d'une apparition tardive des troubles proprement dits. Or aucune raison ne justifie l'indemnisation des seuls contaminés ayant connu la "chance" de tomber malades tout de suite : les autres peuvent subir à plus grande distance des préjudices tout aussi graves en conséquence de la même contamination. Cette idée d'un bref délai doit donc se manier avec beaucoup de précaution. D'autant qu'à défaut, la probabilité est grande de voir se développer, dans le contexte d'une sorte de suspicion globale, une demande de dépistage systématisé de toutes les maladies virtuellement transmissibles trois ou quatre mois après chaque séjour à l'hôpital. Au demeurant, rien ne prouve que l'on ne s'achemine pas déjà vers la généralisation de tels comportements. En l'état du droit, la garantie de parfait fonctionnement de la présomption de causalité ne peut d'ores et déjà être obtenue qu'au prix d'un double bilan biologique : juste avant l'hospitalisation pour établir que l'on n'était pas préalablement infecté, et trois mois après pour attester qu'on l'est bien devenu. Une présomption de causalité ne vaut que parce qu'elle présume, et dispense d'établir quelque chose que l'on ne peut jamais avérer. La rigueur veut donc que seule la preuve contraire puisse aller contre. Et certainement pas une autre présomption, même plus crédible. Le caractère extrêmement discutable des solutions enregistrées en sens inverse (Cf. nos obs. s/ CE, 16 juin 1997, Assistance publique - Hôpitaux de Paris et CE, 30 juill. 1997 Csts. Beaumer, D. 1999, SC. p. 57, et récemment le très discutable arrêt de la le Chambre civile de la Cour de cassation du 23 nov. 1999, Médecine et Droit, 40, 2000, p. 22, n°°10), conduit à espérer que le Conseil d'État usera ici de ce paramètre temporel avec une toute particulière parcimonie. D'autant qu'à défaut une certaine discordance pourrait se faire jour sous cet angle entre le régime de la responsabilité du fait des infections nosocomiales et celui des contaminations par le truchement d'un usage volontaire de dérivés biologiques humains, que l'on aurait grand peine à fonder. Mais rien n'indique que la jurisprudence administrative tende vers cet écueil (Cf. par ex. l'application très nette de la présomption de causalité dans une affaire de contamination transfusionnelle à l'hépatite C par la CAA de Paris, 12 févr. 1998, X. et Y., DA 1998, n°°293)
* 1 Cass., le civ. 8 nov. 2000, (n° 1815), Rapp. SARGOS, l'un et l'autre disponibles sur le site Internet de la Cour de cassation
* 2 Celle qui consiste à dire que le juriste, observant une partie de cartes, tendrait à analyser la règle du jeu alors que le sociologue s'attacherait à comprendre comment jouent les joueurs. Là-dessus, Cf. surtout E. SERVERIN, Sociologie du Droit, La Découverte, 2000, "Agir selon les règles dans la sociologie du droit de M. Weber", in E. SERVERIN et A. BERTHOUD (éds), La production des normes entre État et société civile, L'Harmattan, 2000, E. SERVERIN et p. LASCOUMES, "Le droit comme activité sociale : pour une approche weberienne des activités juridiques", in p. LASCOUMES (dir.), Actualité de Max Weber pour la sociologie du Droit, LGDJ 1996.
* * voir note explicative fournie p. 261
* 1 Très significatives sont les réactions entraînées par deux affaires qui ont connu en même temps un véritable déchaînement médiatique et des prises de position, parfois fort argumentée, de la part de la doctrine juridique. À ce dernier égard, on citera seulement deux exemples. D'une part, l'ouvrage d'Olivier BEAUD, "Le sang contaminé" (P.U.F. - 1999), qui a fait l'objet d'un très intéressant commentaire critique d'Olivier CAYLA dans le n° 642 de "Critique" (éd. de Minuit - nov. 2000). Et de ce dernier, avec Yann THOMAS, l'ouvrage paru en 2002 (Gallimard, coll. Le Débat) à propos de l'affaire PERRUCHE, "Du droit de ne pas naître", étude qui donne à cette affaire une analyse à la fois rigoureuse et engagée du plus grand intérêt.-
* 2 Sur cette question, voir notamment l'excellent petit ouvrage de Philippe SÉGUR, "La responsabilité politique" - Que sais-je ? n° 3294, P.U.F., 1998.
* 3 Parmi les études contemporaines consacrées au thème de la responsabilité, outre celles de Paul RICOEUR (notamment les deux volumes de "Le juste", éd. Esprit, 1995-2000) que nous retrouverons très longuement, on peut citer l'ouvrage de Hans JONAS, "Le principe responsabilité" (éd. du Cerf- 1990, et Champs Flammarion, 3 e éd., 2000), ceux d'Emmanuel LEVINAS, "Éthique et infini", (Livre de poche, Biblio essais, 2000), de Gilles LIPOVETSKY, "Le crépuscule du devoir", (Gallimard, 1992 et Folio essais, 2000), d'Alain ETCHEGOYEN, "La vraie morale se moque de la morale - Être responsable", cité ici surtout pour l'excellent commentaire très critique qu'en a fait Denys de BÉCHILLON dans le revue "Critique", (éd. de Minuit, n° 642, novembre 2000). On signalera aussi le numéro de la revue "Autrement", série Morales, n° 14, 1995, consacrée à "La responsabilité", sous la direction de Monette VACQUIN, et notamment l'étude de Catherine LABRUSSE-RIOU, "Entre mal commis et mal subis : les oscillations du droit", p. 94 et s.
* 1 Voir à cet égard le panorama bien dessiné par Jacqueline RUSS, "La pensée éthique contemporaine", Que sais-je ?, n° 2834, P.U.F., 1994.
* 2 Paul RICOEUR, postface aux "Temps de la responsabilité" (ouvrage collectif publié aux éd. Fayard en 1991), in "Lectures 1 -Autour du politique", Seuil, 1991, p. 270 et s.
* 3 Voir en particulier l'étude de Jacques CHEVALLIER, "L'obligation en droit public", in " L'obligation", Archives de philosophie du droit, T. 44, 2000. Et aussi F. LINDITCH, "Recherches sur la personnalité morale en droit administratif, Bibliothèque de droit public, T. 176, L.G.D.J., 1997.
* 4 Dans la "Théorie pure du Droit", KELSEN ne consacre guère plus d'une dizaine de pages à la question des fondements de la responsabilité. On conviendra cependant que cette question est traitée dans une étude spécifique citée par cet ouvrage, et dont il sera question plus loin : "Vergeltung und Kausalität", La Haye, 1941, p. 1 et s., "Society and Nature", Chicago, 1943, p. 1 et s.
* 1 On peut cependant relever l'ensemble des études publiées dans le tome 22 des "Archives de philosophie du droit" en 1977, et précisément consacrées au thème de la responsabilité (Sirey, 1977). Et bien évidemment, à propos de l'affaire PERRUCHE, la remarquable contribution déjà citée d'Olivier CAYLA et Yann THOMAS, "Le droit de ne pas naître", Gallimard, 2002.
* 2 Sur la distinction problématique entre morale et éthique, beaucoup a été écrit. Voir, quant au sens de ces deux mots, les positions d'André LALANDE dans son "Vocabulaire technique et critique de la philosophie", P.U.F. (10 e éd., 1968).
* 3 Voir notamment V. JANKELEVITCH, "Le pardon", in "Philosophie morale", Flammarion, 1998, p. 993 et s.
* 1 Ch. EISENMANN - Cours de droit administratif T. II "La responsabilité du droit administratif (1953-1954), L.G.D.J 1983 p. 833 et suite ; et l'excellent petit ouvrage de J. MOREAU "La responsabilité administrative" - Q.S.J. n°°2292 - l ère éd. 1986, p. 67 et suite.
* 1 H. KELSEN "Théorie pure du Droit", trad. 2 ème éd. par Ch. EISENMANN - Dalloz 1962 p. 169.
* 2 p. RICOEUR "Le Juste", éd. Esprit, 1995, p. 41 et suite.
* 1 Cf. not. : "Le concept de responsabilité", op. cit., p. 52 ; "La personne et la référence identifiante", in "Soi-même comme un autre", Seuil 1990, p. 39 et suite. Dans ce texte, P. RICOEUR explique qu'il utilise le terme anglais et non une traduction "afin de marquer dans le vocabulaire la référence qui sépare l'attribution d'expériences à quelqu'un de l'attribution au sens général" (note 1, p. 53).
* 2 J.M. FERRY, "Narration, interprétation, argumentation, reconstruction. Les registres du discours et la normativité du monde social" in "Histoire de la philosophie politique", t. 5 "Les philosophies politiques contemporaines", p. 234. J.M. FERRY utilisant ce mot, donne sa traduction en allemand (Zuschreibung), et il le met en rapport avec le mot imputation ( Zurechmmg ) .
* 3 L.A. HART - "Positivism and the Séparation of Law and Morals" Harvard Law Review -1958 ; reproduit in "Essays in Jurisprudence and Philosophy" Oxford - 1983 - Clarendon Press, p. 56 n. 25.
* 4 Article paru in "Proceedings of the Aristotelian Society" 1948 p. 171-194.
* 5 P. RICOEUR "La personne et la référence identifiante", in "Soi même comme un autre" op. cit p. 43.
* 6 P. RICOEUR "La personne et la référence identifiante" op. cit. p. 44.
* 1 P. STRAWSON - op. cit., p. 100.
* 2 On connaît la formule fameuse de PROTAGORAS selon laquelle "l'homme est la mesure de toutes choses" qui traduirait l'enfermement de chacun dans ses propres représentations. Cf. sur ce point Paul DELMONT - "La formule de Protagoras : l'homme est la mesure de toute chose", in "Problèmes de la morale antique" (dir. P. DELMONT), publications de la Faculté des Lettres d"Amiens, 1993, p. 39-57.
* 3 P. STRAWSON, op. cit., p. 112. P. RICOEUR "La personne et la référence identifiante", op. cit., p. 53. On ne peut ici évoquer les remarques critiques, très nuancées, que RICOEUR formule à cet égard. On notera seulement celle-ci : "Au vu de ces questions, la thèse de la mêmeté de l'ascription à soi-même et à un autre que soit requiert que l'on rende compte de l'équivalence entre les critères description : ressentis et observés" (ibid.)
* 1 P. RICOEUR, "Le concept de responsabilité", op. cit., p. 53.
* 2 Dans cette perspective nous ne reprendrons pas la question des diverses conceptions de la causalité retenues par la doctrine juridique classique, et en particulier la théorie bien connue de la théorie de l'équivalence des conditions, de la conditio proxima et de la causalité adéquate. On rappellera cependant que la doctrine, aussi bien publiciste que privatiste, aborde le problème de la causalité de manière essentiellement empirique, à partir des solutions de la jurisprudence qu'elle tente de systématiser. Sur ce point, voir l'étude de G. MARTY, "La relation de cause à effet comme condition de la responsabilité civile", Revue Trim. Dr. Civ., 1939, p. 702 et s. V. aussi R. CHAPUS, "Responsabilité publique et privé", Bibl. de dr. Public tome VIII - L.G.D.J. 1957, p. 439 et s. ; et plus récemment : Maryse DEGUERGUE, "Jurisprudence et doctrine dans l'élaboration du droit de la responsabilité administrative", Bibl. de dr. Public, t. 171 - 1994, not. p. 439 et s., et p. 610 et s.
* 3 H. KELSEN, "Théorie pure du droit", op. cit., p. 105 et s. ; cf. aussi "Théorie générale des normes" - 1979, trad. Française O. BEAUD et F. MALKANI - P.U.F. (coll. Leviathan), ch. 7, p. 31 et s.
* 1 H. KELSEN, "Théorie pure du droit", op. cit., p. 118.
* 2 H. KELSEN, ibid., p. 124.
* 3 P. RICOEUR, "Le concept de responsabilité", op. cit., p. 50.
* 4 Il faut préciser, sur ce point, qu'une telle distinction, nécessaire à la clarification du processus de recherche de la responsabilité entendue comme obligation de réparer ne se manifeste pas clairement au plan empirique, et que les deux interrogations évoquées au texte sont dans la réalité étroitement imbriquées et qu'effectivement elles semblent se confondre. Mais, il faut le répéter, l'analyse doit conduire à les distinguer.
* 1 P. RICOEUR, "Le concept de responsabilité", op. cit., p. 55.
* 2 ARISTOTE, "Éthique à Nicomaque", III, V, éd. Garnier-Flammarion, 1992, p. 84 et s.
* 3 C'est par des métaphores qu'ARISTOTE fait intervenir ces deux types de déterminations qui viennent se tisser avec notre choix. Celles de la nature d'abord, avec la métaphore de la pierre lancée : si un homme a la libre décision de jeter une pierre ou de la laisser tomber, il reste que " qui lance une pierre ne peut plus la rattraper "(p. 86). Et pour les déterminations résultant des actions humaines qui interfèrent à la nôtre, cette remarque ambiguë : " l'homme est le principe générateur des ses actes comme de ses enfants" (p. 84), des enfants que nous générons et élevons, mais qui décident ensuite leurs propres choix.
* 4 H. KELSEN, "Vergeltung und Kausalität" - La Haye - 1941, "Society and nature", - Chicago - 1953 ; cette analyse est reprise dans la "Théorie pure du droit", op. cit., spéc, p. 114 et s. II faut rappeler que le terme "imputation" est interprété par KELSEN dans un sens qui s'oppose à celui de "causalité".
* 5 KELSEN précise sur ce point : "Si un événement est ressenti comme un mal, il est interprété comme une peine pour une conduite mauvaise, pour un délit, s'il est ressenti comme un bienfait, il est interprété comme la récompense d'une bonne conduite", in "Théorie pure du droit", op. cit., p. 115.
* 6 KELSEN relève à cet égard que l'"une des premières formulations de la loi de causalité est le célèbre fragment d'Héraclite : si le soleil ne se maintient pas dans le chemin qui lui est prescrit, les Erinnyes, instruments de la justice, sauront le remettre dans le droit chemin", ibid., p. 117.
* 1 KELSEN, ibid., p. 117.
* 2 Sur ce point, v. notamment l'importante étude de J.P. VERNANT, "La formation de la pensée positive dans la Grèce archaïque", Annales E.S.C., 1957, p. 283 et s. ; repris in "Mythe et pensée chez les Grecs", éd. F. Maspero (PCM), 1981, t. II, p. 95 et s.
* 3 Dans les poèmes homériques, les Erinyes maudissent la famille d'Agamemnon à la suite du sacrifice d'Iphigénie : ce sont elles qui poussent Clytemnestre à tuer son mari. On connaît aussi la malédiction des Erinyes sur la personne d'OEdipe. On est, dans tout cela, assez loin de la " rétribution ".
* 4 Sur les Moires chez Homère, cf. not. in L'Iliade, : IV, 517 ; V, 83 ; 613 ; XII, 116 ; XVI, 483 et s., 849 et s. ; XIX, 87 ; XX, 128 ; XXIV, 132 ; 209.
* 5 Sur ce point, cf. not. le "Dictionnaire de l'Antiquité" établi par l'université d'Oxford, sous la direction de M.C. HOWATSON - Oxford University Press, 1989 ; trad. fr : éd. R. Laffont, coll. Bouquins, 1993 - V° "destin".
* 1 KANT - "Critique de la raison pure" - coll. Quadrige P.U.F., p. 348 et s.
* 2 KANT - "Critique de la raison pure", op. cit., p. 350.
* 3 Ibid .
* 4 Ibid .
* 5 Ibid .
* 6 Ibid .
* 1 KANT, "Critique de la raison pure", op. cit., p. 349.
* 2 KANT - "Critique de la raison pure", op. cit., p. 353.
* 3 KANT - "Introduction à la Métaphysique des moeurs" (1797) in "Doctrine du droit" - Vrin -1971.
* 4 Simone GOYARD-FABRE - "Responsabilité morale et responsabilité juridique selon Kant", in "La responsabilité", t. 22, Archives de philosophie du droit (Sirey - 1977), p. 116.
* 5 "Doctrine du droit - Introduction à la Métaphysique des Moeurs", trad. PHILONENKO -Vrin- 1971-p. 97-98.
* 6 Simone GOYARD-FABRE - "Responsabilité morale et responsabilité juridique selon Kant", op. cit., p. 120.
* 1 Sur ce point que l'on ne peut ici développer, cf. S. GOYARD-FABRE - "Responsabilité morale et responsabilité juridique selon Kant", op. cit., p. 117 et s. Cf. aussi sur cette distinction, A. TOSEL, "Kant révolutionnaire - Droit et politique" - P.U.F., coll. Philosophies, 2 e éd., 1990, p. 40 et s.
* 2 P. RICOEUR, "La concept de responsabilité", op. cit., p. 56.
* 1 KANT, "Critique de la raison pure", op. cit.
* 1 DESCARTES, "Méditations métaphysiques" - (1647), 3 e méditation - § 7, 115 - éd. Hachette - Classiques Philos., 1996, p. 42.
* 2 Michel FOUCAULT, "Ceci n'est pas une pipe" - éd. Fata Morgana - 1973.
* 3 Ibid., p. 25.
* 4 L.L. GRATELOUP, "Problématiques de la philosophie", Livre de Poche - Biblio essais, Hachette, 1995, p. 262. Et l'auteur cite WITTGENSTEIN, qui, dans "De la certitude", livre cette anecdote : "...
* 1 KELSEN, "Théorie pure du droit", op. cit., p. 93 et s.
* 2 KELSEN, "Théorie pure du droit", op. cit.? p. 100.
* 3 KELSEN, "Théorie pure du droit", op. cit.? p. 235.
* 4 Ibid., p. 236.
* 5 RAWLS, "Théorie de lajustice", op. cit.
* 6 Michel VILLEY, "Philosophie du droit", Dalloz, 2 e éd., 1978, t. 1, n°111, p. 190. Cf. aussi P. HEBRAUD : "le droit ne se propose pas la recherche de la vérité dans la connaissance, mais celle de la justice dans l'action" ("La logique juridique", Ve colloque des Instituts d'Études Judiciaires - Rapport introductif - P.U.F., 1969, p. 25.
* 1 P. RICOEUR - "Justice et vérité" in "Le juste 2" - éd. Esprit 2001, p. 69 et s.
* 2 Ibid., p. 70.
* 3 Ibid., p. 81.
* 4 Ibid., p. 71.
* 5 Ibid., p. 76.
* 1 M. FOUCAULT - "La vérité et les formes juridiques", in "Dits et écrits", t. II, n°139, p. 538 et s.
* 2 M. FOUCAULT - "La vérité et les formes juridiques", op. cit., p. 541.
* 3 Ibid.
* 1 V. sur ce point notamment G. MARTY, préc.
* 2 H. KELSEN, "Théorie pure du droit", op. cit., p. 25 et la note consacrée à la position de ROSS in "Towards a Realistic Jurisprudence" - Copenhague - 1946, p. 42 et s.
* 3 CE. - 14 janvier 1916 - Camino- Rec. 15 ; G.A.J.A. - Dalloz, 12 e éd., p. 179 (commentaire cité au texte).
* 4 CE. - sect. - 2 février 1945 - Moineau - Rec. 27, G.A.J.A. p. 369.
* 5 Ronald DWORKIN - "A Matter of Principle", 2 e partie : "Law as interpretation", Oxford University Press - 1985.
* 1 P. RICOEUR - "Justice et vérité" in "Le Juste 2", op. cit., p. 82 - cf. aussi : "Interprétation et/ou argumentation", in "Le Juste 1", op. cit., p. 163 et s., et not. p. 164.
* 2 Cette conception n'est pas très éloignée de la "théorie structurante du droit" élaborée par Friedrich MÜLLER ("Discours de la méthode juridique" - P.U.F., 1996 ; et en allemand "Strukturierende Rechtslahre" - 2 e éd. Dunker et Humblot - 1994). Sur cette théorie, cf. l'analyse d'Olivier JOUANJAN : "Nommer/normer - Droit et langage selon la théorie structurante du droit" in "La dénomination" Cahier de l'Institut Universitaire de France - Sciences et humanités - n° 1, 1999, p. 103 et s., spéc. p. 118.
* 3 M. FOUCAULT, "La vérité et les formes juridiques", op. cit., p. 542 et s. Notamment, ce texte daté de 1873 : "Au détour de quelque coin de l'Univers inondé des feux d'innombrables systèmes solaires, il y eut un jour une planète sur laquelle des animaux intelligents inventèrent la connaissance. Ce fut la minute la plus orgueilleuse et la plus mensongère de l'histoire de l'humanité".
* 1 M. FOUCAULT, "La vérité et les formes juridiques", op. cit., p. 545.
* 2 M. FOUCAULT, "La vérité et les formes juridiques", op. cit., p. 553.
* 3 Ibid., p. 551.
* 4 Ibid., p. 561.
* 1 HOMÈRE, "L'Iliade", T. IV, chant XXIII, trad. p. MAZON, Les Belles Lettres, 1998, p. 108 et s.
*
2
SOPHOCLE, "OEdipe Roi", in Tragédies, T. Il, coll. Des Universités de France, 8
e
tirage,
1994.
La vérité révélée par le devin Tirésisas apparaît dès le premier épisode, v. 316 à 462. Et comme l'écrivait SCHILLER dans une lettre à GOETHE le 2 octobre 1797 : "OEdipe Roi n'est guère en quelque sorte qu'une analyse tragique. Le tout est déjà accompli, et la pièce se borne à le débrouiller" (cité par Ph. BRUNET - Introduction à "OEdipe Roi" - op. cit., p. XVI).
* 3 M. FOUCAULT - "La vérité et les formes juridiques", op. cit., p. 566.
* 4 Sur le sens de cette boiterie dans l'interprétation du mythe d'OEdipe on renvoie à l'analyse aujourd'hui classique menée par Claude LEVI-STRAUSS dans son "Anthropologie structurale" (Plon, 1958 et coll. Agora 1996), spécialement p. 246 et s. ; voir aussi J.-P. VERNANT - "Le tyran boiteux : d'OEdipe à Périandre", cité par Ph. BRUNET dans son introduction précitée à "OEdipe Roi", p. XVII.
* 5 L'idée que l'énigme de la sphinge était "destinée" spécialement à OEdipe se retrouve dans l'interprétation suggérée vers 1849 par QUINEY : le sujet de l'énigme aurait été "moins l'homme en général que l'individu OEdipe, misérable et orphelin en son matin, seul à l'âge adulte, et appuyé sur Antigone dans sa vieillesse aveugle et désespérée" (BORGES - "Manuel de zoologie fantastique" - 1957, éd. 10/18, 1970, p. 81).
* 1 Cf. sur ce point J.P. VERNANT, "Du mythe à la raison : la formation de la pensée positive dans la Grèce archaïque" in "Mythes et pensée chez les Grecs", Maspero, t. II, 1981, p. 95 et s.
* 2 M. FOUCAULT, "La vérité et les formes juridiques", op. cit., p. 571.
* 1 Ibid.
* 1 La responsabilité des personnels hospitaliers pour faute personnelle, dont la mise en jeu est très exceptionnelle, ne sera pas analysée dans le cadre de cet examen.
* 1 Droit du dommage corporel, Dalloz, 3e éd., 1996, n° l.
* 1 Conseil d'État, Réflexions sur le droit de la santé, Études et documents du Conseil d'État, n° 49, 1998, p. 241 et s. ; J. Waline, "L'évolution de la responsabilité extra-contractuelle des personnes publiques", E.D.C.E., n° 46, 1995, p. 495 et s. ; D. Truchet, M. Morisot, S. Daël, "La responsabilité administrative médicale", in La responsabilité médicale : de la faute au risque, E.N.M., 1996, p. 83 et s., L. Dubouis, "La distinction droit-public-droit privé à l'épreuve de l'évolution de la responsabilité médicale", Mélanges Jean Waline, Dalloz, 2002, p. 195 et s.
* 2 Rec. p. 5 ccl Chauvaux ; A.J.D.A., 2000, p. 180 chron. M. GUYOMAR et p. COLIN ; R.F.D.A., 2000, p. 641, ccl. Chauvaux, note p. Bon ; R.D. sanit. et soc, 2000, p. 357 note L. DUBOUIS.
* 1 Rec. p. 171 ccl. Légal ; J.C.P., G., 1992, II, 21881, note J. Morreau.
* 2 A.J.D.A., 1991, p. 121 chron. J.P. Longuelet et F. Loloum ; J.C.P., G., 1991, II, 21698 note J. Moreau, R.D. sanit et soc, 1991, p. 258, note R.G. Médouze.
* 3 Rec. p. 127 ccl. S. Daël ; A.J.D.A., 1993, p. 349 chron. C. Maugue et L. Touvet : J.C.P., G., 1933, II, 22601 note J. Moreau, R.D.P., 1993, p. 1059 note M. Paillet.
* 1 D. 1999, som., p. 395, obs. J. Penneau, jur., p. 559 note D. Thouvenin ; J.C.P., G., 1999, II, 10138 rapp. Sargos, 2000, I, 1999 chron. G. Viney : R.D. sanit et soc, 1999, p. 568 note G. Mémeteau.
* 1 Obligation dont la C.A.A. de Pars a fait une application remarquable dans l'affaire du sang contaminé : C.A.A. Paris, 12 novembre 1999, Consorts X c/ A.P.-H.P., A.J.D.A, 2000, p. 235 obs. J. de Saint-Guilhem.
* 2 Par exemple ; D. Kourilsky et G. Viney, Le principe de précaution - Rapport au Premier ministre, 2000, p. 167 et les références ; A. Rouyère, "L'exigence de précaution saisie par le juge", R.F.D.A., 2000, p. 278.
* 3 S. Barré et L. Houdart, "Les nouvelles règles de l'indemnisation des accidents médicaux", Rev. hosp. de France, n° 487, juillet-août 2002, p. 41 ; L. Dubouis, "La réparation des conséquences des risques sanitaires", R. dr. san. soc, 2002, n° 3 ; A.M. Duguet, "L'expertise médicale des risques sanitaires", Rev. hosp. de France, n°487, p. 37 ; Y. Lambert-Faivre, "La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé - II - L'indemnisation des accidents médicaux", D., 2002, chron., p. 1367 ; N. Rebout-Maupin, "L'indemnisation de l'aléa thérapeutique", Petites Affiches, 19 juin 2002, p. 77.
* 1 M. Le Foyer de Costil, "Évolution de la jurisprudence judiciaire en matière de responsabilité médicale", E.D.C.E., n° 49 précité, p. 396 ; Conseil d'État, "Réflexions sur le droit de la santé", E.D.C.E., n° 49, précité, p. 265 et s.
* 1 Rec. p. 37 ; A.J.D.A. 1988 p. 154 chron. M. Azibert et M. de Boisdeffre ; Rev. dr. san. soc, 1988, 317, L. Dubouis
* 2 Rec. p. 194 ccl. Kessler, AJDA 1993 p. 530 chron. C. Maugüe et L. Touvet ; D. 1994, 74, Peyrical ; J.C.P., 1993, JCP 1993 II 22133 Gonod.
* 1 C.E., 14 février 1997, Rec. p. 44 ccl. V. Pécresse et R.F.D.A., 1997, p ; 374 ccl.
* 2 Cass, ass. plén., 17 novembre 2000, JCP II 10438 rapp. P Sargos ccl. J. Sainte-Rose. Cette décision a suscité plus d'une quarantaine de commentaires !
* 3 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, art. 1 er .
* 4 RFDA, 1998, 1231 ccl. M. Heers.
* 5 N° 198546, à paraître au Rec.
* * Retenu dans un autre colloque, Monsieur le professeur DUPRAT a bien voulu nous adresser sa communication
* 1 CE 17 mai 2000 - Canas, note E. Savatier, JCP, 24 janvier 2001, II, 10462, p. 199, confirmant CE - 5 janvier 2000 - Époux Telle, RFDA, mai-juin 2000, p. 652.
* 2 Conclusions D. Chauvaux, RFDA, précité, p. 648.
* 3 Cassation - 1 ère civile, 18 janvier 2000 - Mme D. c/. Mme S., JCP 14 février 2001, II, 10473, p. 371, note A. Domster-Dolivet.
* 1 Sur ce point, la thèse de C. Clément - La responsabilité du fait de la mission de soins des établissements publics et privés de santé - Les Études hospitalières, Bordeaux, 2000, faisant apparaître à la fois les convergences et la persistances de solutions propres.
* 2 Proposition de loi de MM. Debré et Douste-Blazy, Doc AN, 22 juin 2000.
* 3 Le Monde 17 février 2000.
* 4 J.C. Baste - L'aléa médical : évolution du concept en droit public, in D. Truchet (direction) - L'indemnisation de l'aléa thérapeutique, Sirey, 1995, p. 20 et s.
* 5 D. Dendonker - L'information médicale face au dualisme juridictionnel - Revue administrative, n°°319, p. 79.
* 6 Y. Lambert-Faivre - Droit du dommage corporel, Dalloz, 1996, p. 630.
* 1 F, Chabas - Note sous 1ère civile - 8 novembre 2000 - Destandau-Touneur, JCP 21 mars 2001, 11, 10493, p. 605.
* 2 Dans cette affaire Destandau-Tourneur, la première Chambre civile précise :..." la réparation des conséquences de l'acte thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont le médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient". L'expression est également utilisée par M. Sargos dans son rapport (précité p. 603) qui donne la définition suivante :..." la réalisation en dehors de toute faute du praticien d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé", voir les observations de L. Dubouis - Revue de Droit sanitaire et social, 2001, p. 55.
* 3 Réflexions du Conseil d'État sur le droit de la santé - EDCE, n°° 49, Documentation française 1998, p. 253.
* 4 Idem p. 253, avec la citation des conclusions de M. Daël sur l'affaire Bianchi.
* 1 Rapport précité p. 255.
* 2 Rapport de F. Ewald - Le problème français des accidents thérapeutiques, enjeux et solutions -septembre-octobre 1992, documentation française 1993, p. 103.
* 3 JCP 21 mars 2001, p. 604.
* 4 V. notamment l'étude de C. Radé - Réflexions sur les fondements de la responsabilité civile, D. 1999, chronique, p. 317.
* 1 P. Sargos - L'aléa thérapeutique devant le juge judiciaire, JCP 2 février 2000, I, 202, p. 190.
* 2 Première civile, 9 novembre 1999 - Havet-Delsart, D. 2000, p. 117,. note Jourdain, à propos de la table d'examen radiographique. Dans le cas des produits, il doit être tenu compte des effets de la loi du 19 mai 1998 concernant les produits défectueux.
* 3 CA Paris - 15 janvier 1999, JCP 1999, II, 10068, note L. Bloy.
* 4 V. Y. Lambert-Faivre - La réparation de l'accident médical - D. 2001, p. 572.
* 5 A cet égard, l'arrêt du 7 novembre 2000 - Polyclinique Saint Roch, rendu également par la l ère chambre civile étend de manière significative l'obligation de sécurité aux produits désinfectant dont l'usage est courant notamment dans la pratique chirurgicale - D. 2000, IR, p. 293.
* 1 A. Demichel - Médecine et Droit : bilan provisoire d'une cohabitation problématique -Mélanges JM Auby, Dalloz 1992, p. 718 ; J. Penneau - La responsabilité du médecin, Dalloz, 1996, p. 33.
* 2 Idem, p. 8.
* 3 Conclusions Légal - CE - Assemblée 10 avril 1992, M. et Mme V.
* 1 V. les observations de p. Sargos concernant les effets que l'admission de l'aléa thérapeutique produiraient sur le médecin libéral : JCP 2000, I, 202, p. 193. Également, C. Esper - Le dernier état de la responsabilité des hôpitaux publics -G.P., 12-13 juillet 95 - p. 5.
* 2 J. Montador - La responsabilité des services publics hospitaliers, Berger-Levrault, 1973, p. 58.
* 3 J. Ferrari - Le médecin devant le juge pénal - Cour de cassation, rapport 1999, documentation française 2000, p. 146.
* 4 Par exemple : CE. - 17 janvier 1986, Rec. p. 706 ( Clemens).
* 5 Conclusions sur l'affaire Rouzet -( CE 26 juin 1959 - AJDA, 1959, II, 273).
* 6 Observations Chabas - Droit et Patrimoine, n° 86, octobre 2000, p. 99. Il s'agit d'arrêts rendus par la 1 ère Chambre civile.
* 7 Première Chambre civile 7 janvier 1997, Rapport p. Sargos, note D. Thouvenin, D. 1997, J.
* 1 P. Sargos - L'aléa thérapeutique devant le juge judiciaire, précité, p. 192. Cette jurisprudence s'applique aux différents cas de perforation de membranes, sans que l'état du patient en ait favorisé la réalisation.
* 2 Sur la distinction aléa - risque : J. Saison - Le risque médical, L'Harmattan, 1999, p. 31 et 35.
* 3 F. Thiriez - La jurisprudence Bianchi : symbole ou réalité ? Droit administratif, janvier 2001, p. 9.
* 4 Rec. 1993, p. 127 avec les conclusions de M. Daël.
* 1 Idem p. 131.
* 2 Idem p. 133.
* 3 CAA Lyon - Hôpital Joseph -Imbert d'Arles, RFDA, janvier- février 1994, p. 99 et CE -Section 13 novembre 1997, Rec. p. 412, conclusions V. Pécresse, RFDA, janvier-février 1998, p. 90 et s. Mme Pécresse calque le régime juridique de l'anesthésie générale sur celui de l'artériographie.
* 1 Chronique p. Bon, D. Bechillon - Responsabilité de la puissance publique, D. 1999, sommaires commentés, p. 46.
* 2 C.E. - 21 octobre 2000, Centre hospitalier Seclin, note M. Deguergue, AJDA, 20 mars 2001, p. 309.
* 3 V- les explications de Mme Pécresse : RFDA précité, p. 94.
* 4 CE Section, 5 janvier 2000, avec les conclusions D. Chauvaux, RFDA, 2000, p. 651.
* 1 Première chambre civile, 7 octobre 1998, JCP 1998, II, 10179, conclusions J. Sainte-Rose.
* 2 V. la liste établie par F. Ewald jusqu'en 1992 : Le problème français des accidents thérapeutiques, précité, p. 149 et s.
* 3 Toute une série de déclarations officielles affirmant la volonté d'inclure des dispositions spécifiques dans un projet de loi relatif aux droits des malades et à la modernisation du système de santé : extraits dans le rapport C. Huriet sur la proposition de loi relative à l'indemnisation de l'aléa médical et à la responsabilité médicale - Doc Sénat, 2000-2001, 19 avril 2001, n°°277 p. 16 et s. Également les Échos 17 avril 2001.
* 4 IGAS et IGSJ - Rapport sur la responsabilité et l'indemnisation de l'aléa thérapeutique -septembre 1999, voir analyse dans le Dictionnaire de bioéthique.
* 5 Libre Belgique - 7 février 2000, le Soir, 22 juin 2000.
* 6 Doc Sénat, 200-200 1, n°°221. Voir également Dictionnaire permanent de bioéthique -Bulletin 99, 12 mars 2001, p. 7603.
* 1 Sur ce point, les déclarations du sénateur C. Huriet - Concours médical, 10 mars 2001, p. 603 : "le Gouvernement a peur de s'engager pour des raisons financières".
* 2 Observations de H. Pauliat - Le risque thérapeutique et la responsabilité médicale et hospitalière sans faute - Petites Affiches, 13 juin 1994, p. 20.
* 3 Des études réalisées par les compagnies d'assurances permettent d'estimer à un doublement l'augmentation des indemnisations si les accidents médicaux non fautifs donnent lieu à réparation et sans doute à un quadruplement pour tenir compte de l'effet d'entraînement : J. Saison - Le risque médical, précité, p. 112.
* 4 M. Germond - L'indemnisation de l'aléa thérapeutique par les compagnies d'assurances, in D. Truchet -L'indemnisation de l'aléa thérapeutique, précité, p. 60.
* 5 F. Ewald, rapport précité, p. 78.
* 1 V. par exemple l'entretien de M. Kouchner donné au Journal Le Monde, 17 décembre 1992. Dans ce projet, s'agissant de responsabilité pour faute, le ministre prévoyait l'intervention d'un comité d'experts, avant toute instance contentieuse, afin de favoriser des solutions à l'amiable. De la même manière les dommages liés à un aléa médical auraient été dédommagés par un fonds après intervention de ce comité d'experts. La question aurait été alors ouverte de l'alimentation de ce fonds.
* 2 Des extraits significatifs sont donnés par M. Thiriez - La jurisprudence Bianchi.... précité, p. 9.
* 3 Proposition de loi relative à l'indemnisation des accidents sanitaires - Doc AN, 11 ème législature, 7 janvier 1998, n°°616.
* 4 Proposition de loi relative à l'indemnisation de l'aléa thérapeutique - Doc AN, 10 ème législature, 28 avril 1994, n°°1181.
* 5 Dictionnaire permanent, Bulletin n°°99, précité.
* 6 B.W. Dufwa - La responsabilité disparue, in G. Viney (direction) L'indemnisation des accidents médicaux, LGDJ, 1997, p. 58.
* 1 C. Radé - Brefs propos spéculatifs sur la réforme de la responsabilité médicale - Risques n°°40, décembre 1999, p. 117
* 2 J.M. Pontier - La prise en charge collective de l'aléa thérapeutique, l'État et les fonds de garantie, in D. Truchet, l'indemnisation de l'aléa thérapeutique, précité, p. 86.
* 3 Proposition Serrou, Une solution comparable était retenue dans la proposition Evin avec la commission nationale des accidents sanitaires.
* 1 Dictionnaire permanent de bioéthique, précité. On remarquera que la solution des commissions d'experts a été retenue en Allemagne comme une des alternatives présentées dans le cas des instances de médiation établies par l'Ordre des médecins.
* 2 J.O. débats Sénat, séance du 26 avril 2001, p. 1576 et s.
* 3 Idem, p. 1580. Le dépôt du projet de loi sur le droit des malades et la modernisation du système de santé paraît avoir été retardé du fait du changement de ministre délégué et précisément du fait de la volonté du nouveau titulaire d'aborder personnellement la question de l'aléa médical.
* 4 Proposition de loi relative à l'indemnisation de l'aléa médical et à la responsabilité médicale - Doc Sénat, 2000-2001, n°°221, 8 février 2001.
* 5 Ce texte se démarque donc de la proposition de MM. Debré et Douste-Blazy.
* 1 Dictionnaire permanent de bioéthique - Bulletin n°°99, p. 7603.
* 2 JO débat, Sénat, 2001, p. 1588.
* 3 Idem, p. 1584.
* 1 G. Cornu " Droit et esthétique " Présentation, Archives de philosophie du droit, 1996, pli.
* 1 G. Vedel " L'esthétique, élément de l'éthique démocratique " in " L'esthétique urbaine ", Litec, 1992, p. 56.
* 2 Voir notamment les propos critiques d'A. Mine ou A. Etchegoyen, " La valse des éthiques " .
* 1 " Critique de la faculté de juger ".
* 1 P. Ricoeur, " Morale, éthique et politique ", Pouvoirs, 1993, n° 65, p. 5.
* 2 Aristote, " Éthique à Nicomaque ", Livre II, Chapitre III, 2
* 3 L'Italie a même hissé au niveau constitutionnel la protection par la République du paysage et du patrimoine historique et artistique ( Const. art. 9 ).
* 1 Elles se limitent à des orientations et des principes généraux éventuellement accompagnées de recommandations mais n'ont pas connu un grand succès jusqu'ici.
* 2 Voir par exemple l'affaire du " Parc de Rentilly " : CAA Paris 10 février 1994 ou celle portant sur 28 000 m2 SHOB à proximité du Cap d'Antibes : CE 21 septembre 1992 " SCI Juan-les-Pins Centre " .
* 1 Sur ces questions voir en particulier : Ph. Saint-Marc, " Socialisation de la nature ", Stock, 1971 ; P Girod, " Le préjudice écologique ", LGDJ, 1974 ; F. Cabalerro, " Essai sur la notion de nuisances ", LGDJ, 1981 ; J. de Malafosse, " Le droit à la nature ", Montchrestien, 1973 ; B. Edelman et M.A. Hermine, " L'homme, la nature et le droit ", Ch. Bourgeois, 1988.
* 2 P. Trétiack, " Faut-il pendre les architectes ?", Seuil, 2001.
* 1 C.E. 22 juillet 1977, " Synd. pour l'exploitation d'une usine d'incinération de l'agglomération caennaise ", RJE 1997, p. 312.
* 2 Compensation de la moins value si le propriétaire vend son bien dans les 4 ans suivant la mise en service de la ligne.
* 1 Les analyses de John Rawls dans sa " Théorie de la justice " vont dans le sens du consensus majoritaire, issu d'un consentement libre et éclairé plus que d'un compromis, qui conduit à la perception du Bien commun et, par analogie, du sens esthétique commun. Une confrontation loyale des opinions, telle que la souhaite Habermas, permet de révéler le " potentiel d'universalité " inhérent à ces notions.
* * Seuls Madame et Monsieur les professeurs Danièle LOCHAK et Jean-Claude HELIN nous ayant remis leur rapport, il ne nous a pas été possible de fournir la totalité de la table ronde. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser
* 1 Au sens large, la responsabilité désigne tout mécanisme qui aboutit à désigner la personne à qui il revient d'indemniser le dommage provoqué par son activité ou celle d'un tiers, sans préjuger des raisons pour lesquelles il en va ainsi. La responsabilité ainsi entendue peut à son tour recouvrir un mécanisme de responsabilité au sens strict, un mécanisme d'assurance, ou encore un mécanisme de solidarité.
* 1 Voir par exemple sa présentation du numéro de la revue Risques sur "Assurance, droit, responsabilité", n°°10/1992, p. 12.
* 2 "Le degré d'originalité du régime de la responsabilité extra-contractuelle des personnes morales de droit public", JCP 1949, I. 742 et 751.
* 1 "Responsabilité - solidarité - sécurité. La crise de la responsabilité en France à la fin du XX e siècle", Risques n°° 10/1992.
* 1 Yvonne Flour, "Faute et responsabilité civile : déclin ou renaissance ?", Droits n°° 5/1987, "Fin de la faute ?".
* 1 Jacques Donzelot, L'invention du social, Fayard, 1984.
* 2 Pierre Rosanvallon, La nouvelle question sociale, Seuil, 1995.
* 3 François Ewald, L'État providence, Grasset, 1986.







