Rapport n° 270 (1995-1996) de M. Alain LAMBERT , fait au nom de la commission des finances, déposé le 13 mars 1996
Disponible au format Acrobat (6,7 Moctets)
-
TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR
PUBLIC
-
Article 23 - Opérations de cession de
participations dans des entreprises publiques de faible taille
-
Article 24 - Traitement des certificats
pétroliers
-
Article 25 - Modifications de la loi relative aux
modalités des privatisations
-
Article 25 bis (nouveau) - Amélioration des
techniques de privatisation
-
Article 26 - Désignation de
représentants de l'Etat au conseil d'administration de
sociétés du secteur public de second rang
-
Article 27 - Inscription de la
Société française de production et de création
audiovisuelles sur la liste des entreprises figurant à l'annexe de la
loi de privatisation
-
Article 28 - Dispositions relatives au statut de la
Société française de production et de création
audiovisuelles
-
Article 29 - Disposition relative au CEPME
-
Article 23 - Opérations de cession de
participations dans des entreprises publiques de faible taille
-
TITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS, A
L'AGRICULTURE ET A L'AMÉNAGEMENT FONCIER
-
Article 30 - Dispositions relatives à la
taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres
ouvrages hydrauliques
-
Article 31 - Dispositions relatives à la
déclaration d'utilité publique d'une section de l'autoroute A
89
-
Article 32 - Dispositions relatives à la
Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers
-
Article 33 (Retiré) - Actualisation des
modalités de détermination du prix du lait
-
Article 34 - Dispositions relatives à la
reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée
-
Article 35 - Dispositions relatives au Conseil
interprofessionnel des vins du Languedoc
-
Article 35 bis (nouveau) - Etalement dans le temps
de l'imposition des sommes reçues à titre d'avance sur des
fermages
-
Article additionnel après l'article 35 bis
(nouveau) - Exonération des taxes spéciales d'équipement
au profit des jeunes agriculteurs
-
Article 36 - Dispositions relatives au plafond de
la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de
rétablissement public d'aménagement en Guyane
-
Article 37 - Dispositions relatives aux petites
parcelles incluses dans un périmètre d'aménagement
foncier
-
Article 37 bis (nouveau) - Organisation de paris
sur les parties de pelote basque
-
Article 30 - Dispositions relatives à la
taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres
ouvrages hydrauliques
-
TITRE VII - MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES
-
TITRE VIII - MODIFICATIONS DU CODE DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE
-
TITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES
-
Article 43 - Disposition relative aux
sociétés de développement régional en
liquidation
-
Article 44 - Dispositions relatives au monopole
d'État pour la vente au détail des tabacs
manufacturés
-
Article 45 - Redevances de mise à
disposition de fréquences radioélectriques et de gestion
-
Article 46 (Retiré) - Taux de TVA
applicable aux locations d'immeubles à des exploitants
d'établissements d'hébergement
-
Article 47 - Versement afférent à la
délivrance de la carte européenne d'arme à feu
-
Article 48 (retiré) - Prorogation de la
suspension des poursuites en faveur des rapatriés
réinstallés
-
Article 49 - Modifications du code des
assurances
-
Article 49 bis (nouveau) - Disposition relative au
tableau d'amortissement des offres de prêts immobiliers
-
Article 49 ter (nouveau) - Création d'une
commission de la transparence de l'assurance catastrophe naturelle
-
Articles 50, 51 et 52 - Dispositions relatives
à l'équipement commercial
-
Article 50 - Dispositif transitoire concernant
l'urbanisme commercial :
-
Article additionnel après l'article 50 -
Abaissement du seuil déclaratif d'activité à l'ORGANIC de
400 m2 à 300 m2 pour les surfaces de vente
-
Article 51 - Dérogation aux mesures
transitoires prévues à l'article 50 du projet de loi
-
Article 52 - Prorogation du mandat des membres de
la commission nationale d'équipement commercial (CNEC)
-
Article 53 - Participation des chefs
d'exploitation agricole au financement de la formation professionnelle
continue
-
Article 54 (nouveau) - Cas de vacance des
administrateurs élus par les salariés dans les
sociétés anonymes
-
Article 55 (nouveau) - Aménagement du
monopole de Gaz de France
-
Article 56 (nouveau) - Validation
législative
-
Article 57 (nouveau) - Allégements de
cotisations sociales dans les secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et
de la chaussure
-
Article 43 - Disposition relative aux
sociétés de développement régional en
liquidation
N° 270
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Annexe au procès-verbal de la séance du 13 mars 1996.
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Par M. Alain LAMBERT,
Sénateur,
Rapporteur général.
TOME I
Fascicule 2
Examen des articles des titres V à IX.
(1 ) Cette commission est composée de : MM. Christian Poncelet, président ; Jean Cluzel, Henri Collard, Roland du Luart, Jean-Pierre Masseret, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Philippe Marini, vice - présidents ; Emmanuel Hamel, René Régnault, Alain Richard, François Trucy, secrétaires ; Alain Lambert, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Bernard Barbier, Jacques Baudot, Claude Belot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Guy Cabanel, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Yvon Collin, Jacques Delong, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Marc Massion, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Maurice Schumann, Michel Sergent, Henri Torre, René Trégouët
Voir les numéros :
Assemblée nationale (10 ème législ.) : 2548. 2585 et TA 490.
Sénat : 259 (1995-1996).
Politique économique et sociale.
TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC
Article 23 - Opérations de cession de participations dans des entreprises publiques de faible taille
Commentaire : le présent article a pour objet d'autoriser la privatisation par voie réglementaire des entreprises publiques de faible taille dont plus de la moitié du capital est directement détenue par l'Etat.
La loi du 2 juillet 1986 autorisant le gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social a, dans son article 7, défini les règles générales applicables aux transferts d'entreprises du secteur public au secteur privé. Ces principes généraux constituent la norme en vigueur.
Régime actuel
Sont approuvés par la loi les transferts au secteur privé de la propriété des entreprises :
- dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social ;
- qui sont entrées dans le secteur public en application d'une disposition législative.
Relèvent de l'autorité administrative :
- le transfert au secteur privé des autres entreprises publiques ;
- l'ouverture minoritaire du capital d'entreprises de "premier rang" (dans lesquelles l'Etat détient directement la majorité du capital social).
Le présent article a pour objet de modifier le périmètre des opérations de transfert devant être approuvées par la loi, et, par voie de conséquence, celui des opérations relevant de la simple autorisation administrative.
Ainsi, seul le transfert de la propriété des entreprises détenues directement et majoritairement par l'Etat dont le chiffre d'affaires (filiales incluses) dépasse un milliard de francs ou dont les effectifs (filiales incluses) sont supérieurs à 1.000 personnes devra désormais être approuve par la loi. Pour les autres entreprises publiques, considérées comme de faible taille, la privatisation pourra s'effectuer par la voie réglementaire.
Toutefois, les entreprises entrées dans le secteur public par la voie législative ne pourront être transférées au secteur privé que dans les mêmes conditions.
Régime proposé par le projet de loi
Sont approuvés par la loi les transferts au secteur privé de la propriété des entreprises :
- dont l'Etat détient directement et majoritairement le capital et dont les effectifs (filiales incluses) sont supérieurs à 1.000 personnes ou dont le chiffre d'affaires (consolidé avec celui des filiales) dépasse un milliard de francs ;
- qui sont entrées dans le secteur public en application d'une disposition législative.
Relèvent de l'autorité administrative :
- le transfert au secteur privé des autres entreprises publiques et notamment des entreprises détenues directement et majoritairement par l'Etat dont les effectifs (filiales incluses) sont inférieurs à 1.000 personnes et dont le chiffre d'affaires (consolidé avec celui des filiales) est inférieur à un milliard de francs ;
- l'ouverture minoritaire du capital des entreprises de premier rang.
Selon les informations fournies à votre rapporteur, 12 entreprises publiques seraient concernées par ces dispositions et pourraient, répondant aujourd'hui à ces conditions, être privatisées non par la voie législative mais par la voie réglementaire.
Leurs effectifs varient de 2 à 600 personnes, pour un effectif total d'environ 2.600 personnes. Le montant cumulé des chiffres d'affaires de ces douze entreprises est proche de 1,8 milliard de francs.
Liste des douze entreprises concernées
- Bureau central d'études d'ingénierie pour l'outre-mer (BCEOM) ;
- Centre médical de cure climatique d'altitude "Les neiges" :
- Compagnie française pour le développement des fibres textiles (CFDT) ;
- Compagnie française de navigation rhénane (CFNR) ;
- Défense Conseil International (DCI), ex Cogepag ;
- Orkem ;
- Centre d'étude des systèmes d'information des administrations (SA CESIA) :
- SCI du domaine du Grand Lieu ;
- Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Paris La Villette (SEMVI) ;
- Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) ;
- Société française de radiodiffusion (SOFIRAD) ;
- Société concessionnaire pour la construction et l'exploitation du tunnel sous le Mont Blanc.
On observera qu'en dehors du changement d'autorité compétente pour décider de l'opération de transfert au secteur privé de ces entreprises, le reste de la procédure de privatisation est identique. En particulier, l'intervention de la commission de la privatisation se fera dans les mêmes conditions.
Votre commission approuve cette simplification de la procédure applicable aux privatisations d'entreprises de petite taille. A cet égard, elle considère les seuils proposés comme raisonnables, constatant qu'il s'agit des mêmes seuils que ceux utilisés dans le cadre des opérations de "respiration du secteur public" depuis la loi de privatisation du 19 juillet 1993.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 24 - Traitement des certificats pétroliers
Commentaire : le présent article a pour objet, d'une part, de clarifier la nature juridique des certificats pétroliers et, d'autre part, d'autoriser la mise en place d'une procédure d'échange obligatoire des certificats pétroliers encore en circulation
I. LE RÉGIME DES CERTIFICATS PETROLIERS
Les certificats pétroliers ont été créés par la loi du 26 juin 1957 portant assainissement économique et financier. Son article premier autorisait le gouvernement à "fixer les conditions dans lesquelles l'Etat, ainsi que les personnes morales, publiques et privées, qui seront spécialement autorisées par décret, seront habilitées à émettre ou à faire émettre des certificats négociables en représentation des droits attachés aux actions des sociétés de recherche, d'exploitation et de transformation d'hydrocarbures qui leur appartiennent, à l'exception du droit de vote dans les assemblées générales ; ces certificats seront exempts de droits de timbre et leur existence n'entraînera aucune imposition supplémentaire sur les produits distribués ; les sommes à provenir de la vente de ces certificats devront être consacrées exclusivement au financement de la recherche, de l'exploitation, du transport et de la transformation d'hydrocarbures".
Le décret du 10 septembre 1957 relatif aux certificats pétroliers a défini précisément le régime de ces titres. Ils bénéficient de tous les droits attachés aux actions à l'exception du droit de vote.
Pour l'Etat, il s'agissait avant tout de disposer d'un moyen de financer les augmentations de capital des deux opérateurs pétroliers nationaux sans toutefois modifier la répartition des droits de vote dans ces deux sociétés.
Ainsi, des certificats pétroliers ont été émis par l'Etat, actionnaire principal de Total, et par l'ERAP, établissement public actionnaire d'Elf-Aquitaine, au profit de ces deux sociétés. Ils ont permis d'accroître sensiblement leurs moyens dans une phase déterminante de la croissance des investissements dans le domaine de l'exploration-production.
Les actions correspondant aux certificats pétroliers émis par l'Etat et par l'ERAP ont été consignées à la Caisse des dépôts et consignations.
II - LA CLARIFICATION DE LA NATURE JURIDIQUE DES CERTIFICATS PÉTROLIERS
La loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations a assimilé les certificats pétroliers aux certificats d'investissement. Or, ceci n'étant pas exact sur le plan juridique, une modification de la loi était nécessaire, ce que fait le présent article.
En effet, les certificats d'investissement sont issus du démembrement d'une action entre un certificat de droit de vote et un certificat d'investissement ou un certificat d'investissement privilégié.
Les certificats pétroliers sont d'une autre nature. Ils ne sont pas issus du démembrement d'une action, mais sont des titres de créance sur l'émetteur, assortis de droits patrimoniaux gagés sur des actions consignées chez un tiers.
L'article 5 du décret du 10 septembre 1957 précise que "toute action donnant lieu à création d'un certificat doit revêtir la forme nominative. Elle est inaliénable tant que le certificat n'a pas été restitué à l'établissement émetteur".
Cette dernière disposition est en contradiction avec le texte de l'article 6 de la loi du 6 août 1986 car, contrairement aux certificats d'investissement, la réunion de certificats pétroliers et de droits de vote ne peut entraîner la reconstitution d'une action. Aussi, le présent article supprime la référence aux certificats pétroliers dans les deuxième et troisième alinéas de l'article 6, de façon à lever toute ambiguïté juridique.
III. L'AUTORISATION DE PROCÉDER À L'ÉCHANGE O BLIGATOIRE DES CERTIFICATS PÉTROLIERS
Le présent article autorise la mise en place d'une procédure d'échange obligatoire des certificats pétroliers encore en circulation.
En effet, malgré les opérations d'échange déjà effectuées, il demeure un stock résiduel de certificats pétroliers. Celui-ci est peu important mais relativement lourd et coûteux à gérer pour l'Etat et l'ERAP qui évaluent les frais de gestion de ces titres à environ 500.000 francs par an.
Les deux dernières opérations d'échange sont intervenues :
ï pour Total en 1992, à l'occasion de l'opération de cessions de titres Total par l'Etat : sur un peu plus de 16 millions de certificats pétroliers, 15,2 ont alors été retirés de la circulation ; l'échange est intervenu à raison de trois actions contre quatre certificats pétroliers ;
ï pour Elf-Aquitaine en 1994, lors de la privatisation de l'entreprise : sur près de 5,8 millions de certificats existants, 5,03 ont été retirés de la circulation ; l'échange est intervenu sur la base d'une action contre un certificat pétrolier et le versement d'une somme en numéraire de 40 francs.
Actuellement, le stock résiduel de certificats pétroliers comprend un peu plus de 980.000 certificats Total et 750.000 certificats ERAP-Elf Aquitaine. Les actions gagées par ces certificats représentent 0,42 % du capital de Total et 0,27 % du capital d'Elf-Aquitaine.
En autorisant le ministre chargé de l'économie à prévoir par arrête que les certificats pétroliers encore détenus par le public sont obligatoirement échangés contre des actions, le présent article rend possible la disparition définitive des certificats pétroliers et, par voie de conséquence, le désengagement total de l'Etat du capital des deux sociétés pétrolières nationales.
Bien entendu, les conditions de l'échange devront intervenir "sur la base d'une parité fixée à dire d'experts" .
Votre commission approuve cette mesure qui constitue essentiellement une simplification de la gestion administrative de ces titres.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 25 - Modifications de la loi relative aux modalités des privatisations
Commentaire : le présent article modifie plusieurs dispositions de la loi relative aux modalités des privatisations. Il a un triple objet : il accroît certains droits attachés à l'action spécifique, il supprime la limitation des prises de participation étrangères, il étend aux opérations autres que de marché les avantages dont peuvent bénéficier les salariés.
I. LA MODIFICATION DES DROITS ATTACHÉS A L'ACTION SPÉCIFIQUE
L'article 10 de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, modifiée par la loi de privatisation du 19 juillet 1993, a prévu que "si la protection des intérêts nationaux l'exige", une action ordinaire de l'État peut être transformée en une action spécifique, assortie de certains droits.
Cette transformation doit être prononcée par décret, celui-ci devant énumérer les droits attachés à l'action spécifique.
Les droits pouvant être attachés à une action spécifique sont, aux termes de l'article 10 de la loi du 6 août 1986, les suivants :
"1° L'agrément préalable par le ministre chargé de l'économie pour le franchissement, par une personne agissant seule ou de concert, d'un ou plusieurs des seuils fixés dans le décret mentionné au premier alinéa ci-dessus calculés en pourcentage du capital social ou des droits de vote ;
"2° La nomination au conseil d'administration ou de surveillance, selon le cas, d'un ou deux représentants de l'Etat désignés par décret et sans voix délibérative ;
"3° Le pouvoir de s'opposer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, aux décisions de cession d'actifs ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux. "
S'agissant de cette dernière catégorie, visée par le 1° du présent article, l'article premier du décret du 13 décembre 1993 pris pour l'application de la loi de privatisation du 19 juillet 1993, a prévu que "lorsque le décret instituant une action spécifique (...) attache à cette action le pouvoir de s'opposer aux décisions de cessions d'actifs ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux, ce décret détermine la liste des actifs concernés".
Or, à l'usage, il apparaît que certains actifs ne peuvent être facilement énumérés de manière exhaustive, alors qu'il est possible de les caractériser de manière générique.
C'est pourquoi, le présent article propose d'ajouter l'expression "certains types d'actifs" dans le texte du 3° du paragraphe I de l'article 10 de la loi du 6 août 1986.
En outre, il étend le contrôle de l'Etat aux actifs des filiales des sociétés concernées par l'action spécifique.
A ce jour, la seule action spécifique détenue par l'Etat est celle qui a été instituée par un décret du 13 décembre 1993 pour la Société Elf-Aquitaine. Dans ce décret, il est prévu qu' "il peut être fait opposition aux décisions de cession et d'affectation à titre de garantie des actifs dont la liste figure en annexe au présent décret". Cette liste énumère les actifs suivants : majorité du capital d'Elf-Aquitaine-Production, d'Elf-Antar-France, d'Elf-Gabon SA et d'Elf-Congo SA.
Dans la poursuite du programme de privatisation, l'institution d'une action spécifique au profit de l'Etat devrait intervenir pour des entreprises intervenant dans le domaine de l'armement. Les dispositions du présent article pourraient alors s'avérer très utiles.
II. LA SUPPRESSION DE LA LIMITATION DES PRISES DE PARTICIPATION ÉTRANGÈRES
Le 2° du présent article a pour objet de supprimer l'article 10-1 de la loi du 6 août 1986 qui limite les prises de participation étrangères -autres que communautaires- dans le capital des entreprises privatisées à un seuil de 20 % du capital de ces entreprises.
On rappellera que, dans le projet de loi de privatisation de 1993, il avait été prévu de supprimer cette limite de 20 %. Votre commission, saisie en premier lieu de ce projet de loi, avait alors approuvé cette mesure considérant qu' "aujourd'hui une telle limite parait assez artificielle, les moyens de la contourner étant nombreux". En outre, elle constatait que "l'internationalisation croissante des marchés en rend le maintien impossible" (1 ( * )) . Toutefois, l'Assemblée nationale avait ensuite souhaité rétablir cette limite.
Aujourd'hui, il apparaît avec évidence que cette limite doit être supprimée.
En effet, lorsque l'opération est réalisée selon les procédures du marché financier, la limite est inopérante dans la mesure où les investisseurs non communautaires peuvent acquérir librement les titres sur les marchés. Par ailleurs, lorsque l'opération a lieu de gré à gré, cette limite peut constituer un véritable handicap s'il n'y a qu'un petit nombre d'acquéreurs potentiels, pour l'essentiel non communautaires. Enfin, cette limite a fait l'objet de critiques répétées par les partenaires de la France au sein de l'OCDE.
Votre commission se félicite donc de cette mesure qu'elle avait déjà approuvée en 1993.
III. L'EXTENSION AUX OPÉRATIONS AUTRES QUE DE MARCHÉ DES AVANTAGES ACCORDÉS AUX SALARIÉS
Le 3° du présent article a pour objet d'étendre le système des avantages accordés aux salariés dans le cadre des opérations de privatisation.
En effet, conformément à l'article 11 de la loi du 6 août 1986, ces avantages ne peuvent actuellement s'appliquer que dans le cas de "cession d'une participation de l'État suivant les procédures du marché financier".
Or, les participations de l'Etat peuvent aussi être cédées hors marché, par appel d'offres ou de gré à gré, et, dans ce cas, les avantages dont peuvent bénéficier les salariés (attributions gratuites d'actions notamment) ne s'apppliquent pas.
Le présent article, amendé à l'initiative du gouvernement à Assemblée nationale, modifie cet état de fait et supprime la différence de traitement non justifiée dans l'association des salariés au processus de privatisation de leur entreprise.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 25 bis (nouveau) - Amélioration des techniques de privatisation
Commentaire : issu d'un amendement du gouvernement, cet article a pour objet de permettre la réalisation d'opérations de privatisation par cessions de titres assortis de bons d'acquisition ou de souscription d'actions.
Afin de faciliter, le cas échéant, certaines opérations de privatisation, le gouvernement a souhaité inscrire dans la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, la possibilité de recourir à la technique des actions assorties de bons d'acquisition ou de souscription d'actions (ABAA).
Cette technique consiste à céder à tout ou partie des acquéreurs un lot composé d'une action et d'un bon ou d'une fraction de bon permettant d'acquérir ou de souscrire une action au cours d'une période donnée et à un prix fixé à l'avance.
Il s'agit d'un mécanisme courant sur les marchés financiers et fréquemment utilisé dans des opérations de privatisation à l'étranger. Il pourrait s'avérer intéressant dans certaines opérations à venir et favoriser le succès de ces futures privatisations.
Le paragraphe I de l'article a pour objet de mentionner, parmi les modalités de cessions prévues à l'article 1 er de la loi du 6 août 1986, la possibilité de recourir à la technique des ABAA. Il prévoit cependant que le franchissement du seuil majoritaire pour le transfert du secteur public au secteur privé du capital de l'entreprise ne pourra résulter de l'exercice de ces options d'acquisition ou de souscription.
Le paragraphe II inclut ces options d'acquisition ou de souscription d'actions dans les éléments devant être pris en compte par la commission de la privatisation pour procéder à ses évaluations.
Le paragraphe III apporte une précision dans la manière dont ces options doivent être considérées au regard des cessions de participations de l'Etat par tranches successives, en distinguant bien les deux mécanismes.
Le paragraphe IV vise à étendre la possibilité de participer à des opérations de privatisation au moyen de titres d'emprunt d'Etat (emprunt "Balladur" d'août 1993). Il étend cette faculté à l'ensemble des titres pouvant être cédés à l'occasion d'une opération de privatisation et non aux seules actions cédées dans ce cadre.
Votre commission approuve cette mesure de souplesse qui devrait permettre de rendre plus attractives certaines opérations de privatisation.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 26 - Désignation de représentants de l'Etat au conseil d'administration de sociétés du secteur public de second rang
Commentaire : le présent article a pour objet de préciser le statut des représentants que l'Etat peut nommer dans les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des entreprises publiques de second rang.
La loi de démocratisation du secteur public du 26 juillet 1983 a clairement organisé le statut des représentants de l'Etat dans les entreprises publiques de premier rang, c'est-à-dire dans les entreprises dont la majorité du capital social appartient directement à l'Etat.
En revanche, pour les entreprises dont l'Etat détient indirectement la majorité du capital, c'est-à-dire les entreprises publiques de second rang, il est seulement spécifié que la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales s'applique.
Ainsi, dans ces entreprises, les représentants de l'Etat sont désignes par l'assemblée générale des actionnaires conformément aux règles générales du droit commun des sociétés.
Or, ces représentants-administrateurs ne sont pas nommés à titre personnel puisqu'ils représentant l'Etat au titre des fonctions qu'ils exercent dans tel ou tel ministère. En outre, ils ne peuvent être considérés comme de véritables représentants permanents d'une personne morale, au sens de la loi de 1966. Par ailleurs, ils n'ont pas d'intérêt personnel ni d'intérêt financier dans l'entreprise concernée. En effet, ils ont pour fonction de prendre part aux délibérations de ces conseils en respectant les instructions qui leur ont été données par le ou les ministres compétents.
Cette application du droit commun est donc peu satisfaisante sur le plan juridique. Elle l'est encore moins sur un plan pratique puisqu'elle rend obligatoire la détention d'actions de la société par les représentants de l'État-administrateurs, à qui des jetons de présence sont en outre accordés. Ces règles nécessitent une gestion administrative lourde et inutile.
C'est pour l'ensemble de ces raisons que le présent article propose de clarifier le statut des représentants de l'Etat dans les entreprises publiques de second rang.
Leur nombre sera désormais fixé par décret, sans pouvoir excéder 6 ni le tiers des membres du conseil d'administration ou de surveillance.
Les articles de la loi de 1966 qui font obligation aux administrateurs et aux membres des conseils de surveillance de détenir un certain nombre d'actions de la société, déterminé par les statuts, ne leur seront plus applicables.
De même, le mandat de ces représentants sera désormais gratuit "sans préjudice de remboursement par l'entreprise des frais exposés pour l'exercice dudit mandat".
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 27 - Inscription de la Société française de production et de création audiovisuelles sur la liste des entreprises figurant à l'annexe de la loi de privatisation
Commentaire : en ajoutant la Société française de production et de création audiovisuelles à la liste des entreprises figurant à l'annexe de la loi de privatisation n°93-923 du 19 juillet 1993, cet article permet la privatisation de cette société.
I. LE STATUT JURIDIQUE DE LA SFP : UNE SOCIÉTÉ DU SECTEUR PUBLIC
La Société française de production et de
création audiovisuelles (SFP) a été créée
par la loi du 7 août 1974 sous la forme d'une société
• anonyme de droit privé, à capitaux publics
majoritaires (99,74 %). En application de la loi du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle » elle a été incluse dans
le service public de la radiodiffusion sonore et de la
télévision. Un décret du 17 septembre 1982 a formellement
créé la société nationale, dont les statuts ont
été approuvés par décret du 31 décembre
1982.
En vertu de l'article 52 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la SFP est "chargée de produire ou de faire produire des oeuvres et des documents audiovisuels" et "fournit des prestations, notamment pour le compte des sociétés nationales de programme". Le même article dispose expressément que la SFP est soumise à la législation sur les sociétés anonymes, c'est à dire aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966.
La structure de la SFP est assez complexe. L'organigramme ci-après permet de mieux appréhender cette société.
ORGAN1GRAMME DE LA SFP
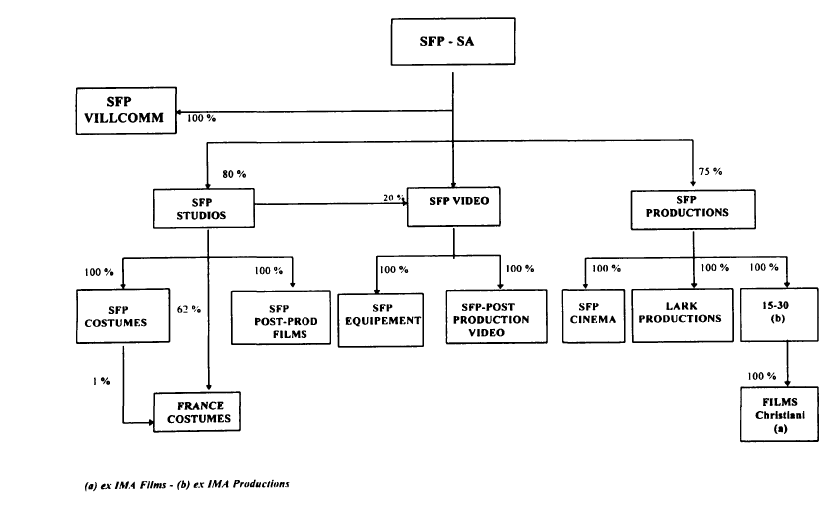
II. LA SITUATION DE LA SFP : UNE INADAPTATION A L'ÉVOLUTION DU PAYSAGE AUDIOVISUEL
A l'origine, la SFP bénéficiait d'un régime de commandes préférentielles des chaînes publiques de télévision, dont la suppression, en 1979, avait entraîné un plan de licenciement de 500 personnes. La privatisation de TF1, en 1986, et le fait que la SFP n'a plus eu accès à la redevance à compter de cette date, ont eu des conséquences importantes sur les comptes et la gestion de la société, ainsi livrée à la concurrence. La SFP n'a, en fait, jamais pu s'adapter à la déréglementation du secteur, qui a conduit à une multiplication rapide du nombre de sociétés de production.
Cette évolution est décrite dans un rapport d'information fait au nom de votre commission des finances sur la situation et les perspectives de la presse et de la production audiovisuelle, présenté par notre collègue, M. Jean Cluzel (2 ( * )) :
" Il a fallu attendre 1986, année où le compte de soutien aux industries de programmes audiovisuels a été mis en place, pour qu'enfin un véritable secteur privé de production puisse prendre son essor en France. Ce secteur réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 5 milliards de francs, alors qu'en 1986, n'existaient qu'une dizaine de sociétés gravitant autour de la SFP dont le chiffre d'affaire global n'excédait guère 100 millions de francs. Cet essor est étroitement lié à l'augmentation de la demande de programmes émanant de chaînes nouvelles, qui, par nature, n'avaient pas une tradition de production. De plus, il a été facilité par la mise en place d'un dispositif important d'aides".
Malgré le dynamisme de ce secteur, la SFP est en situation de déficit chronique. Le chiffre d'affaires stagne et, malgré une division par deux des effectifs depuis 1989 (1 096 personnes en 1994, contre 2 185 en 1989), le résultat net a été constamment négatif, en dépit d'un redressement continu depuis 1992.
La SFP ne s'est véritablement jamais montrée capable d'affronter la concurrence des sociétés privées de production audiovisuelle.
Dès 1994, les développements du rapport public de la Cour des comptes consacrés à la société constataient :
"En l'absence de directives précises des autorités de tutelle aux nombreux présidents successifs et faute de mesures de redressement et de compression des charges prises à temps, les importants concours financiers consentis par l'Etat -plus de deux milliards de francs depuis 1986- n'ont pas permis à la société, malgré les efforts entrepris à partir de 1990, de s'adapter aux conditions nouvelles d'exercice de ses activités".
Le rapporteur spécial de la communication audiovisuelle, notre collègue M. Jean Cluzel, dénonçait également, à l'occasion du dernier débat budgétaire la situation dans laquelle se trouvait la SFP (3 ( * )) :
"Aux doublons, aux concurrences des diffuseurs en matière de production audiovisuelle, se sont ajoutées les délocalisations audiovisuelles. Les diffuseurs invoquent, pour justifier ces deux pratiques, le coût des prestations offertes par la SFP. Ce coût, certes élevé, s'explique principalement par celui du travail. L'utilisation des intermittents du spectacle par les concurrents de la SFP, laquelle est obligée de faire appel à un personnel permanent nombreux, représente un exemple symbolique d'incohérence et de gabegie des fonds publics" .
L'affiliation de la SFP à la convention collective de l'audiovisuel public a constitué un handicap certain pour la société dans l'environnement de concurrence croissante auquel elle a été confrontée. Les conditions de l'emploi et la permanence du travail auraient induit une écart d'au moins 15 % du coût du travail entre la SFP et les sociétés privées du secteur. La masse salariale représente 73 % du chiffre d'affaires de la SFP, ce qui constitue un chiffre supérieur de 30 à 50 % à celui de ses concurrents.
Face à cette situation, l'Etat a donc été conduit à consentir des aides massives à la SFP. De 1987, et jusqu'à février 1996, l'État a versé, directement ou indirectement, 2.346 millions de francs à la SFP. Il aura notamment consacré 750 000 francs par salarié au financement de la SFP en 1993 et 1994.
En conséquence de ces avances, et depuis le 8 décembre 1995, l'Etat est désormais le seul actionnaire de la SFP.
Ces aides ont provoqué l'intervention de la Commission européenne.
A deux reprises, le 27 février 1991 et te 15 mars 1992, la Commission avait autorisé des recapitalisations de la SFP par ses actionnaires. Dans la seconde décision, la Commission avait cependant considéré que le plan de restructuration engagé à l'époque devait assurer la viabilité financière de l'entreprise et avait pris note de l'engagement du Gouvernement français de s'abstenir de toutes interventions ultérieures.
Par lettre du 22 juin 1994, la Commission a relevé que l'État avait procède "de 1992 à 1994 à de nouveaux transferts d'au moins 460 millions de francs" et s'est inquiétée de l'intention de l'Etat français de recapitaliser une nouvelle fois le groupe SFP à hauteur de 400 millions de francs avant la fin 94.
Dans une nouvelle lettre datée du 18 novembre 1994, la Commission a informé le Gouvernement français qu'elle avait été saisie, pour les mêmes raisons, d'une plainte émanant de deux producteurs de télévision français qui affirmaient subir un « préjudice grave ».
La Commission a décidé alors d'engager la procédure prévue par l'article 93, paragraphe 2, du traité à l'égard des avances de l'État à la SFP d'un montant total de 860 millions de francs.
Dans une lettre d'observation du 1 er avril 1995, la Commission exige, en particulier, la fourniture "d'un plan complet de restructuration de l'entreprise qui lui permette de regagner sa viabilité sur la base d'hypothèses réalistes concernant ses coûts et recettes futurs".
Enfin, la Commission priait le gouvernement français de s'engager à ne pas mettre d'autres fonds publics à la disposition de la SFP sans son autorisation préalable.
C'est pourquoi l'État français a dû être autorisé par la Commission européenne, le 19 février 1996, avant d'apporter 250 millions de francs à la SFP pour couvrir des dettes à court terme et pour faire face à une trésorerie très dégradée, en raison notamment de la réalisation différée de la vente des terrains qu'elle possédait aux Buttes-Chaumont.
Toutefois, et selon les informations fournies à votre rapporteur par le ministère de l'économie et des finances, "la Commission réserve son jugement final, qu'elle envisage d'arrêter en toute hypothèse avant l'été, sur la compatibilité des aides versées depuis 1993 avec les règles du Traité de Rome. Elle n'exclut pas, à ce stade, de demander le recouvrement, partiel ou total, de ces aides, dans l'hypothèse où le processus en cours n'aboutirait pas à la privatisation de la SFP sur la base d'un plan de retour à la viabilité".
III. L'INSCRIPTION DE LA SFP SUR LA LISTE DES SOCIÉTÉS PRIVATISABLES
Selon l'article 7-I de la loi n°86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, la loi doit approuver tout transfert au secteur privé de la propriété des entreprises dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social et des entreprises qui sont entrées dans le secteur public en application d'une disposition législative.
L'inscription de la SFP sur la liste annexée à la loi n°93-923 de Privatisation du 19 juillet 1993 vaut donc approbation législative au transfert au secteur privé, en application du premier alinéa de l'article 2-I de ladite loi.
A compter de la promulgation de la présente loi, la SFP pourra donc être privatisée.
Compte tenu de ses caractéristiques, la procédure retenue pour la SFP sera la cession de gré à gré, avec appel d'offres. La décision d'accompagner cet appel d'offres d'un cahier des charges public n'est pas encore arrêtée.
Une privatisation en deux blocs avait été envisagée par le précédent directeur-général, M. Michel Bassi. La SFP est en effet divisée en trois pôles -SFP vidéo, SFP studio et SFP production - le pôle studio, qui regroupe les trois quart des effectifs, étant lourdement déficitaire. La SFP aurait été regroupée en deux pôles, SFP vidéo et SFP production.
Le gouvernement a cependant clairement exclu la cession "par appartement" de la SFP. Le ministre délégué au budget a ainsi déclaré à Assemblée nationale, lors de la séance du mardi 13 février 1996, "qu'il n'y aurait pas de démantèlement de la SFP".
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 28 - Dispositions relatives au statut de la Société française de production et de création audiovisuelles
Commentaire : le présent article tire les conséquences de l'inscription de la SFP sur la liste des entreprises dont la privatisation est autorisée par la loi.
Cet article poursuit trois objectifs. Plusieurs dispositions transitoires entre l'inscription de la SFP sur la liste des sociétés privatisables et sa cession effective au secteur privé doivent être prises ; les conséquences de cette inscription sur la loi du 30 septembre 1986 doivent être tirées ; enfin, le volet social de cette privatisation doit faire l'objet de prescriptions particulières.
• Le
paragraphe I
du présent
article propose l'abrogation de l'article52 de la loi n°86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication, ci-dessus
évoqué, qui fixe les missions et précise la nature du
statut de la SFP.
Le présent projet de loi autorisant le transfert de la SFP au secteur privé, il est logique de "sortir" cette société du périmètre du secteur public de l'audiovisuel.
ï Le paragraphe II du présent article supprime la référence à l'article 52 dans l'article 7 de ladite loi, qui édicté, notamment, une interdiction au personnel des services du CSA de participer à la gestion de la SFP. Cette restriction ne se justifie plus dans la mesure où celle-ci sortirait du champ du secteur public de l'audiovisuel.
ï Le paragraphe III du présent article supprime également la référence à l'article 52 dans l'article 104 de ladite loi, qui organisait le transfert du patrimoine, des droits et des obligations des organismes du secteur public de l'audiovisuel institués en application de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 aux organismes visés par les articles de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. La référence à la SFP devient, dans cet article, superflue.
• Le paragraphe IV
du
présent article édicté des dispositions transitoires
durant la période s'écoulant entre l'adoption du présent
projet de loi et le transfert effectif de la société au secteur
privé :
- La SFP demeurera explicitement soumise à la législation sur les sociétés anonymes, conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966.
- Les règles applicables à la composition du conseil d'administration de la SFP sont également maintenues. S'agissant d'une société du secteur Public "de premier rang", les dispositions de la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public continuent à s'appliquer.
A l'origine, les dispositions sociales, et notamment la sortie des salariés de la SFP, une fois celle-ci privatisée, du champ d'application de la convention collective nationale de l'audiovisuel, n'avaient pas été prévues par le projet de loi.
Par amendement lors du débat à l'Assemblée nationale, le gouvernement a complété le présent article par deux paragraphes, qui s'inspirent des dispositions de l'article 68 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Cet article, adopté à l'initiative du rapporteur de la commission spéciale du Sénat qui avait examiné ce texte, notre éminent collègue M. Adrien Gouteyron, avait prévu des dispositions particulières relatives aux relations individuelles et collectives de travail, lors de la privatisation de TF1.
Cet amendement donne une base législative aux résultats des négociations qui se sont tenues entre la direction et les syndicats de la SFP, après le dépôt du projet de loi.
• Le
paragraphe V
du présent
article régit la transition entre ancienne convention collective et les
conventions ou accords qui viendront s'y
substituer. Cette disposition
permet d'éviter un vide conventionnel qui serait préjudiciable
aux salariés et un blocage du dialogue social dommageable pour le
repreneur.
L'actuelle convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, signée le 31 mars 1984, prévoit, en effet, dans son article I.2, des modalités de dénonciation ou de révision très détaillées qui peuvent s'étendre sur un délai de trois ans. Le repreneur de la SFP ne pourra adhérer à l'association des employeurs de l'audiovisuel du secteur public, qui l'une des parties signataires de la convention : celle-ci pourrait donc cesser, en l'absence de disposition contraire, de produire ses effets, et conduire à l'application du droit commun.
L'article L.132-8 du code du travail dispose que, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
La disposition proposée prévoit que l'actuelle convention continue de produire effet jusqu'à l'expiration d'une période de quinze mois à compter de la cession au secteur privé de la SFP, sauf, bien entendu, conclusion d'une nouvelle convention.
Cette "survie" de l'actuelle convention collective ne concerne cependant pas les dispositions relatives aux commissions paritaires et au conseil de discipline, qui sont très proches du droit disciplinaire de la fonction publique.
Dans les trois mois suivant la cession de la SFP au secteur privé, des négociations devront s'engager à la demande du nouvel employeur ou des organisation syndicales ; à défaut d'accord dans les quinze mois, les salariés conserveront les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention, à l'expiration de cette période.
• Le
paragraphe VI
du
présent article régit les relations individuelles de travail qui
seront applicables à l'issue de la cession de la SFP au secteur
privé.
L'article L.122-12 du code du travail pose le principe de la continuité des relations individuelles de travail. La référence à cette disposition et la mention expresse que "les contrats de travail en cours au jour de la cession subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de la société" au premier alinéa de ce paragraphe sont de nature à apporter aux salariés de la SFP des garanties fermes quant à la sauvegarde de leurs droits acquis.
En outre, le second alinéa de ce paragraphe maintien l'affiliation du personnel de la SFP à l'IRCANTEC.
Comme la plupart des personnels des sociétés issues de l'ancienne ORTF, les salariés de la SFP bénéficient depuis 1974, et ce à titre dérogatoire, de l'affiliation à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales, créée en application du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970.
Le maintien en l'état de l'affiliation -dont a également bénéficié le personnel de TF1- évite de diminuer le nombre des cotisants de l'IRCANTEC et surtout de remettre en cause une construction complexe et ancienne en matière de retraites complémentaires, de retraites sur-complémentaires et de capital-décès.
• Le
paragraphe VII
du
présent article prévoit enfin que les dispositions des
paragraphes V et VI sont applicables aux sociétés filiales de la
SFP.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 29 - Disposition relative au CEPME
Commentaire : le présent article a pour objet de modifier les règles de désignation des membres du directoire du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME).
I. LE RÉGIME ACTUEL
Le CEPME est un établissement de crédit dont l'objet est le financement du développement des petites et moyennes entreprises. Il a été créé sous la forme d'une société anonyme à conseil de surveillance et directoire.
Son capital est actuellement réparti entre trois actionnaires :
ï la Caisse des dépôts et consignations pour 43 % ;
ï l'Etat pour 39 % ;
ï la Caisse centrale des banques populaires pour 13 %.
Il s'agit donc d'un établissement de crédit de second rang puisque l'Etat n'est pas directement majoritaire dans son capital.
Actuellement, aux termes de la loi de démocratisation du secteur public du 26 juillet 1983 et de diverses autres mesures :
ï le conseil de surveillance du CEPME est composé de 18 membres, dont 6 représentants des salariés et 2 représentants de l'Etat. Une particularité subsiste dans ce conseil puisque son président et son vice-président doivent être soumis à l'agrément du ministre de l'économie et des finances ;
ï le directoire du CEPME comprend 5 membres désignés par décret, le président du directoire étant nommé par décret en Conseil des ministres.
II. LA MESURE PROPOSÉE
Le présent article a pour objet de supprimer le CEPME de la liste des entreprises figurant à l'annexe I de la loi de démocratisation du secteur public du 26 juillet 1983.
En conséquence, la nomination des membres du directoire sera régie par les règles du droit commun des sociétés, ce qui signifie que ses membres seront nommés par le conseil de surveillance.
On observera toutefois que le président du directoire restera nommé dans les conditions actuelles, c'est-à-dire par décret en Conseil des ministres.
En supprimant le CEPME de la liste des entreprises figurant à l'annexe I. le présent article ne soustrait pas le CEPME aux dispositions de la loi de démocratisation du secteur public. C'est en effet l'inverse Puisque, désormais, les règles générales de cette loi lui seront applicables.
Toutefois, l'Assemblée nationale a souhaité en faire la mention explicite dans le présent article, craignant que la présence de la Caisse des dépôts et consignations (établissement public "sui generis") comme actionnaire principal du CEPME ne puisse donner lieu à des interprétations afférentes.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
TITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS, A L'AGRICULTURE ET A L'AMÉNAGEMENT FONCIER
Article 30 - Dispositions relatives à la taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques
Commentaire : le présent article a pour objet de modifier le régime de la taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques instituée par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 au profit de l'établissement public Voies navigables de France.
I. LE RÉGIME ACTUEL
L'article 124 de la loi de finances pour 1991 a confié l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension des voies navigables et de leurs dépendances ainsi que la gestion du domaine de l'Etat nécessaire à l'accomplissement de ces missions à l'établissement public Voies navigables de France.
Il a assorti cette disposition de l'institution de ressources propres au profit de Voies navigables de France.
Ces ressources sont essentiellement constituées par la taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques. S'y ajoutent des péages auxquels sont assujettis les transporteurs de marchandises ou de passagers et les propriétaires de bateaux de plaisance.
Ainsi, en 1995, la taxe hydraulique a rapporté 510 millions de francs » soit 80 % des ressources propres (570 millions de francs) et 42 % des ressources totales de l'établissement public (1.220 millions de francs).
La taxe hydraulique comporte deux éléments :
- un élément lié à la surface d'emprise de l'ouvrage, dont le taux est fonction du nombre d'habitants de la commune d'implantation de l'ouvrage (- de 2.000 habitants, + de 2.000 habitants ou de + de 100.000 habitants) ;
- un élément lié au volume d'eau prélevable ou rejetable par l'ouvrage, un coefficient d'abattement étant affecté au taux applicable à cet élément en fonction de l'usage agricole ou industriel.
Or, les éléments ainsi définis pour calculer la taxe à laquelle sont assujettis les titulaires d'ouvrages hydrauliques sont apparus parfaitement inadaptés à certaines situations. En effet, ils conduisaient parfois à percevoir une taxe hors de proportion avec le chiffre d'affaires des exploitants (jusqu'à 30 fois le chiffre d'affaires !) Dans ces cas particuliers, le recouvrement de la taxe était donc impossible.
II. LA MESURE PROPOSÉE
Le présent article vise à modifier la définition des éléments de la taxe hydraulique dans deux cas particuliers : pour les ouvrages à usage agricole et Pour les micro-centrales hydroélectriques.
• Dans le régime actuel, les ouvrages
à usage agricole sont taxés de manière très
différente selon qu'ils se situent dans une communes de moins de2.000
habitants ou de plus de 2.000 habitants : le plafond de la taxe qui leur
est applicable peut passer de 10 à 100 francs par mètre
carré.
Or, cette situation ne paraît pas justifiée par des raisons objectives, en particulier si la différence tient seulement au territoire plus ou moins étendu de la commune. En Camargue par exemple, le territoire très étendu de la commune d'Arles est particulièrement pénalisant pour les agriculteurs qui y exercent leur activité.
Le présent article propose donc de plafonner à 10 francs par mètre carré le montant du premier élément de la taxe pour les ouvrages à usage agricole, quelle que soit la population des communes d'implantation.
• Dans le cas des micro-centrales,
c'est-à-dire des ouvrages hydroélectriques autorisés en
application de la loi du 16 octobre 1919 (d'une puissance inférieure
à 4.500 kW), les critères définis à l'article 124
de la loi de finances pour 1991 se sont révélés
particulièrement absurdes, rendant impossible la perception de la
taxe.
L'article 89 de la loi de finances rectificative pour 1992 a donc modifié ce régime afin de prendre en compte non seulement la surface d'emprise de l'ouvrage mais également la puissance installée.
La taxe ainsi modifiée est toutefois restée inapplicable dans le cas d'une surface d'emprise importante due, par exemple, à la seule longueur des canaux d'amenée et de rejet, qui peuvent dépasser un kilomètre.
Le présent article propose donc une définition plus restrictive de I* surface d'emprise de façon notamment à ne prendre en compte que l'emprise des canaux situés aux abords immédiats de l'usine d'exploitation de la microcentrale.
Par ailleurs, il est prévu un plafonnement de la taxe à 5 % du chiffre d'affaires généré par ces ouvrages au cours de l'année précédant l'année d'imposition, avec un abattement particulier pour les dix premières années d'exploitation de l'ouvrage.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission se félicite que l'on ait décidé de corriger des situations aberrantes, empêchant le recouvrement de cette taxe hydraulique dans de bonnes conditions.
Toutefois, elle s'inquiète d'un des nouveaux critères retenus pour l'assujettissement des micro-centrales. En effet, il lui paraît qu'un plafonnement de la taxe à 5 % du chiffre d'affaires reste encore un taux très élevé qui, dans certaines situations, pourrait s'avérer excessif et rendre à nouveau impossible le recouvrement de la taxe.
Votre commission souhaite donc que le gouvernement puisse répondre en séance à cette interrogation et clarifie les choix effectués.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 31 - Dispositions relatives à la déclaration d'utilité publique d'une section de l'autoroute A 89
Commentaire : le présent article procède à la validation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges désignant la commission d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de l'autoroute A 89. Cette ordonnance est entachée d'erreur de compétence.
La validation législative, qui vise à légaliser des actes illégaux au regard du droit en vigueur, doit être utilisée avec la plus grande circonspection. En l'occurrence, le problème juridique soulevé est mineur alors que le projet qu'il pourrait entraver est très important.
I. UN PROBLÈME JURIDIQUE MINEUR
Par une ordonnance du 23 mars 1994, le président du tribunal administratif de Limoges a désigné la commission d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de la section Arveyres (Gironde), Saint-Julien-Puy-Lavèze (Puy de Dôme) de l'autoroute A 89 (288 km). C'est cette décision que le présent article propose de valider.
Elle est en effet entachée d'erreur de compétence. Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que cette désignation est de la compétence du président du tribunal administratif dans le ressort duquel doit prendre place la plus grande partie de l'ouvrage. Or cette section de l'A 89 comptera 123 km en Limousin contre 148 km en Aquitaine (17 km en Auvergne). Le président du tribunal compétent était celui de Bordeaux.
Cette erreur s'explique en amont par une anomalie de notre droit et n'a pas eu de conséquence particulière en aval.
Le président du tribunal administratif de Limoges a agi sur saisine du préfet de Corrèze, qui était le préfet compétent pour coordonner l'ensemble de l'enquête publique, puisque ce département est celui qui compte la plus grande Partie de l'ouvrage (123 km contre 111 en Dordogne, 37 en Gironde, 17 dans le Puy-de-Dôme). Ce préfet s'est naturellement tourné vers le président du tribunal de sa région, alors que ce n'était pas le bon : il s'agit d'un cas limite mais qui peut se produire dès lors que le raisonnement se fait par région sur un aspect, par département sur un autre. Au demeurant, la différence de taille de l'ouvrage entre les deux départements est modique au regard de l'ensemble (25 km) et le plus grand nombre d'ouvrages d'art sera construit en Corrèze. La différence de coût est encore plus réduite (7 milliards de francs pour l'Aquitaine, 6,7 milliards de francs pour les autres départements).
En aval, cette erreur n'a pas nui au but de cette procédure, qui est de traiter équitablement les régions concernées. En effet, le président du tribunal administratif de Limoges a désigné deux commissaires-enquêteurs par département pour chaque département traversé. Dès lors, le Limousin n'a pas été indûment mieux traité que l'Aquitaine.
La validation ne porte que sur cet élément restreint de la procédure de déclaration d'utilité publique : la saisine du président du tribunal administratif de Limoges par le préfet de Corrèze, l'ordonnance du 22 mars 1994. Cette dernière n'est validée qu'en ce qui concerne l'incompétence. Elle reste éventuellement attaquable sur tous les autres points.
A fortiori, la déclaration d'utilité publique du 10 janvier 1996, relative à la section Arveyres-Saint-Julien-Puy-Lavèze, n'est donc validée sur aucun autre point.
II. UN PROBLÈME ÉCONOMIQUE IMPORTANT
L'autoroute A 89 est un élément de la liaison transversale Bordeaux-Lyon, très importante pour le désenclavement du Massif central et la traversée du sud de la France d'ouest en est.
La réalisation de la section de l'autoroute entre Arveyres et Saint-Julien-Puy-Lavèze est inscrite au contrat de plan entre l'Etat et la Société des autoroutes du sud de la France (ASF). Ce contrat de plan, qui couvre la période de 1995 à 1999, prévoit pour cette liaison autoroutière un engagement de dix milliards de francs. Cet engagement sera soldé dans le cadre du contrat de plan suivant pour terminer cette section (3,7 milliards de francs), auquel s'ajoutera également la section entre Saint-Julien-Puy-Lavèze et l'autoroute A 71, au nord de Clermont-Ferrand (2,5 milliards de francs).
La répartition annuelle de ces investissements, tant en engagements qu'en dépenses, n'est pas fixée et ne peut être annoncée qu'à titre indicatif. La mise en service des premières sections (Arveyres-Coutras et Ussel-Saint-Julien-Puy-Lavèze) est attendue respectivement pour décembre 1999 et septembre 2000.
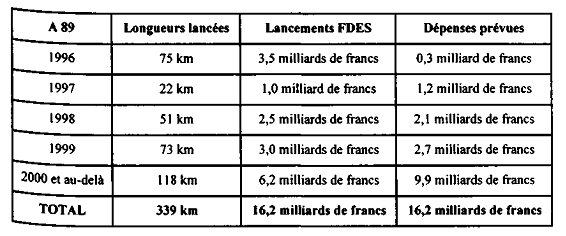
Reprendre une nouvelle procédure préalable à la déclaration d'utilité publique de la section Arveyres-Saint-Julien-Puy-Lavèze induirait un retard de cet échéancier d'au moins quatorze mois. Avec les remises en cause éventuelles de certains aspects de ce projet difficile, le retard pourrait être supérieur à deux ans.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 32 - Dispositions relatives à la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers
Commentaire : le présent article tend à autoriser la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD) à consacrer une partie de son fonds de réserve au financement des plans sociaux qui ont accompagné la réforme de la manutention portuaire mise en oeuvre depuis 1992.
I. LE COÛT DE LA RÉFORME DE LA MANUTENTION PORTUAIRE DE 1992 EST CONSIDÉRABLE
Dans le régime de travail de la manutention portuaire antérieur à 1992, tel qu'il résultait de la loi du 6 septembre 1947, les anciens dockers disposaient d'un monopole d'emploi pour l'exécution des opérations de chargement et déchargement des navires et de certaines opérations annexes.
Les ouvriers dockers professionnels et occasionnels travaillaient sous le régime de l'intermittence, c'est-à-dire à la vacation. Rattachés au bureau central de la-main-d'oeuvre (BCMO) de chaque port et titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'Etat, ils étaient juridiquement indépendants de leurs employeurs. A condition de se présenter régulièrement à l'embauche, ils avaient droit à une indemnité de garantie en cas d'inemploi. Cette indemnité leur était servie par la CAINAGOD, alimentée par les cotisations des entreprises de manutention.
La loi n° 92-946 du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes a radicalement réformé les conditions d'emploi de la main-d'oeuvre portuaire, dans le souci d'améliorer la compétitivité des ports français. Cette réforme s'est déroulée selon deux axes complémentaires.
- D'une part, la mensualisation sur une base volontaire des dockers, qui sont désormais dans leur grande majorité rattachés aux entreprises de manutention par des contrats de travail de droit commun.
- D'autre part, la réduction négociée des effectifs dans le cadre de plans sociaux comportant des mesures d'âge et des mesures de reconversion.
En effet, les sureffectifs résultant de la mécanisation de la manutention se traduisaient par des taux d'inemploi très importants qui risquaient de bloquer te processus de mensualisation.
Entre fin juin 1992 et fin juin 1995, le nombre des dockers Professionnels est passé de 8.151 à 4.149, dont 3.847 seulement sont en situation d'activité. L'essentiel de ces dockers en activité sont mensualisés : il ne subsiste que 486 dockers intermittents, dont les deux-tiers sont à Marseille.
Les objectifs de la réforme sont donc atteints puisque, si l'on écarte les dockers intermittents handicapés ou en maladie de longue durée, dans vingt BCMO sur trente-et-un, il n'y a actuellement plus aucun docker Professionnel intermittent en situation d'activité.
Mise en oeuvre sur une base négociée et volontaire, la réforme de 1992 a été coûteuse. Le coût total des plans sociaux qui ont permis de diviser par deux le nombre des dockers en trois ans est estimé à 4 milliards de francs. Soit 2 milliards de francs à la charge de l'Etat et 2 milliards de francs à la charge des places portuaires, dont 1,2 milliard de francs à la charge des entreprises de manutention (le solde étant essentiellement financé par les établissements portuaires et, plus rarement, par les collectivités locales).
Le coût moyen par docker bénéficiant d'une mesure d'âge ou de reconversion est de 957.000 francs. Mais, les plans ayant été négociés port par port, ce montant moyen recouvre des variations considérables : entre 446.000 francs à Cherbourg et 1,3 milliard de francs au Havre.
II. CETTE RÉFORME S'EST TRADUITE PAR L'ACCUMULATION DE RESERVES FINANCIERES À LA CAINAGOD
La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, organisme doté de la personnalité morale, est chargée de la gestion de l'intermittence et de indemnisation de l'inemploi dans le domaine de la manutention portuaire. Elle est dirigée par un conseil d'administration tripartite où sont représentés l'État, les employeurs et les dockers.
Elle a pour mission d'assurer, par l'intermédiaire des bureaux centraux de la main-d'oeuvre, qui constituent ses services locaux dans les ports, le paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels intermittents inemployés. Elle peut également avoir à verser des indemnités compensatrices dans le cas où il devrait être procédé à une réduction de l'effectif des intermittents.
Les ressources de la Caisse sont essentiellement constituées de cotisations versées par les employeurs de main-d'oeuvre dans les ports et assises sur les rémunérations payées aux dockers intermittents ou occasionnels.
Jusqu'en 1992, le taux de cotisation était identique sur tout le territoire, ce qui signifie qu'il y avait péréquation des charges entre les ports. Aujourd'hui, ce taux est fixé port par port afin d'assurer l'équilibre financier de chaque BCMO. Il varie très fortement, entre 2 % à Douarnenez et 28 % à Rouen, et est égal à 0 dans les ports qui n'ont plus aucun docker intermittent.
La réforme de la manutention a bouleversé l'activité de la CAINAGOD : le nombre de dockers intermittents qui lui sont affiliés a été diminué par vingt en trois ans.
Cette évolution a entraîné une diminution drastique des recettes de la Caisse : les cotisations versées par les employeurs sont passées de 105,8 millions de francs en 1992 à 18,1 millions de francs en 1995. Mais ses dépenses ont diminué encore plus vite : entre 1992 et 1995, les indemnités de chômage versées par la Caisse sont passées de 74,1 millions de francs à 2,9 millions de francs, tandis que ses frais de fonctionnement diminuaient de 48,1 millions de francs à 18,6 millions de francs. Depuis 1985, la CAINAGOD a réduit les effectifs de son personnel de 246 à 44 personnes.
II en résulte que la CAINAGOD a accumulé des réserves consistantes, qui sont passées de 66,4 millions de francs en 1992 à 110,7 millions de francs en 1995, soit plus de cinq années de ses dépenses.
Evolution du budget de la CAINAGOD (1992-1995)
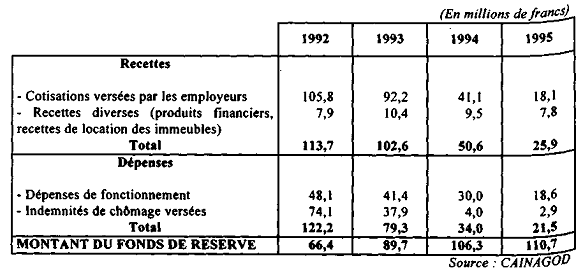
III. L'AFFECTATION D'UNE PARTIE DES RESERVES DE LA CAINAGOD AU FINANCEMENT DE LA RÉFORME EST LOGIQUE
Réglementairement, la CAINAGOD ne peut disposer de réserves supérieures au montant des dépenses susceptibles d'être mises à sa charge Pendant huit mois (arrêté du 20 novembre 1969 modifié le 7 avril 1971). Le niveau actuel de son fonds de réserve, soit 110,7 millions de francs à la fin de 1995, va bien au-delà de cette norme prudentielle.
Cet excédent ayant été constitué par les cotisations des entreprises de manutention, il est logique de l'utiliser pour alléger la contribution de celles-ci aux plans sociaux qui ont accompagné la réforme. Selon l'Union nationale des industries de la manutention (UNIM), cette contribution s'élève pour l'ensemble de la profession à 1,243 milliard de francs, dont 694 millions de francs restaient encore à verser au 1 er janvier 1996.
Les catégories de dépenses de la CAINAGOD étant fixées par la loi, le législateur doit au préalable autoriser ce nouvel usage des ressources de la Caisse. C'est l'objet du présent article, qui pose le principe de l'affectation d'une partie des réserves de la CAINAGOD aux dépenses d'exécution des Plans sociaux agréés avant le 31 décembre 1996, et en renvoie les modalités à un décret.
Compte tenu des engagements de la CAINAGOD existants par ailleurs, la totalité de son fonds de réserve ne sera pas disponible. La
Caisse est en effet redevable de 19 millions de francs envers le Fonds national Pour l'emploi, au titre de sa contribution au financement du départ en préretraite de dockers entre 1982 et 1985. Par ailleurs, la Caisse a provisionné 38 millions de francs pour le financement du plan social concernant son propre personnel, nécessaire pour adapter ses effectifs à la diminution de son activité.
Au total, la part excédentaire du fonds de réserve de la CAINAGOD que le Gouvernement projette d'affecter au financement des Plans sociaux dans les ports est estimée à 50 millions de francs.
Le décret devra également fixer les critères de répartition de cette contribution de la Caisse entre les ports. Deux critères seront combinés :
- le premier critère se fondera sur les coûts restant à financer, calculés de façon à neutraliser leur variation d'un port à l'autre (faute de cette correction, les places portuaires ayant mis en place les plans sociaux les plus dispendieux seraient avantagées) ;
- le second critère se fondera sur le solde des cotisations de chaque port à la Caisse depuis 1947, net des indemnités reversées (ce second critère vise à donner une prime aux ports qui étaient contributeurs nets dans l'ancien système de péréquation des charges, c'est -à dire les grands ports autonomes).
Il est prévu que les sommes ainsi réparties soient versées aux caisses de compensation des congés payés, institutions propres au secteur de la manutention portuaire par lesquelles ont déjà transité les contributions des entreprises aux plans sociaux.
Le décret devra enfin préciser les modalités de contrôle du bon emploi de cette fraction du fonds de réserve de la Caisse et, le cas échéant, les conditions de reversement des sommes si leur emploi n'était pas conforme. Ce contrôle ne pourra en effet intervenir qu'a posteriori, sauf à ralentir excessivement la procédure de répartition des fonds et d'ajustement des volets financiers des plans sociaux dans les ports.
A titre de conclusion, il convient de relever que la prochaine étape consistera sans doute, dès que la réforme de la manutention portuaire aura atteint une certaine maturité, à reconsidérer l'existence même de la CAINAGOD, qui est appelée à s'éteindre en même temps que la catégorie de docker intermittent.
Il semble d'ores et déjà contre-productif de maintenir une structure spécifique pour gérer les 486 intermittents encore en activité, ce qui aboutit à un ratio aberrant de 6 francs de cotisations payées pour 1 franc d'indemnité de garantie versée, les frais de fonctionnement absorbant 86,5% des dépenses de la CAINAGOD, qui n'en continue pas moins à accumuler des réserves.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 33 (Retiré) - Actualisation des modalités de détermination du prix du lait
Commentaire : Cet article vise à modifier les dispositions législatives en vigueur qui ne permettent pas de prendre en compte, pour la fixation du prix au producteur, des critères techniques relatifs aux possibilités de transformation du lait. Cet article a été retiré par le gouvernement dans le souci de conduire une concertation nouvelle contre les parties intéressées "sans doute, si la concertation aboutit, pour introduire une nouvelle disposition devant le Sénat par voie d'amendement".
L'excellent rapport de l'Assemblée nationale procède à une analyse très détaillée des modalités de détermination du prix du lait. Il rappelle que les critères régissant le paiement du lait aux producteurs sont fixés par la loi du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité, dite "loi Godefroy". Depuis la publication de cette loi, la filière laitière a profondément évolué. Une actualisation de la loi était devenue nécessaire.
I - LES CRITÈRES PRIS EN COMPTE POUR FIXER LE PRIX DU LAIT : DU "BIOLOGIQUE" AU "SANITAIRE"
Lors de l'adoption de la loi de 1969, les entreprises de transformation du lait produisaient généralement plusieurs types de produits. Peu à peu une spécialisation s'est effectuée et les entreprises ont recherché le lait correspondant au mieux à leur production. Pour ce faire, elles ont d'abord accordé des bonifications aux producteurs de lait leur livrant le lait recherché. Puis, prenant en compte l'amélioration globale de la qualité hygiénique et sanitaire du lait à la suite de directives communautaires, elles ont parfois Préféré imposer des réfactions sur le prix du lait mal adapté à la fabrication de leurs produits.
Cependant, certains producteurs de l'ouest de la France ont déposé des recours contentieux en arguant que les critères justifiant l'application de pénalités allaient au-delà des prescriptions de la loi de 1969 et du décret application n° 70-1056 du 16 novembre 1970 qui prévoient que les prix des laits doivent être déterminés en fonction de leur composition en matières grasses et en protéines et de leur qualité hygiénique et biologique. Les demandes ont été jugées recevables par les tribunaux mais aucune décision n'est encore intervenue au fond.
A la demande du Centre national interprofessionnel de l'économie laitière, une concertation a été engagée avec les professionnels du lait afin de pouvoir introduire dans la fixation du prix du lait des critères liés à l'aptitude du lait à fournir des produits transformés de bonne qualité.
Lors de la séance du 7 mars à l'Assemblée nationale, le ministre chargé des relations avec le Parlement a souligné : "Le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière a saisi l'administration de propositions de modifications de la réglementation relative au paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité. L'interprofession -je rappelle qu'elle comprend les producteurs, les transformateurs coopératifs et les transformateurs privés- souhaite introduire des critères liés à l'aptitude technologique du lait à fournir des produits transformés de bonne qualité. Les dispositions actuelles sont fixées par la loi du 3 janvier 1969, dite loi Godefroy. Le conseil de direction de l'office du lait à reçu mission de formuler un avis sur le dispositif élaboré pour répondre à la demande de l'interprofession ; le groupe de travail qui a été constitué a conclu que les aménagements demandés ne peuvent pas être menés à bien sans une modification de la loi Godefroy".
Les deuxième et troisième alinéas du 1° du I du présent article ont donc pour objet d'autoriser, à titre facultatif, la prise en compte de critères relatifs aux possibilités de transformation du lait et aux caractéristiques des produits susceptibles d'être obtenus pour la détermination du prix du lait.
Ces critères ne sont que facultatifs car des produits comme la poudre de lait n'exigent pas d'y avoir recours. Ils viennent ainsi compléter les critères obligatoires concernant la composition et la qualité du lait.
Il convient néanmoins de remarquer que cette nouvelle rédaction précise le critère relatif à la qualité en indiquant qu'il s'agit de la qualité "hygiénique et sanitaire". Ces deux termes ont été choisis de façon à englober, d'une part, les conditions d'élevage, l'exécution de la traite et la conservation du lait -on parle alors de conditions d'hygiène- et, d'autre part, les caractéristiques des produits dans l'optique de la sécurité du consommateur -on parle alors de conditions sanitaires.
Un décret précisera le contenu des engagements conclus entre les producteurs et les acheteurs de lait. Il indiquera également les modalités techniques de mise en oeuvre des critères.
Selon M. Philippe Auberger, l'élargissement des critères pris en considération pour la fixation du prix du lait ne fait qu'entériner une pratique largement diffusée et devrait donc avoir peu de répercussion sur les prix actuels du lait. Toutefois, les débats à l'Assemblée nationale ont révélé certaines réticences à rencontre du projet de loi, certains députés craignent en effet que "parmi les critères additionnels pourrait être retenu celui de la lipolyse, ce qui diminuerait le prix payé aux producteurs et les pénaliserait ajustement car la lipolyse est le plus souvent imputable aux transporteurs qui agissent pour le compte de transformateurs".
Il importe enfin d'observer que le texte des deuxièmes et troisièmes alinéas du 1° du I du présent article fixent des critères techniques de différenciation du prix du lait et non le prix du lait lui-même. En effet, l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 novembre 1979 (affaire 10/79 TOFFOLI et autres contre la région de Vénétie) interdit la fixation de tarifs imposés par les autorités publiques ou à caractère indicatif.
II. - LA PROCÉDURE DE FIXATION DU PRIX DU LAIT : CONSÉCRATION DU RÔLE DES INTERPROFESSIONS
La loi du 3 janvier 1969 a été publiée à une époque où l'interprofession laitière n'existait pas encore. Le dispositif qu'elle prévoyait pour fixer, au niveau local, le prix du lait au regard des critères retenus (intervention d'un arrêté préfectoral après consultation des organisations Professionnelles laitières les plus représentatives) n'a donc pas perduré après la promulgation des lois n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière et n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole.
Le quatrième alinéa du 1° du I du présent article prévoit donc d'harmoniser le texte de loi et la pratique en indiquant que des grilles de classement des laits sont fixées, au niveau régional, au moyen d'accords interprofessionnels pouvant être homologués par arrêtés conjoints du ministre de l'Agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre de l'Economie et des finances, en application de la loi du 12 juillet 1974 précitée, ou pouvant être étendus en application de la loi du 10 juillet 1975 précitée, afin d'être obligatoires pour tous les producteurs et transformateurs de la zone concernée.
Les débats à l'Assemblée nationale ont fait ressortir une crainte devant l'extension des pouvoirs de l'interprofession. Selon M. Jean-Claude Lemoine : "cet article accentue le poids de l'interprofession qui est, on le sait, dominée par les transformateurs". Aux dires de M. Patrick Ollier : "D'autre part, alors que nombreux sont les petits producteurs qui ne peuvent pas faire valoir leurs droits, écrire dans la loi que c'est l'interprofession qui interviendra bloque le système et risque d'avoir des conséquences extrêmement graves. Nous préférerions que le Gouvernement conserve la possibilité d'intervenir, dans un souci de justice. "
Le champ d'application de la loi du 3 janvier 1969, modifiée par le présent article, ne se limite enfin pas au lait de vache, mais s'étend également aux laits de chèvre et de brebis. Or, l'aire géographique des organisations interprofessionnelles des laits de chèvre et de brebis ne couvre pas l'ensemble du territoire. Toutefois, ces interprofessions existent dans les régions où l'essentiel de la transformation est effectuée (Poitou-Charentes pour le lait de chèvre, Aveyron et Pyrénées-Atlantiques pour le lait de brebis). En outre, la loi ne concerne que les achats de lait par l'industrie de transformation et la production de fromage à partir des laits de chèvre et de brebis est souvent une production fermière effectuée dans des régions dépourvues d'outils de transformation industriel. La discontinuité géographique des organisations de ces secteurs ne fera donc pas obstacle à l'application de la loi.
Par ailleurs, le présent article remet en forme la loi du 3 janvier 1969. Les dispositions figurant ans l'article 3 sont modifiées et insérées à l'article 2 dont les dispositions actuelles sont supprimées puisque la définition des normes de composition et de qualité relève désormais de lé réglementation communautaire (directive n° 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant des règles sanitaires pour la production de lait cru, de lait traite thermiquement et de produits à base de lait). En conséquence, l'article 4 qui définit les sanctions applicables en cas d'infractions aux décrets prévus à l'article 2 est abrogé. L'article 5 devient donc l'article 3 et les références qu'il contient sont adaptées au nouveau texte.
Enfin, le II du présent article supprime la référence à la loi du 3 janvier 1969 dans le texte de l'article L. 213-5 du code de la consommation qui énumère les cas de récidive légale en matière de conformité et de sécurité des produits de consommation. Cette suppression découle de l'abrogation de l'article 4.
Compte tenu des observations critiques présentées par quelques députés, le gouvernement a cru devoir retirer cet article 33. Votre rapporteur a pris contact avec tous les organismes représentatifs de la filière (producteurs, transformateurs privés, coopératives) qui lui ont confirmé leur attachement à une adoption "rapide" de la modification de la loi Godefroy. Ils ont rappelé leur accord sur les objectifs poursuivis qui visent à :
- "formaliser la procédure d'organisation du paiement du lait au niveau régional au moyen d'accords interprofessionnels ;
- rendre possible l'adoption de nouveaux critères (de composition, de qualité hygiénique ou d'aptitude technologique) dont l'intérêt est avéré et après négociation entre producteurs et transformateurs ;
- actualiser l'arrêté du 2 mai 1985 et notamment ses annexes, qui définissent les modalités techniques de prélèvement et d'analyse."
Votre rapporteur s'attachera, compte tenu des délais d'examen du projet de loi, à rechercher les voies d'un consensus avant le débat en séance publique.
Décision de la commission : votre commission a pris acte du retrait de cet article. Elle estime cependant urgent de parvenir à une modification de la loi "Godefroy".
Article additionnel après l'article 33
Option des SARL de famille pour l'impôt sur le revenu lorsqu'elles exercent une activité agricole
Commentaire : Cet article additionnel vise à élargir le champ d'application de l'option des SARL de famille pour l'impôt sur le revenu en autorisant ces dernières à opter lorsqu'elles réalisent une activité agricole.
Lors des débats sur la seconde loi de finances rectificative pour 1995, le Sénat a examiné un amendement présenté par notre collègue Michel Souplet et visant à élargir le champ d'application de l'option des SARL de famille pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques en autorisant ces dernières à opter lorsqu'elles réalisent une activité agricole.
Les dispositions actuelles excluent de ce dispositif les SARL de famille n'exerçant pas une activité de nature industrielle, commerciale ou artisanale.
Comme il a été indiqué à la tribune de la Haute Assemblée :
"Un nombre croissant d'exploitations agricoles à responsabilité limitée constituées entre parents et donc soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques réalisent une activité agricole et une activité commerciale, les deux étant intimement imbriquées (...). Cette connexité des activités n'est pas compatible avec la scission des activités dans deux structures juridiques différentes, une EARL -exploitation agricole à responsabilité limitée- réalisant l'activité agricole et une SARL ou une EURL -entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée- réalisant l'activité commerciale.
Ces sociétés peuvent réaliser ces opérations commerciales tout en restant assujetties à l'IRPP tant que les recettes commerciales ne dépassent pas le double seuil fixé à l'article 75 du code général des impôts, c'est-à-dire 30 % du chiffre d'affaires ou 200.000 francs. Si elles viennent à dépasser l'un de ces seuils, ces EARL basculent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, ce qui est comptablement et fiscalement très lourd pour ces sociétés, qui sont le plus souvent de petites structures.
Afin de conserver leur statut social, il pourrait être envisagé de Permettre à ces sociétés de type familial de se transformer en SARL avec la Possibilité d'option pour l'IRPP".
Cette proposition intéressante soulevait toutefois quelques difficultés techniques d'application qui devaient être préalablement expertisées. Cette expertise a été conduite conjointement avec les services ministériels concernés et les organisations professionnelles. Ces difficultés ont été aplanies, et le présent article additionnel doit pouvoir être accepté par le Sénat.
L'article 239 bis AA du code général des impôts autorise les entreprises familiales exploitées sous la forme de société à responsabilité nuitée qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale à sortir du champ d'application de l'impôt sur les sociétés au moyen d'une option pour le régime des sociétés de personnes.
Conformément aux dispositions de l'article 8 5° b du code général des impôts, le même régime des sociétés de personnes s'applique aux associés une exploitation agricole à responsabilité limitée. Toutefois, dans cette situation, la réalisation d'opérations commerciales au-delà des limites prévues à l'article 75 du code (30 % du chiffre d'affaires ou 200.000 francs de recettes titre d'un exercice) rend la société redevable de l'impôt sur les sociétés en application du 2 de l'article 206.
Le présent article additionnel vise à élargir l'option pour le régime des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis AA aux sociétés à responsabilité limitée qui exercent une activité agricole.
Cela permettra ainsi aux exploitations agricoles à responsabilité limitée qui viendraient à dépasser les limites fixées à l'article 75 de conserver leur assujettissement au régime des sociétés de personnes lors de leur transformation en société à responsabilité limitée à caractère familial dès lors que l'option prévue à l'article 239 bis AA sera exercée dans l'acte constatant la transformation, conformément à l'article 46 terdecies B de l'Annexe III au code général des impôts
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet
Article 34 - Dispositions relatives à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée
Commentaire : cet article, voté par l'Assemblée nationale après l'adoption d'un amendement de portée rédactionnelle, vise à proroger certains délais de dépôt ou de traitement de demande de reconnaissance d'AOC.
L'article premier de la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, ouvre à l'ensemble des produits agro-alimentaires la faculté de se voir reconnaître une appellation d'origine contrôlée (AOC) sous réserve d'en remplir les conditions.
Cependant, avant cette réforme de 1990, certains produits agro-alimentaires, autres que les produits viticoles, se sont vu attribuer une appellation d'origine simple, soit par voie législative ou réglementaire, soit par voie judiciaire, en application des dispositions de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine.
La loi du 2 juillet 1990 précitée a donc précisé que les appellations d'origine simples définies par voie législative ou réglementaire avant le 1 er juillet 1990 devenaient automatiquement des appellations d'origine contrôlées.
En revanche, les neuf produits (huîtres de Belon, huile d'olive de Nyons, lentille verte du Puy, carotte de Créance, foin de Crau, miel de sapin des Vosges, pintadeau de la Drôme, poulet du Bourbonnais et truffe noire du Tricastin) dont l'appellation d'origine simple a été définie par voie judiciaire (AOJ) ainsi que les trente-quatre eaux-de-vie ayant obtenu cette appellation selon une procédure spécifique (articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 dans sa rédaction antérieure à la loi de 1990 précitée, qui a abrogé ces deux articles) devaient faire l'objet, avant le 1 er juillet 1995, d'un décret leur attribuant, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine (INAO), une AOC, s'ils satisfaisaient aux conditions.
Comme le souligne le rapport très complet de M. Philippe Auberger, seule l'huile d'olive de Nyons s'est vue reconnaître une AOC dans le délai fixé. Le miel de sapin des Vosges, cher au président Christian Poncelet, et la lentille verte du Puy ont fait l'objet d'une proposition de reconnaissance de la part de l'INAO, mais les décrets n'ont pas encore été publiés.
Les autres AOJ n'ont pas obtenu l'AOC, soit parce qu'ils n'ont pas déposé une demande de reconnaissance auprès de l'INAO, soit parce qu'ils ne satisfont pas encore aux conditions fixées par l'article L. 115-5 du code de la consommation. En outre, il convient d'indiquer que l'INAO, compétente Uniquement en matière de vin avant 1990, doit apprendre à connaître ces nouvelles filières.
S'agissant des eaux-de-vie, une commission d'enquête de l'INAO a vérifié que les productions concernées n'ont pas cessé, mais aucun producteur n'a déposé une demande de reconnaissance en AOC. Ces eaux-de-vie correspondent, en effet, à des productions marginales ne ressentant pas la nécessité de bénéficier d'une AOC.
Les dispositions du présent article concernent donc essentiellement les six AOJ n'ayant pas encore fait l'objet d'une proposition de reconnaissance en AOC par l'INAO. Elles prévoient de proroger le dispositif figurant dans la loi du 2 juillet 1990 précitée. Il s'agit donc :
- de fixer un délai -le 31 décembre 1996- pour clore le délai de dépôt des demandes en AOC auprès de l'INAO. Cette mesure vise particulièrement le poulet du Bourbonnais, seule AOJ pour laquelle aucune demande n'a encore été effectuée ;
- de repousser au 1 er juillet 2000 le terme du délai légal pour le traitement des demandes.
Les appellations d'origine simples seront ainsi progressivement caduques :
- soit le 1 er janvier 1997, en cas de défaut de demande de reconnaissance en AOC ;
- soit en cas de refus de reconnaissance en AOC intervenant avant le 1 er juillet 2000 ;
- soit le 1 er juillet 2000, à l'expiration du délai.
Il importe de souligner, toutefois, comme le rapporteur de l'Assemblée nationale, que les produits dont l'appellation d'origine simple sera devenue caduque auront toujours la possibilité d'effectuer une demande de reconnaissance en AOC par la suite dans le cadre de la procédure normale prévue par l'article L. 115-6 du code de la consommation. Cette reconnaissance pourra alors leur être accordée s'ils satisfont aux conditions fixées par l'article L. 115-5 dudit code.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 35 - Dispositions relatives au Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc
Commentaire : Cet article vise à permettre, sans perception de droits d'enregistrement, le transfert des biens du conseil interprofessionnel des vins de Fitou, Corbières et Minervois au Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc.
La loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole permet de reconnaître en qualité d'organisations interprofessionnelles, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés, les groupements constitués par les organisations professionnelles agricoles les plus représentatives.
Afin d'encourager ces regroupements, l'article 9 de la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlée des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, prévoit que les transferts sans contrepartie de l'ensemble de l'actif et du passif, opérés lors de la dissolution d'organismes interprofessionnels agricoles au profit d'une organisation interprofessionnelle reconnue au sens de la loi de 1975 précitée, bénéficient d'un régime particulier.
Le présent article tire les conséquences de la reconnaissance en tant qu'organisation interprofessionnelle, au sens de la loi de 1975 précitée, du Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc. Cette reconnaissance est intervenue le 4 septembre 1994.
Cette organisation exerce sa compétence sur les aires de production des vins à appellation d'origine d'Aude, du Gard et de l'Hérault. Ses activités concernent donc les appellations d'origine contrôlées Fitou, Corbières, Minervois, Côteaux du Languedoc, Faugères, Saint-Chinian, Clairette du Languedoc, Limoux et Côtes de Malepère.
Le Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc reprend ainsi les activités de trois organismes : l'Union interprofessionnelle des Côteaux du Languedoc, l'Association interprofessionnelle Crémant et Blanquette de Limoux et le Conseil interprofessionnel des vins de Fitou, Corbières et Minervois.
Comme le rappelle l'excellent rapport de l'Assemblée nationale, les deux premiers organismes cités ont été reconnus par arrêtés du 24 juillet 1980 et du 1er septembre 1983 selon la procédure prévue par la loi du 10 juillet 1975 précitée. Le transfert de leurs activités au sein du Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc a été constaté par deux arrêtés du 6 avril 1995 leur retirant la reconnaissance d'organisations interprofessionnelles.
Le Conseil interprofessionnel des vins de Fitou, Corbières et Minervois, en revanche, a été créé par la loi n° 56-210 du 27 février 1956. Après l'entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958, ce texte de forme législative a été considéré comme relevant du domaine réglementaire. Il a donc pu être modifié par décret. Mais, revenant sur sa jurisprudence, le Conseil d'Etat a estimé que la création d'une personne morale de droit prive est, sauf consentement unanime des intéressés, du domaine de la loi. En conséquence, la loi n° 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels a validé le décret n° 66-369 du 8 juin 1966 modifiant la loi n° 56-210 du 27 février 1956 précitée (ce décret réorganisait le Conseil interprofessionnel pour tenir compte du retrait des producteurs de vins de la Clape et de Quatourze).
Le premier alinéa du présent article abroge donc non seulement la loi n° 56-210 du 27 février 1956 mais également le décret n° 66-369 du 8 juin 1966 validé par la loi n° 77-731 du 7 juillet 1977.
Le second alinéa de cet article prévoit que le transfert des droits, biens et obligations du Conseil interprofessionnel des vins de Fitou, Corbières et Minervois au Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc bénéficie des exonérations énumérées par l'article 9 de la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 précitée. Ce transfert est ainsi exonéré de droits de timbre, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et ne donne pas lieu au versement d'un salaire au conservateur des hypothèques pour l'accomplissement des formalités foncières.
Comme le souligne avec pertinence Philippe Auberger, les exonérations ainsi prévues n'ont manifestement pas permis d'encourager les regroupements -objectif de l'article 9 de la loi du 2 juillet 1990 précitée-puisque le Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc est la première organisation à bénéficier de ces dispositions depuis cette date.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 35 bis (nouveau) - Etalement dans le temps de l'imposition des sommes reçues à titre d'avance sur des fermages
Commentaire : cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale sur l'initiative de M. Hervé Mariton, vise à éviter les effets de la progressivité de l'impôt sur les sommes reçues par les bailleurs au titre d'avances sur fermages versées notamment par des collectivités locales.
Depuis plusieurs années, diverses collectivités locales ont mis en place un système d'avances sur fermages destiné à favoriser l'installation de Jeunes agriculteurs. Pour encourager les bailleurs à louer à des jeunes et conforter la situation économique, souvent délicate, de ces exploitants pendant leurs premières années d'activité, la collectivité verse au bailleur quelques années de fermage en avance. Bien évidemment, ces sommes doivent être déclarées au titre des revenus fonciers et subissent les effets de la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu.
Ce système n'est pas pleinement convaincant au plan logique et au Plan des mécanismes financiers retenus. Il pallie toutefois certaines lourdeurs du statut du fermage. Il ne garantit pas enfin que les fermiers bénéficiaires du système mis en place répondent aux critères d'éligibilité à la D.J.A. ou aux prêts à moyen termes spéciaux. Or, il a été constaté à plusieurs reprises que des collectivités locales encourageaient des installations ne présentant pas des garanties suffisantes et non cohérentes avec le dispositif d'aides publiques, n'est donc pas pleinement satisfaisant que ces pratiques soient encouragées fiscalement.
Dans la Charte nationale pour l'installation des jeunes en agriculture signée le 6 novembre 1995, le gouvernement s'est engagé à aménager la fiscalité de ces revenus afin de favoriser le développement de tels financements.
Le rapport au Parlement déposé le 20 février 1996, en application de l'article 33 de la loi n° 95-95 de modernisation de l'agriculture, indique qu'une circulaire était en préparation au ministère de l'Economie et des finances.
Les sommes reçues à titre d'avance sur des fermages seront désormais soumises aux dispositions de l'article 163-OA du code général des impôts.
L'article 163-OA du code général des impôts prévoit que, lorsqu'au cours d'une année un contribuable a bénéficié d'un revenu exceptionnel, l'impôt peut être calculé -à la demande de l'intéressé- en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.
Ce dispositif permet d'imposer le contribuable recevant des sommes à titre d'avance sur des fermages au titre de la seule année pendant laquelle il a perçu ces sommes, mais en effaçant les conséquences de la progressivité de l'impôt pour l'année considérée.
Ce dispositif limite de fait à trois ans le nombre des annuités de fermage qui peuvent être reçues par avance (en sus de l'année en cours).
A défaut, la progressivité de l'impôt serait défavorable au propriétaire bailleur.
Contrairement à l'amendement initial de M. Hervé Mariton, il n'ouvre pas la possibilité d'étaler dans le temps le versement de l'impôt. Il ne fixe pas non plus la date d'entrée en vigueur de ce dispositif. Ces précisions feront vraisemblablement l'objet d'une instruction ministérielle ad hoc.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 35 bis (nouveau) - Exonération des taxes spéciales d'équipement au profit des jeunes agriculteurs
Commentaire : cet article additionnel vise à exonérer les jeunes agriculteurs du versement des taxes spéciales d'équipement.
Depuis cette année, les terres agricoles sont désormais exonérées des Parts départementale et régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
De plus, conformément aux articles 1647-00 bis et 1636 C du code général des impôts, les collectivités locales peuvent décider d'accorder un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs.
En revanche, les taxes spéciales d'équipement relatives aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs demeurent maintenues, sans possibilité d'allégement, puisque les établissements publics ne peuvent pas prendre de délibération d'exonération. Ces taxes seraient ainsi les seules acquittées par les jeunes agriculteurs, en ce qui concerne leurs terres agricoles.
C'est pourquoi, dans un souci de simplification et de clarté, cet article vise à exonérer les terres agricoles de taxe spéciale d'équipement. Cette mesure s'inscrit dans la logique de l'allégement de l'imposition du foncier non bâti, à la charge des agriculteurs.
Parallèlement, pour que cette exonération n'entraîne pas de transferts de charges excessifs sur les autres redevables de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, et notamment sur les propriétaires de terres non agricoles, il est proposé de modifier les modalités de répartition du produit des taxes spéciales d'équipement. La charge de cet allégement serait ainsi répartie sur l'ensemble des redevables des taxes spéciales d'équipement (taxe habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe professionnelle).
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction qu'elle vous soumet.
Article 36 - Dispositions relatives au plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de rétablissement public d'aménagement en Guyane
Commentaire : Cet article fixe à 12,3 millions de francs le plafond de la taxe spéciale d'équipement que le nouvel Etablissement public d'aménagement en Guyane sera, dès cette année, habilité à percevoir.
L'article 38 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte a ouvert la voie à la création en Guyane d'un établissement public d'aménagement disposant de moyens spécifiques d'intervention.
Celui-ci pourrait, notamment, se voir confier par convention la passation des contrats de concession et de cession au bénéfice de tiers des terres relevant du domaine privé de l'Etat.
Le décret portant création d'un établissement public de l'Etat habilité à gérer les terres destinées à être concédées ou cédées devait être publié au Journal officiel au cours du mois de mars, après avis du conseil régional et du conseil général de Guyane.
Le conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement en Guyane devant être composé, à concurrence de la moitié au moins, de membres représentant les collectivités et établissements publics intéressés, les décisions prises en matière d'aménagement de l'espace et de structuration de la propriété devraient revêtir un caractère plus consensuel que par le passé, puisqu'aujourd'hui encore c'est le préfet seul qui décide des concessions et des cessions après avis simple d'une commission.
Les ressources de cet établissement seront constituées par des dotations ou subventions publiques (Union européenne, Etat, collectivités territoriales) ou privées, des rémunérations perçues au titre des conventions qu'il pourra conclure avec l'Etat et les collectivités territoriales, des emprunts, le produit de la cession de ses biens, les revenus nets de ses biens, des dons et legs ainsi que par une taxe spéciale d'équipement prévue par l'article 1609 B du code général des impôts.
Cet article précise que "le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans les limites d'un plafond fixé par la loi de finances".
La taxe spéciale d'équipement est un impôt additionnel aux quatre taxes directes locales.
Le premier objet, accessoire, du présent article 36 est de supprimer la référence à une loi de finances dans la rédaction du troisième alinéa de l'article 1609 B du code général des impôts. Il n'existe, en effet, aucun motif, juridique ou d'opportunité, pouvant justifier que le plafond de la taxe spéciale d'équipement levée par l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane soit, d'une part, fixé annuellement et, d'autre part, dans le cadre très strict d'une loi de finances. Les dispositions à caractère fiscal peuvent certes figurer dans une loi de finances, mais l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 autorise tout autant leur présence dans une loi ordinaire.
Au surplus, on notera que les plafonds des deux taxes spéciales d'équipement déjà perçues, d'une part au profit de l'Etablissement public de la métropole lorraine, d'autre part au profit de l'Etablissement public d'aménagement de la Basse-Seine sont les mêmes depuis 1986 (respectivement 60 millions de francs et 45 millions de francs).
Le second objet , principal, du présent article est de fixer le plafond de la taxe spéciale d'équipement à 12,3 millions de francs et de préciser que le montant retenu par le conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane devra être arrêté et notifié aux services fiscaux avant le 30 avril 1996.
Ce plafond de 12,3 millions de francs correspond à 3 % du produit des taxes locales (410 millions de francs), soit un taux sensiblement plus élevé que ceux pratiqués par les deux établissements publics d'aménagement métropolitains dont les missions sont proches de celles de l'établissement de Guyane, l'Etablissement public de la métropole lorraine (avec 0,9 %) et l'Etablissement public d'aménagement de la Basse-Seine (avec 0,4 %).
Deux remarques viennent toutefois atténuer ce constat :
- D'une part, la taxe spéciale d'équipement perçue par l'Etablissement public de la métropole lorraine équivalait, lors de sa création en 1973, à 2 %des taxes directes locales.
- D'autre part, la valeur locative cadastrale des biens sur lesquels est assise la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane est sensiblement plus faible que celle des biens situés en métropole.
Quant à la date limite du 30 avril 1996 proposée pour le vote et la notification aux services fiscaux de la taxe levée en 1996, elle ne peut se comprendre qu'au regard des dispositions générales de l'article 1639 A du code général des impôts qui fixent au 31 mars de chaque année la date avant laquelle les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit.
Ce délai de droit commun du 31 mars ne pouvait clairement pas être tenu cette année, mais devra l'être à compter de 1997.

L'Assemblée nationale n'a adopté qu'un amendement rédactionnel de portée mineure sur cet article.
Pour sa part, votre commission des finances vous proposera, par souci de lisibilité et de cohérence avec les solutions retenues pour les autres taxes spéciales d'équipement, d'insérer directement dans le code général des impôts, à l'article 1609 B, le montant du plafond prévu pour la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, ainsi que les obligations en matière de vote et de notification de la taxe aux services fiscaux en 1996.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 37 - Dispositions relatives aux petites parcelles incluses dans un périmètre d'aménagement foncier
Commentaire : Cet article vise à modifier le régime de cession des micro-parcelles situées dans le périmètre d'une opération d'aménagement foncier.
L'article L. 121-24 du code rural, dans sa rédaction issue du I de l'article 56 de la loi n° 95-95 du 1 er février 1995 de modernisation de l'agriculture, aménage les opérations de cession des petites parcelles, d'une superficie maximale d'un hectare, figurant au sein du périmètre d'un aménagement foncier.
Comme l'indique le rapport de l'Assemblée nationale, les propriétaires de ces micro-parcelles ne sont guère tentés par un échange reposant sur le principe d'équivalence entre les terres apportées par un propriétaire et celles qui lui sont attribuées. Ils préfèrent vendre ces terrains mais le montant des droits d'enregistrement et des frais de notaire, comparé à la valeur des biens, les en dissuade.
La loi votée en 1995 vise à faciliter les transferts de propriété des petites parcelles en les intégrant aux opérations d'aménagement foncier et en assimilant le prix de leur cession à une soulte.
Cependant, lors de l'examen du projet de décret d'application de la loi de modernisation, le Conseil d'Etat a estimé que le texte réglementaire présenté par le gouvernement était trop restrictif au regard de la lettre du texte législatif.
En effet, le projet de décret n'autorise la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 121-24 du code rural que lorsque la ou les parcelles ainsi cédées font partie d'un compte de propriété ne dépassant pas, par nature de culture, le seuil fixé à un hectare. En revanche, le projet de décret ne permet pas à un propriétaire possédant des parcelles d'une même nature de culture d'une superficie totale supérieure à ce plafond au sein du périmètre d'un aménagement foncier de céder, en bénéficiant du nouveau régime fiscal, une ou plusieurs micro-parcelles.
Le présent article transcrit cette interprétation.
Pour être possible, une cession réalisée en application de l'article L. 121-24 du code rural devrait donc répondre à trois conditions :
- la ou les parcelles doivent avoir une superficie maximale déterminée par la commission départementale d'aménagement dans la limite de un hectare au total et faire partie d'un compte de propriété ne dépassant pas ce plafond pour une même nature de culture ;
- le prix de ces parcelles ne doit pas être supérieur à 5.000 francs (article 704 du code général des impôts) ;
- les terrains ne doivent pas comporter de bâtiments d'exploitation ; ils ne doivent pas être clos de murs et ne pas renfermer des mines, carrières ou sources d'eau minérale ; ils ne doivent pas non plus présenter les caractéristiques d'un terrain à bâtir (articles L. 123-2 et L. 123-3 du code rural).
Les propriétaires souhaitant se séparer d'une petite parcelle doivent transmettre, pour autorisation, le projet de cession, passé par acte sous seing privé, à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Si le projet de cession est refusé par cette commission, un recours est possible devant la commission départementale. En revanche, si la cession est autorisée, celle-ci est reportée sur le procès-verbal de clôture des opérations d'aménagement foncier. Le prix de cession est alors assimilé à une soulte.
Votre rapporteur admet que cet article limite la portée de la loi de modernisation. Il n'autoriserait la mise en oeuvre de la procédure que lorsque la ou les parcelles font partie d'un compte de propriété ne dépassant pas au maximum un hectare. Ainsi, un propriétaire disposant de 3 parcelles de 0,40 hectare disséminées sur une commune en cours de remembrement ne pourrait plus utiliser la procédure résultant de la loi de modernisation parce qu'il a, au total, une superficie supérieure à un hectare. Un juste équilibre pourrait être trouvé entre la loi en vigueur et l'article nouveau soumis à notre examen.
Décision de la commission : sous réserve des amendements de la commission des affaires économiques saisie pour avis, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 37 bis (nouveau) - Organisation de paris sur les parties de pelote basque
Commentaire : Le présent article vise à légaliser les paris organisés sur des parties de pelote basque.
Le Parlement a déjà débattu de l'amendement déposé par M. Michel Inchauspé dans le cadre de l'examen du second projet de loi de finances rectificative pour 1995. Cet amendement a été techniquement "amélioré" au regard des observations présentées, dans ce cadre, par votre commission des finances.
Il continue de susciter deux questions principales : celle de l'opportunité de légaliser des paris sur des manifestations sportives, celle de son applicabilité juridique.
A ce titre, deux observations peuvent être présentées :
- la rédaction ne précise pas si les paris sont recueillis dans l'enceinte de l'hippodrome où se déroule la partie de pelote basque ou dans l'enceinte de toutes les sociétés de courses. Elle n'indique pas non plus, contrairement à la volonté de l'auteur de l'amendement, que le fronton doit être situé à l'intérieur d'un hippodrome ;
- la rédaction retenue par l'Assemblée nationale dispose que les paris sont soumis aux mêmes "prélèvements" que les paris sur les courses de chevaux. Ce parallélisme semble techniquement difficile à mettre en oeuvre, qu'il s'agisse de la TVA applicable sur la part du prélèvement proportionnel affectée aux sociétés de courses ou du prélèvement supplémentaire progressif (PSP).
Décision de la commission : votre commission ne vous propose pas de vous opposer à l'adoption de cet article en l'état.
TITRE VII - MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES
Article 38 - Modifications destinées à faciliter la gestion des collectivités locales
Commentaire : Cet article contient deux séries de mesures ; les unes relatives aux pouvoirs des ordonnateurs et des comptables dans la période allant du 1 er janvier au vote du budget afférent à l'exercice et cours ; les autres précisant la responsabilité du comptable dont les comptes sont produits avec retard.
I. LES POUVOIRS DE L'ORDONNATEUR ET DU COMPTABLE DANS LA PÉRIODE PRECEDANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF
Ø L'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales dispose que, dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption.
L'autorisation mentionnée au précédent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.
Ce dispositif, de portée générale, est complété, pour les régions, par l'article L.4311-3 du même code qui prévoit, dans son dernier alinéa, que lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil régional peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent".
Le paragraphe I du présent article complète l'article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales afin de tirer les conséquences des dispositions de l'article 50 de la loi d'orientation n° 92-125 du février 1992 relative à l'administration territoriale de la République offrant la faculté aux communes, aux départements et aux établissements publics administratifs de voter leurs dépenses d'investissement sous la forme d'autorisations de programme et de crédits de paiement, à l'instar du régime déjà en place pour les régions.
Les maires et les présidents de conseils généraux pourraient ainsi, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, liquider et mandater, sur autorisation de l'organe délibérant, les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
A défaut de précision, c'est la règle générale (plafond du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent) qui se serait appliquée.
Le régime spécifique applicable aux régions en application de article L.4311-3 précité, différant sensiblement de celui ici proposé, continuerait cependant de subsister parallèlement.
Interrogée par votre rapporteur général, la direction générale des .collectivités locales a justifié la présence de deux mécanismes distincts en Indiquant qu'il lui avait paru préférable d'aller jusqu'au bout de la logique de gestion des dépenses d'investissement par autorisations de programme et crédits de paiement en permettant la liquidation et le mandatement de tous les crédits de paiement prévus pour l'exercice concerné. Toutefois, les régions ont exprimé leur satisfaction à l'égard du régime particulier qui leur est déjà appliqué et l'administration a préféré ne pas bouleverser les équilibres atteints, en se contentant de réserver la solution qui lui paraissait la plus logique aux seuls départements et communes.
Plafond des crédits de paiement que l'ordonnateur est habilité à liquider et mandater avant le vote du budget primitif
ï Communes et départements (art. 38 du DDOEF) : la limite des crédits de paiement engageables est fixée, opération par opération, en fonction de la décision prise lors de l'ouverture de l'autorisation de programme.
ï Régions (art. L.4311-3 du CGCT) : la limite des crédits de paiement engageables est fixée, chapitre budgétaire par chapitre budgétaire, au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent.
En outre, en cas de non adoption du budget, la possibilité ainsi offerte ne peut être exercée que jusqu'au 31 mars pour les communes et les départements alors que l'exécutif régional dispose de cette latitude jusqu'au règlement du budget par le préfet.
A titre de conclusion sur ce point, votre commission des finances précise qu'au cours de sa séance du 29 novembre 1993, le comité des finances locales avait examiné un projet de décret relatif à l'extension de la procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement aux communes » aux départements et aux établissements publics administratifs, mettant ainsi en oeuvre les dispositions précitées de l'article 50 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.
Tout en émettant un avis favorable au projet de décret, le comité avait souhaité qu'il donne lieu à une concertation plus développée avec les associations nationales représentatives des élus locaux.
A ce jour toutefois, et après une nouvelle consultation de ces associations, aucune disposition réglementaire n'a encore, à notre connaissance, été publiée au Journal Officiel.
Il paraîtrait pourtant hautement préférable que les pratiques des collectivités et établissements publics visés par le projet de décret présenté le 29 novembre 1993 au comité des finances locales s'inscrivent enfin dans un cadre précis et fiable.
En tout état de cause, nos collègues doivent avoir présent à esprit que les dispositions ci-dessus décrites resteront inappliquées tant que le décret, attendu depuis quatre ans, n'aura pas été publié.
> Le paragraphe I du présent article, complétant l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, précise également que le comptable est en droit de payer les mandats et de recouvrer les titres de recettes émis par les ordonnateurs sous les contraintes très précises rappelées ci-dessus, dans la période allant du début de l'exercice au vote du budget afférent à cet exercice.
En effet, dans un arrêt en date du 30 juin 1994 (Association foncière de remembrement de la commune de Saint-Loup sur Semouse), la quatrième chambre de la Cour des comptes, statuant en appel sur le pouvoir des comptables, a jugé que seule figurait dans la loi l'autorisation donnée à l'ordonnateur jusqu'au 31 mars de mandater les annuités de la dette, ce qui n'impliquait pas que le comptable soit autorisé à les payer ; et elle a ajouté qu'en effet "ce dernier demeure soumis à l'obligation qui lui est imposée (...) de vérifier la disponibilité des crédits préalablement aux paiements".
Cette dernière formule suppose que le budget primitif ait été Préalablement voté et supprime ainsi en fait les possibilités d'engagements données par ailleurs à l'ordonnateur par le législateur.
II. LA RESPONSABILITÉ DU COMPTABLE POUR PRODUCTION TARDIVE DE SES COMPTES (PARAGRAPHES II ET III).
L'article L. 131-6 du code des juridictions financières prévoit que la Cour des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre.
L'article L. 231-10 du même code reconnaît un pouvoir identique, dans leur champ de compétence, aux chambres régionales des comptes.
Toutefois, la législation est aujourd'hui muette sur les conséquences à tirer de ces deux articles dans le cas, assez fréquent, d'une mutation du comptable survenue entre la clôture de l'exercice dont il est rendu compte et le délai limite de production des comptes.
A titre d'exemple, l'article 3, premier alinéa, du décret n° 85-372 du 27 mars 1985 dispose que les comptes de gestion des comptables des collectivités et établissements publics locaux doivent parvenir à la chambre régionale au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. Une, voire plusieurs mutations peuvent aisément intervenir dans ce délai d'un an.
Le problème tient à ce que la jurisprudence n'est, sur cette matière, pas totalement fixée, la responsabilité du retard étant, selon les cas, imputée tantôt au comptable en fonction à la date de clôture de l'exercice, tantôt à celui en poste à la date ultime fixée pour la production du compte.
La solution, très souple, proposée par le gouvernement dans le cadre du présent article vise à donner à la Cour et aux chambres régionales une certaine latitude d'appréciation tout en fixant un principe de base.
Le nouvel article L. 131-6-1 inséré dans le code des juridictions financières affirme, à titre de règle générale, que le comptable passible de l'amende pour retard dans la production des comptes est celui en fonction à I* date réglementaire de dépôt des comptes (soit au 31 décembre de l'année suivant la clôture de l'exercice pour les comptables locaux).
Toutefois, un second alinéa précise qu'en cas de changement de comptable entre la fin de la période d'exécution du budget et la date à laquelle le compte doit être produit, la Cour, ou selon les cas, les chambres régionales des comptes, pourront infliger l'amende à l'un des prédécesseurs du comptable en fonction à la date réglementaire de production des comptes.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 39 - Ajustements du code général des collectivités territoriales et du code des juridictions financières
Commentaire : Cet article vise à rectifier certaines erreurs matérielles qui se sont glissées lors de la rédaction du code des juridictions financières et du code général des collectivités territoriales. Il est également l'occasion d'apporter certaines précisions sur la portée de certains articles de ces codes.
• Paragraphe I : rectification d'une
erreur matérielle.
L'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions précisait, avant sa édification, que "lorsque le budget d'une commune n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article 2, le constate et propose à la commune, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil municipal une nouvelle délibération."
L'article 2 susmentionné posait, quant à lui, le principe selon lequel les actes pris par les autorités locales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Cette formule, de portée générale, s'appliquait à tous les actes qu'ils soient ou non de nature budgétaire.
La lecture combinée des articles 8 et 2 de la loi de décentralisation du mars 1982 avait ainsi pour effet de soumettre tous les actes budgétaires des collectivités locales à la règle de l'équilibre réel et, par voie de conséquence, au contrôle de la chambre régionale de comptes.
Or, l'article L. 232-5 du code des juridictions financières, codifiant l'article 8 de la loi du 2 mars 1982 précitée ne fait référence qu'à l'article L. 232-7 du même code, relatif au seul budget primitif de la commune.
En effet, l'article L. 232-7 du code des juridictions financières dispose que "le budget primitif de la commune est transmis au représentant de l'État dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 232-2 et L. 232-8 [ en général, le 30 mars ]."
Le caractère trop restrictif de la codification n'a pas été corrigé lors du transfert des dispositions de l'article L. 232-5 du code des juridictions financières au nouvel article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales. Ce dernier fait, en effet, référence à l'article L. 1612-8 dont la rédaction a été reprise de l'article L. 232-7 précité du code des juridictions financières.
Afin d'écarter toute interprétation qui restreindrait le champ de compétence des chambres régionales des comptes aux seuls budgets primitifs alors qu'il inclut, depuis la loi de décentralisation du 2 mars 1982, tous les actes budgétaires des collectivités locales, le paragraphe I du présent article propose de remplacer la référence à l'article L. 1612-8 dans l'article L. 1612-5 par la référence aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 qui reproduisent les dispositions de l'ancien article 2 de la loi du 2 mars 1982 en les appliquant, respectivement, aux actes pris par les autorités communales, aux actes pris par les autorités départementales et aux actes pris par les autorités régionales.
La correction ainsi introduite à l'article 1612-5 du code général des collectivités territoriales, "code pilote" sera insérée également, par ricochet, dans le code des juridictions financières, "code suiveur", puisque celui-ci comprend dorénavant, reproduits sous son article L. 232-1, l'ensemble des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
•
Paragraphe II : extension du champ
des missions susceptibles d'être confiées aux
conseillers-maîtres à la Cour des comptes en service
extraordinaire.
L'article L. 112-5 du code des juridictions financières dispose que "des fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministres exerçant la tutelle des entreprises publiques ou des personnes ayant exercé des responsabilités dans les fonctions de tutelle ou de gestion des entreprises publiques peuvent être nommés conseillers maîtres en service extraordinaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 133-1 et L. 1333-2. Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel" .
Les conseillers-maîtres en service extraordinaire, dont le nombre ne peut être supérieur à dix, sont nommés par décret pris en conseil des ministres pour une période de quatre ans non renouvelable.
Par la référence aux articles L. 133-1 et L. 133-2, les missions des conseillers-maîtres en service extraordinaire sont restreintes à la vérification des comptes et de la gestion :
- des établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial, des entreprises nationales, des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte ou des sociétés anonymes dans lesquelles l'État possède la majorité du capital social ;
- des autres établissements ou organismes publics, quel que soit leur statut juridique, qui exercent une activité industrielle ou commerciale ;
- des sociétés, groupements ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l'État, les collectivités, personnes ou établissements publics, les organismes déjà soumis au contrôle de la Cour détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;
- des filiales des organismes visés aux deux alinéas précédents, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec l'État, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;
- des personnes morales dans lesquelles l'État ou des organismes déjà soumis au contrôle de la Cour détiennent, directement ou indirectement,séparément ou ensemble, une participation au capital permettant d'exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Le gouvernement propose d'étendre le champ de compétence des conseillers-maîtres en service extraordinaire afin de le rapprocher de celui des membres des corps et services de l'Etat dont l'article L. 112-7 du code des juridictions financières précise qu'ils peuvent exercer les fonctions de rapporteurs à la Cour des comptes sauf en matière juridictionnelle.
Le paragraphe II du présent article a donc pour objet de substituer dans l'article L. 112-5 du code des juridictions financières à la référence aux articles L. 133-1 et L. 133-2 la référence aux articles L. 111-2 à L. 111-8 relatifs aux missions générales de la Cour des comptes de caractère non juridictionnel (assistance au Parlement et au Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances ; vérification sur pièces et sur place de la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités publiques ainsi que du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'État ; vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques ; contrôle des institutions de la sécurité sociale ; contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale par les administrations centrales et les services déconcentrés de l'État pour les contributions et cotisations dont ils sont redevables envers le régime général ; contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'État ou d'une autre personne soumise au contrôle de la Cour ; contrôle du compte d'emploi des ressources collectées par des organismes faisant appel à la générosité publique).
•
Paragraphe III : aménagement
de la procédure applicable au jugement des personnes
déclarées comptables de fait.
L'article L. 131-2 du code des juridictions financières prévoit que la Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Son second alinéa précise que "les dispositions définitives des arrêts portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait. Les arrêts sur les appels formés contre les dispositions définitives des jugements des chambres régionales des comptes portant sur des gestions de fait, sont délibérés après l'audition, à leur demande, des requérants".
La première des deux situations envisagées par la loi est celle où la Cour statue en premier ressort sur des comptes relevant de son champ normal de compétence. En ce cas, il est explicitement prévu que la personne déclarée comptable de fait puisse être entendue, à sa demande, par la Cour avant que celle-ci ne délibère.
Dans le second cas, la Cour statue en appel des jugements prononces par des chambres régionales des comptes sur des gestions de fait de leur compétence. Les seules personnes susceptibles alors d'être entendues, à leur demande, par la Cour sont les "requérants", c'est-à-dire ceux qui ont forme l'appel.
Si le requérant n'est pas la personne à l'encontre de laquelle le reproche de gestion de fait a été soulevé et si la Cour décide d'infirmer la décision de la chambre régionale en déclarant effectivement cette personne "comptable de fait", celle-ci n'aura donc pas pu être entendue par la Cour préalablement à la délibération d'appel. La même situation prévaut lorsque plusieurs personnes ont été déclarées "comptables de fait" en première instance mais que l'appel n'est formulé que par l'une ou certaines d'entre elles. Celui qui n'a pas fait appel n'est pas requérant et ne peut donc être entendu par la Cour.
Afin de corriger l'asymétrie ainsi apparue entre les deux phrases du second alinéa de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières, le paragraphe III du présent article propose de prévoir que dorénavant les arrêts sur les appels formés contre les dispositions définitives des jugements des chambres régionales des comptes portant sur des gestions de fait, seront délibérés après l'audition, à leur demande, des requérants et des autres parties intéressées.
Sous le vocable de "partie intéressée", il faut comprendre le représentant légal de la collectivité éventuellement lésée ainsi que l'ensemble des personnes dont le comportement relève de la gestion de fait.
* Paragraphe IV : moyens d'information dont dispose la Cour des comptes dans son activité de contrôle des sociétés entrant dans son champ de compétence.
L'article L. 140-2 du code des juridictions financières dispose que "les magistrats, conseillers-maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports, tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés"
L'objet du paragraphe IV du présent article est de viser expressément parmi les commissaires aux comptes, auxquels la Cour peut demander les enseignements qu'elle souhaite obtenir sur la société qu'elle contrôle, l es commissaires à la fusion. Ces derniers sont désignés par le président du tribunal de commerce statuant sur requête présentée par les dirigeants sociaux des sociétés concernées par la fusion.
Plusieurs d'entre eux ont refusé, récemment, de répondre aux demandes d'information de la Cour des comptes, faisant observer que, s'ils ont certes le statut de commissaires aux comptes, la fonction temporaire de commissaire à la fusion ne peut être confondue avec la fonction de commissaire aux comptes qu'ils exercent en temps ordinaire.
* Les paragraphes V et VI : des corrections de forme.
-En premier lieu, l'article L. 211-4 du code des juridictions gantières prévoit que "la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10.000 francs ou dans lesquelles elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. "
Le paragraphe V du présent article propose de substituer aux mots "elles détiennent" les mots "ils détiennent" afin d'écarter toute ambiguïté sur la portée des dispositions reproduites ci-dessus. En effet, la chambre régionale des comptes doit pouvoir assurer la vérification des comptes des structures, quel que soit leur statut juridique dont un ou plusieurs établissements publics sont seuls à contrôler les décisions, sans présence d'une collectivité territoriale dans le capital ou les organes dirigeants de cette structure.
-En second lieu, l'article L. 211-6 du code des juridictions financières dispose que "les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 211-4 et L. 211-5 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de sa compétence peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des dispositions de l'article L. 111-7."
Le paragraphe VI du présent article propose, dans un souci de parfaite lisibilité, de substituer aux mots "de sa compétence" les mots "de la compétence des chambres régionales des comptes".
Le caractère imprécis du texte reproduit ci-dessus provient de ce qu'il a été prélevé sur l'article 87 de la loi de décentralisation du 2 mars 1982 précitée qu'il avait semblé préférable de scinder en plusieurs dispositions lors de la confection du code des juridictions financières. Certaines références, dénuées d'ambiguïtés dans la rédaction d'origine, sont ainsi devenues plus incertaines.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 40 - Dotation globale d'équipement dans les départements d'outre-mer
Commentaire : Cet article aménage les règles de répartition entre les départements des enveloppes de la dotation globale d'équipement des communes afin de tenir compte de la situation particulière des départements d'outre-mer.
L'article 33 de la loi de finances pour 1996, tout récemment précisé par l'article 12 de la loi portant diverses dispositions relatives aux concours de l'État aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales, a réduit le champ des collectivités éligibles à la DGE des communes aux catégories suivantes :
- les communes dont la population n'excède pas 2.000 habitants dans les départements de métropole ou 7.500 habitants dans les départements d'outre-mer ;
- les communes dont la population est supérieure à 2.000 habitants et n'excède pas 20.000 habitants dans les départements de métropole ou est supérieure à 7.500 habitants et n'excède pas 35.000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de métropole dont la population est supérieure à 2.000 habitants et n'excède pas 20.000 habitants ;
- les établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 20.000 habitants dans les départements de métropole et 35.000 habitants dans les départements d'outre-mer.
Dans chaque département, l'enveloppe unique de dotation globale d'équipement est, à compter de 1996, répartie selon les règles en vigueur jusqu'à l'an dernier pour la seconde part :
- Subvention (de 20 % à 60 % de l'investissement) accordée sur présentation d'un dossier par la commune ou le groupement.
- Décision du préfet après avis d'une commission d'élus.
Toutefois, le législateur a maintenu l'existence de deux enveloppes distinctes, calculées au plan national, pour la répartition de la DGE entre les départements. La première enveloppe, dotée en 1996 de 1 366 millions de francs, est affectée en tenant compte de plusieurs critères afférents aux communes et groupements dont la population n'excède pas 2.000 habitants. La seconde enveloppe, dotée en 1996 de 797 millions de francs, est répartie entre les départements au prorata de la population des communes de 2.000 habitants et plus restant éligibles à la DGE ainsi qu'en proportion des investissements réalisés par les groupements restants éligibles de 2.000 habitants et plus.
A compter de 1997, ces deux enveloppes progresseront au rythme du taux prévisionnel de la formation brute de capital fixe des administrations publiques.
Ce dispositif, adopté par le Sénat à l'initiative de sa commission des finances, vise à préserver le niveau d'attribution des départements ruraux dans un contexte marqué par la réversion sur l'ancienne seconde part de la dotation globale d'équipement de collectivités et groupements qui émargeaient jusqu'à présent à la première part (ancien système du taux de concours).
La fongibilité des deux enveloppes une fois parvenues dans le département est cependant justifiée par la nécessité de déconcentrer la décision dans une matière où il a paru impossible de fixer des critères nationaux permettant de délimiter la part devant revenir aux plus petites collectivités et celle pouvant être accordée aux plus grandes.
Un schéma a été placé à la page suivante afin de visualiser les effets du mécanisme mis en place par l'article 33 de la loi de finances pour 1996.
Le présent article 40 ne vise en réalité qu'à réparer un oubli et à mettre en conformité les dispositions relatives à la dotation globale d'équipement avec l'intention clairement manifestée par le législateur à l'automne dernier.
En effet, dans la logique énoncée plus haut de protection des départements ruraux, le seuil de 2.000 habitants choisi alors pour distinguer la première et la deuxième enveloppes devant être réparties entre les départements correspondait à la ligne de démarcation entre les communes et groupements précédemment éligibles de plein-droit à la seconde part et ceux éligibles, toujours de plein-droit, à la première part. Toutefois, cette limite ne s'appliquait qu'en métropole.
Dans les départements d'outre-mer, ce seuil avait, en effet, été porté dès la création de la DGE à 7.500 habitants.
A titre d'exemple, le département de la Réunion ne compte aucune commune, et donc a fortiori aucun groupement, de moins de 2.000 habitants.
Le maintien en la forme du texte actuel régissant la répartition de chacune des deux enveloppes composant la DGE conduirait ainsi à exclure en totalité ce département du bénéfice de la première, la plus abondante puisque dotée en 1996, rappelons-le, de 1.366 millions de francs.
Modalités de répartition de la DGE des communes en 1996
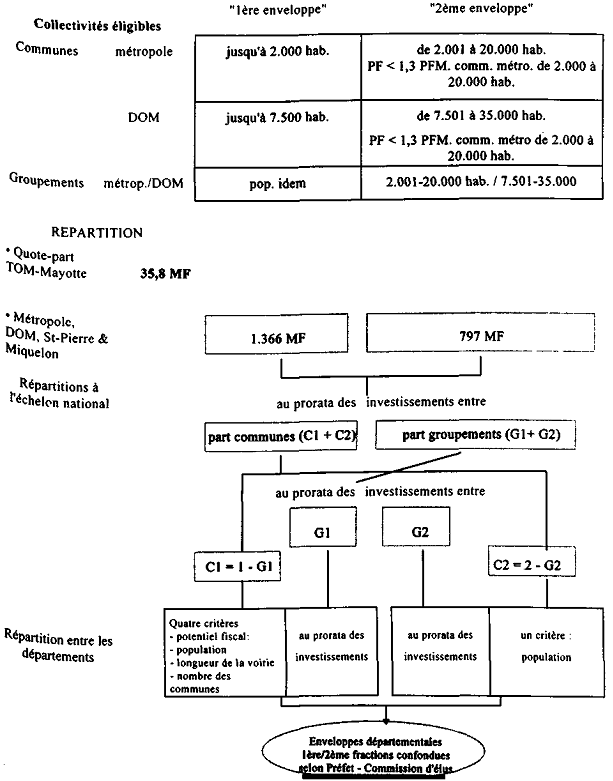
Pour ce motif, le présent article insère un nouvel article dans le code général des collectivités territoriales précisant que dans les départements d'outre-mer, le seuil de 2.000 habitants mentionné pour la définition des deux enveloppes de DGE est porté à 7.500 habitants.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 40 bis (nouveau)
Écrêtement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle des bases excédentaires des districts
Commentaire : l'Assemblée nationale a adopté un amendement, d'origine parlementaire, étendant, sous certaines conditions restrictives, le principe de l'écrêtement des bases de taxe professionnelle des "établissements exceptionnels" aux districts créés avant la promulgation de la loi orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.
I - LES RÈGLES D'ÉCRÊTEMENT DES GROUPEMENTS
Jusqu'à la loi d'orientation du 6 février 1992, seules les bases communales des établissements exceptionnels étaient écrêtées au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
La loi d'orientation relative à l'administration territoriale de la République a modifié ce principe en instituant l'écrêtement des bases de taxe professionnelle des groupements de communes nouvellement créés ou existant à la date d'entrée en vigueur de la loi mais ayant opté pour l'un des régimes de taux unique de taxe professionnelle institués à cette occasion (taxe professionnelle d'agglomération et taxe professionnelle de zone).
Écrêtement des groupements de communes
Les groupements concernés :
L'écrêtement concerne les nouveaux groupements, c'est-à-dire :
- les districts créés après le 8 février 1992 (date de promulgation de la loi ATR),
- les communautés de communes,
- les communautés de villes.
Mais il concerne également :
- les districts existants au 8 février 1992 qui auront opté pour la taxe professionnelle d'agglomération (fiscalité des communautés de villes),
- ou pour la taxe professionnelle de zone (fiscalité des communautés de communes) mais seulement en ce qui concerne le périmètre de la zone d'activités économiques.
Écrêtement des groupements de communes (suite)
Les groupements exclus :
Les groupements qui ne sont pas soumis à écrêtement sont :
- les districts à Fiscalité propre existants au 8 février 1992,
- les communautés urbaines (quelle que soit leur date de création),
- les syndicats d'agglomération nouvelle (quelle que soit leur date de création).
Les modalités de l'écrêtement :
Pour calculer les bases excédentaires, il y a lieu de rapporter les bases de l'établissement exceptionnel à la population de la commune d'implantation de l'établissement et non à la population du groupement.
Pour calculer le produit qui revient au fonds départemental, le montant des bases écrêtées est multiplié par le taux communautaire de taxe professionnelle.
En 1994, le montant des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle a atteint environ 2,4 milliards de francs, dont 143,6 millions de francs provenant de l'écrêtement des groupements.
II - LE DISPOSITIF VOTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le dispositif voté par l'Assemblée nationale, sur proposition de M. Jean-Pierre Thomas, tend à soumettre à l'écrêtement au titre des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle les districts crées avant la date de promulgation de la loi d'orientation du 6 février 1992.
Toutefois, afin de ne pas bouleverser l'équilibre budgétaire de ces groupements, le premier alinéa du I quater A inséré dans l'article 1648 A du code général des impôts précise qu'aux bases excédentaires s'applique non pas le taux de taxe professionnelle voté par le district mais le différentiel entre le taux de l'année au titre de laquelle est opéré l'écrêtement et celui qui aura été voté en 1996.
Selon les dispositions du deuxième alinéa du nouveau paragraphe inséré dans l'article 1648 A du code général des impôts, les districts appliquant la taxe professionnelle unique d'agglomération, à l'instar des communautés de villes, continueront d'être écrêtés en application du I ter de ce même article et ne le seront pas une seconde fois en vertu du nouveau mécanisme ici mis en place.
Dans le même esprit, les établissements écrêtés puisque situés dans une zone d'activité économique à taxe professionnelle unique d'un district ne seront pas écrêtés une seconde fois, sous le régime institué par le nouveau paragraphe I quater. En revanche, pour les districts antérieurs au 8 février 1992 dont une partie a été transformée en zone d'activités économique à taxe professionnelle unique, le nouvel écrêtement devient possible pour les établissements situés hors de la zone d'activités économique.
Le texte du troisième alinéa du nouveau I quater A de article 1648 A du code général des impôts est issu d'un amendement présenté Par des députés de toutes tendances, membres de l'Association nationale des élus de la montagne. Il tend à épargner le principe de l'écrêtement, même atténué par l'application d'un simple différentiel de taux aux bases excédentaires, aux districts dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont inférieures à deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de l'ensemble des districts.
On relèvera que les bases de taxe professionnelle ici visées sont toutes celles situées sur le territoire du district et pas seulement celles provenant de l'établissement exceptionnel écrêté. Il en est de même pour le nombre des habitants placés au numérateur, qui sont tous les habitants et pas seulement ceux de la commune de l'établissement à l'origine de l'écrêtement.
Dans ces conditions, afin d'éviter que certains districts "n'organisent" leur appauvrissement relatif en étendant leur périmètre et en accroissant le nombre de leurs habitants, l'observation de la condition de bases de taxe professionnelle par habitant inférieures à deux fois la moyenne de bases de taxe professionnelle par habitant de l'ensemble des districts a été définitivement figée à l'exercice 1996, grâce à un sous-amendement oral de M. Yves Fréville.
L'ensemble apparaît singulièrement touffu pour un résultat qui promet d'être assez limité en termes de sommes redistribuées dans le cadre de la péréquation.
Il s'agit toutefois d'une solution de compromis entre plusieurs intérêts divergents, et votre commission des finances a jugé qu'elle pouvait être maintenue en l'état.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
TITRE VIII - MODIFICATIONS DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Article 41 - Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques
Commentaire : le présent article propose de pérenniser la contribution exceptionnelle à la charge des grossistes en médicaments, qui a été instaurée en 1991 et reconduite depuis chaque année.
I. UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DEVENUE EN PRATIQUE PERMANENTE
A. LA RÉPARTITION PHARMACEUTIQUE : UN MAILLON ESSENTIEL DE LA CHAÎNE DU MÉDICAMENT
Les grossistes-répartiteurs assurent l'essentiel de l'approvisionnement en médicaments des pharmacies d'officine et une partie de celui des hôpitaux. Ils constituent l'interface indispensable entre les 320 laboratoires fabricants et les 22.500 pharmacies, les ventes directes demeurant marginales.
Alors qu'une, officine dispose en moyenne de 3.000 références, chaque établissement de vente en gros de médicaments stocke et gère en permanence 20.000 références : la gestion des stocks des pharmacies est ainsi pour l'essentiel externalisée. Ce service rendu par les grossistes-répartiteurs permet d'éviter toute rupture de stock, alors même que le médicament est un produit à rotation lente et à vente aléatoire. Il permet également de maintenir un réseau dense d'officines sur l'ensemble du territoire, en assurant une péréquation de leurs coûts d'approvisionnement.
La qualité de ce service est garantie par une réglementation stricte. Un arrêté du 3 octobre 1962 impose à tout grossiste-répartiteur :
- de déclarer son secteur d'activité aux pouvoirs publics ;
- de fournir tout médicament à tout pharmacien du secteur déclaré dans les 24 heures ;
- de disposer en permanence d'un stock correspondant à un mois de vente et comportant au moins les 2/3 des spécialités commercialisables.
Ces règles sont assimilables à des obligations de service public. En Pratique, le délai moyen de délivrance d'un médicament commandé par un pharmacien est de 2 heures.
Economiquement, l'activité de répartition pharmaceutique s'insère dans le secteur très administré qu'est le médicament. Les spécialités remboursables sont soumises à une réglementation dérogatoire au droit commun de la concurrence qui permet aux pouvoirs publics de fixer les prix et les marges de distribution.
La marge des grossistes-répartiteurs pour les médicaments remboursables, qui constituent 85 % de leur activité, est fixée depuis 1987 à 9,7 % du prix d'achat du pharmacien. Ce "taux de marque", compte tenu de la marge du pharmacien (elle aussi réglementée), des remises, de la TVA et de la contribution spécifique qui fait l'objet du présent article, correspond à 4,15 % du prix de vente public.
La décomposition du prix TTC des médicaments remboursables est la suivante (taux moyens constatés ex-post en 1994) :
- part de l'industrie : 64,10 % ;
- marge du pharmacien : 27 % ;
- remise maximum au pharmacien : 1,80 % ;
-TVA : 2,1 % ;
- marge du grossiste-répartiteur : 4,15 % ;
- contribution exceptionnelle : 0,85 %.
La contribution exceptionnelle vient en déduction de la marge du grossiste-répartiteur.
La concurrence sévère que les grossistes-répartiteurs exercent entre eux ne peut donc être amortie ni par leurs prix, ni par leurs marges, mais se traduit directement dans leurs résultats et leurs parts de marché.
Cette contrainte réglementaire a favorisé un puissant mouvement de concentration de la profession. Il existait en France une soixantaine d'entreprises de répartition pharmaceutique à la fin des années soixante. En février 1996, quatorze entreprises se partagent le marché métropolitain, dont onze appartiennent à trois groupes ou réseaux détenant 96,5 % du marché :
- Groupe OCP : 41 % de parts de marché ;
- Alliance Santé : 30,3 % ;
- Réseau CERP, issu de coopératives de pharmaciens détaillants :
25,2 %.
Schéma de parcours du médicament en France
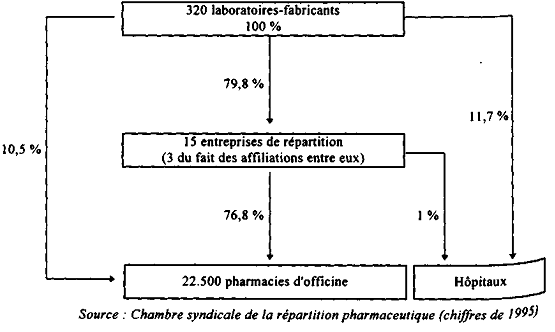
B. LA CONTRIBUTION A ÉTÉ CREEE POUR ACCOMPAGNER LE PLAFONNEMENT DES REMISES
En 1991, le législateur a jugé opportun de plafonner le niveau des remises que les grossistes-répartiteurs peuvent consentir aux pharmaciens afin que le jeu de la concurrence n'aboutisse à déstabiliser économiquement le secteur de la répartition pharmaceutique. En effet, le taux de marque" des répartiteurs étant fixé réglementairement, ces remises sont mécaniquement prises sur leur marge commerciale.
La loi n° 91-738 portant diverses dispositions d'ordre social du juillet 1991 a donc limité le taux maximal des remises à 2,25 % alors que celles-ci étaient en moyenne de 3,7 %. En contrepartie, une contribution exceptionnelle a été mise à la charge des grossistes-répartiteurs, au taux de 0,6%, et son produit affecté à la branche maladie.
Créée de façon conjoncturelle, la contribution des grossistes en spécialités pharmaceutiques est devenue une recette d'appoint de la branche maladie, reconduite à cinq reprises jusqu'à ce jour. Dès la fin de 1991, son taux a été porté à 1,2 %, le plafond des remises étant par ailleurs relevé à 2,5 %.
Depuis octobre 1993, son taux est modulé entre 1,5 % et 1 % en fonction du taux de croissance du chiffre d'affaires global de la profession, calculé par trimestre :
- 1,5 % si le chiffre d'affaires s'accroît de 6 % ou plus par rapport à la Période de l'année précédente ;
- 1,35 % si la progression de ce chiffre d'affaires est comprise entre 5 % et moins de 6 % ;
- 1,2 % si cette progression est comprise entre 2 % et moins de 5 % ;
- 1 % si cette progression est inférieure à 2 %.
La contribution est recouvrée par l'Agence comptable centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Son produit, réparti entre les principaux régimes d'assurance maladie, a été de 296 millions de francs en 1991, 676 millions de francs en 1992, 718 millions de francs en 1993, 759 millions de francs en 1994 et 880 millions de francs en 1995.
II. LA PÉRENNISATION PROPOSÉE
Le présent article propose de pérenniser la taxe dans sa dernière configuration, dotée d'un taux modulé, en l'insérant dans le code de la sécurité sociale.
Sur le principe, il convient de relever qu'une taxe de ce type n'est pas intellectuellement très satisfaisante. En effet, il ne s'agit pas d'un outil de régulation des prix, qui sont fixés administrativement, ni de modération des dépenses de médicaments, qui ne sont pas prescrits par les redevables de la taxe. Il s'agit en fait tout simplement de réinjecter dans le circuit une partie des fonds de l'assurance maladie gaspillés par la surconsommation pharmaceutique propre à la France.
Il apparaît plus que jamais nécessaire de disposer enfin d'une véritable maîtrise du système de santé, qui permettrait d'éviter d'y brancher ce genre de dérivations financières.
Sur la forme, cet article appelle quelques modifications.
A. UNE CODIFICATION A PRÉCISER
Le présent article propose de codifier la contribution sous les articles L. 137-5 à L. 137-13, à la suite de la nouvelle taxe de 6% sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, qui vient d'être créée par l'article 8 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, et qui fait l'objet des articles L. 137-1 à L. 137-4 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le paragraphe I remodèle le nouveau chapitre 7 du titre III du livre premier du code précité créé par l'ordonnance et intitule "Recettes diverses", pour y distinguer une section 1, relative à la taxe, et une section 2, relative à la contribution.
Cette modification, bien que purement formelle, reviendrait à ratifier implicitement les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance précitée.
En effet, selon une jurisprudence commune au Conseil d'Etat (CE du 19 décembre 1969, Dame Briard) et au Conseil constitutionnel (décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987), la ratification de tout ou partie d'une ordonnance peut "résulter d'une loi qui, sans avoir cette ratification pour objet direct, l'implique nécessairement".
Or, une telle ratification implicite d'une partie d'ordonnance ne paraît pas de bonne méthode, même s'il est loisible au Gouvernement de la tolérer alors que la période pour laquelle le Législateur s'est dessaisi de sa compétence n'est pas encore close. Votre commission estime préférable que le Parlement attende d'être saisi du projet de loi de ratification de l'ensemble des cinq ordonnances qui sera déposé au plus tard le 31 mai Prochain et que le Premier ministre s'est engagé à faire effectivement discuter.
En conséquence, elle vous propose un amendement supprimant toute référence aux articles L. 137-1 à L. 137-4 du code de la sécurité sociale.
B. UN DISPOSITIF A AFFINER
Dans la rédaction proposée, l'article L. 137-6, qui fixe le barème de la contribution, n'envisage que les hypothèses où le chiffre d'affaires des grossistes en médicaments s'accroît, avec un taux minimal de 1 % pour une progression inférieure à 2 %.
Une interprétation littérale de cette disposition pourrait amener à conclure qu'aucune contribution n'est due en cas de diminution du chiffre d'affaires, ou plus exactement qu'elle est due au taux 0, ce qui revient au même.
Lorsqu'au premier trimestre 1994, le cas s'est présenté d'une diminution des ventes de médicaments remboursables, les grossistes-répartiteurs n'ont pas cherché à tirer parti de cette lacune rédactionnelle, et se sont acquittés de leur contribution au taux de 1 %.
Toutefois, dès lors que l'on pérennise la contribution, la profession souhaite que l'on envisage expressément l'hypothèse d'une diminution de son chiffre d'affaires, avec une adaptation du barème à un cas de figure qui fragilise par définition sa situation financière. L'hypothèse d'une baisse forte et transitoire des dépenses de médicaments ne sera bientôt plus un cas d'école, si le dispositif de maîtrise des dépenses de santé qui est en train de se mettre en place produit pleinement ses effets.
Votre commission vous propose donc un amendement tendant à compléter le barème de la contribution vers le bas, avec deux taux supplémentaires de 0,75 %, pour une diminution du chiffre d'affaires comprise entre 0 et 3 %, et de 0,5 % pour une diminution du chiffre d'affaires supérieure à 3 %.
Il convient de souligner que ces taux d'évolution sont calculés par rapport au même trimestre de l'année antérieure, et non pas par rapport au trimestre immédiatement précédent : les diminutions de chiffre d'affaires auront donc un caractère tout à fait exceptionnel. Cette adaptation du barème amortira les effets déstabilisateurs pour le secteur de la répartition pharmaceutique d'un mouvement brutal de baisse des dépenses de médicaments, qui n'est pas à exclure dans les prochaines années, mais qui ne saurait évidemment se prolonger. La diminution du rendement de la contribution induite par l'adaptation de son barème sera donc à la fois éventuelle et transitoire.
Les articles L. 137-8 à L. 137-12 comportent les dispositions relatives au recouvrement et au contrôle de la contribution, assurés par l'ACOSS, assistée, en tant que de besoin par les URSSAF et les caisses générales des départements d'outre-mer. La contribution est recouvrée comme une cotisation de sécurité sociale. Les versements afférents à un trimestre sont effectués au cours du trimestre suivant.
Le produit de la contribution est réparti entre les régimes d'assurance maladie selon une clé fixée par arrêté.
L'article L. 137-13 pérennise le plafonnement des remises, ristournes, avantages commerciaux et financiers assimilés consentis par les fournisseurs des officines, à 2,5 % du prix des spécialités pharmaceutiques remboursables.
Ce plafonnement a été régulièrement reconduit depuis son instauration en 1991, en même temps que la contribution. Il est assorti d'une clause selon laquelle il ne s'applique qu'à défaut d'un accord de bonnes pratiques commerciales entre les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officines. La rédaction proposée par le présent article pour cette clause suspensive n'est pas satisfaisante. D'une part, parce que, curieusement, la clause n'est pas codifiée à l'article L. 137-13, mais fait l'objet du paragraphe IV du présent article. D'autre part, parce que la formule selon laquelle "le plafonnement (...) sera suspendu en cas d'intervention d'un accord" est d'une portée juridique douteuse et semble plus proche de la déclaration d'intention que de la norme législative.
Votre commission vous propose donc un amendement tendant à insérer la clause suspensive du plafonnement directement dans le code de la sécurité sociale, à l'article L. 137-13, et à lui donner juridiquement effet de plein droit.
Le paragraphe II bis nouveau du présent article résulte d'un amendement de la commission des finances de l'Assemblée nationale qui tend à pérenniser l'exclusion de l'assiette de la contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés. Cette exclusion était prévue pour la contribution exceptionnelle que le présent article a pour objet de reconduire. Elle découle d'un amendement de votre commission des finances qui visait à atténuer les conséquences de l'extension du champ de la contribution sociale de solidarité des sociétés, opéré par l'article 30 de la première loi de finances pour 1995, sur l'équilibre économique du secteur de la répartition pharmaceutique.
Le paragraphe III du présent article prévoit l'application rétroactive des dispositions précédentes au 1 er octobre 1995. En effet, la dernière période couverte par la contribution exceptionnelle courait d'octobre 1994 à septembre 1995. Il convient donc d'éviter toute solution de continuité dans son recouvrement.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 42 - Répartition du produit de la contribution sociale des sociétés
Commentaire : le présent article tend à donner une base légale aux règles de répartition de la contribution sociale de solidarité des sociétés entre les différents régimes de non salariés bénéficiaires, et à limiter les conséquences de l'annulation par le juge administratif des répartitions déjà effectuées entre 1980 et 1994.
I. UNE REPARTITTION EFFECTUEE JUSQU'A PRÉSENT SUR DES BASES JURIDIQUEMENT FRAGILES
Instituée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970, la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (CSSS) participe au financement des régimes d'assurance maladie et vieillesse des non salariés. Cette contribution a pour but de compenser l'amenuisement des ressources des régimes concernés induit par le développement de l'emploi salarié et par le mouvement de transformation des entreprises individuelles en sociétés. Son régime juridique est fixé par les articles L. 651-1 à L. 651-9 du code de la sécurité sociale.
Jusqu'en 1991, le produit de la contribution a été directement réparti par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sans que le décret d'application prévu à l'article L. 651-9 ait été pris au préalable.
Le produit de la contribution a ainsi été réparti en fonction des besoins de trésorerie présentés par le régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles (CANAM), les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales (CANCAVA), industrielles et commerciales (ORGANIC) et le régime complémentaire obligatoire des entrepreneurs du bâtiment et travaux publics (CNREBTP).
L'article 52 de la loi de finances pour 1992 a étendu le champ de la contribution sociale de solidarité des sociétés aux régimes d'assurance vieillesse des professions agricoles, des ministres des cultes (CAMAVIC) et des avocats (CNBF), ce qui a permis au BAPSA d'absorber en deux ans les 7,3 milliards de francs de réserves accumulées à la fin de 1990 par l'ORGANIC, qui est chargée du recouvrement et de la gestion de la CSSS.
Le tableau ci-dessous retrace la répartition du produit de la contribution sur les cinq dernières années et les prévisions pour 1996. On remarquera le net accroissement de son rendement dans la dernière période résultant de l'article 30 de la première loi de finances rectificative pour 1995, qui a porté le taux de la CSSS de 0,1 % à 0,13 % dès 1995, et étendu son champ d'application à compter de 1996.
Répartition du produit de la contribution sociale de solidarité depuis 1991
(En millions de francs)
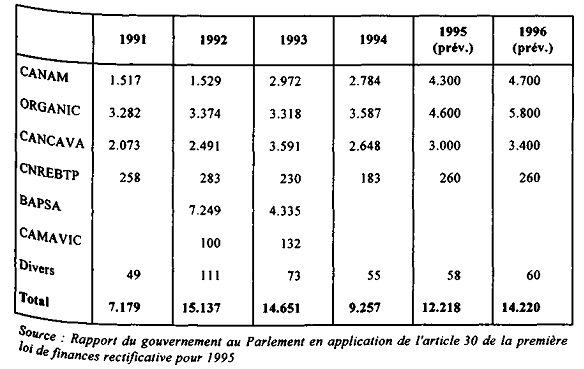
Ainsi, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) n'a jamais reçu de CSS depuis l'instauration de celle-ci 1970, bien qu'elle figure parmi les régimes bénéficiaires énumérés à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale. Une telle exclusion se comprend aisément, dans la mesure où la CNAVPL, à la différence des autres régimes de non salariés, est démographiquement équilibrée et financièrement excédentaire. Mais, bien que cette exclusion soit conforme à la logique de la CSSS, elle ne résulte d'aucune disposition législative expresse.
Contestant cette situation, la Caisse autonome des médecins français, qui est une section professionnelle de la CNAVPL, a engagé un recours contre les arrêtés de répartition pris entre 1980 et 1991, dont elle a obtenu annulation. Le décret n° 91-1268 du 19 décembre 1991 ayant repris les montants de CSS fixés par les arrêtés annulés, le même requérant a obtenu du Conseil d'Etat l'annulation de ce décret par un arrêt du 29 juillet 1994, au double motif que la procédure de répartition de la contribution n'avait jamais été fixée par le décret prévu à l'article L. 651-9 du code de la sécurité sociale et que la CNAVPL ne figurait pas parmi les bénéficiaires de cette répartition.
Le décret n° 93-1306 du 9 décembre 1993 est venu enfin fixer les principes de répartition du produit de la CSSS, avec un dispositif en deux étages :
- une attribution prioritaire aux régimes déficitaires qui ont bénéficié de la CSS avant le 31 décembre 1991 (CANAM, CANCAVA, ORGANIC et CNREPTP) ;
- une répartition du solde éventuel entre les autres régimes énumérés à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, au prorata des montants perçus au titre de la compensation démographique pour l'année en cours.
Les répartitions de 1992, 1993 et 1994 ont été faites en application de ce décret, sur une base réglementaire apparemment plus solide que les répartitions des années antérieures.
Cependant, saisi de nouveau par la Caisse autonome des médecins français, le Conseil d'Etat a partiellement annulé, par un arrêt du 9 décembre 1994, le décret n° 93-1306 du 9 décembre 1993 au motif que celui-ci ne pouvait pas, pour distinguer deux catégories de bénéficiaires de la CSSS, se borner à se référer à la répartition agréée avant le 31 décembre 1991 sur la base du décret précédemment annulé.
II. LA SOLUTION PROPOSÉE
Les péripéties contentieuses évoquées ci-dessus justifient le présent article qui tend, d'une part, à fixer les règles de répartition de la CSSS pour l'avenir et, d'autre part, à limiter les inconvénients de l'annulation des répartitions passées.
A. LA LÉGALISATION DES RÈGLES DE RÉPARTITION DU PRODUIT DE LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ ENTRE LES SOCIÉTÉS
Le 1° du paragraphe I du présent article tend à insérer dans les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la CSSS un article L. 651-2-1 précisant les règles de répartition du produit de celle-ci. Ces règles sont celles qui avaient déjà été fixées par le décret n° 93-1306 du 9 décembre 1993, annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 9 décembre 1994.
Le premier alinéa du texte proposé pour cet article L. 651-2-1 prévoit que le produit de la CSSS est d'abord réparti entre la CANAM, la CANCAVA et l'ORGANIC. Les régimes prioritaires sont ainsi limitativement énumérés. La CNREBTP n'est pas citée à ce niveau légal dans la mesure car elle bénéficie réglementairement d'un prélèvement sur la fraction de CSS attribuée à l'ORGANIC, en vertu de l'article L. 651-19 du code de la sécurité sociale.
Une déduction est opérée sur le produit de la CSSS au profit de ORGANIC, au titre des frais de recouvrement de la contribution dont elle est chargée. A l'inverse, ce produit est, le cas échéant, abondé du solde positif de exercice précédent.
Les régimes prioritaires ainsi définis reçoivent chacun une fraction de CSS égale à la différence entre leurs dépenses et leurs recettes, abstraction faite de la CSS reçue au titre des exercices antérieurs et de la subvention d'équilibre que l'Etat peut verser à l'ORGANIC et à la CANCAVA en application du 5° de l'article L. 633-9 du code de la sécurité sociale (en pratique il n'y a pas de précédent d'une telle contribution budgétaire à ces régimes). Ainsi, seuls les cotisations et les transferts de compensation démographique sont pris en compte pour le calcul des besoins de financement des régimes bénéficiaires.
Enfin, si le produit de la CSS ne suffit pas à les combler, il est réparti proportionnellement aux déficits comptables ainsi calculés.
Votre commission vous propose pour cet alinéa un premier amendement tendant à une rédaction plus économe et syntaxiquement plus correcte.
Egalement dans le souci d'en alléger la rédaction, elle vous propose, par un deuxième amendement, de faire figurer à l'article L. 651-4 du code de la sécurité sociale le principe du remboursement à ORGANIC des frais occasionnés par le recouvrement et la gestion de la CSS.
Le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 651-2-1 prévoit que le solde éventuel du produit de la CSS, une fois les déficits des régimes prioritaires comblés, est réparti à son tour entre les autres régimes mentionnés l'article L. 651-1 comme bénéficiaires de la contribution : régimes assurance vieillesse des professions libérales, des non salariés agricoles, des ministres des cultes et des avocats. Ce solde est réparti au prorata des montants reçus au titre de la compensation démographique et dans la limite de leurs déficits comptables.
Il convient de remarquer que la CNAVPL, qui est contributrice dans le système de compensation démographique (elle a versé 2,16 milliards de francs à ce titre en 1995), est a priori exclue de ce second étage de répartition de la CSS. Cette position contributrice marque bien le caractère favorable de son rapport démographique entre cotisants et retraités.
De toute façon, la répartition de ce reliquat est dans l'immédiat toute théorique, puisque les 14,22 milliards de francs attendus de la CSS en 1996 permettront seulement de ramener les besoins de financement des quatre régimes prioritaires de 15,3 milliards de francs à 1,14 milliard de francs Situation financière des régimes prioritairement bénéficiaires avant et après versement de la CSS depuis 1994
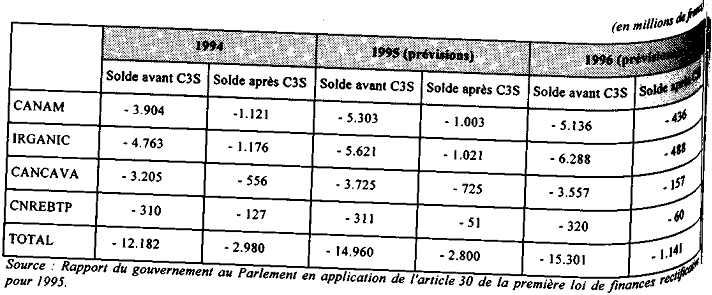
Le troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe les montants de CSS ainsi répartis.
Votre commission vous propose, par un troisième amendement, une rédaction plus concise pour la première phrase de cet alinéa.
Le 2° du paragraphe I du présent article étend à la CSS certaines dispositions relatives aux cotisations de sécurité sociale : l'article L. 243-3 du code de la sécurité sociale, qui autorise l'admission en non-valeur des cotisations, et l'article L. 243-6 du code précité, qui prévoit la prescription par deux ans des demandes de remboursement des cotisations indûment versées.
Enfin, l e 3° du paragraphe I du présent article rectifie la rédaction de l'article L. 651-9 du code précité, qui ne précisera plus que le décret d'application auquel il renvoie détermine "la procédure de répartition des sommes recouvrées entre les régimes bénéficiaires", puisque cela est précisément l'objet du nouvel article L. 651-2-1 créé par ailleurs.
B. LA LIMITATION DES CONSÉQUENCES DE L'ANNULATION DES RÉPARTITIONS PASSÉES
Le paragraphe II du présent article tend à limiter les conséquences de l'annulation des arrêtés de répartition intervenus entre 1980 et 1994.
Il ne s'agit évidement pas de valider ces arrêtés annulés, ce qui contredirait directement des arrêts du Conseil d'Etat en violation flagrante du principe de séparation des pouvoirs.
La solution proposée consiste simplement à préciser que les sommes perçues et comptabilisées au profit des régimes bénéficiaires au titre de la CSS, pour les exercices 1980 à 1994, leur sont définitivement acquises. Environ 130 milliards de francs de CSS ont été répartis entre les régimes bénéficiaires sur la période concernée.
Les arrêtés de répartition antérieurs n'ayant pas été annulés, il n'est Pas nécessaire de remonter plus loin dans le temps.
Enfin, le paragraphe III du présent article dispose que les nouvelles règles de répartitions légalisées par l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au produit de la CSS à compter du 1er janvier 1995.
Ainsi, les répartitions effectuées à titre provisoire l'an dernier, sur la base du décret n° 95-716 du 9 mai 1995 qui prévoit la possibilité d'acomptes Provisionnels, deviendra définitive.
III. LA QUESTION DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES DUES AUX RÉGIMES DES NON SALARIÉS
Le dernier paragraphe de l'article 30 de la première loi de finances rectificative pour 1995 prévoyait que le gouvernement présente au Parlement un rapport sur la situation financière des régimes bénéficiaires de la CSSS avant le 31 décembre 1995. Lors de la discussion de cet article, le Parlement avait en effet estimé qu'il ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour l'éclairer sur la nécessité d'augmenter le taux et d'élargir l'assiette de la CSSS. Ce rapport devait préciser notamment la répartition de la contribution entre les régimes bénéficiaires, les emplois et les ressources de chaque régime, l'état de leurs réserves, ainsi que les modalités de recouvrement des cotisations.
Lorsque la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui est à l'origine de cette demande d'informations supplémentaires, a examiné le présent article, elle ne disposait pas encore du rapport qui aurait dû être déposé sur le bureau des assemblées depuis deux mois déjà. Cette négligence du gouvernement, alors même que celui-ci proposait de modifier une nouvelle fois la CSSS, a motivé de sa part un amendement de suppression destiné à marquer son mécontentement.
Ce rapport a été providentiellement déposé la veille de la discussion en séance publique à l'Assemblée nationale. Votre rapporteur a donc pu en prendre connaissance en temps utile.
Il est toutefois au regret de constater que ce rapport est très décevant. S'il en apprécie la remarquable concision, il déplore de n'y avoir trouvé aucune information qui n'ait déjà été rendue publique par les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale.
En particulier, le rapport n'aborde pas la question essentielle des difficultés rencontrées par les régimes de non salariés pour recouvrer les cotisations auprès de leurs assurés. La Cour des comptes a pourtant consacré des développements édifiants à cette question dans son premier rapport au Parlement sur la sécurité sociale (pages 163 et 165).
Dans ce rapport, après avoir rappelé que le montant global des dettes accumulées par les adhérents de la Confédération de défense des commerçants et artisans (CDCA) envers la CANCAVA, l'ORGANIC et la CANAM était estimé par les caisses concernées à 850 millions de francs en 1993, la Cour relève que ce mouvement de refus du paiement des cotisations commence à s'implanter parmi les professions libérales, notamment médicales.
Les procédures contentieuses de recouvrement des cotisations mises en oeuvre par les caisses se heurtent à une résistance juridique organisée de façon systématique par la CDCA, qui les retardent et en accroît le coût.
Certaines caisses en sont venues à mettre en concurrence les huissiers chargés de signifier les contraintes, pour stimuler leur zèle.
Au total, il ne semble pas inutile d'évaluer de la façon la plus précise les montants de cotisations non recouvrées par les régimes de non salariés, en distinguant dans la mesure du possible ce qui relève de refus délibérés, et de faire un bilan des dispositions tendant à pénaliser les assurés se soustrayant volontairement à leur obligation de cotisation ainsi que les personnes qui les y incitent.
En effet, il y a un lien évident entre ce problème et la situation financière des régimes concernés, c'est-à-dire en dernier ressort le montant de CSSS nécessaire à leur équilibre financier. Rappelons que le rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale de juillet 1995 relevait que le taux des restes à recouvrer atteignait 17,59% pour les employeurs et travailleurs indépendants, à comparer avec un taux de 1,57 % pour les entreprises de salariés.
Votre commission vous propose donc, par un quatrième amendement, de demander au gouvernement un rapport complémentaire sur cette question précise, avant le 30 septembre 1996.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié et complété.
TITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 43 - Disposition relative aux sociétés de développement régional en liquidation
Commentaire : le présent article accorde une autorisation législative rétroactive aux actes accomplis par l'État dans le cadre de la liquidation amiable de trois sociétés de développement régional, LORDEX, CENTREST et la SDR de Picardie.
Les sociétés de développement régional connaissent, depuis le début des années quatre-vingt, des difficultés financières sérieuses, au point que trois d'entre elles, celle de Lorraine, LORDEX, celle du centre de l'est, CENTREST et celle de Picardie, ont dû être mises en liquidation amiable sous le contrôle d'un administrateur nommé par la commission bancaire.
Il n'y a pas lieu de revenir ici sur la problématique d'ensemble des SDR, sujet exploré par les commissions des finances des deux assemblées ( 4 ( * )) .
Le présent article a un objet très précis : valider les actes de l'État » déjà accomplis, dans le cadre des trois liquidations, non dans l'ensemble de leurs aspects, mais uniquement pour le cas où ils seraient contestés sur le fondement de l'absence d'autorisation législative.
I. L'INTERVENTION DE L'ÉTAT DANS LA CONSOLIDATION DES SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL EST JUSTIFIÉE PAR LEUR RÔLE DANS LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
A l'exception de la SDR de Corse, la CADEC, l'État est absent du capital des SDR. Il ne nomme ni n'agrée leurs dirigeants. La présence d'un commissaire du gouvernement au sein de leurs conseils d'administration n'est justifiée que par les avantages fiscaux dont bénéficient les SDR.
Pour autant, l'État ne pouvait se désintéresser de leur sort.
L'État apporte en effet sa garantie, en vertu de la loi n°53-30 du 7 février 1953 modifiée, aux emprunts des SDR, soit directement, soit, depuis 1987, à travers la garantie des émissions de FINANSDER, société financière chargée de leur refinancement, créée en 1983 pour gérer la dette commune, et dont les SDR détiennent la totalité du capital. Cette société emprunte sur le marché obligataire avec la garantie de l'État et reprête aux SDR sur des durées équivalentes.
Le montant actuel des garanties accordées s'élève à plus de 30 milliards de francs.
En outre, le rôle des SDR, au service du financement des PME, ne peut être oublié. Ces instruments locaux du développement économique doivent être consolidés par la puissance publique.
II. LES MODALITÉS DE L'INTERVENTION DE L'ÉTAT POUR RÉSOUDRE LA CRISE FINANCIÈRE DES SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
L'intervention de l'État dans le redressement financier des SDR prend trois formes.
1. La consolidation globale de la situation financière des SDR.
Même si les SDR ne se sont pas réunies en réseau, le risque de faillites en chaîne n'est pas à négliger.
En raison de l'importance des emprunts groupés, comportant des clauses de défaut croisées selon lesquelles en cas de non paiement par l'un quelconque des débiteurs, l'ensemble des prêts devient exigible par anticipation, la mise en jeu de l'une de ces clauses par le dépôt de bilan de l'une des SDR aurait pu placer en grande difficulté l'ensemble des SDR.
En outre, les SDR ont souscrit des prêts auprès de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et auprès de la Banque européenne d'investissement. Ces prêts comportent des clauses particulières au terme desquelles le prêteur peut demander le remboursement du prêt dès que la situation de la société lui paraît de nature à mettre en cause sa solvabilité finale. De telles clauses pourraient être invoquées par ces institutions européennes si la situation des SDR n'était pas apurée à bref délai, de façon à leur garantir le paiement final de leurs prêts.
Enfin, FINANSDER gère un fonds de garantie mutualisé qui s'analyse comme un dépôt des SDR lequel, s'il était amené à être utilisé pour couvrir les pertes de l'une des SDR, dans le cas par exemple d'un dépôt de bilan, pourrait provoquer des pertes à due concurrence dans les SDR saines contributrices.
Pour ces motifs, le règlement ordonné du cas des SDR en difficulté a été entrepris depuis plus de deux ans. Ce règlement doit apporter des solutions au cas par cas, dans le but d'aider ces sociétés à surmonter ces difficultés afin de leur permettre de jouer à nouveau un rôle actif dans le développement régional des PME.
Sur un plan général, les SDR devraient se recentrer sur leurs missions originelles d'apporteurs de capitaux à long ternie aux PME : fonds propres, crédit bail immobilier, crédit à long terme.
2. La restructuration de l'actionnariat des SDR.
Afin de favoriser la restructuration de l'actionnariat des SDR financièrement saines pour leur redonner une capacité d'action nouvelle, celles-ci ont été ou seront adossées sur un actionnaire principal assurant, à terme, leur financement et responsable de leur devenir.
Ces actionnaires principaux sont les Caisses d'épargne et la Caisse des dépôts et consignations.
3. La liquidation amiable des trois SDR les plus en difficulté.
Pour les trois SDR les plus en difficulté, LORDEX, CENTREST et PICARDIE, un processus de liquidation amiable a été enclenché.
Afin d'éviter un dépôt de bilan dont les conséquences ont été évoquées, les pouvoirs publics ont entrepris des négociations avec les principaux actionnaires et créanciers, au premier rang desquels figure FINANSDER pour 310,9 millions de francs répartis de la façon suivante :
- 116,5 millions de francs dans CENTREST,
- 39,2 millions de francs dans LORDEX,
- 155,2 millions de francs dans PICARDIE.
Dans chaque cas, un protocole de liquidation amiable a été conclu.
Les créanciers participeront au comblement du passif de liquidation en contrepartie d'un engagement de l'Etat d'apurer les passifs de liquidation résiduels de ces institutions.
Le coût direct actualisé pour l'Etat de la liquidation de ces trois SDR sera de l'ordre de 1,25 milliard de francs.
Les encours à gérer devraient diminuer rapidement. Le montant des remboursements d'emprunts accordés par ces SDR était estimé, au 31 décembre 1995, à 10 milliards de francs et devrait diminuer progressivement Pour passer à 4 milliards de francs en 1999 et s'éteindre totalement en 2007, compte non tenu de la cession d'encours des filiales de crédit-bail des SDR, pour un montant de 2,4 milliards de francs.
Les actifs des SDR concernées, constitués d'encours de crédit pour environ 5 milliards de francs et de participations industrielles pour environ 700 millions de francs, seront cédés, avec une forte décote.
La charge financière supportée par l'Etat devrait s'étaler entre 1997 et 2008 et pourrait s'éteindre aux alentours de 2002.
Un contrôle a été mis en place pour préserver les intérêts patrimoniaux de l'État. Un administrateur provisoire a été nommé à LORDEX et PICARDIE par la commission bancaire. L'État dispose de surcroît d'un unique commissaire du gouvernement pour les trois SDR, afin d'assurer une meilleure coordination et un suivi de leurs actions. Enfin, les pouvoirs publics pourraient prochainement bénéficier des services d'une banque conseil.
III. LA LIQUIDATION AMIABLE DES TROIS SDR DOIT ÊTRE VALIDÉE PAR LE LÉGISLATEUR
Les conventions de liquidation amiable ont été conclues entre l'Etat, les actionnaires et les créanciers de CENTREST (28 septembre 1994), LORDEX (3 janvier 1995) et PICARDIE (31 mars 1995).
Or, l'État a apporté sa garantie sans autorisation préalable du Parlement.
Le présent article propose donc de valider tous les actes accomplis et les garanties accordées par l'État dans le cadre de cette liquidation amiable.
Il s'agit d'éviter que ces actes ne soient contestés en raison de l'absence d'une autorisation législative. Cette validation ne concerne que leur contestation sur le terrain du défaut de base légale.
Une telle procédure a déjà été mise en oeuvre par les articles 18 et 19 de la loi n°95-1251 du 28 novembre 1995, relative à l'action de l'État dans les plans de redressement du Crédit Lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs, pour valider les actes accomplis et les engagements pris par l'État dans le cadre du redressement des deux établissements précités.
Alors que le rapporteur de la commission des finances de l'Assemblée nationale avait proposé la suppression de cet article au motif que l'article 83 de la loi de finances pour 1995, qui prescrit au Gouvernement de déposer en annexe du projet de loi de finances initiale un rapport décrivant chacune des opérations de crédit à court, moyen ou long terme ou des opérations financières bénéficiant de la garantie de l'État, n'était toujours pas appliqué, aucun document n'ayant été déposé à cet effet, l'Assemblée nationale a adopte cet article sans modification.
Le rapport en question a en effet été déposé entre-temps. Par ailleurs, lors de la séance du 7 mars 1996, le ministre de l'économie et des finances, M. Jean Arthuis, a précisé qu'il s'attacherait à renforcer la connaissance et l'évaluation du patrimoine de l'Etat et annoncé la constitution d'une mission "afin que soient présentés au Parlement des comptes consolidés des entreprises dont l'État est l'actionnaire majoritaire ou dont il détient des participations significatives".
Cette réforme, destinée à renforcer l'information du Parlement et à lui permettre de mieux exercer sa mission de contrôle de l'action gouvernementale et des administrations, permettra sans doute d'éviter qu'à l'avenir le Parlement valide l'octroi de garanties financières par l'État, en étant informé seulement a posteriori.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 44 - Dispositions relatives au monopole d'État pour la vente au détail des tabacs manufacturés
Commentaire : Le présent article a pour objet principal de confirmer -ou de rétablir, selon les interprétations- le monopole de vente au détail des tabacs manufacturés en Corse au profit de l'État
I. LE RÉGIME DES TABACS EN CORSE ET LA LOI DE PRIVATISATION DU 19 JUILLET 1993
A. UN RÉGIME SPÉCIFIQUE
Avant la loi de privatisation du 19 juillet 1993, le régime des tabacs applicable à la Corse avait gardé sa spécificité : une liberté de fabrication, importation et commercialisation en gros des produits du tabac.
En revanche, la vente au détail faisait l'objet d'un monopole d'État.
Toutefois en 1974, sans base juridique, l'administration des douanes s'était dessaisie de la gestion de ce monopole au profit de la SEITA. Celle-ci avait alors conclu des "contrats de concession exclusive", les concessionnaires s'approvisionnant auprès de la SEITA, celle-ci s'engageant à "ne vendre ses produits qu'au seul concessionnaire dans chaque zone concédée".
B. LA PRIVATISATION DE LA SEITA
La loi de privatisation du 19 juillet 1993 a posé, avec la perspective de la privatisation de la SEITA, le problème de la dévolution du monopole de l'État en matière de fabrication de produits du tabac, d'importation et de commercialisation en gros des tabacs manufacturés, sur le territoire de la France continentale.
Ces deux monopoles étaient en effet confiés à la SEITA.
La solution retenue a été, pour la France continentale, de prévoir la liberté de fabrication d'importation, d'introduction et de commercialisation en gros des tabacs manufacturés et de réserver à l'État le monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, l'ensemble de ces dispositions devant entrer en vigueur dès la publication du décret de privatisation de la SEITA.
On peut donc considérer que ces dispositions s'appliquent depuis le 5 janvier 1995, date de publication du décret de privatisation de la SEITA.
II. L'AMÉNAGEMENT DU MONOPOLE DE L'ÉTAT EN CORSE
Dans l'intervalle séparant la loi du 19 juillet 1993 de la privatisation de la SEITA, l'article 51 de la loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a étendu expressément à la Corse :
- le monopole d'État de l'importation et de la commercialisation en gros des tabacs en provenance des pays extérieurs à l'Union européenne ;
- le monopole d'État de la distribution de la vente au détail des tabacs manufacturés.
Cette deuxième extension paraissait la meilleure solution pour donner une assise juridique stable au réseau corse de vente au détail de tabacs, le tribunal de commerce d'Ajaccio ayant condamné, dans le cadre d'un jugement "Scaglia" du 30 juillet 1990, le système des contrats de concession exclusive de la SEITA comme contraire au traité de Rome et la cour d'appel de Bastia, saisie par la SEITA, n'ayant pas encore rendu sa décision.
III. LA JUSTIFICATION DE L'ARTICLE 44
A. LE MONOPOLE D'ÉTAT DE LA VENTE AU DÉTAIL DES TABACS EN CORSE
L'article 44 a pour objet de réaffirmer le monopole d'État de la vente au détail des tabacs en Corse. En effet, même si cette affirmation figure dans le texte actuellement publié de l'article 565 A du code général des impôts, issu de la loi du 8 août 1994, on peut considérer que la privatisation de la SEITA, effective au 5 janvier 1995, a entraîné l'application d'une autre version de l'article 565 A, où le mot "continentale" figure au lieu du mot "métropolitaine".
B. LES CONSÉQUENCES DE LA DISPARITION DU MONOPOLE DE LA FABRICATION
Le II de l'article 44 propose de tirer les conséquences de la disparition du monopole de la fabrication sur l'article 575 K du code général des impôts.
En effet, depuis la privatisation de la SEITA, l'État ne dispose plus du monopole de fabrication des tabacs manufacturés en France continentale. Cette activité peut être exercée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Il convient dès lors de modifier l'article 575 K du code général des impôts, qui fait encore référence au "tabac du monopole".
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 45 - Redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion
Commentaire : le présent article a pour objet de conférer un caractère rétroactif aux articles 2 et 3 du décret du 20 juillet 1995 qui modifient un décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques. Ce faisant, cet article autorise le recouvrement de redevances dues pour les années 1993, 1994 et 1995.
I. LA SITUATION ACTUELLE
L'article 45 de la loi de finances pour 1987 a prévu un régime de taxes applicables aux liaisons radioélectriques privées. Outre une taxe de constitution de dossier et une taxe annuelle de gestion, d'un montant fixe en fonction de la puissance des installations, le dispositif comprend une redevance annuelle avec un barème dégressif et un certain nombre de cas particuliers.
A la suite d'un avis du Conseil d'État de novembre 1991, requalifiant en redevances domaniales les taxes perçues depuis 1987, celles-ci ont été recréées par un décret du 3 février 1993. Toutefois, dans ce décret qui a repris l'essentiel du dispositif de 1987 ne figure plus le tableau de dégressivité de l'ancien dispositif pour les réseaux ayant des liaisons unidirectionnelles, c'est-à-dire principalement les réseaux de recherche de personnes. Cet "oubli" représente une hausse substantielle de la redevance annuelle pour environ 16.600 réseaux, sur un total de 65.300 réseaux radioélectriques indépendants.
Afin de remédier à cette situation, le gouvernement a décidé, dans un décret du 20 juillet 1995, de réintroduire le barème dégressif en vigueur avant 1993. Il a également prévu d'étendre l'abattement de 50% des redevances dont bénéficient les collectivités territoriales aux groupements de collectivités.
L'évolution du cadre réglementaire des redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques à ainsi été particulièrement mal maîtrisée au cours des dernières années.
S'y est ajouté un grave problème de gestion technique et administrative des facturations.
En effet, de 1987 à 1990, France Télécom a été chargé d'émettre les factures pour le compte de l'État, le produit des redevances étant reversé au budget général. Cette procédure fonctionnant bien, il a été décidé qu'à la suite du changement de statut de France Télécom, le 1 er janvier 1991, l'exploitant Public continuerait à émettre les factures pendant deux années pour permettre à l'État de se donner les moyens de le faire lui-même par la suite.
Or, ces deux années, n'ont pas suffi au ministère de tutelle pour mettre en place les programmes informatiques adéquats. Les redevances n'ont donc pas été perçues en 1993, 1994 et 1995. Les outils informatiques de facturation ne sont devenus opérationnels qu'à l'automne 1995.
C'est ainsi que 48.700 réseaux ont pu être facturés le 29 décembre 1995, au titre des redevances dues pour les années 1993 et 1994. Les factures émises atteignent un total de 486 millions de francs payables avant le 1 er juin 1996.
Au cours du 2 ème semestre 1996, les factures porteront sur les redevances dues au titre des années 1995 et 1996. A partir de 1997, le rythme de facturation devrait redevenir normal.
II. LA MESURE PROPOSÉE
Le présent article vise à rendre rétroactifs les articles 2 et 3 du décret du 20 juillet 1995 et donc, en particulier, à réintroduire un barème dégressif Pour les redevances dues par les 16.600 réseaux unidirectionnels.
Il permettra de facturer ces réseaux pour les redevances dues au titre des années 1993, 1994 et 1995, sans hausse excessive par rapport aux factures émises avant 1993.
Le montant mis en recouvrement pour 1993 et 1994 devrait ainsi atteindre 49 millions de francs au lieu de 85 millions en l'absence du tableau de dégressivité.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission se félicite du fait que le gouvernement soit enfin parvenu à régler, d'une part, le problème réglementaire et, d'autre part, le problème technique qui ont empêché la facturation et le recouvrement des redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques depuis trois ans.
Toutefois, elle déplore vivement qu'une telle situation ait pu se produire. En raison d'un oubli, de négligences, d'une réelle "légèreté administrative", des sommes importantes n'ont pu venir alimenter le budget général : près de 900 millions de francs depuis 1993.
Or, la situation actuelle des finances publiques ne permet pas de négliger de pareilles sommes. De même, une réelle interrogation concerne l'utilisation des substantiels crédits informatiques inscrits chaque année dans les budgets ministériels.
Il n'est donc pas surprenant que la Cour des comptes ait relevé cette mauvaise gestion et envisage d'en faire état dans son prochain rapport public.
C'est pourquoi, afin d'obtenir des explications détaillées du gouvernement sur les raisons de cette situation et sur les conséquences qu'il en tire, votre commission a souhaité supprimer le présent article.
Cette position lui permet également de regretter, une fois de plus » qu'on lui propose d'adopter des mesures à caractère rétroactif.
En l'occurrence, la reprise des facturations sur trois années ne peut que pénaliser les utilisateurs des réseaux concernés, c'est-à-dire les autoécoles, les taxis, les hôpitaux, les entreprises de gardiennage, les collectivités territoriales, etc..
Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.
Article 46 (Retiré) - Taux de TVA applicable aux locations d'immeubles à des exploitants d'établissements d'hébergement
Commentaire : cet article proposait de simplifier le régime de TVA applicable aux locations d'immeubles à des exploitants d'établissements d'hébergement. Cette mesure, déjà repoussée une première fois par la commission mixte paritaire lors de la discussion de la seconde loi de finances pour 1995, a fait l'objet d'un amendement de suppression de la part de la commission des Finances de l'Assemblée nationale avant d'être finalement retirée par le Gouvernement.
Les exploitants privés d'établissements d'hébergement (maisons de retraite, hôtels, résidences de tourisme...) sont obligatoirement imposables à la TVA lorsque leur activité est lucrative. Le taux réduit de 5,5 % est applicable à leur activité d'hébergement stricto sensu, leurs activités annexes (location de salles, restauration, organisation de séminaires...) étant imposables au taux normal.
Lorsque ces exploitants sont locataires de leur immeuble, les loyers qu'ils doivent acquitter sont soumis au même régime différencié de TVA que leur activité, en vertu de l'article 260 D du code général des impôts. Le bailleur doit appliquer le taux de 5,5 % à la fraction du loyer correspondant aux locaux à usage d'habitation et le taux de 20,6 % à la fraction du loyer correspondant aux locaux utilisés pour des activités annexes.
Cette ventilation des locaux en fonction de leur destination étant souvent délicate, certains bailleurs ont pris l'initiative d'appliquer le taux de 20,6 % à la totalité du loyer. Cette pratique simplificatrice, a priori neutre pour le preneur qui peut déduire la taxe, est admise par l'administration. Celle-ci a considéré, par simples lettres adressées aux bailleurs qui l'ont saisie de la question, qu'en l'absence de ventilation la taxe est due au taux le plus élevé.
Toutefois, sur le plan juridique, cette solution est en contradiction avec l'article 223 de l'annexe II du code général des impôts qui conditionne la déductibilité de la taxe d'amont à une facturation régulière. Il s'agit là d'un principe posé par la sixième directive européenne, comme l'a rappelé une décision récente de la cour administrative d'appel de Paris (5 ( * )) , aux termes de laquelle "le droit à déduction est exclu pour toute taxe qui ne correspond pas à une opération donnée, soit lorsque cette taxe est plus élevée que cette légalement due , soit lorsque l'opération en cause n'est pas soumise à la TVA." Une simple tolérance de l'administration ne suffit certainement pas pour déroger à cette règle de portée générale.
Cet article tendait donc à donner une base légale à la solution pragmatique souhaitée par les bailleurs. Celle-ci présente toutefois des inconvénients qui ont conduit le gouvernement à y renoncer.
En effet, même si leur droit à déduction était conforté par une disposition légale, les exploitants d'établissements d'hébergement se trouveraient financièrement pénalisés.
D'une part, l'application du taux normal de la TVA en amont d'activités relevant principalement du taux réduit peut entraîner une charge de trésorerie pour les exploitants qui se trouvent en situation de crédit de taxe. Cette situation n'a rien d'exceptionnel dans le secteur de l'hébergement touristique, dont l'activité est très cyclique alors que les loyers sont constants.
D'autre part, une partie de la charge financière résultant de l'application du taux normal à l'ensemble de la location serait définitive pour ceux des exploitants qui ne disposent que d'un droit à récupération partiel. C'est notamment le cas des maisons de retraite dotées de sections de cures médicales, cette partie de leur activité étant exonérée de TVA depuis le 1 er janvier 1996 en application de l'article 28 de la seconde loi de finances rectificative pour 1995.
Une autre solution envisageable pourrait consister à appliquer le taux réduit de la TVA à l'ensemble du loyer, ce qui éviterait d'imposer une charge supplémentaire aux exploitants d'établissements d'hébergement. Mais cette solution ne serait pas conforme à la sixième directive européenne, qui définit précisément et limitativement le champ du taux réduit de la TVA.
En dernière analyse, il semble que la solution la plus satisfaisante serait tout simplement une directive de l'administration fiscale précisant à l'usage des bailleurs et des preneurs les règles de ventilation applicables aux locations d'établissements d'hébergement.
Décision de la commission : votre commission a pris acte du retrait de cet article.
Article 47 - Versement afférent à la délivrance de la carte européenne d'arme à feu
Commentaire : le présent article a pour objet d'assujettir la délivrance de la carte européenne d'arme à feu au versement d'un droit de 50 francs, sous forme de timbre fiscal. II a été voté par l'Assemblée nationale après adoption d'un utile amendement de précision.
La directive du Conseil des communautés européennes relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (n°91/477 du 18 juin 1991) prévoit une harmonisation des règles entre les différents États membres. Elle a aussi pour objectif de préciser les règles s'appliquant au passage des armes et munitions entre États membres. Elle instaure à cet effet un document nouveau, "la carte européenne d'arme à feu".
Le décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 a procédé à la transcription des dispositions de la directive. La délivrance de la carte européenne d'arme à feu par les préfets est prévue à son article 56.
Dans la mesure où la directive précitée de 1991 a procédé à une harmonisation profonde des règles concernant le classement en différentes catégories, l'acquisition et la détention d'armes à feu (dans le cas de la France en conduisant à une réglementation sensiblement plus sévère), l'octroi d'une certaine facilité de circulation pour les personnes détenant légalement des armes est apparue nécessaire.
Le principe général reste cependant que la personne détenant une arme au cours d'un voyage dans un État membre doit être autorisée à le faire par ce dernier. Les articles 87 et 88 du décret du 6 mai 1995 procèdent à la transcription en droit interne de ce principe. Ainsi, dans le cas d'un ressortissant d'un État membre souhaitant voyager en France, la détention d'arme doit être autorisée par le préfet du lieu de destination. L'autorisation peut être donnée pour un ou plusieurs voyages et pour une période maximale d'un an. Comme le fait observer judicieusement le rapporteur de l'Assemblée nationale, la procédure ainsi mise en place est particulièrement lourde, sachant notamment le degré d'encombrement des préfectures en la matière.
Pour faciliter les déplacements des chasseurs et des tireurs sportifs, a été mise en place la carte européenne d'arme à feu. Elle leur permet "de détenir sans autorisation préalable, une ou plusieurs armes à feu relevant du régime général, en vue de pratiquer leur activité à condition qu'ils soient en possession de la carte européenne d'arme à feu et puissent justifier qu'ils voyagent dans un but de chasse ou de tir sportif (article 87, alinéa second du décret n° 95-589).
Cette carte européenne "est délivrée par le préfet du lieu du domicile à toute personne légalement détentrice ou utilisatrice d'armes à feu, de nationalité française ou possédant la qualité de résident en France, qui en fait la demande" (article 85, alinéa premier du décret n° 95-589). Sa durée de validité est fixée à cinq ans. Cette durée peut être portée à dix ans si ne figurent sur la carte que certains types d'armes (armes de 5ème catégorie non soumises à déclaration).
Le présent article a pour objet d'assortir la délivrance de là carte européenne d'arme à feu d'un versement de 50 francs, sous la forme de timbre fiscal. La taxe porte sur la carte elle-même et donc est indépendante du nombre d'armes mentionnées.
Selon les estimations fournies par le ministère de l'Intérieur au rapporteur de l'Assemblée nationale, le nombre de titulaires potentiels de cette carte serait évalué à 100.000. Sur 1,65 million de chasseurs en France, environ 50.000 d'entre eux pourraient la solliciter, essentiellement dans les départements frontaliers. Le produit de la taxe est dès lors estimé à 5 millions de francs, soit en moyenne un million de francs par an. Le rendement de cette taxe sera inférieur au coût administratif de la nouvelle procédure , l'Assemblée nationale s'est livré aux calculs suivants :
- l'établissement de la carte européenne d'arme à feu induira des frais, supportés par le budget de fonctionnement des préfectures. Le coût unitaire du document sécurisé fabriqué par l'Imprimerie nationale (qui comprendra 16 pages) sera de 10 francs ;
- par ailleurs, un certain nombre d'investissements sont nécessaires. L'équipement des cent préfectures pour l'édition automatisée du document est évalué à 5 millions de francs par le ministère de l'intérieur. Par ailleurs, l'étude et la réalisation du logiciel chargé de prendre en compte les fichiers de détenteurs d'armes coûteraient 5 millions de francs, dont 1,1 million dès 1996.
Le Sénat ne manquera pas de mérite à se convaincre que l'obligation de détenir un document administratif supplémentaire justifiant une démarche à la préfecture et la nécessité de verser une taxe fiscale de plus soient indispensables à la mise en oeuvre du marché unique et à la préservation de l'ordre public en Europe.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 48 (retiré) - Prorogation de la suspension des poursuites en faveur des rapatriés réinstallés
Commentaire : cet article a été retiré par le Gouvernement parce qu'il * perdu son objet depuis le dépôt du présent projet de loi.
Cet article proposait de proroger jusqu'au 30 juin 1996 les dispositions de l'article 22 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, qui a prolongé jusqu'au 31 décembre 1995 la suspension des poursuites en faveur des rapatriés réinstallés et surendettés.
Toutefois, avant le dépôt du présent projet de loi, cette prorogation a fait l'objet d'une proposition de loi de nos collègues MM. José Balarello, Guy Cabanel, Jean-Pierre Camoin et René Marquès ( 6 ( * )) qui a été successivement adoptée par le Sénat le 25 janvier 1996, puis par l'Assemblée nationale le 8 février 1996, pour devenir la loi n° 96-110 du 14 février 1996.
Il s'agit de la sixième prorogation de la mesure de suspension des poursuites votée initialement en 1989.
Le texte d'initiative parlementaire laissera six mois de plus que le projet gouvernemental aux commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés (CODAIR) pour régler les 350 derniers dossiers restants, puisqu'il proroge les dispositions concernées jusqu'au 31 décembre 1996.
La commission des Finances de l'Assemblée nationale avait tiré les conséquences de cette course de vitesse remportée par le Parlement, et voté la suppression de cet article. Le Gouvernement, reprenant les devants, a préféré le retirer.
Décision de la commission : votre commission a pris acte du retrait de cet article.
Article 49 - Modifications du code des assurances
Commentaire : Le présent article procède à deux modifications, indépendantes, du code des assurances : d'une part, la suppression des dérogations accordées à d'autres personnes que l'État pour l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, d'autre part l'abrogation de dispositions relatives au fonds de revalorisation des rentes d'accidents de la circulation.
I. LA SUPPRESSION DES DÉROGATIONS ACCORDÉES AUX PERSONNES AUTRES QUE L'ÉTAT POUR L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR
A. LE PRINCIPE DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE
L'article L. 211-1 du code des assurances impose une obligation de s'assurer "à toute personne physique et toute personne morale autre que l'État dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques en semi-remorques, est impliqué" (7 ( * )) .
B. LES DÉROGATIONS
1. Le cadre
L'article 211-3 prévoit une possibilité de dérogation à l'obligation d'assurance :
- partielle ou totale,
- accordée par l'autorité administrative par arrêté ministériel (article R. 211-1),
- aux collectivités publiques, entreprises ou organismes "justifiant de garanties financières suffisantes".
2. Les effets
En cas de dommages causés par un de leurs véhicules, les personnes ayant obtenu la dérogation sont soumis aux mêmes obligations que l'assureur.
3. Les bénéficiaires
Une trentaine de bénéficiaires ont été dénombrés depuis les débuts de ce système. En juin 1994, dix bénéficiaires ont été recensés, pour un parc d'environ 120.000 voitures.
C. L'EXTINCTION DU DISPOSITIF DE DÉROGATION
Selon la Direction du Trésor, les dérogatoires ont été informés de l'extinction progressive du dispositif, les dérogations valables 3 ans n'étant plus renouvelées au-delà de 1996.
Le gouvernement justifie cette décision par la distorsion de concurrence créée par le non-paiement de la taxe sur les conventions d'assurance (8 ( * )) , mais aussi et surtout par le risque financier potentiel encouru par les dérogataires en cas de sinistre.
Il subsiste aujourd'hui quatre dérogataires : l'INRA (1.300 véhicules), la SNCF (3.400 véhicules ne circulant pas sur la voie publique), la ville de Paris (4.400 véhicules) et surtout la RATP (4.500 véhicules dont environ 4.000 bus).
II. L'ABROGATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU FONDS DE REVALORISATION DE CERTAINES RENTES D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
La loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 disposait que la caisse centrale de réassurance assurait la gestion du fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, à compter du 1 er janvier 1975.
Ce fonds, créé par une loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, finançait les majorations de rentes allouées en réparation de préjudice causé par un véhicule à moteur, dont le service incombait aux sociétés d'assurance. Il était financé par une contribution additionnelle proportionnelle aux contrats d'assurance de véhicules.
L'article 42 de la loi de finances pour 1990 a transféré le service de la revalorisation des rentes à l'État, et le décret d'application de cet article, du 6 février 1990, a créé un compte de liquidation du fonds, géré par la caisse centrale de réassurance, qui était amené à être clos par décision du ministre de l'économie et des finances. Cette clôture est intervenue et a été notifiée le 26 août 1994.
Dès lors, l'article 49 du présent projet de loi propose d'abroger l'article L. 431-13 du code des assurances, qui attribuait la gestion du fonds à la caisse centrale de réassurance (par codification de l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974).
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 49 bis (nouveau) - Disposition relative au tableau d'amortissement des offres de prêts immobiliers
Commentaire : Inséré à l'initiative du rapporteur général de la commission des finances, M. Philippe Auberger, le présent article a pour objet de valider les offres de prêts au logement des particuliers dans la mesure où elles seraient contestées pour n'avoir pas mentionné l'échéancier des amortissements.
L'article L 312-8 du code de la consommation prévoit qu'une offre de prêt à un particulier doit préciser "la nature, l'objet, les modalités du prêt notamment celles qui sont relatives aux droits et conditions de mise à disposition des fonds ainsi qu'à l'échéancier des amortissements".
A propos de l'échéancier, la loi prescrit seulement que l'offre doit en préciser les modalités. Elle ne dit pas nécessairement qu'à ce stade, l'échéancier lui-même doive être mis à disposition.
Cependant, le texte de l'article L.312-8 paraît dans ces conditions difficile à appliquer, car que peut-on entendre par "modalités relatives à l'échéancier des amortissements" ? Cette expression peut signifier que l'établissement doit préciser, au stade de l'offre, si les remboursements seront mensuels ou trimestriels ou selon toute autre périodicité, mais aussi la répartition des paiements en capital et en intérêt selon ces périodes.
La plupart des établissements de crédit n'ont retenu que la première idée : les offres de prêt ont donc le plus souvent comporté la durée. la périodicité, le montant de l'échéance, sans préciser quelle serait la répartition des échéances en capital et en intérêts, et son évolution.
Ce n'est pas cette interprétation qu'a retenue la Cour de cassation dans deux arrêts de 1994 : l'un du 16 mars et le second du 20 juillet. La Cour a estimé le 16 mars que l'offre devait préciser "pour chaque échéance, la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts." Selon cette interprétation, les établissements doivent, et auraient dû, produire dès le stade de l'offre un échéancier, détaillant pour chaque échéance, la répartition de la charge entre capital et intérêts.
Confirmant son interprétation le 20 juillet, la Cour a alors considéré que la loi était d'ordre public et que par conséquent son interprétation devrait s'appliquer à tous les prêts accordés depuis la loi "Scrivener" n° 79-596 du 13 juillet 1979. Le non-respect de cette disposition est une cause de nullité du contrat, et surtout entraîne la "déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur"
L'immense majorité des emprunteurs n'a pas considéré que cette absence d'échéancier au moment de l'offre a pu leur provoquer un grief qui justifierait de leur part que soit mis un terme à leur contrat, que l'établissement doive leur rembourser les intérêts et qu'en contrepartie ces emprunteurs doivent rembourser le capital.
Cependant, dès lors que cette jurisprudence existe, elle peut intéresser des emprunteurs qui, proches ou non de l'échéance de leur prêt, pourraient le rembourser par anticipation sans pénalité, éventuellement pour en contracter un autre à un taux plus bas.
Les établissements de crédit font état d'une somme très élevée qui pourrait être en jeu, 2.000 milliards de francs, dont environ 1.600 milliards de francs de crédits à l'habitat. Il est en réalité très peu probable que des millions d'emprunteurs se précipitent dans un contentieux, pour obtenir, au bout d'une durée plus ou moins longue, un gain hypothétique.
Le risque ne doit cependant pas être négligé : le grief qui serait alors fait au système bancaire serait sans commune mesure avec celui subi par les emprunteurs.
L'Assemblée nationale a donc souhaité valider les prêts, uniquement dans la mesure où ils n'auraient pas respecté le 2° de l'article L.312-8 tel qu'interprété par la Cour de cassation.
Votre rapporteur n'est pas hostile à cette validation. Il ne serait en effet pas opportun que des emprunteurs qui n'ont pas subi d'inconvénients réels s'en découvrent subitement à la suite de cette jurisprudence.
Cependant, deux difficultés surgissent.
D'une part, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale ne paraît pas opérante. Conformément à une réponse ministérielle publiée au J.O. du 5 avril 1982, il y est question d'échéances annuelles (or, les prêts à la consommation ou au logement ne comportent pas cette périodicité), du capital restant dû en fin d'année et du montant des intérêts et frais accessoires sur ensemble de la période du prêt. En réalité, la plupart des prêts accordés de 1979 à 1994 ne comportaient pas tout ou partie de ces trois éléments.
D'autre part, il convient de s'assurer, au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de validation législative, que l'intérêt général peut commander une telle validation. Il y a en effet d'un côté l'intérêt du système bancaire, de l'autre celui des emprunteurs, souvent des accédants à la propriété.
Afin de résoudre ces deux difficultés, votre commission préfère surseoir à sa décision.
Décision de la commission : votre commission a décidé de reporter à une date ultérieure sa décision sur le présent article.
Article 49 ter (nouveau) - Création d'une commission de la transparence de l'assurance catastrophe naturelle
Commentaire : le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de MM. Philippe Mathot et Thierry Mariani, tend à créer auprès du Conseil national des assurances une commission chargée de la transparence de l'assurance catastrophe naturelle.
Nos collègues députés Philippe Mathot et Thierry Mariani ont été, en 1994, respectivement président et rapporteur de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les inondations qui a donné lieu à un remarquable rapport, publié le 4 novembre 1994 (9 ( * )) .
Par la suite, M. Thierry Mariani a déposé, le 6 novembre 1995, une proposition de loi dont l'objet est très proche du présent article. Cette proposition fait état d'une inquiétude légitime. Mais le moyen choisi pour y remédier n'est peut-être pas le plus approprié.
I. UNE INQUIÉTUDE LÉGITIME
L'objectif essentiel de notre collègue est de mieux cerner les frais généraux et les coûts d'intermédiation du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, dont le montant (plus de 25 % des primes collectées) lui apparaît difficilement justifiable, dans la mesure où les surprimes relatives aux catastrophes naturelles constituent une tarification accessoire applicable à un contrat principal et qu'elles sont obligatoirement incluses dans les contrats d'assurance-dommage.
Organisé de façon à permettre la couverture de l'ensemble des assurés, le régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles est fondé sur le principe de solidarité. Pour ce faire, la loi prévoit que la garantie catastrophes naturelles est couverte par une surprime uniforme par catégorie de contrats, fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Le taux de droit commun est actuellement de 9 %.
Le principe de solidarité sur lequel repose le régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles est mis en oeuvre grâce à la garantie financière de l'État, par le biais de la caisse centrale de réassurances (CCR).
Lorsque les pouvoirs publics reconnaissent l'état de catastrophe naturelle, les entreprises d'assurance procèdent à l'indemnisation directe des victimes, en contrepartie de la collecte de la surprime.
Les commissions versées aux intermédiaires et les frais de fonctionnement à la charge des entreprises d'assurance pour la gestion du régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles s'élèvent à 10,9 milliards sur la période 1982-1994, soit 25,6 % des primes acquises cumulées. L'examen de ce taux année par année à partir des états comptables agrégés par la commission de contrôle des assurances témoigne de faibles fluctuations autour de cette valeur moyenne. Le ratio sinistres/primes, qui permet de calculer la part des primes consacrées au règlement des sinistres, s'élève à 55,4 %, selon la direction du Trésor, et à 46 % selon la proposition de loi.
Notre collègue Mariani paraît donc fondé à juger élevés les frais de gestion de cette branche d'assurance, du fait de son caractère accessoire ; même s'il est vrai que d'autres branches connaissent des niveaux de frais également élevés : 40 % pour la multirisque habitation ; 23 % pour l'automobile.
II. UNE SOLUTION EXCESSIVEMENT LOURDE
Le ministère de l'économie et des finances s'est penché sur le coût de la branche catastrophes naturelles à l'occasion du rapport qui doit être remis prochainement au Parlement en application de la loi sur l'environnement dite "loi Barnier".
Il apparaît que le coût de commercialisation spécifique de l'assurance catastrophes naturelles est faible en raison du caractère accessoire de cette dernière. En particulier, la commission versée aux intermédiaires ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 8 % du montant de la prime (article A 335-19 du code des assurances).
S'agissant des frais de fonctionnement, les entreprises d'assurance reconnaissent que les frais exposés pour l'acquisition des contrats sont très faibles (sinon nuls) et ceux de production (frais d'informatique essentiellement) relativement réduits. Elles soulignent toutefois que les coûts de gestion des sinistres sont particulièrement élevés. Les frais induits par la mobilisation d'équipes envoyées sur place en cas de survenance d'une catastrophe, le coût des expertises ou bien encore une gestion plus longue des dossiers liés à des sinistres complexes peuvent expliquer le taux constaté de 25,6 %.
Le ministère de l'économie et des finances conclut à la difficulté de porter aujourd'hui un jugement plus précis sur le montant des commissions et frais de fonctionnement, en l'absence de chiffres donnant le détail de la répartition des coûts. Il note toutefois que l'entrée en vigueur le 1 er janvier 1995 du nouveau plan comptable de l'assurance, facilitant l'emploi de la comptabilité analytique, pourrait permettre de disposer d'éléments supplémentaires en vue de l'analyse de ces commissions et frais.
Compte tenu des lacunes que reconnaît le ministère, la nécessité d'approfondir la connaissance du dossier paraît justifier la démarche souhaitée par l'Assemblée nationale. Cependant la solution retenue paraît Particulièrement lourde.
La commission se verrait confier des pouvoirs d'investigation qui permettraient à ses membres d'accéder à tout document ou élément d'information détenu par les personnes morales chargées de la gestion des primes.
Ces pouvoirs d'investigation sont exorbitants du droit commun. A l'heure actuelle, seule la commission de contrôle des assurances dispose de ce type de pouvoirs.
Mais, malgré ses pouvoirs, cette commission ne serait pas nécessairement très efficace. Il faudrait pour cela qu'elle dispose de services ; or l'administration n'y est pas représentée. Qu'elle soit composée de personnes directement intéressées par le problème posé n'est pas un gage d'efficacité.
Il existe en revanche une instance compétente pour traiter de ce type de dossier : le Conseil National des Assurances, prévu à l'article L 411-1 du code des assurances, et qui comprend notamment deux parlementaires et huit représentants des assurés.
Par ailleurs, la commission de contrôle des assurances effectue d'ores et déjà un contrôle comptable aussi précis que possible, et traite de la branche catastrophe naturelle dans son rapport annuel.
A ce stade, votre rapporteur observe que les députés n'avaient pas proposé, dans les conclusions de leur commission d'enquête, la création d'une telle commission.
Aussi, même si votre commission n'exclut pas que ce soit finalement la solution à retenir, elle considère qu'il convient de réfléchir de façon approfondie auparavant : il faut atteindre le but qu'a fixé l'Assemblée nationale de la manière la plus efficace.
C'est pourquoi votre commission propose de confier au gouvernement un rapport chargé d'explorer les voies d'un renforcement de la transparence du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, et ce avant le 1 er octobre 1996. Par la suite, et notamment si le rapport ne donnait pas satisfaction, il conviendra de statuer sur une solution éventuelle.
Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Articles 50, 51 et 52 - Dispositions relatives à l'équipement commercial
I. LE CONTEXTE
a) Le droit en vigueur
L'urbanisme commercial est aujourd'hui régi essentiellement par deux textes : la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat dite "loi Royer" et la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques qui, sans changer le champ d'application de la loi Royer, a modifié la procédure des autorisations, précisé les critères de recevabilité et d'appréciation des demandes et créé une nouvelle instance de réflexion et de concertation, l'observatoire national d'équipement commercial (ONEC).
La loi Royer donne pouvoir aux commissions départementales d'urbanisme commercial (CDUC) d'autoriser l'ouverture ou l'extension des surfaces commerciales en fonction de conditions fixées par l'article 29. L'appel de ces décisions était possible auprès du ministre chargé du commerce. La loi de 1993 tout en ne modifiant pas les conditions d'ouverture ou d'extension fixées par l'article 29 de la loi Royer :
- substitue aux CDUC, les commissions départementales d'équipement commercial (CDEC) dont la composition fait une plus large part aux élus (4 contre 3 professionnels ou représentants des consommateurs) ;
- créé la commission nationale d'équipement commercial (CNEC) qui, sur recours, décide en dernier ressort. C'est donc une autorité administrative indépendante dont les décisions sont susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ;
- place auprès des observatoires départementaux de l'équipement commercial (ODEC) chargés d'études et d'analyses, un observatoire national d'équipement commercial (ONEC). Cette instance nationale, qui a été mise en place en novembre 1995, fait la synthèse des travaux des ODEC, publie un rapport annuel et rend des avis sur toute question qui lui est soumise.
Ces dispositions législatives ont eu, depuis 1973, deux effets principaux :
- elles ont contribué incontestablement à la modernisation de l'équipement commercial ;
- en revanche, elles n'ont pas empêché la disparition d'un certain type de commerce (commerce de proximité et de centre-ville) face aux grandes surfaces, bien que ce fût clairement leur objectif premier. Tout au plus, elles ont étalé dans le temps cette mutation et organisé "les files d'attente".
b) La présentation et l'évolution du parc des grandes surfaces
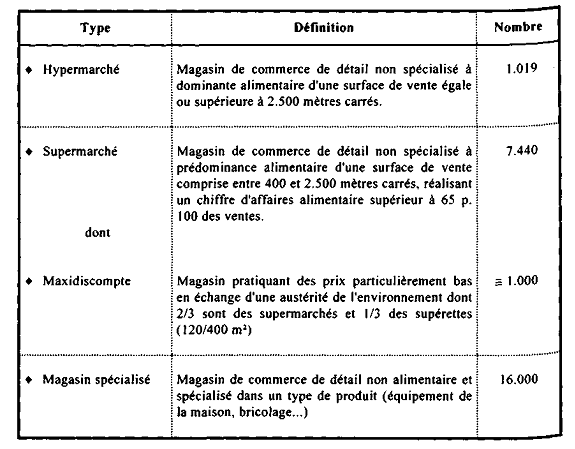
Malgré une volonté politique qui se voulait restrictive, la grande distribution n'a donc pas cessé de se développer.
Les chiffres le démontrent : de 1973 à 1987, ce sont 0,5 million de m 2 qui ont été créés chaque année ; en 1987, le million de m 2 est franchi pour aboutir à une moyenne de 1,8 million par an jusqu'en 1993. Cette année-là, un moratoire décidé par le gouvernement a fait chuter les autorisations à 0,2 million de m 2 ; en 1994, 969.000 m 2 ont été à nouveau autorisés. Le bilan de vingt-trois années d'application de loi Royer fait donc apparaître la part grandissante prise par la grande distribution dans le commerce de détail. La France, de ce point de vue, se distingue de tous les pays européens que ce soit en termes de chiffres d'affaires, de parts de marché ou de concentration géographique. La spécificité française, se caractérise, en outre, par la place prédominante de l'hypermarché polyvalent.
Après le Royaume-Uni, notre pays apparaît, en effet, comme détenant un record, celui de la part de marchés la plus élevée réalisée par le plus petit nombre de magasins. Ainsi, 20 % des magasins les plus importants réalisent 49 % du chiffre d'affaires total du commerce de détail ; 10 % d'entre eux se Partagent 80 % du marché des ventes de détail.
Toutefois, il convient d'observer que, depuis deux ou trois ans, la part des hypermarchés tend à stagner dans le commerce de détail. Ce sont les grandes surfaces maxidiscompte (concept de vente à 390 m 2 ), type ED ou Leader Price, qui connaissent un vif développement. Aujourd'hui, deux ouvertures de supermarché sur trois concernent des maxidiscomptes. Ce constat explique sans doute le choix du nouveau seuil d'autorisation (300 m 2 ) retenu par l'article 50 du projet de loi.
LES OUVERTURES DE SUPERMARCHES DE MAXIDISCOMPTE EN 1989 ET 1994
Effectif en nombre de magasins Surface en milliers de m 2
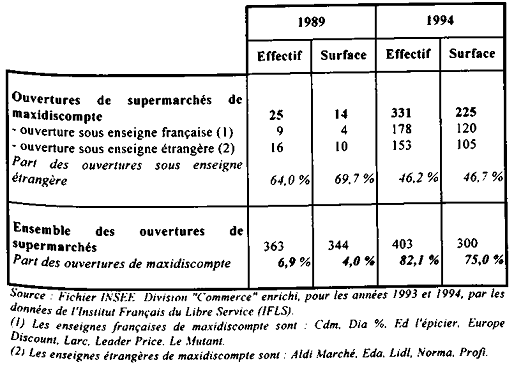
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Cette section du DDOEF comporte trois articles dont l'article 50 qui modifie plusieurs dispositions de la loi Royer relative à l'urbanisme commercial. Il s'agit de mesures transitoires et urgentes destinées à préparer la réforme de la loi Royer annoncée dans le "Plan PME pour la France" par le Premier ministre, le 27 novembre 1995.
Ce projet de réforme devrait modifier en profondeur, dans le sens d'un durcissement, le dispositif mis en place depuis 1973.
Sept dispositions principales sont actuellement à l'étude, dont certaines devraient pérenniser une partie du dispositif transitoire. Il s'agirait :
- d'abaisser à 300 m 2 le seuil des surfaces de vente nécessitant une autorisation préalable (seuil unique) ;
- d'introduire un contrôle pour les changements d'activité des grandes surfaces ;
- d'instaurer une enquête publique préalable, spécifique à l'urbanisme commercial, pour les unités de plus de 6.000 m 2 ;
- d'introduire un critère "emploi" dans l'appréciation des dossiers de demande d'autorisation ;
- d'aggraver les sanctions pour les infractions en cas de non respect des prescriptions des autorisations obtenues ou d'exploitation illégale de surfaces commerciales ;
- de rééquilibrer la composition des commissions départementales d'équipement commercial au profit des professionnels ;
- d'ajouter dans la commission nationale d'équipement commercial un représentant choisi par le ministre du travail en raison de ses compétences en matière d'emploi.
Le dispositif transitoire du présent projet de loi, applicable six mois à compter de la publication de la loi, comporte, quant à lui, quatre mesures principales :
1. le gel temporaire des autorisations pour les seules créations de surfaces de vente.
2. l'abaissement à 300 m 2 de surfaces de vente du seuil d'autorisation se substituant aux seuils existants (1.000 et 1.500 m 2 ) pour :
- les créations,
- les extensions de magasins.
3. l'instauration d'un contrôle pour les changements d'activité.
4. et, enfin, un durcissement des sanctions appliquées aux contrevenants.
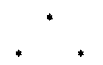
Article 50 - Dispositif transitoire concernant l'urbanisme commercial :
Gel provisoire des créations de grandes surfaces et instauration d'un seuil unique pour les projets d'équipement commercial
Commentaire : cet article modifie les dispositions des articles 29 et 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973.
1. Les créations de surfaces de vente
Le 1°) de cet article contient deux mesures, l'une tend à abaisser le seuil d'autorisation à 300 m 2 , l'autre à geler les demandes d'autorisation pour les opérations concernées.
En effet, les créations, qui comprennent les constructions nouvelles et les transformations d'immeubles, voient leur seuil d'autorisation de surface de vente ramené à 300 m 2 .
Cette mesure instaure un seuil unique. Elle ne reprend donc pas la distinction de l'article 29-1 de la loi Royer qui prévoyait des seuils de surface de vente de 1.500 m 2 et 1.000 m 2 distinguant ainsi les communes de plus ou moins de 40.000 habitants.
En outre, les seuils de surfaces de plancher hors d'oeuvre attachés à ces seuils de surfaces de vente, soit 3.000 m 2 et 2.000 m 2 , deviennent de fait inapplicables en raison du niveau très bas (300 m 2 ) retenu pour le nouveau seuil d'autorisation. En tout état de cause, ce critère -la surface de plancher hors d'oeuvre- était peu pertinent et pratiquement jamais utilisé.
Enfin, pour éviter toute stratégie d'anticipation notamment de la part des maxidiscomptes (surfaces de 390 m 2 en moyenne, spécialisées dans le commerce alimentaire) les demandes d'autorisation sont gelées pendant six mois à partir de la publication de la présente loi et dans l'attente de la réforme de la loi Royer.
2. Les extensions de magasins et les changements de secteur d'activité des commerces de détail
Ces opérations font l'objet du 2°) du présent article qui abaisse le seuil d'autorisation pour les premières et instaure un contrôle pour les secondes.
a) Les extensions - L'article 29-2 de la loi Royer soumet à autorisation tout projet d'extension ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1° de l'article 29 (1.500 m 2 et 1.000 m 2 ) ou devant les atteindre ou les dépasser par la réalisation du projet, si celui-ci porte sur une surface de vente supérieure à 200 m 2 . Le nouveau dispositif prévoit que toute extension au-delà de 300 m 2 de la surface de vente est soumise à autorisation quelle que soit la surface initiale du magasin. Les seuils d'autorisation initiaux sont donc supprimés. La franchise de 200 m 2 est également supprimée par l'application uniforme et absolue d'un seuil d'autorisation pour l'extension du magasin.
A la date de publication de la loi, les projets d'extension nécessitant un permis de construire qui serait en cours d'instruction, devront repasser devant les CDEC et seront donc soumis aux nouveaux critères d'autorisation.
AUTORISATION ABSENCE D'AUTORISATION
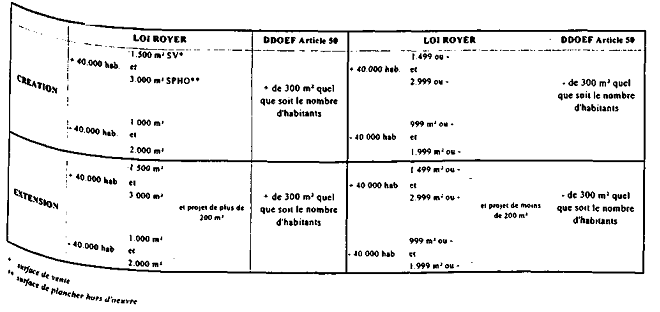
Contrairement aux créations, les extensions ne sont donc pas concernées par la mesure de gel, alors qu'elles peuvent avoir les mêmes conséquences économiques et sociales que les créations sur le commerce de proximité. Toutefois, étendre le gel aux extensions de surfaces pouvait présenter un risque de censure du Conseil constitutionnel au regard du principe de la liberté du commerce. L'interdiction aurait pris, en effet, un caractère plus général et plus absolu. Par ailleurs, la mesure de gel concernant les créations porte à la fois sur le commerce de détail alimentaire et non alimentaire et semble donc suffisante quant à son étendue.
b) Les changements d'activité. Le présent article introduit une disposition nouvelle par rapport à la loi Royer qui n'avait édicté aucune règle concernant les changements d'activité. Le Conseil d'État, saisi pour interprétation de l'article 29 avait d'ailleurs rendu un avis le 28 octobre 1975 par lequel il avait précisé que "la loi d'orientation ne subordonne pas à autorisation la modification de la nature du commerce d'un magasin de détail existant (...) car l'article 29 ne concerne que la modification substantielle des projets avant leur réalisation".
Cette disposition vient donc combler une lacune et vise ainsi à mettre fin à de nombreuses fraudes à l'esprit de la loi constatées au cours de ces dernières années. C'est pourquoi une proposition de loi (n° 282, Sénat 1994-1995) présentée par M. Philippe Marini et plusieurs de nos collègues avait déjà proposé de contrôler les changements d'activité, dans une rédaction proche de celle du présent projet.
Les seuils d'autorisation sont fixés de la façon suivante :
- 300 m 2 pour les commerces à dominante alimentaire,
- 1.500 m 2 pour les commerces à dominante non alimentaire.
Ces seuils prennent en compte, pour le premier, le niveau général d'autorisation retenu par le présent article et pour le second, la nature des activités exercées.
Le contrôle de changements de destination constitue un problème complexe nécessitant une étude juridique approfondie. Un décret en Conseil d'État en réglera les modalités pratiques. Les critères choisis devront être tout à la fois assez larges, pour tenir compte des exigences du marché, et stricts, pour éviter les fraudes.
La parution de ce décret devra être rapide pour assurer une meilleure efficacité à ce dispositif qui a pour but essentiel d'être dissuasif.
- les commerces de détail non alimentaire en magasin spécialisé tels que l'hygiène, la culture, le sport, l'équipement de la maison...etc.
A cet égard, les déclarations d'activités faites à l'ORGANIC devraient constituer une base de contrôle des surfaces et des activités.
Toutefois, le régime déclaratif auquel sont soumis les redevables de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ne concerne que les surfaces de vente de 400 m 2 et plus ; au regard du nouveau seuil défini par le présent projet de loi (300 m 2 ), il apparaît donc indispensable de modifier l'article 4 de la loi n° 72-657 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ; votre commission vous proposera un amendement en ce sens.
3. Le délai d'instruction des commissions départementales d'équipement commercial (CDEC)
L'article 32 de la loi Royer prévoit que la CDEC doit statuer sur les demandes d'autorisation dans un délai de trois mois. Passé ce délai, autorisation est réputée accordée.
Le nouveau dispositif fait passer le délai d'examen des dossiers par les CDEC de trois à quatre mois. Cette mesure se justifie par les motifs suivants :
- un abaissement des seuils d'autorisation tel que le nombre des dossiers traités va augmenter sensiblement.
- l'harmonisation du délai laissé aux CDEC avec celui dont dispose la commission nationale d'équipement commercial (CNEC) qui constitue l'instance d'appel des décisions des CDEC.
4. Les sanctions
Le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 (article 40) définit le régime des sanctions applicables en cas d'utilisation illégale des surfaces commerciales ou de non respect des prescriptions de l'autorisation obtenue.
Actuellement, la sanction applicable est une amende de la catégorie des contraventions de 5ème classe, (article 131-3 du code pénal) dont le maximum est fixée à 10.000 F. Elle est appliquée quelle que soit la surface utilisée mais peut être constatée pour chaque jour d'exploitation. La sanction est donc financièrement peu dissuasive sauf à demander à l'administration de constater quotidiennement l'infraction !
Par ailleurs, la possibilité donnée par l'article 40 du décret du 9 mars 1993 de pouvoir confisquer totalement ou partiellement les meubles et marchandises présentés à la vente est peu utilisée, malgré son caractère dissuasif.
Au vu de ces remarques, il semble nécessaire d'aggraver les sanctions actuellement prévues d'autant plus que les informations transmises par l'administration donnent à penser que les infractions sont assez fréquentes.
Le présent article vise donc à alourdir les sanctions en cas de violation des dispositions de la loi Rover. Il faut noter, tout d'abord, que ce durcissement des sanctions se place dans le cadre du nouveau régime d'autorisation, plus drastique que celui actuellement en vigueur et donc de nature à renforcer le caractère dissuasif des dispositions prévues.
L'article 50 du présent projet de loi indique que les autorisations sont données par mètre carré. Les sanctions, qui restent des contraventions de 5ème classe, seront donc appliquées par mètre carré en infraction. Comme actuellement dans le droit en vigueur, elles pourront être constatées par jour et donner lieu à une confiscation totale ou partielle des meubles et marchandises.
Le choix d'une application par mètre carré en infraction accroît considérablement le poids de la sanction, donc son efficacité théorique. Actuellement pour un dépassement de 1.000 m 2 de l'autorisation donnée, l'amende peut atteindre 10.000 F ; le présent projet de loi multiplierait par mille l'amende, soit dix millions de francs.
Toutefois, il faut souligner que le poids relatif de la sanction prévue diminue avec la taille du magasin. Le commerce de détail fonctionne en effet sur un régime de rendements croissants.
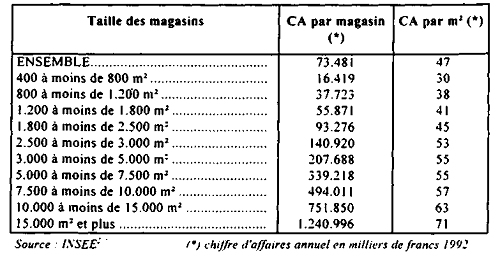
L'efficacité dissuasive de la sanction est donc inversement proportionnelle à la taille du magasin.
Cependant, la solution choisie par le présent projet de loi semble la mieux adaptée. En effet, sa nature réglementaire -il s'agit d'une contravention de 5 ème classe et non d'un délit- permet une application, si nécessaire, par jour d'exploitation. En outre, si son quantum (10.000 F par m 2 ) peu paraître élevé, il faut souligner que le juge a un pouvoir d'appréciation et qu'il s'agit donc d'un maximum ; enfin le juge pourra tenir compte, s'il le croit utile, du chiffre d'affaires réalisé par la surface de vente en cause.
Le nouveau régime de sanction, compte tenu du principe de la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère, ne s'appliquera pas :
- aux surfaces déjà exploitées sans autorisation avant la date de publication de la présente loi (moins de 1.500 m 2 et moins de 1.000 m 2 pour les communes de plus de 40.000 habitants et moins de 40.000 habitants) :
- aux surfaces déjà exploitées et utilisées de manière illégale par extension de la surface de vente même si l'autorisation donnée spécifiait le nombre de mètres carrés sur laquelle elle portait.
La lisibilité du nouveau dispositif risque d'en pâtir, ce qui peut paraître contradictoire avec le renforcement des sanctions prévues par le présent article.
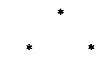
A cet article, l'Assemblée nationale a adopté, outre deux amendements rédactionnels, deux amendements de fond présentés respectivement par M. Hervé Novelli et M. Francis Saint-Hellier introduisant un 3° (nouveau) et un 4° (nouveau).
Le 3° (nouveau) prévoit d'annuler les projets de construction nouvelle faisant l'objet d'un contentieux juridictionnel à compter de la publication de la présente loi. Cette disposition aurait pour conséquence d'étendre la mesure de gel des autorisations de création de grandes surfaces non seulement aux projets non encore examinés ou en cours d'examen devant commissions départementales et la commission nationale d'équipement commercial, mais également aux décisions d'autorisations attaquées devant le Conseil d'État, instance de recours de la CNEC. Cette disposition, qui va à l'encontre de la règle de non-rétroactivité, remet en cause les droits acquis par acteurs économiques. En outre, elle risque de multiplier les dépôts de recours entre le vote et la publication de la loi.
Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose par voie d' amendement de supprimer le 3° de cet article.
Le 4° (nouveau) vise à soumettre à autorisation de la CDEC tout projet de complexe cinématographique comportant plus de mille places. Cette mesure paraît prématurée et inadaptée. Prématurée, car le ministre de la culture a mis récemment en place un groupe de travail sur le devenir des cinémas de centre-ville, groupe qui n'a pas encore rendu ses conclusions. Il n'est donc pas très satisfaisant de légiférer sur un sujet aussi complexe qui requiert le temps de la réflexion. Par ailleurs, il semble difficile d'assimiler ces complexes culturels à des grandes surfaces commerciales même si la création de ces géants cinématographiques peut, à terme, entraîner une désertification culturelle des centres-villes avec toutes ses conséquences économiques pour les commerces de proximité. En outre, les dispositions du 4° ne prévoient pas de représentation, au sein des instances de décision (CDEC et CNEC), des professionnels du cinéma. Il convient toutefois de souligner que les auteurs de l'amendement ont eu le mérite d'ouvrir un débat de fond devant le Parlement. Le sujet est complexe et préoccupe bon nombre de maires de villes grandes ou moyennes. La clientèle apprécie les complexes cinématographiques, mais les centre-ville ne se prêtent pas aisément à la création, l'extension ou la transformation de salles de cinéma (problèmes de stationnement, de « tapage nocturne ». de dessertes en transports publics, d'intégration dans les documents d'urbanisme ...) En revanche, l'implantation en périphérie de « mégacomplexes » est souvent plus aisée. Elle est même parfois de nature à drainer une clientèle nouvelle Il importe donc de trouver un équilibre entre le centre-ville et la périphérie. Votre rapporteur général ne manquera pas d'interroger le gouvernement sur les mesures qu'il entend prendre ou accentuer pour favoriser cet équilibre souhaitable
Inadaptée, car l'intention est de viser les complexes cinématographiques (16/17 salles) qui s'installent en périphérie des villes. Or le seuil de mille places, retenu par le paragraphe (4°), correspond plus à des complexes de 5/6 salles, donc de centre-ville, qu'aux grands complexes cinématographiques qu'il prétend contrôler.
Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose de supprimer le 4° de cet article dans l'attente du projet de loi portant réforme de la loi Royer qui pourrait se prononcer sur ces légitimes préoccupations.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 50 - Abaissement du seuil déclaratif d'activité à l'ORGANIC de 400 m2 à 300 m2 pour les surfaces de vente
Commentaire : votre commission vous propose un article additionnel tirant les conséquences de l'article 50 sur le seuil déclaratif d'activité à l'ORGANIC.
Le régime déclaratif auquel sont soumis les redevables de la taxe aide au commerce et à l'artisanat ne concerne actuellement que les surfaces de vente de 400 m 2 et plus ; le présent projet de loi définissant un nouveau seuil pour les autorisations de surface de vente, il apparaît nécessaire de modifier en conséquence l'article 4 de la loi 72-657 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ; votre commission vous propose donc un amendement créant un article additionnel après l'article 50, abaissant de 400 m 2 à 300 m 2 les déclarations d'activité à l'ORGANIC ; il paraît toutefois souhaitable de maintenir l'exigibilité de la taxe pour les seules surfaces de vente de plus de 400 m 2 .
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
Article 51 - Dérogation aux mesures transitoires prévues à l'article 50 du projet de loi
Commentaire : par le présent article, sont exclues du champ d'application de l'article 50 :
- les zones de redynamisation urbaine prévues à l'article 42 de I » loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation et de développement du territoire,
- les agglomérations nouvelles délimitées en fonction de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 ou les communes relevant de l'article 10 de ladite loi.
Dans la mesure où les dispositions de l'article 50 visent à une meilleure maîtrise de l'équipement commercial urbain, il paraît souhaitable d'encourager l'implantation de surfaces de vente pour le commerce de détail dans les zones urbaines où elles ont disparu ou sont en voie de disparition.
Le présent article exclut donc du dispositif restrictif de l'article 50 les "zones de redynamisation urbaine" et les agglomérations nouvelles. Celles-ci resteront soumises aux dispositions actuelles de la loi Royer, et relèveront donc de la compétence des CDEC et de la CNEC pour les surfaces de vente supérieures à 1.500 m 2 ou 1.000 m 2 .
Après la réforme de la loi Royer et donc la pérennisation des mesures prévues à l'article 50, ces zones devraient relever du nouveau dispositif et se voir appliquer le seuil général d'autorisation de 300 m 2 , ce qui semble compatible avec les objectifs d'aménagement définis pour ces zones.
A. LES ZONES DE REDYNAMISATION URBAINE
Elles sont définies par le second alinéa du paragraphe 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1994.
Les zones de redynamisation sont incluses dans les zones urbaines sensibles. Ces dernières sont au nombre de 546 tel qu'établi par le décret du 5 février 1993. 350 zones de redynamisation urbaine devraient être définies par un arrêté dont la parution est prévue dans quelques semaines.
Les zones urbaines sensibles sont caractérisées par la présence de grands ensembles, de quartiers d'habitat dégradés ou par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi. Les zones de redynamisation urbaine s'en distinguent par des difficultés particulières et correspondent aux quartiers difficiles des communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU).
Le développement de ces zones constitue un des volets important du pacte de relance pour la Ville présenté à Marseille, le 18 janvier 1996, par le Premier ministre, qui prévoit diverses mesures en faveur de l'activité économique et de l'emploi.
Toutefois, au regard de la pratique de délimitation des "zones de redynamisation urbaine", il aurait sans doute été préférable de les inclure dans le dispositif de l'article 50. En effet, ces zones où s'appliquent nombre de mesures fiscales avantageuses pour les redevables ont un périmètre défini assez diversement selon les collectivités concernées ; ne pas appliquer les mesures de gel et d'abaissement du seuil d'autorisation pourrait ne pas être favorable au commerce de détail de proximité dans ces zones au tissu économique déjà fragile.
B. LES AGGLOMÉRATIONS NOUVELLES DÉLIMITÉES EN APPLICATION DE LA LOI N° 83-636 DU 13 JUILLET 1983
Elles comprennent les 58 communes situées à l'intérieur du périmètre de compétence des établissements publics d'aménagement des agglomérations nouvelles. Actuellement ces établissements sont au nombre de dix :
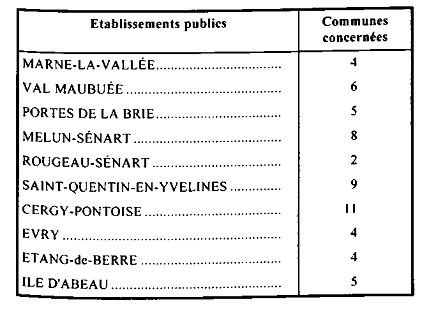
Il paraît normal d'exclure ces zones du dispositif de l'article 50 puisqu'elles sont dotées de plans propres d'aménagement à long terme dont l'équipement commercial est l'un des volets. Plus particulièrement à Marne-la-Vallée, les projets d'équipements commerciaux d'Eurodisney risqueraient d'être freinés voire stoppés en cas de modification même provisoire des dispositions législatives actuellement en vigueur.
Toutefois, on peut regretter que les centres-villes ne soient pas, eux aussi, exclus du champ d'application de l'article 50.
Des amendements tendant à inclure les centre-ville dans le texte de l'article 51 ont été rejetés en séance publique à l'Assemblée nationale au motif que la notion de centre-ville n'était pas "stable" juridiquement ; le Gouvernement a précisé qu'il était attentif à cette question et a proposé la création d'un groupe de travail sur ce sujet. Actuellement, la définition qui semblerait la plus pertinente sur le plan juridique serait celle des centres urbains dotés de ZAC dans les communes de plus de 25.000 habitants. En effet, ces centres urbains fixent des objectifs précis en matière d'habitat et de commerce.
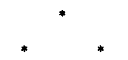
L'Assemblée nationale a adopté, à cet article, un amendement de MM. Raoul Beteille et Gilles Carrez ajoutant un quatrième alinéa concernant la ZAC d'État sur le site du Cornillon Nord à Saint-Denis. Il s'agit des équipements commerciaux entourant le Grand Stade. Le gel des installations commerciales dans cette zone nuirait aux efforts déjà engagés et risquerait de freiner un projet d'aménagement qui a des difficultés à trouver son financement.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 52 - Prorogation du mandat des membres de la commission nationale d'équipement commercial (CNEC)
Commentaire : la commission nationale d'équipement commercial (CNEC) est composée de 7 membres et statue sur les recours engagés contre les décisions des commissions départementales ; depuis la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, elle rend des décisions et non plus des avis précédant une décision ministérielle.
L'article 33 de la loi Royer prévoit actuellement que les membres de la commission nationale sont nommés pour trois ans non renouvelables.
Nommés le 26 mars 1993 par arrêté du 27 mars 1993 après la réforme de l'article 33 de la loi Royer par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, leur mandat arrivera donc à expiration le 26 mars 1996.
Le présent article proroge de six mois à compter de la publication de la présente loi le mandat des membres de la CNEC. Cette disposition a pour but d'attendre la réforme de la loi Royer qui doit modifier la composition de la commission nationale. Par ailleurs, cela permettra l'application du dispositif transitoire de l'article 50 sans bouleverser concomitamment les instances de décision.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision permettant le maintien de la CNEC entre la fin de son mandat (26 mars 1996) et la date de publication de la loi. En effet, dans la rédaction initiale, en cas de publication de la loi postérieure au 26 mars, la CNEC n'aurait plus eu d'existence légale.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 53 - Participation des chefs d'exploitation agricole au financement de la formation professionnelle continue
Commentaire : Cet article additionnel, introduit par le gouvernement à l'Assemblée nationale, vise à fixer pour 1995 et pour les années suivantes la contribution des chefs d'exploitation agricole au financement de la formation professionnelle continue.
La loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi a institué pour les membres des professions non salariées une contribution destinée à financer leur formation professionnelle.
Dans le secteur agricole, cette contribution fait l'objet d'un cadre spécifique défini par l'article L. 953-3 du code du travail. Cet article dispose que "pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 953-1 est calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire déterminée à l'article 1003-12 du code rural. Son taux ne peut être inférieur à 0,20 % pour l'année 1993 et 0,30 % pour l'année 1994, dans la limite d'une somme dont le montant minimal et maximal est fixé par décret par référence au montant prévu au troisième alinéa de l'article L. 953-1. "
Cet article L. 953-3, qui résulte de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, ne fixe la contribution exigible que pour les années 1993 et 1994. L'année 1995 a été "oubliée". Il est donc proposé au Parlement de réparer cet "oubli" dans la mesure où les contributions 1995 ont été appelées et recouvrées. Comme l'indique l'exposé des motifs de l'amendement : "les dispositions de cet article prévoient notamment les taux de la contribution pour les seules années 1993 et 1994. S'agissant d'une contribution à caractère pérenne, il est nécessaire d'en prévoir le taux pour l'année 1995 et les suivantes. Il est proposé à cet effet de proroger le taux de 1994. "
Il subsiste toutefois une apparente discordance entre l'exposé des motifs de l'amendement qui prévoit une fixation rétroactive du taux applicable en 1995 et le libellé de l'article additionnel qui ne dispose pas pour le passé. Dans l'hypothèse où la contribution 1995 manquerait de base légale, car la rédaction de la loi de 1993 est ambiguë, ou n'aurait pas été complètement recouvrée, l'adoption du présent article vaudrait intention du Parlement d'y pourvoir.
Par ailleurs, pour une meilleure lisibilité du texte, il est proposé d'inscrire le principe du droit à la formation professionnelle continue dans le corps même de l'article L. 953-3 et non pas par renvoi à l'article L. 953-1 du code du travail.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 54 (nouveau) - Cas de vacance des administrateurs élus par les salariés dans les sociétés anonymes
Commentaire : Le présent article tend à étendre la liste des cas de vacance des administrateurs élus par les salariés dans les sociétés anonymes, donnant lieu aux procédures de remplacement prévues par l'article 97-8 de la loi du 24 juillet 1966 (modifiée par l'ordonnance n° 86-1135 du 21 octobre 1986).
L'article 97-1 de la loi du 24 juillet 1966 prévoit que les statuts des sociétés anonymes peuvent stipuler que les conseils d'administration comprennent, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles 89 et 90, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est situé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être supérieur à quatre ou, dans les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs, cinq, ni excéder le tiers du nombre des autres administrateurs. Les administrateurs élus par les salariés doivent être titulaires d'un contrat de travail avec la société ou l'une de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est situé sur le territoire français, antérieur de deux années au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif.
L'article 97-8 de la loi du 24 juillet 1966 dispose, quant à lui, qu'en cas de vacance, par décès, démission, révocation ou rupture du contrat de travail, d'un siège d'administrateur élu par les salariés, le siège vacant est pourvu de la manière suivante :
- lorsque l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire à deux tours, par le remplaçant ;
- lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu.
Le mandat de l'administrateur ainsi désigné prend fin à l'arrivée du terme normal du mandat des autres administrateurs élus par les salariés.
Rappelons qu'en ce qui concerne les administrateurs "de droit commun", c'est-à-dire nommés par l'assemblée générale constitutive ou l'assemblée générale ordinaire, l'article 94 de la loi précitée prévoit simplement qu'en cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil.
Dans l'exposé des motifs de l'amendement qui a donné lieu à l'insertion de l'article 54 nouveau, le député Gilbert Gantier a relevé que la loi du 24 juillet 1966 n'avait expressément envisagé le remplacement des administrateurs salariés que dans les cas de décès, démission, révocation ou rupture du contrat de travail, laissant subsister une incertitude sur les autres cas de vacance, en particulier sur les cas d'annulation de l'élection d'un ou plusieurs administrateurs salariés. Soulignant que les jugements annulation des élections des administrateurs salariés (rendus en premier et entier ressort par les tribunaux d'instance) sont immédiatement exécutoires, nonobstant le pourvoi en cassation, M. Gantier a fait valoir que la représentation des administrateurs salariés au conseil d'administration risquait de ne plus être assurée dans les conditions prévues aux statuts dès lors que la Cour de cassation ne s'était pas encore prononcée sur le pourvoi formé contre de telles décisions.
L'amendement remplace donc, dans le premier alinéa de l'article 97-8, les mots "ou rupture du contrat de travail" par les mots "rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit".
Le rapporteur général de la commission des finances, puis le Gouvernement, ont donné un avis favorable à cet amendement qui a été adopté par l'Assemblée nationale.
L'article 54 nouveau remédie donc à la vacance du siège de l'administrateur élu jusqu'à l'arrêt définitif en cas de pourvoi.
Au cas où la Cour de cassation casserait l'invalidation prononcée par tribunal d'instance, le siège de l'administrateur ne serait pas pour autant disputé entre les deux titulaires. En effet, aux termes de l'article 625 du nouveau code de procédure civile : "Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire."
Comme le rapporteur général de l'Assemblée nationale, votre rapporteur regrette, cependant, que la loi sur les sociétés commerciales soit modifiée, même sur un point minime, à l'occasion d'un DDOEF.
La Chancellerie ayant donné son accord à l'amendement, votre commission des finances vous propose de retenir le dispositif adopté par l'Assemblée nationale.
Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 55 (nouveau) - Aménagement du monopole de Gaz de France
Commentaire : Issu d'un amendement du gouvernement, le présent article a pour objet d'autoriser l'extension du périmètre d'intervention des régies municipales de gaz aux communes connexes non encore desservies par un réseau public de gaz.
I - RÉGIME ACTUEL
La loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz a, dans son article 23, prévu une dérogation au monopole et autorisé le maintien des services publics locaux de distribution du gaz en cours d'exploitation à la date de promulgation de la loi.
Il s'agissait des services locaux exploités sous forme de régies, de sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités détenaient plus de la majorité du capital, ou bien de SICAE (Sociétés d'intérêt collectif agricole pour l'électricité) ou de coopératives d'usagers.
L'article 88 de la loi d'orientation relative à l'administration territoriale de la République du 6 février 1992 a réaffirmé ce principe en l'inscrivant à l'article L. 374-2 du code des communes.
Ce dernier article a également permis une régularisation de la situation en vigueur au 1 er juillet 1991. Il a autorisé les régies créées après la loi de 1946. En effet, l'ambiguïté de la rédaction de l'article 23 a permis la création de nouvelles régies, ou l'extension de régies existantes, alors que les travaux préparatoires de la loi de nationalisation semblaient clairement en interdire la possibilité. De fait, le nombre de situations "irrégulières" était faible en 1991 : trois régies créées à Aire-sur-Adour dans les Landes en 1957, à la Réole en Gironde en 1961 et à Brou en Eure-et-Loir en 1963, deux pensions de régies existantes à Bordeaux (sur 35 communes voisines) et à Dreux (sur 10 communes), deux régies municipales d'électricité ayant étendu leur activité à la distribution du gaz à Bonneville en Haute-Savoie (1986) et à Villard-Bonnot en Isère (1988).
Aujourd'hui, la distribution non nationalisée du gaz concerne environ 400.000 usagers, soit 3 % du total des clients de gaz naturel. Le volume des ventes de ces régies est d'environ 11 milliards de Kwh alors que celui de Gaz de France est proche de 407 milliards de Kwh, soit une distribution non nationalisée d'environ 2,7 % des ventes.
Distribution non nationalisée de gaz
A la fin de 1995, on recense 16 distributeurs de gaz naturel non nationalisés (auxquels s'ajoute la société monégasque de l'électricité et du gaz de Monaco). Ils desservent 169 communes.
- Régie municipale de Dreux (12 communes)
- Syndicat intercommunal de l'usine à gaz de Huningue-Saint-Louis (4 communes)
- Service gaz et eau de la ville de Guebwiller (7 communes)
- Gaz de Barr (10 communes)
- Gaz de Strasbourg (63 communes)
- Régie municipale de Colmar (13 communes)
- Régie municipale d'électricité, de gaz et d'eau de Saint-Avold (1 commune)
- SICAE de la région de Péronne (3 communes)
- Régie municipale de distribution d'énergie de Villard-Bonnot (3 communes)
- Gaz et électricité de Grenoble (1 commune)
- Régies municipales de Bazas (1 commune)
- Société du gaz de Bordeaux (43 communes)
- Régie municipale multiservices de la ville de La Réole (3 communes)
- Energies services de Lannemezan (1 commune)
- Régie municipale d'Aire-sur-Adour (1 commune)
- Régie municipale gaz et électricité de Carmaux (3 communes).
II. LA MODIFICATION PROPOSÉE
Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article 88 de la loi du 6 février 1992, en y ajoutant la possibilité pour les services publics locaux de distribution du gaz en activité au 1 er janvier 1996 d'étendre leur "activité aux communes connexes à celles qu'elles desservent.
Outre la proximité géographique, cette extension comporte deux conditions :
- les communes "connexes" ne doivent pas disposer d'un réseau public de gaz,
- la rentabilité de l'investissement devra être suffisante pour que la commune puisse concéder la distribution de gaz sur son territoire. Il est précisé que "cette rentabilité sera appréciée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, en fonction des recettes et des dépenses prévisionnelles actualisées, y compris le montant des investissements envisagés pour réaliser la nouvelle desserte en gaz."
Cette disposition ouvre une brèche dans le strict monopole de Gaz de France en matière d'extension de la desserte de gaz naturel en France. De fait, Gaz de France raccorde chaque année environ 250 communes nouvelles à son réseau.
Toutefois, depuis plusieurs années, les régies existantes demandent l'ouverture d'un droit à l'extension de leurs activités. Des initiatives parlementaires ont été menées à plusieurs reprises en ce sens, sans néanmoins parvenir à l'adoption définitive des amendements déposés.
Par ailleurs, la Commission européenne, saisie d'une plainte déposée le Syndicat des entreprises gazières non nationalisées, a demandé à l'État français une modification du cadre juridique actuel, afin de permettre à un opérateur mieux placé que Gaz de France pour desservir une commune nouvelle d'avoir la possibilité de le faire.
C'est donc dans ce contexte qu'intervient le présent article. On notera qu'il maintient clairement les principes de la loi de 1946 et du monopole de Gaz de France, celui-ci n'étant remis en cause qu'au profit des régies et services locaux existants.
Votre commission approuve cette disposition essentiellement pragmatique qui doit permettre d'offrir un meilleur service aux usagers.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 56 (nouveau) - Validation législative
Commentaire : Cet article, adopté sur proposition du gouvernement » valide les nominations et titularisations dans le grade de conseiller de deuxième classe de chambre régionale des comptes prononcées par décret du Président de la République en date du 26 février 1991.
L'exposé sommaire de l'amendement déposé par le gouvernement à l'Assemblée nationale précise qu'afin d'autoriser le recrutement exceptionnel de 45 conseillers de chambre régionale des comptes de deuxième classe, les dispositions de l'article 27 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes, ont été remises en vigueur jusqu'au 31 décembre 1990 par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 (10 ( * )) .
Le jury compétent pour procéder à cette sélection a établi une liste d'aptitude à ces fonctions comportant 68 lauréats classés par ordre de mérite. Cette liste a été publiée au Journal officiel du 14 décembre 1990. La procédure de sélection proprement dite était donc achevée à cette date.
Les lauréats ont été invités, en janvier 1991, à faire connaître, dans l'ordre de leur classement, leur choix d'affectation. Le décret présidentiel prononçant leur nomination est finalement intervenu le 26 février 1991 et a été publié au Journal officiel du lendemain.
Le décret est menacé d'annulation par le Conseil d'Etat. La Haute juridiction, saisie par un candidat malheureux à la sélection, devrait en effet, selon toute vraisemblance, considérer que la nomination des 45 conseillers de chambre régionale des comptes intervenue en 1991, excède l'autorisation législative de recrutement qui n'avait été donnée que jusqu'au 31 décembre 1990.
Or, les 45 conseillers en cause sont effectivement entrés en fonctions dès 1991. Ils ont depuis lors pris les actes juridiques nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ces hauts fonctionnaires ont, par ailleurs, été titularisés et ont obtenu des avancements de grade.
L'annulation contentieuse du décret du 26 février 1991 prononçant leur nomination, qui interviendrait pour un motif de forme et non pas pour des raisons tenant à la régularité de la sélection proprement dite, remettrait certainement en cause tant le fonctionnement de la juridiction financière que la stabilité juridique des situations personnelles de ces agents, sans qu'aucune mesure administrative puisse juridiquement y faire obstacle.
Pour ces motifs, le gouvernement propose de valider les nominations titularisations prononcées en leur faveur par le décret du 26 février 1991, sur le fondement de la liste d'aptitude établie par le jury et publiée au Journal officiel du 14 décembre 1990.
Sur le fond , il convient tout d'abord de noter que l'interprétation des textes Prêtée au Conseil d'Etat, si elle était confirmée dans un prochain arrêt, résulterait de leur simple lecture. En effet, l'article 27 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 modifiée par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 est d'une clarté aveuglante, qui précise "jusqu'au 31 décembre 1990, pourront être nommés (...) membres du corps des chambres régionales des comptes, les fonctionnaires (etc...)".
Les nominations intervenues après cette date sont assurément illégales.
De ce point de vue, il n'est d'ailleurs pas exact de mentionner une "autorisation de recrutement", comme le fait le second alinéa du présent article, dont la portée est plus vague et qui vise à atténuer l'illégalité, voire à l'escamoter, en soulignant que le choix du jury était intervenu avant la date limite fixée par la loi.
Le Conseil constitutionnel a plusieurs fois avalisé des "validations préventives" consistant à valider un acte qui n'a pas encore été annulé par le juge mais qui risque de l'être (voir notamment les décisions 159 DC et 192 DC des 19 juillet 1983 et 24 juillet 1985).
Votre commission note toutefois que si la procédure contentieuse engagée devant le Conseil d'Etat allait jusqu'à son terme, c'est bien la nomination des conseillers des chambres régionales des comptes qui serait annulée. En d'autres termes, en validant directement ces nominations, le présent article censure, en quelque sorte préventivement, une décision de justice. Certes, il ne s'agit pas d'une censure a posteriori qui serait clairement inconstitutionnelle, mais la formule paraît pour le moins maladroite. Sans doute, eut-il été préférable que la loi confère la qualité de conseillers de chambres aux personnes concernées sans mentionner le décret de nomination.
Sur la forme, l'article proposé gagnerait en précision et en clarté si les deux alinéas étaient regroupés en un seul. Il devrait apparaître, en effet, sans ambiguïté, que les nominations et titularisations concernées ne sont validées qu'en tant qu'elles seraient contestées sur le fondement du non respect du terme du 31 décembre 1990 fixé par l'article 27 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 modifiée. Le second alinéa annule la portée en apparence générale du premier alinéa.
Votre commission a cependant estimé que c'était au gouvernement, si celui-ci le jugeait opportun, de procéder aux améliorations qu'appelle sa rédaction.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 57 (nouveau) - Allégements de cotisations sociales dans les secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure
Commentaire : Introduit par amendement du gouvernement dans le présent projet de loi, l'article 57 institue un régime provisoire d'allégement de cotisations sociales spécifique aux secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure.
Le ministre de l'industrie a annoncé le 5 mars dernier, deux mesures en faveur des secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure : des allégements des charges sociales spécifiques et une prise en charge accrue du chômage partiel. L'article 57 instaure un dispositif temporaire d'allégement de charges sociales spécifique à ces secteurs, qui s'insère dans le régime de droit commun tout récemment défini par la loi de finances pour 1996.
I. LES SECTEURS CONCERNÉS
Le choix des secteurs concernés se justifie par leur situation particulière
A. DES INDUSTRIES DE MAIN D'OEUVRE
Les secteurs du textile et de l'habillement, du cuir et de la chaussure emploient un très grand nombre de salariés : 141.000 dans le textile, 142.000 dans l'habillement, 47.000 pour le cuir et la chaussure.
B. DES INDUSTRIES PEU CONCENTRÉES
Le textile reste dominé par les PME : 3.200 entreprises de 50 personnes au plus sur un total de 3.600 ; l'habillement ne compte que 500 entreprises de plus de cinquante salariés, l'industrie de la chaussure compte.270 entreprises pour 30.900 salariés et l'industrie du cuir 250 entreprises pour 11.000 salariés.
C. UN ENVIRONNEMENT PEU FAVORABLE
1. Une demande peu soutenue
L'ensemble de ces secteurs est confronté à une consommation atone depuis 1994. Les habitudes des ménages s'étant modifiées, la demande se porte de plus en plus vers des produits bon marché : ainsi, les dépenses des consommateurs en produits de textile-habillement ont diminué de 1 % par an en francs constants depuis dix ans.
2. Une concurrence croissante
Outre la concurrence des pays à bas salaires, qui se sont résolument orientés vers l'industrie de l'habillement avec des coûts horaires de main d'oeuvre dix à cent fois moins élevés que ceux de la France, ces secteurs subissent de plein fouet les effets des dévaluations compétitives menées depuis 1992 au sein même de l'Union européenne.
Dans une étude réalisée à la fin de l'année 1995 pour l'Union des industries textiles, par M. Antoine Bouet, professeur d'économie à l'Université de Nantes, il apparaissait clairement que les dévaluations pratiquées par les pays d'Europe du Sud depuis septembre 1992 affectaient gravement la compétitivité des secteurs du textile et de l'habillement :
"En tenant compte des poids de chaque pays dans la structure du commerce extérieur français de textile, le franc s'est apprécié au sein de l'Union européenne de près de 15 % entre septembre 1992 et avril 1995 (...) le taux de change effectif nominal évalué de façon identique pour le secteur habillement fait apparaître une évolution identique, mais légèrement atténuée (13 % d'appréciation entre septembre 1992 et avril 1995)".
L'aspect le plus grave de cette perte de compétitivité relative est bien sûr la destruction massive d'emplois qui est en cours. Depuis 15 ans, les secteurs du textile et de l'habillement, du cuir et de la chaussure sont passés de 600.000 à 350.000 emplois. Actuellement, la perte d'emplois est évaluée à 1 % des effectifs par mois.
II. LES MESURES PRÉVUES
C'est en faveur de ces secteurs gravement éprouvés que le ministre de l'industrie a annoncé, le 5 mars dernier, une prise en charge du chômage Partiel à un taux horaire de 27 francs au lieu de 18 francs qui devrait Permettre aux entreprises de pouvoir attendre les mesures d'allégement des charges sociales prévues dans l'article 57 du présent projet de loi.
A. DES ALLÉGEMENTS DE CHARGES QUI VONT PLUS LOIN QUE LE DROIT COMMUN
1. Un cadre récemment stabilisé
Le dispositif prévu s'articule avec le régime instauré par l'article 113 de la loi de finances pour 1996, soit un dispositif unique de ristourne dégressive des cotisations sociales pour les salaires inférieurs ou égaux à 1,33 SMIC, qui se substitue à compter du 1 er octobre 1996 jusqu'au 31 décembre 1997 à l'allégement de cotisations d'allocations familiales institué par la loi quinquennale du 30 décembre 1993 et à la ristourne dégressive de cotisations sociales sur les salaires inférieurs à 1,2 SMIC contenue dans la loi du 4 août 1995 portant mesures d'urgence en faveur de l'emploi. Dans ce régime, l'avantage sera maximal pour les salaires égaux au SMIC -soit 6.250 francs mensuels- et représentera 1.360 francs par mois, au lieu de 1.137 francs.
2. Un dispositif spécifique
Le dispositif prévu pour les secteurs du texte, de l'habillement, du cuir et de la chaussure est plus favorable sur deux points :
D'une part, il étend la ristourne dégressive jusqu'aux salaires égaux à 1,5 SMIC. Ainsi, la réduction de cotisations sera égale à la différence entre le plafond de 1,5 SMIC et la rémunération versée multipliée par un coefficient fixé par décret. L'article 57 prévoyant que l'avantage ne pourra dépasser 1.892 francs, le coefficient devrait être de 0,605 d'après le calcul suivant :
(1,5 SMIC-SMIC) x = 1.892
1.892
x= =0,605
3.125
D'autre part, l'entrée en vigueur de ce nouveau régime devrait être avancée par rapport au 1 er octobre 1996, dans la mesure où la date d'application sera le 1 er jour du mois suivant la conclusion d'une convention cadre avec la branche et la conclusion d'une convention avec l'entreprise si celle-ci compte plus de 50 salariés et dispose donc d'un comité d'entreprise-
B. LE PRINCIPE DU "DONNANT-DONNANT"
En contrepartie de ce régime plus avantageux, les employeurs devront apporter des garanties dans ces conventions.
1. Le texte de l'article 57
a) Les obligations des entreprises
"Les conventions cadre devront comporter des dispositions relatives au maintien ou au développement de l'emploi, "tenant compte des résultats de la négociation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail engagée après l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 31 octobre 1995" (cette négociation se tenant au sein des branches entre les partenaires sociaux), et les conventions d'entreprise devront porter "notamment sur le maintien ou la création d'emplois et l'aménagement et la réduction du temps de travail".
b) La sanction des obligations
L'article 57 prévoit une sanction à ces obligations, en disposant que le non respect des engagements pris dans une convention spécifique entraîne l'interruption de l'application des allégements spécifiques et "peut conduire au reversement des aides perçues.
2. Le contexte économique et social
Selon le dossier rendu public par le ministère de l'Industrie, le 5 mars dernier, une convention cadre devra être signée avant le 30 mars, avec chacune des trois branches.
Elle portera sur "le nombre d'emplois maintenus (35.000 au total sur deux ans) " soit un plafonnement du nombre de licenciements à 25.000 sur deux ans pour les trois branches,
- "l'embauche des jeunes (7.000 au minimum sur deux ans et 2/3 des embauches),
- la mise en place d'un observatoire professionnel,
- la mise en oeuvre et l'aboutissement de négociations de branche sur l'aménagement et la réduction du temps de travail. "
En ce qui concerne les conventions conclues avec les entreprises de plus de 50 salariés, elles porteraient sur "le nombre d'emplois préservés et l'embauche de jeunes, la mise en oeuvre des accords d'aménagement et de réduction du temps de travail de la branche, ainsi que le développement du temps partiel."
Ce sont quelque 1.300 entreprises qui devraient être concernées (sur un total de 13.000) par ces conventions, regroupant plus de 2/3 des salariés des secteurs.
C. COÛTS ET AVANTAGES DES MESURES
1. Un impact important
L'impact de l'allégement des charges devrait être très important, dans la mesure où :
- l'allégement représentera, sur un salaire égal au SMIC, plus de 30 %du coût du travail,
- les salariés percevant des rémunérations inférieures à 1,5 SMIC représentent les 2/3 du total des trois secteurs concernés.
2. Le coût de la mesure
Le coût de la mesure est estimé par le gouvernement à 4,2 milliards de francs sur deux ans.
Toutefois, le ministère de l'Industrie fait remarquer que ces mesures représenteraient une économie de 2,6 milliards de francs sur deux ans, compte tenu de la limitation du nombre de licenciements qu'elles permettront.
Coût budgétaire et social sur deux ans
(en millions de francs)
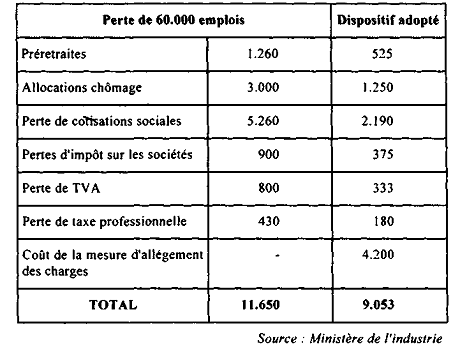
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission des finances est consciente de la gravité de l a situation des secteurs concernés par l'article 57, et de l'urgence absolue requise par les mesures prévues.
Par ailleurs, elle salue le caractère contractuel de ces aides, désormais baptisé le "donnant-donnant", dont l'industrie textile a prôné l'avènement depuis plusieurs mois, et s'est fait le précurseur.
C'est pourquoi, tout en s'interrogeant sur la possibilité de conclure les conventions cadre avec les trois branches concernées avant le 30 mars, votre commission soutient la démarche novatrice contenue dans l'article 57 du présent projet de loi, qui conserve, selon les termes mêmes de cet article, un caractère encore "expérimental".
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 1 Rapport n°326 (1992-1993) de M. Claude Belot sur le projet de loi de privatisation.
* 2 Sénat, Seconde session ordinaire 1993-1994, rapport n°514 du 15 juin 1994.
* 3 Sénat Session ordinaire de 1995-1996, rapport n°77, tome III, annexe n°12, du 21 novembre
* 4 Rapports Sénat n° 44, 1994-1995 - Jean Arthuis, Paul Loridant, Philippe Marini et Assemblée nationale n° 1841 (1994) - Gérard Trémège.
* 5 CAA Paris, 18 avril 1991, n°477, 3 ème ch., SA Horeva
* 6 Proposition de loi n° 161 (1995-1996) relative à la prorogation des poursuites en faveur des rapatriés réinstallés.
* 7 Les chemins de fer et tramways sont exclus de cette obligation.
* 8 Toutefois, en ce qui concerne les autobus de la RATP, cet argument n'est pas pertinent, les contrats sur les véhicules terrestres à moteur utilitaires de plus de 3,5 tonnes étant exonérés de taxe (article 995 du code général des impôts).
* 9 "Inondations : une réflexion pour demain" - n° 2641 - 1994 -
* 10 L'article 27 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 , dans sa version antérieure à la loi du 13 janvier 1989 disposait : "Jusqu'au 31 décembre 1986, pourront être nommés, par dérogation aux dispositions des articles 13 à 16 inclus, membres du corps des chambres régionales des comptes, les fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés aux articles 13, 14 et 15 remplissant les conditions de grade ou de niveau d'emploi fixées par le décret en Conseil d'État pris en application de l'article 17, à l'exclusion de toute condition autre que celles posées par l'article 28 ci-après.
"Jusqu'au 31 décembre 1986, pourront également être nommés par dérogation aux dispositions des articles 13 à 16 inclus les agents non titulaires de l'État et des collectivités locales, occupant un emploi de catégorie A ou un emploi de même niveau, remplissant les mêmes conditions d'âge que celles fixées aux articles 13, 14 et 15 justifiant de ta durée minimum de services publics exigée par ces articles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de grade ou de niveau d'emploi exigées des intéressés.
"Les magistrats ainsi recrutés suivent un stage pratique. Ce stage, dont les modalités et la durée sont fixées par un décret en Conseil d'État, peut s'effectuer à la Cour des comptes. "







