3. Mobiliser toutes les énergies locales au service du patrimoine
Les collectivités sont de plus en plus conscientes de la nécessité de préserver leur écosystème patrimonial.
A court terme et indépendamment des expériences en cours, des champs restent ouverts pour une prise de responsabilité plus franche des collectivités, qu'il s'agisse du patrimoine dit « non protégé » ou de l'inventaire, qui doivent s'appuyer sur des structures de nature à associer toutes les énergies locales, et, notamment, sur la Fondation du patrimoine.
a) Le patrimoine « non protégé », compétence naturelle des collectivités locales
La création d'un troisième niveau de protection est-elle une solution simple pour donner aux collectivités territoriales un supplément de compétences en matière de patrimoine monumental sans rien retirer à l'État central ?
Depuis le rapport de 1994 de M. Jean-Paul Hugot, parlementaire en mission, qui fut à l'origine de la création de la fondation du patrimoine, on a pris conscience de l'importance d'un patrimoine diffus, notamment dans les zones rurales, lavoirs, calvaires, chapelles, etc, qui font le caractère des paysages de la France.
Ce patrimoine, dit initialement patrimoine rural non protégé -PRNP-, ne mérite plus vraiment cette appellation. D'abord, par ce qu'il n'est plus seulement rural ; ensuite, parce que s'il n'est pas soumis aux réglementations de la loi de 1913 en matière de travaux ou d'abords, il bénéficie d'aides financières non négligeables et qu'il est souvent pris en compte dans les documents d'urbanisme.
La responsabilité particulière des collectivités territoriales en la matière est évidente, qu'il s'agisse des régions, des départements, ainsi que des communes dont les pouvoirs devraient être réaffirmés notamment au niveau du permis de construire.
Créer officiellement un troisième niveau de protection, ou plutôt un niveau de base, est une solution qui a le mérite de la simplicité, à cette réserve qu'elle aboutit à rendre plus complexe un édifice réglementaire, qui n'est déjà pas toujours cohérent.
Trois niveaux de protection n'est-ce pas trop ?
On serait tenté de souligner qu'au-delà de l'appellation officielle de patrimoine non protégé, le troisième niveau de protection existe déjà et qu'on peut à la fois l'officialiser et le confier aux collectivités locales .
La consécration fiscale de ce premier niveau, on la trouve dans l'article 156 du code général des impôts qui organise la procédure de l'agrément fiscal, et auquel donne droit sous certaines conditions le label de la Fondation du patrimoine, lui même accordé en liaison, contrairement à l'agrément direct, avec les collectivités locales et non les services de la DRAC.
Substituer des services dépendants des collectivités pour l'agrément de l'article 156 du code général des impôts et systématiser sa prise en compte dans les documents d'urbanisme achèverait le processus.
La solution d'un niveau de protection purement local, aux incidences fiscales près, peut se justifier mais seulement si elle s'accompagne d'une simplification de l'architecture d'ensemble de notre système juridique, telle qu'elle pourrait résulter sinon de l'alignement du moins l'articulation très étroite du régime des monuments inscrits sur celui des classés.
b) Faire de l'Inventaire général une affaire de proximité
L'inventaire général, créé à l'initiative d'André Malraux et porté par André Chastel, a subi les dérives d'une bureaucratisation. Alors qu'à l'origine il était question de s'appuyer sur des relais locaux et, notamment, sur des sociétés savantes, le projet a évolué vers une institutionnalisation croissante et le détournement des objectifs initiaux.
Écrasés par l'énormité de la tâche, la demi-douzaine et parfois moins de fonctionnaires affectés à cette tâche, ont largement renoncé à la couverture géographique, pourtant seule cohérente, pour se tourner vers des inventaires thématiques, plus gratifiants certes, mais qui laissent craindre un processus d'inventaire sans horizon défini.
Les services régionaux de l'Inventaire travaillent désormais en liaison étroite avec les collectivités locales, qu'il s'agisse des conseils régionaux, des conseils généraux, des villes, des pays, des SIVOM, etc. Cette collaboration démontre que la part des collectivités locales dans le financement des opérations d'inventaires est de plus en plus importante .
Il convient de prolonger le mouvement actuel en transférant la responsabilité des opérations d'inventaire au niveau départemental sur le modèle de l'Isère- qui a créé dès 1992 une conservation du patrimoine.
Les services d'État au niveau régional ne conserveraient que la responsabilité de la définition d'un vocabulaire commun.
Nombreux sont ceux qui reconnaissent, à commencer par les intéressés eux-mêmes, que les résultats de l'Inventaire doivent être désormais enregistrés de manière à répondre au maximum aux besoins spécifiques des gestionnaires du patrimoine urbain.
Il y a là un double intérêt dans cette démarche :
• politique : en faisant de la réalisation d'un inventaire sommaire, l'affaire des intéressés eux-mêmes, à commencer par les élus et les habitants du canton concerné, sans oublier les sociétés savantes, on permet aux intéressés de s'approprier leur patrimoine et donc à la fois de mieux en percevoir et l'intérêt et de mieux accepter les contraintes liées à sa conversation ;
• technique : on peut se donner les moyens d'aller vite et donc ne pas arriver « après la bataille », en signalant l'intérêt patrimonial d'immeubles ou d'objets. déjà disparus au moment même de la communication ;
L'idée d'un inventaire léger, rapide, sans cesse réitérée, doit être enfin inscrite dans les faits. Il faut fixer des objectifs précis en matière de couverture du territoire.
Votre rapporteur estime que le transfert des personnels aux départements dans un cadre plus polyvalent, gage de productivité sur le modèle des services patrimoniaux de l'Isère devrait insuffler un dynamisme nouveau à une fonction indispensable mais qui, faute de moyens et d'objectifs, a perdu son impulsion initiale .
Pour ceux des fonctionnaires qui refuserait une telle démarche, il ne resterait plus qu'à les maintenir au niveau régional pour veiller à la transférabilité des résultats entre les départements, voire à les transférer dans le cadre naturel d'une telle démarche, c'est-à-dire au CNRS, où il existe d'autres règles d'appréciation des performances mais aussi d'évaluation des chercheurs que dans l'administration active.
L'inventaire général doit être conduit de façon globale sur la base de programmes chiffrés pour retrouver l'élan initial de la planification à la française.
DÉPENSES RELATIVES AU PATRIMOINE RURAL NON PROTÉGÉ
(Autorisations de programme affectées)
|
CHAPITRE 6620/20 (en euros)) |
2000 |
2001 |
|
ALSACE |
114 992 |
114 127 |
|
AQUITAINE |
331 027 |
143 006 |
|
AUVERGNE |
182 449 |
347 599 |
|
BOURGOGNE |
352 147 |
291 277 |
|
BRETAGNE |
528 913 |
547 908 |
|
CENTRE |
450 129 |
504 748 |
|
CHAMPAGNE ARDENNE |
81 414 |
288 281 |
|
FRANCHE COMTE |
301 396 |
188 504 |
|
ILE DE FRANCE |
175 875 |
103 775 |
|
LANGUEDOC ROUSSILLON |
233 811 |
538 659 |
|
LIMOUSIN |
84 929 |
119 745 |
|
LORRAINE |
306 258 |
67 683 |
|
MIDI PYRENEES |
480 244 |
344 129 |
|
NORD PAS DE CALAIS |
171 273 |
108 056 |
|
BASSE NORMANDIE |
406 269 |
329 099 |
|
HAUTE NORMANDIE |
403 357 |
362 227 |
|
PAYS DE LOIRE |
269 796 |
357 548 |
|
PICARDIE |
253 561 |
145 414 |
|
POITOU CHARENTES |
681 018 |
330 944 |
|
PROV. ALPES COTE D'AZUR |
396 398 |
256 179 |
|
RHÔNE-ALPES |
357 012 |
428 564 |
|
GUADELOUPE |
105 640 |
125 556 |
|
GUYANE |
107 550 |
40 168 |
|
MARTINIQUE |
9 707 |
85 798 |
|
REUNION |
51 074 |
11 202 |
|
NOUVELLE CALEDONIE (1) |
22 867 |
22 867 |
|
TOTAL |
6 859 105 |
6 203 062 |
|
( 1) en l'absence de remontées d'information disponibles pour cette région, le montant indiqué correspond aux AP déléguées et non aux AP effectivement affectées |
||
c) Utiliser la Fondation du patrimoine comme un auxiliaire de terrain
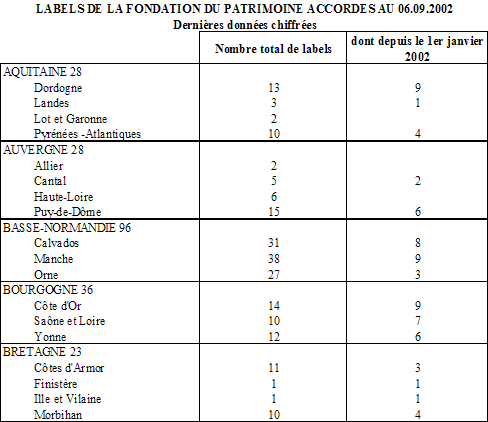
Créée par la loi du 2 juillet 1996, la fondation du patrimoine, organisme privé a but non lucratif, reconnue d'utilité publique par un décret du 18 avril 1997, a pour objet de promouvoir la sauvegarde, la connaissance et la mise en valeur du patrimoine non protégé par l'État.
Identifier des édifices et des sites menacés, participer par un soutien financier à la réalisation de programmes de restauration et contribuer, par l'attribution d'un label comportant des avantages fiscaux, à la sauvegarde du patrimoine menacé, tels sont les objectifs majeurs de la Fondation.
A ces tâches, s'ajoutent des missions plus générales consistant à favoriser le partenariat entre les associations et les pouvoirs publics ainsi que la création d'emplois et la transmission des métiers.
La Fondation du patrimoine a adopté une organisation décentralisée reposant sur un réseau de délégations régionales et départementales. Au sein du conseil d'administration, figurent des représentants d'institutions nationales et locales ainsi qu'un certain nombre de mécènes fondateurs 14 ( * ) .
L'État n'est plus le dépositaire unique de l'action publique. Un État qui entend agir seul se prive de relais qui accroissent l'efficacité de son action.
C'est dans le cadre de la réforme de l'État, qu'il convient de relancer la Fondation du patrimoine, qui par son organisation décentralisée, largement fondée sur le volontariat, constitue l'auxiliaire de proximité de l'action de l'État, de nature à constituer le lieu de rencontre entre tous les partenaires du patrimoine publics et privés.
Les ressources de la Fondation sont constituées par du mécénat en provenance des particuliers et des entreprises. Les dons faits à la Fondation sont déductibles de l'impôt sur le revenu à concurrence de 50 % de leur montant et dans la limite de 10 % du revenu imposable, en application de l'article 200 du Code général des impôts et, pour les entreprises, déductibles du bénéfice imposable des sociétés, dans la limite de 3,5 pour mille du chiffre d'affaires, en application de l'article 238 bis du même code.
La Fondation peut octroyer un label qui est susceptible de permettre l'octroi d'avantages fiscaux pour les propriétaires, lorsque l'opération a reçu l'accord de l'architecte des bâtiments de France.
Les projets, qui portent sur des bâtiments non protégés, doivent répondre à certains critères. Notamment, les travaux doivent présenter certaines caractéristiques de nature patrimoniale ou sociale. En effet, l'objectif de la Fondation n'est pas simplement de préserver un environnement de qualité, il est aussi de réintégrer le patrimoine dans les activités quotidiennes des Français.
Trois types d'immeubles sont concernés : les immeubles non habitables constituant le petit patrimoine de proximité, tels que pigeonniers, lavoirs, fours à pain ; les immeubles habitables caractéristiques de l'habitat rural, ainsi que les immeubles habitables ou non, situés dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
Les travaux doivent concerner les parties visibles de la voie publique, sauf pour les éléments de patrimoine non habitable . Il s'agit essentiellement de travaux concernant les toitures, les façades et les pignons.
La déduction fiscale, dont peut bénéficier le propriétaire, est de :
• 50 % du montant supporté par le propriétaire -après déduction des subventions perçues-, si les subventions recueillies sont inférieures à 20% du montant des travaux ;
• 100 % du montant supporté par le propriétaire -après déduction des subventions perçues-, si les subventions recueillies excèdent 20%.
Le label est accordé par le délégué régional de la Fondation après accord du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
Enfin, la Fondation du patrimoine lance aussi des opérations de mécénat de proximité. Lorsque, s'agissant de projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une commune ou une association, l'opération ne parvient pas à réunir les financements nécessaires, la Fondation se charge de lancer des souscriptions pour trouver des fonds complémentaires moyennant une commission de gestion de 3 %.
Votre rapporteur spécial s'est penché sur les intentions du législateur lorsqu'il a créé la Fondation du Patrimoine. A cette occasion, il a constaté que l'on avait cherché à prendre modèle sur le National Trust britannique et que, loin de se limiter à l'octroi d'un label fiscal, la Fondation avait initialement pour objectif de relayer l'action de ce qui était alors la Caisse nationale des monuments historiques et des sites.
A la lecture du rapport de M. Jean-Paul Hugot, la Fondation aurait eu initialement pour vocation de jouer le rôle d'interface entre le secteur public et le secteur privé en reprenant notamment des actions pilotes jusqu'alors menées par la Caisse en matière de « routes historiques », de « villes d'art et d'histoire » et de « pays d'art et d'histoire ».
Sans doute le rapport allait-il trop loin, faisant relever de la Fondation une mission de promotion des éditions sur le patrimoine et en lui permettant de prendre en gestion certains monuments appartenant à des collectivités locales pour leur bâtir des projets de monuments.
Faut-il relancer cet aspect des compétences de la Fondation qu'elle n'a pas pu développer faute de moyens et de volonté politique ? La question mérite d'être posée.
Votre rapporteur spécial a considéré que la Fondation devait, en tout état de cause, avoir un rôle pilote dans la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine dit « non protégé ». C'est dans ce but qu'il souhaite lui en donner les moyens en proposant de lui a ffecter une ressource en harmonie avec sa vocation, en l'occurrence, le produit des successions vacantes .
LE PRODUIT DES SUCCESSIONS VACANTES
|
Années |
En francs |
En euros |
|
1990 |
88 460 804 |
(13 485 763) |
|
1991 |
86 717 171 |
(12 762 600) |
|
1992 |
75 622 920 |
(11 528 640) |
|
1993 |
71 068 646 |
(10 834 345) |
|
1994 |
74 048 745 |
(11 288 658) |
|
1995 |
100 368 219 |
15 301 036) |
|
1996 |
90 896 652 |
(13 857 105) |
|
1997 |
91 001 512 |
(13 873 091) |
|
1998 |
104 929 667 |
15 996 425 |
|
1999 |
88 668 159 |
13 517 374 |
|
2000 |
84 984 437 |
12 955 794 |
|
2001 |
62 630 327 |
9 547 932 |
Tout ou partie de ce produit, dont le montant, selon les années, est compris entre 10 et 15 millions d'euros, pourrait venir utilement encourager, en liaison avec les collectivités territoriales, la remise en état du petit patrimoine et favoriser, en liaison cette fois-ci avec les associations, la mise en valeur du patrimoine et des sites.
*
* *
Pour conclure ce rapport, il convient d'ajouter au relativisme, dont votre rapporteur spécial faisait état dans sa présentation, un paradoxe budgétaire .
On ne manquera pas, en effet, de remarquer qu'un certain nombre des propositions contenues dans ce rapport, pourrait se traduire par des dépenses accrues, à court terme, même s'il est possible d'agir par voie de redéploiement de crédits ou de personnels.
Certes, l'augmentation des moyens à consacrer aux opérations d'entretien devrait être aisément dégagée par une diminution des ouvertures de crédits au titre des dépenses d'investissement .
Mais, au niveau de la gestion de ces dépenses, il faut s'attendre à des coûts supplémentaires, soit que l'on opte pour le renforcement des services qui en ont la charge, services départementaux de l'architecture et du patrimoine ou services à créer dans les collectivités territoriales, soit que l'on confie un nombre plus important d'opérations à des architectes agréés qu'il faudra bien rémunérer.
De même, l'augmentation du nombre des architectes en chef des monuments historiques , tout comme celle des architectes habilités à travailler dans le secteur à l'issue d'une procédure d'agrément, pourrait déboucher sur des dépenses et des coûts supplémentaires. A ces facteurs de dépenses supplémentaires, s'ajouterait la nécessaire revalorisation des vacations perçues par ces fonctionnaires en leur qualité de « Conseils du ministère de la culture » et la création d'inspecteurs fonctionnaires .
Une troisième catégorie de mesures, consistant en la création d'agences de maîtrise d'ouvrage est, elle aussi, porteuse de dépenses, si l'on ne parvient pas à constituer ces nouveaux organes par réaffectation de personnels et de moyens.
A ceux qui y verraient une sorte de contradiction interne dans un rapport animé par un souci d'économie, votre rapporteur spécial fera valoir que l'on a sans doute , ces dernières années, trop investi sans avoir les moyens de maîtriser la dépense.
Trop de projets, pas assez de personnels pour les suivre, ont conduit à laisser les maîtres d'oeuvre prendre l'ascendant sur les maîtres d'ouvrage avec, pour conséquence, une dérive des dépenses résultant, non de coûts unitaires trop élevés, mais de projets inadaptés aux moyens disponibles , voire carrément surdimensionnés par rapport aux besoins.
Le même raisonnement vaut pour les perspectives de décentralisation dressées dans ce rapport. Transférer des compétences en matière patrimoniale aux collectivités territoriales devrait avoir également pour conséquence une augmentation des coûts de fonctionnement, ici non au niveau de l'État central mais des administrations publiques dans leur ensemble.
Cela ne suffit-il pour condamner une telle évolution ?
Votre rapporteur spécial ne le pense pas, à la fois parce qu'il y a sans doute-sous réserve des audits souhaités par votre rapporteur spécial- une sous-administration de la dépense d'investissement, et parce que la montée en puissance des collectivités territoriales est de nature à favoriser un dynamisme, gage d'augmentations de productivité.
Derrière la plupart des propositions de ce rapport -qui se présente plus comme une boite à idées que comme un mécano prêt à l'emploi- il y a un fil directeur essentiel : la conviction que s'il doit être mis face à ses responsabilités, le propriétaire doit aussi se voir donner les moyens de les exercer.
* 14 Axa, Bellon SA (Sodexho Alliance), Caisse nationale de Crédit Agricole, Danone, Devanlay, Fimalac SA, Fédération française du bâtiment, Fondation Électricité de France, Inderco, l'Oréal, Michelin, Shell, Par cet Jardins de France, Videndi.







