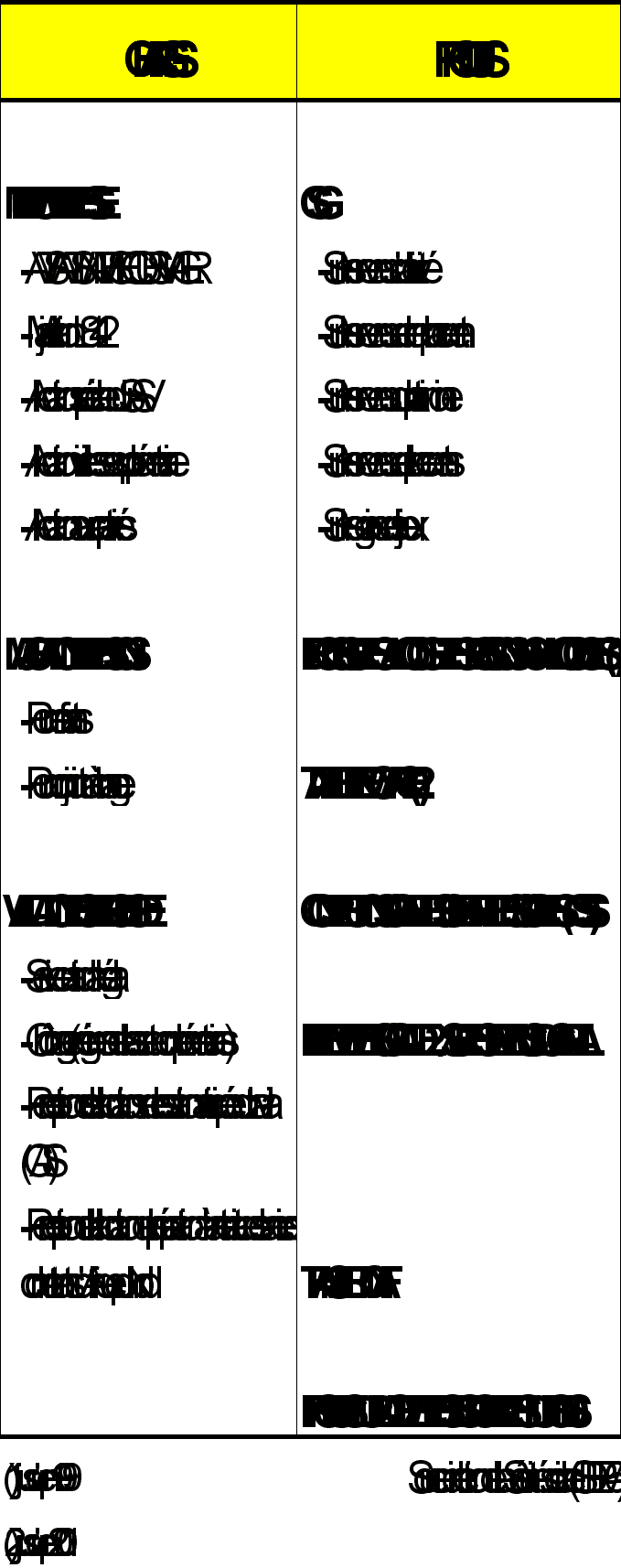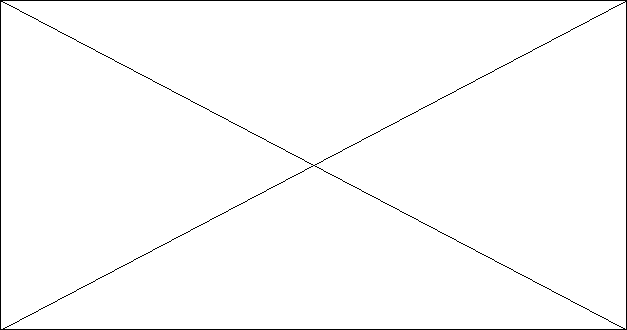Rapport d'information n° 44 (2003-2004) de M. Alain VASSELLE , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 29 octobre 2003
Disponible au format Acrobat (569 Koctets)
-
AVANT-PROPOS
-
I. LA PROLIFÉRATION DES
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX : UN MAL FRANÇAIS ?
-
II. JUSQU'OÙ DIVERSIFIER LES
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX ?
-
A. SORTIR DES COTISATIONS SOCIALES :
AMÉNAGEMENTS TECHNIQUES OU RÉVOLUTION THÉORIQUE ?
-
B. LES TROIS VOLETS DE LA FISCALISATION PROGRESSIVE
DES FINANCES SOCIALES
-
1. La contribution sociale
généralisée (CSG) : instrument de la fiscalisation
des cotisations salariales
-
2. La compensation des allégements de
cotisations : instrument de fiscalisation des charges patronales
-
3. La création du Fonds de solidarité
vieillesse : la fiscalisation de certaines prestations non contributives
-
1. La contribution sociale
généralisée (CSG) : instrument de la fiscalisation
des cotisations salariales
-
C. L'AFFAIRE FOREC : LES LIMITES DE LA
PROGRESSION DES PRELÈVEMENTS SOCIAUX
-
A. SORTIR DES COTISATIONS SOCIALES :
AMÉNAGEMENTS TECHNIQUES OU RÉVOLUTION THÉORIQUE ?
-
III. L'ÉVOLUTION MAL ASSISE DES TAXES SUR
LES TABACS
-
I. LA PROLIFÉRATION DES
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX : UN MAL FRANÇAIS ?
-
TRAVAUX DE LA COMMISSION
N° 44
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 octobre 2003
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur les prélèvements obligatoires et leur évolution ,
Par M. Alain VASSELLE,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About, président ; MM. Alain Gournac, Louis Souvet, Gilbert Chabroux, Jean-Louis Lorrain, Roland Muzeau, Georges Mouly, vice-présidents ; M. Paul Blanc, Mmes Annick Bocandé, Claire-Lise Campion, M. Jean-Marc Juilhard, secrétaires ; MM. Henri d'Attilio, Gilbert Barbier, Joël Billard, Mme Brigitte Bout, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Jean Chérioux, Mme Michelle Demessine, M. Gérard Dériot, Mme Sylvie Desmarescaux, MM. Claude Domeizel, Michel Esneu, Jean-Claude Étienne, Guy Fischer, Jean-Pierre Fourcade, Serge Franchis, André Geoffroy, Francis Giraud, Jean-Pierre Godefroy, Mme Françoise Henneron, MM. Yves Krattinger, Philippe Labeyrie, Roger Lagorsse, André Lardeux, Dominique Larifla, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Mmes Valérie Létard, Nelly Olin, Anne-Marie Payet, M. André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roujas, Mmes Janine Rozier, Michèle San Vicente, MM. Bernard Seillier, André Vantomme, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.
|
Sécurité sociale. |
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
Le débat sur les prélèvements obligatoires constitue, pour la commission des Affaires sociales, une opportunité toute particulière de rendre un hommage appuyé à son ancien rapporteur pour les équilibres financiers généraux, Charles Descours, qui fut l'ardent partisan de l'autonomie des comptes de la sécurité sociale en même temps que l'artisan d'un dialogue toujours constructif entre les finances de l'État et les finances sociales.
L'originalité de son initiative - imposer un débat commun aux commissions des Finances et des Affaires sociales - prenait tout son sens dans une période caractérisée par la multiplication des usines à gaz et des dérivations suspectes.
Pourtant, le contexte nouveau, voulu par le présent Gouvernement et réclamé par les élus, d'une clarification des relations financières entre l'État et la sécurité sociale n'a pas renvoyé son excellente initiative au rang d'une intervention ponctuelle.
En effet, cette année, celle-ci prend un relief particulier car le Parlement se trouve, en raison de l'application de la nouvelle loi organique relative aux lois de finances, confronté à une regrettable schizophrénie des discussions budgétaires.
Ainsi, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 fixe les règles relatives à la taxe sur le tabac et enregistre son produit dans les prévisions de recettes des organismes qui en bénéficient, mais la répartition correspondante de cette même taxe entre ces mêmes bénéficiaires est opérée par le projet de loi de finances.
Jamais les législateurs organiques de 1996 et 2001, chacun attentif à ce que les prérogatives du Parlement soient renforcées, n'ont souhaité, ni même envisagé, qu'un tel morcellement puisse se produire.
Or, à la vitesse avec laquelle l'application des règles de procédure budgétaire rapatrie, en loi de finances, l'examen des ressources affectées aux organismes sociaux, il faudra bientôt, et cela constituerait un événement, que votre commission des Affaires sociales se saisisse pour avis de la première partie du budget afin d'y examiner les recettes de la sécurité sociale que les prévisions de recettes de la loi de financement ne font plus qu'évoquer.
Au-delà d'une réponse à cette difficulté d'ordre procédural, un débat sur les prélèvements obligatoires, à proximité des discussions budgétaires, offre cette année l'occasion à votre rapporteur de dresser un bilan et quelques perspectives des prélèvements sociaux. Entre deux réformes essentielles, celle des retraites du printemps dernier et celle de l'assurance maladie du printemps prochain, il ne peut en être différemment.
Ainsi, pour un premier exercice, ce rapport s'attache à répondre à la question formulée l'an passé, avec beaucoup d'à propos, par le président de la commission des Affaires sociales, lors du débat sur les prélèvements obligatoires : « Où va l'argent ? » .
En effet, le président Nicolas About rappelait, non sans humour, que l'essentiel de la tâche assignée au Parlement consistait, aux termes de l'article 14 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, à lever l'impôt et à répondre du bon usage qui en est fait.
La connaissance de l'origine et de la destination des ressources destinées à notre santé ou à nos retraites doit, sans aucun doute, être parfaite. La réforme de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale constitue à cet égard un chantier à part entière des réformes futures touchant à la protection sociale et aux finances publiques.
Dans cette perspective, et pour cette année de « vaches maigres », ce rapport porte l'ambition modeste qu'il soit donné une autre réponse à cette importante question que celle d'un philosophe citée par Léon Bloy 1 ( * ) voici plus de cent ans : « Eh bien mes amis, l'argent se cache ! ».
I. LA PROLIFÉRATION DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX : UN MAL FRANÇAIS ?
A. UN OBJET COMPTABLE MAL IDENTIFIÉ
1. Un ensemble hétérogène
Ainsi que le rappelle l'annexe I du rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution 2 ( * ) , l'OCDE fut la première organisation à proposer une définition des prélèvements obligatoires afin de faciliter la comparaison de la pression fiscale entre les différents États sur des bases sinon identiques, du moins relativement homogènes.
Cette définition désigne, pour la résumer, les prélèvements obligatoires comme les « flux financiers effectifs, versés à destination des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale et les institutions communautaires européennes, et qui revêtent un caractère non volontaire ».
Les agrégats de prélèvements obligatoires présentés par le Gouvernement dans le cadre du rapport précité font référence à cette définition. Tirés des « comptes nationaux » élaborés notamment par l'INSEE, ces agrégats constituent les « statistiques officielles » que la France déclare auprès de la Commission européenne dans le cadre du pacte de stabilité applicable aux finances publiques.
Les « comptes de la Nation » séparent les comptes des administrations publiques en quatre catégories :
- l'État,
- les organismes d'administration centrale (ODAC),
- les collectivités locales (APUL),
- les organisations de sécurité sociale (ASSO).
La ligne présentée au titre des organisations de sécurité sociale, dans les comptes nationaux, ne constitue qu'une fraction de l'agrégat comptable dénommé comptes de la protection sociale.
Domaines de la protection sociale et des assurances sociales
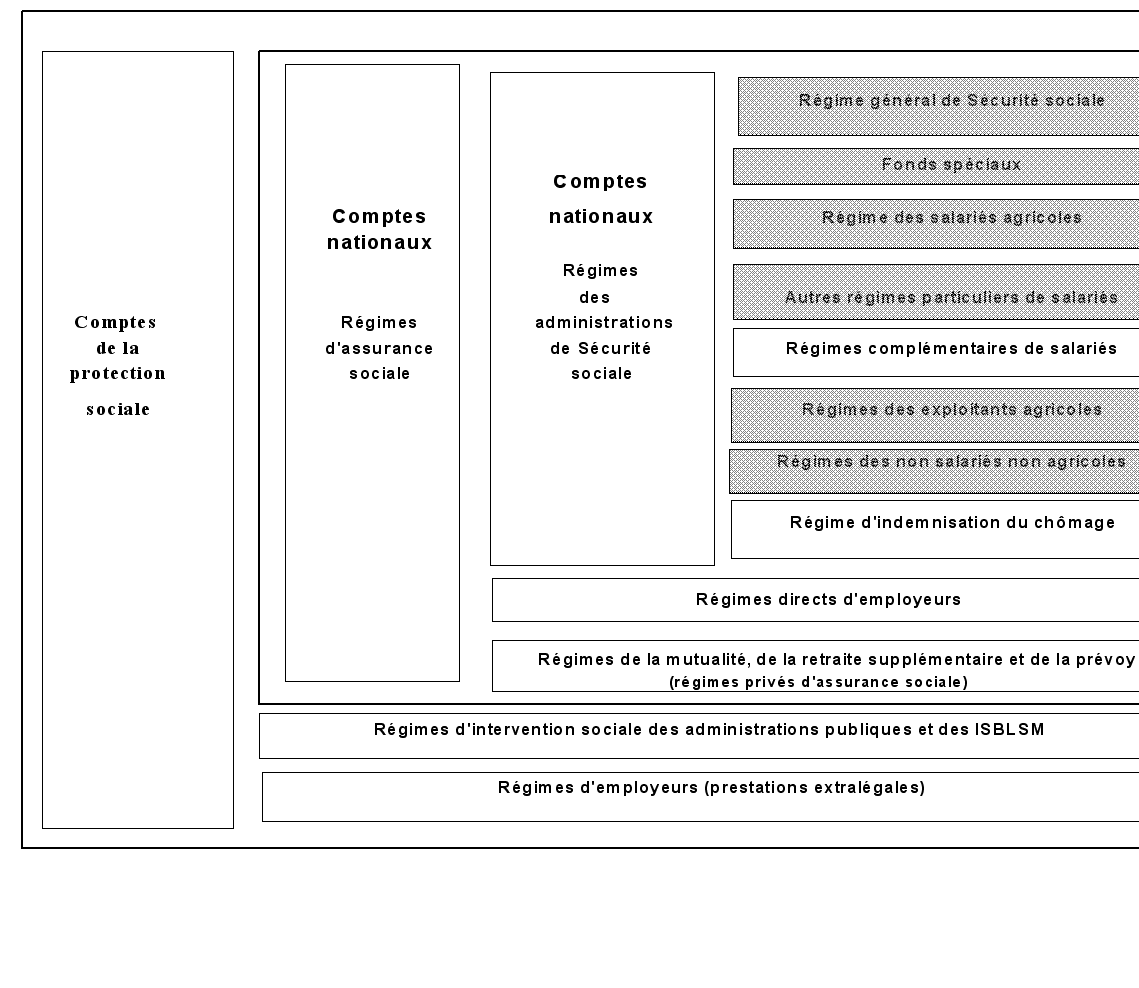
A côté de la protection sociale, les comptes de la sécurité sociale présentent les soldes financiers des comptes des régimes obligatoires de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement. Ces comptes sont établis essentiellement par la direction de la sécurité sociale, dans le cadre de la Commission des comptes. Ils permettent d'établir, après diverses opérations de retraitement, les annexes du projet de loi de financement de la sécurité sociale et servent à l'élaboration des agrégats proposés par le Gouvernement au Parlement dans cette loi.
Il faut donc retenir que le compte de la protection sociale est d'un champ plus vaste et que si la ligne présentée au titre de l'État retrace relativement fidèlement le périmètre des recettes approuvées par le Parlement après examen des différentes lois de finances, il n'en est pas de même pour les comptes des administrations sociales (ASSO), qui ne recoupent pas les périmètres des agrégats votés en lois de financement de la sécurité sociale.
|
|
|
|
Prélèvements obligatoires de l'État |
= recettes fiscales nettes du budget général |
|
|
+ corrections droits constatés |
|
|
- autres opérations des comptes |
|
|
+ recettes non fiscales en PO |
|
|
+ fonds de concours en PO |
|
|
- prélèvements sur recettes (UE et collectivités locales en PO) |
|
|
+ budgets annexes en PO |
|
|
+ comptes spéciaux du Trésor en PO |
Plusieurs différences importantes existent entre ces deux ensembles :
- les agrégats de la loi de financement de la sécurité sociale présentent les seuls comptes des régimes de base de sécurité sociale, justifiant de plus de 20.000 ressortissants, et des organismes concourant à leur financement (fonds de solidarité vieillesse, fonds de réserve des retraites), à l'exception notable de la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) ;
- les agrégats des administrations sociales (ASSO) présentent les comptes de l'ensemble des régimes de sécurité sociale de base, mais également des régimes obligatoires complémentaires de retraite, comme l'AGIRC et l'ARRCO, et le régime d'assurance chômage (Unédic). En revanche, la CADES ou le fonds de réserve des retraites ne sont pas comptabilisés en ASSO mais en organismes d'administration centrale (ODAC).
Votre rapporteur ne s'étendra pas sur les différences de nomenclature comptable entre les comptes de la sécurité sociale, notamment l'agrégat loi de financement, et les comptes des régimes de sécurité.
Tout en rappelant qu'un agrégat comptable est toujours contestable, il constate que le traitement en ODAC des recettes de plusieurs fonds concourant au financement des régimes de sécurité sociale demeure regrettable. La raison de cette éviction est justifiée par le fait que ces fonds ne distribuent pas eux-mêmes de prestations sociales. Pour autant, la non prise en compte des recettes du fonds de réserve des retraites, qui in fine servira au financement des prestations, dégrade comptablement la situation des administrations sociales.
De même il s'interroge sur l'absence de comptabilisation des recettes de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) dans les comptes des ASSO ainsi que dans les agrégats de la loi de financement, dès lors que les frais d'amortissement de la dette budgétaire - aujourd'hui bien lourds - constituent une partie indétachable du budget général et permettent d'en retracer ainsi plus fidèlement l'évolution.
2. Des périmètres fragiles
Entravée par l'existence de deux agrégats qui ne se répondent pas, la compréhension des finances sociales est en outre handicapée par le peu d'étanchéité de son périmètre.
En effet, depuis plusieurs années, les lois de financement et les lois de finances procèdent à des ajustements de recettes et de dépenses modifiant de ce fait la répartition des missions et des moyens entre l'État et la sécurité sociale.
De manière systématique, votre commission a déploré ces reclassements qui n'ont pas d'objectifs techniques ou politiques cohérents mais sont effectués pour des raisons anecdotiques de bouclage financier, dans la plupart des cas d'ailleurs au profit du budget de l'État. Sans lister l'intégralité des opérations étant intervenue ces dernières années, on rappellera ici celles dont l'impact est le plus significatif sur la stabilité et la lisibilité des finances sociales.
La débudgétisation de la compensation des allégements de cotisations sociales, via la création d'un fonds ad hoc , le FOREC, a été l'occasion de distraire la sécurité sociale d'une partie de ses recettes pour en doter ce fonds. En effet, celui-ci fut financé 3 ( * ) par une fraction des droits de consommation sur les alcools et par la taxe de prévoyance précédemment affectés au fonds de solidarité vieillesse, ou encore par la reprise de la fraction des droits de consommation sur les tabacs ou de la taxe auto affectés à la CNAM.
En quelque sorte, les administrations sociales se sont « auto-indemnisées » des allégements de cotisations décidés dans le cadre de la politique des trente-cinq heures. Les projets de loi de financement et de budget pour 2004 proposent de concert la suppression du FOREC et la rétrocession de ses charges et produits au budget général, sans que cette opération envisage la restitution de ses recettes, ou même l'indemnisation des régimes de sécurité sociale au titre du passé.
Mais cette opération, d'une ampleur inégalée jusque-là, ne constituait pas un précédent dans l'histoire récente des relations financières entre l'État et la sécurité sociale.
Ainsi, au cours de la législature précédente, le Gouvernement a décidé la débudgétisation de la majoration de l'allocation de rentrée scolaire (MARS) sur la CNAF, de même que le financement des majorations de pension pour enfants, la mise à la charge du fonds de solidarité vieillesse (FSV) de la dette du budget à l'égard des régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, non sans retirer à la branche famille le financement de l'allocation de parent isolé (API), pour les mêmes raisons anecdotiques précédemment énoncées. A l'issue de ces mouvements, le FSV assure le service d'une dette de l'État, le budget général paye une prestation familiale historique et la branche famille supporte un avantage vieillesse non contributif !
Nombreuses sont, en réalité, les « plaques tournantes » financières qui permettent d'injecter ou de capter les fonds de la sphère sociale. C'est notamment le cas du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) ou du mécanisme financier des compensations généralisées et spéciales d'assurance vieillesse qui ont permis à l'État, ce fait n'est plus à démontrer, de se défausser durant de nombreuses années de tout ou partie de sa mission de garant des régimes spéciaux sur le régime général ou le régime des collectivités locales (CNRACL).
Enfin, chaque projet de loi constitue en lui-même une occasion de déporter ici une charge - financement du plan contre le terrorisme bactériologique BIOTOX ou de missions de santé publique sur la CNAM - ou de prélever une recette - budgétisation du produit et des réserves constituées par la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat collectée par et initialement au profit de la caisse de retraite des commerçants des professions industrielles (ORGANIC) -.
La sécurité sociale ne fut pas la seule victime puisque l'État a su également, lorsqu'il en eut l'occasion, prélever une partie des fonds de l'assurance chômage.
En cherchant le plus souvent à « se repasser le mistigri des déficits », les administrations mettent en avant, de manière regrettable, la porosité des périmètres budgétaires.
3. Une responsabilité partagée
On ne peut que déplorer une telle situation et saluer la tentative, encore timide, menée par le Gouvernement d'en sortir.
En effet, cette situation est éminemment contestable en matière de finances sociales dont la spécificité tient au fait que l'État n'est pas, comme pour le budget général, « seul maître à bord ». Les partenaires sociaux sont, en effet, les gestionnaires des régimes de sécurité sociale et responsables à des degrés divers, pour les régimes de base et complémentaires, de l'évolution des comptes sociaux. Si la Constitution affirme la compétence du Parlement sur les recettes et les dépenses des organismes de base, les finances des régimes complémentaires obligatoires de retraite et du régime d'assurance chômage demeurent du ressort quasi exclusif des organisations patronales et syndicales.
Le fait que la réforme constitutionnelle de 1996 ait introduit le Parlement dans le pilotage des régimes de base n'a pas pour autant dégagé les partenaires sociaux de leurs responsabilités. Notre collègue député, Pierre Morange 4 ( * ) , rappelait dernièrement, dans un entretien accordé à un quotidien, que l'État était « le garant et non le gérant du système » . Cette affirmation prend tout son sens dans une acception large de la notion de garant : l'État fixe des objectifs que les partenaires sociaux mettent en oeuvre, eux dont dépendent les conseils d'administration des caisses.
Lorsque, dans le cadre du pacte de stabilité, le Gouvernement présente auprès de la commission les soldes des comptes sociaux, il en partage ainsi la responsabilité avec les partenaires sociaux.
A ce titre, peut-il obtenir de ses partenaires de gestion l'exercice de leurs responsabilités si ceux-ci conservent la faculté de lui opposer ses propres turpitudes ? En bref, l'État peut-il exiger de ses partenaires une certaine orthodoxie financière dès lors qu'il se révèle incapable lui-même de se soumettre à une telle discipline et est constamment soupçonné, à tort ou à raison, de se livrer, au moyen de « tuyauteries » sans cesse renouvelées, à « des rapts dans l'obscurité » ?
Votre rapporteur ne le pense pas.
B. UNE PONCTION CROISSANTE
1. Un effort significatif
Les comptes de la Nation révèlent qu'en 2002, l'effort en faveur de la protection sociale s'élevait à 328,3 milliards d'euros soit près de 50 % du total des prélèvements obligatoires au sens de la comptabilité nationale, nettement supérieur à l'effort réalisé au profit de l'État (256,6 milliards d'euros) ou des collectivités territoriales (75,6 milliards d'euros).
Prévision d'évolution des prélèvements obligatoires sur 2002-2004
|
En milliards d'euros |
2002 |
2003 (p) |
2004 (p) |
|
État + ODAC |
256,6 |
258,1 |
274,8 |
|
Administrations publiques locales |
75,6 |
77,8 |
86,2 |
|
Administrations de sécurité sociale |
328,3 |
340,7 |
336,4 |
|
Union européenne |
7,1 |
6,8 |
5,4 |
|
Total |
667,6 |
683,4 |
702,8 |
|
PIB en valeur |
1520,8 |
1559,0 |
1612,3 |
|
État + ODAC |
16,9 |
16,6 |
17,0 |
|
Administrations publiques locales |
5,0 |
5,0 |
5,3 |
|
Administrations de sécurité sociale |
21,6 |
21,9 |
20,9 |
|
Union européenne |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
|
Taux de prélèvement obligatoire |
43,9 |
43,8 |
43,6 |
Source : DP
L'agrégat de recettes des lois de financement de sécurité sociale - les prévisions de recettes - qui relève d'un périmètre différent proposait, pour cette année, le chiffre de 316 milliards d'euros, alors qu'en 2002 les ressources nettes du budget général, notamment hors prélèvements au profit de l'Union européenne et des collectivités territoriales, ne s'élevaient qu'à 224 milliards d'euros.
Pour effectuer quelques comparaisons significatives ou pédagogiques, les produits des principaux régimes d'assurance maladie 5 ( * ) sont, en 2002, équivalents à la totalité du produit de l'impôt sur le revenu, sur les sociétés et sur les produits pétroliers.
|
124,2 |
|
122 |
|
Exploitant agricole
|
|
Taxe intérieure sur les produits
pétroliers
|
|
CANAM
|
|
Impôt sur les sociétés
|
|
CNAM
|
|
Impôt sur le revenu
|
|
Produits de la branche maladie
|
|
Recettes fiscales de l'État
|
Pour mémoire, la totalité du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (142 milliards d'euros en 2003) ne suffirait pas à couvrir les charges des régimes de retraites de base (160 milliards d'euros).
Ces rapprochements sont utiles. Ils éclairent dans quelles proportions les masses des finances sociales excèdent les finances de l'État. Les prévisions de recettes votées en loi de financement pour 2002 s'élevaient, pour les quatre branches de la sécurité sociale, à 315,2 milliards d'euros, d'ailleurs à plus de 80 % destinés aux branches maladie et vieillesse, et constituaient déjà un volume de 30 % supérieur à l'ensemble des recettes fiscales de l'État.
Cette situation n'était sans doute pas envisagée il y a trente ans. La création de la loi de financement de la sécurité sociale constitue une première prise en compte de cette évolution dans des proportions encore largement imparfaite : notre Haute assemblée consacrera encore cette année une quinzaine entière à l'examen du projet de loi de finances, lorsqu'il n'est réservé que trois jours à l'examen du PLFSS. La première recette fiscale des administrations publiques, la CSG n'est pas votée en loi de finances mais en loi de financement de la sécurité sociale au cours d'un débat malheureusement beaucoup plus bref (une soirée pour tout le volet recettes !) que l'examen de la première partie du budget. Dès lors, le Parlement est-il en mesure de répondre à l'exigence que pose l'article 14 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen qui affirme que « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée » ?
Votre rapporteur ne le pense pas.
2. Une pression grandissante
Les ressources des administrations sociales (ASSO) ont en effet crû régulièrement durant les trois dernières décennies. De 13,1 % du PIB en 1970, les prélèvements obligatoires qui leur sont consacrés atteignent 21,6 % du PIB aujourd'hui.
Les causes de l'accroissement des besoins de financements sociaux depuis cette époque sont de nature économique et démographique : maturité progressive des régimes d'assurance vieillesse, allongement de la durée de vie et ses conséquences sur la protection sociale, amélioration de la prise en charge médicale et, dans le même temps, augmentation du chômage qui diminue les bases de recettes et augmente les dépenses d'indemnisation.
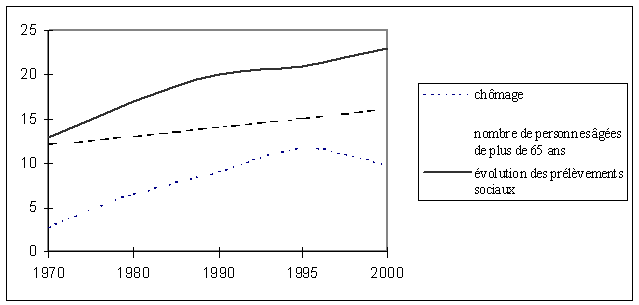
En apparence, cette croissance a marqué deux phases. La première s'étend jusqu'en 1990 et se caractérise par un rythme d'augmentation soutenu des prélèvements obligatoires affectés à ces régimes, passant, de 1970 à cette date, de 13 % à 20 % du PIB. L'évolution connue lors de la troisième décennie nourrit, par contraste, l'impression d'une stagnation, les recettes des ASSO ne passant que de 20 % à 21 % et encore, essentiellement sur les années 1998-2002.
A bien des égards, cette impression est trompeuse. Elle traduit, en réalité, la difficulté de ces administrations pour trouver de nouvelles recettes et le recours croissant au financement par l'emprunt, ou par l'externalisation du financement de certaines charges, notamment via des fonds ad hoc . Or, tant la structure d'amortissement de la dette que ces fonds n'apparaissent pas dans les comptes des ASSO, ce qui ne permet pas de retracer clairement l'évolution de leurs comptes.
Ce mouvement de forte évolution, puis de stagnation apparente, ne constitue pas un précédent. Les recettes de l'État sur cette même période ont décrû de 18,4 à 15,9 % du PIB, ce qui ne signifie pas que les dépenses de l'État diminuent dans des proportions équivalentes, car depuis une vingtaine d'années :
- le développement du processus de décentralisation a permis à l'État de progressivement transférer des recettes et des dépenses aux collectivités territoriales ;
- l'État a recouru massivement à l'endettement, le dernier excédent budgétaire datant du gouvernement de Raymond Barre. Mais dans le cas de l'État, l'endettement est clairement identifié dans ses comptes.
Une fois ce tableau brossé, peut-on parler véritablement des prélèvements sociaux comme d'un mal français, dont le poids sur la croissance et l'emploi est de plus en plus difficile à supporter ?
Le fait que la France se caractérise par un niveau élevé de prélèvements sociaux par rapport aux autres administrations (État, collectivités locales) et par rapport aux autres pays industrialisés n'est pas contestable. Une comparaison rapide avec les autres états de l'OCDE permet de mesurer l'ampleur du phénomène.
Dépenses sociales publiques par domaine de politique sociale, 1998
En pourcentage du PIB
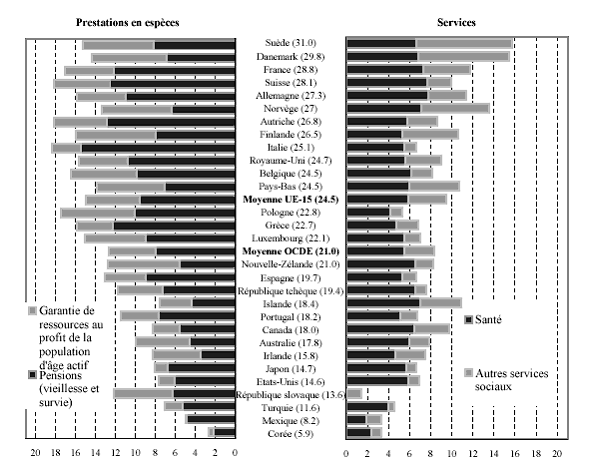
Source : OCDE
Il doit toutefois être relativisé car, pour une large part, il traduit un double choix politique :
- celui d'une protection sociale collective et solidaire, à l'opposé d'États ayant choisi d'assurer la prise en charge des risques maladie et vieillesse selon des modalités décentralisées et concurrentielles. L'analyse en exemple du niveau des dépenses de santé rapporté au PIB dans d'autres pays de l'OCDE, dont les Etats-Unis (13,9 % mais seulement 6 % pris en charge par la collectivité) souligne que la part des richesses consacrée à ces dépenses ne diminue pas dans un environnement libéralisé ;
- celui d'une protection sociale professionnelle et paritaire, à l'opposé d'États ayant choisi d'assurer la prise en charge des risques par ses propres services.
3. Des perspectives alarmantes
Cette situation est surtout alarmante en raison de ses perspectives. Dans une précédente étude, votre rapporteur avait placé certaines dépenses de protection sociale dans une optique de long terme. Dans le cas de l'assurance maladie, un rapide calcul laissait apparaître qu'un rythme d'évolution de ces dépenses supérieur, de deux points, à celui du PIB porterait l'effort public de santé de 9 % à 23 % du PIB d'ici 2040.
Part des dépenses d'assurance maladie dans le
PIB à l'horizon 2040
(comparaison avec les
dépenses de retraite)
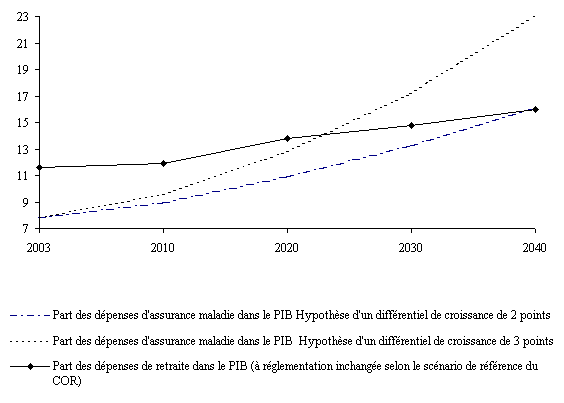
Source : commission des Affaires sociales du Sénat
Ces chiffres seront sans doute affinés par le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Il n'en demeure pas moins que la sécurité sociale ne dispose pas de ressources susceptibles d'équilibrer spontanément cette charge.
Les conclusions du rapport présenté par Alain Coulomb 6 ( * ) ont avancé que les dépenses de santé que l'on peut qualifier « d'incompressibles » à court et moyen termes augmentent sur un rythme de 3 ou 3,5 points en volume annuel. A titre de comparaison, la CSG a crû, en valeur, de 6,4 % en 2001, mais seulement de 2 % et en prévision de 2,6 % en 2002 et 2003, c'est-à-dire sur un rythme bien supérieur aux dépenses d'assurance maladie.
Un système de protection sociale, quelle que soit son organisation, doit conserver pour contrainte d'équilibrer ses produits et ses charges. L'exemple ci-dessus évoqué montre à bien des égards que les recettes affectées à la protection sociale sont conséquentes et dynamiques en période de croissance, mais toutefois insuffisantes pour assumer le moindre gaspillage.
Aujourd'hui, plusieurs pistes sont avancées pour résoudre le déséquilibre des régimes sans réduire le niveau de protection sociale.
L'augmentation des prélèvements obligatoires, immédiate ou différée, en constitue la première.
La deuxième consiste à procéder en quelque sorte comme l'État à son échelle, c'est-à-dire à transférer hors de son périmètre une partie de son « chiffre d'affaires ». Dans le cas des administrations de sécurité sociale, il pourrait s'agir de placer dans le secteur concurrentiel une fraction plus importante de la gestion de certains risques, ce qui pose à la fois la question de la responsabilité de l'assuré, invité à compléter par lui-même la réduction de la couverture collective, et celle de la qualité de la gestion et du rapport qualité-prix offert par les administrations sociales et par les organismes privés en matière de protection sociale.
Historiquement, les pouvoirs publics ont plutôt eu recours à la première solution. En effet, et à titre d'exemple, le taux de remboursement des soins s'est amélioré en trente ans et les prestations sont prises en charge en moyenne, à plus de 85 % par les régimes de base ou complémentaires obligatoires.
Cette préférence pour le prélèvement obligatoire a été rendue possible, au cours des années 1990, par une modification de la structure du financement de la sécurité sociale, en élargissant l'assiette, et par le recours à l'endettement. Mais cette stratégie trouve aujourd'hui ses limites et ne permet plus d'exclure tout uniment le réexamen du périmètre des dépenses sociales, au regard de l'évolution de leur financement.
Dans le cadre de cette étude consacrée à l'évolution des prélèvements sociaux, votre rapporteur ne pouvait pas éluder cette question. Il ne peut davantage la trancher.
II. JUSQU'OÙ DIVERSIFIER LES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX ?
A. SORTIR DES COTISATIONS SOCIALES : AMÉNAGEMENTS TECHNIQUES OU RÉVOLUTION THÉORIQUE ?
1. Les cotisations sociales, ennemies de l'emploi ?
Dans un régime de protection sociale fondé sur l'affiliation professionnelle et organisé de manière paritaire, le financement des risques est assez largement assuré par des cotisations assises sur les salaires, versées par les employeurs et les salariés, et il participe de la théorie du « salaire différé », perçu sous forme de prestations en nature ou en espèces.
Dès sa fondation, la sécurité sociale s'est inscrite dans la logique professionnelle (interprofessionnelle pour le régime général) et paritaire, la structure du financement des régimes reposant quasi uniquement sur des cotisations.
Or, à la fin des années 1980, les pouvoirs publics ont pris conscience que le financement de la protection sociale ne saurait peser davantage uniquement sur l'emploi.
Le premier argument plaidant alors pour une extension de l'assiette des prélèvements sociaux tenait à ce que la logique professionnelle du financement de la protection sociale limitait fortement l'effort d'une partie significative et croissante des bénéficiaires de prestations, notamment les titulaires de revenus de remplacement ou de revenus de placement.
En quelque sorte, le principe de justice sociale commandait qu'une participation soit exigée d'une fraction de la population dont la part des revenus dans la richesse nationale s'était sensiblement accrue depuis la fondation de la sécurité sociale.
Au fil du temps, les revenus distribués aux différentes générations de retraités ont crû de manière sensible entre 1945 et 1990, du fait de mesures de revalorisation et des conditions d'indexation des pensions.
Evolution des revenus des retraites par rapport aux actifs
(en euros)
|
|
1970 |
1979 |
1990 |
1996 |
|
Ménages actifs (1) |
10.519 |
14.635 |
15.855 |
16.007 |
|
Ménages de retraités (2) |
6.555 |
10.519 |
12.806 |
14.635 |
|
(2)/(1) |
62 % |
72 % |
81 % |
91 % |
De même, la rentabilité des capitaux et la part de la rémunération du capital dans le partage de la valeur ajoutée se sont significativement redressées au cours des années 1980.
Les situations des personnes titulaires de revenus de remplacement et de placement s'étant donc relativement améliorées par rapport à celle des salariés, il ne devenait pas illégitime de requérir de ces personnes qu'elles contribuent davantage au financement de la protection sociale.
Le second argument découle en quelque sorte du précédent. Depuis le milieu des années 1970, la situation de l'emploi s'est dégradée, notamment dans les secteurs industriels à fort coefficient de main-d'oeuvre. Il est apparu que le coût du travail, notamment peu qualifié, constituait une entrave à sa demande. Plusieurs études économiques empiriques sur la richesse de la croissance française en emploi sont venues confirmer par la suite ce diagnostic.
Dans le même temps, la situation financière de la sécurité sociale imposait que de nouvelles ressources lui soient affectées. Les pouvoirs publics semblaient ainsi se trouver confrontés à un choix entre équilibre des comptes sociaux et emploi. En réalité, ce choix n'était qu'apparent. La hausse des cotisations n'aboutit pas à une augmentation proportionnée des ressources : elle provoque une destruction de l'emploi et ne permet donc pas l'accroissement des recettes initialement escompté. Il n'y a donc pas d'arbitrage à réaliser entre la protection sociale et l'emploi : sans l'emploi, il n'y a pas de financement possible de la protection sociale.
2. 1991-2001 : l'ampleur d'un changement structurel
Entre 1990, année précédant la création de la CSG, et 2002, la part de la protection sociale financée par les cotisations sociales est tombée de 85 % à 65 % quand, dans le même temps, la part des recettes fiscales passait de 3,1 % à 23,5 % de ce total.
Une autre façon de mesurer cet état de fait est de rappeler l'évolution du taux de « pression sociale » sur cette période.
Le taux de pression sociale 7 ( * )
|
|
1990 |
1995 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Cotisations/PIB |
22,5 % |
22,6 % |
20,4 % |
20,4 % |
20,6 % |
|
Impôts et taxes affectées/PIB |
0,9 % |
2,2 % |
5,7 % |
5,9 % |
5,8 % |
|
(Cotisations+impôts et taxes affectées)/PIB |
23,4 % |
24,8 % |
26,0 % |
26,3 % |
26,4 % |
Source : Compte de la protection sociale - DREES ; comptes nationaux INSEE
Cette présentation globale résume imparfaitement l'ampleur d'un phénomène qui a inégalement affecté les différentes composantes de la protection sociale.
Les régimes de retraite obligatoire complémentaire - notamment l'AGIRC et l'ARRCO - se financent quasi intégralement par des cotisations assises sur les salaires. A titre d'exemple, en 2001, le financement du régime des cadres AGIRC reposait à 92 % sur ces cotisations. Il en est de même des régimes d'indemnisation du chômage (95 %).
Les régimes de retraite de base présentent une situation plus contrastée :
- d'un côté, le régime général, dont les recettes fiscales ne représentent stricto sensu que 0,3 % des ressources, contre 71 % pour les cotisations, mais qui bénéficie de l'effet « fonds sociaux » assurant indirectement 20 % des ressources du régime au moyen de produits fiscaux ;
- de l'autre, un grand nombre de régimes d'origine professionnelle, indépendants ou spéciaux, qui survivent pour la plupart de transferts (compensation, subventions d'équilibre, fiscalité affectée). C'est le cas notamment de nombreux régimes spéciaux, des régimes de commerçants et artisans et in fine des fonctionnaires de l'État.
Le régime des allocations familiales et de l'assurance maladie sont sans doute « les risques » dont le financement repose aujourd'hui le plus sur la fiscalité, puisqu'une petite moitié seulement des ressources de ces branches est encore financée par des cotisations, d'ailleurs exclusivement patronales dans le cas des allocations familiales.
Les différents volets de la fiscalisation progressive des finances sociales ont réduit significativement la force relative des cotisations versées à l'assurance maladie dans les produits de la branche. Alors que les recettes de cotisations représentaient 93 % des recettes de la CNAM en 1990, elles ne s'élèvent plus qu'à 53 % en 2002, alors que dans le même temps les ressources fiscales directes ou indirectes sont passées de 2 % à 43 %.
Cette montée en force des ressources fiscales au détriment des cotisations sociales constitue-t-elle un simple aménagement technique ou au contraire une remise en cause profonde de la protection sociale, et de la sécurité sociale notamment ?
En effet, la légitimité de gestion par les partenaires sociaux est tout à fait évidente dès lors que le financement repose en grande majorité sur le monde du travail. La fiscalisation progressive des ressources de certaines branches a pour conséquence de saper cette légitimité. Dès lors que les ressources sont procurées par l'impôt, quel espace reste-t-il aux partenaires sociaux pour revendiquer la gestion des régimes ?
La création de la loi de financement a pu être considérée comme une conséquence de ce phénomène de fiscalisation. Elle fut d'ailleurs contestée par certaines centrales syndicales. Votre rapporteur ne partage pas cet avis. L'intervention du Parlement était rendue nécessaire par le fait que les masses des prélèvements sociaux échappaient au consentement parlementaire, créant ainsi un déficit démocratique certain.
Sans remettre en cause le fondement de la démocratie participative - les organisations syndicales -, il rappelle que la démocratie représentative s'est construite sur le consentement parlementaire à l'impôt. L'augmentation ininterrompue des cotisations par voie réglementaire, sans intervention des élus du peuple, constituait en soi une anomalie que la loi de financement ne faisait que réparer.
Pour autant, poursuivre plus avant la fiscalisation des prélèvements sociaux est potentiellement porteur d'une modification sensible de la philosophie de la protection sociale dans son ensemble, ou d'un éclatement de celle-ci entre la gestion des risques relevant de l'État et ceux relevant des partenaires sociaux. Une telle évolution ne saurait être l'aboutissement d'ajustements techniques, c'est-à-dire l'augmentation ici ou là d'un impôt affecté à la protection sociale, mais elle doit au contraire susciter un large débat. La France ne fera désormais plus l'économie d'une telle réflexion, même si les différents volets de la fiscalisation des ressources sociales semblent avoir atteint leurs limites.
B. LES TROIS VOLETS DE LA FISCALISATION PROGRESSIVE DES FINANCES SOCIALES
1. La contribution sociale généralisée (CSG) : instrument de la fiscalisation des cotisations salariales
Instrument central de diversification des ressources de la sécurité sociale, la CSG a été créée par les articles 127 à 135 de la loi de finances pour 1991.
Rangé par le Conseil constitutionnel, lors de l'examen de cette loi, dans la catégorie des « impositions de toute nature », ce prélèvement avait comme propriété d'être assis sur une base plus large que les seuls revenus du travail. En effet, il s'appuyait aussi sur les revenus d'activité, de transferts ou de placements et se caractérisait par un taux bas, à l'époque 1,1 %, affecté à la caisse nationale des allocations familiales en contrepartie de la modification du régime de ses cotisations, qui ne comporte désormais plus de part salariale.
En 1993, le gouvernement d'Edouard Balladur a majoré le taux de CSG de 1,3 % en faveur d'un nouveau fonds, le fonds de solidarité vieillesse (FSV), créé pour financer certaines charges des régimes d'assurance vieillesse. Le taux fut donc porté à 2,4 % et n'était pas, cette fois, la contrepartie d'une diminution de cotisations salariales.
Confronté aux difficultés financières de la sécurité sociale, le gouvernement suivant a proposé, dans le cadre du « plan Juppé » un panel de mesures destinées à rééquilibrer la sécurité sociale. Pour assurer son redressement durable, il a décidé de la doter de nouvelles ressources, ou de ressources plus dynamiques, et des efforts furent exigés des usagers et de ses acteurs.
Les mesures financières de sauvegarde du
plan Juppé
Elles visaient, d'une part, à apurer la dette cumulée du régime général, d'autre part, à engager un rééquilibrage des trois branches déficitaires :
la reprise de la dette accumulée par le régime général a été assurée par un établissement public créé à cet effet, la caisse d'amortissement de la dette sociale financée par l'instauration d'une contribution pour le remboursement de la dette sociale au taux de 0,5 %, permettant dans le même temps de libérer le fonds de solidarité vieillesse des charges liées à la prise en charge de la dette de 110 milliards de francs accumulée à fin 1993 ;
le rééquilibrage de la branche retraite a été entrepris au moyen de la prise en charge par le fonds de solidarité vieillesse de dépenses de solidarité incombant au régime général, à hauteur de 11 milliards de francs, à quoi s'ajoutaient la limitation à 2 % de la revalorisation des pensions au 1 er janvier 1996 (0,5 milliard) et l'harmonisation des prises en compte de durée d'activité des polypensionnés (0,2 milliard) ;
le rééquilibrage de la branche famille comportait l'extension de l'assiette de la CSG en 1997, la non-revalorisation des prestations familiales en 1996 (2,6 milliards de francs), l'harmonisation des conditions d'attribution de certaines prestations familiales et des aides au logement (2,4 milliards au total), le transfert à la CNAF de la gestion des prestations servies à leurs agents par l'État et les entreprises publiques (0,7 milliard) et l'imposition des prestations des allocations familiales à compter de 1997, ensuite abandonnée ;
le rééquilibrage de la branche maladie incluait la limitation de l'évolution des dépenses d'hospitalisation et de médecine de ville à celle des prix en 1996 et en 1997 (3,3 milliards), une contribution exceptionnelle des laboratoires pharmaceutiques (2,5 milliards) et d'autre part des médecins (suspension partielle en 1996 de la prise en charge des cotisations familiales des médecins du secteur I (0,4 milliard), affiliation des médecins du secteur II au régime général pour leur assurance maladie (1,4 milliard), et l'harmonisation progressive des cotisations maladie sur les revenus de remplacement avec les cotisations des actifs par une hausse de 1,2 point du taux en 1996 puis en 1997 (7,1 milliards en 1996) ;
en outre, une réduction des dépenses de
gestion était demandée aux caisses de sécurité
sociale (1,5 milliard en 1996).
Dans ce cadre, le législateur a décidé le basculement de 1,3 point de cotisations salariales maladie sur l'augmentation de 1,2 point CSG affecté à ces régimes. Le taux de la cotisation sociale généralisée se trouvait ainsi porté à 3,4 %.
Un an plus tard, une nouvelle majorité parachevait le mouvement engagé six ans auparavant en procédant dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 à une substitution massive :
- diminution du taux de cotisations salariales maladie de 4,75 points contre une augmentation de la CSG sur les revenus d'activité et du patrimoine de 4,1 points ;
- suppression de la cotisation maladie sur les revenus de remplacement contre une hausse du taux de CSG sur ces revenus de 2,8 points.
A l'origine, le bilan de ces basculements fut malaisé à établir, mais finalement, couplé avec l'affectation de droits de consommation sur les alcools à la CNAM, le basculement des cotisations sociales sur la CSG s'est révélé financièrement positif pour l'assurance maladie.
Solde de l'opération de substitution tous
régimes -
Métropole et DOM
(en milliards de francs)
|
Au titre de |
1998 |
1999 |
|
SOLDE |
5,2 |
12,6 |
|
CSG maladie |
208,3 |
239,1 |
|
Droits sur les alcools |
4,8 |
4,7 |
|
Pertes de cotisations sociales |
- 207,8 |
- 231,3 |
Source : Commission des comptes de la sécurité sociale
2. La compensation des allégements de cotisations : instrument de fiscalisation des charges patronales
Depuis une décennie, les pouvoirs publics ont accéléré la mise en place de mesures d'allégement ou d'exonération de cotisations sociales afin d'inciter à l'embauche ou au maintien dans l'emploi de certains salariés.
Depuis le premier dispositif d'exonération de cotisations sociales institué en 1979 en faveur du contrat d'apprentissage, le nombre de mesures de ce type a fortement augmenté. La multitude des contrats aidés date en effet du début des années 1990, suivi de peu par les exonérations ciblées sur les bas salaires.
Initialement, la sécurité sociale assumait financièrement le coût de cette fraction de la politique de l'emploi décidée par l'État. Très rapidement, sa situation financière interdit que davantage d'exonérations soient mises en place sans être compensées aux régimes. La loi du 25 juillet 1994 a posé le principe de la compensation intégrale des allégements et exonérations décidés par l'État. À cette occasion, le Parlement a formellement condamné ce qui reviendra plus tard sous la dénomination de « théorie des retours » : peu importe le bilan financier positif que peut avoir une mesure d'allégement, par exemple en stimulant l'emploi, la sécurité sociale ne doit en assumer aucun coût.
En conséquence, si la sécurité sociale assumait, en 1993, les deux tiers du coût des allégements (1,8 milliard d'euros sur 3 milliards), elle ne supporte plus désormais, du fait de la règle de la compensation intégrale, du moins en affichage, que 2 milliards d'euros sur 21 milliards, somme représentant le coût total des allégements en 2003.
En effet, à partir des années 1996, une stratégie résolue de baisse des charges a été menée en faveur de l'emploi des salariés modestes, notamment par la création de la ristourne sur les bas salaires. Par la suite, les dispositifs relatifs à la réduction du temps de travail (« Robien », puis « Aubry I » et « Aubry II ») ont représenté, en 2002, plus de 10 milliards d'euros 8 ( * ) .
Depuis le 1 er juillet 2003, le dispositif « Fillon » remplace par un allégement unique dégressif, le dispositif d'exonération lié aux trente-cinq heures et la réduction dégressive sur les bas salaires. Au terme de cette réforme, le 1 er juillet 2005, cet allégement unique sera linéairement dégressif en montant jusqu'à 1,7 fois le SMIC, pouvant ramener, pour un salaire au niveau du SMIC, le taux de cotisations patronales de sécurité sociale de 30,2% jusqu'à 4,2 %.
A côté de cet allégement général, des allégements ciblés demeurent sur certaines zones géographiques ou à destination de publics particuliers dont on avait, pour certains, prévu l'extinction. Ainsi, en est-il des zones franches urbaines. Plusieurs lois ou projets de loi, comme la loi du 1 er août 2003 pour l'initiative économique ou le projet portant décentralisation en matière de RMI et création du revenu minimum d'activité, amplifient cette politique d'exonérations ou d'allégements.
Le processus de fiscalisation des cotisations salariales réalisé par le basculement de cotisations maladie et famille sur la cotisation sociale généralisée est en voie d'être accompli pour les cotisations patronales pesant sur les bas salaires et certaines cibles particulières, par les politiques d'allégements.
En effet, la compensation de ces allégements fut réalisée d'abord, par le versement d'une dotation en provenance du budget général jusqu'en 1997 puis, par la suite, partiellement au moyen d'un fonds ad hoc , le FOREC. Or, qu'il s'agisse du budget général, ou surtout du FOREC, l'origine des fonds était de nature fiscale. D'un point de vue des prélèvements sociaux, la compensation des allégements de cotisations constitue bien une modification structurelle majeure.
3. La création du Fonds de solidarité vieillesse : la fiscalisation de certaines prestations non contributives
Confronté aux difficultés financières de la branche vieillesse, le législateur a décidé de séparer, par la loi du 22 juillet 1993, la prise en charge des prestations non contributives des régimes de retraite, devant être financées par la solidarité nationale, des prestations contributives devant être, pour leur part, financées par les cotisations des assurés.
Cette loi prévoyait donc la création d'un fonds spécifique, le fonds de solidarité vieillesse (FSV). La vocation initiale de ce fonds était double :
- prendre en charge des prestations non contributives des régimes d'assurance vieillesse ;
- assurer le service de la dette de la sécurité sociale, en remboursant l'État qui avait lui-même effacé une ardoise de 110 milliards de francs contractée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Dépenses et recettes FSV et leur évolution
Pour prendre en charge ces deux dépenses, le fonds de solidarité vieillesse se voyait doté de deux ressources essentielles : le produit d'une augmentation de CSG de 1,3 % et l'affectation des droits de consommation sur les alcools, dits « droits 403 », dont bénéficiait précédemment le budget général.
Lors de la création de la CADES en 1996, le FSV fut déchargé du remboursement de la dette de 1993. Ainsi, les transferts au bénéfice du régime général ont pu être majorés, notamment par le relèvement de l'assiette servant de base à la validation des périodes assimilées au chômage et au service national de 60 % à 90 % de la valeur du SMIC. Cette mesure a généré un transfert supplémentaire vers les régimes de retraite estimé à 11,5 milliards de francs (1,75 milliard d'euros) en 1996.
Dans le même temps, le remboursement de la dette, ancienne et nouvelle, était assuré par la CADES, c'est-à-dire par une nouvelle ressource fiscale.
Votre rapporteur ne procèdera pas ici à une analyse détaillée de la CADES, qui a fait l'objet d'une mission de contrôle 9 ( * ) au printemps dernier.
La création de cette caisse pourrait à bien des égards constituer un exemple de la création de ces fonds qui, avec le FSV, ont permis le financement de la protection sociale au moyen de recettes fiscales (fonds de financement de la couverture maladie universelle, pour le volet complémentaire de cette dernière). Toutefois, la CADES, par sa nature, met en avant la limite atteinte par cette stratégie de diversification.
La contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) est à n'en pas douter une recette fiscale de la sécurité sociale, pesant sur l'ensemble des revenus, par un taux bas (0,5 %). Mais dans le même temps, elle constitue l'amortissement d'une somme déjà consommée (53 milliards d'euros) dont la charge pèsera sur les générations futures. Sous cet aspect, elle ne constitue pas un élément de diversification des finances sociales mais l'indice d'une fuite en avant dangereuse : la France peut-elle supporter, à côté d'un budget général dont l'endettement va croissant et qui n'a plus réalisé un excédent depuis vingt ans, le coût d'une protection sociale incapable d'équilibrer ses charges et qui, elle aussi, doit recourir aux services d'une caisse de refinancement permanente ?
Votre rapporteur ne le pense pas.
C. L'AFFAIRE FOREC : LES LIMITES DE LA PROGRESSION DES PRELÈVEMENTS SOCIAUX
1. L'abandon masqué de la compensation intégrale
La tentative d'abandon du « garde fou » institué par la loi Veil de 1994 constitue le premier volet de ce que votre rapporteur appellera une dernière fois « l'affaire FOREC ».
A l'occasion d'une mission de contrôle sur ce fonds, notre ancien collègue Charles Descours avait démontré, par la saisie de documents au ministère des finances, que cette administration craignait avant tout que la mise en place des trente-cinq heure ne se traduise par une dégradation de grande ampleur de l'équilibre du budget de l'État.
Aussi fut-il annoncé ouvertement, dans un premier temps, que la sécurité sociale - et le régime d'assurance chômage - contribueraient directement au financement des trente-cinq heures. Cette position s'appuyait sur la justification que la réduction du temps de travail produit, par l'augmentation de la main-d'oeuvre, une bonification des recettes sociales. Sous la pression des partenaires sociaux, peu convaincus par une argumentation qui éludait les conséquences, pour le produit des cotisations, de la modération salariale accompagnant la RTT, cette déclaration fut retirée. Mais la volonté dolosive à l'égard des comptes sociaux de les faire participer à ce financement demeurait, et elle fut mise en oeuvre au moyen de circuits financiers opaques.
Sans détailler à nouveau l'ensemble des dysfonctionnements ayant accompagné la mise en place de ce fonds 10 ( * ) , votre rapporteur rappellera :
- que les organismes de sécurité sociale, notamment le FSV et la CNAMTS directement, la CNAF et la CNAVTS indirectement, ont cédé des recettes au financement des trente-cinq heures. En 2002, votre rapporteur avait chiffré, par reconstitution des comptes, l'ensemble de ce coût à 4,5 milliards d'euros annuels (30 milliards de francs) pour la sécurité sociale ;
Exercice 2002
|
(en millions de francs) |
CNAMTS AM |
CNAMTS AT |
Total CNAMTS |
CNAVTS |
CNAF |
Total RG |
FSV |
FOREC |
|
Compensation intégrale des exonérations de cotisations FOREC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Répartition du prélèvement social de 2 % sur la base CMU (valeurs 2002) |
3.696 |
|
3.696 |
4.620 |
2.904 |
11.220 |
- 2.640 |
|
|
Répartition droits tabac sur base CMU (valeurs 2002) |
4.203 |
|
4.203 |
|
|
4.203 |
|
- 4.203 |
|
Répartition droits alcools CNAMTS et FSV (valeurs 2002) |
5.805 |
|
5.805 |
|
|
5.805 |
11.900 |
- 17.705 |
|
Répartition CSG entre CNAMTS et FSV |
- 8.574 |
|
- 8.574 |
|
|
- 8.574 |
13.190 |
|
|
Transfert au FSV de la dette de l'État envers l'AGIRC et l'ARRCO |
|
|
|
|
|
|
- 3.000 |
|
|
Transfert « croisé » MARS - FASTIF entre la CNAF et l'État |
|
|
|
|
- 5.500 |
- 5.500 |
|
|
|
Transfert majorations de pensions FSV - CNAF |
|
|
|
|
- 6.000 |
- 6.000 |
6.000 |
|
|
Taxe sur les contributions employeurs (financement des prestations complémentaires de prévoyance) FSV - FOREC |
|
|
|
|
|
|
2.900 |
- 2.900 |
|
Transfert taxe sur les véhicules à moteur CNAMTS - FOREC |
5.900 |
|
5.900 |
|
|
5.900 |
|
- 5.900 |
|
Total |
11.030 |
0 |
11.030 |
4.620 |
14.404 |
30.054 |
22.350 |
- 30.708 |
|
Soldes PJLFSS 2002 |
- 13.113 |
3.450 |
- 9.662 |
6.671 |
8.114 |
5.123 |
- 4.014 |
0 |
|
Soldes « révisés » |
- 2.083 |
3.450 |
1.368 |
11.291 |
22.518 |
35.177 |
18.336 |
- 30.708 |
|
Cumul F2R après modification des dispositions CNAVTS et FSV 2000 et 2001 : 100 milliards de francs (PJLFSS 86 milliards) |
||||||||
- qu'en plus de cette participation, le FOREC s'est trouvé, en 2000, dans l'impossibilité de faire face à ses charges car il avait été sous-doté de 2,2 milliards d'euros que le gouvernement d'alors prétendait ne pas rembourser aux organismes sociaux. Ces créances seront remboursées par la CADES, c'est-à-dire, à bien des égards, par la sécurité sociale elle-même.
Sans revenir sur l'irresponsabilité du gouvernement précédent ayant gravement fragilisé les comptes sociaux, votre rapporteur soulignera l'extrême difficulté du budget général à financer, aujourd'hui, plus de 15 milliards d'euros annuels d'exonérations de cotisations sociales.
La suppression du FOREC décidée en 2004 se fait dans des conditions de transparence satisfaisantes puisque la compensation sera effectuée à l'avenir comme elle l'était antérieurement à 1997, par dotation budgétaire. L'épisode du FOREC se solde tout de même par une perte de recettes significative pour la sécurité sociale, environ 5 milliards d'euros annuels, le budget récupérant, avec les charges du FOREC, les produits qui lui sont affectés, y compris ceux distraits aux régimes sociaux.
Cet épisode doit attirer l'attention du législateur sur l'extrême vigilance avec laquelle il doit consentir des allégements de cotisations dont la charge, pour l'équilibre des finances publiques, atteint désormais un sommet.
Le législateur doit également s'attacher à ce que le principe de compensation intégrale soit respecté sans entorse.
2. L'échec de la réforme des cotisations patronales
Le deuxième volet de « l'affaire FOREC » est constitué par la réforme imaginaire des cotisations patronales. Durant la campagne électorale de 1997, l'équipe de Lionel Jospin avait pris l'engagement de procéder à une réforme ambitieuse des cotisations patronales, notamment en asseyant le calcul de ces dernières sur la valeur ajoutée.
Grâce à deux rapports qui se sont (opportunément ?) neutralisés - le rapport Chadelat, favorable à un passage progressif à une assiette valeur ajoutée, et le rapport Malinvaud, défavorable à une telle évolution -, l'assiette des cotisations patronales de sécurité sociale est restée assise sur les seules rémunérations.
La dénomination initiale du FOREC était « fonds de financement de la réduction du temps de travail » . Ainsi que l'avait déjà noté Charles Descours, « le choix de l'intitulé « fonds de financement de la réforme des cotisations patronales » présentait l'avantage de faire accroire qu'une telle réforme avait eu lieu puisque l'on était au stade de son financement. Il n'en est évidemment rien : le calcul des cotisations patronales n'est aucunement affecté par un élément « valeur ajoutée », un élément « pollution » ou un élément « bénéfices » ni, a fortiori, par un élément « tabac » ou « alcool ». En revanche, le coût des exonérations de cotisations sociales accordées dans le cadre de la réduction du temps de travail est bien financé en 2000 par quatre impositions affectées (tabacs, droits sur les alcools, contribution sociale sur les bénéfices, taxe générale sur les activités polluantes) que sont venus compléter en 2001 deux prélèvements supplémentaires (une fraction de la taxe sur les conventions d'assurance et la taxe sur les véhicules de sociétés) ».
Le gouvernement d'alors a bien évidemment prétendu qu'il s'agissait là d'une réforme ambitieuse des cotisations patronales, en affectant au remboursement des allégements les produits de quelques « rossignols de la fiscalité », c'est-à-dire des taxes à la constitutionnalité incertaine et au rendement décroissant.
En aucun cas le FOREC ne constituait une réforme ambitieuse des cotisations patronales mais symbolisait, en toute évidence, la caricature d'un engagement important - le calcul des cotisations sur la valeur ajoutée - qui, pour des raisons économiques majeures, avait été ajourné.
Ce deuxième aspect de l'affaire FOREC constitue en tout cas pour votre rapporteur l'indice irréfutable que l'opportunité d'une réforme des cotisations sociales par substitution d'assiette devenait économiquement réfutable et que, désormais, les nouvelles prestations devraient être financées au moyen d'économies.
Ce jugement est d'ailleurs renforcé par l'évolution progressive des fonds sociaux, et notamment du FSV, sur la fin de la législature. Celui-ci s'est trouvé progressivement asséché au profit non seulement du FOREC mais d'autres financements, dont l'allocation personnalisée d'autonomie, à laquelle il a dû céder 0,1 point de CSG et à laquelle il doit depuis un déficit structurel.
Le bilan de l'évolution des finances sociales au cours de la dernière décennie peut donc être dressé de la manière suivante :
- les périodes de ralentissement économique se traduisent par des crises majeures des finances sociales ;
- ces crises ont été résolues à court et moyen termes par l'apport de recettes nouvelles, notamment de caractère fiscal, et par l'endettement ;
- pour autant cette « bouffée d'oxygène » s'est rapidement trouvée raréfiée du fait de l'extension importante des dépenses sociales au cours de la dernière législature (couverture maladie universelle, allocation personnalisée d'autonomie et, bien sûr, compensation de la hausse du coût du travail constituée par les trente-cinq heures) : la législature 1997-2002 fut, en matière de finances sociales, une fuite en avant ;
- mais structurellement, cette fuite en avant s'inscrit dans un contexte propre aux finances publiques françaises et souligne les limites de l'augmentation, ininterrompue sur trente ans, des prélèvements sociaux. Comme le dit l'adage, « les arbres ne montent pas jusqu'au ciel » .
III. L'ÉVOLUTION MAL ASSISE DES TAXES SUR LES TABACS
A. UNE FISCALITÉ COMPLEXE POUR DES OBJECTIFS CONTRADICTOIRES
1. Une fiscalité complexe
La fiscalité sur les produits composés à partir de tabac est triple. Sur son prix d'achat, le consommateur acquitte successivement :
- la taxe sur la valeur ajoutée, appliquée au taux normal de 19,6 % (également appelé taux « en dehors »), qui est assise sur le prix de vente au détail. La TVA est égale à 16,388 % du prix de vente du paquet de cigarettes (taux « en dedans ») et rapporte à l'État 2,3 milliards d'euros par an ;
- une taxe spécifique de 0,74 % au bénéfice du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA), cette taxe ayant rapporté 132 millions d'euros en 2002 ;
- le droit de consommation, également dénommé « accise », qui représente l'essentiel de la fiscalité sur le tabac et dont le produit s'est élevé en 2002 à 8,6 milliards d'euros.
Le mécanisme de calcul de l'accise est réputé pour sa complexité. Encadré par le droit européen, le principe de cette fiscalité est de se calculer « à rebours ».
- pour les cigarettes, le droit de consommation se décompose en deux parts établies à partir de la cigarette de la classe de prix la plus demandée (actuellement la Marlboro) : une part spécifique (montant forfaitaire par cigarette) et une part proportionnelle (fonction du prix de vente au détail).
- les autres produits à base de tabac sont frappés d'un droit de consommation proportionnel au prix de vente.
La fiscalité du tabac a deux caractéristiques :
- la fiscalité - et son produit - sont indirectement déterminés par les fabricants car c'est in fine par rapport au prix décidé par le cigaretier que le taux est calculé (principe de la fiscalité « à rebours » ou « en dedans ») ;
- la fiscalité a une incidence forte sur le marché.
A titre d'exemple, le relèvement de la part proportionnelle sans augmentation du minimum de perception peut favoriser l'écart de prix et donc redistribuer des parts de marchés en faveur des fabricants se positionnant en entrée de gamme. A l'inverse, le relèvement du minimum de perception « écrase » le marché en renchérissant le seul prix des cigarettes les moins chères, favorisant ainsi indirectement le fabricant de la cigarette la plus demandée.
A ces deux éléments s'ajoute le fait que les prix sont libres mais doivent être homologués par l'administration. Dans la pratique, les alternances d'accords avec cette dernière et de guerre de prix entre fabricants rendent erratiques l'impact budgétaire et sanitaire, à court terme, d'une variation de la fiscalité.
2. Une fiscalité efficace ?
La lutte contre le tabac est un enjeu de santé publique évident, rappelé à sa juste mesure dans le cadre du plan cancer. En effet, la mortalité annuelle directe liée au tabagisme est estimée à 60.000 décès, soit peu ou prou 10 % de la mortalité globale, notamment par cancer des voies aérodigestives supérieures, maladies respiratoires ou cardio-vasculaires. Or, les budgets dédiés à l'information et à la lutte contre le tabac restent limités alors même que l'Organisation mondiale de la santé recommande de consacrer 1 % de la fiscalité du tabac au financement des actions de lutte contre le tabagisme.
La fiscalité sur le tabac, en fait, constituerait « en soi » une politique efficace en termes de santé publique puisque pourrait être mise à son crédit la baisse de la consommation du tabac depuis dix ans. D'après l'INSEE, une augmentation de 1 % du prix des cigarettes se traduit par une baisse de 0,3 % des volumes consommés sur l'année. S'appuyant sur cette donnée, le rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2002 cautionnait un tel scénario.
En réalité, si, sur la décennie 1990-2000, la consommation de cigarettes distribuées a baissé d'un sixième, d'ailleurs essentiellement sur la partie 1990-1997, sur longue période les données sont plus incertaines pour deux raisons.
La consommation totale de tabac forme une « cloche » sur une période plus longue, notamment sur vingt ans. Ainsi, la référence de 1990 constitue un sommet, et prise par rapport à 1980, la consommation totale de tabac n'a reculé que de 2,5 % 11 ( * ) .
Vente de tabac en milliers de tonnes
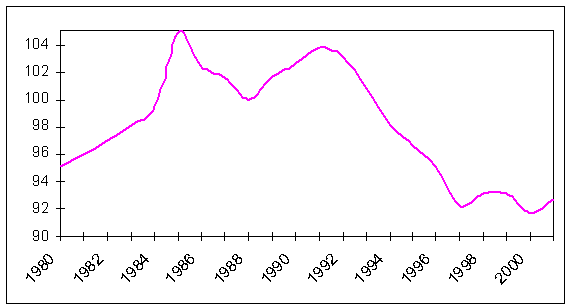
Source : CDIT
Certes, la consommation de cigarettes a légèrement reculé sur vingt ans et significativement sur dix ans. Mais la courbe d'évolution de la consommation du tabac à fumer montre une évolution quelque peu inverse.
En effet, le niveau de consommation, après avoir fortement décru au cours des années 1988-1992, a, à nouveau, fortement augmenté depuis 1993-1994, dates où le prix de la cigarette de référence - la Marlboro - a crû respectivement de 16 % et 17,2 %. Cette évolution parallèle laisse penser que la hausse brutale de la fiscalité en 1993-1994 a déformé le marché, favorisant une modification de la consommation du tabac, des cigarettes vers le tabac à fumer.
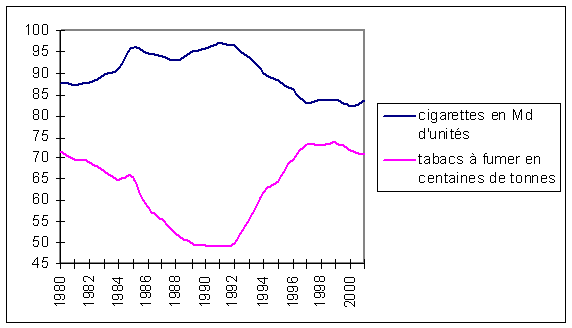
Source : CDIT
Aussi votre rapporteur ne sera-t-il pas aussi affirmatif que la Commission des comptes sur l'impact de la fiscalité sur la consommation du tabac. Il est probable que la fiscalité ait contenu l'emballement de la consommation de cigarettes à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Cette période est celle notamment de la baisse de la consommation de tabac brun, remplacée par de jeunes fumeurs de tabac blond sans doute plus sensibles à l'augmentation de la fiscalité.
Ne peut être contestée, en revanche, l'augmentation des quantités saisies par le service des douanes qui ont crû de 160 % en dix ans. Sans doute le tabac est devenu un sujet de préoccupation croissant pour cette direction du ministère des finances, qui prélève d'ailleurs la taxe, au fur et à mesure que son montant augmentait. Pour autant, il n'est pas extravagant d'envisager une augmentation significative de la contrebande sur cette période, d'autant plus que les années d'augmentation les plus significatives de la fiscalité furent également celles d'une augmentation significative des saisies.
Evolution respective des quantités saisies
et
variation du prix de la Marlboro en %
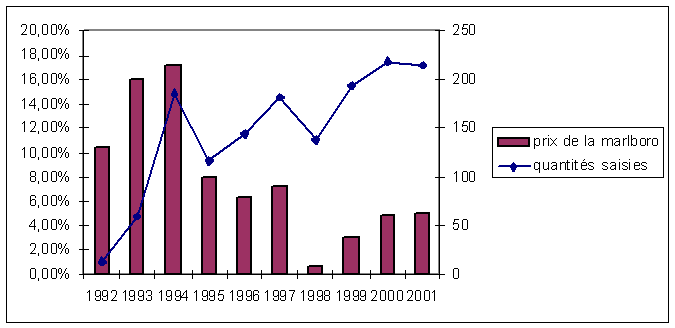
Source : CDIT
L'augmentation de la fiscalité du tabac doit encore démontrer, sous certains aspects, en matière de santé publique (baisse véritable de la consommation), qu'elle atteint tous ses objectifs. Mais, en revanche, il est certain qu'elle a permis une augmentation significative des recettes de l'Etat sur la période, le produit du droit de consommation en euros constants étant passé de 2 à 8 milliards en dix ans.
B. LES LIMITES ET LES RISQUES D'OPÉRATIONS PONCTUELLES
1. Les enjeux cachés d'une recette instable
La fiscalité du tabac est traditionnellement une fiscalité d'État. Pour la première fois, une fraction de son produit fut affectée à la CNAM en 1996 12 ( * ) , à hauteur de 6,39 %.
A partir de 2000, le financement du FOREC fut assuré notamment par la quasi-intégralité des droits sur le tabac. Cette affectation fut, à de nombreuses reprises, critiquée. Alors même que le bénéfice, pour l'État, de cette accise n'avait jamais suscité le moindre commentaire, il est apparu subitement absurde que la CNAM n'en soit pas dotée et qu'il abonde le fonds de financement des trente-cinq heures.
En réalité, l'impact budgétaire était bien entendu identique à l'affectation, à ce fonds, d'une dotation. Toutefois, si l'on retient l'hypothèse formulée par la Cour des comptes 13 ( * ) que, « pour le ministère des finances du moins, la création du FOREC répondait aussi à l'idée qu'à l'avenir les taxes affectées pourraient se substituer à la logique du remboursement des exonérations - et donc à l'abandon du principe posé par la loi de 1994 » , alors le choix de cette recette était astucieuse dans la perspective d'une suppression du fonds :
- elle rendait intellectuellement plus difficile la rebudgétisation des allégements de charges ; en effet, la masse financière du FOREC imposait nécessairement qu'une rebudgétisation soit effectuée à périmètre constant. Or, il aurait donc fallu pour cela condamner l'hypothèse d'une affectation à moyen terme des droits sur les tabacs à la sphère sociale ;
- bien plus, elle soutenait l'hypothèse d'un éclatement du FOREC, décrié pour des raisons bien étrangères aux véritables griefs que pouvait encourir légitimement ce fonds. En effet, dès lors que le FOREC devait être supprimé, l'éclatement de ses produits et ses charges entre les différentes caisses de la sécurité sociale constituait le seul scénario permettant d'affecter tout ou partie des droits sur les tabacs à la CNAM. Mais le prix de ce symbole aurait été en réalité exorbitant à payer pour la sécurité sociale : l'abandon de fait de la compensation intégrale des allégements. En effet, l'éclatement des recettes et des dépenses du FOREC entre les caisses aurait abouti à la reconstitution de mini-FOREC au sein de chaque branche, que le législateur aurait été dans l'impossibilité pratique d'équilibrer. L'opération aurait donc été pour « solde de tout compte ».
Ce scénario n'a pas prévalu, puisque le FOREC sera rebudgétisé, et avec lui les droits sur les tabacs. Pour autant, si l'on suit la grille de répartition proposée par la nouvelle loi de finances, on ne peut que s'étonner de l'empressement de la direction du budget à réaffecter cette recette.
En effet, l'article 24 du projet de loi de finances pour 2004 prend acte de la disparition du FOREC et procède à la réaffectation du produit selon la répartition principale 14 ( * ) suivante :
- une fraction égale à 22,27 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- une fraction égale à 50,16 % est affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles ;
- une fraction égale à 26,94 % est affectée au budget général ;
Le nouveau principal bénéficiaire est le BAPSA, ou la structure assurant sa succession qui, en contrepartie, rétrocède la TVA affectée précédemment à la protection sociale agricole.
Du côté des droits de consommation sur les tabacs, ceux-ci ont depuis trois années été l'objet d'augmentations sensibles. Les ministres de la santé successifs ont prétendu, en faveur de la santé, majorer le produit des prélèvements sur le tabac d'un milliard d'euros, sans qu'en 2003 le produit escompté de l'augmentation soit atteint.
D'après les informations dont dispose votre rapporteur, la différence entre la réalisation (300 millions ?) et la prévision (1 milliard d'euros) de recettes découlant de l'augmentation des taxes est officiellement expliquée par une hausse moins forte du prix des cigarettes (11 %) que la prévision en loi de financement de la sécurité sociale l'escomptait (17 %) et par une baisse de la consommation de l'ordre de 8 %.
D'autres sources laissent entendre une répartition différente en mettant en avant l'impact de la contrebande sur le produit de la fiscalité.
- 200 millions d'euros dus à une erreur de base, du fait d'une accélération du circuit de recouvrement ;
- 400 millions au titre des circuits parallèles d'approvisionnements ;
- 100 millions dus à l'absence de remontée des prix pourtant attendue de l'augmentation de la fiscalité ;
- 300 millions de recettes supplémentaires.
Au total, votre rapporteur demeurera extrêmement prudent sur les chiffres communiqués ici et là. Il constate que le produit prévu pour cette année par les projets de loi de financement de la sécurité sociale et de finances pourrait s'élever à 9,6 milliards d'euros, ce qui correspondrait peu ou prou à 64 milliards d'unités de cigarettes consommées. Or, en 2002, la consommation s'élevait à 80 milliards.
Sans doute cette prévision est-elle avancée comme un argument d'efficacité de la fiscalité dans la lutte contre le tabagisme. Or, elle implique une baisse de la consommation des cigarettes de 20 % en deux ans. Une telle prévision est-elle crédible alors même que l'on ne dispose d'aucune statistique fiable sur l'évolution des détournements de trafic et sur le développement de la contrebande ? Votre rapporteur n'ose le penser.
En revanche, il constate qu'une diminution de la consommation de 5 % en 2004 constituerait sans doute un succès de santé publique, s'il était certain que des effets de substitutions (vers d'autres produits ou circuits d'approvisionnement parallèles) n'en sont pas à l'origine. Et d'un point de vue budgétaire, ce niveau de consommation produirait près de 800 millions de recettes supplémentaires. Devant ce constat, votre rapporteur n'est pas loin de penser, sans bien sûr pouvoir étayer ce sentiment, que la prévision des produits du tabac, après avoir été fortement surestimée en 2003, serait sous-estimée en 2004.
2. L'augmentation de la taxe BAPSA pour 2004, une fuite en avant ?
Comment juger, dès lors, de l'augmentation par la loi de finances de la taxe spécifique affectée au BAPSA, pour un produit majoré de 300 millions d'euros ?
Cette augmentation supplémentaire participe de l'instabilité de la fiscalité du tabac, qui fut modifié à deux reprises en 2003, d'abord par l'augmentation en loi de financement initiale, puis dans le cadre de la loi Joly relative à l'interdiction de vente du tabac aux jeunes.
Cette augmentation constitue ce qui fut dénommé ci-dessus « une raison anecdotique de bouclage financier », la direction du budget cherchant sans nul doute à équilibrer le montage du fonds de financement des prestations agricoles qui se substituera prochainement au BAPSA. Ce faisant, elle favorise le sentiment que les différentes administrations poursuivent des stratégies qui leur sont propres.
Toutefois, il existe une interdépendance des prélèvements sur le tabac. La hausse de la taxe BAPSA sera neutre sur le produit du droit de consommation dans l'hypothèse où les fabricants ne la répercuteront pas. Dès lors que la moitié de ce droit est, du fait de la loi de finances, affectée au BAPSA, une sous-estimation de l'ampleur de celle évoquée ci-dessus aurait pour effet de procurer à celui-ci 400 millions d'euros de recettes supplémentaires, soit le produit attendu de la hausse sur la taxe BAPSA. Or cette dernière introduit un nouvel élément de conflit avec une filière dont l'adhésion est nécessaire à une stratégie efficace en matière de santé publique (hausse continue des prix, contrôle de l'approvisionnement, participation à la lutte contre les trafics et la contrefaçon). L'économie d'une telle mesure pouvait sans doute être réalisée.
Pour autant, votre rapporteur demeure convaincu qu'une augmentation régulière de la fiscalité sur le tabac est nécessaire pour lutter contre ce produit dangereux dont les conséquences sur la santé sont désormais bien établies.
A ce titre, il constate que certains États ont pu atteindre des niveaux élevés de taxation d'une manière progressive. En conséquence, une évolution de la fiscalité pourrait être envisagée selon deux voies complémentaires :
- un simplification des taxes sur le tabac et sa répartition, ne laissant subsister que la TVA, affectée à l'État, et l'accise affectée aux régimes sociaux ;
- une augmentation de la fiscalité normée dans un cadre pluriannuel, calée par exemple sur l'inflation majorée d'un pourcentage.
Pour autant, la situation des États ayant précédé la France dans cette voie laisse entendre qu'il existe des limites au-delà desquelles la décroissance du tabagisme passe par la lutte contre une forme de criminalité organisée. Certains États, dont les pays scandinaves, font aujourd'hui marche arrière et diminuent leur fiscalité.
Cette direction est regrettable mais elle est la conséquence d'un encadrement trop lâche de la fiscalité du tabac au niveau communautaire. Au sein de l'Union européenne, les disparités de prix s'élèvent jusqu'à 300 %. C'est sans doute de cet échelon que peut venir un encadrement décisif de la fiscalité de ces produits susceptibles de lutter contre les trafics et d'assurer les moyens d'une lutte efficace contre les pathologies liées au tabac.
*
* *
A l'issue d'une analyse peut être trop rétrospective pour une réalité aussi mouvante, votre rapporteur s'attachera en guise de conclusion, à insister sur deux observations essentielles.
La clarification des relations financières entre l'État et la sécurité sociale constitue la voie unique d'une responsabilisation des acteurs de la protection sociale.
Il n'est en effet guère possible pour l'État d'exiger de ses « coactionnaires » (acteurs, gestionnaires, assurés, cotisants ou prestataires) qu'ils déploient les efforts nécessaires à la sauvegarde de notre protection sociale « à la française » si ceux-ci conservent à tort ou à raison le sentiment que les moyens d'assumer leurs missions leur sont dérobés « en catimini ».
La capacité du présent Gouvernement à s'attaquer à des problèmes réputés insolubles a déjà été démontrée. Après les retraites viendra l'assurance maladie. Ce train de réformes ne doit pas éluder l'évolution nécessaire des lois de financement de la sécurité sociale.
Cet outil a montré qu'il constituait un outil de connaissance des finances sociales indispensable en même temps qu'un exercice démocratique essentiel. Les limites qui sont mises à jour, à la fois dans les textes et dans les pratiques, imposent qu'en parallèle à la réflexion sur l'avenir de l'assurance maladie, le Parlement s'empare de cette autre grande réforme de la protection sociale afin de parfaire son insertion dans l'édifice des finances publiques, par une meilleure articulation avec les nouvelles règles régissant le budget général et l'ensemble des comptes publics dont répond in fine la France devant l'Union européenne.
TRAVAUX DE LA COMMISSION
Réunie le mercredi 29 octobre 2003, sous la présidence de M. Alain Gournac, vice-président , la commission a entendu une communication de M. Alain Vasselle sur le rapport du Gouvernement sur les prélèvements obligatoires et leur évolution (article 52 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances).
En préambule, M. Alain Vasselle, rapporteur pour les équilibres financiers, a présenté les grandes lignes de son rapport (cf. exposé général).
M. Alain Gournac, vice-président , s'est inquiété des perspectives d'évolution des finances sociales telles que décrites par le rapporteur.
M. Jean Chérioux a rappelé qu'en plus des dépenses de la sécurité sociale, devait être pris en compte le coût des régimes de la fonction publique. Il a déclaré que le financement de la protection sociale par les droits sur les tabacs constitue une option paradoxale, puisque la réussite d'une politique de santé publique, qui réduirait fortement la consommation de tabac, aurait pour corollaire une diminution des ressources de la protection sociale.
M. Serge Franchis s'est interrogé sur le caractère significatif des comparaisons entre les taux de prélèvements obligatoires des différents États de l'OCDE.
En réponse aux différents intervenants, M. Alain Vasselle, rapporteur pour les équilibres financiers, a rappelé que les prélèvements sociaux incluent certains prélèvements fiscaux et que la comparaison entre les États reflète en elle-même des choix de société. Il a confirmé que l'augmentation de la taxe sur les tabacs ne constitue pas, à son sens, une solution de financement du déficit de l'assurance maladie, ni à court terme, ni à long terme.
La commission a donné acte au rapporteur de sa communication et en a autorisé la publication sous la forme d'un rapport d'information.
Les prélèvements sociaux
Quelles
ressources pour quelle protection sociale ?
Après une décennie de fiscalisation progressive, les ressources de la protection sociale représentent désormais la moitié des prélèvements obligatoires sans pour autant suffire à contenir l'explosion des déficits sociaux.
Masse instable et hétérogène, affectée par des montages complexes et des dérivations suspectes, les finances sociales peuvent-elles croître davantage sans un réexamen préalable de l'architecture de la sécurité sociale ?
Le débat sur les prélèvements obligatoires et leur évolution est né en 2001 de la volonté conjointe des commissions des Finances et des Affaires sociales du Sénat de sacraliser un espace de dialogue annuel entre finances sociales et finances de l'État au moment de l'examen de leur budget respectif.
A cette occasion, M. Alain Vasselle, rapporteur des lois de
financement de la sécurité sociale, fait le point sur
l'évolution des prélèvements sociaux à quelques
mois d'une réforme de grande ampleur de la sécurité
sociale.
* 1 Léon Bloy, exégèse des lieux communs.
* 2 Etablie par le Gouvernement en application de l'article 52 de la loi organique du 1 er août 2001.
* 3 Cf. infra p. 32.
* 4 Rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour les équilibres financiers, cf. La Tribune, 27 octobre 2003.
* 5 CNAM, CANAM, Exploitant.
* 6 Alain Coulomb, sur la médicalisation de l'ONDAM.
* 7 Ce taux ne se limite pas aux seules ASSO.
* 8 Pour mémoire, en 2002, les allégements « Aubry I » et « Aubry II » relatifs au financement des trente-cinq heures représentaient 96 % des sommes consacrées à la réduction du temps de travail, contre 4 % pour le dispositif « Robien »
* 9 Alain Vasselle, La CADES nouvel enjeu des finances sociales ?Rapport de la Commission des Affaires sociales. Session 2002-2003, rapport n°248
* 10 Rapport de M. Charles Descours, Les fonds sociaux, Sénat, n° 382 - Session 200-2001.
* 11 Mais il est vrai que la population française a augmenté de 8 % sur cette période. Sur cette période, la consommation de cigarettes par habitant a diminué de 8,5 %, mais cette diminution ne tient évidemment compte ni d'effets de substitution, ni d'approvisionnement paralégal.
* 12 Loi de financement de la sécurité sociale pour 1997.
* 13 Réponse de la Cour des comptes au questionnaire de votre rapporteur sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.
* 14 Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ; une fraction égale à 0,32 % est affectée au fonds créé par le III de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.