Rapport d'information n° 705 (2013-2014) de M. Serge LARCHER , fait au nom de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer, déposé le 9 juillet 2014
Disponible au format PDF (1,8 Moctet)
-
1. Ouverture
-
2. Présentation de la rencontre
-
2.1. M. PASCAL BLANCHARD, HISTORIEN, CHERCHEUR AU
LABORATOIRE COMMUNICATION ET POLITIQUE (CNRS), CO-DIRECTEUR DU GROUPE DE
RECHERCHE ACHAC. COORDONNATEUR SCIENTIFIQUE DE LA RENCONTRE.
-
2.2. MME FRANÇOISE VERGÈS,
POLITOLOGUE, ÉCRIVAIN, CHERCHEUR ASSOCIÉ AU COLLÈGE
D'ÉTUDES MONDIALES. COORDONNATRICE DE LA RENCONTRE
-
2.1. M. PASCAL BLANCHARD, HISTORIEN, CHERCHEUR AU
LABORATOIRE COMMUNICATION ET POLITIQUE (CNRS), CO-DIRECTEUR DU GROUPE DE
RECHERCHE ACHAC. COORDONNATEUR SCIENTIFIQUE DE LA RENCONTRE.
-
3. Table ronde 1 - Le temps des conflits :
présence des outre-mer dans les deux conflits mondiaux
-
3.1. MME SABINE ANDRIVON-MILTON, HISTORIENNE,
ENSEIGNANTE LES ANTILLAIS ET GUYANAIS DANS LE PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE
-
3.2. M. ÉRIC DEROO, HISTORIEN, CHERCHEUR
ASSOCIÉ (UMR 7268 ADES, AMU-CNRS-EFS), DOCUMENTARISTE LES TROUPES
COLONIALES EN EUROPE
-
3.3. M. GILLES AUBAGNAC, HISTORIEN, CHEF DU SERVICE
DE LA CONSERVATION AU MUSÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE LES PRÉSENCES
DU MONDE DANS LES DEUX CONFLITS MONDIAUX
-
3.4. HENRI HAZAËL-MASSIEUX, ADMINISTRATEUR
CIVIL HC HONORAIRE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE, CHARGÉ DE
MISSION MÉMOIRE LES COLONIES DANS LES DEUX GUERRES MONDIALES
-
3.5. M. GRÉGOIRE GEORGES-PICOT, HISTORIEN ET
CINÉASTE DES ANTILLAIS, FRANÇAIS LIBRES
-
3.6. MME SYLVETTE
BOUBIN-BOYER,
HISTORIENNE
LES COMBATTANTS FRANÇAIS ET INDIGÈNES CALÉDONIENS DANS LA GRANDE GUERRE
-
3.1. MME SABINE ANDRIVON-MILTON, HISTORIENNE,
ENSEIGNANTE LES ANTILLAIS ET GUYANAIS DANS LE PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE
-
4. Table ronde 2 - Le temps des héritages et
des mémoires : ruptures, nouvelles visions, nouvelles
solidarités
-
4.1. MME SARAH FRIOUX-SALGAS,
HISTORIENNE, RESPONSABLE DES ARCHIVES ET DE LA DOCUMENTATION
DES COLLECTIONS À LA MÉDIATHÈQUE DU MUSÉE DU QUAI BRANLY
L'ÉVEIL DES MONDES NOIRS
-
4.2. MADAME CATHERINE COQUERY-VIDROVITCH,
HISTORIENNE, PROFESSEUR ÉMÉRITE À L'UNIVERSITÉ DE
PARIS DIDEROT (PARIS VII) HÉRITAGES ET RUPTURES DANS LES COLONIES
D'AFRIQUE DE L'EMPIRE COLONIAL FRANÇAIS À L'HEURE DES
CONFLITS
-
4.3. M. MICHEL WIEVIORKA, SOCIOLOGUE, DIRECTEUR DU
COLLÈGE D'ÉTUDES MONDIALES LES HÉRITAGES DE CES
PASSÉS DANS LA FRANCE CONTEMPORAINE : QUELS
DÉFIS ?
-
4.4. MADAME ANNETTE BECKER, HISTORIENNE, PROFESSEUR
DES UNIVERSITÉS À L'UNIVERSITÉ PARIS OUEST-NANTERRE LA
DÉFENSE, MEMBRE DU COMITÉ SCIENTIFIQUE DU CENTENAIRE DE LA
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE COMMÉMORER : LES POLITIQUES
PUBLIQUES ET L'HISTOIRE
-
4.5. MME VIVIANE FAYAUD, HISTORIENNE, CHERCHEURE
ASSOCIÉE AU CENTRE D'HISTOIRE CULTURELLE DES SOCIÉTÉS
CONTEMPORAINES (CHCSC), UNIVERSITÉ DE VERSAILLES
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES LE PREMIER CONFLIT MONDIAL FONDATEUR DE LA
NATION : L'EXEMPLE DU PACIFIQUE
-
4.1. MME SARAH FRIOUX-SALGAS,
-
5. Conclusion de la rencontre
-
6. Clôture
-
7. programme de la rencontre
N° 705
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014
|
Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juillet 2014 |
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la délégation sénatoriale à l'outre-mer (1) sur la rencontre Histoires Mémoires Croisées « Des champs de bataille aux réécritures de l' Histoire coloniale » du 8 juillet 2014 ,
Par M. Serge LARCHER,
Sénateur.
|
(1) Cette délégation est composée de : M. Serge Larcher, président ; MM. Éric Doligé, Michel Fontaine, Pierre Frogier, Joël Guerriau, Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. Michel Magras, Jean-Claude Requier, Mme Catherine Tasca, MM. Richard Tuheiava, Paul Vergès et Michel Vergoz, vice-présidents ; Mme Aline Archimbaud, M. Robert Laufoaulu, secrétaires ; MM. Maurice Antiste, Jean-Étienne Antoinette, Mme Éliane Assassi, MM. Jacques Berthou, Jean Bizet, Jean-Marie Bockel, Gérard César, Mme Karine Claireaux, MM. Christian Cointat, Jacques Cornano, Félix Desplan, MM. Gaston Flosse, Jacques Gillot, Mme Odette Herviaux, Jean-Jacques Hyest, Jacky Le Menn, Jeanny Lorgeoux, Roland du Luart, MM. Thani Mohamed Soilihi, Alain Néri, Georges Patient, Mme Catherine Procaccia, MM. Charles Revet, Didier Robert, Gilbert Roger, Abdourahamane Soilihi et Hilarion Vendegou |
1. Ouverture
1.1. M. THANI MOHAMED SOILIHI, SÉNATEUR DE MAYOTTE
1.2. DISCOURS INTRODUCTIF DE M. SERGE LARCHER, SÉNATEUR DE LA MARTINIQUE ET PRÉSIDENT DE LA DÉLÉGATION SÉNATORIALE À L'OUTRE-MER
Monsieur le Président du Sénat,
Madame la Déléguée interministérielle à l'égalité des chances des Français d'outre-mer,
Mes chers collègues,
Mesdames et messieurs,
Le président de la Délégation sénatoriale, Serge Larcher, ne peut, à son grand regret, être parmi nous aujourd'hui. Retenu en Martinique par les obsèques d'un proche, il vous prie de bien vouloir excuser son absence et m'a demandé, en ma qualité de sénateur de Mayotte, de vous donner lecture de son message.
Monsieur le Président du Sénat, Cher Jean-Pierre Bel, qui nous accueillez une nouvelle fois aujourd'hui pour la troisième manifestation de la série des rencontres Histoires/Mémoires croisées,
Madame la Déléguée interministérielle à l'égalité des chances des Français d'outre-mer, Chère Sophie Élizéon,
Chère Françoise Vergès et Cher Pascal Blanchard qui, tous deux, orchestrez, en complémentarité et en complicité, notre rencontre d'aujourd'hui,
Chers amis qui avez accepté d'entrer dans l'orchestre des « Histoires et mémoires croisées »,
Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Bonjour et bienvenue à tous !
Après une première rencontre le 9 mai 2012, veille de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, puis une deuxième séquence des « Histoires et mémoires croisées » le 14 novembre 2013 où nous avons fait revivre des chapitres oubliés de l'histoire coloniale française, nous voilà une nouvelle fois réunis aujourd'hui pour évoquer le rôle joué par nos compatriotes des colonies dans les deux grands conflits du XX e siècle, mais aussi les bouleversements que ces conflits ont engendrés avec la rencontre des peuples et le croisement des cultures.
Il s'agit de continuer à mettre en lumière des chapitres occultés par l'histoire officielle, de mettre à l'honneur des vies dédiées à la liberté, des sangs qui ont coulé pour défendre la « Mère Patrie » contre la barbarie.
Comme l'exprimait Léopold Sedar Senghor dès 1948 dans son recueil Hosties noires , dont Jacques Martial nous livrera d'autres extraits poétiques tout à l'heure :
« On fleurit les tombes, on réchauffe le Soldat inconnu.
Vous, mes frères obscurs, personne ne vous nomme. »
Senghor évoquait ainsi à la Libération une amnésie collective que les nouvelles blessures de la décolonisation ont ensuite longtemps encore fait perdurer : nos « frères obscurs » ont ainsi été victimes une seconde fois, victimes de l'oubli commandé par les mouvements d'émancipation que leur engagement avait engendrés. En effet, alors qu'il n'était pas question pour une ancienne puissance coloniale de valoriser la contribution des peuples précédemment assujettis ayant fait sécession, ces peuples eux-mêmes, devenus indépendants, ne pouvaient davantage mettre à l'honneur ces faits d'armes.
Le mur du silence et de l'oubli n'a commencé à véritablement se fissurer que depuis une quinzaine d'années, notamment depuis le célèbre arrêt du Conseil d'État de 2001 qui a considéré que la « cristallisation », c'est-à-dire le gel des pensions et retraites versées aux soldats indigènes, constituait une discrimination violant la Convention européenne des droits de l'homme. Le Conseil constitutionnel devait, à son tour, en mai 2010, à l'occasion de sa première décision rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), juger contraire au principe d'égalité le régime spécial des pensions applicable aux ressortissants des pays et territoires autrefois sous souveraineté française.
Pour le grand public, la naissance à l'histoire du rôle joué par les soldats originaires des colonies est également très récente. À cet égard, le film Indigènes réalisé par Rachid Bouchareb tient une place majeure ; sorti à l'écran en septembre 2006, il a reçu de nombreuses distinctions.
Et je me félicite de l'heureuse initiative prise avec la réalisation de la série Frères d'armes , à l'occasion du centième anniversaire du déclenchement de la Grande Guerre et du soixante-dixième anniversaire de la Libération. Les cinquante évocations dont la diffusion a commencé le 30 mai donnent des visages à ces héros de l'ombre issus des anciennes colonies et leur rendent hommage, poursuivent une démarche pédagogique, ô combien nécessaire !, et viennent irriguer la conscience collective. Nous aurons le plaisir d'en visionner quelques-unes, dont deux encore inédites, à l'issue de la première table ronde.
Sans entrer dans une présentation historique détaillée et empiéter sur nos deux tables rondes, je souhaite simplement rappeler qu'en 1914, à la veille du premier conflit mondial, la France disposait du deuxième empire colonial au monde. Celui-ci couvrait plus de 10 millions de kilomètres carrés et seulement 3 % des presque 45 millions d'habitants qui le peuplaient bénéficiaient de la nationalité française, l'écrasante majorité étant « sujets français », soumis depuis la loi du 28 juin 1881 au code de l'indigénat et, à ce titre, non mobilisables par la conscription en cas de conflit armé.
Avec la montée des périls et le déséquilibre démographique plaçant la France en situation de nette infériorité face à l'Allemagne, plusieurs responsables politiques ou militaires plaidèrent pour le recours à ce réservoir humain : ainsi le général Mangin en 1910, dans un ouvrage intitulé La force noire . Mais il fallut attendre décembre 1915 pour que cette question controversée soit tranchée par décret, après que les échecs meurtriers subis sur les fronts d'Artois et de Champagne et aux Dardanelles eurent accentué la crainte d'un déficit en hommes. Ainsi, le 1 er janvier 1916, la commission sénatoriale de l'armée présentait un rapport sur l'organisation d'une « armée indigène pour l'Afrique du Nord, l'Afrique occidentale française (AOF), l'Afrique équatoriale française (AEF), Madagascar, la Côte des Somalis, l'Indochine, l'Inde française et l'Océanie », estimant « qu'aucune colonie ne devait manquer à l'appel de la Mère-Patrie » .
Le mouvement était lancé et la mobilisation en marche, sur le mode du volontariat mais aussi de la contrainte. Le nombre d'« indigènes » mobilisés du 1 er août 1914 au 31 décembre 1918 est estimé à 545 000 hommes dont plus des quatre cinquièmes combattirent en Europe, les pertes étant généralement évaluées à plus de 70 000.
Les « vocations » furent encouragées par le versement de primes et d'indemnités pour les familles, l'attribution massive de décorations mais aussi la promesse d'obtenir des droits politiques... Cependant, si les qualités de bravoure et de fidélité furent largement reconnues à ces soldats, l'image du « sauvage » au comportement infantile continua à s'imposer. En dépit de l'impôt du sang abondamment versé, notamment lors d'épisodes très meurtriers tels que le Chemin des Dames, la reconnaissance d'une égalité entre les civilisations n'était pas encore de mise, loin s'en faut.
Il fallut une nouvelle implication décisive des originaires des colonies, un nouvel impôt du sang lors du Second conflit mondial pour parvenir à la reconnaissance de la citoyenneté. Les troupes coloniales payèrent à nouveau un lourd tribut avec plus de 40 000 tués et les colonies jouèrent un rôle déterminant dans l'organisation de la résistance et de la riposte.
Je voudrais à cet instant accorder une pensée particulière à Félix Éboué, disparu il y a soixante-dix ans, juste quelques jours avant le débarquement de Normandie qui, dès le 18 juin, répondit à l'appel du général de Gaulle et fut l'artisan du ralliement à la France libre du Tchad puis de toute l'Afrique équatoriale française (AEF). Ce Guyanais, petit-fils d'esclave devenu administrateur colonial, fut le premier résistant de la France d'outre-mer. Lors de son inhumation au Panthéon le 20 mai 1949, Gaston Monnerville, alors président du Conseil de la République, déclara : « C'est un message d'humanité qui a guidé Félix Éboué, et nous tous, Résistants d'outre-mer, à l'heure où le fanatisme bestial menaçait d'éteindre les lumières de l'esprit et où, avec la France, risquait de sombrer la liberté ».
Sur cette évocation de la mémoire d'un grand homme incarnant les valeurs que tant d'autres, restés anonymes, ont également défendues au prix de leur vie, je forme le voeu que la rencontre d'aujourd'hui, par la solennité du lieu et la qualité de ceux qui l'honorent, contribue à porter la voix de ces combattants des colonies, ces « oubliés de l'histoire », ces hommes et ces femmes qui, au front comme à l'arrière, ont joué un rôle décisif dans les conflits mondiaux pour la défense de la liberté.
Je vous remercie.
2. Présentation de la rencontre
2.1. M. PASCAL BLANCHARD, HISTORIEN, CHERCHEUR AU LABORATOIRE COMMUNICATION ET POLITIQUE (CNRS), CO-DIRECTEUR DU GROUPE DE RECHERCHE ACHAC. COORDONNATEUR SCIENTIFIQUE DE LA RENCONTRE.
Bienvenue à tous. Merci Monsieur le sénateur d'avoir situé et mis en perspective le sujet de cette journée à travers quelques chiffres et éléments de contexte.
Dans le cadre de l'organisation de cette journée, un dialogue a été mené avec nos partenaires tels que le ministère de la Défense et celui des Anciens combattants avec son ministre Monsieur Kader Arif, mais aussi des institutions comme l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (Acsé), pour chercher la meilleure manière de penser ces présences des quatre coins du monde dans les différents conflits en France. Une des manières d'y répondre a été ces trois expositions, sur les présences étrangères, ultramarines et coloniales dans l'armée française et les troupes alliées, une autre est cette série de 50 films pour France télévisions, une troisième est cette série de rencontres, dont celle d'aujourd'hui (après les Invalides au mois de juin) est un des moments forts. Notre objectif est d'accompagner pendant quatre ans (2014-2018) en France, dans les départements ultramarins et à l'étranger ces récits croisés pour les partager avec le plus grand nombre. Pour mener à bien ce moment d'échanges et de savoir, le Groupe de recherche Achac a souhaité inviter des spécialistes et des porteurs d'expériences d'origines très diverses. Pour guider les débats nous avons retenu l'idée de rassembler ces intervenants en deux tables rondes.
La première table ronde exposera l'enjeu de l'histoire et les impacts sociaux, politiques et culturels de ces présences qui dépassent le fait militaire. Elles ont marqué l'histoire coloniale française.
La deuxième sera liée aux héritages et aux mémoires de ces présences.
La télévision française a consacré trop peu de place à ce million et demi de combattants venus en France et en Europe pour les différents conflits dans le cadre de ses programmes consacrés à la commémoration des deux grands conflits mondiaux. À la suite de ce constat, un programme de films courts, 50 au total diffusés pendant un an de mai 2014 à juin 2015, sera diffusé sur France télévisions chaque semaine. Ces films sont accessibles en ligne à l'adresse suivante : www.seriefreresdarmes.com et peuvent être téléchargés par les enseignants. Les films de la série Frères d'armes consacrés à cette question des présences diverses venues des quatre coins du monde, permettent de découvrir une histoire sur le temps long, deux siècles. Ils ont été réalisés par Rachid Bouchareb, écrits par des historiens sous ma conduite et fortement soutenus par le ministre Kader Arif. Ces films permettent d'illustrer la Première ou la Seconde Guerre mondiale dans le cadre du travail en classe, mais aussi chaque semaine de découvrir un combattant au destin singulier, incroyable ou tragique, pour enfin donner des noms à ceux qui jusqu'alors n'étaient que des ombres de notre histoire. Il s'est alors agi de sortir du cadre habituel qui évoquait les tirailleurs sénégalais, les combattants des outre-mer, ceux du Maghreb (les Goumiers) et ceux des Antilles. Nous croisons désormais l'histoire collective et le récit individuel, dans une dimension monde, pour bâtir un autre récit de ces présences sur le sol de France, de l'expédition d'Égypte (avec les Mamelouks) jusqu'aux présences actuelles. Nous avons choisi de raconter l'histoire d'individus clairement identifiés dont les noms et les prénoms sont mentionnés, pour marquer le présent, et aussi construire un récit pour demain. Ainsi, nous pouvons rendre compte d'une histoire non seulement collective, mais aussi individuelle grâce aux combattants de ces deux guerres. C'est une histoire de France, mais aussi une histoire monde en France.
Nous sommes partis du constat que dans notre histoire collective et notre écriture actuelle de l'histoire, il existait un déficit de reconnaissance individuelle et collective de ces présences, uniquement vues à travers un patriotisme sans questionnement ou un destin sans engagement individuel. Nous le savons, l'histoire est plus complexe. Ces hommes ou ces femmes, ces héros ou non-héros, ces combattants de métier, d'infortune ou de fortune ont choisi de répondre à l'appel de la France -- certaines fois contraints et forcés -- et de s'engager pour des idéaux de liberté et de résistance au fascisme. Leur choix a donc été d'abord individuel : c'est pourquoi nous devons leur donner un nom afin qu'ils puissent être des référents pour ceux qui portent un regard sur l'histoire de France et afin que ceux-ci se reconnaissent dans cette histoire et découvrent que Roland Garros, par exemple, n'est pas qu'un tennisman, que Bakary Diallo éclaire une histoire autrement à travers son récit et qu'Addi Bâ fut un résistant au destin tragique. On découvre un autre récit autour de Senghor, de Joséphine Baker, de l'aviateur Do Huu Vi ou de ces hommes et ces femmes venus des Antilles, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie, du Sénégal ou des Indes.... Ce récit nous fait comprendre que ces conflits furent aussi des moments de métissage sans équivalent, qui vont modifier en profondeur les époques qui suivent, dans les années 20 ou après 1945.
Afin de construire une mémoire collective, il convient d'abord de commencer par le récit historique. Nous devons également nous demander comment nous pouvons transmettre ces histoires du passé au présent, « fabriquer des mémoires » ensemble et réécrire en commun cette histoire de France. Pour répondre à ces questions, il convient de donner la parole aux « passeurs de savoirs », c'est à eux de prendre la parole maintenant.
2.2. MME FRANÇOISE VERGÈS, POLITOLOGUE, ÉCRIVAIN, CHERCHEUR ASSOCIÉ AU COLLÈGE D'ÉTUDES MONDIALES. COORDONNATRICE DE LA RENCONTRE
Ces rencontres accueillies par le Sénat et la Délégation sénatoriale à l'outre-mer ne visent pas uniquement à revisiter l'histoire et à y ajouter des chapitres oubliés, mais également à revoir la manière dont nous écrivons et concevons l'histoire. Nous devons donc reconsidérer la cartographie même de cette histoire et la penser de manière globale et connectée.
La première rencontre organisée dans le cadre des journées Histoires/Mémoires croisées a eu lieu en 2012. Elle a été suivie de deux nouvelles éditions en 2013 : la première a concerné les chapitres oubliés, tandis que la seconde a été consacrée aux mémoires croisées France-Maghreb. Lorsque nous avons mis en place les rencontres que nous tenons aujourd'hui, nous avons constaté que peu de travaux portaient sur la vie dans les colonies durant les deux grands conflits mondiaux. Nous ne disposons que de très peu d'éléments sur la situation dans les colonies au moment des deux conflits mondiaux et à l'issue de cette période, qui a certainement dû apporter des changements dans la vie sociale, culturelle et économique. S'il est souvent question des soldats, que sait-on des femmes dans les colonies ? Comment ont-elles vécu la guerre et le départ de leurs maris, de leurs fiancés ou frères qu'elles n'ont plus revus ?
Il s'agit donc d'un travail qui ne fait que commencer et qui propose d'ouvrir de nouveaux champs, de nouveaux chapitres et de nouvelles manières d'écrire et de voir l'histoire.
La deuxième partie de cette journée sera consacrée aux bouleversements produits par les deux grands conflits mondiaux dans le monde culturel, social et politique. Elle s'attachera également à considérer la manière dont cette histoire est perçue et interprétée par les artistes dans les territoires et départements d'outre-mer et dans l'Hexagone aujourd'hui.
3. Table ronde 1 - Le temps des conflits : présence des outre-mer dans les deux conflits mondiaux
3.1. MME SABINE ANDRIVON-MILTON, HISTORIENNE, ENSEIGNANTE LES ANTILLAIS ET GUYANAIS DANS LE PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
En 1914, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane sont des colonies françaises faisant partie des « vieilles colonies ». Malgré la distance, ces colonies sont très liées à la métropole. L'annonce de l'entrée en guerre de la France déclenche, selon les journaux, des mouvements spontanés dans les villes. À Fort-de-France des vidés improvisés déambulent dans les rues aux cris de « mort aux Boches, l'Allemagne crèvera, la France vaincra » 1 ( * ) ...
La mobilisation est décrétée dans ces colonies, ordonnant aux mobilisés de se mettre à la disposition de l'autorité militaire. Cependant, il ne s'agit pas d'une mobilisation générale car étaient seulement appelés les hommes de la réserve de l'armée active (appelés ou engagés des classes 1901 à 1911 inclus) et tous les officiers et sous-officiers en activité de service, en permission ou en congé. En résumé, seuls les Européens sont mobilisés.
Cette situation avait créé de la déception et le mécontentement de la part des originaires des colonies qui étaient déjà prêts à partir. En Guyane, une pétition est signée le 7 août 1914 par 200 hommes qui « sont prêts à mourir à la défense de la Patrie et ne demandent qu'à partir ». Ils supplient le gouverneur de transmettre au ministre des colonies, par câble, l'intention qui les anime.
Les citoyens français originaires des quatre vieilles colonies domiciliés en France sont recrutés dans leurs localités et intègrent les régiments métropolitains.
Ceux qui n'étaient pas mobilisables et désiraient partir pouvaient souscrire un engagement dans un corps stationné en métropole, mais pour se rendre en France ils devaient payer leur voyage. Cette clause jugée inadmissible fut longuement contestée par la classe politique. Celle-ci s'était battue pour que la conscription soit appliquée dans les colonies dans leur quête d'assimilation avec la métropole. Ils avaient milité pour que les originaires d'outre-mer paient l'impôt du sang et soient considérés comme des Français à part entière.
Pourquoi n'a-t-on pas mobilisé les Antillais et les Guyanais en août 1914 ?
- La guerre devait être courte et il aurait été pour l'heure dispendieux d'acheminer des hommes issus de ces colonies vers la métropole ;
- La conscription dans ces colonies datait de 1913 et les résultats n'étaient pas concluants. En effet, les premiers conscrits des classes 1912 et 1913 ont quitté les colonies en octobre 1913 et il y eut de nombreux réformés pour maladies. De plus, leur valeur militaire n'avait pas satisfait les autorités militaires.
Mais la guerre s'éternise et les pertes en hommes sont importantes. La présence de renforts s'avère indispensable. La France fait appel aux originaires d'outre-mer et, le 28 mars 1915, les gouverneurs doivent procéder au recensement des Antillo-Guyanais. Mais les hommes sur place n'ont pas fait de service militaire et ne savent pas manier des armes. Afin de les préparer, le ministre de la guerre avait envoyé dans la colonie des hommes expérimentés qui devaient leur enseigner, à la hâte, le maniement des armes, la discipline, les manoeuvres. Les soldats étaient soumis à un entraînement intensif avant leur départ.
Qui sont les hommes qui partent ?
Tous les hommes des classes 1889 à 1916 étaient recensés. En 1915, il s'agit des hommes ayant entre 19 et 46 ans. Mais l'appel sous les drapeaux commençait d'abord par les plus jeunes.
Aux Antilles, les descendants hindous ne sont pas mobilisés car ils ne sont pas citoyens français. En Guyane, les étrangers (Chinois, Libanais, Hindous), les Bushinengués, les Amérindiens et les bagnards ne sont pas concernés par la mobilisation.
Le nombre d'hommes originaires des Antilles et de la Guyane était moins élevé que celui escompté. En effet, le taux élevé d'exemptés et de réformés montre le mauvais état sanitaire des colonies à cette époque car les hommes sont nombreux à souffrir de constitution physique insuffisante et de maladies diverses liées à la sous-nutrition.
Les chiffres varient selon les sources mais on estime que :
|
Désignation des colonies |
Effectifs venus en Europe |
|
Guyane |
1 610 dont 510 Antillais |
|
Martinique |
8 788 |
|
Guadeloupe |
6 345 |
|
TOTAL |
16 743 |
Ces chiffres ne tiennent pas compte des hommes qui étaient déjà en Europe au début de la guerre.
Les hommes politiques martiniquais, bien que mécontents du faible nombre d'hommes obtenus, étaient fiers de faire remarquer que la Martinique avait été la colonie la plus « généreuse ».
Qui ne part pas ?
Ceux qui ont été réformés pour maladie ou d'autres motifs, ceux qui ont obtenu des sursis d'appel, ceux qui ont fui dans les îles voisines, ceux qui sont pères de famille nombreuse. À ce propos, on a assisté à une augmentation du nombre des reconnaissances car les pères de famille étaient mobilisés après tous les autres.
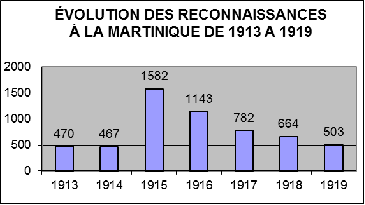
C'est en Martinique que les soldats antillais et guyanais et quelques hommes originaires de Saint-Thomas se retrouvaient pour emprunter le bateau qui les emmena en Europe. Les premiers grands départs eurent lieu en mars 1915 et s'effectuèrent avec faste : discours, passage en revue, foule, mais par la suite, ils s'effectuèrent dans la discrétion.
La traversée dure 12 jours et ils arrivent dans les ports de Bordeaux, Nantes et Saint-Nazaire, puis sont casernés dans les dépôts d'infanterie coloniale du sud de la France afin de parfaire leur instruction militaire. D'abord intégrés dans les troupes coloniales (bataillons de tirailleurs et régiments d'infanterie coloniale), ces soldats sont versés dans les troupes métropolitaines et en Afrique du Nord.
Ils sont en grande majorité reversés dans l'infanterie, car ils n'ont pas l'instruction suffisante pour intégrer les corps techniques. Toutefois, on retrouve quelques Antillo-Guyanais dans l'artillerie, le génie et l'aviation.
À leur arrivée en 1915, une grande partie des originaires des colonies sont dirigés dans l'armée d'Orient, aux Dardanelles, car les autorités militaires estimaient que cette région serait moins difficile pour eux que les régions de l'Est. Mais là, ils furent nombreux à succomber à cause des maladies (dysenterie, paludisme) et du froid (pieds gelés qui nécessitent parfois l'amputation) et des combats épouvantables. Le 22 mai 1915, au combat de la Redoute Bouchet, à Gallipoli, 49 Martiniquais meurent sans compter ceux qui sont décédés des suites de leurs blessures.
Les Dardanelles sont restées dans la mémoire collective des Antillo-Guyanais comme un traumatisme, car la vie y est dure à cause du manque d'eau et de ravitaillement, de la chaleur étouffante en été, du froid glacial, des permissions inexistantes. Pendant l'hiver, ils sont envoyés sur l'île de Mytilène.
Après le retrait des troupes en Orient, les soldats antillo-guyanais sont dirigés vers Salonique où les conditions de vie sont encore plus difficiles. Ceux qui ne faisaient pas partie de l'armée d'Orient étaient engagés sur le front de l'Est. Là, ils prirent part à toutes les batailles : Verdun, Chemin des Dames, Champagne...
Pendant l'hiver, les soldats des colonies sont retirés du front de l'Est et envoyés dans les camps du Midi, sur la Côte d'Azur, plus particulièrement à Fréjus-Saint-Raphaël ou le nord de l'Afrique car ils supportaient mal le froid et tombaient malades.
En dépit des apparences physiques souvent bonnes d'un assez grand nombre d'hommes, les contingents créoles présentaient, dans leur généralité, une très médiocre résistance à toutes les maladies et en particulier aux variations de température, au froid, aux fatigues inhérentes à l'entraînement militaire. Ils étaient très réceptifs à l'égard de la plupart des maladies contagieuses. Même en étant mis dans les conditions favorables au point de vue du logement, de la nourriture, de l'entraînement, ces contingents présentaient une morbidité extraordinairement plus élevée que celles des troupes européennes stationnées dans les mêmes garnisons. 2 ( * )
Un rapport sanitaire 3 ( * ) avait signalé que le contingent le moins résistant était celui de la Guadeloupe, suivi de la Martinique, la Guyane, La Réunion et la Nouvelle-Calédonie.
Pourtant, le ministre de la guerre avait attiré l'attention des généraux sur les soins à prendre envers les recrues créoles en raison des difficultés qu'elles éprouvaient à s'acclimater. Il leur recommandait de ne les affecter qu'à des dépôts tenant garnison dans des régions offrant un climat égal et tempéré. Ils devaient être logés exclusivement dans les casernes préalablement désinfectées et les mesures d'hygiènes les plus strictes devaient leur être appliquées, notamment en ce qui concernait le couchage. Leur nourriture devait faire l'objet d'une surveillance particulière : il fallait les habituer progressivement à l'alimentation des soldats métropolitains.
Ces mesures prises en faveur des hommes originaires des colonies avaient mécontenté les députés qui estimaient que l'on infantilisait ces soldats en leur accordant des avantages particuliers (privilèges).
Ceux qui étaient inaptes étaient soit renvoyés chez eux soit transformés en ouvriers dans les usines. Les blessés et les convalescents sont envoyés dans les ateliers de dépôts ou les hôpitaux de l'arrière.
Les soldats antillo-guyanais obtenaient des permissions pour se rendre à l'arrière ou dans les foyers coloniaux. Mais il leur faudra attendre 1917 pour rentrer en permission dans leur colonie et ce grâce aux interventions répétées des députés.
En septembre 1916, le député guadeloupéen Bérenger demanda au ministre des colonies d'autoriser les soldats des colonies qui étaient en France depuis plus de deux ans à revenir au pays comme le faisaient les soldats métropolitains, les Algériens, les Sénégalais et les Corses.
Il souligna : « Il faudrait par mesure d'équité que les Antillais rentrent chez eux au lieu de les envoyer en Algérie ou en Tunisie pendant l'hiver. Les soldats antillais doivent avoir la joie de retrouver leur famille, ils souffrent moralement de ne pas voir leur famille et physiquement à cause du froid » . 4 ( * )
Les parlementaires antillo-guyanais recevaient régulièrement des courriers des soldats qui leur faisaient part des discriminations, des sévices et des brimades que leur faisaient subir les gradés et ils étaient montés à la Tribune pour dénoncer cette situation.
Les autorités militaires se plaignaient des originaires des colonies qu'ils qualifiaient d'hommes indolents, paresseux et indisciplinés. Toutefois ils furent nombreux à obtenir des citations et à se distinguer. L'histoire retiendra les noms de Mortenol pour la Guadeloupe, de Jean-Marie Guibert et Pierre Réjon, deux aviateurs martiniquais, du lieutenant Léon Becker de la Guyane...
Ils furent nombreux à ne pas revenir.
Le nombre de morts est de :
|
Nombre d'hommes partis à la guerre |
Nombre de morts |
|
|
Martinique |
8 788 |
1 680 |
|
Guadeloupe |
6 345 |
1 137 (mémoire des hommes) |
|
Guyane |
1 610 |
275 |
|
TOTAL |
16 743 |
3 092 |
Beaucoup de soldats sont tués à l'ennemi, mais beaucoup sont emportés par les maladies (surtout pulmonaire). En Guyane, Virginie Brunelot signale que 47% des soldats sont morts de maladies.
La plupart des soldats sont enterrés dans les nécropoles nationales ou les cimetières militaires. Seules quelques familles (les fortunées) ont rapatrié les corps.
Les retours s'effectuent de février à novembre 1919. Certains restent en France pour travailler, d'autres se marient. Ceux qui retournent sont considérés au début comme des héros (on leur cède le passage), mais ils sont amers car rien n'est fait spécialement pour eux. Certains tombent dans la misère, sont sans ressources et sans moyens de subsistance. Les associations d'anciens combattants se mettent en place. Les monuments sont érigés dans les communes, les noms de rues et les stèles rendent hommage à ces hommes. Peu de soldats racontent leurs aventures et préfèrent ne pas en parler pour ne pas raviver les horreurs de la guerre. Leur déception ne va pas atténuer le patriotisme de la population masculine perceptible à travers les actions des dissidents de la Seconde Guerre mondiale.
3.2. M. ÉRIC DEROO, HISTORIEN, CHERCHEUR ASSOCIÉ (UMR 7268 ADES, AMU-CNRS-EFS), DOCUMENTARISTE LES TROUPES COLONIALES EN EUROPE
Les troupes indigènes dans l'armée française
De tous temps, les conquêtes militaires s'appuient sur des forces recrutées localement. Les pertes dues aux pathologies tropicales, la méconnaissance du pays, l'absence de moyens et de volontaires européens conduisent toutes les grandes nations coloniales à créer des unités indigènes constituées de soldats de métier, de conscrits ou de supplétifs. Au XIX e siècle, l'occupation de l'Afrique du Nord puis celle de l'Afrique noire, de Madagascar, de la péninsule indochinoise ou d'îles du Pacifique entraîne la mise sur pied de nombreuses formations spécifiques : l'armée d'Afrique au Maghreb et l'armée coloniale partout ailleurs. Au cours de la campagne d'Égypte en 1798-1799, Bonaparte émet l'idée de recruter 30 000 auxiliaires musulmans. Il constitue un régiment de Dromadaires et gardera des Mamelouks au sein de la Garde impériale.
L'armée d'Afrique
En 1830, lors de la conquête de l'Algérie, le maréchal de Bourmont recrute 500 hommes dans la tribu des Zouaoua , qui fournissait régulièrement des contingents militaires auxiliaires au bey d'Alger, représentant du pouvoir ottoman. Cette première troupe d'infanterie est dénommée zouaves . Bientôt des cavaliers musulmans forment les premiers régiments de Chasseurs d'Afrique. Peu à peu, les Zouaves et Chasseurs d'Afrique intégrant dans leurs rangs des volontaires européens, les indigènes cessent d'en constituer l'essentiel du recrutement. En 1841 sont créés des escadrons de spahis (cavaliers) et trois bataillons de tirailleurs, surnommés Turcos car certains ont servi dans les garnisons turques de la Régence. Ces formations participent à la conquête de l'Algérie.
En 1854, Napoléon III engage les tirailleurs dans l'expédition de Crimée et, en octobre 1855, sont créés trois régiments de tirailleurs algériens. En 1859, ils participent à la campagne d'Italie. Chaque année, un bataillon de tirailleurs est détaché à Paris pour servir dans la prestigieuse Garde Impériale et un escadron de spahis est affecté à l'escorte des souverains. Cette présence de l'Armée d'Afrique en métropole durera plus de cent ans.
Sénégal, Cochinchine, Mexique, Chine : l'Armée d'Afrique est de toutes les campagnes du Second Empire. Elle prend part également à la guerre contre la Prusse. Elle participe aux campagnes du Tonkin et de Madagascar. Sur le continent africain, l'occupation du Sahara mobilise tirailleurs et spahis, puis les unités spécialisées de méharistes mises sur pied par Laperrine. En 1882 la France impose un protectorat à la Tunisie et l'on crée des unités tunisiennes. À partir de 1907, et jusqu'au milieu des années 1930, c'est au Maroc que tirailleurs et spahis combattent les résistances. Des unités de goumiers, de fantassins et de cavaliers marocains sont également recrutées. À la veille de la Grande Guerre, tirailleurs, spahis et goumiers indigènes côtoient les unités composées de métropolitains de l'armée d'Afrique, légion étrangère, zouaves, chasseurs d'Afrique, infanterie légère d'Afrique et Sahariens, et celles de l'armée coloniale qui regroupent, elles, Européens, Antillais, Guyanais, Réunionnais, Pondichériens, Calédoniens, Tahitiens, Africains, Malgaches, Comoriens et Indochinois.
L'armée coloniale
La Force noire
Dès les premiers comptoirs commerciaux européens implantés sur les côtes africaines au XVI e siècle, les marins recrutent des auxiliaires, notamment à Gorée et Saint-Louis du Sénégal. La marine crée en 1765 le corps des laptots (mousse). De multiples tentatives sont encore faites pour organiser une troupe noire et la marine recrute même des contingents à destination des Antilles, de Madagascar en 1827 ou de Cayenne en 1831. Avant l'abolition de l'esclavage en 1848, on recourt même au rachat d'esclaves, libérés en échange d'un engagement comme soldat. L'expérience réussie de la création des spahis sénégalais en 1845 conduit le capitaine du génie Louis Faidherbe à constituer un bataillon, officialisé le 21 juillet 1857 par l'empereur Napoléon III sous le nom de « tirailleurs sénégalais ». Conquérant des zones de plus en plus vastes à partir des anciens comptoirs, les expéditions militaires se succèdent et les tirailleurs y occupent une place prépondérante. Le 1 er régiment de tirailleurs sénégalais est constitué en 1884, suivi de nombreux autres, gabonais, haoussa, soudanais, congolais, tchadiens qui, par souci d'uniformité, gardent l'appellation de « sénégalais ». En 1910, le lieutenant-colonel Mangin publie La Force noire et propose de mobiliser jusqu'à 120 000 hommes. Au Maroc combattent cinq bataillons de Sénégalais.
À la suite d'une compagnie sakalave créée en 1885 sont mis sur pied quatre régiments de tirailleurs malgaches. Dès 1869, une compagnie de recrutement comorien stationne à Nosy Be. Servant au sein de diverses formations, les Comoriens participent comme les Sénégalais aux opérations de Madagascar puis sont intégrés aux bataillons de tirailleurs malgaches et plus tard au bataillon somali. À la veille de la guerre, les troupes noires africaines comptent trente-cinq bataillons, soit 30 000 hommes.
Les Indochinois
À partir de 1856, des unités indigènes sont formées dans les colonies ou protectorats du Vietnam, Cambodge et Laos. En 1879 est créé le 1 er régiment de tirailleurs annamites, puis de 1883 à 1886, quatre régiments de tirailleurs tonkinois, ainsi que des unités de chasseurs à cheval, de chasseurs cambodgiens et laotiens, de tirailleurs chinois et de frontières, qui inspirent au général Pennequin l'idée d'une « Force jaune ». L'Indochine compte à la veille de la Grande Guerre près de 15 000 militaires, 12 500 gardes indochinois et 24 000 réservistes.
Le défilé du 14 juillet qui se déroule traditionnellement à Longchamp voit en 1913 s'affirmer le rôle des troupes issues de l'Empire. Les unités de tirailleurs annamites, malgaches ou algériens reçoivent leur drapeau et l'emblème du 1 er régiment de tirailleurs sénégalais est décoré de la Légion d'honneur des mains du président Poincaré.
La Grande Guerre 1914-1918
Dès le début des opérations, aux mois d'août et septembre 1914, dix bataillons de sénégalais sont acheminés en France, soit 8 000 combattants, engagés de la Picardie à Ypres et Dixmude. À l'hiver, les Sénégalais sont retirés du front et cantonnés dans le Midi pour l'hivernage. Ils participent également aux opérations au Togo et au Cameroun. Fin 1914, l'hécatombe est telle pour l'armée française - près de 500 000 tués, blessés et prisonniers - que de nouvelles recrues sont réclamées à l'Afrique. Les recrutements forcés et l'économie de guerre imposée aux populations entraînent d'importantes révoltes dans plusieurs régions d'Afrique occidentale. Plus de 130 000 Africains participent à la guerre en Europe et dans les Balkans au sein de 137 bataillons et perdent 25 000 tués et 36 000 blessés. 34 000 combattants malgaches et comoriens servent au sein de vingt bataillons de tirailleurs malgaches et de vingt et un bataillons d'étape et dans l'artillerie lourde. 2 300 Malgaches meurent pour la France au cours du conflit. Plus de 5 000 Malgaches sont également levés comme travailleurs. Quant au bataillon somali, il est rattaché au régiment d'infanterie coloniale du Maroc. Sur 2 000 tirailleurs venus combattre en Europe, 517 sont morts et plus de 1 000 blessés. Les mille combattants du bataillon du Pacifique perdent plus de 200 hommes. 43 000 combattants indochinois servent en Europe et sur le front d'Orient, dont 4 800 au sein de quatre bataillons combattants et 24 000 dans 15 bataillons d'étape (5 000 conducteurs, 9 000 infirmiers, 5 000 ouvriers). 49 000 Indochinois recrutés comme travailleurs indigènes viennent également en France. Plus d'un millier sont morts.
En août 1914, 25 000 tirailleurs maghrébins, pour la plupart engagés, sont acheminés vers les frontières du Nord-Est. La « guerre totale » oblige rapidement à recourir à la conscription, puis fréquemment au recrutement forcé qui entraîne de nombreuses révoltes en Algérie. Au total, de 1914 à 1918, 175 000 Algériens, 62 000 Tunisiens et près de 37 000 Marocains combattent sur tous les fronts de France et sur le front d'Orient. 140 000 Maghrébins participent à l'effort de guerre dans l'industrie ou l'agriculture. À la fin de la guerre, les unités de tirailleurs maghrébins figurent parmi les plus décorées de l'armée française. Leurs pertes s'élèvent à 25 000 tués pour les Algériens, 9 800 pour les Tunisiens et 12 000 pour les Marocains, sans oublier des dizaines de milliers de grands blessés et d'invalides.
L'entre-deux-guerres
Sous mandat de la Société des Nations, troupes coloniales et unités de l'armée d'Afrique mènent des opérations au Levant. 300 officiers et 9 000 hommes de troupe de l'Armée d'Afrique y laissent la vie. Des unités de recrutement libanais, druze, alaouite ou tcherkesse et celles de la coloniale y combattent également. Près de 150 000 hommes - dont dix-huit régiments de tirailleurs nord-africains et dix bataillons sénégalais - sont engagés pour pacifier le Maroc jusqu'en 1934. En 1930, de grandes fêtes marquent le centenaire de l'Algérie. L'empire colonial semble à son apogée lors de l'Exposition coloniale internationale de 1931. Plusieurs régiments de l'Armée d'Afrique et des troupes coloniales sont alors en garnison dans nombre de villes en métropole.
La Seconde Guerre mondiale
La mobilisation de l'armée en Afrique permet de disposer de sept divisions d'infanterie nord-africaines, une division marocaine, quatre divisions d'infanterie d'Afrique, trois brigades de spahis, soit 200 000 soldats maghrébins mobilisés, dont près de 80 000 sur le sol métropolitain tandis que huit divisions d'infanterie coloniale montent en ligne. On estime à 5 400 le nombre des Maghrébins tués. 65 000 prennent le chemin de la captivité. 63 000 Africains, 14 000 Malgaches et 15 000 Indochinois servent dans les formations indigènes de la coloniale : 4 500 sont tués, 25 000 blessés et disparus, 50 000 prisonniers (dont 28 000 Africains, 12 000 Indochinois et 9 000 Malgaches) sur environ 105 000 coloniaux engagés dans les combats. Des centaines de prisonniers s'évaderont par la suite pour rejoindre les maquis de l'Oisans, du Vercors, de Bretagne...
En Afrique du Nord, les généraux Weygand, puis Juin, préparent la reprise des combats en dissimulant troupes et matériels. 20 000 goumiers sont militarisés. Pendant ce temps, les tirailleurs africains du général Leclerc s'emparent de Koufra tandis que ceux des brigades françaises libres, avec les légionnaires de la 13 e demi-brigade de légion étrangère (DBLE) et les tirailleurs nord-africains que rejoindront les tirailleurs du Pacifique, livrent bataille en Érythrée, subissent les combats fratricides au Levant, avant de s'illustrer à Bir Hakeim et El Alamein.
Le 8 novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. En 1943, l'armée d'Afrique reprend en Tunisie le combat interrompu en 1940. Il coûte 17 000 tués, blessés et disparus. En septembre 1943, le 1 er régiment de tirailleurs marocains et le 2 e groupement de tabors marocains libèrent la Corse. Le réarmement décidé à Anfa permet la constitution de trois divisions blindées et de cinq divisions d'infanterie, dont trois de l'armée d'Afrique et deux des troupes coloniales : la 2 e division d'infanterie marocaine (DIM), la 3 e division d'infanterie algérienne (DIA), la 4 e division marocaine de montagne (DMM), la 1 re division française libre (DFL) et la 9 e division d'infanterie coloniale (DIC). La fusion des Forces françaises libres et de l'armée d'Afrique est réalisée au sein de la France combattante. La mobilisation générale permet de fournir 118 000 Européens et 160 000 musulmans rappelés qui s'ajoutent aux 224 000 hommes déjà sous les armes. Placé sous les ordres du général Juin, le corps expéditionnaire français en Italie se compose en 1943 des 2 e DIM et 3 e DIA qui montent en ligne au nord de Cassino. Au printemps 1944, la 4 e DMM et la 1 re DFL les rejoignent. Elles donnent l'assaut au Garigliano et entrent à Rome le 6 juin. La 9 e DIC libère l'île d'Elbe. Le succès est chèrement payé : 15 % des 200 000 hommes engagés sont tués. Les pertes atteignent 80 % de l'effectif pour les compagnies d'infanterie.
Les grandes unités retirées d'Italie et de Corse ainsi que les 1 re et 5 e divisions blindées venues d'Afrique du Nord forment l'armée B du général de Lattre de Tassigny qui compte 260 000 militaires, dont la moitié issus de l'Empire. Tandis que coloniaux, spahis marocains et artilleurs nord-africains de la 2 e DB s'illustrent de la Normandie à Paris, les premières unités débarquent en Provence le 15 août 1944, de Sainte-Maxime à Cavalaire. Toulon, où le 6 e RTS perd 587 tirailleurs tués, disparus et blessés, et Marseille sont libérés. Puis c'est Lyon et Dijon. Le 12 septembre, les unités venues de Normandie et celles de Provence se rejoignent. À l'automne, les tirailleurs africains de la 9 e DIC et de la 1 re DFL sont relevés par les jeunes des maquis lors du « blanchiment » des unités. Belfort est atteint le 20 novembre. Strasbourg et Mulhouse sont libérées. Début février 1945, les Français entrent dans Colmar. À la mi-mars, la ligne Siegfried est percée et le Rhin franchi de vive force. C'est en Autriche que l'armistice arrête la progression. La victoire est acquise. Les pertes sont élevées : plus de 13 000 tués dont les deux tiers de musulmans. 210 des 3 634 jeunes aspirants formés à Cherchell entre 1942 et 1945 sont tombés. Comme en 1918 et 1919, les unités indigènes participent aux cérémonies de la Libération en 1944, puis de la Victoire en 1945.
La décolonisation
De 1946 à 1954, plus de 120 000 tirailleurs, artilleurs, sapeurs ou cavaliers algériens, marocains et tunisiens, et plus de 60 000 tirailleurs africains ou malgaches combattent sur la terre indochinoise. Neuf des treize bataillons d'infanterie de la garnison de Diên Biên Phu sont composés de tirailleurs et de légionnaires. Le coût de cette guerre est particulièrement élevé : 23 000 morts dont 11 000 Français, 7 500 légionnaires et 4 500 Nord-Africains et Africains ; 10 000 disparus, 16 500 prisonniers. Sur les 6 000 Nord-Africains et Africains prisonniers, 2 300 sont non rendus. En 1954, plus de 66 000 Vietnamiens, Cambodgiens et Laotiens servent au sein des unités du corps expéditionnaire ainsi que 44 000 supplétifs. 45 000 sont tués et 57 000 blessés.
L'indépendance du Maroc, le 2 mars 1956, entraîne la dissolution des unités marocaines. Celles en garnison en France ou en Allemagne disparaissent entre 1955 et 1965. La Tunisie devient indépendante le 20 mars 1956. Le retrait des troupes françaises est terminé en 1958, tandis que les régiments de tirailleurs tunisiens perdent leur qualificatif régional et sont envoyés en Algérie. En 1954, débute la guerre d'Algérie qui s'achève en 1962 par son indépendance. En 1961, on compte en Algérie 26 000 Algériens engagés, 39 000 appelés et plus de 150 000 supplétifs locaux, tandis que 1 500 engagés et 21 400 appelés algériens cantonnent en Allemagne occupée. Huit régiments de tirailleurs africains, un groupe saharien, des unités d'artillerie et des services, soit plus de 15 000 hommes, servent également en Algérie. Leurs dernières unités sont dissoutes en 1964.
3.3. M. GILLES AUBAGNAC, HISTORIEN, CHEF DU SERVICE DE LA CONSERVATION AU MUSÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE LES PRÉSENCES DU MONDE DANS LES DEUX CONFLITS MONDIAUX
Une idée fausse revient souvent : la France aurait oublié, voire condamné à l'oubli définitif, le sacrifice des soldats recrutés en dehors de la métropole et qui ont combattu pour elle. Je ne veux entrer dans aucune polémique mais je voudrais montrer, en quelques minutes, que, dans le domaine militaire, il n'y a pas d'oubli, bien au contraire, en dépit de l'histoire, lourde, de la décolonisation.
Écoutez les noms de ces régiments de l'armée française... derrière les noms il y a une histoire et la mémoire de tous soldats qui nous ont précédés :
(Formations héritières des traditions de l'armée d'Afrique)
1 er régiment de tirailleurs, Épinal
1 er régiment de spahis, Valence
1 er régiment de chasseurs d'Afrique, Canjuers
40 e régiment d'artillerie, Suippes
54 e régiment d'artillerie, Hyères
68 e régiment d'artillerie d'Afrique, La Valbonne
31 e régiment du génie, Castelsarrasin
41 e régiment de transmissions, Senlis
511 e régiment du train, Auxonne
515 e régiment du train, La Braconne
516 e régiment du train, Toul
mais aussi toutes les unités de la Légion étrangère
(Formations héritières des traditions des troupes indigènes coloniales)
5 e régiment interarmes d'outre-mer (bataillons de marche somalis), Djibouti
9 e régiment d'infanterie de marine (tirailleurs tonkinois), Cayenne et Saint-Jean du Maroni, Guyane
21 e régiment d'infanterie de marine (troupes indigènes), Fréjus
Régiment de marche du Tchad (régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad), Noyon
3 e régiment du service militaire adapté (5 e régiment d'artillerie coloniale, artilleurs indochinois), Cayenne, Guyane
4 e régiment du service militaire adapté (7 e régiment d'artillerie de marine, artilleurs malgaches), Saint-Denis, La Réunion
Groupement du SMA de Guyane (28 e RIAOM, 8 e régiment de tirailleurs sénégalais), Saint-Jean-du-Maroni, Guyane
Groupement du SMA de Polynésie (11 e régiment d'infanterie de marine, tirailleurs cochinchinois).
Il ne s'agit pas d'une litanie datant de l'exposition coloniale de 1931. Ces régiments sont ceux de l'armée française d'aujourd'hui. Ils ont été engagés au cours des années passées au Liban, en Ex-Yougoslavie, en Afghanistan et, aujourd'hui, en Centrafrique ou au Mali. Sachant que la marine et l'armée de l'air représentent des effectifs squelettiques et qu'il n'y a plus seulement qu'environ 80 régiments dans l'armée de terre d'aujourd'hui, il est évident que l'héritage des soldats qui n'étaient pas « gaulois » est important 5 ( * ) .
Les salles d'honneur et de traditions de ces unités et les musées du ministère de la défense présentent également au public des collections illustrant l'engagement des troupes d'outre-mer. De nombreux monuments illustrent leur sacrifice et sont le lieu de cérémonies régulières. Certes, ces questions sont la plupart du temps ignorées du grand public et n'intéressent pas toujours les grands médias...
Aujourd'hui cet héritage est donc, à la fois, un hommage rendu aux anciens et un des éléments de l'efficacité opérationnelle. Plusieurs façons de mettre en oeuvre cet héritage existent. Je retiens, pour faire simple et rapide, deux pistes :
• la conservation et la recréation des régiments, ainsi que les unités de tradition ;
• les noms de promotion, les monuments, les commémorations et les musées.
Mais pour comprendre cela, il faut aussi connaître le fonctionnement mental psychologique des militaires et pourquoi l'histoire est l'un des moyens qui permet aux armées de la République de traverser les périodes au service de la France.
L'histoire, dans les armées, est une sorte de généalogie ; et c'est en cela qu'elle participe à l'efficacité opérationnelle.
Pour qui meurt-on encore aujourd'hui en Afghanistan, au Mali ; il y a quelques années en ex-Yougoslavie ou encore au Liban ?
Certes « pour la France ! » C'est une loi du 2 juillet 1905.
Mais au-delà de cette formule et des grandes idées il existe une réalité plus terre à terre. Le soldat meurt pour son camarade, pour son binôme, pour son sergent, pour son lieutenant, pour la mission qu'il doit remplir. Il meurt pour l'idée qu'il se fait de lui-même et qu'il cherche parfois dans le regard des autres. Les militaires fonctionnent avec un fort surmoi (Freud) dans une morale close (Bergson). S'il n'y a pas ces deux piliers - le surmoi et la morale close -, il n'y a plus d'armée de la République dans un pays démocratique ; il n'y a plus que des sociétés de sécurité ou des mercenaires. L'histoire du régiment, l'action des « anciens » est l'armature de cette généalogie qui s'appuie sur ces deux piliers. Cette généalogie est variable et l'histoire finalement polymorphe. Certaines unités rechercheront cette identité - appelée culture d'arme - dans les batailles du Premier Empire, d'autres dans les combats de la Grande Guerre et d'autres encore justement dans cette période de la France des outre-mer. À travers l'histoire de ces unités, c'est aussi la mémoire des soldats originaires de ces pays qui est active : les tirailleurs, les spahis, les artilleurs d'Afrique, les cavaliers de Yusuf...
Le soldat d'aujourd'hui s'inscrit dans une lignée ; il existe d'une certaine manière un culte des ancêtres. L'ancien, dans ce qu'il a de meilleur, est un guide et il n'est pas question de le trahir. Et « l'ancien » dans l'armée française de 2014, c'est aussi le tirailleur somali, l'artilleur du Maroc, le marsouin ultra-marin...
L'histoire est nécessaire car elle rappelle le passé ; sans passé pas de perception du présent, pas de vision sur l'avenir. Le présent n'est qu'une succession d'instants sans hiérarchie possible : tout vaut tout. Alors que la relativité et la priorisation sont seuls des moyens de comprendre l'action. « Ici et maintenant » n'a de sens que si un « ailleurs et hier » est connu.
Bien sûr, certains pourront dire qu'il y a là une instrumentalisation de l'histoire. Mais ne soyons pas dupes. Certes l'histoire tend vers la neutralité et l'objectivité, mais elle est toujours étudiée, diffusée, vulgarisée dans et pour des considérations du temps présent. C'est elle qui donne du sens.
Cette histoire, cette généalogie passe par le drapeau (ou l'étendard) de chaque régiment. C'est un point majeur pas toujours compris dans la société civile, surtout depuis la disparition du service militaire.
Le drapeau est, à la fois, une illustration de quelques articles de la Constitution et un résumé de la généalogie de l'unité.
Il est tricolore, porte les initiales RF et la devise de la République « Liberté, égalité, fraternité ». Il est la manifestation visible de la délégation de l'usage de la force que font les citoyens dans le registre le plus régalien qui soit. C'est le drapeau qui fait que le soldat de la République n'est pas un mercenaire.
Mais le drapeau porte aussi le nom et le numéro d'un régiment. Il y a là une histoire qui est illustrée, presque célébrée pourrait-on dire, par l'inscription des noms de batailles dans ses plis et par les décorations qu'il porte agrafées sur sa cravate.
Cette identité est importante et ce depuis des siècles.
« On sait de quels prodiges de valeur les régiments sont capables pour soutenir l'honneur de leur numéro et pour se montrer digne de leur surnom. Rétablir et conserver les glorieux souvenirs qui se rattachent aux anciens corps de troupes seraient le moyen le plus efficace de ranimer l'esprit de corps, trop souvent ébranlé en France par les licenciements, par les réorganisations de l'armée et remédier à l'absence de traditions dont les rangs de nos jeunes soldats sont vides aujourd'hui. » (Rapport au roi du général Currières, ministre de la guerre, le 17 avril 1839)
Le nom ? Nous l'avons déjà évoqué :
• 68 e régiment d'artillerie d'Afrique...
• 1 er régiment de tirailleurs...
• 1 er régiment de spahis...
• Et tous les autres...
Ce n'est pas de l'orientalisme comme la peinture de la fin du XIX e siècle, c'est une réalité et une fierté pour tous les soldats qui servent dans ces unités.
Lorsque les jeunes engagés sont présentés à l'emblème de leur unité, c'est cette histoire qu'il leur est racontée, c'est cette histoire qui est illustrée dans les salles d'honneur des régiments mais aussi dans des musées comme ceux des troupes de marine à Fréjus, de l'artillerie à Draguignan ou de la cavalerie à Saumur.
Car cette histoire est constituée par un patrimoine à la fois matériel et immatériel et, pour ces régiments, si le nom des anciens ou leur couleur de peau ne sont pas les mêmes que ceux du régiment d'infanterie mis sur pied en août 1914 à... Brive-la-Gaillarde, par exemple, la valeur de l'exemple est exactement la même.
En effet, ces noms, contrairement à une idée fausse, ne sont pas des relents ou des regrets d'une histoire coloniale...
Ces noms sont des exemples d'hier pour une action aujourd'hui.
Cette histoire d'hier est portée par les noms de bataille.
Cette tradition est née par la volonté de Napoléon I er de s'autocélébrer, mais elle a été reprise de manière bien moins hagiographique par la III e République à partir de 1880. Aujourd'hui nous héritons de cet esprit, de ces régiments en les ayant adaptés à l'histoire et à la mémoire des soldats de la France.
Quelques exemples permettent de comprendre cet héritage, cette généalogie, cette mémoire.
Le régiment de marche du Tchad (RMT)
Il a été créé au cours de la Seconde Guerre mondiale mais à partir du régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad (RTST) dont les inscriptions de bataille sur son drapeau étaient : Tchad 1900, Ouaddaï 1909, Borkou-Ennedi 1913, Cameroun 1914-1916 . Le 30 juillet 1943, le général de Gaulle accorde au régiment deux citations à l'ordre des Forces françaises libres pour les combats de 1941 à 1943 en Libye et en Tunisie. Ces deux premières citations à l'ordre de l'armée confèrent au drapeau du RTST la croix de guerre 1939-1945 avec deux palmes, ainsi que la fourragère aux couleurs de la croix de guerre 1914-1918 avec olive 1939-1945. Lorsqu'en Afrique du Nord le RTST devient RMT, les tirailleurs noirs sont rapatriés au Tchad. Mais le général de Gaulle est attentif aux traditions et aux symboles. Si bien que par décision du 17 janvier 1944, le régiment de marche du Tchad est proclamé « héritier des traditions du régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad dans la continuation de l'action de guerre menée par les troupes coloniales. La croix de guerre avec deux palmes et la fourragère aux couleurs de la croix de guerre sont ainsi conférées au drapeau du régiment de marche du Tchad 6 ( * ) . »
Par la suite, le régiment de marche du Tchad obtient au sein de la 2 e DB deux nouvelles citations à l'ordre de l'armée 7 ( * ) . Avec un total de quatre citations à l'ordre de l'armée, le drapeau du RMT reçoit la fourragère aux couleurs du ruban de la médaille militaire 8 ( * ) .
Après la guerre, la commission des emblèmes accorde au RMT six inscriptions 9 ( * ) de bataille sur la soie du drapeau : Koufra 1941, Fezzan 1942, Sud Tunisien 1943, Alençon 1944, Paris 1944, Strasbourg 1944 .
Ces noms de Koufra et de Fezzan et Sud-Tunisien ont été particulièrement inscrits pas les tirailleurs. Citer ces noms, c'est rappeler les noms de ces soldats.
Mais le RMT n'est pas le seul. On peut considérer que les cinq autres unités coloniales faites compagnons de la Libération par le général de Gaulle sont, elles aussi, dépositaires d'un patrimoine légué par les troupes indigènes qui ont servi en leur sein : 2 e régiment d'infanterie de marine (RIMa), héritier de la 2 e brigade de la 1 re division française libre (bataillon de marche n° 4, BM 5 et BM 11), 1 er régiment d'artillerie de marine, 3 e régiment d'artillerie de marine. Il en va de même pour une autre unité de l'armée d'Afrique, compagnon de la Libération, le 1 er régiment de spahis, qui au travers d'appellations différentes a été maintenu à l'ordre de bataille et stationne à Valence depuis 1984.
Des régiments ont aussi été recréés lors des réorganisations pour en quelque sorte « redonner vie » à un patrimoine.
C'est le cas des deux unités d'infanterie de marine du Pacifique (Nouvelle-Calédonie et Polynésie). À partir du 1 er juillet 1948, un bataillon mixte d'infanterie coloniale du Pacifique stationne en Nouvelle-Calédonie et un de ses détachements sert à Tahiti à compter du 1 er juillet 1949, sous l'appellation de détachement autonome de Tahiti . Tout naturellement, cette unité se considère comme dépositaire des traditions du bataillon d'infanterie de marine et du Pacifique (BIMP, cinq fois citée à l'ordre de l'armée en 1940-1945, titulaire de la fourragère aux couleurs du ruban de la médaille militaire avec olive 1939-1945, et compagnon de la Libération, constitué après la bataille de Bir-Hakeim, en juillet 1942, par la fusion du 1 er bataillon d'infanterie de marine 10 ( * ) et du bataillon du Pacifique 11 ( * ) .
Le système évolue en fonction des réorganisations mais le principe demeure.
En 1981, lorsque l'on transforme les deux bataillons en deux régiments du Pacifique 12 ( * ) , ils sont autorisés à « recueillir intégralement et conjointement » les traditions du BIMP. Il se trouve que l'on attribue, en fait, le patrimoine d'un bataillon (formant corps, il est vrai) à deux régiments distincts. Seule différence entre les deux drapeaux, la localisation géographique de l'unité. Pour le reste, appellations, noms de bataille marqués sur la soie et décorations accrochées à la cravate 13 ( * ) sont identiques.
En fait, cette situation exceptionnelle s'explique aisément : le pouvoir politique et la hiérarchie militaire soulignent, au prix de quelques entorses aux règles en usage, l'importance qu'elles attachent aux traditions militaires héritées du Pacifique. Pour preuve supplémentaire, l'inscription « Grande Guerre 1914-1918 » et la croix de guerre avec palme méritées par le 1 er bataillon mixte du Pacifique en 1916-1918, patrimoine confié en 1988 aux deux régiments du Pacifique 14 ( * ) .
Cette politique de préservation de la mémoire des unités indigènes est toujours active au sein des armées et profite des opportunités offertes par les réorganisations fonctionnelles de l'institution. C'est ainsi que le souvenir des tirailleurs algériens, tunisiens et marocains de l'armée d'Afrique est ravivé par la création en 1994, à Épinal, d'un 1 er régiment de tirailleurs 15 ( * ) . Dans le même esprit, un 1 er régiment de chasseurs d'Afrique (camp de Canjuers) figure à nouveau à l'ordre de bataille de l'armée de terre depuis 1998.
Sur l'étendard du 68 e régiment d'artillerie d'Afrique (RAA) , il y a Maroc 1908, Les Deux Morins 1914, Champagne 1915, Verdun 1917, L'Aisne 1917, Picardie 1918 ; Djebel Zaghouan 1943, Mulhouse 1944, Danube 1945.
Ces batailles ont été livrées par des artilleurs venant d'Algérie et du Maroc. L'exemple à suivre aujourd'hui pour les artilleurs de La Valbonne près de Lyon est donné par des hommes venant de ces pays, plus berbères et kabyles que gaulois.
Pour perpétuer cette mémoire, la transmission des traditions de certaines unités de tirailleurs à d'autres unités des troupes de marine qui n'ont pas le même numéro ou la même appellation ; ces dernières deviennent alors des unités de tradition gardiennes du patrimoine qui leur est confié. Deux unités sont à cet égard exemplaires : le 41 e BIMa et le 5 e régiment interarmes d'outre-mer (RIAOM) qui conservent respectivement le souvenir du 12 e bataillon de tirailleurs malgaches (BTM) et celui du bataillon de tirailleurs somalis.
Les marsouins présents en Côte française des Somalis, puis, à partir de 1967, sur le Territoire français des Afars et des Issas, conservent bien entendu la mémoire de leurs compagnons d'armes somalis. Mais il faut attendre la fin des années soixante pour voir officialisée cette transmission de patrimoine, à la faveur de la création du 5 e régiment interarmes d'outre-mer. En effet, la décision de création de l'unité précise qu'il est attribué au 5 e RIAOM « un emblème où figureront les inscriptions du bataillon somali 16 ( * ) . » Outre les inscriptions de bataille, le 5 e RIAOM hérite également des décorations décernées au bataillon somali. En avril 1970, Michel Debré, ministre de la défense, décida qu'en vue de perpétuer les traditions du bataillon somali, « l'emblème du 5 e RIAOM sera admis, de façon très exceptionnelle, à porter, accrochées à sa hampe, les deux croix de guerre 1914-1918 avec palmes obtenues respectivement par le 5 e RIC et le bataillon somali 17 ( * ) . » La décision ministérielle précise que les rubans des deux croix de guerre seront ornés chacun d'une barrette en métal blanc - comparable à la barrette des médailles commémoratives - portant l'une, l'inscription 5 e Régiment d'infanterie coloniale et l'autre, l'inscription Bataillon somali . Curieusement, la décision de 1970 ignorait les titres de guerre des Somalis de 1945. Oubli réparé - de façon non réglementaire - puisque l'habitude a été prise d'accrocher également à la cravate du drapeau du 5 e RIAOM les décorations décernées au bataillon de marche somali pendant la Seconde Guerre mondiale : la croix de guerre 1939-1945 avec une palme, une étoile d'argent et une barrette Bataillon somali.
Dernier témoignage matérialisant le souvenir des tirailleurs somalis, la décision 18 ( * ) du général chef d'état-major de l'armée de terre, qui donne son accord, en septembre 1996, pour que les personnels du 5 e RIAOM portent en tenue de défilé la ceinture rouge des troupes indigènes 19 ( * ) . C'est ainsi que les marsouins et les bigors 20 ( * ) du 5 e RIAOM maintiennent aujourd'hui en République de Djibouti les traditions des tirailleurs somalis.
Pour tenter d'être complet, mais c'est impossible en si peu de temps, il faudrait citer aussi les monuments commémoratifs et les commémorations elles-mêmes mais aussi, dans le patrimoine immatériel, les noms de promotion.
Les baptêmes de promotion dans les écoles de l'armée de terre sont ainsi l'occasion de faire vivre la mémoire de ces soldats venus des outre-mer. L'adjudant Bourama Dieme, commandeur de la Légion d'honneur, a été choisi pour parrain par les élèves sous-officier de la 225 e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active (ENSOA) à Saint-Maixent-l'École et l'adjudant-chef Hoang Chung par la 242 e promotion.
Monuments du souvenir, sites de mémoire accueillant les cérémonies militaires, collections des musées ou des salles d'honneur du ministère de la défense, adoption par les soldats de l'armée professionnelle de tenues dites de tradition, port d'insignes spécifiques, préservation des unités et de leur patrimoine de traditions, reconnaissance officielle des filiations, transmission aux jeunes générations de combattants des décorations collectives décernées aux anciens, inscriptions de noms de bataille sur le drapeau ou l'étendard, emblèmes confiés à la garde d'unités de tradition, autant d'éléments qui rappellent d'abord l'exemple de ceux qui se sont illustrés au service des armes de la France , qui contribuent ensuite, aujourd'hui comme hier, au développement des forces morales, et qui sont enfin des « réveils de mémoire ». Depuis les années soixante, ils témoignent de la volonté de ne pas oublier dans les formations militaires les tirailleurs, goumiers, spahis, supplétifs, travailleurs, volontaires, miliciens ou auxiliaires, ces Maghrébins, Africains, Malgaches, Somalis, Comoriens, Indochinois, combattants du Pacifique ou des Antilles, ces soldats de l'outre-mer envers lesquels la nation a une dette d'honneur , prix du sang versé pour la défense de la France aux heures les plus sombres de son histoire.
3.4. HENRI HAZAËL-MASSIEUX, ADMINISTRATEUR CIVIL HC HONORAIRE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE, CHARGÉ DE MISSION MÉMOIRE LES COLONIES DANS LES DEUX GUERRES MONDIALES
Les vieilles colonies ont toujours connu la guerre. Il aura fallu se défendre contre les ennemis de la France qui aspiraient à se les approprier, selon les périodes, Espagnols, Anglais, Hollandais.
Au début du XVIII e siècle, pendant la guerre de succession d'Espagne, les Anglais disaient d'ailleurs : « Mieux vaut avoir affaire à deux diables qu'à un seul habitant français ».
Les colons, organisés en milices, n'hésitaient pas, en ce temps-là, à faire appel aux gens de couleur et aux esclaves noirs pour participer aux combats. Ce fut le cas en Guadeloupe en 1759.
Les esclaves qui s'étaient fait remarquer pour leur bravoure étaient alors affranchis en récompense de leurs services.
De même, la guerre d'indépendance des États-Unis puis la Révolution française furent l'occasion d'engager des troupes aussi bien parmi les colons que parmi les esclaves.
L'armée fut donc très tôt considérée par ces derniers comme une passerelle pour sortir de la servitude et un instrument de promotion sociale.
Il en fut ainsi à Saint-Domingue avec Toussaint-Louverture, en Martinique avec Pélage et en Guadeloupe avec plusieurs des nombreux officiers noirs ou de couleur qui s'engagèrent dans la rébellion de 1802, après s'être battus sur les champs de bataille européens.
Cependant, les colons avaient, plus que tout autre, le goût des armes.
Quoi qu'il en soit, aussi bien dans l'armée de terre que dans la marine, des noms sont restés dans l'histoire comme ceux du général Dugommier, du colonel Joseph Bologne, dit chevalier de Saint-Georges de la Guadeloupe, du général Alexandre Dumas, de l'amiral et ministre de la marine Eustache de Bruix de Saint-Domingue, du général et baron d'empire Pierre César Dery de la Martinique, etc.
Tout au long du XIX e siècle, nombreux furent également les originaires des colonies qui participèrent, parfois à des niveaux élevés, aux différents conflits qui l'émaillèrent, qu'il s'agisse de répression de révoltes internes à la France, de conquêtes coloniales, de l'expédition du Mexique ou de la guerre de 1870. On peut citer pêle-mêle les généraux guadeloupéens : Begin, Levassor-Sorval (répression de la Commune), Sonis, La Jaille, Bouscaren, Bossant, De Lacroix ; martiniquais : Dubourdieu, Brière de l'Isle, Vassoigne, Reboul (qui s'illustrèrent en 1870 à Bazeilles) ; guyanais : Virgile ; réunionnais : Lacaze (expansion coloniale sous la III e République : campagnes de Tunisie, de Madagascar, du Sénégal et de l'Indochine), Bornier (premier général d'aviation de l'armée française), Rolland (expédition du Mexique et guerre de 1870).
Dès l'instauration de la République, les élus des vieilles colonies, aussi bien dans les Caraïbes qu'à La Réunion n'eurent de cesse que la conscription leur fût appliquée. Les conseils généraux prirent même des délibérations dans ce sens, estimant que c'était là la meilleure manière d'être « assimilés » et de devenir des citoyens à part entière, que de se faire tuer pour la « Mère Patrie » .
Le 15 juillet 1889 fut votée la nouvelle loi militaire, appliquant le service militaire à tous les coloniaux.
Dans une conférence à l'École coloniale à Paris, le 30 mars 1919, Gratien Candace, député de la Guadeloupe, devait s'écrier : « C'est la loi du 15 juillet 1889 à l'élaboration de laquelle nos députés ont pris une part active, qui est le triomphe des idées d'assimilation et du service obligatoire pour tous. »
Mais cette loi ne devint effective qu'en 1913, lorsque les régiments de tirailleurs commencèrent à se multiplier. Une carte postale bien connue montre le départ en 1903 de Basse-Terre en Guadeloupe des premiers conscrits guadeloupéens.
Rappelons que l'un des pionniers de l'utilisation de troupes coloniales fut le général Faidherbe au Sénégal.
En 1857, Louis Faidherbe, en manque d'effectifs venus de la métropole sur les nouveaux territoires d'Afrique, pour faire face aux besoins de maintien de l'ordre générés par la phase de colonisation, crée le corps des tirailleurs sénégalais. Le décret fut signé le 21 juillet 1857 à Plombières-les-Bains par Napoléon III. Jusqu'en 1905, ce corps intègre des esclaves rachetés à leurs maîtres locaux, puis des prisonniers de guerre et même des volontaires ayant une grande diversité d'origines.
Puis vint le théoricien de la Force noire , le général Mangin, qui estimait que la formation d'unités de soldats africains en nombre serait de nature à apporter une aide précieuse à l'armée française en raison, dit-il, des qualités guerrière de certaines ethnies...
Sa thèse ne fut d'abord guère appréciée. Elle ne fera fortune que plus tard...
Il convient de souligner au passage que la fin du siècle aura été également marquée par plusieurs faits non dénués d'importance pour l'avenir. À la politique d'expansion coloniale menée par le gouvernement républicain correspondit en effet l'adoption du code de l'indigénat en juin 1881, imposé dès 1887 à l'ensemble des nouvelles colonies, et la création de l'École coloniale en 1889, laquelle admit, dès ses débuts, des élèves issus, notamment, des vieilles colonies.
1914-1918
Quand éclate la guerre en 1914, toutes les colonies eurent donc vocation à y participer.
Tableau n° 1 : La contribution globale des colonies à l'effort de Guerre
|
Combattants en Europe |
Tués |
Travailleurs |
|
|
Algérie (musulmans uniquement) |
173 000 |
23 000 |
76 000 |
|
Tunisie |
58 778 |
10 500 |
18 358 |
|
Maroc |
25 000 |
2 043 |
35 010 |
|
AOF/AEF |
164 000 |
33 320 |
|
|
Madagascar |
45 860 |
2 368 |
|
|
Indochine |
43 430 |
1 123 |
49 000 |
|
Côte des Somalis |
2 000 |
400 |
|
|
Pacifique |
1 000 |
325 |
|
|
Antilles/Guyane |
23 000 |
2 037 |
|
|
Réunion |
14 423 |
3 000 |
5 535 |
|
Total |
550 491 |
78 116 |
183 903 |
|
Ces chiffres sont, bien entendu, approximatifs. Aujourd'hui encore, on est dans l'incapacité d'en donner qui soient exacts. Rapport Marin présenté en 1920 devant le Parlement et faisant l'état des pertes subies pendant le conflit de 1914 - 1918 Rapport présenté au Parlement par le baron des Lyons de Feuchin le 24 décembre 1924, soulignant l'importance de l'effort de guerre consenti par le pays. |
|||
En Afrique Noire tout d'abord, le commandement français lance de nombreux appels pour recruter. Mais, contrairement aux idées reçues, les Africains ne sont, dans un premier temps, guère enthousiastes pour aller se battre et le commandement français doit même avoir recours à la contrainte, (ce que facilitait bien sûr le code de l'indigénat) quitte à provoquer parfois des révoltes, durement réprimées.
Il faut attendre 1917, avec la campagne de recrutement de Blaise Diagne, député du Sénégal, nommé pour ce faire commissaire de la République, pour que l'Afrique fournisse enfin des contingents importants.
Blaise Diagne n'aura pas ménagé sa peine. À coup de « certificats de manger », qui promettaient aux engagés de devenir promptement « plus gros et plus gras », d'être « logés dans de belles maisons européennes en cas d'hospitalisation », de disposer immédiatement d'un uniforme neuf, 73 000 hommes furent recrutés en quatre mois. Il est vrai que l'entreprise de séduction de Diagne s'était adressée en priorité aux notables, les chefs et leurs fils, à qui des promotions étaient rapidement attribuées, tandis que les Légions d'honneur et les médailles ruisselaient sur les poitrines.
Le Journal illustré quotidien du 21 janvier 1916 publie la photo du sous-lieutenant Dinah Salifou , fils du roi des Malous , engagé comme simple soldat, qui a reçu en 1916 la croix de la Légion d'honneur dans la cour de l'Hôtel national des Invalides.
Les soldats indigènes d'Afrique du Nord , quant à eux - Algériens, Marocains et Tunisiens - ont été engagés dès août 1914. Ils ont combattu sur tous les fronts : en France, aux Dardanelles, dans les Balkans, en Palestine. Ces troupes étaient, semble-t-il, particulièrement redoutées par les Allemands qui les avaient surnommées les « Hirondelles de la mort ».
Madagascar et les Comores, la Somalie fournissent un important contingent de soldats, mais aussi de travailleurs employés dans les usines d'armement. Le nombre de Malgaches et Comoriens tués (3 010) et blessés (1 835), de Somaliens (212 tués et 1 035 blessés sur 2 000 engagés) témoigne de l'effort accompli par ces colonies.
L'Indochine aura principalement fourni des travailleurs, les stratèges de l'armée française estimant, en fonction de l'apparence, que les Indochinois auraient été de piètres combattants. Il est certain que ceux qui devaient vivre plus tard Diên Biên Phu ne furent pas de cet avis...
Les îles du Pacifique ont, elles aussi, répondu à l'appel, aussi bien les Kanak que les Polynésiens. Y seront recrutés un peu plus de 2 000 hommes dont un tiers sera tué au combat.
Le reste de l'empire colonial français , les comptoirs des Indes, Saint-Pierre-et-Miquelon et les vieilles colonies se feront remarquer par l'enthousiasme avec lequel elles partent combattre.
En 1917 le Journal de l'Université des Annales publie même un Hymne créole qui lance, sur un air martial :
« Camarades, le clairon sonne,
Il faut qu'il ne manque personne
Voici ton heure, Impôt du sang,
En avant pour le régiment... »
Les troupes créoles, comme on les appelle, seront, elles aussi, sur tous les fronts, aux Dardanelles, dans l'Yonne, à Verdun, dans la Somme.
Elles auront donné presque 25 % de leur population mâle active à la « Mère Patrie ».
Au total, la participation des colonies au conflit n'aura donc pas été négligeable.
On ne peut pas ne pas signaler in fine que quelques figures originaires des colonies ont marqué le conflit :
• L'amiral Lucien Lacaze, réunionnais, ministre de la marine de 1915 à 1917 sous le gouvernement Briand, et qui contribua sensiblement, aux côtés des Alliés de la France, à la lutte contre les sous-marins allemands.
• Le général Charles Lanrezac , guadeloupéen, qui, en 1914, fut le premier à arrêter l'avance allemande à Guise, sauvant ainsi l'armée française de la déroute.
• Les aviateurs Roland Garros, réunionnais, Henri Cadousteau, tahitien, Pierre Rejon, martiniquais qui contribuèrent à la naissance d'une véritable aviation de guerre française.
Il y a également tous ceux, gazés, mutilés, tués dont la mémoire a été perdue, mais qui ont laissé parfois, tout de même, une petite trace :
• Ainsi celle de Gilbert Béville, le frère aîné d'Albert (alias Paul Niger).
• Au cours d'une cérémonie militaire sur le Champ d'Arbaud (Basse-Terre, Guadeloupe), le 22 février 1916, la citation suivante fut lue par le commandant supérieur, le colonel Landouzy, s'adressant à son père, M. Raoul Béville, conseiller général (qui fut également président de cette collectivité) :
« Béville Gilbert, aspirant au 35 e régiment d'artillerie, jeune aspirant plein de calme et de sang-froid, intelligent et dévoué. A contribué, sous un violent bombardement, à dégager son capitaine grièvement blessé le 2 avril 1916. Blessé à son poste de combat le 4 avril. »
Le colonel rappela alors en quelques mots l'enfance studieuse du jeune héros, qui préparait le concours de l'École polytechnique et sa courte mais brillante carrière dans l'armée, depuis le début de la guerre. Il termina par ces mots :
« Par son caractère affable, et doux, par sa vive intelligence et aussi par sa modestie, votre fils s'était acquis l'affection et l'amitié de ses camarades et de ses chefs. C'est, Monsieur, pour vous son Père, et sa malheureuse Mère, une chose terrible que cette mort, mais soyez, l'un et l'autre, très fiers de votre enfant. Il est tombé en héros pour notre France bien aimée. »
M. Béville, qui pleurait, la tête penchée, se redressa et cria au milieu de ses sanglots : « Vive la France quand même ! »
Le colonel, s'approchant, lui remit la Croix de guerre de son fils et lui donna l'accolade.
(Source : Presse de la Guadeloupe)
Signalons que la fin du conflit aura été marquée par quelques couacs à caractère raciste dans l'ouest de la France (Nantes et Saint-Nazaire) dûment dénoncés (quoique tardivement pour ne pas gêner les négociations de Versailles) par les députés des colonies Achille René-Boisneuf (Guadeloupe) et Joseph Lagrosillière (Martinique).
En 1919, la Guadeloupe et la Martinique se firent marraines de deux communes de France : Neuvilly-en-Argonne et Étain. Des souscriptions avaient été organisées qui aidèrent à la reconstruction de ces communes.
L'entre-deux-guerres
Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le premier conflit mondial aura eu des conséquences notables pour l'empire colonial français. Le passage en France de milliers de soldats d'origines diverses aura, en effet, complètement bouleversé le paysage social et politique du pays, surtout de sa capitale.
Il y eut d'abord une large prise de conscience par les Noirs de leur identité. Le panafricanisme renaît et fait florès pendant deux décennies.
Il y avait déjà eu un congrès panafricain à Londres en 1900. Mais c'est en 1919 que se tient à Paris, avec l'aide de Clemenceau, le grand congrès panafricain du siècle, qui rassemble des personnalités africaines, caribéennes, américaines : William Edward Burghardt Du Bois, Blaise Diagne , Marcus Garvey, Candace, etc. Il vise à redéfinir les droits des populations noires dans le monde.
La présence nègre en France s'affirme dans tous les domaines.
Entre 1920 et 1939, plusieurs hommes de couleur seront nommés ministres des gouvernements successifs de la France : Henry Lemery, Alcide Delmont, Gratien Candace, Gaston Monnerville ; d'autres deviennent député en France, comme Élie Bloncourt, ou maire, comme Raphaël Élizé, tandis que Félix Éboué est le premier Noir nommé gouverneur des colonies.
En 1921, André Maran, obtient le prix Goncourt pour le « premier véritable roman nègre », Batouala , dont la préface est un implacable pamphlet contre la colonisation française...
Les journaux et revues, les associations pour la défense et la promotion des nègres se multiplient ( La voix des nègres , Le Cri du nègre , le Comité de défense des nègres , etc.) et revendiquent l'égalité de traitement.
Lamine Senghor, fondateur du Comité de défense de la race nègre , peut écrire en 1927 dans La voix des Nègres :
« Nous savons et nous constatons que, lorsque l'on a besoin de nous, pour nous faire tuer ou pour nous faire travailler, nous sommes des Français ; mais quand il s'agit de nous donner les droits, nous ne sommes plus des Français, nous sommes des Nègres. »
L'élite antillaise et africaine à Paris s'engage : à l'occasion de la III e Internationale communiste à Moscou, en 1924, un jeune Guadeloupéen noir, Joseph Gothon-Lunion est photographié par les Soviétiques, assis sur le trône des Tsars. La photo, publiée par L'Illustration , fait le tour du monde en laissant un parfum de scandale...
L'art nègre connaît une pleine reconnaissance de la part des plus grands artistes de l'époque.
La musique de Jazz et des Caraïbes envahit la capitale avec des vedettes noires comme Joséphine Baker et des orchestres antillais comme celui de Stellio, qui se produisent dans de nombreux cabarets parisiens ( La Boule Blanche , le Bal Blomet , dit aussi Bal nègre , etc.), mais aussi en province.
Au début des années 1930, paraît la Revue du Monde Noir , publiée par un cercle fondé par les soeurs Nardal, (Paulette Nardal, martiniquaise, aurait été la première femme noire à être admise à la Sorbonne) et auquel appartiennent des intellectuels antillais et africains. La Revue définit ainsi ses objectifs :
« Ce que nous voulons faire :
« Donner à l'élite intellectuelle de la Race noire et aux amis des Noirs un organe où publier leurs oeuvres artistiques, littéraires et scientifiques.
« Étudier et faire connaître par la voix de la presse, des livres, des conférences ou des cours, tout ce qui concerne la CIVILISATION NÈGRE et les richesses naturelles de l'Afrique, patrie trois fois sacrée de la race noire.
« Créer entre les Noirs du monde entier, sans distinction de nationalité, un lien intellectuel et moral qui leur permette de se mieux connaître, de s'aimer fraternellement, de défendre plus efficacement leurs intérêts collectifs et d'illustrer leur Race, tel est le triple but que poursuivra LA REVUE DU MONDE NOIR .
« Par ce moyen, la race noire contribuera avec l'élite des autres races et tous ceux qui ont reçu la lumière du vrai, du beau et du bien, au perfectionnement matériel, intellectuel et moral de l'humanité.
« Sa devise est et restera :
« Pour la PAIX, le TRAVAIL et la JUSTICE.
« Par la LIBERTÉ, l `ÉGALITÉ et la FRATERNITÉ.
« Et ainsi, les deux cent millions de membres que compte la race noire, quoique partagés entre diverses Nations, formeront, au-dessus de celles-ci, une grande DÉMOCRATIE, prélude de la Démocratie universelle.
« La Direction, 1931 »
C'est dans ce cercle que naîtra, reprise par Léopold Sedar Senghor et Aimé Césaire, l'idée de la Négritude .
Enfin, dans la décennie, auront lieu de grandes manifestations mettant en lumière les colonies : l'Exposition coloniale internationale de 1931 à Paris, les fêtes du Tricentenaire de l'appartenance des Antilles à la France.
Mais c'est alors que se profile le spectre de la Seconde Guerre mondiale. Dans les vieilles colonies, la presse locale se fait, avec inquiétude, l'écho des thèses racistes exprimées par les nazis, préparant ainsi d'une certaine manière l'opinion à l'explosion prochaine.
Dans le Miroir de la Guadeloupe du 1 er février 1939, le journaliste Arsène Cézaire, en parlant de thuriféraires locaux du nazisme, écrivait par exemple sous le titre Mein Kampf et nous :
« On est en droit de s'étonner, même de se révolter, quand on pense que dans un coin de terre comme la Guadeloupe, perdue, égarée sur le globe, des gens qu'Hitler dénonce comme des impurs parce que non-aryens prétendent faire une différence entre les races... et admirent la politique fasciste ! Tout comme Hitler, ils sont de ces nazis haïssant la France »qui descend de plus en plus au niveau des nègres mettant ainsi sans faire d'éclat l'existence de la race blanche en danger« . »
1939-1945
La Drôle de Guerre et la défaite
Au début de la guerre, on compte assez peu sur les colonies. Sur les 5 345 000 mobilisés, il y à peine 10 % de troupes en provenance d'Afrique du Nord et des colonies. Ce n'est qu'après la Drôle de Guerre et la défaite de 1940 qu'apparaîtra leur intérêt stratégique.
Les coloniaux se seront cependant battus comme des lions, au point qu'ils seront en plusieurs endroits les derniers à résister à l'envahisseur. Dans les Alpes, dans l'Eure, dans l'Oise, des tirailleurs sénégalais, parmi lesquels se trouvent souvent des créoles des vieilles colonies, sont massacrés par les Allemands qui, contrairement aux conventions internationales, exécutent sommairement des officiers, simplement parce qu'ils sont noirs. C'est le cas du capitaine Bébel, Guadeloupéen, mort le 11 juin 1940 à Équinvilliers dans l'Oise, à la tête d'un bataillon de tirailleurs sénégalais.
Après l'armistice, il y eut de nombreux prisonniers de guerre originaires des colonies et d'Afrique du Nord.
Ils furent placés dans des camps spéciaux en zone occupée pour éviter, selon les Allemands, la contagion raciale et les problèmes sanitaires.
Les Frontstalags sont, en effet, des camps ouverts par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, destinés aux soldats prisonniers issus des colonies françaises. On en dénombre, en avril 1941, 22 sur le territoire occupé qui recueillent environ 69 000 « indigènes » : près de 50 000 Nord-Africains, 16 000 Sénégalais, les autres se répartissant selon les engagements (Malgaches, Antillais, Indochinois, etc.). Ces prisonniers coloniaux d'abord gérés par les Allemands, puis par les autorités françaises, ont des conditions de vie déplorables et sont décimés par la maladie, notamment par la tuberculose.
Notons pour l'anecdote qu'au Frontstalag de Poitiers se seront rencontrés Léopold Sedar Senghor (qui faillit être fusillé lors de sa capture, parce qu'il était nègre), le poète guadeloupéen Guy Tirolien et les fils de Félix Eboué. On n'a gardé aujourd'hui pratiquement aucune trace de ces camps, dont la mémoire aurait été complètement perdue sans les méritoires efforts de quelques chercheurs...
La guerre terminée, la fermeture des Frontstalags débouchera sur la lamentable affaire du camp de Thiaroye au Sénégal où furent tués plusieurs dizaines des anciens prisonniers africains qui s'étaient révoltés parce que les autorités militaires françaises avaient refusé de leur payer l'intégralité de leur pécule.
La défaite de l'armée française accomplie, commence alors le règne de l'État français sous l'autorité du maréchal Pétain. La France est sous la botte de l'Allemagne.
On ne peut passer sous silence que certains représentants des colonies contribuent par leur vote à l'instauration de ce régime : Auguste Brunet pour La Réunion, Gratien Candace et Maurice Satineau pour la Guadeloupe, Henri Lemery pour la Martinique, Jean de Beaumont pour la Cochinchine, Eugène Le Moignic pour les Établissements français de l'Inde.
Mais la réaction ne se fait pas attendre.
Le 18 juin, c'est l'appel du général de Gaulle qui, à partir de Londres se proclame chef de la France libre.
C'est aussi le début de la Résistance sur le territoire de la France.
Dans les deux cas, les originaires des colonies ont manifesté leur présence.
La Résistance des coloniaux sur le territoire de la France
On oublie trop souvent de rappeler qu'ils ont, dès 1940, été nombreux à résister à la présence allemande sur le territoire de la France.
On peut citer « à la pelle » : René Jadfard, Raphaël Élizé, Élie Bloncourt, Tony Bloncourt, le capitaine Pierre Rose et bien d'autres.
Certains ont été fusillés, d'autres déportés, dont certains morts en déportation, comme en témoigne la liste non exhaustive ci-dessous :
Déportés originaires de la Martinique
ALPHA Isidore, décédé à Wöbbelin le 27 mars 1945
BIDARD Bernardin, décédé à Dora le 8 mars 1945
BILAN Ambroise, présumé mort à Bergen-Belsen en avril 1945
BOEUF Antoine, décédé à Elsdorf le 13 avril 1945
BOLLIN Joseph, libéré le 29 avril 1945
ÉLIZÉ Raphaël, décédé à Weimar (Buchenwald) le 14 février 1945
FACELINA Henri, évadé lors d'un transport vers Dachau le 10 août 1944
GOUSSARD Yves, décédé courant mars 1945 à Bergen-Belsen
MARTINIS Georges, évadé de Hanovre début mars 1945
MEISTER Georges, décédé à Buchenwald le 30 novembre 1944
NATTES Gentil, décédé à Mannheim le 9 octobre 1943
OZIER-LAFONTAINE Victor, libéré le 5 mai 1945
PARFAIT Édouard, décédé à Mauthausen le 5 novembre 1945
VÉSIR Antoine, libéré en avril 1945
VÉSIR Jacques, libéré en avril 1945
Déportés originaires de la Guadeloupe
ABRIAL Jean, libéré en mai 1945
APASSAMY Lucien, libéré le 29 avril 1945
BOGAT Léon dit Jali, libéré en mai 1945
DÉSIRÉ Norbert, date de libération ou de décès inconnue
ÉPITER André, libéré (date en cours de vérification)
FATHOU André, date de libération ou de décès inconnue
GÉDÉON Victor, libéré le 5 mai 1945
NAUDAR Georges, libéré le 23 avril 1945
ROLLIN Michèle, libérée le 7 mai 1945
SAMSON Cyprien, décédé à Wittlich le 22 novembre 1943 (fusillé)
TRIVAL Michel, date de libération ou de décès inconnue
VALMY André, décédé à Flossenbürg le 24 novembre 1944
Déportés originaires de la Guyane
CARLI Jean-Pierre, libéré le 1 er mai 1945
DÉFENDINI Ange, décédé à Buchenwald le 14 septembre 1944
JARRY Pierre, décédé à Gross-Rosen le 31 octobre 1944
JOSEPH-TANCRÈDE Roger, décédé à Ebensee le 30 mars 1944
Déportés originaires de La Réunion
AMPHOUX Léonce Raoul
LE BALLE René
Déportés originaires de Tahiti
ANDRÉ Constantin Victor Adrien Corentin
MAISTRE Jeanne
Déportés originaires de Nouvelle-Calédonie
CABANETTE Louis Gabriel
La France libre
Lorsque le général de Gaulle lance un appel aux Français le 18 juin 1940 à Londres, il est bien seul au milieu de quelques dizaines de résistants qui se sont ralliés à lui, dont quelques Antillais. Les Anglais lui prêtent leur appui, mais chichement.
Aussi lorsqu'il apprend en juillet le ralliement du Tchad à la France libre, par la voix de Félix Éboué, cet administrateur sorti de l'École coloniale et qui avait été le premier noir à être nommé à un poste de gouverneur des colonies (à la Guadeloupe), il comprend immédiatement que c'est la chance à saisir. De fait Félix Éboué donne à la France libre une assise territoriale qui lui confère le statut d'un État. C'est en effet à partir du Tchad que la France libre va s'implanter d'abord en Afrique équatoriale française où elle inaugurera son premier gouvernement et d'où elle partira à la conquête de toutes les autres colonies restées sous la coupe de Vichy.
C'est le nègre guyanais Félix Éboué qui permettra à la France libre de disposer non seulement d'une base territoriale, mais aussi d'un budget fondé sur l'exploitation des richesses africaines, or, caoutchouc, minerais divers etc., budget qui se concrétise au travers de la Caisse centrale de la France libre , créée le 2 décembre 1941 (et considérée alors comme la « banque d'émission de la France libre où que ce fût dans le monde »). Elle est chargée de l'émission monétaire, du Trésor public et du contrôle des changes du gouvernement du général de Gaulle en exil à Londres et des territoires ultra-marins ralliés au Comité français de Libération nationale (CFLN).
La plupart des originaires des vieilles colonies résidant en Afrique, administrateurs et militaires, et Dieu sait s'ils étaient nombreux, se rallièrent alors à la France libre.
Progressivement, la plupart des colonies s'y rallièrent également. Du Pacifique à l'océan Indien, des Caraïbes au Sénégal. Toutes vinrent apporter leur contribution non seulement au budget de la France libre, mais aussi au renfort de ses troupes, lesquelles n'étaient constituées au départ que de noirs africains, n'en déplaise à la légende.
L'historien Éric Jennings intitule fort justement un de ses ouvrages : La France libre fut africaine .
La prise en main de l'Afrique noire aura, par ailleurs, opportunément permis au général de Gaulle de devenir encore plus indépendant financièrement des alliés de la France en récupérant les 736 tonnes d'or de la Banque de France cachés à Kayes au Haut-Sénégal (actuellement Mali) et aussi 250 tonnes à Fort-de-France, outre la garantie Or du trésor des vieilles colonies...
Le ralliement des vieilles colonies
Ce n'est qu'en 1943 que les vieilles colonies des Caraïbes se rallièrent officiellement à la France libre. Jusqu'au mois de juillet de cette année-là, elles étaient en effet sous la coupe du régime de Vichy, représenté par le fameux amiral Robert nommé dès la fin de 1939, d'abord commandant en chef de l'Atlantique Ouest puis haut-commissaire de France aux Antilles, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Guyane.
L'amiral Robert exerce de 1940 à 1943 une véritable dictature sur les territoires qu'il dirige, avec l'aide de ses séides, le contre-amiral Rouyer et les gouverneurs des territoires réduits à l'obéissance et à l'impuissance. Il dispose de plusieurs bâtiments, des croiseurs Émile Bertin et Jeanne d'Arc , du porte-avions Béarn , des croiseurs auxiliaires Barfleur et Quercy , du pétrolier Var , de l'aviso Ville-d'Ys , et d'une importante garnison de marins à la Martinique qui bénéficie de toutes ses faveurs.
À ses côtés, le contre-amiral Charles Chomereau-Lamotte, issu d'une famille originaire de la Guadeloupe et de la Martinique, essaye bien de convaincre l'amiral Robert de choisir le camp de la France libre, mais il meurt brutalement en juillet 1940. Le contre-amiral Rouyer, ardent partisan de la Révolution nationale, aurait déclaré au moment de sa mort : « Il aura bu un mauvais café ! »
En Guadeloupe, comme en Martinique et en Guyane, dès la fin de 1940, la population commence à se montrer réticente à l'égard du pouvoir en place. L'application stricte des mesures prises par Vichy à l'encontre des juifs et des francs-maçons n'arrange rien, outre les limitations aux libertés publiques et les restrictions qui frappent les populations les plus pauvres. Déjà quelques hommes s'enfuient pour rejoindre la France libre.
Une anecdote souligne bien l'ambiguïté dans laquelle vivaient les habitants de la Guadeloupe et de la Martinique.
Des agriculteurs des deux îles savaient fort bien que la marine de l'amiral Robert approvisionnait en vivres frais les hordes de sous-marins allemands naviguant dans la zone, en leur fournissant notamment des ignames.
Les contacts entre la marine stationnée en Guadeloupe et en Martinique et les sous-marins allemands furent confirmés lorsque l'amiral Robert fit accueillir par ses hommes dans la rade de Fort-de-France un officier allemand qui avait été blessé lors de l'attaque d'un dépôt de pétrole à Aruba. Cet officier, Dietrich Alfred von dem Borne , qui fut amputé d'une jambe à l'hôpital de Fort-de-France, passa le reste de la guerre en Martinique, où il se fit des amis et revint après la guerre.
L'épisode est d'autant plus intéressant qu'aussi bien le président des États-Unis d'Amérique, Roosevelt, que Churchill, n'ont jamais cessé de considérer que la Martinique était un paradis pour les sous-marins allemands U-Boats.
La dissidence
À partir de 1942, le mouvement de ceux qu'on appellera les Dissidents , devient de plus en plus perceptible. Beaucoup d'hommes et de femmes, appartenant à toutes les classes sociales, s'enfuient vers les îles anglaises voisines, sur de frêles esquifs pour rejoindre la France libre, malgré les dangers de la mer et la surveillance dont font l'objet les côtes par les navires de l'amiral Robert. On compte à peu près cinq mille évadés, dont moins de deux mille rejoindront effectivement les Forces Françaises Libres.
Par la Dominique, Sainte-Lucie, Trinidad, ils rejoignent les États-Unis à Fort Disk (New Jersey) où ils subissent une formation militaire avant de traverser l'Atlantique sur des Liberty Ships jusqu'en Afrique du Nord. Certains iront directement à Londres...
L'anecdote la plus connue sans doute est celle du fils du gouverneur de la Martinique, Joël Nicol, qui choisit de partir en dissidence avec de jeunes créoles martiniquais, camarades de lycée, Louis Lucy de Fossarieu et Roger Ganteaume. Après avoir emprunté la baleinière à voile dont disposait son père dans l'exercice de ses fonctions, il partit en dissidence et rejoignit Sainte-Lucie au nez et à la barbe des autorités de surveillance des côtes.
On en parle peu, mais le parcours de ceux qui constituèrent le Bataillon de Marche Antillais n° 1 (BMA), devenu plus tard le 21 e Groupe Antillais de DCA , fut plus que remarquable.
Partis volontairement des Caraïbes, ils passent par les États-Unis, rejoignent le Maroc, traversent l'Afrique du Nord, sont intégrés à la Première Division Française Libre (1 re DFL) avant de participer à la campagne d'Italie (certains s'illustrèrent au Monte Cassino), au débarquement de Provence, à la campagne de France, à la bataille des Vosges, et de se retrouver au combat à Herbsheim et à Benfeld lors de la libération de Strasbourg, au prix de nombreux camarades tués ou blessés.
En 1943, les vieilles colonies se rallient à la France libre.
Plusieurs initiatives locales sont à l'origine du départ des représentants du régime de Vichy.
En Guadeloupe et en Guyane, des groupements de résistants s'étaient constitués et avaient essayé à plusieurs reprises de prendre des initiatives de nature à déstabiliser le pouvoir en place, mais sans succès. Les têtes de ces mouvements, comme Paul Valentino en Guadeloupe, avaient été déportées ou bien aux îles du Salut (Guyane) comme ce dernier, ou bien emprisonnées au fort Napoléon aux Saintes (Guadeloupe).
C'est en Martinique que sont menées les actions décisives, grâce aux initiatives de militaires de l'infanterie casernés au camp de Balata, notamment le commandant Tourtet, et d'un comité civil de libération de la Martinique.
L'amiral Robert est contraint de laisser la place à l'envoyé du général de Gaulle, Henri Hoppenot, qui désigne de nouveaux gouverneurs.
Dès lors, le recrutement de soldats peut recommencer et est formé le Bataillon de Marche Antillais n° 5 (BMA 5).
C'est ce bataillon qui participe en 1945, en même temps que plusieurs bataillons de tirailleurs sénégalais, sous le commandement du général de Larminat, à la libération de la poche de Royan. Il y laisse quelques morts, dont le commandant Tourtet, qui reposent dans la nécropole nationale de Rétaud (Charente-Maritime).
Au total, les colonies auront marqué l'histoire de la Seconde Guerre mondiale par quelques noms, outre ceux déjà cités. On notera celui de Jean L'Herminier, guadeloupéen d'origine, né à Fort-de-France, qui réussit en 1942 à soustraire le sous-marin Casabianca au sabordage de la flotte à Toulon.
Il faut retenir également celui plus modeste de Guy Cornély qui débarqua en Normandie. Guy Cornély, avec cinquante autres soldats français, faisait partie de l'équipage du Courbet , un grand et vieux bâtiment de la marine française.
La mission de ces hommes était de saborder leur outil de navigation pour servir de barrage et alimenter l'offensive contre les Allemands. En touchant terre, Guy Cornély se serait écrié : « Schoelcher nous sommes quittes ! ».
Et puis le nom de Philippe Kieffer, haïtien, chef du commando qui porte son nom et qui fut la seule unité française constituée à avoir débarqué en Normandie.
Conclusion
Les deux conflits mondiaux que l'on distingue souvent d'une manière un peu abrupte, car le second est l'évident prolongement du premier, auront profondément changé le devenir de l'empire colonial français.
La France, qui avait organisé en 1944 la conférence de Brazzaville pour envisager enfin quelques changements dans la manière de traiter ses colonies, ne réussit pas à prendre la mesure du problème posé par l'épouvantable choc des deux guerres.
Elle fut dès la fin de la guerre 1939-1945 confrontée à la nécessité de réorganiser l'Empire. Les vieilles colonies furent transformées en d'improbables départements d'outre-mer, le reste des colonies en une Union française qui ne put résister aux tensions nées des conflits indochinois et algériens, puis en une Communauté , fédération entre la France et certaines de ses anciennes possessions, qui n'eut qu'une existence éphémère.
On retiendra in fine que l'indépendance de la plupart des colonies aura entraîné la « cristallisation » des pensions d'invalidité et d'anciens combattants des originaires des anciennes colonies pendant plusieurs décennies, juste le temps d'en laisser mourir le plus grand nombre. On est bien loin de la volonté première des coloniaux de se sacrifier en payant l'impôt du sang afin d'être enfin citoyens à part entière.
3.5. M. GRÉGOIRE GEORGES-PICOT, HISTORIEN ET CINÉASTE DES ANTILLAIS, FRANÇAIS LIBRES
Le ralliement des pêcheurs de l'île de Sein à la France libre en juin 1940 est un épisode illustre de l'épopée gaulliste. Il en est un autre, moins célèbre, dont les protagonistes furent, pareillement, des îliens et des marins : des hommes jeunes, beaucoup de jeunes femmes aussi, s'évadèrent de Martinique ou de Guadeloupe pour s'enrôler dans les armées de la France libre.
Comment et pourquoi furent-ils ainsi des milliers ? Quelles étaient les sources de ce patriotisme si fervent qu'il surmonta tous les obstacles, la répression d'un régime autoritaire dans les îles, comme la défiance de militaires de la France combattante ? Dans mes recherches en réponse à ces questions, deux personnes auront été des guides : l'historien Éric Jennings en inscrivant la Résistance aux Antilles dans une histoire plus vaste, celle de leur colonisation et de leur émancipation ; Frantz Fanon, parce qu'il fut témoin et acteur de cette histoire. 21 ( * )
Dissidence et dissidenciés
« La dissidence est née en juin 1940 du sursaut des Français d'outre-mer qui les poussait à poursuivre la lutte » déclarait le maréchal Pétain, au cours d'un discours retransmis à la radio, le 7 avril 1941 22 ( * ) . Dans son sens originel, le dissident est celui qui se met à l'écart de la communauté. En désignant ainsi les Français libres, le chef de l'État français voulait signifier qu'au-delà de leur erreur première, ils s'étaient mis au ban de la Nation. Les résistants antillais adoptèrent le mot et se nommèrent dissidenciés .
Paradoxalement, les paroles du maréchal Pétain s'appliquent à la naissance de la Résistance dans les Antilles. Une dizaine de jours après l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940, les représentants élus de Guadeloupe et de Martinique, réunis au sein des conseils généraux, avaient, quasi unanimes, appelé au ralliement à la France combattante.
Mais le premier représentant de la République aux Antilles, l'amiral Georges Robert, également commandant du théâtre d'opérations de l'Atlantique ouest, avait fait allégeance au gouvernement de Vichy. Il avait, pour lui, les navires de la marine nationale, repliés aux Antilles, qui tenaient les principales villes sous le feu de leurs canons. Plus de 5 000 marins, la plupart métropolitains, constituaient une force de dissuasion dont l'amiral usa pour briser les oppositions.
La Résistance se révéla d'emblée dans de petits gestes du quotidien. Frantz Fanon, alors adolescent à Fort-de-France, se souvenait de ces actes apparemment anodins, portés par une autre idée de la France : « On vit cette chose extraordinaire : des Antillais refusant de se découvrir pendant l'exécution de la Marseillaise. Quel Antillais ne se rappelle ces jeudis soirs où, sur l'esplanade de la Savane, des patrouilles de marins armés réclamaient le silence et le garde-à-vous quand on jouait l'hymne national ? Que s'était-il donc passé ? Par un processus qui est facile à comprendre, les Antillais avaient assimilé la France des marins à la mauvaise France et la Marseillaise que respectaient ces hommes n'était pas la leur. Il ne faut pas oublier que ces militaires étaient racistes. Or « il ne fait de doute pour personne que le véritable Français n'est pas raciste, c'est-à-dire ne considère pas l'Antillais comme un nègre ». Puisqu'eux le faisaient, c'est qu'ils n'étaient pas de véritables Français. Qui sait, peut-être des Allemands ? Et de fait, systématiquement, le marin fut considéré comme un Allemand. » 23 ( * )
Cette réflexion lève le voile sur la nature du patriotisme des dissidenciés pour qui la véritable France était celle de la République et de l'Égalité. En faisant le choix de la France libre, ils témoignaient de leur attachement à la patrie et, en même temps, affirmaient qu'ils étaient Français à part entière. Ainsi, la Résistance aux Antilles s'inscrivait-elle dans le long processus politique de l'assimilation qui, à partir de l'abolition de l'esclavage en 1848, allait faire des Antillais, sujets d'un Empire colonial, des citoyens français ayant les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres Français.
Parmi les devoirs, il y avait celui de se porter au secours de la France lorsque celle-ci était en danger. Lors de la Première Guerre mondiale, les représentants politiques de Martinique et Guadeloupe avaient obtenu que les Antillais soient mobilisés au même titre que les Français en métropole. Cette fois, la libération de la « Mère Patrie » passait par des actes volontaires et l'exil, tant que Vichy régnait sur les Antilles françaises.
Ils furent nombreux à s'évader vers les Antilles anglaises avec l'intention de rejoindre les armées de la France libre. Mais bien d'autres motivations pouvaient déterminer les départs. Moins nobles ou plus pragmatiques, ces mobiles ont bien souvent été minimisés parce que les autorités vichystes s'en servirent justement pour dénigrer la dissidence : « Je n'ignore pas qu'un certain nombre de jeunes Guadeloupéens ont quitté la Guadeloupe pour une île voisine. Les raisons qui les ont amenés à s'enfuir ne sont pas toujours des plus honorables et très rares sont ceux qui ont agi par patriotisme, croyant servir la France et leur petite patrie. » déclarait le gouverneur Sorin dans une circulaire à l'attention des maires de l'île en mai 1942 24 ( * ) .
Au nombre de ces raisons, il y avait le blocus des îles, une arme utilisée par les Américains dans leurs négociations avec les autorités de Vichy, et ses conséquences : pénuries et rationnements, chômage, disettes et marché noir ont eu, si on permet la comparaison, un rôle semblable à celui joué en France par le Service du travail obligatoire dans la montée au maquis de jeunes qui voulaient y échapper.
En lisant les témoignages d'anciens dissidenciés, on se rend compte que raisons nobles et prosaïques se sont bien souvent conjuguées pour décider du départ. L'un d'entre eux, arrivé à Sainte-Lucie en juillet 1941, déclarait au chef de la police qui l'interrogeait que les pénuries l'avaient incité à partir et qu'il se mettait au service du général de Gaulle 25 ( * ) . Un autre, alors jeune maçon, se souvient : « Les jeunes, nous étions un peu dégoûtés de rester comme ça... en 1943, on trouvait pas de travail, c'était difficile, on ne pouvait pas manger... » 26 ( * ) .
La dissidence était aussi l'héritière d'autres résistances, plus anciennes. Jean-Charles Timoléon, ouvrier agricole dans une plantation, expliquait ainsi les raisons de son évasion vers les îles anglaises : « Des bruits couraient sur l'arrivée en cachette de bonnets rouges appelés «chéchia» que portent les Sénégalais et les Arabes. De même qu'on disait que les usiniers faisaient planter du karaté pour fabriquer des fouets pour les nègres. À la fin de la guerre, on rétablirait l'esclavage. Avec des amis, je discutais souvent de ce problème. Certains disaient que jamais on ne pourrait rétablir l'esclavage en Guadeloupe, d'autres se basant sur l'idéologie raciste des nazis rétorquaient qu'en cas de victoire d'Hitler, c'était tout à fait possible. Un jour, revenant du travail sur l'habitation «Vounon», nous avons vu deux gendarmes parlant au géreur devant la case de ce dernier. Quelques instants plus tard, le géreur nous rassemble tous, hommes et femmes. Les gendarmes relevèrent nos noms, prénoms, âges et adresse. Ils nous demandèrent de signer un registre et nous donnèrent chacun un livret de travail. Au moment de signer, j'avais demandé aux gendarmes les raisons de cette formalité et ils m'avaient répondu que nous ne pourrions quitter l'habitation qu'après en avoir prévenu la gendarmerie. Cet événement confirma mes craintes et, arrivé dans la case que nous occupions, je déclarais à nos compagnons que durant l'esclavage, c'était pareil ; les esclaves n'avaient pas le droit de quitter l'habitation sur laquelle ils travaillaient. Tout le monde se plongea dans de profondes réflexions sur la signification de cette signature donnée. Le lendemain, à l'heure du départ pour les champs de cannes, Ambroise, un camarade de Pointe-à-Pitre et moi, nous nous déclarâmes malades. » 27 ( * )
Le dissidencié, s'évadant vers une île anglaise, adoptait la même stratégie de survie que l'esclave marron s'échappant de la plantation pendant la période coloniale. Un soldat guadeloupéen des Forces françaises libres résumait sa décision de rejoindre de Gaulle avec ces mots : « Schoelcher a libéré la Guadeloupe, je suis venu libérer la France. » 28 ( * )
Évadés par milliers
Un de ces évadés a décrit dans son journal sa traversée vers Sainte-Lucie : « Quel était le meilleur moyen de quitter notre île de la Martinique pour rallier les possessions anglaises de la Dominique ou Sainte-Lucie ? Un seul était à notre disposition : le gommier, pirogue très légère et instable construite par les pêcheurs dans le tronc de l'arbre du même nom.
« Avec deux camarades, je demandais une permission de 24 heures, et après entente avec deux pêcheurs contre une somme d'argent et des vêtements, nous nous sommes donnés rendez-vous à la tombée de la nuit au bout de l'immense plage du Diamant, munis de quelques photos de famille et du strict indispensable comme vêtements.
« Les îles anglaises sont distantes de soixante à cent kilomètres, mais des courants assez violents circulent entre l'Atlantique et la mer Caraïbe ; de plus, en période d'équinoxe comme c'est le cas, la mer est souvent mauvaise et notre embarcation surchargée est difficile à diriger avec une seule voile carrée ; l'équipage comprend un pêcheur au gouvernail et l'autre assis sur un bordé pour faire contrepoids avec un camarade ; les deux autres passagers sont au fond du gommier et vident l'eau sans arrêt avec des calebasses ; des poissons volants viennent s'abattre sur la voile et tombent dans l'embarcation, seule distraction au cours de ces heures assez angoissantes car, à plusieurs reprises, nous sommes surpris par une lame plus forte qui oblige l'homme de barre à nous aider à écoper afin de ne pas couler ; au lever du jour, nous apercevons enfin une masse grise à tribord : c'est l'île de Sainte-Lucie. » 29 ( * )
Les Petites Antilles
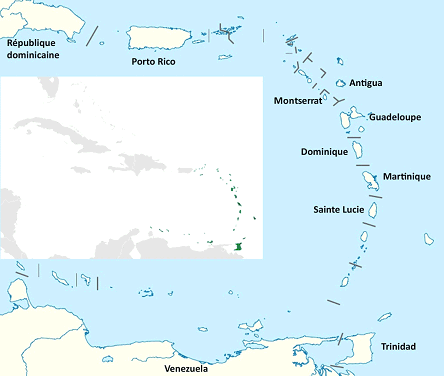
La première évasion recensée daterait du 15 septembre 1940. Elle fut rapidement suivie d'autres car « dès le début de 1941, le quartier général des Forces françaises libres, à Londres, fut informé qu'une effervescence se manifestait à la Martinique et à la Guadeloupe. Des volontaires s'étaient évadés de ces îles. » 30 ( * ) Ainsi commence le témoignage de Jean Massip qui fut le délégué de la France combattante aux Antilles pendant trois ans. Avant son arrivée, un ancien capitaine de la marine marchande, Pierre Adigard des Gautries, avait organisé à partir de Trinidad une filière conduisant les volontaires vers l'Angleterre ou le Canada.
« Nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Nous savons que le salut du monde dépend de nous aussi. Que la terre a besoin de n'importe lesquels d'entre ses fils. Les plus humbles. L'Ombre gagne Ah! Tout l'espoir n'est pas de trop pour regarder le siècle en face! » 31 ( * ) Lorsqu'Aimé Césaire écrivit ces lignes en avril 1941, savait-il que des Antillais avaient déjà franchi le pas ? Ses mots étaient, en tout cas, prémonitoires d'un phénomène qui allait ébranler le pouvoir de Vichy aux Antilles. Car ce n'était plus désormais l'aventure de quelques téméraires.
En juillet 1941, lorsque Jean Massip arriva aux Antilles, les exilés étaient une petite centaine à la Dominique. D'autres avaient gagné les îles de Monserrat, d'Antigua ou de Sainte-Lucie. À la fin de l'année 1942, ils étaient plus de 1 800 à la Dominique. Dans une ville comme Roseau, la capitale, avec ses 5 000 habitants, leur présence, sans cesse grandissante, n'était pas sans poser de difficiles problèmes de ravitaillement, d'hébergement... et d'ordre public. Pour tenter d'y remédier, Jean Massip avait rassemblé les évadés en compagnies. Afin de les occuper, il avait, avec l'aide des rares officiers présents, organisé une instruction militaire minimale.
La solution vint des États-Unis. Alertés par des représentants de la France combattante, les Américains acceptèrent de prendre en charge l'instruction militaire des volontaires aux États-Unis. Ils envoyèrent un bateau à la Dominique au début de l'automne 1942. Un contingent de 325 personnes quittait Roseau le 10 octobre à destination de Baltimore et de la Nouvelle Orléans. Ce premier convoi fut suivi de cinq autres voyages entre janvier et juin 1943.
Des dissidenciés en partance pour les
États-Unis, San Juan de Porto Rico,
2 mai 1943
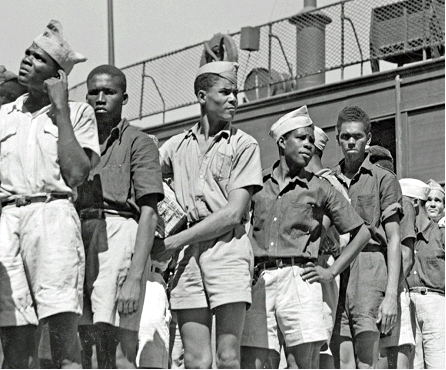
Source : US Navy
Qui étaient ces dissidenciés ? Un discours unanimiste affirme que toutes les classes sociales étaient présentes, touttemoun était là. Il est aussi vrai que certaines d'entre elles étaient beaucoup plus représentées que d'autres comme le révèlent les rares listes d'engagés existantes.
Il existe dans les archives de la police de Sainte-Lucie une liste de 447 volontaires ayant passé une visite médicale d'aptitude. Leur métier est indiqué : en tête, viennent les activités liées à la mer. Pêcheurs, marins, dockers, charpentiers navals... étaient largement majoritaires. Deux autres métiers étaient couramment cités : cultivateurs et ouvriers de sucrerie. Ces trois catégories représentaient ensemble la plupart des volontaires. 32 ( * ) Un recensement réalisé par le centre du service national de Martinique sur 521 engagés indique, pour sa part, une majorité d'ouvriers agricoles. La moyenne d'âge y était de 24 ans et demi.
Ces quelques informations tirées des deux « sondages » sont confirmées par le directeur des troupes coloniales, le colonel Valluy, inspectant le bataillon de marche des Antilles n° 1 en octobre 1943 : il constatait que la grande majorité des engagés était des cultivateurs et des pêcheurs, qu'il y avait quelques commerçants et des petits fonctionnaires, très peu d'ouvriers qualifiés. 33 ( * )
L'automne 1942 constitua un véritable tournant pour la dissidence. La nouvelle du premier transfert des engagés vers les États-Unis en octobre 1942 se répandit dans les îles et dut en convaincre plus d'un de franchir l'océan pour rejoindre la France libre. Novembre 1942 fut aussi le moment où les Américains, voulant faire pression sur les autorités françaises, cessèrent de ravitailler les îles : la pénurie généralisée et la crainte de la disette, la disparition de nombreux emplois en raison du blocus furent autant d'incitations aux départs.
Au sortir de l'hiver, saison où la mer est mauvaise et rend dangereuses les traversées des canaux de Sainte-Lucie et de la Dominique, les évasions reprirent et suivirent une spectaculaire courbe ascendante. Les départs saignaient les deux îles de leurs jeunes générations. Ce furent aussi des familles entières, des femmes seules avec leurs enfants qui prirent le chemin de l'exil. Les moyens de s'enfuir étaient les plus variés : embarcations traditionnelles telles que gommiers, saintoises et yoles, remorqueurs à moteur tirant des chalands, vedettes de la marine ou encore hydravions ! Quand des candidats au départ ne trouvaient pas de passeur, certains n'hésitaient pas à voler des canots ; sur les plus gros, on s'entassait à vingt.
Cet exode d'une génération de jeunes gens ébranla par contrecoup l'économie des deux îles. En avril 1943, le directeur d'une sucrerie à Sainte-Rose en Guadeloupe avertissait le gouverneur : « J'ai l'honneur de vous faire savoir qu'à cause des nombreux départs journaliers de dissidents et malgré le concours de prisonniers, la récolte ne pourra être enlevée. » 34 ( * )
Pourtant, dès l'été 1941, les autorités s'étaient inquiétées de ces évasions et avaient tenté de stopper l'hémorragie humaine qui anémiait les îles. Dans la circulaire destinée aux maires de la Guadeloupe citée plus haut, le gouverneur Constant Sorin brandissait cette menace : « Il est bon que la population soit renseignée et sache, d'ores et déjà, que ceux qui sont partis ne reviendront plus en Guadeloupe. La cause est entendue pour eux. Ils ont émigré définitivement. Ils comprendront vite... Car la patrie comprend le village natal, le cimetière où dorment ceux que l'on a chéris de leur vivant, les parents, les amis. » 35 ( * )
Au-delà de cette menace de bannissement définitif, ce fut, sur terre, la chasse à l'homme dans laquelle les différentes forces de répression étaient mises à contribution, comme le relate dans son journal un marin de l' Émile Bertin : « On nous envoie souvent à terre pour seconder les gendarmes dans leurs missions d'investigation. Certains que les Noirs appellent la Milice, sont spécialement chargés de fouiller les criques et les anses reculées afin de tenter d'y débusquer ces jeunes gens qui cherchent à gagner les Forces françaises libres en traversant, au péril de leur vie, le canal de la Dominique, moins surveillé, et, plus rarement, celui de Sainte-Lucie. Il paraît que ces partisans de de Gaulle s'y cachent des jours entiers dans l'attente d'une embellie car, bien que nous soyons en mai, la mer est souvent démontée. Des barques de pêcheurs les transportent nuitamment dans les îles voisines de la Martinique. » 36 ( * )
Les personnes arrêtées étaient déférées devant les tribunaux militaires ou civils. La justice était particulièrement sévère : les militaires, considérés comme déserteurs, pouvaient être condamnés à mort même si les peines capitales ne furent pas exécutées. Les complicités de désertion étaient lourdement punies : cinq ans pour avoir caché un candidat au départ ; dix ans pour un pêcheur qui avait transporté des dissidenciés. 37 ( * ) Délation, menaces, intimidations des pêcheurs qui se faisaient passeurs, arrestations, condamnations, patrouilles navales et reconnaissances aériennes, rien n'y fit. Le chiffre des évasions alla croissant jusqu'à la libération des Antilles en juillet 1943.
Combien furent-ils au final à s'évader de Martinique et de Guadeloupe ? Jean Massip, le délégué de la France combattante aux Antilles, et le général Jacomy, le commandant supérieur des troupes du groupe Antilles-Guyane, nommé par Alger en juin 1943, évoquaient tous deux le nombre de 4 000. Il semble qu'ils aient été plus nombreux. « Au moment de la libération de la Martinique et de la Guadeloupe, il y a à la Dominique près de 3 000 volontaires à rapatrier », écrit Jean Massip 38 ( * ) . Quant aux évadés vers Sainte-Lucie, ils n'auraient pas dépassé le millier, la plupart ayant gagné l'île entre février et l'été 1943 39 ( * ) . Aux États-Unis, en juillet 1943, ils étaient 1 433 Antillais à Fort Dix, un camp militaire dans le New Jersey où les volontaires avaient été rassemblés 40 ( * ) .
En ne s'en tenant qu'à ces trois chiffres, ils furent donc plus de 5 000 hommes et femmes à s'être évadés 41 ( * ) . Parmi eux, il y eut plusieurs centaines de soldats et de marins. En définitive, les dissidenciés martiniquais et guadeloupéens furent probablement entre 4 500 et 5 000. Mais un dissidencié ne devenait pas nécessairement un soldat de la France.
Les Antillais et la libération de la France
« On ne peut espérer des Antilles plus de quelques centaines d'hommes de troupe des jeunes classes, soigneusement choisis et quelques dizaines de sous-officiers. [...] Les 2 000 créoles des Antilles ayant fui à la Dominique sont notamment inaptes au service militaire » 42 ( * ) pronostiquait, en juin 1943, le général Blaizot, l'un des théoriciens des troupes coloniales à l'état-major général à Alger. Qu'advint-il réellement ?
Sur les 3 000 rapatriés de Sainte-Lucie et de la Dominique qui souhaitaient s'engager, seule la moitié fut retenue « après un tri sévère qui n'a pas été sans soulever de nombreuses récriminations » 43 ( * ) . L'une des principales raisons en était la santé des volontaires. Ainsi, plus de la moitié des candidats qui s'étaient présentés aux visites médicales d'aptitude à Sainte-Lucie furent déclarés inaptes ; l'indication des affections dont certains étaient atteints révélait un état de santé très médiocre. 44 ( * )
Il en fut autrement avec les volontaires qui avaient gagné les États-Unis car ils étaient passés devant des médecins américains avant leur départ. Le général Jacomy préconisa néanmoins une sélection serrée avec une élimination d'un tiers : un certain nombre des engagés avaient eu quelques difficultés à s'adapter à la discipline militaire quand d'autres avaient bien l'intention de faire leur vie en Amérique.
Au camp de Fort Dix, août 1943

Source : US Signal Corp
Ce qui allait devenir le bataillon de marche des Antilles n° 1 comptait, au début de l'été 1943, 1 608 officiers, sous-officiers et soldats rassemblés au camp militaire de Fort Dix. Ils n'étaient plus que 1 074 lorsque le bataillon arriva, en octobre 1943, en Afrique du Nord où il allait poursuivre son instruction à El Hadjeb dans le Moyen-Atlas marocain, puis en Tunisie.
Le périple d'un volontaire du bataillon de
marche des Antilles n° 1
(été 1942-novembre
1945)
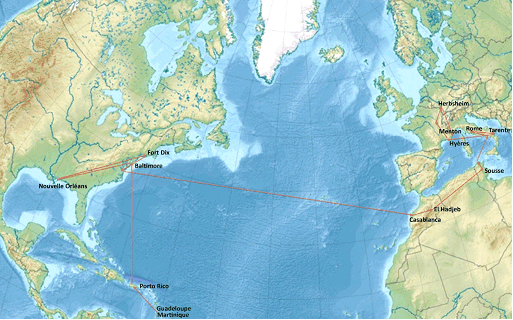
En janvier 1944, le bataillon était intégré à la 1 re division française libre, devenant le 21 e groupe antillais de défense contre avion. Celui-ci fut désormais de toutes les campagnes de la division gaulliste, en Italie, lors de l'offensive au nord de Rome après Monte Cassino, en Provence, dans les Vosges et en Alsace. Il s'était mué au fur et à mesure en unité anti-char dotée de sections d'infanterie et fut engagé, notamment, dans la défense de Strasbourg dans l'hiver 1944. Il termina la guerre sur le front des Alpes.
Pendant ce temps, le bataillon de marche n° 5 avait été constitué à Fort-de-France avec les volontaires rapatriés de la Dominique et de Sainte-Lucie. Il traversait l'Atlantique en mars 1944, complétait son instruction en Afrique du Nord avant d'être envoyé sur le front de l'Atlantique en janvier 1945 jusqu'à l'offensive finale contre la poche de Royan en avril 1945.
Les deux bataillons de marche ne furent pas les seules unités à combattre en Europe. Deux détachements de renfort, de 500 soldats chaque fois, avaient traversé l'océan au cours de l'année 1944. Tous volontaires, les tirailleurs, artilleurs et ouvriers spécialisés qui composaient ces renforts furent affectés dans des unités très diverses.
À côté de ses engagements collectifs, il y eut des aventures individuelles. Voici avec Frantz Marguerite Victor Fanon une illustration de la diversité des trajectoires, qui étaient faites souvent d'affectations successives. Son frère Joby a raconté comment il prit la mer le jour du mariage de son frère aîné après avoir vendu des costumes de son père pour payer la traversée vers l'île de la Dominique. Le 3 août 1943, il s'engageait officiellement pour la durée de la guerre ; il venait de fêter ses 18 ans. Incorporé dans le bataillon de marche des Antilles n° 5, il traversa avec lui l'Atlantique en mars 1944. À Casablanca, il fut réaffecté au 15 e régiment de tirailleurs sénégalais puis débarqué à Saint-Tropez le 31 août 1944, Frantz Fanon fut transféré au 6 e régiment de tirailleurs sénégalais, décimé après les durs combats pour la libération de Toulon.
Ce régiment, devenu le 6 e régiment d'infanterie coloniale, fut l'une des unités engagées dans l'offensive en direction du Rhin qui commença le 15 novembre 1944 dans la neige et le brouillard. Le régiment, en pointe aux environs de Belfort, subit les contre-offensives allemandes. Servant de mortier, Frantz Fanon fut blessé ce jour-là. Cité à l'ordre de la brigade, il fut décoré de la croix de guerre par le colonel Raoul Salan qui commandait le régiment. Au bout de trois mois de convalescence, Frantz Fanon était de retour sur le front d'Alsace. Il demeura au sein de la 1 re armée française jusqu'à la capitulation nazie. 45 ( * )
Une décision politique
Comment expliquer une telle différence entre les pronostics du général Blaizot en juin 1943 et la réalité de l'engagement des Antillais dans la libération de la France, un an et demi plus tard ? Car ce furent, en définitive, pas moins de 3 000 Antillais qui traversèrent l'Atlantique. La première raison tenait au patriotisme fervent qui animait bien des Martiniquais et des Guadeloupéens, à leur engagement qui était en même temps revendication identitaire.
L'écart entre les estimations du général Blaizot et les engagements effectifs découle également des profondes divergences au sein des hautes sphères militaires, de profondes divergences sur l'emploi des dissidenciés. Pour les uns, en particulier à la direction des troupes coloniales, les Antilles étaient perçues comme une partie de l'Empire. La mobilisation des volontaires antillais ne pouvait se concevoir que dans des unités de type colonial, en « panachage » avec les tirailleurs sénégalais. Elle obéissait aussi aux principes traditionnels d'efficacité militaire. Le colonel Valluy, directeur des troupes coloniales, inspecta le bataillon de marche des Antilles n° 1 fin octobre 1943 au Maroc et en conclut que l'unité n'était pas prête à partir au front : elle n'était même pas équipée d'un armement moderne...
Pour les autres, des impératifs politiques l'emportaient sur les considérations militaires. L'un d'entre eux, le général Jacomy, ouvrait son « mémorandum sur la participation effective des Antilles à la guerre » avec cette phrase : « Ce qui est en jeu, c'est le maintien de la souveraineté de la France aux Antilles, terre française, habitée par des citoyens français. » Les menaces étaient aussi bien extérieures, avec les convoitises des Américains, qu'intérieures. Et de conclure : « L'armée de terre aux Antilles compte dans ses rangs, en qualité d'engagés volontaires, la future élite du pays que l'on ne peut décevoir ni risquer de détacher de la France. » Ne pas admettre les Antillais serait un « déni à leur qualité de citoyen français ». 46 ( * )
Ce fut ce point de vue qui l'emporta. La direction des troupes coloniales finit par concéder que « les visées politiques des États-Unis et de certaines républiques sud-américaines sur les Antilles d'une part, des considérations d'ordre psychologique et moral à l'égard de nos vieilles colonies d'Amérique d'autre part, exigeront, en effet, que celles-ci soient représentées par leurs volontaires, à la Libération de la Patrie. » 47 ( * )
La décision était politique et les officiers généraux eurent à la concrétiser sur le terrain militaire. Le comité français de libération nationale décréta le 17 novembre 1943 que le bataillon de marche des Antilles n° 1 serait rattaché à la 1 re division française libre, « pour combler ses déficits en Français » 48 ( * ) : les dissidenciés antillais rejoignaient la 1 re DFL, la division « gaulliste » par excellence, ils étaient « reconnus » comme Français. Deux mois furent cependant nécessaires pour appliquer cette décision prise au plus haut niveau, le temps de rendre opérationnelle une unité qui ne l'était pas deux mois plus tôt. Le bataillon fut donc remanié pour devenir l'unité de défense contre avions de la 1 re DFL, grâce au transfert de combattants aguerris de la division et en complétant son encadrement. En quelques mois, ces soldats allaient exceller comme unité de défense anti-aérienne au point de recevoir les félicitations de leurs instructeurs américains. Engagés dans les combats pour la libération de la France, les soldats combattirent si bravement que le bataillon fut cité à l'ordre de la division.
Le sillon ainsi tracé par le premier bataillon, le déploiement de la deuxième unité antillaise, le bataillon de marche n° 5, se fit sans obstacle. Son histoire fut moins prestigieuse que celle du premier bataillon mais il fut souvent à l'honneur dans les défilés militaires : il symbolisa, aux yeux de tous, l'engagement des Antillais pour la libération de la patrie.
Ainsi le destin des dissidenciés fut-il la résultante de deux volontés, apparemment contradictoires : la revendication d'égalité des Antillais rencontrant la défense des intérêts impériaux de la France.
Les « vieilles colonies » des Antilles et la France
La participation des Antillais à la libération de la France était dans tous les esprits lorsque la loi qui allait transformer les quatre vieilles colonies en départements français vint en discussion au Parlement, les 12 et 14 mars 1946. Elle marquait l'aboutissement d'un processus d'assimilation qui s'était déployé sur un siècle et avait conduit Guadeloupéens et Martiniquais à conquérir leurs droits de citoyens français.
Cinq ans plus tard, le 5 juillet 1951, Aimé Césaire prenait la parole à l'occasion de l'inhumation du résistant martiniquais inconnu. Son discours se terminait ainsi : « Martiniquais inconnu, petit-fils d'esclave, tombé à huit mille kilomètres de ton île natale pour la défense du genre humain, pour la défense des libertés communes, homme martiniquais tombé pour la défense des droits de l'homme, homme simple tombé pour que l'égalité soit... » 49 ( * )
Ces paroles font écho à ces mots de Frantz Fanon, rapportés par son ami Marcel Manville, lui aussi un Français libre : « Chaque fois que la dignité et la liberté de l'homme sont en question, nous sommes concernés, Blancs, Noirs ou Jaunes, et chaque fois qu'elles seront menacées en quelque lieu que ce soit, je m'engagerai sans retour » . 50 ( * ) Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, pour Frantz Fanon, comme pour Marcel Manville, le combat pour la liberté allait désormais croiser celui des peuples colonisés en quête de leurs indépendances.
3.6. MME SYLVETTE BOUBIN-BOYER,
HISTORIENNE
LES
COMBATTANTS FRANÇAIS ET INDIGÈNES CALÉDONIENS DANS LA
GRANDE GUERRE
La Nouvelle-Calédonie fait partie de l'empire colonial français depuis 1853. En 1914, sa population est peu nombreuse (58 000 habitants au recensement de 1911) et elle est extrêmement hétérogène. Le 5 août 1914, dans ce lointain « arrière » de la Grande Guerre, le gouverneur Repiquet fait afficher aux portes des mairies à la fois la guerre et la mobilisation. Il a pris cette décision en vertu de la circulaire ministérielle du 13 août 1912, relative à la conduite à tenir en temps de guerre, selon laquelle le gouverneur est « seul responsable, devant le gouvernement... de la défense et de la conservation de la colonie ». En collaboration avec le conseil de défense de la colonie et le commandant supérieur des troupes, il arrête les instructions pour l'organisation de la défense de la colonie. Le commandant supérieur des troupes, sous l'autorité du gouverneur, met en oeuvre les consignes relatives à la mobilisation en cas de guerre. Nouméa devient « centre de recrutement pour tous les citoyens français du Pacifique » : les deux colonies - Nouvelle-Calédonie et Établissements Français d'Océanie (EFO) -, le protectorat de Wallis-et-Futuna et, pour les Français du condominium franco-britannique, des Nouvelles-Hébrides. L'annonce du 5 août suscite maintes déclarations patriotiques. Mais, au cours des années de guerre, l'enthousiasme des hommes à « aller tous à Berlin » devient le désir de retrouver leur « France australe ».
Pourquoi et comment les calédoniens de toutes ethnies vont-ils participer à une guerre qui se déroule aux antipodes de la colonie ?
Les premiers à partir à la guerre
1. Lors de la mobilisation générale, des étudiants calédoniens en métropole ont rejoint des centres de recrutement pour y être incorporés. Ils sont affectés principalement dans les 1 er , 3 e et 4 e RI. Ils sont pour la plupart sous-lieutenants et meurent dans les premiers combats.
2. Début août, la flotte alliée anglo-australienne et néo-zélandaise est en rade de Nouméa avec le Montcalm , navire amiral de la flotte française d'Extrême-Orient. Les navires partent pour la conquête des colonies allemandes océaniennes, associées aux Japonais jusqu'en décembre 1914. Des inscrits maritimes et des matelots figurent sur les rôles d'équipage durant toute la guerre, de navires de la Marine comme le Kersaint à Nouméa et de navires civils militarisés afin d'assurer le ravitaillement et les divers transports de ou vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Indochine, les Nouvelles-Hébrides, les EFO et l'Europe.
3. Dès septembre 1914, l'armée rapatrie en métropole 117 gendarmes et militaires en poste en Nouvelle-Calédonie. Quelques volontaires calédoniens et néo-hébridais partent alors.
4. À la suite de la mobilisation et après bien des vicissitudes dues au manque de navires pour envoyer en métropole les soldats calédoniens, le bataillon d'infanterie coloniale de la Nouvelle-Calédonie envoie quatre « contingents » de Calédoniens et de Tahitiens mobilisés et 51 volontaires. Avec les 756 Calédoniens de ces contingents, il y a aussi 68 soldats venant des Nouvelles-Hébrides, 2 de Fidji et 3 d'Australie. 165 Tahitiens sont inscrits sur les registres calédoniens alors qu'ils sont 1 057 en tout à partir se battre. Ce sont donc 1 047 citoyens français qui quittent la Calédonie pour être affectés dans les régiments d'infanterie ou d'artillerie coloniale, quelques-uns dans les bataillons de tirailleurs sénégalais ou de spahis nord-africains, le plus grand nombre en renforts de régiments d'infanterie ou d'artillerie coloniale dans la Somme, l'Artois, l'est de la France et sur le front d'Orient, voire dans d'autres colonies. Quelques ouvriers des mines et de la métallurgie sont recrutés dans les usines d'armement.
Les indigènes calédoniens, appelés Canaques , sont eux 948 embarqués pour Marseille sur 1 105 engagés volontaires retenus après les visites médicales. Ils sont incorporés au sein du bataillon du Pacifique qui comprend également 12 Néo-Hébridais, 18 Indochinois, 4 Marquisiens et 1 Wallisien.
Ces renforts embarquent sur le Sontay le 23 avril 1915, puis, le 4 juin (bataillon du Pacifique) et le 3 décembre 1916 sur le Gange , puis le 10 novembre 1917 sur l' El Kantara . Cette année-là, 258 permissionnaires restent mobilisés au pays dans le cadre de la répression de la révolte kanak de 1917 et ne regagnent pas la France.
Quel engagement pour les Calédoniens ?
Pour mieux comprendre l'engagement de tous ces hommes, il est nécessaire de revenir sur leurs origines.
1. Les Kanak sont « les premiers occupants » de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont soumis au régime de l'indigénat depuis 1887, au paiement de l'impôt de capitation et au cantonnement dans des réserves créées en partie pour laisser place à la colonisation agricole ou à l'exploitation minière. Chrétiens pour la plupart, ils vivent regroupés en tribus au plus près de leurs missionnaires, parfois sur des « réductions » entourant l'église ou le temple. Après s'être désintéressé des populations indigènes océaniennes supposées en voie de disparition, le Parlement fait appel aux Kanak, fin 1915, au nom de l'égalité entre populations des colonies mais surtout par besoin en hommes après les hécatombes du début de la guerre. La mobilisation est impossible puisque les indigènes sont des sujets et pas des citoyens. La levée des indigènes commence le 6 janvier 1916 durant quatre campagnes jusqu'à la fin de 1917. Comme dans toutes les colonies, le recrutement sur la Grande Terre favorise le déclenchement d'une révolte ou « guerre kanak » en 1917, sans en être toutefois la seule cause.
2. Les Européens : La colonisation a généré dans la colonie deux catégories de citoyens mobilisables, que le ministère de la Guerre désigne sous les noms de créoles et de français . Les citoyens français sont 11 128, dont 7 044 nés dans la colonie. Ils sont partagés en deux groupes :
Les français , population française d'origine métropolitaine (4 084 nés en France) est constituée de fonctionnaires en poste, la plupart à Nouméa, d'anciens militaires (gendarmes, surveillants de la pénitentiaire) ; certains sont colons, anciens soldats démobilisés sur place, ayant souvent dépassé l'âge limite de l'appel. Les troupes stationnées en Nouvelle-Calédonie (396 personnes en 1911) sont considérées comme « résidents de passage » tout comme les équipages de navires de commerce. Tous nés en France, ils ont eu l'occasion de servir leur pays.
Les créoles (ou colons, ou Caldoches dirait-on aujourd'hui) , nés en Nouvelle-Calédonie, un certain nombre sont descendants des premiers colons libres. Inscrits dans les registres d'état-civil, ils sont des citoyens de nationalité française. Beaucoup sont des descendants de la population d'origine pénale, leurs enfants nés dans la colonie, citoyens de nationalité française eux aussi chercheront dans l'engagement la réhabilitation de leur nom. Le ministère de la guerre désigne tous ces hommes sous le nom de « créoles calédoniens ». En Calédonie, les recensements ne comportent pas de catégorie « créoles » comme dans les autres colonies. Les créoles calédoniens récusent fortement le mot, qui les associerait par trop aux créoles antillais qu'ils abhorrent. Mais on peut aussi voir une grande différence entre ces hommes selon qu'ils viennent de Nouméa où ils ont pu fréquenter l'école ou de la brousse comme le montrent les derniers conscrits arrivés en 1913, illettrés à 76%.
Mais la déclaration de guerre oblige également à des prises de conscience : qui est vraiment citoyen français ? Quelques-uns sont fils ou petits-fils des premiers colons britanniques ou allemands, arrivés dans l'archipel parfois avant la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France. Ainsi, des descendants d'Allemands, des heimatlosen sont en position délicate après la déclaration de guerre (Gaertner, Schmitt), quelques-uns s'engagent dans la légion étrangère ou les ANZAC. Des jeunes gens découvrent leur statut légal lors de la mobilisation comme François Azzaro, né en 1888 à Bourail, qui est « rayé des contrôles de l'armée, classé fils d'étranger ». D'autres, nés de mère kanak, non reconnus par leur père, sont classés indigènes . Les Belges et les Italiens sont naturalisés puis mobilisés en avril 1915. Pour l'anecdote, 20 condamnés obtiennent, à leur demande, leur réhabilitation en 1916 et 5 sont versés dans un bataillon disciplinaire. 100 Japonais s'engagent dans la légion et désertent presque tous à l'arrivée du navire à Marseille. Malgré les nombreuses difficultés, la Nouvelle-Calédonie est la colonie qui compte le moins de déserteurs, d'insoumis et sans doute de fuyards.
Comment nos soldats ont-ils « tenu » ?
Les Calédoniens sont extrêmement dispersés et jamais plus de quatre ou cinq au même endroit. Une grande solidarité est visible dans leurs lettres : ceux qui ne savent ni lire ni écrire sont aidés par leurs compagnons. Ils se retrouvent dans les tranchées ou bien dans les foyers du soldat durant leurs permissions. Les Kanak sont soutenus par les pasteurs et les catéchistes qui écrivent régulièrement pour eux. Le « Colis du Niaouli » et autres oeuvres charitables réconfortent les soldats.
Mais l'évolution du bataillon du Pacifique, au sein de la 72 e division d'infanterie, passant de bataillon d'étapes (ouvriers à l'arrière) à bataillon de marche (combattants sur le front), permet aux créoles calédoniens d'être incorporés au sein du bataillon mixte du Pacifique à compter d'avril 1917, à l'arrière du Chemin des Dames, puis surtout de juillet à novembre 1918 lorsqu'ils participent aux combats sur la ligne Hindenbourg près de Soissons et à Vesles-et-Caumont (Aisne). Cette nouvelle organisation permet aux Océaniens d'être pour la première fois : « Canaques, Calédoniens et Tahitiens » tous ensemble pour terminer la guerre. Là, ils apprennent à s'apprécier, se connaître et se reconnaître.
Le bilan de quatre années de guerre
193 Calédoniens meurent au champ d'honneur (19 % des mobilisés). Le bilan s'alourdit avec les 382 tirailleurs kanak morts pour la France (35 % des engagés : 20% sur le champ de bataille, 75% sur la côte d'Azur.)
Les anciens combattants de toutes ethnies doivent attendre 1919 pour regagner le pays, marqués par les épreuves de la guerre. Les cérémonies du 2 novembre (pour les morts) et du 11 novembre (pour la paix), les obsèques de ceux qui meurent alors maintiennent entre les combattants de toutes origines des liens qui se renforceront dans l'application de la nouvelle politique indigène de la France (NPI) de l'entre-deux-guerres et de l'entraide mise en oeuvre ensuite par l'ONAC. Plusieurs anciens combattants de 14-18 et leurs fils s'engagent volontairement durant la Seconde Guerre mondiale. Contrairement à d'autres colonies, aucun nationalisme n'émerge dans les années suivant l'armistice mais deux associations confessionnelles créées par des anciens combattants en 1947 donnent naissance à l'Union Calédonienne (UC), parti politique à la devise : « deux couleurs un seul peuple » qui regroupe également un grand nombre de créoles et de français anciens combattants des deux guerres.
4. Table ronde 2 - Le temps des héritages et des mémoires : ruptures, nouvelles visions, nouvelles solidarités
4.1. MME SARAH FRIOUX-SALGAS,
HISTORIENNE, RESPONSABLE DES
ARCHIVES ET DE LA DOCUMENTATION
DES COLLECTIONS À LA
MÉDIATHÈQUE DU MUSÉE DU QUAI BRANLY
L'ÉVEIL
DES MONDES NOIRS
Présenter en quelques minutes « l'éveil des mondes noirs dans la première moitié du XX e siècle » est une tâche difficile à laquelle je vais essayer de m'atteler.
Il me semble tout d'abord que le mouvement qui illustre le mieux ce qu'on appelle « l'éveil des mondes noirs » est le panafricanisme dont la définition assez large proposée par l'historien Elikia M'Bokolo, permet d'illustrer les enjeux politiques et intellectuels multiples et parfois contradictoires du sujet qui nous intéresse ici.
Je cite :
« le panafricanisme est une expression de la solidarité entre les peuples africains et d'origine africaine et en tant que volonté d'assurer la liberté du continent africain et son développement à l'égal des autres parties du monde est né dans le même contexte historique que d'autres grands mouvements de rassemblement de peuples, comme le panaméricanisme, le panarabisme, le pangermanisme, le panslavisme ou le pantouranisme. Or, il n'a pas seulement survécu à la plupart de ces mouvements : il a aussi produit des effets visibles, en contribuant directement à l'émancipation politique de l'Afrique. »
Je tenterai donc ici de montrer que l'éveil des mondes noirs est d'une part indissociable des luttes anticoloniales et antiségrégationnistes modérées ou radicales du début du XX e siècle et, d'autre part, qu'il est le fruit de la diversité des échanges intellectuels internationaux et transculturels entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques qui constituèrent la formation politique et culturelle que le sociologue anglais Paul Gilroy a pu nommer « l'Atlantique noir ».
Pour illustrer mon propos, je parlerai des mouvements politiques et intellectuels, publications, événements et personnalités qui ont constitué en partie l'histoire du panafricanisme politique et culturel, mais aussi l'histoire de l'anticolonialisme et de l'anti-racisme.
Je vous propose de commencer cette présentation en évoquant deux leaders africains-américains majeurs dans l'histoire politique de l'internationalisme noir.
Le premier Marcus Garvey (1847-1940) prônait un nationalisme noir fondé sur l'Union des Noirs de tous les continents et leur retour en Afrique.
Il créa en 1918, pour défendre ses opinions, le journal The Negro World , qui comportait des suppléments en espagnol et en français pour atteindre les immigrés noirs non-anglophones.
Le second W.E.B Du Bois pensait au contraire que les Noirs américains pouvaient être à la fois noirs et américains.
Il estimait aussi nécessaire de lier la lutte pour la reconnaissance des droits civiques aux États-Unis aux mouvements africains de décolonisation.
Ce dernier dirigea également pendant quelques années The Crisis , le mensuel de la NAACP, première grande association de défense des droits civiques des noirs américains qu'il fonda en 1909 avec d'autres militants.
The Crisis s'intéressait à la vie politique et culturelle des Noirs en Europe, aux Antilles et en Afrique à travers une rubrique intitulée Along The Color Line et ouvrait également ses colonnes à des intellectuels africains. Le premier président du Nigéria indépendant, Nmandi Azikiwe, y publia par exemple de nombreux articles.
Dubois est également considéré comme l'un des pères du panafricanisme notamment en raison de son rôle dans l'organisation à Londres, en 1900, de la première conférence panafricaine qui rassembla 32 participants africains, essentiellement anglophones et représentants de la diaspora.
Cette conférence donna lieu à une déclaration finale adressée « aux nations du monde » introduite avec ces mots :
« Au sein de la métropole du monde moderne, en cette année qui vient clore le dix-neuvième siècle, un congrès d'hommes et de femmes de sang africain s'est réuni afin de délibérer solennellement sur la situation actuelle et l'avenir des races de couleur de l'humanité. Le problème du vingtième siècle est celui de la différenciation des races, à savoir jusqu'où les différences de races - qui se manifestent surtout par la couleur de peau et la texture des cheveux - serviront d'argument pour refuser à plus de la moitié du monde, le droit de jouir, autant qu'elle le peut, des opportunités et des privilèges de la civilisation moderne . »
À la suite de cette conférence fondatrice, plusieurs congrès panafricains eurent lieux en Europe, dont l'un tenu après la Première Guerre mondiale et un second après 1945.
Celui de 1919 eut lieu à Paris en marge de la Conférence de la paix qui devait entre autres décider de l'avenir des colonies allemandes.
Celui de 1945, qui se déroula à Manchester, organisé par la nouvelle génération de militants africains et antillais, posa alors clairement la question de l'indépendance.
À propos de l'histoire du panafricanisme anglophone, je souhaiterais faire un petit retour en arrière pour évoquer la Negro Anthology de Nancy Cunard éditée en 1934.
Très illustré, cet ouvrage de huit cent cinquante-cinq pages, dédié à l'histoire de l'Afrique, de Madagascar et des Amériques noires, rassemble deux cent cinquante articles et cent cinquante-cinq auteurs.
L'aspect unique et original de cette publication tient non seulement à son concept et à sa réalisation, semblable à une grande enquête documentaire, mais également à ses auteurs. Les contributeurs étaient militants, intellectuels, journalistes, artistes, poètes, universitaires, anthropologues, Africains-Américains, Antillais, Africains, Malgaches, Latino-Américains, Américains, Européens, femmes et hommes. Certains d'entre eux étaient colonisés, discriminés, ségrégués.
Malgré certaines contradictions et certains poncifs primitivistes et essentialistes, Negro Anthology reste à mes yeux une synthèse majeure, unique et originale de la diversité des discours scientifiques, politiques et culturels des Noirs et sur les Noirs dans les années 1930 que les historiens devraient se réapproprier.
Par ailleurs, c'est à l'occasion de la préparation de l'exposition que j'ai consacré à cette publication que j'ai pu découvrir le sens de l'expression « American Congo », titre de l'un des articles du militant africain-américain William Pickens .
Cette expression, qui à la fois illustre la solidarité internationale entre les Noirs du début du XX e siècle mais aussi l'identification de certains Africains-Américains avec le sort des africains de leurs temps, fut utilisée pour la première fois par Pickens en 1921 pour décrire la situation des Noirs dans la vallée du Mississipi.
À ce moment-là, la comparaison entre le sort des Noirs américains et des Africains n'était pas nouvelle.
Depuis la fin du XIX e siècle, divers activistes africains-américains invoquèrent le Congo pour décrire leurs propres expériences en matière d'exploitation économique, de violence raciale et d'exclusion politique.
En 1895, Ida B. Wells, journaliste et activiste anti-lynchage, décrivit le meurtre de deux de ses collègues à Memphis, dans le Tennessee, comme « une scène de sauvagerie choquante qui ferait honte au Congo ».
Quelques années plus tard, un éditorial de 1907 du mensuel Voice of the Negro rappelait à ses lecteurs que ni le Congo, ni les agressions russes antisémites n'étaient très éloignées : « Il y a des Congos et des Kishenevs dans notre propre pays, chez nous. »
Après avoir présenté les militants anglophones, il me paraît important de m'attarder sur les militants francophones.
De nombreux africains proches du parti communiste s'organisèrent dès les années 1920 pour dénoncer l'impérialisme européen, la condition sociale des Noirs, la colonisation mais aussi revendiquer « la dette de sang » que la France avait à l'égard des tirailleurs sénégalais.
Ces organisations rassemblaient essentiellement de petits employés, des marins, des ouvriers et des tirailleurs africains et diffusaient leurs idées à travers des journaux distribués en France, en Afrique et en Amérique qui étaient régulièrement censurés par le ministère des colonies.
Je profite de cette évocation des militants francophones pour m'arrêter sur Lamine Senghor, figure africaine majeure de l'anticolonialisme des années 20 et 30 dont l'historien anglais David Murphy a récemment rassemblé les textes politiques.
Senghor, militant proche des communistes mais aussi ancien combattant de la guerre 14-18 qui fut gazé à Verdun en 1917, est l'auteur de nombreux textes très éloquents et nourris d'une rhétorique communiste à propos de la violence coloniale, de la dette de sang mais aussi de l'emploi du mot « Nègre » comme une réponse aux colonisateurs dont voici quelques extraits publiés dans le 1 er numéro du journal la Voix des Nègres qu'il fonda en 1927 :
« Nous nous faisons honneur et gloire de nous appeler Nègre, avec un N majuscule en tête. C'est notre race nègre que nous voulons guider sur la voie de la libération totale du joug esclavagiste qu'elle subit. Nous voulons imposer le respect dû à notre race, ainsi que son égalité avec toutes les autres races du monde, ce qui est son droit et notre devoir, et nous nous appelons nègre. »
À propos de la dette de sang :
« Pourquoi un tirailleur Sénégalais, mutilé de la ?Grande Guerre?, domicilié en France, reçoit-il une pension de 6 à 8 fois moins forte que celle payée à un Français de la métropole de la même mutilation et du même pourcentage d'invalidité ?
« Pourquoi ne paie-t-on pas de pensions aux femmes, orphelins et parents de tirailleurs sénégalais qui ont perdu leur soutien pour la défense de la France ?
« Serait-ce qu'un nègre n'a pas un estomac aussi grand que celui d'un blanc ?
« Le sang d'un nègre ne vaut-il pas celui d'un blanc ?
« Pourquoi y avait-il égalité devant le devoir, puis deux poids et deux mesures devant les droits ?
« Monsieur le Ministre des Pensions pourrait-il nous donner les raisons de cette injustice ? »
Sur ce même sujet quelques années auparavant il introduisit un article dans le journal communiste Le paria en attaquant très violemment son congénère Blaise Diagne, premier député noir du Sénégal élu en 1914, qui s'était chargé des recrutements de soldats en Afrique :
« Dans les journées des 24-25 novembre, M. Diagne, le commis recruteur, l'agent de liaison entre les vendeurs d'esclaves (les chefs indigènes de l'AOF) et l'acheteur (la France impérialiste) : marché de chair à canon pour la guerre de la civilisation, M. Diagne pour mieux établir son patriotisme et, pour plaire à Clemenceau, Herriot et compagnie, accuse René Maran de l'avoir diffamé dans un entrefilet publié par les continents »
Après avoir examiné les combats politiques de l'entre-deux-guerres des militants africains, antillais et africain-américains je terminerai mon intervention sur des combats plus culturels. Je vous propose donc encore une fois de partir des États-Unis où apparaît le fameux mouvement intellectuel et artistique de la Harlem Renaissance .
Dans les années 1920, Harlem voit apparaître une jeune génération d'écrivains et d'artistes noirs qui avaient décidé de s'approprier leur héritage africain, qui revendiquaient aussi leur identité américaine et dénonçaient la condition des Noirs.
Les écrivains et poètes Langston Hughes, Claude McKay, Countee Cullen, l'acteur Paul Robeson, le peintre Aaron Douglas ou encore l'antropologue Zora Neale Hurston étaient les représentants les plus connus de ce mouvement que le grand intellectuel africain-américain Alain Locke nomma The New Negro.
Dans un texte publié en 1926 Langston Hughes résume très clairement l'engagement de ces artistes :
« Nous les jeunes générations qui créons aujourd'hui, nous avons l'intention d'exprimer sans crainte, ni honte, notre personnalité noire ».
En France, inspirée par le mouvement New Negro , la martiniquaise Paulette Nardal fonda à Paris en 1931 La Revue du Monde Noir, bilingue (français-anglais), pour défendre un internationalisme culturel noir.
Dans les six numéros qu'aura duré cette tribune, les mondes noirs se croisent à travers des poèmes et des essais... On y abordait la vie politique et économique du Libéria ou de l'Éthiopie, l'importance du Mouvement indigéniste haïtien, la spécificité de la communauté noire de Cuba, ou encore l'engagement poétique des auteurs noirs américains.
Cet inventaire de la richesse et de la diversité des cultures noires devait permettre de, je cite Paulette Nardal, « [...] redonner à nos congénères la fierté d'appartenir à une race dont la civilisation est peut-être la plus ancienne au monde [...] mais aussi de rejoindre la position des écrivains de la Harlem Renaissance qui [...] expriment tranquillement leur « être individuel à la peau noire et sans honte »[... ] ».
Les désirs exprimés ici par Paulette Nardal anticipaient déjà l'idéologie de la négritude.
Aimé Césaire est d'ailleurs très explicite sur son influence : « Je connaissais les écrivains noirs-américains qui m'avaient été révélés par La Revue du Monde Noir. »
Cet exposé permet j'espère de vous faire comprendre dans quel contexte culturel et politique s'est construite la négritude que nous connaissons bien et sur laquelle je ne m'attarderai pas aujourd'hui.
Je vous propose de terminer mon intervention en évoquant les héritiers de ces mouvements politiques et culturels de l'entre-deux-guerres que le Sénégalais Alioune Diop fédéra autour de Présence Africaine , structure éditoriale mise en place pour réagir à la situation coloniale. Il créa en 1947 une revue, en 1949 une maison d'édition et en 1962 une librairie rue des Écoles.
Diop s'engagea d'abord dans un combat pour la reconnaissance des cultures noires qui se transforma rapidement en une lutte contre le racisme et pour la liberté culturelle, politique et économique de l'Afrique.
Présence Africaine publia des romans, des manifestes politiques, des articles et des ouvrages d'histoire, de sociologie, d'économie, de linguistique concernant l'Afrique, les Antilles, l'Océan Indien et les Amériques. À travers ses choix éditoriaux et en fédérant des auteurs d'horizons très divers, Alioune Diop a constitué la bibliothèque d'une histoire politique, littéraire et scientifique plurielle des intellectuels d'Afrique et de la diaspora des années 1950-1960.
Il organisa également à Paris en septembre 1956 le premier congrès des artistes et écrivains noirs.
Il réussit à rassembler pour la première fois des intellectuels noirs de divers continents et de toutes obédiences politiques. Il s'agissait de réaliser l'inventaire commun des cultures noires et d'analyser « les responsabilités de la culture occidentale dans la colonisation et le racisme ».
Les débats montrèrent que l'unité culturelle et politique des Noirs n'était pas une évidence et que les combats qui paraissaient aller de soi dans les années 20-30 l'étaient beaucoup moins dans les années 50. L'intervention d'Aimé Césaire intitulée Culture et colonisation , dans laquelle il jugeait analogue la situation des Noirs américains et celle des Africains colonisés fit scandale. Refusant cette comparaison, les Américains menacèrent de quitter le congrès. L'ensemble des congressistes s'accordèrent pourtant pour déclarer que « l'épanouissement de la culture est conditionné par la fin de ces hontes du XX e siècle : le colonialisme, l'exploitation des peuples faibles et le racisme ».
En 1959, Présence Africaine organisa à Rome le second congrès des artistes et écrivains noirs. L'heure n'était plus à l'élaboration d'un inventaire des cultures noires mais à la construction d'une politique culturelle, scientifique et éducative commune autour du thème « Unité et Responsabilités ». À la veille des indépendances, les intellectuels proposaient ainsi de participer aux changements à venir.
Je vous remercie pour votre attention et j'espère avoir réussi à vous montrer les multiples stratégies politiques et culturelles des colonisés avant les indépendances, dont les engagements sont trop souvent oubliés de l'écriture de l'histoire coloniale.
4.2. MADAME CATHERINE COQUERY-VIDROVITCH, HISTORIENNE, PROFESSEUR ÉMÉRITE À L'UNIVERSITÉ DE PARIS DIDEROT (PARIS VII) HÉRITAGES ET RUPTURES DANS LES COLONIES D'AFRIQUE DE L'EMPIRE COLONIAL FRANÇAIS À L'HEURE DES CONFLITS
Le corps des tirailleurs sénégalais n'était que minoritairement composé de Sénégalais. Ces soldats tiennent leur nom de la création de ce corps par Faidherbe au Sénégal au milieu du XIX e siècle. Les Français considéraient que les peuples du Sahel étaient des peuples guerriers. C'est pourquoi ils recrutaient beaucoup au Soudan (qui correspond au Mali actuel), au Niger et au Burkina Faso. Je vous propose d'analyser l'image du tirailleur, non pas du point de vue français (métropolitain), mais du point de vue africain non citoyen.
Les intellectuels africains de cette époque pensaient que la conquête de la nationalité française était le moyen d'atteindre l'objectif « liberté, égalité, fraternité ». En échange, Blaise Diagne, élu député du Sénégal en 1914, l'a négocié très habilement en 1916. Il a ainsi fait voter par le Parlement que les jeunes habitants des quatre communes sénégalaises effectueraient leur service militaire. De ce fait, ils deviendraient des citoyens français. Ainsi, les quatre communes sénégalaises ont acquis la citoyenneté pleine et entière trente ans avant les autres vieilles colonies. Blaise Diagne s'était engagé à recruter des Africains pour la Première Guerre mondiale. Il ne s'agissait pas de citoyens qui faisaient leur service militaire, mais d'indigènes ou « sujets » soumis au code de l'indigénat qui couvrait l'ensemble de l'Afrique occidentale française.
Les historiens spécialisés estiment que les trois-quarts des indigènes recrutés étaient des esclaves, puisque le système esclavagiste avait été très développé dans les sociétés africaines du XIX e siècle. L'enrôlement pour quatorze années de service constituait une forme de rachat de leur liberté. Ce mouvement a provoqué, pour les tirailleurs revenus de France, une promotion sociale parfois incroyable puisque certains administrateurs en ont fait des chefs locaux. Il a également permis une ouverture sur les sociétés modernes, avec la découverte qu'elles existaient ailleurs. Ces anciens mobilisés ont été utilisés en divers lieux de l'Afrique occidentale française.
Les tirailleurs sénégalais ont également été envoyés dans les autres colonies - en particulier en Afrique équatoriale française - pour commencer ou parachever des conquêtes. L'image des tirailleurs sénégalais chez les Africains non citoyens était donc mauvaise.
L'histoire de la statue dite Dupont et Demba illustre parfaitement ces propos. On y voit un poilu français et un tirailleur sénégalais regardant dans la même direction. Ce monument à la gloire coloniale a été érigé en 1923 devant le palais du gouverneur à Dakar. Il a été déboulonné à l'indépendance.
L'image des tirailleurs sénégalais s'est transformée avec la redécouverte de l'importance de ces soldats par l'ensemble des historiens. Le Président Wade a ainsi retrouvé la statue là où elle était dissimulée et il l'a fait installer devant l'ancienne gare de Dakar. Cela montre que les images, les perceptions changent en fonction du temps, des besoins et du contexte.
La richesse actuelle de l'Afrique, c'est sa richesse en jeunes. La masse de ces jeunes comporte ses risques, mais c'est aussi une promesse à condition que l'éducation continue de se développer. Ils sont nés après l'indépendance, c'est à eux que revient de construire l'Afrique de demain, et d'élaborer un avenir démocratique. Cela prend du temps de construire cette démocratie, mais je refuse d'être pessimiste face au futur.
4.3. M. MICHEL WIEVIORKA, SOCIOLOGUE, DIRECTEUR DU COLLÈGE D'ÉTUDES MONDIALES LES HÉRITAGES DE CES PASSÉS DANS LA FRANCE CONTEMPORAINE : QUELS DÉFIS ?
Nous devons nous méfier des récits mythiques : ils produisent des images héroïques souvent simplifiées qui sont rapidement contestées.
Si les mémoires surgissent dans l'espace public, c'est parce que des acteurs les portent. Il existe tantôt un acteur isolé, tantôt une pluralité d'acteurs. Ils peuvent parfois s'opposer, ce qui dessine un paysage hautement contradictoire. À ce titre, les supporters de l'équipe de football algérienne en France constituent un bon exemple. Il s'agit à la fois des nostalgiques de l'Algérie française, mais aussi des enfants des harkis, etc.
À un instant t de l'histoire, l'identification à la patrie ou à la nation française peut être forte, mais quelques années plus tard, les enfants ou les petits-enfants lutteront peut-être pour s'émanciper de cette nation.
Souvent, les mémoires mettent du temps à surgir comme si les descendants ne parvenaient pas à parler. Or, c'est en réalité la société qui n'arrive pas à les entendre ou qui ne veut pas les entendre.
Ces enjeux de mémoires qui se télescopent m'évoquent l'ouvrage Malaise dans la civilisation de Freud où il décrit Rome tel un enchevêtrement complexe. Dès lors, il convient d'éviter les idées simplistes.
Les mémoires dont nous parlons ont des dimensions victimaires. Ce phénomène peut s'orienter vers trois directions. La première consiste à s'enfermer dans le passé et dans la mélancolie. La deuxième vise à oublier le passé. Enfin, la troisième s'efforce de ne pas oublier tout en se projetant vers l'avenir. Les situations en lien avec la mémoire peuvent être nombreuses et varier en fonction des personnes et des groupes.
On peut être victime de trois façons différentes :
• soit en ayant été privé d'accès aux fruits de la modernité ;
• soit en ayant été privé de l'accès aux fruits de la modernité et de la capacité à se construire comme personne : cela relève de l'aliénation, du traumatisme ;
• ou bien en ayant été privé en tant que groupe car votre culture a été détruite.
La relation entre mémoire et histoire est complexe. Il arrive parfois que la mémoire paralyse le débat des historiens. La mémoire peut également introduire des contradictions, des tensions politiques, comme par exemple la mémoire de la guerre d'Algérie.
L'ensemble de ces débats débouche sur la nécessité d'une réflexion sur les réparations. Nous devons nous demander qui sont les États concernés et les descendants et qui doit payer. Ces questions appellent une réflexion sur la solidarité. Si ces idées sont portées par des groupes, cela risque de fragmenter la société et de compromettre la démocratie. Si cet enjeu se réfère à la patrie et peut-être à la nation, il n'est pas entièrement satisfaisant. Peut-être faudrait-il s'intéresser aux individus et à un enjeu très contemporain : le racisme. Il frappe les groupes mais aussi des personnes singulières.
4.4. MADAME ANNETTE BECKER, HISTORIENNE, PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS À L'UNIVERSITÉ PARIS OUEST-NANTERRE LA DÉFENSE, MEMBRE DU COMITÉ SCIENTIFIQUE DU CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE COMMÉMORER : LES POLITIQUES PUBLIQUES ET L'HISTOIRE
Aujourd'hui, certains pensent parfois que l'on peut tenter de fabriquer une mémoire, ce qui doit être évité à tout prix. En effet, je pense que nous sommes là pour réfléchir à sa fabrication et aussi et surtout à son instrumentalisation.
Je n'apprécie pas la notion de « devoir de mémoire ». Je considère qu'il n'existe pas de devoir de mémoire mais un travail de mémoire et un devoir d'histoire accompagné d'un travail de l'histoire. Nous devons essayer de réfléchir à l'histoire du temps - c'est-à-dire le temps de la guerre - puisque la mémoire commence dès la première minute de l'histoire, de la guerre, dans l'été 1914.
Prenons l'exemple du racisme durant la Grande Guerre. Que signifie ce racisme en France mais aussi dans le monde entier ? Cette guerre est immédiatement mondiale car les grandes puissances qui s'affrontent possèdent toutes des colonies.
Dès lors, des contradictions surgissent. Ainsi, en 1914, le Manifeste des 93 plus grands intellectuels allemands souligne que les Allemands sont les seuls détenteurs de la culture au motif que les armées britanniques et françaises comptent des « barbares » dans leurs rangs, c'est-à-dire des troupes venues des colonies.
Or, quel est l'enjeu de cette guerre ? C'est la guerre du droit, la guerre de la civilisation.
Selon les Allemands, leurs ennemis sont des barbares. Ainsi, dans les camps de prisonniers militaires en Allemagne, les combattants venus d'Afrique ou d'Asie étaient séparés des autres. Des « zoos humains » à l'intérieur des camps de prisonniers avaient été créés pour « exposer » la barbarie de ceux qui employaient ces sous-hommes.
Par pacifisme, dans l'après-guerre, l'ensemble de ces événements a été effacé car il était de bon ton d'affirmer que tous les hommes étaient frères. Dans cette logique, les pacifistes auraient dû également être anticoloniaux, mais tout cela a été gommé.
Au même moment, l'armée française, qui occupait la rive gauche du Rhin, a choisi d'y aligner beaucoup de troupes venues d'Afrique ; un certain nombre ont été accusés - à tort, par racisme - de violer des femmes allemandes. De cet épisode est né un racisme anti-français et anti-troupes africaines qui fut relayé par les nazis, dès 1933, avec la stérilisation des enfants métis par exemple.
Tous ces épisodes ont été gommés par ceux qui ne voulaient voir dans les tranchées qu'une grande amitié.
Il existe une concurrence des racismes et des victimes que les artistes d'aujourd'hui sont à même d'exprimer. Ainsi, Jochen Gerz a créé plusieurs installations mémorielles très subtiles car, dit-il, « ce qu'on n'a pas connu, on ne s'en souvient pas ». Il nous montre des bribes du passé avec ce qu'il a pu dénicher. Un autre artiste, Christian Lapie, a installé son oeuvre intitulée La constellation des douleurs au Chemin des Dames. Il s'agit de statues d'hommes Noirs, en bois carbonisé, qui rappelle l'importance des troupes africaines qui se sont battues au Chemin des Dames en 1917...et leur oubli.
4.5. MME VIVIANE FAYAUD, HISTORIENNE, CHERCHEURE ASSOCIÉE AU CENTRE D'HISTOIRE CULTURELLE DES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES (CHCSC), UNIVERSITÉ DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES LE PREMIER CONFLIT MONDIAL FONDATEUR DE LA NATION : L'EXEMPLE DU PACIFIQUE
L'implication de l'Océanie dans la Grande Guerre, à laquelle elle a payé un lourd tribut, demeure méconnue du grand public, notamment français, focalisé sur Verdun, mais aussi des spécialistes tant de l'Océanie que de la Grande Guerre. Ainsi, à la veille d'un Centenaire international très médiatisé, de grands rassemblements scientifiques portant précisément sur le phénomène de la guerre, tel le 136 e Congrès des sociétés historiques et scientifiques à Perpignan (2011) 51 ( * ) ou la 16 e édition des Rendez-vous de l'Histoire à Blois (2013), ne l'évoquent pas ou à peine, et encore à la faveur de la parution d'ouvrages d'anthropologues 52 ( * ) faisant oeuvre d'historiens.
D'où l'organisation du colloque international 53 ( * ) , Les Océaniens dans la Grande Guerre 54 ( * ) . Cette étude historique des confins des empires a choisi de raisonner sur l'aire géographique dans son ensemble, selon une approche originale, qualifiée de « première scientifique » par le professeur Jacques Frémeaux, historien des empires coloniaux. Le colloque ne s'est pas cantonné à circonscrire l'ampleur des bouleversements subis par les îles du Pacifique, allant de l'immense Australie au plus petit des atolls. Il s'est focalisé sur le rôle de récit fondateur joué par le conflit pour ces sociétés insulaires. La problématique a donc porté sur le sentiment d'appartenance et le nationalisme. Ce fil conducteur de précédents colloques 55 ( * ) a été traité ici dans la longue durée du siècle (1914-2014).
La Grande Guerre, n'épargnant ni les archipels des antipodes ni les îles les plus isolées, bouleverse les mers du Sud dès août 1914. Le 10 août débute le recrutement de l' Australian Imperial Force (AIF), le 28 du même mois, un corps expéditionnaire australo-néo-zélandais prend possession des colonies allemandes d'Océanie, lesquelles sont réparties entre les alliés à la fin de l'automne. Le 7 septembre, le point faible du réseau de communication britannique, l'île Fanning, est attaqué et son câble coupé ; le 22, Tahiti est bombardée. Impliquée, l'Océanie s'engage résolument dans la Grande Guerre, ce qui s'avère d'autant plus illogique qu'elle est un désert humain 56 ( * ) . En 1911 57 ( * ) , les Établissements Français d'Océanie (ÉFO) comptent environ 30 000 habitants, la Nouvelle-Calédonie 50 000, l'Australie à peine 5 millions. Ce court propos s'attarde sur l'Australie et les ÉFO.
Paradoxalement, dans le même temps qu'il soutient sans réserve l'effort de guerre de l'Empire, le dominion australien s'en affranchit. Premièrement, les hommes politiques entament dès 1915 contre Londres une bataille diplomatique soutenue pour obtenir la satisfaction d'anciennes ambitions d'annexion d'archipels adjacents à l'Australie telle la Nouvelle-Guinée. Ils y ajoutent un élargissement de leur capacité d'action et de décision, un rôle politique en Océanie par une participation à la politique de l'Empire sur les sujets relevant des intérêts australiens et une présence à la table des négociations corollaire du statut d'État allié. Le Premier ministre australien signe bel et bien le traité de Versailles en 1919. Deuxièmement, la première commémoration, le 25 avril 1916, du premier grand combat australien de la Grande Guerre, celui des Dardanelles (Gallipoli), est un jour de recueillement alors à demi-chômé. Il rend hommage au sacrifice des Anzac (Australian and New Zealand Army Corps), et surtout donne sens aux souffrances vécues en réaffirmant l'indéfectible loyauté du dominion à l'Empire.
Cependant, ce jour s'avère pour la presse de l'époque « d'une valeur inestimable pour l'avenir de l'Australie et pour la construction de la nation ». ( Kalgoorlie Miner , 24 avril 1916). Dès cette date, s'élabore en effet « l'esprit Anzac », marque distinctive de l'identité australienne faite de patriotisme, d'abnégation, de sens du devoir et de camaraderie. Troisièmement, une vaste diplomatie mémorielle constituée de cérémonies de l'Anzac Day (Belgique, Grèce, Turquie, France), de monuments, et de mémoriaux se déploie. En 1938, le roi George VI inaugure à Villers-Bretonneux (Picardie) un colossal mémorial, mémorial national et non pas militaire. Dans la ville reprise par les Australiens trois ans jour pour jour après Gallipoli, ce haut lieu est toujours sacré. En conséquence, la Grande Guerre a été dès 1914 perçue par l'Australie comme un enjeu de sa construction identitaire pour se démarquer du modèle et de l'Empire britannique, pour forger le sentiment national et pour acquérir une visibilité sur la scène politique mondiale, sa place d'État membre de la communauté internationale. Ainsi que l'observait l'historien Jay Winter, de l'university of Yale dans Le Monde des livres du 11 octobre 2013 : « En Europe occidentale et dans les dominions britanniques, l'hécatombe de la Grande Guerre a fini par incarner le récit fondateur de notre temps. »
Autre héritage inattendu de la Grande Guerre, l'ouverture au monde des autochtones qui, brusquement peuvent revendiquer d'en être acteurs. C'est le cas aux ÉFO où les déflagrations du bombardement de Papeete le 22 septembre 1914, ses dégâts et le violent incendie du centre-ville qui s'ensuit, provoquent un choc. La colonie soutient sans réserve l'effort de guerre de la métropole. Un millier de poilus de Polynésie s'enrôlent selon une mosaïque de statuts imposés par les différentes étapes de la colonisation : certains habitants sont mobilisables (Îles du Vent, Tuamotu), d'autres non, étant alors recrutés en qualité de volontaires (Îles Sous-le-Vent et Marquises). Cependant, l'ampleur des sacrifices et les tragédies vécues sur le front contribuent à l'émergence du sentiment de souffrir différemment de la métropole l'horreur de la guerre. L'expérience du front mais également celle de la métropole orientent certaines revendications pour que les archipels bénéficient d'évolutions institutionnelles estimées indispensables ; elles sont jugées légitimes car acquises par le prix du sang, d'une part, et conquises par le combat, d'autre part. En conséquence, le ressentiment est grand devant des sacrifices qui ne conduisent pas à l'émancipation.
Pouvanaa a Oopa, artisan né aux Îles Sous-le-Vent, fut dans les années suivant son retour du front d'abord un modeste agent électoral. « Devenant un personnage qui compte à Tahiti » , il participe aux cérémonies officielles, photographié « au pied du monument aux morts aux côtés des notables de la ville, en costume blanc et cravate, souliers et chapeau » 58 ( * ) . Il prend la tête d'un combat politique qui, de député à sénateur (1958), lui vaut le titre de « guide ( Metua ) des Polynésiens ». Ses adversaires politiques concèdent : « [Il a insufflé] à la population polynésienne une prise de conscience profonde et véritable de son identité ». « Père du nationalisme tahitien », son portrait sculpté trône aujourd'hui devant l'assemblée où se réunit le gouvernement de Polynésie française.
Enfin, tout en « exportant » des hommes dans des proportions colossales au regard de leur démographie, les îles doivent faire face à des problèmes intérieurs, certains récurrents, d'autres nés du conflit. Dans les ÉFO par exemple, se cumulent : le manque de main-d'oeuvre, le patrimoine foncier indivisible, la nécessité d'une présence militaire imposée par la colonisation et, un temps, par la crainte de la flotte allemande, les pertes matérielles dues au bombardement et à la rupture des relations commerciales avec les entreprises allemandes (Société commerciale de l'Océanie) ou encore les morts au champ d'honneur auxquels s'ajoutent ceux de la grippe dite espagnole (2 500 décès). Aussi, les insulaires restés sur place peuvent revendiquer leur participation à l'existence de territoires et de pays en profonde évolution.
Au-delà de la redécouverte des chiffres et des lieux de l'implication de l'Océanie dans la Grande Guerre, le va-et-vient entre histoire et mémoire, entre global et local, entre la métropole et ses colonies lointaines, dévoile les intentions, les représentations et les stratégies. Sur le loyalisme à l'empire colonial se construit paradoxalement une identité en rupture avec lui. Franchir 20 000 km pour le défendre favorise en Australie le renforcement du sentiment national, et dans les ÉFO son émergence et son développement. La Grande Guerre constitue un ancrage historique des îles d'Océanie dans le long processus de leur émancipation politique.
5. Conclusion de la rencontre
5.1. MME FRANÇOISE VERGÈS
Ces rencontres ne sont pas conçues comme des colloques. Elles sont l'occasion de croiser des regards, des méthodes, des disciplines afin de faire apparaître des figures et des événements dans toutes leurs dimensions. Elles visent à mettre en lumière des conflits de mémoire mais aussi des mémoires qui sont multidirectionnelles, c'est-à-dire qui ne sont pas liées à un seul groupe, un seul événement mais s'inscrivent, de manière directe ou imaginaire, dans des espaces et des temporalités différentes les unes des autres.
Plusieurs questions restent en suspens. Ainsi, nous pourrions poursuivre le débat sur la problématique de la dette et de la reconnaissance qui revient de manière insistante dans les débats sur les mémoires. Comment penser la dette et la reconnaissance tout en répondant à la question politique de la construction du bien commun ? Nous ne partons pas de rien, en effet toute une littérature s'est penchée sur ces notions de dette et de reconnaissance. Aujourd'hui, les débats sur la citoyenneté et la démocratisation se posent souvent en termes de dette et de reconnaissance, et moins en termes de bien commun, pourquoi ? Ou alors, est-ce une redéfinition du bien commun qui s'avère urgente ?
Les mémoires et les récits historiques qui surgissent dépendent des contextes sociaux et culturels et de ce que les sociétés sont prêtes à entendre. Depuis quelques années, les mémoires coloniales, esclavagistes, post-esclavagistes et post-coloniales ont investi l'espace public conduisant à une demande de révision du récit national, à des demandes d'inscription à travers des programmes d'enseignement, des stèles, des monuments, des musées. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant, comme l'ont souligné des intervenants, que des mémoires soient instrumentalisées. Mais elles sont également une manière d'exprimer, pour certains groupes, la nécessité qu'une histoire soit non seulement reconnue mais aussi qu'elle montre, par son existence, des oublis, des effacements qui sont le produit d'une hégémonie culturelle. Ce sont des faits historiques qui sont pourtant appelés « mémoires » et non « histoires », le terme de mémoire cherchant à refléter un fait venant « d'en bas », de celles et ceux qui sont ignorés par la « grande » histoire par fait de racialisation, d'indifférence ou de mépris. Ils renvoient souvent à des itinéraires singuliers, faisant entendre la voix de l'acteur, du témoin qui se ferait par la mémoire et non par l'histoire, perçue comme outil des puissants. Cela ne signifie en rien l'abandon de la recherche historique et sa demande de rigueur mais, sans doute, un moins grand mépris pour ce qui s'exprime dans ces demandes de mémoire.
Ce dont il s'agit, c'est d'un élargissement de la démocratie et du peuple.
Dès lors, la question des réparations, qui soulève des débats émotionnels et des positions tranchées, ne peut être évitée. Il s'agit de débattre de la justice et de l'égalité. Il faut ouvrir le dossier, examiner les archives, s'inspirer des solutions trouvées dans d'autres pays, ne pas éviter par principe la solution monétaire qui, bien qu'elle soit dès l'abord controversée, mérite d'être débattue. De quoi pouvons-nous avoir peur ? L'enjeu est de parvenir à vivre ensemble tout en restant différents car s'identifier comme Guadeloupéen, Kanak, Tahitien, Réunionnais, Mahorais, Guyanais ou Martiniquais signifie s'identifier à des langues, des récits, des religions, des cultures, des histoires et des pratiques (et sur chaque territoire, on observe une multiplicité de ces formes et de ces expressions) qui ne peuvent être fondues dans un grand ensemble. Elles doivent trouver une place juste, place qui se renégociera inévitablement. Car l'inattendu et l'imprévisible, qui font l'histoire, agissent.
Ces récits méritent également d'être « déracialisés », comme ont pu le revendiquer écrivains et artistes du monde noir. Ainsi, Aimé Césaire appelait à un « nouvel humanisme », qui tiendrait compte de toutes les personnes exclues d'une conception étroite de l'humanité.
Toutes ces questions sont d'actualité. L'objectif de nos rencontres consiste à mener une réflexion sur la manière de faire entrer dans le débat citoyen le vivre ensemble et le bien commun, malgré les ressentiments, les frustrations et les colères.
5.2. M. PASCAL BLANCHARD
Pendant longtemps, la mémoire et l'histoire composaient deux mondes séparés. Mais le public lit, écoute, s'informe, échange aussi. Ainsi, le film Indigènes de Rachid Bouchareb a certainement eu plus d'impact que les écrits des historiens sur l'histoire militaire de la Seconde Guerre mondiale pour toucher et mobiliser la jeune génération issue de l'immigration maghrébine. Ce film a créé une émotion, qui a provoqué un débat politique, qui lui-même a produit une réaction politique sur les pensions des anciens combattants. Mais l'histoire puise dans ces passions nouvelles pour investir de nouvelles questions, interroger le passé, motiver de nouvelles générations de chercheurs et interpeller de nouveaux publics. Histoire et mémoire sont en mouvement et, ensemble, ils concourent à écrire un récit commun.
Nos rencontres permettent de croiser la mémoire et l'histoire. Nous vivons une époque où les deux peuvent vivre et commencent à être entendues. Aucune ne domine l'autre, aucune ne s'oppose à l'autre, elles servent toutes les deux le même dessein : participer au vivre ensemble. Certes des moments de frottement, de conflits aussi, peuvent exister, mais cela est assez évident lorsque les « ennemis » d'hier décident de participer ensemble à bâtir une nation, à se construire un destin, à fabriquer une citoyenneté partagée. Ainsi, France Télévisions, à l'occasion des commémorations du centième anniversaire de la Première Guerre mondiale et du soixante-dixième anniversaire de la Libération de la France (1943-1945), a diffusé cette série Frères d'armes que j'ai le plaisir de co-écrire avec Rachid Bouchareb en 50 épisodes. Cette série participe à sa façon à bâtir les récits d'aujourd'hui pour les mémoires communes de demain. C'est dans cette dynamique d'échanges que doivent être lus les présents échanges et contributions, en quête de nouveaux territoires oubliés de l'histoire, qui désormais sont parties communes de nos mémoires. Commémorer ce n'est pas seulement se souvenir, c'est aussi découvrir, apprendre, comprendre, réagir, discuter, pour mieux puiser demain dans l'histoire le sens du présent qui guide le chemin vers l'avenir.
6. Clôture
6.1. M. JEAN-PIERRE BEL, PRÉSIDENT DU SÉNAT
Chère Françoise Vergès,
Cher Pascal Blanchard,
Mesdames, messieurs,
Cher(e)s ami(e)s,
Il y a un peu plus de deux ans, le 9 mai 2012, nous nous rencontrions pour la première fois dans ces salons de Boffrand où nous avons abordé des thèmes qui sont chers à chacun de nous. En novembre dernier, j'avais à nouveau le plaisir de vous accueillir ici à l'initiative de la Délégation sénatoriale de l'outre-mer, sur une nouvelle rencontre initiée par le sénateur Serge Larcher dédiée aux chapitres oubliés de l'Histoire de France. Ces journées de dialogue sont des enrichissements nécessaires à la mémoire que nous devons partager pour vivre en paix avec le passé.
Aujourd'hui, c'est avec la même passion que nous nous retrouvons et je suis très fier de la qualité de vos contributions qui participent à la mémoire nationale. On ne peut effacer le souvenir de toutes celles et de tous ceux qui ont perdu la vie sur les champs de bataille. C'est l'histoire croisée des hommes que vous avez voulu évoquer cet après-midi autour de deux tables rondes animées par Pascal Blanchard et par Françoise Vergès et d'une projection de films courts et inédits sur les combattants de ces mondes, et je tiens à les remercier pour leur participation.
Cette année, la France célèbre deux événements majeurs : le début de la Grande Guerre et le 70 ème anniversaire de la Libération de notre pays. Ces deux conflits majeurs s'inscrivent dans notre mémoire collective. Vos rencontres, tout comme les commémorations, participent à ces moments de transmission.
Commémorer ces deux moments historiques, c'est aussi célébrer la victoire de la démocratie et nous rappeler que ce sacrifice a été lourd pour ces jeunes hommes venus des cinq continents et qui sont morts sur les champs de bataille. Commémorer ces deux guerres, c'est aussi délivrer un message de paix.
Cette rencontre est un moment pour moi de rendre hommage aux 430 000 soldats des colonies qui ont pris part à la Grande Guerre, qui n'était pas la leur, et aux 200 000 ouvriers venus des outre-mer pour faire tourner les usines d'armement françaises. Ces hommes, qui ne s'étaient jamais rencontrés, sont venus se battre pour des valeurs et se sont retrouvés sur des terres inconnues et lointaines. Ce sont leurs histoires personnelles qui s'associent aujourd'hui au destin de la France. Ce sont des générations qui se sont forgées avec ce souvenir ; le souvenir de ces deux épouvantables conflits.
Nos frères d'armes des outre-mer et des colonies françaises sont devenus des combattants français sur le sol de l'Europe. Ils ont connu le froid, la faim, la fureur, la peur, l'angoisse, l'épuisement, la mort. Nous ne pouvons les oublier et nous devons être exigeants pour préserver les traces de ces récits individuels car ils appartiennent à notre histoire, à notre passé, à notre héritage et à notre mémoire.
Ces moments d'histoire complexes nous rappellent la force d'une Nation quand elle est rassemblée, cette capacité à mobiliser, parfois de gré ou de force, pour préserver la démocratie et cette énergie pour défendre notre destin.
Ces moments d'histoire ne s'identifient pas forcément à des victoires. Des monuments sur les champs de bataille sont là pour nous rappeler le courage et le sang qui a coulé de ces soldats du monde. Ces soldats du monde, qui étaient-ils ? Des spahis, des goumiers, des annamites, des kanaks, des malgaches, des tirailleurs qui venaient du Maghreb, des Comores, de Djibouti, des Outre-mer, d'Afrique noire. Pendant la Première Guerre mondiale, près de 180 000 tirailleurs du Sénégal sont venus sur notre sol défendre les couleurs du drapeau qui était alors le leur. Trente ans plus tard, leurs descendants sont venus des mêmes territoires pour répondre à l'appel du Général de Gaulle et de la France et combattre les forces ennemies dans leur pays et sur notre sol. De juin 1940 à mai 1945, 55 000 Algériens, Marocains, Tunisiens et combattants d'Afrique noire furent tués. Près de 25 000 d'entre eux servaient dans l'Armée d'Afrique, qui comptait 400 000 hommes, dont 173 000 Africains. On connaît le rôle des goumiers marocains dans la libération de la Corse en 1943, premier département de la métropole à se libérer.
Ces soldats du monde entier étaient venus combattre pour marquer leur fidélité et leur loyauté à ce qui était la nation française ; une nation qui défendait son intégrité et ses valeurs.
De ces combats, la fraternité des armes dans les tranchées, la circulation des hommes et des idées firent naître une légitime exigence d'émancipation et d'indépendance.
Mais ce sont ces combats qui ont libéré la France ; ce sont ces soldats qui sont devenus des compagnons ; ce sont ces hommes qui ont laissé leur vie sur notre territoire. Ces rencontres des Mémoires croisées sont là aussi pour leur rendre justice en reconnaissant nos frères d'armes qui sont tombés pour notre pays. Ces histoires croisées sont des moments de mémoire partagée. Ce sont des moments où les destins individuels doivent être connus et reconnus, mais où ces histoires personnelles se lient à l'histoire nationale. Elles témoignent de notre respect pour les morts d'hier et de ce lien qui unit ces peuples, leurs cultures, leurs religions et notre République.
Si la France est riche de sa diversité, c'est aussi grâce à ce lien.
Ces Mémoires croisées honorent cette partie de notre mémoire nationale et tous ceux qui sont morts pour notre pays. Elles permettent de mieux comprendre ces histoires personnelles qui ont participé à l'histoire de notre pays. Ces histoires qui nous permettent de vivre ensemble le même destin, dans cette communauté qu'est la Nation. Il nous faut maintenant les faire vivre, les faire entendre par nos plus jeunes concitoyens afin que l'erreur de l'oubli ne se reproduise jamais, et que cet héritage perdure.
Au nom de ces histoires personnelles, de cet héritage et de la Nation, je tiens à vous remercier pour votre travail et vous renouvelle mes chaleureuses félicitations pour la qualité de vos échanges et de vos débats.
7. programme de la rencontre
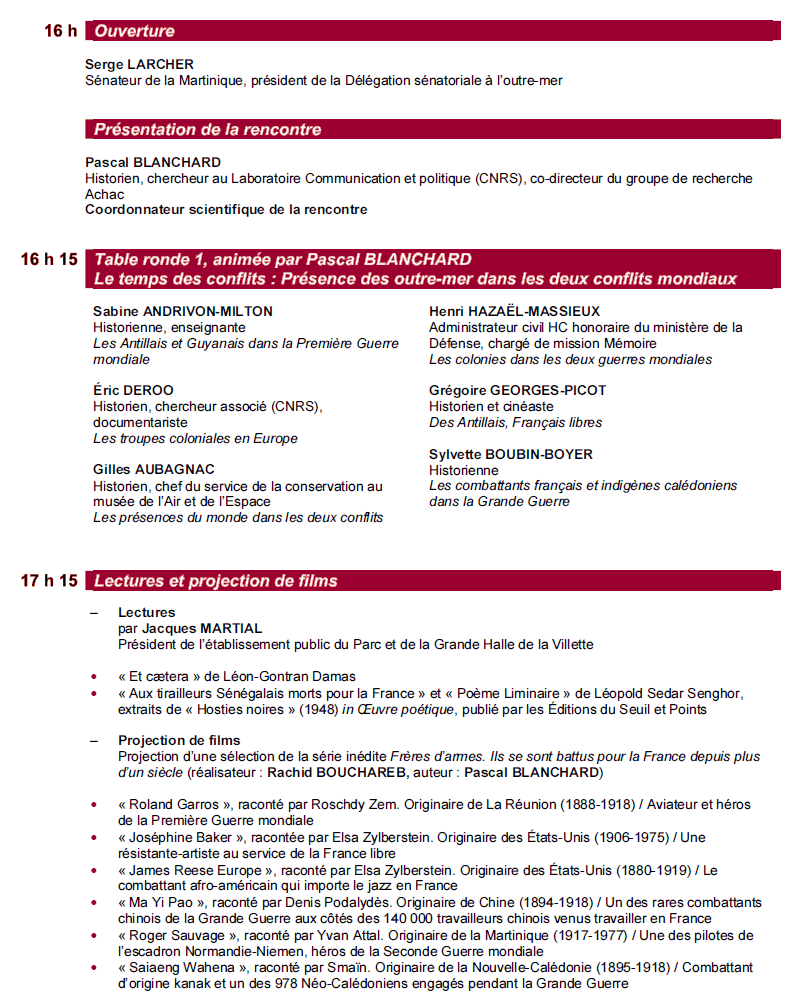
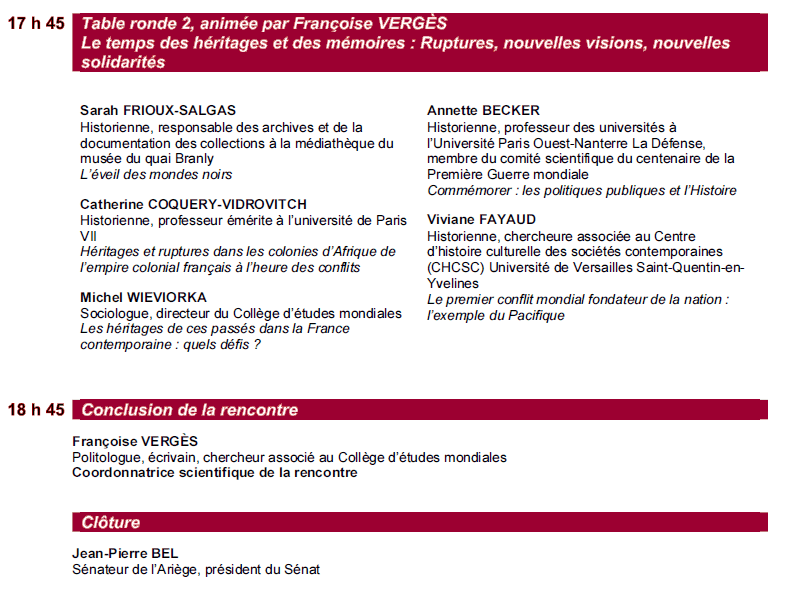
* 1 Jérôme Duhamel, La Grande Guerre, Mémorial Martiniquais, tome III, Société des Éditions du Mémorial, Nouvelle-Calédonie, 1978, p364.
* 2 Contingent créole. Personnel et effectif. 7N1992. le 18 octobre 1915. S.H.A.T.
* 3 Contingent créole. Personnel et effectif. 7N1992, situation du 15 au 31 juillet 1915. S.H.A.T.
* 4 Lettre publiée dans L'Union sociale, le 20 septembre 1916.
* 5 Il serait très long de faire ici un point détaillé sur ce sujet et je ne peux que renvoyer à un excellent article d'Antoine Champeaux dans la Revue historique des armées. « Le patrimoine des traditions des troupes indigènes » RHA n°271/2013.
* 6 Extrait de la décision n° 31/CAB/MIL/2.G.
* 7 Décision n° 171 du 21 novembre 1944 (JO du 17 décembre 1944) ; Décision n ° 649 du 19 avril 1945 (JO du 7 juin 1945).
* 8 Décision n° 1F du 18 septembre 1946 (BOPP n° 18 du 5 mai 1947, p. 1290). Seules cinq autres unités de l'armée de terre ont obtenu cet honneur en 1939-1945 : le 2 e groupe de tabors marocains, la 13 e demi-brigade de légion étrangère, le 4 e régiment de tirailleurs tunisiens, le 3 e régiment de tirailleurs algériens et le bataillon d'infanterie de marine et du Pacifique (BIMP). Sans oublier le 2 e régiment de chasseurs parachutistes de l'armée de l'air, unique titulaire de la fourragère à la couleur du ruban de la Légion d'honneur, avec six citations à l'ordre de l'armée.
* 9 Ce qui constitue une exception notable à la règle instituée consistant à n'attribuer au maximum que quatre inscriptions au titre du conflit 1939-1945.
* 10 Première des unités des Forces françaises libres, répondant dès juin 1940 à l'appel du général de Gaulle, à Chypre et à Tripoli, le 1 er BIM, sous le commandement du capitaine Lorotte, est le premier à reprendre les combats contre les forces italiennes aux confins de l'Égypte et de la Cyrénaïque (septembre 1940).
* 11 Créé le 2 septembre 1940 à Tahiti, le bataillon rassemble 600 volontaires tahitiens, néo-calédoniens et néo-hébridais.
* 12 Régiment d'infanterie de marine du Pacifique/Nouvelle-Calédonie (RIMaP/NC) et Régiment d'infanterie de marine du Pacifique/Polynésie (RIMaP/P). En juillet 2012, le RIMaP devient détachement Terre Polynésie RIMaP.
* 13 Croix de la Libération, croix de guerre 1939-1945 avec cinq palmes, fourragère aux couleurs de la croix de la Libération et fourragère aux couleurs du ruban de la médaille militaire avec olive 1939-1945.
* 14 Décision n° 3181/DEF/EMAT/EMPL/AA du 12 novembre 1988.
* 15 Le régiment reçoit le patrimoine de tradition du 1 er régiment de tirailleurs algériens.
* 16 Ces cinq inscriptions rappelant les faits d'armes du 1 er bataillon de tirailleurs somalis pendant la Grande Guerre sont : Verdun-Douaumont 1916, La Malmaison 1917, L'Aisne 1917-1918, La Marne 1918 et Noyon 1918. Elles se rajoutent aux quatre inscriptions méritées par le 5 e RIC : Lorraine 1914, Champagne 1915, La Somme 1916 et Picardie 1918.
* 17 Décision n° 12 475 du 1 er avril 1970.
* 18 Décision n° 7347/DEF/EMAT/CAB/16 du 18 septembre 1996.
* 19 À l'origine simple sous-vêtement utilisé par tous les soldats, portée de façon apparente dans l'infanterie d'Afrique, la ceinture était de diverses couleurs. Une répartition a été peu à peu adoptée puis réglementée. La ceinture bleue distinguait les corps à recrutement européen : zouaves, infanterie légère d'Afrique, légion étrangère. La ceinture rouge était portée par les unités de tirailleurs à recrutement indigène.
* 20 Artilleurs de marine.
* 21 Pour le lecteur qui souhaiterait en savoir plus, voici une courte bibliographie indicative :
Lucien-René Abenon et Henry E. Joseph, Les dissidents des Antilles dans les Forces françaises combattantes, 1940-1945 , Désormeaux, 1999
Anthony Girod, Les dissidenciés guadeloupéens dans les Forces françaises libres , Paris, L'Harmattan, 2001
Éric Jennings, La dissidence aux Antilles , Revue du XX e siècle, 2000, volume 68, pp. 55-71
Éric Jennings, Le ralliement des Antilles (juillet 1943), revue de la Fondation de la France libre, n°48, juin 2013, pp. 3-6
Serge Mam Lam Fouck, Histoire de l'assimilation , Matoury, Ibis rouge, 2006
Éliane Sempaire, La dissidence an tan Sorin , Éditions Jasor, Pointe-à-Pitre, 1989
À voir :
Les élèves du lycée Saint-James ont fait un remarquable travail dans le cadre du Concours national de la Résistance en 2005-2006. Le résultat est consultable sur le site du lycée :
http://cms.ac-martinique.fr/lpsaintjames/articles.php?lng=fr&pg=62
Parcours de dissidents (2005), un film d'Euzhan Palcy
* 22 Messages d'outre-tombe du maréchal Pétain : textes officiels, ignorés ou méconnus, consignes secrètes, Nouvelles éditions latines, 1983, pp. 32-34
* 23 Frantz Fanon, Antillais et Africains , Revue Esprit, décembre 1955, p. 266
* 24 Archives départementales de Guadeloupe SC3 995 Circulaire 51, Appel aux maires, Basse-Terre, 18 mai 1942
* 25 Service historique de la défense (désormais indiqué par les initiales SHD) 1 K 518. Le document fait partie des archives de la police de Sainte-Lucie relatives aux réfugiés de la Martinique et aux Forces françaises libres 1940-1943 dont un « double » est aujourd'hui consultable au Service historique de la défense à Vincennes grâce à Xavier Steiner, attaché de recherche à l'état-major du commandement supérieur Antilles-Guyane.
* 26 Témoignage recueilli par Anthony Girod-À-Petit Louis, cité dans son livre Les dissidenciés guadeloupéens dans les Forces française libres, Paris, L'Harmattan, 2001, p. 117
* 27 Jean-Charles Timoléon, Chronique du temps passé , Office municipal de la culture et du sport, Basse-Terre, 1987, p.26. cité dans E. Jennings, La dissidence aux Antilles , Revue du XXe siècle, 2000, volume 68, page 64
NB : l'usinier est le directeur d'une sucrerie ; le géreur est le gérant d'une plantation de canne à sucre.
* 28 Témoignage recueilli par Anthony Girod-À-Petit Louis, op.cit ., p. 127
* 29 René Auque, Journal d'un engagé volontaire . Archives Guy Cornély, cité dans Éliane Sempaire, La dissidence an tan Sorin , Éditions Jasor, Pointe-à-Pitre, 1989 p.93
* 30 Archives nationales 72 AJ/225/IV Antilles. Témoignage de Jean Massip
* 31 Aimé Césaire, éditorial de la revue Tropiques, n°1, avril 1941
* 32 Service historique de la Défense (désormais indiqué par les initiales SHD) 1 K 518. Le document fait partie des archives de la police de Sainte-Lucie relatives aux réfugiés de la Martinique et aux Forces françaises libres 1940-1943 dont un « double » est aujourd'hui consultable au service historique de la défense à Vincennes grâce à Xavier Steiner, attaché de recherche à l'état-major du commandement supérieur Antilles-Guyane.
* 33 SHD 12 P 260 Fiche sur le bataillon des Antilles, 26 octobre 1943.
* 34 Archives départementales de Guadeloupe, SC 4088, cité dans E. Jennings, La dissidence aux Antilles , Revue du XX e siècle, 2000, volume 68, page 61
* 35 ADG SC3 995 Circulaire 51, Appel aux maires, Basse-Terre, 18 mai 1942
* 36 Raphaël Confiant, La dissidence , Paris, Écriture, 2002, p. 206. Raphaël Confiant a intercalé dans son roman des extraits du Journal d'un engagé volontaire écrit par René Auque, un quartier-maître du croiseur Émile Bertin , l'un des navires de la marine française mouillant aux Antilles.
* 37 SHD TTD 790 État des jugements du tribunal maritime temporaire de Fort-de-France soumis à la chambre de révision de la cour d'appel de la Martinique, 1 er avril 1945.
* 38 Archives nationales 72 AJ/225/IV Antilles. Témoignage de Jean Massip
* 39 SHD 1 K 518 Cette estimation a été établie par Xavier Steiner, en s'appuyant sur les archives de la police de Sainte-Lucie relatives aux réfugiés de la Martinique et aux Forces françaises libres 1940-1943, archives photographiées et inventoriées par lui.
* 40 SHD 13 H 6 dossier 1 Ralliement des Antilles et Guyane à la France libre. Inventaire des ressources de Fort Dix. Outre 1433 Antillais, il y avait aussi des Syriens, des Sud-Américains, des volontaires de Saint-Pierre-et-Miquelon et des officiers venus d'Angleterre et de Madagascar.
* 41 Cela sans tenir compte des départs vers l'Angleterre ou le Canada antérieurs à octobre 1942, ni des évadés vers les autres îles des Petites Antilles, Montserrat ou Antigua : au total, quelques centaines, tout au plus.
* 42 SHD 13 H 6 dossier 1 Ralliement des Antilles et de la Guyane à la France libre. Note sur la réorganisation des troupes des Antilles par le général Blaizot, Alger, 25 juin 1943
* 43 SHD 13 H 6 dossier 1. Mémorandum sur la participation effective des Antilles à la guerre par le général Jacomy, 18 décembre 1943
* 44 SHD 1 K 518. Archives de la police de Sainte-Lucie relatives aux réfugiés de la Martinique et aux Forces françaises libres 1940-1943. Liste des volontaires ayant accompli une visite médicale d'aptitude, 1943.
* 45 État signalétique et des services de Frantz Fanon communiqué par le centre du Service national de la Martinique.
* 46 SHD 13 H 6 dossier 1. Mémorandum sur la participation effective des Antilles à la guerre, 18 décembre 1943
* 47 SHD 12 P 260 dossier Bataillon de marche des Antilles n°1. Rapport du colonel Valluy, directeur des troupes coloniales, 26 octobre 1943
* 48 SHD 12 P 260 dossier Bataillon de marche des Antilles n°1. Fiche en date du 11 janvier 1944
* 49 Discours prononcé par Aimé Césaire, le 5 juillet 1951, à l'occasion de l'inhumation du résistant inconnu martiniquais, in Raphaël Confiant, A imé Césaire une traversée paradoxale du siècle , Paris, Écritures, 2006
* 50 L'Actualité de Frantz Fanon : actes du colloque de Brazzaville, 12-16 décembre 1984 . Paris, Karthala, 1986, p.16
* 51 Faire la guerre, faire la paix, 136 e congrès des sociétés historiques et scientifiques, université de Perpignan, 2011.
* 52 Bensa Alban, Kacué Goromoedo Yvon et Muckle Adrian, Les sanglots de l'aigle pêcheur : Nouvelle-Calédonie, la guerre kanak de 1917 , éd. Anacharsis, 2013. Naepels Michel, Conjurer la guerre : violence et pouvoir en Nouvelle-Calédonie, EHESS, 2013.
* 53 Labellisé au niveau national par la mission du Centenaire en juillet 2013.
* 54 www.bu.u- picardie.fr/BU/ onglet : ww1 oceania 14-18.
* 55 « 1988 : Accords de Matignon Oudinot, 1998 : Accord de Nouméa, Textes fondateurs de la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui», Palais du Luxembourg, Paris, 25-26 avril 2008. « Destins des collectivités politiques d'Océanie », Institut de recherche pour le développement, Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 10-12 mars 2011.
* 56 1905 : 4 millions d'habitants en Australie, 913 000 en Nouvelle-Zélande, 30 000 à 35 000 en Nouvelle-Calédonie.
* 57 Gille Bernard, Toullelan Pierre-Yves, De la conquête à l'exode, histoire des Océaniens et de leurs migrations dans le Pacifique, Pirae, Au vent des îles, 1999, 2 vol., vol. 1, p. 280. Boubin-Boyer S., « Communautés calédoniennes et guerres mondiales », Faberon J.-Y., Fayaud V., Regnault J.-M. (éds.), Destins des collectivités politiques d'Océanie, Aix-en-Provence, PUAM, 2 vol., 2011, p. 593-603.
* 58 Regnault J.-M., « Deux destins », in Fayaud V. Les Océaniens dans la Grande Guerre . À paraître.







