c) Le débat sur la dette publique comme indicateur de la soutenabilité des modèles de développement nationaux
Les éléments qui précèdent justifient que le Parlement témoigne d'une vigilance accrue en ce qui concerne notre niveau d'endettement. Cette vigilance impose tout d'abord de ne pas s'en tenir à l'approche « maastrichtienne » de la dette, telle que définie par Eurostat, et de la mettre en perspective à l'aide d'une approche bilancielle . Elle implique également d'améliorer l'information parlementaire sur les choix stratégiques des administrations chargées de la politique d'émission de l'Etat.
(1) La dette brute : une approche aujourd'hui trop rudimentaire
La dette publique, telle qu'appréhendée pour l'application du Pacte de stabilité et de croissance, est une dette brute , nominale et consolidée. En tant que dette brute , elle ne rend compte qu'en partie de la situation financière des administrations et de la soutenabilité des finances publiques, puisqu'elle ignore les actifs détenus par les administrations publiques.
S'il peut pallier à cet inconvénient, le calcul d'une dette nette , en retranchant de la dette brute les actifs physiques et financiers 47 ( * ) , présente également plusieurs limites. Selon la Cour des comptes, ces limites tiennent en premier lieu à la difficile valorisation des actifs physiques et à leur caractère non cessible, qui « ne permettent pas de les intégrer dans une analyse des risques de solvabilité posés par l'endettement public » .
S'agissant de la dette nette des actifs financiers , qui s'élevait à 34 % du PIB en France en 2007, contre 44 % dans la zone euro, elle est estimée par l'OCDE sur la base de la valeur de marché des actifs. Compte tenu du poids des actions et des participations, le recours à ce mode de valorisation rend l'appréciation de la dette nette française très sensible à la conjoncture .
La présentation des recettes et dépenses budgétaires de l'Etat en sections d'investissement et de fonctionnement , telle qu'elle figure dans chaque projet de loi de finances, peut fournir quelques éléments d'information.
Le projet de loi de finances pour 2009 enseigne ainsi que 165,30 milliards d'euros de ressources d'emprunt 48 ( * ) ont vocation à financer à hauteur de 32,54 milliards d'euros le déficit de la section de fonctionnement, à hauteur de 19,15 milliards d'euros des dépenses d'investissement et à hauteur de 118,61 milliards d'euros l'amortissement des emprunts passés et les prises de participation.
Moins de 20 % de l'emprunt contracté sont donc consacrés au « fonctionnement courant », tandis que 11,6 % vont à l'investissement, et le solde au désendettement ou aux prises de participation.
La section d'investissement du budget de l'Etat selon le projet de loi de finances pour 2009
(en milliards d'euros)
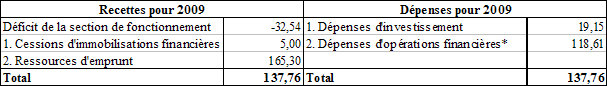 * Dont remboursements
d'emprunts et autres charges de trésorerie (113,20 milliards
d'euros), Opérations financières (5 milliards d'euros) et
Participations (0,41 milliard d'euros). Source : projet de loi de finances
pour 2009.
* Dont remboursements
d'emprunts et autres charges de trésorerie (113,20 milliards
d'euros), Opérations financières (5 milliards d'euros) et
Participations (0,41 milliard d'euros). Source : projet de loi de finances
pour 2009.
Ainsi que votre rapporteur général l'a déjà souligné, la présentation du budget de l'Etat en sections d'investissement et de fonctionnement demeure toutefois trop peu documentée pour constituer un outil d'analyse totalement pertinent à la disposition du Parlement.
De surcroît, les dépenses d'investissement présentées dans la section d'investissement ne correspondent pas stricto sensu aux crédits du titre 5 au sens de la nomenclature budgétaire.
Cette divergence de périmètre ajoute encore au « flou » entourant la notion d'investissement public, « flou » qui apparaît particulièrement regrettable à l'heure où le débat de focalise sur les dépenses d'avenir.
(2) La « règle d'or » : un principe de bonne gestion à adapter au contexte actuel d'hypertrophie des dettes publiques
Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a, dans un entretien au Financial Times Deutschland du 2 juin dernier, relancé le débat sur la discipline budgétaire en affirmant qu'il faut « réfléchir à un traitement spécial pour les dettes qui apparaissent comme les conséquences de la crise ».
Interprétée comme conduisant à faire la différence entre la « bonne » et la « mauvaise » dette - à l'image du « bon » et du « mauvais » cholestérol -, cette déclaration a suscité des critiques. Votre rapporteur général rappelle que, dès lors qu'une dette doit être remboursée, il n'y a pas de « bonne » et de « mauvaise » dette mais simplement de la dette « tout court », dont il faut assurer le service.
S'il s'agit de distinguer « les déficits réversibles liés à la crise » de celui « récurrent depuis trente ans », la déclaration prend du sens, même s'il convient d'affiner l'analyse.
Cette « dette de crise » s'oppose effectivement à une « dette structurelle » ou « dette historique » , héritée du passé, une sorte de « legacy debt ». Celle-ci correspond au legs de trente cinq années sinon de laxisme, du moins d'incapacité à prélever des ressources suffisantes pour couvrir les besoins publics.
Mais la « dette de crise » recouvre des réalités différentes, qui doivent être soigneusement distinguées notamment au regard de la notion de réversibilité.
En premier lieu, au sein de celle-ci, il y a la traduction de moins values de recettes et de suppléments de dépenses qui résultent de façon mécanique de la crise. Ce déficit, consécutif au jeu des stabilisateurs automatiques, débouche sur une dette que l'on peut qualifier de « passive ».
Toute la question est de savoir si le déficit et la dette ainsi constitués vont se résorber lorsque les différentes économies retrouveront leur croissance tendancielle.
L'exemple anglais a le mérite d'attirer l'attention sur la façon dont la crise va impacter la croissance potentielle . Le Gouvernement britannique a ainsi considéré que le choc de croissance a pour conséquence un recul, non rattrapable, du PIB potentiel. En d'autres termes, et dès lors qu'il faut réajuster les paramètres relatifs à la croissance potentielle, la résorption du « déficit de crise » et de la « dette de crise » qui en résulte, ne peut reposer sur le seul jeu des stabilisateurs automatiques et exige des efforts complémentaires d'envergure.
En second lieu, à l'intérieur de cette « dette de crise » il est un autre type de dettes qu'il paraît légitime d'isoler au regard du critère, effectivement essentiel, de réversibilité : la dette qui finance des opérations en capital et notamment des achats d'actifs pour soutenir le système bancaire.
L'endettement de la SFEF doit-il être sorti de la dette des administrations publiques ? Certainement pas, mais la signification économique de cet endettement est sensiblement différente.
D'une part, il s'agit « d'une dette qui rapporte », l'Etat intervenant en tant que quasi-banque centrale pour réaliser des opérations de transformation et se faisant rémunérer pour ce service d'intermédiation financière.
D'autre part, s'agissant des prises de participation -et la France n'est pas à cet égard dans une situation différente de celle d'autres pays- cette dette a pour contrepartie des actifs théoriquement liquides en tous cas valorisables. Bref, il s'agit d'une « dette avec contrepartie », qui, de surcroît, peut même être productrice de revenus. Certes, ces actifs ne peuvent pas être remis brutalement sur le marché -on le voit avec l'Angleterre- mais ils ont vocation à être revendus à court terme. Ces opérations en capital sont, par nature, éminemment réversibles.
La « règle d'or » , entendue comme n'autorisant l'Etat à emprunter que pour financer ses dépenses d'investissement, telle que l'ont plus ou moins appliquée les Britanniques ces dernières années, doit être interprétée dans les circonstances actuelles, même en ne recherchant l'équilibre que sur la durée du cycle économique.
En revanche, cette notion peut aujourd'hui déboucher sur de nouvelle lignes de conduite : concentrer les actions publiques sur celles correspondant à de l'investissement et continuer à réduire le plus possible les dépenses de fonctionnement.
Certaines dépenses relevant du « déficit de crise », bien que ne constituant pas des investissements au sens comptable, n'en ont pas moins, du fait de leur effet multiplicateur, un impact positif sur la croissance :
- faut-il, parce qu'elles ont pour objet d'atténuer la crise et d'en raccourcir la durée (soutien de la consommation ou sauvegarde de la trésorerie des entreprises par exemple), les traiter à part ?
- faut-il, au contraire, considérer ces décisions discrétionnaires comme des dépenses courantes comme les autres ? De fait si elles creusent bien le déficit structurel, elles stimulent aussi la croissance et donc le respect du ratio dette/PIB. Cette dette comme celle qui résulte de l'investissement, est certes une dette active mais elle ne comporte pas de contreparties en termes d'actif et ne peut être considérée comme suffisamment « vertueuse » pour justifier un traitement à part.
En tout état de cause, la soutenabilité des finances publiques doit être appréciée au regard du cycle : c'est ce que fait le marché quand il tend à proportionner l'ampleur du « spread » qu'il exige d'un pays, à l'aune de la solidité de son modèle économique .
Pour résumer cette analyse, il convient de distinguer la dette de fonctionnement de celle adossée à des actifs, qu'ils soient financiers ou physiques, qui n'a pas la même nature que celle finançant des opérations courantes.
C'est le nouveau sens de la « règle d'or » : une dette, qui peut se rembourser avec la cession d'un actif ou qui s'amortit en même temps que lui, peut être considérée comme soutenable voire comme « bonne », surtout lorsqu'elle favorise l'amélioration de la productivité des facteurs et donc la croissance.
(3) La nécessaire prise en compte des engagements hors-bilan - de fait ou de droit - dans le cadre de la réforme de la gouvernance d'Eurostat
Le débat ouvert par Mme Christine Lagarde montre bien qu'il faut une analyse fine des causes du déficit comme de la structure de la dette dans une optique bilancielle . A ces deux niveaux, il y a des charges qui correspondent à de la consommation et d'autres qui constituent de l'investissement.
Au titre des enrichissements souhaitables de l'approche « maastrichtienne », l'appréciation des engagements hors bilan des Etats doit enfin constituer une priorité.
A cette fin, une mise en relation des pratiques des certificateurs nationaux serait propice à élaborer une méthodologie commune d'évaluation du hors bilan des Etats, dont l'évolution constitue un indice beaucoup plus pertinent de la soutenabilité à long terme des finances publiques que celle de leur endettement brut .
Selon les calculs de l'INSEE, à la fin de 2008, la dette des administrations publiques au sens de Maastricht s'élève à 1 327,1 milliards d'euros, soit 68,1 % du PIB, après 63,8 % fin 2007.
Au sein de celle-ci, la contribution de l'Etat à la dette publique dépasse les mille milliards d'euros. Elle a progressé de 107,0 milliards d'euros en 2008, soit une augmentation plus importante que son déficit (54,1 milliards d'euros). La différence résulte notamment du financement de la Société de prise de participation de l'Etat (11,6 milliards d'euros), de la reprise des dettes du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles (8,0 milliards) et d'une hausse de la trésorerie de l'Etat (+ 11,8 milliards) par anticipation des dépenses de l'année 2009.
Au total, la dette publique nette augmente moins rapidement que la dette au sens de Maastricht : elle s'établit à 61,3 % du PIB, après 59,1 % en 2007. En particulier, les mesures d'aide au secteur financier intervenues en fin d'année n'ont quasiment pas d'impact sur l'évolution de la dette publique nette (+ 1,0 milliard d'euros) dans la mesure où elles conduisent aussi à augmenter l'actif des administrations publiques.
|
Dette publique notifiée et dette publique nette |
||||||||
|
Au 31/12/2007 |
Au 31/12/2008 |
|||||||
|
Dette publique notifiée |
Dette publique nette |
Dette publique notifiée |
Dette publique nette |
|||||
|
En milliards d'euros |
En % du PIB |
En milliards d'euros |
En % du PIB |
En milliards d'euros |
En % du PIB |
En milliards d'euros |
En % du PIB |
|
|
Etat |
929,2 |
49 |
899,5 |
47,5 |
1036,2 |
53,1 |
995,4 |
51 |
|
Organismes divers d'administration centrale |
97,7 |
5,2 |
74,4 |
3,9 |
109,1 |
5,6 |
58,2 |
3 |
|
Administrations locales |
136,7 |
7,2 |
123,9 |
6,5 |
146,7 |
7,5 |
134,4 |
6,9 |
|
Administrations de sécurité sociale |
45,2 |
2,4 |
22,8 |
1,2 |
35,1 |
1,8 |
7,9 |
0,4 |
|
Total administrations publiques |
1208,8 |
63,8 |
1120,6 |
59,1 |
1327,1 |
68,1 |
1195,8 |
61,3 |
|
Source : Insee, comptes nationaux, base 2010 |
||||||||
Au total, votre rapporteur général considère donc que la « fiction maastrichtienne » doit céder la place à une analyse plus réaliste. Il incombe à l'analyse bilancielle de rechercher , Etat par Etat, la réalité des risques et des engagements. L'élaboration d'une méthode d'évaluation de l'endettement public moins « fruste » que celle d'Eurostat est urgente dans la mesure où elle conditionne la qualité de l'information des créanciers de la sphère publique.
Dans un contexte où les questions de confiance sont essentielles, il est important d'adapter la gouvernance d'Eurostat pour en faire une véritable autorité comptable indépendante, capable d'évaluer et de comparer les engagements des Etats, que ceux-ci soient directs ou indirects au travers de ceux de leur système bancaire.
Tant que durera la crise en effet, il convient de ne pas s'attacher à des considérations simplement juridiques pour considérer au titre des engagements des Etats les soutiens de fait que ceux-ci pourraient être amenés à accorder pour venir en aide à leur système bancaire comme à des filières industrielles .
Les marchés ne s'y sont pas trompés, quand ils ont estimé que les emprunts de l'Etat autrichien devaient supporter une prime de risque pour tenir compte du coût des interventions publiques en faveur des banques que pourrait rendre nécessaire la dépréciation de leurs créances sur certains pays d'Europe centrale et orientale.
* 47 Dépôts, crédits, titres de créance négociables, participations.
* 48 Complétées par 5 milliards d'euros de ressources tirées des cessions d'immobilisations financières.







