B. UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE QUI LAISSE LES VICTIMES AU BORD DU CHEMIN
Plus encore que pour de nombreux autres citoyens, la justice apparaît aux personnes handicapées et à leurs familles comme un monde hermétique. Les reproches qui lui sont adressés sont divers : absence de prise en compte de la parole de la personne handicapée, absence de communication sur l'état d'avancement des procédures et sur les droits des victimes, inadaptation des procédures à des personnes dont l'autonomie est faible.
Si elle ne peut entièrement souscrire à ces critiques, exprimées de façon souvent excessive, la commission d'enquête estime toutefois qu'elles révèlent la nécessité de mieux prendre en compte, au-delà de la définition des infractions elles-mêmes, la spécificité du handicap dans la procédure judiciaire.
1. Une connaissance insuffisante des suites données par la justice
Les statistiques du ministère des affaires sociales laissent supposer un taux de transmission à la justice relativement élevé, dans la mesure où plus de 90 % des cas signalés aux DDASS en 2001 ont fait l'objet d'une saisine du procureur de la République.
Mais au-delà du nombre de saisines, il est malheureusement difficile de connaître exactement les suites données aux affaires signalées à la justice, dans la mesure où les seules statistiques disponibles ne donnent qu'une « photographie à l'instant » des dossiers ouverts au cours de l'année étudiée.
Etat, au 31 décembre 2001 des procédures judiciaires
ouvertes pour maltraitance au cours de l'année
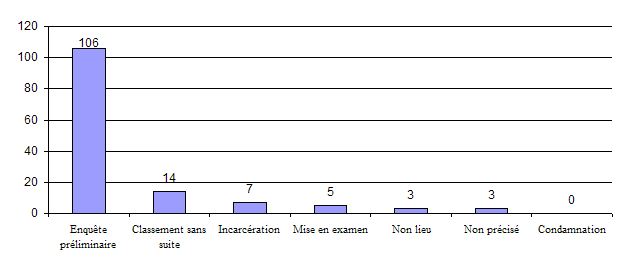
Source : IGAS
Ainsi, le nombre d'enquêtes préliminaires paraît peu significatif, dans la mesure où la « photographie » est très proche de l'ouverture du dossier : la procédure judiciaire, au moment de la transmission du signalement à la DGAS, se trouve, compte tenu de la difficulté liée à l'instruction des affaires de maltraitance, encore très souvent au stade de l'enquête préliminaire. Cette proportion importante ne préjuge en rien des suites qui seront données aux dossiers. Comme le souligne elle-même la DGAS, « les services déconcentrés ne se sont pas rapprochés systématiquement par la suite du procureur de la République afin de renseigner l'administration centrale sur les suites de la saisine. » 47 ( * )
De même, si la DGAS met en avant un taux de classement sans suite de seulement 9 %, il est nécessaire de rappeler qu'il s'agit des seuls classements intervenus au cours de l'année d'ouverture du dossier.
Ce « bon résultat » affiché par le ministère paraît contradictoire avec la manière dont les intervenants ressentent sur le terrain l'action de la justice.
« Nous avons (...) recensé douze situations de maltraitance, dont neuf sont restées à ce jour sans suite sur le plan judiciaire. Cela ne signifie pas pour autant que rien ne s'est passé, mais nous ignorons pour le moment la suite que la justice réservera à ces dossiers. En revanche, trois dossiers ont débouché sur une mise en examen et deux rappels à la loi. » Tel est par exemple le bilan dressé par l'Association des paralysés de France sur les 12 derniers mois.
Les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, rencontrés par la commission d'enquête lors de ses déplacements, ne donnent pas une image beaucoup plus rassurante de l'écoute trouvée par les personnes handicapées auprès de la justice : à plusieurs reprises, ceux-ci ont déploré être sans nouvelle des affaires qu'ils avaient portées devant la justice.
Cette absence de communication plaide à l'évidence pour une amélioration de la coordination entre services administratifs et judiciaires . A cet égard, la commission d'enquête souligne l'expérience intéressante menée dans le cadre de l'association ALMA : un comité technique de pilotage regroupe, entre autres, les services de la DDASS et ceux du procureur, « de sorte qu'il arrive parfois que le procureur (...) dicte lui-même la lettre qu'il souhaite recevoir pour se saisir d'un cas précis. » 48 ( * )
De la même manière, Mme Emmanuelle Salines, médecin-inspecteur de la santé publique, insistait sur le gain en efficacité du travail de coordination avec la justice mis en place dans le département de l'Essonne : « nous avions souhaité opérer au sein d'un grand groupe qui réunisse les services du procureur de la République. Nombre de situations nous posaient des problèmes de classement juridique des actes. Nous ne savions pas toujours si elles relevaient du domaine pénal ou d'un tout autre domaine. J'appelais donc le substitut qui avait été désigné pour lui demander conseil. »
Une telle coordination est expressément prévue, au niveau départemental, par la circulaire du 3 mai 2002 relative à la prévention et à la lutte contre la maltraitance envers les adultes vulnérables, et notamment les personnes âgées .
La commission d'enquête ne reviendra pas sur l'absence de mise en oeuvre de ce dispositif dans la grande majorité des départements. Elle insiste cependant encore une fois sur la nécessité et l'urgence de son application.
Au niveau central, le groupement permanent interministériel de l'enfance maltraitée (GPIEM) a été réactivé et sa structure a été élargie aux départements. D'après les informations recueillies par la commission d'enquête, son champ d'action pourrait être élargi à l'ensemble des personnes vulnérables.
La commission d'enquête estime donc que cette instance pourrait servir de pivot pour le suivi des suites, tant administratives que judiciaires, données aux affaires de maltraitance.
2. Victimes et familles se sentent abandonnées par la justice
La commission d'enquête tient à rappeler qu'elle ne saurait contester en quoi que ce soit, et surtout de manière générale, le traitement judiciaire des affaires de maltraitance. Il reste que l'absence de communication de la part du système judiciaire sur les suites données aux plaintes suscite chez les victimes et les familles le sentiment que la parole de la personne handicapée n'est pas entendue.
a) L'absence de motivation des décisions de classement
Les décisions de « classement sans suite » sont très mal comprises des victimes et de leurs familles : bien qu'une décision de classement soit une mesure à caractère administratif qui ne fait pas obstacle à une reprise ultérieure, voire à une poursuite concomitante des investigations, les victimes vivent ces décisions comme un refus de voir leurs souffrances.
Pourtant, ainsi que le soulignait la commission de réflexion sur la justice en 1997 49 ( * ) , « s'il y a des classements, ce ne sont pas des « classements sans suite » selon la terminologie habituelle, mais des « classements sans poursuite », qui impliquent qu'une réponse judiciaire a néanmoins été donnée : en droit (absence d'infraction caractérisée), en fait (enquête restée infructueuse : auteur inconnu, préjudice réparé et retrait de plainte) ou par le recours à des mesures non répressives (avertissement, médiation, transaction, sanctions disciplinaires). »
|
L'enquête préliminaire : Elle est menée par les services de police et de gendarmerie sous la direction du procureur de la République. Elle a pour but de recueillir des éléments permettant de caractériser une infraction pénale. Si aucune infraction ne peut être caractérisée, si l'auteur des faits n'a pu être identifié ou si la loi ne permet pas sa poursuite, le procureur de la République procède au « classement sans suite » de la procédure. Si au contraire une infraction pénale est relevée, le procureur peut demander l'ouverture d'une information judiciaire : le dossier est alors confié à un magistrat instructeur. L'information judiciaire : L'ouverture d'une information judiciaire ne s'impose que lorsqu'elle est exigée par la loi (en matière criminelle) ou lorsqu'il est nécessaire de mettre en oeuvre les pouvoirs spécifiques du juge d'instruction : interception de communications téléphoniques, perquisition sans l'accord des intéressés... Elle est également ouverte de plein droit en cas de plainte avec constitution de partie civile. L'information judiciaire peut se conclure par : - une ordonnance de non-lieu , lorsque l'auteur demeure inconnu, que les faits ne peuvent recevoir de qualification pénale, qu'une clause légale d'irresponsabilité a été mise à jour ou que les faits sont prescrits ; - une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente (tribunal de police ou tribunal correctionnel) si le juge d'instruction estime que les faits retenus à charge constituent une contravention ou un délit ; - une ordonnance de mise en accusation devant la Cour d'assises , s'il estime que les faits retenus à charge constituent un crime. |
Il reste que le procureur de la République n'a obligation de motiver le classement sans suite que lorsque la plainte concerne un viol, une agression sexuelle, une atteinte sexuelle commise à l'encontre d'un mineur ou la pornographie à caractère pédophile.
La commission d'enquête ne conteste pas le principe d'opportunité des poursuites qui est à l'origine de l'absence d'obligation pour le procureur de motiver ses classements sans suite. Une telle obligation ne saurait être systématisée, sous peine de paralyser totalement le travail du parquet.
Mais, de même que le code pénal a étendu la protection hier réservée aux mineurs de quinze ans à l'ensemble des personnes vulnérables en matière d'infraction, il ne serait pas incohérent de prévoir un traitement équivalent en matière de procédure pénale et donc d'étendre la motivation des classements aux plaintes qui concernent des personnes vulnérables .
Cette question n'est toutefois pas absente des préoccupations du Gouvernement : le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, présenté par M. Dominique Perben, ministre de la justice, en Conseil des ministres le 9 avril 2003, propose d'instaurer un principe de « réponse judiciaire systématique », qui viendrait préciser le principe traditionnel de l'opportunité des poursuites.
|
L'exposé des motifs du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité précise les conditions dans lesquelles la motivation des classements sans suite deviendrait obligatoire : « Un nouvel article 40-1 traduit dans le code de procédure pénale le principe de la réponse judiciaire systématique , venant préciser le principe traditionnel de l'opportunité des poursuites qui est par ailleurs consacré par la loi. Lorsque les faits sont constitués et l'auteur identifié , le procureur de la République devra ainsi apprécier l'opportunité, soit d'engager des poursuites pénales, soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites (en recourant le cas échéant à la plus simple d'entre elles, à savoir le rappel à la loi), et il ne pourra classer sans suite la procédure que s'il estime que des circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. « Le nouvel article 40-2 précise les règles actuelles sur l'information des victimes : l'avis de classement doit ainsi être motivé mais cette obligation ne concerne que les affaires dans lesquelles l'auteur est identifié , ce qui est la pratique la plus courante actuellement. Les enquêteurs devront pour leur part aviser la victime qu'en cas de défaut d'élucidation, son affaire sera classée . Les autorités publiques, au nombre desquelles figurent les maires qui ont dénoncé des infractions au parquet, doivent également être informées. » |
La commission d'enquête ne peut que se féliciter qu'une attention plus grande soit portée aux victimes dans le déroulement de la procédure pénale et insister pour que la vulnérabilité des victimes soit particulièrement prise en compte par les parquets dans la manière de motiver leurs classements.
b) La carence du soutien apporté aux victimes
Par ailleurs, lorsqu'une information judiciaire est ouverte, rien n'oblige, en droit, le juge d'instruction, en dehors des cas de constitution de partie civile, à communiquer aux victimes et aux familles l'état d'avancement de ses investigations. Il n'est légalement tenu que de l'informer de l'ouverture de l'instruction, de son droit à se constituer partie civile et des modalités de ce droit, ainsi que de la clôture de l'instruction.
Or, bien souvent, cette simple information est insuffisante : il paraît notamment nécessaire d'améliorer l'information dont disposent les personnes handicapées concernant la possibilité qui leur est ouverte de demander l'aide juridictionnelle, dont elles peuvent bénéficier soit sous condition de ressources 50 ( * ) , soit de plein droit en cas de violences, d'actes de torture ou de barbarie ou viol.
De plus, une simple information reste souvent inefficace face à des personnes handicapées qui, prises en charge toute leur vie dans un établissement, ne parviennent pas toujours à prendre en main leur défense : dans ces conditions, l'aide apportée à la victime pour comprendre la procédure dépendra de la manière dont le magistrat instructeur conçoit les limites de son rôle.
C'est ce que soulignait M. Hervé Auchères, à partir de son expérience de magistrat instructeur : « Les victimes, qui ne sont pas forcément sous tutelle, qui sont parfois sous curatelle, mais qui ne font pas toutes l'objet de mesures de protection particulières, sont souvent complètement désemparées face au procès pénal et au cours de l'instruction. Elles ne se sont pas forcément constituées partie civile. Dans la mesure où elles sont majeures, elles ne bénéficient pas de la logistique applicable aux personnes mineures. L'idéal serait donc que le juge d'instruction prenne à bras-le-corps le cas de ces victimes, qu'il leur explique en détail comment se constituer partie civile et comment obtenir le concours d'un avocat. Toutefois, cela pose un problème, car le juge d'instruction doit rester neutre et impartial afin d'instruire à charge et à décharge. Il arrive cependant que, par humanité, nous sortions de notre cadre légal d'activité. »
Si elle salue les initiatives menées, ça et là, par les magistrats instructeurs, la commission d'enquête estime cependant qu'il n'entre manifestement pas dans l'attribution d'un juge d'instruction de conseiller les victimes sur la manière dont elles doivent se défendre.
La famille de la personne handicapée peut par ailleurs ne pas être en mesure de l'assister au cours de la procédure, soit parce que celle-ci a disparu - les situations de ce type risquant d'être de plus en plus fréquentes, du fait du vieillissement de la population handicapée -, soit parce que, du fait de pressions extérieures ou d'intérêts divergents, elle ne défend pas complètement les intérêts de la victime.
Afin d'améliorer l'aide apportée aux personnes vulnérables victimes d'actes de maltraitance, il paraît nécessaire de donner au juge d'instruction la possibilité de désigner un administrateur ad hoc , comme c'est déjà le cas pour les mineurs victimes, dont le rôle serait non seulement d'exercer, au profit de la personne handicapée, les droits reconnus à la partie civile, mais également de protéger et de défendre les intérêts de la personne.
Bien entendu, le rôle de l'administrateur ad hoc ne serait pas exclusif de celui de l'avocat, qui continuerait à intervenir dans les mêmes conditions qu'actuellement.
|
Le régime de l'intervention de l'administrateur ad hoc a été profondément modifié par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles et à la protection des mineurs . Alors que, dans le régime antérieur, la nomination d'un tel administrateur était facultative et ne pouvait intervenir que dans les cas où les faits faisant l'objet de l'instruction avaient été commis volontairement par le titulaire de l'autorité parentale, elle est aujourd'hui obligatoire lorsque : - les intérêts de l'enfant et de l'un de ses représentants légaux sont totalement divergents ; - les représentants légaux du mineur ne défendent pas complètement ses intérêts. L'administrateur ad hoc est chargé, outre l'exercice, au nom de l'enfant, des droits reconnus à la partie civile, de la protection de l'ensemble de ses intérêts pendant la durée de la procédure : il est notamment chargé du placement des sommes éventuellement perçues par l'enfant à l'occasion de la procédure. Au terme de l'instruction, il remet au juge un rapport détaillant les mesures qu'il a prises pour assurer la protection des intérêts de l'enfant tout au long de la procédure. L'administrateur ad hoc peut être nommé parmi les proches de l'enfant ou sur une liste de personnalités, qualifiées dans le domaine de l'enfance. Cette liste est constituée selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. |
La commission d'enquête estime que, dans le cas des personnes accueillies en institutions sociales et médico-sociales, le rôle d'administrateur ad hoc pourrait utilement être confié aux médiateurs créés par la loi du 2 janvier 2002 (article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles) , dans la mesure où ceux-ci ont, d'ores et déjà, le pouvoir d'assister la personne accueillie dans ses litiges avec l'établissement.
A défaut d'une extension de la possibilité de nommer un administrateur ad hoc , une réflexion sur la possibilité de constitution de partie civile pour les associations de défense des personnes handicapées ne pourrait être écartée.
Par dérogation au principe selon lequel l'action civile appartient à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction, cette possibilité est déjà ouverte pour une large catégorie d'associations , énumérées aux articles 2-1 et suivants du code de procédure pénale. Les associations de défense et d'assistance aux personnes handicapées peuvent notamment déjà se porter partie civile en ce qui concerne les faits de discrimination à l'encontre des personnes handicapées (article 2-8 du code de procédure pénale) .
Dans ce contexte, proposer une extension de la capacité des associations à se porter partie civile, sur le modèle adopté pour les associations de défense de l'enfance martyrisée (article 2-3 du code de procédure pénale) ne paraît pas incohérent.
Mais la commission d'enquête insiste sur le fait que l'ouverture d'une telle possibilité devrait nécessairement être encadrée :
- les associations susceptibles de se porter partie civile doivent avoir pour objet exclusif la défense des droits des personnes handicapées : en l'état actuel du paysage associatif dans le monde du handicap, il est en effet nécessaire de préciser cette condition, dans la mesure où la plupart des associations représentant les personnes handicapées sont également gestionnaires de structures d'hébergement ou de prise en charge et que leurs intérêts, dans une affaire de maltraitance survenant en établissement, pourraient être différents de ceux de la victime ;
- les sanctions en cas d'abus de constitution de partie civile doivent être clairement affirmées , sous peine de voir se multiplier de façon exponentielle des instances parfois peu fondées. C'est d'ailleurs la préoccupation exprimée par M. Dominique Perben, garde des Sceaux, devant la commission d'enquête : « Je ne suis pas hostile au fait que des associations se portent parties civiles dans un nombre élargi de situations, mais il faut bien avoir conscience des conséquences que cela aurait sur le fonctionnement de la justice. »
C'est la raison pour laquelle la commission d'enquête exprime sa préférence pour l'extension de l'intervention d'un administrateur ad hoc , indépendant, et chargé de suivre personnellement la victime, aux personnes vulnérables.
|
Etendre, sur le modèle existant pour les mineurs, la possibilité pour le juge d'instruction de désigner un administrateur ad hoc chargé d'assister la personne vulnérable tout au long de la procédure judiciaire. |
3. Donner à la justice des outils adaptés aux procédures concernant des victimes handicapées
Toute enquête en matière de maltraitance est particulièrement éprouvante pour les familles dans la mesure où les procédures judiciaires sont nécessairement longues. Les victimes ont souvent du mal à maintenir leur déposition jusqu'au terme de l'instruction, soit qu'elles doutent d'elles-mêmes, soit que des pressions s'exercent sur elles.
Il est vrai que, compte tenu de l'encombrement des cabinets d'instruction et des multiples commissions rogatoires et expertises nécessaires à l'établissement des faits, la durée des instructions est difficilement compressible.
|
La durée incompressible des informations judiciaires en matière de maltraitance : le témoignage d'un magistrat « La phase d'instruction sera d'autant plus longue que les faits sont contestés. Cela est généralement le cas dans la plupart des affaires relatives à des cas de maltraitance commis à l'égard des personnes handicapées. Le juge d'instruction, qui doit rechercher la vérité, instruit à charge et à décharge. Il ne faut pas oublier que la présomption d'innocence constitue un principe gouvernant de la procédure pénale en France. « La durée parfois très longue des instructions s'explique aussi par l'obligation qui nous incombe de procéder à l'audition de l'ensemble des personnels et des résidents des établissements au sein desquels sont advenus des faits de maltraitance. Le nombre d'auditions à effectuer prend très rapidement des proportions phénoménales. Lorsque le juge d'instruction délivre une commission rogatoire aux services de police ou de gendarmerie afin de procéder à ces auditions, il n'est pas rare que ladite commission s'étale sur huit mois, dix mois, un an ou même un an et demi (...). « Dans le cas où des faits de maltraitance sont mis à jour, les victimes(...) doivent également subir des expertises. L'expertise systématique de toutes les victimes est indispensable à la procédure, que celle-ci se déroule en correctionnelle ou en assises. Malheureusement, nous nous heurtons à des délais de remise des résultats extrêmement longs. Il faut parfois six mois à un expert pour nous remettre les conclusions de son travail. C'est autant de temps de pris sur la durée de l'instruction. « Si vous mettez bout à bout les commissions rogatoires, les expertises, les confrontations et les différentes auditions de la victime, vous vous apercevez qu'il est extrêmement difficile de restreindre la durée d'une instruction criminelle pour des faits de maltraitance subis par des personnes handicapées. »
Extrait de l'audition de M. Hervé Auchères, juge
d'instruction, le 9 avril 2003
|
Dans ce contexte, comme le résume M. Hervé Auchères, « La seule réponse qu'il est possible d'apporter très rapidement à une personne handicapée consiste à la recevoir et à l'entendre. Ainsi, cette personne sera en mesure de constater par elle-même qu'un magistrat s'est saisi de l'affaire la concernant. Ce magistrat pourra lui expliquer aussi clairement que possible le déroulement d'une procédure d'instruction. »
Mais au-delà de ces difficultés que connaissent toutes les victimes d'infractions pénales, on ne peut que constater que la procédure pénale est encore trop souvent inadaptée à l'instruction des affaires de maltraitance envers des personnes vulnérables.
a) Une conciliation difficile des droits de la victime et des droits de la défense
La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a prévu la possibilité pour la personne mise en examen de demander une audition de témoin ou de la partie civile. Au cours de cette audition, elle peut également demander la présence de son avocat.
Il convient de préciser que cette possibilité n'est offerte que pour les auditions dont la demande a été formulée par le prévenu lui-même : la présence de l'avocat n'est en rien prévue lors des auditions organisées par le juge lui-même.
Si cette possibilité s'explique par la volonté du législateur de renforcer le caractère contradictoire de la procédure et de permettre à la défense de ne pas attendre l'audience pour pouvoir poser les questions qu'elle estime nécessaires à la manifestation de la vérité, la présence de l'avocat de l'agresseur peut malgré tout être dommageable pour la victime .
C'est d'ailleurs l'opinion exprimée par Mme Marie-Antoinette Houyvet, présidente de l'Association française des magistrats instructeurs : « Il s'agit d'une difficulté lourde, du moins la ressentons-nous ainsi dans nos cabinets d'instruction, car la victime se retrouve seule et déstabilisée face à son présumé agresseur. Le juge d'instruction aura eu beau, dans un premier temps, recevoir la victime, l'entendre, faire connaissance avec elle et lui expliquer la manière dont la procédure se déroule, il n'en reste pas moins qu'une confrontation entre la personne handicapée victime de faits de maltraitance et l'avocat de l'accusé mis en examen peut causer des dégâts irrémédiables sur la victime. »
Normalement, le juge d'instruction reste libre d'accéder ou non à la demande du prévenu, ainsi que le souligne une circulaire du ministère de la justice, en date du 20 décembre 2000. Le magistrat peut en effet estimer que la présence de l'avocat de l'agresseur présumé est inopportune. La circulaire précise : « il pourra en être ainsi pour l'audition d'une victime ou d'un témoin dont la particulière vulnérabilité risque de ne pas lui faire supporter la présence de l'avocat du mis en examen (par exemple dans une hypothèse de violences sexuelles contre un mineur ou contre un majeur qui aurait été particulièrement traumatisé du fait de cette agression). » 51 ( * )
Il reste que, pour refuser la présence de l'avocat lors d'une audition, le juge d'instruction doit prendre une ordonnance motivée et susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction . Les magistrats auditionnés par la commission d'enquête ont d'ailleurs conclu que le juge ne peut « refuser qu'exceptionnellement, et ce sur justification » , estimant par ailleurs que la confrontation apparaît souvent comme « indispensable à la manifestation de la vérité. »
Afin d'éviter une multiplication des auditions de la victime, et toujours dans un souci de « parallélisme des formes » par rapport au statut de mineur victime, un certain nombre d'intervenants ont évoqué la possibilité d'étendre aux personnes vulnérables la possibilité, ouverte par la loi du 17 juin 1998 pour les mineurs, d'un enregistrement audiovisuel de la déposition.
L'adoption d'une telle procédure ne va toutefois pas sans soulever de nombreuses interrogations, comme en témoigne le rapport de notre ancien collègue, M. Charles Jolibois, à propos de l'enregistrement des dépositions de mineurs victimes.
|
l'enfer est pavé de bonnes intentions... « Votre commission partage pleinement le souci de Mme le garde des Sceaux de limiter autant que faire se peut les confrontations ou auditions des mineurs victimes d'infractions sexuelles. Comme l'a fait observer M. Philippe Jeannin, procureur de la République à Meaux, cet enregistrement pourra constituer l'unique audition du mineur, évitant ainsi la multiplication d'entretiens, pouvant être traumatisants, dans les nombreux cas où l'auteur reconnaît les faits. « Toutefois, les personnes entendues lors de la journée d'auditions publiques ont soulevé deux séries de difficultés susceptibles de résulter de cet enregistrement. « Si l'enregistrement ne devrait pas soulever de difficulté dans les affaires simples, il pourrait en aller tout autrement dans les cas où la personne poursuivie nierait les faits(...). Dans une telle hypothèse, il serait dangereux de considérer que l'enregistrement permet de se passer de nouvelles auditions du mineur : pour les droits de la défense tout d'abord car, en cas d'affabulation, la déposition de l'enfant serait difficile à contester sans confrontation (d'autant plus que, selon Mme Christiane Berkani, la France, à la différence du Canada, ne dispose pas de psychiatres formés à l'expertise de crédibilité des enregistrements) ; pour l'enfant lui-même qui, impressionné lors de sa première audition, peut se révéler incapable de décrire les faits ou d'exprimer ses sentiments. » Extrait du rapport n° 49 (1997-1998) de M. Charles Jolibois, sénateur,
fait au nom de la commission des Lois
|
Mme Marie-Antoinette Houyvet, présidente de l'AFMI, faisait part de son inquiétude vis-à-vis d'un tel dispositif en ces termes : « Si, dans les propositions que nous avons formulées au nom de l'AFMI, nous nous sommes beaucoup appuyés sur les dispositifs existant en matière de protection des mineurs, vous aurez certainement remarqué que nous n'avons pas évoqué cet enregistrement audiovisuel unique. Il nous a semblé extrêmement dangereux de fixer sur pellicule les déclarations d'une personne handicapée. Ce discours lui est parfois difficilement compréhensible. En isolant certaines phrases d'un contexte global, il est possible de faire dire à la personne handicapée ce qu'elle n'a pas forcément voulu dire. Ce dispositif nous apparaît donc assez dangereux. »
Au demeurant, la loi du 17 juin 1998 ne met pas d'obstacle à la mise en oeuvre de systèmes expérimentaux pour les infractions commises à l'encontre de victimes autres que les mineurs et dont la vulnérabilité justifierait une solution identique.
La commission d'enquête estime donc qu'il n'est pas nécessaire de rendre obligatoire cet enregistrement . En tout état de cause , si la possibilité d'appliquer une telle procédure aux adultes vulnérables devait être introduite dans la loi, il serait impératif de préciser que le fait d'effectuer un enregistrement doit être un moyen d'éviter une multiplication excessive d'auditions traumatisantes et non un obstacle à une audition considérée ultérieurement comme nécessaire par le magistrat .
b) Une difficulté majeure : recueillir le témoignage des personnes handicapées mentales
M. Hervé Auchères, magistrat instructeur, le reconnaissait lors de son audition devant la commission d'enquête : les personnes mises en examen « auront tendance à jouer du handicap de l'accusateur pour remettre en cause son témoignage » , rendant extrêmement compliquée pour le juge la manifestation de la vérité.
Dans ce contexte, la commission d'enquête tient à insister sur l'extrême importance que prend pour les victimes la valeur donnée par la justice à leur témoignage. Les magistrats doivent s'efforcer de ne pas écarter a priori la véracité de leurs propos, même s'il est incontestable qu' « au même titre que pour n'importe quel citoyen auditionné par la justice, la crédibilité des propos tenus [par la personne handicapée victime] ne doit être ni exclue a priori ni considérée comme un principe absolu. Comme tout autre citoyen, une personne handicapée est autant capable de mentir que de dire la vérité ».
Mais au-delà de la question de la crédibilité des propos tenus par la personne handicapée, l'instruction des affaires de maltraitance envers les personnes handicapées pose un problème spécifique, qui est celui du recueil du témoignage de la victime, notamment lorsque celle-ci est handicapée mentale ou présente un « défaut d'oralité ».
Mme Marie-Antoinette Houyvet, présidente de l'AFMI 52 ( * ) , estimait que « si le juge, en matière criminelle, est habitué à entendre lui-même la victime, il réussira sans doute à obtenir d'elle la révélation de faits précis. » Mais elle concédait que « compte tenu des difficultés d'expression des personnes handicapées, l'accès à ces informations supposera de la part du juge une grande disponibilité. »
Compte tenu de l'encombrement des cabinets d'instruction, il est toutefois permis de douter de la possibilité pour le juge de trouver tout le temps nécessaire à une véritable écoute de la personne handicapée.
Or, il est évident que le temps nécessaire à une bonne compréhension de la victime sera d'autant plus long que son interlocuteur n'aura aucune expérience du monde du handicap. De ses multiples auditions et déplacements, la commission d'enquête a en effet acquis la conviction qu'une formation spécifique aux problématiques du handicap, et notamment aux difficultés d'expression des personnes handicapées mentales, autistes ou polyhandicapées, est nécessaire pour tous les professionnels susceptibles d'intervenir dans le domaine de la lutte contre la maltraitance.
Une telle formation, concernant les magistrats, ne saurait occuper une place centrale dans l'ensemble de leur formation qui se doit d'aborder avant tout l'ensemble de notre droit dont chacun connaît la complexité. Une sensibilisation au handicap est cependant loin d'être superflue, au moins au niveau de la formation continue.
|
La sensibilisation des magistrats : une urgence « En tant que juges, nous bénéficions d'une formation généraliste au sein de l'école de la magistrature. Par la suite, dans le cadre de la formation continue des magistrats, nous bénéficions de quinze jours de formation obligatoire durant les sept premières années de fonction. Au-delà, la formation devient facultative. Elle n'en reste pas moins accessible. Cette formation continue nous permet de suivre des stages ou des sessions qui sont en relation avec les matières sur lesquelles nous travaillons. « S'il n'est pas aisé d'entendre des enfants ou des personnes handicapées, il n'est pas non plus évident d'entendre des personnes soupçonnées d'appartenir à des réseaux mafieux . Je ne crois donc pas plus en une formation spécifique dans cette matière que dans une autre. Un cabinet de juge d'instruction recèle beaucoup d'humanité. C'est le message que nous devons faire passer. » Extrait de l'audition de Mme Marie-Antoinette Houyvet, présidente de l'AFMI |
Au-delà de la nécessité d'une meilleure formation des magistrats instructeurs, il est indispensable que la justice dispose de professionnels qualifiés - bénéficiant de la qualité d'experts auprès des tribunaux - et davantage spécialisés dans les questions relatives au handicap : de même qu'une personne sourde a besoin d'un interprète en langue des signes, d'autres catégories de personnes handicapées ont besoin d' « interprètes » pour bien faire comprendre leur témoignage.
c) Des règles de prescription inadaptées
Même si un effort d'amélioration des dispositifs de signalement, de contrôle et de prévention est entrepris dans les prochaines années, il est illusoire d'imaginer que les pressions qui s'exercent aujourd'hui sur les victimes disparaîtront totalement. Il est donc permis de penser qu'un nombre encore important d'actes de maltraitance envers des personnes handicapées accueillies en établissements sociaux et médico-sociaux ne sera révélé que tardivement, plusieurs mois, voire plusieurs années après les faits.
C'est la raison pour laquelle la commission d'enquête estime que le constat dressé par M. Hervé Auchères lors de son audition gardera toute son actualité : « il arrive très souvent, lorsque les faits de maltraitance finissent par être dénoncés, ce qui peut prendre jusqu'à cinq, six, dix ou quinze ans, que nous nous heurtions à un problème de prescription. (...) Je dispose de souvenirs assez précis de longues enquêtes, menées par exemple dans des centres d'aide au travail lors d'un changement de direction, qui ont conduit à la révélation de faits de maltraitance commis au cours des dix ou des quinze années précédentes. Les personnes handicapées ne révélaient ces faits que lorsqu'elles étaient interrogées par les services de police ou de gendarmerie, car ces services leur donnaient enfin la possibilité de s'exprimer. Malheureusement, du fait de la prescription de ces faits, les juges d'instruction n'étaient pas en mesure d'entamer une procédure normale. »
Le code de procédure pénale fait en effet courir le délai de prescription de l'action publique à compter du jour où l'infraction a été commise, ce qui, compte tenu des difficultés éprouvées par les victimes à révéler les faits, a trop souvent pour conséquence de les priver de la possibilité d'obtenir la poursuite de leur agresseur.
|
Les règles applicables en matière de prescription de l'action publique Le délai de prescription : Le délai de prescription se calcule à compter du jour où l'infraction a été commise ou, le cas échéant, à compter du dernier acte d'instruction ou de poursuite. Ce délai est de : - 10 ans pour les crimes (article 7 du code de procédure pénale) ; - 3 ans pour les délits (article 8 du code de procédure pénale) ; - 1 an pour les contraventions (article 9 du code de procédure pénale) . Lorsque la partie civile est dans l'impossibilité de provoquer un acte d'instruction susceptible d'interrompre la prescription, celle-ci est suspendue. Cette règle est désormais d'application rare, dans la mesure où les parties ont la possibilité de demander au juge des actes d'instruction (auditions, confrontation...) que le juge ne peut refuser que par ordonnance motivée. Les règles particulières applicables aux infractions commises à l'égard des mineurs : Le délai de prescription en matière de crime commis à l'égard des mineurs ne court qu'à compter de leur majorité. Il en est de même pour un certain nombre de délits limitativement énumérés : les violences, l'empoisonnement, le proxénétisme, le travail forcé, la corruption, les agressions sexuelles, la traite des êtres humains et les atteintes sexuelles sur mineur consentant. Dans ces trois derniers cas, le délai de prescription est par ailleurs porté de 3 à 10 ans, lorsqu'ils ont été commis par une personne ayant autorité. |
Dans des propos certes excessifs, plusieurs intervenants ont souligné la difficulté posée par la prescription des crimes et délits en matière de maltraitance des personnes handicapées.
Ainsi M. Jean-Pierre Picaud, président de la Confédération des personnes handicapées libres s'insurgeait : « dans l'affaire des disparues d'Auxerre, la France a été choquée de constater qu'Emile Louis ne pouvait être condamné pour meurtre sur des personnes vulnérables (dans ce cas, sur des jeunes filles handicapées mentales) car la prescription pour un meurtre est de dix ans. Lorsque ce délai est passé, il n'existe plus le moindre recours. Les crimes contre l'humanité sont considérés comme imprescriptibles. Les infractions aux législations sur les stupéfiants se prescrivent par 30 ans pour les crimes et 20 ans pour les délits. Les agressions sexuelles commises sur les mineurs sont prescrites par dix années. Nous proposons de rendre imprescriptibles les actes de meurtre et de viol sur personnes vulnérables. »
De la même manière, Mme Anne-Sophie Parisot, membre du Collectif des démocrates handicapés, demandait « l'imprescriptibilité des crimes et des délits commis à l'encontre des personnes vulnérables ou, du moins, l'extension du délai de prescription de 10 ans en cas de crimes ou de délits sexuels « aggravés » commis sur des personnes vulnérables, soit à compter de la majorité des victimes, soit, si celle-ci est sous tutelle, à compter du dépôt de la plainte ou de la découverte des faits. »
La commission d'enquête estime qu'il n'est sans doute pas nécessaire d'aller jusqu'à une imprescriptibilité des crimes commis à l'encontre des personnes vulnérables.
Une telle disposition poserait en effet davantage de problèmes qu'elle n'en résoudrait : la prescription de l'action publique, au terme d'un délai donné, se justifie tant par l'inutilité du brassage de souvenirs anciens et douloureux que par l'inefficacité d'une action publique entreprise alors que les preuves de l'infraction se sont effacées.
Il paraît néanmoins souhaitable d'aménager les conditions de prescription de l'action publique lorsqu'elle concerne des infractions commises à l'encontre des personnes vulnérables.
Cet aménagement pourrait être entrepris selon le principe que le doute quant à la date exacte des faits doit profiter à la personne handicapée victime : cet aspect semble particulièrement important eu égard au fait que les personnes handicapées mentales peuvent ne pas avoir de repères temporels solides leur permettant de dater les faits.
Il serait alors possible de prendre comme point de départ du délai de prescription la date de signalement . La commission d'enquête souligne que la Cour de cassation elle-même, faute de date certaine, prend dans un certain nombre de cas pour point de départ du délai de prescription « le jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique » 53 ( * ) .
|
Fixer le point de départ du délai de prescription de l'action publique, en cas de crime commis à l'encontre d'une personne vulnérable, non pas à la date de commission des faits, mais à celle de leur révélation. |
* 47 « Statistiques 2001 sur la maltraitance dans les institutions sociales et médico-sociales » Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, DGAS
* 48 Audition de M. le Professeur Robert HUGONOT, président de Allô Maltraitance (ALMA) France et de M. André LAURAIN, président de l'Association ALMA H 54, le 5 février 2003.
* 49 Rapport au Président de la République de la commission de réflexion sur la justice, 1997, Pierre Truche
* 50 Les prestations sociales et familiales, et notamment l'allocation aux adultes handicapés, sont exclues des ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle.
* 51 Circulaire CRIM 00-16 F1 du 20 décembre 2000, présentant les dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes concernant l'instruction, la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention et le jugement correctionnel.
* 52 Voir glossaire in fine du présent rapport.
* 53 Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 29 octobre 1984, en matière d'abus de confiance et Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 6 février 1997, en matière d'abus de bien social.







