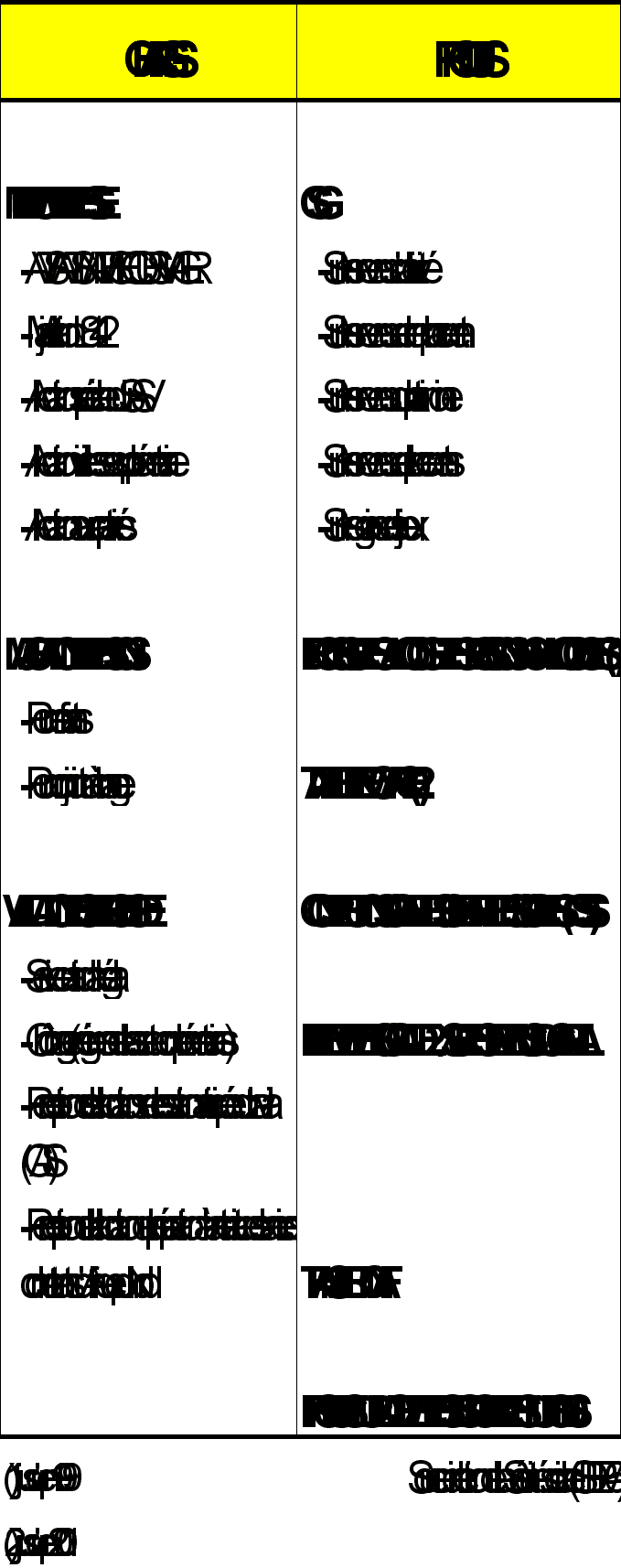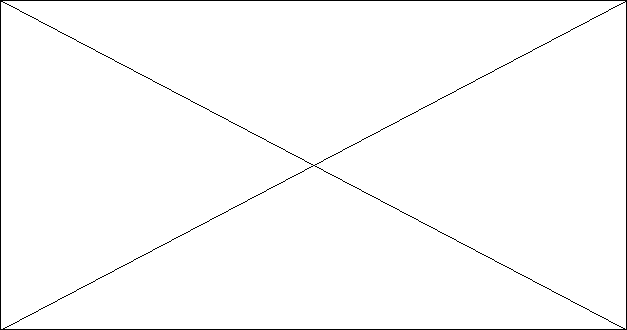II. JUSQU'OÙ DIVERSIFIER LES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX ?
A. SORTIR DES COTISATIONS SOCIALES : AMÉNAGEMENTS TECHNIQUES OU RÉVOLUTION THÉORIQUE ?
1. Les cotisations sociales, ennemies de l'emploi ?
Dans un régime de protection sociale fondé sur l'affiliation professionnelle et organisé de manière paritaire, le financement des risques est assez largement assuré par des cotisations assises sur les salaires, versées par les employeurs et les salariés, et il participe de la théorie du « salaire différé », perçu sous forme de prestations en nature ou en espèces.
Dès sa fondation, la sécurité sociale s'est inscrite dans la logique professionnelle (interprofessionnelle pour le régime général) et paritaire, la structure du financement des régimes reposant quasi uniquement sur des cotisations.
Or, à la fin des années 1980, les pouvoirs publics ont pris conscience que le financement de la protection sociale ne saurait peser davantage uniquement sur l'emploi.
Le premier argument plaidant alors pour une extension de l'assiette des prélèvements sociaux tenait à ce que la logique professionnelle du financement de la protection sociale limitait fortement l'effort d'une partie significative et croissante des bénéficiaires de prestations, notamment les titulaires de revenus de remplacement ou de revenus de placement.
En quelque sorte, le principe de justice sociale commandait qu'une participation soit exigée d'une fraction de la population dont la part des revenus dans la richesse nationale s'était sensiblement accrue depuis la fondation de la sécurité sociale.
Au fil du temps, les revenus distribués aux différentes générations de retraités ont crû de manière sensible entre 1945 et 1990, du fait de mesures de revalorisation et des conditions d'indexation des pensions.
Evolution des revenus des retraites par rapport aux actifs
(en euros)
|
|
1970 |
1979 |
1990 |
1996 |
|
Ménages actifs (1) |
10.519 |
14.635 |
15.855 |
16.007 |
|
Ménages de retraités (2) |
6.555 |
10.519 |
12.806 |
14.635 |
|
(2)/(1) |
62 % |
72 % |
81 % |
91 % |
De même, la rentabilité des capitaux et la part de la rémunération du capital dans le partage de la valeur ajoutée se sont significativement redressées au cours des années 1980.
Les situations des personnes titulaires de revenus de remplacement et de placement s'étant donc relativement améliorées par rapport à celle des salariés, il ne devenait pas illégitime de requérir de ces personnes qu'elles contribuent davantage au financement de la protection sociale.
Le second argument découle en quelque sorte du précédent. Depuis le milieu des années 1970, la situation de l'emploi s'est dégradée, notamment dans les secteurs industriels à fort coefficient de main-d'oeuvre. Il est apparu que le coût du travail, notamment peu qualifié, constituait une entrave à sa demande. Plusieurs études économiques empiriques sur la richesse de la croissance française en emploi sont venues confirmer par la suite ce diagnostic.
Dans le même temps, la situation financière de la sécurité sociale imposait que de nouvelles ressources lui soient affectées. Les pouvoirs publics semblaient ainsi se trouver confrontés à un choix entre équilibre des comptes sociaux et emploi. En réalité, ce choix n'était qu'apparent. La hausse des cotisations n'aboutit pas à une augmentation proportionnée des ressources : elle provoque une destruction de l'emploi et ne permet donc pas l'accroissement des recettes initialement escompté. Il n'y a donc pas d'arbitrage à réaliser entre la protection sociale et l'emploi : sans l'emploi, il n'y a pas de financement possible de la protection sociale.
2. 1991-2001 : l'ampleur d'un changement structurel
Entre 1990, année précédant la création de la CSG, et 2002, la part de la protection sociale financée par les cotisations sociales est tombée de 85 % à 65 % quand, dans le même temps, la part des recettes fiscales passait de 3,1 % à 23,5 % de ce total.
Une autre façon de mesurer cet état de fait est de rappeler l'évolution du taux de « pression sociale » sur cette période.
Le taux de pression sociale 7 ( * )
|
|
1990 |
1995 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Cotisations/PIB |
22,5 % |
22,6 % |
20,4 % |
20,4 % |
20,6 % |
|
Impôts et taxes affectées/PIB |
0,9 % |
2,2 % |
5,7 % |
5,9 % |
5,8 % |
|
(Cotisations+impôts et taxes affectées)/PIB |
23,4 % |
24,8 % |
26,0 % |
26,3 % |
26,4 % |
Source : Compte de la protection sociale - DREES ; comptes nationaux INSEE
Cette présentation globale résume imparfaitement l'ampleur d'un phénomène qui a inégalement affecté les différentes composantes de la protection sociale.
Les régimes de retraite obligatoire complémentaire - notamment l'AGIRC et l'ARRCO - se financent quasi intégralement par des cotisations assises sur les salaires. A titre d'exemple, en 2001, le financement du régime des cadres AGIRC reposait à 92 % sur ces cotisations. Il en est de même des régimes d'indemnisation du chômage (95 %).
Les régimes de retraite de base présentent une situation plus contrastée :
- d'un côté, le régime général, dont les recettes fiscales ne représentent stricto sensu que 0,3 % des ressources, contre 71 % pour les cotisations, mais qui bénéficie de l'effet « fonds sociaux » assurant indirectement 20 % des ressources du régime au moyen de produits fiscaux ;
- de l'autre, un grand nombre de régimes d'origine professionnelle, indépendants ou spéciaux, qui survivent pour la plupart de transferts (compensation, subventions d'équilibre, fiscalité affectée). C'est le cas notamment de nombreux régimes spéciaux, des régimes de commerçants et artisans et in fine des fonctionnaires de l'État.
Le régime des allocations familiales et de l'assurance maladie sont sans doute « les risques » dont le financement repose aujourd'hui le plus sur la fiscalité, puisqu'une petite moitié seulement des ressources de ces branches est encore financée par des cotisations, d'ailleurs exclusivement patronales dans le cas des allocations familiales.
Les différents volets de la fiscalisation progressive des finances sociales ont réduit significativement la force relative des cotisations versées à l'assurance maladie dans les produits de la branche. Alors que les recettes de cotisations représentaient 93 % des recettes de la CNAM en 1990, elles ne s'élèvent plus qu'à 53 % en 2002, alors que dans le même temps les ressources fiscales directes ou indirectes sont passées de 2 % à 43 %.
Cette montée en force des ressources fiscales au détriment des cotisations sociales constitue-t-elle un simple aménagement technique ou au contraire une remise en cause profonde de la protection sociale, et de la sécurité sociale notamment ?
En effet, la légitimité de gestion par les partenaires sociaux est tout à fait évidente dès lors que le financement repose en grande majorité sur le monde du travail. La fiscalisation progressive des ressources de certaines branches a pour conséquence de saper cette légitimité. Dès lors que les ressources sont procurées par l'impôt, quel espace reste-t-il aux partenaires sociaux pour revendiquer la gestion des régimes ?
La création de la loi de financement a pu être considérée comme une conséquence de ce phénomène de fiscalisation. Elle fut d'ailleurs contestée par certaines centrales syndicales. Votre rapporteur ne partage pas cet avis. L'intervention du Parlement était rendue nécessaire par le fait que les masses des prélèvements sociaux échappaient au consentement parlementaire, créant ainsi un déficit démocratique certain.
Sans remettre en cause le fondement de la démocratie participative - les organisations syndicales -, il rappelle que la démocratie représentative s'est construite sur le consentement parlementaire à l'impôt. L'augmentation ininterrompue des cotisations par voie réglementaire, sans intervention des élus du peuple, constituait en soi une anomalie que la loi de financement ne faisait que réparer.
Pour autant, poursuivre plus avant la fiscalisation des prélèvements sociaux est potentiellement porteur d'une modification sensible de la philosophie de la protection sociale dans son ensemble, ou d'un éclatement de celle-ci entre la gestion des risques relevant de l'État et ceux relevant des partenaires sociaux. Une telle évolution ne saurait être l'aboutissement d'ajustements techniques, c'est-à-dire l'augmentation ici ou là d'un impôt affecté à la protection sociale, mais elle doit au contraire susciter un large débat. La France ne fera désormais plus l'économie d'une telle réflexion, même si les différents volets de la fiscalisation des ressources sociales semblent avoir atteint leurs limites.
B. LES TROIS VOLETS DE LA FISCALISATION PROGRESSIVE DES FINANCES SOCIALES
1. La contribution sociale généralisée (CSG) : instrument de la fiscalisation des cotisations salariales
Instrument central de diversification des ressources de la sécurité sociale, la CSG a été créée par les articles 127 à 135 de la loi de finances pour 1991.
Rangé par le Conseil constitutionnel, lors de l'examen de cette loi, dans la catégorie des « impositions de toute nature », ce prélèvement avait comme propriété d'être assis sur une base plus large que les seuls revenus du travail. En effet, il s'appuyait aussi sur les revenus d'activité, de transferts ou de placements et se caractérisait par un taux bas, à l'époque 1,1 %, affecté à la caisse nationale des allocations familiales en contrepartie de la modification du régime de ses cotisations, qui ne comporte désormais plus de part salariale.
En 1993, le gouvernement d'Edouard Balladur a majoré le taux de CSG de 1,3 % en faveur d'un nouveau fonds, le fonds de solidarité vieillesse (FSV), créé pour financer certaines charges des régimes d'assurance vieillesse. Le taux fut donc porté à 2,4 % et n'était pas, cette fois, la contrepartie d'une diminution de cotisations salariales.
Confronté aux difficultés financières de la sécurité sociale, le gouvernement suivant a proposé, dans le cadre du « plan Juppé » un panel de mesures destinées à rééquilibrer la sécurité sociale. Pour assurer son redressement durable, il a décidé de la doter de nouvelles ressources, ou de ressources plus dynamiques, et des efforts furent exigés des usagers et de ses acteurs.
Les mesures financières de sauvegarde du
plan Juppé
Elles visaient, d'une part, à apurer la dette cumulée du régime général, d'autre part, à engager un rééquilibrage des trois branches déficitaires :
la reprise de la dette accumulée par le régime général a été assurée par un établissement public créé à cet effet, la caisse d'amortissement de la dette sociale financée par l'instauration d'une contribution pour le remboursement de la dette sociale au taux de 0,5 %, permettant dans le même temps de libérer le fonds de solidarité vieillesse des charges liées à la prise en charge de la dette de 110 milliards de francs accumulée à fin 1993 ;
le rééquilibrage de la branche retraite a été entrepris au moyen de la prise en charge par le fonds de solidarité vieillesse de dépenses de solidarité incombant au régime général, à hauteur de 11 milliards de francs, à quoi s'ajoutaient la limitation à 2 % de la revalorisation des pensions au 1 er janvier 1996 (0,5 milliard) et l'harmonisation des prises en compte de durée d'activité des polypensionnés (0,2 milliard) ;
le rééquilibrage de la branche famille comportait l'extension de l'assiette de la CSG en 1997, la non-revalorisation des prestations familiales en 1996 (2,6 milliards de francs), l'harmonisation des conditions d'attribution de certaines prestations familiales et des aides au logement (2,4 milliards au total), le transfert à la CNAF de la gestion des prestations servies à leurs agents par l'État et les entreprises publiques (0,7 milliard) et l'imposition des prestations des allocations familiales à compter de 1997, ensuite abandonnée ;
le rééquilibrage de la branche maladie incluait la limitation de l'évolution des dépenses d'hospitalisation et de médecine de ville à celle des prix en 1996 et en 1997 (3,3 milliards), une contribution exceptionnelle des laboratoires pharmaceutiques (2,5 milliards) et d'autre part des médecins (suspension partielle en 1996 de la prise en charge des cotisations familiales des médecins du secteur I (0,4 milliard), affiliation des médecins du secteur II au régime général pour leur assurance maladie (1,4 milliard), et l'harmonisation progressive des cotisations maladie sur les revenus de remplacement avec les cotisations des actifs par une hausse de 1,2 point du taux en 1996 puis en 1997 (7,1 milliards en 1996) ;
en outre, une réduction des dépenses de
gestion était demandée aux caisses de sécurité
sociale (1,5 milliard en 1996).
Dans ce cadre, le législateur a décidé le basculement de 1,3 point de cotisations salariales maladie sur l'augmentation de 1,2 point CSG affecté à ces régimes. Le taux de la cotisation sociale généralisée se trouvait ainsi porté à 3,4 %.
Un an plus tard, une nouvelle majorité parachevait le mouvement engagé six ans auparavant en procédant dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 à une substitution massive :
- diminution du taux de cotisations salariales maladie de 4,75 points contre une augmentation de la CSG sur les revenus d'activité et du patrimoine de 4,1 points ;
- suppression de la cotisation maladie sur les revenus de remplacement contre une hausse du taux de CSG sur ces revenus de 2,8 points.
A l'origine, le bilan de ces basculements fut malaisé à établir, mais finalement, couplé avec l'affectation de droits de consommation sur les alcools à la CNAM, le basculement des cotisations sociales sur la CSG s'est révélé financièrement positif pour l'assurance maladie.
Solde de l'opération de substitution tous
régimes -
Métropole et DOM
(en milliards de francs)
|
Au titre de |
1998 |
1999 |
|
SOLDE |
5,2 |
12,6 |
|
CSG maladie |
208,3 |
239,1 |
|
Droits sur les alcools |
4,8 |
4,7 |
|
Pertes de cotisations sociales |
- 207,8 |
- 231,3 |
Source : Commission des comptes de la sécurité sociale
2. La compensation des allégements de cotisations : instrument de fiscalisation des charges patronales
Depuis une décennie, les pouvoirs publics ont accéléré la mise en place de mesures d'allégement ou d'exonération de cotisations sociales afin d'inciter à l'embauche ou au maintien dans l'emploi de certains salariés.
Depuis le premier dispositif d'exonération de cotisations sociales institué en 1979 en faveur du contrat d'apprentissage, le nombre de mesures de ce type a fortement augmenté. La multitude des contrats aidés date en effet du début des années 1990, suivi de peu par les exonérations ciblées sur les bas salaires.
Initialement, la sécurité sociale assumait financièrement le coût de cette fraction de la politique de l'emploi décidée par l'État. Très rapidement, sa situation financière interdit que davantage d'exonérations soient mises en place sans être compensées aux régimes. La loi du 25 juillet 1994 a posé le principe de la compensation intégrale des allégements et exonérations décidés par l'État. À cette occasion, le Parlement a formellement condamné ce qui reviendra plus tard sous la dénomination de « théorie des retours » : peu importe le bilan financier positif que peut avoir une mesure d'allégement, par exemple en stimulant l'emploi, la sécurité sociale ne doit en assumer aucun coût.
En conséquence, si la sécurité sociale assumait, en 1993, les deux tiers du coût des allégements (1,8 milliard d'euros sur 3 milliards), elle ne supporte plus désormais, du fait de la règle de la compensation intégrale, du moins en affichage, que 2 milliards d'euros sur 21 milliards, somme représentant le coût total des allégements en 2003.
En effet, à partir des années 1996, une stratégie résolue de baisse des charges a été menée en faveur de l'emploi des salariés modestes, notamment par la création de la ristourne sur les bas salaires. Par la suite, les dispositifs relatifs à la réduction du temps de travail (« Robien », puis « Aubry I » et « Aubry II ») ont représenté, en 2002, plus de 10 milliards d'euros 8 ( * ) .
Depuis le 1 er juillet 2003, le dispositif « Fillon » remplace par un allégement unique dégressif, le dispositif d'exonération lié aux trente-cinq heures et la réduction dégressive sur les bas salaires. Au terme de cette réforme, le 1 er juillet 2005, cet allégement unique sera linéairement dégressif en montant jusqu'à 1,7 fois le SMIC, pouvant ramener, pour un salaire au niveau du SMIC, le taux de cotisations patronales de sécurité sociale de 30,2% jusqu'à 4,2 %.
A côté de cet allégement général, des allégements ciblés demeurent sur certaines zones géographiques ou à destination de publics particuliers dont on avait, pour certains, prévu l'extinction. Ainsi, en est-il des zones franches urbaines. Plusieurs lois ou projets de loi, comme la loi du 1 er août 2003 pour l'initiative économique ou le projet portant décentralisation en matière de RMI et création du revenu minimum d'activité, amplifient cette politique d'exonérations ou d'allégements.
Le processus de fiscalisation des cotisations salariales réalisé par le basculement de cotisations maladie et famille sur la cotisation sociale généralisée est en voie d'être accompli pour les cotisations patronales pesant sur les bas salaires et certaines cibles particulières, par les politiques d'allégements.
En effet, la compensation de ces allégements fut réalisée d'abord, par le versement d'une dotation en provenance du budget général jusqu'en 1997 puis, par la suite, partiellement au moyen d'un fonds ad hoc , le FOREC. Or, qu'il s'agisse du budget général, ou surtout du FOREC, l'origine des fonds était de nature fiscale. D'un point de vue des prélèvements sociaux, la compensation des allégements de cotisations constitue bien une modification structurelle majeure.
3. La création du Fonds de solidarité vieillesse : la fiscalisation de certaines prestations non contributives
Confronté aux difficultés financières de la branche vieillesse, le législateur a décidé de séparer, par la loi du 22 juillet 1993, la prise en charge des prestations non contributives des régimes de retraite, devant être financées par la solidarité nationale, des prestations contributives devant être, pour leur part, financées par les cotisations des assurés.
Cette loi prévoyait donc la création d'un fonds spécifique, le fonds de solidarité vieillesse (FSV). La vocation initiale de ce fonds était double :
- prendre en charge des prestations non contributives des régimes d'assurance vieillesse ;
- assurer le service de la dette de la sécurité sociale, en remboursant l'État qui avait lui-même effacé une ardoise de 110 milliards de francs contractée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Dépenses et recettes FSV et leur évolution
Pour prendre en charge ces deux dépenses, le fonds de solidarité vieillesse se voyait doté de deux ressources essentielles : le produit d'une augmentation de CSG de 1,3 % et l'affectation des droits de consommation sur les alcools, dits « droits 403 », dont bénéficiait précédemment le budget général.
Lors de la création de la CADES en 1996, le FSV fut déchargé du remboursement de la dette de 1993. Ainsi, les transferts au bénéfice du régime général ont pu être majorés, notamment par le relèvement de l'assiette servant de base à la validation des périodes assimilées au chômage et au service national de 60 % à 90 % de la valeur du SMIC. Cette mesure a généré un transfert supplémentaire vers les régimes de retraite estimé à 11,5 milliards de francs (1,75 milliard d'euros) en 1996.
Dans le même temps, le remboursement de la dette, ancienne et nouvelle, était assuré par la CADES, c'est-à-dire par une nouvelle ressource fiscale.
Votre rapporteur ne procèdera pas ici à une analyse détaillée de la CADES, qui a fait l'objet d'une mission de contrôle 9 ( * ) au printemps dernier.
La création de cette caisse pourrait à bien des égards constituer un exemple de la création de ces fonds qui, avec le FSV, ont permis le financement de la protection sociale au moyen de recettes fiscales (fonds de financement de la couverture maladie universelle, pour le volet complémentaire de cette dernière). Toutefois, la CADES, par sa nature, met en avant la limite atteinte par cette stratégie de diversification.
La contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) est à n'en pas douter une recette fiscale de la sécurité sociale, pesant sur l'ensemble des revenus, par un taux bas (0,5 %). Mais dans le même temps, elle constitue l'amortissement d'une somme déjà consommée (53 milliards d'euros) dont la charge pèsera sur les générations futures. Sous cet aspect, elle ne constitue pas un élément de diversification des finances sociales mais l'indice d'une fuite en avant dangereuse : la France peut-elle supporter, à côté d'un budget général dont l'endettement va croissant et qui n'a plus réalisé un excédent depuis vingt ans, le coût d'une protection sociale incapable d'équilibrer ses charges et qui, elle aussi, doit recourir aux services d'une caisse de refinancement permanente ?
Votre rapporteur ne le pense pas.
C. L'AFFAIRE FOREC : LES LIMITES DE LA PROGRESSION DES PRELÈVEMENTS SOCIAUX
1. L'abandon masqué de la compensation intégrale
La tentative d'abandon du « garde fou » institué par la loi Veil de 1994 constitue le premier volet de ce que votre rapporteur appellera une dernière fois « l'affaire FOREC ».
A l'occasion d'une mission de contrôle sur ce fonds, notre ancien collègue Charles Descours avait démontré, par la saisie de documents au ministère des finances, que cette administration craignait avant tout que la mise en place des trente-cinq heure ne se traduise par une dégradation de grande ampleur de l'équilibre du budget de l'État.
Aussi fut-il annoncé ouvertement, dans un premier temps, que la sécurité sociale - et le régime d'assurance chômage - contribueraient directement au financement des trente-cinq heures. Cette position s'appuyait sur la justification que la réduction du temps de travail produit, par l'augmentation de la main-d'oeuvre, une bonification des recettes sociales. Sous la pression des partenaires sociaux, peu convaincus par une argumentation qui éludait les conséquences, pour le produit des cotisations, de la modération salariale accompagnant la RTT, cette déclaration fut retirée. Mais la volonté dolosive à l'égard des comptes sociaux de les faire participer à ce financement demeurait, et elle fut mise en oeuvre au moyen de circuits financiers opaques.
Sans détailler à nouveau l'ensemble des dysfonctionnements ayant accompagné la mise en place de ce fonds 10 ( * ) , votre rapporteur rappellera :
- que les organismes de sécurité sociale, notamment le FSV et la CNAMTS directement, la CNAF et la CNAVTS indirectement, ont cédé des recettes au financement des trente-cinq heures. En 2002, votre rapporteur avait chiffré, par reconstitution des comptes, l'ensemble de ce coût à 4,5 milliards d'euros annuels (30 milliards de francs) pour la sécurité sociale ;
Exercice 2002
|
(en millions de francs) |
CNAMTS AM |
CNAMTS AT |
Total CNAMTS |
CNAVTS |
CNAF |
Total RG |
FSV |
FOREC |
|
Compensation intégrale des exonérations de cotisations FOREC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Répartition du prélèvement social de 2 % sur la base CMU (valeurs 2002) |
3.696 |
|
3.696 |
4.620 |
2.904 |
11.220 |
- 2.640 |
|
|
Répartition droits tabac sur base CMU (valeurs 2002) |
4.203 |
|
4.203 |
|
|
4.203 |
|
- 4.203 |
|
Répartition droits alcools CNAMTS et FSV (valeurs 2002) |
5.805 |
|
5.805 |
|
|
5.805 |
11.900 |
- 17.705 |
|
Répartition CSG entre CNAMTS et FSV |
- 8.574 |
|
- 8.574 |
|
|
- 8.574 |
13.190 |
|
|
Transfert au FSV de la dette de l'État envers l'AGIRC et l'ARRCO |
|
|
|
|
|
|
- 3.000 |
|
|
Transfert « croisé » MARS - FASTIF entre la CNAF et l'État |
|
|
|
|
- 5.500 |
- 5.500 |
|
|
|
Transfert majorations de pensions FSV - CNAF |
|
|
|
|
- 6.000 |
- 6.000 |
6.000 |
|
|
Taxe sur les contributions employeurs (financement des prestations complémentaires de prévoyance) FSV - FOREC |
|
|
|
|
|
|
2.900 |
- 2.900 |
|
Transfert taxe sur les véhicules à moteur CNAMTS - FOREC |
5.900 |
|
5.900 |
|
|
5.900 |
|
- 5.900 |
|
Total |
11.030 |
0 |
11.030 |
4.620 |
14.404 |
30.054 |
22.350 |
- 30.708 |
|
Soldes PJLFSS 2002 |
- 13.113 |
3.450 |
- 9.662 |
6.671 |
8.114 |
5.123 |
- 4.014 |
0 |
|
Soldes « révisés » |
- 2.083 |
3.450 |
1.368 |
11.291 |
22.518 |
35.177 |
18.336 |
- 30.708 |
|
Cumul F2R après modification des dispositions CNAVTS et FSV 2000 et 2001 : 100 milliards de francs (PJLFSS 86 milliards) |
||||||||
- qu'en plus de cette participation, le FOREC s'est trouvé, en 2000, dans l'impossibilité de faire face à ses charges car il avait été sous-doté de 2,2 milliards d'euros que le gouvernement d'alors prétendait ne pas rembourser aux organismes sociaux. Ces créances seront remboursées par la CADES, c'est-à-dire, à bien des égards, par la sécurité sociale elle-même.
Sans revenir sur l'irresponsabilité du gouvernement précédent ayant gravement fragilisé les comptes sociaux, votre rapporteur soulignera l'extrême difficulté du budget général à financer, aujourd'hui, plus de 15 milliards d'euros annuels d'exonérations de cotisations sociales.
La suppression du FOREC décidée en 2004 se fait dans des conditions de transparence satisfaisantes puisque la compensation sera effectuée à l'avenir comme elle l'était antérieurement à 1997, par dotation budgétaire. L'épisode du FOREC se solde tout de même par une perte de recettes significative pour la sécurité sociale, environ 5 milliards d'euros annuels, le budget récupérant, avec les charges du FOREC, les produits qui lui sont affectés, y compris ceux distraits aux régimes sociaux.
Cet épisode doit attirer l'attention du législateur sur l'extrême vigilance avec laquelle il doit consentir des allégements de cotisations dont la charge, pour l'équilibre des finances publiques, atteint désormais un sommet.
Le législateur doit également s'attacher à ce que le principe de compensation intégrale soit respecté sans entorse.
2. L'échec de la réforme des cotisations patronales
Le deuxième volet de « l'affaire FOREC » est constitué par la réforme imaginaire des cotisations patronales. Durant la campagne électorale de 1997, l'équipe de Lionel Jospin avait pris l'engagement de procéder à une réforme ambitieuse des cotisations patronales, notamment en asseyant le calcul de ces dernières sur la valeur ajoutée.
Grâce à deux rapports qui se sont (opportunément ?) neutralisés - le rapport Chadelat, favorable à un passage progressif à une assiette valeur ajoutée, et le rapport Malinvaud, défavorable à une telle évolution -, l'assiette des cotisations patronales de sécurité sociale est restée assise sur les seules rémunérations.
La dénomination initiale du FOREC était « fonds de financement de la réduction du temps de travail » . Ainsi que l'avait déjà noté Charles Descours, « le choix de l'intitulé « fonds de financement de la réforme des cotisations patronales » présentait l'avantage de faire accroire qu'une telle réforme avait eu lieu puisque l'on était au stade de son financement. Il n'en est évidemment rien : le calcul des cotisations patronales n'est aucunement affecté par un élément « valeur ajoutée », un élément « pollution » ou un élément « bénéfices » ni, a fortiori, par un élément « tabac » ou « alcool ». En revanche, le coût des exonérations de cotisations sociales accordées dans le cadre de la réduction du temps de travail est bien financé en 2000 par quatre impositions affectées (tabacs, droits sur les alcools, contribution sociale sur les bénéfices, taxe générale sur les activités polluantes) que sont venus compléter en 2001 deux prélèvements supplémentaires (une fraction de la taxe sur les conventions d'assurance et la taxe sur les véhicules de sociétés) ».
Le gouvernement d'alors a bien évidemment prétendu qu'il s'agissait là d'une réforme ambitieuse des cotisations patronales, en affectant au remboursement des allégements les produits de quelques « rossignols de la fiscalité », c'est-à-dire des taxes à la constitutionnalité incertaine et au rendement décroissant.
En aucun cas le FOREC ne constituait une réforme ambitieuse des cotisations patronales mais symbolisait, en toute évidence, la caricature d'un engagement important - le calcul des cotisations sur la valeur ajoutée - qui, pour des raisons économiques majeures, avait été ajourné.
Ce deuxième aspect de l'affaire FOREC constitue en tout cas pour votre rapporteur l'indice irréfutable que l'opportunité d'une réforme des cotisations sociales par substitution d'assiette devenait économiquement réfutable et que, désormais, les nouvelles prestations devraient être financées au moyen d'économies.
Ce jugement est d'ailleurs renforcé par l'évolution progressive des fonds sociaux, et notamment du FSV, sur la fin de la législature. Celui-ci s'est trouvé progressivement asséché au profit non seulement du FOREC mais d'autres financements, dont l'allocation personnalisée d'autonomie, à laquelle il a dû céder 0,1 point de CSG et à laquelle il doit depuis un déficit structurel.
Le bilan de l'évolution des finances sociales au cours de la dernière décennie peut donc être dressé de la manière suivante :
- les périodes de ralentissement économique se traduisent par des crises majeures des finances sociales ;
- ces crises ont été résolues à court et moyen termes par l'apport de recettes nouvelles, notamment de caractère fiscal, et par l'endettement ;
- pour autant cette « bouffée d'oxygène » s'est rapidement trouvée raréfiée du fait de l'extension importante des dépenses sociales au cours de la dernière législature (couverture maladie universelle, allocation personnalisée d'autonomie et, bien sûr, compensation de la hausse du coût du travail constituée par les trente-cinq heures) : la législature 1997-2002 fut, en matière de finances sociales, une fuite en avant ;
- mais structurellement, cette fuite en avant s'inscrit dans un contexte propre aux finances publiques françaises et souligne les limites de l'augmentation, ininterrompue sur trente ans, des prélèvements sociaux. Comme le dit l'adage, « les arbres ne montent pas jusqu'au ciel » .
* 7 Ce taux ne se limite pas aux seules ASSO.
* 8 Pour mémoire, en 2002, les allégements « Aubry I » et « Aubry II » relatifs au financement des trente-cinq heures représentaient 96 % des sommes consacrées à la réduction du temps de travail, contre 4 % pour le dispositif « Robien »
* 9 Alain Vasselle, La CADES nouvel enjeu des finances sociales ?Rapport de la Commission des Affaires sociales. Session 2002-2003, rapport n°248
* 10 Rapport de M. Charles Descours, Les fonds sociaux, Sénat, n° 382 - Session 200-2001.