PROGRAMME DE LA JOURNÉE DES ENTREPRISES DU JEUDI 16 MARS 2017 AU SÉNAT

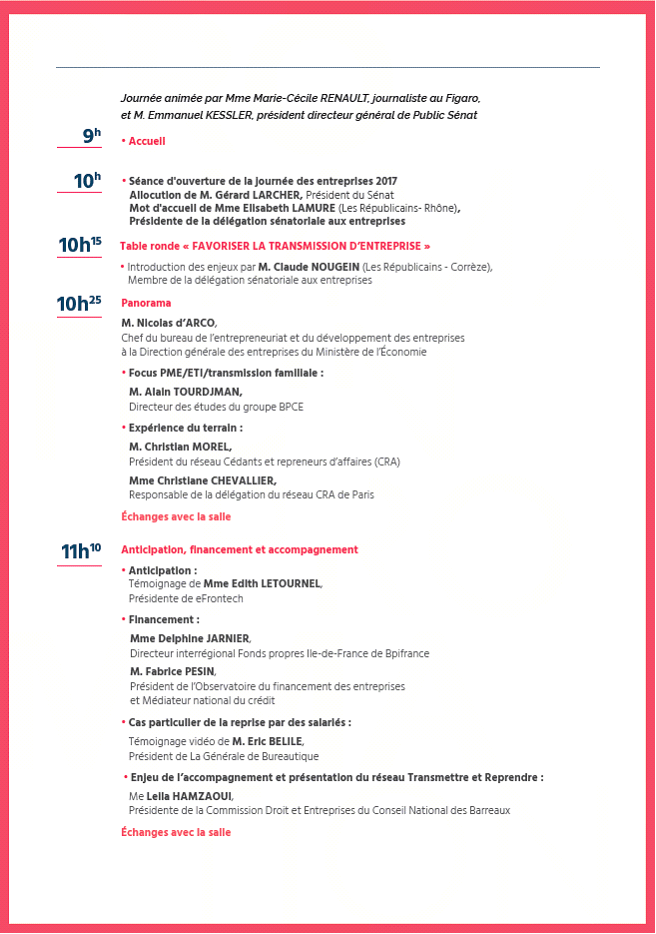
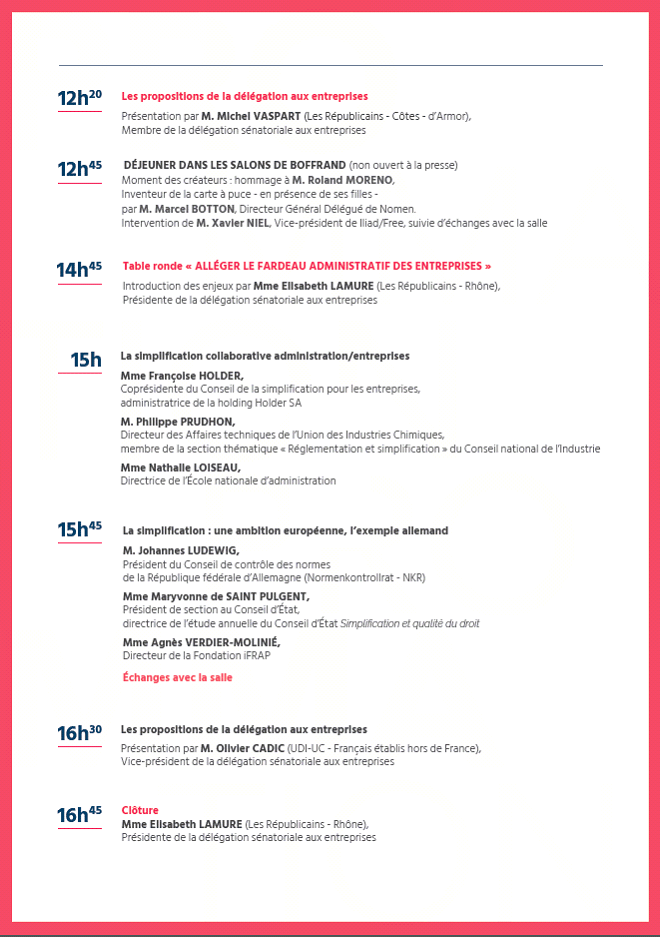
COMPTE-RENDU DE LA JOURNÉE
M. Gérard Larcher , président du Sénat . - Madame la présidente de la délégation aux entreprises, chère Élisabeth Lamure, monsieur le président de la commission des affaires économiques, cher Jean-Claude Lenoir, chers collègues sénateurs, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, mesdames, messieurs, je suis heureux de vous accueillir pour cette deuxième Journée des entreprises, organisée au Sénat par notre délégation aux entreprises.
Nous avons proposé de créer cette délégation à la fin de l'année 2014, sur mon initiative, car aucune structure du Sénat ne traitait auparavant des entreprises dans leur globalité, alors qu'elles sont les moteurs du développement économique de notre pays et de la préservation du modèle social. En un peu plus de deux ans d'existence, cette délégation a démontré toute son utilité, d'abord en allant à la rencontre des chefs d'entreprise dans de nombreux départements, mais aussi d'entrepreneurs français établis dans d'autres pays de l'Union européenne, à Londres, à Bruxelles, à La Haye, en Allemagne et en Suède.
Les sénateurs de la délégation ont relayé avec force au sein de notre assemblée et à l'extérieur les préoccupations que les chefs d'entreprise ont exprimées. Ils ont conduit plusieurs études et pris des initiatives législatives, en particulier pour évaluer nos modes de relations sociales dans l'entreprise, développer l'apprentissage et simplifier les normes qui brident la croissance des entreprises françaises.
La délégation a clos cette session parlementaire en publiant deux rapports, l'un pour faciliter la transmission et la reprise des entreprises, l'autre pour poursuivre les démarches de simplification visant à libérer les entreprises, deux thèmes qui structureront les débats de cette journée. À son initiative, le Sénat vient également de débattre avec le Gouvernement pour dresser un bilan, disons-le, en demi-teinte du « choc de simplification » qui avait été annoncé par le Président de la République, les effets concrets n'étant pas à la hauteur des espérances.
À travers ses différents travaux, aux côtés des commissions et des autres délégations du Sénat, la délégation aux entreprises porte un message que je partage : il est urgent d'agir pour moderniser notre cadre économique et social, pour redonner des perspectives juridiques et fiscales claires aux entreprises, pour leur redonner de la compétitivité. C'est ainsi que notre pays pourra retrouver enfin un niveau de croissance plus soutenu pour créer de la richesse et préserver notre cohésion sociale.
Comme la délégation, je ne me satisfais pas que la France occupe seulement le 115 e rang sur 138 dans le classement du Forum économique mondial sur le poids de la réglementation. Nous avons là des marges de manoeuvre évidentes pour redonner des perspectives à notre pays, sans créer de dépenses publiques supplémentaires, car nous ne pouvons plus nous le permettre : nous sommes déjà, en ce domaine, champion d'Europe, quasi ex aequo avec la Finlande, avec des dépenses qui représentent près de 57 % du PIB, un déficit et une dette très élevés et un taux de prélèvements obligatoires supérieur à la moyenne de nos concurrents européens.
Les présidents des Parlements nationaux des vingt-sept pays de l'Union européenne se réuniront à Rome cet après-midi et je devrai bientôt vous quitter en conséquence. Sans convergence fiscale et sociale entre pays européens, nous traînerons derrière nous un boulet qui nous ralentira. C'est un des sujets que nous aborderons : quelles peuvent être les perspectives de l'Union européenne ?
Le modèle français est-il une réussite ? La réponse est clairement non, et je le mesure chaque semaine en me rendant dans les départements à la rencontre des élus locaux et de nos concitoyens.
Même si l'INSEE a annoncé une baisse légère du chômage en 2016, je ne me résous pas à un taux qui frôle toujours les 10 % et qui dépasse 23 % chez les jeunes. L'ancien ministre du travail que je suis sait bien que ces chiffres sont fatidiques pour notre cohésion sociale.
Je ne me résous pas à voir des pans entiers de notre territoire décliner économiquement et se sentir laissés de côté, méprisés.
Je ne me résous pas à ce que certains de nos concitoyens se sentent presque « abandonnés » par les politiques publiques. Il y a un an, un élu territorial m'a dit à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, que nous ne légiférions que pour quelques métropoles et quelques régions puissantes. Le Sénat, assemblée des territoires, doit se sentir interpellé !
Alors, oui, il nous faut réformer, réduire la fracture territoriale et redresser notre économie ! Mais ce ne sera pas en injectant massivement des crédits publics, que nous financerions à crédit.
La semaine dernière, lors d'une réunion sur l'avenir de la voie fluviale, nous avons comparé l'investissement annuel pour les canaux à grand gabarit et l'entretien des canaux non touristiques : la France investit 150 millions d'euros, contre 1,5 milliard d'euros pour l'Allemagne. Cela résume l'état dans lequel nous sommes, car le fluvial est très important pour une partie de notre économie. Mes collègues Jean-Claude Lenoir et Jean-Paul Émorine le savent bien : voilà vingt-cinq ans que nous tenons le même discours, mais aucune décision n'a été prise, hormis le canal Seine-Nord Europe, lequel a été voulu par des collectivités territoriales et deux régions.
Les élus locaux vivent comme vous l'instabilité législative et réglementaire, notamment les changements incessants pendant huit ans de leur périmètre d'action. Nous avons tenu sur ce sujet une réunion avec Mme Françoise Gatel, qui occupe des responsabilités importantes au sein de l'AMF, l'Association des maires de France. La variabilité des normes a coûté 1,3 milliard d'euros aux collectivités territoriales pour la seule année 2015 !
Comme les chefs d'entreprise, les collectivités locales subissent de plein fouet le poids des normes et la logique de contrôle tatillon de l'État, alors que celui-ci devrait être un partenaire de confiance au service du développement des territoires. C'est donc logiquement que, depuis 2014, le Sénat s'est engagé au côté des collectivités territoriales, comme des chefs d'entreprise, pour leur redonner des perspectives et engager des démarches de simplification. Je suis en effet convaincu que la confiance doit être la matrice de notre action publique en faveur des entreprises. Sans confiance, nous ne parviendrons pas à atteindre le niveau de croissance auquel nous pouvons prétendre ! Et c'est aussi l'objectif de cette journée des entreprises que de consolider la relation de confiance que le Sénat souhaite établir avec les entrepreneurs. Nous entendons poursuivre les démarches engagées depuis deux ans, car nous pensons, au Sénat, dans la diversité de nos sensibilités politiques, que la simplification et la stabilisation de nos règles de droit sont un enjeu majeur.
Il a beaucoup été question des Pays-Bas ces derniers jours, et j'ai respiré hier soir en prenant connaissance des résultats électoraux. Ce pays, comme le Royaume-Uni, a adopté une démarche : ne pas créer de norme nouvelle sans en faire disparaître entre une et trois. Les Pays-Bas, dans le domaine des entreprises et des collectivités territoriales, ont réussi leur pari.
Pour renouer avec un taux de croissance plus élevé, pour abaisser durablement le niveau de chômage et préserver notre cohésion sociale, nous aurons besoin de vous, les entrepreneurs, qui êtes source de cette réussite nommée confiance, croissance, richesse et cohésion sociale. Notre cap, au Sénat, ne variera pas, et je pense que vous le partagerez : nous serons aux côtés des entrepreneurs et des forces vives de notre pays pour développer l'économie et les territoires.
Je vous souhaite une très belle journée d'échanges au Sénat. À ceux qui se posent la question de la pertinence du bicamérisme, je réponds que le territoire, ce n'est pas simplement le seigle et la châtaigne. Le Sénat représente le territoire dans sa diversité : sans activité économique, le territoire ne peut pas vivre. Nous sommes sans doute appelés à une révolution dans nos têtes. La délégation aux entreprises du Sénat jouera pleinement son rôle. Très bonne journée et très bon travail tous ensemble !
Mme Élisabeth Lamure , présidente de la délégation sénatoriale aux entreprises . - Mes chers collègues, mesdames, messieurs, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement le président du Sénat de s'être rendu disponible pour ouvrir cette journée. Il marque ainsi l'importance que le Sénat accorde aux entreprises. C'est en effet sur l'impulsion de M. Gérard Larcher que cette délégation sénatoriale aux entreprises a vu le jour il y a près de deux ans et demi.
La délégation aux entreprises a reçu pour mission d'informer le Sénat sur la situation et les perspectives de développement des entreprises, de recenser les obstacles à leur développement et de proposer des mesures pour favoriser la croissance et l'emploi dans les territoires. Les quarante-deux sénateurs qui la composent sont désignés à la représentation proportionnelle des groupes politiques.
Sa méthode de travail la distingue de tous les autres organes internes au Sénat : sa marque de fabrique est d'aller régulièrement sur le terrain pour ensuite porter la voix des entreprises au Sénat. Pas celle des plus grandes, ni celle des lobbies patronaux, qui ont souvent les moyens de se faire entendre au Parlement, mais celle de toutes vos entreprises, de taille petite, moyenne ou intermédiaire. Depuis janvier 2015, la délégation est ainsi allée à la rencontre de 300 entrepreneurs français, dont plusieurs d'entre vous, dans une douzaine de départements ainsi qu'à Londres, en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas et à Bruxelles. Plusieurs rapports ont permis de faire connaître publiquement vos sujets de préoccupation.
Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui au Sénat, pour cette deuxième édition de la journée des entreprises. Merci de vous être déplacés jusqu'ici, de loin pour certains d'entre vous : vous représentez près de quarante départements français, ce dont je me félicite.
C'est un moment privilégié d'échanges qui s'ouvre devant nous. Nous l'avons expérimenté l'an passé. Je ne doute pas qu'il en sera de même aujourd'hui. Notre journée a pour objet de valoriser l'entreprise et d'encourager son développement : cette année, elle sera l'occasion de chercher ensemble comment faciliter la transmission d'entreprise - c'est l'objet de notre matinée - et comment simplifier votre environnement administratif - ce sera le sujet de l'après-midi. Le déjeuner nous offrira également l'occasion de célébrer l'innovation et les créateurs d'entreprise.
Je ne veux pas plus retarder le commencement de nos travaux, et je laisse à Mme Marie-Cécile Renault, journaliste au Figaro , le soin d'animer la table ronde consacrée à la transmission d'entreprise. Je vous souhaite une excellente journée !
TABLE RONDE « FAVORISER LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE »
M. Claude Nougein , membre de la délégation sénatoriale aux entreprises . - Chers collègues, mesdames, messieurs, la délégation aux entreprises a été, je le rappelle, créée en 2014 à l'initiative du président Gérard Larcher. Son objectif est d'aller à la rencontre des entrepreneurs, d'aller à votre rencontre sur votre terrain, dans vos entreprises, partout en France.
Lors de nos déplacements en région, plusieurs d'entre vous nous ont fait part des difficultés qu'ils rencontraient dans la transmission de leur entreprise. Parfois, ces difficultés étaient d'ordre fiscal, parfois elles étaient d'ordre administratif, d'autres fois encore d'ordre financier. Certes, ces difficultés peuvent prendre des formes différentes selon que vous dirigez une TPE, une PME ou une ETI, mais nous avons pu constater que, quels que soient la taille, le lieu d'implantation ou la structure de l'entreprise, ces difficultés existent. La délégation aux entreprises a donc jugé important de confier à mon collègue Michel Vaspart et à moi-même le soin de travailler sur le sujet de la transmission en n'en négligeant aucun aspect, en ne délaissant aucun secteur et en s'intéressant à tous les types d'entreprises. Notre rapport a été publié cette semaine et se trouve à votre disposition à l'entrée de la salle.
Dans le passé, de nombreux rapports ont été produits sur la transmission, mais la plupart d'entre eux traitaient des TPE et des petites PME, certes très nombreuses. Nous avons donc souhaité apporter un éclairage particulier sur les ETI et les grosses PME, souvent oubliées, sachant qu'elles emploient en France plus de 7,5 millions de salariés.
Nous avons voulu aborder la question de la transmission de façon très exhaustive. Nous avons ainsi passé en revue tous les types de transmissions : la transmission familiale comme la cession aux salariés ou à un repreneur tiers, de la TPE artisanale à l'ETI industrielle. Une ETI qui s'étiole dans une région isolée et qui finit par fermer, cela occasionne des dégâts considérables en termes d'emplois - directs et indirects - comme en termes d'aménagement du territoire.
Nous avons travaillé plus de cinq mois et auditionné plus de quatre-vingts personnes : spécialistes du financement, spécialistes de l'accompagnement, juristes, fiscalistes, représentants des ETI, des PME tout comme des représentants du monde artisan, industriel ou agricole.
Les enjeux de la transmission sont nombreux. Près de 20 % des dirigeants de PME sont âgés de plus de soixante ans et plus de 60 % des dirigeants d'ETI ont plus de cinquante-cinq ans : le nombre d'entreprises qui seront sur le marché de la transmission augmentera considérablement ces prochaines années. Or, quelle que soit l'entreprise, le moment de la transmission est une période délicate pour l'économie locale : une entreprise qui ne trouve pas de repreneur, c'est une entreprise qui ferme, un bassin d'emplois qui souffre, un savoir-faire qui disparaît. Même lorsqu'un repreneur est trouvé, le risque ne s'évanouit pas pour autant : la recherche d'économies d'échelle peut inciter le nouveau propriétaire à opérer des restructurations, voire des délocalisations, qui ont un impact immédiat sur les emplois directs et indirects locaux.
L'enjeu de la transmission est donc tout autant économique que social et territorial. Fluidifier la transmission en France, vous aider, vous, chefs d'entreprise, à anticiper et à financer la reprise, c'est protéger notre savoir-faire et favoriser le maintien dans nos territoires d'entreprises dynamiques.
Nous l'avons vu lors de nos déplacements : les Français ont souvent trop peu conscience du dynamisme économique de nos régions. Certains d'entre vous viennent parfois de régions enclavées et sont pourtant à la pointe de l'innovation technologique en Europe et dans le monde. Il y a parmi vous, en région, de véritables « pépites » françaises qu'il nous faut conserver et protéger.
Nous avons identifié six obstacles auxquels étaient confrontés acteurs publics et privés en matière de transmission et de reprise d'entreprises en France. Certaines de ces difficultés seront certainement illustrées et développées par nos intervenants aujourd'hui.
Première difficulté : le manque de statistiques fiables sur la réalité de la transmission en France. Nous n'avons que des informations parcellaires sur le nombre d'entreprises et les secteurs ou les territoires potentiellement concernés par des difficultés de transmission. Par exemple, il a été très difficile de savoir combien notre pays comptait d'ETI. Nous ne disposons d'aucune statistique, mais nous estimons qu'elles sont autour de 5 000.
On estime à 60 000 le nombre de transmissions par an en France, mais ce chiffre est plus le fruit d'un consensus que le résultat d'un décompte officiel. L'INSEE ne publie plus de statistiques sur le sujet depuis 2006 et, à quelques exceptions près, aucune donnée chiffrée territoriale n'est disponible, ce qui rend difficile une action ciblée des pouvoirs publics. Voilà pourquoi nous avons souhaité consacrer le premier moment de notre matinée à un bref état des lieux de la transmission en France avec des experts, qui pourront nous donner, malgré le manque de statistiques, un aperçu de la réalité de la reprise en France aujourd'hui.
Deuxième difficulté : le manque de communication autour de la reprise. Reprendre une entreprise est moins risqué économiquement que d'en créer une nouvelle de toutes pièces. Reprendre une entreprise est également particulièrement noble, puisque le repreneur contribue au maintien d'un savoir-faire et d'emplois sur un territoire. Pourtant, la reprise est moins valorisée dans les cursus académiques que la création, et peu de jeunes entrepreneurs semblent formés et informés des possibilités de reprise.
Troisième difficulté : le manque d'anticipation, tant des cédants que des repreneurs. Une transmission réussie doit se préparer idéalement entre cinq et dix ans à l'avance. Deux ans, c'est un minimum selon l'ensemble des personnes que nous avons entendues.
Quatrième difficulté : le financement. Malgré un desserrement du crédit, certains secteurs, notamment l'artisanat en milieu rural, continuent de nous faire part d'un manque d'engagement de certaines banques, ce qui oblige souvent les entreprises à trouver des financements complémentaires.
Cinquième difficulté : le cadre fiscal et économique inadapté à la transmission. Les obstacles dont on nous a fait part ne concernent pas que les droits de mutation et le pacte « Dutreil », mais également l'ensemble de la fiscalité qui touche en amont et en aval la transmission : impôt sur les sociétés, impôt de solidarité sur la fortune, contributions sociales, etc. C'est toute une économie fiscale de la reprise d'entreprise qu'il faudrait réformer pour fluidifier la transmission en France.
L'inadaptation fiscale est surtout cruciale pour les ETI. C'est probablement la raison essentielle du petit nombre d'ETI en France, alors que l'Italie en compte deux fois plus et l'Allemagne trois fois plus.
Sixième difficulté : le soutien inégal à la reprise interne par les salariés. Celle-ci est souvent gage de réussite et de maintien des emplois dans nos territoires. Il faut pouvoir accompagner la reprise salariale différemment, par des incitations, des formations et des simplifications, et non par des obligations telles que le droit d'information préalable, qui a fait l'unanimité contre lui lors des auditions. Quant au délai de deux mois qui s'y attache, il est au choix soit trop long, soit trop court !
La deuxième partie de la matinée sera justement consacrée à l'anticipation, au financement et à l'accompagnement et permettra d'identifier les besoins que nous avons en la matière. Vous y verrez notamment une vidéo retraçant notre récent déplacement à Nantes pour rencontrer un chef d'entreprise qui compte transmettre progressivement son entreprise à ses salariés. La séquence résume bien les difficultés administratives, financières et fiscales auxquelles certains d'entre vous sont confrontés.
Mon collègue Michel Vaspart clôturera cette matinée en vous présentant certaines des propositions de la délégation aux entreprises pour moderniser et fluidifier la transmission d'entreprise en France, afin que nos territoires puissent garder le tissu économique qui constitue leur force.
Première séquence - Panorama de la transmission d'entreprises
Mme Marie-Cécile Renault, journaliste au Figaro . - L'objet de cette première séquence, que M. Claude Nougein, rapporteur, vient d'introduire, est d'abord de dresser un panorama de la transmission d'entreprise. Nous allons commencer par entendre Nicolas d'Arco, chef du bureau de l'entrepreneuriat et du développement des entreprises à la Direction générale des entreprises de Bercy. On parle beaucoup de création d'entreprise, sujet très populaire, notamment parmi les jeunes. En revanche, on parle très peu de transmission. Pourquoi ? N'est-il pas plus simple de reprendre une entreprise que d'en créer une ex nihilo ?
M. Nicolas d'Arco, chef du bureau de l'entrepreneuriat et du développement des entreprises à la direction générale des entreprises du ministère de l'économie . - Je remercie la délégation sénatoriale aux entreprises de son invitation.
La direction générale des entreprises a pour mission de proposer et de mettre en oeuvre des politiques pour favoriser la compétitivité et le développement des entreprises. C'est à ce titre qu'elle a été chargée d'élaborer, avec de nombreux acteurs présents aujourd'hui, un certain nombre de mesures en faveur de la transmission-reprise.
À l'heure actuelle, la dynamique entrepreneuriale en France est bonne. Le statut social du dirigeant d'entreprise est désormais considéré. Les créations d'entreprises sont à leur plus haut niveau depuis 2011. Le nombre de créations d'entreprises, hors micro-entrepreneurs, n'a jamais été aussi élevé. Des populations particulières se tournent de plus en plus vers l'entrepreneuriat. Le nombre de jeunes entrepreneurs a été notamment multiplié par trois depuis 2005, et par cinq parmi les étudiants.
La transmission d'entreprise reste, elle, en marge de cette dynamique très positive. La transmission-reprise des petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises de taille intermédiaire (ETI) reste stable ou en croissance modérée. De manière plus préoccupante, la transmission des très petites entreprises est en baisse depuis plus de dix ans.
En ce qui concerne les statistiques, nous ne disposons pas de données nationales précises. Il revient notamment au législateur d'accorder à l'INSEE l'accès aux données désormais récoltées dans le cadre de la transposition de la quatrième directive sur la lutte anti-blanchiment.
Il existe une différence entre la création et la reprise d'entreprise. La seconde se distingue de la première en ce sens qu'elle est moins risquée : en effet, le taux de succès des reprises est plus élevé que celui des créations. Par ailleurs, le financement de la reprise est possible même avec des fonds propres limités grâce aux dispositifs financés par l'État et la Caisse des dépôts et consignations. On peut, avec les garanties et les aides territoriales, sans apport personnel, reprendre une entreprise d'une valeur de 100 000 euros, voire de 200 000 euros. Nous devons donc travailler ensemble pour changer la vision qu'un grand nombre de nos compatriotes ont de la reprise d'entreprise.
En outre, reprendre une entreprise, c'est aussi entreprendre, ce n'est pas simplement reprendre l'affaire du prédécesseur pour refaire la même chose. C'est un acte qui permet de moderniser et de transformer l'entreprise, notamment avec le numérique.
Mme Marie-Cécile Renault . - Quels seraient les grands axes prioritaires pour faciliter la reprise ? Faut-il renforcer l'accompagnement des repreneurs, modifier la fiscalité, travailler sur la gouvernance ?
M. Nicolas d'Arco . - Il existe deux points de préoccupation.
Le premier est que le marché de la cession-reprise des très petites entreprises (TPE) est grippé. Il convient de stimuler la demande. Des actions de communication doivent être menées pour présenter aux entrepreneurs les possibilités existantes en termes de création ou de reprise. La fluidité du marché est très dépendante à la fois des territoires et des secteurs, d'où l'importance des organisations professionnelles sectorielles ou des acteurs de terrain.
Par ailleurs, il est nécessaire d'anticiper davantage les cessions, par conséquent de communiquer avec les cédants. Un marché étant la rencontre d'une offre et d'une demande, il est nécessaire d'organiser les rencontres. Cela ne peut pas se faire au niveau national, mais par des actions territoriales. Les régions ont donc une responsabilité particulière avec les acteurs de terrain. Pour fluidifier le marché, il convient également de simplifier l'environnement réglementaire, ce qui fait écho aux propos introductifs du président du Sénat. Des efforts ont été réalisés ces dernières années, mais il faut aller plus loin.
Enfin, il est nécessaire d'accompagner tant les cédants que les repreneurs. Encore une fois, les acteurs de terrain ont un rôle particulier à jouer.
Le deuxième point de préoccupation est la transmission des entreprises familiales. Nous manquons de données précises, mais on estime que le taux de transmission à la famille pour les PME et ETI est de l'ordre de 15 %. Il est très difficile de comparer ces chiffres avec ceux d'autres pays.
Quels sont les axes de travail ?
Le premier axe est l'accompagnement. Il est nécessaire d'aider les familles à anticiper leur transmission, en termes de fiscalité, mais aussi afin de profiter de cet acte pour moderniser l'entreprise.
Le deuxième axe, mis en avant dans le rapport de la délégation sénatoriale aux entreprises, est la fiscalité pour les entreprises familiales. Pour les donations, les droits de mutation à titre gratuit sont à un niveau élevé en France, de l'ordre de 30 % à 45 %. Ces droits sont financés par l'entreprise. Cependant, de nombreux dispositifs de faveur, dont le pacte « Dutreil », permettent d'abaisser ce taux à des niveaux plus raisonnables, de l'ordre 2 % à 5 % en fonction des typologies.
D'un point de vue technique, la priorité est la lisibilité, la simplicité, la sécurité et la stabilité des dispositifs de faveur. Surtout, il convient de travailler avec l'écosystème pour que les dirigeants d'entreprise et les acteurs du conseil s'approprient mieux ces instruments. Une enquête récente montre que la grande majorité des entrepreneurs employant de 10 à 500 salariés ne connaissent pas ces dispositifs.
Mme Marie-Cécile Renault . - Je me tourne vers Alain Tourdjman, directeur des études économiques et de la prospective du groupe BPCE. Cela fait plus de vingt ans, monsieur Tourdjman, que vous étudiez les comportements financiers des ménages et des entreprises. Depuis six ans, vous travaillez plus spécifiquement sur les sujets de cession-transmission. On cite souvent le chiffre de 60 000 entreprises en attente de reprise. Il me semble que vous n'êtes pas entièrement d'accord avec ce chiffre...
M. Alain Tourdjman, directeur des études économiques et de la prospective du groupe BPCE . - La base de notre diagnostic sur la transmission d'entreprise repose sur une évaluation réalisée il y a dix ou quinze ans, à une époque où il y avait 2,5 millions d'entreprises. Or notre pays en compte aujourd'hui plus de 4 millions...
Le premier problème est que l'évaluation est globalisante, alors que l'enjeu de la transmission n'est pas identique selon qu'il s'agisse d'une TPE - environ 2,3 salariés, quand elle en a - ou d'une PME - 27 salariés.
Pour 2014, on évalue à 76 000 environ le nombre d'entreprises en attente de reprise. Or ce chiffre ne prend en compte que les artisans-commerçants et les sociétés commerciales, ce qui laisse de côté une partie des TPE. L'enjeu en termes d'emplois est d'environ 140 000 salariés pour les TPE et de plus de 400 000 pour les PME. Adopter une approche globalisante sur les statistiques conduit à ne pas déterminer les priorités.
L'autre problème est que l'on nous a toujours fait croire que les transmissions s'opéraient au moment où les dirigeants atteignaient l'âge de la retraite et que le nombre de cessions-transmissions augmentait avec le nombre de départs en retraite. Or ce postulat est complètement erroné. Le nombre de cessions de TPE dont le dirigeant a plus de soixante ans est inférieur à 20 %. La fin de l'activité professionnelle ne signifie pas nécessairement la multiplication des cessions-transmissions. On laisse donc passer des générations de TPE.
Les PME qui ne cessent pas leur activité et dont les dirigeants demeurent à la tête de leur entreprise ralentissent, se désendettent, investissent moins. Plus de 20 % des dirigeants de PME ayant plus de soixante ans, cela finit par entraîner l'ensemble du tissu des PME dans une sorte de croissance sous-optimale, mauvaise pour tous !
La question du vieillissement associé à la cession n'est pas une thématique pour plus tard, mais c'est un sujet de réflexion dès maintenant sur la destruction, soit d'emplois, soit de croissance future. Nous n'avons que trop tardé à traiter ce problème !
Le défi fondamental de la reprise, sur le plan économique, concerne les dirigeants en fin d'activité. Entre le noyau dur des dirigeants de TPE qui voudraient céder leur entreprise et le nombre de cessions réelles, le rapport est de 1 à 5. Entre le noyau dur des dirigeants de PME qui voudraient céder leur entreprise et le nombre de reprises effectives, le rapport est de 1 à 2, voire de 1 à 3.
Le fait de construire notre réflexion en nous appuyant sur des statistiques anciennes et sur des a priori nous conduit à ne pas bien cerner les difficultés. À ce titre, je remercie les sénateurs Claude Nougein et Michel Vaspart d'avoir tenté d'identifier les priorités.
Oublions ce chiffre de 60 000 entreprises et cessons de faire le lien entre cession et fin d'activité professionnelle. Depuis une dizaine d'années, le sujet est majeur et l'on ne fait rien ! L'asymétrie construite entre cessions et créations d'entreprise est de nature à desservir la reprise des TPE. En effet, l'analyse territoriale montre qu'il y a moins de reprises de TPE dans les zones qui enregistrent un fort taux de création d'entreprises unipersonnelles. Souhaite-t-on promouvoir la création fragmentée d'auto-entrepreneurs ou consolider des entreprises implantées et capables d'investir, d'exporter, d'innover ?
Mme Marie-Cécile Renault . - Christian Morel, vous êtes chef d'entreprise à la retraite et président du réseau cédants et repreneurs d'affaires, le CRA. Votre réseau compte 600 entreprises à vendre et 1 200 repreneurs. Que viennent-ils chercher chez vous ?
M. Christian Morel, président du réseau Cédants et repreneurs d'affaires . - Les cédants et les repreneurs cherchent avant tout un accompagnement. C'est tout l'enjeu du CRA. Nos 225 délégués implantés dans toute la France sont tous d'anciens dirigeants d'entreprise. Notre première caractéristique est que nous sommes entièrement bénévoles. Notre seconde particularité est que tout adhérent au CRA est accompagné par un délégué. Nous ne sommes pas une plateforme informatique, ce qui est pour nous l'anti-modèle.
Notre objectif est la sauvegarde des emplois et des savoir-faire. Nous connaissons parfaitement tout le processus de transmission d'entreprise, c'est notre force. Bien sûr, le CRA apporte également des moyens aux cédants et aux repreneurs : trois salles en plein coeur de Paris, organisation de speed dating , de matinales et de réunions avec les experts pour conseiller les repreneurs.
Mme Marie-Cécile Renault . - Quel est l'intérêt de se tourner vers votre réseau plutôt que vers une CCI, une chambre de commerce et d'industrie ?
M. Christian Morel . - Nous sommes bénévoles et nous faisons de notre mieux pour répondre aux problèmes évoqués par Alain Tourdjman. Chaque année, le CRA accompagne environ 350 cessions.
Nous ne sommes évidemment pas les seuls sur le marché. Les CCI ou les chambres de métiers et de l'artisanat opèrent notamment un travail remarquable. Mais il y a aussi des professionnels intermédiaires et certaines fédérations, ainsi que les notaires, les avocats et les experts-comptables dont les conseils techniques sont essentiels. Pour que cette aide soit la plus efficace possible, tous ces intervenants, y compris le CRA, se sont regroupés au sein du réseau « Transmettre et Reprendre ».
Mme Marie-Cécile Renault . - Christiane Chevallier, qu'est-ce que le CRA apporte en matière de formation et de préparation au cédant et au repreneur ?
Mme Christiane Chevallier, responsable de la délégation du réseau CRA de Paris . - Au CRA, je suis la personne de terrain, c'est-à-dire que je reçois à longueur de journée des cédants et des repreneurs. En moyenne, il s'agit d'entreprises qui comptent une quinzaine de personnes et réalisent 1,8 million d'euros de chiffre d'affaires, soit déjà de jolies petites PME.
Il faut connaître les expériences antérieures du repreneur, ses moyens financiers, savoir s'il a informé son environnement familial de son projet, ce qui est un point très important lors d'une reprise, et déterminer exactement quel est son projet. Si l'adéquation entre le projet et les possibilités de la personne ne nous paraît pas évidente, nous pouvons, par exemple, lui suggérer de poursuivre une carrière salariée afin d'acquérir certaines compétences, voire purement et simplement le dissuader.
À partir du moment où le repreneur se lance sur le marché de la reprise, s'ouvre pour lui un véritable parcours du combattant qui dure au mieux six mois, mais plus généralement quinze ou dix-huit mois, parfois plus.
L'autre partie de l'équation est le cédant. Est-il prêt à céder son entreprise ? A-t-il un projet de vie pour la suite ? A-t-il consulté sa famille ou son entourage pour savoir si quelqu'un parmi ses proches ne souhaite pas reprendre l'entreprise ? Que vend-il ? S'agit-il du fonds de commerce, de l'immobilier, des titres de la société ? L'entreprise est-elle prête ? Souvent, le dirigeant d'entreprise est plus l'homme à tout faire que le chef d'orchestre : y a-t-il derrière lui une équipe pour faciliter la reprise ? Quel est pour lui le profil du repreneur idéal ? À quel prix veut-il vendre ?
Bien souvent, la préparation est insuffisante : les cédants ont généralement le couteau sous la gorge à cause de leur départ à la retraite, l'entreprise se délite depuis plusieurs années, et ils n'ont rien fait pour passer la main dans de bonnes conditions. Il aurait fallu anticiper la transmission deux ou trois ans à l'avance.
La décision de céder n'est pas évidente. On a vu des gens qui, le jour de signer, partaient acheter un paquet de cigarettes et ne revenaient pas !
Par ailleurs, bien souvent, le prix du cédant est irrationnel : c'est parfois le prix du bateau qu'il a toujours rêvé d'acheter ! Fréquemment, le prix est beaucoup trop élevé par rapport au prix du marché et à la rentabilité de la structure.
Les acquéreurs doivent être formés à la reprise, mais les cédants également. Nous leur proposons au moins une journée de sensibilisation à la cession.
En dehors de l'aspect technique, il ne faut pas négliger non plus la dimension psychologique. Nous présentons au cédant des repreneurs présélectionnés. Mais nous expliquons au repreneur que la première des choses à faire est de voir l'entreprise. Au départ, c'est même beaucoup plus important que de parler de chiffres. S'imagine-t-il à la place qu'occupe le cédant ? C'est presque une danse de séduction entre l'un et l'autre qui s'engage : ils ne passeront aux chiffres et à la négociation qu'à partir du moment où ils se seront plu l'un l'autre ; en général, c'est plutôt le cédant qui choisit son repreneur, et pas l'inverse.
Puis, troisième phase, quand ils ont décidé de faire affaire ensemble, reste le problème du financement. Il existe plusieurs points d'achoppement : multiplicité des intervenants - comment être sûr de frapper à la bonne porte par rapport aux banquiers traditionnels ? -; garanties ; délais de réponse extrêmement longs.
Mme Marie-Cécile Renault . - Je laisse maintenant la parole à la salle.
M. Serge Dassault , secrétaire de la délégation sénatoriale aux entreprises . - Je suis président du groupe industriel Marcel Dassault, non-retraité, président à vie, ce qui est très pratique pour éviter les problèmes de succession.
Selon moi, pour faciliter les successions dans les familles, il faut totalement supprimer les impôts sur les successions !
Dans une famille, à chaque départ, les enfants doivent payer des droits de succession très importants, alors qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ne peuvent donc les payer qu'en vendant l'entreprise, ce qui est aberrant. Il serait utile de prévoir au moins que la famille puisse conserver l'entreprise durant cinq ans afin que tous continuent à travailler normalement.
Quant à la retraite, c'est une catastrophe parce qu'on s'embête ! On n'a plus ni responsabilités ni relations. Je conseille donc à chacun de ne pas prendre sa retraite et de continuer à travailler !
M. Christian Morel . - Christiane Chevallier a démontré toute la difficulté et tout le savoir-faire du CRA en matière d'accompagnement. Pour cela, nous avons besoin d'anciens chefs d'entreprise.
Notre organisme forme environ 320 repreneurs chaque année. Les repreneurs sont face à un monde de professionnels et doivent donc être bien formés pour être efficaces.
Mme Christiane Chevallier . - L'expérience prouve que plus le cédant envisage tardivement de céder son entreprise, plus difficile sera la cession. Celui qui n'a pas cédé son entreprise à soixante-dix ans peut s'y accrocher, avec le risque que l'entreprise se délite petit à petit.
M. Christian Morel . - Bien sûr, notre expérience ne va pas jusqu'aux très grosses entreprises : nous ne jouons pas dans la même cour que M. Dassault.
M. Olivier Meril . - Je suis dirigeant d'une entreprise de webmarketing que j'ai reprise il y a six ans. J'ai racheté mon agence en six semaines et nous sommes passés de 10 à 110 collaborateurs.
Puis j'ai repris une autre agence dans le même domaine, mais, entre-temps, a été votée la loi Hamon, qui impose d'informer les collaborateurs. L'un d'entre eux a refusé de signer le document et a exercé une sorte de chantage. Bref, j'ai été contraint de respecter le délai de deux mois, au terme duquel je n'ai récupéré que trois collaborateurs sur six, soit une coquille quasiment vide. Je n'aurais pas pu reprendre la première société avec cette nouvelle loi.
Mme Marie-Cécile Renault . - Une réaction sur la loi Hamon, qui a suscité beaucoup d'émoi ?
M. Alain Tourdjman . - Ce témoignage est archétypique des dérives de la loi Hamon, qui aurait pu aider la cession-transmission. Le risque majeur de cette loi, et vous l'illustrez parfaitement, est de se trouver pris en otage par un collaborateur clé. Ce texte a été allégé, mais il faudrait aller plus loin, sachant qu'il remet également en cause le principe de la confidentialité, qui est déterminant dans le cadre de la cession-transmission.
M. Nicolas d'Arco . - Je souhaite rebondir sur une autre partie de ce témoignage que j'ai trouvé particulièrement utile.
Vous avez bénéficié d'une reprise dans des conditions simples. En amont, effectivement, le parcours d'une reprise est complexe, mais une fois que l'opération est réalisée, on se trouve à la tête d'une entreprise qui génère des revenus. Pour les créations d'entreprises, la situation est inversée : le processus est très simple au départ puisqu'en quatre jours, on peut créer une entreprise, mais on met ensuite deux à trois ans à créer du revenu et une stabilité. On sait que le taux de défaillance des entreprises atteint son maximum au bout de deux ans. Nous devons mieux communiquer sur le sujet pour ne pas déséquilibrer le ratio reprise-création, car on a tendance à valoriser la création d'entreprise au motif que ce serait plus rapide.
M. Jean-Paul Émorine , sénateur . - Je suis sénateur de Saône-et-Loire et ancien président de la commission de l'économie et du développement durable. Je travaille actuellement sur la question du soutien aux PME à l'export au sein de la commission des affaires étrangères. Dans le cadre de nos débats, j'aimerais que nous nous interrogions sur ce sujet et puissions étudier les mesures qui pourraient aider les entreprises qui le souhaitent à investir sur les marchés d'exportation.
Aujourd'hui, le chiffre d'affaires des PME, lesquelles représentent pourtant 98 % des entreprises exportatrices, n'atteint que 150 milliards d'euros, contre un total de 650 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisé par les entreprises françaises à l'exportation.
Selon moi, la reprise d'entreprise - c'est pourquoi j'évoque cette question - pourrait être l'occasion pour un repreneur, qui voudrait relever le défi de l'export, de réfléchir à la nécessaire consolidation de son entreprise.
Ma seconde remarque porte sur le plan Juncker, dont le montant devrait doubler prochainement, passant de 300 milliards d'euros environ à plus de 500 milliards d'euros. Il me semble que cela pourrait être le moment de réorienter une partie de ce plan vers les PME exportatrices, dans la mesure où ce système de financement comprend une garantie financière.
M. Alain Tourdjman . - Beaucoup de cessions-transmissions sont des occasions de croissance externe pour les entreprises au-delà d'une certaine taille. Je parle là des sociétés de taille moyenne ou intermédiaire. Aujourd'hui, ces opérations constituent un levier fondamental de croissance pour les entreprises en France.
Malheureusement, pour l'essentiel, la création de nouvelles entreprises moyennes ou intermédiaires est compensée par la disparition d'autres entreprises. En raison de ce phénomène, on ne constate donc pas vraiment d'augmentation du nombre d'entreprises de taille plus importante.
Les entreprises françaises rencontrent un véritable problème d'économie d'échelle quand elles cherchent à innover et exporter davantage. On ne travaille pas suffisamment à la consolidation et au renforcement des entreprises en France et trop à la diffusion de l'entrepreneuriat. Par conséquent, la France a perdu 25 % des PME travaillant dans l'industrie manufacturière entre 2003 et 2014. À ce phénomène, il faut ajouter le manque d'entreprises intermédiaires, ce qui a provoqué le recul des PME françaises à l'export.
Enfin, une grande majorité des dirigeants de PME considèrent que les marchés d'exportation ne les concernent pas. Autant l'innovation fait l'objet d'un consensus au sein des dirigeants de PME, autant l'internationalisation n'en est pas un. Comme pour la cession-transmission, il est nécessaire de diffuser une culture de l'internationalisation des entreprises en France.
M. Olivier Cadic , vice-président de la délégation sénatoriale aux entreprises . - En matière de cession d'entreprise, j'ai une expérience un peu différente de celle de mon collègue Serge Dassault. En effet, à quarante-trois ans, j'ai décidé de prendre ma retraite et de céder toutes mes activités de chef d'entreprise, preuve que cette question n'est pas réservée aux dirigeants d'un certain âge.
On peut aborder le sujet de différentes façons. Personnellement, je n'ai pas jamais vendu mon entreprise. En effet, vendre une entreprise est compliqué. Pour ne donner qu'un exemple, la clause de garantie de passif engage le cédant, alors même que la cession est déjà réalisée et que le sort de l'entreprise ne le regarde plus.
De mon côté, j'ai préféré céder mon activité mais conserver l'entreprise. Celle-ci demeure une coquille vide, dont on peut faire ce que l'on veut. Il est donc possible, me semble-t-il, de trouver des modes de gestion qui facilitent les cessions et les rendent plus simples à mettre en oeuvre.
Pour terminer, j'ajouterai que j'ai un véritable point d'accord avec Serge Dassault sur la question de la taxation des transmissions d'entreprise. En effet, j'ai pu constater à plusieurs reprises que beaucoup d'entreprises françaises étaient passées sous pavillon étranger en raison du décès, parfois accidentel, de leur dirigeant. Au Royaume-Uni, par exemple, cela n'arriverait pas, car les parts d'entreprises non cotées ne sont pas soumises aux droits de succession. Il s'agit d'une forme de garantie pour les entrepreneurs. Cela facilite également l'éventuelle reprise de l'entreprise par ses cadres, dans la mesure où ces derniers n'ont alors pas de droits de succession à régler. À mes yeux, il s'agit d'une bonne mesure pour assurer la pérennité des entreprises. En effet, cette question ne concerne pas seulement les héritiers des dirigeants d'entreprise. C'est également un enjeu pour l'ensemble des personnes qui font vivre l'entreprise, et c'est peut-être sous cet angle qu'il faudrait envisager les choses.
M. Nouredine Azzouk . - Je m'exprime au nom de l'Institut économique France-Algérie et souhaite évoquer la question de la dette. En effet, quand on reprend une entreprise, on crée une dette qui n'est pas amortissable et ne rapporte rien. Comment faire pour qu'une telle dette ne pèse pas trop lourdement sur les comptes de l'entreprise ?
Mme Christiane Chevallier . - Je ne comprends pas votre question. En effet, dans le cadre d'un LBO, c'est-à-dire de la création d'une société holding en vue du rachat de l'entreprise cible, la dette contractée est amortissable et remboursée indirectement grâce aux résultats de l'entreprise rachetée. C'est la raison pour laquelle la dette initiale ne doit pas être trop élevée.
On parle alors de la fameuse règle des trois « 7 » : on vous prête une somme plafonnée à 70 % de votre besoin global sur une période de sept ans, en contrepartie de quoi l'entreprise ne doit pas consacrer plus de 70 % de ses résultats au remboursement de la dette.
Deuxième séquence - Anticipation, financement et accompagnement
Mme Marie-Cécile Renault . - Dans le cadre de cette deuxième séquence, nous allons entendre le témoignage de Mme Édith Letournel qui, à quarante-huit ans, après une belle carrière chez Orange, a décidé de quitter le confort d'un grand groupe pour reprendre l'entreprise eFrontech, PME spécialisée dans le conseil et les services informatiques. Cette société emploie aujourd'hui 85 salariés et réalise 9 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Une vidéo de présentation de la récente reprise de la société eFrontech est diffusée.
Mme Marie-Cécile Renault . - Madame Letournel, quelle mouche vous a piquée de quitter le confort d'Orange pour vous lancer dans la reprise d'entreprise ?
Mme Édith Letournel, présidente de eFrontech. - Ma démarche est née d'un long cheminement et a nécessité beaucoup de réflexion. J'avais déjà un parcours professionnel au sein d'Orange où j'avais exercé diverses responsabilités, que ce soit dans les domaines techniques et informatiques, le management, le business unit , le conseil, le commercial ou le marketing. J'avais donc déjà connu le plaisir de découvrir différents secteurs d'activité et souhaitais pouvoir mettre à profit mes compétences dans une aventure entrepreneuriale à part entière.
J'avais également envie de contribuer au développement d'une PME en quittant - comme vous l'avez indiqué - le confort d'un grand groupe. Cette envie m'est venue après avoir effectué un executive MBA , cycle d'études qui est souvent l'occasion de se poser des questions sur son orientation. Cela a été l'occasion pour moi de me réorienter vers des fonctions marketing et commercial après un parcours professionnel plus technique.
J'ai franchi le pas sans regret. À un moment, il faut prendre la décision de se lancer, même si ce n'est pas rationnel et que c'est risqué.
Mme Marie-Cécile Renault . - Comment avez-vous choisi la cible de la reprise ?
Mme Édith Letournel . - Cela a été particulièrement compliqué. J'ai vécu dans toute sa dimension ce que le représentant du CRA a évoqué précédemment : j'ai mis deux ans et demi à trouver l'entreprise à reprendre. Cela a donc été particulièrement long et difficile. Dès le départ, j'ai suivi la formation du CRA pour acquérir toutes les connaissances techniques et financières nécessaires. Reprendre une entreprise est vraiment un métier à part entière, cela ne se décrète pas, même quand on a eu comme moi un long parcours dans une grande entreprise. En effet, même si l'on possède les bases et les repères, ce n'est pas le même exercice.
Je confirme qu'il s'agit d'un parcours du combattant : il faut apprendre de ses échecs, savoir rebondir et être persévérant. Il est important de développer ses réseaux, ses connaissances et ses contacts pour parvenir à cibler l'entreprise à reprendre.
Mme Marie-Cécile Renault . - Vous avez évoqué l'aide de réseaux. En dehors du CRA, sur quels réseaux vous êtes-vous appuyée ?
Mme Édith Letournel . - J'ai cherché à comprendre l'ensemble de l'écosystème de la reprise, qu'il s'agisse des intermédiaires qui accompagnent les cédants, des conseils en investissement, des fonds d'investissement, des banques, des avocats ou des experts-comptables.
J'ai également travaillé avec différents réseaux d'anciens de grandes écoles. J'animais notamment le club HEC-Repreneurs, ce qui m'a permis d'échanger avec mes pairs et des repreneurs comme moi. Cela aide à ne pas rester seul et à identifier les opportunités, les bonnes manières de travailler et d'avancer, et à se faire connaître au moment où la reprise se concrétise.
Je formulerai trois remarques pour finir.
La première, c'est que je suis l'une des rares femmes à avoir repris une entreprise. J'ai d'ailleurs constaté que le vocabulaire employé tout à l'heure pour décrire les opérations de reprise d'entreprise était très masculin.
La deuxième, c'est que j'ai repris une entreprise du secteur informatique en région parisienne, alors que la plupart des entreprises à reprendre se situent plutôt en province et concernent des secteurs d'activité moins en pointe.
Enfin, troisième et dernière remarque, j'ai repris une entreprise dans un secteur où les cessions d'entreprises résultent la plupart du temps d'opérations d'acquisition externe, si bien qu'avant de trouver ma cible, je me suis fait « coiffer sur le poteau » à plusieurs reprises par des personnes morales qui avaient la préférence du cédant. On ne peut pas empêcher un tel phénomène, mais cela complique un peu les choses.
Cela étant, il faut continuer à encourager et à développer la transmission d'entreprise, y compris par des personnes physiques comme moi.
Mme Marie-Cécile Renault . - Madame Jarnier, vous êtes directeur interrégional Fonds propres Île-de-France pour Bpifrance. Vous accompagnez les PME depuis plus de vingt ans dans leurs recherches de financement et avez réalisé de nombreuses opérations de capital-développement et de capital-transmission. Dans le cadre d'un projet de reprise, le financement revêt un aspect crucial, les sommes à mobiliser sont souvent importantes. Quelle aide Bpifrance peut-elle apporter ?
Mme Delphine Jarnier, directeur interrégional Fonds propres Île-de-France de Bpifrance . - La question de la transmission d'entreprise comporte une dimension psychologique très importante, mais elle soulève aussi un enjeu essentiel en termes de financement. Les sommes en jeu sont considérables, tout comme les risques encourus. L'enjeu est assez binaire dans ces cas-là : les acteurs, que ce soit les banquiers ou les investisseurs, ne sont pas toujours très enclins à financer des opérations qu'ils estiment risquées à certains égards.
Bpifrance, dont le rôle est d'aider les entreprises évoluant dans certains secteurs économiques un peu délaissés à se financer, propose un continuum de produits pour soutenir la transmission d'entreprise : cela va des garanties octroyées aux banques qui financent les transmissions de TPE - soit environ 6 500 opérations par an - à la mise en place de cofinancements à destination des PME et ETI - de l'ordre de 1 700 opérations par an -, qui prennent la forme de prêts bancaires ou de prises de participation minoritaires grâce à des apports en fonds propres.
Mme Marie-Cécile Renault . - Au bout de cinq ans, 40 % des PME transmises sont en défaillance. Auriez-vous des conseils pour éviter les chausse-trapes classiques ?
Mme Delphine Jarnier . - Ce chiffre est impressionnant, mais il faut relativiser les choses : la défaillance dont on parle, c'est simplement la difficulté que peut rencontrer une entreprise à faire face, à un moment donné, à une échéance bancaire. Cela ne signifie pas nécessairement la disparition de l'entreprise.
Les cinq années qui suivent la transmission d'une entreprise sont en effet des années cruciales et risquées.
Dans le cadre du montage financier d'une reprise d'entreprise, il existe trois modes de financement principaux : le financement par fonds propres, la dette bancaire et la mobilisation de la trésorerie disponible dans l'entreprise.
Bpifrance est extrêmement attentive aux montages financiers, parce qu'une dette trop importante ou une mobilisation trop forte de la trésorerie de la cible peut fragiliser l'entreprise lors de la reprise. Elle veille par conséquent à ce que le résultat consacré au remboursement de la dette de transmission laisse à l'entreprise une marge de manoeuvre suffisante pour se développer et investir. En d'autres termes, le résultat net d'une entreprise ne doit pas être intégralement mobilisé pour rembourser une dette, qui est certes importante pour sa pérennité et sa survie, mais qui peut l'handicaper, au moins dans un premier temps.
Mme Marie-Cécile Renault . - Si le montage financier est essentiel, il ne faut pas pour autant négliger les risques opérationnels. Quels sont les grands points de vigilance à avoir en tête ?
Mme Delphine Jarnier . - Nous sommes partis du constat que notre coeur de métier touchait au financement des entreprises. C'est pourquoi Bpifrance s'est attachée au problème du montage financier des opérations de reprise. Néanmoins, dans les faits, le risque est essentiellement humain et opérationnel.
Nous avons cherché à développer un certain nombre d'outils permettant d'identifier ces risques, comme le « Pass Repreneur », outil lancé l'an dernier pour accompagner les repreneurs dans les cent premiers jours de la reprise. Ce « pass » repose sur six grands points de vigilance.
Les deux premiers points consistent en la réalisation d'un autodiagnostic du repreneur, de ses compétences et de ses appétences ainsi que dans l'élaboration d'une cartographie précise des futurs enjeux de l'entreprise et de sa stratégie. En confrontant ces deux analyses, le repreneur doit pouvoir identifier un certain nombre de manques et déterminer le montant des ressources à trouver.
Le quatrième point, qui est très important pour les PME dans lesquelles cette pratique n'est pas très courante, est d'établir une stratégie précise pour les dix-huit premiers mois suivant la reprise. Bpifrance s'attache notamment à définir cinq recommandations qu'elle adresse à l'entrepreneur dans les trois premiers mois de la reprise. Nous avons constaté qu'il existait une forte mobilisation juste avant la reprise, car le repreneur est alors entouré de ses conseils et de banquiers, suivie d'une espèce de « vide » juste après l'opération : le nouveau dirigeant dispose des clefs d'une entreprise qu'il connaît encore mal et fait face à des équipes qu'il ne connaît pas encore très bien non plus. Il nous est apparu utile d'élaborer une feuille de route très précise pour ces trois premiers mois.
Le cinquième point de vigilance concerne la communication et le partage dans l'entreprise. La capacité du repreneur à se faire accepter au sein de l'entreprise et la « greffe sociale » sont des éléments fondamentaux et difficilement quantifiables : autant il est toujours possible d'ajuster et d'étudier l'aspect technique d'un montage financier, autant la question sociale prend du temps et nécessite une communication efficace du repreneur. L'enjeu pour lui est de parvenir à faire partager sa vision aux cadres de l'entreprise.
Dernier et sixième point, il faut que les chefs d'entreprise prévoient de prendre régulièrement du recul, et ce dès l'origine. De manière générale, les dirigeants de PME ont des lacunes en la matière, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire et qu'ils agissent à court terme.
Mme Marie-Cécile Renault . - Monsieur Pesin, vous êtes Médiateur national du crédit et président de l'Observatoire du financement des entreprises. Vous venez de remettre un rapport à Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances, dont la conclusion insiste sur le fait qu'il n'existe pas de problème d'accès au crédit lors des reprises. Les chefs d'entreprise présents aujourd'hui s'interrogent probablement sur le constat que vous dressez.
M. Fabrice Pesin, président de l'Observatoire du financement des entreprises et Médiateur national du crédit . - En effet, il n'existe pas de difficulté générale.
Tout d'abord, les acteurs bancaires distribuent bel et bien du crédit aux repreneurs éventuels, notamment parce que la BCE les soutient. Ensuite, les fonds de capital-transmission ont de l'argent à leur disposition. Enfin, il existe des acteurs très actifs comme Bpifrance, ainsi que de nouveaux acteurs comme ceux du financement participatif. De façon générale, les entrepreneurs ne rencontrent donc pas nécessairement de grandes difficultés.
Cela étant, ce constat n'est valable que sous certaines conditions. Le problème aujourd'hui, c'est que certains repreneurs ne connaissent pas nécessairement l'existence de tous ces financements. En outre, ils sous-estiment trop les enjeux soulevés par une reprise d'entreprise.
Mme Marie-Cécile Renault . - Que sous-estiment-ils exactement ?
M. Fabrice Pesin . - Le premier problème concerne l'évaluation du bon prix de cession. Il ne faut pas acheter trop cher : s'il apparaît évident aux financeurs que la rentabilité de l'entreprise ne leur permettra pas d'être remboursés, cela posera problème assez rapidement.
On cherche parfois à ajuster un plan de financement en demandant au repreneur d'augmenter le montant de son apport personnel ou encore de souscrire un crédit-vendeur. Or ce n'est pas nécessairement une bonne idée, parce qu'un crédit de ce type, comme tout crédit bancaire, doit en définitive être remboursé. Si le prix de cession est mal calibré, c'est l'entreprise elle-même qui sera en danger au bout du compte.
Pour certaines cessions d'entreprise, on constate également que le cédant n'a pas toujours bien investi. Il faudra donc prévoir les ressources nécessaires pour remettre les capacités productives de l'entreprise à niveau et l'aider à faire face à de nouveaux défis, comme la transition numérique.
Le deuxième enjeu, c'est le plan de financement. On entend parfois dire que la reprise d'une entreprise comporte moins de risques pour un entrepreneur qu'une création. Mais attention, le risque existe tout de même ! C'est d'ailleurs pourquoi certains financeurs se montrent parfois frileux. Au cours des trois, quatre ou cinq premières années, le risque est sensible. Changement de stratégie, nouvel homme ou nouvelle femme-orchestre : tout est remis en cause.
La situation dépend en grande partie du profil du repreneur. Travaillait-il dans le secteur auparavant ? Ainsi, reprendre une entreprise du BTP, sans avoir travaillé dans ce secteur, est compliqué. S'agit-il d'un ancien salarié ? L'exemple de Mme Letournel est très intéressant de ce point de vue : elle était salariée d'un grand groupe et a su se transformer en chef d'entreprise. Son expérience est très positive, mais tous les cadres salariés de grands groupes ne sont pas capables de se muer en chefs d'entreprise du jour au lendemain. Soyons honnêtes, ce n'est pas si facile. Cela pose du reste la question de l'accompagnement et de la formation des repreneurs.
Il faut également s'efforcer de bien intégrer les nouvelles règles de financement et prendre en compte l'existence d'une multiplicité d'acteurs du financement. Dans le seul domaine bancaire, alors qu'il suffisait d'une seule banque pour financer une opération s'élevant à 500 000 euros il y a encore quelques années - cette banque était prête à assumer seule le risque de l'opération -, il faut désormais faire appel à trois banques différentes pour répartir le risque. Puis, pour atténuer encore davantage ce risque, le repreneur doit parfois encore rechercher des garanties auprès de Bpifrance, par exemple, ou d'une société de caution mutuelle.
Il s'agit d'un enjeu pour le repreneur, dans la mesure où il doit prendre le temps de préparer son plan de financement et de convaincre un grand nombre d'interlocuteurs, sachant qu'on lui demande désormais d'augmenter le montant de son apport personnel en application des accords de Bâle III. Toutes ces nouvelles réalités sont à prendre en considération.
Mme Marie-Cécile Renault . - Vous avez évoqué les nouveaux outils de financement participatif. Sont-ils vraiment adaptés à la reprise d'entreprise ?
M. Fabrice Pesin . - Le financement participatif est assez à la mode, on en parle beaucoup. Même si cela représente une part encore très modeste du financement des entreprises aujourd'hui, quelques plateformes proposent des solutions de financement participatif, notamment sous la forme de prêts. Ce sont de petites affaires de 100 000 ou 200 000 euros, qui concernent généralement des TPE. J'ai en tête quelques exemples dans l'hôtellerie-restauration.
Mme Marie-Cécile Renault . - Les fonds de capital-transmission représentent également un recours pour les repreneurs, même s'ils ont souvent peur de les faire entrer au capital de leur entreprise. Est-ce malgré tout une solution selon vous ?
M. Fabrice Pesin . - Oui, il s'agit d'une solution à ne pas négliger. Les fonds de capital-transmission sont destinés à des entreprises de taille beaucoup plus importante que les entreprises concernées par le financement participatif, c'est-à-dire les grosses PME ou les ETI. En 2015, on a enregistré 261 opérations réalisées par des fonds de capital-transmission pour un montant de 6,1 milliards d'euros, soit des opérations d'un montant de 23 millions d'euros en moyenne.
Au cours de nos travaux, nous avons constaté une forme d'appréhension chez certains repreneurs par rapport à ce mode de financement. Alors, certes, il faut partager un peu le pouvoir ; en outre, les fonds ont des exigences en matière de reporting et de suivi. Toutefois, il nous semble que ces fonds de capital-transmission apportent davantage de professionnalisme, ce qui est important pour des opérations de reprise qui, comme je l'ai dit, sont parfois risquées.
Mme Marie-Cécile Renault . - À ce stade de nos débats, nous vous proposons le témoignage vidéo de M. Éric Belile, président de la Générale de Bureautique, une PME de 40 salariés, qui réalise un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Vous avez sans doute entendu parler de lui, car il a récemment annoncé la cession de son entreprise à ses salariés.
Dans un témoignage vidéo, M. Belile explique que la reprise de son entreprise par des salariés, bien que plus risquée et moins bénéfique pour lui que toute autre procédure de reprise, permettra d'éviter les licenciements. Il insiste in fine sur quelques propositions pouvant faciliter ce type de transmission, comme la mise en place d'une fiscalité plus adaptée ou le nécessaire rapprochement entre services financiers de l'État et dirigeants d'entreprise.
Mme Marie-Cécile Renault . - Madame Hamzaoui, vous êtes avocate, présidente de la commission Droit et Entreprises du Conseil national des barreaux que vous représentez au sein du réseau « Transmettre et Reprendre ». Il existe de nombreux professionnels pour accompagner les reprises d'entreprise. À qui peut-on se confier ? Existe-t-il des labels pour distinguer les professionnels réellement formés ?
Maître Leila Hamzaoui , présidente de la Commission Droit et Entreprises du Conseil national des barreaux . - Non, il n'existe aucun label, et c'est là l'une des difficultés majeures que nous rencontrons.
L'une des clés du succès dans le cas d'une reprise d'entreprise, c'est l'accompagnement des repreneurs. Cette aide sera d'autant plus vertueuse qu'elle interviendra en amont de la reprise et se poursuivra dans les mois qui suivent sa concrétisation.
Aujourd'hui, une multitude d'acteurs revendiquent - à tort ou à raison - des compétences en matière de transmission-reprise ou en matière d'accompagnement. Il s'agit pourtant de compétences très techniques, qui réclament plusieurs aptitudes complémentaires. Peu de professionnels détiennent toutes ces compétences en réalité. C'est tout l'enjeu de la création du réseau « Transmettre et Reprendre ».
Je vais reprendre l'exemple donné par le sénateur Olivier Cadic, lorsqu'il a expliqué qu'il était beaucoup plus simple de procéder à la cession de son fonds de commerce plutôt qu'à la cession de ses parts : ce n'est pas intuitif du tout pour un chef d'entreprise. Un dirigeant ne connaît pas ces mécanismes. Surtout, son rôle consiste avant tout à rester concentré sur les activités de sa société, en particulier les enjeux liés à la reprise ou à la cession. Dans cette période, il doit se décharger d'un certain nombre de préoccupations, pour continuer à assurer la rentabilité de son entreprise. C'est le rôle des accompagnants d'assurer cette part du travail.
Pour identifier les bons accompagnants et décharger les chefs d'entreprise de cette mission, nous avons donc créé le réseau « Transmettre et Reprendre ». À l'origine, ce réseau regroupait les chambres consulaires, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat, l'agence France Entreprendre, Bpifrance et des représentants des trois professions réglementées que sont les professions d'avocat, d'expert-comptable et de notaire.
L'objectif du réseau est double.
En premier lieu, il vise à accompagner les repreneurs et lever les freins à la transmission-reprise en incitant les pouvoirs publics à améliorer les textes en vigueur, tout en leur proposant un certain nombre de mesures de simplification. Le réseau a beaucoup travaillé sur ces questions de fond.
En second lieu, il cherche à faciliter l'identification des professionnels les plus aptes à accompagner les chefs d'entreprise. Pour ce faire, le réseau va mettre en place des formations, axées notamment sur le travail en commun, la complémentarité des acteurs et la recherche de la meilleure manière d'empêcher un entrepreneur de perdre son temps.
Depuis peu, le CRA a rejoint notre réseau, ce qui permet d'accroître la représentativité des acteurs de la transmission-reprise.
Mme Marie-Cécile Renault . - On parle parfois d'une défiance des entrepreneurs à l'égard de cette multitude d'intervenants. Pour eux, cela représenterait un coût. Comment faire pour lever ce frein ?
Me Leila Hamzaoui . - Selon moi, l'accompagnement des chefs d'entreprise est tellement important que ce coût devrait figurer dans le business plan de l'entreprise.
En réalité, le constat que vous dressez est très culturel. En Grande-Bretagne, la moindre opération de création, de structuration, de réorganisation ou de reprise est planifiée avec l'aide d'accompagnants financiers et juridiques. Il n'est pas envisageable de ne pas prendre en compte cette dimension. En France, c'est l'inverse : on considère que cette sécurité financière et juridique est un coût et non un investissement, au motif que les enjeux liés à la juste définition du prix de cession ou à la rentabilité de l'entreprise sont beaucoup plus importants.
Au sein de notre réseau, nous cherchons des solutions pour que ces coûts soient les plus raisonnables possible. Afin d'être efficaces, nous nous sommes organisés en structures interprofessionnelles et pluridisciplinaires et avons créé des « pools ».
Cette évolution culturelle est nécessaire. Toutes les études le montrent : les entreprises bénéficiant d'un accompagnement ont un meilleur taux de réussite que les autres.
Mme Marie-Cécile Renault . - Vous avez participé à la rédaction d'un Livre blanc pour faciliter la transmission d'entreprise. Pourriez-vous nous résumer vos principales propositions en la matière ?
Me Leila Hamzaoui . - C'est presque impossible ! En plus du Livre blanc, nous avons collaboré aux mesures de simplification et d'incitation mises en place par la Direction générale des entreprises, la DGE, ainsi qu'aux travaux du Sénat sur ces questions.
L'enjeu est colossal, et pas seulement sur le plan fiscal, contrairement au lieu commun. En travaillant avec la DGE, nous avons constaté que certaines difficultés étaient rédhibitoires, alors qu'elles n'apparaissaient pas comme telles au premier examen. C'est notamment le cas de la situation du conjoint participant à l'activité de l'entreprise ou du régime matrimonial, qui sont autant de points clés sur lesquels on ne travaille jamais, parce que l'on se concentre toujours sur les questions de fiscalité.
Parmi nos dernières propositions, en partie identiques à celles qu'a formulées la délégation sénatoriale aux entreprises, figure l'objectif d'harmoniser la structuration des entreprises. Aujourd'hui, les chances de réussir une reprise d'entreprise et le coût de cette reprise dépendent de la manière dont l'entreprise est structurée. Or le mode de structuration d'une société sert avant tout au développement et à la croissance de l'entreprise, et non à la réussite de sa reprise.
Il existe des dispositifs très efficaces mais trop peu connus malheureusement. M. d'Arco a parlé du pacte « Dutreil » : c'est un dispositif très important, qui sert à la fois pour les transmissions familiales et les opérations de reprise d'une société par ses salariés. Il est méconnu et mériterait d'être stabilisé.
La stabilisation de l'environnement juridique constitue d'ailleurs un enjeu primordial. Le droit change constamment et un chef d'entreprise ne peut pas être sûr que le droit restera constant. L'exemple de la loi Hamon est très significatif : pour des opérations qui durent quatre ou cinq ans, sans parler des LBMO qui sont des procédures qui durent quatorze ans, on ne peut pas garantir la stabilité du droit. Cela crée une forte insécurité fiscale, qui fragilise la faisabilité des opérations d'achat d'entreprises et leur structuration.
Mme Marie-Cécile Renault . - J'invite les personnes présentes dans la salle à poser leurs questions.
M. Philippe Verne . - En 2008, j'ai repris la société Brevet, une entreprise industrielle de 80 personnes dans l'Ain, grâce à un LBO classique. Contrairement à d'autres dirigeants d'entreprise, je n'ai pas connu la crise à cette époque. Pourtant, je trouve qu'il manque un dispositif permettant de compléter le système de financement proposé par les banques ou les fonds.
Le recours à l'endettement dans le cadre d'un LBO est particulièrement lourd pour une entreprise industrielle comme la mienne. L'État ne pourrait-il pas proposer aux repreneurs un nouveau dispositif de garantie, qui prendrait la forme d'une dette mezzanine, par exemple, ce qui leur éviterait d'avoir recours à un fonds LBO, qui, comme vous le savez, est assez gourmand en termes de retour sur investissement ?
Mme Delphine Jarnier . - Les dettes mezzanines sont intéressantes - Bpifrance a un fonds de dette mezzanine -, car non dilutives : personne ne prend une part de votre capital. En revanche, il s'agit d'un produit extrêmement cher, à l'instar de tous les fonds propres. Elles sont donc adaptées à quelques cas précis, mais certainement pas à l'ensemble des montages. La dette mezzanine devra bien être remboursée à un moment donné, même si ce remboursement peut être décalé dans le temps.
M. Philippe Verne . - Certes, mais je suis obligé de rembourser mes fonds, ce qui revient au même, voire plus cher.
Mme Delphine Jarnier . - Rembourser des investisseurs ou une dette mezzanine revient à peu près au même. Beaucoup d'investisseurs choisissent d'ailleurs de recourir à un mix regroupant actions et dette mezzanine.
Si l'entreprise ne fonctionne pas bien, la dette mezzanine sera plus chère. En revanche, si vous surperformez, le gain de valeur des investisseurs au capital sera plus important, alors que le détenteur de dette mezzanine ne profitera que du taux élevé, stable, de ce produit.
La dette mezzanine peut sembler plus adaptée à certaines situations, mais ce n'est pas forcément la panacée : l'entreprise doit souvent rembourser de gros montants, en une seule fois, au bout de cinq, six ou sept ans.
Mme Charlotte Bourgeois . - À la fin de l'année 2010, j'ai repris une entreprise industrielle dans les Hautes-Alpes. Il s'agissait d'une reprise familiale, par LBO, sans accompagnement particulier. J'ai toutefois pris soin de rejoindre un réseau de dirigeants d'entreprise pour ne pas me retrouver seule face à des problématiques qui peuvent s'avérer difficiles et que nous avons tous déjà rencontrées.
Mme Marie-Cécile Renault . - De quel réseau s'agissait-il ?
Mme Charlotte Bourgeois . - De l'Association progrès du management, ou APM, qui s'est avérée très précieuse pour moi depuis cette reprise.
Le fait d'être accompagné permet tout d'abord d'accéder plus facilement au crédit bancaire, en confortant la confiance des financeurs.
Cet accompagnement permet également de prendre du recul sur la gestion quotidienne de l'entreprise. À cet égard, il me semble important de sensibiliser les chefs d'entreprise à l'importance de la gouvernance, qu'il s'agisse d'anticiper les transmissions familiales ou de disposer d'un regard un peu plus serein sur la stratégie suivie.
M. Fabrice Pesin . - Je suis tout à fait d'accord avec vous : l'accompagnement facilite l'accès au financement, notamment au crédit bancaire.
Certaines banques renvoient leurs clients désireux de reprendre une entreprise vers ces associations - réseau Entreprendre, France Active, France Initiative Réseau... - dont elles sont souvent partenaires. Le dossier qui leur revient ensuite est bien mieux ficelé et les choses se passent beaucoup mieux.
Comme beaucoup de sénateurs sont présents parmi nous, je voudrais souligner que de plus en plus de fonds régionaux interviennent en matière de capital-transmission, en pratiquant parfois des seuils légèrement inférieurs à ceux des grands fonds nationaux, sans argent public.
Mme Delphine Jarnier . - Je partage tout à fait cette analyse. Bpifrance a développé un programme dénommé « capital famille » qui correspond en partie à la situation que vous évoquez.
Il s'agit moins d'une question financière ou technique que d'une question d'accompagnement et de structure qui s'accorde à la situation de l'entreprise concernée.
En matière de transmission familiale, la gouvernance est un vrai sujet. Il est parfois bon qu'un tiers - fonds ou investisseur - accompagne la réflexion familiale afin de mettre en place la gouvernance la plus fluide possible en vue d'éviter tout conflit qui pourrait, à terme, handicaper l'entreprise.
Mme Marie-Cécile Renault . - Madame Letournel, je crois que vous avez fait rentrer des fonds dans votre entreprise. Cela vous semblait-il une évidence ?
Mme Édith Letournel . - C'était indispensable pour pouvoir acquérir l'entreprise, dont la valorisation était élevée.
Cette situation comporte des avantages, mais aussi des contraintes. C'est particulièrement le cas cette année, alors que nous changeons de business model . Sans entrer dans les détails, le développement du cloud nécessite des investissements dont nous devons discuter avec notre fonds.
Jusqu'à présent, nous avons entretenu de bonnes relations. Le fait d'être confrontée au questionnement intéressant du fonds m'a permis de prendre du recul, de sortir de la gestion quotidienne de l'entreprise, pour mettre en place des modalités de reporting et un contrôle de gestion plus affinés, ce qui était indispensable pour bien comprendre où nous étions et où nous voulions aller. Dans ce cadre, le fonds s'est donc aussi révélé force de proposition.
M. Thierry Vrillacq . - Je dirige une petite société d'une quinzaine de personnes, en Haute-Saône. Nous fabriquons des meules diamant.
J'ai déjà racheté six sociétés, toujours par croissance externe. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à donner envie aux jeunes de racheter des sociétés. Aucun de mes trois enfants ne souhaite reprendre mon entreprise industrielle qui fonctionne très bien.
Il faut expliquer aux jeunes en quoi consiste la reprise d'une société, leur donner envie de se lancer et leur faciliter les choses, ce qui n'est pas très simple.
Me Leila Hamzaoui . - Nous avons beaucoup travaillé sur cet enjeu, notamment avec les réseaux étudiants. Nous essayons de promouvoir la reprise d'entreprise dans les parcours scolaires et universitaires. Si la création d'entreprise est très valorisée auprès des jeunes, il n'en va pas de même pour la reprise, même dans les milieux artisanaux ou industriels.
De même que l'on apprend les bases de la gestion, du droit ou de la comptabilité, la formation initiale doit permettre de comprendre les modalités de reprise d'une entreprise. Nous sommes aujourd'hui tous d'accord pour intégrer cette dimension dans le cadre de la formation initiale, des études universitaires, de l'apprentissage ou de la professionnalisation. Certaines facultés sont d'ailleurs en train de mettre en place des formations au « repreneuriat ».
De nombreux dispositifs existants pourraient être utilisés pour faciliter la recherche et la reprise d'une entreprise par des salariés désireux de se regrouper, de travailler ensemble. La principale difficulté tient au fait qu'il n'existe pas, dans le cadre de la formation professionnelle, de formation permettant de se reconvertir en chef d'entreprise. Les financeurs de la formation professionnelle n'ont pas encore franchi ce pas. De fait, le champ de la reprise d'entreprise se restreint à ceux qui sont déjà entrepreneurs et qui connaissent les rouages de la croissance externe.
Mme Delphine Jarnier . - La création d'entreprise est valorisée en France. On l'associe à la liberté d'entreprendre. Et si jamais cela ne marche pas, ce n'est pas grave - c'est même parfois vu comme un atout.
Il n'en va pas de même de la reprise d'entreprise, qui souffre de l'image négative des grands LBO organisés par d'horribles financiers « vautours » qui viennent dépecer des entreprises en laissant des dettes épouvantables.
Les médias mettent toujours en avant ces erreurs de gestion et jamais les succès de la multitude d'entreprises, reprises depuis des décennies, qui continuent de se développer et d'innover sur leurs marchés.
Il faut commencer par apprendre aux jeunes, aux étudiants, ce qu'est un montage financier et quelle est l'utilité d'un LBO. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, parce que certains acteurs - comme partout ailleurs - se sont trompés.
Me Leila Hamzaoui . - Il faut changer les réflexes et faire comprendre à ceux qui se sentent entrepreneurs qu'il existe un autre parcours que celui de la création d'entreprise.
M. Thierry Vrillacq . - Je pense que l'on naît entrepreneur, on ne le devient pas.
Reprendre une entreprise n'est jamais simple, même avec Bpifrance. Le fait est que cet organisme est une banque et que les banquiers ne sont pas des gens simples. Beaucoup de chefs d'entreprise vous diront la même chose.
Qu'un dirigeant crée ou reprenne une entreprise, il ne le fait pas pour perdre, mais pour gagner. Mais on ne sait pas accepter le risque en France.
Le Paris-Saint-Germain a perdu son match contre Barcelone - je ne suis pas un amateur de foot -, mais plutôt que de voir dans cette défaite une erreur de parcours, on préfère se gausser et tirer sur l'ambulance. De la même façon, peu de gens soutiennent les entrepreneurs.
Me Leila Hamzaoui . - Il existe de nombreux dispositifs pour aider les entrepreneurs, notamment en termes de prévention. Mais c'est aussi très français de ne pas vouloir en bénéficier...
M. Thierry Vrillacq . - Nous avons nos entreprises à faire tourner, petites ou grosses, qu'il s'agisse du groupe Dassault ou d'une petite entreprise de plâtrerie. Nous n'avons tout simplement pas le temps.
Me Leila Hamzaoui . - Quand on se fait dépasser par sa dette, par son fonctionnement, par sa gestion, par sa gouvernance, le recours à un mandataire ad hoc ou à une conciliation est trop peu sollicité par les chefs d'entreprise, qui ont du mal à accepter de reconnaître leurs difficultés.
M. Thierry Vrillacq . - Certes, mais aller voir un mandataire ad hoc , pour un chef d'entreprise, c'est un terrible constat d'échec. Aucun d'entre nous n'est programmé pour cela.
Me Leila Hamzaoui . - C'est bien dommage, car les résultats des conciliations, des sauvegardes et des mandats ad hoc montrent que ces dispositifs permettent bien souvent de préserver les entreprises.
M. Fabrice Pesin . - S'il est aussi quelque chose de très français, c'est la négligence des chefs d'entreprise en matière financière.
Je le dis à tous les dirigeants que je rencontre dans le cadre de médiations ou de transmissions : vous êtes d'excellents chefs d'entreprise, vous maîtrisez votre métier, mais vous ne devez pas pour autant négliger la logique des financeurs ni les documents et la transparence qu'ils attendent de vous et que vous leur devez.
Un chef d'entreprise, qu'il s'agisse d'un repreneur ou d'un créateur, doit avoir en tête les exigences de ses financeurs en termes de dette ou de fonds propres. Ceux qui vont vous financer lors d'une opération de croissance externe ou de reprise d'une entreprise ont des exigences. Ce sont aussi des commerçants dont l'activité doit être à peu près rentable sous la contrainte de règles prudentielles particulières.
Vous devez intégrer ces éléments. Si vous y parvenez et que vous êtes bien accompagnés, les choses se passent généralement bien. Si vous négligez les demandes de vos financeurs, qui sont des partenaires, le moteur risque de se gripper. Je crois que des progrès restent à faire dans ce domaine.
M. Christian Morel . - Je voudrais revenir un instant sur la formation des jeunes.
J'adhère tout à fait aux propos de Me Hamzaoui. Toutefois, avant de former les jeunes, il faut former les enseignants.
J'ai eu l'occasion, voilà quelques années, de recevoir dans mon entreprise des enseignants en formation. Leur « encéphalogramme économique » était totalement plat.
Il faut réaliser un énorme travail afin que nos enseignants connaissent mieux l'économie.
Me Leila Hamzaoui . - Ou alors il faut laisser cet enseignement aux praticiens.
Je suis assez d'accord pour dire que la fibre entrepreneuriale est innée et qu'elle s'acquiert difficilement. Quand on n'a pas du tout cette fibre, il me semble compliqué de l'enseigner. C'est peut-être aussi le rôle des praticiens et des opérateurs économiques, notamment à travers la professionnalisation et l'apprentissage.
M. Bernard Truttmann . - Je suis artisan du bâtiment, à Strasbourg. Je dirige une petite entreprise de 10 salariés que j'ai reprise en 2008, juste avant Lehman Brothers...
Si nos jeunes doivent être formés, il faut aussi valoriser les métiers. Dans le monde de l'artisanat, nous souffrons d'un déficit majeur, énorme. J'aimerais avoir en face de moi un ministre de l'éducation nationale pour lui dire haut et fort que notre corps enseignant décourage nos jeunes de se lancer dans l'apprentissage.
Comment valoriser ces métiers ? Je suis sûr que moins de la moitié des chefs d'entreprise ici présents savent que se tenaient à Bordeaux, le week-end dernier, les Olympiades des métiers. Cette manifestation promeut pourtant l'excellence même de nos métiers.
Qui est chargé, en France, de la promotion des métiers ? Si je pose la question à Bernard Stalter, président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et d'artisanat, l'APCMA, il me répondra forcément qu'il s'agit de la chambre de métiers. Il aura certes raison, mais si une opportunité se présente, la chambre de commerce peut aussi en profiter pour communiquer.
Il me semble qu'à chaque échelon territorial - commune, communauté de communes, département, région - une personne, en plus du ministre, est chargée de la valorisation des métiers. Je voudrais enfin savoir qui est responsable. Pourquoi les Olympiades des métiers ne font-elles pas la une des journaux ?
Les jeunes qui sont dans ces métiers y demeurent. C'est le cas des meilleurs apprentis de France, que j'ai emmenés ici même voilà dix ans. Je parle d'excellence, car les participants aux finales nationales sont déjà trois fois champions : de leur département, de leur région et de leur grande région ! Ce n'est tout de même pas rien !
Si l'on veut garder nos jeunes, il faut commencer par parler des métiers de manière positive au lieu de tout faire pour les dissuader de prendre la voie de l'apprentissage. Certes, après un cursus complet, on peut tenter de reprendre une entreprise, mais c'est difficile.
Les courbes des effectifs de l'artisanat du bâtiment suivent celles de l'apprentissage. Il ne faut donc pas s'étonner de cette baisse.
Tant que l'Éducation nationale nous enverra des jeunes en échec scolaire, nous ne pourrons en faire, demain, des compagnons ou des chefs d'entreprise.
Nous n'avons pas à assurer la formation initiale de ces jeunes, à leur apprendre à lire, à compter et à calculer. La seule chose qu'ils calculent correctement, c'est leur salaire ! Un jeune qui ne sait pas calculer une surface n'a rien à faire dans nos métiers. Ce n'est même pas la peine de nous l'envoyer.
Hier, les maçons avaient besoin de bras pour porter les sacs de ciment, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Que fait-on des jeunes en échec scolaire ? Lorsqu'un jeune ne sait ni lire ni écrire, il ne doit pas nous être envoyé. Comment voulez-vous en faire un repreneur ou un artisan ?
Mme Marie-Cécile Renault . - Nous en avons terminé avec les questions. La parole est désormais à M. Michel Vaspart, qui va vous présenter les propositions de la délégation sénatoriale aux entreprises.
M. Michel Vaspart , membre de la délégation sénatoriale aux entreprises . - Mesdames, messieurs, avant toute chose, je voudrais remercier les huit intervenants des deux tables rondes. Vous avez dialogué, posé des questions et formulé des propositions, notamment en matière de formation. Je ne doute pas que la délégation sénatoriale aux entreprises accordera la plus grande attention aux éléments que vous nous avez communiqués ce matin.
En introduction de cette matinée, mon collègue Claude Nougein avait identifié six difficultés auxquelles acteurs publics et privés étaient confrontés en France en matière de transmission et de reprise d'entreprise. Sur notre initiative, la délégation aux entreprises a proposé six actions à prendre d'urgence, déclinées en vingt-sept propositions, pour moderniser la transmission d'entreprise en France et mieux sécuriser les emplois sur l'ensemble de notre territoire.
La première action consisterait à mieux connaître les réalités statistiques et économiques. Depuis 2006, nous avons une réelle difficulté à obtenir des statistiques fiables en termes de transmission d'entreprise. Or il est compliqué d'avoir une politique proactive en matière de reprise d'entreprise sans s'appuyer sur des outils fiables. Nous vous proposons donc de confier à l'INSEE une mission de collecte de données basées sur des définitions claires pouvant servir de référence en matière de transmission d'entreprise. Nous vous proposons également d'affiner les données statistiques disponibles au niveau d'un territoire.
Nous l'avons vu tout au long de cette matinée, il est primordial de savoir anticiper la transmission de l'entreprise. Agir en faveur de la transmission, c'est également favoriser l'anticipation. C'est la deuxième action que nous déclinons en trois propositions distinctes : permettre un meilleur accompagnement des cédants en facilitant la déductibilité de certains diagnostics, inciter fiscalement les cédants à transmettre avant l'âge de soixante-cinq ans et moderniser le dispositif de la location-gérance, qui favorise cette anticipation.
La troisième action serait de mieux informer et de mieux communiquer sur la reprise d'entreprise. Certes, depuis le rapport de notre collègue députée Fanny Dombre-Coste, des progrès notables ont été accomplis à travers la semaine de la Transmission ou la mobilisation de l'agence France Entrepreneur dans son rôle de coordination, en partenariat avec le réseau « Transmettre et Reprendre ». Toutefois, ces initiatives ne se traduisent pas encore par l'augmentation du nombre des reprises en France. Il nous semble que des progrès restent à faire pour promouvoir la transmission et élargir le public visé.
Pour cela, nous vous proposons dans un premier temps de mieux orienter les démarches de promotion de l'entrepreneuriat vers la reprise, et ce à toutes les étapes : cursus universitaire, école de commerce, apprentissage, dispositifs locaux et nationaux. Nous vous proposons également de renforcer le rôle de coordonnateur de l'Agence France Entrepreneur et de sa plateforme internet. Nous souhaitons aussi renforcer la déclinaison locale de la semaine de la transmission.
La quatrième action que nous préconisons concerne le financement de la transmission, qui doit être modernisé et dynamisé. Certes, l'accès au crédit pose moins de difficultés aujourd'hui qu'après la crise de 2008, mais, sur le terrain, certains entrepreneurs continuent de nous faire part de négociations tendues avec leurs banques. D'autres sources de financement doivent pouvoir être développées.
Je le dis en aparté : tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Je n'étais que partiellement d'accord avec l'intervenante qui affirmait que ce n'était pas si grave de connaître un échec lors d'une reprise d'entreprise. Je n'en suis pas si sûr : en France, il n'est en effet pas évident d'obtenir de nouveaux prêts auprès d'une banque après un tel échec, alors que c'est tout à fait possible dans d'autres pays.
Au nom tant de l'équité fiscale entre TPE, PME et ETI que de l'efficacité de la mesure, il est nécessaire d'élargir aux PME et ETI - et non plus aux seules TPE - l'échelonnement du paiement de l'impôt sur les plus-values en cas de crédit-vendeur. Afin de faciliter le financement de la transmission, la délégation aux entreprises propose d'abaisser à 3 % la condition fixée par le code général des impôts autorisant un paiement différé puis fractionné des droits de mutation dans le cadre des entreprises familiales à actionnaires multiples. Cela permettrait de fluidifier les successions sans que les droits restant à payer contraignent les héritiers à une vente partielle ou totale de l'entreprise.
Nous suggérons également de prévoir une alerte systématique de la Banque de France afin que de jeunes entreprises transmises ne voient pas leur cote dégradée, alors même qu'elles sont en phase d'investissement.
La cinquième action a pour objet de simplifier et moderniser le cadre fiscal et économique. Nous préconisons notamment d'aménager le pacte « Dutreil » en permettant aux entreprises intéressées de bénéficier d'un taux d'exonération de 90 % sous condition d'un engagement global et unique de huit ans. Pourquoi 90 % et pas 100 %, me direz-vous ? Apparemment, ce taux de 100 % serait inconstitutionnel, même si cela demande encore à être confirmé. Si ce n'était pas le cas, nous proposerions évidemment un taux d'exonération de 100 % dans une future proposition de loi. Une telle mesure figurait d'ailleurs dans la proposition de loi élaborée par Claude Nougein il y a quelque temps.
Le système actuel du pacte, avec un taux d'exonération à 75 %, serait conservé pour ceux qui souhaitent limiter leur engagement dans le temps. Ce système à deux niveaux aurait comme avantage de mieux garantir le maintien des entreprises et des emplois sur les territoires, tout en gardant une certaine souplesse.
Vous avez été nombreux à citer l'ISF comme un frein à une transmission bien anticipée et réussie. En effet, la perspective de son paiement à l'issue de la transmission ralentit largement les procédures, notamment lors des transmissions familiales où les jeunes générations ne sont pas prêtes à s'endetter et payer à la fois droits de mutation et ISF pour un appareil productif sur lequel ils doivent en plus investir. À défaut de suppression, nous suggérons l'exonération des actifs productifs.
Vous avez également été nombreux à nous signaler des différences d'appréciation ou des tensions avec l'administration fiscale, voire parfois de la mauvaise foi de la part des services de l'État - j'ose le dire ! Pour améliorer ces relations, nous vous proposons de créer un système d'évaluation des services locaux des finances locales, qui prendrait en compte les bonnes relations avec les entreprises et leur degré de satisfaction. Il s'agit là tout simplement de mettre en place une démarche qualité comme le font toutes les entreprises de France. Nous pensons que le ministère des finances serait lui-même intéressé par un tel dispositif, qui donnerait une réalité tangible aux actions facilitatrices de son administration.
Nous souhaiterions également harmoniser les droits d'enregistrement, qui sont à l'heure actuelle différenciés selon le statut de l'entreprise. L'objectif serait d'avoir un taux unique simplifié, quel que soit le statut de l'entreprise. Aujourd'hui, des entreprises changent de statut, juste le temps de la transmission, pour de simples raisons fiscales : cette contorsion administrative est finalement contre-productive du point de vue tant fiscal qu'économique. Afin de protéger l'investissement productif, notamment pour nos entreprises les plus jeunes, nous préconisons également d'instaurer un véritable compte entrepreneur-investisseur, afin de permettre aux dirigeants d'entreprise de soutenir plus activement la croissance des PME françaises.
Afin de favoriser l'investissement dans les secteurs de l'artisanat et de l'agriculture, nous souhaitons proposer, sous la forme d'une expérimentation territoriale, un système de déduction fiscale innovante en faveur de la transmission et de l'installation des agriculteurs et artisans. Ce système est détaillé dans notre rapport.
La question de la définition de la holding animatrice a également été évoquée à plusieurs reprises. Nous souhaiterions donc obtenir de l'administration fiscale et des acteurs économiques une définition plus claire de cette holding, une définition suffisamment sécurisée pour éviter de nouveaux contentieux ultérieurs.
Lors de nos auditions, nous avons constaté tout l'intérêt du rescrit-valeur, qui permet aux entreprises à la fois de mieux anticiper leurs opérations de transmission et de les sécuriser. Dans le cadre de la commission d'enquête sénatoriale sur le crédit d'impôt recherche, j'avais moi-même pu saisir tout l'intérêt de ce rescrit. Toutefois, il reste largement sous-utilisé, notamment en raison de la crainte qu'ont certains entrepreneurs de voir cette valorisation se retourner contre eux ultérieurement. Afin de sécuriser les chefs d'entreprise tant sur la possibilité de revenir sur cette valorisation que d'en limiter les usages malveillants, nous recommandons d'en faciliter et d'en promouvoir l'utilisation, y compris en autorisant une anonymisation et une adaptation des méthodes de calcul. Enfin, nous proposons de prévoir des délais de mise aux normes pour les repreneurs, qui seraient adaptés en fonction du montant de l'investissement. En effet, il est anormal que le coût de mise aux normes pénalise le redémarrage de l'activité d'une entreprise après sa cession.
La sixième action que nous préconisons concerne la reprise interne par les salariés, insuffisamment accompagnée en France comme nous avons pu le constater lors de notre déplacement à Nantes. Les dispositions relatives à l'information préalable des salariés ont un effet largement contre-productif, de l'avis de l'ensemble des personnes rencontrées : le temps octroyé est trop court pour permettre aux salariés de s'organiser, mais il est suffisamment long pour fragiliser l'entreprise, qui devient vulnérable aux yeux tant des fournisseurs que des clients. Une transmission réussie est souvent une transmission effectuée à l'abri des regards et non une transmission affichée sur la place publique.
Nous préconisons un dispositif fondé non pas sur l'obligation mais sur la formation, l'incitation et la facilitation. Cela passe par une information, voire une formation régulière offerte à certains hauts potentiels de l'entreprise, en partenariat par exemple avec la chambre de commerce et d'industrie locale. Les dispositifs contraignants, ceux qui créent une information préalable obligatoire par exemple, doivent être abrogés. En d'autres termes, nous proposons l'abrogation de la loi Hamon !
L'incitation, pour sa part, peut être fiscale, avec des abattements plus élevés que ceux qui existent aujourd'hui. Nous suggérons également d'assouplir les conditions d'accès au crédit d'impôt prévu pour les sociétés rachetées par leurs salariés en octroyant ce droit dans le cadre de toute opération de reprise effectuée par au moins cinq salariés. Nous suggérons aussi de réévaluer les dispositifs d'aide en prenant mieux en compte les spécificités de la reprise salariale ; cela pourrait notamment passer par une augmentation de six à neuf mois de la durée maximale des aides au montage et à la structuration financière dans le cadre du Nouvel accompagnement pour la création ou la reprise d'entreprise - le dispositif NACRE.
Enfin, pour rester sur le cas spécifique de la reprise d'entreprise en difficulté, nous appelons dans notre rapport à une meilleure coordination des actions des administrateurs judiciaires et des différents acteurs et conseils de la reprise, afin que l'intérêt de l'emploi et le maintien de l'activité soient bien affirmés comme prioritaires.
Voilà résumé de manière succincte l'ensemble des dispositions que nous préconisons au nom de la délégation sénatoriale aux entreprises, pour dynamiser la transmission d'entreprise, éviter que les entreprises quittent nos territoires en incitant nos jeunes à les reprendre et sauvegarder ainsi l'emploi.
Avec les remarques que nous avons entendues aujourd'hui, nous espérons disposer désormais d'une véritable feuille de route pour moderniser la transmission d'entreprise en France. Nous l'avons vu ce matin : il s'agit réellement d'une urgence pour le maintien et le développement de l'emploi sur nos territoires !
Reprise des travaux l'après-midi
M. Emmanuel Kessler, président-directeur général de Public Sénat . - L'initiative de la délégation sénatoriale aux entreprises me paraît importante. Dans cette période cruciale pour notre pays, nous sommes abreuvés de considérations qui esquivent trop souvent le fond des choses. Cette journée permet d'aborder des enjeux qui concernent concrètement des millions d'entreprises en France dans les mois et les années à venir.
TABLE RONDE « ALLÉGER LE FARDEAU ADMINISTRATIF DES ENTREPRISES »
Mme Élisabeth Lamure , présidente de la délégation sénatoriale aux entreprises . - Mesdames, messieurs, chers collègues, depuis sa création il y a un peu plus de deux ans, la délégation aux entreprises sillonne le territoire à la rencontre des entrepreneurs. Partout, les entreprises nous ont confié que le poids de l'administratif était l'un des premiers blocages à leur développement. Elles souffrent de l'excès de normes, du maquis de règles comme de leur instabilité et trop souvent aussi de la rigidité de l'administration : plus les entreprises se voient imposer des règles, plus leur espace de liberté est réduit, et donc moins elles sont créatives et moins elles peuvent croître. Ce fardeau administratif pèse surtout sur les plus petites entreprises.
Le coût de ce fardeau administratif est réel. L'OCDE l'estime à 60 milliards d'euros. Mais ce coût se mesure aussi en emplois perdus. Sur ce critère du poids de la réglementation, la France est classée 115 e sur 138 pays par le Forum économique mondial. C'est donc un enjeu économique majeur, qui affecte non seulement notre compétitivité, mais aussi notre attractivité.
De nombreux pays européens l'ont bien compris et se sont saisis du problème. On peut se demander si la France a pris la mesure de l'enjeu, même si le Président de la République a annoncé en mars 2013 un « choc de simplification ».
La délégation aux entreprises s'est saisie de cette question dès sa création. Elle a fait plusieurs propositions en faveur de la simplification, à l'occasion de l'examen au Sénat des projets de loi Macron, Rebsamen, El Khomri et Sapin II : doublement des seuils sociaux, facilitation du travail des jeunes apprentis mineurs en entreprise, suppression du contrat de génération, allégement des obligations anti-corruption dans les PME... Elle a également déposé, en décembre 2015, une proposition de résolution et une proposition de loi constitutionnelle pour favoriser la simplification législative pour les entreprises. La majorité sénatoriale a aussi oeuvré en ce sens en proposant de diminuer les délais de paiement à 30 jours fin de mois, de transformer le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en allégement de charges, de simplifier le droit du travail...
En octobre 2016, la délégation sénatoriale aux entreprises a voulu prendre le sujet de la simplification sous un angle systémique : elle a confié à Olivier Cadic et à moi-même le soin d'élaborer un rapport qui proposerait les moyens de simplifier efficacement pour libérer les entreprises.
Pour élaborer ce rapport, nous avons effectué des déplacements en Europe afin de comprendre la démarche de simplification menée par plusieurs de nos voisins : Allemagne, Suède et Pays-Bas.
Nous avons ensuite entendu à Paris une vingtaine d'acteurs qui sont au coeur du sujet : les représentants des entreprises et de ceux qui les accompagnent pour gérer la complexité ; les institutions chargées de la simplification, à commencer par le secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification, mais aussi le Conseil de la simplification pour les entreprises, dont je remercie la présidente, Mme Françoise Holder, d'être parmi nous, ainsi que le Conseil national de l'industrie, qui comprend une section thématique « réglementation et simplification », dont nous avons rencontré le président, M. Alain Devic - malheureusement, il est retenu aujourd'hui, mais il est représenté par M. Philippe Prudhon, que je remercie aussi d'être présent. Nous avons également dialogué avec des députés, avec la Cour des comptes ou encore avec France Stratégie, l'ancien commissariat général du plan. Enfin, nous avons exploré certaines idées en entendant des universitaires ou des think tanks , dont l'iFRAP, qui sera représenté par sa présidente à la seconde table ronde de cet après-midi.
Notre premier sujet d'analyse était le suivant : la volonté de simplification, affichée en haut lieu ces dernières années, a-t-elle produit des résultats pour les entreprises françaises ?
L'inflation législative ne date pas d'hier, mais, fait nouveau, elle va en s'accélérant. Le Conseil d'État y a consacré plusieurs rapports successifs, notamment sa dernière étude annuelle, Simplification et qualité du droit , que Mme Maryvonne de Saint Pulgent a aimablement accepté de nous présenter. Certains dénoncent même une « formalisation névrotique des procédures ». Si le nombre de projets de loi évolue peu, c'est leur volume qui augmente, notamment à la faveur de leur examen au Parlement : le nombre d'articles des projets de loi double en moyenne à l'issue de la navette parlementaire. On a tôt fait d'accuser les parlementaires, mais le Gouvernement est comptable du cinquième de la dérive due aux amendements. En outre, pour légiférer, le Gouvernement recourt à l'ordonnance aussi bien qu'au projet de loi, contribuant ainsi directement à l'hyperactivité législative sans l'aide du Parlement.
S'ensuit mécaniquement un emballement réglementaire, toutes ces normes enchevêtrées créant de la complexité et de l'insécurité juridique. L'Union des industries chimiques nous a transmis une courbe frappante qui manifeste l'emballement normatif depuis une quinzaine d'années, et encore ne concerne-t-elle que le domaine de l'hygiène, de la santé et de la sécurité. Il aurait été intéressant d'avoir la même courbe en matière fiscale ou de droit du travail...
La France resserre encore un peu plus cet étau normatif en transposant souvent les directives européennes au-delà des obligations minimales, ce qui disqualifie nos entreprises et, même, les incite à délocaliser leur production.
Cela fait des années que l'on tente d'améliorer la situation sans grand succès visible, malgré le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, un secrétaire d'État dédié, un conseil de la simplification pour les entreprises créé en 2014 et des efforts menés au sein de l'appareil de l'État.
Mais l'élan initial s'est assez rapidement essoufflé : le 10 juin 2015, M. Thierry Mandon, alors secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification, annonçait au Sénat la mise en place, pour le 1er juillet 2015, d'un comité permettant d'expertiser les études d'impact du Gouvernement. Or ce comité n'a pas vu le jour, M. Mandon a changé de portefeuille une semaine plus tard et, depuis lors, trois ministres se sont succédé à ce poste en trois ans !
Le Conseil de la simplification a produit des mesures en tous genres ; le rapport de la délégation aux entreprises a tenté de les classer par catégories. Personne ne peut nier l'activité et le dynamisme du Conseil de la simplification pour les entreprises, mais tout cela forme un tableau pointilliste : la politique de simplification n'arrive pas à convaincre, prise entre effets d'annonce et difficultés de mise en oeuvre. D'ailleurs, 43 % des mesures annoncées par le Conseil de la simplification ne sont pas effectives : Mme Holder pourra évoquer devant vous les blocages systémiques, qui tiennent notamment à la résistance au changement de ceux à qui profite la complexité.
Pourtant, le Gouvernement soutient que son action a dégagé une économie potentielle pour les entreprises d'environ 5 milliards d'euros annuels. Un tel chiffrage, effectué à partir des études d'impact produites par l'administration, reste invérifiable. Aucun audit préalable n'a été fait. Surtout, il néglige le coût qui résulte du flux parallèle d'obligations nouvelles : pénibilité, compte personnel de formation, transition énergétique... Nous pourrions vous laisser compléter la liste. Si les entreprises ne ressentent pas un choc de simplification, elles ressentent assurément un choc de réglementation.
Or, la délégation sénatoriale aux entreprises en est convaincue, il est tout à fait possible de réussir : nos voisins d'Europe du Nord, eux, ont misé durablement sur l'amélioration de leur réglementation. L'Union européenne elle-même s'est engagée dans une telle démarche : sous l'impulsion du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, le flux de textes nouveaux a objectivement ralenti.
Que conclure de nos déplacements en Europe ? Là où elle fonctionne, la simplification est un objectif politique transpartisan, qui mobilise l'ensemble du Gouvernement. L'évaluation préalable des coûts y est vue comme un moyen d'objectiver la décision politique, pas de s'y substituer. La simplification obéit à une méthodologie rigoureuse et repose sur des objectifs et le suivi d'indicateurs. Surtout, des résultats chiffrés et vérifiés sont obtenus. L'Allemagne a ainsi allégé le coût de la bureaucratie pour ses entreprises de 14 milliards d'euros entre 2006 et 2011. Dans plusieurs pays voisins, la réduction du stock de règles s'articule souvent avec une régulation du flux de normes, grâce à une règle de compensation entre création et suppression de normes : « one in, one out », ou plutôt « one in, two out », comme c'est désormais le cas en Grande-Bretagne.
Dans tous ces pays, un organe indépendant contrôle la qualité des études d'impact, sur lesquelles repose le pilotage de la simplification pour les entreprises. Chacun de ces organes est doté d'un collège de quelques membres experts issus du monde économique, sans mandat politique ni fonction administrative. Il rend un avis qui est publié en même temps que le texte du projet de loi ou du règlement envisagé.
M. Johannes Ludewig, qui préside le Conseil national de contrôle des normes allemand, le NKR, nous a fait l'honneur de se déplacer jusqu'à Paris pour nous expliquer comment le NKR contribue au succès de l'Allemagne en matière de réduction des charges administratives pour les entreprises.
Je laisse maintenant la parole aux intervenants des tables rondes, que je remercie vivement d'avoir bien voulu contribuer à nos débats. Une discussion s'engagera ensuite avec la salle, puis, à l'issue de ces tables rondes, mon collègue Olivier Cadic présentera les conclusions du rapport de la délégation aux entreprises : il analysera la situation française au regard des enseignements que nous avons pu tirer de nos observations à l'étranger et vous présentera les propositions de la délégation aux entreprises.
Première séquence - La simplification collaborative administration/entreprises
M. Emmanuel Kessler . - Nous allons à présent entendre les trois premiers intervenants s'exprimer sur le thème de la simplification dite « collaborative » entre l'administration et les entreprises.
Mme Françoise Holder est coprésidente du Conseil de la simplification pour les entreprises, créé en 2014, et administratrice de la holding Holder SA, qui regroupe les enseignes Paul et Ladurée, bien connues des Français.
M. Philippe Prudhon est directeur des affaires techniques de l'Union des industries chimiques et membre de la section thématique « réglementation et simplification » du Conseil national de l'industrie. Il a également occupé des fonctions de directeur d'usine qui lui ont permis d'apprécier sur le terrain ces problèmes de réglementation.
Enfin, Mme Nathalie Loiseau est directrice de l'École nationale d'administration. On reproche parfois aux énarques d'avoir une vision trop théorique des réalités de l'entreprise, malgré un stage en entreprise dont la durée a toutefois été réduite dans le cadre des nouvelles conditions de scolarité. Nous verrons donc si les énarques sont sensibilisés aux questions évoquées à l'instant par Mme Lamure.
Madame Holder, le rapport de la délégation sénatoriale aux entreprises porte une appréciation somme toute assez mitigée sur l'action du Conseil de simplification que vous coprésidez, en particulier sur le suivi des mesures qu'il a initiées. Quel regard portez-vous sur ces éléments d'appréciation ?
Mme Françoise Holder, coprésidente du Conseil de la simplification pour les entreprises, administratrice de la holding Holder SA. J'ai lu avec beaucoup d'attention le rapport de la délégation sénatoriale aux entreprises, même si certains passages m'ont fait sursauter.
Permettez-moi quelques remarques préliminaires.
Le Conseil de la simplification pour les entreprises a été installé en janvier 2014 par le Président de la République François Hollande. Il a pour originalité de rassembler des élus, des représentants de la haute administration et des entrepreneurs. Pourtant, trois ans après, nous sommes toujours vivants...
Nous avons mené de nombreux ateliers qui reprenaient les principaux moments de la vie d'une entreprise : de sa création à l'embauche ou au licenciement de personnel, jusqu'à sa mort éventuelle ; le tout sous l'égide du secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, le SGMAP, et du secrétariat général du Gouvernement, ou SGG, qui nous ont beaucoup aidés.
Depuis janvier 2014, nous avons recommandé l'adoption de 291 mesures. Le rapport de la délégation en a fait le bilan dans un tableau qui voit, je dois le dire, le verre à moitié vide, en indiquant que 43 % de ces mesures n'ont pas encore été prises. En réalité, 55 % de nos recommandations sont devenues des mesures effectives ; 28 % sont en cours de déploiement sans risque ; 4 % sont considérées en cours de mise en oeuvre avec risque ; 7 % sont en attente d'arbitrage ; 5 % sont abandonnées.
Dès l'origine, nous avons beaucoup bataillé pour obtenir la création d'un comité d'impact. Hélas, nous n'avons obtenu la mise en place que d'un atelier d'impact ; c'est différent. Néanmoins, mon expérience d'entrepreneur m'a appris, au début de toute aventure, à me contenter de ce que j'avais pour avancer. C'est ce que nous avons fait, et nous avons essayé d'agir. Nous nous sommes donc livrés à un travail important : étude de textes de loi - le projet de loi pour une République numérique, par exemple -, publications d'avis, travaux sur la dématérialisation... Nous avons particulièrement travaillé sur les nouvelles conditions du dialogue social après la remise du rapport Combrexelle, sur la réécriture du code du travail, sur la réforme de la médecine du travail.
Cet atelier ne peut donc pas se comparer à ce qui existe chez nos voisins, j'en conviens, mais il n'est pas réduit à un travail de saupoudrage, uniquement symbolique : les réflexions qu'il lance, les avis qu'il rend ont d'ores et déjà beaucoup aidé. Il s'inscrit pleinement dans cette période pionnière de la simplification.
J'ajoute que ce Conseil n'est pas politique ; il est économique. Il doit s'intégrer dans le paysage économique du pays. En cette période de fin de mandat, nous allons mener des actions pour faire reconnaître la qualité de nos actions. Certes, nous ne pouvons pas encore prétendre avoir causé un véritable choc de simplification, je l'ai dit au Président de la République ; mais nous ouvrons un chemin en ce sens.
Ce Conseil est de surcroît transpolitique. Il doit donc également s'intégrer dans la vie politique française.
Je veux vous donner quelques exemples de notre action. En matière d'environnement, depuis 2014, plusieurs permis ont été regroupés en un seul. C'est ce qu'on a appelé la réforme de l'autorisation environnementale, remise par le préfet. C'est un vrai progrès.
Pour les marchés publics simplifiés, les entreprises peuvent désormais candidater avec leur seul numéro SIRET.
Nous avons lancé le programme « Dites-le nous une fois ». Sa mise en place n'est pas terminée, mais il a déjà des impacts importants, notamment pour les PME et les petites entreprises.
Nous avons également permis des avancées dans la dématérialisation, le e-service, pour rapprocher le temps de l'entreprise du temps administratif.
Notre bilan est certes imparfait, mais l'élan a été donné. Nous avons même réussi à commencer de contrer l'inflation normative, en faisant prendre conscience de ses effets.
Notre souhait est que le processus de simplification se perpétue, que les études d'impact se généralisent. Ce système existe en Allemagne depuis dix ans, ses résultats sont donc supérieurs.
L'une des priorités du prochain quinquennat sera de supprimer nombre de lois obsolètes. C'est la règle du « one in, one out », voire du « one in, two out », mentionnée par la présidente de la délégation sénatoriale en introduction. Nous devrons en somme continuer la lutte complexe de la simplification, plutôt que de céder à la simplicité du laisser-faire et de la complexité.
M. Emmanuel Kessler . - Le rapport de la délégation décrit la politique de simplification pour les entreprises comme « un mirage politique en France ». Qu'en pensez-vous ?
Mme Françoise Holder . - Nous n'avons que trois ans d'ancienneté. Notre mission est d'ouvrir le chemin de la simplification à ceux qui nous succéderont.
M. Emmanuel Kessler . - Xavier Niel disait recevoir des formulaires de différentes administrations demandant plusieurs fois les mêmes informations.
Mme Françoise Holder . - Le programme « Dites-le nous une fois » n'est pas encore totalement déployé. Nous n'en sommes qu'à 50 % environ. Vous citez Xavier Niel, mais je pourrais vous présenter des entrepreneurs qui ont vu leur vie simplifiée par ce processus.
M. Emmanuel Kessler . - Je me tourne désormais vers Philippe Prudhon. Pouvez-vous nous dire si, de votre point de vue, les choses ont avancé dans la bonne direction en matière de simplification ?
M. Philippe Prudhon, directeur des affaires techniques de l'Union des industries chimiques, membre de la section thématique « réglementation et simplification » du Conseil national de l'industrie . - L'industrie chimique française est la deuxième en Europe, après l'Allemagne. Elle emploie 160 000 salariés, dont 97 % en contrat à durée indéterminée. Son chiffre d'affaires total est de 75 milliards d'euros, et sa balance commerciale a toujours été positive, juste après celles de l'aéronautique et de la pharmacie. Il s'agit d'une industrie très capitalistique et, à ce titre, très encadrée. C'est tout à fait normal ; nous soutenons la nécessité des contrôles et des règles. Il faut néanmoins que ces derniers ne créent pas de distorsions.
Nos investissements se montent à 1,7 milliard d'euros par an pour la recherche et le développement, et à 3,4 milliards d'euros sur l'outil industriel. Nous préférerions d'ailleurs investir davantage dans la recherche et le développement qu'en matière d'hygiène, sécurité, environnement.
La France a un coût de contrôle 30 % supérieur à celui de l'Allemagne, dont le secteur de l'industrie chimique pèse pratiquement le double de celui de la France. Nous sommes favorables à la réglementation et aux contrôles, je l'ai dit, mais certains principes doivent être respectés. Beaucoup de règles sont établies à l'échelon européen. Nous demandons seulement qu'elles ne fassent pas l'objet d'une surréglementation à l'échelon français. Une simple traduction législative suffit.
La France, si elle veut légiférer, doit en référer à l'échelon européen. A minima , les études d'impact économique des mesures envisagées sont absolument essentielles, afin d'éviter toute forme de distorsion.
Il faut faire preuve de pragmatisme en la matière. Le Parlement a voté la mise en place des plans de prévention des risques technologiques avec la loi Bachelot de 2003. Il fallait en effet faire quelque chose en la matière, corriger les anomalies qui existaient depuis des décennies. Les maisons s'étaient bien trop approchées des usines. La situation était devenue critique avec le drame d'AZF.
Hélas, au moment de son adoption, on ne s'est pas posé la question de son application. En 2017, la situation n'est toujours pas réglée. Ce n'est pas faute d'avoir travaillé main dans la main avec l'administration. Il aurait seulement fallu définir quelques lignes directrices, lancer un pilote expérimental sur quelques sites, puis, sur la base des enseignements que l'on aurait pu en tirer, extrapoler les solutions retenues à toute la France.
Pourquoi, d'ailleurs, adopter des textes aussi longs ? Une loi, ce sont souvent 150 articles, et donc 150 décrets d'application différents. Il faudrait revenir à des choses plus simples et laisser les autorités compétentes et les exploitants définir les lignes techniques, sur la base des grands principes adoptés.
Un exemple pour illustrer mes propos. Le directeur général de la prévention des risques nous a un jour convoqués pour évoquer un plan de modernisation de nos sites industriels. Nous avions déjà commencé à travailler sur ce sujet, bien sûr, mais nous avons revu tous les détails de nos usines : le génie civil, le béton, les réacteurs, les toitures, les automates... Nous avons pu éditer plusieurs nouveaux guides, dont tous ont fait l'objet d'un examen attentif de l'administration. Le premier guide a même connu 25 versions différentes. Ces guides sont pratiques pour les grandes entreprises comme pour les petites. L'administration a même consenti à ne pas recourir à une tierce expertise si ces guides étaient utilisés par l'entreprise.
Autre exemple : la France a revu sa carte de zones sismiques, selon une échelle de risques qui va de 1 à 5. Là encore, on a légiféré sans se poser la question de l'impact des mesures prises. Depuis cinq ans, nous définissons donc des guides techniques très compliqués. Nous avons proposé à l'administration, qui l'a accepté, de mettre en place un pilote avec seize entreprises qui se sont engagées à faire des études sur la base des guides pour évaluer leur pertinence. C'est ce qu'il aurait fallu faire dès le départ. Pourquoi, en outre, dépenser autant d'argent sur les risques sismiques quand le risque d'inondation peut être supérieur dans certaines zones ? Sur ces matières, il faut agir en bon père de famille.
M. Emmanuel Kessler . - Il y a dans ces murs, comme au-dehors, un courant fort pour plus de simplification, mais aussi pour plus de sûreté, plus de respect des règles environnementales. Peut-on concilier ces deux exigences ?
M. Philippe Prudhon . - Je l'ai dit, nous avons un solde positif. Les industriels ont tout mis en oeuvre pour assurer la sécurité des sites et des personnels. Je rappelle d'ailleurs qu'en cas d'accident nous sommes les premiers concernés. Il est donc impératif pour nous d'assurer la sécurité des salariés, mais aussi celle des riverains. Avec l'Association nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs, l'AMARIS, et son président Yves Blein, nous avons oeuvré en ce sens.
Nous devons également diminuer notre empreinte environnementale. Toutes les activités humaines sont polluantes. Nous appliquons les réglementations, notamment européennes. Nous demandons seulement que la France n'en rajoute pas une couche si les règles nous concernant sont fixées à échelle de l'Union européenne.
M. Emmanuel Kessler . - Madame Loiseau, comment les futurs hauts fonctionnaires que l'on retrouvera dans les ministères de l'industrie et de l'écologie, notamment, sont-ils sensibilisés à cette question du fardeau administratif ?
Mme Nathalie Loiseau, directrice de l'École nationale d'administration . - Je me considère, dans mes fonctions à l'ENA, à la tête d'une PME. Cette PME est, comme d'autres, soumise à la lourdeur administrative. Je ne suis pas issue de cette école, ce qui me donne une certaine liberté pour en parler. Je viens d'une dynastie d'entrepreneurs, où j'ai été la première à briser le tabou du service public.
J'apporterai pour commencer une petite rectification à vos propos, monsieur Kessler. Les anciens élèves de l'ENA ne représentent qu'un tiers des hauts fonctionnaires, et ils sont peu présents dans les ministères que vous avez cités. La question de la simplification est donc large, plus large que celle des fonctionnaires formés à l'ENA. C'est à un véritable choc de simplification qu'il faut s'atteler, puisqu'il faut acculturer tous les acteurs à cette logique.
La sensibilisation des élèves fonctionnaires de l'ENA à la question du fardeau administratif pesant sur les entreprises passe d'abord par le stage obligatoire en entreprise. Certes, il n'est pas assez long. Nous allons essayer de l'allonger, même si la scolarité totale à l'ENA a déjà perdu trois mois. L'une de nos décisions concernant ce stage a été de l'étendre aux PME, aux ETI performantes et aux start-up . Ce stage ne se fait donc pas toujours au sein de la direction des affaires publiques d'un grand groupe, direction qui ressemble d'ailleurs bien souvent à une administration comme une autre...
Nous avons la chance d'avoir des élèves de profils très hétérogènes. Les élèves issus du troisième concours sont majoritairement issus du secteur privé. Avec les élèves et les maîtres de stage, nous avons travaillé pour mettre sur pied un système grâce auquel nos élèves en stage doivent identifier une norme récemment édictée et évaluer son impact sur la vie de l'entreprise. Tous les élèves l'ont fait ; ils ont rédigé un rapport spécifique, contenant des propositions de modifications et de simplifications, qui ont été distribuées aux services du Premier ministre. Je voudrais pérenniser cette pratique, pour que, tous les ans, 90 personnes, dans 90 entreprises différentes, puissent développer ce réflexe. L'une de nos préoccupations premières, en effet, est que les élèves aient le réflexe de s'interroger sur l'impact d'une norme. Mais nous devons être conscients d'une chose : l'État n'a pas le monopole de l'intérêt général. L'intérêt général se construit avec toutes les parties prenantes d'une politique publique, avec les citoyens, les élus, les associations et, bien sûr, les entreprises.
Le stage, donc, ne suffit pas. C'est pourquoi nous avons développé des cours sur les réalités de la nouvelle économie en France et dans le monde, sur les forces et faiblesses de la France en la matière, sur ce que cela signifie pour l'administration, les citoyens, les entreprises, sur l'enjeu de la régulation, dont le monde numérique ne peut s'exonérer.
Le profil des intervenants à ces conférences a beaucoup changé : ce sont désormais des responsables d'entreprise qui parlent aux élèves de pôles de compétitivité, de négociation européenne... L'intervenant type de l'ENA n'est plus nécessairement un haut fonctionnaire. Cela n'allait pas de soi au début. En revanche, la bonne surprise, c'est la facilité avec laquelle je suis parvenue à convaincre des responsables d'entreprise aux profils très divers de partager leur expérience avec les élèves de l'école. Cette dimension se développe, même si notre école n'est pas une business school . Nous ne souhaitons pas singer ces écoles, nos missions respectives étant très différentes.
À travers différentes expérimentations, nous apprenons à nos élèves que la conception des politiques publiques et l'élaboration des projets de normes supposent de ne pas rester seul dans son bureau. On attribue toujours au Parlement la responsabilité de l'inflation normative, parce que le coupable, c'est toujours l'autre. En réalité, nous sommes tous ici conjointement coupables et conscients de la nécessité de remédier à cette situation.
Il faut oser ne pas chercher à composer un jardin à la française à chaque fois. Il faut tenter de construire une action nouvelle, innovante, de manière collaborative et, enfin, admettre que l'on n'a pas forcément raison du premier coup. Petit à petit, en dialoguant avec les personnes réellement concernées par l'action publique, il faut tendre vers une généralisation des bonnes pratiques et l'abandon des mauvaises.
À la demande d'un certain nombre de ministères, les élèves de l'ENA expérimentent déjà cette forme d'action à taille réelle pendant leur scolarité. Ils travaillent souvent avec des apprentis codeurs, des élèves de l'École 42, des étudiants d'écoles de commerce et des apprentis designer . L'objectif est de partir des usages des citoyens, plutôt que du sommet de l'État, selon une logique descendante, dont chacun sait qu'elle a vieilli.
L'expérimentation ne concerne encore que les élèves en formation initiale, c'est-à-dire 80 personnes environ. Je suis évidemment consciente que cela ne suffira pas à déclencher un choc de simplification en six mois.
Nous avons l'intention d'aller encore un peu plus loin : nous avons ouvert deux chaires, l'une autour de l'innovation publique, pour faire en sorte qu'il y ait davantage de recherche et de partenariats avec les entreprises, notamment publiques, l'autre en association avec l'École normale supérieure, afin de rapprocher recherche universitaire, prospective et décision publique. L'idée est d'éviter le retour de cette vieille habitude des plus hauts dirigeants publics de décider seuls.
M. Laurent Brutinel . - Je suis président de l'Union patronale des Hautes-Alpes et chef d'entreprise. Par avance, je vous prie de bien vouloir m'excuser de mettre les pieds dans le plat : bien souvent, on trouve très peu de chefs d'entreprise dans ces commissions ou dans les instances de dialogue social ; quand il y en a, ce sont des dirigeants de grands groupes, la plupart du temps représentés par leur DRH. Les PME n'y sont pas du tout représentées.
Madame Loiseau, vous disiez bien connaître les PME. Malgré cela, beaucoup de chefs d'entreprise font face à des difficultés que vous n'imaginez sans doute pas. Si vous souhaitez faire quelque chose pour la France, il faut penser aux PME, car ce sont elles qui créent de l'emploi.
À la tribune, on trouve des intervenants représentant l'industrie de la chimie ou la holding d'un très grand groupe. Ce sont probablement des personnes pleines de qualités et de bonne volonté, mais, pour faire avancer les choses, il faut davantage penser aux PME !
Mme Françoise Holder . - Je suis parfaitement d'accord avec vous. Le tissu médian des entreprises et des entrepreneurs est essentiel en France et pourtant insuffisamment développé si on le compare à nos voisins. C'est pourquoi nous mettons la question des PME au coeur de nos préoccupations. C'est le cas notamment lorsque nous réfléchissons à simplifier les choses : nous tenons compte du fait que certaines entreprises ne disposent pas d'un service juridique ou d'un service comptable suffisamment étoffé. Croyez-le bien, notre ambition première est d'accompagner les PME.
Sur un plan plus personnel, je vais tenter de me défendre. J'ai commencé moi-même comme petit artisan et souhaite sincèrement à chaque petit artisan ou commerçant de finir dans ce que vous appelez un grand groupe. Pour moi, l'appellation n'est pas injurieuse, car ces sociétés sont également utiles à notre économie. En tous les cas, je vous prie de me croire : on peut parfaitement diriger un grand groupe et rester sensible aux problématiques des petits artisans et des PME.
M. Philippe Prudhon . - L'UIC représente l'ensemble des industriels de la chimie. Plus de 80 % de nos adhérents sont des PME ou des ETI.
Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, nos guides sont intéressants, non seulement pour les grands groupes, car ils leur permettent de se jauger par rapport à leurs homologues, mais aussi pour les PME, car ils leur évitent de devoir faire appel à des consultants extérieurs et donc de dépenser de l'argent. Il s'agit d'une oeuvre collective : nous sommes tous dans la même barque, les uns avec les autres.
M. Laurent Brutinel . - Vous parliez tout à l'heure du dialogue social dans les entreprises. Vous savez très bien que les nouvelles règles dans ce domaine, comme la mise en place de commissions régionales de dialogue social pour les TPE de moins de 10 salariés - elles n'en avaient pourtant pas du tout besoin -, ont été acceptées en échange d'avantages accordés à de grands groupes.
On nous parle de simplification, mais, en réalité, tout est fait pour les grandes entreprises, qui sont puissantes, ont des moyens, du temps pour participer aux négociations, et rien pour les PME.
Mme Françoise Holder . - J'ai parlé tout à l'heure de l'intérêt des marchés publics simplifiés. Ce type de marchés facilite les démarches des PME et des ETI quand elles répondent à des offres de marchés publics. Cela n'existait pas jusqu'à présent. En effet, la plupart du temps, les appels d'offres étaient, de fait, réservés aux grandes entreprises. Les marchés publics simplifiés sont une forme d'ouverture pour les plus petites sociétés.
Nous avons fait la même chose en matière de procédures douanières pour simplifier le travail des PME. En matière sociale, nous avons également simplifié la feuille de paie. Croyez-le bien, notre préoccupation première est de simplifier le travail pour les PME.
M. Marc-André Van Huffel . - Je représente le Comptoir médical du Sud-Ouest.
Madame Holder, une PME n'a aucun intérêt à répondre à un appel d'offres public aujourd'hui, car elle ne peut pas en vivre. En tant que gérant d'une société qui vend du matériel médical, je ne réponds pas aux appels d'offres des hôpitaux et des cliniques, parce que cela prendrait trop de temps, parce que la réglementation est trop complexe et parce que ces marchés ne permettent pas de gagner correctement sa vie. Pis, ces marchés publics font mourir certaines PME. Les collectivités publiques ne paient pas bien et ne respectent pas la réglementation, tout simplement.
Mme Françoise Holder . - Je comprends parfaitement ce que vous venez de dire. Simplement, vous le savez comme moi, ouvrir les marchés publics aux PME ne veut pas dire que les collectivités publiques doivent représenter 100 % de leur clientèle. Il s'agit seulement d'une opportunité supplémentaire.
J'espère comme vous qu'une législation plus drastique sera prochainement adoptée, afin de mettre fin aux retards de paiement et aux impayés de l'État.
M. Christophe Baeza . - J'ai créé une marque de vélo appelée ThirtyOne, dont la particularité est d'avoir été le premier Vélib' électrique de France. Les collectivités publiques ne représentent pas 100 % de mon activité à la fois par nécessité et par obligation.
Aujourd'hui, il existe des dispositifs régionaux, comme les agences régionales de l'innovation, qui vous permettent d'exister, mais qui, en revanche, ne sont pas en mesure de vous aider lorsque votre société a besoin de se développer. Il y a là un vide important : que l'on s'adresse à Bpifrance ou à une banque, on ne parvient pas à financer les besoins en fonds de roulement de son entreprise, alors même qu'il n'est question que de quelques milliers d'euros ou de quelques centaines de milliers d'euros. C'est un désert total au niveau financier ! J'aimerais bien répondre aux appels d'offres, mais je ne le fais pas, parce que, si je remportais une commande, je ne pourrais pas la financer.
Mme Françoise Holder . - Je vous invite à venir me voir à l'issue de la table ronde. Je vous communiquerai quelques adresses.
M. Bernard Truttmann . - À qui profitent la loi de modernisation de l'économie (LME) et la fixation d'un délai maximal de paiement de 45 jours ? Je vais vous le dire : aux grands groupes et à l'État ! J'ai un exemple précis en tête : le paiement d'une commande passée par l'État plus de 180 jours après, alors même que toutes les pièces comptables étaient conformes à la virgule près !
On peut botter en touche, mais la réalité économique, c'est que nous, chefs d'entreprise, sommes caution personnelle des découverts bancaires dont l'État est parfois responsable, parce qu'il ne nous paie pas en temps et en heure.
Madame Holder, vous avez précisé qu'une entreprise ne devait pas travailler exclusivement avec l'État. Je l'ai compris il y a longtemps, heureusement !
Mme Françoise Holder . - Je ne cherche évidemment pas à botter en touche. Je ne pensais pas que nous aborderions ces sujets aujourd'hui. Nous sommes bien loin des problématiques de simplification, puisque nous abordons des sujets économiques, financiers et presque politiques...
M. Bernard Truttmann . - Ce n'est peut-être pas le sujet du jour, mais c'est la réalité économique.
M. Emmanuel Kessler . - Je vais tenter de recadrer le débat, car je ne voudrais pas que vous portiez un chapeau trop large pour vous, madame Holder.
À écouter les uns et les autres, j'ai le sentiment que le tissu économique français, composé pour l'essentiel de PME, suscite l'incompréhension du législateur, au sens large, et de l'appareil administratif, lesquels ne parviennent pas à comprendre la réalité des besoins et la nature des adaptations nécessaires.
Mme Nathalie Loiseau . - Je voudrais abonder dans le sens de ce que j'ai entendu. On a tendance à penser que la simplification veut dire moins de normes. Ce n'est pas ce qui vient d'être dit. Nous avons le témoignage de quelqu'un à qui l'on conseille de répondre à un appel d'offres et qui répond qu'il ne le fera pas, parce qu'il sera mal payé et trop tardivement.
L'administration dans son ensemble ne doit pas seulement parvenir à se désintoxiquer de l'inflation normative. Elle doit également être infiniment plus efficace, notamment lorsqu'elle a à régler ses fournisseurs. Je le dis d'autant plus aisément que j'ai passé beaucoup de temps à faire en sorte que l'ENA, établissement public, soit exemplaire dans le paiement de ses factures. Ce n'était pas le cas : certains de nos fournisseurs n'étaient pas payés depuis longtemps. Il a fallu entrer dans cette culture comptable. Nous-mêmes, lorsque nous obtenons une subvention de l'État, nous sommes parfois obligés d'exiger qu'elle soit versée rapidement pour que les personnels et les intervenants soient payés.
Souvent, la simplification est également interne à l'administration. Les collectivités publiques ont mis en place une comptabilité publique qui exige des justificatifs et des contrôles très lourds, si bien que les entrepreneurs, qui sont en bout de chaîne, en sont les victimes.
On ne doit pas se limiter intellectuellement à la seule obsession du « moins de normes ». C'est insuffisant, d'autant plus que nous sommes bien contents de certaines normes récentes qui nous ont permis de mieux respirer et de manger plus sainement.
M. Jean-Marc Gabouty , membre de la délégation sénatoriale aux entreprises . - Je suis sénateur de la Haute-Vienne et chef d'entreprise en exercice.
Je suis d'accord avec M. Brutinel à propos des commissions paritaires régionales interprofessionnelles. La meilleure preuve en est que j'ai défendu avec plusieurs de mes collègues un amendement tendant à supprimer ces commissions. En revanche, pour être tout à fait exact, cette mesure n'était pas une contrepartie donnée aux grands groupes mais plutôt aux syndicats. Le Gouvernement, pour faire accepter un certain nombre de dispositions aux organisations professionnelles, a accepté la création de ces commissions au niveau des TPE. Or, on le voit bien, ce système ne fonctionne pas : le taux de participation lors des premières élections a été parfaitement ridicule. C'est l'exemple d'une loi qui ne sert strictement à rien.
Les marchés publics peuvent être intéressants pour les entreprises, mais cet intérêt est très variable selon les secteurs. Rappelez-vous qu'il y a une dizaine d'années, une réglementation nous obligeait à une mise en concurrence au premier euro. Très vite, M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre de l'époque, a publié un décret pour relever le seuil à 4 000 euros. Il a ainsi réagi à l'absurdité de la norme en vigueur.
D'après ma propre expérience, les collectivités locales paient bien de manière générale. C'est le cas des communes, des départements et des intercommunalités, qui sont autant de structures à dimension humaine. Je suis en revanche plus réservé s'agissant des régions. Quant à l'État et aux grandes agences publiques, il y a effectivement encore beaucoup de progrès à accomplir, car ils utilisent souvent des méthodes dilatoires pour retarder le paiement de leurs fournisseurs.
M. Philippe Rouballay . - Je dirige l'entreprise Symbiose technologies, qui est spécialisée dans la gestion des eaux usées et qui emploie une dizaine de personnes en Saône-et-Loire.
Je ferai une remarque constructive, car j'ai conscience que le travail de simplification n'est pas facile et qu'il y a une montagne de choses à faire.
Selon moi, il faudrait parvenir à mettre en place un système plus équitable. Certes, nul n'est censé ignorer la loi, mais ma société de 10 salariés a les mêmes obligations qu'un groupe comme Renault. Cela signifie que, pour respecter la loi, je dois embaucher proportionnellement beaucoup plus de personnels improductifs, administratifs, que ne le font les grandes entreprises et que je suis obligé d'externaliser un certain nombre de tâches administratives et juridiques.
Il faudrait également veiller à préserver une forme d'équité entre collectivités publiques et entreprises. Aujourd'hui, on voit que l'État et certains acteurs publics se préoccupent des entreprises et des PME. C'est une bonne chose, mais, dès lors, pourquoi les entreprises privées ne pourraient-elles pas bénéficier des mêmes règles que le secteur public ? Pour donner un exemple, je n'ai pas le droit de renouveler le contrat à durée déterminée d'un salarié de mon entreprise plus de deux fois, alors que c'est possible pour les collectivités.
Mme Françoise Holder . - Quand vous évoquez les CDD et certains problèmes sociaux, vous avez évidemment raison. Cela étant, je ne comprends pas très bien à quoi servent les organisations professionnelles et les syndicats s'ils ne sont pas là pour soulager les PME et les TPE et leur éviter d'embaucher des experts-comptables, des avocats...
M. Emmanuel Kessler . - Avant de clore cette séquence, je propose aux deux autres intervenants d'ajouter quelques mots. Je vais être provocateur, madame Loiseau, car le sujet est un peu démagogique : la France se porterait-elle mieux si l'on supprimait l'ENA ?
Mme Nathalie Loiseau . - Je ne suis pas actionnaire de l'école que je dirige. Ce que je sais, c'est que cela n'a jamais été aussi compliqué de prendre des décisions publiques. On a donc besoin de bien former ceux à qui l'on confie des responsabilités complexes. L'école doit-elle continuer à s'appeler l'ENA ? Doit-elle au contraire changer de nom et de « marque » pour plaire davantage et être dans l'air du temps ? Je n'en sais rien.
Comme toutes les grandes écoles, l'ENA est en pleine transformation : elle est tout à fait consciente des enjeux et de ses responsabilités. Dans un monde complexe, on a besoin de davantage de formation, me semble-t-il.
M. Philippe Prudhon . - Vous pouvez compter sur l'industrie chimique pour innover face aux grands défis de la planète : changement climatique, raréfaction des matières, usage de l'eau. Pour cela, la France a besoin d'une industrie chimique forte. La question de la simplification est un levier majeur pour faire de la France un pays attractif.
Deuxième séquence - La simplification : une ambition européenne, l'exemple allemand
M. Emmanuel Kessler . - Nous allons à présent entendre les trois prochains intervenants s'exprimer sur le thème de la simplification, une ambition européenne.
M. Johannes Ludewig est président du Conseil national de contrôle des normes, le NKR, institué en 2006 pour soutenir le gouvernement allemand dans la mise en oeuvre des mesures de réduction de la charge bureaucratique et d'amélioration de la réglementation. Il s'agit d'un organisme indépendant qui veille à ce que les estimations du gouvernement fédéral sur les coûts engendrés par les dispositions juridiques, nouvelles ou modifiées, soient complètes, compréhensibles et plausibles.
Mme Maryvonne de Saint Pulgent est président de section au Conseil d'État. Elle a notamment dirigé un récent rapport qui traite de la simplification et de la qualité du droit.
Enfin, Mme Agnès Verdier-Molinié est directrice de la fondation iFRAP. En 2017, elle a publié un ouvrage intitulé Ce que doit faire le (prochain) président .
Monsieur Ludewig, pourriez-vous nous en dire davantage sur la création de ce NKR ou Conseil national de contrôle des normes ? Nous verrons par la suite si cette initiative allemande est transposable en France.
M. Johannes Ludewig, président du Conseil national de contrôle des normes de la République fédérale d'Allemagne . - C'est un grand honneur pour moi de participer à cette journée de travail.
Le NKR est totalement indépendant du Gouvernement, ce qui est très important. Il se compose de dix membres, tous nommés par le Président de la République sur proposition du Gouvernement pour une période de cinq ans.
En Allemagne, quand un ministère élabore un projet de loi, il doit obligatoirement le soumettre au NKR avant de le présenter en conseil des ministres. Ce n'est pas le rôle du Conseil de contrôle des normes d'apprécier si le projet de loi est une bonne idée ou non - c'est davantage une question politique. Le Conseil de contrôle des normes a pour mission de contrôler l'étude d'impact que le ministère doit obligatoirement joindre à son projet de loi. Cette étude chiffrée évalue l'impact du texte de loi, non pas sur le budget national, car c'est le rôle du ministère des finances, mais sur les entreprises, l'administration et les citoyens. Je le précise, car c'est important : les effets du projet de loi doivent être quantifiés.
Le NKR a pour tâche de vérifier si les calculs du ministère font sens, sont plausibles et acceptables et suivent la méthodologie prescrite pour ce type d'exercice. Il produit un avis joint au projet de loi transmis au conseil des ministres. Cet avis peut être positif : dans ce cas, les calculs du ministère reflètent bien la réalité. À l'inverse, il peut être négatif, ce qui traduit le désaccord entre le Conseil de contrôle des normes et le ministère. Dans ce cas, des considérations d'ordre politique commencent évidemment à émerger.
En principe, le conseil des ministres peut tout à fait adopter le projet de loi malgré l'avis négatif du Conseil de contrôle des normes. Cependant, dans les faits, c'est très rare : si le ministère n'a pas l'obligation formelle de respecter l'avis rendu par le NKR, en pratique, une certaine pression s'exerce sur le ministère pour qu'il se mette d'accord avec notre organisme. Ensuite, l'avis rendu par le NKR accompagne le projet de loi au Bundestag. Chaque parlementaire peut donc en prendre connaissance.
Deux ans après l'entrée en vigueur du texte, l'Office statistique fédéral allemand calcule de nouveau quel a réellement été l'impact de la loi et vérifie ainsi si les chiffres du ministère étaient fiables. En outre, dès qu'un projet de loi entraîne plus d'un million d'euros de coûts, le Gouvernement est obligé d'organiser une évaluation trois à cinq ans après l'entrée en vigueur du texte.
La question clé que pose cette évaluation est de savoir si l'objectif que la loi s'était fixé est vraiment atteint. C'est très important, parce que, en Allemagne, beaucoup de projets de loi n'avaient pas d'objectifs clairement définis.
Grâce à cette évaluation obligatoire, le NKR peut désormais vérifier très tôt si l'objectif d'un texte est clair et si les critères d'évaluation sont bien définis. Si l'on constate au bout de trois, quatre ou cinq ans que l'objectif visé n'est pas atteint ou que la loi a entraîné des coûts supplémentaires, c'est une sorte de première étape vers la future révision de la loi.
Encore une fois, il est très important que le Conseil de contrôle des normes soit indépendant du Gouvernement. J'ai travaillé cinquante-trois ans pour l'administration, et je peux dire que l'on y subit une certaine pression politique afin de faire avancer certains projets. Il est donc essentiel qu'une instance extérieure, à l'abri des pressions, soit chargée de vérifier si l'impact de la législation sur les entreprises est calculé d'une manière réaliste.
Nous avons commencé à calculer les coûts de la mise en conformité en 2011 : ils pèsent à hauteur de 90 % sur les entreprises. Pour maintenir ces coûts à un niveau relativement faible, on a introduit en 2015 le mécanisme dit « one in, one out », inspiré de l'expérience britannique. Ainsi, un ministre qui présente un projet de loi dont les coûts de mise en conformité sont évalués à 50 millions d'euros doit parallèlement abroger d'autres normes dont la charge administrative représente un coût équivalent. Cette méthode a pour objet de stabiliser et de plafonner le coût des modifications législatives pour les entreprises. Entre 2015 et le début de 2017, nous avons observé effectivement une stabilisation de ces coûts. Sur la même période, le coût global de la mise en conformité à la législation nationale a été réduit de 1,7 milliard d'euros, mais il faut également prendre en compte le coût de la mise en oeuvre de la législation européenne, qui n'est pas soumise à la règle « one in, one out ». La diminution nette du coût de la mise en conformité à la législation nationale a été en partie compensée par le coût de la mise en conformité aux règles émanant de Bruxelles.
Il n'est donc pas suffisant d'étudier les effets de la législation nationale, il faut également évaluer les effets des décisions communautaires. Ce travail d'évaluation reste à faire en Allemagne, comme dans la plupart des pays européens. Si vous demandez à votre gouvernement des chiffres clairs sur les conséquences de la législation européenne pour les entreprises françaises, je pense qu'il n'est pas en mesure de répondre, pas plus que le gouvernement allemand, parce qu'aucune analyse systématique n'est effectuée en ce sens. C'est un point sur lequel il va falloir changer.
Pour résumer notre parcours du combattant, nous avons commencé notre travail en 2006, avec l'estimation ex ante des coûts administratifs résultant de l'adoption de nouveaux projets de loi. Ensuite, nous avons mis en place une procédure d'échanges avec le Gouvernement, puis une évaluation ex post du coût induit par les projets de loi. Je l'ai dit : tout projet de loi dont le coût de mise en oeuvre est estimé supérieur à 1 million d'euros doit faire systématiquement l'objet d'une évaluation dans un délai de trois à cinq ans, afin d'envisager d'éventuelles modifications. C'est une innovation absolue en Allemagne, très importante selon moi.
Pour l'avenir, nous envisageons de procéder à une analyse systématique des coûts des propositions de la Commission européenne pour les entreprises allemandes afin de pouvoir donner des orientations très claires aux ministères allemands responsables de la négociation à Bruxelles. Il est très important d'avoir conscience de ce coût pendant la négociation.
Enfin, nous travaillons sur la quantification des bénéfices résultant de l'adoption de nouvelles législations. En effet, une entreprise procède à l'évaluation des coûts et des bénéfices de tout projet d'investissement. Jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés sur les coûts, mais il faut aussi quantifier les gains, pour arriver à une évaluation convaincante qui puisse servir de base au législateur.
Pour conclure, je voudrais dire que l'intérêt de cette démarche est de permettre au Gouvernement et au Parlement de se prononcer sur l'adoption d'un projet de loi en ayant pleinement conscience des incidences de leur décision sur les entreprises, sur les citoyens et sur l'administration. Il s'agit de créer une transparence suffisante dans ce domaine. L'existence d'une instance indépendante chargée de cette évaluation est donc très importante. Nous effectuons ce travail depuis dix ans et l'expérience est positive. Les résultats des élections de cette année en Allemagne ne devraient pas remettre en cause l'existence ni l'indépendance de notre institution, qui fait l'objet d'un assez large consensus.
M. Emmanuel Kessler . - Il est toujours intéressant d'observer ce qui se passe au-delà de nos frontières.
Madame de Saint Pulgent, vous avez dirigé l'étude publiée en 2016 par le Conseil d'État et intitulée Simplification et qualité du droit . L'expérience retracée par M. Ludewig vous semble-t-elle un élément de comparaison intéressant pour évaluer la situation française ?
Mme Maryvonne de Saint Pulgent, président de section au Conseil d'État . - C'est évident. L'étude du Conseil d'État comprend d'ailleurs l'analyse des méthodes mises en oeuvre par quatre pays européens pour parvenir à un droit plus simple et de meilleure qualité, et l'Allemagne fait partie de ces pays.
Nous avons également étudié le cas des Pays-Bas. En effet, les Néerlandais sont des pionniers du calcul de la charge administrative des textes. Le cas britannique offre un exemple intéressant d'autolimitation très forte de la production des lois par le Parlement. Les Britanniques sont aussi très allants sur la transposition « sèche » des directives, c'est-à-dire sans « surtransposition »...
M. Emmanuel Kessler . - Jusqu'à présent ! À l'avenir, c'est moins évident...
Mme Maryvonne de Saint Pulgent . - Cela ne les a certes pas empêchés de vouloir sortir de l'Union européenne, mais ils en font encore partie pour l'instant...
Le dernier pays que nous avons étudié est l'Italie.
Nous sommes tous d'accord sur le fait que, dans une économie ouverte, un droit simple et de qualité contribue à l'attractivité du territoire et à la croissance. Le problème est de savoir comment définir un droit « simple et de qualité ». La précédente table ronde a montré que ce n'était pas évident.
Le véritable objectif n'est pas la simplification du droit, mais la qualité du droit. La simplification est un des moyens pour parvenir à la qualité, la complexité est un des défauts du droit, mais la simplification n'est pas un objectif en soi. Un droit de qualité est un droit efficace, qui permet d'atteindre les objectifs fixés - ce qui suppose que ceux-ci soient clairs -, compris par tous, stable, dont le coût est limité pour les usagers - c'est la question de la charge administrative.
La charge administrative est une question centrale, même si ce n'est pas la seule. Paradoxe absolu, la France, bien que réputée pour son école mathématique et ses statisticiens parmi les meilleurs au monde, ne dispose pas d'une méthode de calcul de la charge administrative, contrairement aux Pays-Bas, à l'Allemagne ou au Royaume-Uni. Comment se fait-il que notre pays ne soit pas en mesure de calculer la charge administrative de ses textes ? L'Allemagne nous montre comment mettre en oeuvre le contrôle de la charge administrative - encore faut-il disposer d'instruments pour le faire.
Le seul outil dont nous disposons est l'étude d'impact préalable, mise en place en 2008, à la suite d'une proposition du Conseil d'État, dans le droit fil de la révision constitutionnelle. En 2016, pour réaliser notre étude, nous nous sommes intéressés à ce que la Cour des comptes appelle les « suites ». Il est clair que l'étude d'impact est mal utilisée et, en outre, lacunaire.
Il est difficile d'établir des comparaisons avec nos voisins européens, parce que leurs systèmes de production de la norme sont très différents du nôtre. L'Allemagne est un pays fédéral : on nous a présenté le système de contrôle de la loi fédérale, mais il existe d'autres instances qui produisent de la norme. En France, le droit est relativement plus simple qu'en Allemagne, parce que la production de la norme y est plus centralisée, ce qui est un facteur de simplification. En revanche, d'autres facteurs de complexification jouent un rôle considérable chez nous. Je n'hésite pas à dire devant le Sénat que la décentralisation mise en oeuvre depuis trente ans complique le droit, parce qu'elle crée de nouveaux producteurs de normes, de même que la création de nouvelles autorités indépendantes de régulation complique le droit.
Par ailleurs, le fait que le Parlement délègue au pouvoir exécutif le soin de prendre des ordonnances - s'il ne le souhaite pas, il n'a qu'à le dire ! - complique aussi le droit. On a ainsi un continuum entre la loi, l'ordonnance et le décret, qui est aussi une forme de délégation au pouvoir réglementaire. Pour aucune de ces catégories de textes, nous ne disposons d'un système efficace de mesure de la charge administrative. Les études d'impact ne s'appliquent qu'aux projets de loi, et à la seule partie de ces projets de loi fabriquée avant le passage au Parlement. Or le volume de la loi peut doubler, voire quadrupler, lors de son passage au Parlement, et cet apport, qui n'est pas toujours d'origine parlementaire, ne fait l'objet d'aucune étude d'impact.
Notre première préconisation consiste donc à étendre l'étude d'impact à l'ensemble de la production normative d'importance, mais cela ne servira à rien si nous n'améliorons pas le contenu des études d'impact. Il faut donc se doter d'un système de calcul de la charge administrative et faire de ce calcul un des éléments fondamentaux de ces études d'impact, même s'il ne doit pas être le seul. La notion de charge administrative n'a véritablement de sens que pour les entreprises, mais il faut bien voir que la norme pèse aussi sur les usagers et sur les collectivités territoriales.
Pour ce qui est du calcul de la charge administrative, l'exemple allemand est très utile, de même que l'exemple néerlandais. Les Néerlandais ont développé un premier instrument pour calculer la charge administrative d'une norme sur l'ensemble de l'économie. Dans un second temps, ils ont mis au point un système de calcul de la charge administrative par catégorie d'entreprises. En effet, cela a été dit ici, la charge administrative est très différente selon la taille des entreprises : on estime qu'elle est trois fois plus lourde pour les petites entreprises que pour les grandes, en fonction de leurs ressources.
Il faut donc développer de bons instruments de calcul de la charge, parce qu'un calcul en moyenne ou en volume global ne renseigne pas complètement sur le problème de la charge administrative.
En outre, il faut distinguer le calcul de la charge administrative en année pleine et le coût de mise en conformité, c'est-à-dire le coût du changement de la norme. Dans certains cas, une norme plus simple peut entraîner une baisse de la charge en année pleine, surcompensée par un coût de mise en conformité excessif. La comparaison de ces deux éléments est indispensable pour bien comprendre l'intérêt de l'adoption d'une norme.
Enfin, il est très important de savoir à quel moment et dans quelles conditions on réalise l'étude d'impact.
En France, nous avons une passion pour la fabrication de la norme - loi, décret, ordonnance... -, passion partagée par tous les auteurs de la norme - les sénateurs et les députés n'en sont pas exempts. De très fortes pressions s'exercent donc pour que la norme soit adoptée à tout prix. Par conséquent, il faut que l'évaluation préalable soit réalisée et publiée par un organisme indépendant, comme en Allemagne. Nous avons préconisé qu'un organisme indépendant assure une certification des études d'impact, certification qui serait publiée suffisamment tôt pour qu'il soit encore temps d'arrêter le processus de fabrication de la norme.
C'est le principal problème : quand peut-on procéder à cet « arrêt sur image », afin de garder la possibilité de décider, si nécessaire, de ne pas aller plus loin ? Ce problème me paraît le plus difficile à résoudre dans le cas de la France, car la pression politique pour adopter des textes est considérable et s'exerce à tous les niveaux. L'exemple britannique est à cet égard intéressant : on peut compléter le dispositif en créant un « robinet d'arrêt » placé sous l'autorité du Premier ministre, qui empêche chaque ministre, chaque direction ou chaque bureau de fabriquer des textes sans discontinuer. Ce dispositif pourrait s'appliquer non seulement aux lois, mais à tous les textes réglementaires.
M. Emmanuel Kessler . - Il faudrait faire passer ce message à tous les candidats à l'élection présidentielle, parce qu'ils nous annoncent de nombreuses lois. Le Parlement risque de siéger de longues semaines, quel que soit l'élu !
Comment avez-vous perçu ce qui vient d'être dit, madame Verdier-Molinié ?
Mme Agnès Verdier-Molinié, directeur de la fondation iFRAP . - Je souscris à tout ce qui vient d'être dit et tiens à saluer les travaux du Conseil d'État, du Conseil de la simplification, ainsi que le rapport d'Élisabeth Lamure et Olivier Cadic. Une prise de conscience est en cours, et nous assistons à une évolution importante sur ces questions. Bien sûr, tout reste à faire.
Ces dernières années, en France, on a énormément parlé de simplification et on a énormément complexifié. En fait, on ne s'est jamais préoccupé de dire de quoi nous souffrons, alors qu'on pouvait le faire. Pendant le précédent quinquennat, des audits de modernisation ont été lancés, suivis par la révision générale des politiques publiques. Plusieurs projets développés par des cabinets d'audit ont estimé à 15 millions d'euros la nécessaire évaluation de la charge administrative pesant sur les entreprises. Or il a été décidé en haut lieu de ne pas dépenser cette somme, ce qui est un peu ridicule !
Du coup, nous ne savons toujours pas quel est le poids de la charge administrative sur nos entreprises. Le seul chiffre, que nous connaissons tous, date de 2010 et émane de l'OCDE : 60 milliards d'euros, soit 3 % du PIB. Or il est impossible de savoir comment il a été calculé. C'est du travail « au pifomètre », passez-moi l'expression ! Le plus incroyable, c'est que les mesures prises par la suite, le fameux « choc de simplification », sont évaluées en pourcentage de ces 60 milliards d'euros. Tout est faussé : on part de faux chiffres, on procède à de fausses évaluations et on réalise de fausses avancées.
Par ailleurs, on nous dit qu'on simplifie, mais on complexifie toujours plus. Par exemple, on a adopté le principe selon lequel le silence de l'administration vaut accord, mais il connaît 2 400 exceptions, soit plus d'exceptions que de cas où ce principe s'applique ! Comment voulez-vous que les entreprises s'y retrouvent ? On aggrave l'insécurité juridique et on crée une complexité supplémentaire. En outre, il est impossible de rétropédaler, puisque trente-deux décrets ont été publiés pour définir les exceptions au principe. Il aurait mieux valu ne rien faire plutôt que de se lancer dans cette opération dont personne ne peut évaluer l'impact réel.
J'ai beaucoup étudié les études d'impact des derniers textes votés, et je suis sidérée. Prenons l'exemple du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, qui va créer une charge administrative supplémentaire pour les entreprises, surtout les plus petites, et pour les particuliers employeurs. J'espère que l'on pourra continuer à créer de nombreux emplois dans les services à domicile dans les prochaines années, mais si vous lisez le projet, vous risquez d'être dissuadés d'employer une personne à domicile, qu'elle soit payée par le CESU ou par la PAJE, au vu de la difficulté à calculer son impôt.
M. Emmanuel Kessler . - Pourtant, beaucoup de nos voisins ont mis en place ce système et ne s'en portent pas plus mal...
Mme Agnès Verdier-Molinié . - Oui, mais leur mode de calcul de l'impôt n'est pas aussi complexe que le nôtre, sans conjugalisation ni familialisation. Le taux risque de varier d'une année à l'autre. Quant aux niches fiscales, on ne sait pas ce qu'elles deviendront. Nous avons évalué à 2 milliards d'euros la charge administrative de cette réforme pour les entreprises. (Mme Nicole Bricq proteste.)
Je constate que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais il me semble qu'il aurait fallu évaluer la charge réelle que vont supporter les entreprises. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait dès l'étude d'impact ?
La même critique vaut pour le compte de pénibilité. Où peut-on trouver dans l'étude d'impact un chiffrage du coût de ce dispositif pour les entreprises ? Nulle part ! Pourtant, un rapport des corps d'inspection explique que ce dispositif ne pourra pas être appliqué à l'administration, parce qu'il est trop compliqué... Je pourrais vous en citer des extraits !
Nous devrions pourtant être en mesure de nous demander si l'adoption d'un texte risque de détruire de la valeur, de créer de l'attractivité ou d'améliorer notre compétitivité. La charge administrative est un élément qui influe sur la compétitivité, les entreprises ne peuvent pas s'y soustraire, elle a donc potentiellement le même impact qu'un impôt.
Le Conseil de la simplification pour l'entreprise n'a malheureusement que très peu de pouvoirs, pas de moyens. Autant essayer de vider la mer avec une petite cuillère !
Si l'on veut se donner les moyens de travailler sérieusement, on cesse de faire de la communication en annonçant la création d'un conseil de simplification qui n'est qu'une coquille vide et on crée, comme l'on fait nos amis allemands, une autorité administrative indépendante, un vrai conseil national d'évaluation de la norme doté de moyens. En France, toutes les structures chargées de réfléchir sur les politiques publiques comportent en leur sein des élus ou des agents publics. M. Ludewig nous a expliqué que sa structure était vraiment indépendante, parce qu'elle ne comptait ni élus ni agents publics : c'est l'Office fédéral de la statistique - Destatis - qui met à disposition du Conseil de contrôle des normes une soixantaine de personnes. On pourrait donc imaginer que l'INSEE apporte ses compétences à l'autorité administrative indépendante chargée de l'évaluation des normes.
La seule structure d'évaluation des normes dont nous disposions a été créée en 2007 : le Conseil national d'évaluation des normes, présidé par Alain Lambert, n'évalue que les normes applicables aux collectivités locales. 97 % de ses avis sont favorables à la mise en place de la norme et, sur 34 avis défavorables, 26 n'ont malgré tout pas été suivis. Vous le voyez, cette structure ne sert quasiment à rien.
Il va aussi falloir changer la manière dont sont rédigées les études d'impact. La future autorité administrative indépendante, le conseil national d'évaluation des normes, devra avoir son mot à dire sur ces études qui sont aujourd'hui rédigées par les ministères. Nos ministères ne disposent pas en leur sein de chargés de simplification, alors que chaque ministre allemand a un secrétaire d'État compétent pour ces questions.
La question se pose aussi pour les parlementaires. Si le système allemand est difficile à comparer au système français, en raison du fédéralisme, tournons-nous alors vers nos amis britanniques et posons-nous la question de la capacité de notre parlement à évaluer les politiques publiques, non plus ex ante , mais ex post . Dans ce domaine, tout reste à faire.
Pourquoi légifère-t-on autant en France ? Parce que l'on ne se concentre pas suffisamment sur l'évaluation des politiques publiques ex post . C'est essentiel, parce que l'on ne peut pas simplifier si l'argent public est mal utilisé, on ne peut pas simplifier sans changer le fond du droit, sans réorganiser les administrations, sans modifier l'organisation des missions publiques, sans réfléchir globalement à l'organisation de l'État, de la sécurité sociale et des collectivités locales. Il faut vraiment s'engager dans cette voie, au lieu de se contenter de créer des portails internet, ce qui revient à ravaler la façade sans repenser la tuyauterie administrative extrêmement complexe qu'elle cache et dont personne ne comprend le fonctionnement.
Ce travail de simplification incombe au Parlement. Si l'on veut réduire le volume de la législation, il faut que l'ordre du jour du Parlement comporte moins de semaines consacrées aux travaux législatifs - comme l'a dit Mme de Saint Pulgent, il faut fermer le robinet ! - et plus de temps consacré au contrôle. Si l'on se donne une contrainte supplémentaire en adoptant le bon principe du « one in, two out »...
M. Emmanuel Kessler . - « One, one » ou « one, two »?
Mme Agnès Verdier-Molinié . - Qu'importe, l'essentiel étant d'engager la démarche.
Mme Maryvonne de Saint Pulgent . - Il faut surtout calculer en termes de charge administrative. Sinon, comme on le fait maintenant, on va supprimer des textes qui ne sont pas appliqués pour les remplacer par des textes qui le seront.
Mme Agnès Verdier-Molinié . - Puisque nous vivons la campagne pour l'élection présidentielle, la fondation iFRAP a mis en ligne un projet de loi qui reprend l'idée du « one in, two out ». C'est une démarche très modeste : nous essayons de proposer des mesures, dans l'hypothèse où le futur gouvernement ou le futur parlement aurait envie de faire bouger les choses. L'article 5 de ce projet crée une « autorité de l'évaluation normative »...
M. Emmanuel Kessler . - Le document qui figure sur votre site est à l'en-tête de l'Assemblée nationale. Or ce projet de loi pourrait tout à fait être déposé devant le Sénat...
Mme Agnès Verdier-Molinié . - Sur toutes ces questions, il faut provoquer un changement de culture.
Nous savons aussi qu'il est difficile d'évaluer le stock de normes. Quand notre fondation s'est adressée au secrétariat général du Gouvernement, elle n'a pas pu obtenir de données véritablement utilisables par une entité extérieure. Cela pose donc le problème de l'ouverture de l'accès aux données publiques, qui ne doit pas être que de façade. Encore une fois, le site data.gouv.fr met en ligne de nombreuses données, mais il est très difficile de les agréger et de les évaluer. Ni la direction de l'information légale et administrative ni le secrétariat général du Gouvernement ne jouent un rôle proactif à l'égard d'un organisme comme le nôtre, qui ne cherche qu'à aider à l'amélioration du système. Ils nous renvoient à leur site, sans que l'on puisse engager un travail commun sur ces questions, alors que nous ne demandons qu'à apporter notre éclairage et nos évaluations.
Il est possible de réduire la charge administrative et le stock normatif, mais il faut se donner les outils pour le faire. Lors des débats sur la révision constitutionnelle de 2008, la mise en place d'un organe d'audit indépendant, rattaché au Parlement, avait été évoquée. Finalement, on a préféré conserver la Cour des comptes, à équidistance du Parlement et du Gouvernement. Or si le Parlement britannique peut vraiment empêcher l'adoption de trop de lois ou de normes, c'est parce qu'il dispose en permanence du National Audit Office pour évaluer ex post toutes les politiques publiques. Cet organisme publie une cinquantaine de rapports par an, qui sont vraiment pris en compte par le Public Accounts Committee , sous-commission de la commission des finances.
Il est clair que le Parlement ne dispose pas aujourd'hui des bons outils. Il va falloir investir en ce sens, car il suffirait de 10 millions à 20 millions d'euros pour que le Parlement ne soit pas prisonnier des évaluations de Bercy, comme il l'est aujourd'hui. Sur une question de fiscalité ou de dépense publique, on dépend toujours des chiffreurs du ministère du budget, ce qui ne permet pas l'indépendance nécessaire au travail parlementaire.
Dans les années 1990, de vastes débats avaient eu lieu sur cette question, ils ont abouti à l'adoption de la loi organique relative aux lois de finances, la fameuse LOLF. Les sénateurs ici présents savent comme moi que ce texte ne leur a pas donné une once de pouvoir supplémentaire en matière d'évaluation des politiques publiques. Si l'on veut que le Parlement joue un rôle proactif, qu'il soit le garant d'une bonne évaluation des politiques publiques conformément à l'article 24 de la Constitution, il faut le doter d'un véritable outil d'évaluation.
M. Emmanuel Kessler . - Je donne à présent la parole à l'assistance pour quelques questions complémentaires.
M. Philippe Rouballay . - J'adhère tout à fait aux propos de Mme Verdier-Molinié. L'an dernier, la Côte d'Ivoire a révisé sa Constitution en vue d'alléger l'édifice normatif ; de son côté, la Chine commence à « délégiférer » pour s'ouvrir davantage. Pour avancer sur le marché mondial, la France doit procéder à un véritable décapage législatif : cette réunion nous prouve que nous sommes tous dans le même bateau, que nous avons tous une rame et que nous voyons tous les fuites qui existent un peu partout. À présent, nous devons agir !
M. Johannes Ludewig . - J'ajoute un élément capital, tiré de mon expérience. En Allemagne, lorsqu'il s'est agi d'accomplir ce travail, l'administration et, en règle générale, les parlementaires n'ont manifesté qu'un enthousiasme modéré. En effet, la transparence implique une quantification des coûts pour les entreprises. C'est là un élément supplémentaire, qui impose de nouvelles justifications des textes de loi. On ne peut plus se contenter d'adapter juridiquement de bonnes idées politiques.
Un tel travail exige l'engagement personnel et total du chef du Gouvernement. La Chancelière allemande a joué ce rôle, et les chefs des deux principaux partis de la coalition sont allés dans son sens. Voilà pourquoi notre réforme a fonctionné.
Mme Agnès Verdier-Molinié . - La France n'est pas du tout dans cette situation ! Depuis plusieurs années, on parle beaucoup de simplification ; mais dès que Thierry Mandon a commencé à formuler des propositions efficaces - je pense à la création d'une commission indépendante comprenant les représentants des chefs d'entreprise -, on lui a confié un nouveau poste gouvernemental.
À l'évidence, il sera très difficile de lever les freins existant au sein de la technostructure. L'engagement du Président de la République, du Premier ministre, du ministre des finances et du garde des sceaux, voire de tout le Gouvernement, sera bel et bien essentiel.
Dès lors que le Président de la République s'est désintéressé de la révision générale des politiques publiques, tout est parti à vau-l'eau. De son côté, Thierry Mandon n'a pas reçu l'imprimatur de la hiérarchie gouvernementale, notamment de Matignon et du secrétariat général du Gouvernement. Voilà pourquoi le bilan du secrétariat général pour la modernisation de l'action publique est si faible. Certes, cette structure a peu de forces vives, mais il ne serait pas si difficile de désigner 100 personnes parmi les 4,5 millions d'agents publics existant en France !
Mme Maryvonne de Saint Pulgent . - Que les choses soient bien claires. M. Mandon a quitté le secrétariat d'État à la réforme de l'État et à la simplification pour un ministère disposant d'une compétence disciplinaire. C'était là un poste plus intéressant pour lui. Nous regrettons tous son départ, mais il s'agit là d'un choix politique.
J'admets volontiers que ce travail de simplification doit être conçu, par le Gouvernement, comme une politique publique en soi. Mais je n'incrimine pas pour autant la « technostructure ». C'est tout l'appareil politique qui oeuvre en faveur de la complexité. La prise de conscience politique doit nous permettre de changer de culture normative.
M. Ludewig a pleinement raison : la simplification doit être érigée en politique publique de premier plan, et le soutien politique est un élément clé. Ce n'est pas la peine d'accuser les bureaux !
À ce titre, l'exemple du « silence vaut accord » est très intéressant. Le Président de la République a affirmé qu'en érigeant cette règle en principe, on pourrait presque résoudre tous les problèmes avec l'administration. C'est le cas typique d'une mesure programmée pour décevoir.
Dans l'administration, il existait déjà un certain nombre de cas de silence valant accord et de silence valant rejet. L'inversion du principe a bouleversé les habitudes et a engendré un travail considérable. Il aurait suffi d'identifier les cas particuliers où il fallait inverser le principe. Mais les intérêts politiques exigeaient de grandes déclarations de tribune.
Cette situation est caractéristique de la préférence de la France pour la norme : on ne se préoccupe absolument pas d'efficacité !
M. Jean-Marc Barki . - En tant qu'industriel installé dans le Nord, j'ai pu rencontrer la Délégation aux entreprises et travailler avec sa présidente Mme Lamure, à qui je tiens à rendre hommage, car elle a mis toute son expertise de chef d'entreprise au service de la Haute Assemblée ; je salue également le travail accompli par l'Institut du Sénat en faveur des personnalités de la société civile.
Membre du réseau Croissanceplus et ancien président d'une fédération professionnelle de la chimie en Allemagne, je souscris à tout ce qui a été dit. Avec mon expérience, je peux affirmer qu'il est nécessaire que chacun puisse travailler et grandir ensemble.
Tel est le cas en Allemagne. Or je suis frappé par la logique de chasse gardée qui s'applique en France : voilà ce qui nous empêche d'avancer. Pour qu'il y ait moins de lois et davantage de lois pertinentes, il faut élaborer les textes en consultant les premiers concernés. Pour l'heure, on mène des études d'impact avec les associations, par exemple professionnelles, mais on ne cible pas des personnalités, des membres de la société individuellement. Il serait bon de les écouter.
Pour l'heure, certains d'entre nous peuvent avoir le sentiment que le SGMAP travaille dans le vide ; nous continuons nos efforts, car nous sommes passionnés et nous avons envie de faire bouger les lignes. Mais, sur le modèle évoqué par Mme Verdier-Molinié, il faut ouvrir l'élaboration normative à la société civile.
Mme Maryvonne de Saint Pulgent . - Au-delà de l'étude d'impact, menée en amont, il faut effectivement confronter les normes à leurs destinataires.
Mme Verdier-Molinié s'est montrée très critique envers le Conseil national d'évaluation des normes. Toutefois, cette instance est tenue de justifier ses choix devant des élus, ce qui, à nos yeux, est un moyen efficace et pédagogique d'améliorer la norme. Il en est de même du principe de la deuxième lecture. Aussi, le Conseil d'État estime que le bilan de ce Conseil est positif.
Nous souhaitons même que, moyennant certaines adaptations, le Conseil de la simplification pour les entreprises devienne le deuxième collège du CNEN.
Une fois la norme élaborée, il faut la confronter à ses destinataires : souvent, le diable se niche dans les détails ! Nous devons donc mener, avec les entreprises, le travail qui est déjà assuré avec les collectivités territoriales.
N'oublions pas non plus les usagers, qui mériteraient de composer un troisième collège.
Mme Agnès Verdier-Molinié . - Chacun doit bel et bien s'emparer du débat dans le cadre d'un véritable échange de vues, car, en la matière, chacun a voix au chapitre. J'espère sincèrement que cette transformation pourra avoir lieu d'ici cinq à dix ans ; mais il faut que chacun continue à travailler et à communiquer en ce sens, dans les médias, dans les collectivités territoriales, dans les assemblées et dans les ministères. Il n'y a aucune raison pour que les Français soient plus mauvais que leurs voisins. Surtout, il faut briser l'entre soi qui existe aujourd'hui !
M. Johannes Ludewig . - Pour que l'Europe avance sur ce sujet, il faut que la France et l'Allemagne travaillent de concert. Il serait bon que le Sénat organise une réunion publique à cette fin après les élections françaises. Personnellement, je demanderai à la Chancellerie allemande d'inscrire ce sujet à l'ordre du jour !
M. Emmanuel Kessler . - Merci de ces interventions très constructives. On est frappé par la richesse de cette discussion, face à des débats électoraux qui, parfois, semblent manquer de densité.
M. Emmanuel Kessler . - M. Olivier Cadic, vice-président de la délégation sénatoriale aux entreprises, va tirer les conclusions de notre table ronde.
M. Olivier Cadic , vice-président de la délégation sénatoriale aux entreprises . - Mes chers collègues, mesdames, messieurs, comme l'a annoncé Mme Élisabeth Lamure, présidente de la délégation aux entreprises, je voudrais conclure cette table ronde en vous présentant les propositions de la délégation pour alléger le fardeau administratif des entreprises.
La simplification, en France, c'est beaucoup de travail pour peu de résultats. Nous avons pu mesurer l'énergie dépensée par plusieurs des intervenants aux tables rondes de cet après-midi, mais aussi leur amertume à l'égard des maigres fruits de leur investissement dans la simplification.
À l'étranger, M. Ludewig nous en a apporté la démonstration : la simplification est un processus méthodique. Chez nous, elle tient plutôt du mirage politique. C'est le fameux choc de simplification, incarné par trois ministres successifs en trois ans. Leur approche a le mérite de se vouloir pragmatique en cherchant à obtenir des résultats immédiats. Elle est aussi servie par des acteurs dynamiques, comme Mme Holder notamment.
Cependant, cette démarche prend la simplification par le petit bout. La simplification, c'est un instrument de compétitivité qui doit s'imposer aux politiques sectorielles. Aujourd'hui, les ministères persistent à élaborer des normes indépendamment les uns des autres ; ils continuent aussi à en rajouter aux règles européennes, sans se soucier de l'impact économique global. Bref, les acteurs de la simplification s'épuisent en vidant la mer avec une cuillère, pour reprendre l'expression utilisée par Mme Verdier-Molinié.
Depuis la loi organique de 2009, une étude d'impact doit être présentée pour vérifier l'opportunité d'une nouvelle législation. C'est la même chose pour tout nouveau texte réglementaire. Le principe semble acquis. Néanmoins, les ordonnances, les propositions de loi et les amendements y échappent encore. Surtout, l'exercice reste trop formel pour être utile : ces études d'impact sont de qualité inégale et sont réalisées au dernier moment. Le Parlement ne s'en est donc pas emparé. De plus, la qualité de ces études d'impact n'a pas pu être améliorée malgré le contrôle assuré par le Conseil constitutionnel, le secrétariat général du Gouvernement et le Conseil d'État. Ce dernier l'a lui-même reconnu dans sa dernière étude annuelle, Mme de Saint Pulgent nous l'a rappelé. Si bien que notre pays continue à légiférer pour un oui, pour un non, et avec entrain ! On l'a encore vu récemment avec les régions qui veulent imposer la clause Molière. Vous imaginez l'inspection du travail contrôlant les chantiers en demandant aux ouvriers de réciter une fable de la Fontaine ? C'est à rendre fou !
Quant à l'évaluation rétrospective des lois, chère à Roland Moreno - nous l'avons vu -, elle est loin d'être systématique. Même si tout n'est évidemment pas chiffrable, il n'y a que la comparaison dans le temps et dans l'espace qui permette de mesurer l'écart produit par une réglementation publique.
Dans ce contexte, annoncer la suppression d'une norme pour toute norme nouvelle, la fin des surtranspositions de textes européens et la généralisation des tests PME ne peut que créer de la désillusion.
Pour s'attaquer à la simplification, la France traite le symptôme plutôt que le mal. Nous devons assumer notre responsabilité collective et nous interroger sur nos méthodes, sans quoi le fardeau administratif des entreprises ne pourra pas être allégé. Nous proposons donc quatre étapes pour arriver à bon port.
La première consiste à penser la simplification comme un processus qualité.
Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre : quelle entreprise peut fonctionner sans un service qualité ? Ce n'est pas un hasard si certaines entreprises réussissent et d'autres disparaissent. Nous devons créer ce service qualité pour la règle de droit. Sous la houlette du Premier ministre, un réseau dédié au sein du Gouvernement permettra de mobiliser tous les ministères sur cette question : pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?
Sa première mission sera de chiffrer la charge administrative supportée par les entreprises : il s'agit de savoir où nous en sommes et de pouvoir nous comparer avec nos voisins. Comment savoir où aller si l'on ne sait pas où l'on est ? On nous oppose que ce chiffrage coûterait quelques millions d'euros, mais qu'est-ce que cela représente par rapport aux gains substantiels que nous pouvons attendre de cette méthode qui a fait ses preuves chez nos voisins ? Nous pourrons ensuite arrêter des objectifs de réduction nette de la charge bureaucratique, comme l'a fait l'Allemagne par exemple - 25 % en quatre ans -, ainsi que des indicateurs et des règles pour y parvenir.
L'établissement d'un plan de réformes globales au début de chaque mandat évitera que les dispositions juridiques applicables aux entreprises soient modifiées plus d'une fois au cours d'une législature. Leur impact sera étudié en amont, leurs objectifs seront chiffrés et les indicateurs à suivre définis. L'étude d'impact deviendra ainsi l'outil principal de qualité de la norme. Une clause de révision devrait aussi être insérée dans chaque loi pour évaluer son efficacité dans les cinq ans suivant son adoption. Ainsi, l'élaboration des lois obéira à un processus d'amélioration continue. La roue de Deming décrit ce cercle vertueux : préparer, exécuter, contrôler, ajuster.
La deuxième étape consiste à alléger le stock normatif.
Nous avons deux siècles de lois derrière nous : pour commencer, il faut élaguer le stock de normes et l'alléger des règles devenues obsolètes. La courbe que nous a transmise l'Union des industries chimiques - merci, monsieur Prudhon - traduit bien l'emballement normatif qu'a connu la France depuis une quinzaine d'années dans le seul domaine de l'hygiène, de la santé et de la sécurité.
La collaboration déjà engagée entre entreprises et administration doit se poursuivre : il faut réévaluer la nécessité des règles et procédures qui compliquent la vie des entreprises. L'objectif est de parvenir à des simplifications substantielles. Ce travail doit être mieux articulé avec l'échelon européen, à la fois avec Bruxelles et avec les autres États européens. Nous devons comparer la performance de notre réglementation avec celle d'États voisins qui partagent des exigences comparables aux nôtres, en termes de santé publique, de protection du consommateur et de sécurité industrielle.
Les salariés français sont-ils en meilleure santé que leurs voisins grâce à l'existence d'une médecine du travail ? Le premier employeur de France, l'Éducation nationale, ne dispose pas d'une médecine du travail ! Nos raffineries pétrolières sont-elles plus sûres grâce à une législation plus stricte ? Non, les raffineries françaises concourent pour 26 % des accidents en Europe, alors qu'elles ne représentent que 10 % des sites ! L'efficacité des règles juridiques doit s'apprécier à l'aune de résultats concrets.
La troisième étape consiste à concevoir la régulation au service des entreprises.
Pourquoi faire porter la responsabilité à un fonctionnaire de déterminer ce qui est autorisé ou pas ? Il nous faut passer d'un système où tout est interdit sauf ce qui est autorisé à un système où tout est autorisé sauf ce qui est interdit. Ainsi, nous libérerons les entreprises, mais aussi l'administration. La régulation doit se faire par objectif et non par moyen. Plus libre, l'entreprise sera plus responsable.
Il convient aussi de porter au niveau européen nos exigences nationales. La transposition de directive doit se faire de manière stricte. Si, ensuite, nous voulons poser des exigences supplémentaires, cela doit faire l'objet d'un texte distinct, dont l'impact devra être évalué. Enfin, notre pays doit cesser d'anticiper sur les règles européennes à venir.
La quatrième étape consiste à mieux légiférer.
Le Parlement est comme une usine à produire des lois. Seul un processus qualité pour leur élaboration peut garantir leur efficacité et leur simplicité. Cela appelle plusieurs changements.
En amont, il faut associer les entreprises à l'élaboration des lois : acceptons de prendre ce temps-là avec vous, car il est déterminant pour améliorer non seulement la qualité, mais aussi la légitimité, et donc l'effectivité, de la loi. La réalisation d'un test PME sur les projets de textes qui leur sont applicables doit devenir obligatoire. Faciliter les expérimentations en amont est aussi un moyen de mieux calibrer les règles avant leur adoption.
Nous devons également miser sur l'étude d'impact préalable, qui doit être approfondie, et poser d'abord la question de l'utilité d'une nouvelle règle. L'étude d'impact devrait aussi concerner les projets d'ordonnance et les propositions de loi inscrites à l'ordre du jour. Surtout, sa qualité doit être contrôlée par le Conseil de la simplification pour les entreprises, dont nous proposons de transformer les missions et la composition pour en assurer l'indépendance. Sur le modèle du NKR, que nous a présenté son président, M. Ludewig, le Conseil rendrait un avis consultatif mais public sur l'étude d'impact, afin de créer du débat public et de l'émulation entre ministères.
Enfin, au Parlement, la procédure d'examen des textes pourrait aussi être améliorée. Nous suggérons un débat d'orientation préalable avant d'attaquer l'examen d'un projet de loi concernant les entreprises. Nous proposons de réfléchir à de nouveaux outils pour endiguer le gonflement des textes au cours de la navette. Nous voulons qu'un nouveau regard soit porté sur l'activité des parlementaires, qui ne se réduise pas à mesurer combien de textes ou d'amendements ils déposent. Je préfère un parlementaire qui fait moins d'amendements mais des amendements utiles, qu'un parlementaire qui en dépose beaucoup. Nous demandons une mise à jour de l'étude d'impact après la première lecture dans une chambre du Parlement. Enfin, nous voulons développer une culture d'évaluation préalable au sein du Parlement. Le contrôle de l'efficacité des lois adoptées doit également être renforcé. Leur déclinaison réglementaire doit enfin mieux respecter la volonté du législateur.
Voilà l'essentiel des propositions qu'avance la délégation sénatoriale aux entreprises pour simplifier efficacement et libérer nos entreprises. Elles sont détaillées dans le rapport que nous avons rédigé. Il s'agit de revoir en profondeur nos façons de faire, au bénéfice de la compétitivité de nos entreprises. « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent », aurait dit Albert Einstein. La délégation sénatoriale aux entreprises propose tout simplement de changer de manière de faire de la politique.
Mme Élisabeth Lamure . - Mesdames, messieurs, je voudrais simplement ajouter quelques mots pour clore notre journée.
Je tiens tout d'abord à remercier tous les intervenants. Chacun est venu nous apporter le fruit de son expérience et de son travail. Je veux aussi tous vous remercier pour votre présence. Vous venez de près de quarante départements différents, et vous avez bien voulu consacrer une journée de votre précieux temps de dirigeant d'entreprise au Sénat. Nous vous en sommes sincèrement reconnaissants.
Cette journée est pour nous l'occasion d'un dialogue très utile entre les entreprises et le Parlement. Elle nous permet de mieux nous connaître mutuellement et, surtout, de créer une relation de confiance qui produira des fruits à l'avenir, dans le travail de législateur qui revient au Parlement.
Nous continuerons à vous tenir informés de nos travaux, au moyen notamment de la lettre d'information de la délégation aux entreprises, qui vous informe plusieurs fois par an de ce qu'elle fait pour vous, entrepreneurs.
À l'ordre du jour de nos prochains travaux, nous allons travailler ces prochaines semaines sur la réforme du droit des contrats, qui a été opérée par une ordonnance entrée en vigueur en octobre dernier. Le Parlement devra prochainement ratifier cette ordonnance. Il nous semble donc important d'examiner les conséquences de cette réforme pour les entreprises avant de la valider.
Nous prévoyons aussi de faire réaliser une étude de l'impact, pour les entreprises, de la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. En effet, dans l'évaluation préalable que le Gouvernement a faite de cette réforme, ne figure aucune estimation chiffrée de son coût pour les entreprises. Nous entendons combler cette lacune d'ici à l'été, afin d'éclairer le Parlement avant le vote de la loi de finances rectificative que lui soumettra sans doute le prochain gouvernement.
Enfin, nous entendons nous pencher après l'été sur la problématique de la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, qui concerne aussi bien les collectivités territoriales que les entreprises.
Vous le voyez, nous restons mobilisés à vos côtés. Nous le resterons, croyez-le bien, au-delà des prochaines échéances électorales.
Il me reste à vous souhaiter un bon retour et de beaux succès pour chacune de vos entreprises !







