B. UNE TRAJECTOIRE MACROECONOMIQUE CONFRONTÉE À UN CHOC DE CROISSANCE
La programmation des finances publiques est, par essence, étroitement dépendante de la conjoncture économique. Elle repose en particulier sur une hypothèse d'élasticité des recettes fiscales au PIB. Les variations de la croissance ont également un impact de court terme sur la dépense publique, mais qui paraît de moindre ampleur que s'agissant des recettes.
1. Une panne de croissance en perspective ?
Les prévisions de croissance du PIB de la France pour 2008 ont été constamment revues à la baisse depuis le début de l'année 2008, du fait en particulier de l'envolée du prix du pétrole, de la hausse du cours de l'euro, et d'une croissance des Etats-Unis plus faible que prévu.
Les fourchettes de prévisions du consensus s'établissaient, à la mi-octobre 2008 7 ( * ) :
- pour l'année 2008, entre 0,8 % (BNP Paribas en particulier) et 1,5 % (ING Financial Markets), avec une moyenne de 0,9 % ;
- pour l'année 2009, entre - 0,5 % (BNP Paribas) et 1 % (BIPE), avec une moyenne de 0,5 %.
Le gouvernement prévoit une croissance du PIB de 1 % en 2008 et comprise entre 1 % et 1,5 % en 2009. Le projet de loi de finances est construit sur une hypothèse de croissance de 1 %. S'agissant de 2009, Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, a indiqué le 20 octobre 2008, au moment de la présentation du présent projet de loi devant l'Assemblée nationale, que : « il est très probable que la croissance en 2009 n'atteigne pas 1 % et que nous soyons amenés à réviser notre prévision. (...) Nous le ferons sur la base d'informations complémentaires. En particulier, nous estimons prudent et respectueux de disposer du taux de croissance pour le troisième trimestre, qui sera connu le 14 novembre. De la même manière, nous souhaitons disposer de la prévision de la Commission européenne pour ajuster la prévision de croissance pour 2009 ».
a) Une croissance de l'ordre de 1 % en 2008 ?
Légèrement supérieures à 2 % pour la France, la zone euro et les Etats-Unis en septembre 2007, les prévisions de croissance du consensus sont désormais de l'ordre de 1 % pour la France (0,9 %) et la zone euro (1,2 %). L'évolution du consensus pour la zone euro a été défavorable de façon à peu près continue, avant même que la crise financière fasse véritablement sentir ses effets.
L'évolution des prévisions de croissance du PIB pour 2008
(en %)
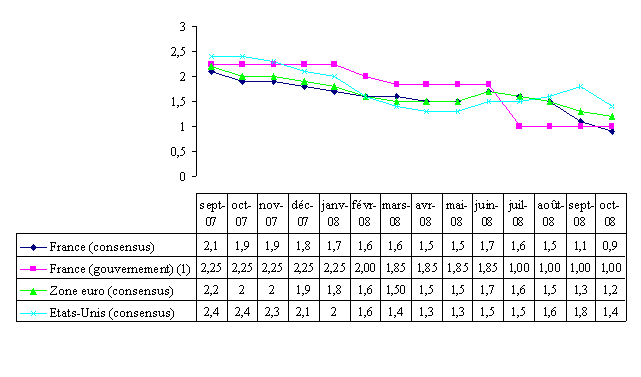 Sources : Consensus
Forecasts, déclarations du gouvernement, projet de loi de finances pour
2009
Sources : Consensus
Forecasts, déclarations du gouvernement, projet de loi de finances pour
2009
Cette prévision d'une croissance de l'économie française de 0,9 % en 2008 correspond à celle publiée par l'Insee dans sa note de conjoncture du 3 octobre 2008.
La prévision de croissance du gouvernement, de 1 %, ne s'écarte donc pas de façon significative du consensus.
b) Une croissance de l'ordre de 0 % en 2009 ?
Le taux de croissance de 2009, de 1 % selon le consensus de début septembre 2008, serait de 0,5 % selon le consensus du début octobre 2008. Si l'on prend en compte le fait que certains organismes n'ont pas révisé leur prévision depuis le mois de septembre, la croissance en 2009 semble donc devoir être proche de 0 %.
Les prévisions de croissance du PIB du consensus pour 2009 ont évolué de manière défavorable depuis le début de l'année, comme l'indique le graphique ci-après.
L'évolution des prévisions de croissance du PIB pour 2009
(en %)
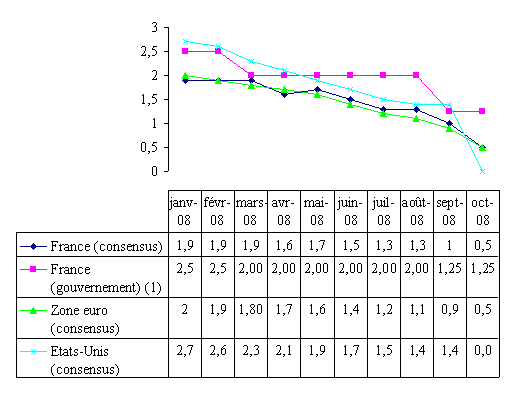
(1) Le projet de loi de finances pour 2009 est construit sur l'hypothèse d'une croissance de 1 % en 2009, mais la « fourchette » retenue par le gouvernement est comprise entre 1 % et 1,5 %.
Sources : Consensus Forecasts, déclarations du gouvernement, projet de loi de finances pour 2009
Bien que la prévision de croissance du gouvernement, de 1 % (exprimée, conformément à l'usage, en moyenne annuelle), soit analogue à la prévision de croissance pour 2008, elle suppose en fait que la croissance de trimestre à trimestre soit, en 2009, de l'ordre de 0,4 % ou 0,5 %, c'est-à-dire proche de 2 % en rythme annualisé, ce qui ne paraît guère vraisemblable.
|
Pourquoi une croissance de 1 % (en moyenne annuelle) en
2008, comme en 2009,
La croissance du PIB une année donnée est exprimée en « moyenne annuelle » : cela signifie que le taux de croissance d'une année donnée est calculé en fonction du rapport entre le PIB total de l'année n et le PIB total de l'année n-1. Il en découle ce paradoxe que si la croissance de trimestre à trimestre est positive l'année n-1, et nulle l'année n, la croissance du PIB de l'année n est considérée comme positive 8 ( * ) . Les économistes appellent « acquis de croissance » la croissance en moyenne annuelle qui serait enregistrée une année donnée, dans l'hypothèse où la croissance trimestrielle serait nulle. Aussi, le fait que le gouvernement prévoie une croissance de l'ordre de 1 % en moyenne annuelle en 2008 et en 2009 n'a pas la même signification pour chacune de ces deux années. Dans le cas de l'année 2008, l'Insee prévoit que la croissance de trimestre à trimestre sera globalement nulle, voire négative (avec une croissance de 0,4 %, - 0,3 %, - 0,1 % et - 0,1 % aux 1 er , 2 e , 3 e et 4 e trimestres). Une récession se définissant comme deux trimestres consécutifs de croissance négative, l'Insee prévoit donc, au-delà des précautions sémantiques, une récession, puisque selon lui la croissance serait négative trois trimestres de suite. La croissance de l'ordre de 1 % en moyenne annuelle prévue pour 2008 s'explique par le phénomène précité : comme la croissance trimestrielle a été positive en 2007, l'acquis de croissance en 2008 est de l'ordre de 1 % (plus précisément, de 0,8 %). En revanche, une prévision de croissance de 1 % en 2009 suppose une reprise de la croissance de trimestre à trimestre. En effet, si la croissance trimestrielle était nulle en 2009, la croissance en moyenne annuelle le serait également 9 ( * ) . Plus précisément, si la croissance de trimestre à trimestre est de 0,4 % en 2009, on peut considérer, en simplifiant, que le PIB, sur une base de 100 pour chaque trimestre de 2008, est de 100,4, 100,8, 101,2 et 101,6 aux 1 er , 2 e , 3 e et 4 e trimestres 2009. Le PIB de 2009 est alors de 404, contre 400 pour celui de 2008, ce qui représente bien une augmentation de 1 %. |
Dès lors, le débat relatif au taux de croissance en 2009 est le suivant :
- soit on suppose qu'après une année 2008 marquée par la stagnation économique consécutive à l'augmentation du prix du pétrole, à l'appréciation de l'euro et au resserrement des conditions de crédit, la croissance de trimestre à trimestre reprendra en 2009, et on aura alors une croissance positive (en moyenne annuelle). Une croissance de 1 % semble cependant exclue : comme on l'a indiqué, si la croissance trimestrielle était égale en 2008 aux prévisions de l'Insee, il faudrait en 2009 une croissance de à 0,4 % à 0,5 % par trimestre pour que la croissance soit égale à 1 % en moyenne annuelle ;
- soit on suppose que l'année 2009 sera également marquée par une croissance trimestrielle nulle, du fait de la crise financière et du climat d'incertitude qui en découle, et on aura alors une croissance nulle en moyenne annuelle (et même, si les prévisions de croissance de l'Insee pour 2008 se confirment, légèrement négative, l'acquis de croissance étant alors de - 0,2 %) ;
- soit on suppose que l'année 2009 connaîtra une croissance trimestrielle négative, et la croissance en moyenne annuelle pourra alors être franchement négative (par exemple, avec une croissance de - 0,5 % au premier trimestre et nulle ensuite, la croissance serait de - 0,7 % en moyenne annuelle).
Une croissance plus faible à la fin de 2008 aurait aussi, comptablement, un impact négatif sur la croissance de 2009 en moyenne annuelle. Par exemple, en supposant une croissance de trimestre à trimestre nulle en 2009, une croissance trimestrielle égale en 2008 aux prévisions de l'Insee, sauf au dernier trimestre, où la croissance serait de - 0,5 %, susciterait une croissance de 2009 de - 0,5 % en moyenne annuelle.
Le FMI, dans ses prévisions du 8 octobre 2008, et la Commission européenne, dans ses prévisions du 3 novembre 2008, prévoient pour la France une croissance de respectivement 0,2 % et 0 % en 2009. Au total, il semble donc désormais falloir tabler sur une croissance quasiment nulle en 2009.
c) Pétrole et taux d'intérêt : des facteurs de soutien en 2009 ?
Les principaux facteurs susceptibles d'éviter une récession en 2009 sont l'évolution du prix du pétrole et des taux d'intérêt.
La récente dépréciation de l'euro, si elle se confirmait, serait également un facteur de soutien important.
On rappelle que, selon les estimations usuelles, la première année :
- un prix du pétrole inférieur de 10 dollars, une baisse des taux d'intérêt (courts et longs) de 100 points de base (ou une croissance de l'économie des Etats-Unis supérieure de 1 point), augmentent la croissance du PIB de la zone euro et de la France d'environ 0,25 point ;
- une dépréciation de l'euro contre toutes les monnaies de 10 % augmente la croissance du PIB de la zone euro de 0,5 point.
Certes, il n'est pas possible d'additionner les impacts des différents phénomènes. En particulier, une poursuite de la baisse du prix du pétrole et de la dépréciation de l'euro serait vraisemblablement la conséquence d'un ralentissement important de l'économie mondiale, en particulier européenne. Par ailleurs, si le crédit est rationné ou la confiance faible, comme cela semble devoir être le cas, la croissance sera forcément faible, quel que soit l'environnement international. Ces facteurs de soutien de l'économie pourraient toutefois jouer un rôle stabilisateur.
On rappelle qu'un euro vaut actuellement 1,32 dollar (après être descendu jusqu'à 1,24 dollar), et que le prix du baril de Brent 66,50 dollars 10 ( * ) .
Le taux de change de l'euro
(valeur de l'euro, en dollars)
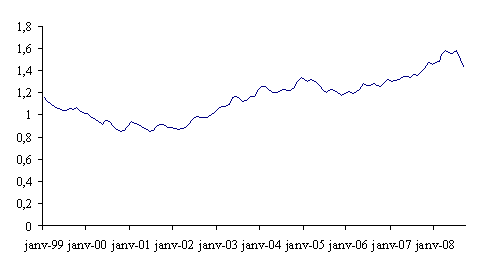
Source : Banque centrale européenne
Le prix du baril de Brent
(en dollars)
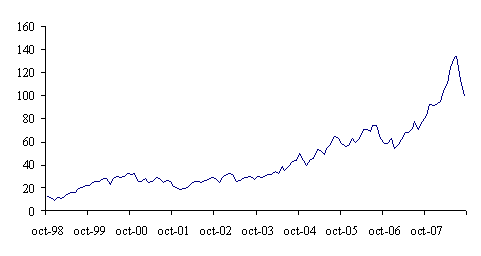
Source : Fonds monétaire international
2. Hypothèses et paris des perspectives gouvernementales associées au projet de loi
a) Une hypothèse de croissance du gouvernement à partir de 2010, de 2,5 %, frappée d'incertitudes
Pour les années 2010, 2011 et 2012, le gouvernement formule une hypothèse de croissance annuelle de 2,5 %. Comme il le souligne, cette hypothèse est conventionnelle : « Le rebond de croissance dès 2010 repose sur l'hypothèse conventionnelle d'un retour de l'environnement international sur un sentier de croissance moyen, et un rattrapage partiel des retards de croissance accumulés en 2008 et 2009 » 11 ( * ) .
Une telle convention est habituelle dans le cas d'un exercice de programmation à moyen terme. Cependant, elle est affectée par l'impact de la crise financière. Selon un article publié en février 2008 par Mme Carmen Reinhart et M. Kenneth Rogoff 12 ( * ) , en moyenne, les 5 crises bancaires les plus graves des 30 dernières années se sont caractérisées par une croissance inférieure de plus de 5 points à celle du haut de cycle, et la croissance est demeurée bien inférieure à son niveau d'avant la crise pendant plus de 3 ans.
Ainsi, selon le consensus des conjoncturistes d'octobre 2008, la croissance du PIB serait encore inférieure à son potentiel en 2010, et simplement égale à son potentiel en 2011 et 2012, soit environ 2,1-2,2 % par an, comme l'indique le graphique ci-après.
Le scénario du consensus n'est pourtant pas un scénario pessimiste. En effet, les conjoncturistes ont tendance à prévoir un « rapprochement de la normale » à l'horizon de leur prévision. Aussi sont-ils généralement assez « démunis » quand il s'agit de prévoir un infléchissement de la conjoncture. Comme le montre le graphique ci-après, l'impact de l'explosion de la « bulle internet » du début des années 2000 a été largement sous-estimé en 2001, 2002 et 2003, les conjoncturistes prévoyant à chaque fois un retour à la normale, qui ne s'est produit qu'en 2004.
La croissance du PIB en volume : prévisions jusqu'en 2012
(en %)
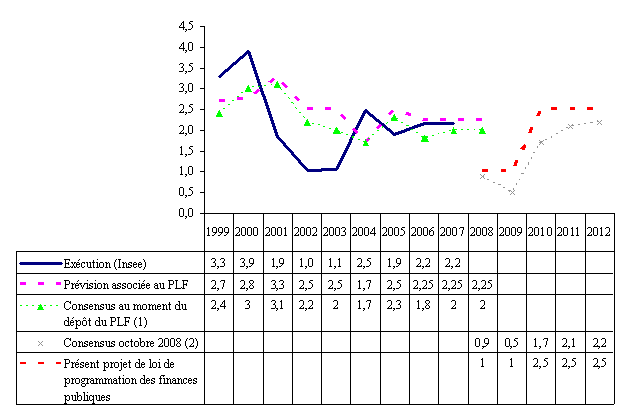
(1) Commission économique de la Nation, fin septembre ou début octobre.
(2) Consensus Forecasts.
Sources : Insee, projets de lois de finances, Commission économique de la Nation
b) Des prélèvements obligatoires qui pourraient être moins dynamiques que prévu
L'évolution de la conjoncture aura aussi un impact sur les hypothèses du gouvernement en ce qui concerne l'élasticité des prélèvements obligatoires au PIB.
|
L'élasticité des prélèvements obligatoires au PIB L'élasticité des prélèvements obligatoires au PIB est le coefficient par lequel il faut multiplier la croissance du PIB en valeur pour obtenir la croissance « spontanée » des prélèvements obligatoires (c'est-à-dire avant les modifications du droit, appelées « mesures nouvelles »), l'année considérée. Sur longue période, les prélèvements obligatoires « spontanés » tendent à augmenter à la même vitesse que le PIB. On dit alors que leur élasticité au PIB est égale à 1. En revanche, il arrive fréquemment à court terme que cette élasticité s'éloigne de l'unité. Ainsi, certaines années (en général quand la croissance du PIB est forte), les prélèvements obligatoires augmentent plus rapidement que le PIB : leur élasticité au PIB est alors supérieure à 1. D'autres années (en général quand la croissance du PIB est faible), les prélèvements obligatoires au PIB augmentent moins rapidement que le PIB : leur élasticité au PIB est alors inférieure à 1. |
Les hypothèses d'élasticité au PIB retenues par le gouvernement, tant pour les prélèvements obligatoires dans son ensemble que pour les seules recettes fiscales, sont indiquées dans le tableau ci-après.
Les hypothèses d'élasticité des prélèvements obligatoires au PIB retenues par le gouvernement
|
2008 |
2009 |
2010-2012 |
|
|
Ensemble des prélèvements obligatoires |
1,3 |
1 |
« élasticité quasiment unitaire » |
|
Recettes fiscales |
1,5 |
0,8 |
« élasticité au PIB légèrement supérieure à 1 » |
Source : rapport annexé au présent projet de loi de programmation des finances publiques
Schématiquement, la situation est la suivante :
- l'élasticité des cotisations sociales au PIB varie peu, et est à peu près égale à l'unité ;
- l'élasticité des recettes fiscales au PIB varie fortement (entre -1 et 2, pour une moyenne de 1) ;
- en conséquence, l'élasticité des prélèvements obligatoires au PIB est à peu près égale à la moyenne de 1 et de ce dernier coefficient. Elle connaît donc des fluctuations significatives. L'élément essentiel pour la prévision est donc l'élasticité des recettes fiscales au PIB. Celle-ci est fortement liée à la croissance du PIB, comme l'indique le graphique ci-après.
La courbe inférieure représente l'élasticité, c'est-à-dire la « sensibilité » des recettes fiscales au PIB nominal. On constate que cette élasticité a été nettement supérieure à 1, et donc que les recettes fiscales ont spontanément eu tendance à augmenter nettement plus vite que le PIB, en 1987, de 1999 à 2001, et de 2004 à 2007.
On constate, par ailleurs, qu'en règle générale, l'élasticité des recettes fiscales est à peu près égale à la moitié de la croissance du PIB en volume. La forte élasticité constatée de 2004 à 2007 constitue donc une exception remarquable.
Croissance du PIB et élasticité des recettes fiscales au PIB
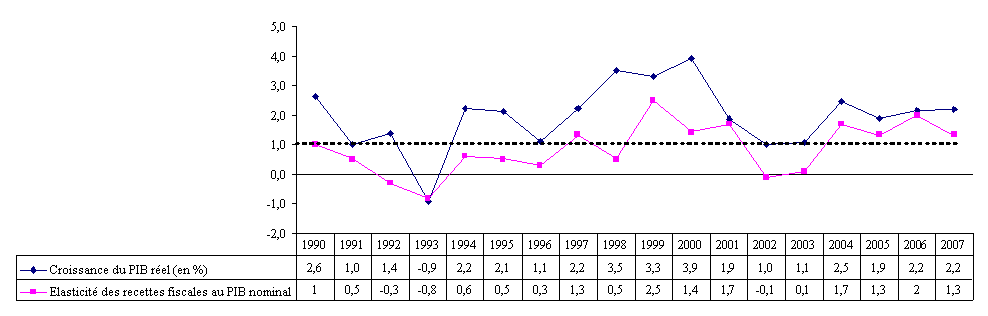
Sources : Insee, ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Corrélation entre croissance du PIB réel et élasticité des recettes fiscales au PIB nominal
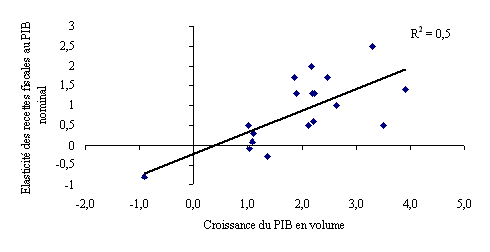
Sources : Insee, ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Les prévisions d'élasticité des recettes fiscales au PIB retenues par le gouvernement sont cohérentes avec ses prévisions de croissance du PIB. Les premières sont cependant fortement tributaires des secondes. Une croissance du PIB plus faible que prévu se traduirait par une élasticité d'autant plus faible.
Par ailleurs, il convient de s'interroger sur les causes concrètes du dynamisme des recettes constaté ces dernières années. Comme votre rapporteur général le soulignait dans son rapport d'information précité relatif au débat d'orientation budgétaire pour 2008, ce dynamisme des recettes fiscales résulte pour l'essentiel de phénomènes conjoncturels, susceptibles de s'inverser à court terme.
En particulier, le dynamisme des impôts assis sur les revenus du capital et les plus-values (impôt sur le revenu, CSG, droits de mutation, impôt de solidarité sur la fortune) provient de la hausse cyclique des prix des actifs financiers et immobiliers, qui plafonne puis, le cas échéant, s'inverse en période de crise. Une analyse analogue peut être faite au sujet de l'impôt sur les sociétés.
La Cour des comptes, dans son rapport de juin 2007 sur la situation et les perspectives des finances publiques, attribue les fortes recettes d'impôt sur les sociétés aux « résultats très élevés en 2006 des sociétés du secteur financier et de l'énergie ». Or, les bons résultats du secteur de l'énergie et du secteur financier s'expliquaient alors largement, respectivement, par le niveau élevé du prix du pétrole, et par la situation favorable des marchés boursiers. La crise financière actuelle devrait donc avoir des répercussions importantes sur les recettes de l'impôt sur les sociétés. On peut rappeler à cet égard que le secteur financier correspond à peu près au quart des recettes d'impôt sur les sociétés.
c) Des dépenses publiques moins sensibles à la conjoncture et susceptibles être contrôlées
Comme le souligne le rapport du gouvernement sur la dépense publique et son évolution, joint au projet de loi de finances pour 2009, les dépenses sont, pour l'essentiel, liées aux montants votés. Le gouvernement peut donc les piloter , et limiter ainsi l'impact que pourrait avoir une inflexion de la croissance sur les dépenses sensibles à l'évolution de l'activité. Il existe dans ce domaine un pouvoir assez largement discrétionnaire du gouvernement.
La sensibilité de certaines dépenses à la conjoncture peut néanmoins être forte. Le rapport précité souligne que « les dépenses d'indemnisation du chômage augmentent en cas de dégradation de l'activité et de redressement du chômage. Les dépenses liées au revenu minimum d'insertion suivent avec retard ce phénomène : à l'issue d'une période de basse conjoncture, les chômeurs en fin de droits sont plus nombreux et les dépenses liées au RMI plus importantes. En phase de redémarrage, la décrue des dépenses de RMI est plus lente que celle des dépenses de chômage. D'autres dépenses sous conditions de ressources (allocation logement par exemple) sont aussi affectées par l'activité avec retard (environ une année) dans la mesure où elles sont liées au montant des revenus perçus l'année qui précède leur versement ».
Evolution comparées de la dépense publique et du PIB
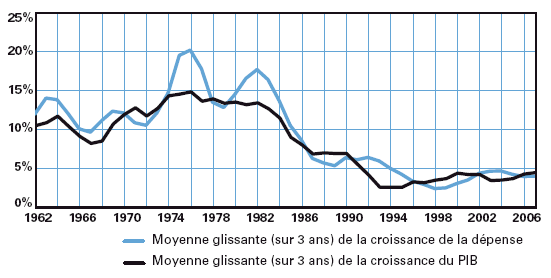
Source : INSEE/rapport du gouvernement sur la dépense publique et son évolution joint au PLF 2009
3. De la crise financière à la crise économique ?
L'économie mondiale est actuellement confrontée à une grave crise bancaire et financière.
a) Rappel chronologique
Pour un exposé plus détaillé, on se reportera au rapport de votre rapporteur général sur le récent projet de loi de finances rectificative pour le financement de l'économie 13 ( * ) .
(1) Une crise d'origine américaine
On considère que la crise a débuté en 2007, à la suite de la chute des prix immobiliers aux Etats-Unis, et de la crise du marché des crédits hypothécaires (les « subprimes ») qui en avait résulté.
Certaines banques s'en sont trouvées fragilisées, soit directement, soit indirectement, du fait en particulier du développement de la titrisation. En raison des nouvelles normes de comptabilisation en valeur de marché, les établissements bancaires ont été confrontés à la nécessité de provisionner d'importantes pertes latentes sur des actifs dépréciés et de faire appel aux marchés financiers pour se recapitaliser et respecter les normes de solvabilité imposées par le Comité de Bâle. De très nombreuses augmentations de capital ont été réalisées entre septembre 2007 et juin 2008, pour un montant global d'environ 300 milliards de dollars .
|
La solvabilité des banques 1. L'obligation de disposer de fonds propres positifs Les banques sont soumises, comme toute entreprise, à l'obligation de disposer de fonds propres positifs. Des pertes financières importantes peuvent donc les rendre insolvables. Supposons par exemple qu'une banque dispose, avant la crise, d'un actif constitué d'actifs financiers égal à 100, et d'un passif hors fonds propres constitué de dépôts pour un montant 80. Les fonds propres nécessaires pour équilibrer le bilan sont donc égaux à 100-80=20. L'insolvabilité apparaît si l'actif de la banque diminue suffisamment pour rendre ses fonds propres négatifs, c'est-à-dire, dans notre exemple simplifié, si les actifs financiers deviennent inférieurs à 80. Actuellement, une proportion importante des actifs soit, sont nettement en-dessous de leur valeur de long terme (s'agissant des placements dans des sociétés cotées), soit ne peuvent plus être valorisés par le marché faute de transactions (cas des véhicules structurés et de titrisation). Il peut en résulter un problème de solvabilité , les banques étant tenues par les normes comptables internationales de respecter la règle dite du « mark to market », c'est-à-dire d'évaluer leurs actifs selon les prix du marché. 2. L'obligation de respecter des règles prudentielles strictes Outre l'obligation de disposer de fonds propres positifs, les banques de dépôts doivent également respecter certaines règles prudentielles liées à leur rôle central dans l'économie : - les accords de Bâle I (1988) ont mis en place le ratio Cooke, selon lequel les fonds propres ne pouvaient être inférieurs à 8 % de l'encours pondéré des crédits (avec des fonds propres de 1, on pouvait ainsi prêter 12,5) ; - les accords de Bâle II , formalisés le 26 juin 2004 et transposés en Europe par deux directives du 14 juin 2006, ont mis en place le ratio McDonough actuellement en vigueur, selon lequel les fonds propres ne peuvent être inférieurs à 8 % de la somme pondérée des différents types de risques. Les banques appliquent également un ratio dit « Tier One » , indicateur largement utilisé par les régulateurs afin de mesurer le degré de capitalisation des institutions financières. Défini par les accords de Bâle I sans avoir été substantiellement modifiée par Bâle II, il désigne les fonds propres « de base », soit la partie jugée la plus solide de leurs capitaux propres, et rassemble essentiellement : - au numérateur, le capital social, les résultats mis en réserve et les intérêts minoritaires dans les filiales consolidées, moins les actions auto détenues et l'éventuel goodwill (valorisation de l'écart d'acquisition) ; - au dénominateur, le total des actifs ajustés du risque. Le minimum requis selon les accords de Bâle I est de 4 % mais dans la pratique, la plupart des banques visent au moins 7 %. La dépréciation des actifs des banques a donc pour conséquence de réduire leur possibilité de prêt , et peut leur poser un problème de solvabilité si le ratio devient inférieur à 8 %. 3. La réaction des pouvoirs publics Face à de tels problèmes de solvabilité, les pouvoirs publics peuvent réagir de deux manières. Ils peuvent tout d'abord racheter les actifs à risque à un prix qu'ils déterminent . Le risque est alors de les acheter à une valeur inférieure ou supérieure à ce qui, dans des circonstances normales, constituerait leur prix de marché. Dans le premier cas, le problème de solvabilité peut ne pas être résolu ; dans le second cas, l'Etat augmente de fait le capital de la banque, sans disposer d'aucun des droits de l'actionnaire, ni avoir de possibilité de « récupérer » ses fonds quand la situation s'améliore. C'est le principe du « plan Paulson » (cf. infra ). L'Etat peut également contribuer à une recapitalisation des banques en devenant directement actionnaire ou souscripteur de fonds propres, avec les avantages qui en découlent et la possibilité de revendre les actions une fois que la situation s'améliore. Ce cas de figure est privilégié par les pays européens. |
L'impact de la crise du crédit hypothécaire sur le bilan des banques s'est propagé avec la défiance. Le montant global des dépréciations liées aux subprimes atteignait ainsi en septembre 2008 près de 590 milliards de dollars pour un marché de prêts subprimes de 1.300 milliards de dollars. Si les pertes connues des banques françaises étaient, fin septembre 2008, « limitées » à une vingtaine de milliards d'euros, compte tenu de leur stratégie plus prudente en matière de titrisation, celles des banques européennes culminaient à plus de 150 milliards d'euros.
(2) Les défaillances des banques Northern Rock et Bear Sterns
Sans revenir en détails sur la chronique des difficultés des établissements financiers, on peut rappeler qu'une première prise de conscience de la gravité de l'impact sur le secteur bancaire est née à l'occasion des défaillances des banques Northern Rock et Bear Sterns . La première, spécialisée dans le crédit immobilier hypothécaire, a été de facto nationalisée par le gouvernement britannique le 18 février 2008, et la seconde, une des cinq plus grandes banques d'investissement américaines, a été rachetée par J.P. Morgan Chase le 16 mars 2008 avec le soutien de la Fed.
Les principales banques centrales sont intervenues sur le marché interbancaire dès l'été 2007, par des initiatives concertées ou individuelles. Elles ont ainsi massivement injecté des liquidités sous forme de prêts à très court terme aux banques, et ont graduellement atténué leurs exigences sur la qualité des actifs détenus par ces dernières qu'elles acceptaient en garantie (on parle de « collatéral ») de leurs interventions. La Fed a ainsi inclus dans le périmètre des actifs éligibles des actions d'entreprises cotées.
(3) Les événements de septembre 2008 et l'extension de la crise à l'Europe continentale
Le cours des événements s'est accélérée en septembre 2008, avec la mise sous tutelle gouvernementale et la recapitalisation par les pouvoirs publics des organismes de refinancement hypothécaire Freddie Mac et Fannie Mae, l'acquisition de Merrill Lynch - une autre des cinq principales banques d'investissement américaines - par Bank of America, la première banque de dépôt américaine, et, surtout, la faillite, le 15 septembre 2008, de Lehman Brothers - qui faisait également partie des cinq plus grandes banques d'investissement américaines. Ainsi, des cinq plus grandes banques d'investissement américaines d'avant la crise, seules deux n'avaient pas disparu et n'avaient pas été rachetées : Morgan Stanley et Goldman Sachs, qui se sont transformées en banques de dépôt.
La faillite de Lehman Brothers a été permise par les autorités américaines afin de réduire le phénomène d' « aléa moral » : il s'agissait de signifier aux banques que les pouvoirs publics ne viendraient pas systématiquement à leur secours en cas de prise de risque inconsidérée. Elle a été perçue comme un véritable séisme, et a suscité une fuite devant le risque 14 ( * ) qui a transformé le risque de liquidité en risque de solvabilité pour les institutions financières les plus endettées.
b) Eléments de mise en perspective
(1) Des précédents de crises bancaires majeures restés confinés au plan national
Bien entendu, ce n'est pas la première fois qu'une crise bancaire et financière importante se produit. Dans l'article précité publié en février 2008 15 ( * ) , Mme Carmen Reinhart et M. Kenneth Rogoff rappellent que les trente dernières années ont vu 5 crises bancaires majeures : Espagne (1977), Norvège (1987), Finlande (1991), Suède (1991) et Japon (1992) 16 ( * ) .
L'impact sur la croissance a été significatif. Si le cas de la Finlande - qui a connu 4 ans de croissance nulle ou négative, avec un minimum à - 6 % en 1991 - n'est probablement pas représentatif, la crise bancaire s'inscrivant alors dans le contexte d'une crise plus générale consécutive à l'effondrement économique de l'ancienne URSS, on peut rappeler que la croissance a été nulle en Espagne en 1979, de - 0,2 % en Norvège en 1988, et de - 2 % en Suède et au Japon, respectivement en 1993 et 1998.
Ces crises n'ont pas suscité d'effondrement du système bancaire, grâce à l'intervention des gouvernements et des banques centrales. En particulier, les banques ont été recapitalisées et ont vu tout ou partie de leurs actifs douteux repris par les pouvoirs publics. Le coût ex ante de ces mesures a été important, de 6 points de PIB pour la crise suédoise de 1991 à 20 points de PIB pour la crise japonaise de 1991 (qui il est vrai n'a commencé à être « traitée » qu'à la fin des années 1990, ce qui pourrait contribuer à expliquer ce montant élevé). Ces sommes ont ensuite été en partie récupérées par les pouvoirs publics.
Les Etats-Unis ont connu une crise moins importante, celle de leurs caisses d'épargne, qui a commencé en 1984 et contribua à une croissance de seulement - 0,2 % en 1991. Le coût ex ante pour les pouvoirs publics a alors été de 3,2 points de PIB.
La crise bancaire et financière actuelle ne paraît pas, dans sa nature, fondamentalement différente de celles qui l'ont précédée . En particulier, les 5 grandes crises précitées ont toutes été précédées d'un krach immobilier.
(2) Une crise mondiale d'une ampleur, au plan financier, inégalée depuis 1929
Si la crise actuelle se distingue de celles qui l'ont précédée, ce n'est donc pas par sa nature, mais par son ampleur. Il s'agit, sur le plan financier, de la plus grave depuis la crise de 1929 .
Par ailleurs, cette crise est mondiale, ce qui a d'importantes conséquences :
- l'impact sur le PIB est, toutes choses égales par ailleurs, plus marqué, puisque la crise touche tous les pays en même temps ;
- le nombre de pays concernés étant plus grand, le risque que se produise dans l'un d'entre eux un événement négatif est accru, ce qui rend plus difficile le rétablissement de la confiance, alors la moindre mauvaise nouvelle prend immédiatement une ampleur mondiale ;
- la gestion de la crise est complexifiée par les difficultés de la coordination entre Etats.
Ce caractère mondial de la crise fait du FMI un acteur essentiel.
Le 24 octobre 2008, le FMI a annoncé un accord initial avec l'Islande sur un prêt de deux ans de 2,1 milliards de dollars à l'appui d'un programme de redressement économique visant à rétablir la confiance dans le système bancaire et à stabiliser la monnaie.
Le FMI a indiqué disposer de plus de 200 milliards de dollars de fonds prêtables, et pouvoir mobiliser des ressources supplémentaires par l'intermédiaire de deux accords d'emprunt permanents conclus avec des groupes de pays membres. Plusieurs pays émergents connaissent en effet une dette élevée et un déficit courant important, qui suscitent une chute de leurs devises. La Hongrie, l'Ukraine, la Serbie, la Biélorussie ont ainsi sollicité l'aide du FMI.
L'enjeu est essentiel pour les pays d'Europe occidentale, dont les banques sont fortement engagées dans les pays émergents, en particulier européens.
c) La réaction énergique des autorités politiques européennes
(1) Des réponses initiales en ordre dispersé
Dans un premier temps, face à l'urgence, les Etats ont cédé à la tentation du « chacun pour soi » et la coordination des efforts ne put se faire.
Cette absence initiale de coordination s'explique en partie par le fait que les situations nationales étaient différentes.
Dans certains pays, la crise correspondait à un problème de sous-capitalisation du système bancaire. Tel était en particulier le cas des Etats-Unis et du Royaume-Uni. Ces deux pays ont réagi de façon différente.
Les Etats-Unis se sont efforcés d'éviter, autant que possible, la recapitalisation. Certes, on a vu que Freddie Mac et Fannie Mae ont été nationalisés. Cependant, le « plan Paulson » a prévu simplement la reprise par les pouvoirs publics d'actifs à problèmes. Les Etats-Unis ont laissé largement jouer les mécanismes du marché : les banques en difficultés ont été rachetées par des concurrents (rachat de la Bear Stearns et de Washington Mutual, la plus grande caisse d'épargne du pays, par JP Morgan Chase ; offre de rachat de Wachovia par Citigroup, puis Wells Fargo), voire ont fait faillite (Lehman Brothers).
|
Le « plan Paulson » Le « plan Paulson », inclus dans l' Emergency Economic Stabilization Act , et parfois surnommé TARP ( Troubled Assets Relief Program , « programme d'assistance aux actifs en détresse »), fut adopté par la Chambre des Représentants le 3 octobre 2008, après un rejet initial, découlant de l'opposition de la majorité des représentants républicains, pour des raisons électorales. Il permet au gouvernement fédéral des Etats-Unis d'acheter des actifs illiquides, jusqu'à 700 milliards de dollars. La mise à disposition de cette somme sera faite par étapes : une première tranche de 250 milliards de dollars sera débloquée immédiatement, puis 100 milliards, puis 350 ensuite, ce déblocage requérant alors l'assentiment du Congrès. Ces 700 milliards de dollars correspondent à 5 % du PIB des Etats-Unis. Par ailleurs, le plafond d'indemnisation accordé aux déposants américains a été porté de 100.000 dollars à 250.000 dollars. Pour financer cette augmentation, la capacité d'emprunt de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) auprès du Trésor a été déplafonnée. Ce plan a été critiqué par de nombreux économistes, parce qu'il ne prévoit pas de recapitalisation directe des banques en difficulté. Il prévoit cependant que les institutions financières qui vendront des actifs illiquides au Trésor devront en contrepartie émettre en sa faveur des warrants (c'est-à-dire des titres lui donnant le droit d'acheter des titres pour un prix fixé à l'avance), ce qui permettrait au Trésor de devenir actionnaire des banques secourues. |
Le Royaume-Uni a réagi quant à lui par la recapitalisation de son système bancaire. Ainsi, la Northern Rock et Bradford & Bingley ont été nationalisées (et, dans ce dernier cas, certaines de ses activités ont été vendues à la banque espagnole Santander). Le 8 octobre 2008, son gouvernement a annoncé un plan de recapitalisation du secteur bancaire de 50 milliards de livres. Cela n'empêche pas le Royaume-Uni de laisser des banques en racheter d'autres (rachat de Halifax-Bank of Scotland par la Lloyds TSB).
La situation était différente dans les pays où la crise se limitait, pour l'essentiel, à la crise de confiance sur le marché interbancaire. Dans ces pays, l'action initiale des pouvoirs publics a consisté :
- à accorder des liquidités importantes (en Allemagne, Hypo Real Estate - fragilisée par sa filiale Depfa -, grâce à un prêt initial par l'Etat et un consortium de banques, de 35 milliards d'euros, porté à 50 milliards d'euros, la banque ayant initialement sous-estimé ses besoins de liquidités) ;
- à procéder à des augmentations ponctuelles de capital (Dexia - fragilisée par sa filiale américaine FSA, un « rehausseur de crédit » 17 ( * ) -, par les gouvernements français - aidé par la Caisse des dépôts et consignations -, belge et luxembourgeois ; Fortis, par les gouvernements belge, néerlandais et luxembourgeois, l'essentiel de ses activités belges et luxembourgeoises étant ensuite acquises par BNP Paribas) ;
- à garantir les emprunts interbancaires (cas de ceux de Dexia, garantis jusqu'au 31 octobre par les gouvernements français, belge et luxembourgeois ; cas des banques du Royaume-Uni, pour un montant de 250 milliards de livres).
Un cas emblématique du manque de coordination se présente avec les relèvements unilatéraux du plafond de garantie des dépôts et comptes d'épargne.
Le Conseil ECOFIN de Luxembourg du 7 octobre 2008 a toutefois apporté davantage de coordination en convenant que tous les Etats membres de l'Union européennes « fourniraient, pour une période initiale d'un an au moins, une garantie pour les dépôts des particuliers d'un montant minimal de 50.000 euros, en prenant acte de ce que de nombreux Etats membres ont décidé de porter ce minimum à 100.000 euros ». Plusieurs Etats européens ont adapté la garantie de dépôt en vigueur dans leur pays à la suite de ce Conseil, ce qu'illustre le tableau ci-après.
Garantie des dépôts dans plusieurs pays
européens
avant et après le Conseil ECOFIN du 7 octobre
2008
(en euros)
|
Avant |
Après |
|
|
Allemagne, Grèce, Irlande (*) |
20.000 |
Illimitée |
|
Autriche, Belgique, Espagne |
20.000 |
100.000 |
|
Danemark |
40.000 |
Illimitée |
|
France |
70.000 |
70.000 |
|
Italie |
103.291 |
103.291 |
|
Pays-Bas |
38.000 |
100.000 |
|
Royaume-Uni |
44.000 |
64.000 |
(*) Irlande : garantie illimitée pendant 2 ans non seulement des dépôts bancaires, comme les autres pays, mais aussi des dettes dans les 6 grandes banques du pays.
Source : Crédit agricole
L'ensemble de ces actions n'a pas rassuré les acteurs du monde financier, ce qu'illustre la baisse historique des marchés d'actions dans la semaine du 6 au 10 octobre 2008. Depuis la fin 2007, le CAC 40 a perdu environ la moitié de sa valeur, comme l'indique le graphique ci-après.
L'évolution du CAC 40 depuis la fin 2007
(base 100=31 décembre 2007)
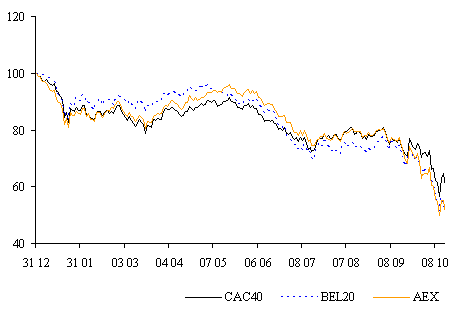
Source : Euronext
Ce krach résulte largement d'une longue surévaluation des cours boursiers, et d'inquiétudes des marchés sur l'économie réelle.
L'Islande, dont le secteur financier, très endetté, représente une grande part du PIB, a dû nationaliser en octobre 2008 ses trois plus grandes banques. Les inquiétudes sur une possible faillite de l'Etat islandais ont suscité une dégradation de sa dette publique par les agences de notation, et aggravé la crise de change dont la monnaie était victime depuis le début de l'année. Le gouvernement islandais et le Fonds monétaire international (FMI) ont annoncé, le 24 octobre 2008, être parvenus à un accord sur l'octroi d'un prêt de 2,1 milliards de dollars.
(2) Le renforcement de la coordination des politiques nationales depuis octobre 2008
L'inefficacité des mesures prises isolément a convaincu les dirigeants des principales économies du monde d'agir en plus étroite concertation.
Cette concertation a concerné tout d'abord les banques centrales. Le 8 octobre 2001, la Réserve fédérale des Etats-Unis (Fed), la Banque centrale européenne (BCE), la Banque du Canada (BoC), la Banque d'Angleterre (BoE), la Banque centrale de Suède (Riksbank) et la Banque Nationale Suisse (SNB) ont baissé conjointement leurs taux directeurs de 50 points de base. Le taux de refinancement était alors à 3,75 % en zone euro et à 1,5 % aux Etats-Unis 18 ( * ) .
Cette concertation a concerné ensuite les Etats, et en particulier les Etats membres de l'Union européenne ayant adopté l'euro. C'est ainsi qu'à l'initiative de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République et actuel président du Conseil européen, un sommet des Etats de la zone euro s'est tenu, à Paris, le 12 octobre 2008, au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement.
Cette réunion avait été précédée, toujours à l'initiative du Président de la République, d'une réunion préparatoire des pays européens membres du G7 (France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni) 19 ( * ) , le 5 octobre à Paris et d'un Conseil ECOFIN le 7 octobre 2008 à Luxembourg. D'autre part, un G7 finances s'est tenu à Washington le 10 octobre 2008. L'effort de coordination s'étend donc à l'ensemble de nos principaux partenaires, ce que montre également l'entretien du Président Nicolas Sarkozy avec M. Gordon Brown, Premier ministre du Royaume-Uni, avant le sommet de la zone euro précité.
Votre rapporteur général tient à souligner la cohérence des lignes directrices exprimées à l'issue du sommet des Etats de la zone euro , qui sont de nature à « réenclencher » la mécanique du crédit et donc le financement de l'économie tout en préservant au mieux les intérêts des contribuables.
D'une part, l'ensemble des pays affirme avec force qu'aucune banque européenne importante ne fera faillite , les Etats s'engageant, si nécessaire, à employer des moyens « hétérodoxes » pour y parvenir, y compris la prise de participations. Comme indiqué précédemment, plusieurs pays ont d'ailleurs déjà eu recours à de tels procédés.
Mais, de telles annonces n'ayant pas suffi à restaurer la confiance des prêteurs, les Etats de la zone euro sont allés plus loin en préconisant l'apport de garanties publiques aux nouvelles émissions des banques . Cela doit permettre de relancer enfin le marché interbancaire.
(3) La loi du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie
La loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie a pour fonction essentielle d'autoriser l'octroi de la garantie de l'Etat, dans la limite de 360 milliards d'euros, soit environ 20 % du PIB . La répartition de ces 360 milliards d'euros n'est pas précisée par la loi. Cependant, selon les informations transmises à votre commission des finances, elle se décomposerait de la manière suivante.
Tout d'abord, 320 milliards d'euros concernent la garantie des créances émises avant le 31 décembre 2009. Cette garantie sera accordée par une société de refinancement des établissements de crédits, la Société de financement de l'économie française (SFEF), au capital majoritairement détenu par les banques, et se finançant par des émissions obligataires garanties par l'Etat. La garantie de l'Etat ne pourra jouer que pour les obligations émises avant le 31 décembre 2009, et d'une maturité moyenne de 5 ans maximum. La société gèrera donc un portefeuille de prêts garantis en extinction progressive sur six ans, jusqu'au 31 décembre 2014 20 ( * ) . La société n'aura pas la qualité d'établissement de crédit pour ne pas être soumise à la contrainte, coûteuse et peu utile en l'espèce, de disposer d'un capital minimum répondant aux exigences prudentielles applicables à ceux-ci. Le capital ne sera donc constitué que pour couvrir des frais de fonctionnement réduit. Les établissements bénéficiaires devront apporter des actifs en garantie de leurs emprunts auprès de la société de refinancement. Ces titres ont vocation à être rétrocédés à la banque cessionnaire, à une date et un prix convenus à l'avance. Cette société est présidée par M. Michel Camdessus, ancien directeur général du Fonds monétaire international (FMI).
Le 24 octobre 2008, la SFEF a accordé ses premiers prêts au secteur bancaire, pour un montant total de 5 milliards d'euros. 7 banques ont bénéficié de cette opération. La Caisse des dDépôts et consignations a octroyé à la SFEF un prêt relais pour le financement de cette opération.
Ensuite, 40 milliards d'euros, garantis à titre gratuit par l'Etat, correspondent aux financements qui pourraient être levés par une société de prises de participations de l'Etat (SPPE), dont l'Etat sera l'unique actionnaire. La SPPE a été créée et a pris une participation dans Dexia avant même la loi de finances rectificative précitée. Elle a pour objet de souscrire à des titres émis par des organismes financiers. Le gouvernement a d'ores et déjà annoncé que 10,5 milliards d'euros seraient consacrés à des émissions de titres de dette subordonnée effectuées par les établissements de crédit à un taux supérieur d'environ 400 points de base en moyenne au taux sans risque et pour les montants suivants :
Souscriptions éventuelles de titres subordonnées par la SPPE
(en milliards d'euros)
|
Etablissement |
Intentions d'émissions |
|
Banques populaires |
0,95 |
|
BNP Paribas |
2,55 |
|
Caisses d'épargne |
1,10 |
|
Crédit agricole |
3,00 |
|
Crédit mutuel |
1,20 |
|
Société générale |
1,70 |
|
Total |
10,50 |
Source : ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Ce plan s'inscrit dans le cadre d'une initiative concertée des pays de l'Union européenne . Comme l'a souligné M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, « si on tient compte des différences de PNB, il est comparable à celui de l'Allemagne (400 milliards d'euros pour la garantie interbancaire et 80 milliards d'euros pour la recapitalisation) et du Royaume-Uni (318 milliards d'euros pour la garantie interbancaire et 64 milliards d'euros pour la recapitalisation) ».
Principales mesures prises au 16 octobre 2008
(en milliards d'euros)
|
Garanties sur les émissions de dette |
Renforcement et refinancement des fonds propres |
Rachats d'actifs |
|
|
Allemagne |
400 |
80 |
|
|
Autriche |
85 |
15 |
|
|
Espagne |
100 |
50 |
|
|
France |
320 |
40 |
|
|
Pays-Bas |
20 |
||
|
Royaume-Uni* |
200 |
50 |
|
|
Etats-Unis |
totale sur certains titres de dette senior |
185 |
335 |
* Plus 200 Mds £ Special Liquidity Scheme (dette interbancaire)
Source : Crédit agricole, « Perspectives hebdo », n°37/08, 17 octobre 2008
Dans tous les cas de figure, ces 360 milliards d'euros ne seront pas payés par le contribuable. En effet, dans l'hypothèse - peu probable - où la garantie de l'Etat jouerait, elle ne ferait qu'accroître la dette publique. Si l'appel en garantie portait sur la totalité des 360 milliards d'euros, la dette publique, actuellement de l'ordre de 65 points de PIB, augmenterait de 20 points de PIB, soit environ 30 %. Dans cette hypothèse, le contribuable devrait payer l'augmentation de la charge de la dette qui en résulterait, soit environ 20 milliards d'euros.
(4) Le plan d'aide aux PME
Par ailleurs, le gouvernement a mis en place un plan de 22 milliards d'euros d'aide aux PME :
- 17 milliards d'euros d'excédent d'épargne réglementée (7,5 milliards d'euros du livret de développement durable et 9,5 milliards d'euros du livret d'épargne populaire), transférés aux banques pour prêter aux PME ;
- 5 milliards d'euros de capacité d'intervention supplémentaire d'OSEO pour les PME (2 milliards d'euros par augmentation de son activité de cofinancement 21 ( * ) , 2 milliards d'euros par augmentation de son activité de garantie 22 ( * ) et 1 milliard d'euros par la création d'un fond de garantie ciblé sur la conversion de financements de court terme en financements de moyen et long terme).
* 7 Source : Consensus Forecasts, octobre 2008.
* 8 Cela peut facilement être « visualisé » en s'imaginant le PIB trimestriel de l'année n-1 comme un escalier montant, constitué de quatre « marches », et celui de l'année n comme un palier. Le « palier » étant plus élevé que la moyenne des quatre marches (puisqu'il est au niveau de la 4e marche), il y a nécessairement croissance du PIB en moyenne annuelle.
* 9 On peut « visualiser » ce phénomène en s'imaginant le PIB trimestriel des années 2008 et 2009 comme un long palier : le palier étant alors à la même « hauteur » en 2008 et en 2009, la croissance en moyenne annuelle serait forcément nulle.
* 10 Le 30 octobre 2008.
* 11 Source : rapport sur la programmation des finances publiques pour la période 2009 à 2012 annexé à l'article 3 du projet de loi de programmation des finances publiques pour la période 2009-2012.
* 12 « Is the 2007 U.S. Sub-Prime Financial Crisis So Different ? An International Historical Comparison», 5 février 2008.
* 13 Rapport n° 23 (2008-2009).
* 14 La fuite devant le risque fut telle que le rendement des billets à trois mois du Trésor des Etats-Unis devint négatif pendant quelques heures.
* 15 Il s'agit des débuts des crises. Source : « Is the 2007 U.S. Sub-Prime Financial Crisis So Different ? An International Historical Comparison», 5 février 2008.
* 16 Les autres crises bancaires et financières sont : Australie (1989), Canada (1983), Danemark (1987), France (1994 ; c'est la crise du Crédit Lyonnais), Allemagne (1977), Grèce (1991), Islande (1985), Italie (1990), Nouvelle Zélande (1987), Royaume-Uni (1974, 1991, 1995 ; en 1995, c'est la crise de la Barings), Etats-Unis (1984 ; c'est la crise des « Savings and Loans », c'est-à-dire des caisses d'épargne). Parmi ces crises, la plus grave est celle des Savings and Loans, qui a coûté 3,2 points de PIB au contribuable.
* 17 Ou « assureur monoline ». Il s'agit d'un établissement qui assure des emprunts obligataires.
* 18 Le 29 octobre 2008, la Réserve fédérale des Etats-Unis a ramené ce taux à 1 %.
* 19 Le président de l'Eurogroupe, le président de la Commission européenne et le président de la Banque centrale européenne ont participé à cette réunion.
* 20 En théorie, la société pourrait cependant continuer de fonctionner au-delà de cette date.
* 21 En mobilisant 40 millions d'euros et en tenant compte de l'effet de levier et du taux d'intervention d'OSEO.
* 22 De même que précédemment, cette somme correspond à une mobilisation de crédits à hauteur de 70 millions d'euros en 2008.







