Rapport de commission d'enquête n° 321 (2002-2003) de M. Bernard PLASAIT et Mme Nelly OLIN , fait au nom de la commission d'enquête, déposé le 3 juin 2003
Disponible au format Acrobat (1,5 Moctet)
-
INTRODUCTION
-
LES TRAVAUX DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE
-
REPÈRES CHRONOLOGIQUES : DE LA
PHARMACOPÉE DES EMPEREURS DE CHINE À L'ECSTASY DES RAVE PARTIES
-
LISTE DES PERSONNALITÉS
AUDITIONNÉES
PAR LA COMMISSION D'ENQUÊTE
-
PREMIÈRE PARTIE
-
UN CONSTAT TRÈS PRÉOCCUPANT
-
I. L'EXPLOSION DES DROGUES
-
A. UNE CONSOMMATION DE DROGUES EN CONSTANTE
AUGMENTATION DEPUIS DIX ANS
-
1. Une consommation en pleine expansion
-
a) Le cannabis : une consommation de masse
croissante, notamment chez les jeunes
-
b) Les drogues dites dures : un usage
très circonscrit mais en augmentation préoccupante
-
c) L'ecstasy, les amphétamines et les
drogues de synthèse : successeurs potentiels du cannabis au
« hit parade » de la consommation ?
-
d) Les produits dopants : un usage important
bien que méconnu
-
e) Les médicaments psychotropes
détournés de leur usage médical : un mal
français
-
a) Le cannabis : une consommation de masse
croissante, notamment chez les jeunes
-
2. Des modes de consommation et des comportements
addictifs en mutation
-
1. Une consommation en pleine expansion
-
B. UNE PRODUCTION ET UN TRAFIC MULTIFORME EN
CONSTANTE AUGMENTATION
-
1. Les grands axes du trafic international et
l'émergence de nouvelles filières
-
2. Le trafic en France : un trafic de passage
et de proximité
-
3. Les revenus générés par la
production et le trafic de drogues illicites : des facteurs
déstabilisateurs pour l'ensemble des économies
concernées
-
1. Les grands axes du trafic international et
l'émergence de nouvelles filières
-
A. UNE CONSOMMATION DE DROGUES EN CONSTANTE
AUGMENTATION DEPUIS DIX ANS
-
II. LA DANGEROSITÉ CERTAINE DES
DROGUES
-
A. DES DOMMAGES SANITAIRES AVÉRÉS
TOUCHANT ESSENTIELLEMENT LA JEUNESSE
-
B. DES DOMMAGES SOCIAUX RECONNUS
-
1. Le risque de désocialisation
-
2. Le lien entre usage de drogues et
délinquance
-
3. Les dangers désormais reconnus du
cannabis en termes de conduite automobile
-
4. Les dangers de la drogue en milieu
professionnel
-
1. Le risque de désocialisation
-
A. DES DOMMAGES SANITAIRES AVÉRÉS
TOUCHANT ESSENTIELLEMENT LA JEUNESSE
-
I. L'EXPLOSION DES DROGUES
-
DEUXIÈME PARTIE -
UNE POLITIQUE À LA DÉRIVE :
DES INSTRUMENTS DE LUTTE VIEILLIS ET INSUFFISANTS
-
I. UNE ORGANISATION INTERMINISTÉRIELLE ET
UN ARSENAL LÉGISLATIF IMPORTANT
-
II. UN DISPOSITIF RÉPRESSIF IMPORTANT SUR
LE TERRAIN MAIS AYANT LONGTEMPS SOUFFERT DE L'ABSENCE DE VOLONTÉ
POLITIQUE
-
A. LA DOUANE : UNE NÉCESSAIRE
ADAPTATION EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LES STUPÉFIANTS DU FAIT DE
LA LIBÉRALISATION DES ÉCHANGES
-
1. L'organisation et les pouvoirs
généraux de contrôle des services douaniers
-
2. Les pouvoirs et moyens spécifiques des
services douaniers en matière de lutte contre le trafic de
stupéfiants
-
3. La nécessaire adaptation des
méthodes de travail des services douaniers
-
4. Les moyens budgétaires des services
douaniers assignés à la lutte contre le trafic illicite de
stupéfiants
-
1. L'organisation et les pouvoirs
généraux de contrôle des services douaniers
-
B. LES FORCES DE POLICE AFFECTÉES À
LA LUTTE CONTRE LES STUPÉFIANTS
-
C. LA GENDARMERIE NATIONALE : L'ABSENCE
D'ORGANISMES SPÉCIALISÉS
-
D. LE DISPOSITIF DE CONTRÔLE DES PRODUITS
PRÉCURSEURS DE DROGUES
-
E. LE DISPOSITIF RÉPRESSIF DE LUTTE CONTRE
LE BLANCHIMENT
-
F. LE RENFORCEMENT DE LA COORDINATION DES SERVICES
RÉPRESSIFS NATIONAUX
-
G. LE DISPOSITIF JUDICIAIRE
-
A. LA DOUANE : UNE NÉCESSAIRE
ADAPTATION EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LES STUPÉFIANTS DU FAIT DE
LA LIBÉRALISATION DES ÉCHANGES
-
III. UNE RÉPONSE JUDICIAIRE
ERRATIQUE
-
A. LA RÉPRESSION DE L'USAGE : UNE
DÉPÉNALISATION DE FAIT
-
1. Des interpellations à la baisse
-
2. Une réponse judiciaire affaiblie et
disparate
-
a) L'injonction thérapeutique : une
mesure longtemps laissée en jachère et dont la relance reste
difficile
-
(1) Une mesure mise en sommeil dès
l'origine ?
-
(2) Une relance laborieuse
-
(3) Le bilan mitigé de l'injonction
thérapeutique à la fin des années 90
-
(a) Le constat : un faible nombre
d'injonctions thérapeutiques
-
(b) La diversité des pratiques selon les
parquets
-
(c) Un cloisonnement des acteurs
préjudiciable
-
(1) Une mesure mise en sommeil dès
l'origine ?
-
b) La politique du gouvernement pour la
période 1999-2001 : des intentions louables
-
(1) Le plan triennal 1999-2001 de la MILDT
-
(a) Des objectifs compris et partagés par
tous les acteurs
-
(b) Prévenir la récidive en
privilégiant les alternatives à l'incarcération et le
suivi à la sortie de la prison
-
(c) La généralisation des
conventions départementales d'objectifs comme instruments de mise en
oeuvre des orientations de politique pénale
-
(2) La circulaire Guigou du 17 juin
1999 : utiliser la réponse judiciaire aux toxicomanies comme
tremplin pour une orientation sanitaire ou psychosociale
-
(a) Une enquête de personnalité plus
approfondie à tous les stades de la procédure
-
(b) L'adaptation des réponses judiciaires
tout au long de l'enquête initiale
-
(c) L'adaptation des réponses judiciaires
dans la phase pré-sentencielle
-
(d) L'adaptation des réponses judiciaires
dans les phases sentencielle et post-sentencielle : l'emprisonnement ferme
à l'encontre d'un usager n'ayant pas commis d'autre délit
connexe, utilisé comme un ultime recours
-
(e) L'adaptation des réponses judiciaires
aux problématiques des mineurs usagers de drogues
-
(3) L'objectif de la circulaire Chevènement
du 11 octobre 1999 relative au renforcement de la lutte contre l'usage et le
trafic local de stupéfiants : préciser la place de la police
dans la chaîne judiciaire
-
(1) Le plan triennal 1999-2001 de la MILDT
-
c) Des résultats qui peuvent être
diversement appréciés
-
(1) Une évaluation du plan par
l'OFDT
-
(2) Des difficultés méthodologiques
certaines
-
(3) Des objectifs diversement
réalisés
-
(a) En matière d'intégration des
objectifs socio-sanitaires dans l'approche pénale
-
(b) En matière de capacité des
dispositifs socio-sanitaires à prendre en charge les usagers
-
(c) En matière d'accès aux soins des
interpellés
-
(d) En matière de recentrage de
l'injonction thérapeutique
-
(e) En matière de développement des
peines alternatives
-
(f) En matière de rapprochement entre
instances sanitaires et judiciaires
-
(4) Une disparition de la sanction sans prise en
charge effective ?
-
(1) Une évaluation du plan par
l'OFDT
-
a) L'injonction thérapeutique : une
mesure longtemps laissée en jachère et dont la relance reste
difficile
-
1. Des interpellations à la baisse
-
B. LA RÉPRESSION DU TRAFIC
-
1. Les statistiques : le reflet de
l'activité des services répressifs
-
2. La répression du petit deal et du trafic
local
-
a) La nécessité de réprimer
les petits trafics
-
b) La nécessité d'agir sur l'usager
à l'origine du trafic
-
c) La délicate distinction entre l'usager
et l'usager-revendeur
-
d) La difficile conciliation entre police de
proximité et police judiciaire
-
e) Les difficultés de preuve
-
f) Les récentes avancées
législatives
-
a) La nécessité de réprimer
les petits trafics
-
3. La répression des réseaux
organisés et du trafic international : les difficultés
pratiques et institutionnelles de mise en oeuvre de la
législation
-
a) Des difficultés liées à
l'insuffisante coordination institutionnelle des services
répressifs
-
b) Des difficultés liées à la
sophistication croissante des méthodes des trafiquants
-
(1) Les nouvelles technologies au service des
trafiquants de drogues
-
(2) Des méthodes d'interception
inadaptées à la nouvelle technique des
« go fast »
-
(3) Les « bolitas » :
nouvelle technique de transport des drogues dures
-
(4) Des difficultés liées à
l'insuffisante circulation de l'information et à l'absence de statut
des indicateurs
-
(1) Les nouvelles technologies au service des
trafiquants de drogues
-
c) Des difficultés liées à
l'insuffisante exploitation des outils législatifs disponibles
-
(1) Les dispositions visant à atteindre le
patrimoine des trafiquants ou de ceux dégageant un profit indirect du
trafic de drogues
-
(a) Les sanctions patrimoniales spécifiques
au trafic de stupéfiants
-
(b) La création du délit de non
justification de ressources : une innovation méconnue
-
(c) La création du délit de
blanchiment de fonds provenant de tout crime ou de tout délit
-
(2) Les dispositions visant à la lutte
contre la fabrication et la diffusion de nouvelles drogues de
synthèse
-
(1) Les dispositions visant à atteindre le
patrimoine des trafiquants ou de ceux dégageant un profit indirect du
trafic de drogues
-
a) Des difficultés liées à
l'insuffisante coordination institutionnelle des services
répressifs
-
1. Les statistiques : le reflet de
l'activité des services répressifs
-
A. LA RÉPRESSION DE L'USAGE : UNE
DÉPÉNALISATION DE FAIT
-
IV. UNE POLITIQUE DE PRÉVENTION
DÉFAILLANTE : LES RAVAGES DE LA BANALISATION DE L'USAGE DES
DROGUES
-
A. UN DISPOSITIF INTERMINISTÉRIEL AU
MESSAGE AMBIGU ET PEU CRÉDIBLE
-
B. UN « BRUIT DE FOND »
COMPLAISANT ENVERS LA DROGUE
-
C. L'IMBROGLIO DES STRUCTURES COMPÉTENTES
EN MATIÈRE DE PRÉVENTION, OBSTACLE À LEUR
EFFICACITÉ
-
D. LES CARENCES DES ACTEURS NATURELS DE LA
PRÉVENTION
-
1. La police et la gendarmerie, acteurs inattendus
mais désormais essentiels de la prévention
-
2. Des actions globalement satisfaisantes dans le
milieu sportif
-
3. La faiblesse du dispositif Santé et
affaires sociales
-
4. Le dispositif Sécurité
routière : des carences en partie provisoires ?
-
5. L'éducation nationale : la grande
absente de la prévention
-
a) Une présence très importante des
drogues dans les établissements scolaires ayant des effets nocifs sur
les élèves
-
b) Des instruments de prévention rares,
sous-utilisés et inefficaces
-
(1) Les comités d'éducation à
la santé et à la citoyenneté (CESC) : des structures
de papier
-
(2) La diffusion de publications sur les conduites
addictives au contenu discutable
-
(3) Une formation inexistante des
personnels
-
(4) Un dispositif de prévention sanitaire
et social inadapté en raison de la faiblesse de ses moyens
-
(1) Les comités d'éducation à
la santé et à la citoyenneté (CESC) : des structures
de papier
-
c) Des enseignants peu concernés
-
d) Des actions de prévention
« sous-traitées » aux acteurs extra scolaires
-
a) Une présence très importante des
drogues dans les établissements scolaires ayant des effets nocifs sur
les élèves
-
6. Les parents : des partenaires prioritaires
largement oubliés
-
1. La police et la gendarmerie, acteurs inattendus
mais désormais essentiels de la prévention
-
A. UN DISPOSITIF INTERMINISTÉRIEL AU
MESSAGE AMBIGU ET PEU CRÉDIBLE
-
V. UNE POLITIQUE DE RÉDUCTION DES RISQUES
AUJOURD'HUI INADAPTÉE AUX NOUVEAUX MODES DE CONSOMMATION
-
A. LES IMPASSES DE LA POLITIQUE DE
RÉDUCTION DES RISQUES
-
B. L'INADAPTATION DES STRUCTURES DE SOINS AUX
NOUVEAUX MODES DE CONSOMMATION : UN SYSTÈME COMPLEXE ET DES ACTEURS
MULTIPLES
-
C. LE PLAN TRIENNAL 1999-2001
-
A. LES IMPASSES DE LA POLITIQUE DE
RÉDUCTION DES RISQUES
-
VI. UNE COOPÉRATION INTERNATIONALE QUI
MANQUE DE SOUFFLE
-
A. DES CONVENTIONS INTERNATIONALES
BAFOUÉES
-
1. Le système onusien de contrôle
des drogues : un dispositif complexe articulé autour de conventions
et d'institutions internationales spécialisées
-
2. La situation actuelle dans le monde concernant
la production et le trafic illicites de drogues : « des
progrès encourageants dans la réalisation d'objectifs encore
lointains ».
-
3. Le non-respect par certains Etats de leurs
obligations internationales, limite à l'efficacité du
système onusien
-
1. Le système onusien de contrôle
des drogues : un dispositif complexe articulé autour de conventions
et d'institutions internationales spécialisées
-
B. L'ABSENCE D'HARMONISATION
EUROPÉENNE
-
1. Une politique européenne de lutte
contre les drogues embryonnaire
-
2. Des législations très
disparates
-
3. Deux exemples opposés : les
Pays-Bas et la Suède
-
a) L'exemple des Pays-Bas
-
b) L'exemple suédois
-
(1) Le constat : une consommation
relativement faible
-
(2) La particularité de l'approche
suédoise: l'objectif d'une société sans drogues
-
(3) Une répression
déterminée de l'usage comme du trafic
-
(4) Drogue et prison
-
(5) Une approche globale des soins
-
(6) Une réticence à l'égard
de la politique de réduction des risques et de substitution
-
(7) La priorité accordée à
la prévention
-
(1) Le constat : une consommation
relativement faible
-
a) L'exemple des Pays-Bas
-
1. Une politique européenne de lutte
contre les drogues embryonnaire
-
C. DES INSTRUMENTS JURIDIQUES ENCORE
INSUFFISANTS
-
1. Développer la coopération
internationale : un objectif essentiel du plan triennal de lutte contre la
drogue
-
2. Des dispositifs de coopération
internationale multiples et d'efficacité inégale
-
1. Développer la coopération
internationale : un objectif essentiel du plan triennal de lutte contre la
drogue
-
A. DES CONVENTIONS INTERNATIONALES
BAFOUÉES
-
I. UNE ORGANISATION INTERMINISTÉRIELLE ET
UN ARSENAL LÉGISLATIF IMPORTANT
-
TROISIÈME PARTIE
-
HUMANISME ET RESPONSABILITÉ :
LES DEUX PILIERS D'UNE NOUVELLE POLITIQUE
-
I. UNE RÉPONSE JUDICIAIRE
SYSTÉMATIQUE
-
A. ÉVITER LE PIÈGE DE LA
LIBÉRALISATION
-
1. Des arguments théoriquement
séduisants
-
a) L'échec de la loi de 1970,
paradoxalement à l'origine de tous les maux
-
b) La proposition d'une légalisation
réglementée
-
c) Une vision idyllique et utopique de la
légalisation des drogues
-
(1) Des progrès en termes de santé
publique
-
(a) Des drogues de qualité ?
-
(b) Une politique de réduction des risques
enfin cohérente
-
(2) En termes de sécurité
-
(a) Les produits étant moins chers, la
délinquance induite des toxicomanes diminuerait...
-
(b) ... ainsi que le crime organisé
-
(3) Une légalisation sans augmentation de
la consommation
-
(1) Des progrès en termes de santé
publique
-
a) L'échec de la loi de 1970,
paradoxalement à l'origine de tous les maux
-
2. Des avantages incertains
-
3. Des inconvénients
avérés
-
4. Le débat sur la
légalisation : un débat biaisé
-
1. Des arguments théoriquement
séduisants
-
B. RÉAFFIRMER L'IMPORTANCE DE LA
LOI
-
C. PRÉVOIR UNE SANCTION
SYSTÉMATIQUE, GRADUÉE ET COMPRISE
-
D. CONCILIER LE TRAITEMENT D'UN CONTENTIEUX DE
MASSE ET L'ORIENTATION SANITAIRE ET SOCIALE
-
1. Eviter l'encombrement des juridictions
-
a) Encourager le recours à l'ordonnance
pénale pour la contravention d'usage
-
b) Etendre le champ de la «
procédure simplifiée » pour les usagers de drogues
récidivistes, mais ne nécessitant pas d'orientation
particulièrement poussée
-
c) Elargir les mesures de composition
pénale à l'obligation de soins
-
a) Encourager le recours à l'ordonnance
pénale pour la contravention d'usage
-
2. Maintenir l'objectif d'orientation
sociosanitaire des usagers de drogues à l'occasion de la réponse
judiciaire en pérennisant les conventions départementales
d'objectifs justice-santé
-
1. Eviter l'encombrement des juridictions
-
E. HOMOGÉNÉISER LES SANCTIONS
-
F. DES PISTES À CREUSER
-
G. DÉVELOPPER L'INDISPENSABLE
PARTENARIAT
-
A. ÉVITER LE PIÈGE DE LA
LIBÉRALISATION
-
II. POUR UNE PRÉVENTION DIGNE DE CE
NOM
-
A. ASSURER L'INFORMATION ET LA FORMATION
-
B. ÉRIGER L'ÉCOLE EN
« FER DE LANCE DE LA PRÉVENTION »
-
A. ASSURER L'INFORMATION ET LA FORMATION
-
III. UN DISPOSITIF SANITAIRE ET SOCIAL EFFICACE
POUR LA PRISE EN CHARGE, LE TRAITEMENT ET LA RÉINSERTION
-
A. LE NÉCESSAIRE DÉVELOPPEMENT DES
STRUCTURES D'ACCUEIL
-
1. Le renforcement indispensable des
capacités en centres d'accueil
-
2. La nécessaire adaptation de la prise en
charge sanitaire des détenus et des mineurs délinquants
-
1. Le renforcement indispensable des
capacités en centres d'accueil
-
B. FAVORISER DES MÉTHODES INNOVANTES DE
TRAITEMENT
-
1. Des modalités nouvelles de prescription
des traitements de substitution
-
2. Le nécessaire développement des
programmes de recherche sur les drogues
-
3. La nécessité de promouvoir de
nouveaux savoir-faire
-
1. Des modalités nouvelles de prescription
des traitements de substitution
-
C. ABORDER LE PROBLÈME DE L'USAGE DES
DROGUES EN MILIEU PROFESSIONNEL
-
1. La législation actuelle en
matière de drogue en milieu professionnel
-
2. La nécessité de mieux prendre en
compte la réalité de la drogue au travail
-
1. La législation actuelle en
matière de drogue en milieu professionnel
-
A. LE NÉCESSAIRE DÉVELOPPEMENT DES
STRUCTURES D'ACCUEIL
-
I. UNE RÉPONSE JUDICIAIRE
SYSTÉMATIQUE
-
RÉSUMÉ DES PROPOSITIONS
DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE :
64 propositions autour de 4 priorités
-
CONTRIBUTIONS DES GROUPES POLITIQUES
N° 321
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
|
Rapport remis à Monsieur le Président du Sénat le 28 mai 2003 Dépôt publié au Journal officiel du 29 mai 2003 Annexe au procès-verbal de la séance du 3 juin 2003 |
RAPPORT
de la commission d'enquête (1) sur la politique nationale de lutte contre les drogues illicites , créée en vertu d'une résolution adoptée par le Sénat le 12 décembre 2002,
Tome I
Présidente
Mme Nelly OLIN
Rapporteur
M. Bernard PLASAIT
Sénateurs.
(1) Cette commission est composée de : Mme Michèle André, MM. Gilbert Barbier, Jean-Pierre Bel, Laurent Béteille, Joël Billard, Jean Boyer, Gilbert Chabroux, Mme Michelle Demessine, MM. Christian Demuynck, Gérard Dériot, Paul Girod, Adrien Gouteyron, Serge Lagauche, Lucien Lanier, Mme Valérie Létard, MM. Roland du Luart, Jacques Mahéas, Roland Muzeau, Mmes Nelly Olin, Monique Papon, M. Bernard Plasait.
Voir les numéros :
Sénat : 348 (2001-2002), 89 , 82 et T.A. 38 ( 2002-2003).
|
Drogue. |
GLOSSAIRE NARCOTIQUE ET PRINCIPAUX SIGLES Utilisés
|
Alcaloïde se dit d'une substance organique basique d'origine végétale aux puissants effets physiologiques Amphétamine produit de synthèse qui stimule la vigilance ANIT Association nationale des intervenants en toxicomanie Bolitas boulettes de cocaïne, généralement enveloppées d'un préservatif, ingérées par les passeurs des Etats andins Cannabis plante dont les feuilles et la résine ont des propriétés psychoactives du fait de son principe actif, le tétrahydrocannabinol (THC), ou delta - 9
Champignons
CIRC collectif d'information et de recherche cannabique Cocaïne principal alcaloïde de la coca, isolé en 1859. Les différentes formes de cocaïne obtenues par distillation des feuilles, avec divers produits chimiques, sont la pâte de coca (cocaïne base), la poudre, ou chlorhydrate de cocaïne et le crack CND Commission sur les drogues créée en 1946 par le Conseil économique et social des Nations unies CNID Centre national d'information sur la drogue CPLD Conseil de prévention et de lutte contre le dopage Crack puissant dérivé de la cocaïne aux effets fortement addictifs Dawamesc confiture verte à base de résine de cannabis, consommée en Egypte et à Paris par les membres du « Club des Haschischins » à partir des années 1845 Drogue en pharmacologie, le terme réfère à tout agent chimique qui modifie les processus biochimiques ou physiologiques des tissus et de l'organisme Ecstasy produit de synthèse de la famille des amphétamines, qui augmente la vigilance et lève les inhibitions Gandja terme utilisé dans la culture rasta, et en Jamaïque, pour désigner la marijuana GHB puissant inhibiteur du système nerveux, dont l'utilisation parfois criminelle lui a valu le nom de « drogue du viol » Go-fast véhicules rapides de marques allemandes, souvent volés, circulant à très haute vitesse sur autoroute en convoi et utilisés par les trafiquants pour « remonter » de grandes quantités de cannabis d'Espagne Haschisch résine issue de la plante de cannabis et transformée en pâte Héroïne dérivé de la morphine, commercialisé à partir de 1898 Joint cigarette de marijuana, avec ou sans tabac Kétamine anesthésiant pour animaux Kif préparation prête à fumer à base de cannabis et de tabac, répandue dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient Kitchen lab laboratoire à domicile utilisé pour fabriquer des drogues de synthèse LSD substance synthétique aux effets hallucinogènes obtenue à partir de l'acide lysergique, principal alcaloïde de l'ergot de seigle, découverte par le chimiste Albert Hofmann en 1938 Marijuana feuilles de cannabis séchées MDMA méthylène dioxyméthamphétamine, ou ecstasy Mescaline alcaloïde de certaines plantes cactacées, et notamment du peyotl, aux effets hallucinogènes méthadone opiacé de synthèse prescrit en substitution à la morphine ou à l'héroïne MILAD Mission de lutte anti-drogue MILDT Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie Morphine principal alcaloïde de l'opium, isolé en 1804 Mules passeurs de bolitas Nederwiet chanvre batave à forte concentration de THC Nicotine alcaloïde extrait du tabac et de diverses plantes solanacées OCRTIS Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants OEDT Observatoire européen des drogues et des toxicomanies OFDT Observatoire français des drogues et des toxicomanies OICS Organe international de contrôle des stupéfiants, chargé depuis 1968 de l'application des conventions des Nations unies sur les drogues ONDCP Office of national drug control policy ; créé en 1984 et rattaché directement à la Maison Blanche, l'Office coordonne la politique américaine sur les drogues et gère un budget annuel d'environ 18 milliards de dollars Opium suc des capsules de pavot Poppers se dit de préparations à base de solvants, vendues comme aphrodisiaques notamment dans le milieu homosexuel à partir des années 70 Peyotl cactus dont est extrait la mescaline PNUCID Programme des Nations unies pour le contrôle international des drogues (UNDCP en anglais) Psychédélique terme inventé par le psychiatre anglais Humphry Osmand pour décrire l'action des substances hallucinogènes, notamment celle du LSD Psychotrope se dit d'une substance dont l'effet principal est de modifier le psychisme ; se réfère aux médicaments utilisés dans le traitement des désordres mentaux, tels les neuroleptiques ou les anxiolytiques Speed boats embarcations sur-motorisées utilisées par les narcotrafiquants dans la zone Caraïbe Stupéfiants se dit des substances dont les effets psychoactifs peuvent entraîner des effets de tolérance et de dépendance Subutex buprémorphine prescrite en substitution aux opiacées THC tétrahydrocannabinol (principe actif contenu dans la résine de cannabis) ; le delta - 9 THC est très liposoluble et a une demi-vie d'élimination très longue ; à l'état naturel, le cannabis contient entre 0,5 % et 5 % de concentration en THC, mais les modes de culture sophistiqués, comme aux Pays-Bas, permettent d'atteindre des taux de concentration jusqu'à 30 % Toxicomanie addiction ou dépendance |
INTRODUCTION
« L'opium agrandit ce qui n'a pas de bornes,
Allonge l'illimité,
Approfondit le temps, creuse la volupté,
Et de plaisirs noirs et mornes,
Remplit l'âme au-delà de sa capacité »
(Les Fleurs du Mal)
« Le haschisch rend la société inutile à l'homme, comme l'homme inutile à la société »
(Charles Baudelaire)
«
Vous connaissez la position de la
France : la drogue est une gangrène qui menace chaque pays
touché par son trafic, qu'il soit producteur, transitaire ou
destinataire. Une gangrène répandue sur tous les continents et
aggravée par la mondialisation. Une gangrène qu'il faut combattre
dans toutes ses dimensions, loin en amont des routes, par une combinaison
d'approches répressive et judiciaire, sanitaire et sociale,
économique et financière et sur tous les fronts, national,
régional, mondial
. »
(Discours de M. Jacques
Chirac, Président de la République, lors de la
cérémonie d'ouverture de la Conférence internationale sur
les routes de la drogue à Paris le 22 mai 2003)
Mesdames, Messieurs,
À l'initiative de MM. Bernard Plasait et Henri de Raincourt, et des membres du groupe des Républicains et Indépendants, le Sénat a constitué le 12 décembre 2002 une commission d'enquête sur la politique nationale de lutte contre les drogues illicites.
L'intérêt du Sénat en ce domaine ne date pas d'aujourd'hui : lors du débat sur la loi de 1916, adoptée à l'unanimité en pleine guerre mondiale et qui réprime, outre l'usage en société, le commerce et la détention frauduleuse de substances vénéneuses, réservant leur seul usage légal à une médecine sous haute surveillance, le sénateur Dominique Delahaye dénonçait à la tribune « l'une des invasions les plus dangereuses de nos « amis » les boches », alors que l'on s'inquiétait depuis 1911 de l'effet délétère sur l'armée des « drogues allemandes », c'est-à-dire de la morphine et de la cocaïne.
On rappellera également que le sénateur Justin Godart devint entre les deux guerres le responsable européen de l'association internationale de défense contre les stupéfiants et que Marius Moutet, ministre des colonies du gouvernement de Front populaire, lui confia en 1937 la mission d'enquête sur l'Indochine qui constata que la Régie de l'opium, instituée en Cochinchine en 1882, et étendue par Paul Doumer à l'ensemble de la colonie en 1897 -ses gains représentant le quart de ses recettes budgétaires en 1914-, était encore en place.
Plus près de nous, M. Roland du Luart, par ailleurs vice-président de la commission d'enquête, a été chargé au nom de la commission des finances du Sénat d'un nécessaire contrôle budgétaire de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie (MILDT) 1 ( * ) .
Par ailleurs, le Sénat dispose d'un groupe d'études 2 ( * ) sur la lutte contre la drogue et la toxicomanie, présidé par Mme Nelly Olin, qui a assuré avec autorité, souplesse et toute la neutralité requise la présidence de la présente commission d'enquête.
Il était donc légitime que le Sénat décide de la création de cette commission pour y voir plus clair dans la mise en oeuvre de la politique nationale de lutte contre les drogues illicites, et surtout pour relever ses carences.
En se gardant de tout parti-pris, compte tenu du fait que la situation très préoccupante de notre pays au regard de la consommation et des trafics de drogues est la résultante de politiques des gouvernements qui se sont succédé depuis plus de trente ans, la commission a engagé des investigations approfondies dans un climat de consensus républicain qu'elle s'est efforcée de prolonger aussi longtemps qu'il était possible tout au long de sa période d'existence légale.
Comme le lui suggérait l'exposé des motifs de la proposition de résolution, la commission a limité ses investigations aux seules drogues illicites et a exclu de son enquête notamment l'alcool et le tabac qui entraînent, il convient de le rappeler, respectivement 45 000 et 60 000 morts par an.
Alors que la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) a élargi son domaine de compétences aux drogues licites, la commission s'est tenue strictement à la feuille de route qui lui avait été assignée par le Sénat, même si nombre de ses interlocuteurs ont fréquemment évoqué lors de leur audition les dangers des médicaments psychotropes, du tabac et de l'alcool, qui sont bien entendu avérés, mais dont la problématique ne relève pas, à son sens, de celle des drogues illicites 3 ( * ) .
S'il existe incontestablement des similitudes dans les phénomènes d'addiction, la commission ne pouvait traiter de l'ensemble des comportements à risque et son champ d'investigation était déjà extrêmement large puisqu'il englobait à la fois la prévention, la prise en charge sanitaire et sociale des toxicomanes et la répression de l'usage et du trafic de stupéfiants.
On rappellera en effet que le périmètre de l'enquête assigné par la proposition de résolution à la commission portait précisément :
- sur l'évaluation des politiques publiques de lutte contre la toxicomanie, la détention, la consommation, la vente et le trafic de stupéfiants ;
- sur la définition des drogues, de leurs effets sur la santé des consommateurs, la santé et la sécurité publiques au regard des connaissances scientifiques actuelles ;
- sur la définition d'une politique nationale forte, claire et cohérente de lutte contre les drogues illicites.
Par ailleurs, le développement de la consommation des drogues, notamment du cannabis, qui place désormais la France en tête du classement des pays de l'Europe élargie en termes de prévalence chez les jeunes de 15 à 16 ans , la montée socialement déstabilisante de l'économie souterraine liée à la drogue , qui devient la première activité dans certaines de nos cités, l'essor des drogues de synthèse à usage festif , notamment dans les rave parties -véritables supermarchés de la vente de stupéfiants-, l'explosion du trafic international des drogues 4 ( * ) -désormais aux mains des puissantes mafias criminelles-, qui déstabilise les Etats et l'économie mondiale, sont autant d'éléments qui justifiaient la création de la commission d'enquête.
Sans déflorer les développements ci-après, elle ne peut que constater que la loi du 31 décembre 1970 , relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic de l'usage de substances vénéneuses, initialement prévue pour contenir le développement préoccupant de la consommation de l'héroïne n'est plus adaptée à la situation actuelle et aux nouvelles consommations, et est d'ailleurs largement inappliquée : le délit d'usage n'est plus sanctionné, l'injonction thérapeutique, c'est-à-dire l'obligation de se soigner contre une remise de peine est diversement prescrite, le volet prévention a été négligé, et les capacités de prise en charge des toxicomanes sont dramatiquement insuffisantes.
Force est également de constater que le discours officiel tenu au cours des dernières décennies, et surtout des dernières années, sur les drogues, sur leur dangerosité et sur leur interdit, s'est brouillé : en privilégiant un seul volet, celui de la réduction des risques, notamment par l'échange des seringues et la délivrance de produits de substitution aux toxicomanes, dont les résultats en termes de santé publique doivent cependant être salués, au détriment d'un véritable programme d'information et de prévention, notamment en direction des jeunes, il a accrédité l'idée que les pouvoirs publics, via la MILDT et la nébuleuse des acteurs associés à la politique de lutte contre les drogues illicites, se bornaient à gérer le problème de la toxicomanie .
Ce discours brouillé, renforcé par les déclarations de certains responsables politiques au cours des années récentes, entretenu par une complaisance extravagante de certains medias de la presse écrite et de l'audiovisuel, ainsi que par les comportements de certains « beautiful people » et groupes-pilotes, n'est évidemment pas dépourvu de tout lien avec la banalisation de la consommation des stupéfiants, et notamment du cannabis, dont l'usage reste cependant interdit, il convient de le rappeler, comme celui des drogues dites dures.
Alors qu'un puissant lobby, notamment inspiré de l'étranger, promeut la dépénalisation ou la libéralisation du cannabis, mais aussi d'autres drogues, la commission rappellera que la France est déjà confrontée à deux fléaux légaux et « culturels » -l'alcool et le tabac- et qu'elle n'a pas à se charger d'un troisième en autorisant, et donc en organisant, l'usage du cannabis, dont la prévalence rejoint déjà pour certaines classes d'âge, celui du tabac.
Les enquêtes les plus récentes montrent cependant que les trois quarts de la population de notre pays rejettent ce discours banalisateur . Il est donc encore temps de réagir contre une trop longue dérive en mettant en place une nouvelle politique de lutte contre les drogues illicites, fondée sur l'humanisme et sur le réalisme : celle-ci devrait s'inscrire dans une nécessaire continuité, en apportant une réponse judiciaire systématique et modulée à toutes les infractions, en mettant en oeuvre une prévention digne de ce nom dès le plus jeune âge, et notamment à l'école qui est restée trop longtemps à l'écart de cette action prioritaire, en donnant de véritables moyens au dispositif sanitaire de prise en charge, de traitement et de réinsertion, et en prenant des mesures propres à réduire l'usage des drogues dans le monde du travail.
*
* *
Dans les développements ci-après, la commission n'évoquera qu'à titre incident la longue et tumultueuse histoire des drogues. La chronologie sommaire figurant à la page 27 du présent rapport s'efforcera cependant de rappeler très brièvement les usages anciens du pavot, du chanvre et de la coca, liés depuis des siècles à la tradition et à des pratiques médicales, religieuses et sociales ; les conditions dans lesquelles le fléau de l'opium s'est abattu sur la Chine sous la pression anglaise ; les nouvelles pratiques expérimentées en Europe à partir du premier tiers du XIX e siècle, notamment par des amateurs d'exotisme, des médecins aliénistes, des écrivains et des artistes ; la découverte des alcaloïdes et la mise au point de médicaments-miracles (morphine, cocaïne, héroïne...) comportant cependant de redoutables effets secondaires ; la prohibition des drogues qui sera progressivement mise en place par les Etats au début du siècle dernier, à la suite de conférences internationales, mais qui sera aussi à l'origine d'un trafic international aujourd'hui considérable ; enfin, la « démocratisation » de l'usage des drogues depuis les années 60, notamment dans la jeunesse, et la banalisation de la consommation de produits de plus en plus diversifiés, en dépit du renforcement des législations et des conventions internationales.
*
* *
LES TRAVAUX DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE
• Les étapes de la constitution de la commission d'enquête
- La présente commission d'enquête a été créée par le Sénat à la suite du dépôt, le 10 juillet 2002, d'une proposition de résolution n° 348 (2001-2002) présentée par MM. Bernard Plasait et Henri de Raincourt et les membres du groupe des Républicains et Indépendants 5 ( * ) , « tendant à la création d'une commission d'enquête sur la politique nationale de lutte contre les drogues illicites ».
- Au cours de sa réunion du 4 décembre 2002, la commission des lois, sur la proposition de son rapporteur pour avis, M. Laurent Béteille , a estimé que la proposition de résolution, qui visait à contrôler un service public, entrait dans le champ défini par l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, sans qu'il soit nécessaire d'interroger le gouvernement sur l'existence de poursuites judiciaires.
- Au cours de sa réunion du 10 décembre 2002, la commission des affaires sociales, sur proposition de son rapporteur, M. Jean-Marc Juilhard , a adopté sans modification la proposition de résolution en excluant toute extension de sa compétence aux drogues licites, c'est-à-dire au tabac, à l'alcool ou aux médicaments.
- Dans sa séance publique du 12 décembre 2002, le Sénat a adopté sur le rapport de M. Jean-Marc Juilhard (n° 89, 2002-2003), la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur la politique nationale de lutte contre les drogues illicites et son article unique dans les termes proposés par la commission des affaires sociales, en repoussant un amendement de M. le Président Fischer tendant à supprimer le mot « illicites ».
- Lors de sa réunion du 22 janvier 2003, la commission d'enquête a constitué son bureau.
- Lors de sa réunion du 29 janvier 2003, elle a procédé à un large échange de vues sur son programme et son calendrier de travail, en décidant que ses auditions seraient ouvertes à la presse, feraient l'objet d'une couverture par la chaîne de télévision Public Sénat et que leur compte rendu intégral serait annexé au rapport de la commission, sauf demande de huis clos formulée par ses interlocuteurs.
• Les auditions de la commission d'enquête
Du 5 février au 30 avril 2003, la commission d'enquête a organisé douze séries d'auditions au Sénat et convoqué 56 personnalités, spécialistes à un titre ou à un autre des drogues illicites, notamment dans les domaines de la psychiatrie, de la toxicologie, de la pharmacologie, de la pédiatrie mais aussi des médecins de ville ou relevant de l'administration pénitentiaire conduits à se spécialiser dans la toxicomanie, ainsi que des sociologues, des chercheurs au CNRS et à l'INSERM, des criminologues, des avocats...
Elle a également entendu la plupart des acteurs du dispositif de la politique de lutte contre les drogues illicites : les deux derniers présidents de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) des représentants de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLP), des hauts fonctionnaires des administrations centrales (santé, gendarmerie nationale, protection judiciaire de la jeunesse, administration pénitentiaire, douanes, renseignements et enquêtes douanières, police urbaine de proximité...).
A cet égard, l'audition des responsables chargés du nécessaire volet répressif a été particulièrement instructive et témoigne de la mobilisation exemplaire de certains services de l'Etat dans la politique de lutte contre les drogues illicites -Mission de lutte anti-drogue, Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants, Brigade des stupéfiants- comme d'ailleurs celle des magistrats et préfet entendus.
La commission a également souhaité consacrer une large part de ses travaux à l'audition des multiples intervenants qui sont associés au dispositif d'information, de prévention et de prise en charge ainsi que ceux qui militent pour la dépénalisation, voire la légalisation de certaines drogues.
Tout en soulignant le rôle essentiel de la plupart de ces associations, notamment celles représentant les parents d'élèves, la commission a également pris acte des positions qui ont parfois été présentées avec quelque excès d'un côté comme de l'autre, au détriment sans doute de la crédibilité de la cause qu'elles défendent.
La commission a ainsi entendu le collectif d'information et de recherche cannabique (CIRC) qui a appelé ses partisans à manifester à Paris le 3 mai dernier, suite notamment à l'audition du ministre de l'intérieur le 23 avril 2003.
Ces auditions lui ont également permis de recueillir des témoignages parfois bouleversants de parents de victimes, mais aussi des discours caricaturaux de responsables d'association appelés pourtant à intervenir en milieu scolaire pour y développer une nécessaire prévention restée trop longtemps en jachère. La commission n'a pas été en mesure, en raison de son calendrier contraint, de répondre à toutes les sollicitations qui lui ont été adressées par la nébuleuse associative gravitant autour des problèmes de la drogue, et a invité les intéressés à lui transmettre leurs observations par écrit.
Dans la phase finale de ses investigations, elle a naturellement procédé à l'audition de l'ensemble des ministres concernés, en charge des sports, de l'éducation nationale, de la justice, de la santé et de l'intérieur, certaines de ces interventions ayant été très médiatisées.
Elle tient à souligner le parfait déroulement de ces auditions qui ont été largement couvertes par la presse, notamment celles des ministres, tous ses interlocuteurs convoqués pour déposer sous serment s'étant pliés de bonne grâce à cette obligation et ayant accepté, à une exception près et pour des motifs singuliers, que leur déposition soit enregistrée et filmée par la chaîne Public-Sénat et que leur procès-verbal soit inséré en annexe du rapport de la commission.
• Les déplacements de la commission d'enquête
Outre ces auditions traditionnelles, la commission d'enquête a complété ses investigations en effectuant une série de déplacements 6 ( * ) sur le territoire national, métropolitain et ultra-marin, et dans trois pays européens.
|
6 mars : - maison d'arrêt de Paris-La Santé ; - centre de soins spécialisés pour toxicomanes St-Germain Pierre Nicole ; - centre de jour de l'hôpital Saint-Antoine et service psychiatrique de l'hôpital 13 mars : - Valenciennes : rencontres à la mairie de l'ensemble des acteurs de la politique de prévention, de soins et de répression ; - visite du Groupe écoute information dépendance (GREID) 20-21 mars : Stockholm 3 au 6 avril : Saint-Martin 10 et 11 avril : Vienne, pendant la session de la Commission des stupéfiants de l'ONU 24 et 25 avril : Rotterdam et La Haye aux Pays-Bas |
Le choix des destinations de la commission d'enquête ne devait évidemment rien au hasard. Qu'on en juge !
Elle a d'abord souhaité se déplacer à la maison d'arrêt de Paris-La Santé , afin de mesurer la réalité des trafics, de la consommation de drogues en prison et de la prise en charge des toxicomanes, qui avait d'ailleurs été longuement évoquée par une autre commission d'enquête du Sénat 7 ( * ) . Elle a constaté que cette réalité était très éloignée de celle observée dans la prison modèle pour toxicomanes de Hoogvliet aux environs de Rotterdam, que la commission a pu visiter lors de son déplacement aux Pays-Bas.
Elle a tenu également à effectuer un déplacement dans un centre de soins parisien spécialisé pour toxicomanes, dans un centre de jour hospitalier et dans un service psychiatrique d'un grand hôpital parisien : ces visites lui ont permis de prendre conscience de la détresse des malades rencontrés, de la diversité de leur profil (jeunes polyconsommateurs désocialisés passés des solvants et du cannabis aux drogues les plus dures, mais aussi adultes, avocate ou normalienne en rupture de barreau et d'école...), de leur dépendance à l'égard des produits chimiques de substitution et de la psychiatrie qui s'est arrogée une sorte de monopole dans leur traitement, des conditions difficiles dans lesquelles ils tentent de se reconstruire en se livrant à des activités collectives d'ergothérapie qui peuvent apparaître dérisoires (dessin, peinture, modelage, bandes dessinées...), mais aussi et surtout de l'insuffisance criante des moyens consacrés à leur prise en charge, en dépit du dévouement exemplaire des personnels, et qui illustre jusqu'à la caricature le fait que la loi de 1970, dans son volet sanitaire, reste largement lettre morte...
A l'initiative de Mme Valérie Létard, vice-présidente de la commission, elle s'est ensuite rendue dans le Valenciennois , proche de la Belgique et des Pays-Bas, par lequel transite, via l'autoroute A 22, tous les trafics de drogues, et qui constitue aussi un important pôle de consommation du fait notamment d'une économie qui reste encore convalescente.
Elle a ensuite souhaité se rendre en Suède , qui, après une période de libéralisation aux effets particulièrement néfastes, a engagé une politique rigoureuse inspirée de l'objectif ambitieux d'une société sans drogue.
Compte tenu du rôle central joué par Saint-Martin du fait de sa position géographique, il lui est apparu indispensable de se rendre dans les parties française et « hollandaise » de l'île pour y mesurer l'importance du narco-trafic en provenance des Etats andins et notamment de la Colombie, destiné principalement aux marchés nord-américain et européen, recenser les moyens des services de l'Etat disponibles pour combattre ce trafic, faire le point sur la coopération internationale, analyser les raisons qui font de cette île une base logistique pour les trafiquants, et les difficultés suscitées par sa partition 8 ( * ) .
Les travaux de la 46 e session annuelle de la Commission des stupéfiants de l'ONU lui commandaient ensuite évidemment de se rendre à Vienne , aussi bien pour y rencontrer le plus grand nombre possible de délégations nationales, que les responsables politiques et administratifs autrichiens de la politique de lutte contre les drogues.
Enfin, son dernier déplacement à l'étranger, aux Pays-Bas , s'imposait à l'évidence : la commission souhaitait, en effet, tenter d'appréhender la cohérence d'une législation batave particulièrement singulière, qui autorise la vente contrôlée et la consommation des drogues dites douces, qui ne condamne pas l'usage des drogues dures, pourtant interdites, et qui encourage la floraison des cultures de cannabis et des coffee shops en favorisant notamment le développement d'un narco-tourisme, préjudiciable à une politique européenne commune en matière de lutte contre les drogues, bref qui fait du « polder-model » en ce domaine, le « mouton noir » de l'Europe.
*
* *
Des ruelles sordides squattées par les « crackés » du quartier du ghetto de Marigot, sous bonne escorte de l'Arme 9 ( * ) , et notamment de son énergique maître-chien jusqu'au Sveriges Riksdag encore enchâssé dans les glaces de la Baltique ; de notre ambassade aujourd'hui surdimensionnée de la vieille capitale impériale austro-hongroise aux « kitchen-labs » reconstitués de l'Unité des drogues synthétiques proche d'Eindhoven, mise en place sous la pression américaine ; du scanner pour containers du port de Rotterdam au bolitas confisquées par les douanes néerlandaises de Sint-Maarten ; du Nationalrat autrichien aux rares coffee shops de La Haye ; du centre de désintoxication pour jeunes « Maria Ungdom » de Stockholm au dédale des couloirs de l'Austria Center qui accueillait les délégations onusiennes de la Commission sur les stupéfiants ; du contrôle en mer de deux voiliers dans la baie de Marigot avec la brigade garde-côtes des douanes 10 ( * ) à l'audience très officielle accordée à Philipsburg par le lieutenant-gouverneur de Sint-Maarten ; des opérations de contrôle routier menées dans le quartier de Sandy ground par toutes les composantes de nos forces de l'ordre de l'île aux mega-dancings d'outre-Quiévrain offrant aux noctambules frontaliers l'éventail de toutes les drogues de synthèse ; de l'interpellation musclée dans un bar sans licence de Saint-Martin de trois ressortissants clandestins haïtiens en infraction à la législation sur le séjour au dîner de travail à la résidence de France à La Haye, hors la présence de notre ambassadeur et de certains de ses invités..., la commission d'enquête a pu appréhender au cours de ces rencontres et de ces opérations la réalité ô combien diverse du monde de la drogue et les politiques de lutte engagées, tant en termes de répression du trafic que de prise en charge des toxicomanes, et mesurer la nécessité d'une coopération internationale en ce domaine, ainsi que d'une harmonisation européenne.
Le temps lui a manqué pour effectuer d'autres déplacements, notamment dans les pays producteurs du triangle d'Or ou de l'Asie centrale, alors que la vieille route de la soie est devenue celle de la drogue, comme d'ailleurs le « pipe-line » des Balkans et la filière du Nord (Mer noire, Ukraine, pays baltes...), et que les Marco Polo, les grands marchands et les grands conquérants de l'histoire ont été remplacés par les puissants narcotrafiquants des mafias albanaise, turque, kurde, bulgare, kosovare...
La 46 e session de la Commission des stupéfiants qui se réunissait à Vienne lui a cependant donné l'occasion de rencontrer des représentants de la délégation iranienne , qui ont surtout commenté la situation de leur voisin afghan ; de la délégation russe qui a réfuté l'existence d'une économie souterraine de la drogue ; de la délégation anglaise qui a exposé le projet de modification de la classification interne du cannabis ; de la délégation allemande qui a souligné les difficultés résultant de la proximité des Pays-Bas et de la Pologne ; de la délégation suisse qui a précisé les limites de la nouvelle loi de dépénalisation du cannabis et a justifié la mise en place controversée de dispositifs d'injection d'héroïne contrôlés et pris en charge par l'Etat ; de la délégation espagnole qui a souligné la qualité de la coopération avec la France et son insuffisance avec le Maroc ; de la délégation marocaine qui a exposé le programme d'éradication des cultures de cannabis et la difficulté de contrôler, faute de moyens, les côtes marocaines ; de la délégation turque 11 ( * ) qui a souligné les efforts engagés pour contrôler la production du pavot, traditionnelle dans l'empire ottoman, en éludant avec diplomatie certaines questions de la présidente de la commission d'enquête ; de la délégation polonaise qui a reconnu que de nombreux laboratoires fabriquaient des drogues de synthèse sur son territoire et regretté que les programmes de coopération onusiens ne puissent être mis en oeuvre faute de financement ; enfin, d'une forte délégation américaine qui s'est félicitée -dans un contexte bilatéral pourtant difficile- de la coopération avec la France dans la zone Caraïbe et de l'appui qu'apportait notre pays dans la lutte menée par le gouvernement américain contre le puissant lobby visant à légaliser le cannabis.
La commission ne peut que regretter que le rendez-vous prévu avec la délégation afghane ait été annulé à la demande de cette dernière, sans autre forme d'explication.
Ayant été évidemment dissuadée de se rendre en Colombie , la commission d'enquête a cependant profité de son déplacement à Saint-Martin pour y convoquer notre dynamique attaché douanier à Bogota, qui lui a apporté des informations précieuses, ainsi que le secrétaire général français de la Conférence douanière inter-caraïbe, dont le siège est à Sainte-Lucie.
*
* *
REPÈRES CHRONOLOGIQUES : DE LA PHARMACOPÉE DES EMPEREURS DE CHINE À L'ECSTASY DES RAVE PARTIES 12 ( * )
|
2700 av JC : |
Le cannabis est déjà utilisé comme sédatif et traitement de l'aliénation mentale dans la pharmacopée de l'empereur chinois Chen-Nong. |
|
1552 av JC : |
Un papyrus égyptien témoigne que le chanvre fait déjà partie des drogues sacrées des pharaons. |
|
VIIIe siècle av JC : |
La Théogonie d'Hésiode mentionne le suc des capsules de pavot. |
|
VIe siècle av JC : |
Les moines bouddhistes fument pour la méditation diverses préparations à base de cannabis |
|
Ve siècle av JC : |
- Le cannabis gagne l'Europe occidentale, via le royaume des Scythes et les rives de la mer Noire. - Hippocrate mentionne l'opium comme remède pour calmer les douleurs les plus variées. |
|
IVe siècle av JC : |
Alexandre utilise l'opium pour combattre ses migraines et emporte la plante miracle avec ses troupes jusqu'en Asie centrale, puis en Inde. |
|
Ier siècle : |
L'opium devient un médicament courant, apprécié des empereurs à Rome. |
|
IIe siècle : |
Le médecin grec Galien invente la thériade, un antidote contre les poisons à base de jus de pavot. |
|
VIIIe siècle : |
Les savants arabes Rhazès et Avicenne préparent la thériade de Galien pour soigner toux et diarrhées. |
|
1090 : |
Le Perse ismaélien Hassan ben Sabah fonde la secte des « haschischins », ou mangeurs d'herbe. |
|
XIIIe au XVe siècles : |
Les marchands arabes diffusent le cannabis vers l'Afrique centrale et australe, ainsi qu'au Maghreb et dans les Balkans. |
|
XVIe siècle : |
- Dans l'empire ottoman, l'opium est couramment fumé dans un narguilé, mélangé au chanvre et au tabac, ou mangé par les amateurs du produit (thériakis). - Le médecin suisse Paracelse utilise la teinture d'opium comme médicament. - Les conquérants espagnols découvrent dans le Nouveau Monde la coca, le peyotl et les champignons hallucinogènes. - Les Portugais développent la production locale de l'opium dans la région de Malwa, au nord-ouest de l'Inde. |
|
XVIIe siècle : |
- Les Hollandais intensifient la production de l'opium du Bengale et développent son commerce vers les Philippines, Formose et le sud de la Chine. |
|
1660 : |
Le médecin anglais Thomas Sydenham élabore le laudanum en diluant l'opium dans du vin de Malaga, en lui ajoutant des épices : Cromwell et Charles II en font un large usage. |
|
1715 : |
Les Britanniques prennent le monopole des échanges commerciaux avec la Chine. |
|
1729 : |
Les empereurs mandchous promulguent le premier édit interdisant le commerce de l'opium en Chine. |
|
1757 : |
La victoire de Plassey assure aux Anglais, à l'initiative de l'East India Company, la domination du Bengale, jadis sous la coupe de l'Empire moghol, et le contrôle des terres à opium autour de Bénarès, Patna et Agra. |
|
1775 : |
Warren Hastings, gouverneur du Bengale, dirigeant de l'East India Compagny, obtient de Londres le monopole de la compagnie sur le contrôle, l'achat et la livraison à Calcutta de la récolte d'opium et s'efforce de conquérir le marché chinois. |
|
1798 : |
Débarquant en Egypte, Bonaparte interdit à ses soldats de boire la liqueur de haschisch et de fumer les sommités fleuries du chanvre sous peine de trois mois de prison. |
|
1799 : |
La législation anti-opium est renforcée par les autorités chinoises : les marchands de Canton ont l'interdiction d'acheter l'opium et de recevoir des navires qui le transportent. |
|
1804 : |
- Armand Seguin, médecin de l'armée napoléonienne, isole la morphine. Un chimiste de Hanovre la baptise du nom de « Morphium » en hommage au dieu des Songes. - Le médecin écossais Alexander Wood procède à la première injection d'acétate de morphine. |
|
1808 : |
Les importations chinoises d'opium sont de l'ordre de 200 tonnes. |
|
1820 : |
Les rapides clippers des « country traders » transportent désormais la drogue de Calcutta jusqu'à Canton, seul port ouvert aux étrangers. |
|
1822 : |
Les « Confessions d'un anglais mangeur d'opium » sont publiées à Londres par Thomas de Quincey. |
|
1828 : |
La tradition de « l'opium littéraire » se développe en France avec la traduction par Alfred de Musset de l'ouvrage de Thomas de Quincey. |
|
1838 : |
- Les importations chinoises d'opium passent à près de 3 200 tonnes. - Théophile Gautier publie « La Pipe d'opium ». |
|
1839 : |
L'empereur de Chine envoie à Canton son commissaire Lin Tsê-Hsu pour mettre fin au « scandaleux » commerce des marchands d'opium. |
|
1839-1842 : |
Première « guerre de l'opium ». |
|
1842 : |
Signature du traité de Nankin qui contraint la Chine à ouvrir cinq ports aux navires britanniques et à céder Hong-Kong. |
|
1845 : |
- L'aliéniste Joseph Moreau de Tours, de retour d'Egypte, publie son ouvrage « Du haschisch et de l'aliénation mentale ». - Le club des Haschischins se réunit désormais dans l'hôtel de Pimodan, quai d'Anjou : Baudelaire, Nerval, Gautier, Delacroix, Daumier, Balzac y dégustent le dawamesc. |
|
1846 : |
Théophile Gautier publie son conte fantastique, « Le Club des Haschischins ». |
|
1850 : |
- Les exportations indiennes vers la Chine atteignent 3 300 tonnes et l'opium est vendu à bas prix pour gagner une clientèle populaire. - La loi du 19 juillet 1845 constitue la première législation sur les stupéfiants en France : elle assimile l'opium à un poison, la range comme la morphine dans la liste des substances vénéneuses et renforce son contrôle à la vente. - La morphine se démocratise avec l'invention de la seringue hypodermique. |
|
1853 : |
Jean Martin Charcot expérimente sur lui-même les effets du haschisch. |
|
1856-1858 : |
La deuxième guerre de l'opium est déclenchée par les Français et les Britanniques pour forcer plus encore les portes du marché chinois. |
|
1858 : |
- Le traité de T'ien-Tsin ouvre onze nouveaux ports au commerce occidental et autorise officiellement l'importation de l'opium en Chine, dont la consommation devient un problème de santé publique. - Le terme « stupéfiant » apparaît en France dans l'Encyclopédie du XIXe siècle. |
|
1859 : |
Le chimiste viennois Albert Niemann isole la cocaïne de la coca. |
|
1860 : |
Baudelaire publie « Les Paradis artificiels » : cette compilation d'un texte de 1858 sur le haschisch et d'un résumé commenté des confessions de De Quincey constitue une ferme condamnation des drogues. |
|
1870 : |
Angelo Mariani, préparateur en pharmacie d'origine corse exploite les vertus stimulantes de la coca du Pérou en créant le vin Mariani. |
|
1875 : |
Le médecin allemand Edouard Levinstein publie un ouvrage très remarqué « Sur la morphine ». |
|
1876 : |
1 700 fumeries sont recensées à Shangaï, devenu centre du commerce avec l'étranger et capitale du vice. |
|
1880 : |
Sigmund Freud expérimente sur lui-même à Vienne les effets euphorisants et stimulants de la cocaïne, dont il devient un consommateur régulier : en raison de graves réactions psychotiques, il prend rapidement ses distances avec cet alcaloïde. |
|
1882 : |
La France instaure en Cochinchine une Régie de l'opium. |
|
1888 : |
Les exportations d'opium des marchands anglo-indiens vers la Chine atteignent 5 507 tonnes, contre une production chinoise de 13 300 tonnes, soit 85 % des besoins intérieurs : au début du XXe siècle, le nombre de fumeurs chinois réguliers est estimé à 20 millions de personnes. |
|
1890 : |
Les laboratoires Bayer mettent au point un dérivé de la morphine, commercialisé à partir de 1898 sous le nom d'héroïne. |
|
1897 : |
Paul Doumer étend la Régie à l'ensemble de la colonie et la charge de l'achat du produit brut, du monopole du raffinage et de la vente de l'opium. |
|
1898 : |
Les Etats-Unis prennent le contrôle des Philippines où l'opiomanie fait des ravages. |
|
1905 : |
A la demande de Théodore Roosevelt, les Etats-Unis envoient une commission officielle dans le sud de la Chine et en Indonésie. |
|
1906 : |
Un édit impérial interdit la consommation de l'opium en Chine. |
|
1907 : |
L'affaire Ullmo aboutit en 1908 à la restriction du commerce de l'opium en France. 13 ( * ) |
|
1908 : |
Le décret du 1 er octobre complète la loi de 1845 et permet de poursuivre les individus soupçonnés de détention ou de préparation d'opiacés. |
|
1909 : |
Les grandes puissances européennes et les pays d'Asie et d'Amérique concernés par le problème de l'opium se réunissent à Shanghai : les pays prohibitionnistes (Chine, Etats-Unis...) s'opposent aux pays producteurs et aux métropoles coloniales (France, Angleterre...) |
|
1911-1912 : |
Une convention est votée à la conférence de La Haye pour contrôler la production, le commerce et l'usage de l'opium, de la morphine et de la cocaïne. |
|
1914 : |
- Les gains de la Régie en Indochine représentent plus du quart du budget de la colonie. - Le Harrison Narcotic Act aux Etats-Unis est adopté pour contrôler la circulation et la vente des stupéfiants et n'en autoriser que les usages médicaux. - La brigade mondaine se dote en France d'une équipe chargée de la répression du trafic des stupéfiants. |
|
1915 : |
Des toxicomanes, dont la plupart en attente de jugement, sont évacués de la capitale et de la zone des armées pour être internés au camp de la Ferté-Macé en compagnie d'autres indésirables et suspects du point de vue national (ressortissants des pays ennemis, Alsaciens-Lorrains, « filles soumises », danseurs de tango...). |
|
1916 |
La loi de 1916, adoptée en pleine guerre mondiale, réprime, outre « l'usage en société », le commerce et la détention frauduleuse de « substances vénéneuses », réservant leur seul usage légal à une médecine sous haute surveillance. Après une campagne engagée dès 1911, alors que l'on s'inquiète de l'effet délétère sur l'armée des « poisons boches » (morphine et cocaïne), cette loi de prohibition est votée par le Parlement à l'unanimité. Le sénateur Dominique Delahaye dénonce à la tribune l'« une des invasions les plus dangereuses de nos « amis » les boches » 14 ( * ) . Elle fait l'objet d'une critique acerbe du poète Antonin Artaud : « Lettre à Monsieur le législateur de la loi sur les stupéfiants ». |
|
1920 : |
- Le Dangerous Drug Act en Grande-Bretagne officialise les restrictions du temps de guerre. - La SDN crée la commission consultative de l'opium et autres drogues nuisibles (CCO), chargée de renforcer la législation internationale. - Les seigneurs de la guerre encouragent la reprise de la production et du trafic de l'opium en Chine. |
|
1922 : |
- Tous les Etats signataires appliquent désormais la convention de La Haye de 1912, à l'exception de l'Allemagne qui est l'un des premiers producteurs mondiaux de cocaïne et d'héroïne. - Victor Margueritte, dans son best-seller « La Garçonne », dépeint un Paris mondain, gangrené par la drogue, l'opium et la cocaïne. - La loi du 13 juillet impose au juge de prononcer l'interdiction de séjour contre les individus convaincus de trafic et de facilitation d'usage ; elle autorise la police à effectuer des visites domiciliaires, de jour comme de nuit, et en dehors de toute réquisition judiciaire préalable, dans les lieux où des individus se livrent à l'usage des stupéfiants : cette mesure dérogatoire s'appuie sur l'article 10 du décret des 19 et 22 juillet 1791 autorisant les autorités à pénétrer à tout moment, même la nuit, dans « les maisons de jeux et les lieux notoirement livrés à la débauche ». |
|
1923 : |
La police internationale Interpol est créée et consacre rapidement une large part de ses activités à la lutte contre les trafiquants. |
|
1924 : |
Lors de la seconde conférence sur l'opium, qui se réunit à Genève, le délégué égyptien demande aux autres délégations d'inclure le cannabis dans la liste des stupéfiants. |
|
1925 |
- Dans « Satan conduit le bal », Georges Anquetil dénonce, à partir des archives de la police, le développement de la toxicomanie dans le Paris des Années folles. - La convention de Genève met en place un système de certificats destinés à contrôler étroitement la circulation des produits. Ce texte sera renforcé par la convention de 1931 qui tente de planifier strictement les besoins médicaux mondiaux afin d'éviter toute fuite vers les circuits clandestins. |
|
1929 : |
- L'Allemagne se dote enfin d'une législation restrictive. - Le gouvernement Tchang Kaï-Shek lance une campagne de prohibition. |
|
Années 30 : |
- Marseille devient, quarante ans avant la « French Connection », notamment avec les trafiquants Carbone et Spirito, le pôle national et même mondial du marché de la drogue. - Le sénateur Justin Godart devient le responsable européen de l'association internationale de défense contre les stupéfiants |
|
1930 : |
- Une « commission interministérielle sur les stupéfiants », lointain ancêtre de la MILDT, est créée pour constituer un carrefour interadministratif permanent d'information et de concertation entre les différents services concernés. |
|
1931 : |
Pierre Drieu la Rochelle publie « Le Feu follet ». |
|
1933 : |
Un « service central des stupéfiants » est créé : il succède à l'ancien « service des stupéfiants et de la traite des blanches ». |
|
1936 : |
- Cocaïnomane notoire et trafiquant, Lucky Luciano est arrêté aux Etats-Unis. - Hergé publie « Le Lotus Bleu ». |
|
1937 : |
La mission d'enquête sur l'Indochine confiée par Marius Moutet, ministre des colonies du gouvernement de Front populaire, au sénateur Justin Godart, constate que les régies fonctionnent toujours. |
|
1939 : |
L'article 130 du décret-loi du 29 juillet relatif à la famille et à la natalité française renforce les prescriptions de la loi de 1916 en augmentant la fourchette du montant de l'amende et en portant la durée maximum de l'emprisonnement jusqu'à cinq ans. |
|
1943 : |
- Le surréaliste Robert Desnos dénonce dans le « Le vin est tiré » les ravages croissants de la toxicomanie. - Le chimiste suisse Albert Hofmann isole la molécule du LSD 25. |
|
1953 : |
- William Burroughs publie à New York « Junkie », qui décrit la trajectoire d'un camé et le monde de la défonce. - La loi du 24 décembre met en place pour la première fois un volet sanitaire dans la législation française anti-drogues. |
|
1955 : |
- La France, avec la décolonisation, met enfin un terme à la Régie de l'opium. - « Razzia sur la chnouf », d'Auguste le Breton, est porté à l'écran. |
|
1964 : |
Le mouvement psychédélique, dont le terme a été inventé par le psychiatre anglais Humphrey Osmond, prend son essor. |
|
1965 : |
Le LSD se répand dans le quartier hippie de Haight Ashbury à San Francisco. La chanson des Beatles (« Lucy in the Sky with Diamonds ») fait explicitement référence au LSD. |
|
1966 : |
Les Etats-Unis interdisent la fabrication et la vente de LSD sur le territoire américain ; la simple détention sera interdite en 1968. |
|
1967 : |
Le « Summer of love », fondé sur le slogan « Sex, drugs and rock'n roll », rassemble des groupes musicaux adeptes des stupéfiants (Joplin, Hendrix, Les Byrds, Jefferson Airplane...). |
|
Années 70 : |
Les drogues récréatives et psychédéliques cèdent la place à des produits plus durs, et notamment à l'héroïne. |
|
1970 : |
La loi française alourdit considérablement les peines contre les trafiquants, établit le délit controversé d'usage et crée l'injonction thérapeutique, c'est-à-dire l'obligation de se soigner contre une remise de peine. |
|
1972 : |
L'association « Le Patriarche » est créée. |
|
1974 : |
Le Maroc, par le dahir du 21 mai, classe le cannabis parmi les stupéfiants dangereux. |
|
1976 : |
- Le mouvement punk promeut l'usage des amphétamines (speed) et de la cocaïne. - La loi hollandaise distingue les drogues dures des drogues douces en autorisant la vente contrôlée et la consommation de ces dernières ; il en résulte une floraison des cultures et des coffee shops, favorisant notamment le développement d'un narco-tourisme, tandis que l'usage des drogues dures n'est pas condamné, en dépit de leur interdiction. |
|
1980 : |
Faisant l'objet d'une promotion à bas prix sur les marchés clandestins, le crack devient la drogue des ghettos ethniques et de la misère sociale. |
|
1986 : |
L'ecstasy est inscrit au tableau des stupéfiants. |
|
1989 : |
Le retrait des soviétiques de l'Afghanistan, puis l'installation d'un gouvernement islamique à Kaboul, favorisent l'envol de la production d'opium. |
|
Fin des années 80 : |
Le mouvement des rave parties promeut l'ecstasy, un dérivé des amphétamines, qui permet aux ravers de danser des nuits entières au rythme hypnotique de la musique techno. |
|
1998 : |
Mort de la championne olympique Florence Griffith, vedette des JO de Séoul. |
|
2002 : |
Le Sénat crée une commission d'enquête sur la politique nationale de lutte contre les drogues illicites... |
LISTE
DES PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES
PAR LA COMMISSION
D'ENQUÊTE
|
5 février 2003 M. le Professeur Roger Nordmann , membre de l'Académie nationale de médecine M. le Professeur Bernard Roques, membre de l'Académie des sciences, auteur du rapport sur les « Problèmes posés par la dangerosité des drogues » M. le Docteur Léon Hovnanian , Président du centre national d'information sur la drogue (CNID) M. le Docteur Francis Curtet, psychiatre, spécialiste de la toxicomanie 12 février 2003 M. le Docteur Patrick MURA , Président de la Société française de toxicologie analytique M. le Docteur Didier JAYLE, Président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT), Vice-président du conseil d'administration de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies M. le Professeur Lucien ABENHAIM , Directeur général de la santé M. le Docteur Gilbert PÉPIN, expert en pharmacologie et toxicologie ( huis clos demandé ) 26 février 2003 M. Alain EHRENBERG , Sociologue, Directeur de recherche au CNRS et de M. Hugues LAGRANGE , Sociologue au CNRS-OSC Mme Nicole MAESTRACCI , Conseiller à la Cour d'appel de Paris, ancienne Présidente de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) M. Jacques FRANQUET , Préfet de la Dordogne, Premier vice-président de l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) M. Jean-Luc SALADIN , Médecin 5 mars 2003 M. le professeur Philippe-Jean PARQUET , Président de l' Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (O.F.D.T.) et M. Jean-Michel COSTES , Directeur M. Pierre MUTZ , Directeur général de la gendarmerie nationale Mme le docteur Véronique VASSEUR , Médecin hospitalier M. le professeur Renaud TROUVÉ , Pharmacologue 12 mars 2003 M. Alain EHRENBERG , Sociologue, Directeur de recherche au CNRS M. Michel BOUCHET , Chef de la mission de lutte anti-drogue (MILAD) M. Hugues LAGRANGE , Sociologue au CNRS-OSC M. Xavier RAUFER , Chargé de cours à l'institut de criminologie de Paris, université Panthéon-Assas (Paris II) 19 mars 2003 M. Yves BOT , Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris M. Bernard PETIT , Commissaire Principal, Chef de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) M. Francis CABALLERO , Professeur à l'Université de Paris X, Avocat à la Cour de Paris, président du « Mouvement de légalisation contrôlée » Mme Edwige ANTIER , Pédiatre 26 mars 2003 M. Jean-Pierre CARBUCCIA-BERLAND , Directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au Ministère de la justice M. Gérard PEUCH , Commissaire Divisionnaire, Chef de la brigade des stupéfiants à la direction de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris M. Didier LALLEMENT , Directeur de l'administration pénitentiaire au Ministère de la justice M. Gérard TCHOLAKIAN , membre de la commission libertés et droits de l'homme au Conseil national des barreaux (CNB) 2 avril 2003 M. Jean-François LAMOUR , Ministre des sports M. Pierre CARDO , Député, Maire de Chanteloup-les-Vignes Mme Catherine DOMINGO , Substitut du Procureur de la République de Bayonne M. Luc FERRY , Ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche 9 avril 2003 M. Jean-Pierre LHOMME , responsable des missions échange de seringue et bus méthadone à l'association Médecins du monde Mme Marie-Christine d'WELLES , fondatrice de l'association Enfance sans drogue, Présidente de l'Observatoire de la psychiatrie M. Serge LEBIGOT , Président de l'association France sans drogue M. Dominique PERBEN , Garde des Sceaux, Ministre de la justice 23 avril 2003 Mme Nadine POINSOT , Présidente de l'association « Marilou » Mme Marie-Françoise CAMUS , Présidente de l'association « Le Phare » M. le docteur Michel HAUTEFEUILLE, Psychiatre au Centre Médical Marmottan à Paris, Directeur de la société d'enseignement et de recherche en toxicomanie, ancien président de l'association « Imagine ». M. Nicolas SARKOZY, Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales M. Jean-François MATTEI, Ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées M. Xavier DARCOS , Ministre délégué à l'enseignement scolaire 29 avril 2003 M. Michel SETBON Chercheur au laboratoire d'économie et de sociologie du travail du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) M. François-Georges LAVACQUERIE, membre du Collectif d'information et de recherche cannabique (CIRC) Mme Lucile RABILLER , membre conseiller de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) M. Michel BOYON , Président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD) M. François MONGIN , Directeur général des douanes et droits indirects (DGDDI) M. Gérard ESTAVOYER , Directeur national du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) M. Alain QUÉANT , Sous-directeur de la police territoriale à la Direction de la police urbaine de proximité 30 avril 2003 M. François HERVÉ , Président de l'association nationale des intervenants en toxicomanie (ANIT) M. Faride HAMANA , Secrétaire général de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) Mme Marie CHOQUET , Chercheur à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) M. le Docteur Raymond TRARIEUX , Président de l'Association pour l'étude des conduites addictives et des conséquences sur l'aptitude médico-professionnelle M. le Professeur Claude GOT , Président du Collège scientifique de l'Observatoire français des Drogues et Toxicomanies (OFDT) |
PREMIÈRE PARTIE
-
UN CONSTAT TRÈS PRÉOCCUPANT
I. L'EXPLOSION DES DROGUES
Depuis une dizaine d'années, on constate une augmentation très importante de la consommation des drogues illicites, il est vrai inégale selon les produits, qui sont de plus en plus diversifiés, ainsi qu'une production et un trafic multiforme en forte progression.
Ce constat est d'autant plus préoccupant que la dangerosité de ces produits est désormais avérée.
A. UNE CONSOMMATION DE DROGUES EN CONSTANTE AUGMENTATION DEPUIS DIX ANS
1. Une consommation en pleine expansion
Ainsi que l'ont souligné une très grande partie des intervenants, la tendance manifeste depuis quelques années est à la fois à la croissance et à la diversification de la consommation de drogues illicites, à des niveaux toutefois très distincts concernant chaque produit.
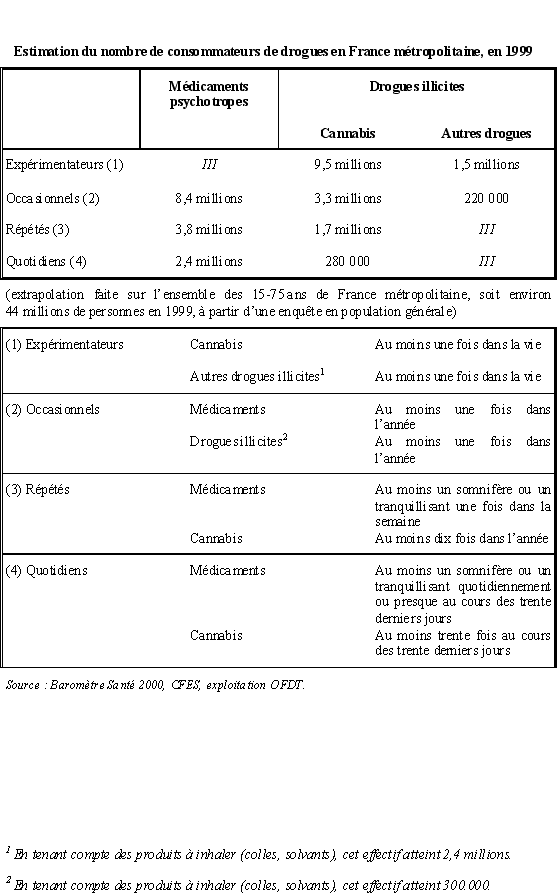
a) Le cannabis : une consommation de masse croissante, notamment chez les jeunes
L'ensemble des études européennes montre un accroissement important de la consommation de cannabis dans le courant des années 60, qui s'est accentuée dans le courant des années 70, avec une stabilisation dans les années 80. Au cours des années 90, une reprise très nette de la consommation, surtout chez les jeunes, est constatée dans tous les pays développés, à des niveaux supérieurs à ceux observés dans la décennie 70.
Comme l'a souligné devant la commission le nouveau président de la MILDT, M. Dider Jayle, « il est clair, (même si) ce ne l'était pas tellement pour beaucoup de gens et toujours pas, qu'il y a eu une explosion de consommation de cannabis aux Etats-Unis, en Europe et en France. (...). Il y a (là) un problème ».
Le ministre de l'intérieur, M. Nicolas Sarkozy, s'est dit également très préoccupé par cette évolution générale, déclarant à la commission : « Je crois que toute personne qui regarde la situation telle qu'elle est, avec le regard le plus objectif et le plus responsable, ne peut qu'être inquiète. Disons le clairement, la situation n'a fait que se dégrader ces dernières années. Quand je parle de dégradation, c'est de forte dégradation dont il s'agit, à tel point que la France détient un record dont elle se serait bien passée : la France est le premier pays d'Europe où les jeunes consomment du cannabis ».
Cette évolution peut tout particulièrement s'observer en France, où la prévalence de consommation du cannabis était particulièrement faible au début des années 60 alors que cette substance est aujourd'hui la drogue illicite de loin la plus utilisée. L'usager type de cannabis est jeune (21 ans environ en moyenne), sans profession de ce fait (à plus de 60 %) et essentiellement masculin (à plus de 90 %).
Ainsi, parmi les 18-75 ans, un individu sur cinq (21,6 %) l'a déjà expérimenté, 6,5 % en ont un usage occasionnel (au moins une fois dans l'année), 3,6 % un usage répété (au moins dix fois dans l'année) et 1,4 % un usage régulier (dix fois par mois et plus). Cela représente respectivement 9,5 millions d'expérimentateurs, 3,3 millions d'usagers occasionnels, 1,7 millions d'usagers répétés et environ 280 000 usagers réguliers.
L'augmentation du nombre des expérimentateurs de cannabis, signe de sa banalisation, est particulièrement importante au cours des années 90. Elle est ainsi passée, en population générale adulte âgée de 18 à 44 ans, de moins de 20 % au début de cette décennie à plus de 30 % au début de la décennie suivante. M. Jean-Michel Costes, directeur de l'OFDT, a ainsi confirmé à la commission que « quand on retrace l'évolution de la consommation de cannabis, on constate une progression constante, depuis 1993, première enquête de référence dont on dispose, jusqu'à 2002 ».
Une telle augmentation des quantités consommées est confirmée indirectement par les statistiques officielles qui relèvent un substantiel accroissement au cours des années 90 des quantités de cannabis saisies et du nombre des interpellations pour usage et usage-revente. Celles-ci sont en effet passées de 4 954 interpellations en 1980 à 20 094 en 1990 et à 78 804 en 1999. Par ailleurs, en 2002, la majorité des interpellations pour usage (90,39 %) concernait le cannabis.
La population adolescente est encore plus marquée par ce phénomène. En 1999, 59 % des garçons et 43 % des filles de 18 ans déclarent avoir déjà pris du cannabis contre respectivement 34 % et 17 % en 1993, soit une augmentation d'environ 25 points en 6 ans pour chaque sexe.
La consommation de cannabis est donc devenue, en termes statistiques, un comportement majoritaire chez les jeunes arrivant à l'âge adulte. Si l'usage est essentiellement expérimental ou occasionnel, une proportion non négligeable de jeunes s'adonne à des consommations répétées : près de 16 % des garçons de 19 ans reconnaissent en 2000 avoir un usage intensif du cannabis (plus de vingt fois par mois) et plus d'un sur trois a une consommation régulière (de 10 à 19 fois par mois).
Force est de reconnaître que le cannabis est aujourd'hui une substance familière pour les jeunes Français, soit qu'ils en consomment ou en aient consommé personnellement, soit qu'ils fréquentent des amis relevant de ce profil (selon l'enquête Espad de 1999, un jeune sur trois estime que la plupart de ses amis consomme du cannabis). La France arrive même en tête en 1999 (ex-aequo avec la Grande-Bretagne et la République tchèque) du classement des pays de l'Europe élargie en termes de prévalences de consommation chez les jeunes de 15 à 16 ans, alors qu'elle n'était qu'en septième position en 1995, selon la même enquête Espad.
A cet égard, Mme Marie Choquet, chercheur à l'INSERM, a indiqué que si les enquêtes montrent que « le cannabis a augmenté partout, dans tous les pays européens (...), la France a été championne en la matière, dans la mesure où nous sommes passés d'une place moyenne en 1993, 1995, à une première aujourd'hui ».
M. Didier Jayle a insisté sur le fait que cette tendance particulièrement forte de la jeunesse française à consommer du cannabis perdurait. Il s'est référé à une étude européenne très récente indiquant « que la France est numéro un dans la consommation de cannabis chez les jeunes de 16 à 24 ans, avant la Hollande » : on y apprend en effet que le nombre de jeunes français de cette classe d'âge ayant consommé du cannabis dans le mois précédent l'enquête est de 19,8 % en France, contre 14,4 % aux Pays-Bas et 2,4 % en Suède, le taux européen moyen étant de 11,3 %.
Il a été rejoint dans son analyse par M. Michel Bouchet, chef de la MILAD, qui a lui aussi constaté devant la commission que « l'usage (du cannabis) s'est très nettement étendu dans notre pays et a doublé au cours des dix dernières années, particulièrement chez les jeunes », ajoutant que « l'initiation a progressivement touché les adolescentes de façon de plus en plus précoce ».
Le docteur Francis Curtet a illustré cette banalisation rampante du cannabis devant la commission en expliquant qu'« on en est arrivé maintenant à un stade auquel, pour la majorité des jeunes, le cannabis est considéré comme leur apéritif, en comparaison à l'alcool, qui serait l'apéritif des parents ».
Plus encore que la croissance de l'expérimentation, c'est l'augmentation de la consommation régulière de cannabis chez les jeunes qui est en effet préoccupante. Comme l'a expliqué à la commission Mme Marie Choquet, « avec l'augmentation de l'expérimentation du cannabis, nous avons vu l'augmentation de la consommation régulière de cannabis. C'est une loi assez constante ». Mme Choquet a ajouté que « si certains croient que l'on peut augmenter l'expérience sans augmenter la consommation régulière », elle ne voyait pas « par quel moyen », écartant ainsi l'argument souvent présenté selon lequel la croissance de l'expérimentation n'irait pas forcément de pair avec celle de l'usage répété.
b) Les drogues dites dures : un usage très circonscrit mais en augmentation préoccupante
(1) L'héroïne et les opiacés
L'expérimentation, et plus encore l'usage problématique de l'héroïne et d'autres opiacés restent rares en France. Des observations de terrain relèvent une certaine désaffection pour ces produits au cours des années 90, ce qui s'explique en grande partie par le développement de produits de substitution à l'héroïne (méthadone, Subutex), par les dangers accrus de contamination au VIH et aux diverses hépatites que fait courir aux héroïnomanes l'injection par voie intraveineuse ainsi que par le développement et la baisse du prix de la cocaïne et des drogues de synthèse.
Ainsi, seuls 0,4 % des femmes et 1,7 % des hommes de 18 à 44 ans ont expérimenté l'héroïne en 2000, ce taux se rapprochant de 0 au-delà de cet âge.
Quant à la consommation problématique, elle est encore plus limitée, malgré une visibilité sociale plus marquée : on estime que la population d'usagers d'opiacés « à problèmes » se situe entre 150.000 et 180.000 personnes. Une proportion importante d'entre eux utilise par intraveineuse des médicaments opiacés, essentiellement la buprémorphine (Subutex).
Si la prévalence de la consommation d'héroïne est donc faible en valeur absolue, elle semble toutefois connaître une croissance notable. Le chef de la Mission de lutte anti-drogue (MILAD), M. Michel Bouchet, a remarqué devant la commission que « l'expérimentation de cette drogue chez les jeunes adultes et les adolescents est en augmentation. L'héroïne est maintenant présente dans les évènements festifs, notamment les rave parties, où elle est utilisée pour amoindrir les effets des produits stimulants. Selon une enquête récente, près de 4 % des garçons de 16 ans et 1,6 % des filles du même âge ont déjà consommé de l'héroïne au moins une fois dans leur vie, soit trois fois plus qu'il y a dix ans ».
Cette tendance préoccupante a été confirmée par M. Bernard Petit, chef de l'OCRTIS, qui a indiqué à la commission que « le risque de regain de consommation (...) est présent aujourd'hui, tant du fait d'un accroissement de l'offre (très importante activité des filières turques, albanaises et afghanes) qu'en raison de nouveaux modes de consommation « des jeunes qui, dans les rave parties, se mettent à consommer de l'héroïne pour atténuer les effets stimulants des drogues de synthèse, pour « atterrir » après la consommation de ces drogues, et qui, en ce sens créent un nouvel appel d'air en termes de demande et de consommation ».
Ainsi, l'héroïnomane n'est pas nécessairement le « junky » en mauvaise santé, sale, sans argent, sans métier et sans domicile fixe auquel renvoie l'imaginaire collectif. Beaucoup de consommateurs d'héroïne ne possèdent en effet aucun signe extérieur indiquant leurs pratiques addictives. Ils sont assez âgés (âge moyen de 28 ans environ), essentiellement masculins (à 85 % environ) et aux deux-tiers sans activité professionnelle, ce pourcentage étant toutefois en baisse constante depuis le milieu des années 90.
(2) La cocaïne et le crack
S'ils sont supérieurs à l'héroïne et aux opiacés, l'expérimentation et plus encore l'usage actuel de la cocaïne et du crack demeurent réduits. Ainsi, en 2000, l'usage d'héroïne au cours de la vie est limité à 1,2 % des femmes et 3,7 % des hommes de 18 à 44 ans. Au-delà de cet âge, l'expérimentation est quasi nulle. Chez les jeunes scolarisés, 2 % des filles et 2,1 % des garçons de 14 à 18 ans déclarent avoir pris de la cocaïne au cours de leur vie.
Toutefois, la tendance récente semble être à l'augmentation de l'usage de cocaïne, en raison notamment de la baisse de son prix de vente. Les enquêtes de terrain montrent ainsi une diffusion en expansion de la cocaïne, notamment dans le cadre d'événements festifs . M. Michel Bouchet a indiqué à la commission que « la consommation de ce produit dépasse maintenant le cercle habituel des privilégiés et des milieux à la mode pour toucher une population jeune de toutes origines sociales, plus vulnérable aux phénomènes de mode et à l'exemplarité de certaines « élites ». (...) dans certaines secteurs, sous sa forme classique ou sous forme de crack, ce produit fait jeu égal, voire dépasse l'héroïne ».
Cette tendance est confirmée par M. Bernard Petit, chef de l'OCRTIS, qui voit dans la consommation de cocaïne « une véritable menace immédiate et, sans doute, pour quelques années à venir » en raison « d'un intérêt particulier (pour le trafic de cocaïne) de puissantes organisations criminelles qui appartiennent au grand banditisme français ».
La population concernée par la consommation de cocaïne est relativement âgée (une trentaine d'année en moyenne), essentiellement masculine (à plus de 80 %) et possédant une activité professionnelle (à plus de 80 % également).
Quant à l'expérimentation et l'usage du seul crack, ils restent encore trop circonscrits (essentiellement à des populations particulièrement stigmatisées de certains quartiers de Paris, des Antilles 15 ( * ) et de la Guyane) pour faire l'objet d'enquêtes précises. On sait cependant que les consommateurs de crack, comme ceux de cocaïne, sont relativement âgés (l'âge moyen étant d'environ 31 ans) et essentiellement masculins (à plus de 80 %). En revanche, ils sont généralement chômeurs (aux trois-quarts).
c) L'ecstasy, les amphétamines et les drogues de synthèse : successeurs potentiels du cannabis au « hit parade » de la consommation ?
Apparue en France au début des années 90, la consommation de drogues chimiques n'a cessé depuis de progresser au point de devenir aujourd'hui un enjeu prioritaire. M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, a ainsi déploré que « l'arrivée de quantités toujours plus importantes de drogues de synthèse dans notre pays risque à court terme d'entraîner (...) une nouvelle épidémie de consommation, mettant ainsi gravement en danger la santé des plus jeunes ». Le ministre s'est référé aux chiffres relatifs à la consommation de ces produits, « proprement consternants », indiquant qu'« entre 2000 et 2002, le nombre de jeunes ayant expérimenté de l'ecstasy a tout simplement doublé ».
Si elle reste relativement faible en valeur absolue en population générale adulte, cette tendance à l'augmentation est toutefois nette : chez les 18-44 ans, entre le milieu et la fin de la dernière décennie, l'expérimentation d'ecstasy et/ou d'amphétamines est passée de 0,7 % à 1,6 % chez les femmes et de 1,8 % à 3,5 % chez les hommes.
Comme pour le cannabis, l'accroissement de la consommation est particulièrement marqué chez les jeunes : une enquête menée dans les lycées parisiens montre que la proportion d'élèves ayant déjà essayé l'ecstasy est passée de 0,1 % en 1991 à 3 % en 1998. La tendance se poursuit puisqu'en 2000, 3,7 % et 6,7 % des garçons de 19 ans ont expérimenté respectivement l'ecstasy et les amphétamines.
La très grande majorité des consommateurs a entre 18 et 25 ans (l'âge moyen étant de 23 ans). Les jeunes ayant déjà pris un produit stupéfiant de synthèse sont nettement plus souvent consommateurs répétés d'alcool, de tabac et de cannabis que les autres.
Le lien entre l'usage de ces produits et les fêtes techno est très net, notamment chez les jeunes : la proportion de consommateurs s'étant déjà rendus à une fête de ce type est significativement plus élevée que parmi les jeunes n'en ayant jamais fréquenté (respectivement 9,5 % et 4,3 % des jeunes de la première catégorie ont déjà pris de l'ecstasy et des amphétamines, contre moins de 1 % pour ceux de la seconde catégorie).
d) Les produits dopants : un usage important bien que méconnu
Les produits dopants recouvrent tous les méthodes et produits, licites ou illicites (médicaments psychotropes, médicaments courants, stimulants, stupéfiants ...) utilisés par une personne pour augmenter ses performances physiques ou intellectuelles.
Au sens strict du terme, sur un plan purement sportif, le dopage se définit comme l'usage aux fins d'améliorer ses performances sportives de certaines substances (stimulants, narcotiques, anabolisants ...) et de certains procédés (dopage sanguin, manipulations pharmacologiques, chimiques et physiques) interdits, d'autres substances (alcool, cannabinoïdes, bêta-bloquants ...) étant soumis à restriction 16 ( * ) .
Bien que les drogues illicites ne constituent qu'une infime partie des produits dopants inscrits sur la liste des substances considérées comme « dopants », l'usage de cannabis aux fins de dopage tend à prendre des proportions importantes (25 % des substances détectées par le Laboratoire national de dépistage du dopage en 2001, chiffre ramené à 21 % pour l'année 2002).
Si le comportement du sportif qui se dope de manière usuelle présente des similarités avec celui d'une personne qui se drogue (phénomènes de dépendance et de sevrage, existence d'un trafic des produits illicites comparables), il existe d'importantes différences : d'une part, le sportif consommant des produits stupéfiants le fait le plus souvent de façon ludique et non pour influer sur ses performances, même si celles-ci peuvent s'en trouver améliorées (ainsi, le cannabis peut avoir un effet désinhibiteur appréciable pour des gardiens de but, des joueurs de tennis ou de tir à l'arc) ; d'autre part, les motivations sont opposées, la toxicomanie étant plutôt une fuite (même si cela devient moins vrai avec le développement des consommations « récréatives ») tandis que le dopage procède d'une volonté de s'affirmer et de prouver sa supériorité.
Environ 6 % de la population générale adulte âgée de 15 à 75 ans a pris une substance destinée à améliorer ses performances physiques ou intellectuelles au cours des douze derniers mois. Parmi les sportifs adultes, les enquêtes divergent, la consommation de produits dopants variant de 3 % à 10 %, ce taux passant à plus de 17 % chez les athlètes de haut niveau. Chez ces derniers, le taux de contrôle positif en 2002 a été de 7 %, en augmentation par rapport aux années précédentes.
Les sports les plus touchés par le dopage sont traditionnellement le cyclisme et l'haltérophilie. M. Michel Boyon, président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, a parlé à cet égard devant la commission de « véritable culture du dopage, encore aujourd'hui, (...) dans le monde du cyclisme », tout en reconnaissant qu'« aucun sport n'est épargné », des contrôles positifs ayant lieu tous les ans dans des disciplines paraissant a priori peu concernées par le dopage (tir à l'arc, pétanque, badminton). M. Boyon s'est également dit tout particulièrement préoccupé par le rugby, « à la fois du fait du phénomène de mondialisation, qui fait que les joueurs jouent de plus en plus dans d'autres pays que ceux dont ils ont la nationalité, et du fait de la professionnalisation, qui est une tentation très forte ».
Les jeunes semblent particulièrement exposés aux pratiques de dopage : ainsi, 11 % des élèves reconnaissent en 1999 avoir pris au cours de leur vie un produit destiné à améliorer leurs performances physiques ou intellectuelles.
e) Les médicaments psychotropes détournés de leur usage médical : un mal français
S'ils ne relèvent pas des drogues illicites lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'une prescription médicale, ce qui est généralement le cas, ils peuvent en revanche y être assimilés lorsqu'ils sont utilisés en dehors de toute prescription. Or, cette pratique tend à croître considérablement, notamment chez les populations jeunes et féminines. Selon l'enquête Espad de 1999, l'expérimentation de médicaments psychotropes hors prescription chez les jeunes scolarisés est passée entre 1993 et 1999 de 7,7 % à 17,4 % chez les filles et de 2,6 % à 11 % chez les garçons.
L'usage de médicaments psychotropes est à la fois typiquement féminin et spécifique à la France, celle-ci se trouvant loin devant ses voisins européens en ce qui concerne la vente et la consommation. Au sein de la population scolaire et parmi les trente pays interrogés dans l'enquête ESPAD, l'usage au cours de la vie de tranquillisants ou de somnifères des élèves français de 16 ans place la France parmi les pays de tête, qu'il y ait prescription ou pas, pour les garçons comme pour les filles.
Mme Marie Choquet, chercheur à l'INSERM, a insisté sur l'importance de ces consommations, indiquant à la commission que « parmi les autres drogues (que le cannabis), les plus consommées sont les médicaments contre la nervosité et l'insomnie sans ordonnance médicale », point sur lequel « la France est « meilleure » que l'Europe ».
De nombreux médicaments psychotropes, notamment ceux appartenant à la famille des benzodiazépines, sont susceptibles d'être détournés de leur usage à des fins addictives. Ainsi, le Rohypnol (un hypnotique) est un médicament consommé hors cadre médical par des usagers de drogues en grande difficulté sociale et très marginalisés (squatters, prostitués, SDF ...). Recherché pour ses effets désinhibiteurs et d'invincibilité d'une part, comme produit associé à la consommation des opiacés (héroïne et buprénorphine) et/ou de l'alcool d'autre part, il peut être ingéré par voie orale ou bien injecté.
A la frontière du médicament et du produit stupéfiant, se pose par ailleurs le problème des produits de substitution, et notamment du Subutex. Destiné à soigner les personnes dépendantes aux opiacés et en principe fourni sur prescription médicale, il fait l'objet d'un important trafic chez des toxicomanes capables, après l'avoir pilé, d'en récupérer uniquement la fraction agoniste, c'est-à-dire celle qui donne les mêmes effets que l'héroïne.
2. Des modes de consommation et des comportements addictifs en mutation
a) L'évolution des produits
(1) Le développement de drogues « festives » et « séquentielles »
Le concept de drogues festives renvoie à la fois à certains produits, certains lieux et certains comportements hédonistes.
S'agissant des produits, il s'agit essentiellement des pilules d'ecstasy dont la présentation attrayante prévient les craintes des consommateurs potentiels. Ces pilules ont en effet l'aspect de comprimés le plus souvent ronds, parfois en forme de coeur ou d'étoile ; elles sont de multiples couleurs, souvent gravées avec certains logos 17 ( * ) (papillon, dollar, pomme, soleil ...) et emballées en sachets leur donnant l'aspect de friandises ; elles sont solubles dans l'eau ou dans l'alcool dans lesquels leurs consommateurs les dissolvent généralement ; elles sont bon marché (un comprimé d'ecstasy acheté à l'unité vaut environ 15 euros en France).
Leurs effets immédiats sont a priori inoffensifs : euphorie, accroissement de l'énergie émotionnelle et physique, diminution du besoin de manger, boire et dormir, désinhibition favorisant la communication avec autrui, augmentation de la confiance en soi...
Si les pilules d'ecstasy évoquent la fête, les lieux où elles sont consommées également. Outre de nombreux bars et boîtes de nuit où elles circulent abondamment (la délégation sénatoriale a ainsi recueilli, lors de son déplacement à Valenciennes, le témoignage de nombreuses personnes soulignant l'importance du phénomène dans les méga dancings situés à la frontière belge), les pilules d'ecstasy sont associées le plus souvent aux « rave parties » où une population jeune danse frénétiquement jusqu'au petit matin sur une musique « techno ».
Originaire des Etats-Unis, le mouvement « techno-rave » s'est introduit en Europe via l'Angleterre au milieu des années 80. Il consiste, pour des milliers de jeunes, à se réunir autour de musiques techno émises à un très fort volume pendant plusieurs jours et plusieurs nuits dans des lieux insolites (usines désaffectées, entrepôts, grottes...) tenus secrets jusqu'au dernier instant, une heure et un lieu de rendez-vous où sera expliquée la façon de se rendre à la rave party étant communiqué par « flyer » (prospectus), « infoline » (répondeur téléphonique), « fanzine » (magazine alternatif) ou radio indépendante.
Dès les années trente, le lien entre l'usage récréatif de substances psychoactives, la musique et la vie nocturne était établi, les musiciens de jazz consommant largement de la marijuana et de la cocaïne. Dans les années 60, en lien avec le phénomène rock and roll, puis dans les années 70, avec la vague pop, sont venus s'y ajouter amphétamines, hallucinogènes et médicaments psychotropes. C'est au cours des années 80 que l'ecstasy est apparue puis s'est propagée très rapidement en Europe dans le monde de la danse « rave », « acid house » ou « techno », chaque pays ayant ses spécificités (« trans » à Bruxelles, « happy techno » à Londres, « acid » à Rome, « techno progressive » à Paris et Amsterdam ...).
Force est de constater que les consommateurs de drogues synthétiques à des fins festives ne se trouvent pas majoritairement parmi les personnes marginalisées ou socialement défavorisées, mais parmi des jeunes de milieux aisés, poursuivant des études supérieures ou déjà engagés dans la vie professionnelle. Tenant là une clientèle ayant des moyens financiers conséquents, les industries de la musique, des boissons alcoolisées et de la mode se sont emparées du marché en développant des marques et des produits (boissons énergisantes, chaussures de sport, vêtements, gel capillaire...) spécialement adaptés aux « ravers ».
Inhérente à la culture « rave » et « techno », l'ecstasy participe d'une aspiration contemporaine à la recherche du plaisir pur, de la libération d'énergie et de la communion au sein de fêtes modernes où s'effaceraient les rapports sociaux conventionnels. Rassurante par son aspect ludique, la pilule d'ecstasy y est facilement considérée comme un inoffensif stimulant (« safe drug ») indispensable pour atteindre l'état de transe recherché.
Mais l'ecstasy n'est pas le seul type de drogue à pouvoir faire l'objet d'un usage « récréatif » : si l'on met de côté l'alcool, qui reste la substance psychoactive la plus fréquemment et la plus largement utilisée de façon « festive », le cannabis, mais aussi la cocaïne, voire l'héroïne, sont de plus en plus consommés par des populations jeunes pour le plaisir qu'ils procurent plus que pour la faculté qu'ils offrent de s'extraire artificiellement d'une réalité vécue comme insupportable. Sont également consommés pour le plaisir des drogues et plantes hallucinogènes ainsi que des poppers, souvent en conjonction avec des sédatifs, des tranquillisants et des drogues hypnotiques.
Parallèlement, du fait de sa progressive démocratisation, l'ecstasy tend à quitter les lieux de consommation collective « branchés » tels que rave parties, boîtes de nuit ou bars « tendance » pour être utilisée dans des soirées privées entre amis, voire par des personnes seules, passant d'un mode de consommation hédoniste à un mode de consommation centré davantage sur la recherche de la seule « défonce ».
Le concept de « drogue séquentielle » renvoie quant à lui à de nouvelles substances chimiques, à mi-chemin entre le médicament, le dopant et le stupéfiant, ayant pour particularités d'entraîner des effets psychoactifs différents dans le temps, leurs modes d'actions étant en quelques sorte fractionnés selon le moment de la journée ou de la nuit auquel ils interviennent.
L'ingestion d'un produit de ce type permet ainsi, par exemple, d'accroître son efficacité professionnelle durant la matinée, d'augmenter ses performances sportives pendant l'après-midi, de stimuler sa sensibilité le soir et de provoquer un état de relaxation ou d'extase pour la nuit.
Si ces effets peuvent être obtenus en consommant un seul produit, ils peuvent l'être également en consommant successivement plusieurs produits différents : le docteur Léon Hovnanian a évoqué devant la commission le cas de personnes « utilisant la cocaïne, les amphétamines ou l'alcool pour être performantes 24 heures sur 24 et le cannabis pour soulager leur stress. C'est l'équivalent du dopage de haut niveau ».
Ce comportement, qui s'apparente à la polyconsommation, s'en différencie cependant : les produits sont consommés successivement et l'effet recherché est l'enchaînement d'effets psychoactifs différents.
(2) L'apparition de drogues exotiques
Parallèlement aux drogues traditionnelles (héroïne et cocaïne) et aux drogues modernes (cannabis, drogues de synthèse), l'effacement des distances et l'accroissement des échanges entre les diverses régions du monde provoquent l'apparition de toute une série de produits jusqu'alors inconnus.
Comme l'a indiqué le Professeur Patrick Mura devant la commission, le marché clandestin français voit aujourd'hui arriver le yagé, le cohoba, l'iboga ou l'haïwachka, qui sont des lianes hallucinogènes d'Afrique ou d'Amérique, mais aussi le khat et le kava, utilisés notamment en Nouvelle-Calédonie, le peyotl et la psilocybine, champignons hallucinogènes de plus en plus consommés en France.
De telles substances exotiques sont d'un accès très facile pour qui possède un accès à internet : de nombreux sites étrangers les proposant à la vente sans risquer d'être poursuivis par les autorités nationales, il est aisé d'en passer commande et de se les faire livrer par colis postal. Souvent très concentrées en produits actifs, elles ont été très peu étudiées et leurs effets sont largement inconnus.
(3) L'augmentation de la teneur en principes actifs
Il s'agit là d'une évolution particulièrement caractéristique en ce qui concerne le cannabis, dont la teneur en principes psychoactifs est mesurée en taux de THC. Si celui-ci ne dépassait jamais 10 % jusqu'à récemment, sont apparus sur le marché depuis un certain temps des produits beaucoup plus riches, provenant non plus du Maroc comme autrefois, mais essentiellement des Pays-Bas.
Les conditions de culture assurées en Hollande (pollen très pur, utilisation de serres, arrosage régulier ...), mais aussi le développement de variétés de cannabis particulièrement fortes en substances psychoactives (skunk, aya), permettent en effet d'obtenir du cannabis titrant à 30, voire 40 % de THC. Cette teneur fort élevée en fait une drogue dure hallucinogène et remet donc en cause sa classification officieuse dans la catégorie des drogues dites « douces ».
Les effets d'un cannabis aussi fortement titrés sont naturellement beaucoup plus dangereux que ceux d'un cannabis « normalement » titré. Le docteur Gilbert Pépin a rapporté ainsi devant la commission le cas, fort médiatisé, d'un jeune homme s'étant défenestré après avoir fumé un « joint » préparé avec du cannabis provenant de Hollande et titré à 14,4 %.
(4) Le raccourcissement du cycle des produits
Le marché des drogues illicites est régi par des cycles et des modes se succédant plus ou moins rapidement en fonction du lieu considéré ainsi que de l'évolution de l'offre et de la demande. Très schématiquement, on peut considérer que les années 60 ont vu se développer l'héroïne, les années 70 la cocaïne, les années 80 le cannabis et les années 90 les drogues de synthèse.
Ces cycles de renouvellement et de disparition des produits se sont accélérés ces dernières années. Le Professeur Renaud Trouvé a indiqué à la commission : « Alors qu'un cycle durait auparavant une dizaine d'années, on peut dire qu'actuellement, du fait des luttes entre trafiquants, de la répression policière, des goûts des consommateurs, des accidents qui se produisent et des mises en garde sévères que reçoivent certaines franges de toxicomanes, la période a tendance à s'accélérer : dans les années 1995, elle est passée à une base de cinq ans et on peut estimer qu'à l'heure actuelle, on tourne sur deux ou trois ans ».
S'ils se caractérisent généralement par l'apparition de produits nouveaux et la disparition de produits anciens, les cycles peuvent également correspondre à la réapparition d'un produit qui semblait être passé de mode. Ainsi, s'agissant de la cocaïne, que l'on avait pu croire dépassée par les nouveaux stimulants de synthèse, l'OEDT 18 ( * ) remarque que « servie par sa large disponibilité et son image festive haut de gamme, (elle) pourrait être en passe de supplanter l'ecstasy dans les sanctuaires de la vie nocturne où naissent les modes ».
Ce phénomène général de raccourcissement des cycles perturbe profondément la mise en oeuvre des politiques publiques de lutte contre les drogues, s'organisant sur le long terme en ce qui concerne le suivi des réseaux et la prise en charge des toxicomanes. Elle rend surtout difficile la réalisation d'études épidémiologiques sur les effets et la dangerosité des diverses substances apparaissant continuellement sur le marché, préalable indispensable à la mise en place de traitements appropriés.
(5) Le développement croissant de l'autoproduction
Si la consommation de drogues illicites nécessitait jusqu'à présent de s'approvisionner en rencontrant, directement ou non, un dealer, l'apparition de l'autoproduction, du moins en ce qui concerne le cannabis, pourrait remettre en cause cette réalité.
C'est aux Pays-Bas que le phénomène a pris le plus d'ampleur : la culture de plants de cannabis aux fins de consommation personnelle étant autorisée dans la limite de certaines quantités, la Hollande commercialise des kits comportant des graines de cannabis sélectionnées génétiquement ou des spores de champignons hallucinogènes, des lampes fournissant un éclairage optimal et des systèmes d'arrosage automatique, ainsi que des livrets de conseils sur les méthodes de culture. Tout individu ayant la main « verte » peut ainsi produire une quantité non négligeable de cannabis, y compris en appartement, ou même dans un placard.
De nombreux consommateurs français vont acquérir de tels matériels de production aux Pays-Bas, mais il semble en plus que ce phénomène soit en train d'apparaître en France : l'une des personnes auditionnées par la commission a ainsi reconnu qu'étaient élaborés et vendus à Paris de tels kits de production, dont certains ont déjà été saisis par les services de police et de gendarmerie.
Le problème de l'autoproduction ne se limite pas au cannabis et aux champignons hallucinogènes, mais s'étend aux drogues de synthèse. S'il n'a pas été fait état de kits de production en la matière, l'accessibilité des matières premières et la simplicité des procédés de fabrication de certains produits permettent à tout chimiste un tant soit peu expérimenté d'en envisager l'élaboration 19 ( * ) . Ainsi, selon M. Renaud Trouvé, « ces produits sont souvent relativement faciles à réaliser et (...) une personne qui a des connaissances de chimie élémentaire peut tout à fait les synthétiser sans le faire forcément comme il faut, ce qui explique les accidents, parce que des dérivés de synthèse toxiques peuvent être contenus dans ces produits ».
Les observations de terrain confirment cette tendance. M. Bernard Petit, chef de l'OCRTIS, a indiqué à la commission avoir découvert à Montpellier un « kitchen lab, un laboratoire de cuisine, avec des jeunes qui ont les produits, les précurseurs chimiques, etc. et qui s'essaient à fabriquer de l'ecstasy », ajoutant que cette affaire prouve « qu'il y a des velléités d'ouvrir des petits laboratoires, çà et là, pour être au plus près de la consommation ».
b) L'évolution du profil des consommateurs
(1) Un rajeunissement général
Ce phénomène, sans doute le plus marquant de ces dernières années, a été souligné devant la commission par de nombreuses personnes auditionnées. Il recouvre plusieurs éléments : les jeunes connaissent leur primoconsommation de plus en plus tôt, de plus en plus de jeunes consomment et l'intensité des phénomènes de consommation chez les jeunes s'accroît avec l'âge.
La France est particulièrement touchée par ce phénomène puisqu'elle vient en tête des pays européens pour le cannabis. Si l'on intègre substances psychoactives licites et illicites, ce sont 92 % des jeunes qui en ont pris au moins une fois durant leur vie.
En ce qui concerne la primoconsommation, le rapport 2002 de l'OFDT indique que « l'initiation aux trois principales drogues consommées par les jeunes se fait, en moyenne, dans l'ordre suivant : l'alcool (13 ans), le tabac (14 ans), puis le cannabis (15 ans) » : la primoexpérimentation de ces trois produits, qui intervenait auparavant entre 15 et 20 ans, a lieu désormais avant.
Le professeur Roger Nordmann a souligné devant la commission « l'évolution vers une précocité de plus en plus marquée du début de la consommation. Si le pic de prévalence se situe vers la classe de troisième ou de seconde, nous avons actuellement des expérimentateurs au stade de la pré-adolescence ou du début de l'adolescence, c'est-à-dire à un moment où, par définition, le sujet est particulièrement fragile ».
Si l'expérimentation des drogues illicites chez les plus jeunes est rare, elle n'en est pas moins non négligeable : l'enquête Espad de 1999 20 ( * ) montre ainsi qu'à 14 ans, 11 % des jeunes ont déjà expérimenté le cannabis, 11 % les tranquillisants et/ou les somnifères sans ordonnance médicale, 11 % un produit à inhaler, 2 % des champignons hallucinogènes, 2 % de l'ecstasy, 2 % du crack, 2 % de l'héroïne et 2 % de la cocaïne.
L'augmentation de la consommation chez les jeunes est indéniable. En ce qui concerne le cannabis, drogue illicite la plus répandue parmi les jeunes, l'enquête Espad précitée montre qu'entre 1993 et 1999, l'expérimentation chez les jeunes de 14 ans est passée de 7 % à 14 % et chez les jeunes de 19 ans de 34 % à 59 %. La consommation répétée (dix fois par an et plus) suit la même évolution puisqu'elle est passée au cours de la même période de 0,2 % à 1,7 % chez les jeunes de 14 ans et de 11 % à 29 % chez les jeunes de 19 ans.
Dernier phénomène abondamment documenté : la forte progression de la consommation chez les jeunes en fonction de l'âge. Toujours selon l'enquête Espad précitée, l'expérimentation de certaines substances se banalise entre 14 et 19 ans : à 19 ans en effet, 50 % des élèves interrogés ont essayé le cannabis (contre 11 % à 14 ans). La consommation régulière suit la même tendance : 17,6 % des garçons de 19 ans et 7,6 % des filles du même âge consomment régulièrement du cannabis (dix fois et plus au cours des trente derniers jours) contre respectivement 0,7 % et 0,1 % à 14 ans.
Cette augmentation de la consommation de substances illicites, et notamment de cannabis, chez les jeunes, semble liée à des facteurs tenant à la fois à l'offre et à la demande. L'exposition à la drogue est particulièrement importante chez les jeunes : selon l'Eurobaromètre 57.2 d'octobre 2002 21 ( * ) , une grande majorité d'entre eux considère en France qu'il est facile de s'en procurer dans des soirées (85,3 %), près de chez soi (70,2 %) et même dans son établissement scolaire (63,8 %).
Quant aux facteurs tenant à la demande, la majorité des expérimentateurs de drogues est motivée par la curiosité (58,8 %), loin devant la pression des autres jeunes (39,6 %) et la recherche de l'excitation (35,6 %), ou encore les effets attendus (30 %) ou l'existence de problèmes à la maison (25,8 %).
(2) Une progressive extension socio-géographique
L'usage de drogues illicites était traditionnellement circonscrit aux grandes agglomérations (notamment à certains quartiers de Paris et à sa banlieue) ainsi qu'aux deux extrémités de l'échelle sociale (milieux très défavorisés et fortement marginalisés d'un côté, élite artistique et intellectuelle de l'autre).
Or, ce double constat se vérifie de moins en moins. En ce qui concerne la localisation géographique des usagers de drogues, la tendance semble être au développement de la consommation de drogues en-dehors des grandes villes et à son extension à l'ensemble du territoire français. MM. Pierre Mutz et Christophe Métais ont ainsi indiqué que les services de la gendarmerie nationale voyaient s'étendre les problèmes de drogues aux zones périurbaines et aux zones rurales, parfois même dans des campagnes très reculées.
Quant au développement de l'usage de drogue sur l'ensemble du territoire hors région parisienne, il apparaît clairement dans le rapport 2002 de l'OFDT mais varie selon les produits envisagés. S'agissant du cannabis par exemple, sa prévalence en termes d'expérimentation et de consommation, mesurée dans le baromètre santé 2000 du CFES, est significativement plus élevée que la moyenne en Ile-de-France, mais aussi en Bretagne, dans le sud-ouest et dans le sud-est, le centre de la France étant plus épargné.
En ce qui concerne la diffusion des drogues illicites à toutes les couches de la société, elle a été soulignée à plusieurs reprises par bon nombre des personnes auditionnées. Concernant le seul cannabis, le professeur Roger Nordmann parle ainsi d'un « phénomène de diffusion qui ne touche pas spécifiquement certaines personnes en difficulté », ajoutant qu'on trouve des consommateurs « dans les collèges de banlieues parisiennes ou des huitième ou seizième arrondissement ».
Le criminologue Xavier Raufer a confirmé cette tendance concernant les drogues de synthèse dont la consommation touche « la population générale », et notamment « des lycéens qui sont toujours plus intégrés », et « non pas uniquement des marginaux et des gens en proie à un phénomène d'autodestruction ».
Le fait nouveau est sans doute l'extension de l'usage de drogues aux classes moyennes, jusqu'ici relativement épargnées, et le nivellement des différences entre les différentes couches sociales en découlant. Le rapport OFDT de 2002 conclut ainsi à l'absence de lien significatif entre le niveau de diplôme, la catégorie socioprofessionnelle ou le revenu du ménage d'une part, et la consommation de drogue d'autre part, en ce qui concerne le cannabis, l'héroïne et la cocaïne.
Si les drogues touchent tous les milieux sociaux, elles n'y ont pas en revanche les mêmes effets. Il semble en effet que les milieux défavorisés soient surreprésentés parmi la population des consommateurs à problèmes, notamment chez les jeunes : le sociologue Hugues Lagrange a souligné en ce sens devant la commission que les adolescents ayant un usage problématique 22 ( * ) de drogues sont plus souvent des jeunes « qui ne sont pas scolarisés, qui ont redoublé au moins deux fois dans le cours de l'enseignement obligatoire, qui viennent des filières professionnelles et dont les parents sont séparés ».
Il y aurait donc, selon le sociologue, deux profils dans les modes de consommation : d'une part, un usage de drogues illicites « festif ou récréatif, voire de performance (...), qui est le fait de jeunes venant de tous les milieux, y compris les plus favorisés », et d'autre part, un usage « problématique de drogues illicites qui est le fait de jeunes qui sont issus de familles ayant des difficultés et qui sont eux-mêmes en difficulté scolaire ou en difficulté d'insertion professionnelle ».
Cette dualité de profil des consommateurs se retrouve dans la distinction opérée devant la commission par le docteur Francis Curtet entre les « simples usagers de drogues » et les véritables « toxicomanes ». Remarquant que la drogue « touche tous les milieux », avec toutefois « une petite prédominance pour les milieux défavorisés, conséquence inévitable de la crise économique que nous connaissons depuis longtemps maintenant », M. Curtet distingue en effet les usagers de drogues prenant un produit « par plaisir, par curiosité ou parce qu'on leur a proposé », que l'on trouve dans toutes les catégories sociales, et les usagers consommant de la drogue « parce qu'ils ne vont pas bien », plus spécifiquement concentrés dans les milieux sociaux difficiles ou défavorisés.
(3) Une polyconsommation désormais chronique
Elle est l'un des phénomènes les plus marquants de ces dernières années, à tel point que la monoconsommation est devenue aujourd'hui rarissime. Son ampleur varie selon que l'on parle de polyconsommation au sens strict (consommer avec une certaine fréquence, concomitamment ou successivement, au moins deux substances psychoactives) ou de polyexpérimentation (avoir expérimenté au moins deux produits psychoactifs dans sa vie), les effets attendus variant selon les types d'usage.
Si elle renvoie le plus souvent à l'utilisation de plusieurs drogues licites (l'association tabac, alcool et/ou médicaments étant devenue banale), elle fait de plus en plus référence à l'association drogues licites/drogues illicites (tabac/cannabis ou alcool/cannabis notamment), ou à l'association de plusieurs drogues illicites (dont le cannabis le plus souvent).
En population générale adulte âgée de 18 à 44 ans et en ce qui concerne les seules substances illicites, le baromètre santé 2000 du CFES indique que si les expérimentateurs de cannabis ont essayé en moyenne 1,4 substance parmi les huit retenues (cannabis, amphétamines, cocaïne, LSD, héroïne, ecstasy, médicaments « pour se droguer » et produits à inhaler), ceux d'ecstasy en ont expérimenté 4,2 et ceux d'héroïne 4,7. Les indicateurs croisés mettent par ailleurs en évidence l'importance de la polyexpérimentation concernant les drogues dures : 72 % de ceux ayant déjà essayé l'héroïne ont également essayé la cocaïne. Le fait d'avoir expérimenté du cannabis semble partagé par la quasi totalité des expérimentateurs de drogues illicites (94,1 % des expérimentateurs de cocaïne, 95 % d'héroïne et 96 % d'ecstasy).
S'agissant de polyconsommation, si l'usage répété d'alcool, tabac et/ou cannabis est relativement fréquent 23 ( * ) (15 % des 18-44 ans), l'usage répété de plusieurs drogues illicites hors cannabis est circonscrit à une très faible population de toxicomanes particulièrement stigmatisés. Mais c'est parmi les consommateurs de cannabis que l'on trouve la plus grande proportion d'expérimentateurs de substances illicites.
A la fin de l'adolescence, près de 80 % des jeunes ont expérimenté plusieurs substances psychoactives, mais il s'agit la plupart du temps d'alcool, de tabac et/ou de cannabis. Cependant, comme chez les adultes, il existe un petit groupe d'expérimentateurs d'un relativement grand nombre de substances illicites, le cannabis apparaissant encore comme la substance qu'ils ont presque tous essayée.
S'agissant de polyconsommation chez les jeunes, l'usage répété d'alcool, tabac et/ou cannabis est très répandu (15 % des filles et 28 % des garçons de 18 ans), notamment par l'association de l'usage de cannabis à l'usage de l'une au moins des deux autres substances (6,8 % des garçons de 18 ans consomment de façon répétée du cannabis avec de l'alcool et du tabac, 15,8 % du cannabis avec du tabac, mais 1 % seulement du cannabis et de l'alcool).
La polyconsommation, notamment de drogues illicites, est un phénomène particulièrement développé dans les lieux festifs et parmi les consommateurs abusifs ou dépendants . Elle a généralement pour objet de modifier, par un usage concomitant ou différé, les effets d'autres substances déjà consommées, en vue soit de les amplifier quantitativement et « qualitativement » (cannabis pour l'héroïne, cocaïne pour l'ecstasy), soit de les équilibrer en les corrigeant mutuellement (cocaïne pour l'alcool, ecstasy pour le LSD), soit de les réduire afin notamment de contrôler les effets négatifs apparaissant dans la phase de « descente » (cannabis pour le crack, héroïne pour l'ecstasy).
Les conséquences sanitaires et sociales de la polyconsommation sont particulièrement alarmantes : plus de la moitié des usagers de drogues ayant recours au système de soins sont des polytoxicomanes. Les opiacés sont surreprésentés dans ces polyconsommations « à problème » ; ils sont associés à l'alcool, au cannabis, aux médicaments psychotropes et à la cocaïne.
On constate par ailleurs une polyconsommation involontaire, notamment en ce qui concerne les drogues de synthèse, dont les composants sont souvent inconnus des consommateurs, et peuvent contenir plusieurs substances psychoactives dont les interactions peuvent être potentiellement très dangereuses . On estime ainsi que seulement deux tiers des pilules d'ecstasy ne contiennent que le produit désiré (la MDMA généralement), dont le dosage est d'ailleurs fort variable (de 1 à 30). Le dernier tiers contient des substances très diverses : médicaments, le plus souvent ; produits inoffensifs ne servant qu'à donner du poids (lactose, bicarbonate, amidon), mais aussi lessive, kétamine (anesthésiant pour animaux), voire poisons comme la strychnine ou la mort-aux-rats...
M. Renaud Trouvé a résumé devant la commission le phénomène de polyconsommation en expliquant que « les gens ne consomment plus une substance ou ne passent plus dans cette fameuse gradation décrite à une époque qui commençait par le cannabis et qui se terminait à l'héroïne (...). A l'heure actuelle, on peut entrer en toxicomanie (...) par n'importe quelle porte, sachant que c'est une question d'opportunité. On peut constater que la plupart des jeunes ou des toxicomanes consomment souvent plusieurs produits associés ou de façon séquentielle, (ce qui) pose des problèmes de fond et de toxicologie obscurs pour le moment ».
(4) Une recherche de la performance à travers l'usage de drogues
Ce phénomène prend une ampleur grandissante. Des substances illicites en soi, ou bien licites mais détournées de leur usage normal ou acquises selon des moyens illicites, sont utilisées désormais, ni pour le plaisir immédiat, ni pour l'oubli du réel qu'elles procurent, mais parce qu'elles permettent d'augmenter sensiblement ses capacités, notamment intellectuelles ou professionnelles. La frontière entre médicaments, drogue et produit dopant tend à se brouiller, comme celle entre licite et illicite.
Il s'inscrit dans un phénomène socioéconomique plus large de « course à la performance » et de croissance exponentielle des rendements attendus qu'a analysé le sociologue Alain Ehrenberg devant la commission : « Les exigences d'action et de décision se sont largement accrues pour toutes les couches sociales. (...) aujourd'hui, pour trouver un emploi, même précaire, il faut faire preuve de motivation, de capacités de présentation de soi, avoir des projets, etc . Or, drogues illicites et médicaments psychotropes sont souvent utilisés pour se désinhiber et être finalement à la hauteur du culte de la performance, qui est exigée aujourd'hui pour rester dans la socialité. (...). La réalité quotidienne de la dépression est nouée à ces normes qui poussent au dépassement de soi, pour le meilleur et pour le pire, sur le modèle de la compétition sportive. C'est à ce sentiment d'insuffisance, de ne pas être à la hauteur, que répondent bien souvent, pour les gens, médicaments et psychotropes. C'est pourquoi le mot « dopage » est sociologiquement un mot clé d'aujourd'hui ».
Le problème se pose naturellement d'abord dans le cadre professionnel. L'usage de produits, licites ou illicites, en vue d'augmenter ses performances tend à y augmenter considérablement, posant la question de l'usage de drogues sur le lieu de travail . Le docteur Michel Hautefeuille range ainsi parmi les nouvelles formes d'addiction les « dopés du quotidien », salariés ayant des responsabilités professionnelles et recourant à certains produits stupéfiants afin de gérer leur stress ou d'améliorer leurs performances.
Le scénario est souvent identique : l'intéressé, bien inséré socialement et professionnellement, commence par utiliser des médicaments psychotropes pour « assurer » professionnellement, puis « dérape » lorsque ceux-ci deviennent insuffisant en ayant recours à des drogues illicites qu'il se met à consommer en dehors des périodes de travail.
(5) Un rôle croissant des nouvelles technologies
Les liens entre drogues et nouvelles technologies concernent à la fois l'usage et le trafic. « Les progrès de la téléphonie mobile et la disposition du réseau internet facilitent grandement les activités de trafic des organisations spécialisées et les rendent, par certains aspects, moins vulnérables aux attaques de la police, de la douane, de la gendarmerie et de la justice » a indiqué M. Bernard Petit, chef de l'OCRTIS, devant la commission.
S'agissant de la consommation, le réseau électronique peut d'abord être utilisé pour se fournir directement : toute la gamme des produits stupéfiants est en effet proposée sur des centaines, voire des milliers de sites à travers le monde échappant par principe à tout contrôle national . Ces sites offrent aux consommateurs non seulement la « panoplie » des drogues illicites classiques, mais également, cela a été évoqué, des drogues « exotiques », ou encore des drogues de synthèse telles que le gamma hydroxyde butyrate (GHB), encore appelé « drogue des violeurs ». « Vous avez 80 sites sur la drogue des violeurs sur internet (sur lesquels) on vous explique comment l'utiliser pour soumettre votre victime et aboutir au fait criminel qu'est le viol » a indiqué un expert en pharmacie et toxicologie devant la commission.
Internet peut également être utilisé pour obtenir des renseignements sur les méthodes de mise au point de certaines drogues, qu'elles soient naturelles ou chimiques. M. Bernard Leroy indique avoir listé 800 sites de ce type. M. Jacques Franquet, premier vice-président de l'OICS, a reconnu devant la commission qu'on trouvait aujourd'hui sur internet « tous les modes de culture du cannabis, toutes les recettes possibles pour fabriquer de l'ecstasy ».
B. UNE PRODUCTION ET UN TRAFIC MULTIFORME EN CONSTANTE AUGMENTATION
L'expansion de la consommation de drogues illicites sur les dix dernières années s'accompagne parallèlement d'une explosion de la production des drogues. Les statistiques annuelles du PNUCID font ainsi apparaître une augmentation sensible des productions de toutes les drogues illicites, notamment depuis le début des années 90.
Dans le même sens, l'Office des Nations Unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime (OCDPC), dans son rapport sur les tendances mondiales des drogues illicites en 2002, indique quant à lui que « la culture mondiale du pavot à opium a considérablement baissé en 2001 et celle du cocaïer s'est légèrement contractée. Par manque de renseignements, on ne peut évaluer la culture illicite de cannabis à l'échelon mondial, mais l'ampleur grandissante des saisies donne à penser qu'elle est en augmentation continue ».
Cette explosion des volumes de production sur les dix dernières années s'accompagne d'une mutation du trafic de drogues illicites.
Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Bernard Petit, commissaire principal, chef de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a ainsi déclaré : « Le trafic de stupéfiants, depuis quelques années, est en pleine mutation : un changement radical s'opère dans le trafic. Les pays du Nord, qui étaient jusqu'alors plutôt consommateurs, sont devenus des pays producteurs de drogues de synthèse alors que les pays du Sud, qui étaient jusqu'ici plutôt des pays producteurs et faiblement consommateurs, sont devenus des pays consommateurs de ces drogues de synthèse produites dans le nord. Ce bouleversement géopolitique de la drogue produit des effets qu'on ne mesure pas encore complètement aujourd'hui, et les conséquences n'en sont pas encore pleinement connues ».
Au-delà de ce bouleversement géopolitique de la drogue souligné par M. Bernard Petit, la commission d'enquête a pu noter l'existence d'une double mutation du trafic de drogues illicites : mutation du trafic international d'une part, caractérisée par l'émergence de nouvelles filières régionales ainsi que par la décentralisation, ou l'atomisation, des organisations criminelles « traditionnelles », type cartels, liées au trafic de drogues ; mutation du trafic national, d'autre part, caractérisée notamment par le développement d'un trafic local, de proximité, générateur d'une économie souterraine déstabilisatrice dans les quartiers et de comportements liés au grand banditisme français.
1. Les grands axes du trafic international et l'émergence de nouvelles filières
S'agissant des grands axes du trafic international et des pays producteurs, il est possible d'identifier des zones géographiques de production en les distinguant par produit, même si on observe que des filières, à l'origine strictement différenciées et qui acheminaient chacune un produit, ont eu tendance avec le temps à prendre en charge toute forme de drogues illicites.
a) Les filières de l'héroïne et la menace d'un regain du trafic
Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Michel Bouchet, chef de la Mission de lutte anti-drogue (MILAD), a précisé que l'héroïne « nous vient à 80 % d'Afghanistan via les républiques d'Asie centrale et la Turquie, pour aboutir en Europe par la route des Balkans, mais aussi par diverses routes qui passent par le nord ». La production se développe en outre en Europe centrale, dans le Caucase et les Balkans, en Chine ou au Vietnam, et des essais ont été effectués en Afrique.
Si toutes les études épidémiologiques font apparaître une régression de la consommation d'héroïne en France et une stabilisation du trafic, la commission a été informée lors de ses auditions d'un possible regain du trafic d'héroïne dans notre pays lié à plusieurs facteurs, explicités notamment par M. Bernard Petit, chef de l'OCRTIS, lors de son audition : « Le risque de regain de consommation et de trafic est présent aujourd'hui, tout simplement, pour être bref, parce que les filières turques, qui sont les principaux fournisseurs de l'héroïne en Europe, sont toujours actives . Elles le sont particulièrement en Allemagne et elles peuvent à tout moment revenir vers nous avec leurs produits. Il faut ajouter que la route des Balkans continue d'être un grand pipe-line pour l'Europe de l'ouest quant à l'acheminement des drogues, dont l'héroïne, et que ce pipe-line peut servir à tout instant. Vous avez enfin l'apparition et la montée en puissance des filières albanaises qui commencent à être polyvalentes , c'est-à-dire qui sont capables de vendre des drogues de synthèse et de la cocaïne, mais aussi, à plus forte raison, de l'héroïne, parce qu'elles sont situées à proximité de la Turquie, un pays qui reçoit de la morphine base, qui fabrique de l'héroïne de grande qualité et qui cherche des voies d'écoulement ».
Un autre élément, lié aux évolutions géopolitiques, peut faire craindre le regain du trafic d'héroïne et réside dans la relance de la culture du pavot en Afghanistan en 2002, après la chute du régime des Talibans. A cet égard, M. Bernard Petit a indiqué devant la commission que « les chiffres (...) font état d'estimations de l'ordre de 2.000 à 3.400 tonnes d'opium disponibles en 2002, ce qui signifie qu'à nouveau le croissant d'or va produire énormément d'héroïne que les trafiquants devront écouler ».
Cette crainte d'une recrudescence du trafic d'héroïne en France a été confirmée à la commission par le chef de la brigade des stupéfiants à la direction de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris, M. Gérard Peuch, selon lequel on trouve toujours autant d'héroïne sur Paris. Selon lui, « sa consommation n'a baissé que pour une raison mécanique : le seul côté positif des Talibans, c'est qu'ils ont fait arracher les plans de pavot. Malheureusement, en ce moment, on replante à tout va dans ce secteur, cela va même dépasser toutes les espérances. Je vous donne rendez-vous d'ici dix-huit mois à deux ans : nous verrons quel sera le profil de l'héroïne en France, d'autant que les réseaux d'importation, qui sont essentiellement aux mains des Turcs et des Kurdes à l'heure actuelle, se battent en Allemagne pour refaire le marché et essaient, bon an mal an, de reconquérir le marché français qu'ils avaient perdu ».
Le rapport pour 2002 de l'OICS confirme cette tendance et indique qu'en 2002, la production d'opium en Afghanistan a retrouvé son niveau du milieu des années 1990 mais reste toutefois en deçà des pics enregistrés en 1999 et 2000. Une enquête préliminaire du PNUCID en février 2002 avait montré que la culture du pavot à opium avait repris en Afghanistan et pourrait s'étendre sur une superficie de 45.000 à 65.000 hectares, ce qui donnerait de 1.900 à 2.700 tonnes d'opium en 2002, chiffre comparable au niveau atteint au milieu des années 1990. D'après les chiffres de l'OICS issus de son rapport pour 2002, ce sont environ 3.400 tonnes d'opium qui auraient été récoltées en 2002 en Afghanistan.
En outre, la contrebande d'opiacés d'origine afghane vers la République islamique d'Iran et le Pakistan, et le trafic de transit par ces pays sont redevenus ce qu'ils étaient avant l'interdiction de la culture du pavot à opium imposée par le régime des Talibans en 2000, comme le montrent les saisies effectuées dans ces pays. Le transit par les pays d'Asie centrale se poursuit, et cet itinéraire demeure l'un des plus importants pour l'acheminement illégal des drogues d'Afghanistan vers la Fédération de Russie et, de là, vers les pays d'Europe orientale et occidentale.
Selon l'OICS, les saisies pratiquées au Tadjikistan indiquent que l'héroïne destinée à être vendue illicitement dans les pays européens est de plus en plus pure, et qu'en Turquie, les autorités continuent de repérer et de démanteler des laboratoires clandestins de fabrication d'héroïne.
L'analyse fournie par l'Office des Nations Unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime (OCDPC) dans son rapport sur les tendances mondiales des drogues illicites en 2002 est toutefois moins alarmiste puisque ce dernier estime que « l'interdiction de la production d'opium décidée en Afghanistan en 2001 et les événements qui se sont produits par la suite dans ce pays font que les marchés mondiaux des opiacés sont aujourd'hui à la croisée des chemins. Bien que les conséquences de la chute de la production en 2001 aient été retardées par l'existence de stocks importants et que la menace de reprise de la production pose de grandes difficultés à l'Autorité intérimaire afghane et à la communauté internationale, plusieurs facteurs créent un terrain favorable à de grandes avancées en matière de contrôle de la production illicite d'opium dans le monde ».
La commission ne peut toutefois que s'interroger sur la pertinence d'une telle vision à moyen terme étant donné les informations relatives à une reprise de la culture du pavot à opium en Afghanistan qu'elle a pu recueillir lors de ses auditions.
S'agissant de la production illicite d'opium en Asie de l'Est et du Sud-Est, celle-ci a continué à diminuer en 2002. Le Myanmar (Birmanie) occupe désormais le deuxième rang mondial pour la production illicite d'opium, derrière l'Afghanistan, sa production ayant en outre été réduite de moitié environ par rapport à 1996.
Enfin, le rapport pour 2002 de l'OICS note que la superficie totale des cultures illicites de pavot à opium en Colombie est la plus vaste qui existe dans un pays non-asiatique. L'héroïne fabriquée en Colombie est pour l'essentiel introduite clandestinement aux Etats-Unis au moyen de passeurs (ou « mules »), bien que le trafic d'héroïne se fasse de plus en plus par mer et suive les mêmes itinéraires que la cocaïne. Selon le gouvernement des Etats-Unis, 60 % environ de l'héroïne saisie dans ce pays provient de la Colombie. Les saisies d'héroïne ont augmenté régulièrement ces dernières années en Colombie, passant de 80 kilogrammes en 1996 à plus de 790 kilogrammes en 2001.
b) Les filières de la cocaïne et la stabilisation de l'offre mondiale
En provenance exclusive d'Amérique du Sud où la production reste le monopole de trois pays andins -la Bolivie, le Pérou et la Colombie- la cocaïne inonde plus largement l'Europe depuis quelques années en raison de la saturation du marché nord-américain.
D'après les indications du rapport pour 2002 de l'OICS, les saisies de cocaïne effectuées en Amérique du Sud représentent plus de 40 % du total mondial. Près de 70 % de ces saisies sont effectuées en Colombie, environ 8 % au Pérou et autant au Venezuela.
En outre, ce rapport indique que les actions menées par les gouvernements bolivien et péruvien pour éradiquer la culture illicite du cocaïer ont été largement couronnées de succès jusqu'en 2000, mais depuis lors les résultats obtenus sont mitigés.
Par ailleurs, selon les données fournies par le Système intégré pour la surveillance des cultures illicites de la Colombie, on a observé dans ce pays en 2001, pour la première fois depuis de nombreuses années, une diminution de la superficie totale consacrée à la culture illicite du cocaïer (de 163.000 hectares en 2000 à 144.000 hectares en 2001). Ce résultat est très important pour la Colombie puisque c'est le pays où a lieu l'essentiel de la production illicite de feuilles de coca et où est fabriquée la plus grande quantité de cocaïne. Toutefois, on a pu observer de manière concomitante la réapparition ou le développement de la production dans d'autres pays, tels la Bolivie ou le Pérou, ainsi que l'Equateur et le Venezuela où des cultures à petite échelle de cocaïers ont été détectées.
En Colombie, la guérilla et les groupes paramilitaires fournissent une protection aux trafiquants de drogues moyennant paiement et parfois même contrôlent le trafic de drogues et les laboratoires de fabrication illicites dans de nombreuses régions. Au Pérou, le gouvernement s'inquiète d'un possible regroupement des groupes rebelles démantelés et du développement de nouveaux contacts avec les narcotrafiquants. Enfin, l'Equateur, le Pérou et le Venezuela s'inquiètent de la possibilité que des groupes rebelles colombiens s'installent sur leur territoire et y importent leurs activités de narcotrafic.
Parallèlement, on a pu observer au cours des dernières années une transformation du trafic de cocaïne : d'une part, les grandes organisations impliquées dans le trafic ont eu tendance à se décentraliser, sous l'effet notamment de la répression à laquelle elles fournissaient des cibles trop facilement identifiables, d'autre part, ces organisations ont eu tendance à se saborder volontairement pour se réorganiser sous d'autres formes. On a ainsi pu assister au démantèlement des grands cartels colombiens, réorganisés sous la forme d'organisations de taille plus réduite, à côté desquelles ont proliféré une multitude de petits entrepreneurs, voire même de structures familiales. Ces transformations ont induit une modification des modalités du trafic international : ainsi, une quantité considérable de petits lots de marchandises, souvent transportés par des passeurs, ou « mules », après ingestion, circule désormais sur le marché.
D'après le rapport pour 2002 de l'OICS, le transit de cocaïne par l'Amérique centrale et les Caraïbes se poursuit, les principaux points de transbordement dans l'arc caribéen se trouvant en République dominicaine, en Haïti et en Jamaïque. Toutefois, si le couloir constitué par l'Amérique centrale et le Mexique demeure essentiel pour le trafic par voie terrestre, le couloir maritime du Pacifique prend de plus en plus d'importance.
Des quantités importantes de cocaïne transitent donc, via la Caraïbe, par l'Espagne et les Pays-Bas. C'est pourquoi, a indiqué M. Michel Bouchet, chef de la MILAD, « le ministère de l'intérieur avec les autres ministères chargés de l'application de la loi (douane et gendarmerie), a entrepris de renforcer son dispositif dans nos départements d'outre-mer, notamment en liaison avec les autorités maritimes, pour le trafic maritime ».
Pour toutes ces raisons, la commission d'enquête a tenu à se rendre à Saint-Martin , commune de la Guadeloupe, où elle a pu rencontrer l'ensemble des acteurs institutionnels impliqués dans la lutte contre le narcotrafic au sein de la zone Caraïbe et prendre conscience du caractère stratégiquement sensible de cette zone en termes de lutte contre le trafic de stupéfiants 24 ( * ) .
|
SITUATION DU NARCOTRAFIC EN COLOMBIE EN 2003 25 ( * ) 1 - Situation générale M. Uribe a été élu au mois de mai dernier Président de la République colombienne. Ce dernier a remporté les élections avec une très large majorité, basant son programme sur une tolérance zéro à l'égard des guérillas ainsi que du narcotrafic. Le levier principal de la politique gouvernementale en matière de lutte contre le narcotrafic repose sur les opérations de fumigations, c'est-à-dire d'éradication des cultures illicites de coca : 129.000 ha de plantations de coca ont été fumigées en 2002, soit une hausse de 42 % par rapport à 2001. Le ministre de la justice, M. Londono, a récemment déclaré que l'Etat colombien envisageait, en 2003, « d'en finir avec le narcotrafic », l'idée étant « d'asphyxier financièrement la guérilla, principal acteur, en augmentant massivement les destructions de champs de coca et d'amapola (pavot). La Colombie conserve le leadership en matière de production, transformation et exportation de stupéfiants, tout particulièrement de cocaïne. La direction de la police antinarcotique estime que le rendement de la feuille de coca est de 1.153 kg par hectare et par récolte. Avec quatre récoltes par an, le potentiel de production est actuellement évalué à 5,8 kg de cocaïne par hectare. En totalisant près de 144.807 hectares semés, plus de 840 tonnes ont été produites durant l'année 2002. Le prix moyen se situe à 1.750 dollars US le kilogramme. 2 - Quantités totales saisies par tous les services colombiens : 380 tonnes, tous produits confondus. La production d'héroïne continue de croître avec pour corollaire une diminution du prix au kilogramme : 17.519 US $ en 1998, 10.833 US $ en 2002, soit une diminution de 38,16 %. Par ailleurs, il semble que les narcotrafiquants diversifient leurs activités. Outre la cocaïne et l'héroïne, ils s'engagent dans la production de substances psychotropes. En effet, un grand laboratoire de fabrication de MDMA (ecstasy) a été démantelé en 1999 et un autre en 2002. Alors que les grands cartels colombiens des années 1990 semblaient avoir vécu, on assiste à l'émergence de petites structures, « cartelitos », très bien organisées, très discrètes, n'investissant plus en Colombie et donc difficiles à démanteler. Leur nombre est évalué à environ 300. Au côté de ces groupes, participent également au narcotrafic les organisations terroristes comme les FARC (Forces armées révolutionnaires colombiennes) et AUC (paramilitaires). Quelques différences dans leur mode de fonctionnement sont à relever : les paramilitaires exportent essentiellement à partir de la côte caraïbe comme la Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta, le golfe d'Uraba ainsi que du sud de la côte pacifique. Au contraire, les groupes terroristes des FARC utilisent les ports des pays voisins comme le Venezuela, le Pérou, l'Equateur, le Surinam et Panama. 3 - Le vecteur maritime reste le moyen de transport privilégié . La diminution du trafic par conteneur, constatée ces dernières années, est une tendance qui se confirme . Celle-ci est largement due à la réussite des programmes de surveillance des ports colombiens parallèlement à la multiplication des accords BASC (Business anti-smuggling coalition), équivalant aux accords DEFIS (partenariat Douane entreprise pour la lutte anti-stupéfiants). Concernant le programme BASC, l'année 2002 a vu une augmentation importante du nombre de sociétés certifiée. Le deuxième congrès BASC mondial qui s'est déroulé à Quito en juillet 2002 a été l'occasion d'affirmer la participation de la direction générale des douanes et droits indirects ainsi que des douanes espagnoles à ce programme. En matière de sécurisation des ports, des efforts importants ont été réalisés. Le programme CSI américain (Initiative pour la sécurisation des conteneurs maritimes) pourrait avoir une incidence directe en matière de contrôle des exportations de marchandises illicites. A ce propos, il faut souligner l'installation à Carthagène, début 2003, de deux douaniers américains ayant les mêmes fonctions que leurs collègues implantés depuis peu au Havre. Pour ces raisons, et comme indiqué ci-dessous, le trafic en dehors des enceintes portuaires reste constant . Le modus operandi « classique », particulièrement sur la côte Caraïbe, demeure l'utilisation d'embarcations légères et surpuissantes de type « Go Fast » . L'exportation à destination des Etats-Unis et de l'Europe se fait essentiellement via une vaste zone de transit qui inclut la mer des Caraïbes, le golfe du Mexique et la région orientale de l'Océan Pacifique . Les services de renseignement estiment que le volume annuel de cocaïne transitant par cette zone dépasse les 900 tonnes . Plus de 90% de ces quantités sont transportées par voie maritime, transport multimodal ou bateaux de pêche et vedettes rapides. A ces derniers modes de transport correspond 80 % du volume précité. Certaines îles comme San Andres ou Providencia, au large des côtes colombiennes, se sont transformées en véritables centres logistiques : stockage de drogues, (enterrée, immergée), fourniture de carburant pour les Go Fast continuant leur route vers l'Amérique centrale, voire le Mexique. Il est à noter la sophistication croissante des moyens utilisés par les narcotrafiquants : motorisations surpuissantes, moyens de communication satellitaires, infiltrations, etc... La zone pacifique présente quelques différences. L'utilisation de vedettes est utilisée également à destination directe des pays d'Amérique centrale, mais surtout pour ravitailler en haute mer des embarcations exerçant une activité licite (pêche, cabotage). Les distances couvertes par les Go Fast en haute mer sont de plus en plus importantes afin d'échapper à la vigilance côtière. Certaines opérations de transbordement ont été détectées au large des îles Galápagos. Quant à la navigation de plaisance, celle-ci est particulièrement réduite en Colombie, ce qui ne permet pas d'éluder ce moyen de transport. Des saisies récentes en Europe sur des voiliers provenant des Antilles attestent de la sensibilité de ce vecteur au sein de la Caraïbe 26 ( * ) . 4 - Le transport terrestre , bien évidemment ne concerne pas le continent européen. Cependant, ce vecteur demeure essentiel dans la mesure où il s'agit d'envois destinés aux pays limitrophes. 5 - S'agissant du transport aérien , plusieurs éléments sont à relever : Tout d'abord une augmentation du nombre de saisies sur voyageurs, quel que soit le mode de dissimulation (in corpore, double fonds). En 2002, 224 passeurs ont été arrêtés à l'aéroport international de Bogota, contre 185 en 2001, soit une augmentation de plus de 20 %. La grande majorité sont des Colombiens (plus de 60 %), ensuite ce sont des Equatoriens (8,5 %) des Espagnols (7,5 %), des Mexicains (5,7 %) et des Italiens (4 %). Une seule personne de nationalité française a été appréhendée. 73 % des passeurs sont des hommes. En France, alors que le volume des saisies douanières de cocaïne est en forte progression ces trois dernières années, les quantités en provenance directe de Colombie (tous vecteurs confondus) sont dérisoires. En 2002 par exemple, la quantité appréhendée (55,9 kg sur un total de 2.581 kg) représente un peu plus de 2 % du volume total saisi. 50,6 kg ont été saisis sur le transport aérien sur cette provenance (soit 90,5 %). Le reste a été saisi sur le vecteur ferroviaire et postal. Le nombre de saisies sur fret réalisées en 2002 a diminué par rapport à 2001, selon la police aéroportuaire, chargée des contrôles à l'exportation à l'aéroport de Bogota. Les quantités saisies (sur passagers et sur fret confondus) en 2002 ont globalement baissé par rapport à 2001. Cette baisse est principalement due à la diminution considérable de la quantité de cocaïne saisie (476 kg de cocaïne en 2002 contre 896 kg en 2001), alors que la quantité d'héroïne saisie a augmenté (115 kg en 2002 contre 91 kg en 2001). Il est à noter la création récente d'une unité de la police fiscale et douanière (POLFA) chargée du ciblage voyageurs, toujours à l'aéroport international El Dorado, Bogota. Cependant, ces services relevant de la direction des douanes et impôts (DIAN) n'exercent leur contrôle qu'à l'importation. A ce titre, les services douaniers américains (US Customs service) ont annoncé (début mars 2003) l'attribution de six appareils à rayons X destinés aux principaux aéroports du pays. |
Enfin, lors de ses auditions, la commission d'enquête a été informée à plusieurs reprises de la stabilité de l'offre mondiale de cocaïne depuis plusieurs années malgré les efforts internationaux de lutte contre la production illicite . En effet, cette stabilisation de l'offre de cocaïne est intervenue, d'après M. Bernard Petit, « malgré les efforts considérables qui ont été faits au plan international et au plan national de chaque pays intéressé, malgré beaucoup d'argent investi, malgré une intervention américaine qui a privilégié des segments armés pour lutter contre les trafics et malgré le fait que la cocaïne, contrairement au cannabis et à l'héroïne, n'est produite que dans trois pays dans le monde : la Colombie, le Pérou et la Bolivie. Malgré tous ces éléments, on n'arrive pas à réduire l'offre de façon suffisamment notable pour que cela altère la disponibilité du produit sur les marchés ».
SURFACES ÉRADIQUÉES DÉCLARÉES EN 1992-2001
(en hectares)
|
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
|
|
Pavot à opium |
||||||||||
|
Afghanistan |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
400 |
121 |
- |
|
Colombie |
12.864 |
9.400 |
5.314 |
5.074 |
7.412 |
7.333 |
3.077 |
8.434 |
9.279 |
2.583 |
|
Mexique |
11.222 |
13.015 |
10.959 |
15.389 |
14.671 |
17.732 |
17.449 |
15.461 |
15.717 |
15.350 |
|
Myanmar |
4.228 |
160 |
1.041 |
3.310 |
1.938 |
3.093 |
3.172 |
9.824 |
1.643 |
9.317 |
|
Pakistan |
977 |
856 |
463 |
- |
867 |
654 |
2.194 |
1.197 |
1.704 |
1.484 |
|
Thaïlande |
2.148 |
1.706 |
1.313 |
580 |
886 |
1.053 |
716 |
808 |
757 |
832 |
|
Vietnam |
3.243 |
- |
672 |
477 |
1.142 |
340 |
439 |
- |
426 |
- |
|
Cocaïer |
||||||||||
|
Bolivie |
5.149 |
2.400 |
1.100 |
5.493 |
7.512 |
7.000 |
11.620 |
15.353 |
7.653 |
9.395 |
|
Colombie |
944 |
946 |
4.904 |
25.402 |
23.025 |
44.123 |
69.155 |
44.157 |
61.574 |
95.898 |
|
Pérou |
5.150 |
- |
240 |
7.512 |
7.512 |
3.462 |
17.800 |
13.800 |
6.200 |
3.900 |
|
Plante du cannabis |
||||||||||
|
Mexique |
16.802 |
16.645 |
14.207 |
21.573 |
22.769 |
23.576 |
23.928 |
33.569 |
31.046 |
33.000 |
Source : OCDPC, Tendances mondiales des drogues illicites 2002
c) Les filières des drogues de synthèse et le développement continu du trafic
Les nouvelles drogues de synthèse, et plus particulièrement l'ecstasy , sont produites essentiellement par les pays du Nord de l'Europe, et plus spécifiquement par les Pays-Bas et par la Belgique, ainsi que par certains pays d'Europe centrale.
Le rapport pour 2002 de l'OICS indique que l'Europe continue à fabriquer illicitement des quantités considérables de drogues de synthèse, en particulier de MDMA (ecstasy), qui sont ensuite distribuées clandestinement non seulement sur le territoire européen, mais aussi dans d'autres régions du monde, surtout en Amérique du Nord et en Océanie et, dans une moindre mesure, en Afrique et dans certaines parties de l'Asie.
M. Bernard Petit, chef de l'OCRTIS, a ainsi noté devant la commission d'enquête que « les pays d'Europe du Nord se sont mis à produire de façon considérable des drogues de synthèse que l'on vend dans les pays du Sud mais aussi sur le continent nord-américain. Cette situation est un problème majeur dans tous les pays d'Europe, et non pas seulement en France ».
Les Pays-Bas, notamment à proximité des frontières belge et allemande, restent l'une des premières sources de MDMA (ecstasy) fabriquée illicitement. Le rapport pour 2002 de l'OICS indique, à ce titre, que si les saisies d'ecstasy ont diminué en 2001 aux Pays-Bas, celles effectuées dans d'autres pays mais pour lesquelles un lien avec les Pays-Bas a pu être établi ont continué d'augmenter de volume.
Il a été également indiqué à la commission d'enquête que la production et le trafic des drogues de synthèse résultaient avant tout d'organisations criminelles internationales très structurées et non pas seulement d'un « trafic de petite rivière », aux mains de personnes sans lien direct avec des réseaux criminels mais investissant les rave parties et autres lieux festifs, considérés comme des lieux traditionnels de consommation d'ecstasy.
M. Bernard Petit a ainsi souligné devant la commission d'enquête : « Ce n'est pas simplement, comme on pourrait le croire à travers les rave parties et les événements dits festifs, un trafic qui est entre les mains de jeunes qui découvrent un produit et qui se le passent de main en main. Il y a, derrière ce phénomène, des réseaux structurés de trafiquants internationaux qui sont généralement implantés dans les pays du Nord de l'Europe, précisément aux Pays-Bas, qui constituent le point d'ancrage pour la fabrication et le grand trafic d'ecstasy, qui opèrent à destination du marché européen (et donc de la France) et qui utilisent notre territoire comme un pays de rebond à destination de deux grandes directions : le continent nord-américain (les Etats-Unis et le Canada) et le Sud de l'Europe, avec l'Espagne qui devient un pays de grande consommation de drogues de synthèse ».
M. Bernard Petit a notamment attiré l'attention de la commission d'enquête sur le danger qu'il y avait à n'aborder la question des nouvelles drogues de synthèse que par le biais de leur usage et notamment de leur lieu de consommation. En effet, si cette consommation a lieu essentiellement au cours de rave parties ou d'événements festifs, sa fabrication est le résultat d'un trafic très organisé et structuré aux mains de filières « notamment asiatiques, israéliennes et d'Europe de l'Est, qui sont très actives et qui sont l'apanage des gens du business de la came, qui n'ont rien à voir avec les usagers, qui font beaucoup d'argent et qui sont les propriétaires des laboratoires ».
De manière plus radicale, M. Xavier Raufer, chargé de cours à l'Institut de criminologie de Paris, a déclaré lors de son audition par la commission d'enquête : « Dans le cas particulier de l'ecstasy, il faut savoir que 70 à 80 % du marché mondial de l'ecstasy sont contrôlés par des criminels israéliens. Le « Pablo Escobar » de l'ecstasy s'appelle Odeth Tuito et c'est un citoyen israélien (...) les policiers israéliens ont les plus grandes difficultés à faire poursuivre ces individus qui, pour l'essentiel, vivent en Californie. Ils sont néanmoins citoyens israéliens et contrôlent le marché mondial de l'ecstasy. Les quelques grandes saisies de plusieurs millions de cachets ont été réalisées à chaque fois, notamment à New York en 2000, après l'arrestation de citoyens israéliens. Les drogues chimiques sont l'un des marchés protégés (...) ce sont des niches ».
La facilité de fabrication de ces drogues de synthèse constitue une réelle difficulté pour les services répressifs, qui a été soulignée par plusieurs responsables auditionnés par la commission d'enquête. Ainsi, M. Didier Jayle, président de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT), a déclaré devant la commission : « Pour les narcotrafiquants, pouvoir mettre en place à Paris, à Clamart, à Londres, à Amsterdam des usines toutes petites fabriquant des drogues de synthèse, et que l'on vend avec une plus-value de l'ordre de facteur 1.000, est un vrai danger ».
La multiplication des kitchen lab , aux Pays-Bas et en Belgique notamment, c'est-à-dire de laboratoires à domicile permettant de fabriquer des quantités non négligeables de drogues de synthèse, et en premier lieu d'ecstasy, constitue, du fait de leur clandestinité et de leur « confidentialité », un obstacle majeur au démantèlement de ces nouvelles filières. Cette caractéristique témoigne de l'atomisation des réseaux, particulièrement marquée s'agissant du trafic des drogues de synthèse.
Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Bernard Petit s'est ainsi inquiété du fait que « le savoir-faire qui nous vient des Pays-Bas s'exporte. Nous avons découvert récemment, à Montpellier, ce qu'on appelle un kitchen lab, un laboratoire de cuisine, avec des jeunes qui ont les produits, les précurseurs chimiques, etc. et qui s'essaient à fabriquer de l'ecstasy. Nous avons coupé l'herbe sous le pied à ces jeunes, mais l'existence de ce petit kitchen lab à Montpellier et d'autres affaires qui vont peut-être arriver prouvent qu'il y a des velléités d'ouvrir des petits laboratoires, ça et là, pour être plus près de la consommation ». Il a en outre ajouté que « d'autres pays vont malheureusement se réveiller avec de petites unités de fabrication (...) en particulier l'Espagne ».
Lors de son déplacement à Valenciennes, dont le compte rendu figure en annexe du présent rapport, la commission d'enquête a été alertée par la plupart des intervenants, et notamment par les représentants belges de la police et de la justice, de la recrudescence de laboratoires clandestins de production de drogues de synthèse, la plupart étant situés le long des frontières entre la Belgique et les Pays-Bas d'une part, entre la Belgique et l'Allemagne d'autre part, un premier laboratoire ayant également été démantelé à la frontière entre la Belgique et la France.
M. Jean-Pierre Cambier, premier substitut du Roi à Tournai, a affirmé que ces laboratoires clandestins le long de la frontière franco-belge étaient appelés à se multiplier du fait de l'intérêt manifesté par le marché français pour ces nouvelles drogues. De même, M. Michel Mathy, commissaire de police au service judiciaire de Mons, a révélé la découverte de six laboratoires clandestins de fabrication d'ecstasy à Anvers en 2001, et de neuf laboratoires au même endroit en 2002.
Au cours de son déplacement à Valenciennes, la commission d'enquête a donc pu mesurer l'ampleur des difficultés rencontrées par les services répressifs du département du Nord, dues à la situation géographique transfrontalière particulière de ce département, et un fâcheux voisinage avec les principaux producteurs de drogues de synthèse dans le monde.
d) Le trafic international de cannabis
D'après le rapport pour 2002 de l'OICS, le cannabis continue d'être cultivé illicitement à grande échelle dans de nombreux pays africains, ce qui s'explique en partie par les prix peu élevés offerts pour les produits agricoles traditionnels. Les superficies illicitement cultivées s'étendent dans les pays ou les régions touchés par la guerre civile ou les conflits armés. Environ un quart des saisies mondiales de résines et de feuilles de cannabis sont effectuées en Afrique et, d'après les chiffres de l'OICS, 60 à 70 % de la résine de cannabis saisie en Europe proviendraient du Maroc.
Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Bernard Petit, chef de l'OCRTIS, a déclaré : « L'honnêteté me pousse à dire que 85 %, voire 90 % de la résine de cannabis interceptée dans tous les pays d'Europe provient du Maroc. C'est le Maroc qui est le grand producteur de résine de cannabis pour toute l'Europe. Cela représente environ 2.000 tonnes de résine produite au Maroc -certains vont jusqu'à 3.000 tonnes- et les autorités marocaines n'en reconnaissent que 1.750. C'est énorme. On en saisit environ 600 à 700 tonnes en Europe et 1.000 tonnes s'évaporent donc et passent à travers tous les filtres. Effectivement, le Maroc est un problème au regard du trafic de résine de cannabis 27 ( * ) ».
Le cannabis marocain est acheminé principalement par l'Espagne et, dans une moindre mesure, par le Portugal et la France, à destination de divers pays européens. Certaines filières passeraient aussi par l'Algérie et la Tunisie ou y aboutiraient.
S'agissant des autres zones de culture illicite de cannabis, le rapport pour 2002 de l'OICS mentionne également les pays d'Amérique centrale et des Caraïbes où il est essentiellement destiné à la consommation locale, de même que le cannabis produit en Amérique du Sud. Tous les pays d'Amérique du Sud ont signalé des saisies de cannabis qui représentent un total d'environ 8 % de l'ensemble des saisies de feuilles de cannabis effectuées dans le monde. En outre, le cannabis produit en Colombie est introduit clandestinement aux Etats-Unis. Enfin, s'agissant du continent asiatique, le rapport pour 2002 de l'OICS mentionne notamment l'ampleur considérable de la culture illicite du cannabis en Afghanistan et au Pakistan où ce produit « pousse à l'état sauvage ». La résine de cannabis continue ainsi d'être acheminée clandestinement de ces deux Etats vers d'autres pays d'Asie occidentale et vers l'Europe.
Enfin, le rapport pour 2002 de l'OICS révèle également que le cannabis continue d'être cultivé illicitement à une grande échelle dans toute l'Europe et que cette culture est en progression sensible dans les Etats membres de l'Union européenne, ce qui pourrait être lié aux politiques que certains Etats ont adoptées et qui témoignent d'une indulgence discutable à l'égard de la détention de cannabis.
Dans la pratique, on distingue trois niveaux de trafic international de résine de cannabis :
- un niveau bas , pour lequel le trafic est entre les mains d'usagers/revendeurs ou de petits trafiquants locaux, portant sur des quantités relativement modestes (10 à 100 kilogrammes) dissimulées dans des véhicules de tourisme pour franchir les frontières marocaine, espagnole et française ;
- le grand trafic international ayant lieu presque exclusivement par le biais des transports routiers internationaux, en provenance du Maroc et d'Espagne et étant le fait de réseaux structurés et organisés. Ces trafiquants profitent des flux licites de marchandises pour importer en Europe des quantités très importantes (de 500 kilogrammes à plusieurs dizaines de tonnes) en un seul passage. Pour ce type de trafic, la France n'est souvent qu'un pays de transit, ces grandes quantités étant destinées aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni, où le haschisch est souvent reconditionné sous des quantités plus petites pour être réexpédié en France ;
- le trafic intermédiaire , sans doute le plus déstabilisant sur le plan économique et social, qui est apparu en France depuis environ trois ans, et qui est le fait de différents groupes de délinquants qui importent, régulièrement, d'importantes quantités de cannabis d'Espagne en France selon le mode opératoire des « go fast ».
|
LA TECHNIQUE RÉCENTE DES « GO FAST » Les « go fast » sont des véhicules sur-motorisés, souvent volés et faussement immatriculés, avec lesquels les trafiquants se rendent en Espagne pour prendre possession de très grandes quantités de cannabis (400 à 800 kilogrammes remontés en une fois) qu'ils achètent auprès de trafiquants internationaux basés dans la région de Marbella, avec la complicité d'une communauté française établie dans cette région. Le cannabis est ensuite acheminé vers la France, toujours de la même façon : plusieurs véhicules, trois à cinq voitures, roulant en convoi selon une formation pré-établie, à grande ou très grande vitesse (souvent plus de 200 km/h), de nuit, avec une liaison téléphonique permanente, empruntant l'autoroute à partir de la frontière espagnole jusqu'aux abords des villes françaises où la marchandise est finalement livrée, avec une ou deux voitures « ouvreuses » en tête de convoi pour détecter d'éventuels barrages ou contrôles, un ou deux véhicules « porteurs » et une voiture « balai » pour fermer la route, éviter une remontée du convoi par la police et servir de véhicules de secours en cas de difficultés. Lors de son audition devant la commission d'enquête, M. Nicolas Sarkozy , ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, a détaillé cette nouvelle méthode des go fast : « La technique est la suivante : ils volent des véhicules de grosses cylindrées (Audi, BMW, Mercedes). Ils sont lourdement armés. Ils traversent l'Espagne et la France à toute allure, avec des véhicules de reconnaissance qui se prépositionnent aux péages pour repérer si la voie est libre, pied au plancher, malheur à celui qui se trouve sur leur route. Voilà la réalité devant laquelle nous nous trouvons. Ce sont des jeunes pour qui la violence est sans limite et pour qui la vie des autres n'a aucun sens. Lors d'une des dernières prises, je crois qu'ils ont trouvé 180 kilos de drogue dans la voiture. Une partie des trafiquants a été arrêtée, les autres se sont enfuis. Les interpellations sont extrêmement à haut risque pour les fonctionnaires ou les militaires, mais aussi pour ceux se trouvant autour. C'est un phénomène que nous connaissons, hélas. Je ne suis pas venu le nier, bien au contraire, je vous le confirme ». La prise de risque est maximale lors de la remontée de la marchandise et parfaitement intégrée par les malfaiteurs. M. Bernard Petit, chef de l'OCRTIS, analysait ainsi le phénomène des go fast lors de son audition par la commission d'enquête : « A la différence du trafic de niveau bas ou du grand trafic, dans lequel on utilise la ruse et la dissimulation pour importer les produits, il n'y a aucune dissimulation : la marchandise est livrée en vrac dans le coffre, sur les banquettes arrière de voitures et parfois même sur le siège avant du passager (...) cela veut dire que, par avance, ces organisations acceptent les confrontations avec les gendarmes et les douaniers qui peuvent faire des barrages au hasard sur l'autoroute. C'est accepté et pris en compte. Il s'agit donc de remontées de résine de cannabis qui se font à « force ouverte », sans dissimulation, ni ruse. On prend le risque et on l'intègre dans la technique ». |
Ce trafic intermédiaire se situe donc entre le trafic international et de ce qui peut être qualifié de trafic local ou « de proximité », dont l'émergence en France a coïncidé avec le développement d'une économie souterraine dans les quartiers péri-urbains, particulièrement déstabilisatrice pour la société française.
2. Le trafic en France : un trafic de passage et de proximité
Les grandes filières internationales alimentent un trafic national de passage, puisque la France occupe une position géographique centrale en Europe, qui lui confère un rôle de pays de transit pour le trafic de stupéfiants.
Toutefois, la commission d'enquête a également pu constater que se développe de plus en plus en France un trafic exclusivement national que l'on pourrait qualifier de trafic local de proximité, souvent lié à la grande criminalité française, portant essentiellement sur la résine de cannabis.
La commission a également été informée par plusieurs de ses interlocuteurs de la résurgence sur le territoire national de l'implantation de réseaux dits internationaux, dans la droite ligne de la French connection des années 1970.
On notera enfin la situation tout à fait particulière des Antilles françaises qui, au sein de la zone Caraïbe, occupent une position géographique stratégique en termes de trafic de stupéfiants. La commission d'enquête a pu mesurer l'ampleur du problème lors de son déplacement à Saint-Martin.
a) La France, lieu de passage ou lieu de destination du trafic de stupéfiants en Europe ?
Comme la France est un pays de transit, les statistiques de saisies de drogues réalisées sur notre territoire par les différents services répressifs témoignent de l'existence d'un trafic « national » de stupéfiants, à la fois trafic de passage, à destination d'autres pays, et trafic destiné à la consommation locale.
Les statistiques fournies à la commission d'enquête par la direction générale des douanes et des droits indirects d'une part, par la direction générale de la police nationale et la direction générale de la police judiciaire d'autre part, permettent de déterminer quelle est la part des quantités saisies destinées au marché intérieur, et celle destinée au trafic extérieur. Elles permettent en outre de déterminer les grandes tendances d'évolution du trafic de stupéfiants en France au cours des dix dernières années.
(1) Les produits dont les saisies en France sont les plus significatives et les principaux facteurs d'évolution de ces saisies
Les produits dont les saisies en France sont les plus significatives sont l'héroïne, la cocaïne, la résine de cannabis et l'ecstasy.
Les saisies douanières d'héroïne fluctuent depuis 1993, évoluant en dents de scie entre 1993 et 1996, oscillant entre 233 kg et 325,5 kg, le pic étant atteint en 1994. Elles connaissent une courbe descendante à partir de 1997 jusqu'en 1999 où elles sont à leur plus bas niveau. En 2000, après quatre années de réduction continue, elles connaissent un nouveau pic (318,4 kg) puis enregistrent à nouveau une baisse notable en 2001 pour se stabiliser en 2002 (178,8 kg). Toutefois, il faut noter qu'au cours des trois dernières années, le nombre de saisies d'héroïne suit une courbe ascendante .
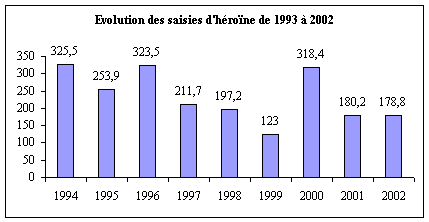
A l'instar de l'héroïne, les quantités de cocaïne saisies par les douanes sont fluctuantes. Elles évoluent en dents de scie de 1993 à 1997. Après deux baisses successives en 1997 (695,9 kg) et 1998, année où le montant saisi est le plus faible (624,8 kg), elles connaissent une courbe ascendante pour atteindre un niveau record en 2002 (2.580,8 kg). Si en 2001, cette forte hausse est essentiellement due à la réalisation d'une saisie exceptionnelle de 1.194 kg opérée à Brest en décembre de cette même année, en 2002, elle résulte non seulement de la saisie d'envergure portant sur 946 kg réalisée à Lorient en décembre 2002, mais également d'une recrudescence générale des saisies, tant en métropole que dans les départements français d'Amérique. Ainsi, au cours des trois dernières années, le nombre de saisies ainsi que le volume appréhendé sont en constante progression. La recrudescence des saisies destinées à l'Europe ces dernières années laisse donc craindre un début de banalisation de ce type de drogue .
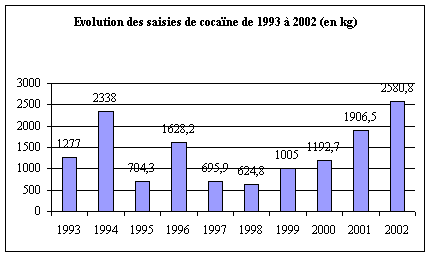
De 1993 à 2002, les saisies douanières de résine de cannabis se sont maintenues à un niveau élevé. Le volume moyen des saisies réalisées au cours de cette période est de 40 tonnes. Le volume le plus bas a été enregistré en 1996 (29,9 t) et le plus élevé en 1999 (54,9 t). Au cours des trois dernières années, c'est en 2001 que le nombre de saisies ainsi que le volume intercepté étaient les plus élevés. En 2002, si le volume saisi est en recul de 13,6 % par rapport à 2001, il dépasse de 4,5 % celui de 2000. En ce qui concerne le nombre de saisies, le chiffre de 2002 a été plus faible que celui de 2000 et 2001.
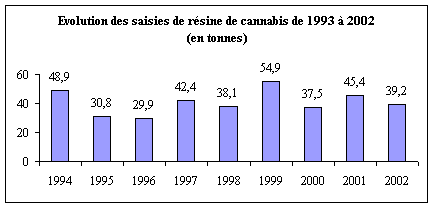
Enfin, s'agissant des saisies douanières annuelles d'ecstasy , elles restent à un niveau relativement bas de 1993 à 1997, entre 120.000 et 200.000 comprimés. Une augmentation spectaculaire intervient à partir de 1998, lorsque les quantités appréhendées passent le cap du million de comprimés grâce à la réalisation de quatre saisies de plus de 50.000 doses. L'explosion des saisies à partir de 1998 semble traduire le développement de la consommation de ce produit, notamment auprès des jeunes. En 2002, le volume saisi est en hausse de 47,2 % par rapport à 2001. On dénombre dix saisies de plus de 50.000 doses dont quatre de plus de 100.000, les deux plus importantes ayant été respectivement de 300.117 et 210.710 doses.
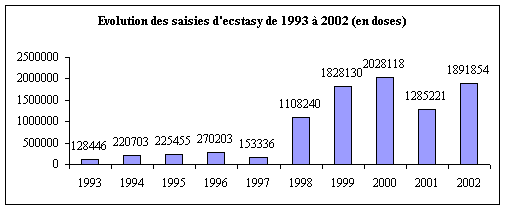
S'agissant des saisies multi-produits , si l'on raisonne en nombre de saisies elles sont majoritaires, mais elles ne représentent qu'une part marginale des quantités interceptées par les douanes. En effet, les saisies portant sur des quantités significatives de cocaïne sur le vecteur aérien et maritime d'ecstasy, d'herbe ou de résine de cannabis portent généralement sur un seul produit.
Les saisies multi-produits concernent essentiellement des affaires réalisées sur les personnes pratiquant le « tourisme de la drogue » aux frontières franco-belge et franco-suisse, en provenance des pays où sont implantés les réseaux de stockage et de distribution à l'intérieur de l'Union européenne (Pays-Bas notamment) et qui sont trouvées en possession de petites ou moyennes quantités de plusieurs produits . On note cependant ces dernières années quelques saisies multi-produits (ecstasy, résine de cannabis, amphétamines notamment) portant sur des quantités importantes sur la façade Manche/Mer du Nord, à destination de la Grande-Bretagne .
(2) La France n'est pas qu'un lieu de passage du trafic international de stupéfiants
Etant un pays de transit et situé dans une position géographique stratégique en termes de circulation du trafic de stupéfiants en Europe, il est légitime de se poser la question de savoir si les saisies réalisées sur le territoire français sont majoritairement destinées au marché extérieur ou bien à la consommation nationale.
Les statistiques fournies à la commission d'enquête par la direction générale des douanes et des droits indirects permettent d'établir que la France occupe une position double en Europe, à la fois lieu de passage et lieu de destination finale du trafic international. En outre, il est possible de distinguer ces deux cas de figure en fonction des produits saisis, mais aussi en fonction des années considérées.
S'agissant de l'héroïne , on remarque ainsi que la part de ce produit saisi destinée au marché intérieur est significative, comparativement aux autres drogues saisies. Par exemple en 1997, la part de l'héroïne destinée à la consommation intérieure représentait plus de 60 % de l'héroïne saisie en France ; en 2002, elle représentait près de 39 % de la quantité totale saisie. La France arrivait en outre en tête des principaux pays destinataires de l'héroïne saisie sur son territoire en 1993, 1994, 1997, 1999 et 2002. Les autres principaux pays de destination sont le Royaume-Uni, en tête des pays destinataires en 1996, 1998, 2000 et 2001, l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, l'Italie et l'Allemagne, et de manière plus marginale, les Etats-Unis et certains pays d'Afrique de l'ouest.
S'agissant de la cocaïne , la part du produit saisi destinée au marché intérieur est minoritaire même si la France arrive au premier rang des principaux pays de destination de la cocaïne saisie sur son territoire en 1995, 1997 et 2000 et en deuxième position en 1994, 1998, 1999, 2001 et 2002. Les autres principaux pays destinataires de la cocaïne saisie sur le territoire national sont l'Italie, les Pays-Bas, premier pays destinataire en 2001 et 2002, et les Etats-Unis. Sont également classés parmi les cinq principaux pays destinataires l'Espagne et le Royaume-Uni.
La part de résine de cannabis saisie en France et destinée au marché intérieur est assez faible depuis 1997 et n'atteint que 4,6 % de la quantité totale saisie en 2002. Depuis 2000, le Royaume-Uni est le principal pays destinataire de la résine de cannabis saisie en France, les autres principaux pays concernés étant les Pays-Bas, l'Italie, la Belgique et l'Allemagne. La France était toutefois le principal pays destinataire de la marchandise saisie sur son territoire en 1993 et en 1995.
Enfin, s'agissant des saisies d'ecstasy , la part de l'ecstasy destinée au marché intérieur reste minoritaire même si la France figure toujours depuis 1993 parmi les cinq principaux destinataires de la marchandise saisie. En 1995, 1997 et 2001, la part d'ecstasy saisie en France et destinée au marché intérieur représentait plus de 20 % du total des saisies de ce produit réalisées sur le territoire national. La France n'a jamais été classée au premier rang des pays destinataires de l'ecstasy saisie sur son territoire mais est arrivée en seconde position en 1994, 1995, 1997 et 2001. Les autres principaux pays destinataires sont notamment le Royaume-Uni, premier pays destinataire en 1994, 1997, 1998, 1999 et 2000, l'Espagne, premier pays destinataire en 1993, 1995, 1996, 2001 et 2002, l'Italie, le Portugal mais aussi les Etats-Unis, deuxième pays destinataire de la marchandise saisie en France en 1998, 1999 et 2002.
LES PRINCIPAUX PAYS DE DESTINATION CONNUS DE L'HÉROÏNE SAISIE
(quantités en kg)
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
France 129,6 |
France 169,2 |
Espagne 132,4 |
Royaume-Uni 108,7 |
France 130,1 |
Royaume-Uni 91,5 |
France 46,8 |
Royaume-Uni 126,6 |
Royaume-Uni 67,4 |
France 69,2 |
|
Royaume-Uni 61,1 |
Espagne 74,5 |
France 96,6 |
France 94,6 |
Espagne 30 |
France 50,8 |
Espagne 43 |
Espagne 89,6 |
Espagne 47,1 |
Portugal 36,9 |
|
Espagne 29,8 |
Royaume-Uni 32,2 |
Portugal 15,5 |
Portugal 50,7 |
Royaume-Uni 28,2 |
Espagne 36,3 |
Allemagne 9,4 |
France 72,5 |
France 43,7 |
Espagne 26,1 |
|
Nigéria 4 |
Portugal 20,4 |
Pays-Bas 4,9 |
Espagne 40,8 |
Etats-Unis 7,9 |
Danemark 6,3 |
Cameroun 5,9 |
Pays-Bas 18,7 |
Italie 14,1 |
Italie 20,3 |
|
Portugal 3,6 |
Nigéria 10,5 |
Italie 2,5 |
Allemagne 6,9 |
Bénin 6,4 |
Italie 2,4 |
Italie 4,9 |
Autriche 4,2 |
Portugal 3,6 |
Royaume-Uni 20,1 |
LES PRINCIPAUX PAYS DE DESTINATION CONNUS DE LA COCAÏNE SAISIE
(quantités en kg)
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Italie 507,1 |
Italie 1276,5 |
France métropolitaine 199,5 |
Etats-Unis 1160 |
France métropolitaine 174 |
Italie 233,8 |
Italie 326,5 |
France métropolitaine 255,4 |
Pays-Bas 1234,8 |
Pays-Bas 1101,8 |
|
Guadeloupe 206,7 |
France métropolitaine 462,2 |
Sierra Léone 155,5 |
Pays-Bas 115,5 |
Italie 81,8 |
France métropolitaine 86,6 |
France métropolitaine 141,4 |
Royaume-Uni 160,6 |
France métropolitaine 215,1 |
France métropolitaine 341,5 |
|
France métropolitaine 159,5 |
Etats-Unis 276 |
Espagne 85,6 |
France métropolitaine 89,7 |
Pays-Bas 81,5 |
Allemagne 83,3 |
Guyane 87,2 |
Italie 126,1 |
Italie 160,7 |
Italie 332,4 |
|
Maroc 143,6 |
Pays-Bas 89 |
Pays-Bas 79 |
Italie 73,1 |
Espagne 61,9 |
Royaume-Uni 71,5 |
Royaume-Uni 78 |
Pays-Bas 125,9 |
Espagne 74,6 |
Royaume-Uni 298,8 |
|
Guyane 63,8 |
Espagne 59,6 |
Italie 72,3 |
Espagne 60,4 |
Royaume-Uni 55,6 |
Espagne 28,7 |
Côte d'Ivoire 70,3 |
Côte d'Ivoire 54,7 |
Allemagne 28,4 |
Espagne 205,6 |
LES PRINCIPAUX PAYS DE DESTINATION CONNUS DE LA RÉSINE DE CANNABIS SAISIE (quantités en tonnes)
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
France 13,2 |
Pays-Bas 14,4 |
France 11,6 |
Italie 6,3 |
Pays-Bas 11 |
Pays-Bas 15,4 |
Pologne 23 |
Royaume-Uni 16 |
Royaume-Uni 16 |
Royaume-Uni 19,3 |
|
Pays-Bas 11,2 |
Australie 9,6 |
Pays-Bas 9 |
Pays-Bas 6,3 |
Royaume-Uni 8,5 |
Royaume-Uni 5,9 |
Pays-Bas 11 |
Pays-Bas 8,6 |
France 7,2 |
Pays-Bas 7 |
|
Royaume-Uni 4,8 |
France 8,8 |
Italie 2,7 |
France 5,9 |
France 6 |
Italie 5,5 |
France 7,6 |
France 6,1 |
Italie 6,4 |
Italie 4,9 |
|
Belgique 3,4 |
Belgique 6,9 |
Royaume-Uni 2,6 |
Royaume-Uni 5 |
Italie 4,8 |
France 4 |
Royaume-Uni 5,7 |
Italie 5,9 |
Pays-Bas 5 |
France 1,8 |
|
Canada 2,2 |
Royaume-Uni 3,4 |
Belgique 2,6 |
Allemagne 3,5 |
Belgique 3,5 |
Belgique 3,1 |
Italie 4,6 |
Allemagne 1,4 |
Belgique 4,5 |
Allemagne 1,7 |
LES PRINCIPAUX PAYS DE DESTINATION CONNUS DE L'ECSTASY
SAISIE
(quantités exprimées en comprimés)
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
|
Espagne 53.474 |
Royaume-Uni 74.515 |
Espagne 82.297 |
Espagne 104.569 |
Royaume-Uni 66.674 |
|
Royaume-Uni 37.954 |
France 70.368 |
France 64.417 |
Royaume-Uni 62.370 |
France 40.134 |
|
Italie 27.771 |
Espagne 33.908 |
Royaume-Uni 37.802 |
France 20.879 |
Espagne 30.913 |
|
France 5.539 |
Italie 31.412 |
Italie 28.376 |
Italie 17.335 |
Italie 6.679 |
|
Irlande 1.849 |
Portugal 3.430 |
Portugal 3.430 |
Portugal 13.987 |
Malaisie 5.035 |
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Royaume-Uni 939.872 |
Royaume-Uni 1.083.893 |
Royaume-Uni 1.115.042 |
Espagne 724.187 |
Espagne 556.741 |
|
Etats-Unis 71.391 |
Etats-Unis 195.983 |
Espagne 458.592 |
France 284.130 |
Etats-Unis 449.465 |
|
Espagne 58.649 |
Irlande 186.124 |
Thaïlande 115.210 |
Royaume-Uni 95.574 |
Saint-Martin (NL) 312.675 |
|
France 20.583 |
Espagne 129.813 |
France 116.340 |
Portugal 44.621 |
France 222.110 |
|
Italie 15.642 |
France 102.885 |
Canada 96.763 |
Maroc 42.301 |
Royaume-Uni 184.752 |
Source : DGDDI
Les statistiques douanières permettent également de distinguer la part du trafic intra-communautaire et du trafic extra-communautaire . Là encore, les données varient d'un produit à l'autre. Ainsi, s'agissant de l'héroïne, de la résine de cannabis et de l'ecstasy, c'est le trafic intra-communautaire qui est très largement majoritaire, avec toutefois une évolution notable pour l'ecstasy en 2002 où la part du trafic intra-communautaire et du trafic extra-communautaire est quasi équivalente ; en revanche, s'agissant de la cocaïne, c'est le trafic extra-communautaire qui est très largement majoritaire.
Contrairement à certaines idées reçues, en raison de sa situation géographique, la France n'est pas qu'un pays de transit du trafic international de stupéfiants en Europe . Certes, ce rôle lui est en partie dévolu puisque nombre de saisies réalisées sur le territoire national étaient en réalité destinées à la consommation de ses principaux voisins européens, mais dans un nombre non négligeable de cas, la France reste le principal pays destinataire de la marchandise saisie sur son territoire.
En outre, lorsque l'on met en relation les chiffres relatifs aux principaux pays destinataires de la drogue saisie et ceux relatifs à la provenance des produits saisis, on constate que la France se situe bien à un carrefour du trafic de drogues en Europe et qu'un renforcement de la coopération communautaire en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants est aujourd'hui indispensable. A ce titre, par exemple, l'héroïne et l'ecstasy saisies sur le territoire national proviennent en priorité et quasi exclusivement des Pays-Bas. Un approfondissement de notre coopération avec les Pays-Bas en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants s'impose aujourd'hui avec évidence.
b) La résurgence des réseaux dits internationaux implantés sur notre territoire
Encore marginal, ce phénomène inquiétant a été évoqué à plusieurs reprises devant la commission d'enquête.
M. Gérard Peuch, commissaire divisionnaire, chef de la brigade des stupéfiants à la direction de la police judiciaire de la préfecture de police, a ainsi expliqué à la commission d'enquête qu'il était possible de distinguer quatre types de réseaux sur Paris, parmi lesquels il a cité, en premier lieu, les réseaux dits internationaux , « essentiellement à structure mafieuse, qui sont redoutables, puissants et riches et qui ont des ramifications dans toute l'Europe. C'est le prototype des cartels de Medelin, c'est-à-dire des réseaux colombiens, boliviens et péruviens. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle ces réseaux font une offensive énorme sur la France, nous en avons des exemples tous les jours. Je vous rappelle qu'au mois de novembre dernier, nous avons, à notre grand étonnement, démantelé un laboratoire de fabrication de cocaïne en plein Paris, dans le 13 e arrondissement . Depuis la French connection des années 70, cela ne nous était pas encore arrivé. Je ne vous cache pas que, dans un certain sens, nous étions très fiers de notre victoire mais je vous avoue aussi que, depuis, je me pose énormément de questions. Certes, nous en avons trouvé un, mais était-ce le seul ? ».
De même, M. Bernard Petit, chef de l'OCRTIS, a expliqué à la commission d'enquête que le trafic de cocaïne faisait aujourd'hui en France l'objet d'un intérêt particulier de la part de puissantes organisations criminelles appartenant au grand banditisme français : « Nous avons, ça et là, des enquêtes qui démontrent très clairement que des gens qui appartiennent au grand banditisme et qui ont donc des activités traditionnelles dans le monde de la criminalité (proxénétisme, jeu clandestin, contrefaçon de documents, trafics de voitures, etc.) sont hautement intéressés par le trafic de cocaïne dans notre pays et investissent des sommes importantes pour importer de grands lots de cocaïne qu'ils revendent en France et dans les pays étrangers (...) on parle de centaines de kilo et même de tonnes et non pas de petites importations de 400 ou 500 grammes aux aéroports. Nous en sommes à ce stade et nous avons en face de nous des organisations criminelles qui sont les nôtres : celles du banditisme français ».
c) Le développement d'un trafic local dans certaines cités
Parallèlement au grand trafic international de cannabis, on a pu observer l'émergence de réseaux qui n'étaient pas liés, du moins au départ, à la criminalité organisée. Il s'agit le plus souvent d'entreprises « familiales », issues des cités, qui vont se fournir dans leur pays d'origine, d'où elles ramènent quelques dizaines à quelques centaines de kilogrammes.
Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, a ainsi indiqué que « les notions familiales jouent beaucoup maintenant. Nous imaginons le trafic international, mais cela ne se passe pas ainsi, il y a le grossiste international qui fournit et de véritables entreprises familiales où toute la famille est concernée, dans des immeubles passés en coupe réglée ». Ces entreprises familiales distribuent en gros sur une zone ou une cité et sont donc très liées aux milieux de distribution locaux. En outre, ce type de réseaux est plus enclin à fournir d'autres drogues dans la mesure où il est plus proche de la demande.
Lors de son audition, M. Nicolas Sarkozy a également mis en évidence l'imbrication des différents types de trafics locaux, en soulignant que « tout cela est un marché et il n'est pas vrai que celui qui peut se fournir en cannabis et qui en fournit n'est pas capable de fournir autre chose. (...) Nous nous apercevons que les revendeurs sont comme les représentants, avec des cartes multiples, ils ont toutes les formes de produit ».
Parallèlement au phénomène de polyconsommation constaté par la commission d'enquête, se développe donc un phénomène de « polytrafics » gérés par des filières très bien implantées localement.
La commission d'enquête a constaté en outre que ces filières locales de trafic de cannabis avaient de plus en plus recours à des méthodes dignes du grand banditisme et que, d'entreprises familiales à l'origine, elles s'étaient souvent muées en organisations criminelles structurées et particulièrement violentes, gérant tout un pan de l'économie parallèle dans nos cités.
Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Dominique Perben, ministre de la justice, a insisté sur le fait qu'il n'existait plus « d'étanchéité entre les réseaux de grande criminalité et les systèmes d'économie souterraine qui génèrent la petite délinquance. C'est parce qu'on a de grandes organisations criminelles que l'on constate aussi le développement d'une petite délinquance, en particulier par la drogue ».
Le développement de l'économie souterraine dans les cités repose très largement sur le trafic de cannabis et l'on assiste à une véritable collusion entre les milieux du grand banditisme et les trafiquants locaux implantés dans les quartiers. A ce titre, M. Michel Bouchet, chef de la MILAD, a souligné lors de son audition que « les petits dealers des cités vont directement au contact de ce grand banditisme pour obtenir des quantités très importantes qu'ils remontent directement dans la cité » selon la technique, déjà évoquée, et aujourd'hui largement éprouvée, des go fast .
M. Bernard Petit, chef de l'OCRTIS, a été encore plus alarmiste devant la commission en affirmant que « les groupes qui réussissent dans ce trafic sont des groupes émergeants, de nouveaux malfaiteurs, violents, actifs et très organisés, qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont certainement le noyau dur de la criminalité de demain . Ils feront partie, demain, de ce que l'on appelle le grand banditisme français (...) cette forme de trafic est celle qui contribue le plus à l'économie souterraine des cités . Ce sont eux qui alimentent les cités en flux tendu et cela part ensuite dans les petits réseaux, le deal de quartier et les semi-grossistes, jusqu'à aboutir aux ventes de barrettes dans les cages d'escaliers ».
La commission d'enquête a en outre eu l'occasion de prendre la mesure de la manne financière que représente le développement de ce trafic « péri-urbain » de cannabis. M. Yves Bot, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, a ainsi révélé lors de son audition que le trafic de cannabis pouvait, dans un quartier d'une ville de la région parisienne, générer en quelques mois des profits qui se calculent en centaine de milliers d'euros.
Dans le même sens, M. Gérard Peuch, chef de la brigade des stupéfiants à la direction de la police judiciaire de la préfecture de police, a fustigé devant la commission « ces réseaux animés par les petits truands ou les petits caïds de banlieue qui sont certainement les grands truands de demain, car ils sont en train de se former à la délinquance. Ils sont surtout en train de se remplir les poches d'une façon épouvantable, parce qu'il faut savoir qu'un beau réseau de cannabis représente un bénéfice moyen d'environ 1.500 euros le kilogramme une fois tous les frais déduits. Quand vous savez que certains de ces réseaux font une importation moyenne de 500 à 600 kilogrammes par semaine, vous pouvez imaginer les sommes que cela représente. Sachez que Paris et la petite couronne, à l'heure actuelle, consomment 2,5 tonnes de résine de cannabis par semaine ! ».
|
DEUX EXEMPLES DE DÉMANTÈLEMENT DE
RÉSEAUX LOCAUX
1 - Le démantèlement d'un réseau de trafic de cannabis à Colombes en février 2003 Cet exemple récent est connu car il a été particulièrement médiatisé. Il a été évoqué devant la commission d'enquête par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, M. Nicolas Sarkozy. En février 2003, le GIR 92 est parvenu à démanteler un réseau local de trafic de cannabis dans la cité des Grèves de Colombes. L'enquête en cours depuis juin 2002 a trouvé une issue grâce notamment au travail fourni par l'inspecteur général des impôts du GIR, ce qui souligne l'indispensable présence d'un agent du fisc au sein des GIR. L'opération d'interpellation des membres du réseau de Colombes a mobilisé 300 hommes et permis de saisir quatre litres d'huile de cannabis (22.000 euros l'unité), vingt kilogrammes de résine de cannabis, 40.000 euros en espèce, quatre kilogrammes de bijoux en or et 150.000 euros en numéraire bloqués sur des comptes bancaires. Ce réseau alimentait une centaine de clients par jour, à qui étaient vendus entre dix et quinze kilos de cannabis vendus quotidiennement pour un bénéfice estimé à 4.500 euros. Chaque mois des dizaines de milliers d'euros étaient déposés en liquide sur des comptes courants, complétés par des Codevi et des PEL. L'enquête ouverte notamment pour « blanchiment », doit tenter d'établir le patrimoine complet de ces trafiquants et le détail des circuits financiers utilisés. A propos de l'interpellation des trafiquants de Colombes, M. Yves Bot, Procureur de la République près le TGI de Paris, a déclaré devant la commission d'enquête : « Cette intervention policière et judiciaire a permis de mettre en lumière le fait que les responsables de ce deal étaient titulaires de sommes extrêmement importantes, et propriétaires de biens immobiliers relativement conséquents, sachant que le plus fortuné d'entre eux avait un âge qui ne devait pas dépasser (...) 25 ans ». Il a estimé que ces trafics étaient « enkystés dans un urbanisme qui devient, pour les trafiquants, une véritable forteresse, que les forces de police et de gendarmerie ont toutes les peines du monde à investir ». 2 - Le démantèlement d'un réseau local de trafic de cannabis dans une cité d'urgence du Val-de-Marne Cet exemple a été évoqué devant la commission d'enquête par M. Gérard Peuch, chef de la brigade de stupéfiants à la direction de la police judiciaire de la préfecture de police, afin d'illustrer le type de mouvements financiers que peut générer un tel trafic. Il s'agissait en l'espèce d'un réseau constitué de cinq individus, âgés de 18 à 23 ans, habitant dans une cité d'urgence du Val-de-Marne. Lors de leur interpellation, ils se trouvaient à bord d'une voiture convoi contenant 480 kilogrammes de résine de cannabis. M. Gérard Peuch a précisé devant la commission la nature des découvertes réalisées par la brigade des stupéfiants au cours des perquisitions effectuées aux domiciles de ces trafiquants : « Quand nous avons fait les perquisitions, nous n'avions rien trouvé en dehors d'une valise, sous le lit d'une des mères, contenant 700.000 francs (on en était encore à l'époque des francs) ... Quand on leur a demandé quel était le but de cet argent, ils nous ont dit « C'est pour maman, pour faire des courses » (...). Dans cette même perquisition, nous avons trouvé un bout de papier à moitié déchiré qui correspondait à une adresse bancaire. Après identification, nous sommes tombés sur une banque du Liechtenstein. A chaque fois qu'ils avaient de l'argent issu de leur commerce, ils partaient au Liechtenstein, où ils avaient un compte bloqué à 8 % d'intérêt sur treize ans, sur lequel on a trouvé presque 17 millions de francs. Au cours de cette même perquisition, nous avons trouvé un catalogue FRAM (...) sur lequel figurait un hôtel avec une croix surlignée. Nous nous sommes dits qu'ils avaient dû aller en vacances là-bas avec leur famille (...) Nous avons donc envoyé une mission là-bas pour voir s'ils n'avaient pas un train de vie supérieur à la moyenne. Je précise qu'ils étaient tous sans emploi, bien évidemment. C'est là que nous avons découvert que cet hôtel de 55 chambres, avec deux boîtes de nuit, trois courts de tennis, un terrain de golf et une piscine leur appartenait ! ». Il a conclu ses propos sur cette affaire en estimant : « ce sont des petits jeunes de banlieue, mais vous avez des petits jeunes comme ceux-là, hélas, par dizaines sur Paris et la petite couronne. L'économie souterraine fonctionne bien ». |
d) La situation particulière des Antilles françaises
L'analyse de l'existence d'un trafic illicite de drogues ayant cours sur le territoire national ne peut bien sûr occulter la situation particulière des Antilles françaises, situées dans une zone -la Caraïbe- traditionnellement considérée comme une « plaque-tournante » du trafic international de stupéfiants.
La commission d'enquête s'est ainsi rendue à Saint-Martin, île du Nord de la Guadeloupe située dans une position géographique stratégique en termes de trafic international de stupéfiants, et utilisée comme base logistique essentielle au trafic transitant par la zone Caraïbe à destination de l'Europe ou des Etats-Unis.
Les différents représentants institutionnels rencontrés par la commission d'enquête à l'occasion de son déplacement à Saint-Martin ont précisé de manière particulièrement claire les caractéristiques particulières du trafic de stupéfiants dans la zone Caraïbe et ont insisté plus spécifiquement sur le rôle de Saint-Martin dans cette configuration.
(1) La zone Caraïbe : une position géographique clé en termes de trafic international de stupéfiants
M. Robert Chauvin , inspecteur des douanes, chef de la brigade de surveillance et de recherche (BSR) des douanes de Saint-Martin a ainsi indiqué qu'il existait cinq circuits de trafic de stupéfiants en partance des pays producteurs d'Amérique du Sud :
- deux circuits dans la zone pacifique ;
- un circuit vers les pays de l'Est de l'Amérique du Sud ;
- un circuit vers les Etats-Unis ;
- un circuit au niveau de l'arc caribéen avec trois passages : un passage via le Golfe du Mexique, un passage via Haïti et Saint-Domingue et enfin un passage via l'arc antillais.
M. Laurent Le Gentil, commandant la gendarmerie de Saint-Martin, a pour sa part précisé que le narcotrafic de la zone Caraïbe était un trafic organisé, structuré et de portée internationale, régi par des organisations criminelles à grande échelle et impliquant des produits diversifiés et des flux importants.
Il a rappelé que la Caraïbe était un pôle idéal du narco-trafic mondial car il s'agit d'une zone perméable, caractérisée par une multiplicité d'Etats très hétérogènes, un enchevêtrement des eaux territoriales, la proximité des zones de producteurs et de consommateurs, et enfin une situation géographique stratégique.
Il a souligné l'essor du trafic depuis les années 1980 et l'existence d'un trafic permanent sous toutes ses formes, par voie maritime et aérienne.
(2) Saint-Martin : base logistique incontournable des trafiquants internationaux dans la zone Caraïbe
S'agissant plus spécifiquement de l'île de Saint-Martin, le commandant Le Gentil a indiqué qu'elle occupait une position géographique stratégique , située à proximité de Puerto Rico, porte d'entrée pour les Etats-Unis, qu'elle avait l'avantage d'offrir de nombreux points de repère et d'appui, située à la croisée de plusieurs eaux territoriales et qu'elle faisait office de lieu de transbordement et de largage idéal. Il a également rappelé que l'île de Saint-Martin, une île touristique et cosmopolite, constituait un environnement extrêmement favorable pour les narco-trafiquants, en raison notamment de sa partition et du caractère particulièrement perméable de sa frontière.
Il a ajouté que Saint-Martin constituait également une base logistique idéale pour les trafiquants en raison de la présence de nombreuses industries nautiques et de petits chantiers navals dans son lagon, concentrés dans la partie hollandaise, permettant des conditions d'anonymat et de facilités d'arrivée sur l'île pour l'achat et l'entretien des bateaux, et enfin étant située dans le rayon d'action des « Go-fast ».
Saint-Martin présente ainsi plusieurs atouts pour les narco-trafiquants, liés notamment à son double statut, sa situation géographique de proximité avec les Etats-Unis, sa situation géographique vis-à-vis de l'Europe (une des dernières îles utiles de l'arc antillais), sa forte population immigrée, son activité nautique et maritime soutenue et enfin son statut de zone franche expliquant l'installation tardive des douanes françaises sur l'île (depuis 1990).
M. Robert Chauvin a également précisé à la commission d'enquête les différentes étapes du trafic de drogue, de prestataire de service en prestataire de service : depuis les transporteurs colombiens, transitant par le Venezuela, jusqu'aux dépositaires des différentes îles de l'arc antillais, notamment à Saint-Martin où l'on trouve des affrêteurs de navires. Lorsque la drogue -notamment la cocaïne- quitte la Colombie elle vaut 500 dollars le kilo ; lorsqu'elle est déposée à Saint-Martin, elle vaut 6.000 dollars le kilo ; après son transfert, vers Puerto Rico par exemple, elle vaut 18.000 dollars le kilo ; enfin quand elle arrive en Europe et en métropole, elle vaut 100.000 dollars le kilo.
Saint-Martin représente donc d'abord une base logistique idéale pour les trafiquants qui s'en servent aussi pour entreposer de la drogue. Elle est caractérisée par la présence de nombreux prestataires de services et par des possibilités diversifiées de blanchiment d'argent, surtout dans la partie hollandaise. L'île présente ainsi des avantages à la fois en termes de moyens logistiques et de situation géographique dans l'arc antillais.
S'agissant des saisies , M. Jean-Louis Malves, directeur régional des douanes de la Guadeloupe, a indiqué qu'en 2002, 31 kg de cocaïne, 5,5 kg d'héroïne et 4 kg de cannabis avaient été saisis à Saint-Martin, tandis que le ciblage aérien effectué depuis l'île avait permis aux douanes de l'aéroport de Roissy de saisir 15 kg de cocaïne. De même 650 kg de cocaïne ont pu être saisis au large des côtes espagnoles grâce au renseignement provenant des douanes de Saint-Martin. Enfin, il a indiqué qu'en février 2003, la brigade de Saint-Martin avait réalisé sur un voilier une saisie de 204 kg de cocaïne, 15 kg d'héroïne et 55 kg de cannabis.
BILAN DES SAISIES RÉALISÉES PAR LA
BRIGADE DE SURVEILLANCE
ET DE RECHERCHE DES DOUANES DE SAINT-MARTIN
DEPUIS SA CRÉATION EN OCTOBRE 1990
(en kilogrammes)
|
Saisie de drogue par l'unité |
Saisie de drogue grâce à une participation ou une intervention de l'unité dans le dossier |
Saisie de drogue par des services extérieurs ou étrangers sur information de l'unité |
|
|
COCAÏNE |
1 700 |
1 180 |
1 195 |
|
HÉROÏNE |
7,287 |
16 |
- |
|
CANNABIS |
450 |
- |
1 137 |
En 2002, les douanes néerlandaises de Sint Maarten ont pour leur part réalisé 84 interpellations, dont 80 pour trafic de stupéfiants. La plupart de ces interpellations concernaient des passeurs ayant ingéré des boulettes (« bolitas ») de cocaïne.
BILAN DES SAISIES RÉALISÉES PAR LES
DOUANES NÉERLANDAISES
DE SINT MAARTEN DEPUIS 2000
(en kilogrammes)
|
2000 |
2001 |
2002 |
|
|
COCAÏNE |
22,679 |
489,509 |
60,240 |
|
HÉROÏNE |
12,810 |
63,115 |
22,400 |
|
MARIJUANA |
14,990 |
124,340 |
1 395,440 |
|
TOTAL |
175,479l |
676,964 |
1 478,080 |
Le phénomène des bolitas n'est pas récent puisqu'il est apparu il y a une quinzaine d'années. La quantité maximale ingérée par une personne constatée par les douanes est de 170 bolitas de 10 grammes. La majorité des passeurs ont pour destination l'Europe, et notamment la France et les Pays-Bas.
Au total, en termes de trafic de drogues , l'île de Saint-Martin constitue un point névralgique de la zone Caraïbe . Les difficultés rencontrées dans l'application d'une politique de lutte contre les drogues illicites dans cette région résident notamment dans la situation géographique particulière de l'île, séparée par une frontière fictive entre la partie française et la partie relevant de la Fédération des Antilles néerlandaises, ainsi que dans la faiblesse numérique des services répressifs représentés sur le territoire.
3. Les revenus générés par la production et le trafic de drogues illicites : des facteurs déstabilisateurs pour l'ensemble des économies concernées
Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Jacques Franquet, préfet de la Dordogne et premier vice-président de l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS), a exposé les principales conclusions du rapport pour 2002 de cet organe des Nations Unies.
S'agissant des revenus tirés de la production et du trafic illicites de drogues, M. Jacques Franquet a déclaré devant la commission : « nous avons prouvé dans notre rapport que seulement 1 % vont aux paysans et que 99 % alimentent les réseaux de trafiquants ».
A ce titre, le rapport pour 2002 de l'OICS rappelle, d'une part, que l'héroïne et la cocaïne restent les drogues illicites qui ont les plus fortes incidences socio-économiques à l'échelle mondiale et que leur trafic illicite représente la majeure partie du trafic illicite mondial en termes monétaires, d'autre part, que les drogues illicites profitent à quelques-uns sur le court terme mais que, pour beaucoup, elles entraînent des pertes à long terme.
La commission tient à souligner l'intérêt de l'analyse faite par l'OICS dans son rapport pour 2002 sur les retombées à court terme de la production et du trafic illicites de drogues, sur l'estimation des revenus dégagés de la production et du trafic illicites de drogues, et enfin sur les conséquences à long terme sur la croissance économique de cette production et de ce trafic sur les économies concernées.
a) Des profits captés par une minorité et des revenus résiduels pour les pays en développement
A court terme, l'existence d'activités génératrices de revenus, telles les activités rurales, induites par la production et le trafic illicites de drogues peut être considérée comme positive sur le plan économique. Toutefois, si un petit nombre de personnes, principalement celles qui organisent le commerce illicite de la drogue, dégage d'importants bénéfices de la culture illicite, ces activités sont préjudiciables pour la grande majorité de la population, y compris pour la plupart des personnes qui, dans un premier temps, en ont tiré parti. Le rapport pour 2002 de l'OICS en conclut qu'« à long terme, l'industrie illicite de la drogue crée des problèmes majeurs qui finalement nuisent au développement économique du pays concerné ».
Le rapport tente également d'estimer les revenus dégagés de la production et du trafic illicites de drogues et conclut que « l'essentiel des profits résultant du trafic n'est (...) pas réalisé dans les pays en développement mais dans le monde développé ».
D'après les données fournies par le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID), en 2001, la valeur totale des récoltes illicites de pavot à opium et de coca s'élevait à 1,1 milliard de dollars, soit 1,3 % en moyenne du revenu agricole total des pays concernés, tandis que le revenu global dégagé par les agriculteurs de la production illicite de coca et de pavot à opium s'établissait à 2 % de l'aide mondiale au développement en 2000.
Au total, le rapport pour 2002 de l'OICS estime que le revenu des paysans dans les pays en développement représente 1 % seulement de l'argent finalement dépensé dans le monde entier par les toxicomanes pour maintenir leurs habitudes de consommation, les 99 % restants du revenu mondial provenant des drogues illicites étant empochés par les groupes se livrant au trafic de drogues à tous les niveaux de la chaîne. Les profits résultant du trafic illicite de drogues dans les pays développés représentent, en moyenne, de la moitié aux deux tiers du total des bénéfices tirés de ce trafic.
A cet égard, M. Xavier Raufer, chargé de cours à l'Institut de criminologie de Paris, a fait état devant la commission d'enquête de « sommes colossales » produites par le commerce de la drogue : « Nous n'avons pas de chiffres précis puisque, lorsqu'on vend des stupéfiants, on n'envoie pas un double de la facture au fisc, laquelle est de toute façon inexistante, mais, de l'avis des Nations Unies, la production et le trafic des stupéfiants à l'échelle planétaire représentent chaque année un chiffre d'affaires de 500 milliards de dollars ».
Dans son Rapport mondial sur les drogues 1997, le PNUCID précise que « de nombreuses estimations ont été faites du chiffre d'affaires total de l'industrie des drogues illicites ; la plupart naviguent entre 300 et 500 milliards de dollars US. Cependant, des indices de plus en plus nombreux montrent qu'il se situerait aux alentours de 400 milliards de dollars. (...) un chiffre d'affaires de 400 milliards de dollars équivaudrait à 8 % environ du total des échanges commerciaux internationaux ».
M. Xavier Raufer a ajouté que le trafic illicite de stupéfiants faisait l'objet d'une captation exclusive par quelques sociétés criminelles organisées : « Je vais vous donner un (...) chiffre qui provient du précédent secrétaire général d'Interpol, Raymond Kendall. Il a dit que si on fait le total des gens fichés au grand banditisme dans les Etats de droit (...), c'est-à-dire si on retient tous les pays ayant un système juridique décent et leurs fichiers d'individus fichés au grand banditisme, notamment le fichier du FBI des Etats-Unis, le fichier du grand banditisme français, et ainsi de suite pour les 25 Etats de droit reconnus de la planète, on obtient environ 250.000 individus, dont 200.000 sont impliqués, de manière prouvée, suite à des procès en justice, dans le trafic de stupéfiants . Ce n'est donc pas une activité comme les autres. Il y en a d'autres, notamment tout ce qui tourne autour de la pornographie et du marché du sexe ou du vice, qui est un apanage à peu près total et absolu du crime organisé, mais il faut avoir cela en tête ».
Dans son Rapport mondial sur les drogues 1997, le PNUCID souligne également que « les mouvements internationaux à grande échelle de la cocaïne et de l'héroïne sont presque entièrement contrôlés par des organisations criminelles internationales pour qui les drogues sont une source majeure de revenus. Ainsi, l'économie des drogues illicites et le crime organisé sont, en quelque sorte, interdépendants. En l'occurrence, le rôle capital du crime organisé consiste à fournir et à investir des capitaux (...). Au cours des vingt dernières années, les organisations de trafiquants ont progressivement diversifié leurs activités criminelles afin de protéger leur principal intérêt ; c'est ainsi qu'elles s'occupent désormais de trafic d'armes et de blanchiment d'argent et investissent les secteurs licites de l'économie, de la politique et de l'administration ».
Toutefois, d'après les calculs du PNUCID, le montant global des capitaux liés à la drogue, injectés dans les économies nationales des pays en développement producteurs de drogues, ne serait que de 3,8 milliards de dollars en 2001 . En pourcentage du PIB, la production et le trafic illicites de drogues ont été évalués entre 10 et 15 % pour l'Afghanistan et le Myanmar, entre 2 et 3 % pour la Colombie et la République démocratique populaire Iao, à un peu plus de 1 % pour la Bolivie et à moins de 1 % pour tous les autres pays. Au total, force est de constater que les revenus dégagés dans les pays où sont pratiquées des cultures illicites de drogues sont particulièrement modestes.
b) Des effets dévastateurs à long terme
Plus généralement, le rapport pour 2002 de l'OICS montre qu'il existe une corrélation négative entre la production illicite de drogues et la croissance économique d'un pays. Les données disponibles montrent en effet que les pays dans lesquels ont été produites des drogues illicites ont enregistré une baisse de leur croissance économique.
Par ailleurs, il est désormais avéré que la production illicite de drogues et les activités économiques qui y sont liées compromettent le développement économique à long terme en exerçant un effet déstabilisateur sur l'Etat, l'économie et la société civile.
D'après l'OICS, « la déstabilisation de l'Etat est généralement la conséquence la plus grave de l'existence d'une importante industrie illicite de la drogue dans un pays. Si les fonds générés par le trafic de drogues dans les pays en développement ne sont peut-être pas suffisants pour faire décoller l'économie, ils suffisent d'habitude amplement pour corrompre le régime politique ».
Le processus de déstabilisation de l'économie se manifeste de diverses manières. Il compromet le processus d'investissement classique, il entraîne une surévaluation du taux de change en raison de l'afflux de profits illicites, d'où un recul des exportations « légitimes », il favorise le commerce illégal et la concurrence déloyale, il encourage une consommation ostentatoire au détriment de l'investissement à long terme, il promeut l'investissement dans des secteurs non productifs, lié le plus souvent à des stratégies de blanchiment d'argent, enfin il accentue les inégalités dans la répartition des revenus.
S'agissant des effets néfastes du commerce de la drogue sur les pays producteurs, M. Xavier Raufer a déclaré devant la commission : « On sait qu'à partir du moment où un pays devient producteur de stupéfiants, il abandonne toutes les productions licites : pourquoi gagner 50 dollars par hectare de blé alors que la production d'un seul kilo de sève de pavot, c'est-à-dire d'opium, vous en rapporte dix ou vingt fois plus ? Tout cela joue un rôle important dans les misères du monde ».
L'industrie de la drogue est également génératrice d'une déstabilisation de la société civile, en raison d'une augmentation de la criminalité, de l'érosion du capital social et humain, des atteintes à l'Etat de droit, de la corruption des élites et du système politique, et enfin du développement de toutes les activités annexes liées au commerce de la drogue.
VALEUR POTENTIELLE À L'EXPLOITATION DE LA
PRODUCTION DE 2002
(ESTIMATIONS PNUCID)
|
OPIUM |
|||
|
Prix à l'exploitation Dollars des EU par kg |
Production Tonnes |
Valeur potentielle Million de dollars des EU |
|
|
Myanmar |
222 |
1 097 |
244 |
|
Afghanistan |
301 |
185 |
56 |
|
RPD Lao |
165 |
134 |
22 |
|
Autres pays d'Asie |
- |
51 |
22 |
|
Colombie |
340 |
88 |
30 |
|
Mexique |
340 |
71 |
24 |
|
Total, opium |
1 626 |
398 |
|
|
COCAÏNE BASE |
|||
|
Colombie |
880 |
617 |
543 |
|
Pérou |
559 |
150 |
84 |
|
Bolivie |
1 430 |
60 |
86 |
|
Total, cocaïne base |
827 |
713 |
|
|
Valeur potentielle combinée |
1 110 |
||
Source :OCDPC, 2002
II. LA DANGEROSITÉ CERTAINE DES DROGUES
« Yagé, cohoba, iboga. Ce sont des lianes hallucinogènes africaines ou d'Amérique du nord, d'Amérique du sud. Il y a le khat, le kava, qui font partie des drogues utilisées dans un de nos départements français, la Nouvelle-Calédonie, le peyotl, la psilocybine, c'est-à-dire les champignons hallucinogènes qui sont de plus en plus rencontrés en France et on ne le dit pas assez, on ne s'en méfie pas assez. Il y a le pencyclidine, qui pose tant de problèmes aux Etats-Unis, qui, pour l'instant heureusement, n'est pas encore arrivé en France. Il y a le pentanyl, la kétamine, le GHB, qui sont utilisés comme des anesthésiques théoriquement, mais détournés de leur usage par les toxicomanes et qui commencent à poser de gros problèmes. »
Ce propos liminaire du professeur Patrick Mura, président de la société française de toxicologie analytique, lors de son audition par la commission, illustre la diversité des produits stupéfiants.
Sans prétendre à l'exhaustivité, la commission examinera les conséquences physiques, psychiques et psychiatriques de la consommation des substances les plus répandues dans notre pays -les drogues « dures » (héroïne, cocaïne, crack), le cannabis et les nouvelles drogues synthétiques- tout en soulignant la pertinence très relative de la comparaison établie entre les dangers respectifs de chaque produit.
A. DES DOMMAGES SANITAIRES AVÉRÉS TOUCHANT ESSENTIELLEMENT LA JEUNESSE
1. Le consensus scientifique et social concernant les drogues dites « dures »
La commission tient d'abord à souligner les effets particulièrement néfastes de la consommation de deux types de produits, largement utilisés : l'héroïne, qui apparaît de loin comme le plus dangereux des opiacés et les produits tirés de la feuille de coca, la cocaïne et le crack.
a) Le facteur de la dépendance
Les multiples études menées sur le sujet controversé de la dangerosité des drogues s'accordent à considérer la dépendance au produit comme l'un des principaux facteurs de dangerosité. On rappellera que la dépendance peut être définie comme un usage compulsif incontrôlé et incontrôlable, c'est-à-dire une perte de contrôle de sa consommation, en dépit des effets néfastes connus du consommateur à la fois pour lui-même et pour son environnement.
La dangerosité d'un produit en termes de dépendance se mesure à la fois par les efforts effectués pour se procurer le produit et l'énergie considérable dépensée pour parvenir à l'abstinence . Partant de ce constat et de la forte dépendance créée par la consommation de drogues dures, notamment d'héroïne et de crack, un consensus se dégage pour classer ces dernières dans la catégorie la plus dangereuse de stupéfiants. D'après la récente enquête de l'OFDT sur l'évolution des perceptions et des opinions (1999-2002) 28 ( * ) , « le produit jugé le plus dangereux par les Français reste l'héroïne. En effet, 42,6 % le placent en tête, devant l'ecstasy (21,4 %) et la cocaïne (19,3 %) ».
Il n'existe toutefois pas de réponse unanime à la question de savoir pourquoi un sujet se drogue et pourquoi une substance à potentialité addictive n'est pas « toxicomanogène » pour tout le monde, ni de la même façon. Une première rencontre avec la drogue répond souvent à une recherche de sensations, à l'obtention d'un effet euphorisant ou antalgique. Selon les individus, cet événement, s'il est répété, peut être le début d'un processus évolutif toxicomaniaque ou, à l'inverse, rester du domaine d'un comportement hédoniste. Il existe donc un état de prédisposition du cerveau sur lequel agissent, de manière spécifique, les différents stupéfiants.
La dépendance dépendrait ainsi essentiellement de deux facteurs : les propriétés du produit consommé et la prédisposition de l'usager.
Ces facteurs ont été définis par le PNUCID dans son rapport mondial sur les drogues, paru en 1996 29 ( * ) . Par propriétés de la drogue, on entend ses propriétés pharmacologiques, son mode d'administration (ingestion, prise, inhalation, injection sous-cutanée, intraveineuse ou intramusculaire), les conditions de sa consommation (cas de polyconsommation), son degré de pureté et la posologie.
Peuvent être considérées comme les caractéristiques individuelles du consommateur : la personnalité de l'usager, l'intensité ou la fréquence de l'usage antérieur, son état de santé au moment où il a commencé à se droguer, son statut économique, social ou familial et ce qu'il attend de la prise du produit.
Le professeur Bernard Roques a ainsi indiqué à la commission que si les drogues « dures » ont toutes les propriétés qui en font des produits extrêmement dangereux, les individus ne sont pas égaux devant la dépendance : « Si tous les individus ne deviennent ni « abuseurs », ni dépendants, c'est qu'il existe une vulnérabilité particulière au risque addictif. Tous les individus ne sont pas égaux devant la transition entre abus et dépendance et il existe des facteurs de risques qui ne s'excluent pas, notamment des facteurs génétiques, comme on le sait maintenant. (...) Il y a également des facteurs émotionnels très importants. Les traumatismes de l'enfance, par exemple, sont réputés comme déclenchant, à la période de l'adolescence, un risque très grave, dix fois plus important, de toxicomanie. On note étalement une comorbidité, qui plait bien aux Anglo-saxons et qui est sûrement vraie, chez des gens qui deviennent dépendants ou les « abuseurs », c'est-à-dire l'existence de maladies mentales ou de désordres mentaux comme les dépressions, les troubles obsessionnels compulsifs, de l'anxiété, voire des psychoses, qui entraînent évidemment le patient à une sorte d'automédication qui est la prise de produits. Bien sûr, il y a également des facteurs de risques environnementaux : la désorganisation du milieu familial, les conditions socioculturelles défavorables, la perte de l'estime de soi (...) et, bien entendu, l'accès facile aux produits. (...) Le psychotrope agit dans ce cas comme une sorte de « béquille hédonique chimique ». Puisqu'il y a béquille hédonique, cela veut dire qu'elle est là pour entraîner une sensation de mieux-être ou de plaisir ».
La dépendance semble ainsi résulter de la sensation de plaisir qu'entraîne la consommation de produit, enregistrée par le cerveau, qui réclame alors de retrouver cette sensation, parfois même après un sevrage. La dépendance psychologique apparaît alors au moins aussi importante que la dépendance physique.
On constate également une dépendance sociale qui rend difficile la démarche de sevrage. Le toxicomane dépendant organise toute sa vie relationnelle et sociale autour de la drogue, qui l'enferme dans un monde dont il pourra d'autant moins échapper qu'il en est souvent débiteur financièrement.
La dangerosité certaine des drogues dures s'explique également par les très graves effets physiques secondaires que leur consommation entraîne, pouvant aller parfois jusqu'à entraîner la mort. Ces effets diffèrent toutefois selon le type de produits consommés.
b) Les dangers avérés de l'héroïne
L'héroïne est souvent le produit préféré des consommateurs d'opiacés du fait de ses effets puissants ; elle est soluble dans l'eau (ce qui facilite l'injection) et ses effets, qui perdurent pendant quatre à six heures, sont plus rapides que ceux de la morphine. L'héroïne est également mais plus rarement prisée, fumée ou inhalée après avoir été chauffée sur des papiers d'aluminium. On observe toutefois la recrudescence de l'usage de l'héroïne « sniffée » dans les soirées où sont consommées des drogues chimiques, afin d'atténuer la fin brutale sur l'organisme de l'effet de ces dernières. On peut donc légitimement s'inquiéter du développement de ce phénomène chez de jeunes consommateurs, alors même que la consommation d'héroïne était stable depuis plusieurs années.
MODES DE CONSOMMATION DES USAGERS
D'HÉROÏNE
PRIS EN CHARGE DANS LES STRUCTURES DE SOINS, DE 1995
À 1999
|
Mode de consommation |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
Consommateurs d'héroïne par voie intraveineuse / Total des consommateurs d'héroïne |
75 |
66 |
60 |
52 |
36 |
|
Consommateurs d'héroïne par voie nasale /
|
29 |
39 |
40 |
47 |
62 |
Source : d'après OPPIDUM, CEIP
D'après le rapport mondial sur les drogues de 1996, les études réalisées en Angleterre dans les années 60 montrent que les héroïnomanes, même quand ils sont approvisionnés en drogues « propres » et en aiguilles neuves, ont un taux de mortalité très supérieur à celui du reste de la population . La consommation d'héroïne a, en effet, des effets sur le système nerveux, entraînant une rigidité musculaire, des vomissements, des problèmes respiratoires, sur le système cardiovasculaire (modification de la fréquence cardiaque), sur le système gastro-intestinal, sur la vésicule biliaire, la peau et les dents (des caries dentaires sont susceptibles d'apparaître au bout d'un ou deux ans d'usage intensif), même si l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques considère que, comparés à la cocaïne, « les opioïdes ne sont pas les plus dangereux pour le système nerveux central » 30 ( * ) .
D'autres effets secondaires résultant de la consommation de fortes doses d'opiacés sont susceptibles de se manifester : baisse du désir sexuel jusqu'à l'impuissance chez l'homme, perturbation du cycle menstruel chez la femme, instabilité d'humeur, léthargie et anorexie. Par ailleurs, les symptômes de manque peuvent également se traduire pendant plusieurs jours par des frissons, des bâillements, des larmoiements, une hyperthermie, des diarrhées, des vomissements et une impression d'anxiété.
D'après le rapport Roques 31 ( * ) : « la dose létale chez l'homme pour l'héroïne ou d'autres opiacés est difficile à établir étant donné que cette dose peut changer considérablement chez les individus tolérants. Ainsi, chez une personne naïve, une administration de 30-40 mg par voie sous-cutanée peut induire une intoxication grave, alors que chez certains toxicomanes une dose de 2.000 mg peut n'induire qu'une faible diminution de la respiration ».
La surmortalité des héroïnomanes par overdose est due généralement à la composition du produit et à l'association de ce dernier à d'autres substance psychoactives (essentiellement l'alcool, la cocaïne, le cannabis et les médicaments psychotropes).
Les derniers chiffres publiés par l'OFDT 32 ( * ) font état de 71 décès dus à une surdose d'héroïne, sur un total de 120 en 2002. Si ce chiffre est en baisse depuis 1990 du fait de la mise en place de la politique de réduction des risques, il reste non négligeable et s'ajoute aux décès liés à l'héroïne sans surdose (72 en 1997 selon l'INSERM).
DÉCÈS PAR SURDOSES LIÉES À
L'HÉROÏNE CONSTATÉS
PAR LES SERVICES DE POLICE DE 1990
À 2000
|
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
|
|
Héroïne |
302 |
368 |
460 |
408 |
505 |
388 |
336 |
164 |
92 |
69 |
71 |
|
Total |
350 |
411 |
499 |
454 |
564 |
465 |
393 |
228 |
143 |
118 |
120 |
|
En % du total |
86,3 |
89,5 |
92,2 |
89,9 |
89,5 |
83,4 |
85,5 |
71,9 |
64,3 |
58,5 |
58,8 |
Source : FNAILS, OCRTIS
On notera également que les héroïnomanes peuvent souffrir de complications liées au mode d'injection par voie intraveineuse (embolies, lésions neurologiques et musculosquelettiques) qui s'effectue trop souvent dans des conditions hygiéniques douteuses et provoque des septicémies, des hépatites, le sida, le tétanos, la tuberculose, des infections pulmonaires et cérébrales, le risque essentiel étant le VIH et les hépatites C et B.
PRÉVALENCE DÉCLARÉE DU VIH ET DU VHC CHEZ LES PERSONNES PRISES EN CHARGE POUR USAGE D'OPIACÉS EN PRODUIT PRIMAIRE, EN 1997 ET 1999*
(en % des sérologies connues)
|
1997 |
1999 |
|
|
Prévalence du VIH chez les personnes ayant pratiqué l'injection (actuellement ou antérieurement) |
18,7 |
15,4 |
|
Prévalence du VIH chez les personnes ayant pratiqué l'injection (au cours des 30 derniers jours) |
20,5 |
17,5 |
|
Prévalence du VHC chez les personnes ayant pratiqué l'injection (actuellement ou antérieurement) |
62,8 |
64 |
|
Prévalence du VHC chez les personnes ayant pratiqué l'injection (au cours des 30 derniers jours) |
63,9 |
65,4 |
* Dans les établissements spécialisés uniquement
Source : enquête sur la prise en charge des toxicomanes en novembre 1997 et 1999, DREES/DGS
Le risque de contamination par le VIH reste ainsi non négligeable, même s'il s'est réduit avec les traitements de substitution, alors que la prévalence du VHC tend à augmenter dans la population héroïnomane. Selon l'étude menée par les docteurs Pierre-Michel Llorca et Jean-Claude Scotto, de l'hôpital Sainte-Marguerite de Marseille, plusieurs facteurs sont associés au risque de contamination du VIH chez les usagers par voie intraveineuse 33 ( * ) :
- le partage des seringues ;
- la durée importante de prise de toxique ;
- la fréquence élevée des injections ;
- l'absence de domicile fixe ;
- une personnalité antisociale, souvent associée à la présence de comportements marqués par l'impulsivité et la difficulté à différer ; dans ce cas, le partage des seringues est une conduite fréquente ;
- des conduites sexuelles à risque (rapports non protégés, partenaires multiples).
c) La cocaïne et le crack : une addiction très rapide
La cocaïne et le crack sont des stupéfiants très addictifs. On rappellera que le premier usage, pour ce qui concerne la cocaïne, est souvent festif et que, selon les estimations, 10 % de ceux qui se sont engagés dans une consommation « récréationnelle » sont susceptibles de devenir dépendants.
Toutefois, aucun consensus ne se dégage de la littérature scientifique pour définir la dépendance à la cocaïne. On cite plusieurs exemples d'individus chez qui une tolérance à la cocaïne s'était manifestée, mais en général de courte durée et pour de faibles consommations à usage non régulier. On rappellera que la cocaïne est généralement absorbée par voie nasale, et plus rarement injectée, le crack étant fumé 34 ( * ) . L'usage abusif de la cocaïne est susceptible de provoquer des changements d'humeur (euphorie/dystonie) et, dans certains cas extrêmes, une psychose cocaïnique aiguë, caractérisée par des hallucinations visuelles ou tactiles (bêtes sous la peau), une paranoïa et une forte anxiété.
A l'inverse de ce qui est observé avec les opiacés, le sevrage de la cocaïne ne semble pas produire de symptômes physiques, mais conduit à un état dépressif, pendant une période de quatre heures à six jours, qui peut favoriser la reprise de la drogue. Des dégâts organiques importants peuvent découler d'une consommation de cocaïne : effets dramatiques au niveau du système cardiovasculaire, du foie et du cerveau, avortement spontané et complications néonatales pour les femmes enceintes.
Selon le professeur Bernard Roques 35 ( * ) , l' « un des facteurs essentiels de la neurotoxicité de la cocaïne est dû à ses effets vasoconstricteurs ». La cocaïne favorise le développement de caillots sanguins, les cas d'oedèmes cérébraux, d'atrophies cérébrales, d'infarctus du myocarde et de crises d'épilepsie. L'usage de cocaïne conduit également à des déficits de l'attention, de la mémoire, à des tremblements des mains semblables à ceux de la maladie de Parkinson et à l'atrophie des muqueuses nasales.
Outre les accidents vasculaires cérébraux et les manifestations psychiatriques susceptibles de conduire au suicide, la consommation de cocaïne est aussi à l'origine de décès par surdose. Selon les chiffres fournis par l'OFDT dans son dernier rapport annuel, la cocaïne, et notamment le crack, ont été à l'origine de 11 décès sur les 120 décès par surdose enregistrés en 2000. Les surdoses de cocaïne résultent généralement d'une mauvaise estimation par l'usager de sa tolérance à la drogue ou par une polyconsommation. Il arrive également que des passeurs de bolitas décèdent après l'éclatement des préservatifs contenant des boulettes de cocaïne qu'ils ont ingérés.
Si le nombre de décès liés à la cocaïne a fluctué au cours des quinze dernières années, le nombre de surdoses constaté par l'OFDT est pour la première fois supérieur à 10, alors que l'on observe une forte diminution des décès liés à l'héroïne au cours des années 90. Enfin, dans la mesure où une partie de la consommation de cocaïne s'effectue par injection, les usagers concernés sont exposés au même risque de contamination au VIH et au VHC que dans le cas de l'héroïne.
PRÉVALENCE DÉCLARÉE DU VIH ET DU
VHC CHEZ LES PERSONNES PRISES
EN CHARGE EN 1997 ET 1999 POUR USAGE DE
COCAÏNE EN PRODUIT PRIMAIRE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS
SPÉCIALISÉS
|
1997 |
1999 |
|
|
Prévalence du VIH chez les personnes ayant pratiqué l'injection (actuellement ou antérieurement) en % du nombre de sérologies connues |
20
|
14,9
|
|
% de sérologies inconnues |
23
|
16,1
|
|
Prévalence du VHC chez les personnes ayant pratiqué l'injection (actuellement ou antérieurement) en % du nombre de sérologies connues |
53,3
|
59,7
|
|
% de sérologies inconnues |
30
|
19,7
|
Source : enquête sur la prise en charge des toxicomanes en novembre 1999, DREES/DGS
La consommation de cocaïne par voie intraveineuse constitue ainsi un facteur de risque important de contamination du fait du rôle désinhibiteur du produit, qui favorise les comportements à risque 36 ( * ) .
S'agissant du crack, les effets euphorisants, la dépendance et la probabilité d'une évolution vers une consommation compulsive sont considérablement augmentés. Lors de son audition devant la commission, M. Jean-Pierre Lhomme, responsable à l'association Médecins du Monde, a fait ainsi une description inquiétante des effets du crack : « L'effet est encore plus puissant que la cocaïne. (...) Il est quasiment impossible d'être dépendant physiquement, dans la mesure où, physiquement, on ne tient pas. On « cracke » pendant 48 heures et on est ensuite obligé de s'arrêter car c'est totalement épuisant. »
On rappellera que le crack est fumé et directement absorbé par les membranes pulmonaires. La drogue atteint le cerveau en 6 à 7 secondes et provoque des effets euphorisants immédiats d'une très forte intensité (flash). En outre, alors que la cocaïne est en général coupée (20 à 60 %), le crack se présente sous forme de cristaux dont le degré de pureté peut atteindre 95 %. Par ailleurs, la durée des effets est d'autant plus courte que l'absorption est rapide : ils persistent ainsi 15 à 30 minutes pour la cocaïne (par voie nasale), mais seulement 5 à 10 minutes pour le crack, ce qui favorise une reprise très régulière du produit. Les effets sur l'organisme sont généralement les mêmes que lors d'une prise de cocaïne « classique », mais souvent plus violents : fumer du crack prédispose en outre aux brûlures, à la bronchite chronique et au flétrissement des tissus pulmonaires, mais surtout détruit à moyen terme, de manière irréversible, les cellules neuronales.
Contrairement à certaines prévisions, le crack n'a pas vu sa consommation se développer en Europe comme elle a explosé aux Etats-Unis, dans les quartiers populaires noirs et hispanophones, mais aussi dans les Antilles françaises, comme a pu le constater la commission lors de son déplacement à Saint-Martin.
|
LE CRACK À SAINT-MARTIN La commission s'est rendue à Saint-Martin du 3 au 6 avril 2003 et a pu mesurer l'ampleur du problème de la consommation de crack sur l'île. Le crack est obtenu à partir d'un mélange de cocaïne et de bicarbonate de soude et se présente sous la forme de petits cailloux ou de plus gros rochers (ou « rocks »). A Saint-Martin, le crack est plus souvent confectionné à partir d'un mélange de cocaïne et de « baking soda », à la place du bicarbonate de soude, produit utilisé pour le nettoyage domestique à base de levure chimique. Les toxicomanes de Saint-Martin fument le crack à l'aide de pipes rudimentaires confectionnées avec une boîte de soda ou un récipient en verre fermé par une rondelle de caoutchouc, provenant souvent d'une semelle de « tong », percée d'un tuyau de plastique et d'un fragment d'antenne de radio de véhicule automobile. La majorité des « crackés » sont des locaux. L'utilisation de ce produit provoque un « flash caractéristique » procurant une sensation immédiate d'euphorie intense mais ne durant pas plus d'une dizaine de minutes ; la « descente » extrêmement brutale s'accompagne du besoin impérieux d'en reprendre immédiatement. Les prix pratiqués en 2001 à Saint-Martin étaient de 15 à 20 dollars pour le gramme de cocaïne et de 5 dollars pour le caillou de crack et sont à l'origine d'un narco-tourisme non négligeable. La commission a notamment pu visiter, escortée par la gendarmerie, le quartier du « ghetto » de Marigot, où se regroupent les consommateurs de crack, qui sont le plus souvent dans un état physique extrêmement dégradé. Elle ne peut que souligner la très grande dangerosité de cette drogue, encore peu développée en France, sinon dans le quartier Stalingrad à Paris, et en Europe, et qui ne fait pas l'objet de campagnes de prévention. |
2. Les effets du cannabis : la fin du mythe des drogues « douces »
a) Le cannabis : un produit de plus en plus dangereux
La marijuana, ou herbe, est le nom donné aux feuilles et aux fruits du cannabis qui, hachés et broyés, sont fumés purs ou avec du tabac. Le haschich est la résine secrétée par les feuilles et les sommités mûres de la plante. Il est quatre à huit fois plus actif que la marijuana. Le plus souvent le haschich est fumé mélangé à du tabac ; il est beaucoup plus rarement injecté par voie intraveineuse ou utilisé sous forme de comprimé. Il peut également être consommé mélangé à des friandises ou des gâteaux. La résine de cannabis peut être vendue par des dealers « peu scrupuleux », mélangée à du cirage ou du savon pour en conserver l'aspect et vendre pour le même poids une moindre quantité de produit.
Les substances psychotropes contenues dans le haschich sont des cannabinoïdes dont la plus importante est le delta-9-tétrahydrocannabinol (ou delta-9-THC). Une cigarette ou joint de marijuana contient 2 à 5 mg de THC, dont la moitié seulement est absorbée lors de l'inhalation. On estime aujourd'hui que les effets du cannabis se manifestent pour une dose de 0,05 mg/kg de THC absorbée.
Ces effets sont connus depuis les temps les plus lointains et ont longtemps été utilisés pour soulager certains maux. L'efficacité de ces qualités thérapeutiques est aujourd'hui pourtant loin de faire l'unanimité dans le milieu scientifique et médical.
|
L'UTILISATION THÉRAPEUTIQUE DU CANNABIS EN QUESTION Le cannabis était vanté par le passé pour ses vertus à soulager les migraines et à diminuer les réactions allergiques. Il était ainsi présent dans de nombreuses pharmacopées jusque dans les années 1930-1940 (officiellement jusqu'en 1953 en France) où il a été progressivement retiré en raison de ses effets psychotropes. Depuis quelques années, on assiste à une demande de réintroduction du THC à des fins thérapeutiques qui s'inscrit, entre autres, dans la tendance actuelle à privilégier l'utilisation médicale des composés naturels. Plus récemment, le THC a été utilisé pour ses propriétés analgésiques dans le traitement du glaucome, pour l'apaisement des spasmes musculaires, dans les cas de sclérose en plaques et comme antiémétique. Ce dernier effet lui a valu d'être introduit dans la pharmacopée américaine en 1987 avec le Dronebinol (contre les nausées et vomissements, en particulier pour les patients traités par anticancéreux et antiviraux). C'est donc probablement dans ce domaine que les résultats sont les plus convaincants, en particulier chez les malades atteints du sida, chez qui une reprise de l'appétit a été observée. Le cannabis est utilisé pour ces différentes propriétés en Suisse, en Australie, au Canada, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et dans 35 États. Auditionné par la commission, le professeur Roger Nordmann, membre de l'Académie nationale de médecine, a résumé le point de vue défendu par la France sur la question : « Il est certain que le cannabis a un certain nombre d'effets que l'on peut appeler thérapeutiques, c'est-à-dire que le fait de fumer calme certaines douleurs, a une certaine action positive pour empêcher le glaucome et soulage certains sidaïques de leurs multiples affections. Il est donc certain qu'il a une action thérapeutique. (...) Il faut mener des études contre placebo sérieuses, car toutes les études qui ont été faites jusqu'à présent n'ont pas montré de supériorité des dérivés du cannabis ou du cannabis lui-même par rapport aux médicaments » . Une autre difficulté a par ailleurs été soulignée par le rapport Roques : « De très nombreux travaux chimiques ont été effectués pour tenter d'éliminer les effets psychiques des cannabinoïdes en gardant leurs effets thérapeutiques potentiels, sans succès probant. » S'il ne semble pas y avoir d'opposition de principe du corps médical, l'absence d'étude sérieuse empêche pour le moment toute utilisation thérapeutique sécurisée du cannabis. Toutefois, des voix se font entendre pour que la question de l'utilisation thérapeutique du cannabis soit réexaminée par la France. En janvier 1998, le Mouvement de légalisation contrôlée (MLC) du cannabis a demandé au ministère de la santé, au nom de 10 personnes atteintes de maladies incurables, de pouvoir importer 10 kilos d'herbe de cannabis afin de les soulager de certaines douleurs. En l'absence de toute réponse de M. Bernard Kouchner, alors ministre délégué à la santé, le MLC a saisi la justice administrative, via son avocat et président, M. Francis Caballero, par ailleurs auditionné par la commission, à la fois sur le refus d'importation et sur « le classement du cannabis parmi les substances stupéfiantes dépourvues de toute utilité thérapeutique ». Cette requête a été rejetée par le tribunal administratif de Paris le 29 mai 2001. Le débat reste cependant ouvert parmi certains membres du corps médical. « Peu de praticiens utilisent cette possibilité, par méconnaissance, conviction ou en raison de la procédure très lourde pour le médecin, qui doit justifier sa prescription », indique ainsi le docteur Bertrand Lebeau. Attaché à l'hôpital parisien Saint-Antoine, dans le service des maladies infectieuses, il avoue avoir déjà eu recours à ce procédé pour soulager l'un de ses patients atteint de sclérose en plaques. En juin 2001, M. Bernard Kouchner avait annoncé des expérimentations thérapeutiques sur le cannabis en France. Un an après, les programmes hospitaliers de recherche clinique (PHRC) ont été attribués à deux établissements, le service de médecine interne du centre Monte-Cristo (hôpital européen Georges-Pompidou), dirigé par le professeur Lejeune, et le service de neurologie du Pr Catherine Lubetzki à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Les résultats ne sont pas encore connus. La commission ne peut donc qu'être réservée sur les effets thérapeutiques du cannabis et estime que le principe de précaution doit s'appliquer tant qu'une étude validée au niveau international n'a pas prouvé l'intérêt thérapeutique de ce produit. |
Par ailleurs, la teneur en THC varie de manière importante selon l'origine des produits et la commission ne peut que s'inquiéter de l'apparition de variétés de cannabis de plus en plus dotées en THC.
De nouveaux produits sont en effet apparus sur le marché français depuis 1998 et appréciés des jeunes consommateurs, rarement informés de la toxicité accrue de ces substances : le Nederwiet, la « skunk » (variété de fleurs de cannabis originaire des États-Unis et des Pays-Bas) et le « pollen » (étamines des plants mâles) contiendraient des concentrations en 9 - THC de l'ordre de 20 à 25 % (contre environ 5 % à 8 % pour le cannabis marocain « classique »). Leur fabrication résulte d'une sélection de plants et de conditions de culture diffusées largement sur internet.
L'augmentation de la teneur en THC du cannabis actuellement consommé est en particulier visible dans l'étude des échantillons saisis par la police et la douane.
TAUX DE CONCENTRATION EN THC DES ÉCHANTILLONS DE
CANNABIS
SAISIS PAR LA POLICE NATIONALE ET LA DOUANE, EN 1999
|
HERBE |
RÉSINE |
|||
|
Effectifs |
% |
Effectifs |
% |
|
|
0-4 % |
122 |
46,0 |
60 |
16 |
|
4-8 % |
88 |
33,0 |
162 |
43 |
|
8-12 % |
39 |
15,0 |
69 |
18 |
|
12-20 % |
15 |
5,5 |
63 |
18 |
|
+ 20 % |
1 |
0,5 |
19 |
6 |
|
TOTAL |
265 |
100,0 |
373 |
100 |
Source : TREND, OFDT (données fournies par le laboratoire scientifique de la police de Lyon et le laboratoire interrégional de la douane de Paris)
En 1997, déjà, un rapport de l'Académie des sciences avait souligné la toxicité accrue de ces nouvelles variétés de cannabis 37 ( * ) : « si la dépendance au cannabis semble modeste par rapport à celle observée pour les opiacés, l'expérience ne porte que sur des préparations de cannabis à 3 % de THC. Or, l'apparition sur le marché de nouvelles espèces dites « cannabis rouge », pouvant contenir jusqu'à 20 % de THC, pourrait induire une tout autre conclusion . »
Le docteur Léon Hovnanian, président du Centre national d'information sur la drogue (CNID), auditionné par la commission, a également mis l'accent sur les dangers liés à l'apparition de ces nouveaux produits, qui doivent être pris en compte dans les débats sur la dangerosité du cannabis : « il en est du cannabis comme de l'alcool : il est évident qu'entre un vin à 10 degrés et un Ricard à 40 degrés, à doses égales, les résultats ne sont pas les mêmes. De même, le cannabis de grand-papa, qui était à 2 ou 4 % de cannabinol, est passé progressivement, avec le haschich, à 7 ou 8 % et les Hollandais, qui ne sont pas des pauvres cultivateurs du Maroc ou du Liban mais de bons horticulteurs de tulipes (qu'ils ont abandonnées parce que le cannabis leur rapporte plus) sortent du cannabis à 25 ou 30 % de teneur de cannabinol. »
La dangerosité du cannabis fait cependant l'objet de débats, notamment depuis la publication du rapport Roques en mai 1998 qui affirmait notamment : « la toxicomanie au cannabis n'entraîne pas de neurotoxicité ». Ce jugement n'est pas partagé par l'opinion puisque la moitié de la population française juge dangereuse l'expérimentation de cannabis 38 ( * ) .
Ces différences de perception de la toxicité du produit peuvent s'expliquer pour une part par les différences de législation, au niveau européen, qui constituent un obstacle à la lutte contre le trafic et la consommation. A cet égard, on ne peut que souhaiter qu'une étude européenne puisse servir de base à une législation commune en ce domaine.
Le principal débat porte sur le problème de la dépendance au cannabis. Si ce produit n'entraîne généralement pas de syndrome de sevrage sévère, comme c'est le cas pour les opiacés ou la cocaïne, du fait de son élimination lente, mais seulement des signes de nervosité, des troubles légers du sommeil et une diminution de l'appétit qui disparaissent rapidement, il n'apparaît pas pour autant que l'on puisse parler d'une absence de dépendance dans le cas des consommateurs réguliers.
D'après les propos tenus par le professeur Patrick Mura, président de la société française de toxicologie analytique, devant la commission « la dépendance au cannabis est reconnue, puisqu'elle entre dans les critères du DCM4. Ce sont des critères qui ont été établis par les Américains (...) dans le cadre de l'Association américaine de psychiatrie. [Le cannabis] répond à un certain nombre de ces critères, il entraîne donc une dépendance. (...) Cette dépendance est tout à fait objectivée chez le nouveau-né d'une mère toxicomane. (...) Le bébé à la naissance présente des troubles du comportement (...), avec des troubles neurologiques évidents qui disparaissent au bout de quelques jours, voire quelques semaines. »
Il serait donc aujourd'hui hasardeux de considérer le cannabis sans danger pour la santé physique et psychique de l'individu, même s'il est vrai que les risques augmentent avec la quantité de produit inhalée, la durée, les modes de consommation et la vulnérabilité personnelle de l'usager.
b) Des effets physiques et psychiques sur le consommateur
Outre des conséquences qui seront examinées avec la question du cannabis au volant, la consommation de ce produit a des effets tant physiques que psychiques sur le consommateur. Ces effets sur le comportement et la santé ont en particulier fait l'objet d'une étude récente de l'INSERM publiée en février 2003.
Une vingtaine de minutes après la prise de cannabis, on observe les symptômes suivants (variables en fonction de la vulnérabilité du consommateur et de la teneur du produit en THC) : des pupilles dilatées, avec une irritation des conjonctives (effet « yeux rouges »), une tachycardie, des modifications de la tension (hypotension), une sensation de soif, une hypoglycémie responsable d'une sensation de faim impérieuse, parfois des nausées et des vomissements. Tous ces signes sont temporaires, réversibles et d'intensité en règle générale modérée, mais ils peuvent parfois être à l'origine de malaises, d'une chute de la tension artérielle et de tachycardie favorisant les thromboses et les embolies.
En cas de prise répétée et massive, les effets sont évidemment plus importants et sont de même nature que ceux observés chez les grands fumeurs (laryngites et bronchites, problèmes cardiovasculaires et troubles asthmatiques, probabilité accrue de complications foetales et néonatales). On observe également des troubles du sommeil, un amaigrissement, une pâleur, une constipation et des problèmes dentaires. Le risque de cancer du poumon est par ailleurs plus élevé. Des cas de cancers du cerveau, du cou, du tractus respiratoire et de carcinomes de la langue sont en outre relevés par le rapport du Sénat canadien sur le cannabis 39 ( * ) chez des jeunes consommateurs de moins de 40 ans.
Les effets toxiques les plus évidents du cannabis sont donc liés à son utilisation excessive par inhalation, d'autant plus que sa consommation ne réduit pas celle du tabac. Il apparaît que les risques liés à l'inhalation de substances cancérigènes sont plus forts avec le cannabis qu'avec le tabac parce que l'inhalation est plus profonde et l'air aspiré plus chaud. Selon le rapport précité du Sénat canadien, « à poids égal de produit, le cannabis fournit jusqu'à quatre fois plus de goudron que le tabac fort ».
Il serait donc souhaitable que ce risque de santé publique soit pris en compte pour les années à venir, en raison du nombre aujourd'hui important de consommateurs de moins de 25 ans.
Si l'OFDT ne dénombre aucun décès par surdose lié au cannabis, certains cas ont été rapportés, lors de son audition, par le docteur Véronique Vasseur, ancien médecin-chef de la prison de la Santé : « (...) à l'occasion d'une série de décès d'août 1998 à février 1999, sur six décès, quatre analyses de toxicologie faites lors des autopsies ont montré la présence importante de cannabis en grande quantité dans le sang et l'urine, avec une embolie pulmonaire massive et deux infarctus chez des patients d'une quarantaine d'années sans antécédents particuliers, ce qui est la preuve à la fois d'une consommation régulière et chronique et du fait qu'ils fumaient au moment de leur décès ou très peu de temps auparavant. Le cannabis est un analgésique très puissant. Il masque la douleur et il n'y a donc pas de signe d'appel et aucune douleur thoracique. (...) Après cette succession de décès brutaux, j'avais alerté la direction de la Santé et on m'avait répondu : « Le cannabis ne tue pas ». Il est vrai qu'il ne tue pas, mais il achève. »
Un autre cas a été signalé à la commission par le docteur Patrick Mura, président de la Société française de toxicologie analytique : « Tout récemment, un homme de 27 ans est retrouvé mort dans son lit. Le rapport d'autopsie révèle une pneumopathie d'inhalation. C'est ce que l'on appelle le syndrome de Mendelson. Nous connaissions cela avec l'alcool. Nous n'avons pas l'habitude de voir cela avec le cannabis, parce que bien souvent le cannabis n'est pas recherché dans ces cas-là. Là, en l'occurrence, il n'y avait rien d'autre dans le sang que du cannabis. Autrement dit, il était ivre avec le cannabis. Il a inhalé ses vomissements et est décédé dans la nuit, après une ivresse cannabique » .
c) Une altération de la perception
L'ivresse cannabique, ainsi désignée en 1845 par l'aliéniste Moreau de Tours, est le principal effet psychique lié à la consommation de cannabis . Il varie en fonction de la nature et de la quantité du produit consommé, de la personnalité de l'usager et du mode de consommation.
Les quatre phases de l'intoxication cannabique ont été notamment décrites par le docteur Sylvie Wieviorka, auteur du rapport du Conseil économique et social sur « les toxicomanes dans la cité » et responsable du centre pour toxicomanes Saint-Germain - Pierre Nicolle, que la commission a pu visiter 40 ( * ) :
- la première phase est une phase d'euphorie faite d'une sensation de bien-être physique et psychique, que le consommateur veut partager avec son entourage ;
- la deuxième phase est dite phase confusionnelle : développement de l'ouïe, illusions perceptives, pouvant aller jusqu'à de véritables hallucinations visuelles ou auditives. Des troubles de la sphère affective ont également été décrits, parfois responsables de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif, comme l'a expliqué un expert en pharmacologie et en toxicologie devant la commission. Des perturbations spatio-temporelles (sensation que le temps passe lentement) et des modifications du schéma corporel pouvant aller jusqu'à la dépersonnalisation, voire la psychose aiguë, sont aussi évoquées ;
- la troisième phase est une phase d'extase, de retour à la jouissance tranquille (apathie) ;
- la quatrième phase est celle du retour à la normale, le plus souvent faite d'un sommeil profond.
L'analyse de ces quatre phases et de leurs effets a été faite dans les mêmes termes par le Sénat canadien dans son rapport sur le cannabis. Si ces effets psychiques sont temporaires (quelques heures) et réversibles, ils apparaissent dès le premier « joint » et peuvent causer de graves accidents. En outre, un usage intensif et prolongé du cannabis peut entraîner un retentissement psychique encore plus dommageable, ainsi qu'ont pu le montrer les dernières expertises de l'INSERM 41 ( * ) . Peuvent être ainsi observés chez un fumeur régulier de cannabis des troubles du caractère (anxiété et irritabilité), des troubles de l'humeur (indifférence affective), un déficit du processus intellectuel, le tout pouvant constituer une véritable inhibition des motivations, associant un déficit de l'activité professionnelle ou scolaire, des troubles du fonctionnement intellectuel (fatigabilité, pensée abstraite, difficulté de concentration, troubles de la mémoire, pauvreté idéatoire) et une indifférence affective qui a pour corollaire un rétrécissement de la vie relationnelle.
d) Des effets neuro-psychiatriques détectés
Outre des effets physiques et psychiques avérés, l'usage de cannabis a pu être incriminé dans l'apparition de certaines schizophrénies, même si la question de savoir s'il s'agit d'un processus créé par l'abus de cannabis, ou de l'activation d'un processus pathologique sous-jacent, n'est pas tranchée.
Le docteur Jean-Luc Saladin a ainsi exposé devant la commission l'étude du chercheur suédois Andreasson qui a suivi 50.000 conscrits pendant une vingtaine d'années : « Cette étude démontre que, pour les sujets sans cannabis, on est aux alentours de cinq cas de schizophrénie pour mille patients alors que, dans le groupe qui prend plus de cinquante joints, on est à trente cas de schizophrénie pour mille patients ».
D'après l'étude précitée de l'INSERM, la prévalence des troubles schizophréniques chez les sujets abuseurs ou dépendants au cannabis est de 6 %, alors qu'elle est d'environ 1 % en population générale. En outre, 36 % des sujets schizophrènes hospitalisés ont été ou sont dépendants au cannabis.
Par rapport aux schizophrénies isolées, l'association d'une schizophrénie à un abus de cannabis se caractérise par des troubles plus précoces, une moindre observance thérapeutique, un recours plus fréquent à l'urgence et à l'hospitalisation, une plus grande désinsertion sociale, des risques de dépression et de passage à l'acte suicidaire plus marqués, des troubles psychotiques plus fréquents et une difficulté à élaborer une demande de soins. Cette association entre troubles schizophréniques et usage abusif de cannabis pourrait avoir plusieurs origines : automédication d'une schizophrénie primaire pour tenter d'en soulager les premiers symptômes ou consommation de cannabis primaire avec développement d'un trouble schizophrénique secondaire.
Le rapport précité de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur l'impact éventuel de la consommation des drogues sur la santé mentale de leurs consommateurs, paru en février 2002, concluait déjà que « les conséquences à long terme d'une forte consommation de cannabis sur le cerveau demeure un objet de controverse ».
Cette conclusion rejoint celle du rapport du Sénat canadien précité : « La plupart des études tendent à démontrer que les ex-consommateurs récupèrent globalement l'ensemble des fonctions cognitives, mais selon la durée de la consommation, des perturbations multiples pourraient persister, notamment sur la capacité à traiter des informations complexes. (...) Selon l'expertise collective de l'INSERM, l'âge de début de la consommation pourrait être un facteur discriminant ».
La commission ne peut que souhaiter la poursuite des recherches dans ce domaine afin d'obtenir rapidement une information claire pour définir une politique de prévention plus efficace.
Le cannabis ne saurait donc être considéré comme une drogue « douce », comme en témoignent enfin les propos tenus par le docteur Edwige Antier, pédiatre, devant la commission : « Le fait de parler d'une drogue douce ne veut rien dire. C'est une drogue qui endort, qui marginalise et qui met finalement ses consommateurs dans un état de dépression, parce qu'à 22 ou 23 ans, quand on n'a rien fait et qu'on s'est mis de côté, il est vraiment difficile de retrouver ensuite son chemin alors que la société ou la famille ne vous soutiennent plus de la même façon. »
Il est enfin malvenu de continuer à parler de drogue douce si sa consommation conduisait à celle de drogues dites « dures ». Si ce passage ne concerne qu'une minorité de cas, et heureusement compte tenu du grand nombre de jeunes fumeurs de cannabis dans notre pays, il reste qu'un très grand nombre des usagers de drogues dures fument ou ont fumé du cannabis.
3. Les drogues de synthèse et les nouvelles drogues : le fléau de demain ?
a) Des produits diversifiés aisément accessibles
A côté des drogues traditionnelles tirées directement des plantes, une série de substances est apparue avec le développement de la chimie : les nouvelles drogues.
L'une des caractéristiques de la consommation de ces nouvelles substances réside dans le fait que l'usage récréatif a graduellement remplacé une consommation fondée sur des motivations religieuses, sociales ou culturelles. L'éventail de l'usage lui-même s'est élargi : naguère conçue comme utilitaire (on prenait de la drogue comme médicament ou pour améliorer ses performances au travail, pour les premières amphétamines), la consommation devient une fin en soi , la seule motivation étant désormais d'en expérimenter les effets. Une étape est aujourd'hui franchie avec le passage du médicament à la drogue synthétique. La plupart des drogues nouvelles qui apparaissent sur les marchés illicites n'ont désormais plus aucun usage thérapeutique.
On rappellera à cet égard que la prescription de stimulants synthétiques (amphétamines notamment) est limitée à trois indications, faisant d'ailleurs l'objet de controverses dans le milieu médical : la narcolepsie (accès soudain d'endormissement diurne), l'obésité et le traitement des enfants hyperactifs (notamment aux États-Unis).
Tout au long du siècle dernier, un glissement dangereux s'est opéré avec le passage d'une fabrication et d'un usage licites des substances chimiques (la MDMA a été synthétisée en 1912 dans un but militaire pour accroître l'effet coupe-faim des amphétamines, mais n'a jamais obtenu d'autorisation de mise sur le marché, même si elle a brièvement été utilisé en psychiatrie dans les années 1970 en Californie), à une synthèse et des abus illicites. Ces nouvelles drogues sont désormais fabriquées par synthèse dans des laboratoires clandestins.
|
LA FABRICATION ARTISANALE DES NOUVELLES DROGUES
Afin de produire des drogues de synthèse, les fabricants doivent d'abord se procurer des précurseurs, c'est-à-dire des produits chimiques autorisés (utilisés, par exemple, par l'industrie de la peinture) et deux produits illicites, le BMK pour les amphétamines et le PMK (issu d'un arbre chinois) pour la MDMA. La production s'effectue dans des laboratoires clandestins (camion, bâtiment de chantier, cave, etc.). Certains trafiquants se spécialisent d'ailleurs dans la fabrication de fûts destinés à ces laboratoires. La production de ces drogues chimiques présente des dangers, comme en témoignent les explosions fréquentes de laboratoires, parfois en centre ville, et s'avère polluante : ces laboratoires sont ainsi souvent repérés par l'odeur de leurs rejets dont la toxicité dépend de la méthode de production utilisée. La commission d'enquête a pu visiter un laboratoire clandestin reconstitué par l' Unit synthetische drugs (USD). On lui a indiqué que trois méthodes de production plus ou moins artisanales étaient utilisées pour les drogues chimiques, les produits étant parfois mélangés dans un robot de cuisine ou un aspirateur : - la méthode, inventée par un chimiste allemand au 19 e siècle pour la fabrication des amphétamines, consiste à faire bouillir le BMK avec d'autres précurseurs afin d'obtenir une huile d'amphétamine, qui est ensuite purifiée et cristallisée pour obtenir des cachets. Depuis trois ou quatre ans, les laboratoires clandestins démantelés sont dotés de fûts métalliques ; - la méthode du catalyseur pour le MDMA consiste à mélanger du PMK, de l'huile de sassafra et d'autres produits dans un fût en acier, puis à catalyser électriquement le mélange en tentant de limiter les risques d'explosion ; l'huile de MDMA est ensuite purifiée et cristallisée ; - la méthode froide consiste à placer des jerricans contenant un mélange de produits chimiques dans un congélateur à - 20°. Une dernière méthode, rarement utilisée, utilise des feuilles d'aluminium pendant la combustion et du mercure comme catalyseur. Le poids des pilules d'ecstasy ou d'amphétamine ainsi produites est d'environ 300 mg. Le consommateur ne connaît jamais leur composition exacte et leur dangerosité peut être extrêmement variable. Ces pilules, façonnées à l'aide d'outillages utilisés dans l'industrie pharmaceutique, sont de forme et de couleurs différentes (sans rapport avec leur composition) et sont marquées d'un logo, souvent de grandes marques (Nike, Armani, Mitsubishi, Rolls-Royce...) qui nuisent évidemment à l'image des entreprises concernées. Il serait souhaitable que, dans le cadre d'une véritable prévention contre les drogues chimiques, les sociétés concernées se constituent partie civile et mettent en place une politique de communication claire à destination de leurs clients, en condamnant de telles fabrications. |
La possibilité de fabriquer clandestinement des stimulants synthétiques de manière relativement simple contribue évidemment à la diffusion de ces substances. De nouvelles substances synthétiques illicites apparaissent régulièrement, ce qui explique qu'il soit difficile d'en connaître les effets et les conséquences à longue échéance en termes de santé publique.
Certains responsables politiques, alertés par les médecins et les associations de terrain, ont commencé à prendre conscience de l'ampleur de ce nouveau fléau et à développer la recherche scientifique dans ce domaine. La création de l' Unit synthetische drugs (USD) aux Pays-Bas en 1997, sous la pression des Etats-Unis, constitue un précédent dont notre pays pourrait s'inspirer, compte tenu du développement de la consommation de ces nouveaux produits en France et de l'apparition des premiers laboratoires.
Dans son ouvrage controversé, « Savoir plus, risquer moins » 42 ( * ) , la MILDT a établi un inventaire des drogues de synthèse :
- l' ecstasy se présente sous la forme de comprimés de couleurs et de formes variées, ornés d'un motif. Elle désigne la molécule chimique MDMA (3,4 méthylènedioxyméthamphétamine) et s'apparente à la fois aux psychostimulants et aux hallucinogènes de type LSD. Cette molécule est toutefois souvent mélangée à d'autres substances (amphétamines, analgésiques, hallucinogènes, anabolisants) et peut même être coupée avec de la caféine, de l'amidon, des détergents ou du savon ;
- le LSD (diméthylamide de l'acide lysergique) est obtenu à partir de l'ergot de seigle (champignon parasite du seigle). C'est un hallucinogène puissant, qui se présente sous la forme d'un buvard, d'une « micropointe » (ressemblant à un morceau de mine de crayon) ou sous forme liquide ;
- les amphétamines (speed, ice ou cristal) sont des psycho-stimulants puissants et coupe-faim. Elles se présentent sous forme de cachets ou de poudre à sniffer et sont très souvent coupées avec d'autres produits ;
- les poppers sont des vasodilatateurs utilisés en médecine pour soigner certaines maladies cardiaques. Ils contiennent des nitrites de butyle et de pentyle et sont interdits au public depuis 1980 ;
- le gamma OH ou GHB est vendu en poudre ou en granulés à dissoudre dans l'eau. Utilisé en anesthésie, et plus particulièrement en obstétrique, le GHB peut produire des états d'amnésie ou d'ébriété. En raison de ces propriétés parfois utilisées à des fins criminelles, il est également appelé « drogue du viol ». Si plusieurs cas ont été rapportés à la commission, il est toutefois difficile d'évaluer dans quelle mesure l'utilisation du GHB à des fins d'agression sexuelle est répandue ou en progression, car ces pratiques restent sous-déclarées. Le développement de la « toxicomanie cool » et l'utilisation banalisée de psychotropes dans les relations sexuelles apparaissent particulièrement préoccupantes ;
- la kétamine (ou spécial K ), vendue sous forme de comprimés sous le label « ecstasy », présente des effets hallucinogènes et possède des propriétés anesthésiques et analgésiques ;
- le protoxyde d'azote ou gaz hilarant . Utilisé notamment dans les aérosols alimentaires, il est inhalé dans les soirées festives sous forme de ballons vendus à un prix modique. Compte tenu de la brièveté de ses effets et de l'aspect folklorique de sa consommation, il est perçu par beaucoup de consommateurs comme inoffensif et anodin.
La plupart de ces produits ont des effets psychoactifs dangereux, dont les manifestations peuvent toutefois varier d'une substance à l'autre (hallucinations, crises d'angoisse, vertiges, anémies, perte de connaissance, troubles digestifs, acné...).
b) L'ecstasy : une mode dangereuse
La commission soulignera tout particulièrement les effets de la consommation la plus répandue, celle de l'ecstasy , le plus souvent ignorés du fait de l'image festive de cette drogue depuis son apparition dans les années 1980, et son développement dans les années 1990 avec le mouvement des rave parties.
Si les effets de la consommation de MDMA sont généralement ignorés, on remarquera cependant que la dangerosité du produit apparaît comme un fait acquis pour plus des trois quarts des Français, ainsi que le montre la dernière enquête de l'OFDT 43 ( * ) , « la proportion d'individus jugeant que l'ecstasy est dangereuse dès la première expérimentation , passant de 75,6 % à 78,6 % alors que la proportion de personnes qui disaient ne pas connaître la substance a décru, passant de 4,9 à 3,3 %. »
On rappellera que les effets recherchés par la prise d'ecstasy sont l'empathie, un sentiment de paix et de sérénité, l'amélioration des performances et de la communication, l'amplification des expériences sensorielles accompagnés d'une euphorie importante. Il est cependant aujourd'hui largement admis que la MDMA a des conséquences redoutables sur l'organisme du consommateur . Ces effets ont été notamment mis en lumière par l'expertise collective de l'INSERM sur l'ecstasy en 1998 44 ( * ) .
Dans le même sens, le rapport Roques précité sur la dangerosité des drogues mentionne plusieurs conséquences physiques graves dues à l'ecstasy : manifestations de coagulation intravasculaire, insuffisances rénales aiguës, et cas d'anémie aplasique. Des cas d'accidents cérébrovasculaires sévères apparemment induits par la MDMA ont également été évoqués devant la commission par le professeur Renaud Trouvé, pharmacologue, les risques semblant plus élevés en cas de vulnérabilité neurologique préexistante, d'utilisation d'alcool et d'autres substances. D'autres troubles physiologiques sont aussi déclenchés par la consommation de MDMA, tels que : tension musculaire, nausée, vision brouillée, faiblesse générale, frissons ou transpiration, soit des symptômes semblables à ceux d'une forte insolation. Le rapport mondial précité sur les drogues paru en 1996 signale également que « la surcompensation consistant à ingurgiter de grandes quantités d'eau aboutit parfois à une réhydratation excessive pouvant provoquer la mort. »
On observe également, plusieurs jours après la prise, que les douleurs musculaires, le sentiment de fatigue générale et la dépression subsistent et que l'abus prolongé d'ecstasy peut sérieusement endommager certains organes comme le foie, le cerveau et le coeur.
La nouvelle tendance consistant à prendre de l'ecstasy par injection confère une nouvelle dimension à une drogue considérée jusque-là comme « propre », précisément parce qu'on la prenait par voie orale. On notera enfin une contre-indication entre l'ecstasy et les contraceptifs oraux, qui peut se traduire par un risque accru d'hépatites.
Force est donc de constater que la consommation d'ecstasy peut provoquer des effets graves et même conduire à la mort, ce que ne mentionne pas la brochure de prévention de la MILDT qui qualifie seulement cette consommation de dangereuse. La commission ne peut que s'étonner d'un tel « oubli », alors que des cas de décès sont connus, comme l'ont rappelé les professeurs Patrick Mura et Renaud Trouvé, respectivement toxicologue et pharmacologue, lors de leur audition.
Selon l'OFDT 45 ( * ) , deux décès associés à la consommation d'ecstasy ont été recensés en 1999. En 2000, un seul cas est rapporté mais la présence d'ecstasy a également été décelée dans trois autres décès liés à l'héroïne, la cocaïne ou la méthadone.
Outre les effets physiques, les effets psychiques et psychologiques de la prise d'ecstasy sont de plusieurs ordres : confusion, dépression, anxiété et paranoïa dans les cas extrêmes, qui relèvent de l'ordre psychiatrique. Le risque neuro-psychiatrique lié à la consommation de ce produit est donc réel, comme il l'est également pour la plupart des drogues chimiques. Le docteur Francis Curtet, psychiatre, a exprimé le même point de vue sur le LSD devant la commission : « Le LSD, c'est horriblement dangereux : c'est comme si on prenait un aller simple pour la folie ; on n'est jamais certain de revenir du voyage, quoi qu'il arrive » .
Le rapport Roques indique pour sa part que : « des effets psychiatriques ont été rapportés soit dans les jours, soit dans les mois qui suivent la prise. Les troubles les plus fréquents sont des troubles anxieux notamment de type d'attaques de panique, des troubles dépressifs, des troubles du sommeil, des « flash-back » et des troubles psychotiques. »
L'ecstasy est, en outre, susceptible de provoquer une dégénérescence des cellules nerveuses, dont on ne sait à l'heure actuelle si elle est réversible. D'après l'expertise de l'INSERM 46 ( * ) , la prise de MDMA peut être responsable de complications psychosomatiques immédiates ou différées. La possibilité de voir apparaître à long terme des maladies neurodégénératives chez les consommateurs réguliers d'ecstasy n'est par ailleurs pas exclue, comme le professeur Bernard Roques l'a lui-même affirmé devant votre commission : « (...) Le vrai problème avec l'ecstasy, c'est qu'on n'est toujours pas sûr qu'il ne provoquera pas à long terme une destruction irréversible des neurones et, par conséquent, qu'il pourra engendrer des maladies irréversibles comme la maladie de Parkinson. »
Quoi qu'il en soit, « ces propriétés font de la MDMA un produit toxique indépendamment de tout abus » , ainsi que concluait, dans son rapport sur l'impact des drogues sur la santé mentale des consommateurs, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifique et technologique.
Cette toxicité est encore plus avérée avec le développement de comprimés de MDMA fortement dosés vendus dans les lieux festifs , comme les « méga dancings » de la frontière franco-belge : l'association Spiritech (chargée de faire de la prévention dans ces lieux) l'a signalé à la commission lors de son déplacement à Valenciennes. Ce phénomène a été confirmé par une note d'information de l'OFDT 47 ( * ) faisant état de produits collectés dans le cadre du dispositif SINTES. Dans les cas cités par l'OFDT, la dose létale minimale de 150 mg est nettement dépassée par la prise de deux comprimés.
Ces éléments ne peuvent que conduire, même si des incertitudes subsistent, à ce que le principe de précaution soit mis en oeuvre à l'égard de l'ecstasy et de l'ensemble des drogues chimiques en général.
Les propos tenus devant la commission par le docteur Didier Jayle, président de la MILDT « les drogues de synthèse sont peut-être le fléau de demain. Si vous m'auditionnez dans cinq ans, je vous dirai peut-être que le seul problème en France est celui des drogues de synthèse » et par M. Jean-François Mattei « vous avez parlé des drogues synthétiques. Tous les spécialistes (...) pensent que c'est le grand danger de demain parce que l'on pourra composer des drogues avec des substances inattendues, imprévues. Il faudra que, dans le domaine de la santé publique, nous ayons véritablement une prévention consistant à saisir le comportement anormal. Il faudra probablement que nous développions cela. » résument bien la gravité de ce nouveau problème et l'urgence qu'il y a à l'intégrer dans une politique de santé publique.
B. DES DOMMAGES SOCIAUX RECONNUS
1. Le risque de désocialisation
S'il a concerné pendant longtemps essentiellement les usagers de drogues dures (à travers l'image de l'héroïnomane marginalisé, fréquentant un microcosme constitué de personnes et de lieux fortement stigmatisés), le risque de désocialisation s'étend de façon inquiétante aux usagers de drogues dites douces, notamment de cannabis et d'ecstasy, et met en cause une population de plus en plus jeune.
La diminution de la sociabilité du consommateur de drogue provient à la fois des effets physiques et psychiques liés à la consommation du produit. Physiologiquement tout d'abord, les substances psychoactives endommagent le cortex, les communications entre les synapses se faisant moins vite et moins facilement (excepté en ce qui concerne les stimulants, du moins à court terme) : le sujet raisonne plus difficilement, voit sa mémoire s'altérer et finit par se trouver prisonnier d'un état de conscience modifié lui faisant percevoir la réalité extérieure à travers une sorte de halo et l'empêchant de s'intéresser et de se concentrer de façon prolongée sur un sujet déterminé.
D'un point de vue psychique d'autre part, dès lors que s'installe un phénomène de dépendance, l'usager de drogue consacre une partie sans cesse croissante de son temps à trouver les moyens de se procurer une nouvelle « dose » de la substance à laquelle il est « accroc », sous peine d'éprouver une sensation de « manque ». Pour les cas les plus graves, le sujet finit par vivre perpétuellement dans l'anxiété de ne pouvoir renouveler son produit et consacre à sa recherche (ainsi qu'à la recherche des moyens permettant de le financer) l'essentiel de ses activités, se coupant ainsi de son environnement extérieur.
a) Les drogues « dures », sources traditionnelles de désocialisation
Le risque de désocialisation est d'autant plus fort que la toxicité et le degré de dépendance au produit considéré est important. A cet égard, l'héroïne reste la drogue illicite la plus « désocialisante » 48 ( * ) . Très rapidement en effet, la vie de l'héroïnomane se concentre autour de la drogue pour finalement s'y réduire totalement. Le rendement scolaire, universitaire ou professionnel est fortement réduit ou devient nul (absentéisme, détachement, inattention...). Le champ des intérêts, subordonné à la seule acquisition et consommation de drogue, s'étiole. Le toxicomane se replie sur lui-même, manifeste une totale indifférence à l'égard des autres, notamment de la famille, néglige sa tenue vestimentaire, ne prend plus soin de son hygiène et finit par ne plus supporter que la compagnie d'autres héroïnomanes.
Bien que de nombreux cocaïnomanes puissent mener une vie sociale et professionnelle apparemment normale, la consommation de cocaïne excessivement répétée, à des doses importantes ou par des personnes particulièrement vulnérables provoque fréquemment des troubles graves du comportement induisant à terme un risque important de désocialisation. Souffrant d'insomnies, d'anxiété et d'un sentiment général de malaise lorsqu'il n'est plus sous l'emprise du produit, le sujet devient irritable, en proie à des psychoses ou à des réactions paranoïaques. Concentrant son quotidien sur l'obtention de sa « dose », il devient méfiant à l'égard de son entourage et perd famille, amis et emploi.
b) Les drogues de synthèse et le cannabis, facteurs nouveaux de désocialisation
- Si les effets psychophysiologiques de l'ecstasy et des autres drogues de synthèse sont encore mal connus, il semble toutefois que nombre de ceux déjà isolés puissent avoir des conséquences désocialisantes sur les sujets concernés. L'état anxieux, dépressif et confusionnel fréquemment ressenti le lendemain d'une consommation ponctuelle peut en effet s'amplifier et perdurer pendant plusieurs semaines, selon le degré de vulnérabilité du consommateur.
Associé à une dépendance psychique, à une asthénie avec des troubles du sommeil (de la somnolence légère à l'insomnie aiguë), à des troubles de l'humeur (état dépressif, irritabilité), à des troubles sensoriels (engourdissements, sensation de froid), à des troubles cognitifs (diminution de l'attention, de la mémoire) et à la survenance possible de complications psychiatriques (parmi lesquelles des phobies secondaires avec de fréquentes conduites agoraphobiques), cet état de mal-être physique et mental peut très facilement provoquer un éloignement du sujet de ses relations familiales, sociales ou professionnelles.
- Quant au cannabis , dont il a longtemps, et jusqu'à récemment, été dit qu'il n'occasionnait pas de dommages sociaux, ses effets « désocialisants » semblent être aujourd'hui reconnus, particulièrement chez les jeunes.
Le rapport 2001 de l'INSERM sur les effets du cannabis 49 ( * ) fait référence à des études ayant montré comment le cannabis provoque une altération de la perception temporelle, des troubles de la mémoire à court terme et une incapacité à accomplir des tâches multiples simultanées, ainsi que des troubles du langage et de la coordination motrice en cas de consommation plus importante. Le rapport conclut sur ce point que « ces troubles de la mémoire et des facultés d'apprentissage peuvent également retentir sur le travail scolaire et l'adaptation sociale », ajoutant qu'« il s'agit là de l'altération la plus problématique, car la plus fréquemment rencontrée, liée à la prise répétée de cannabis ».
Par ailleurs, tout en indiquant que différentes études, expérimentales ou menées chez des élèves, des étudiants ou des travailleurs, sont parvenues à des résultats contradictoires concernant l'impact de la consommation de cannabis sur la performance et la réussite scolaire ou professionnelle, le rapport fait état d'observations cliniques ayant décrit un état de « démotivation des consommateurs réguliers » et des « syndromes amotivationnels sévères (...) chez de grands consommateurs » (déficit de l'activité professionnelle ou scolaire, mais également pauvreté idéatoire et indifférence affective).
Dans une thèse présentée en 2002 sur les dangers du haschisch 50 ( * ) , l'auteur décrit ce « syndrome amotivationnel » identifié par deux scientifiques dès 1968 et observé par deux autres en 1973 comme associant les signes suivants : apragmatisme, apathie, perte de la capacité de projection dans l'avenir, perte de l'élan vital, désintérêt, émoussement des affects, manque d'ambition, diminution de l'efficience intellectuelle, intolérance aux frustrations, troubles mnésiques et troubles de la concentration.
L'auteur de la thèse mentionne par ailleurs l'étude menée voici quelques années par un chercheur suédois sur 400 usagers de cannabis qui a permis de décrire le profil type du grand consommateur. Selon l'étude, ce dernier a des difficultés à trouver ses mots, présente une capacité limitée à apprécier un livre, un film ou une pièce de théâtre, ressent de la tristesse ou du vide dans son quotidien, ne supporte pas la critique, pense que ses problèmes viennent des autres, ne supporte pas la moindre frustration, est incapable de mener un dialogue, a des problèmes d'attention et de concentration, ne peut planifier sa journée ...
Toujours en ce sens, les docteurs Léon Hovnanian et Renaud Trouvé font état, dans une fiche réalisée pour le CNID, d'un « ralentissement de l'intérêt intellectuel », d'une « certaine indifférence » et d'un « éloignement de la vie sociale » en cas de consommation régulière de cannabis. Largement documenté, ce risque de désocialisation touche particulièrement les jeunes, surreprésentés parmi la population consommatrice de cannabis.
Utilisé de façon répétitive ou intensive, le professeur Roger Nordmann a dit ainsi du cannabis devant la commission qu'« il modifie la qualité de vie, il démotive, il déconnecte et il peut désocialiser », ajoutant que cela se manifeste d'abord chez un jeune adolescent par « un désintéressement vis-à-vis de son entourage, en particulier vis-à-vis de ses parents ». A terme, le jeune risque « d'être totalement désocialisé et de ne plus avoir du tout la possibilité de s'insérer dans la vie ».
De même, le docteur Léon Hovnanian a indiqué que le cannabis favorisait la « fuite en avant » chez le jeune : progressivement, la dépendance s'installe et le cannabis « diminue les facultés intellectuelles et les facultés de mémoire, ce qui entraîne l'échec scolaire, une désocialisation et une perte d'intérêt à tout ».
Le docteur Edwige Antier, psychiatre, a confirmé ce constat devant la commission en indiquant que la consommation de cannabis par un jeune « en pleine période d'apprentissage de sélection dans ses cursus (...) provoque chez lui un syndrome amotivationnel qui lui retire sa motivation ». L'adolescent se trouve ainsi « marginalisé à l'âge clef où les choix se font pour lui », éprouvant des difficultés à obtenir son baccalauréat et à intégrer des études supérieures, lorsqu'il y parvient, et à « retrouver ensuite son chemin alors que la société ou la famille ne (le) soutient plus de la même façon ».
Evoquant à cet égard la thèse précitée de l'un de ses élèves, portant sur les effets du cannabis, le docteur Jean-Luc Saladin a mentionné devant la commission les « deux cents patients référencés dans son cabinet qui sont en échec psychosocial majeur du fait de leur rencontre avec le cannabis ». Citant Baudelaire (« le haschisch rend la société inutile à l'homme comme l'homme inutile à la société »), il a expliqué que l'individu ne possédant plus de fonctions exécutives « n'est plus un zoon politicon, un animal fait pour vivre en société », qu'il « est prisonnier du présent » et que « les autres n'ont pas d'existence réelle » pour lui.
Enfin, interrogé sur les liens entre l'utilisation de drogues et la marginalisation, M. Jean-Pierre Carbuccia-Berland, Directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice, a indiqué à la commission que le cannabis, lorsqu'il s'ajoute à des précarités sociales, scolaires ou familiales préexistant, constitue « très clairement un facteur qui contribue à maintenir la personne dans la désocialisation ».
2. Le lien entre usage de drogues et délinquance
En 1993, M. Charles Pasqua, alors ministre de l'Intérieur, avait provoqué une polémique en affirmant que les drogues étaient à l'origine de 50 % de la délinquance. De même, M. Pierre Mutz, directeur général de la gendarmerie nationale, a indiqué lors de son audition par la commission d'enquête que « l'usage de produits stupéfiants est la cause d'une délinquance active et souvent violente qui pèse directement sur l'insécurité ressentie par nos compatriotes ». La lutte contre « le développement du trafic de drogues qui génère en amont comme en aval de multiples formes de délinquance » est donc érigée au rang de priorité par la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure 51 ( * ) .
Mais si les enquêtes révèlent indéniablement une prévalence de la délinquance supérieure chez les usagers de drogues, la relation entre l'usage de substances psychotropes et la délinquance n'est pas univoque et il est difficile de distinguer la cause de l'effet.
a) Une corrélation indéniable
Ainsi que l'a souligné M. Hugues Lagrange, sociologue au CNRS, lors de son audition par la commission d'enquête, la recherche française en sciences sociales a longtemps été réticente pour admettre le lien entre drogues et délinquance, alors même qu'il était depuis longtemps considéré comme un fait incontournable outre-Atlantique.
Dans les pays anglo-saxons, on constate 52 ( * ) que la proportion de consommateurs de drogue chez les jeunes incarcérés aux Etats-Unis est plus de deux fois supérieure à celle des adolescents du même âge dans la population totale 53 ( * ) . De même, 80 % des détenus ont fait usage de drogues illicites avant leur incarcération, essentiellement du cannabis et de la cocaïne, 60 % en consommaient régulièrement et près de 30 % avaient commis leurs délits sous l'influence de ces drogues ; 20 % admettaient avoir agi ainsi pour s'en procurer 54 ( * ) .
M. Hugues Lagrange a également indiqué qu'en 1998, 11 % des 16-20 ans arrêtés au Royaume-Uni pour un délit en dehors de la drogue avaient été testés positifs aux opiacés, alors que seuls 1,5 % des 16-20 ans étaient des expérimentateurs d'opiacés et 0,3% des consommateurs réguliers. Il a souligné la différence considérable quant aux propensions à la consommation de drogues dures (de 1 à 30) chez les jeunes délinquants et les autres. Il a également fait état d'une étude britannique 55 ( * ) établissant que le risque de délinquance violente était de 3,9 pour les utilisateurs de marijuana, 2,5 pour les éthyliques chroniques et 1,9 pour les schizophrènes.
En France, les études sont rares et très circonscrites. Elles se fondent sur l'analyse des mis en cause dans des procès-verbaux transmis à la justice 56 ( * ) , c'est-à-dire des personnes bi-impliquées, dans des infractions à la législation sur les stupéfiants, mais aussi dans d'autres catégories d'infractions.
En 1991, sur 1.000 délinquants étudiés dans le XVIII e arrondissement de Paris, 266 étaient mis en cause pour usage de drogue et pour d'autres faits. Parmi les usagers de drogues, 68 % étaient impliqués pour faits de délinquance ou de trafic-vente (85 % pour les usagers d'héroïne). 31 % des personnes impliquées dans des affaires de délinquance étaient des usagers de drogues, dont 13 % des héroïnomanes 57 ( * ) .
Cette enquête, menée dans le XVIII e arrondissement, marquée par l'importance du nombre de toxicomanes mis en cause par la police, semble indiquer que le chiffre de 13 % de délinquants héroïnomanes représente un plafond. Réitérée en 1997 dans un endroit différent du nord de Paris, elle a conclu à 4 % d'usagers de drogues dures parmi les personnes mises en cause. Cette diminution pourrait être due à la politique de réduction des risques menée entre-temps. Le docteur Lucien Abenhaïm, directeur général de la santé, a ainsi estimé lors de son audition qu'elle avait apporté des gains considérables en termes de prévention de la délinquance.
Si les usagers de drogues dites dures ne constituent donc pas l'essentiel des délinquants, leur prévalence dans la délinquance est néanmoins nettement supérieure.
S'agissant de la délinquance des jeunes 58 ( * ) , l'étude de M. Sébastian Roché montrait que 83 % des usagers réguliers de cannabis avaient commis un petit délit, contre 73 % des consommateurs occasionnels et 48 % des non-expérimentateurs de drogue. 26 % des usagers fréquents de cannabis avaient perpétré un acte grave de délinquance, contre 14 % des consommateurs occasionnels et 9 % des autres jeunes de l'enquête.
De plus, les usagers de drogues sont plus actifs dans la délinquance que la moyenne des délinquants . Au cours des deux années précédentes, les usagers fréquents de cannabis avaient commis en moyenne 11,6 délits peu graves et 1,3 acte plus sérieux, les prévalences étant de 7,2 et 0,4 délits chez les consommateurs occasionnels de drogues et 3,8 et 0,3 s'agissant des autres adolescents. Un jeune sur cinq consommant fréquemment du cannabis avait fait du trafic durant cette période, 93 % des revendeurs étant des utilisateurs réguliers.
Enfin, M. Jean-Pierre Carbuccia-Berland, directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, a indiqué lors de son audition par la commission que l'enquête réalisée en 1998 auprès des jeunes de 14 à 21 ans pris en charge par ses services révélait que 60 % avaient déjà expérimenté une drogue. Il convient de rappeler que ces jeunes sont soit des mineurs délinquants, soit des mineurs en danger.
Le lien entre drogue et délinquance, ressenti empiriquement, est donc clairement établi par la recherche.
b) Les incertitudes quant à la nature de ce lien
Rien n'indique en l'état actuel des recherches que la consommation de drogues soit de nature à « provoquer » à elle seule l'acte délinquant ni, à l'inverse, que la délinquance conduise nécessairement à un usage répété de produits stupéfiants. Plusieurs thèses ont été avancées.
(1) La délinquance comme moyen de financer une consommation de drogue
Les tenants du modèle « économico-compulsif » postulent que le besoin du consommateur de se procurer des drogues dispendieuses le conduira à recourir à des activités criminelles pour financer sa pratique.
Cette hypothèse paraît particulièrement intéressante s'agissant de consommateurs réguliers de drogues dites dures, comme l'héroïne ou la cocaïne, pour lesquels de nombreuses études ont mis en évidence la forte implication criminelle : 72 % de participants à un programme de substitution à la méthadone admettaient qu'une de leurs principales sources de revenus consistait à vendre des drogues, à commettre des vols (également par effraction ou avec violence) ou à se prostituer 59 ( * ) . Les revenus engendrés par l'implication criminelle d'un héroïnomane étaient estimés en 1991 à près de 20.300 euros par an 60 ( * ) . Mme Marie-Danielle Barré soulignait que l'hypothèse de la délinquance comme source de revenus nécessaire pour l'usager, et donc comme conséquence de l'usage, concernait principalement les usagers de drogues dures qui, dans l'enquête du CESDIP, ne représentaient que 13 % des personnes mises en cause pour « petite et moyenne délinquance ».
Néanmoins, un tel phénomène peut également toucher de jeunes consommateurs réguliers de cannabis, dont le seul argent de poche ne suffit pas à financer une consommation régulière. Comme l'indiquait lors de son audition M. Michel Bouchet, chef de la mission de lutte anti-drogue au ministère de l'intérieur, il est probable que l'importance de la consommation de cannabis et d'autres produits dans les classes de l'enseignement secondaire n'est pas étrangère à l'insécurité régnant dans certains établissements . Il a ainsi estimé que le coût d'une forte consommation de cannabis -jusqu'à 400 euros par mois- pouvait expliquer dans une certaine mesure le développement du racket. De même, Mme Catherine Domingo, substitut du procureur de Bayonne, a indiqué à la commission d'enquête que la consommation de stupéfiants pouvait générer, de la part des jeunes, des vols ou des cambriolages, notamment chez leurs parents.
Néanmoins, les indicateurs statistiques de la Chancellerie ne permettent pas de corréler la consommation de stupéfiants avec des délits bien identifiés tels que vols ou violences.
(2) La drogue, source de désinhibition et donc de violence
Les propriétés psychopharmacologiques des drogues, par leur action sur certains centres spécifiques du système nerveux central, conduiraient à l'adoption de comportements violents : certains crimes ou délits seraient ainsi directement liés au fait que les victimes ou les auteurs de ces infractions étaient alors sous l'emprise de drogues ou de certains médicaments psychoactifs 61 ( * ) .
Les consommateurs, notamment adolescents, seraient plus enclins à risquer des agissements délictueux du fait d'un abaissement du seuil d'inhibition consécutif à l'usage de stupéfiants . Un pharmacien toxicologue a ainsi souligné lors de son audition qu'en qualité d'expert judiciaire, il avait observé la présence de THC dans le sang de victimes ou de délinquants dans de nombreuses affaires criminelles. Il semblerait qu'une consommation élevée de cannabis rende la personne incapable d'analyser une situation dangereuse et la conduise à des provocations. De même, M. Pierre Cardo, député-maire de Chanteloup-les-Vignes, a souligné devant la commission d'enquête que l'usage de drogues pouvait rendre des jeunes totalement imprévisibles et incontrôlables : « En traversant la rue, ils vont brutalement avoir l'idée qu'ils pourraient faire un braquage et passer à l'acte instantanément . »
Cette relation entre intoxication et violence, ressentie empiriquement, n'a toutefois pas fait l'objet d'études sérieuses jusqu'à présent 62 ( * ) .
(3) Le lien avec le grand banditisme
Selon M. Xavier Raufer, criminologue entendu par la commission d'enquête, la dépénalisation (légale ou de fait) de drogues est susceptible d'exacerber la concurrence entre trafiquants , les exclus se tournant alors accessoirement vers le vol à main armée et le braquage, comme l'indiquerait la récente explosion des vols à main armée en France (plus de 50 % en un an). Il a d'ailleurs rappelé que la dépénalisation des drogues en 1982 en Espagne avait été suivie d'une explosion des vols à main armée . Il a en outre estimé que les jeunes liés au grand banditisme avaient également recours aux trafics de machines à sous et au racket, les braquages étant des sources de revenus irrégulières.
Cette analyse est partagée par M. Pierre Cardo, député-maire de Chanteloup-les-Vignes. Il a ainsi indiqué lors de son audition que les récentes opérations menées par les groupements d'intervention régionaux avaient certes provoqué une baisse de la délinquance « expressive » (provocations et agressions), les jeunes étant plus méfiants, mais que l'on assistait parallèlement à une augmentation de la délinquance d'appropriation (cambriolages et vols). Les besoins d'argent perdurant alors même que le trafic de drogue ne permet plus de les satisfaire, se développent des filières organisées de vols de voitures ou de matériel informatique.
(4) Drogue et délinquance : deux effets d'une même cause, le rôle des pairs
Si consommation de drogues illicites et criminalité sont souvent susceptibles d'être observées chez un même individu, la dynamique entre ces deux comportements reste encore mal comprise. L'existence d'une relation statistique entre drogue et criminalité ne signifie pas nécessairement que la consommation de produits psychoactifs précède les délits dans le temps 63 ( * ) . Ainsi, le docteur Francis Curtet, psychiatre ayant exercé pendant 10 ans en prison, a indiqué lors de son audition qu'un quart des toxicomanes détenus étaient délinquants avant de devenir toxicomanes.
On doit distinguer, d'une part, un usage de drogues illicites festif ou récréatif, voire de performance, qui est le fait de jeunes venant de tous les milieux, y compris les plus favorisés, et qui est, dans la plupart des cas, financé par des moyens licites et, d'autre part, un usage problématique de drogues illicites qui est le fait de jeunes issus de familles ayant des difficultés, et eux-mêmes en difficulté scolaire ou en difficulté d'insertion professionnelle.
Il apparaît que délinquance et prise de substances psychoactives sont le plus souvent reliées à un même système de covariables sociologiques, psychologiques et démographiques.
Ainsi que l'a précisé M. Hugues Lagrange, sociologue au CNRS, devant la commission d'enquête, l'analyse des enquêtes de l'OFDT et de l'INSERM montre que si les usages problématiques -c'est-à-dire les usages répétés ou les usages de drogues dites dures- sont effectivement fortement corrélés avec l'anxiété, ils sont aussi le fait de jeunes sortant beaucoup. Ces consommations traduisent plutôt la recherche de reconnaissance, de gratifications et d'estime de soi qui ne leur sont pas accessibles à travers l'école ou une insertion professionnelle. Cette sociabilité extra-scolaire caractérise aussi les jeunes engagés dans la délinquance en dehors de l'usage des drogues 64 ( * ) . L'usage de drogues se conçoit fondamentalement comme une expérience entre pairs, en particulier en cas de déficience ou d'absence de contrôle parental.
Certains jeunes sont aux prises avec une sorte de syndrome général de déviance. Les consommations de cannabis, d'autres drogues, d'alcool, la délinquance et la violence sont bien souvent corrélées entre elles . La consommation se révèle assurément être un facteur aggravant mais ces phénomènes sont avant tout liés à une socialisation et à un mode de vie déviants , et à l'intégration du jeune à des groupes de pairs antisociaux 65 ( * ) .
Le recours aux substances psychoactives est souvent décrit comme un type de comportement délinquant ou un symptôme, et non spécifiquement une cause de délinquance. Les modèles confirment l'incidence de l'entourage familial direct et de l'environnement urbain sur l'exposition ou la protection de la jeunesse face à l'occurrence des infractions de petite et moyenne délinquances, contribuant par là à nuancer l'appréciation de l'effet aggravant de la consommation de cannabis.
(5) Délinquance et drogue : des influences réciproques
Certains auteurs ont élaboré des modèles « intégratifs ». M. Serge Brochu (1995) parle ainsi de « trajectoires déviantes » et insiste sur la réciprocité des influences (drogues sur crimes et inversement). La relation entre drogues et criminalité serait dynamique et non statique, l'explication apportée pour un individu à un moment donné n'étant pas nécessairement valable à une autre période.
3. Les dangers désormais reconnus du cannabis en termes de conduite automobile
Le propre des produits psychoactifs est de modifier le comportement des personnes, qu'il s'agisse d'un usage occasionnel ou régulier.
La dangerosité de drogues telles que l'héroïne ou la cocaïne est acceptée par tous les spécialistes. En effet, les effets des morphiniques, incompatibles avec la conduite automobile, consistent en une diminution importante, voire majeure, de l'attention, des réflexes, de la conscience du danger et des obstacles. Les effets de la cocaïne et des amphétamines sur l'aptitude à conduire un véhicule sont très voisins et liés à la stimulation du système nerveux central. L'hyperactivité motrice et l'euphorie sont constantes, conduisant à des comportements irrationnels et notamment à des prises de risques accrues. Les amphétamines entraînent une plus grande sensibilité aux éblouissements dus au soleil ou à l'éclairage des voitures, ainsi qu'une acuité visuelle diminuée.
Les effets du cannabis sur la conduite automobile sont plus discutés , alors même qu'il s'agit de la substance illicite la plus consommée.
a) Les études relatives aux effets du cannabis sur la conduite automobile
Les études menées montrent toutes un risque aggravé après usage de cannabis. Elles souffrent pourtant de difficultés méthodologiques. De plus, deux points font toujours l'objet de discussions au sein de la communauté scientifique : la possibilité de fixer un seuil légal de dangerosité du cannabis et les effets du relargage.
(1) La convergence des études en faveur de la reconnaissance d'un risque lié au cannabis
Tous les experts scientifiques auditionnés par la commission d'enquête ont mis en avant certaines particularités du cannabis susceptibles d'avoir une influence sur la conduite . La mise en évidence des risques d'accident liés à un usage récent de stupéfiants repose sur différentes observations : les mécanismes d'action des principes actifs de ces substances et leurs effets sur le comportement des consommateurs, les données apportées par des études sur simulateur de conduite, les tests de conduite en situation réelle, ainsi que les résultats d'études épidémiologiques.
Les effets du cannabis lors d'un usage occasionnel sont principalement 66 ( * ) :
- des modifications de la perception du temps et des distances ;
- des perturbations de la mémoire à court terme ;
- des perturbations sensorielles : perception exacerbée de sons et surtout modifications de la vision ;
- des troubles alliant euphorie, anxiété, agressivité , dépersonnalisation avec disparition des inhibitions et indifférence vis-à-vis de l'environnement, conscience accrue de soi ;
- des hallucinations et délires exceptionnels mais possibles, notamment avec les nouveaux produits très concentrés en cannabinoïdes ;
- une diminution des performances intellectuelles (baisse de la productivité et de la concentration avec une pensée fragmentaire), motrices et cognitives.
Le docteur Patrick Mura, président de la Société française de toxicologie analytique, a indiqué lors de son audition devant la commission que le cannabis, en modifiant les capacités à estimer les distances, pouvait expliquer des chocs violents contre des obstacles fixes que les conducteurs jugeaient plus éloignés que dans la réalité. Des chocs frontaux avec des véhicules arrivant en face sont également possibles, le conducteur sous l'influence du cannabis s'étant tout d'un coup déporté sur la gauche, sans prendre conscience du danger. De même, le cannabis a une influence sur le contrôle des virages, sur l'efficacité du freinage et sur la précision de la conduite, du fait d'une baisse de la vigilance.
Le cannabis altère la perception sélective (le fait que l'on ne fasse attention qu'aux événements importants lors de la conduite). Les troubles de l'acuité visuelle, qui entraînent une augmentation du temps de récupération après éblouissement, des problèmes de convergence, et de vision nocturne ou des couleurs peuvent amener les patients sous cannabis au volant à prendre des passants pour des taches lumineuses , ainsi que l'a d'ailleurs souligné devant la commission d'enquête un expert en pharmacie et toxicologie, en citant le cas d'un conducteur ayant confondu un piéton avec une poubelle.
Ceci peut expliquer des accidents jugés incompréhensibles, sans trace d'alcool.
Le professeur Roger Nordmann, membre de l'Académie nationale de médecine, a ainsi souligné devant la commission d'enquête les troubles de la coordination percepto-motrice et du traitement de l'information, à l'origine d'un allongement du temps de réaction. Il a donc estimé que le cannabis provoquait une altération de l'accomplissement des tâches complexes, parmi lesquelles figure la conduite automobile.
De plus, on observe exceptionnellement chez certains sujets particulièrement sensibles des hallucinations, des épisodes délirants ou des crises de panique, qui peuvent évidemment se révéler désastreuses si le sujet conduit.
Le professeur Renaud Trouvé, pharmacologue, a indiqué lors de son audition par la commission d'enquête que des expérimentations avaient clairement démontré une atteinte de la vigilance et un ralentissement des réflexes, ainsi qu'une incoordination spatio-temporelle grave . Il a cité une expérience répétée trois fois, la dernière fois il y a dix ans, par le professeur Leirer 67 ( * ) , visant à évaluer l'influence d'une consommation de cannabis sur le comportement de pilotes d'avion sur simulateurs . On a alors pu constater, en matière d'atterrissage aux instruments, que les trajectoires de descente et d'atterrissage étaient mal gérées. En outre, alors que les pilotes non intoxiqués attendaient patiemment que les corrections fassent leur effet, ceux qui avaient fumé (des doses de cannabis relativement modérées par rapport à ce qui se consomme actuellement) n'attendaient pas et avaient des réactions complètement désordonnées. Il a indiqué que cela était dû à la distorsion temporelle, c'est-à-dire à l'incapacité à évaluer le temps, même à l'échelle de quelques secondes. Le professeur Renaud Trouvé a d'ailleurs indiqué à la commission d'enquête que les compagnies aériennes avaient réagi en mettant en place, d'abord aux Etats-Unis, puis partout ailleurs du fait de conventions internationales, des tests inopinés, même à l'embarquement de l'équipage.
Ces résultats sont évidemment transposables à la conduite automobile.
Le docteur Jean-Luc Saladin, médecin, a en outre présenté à la commission d'enquête les conclusions d'une thèse consacrée au cannabis soutenue à l'Université de Rouen par le docteur Jacques Chamayou en septembre 2002, et dont il avait assuré la direction.
Cette thèse fait état d'un certain nombre d'études, pour la plupart américaines ou australiennes, soulignant les effets dangereux de la prise de cannabis en conduisant. Ainsi, ont été analysées 68 ( * ) les réactions de sujets ayant fumé deux cigarettes de marijuana dosées à 1,8 % puis 3,6 % à 10 minutes d'intervalles. Après 20 minutes, les tests de sobriété (épreuve « doigt-nez », appui sur un seul pied et épreuve « marche tourne ») montraient une altération de la coordination des fonctions. Une autre étude 69 ( * ) a démontré des troubles quant à l'évaluation des distances entre véhicules, des troubles de l'habileté psychomotrice, de l'attention, notamment discriminative, des fonctions visuelles, ainsi qu'un temps de réaction altéré, avec des doses médianes de THC de 10,7 mg. Certaines études 70 ( * ) mettent en évidence une déviance latérale de position. D'autres 71 ( * ) semblent en revanche indiquer que les participants à l'étude sont conscients des altérations et enclins à la compenser par une conduite plus précautionneuse.
Il ressort également de ces études l'importance de la variabilité des effets du cannabis sur les individus. Les effets sur la sécurité routière semblent donc moins prévisibles que pour l'alcool.
Le docteur Patrick Mura, président de la Société française de toxicologie analytique, a présenté à la commission d'enquête les résultats d'une étude établie en collaboration avec 18 autres toxicologues experts judiciaires du 1er octobre 2001 au 1er octobre 2002 et publiée en février 2002. Cette étude, la première d'une telle importance en France, a permis d'estimer le risque relatif d'accident associé à un usage récent de substances psychoactives , en analysant le sang de 900 conducteurs ayant eu un accident corporel et en comparant les résultats à ceux de 900 sujets témoins. Les analyses concernaient les produits suivants : cannabis, amphétamines, opiacés, cocaïne, alcool, ainsi que la recherche des principaux médicaments psychoactifs.
Des différences de prévalences très significatives ont été observées chez les moins de 27 ans pour le cannabis (20 % des conducteurs et 9 % des témoins), quel que soit l'âge pour la morphine (2,6 % des conducteurs et 0,4 % des témoins), pour l'alcool (26 % des conducteurs et 9 % des témoins). Parmi les conducteurs positifs au cannabis, celui-ci était seul présent chez 60 % d'entre eux.
L'analyse statistique de ces résultats a permis de montrer que chez les moins de 27 ans, la fréquence des accidents était multipliée par :
- 1,8 avec les médicaments ;
- 2,5 avec le cannabis seul ;
- 3,8 avec l'alcool seul ;
- 4,8 avec l'association alcool-cannabis ;
- et 9 avec la morphine.
Enfin, une enquête conduite entre avril 1999 et novembre 2001 à la demande de la société de l'assurance automobile du Québec sur 354 conducteurs mortellement blessés et 5.931 conducteurs témoins contrôlés sur le bord de la route a montré que le risque d'accident mortel est multiplié par 3,7 en cas d'usage d'alcool, 2,2 en cas d'usage de cannabis, 4,9 en cas d'usage de cocaïne et 2,5 en cas d'usage de benzodiazépines.
(2) Des difficultés méthodologiques persistantes
Ainsi que l'a rappelé le professeur Claude Got lors de son audition, la méthodologie de toutes ces études fait l'objet de débats. Les seules expériences françaises de tests en situation réelle, effectués en circuit fermé, ont été menées par des journalistes, sous contrôle de scientifiques et de médecins anonymes. Ce fut ainsi le cas du Magazine Auto Plus à deux reprises, en 1998 et 2001, puis de l'émission Zone interdite diffusée sur M6 en 2003. Le rapport de l'INSERM 72 ( * ) , antérieur à l'étude du docteur Patrick Mura, a d'ailleurs souligné ces problèmes méthodologiques.
Tout en reconnaissant que les résultats montrent globalement une nette détérioration de certaines facultés sous l'influence du cannabis (temps de réaction allongé, capacité de contrôle d'une trajectoire amoindrie, mauvaise appréciation du temps ou de l'espace, réponses en situation d'urgence détériorées ou inappropriées), il souligne que l'ampleur du phénomène semble encore inégalement appréciée par les différents auteurs.
Ainsi, certaines études aboutissent à la conclusion que les conducteurs sous influence du cannabis « compenseraient » la diminution de leurs capacités en modifiant leur comportement, cette hypothèse restant toutefois controversée. Par ailleurs, les auteurs insistent tous sur la variabilité individuelle des effets, et les modifications comportementales négatives n'apparaissent généralement significatives que pour des doses élevées.
Le rapport de l'INSERM relevait ainsi un certain nombre de problèmes de méthodologie :
En premier lieu, il est difficile de constituer un échantillon témoin , qui influe pourtant largement sur le résultat. Ainsi, le professeur Claude Got a devant la commission d'enquête contesté la qualité de l'échantillon témoin retenu par l'étude du docteur Patrick Mura (900 personnes admises aux urgences pour un autre motif), estimant que les personnes retenues auraient dues être exposées au même risque et donc être des automobilistes sélectionnés à l'endroit même des accidents. Même dans ce cas, des biais peuvent encore survenir, les personnes n'étant pas obligées de se soumettre à des tests inopinés. Or, on peut raisonnablement imaginer que parmi celles refusant se trouve une proportion supérieure à la moyenne de personnes ayant fait un usage de substances psychoactives.
De plus, le rapport soulignait que les prévalences de détection de cannabis chez les conducteurs impliqués dans des accidents de la circulation en France variaient de 6,3 % à 16 %, voire 34 % lorsqu'il s'agit de réquisitions à la demande du procureur, reflétant la diversité des pratiques et donc la difficile compatibilité des résultats. En Europe, les proportions estimées de sujets au cannabis varient de manière similaire entre 5 % et 16 %. Les proportions retrouvées parmi les conducteurs soupçonnés de conduire sous l'influence de substances psycho-actives sont sans surprise plus élevées, puisqu'elles dépendent avant tout de la sélection qu'opèrent les officiers de police.
Par ailleurs, le rapport de l'INSERM estimait que les publications échouaient globalement à démontrer un effet du cannabis seul sur le risque d'être responsable d'un accident corporel ou mortel, une proportion substantielle de conducteurs positifs au cannabis l'étant généralement à l' alcool (environ 50 % dans les études en France). Ce dernier apparaît donc comme un facteur de « confusion » important. Ainsi, le risque combiné d'alcool et de cannabis, comparativement à celui du cannabis seul, conduit à des chutes de performance beaucoup plus importantes, ce constat restant vrai lorsque des doses faibles ou modérées de cannabis sont associées à de faibles doses d'alcool. Néanmoins, le rapport reconnaissait que les études suggéraient que l'association entre l'alcool et le cannabis représentait un facteur de risque supérieur à celui de l'alcool seul.
Enfin, le rapport soulignait l'absence de relation synchrone entre la présence du cannabis (sang ou urine) et ses effets sur le comportement : le niveau de delta 9-THC peut en effet être proche de zéro et l'effet préjudiciable perdurer, ou, inversement, les métabolites pouvant être détectés bien après que tout effet psychologique ou détériorant des facultés a disparu. Une détection positive de cannabinoïdes n'a pas une signification univoque en termes de sécurité routière, la présence de delta 9-THC dans le sang à un certain degré attestant une consommation récente de cannabis pouvant perturber les facultés du conducteur, tandis que la présence de delta 9-THC COOH dans le sang ou dans les urines révèle une consommation pouvant parfois remonter à plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans lien avec d'éventuels effets sur le comportement de conduite.
Le rapport concluait par conséquent : « malgré la présomption de dangerosité du cannabis sur le comportement de conduite, il est encore aujourd'hui impossible d'affirmer, faute d'études épidémiologiques fiables, l'existence d'un lien causal entre usage du cannabis et accident de la circulation. Le substrat scientifique, dans le cas du cannabis, semble encore fragile. »
Si ces précautions méthodologiques honorent l'INSERM, plusieurs observations cette fois de nature plus pratiques peuvent leur être opposées par la commission d'enquête.
Tout d'abord, et ainsi que l'a d'ailleurs souligné le professeur Renaud Trouvé, pharmacologue, lors de son audition par la commission, l'exemple de la législation relative à la conduite sous l'influence de l'alcool montre qu'il est possible et nécessaire d'agir sans attendre d'avoir une connaissance parfaite de l'influence d'une substance sur la conduite automobile. Si l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 a fait de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique une infraction, il a fallu attendre la loi n° 70-597 du 9 juillet 1970 pour que soit institué un taux légal d'alcoolémie fixé à 0,8 g d'alcool par litre de sang et pour que des études scientifiques établissent vraiment les liens entre alcool et conduite automobile. En effet, si le législateur doit s'appuyer sur les études scientifiques existantes, il ne peut justifier une inaction prolongée vis-à-vis d'un phénomène dramatique du seul fait que ces études, toutes convergentes, ne parviennent qu'à suggérer des résultats.
Ensuite, une remarque empirique. Maître Francis Caballero, président du Mouvement de légalisation contrôlée, donc a priori favorable au cannabis, et dont on peut raisonnablement supposer qu'il a en la matière une certaine expérience (personnelle et professionnelle, étant souvent appelé à défendre des usagers de cannabis), a déclaré devant la commission d'enquête que le cannabis au volant était indiscutablement dangereux lorsqu'on était en état d'ivresse cannabique.
Au final, il apparaît un large consensus dans la communauté scientifique pour reconnaître que le cannabis a des effets néfastes sur la conduite, les points débattus se limitant à la fixation d'un seuil de dangerosité et à la possibilité de « relargage ».
(3) Les controverses tenant à la fixation d'un seuil et aux effets du relargage
• Les difficultés de fixation d'un seuil de dangerosité du fait de la nature même du cannabis
Le seuil légal de positivité au cannabis a été fixé à 1 ng/ml par un arrêté du 5 septembre 2001. En effet, au-delà de ce taux, les résultats des tests deviennent aléatoires.
Ainsi que l'a indiqué le docteur Patrick Mura lors de son audition par la commission d'enquête, lorsqu'on inhale un « joint », les concentrations sanguines montent très rapidement, pour atteindre leur paroxysme quelques dizaines de secondes après la fin du « joint », avant de diminuer assez rapidement, alors même que les effets commencent à apparaître. Il y a donc un décalage entre les effets et les concentrations sanguines. Le cannabis étant un produit très lipophile et attiré par les graisses, principalement du cerveau, il disparaît rapidement du sang. Par conséquent, lorsqu'il y a présence de principe actif dans le sang, le sujet est sous influence , la fenêtre de détection dans le sang étant inférieure à celle des effets.
Le rapport de l'INSERM, rappelant que le niveau de delta 9-THC dans le sang chutait rapidement, soulignait d'ailleurs que le délai entre l'accident et le prélèvement conditionnait fortement le résultat et qu'il devait donc être le plus court possible. Le docteur Gilbert Pépin a également soulevé ce problème devant la commission d'enquête. Les résultats des enquêtes épidémiologiques apparaissent sous-évalués par rapport à la réalité puisque le delta 9-THC ne demeure dans le sang qu'entre 6 et 7 heures alors que les prélèvements sont effectués en moyenne 2 heures après le décès. Les concentrations relevées sont donc moindres et on perd une large part des cas positifs.
Maître Francis Caballero, président du Mouvement de légalisation contrôlée, a quant à lui récusé devant la commission d'enquête ces arguments et le seuil légal de 1ng/ml, en arguant du fait que le cannabis était également un produit dopant et qu'un champion automobile tchèque de Formule 3000 avait été contrôlé positif au cannabis avec un taux de 150 ng/ml lors de compétitions. Il a en outre cité un de ses dossiers, dans lequel le conducteur avait été testé positif avec 3,5 ng/ml en ne reconnaissant qu'une consommation 20 jours plus tôt. En outre, il a évoqué une étude faite conjointement par la France, la Belgique et les Pays-Bas, fixant le taux d'ivresse cannabique entre 40.000 et 300.000 ng/ml de THC.
Ces observations ont suscité une certaine perplexité de la commission d'enquête, au regard de l'expérience dramatique vécue par Mme Nadine Poinsot, présidente de l'association Marilou, du nom de sa petite fille de neuf ans tuée dans un accident de voiture par un chauffard sous l'emprise du cannabis. Or, ainsi qu'elle l'a rappelé lors de son audition, l'analyse sanguine du conducteur avait révélé un taux de 0,9 ng/ml, donc inférieur au seuil légal de positivité. Certes, le prélèvement avait été fait quatre heures après, mais les tests psycho-comportementaux effectués concomitamment à l'hôpital avaient tous indiqué l'emprise cannabique. Notons d'ailleurs que cet accident, dans lequel le taux de THC était inférieur à 1ng/ml, n'avait pu être pris en compte pour l'étude épidémiologique.
|
LES TESTS PRATIQUÉS POUR DÉTERMINER LA PRÉSENCE DE STUPÉFIANTS L'urine permet de mettre en évidence une consommation de cannabis, sans préjuger du temps écoulé entre le moment de la dernière consommation et celui du recueil d'urine, le délai maximum de détection étant de 2 à 7 jours pour une consommation occasionnelle et de 7 à 21 jours pour une consommation régulière, contre 2 à 8 heures dans le sang. Le coût d'un dépistage immunochimique est d'environ 25 euros, auquel s'ajoute le coût des honoraires des médecins (30 euros), tous deux prélevés sur le chapitre des frais de justice. Tout résultat positif doit obligatoirement être confirmé par une analyse de sang qui permet d'estimer le temps écoulé entre le moment de la dernière consommation et celui de la prise de sang . C'est donc la seule méthodologie acceptable dans tout contexte médicolégal (incluant les accidents de la voie publique). La recherche et le dosage dans le sang sont facturés 241,48 euros sur le chapitre des frais de justice. Si ces analyses sont fiables, elles sont coûteuses et contraignantes. Elles ne peuvent être pratiquées par les forces de l'ordre au bord de la route (même si les Allemands les emploient sur les stations-services d'autoroutes) et impliquent le transport des personnes concernées vers des établissements médicaux ou hospitaliers et l'attente des résultats. En 2001, 116.745 accidents corporels ont été dénombrés, faisant 7.720 morts et 153.945 blessés. En prenant l'hypothèse qu'un accident concerne deux véhicules, plus de 232.000 dépistages devraient être effectués chaque année. Il ne paraît donc pas possible de procéder à des dépistages systématiques. En pratique, les forces de l'ordre ne font pas les tests d'urine, trop lents, et procèdent directement aux tests sanguins. Les cheveux reflètent des expositions répétées et permettent à ce titre d'établir un calendrier d'exposition : chaque centimètre de cheveu représente grossièrement la pousse d'un mois. L'analyse de segments permet ainsi de mettre en évidence des consommateurs chroniques et d'établir un niveau (faible, moyen, important) de consommation, ce qui n'est pas possible par l'analyse urinaire. L'abstinence est ainsi mieux appréhendée par cette approche que par un suivi dans les urines. Des tests salivaires sont utilisés dans certains pays, notamment en Allemagne. S'ils sont fiables pour de nombreux stupéfiants, cela ne dépasserait pas 65 à 70 % s'agissant du cannabis. Il n'existe à ce jour aucun dispositif commercial. La sueur constitue un très mauvais milieu d'investigation. Le 14 mars dernier, la société ID pharma a annoncé au 31e MEDEC, salon de la médecine, la mise sur le marché français à partir du mois d'avril d'un test de dépistage rapide baptisé « narcotest », basé sur la sueur ou l'urine. Il bénéficie de l'agrément de l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) et sera vendu sur prescription médicale en pharmacie. Il devra cependant toujours être confirmé par une analyse sanguine. |
• Les interrogations sur la possibilité de relargage de THC et sur ses effets
Le principe actif du cannabis, une fois fixé dans les tissus -3 à 8 heures après la consommation- se défixe très lentement et n'a donc plus d'effets consécutifs.
Cependant, le docteur Jean-Luc Saladin a indiqué lors de son audition que sous l'influence d'un stress, le THC fixé dans les graisses pourrait être brutalement relargué, le sujet revivant alors, quelques fois plusieurs jours après, ce qu'il ressent lorsqu'il est sous l'influence de cannabis.
La majorité des scientifiques auditionnés par la commission d'enquête ont néanmoins fait preuve d'une grande prudence. Ainsi, le docteur Patrick Mura a indiqué que cela avait été rapporté « chez certains sujets et dans certaines circonstances, mais là les travaux scientifiques ne sont pas suffisamment précis pour pouvoir être vraiment formels à ce sujet, nous ne savons pas très bien les circonstances dans lesquelles cela se produit ». Il a cependant lui aussi estimé que de tels cas étaient possibles, même s'ils demeuraient très exceptionnels. Par ailleurs, d'autres scientifiques se demandent si ces cas ne seraient pas plutôt consécutifs à un accident ayant provoqué un stress, auquel cas le lien de causalité ne serait pas établi.
Pour Maître Francis Caballero, président du Mouvement de légalisation contrôlée, cette question « fait partie du charlatanisme qui entoure cette substance ». Il soutient en effet que le THC relargué ne peut avoir les mêmes effets, puisqu'il ne s'agit plus du delta 9-THC, qui s'est dégradé en delta 11, dans lequel on retrouve du delta 8.
Cette opinion est partagée par le professeur Renaud Trouvé quant à la modification de THC intervenue. Néanmoins, il n'en tire pas de conclusions aussi définitives que Maître Francis Caballero, pour lequel « ce n'est pas celui qui fait planer, même s'il continue à être décelable ». S'il affirme pour sa part que ces substances relarguées peuvent avoir un effet psychoactif, il s'interroge encore sur leurs effets et la possibilité d'attribuer certains accidents à la présence du THC. Dans une note adressée par la suite à la commission d'enquête, il a tenu à souligner que dans l'expérience de Leirer sur les pilotes d'avion de 1989, il était montré que 24 heures après avoir fumé une cigarette faiblement dosée en delta 9-THC, les capacités d'analyse spatio-temporelles n'étaient pas revenues à la normale. Il faudrait ainsi 50 heures pour qu'elles le redeviennent. Il en a conclu que la conduite de véhicule devrait être interdite dans les deux jours suivant une prise de cannabis très faiblement dosé, ce seuil devant être porté à trois ou quatre jours du fait des dosages consommés de façon courante, à supposer que l'on ne refume pas avant une semaine.
L'étude actuellement menée par le docteur Patrick Mura en collaboration avec une équipe de l'INSERM sur le stockage de THC dans les graisses du porc permettra sans doute d'apporter des réponses sur ce point.
Compte tenu de toutes ces interrogations méthodologiques, les résultats d'une étude épidémiologique de grande envergure conduite à partir des dépistages effectués sur les conducteurs impliqués dans des accidents mortels sont attendus avec impatience. La loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière, dite loi Gayssot, a en effet institué un dépistage systématique des stupéfiants sur tout conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation, afin de permettre de conduire une enquête épidémiologique. Le décret d'application définissant les modalités du dépistage n'étant paru que le 27 août 2001, l'étude épidémiologique n'a débuté qu'en octobre 2001. Cette étude, menée par l'OFDT, devrait concerner 10.000 cas. Les résultats de cette enquête ne devraient être connus qu'en 2004. Le professeur Claude Got a d'ailleurs indiqué à la commission d'enquête que seuls 6.000 cas avaient déjà été transmis. La commission d'enquête ne peut que déplorer le délai -10 ans- écoulé entre la proposition d'instituer un dépistage et la publication des résultats de l'enquête. Cette enquête devrait satisfaire à toutes les recommandations méthodologiques émises par l'INSERM.
En conclusion, en présence de ces études, certes encore imparfaites sur le plan méthodologique, mais toutes convergentes quant à leurs conclusions, il convient d'appliquer le principe de précaution, ainsi qu'il a été fait pour l'alcool , d'autant plus qu'il s'agit de sanctionner spécifiquement la conduite sous l'influence de stupéfiants, produits dont la consommation est pénalement réprimée.
b) Des risques désormais reconnus par le législateur
Jusqu'à très récemment, la conduite sous l'influence de stupéfiants n'était pas spécifiquement réprimée en France, alors même que la consommation de ces substances était interdite. Néanmoins, le 14 juillet dernier, le Président de la République a fait de la sécurité routière l'un des trois chantiers prioritaires pour les cinq années à venir , au même titre que la lutte contre le cancer et la politique en faveur des handicapés : « Les comportements les plus contraires à la sécurité routière doivent être dénoncés et beaucoup plus lourdement sanctionnés, qu'il s'agisse de la vitesse sur les routes, de l'alcoolisme ou de la consommation de drogues. » La proportion des accident de la route graves ou mortels imputables à la consommation de produits illicites est en effet estimée à 10 à 15 %.
Alors que la France dispose d'un dispositif très complet de répression de la conduite sous l'influence de l'alcool, elle était l'un des rares pays en Europe à ne pas disposer d'une législation spécifique relative à la conduite sous l'influence des stupéfiants 73 ( * ) .
« Après un accident de la route, il est paradoxalement plus facile de mettre en évidence et de sanctionner la consommation excessive et inadaptée d'un produit en vente libre, que de reconnaître l'influence d'une drogue dont la consommation est interdite », comme l'avait souligné le livre blanc sur les effets des médicaments et des drogues sur la sécurité routière de 1995 74 ( * ) .
Le livre blanc préconisait la recherche des conduites sous l'influence de substances, illicites ou détournées de leur usage, capables de modifier l'aptitude à la conduite, en cas d'accident corporel, et lors d'une infraction aux règles de la circulation mettant en jeu la sécurité. La loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière, dite loi Gayssot, a institué un dépistage systématique des stupéfiants sur tout conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation, à des fins épidémiologiques. La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a en outre prévu un dépistage facultatif sur les conducteurs impliqués dans un accident corporel. A cette occasion, et comme lors de l'examen de la loi Gayssot, le Sénat avait proposé la création d'une infraction de conduite sous l'influence de stupéfiants . Il s'était vu opposer un refus de la part du gouvernement de l'époque, arguant des difficultés techniques d'une telle mesure et de l'insuffisance des connaissances scientifiques.
La loi n° 2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, dite « loi Marilou », du nom d'une petite fille tuée par un conducteur sous l'emprise de cannabis, a été adoptée à l'initiative de M. Dell'Agnola. Le fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants (et non d'être sous l'emprise de stupéfiants, comme l'indique l'intitulé de la loi) est désormais incriminé spécifiquement par l'article L. 235-1 du code de la route et passible de deux ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende. Une aggravation des sanctions est prévue lorsqu'elle a causé un homicide ou des blessures involontaires. Est également incriminé, à l'initiative de la commission des Lois du Sénat, le fait de conduire sous la double influence de l'alcool et des stupéfiants.
De plus, les procédures de contrôle, qui avaient jusqu'alors une fonction épidémiologique, sont nettement élargies et ont désormais une finalité répressive évidente. Le texte autorise désormais les officiers ou agents de police judiciaire à réaliser des contrôles dès lors « qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a été fait usage de stupéfiants », ce qui ouvre la voie à des contrôles inopinés . Les modalités du contrôle seront prévues par décret. Le refus de s'y soumettre est passible des mêmes peines que celles encourues pour conduite après usage de stupéfiants.
Par ailleurs, le projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière actuellement en cours d'examen par le Parlement prévoit la possibilité pour les officiers de police judiciaire de retenir à titre conservatoire le permis de conduire en cas d'examens et d'analyses établissant que le conducteur a fait usage de stupéfiants, ou en présence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, ou en cas de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage. Le préfet pourra ensuite prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée maximale de six mois, en cas d'examens établissant l'usage ou de refus de se soumettre aux analyses.
La commission d'enquête se félicite de ce volontarisme, tout en regrettant que cette indispensable prise de conscience ait été aussi longue, du fait notamment de la banalisation du cannabis.
4. Les dangers de la drogue en milieu professionnel
a) La drogue au travail : une réalité
• La consommation de stupéfiants et de produits de substitution
Les toxicomanes ne sont pas tous des marginaux, ce qui explique que la drogue soit une réalité du monde du travail. En effet, il apparaît que 60 % des drogués occupent un emploi à temps plein, soit 30 % d'employés, 20 % d'ouvriers et 10 % de cadres.
La consommation de drogues au travail, longtemps occultée, est aujourd'hui avérée, de même que les dangers qu'elle entraîne dans le milieu professionnel. Les principaux produits utilisés sont le cannabis, les opiacés (héroïne notamment, et morphine), la codéïne, la cocaïne, le crack, les amphétamines, l'ecstasy, les hallucinogènes (LSD notamment) et divers solvants. Tous ont des conséquences extrêmement néfastes sur la qualité du travail, notamment sur les postes dits « à risque » qui nécessitent une vigilance accrue pour assurer sa sécurité et celle des autres, la motivation et les relations professionnelles.
Or, il semble que la consommation de produits illicites, notamment du cannabis, sur les lieux de travail soit un phénomène en pleine expansion. Le docteur Patrick Mura, président de la société française de toxicologie analytique, a ainsi indiqué à la commission les résultats obtenus dans le cadre des dépistages à l'embauche pour les postes à risque à la centrale nucléaire de Civaux : « De 1995 à 1999, nous avons eu deux cas positifs, soit 1,8 %. De 2000 à 2001, nous avons eu 12,8 % de cas positifs à l'embauche. Autrement dit, 12,8 % des candidats à l'embauche pour un poste de sécurité dans une centrale nucléaire étaient positifs au cannabis » . On rappellera de la même façon que la question de la consommation de cannabis se pose lors de certains concours, à l'instar de ceux de l'Armée de l'Air.
Dans certains milieux, comme dans les médias ou le showbiz, il semble que l'usage « festif » de la cocaïne soit relativement répandu. Un expert en pharmacologie et en toxicologie a ainsi indiqué à la commission avoir effectué à la demande d'un juge d'instruction un contrôle capillaire sur un jeune machiniste travaillant sur un plateau de télévision. Les résultats ont montré qu'il était consommateur régulier de cocaïne et occasionnel de cannabis. A cet égard, le jeune homme aurait indiqué qu'il était courant de consommer dans son milieu et que ceux qui en avaient plus difficilement les moyens organisaient généralement un trafic sur les lieux de travail.
En outre, si les traitements de substitution ont notamment pour objectif de permettre une démarche de socialisation, en particulier au travers de l'exercice d'une activité professionnelle, il doit être tenu compte des conséquences de la prise quotidienne de méthadone ou de Subutex sur le comportement, d'autant plus que ces consommations sont souvent associées à d'autres produits.
• Les « dopés du quotidien »
Aux limites de la toxicomanie, les consommations de médicaments psychotropes (barbituriques, psychostimulants, anxiolytiques), parfois associés à des produits illicites, se développent dans les entreprises, notamment chez des cadres soumis à des impératifs de performance, qui recourent à tous les moyens disponibles pour augmenter leur productivité ou, au contraire, mieux décompresser.
Le docteur Michel Hautefeuille, responsable du Centre Marmottan, a ainsi fait état de l'évolution croissante de ce phénomène, lors de son audition par la commission : « Ce sont ceux que j'appelle les « dopés du quotidien », des personnes qui ont recours à des produits licites ou illicites pour faire face à leur activité professionnelle. Le Centre Marmottan n'est pas loin de la Défense, qui est un grand quartier d'affaires, et nous avons beaucoup de cadres ou de personnes qui ont des responsabilités à différents niveaux de la hiérarchie, dans le monde des affaires, qui viennent nous voir parce qu'ils utilisent des produits pour améliorer leurs performances, pour faire face au stress quotidien ou pour répondre aux demandes qui leur sont faites dans le cadre de leur milieu professionnel. (...) Il est vrai que ce type de demandes augmente depuis environ quatre ans de façon significative dans un centre comme Marmottan » .
On notera que certains cadres se considèrent eux-mêmes comme des toxicomanes, ainsi que l'a indiqué le docteur Michel Hautefeuille : « La venue en consultation de ce profil assez particulier renvoie à deux cas de figure. Dans le premier : la personne a connu un dérapage très important dont l'entreprise a été témoin, la personne venant consulter parce qu'elle a peur de perdre son travail. Le deuxième cas de figure est celui des jeunes qui s'aperçoivent d'eux-mêmes qu'ils sont en train de déraper, qui ont pu avoir une utilisation spécifique de produits pendant la semaine et ne rien utiliser le week-end ni pendant les vacances et qui se mettent à déraper : ils s'aperçoivent que, même pendant le week-end et les vacances, ils doivent continuer leur consommation et donc que le prétexte ou la réalité du travail ne suffit plus, à leurs yeux, à expliquer cette dépendance ».
b) Des conséquences parfois dramatiques
Comme il a été vu, la consommation de produits stupéfiants, quels qu'ils soient, entraîne des modifications de l'état psychique et du fonctionnement cérébral de l'usager, entraînant des conséquences sur sa perception des choses et sur sa capacité de concentration . L'utilisation de ces produits n'est pas sans incidence dans le monde du travail.
La commission rappellera que les conséquences de la consommation de drogues ont été prises en compte pour la première fois dans l'aviation civile américaine en 1982, pour tout avion atterrissant sur le sol des Etats-Unis. Cette réglementation, fondée sur des contrôles inopinés, a été reprise en France où les compagnies aériennes ont mis en place un dispositif qui a permis de détecter quelques cas positifs.
L'usage de drogues pendant ou avant le temps de travail, en atténuant la qualité de la vigilance, a ainsi des conséquences au regard de la sécurité au travail, pour soi-même comme pour autrui, notamment dans les postes dits à risque. Les accidents du travail mortels en rapport avec l'abus de drogue ou d'alcool (malheureusement, la distinction n'est pas faite entre les différents produits, ce qui rend la collecte de données concernant exclusivement la drogue extrêmement difficile) représentent jusqu'à 30 % du total de ces accidents.
Un expert en pharmacologie et en toxicologie a ainsi signalé à la commission plusieurs cas d'accidents mortels du travail dus à la consommation de drogues : un conducteur d'un gros engin de chantier, sous emprise de cannabis d'après ses analyses sanguines, a écrasé l'un de ses collègues contre un mur ; sous emprise du cannabis également, un ouvrier est tombé du septième étage d'un chantier, un autre d'un échafaudage.
Si le code du travail ne donne pas de définition précise des postes à risque, les postes de conduite d'engins, les postes de mise au point, de réparation, de maintenance de matériel ou les postes de production dont le mauvais fonctionnement est susceptible de mettre en cause la sécurité des autres salariés, mais aussi la sécurité générale interne ou externe à l'entreprise ou la sécurité des personnes et biens transportés, entrent dans cette catégorie. Dans un certain nombre de cas, cette détermination est assez facile. Dans d'autres cas, elle sera plus délicate à effectuer et demandera une analyse des conditions de travail spécifiques au poste de travail occupé dans l'entreprise considérée. La définition du poste à risque apparaît donc large, ainsi que l'a souligné le docteur Raymond Trarieux, médecin du travail et président de l'Association pour l'étude des conduites addictives et des conséquences sur l'aptitude médico-professionnelle, devant la commission : « les postes de sécurité n'ont pas forcément une sécurité immédiate, mais on doit être sûr de la valeur des personnes. Par exemple, sur un tarmac, beaucoup de personnes viennent autour d'un avion et peuvent introduire certaines choses dedans sans avoir forcément un poste de sécurité. Je penserai simplement (...) aux personnes qui apportent de la nourriture, qui nettoient l'avion et autres ».
Le problème posé par la drogue en milieu professionnel n'est pas circonscrit à la consommation du produit et à ses conséquences sur l'aptitude au travail mais doit également être élargi à la question du trafic dans le cadre de certains postes. Par ailleurs, outre les accidents du travail strictement dus à la drogue, la consommation de produits illicites est à l'origine, chaque année, de plusieurs accidents de trajet entre le domicile et le lieu de travail de l'usager. On rappellera à cet égard que les accidents de trajet représentent 61,2 % des accidents mortels du travail enregistrés par la CNAMTS.
Enfin, compte tenu des effets des drogues sur le comportement des consommateurs, la dimension relationnelle de l'usage de stupéfiants en milieu professionnel ne doit pas être négligée : en créant des réactions d'euphorie ou au contraire d'atonie, le produit stupéfiant peut compromettre la qualité des relations professionnelles. En effet, en fonction de la durée, de la fréquence et de la nature de la consommation de drogue, les réactions du consommateur sous emprise sont susceptibles de faire apparaître des irrégularités dans la qualité de son travail, des absences et retards fréquents et injustifiés (l'absentéisme des toxicomanes est deux à trois fois supérieur à celui des autres travailleurs), des refus de respecter les règles de discipline ou de fonctionnement du service, voire des actes de violence ou d'insubordination caractérisés. Ce type de comportement peut aller jusqu'à compromettre le maintien du salarié concerné dans l'entreprise.
Les conséquences de l'usage de drogues en termes de sécurité, de capacités de travail et de qualité des relations sociales en milieu professionnel sont ainsi avérées. Or, la consommation de drogue au travail, notamment de cannabis et chez les jeunes actifs, est une réalité. S'il ne s'agit pas d'évincer systématiquement du monde du travail les utilisateurs de ces produits, il convient d'éviter que les consommateurs n'occupent des postes de travail où leur capacité d'agir ou de réagir puisse mettre en cause leur propre sécurité, la sécurité d'autres personnes ou la sécurité générale.
La commission considère, comme il sera vu plus loin, que les conséquences de l'usage de drogue au travail doivent ainsi être prises en compte dans le monde du travail, comme elles le sont désormais dans la conduite automobile.
DEUXIÈME PARTIE
-
UNE POLITIQUE À LA DÉRIVE :
DES INSTRUMENTS
DE LUTTE VIEILLIS ET INSUFFISANTS
I. UNE ORGANISATION INTERMINISTÉRIELLE ET UN ARSENAL LÉGISLATIF IMPORTANT
A. LA MILDT : LES DIFFICULTÉS DE L'INTERMINISTÉRIALITÉ
1. La genèse de la MILDT
Après quinze ans de vicissitudes institutionnelles, la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie trouve sa forme définitive en 1996 avec le décret n° 96-350 du 24 avril 1996 portant création de la MILDT et la plaçant sous l'autorité du Premier ministre.
On rappellera que le décret n° 99-808 du 15 septembre 1999, relatif au comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie et de prévention des dépendances, et à la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, élargit le champ de compétences de la MILDT à l'ensemble des pratiques addictives et des substances psychoactives, licites et illicites.
|
LES ÉTAPES SUCCESSIVES DE L'INTERMINISTÉRIALITÉ Depuis 1982, cinq structures interministérielles différentes chargées de mettre en oeuvre la politique de lutte contre la drogue et la toxicomanie se sont succédées, ainsi que sept programmes, rapports et autres plans gouvernementaux censés donner un nouveau souffle à cette politique et proposer de nouvelles orientations souvent inadaptées. La mission interministérielle a changé plusieurs fois d'appellations et d'attributions. Selon les époques, elle a été rattachée aux services du Premier ministre, au ministère de la Santé et de la Solidarité ou au ministère de la Justice. La première structure était la « mission permanente de lutte contre la toxicomanie » aux attributions définies par le décret du 8 janvier 1982. Elle est devenue la « mission interministérielle de lutte contre la toxicomanie » (MILT) en 1985 et en 1989 ; à côté de cette mission interministérielle, une « délégation générale à la lutte contre la drogue » (DGLD) a été créée. En 1990, la MILT et la DGLD fusionnent pour devenir la « délégation générale à la lutte contre la drogue et la toxicomanie » (DGLDT) rattachée au Premier ministre. Dernier avatar de cette structure mouvante : la « mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie » (MILDT) est créée en 1996. Divers plans gouvernementaux, notamment celui du 21 septembre 1993 complété par les orientations du programme gouvernemental du 14 septembre 1995, ont cherché à apporter des réponses à l'extension du phénomène toxicomane, sans toujours prendre en compte l'évolution des modes de consommation. Le dernier en date est le plan gouvernemental du 16 juin 1999. La MILDT, créée par le décret du 24 avril 1996 , est aujourd'hui placée sous l'autorité du Premier ministre. Elle anime et coordonne l'action de vingt départements ministériels concernés par la lutte contre la drogue et la prévention des dépendances, notamment dans les domaines de la prise en charge sanitaire et sociale, de la prévention, de la répression, de la formation, de la communication, de la recherche et de la coopération internationale. Elle anime, soutient et coordonne les efforts des autres partenaires publics et privés que sont les collectivités territoriales, les institutions spécialisées et acteurs de la société civile (associations). Au niveau local , son action est relayée par les chefs de projets désignés par les préfets, qui mettent en oeuvre la politique interministérielle dans les départements et bénéficient à ce titre des différents instruments de la coordination interministérielle tels les conventions d'objectifs ou les plans départementaux de prévention. La MILDT prépare et met en oeuvre les décisions du comité interministériel de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances qui concernent, depuis le plan gouvernemental du 16 juin 1999, aussi bien les consommations de drogues illicites que l'abus d'alcool, de tabac et de médicaments psychoactifs , c'est-à-dire l'ensemble des pratiques addictives. Le fonctionnement actuel de la MILDT est régi par le décret n° 99-808 du 15 septembre 1999 relatif au comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie et de prévention des dépendances et à la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Il s'agit ainsi d'intégrer la nécessité de mieux prévenir et de prendre en charge les conséquences de l'usage du tabac, de la consommation abusive d'alcool, ainsi que de l'emploi excessif ou détourné de médicaments psychoactifs. |
2. Les critiques adressées à la MILDT et la définition du plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances (1999-2002)
Le 7 juillet 1998, la Cour des comptes rend public un rapport très critique sur l'ensemble du dispositif de lutte contre la toxicomanie qui constate l'échec de la mise en oeuvre de la politique interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie et une rupture dans les objectifs de cette politique.
Les critiques formulées par la Cour des comptes étaient principalement de trois ordres.
La Cour constatait d'abord les limites de l'efficacité de la structure interministérielle . Ces limites étaient notamment d'ordre budgétaire. Les crédits votés au titre de l'action interministérielle étaient attribués selon des enveloppes constantes aux ministères concernés pour financer les mêmes mesures d'année en année, sans évaluation ni analyse prospective. Ces pratiques de reconduction automatique limitaient la capacité de proposition et d'impulsion de la MILDT et conduisaient à financer des actions qui, pour l'essentiel, relèvent des crédits de fonctionnement courant des ministères. La Cour suggérait donc que les crédits interministériels soient désormais utilisés pour financer des actions innovantes que les ministères devraient ensuite reprendre et poursuivre sur leur budget propre.
En outre, la Cour relevait que la capacité d'initiative de la MILDT était compromise par les délais de mise à disposition des fonds aux ministères utilisateurs, retardant de fait la mise en place des financements auprès des acteurs de terrain. Enfin, la Cour s'inquiétait également des délégations d'attribution à de multiples associations et de leur contrôle insuffisant.
La Cour insistait ensuite sur la nécessité d'améliorer les connaissances et préconisait en conséquence l'élaboration d'une politique basée sur des données fiables résultant d'études et de recherches dans toutes les disciplines concernées par le sujet ;
Enfin, la Cour soulignait les lacunes de la coordination interministérielle . Au-delà de quelques dossiers sur lesquels elle avait pu jouer un rôle fédérateur, la MILDT n'était pas parvenue à dépasser un rôle de distributeur de crédits ni à animer une véritable politique interministérielle dans des domaines tels que la prévention, la formation, la communication ou la recherche.
En outre, elle n'exerçait pas un réel contrôle sur les crédits délégués. En effet, au niveau national, ces crédits étaient fondus dans les budgets propres des ministères, et au niveau local les sources de financement étaient multiples. La Cour constatait que la multiplicité des administrations concernées et l'implication croissante des collectivités locales rendaient difficile, voire impossible, l'identification de tous les crédits affectés et donc le contrôle de leur emploi.
Parallèlement, la Cour insistait sur l'insuffisante coordination des actions de lutte contre la drogue dans le domaine international et dénonçait « l'instabilité chronique » de la mission ayant connu près d'une quinzaine de présidents depuis sa création en 1982 et ayant été dans les dernières années rattachée successivement au Premier ministre, puis au secrétariat d'Etat à la Santé, un temps au ministère de la Justice, puis à nouveau au Premier ministre sous forme d'une mise à disposition du ministère de l'Emploi et de la Solidarité et du secrétariat d'Etat à la Santé.
Suite à la publication du rapport de la Cour des comptes, le Premier ministre a demandé à la nouvelle présidente de la MILDT, nommée en juin 1998, de lui adresser un ensemble de propositions visant à renforcer la coordination interministérielle aux échelons national et local, à évaluer régulièrement l'efficacité des projets financés, à définir les besoins et planifier le développement de nouvelles actions dans le cadre d'un nouveau plan gouvernemental de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances.
Ces propositions aboutirent au lancement du nouveau plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances adopté par le gouvernement le 16 juin 1999.
|
LES GRANDES LIGNES DU PLAN TRIENNAL DE LUTTE CONTRE LA DROGUE ET DE PRÉVENTION DES DÉPENDANCES (1999-2002) Ce plan tient compte de l'évolution extrêmement rapide des comportements de consommation en particulier chez les jeunes, du développement des polyconsommations associant produits licites et illicites ainsi que de la multiplication des produits qui circulent et dont la teneur n'est pas toujours connue avec précision. Ce plan s'attache également à coordonner les actions des différents ministères impliqués dans la lutte contre la drogue et dans la prévention des dépendances. Il repose sur un ensemble d'orientations et de mesures qui tiennent compte des observations de la Cour des comptes : - une meilleure connaissance du phénomène : l'objectif est d'améliorer le dispositif national d'observation, d'études et de recherche afin de pouvoir anticiper les évolutions. La MILDT a ainsi lancé un nouvel appel d'offre et a cherché à mobiliser de nouvelles équipes de recherche. En s'appuyant sur l'OFDT dont les compétences doivent être élargies, elle a développé des enquêtes épidémiologiques régulières notamment en milieu scolaire et à l'occasion des journées de préparation à la défense. Elle a par ailleurs mis en place deux observatoires en temps réel, l'un (SINTES) pour connaître la composition des drogues de synthèse qui circulent sur les lieux de consommation et l'autre (TREND), à partir d'un réseau sentinelle, pour mieux appréhender la réalité des comportements de consommation, en milieu festif et dans la rue. L'OFDT a en outre été chargé d'une mission d'évaluation globale de la mise en oeuvre du plan triennal. - une politique d'information et de communication inscrite dans la durée à destination de l'usager et plus largement du grand public . L'objectif est de mettre à disposition de celui-ci des informations scientifiquement validées afin qu'il soit plus attentif à sa propre consommation ainsi qu'à celle de ses proches. C'est l'objectif de la campagne de communication lancée le 26 avril 2000 avec la diffusion d'un livre d'information sur les drogues et les dépendances : « Savoir plus, risquer moins ». - une politique de prévention plus en prise avec la réalité des pratiques de consommation . Le but est de permettre d'éviter les consommations mais aussi le passage d'un usage occasionnel ou expérimental à un usage nocif. L'objectif affiché de la MILDT est de prendre en compte les modalités et les contextes de consommation, la personnalité de l'usager, sans cloisonner les actions en fonction du produit utilisé. Dans cette perspective il a été demandé à chaque chef de projet d'établir un plan départemental de prévention qui fixe des objectifs quantitatifs et qualitatifs réalisables et évaluables et qui concerne tous les comportements de consommation à risque des jeunes en milieu scolaire ou hors milieu scolaire. Ces plans devraient être opérationnels à la fin de l'année 2000. Ils tardent cependant à se mettre en place. - une prise en charge plus précoce des usagers excessifs de drogues, d'alcool, de tabac, de médicaments ou de produits dopants . Il s'agit de renforcer la capacité du dispositif de droit commun (médecins généralistes, services hospitaliers) à repérer les consommations nocives, les services spécialisés (centre de soins aux toxicomanes et consultation ambulatoire en alcoologie) devenant des lieux de référence et de formation pour ces derniers. La MILDT affiche également l'objectif de rapprocher les dispositifs de soins spécialisés qui sont aujourd'hui encore excessivement cloisonnés. Plusieurs doivent permettre de réaliser ces objectifs : développement des réseaux de médecins généralistes, renforcement des structures spécialisées en alcoologie et tabacologie, préparation du transfert du financement des centres de soins spécialisés aux toxicomanes à l'assurance maladie et création d'équipes de liaison en addictologie dans tous les hôpitaux de plus de 200 lits. Pour développer la politique de réduction des risques à destination des usagers les plus marginalisés, de nouveaux lieux d'accueil, programmes d'échange de seringues et équipes mobiles de proximité sont en cours de création. - une meilleure articulation des politiques pénales et des politiques sanitaires et sociales. L'objectif est de permettre à chaque usager de drogues ou usager excessif d'alcool interpellé de bénéficier d'une orientation sanitaire et sociale dans le cadre d'une alternative aux poursuites, aux sanctions, ou à l'incarcération. Dans le cadre des orientations définies par le garde des Sceaux (circulaire du 17 juin 1999), la MILDT a mis en place des conventions d'objectifs entre les préfets et les procureurs de la République. Ces conventions existent aujourd'hui dans 75 départements et doivent être généralisées à la fin de l'année 2000. - une meilleure coordination de la coopération internationale : définition de priorités géographiques en fonction des flux de trafics, notamment en Asie centrale et Asie du Sud-est, et dans les pays d'Europe orientale. - la volonté de créer une culture commune à tous les professionnels spécialisés ou non : diffusion de documents d'information divers, ouverture d'un site internet (www.drogues.gouv.fr, élaboré en partenariat avec le Comité français d'éducation pour la santé - CFES - Drogues Info Service, l'OFDT et Toxibase), mise en place de programmes de formation, création dans chaque département ou région d'un Centre d'information et de ressources sur les drogues et les dépendances (7 en 1999, 21 en 2000). - enfin la MILDT, à la suite des observations de la Cour des comptes, a cherché à clarifier l'utilisation des crédits interministériels et a revu ses modalités de financement des actions de ses différents partenaires ministériels (examen plus rigoureux des demandes de crédits aux seules actions identifiées ou identifiables innovantes, mise en place de nouvelles procédures d'évaluation, consolidation de certaines dépenses dans les budgets des ministères concernés). Pour améliorer le fonctionnement de la MILDT et lui conférer une certaine pérennité et stabilité, il a par ailleurs été décidé de procéder au transfert des emplois des fonctionnaires mis à disposition par les différents ministères. Ce transfert d'emploi est en cours et s'étalera sur deux années au moins. |
En outre, dans son rapport 75 ( * ) d'information sur le contrôle budgétaire de la MILDT du 16 octobre 2001, la commission des finances du Sénat avait insisté sur les dysfonctionnements persistants de cette structure interministérielle en évoquant notamment le démarrage difficile et encore insuffisant des procédures d'évaluation et de compte-rendu des opérations pilotées par la MILDT ainsi que la persistance d'un financement par le budget de la MILDT de dépenses récurrentes ou de simple fonctionnement des ministères.
La MILDT est aujourd'hui composée de 43 agents, dont 22 chargés de mission qui sont des fonctionnaires mis à disposition par les différents ministères entrant dans le champ d'action de la MILDT, soit 20 départements ministériels au total.
La MILDT travaille essentiellement sur la base de réunions interministérielles, entre 10 et 20 par an d'après les informations fournies par M. Didier Jayle, nouveau président lors de son audition par la commission d'enquête.
Un nouveau plan gouvernemental quinquennal de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances, faisant suite au plan triennal 1999-2002, devrait être lancé en 2003.
3. L'évaluation de la MILDT : un bilan mitigé
Dans son rapport d'évaluation du plan triennal 76 ( * ) , l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies souligne que « malgré ses efforts, la MILDT n'apparaît pas en mesure de contribuer à la réalisation des objectifs visés avec un égal degré d'effectivité, condition préalable à une quelconque efficacité ».
Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Michel Setbon, chercheur au CNRS ayant participé à cette évaluation, a précisé que le champ d'action de la MILDT pouvait être différencié selon trois cercles concentriques figurant trois niveaux d'engagement distincts.
• Le premier cercle, le plus proche du centre représenté par la MILDT, recouvre le champ où son action prend la forme d'un pilotage « en direct » : la MILDT joue alors le rôle de maître d'ouvrage et constitue l'acteur central d'un certain type d'action, de certains axes stratégiques ou de parties d'entre eux. A cet égard, M. Michel Setbon a cité l'exemple de l'information du grand public ou de la mise en place d'une culture commune sur la politique de lutte contre la drogue, pour lesquelles il a estimé que la MILDT avait joué « un rôle d'acteur moteur et central sans s'attacher directement à des ministères particuliers ».
• Le second cercle d'action de la MILDT correspond à un champ relevant d'un pilotage contractuel : il inclut les actions où la présence interministérielle est réelle, mais réduite pour l'essentiel à une allocation de ressources, sans être en mesure de peser sur le terrain de l'action ou de faire évoluer les comportements des acteurs. A ce sujet, M. Michel Setbon a précisé lors de son audition : « il s'agit d'un espace d'activité ou d'action où sa présence (...) est essentiellement traduite par des contrats d'objectifs avec des ministères, des institutions associatives ou non, et des acteurs divers sous forme de contractualisation mais sur lesquels elle n'a pas d'action propre directe. C'est donc essentiellement à travers le financement qu'elle essaie de générer et d'impulser son action ».
• Enfin, le troisième cercle, le plus lointain, est celui du pilotage par une coordination formelle : il recouvre toutes les actions qui échappent au volontarisme et à ses incitations, illustrant les limites de la fonction de coordination face à des acteurs autonomes disposant de ressources et de registres d'action organisés autour d'enjeux spécifiques (répression, justice, action internationale). M. Michel Setbon a précisé que, dans ce cas de figure, la MILDT était « sans pouvoir réel vis-à-vis d'administrations ou d'acteurs qui (...) n'ont pas réellement besoin d'elle. Il s'agit de la justice, de la police, qui ont leur logique d'action, leur financement ».
M. Michel Setbon a ajouté : « En fonction de l'identification de ces trois champs, nous avons pu constater que la MILDT a pu installer ou inscrire des priorités qui n'étaient pas identifiées au départ de la mise en place de son plan (...) ce constat nous incite à réfléchir au contenu de la fonction interministérielle , qui est une vraie question, à ses possibilités actuelles, à son évolution et aux conséquences qu'il y aurait à renforcer ou à affaiblir ses pouvoirs selon les différents cercles. A notre avis, c'est une question qui demande réflexion. Il s'agit vraiment de se demander ce que peut ou ce que doit faire la MILDT et ce qui peut sortir de son champ ».
Il existe donc aujourd'hui, à la veille d'un nouveau plan, sans doute quinquennal, de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances, un besoin réel de réflexion quant au contenu opérationnel de la fonction interministérielle.
Interrogée par la commission sur les difficultés à conduire une politique interministérielle en matière de lutte contre les drogues, Mme Nicole Maestracci, ancienne présidente de la MILDT, a estimé que « dans notre pays, les administrations ne sont pas extrêmement portées vers l'interministériel : nous avons des administrations (...) verticales qui n'ont pas la culture de l'interministériel, (...) c'est une observation qu'on peut faire dans d'autres domaines que celui de la drogue. Sous cette réserve, à partir du moment où on leur a proposé des outils, elles s'en sont servi et c'est ainsi que, surtout dans les deux dernières années, nous avons beaucoup mieux travaillé, dans ce domaine, avec les différentes administrations. Cela s'est fait avec des limites ; je ne vais pas vous dire que nous avons réussi dans tous les domaines, mais un véritable travail interministériel s'est mis en place et, en tous cas, les résistances que nous avions eues au début n'ont plus eu cours ».
M. Didier Jayle, actuel président de la MILDT, a, pour sa part, estimé que la MILDT est « une mission interministérielle qui fonctionne vraiment, sans doute insuffisamment au niveau des cabinets. C'est un de mes rôles de la rendre plus proche des différents cabinets ». Il a ajouté : « La MILDT est une structure relativement légère, pluridisciplinaire et véritablement interministérielle dans sa conception et dans son fonctionnement ».
La commission d'enquête ne peut donc que prendre acte d'une amélioration du fonctionnement interministériel de la MILDT ainsi que d'une plus grande acceptation, voire appropriation de cet outil par les différents ministères concernés.
Dans ses réponses au questionnaire adressé par la commission, le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales estime que « la MILDT doit conserver une vocation réellement interministérielle et intégrer les aspects répressifs, dès lors qu'une coordination doit être entreprise entre les ministères chargés de l'application de la loi et les autres départements. Au delà du champ purement opérationnel qui reste de la prérogative des ministères concernés, la MILDT peut, le cas échéant, apporter une plus value en termes de concertation entre les ministères répressifs eux-mêmes dans des domaines tels que la formation, les aspects normatifs, etc. ».
4. La faiblesse du pilotage local
Si le pilotage interministériel national de lutte contre la toxicomanie s'est significativement amélioré, le pilotage local reste un des points faibles de la MILDT. M. Didier Jayle a ainsi précisé lors de son audition par la commission : « En termes d'organisation de la MILDT, je crois qu'il y a un gros problème, qui est celui de la déconcentration. (...) Le problème est qu'actuellement les chefs de projet départementaux, il y en a un par département, sont nommés par le préfet. La MILDT en est informée. Ces chefs de projet sont le plus souvent les DDASS, dans deux tiers des cas, et dans un tiers le directeur de cabinet du préfet. Même si le directeur de cabinet du préfet peut être extrêmement intéressé par le problème de la toxicomanie, ce n'est qu'un dossier en plus de beaucoup d'autres qu'il a à gérer ». Il a ajouté : « Je crois que la MILDT manque vraiment d'un meilleur maillage au niveau local et d'une coordination régionale avec des personnels MILDT ».
Enfin, en application d'une circulaire du Premier ministre du 13 septembre 1999, des chefs de projet départementaux désignés par les préfets assurent la coordination locale des actions de la MILDT en termes de lutte contre la toxicomanie : réunion d'un comité de pilotage, mise en place du programme départemental de prévention et de formation, mise en oeuvre de la convention d'objectif justice-santé, répartition des crédits déconcentrés, réorganisation des soins en liaison avec la DDASS, lien avec les collectivités locales, articulation avec les contrats de ville, les contrats éducatifs locaux ou les contrats locaux de sécurité.
En outre, des coordinateurs régionaux ont été désignés par les préfets de région pour assurer notamment la complémentarité avec les programmes régionaux de santé et les programmes de formation des échelons déconcentrés et des conseils régionaux.
La question essentielle, s'agissant de l'efficacité de la coordination locale, est celle de la disponibilité des chefs de projet pour effectuer une tâche qui est devenue de plus en plus lourde depuis l'adoption du plan triennal. Les chefs de projets départementaux devraient pouvoir s'appuyer sur plusieurs cadres de catégorie A pour conduire les dossiers.
L'autre question importante est celle de la pérennité des actions . Ainsi, les plans départementaux ou les conventions justice-santé devraient pouvoir faire l'objet d'engagements pluriannuels se traduisant par une contribution au financement du fonctionnement des structures et pas seulement au financement des actions.
Enfin, l'ensemble des actions financées par le chef de projet font l'objet d'une évaluation en amont dans le cadre du comité de pilotage et en aval dans le cadre des bilans transmis annuellement. Toutefois, le rapport d'information de la commission des finances du Sénat précité portant sur l'utilisation des crédits de la MILDT, estimait que « si la MILDT ne veut pas demeurer un simple distributeur de crédits, elle se doit de développer sa capacité de contrôle et d'évaluation sur les actions et les organismes qu'elle contribue à financer. L'exemple le plus prégnant à cet égard reste sans doute sa grande difficulté à évaluer les actions menées localement par les services déconcentrés de l'Etat ».
5. Le budget de la MILDT
La MILDT dispose d'un budget de fonctionnement inscrit au budget des services généraux du Premier ministre (SGPM) et d'un budget d'intervention inscrit au chapitre 47-16 du budget de la santé.
De 1998 à 2002, les crédits interministériels consacrés à la lutte contre la toxicomanie sont restés stables, autour de 46 millions d'euros. Leur utilisation a toutefois fait l'objet d'une réorientation, à la suite des conclusions sévères du rapport public de la Cour des comptes en 1998, ainsi que pour accompagner la réalisation des objectifs du plan triennal.
On rappellera que le budget de la MILDT finance trois types de dépenses :
- les actions des ministères membres du comité interministériel, dans les domaines de la prévention, de la réduction des risques, de la formation, de la lutte contre le trafic et de la coopération internationale, financées par les crédits répartis entre les ministères ;
- les subventions accordées aux groupements d'intérêt public aux associations et aux organismes publics oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la drogue et la toxicomanie, financées par les crédits d'intervention propres de la MILDT ;
- les programmes départementaux de prévention, les centres d'information sur les drogues et les dépendances ainsi que la prise en charge des toxicomanes incarcérés ou sortant de prison, financés par les crédits déconcentrés, délégués aux chefs de projets départementaux , étant rappelé que les conventions départementales justice-santé sont également financées par des crédits déconcentrés.
La réorientation des crédits interministériels à partir de 1999 a conduit à privilégier la recherche et l'amélioration des connaissances sur les drogues, notamment via le développement des activités de l'OFDT, l'information du grand public, la formation des professionnels et les crédits déconcentrés aux départements. La définition de ces nouvelles priorités s'est faite au détriment des crédits délégués aux différents ministères pour mener leurs propres actions et notamment des crédits d'équipement auxquels les ministères répressifs étaient habitués. En outre, le fonds de concours pour la lutte anti-drogue créé en 1995 dans le but notamment de financer ces équipements n'a jamais fonctionné faute de traçabilité des produits et matériels saisis. Le ministère de la justice a d'ailleurs adressé aux greffes une circulaire relative à la mise en oeuvre du fonds de concours pour la lutte anti-drogue, le 15 février 2002, afin de le relancer.
En 2003, les crédits interministériels consacrés à la lutte contre la toxicomanie se sont élevés à 40 millions d'euros, soit une baisse de 12,2 % par rapport à 2002. Cette diminution résulte d'un transfert des frais liés à la prise en charge des toxicomanes du budget de la santé vers l'assurance maladie, chargée de financer désormais les centres de soins et de prévention en addictologie (CSPA).
LES CHANGEMENTS DE PÉRIMÈTRE BUDGÉTAIRE DE L'ACTION INTERMINISTÉRIELLE POUR LA LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE
(en euros)
|
LFI 2002 |
PLF 2003 |
Evolution
|
|
|
Chapitre 47-15, article 30 (pour 2002) Programmes et dispositifs de lutte contre les pratiques addictives : dépenses non déconcentrées Chapitre 47-11, article 30 (pour 2003) Lutte contre les pratiques addictives dépenses non déconcentrées (nouveau) |
1.235.746 |
1.235.746 |
0,0 |
|
Chapitre 47-15, article 40 (pour 2002) Programmes et dispositifs de lutte contre les pratiques addictives : dépenses non déconcentrées Chapitre 47-11, article 40 (pour 2003) Lutte contre les pratiques addictives dépenses non déconcentrées (nouveau) |
117.228.944 |
9.724.444 |
- 91,7 |
|
Chapitre 47-16, article 10 Action interministérielle de lutte contre la toxicomanie |
45.578.000 |
40.000.000 |
- 12,2 |
|
TOTAL |
164.042.690 |
50.960.190 |
- 68,9 |
B. UN ARSENAL LÉGISLATIF THÉORIQUEMENT COMPLET ET DÉROGATOIRE
En matière de lutte contre les drogues, tout semble avoir été prévu, et pourtant, tout reste à faire. Alors que les forces de l'ordre n'ont pas faibli dans leur détermination à éradiquer la drogue, elles ont sans doute été trop peu soutenues au niveau politique, ce qui ne pouvait qu'avoir des conséquences négatives sur l'intensité de la réponse judiciaire.
1. Un consensus sur l'importance du dispositif actuel
Ainsi que l'a indiqué lors de son audition Maître Francis Caballero, président du Mouvement de légalisation contrôlée et farouche opposant à la politique répressive menée en France, « le système actuel s'appelle la guerre à la drogue. Tout est interdit : l'usage, l'incitation et le trafic, évidemment, dans de conditions de sécurité extrêmes. (...) Pour un détenteur de quelques grammes de cannabis, ce qu'on appelle une barrette, le droit positif, qui punit la détention comme un acte de trafic, prévoit une garde à vue de quatre jours avec un avocat au bout de 72 heures, c'est-à-dire trois jours, alors qu'un assassin violeur d'enfants, une racaille qui a fait quinze braquages de banque et a dix meurtres à son actif aura un avocat dès la première heure et, de nouveau, au bout de vingt heures. Je ne parle pas des perquisitions de nuit, de la prescription de vingt ans pour les délits au lieu de trois ans, des peines perpétuelles ou des vingt ans de réclusion pour la culture... La sévérité est extrême et les compteurs sont très hauts.
Alors que votre commission réfléchit à la manière d'améliorer la législation de lutte contre les drogues, même si je pense que, par nature, vous vous dites qu'il faut accentuer la répression et faire appliquer la loi dans sa plus grande rigueur, je vous signale que vous êtes presque au sommet de tous les compteurs et qu'il ne reste plus beaucoup de dispositions rigoureuses que votre commission pourra proposer : on a pratiquement tout incriminé, tout est puni et on a des procédures qui sont aussi dures qu'en matière de terrorisme. »
Paradoxalement, cette analyse n'est pas loin d'être partagée par M. Dominique Perben, garde des Sceaux, qui a ainsi indiqué lors de son audition : « J'ai plutôt le sentiment qu'il faut que nous fassions un très gros effort d'harmonisation nationale (vous l'avez souligné à travers vos questions et je vous ai dit ma détermination dans ce domaine), mais aussi de prévention, de rééducation et de réinsertion, effort qui, lui, n'est pas exclusivement judiciaire. Si nous devons développer une dynamique publique, c'est davantage dans ce sens qu'il faut agir, me semble-t-il, plutôt que de rouvrir un débat à caractère législatif dont les conséquences me paraissent incertaines. (...) Je ne sais pas vraiment si la modification de la loi est une priorité. Nous sommes beaucoup plus dans une problématique concrète et pratique de mise en oeuvre des politiques publiques. »
M. Yves Bot, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, a également indiqué à la commission d'enquête que « théoriquement, le droit pénal de fond (...) paraît adapté. Durcirait-on le code en multipliant par trois les peines qu'il porte à l'heure actuelle, on n'aurait sans doute pas plus de personnes arrêtées ni déférées devant les tribunaux. »
Mme Catherine Domingo, substitut du procureur de la République de Bayonne, a également indiqué que « la loi de 1970 et les lois complémentaires qui sont actuellement en vigueur (...) semblent présenter un panel de choix et de réponses tout à fait approprié. Il est vrai que cette loi de 1970 n'a pas été exploitée, jusqu'au milieu des années 1980, à sa pleine valeur. »
Enfin, M. Gérard Peuch, chef de la brigade des stupéfiants de la préfecture de police de Paris, après avoir relevé les difficultés pratiques des enquêtes, a indiqué à la commission d'enquête que « [ les dispositions de] la loi de 1970, en ce qui me concerne et concerne mes collègues qui donnent dans le domaine des stupéfiants, sont amplement suffisantes. »
2. Un arsenal législatif pléthorique
Effectivement, tout semble concourir à réprimer efficacement l'usage et le trafic de drogues 77 ( * ) . Qu'on en juge !
a) Concernant l'usage
- La loi du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses a introduit l'article L. 628 du code de la santé publique réprimant l'usage des substances classées comme stupéfiants , passible de deux mois à un an d'emprisonnement, et de 500 à 15.000 francs d'amende. Néanmoins, l'article L. 628-1 du code de la santé publique prévoit une procédure d'injonction thérapeutique : le procureur peut décider de ne pas poursuivre un usager simple de drogues -quelles qu'elles soient- si celui-ci accepte de se faire soigner. Pour les personnes qui suivent jusqu'à son terme le traitement médical prescrit, l'action publique ne sera pas exercée.
Cette loi est donc fortement incitative et s'adressait à l'origine aux héroïnomanes dépendants, avec pour objectif de parvenir au sevrage. Cette procédure peut être utilisée plusieurs fois, en cas de réitération de la consommation.
Dorénavant, les consommateurs encourent une peine d'un an d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende sur la base de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, tandis que la procédure d'injonction thérapeutique est prévue aux articles L. 3413-1 à L. 3413-3 du code de la santé publique.
- Le fait de provoquer à l'usage ou au trafic, qu'il ait ou non été suivi d'effet, ou de présenter ces infractions sous un jour favorable, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.
b) Concernant le trafic
A l'occasion de l'élaboration du nouveau code pénal, le législateur a renforcé la répression du trafic de stupéfiants en conférant aux faits relevant de ce qu'il est convenu d'appeler la « criminalité organisée » un caractère criminel, les infractions les moins graves conservant leur caractère de délit.
(1) Les crimes
- La direction ou l'organisation d'un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants (C. pén., art. 222-34, al. 1 er ) est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7.500.000 euros d'amende. Ceci vise les responsables d'organisations structurées de type mafieux ;
- La production ou la fabrication (C. pén., art. 222-35, al. 1 er ) est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 7.500.000 euros d'amende ;
- L ' importation ou l'exportation en bande organisée (C. pén., art. 222-36, al. 2) est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 7.500.000 euros d'amende ;
- Le blanchiment de nature criminelle , c'est-à-dire portant sur des biens ou des fonds provenant de l'un de ces crimes, pour autant que son auteur en ait eu connaissance (C. pén., art. 222-38, al. 2), est puni des peines prévues pour ces infractions.
(2) Les délits
- L'importation ou l'exportation (C. pén., art. 222-36, al. 1 er ) est punie de dix ans d'emprisonnement et de 7.500.000 euros d'amende ;
- Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de stupéfiants (C. pén., art. 222-37, al. 1 er ) sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7.500.000 euros d'amende. Ces diverses incriminations se trouvent souvent imbriquées, selon le degré de gravité des faits reprochés ;
- La facilitation de l'usage (C. pén., art. 222-37, al. 2) est punie de dix ans d'emprisonnement et de 7.500.000 euros d'amende. La réalisation de cette infraction suppose l'accomplissement d'un acte positif et non une simple abstention. Sa mise en oeuvre semble avoir connu de nouveaux développements, puisqu'elle a notamment été appliquée à des propriétaires d'établissements de nuit parisiens ;
- Les infractions relatives aux ordonnances fictives ou de complaisance (C. pén., art. 222-37, al. 2) visent d'une part l'usager et d'autre part le pharmacien. Elles sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 7.500.000 euros d'amende ;
- Le blanchiment de nature délictuelle a été renforcé par la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 et vise désormais le fait de faciliter par tout moyen la justification mensongère de l'origine des biens et des revenus de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 du code pénal ainsi que le fait d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de ces mêmes infractions ;
- La cession ou l'offre à une personne en vue de sa consommation personnelle (C. pén., art. 222-39, al. 1 er ) est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende. Sa création par la loi du 17 janvier 1986 avait notamment pour but de permettre l'utilisation de la procédure de comparution immédiate pour les agissements des petits revendeurs , qui peuvent aisément être constatés en flagrant délit. La peine d'emprisonnement prévue est de cinq ans et non de dix ans comme dans le délit d'offre ou de cession aujourd'hui incriminé à l'article 222-37. Les contours de cette infraction sont incertains et tiennent essentiellement aux conditions de sa constatation et à un choix de politique criminelle au niveau des poursuites. En revanche, la personne qui, ne s'adonnant pas elle-même à la consommation de drogue, fournit à plusieurs comparses des stupéfiants dont ils s'approvisionnent régulièrement, relève de l'article 222-37.
Deux circonstances aggravantes sont prévues lorsque les faits sont commis, soit auprès de mineurs, soit dans des centres d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration (C. pén., art. 222-39, al. 2). Les peines encourues (dix ans d'emprisonnement) faisaient jusqu'à l'adoption récente de la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, dite loi Perben I, obstacle à l'utilisation de la procédure de comparution immédiate ;
- Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie , tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'une des activités réprimées par la section relative au trafic de stupéfiants ou avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'usage de stupéfiants, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende (C. pén., art. 222-39, al. 1 er ). Le fait que ces personnes soient mineures constitue une circonstance aggravante (alinéa 2).
Cette infraction, couramment appelée « proxénétisme de la drogue », a été introduite dans le code pénal par la loi du 13 mai 1996. Elle repose sur un renversement de la charge de la preuve.
Outre ces infractions prévues par le code pénal, il existe un certain nombre d'infractions douanières.
(3) Des peines complémentaires diversifiées
Peuvent en outre être prononcées l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans le cadre de laquelle l'infraction a été commise, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, la privation des droits civiques, civils et familiaux, l'interdiction d'exercer une fonction publique, la confiscation de véhicules, la confiscation de la chose ayant servi ou destinée à commettre l'infraction, ou en étant le produit.
En outre, il peut être prononcé une peine d'interdiction du territoire français à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, à titre ou non définitif (C. pén., art. 130), ce qui est couramment qualifié de « double peine ». Dans un certain nombre de cas, le tribunal ne peut prononcer cette peine que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné, hormis les cas de direction ou d'organisation d'un groupement ou de fabrication, importation ou exportation et blanchiment.
Sont également prévues des peines obligatoires de confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement à la commission de l'infraction , ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse (C. pén., art. 222-49, al. 1 er ).
Peuvent également être prononcés le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant ainsi que la fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de tout établissement ouvert au public dans lequel ont été commises par l'exploitant ou avec la complicité de celui-ci certaines infractions.
c) Des règles procédurales fortement dérogatoires
Comme en matière de lutte contre le terrorisme, des aménagements particuliers ont été prévus afin de remédier aux difficultés de preuve.
(1) Un dispositif dérogatoire en matière de police judiciaire
• La facilitation de la recherche et de la constatation des infractions
- La livraison contrôlée permet de surveiller le passage par le territoire national de stupéfiants, en vue d'identifier les personnes impliquées dans le trafic. Les agents de l'autorité publique ont donc une attitude purement passive. Prévue à l'origine pour les douaniers, elle a étendue par la loi du 19 décembre 1991 aux policiers et gendarmes (C. proc. pén., art. 706-32, al. 1 er ). Elle implique une information du procureur de la République ;
- Le deuxième alinéa de l'article 706-32 du code de procédure pénale prévoit que les officiers et agents de police judiciaire ne sont pas pénalement responsables lorsqu'en vue de réprimer un trafic, ils commettent certaines infractions à la législation sur les stupéfiants, après y avoir été autorisés par le procureur de la République ou le juge d'instruction. Ceci doit permettre aux forces de l'ordre de remonter les réseaux :
- l ' infiltration consiste pour un policier ou un douanier à s'installer dans le rôle de trafiquant pour collecter des renseignements ;
- la livraison contrôlée implique que les enquêteurs interviennent activement dans la livraison, au besoin en achetant, en détenant ou en transportant eux-mêmes des stupéfiants.
Néanmoins, toute provocation de la part des enquêteurs, et singulièrement la provocation à la vente, est interdite. Est cependant autorisé le « coup d'achat », c'est-à-dire le fait pour un enquêteur de solliciter d'un dealer qu'il lui vende une certaine quantité de stupéfiants. Le vendeur à qui ils s'adressent doit être connu pour s'être livré antérieurement au trafic de stupéfiants.
• Le renforcement de la contrainte dans l'enquête
La loi du 31 décembre 1970 a prévu des règles dérogatoires s'agissant de deux actes coercitifs essentiels de l'enquête policière : les visites, perquisitions et saisies, ainsi que la garde à vue. Ceci ne concerne que la poursuite du trafic, et non de l'usage.
Il est ainsi possible de déroger aux horaires légaux de perquisition , et donc d'opérer des perquisitions de nuit (C. pr. pén., art. 706-28 al. 1 er ). Elle nécessite l'autorisation soit d'un juge d'instruction, soit du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué.
La loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a prévu des dispositions transitoires jusqu'au 31 décembre 2003 pour lutter contre le terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants. L'article 76-1 du code de procédure pénale prévoit ainsi que, si les nécessités de l'enquête l'exigent, pour les crimes et délits en matière de stupéfiants visés aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par décision écrite et motivée les officiers de police judiciaire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu. La loi sur la sécurité intérieure du 13 mars 2003 a prorogé ces dispositions jusqu'au 31 décembre 2005.
La garde à vue peut être prolongée de 48 heures , et durer ainsi quatre jours (C. pr. pén., art. 222-39, al. 1 er ). De plus, l'intervention de l'avocat est reportée à la 72e heure.
(2) Un dispositif dérogatoire en matière de procès pénal
• Des dispositions procédurales exceptionnelles
- Les délais de prescription sont augmentés . Sont ainsi prévues une prescription spéciale de l'action publique de 20 ans pour les délits (contre 3 normalement) et une prescription spéciale de la peine pour les délits de 20 ans.
- Des cours d'assises spéciales composées de magistrats professionnels ont été instaurées par la loi du 16 décembre 1992, afin de remédier aux risques d'intimidations ou de menaces sur les jurés et de s'adapter au caractère complexe des affaires de trafic de stupéfiants. Elles ne peuvent connaître que des crimes commis par des personnes majeures.
• La garantie des condamnations
- Afin de garantir le paiement de certaines condamnations, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peuvent ordonner des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen, sur requête du procureur de la République.
- La fermeture provisoire d'un établissement (pour 6 mois) peut être ordonnée par le juge d'instruction.
- La contrainte par corps, permettant d'incarcérer des personnes condamnées en cas de non-paiement de condamnations pécuniaires, est portée à 2 ans s'agissant d'amendes prononcées pour trafic ou pour les infractions douanières connexes excédant 75.000 euros (C. pr. pén., art. 706-31, dernier alinéa).
II. UN DISPOSITIF RÉPRESSIF IMPORTANT SUR LE TERRAIN MAIS AYANT LONGTEMPS SOUFFERT DE L'ABSENCE DE VOLONTÉ POLITIQUE
La répression des crimes et délits liés à la drogue concerne les services de plusieurs ministères : l'intérieur pour la police, la défense pour la gendarmerie, l'économie et les finances pour les douanes ou les délits financiers.
La loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002 pour la sécurité intérieure a favorisé l'organisation de synergies entre les différents services de l'État, à travers le regroupement de la police et de la gendarmerie nationales sous l'autorité du ministre de l'intérieur ou la création des groupes d'intervention régionaux.
A. LA DOUANE : UNE NÉCESSAIRE ADAPTATION EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LES STUPÉFIANTS DU FAIT DE LA LIBÉRALISATION DES ÉCHANGES
L'audition par la commission d'enquête de M. François Mongin, directeur général des douanes et des droits indirects, accompagné de M. Gérard Estavoyer, directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, a permis de constater à quel point la douane avait fait de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants une de ses priorités d'action, en se concentrant plus spécifiquement sur le démantèlement des grands trafics , notamment ceux empruntant le fret commercial.
La libéralisation des échanges et la création d'un espace unique européen de libre circulation des marchandises, des personnes et des capitaux ont conduit la douane à repenser l'organisation et les modalités d'intervention de ses services, afin de concilier les contraintes en termes de fluidité des échanges et les exigences en matière de protection de la santé et de la sécurité des citoyens.
D'après M. François Mongin, « il est incontestable que ces évolutions ont facilité le développement de la dimension transnationale des grands courants de fraude, en particulier du trafic de stupéfiants ».
Dans ce contexte, la lutte contre les stupéfiants a conservé un caractère prioritaire pour la douane, compte tenu de son rôle spécifique dans ce domaine, lié à sa position stratégique sur le territoire en matière d'observation et de contrôle des flux transfrontaliers de personnes, de marchandises et de capitaux. L'efficacité de son dispositif s'appuie également sur un renforcement de la coopération avec les autres services répressifs concernés et de la coopération douanière internationale.
1. L'organisation et les pouvoirs généraux de contrôle des services douaniers
Comme l'a indiqué M. François Mongin lors de son audition, « la douane (...) est avant tout une administration de terrain, présente 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ».
Il n'existe, à ce titre, pas de dispositif douanier dédié spécifiquement à la lutte contre le trafic de stupéfiants, ce choix organisationnel s'expliquant par la vocation généraliste de la douane et le nombre très important de contrôles dont elle a la charge.
L'exercice des missions de contrôle de la douane repose ainsi sur des pouvoirs d'investigation et d'enquête orientés vers la vérification de la régularité de la situation douanière des marchandises et de leur détention. Dans ce cadre, les contrôles physiques des personnes, moyens de transport et marchandises, prévus aux articles 60 et suivants du code des douanes, constituent un outil essentiel en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants. Ce droit de visite s'étend également aux navires et marchandises se trouvant à bord et, dans certaines conditions, aux locaux professionnels ou autres lieux où sont entreposées les marchandises. Ces contrôles spontanés sont complétés par un dispositif d'enquête fondé en particulier sur le droit de communication de tout document intéressant le service.
a) L'organisation administrative du dispositif douanier de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants
La lutte contre le trafic illicite de stupéfiants concerne non seulement les services déconcentrés de la douane ainsi que les services centraux et les services spécialisés à compétence nationale.
Au niveau central , plusieurs services douaniers sont particulièrement concernés par la lutte contre le trafic de stupéfiants :
- un bureau de la direction générale chargé de déterminer la politique en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants en liaison avec les autres services concernés, et de suivre les travaux interministériels et internationaux relatifs à la drogue ;
- la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), dont certains agents sont spécialisés dans le domaine des stupéfiants, en matière de renseignement et d'analyse, d'enquête et de mise en oeuvre de techniques spéciales d'investigation. Cette direction dispose d'échelons au niveau local.
Les services déconcentrés comprennent quarante directions régionales (y compris les circonscriptions des départements d'outre-mer) regroupées en dix directions interrégionales. Les orientations de contrôle nationales annuelles définies par la direction générale sont déclinées et mises en oeuvre sur le plan régional.
Sur le plan interrégional, la centrale interrégionale du renseignement (CIR) est notamment chargée de centraliser et de traiter le renseignement. Au niveau régional, des services spécialisés dans la recherche et l'exploitation du renseignement, les CERDOC (centres de renseignement, d'orientation et de contrôle) et les brigades de recherche complètent le dispositif général d'assistance et de collaboration avec les différents services de terrain.
Sur le plan local, l'ensemble des services de la surveillance, composés d'agents en uniformes et armés, occupent, à côté des agents chargés du contrôle des opérations commerciales, une place essentielle en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, notamment à l'occasion de leur mission de contrôle des marchandises, des personnes et des moyens de transport, dans le cadre de prérogatives conférées par le code des douanes.
b) Les effectifs présents sur le terrain
Dans ses réponses au questionnaire adressé par la commission à la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), cette dernière a indiqué, s'agissant du nombre d'agents participant directement ou indirectement à la lutte contre le trafic de stupéfiants, que l'on peut « considérer que l'ensemble des services douaniers effectuant des contrôles de marchandises et des flux participent directement ou indirectement dans leur activité quotidienne à la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, qu'il s'agisse des services des opérations commerciales ou de ceux de la surveillance ».
La douane, dont l'effectif total s'élève en 2002 à 19.133 agents, est composée pour moitié d'agents en uniforme, positionnés aux points d'entrée du territoire les plus utilisés, à savoir les aéroports, les ports, les gares, les frontières intra et extra-communautaires, ainsi que sur les principaux axes de circulation de tous les moyens de transport. Ces agents disposent de moyens d'intervention adaptés à leurs missions et ils possèdent une bonne connaissance de leur terrain d'investigation qui leur permet d'effectuer des contrôles efficaces et de recueillir des renseignements.
L'autre moitié des effectifs douaniers est affectée de façon plus classique au contrôle et au traitement des opérations commerciales. Dans ce cadre, les agents maîtrisent et analysent les flux de marchandises et de biens. Ils orientent des recherches ciblées sur les marchandises sensibles et les vecteurs de transport susceptibles d'être utilisés pour organiser des trafics, des infiltrations clandestines de personnes ou de produits.
|
ESTIMATION PAR LA DGDDI DU NOMBRE D'AGENTS
- en métropole : 9.045 agents ; - dans les départements et territoires d'outre-mer : 775 agents - soit un total de 9.820 agents. |
Ces effectifs couvrent l'ensemble des agents de surveillance (recherche du renseignement, contrôles à la circulation et en points fixes, surveillance aéro-maritime...) ainsi que les agents des opérations commerciales effectuant des contrôles des échanges commerciaux. Le nombre d'agents participant directement ou indirectement à la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants représente donc 51,3 % de l'effectif total des agents de la douane.
En outre, sur le plan international la douane dispose d'un réseau de quinze attachés douaniers et attachés douaniers adjoints . Implantés majoritairement sur le continent européen, leur compétence s'étend sur plusieurs pays. Ils sont placés sous l'autorité directe du directeur général des douanes et des droits indirects duquel ils reçoivent des instructions. Outre la DGDDI, les attachés douaniers représentent TRACFIN dans les pays de leur zone de compétence.
Les missions des attachés douaniers recouvrent trois aspects principaux : la lutte contre la fraude, la diplomatie douanière et un rôle économique. La lutte contre le trafic de stupéfiants ne constitue donc qu'un aspect de leur mission. Dans ce domaine, ils entretiennent des relations avec les services de lutte contre la fraude de leur zone de compétence et favorisent les échanges d'informations et la coopération opérationnelle. Ils sont toujours associés aux livraisons surveillées internationales réalisées à l'initiative de la douane française, livraisons lors desquelles ils sont en général les intermédiaires de la DNRED avec les douanes et autorités locales, même si des contacts directs peuvent exister ponctuellement sur ces opérations.
Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Gérard Estavoyer, directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, a ainsi précisé : « les attachés douaniers nous servent de « courroie de transmission » pour les opérations et les échanges de renseignements, et ils sont à notre disposition 24 heures sur 24 ».
2. Les pouvoirs et moyens spécifiques des services douaniers en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants
La lutte contre le trafic de stupéfiants constitue l'une des priorités d'action de la douane. Depuis 1997, cette action figure parmi les priorités définies à travers deux niveaux d'orientation des contrôles : l'instruction-cadre, d'une part, précisant les douze secteurs prioritaires de l'action douanière, le plan national de contrôle annuel, d'autre part, où figure la lutte contre le trafic de stupéfiants depuis 1997 selon des modalités différentes (pour 2003, l'attention du service devra se concentrer plus particulièrement sur la lutte contre les stupéfiants dans le fret commercial et sur les drogues de synthèse).
L'action de la douane en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants s'exerce d'abord à travers ses missions générales de dédouanement et de surveillance des flux de marchandises, de personnes et de capitaux, tant aux frontières extérieures de l'Union européenne que dans le cadre de la surveillance générale sur l'ensemble du territoire national. Dès lors, l'ensemble des agents des douanes participant à ces missions prend part directement ou indirectement à la lutte contre ce type de trafic.
Toutefois, cette stratégie fondée sur l'observation suivant laquelle les trafics illicites empruntent souvent les circuits économiques licites, est complétée par l'existence de services spécialisés en matière de stupéfiants .
Ainsi, la douane dispose de moyens humains et matériels plus spécialisés :
- 190 équipes cynophiles spécialisées dans la détection de stupéfiants, réparties sur l'ensemble du territoire français ;
- un important dispositif aéro-maritime de soutien et d'intervention (14 avions, 6 hélicoptères et 60 vedettes) qui en fait la première force civile en mer ;
- un réseau de dix laboratoires scientifiques, ayant analysé plus de 4.650 échantillons de stupéfiants au cours de l'année 2002 ;
- des matériels de détection spécialisés : deux Sycoscan 78 ( * ) (implantés au Havre et à l'entrée du tunnel sous la Manche) ; douze appareils détecteurs de particules pour la recherche de produits stupéfiants (ionscan) permettant de déceler et d'identifier des produits stupéfiants en quantités infimes ; des appareils fixes ou mobiles de radioscopie à rayons X ainsi que des tests permettant, au-delà de la détection d'un usage de drogue, le dépistage éventuel de stupéfiants transportés in corpore .
Par ailleurs, certains agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) sont spécialisés dans le domaine des stupéfiants, que ce soit aussi bien en matière de renseignement et d'analyse, que d'enquête ou de mise en oeuvre de techniques spéciales d'investigation.
Outre ces pouvoirs généraux de contrôle et d'enquête, la douane dispose de pouvoirs spécifiques en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants , comme la possibilité de faire pratiquer des examens de dépistages médicaux sur une personne suspectée de transporter des stupéfiants in corpore (article 60 bis du code des douanes), la mise en oeuvre de livraisons de produits stupéfiants (article 67 bis du code des douanes) et sous certaines conditions, la possibilité d'intervenir à bord de navires se trouvant en haute mer.
La particularité de la douane tient ainsi au fait qu'elle met en oeuvre une procédure spécifique , fondée sur le code des douanes, qu'elle intervient en amont des autres administrations répressives et que son action se concentre essentiellement sur le démantèlement des grands trafics , notamment ceux empruntant le fret commercial.
Les résultats en termes de saisies annuelles témoignent de l'importance du rôle joué par la douane en matière de lutte contre la drogue. Ainsi, au cours de l'année 2002, les services douaniers ont réalisé 26.753 saisies qui ont donné lieu à l'interpellation de 26.559 personnes et ont permis d'intercepter 46 tonnes de stupéfiants auxquelles s'ajoutent 1,9 million de cachets d'ecstasy. En saisissant en moyenne entre 70 et 80 % du total des quantités de drogues interceptées sur le territoire national, la douane contribue à réduire l'accessibilité de ces produits ainsi qu'à identifier et démanteler les réseaux criminels impliqués dans des trafics .
ÉVOLUTION DES SAISIES DOUANIÈRES DE STUPÉFIANTS DE 1997 A 2002
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|||||||
|
Produits en kg |
Nombre de saisies |
Quantités saisies |
Nombre de saisies |
Quantités saisies |
Nombre de saisies |
Quantités saisies |
Nombre de saisies |
Quantités saisies |
Nombre de saisies |
Quantités saisies |
Nombre de saisies |
Quantités saisies |
|
Opium |
24 |
1,3 |
14 |
2,4 |
23 |
0,4 |
16 |
17,05 |
13 |
0,9 |
18 |
1,1 |
|
morphine |
4 |
0,2 |
8 |
0,2 |
6 |
0,2 |
7 |
0,2 |
8 |
0,07 |
8 |
0,3 |
|
Héroïne |
1.044 |
211,7 |
942 |
197,2 |
750 |
123 |
675 |
318,4 |
694 |
180,2 |
731 |
178,8 |
|
Cocaïne |
1.104 |
695,9 |
910 |
624,8 |
954 |
1.005 |
903 |
1.192,7 |
931 |
1.906,5 |
1.174 |
2.580,8 |
|
Crack |
43 |
9,4 |
49 |
19,1 |
32 |
3,9 |
78 |
4,1 |
43 |
0,8 |
55 |
4 |
|
Herbe |
7.479 |
1.935,7 |
7.718 |
2.608,3 |
7.173 |
2.754,6 |
8.954 |
3.469,1 |
10.343 |
3.590,8 |
10.545 |
4.177,3 |
|
Résine |
19.092 |
42.431,9 |
20.698 |
38.051,7 |
20.316 |
54.944,5 |
17.902 |
37.514.,1 |
18.177 |
45.387,3 |
15.158 |
39.215,9 |
|
Huile |
84 |
0,7 |
38 |
0,2 |
33 |
1,5 |
59 |
1,9 |
39 |
1,3 |
58 |
2,1 |
|
Amphétamines |
269 |
193,9 |
261 |
158,4 |
188 |
231,5 |
156 |
448,5 |
194 |
45,7 |
211 |
154,8 |
|
Khat |
25 |
79,3 |
45 |
34,3 |
30 |
16,9 |
96 |
201,2 |
37 |
28,9 |
27 |
336,2 |
|
Champignons hall |
196 |
2,8 |
292 |
5,7 |
304 |
4,6 |
315 |
6,4 |
443 |
7,2 |
551 |
18,7 |
|
Sous-totaux produits en kg |
29.364 |
45.562,8 |
30.975 |
41.702,3 |
29.809 |
59.086,1 |
29.161 |
43.173,65 |
30.922 |
51.149,67 |
28.536 |
46.610 |
|
Produits en unité |
||||||||||||
|
Ecstasy (doses) |
529 |
153.336 |
457 |
1.108.240 |
564 |
1.829.384 |
529 |
2.028.118 |
1.236 |
1.285.221 |
914 |
1.891.854 |
|
LSD (en doses) |
233 |
4.686 |
167 |
7.822 |
155 |
7.455 |
233 |
9.509 |
139 |
6.007 |
46 |
2.359 |
|
Sous-totaux produits en unité |
762 |
158.022 |
31.602 |
1.116.062 |
30.531 |
1.836.839 |
29.925 |
2.037.627 |
32.298 |
1.291.228 |
29.501 |
1.894.213 |
|
TOTAL GENERAL |
30.126 |
45.562,8 kg 153.336 cachets d'ecstasy et 4.686 doses de LSD |
31.602 |
41.702,3 kg 1.108.240 cachets d'ecstasy et 7.822 doses de LSD |
30531 |
59.086,1 kg 1.829.384 cachets d'ecstasy et 7.455 doses de LSD |
29.925 |
43.173,7 kg 2.028.118 cachets d'ecstasy et 9.509 doses de LSD |
32.298 |
51.149,7 kg 1.285.221 cachets d'ecstasy et 6.007 doses de LSD |
29.501 |
46.610 kg 1.891.854 cachets d'ecstasy et 2.359 doses de LSD |
En outre, les services douaniers interviennent dans les circuits de blanchiment du produit de ces infractions (contrôle des manquements à l'obligation déclarative, contrôle des changeurs manuels). En 2002, 1.784 manquements à l'obligation déclarative ont ainsi été constatés, portant sur un montant de plus de 233 millions d'euros. Certaines de ces affaires sont liées au trafic de stupéfiants, la douane a déposé 13 plaintes pour blanchiment de capitaux issus de ces trafics.
3. La nécessaire adaptation des méthodes de travail des services douaniers
L'internationalisation et l'intensification des échanges commerciaux, le développement des moyens de communication et la diminution des possibilités de contrôles physiques des personnes et des marchandises ont rendu nécessaire une évolution des méthodes de travail de la douane.
Cette adaptation s'est d'abord traduite par un repositionnement de ses unités de surveillance et le redéploiement d'une partie de ses agents vers l'intérieur du territoire.
Par ailleurs, le recours croissant au renseignement et au ciblage des opérations a permis une réorientation des contrôles douaniers, qui se doivent désormais d'être plus rapides, soigneusement sélectionnés et efficaces pour être acceptés et pour maintenir un niveau satisfaisant de sécurisation des échanges.
a) La mise en place d'unités mobiles sur le territoire et le repositionnement des unités de surveillance de la douane
La disparition des formalités et des contrôles systématiques liés au franchissement des frontières intérieures de l'Union européenne le 1 er janvier 1993 a entraîné une redéfinition du dispositif douanier, conformément aux engagements internationaux de la France et au principe communautaire de proportionnalité des contrôles.
Ainsi, la nécessité de pallier les insuffisances de la libre circulation des marchandises et le développement des fraudes a conduit au renforcement des capacités d'intervention de l'administration des douanes aux frontières extra-communautaires, à la généralisation des unités mobiles en retrait des frontières intra-communautaires et au maintien des contrôles à proximité de celles-ci comme à l'intérieur du territoire national.
L'implantation des services répond à la logique des flux de marchandises, ce qui explique une plus forte présence douanière dans les principaux ports et aéroports, de même que dans les zones frontalières. Ces structures fixes sont complétées par des unités mobiles chargées des contrôles à la circulation sur l'ensemble du territoire ainsi que d'un dispositif aéro-maritime de soutien et d'intervention.
|
L'ORGANISATION DES SERVICES OPÉRATIONNELS
1 - Les différents types d'unités terrestres : * les brigades de contrôle : il s'agit d'unités fixes positionnées aux frontières extérieures (aéroports en particulier) chargées d'assurer la garde permanente ou intermittente des points de passage et de procéder au contrôle des marchandises, des moyens de transport et des personnes ; * les brigades de surveillance : il s'agit de structures mobiles positionnées à proximité des frontières extérieures et participant à la surveillance de la zone frontalière, en complément des brigades de contrôle ; * les brigades de contrôle et de surveillance : il s'agit d'unités positionnées à proximité des frontières extérieures et exerçant des fonctions mixtes, consistant en des contrôles fixes sur les points de passage et des contrôles mobiles en arrière de ces points de passage ; * les brigades de surveillance et d'intervention : il s'agit de services implantés dans la zone frontalière intracommunautaire et sur les arrières des frontières intérieures, effectuant des missions de surveillance et de contrôle ; * les brigades d'intervention : il s'agit d'unités mobiles positionnées à l'intérieur du territoire, intervenant sur le réseau routier, sur les arrières des brigades de surveillance ainsi que dans les agglomérations à l'intérieur du territoire. 2 - La surveillance aéro-maritime et aéroterrestre : Les dispositifs aériens et navals constituent un complément indispensable aux structures terrestres dans la lutte contre le trafic international de stupéfiants, compte tenu de la très grande diversité des vecteurs de fraude empruntés par le trafic illicite de stupéfiants. * le dispositif maritime et aéro-maritime : il est organisé en quatre circonscriptions placées chacune sous l'autorité d'un directeur interrégional maritime (Rouen, Nantes, Marseille, Fort-de-France). Il est composé de six brigades de surveillance aéro-maritime, équipées de quatorze avions destinés à la surveillance des eaux territoriales ainsi que de six hélicoptères opérant la surveillance des eaux côtières du littoral métropolitain. Par ailleurs, trente brigades garde-côtes dotées de vedettes de 19 à 32 mètres, équipées pour patrouiller en haute mer et dans la zone côtière, d'une part, et trente brigades de surveillance nautique dotées de vedettes, en charge de la surveillance rapprochée de la zone côtière et pour six d'entre elles de la surveillance des enceintes et rades portuaires, d'autre part, complètent ce dispositif. Enfin, deux camions radar destinés à la surveillance des approches du littoral atlantique et méditerranéen assurent le guidage des unités d'intervention. * le dispositif aéroterrestre : il repose sur une structure unique de commandement rattachée à l'interrégion d'Ile-de-France et basée à proximité de Paris. L'activité des unités aéroterrestres, qui disposent d'avions et d'hélicoptères, s'exerce sur l'ensemble du territoire métropolitain et repose principalement sur la centralisation, le traitement et l'enrichissement du renseignement aérien, la lutte contre la contrebande par voie aérienne, le contrôle des aéronefs en provenance de l'étranger et la surveillance des aérodromes secondaires. |
b) Le développement d'une nouvelle politique du renseignement
- Les évolutions liées au contexte de libéralisation des échanges ont également conduit à la définition d'une nouvelle politique de contrôle et de lutte contre la fraude, basée non plus sur la recherche aléatoire de la fraude mais sur l'exploitation du renseignement et l'exploitation de nouvelles méthodes de travail, telles que l'analyse de risque et le ciblage des contrôles .
L'organisation du renseignement repose sur l'idée que sa collecte concerne tout agent, alors que son analyse et son traitement sont affaire de spécialistes. Une procédure de transmission souple et rapide du renseignement a été mise en place. Par ailleurs au niveau national, la DRNED assure la centralisation des informations sur la fraude et effectue les recoupements nécessaires, y compris internationaux.
L'ensemble des agents de la douane participe au recueil d'informations intéressantes pour la lutte contre la fraude. Un formulaire dit « fiche CERES » est destiné à faciliter le recueil et la diffusion de l'information. Par ailleurs, des services locaux, régionaux et nationaux spécialisés ont une activité plus organisée dans le recueil et le traitement du renseignement, notamment des analyses préalables faites à partir de constatations déjà réalisées.
Le traitement et la diffusion du renseignement relèvent de services spécialisés. Au niveau national, il s'agit de la direction du renseignement et de la documentation au sein de la DRNED.
- Le deuxième volet de la nouvelle politique de renseignement développée depuis dix ans par la douane consiste dans la mise en oeuvre de techniques d'analyse de risque et de ciblage .
Ces nouvelles techniques de contrôle sont fondées non seulement sur les qualités d'observation des agents mais également sur l'établissement de profils de fraude . La diffusion du renseignement aux services, permettant d'orienter et de cibler leurs contrôles, constitue également un élément important dans la lutte contre la fraude. A ce titre, la douane dispose de plusieurs outils pour transmettre les informations obtenues, parmi lesquels le dossier « Suggestions et directives d'enquêtes et de contrôles », les analyses de risque réalisées par les services spécialisés ainsi que les avis de fraude et les demandes d'enquête intégrés dans le fichier national informatisé de documentation.
Les méthodes de travail préconisées pour l'exercice des contrôles, c'est-à-dire l'analyse de risque et le ciblage, le sont également en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants.
|
LA TECHNIQUE DU CIBLAGE Le ciblage des contrôles physiques constitue la conséquence directe du développement de l'analyse de risque par les services douaniers. Le ciblage se fonde sur un travail d'analyse documentaire des flux de voyageurs et de marchandises par des équipes spécialisées implantées dans les sites portuaires et aéroportuaires. La sélection anticipée des personnes ou marchandises à soumettre à un contrôle douanier résulte de l'analyse des documents ou informations connues sur les personnes ou les flux de marchandises effectuée à la lumière des connaissances du service sur la sensibilité à la fraude du pays de provenance, du moyen de transport, de la nature de la marchandise déclarée. Lors de son déplacement à Saint-Martin , la commission d'enquête a été sensibilisée à la technique du ciblage douanier par un exposé de M. Robert Chauvin, chef de la brigade de recherche et de surveillance de Saint-Martin. Il a expliqué à la commission d'enquête que la technique du ciblage était appliquée non seulement sur les moyens trafics, avec le ciblage des containers, des bateaux de plaisance et de commerce, mais aussi sur les petits trafics avec le ciblage de passagers aériens, ciblage ayant pour principe la détermination à l'avance de passagers suspects à partir de l'analyse du listing des compagnies aériennes. Il a en outre précisé que les critères de ciblage avaient été définis en fonction notamment des affaires déjà réalisées. Enfin, il a souligné que lorsque la technique du ciblage aérien avait été mise en place à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, un passager contrôlé sur quatre était « positif ». |
4. Les moyens budgétaires des services douaniers assignés à la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants
Dans ses réponses au questionnaire adressé par la commission d'enquête, la DGDDI précise que « les outils de suivi de la dépense actuellement utilisés en douane n'offrent pas la faculté de retracer directement le coût de l'action de la lutte contre les drogues illicites, seule une évaluation de cette charge budgétaire peut être entreprise ».
A cet égard, il convient de souligner que l'agrégat budgétaire de l'administration des douanes présenté en prévision et en exécution dans le cadre des projets de loi de finances initiale depuis l'année 2000 est exempt de données chiffrées retraçant spécifiquement le coût de la lutte contre les stupéfiants. En effet, cette action n'est pas isolée au sein de l'agrégat intitulé « protection et lutte contre les grands trafics » dont le coût total s'est élevé en 2001 à 325 millions d'euros et, à titre prévisionnel, à 346 millions d'euros en 2002.
Après définition d'un périmètre budgétaire « pertinent », regroupant les coûts de personnel, les moyens de fonctionnement ainsi que les dépenses d'investissement affectés aux douanes, il est possible de dresser un bilan de l'ensemble des moyens budgétaires consacrés par la douane à la lutte contre les stupéfiants depuis 1993.
PART DES DÉPENSES DE LA DOUANE CONSACRÉE À LUTTE CONTRE LES DROGUES ILLICITES AU SEIN DES DÉPENSES TOTALES DEPUIS 1993 (EN EUROS)
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
|
|
Dépenses totales des services douaniers |
642.524.253 |
650.947.857 |
677.504.434 |
724.352.720 |
761.027.222 |
773.902.880 |
810.288.909 |
816.827.608 |
846.204.114 |
|
Part consacrée à la lutte contre les drogues illicites |
100.425.986 |
100.584.766 |
104.952.468 |
110.563.985 |
117.116.415 |
118.492.820 |
126.177.426 |
126.903.767 |
131.666.238 |
|
Pourcentage |
15,63 % |
15,45 % |
15,5 % |
15,26 % |
15,39 % |
15,31 % |
15,6 % |
15,53 % |
15,56 % |
Source : DGDDI
|
LA DOUANE DE SAINT-MARTIN La douane s'est implantée à Saint-Martin en octobre 1990, à l'initiative de M. Michel Charasse alors ministre du budget, dans des conditions particulièrement difficiles compte tenu de l'hostilité affichée de la population et des élus. En dépit des difficultés rencontrées, bénéficiant durant plusieurs mois de la protection des forces de gendarmerie, la douane est parvenue à installer une brigade dont l'action, aujourd'hui, n'est plus contestée. L'effectif de la brigade de surveillance et de recherche (BSR) est de neuf emplois implantés et devait être renforcé à partir de mai 2003 par trois agents afin de compenser certains départs à la retraite. Cette brigade exerce trois missions principales : - l'action anti-fraude (lutte contre les grands trafics : stupéfiants, blanchiment d'argent, marchandises frappées de prohibition, etc.) ; - la recherche et la collecte de renseignements (analyse de risques et connaissance des secteurs porteurs en terme délictuel, gestion des sources, collaboration avec les autorités douanières néerlandaises, ciblage aérien) ; - la surveillance générale (contrôle par épreuves des flux de marchandises et de personnes qu'il s'agisse de l'aéroport de Grand Case, du Port de Galisbay ou de Marigot, qu'il s'agisse des aéronefs, des caboteurs, du trafic de containers ou des navettes passagers ; participation aux actions interministérielles, GIR notamment). Afin de remplir ces missions, la BSR dispose de moyens matériels particuliers : 4 véhicules, 1 scooter et 1 zodiac notamment. Elle peut en outre s'appuyer sur les moyens nautiques de la Brigade des Garde-côtes des douanes et reçoit régulièrement l'aide des forces de police ou de gendarmerie lors d'opérations d'initiative nécessitant une sécurisation ferme des dispositifs mis en place. La BSR a comme secteur d'activité les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy. Par ailleurs, la BSR assure certaines missions pour le compte de la direction des enquêtes douanières (DED) qui dispose d'une antenne à Pointe-à-Pitre. Une brigade garde-côtes (BGC) composée de 17 agents, armant deux moyens maritimes (une vedette garde-côtes de 24 mètres et un intercepteur rapide de type Hurricane) complète le dispositif douanier en place sur l'île de Saint-Martin. Cette BGC relève de la direction interrégionale des douanes Antilles-Guyane basée à Fort-de-France. Le bilan 2002 de la douane de Saint-Martin peut être ainsi résumé. En matière de lutte anti-fraude, la BSR a réalisé des saisies significatives : 31,2 kilogrammes de cocaïne, 3,5 kilogramme d'héroïne, 4,1 kilogramme d'herbe de cannabis, 107 grammes de résine de cannabis. En outre, grâce à un travail de ciblage aéroportuaire, cette brigade a fait réaliser à destination de l'aéroport de Roissy trois saisies pour un poids total de 6,3 kg de cocaïne. Le traitement par l'unité des avis de fraude signalés a permis également de confirmer les soupçons et de réaliser à l'occasion de deux contrôles à Roissy la saisie de 8,2 kg de cocaïne. Enfin, deux avis de fraude pour soupçon de blanchiment ont été transmis (les enquêtes sont en cours). Le 30 janvier 2003, dans le cadre d'une parfaite synergie avec les SRPJ, les services douaniers de Saint-Martin (BGC, BSR) et la DED ont permis la saisie sur un navire, le Daniella, de 204 kg de cocaïne et de 15 kg d'héroïne. En matière de recherche et de collecte de renseignements, la reconquête de secteurs professionnels porteurs en termes de fraudes douanières potentielles ou d'infractions connexes n'a pu être menée aussi loin qu'espéré. La réalisation prioritaire d'objectifs douaniers plus classique (surveillance générale et perception de taxes) a alors prévalu. Dès février 2002, la brigade a ainsi été mobilisée entièrement à la mise en place, au suivi et à la notification d'infractions pour non paiement de la Taxe spéciale sur les carburants à Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Par son action, la BSR a contribué au versement à la collectivité locale de Saint-Martin de plus de 2 millions d'euros. La surveillance générale a revêtu des formes aussi diverses que le contrôle et la visite d'aéronefs privés et de ligne, de caboteurs, de containers et de navettes passagers, la mise en place d'un service, la collaboration à des actions interministérielles (GIR, contrôles routiers, actions contre le travail illégal). Enfin, par des actions conjointes avec la douane hollandaise (lagon, contrôles à l'aéroport de Juliana), la BSR a développé la collaboration voulue par la convention signée le 11 janvier 2002 entre la France et les Pays-Bas, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les deux administrations douanières, mais non encore ratifiée. La BSR doit toutefois faire face à certains obstacles dans l'exercice de ses missions : - en termes de contrôle des flux de personnes et de marchandises : l'aéroport de Grand Case est ouvert au trafic international sans que l'arrêté du 20 avril 1998 portant ouverture des aérodromes au trafic international ne l'ait expressément autorisé. Par ailleurs, les travaux commencés à l'aéroport ont été suspendus, l'état des infrastructures et la localisation du local provisoire affecté à la douane ne lui permettent pas d'assurer convenablement ses contrôles à Grand Case (200.000 passagers). Enfin, en matière de sûreté aéroportuaire, aucun matériel n'est installé pour assurer l'inspection filtrage des bagages de soute sur l'aéroport de Grand Case. En outre, aujourd'hui de nombreux secteurs demeurent non contrôlés, notamment le trafic de containers arrivant au Port de Galisbay, les rotations effectuées par les caboteurs en provenance des îles voisines, les navettes inter-îles de passagers ainsi que les mouvements des bateaux de plaisance ; - en termes de renseignement et de coopération : la convention de coopération douanière signée entre la France et les Pays-Bas le 11 janvier 2002 n'a toujours pas été ratifiée ; - en termes de formation et de commandement : les coûts de transports entre l'île et la Guadeloupe continentale alourdissent le budget de fonctionnement de l'administration des douanes représentée sur l'île de Saint-Martin. Les agents en poste sur l'île sont alors contraints de limiter considérablement leurs déplacements. Le directeur régional et l'un de ses proches collaborateurs se rendent à Saint-Martin toutes les huit semaines environ. |
B. LES FORCES DE POLICE AFFECTÉES À LA LUTTE CONTRE LES STUPÉFIANTS
Au sein de la police nationale, la lutte contre le trafic et l'usage de stupéfiants est assurée par plusieurs services spécialisés.
1. Les dispositifs de lutte contre le trafic organisé et le trafic international
a) La direction centrale de la police judiciaire et l'OCRTIS
La direction centrale de la police judiciaire , dont la vocation est la lutte contre les trafics d'assez haut niveau, dispose de services et de sections dédiés à cette lutte : 80 fonctionnaires au sein de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ( OCRTIS ) et 220 policiers dans les sections stupéfiants des 19 services régionaux de police judiciaire ( SRPJ ). Ces groupes ont vocation à traiter les affaires de réseaux organisés qui vont s'approvisionner hors du ressort géographique régional, voire à l'étranger. Leur rôle est de lutter contre le trafic dans le ressort de leur compétence territoriale. Dès lors qu'il s'agit d'affaires de trafic national ou international, celles-ci sont traitées par l'OCRTIS.
Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Bernard Petit, chef de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS), a précisé « qu'outre le recueil des informations opérationnelles, la centralisation de ces informations et la coordination des actions opérationnelles en matière de lutte, [l'OCRTIS] a également en charge la gestion du fichier national des auteurs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à partir duquel, tous les ans, nous disposons d'un rapport annuel sur l'état de l'usage et du trafic des stupéfiants en France ».
L'OCRTIS, créé par le décret n° 53-726 du 3 mars 1953 au sein de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur, a pour mission de coordonner l'action répressive au plan national, d'assurer la coopération internationale opérationnelle avec nos principaux partenaires étrangers et de centraliser tous les renseignements et informations utiles en matière de stupéfiants, du point de vue statistique mais aussi du point de vue de la connaissance des réseaux et des produits disponibles sur le marché.
A cette fin, l'OCRTIS dispose de groupes d'enquête qui travaillent d'initiative ou en co-saisine avec d'autres services. Organe à vocation interministérielle, il comprend des représentants des douanes et de la gendarmerie nationale qui assurent l'interface avec leur administration respective.
Le pôle documentation gère le Fichier national des auteurs d'infractions à la législation sur les stupéfiants (FNAILS). D'après les informations fournies par les services du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, cette base de données devrait être prochainement refondue dans une nouvelle application qui permettra une gamme de recherche plus étendue et plus fine pour mieux décrire les phénomènes.
En outre, dans le but de pouvoir surveiller les filières de production au niveau international implantées sur le territoire national, l'OCRTIS détache deux enquêteurs auprès de la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques (MNCPC), rattachée au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. La connaissance des filières mondiales approvisionnant le marché français nécessite également l'implantation d'officiers de liaison de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) à l'étranger : l'OCRTIS dispose ainsi de douze antennes et dix-sept officiers situés dans des pays tels que les Etats-Unis, la Colombie et Chypre.
S'agissant de l'articulation entre les différents services de la police nationale , s'il existe depuis de nombreuses années une étroite coopération entre l'OCRTIS et les SRPJ, le contexte national et international de lutte contre le trafic de drogues illicites a conduit à resserrer les liens opérationnels entre la direction centrale de la police judiciaire et les autres directions de la police nationale, pour permettre une assistance mutuelle lors d'actions sensibles d'interception de produits stupéfiants et de démantèlement de réseaux.
La réunion semestrielle du « Bureau de liaison stupéfiants », à l'initiative du chef de l'OCRTIS, est un des éléments moteurs de ce rapprochement des acteurs.
La place qui est accordée à la police judiciaire au sein des GIR permet également de contribuer à la connaissance de l'économie souterraine issue du trafic de stupéfiants, tout en rapprochant les objectifs des différentes directions répressives.
En outre, l'ensemble du trafic transitaire sur le territoire national induit une coordination accrue entre l'OCRTIS et les SRPJ, d'une part, la direction centrale de la police aux frontières, d'autre part, notamment dans le cadre des livraisons surveillées, des observations Schengen et de la circulation des trafiquants.
Enfin, l'action de la direction centrale de la sécurité publique (DCSP) en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants est déterminante du point du vue du nombre d'affaires traitées. L'action répressive est cependant géographiquement morcelée en raison des règles de compétence territoriale qui régissent les circonscriptions de sécurité publique, bien que la plus grande part des affaires diligentées revient aux 26 sûretés départementales, largement impliquées dans la lutte contre les trafics de cités. A ce titre, la participation de la DCSP, mais également de la gendarmerie nationale aux bureaux de liaison stupéfiants organisés en 2003, est envisagée.
Par ailleurs, dans leurs missions habituelles, la direction centrale des renseignements généraux, la police aux frontières, les compagnies républicaines de sécurité, la direction de la surveillance du territoire peuvent être ponctuellement conduites, soit à procéder à des interpellations, soit surtout à fournir des renseignements sur un trafic de stupéfiants.
Ainsi, la police aux frontières , dont la mission première est la lutte contre l'immigration et le trafic de clandestins, est conduite, dans certains cas dans le cadre de son activité et du fait de son implication géographique aux frontières, à traiter des affaires liées aux infractions à la législation sur les stupéfiants, soit d'initiative (découvertes incidentes) à l'issue d'un contrôle documentaire aux points de passage aériens, maritimes ou terrestres autorisés, soit sur remise des services douaniers.
Dans l'exercice de ses missions, la police aux frontières s'appuie également sur ses brigades mobiles de recherche et met en oeuvre des dispositifs particuliers à l'occasion d'opérations ponctuelles, telles celles conduites en janvier 2003 sur des camions en provenance de Belgique.
b) Le réseau des laboratoires de police scientifique
Les laboratoires de police scientifique de Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse disposent d'unités spécialisées dans l'analyse des stupéfiants. L'ensemble des analyses est collecté par réseau et centralisé au laboratoire de Lyon. Il s'agit d'une aide à l'enquête mais aussi d'une indispensable connaissance des produits mis en circulation.
c) La mission de lutte anti-drogue
Ainsi que l'a indiqué lors de son audition M. Michel Bouchet, chef de cette structure, « la Mission de lutte anti-drogue est, au cabinet du directeur général de la police nationale, chargée de coordonner les directions et services du ministère de l'intérieur et de proposer, avec ceux-ci, une stratégie dans le domaine de la lutte contre les stupéfiants, qu'il s'agisse de trafic, de blanchiment, de consommation ou de prévention. La Mission de lutte anti-drogue soutient également la position du ministère de l'intérieur dans les instances nationales et internationales ».
Il s'agit d'une cellule légère et stratégique d'orientation et de coordination . Elle n'a donc pas de vocation opérationnelle .
Ainsi que l'a souligné M. Bernard Petit, chef de l'OCRTIS, lors de son audition, « la MILAD a un champ qui touche la prévention jusqu'à la répression, alors que l'Office central des stupéfiants, heureusement, ne s'intéresse qu'à la répression du trafic. Nous avons donc des caractéristiques très différentes. Cependant, la symbiose entre la MILAD et l'OCRTIS est très forte. Quand la MILAD a besoin de chiffres et de descriptions et de forger son idée sur l'état du trafic, c'est l'Office central des stupéfiants qui fournit les chiffres, les tendances, les écrits, et tous les documents. Il n'y a pas de jour où je n'ai pas M. Michel Bouchet, le chef de la MILAD, une ou deux fois au téléphone pour demander des chiffres, une appréciation, une évaluation ou une participation à une réunion qu'il organise. Nous n'avons pas le même champ et les mêmes activités, mais les liens sont très forts. »
d) La brigade des stupéfiants de la préfecture de police
Au sein de la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ) de la Préfecture de police de Paris qui comprend 205 policiers spécialisés dans la lutte contre les stupéfiants, la brigade des stupéfiants , composée de 95 fonctionnaires de police 79 ( * ) , administratifs compris, intervient sur Paris et dans les trois départements limitrophes de la proche banlieue (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) dans le domaine de la lutte contre le trafic illicite, la vente et l'usage des stupéfiants.
M. Gérard Peuch, chef de la brigade des stupéfiants à la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris, a déclaré, lors de son audition par la commission d'enquête, que cette brigade était « globalement séparée en deux activités ».
La première activité relève de ce qu'il est convenu d'appeler les affaires de ramassage : « Nous sommes ainsi appelés à faire des interpellations dans le domaine des douanes ou dans celui de la police de l'air et des frontières, pour toute personne qui a une autorité et qui, n'étant pas fonctionnaire de police, est susceptible d'interpeller des personnes qui, à divers titres, ont affaire au domaine de la drogue ou du trafic de stupéfiants ».
La seconde activité concerne principalement les affaires dites d'initiative : le travail de la brigade est alors, d'après M. Gérard Peuch, « celui du chien de chasse ou du chien d'arrêt : comme on le dit en termes de métier, son but est de « lever l'affaire ». Pour ce faire nous sommes assistés de quelques fonctionnaires, lesquels s'occupent maintenant -cela devient prépondérant et fondamental- de tout ce qui concerne l'informatique ».
La brigade des stupéfiants a également recours à un ensemble de fonctionnaires de police ayant le statut d'interprètes et de traducteurs.
Enfin, outre son activité propre, la brigade des stupéfiants est chargée d'assurer la coordination de l'action de l'ensemble des service de police à Paris et dans les trois départements de la proche banlieue, c'est-à-dire notamment la police urbaine de proximité et les autres services territoriaux de police judiciaire, dans le domaine de la lutte contre les stupéfiants.
2. Le dispositif de lutte contre l'usage et le petit deal
a) La direction centrale de la sécurité publique
Compétente en matière de trafic local et d'usage, elle dispose de 754 fonctionnaires plus spécialement affectés à cette mission.
Cette mission est assurée par l'intermédiaire des services des brigades de stupéfiants créées au niveau local. Lorsque le tissu urbain justifie une concentration de moyens, des services plus étoffés ont été mis en place : les sûretés départementales. Au nombre de quatorze, elles existent dans les sept départements de la couronne parisienne, la Corse, le Nord, le Rhône, les Alpes maritimes, les Bouches-du-Rhône et la Réunion. Elles constituent le réel fer de lance de la lutte contre les trafics établis au sein des quartiers difficiles notamment.
b) La direction de la police urbaine de proximité de la préfecture de police de Paris
La direction de la police urbaine de proximité de la préfecture de police a été mise en place le 18 avril 1999 dans le cadre de la réforme des services actifs de la préfecture de police de Paris. Elle compte 12.000 policiers et, comme l'a indiqué lors de son audition le sous-directeur de la police territoriale au sein de cette direction, M. Alain Quéant, elle « s'est vu assigner, lors de sa création, la mission de mieux prendre en compte l'insécurité quotidienne dans la capitale par une lutte contre la petite et moyenne délinquance, une présence policière sur la voie publique plus importante et, surtout, adaptée aux besoins des habitants, et un travail de sensibilisation en direction des publics vulnérables et des professions à risques. L'objectif était donc de mettre en place, dans Paris, une véritable police de proximité comprise non comme un appendice d'un service central, comme cela a pu se faire ailleurs, mais comme un dispositif qui intégrait la totalité des missions que la police combat au niveau local. »
Le dispositif est axé sur une organisation territoriale simple basée sur l'arrondissement parisien, et dont la cellule de base est le commissariat central d'arrondissement.
Il comporte trois axes principaux :
- un service de voie publique, qui est une police d'intervention, active tous les jours 24 heures sur 24 (police secours) ;
- un service de la police de quartier, autrefois appelé îlotage, et qui assure la réponse policière sur la voie publique et les contacts avec les administrés, et auquel on peut rattacher une unité chargée de la prévention et de la communication ;
- le service de l'accueil, de la recherche et de l'investigation judiciaire. Il s'agit d'un service de police judiciaire local qui fonctionne et assure un traitement judiciaire tous les jours, 24 heures sur 24, dans chaque arrondissement.
Avant 1999, la brigade des stupéfiants de la préfecture de police de Paris disposait d'un monopole absolu du traitement judiciaire dans le domaine des stupéfiants. Ainsi que l'a souligné M. Alain Quéant, « c'était et c'est toujours un service central chargé de lutter contre le trafic de stupéfiants à grand échelle (...) mais avant 1999, il prenait en compte le dernier usager arrêté sur la voie publique de manière centrale. Il s'ensuivait que ce n'était peut-être pas la meilleure façon de traiter ce phénomène. De même, les aspects de prévention étaient traités par la direction de la police judiciaire ou de la sécurité publique de manière peu cohérente. Il y a donc eu dès le départ un protocole entre l'ensemble des directions de la préfecture de police pour assigner à chacun le rôle qui lui appartient. »
En effet, « avant 1999, autant le trafic de stupéfiants organisé et structuré obtenait de bons résultats, autant le petit usage et le petit deal étaient tombés en déshérence en matière de répression. (...) En 1999, les policiers de la direction de la sécurité publique chassaient les dealers comme ils le pouvaient. Dès qu'ils en avaient, comme ce n'étaient pas des affaires fondamentales, ils allaient à la brigade des stupéfiants qui leur disait : « nous traitons les grands réseaux et vos affaires ne nous intéressent pas. (...) C'est ainsi que les fonctionnaires se démotivaient. Comme leur chef n'avait pas le suivi de l'affaire, cela croissait et perdurait. (...) Nous avons donc repris la main, puisque notre service a pris en compte la lutte contre l'usage simple, ce qu'on appelle dans notre jargon le deal de rue ou d'appartement et le petit trafic local, à l'exception, de manière absolue, de la lutte contre les réseaux organisés que nous laissons à nos collègues de la police judiciaire . »
La direction traite donc 87 % des faits constatés à Paris.
Ce service doit prendre en compte les phénomènes de toxicomanie et, surtout, le traitement des nuisances qu'ils engendrent.
Ainsi que l'a indiqué M. Alain Quéant à la commission d'enquête, cette action doit être adaptée aux particularités de chaque quartier : « Nous sommes confrontés au quotidien aux rassemblements de drogués et de toxicomanes dans certains sites, à la présence de véritables abcès de fixation (immeubles squattés, lieux publics, etc...) ou, de manière moins grave, à la présence dans des halls d'immeubles ou dans d'autres lieux, voire dans les jardins du Luxembourg, de jeunes usagers qui fument du cannabis, ce qui nécessite une véritable prise en compte (...) Ces phénomènes, qui sont bien sûr très divers (on ne va pas comparer les trois fumeurs de joints du Luxembourg aux rassemblements de toxicomanes de la porte de la Chapelle), nécessitent une véritable prise en compte locale très fine d'importance et de sensibilité variables, et les habitants, bien entendu, y sont très sensibles et sollicitent très fréquemment notre concours.
Il a souligné la gravité de la situation dans certains secteurs : « On estime, pour en revenir au XVIII e , qu'une centaine de polytoxicomanes en déshérence erre en permanence sur l'arrondissement. Il y a quelques mois, nous avions eu des phénomènes lourds dans le secteur de la place de Stalingrad (...), ce qui a abouti à la mise en place d'un dispositif important qui a permis de résorber de façon notable les nuisances par une présence massive de police. Nous avons eu également la chance d'évacuer un certain nombre d'immeubles squattés parallèlement, ce qui a assaini le système. »
Néanmoins, la lutte doit toujours être renouvelée : « Je peux vous citer l'exemple de Stalingrad, où il se posait un problème très lourd et où nous avons vraiment, comme on le dit vulgairement, « mis le paquet ». Cela a fonctionné, mais il se produit, comme nous le disons dans notre jargon, un effet « splash », c'est-à-dire que nous traitons un endroit et que cela s'éparpille. »
|
BILAN DE NOTRE EXPÉRIENCE D'HABITANTS
(mai 2003) François NICOLAS, responsable de l'ex-COLLECTIF ANTI-CRACK UN AN DE MOBILISATION...
Les femmes se trouvaient agressées par les toxicomanes, les enfants traumatisés par le spectacle des brutalités et dégradations, les jeunes constamment sollicités et provoqués, et les autres habitants étaient contrôlés dans les rues... par les dealers !
À la suite de ces manifestations, la police a enfin patrouillé dans les rues et ainsi dispersé la « scène ouverte » du crack qui s'était installée depuis des mois au vu et au su de tous.
Comment avait-il été possible que la police ne fasse plus son travail ordinaire de répression du crime organisé et tolère une telle occupation de l'espace public pendant si longtemps ? Pourquoi les municipalités n'avaient-elles rien fait pour témoigner de leur solidarité avec les habitants, avec les enfants de la bibliothèque Hergé abandonnés au coeur du trafic ? Et pourquoi les pouvoirs publics semblaient prendre si facilement leur parti d'une telle situation alors même que le crack est la pire des drogues, qui a décomposé aux États-Unis des quartiers entiers ? Si l'on pouvait comprendre la difficulté pour les pouvoirs publics de lutter contre la délinquance afférente au trafic de haschich, il s'agissait ici d'un trafic de nature criminelle, localisé et concentré, se pratiquant ouvertement et donc facile à prendre pour cible avec des moyens policiers ordinaires. Or, rien de rien, et si nous n'avions pas réagi, les dealers de crack tiendraient encore le haut du pavé en plein Paris ! Comment cela avait-il été possible ? Pouvait-on espérer que cela ne recommence plus ? Nous avons alors étudié la question, et rencontré quantité de responsables (les maires, les commissaires, etc.) et d'experts (en toxicomanie). La clef du problème nous est alors apparue : il y avait, au principe de ce laisser-faire, une politique explicite, déclarée, organisée : la « politique de réduction des risques ». C'est elle qui orientait la politique publique en matière de toxicomanie depuis de nombreuses années, c'est elle qui rendait compte de l'inertie générale contre le crack car elle prônait un pur et simple « faire avec la drogue », une acceptation gestionnaire de la situation en soutenant qu'il n'était plus possible de faire autrement... en raison de l'épidémie du sida ! Nous avons alors réfléchi pour élaborer les grandes orientations de ce qu'une véritable politique contre la drogue pourrait et devrait être -- nous l'avons appelée « politique de soins » : voir la deuxième partie de ce texte. En effet nous ne nous considérions pas seulement comme des habitants d'un quartier, soucieux des conditions de vie locale mais aussi comme habitants d'un pays, soucieux du présent et de l'avenir de la France.
Nous avons alors formé un groupe de pères de famille qui a décidé de se promener tranquillement, un soir par semaine, dans les rues du quartier pour discuter avec les habitants, les jeunes mais également les toxicomanes. Nous voulions ainsi nous réapproprier l'espace public la nuit et montrer qu'il ne saurait y avoir pour les habitants de couvre-feu imposé par les dealers. Nous avons poursuivi ces « tournées-rue » pendant trois mois (mars-mai 2002) puis nous avons appelé à des rassemblements hebdomadaires (juin 2002) devant les trois repaires du crack ( crackhouses qui concentraient désormais le trafic dans des espaces privés) en exigeant des pouvoirs publics qu'ils les ferment et relogent les familles qui y subissaient la loi des dealers. À la suite de tout cela, les pouvoirs publics ont procédé, fin juin 2002, à la fermeture de ces repaires ce qui a ramené le trafic de crack dans le quartier à son étiage. Prenant acte de ce retour à la normale, le Collectif anti-crack a alors décidé en septembre 2002 de se dissoudre. NOS PROPOSITIONS Avant de reprendre nos activités ordinaires « de pères de famille », nous avons souhaité exposer, lors d'une conférence de presse (25 juin 2002), nos propositions concrètes pour réengager en France une lutte contre la drogue visiblement laissée en jachère depuis des années : nous ne nous satisfaisions pas de l'amélioration temporaire de la situation dans notre seul quartier et savions bien qu'il fallait, en complément des nécessaires actions locales, envisager dans tout le pays, tant au niveau des pouvoirs publics que de la société civile, des actions de grande ampleur pour remonter la pente, pour inverser un cours désastreux des choses : la France ne comptait en 1970 que 2 000 héroïnomanes mais près de 200 000 en 2000. À ce rythme, il y aurait en France 500 000 héroïnomanes en 2007 ! On ne pouvait accepter la perspective que la jeunesse de notre pays se rallie en masse à une conception droguée de l'existence. Quelles sont les grandes orientations de la politique de soins que nous avons avancée face à la politique de réduction des risques, stratégiquement responsable de la dégradation de notre quartier ? Contre une désastreuse politique de réduction des risques... La politique de réduction des risques refuse de traiter sur le fond la question de la toxicomanie pour plaider un accommodement général avec les drogues, y compris avec la cocaïne et l'héroïne : -- elle ne fait que déplacer les problèmes, en substituant deux drogues (la méthadone et le Subutex) à une autre (l'héroïne) ; -- elle argumente qu'il ne serait plus nécessaire de soigner les toxicomanes de leur dépendance et qu'il suffirait de les soigner des maladies infectieuses opportunistes (sida...) ; -- elle ne traite plus que des conséquences (les dégâts latéraux de la drogue : infections, etc.) en déclarant qu'il ne servirait plus à rien de combattre la drogue (car il n'y a « pas de société sans drogue » 80 ( * ) ) et qu'il suffirait de gérer ses méfaits ; -- elle veut nettoyer les seringues mais se refuse à nettoyer leur contenu ; -- elle planifie la diminution des places de post-cure et tente de s'imposer comme seule politique « raisonnable » en arguant qu'elle ne coûte pas cher ; -- elle en appelle à la constitution de salles de shoot (sûr moyen, pourtant, d'enfermer les héroïnomanes dans leur servitude volontaire au lieu de les aider à s'en libérer), à la création de droguatoriums comme un Le Pen a souhaité des sidatoriums ... ; -- elle en vient à prôner la légalisation du crack et de l'héroïne ; -- elle excuse les dealers en en faisant des gens au service des toxicomanes ; -- elle prêche la résignation et un arrangement avec une vision droguée de l'existence. Une politique de soins, appuyée sur un Samu-toxicomanie Contre ces orientations, les tâches d'un véritable combat public contre la drogue seraient à notre sens les suivantes. Il faudrait d'abord affirmer « Pas de société sans lutte contre la drogue » et poser que notre pays peut lutter sur deux fronts à la fois : contre le sida et contre la drogue. Il faudrait ensuite :
En effet, une politique de soins, tout en réprimant l'offre, viserait surtout à réduire la demande, en aidant en particulier les toxicomanes à sortir de leur esclavage et non pas seulement à éviter d'attraper le sida et l'hépatite... D'où l'intérêt en amont de créer un Samu-toxicomanie qui irait à la rencontre des toxicomanes pour les aider à prendre du recul et la nécessité en aval de multiplier les places de post-cure plutôt que de les réduire. Une politique de soins n'utiliserait les produits de substitution (méthadone et Subutex) qu'au cas par cas, comme moyen provisoire, non comme fin en soi, comme tactique éventuelle, non comme stratégie. Et si une politique de soins doit continuer d'encourager le nettoyage des seringues, elle ne dissimulerait pas pour autant que leur principal danger reste dans leur contenu ! Une politique de soins pousserait la jeunesse de ce pays à ne pas entrer dans la drogue (prévention primaire) plutôt qu'à en gérer les méfaits une fois dedans... Au total, une politique de soins fixerait aux pouvoirs publics les tâches qui sont les siennes (répression, soins, instruction) mais encouragerait également la société civile à prendre en charge la part indispensable qui lui revient dans la lutte contre la drogue : une telle lutte ne saurait être simplement l'affaire des pouvoirs publics mais nécessite une mobilisation générale, en particulier pour l'éducation et la prévention des jeunes (il faut savoir leur proposer des activités, des perspectives, des buts dans l'existence pour contrecarrer efficacement le nihilisme de la drogue). |
S'agissant des relations avec les associations d'aide et de suivi des toxicomanes, M. Alain Quéant a insisté sur la nécessité d'instaurer un réel partenariat, sachant que « ces structures, avec lesquelles nous entretenons généralement des rapports de partenariats très constructifs, constituent, surtout dans certains quartiers, un pôle de fixation des drogués et génèrent des nuisances, que ce soit des pôles fixes, comme des boutiques ou des centres d'accueil, ou des structures mobiles comme le bus de Médecins du Monde. »
En outre, elle mène également une mission de prévention dans les établissements scolaires.
Au total, en termes de moyens, le nombre de fonctionnaires de police consacrant la totalité de leur activité à la lutte contre les infractions à la législation sur les stupéfiants était estimé à 2.000 personnes en 1995 . D'autres policiers y consacrent une part non négligeable de leur temps mais celle-ci est plus difficile à apprécier. Le nombre total de fonctionnaires de police en équivalent temps plein est de près de 6.500 personnes.
M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, a indiqué lors de son audition vouloir renforcer les effectifs de lutte contre les stupéfiants. La préfecture de police se verra ainsi adjoindre 30 enquêteurs supplémentaires sur un effectif de 95 personnes, et sur les trois départements de la petite couronne, 20 de plus sur un effectif de 110. Des postes d'officiers de liaison en poste à l'étranger supplémentaires devraient également être créés à l'OCRTIS.
C. LA GENDARMERIE NATIONALE : L'ABSENCE D'ORGANISMES SPÉCIALISÉS
1. La nouvelle organisation de la sécurité intérieure
Conformément aux engagements pris durant la campagne présidentielle a été créé un grand ministère de la sécurité intérieure ayant autorité tant sur la police que sur la gendarmerie nationales, dans le but de mieux conjuguer les efforts des deux forces. En effet, jusqu'à présent, le ministre de l'intérieur ne dirigeait que les seuls effectifs de la police nationale, les gendarmes relevant du ministère de la défense.
L'article 3 du décret n° 2002-889 du 15 mai 2002 prévoit que, pour l'exercice de ses fonctions, le ministre de la sécurité intérieure est responsable de l'emploi des services de la gendarmerie nationale. Toutefois, il définit leurs missions, les conditions de leur accomplissement ainsi que les modalités d'organisation en résultant « en concertation » avec le ministre de la défense. Les gendarmes conservent leur statut militaire et continuent à relever à cet égard du ministre de la défense.
2. La gendarmerie dans la lutte contre les drogues illicites
Les problèmes liés à la lutte contre la drogue et l'usage de stupéfiants sont suivis au niveau central par un officier supérieur du bureau de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale. La coordination sur le terrain est assurée par le bureau animation coordination, qui dépend directement de l'administration centrale.
Ainsi que l'ont indiqué MM. Pierre Mutz, directeur général de la gendarmerie nationale, et le colonel Christophe Metais, chef du bureau de police judiciaire à la direction de la gendarmerie nationale, devant la commission d'enquête, la lutte contre les drogues illicites n'est pas conduite en gendarmerie par des organismes spécialisés. Une information sur la drogue est faite dans le cadre de la formation d'officiers de police judiciaire. Ce choix découle de la dimension territoriale de la gendarmerie nationale, dont les 3.551 brigades territoriales irriguent le territoire. Sur 95 % du territoire national, la gendarmerie nationale protège ainsi 50 % de la population.
Comme l'a indiqué M. Pierre Mutz, directeur général de la gendarmerie nationale, « cette typologie de son champ d'intervention conduit la gendarmerie à privilégier la répression des trafics locaux. Cette catégorie de délits ne met pas en cause des sommes et des volumes de produits comparables aux infractions relevées dans les grands centres urbains. Néanmoins, ils génèrent des troubles importants à la tranquillité publique, la consommation et le trafic étant à l'origine d'une délinquance de voie publique très violente et très agressive. La détresse physique et matérielle des consommateurs aboutit à des comportements délictueux qui renforcent le sentiment d'insécurité. Ces actes ont un retentissement décuplé dans les zones rurales. » La délinquance, longtemps cantonnée dans les zones urbaines, se diffuse désormais dans les zones périurbaines et dans les zones rurales du fait d'une mobilité accrue des délinquants.
Lorsqu'il y a présomption de deal, les brigades de gendarmerie font remonter les enquêtes à la brigade de recherche, à la section de recherche ou aux GIR afin d'obtenir des compléments par des spécialistes qui ont plus de temps pour approfondir les enquêtes.
On compte ainsi 302 brigades de recherche, situées au niveau départemental ou de l'arrondissement, ainsi que 30 sections de recherche ayant compétence sur le ressort de la cour d'appel.
Si les efforts de la police nationale portent surtout sur les dealers d'habitude et les réseaux de trafiquants, les gendarmes, compte tenu de leur zone d'intervention, plus rurale, n'hésitent pas à arrêter de tout petits trafiquants, voire des consommateurs portant de la drogue sur eux.
On estime le nombre de gendarmes se consacrant à ces missions à 2.000 personnes en équivalent temps plein.
D. LE DISPOSITIF DE CONTRÔLE DES PRODUITS PRÉCURSEURS DE DROGUES
1. La Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques
Créé au sein du ministère de l'industrie par l'arrêté du 11 mars 1993 portant création d'une Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques (MNCPC), en vertu des dispositions du règlement communautaire n° 3677/90 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, la MNCPC associe des fonctionnaires de police, des douanes et de l'industrie pour le suivi et la mise en oeuvre de la réglementation sur les produits précurseurs telle qu'elle résulte des textes communautaires. Elle a notamment pour fonction d'animer et de coordonner la coopération entre les acteurs administratifs et industriels dans ce domaine.
|
LA SPÉCIFICITÉ DES PRODUITS « PRÉCURSEURS » Certains produits chimiques, plus connus sous l'appellation de « précurseurs », jouent un rôle capital dans la synthèse ou l'extraction des drogues. Fabriqués à des fins licites, les précurseurs font l'objet d'un commerce très large et sont indispensables aux industries chimiques et pharmaceutiques. Leur détournement est très faible au regard des volumes échangés dans le monde. L'importance du commerce des précurseurs a cependant conduit à une démarche conditionnée, consacrée par la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. Vingt-deux substances chimiques, figurant parmi les plus sensibles, ont ainsi été classées en tant que produits précurseurs au niveau international 81 ( * ) . La surveillance du commerce des produits chimiques précurseurs, qui relève de la compétence communautaire, s'opère au travers d'un ensemble de règlements et directives qui régissent aussi bien leur fabrication et leur mise sur le marché que les échanges avec les pays tiers. D'intensité variable selon les catégories concernées de produits, ces mesures de surveillance se sont notamment traduites par la mise en place de mécanismes d'agrément ou d'enregistrement des opérateurs, assortis d'un régime de licence à l'importation, notamment en direction des pays tiers les plus sensibles. Si le dispositif de surveillance du commerce des produits précurseurs est relativement strict pour certaines substances, la philosophie des textes repose avant tout sur la vigilance et la coopération volontaires des opérateurs. Compte tenu des volumes de produits échangés dans le monde, il est certain que seuls les industriels et négociants du secteur chimique sont en mesure d'apprécier le caractère inhabituel d'une commande ou d'une transaction. En France, la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, régit la fabrication et le commerce des précurseurs. L'essentiel du dispositif national est placé sous l'autorité de la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques (MNCPC). |
2. Une politique de sensibilisation et de formation
Dans le cadre de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de produits psychotropes adoptée le 19 décembre 1988 et de la réglementation communautaire, la MNCPC est notamment chargée de développer une politique de sensibilisation et de formation auprès des opérateurs liés à la fabrication et au commerce de certaines substances chimiques susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes et de leur personnel ; de favoriser la coordination de l'action des services compétents ; de centraliser les manquements des opérateurs à leurs obligations ; d'observer en collaboration avec les services spécialisés et leurs laboratoires l'évolution des échanges en matière de précurseurs chimiques ; de rassembler les informations relatives à l'application des mesures de surveillance au plan national et destinées notamment aux organismes internationaux et communautaires compétents.
Dans cette perspective, la MNCPC a notamment proposé que soit créé un document d'accompagnement des précurseurs les plus sensibles lors de leur transport au sein de l'Union européenne.
De plus, la MNCPC mène des actions de sensibilisation individuelle auprès des entreprises et des actions collectives sous forme de colloques pour rappeler aux acteurs industriels leurs obligations réglementaires et leur devoir de vigilance.
En outre, la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure a inclus dans les mesures tendant à mieux prendre en compte les formes nouvelles de criminalité l'extension des compétences de la MNCPC au commerce illicite de produits précurseurs de drogue.
E. LE DISPOSITIF RÉPRESSIF DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
1. TRACFIN : une cellule de surveillance des flux financiers
La lutte contre le blanchiment de l'argent de la drogue et de l'ensemble des produits de la criminalité s'appuie sur une structure créée au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, TRACFIN : Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins.
TRACFIN est une cellule de coordination créée au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie par un décret du 9 mai 1990, chargée du traitement, du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins. Elle constitue une structure majeure de surveillance des flux financiers.
Cet organisme, chargé de recueillir les déclarations de soupçons sur les transactions suspectes transmises par les institutions financières, dispose du pouvoir de bloquer les opérations en cause et de lever le secret bancaire pour se faire communiquer toutes les informations nécessaires. Après avoir analysé et instruit les déclarations de soupçons, TRACFIN les transmet, le cas, échéant, aux autorités judiciaires.
L'effectif de TRACFIN s'élève à une trentaine de personnes. Son secrétaire général, le directeur général des douanes et des droits indirects, est assisté d'un secrétaire général adjoint issu de la même administration. Un magistrat du parquet, détaché en qualité de conseiller juridique, gère les relations entre TRACFIN et les autorités judiciaires, et un directeur départemental des services déconcentrés du Trésor assure les liaisons avec les autorités financières publiques. La division opérationnelle est confiée à un cadre supérieur des douanes, tous les enquêteurs émanant également de cette direction.
2. L'Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF)
Au sein de la DCPJ, l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) décline quant à lui, dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et l'économie souterraine, des axes de travail identiques à ceux de l'OCRTIS. Il intervient par ailleurs en matière de formation et de sensibilisation à destination des services de police ou d'autres services publics, mais aussi en direction des acteurs économiques de la société civile (banques, assurances, etc.). L'OCRGDF est le point de contact permanent de la cellule TRACFIN pour le ministère de l'intérieur.
L'OCRGDF a une fonction de coordination interministérielle marquée pour les enquêtes en matière de délinquance financière mais son décret fondateur ne fait aucune référence au blanchiment ou au recyclage de l'argent du crime organisé.
La lutte contre le blanchiment de l'argent des drogues illicites peut également s'appuyer sur des parquets spécialisés dans les questions financières.
Enfin, il existe des structures de coopération internationale dans le domaine de la lutte contre le blanchiment qui seront évoquées dans la suite du présent rapport.
F. LE RENFORCEMENT DE LA COORDINATION DES SERVICES RÉPRESSIFS NATIONAUX
1. Les outils de coordination antérieurs à la création des GIR : une efficacité limitée en dépit de la motivation des hommes de terrain
Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Yves Bot, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, s'est félicité d'une bonne coopération entre les différents services de police, de gendarmerie et des douanes, notamment « parce que, dans ce domaine, l'habitude de concertation et de coordination est ancienne, et, ensuite, parce qu'il y a vraiment tellement de matière pour tout le monde qu'il n'y a pas de risque de voir un service se disputer avec un autre pour prendre une saisine. Je ne veux pas dire que c'est la seule raison et je ne veux pas être réducteur pour les services de police et de gendarmerie, mais c'est vraiment un domaine dans lequel, à l'heure actuelle, il n'y a vraiment pas de risque de guerre des polices : il y en a vraiment pour tout le monde ».
Si la nécessité d'une coordination d'action entre les divers services répressifs intervenant dans la lutte contre les stupéfiants est indiscutable, les instruments institutionnels de cette coordination n'ont pas toujours été efficaces et leurs insuffisances étaient souvent palliées par la volonté, sur le terrain, de collaborer entre services d'administrations différentes et de mettre en oeuvre une stratégie de mise en commun du renseignement et des informations disponibles, afin notamment d'éviter les chevauchements d'enquête.
Lors de son audition par la commission, M. François Mongin, directeur général des douanes et des droits indirects, a tenu à rappeler que la douane coopérait déjà depuis de nombreuses années avec la police et la gendarmerie afin de lutter plus efficacement contre le trafic de stupéfiants. Outre la participation à des réunions communes, la coordination des activités des services répressifs s'effectuait notamment dans le domaine de l'échange de renseignements, de la formation et de la coopération technique et scientifique. Il a ajouté que la coopération au plan national s'était « renforcée au cours des dernières années dans le cadre d'une politique interministérielle de lutte contre la drogue plus affirmée. Les structures de liaison et de coopération ont ainsi été renforcées, notamment au travers du développement des relations avec les offices centraux de police judiciaire et la mise en place d'un agent des douanes au sein de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants ».
a) Des binômes souvent efficaces
La coopération entre les différents services répressifs s'est d'abord matérialisée par des structures binaires, entre la police et la gendarmerie d'une part, la police et la douane d'autre part.
Les offices centraux de la direction centrale de la police judiciaire, au premier rang desquels l'Office central pour la répression du trafic illicite (OCRTIS), accueillent aussi depuis plus de dix ans des officiers de liaison de la gendarmerie nationale. Au niveau central, l'OCRTIS a donné une tournure opérationnelle à l'activité d'officier de liaison de la gendarmerie nationale en poste en son sein (gestion d'enquêtes conduites en co-saisine avec des services de gendarmerie de province), ne le limitant pas au seul rôle de représentation ou de liaison. Cette approche a pu porter ses fruits dans des enquêtes où l'OCRTIS intervient en soutien opérationnel et logistique d'unités de gendarmerie parfois limitées en moyens.
S'agissant de la collaboration entre la douane et la police, dans ses réponses au questionnaire adressé par la commission d'enquête, la DGDDI a notamment précisé que « malgré l'absence de signature d'accords généraux ou thématiques, la coopération entre la douane et la police en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants s'exerce au plan national depuis plusieurs années, dans le cadre des rencontres annuelles des directeurs généraux de la police et de la douane ». Ces réunions peuvent en outre être élargies aux représentants de la sécurité publique et de la police de l'air et des frontières. Parallèlement à ces rencontres officielles, des réunions locales sont organisées entre les services régionaux de police judiciaire (SRPJ) et les services correspondants des douanes. Quatre rencontres à haut niveau entre directeurs généraux de la douane et de la police ont été organisées depuis 1996.
Des réunions du même type sont également organisées ente le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la gendarmerie nationale. A cet égard, M. Pierre Mutz, directeur général de la gendarmerie nationale, a déclaré lors de son audition par la commission d'enquête : « Je me félicite (...) de la qualité des relations établies entre les partenaires institutionnels qui prennent part à cette lutte. Je fais notamment allusion aux relations que la gendarmerie entretient sur cette question avec la police nationale et la douane. Nous avons dépassé le stade de la simple collaboration pour nous orienter vers une synergie durable ; c'est un atout supplémentaire qui profite à chacune des forces ».
En outre, à la suite de la mise en place d'une unité de coordination de lutte anti-drogue, la MILAD, auprès du directeur général de la police nationale, des réunions bipartites (douane, police), voire tripartites (douane, police, gendarmerie) se tiennent en fonction des besoins.
Au niveau des enquêtes de grande ampleur, l'interlocuteur privilégié de la police judiciaire, et notamment de l'OCRTIS, est la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED). A cet égard, dans ses réponses au questionnaire adressé par la commission d'enquête, le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a précisé qu'« après une période de rapports un peu difficiles, consécutifs aux affaires de 1991 à Lyon et Dijon ayant conduit au placement sous mandat de dépôt de responsables douaniers, les relations entre la police judiciaire et la douane sont à nouveau excellentes. C'est ainsi qu'un officier de liaison de la douane, issu de la DRNED, est détaché à l'OCRTIS depuis le mois de mars 2002. Cette affectation a été très bénéfique dans l'amélioration des relations opérationnelles entre les services spécialisés de la police nationale et ceux de la douane ».
Enfin, l'habilitation de certains agents des douanes à exercer des missions d'officier de police judiciaire (OPJ) est un facteur supplémentaire de rapprochement entre ces deux administrations, accru par la possibilité de création d'unités temporaires mixtes par l'autorité judiciaire en matière de stupéfiants.
b) Des instruments de coordination générale moins efficaces
Il existe d'une part des structures interministérielles de coopération anti-drogue au sein desquels se retrouvent les différents services répressifs de lutte contre la drogue, d'autre part, des structures de coopération à vocation opérationnelle, tels les bureaux de liaison permanents (BLP) créés en 1997, avant la mise en place des GIR, autre structure de coopération à vocation opérationnelle.
Parmi les structures interministérielles de coopération anti-drogue, on peut citer notamment le Secrétariat général du comité interministériel (SGCI) et la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT).
Le SGCI est une instance de coordination au niveau national des politiques menées dans le domaine du titre VI du traité de l'Union européenne, visant la coopération policière au sens large, incluant la police, la douane et la gendarmerie. Ce service, rattaché directement au Premier ministre, a pour mission d'effectuer une coordination entre les ministères afin de définir les positions que la France exprimera au sein des différents instances communautaires.
Douane, police et gendarmerie participent également aux travaux de la MILDT, dont l'objectif est de coordonner les politiques publiques menées par les différents ministères dans le domaine de la lutte contre les toxicomanies. Son action concerne aussi bien la prévention, la prise en charge sanitaire et sociale, que la répression, la formation, la communication, la recherche ou les échanges internationaux.
Parallèlement à ces structures interministérielles sans vocation opérationnelle, la mise en place de bureaux de liaison permanents (BLP), à titre expérimental, dans deux régions particulièrement touchées par le trafic illicite de stupéfiants (Antilles-Guyane et Nord-Pas-de-Calais), a été décidée dans le cadre du plan gouvernemental de lutte contre le trafic de stupéfiants et la toxicomanie de 1995.
La circulaire interministérielle du 13 mai 1997 relative au renforcement de la coordination des moyens répressifs pour la lutte contre le trafic de stupéfiants dans les régions Antilles-Guyane et Nord-pas-de-Calais, instaure aussi un dispositif global comprenant trois structures distinctes et ayant un rôle complémentaire (un comité régional ou zonal, une cellule de coordination judiciaire et un bureau de liaison permanent).
Les BLP, installés au siège du service régional de police judiciaire (SRPJ) concerné, ont trois missions principales :
- gérer un état permanent des objectifs 82 ( * ) des trois principaux services répressifs (police, gendarmerie et douane) afin d'éviter les chevauchements dans les enquêtes ;
- promouvoir et développer les échanges entre les différents services répressifs de la zone ;
- analyser et synthétiser le renseignement en matière de stupéfiants.
Les BLP de Pointe-à-Pitre et de Lille fonctionnent ainsi depuis 1998 et ont obtenu des résultats sensiblement différents. Dans l'ensemble, si un nombre non négligeable de doublons d'enquête ont pu être évités grâce à ces structures, leur efficacité en termes d'analyse, de synthèse et de mutualisation du renseignement reste à prouver.
2. La mise en place d'un outil pluridisciplinaire efficace : les GIR
De l'avis général des acteurs de terrain auditionnés par la commission d'enquête, le bilan des vingt-huit groupes d'intervention régionaux (GIR), créés par la circulaire interministérielle du 22 mai 2002, et devenus opérationnels dès la fin du mois de juin 2002, est globalement très positif.
La mise en oeuvre des GIR, initiée par M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, a eu pour but d'organiser un partenariat effectif et constant entre toutes les administrations concernées par la lutte contre toutes les formes de délinquance déstabilisant les quartiers, au premier rang desquelles figurent les trafics de stupéfiants. Sont ainsi rassemblées, de manière permanente, auprès du chef de l'unité, toutes les composantes impliquées, au titre de leur spécialité, dans la prise en compte en profondeur du phénomène : police et gendarmerie nationales, services fiscaux, douanes, services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du travail et de l'emploi. Implantés au niveau régional ou départemental selon les cas, les GIR ont vocation à couvrir la totalité du territoire national.
Les 268 fonctionnaires et militaires appartenant de façon permanente aux GIR, et qui peuvent bénéficier du concours d'environ 1.400 fonctionnaires de tous les ministères concernés, ont une vocation généraliste mais une part importante, environ un tiers, de leur activité est consacrée directement à la répression du trafic de stupéfiants et nombre d'autres délits distincts qu'ils ont à connaître découlent pour une bonne part de ce trafic.
Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Dominique Perben, ministre de la justice, a déclaré à propos des GIR : « La mise en commun des compétences et des capacités des différentes administrations impliquées a été un vrai apport de cette structure d'organisation et d'action. Les 28 GIR, depuis leur création, ont été associés à 176 opérations, dont 34 % concernaient le trafic de stupéfiants ou le proxénétisme de la drogue, deux éléments qui sont liés ».
En outre, M. Nicolas Sarkozy, a indiqué, lors de son audition par la commission d'enquête, qu'en 2003, les GIR seraient renforcés par de nouveaux moyens humains, matériels et juridiques. Il a notamment fait allusion à « la possibilité d'identifier les réseaux mafieux installés dans certains quartiers, qui sera ouverte par la levée du secret fiscal, qui est un élément essentiel pour lutter contre l'économie souterraine ». En effet, l'article 5 de la loi n° 2002-1094 précitée d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure prévoit, sous certaines conditions, une levée du secret fiscal au profit des officiers et agents de police.
|
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA
LOPSI
« Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction générale des douanes et des droits indirects, de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent répondre aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. » Ce dispositif assouplit le principe d'obligation de discrétion professionnelle, inscrit par les fonctionnaires à l'article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, selon lequel, en dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur ou d'une décision expresse de l'autorité dont ils dépendent, ces agents ne peuvent être déliés de leur obligation de discrétion professionnelle. L'article 226-13 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende la révélation d'une information à caractère secret par son dépositaire. |
La création des GIR a donc constitué un progrès notable dans l'institutionnalisation d'une réelle coordination opérationnelle des différents services impliqués dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et a contribué à faciliter le travail des acteurs de terrain .
Ainsi, lors de son audition par la commission d'enquête, M. Pierre Mutz, directeur général de la gendarmerie nationale, a déclaré : « Je pense que nous avons atteint, grâce aux GIR, une efficacité accrue dans la lutte contre les stupéfiants ». Il a ajouté que « les GIR travaillent énormément dans ce domaine et que des arrestations ont eu lieu en permanence grâce à leur action. Les GIR sont, de ce point de vue, extrêmement efficaces. Pas plus tard qu'en fin de semaine dernière, l'opération à Colombes a permis de faire cesser un trafic de drogue extrêmement important. Certes, l'enquête a débuté avant la création des GIR, mais elle a reçu ensuite leur concours, notamment celui des fonctionnaires du ministère des finances, qui en font partie, ce qui a été d'une aide très précieuse. Cette collaboration extrêmement étroite à l'intérieur des GIR, entre des fonctionnaires de différents ministères qui ont à en connaître, permet d'effectuer des opérations très ciblées et généralement extrêmement productives ».
Dans le même sens, lors de son audition par la commission d'enquête, M. Michel Bouchet, chef de la Mission de lutte anti-drogue (MILAD) a déclaré : « Pour apporter une meilleure réponse à la délinquance et aux trafics qui se sont développés dans les cités, et qui sont le fait d'individus difficiles à confondre, le ministère de l'intérieur a institué, en mai 2002, les groupes d'intervention régionaux (les GIR), qui mettent en oeuvre de façon pluridisciplinaire toutes les synergies des administrations concernées (police, douane, gendarmerie, services fiscaux, etc.). Les GIR peuvent, huit mois après leur création, se prévaloir d'un bilan exceptionnel dont le détail a d'ailleurs fait l'objet d'une communication en Conseil des ministres le 29 janvier dernier : 209 opérations d'envergure ont été réalisées, aboutissant à l'interpellation et au placement en garde à vue de 1.488 personnes. Outre les nombreuses armes et véhicules volés retrouvés, 649 kilos de résine de cannabis ou dérivés, près de 20.000 comprimés d'ecstasy et 3 kilos et demi de doses d'héroïne et de cocaïne ont été retrouvés ».
3. L'extension de la compétence territoriale des OPJ
La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure , conformément aux orientations de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, a étendu le ressort de compétence territoriale des officiers et agents de police judiciaire au minimum sur le département, voire au niveau de plusieurs zones de défense.
La compétence territoriale des officiers de police judiciaire était auparavant déterminée, sous réserve des extensions prévues par l'article 18 du code de procédure pénale, par la compétence des services dans lesquels ils exercent leurs fonctions habituelles. Si certains services ont une compétence nationale (comme les offices centraux de la direction centrale de la police judiciaire), d'autres ont une compétence s'étendant sur le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou partie de celles-ci (comme les services régionaux de police judiciaire et les sections de recherche de la gendarmerie départementale), ou s'étendent sur le ressort d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance d'une même cour d'appel ou partie de ceux-ci (comme les sûretés départementales, les services de sécurité publique ou les brigades de recherche de la gendarmerie départementale).
De nombreux officiers de police judiciaire avaient donc une compétence inférieure au ressort d'un tribunal de grande instance : les services de sécurité publique et les brigades territoriales de la gendarmerie nationale.
Or l'article 18 du code de procédure pénale ne prévoit que des possibilités d'extension limitées du ressort de compétence des officiers de police judiciaire en dehors des limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles 83 ( * ) .
La loi a élargi le ressort de compétence des officiers et agents de police judiciaire, l'étendue minimale du ressort de compétence passant d'une partie du ressort d'un tribunal d'instance au département . Cette compétence n'est d'ailleurs plus fonction d'un découpage judiciaire (cour d'appel, tribunaux de grande instance), mais fonction d'un découpage administratif (département, zone de défense, territoire national).
Cette mesure est dictée par la recherche d'une meilleure efficacité de la lutte contre la délinquance, marquée par une mobilité accrue des délinquants, opérant indistinctement en zone de police et de gendarmerie. Les extensions temporaires prévues par l'article 18 du code de procédure pénale étaient trop restrictives et toujours soumises à l'urgence ou à une flagrance, et éventuellement à une décision d'un magistrat qu'il peut être matériellement difficile d'obtenir.
Un décret devra déterminer les services ayant une compétence sur l'étendue d'une ou plusieurs zones de défense ou d'une partie d'une de ces zones. Lors de la discussion de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, la commission des Lois du Sénat, approuvée en cela par le ministre de l'intérieur, avait souhaité que les services régionaux de police judiciaire et les sections de recherche de la gendarmerie soient compétents sur l'ensemble de la zone de défense. Cette extension de compétence faciliterait notamment l'action des groupes d'intervention régionaux (GIR), rattachés soit à un service régional de police judiciaire, soit à une section de recherche de la gendarmerie.
En outre, il est désormais prévu que les officiers de police judiciaire mis temporairement à la disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil . Ceci permet de donner une base légale aux habilitations temporaires actuellement délivrées aux « personnels ressources » des GIR.
De plus, la condition d'urgence permettant l'extension de compétence au niveau national sur commission rogatoire ou sur réquisition du procureur est supprimée.
G. LE DISPOSITIF JUDICIAIRE
1. La quasi-absence de structures spécialisées dans la lutte contre les stupéfiants
Au ministère de la justice, le bureau de la lutte contre la criminalité organisée, le trafic de stupéfiants et le blanchiment assure l'animation et la coordination de l'action publique.
Depuis quelques années, des magistrats de liaison sont en poste dans des ambassades de France. Ils facilitent la coopération judiciaire internationale, notamment dans le domaine de la lutte contre les stupéfiants.
A l'exception de quelques substituts spécialisés, il n'existe pas de structures spécifiques dans la lutte contre les infractions à la législation sur les stupéfiants parmi les services de la justice.
Les magistrats du parquet (procureurs et substituts) décident de la suite à donner aux infractions constatées par la police et la gendarmerie nationales dont ils dirigent l'action de police judiciaire. Les faits les plus graves donnent lieu à ouverture d'une information, l'enquête étant alors dirigée par un juge d'instruction avant que le tribunal de grande instance, voire une cour d'assises spéciale professionnelle pour les trafics en bande organisée, ne soient appelés à se prononcer.
2. Une collaboration avec les institutions sanitaires et sociales
Dans le cadre des procédures impliquant des usagers de stupéfiants, les magistrats du parquet sont en rapport étroit avec les autorités sanitaires ou sociales.
L'exécution des peines est suivie et aménagée par les juges de l'application des peines en relation avec les services d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire.
Lorsque l'usager interpellé est un mineur, c'est le juge des enfants qui décide des mesures d'assistance éducative ou pénale qui sont appliquées. Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse prennent en charge ces mesures éducatives à l'égard des mineurs consommateurs de produits psychoactifs.
En équivalent temps plein, le nombre de magistrats consacrant leur activité à la lutte contre les infractions à la législation sur les stupéfiants a été estimé à 200 en 1995, auxquels s'ajoutent 400 fonctionnaires de justice. Ils seraient 3.400 fonctionnaires et personnels socio-éducatifs de l'administration pénitentiaire à consacrer leur temps à cette même activité.
III. UNE RÉPONSE JUDICIAIRE ERRATIQUE
A. LA RÉPRESSION DE L'USAGE : UNE DÉPÉNALISATION DE FAIT
1. Des interpellations à la baisse
Les interpellations par la police, la gendarmerie ou les douanes pour usage simple, après deux années d'augmentation, ont connu un recul notable en 2001 (71.667 usagers, soit une chute de plus de 14 %).
La structure des interpellations est toutefois restée inchangée : près de 9 interpellations sur 10 concernent des consommateurs de cannabis 84 ( * ) .
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
|
|
Interpellations pour ILS |
91.048 |
95.910 |
100.870 |
84.533 |
|
Interpellations pour usage simple |
74.633 |
80.037 |
83.385 |
71.667 |
|
Part d'interpellations des usagers simples (%) |
82,0 |
83,5 |
82,7 |
84,8 |
|
Interpellations pour usage simple de cannabis |
64.479 |
70.802 |
73.661 |
63.694 |
|
Part d'interpellations pour usage de cannabis (%) |
86,4 |
88,5 |
88,3 |
88,9 |
|
INTERPELLATIONS |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
Evol, 1/2 |
|
Trafic international |
1.369 |
1.278 |
1.274 |
1.245 |
1.083 |
-13,0 % |
|
Trafic local |
5.191 |
4.263 |
4.232 |
5.286 |
4.355 |
-17,6 % |
|
Usage revente |
12.281 |
10.874 |
10.367 |
10.954 |
7.428 |
-32,1 % |
|
Usage |
70.444 |
74.633 |
80.037 |
83.385 |
71.667 |
-14,0 % |
|
TOTAL |
89.285 |
91.048 |
95.910 |
100.870 |
84.533 |
-16,2 % |
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
Evol,
|
|
|
Interpellations pour usage simple |
||||||
|
Cannabis |
58.134 |
64.479 |
70.802 |
73.661 |
63.694 |
-13,53 % |
|
Opiacés |
9.168 |
6.052 |
4.955 |
4.863 |
3.816 |
-21,53 % |
|
Cocaïne et dérivés |
1.557 |
2.513 |
2.740 |
2.651 |
2.059 |
-22,33 % |
|
Amphétamines, ecstasy |
1.585 |
1.589 |
1.540 |
2.210 |
2.098 |
-5.07 % |
|
Total |
70.444 |
74.633 |
80.037 |
83.385 |
71.667 |
-14,05 % |
|
Interpellations pour trafic et usage-revente |
||||||
|
Cannabis |
11.957 |
11.262 |
10.950 |
12.313 |
8.593 |
-30,21 % |
|
Opiacés |
4.755 |
2.813 |
2.362 |
2.238 |
1.579 |
-29,45 % |
|
Cocaïne et dérivés |
1.329 |
1.640 |
1.862 |
1.829 |
1.666 |
-8,91 % |
|
Amphétamines, ecstasy |
800 |
700 |
699 |
1.105 |
1.028 |
-6,97 % |
|
Total |
18.841 |
16.415 |
15.873 |
17.485 |
12.866 |
-26,42 % |
Source : OCRTIS, 2001
La commission d'enquête s'est interrogée sur la signification d'une telle chute des interpellations, qui lui a semblé due à une certaine démotivation ressentie par les forces de l'ordre devant la réponse judiciaire apportée. Ainsi, M. Jacques Franquet, premier vice-président de l'Organe international de contrôle des stupéfiants et ancien chef de l'Office central de répression du trafic illite des stupéfiants, a exprimé devant la commission d'enquête le sentiment partagé par nombre de policiers et gendarmes : « On emploie une sorte de double langage incompréhensible : l'usage est prévu dans la loi mais, d'un autre côté, on ne le poursuit pas, et il devient presque honteux de poursuivre les usagers. Je suis désolé, mais c'est dans la loi, et je trouve qu'il n'y a rien de honteux à ce que les policiers fassent des interpellations d'usagers. Ils font leur métier de policier. » M. Pierre Mutz, directeur général de la gendarmerie nationale, a également déclaré devant la commission d'enquête : « Pour notre part, nous avons poursuivi systématiquement les usagers -on nous en a fait grief ces dernières années-, en considérant que des textes existent et que la gendarmerie fait partie des services répressifs qui doivent les faire appliquer. » Il a d'ailleurs indiqué que ces dernières années, marquées par une banalisation de l'usage dans les discours, les gendarmes voyaient de plus en plus de jeunes s'adonner à la consommation, ne serait-ce que dans un cadre convivial ou ludique, à l'occasion de certaines soirées et le week-end.
Il a semblé paradoxal à la commission d'enquête que des représentants de l'ordre soient ainsi contraints de se justifier d'exercer leur activité et elle souhaite elle aussi saluer l'action des forces de l'ordre en ce domaine.
Les directives en la matière paraissent en effet assez contradictoires.
Si la circulaire du garde des Sceaux du 17 juin 1999 préconise en effet que « les procureurs de la République attireront particulièrement l'attention des services de police et de gendarmerie sur les personnes dont la consommation cause des dommages sanitaires ou sociaux pour elles-mêmes ou pour autrui », la circulaire du ministre de l'intérieur du 11 octobre 1999 relative au renforcement de la lutte contre l'usage et le trafic local de stupéfiants tend à apporter des précisions aux services de police, la circulaire de la Chancellerie du 17 juin 1999 ayant provoqué des interrogations parmi les forces de l'ordre quant à l'attitude à adopter face aux usagers, et à dissiper le malaise provoqué par l'approche de l'usage de la MILDT.
Ainsi, elle précise aux policiers que l'interpellation privilégiée de consommateurs problématiques ne dispense pas d'agir également à l'endroit de tous les usagers, notamment de cannabis.
La baisse constatée en 2001 semble donc due en partie à un manque de lisibilité des objectifs de la MILDT, outre les modifications procédurales plus contraignantes intervenues à la suite de l'entrée en vigueur de la loi renforçant la présomption d'innocence.
Les signes forts donnés par le nouveau gouvernement et les objectifs ambitieux affichés dans la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure de l'été 2002 semblent avoir rasséréné les forces de l'ordre.
Ainsi, M. Pierre Mutz, directeur général de la gendarmerie nationale, a indiqué lors de son audition que les faits élucidés en 2002 avaient augmenté de 14,6 % par rapport à 2001, soulignant que « cette variation était cohérente avec le degré d'investissement des enquêteurs de la gendarmerie dans la lutte contre ce type de délinquance ». M. Bernard Petit, chef de l'OCRTIS, a également indiqué lors de son audition que « tous ces chiffres seront à la hausse en 2002. Cette année 2002 est assez bonne pour les services répressifs, une année de reprise très nette ». M. Michel Bouchet, chef de la MILAD a évoqué pour sa part un « saut qualitatif et quantitatif important dans la répression ». Les chiffres fournis par M. Alain Quéant, sous-directeur à la direction de la police urbaine de proximité de la préfecture de police de Paris, sont particulièrement impressionnants : en 2002, les faits constatés ont augmenté de 50,42 % et le nombre de personnes mises en cause de 47,9 %.
M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, a d'ailleurs rendu hommage à la mobilisation des forces de l'ordre lors de son audition : « Je veux souligner, parce que c'est mon devoir, que dans ce contexte, les services de police et de gendarmerie n'ont malgré tout, et c'est très méritant, pas relâché leurs efforts. Il faut du mérite, parce que cela donnait vraiment l'impression de vider la mer Méditerranée avec une cuillère à café. (...) Comment maintenir cette mobilisation des policiers et des gendarmes si l'on peut en toute impunité fumer du cannabis à la sortie même du tribunal où l'on a été convoqué ? (...) Tous les services se sont fortement mobilisés en 2002 dans la lutte contre la toxicomanie. Par rapport à 2001, c'est simple, les arrestations de trafiquants ont augmenté de 20 %, (...) les interpellations d'usagers ont augmenté de 13% et le nombre de saisies de drogues s'est accru de 23 %. Ces chiffres se passent de commentaires. »
Ainsi que l'a rappelé M. Michel Bouchet, chef de la MILAD, « il n'y aurait pas de cohérence à réprimer sévèrement le trafic si, dans le même temps, l'attitude des pouvoirs public donnait le sentiment d'une forme de tolérance concernant la consommation. Trafic et consommation ne sont en effet que deux aspects de la même problématique et si, de toute évidence, les sanctions doivent être différenciées, il ne peut y avoir un langage et une action forts sur l'un et faibles sur l'autre. C'est pourquoi le ministère de l'intérieur tient très fermement à marquer l'interdit qui pèse sur la consommation. Ainsi, pour l'année 2002, les interpellations d'usagers de stupéfiants ont augmenté dans les mêmes proportions que celles des trafiquants et leur nombre s'élève à plus de 80.000. »
M. Nicolas Sarkozy l'a d'ailleurs également rappelé : « Quelle logique y aurait-il à vouloir éradiquer les trafiquants sans lutter contre la consommation ? Tolérer la consommation est favoriser le travail des trafiquants, évidemment. Si le nombre de consommateurs augmente et si l'on peut tranquillement consommer, pourquoi voudriez-vous que les grands réseaux de trafiquants internationaux ne considèrent pas que notre pays est un lieu d'atterrissage, d'expansion et de commercialisation particulièrement sympathique, puisque vendre de la drogue est très mal, mais on ne dit rien si l'on en consomme ? Si ce n'était si grave, nous pourrions parler d'incohérence. Depuis quelques années, le discours dénonce les trafiquants, mais reste complaisant avec les usagers qui détiennent quelques grammes de cannabis ou quelques cachets, « toujours pour leur consommation personnelle ». C'est un illogisme absolu puisque, je l'affirme, il ne peut y avoir de trafic sans consommation. »
Le ministre a enfin clairement refusé de distinguer entre les drogues dites dures et le cannabis : « Le combat est pour que de moins en moins de jeunes consomment de moins en moins de drogues, quelles que soient ces drogues, quels que soient ces jeunes. Certaines substances sont illicites, mais il n'y a pas de drogues douces ou dures, pas de petite consommation personnelle, pas d'expérience individuelle, pas de jeunes « libres et branchés » ; il n'y a que des drogues interdites, des usagers qui mettent en péril leur santé et transgressent la loi, des drogues interdites parce que quoi que l'on ait pu en dire parfois, toutes les drogues sont nocives ;(...) Il faut ajouter, et c'est important, que ce ne sont pas les jeunes qui sont visés, mais bien ceux qui transgressent la loi, quel que soit leur âge. »
On l'aura compris, les forces de l'ordre ont désormais une « feuille de route » claire.
|
LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT À L'ÉGARD DES RAVE PARTIES Le premier rassemblement de sound systems (un groupe de DJ et leur sono-ambulante) a eu lieu en France il y a 10 ans à la faveur d'un mouvement house et techno naissant. Les raves se sont débord déroulées dans des entrepôts, péniches ou carrières abandonnées avant de devenir officielles, mais régulièrement interdites. Les free parties se sont alors développées. Ces rassemblements musicaux d'une durée de 2 à 4 jours se traduisent par l'afflux de milliers ou de dizaines de milliers de personnes vers des terrains ne comportant aucun équipement susceptible d'accueillir ce type de manifestation. Il en résulte des nuisances parfois fortes pour le voisinage, tandis que les sites occupés peuvent subir d'importantes dégradations. De même, la consommation de drogues, et en particulier d'ecstasy, apparaît particulièrement importante dans ces manifestations. La prévention de ces rassemblements est très difficile en raison de leur caractère imprévisible, ainsi que du secret entourant le choix du site. La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne prévoit désormais que les « rassemblements exclusivement festifs à caractère musical organisés par des personnes privées dans des lieux qui ne sont pas au préalable organisés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat » (paru le 3 mai 2002) doivent faire l'objet par les organisateurs d'une déclaration auprès du préfet. Cette déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques, ainsi que l'autorisation d'occuper le terrain donnée par le propriétaire. Le préfet peut imposer toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire, et interdire le rassemblement si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes. Si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le préfet, les officiers et agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal. Ainsi que l'a indiqué M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure, et des libertés locales lors de son audition par la commission d'enquête, il n'y a pas de raison d'empêcher l'organisation d'événements musicaux tels que les rave parties, chaque époque ayant eu son style musical et les concerts afférents. Néanmoins, la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002 a fixé comme objectif de prévenir les nuisances liées aux rave parties. Après les incidents intervenus en août 2002 au col de Larche (Alpes-de-Haute-Provence), envahi par 5.000 ravers contestataires, des discussions se sont ouvertes en septembre et des médiateurs ont été mis en place dans chaque département. Les services du ministère de l'intérieur tentent de trouver des terrains, en échange de l'installation d'un PC de sécurité. Le festival techno du 1 er mai « Teknival », qui existe depuis 10 ans, a donc été organisé pour la première fois en concertation avec le ministère de l'intérieur sur la piste d'un aérodrome militaire désaffecté à Marigny-le-Grand (Marne). Il a réuni durant trois jours plus de 40.000 « teufers », sans incident majeur. La priorité absolue a été la sécurité du voisinage et la protection sanitaire des participants, souvent très jeunes. La Croix rouge comme Médecins du monde se sont félicités de pouvoir travailler dans ces conditions. M. Nicolas Sarkozy a indiqué qu'il était exclu que la gendarmerie intervienne à l'intérieur des raves, qui peuvent compter jusqu'à 40.000 personnes : « une brigade territoriale de 4 ou 8 qui voit arriver 1.000 jeunes est de toute façon désarmée ». Il a cependant souligné que la gendarmerie assurait la sécurité en périphérie afin d'éviter tout débordement de la délinquance en dehors des lieux-mêmes des raves. Il en en outre souligné que si ces rassemblements n'étaient pas violents, l'intervention des forces de l'ordre pouvait tout faire basculer. Par ailleurs, il a rappelé qu'il était procédé à des contrôles d'alcoolémie et de drogue dans un périmètre de 30 kilomètres autour de la manifestation au moment de sa dispersion. M. Xavier Raufer, criminologue, a indiqué à la commission que le profit potentiel pour les dealers se rendant dans une rave party était de plus de 750.000 euros par soirée. Le phénomène des rave parties est suivi statistiquement depuis 1994. Il existe enfin un groupe d'étude commun police-gendarmerie sur les rave parties. |
2. Une réponse judiciaire affaiblie et disparate
La loi du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses a introduit l'article L. 628 du code de la santé publique réprimant l'usage des substances classées comme stupéfiants de deux mois à un an d'emprisonnement et de 500 à 15.000 francs d'amende. Néanmoins, l'article L. 628-1 du code de la santé publique prévoit une procédure d'injonction thérapeutique : le procureur peut décider de ne pas poursuivre un usager simple de drogues -quelles qu'elles soient- si celui-ci accepte de se faire soigner.
Dorénavant, les consommateurs encourent une peine d'un an d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende sur la base de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, tandis que la procédure d'injonction thérapeutique est prévue aux articles L. 3413-1 à L. 3413-3 du code de la santé publique.
a) L'injonction thérapeutique : une mesure longtemps laissée en jachère et dont la relance reste difficile
La mesure d'injonction thérapeutique, plus ou moins tombée en désuétude à la fin des années 1970, a vu son importance réaffirmée par la circulaire Chalandon du 12 mai 1987 puis les circulaires interministérielles des 15 février 1993 et 28 avril 1995 relatives respectivement aux programmes justice-santé et à l'harmonisation des pratiques relatives à l'injonction thérapeutique, ainsi que plus récemment la circulaire du ministre de la justice du 17 juin 1999 relative aux réponses judiciaires aux toxicomanies, qui a déterminé la politique menée ces dernières années.
(1) Une mesure mise en sommeil dès l'origine ?
De 1970 à 1986, cette procédure a été mise en sommeil en raison des réticences du corps médical , considérant qu'on ne pouvait soigner par la contrainte. Le malaise est patent : le prévenu toxicomane n'est pas un prévenu comme un autre, le magistrat devient un prescripteur médical et le médecin l'exécutant d'une sentence . De même, les magistrats, découragés par l'absence d'interlocuteur dans le champ sanitaire et le manque de retour sur le suivi des traitements, les médecins refusant de communiquer des informations en arguant du secret professionnel, ont répugné à y recourir. Comme l'a indiqué le docteur Lucien Abenhaïm, directeur général de la santé, à la commission d'enquête, « l'une des raisons de l'échec thérapeutique était le fait que nous avions recours dans les années 1970 à des thérapies inefficaces, qui étaient surtout des approches psychosociales, psychoéducatives . Il y a donc eu un découragement assez rapide. »
Par ailleurs, se pose le problème des relations entre les parquets et les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, qui peinent parfois à orienter les personnes vers les structures adéquates, en nombre insuffisant.
Le rapport Pelletier, publié en 1978, souligne les disparités de traitement entre usagers selon les produits, les magistrats et les structures sanitaires . Il propose donc de différencier les usagers de drogues selon le produit consommé.
• La circulaire Peyrefitte du 7 mai 1978, inspirée de ce rapport, indique que l'usager de cannabis ne peut être considéré comme un véritable toxicomane et ne relève pas de la cure de sevrage et des dispositions de la loi sur l'injonction thérapeutique , préconisant une simple admonestation, hormis les cas de multiples réitérations. Comme l'a souligné lors de son audition le docteur Léon Hovnanian, président du Centre national d'information sur la drogue : « Il (le garde des Sceaux) a ainsi dépénalisé de fait le cannabis. Il a eu raison, à mon avis, de supprimer la peine de prison pour obtenir le sevrage, car il y a en effet de meilleurs moyens offerts par des prises en charge dans des structures éducatives d'accueil protégées, à condition de les créer. L'erreur de la circulaire Peyrefitte a été de supprimer une sanction sans proposer de mesures de remplacement. Elle a ainsi renforcé l'image du cannabis drogue douce. »
• La circulaire Badinter de 1984 porte un nouveau coup à l'injonction thérapeutique en exprimant de manière voilée le discrédit frappant cette mesure. Elle relève ainsi que cette mesure a montré ses limites, liées au caractère contraint de la cure et à l'association du médecin et du magistrat « dans des conditions difficiles à comprendre pour l'usager ».
Une seconde période s'ouvre ensuite, où les alternatives sanitaires prévues par la loi disparaissent pour laisser la place à une répression beaucoup plus dense, les usagers se livrant à la revente étant assimilés à des trafiquants et poursuivis pénalement. La faible progression du nombre de mesures ordonnées et l'abandon par le ministère de la justice de tout recueil de données concernant les alternatives sanitaires en sont d'autres signes.
Le choc de l'épidémie de sida fait redécouvrir la population des usagers, en particulier par voie intraveineuse. Les alternatives sanitaires sont réactivées, sans aucune évaluation de leur efficacité, avec comme nouvel objectif la mise en contact des usagers avec les services sanitaires.
(2) Une relance laborieuse
• La circulaire Chalandon du 12 mai 1987 relance l'injonction thérapeutique , en opérant pour la première fois une distinction entre l'usager simple, l'usager-trafiquant ou auteur d'un autre délit et le trafiquant. Pour l'usager occasionnel présentant des garanties suffisantes d'insertion sociale, le magistrat du parquet peut se contenter d'adresser un avertissement, mais doit y procéder personnellement, afin de donner à cette décision toute sa signification. Pour l'usager d'habitude présentant des signes d'intoxication ou déjà interpellé pour des faits analogues, l'injonction thérapeutique est préconisée, une fois les éléments d'information sur sa personnalité et son environnement socio-professionnel recueillis. Elle vise donc à adapter l'intervention répressive et supprime l'approche par produit.
• La circulaire Vauzelle-Kouchner du 9 février 1993 vise à généraliser sur l'ensemble du territoire national le recours à l'injonction thérapeutique, estimant que cette procédure permet d'insérer l'action de la justice dans une perspective socio-médicale ; elle rappelle que plus d'un usager de drogue sur deux faisant l'objet d'une telle mesure entre à cette occasion pour la première fois en contact avec un soignant.
Elle relève que malgré les recommandations de la circulaire de 1987, seules 4.000 mesures sont prononcées chaque année, et qu'elles ne concernent encore qu'un faible nombre de toxicomanes. Ce nombre variait en outre fortement d'un département à l'autre, ainsi qu'à l'intérieur d'une même région, le recours à l'injonction thérapeutique étant fonction des politiques policières, judiciaires et sanitaires mises en oeuvre au plan local. Elle rappelle en outre l'importance de la coopération.
• La circulaire interministérielle du 14 janvier 1993 visant à améliorer la prise en charge sanitaire et sociale des toxicomanes relevant de la justice généralise le recours à l'injonction thérapeutique pour les usagers de stupéfiants n'ayant pas commis d'autre infraction. S'agissant des toxicomanes impliqués dans d'autres infractions (atteintes aux biens, atteintes aux personnes, revente de drogue), le plus souvent liées à leur état de dépendance, elle préconise une réponse répressive diversifiée et réellement individualisée, associée à une politique efficace de prévention de la récidive, par le biais d'une prise en charge sanitaire et sociale adaptée.
Pour ce faire, elle met en place des conventions d'objectifs pour mieux prévenir la récidive en assurant la réinsertion dans 15 départements prioritaires et à Paris, afin de renforcer la coordination à l'échelle du département sous la responsabilité du préfet, en liaison avec les autorités judiciaires et si possible en étroite collaboration avec le président du conseil général et les maires des grandes villes.
Elles visent à accompagner sur le plan sanitaire et social l'ensemble des mesures de sûreté et des peines ordonnées par les juridictions à l'égard des délinquants toxico-dépendants, afin de mieux prévenir la récidive, qu'il s'agisse des alternatives à l'incarcération (contrôle judiciaire, ajournement ou emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, travail d'intérêt général) ou des modalités particulières d'application des peines de prison (semi-liberté, placement extérieur et libération conditionnelle). Des démarches spécifiques doivent concerner les mineurs.
Les préfets sont chargés d'une évaluation des besoins et du recensement et de l'analyse des réponses apportées par le dispositif sanitaire et social existant (en termes de prestations des structures d'accueil et de prise en charge, spécialisées ou non, de capacité d'accueil, de moyens et de circuits de financement). Les directeurs départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse, des affaires sanitaires et sociales et le directeur chargé des services de l'enfance relevant du conseil général doivent étudier les modalités de prise en charge des mineurs usagers sous protection judiciaire, recenser les associations partenaires locales, repérer les liens existants avec le dispositif médical ou spécialisé en toxicomanie, et vérifier la qualité des prestations.
Les conventions doivent notamment prévoir le type de prestations dispensées par les associations, les modalités d'articulation des actions des différentes associations, le nombre de toxicomanes pris en charge, les modalités d'accueil du public (notamment en cas d'urgence), la répartition des responsabilités entre les acteurs de la prise en charge sanitaire ou sociale et les autorités judiciaires, la durée de la convention, le montant des crédits et les financeurs, ainsi que les modalités d'évaluation du dispositif.
• La circulaire interministérielle du 28 avril 1995 relative à l'harmonisation des pratiques relatives à l'injonction thérapeutique (Mme Simone Veil, MM. Pierre Méhaignerie et Philippe Douste-Blazy) restreint les catégories d'usagers susceptibles de faire l'objet d'une injonction thérapeutique en insistant sur le critère de nécessité sanitaire : « les usagers de stupéfiants tels que l'héroïne ou la cocaïne, ou ceux qui s'adonnant au cannabis en font une consommation massive, répétée ou associée à d'autres produits (médicaments, alcool...) ». Dans le même temps, la notion d'injonction thérapeutique est élargie, puisqu'elle doit permettre au toxicomane de favoriser son insertion, l'aspect sanitaire et l'aspect social étant étroitement liés .
La circulaire souligne une nouvelle fois que le succès de l'injonction thérapeutique dépend en grande partie de la confiance réciproque entre magistrats et médecins et préconise la signature de conventions d'objectifs pour en assurer le suivi. A cet égard, elle rappelle une nouvelle fois que la DDASS doit impérativement prévenir le parquet en cas d'échec, de même que le parquet du domicile est seul en mesure de mettre en oeuvre efficacement l'injonction thérapeutique.
Elle préconise le recours aux enquêtes de personnalité et souligne que les faits d'usage peuvent faire l'objet d'une réponse très diversifiée .
La DDASS est chargée de faire procéder à un examen médical de l'usager et de son orientation. Le suivi thérapeutique exercé par la DDASS doit articuler une prise en charge médicale, lorsque l'état de l'usager de drogue le justifie, avec un suivi psychologique et un suivi social, mobilisant à cette fin des profils différents : médecins, psychologues, éducateurs ou assistants sociaux.
S'agissant des mineurs, la circulaire déplore la rareté des saisines des magistrats de la jeunesse et invite à recourir à l'injonction thérapeutique en cas de consommation importante de produits stupéfiants ou de polytoxicomanie. Il convient dans tous les cas pour le parquet des mineurs de faire convoquer dans les meilleurs délais le mineur usager et ses parents, de saisir les services de la DDASS et dans le même temps le service éducatif auprès du tribunal (SEAT) pour enquête.
La circulaire appelle enfin, ce qui est récurrent depuis 1971 (et avait été rappelé notamment en 1987), les services d'enquête à dresser des procès-verbaux et non des mains courantes pour toutes les interpellations pour usage, le recours à l'injonction thérapeutique ne pouvant avoir lieu sans une procédure préalable. De plus, elle insiste sur le fait qu'en cas d'impossibilité de déferrement, l'intéressé reçoit du service enquêteur une convocation à se présenter au parquet dans un délai inférieur à 8 jours (les toxicomanes éprouvant souvent de grandes difficultés à se situer dans le temps et tout retard risquant de se solder par un échec).
(3) Le bilan mitigé de l'injonction thérapeutique à la fin des années 90
La répétition, circulaire après circulaire, et ce pendant plus de 25 ans, des mêmes recommandations laisse songeur . Les difficultés d'ordre pratique, responsables dans une large mesure de l'échec de la procédure d'injonction thérapeutique sont bien connues, ainsi que leurs remèdes.
(a) Le constat : un faible nombre d'injonctions thérapeutiques
Le rapport de la Cour des comptes de 1998 notait que le dispositif avait été peu appliqué, malgré les circulaires publiées depuis 1987.
Les relances successives de l'injonction thérapeutique ont permis de faire progresser le nombre de mesures, mais sans commune mesure avec la progression exponentielle des interpellations pour usage illicite de stupéfiants, passées de moins de 2.000 en 1970 à près de 58.000 en 1996. Le nombre d'injonctions thérapeutiques, inférieur à 1.000 jusqu'en 1978, passe à 2.075 en 1981 et, après les relances successives, à 8.052 en 1997. En 1993, moins de 9 % des interpellations d'usagers aboutissaient à des injonctions thérapeutiques, dont un tiers seulement aurait abouti à des résultats satisfaisants 85 ( * ) .
Par ailleurs, si la circulaire du 28 avril 1995 visait à relancer la mesure, elle préconisait également d'en exclure les usagers de cannabis occasionnels. Le nombre d'injonctions thérapeutiques dans certains parquets a ainsi paradoxalement diminué.
De plus, 5,6 % seulement des consultations ou admissions de toxicomanes dans les centres de soins agréés étaient le résultat d'une injonction thérapeutique.
L'injonction thérapeutique, à vocation essentiellement sanitaire, apparaît en outre inadaptée aux nouveaux produits et modes de consommation.
La prise en compte de la personne dans sa globalité, incluant les problèmes sociaux et psychologiques, conduit à rechercher d'autres modes de prise en charge des usagers de drogues. De plus, il paraît difficile de proposer les mêmes traitements à des usagers de cannabis ayant une consommation à caractère dit festif ou récréatif et à des héroïnomanes fortement dépendants.
(b) La diversité des pratiques selon les parquets
Le rapport de la Cour des comptes relevait en outre le manque d'homogénéité de l'application de cette mesure sur le territoire national. Ainsi, les résultats varient considérablement d'une localité à l'autre, en fonction de la réalité des relations entre les diverses institutions impliquées dans la procédure.
La mise en place de l'injonction thérapeutique a été circonscrite à la région parisienne jusqu'au début des années 1980. Elle s'est ensuite étendue sur le reste du territoire national sans pour autant toucher tous les départements, la moitié des mesures prononcées en 1997 concernant l'Ile-de-France, alors même que la circulaire du 28 avril 1995 visait l'extension du dispositif à l'ensemble du territoire. Aucune injonction n'avait été prononcée dans 19 départements en 1995, même si 31 départements disposaient désormais d'une convention départementale d'objectifs pour la prise en charge des toxicomanes suivis par la justice. En 1996, en France métropolitaine, sur 175 tribunaux de grande instance, 17, soit 10 %, n'avaient prononcé aucune mesure et 13 % en avaient prononcé plus de 100.
Ces disparités régionales peuvent difficilement s'expliquer par la seule présence ou absence d'usagers de stupéfiants dans les régions 86 ( * ) , même si les disparités dans les poursuites résultent notamment du nombre d'affaires soumises au parquet. Malgré les circulaires et les formations destinées aux magistrats, ces derniers sont toujours perplexes sur le rôle de la justice pénale dans la prise en charge des usagers. M. Setbon 87 ( * ) note que les magistrats des parquets les plus farouchement opposés à l'injonction thérapeutique réfutent la réalité même de l'usage de l'héroïne, en estimant que tout consommateur est également vendeur, ce qui exclut l'orientation pénale vers une injonction thérapeutique.
On notera que les données administratives publiées ne répartissent pas les injonctions thérapeutiques par produit . Néanmoins, il apparaît que la part de chaque produit dans les injonctions thérapeutiques prononcées est variable selon les juridictions et montre une évolution vers une diversification des produits.
La part de l'héroïne a tendance à baisser, du fait du développement des traitements de substitution. La part de la cocaïne est non négligeable dans la banlieue parisienne où elle tend à augmenter.
Certains parquets appliquent l'injonction thérapeutique à tous les usagers de drogues illicites, quel que soit le produit consommé, ecstasy, cannabis ou héroïne. Les injonctions thérapeutiques s'appliquent majoritairement à des usagers de cannabis (en 1997, seulement 36 % des mesures concernaient les héroïnomanes), contrairement aux orientations interministérielles recommandant de les réserver aux usagers toxico-dépendants.
Selon une enquête effectuée en 1996 auprès des parquets, une majorité d'entre-eux mettait en oeuvre l'injonction thérapeutique pour les usagers de cannabis, alors même que certains relativisaient l'existence d'un état de dépendance pour ceux-ci. Les parquets plutôt favorables aux poursuites pénales des usagers de stupéfiants tendaient à prononcer les injonctions thérapeutiques pour le cannabis, tandis que ceux qui voulaient éviter les poursuites classaient sans suite pour le cannabis et prononçaient l'injonction thérapeutique pour les autres drogues.
L'extension de la conception de l'injonction thérapeutique, intégrant des préoccupations de suivi socio-éducatif, de prise en charge psychologique et de délivrance d'un message préventif et informatif en terme de santé publique, a également été diversement appréciée par les tribunaux de grande instance.
(c) Un cloisonnement des acteurs préjudiciable
Les réponses judiciaires à la toxicomanie demeuraient encore trop marquées par le cloisonnement des interventions des différents acteurs du processus (police, justice, autorité sanitaire), malgré quelques progrès. Ainsi, si les circulaires des gardes des Sceaux successifs depuis 1978 recommandaient pour les usagers de privilégier le soin et la réinsertion, les interpellations pour usage avaient plus que doublé en cinq ans, avec une proportion croissante d'usagers de cannabis (environ 85 % en 1998), alors que moins de 5 % de ces interpellations donnaient lieu à des condamnations pénales, rarement sévères.
Par ailleurs, si la circulaire du 25 août 1971 indiquait déjà : « il est évident que l'application des prescriptions exige une concertation réelle entre les magistrats du parquet et les responsables des services de l'action sanitaire et sociale de manière à définir en commun les modalités pratiques qui donneront à la loi son maximum d'efficacité. A cette fin, des rapports étroits seront entretenus avec les services intéressés et les magistrats des parquets ne devront pas hésiter à prendre l'initiative de les établir » , tel n'a pas été le cas partout. De même, certains parquets ont expérimenté certaines procédures originales, comme l'incitation aux soins, afin de pallier l'inertie des DDASS.
b) La politique du gouvernement pour la période 1999-2001 : des intentions louables
La politique du précédent gouvernement en matière de répression de l'usage des drogues illicites s'est articulée autour du plan triennal 1999-2001 de la MILDT, décliné, s'agissant de la réponse judiciaire, dans la circulaire du garde des Sceaux du 17 juin 1999 et, s'agissant de la réponse répressive, dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 11 octobre 1999.
(1) Le plan triennal 1999-2001 de la MILDT
Ce plan triennal adopté le 16 juin 1999 vise à définir les conditions d'une meilleure articulation entre les politiques sanitaire et répressive.
S'il n'envisage pas une modification de la loi du 31 décembre 1970, qui réprime le simple usage d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an, il recentre la lutte sur le trafic, tout en rappelant l'interdit aux usagers.
Comme l'a indiqué lors de son audition Mme Nicole Maestracci, ancienne présidente de la MILDT : « Sur l'application de la loi, nous avons essayé de mieux articuler l'action de la justice et l'action sanitaire et sociale par des conventions entre les services de soins et les procureurs de la République (...). L'objectif est que l'ensemble des usagers qui ont affaire à la justice pour une consommation excessive d'alcool ou un délit lié à la drogue puissent bénéficier d'une orientation sanitaire et sociale, quelle que soit la sanction pénale par ailleurs : s'ils ont commis d'autres délits, ils peuvent avoir une sanction pénale et, en même temps, une orientation sanitaire et sociale. ».
Une diversification des réponses judiciaires offertes est donc préconisée à tous les stades de la procédure.
Les conventions départementales d'objectifs justice-santé , qui définissent localement les priorités de la politique judiciaire à l'égard des usagers de substances psychoactives (drogues illicites, alcool, polyconsommations) sont l'outil principal de cette politique, en appuyant financièrement les structures socio-sanitaires susceptibles d'accueillir les publics orientés par les instances judiciaires.
(a) Des objectifs compris et partagés par tous les acteurs
Le plan préconise que les objectifs poursuivis par la répression de l'usage soient partagés par tous les acteurs de la politique publique, qu'ils aient une action sanitaire ou répressive, grâce à une formation spécifique. Il rappelle que ces objectifs sont de diminuer les consommations, d'éviter le passage de l'usage à l'usage abusif, en particulier chez les jeunes, de diminuer la délinquance liée à la situation sociale et sanitaire des toxicomanes, ainsi que les dommages sanitaires et sociaux subis par les consommateurs excessifs ou dépendants, en les mettant en contact avec les structures du réseau sanitaire et social.
Soulignant que les logiques d'ordre public et de santé publique devaient être indissolublement liées, il préconise de réserver les poursuites aux cas où l'usager est source de danger pour lui-même ou pour son environnement.
L'injonction thérapeutique doit par ailleurs être réservée aux usagers toxicodépendants, d'autres alternatives sociopsychologiques devant être trouvées pour les autres consommateurs.
Une telle diversification des réponses judiciaires nécessite la mise en place de permanences d'orientation sanitaire et sociale, servant d'interlocuteur spécialisé pour éclairer les décisions des magistrats et assurer le suivi des mesures.
(b) Prévenir la récidive en privilégiant les alternatives à l'incarcération et le suivi à la sortie de la prison
Pour les toxicomanes les plus en difficulté et les plus susceptibles de récidiver, la mesure d'individualisation doit devenir la règle.
En l'absence de délit connexe, les usagers de drogues doivent systématiquement pouvoir bénéficier de mesures alternatives à l'incarcération.
En outre, la détention doit être l'occasion d'entamer une démarche de soins, qui doit se prolonger après la sortie de prison.
(c) La généralisation des conventions départementales d'objectifs comme instruments de mise en oeuvre des orientations de politique pénale
Le plan s'appuie sur les CDO, créées en 1993 et généralisées à l'ensemble des départements. Ce dispositif doit être adapté aux besoins identifiés localement par les autorités judiciaires et les services relevant du ministère de la justice (orientation et prise en charge des usagers interpellés, classement sous condition, prise en charge des mineurs toxicomanes, contrôle judiciaire socio-éducatif, condamnation assortie d'une obligation de soins, développement du travail d'intérêt général ou de mesures d'aménagement de la peine de prison, type semi-liberté ou liberté conditionnelle, intervention en détention, prise en charge immédiate des sortants de prison).
(2) La circulaire Guigou du 17 juin 1999 : utiliser la réponse judiciaire aux toxicomanies comme tremplin pour une orientation sanitaire ou psychosociale
Cette circulaire décline les orientations du plan triennal de la MILDT s'agissant des usagers de drogues sous main de justice.
Elle considère que l'approche judiciaire ne peut être limitée au seul produit, ni au seul aspect sanitaire de la situation d'un toxicomane, mais que les magistrats doivent tenir compte de la personnalité de l'intéressé, de son mode de consommation et du contexte général dans lequel il évolue (famille, activité professionnelle, scolaire, domicile, conditions de vie...), afin d'individualiser le choix de la mesure, à tous les stades de la procédure, depuis l'interpellation jusqu'à la sortie de prison.
La réponse judiciaire doit participer à la lutte contre la récidive en évitant l'engrenage de la délinquance et l'exclusion des toxicomanes.
Elle insiste sur la nécessité pour les magistrats de systématiquement trouver un interlocuteur compétent dans le champ sanitaire et social pour l'orientation de tout usager interpellé, et les invite à s'appuyer sur les permanences d'orientation pénales et les services chargés de l'exécution des injonctions thérapeutiques.
Elle reconnaît enfin que la démarche effectuée par un toxicomane pour lutter contre son lien de dépendance est nécessairement longue et souvent chaotique, et qu'une nouvelle consommation de produits illicites ne signifie pas automatiquement que cette démarche est vouée à l'échec.
(a) Une enquête de personnalité plus approfondie à tous les stades de la procédure
Les procureurs de la République doivent ainsi recourir aux enquêtes sociales rapides prévues à l'article 41 du code de procédure pénale, après concertation avec les services pénitentiaires d'insertion et de probation et les associations habilitées. La personne chargée de l'enquête sociale doit notamment informer le magistrat des mesures propres à favoriser l'insertion sociale et professionnelle de l'usager de drogues et formuler des propositions. Elle recueille des informations auprès de la famille, des établissements scolaires et dans le milieu professionnel ainsi qu'auprès des services judiciaires le cas échéant.
Dans le cadre d'informations judiciaires, l'intérêt des enquêtes sur la personnalité (article 81 du code de procédure pénale), permettant une investigation approfondie sur la personne dépendante, mais également sur ses possibilités de réinsertion, et surtout des expertises médico-psychologiques ou psychiatriques, est rappelé.
Par ailleurs, lorsque le juge de l'application des peines est saisi par le ministère public (article D 49-1 du code de procédure pénale), un rapport sur la situation de la personne condamnée en lien avec une conduite addictive devrait être établi, afin d'éviter les effets désocialisants d'une courte incarcération, comme la perte d'un emploi ou la rupture d'une prise en charge.
Dans l'hypothèse d'une détention, les procureurs de la République sont invités à rédiger une notice relative à la situation de chaque détenu toxicomane, destinée à l'administration pénitentiaire afin de permettre une individualisation du suivi en milieu carcéral.
(b) L'adaptation des réponses judiciaires tout au long de l'enquête initiale
En ce qui concerne les interpellations et les placements en garde à vue d'usagers de stupéfiants, les procureurs de la République doivent attirer l'attention des services de police et de gendarmerie sur les personnes dont la consommation cause des dommages sanitaires ou sociaux pour elles-mêmes ou pour autrui.
Les interpellations, du seul chef d'usage de stupéfiants, à proximité immédiate des structures à bas seuil ou des lieux d'échange de seringues sont proscrites. En tous lieux, le seul port d'une seringue ne doit plus être considéré comme susceptible de justifier une interpellation. De plus, les traitements de substitution doivent être assurés au cours de la garde à vue.
S'agissant du parquet, il est recommandé une fois de plus que le parquet saisi soit celui du lieu de domicile de l'usager, afin de permettre un réel suivi.
La circulaire appelle en outre à une diversification des alternatives aux poursuites, l'injonction thérapeutique devant prioritairement toucher les personnes dépendantes. Elle confirme donc la circulaire du 28 avril 1995 la réorientant vers les héroïnomanes et autres toxicomanes faisant un usage massif ou répété de produits illicites.
Le rappel à la loi, sous la forme d'un classement des poursuites avec avertissement, est donc à privilégier s'agissant des consommateurs occasionnels de produits stupéfiants, et surtout de cannabis, dont la situation ne paraît pas nécessiter de soins mais justifie une réponse judiciaire. Le classement avec orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle paraît plus adapté pour les usagers de substances psychoactives dont l'interpellation laisse paraître soit des difficultés d'ordre familial, médical, social, professionnel ou scolaire, soit un usage récréatif, comme les personnes consommant de l'ecstasy lors de raves, et qui peuvent ainsi se voir délivrer un message de prévention sanitaire, soit les héroïnomanes ou cocaïnomanes lors de leur première interpellation lorsqu'ils ne paraissent pas relever de l'injonction thérapeutique. Ceux-ci peuvent également se voir appliquer un classement sous condition de se rendre auprès d'une structure désignée.
La DDASS, structure pivot, doit rechercher la réponse la plus adaptée. Il est par ailleurs rappelé que les articles L. 355-16 et L. 355-17 du code de la santé publique prévoient que l'autorité sanitaire contrôle le déroulement du traitement et informe régulièrement le parquet de la situation médicale et sociale de la personne, notamment en cas d'interruption du traitement.
(c) L'adaptation des réponses judiciaires dans la phase pré-sentencielle
Entre l'engagement des poursuites et l'audience de jugement, le prévenu doit être particulièrement sensibilisé à l'intérêt de commencer une démarche d'insertion ou de soins.
L'incitation aux soins doit permettre à la personne poursuivie d'entamer une démarche de soins avant de se présenter devant le tribunal correctionnel, qui en tiendra compte lors de son jugement. La convocation à l'audience ne doit donc pas être trop rapprochée (quatre mois). Ce pôle d'orientation et d'accompagnement a déjà été développé par certaines juridictions sous la forme d'une « permanence toxicomanie » tenue par des partenaires sociaux ou sanitaires. Cette orientation ne constitue pas une obligation pour le prévenu, et lui seul peut informer la juridiction de jugement de l'avancée de sa démarche. Elle est également possible dans le cadre d'un ajournement de peine simple.
En outre, les mesures de contrôle judiciaire , et notamment de contrôle judiciaire socio-éducatif (article 138 du code de procédure pénale) font partie d'un cadre coercitif fort. Au-delà du mandat de surveillance assigné au contrôleur judiciaire, celui-ci peut développer une mission d'aide et d'assistance (en matière de soins, d'insertion sociale, de difficultés personnelles ou familiales...).
(d) L'adaptation des réponses judiciaires dans les phases sentencielle et post-sentencielle : l'emprisonnement ferme à l'encontre d'un usager n'ayant pas commis d'autre délit connexe, utilisé comme un ultime recours
La circulaire préconise de recourir plus fréquemment aux ajournements de peine, aux peines alternatives à l'incarcération et aux mesures d'aménagement de peines, rarement prononcées en faveur des toxicomanes, alors qu'il s'agit de mesures structurantes, dont la mise en oeuvre à l'égard des personnes présentant une dépendance avérée aux opiacés est aujourd'hui facilitée par les traitements de substitution, permettant une stabilisation de leur état. En 1998, les services de l'administration pénitentiaire ont suivi plus de 138.000 mesures, dont 105.000 mesures de sursis avec mise à l'épreuve, 24.000 mesures de travail d'intérêt général et 763 mesures d'ajournement avec mise à l'épreuve.
L'ajournement de peine avec mise à l'épreuve permet de responsabiliser le prévenu, à qui le travailleur social peut rappeler l'échéance du jugement comme ultime recours à son inertie. Il permet la mise en oeuvre d'un suivi socio-éducatif général, d'un accompagnement dans le cadre de démarches de soins, mais aussi d'actions à vocation préventive comprenant des séances d'information sur les produits et leurs effets.
La circulaire souligne toutefois que cette mesure n'est pleinement opérationnelle que si elle est mise en oeuvre immédiatement, et préconise la tenue par le service pénitentiaire d'insertion et de probation de permanences d'audition afin que dès la sortie de l'audience, une convocation soit fixée au prévenu et que les pièces nécessaires à la notification de la mesure par le juge de l'application des peines soient rapidement rassemblées.
Le sursis avec mise à l'épreuve , du fait de sa grande souplesse, est la principale sanction alternative prononcée par les juridictions. L'obligation de soins consiste à amener la personne à prendre contact avec un établissement sanitaire, puis à s'engager dans une démarche de soins. La circulaire constate une amélioration du partenariat avec les structures spécialisées. Il doit prendre en compte l'ensemble des difficultés d'insertion et repose donc sur la mise en oeuvre d'un suivi socio-éducatif des condamnés réalisé par le service d'insertion et de probation, et sur une orientation de ceux-ci vers les dispositifs de droit commun : aide sociale, mission locale pour les jeunes, formation professionnelle.
S'agissant du travail d'intérêt général , la circulaire rappelle qu'il peut notamment être prononcé à titre de peine principale (article 131-8 du code pénal), comme obligation particulière dans le cadre d'une peine d'emprisonnement avec sursis (article 132-54 du code pénal) ou comme conversion d'une courte peine d'emprisonnement (article 132-57 du code pénal). Le TIG est une peine alternative en vigueur depuis 1983 qui ne peut être prononcée qu'avec l'accord du condamné. Il s'agit d'un travail non rémunéré d'une durée de 40 à 240 heures maximum, au profit d'une collectivité locale ou d'une association.
Les personnes toxicomanes bénéficient rarement de cette mesure, et ne s'intègrent souvent que difficilement aux postes de travail habituellement prévus à cet effet par les collectivités et établissements publics et les associations habilitées. Ces difficultés ont conduit plusieurs magistrats et services d'insertion et de probation à définir des modalités spécifiques de mise en oeuvre du travail d'intérêt général pour les personnes toxicomanes reposant sur l'idée de progressivité dans l'exécution du travail, intégrant des mesures éducatives particulières et s'appuyant sur un partenariat soutenu. L'exécution proprement dite d'une activité non rémunérée au sein d'une équipe de travail peut être précédée d'une période de préparation (bilan sanitaire, soutien psychologique, remise à niveau scolaire, bilan professionnel...), qui ne peut être ajoutée à la durée du TIG prononcée par la juridiction. Un accompagnement éducatif ou sanitaire au cours de la mesure est indispensable, afin de préparer la sortie du dispositif et de prévenir la récidive. Il doit donc englober la recherche d'une insertion durable de l'intéressé, qu'il s'agisse de l'hébergement, de la situation administrative, des ressources ou des perspectives professionnelles ou de formation. La circulaire préconise la prise en charge rapide des personnes condamnées, grâce à l'exécution provisoire de la décision et à la tenue de permanences par les services pénitentiaires d'insertion et de probation pendant les audiences correctionnelles.
En outre, elle invite les juges de l'application des peines et les services pénitentiaires d'insertion et de probation à rechercher des modes de collaboration plus actifs et plus structurés avec les partenaires de l'institution judiciaire et à présenter régulièrement aux juridictions de jugement les projets déjà mis en place ainsi que leur évaluation.
Enfin, la circulaire indique que lorsque la nature des faits, les antécédents judiciaires et la personnalité du prévenu justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme , la période de détention doit être mise à profit pour favoriser une prise en charge des problèmes de dépendance du condamné dès son accueil par un meilleur repérage des personnes toxicomanes en vue d'une orientation vers les structures sanitaires ou spécialisées et de l'établissement d'un projet d'exécution des peines et de préparation à la sortie.
Elle déplore en outre la diminution du nombre de libérations conditionnelles , susceptibles pourtant de mieux préparer la sortie des détenus incarcérés et d'éviter la récidive. Le bénéfice de cette mesure peut être subordonné à une obligation de soins, mais nécessite une préparation précoce et rigoureuse de la part des services d'insertion et de probation afin d'assurer la crédibilité des projets présentés à la commission d'application des peines.
S'agissant du placement à l'extérieur (article D. 126 du code de procédure pénale), exécuté soit sous surveillance pénitentiaire directe soit par délégation à un tiers (employeur, famille, partenaire sanitaire), la circulaire indique qu'il peut être accordé en vue d'une prise en charge sanitaire, mais que cela reste rare, l'obstacle majeur résidant dans la prise en charge sanitaire, qui exige la création d'un partenariat réel et efficace. Or cette mesure facilite dans un cadre relativement contraignant l'élaboration d'un projet social ou socio-professionnel (contrat emploi-solidarité, stage de formation professionnelle) et dans le même temps la mise en place d'un suivi sanitaire.
Enfin, elle souligne le faible nombre des projets de semi-liberté .
Les diverses suites données aux interpellations d'usagers se présentent comme suit, étant rappelé que l'objectif de la directive de la Chancellerie du 17 juin 1999 était de développer toutes les alternatives à l'incarcération et de permettre une orientation psychosociale ou sanitaire à tout stade de la procédure.
Parcours de l'usager de substances psychoactives
(drogues illicites)
dans la chaîne pénale
POLICE
GENDARMERIE
DOUANES
Interpellation
(constatation de l'infraction)
Orientation pénale
(enquête et décision
de poursuite)
Réponse judiciaire
(jugement et fixation
de la
sanction)
Exception de la peine
(application des peines)
Classement sans suite
Alternative
aux poursuites
(classement sans suite provisoire)
Interpellation
(a) Injonction thérapeutique
(b) Classement avec rappel à la loi et/ou avertissement
(c) Classement avec orientation sanitaire et/ou sociale
Transactions douanières pour ILS
Sanction
Mesure présentencielle (avant jugement)
(a) Contrôle judiciaire
(b) Liberté surveillé, placement...
(c) Enquête sociale
Amende
Peine alternative à incarcération
Emprison
nement
(a) Travail d'intérêt général
(TIG)
(b) Peine de substitution
(c) Mesure éducative
* Avec sursis
(a) Simple
(b) Probatoire
(c) TIG
(a) Partiel
(b) Total
Ferme
(a) Placement à l'extérieur
(b) Semi-liberté
(c) Liberté conditionnelle
Poursuite
PARQUET
TRIBUNAL
(e) L'adaptation des réponses judiciaires aux problématiques des mineurs usagers de drogues
La circulaire souligne l'importance pour les jeunes, quand l'usage existe, de prévenir sa répétition ou son abus.
A l'égard des mineurs ne présentant pas de difficulté personnelle ou sociale méritant une intervention éducative et impliqués dans un simple usage ou une revente occasionnelle, elle privilégie des mesures de rappel à la loi et de classement sous condition , de non renouvellement notamment, notifiées aux intéressés et à leurs représentants légaux par le substitut spécialement chargé des affaires de mineurs ou par le délégué du procureur de la République. Une évaluation par le service éducatif auprès du tribunal est préconisée, suivie si cet usage se révèle important d'une saisine du juge des enfants aux fins d'investigations approfondies.
En raison de leurs modes d'intoxication, les mineurs ne sont qu'exceptionnellement concernés par la mesure d'injonction thérapeutique, qui nécessite en ce qui les concerne l'avis des parents.
S'agissant de mineurs fortement impliqués dans la diffusion des produits, au sein des écoles ou à l'extérieur ou récidivistes, la circulaire préconise la saisine systématique du juge des enfants ou du juge d'instruction spécialisé dans les affaires de mineurs , dans le cadre de l'ordonnance du 2 février 1945. En ce qui concerne les enquêtes et les éléments de personnalité, les services éducatifs auprès des tribunaux peuvent être saisis pour recueillir des renseignements socio-éducatifs comme le prévoit l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945, susceptibles d'être complétés ultérieurement 88 ( * ) .
Elle propose en outre de recourir à toute la palette de réponses éducatives de l'ordonnance du 2 février 1945 : mesures de liberté surveillée, de mise sous protection judiciaire ou de placement en établissement éducatif ou sanitaire.
Elle appelle également au développement de protocoles de collaboration entre la protection judiciaire de la jeunesse et le secteur sanitaire, l'usage de drogue pouvant nécessiter une prise en charge sanitaire en complément d'une mesure éducative.
La consommation de drogues constituant parfois le symptôme de difficultés d'ordre à la fois personnel, familial et social, elle invitait les parquets de mineurs à demander à être systématiquement avisés de ces situations afin qu'ils puissent saisir les juges des enfants à chaque fois qu'apparaissait une notion de danger pour permettre une évaluation approfondie de la situation dans sa globalité.
(3) L'objectif de la circulaire Chevènement du 11 octobre 1999 relative au renforcement de la lutte contre l'usage et le trafic local de stupéfiants : préciser la place de la police dans la chaîne judiciaire
La circulaire du 11 octobre 1999 relative au renforcement de la lutte contre l'usage et le trafic local de stupéfiants vise notamment à expliciter les orientations de la MILDT à des policiers parfois perplexes.
Elle part du constat que les policiers, dans leurs missions quotidiennes sur la voie publique, sont souvent le premier contact entre l'usager de drogue et le monde institutionnel. Elle préconise que ce contact puisse être décliné sous tous ses aspects : prévention de l'usage, marque de l'interdit, aide à la décision judiciaire.
Si la circulaire rappelle que doivent être privilégiés les contrôles susceptibles de conduire à l'interpellation d'usagers dont la situation sanitaire ou le comportement font courir des risques non seulement à eux-mêmes, mais aussi à autrui, elle la nuance sur deux points :
- ces priorités sont sans préjudice de l'action des services commandée par un contexte particulier tels que le flagrant délit, le trouble à l'ordre public, la requête de riverains, l'intérêt d'une enquête ... ;
- « cette priorité ne dispense pas, par ailleurs, d'intervenir à propos des consommations de tous les produits prohibés par la loi, notamment le cannabis », connu pour accompagner ou générer une polytoxicomanie avec d'autres produits, tel l'alcool, des comportements délictuels, dangereux (conduite de voiture), des troubles à l'ordre public et des incivilités à l'origine du sentiment d'insécurité dans les quartiers sensibles.
Par ailleurs, il convient, lorsqu'elles sont inexistantes, de définir en concertation avec le chef de projet les modalités d'action des services de police à proximité immédiate des structures d'accueil de toxicomanes dépendants et des lieux d'échanges de seringues.
En matière d'usage, il est nécessaire d'éviter tout lien automatique entre l'interpellation et la garde à vue. Les chefs de service doivent mener en étroite concertation avec les parquets une réflexion sur les critères (nature du produit, type et fréquence de consommation, absence de trouble à l'ordre public, personnalité et antécédents de l'usager -récidive, insertion sociale, domiciliation-, capacité du service à traiter la procédure immédiatement ou rapidement, urgence d'un traitement médical...).
« Le cas des mineurs justifie une attention particulière. A leur égard aucune consommation ne doit être considérée comme anodine . » La circulaire souligne qu'il faut tendre à la responsabilisation des parents et à leur information. Leur audition est indispensable, au-delà de leur reconnaissance sur le plan de la responsabilité civile, tant pour les sensibiliser aux dangers encourus que pour les renseigner sur les dispositifs d'aide existants.
L'accomplissement de ces diligences conduit généralement à un placement en garde à vue. En outre, il peut être utile de faire procéder à un examen médical. Dans cette hypothèse, une mesure de garde à vue s'impose.
Les services de police doivent s'attacher à mettre le parquet en position de choix en lui fournissant toutes les informations dont il peut disposer, notamment s'agissant du recueil d'informations précises sur la personnalité du mineur, nécessaire à la décision du parquet, voire à la saisine du juge des enfants en matière d'assistance éducative.
L'ensemble de ce dispositif ambitieux semblait donc a priori cohérent et réaliste, un consensus existant sur l'opportunité d'éviter la prison aux toxicomanes, ce lieu pouvant les inciter à essayer de nouveaux produits. Néanmoins, on pouvait craindre qu'il soit interprété par les usagers de drogues, notamment récréatifs, comme une certitude de pouvoir consommer en paix. Par ailleurs, la question de la capacité des structures sanitaires et psychosociales à accueillir ces personnes était également posée.
c) Des résultats qui peuvent être diversement appréciés
La commission d'enquête s'est interrogée tant sur le degré de réalisation des objectifs fixés par le plan triennal 1999-2001 que sur leur pertinence au regard des priorités de lutte contre les drogues illicites.
(1) Une évaluation du plan par l'OFDT
L'OFDT a été chargé par le comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie de procéder à une évaluation du plan. Ainsi que l'a indiqué à la commission d'enquête son directeur, M. Jean-Michel Costes, « l'évaluation ne porte pas sur la pertinence du plan, en termes techniques, c'est-à-dire sur l'adéquation éventuelle entre les objectifs qui avaient été déterminés à l'époque et les enjeux, mais sur ce qu'on appelle l'effectivité, pour déterminer le degré de réalisation des objectifs du plan triennal affichés au départ. »
(2) Des difficultés méthodologiques certaines
Le rapport de l'OFDT 89 ( * ) a tout d'abord souligné les difficultés méthodologiques rencontrées : « Une évaluation complète aurait eu vocation non seulement à apprécier les principaux effets du dispositif des CDO, mais également à tenter de caractériser l'évolution des pratiques pénales intervenue depuis trois ans. Les sources d'information disponibles ne l'ont pas permis. Elles se sont révélées partielles, dispersées, et souvent incompatibles entre elles. (...) La qualité des réponses pénales apportées aux problématiques d'usage de drogues n'a donné lieu qu'à une faible quantité d'expertises, du moins en France. Leur champ d'analyse reste circonscrit et leurs conclusions sont fondées sur des données limitées. »
Ainsi, il est actuellement impossible, de suivre d'un bout à l'autre du processus pénal le parcours des usagers de drogues. Les statistiques ne permettent pas de répondre globalement à la question du développement des orientations socio-sanitaires aux différents stades de la filière pénale.
Les données sont généralement présentées pour une infraction principale, alors que les deux tiers des condamnés pour infraction à la législation sur les stupéfiants le sont pour plusieurs infractions, ce qui aggrave le manque de visibilité statistique. La variabilité des définitions de l'usager d'une source à l'autre fausse tout suivi statistique.
La part des alternatives aux poursuites des auteurs d'infractions à la législation sur les stupéfiants (en particulier des usagers simples) n'est pas distinguée dans les chiffres nationaux . De plus, les alternatives aux poursuites proposées aux auteurs d'infractions à la législation sur les stupéfiants ne sont pas détaillées systématiquement dans les statistiques des parquets, ni par type de contentieux (usage, détention, cession ou trafic), ni par type de procédure alternative (orientation vers une structure sanitaire et sociale, avertissement, rappel à la loi). La plupart du temps, seules sont distinguées les injonctions thérapeutiques.
Le rapport de l'OFDT a donc étudié un échantillon constitué des seules données produites par l'ensemble des parquets franciliens (à l'exception de la Seine-et-Marne) relevant des cours d'appel de Paris et de Versailles : Paris, Créteil, Bobigny, Nanterre, Pontoise, Evry et Versailles. Une projection nationale à partir de ces résultats semble non fondée, l'Ile-de-France étant atypique en matière de contentieux des infractions à la législation sur les stupéfiants.
(3) Des objectifs diversement réalisés
(a) En matière d'intégration des objectifs socio-sanitaires dans l'approche pénale
En ce qui concerne l'intégration par les acteurs répressifs et sanitaires des objectifs socio-sanitaires dans l'approche pénale des usagers justiciables, le rapport estime que la sensibilisation des acteurs répressifs aux besoins des usagers s'est faite essentiellement à travers le partenariat local, mais qu'elle semble encore insuffisante, même si le chiffre des personnes sensibilisées n'est pas connu. Il préconise donc d'étudier les obstacles à l'application des préoccupations socio-sanitaires par les acteurs répressifs.
La sensibilisation des acteurs sanitaires aux enjeux de la politique pénale se heurte au problème récurrent du secret professionnel . Les soignants font valoir l'éthique médicale au détriment du rôle d'expert, auxiliaire de justice, qui est attendu d'eux. Certains estiment ainsi ne pas devoir transmettre plus qu'un simple certificat de suivi. A cet égard, M. Yves Bot, procureur de la République de Paris, a indiqué à la commission d'enquête que « le magistrat est tenu au courant du résultat dans la mesure où le secret médical est préservé. Cela veut dire qu'il sait si la personne s'est soumise à l'injonction thérapeutique ou non. (...) Cependant, nous ne savons pas ce qui s'est passé, ce qu'a fait l'équipe médicale ou médico-psychologique, ni le traitement qu'elle a prescrit. Je dois dire que cela ne me paraît pas anormal. »
D'autre part, les personnels médicaux et sociaux estiment que la démarche de soins doit être demandée par le patient, une obligation s'avérant sans efficacité réelle.
Les dispositifs locaux de partenariat développés dans le cadre de la politique de la ville ou des contrats locaux de sécurité (CLS) ont permis une amélioration des relations entre magistrats et personnels médicaux et sociaux. Sur un échantillon de 173 CLS étudiés, 85 % disposaient d'un volet toxicomanie. Malgré l'absence d'outil de suivi, on peut estimer que le problème a été traité uniquement sur le plan sécuritaire.
(b) En matière de capacité des dispositifs socio-sanitaires à prendre en charge les usagers
Le rapport a ensuite évalué la capacité des dispositifs socio-sanitaires à prendre en charge les usagers justiciables à tous les stades de la filière pénale 90 ( * ) .
|
Les conventions départementales d'objectifs (CDO) ont été créées par la circulaire interministérielle du 14 janvier 1993 et mises en place dans 15 départements prioritaires et Paris, avant d'être généralisées dès 1999 à l'ensemble des départements métropolitains et étendues en 1998 aux personnes sous main de justice ayant des difficultés avec l'alcool. Elles sont l'instrument principal de la circulaire et sont destinées à améliorer la prise en charge sanitaire et sociale des toxicomanes placés sous main de justice et à mieux prévenir la récidive et proposent des réponses adaptées aux besoins identifiés dans les départements par les autorités judiciaires, conjointement avec les autorités sanitaires. Ce dispositif prend la forme de conventions d'objectifs triennales, élaborées par le préfet de département et le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, puis de conventions annuelles de prestation conclues entre le préfet, l'autorité judiciaire et la structure bénéficiaire des fonds (association). Les CDO sont financées par des crédits déconcentrés de la MILDT, de 2,5 millions d'euros en 1998 à 9,9 millions en 2001. Ils ont financé 203 structures en 1999, 286 en 2000 et 333 en 2001. Si les structures spécialisées dans la prise en charge des toxicomanes (CSST) et des alcoolo-dépendants (centre de cure ambulatoire en alcoologie) représentent respectivement 31 % et 22 % des opérateurs financés, les opérateurs du réseau justice (mettant en oeuvre notamment les contrôles judiciaires et les enquêtes rapides) sont mobilisés à hauteur de 22 % ainsi que les opérateurs oeuvrant dans le champ de la lutte contre les exclusions (25 % pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale et les missions locales, points écoute...). Ces conventions ont notamment pour vocation de soutenir financièrement les associations assurant les « permanences toxicomanie » au sein des tribunaux et celles chargées de la mise en oeuvre des classements avec orientation sanitaire ou sociale. Les actions financées par les CDO en 2000 concernent le soin (18 %), le suivi psychologique (15 %), la prévention (15 %), l'insertion professionnelle (18 %) et autres (orientation, hébergement : 44 %). Le nombre de personnes prises en charge est passé de 9.235 en 1999 à 20.069 en 2000 et 36.300 en 2001 (dont 957 mineurs et jeunes majeurs, soit 6 % de la population prise en charge). Néanmoins, il semble que certaines de ces personnes aient en fait déjà été prises en charge par ailleurs. Cette première rencontre avec le système de soins s'est d'ailleurs souvent prolongée bien au-delà de l'obligation judiciaire. Le dispositif a fait l'objet d'une évaluation spécifique rendue publique par l'OFDT en décembre 2002. Elle a souligné la bonne adhésion de l'ensemble des partenaires impliqués mais a fait état du manque de cohérence et de vision d'ensemble des actions menées en terme de politique pénale et a souligné également l'insuffisance de la prise en charge des mineurs et des jeunes majeurs. |
Les rapports d'activité des CSST font apparaître une augmentation du nombre d'usagers de drogues pris en charge par les CSST dans le cadre de mesures judiciaires (de 10,5 % à 12 % de l'ensemble des patients). Le nombre de nouveaux patients pris en charge s'est accru pour passer de 14 % à 17 % de 1999 à 2000.
(c) En matière d'accès aux soins des interpellés
L'objectif d'amélioration de l'accès aux soins à la suite de l'interpellation reste diversement atteint.
Le taux de réponse judiciaire (poursuites et alternatives aux poursuites) en matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants -pour deux tiers des cas d'usage- est remarquablement élevé par rapport aux autres contentieux : 83,7 % en 2001 contre 67,1 % pour les autres, notamment s'agissant des mineurs (88,7 %). Du fait d'un faible taux de classement sans suite « sec », 4 usagers de drogues sur 5 interpellés se trouvent donc en situation d'accéder à des soins.
Ainsi que l'a rappelé lors de son audition M. Yves Bot, procureur de la République de Paris, « le fait qu'un nombre important d'infractions pour simple usage soient classées sans suite ne veut pas dire qu'elles sont sans réponse. C'est l'une des matières pour lesquelles il y a incontestablement de la marge pour ce qu'on appelle le rappel à la loi et l'orientation. Quand on oriente une personne vers une injonction thérapeutique, cela se traduit judiciairement, si elle est menée jusqu'au bout, p ar un classement. (...) Dans ce cas, il y a eu réponse. Désormais, dans la politique pénale moderne des parquets, le classement ne signifie pas obligatoirement absence de réponse. Il peut parfaitement y avoir des réponses : c'est le problème du rappel à la loi, de la médiation et de tout ce qu'on appelle la troisième voie, qui est contenu dans l'article 41 du code de procédure pénale et qui permet justement d'éviter les classements secs. »
Dans les cas d'usage ou de détention impliquant des mineurs, près des trois quarts des affaires donnent lieu à une alternative aux poursuites. En 2001, dans les 7 juridictions de l'échantillon, 1.723 usagers simples de 15 à 17 ans ont été interpellés (en quasi-totalité des usagers de cannabis). Sur 815 affaires impliquant un mineur, 608 ont fait l'objet d'une procédure alternative aux poursuites (dont 477 rappels à la loi ou avertissements, soit 78,5 % des mesures alternatives).
Le nombre de mineurs interpellés pour usage ou pour usage-revente ayant fait l'objet d'un classement sans suite et d'une mesure alternative aux poursuites (en détaillant rappels à la loi, classements sous condition, orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle et injonctions thérapeutiques) n'est pas une donnée statistique disponible à ce jour pour l'ensemble de la France.
S'agissant des majeurs, dans les 7 parquets considérés, dans les deux tiers des cas, l'usage comme la détention donnent lieu à une mesure alternative, alors que pour les autres ILS (cession ou offre, trafic), les poursuites sont largement majoritaires.
ORIENTATION PÉNALE DES PERSONNES
INTERPELLÉES POUR USAGE
OU DÉTENTION DE STUPÉFIANTS
(MAJEURS ET MINEURS)
Échantillon francilien, cours
d'appel de Paris et de Versailles,
année 2001
|
Nombre d'affaires |
Ratio
|
||
|
Usage |
9 174 |
100 |
|
|
Classement sans suite |
1 922 |
21,0 |
|
|
Procédure alternative aux poursuites |
5 611 |
61,2 |
100 |
|
Rappel à la loi/avertissement |
4 560 |
49,7 |
81,3 |
|
Injonction thérapeutique |
459 |
5,0 |
8,2 |
|
Orientation vers une structure sanitaire ou sociale |
276 |
3,0 |
4,9 |
|
Autres |
316 |
3,4 |
5,6 |
|
Poursuite |
1 641 |
17,9 |
|
|
Détention |
4 206 |
100 |
|
|
Classement sans suite |
511 |
12,2 |
|
|
Procédure alternative aux poursuites |
2 870 |
68,2 |
100 |
|
Rappel à la loi/avertissement |
2 287 |
54,4 |
79,7 |
|
Injonction thérapeutique |
259 |
6,2 |
9,0 |
|
Orientation vers une structure sanitaire ou sociale |
248 |
5,9 |
8,6 |
|
Autres |
76 |
0 |
2,7 |
|
Poursuite |
825 |
19,6 |
|
Source : Ministère de la Justice, DACG -
Données indicatives produites par l'Infocentre 2001
(chiffres
provisoires)
Néanmoins, dans 80 % des cas d'usage ou de détention, il s'agit d'un rappel à la loi ou d'un avertissement. Les alternatives socio-sanitaires ne concernent que 15 % des cas .
(d) En matière de recentrage de l'injonction thérapeutique
L'objectif de recentrage de l'injonction thérapeutique sur les usagers majeurs les plus dépendants a été diversement respecté. Le suivi des injonctions thérapeutiques ne peut être fait avec exactitude en raison d'une modification du décompte statistique. Cependant, en calculant le ratio d'injonctions thérapeutiques déclarées par rapport au nombre d'usagers simples interpellés, on note une légère augmentation de 1999 à 2001 : 5,6 % des interpellés contre 5,2 % en 1999. Dans l'échantillon francilien, ce ratio est de 2,7 %, ce qui confirme la diversité des pratiques des parquets en la matière.
La réactivation de la mesure à la suite des effets clarificateurs de la circulaire du 17 juin 1999, qui a précisé le public-cible (les personnes dépendantes faisant un usage massif ou répété de produits illicites, c'est-à-dire en premier lieu les héroïnomanes et le cas échéant les polytoxicomanes), a eu des effets contradictoires selon les parquets . Néanmoins, cette circulaire ne semble pas avoir suffi à recentrer l'injonction sur certaines cibles : sur un échantillon limité, moins d'une mesure sur cinq financée par les CDO concernait les héroïnomanes, soit encore moins qu'en 1997 (36 %). La tendance à la prescription socio-sanitaire aux usagers de cannabis s'est encore renforcée puisqu'ils représentent 71 % du public justiciable visé par une orientation socio-sanitaire. On peut donc penser que dans un certain nombre de cas de consommation restreinte ou récréative de cannabis, l'injonction thérapeutique relève moins d'une préoccupation sanitaire qu'elle ne sert de cadre à un suivi socio-éducatif, à une prise en charge psychologique ou à la délivrance d'un message préventif.
L'impossibilité de mesurer la déperdition des usagers entre le prononcé de l'injonction et leur présentation à la DDASS est l'un des obstacles majeurs à l'évaluation des effets socio-sanitaires de la politique pénale. De plus, il est impossible d'apprécier l'efficacité de l'injonction thérapeutique au vu du taux de récidive, par rapport aux autre mesures mises en oeuvre (classements sans suite, poursuites ou autres alternatives).
50 % des justiciables pris en charge par une structure sanitaire financée dans le cadre des CDO l'ont été en phase pré-sentencielle . Un quart d'entre eux l'était en injonction thérapeutique , la moitié dans le cadre d'une autre alternative aux poursuites et un quart sous contrôle judiciaire.
Du point de vue de la prise en charge par les CSST, l'effectivité des injonctions thérapeutiques semble s'être améliorée. Le nombre des personnes adressées par les parquets au titre d'une injonction thérapeutique a augmenté, mais leur part dans l'ensemble des prises en charges a diminué au profit d'autres types d'alternatives aux poursuites, notamment les classements avec orientation sanitaire 91 ( * ) .
Ceci traduit l'intégration progressive dans les pratiques d'orientation pénale des directives interministérielles et l'essor remarquable des orientations sanitaires et sociales.
S'agissant de l'objectif de développement des permanences d'orientation sanitaire et sociale destinées à repérer les usagers à problèmes pour les orienter immédiatement après la présentation de la personne interpellée au parquet, aucune donnée ne permet d'apprécier le nombre de TGI dotés d'une telle permanence, pourtant primordiale.
(e) En matière de développement des peines alternatives
La systématisation des peines alternatives au stade du jugement devait accompagner le recul des incarcérations pour usage simple de stupéfiants.
Les contrôles judiciaires socio-éducatifs (qui visent à favoriser l'insertion de l'intéressé) sont en augmentation (près de 5.400 cas, dont les deux tiers sont traités par les service pénitentiaires d'insertion et de probation, le tiers restant relevant d'associations).
|
L'OBJECTIF DE DIMINUTION DU NOMBRE DE PEINES
D'EMPRISONNEMENT
En 1998, on dénombrait encore 690 peines d'emprisonnement ferme pour usage (soit 0,9 % de l'ensemble des usagers interpellés, contre 4,5 % en 1990). En 2001, 388 peines d'emprisonnement ferme pour usage ont été prononcées (0,5 % des usagers interpellés). Le recours à l'emprisonnement ferme pour usage de stupéfiants fait donc toujours partie de la pratique judiciaire, en dépit des préconisations du plan triennal et de la circulaire de 1999 le présentant comme un « ultime recours ». En novembre 2000, on dénombrait ainsi 197 personnes en prison pour une condamnation d'usage de stupéfiants en condamnation unique (une trentaine de moins seulement qu'en 1994). |
La circulaire du 17 juin 1999 recommande de systématiser les peines alternatives pour les usagers de drogues en l'absence de délit connexe, dans une perspective de prévention de la récidive.
Depuis 1990, les peines alternatives ont augmenté : jours-amende, travail d'intérêt général. Durant la période triennale, la part des peines alternatives s'est accrue, tant pour les infractions à la législation sur les stupéfiants que pour les usagers en infraction. Au sein des condamnations pour usage illicite (seul ou associé à au moins une autre infraction), les peines alternatives marquent une progression de 43 %.
CONDAMNATION À DES PEINES D'EMPRISONNEMENT
FERME,
À DES MESURES DE SUBSTITUTION OU À DES MESURES
ÉDUCATIVES
SELON LA NATURE DES MESURES OU LE MODE
D'EXÉCUTION
ET SELON LA NATURE DE L'INFRACTION
(en infraction
principale commise seule ou associée à d'autres)
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
|
|
Infractions à la législation sur les stupéfiants |
||||
|
ENSEMBLE des condamnations |
24.081 |
24.112 |
22.917 |
21.448 |
|
Peine d'emprisonnement ferme |
6.595 |
6.369 |
5.709 |
5.080 |
|
TIG |
561 |
511 |
504 |
435 |
|
Jours-amende |
531 |
671 |
781 |
1.043 |
|
TOTAL des mesures de substitution |
1.092 |
1.182 |
1.285 |
1.478 |
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
|
|
Usage illicite |
||||
|
ENSEMBLE des condamnations |
6.686 |
7.000 |
6.616 |
5.993 |
|
Peine d'emprisonnement ferme |
1.288 |
1.164 |
1.003 |
882 |
|
TIG |
172 |
200 |
188 |
143 |
|
Jours-amende |
262 |
327 |
327 |
445 |
|
TOTAL des mesures de substitution |
434 |
527 |
515 |
731 |
Source : Casier judiciaire, Ministère de la Justice, SDSED
Néanmoins, le nombre de TIG reste faible pour les usagers simples de stupéfiants (entre 130 et 150 mesures).
Parmi les peines alternatives à l'incarcération, les peines d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve (SME) prononcées à la suite d'une condamnation pour infraction d'usage simple, principale sanction prononcée par les juridictions avant l'adoption du plan, ont décliné, passant de 632 mesures en 1998 à 453 en 2000.
NOMBRE DE CONDAMNATIONS À UNE MESURE
D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS OU À UNE AMENDE, OU À UNE MESURE DE
SURSIS PROBATOIRE
SELON LA NATURE DE L'INFRACTION (COMMISE SEULE OU
ASSOCIÉE)
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
|
|
Usage illicite |
||||
|
Emprisonnement avec sursis |
2.831 |
2.903 |
2.659 |
2.253 |
|
Amende |
1.672 |
1.920 |
1.964 |
1.858 |
|
Sursis probatoire |
1.250 |
1.124 |
1.028 |
913 |
|
Infractions à législation sur les stupéfiants |
||||
|
Emprisonnement avec sursis |
12.268 |
11.968 |
11.377 |
10.565 |
|
Amende |
3.203 |
3.502 |
3.494 |
3.396 |
|
Sursis probatoire |
4.294 |
4.070 |
4.036 |
3.774 |
Source : Ministère de la Justice, SDSED
L'ajournement avec mise à l'épreuve, identifié comme particulièrement pertinent pour un public d'usagers de drogues, n'a pu être évalué. Toutefois, il semble rarement prononcé. Il serait intéressant de le développer, cette mesure pouvant placer le prévenu dans une dynamique de projet et de responsabilisation.
Les mesures alternatives à l'incarcération ont donc connu une croissance peu importante. L'orientation socio-sanitaire ne semble pas avoir été systématisée. Pour sanctionner l'usage simple, les juridictions ont privilégié les peines classiques (amendes -en augmentation de 5 points-, peines d'emprisonnement avec sursis), celles-ci y ayant eu recours dans environ un tiers des cas pour chacune de ces mesures.
(f) En matière de rapprochement entre instances sanitaires et judiciaires
S'agissant du rapprochement entre instances sanitaires et judiciaires , le développement de l'offre par les prestataires socio - sanitaires n'engendre pas de transformation automatique des pratiques pénales. Les évaluateurs invitent la MILDT à favoriser un partenariat élargi en positionnant plus visiblement les parquets comme interlocuteurs des structures de prise en charge. De plus, toutes les structures financées dans le cadre des CDO ne se positionnent pas sur le même moment judiciaire : les opérateurs du réseau de la justice sont principalement positionnés sur le stade pré - sentenciel (contrôle judiciaire). A l'inverse, les centres d'hébergement interviennent plutôt sur la phase post-sentencielle, notamment pour les alternatives à l'incarcération et les sorties de prison.
(4) Une disparition de la sanction sans prise en charge effective ?
Si l'absence de données statistiques détaillées sur les suites judiciaires données aux interpellations pour usage de stupéfiants ne permet pas de tirer de conclusions précises sur l'exécution du plan, le rapport fait état d'une certaine inflexion du traitement judiciaire des usagers de stupéfiants interpellés.
En termes d'orientation pénale et de jugement, alors qu'en 1998, un usager simple sur dix faisait l'objet de poursuites devant le tribunal, ce rapport passe à un sur douze en 2001. Parallèlement, les condamnations pour usage simple ont diminué régulièrement, passant de 4,6 % du total des interpellations pour usage en 1998 à 4,1 % en 2001. La part des condamnations pour usage dans l'ensemble des condamnations pour infraction à la législation sur les stupéfiants se maintient légèrement en deçà de 30 %. La diminution des poursuites, comme celle des condamnations à l'emprisonnement ferme pour cette infraction, montre un recul de la logique purement répressive.
Les données des juridictions de la région parisienne, selon lesquelles des alternatives aux poursuites sont prononcées dans deux cas sur trois, révèlent une prise en compte des instructions du garde des Sceaux et des objectifs du plan.
M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, a lors de son audition dénoncé cette évolution : « Il ne faut pas nier l'évidence, la sanction de la consommation de produits stupéfiants s'est faite beaucoup plus légère. Deux chiffres illustrent cette affirmation. En 2001, avant mon arrivée (...) 71.667 usagers de drogues ont été interpellés par la police ou par la gendarmerie, moins de 8 % ont été sanctionnés par la justice. Je rappelle qu'en 1990, il y a 13 ans, le taux de sanctions prononcées pour les usagers était encore de 30 % (...) et nous nous retrouvons tous pour constater que la situation ne fait qu'empirer. Peut-être y a-t-il là matière à réflexion ? Cette forte baisse de la sanction, disons-le clairement, a été un choix politique. L'adaptation des réponses judiciaires prévues par la circulaire de la Chancellerie du 17 juin 1999 s'est surtout traduite par la préconisation de toutes les mesures d'évitement de la sanction, tout mieux que la sanction. Le résultat est que pour 9 consommateurs sur 10, (...) l'usage des stupéfiants s'est trouvé de fait dépénalisé . Les alternatives aux poursuites n'ont pas été d'une grande vigueur et le nombre d'injonctions thérapeutiques extrêmement faible. ».
Ce jugement sur l'incidence réelle des alternatives aux poursuites est-il corroboré par les résultats de l'évaluation ?
Le rapport d'évaluation de l'OFDT du plan triennal de la MILDT indique en effet que : « On peut toutefois s'interroger sur le développement de la prise en charge socio-sanitaire : les injonctions thérapeutiques n'ont pas augmenté durant la période d'exécution du plan et les autres alternatives socio-sanitaires restent, selon l'échantillon francilien, d'un nombre très limité. Par ailleurs, la collaboration entre services répressifs et services sanitaires et sociaux ne paraît guère s'être développée. Il est regrettable que les permanences socio-sanitaires qui pouvaient servir d'interface ne paraissent pas avoir été mises en place . La distinction entre usage, usage nocif et dépendance, pertinente au regard de la santé publique, ne semble guère avoir trouvé de traduction dans le processus judiciaire où ces critères ne sont pas déterminants pour la qualification pénale. »
Mme Nicole Maestracci, ancienne présidente de la MILDT, a d'ailleurs reconnu lors de son audition devant la commission d'enquête que la mission interministérielle était encore « loin d'avoir réalisé cet objectif, parce que c'est également un travail qui doit s'inscrire dans la durée. »
M. Didier Jayle, actuel président de la MILDT, a néanmoins souhaité « rendre hommage à (son) prédécesseur sur le travail d'organisation qu'elle a fait, qui était de construire un véritable outil, avec une réflexion (...). Dans les actions importantes qui ont été menées, il y a les conventions départementales d'objectifs (...). Je crois que l'objectif était bon, que l'évaluation va montrer que les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances et qu'il faudra réorienter cette politique de manière à ce que les services répressifs et les services de santé travaillent plus ensemble. Mais il ne faut pas que ces conventions se contentent d'abonder les associations ou les structures de prise en charge sanitaire. »
Il semble donc que les orientations données par le plan n'ont concerné qu'un seul versant du problème, l'évitement de la sanction, sans permettre la réalisation de l'objectif premier de ces mesures, une réelle prise en charge socio-sanitaire de tous les usagers en difficulté avec les substances psychoactives, objectif que la commission d'enquête ne peut que saluer, puisqu'il prenait en compte la complexité de la question des drogues, devant nécessairement allier prévention, répression et soins.
Les pratiques judiciaires évoquées par les magistrats au cours de leur audition ont particulièrement suscité l'intérêt de la commission d'enquête.
|
LA PRATIQUE DU PARQUET DE BAYONNE Audition de Mme Catherine Domingo , substitut du procureur de la République « L'usager, après audition, lorsqu'il réside sur le ressort du tribunal de Bayonne, se voit notifier une injonction à la rencontre, c'est-à-dire qu'une association d'orientation sanitaire et sociale doit le recevoir dans les huit jours qui suivent son interpellation, et le résultat de cette injonction, délivrée à la demande du parquet par l'officier de police judiciaire, voit sa concrétisation dans le récépissé, qui doit être remis au parquet par l'intéressé, qui doit respecter cette convocation. Dans la plupart des cas, les personnes qui font l'objet de cette injonction de rencontre respectent cette mesure. Si tel n'était pas le cas, les poursuites seraient engagées dans un mode soit de composition pénale, soit de poursuite devant le tribunal. Il convient de préciser que cette mesure d'injonction à la rencontre est effectuée dans des cas très précis, d'abord pour des personnes qui sont primo-délinquantes, qui sont interpellées avec de faibles quantités de produits stupéfiants, qui ne font pas l'objet d'une dépendance avérée à ces produits et qui, bien évidemment, sont interpellées dans des conditions qui ne relèvent que du strict usage et non pas d'un éventuel trafic ou revente. Ce sont les conditions, même pour cette orientation sanitaire et sociale, avec une particularité un peu plus marquée pour les mineurs usagers, pour lesquels nous avons à coeur de coupler cette orientation vers une structure avec la rencontre soit du substitut chargé des mineurs, soit du délégué du procureur, qui invite le mineur, en compagnie de ses parents ou des personnes qui en sont civilement responsables, à recevoir un rappel de la loi, des sanctions encourues et des dangers afin de sensibiliser cette population de jeunes qui constitue l'une des populations les plus touchées par ce type de délinquance. S'agissant des usagers qui sont interpellés avec une faible quantité de stupéfiants mais qui ne résident pas sur le ressort de Bayonne, en application de la circulaire du 17 juin 1999, les procédures sont systématiquement adressées au parquet du domicile de la personne concernée. » LA PRATIQUE DU PARQUET DE NANTERRE Audition de M. Yves Bot , ancien procureur de la République de Nanterre et actuel procureur de la République de Paris « On peut se demander, en termes de politique pénale, dans quels cas on soumet une personne à injonction thérapeutique et ce qui peut la forcer à venir, sachant que c'est une procédure assez complexe. (...) Cela suppose ensuite que la personne se rende à la convocation qui lui est donnée, tout d'abord par le magistrat et ensuite par le médecin. Pour ma part, j'avais mis en place à Nanterre (et, encore une fois, je compte également le faire sur Paris) la pratique suivante : lorsque la personne était interpellée, en même temps qu'on lui notifiait d'avoir à se présenter pour une procédure d'injonction thérapeutique, on lui notifiait une date d'audience à laquelle elle serait jugée si elle ne se présentait pas. La personne se présentait et elle était alors reçue d'abord par un de mes substituts, c'est-à-dire par un magistrat qui lui rappelait la loi, qui parlait avec elle et que lui expliquait ce que signifiait l'injonction thérapeutique, pour que le contrat de confiance soit clairement posé. Ensuite, la personne quittait le bureau du substitut pour aller dans le bureau de la DDAS qui avait fort heureusement pu être aménagé, à Nanterre, juste à côté. (...) Il importait d'éviter toute rupture dans la démarche psychologique de l'intéressé (...) L'idée est de dire : « tu viens ou tu ne viens pas. Si tu ne viens pas, c'est la correctionnelle ; si tu viens, tu ne me quittes pas tant que tu n'as pas vu le médecin. » LA PRATIQUE DU PARQUET DE VALENCIENNES Audition de M. Guillaume Girard , premier substitut A l'occasion du déplacement de la commission d'enquête à Valenciennes le 13 mars 2003, le premier substitut au procureur de la République de Valenciennes, M. Guillaume Girard, a exposé la politique suivie. S'agissant de la poursuite du simple usage de drogues, le parquet de Valenciennes (compétent pour les usagers dont le domicile est situé dans son ressort), conforté en cela par le discours prononcé par le Garde des Sceaux en octobre 2002 à l'Assemblée nationale, apporte une réponse judiciaire systématique quel que soit le produit consommé. La réponse est graduée. S'il s'agit d'une première infraction, les personnes se voient proposer une injonction thérapeutique ou un classement sous condition après rappel à la loi. S'il y a réitération, on a alors recours à la composition pénale (amende, retrait de permis de conduire, travail d'intérêt général). Pour une troisième infraction, des poursuites sont engagées devant le tribunal correctionnel. En 2002, 221 personnes ont bénéficié d'une injonction thérapeutique sur le ressort de Valenciennes. Le profil type de la personne à qui on propose cette procédure est un jeune fumeur de cannabis de 16 à 25 ans en cours d'insertion socio-professionnelle (apprenti, étudiant...). Le taux de comparution élevé (90 % environ) s'explique par le fait que la convocation est remise directement par l'officier de police judiciaire, ce qui a semblé à la commission constituer une très bonne pratique susceptible d'être généralisée. Cette procédure poursuit un triple objectif : rappeler la règle (beaucoup de jeunes ignorant l'interdit touchant la consommation de cannabis), expliquer les raisons de l'indulgence présente tout en indiquant les conséquences judiciaires d'une récidive et enfin favoriser la transition avec une prise en charge médicale, un accueil par un médecin de la DDASS étant prévu afin de permettre une éventuelle orientation médicale. En outre, le rappel à la loi concerne essentiellement des mineurs ou des petits consommateurs de cannabis. Il est prononcé par les délégués du procureur et peut conduire à un classement sous condition d'orientation par un psychologue. Les usagers de drogues dites dures sont plus concernés par l'injonction thérapeutique entraînant un suivi médical. Ce suivi médical concerne majoritairement les usagers d'héroïne et de cocaïne et représente 20 % des injonctions thérapeutiques. Cette procédure est souvent efficace, la personne qui ne se présente pas étant poursuivie. Les classements sans suite « secs » sont plus rares, mais peuvent intervenir si la personne a une bonne insertion socio-professionnelle et n'a pas d'antécédents judiciaires. |
B. LA RÉPRESSION DU TRAFIC
Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, a déclaré : « nous allons engager la guerre aux trafiquants. Police et gendarmerie sont maintenant dotées de structures particulièrement efficaces dans la lutte contre l'économie souterraine ».
Cette affirmation peut laisser sous-entendre que la guerre aux trafiquants n'avait pas été menée avec assez de vigueur jusqu'à présent, constat que ne peut que partager, pour partie, la commission d'enquête.
Si le plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances (1999-2001) s'était fixé pour objectif de réaffirmer la priorité accordée à la lutte contre les trafics, force est de constater que les statistiques en termes d'interpellations pour trafic au cours de la période triennale ne sont pas à la hauteur des espérances affichées .
|
LES DEUX AXES PRIORITAIRES DU PLAN TRIENNAL DE LUTTE
CONTRE LA DROGUE ET DE PRÉVENTION DES DÉPENDANCES
(1999-2001)
Le plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances réaffirme la priorité accordée à la lutte contre les trafics et s'assigne, à ce titre, deux axes d'intervention prioritaires : 1 - Rendre plus efficace la répression du trafic local et international Cet objectif est conditionné par trois types de facteurs : - la faculté des autorités à mettre en oeuvre des dispositifs de coordination locale tout en veillant à s'inscrire dans une coopération opérationnelle internationale ; - l'aptitude à porter atteinte aux revenus issus, directement ou indirectement, du trafic de stupéfiants, en systématisant le recours à l'ensemble des outils législatifs et procéduraux offerts par la loi du 13 mai 1996, notamment les dispositions relatives au « proxénétisme de la drogue » ; - la capacité des pouvoirs publics à associer les acteurs économiques de la société civile au repérage des transactions illicites. 2 - Renforcer la lutte contre la fabrication et la diffusion de nouvelles drogues de synthèse Cet objectif, appliqué aux différents stades de la filière, depuis la fabrication et l'importation des produits stupéfiants ou des précurseurs détournés de leur usage, jusqu'au transport, la mise en circulation des produits et le blanchiment des fonds issus de ce trafic spécifique, est décliné selon deux axes : - une identification plus efficace des produits mis en circulation via la mise au point de nouveaux outils juridiques et techniques, notamment un nouveau mode de classement des stupéfiants et des psychotropes plus rapide et plus performant ; - un contrôle renforcé des substances disponibles sur le marché. |
Si, d'après M. Yves Bot, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, auditionné par la commission, s'agissant des « dispositions répressives concernant le trafic, l'arsenal législatif est au point », la commission d'enquête a pu mesurer, au cours de ses travaux, l'ampleur des difficultés pratiques et institutionnelles de mise en oeuvre de cette législation spécifique.
1. Les statistiques : le reflet de l'activité des services répressifs
L'OCRTIS présente chaque année l'état de l'usage et du trafic illicite de produits stupéfiants tel qu'il se dégage des interpellations et des saisies effectuées par l'ensemble des services de police, de douane et de la gendarmerie nationale.
Le trafic de stupéfiants étant une infraction révélée, les fluctuations des indicateurs d'activité sont beaucoup moins le reflet de l'évolution du phénomène lui-même que de l'activité des services répressifs.
Les statistiques pour l'ensemble des services de police, de douane et de la gendarmerie nationale pour 2001 indiquent une baisse du nombre de faits constatés de 12,5 % (98.463 en 2000 contre 86.156 en 2001), une baisse du nombre des saisies et des interpellations. Le nombre de saisies opérées en 2001 est de 53.534, en baisse de 8,37 % par rapport à l'année 2000 (58.421).
Les interpellations d'usagers et de trafiquants sont en baisse de 16,2 %, passant de 100.870 en 2000 à 84.533 en 2001. Cette diminution est générale, qu'il s'agisse des trafiquants internationaux, locaux, usagers-revendeurs ou usagers.
USAGE ET TRAFIC DE PRODUITS STUPÉFIANTS EN
FRANCE
(1997 À 2001)
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
Evolution
|
|
|
Faits constatés |
85.420 |
92.007 |
100.498 |
98.463 |
86.156 |
- 12,5 % |
|
INTERPELLATIONS |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
|
|
Trafic international |
1.369 |
1.278 |
1.274 |
1.245 |
1.083 |
-13,0 % |
|
Trafic local |
5.191 |
4.263 |
4.232 |
5.286 |
4.355 |
-17,6 % |
|
Usage-revente |
12.281 |
10.874 |
10.367 |
10.954 |
7.428 |
-32,1 % |
|
Usage |
70.444 |
74.633 |
80.037 |
83.385 |
71.667 |
-14 % |
|
TOTAL |
89.285 |
91.048 |
95.910 |
100.870 |
84.533 |
-16,2 % |
( Source :OCRTIS)
Par ailleurs, il apparaît que le nombre d'interpellations pour usage a cru sans commune mesure avec celui des interpellations pour usage-revente ou trafic.
|
FAITS CONSTATES |
INTERPELLATIONS |
|||||||||||
|
Usagers |
Trafiquants |
Total |
||||||||||
|
Usag. reven. |
Locaux |
Internationaux |
||||||||||
|
Nb |
Evol |
Nb |
% total |
Nb |
% total |
Nb |
% total |
Nb |
%total |
Nb |
Evol |
|
|
1972* |
2.420 |
2.294 |
76,06% |
472 |
15,65% |
111 |
3,68% |
139 |
4,61% |
3.016 |
+16,36% |
|
|
1978* |
7.534 |
+30,96% |
6.115 |
78,41% |
1.178 |
15,10% |
348 |
4,46% |
158 |
2,03% |
7.799 |
+64,02% |
|
1986* |
49.086 |
+36,95% |
21.618 |
70,89% |
4.549 |
14,92% |
3.322 |
10,89% |
1.004 |
3,29% |
30.493 |
+2,50% |
|
1987 |
50.839 |
+3,57% |
22.364 |
71,90% |
4.623 |
14,86% |
3.242 |
10,42% |
876 |
2,82% |
31.105 |
+2,01% |
|
1988 |
47.377 |
-6,81% |
22.316 |
71,50% |
4.653 |
14,91% |
3.355 |
10,75% |
889 |
2,85% |
31.213 |
+0,35% |
|
1989 |
50.133 |
+5,82% |
24.331 |
72,61% |
4.760 |
14,20% |
3.487 |
10,41% |
931 |
2,78% |
33.510 |
+7,36% |
|
1990 |
56.123 |
+11,95% |
24.856 |
72,65% |
4.159 |
12,16% |
3.873 |
11,32% |
1.325 |
3,87% |
34.213 |
+2,10% |
|
1991 |
61.670 |
+9,88% |
34.311 |
76,14% |
5.449 |
12,09% |
4.214 |
9,35% |
1.089 |
2,42% |
45.063 |
+31,71% |
|
1992 |
65.726 |
+6,58% |
41.549 |
76,28% |
6.937 |
12,74% |
4.947 |
9,08% |
1.035 |
1,90% |
54.468 |
+20,87% |
|
1993 |
63.114 |
-3,97% |
38.189 |
73,93% |
7.017 |
13,58% |
5.289 |
10,24% |
1.162 |
2,25% |
51.657 |
-5,16% |
|
1994 |
69.493 |
+10,11% |
44.261 |
74,14% |
8.257 |
13,83% |
5.832 |
9,77% |
1.347 |
2,26% |
59.697 |
+15,56% |
|
1995 |
74.410 |
+7,08% |
52.112 |
75,05% |
10.213 |
14,71% |
5.866 |
8,45% |
1.241 |
1,79% |
69.432 |
+16,31% |
|
1996 |
77.300 |
+3,88% |
56.144 |
72,31% |
13.084 |
16,85% |
7.079 |
9,12% |
1.333 |
1,72% |
77.640 |
+11,82% |
|
1997 |
85.420 |
+10,50% |
70.444 |
78,90% |
12.281 |
13,75% |
5.191 |
5,81% |
1.369 |
1,53% |
89.285 |
+15,00% |
|
1998 |
92.007 |
+7,71% |
74.633 |
81,97% |
10.874 |
11,94% |
4.263 |
4,68% |
1.278 |
1,40% |
91.048 |
+1,97% |
|
1999 |
100.498 |
+9,23% |
80.037 |
83,45% |
10.367 |
10,81% |
4.232 |
4,41% |
1.274 |
1,33% |
95.910 |
+5,34% |
|
2000 |
98.463 |
-2,02% |
83.385 |
82,67% |
10.954 |
10,86% |
5.286 |
5,24% |
1.245 |
1,23% |
100.870 |
+5,17% |
|
2001 |
86.156 |
-12,50% |
71.667 |
84,78% |
7.428 |
8,79% |
4.355 |
5,15% |
1.083 |
1,28% |
84.533 |
-16,20% |
* Faits constatés par la police et la gendarmerie en métropole uniquement (source 4001).
M. Michel Bouchet, chef de la MILAD, a estimé devant la commission d'enquête que ce décalage entre l'augmentation du nombre d'interpellations d'usagers et du nombre de trafiquants ou d'usagers-revendeurs s'expliquait en partie par une progression de la consommation des stupéfiants plus forte que celle du trafic, en termes de nombre d'individus.
2. La répression du petit deal et du trafic local
a) La nécessité de réprimer les petits trafics
Aucun niveau d'enquête n'est à exclure et les affaires importantes peuvent trouver leur source dans l'interpellation d'un petit revendeur, voire d'un simple usager.
M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, s'est par ailleurs élevé lors de son audition contre la notion de petit dealer qui « me fait penser à celle de drogues douces. Soit on est dealer, soit on ne l'est pas. Qui vous dit qu'il est petit ? Est-ce de petites quantités tous les jours ou une grosse une fois par semaine ? Là encore, nous ne devons pas le tolérer. (...) La défense des dealers est toujours la même : Oui, j'ai quelques cachets. C'est pour ma consommation personnelle et pour mes amis ce soir. »
Ainsi que l'a indiqué M. Yves Bot, procureur de la République de Paris lors de son audition, « cela constitue un exemple déplorable pour les jeunes qui les voient, puisque c'est l'absence de travail ou l'absence d'insertion et, au contraire, le trafic et la vie en marge de la société qui sont générateurs d'un niveau de vie enviable. (...) Au sein, de ces forteresses, dans ces cités et autour de ces cages d'escalier, il y a des appartements dans lesquels vivent des personnes de condition modeste qui sont les otages de ce trafic . »
Il apparaît ainsi primordial de réprimer le trouble à l'ordre public le plus rapidement possible. Tel est d'ailleurs le but de la police de proximité, ainsi que l'a exposé M. Alain Quéant, sous-directeur de la police territoriale de la direction de la police de proximité à la préfecture de police de Paris.
Le plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances (1999-2001) de la MILDT préconisait ainsi d'appliquer la loi et de renforcer la répression du trafic.
La politique répressive était réorientée vers le trafic et non plus l'usage, afin d'être mieux comprise par la population. Il soulignait que les manifestations du trafic local sont de moins en moins occultes et laissent apparaître le développement d'un trafic de plus en plus structuré, souvent selon un mode familial, paradoxalement bien intégré dans les quartiers et générateur de ressources et d'économie parallèle.
Le plan soulignait également depuis plusieurs années une baisse des interpellations pour trafic local, lequel alimente une économie parallèle dans les cités les plus difficiles, et s'inquiétait de leur réduction de 1997 à 1998 (18 %), en dépit d'un doublement des interpellations pour usage.
La circulaire du garde des Sceaux du 17 juin 1999 relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants visant à rendre plus efficace la répression du trafic local et international a donc appelé à utiliser des outils procéduraux tels que la loi du 13 mai 1996 sur le proxénétisme de la drogue , pas ou peu utilisée, et demandait aux procureurs d'organiser une action mieux concertée entre les services opérationnels et financiers concernés. En 2000, des actions expérimentales devaient être conduites dans plusieurs départements pilotes pour mesurer l'efficacité des structures actuelles et définir les modalités pratiques de collaboration avec les services fiscaux.
La circulaire Chevènement du 11 octobre 1999 relative au renforcement de la lutte contre l'usage et le trafic local de stupéfiants insistait également sur ce point. Elle prévoit qu'« il faut viser à la plus grande efficacité possible en privilégiant le cas échéant des investigations rapides et susceptibles d'apporter des réponses tangibles aux situations qui troublent durablement l'ordre public et la vie du quartier (...). L'action locale (est) menée dans un but d'efficacité mais aussi de visibilité pour la population concernée . Il est en effet primordial que nos concitoyens puissent mesurer l'implication des services dans la lutte contre les trafics locaux. Les transports sur place, les prises de contact, l'écoute au quotidien sont également des réponses pertinentes à l'attente de la population. ».
M. Alain Quéant a d'ailleurs indiqué que « Le fait de dire qu'on laisse faire les dealers pour remonter les filières n'est pas vrai au niveau de ma direction et il est exceptionnel que des services spécialisés nous disent : « dans ce domaine, il faut laisser les choses en l'état ». Ils pourront dire que cela va durer un jour ou deux, le temps de faire une surveillance, mais cela restera très limité dans le temps et l'espace. »
Ainsi, plusieurs circulaires ont suggéré de recourir plus largement, et si besoin après disqualification ou abandon de certains chefs de poursuite redondants, aux dispositions de l'article L. 627-2 permettant la comparution immédiate, pour limiter la saisine des juridictions d'instruction aux actes de délinquance complexe, afin de désengorger les tribunaux.
Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de stupéfiants sont passibles de dix ans d'emprisonnement et ne pouvaient donc être poursuivis selon la procédure de la comparution immédiate.
La loi du 17 janvier 1986 a ainsi prévu une infraction de cession ou d'offre à une personne en vue de sa consommation personnelle punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende, afin de permettre l'utilisation de cette procédure (utilisable pour les seules infractions pour lesquelles une peine d'emprisonnement de 7 ans maximum est possible) pour les agissements des petits revendeurs, qui peuvent aisément être constatés en flagrant délit.
Les deux circonstances aggravantes prévues lorsque les faits sont commis, soit auprès de mineurs, soit dans des centres d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, passibles de dix ans d'emprisonnement, n'ont pour cette raison que peu été utilisées.
CONDAMNATIONS DE 1997 À 2001 EN MATIÈRE
D'INFRACTION
À LA LÉGISLATION SUR LES
STUPÉFIANTS
(Source : Casier judiciaire)
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 P* |
|
|
Cession ou offre de stupéfiants à un mineur en vue de sa consommation personnelle |
122 |
126 |
126 |
124 |
102 |
|
Cession ou offre de stupéfiants, dans un centre éducatif, à une personne en vue de sa consommation personnelle |
43 |
42 |
37 |
46 |
37 |
|
Cession ou offre de stupéfiant, dans un local administratif, à une personne en vue de sa consommation personnelle |
8 |
2 |
3 |
4 |
9 |
|
Cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle |
1.608 |
1.502 |
1.450 |
1.434 |
1.588 |
P* : Les données 2001 sont provisoires.
b) La nécessité d'agir sur l'usager à l'origine du trafic
Comme l'a souligné M. Yves Bot, procureur de la République de Paris, « l'usager va permettre au trafiquant de faire sa fortune ».
M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des liberté locales, a d'ailleurs précisé : « Nous nous trouvons dans une situation invraisemblable. Quelle logique y aurait-il à vouloir éradiquer les trafiquants sans lutter contre la consommation ? (...) Tolérer la consommation, c' est favoriser le travail des trafiquants. »
Remarquant, comme l'avait fait M. Alain Quéant (qui parlait d'effet « splash », les trafiquants se déplaçant au gré des opérations policières) que dès que les services diminuaient leur pression le trafic recommençait, il a estimé nécessaire de « demander de la sévérité vis-à-vis des consommateurs, car dans une économie de marché si un client est affamé de produits, comment voulez-vous éradiquer le commerçant qui les offre ? Il n'y a pas d'un côté l'ignoble trafiquant qui tente de faibles victimes et de l'autre côté l'innocent consommateur et ses amis consommateurs habituels. Il y a un véritable marché ».
c) La délicate distinction entre l'usager et l'usager-revendeur
La loi distingue le trafic de l'usage, mais laisse à l'appréciation des magistrats la détermination de la frontière.
Dans les années 1970 et jusqu'au début des années 1980, l'usager-revendeur a plutôt été traité comme usager que comme trafiquant. Une nouvelle circulaire recommande pourtant en 1977 de requérir plus fréquemment des peines d'emprisonnement à l'encontre des usagers-revendeurs dont on dénonce le prosélytisme. Cette tendance à la fermeté s'accentue au cours des années 1980. La circulaire de 1984 revient sur la question de l'usage-vente. S'inquiétant de la progression de la délinquance liée à la toxicomanie, elle invite les procureurs à rechercher si la qualité de trafiquant prime sur la qualité d'usager chez les usagers-revendeurs. La circulaire du garde des Sceaux du 12 mai 1987 indique enfin que s'agissant de l'usager-trafiquant ou auteur d'un autre délit, il convient de poursuivre en priorité les actes de trafic.
Ni la Chancellerie, ni le ministère de l'intérieur ou de la défense n'ont jugé utile de fixer par circulaire un seuil, ou du moins de préciser des critères de distinction, estimant qu'il s'agit là d'une question jurisprudentielle.
Par conséquent, les politiques suivies en matière d'interpellation et de poursuite sont très variables. Comme l'a indiqué Maître Gérard Tcholakian, du Conseil national des barreaux, « cela se traite au cas par cas, parquet par parquet, tribunal par tribunal et aussi fonctionnaire de police par fonctionnaire de police. » Une personne interpellée à Paris ou à Foix avec 50 grammes de résine de cannabis se verra traiter d'une manière différente, ce qui paraît à la commission d'enquête préjudiciable. En effet, cette situation paraît peu satisfaisante et ne contribue pas à améliorer la compréhension et l'acceptation de la loi.
Or cette question revêt une grande importance, puisque si l'usager risque en définitive peu, la plupart des procédures se soldant par un avertissement ou un rappel à la loi, le trafic est fortement poursuivi et réprimé, et fait l'objet de règles procédurales dérogatoires.
Les services répressifs et judiciaires justifient cette situation par la nécessité de s'adapter aux circonstances. Ainsi que l'a indiqué lors de son audition le colonel de gendarmerie Christophe Metais, la distinction est souvent difficile à établir sur le terrain.
En effet, la distinction entre un usager et un usager-revendeur ne tient pas tant à la quantité ou au poids de la possession qu'à son comportement et à l'animation d'un groupe, soit à la sortie de collèges ou de lycées, soit à l'occasion de soirées. Les forces de l'ordre travaillent à partir des éléments recueillis à l'occasion des procédures diligentées pour usage, sur renseignements, voire d'initiatives en exploitant des surveillances de terrain. Les constatations établies à la suite des auditions faites dans le cadre des interpellations et versées aux procédures, les renseignements fournis par la police sur l'intéressé, ainsi que les résultats des filatures et observations vont permettre aux magistrats de se faire une opinion, comme l'a indiqué M. Yves Bot, procureur de la République de Paris. L'un des éléments à prendre en compte concerne également le train de vie de la personne, selon l'âge et l'environnement familial, ainsi que les recoupements et l'analyse des comptes-chèques. Les éléments factuels de l'interpellation interviennent également. Ainsi, en présence d'une personne interpellée en possession d'une importante somme d'argent, il est nécessaire de procéder à des vérifications complémentaires (antécédents).
Néanmoins, le trafic est établi si une personne porte sur elle une quantité manifestement incompatible avec une consommation personnelle journalière (comme une dose létale par exemple).
Mme Catherine Domingo, substitut du procureur de la République de Bayonne, a ainsi indiqué lors de son audition que la détention (qui est un acte de trafic) peut être poursuivie alors même que la personne ne se trouve pas en position de revente : « On peut considérer qu'à partir de 20 à 30 grammes de résine de cannabis, les personnes peuvent faire l'objet de poursuites, que ce soit en composition pénale ou devant le tribunal correctionnel. »
Comme l'a fait observer M. Michel Bouchet, chef de la MILAD, qui a indiqué à la commission d'enquête avoir connu « la période où pour quelques grammes on était considéré comme trafiquant, ce qui était par ailleurs peut-être excessif », on a observé un déplacement du seuil : « Il y a quelques années, une personne qui était interpellée en possession de 50, 100, 150 ou 200 grammes de cannabis était considérée comme détentrice et non pas consommatrice et apparaissait donc comme trafiquante. Or, au fil des années, ces mêmes personnes soit faisaient l'objet d'une transaction douanière aux frontières du Nord, soit n'étaient plus considérées, en un autre point du territoire, comme des trafiquants mais comme des consommateurs. » Il a d'ailleurs cité le cas d'une personne interpellée avec 400 grammes de résine de cannabis et poursuivie uniquement pour usage. Ces données expliquent selon lui dans une large mesure l'évolution à la baisse de la part des trafiquants dans l'ensemble des interpellations.
Enfin, M. Dominique Perben, garde des Sceaux, s'est interrogé lors de son audition sur la notion-même d'usager-revendeur : « En effet, il est bien difficile de distinguer les choses dans la réalité. On n'est pas simple consommateur très longtemps. D'ailleurs, y-a-t-il véritablement de simples consommateurs sachant qu'il y a très vite revente, échange, transport et détention de stupéfiants ? La limite est très floue et très incertaine. Le fait d'accentuer les conséquences de la distinction repose sur le présupposé que cette distinction est réelle. Or elle l'est bien peu ».
d) La difficile conciliation entre police de proximité et police judiciaire
L'article 3 de la loi d'orientation sur la sécurité de janvier 1995 plaçait parmi les orientations permanentes de la politique de sécurité « l'extension à l'ensemble du territoire d'une police de proximité répondant aux attentes et aux besoins des personnes en matière de sécurité ».
Dans la ligne des orientations définies au colloque de Villepinte en octobre 1997, le précédent gouvernement a progressivement généralisé à l'ensemble du territoire une police de proximité. Cette politique, imposée à marche forcée, n'a pas reçu l'adhésion des personnels ni des administrations de l'Etat, comme en témoignent les rapports de l'inspection générale de la police nationale. En pratique, le gouvernement n'a pas été en mesure de placer sur le terrain les moyens matériels et humains nécessaires à cette politique . Faute d'effectifs suffisants, la police de proximité a reposé en grande partie sur des adjoints de sécurité, emplois jeunes formés en quelques semaines, auxquels la loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne a accordé des pouvoirs de police judiciaire.
Enfin, essentiellement axée sur la prévention et engagée dans un contexte de pénurie de personnels, cette politique de proximité s'est développée au détriment de la présence nocturne et des capacités d'investigation des services de sécurité, contribuant à une baisse d'efficacité de l'activité répressive. Les dernières années ont été marquées par un déséquilibre de la procédure pénale préjudiciable à son efficacité, d'autant plus que l'essentiel des efforts consentis en matière de sécurité a porté sur le développement de la police de proximité. Or, « une présence accrue sur la voie publique n'a de sens que si elle est prolongée par la recherche active et systématique des auteurs d'infractions afin qu'ils soient, dans les meilleurs délais, interpellés et mis à disposition de l'autorité judiciaire » 92 ( * ) .
Cette politique allait de pair avec le développement des contrats locaux de sécurité prévus par les circulaires interministérielles des 28 octobre 1997 et 7 juin 1999 avant de recevoir une consécration législative dans la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. Cosignés par le préfet, le procureur de la République et le ou les maires concernés, ces contrats associent différents partenaires privés, tels les bailleurs sociaux ou les sociétés de transport.
Au 15 juillet 2002, 600 contrats avaient été signés et 194 étaient en cours d'élaboration. Mais ce relatif succès quantitatif dissimule l'échec qualitatif de nombre de ces contrats. Comme le révèlent les rapports de l'inspection générale de la police nationale, ils ont souvent été conclus sur la base de diagnostics locaux de sécurité insuffisants et ont fait l'objet d'une faible implication des administrations de l'État et d'un suivi insuffisant. Leur articulation avec la politique de la ville apparaît en outre complexe.
e) Les difficultés de preuve
Ainsi que l'a indiqué lors de son audition M. Yves Bot, procureur de la République de Paris, citant l'opération menée à Colombes, « il a fallu une enquête qui s'est déroulée de juin 2002 à février 2003 pour arriver à sortir une procédure judiciairement exploitable. On comprend ainsi combien ces trafics sont enkystés dans un urbanisme qui devient, pour les trafiquants, une véritable forteresse que les forces de police et de gendarmerie ont toutes les peines du monde à investir. (...) La conformation des lieux est telle que souvent, un policier, même en civil, est repéré à trois kilomètres ! C'est souvent la quadrature du cercle pour faire la preuve judiciaire du trafic. »
En outre, il a expliqué que « le jour où l'affaire vient devant le tribunal, il faut que j'apporte la preuve, c'est-à-dire que je sois capable de le démontrer au tribunal, que c'est bien telle personne qui a importé telle ou telle chose. Cette difficulté matérielle de faire la preuve est la conséquence de situations (...) comme les problèmes d'urbanisme, la pression sur les gens au sein desquels on se trouve, le règne de la terreur, la disparition des témoins, etc. ».
De plus, il a souligné la « grande adaptabilité des délinquants. Dans un très grand nombre de cas, les signes extérieurs de richesse ne sont plus le bon critère parce que désormais ils se méfient. La leçon a été assimilée. Faire le beau dans la cité avec le 4x4 flambant neuf, c'est fini, maintenant ils arrivent dans une bagnole un peu déglinguée afin de ne pas se faire repérer . »
Il a donc souligné le paradoxe « de l'inefficacité pratique d'une législation théoriquement adaptée » , tout en indiquant ne pas avoir la « recette pour faire disparaître cette difficulté pratique, notamment parce qu'à partir du moment où on touche au processus pénal, on touche évidemment aux libertés individuelles et à la présomption d'innocence. Si autant le Conseil constitutionnel que la Cour européenne de Strasbourg admettent les présomptions de culpabilité, c'est quand même de manière très encadrée et dans des domaines restreints, notamment contraventionnels, comme le dit le Conseil constitutionnel français. Je ne suis donc pas sûr qu'il y ait une marge d'efficacité à trouver dans le domaine de la procédure. »
f) Les récentes avancées législatives
- La loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a prévu, à l'initiative du Sénat, que lorsque l'audition d'un témoin est susceptible de mettre gravement en danger l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention peut autoriser cette personne à déposer en conservant l'anonymat. Dans ce cas, deux procès-verbaux de l'audition sont dressés, l'un faisant apparaître l'identité du témoin, l'autre non (article 706-58 du code de procédure pénale). Cela concerne les seules procédures portant sur un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
Il est abusif d'assimiler cette procédure à une dénonciation anonyme comme certains le font parfois : le témoin anonyme le reste pour l'auteur présumé des faits, mais pas pour la justice dont il est nécessairement connu. En outre, aucune condamnation ne peut être fondée exclusivement sur la déposition d'un témoin ayant gardé l'anonymat.
- La loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002 a cherché à concilier la police de proximité et le nécessaire renforcement de la police judiciaire. Elle prévoit de renforcer la présence nocturne et d'amplifier l'action judiciaire des services. Le nombre d'officiers de police judiciaire issus des gardiens de la paix devrait ainsi être augmenté et leur qualification sera mieux prise en compte dans le développement de leur carrière.
- La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a étendu le champ d'application de la procédure de comparution immédiate (article 395 du code de procédure pénale).
Dans l'exposé des motifs du projet de loi, le gouvernement indiquait que l'extension de cette procédure visait à permettre « notamment de faire usage de ce mode de poursuites en matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants ».
Cette procédure de comparution immédiate, qui permet au procureur de la République de traduire sur-le-champ un prévenu devant le tribunal, n'était applicable que lorsque la peine d'emprisonnement encourue était au moins égale à deux ans sans excéder sept ans (en cas de flagrant délit, entre un an et sept ans d'emprisonnement). La loi l'a étendue lorsque la peine encourue est au moins égale à deux ans sans excéder dix ans. En cas de flagrant délit, la procédure de comparution immédiate pourrait être utilisée à l'égard d'un prévenu encourant au moins six mois d'emprisonnement.
On rappellera que la procédure de comparution immédiate ne peut être utilisée qu'en matière délictuelle. Elle peut donc désormais être mise en oeuvre pour tous les délits punis de peines d'emprisonnement, hormis ceux punis de trois mois d'emprisonnement. Elle devrait avoir une grande importance pratique s'agissant du traitement judiciaire des procédures de trafic.
Mme Catherine Domingo, substitut du procureur de la République de Bayonne, a indiqué lors de son audition : « Lorsque sont saisies des quantités inférieures à 40 kg de résine de cannabis et que la personne qui transporte ces produits ne souhaite pas ou n'est pas en mesure de communiquer l'identité de son fournisseur ou du commanditaire du trafic, il est fait recours à la procédure de comparution immédiate, avec un passage très rapide devant le tribunal correctionnel sur le fondement du délit douanier d'importation de marchandises prohibées. Depuis la loi du 9 septembre 2002, y sont associés les délits du code pénal de détention, d'importation et de transport de produits stupéfiants (...). Cette politique pénale fait actuellement l'objet d'une réflexion quant à d'éventuels aménagements, puisque la loi du 9 septembre 2002 permet désormais de poursuivre des personnes pour des délits dont les peines encourues dépassent sept ans. Il est question que les comparutions immédiates concernent des affaires de plus de 40 kg. »
3. La répression des réseaux organisés et du trafic international : les difficultés pratiques et institutionnelles de mise en oeuvre de la législation
a) Des difficultés liées à l'insuffisante coordination institutionnelle des services répressifs
L'insuffisante coordination des services répressifs en termes de lutte contre les trafics de stupéfiants constitue une critique récurrente adressée à l'encontre de la politique nationale de lutte contre les drogues illicites.
Ainsi, dans son rapport public particulier de juillet 1998 sur le dispositif de lutte contre la toxicomanie, la Cour des comptes soulignait « les difficultés rencontrées par l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), que le décret du 3 août 1953 charge de centraliser tous les renseignements pouvant faciliter la recherche et la prévention du trafic illicite de stupéfiants et de coordonner toutes les opérations tendant à la répression de ce trafic, pour faire reconnaître son autorité tant vis-à-vis des autres services de police et de la gendarmerie que, surtout, de l'administration des douanes, en raison de la réticence, voire du refus, de certains services ou structures d'appliquer les textes qui lui confèrent un rôle interministériel ».
Dans son rapport de suivi, rendu public en juillet 2002, la Cour des comptes soulignait la persistance de cette insuffisante coordination des différents services répressifs engagés dans la lutte contre les trafics.
Enfin, dans son rapport d'évaluation du plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances (1999-2002), non encore rendu public, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) souligne les carences de la coordination des services d'enquête d'une part, des services répressifs d'autre part.
(1) La coordination des services d'enquête
La circulaire judiciaire du 17 juin 1999 relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants avait notamment pour but une meilleure coordination dans la conduite de l'action publique et encourageait la création de structures locales de concertation afin d'éviter le chevauchement des interventions visant à lutter contre le trafic.
A ce titre, d'après le rapport d'évaluation précité de l'OFDT, « quelques avancées ont pu être observées au cours de la période triennale », notamment grâce à la conduite d'une réflexion interministérielle ayant permis d'identifier les principaux obstacles à la lutte contre les trafics de façon à pouvoir les contourner et guider ainsi le travail d'enquête.
En outre, il faut souligner que l'annexe de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure citait « parmi les priorités opérationnelles : la lutte contre le développement du trafic de drogues qui génère en amont comme en aval de multiples formes de délinquance et constitue un fléau sanitaire qui frappe en priorité les jeunes. Dans ce contexte, la nocivité de toutes les drogues doit être reconnue et la dépénalisation de l'usage de certains produits stupéfiants doit être rejetée » , et préconisait le développement d'outils d'investigation performants, ainsi que le rapprochement du système uniformisé des produits stupéfiants (fichier STUP) entre les bases de données de la police, de la gendarmerie et des douanes, sous la forme d'une mise en réseau des informations détenues par ces trois services.
L'OFDT dresse en revanche un bilan mitigé des deux bureaux de liaison permanents (BLP) mis en place en 1997 dans le Nord-Pas-de-Calais et aux Antilles-Guyane en précisant que « le partage des renseignements et des objectifs s'est peu développé car les structures qui devaient accompagner le fonctionnement des BLP pour l'exploitation du renseignement et la définition des objectifs n'ont jamais fonctionné ».
|
L'EFFICACITÉ MITIGÉE DES DEUX BLP 1 - Le BLP de Lille Le BLP de Lille se compose de trois agents : deux gendarmes et un policier. Compte tenu de la proximité géographique des services, la douane n'est pas représentée au sein du BLP, deux agents du groupe « recherche » de l'échelon direction des enquêtes douanières de Lille assurant la liaison entre la douane et le BLP et intégrant les objectifs du BLP. La cellule de coordination de Lille fonctionne depuis le mois d'avril 1998. Dans cette base figurent, en permanence et en moyenne, un millier de fiches d'identité d'individus faisant l'objet d'enquêtes et environ 250 objectifs en cours. Au 31 décembre 2002, 277 objectifs étaient inscrits au BLP, dont 55 intégrés par la douane. Les consultations du fichier, effectives de jour comme de nuit, ont permis d'éviter 19 « doublons » d'enquêtes en 1999, 41 en 2000, 53 en 2001 et 58 en 2002. L'augmentation du nombre de doublons évités au fil des ans indique une meilleure prise en compte du dispositif BLP par les services répressifs. Un état des objectifs est adressé chaque trimestre aux onze procureurs de la République du ressort de la Cour d'appel de Douai. Le BLP de Lille a également pour vocation de s'impliquer dans la coopération transfrontalière. Il est l'interlocuteur privilégié des officiers de liaison français en poste aux Pays-Bas pour la région, l'échange de renseignements étant constant. La présence d'un officier de police néerlandais dans les locaux du BLP contribue également à la communication entre les deux pays. Le BLP s'efforce de mettre en place une coopération similaire avec la Belgique, notamment avec le concours du CCPD de Tournai. Une réunion a eu lieu à Mons (Belgique) le 3 février 2003 et le principe de la transmission réciproque des renseignements a été accepté. Lors de son déplacement à Valenciennes , la commission d'enquête a notamment pu rencontrer le major Thirard, représentant du BLP de Lille. Ce dernier a indiqué que le BLP devait permettre des échanges de renseignement entre les services de police, de gendarmerie et des douanes, en collaboration avec un officier de liaison néerlandais. En outre, il a précisé que la mission principale du BLP était de mettre en contact tous les services répressifs de la région, qu'en 2002 le BLP avait fait l'objet de 7.678 consultations contre 3.000 en 2000. Le commandant Gazan, chef d'escadron de la gendarmerie de Valenciennes, a, quant à lui, estimé que le BLP et le GIR étaient deux entités complémentaires et que le BLP mériterait d'être généralisé sur le territoire aux frontières. Enfin, le commandant Rossignol, adjoint au chef du GIR de Valenciennes, a souligné que le BLP avait un rôle de régulateur et qu'il permettait d'éviter les doublons dans les enquêtes tandis que le GIR avait un rôle opérationnel, qu'il devait appuyer l'ensemble des services répressifs dans le montage de leurs dossiers « stupéfiants » et qu'il était en droit d'exercer l'ensemble des prérogatives de poursuite de ses membres participants. Conçu à l'origine comme une structure de coopération à vocation opérationnelle, le BLP s'est donc vu réduit au rôle de simple régulateur sans réelle capacité d'action. 2 - Le BLP de Pointe-à-Pitre Le BLP des Antilles est actuellement composé de quatre fonctionnaires : un policier, deux gendarmes et un douanier. L'agent de la douane, issu de l'antenne de la direction des enquêtes douanières de Guadeloupe, n'y est toutefois pas affecté en permanence, il assure une présence partielle mais régulière permettant d'assurer la liaison avec les services douaniers de la zone. Au 31 janvier 2003, 194 objectifs étaient inscrits au BLP, dont 82 intégrés par la douane. Parmi les objectifs intégrés par la douane en 2002, 24 doublons d'enquête ont pu être évités. Dans ses réponses au questionnaire adressé par la commission d'enquête, le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales précise que « la cellule de coordination des Antilles, basée dans les locaux du SRPJ Antilles-Guyane aux Abymes (Guadeloupe), ne fonctionne pas de manière totalement satisfaisante et n'a pas suffisamment fait la preuve de sa capacité à fédérer les actions des trois administrations répressives ». A cet égard, lors de son déplacement à Saint-Martin , la commission d'enquête a pu se rendre compte des difficultés fonctionnelles rencontrées par le BLP Antilles-Guyane. Ainsi, le Colonel Alain Despaux, commandant la gendarmerie de Guadeloupe, a exprimé des réserves à l'encontre de cette structure et a souligné l'existence d'un problème de coordination entre services notamment en termes d'échange du renseignement. Il a estimé que la question de l'utilité du Bureau de liaison permanent (BLP), créé en 1997 sur la zone Antilles-Guyane, se posait. Il a estimé que le BLP permettait certes d'éviter le chevauchement des enquêtes mais qu'il ne permettait pas une synthèse du renseignement et la désignation d'un pôle opérationnel. De même, M. Serge Garcia, représentant la direction départementale de la police aux frontières de la Guadeloupe, a estimé que les services opérationnels ne redistribuaient pas de manière efficace le renseignement auprès du BLP. En outre, il a souligné que le GIR de Guadeloupe avait une existence quasi virtuelle. Il a estimé nécessaire de créer une cellule administrative commune afin de lutter contre les difficultés matérielles d'échange de renseignement. Plusieurs réformes du fonctionnement du BLP Antilles-Guyane ont été envisagées pour 2003 : - le BLP doit redevenir le centre de référence, le point de passage unique et obligé dans le circuit de toute information en lien avec la lutte contre le trafic de stupéfiants intéressant la zone Caraïbe, que celle-ci provienne des services des départements français d'Amérique ou de ceux, français ou étrangers, présents dans la zone ; - le BLP sera, au cours de l'année 2003, transféré de Pointe-à-Pitre à Fort-de-France (Martinique). Le groupe de travail interministériel, créé en mai 2002 pour réfléchir aux modalités d'amélioration du dispositif de lutte contre le trafic de drogue dans la Caraïbe, avait initialement prévu une implantation du BLP dans les locaux de la direction des douanes ; toutefois, conformément à l'avis du Préfet de la région Martinique, il sera matériellement installé dans les locaux du COMAR afin de faciliter les échanges avec l'autorité maritime lorsque les renseignements impliqueront une action en mer. L'objectif de la démarche est de rapprocher cette structure des principaux centres de décision, tels que le préfet de la Martinique, le COMAR, l'antenne de l'OCRTIS, la direction interrégionale des douanes d'Antilles-Guyane et le Centre interministériel de formation anti-drogue (CIFAD) ; - enfin, le rôle du représentant de l'OCRTIS en Martinique sera conforté afin qu'il puisse assurer l'animation et la coordination de la structure pour, notamment, dégager un consensus sur les analyses et les options opérationnelles. En outre, la gendarmerie nationale installera au BLP deux militaires dont un officier supérieur et un sous-officier, la police nationale un commissaire ainsi qu'un officier tandis que la direction des douanes étudie les modalités de délégation d'un représentant et, en cas d'opérations dont la douane est à l'origine ou lorsqu'elle est chargée de l'intervention, cette administration renforcera temporairement sa représentation en tant que de besoins. Une permanence, bénéficiant des liaisons sécurisées et du personnel du COMAR, sera organisée de telle façon qu'elle couvre l'ensemble de la plage horaire et qu'en dehors de ses heures de présence, le personnel du BLP puisse être alerté à domicile. |
(2) La coordination des services répressifs
La circulaire judiciaire du 17 juin 1999 relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants insistait également sur le fait que « la coordination des services répressifs, tant en termes d'objectifs que de modalités d'intervention des services, est essentielle dans la lutte contre les trafics de stupéfiants. L'insuffisance de celle-ci conduit inéluctablement à une moindre efficacité de l'action judiciaire. Les parquets doivent en conséquence s'impliquer pleinement dans la définition et la mise en oeuvre de l'activité déployée par les services répressifs ».
Le risque découlant d'une coordination défaillante des services répressifs résulte de ce que plusieurs services, agissant en enquête préliminaire ou sur commission rogatoire, enquêtent sur le même trafic ou sur des séquences connexes, avec des objectifs d'enquête parfois différents, de tels chevauchements étant de nature à préjudicier aux résultats des investigations. Sur ce point, la circulaire de 17 juin 1999 précitée rappelle « les missions de centralisation d'informations et de coordination dévolues à l'OCRTIS au sein de la direction centrale de la police judiciaire ».
La question de l'articulation des services de l'Etat dans la répression du trafic local notamment se pose avec acuité en raison des divergences de vue s'étant exprimées dans le cadre des contrats locaux de sécurité (CLS). Les CLS ont ainsi mis en évidence des différences de conception et de logique professionnelle susceptibles de produire des effets sur l'articulation des politiques en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants. La MILDT a ainsi tenté de faciliter la mise en oeuvre d'une approche pénale cohérente à l'égard des trafiquants des acteurs locaux et nationaux participant aux CLS, par le biais des rencontres interrégionales des CLS organisées en 2001 et 2002. A cette occasion, l'idée de concevoir des contrats plus spécifiquement orientés vers la lutte contre les trafics, au sein ou en dehors des cadres des CLS, a été évoquée par les professionnels.
En outre, la circulaire du garde des Sceaux sur la sécurité du 9 mai 2001 a déterminé des outils permettant d'améliorer la coordination locale des services répressifs, des administrations et des intervenants institutionnel du territoire concerné autour d'objectifs spécifiques, parmi lesquels la lutte contre le trafic de stupéfiants, dans le cadre des groupes locaux de traitement de la délinquance (GLTD). Cette orientation a été confirmée par une circulaire interministérielle des ministres de l'intérieur et de la justice du 5 septembre 2001 relative à la mise en oeuvre d'actions répressives contre les infractions commises en bande et les trafics locaux et notamment des actions ciblées sur le démantèlement des bandes et la lutte contre les économies souterraines fondées sur les trafics locaux de stupéfiants ou les vols recels organisés.
Les recommandations contenues dans la circulaire du 17 juin 1999 précitée semblent, pour leur part, être restées lettre morte puisque, dans son rapport d'évaluation du plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances, l'OFDT souligne que « dans sa mission de coordination interministérielle de l'action opérationnelle des services concernés par le trafic de stupéfiants (gendarmerie et douanes), l'OCRTIS semble s'être heurté à de nombreuses résistances ( et) peine à faire fonctionner sa transversalité ». En outre, d'après les informations fournies par l'OFDT, le nombre de fonctionnaires affectés à cet office n'a cessé de diminuer et le détachement d'un agent des douanes à l'OCRTIS a été particulièrement difficile à concrétiser.
Force est toutefois de constater que l'ORCTIS a multiplié les efforts pour améliorer la coordination entre services répressifs en mettant notamment en place une réunion mensuelle sur les objectifs et en travaillant à une meilleure association de la gendarmerie. En outre, pour favoriser la collaboration des services d'enquête, l'OCRTIS a mis en place un fichier de numéros de téléphone à l'étranger (notamment en Espagne). Enfin, l'OCRTIS a lui-même opéré annuellement près de 200 arrestations de trafiquants et la saisie de près de 10 tonnes de produits stupéfiants.
Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Nicolas Sarkozy a d'ailleurs précisé : « Sur l'OCRTIS, nous allons mettre dix fonctionnaires de plus, c'est-à-dire 30 au total à l'issue du programme -il y en a 80 aujourd'hui-, notamment des officiers de liaison en poste à l'étranger (...) pour un pays comme le nôtre, 110 personnes consacrées uniquement aux renseignements et à la lutte contre les trafics internationaux sur la drogue n'est pas rien ».
Les difficultés résultant de cette insuffisante coordination de l'action des services répressifs sont toutefois en passe d'être résolues grâce à la création en mai 2002 des groupes d'intervention régionaux, les GIR, dont le bilan après moins d'un an d'existence est particulièrement satisfaisant.
Dans son rapport d'évaluation précité, l'OFDT indique, à ce titre, que « les vertus d'une meilleure intégration verticale, c'est-à-dire la mise en place de structures nouvelles destinées à piloter de manière plus centralisée l'action répressive constitue une piste qui doit être exploitée. De ce point de vue, la création des GIR constitue une innovation réelle en matière de coordination dont les effets positifs devront être documentés ».
Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, a souligné les effets positifs induits par la création des GIR en termes de lutte contre les trafics de stupéfiants : « Les GIR existent depuis une dizaine de mois, très exactement depuis l'été 2002. Les GIR, rien que sur la lutte contre la drogue et l'économie souterraine, ont engagé 335 opérations, qui ont conduit à 2.500 arrestations, à la saisie d'une tonne de résine de cannabis, de 25.000 comprimés d'ecstasy et de 24 kilos d'héroïne et de cocaïne. Manifestement, les GIR sont la voie la plus adaptée pour lutter contre l'économie souterraine ».
|
LES PRINCIPALES ACTIONS RÉALISÉES PAR LES
GIR
La lutte contre les trafics illicites de stupéfiants et l'infraction de « proxénétisme de la drogue » représente le tiers de l'activité des groupes d'intervention régionaux. Associés principalement à des services combattant ce phénomène au sein des banlieues sensibles, ils participent à des enquêtes contre des trafics locaux où ils apportent la valeur ajoutée de l'interministérialité par le biais de la direction générale des douanes et la direction des services fiscaux, certains moyens matériels et les effectifs nécessaires aux perquisitions et auditions. Depuis l'été 2002, les GIR ont été à l'origine de 335 opérations de police qui ont fortement contribué à restaurer la crédibilité des forces de l'ordre et des administrations partenaires, notamment auprès des couches les plus défavorisées de la population. L'ensemble des enquêtes a permis l'arrestation de plus de 2.500 malfaiteurs dont une bonne part sera poursuivie sur la base des textes du code pénal mais fera également l'objet de sanctions fiscales ou douanières. Ces interpellations ont été assorties de la saisie de près d'une tonne de résine de cannabis, 25.000 comprimés d'ecstasty, 24 kilos d'héroïne et de cocaine. En outre, 2.5000.000 euros d'origine frauduleuse ainsi que 235 armes à feu (dont des pistolets mitrailleurs) ont pu être appréhendés. En termes d'efficacité, il convient de ne pas s'arrêter au volume des prises mais davantage sur l'impact des opérations au sein des collectivités confrontées à une dégradation de l'autorité de l'Etat. Dans cette optique, quatre affaires principales méritent d'être citées. 1- Celle réalisée le 17 septembre 2002 à Mulhouse, au sein du quartier Saint-Fridolin qui, grâce aux investigations du GIR d'Alsace, a retrouvé une vie normale après le démantèlement d'un réseau d'économie souterraine mettant en cause plus de trente personnes dont plusieurs mineurs qui s'étaient progressivement approprié les lieux pour en faire un véritable marché aux stupéfiants approvisionnant la localité de ses environs. Cette intervention est également remarquable au plan des poursuites. Au terme de la procédure de flagrant délit, 15 individus dont un mineur ont été déférés. Les 14 majeurs ont été cités en audience de comparution immédiate en vertu des nouvelles dispositions prévues par l'article 40 de la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, et 12 d'entre eux ont été condamnés à des peines de prison s'échelonnant de 6 mois à 2 ans, assorties partiellement d'un sursis avec mise à l'épreuve. 2- Celle consécutive à la mise en évidence par le service d'investigations et de recherches de la direction départementale de la sécurité publique de Pau (Pyrénées Atlantiques), d'un important trafic de résine de cannabis se déroulant quotidiennement aux abords de la « maison des jeunes et de la culture » et du terrain de basket-ball dans le quartier sensible de « l'Ousse des bois ». L'ampleur des investigations a conduit à la saisine du groupe d'intervention régional d'Aquitaine en septembre 2002. Le 18 novembre 2002, une vaste opération était déclenchée à Pau, Bayonne et Lescar (Pyrénées Atlantique). 46 personnes étaient placées en garde à vue tant pour trafic de stupéfiants que pour « proxénétisme de la drogue ». Les saisies opérées lors des perquisitions confirmaient les faits (1,5 kilo de résine de cannabis et 500 g de la même substance chez les deux organisateurs du trafic, 16.430 euros) et l'implication présumée des suspects dans des affaires de vols et de recel (véhicules, matériel vidéo, etc.). Au terme de la procédure, 18 suspects ont été écroués. 3- Celle réalisée le 25 mars 2003, en appui du service d'investigation et de recherche de la circonscription de sécurité publique d'Orléans et du service régional de police judiciaire local saisis conjointement d'une enquête relative à un vaste trafic de stupéfiants touchant les villes d'Orléans, de Tours, de Vendôme, d'Epinal, de Saint Brieuc, d'Angers et de Strasbourg. A cette occasion, le groupe d'intervention régional a parfaitement rempli sa mission de coordination et de support en apportant aux deux directeurs d'enquête l'appui de 29 personnes « ressource », de 4 services extérieurs à la région (Nancy, Rennes, Strasbourg et Angers), de 16 maîtres-chiens (des douanes, de la gendarmerie nationale, de la direction départementale de la sécurité publique des Yvelines) et des effectifs de sécurisation. 4- Celle consacrant l'aboutissement d'investigations menées depuis l'été 2002 par le commissariat de sécurité publique d'Evreux et le GIR de Haute-Normandie sur divers trafics semblant se dérouler dans le quartier de la « madeleine », théâtre au printemps 2002 d'importantes émeutes consécutives au décès par overdose durant sa garde à vue d'un revendeur notoire d'héroïne. Les surveillances mettaient en évidence plusieurs réseaux de revente de drogues s'interpénétrant à l'occasion ainsi que de nombreuses infractions incidentes (infraction à la législation sur les sociétés de surveillance, travail dissimulé, aide au séjour irrégulier, vols, escroqueries diverses). Le 7 avril 2003, une vaste opération menée au sein de trois quartiers sensible de l'agglomération ébroïcienne permettrait la découverte d'un laboratoire clandestin de culture de plants de cannabis, d'un kilo de résine de cannabis, de trois armes de poing et de divers matériels, vêtements et denrées alimentaires volés). Sur les 36 personnes mises en causes, 12 ont été écrouées. 5- Enfin, bien que rarement sollicités par des services enquêtant sur des trafics internationaux, les groupes d'intervention régionaux ont néanmoins contribué au succès de certaines affaires. A ce titre figure l'importante saisie de 504 kilos de résine de cannabis réalisée le 10 octobre 2002 à Lyon par le GIR de la région « Rhône-Alpes » en appui du service régional de police judiciaire local. |
b) Des difficultés liées à la sophistication croissante des méthodes des trafiquants
Lors de son audition par la commission, M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, a insisté sur un point crucial en termes de lutte contre le trafic de stupéfiants : « Nous nous apercevons que la force des mafias, car ce sont des mafias, est qu'elles sont réactives et s'adaptent plus rapidement que l'Etat. J'aimerais que l'Etat, en tout cas dans l'administration dont j'ai la responsabilité, ait cette culture de la réactivité et de l'adaptabilité. Il faut que nous puissions nous adapter tout de suite, beaucoup plus rapidement. Eux s'adaptent à une vitesse stupéfiante. C'est leur force. Il faut que nous le fassions aussi. »
La commission d'enquête, au cours de ses travaux, a pu constater la sophistication et la criminalisation croissantes des méthodes employées par les trafiquants auxquelles les capacités d'enquête et les moyens des différents services répressifs sont aujourd'hui incapables de faire face.
(1) Les nouvelles technologies au service des trafiquants de drogues
Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Bernard Petit, chef de l'OCRTIS, a déclaré : « Le degré de sophistication auquel on assiste aujourd'hui dans le trafic atteint des niveaux inégalés. Les progrès de la téléphonie mobile et la disposition du réseau internet facilitent grandement les activités de trafic des organisations spécialisées et les rendent, par certains aspects, moins vulnérables aux attaques de la police, de la douane, de la gendarmerie et de la justice. Cela rend notre travail plus difficile. »
En effet, les possibilités d'anonymat de la téléphonie mobile constituent un obstacle important aux capacités d'enquête des services répressifs, de même que les difficultés rencontrées par ces services pour obtenir des opérateurs de téléphonie mobile les facturations détaillées dans des délais compatibles avec les nécessités d'une enquête.
Ainsi, M. Bernard Petit a souligné, lors de son audition par la commission d'enquête, que « tous les trafiquants de stupéfiants aujourd'hui, depuis le petit jusqu'au plus grand, utilisent les cartes prépayées, qui sont source d'anonymat et qui empêchent toute identification. Vous pouvez avoir un informateur qui vous donne une information capitale, notamment le numéro de téléphone de telle personne, mais cela ne vous permet pas de savoir qui se cache derrière la carte prépayée et la facturation que vous allez obtenir, au mieux dans les quatre semaines qui suivent, ne vous permettra pas une exploitation rapide : en quatre semaines, le téléphone aura changé, la carte prépayée aura été jetée après une importation de résine et sera échangée par une autre. »
Il a ajouté : « Ça n'est pas un problème propre à la France, il ne peut sans doute être réglé qu'au niveau européen et sa connotation commerciale pour nos opérateurs téléphoniques mérite d'être prise en considération, mais cela explique pourquoi on piétine parfois dans les enquêtes. »
Dans son rapport sur l'évaluation du plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances, l'OFDT mentionne cet obstacle lié aux possibilités d'anonymat offertes par la téléphonie mobile et précise qu'une discussion avec les opérateurs de téléphonie mobile a été ouverte et a fait l'objet d'un groupe de travail au niveau de la Chancellerie et de la police judiciaire. Ainsi, l'accès aux renseignements relatifs aux lieux et horaires des trafics, échangés anonymement par téléphone portable, a été identifié comme un canal d'investigation qui pourrait être utile aux services d'enquête. Toutefois, l'OFDT souligne que « les opérateurs téléphoniques sont réticents à coopérer : certains refusent ou répondent dans des délais longs ; d'autres font preuve de « mauvaise volonté, ne respectant pas le cahier des charges qu'ils ont signé en matière d'interception ou opposant des tarifs prohibitifs qui bloquent l'autorisation des recherches. »
Toutefois, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, les opérateurs de services de télécommunications sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationales, agissant dans le cadre de missions judiciaires, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs complètes, non expurgées et mises à jour. Sur demande de l'officier de police judiciaire, les organismes publics ou les personnes morales de droit privé mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité, à l'exception de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes ou traitements de données nominatives qu'ils administrent.
L'officier de police judiciaire intervenant sur réquisition du procureur de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention peut requérir des opérateurs de télécommunication de prendre sans délai toutes mesures propres à assurer la préservation pour une durée ne pouvant excéder un an du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs . Ils doivent mettre à disposition les informations reçues dans les meilleurs délais par voie informatique ou télématique.
(2) Des méthodes d'interception inadaptées à la nouvelle technique des « go fast »
Outre la sophistication technique des méthodes employées par les trafiquants, la commission d'enquête a également pu noter une criminalisation croissante de ces méthodes au cours des dernières années, liée essentiellement à l'émergence de la technique des « go fast » , déjà évoquée dans le présent rapport.
Cette méthode particulièrement violente impose une nécessaire adaptation des capacités d'intervention des services répressifs nationaux.
A la question de savoir s'il existait une solution aux problèmes des « go fast » , M. Bernard Petit, chef de l'OCRTIS a répondu: « Oui. Nous organisons régulièrement des bureaux de liaison entre les unités spécialisées des « stup » de toute la France, et nous avons mis au point une stratégie pour mieux lutter contre les « go fast ». (...) Nous nous organisons davantage. Le vrai problème des « go fast », c'est l'interception matérielle de ces véhicules sans mettre en danger la vie des usagers des autoroutes. Si, demain, alors que vous faites votre plein à trois heures du matin sur l'autoroute, vous voyez arriver quatre « go fast » à vos côtés et que la police commence à tirer au fusil à pompe, vous ne serez pas content, ce qui est normal. Les sociétés autoroutières nous demandent aussi d'intervenir légèrement. Nous avons développé certaines stratégies (qui) sont extrêmement vitales pour nous et notre activité. »
M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a également souligné les difficultés rencontrées par les services répressifs liées à la technique des « go fast » . Il a en outre proposé plusieurs pistes de réflexion destinées à contourner ce problème : « nous avons d'abord à mettre en place une nouvelle doctrine pour piéger les autoroutes. Les autoroutes sont devenues des axes de circulation rapide pour la grande délinquance (...) pas simplement pour les trafiquants de drogue. (...) Il faut que la gendarmerie comme la police changent leurs méthodes sur les autoroutes. Nous sommes en train de travailler là-dessus. C'est plus facile à dire qu'à faire. (...) J'ai demandé que l'on travaille sur ces questions pour mettre en place une nouvelle doctrine afin de rendre dangereux pour les délinquants nos axes autoroutiers . C'est un premier élément ».
En outre, M. Nicolas Sarkozy a rappelé devant la commission d'enquête que l'article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure prévoit que des dispositifs fixes et permanents de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, permettant la vérification systématique au fichier des véhicules volés de la police et de la gendarmerie nationales, peuvent être installés en tous points appropriés du territoire, notamment les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires et les grands axes de transit national et international. Cette disposition permet donc de savoir « si chaque voiture qui passe aux péages a été volée ou pas ».
Enfin, M. Nicolas Sarkozy a rappelé l'acquisition de nouveaux véhicules, plus modernes, pour la police et la gendarmerie nationales, respectivement 5.000 et 4.400 en 2003.
Pour conclure son propos sur la question des « go fast » , M. Nicolas Sarkozy a précisé : « Je ne vous dis pas que nous allons résoudre le problème (...) mais des véhicules rapides, des fichiers de lecture automatique des plaques de voiture volées aux péages, de nouvelles stratégies d'intervention sur les autoroutes (...) pourront produire des résultats. »
La nécessité d'un changement des méthodes employées par les services répressifs face à l'avènement de la technique des « go fast » a également été évoquée par M. François Mongin, directeur général des douanes et des droits indirects, lors de son audition par la commission d'enquête. Il a notamment insisté sur la nécessité d'une coopération entre services répressifs sur ce sujet et indiqué que la douane avait mis en place une « veille technologique » permanente, en collaboration avec les services de la gendarmerie, ainsi que des groupes de travail chargé de réfléchir aux différents moyens de sécuriser leurs méthodes d'interception ou leurs barrages. Ainsi, M. François Mongin a déclaré devant la commission d'enquête : « Nous sommes en train d'acquérir, en liaison avec la gendarmerie nationale, un nouveau système de herses qui permettrait d'éviter ce type de passage de vive force. »
M. François Mongin a également tenu, lors de son audition, à attirer l'attention de la commission sur les difficultés que rencontraient les services douaniers ainsi que l'ensemble des services répressifs à opérer des contrôles sur les grands axes routiers et autoroutiers : « Les grands axes routiers, les voies express, les autoroutes deviennent en quelque sorte des tunnels (...) et nous avons de plus en plus de difficultés à obtenir des sociétés d'autoroute des plates-formes de contrôle et des locaux de visite ou de contrôle qui permettent à nos agents et aux gendarmes (...) d'effectuer en toute sécurité des contrôles permettant de savoir si un camion transporte ou non des stupéfiants. »
Sur le même sujet, M. Gérard Estavoyer, directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, a précisé que les services douaniers essayaient de « travailler le plus possible sur le renseignement afin de faire interpeller ces véhicules non pas par des services classiques mais par des services particuliers (...). Les deux façons de lutte contre les « go fast », sur terre comme en mer, sont d'une part, le renseignement et, d'autre part, la technique pour essayer de les immobiliser d'une façon ferme et sans trop de dommages. »
(3) Les « bolitas » : nouvelle technique de transport des drogues dures
Lors de son déplacement à Saint-Martin, la commission d'enquête a été particulièrement sensible à la recrudescence du phénomène des passeurs, ou « mules », qui ingèrent des quantités parfois considérables (jusqu'à 1,7 kilogramme) de drogue (cocaïne, parfois héroïne) sous forme de boulettes, ou « bolitas ».
M. Bernard Petit, chef de l'OCRTIS, a expliqué cette technique lors de son audition par la commission d'enquête : « On roule la cocaïne dans des préservatifs, on la compacte selon un procédé particulier, on avale trente, quarante ou cinquante boulettes et on se présente à l'aéroport de Roissy pour emmener ces boulettes jusqu'à Barcelone. Cela entraîne de temps en temps des incidents graves : si une boulette s'ouvre, on se retrouve dans le coma et en réanimation ».
Cette nouvelle technique de transport de la drogue pose de nombreuses difficultés aux services répressifs chargés de la lutte contre le trafic de stupéfiants.
A cet égard, M. Bernard Petit a souligné lors de son audition : « nous sommes face au dilemme suivant : d'un côté, il nous faut interpeller ces passeurs aux aéroports ; si nous les laissons venir impunément dans notre pays, cela créera un appel d'air, les flux ne feront que s'accroître (...) ; d'un autre côté nous ne pouvons pas engager toutes nos forces pour lutter contre ces passeurs. En effet, tandis qu'un passeur arrive avec 600 ou 700 grammes, cela n'empêche pas un clan lyonnais ou marseillais d'importer 400 kilos par voilier. Il faut donc équilibrer nos forces et penser à la stratégie par rapport aux passeurs avec leurs boulettes et leurs 600 grammes et aux gros trafiquants qui importent massivement par camion et bateau ».
Le phénomène des « bolitas » est commun à l'ensemble des pays européens et particulièrement important aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne.
|
LA RECRUDESCENCE DES PASSEURS À L'AÉROPORT D'AMSTERDAM-SCHIPOL En 2000, le nombre de passeurs de drogues interpellés à Schipol était de 800 ; en 2001, il était de 1.233, soit une augmentation de 54 % par rapport à 2000. En 2002, le bilan de la situation est particulièrement inquiétant puisque le nombre de passeurs interpellés étaient de 1.265 pour un total de saisies évalué à 6.343 kilogrammes. Le total des saisies de cocaïne s'élève à 6.232 kilogrammes, tandis qu'il est seulement de 9,3 kilogrammes d'héroïne. Les saisies de résine de cannabis s'élèvent à 100,6 kilogrammes pour 1,2 kg d'herbe. Sur les 1.265 passeurs interpellés, 867 personnes l'ont été alors qu'elles transportaient des produits stupéfiants in corpore . Pour tenter de trouver une solution au phénomène des « bolitas », les autorités judiciaires néerlandaises ont mis en place une procédure simplifiée qui leur permet de laisser en liberté les personnes pour la première fois interpellées de nationalité néerlandaise et ayant une adresse aux Pays-Bas. Ces personnes seront convoquées à une date ultérieure pour être jugées par un tribunal. Les mesures prises par les autorités néerlandaises visent à restreindre le nombre de détentions provisoires. Dans la pratique, de nombreux passeurs sont ainsi laissés en liberté lorsque les quantités importées sont inférieures à 1,5 kg. En outre, pour tenter de faire face à la recrudescence des passeurs, les autorités néerlandaises ont été contraintes de prendre un certain nombre de mesures parmi lesquelles la construction de locaux, dans l'enceinte de l'aéroport de Schipol. Courant 2002, les autorités de l'aéroport de Schipol ont ainsi identifié jusqu'à 47 passeurs voyageant à bord d'un même avion en provenance de Curaçao (Antilles néerlandaises). A la fin du premier trimestre 2003, les services répressifs de Schipol devraient en outre disposer de 100 cellules pour accueillir ces passeurs. Parallèlement, afin de lutter contre les trafics en amont, les capacités de contrôle dans les aéroports des Antilles néerlandaises ont été renforcées. Une coopération plus étroite avec la compagnie KLM a été mise en place. Du matériel de radiographie a également été dépêché sur l'aéroport d'Hato - Curaçao au début du mois de janvier 2003. L'installation de ce matériel a été décidée afin d'accroître les possibilités d'identification des passeurs avant leur embarquement. Enfin, depuis le 1 er octobre 2002, le gouvernement néerlandais a mis en place un programme de renvoi des passeurs en provenance de pays étrangers après admonestation. Les passeurs faisant l'objet de ce traitement peuvent néanmoins faire l'objet de poursuites judiciaires dans leur pays d'origine et doivent être interdits de territoire pendant une période de dix ans. L'augmentation importante du nombre de passeurs ne permet pas aux autorités de l'aéroport de Schipol de mener des investigations d'envergure permettant l'identification des personnes dirigeant les réseaux internationaux de trafic de stupéfiants. |
La saturation actuelle de certains aéroports européens pourrait avoir pour conséquence une intensification du passage de passeurs de drogues par les grands aéroports parisiens. D'après les chiffres avancés par M. Bernard Petit, l'aéroport de Roissy représente environ 150 à 200 affaires par an, toutes traitées par l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. Toutefois, il a ajouté que « les filières boliviennes de Santa-Cruz, par exemple, s'intéressent énormément à l'aéroport de Roissy parce qu'elles sont moins durement frappées qu'à Heathrow ou Schipol ».
Une réflexion quant à l'évolution des méthodes des services répressifs à l'encontre de ce phénomène est donc dès aujourd'hui nécessaire. Cette adaptation doit notamment reposer sur une intensification de la coopération internationale entre services des différents aéroports considérés comme les plus sensibles, un renforcement de la coordination entre services répressifs nationaux ainsi qu'une simplification des procédures judiciaires engagées à l'encontre des passeurs.
Parmi les techniques les plus efficaces pour lutter contre ces passeurs de drogue, la technique du ciblage aérien , mise en oeuvre par les services douaniers, est celle qui a le plus fait ses preuves et qui permet de détecter à l'avance quels seront les passagers susceptibles de transporter de la drogue in corpore .
De plus, il s'agit d'un mode de transport qui a actuellement tendance à se généraliser et qui ne touche plus seulement les aéroports. Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Gérard Peuch, chef de la brigade des stupéfiants à la direction régionale de police judiciaire de la préfecture de police de Paris, a ainsi déclaré : « Je travaille avec les douanes parce que je suis chargé de gérer les importations par les voies ferroviaires. Les gares étant à Paris, on se rend compte qu'entre Amsterdam et Milan, au lieu de passer par les voies aériennes, de plus en plus de « mules » (...) passent par les trains. Je suis donc chargé de gérer les procédures suite aux interpellations douanières ».
(4) Des difficultés liées à l'insuffisante circulation de l'information et à l'absence de statut des indicateurs
Le renseignement et la circulation de l'information sont deux éléments indispensables à la conduite des enquêtes menées par les services répressifs dans la lutte contre les trafics de stupéfiants.
Dans ce domaine, les carences aussi bien en termes de transmission et de circulation de l'information d'une part, que de statut des informateurs des différents services répressifs d'autre part, sont avérées.
Dans son rapport d'évaluation du plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances, l'OFDT souligne ainsi que les efforts de mise en cohérence des interventions ont été conséquents sur la période triennale mais qu'ils restent limités par un certain nombre de facteurs. Ainsi, le rapport indique que, « au stade de l'enquête sur les trafiquants ou sur ceux qui leur sont indirectement liés, les services spécialisés se heurtent à de nombreux problèmes techniques : les délais de transmission de l'information d'un service à l'autre persistent, les moyens techniques ou en personnel sont insuffisants, les outils juridiques s'avèrent inadaptés ou insuffisants ». En outre, au stade de la constatation de l'infraction de trafic, « la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et des douanes ne fonctionne pas encore de façon suffisamment efficace ; malgré des efforts de rapprochement, la circulation de l'information ne permet pas de confondre en temps réel les trafiquants ou leur complice ».
A cet égard, M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, a déclaré, lors de son audition par la commission d'enquête : « Je souhaite développer le renseignement sur le grand banditisme, sur les trafiquants de drogue et l'infiltration. Ce qui fonctionne avec le terrorisme doit être utilisé avec les mafias ».
Parallèlement, l'attention de la commission d'enquête a été attirée à plusieurs reprises sur le problème du statut des indicateurs des différents services répressifs.
M. Gérard Peuch, chef de la brigade de stupéfiants à la direction de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris, a souhaité lors de son audition donner un réel statut à l'indicateur de police, sur le modèle de « l'aviseur des douanes », « afin de normaliser et de judiciariser les relations que nous pouvons avoir avec ces personnes dont nous avons besoin à 101 %. Les relations que nous entretenons avec les indicateurs de police sont toujours considérées soit comme malsaines, soit comme ambiguës, en tout cas suspectes. C'est une revendication de l'ensemble des personnels de la police judiciaire (...) on ne peut pas continuer à initier des enquêtes en imaginant des faits faux pour mieux protéger un indicateur de police. Il faudrait avoir le courage de dire que nous avons pu traiter une affaire parce que quelqu'un nous a renseignés. ».
Il en va de même pour la gendarmerie nationale.
Le statut de « l'aviseur » douanier est sans doute le plus pertinent. Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Gérard Estavoyer, directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, a précisé : « Pour l'instant, seule la douane est capable de rémunérer ses aviseurs de façon correcte, légitime et parfaitement légale ».
Il a ajouté : « On peut qualifier les relations entre un aviseur des douanes et les services des douanes comme obéissant à une espèce de contrat civil : un aviseur s'engage à fournir un certain nombre de renseignements et, si ce renseignement est utile et s'il produit une affaire, cet aviseur peut être rémunéré dans la parfaite légalité. Cela nous permet aussi de ne faire aucune concession avec les aviseurs, dans la mesure où, dès l'instant où ils sortent de ce contrat sur une affaire que nous connaissons et dont il nous a parlé, nous n'avons pas, comme d'autres, à le protéger. Nous ne le protégeons que sur ce que nous connaissons. Il y a donc une certaine souplesse et des textes qui ont le mérite d'exister ».
Il a ajouté que ces aviseurs étaient rémunérés sur la base du chapitre 15-03 de la dette publique, celui du produit des amendes et des confiscations, pour lequel il existe des barèmes précis et limités. Ce barème est fixé au « tiers théorique (du produit des affaires) avec un plafond (...) actuellement fixé à 3.000 euros, et seule une décision du directeur général des douanes peut permettre d'autoriser son dépassement ».
Parallèlement, dans le cadre de la procédure douanière dite des livraisons surveillées, l'article 67 bis du code des douanes régit le statut des agents douaniers infiltrés, qui ne peuvent être pénalement responsables si, dans le cadre de leurs activités d'infiltration, ils acquièrent, détiennent, transportent ou livrent des stupéfiants.
|
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 67 BIS DU CODE DES DOUANES « Afin de constater les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, d'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après en avoir informé le procureur de la République et sous son contrôle, procéder à la surveillance de l'acheminement de ces substances ou plantes. Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec l'autorisation du procureur de la République et sous son contrôle, ils acquièrent, détiennent, transportent ou livrent ces substances ou plantes ou mettent à la disposition des personnes les détenant ou se livrant aux infractions douanières mentionnées à l'alinéa précédent des moyens à caractère juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt et de communication. L'autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions visées au premier alinéa. Les dispositions des deux premiers alinéas sont, aux mêmes fins, applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite des produits stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels servant à cette fabrication. Ne sont pas pénalement punissables les agents des douanes qui accomplissent, en ce qui concerne les fonds sur lesquels porte l'infraction prévue à l'article 415 et pour la constatation de celle-ci, les actes mentionnés aux deux premiers alinéas. » |
Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Gérard Estavoyer a précisé qu'un projet de loi devait être prochainement déposé afin de modifier les dispositions de l'article 67 bis du code des douanes dans le sens d'une meilleure protection des aviseurs douaniers. Il a en effet souligné que ce texte « qui date de 1991, ne permettait pas suffisamment (...) une protection de ce que nous appelons les aviseurs. Ceux-ci étaient en effet en péril absolu devant la justice s'ils étaient découverts ».
Le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, présenté en conseil des ministres par le garde des Sceaux le 9 avril 2003, prévoit une nouvelle rédaction de l'article 67 bis du code des douanes en définissant la notion d'opération d'infiltration et en organisant la protection pénale des agents des douanes participant à ces opérations.
c) Des difficultés liées à l'insuffisante exploitation des outils législatifs disponibles
Outre des dispositions de procédure pénale dérogatoires au droit commun, certaines incriminations sont spécifiques au domaine des stupéfiants et constituent un arsenal législatif complet mais encore insuffisamment exploité dans le cadre de la répression du trafic de stupéfiants.
(1) Les dispositions visant à atteindre le patrimoine des trafiquants ou de ceux dégageant un profit indirect du trafic de drogues
La loi n° 96-392 du 13 mai 1996, relative à la lutte contre le blanchiment et au trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisies et de confiscation des produits du crime, a eu deux mesures novatrices :
- la création du délit de blanchiment de fonds provenant de tout crime ou délit ;
- la création du délit de non justification de ses ressources par une personne ayant des relations habituelles avec un trafiquant ou des usagers de stupéfiants.
(a) Les sanctions patrimoniales spécifiques au trafic de stupéfiants
La circulaire judiciaire du 17 juin 1999 relative au renforcement de la lutte contre le trafic de stupéfiants rappelle avec force l'intérêt pour les magistrats d'avoir recours aux mesures destinées à atteindre le patrimoine des trafiquants en estimant que la privation du patrimoine des trafiquants doit constituer un axe prioritaire de la politique criminelle en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, passant par une mobilisation accrue des magistrats aux fins de rechercher, d'identifier, de saisir et de confisquer les produits du trafic.
Le législateur a adopté deux types de mesures spécifiques destinées à atteindre le patrimoine des trafiquants , l'une visant à élargir l'assiette de la peine de confiscation, l'autre visant organiser la mise en oeuvre de mesures conservatoires permettant de figer le patrimoine identifié du trafiquant.
• L'élargissement de l'assiette de la peine de confiscation
S'agissant des infraction les plus graves à la législation sur les stupéfiants, le législateur est allé au-delà du régime de droit commun de la peine complémentaire de confiscation qui, aux termes de l'article 131-21 du code pénal, s'applique aux biens qui sont en lien avec l'infraction commise, qu'ils en soient le produit ou qu'ils aient servi à la commettre.
Le deuxième alinéa de l'article 222-49 du code pénal prévoit la possibilité d'une confiscation générale du patrimoine du trafiquant : peut être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, dans les cas limitativement prévus par les articles suivants du code pénal :
- article 222-34 : direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants ;
- article 222-35 : production ou fabrication de stupéfiants ;
- article 222-36 : importation ou exportation de stupéfiants ;
- article 222-38 : blanchiment de fonds provenant du trafic de stupéfiants.
La confiscation peut donc porter sur des biens qui ne sont pas le produit de l'infraction et qui peuvent avoir été acquis licitement, antérieurement ou postérieurement à la commission de l'infraction.
• La possibilité de prendre des mesures conservatoires en vue de permettre la confiscation de tout ou partie des biens du condamné
Aux termes des dispositions de l'article 706-30 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut solliciter la prise de mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen en cas d'ouverture d'une information judiciaire pour les infractions prévues aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal dans deux hypothèses :
- pour garantir le paiement des amendes encourues ;
- pour l'exécution de la confiscation générale prévue au deuxième alinéa de l'article 222-49 du code pénal.
Dans les deux cas, le président du tribunal de grande instance, sur requête du procureur de la République, peut ordonner aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile relatives aux voies d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen. La condamnation vaut validation des saisies confiscatoires et permet l'utilisation définitive des sûretés. La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées.
Peuvent ainsi coexister, dans une même procédure, deux initiatives distinctes tendant à préparer la mesure de confiscation : la mise en oeuvre des pouvoirs habituels de saisie du produit de l'infraction par le magistrat instructeur et la mise en oeuvre par le parquet des dispositions de l'article 706-30 du code de procédure pénale pour les biens qui ne sont pas le produit du crime mais qui sont néanmoins susceptibles de faire l'objet d'une confiscation.
Toutefois, dans son rapport sur l'évaluation du plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances, l'OFDT a estimé que la gamme des outils répressifs effectivement appliqués à l'encontre des trafiquants est difficile à estimer, toute tentative de chiffrage se heurtant aux limites des statistiques policières et pénales , les peines d'emprisonnement seules étant recensées. Par ailleurs d'après l'OFDT, « il semble que les peines de confiscation prononcées par les tribunaux se limitent le plus souvent à la seule confiscation des biens saisis lors des interpellations ».
En effet, la circulaire du 17 juin 1999 relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants souligne également que, faute d'identification du patrimoine des trafiquants et en l'absence de mesures conservatoires préalables prises au cours de l'information, les peines de confiscation prononcées par les tribunaux se limitent le plus souvent à la seule confiscation des biens saisis lors des interpellations, ou dans un temps très proche .
La circulaire rappelle en outre que plusieurs facteurs concourent à rendre complexes ces investigations, dont la difficulté de mettre en évidence et d'appréhender les patrimoines des trafiquants en raison de leur état d'insolvabilité apparente, ainsi que la complexité de certaines investigations financières.
Dans leurs réponses au questionnaire adressé par la commission d'enquête au ministère de la justice, les services de la Chancellerie précisent à cet égard que « le système de recueil de données statistiques ne permet pas de déterminer le nombre total des peines de confiscation prononcées par les juridictions. Il ressort toutefois de l'analyse des différentes procédures suivies par la direction des affaires criminelles et des grâces en matière de trafic de stupéfiants et de blanchiment que ce type de peine est très régulièrement prononcé ».
En outre, ces services indiquent que la peine porte essentiellement sur le produit direct ou indirect de l'infraction. En revanche aucune peine de confiscation de l'ensemble du patrimoine du délinquant, en vertu de l'article 222-49 deuxième alinéa du code pénal, n'a, à leur connaissance, été prononcée à ce jour.
Une réflexion est actuellement en cours sur l'opportunité de procéder à une révision du dispositif législatif applicable en termes de sanctions patrimoniales des trafiquants.
Le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité , présenté par le garde des Sceaux en conseil des ministres le 9 avril 2003, devrait permettre d'étendre au trafic de stupéfiants et au blanchiment l'application du système juridique nouveau de saisie des avoirs criminels en lien avec une entreprise terroriste introduit par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et permettant d'autoriser la prise de mesures conservatoires par le juge des libertés sur saisine du procureur de la République.
• Le régime douanier spécifique de confiscation
D'après le rapport d'évaluation de l'OFDT, « ce sont essentiellement les services douaniers qui procèdent aux saisies et aux mesures confiscatoires. Cependant, l'utilisation des incriminations et sanctions spécifiques dont disposent les services douaniers pour réprimer des infractions liées au trafic n'a pu être chiffrée très précisément avec les données statistiques disponibles ».
La direction générale des douanes et droits indirects a fourni à la commission d'enquête des informations précises quant au régime de confiscation prévu par le code des douanes, à la procédure d'aliénation des biens confisqués et à la procédure de saisie pour sûreté des amendes douanières régie par le code des douanes.
Ainsi, s'agissant du régime douanier de confiscation, l'article 323-2 du code des douanes dispose que ceux qui constatent une infraction ont le droit de saisir tous les objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous les autres documents relatifs aux objets.
|
LES DISPOSITIONS DU CODE DES DOUANES PRÉVOYANT LA CONFISCATION - l'article 412 vise « la confiscation des marchandises litigieuses », c'est-à-dire celles sur lesquelles porte l'infraction douanière ; - l'article 414 dispose que « sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation d'un objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code » ; - l'article 415 (délit de blanchiment) prévoit également que sont punis notamment de la confiscation de sommes en infraction ou d'une somme tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ; - l'article 430 prévoit, à titre de peine complémentaire, la confiscation de marchandises substituées, soit en cours de transport de marchandises placées sous un régime suspensif, soit sous douane, de même que la confiscation du moyen de transport, en cas de refus d'obtempérer ; - l'article 459, relatif aux infractions en matière de réglementation des relations financières avec l'étranger, prévoit la confiscation du corps du délit et des moyens de transport utilisés pour la fraude. |
La confiscation est une peine principale ; elle peut être prononcée en nature et constitue une saisie réelle qui transfère la propriété à l'Etat de tous droits des objets confisqués. En outre, les juges ne peuvent dispenser le redevable de la peine de confiscation dès lors que l'objet de la fraude a été saisi au préalable et en nature.
Ainsi, en vertu des dispositions du code des douanes, une infraction constatée à la législation sur les stupéfiants donne lieu à :
- la saisie et la destruction de la marchandise ;
- une peine d'amende comprise entre une et deux fois la valeur de la marchandise ;
- une peine d'emprisonnement maximum de trois ans ;
- la confiscation de l'objet de la fraude, celle des moyens de transport et celle des objets servant à masquer la fraude.
S'agissant d'opérations de blanchiment provenant de la drogue, la confiscation des sommes en infraction est également prévue par le code des douanes.
L'action visant l'application des sanctions fiscales, dont la confiscation, est exercée à titre principal par l'administration des douanes, sur la base de l'article 343 du code des douanes. Lorsque le jugement est passé en force de chose jugée, l'aliénation des objets confisqués est réalisée par le service des douanes.
Les statistiques fournies par la direction générale des douanes et des droits indirects ne permettent pas distinguer, au sein de l'évaluation du montant des biens et objets confisqués par les douanes, celui relatif aux seules confiscations réalisées dans le cadre d'infractions à la législation sur les stupéfiants.
RECETTES ISSUES DES VENTES DE MARCHANDISES
CONFISQUÉES PAR LES DOUANES
En euros
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
903.961 |
1.315.329 |
1.485.144 |
1.034.915 |
783.558 |
877.469 |
494.705 |
463.117 |
608.109 |
340.612 |
Source : DGDDI
En application des dispositions de l'article 391 du code des douanes, la répartition du produit des amendes et des confiscations s'établit comme suit : 40 % du produit net des saisies sont affectés au Trésor, 10 % à l'oeuvre des orphelins des douanes, 10 % aux sociétés de secours mutuel intéressant le personnel des douanes, le reste à la rémunération des ayants-droit (saisissants, intervenants, transmetteurs d'avis, chefs, agents poursuivants, dépositaires).
En outre, l'article 323-2 du code des douanes autorise, indépendamment de la saisie de marchandises passibles de confiscation, la retenue préventive, concomitamment à la constatation d'une infraction douanière, des objets affectés à la sûreté des pénalités. La retenue est donc effectuée dans le même temps que la constatation de l'infraction et intervient comme complément de la saisie des objets passibles de confiscation. A cet égard, le pouvoir de retenue de l'article 323-2 peut être appliqué aux sommes d'argent détenues par l'infracteur afin de garantir le paiement des amendes qui seront prononcées au jugement, notamment si l'infracteur n'apparaît pas solvable ou réside à l'étranger.
D'après les informations fournies à la commission d'enquête par la DGDDI, le système d'information comptable douanier ne permet pas de distinguer les sommes perçues au titre des amendes de celles perçues suite à des transactions ou à des confiscations, ni les saisies de sommes en numéraire des saisies portant sur d'autres moyens de paiement. De même, il est impossible de distinguer au sein du montant des biens et objets confisqués par les douanes les sommes issues d'une infraction à la législation sur les stupéfiants ou du blanchiment de sommes provenant, directement ou indirectement, d'une infraction à la législation sur les stupéfiants.
(b) La création du délit de non justification de ressources : une innovation méconnue
• Les dispositions relatives au « proxénétisme de la drogue »
La loi du 13 mai 1996 précitée introduit un nouvel article 222-39-1 dans le code pénal, incriminant le fait pour celui qui est en relation habituelle avec un usager ou un trafiquant de stupéfiants de ne pouvoir justifier de l'origine de ses ressources ou de son train de vie.
Cette disposition a été spécifiquement conçue par le législateur pour être mise en oeuvre dans les enquêtes visant à lutter contre les économies souterraines et à renforcer la répression à l'encontre de ceux qui, côtoyant les trafiquants, profitent des fonds générés par le trafic de stupéfiants sans s'y compromettre.
|
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 222-39-1 DU CODE PÉNAL « Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'une des activités réprimées par la présente section [section IV : Du trafic de stupéfiants] ou avec plusieurs personnes se livrant à l'usage de stupéfiants, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende. La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsqu'une ou plusieurs des personnes visées à l'alinéa précédent sont mineures. Les deux premiers alinéas relatifs à la procédure de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent. » |
Cette infraction instaure un renversement de la charge de la preuve selon lequel la connaissance de l'origine frauduleuse des ressources est présumée : si le parquet doit établir l'existence d'une relation habituelle avec une personne se livrant à l'usage ou au trafic de stupéfiants, il n'est pas tenu d'établir le lien financier entre les ressources non justifiées et le produit de l'infraction commise par le trafiquant ou l'usager de stupéfiants.
L'objectif de la création de cette nouvelle infraction, plus connue sous le nom de « proxénétisme de la drogue », était de faciliter l'exercice des poursuites à l'encontre de ceux qui profitent de l'activité des trafiquants de stupéfiants sans se compromettre eux-mêmes dans la manipulation de ces substances ou sans que leur implication ait pu être établie.
En outre, l'article 46 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, en créant une nouvelle infraction, codifiée à l'article 450-2-1 du code pénal, instaure le même renversement de la charge de la preuve et a pour objet de sanctionner pénalement les personnes dont la preuve de la participation à une association de malfaiteurs ne peut être directement rapportée, mais dont le train de vie et les relations habituelles avec une ou plusieurs personnes membres de cette dernière laissent présumer leur implication dans cette association.
La circulaire du 17 juin 1999 relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants invite les magistrats à utiliser pleinement les possibilités légales permettant d'atteindre ceux qui participent au retraitement du produit du trafic sans être impliqués dans sa commission.
Force est pourtant de constater aujourd'hui que le bilan de l'application de ce nouvel instrument juridique est particulièrement décevant .
• Le bilan de l'application de l'article 222-39-1 du code pénal
Dans son rapport d'évaluation du plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances précité, l'OFDT souligne que « les signes extérieurs de richesse ont été très peu exploités pour confondre les trafiquants locaux alors qu'ils peuvent motiver l'engagement d'une procédure judiciaire du fait de l'article 222-39-1 du code pénal. Cet outil législatif puissant autorise en effet les services de police à poursuivre ceux qui disposent de revenus qu'ils ne peuvent pas justifier : il reste néanmoins peu mobilisé par les juridictions. Cette désaffection s'explique en partie par une collaboration difficile à mettre en place avec les services fiscaux ».
En dépit des circulaires d'application tentant de relancer l'article 222-39-1 du code pénal, passé inaperçu à sa création en 1996, et malgré les efforts de formation des services, cet instrument est faiblement utilisé par les services répressifs et les magistrats. Qu'on en juge !
NOMBRE DE CONDAMNATIONS PRONONCÉES
POUR
NON JUSTIFICATION DE RESSOURCES
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
|
0 |
7 |
10 |
8 |
13 |
Source : Chancellerie
La Chancellerie a dressé un premier bilan de cette application pour l'année 2000, transmis à la commission d'enquête, et 12 parquets généraux, interrogés sur 26 dossiers particuliers, ont été invités à préciser la nature des actes d'enquête ayant servi à caractériser le délit ainsi que les éléments constitutifs finalement retenus.
Très majoritairement, les constats dressés dans les rapports des parquets généraux font état de l'absence de situations susceptibles de relever des dispositions de l'article 222-39-1 du code pénal ou de la difficulté d'appliquer ces dispositions en raison de l'ampleur des dossiers de trafics de stupéfiants, peu propice à l'extension des enquêtes aux personnes non directement impliquées dans le trafic.
Enfin, malgré des poursuites exercées de ce chef, plusieurs relaxes ont été prononcées, le tribunal estimant que la preuve n'était pas rapportée d'un train de vie hors de proportion avec les ressources régulières du prévenu ou que les faits étaient mal qualifiés.
L'analyse des rapports des parquets généraux révèle cependant la généralisation des phénomènes d'économie souterraine liés au trafic de stupéfiants, l'impuissance des méthodes traditionnelles d'enquête à y faire face ainsi que la nécessité de mutualiser les recherches patrimoniales sur un objectif préalablement déterminé.
C'est pourquoi des initiatives locales prises par certains parquets ont eu pour but de sensibiliser les différents enquêteurs ou de mettre en place des cellules de coordination pluridisciplinaire composées, outre des différents services enquêteurs, du responsable départemental des douanes, du directeur adjoint des services fiscaux et d'un représentant de la direction du travail, afin de développer une action concertée entre différents services susceptibles de détenir des informations utiles à l'action répressive.
Il faut toutefois noter, avec M. Yves Bot, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, le risque de rapide obsolescence de ce type d'instrument juridique : « À l'heure actuelle, dans un très grand nombre de cas, ce n'est déjà plus le bon critère, parce que, désormais, ils se méfient. On en a trop parlé et, les quelques fois où cette idée a été utilisée, la leçon a été assimilée. Ils sont très réactifs et nous essayons de l'être autant qu'eux, mais nous avons parfois du mal... Comme toujours, c'est la lutte de l'arme et de la cuirasse ».
• Un effort de pédagogie nécessaire
La rareté de l'application de l'article 222-39-1 du code pénal a posé la question de la formation des enquêteurs et des moyens mis à leur disposition ainsi que celle de l'interprétation et de la mise en oeuvre du texte, un certain nombre de relaxes ayant été prononcées. Un groupe de travail interministériel sur la méthodologie d'application de l'article 222-39-1 du code pénal a été mis en place en mai 2002 afin d'envisager les modalités de sa mise en oeuvre opérationnelle.
Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Dominique Perben, ministre de la justice, a souligné la faible mise en oeuvre du délit de proxénétisme de la drogue : « Six ans après son entrée en vigueur, on constate une méconnaissance relative de ce délit tant par les services d'enquête que par les magistrats. Un document méthodologique sur cette disposition sera donc réalisé et diffusé très prochainement aux magistrats, policiers et gendarmes ».
Trois actions principales ont été menées par le ministère de la justice dans le but de relancer le recours au délit de non justification des ressources :
- l'élaboration par la direction des affaires criminelles et des grâces d'un mode d'emploi opérationnel de l'article 222-39-1 du code pénal proposant une « doctrine d'emploi » de cette incrimination. Ce document, à destination des magistrats, des policiers et des gendarmes, a été élaboré et devrait être prochainement diffusé ;
- la facilitation du recueil d'informations :
* en associant plus systématiquement à l'enquête les services fiscaux , au premier rang desquels les agents de la direction générale des impôts qui, sur la base de l'article L.10 B du Livre des procédures fiscales, issu de l'article 29 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, concourent à la recherche des infraction réprimées par l'article 222-39-1 du code pénal dans le cadre des enquêtes menées sur instruction du procureur de la République. A cette fin, ils procèdent à des recherches de nature fiscale permettant de contribuer à la preuve desdites infractions. Une circulaire interministérielle signée conjointement par le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur général des impôts devrait être prochainement diffusée aux parquets généraux ainsi qu'aux directeurs des services fiscaux ;
* en développant le partenariat avec la direction générale des douanes et des droits indirects , par le biais de la transmission de la liste des détenteurs de produits stupéfiants avec lesquels une transaction a été conclue, de l'exploitation systématique des éléments contenus dans les procédures de manquement aux obligations déclaratives et enfin par l'association plus fréquente des agents des douanes aux enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale 93 ( * ) ;
- l'organisation de l'échange d'informations via notamment une plus grande sensibilisation des services enquêteurs à l'approche patrimoniale de la lutte contre les stupéfiants, en particulier dans le cadre nouveau des GIR.
En outre, M. Dominique Perben, ministre de la justice, a précisé devant la commission que le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, présenté en conseil des ministres le 9 avril 2003, prévoyait la création de pôles de criminalité organisée et l'instauration de procédures spécifiques au traitement de ce type de délinquance. Il a ajouté : « Je pense que ces dispositions, si elles sont approuvées par le Parlement, permettront de renforcer notre dispositif de lutte contre les trafics de grande ampleur à travers (...) les juridictions interrégionales spécialisées et les dispositions procédurales spécifiques à ce type de délinquance ».
(c) La création du délit de blanchiment de fonds provenant de tout crime ou de tout délit
Jusqu'en 1996, seul le délit de blanchiment de fonds provenant du trafic de stupéfiants était incriminé.
L'article 324-1 du code pénal créé par la loi du 13 mai 1996 précitée incrimine comme blanchiment le fait de faciliter, par tous moyens, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect et le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.
Ce délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende, et en cas de circonstances aggravantes, la peine est portée à dix ans d'emprisonnement et 750.000 euros d'amende. En outre, lorsque le crime ou le délit dont proviennent les fonds blanchis est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle prévue par les articles 324-1 ou 324-2 du code pénal, le blanchiment est puni des peines attachées à cette infraction sous-jacente.
|
LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU BLANCHIMENT Blanchir de l'argent consiste à « légaliser », par divers procédés, le produit financier d'un crime ou d'un délit. La particularité du blanchiment réside dans le fait qu'il suppose un « concours d'infractions », c'est-à-dire qu'il se définit par rapport à une infraction sous-jacente ou initiale et sur laquelle il s'appuie, par exemple un trafic de stupéfiants. Il est possible de dégager un typologie des opérations de blanchiment sériées en trois grandes catégories, aujourd'hui établies au niveau international : - le placement, qui conduit à convertir les sommes d'argent en numéraire issues des trafics sous d'autres formes, telles que devises, or, monnaie scripturale ou électronique ; - la technique de l'empilage, qui interdit toute possibilité de remonter à l'origine illicite des fonds, grâce à un système complexe de transactions financières successives, au recours à des sociétés-écrans ou encore à des paradis réglementaires ; - l'intégration, qui se traduit par l'investissement des fonds d'origine frauduleuse dans les circuits économiques légaux d'un pays, afin de leur donner une apparence licite. Une fois le procédé de l'empilage achevé, le blanchisseur d'argent a en effet besoin de fournir une explication pour conférer à sa « richesse » une apparence légale. Cinq types d'opérations de blanchiment permettant de répondre aux besoins des organisations criminelles peuvent être distinguées : les commerces de proximité, les casinos 94 ( * ) , les actifs de valeur, les transferts internationaux, enfin les intermédiaires financiers et les centres offshore. Le blanchiment des capitaux est difficile à évaluer compte tenu de la diversité des activités frauduleuses qui l'induisent. Si les chiffres varient selon les différentes structures d'experts, il est uniformément admis qu'il représente des centaines de milliards de dollars chaque année. Le FMI a indiqué en 1998 que l'argent blanchi représentait 2 à 5 % du PIB mondial, alors que les produits du seul trafic de stupéfiants en sont estimés à 1 %. |
La circulaire judiciaire du 10 juin 1996 commentant les dispositions de la loi du 13 mai 1996 précise que, à l'instar du délit de recel, le délit de blanchiment est désormais applicable au produit de tout crime ou délit, et non plus comme par le passé au seul produit du trafic de stupéfiants. La France n'a pas souhaité user de la faculté que lui offrait la convention de Strasbourg du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990, relative au blanchiment, de limiter l'infraction de blanchiment au produit de certaines infractions principales déterminées. Ainsi, quelle que soit l'infraction criminelle ou délictuelle dont proviennent les fonds en cause, toute justification mensongère de l'origine de ceux-ci ainsi que tout concours apporté à leur placement, dissimulation ou conversion, constituent un délit.
L'objectif essentiel de la loi du 13 mai 1996, en créant un délit général de blanchiment de fonds provenant de tout crime ou de tout délit, était donc d'alléger la charge de la preuve de l'élément intentionnel de blanchiment incombant au ministère public.
Trois ans après son entrée en vigueur, l'incrimination générale de blanchiment n'avait toujours pas fait l'objet d'une appropriation réelle par les magistrats puisque la circulaire du 17 juin 1999 relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants invitait les parquets à solliciter des requalifications lorsqu'il apparaissait que les poursuites ne pouvaient pas prospérer sur la base de l'incrimination spécifique du blanchiment de fonds provenant du trafic de stupéfiants.
Force est de constater aujourd'hui que le faible nombre de condamnations pour délit de blanchiment en matière de trafic de stupéfiants prononcées par les juridictions résulte du fait que la qualification de délit général de blanchiment reste encore largement sous-utilisée.
NOMBRE DE CONDAMNATIONS PRONONCÉES POUR
BLANCHIMENT
EN MATIÈRE DE STUPÉFIANTS
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
|
7 |
21 |
24 |
21 |
44 |
Source : Chancellerie
Une des caractéristiques essentielles de la répression du blanchiment réside dans la participation des organismes financiers au repérage des fonds issus du trafic.
D'après l'OFDT dans son rapport d'évaluation précité du plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances, « si le délit général de blanchiment n'a pas donné lieu à une jurisprudence abondante, les organismes financiers semblent avoir mieux concouru au repérage des fonds issus du trafic de stupéfiants ».
La loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants, impose de nouvelles obligations aux établissements de crédit et professions financières, dont celle d'informer TRACFIN, la cellule de coordination créée au sein du ministère de l'économie et des finances, chargée du traitement, du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins, chaque fois qu'une transaction leur paraît suspecte : le principe de la « déclaration de soupçon », qui rompt le secret bancaire, est ainsi institué.
L'activité de la cellule TRACFIN a connu une forte progression en 1999 et en 2000 et globalement, les institutions financières ont davantage contribué au démantèlement des filières de blanchiment des capitaux issus de l'ensemble des trafics (stupéfiants et autres). Ainsi, le signalement d'opérations suspectes au service anti-blanchiment de TRACFIN a doublé au cours de la période triennale, le nombre de déclarations de soupçons passant de 1.244 en 1998 à 2.537 en 2000.
Toutefois, le rapport d'évaluation précité de l'OFDT précise que « cette collaboration plus efficace des services bancaires et financiers concernés est limitée de fait par la faiblesse du pouvoir de sanction des organismes bancaires qui ne jouent pas le jeu ». Les sanctions administratives prévues par la loi à l'encontre de ces organismes n'ont, de fait, jamais été mises en oeuvre. Le système de lutte contre le blanchiment via la régulation bancaire est donc d'autant plus fragile qu'il est exclusivement fondé sur la capacité de contrôle et la bonne volonté des opérateurs financiers.
En outre, même si elles sont respectées, les mesures anti-blanchiment s'adaptent lentement aux évolutions technologiques. Ainsi, le groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) a attiré l'attention sur le fait qu'internet présentait trois caractéristiques aggravant certains risques classiques de blanchiment d'argent : la facilité d'accès, la dépersonnalisation des contacts entre le client et l'établissement bancaire et la rapidité des transactions électroniques. La mondialisation des marchés financiers peut être considérée comme un facteur de risque complémentaire.
Dans le cadre de son audition par la commission d'enquête, M. Jacques Franquet, premier vice-président de l'OICS, a fait part de sa crainte que le recours accru aux virements électroniques ainsi que l'augmentation considérable du volume et de la rapidité des flux monétaires ne réduisent la possibilité de détecter les mouvements de capitaux illicites dans le monde, et ne se traduisent donc par une augmentation du blanchiment de l'argent de la drogue. Il a appelé de ses voeux la signature d'une convention internationale permettant de réguler ces transactions électroniques.
L'OFDT note également dans son rapport d'évaluation que « les déclarations de soupçons des organismes financiers semblent avoir connu une forte « évaporation » entre le stade de leur transmission à TRACFIN et celui de leur présentation aux autorités judiciaires, puis tout au long du processus judiciaire ». Ainsi, TRACFIN a porté 226 dossiers en justice en 2001, sur près de 3.000 déclarations de soupçons, parmi lesquels 6 % seulement concernaient potentiellement des affaires de blanchiment d'argent issu d'un trafic de stupéfiants, soit 13 dossiers environ.
D'après l'OFDT, « cette déperdition peut s'expliquer par la difficulté d'articulation entre le dispositif déclaratif TRACFIN et le délit général de blanchiment : le premier dispositif signale ce que le second n'a pas toujours les moyens de traiter ». En pratique, les procureurs se trouvent souvent bloqués par le fait que les dénonciations de TRACFIN n'établissent pas de relation directe avec une infraction caractérisée. Même s'il est avéré, un flux financier suspect ne peut justifier des poursuites en tant que tel. En outre, les délais d'enquête importants associés au travail de TRACFIN orientent à la baisse le nombre d'affaires transmises à la justice. C'est pourquoi, d'après l'OFDT, « on peut se demander si la place des instruments d'enquête pénale au sein de la cellule TRACFIN est suffisante et si la qualification pénale du soupçon de blanchiment ne doit pas être aménagée ou mieux expliquée ».
La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques prévoit de mieux relayer les interventions consécutives à une déclaration de soupçon en confiant à TRACFIN l'animation d'un comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits. Cette enceinte réunira les professions déclarantes, les autorités de contrôle et les services compétents de l'Etat.
(2) Les dispositions visant à la lutte contre la fabrication et la diffusion de nouvelles drogues de synthèse
Le plan triennal de lutte contre la drogue invoquait la nécessité de maîtriser la fabrication et la diffusion des drogues de synthèse . Compte tenu de la facilité de leur synthèse à partir de matières premières d'emploi courantes dans l'industrie chimique, les profits engrangés par la fabrication et le commerce des drogues de synthèse sont aussi considérables que difficiles à pister. En outre, la composition de ces drogues peut être modifiée par des chimistes clandestins de façon à obtenir des dérivés toujours plus puissants et échappant au contrôle légal du fait qu'ils ne sont pas encore inscrits sur la liste des stupéfiants.
Le plan triennal se fixait donc pour objectif, sur la base des dispositions de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes :
- d'améliorer les procédures d'identification des produits stupéfiants et psychotropes utilisés à des fins d'extraction de drogues ou de fabrication de produits de synthèse ;
- de renforcer le contrôle et la surveillance des produits chimiques précurseurs de drogues.
Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Didier Jayle, président de la MILDT, a précisé à propos de la lutte contre le trafic de drogues de synthèse : « L'administration répressive a toujours un train de retard. Nous pouvons les aider à repérer le plus rapidement possible l'apparition de nouvelles substances, contrôler les précurseurs servant à la fabrication de ces produits. C'est difficile, parce que ce sont des précurseurs utilisés dans l'industrie chimique dans des quantités considérables et celle détournée pour faire des drogues de synthèse correspond à moins de 1 % du volume des transactions. Il est vrai qu'en France c'est assez bien contrôlé. Néanmoins, nous arrivons à avoir des soupçons sur certains détournements ».
Avec moins de sévérité, l'OFDT, dans son rapport d'évaluation du plan triennal, juge que « les mécanismes d'identification et de surveillance, développés dans le cadre d'une coordination entre les multiples services compétents, ont été mis en oeuvre et affinés au cours de la période triennale ».
La mise en place de SINTES (Système d'identification national des toxiques et substances) pour répondre à l'objectif d'une meilleure identification et d'un classement adapté des stupéfiants et des produits psychoactifs répond également en partie à un objectif de répression du trafic.
La part des drogues de synthèse dans l'ensemble des échantillons de stupéfiants saisis et analysés par les douanes a connu une augmentation continue au cours de la période triennale, ce qui témoigne de l'extension rapide de ces nouveaux produits sur le marché. En outre, à deux occasions en 2000, la direction générale des douanes et des droits indirects a déclenché le processus « alerte rapide drogues de synthèse ». Le dispositif d'information rapide mis en place dans le cadre de SINTES a également permis d'informer les partenaires, notamment les services répressifs, de l'existence de produits en circulation susceptibles de mettre en danger la vie des usagers.
L'OFDT précise dans son rapport d'évaluation du plan triennal que « les efforts de vigilance du dispositif de contrôle juridique et administratif aux composants des nouvelles drogues de synthèse se sont traduits par l'inscription de nouveaux produits sur la liste des stupéfiants (...) de nouveaux précurseurs ont également été identifiés ou reclassés ».
S'agissant de l'action de la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques (MNCPC), l'OFDT souligne qu'actuellement la MNCPC n'a pas les moyens d'aller au devant de tout négociant en prise avec les précurseurs, du fait de moyens en personnel quantitativement trop faibles et de possibilités de coordination insuffisantes pour de telles ambitions.
Le principal moyen de la MNCPC pour contrôler le détournement frauduleux de produits précurseurs destinés à la fabrication illicite de produits stupéfiants est constitué par un partenariat avec l'industrie et le commerce du secteur de la chimie. Néanmoins, le nombre de déclarations de soupçons des opérateurs industriels est resté faible et le rapport d'activité pour 2001 de la MNCPC note que la mission ne reçoit pas encore toutes les déclarations de soupçons exploitables qui devraient lui être transmises.
La sensibilisation des industriels et négociants a été développée par la MNCPC au cours des dernières années, par le biais notamment d'une actualisation en 2001 du recueil des textes réglementaires applicables aux précurseurs, par l'organisation de plusieurs colloques et par le développement d'une application informatique destinée à gérer les contraintes administratives liées au signalement. La hausse du nombre d'agréments sur la période triennale traduit ainsi une adhésion croissante des professionnels à l'obligation déclarative et une propension plus grande des industriels concernés à collaborer à la surveillance et à l'encadrement du commerce des précurseurs.
L'OFDT estime donc que « les produits chimiques susceptibles d'être détournés pour la fabrication de stupéfiants ou de produits psychoactifs ainsi que les drogues de synthèse elles-mêmes ont pu être mieux identifiés au cours de la période triennale ».
En revanche, l'OFDT note que « les moyens en personnel à disposition des différents structures semblent, globalement, peu suffisants, qu'il s'agisse des effectifs développés par la MNCPC dans le cadre de la surveillance et du contrôle à l'exportation, qui ne sont pas à la hauteur de ses missions, ou des services douaniers affectés à la surveillance des exportations de produits chimiques entrant dans la fabrication ou la transformation des drogues à destination des pays et régions du monde les plus sensibles ».
IV. UNE POLITIQUE DE PRÉVENTION DÉFAILLANTE : LES RAVAGES DE LA BANALISATION DE L'USAGE DES DROGUES
A. UN DISPOSITIF INTERMINISTÉRIEL AU MESSAGE AMBIGU ET PEU CRÉDIBLE
Le programme triennal « juin 1999 - juin 2002 » élaboré et publié par la MILDT à l'arrivée de sa précédente présidente, Mme Nicole Maestracci, consacrait une part substantielle de ses objectifs et actions au domaine de la prévention, notamment à l'égard des jeunes, dont elle faisait une « priorité ». Au sens le plus large du terme, la prévention recouvrait même la majeure partie des orientations fixées dans ce programme puisque quatre des huit objectifs qu'elle se fixait en 1999 y avaient trait, de façon plus ou moins directe 95 ( * ) .
Si le principe même de faire de la prévention une telle priorité ne peut qu'être approuvé, rien ou presque n'ayant été fait en la matière auparavant, la façon dont il a été mis en oeuvre et les actions auxquelles il a donné lieu peuvent faire l'objet de critiques.
1. Une communication sur la prévention prêtant à confusion
De manière générale, le principal reproche susceptible d'être adressé à la MILDT en matière de prévention est d'avoir adopté une approche n'attirant pas suffisamment l'attention des populations ciblées sur les dangers et l'interdit liés à la consommation de substances psychoactives, approche pouvant même être interprétée comme légitimant implicitement l'usage de certaines drogues, lorsqu'il est effectué de façon modérée et raisonnée.
Un tel positionnement est clairement apparu dans les diverses actions de communication et d'information engagées par la MILDT dans le cadre de son dernier plan triennal, en partenariat avec l'Institut national de prévention et d'éducation à la santé (INPES) :
- publication à cinq millions d'exemplaires d'un livret de prévention grand public intitulé « Savoir plus, risquer moins », appuyée par une campagne publicitaire télévisée sur l'ensemble des chaînes nationales ;
- lancement d'une collection de quatre livrets de connaissances « Drogues : savoir plus » publiés à 70 000 exemplaires à l'adresse des professionnels ;
- diffusion à l'attention des jeunes de cinq séries de brochures (« flyers ») sur l'alcool, le cannabis, l'ecstasy, le tabac et la cocaïne ;
- mise en ligne d'un site internet d'information « drogues.gouv.fr » ;
- renforcement du dispositif d'écoute téléphonique « Drogues alcool tabac info service » (DATIS) facilitant l'accès à l'information et aux soins.
Si ces actions de communication sont quantitativement nombreuses et ont bénéficié de crédits importants, la philosophie du message diffusé prête incontestablement à confusion. C'est ce que constate clairement le ministère dans la réponse fournie au questionnaire de la commission : après avoir reconnu que « la communication grand public a été techniquement, indépendamment du fond, un succès important », avec « sur la forme, (des) documents (...) de qualité, attrayants et informatifs », le ministère note que « sur le fond, (...) beaucoup ont perçu ces outils comme constitutifs d'une éducation à une consommation modérée, dédramatisée et socialisée, comportant indéniablement des aspects banalisants ».
Cette approche ambiguë des problèmes liés à l'usage des drogues par la MILDT découle tout naturellement de la démarche annoncée dans la présentation de son troisième objectif consacré à la prévention. Il y est en effet explicitement indiqué que la MILDT privilégierait une approche fondée « sur le comportement, plus que sur les produits », en distinguant « l'usage, l'usage nocif et la dépendance » et en ne s'attachant « plus seulement à prévenir l'usage, mais aussi, quand celui existe, à éviter le passage à l'usage nocif et à la dépendance ».
Au-delà de ces objectifs apparemment légitimes, chacun de ces termes doit être analysé en relation avec les implications concrètes qu'il sous-entend. Le titre même du livret édité par la MILDT, « Savoir plus, risquer moins », tout d'abord, laisse perplexe : il semble en effet laisser entendre qu'une bonne connaissance des produits psychoactifs pourrait rendre leur consommation raisonnablement risquée, comme une bonne connaissance par exemple des techniques d'un sport extrême rendrait sa pratique certes dangereuse, mais associée à des risques acceptables car en partie maîtrisés.
Le docteur Léon Hovnanian a indiqué devant la commission : « Rien que dans le titre, on suppose qu'il ne s'agit pas d'en savoir plus pour ne pas tomber dans le piège ni pour arrêter mais pour risquer moins, c'est-à-dire qu'on ne lutte plus contre la drogue et qu'on se contente d'en limiter les risques ».
Les dangers de la consommation de drogues seraient donc moindres à partir du moment où ils sont connus et quantifiés par l'usager, qui pourrait alors effectuer des choix « éclairés », quand bien même il ne serait pas majeur. C'est ce que semble indiquer le livret lorsqu'il explique que « les proches peuvent aider à (la) prise de conscience (de l'adolescent) en donnant des informations de base claires, précises et exactes destinées à l'aider à évaluer ses vulnérabilités et ses points forts », afin qu'il soit pour lui « plus facile de faire des choix responsables ».
Par ailleurs, la référence au fait de « risquer moins » implique l'existence d'une consommation préalable : on ne court un risque en matière de drogues qu'à partir du moment où l'on en consomme. A cet égard, il aurait été moins ambigu, comme l'ont souligné plusieurs des personnes auditionnées par la commission, d'intituler le livret « Savoir plus pour ne rien risquer du tout ».
D'autre part, le fait pour la MILDT de s'être donné pour objectif de s'attacher davantage au « comportement » qu'au « produit » prête à confusion. Cela laisse en effet penser que le produit -la drogue- ne serait pas en soi forcément néfaste dès lors que le comportement -la façon de consommer- respecte certaines conditions qualitatives et quantitatives.
Ainsi, le guide édité par la MILDT indique que « la toxicité potentielle des substances psychoactives (...) est liée à la quantité consommée et cette toxicité est variable d'un produit à l'autre » et précise que « moins on consomme un produit, ou si on le consomme à des doses non toxiques, moins on en subit les conséquences ». Le professeur Renaud Trouvé a déploré, à cet égard, devant la commission, qu'il soit « écrit dans le livret de la MILDT qu'en fonction des doses et des produits, on peut gérer la situation, ce qui est faux, au moins pour tous les dérivés amphétaminiques ».
Pour rester dans l'ordre de la sémantique, fondamental en termes de prévention, l'utilisation par la MILDT de la distinction entre « usage », « usage nocif » et « dépendance » paraît regrettable. Elle implique en effet que la consommation de drogues illicites peut ne pas être dangereuse et ne saurait donc être systématiquement condamnée . C'est ce que laisse penser la définition de l'usage qui est donné dans le livret : « consommation de substances psychoactives qui n'entraîne ni complications pour la santé, ni troubles du comportement ayant des conséquences sur les autres ».
Le livret précise par ailleurs que « les usagers (de cannabis) de tous âges consomment généralement pour le plaisir et la détente », que cette consommation se rapproche « des consommations occasionnelles et modérées qui concernent, par exemple, un nombre important d'usagers d'alcools » et que « dans la grande majorité des cas, l'usage n'entraîne pas d'escalade ».
Si toutes ces affirmations ne sont pas erronées, loin s'en faut, elles apparaissent difficilement acceptables dans le cadre d'un livret de prévention dont l'objectif doit être d'exposer les risques physiologiques et pénaux auxquels expose la consommation de produits stupéfiants. Présentant le problème des drogues sous un aspect anodin, elles constituent en effet pour des publics souvent jeunes autant de signaux susceptibles d'être interprétés comme un dédouanement de leur usage à condition qu'il soit « raisonné ».
La commission rappellera que la MILDT constitue la principale structure donnant le « ton » en matière de lutte contre les stupéfiants, les lignes directrices qu'elle assigne à l'ensemble des acteurs concernés étant ensuite déclinées aux niveaux sectoriels et locaux. La philosophie qu'elle adopte dans le combat contre la drogue se doit donc d'être parfaitement claire, lisible et surtout exempte de toute complaisance, implicite ou avérée, à l'égard des produits toxiques contre lesquelles elle prétend lutter.
2. Les « effets pervers » d'une politique excessivement centrée sur la prévention secondaire
Traditionnellement, en matière de lutte contre la drogue, sont distinguées la prévention primaire et la prévention secondaire. La première s'adresse aux personnes ne consommant pas de drogues et vise à les dissuader de devenir usagers. La seconde s'adresse aux personnes utilisant des produits stupéfiants, de façon plus ou moins intense, et cherche à réduire, ou mieux, à supprimer leur comportement addictif. Les deux types de prévention, dont les publics et les objectifs diffèrent, doivent normalement être menées de façon simultanée et équilibrée.
Or, il apparaît que la politique de prévention de la MILDT s'est excessivement focalisée sur la prévention secondaire, au point de considérer comme acquise l'idée qu'existe une consommation et que les pouvoirs publics ne peuvent espérer l'éradiquer, mais tout juste la contenir, ou plutôt en limiter les effets « collatéraux ». C'est en tout cas le message que véhicule l'expression utilisée par Mme Nicole Maestracci lors de son arrivée à la tête de la structure interministérielle en 1998 selon laquelle « une société sans drogue, ça n'existe pas », ce dont elle tire comme conséquence que « l'objectif de la politique publique dans le domaine des drogues est de réduire les dommages sanitaires et sociaux liés à l'usage des drogues ».
Si cet objectif est louable et nécessaire, il ne doit pas pour autant conduire à négliger la prévention primaire, dont la population cible est quantitativement et qualitativement essentielle puisqu'elle concerne l'ensemble des non consommateurs de drogues illicites (qui constituent tout de même plus de 90 % de la population) et surtout la majeure partie de la jeunesse. La réduction des risques est une composante, certes importante, mais non unique, de la politique de lutte contre la drogue ; elle doit prendre en son sein la place aux côtés d'autres instruments et approches tout aussi fondamentaux, concernant aussi bien les stratégies de réduction de l'offre que les stratégies de réduction de la demande. C'est là un élément qu'a clairement souligné M. Philip Emafo, président de l'OICS, lors de l'entretien qu'a eu avec lui la délégation sénatoriale dans le cadre de son déplacement à Vienne.
Or, la politique de réduction des risques a monopolisé le terrain de la lutte contre la drogue, ce qui a eu pour effet de sensibiliser une partie de l'opinion publique à l'idée que l'existence de la drogue était incontournable et qu'il fallait en conséquence se résoudre à la gérer. « Force est de constater que le discours officiel, institutionnel, a entraîné une grande confusion dans les esprits, notamment en détournant (...) la notion de prévention des risques » a affirmé le ministre de l'intérieur M. Nicolas Sarkozy lors de son audition par la commission. Ajoutant qu'elle constituait « une politique utile et justifiée dès que la santé et bien sûr la vie des usagers est susceptible d'être mise en cause », le ministre a appelé à « veiller à ce que cette politique réaliste ne soit pas dévoyée à d'autres fins ».
De son côté, le ministre de la santé, M. Jean-François Mattéi, a déclaré à la commission que les progrès indéniables accomplis dans le domaine de la prévention secondaire « ont peut-être masqué un constat qui s'impose aujourd'hui : la prévention primaire reste le maillon faible de notre système sanitaire ». « Ne nous trompons pas , a t-il ajouté, réduire les dommages liés à la consommation de drogues n'est pas prévenir la consommation elle-même ».
B. UN « BRUIT DE FOND » COMPLAISANT ENVERS LA DROGUE
Dans le prolongement des reproches adressés à la MILDT sur l'ambiguïté de sa position, de nombreux intervenants ont relevé l'attitude complaisante de certains responsables politiques et de nombreuses personnalités du monde du spectacle ou des médias à l'égard des drogues .
1. L'exemple négatif trop souvent donné par des vedettes du sport ou du spectacle
Cette complaisance, affichée ou sous-entendue, est le fait d'une partie du monde du spectacle (stars de cinéma, écrivains, chanteurs renommés...), mais aussi du milieu sportif, dont de nombreuses personnalités ont publiquement reconnu avoir consommé de la drogue ou bien ont été prises en flagrant délit de recel ou d'usage. « Dieu sait que, dans le milieu du showbiz, il est bien difficile d'assister à une fête, quelle qu'elle soit, sans que l'on soit en présence de drogues illicites » a reconnu devant la commission M. Luc Ferry, ministre de l'éducation nationale .
Ces conduites, outre le fait qu'elles constituent des infractions à la législation sur les stupéfiants (car elles entrent dans le champ matériel du délit d'incitation à usage), posent un problème non négligeable en terme d'exemplarité à l'égard de l'ensemble de la population qui en a connaissance, et notamment de la population la plus jeune. « Quand de grands sportifs se shootent et quand, dans le showbiz, on sait que se pratiquent régulièrement certaines consommations, pourquoi voulez-vous que le gamin de banlieue se sente plus concerné que le showbiz » s'est interrogé devant la commission M. Pierre Cardo, maire de Chanteloup-les-Vignes.
S'agissant des sportifs, ces attitudes sont en contradiction totale avec les trois volets de la lutte contre le dopage que décline le ministère des sports : l'interdiction de l'usage de produits visant à l'amélioration de la performance sportive, la protection de la santé des sportifs et la préservation de l'exemplarité du sportif . « C'est bien ce dernier domaine qui est concerné par la prise de cannabis et c'est bien le principe de l'exemplarité qui a été mis en cause dans un exemple récent » a ainsi souligné le ministre des sports, M. Jean-François Lamour, faisant allusion en l'occurrence à la mise en cause d'un rugbyman. « Comment expliquer ensuite à des parents qu'ils ont tout intérêt à inscrire leur enfant dans un club s'ils s'aperçoivent que le sportif en question a un comportement qui ne correspond pas à une référence que nous nous faisons en matière de conduite sociale comme de conduite sportive ? » s'est interrogé le ministre.
Compte tenu du degré d'influençabilité des adolescents et de l'impact qu'ont sur leurs actes et leurs opinions l'image que dégagent les personnalités les plus en vue du monde du sport et du spectacle, on imagine quels dégâts occasionnent ces dernières en affichant ostensiblement l'usage qu'elles font de stupéfiants. Faisant ainsi allusion « aux personnalités connues de la vie artistique ou autre », M. Michel Bouchet, chef de la MILAD, a expliqué devant la commission comment « la consommation est (...) influencée par l'expression médiatisée des représentants de certains milieux, qui ne mesurent pas toujours les conséquences, compte tenu de leur notoriété, qu'entraînent leurs propos dans l'esprit de très jeunes gens ».
Dans le même sens, la direction générale de la gendarmerie nationale, dans une note adressée à la MILAD sur les actions de prévention instituées par la gendarmerie nationale en matière de stupéfiants, déplore devoir faire face dans son action quotidienne « aux discours banalisant l'usage de certains stupéfiants et à leur pénétration auprès du jeune public ». Elle rappelle que l'article L. 3421-4 du code de la santé publique sanctionne la provocation à toutes les infractions à la législation sur les stupéfiants, tout en précisant que les condamnations prononcées sur le fondement de cette disposition sont rares en raison des difficultés à réunir la preuve de l'intention dolosive.
S'interrogeant de ce fait sur le point de savoir si « l'absence de sanctions pénales envers de tels propos médiatisés n'encourage pas les auteurs à la récidive et si ce préjugé favorable ne vient pas perturber certains jeunes dans la compréhension des risques sanitaires et pénaux inhérents aux stupéfiants », elle rapporte que « des militaires de la gendarmerie nationale chargés de la prévention ont noté que certains jeunes ont un préjugé favorable sur le cannabis ou les drogues de synthèse ». Elle en conclut que « la mission des agents peut être compliquée et leur message préventif est susceptible d'être fragilisé par la tenue de tels discours écrits, télévisés ou radiodiffusés ».
2. Les déclarations ambiguës de certains responsables politiques
Le milieu « people » n'est pas le seul en cause : des personnalités politiques de tous bords ont également reconnu publiquement avoir consommé des drogues illicites ou ont appelé explicitement à leur dépénalisation en niant ou minimisant leurs effets sociosanitaires. Au-delà de la prise de position politique qu'ils sous-tendent et dont la légitimité n'est pas contestable en tant que telle, ces discours ont pour effet de saper les efforts entrepris par l'ensemble des acteurs concernés par la politique de lutte contre la drogue pour sans cesse rappeler les notions d'interdit et de dangerosité liées aux produits stupéfiants.
Mme Catherine Domingo, substitut du procureur de la République de Bayonne, a ainsi insisté devant la commission sur le fait que « l'augmentation importante (de la) délinquance et (de l') usage de stupéfiants est liée au discours ambiant qui est développé par les médias et alimenté par les personnalités publiques qui tentent de faire croire aux jeunes que cet usage de stupéfiants est assez banal ».
Le débat s'est instauré plus précisément lors de la parution, en juin 1998, du rapport Roques, commandé par le secrétaire d'Etat à la santé de l'époque, M. Bernard Kouchner, sur la dangerosité comparée des drogues licites et illicites . Ce rapport avait classé l'héroïne, la cocaïne et l'alcool dans le groupe des produits à toxicité générale élevée, reléguant le cannabis à la fin du classement.
Ces conclusions quant à la dangerosité respective des différentes drogues avaient été reprises et interprétées par plusieurs responsables politiques comme dédouanant le cannabis et justifiant scientifiquement une éventuelle dépénalisation, voire une légalisation de son usage et de sa vente . Le docteur Francis Curtet a ainsi rapporté à la commission que des mineurs de « 13 à 14 ans » fumant du cannabis « du matin au soir » lui avaient déclaré avoir « entendu le ministre dire que c'était beaucoup moins dangereux que l'alcool et le tabac ».
Les conclusions de ce rapport, et surtout la façon souvent fallacieuse dont elles ont été interprétées, ont par ailleurs renforcé dans leur position les partisans d'une politique essentiellement axée sur la réduction des risques qui a, selon les déclarations de M. Michel Bouchet devant la commission, « débouché sur une politique de gestion de la consommation plus que de réduction de celle-ci » et « accordé une place congrue à l'application de l'interdit social et pénal pesant sur l'usage ».
La suite de l'analyse développée devant la commission par le chef de la MILAD sur cette politique est particulièrement éclairante : « Les doctrines sur lesquelles elle s'est appuyée (...) ont conduit progressivement, concernant le cannabis, à une quasi acceptation d'un usage simple, prétendument non nocif, au risque d'une intégration des consommations présentées comme « sanitairement et socialement admissibles » dans notre paysage social, oubliant en cela qu'il existe une corrélation certaine et constante entre la masse des consommateurs et des usagers dits « simples » et celle de ceux qui sont problématiques ou dépendants. En terme de prévention, cette option a débouché sur le principe d'une éducation à une consommation « modérée, maîtrisée et dédramatisée ». De puissantes actions de communication ont, dans le même temps, contribué à modifier les représentations des Français en ce sens ».
3. La responsabilité de certains médias
Les médias constituent également parfois un important relais, quand ils ne l'initient pas, du « bruit de fond » participant à la banalisation des drogues. Ce message « déviant » envoyé notamment à la jeunesse perturbe profondément le travail des différents acteurs du dispositif de lutte contre la drogue . Le directeur général de la gendarmerie nationale, M. Pierre Mutz, s'en est inquiété auprès de la commission en déclarant : « Notre jeunesse connaît un réel problème qui vient du fait que presque tous les gens qu'admirent nos jeunes se droguent et le disent publiquement dans la presse, ce qui est absolument dramatique ».
En-dehors de la télévision (on pense aux « Guignols de l'info » sur Canal Plus et à la présentation familière ou sympathique qui y est faite du « pétard » ou du « joint », accessoire incontournable de quelques stars du rap « marionnétisées ») et de la radio (avec, par exemple, les propos ambigus tenus sur une station comme Skyrock sur l'air sec, gaz contenu dans des bombes sous pression à usage domestique dont l'ingestion permet de modifier le son de la voix), une certaine presse a contribué à banaliser les drogues dites « douces » en se livrant notamment à des interprétations erronées des conclusions du rapport Roques.
Peu de temps après la publication du rapport, Libération 96 ( * ) titrait à la une d'une édition spéciale : « Le verdict des experts sur les drogues : Ecstasy : accusé, Cannabis : acquitté ». Reconnaissant que l'ecstasy pouvait entraîner de graves séquelles physiques ou psychiatriques, il y était dit en substance que les dangers du cannabis avaient été surestimés et devaient être totalement reconsidérés, celui-ci étant « moins dangereux que le tabac ».
Le professeur Roger Nordmann a déploré cette présentation fallacieuse des faits lors de son audition par la commission, déclarant qu'« une des causes majeures (de la banalisation du cannabis auprès des jeunes) est le fait qu'ont été diffusés par les médias, et même parfois par les instances officielles, des messages qui étaient soit partiaux, soit incomplets ».
Le premier de ces messages, consistant à affirmer que « le cannabis n'a jamais tué personne », ne tient pas compte selon le professeur Nordmann « des accidents causés par une conduite automobile sous l'emprise de cannabis ou lors d'épisodes psychotiques aigus ». « Dire que le cannabis n'a jamais tué personne », a de son côté déclaré lors de son audition le professeur Claude Got, président du collège scientifique de l'OFDT, « étant donné qu'il y a entre quatre et dix fois dans un joint la quantité de goudron qu'il y a dans la combustion d'une cigarette, est la négation du tabagisme passif et de tout ce qui a été accumulé depuis quarante ans sur la connaissance du risque lié au tabac ».
Le deuxième message, affirmant que « le cannabis n'est pas neurotoxique », s'est uniquement fondé sur les conclusions du rapport Roques sans tenir compte des développements d'un de ses chapitres expliquant que la consommation de cannabis entraîne des troubles du comportement et que de tels troubles constituent les premiers signes de neurotoxicité d'un produit.
Le professeur Nordmann a critiqué les extrapolations effectuées par les médias à partir du classement sur la dangerosité des drogues contenu dans le rapport. Il a ainsi expliqué que le cannabis « n'est (pas) une drogue qu'il faut comparer au point de vue de la dangerosité puisqu'elle ne prend pas la place des autres », ajoutant que « non seulement le cannabis ne se substitue pas à l'alcool ou au tabac, mais (qu'en plus) il favorise l'appétence envers l'alcool et perturbe le sevrage envers le tabac ».
Le nouveau président de la MILDT, M. Didier Jayle, a lui-même reconnu devant la commission que l'exploitation qui avait été faite du rapport Roques était en grande partie déplacée : « Nous avons ressorti du rapport Roques une espèce de classement des dommages entraînés par les différentes drogues. Celui-ci ne niait pas que le cannabis puisse poser des problèmes. C'est peut-être plus dans les commentaires qui en ont été faits que les conséquences de l'alcool, du tabac étaient beaucoup plus graves pour la santé publique que celles liées au cannabis ».
Bien qu'il ait tenu à préciser devant la commission que la MILDT, « pas plus aujourd'hui qu'hier, n'est responsable des commentaires qui peuvent être faits à partir des études », M. Jayle a reconnu que l'institution qu'il préside « a la responsabilité d'engager des campagnes d'information, de formation des professionnels et d'information du grand public pour que les choses changent ».
Si les personnalités « people », responsables politiques et médias portent donc une part de responsabilité dans une banalisation du cannabis, en s'appuyant sur une interprétation biaisée d'un rapport existant sur la question, la MILDT elle-même n'est pas exempte de tout reproche . Son absence de réaction suite à la parution du rapport et aux conclusions hâtives qui en ont été tirées, ainsi que la façon, déjà évoquée, dont elle a abordé le problème des drogues, et plus particulièrement du cannabis, dans ses diverses publications, ont implicitement contribué à amplifier ce phénomène de banalisation en lui donnant implicitement la caution de la principale institution publique dans le domaine de la lutte contre la drogue.
En ce sens, devant la commission, le docteur Léon Hovnanian a constaté que, d'un programme triennal fait « d'intentions louables portant sur l'information du public (et) sur la prévention », la mission interministérielle a abouti « à une information tronquée et partiale du public et des jeunes, visant à occulter délibérément la dangerosité si grande du cannabis » et « à une prévention qui était fondée sur un message lénifiant au prétexte d'être soi-disant pragmatique et crédible ».
C. L'IMBROGLIO DES STRUCTURES COMPÉTENTES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION, OBSTACLE À LEUR EFFICACITÉ
1. L'empilement des structures
Tout au long de ses travaux, la commission a pu constater le nombre et la diversité des structures publiques appelées à intervenir dans le domaine de la prévention, tant au niveau national qu'aux divers échelons locaux, celles-ci impliquant les acteurs des différents champs (éducatif, sanitaire, social et répressif). Cependant, la multiplicité, la dispersion et le manque de coordination des actions qui en résultent altèrent leur lisibilité, amoindrissent les résultats auxquels elles pourraient prétendre et rendent difficile leur évaluation.
Cet empilement de dispositifs de prévention fortement imbriqués les uns dans les autres s'explique par la diversité de la problématique des drogues et des approches préventives pouvant être mises en oeuvre, par les multiples facteurs des comportements de consommation et surtout par l'absence, jusqu'à une date récente, d'une véritable politique globale en matière de prévention.
Se sont ainsi sédimentés, au niveau national , des dispositifs interministériels (MILDT) et des dispositifs propres à chaque ministère (éducation nationale, santé, intérieur ...). Outre les innombrables associations, se sont par ailleurs ajoutés, au niveau local, des dispositifs transversaux fondus dans des programmes généralistes.
On trouve ainsi au niveau de l'agglomération les contrats de ville, dont la thématique santé comporte généralement un volet consacré à la prévention des conduites à risque ; les contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), fusionnant depuis leur création en 2002 les deux dispositifs préexistants que sont le conseil communal de prévention de la délinquance (CCPD) et le contrat local de sécurité (CLS) et abordant le problème des drogues à travers celui de la délinquance ; les contrats intercommunaux de prévention de la délinquance (CIPD), pour certaines villes, dont l'approche est semblable à celle du CLSPD ; et enfin les contrats éducatifs locaux (CEL), ayant une démarche axée sur la consolidation des facteurs de protection reconnus.
A l'échelon départemental ont par ailleurs été instaurés des programmes départementaux de prévention de la dépendance. Enfin, à l'échelon régional , on trouve d'une part les programmes régionaux de santé (PRS), dont les thématiques sont définies annuellement à partir des besoins identifiés dans la région, et d'autre part les programmes d'accès à la prévention et aux soins pour les personnes en situation de précarité (PRAPS), imposés par la loi pour une durée de trois ans, plusieurs de ces PRS et PRAPS ayant défini la prévention et la prise en charge des dépendances comme une priorité.
2. Une coordination défaillante
La coordination de l'ensemble de ces actions de prévention, très souvent menées en partenariat (deux tiers des actions rassemblant au moins deux partenaires, au premier rang desquels les associations et les services de l'Etat), est en principe assurée par des structures spécifiques. Au niveau national, la MILDT, outre les actions d'information et de communication qu'elle mène pour son propre compte, doit financer, soutenir et orienter les différents acteurs nationaux intervenant dans le champ de la prévention, et notamment les vingt départements ministériels qu'elle pilote.
En ce qui concerne l'échelon local , c'est au niveau départemental que doit être opérée la coordination. Le chef de projet « drogues et dépendances », désigné dans chaque département par le préfet, peut en effet s'appuyer sur le comité de pilotage de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances ainsi que sur le conseil départemental de prévention de la délinquance pour élaborer des plans départementaux de prévention déclinant les grands axes définis au niveau national par le plan pluriannuel de la MILDT. Il associe à son action des représentants des dispositifs transversaux connexes couvrant la ville ou la région, ainsi que les divers acteurs déconcentrés ou locaux.
Ces deux instruments de coordination, MILDT et chef de projet, ne remplissent toutefois qu'imparfaitement leur tâche. Tout d'abord, même si d'indéniables progrès ont été effectués par la MILDT pour conférer un caractère véritablement interministériel à ses travaux, le pilotage auquel elle se livre, notamment dans le domaine de la prévention, ne semble pas encore optimal. Cette lacune persistante a été soulignée dans le rapport de suivi rendu public en juillet 2002 par la Cour des comptes, publié quatre ans après son rapport public sur le dispositif de lutte contre la toxicomanie.
Mme Nicole Maestracci, précédente présidente de la MILDT, a elle-même indiqué lors de son audition que « tout en reconnaissant qu'un effort de cohérence et de mise à disposition de moyens a été fait », ce second rapport observait que « la politique de prévention (de la MILDT) reste très déficitaire » . Elle avait par ailleurs concédé dans sa note effectuant un premier bilan de son action à la tête de la MILDT que « l'organisation excessivement verticale de l'administration française résiste toujours, peu ou prou, aux tentatives de créer des méthodes de travail plus transversales ».
Plus encore au niveau local, l'hétérogénéité et la dispersion des actions menées n'ont pas été réellement endiguées par la mise en place du chef de projet. Il apparaît en effet que ce dernier, faute de temps, ne se consacre pas pleinement à sa mission, les préfets choisissant dans plus d'un cas sur deux un directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou un médecin inspecteur, et dans les autres cas des sous-préfets ou des directeurs de cabinet de préfet. Par ailleurs, le renouvellement très fréquent des chefs de projet les empêche de s'investir comme ils le devraient dans leur tâche.
Des coordinateurs régionaux, désignés par les préfets de région pour assurer notamment la complémentarité avec les programmes régionaux de santé et les programmes de formation des échelons déconcentrés, ont certes été mis en place, mais leur nombre et leurs moyens demeurent notoirement insuffisants pour pouvoir compenser les carences des chefs de projet départementaux.
Dans la note précitée portant sur le premier bilan du plan triennal 1999-2002, il est clairement souligné que « la question essentielle est celle de la disponibilité des chefs de projet pour effectuer une tâche qui est devenue de plus en plus lourde » . Tout en reconnaissant qu'il était indispensable que ces chefs de projet continuent à être choisis parmi des personnels de haut niveau, Mme Maestracci précisait qu'« il est nécessaire (...) qu'ils puissent s'appuyer sur un cadre de catégorie A pour conduire les dossiers ».
Quant au ministère de la ville, il a indiqué dans sa réponse au questionnaire lui ayant été adressé par la commission que « l'enjeu majeur de la coordination de la politique de lutte contre la drogue et la toxicomanie au niveau local, ainsi que l'accent particulier qui doit être mis sur la prévention plaident pour le renforcement et la pérennisation des moyens mis en oeuvre, notamment autour de postes identifiés et dédiés à temps plein à la mission des chefs de projet drogues et dépendances, à l'échelon régional et/ou départemental ».
D. LES CARENCES DES ACTEURS NATURELS DE LA PRÉVENTION
De manière générale, et malgré la multiplicité précédemment évoquée des dispositifs existants, l'ensemble des intervenants a, chacun dans son domaine privilégié, très largement insisté devant la commission sur la faiblesse des moyens et des actions mis en oeuvre en matière de prévention contre la drogue . Le système français de lutte contre la drogue s'est en effet essentiellement construit autour de la loi du 31 décembre 1970 dont le seul intitulé indique quelles ont été les orientations privilégiées : répression de l'usage et du trafic et prise en charge sanitaire et sociale des usagers.
Cette double démarche, à laquelle s'ajoute l'absence d'une véritable culture de la prévention en France (que l'on constate dans les principaux autres champs de la santé publique), a eu pour conséquence de reléguer à la portion congrue l'approche préventive du problème des drogues . L'ancienne présidente de la MILDT, Mme Nicole Maestracci, a également reconnu lors de son audition par la commission qu'il était « évident que nous sommes dans un pays qui n'a pas de culture de la prévention, qui n'a donc pas de cadre adapté, qui n'a pas d'espace-temps dans les établissements scolaires consacré à la prévention et qui n'a pas non plus de professionnels de la prévention ».
La réalité révèle que certaines institutions administratives, qui a priori n'étaient pas naturellement les mieux placées pour mener des actions préventives s'y sont largement investies, tandis que celles dont on attendait légitimement le plus en la matière sont restées quasiment inertes.
1. La police et la gendarmerie, acteurs inattendus mais désormais essentiels de la prévention
Si policiers et gendarmes restent les symboles de l'application de l'interdit, leur intervention dans le champ de la prévention de la consommation des produits stupéfiants, et de l'information sur les risques qui y sont liés n'a cessé de croître depuis une quinzaine d'années, notamment auprès des populations les plus jeunes : la police et la gendarmerie sont sans doute aujourd'hui les structures administratives les plus impliquées dans les actions préventives contre les drogues.
a) La MILAD, coordinatrice et actrice de la prévention
La Mission de lutte anti-drogue, au cabinet du directeur général de la police nationale, est chargée de coordonner et d'orienter la politique du ministère de l'intérieur en matière d'usage de stupéfiants, de trafic et de blanchiment, mais aussi de prévention. C'est dans ce cadre qu'elle anime le dispositif de la police nationale, structuré autour des policiers formateurs anti-drogues intervenant dans l'ensemble des domaines de la formation et de la prévention. La MILAD assure notamment l'actualisation de leurs connaissances par l'envoi d'ouvrages pédagogiques et met à leur disposition sa documentation par l'intermédiaire de son site intranet.
La MILAD dispose à cet effet d'un camion podium pouvant recevoir une quarantaine de personnes, à bord duquel le public est informé sur les risques liés à l'usage de drogues et sur les facteurs de protection. Les interventions sont assurées par des officiers de police originaires de services de lutte contre les stupéfiants, qui ont reçu une formation complète incluant une spécialisation propre à l'intervention en milieu scolaire.
Durant la période estivale, ce dispositif embarqué sillonne les routes de France à la rencontre des vacanciers, en partenariat avec différentes structures (ministère de la jeunesse et des sports, Agence nationale de prévention de l'alcoolisme ...). Pendant l'été 2002, il s'est déplacé dans 21 villes de France pour un public de 13 735 personnes.
Au total, ce sont environ 250 000 personnes qui sont ainsi rencontrées chaque année par les policiers. La proportion de jeunes s'élève à plus de 75 %. Quant aux adultes, il s'agit surtout de membres de la communauté scolaire, d'acteurs socio-sanitaires et de parents d'élèves.
b) Les policiers formateurs anti-drogues et les formateurs relais antidrogues de la gendarmerie nationale, spécialistes de la prévention de terrain
• Les PFAD
Au nombre de 266, issus généralement de commissariats de sécurité publique, recrutés sur la base du volontariat et bénéficiant d'une formation spécifique, ils interviennent dans tous les domaines, de la formation continue de leurs collègues à la prévention en milieu scolaire en passant par l'information de publics très variés (parents, enseignants, travailleurs médicaux et sociaux ...). En 2002, ils ont ainsi réalisé 212 actions de formation auprès de 3 413 fonctionnaires de police et ont participé à 4 677 séances d'information touchant un public de 157 352 personnes.
Depuis une circulaire ministérielle du 13 septembre 1999 97 ( * ) , leur action a été réorientée pour l'essentiel vers les établissements scolaires, où ils interviennent à travers les Comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC). Dans ce cadre, ils informent sur les produits licites et illicites, les comportements de consommation qui y sont liés, leurs conséquences individuelles et sociales, les dispositions de la loi dans le domaine du trafic et de l'usage ainsi que sur les divers dispositifs de prise en charge. En 2002, ils ont ainsi consacré 3 355 séances d'information à 82 608 élèves et 540 séances de ce type à 15 169 enseignants et parents.
• Les FRAD
Au nombre de 530 au niveau national, soit environ un par arrondissement, ces sous-officiers reçoivent une formation spécifique dispensée par le Centre national de formation de la police judiciaire (CNFPJ) fondée sur l'apprentissage des techniques de communication orale, de la législation sur les stupéfiants et de la psychologie du toxicomane. Comme pour les policiers formateurs antidrogue, leur action vise essentiellement les jeunes élèves (à plus de 70 %) et leurs parents, mais aussi des responsables sociosanitaires ainsi que des militaires.
Ces militaires sont affectés au sein des 41 brigades de prévention de la délinquance juvénile, à raison de trois ou quatre par structure. Ces brigades agissent en partenariat avec les élus, les administrations concernées et les services du Procureur de la République. Le ministère de l'éducation nationale et les milieux associatifs engagés dans la lutte contre la toxicomanie font un appel croissant à leurs services.
En 2002, ils ont assuré environ 9 000 interventions au cours desquelles ils ont rencontré quelques 408 000 personnes. Un enfant sur deux bénéficie de ce fait d'une information complète sur les drogues illicites. Au total, ce sont près de quatre millions de personnes qui ont bénéficié d'actions d'informations provenant de la gendarmerie nationale.
2. Des actions globalement satisfaisantes dans le milieu sportif
La prévention contre l'usage de stupéfiants et de produits dopants à des fins sportives occupe une part importante du dispositif mis en oeuvre par le ministère des sports (les trois autres volets étant le contrôle antidopage, les sanctions et la répression des trafics). La loi du 23 mars 1999 contre le dopage 98 ( * ) et les décrets qui ont été ou seront pris pour son application en fixent le cadre.
L'action menée passe d'abord par le suivi médical des sportifs : des laboratoires situés sur l'ensemble du territoire permettent de vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication à la pratique du sport de compétition et que les charges d'entraînement sont bien tolérées par le sportif. Ce suivi biologique basé sur des prises de sang régulières ne constitue pas un contrôle antidopage et se fait avec le consentement expresse du sportif.
Par ailleurs, le Conseil national de lutte contre le dopage , outre ses attributions disciplinaires et scientifique, exerce une importante mission de prévention en favorisant les initiatives et en coordonnant les nombreux acteurs intervenant en ce domaine (pouvoirs publics, collectivités locales, établissements d'enseignement, professions de santé, médias...). Le conseil a également lancé en 2002 un important programme de sensibilisation destiné aux 50 000 à 60 000 jeunes des sections scolaires, futurs sportifs de haut niveau, entraîneurs, professeurs de sport, dirigeants de club, gestionnaires d'équipements sportifs... Enfin, le conseil a initié un important programme étalé sur quatre ans reposant sur des conférences interactives sur les drogues et le dopage conduites dans les classes pendant les heures de cours par des intervenants extérieurs à la demande des professeurs.
Un important volet de la prévention a consisté dans la mise en place d'un réseau d'information et de soins, avec la création d'un numéro vert national et d'antennes médicales de lutte contre le dopage (AMLD) dans chaque région. Le numéro vert permet d'offrir au sportif un premier contact informel et anonyme avec des psychologues et des médecins, les antennes médicales assurant ensuite un suivi plus adapté.
Par ailleurs, des conventions d'objectifs sont signées par le ministère et les fédérations sportives nationales afin de définir les actions de prévention devant être menées dans les clubs et les modalités de leur évaluation. Le lien entre le ministère et les fédérations est assuré par la présence auprès de ces dernières, tant au niveau national qu'aux échelons régionaux, d'environ 1 600 cadres techniques sportifs (CTS) généralement recrutés parmi des professeurs de sport et chargés de coordonner l'action des bénévoles et éducateurs intervenant dans les clubs.
Si ce dispositif de prévention contre le dopage et la toxicomanie en milieu sportif est relativement complet et touche un public très large, certaines limites méritent toutefois d'être mentionnées. Tout d'abord, cela a déjà été évoqué, la consommation par des sportifs particulièrement renommés de produits dopants ou stupéfiants contredit l'exigence d'exemplarité qu'ils devraient respecter. D'autre part, le fait qu'un nombre très important de sportifs ne soit licencié dans aucun club rend leur approche difficile.
En outre, la formation des différents acteurs est parfois déficitaire, soit le plus souvent qu'elle n'existe pas pour l'importante proportion de bénévoles encadrant des jeunes dans des clubs, soit qu'elle demeure encore insuffisante ou rapidement inadaptée à l'évolution des produits pour de nombreux éducateurs. M. Jean-François Lamour, ministre des sports, a reconnu lors de son audition par la commission que l'évolution de plus en plus rapide des produits et procédés dopants, ainsi que des procédures liées à leur dépistage, constituait « la grande difficulté » , l'information et la formation destinées aux dirigeants, bénévoles et éducateurs de clubs devant sans cesse être réinitialisée.
M. Michel Boyon, président du CNLD, a de son côté souligné devant la commission la difficulté qu'il y avait à garantir l'impact des messages de prévention à l'égard des jeunes, mais aussi des sportifs de haut niveau : « Le message sur le risque pour la santé, le risque immédiat et le risque à terme passe mal. En effet, quand on a 18 ans, les risques que l'on court vingt ans plus tard paraissent bien éloignés et bien aléatoires. De même, le message sur la tricherie passe chez ceux qui ont envie de l'entendre et non pas chez les autres ».
M. Jean-François Lamour, a déclaré à la commission vouloir amplifier les actions de prévention menées dans le cadre de son ministère. Sera ainsi lancée une campagne de communication destinée à inciter les sportifs à utiliser davantage les structures mises en place, dont les activités seront évaluées. Des actions de sensibilisation au sein du ministère des sports (centres régionaux d'éducation populaire et de sport -CREPS- et Institut national du sport -INSEP-) devraient être menées en partenariat avec la MILDT. Un plan quinquennal de formation initiale et continue des cadres techniques sportifs sera initié et concernera tout particulièrement les conduites à risque.
3. La faiblesse du dispositif Santé et affaires sociales
Au niveau national, ce dispositif repose sur la coopération entre différents acteurs : les deux ministères concernés, la MILDT, l'INPES et l'OFDT, qui élaborent en concertation les stratégies de communication et de soutien aux acteurs de la prévention.
Au niveau déconcentré, les structures susceptibles d'intervenir sont multiples :
- les comités régionaux et départementaux d'éducation à la santé (CRES et CODES), démembrements sur le terrain de l'INPES, mènent des actions de proximité en matière de prévention et d'information ;
- les centres d'information sur les drogues et les dépendances (CIRDD), d'envergure régionale ou interdépartementale et s'appuyant à ce titre sur les CRES et les CODES, destinés essentiellement à soutenir techniquement les acteurs institutionnels et les professionnels mettant en oeuvre des actions locales de prévention ;
- les centres spécialisés de soins pour la toxicomanie (CSST) peuvent participer à des actions de prévention primaire et secondaire dans le champ des addictions ;
- les points d'accueil écoute jeunes (PAEJ), dispositif phare du ministère en matière de prévention de terrain, qui a pour objectif de capter des publics jeunes, éloignés des institutions plus classiques et particulièrement démunis sur le plan social, en fondant leur action sur un principe de prévention globale de la toxicomanie et de la marginalisation ;
- les services de prévention des organismes d'assurance maladie ainsi que ceux des mutuelles ;
- des associations locales souvent rattachées à des organisations « têtes de réseau » (Association nationale des intervenants en toxicomanie -ANIT-, Association nationale pour la prévention de l'alcoolisme -ANPA-, associations intervenant en milieu festif, telle que Médecins du monde...).
Outre le fait, déjà évoqué, que cette multiplicité d'acteurs ne s'inscrit dans aucune stratégie globale de prévention en matière de santé et que les interventions se font donc la plupart du temps sans coordination, il apparaît surtout que les différents dispositifs mis en oeuvre, notamment au niveau local, souffrent d'une insuffisante envergure et d'un manque de moyens matériels, humains et financiers.
Interrogé à ce sujet par la commission, le professeur Lucien Abenhaïm, directeur général de la santé, a déclaré que « très clairement, notre pays souffre d'un manque de moyens de prévention de santé publique au niveau local » , indiquant que « les actions sur le terrain sont très faibles, quelques millions d'euros chaque année, pour l'ensemble du pays ». Les données financières du dispositif santé en matière de prévention de la toxicomanie sont d'ailleurs difficilement identifiables en raison de l'empilement des structures et du nombre importants de financements croisés.
Par ailleurs, il n'existe pas de réel suivi des différents dispositifs mis en place ni d'instruments permettant d'évaluer l'impact de leurs actions en matière de prévention. Le docteur Abenhaïm a particulièrement insisté sur ce point en soulignant que « notre pays souffre très clairement d'un manque de moyens important dans le domaine de l'évaluation ». En effet, la France ne possède pas ou presque de formation dans ce domaine (existe une seule école de santé publique, certes de haut niveau, mais de très petite taille), contrairement aux pays anglo-saxons. Très fréquemment, les institutions publiques souhaitant lancer des programmes d'évaluation sont contraintes de faire appel à des structures privées qui sont toujours les mêmes et le plus souvent débordées.
4. Le dispositif Sécurité routière : des carences en partie provisoires ?
Les dangers de la drogue au volant n'ont pas donné lieu jusqu'à présent à des actions spécifiques de communication au titre de la sécurité routière, ce que le ministère explique par la difficulté encore récente à obtenir des experts une position unanime et claire sur le sujet. Cette attitude pourrait toutefois se trouver modifiée lorsque sera achevée et rendue publique l'étude épidémiologique initiée concomitamment à l'adoption de la loi Gayssot du 18 juin 1999 et menée par l'OFDT 99 ( * ) , qui recense et analyse tous les cas de dépistage de stupéfiants effectués chez des conducteurs de véhicules automobiles impliqués dans des accidents mortels de la circulation, et dont les premiers résultats seront disponibles à la fin de cette années.
Le Conseil national de la sécurité routière, qui ne s'est réuni il est vrai qu'à trois reprises depuis sa création en octobre 2001, et le Comité interministériel à la sécurité routière n'ont pas ajouté de mesures ou d'observations particulières en ce qui concerne la conduite sous l'influence de stupéfiants, compte tenu des dispositions récentes de la loi dite Dell'Agnola du 3 février 2003 100 ( * ) en la matière.
La Délégation interministérielle à la sécurité routière a néanmoins suscité diverses initiatives ayant pour thème la drogue au volant. On peut ainsi citer le livre blanc de 1996 sur la sécurité routière, les drogues licites ou illicites et les médicaments, ainsi que le rapport de l'Institut national de recherche et d'étude sur les transports et la sécurité (INRETS) de juillet 2002 sur la conduite automobile, les drogues et le risque routier.
Si la faiblesse des actions de prévention concernant la conduite sous l'influence de stupéfiants devrait se résorber lorsque le dispositif normatif et scientifique l'encadrant aura été totalement finalisé, reste le problème important du thème des stupéfiants dans la formation aux permis de conduire. Le programme national de formation à la conduite stipule que les élèves conducteurs doivent avoir des « notions sur d'autres intoxications que l'alcool telles que : tabac, drogues, médicaments ». Cette mention ne semble toutefois déboucher que sur peu de résultats pratiques, les notions relatives aux produits psychoactifs n'étant que très accessoirement abordées dans la formation des apprentis conducteurs.
Enfin, constitue un sujet de préoccupation l'usage par les conducteurs automobiles de médicaments ayant des effets psychoactifs , qui n'entre pas dans le champ du dispositif législatif, alors que ses effets peuvent être redoutables en termes de sécurité routière, et dont la réglementation semble inadaptée. Cette dernière prescrit en effet aux fabricants de médicaments d'indiquer clairement sur ceux de leurs produits ayant des effets psychoactifs avérés les dangers qui y sont liés en termes de conduite d'un véhicule. Or, l'un des intervenants auditionnés par la commission a remarqué que cette mesure était inefficace en pratique dans la mesure où les fabricants de médicaments ont, par précaution, porté systématiquement une telle indication sur l'étiquette de leurs produits.
5. L'éducation nationale : la grande absente de la prévention
Si chacun des grands acteurs institutionnels de prévention en matière de drogues connaît des insuffisances, c'est sans doute l'éducation nationale qui en présente le plus, au regard notamment des attentes importantes pesant légitimement sur elle en ce domaine. Une grande unanimité s'est dégagée chez l'ensemble des personnalités auditionnées pour constater les lourdes carences du ministère en matière de prévention de la toxicomanie, face au développement préoccupant du problème des drogues en milieu scolaire.
D'une façon générale, l'OFDT indique dans son rapport d'évaluation sur le plan triennal 1999-2002 de la MILDT que « selon des informations parcellaires mais concordantes, l'éducation pour la santé dans les établissements scolaires n'a pas particulièrement pris son envol au cours du plan triennal et les actions de prévention globalisantes sur les substances psychoactives y sont restées minoritaires, liées à des initiatives quasi individuelles ».
Cette carence apparaît particulièrement inacceptable dans la mesure où l'école est devenue aujourd'hui incontournable dans la thématique des dépendances aux drogues , d'une part en ce qu'elle constitue l'un des lieux les plus concernés par l'usage et le trafic de produits stupéfiants, et d'autre part en ce que les populations qui la fréquentent devraient constituer un public prioritaire pour des actions de prévention.
a) Une présence très importante des drogues dans les établissements scolaires ayant des effets nocifs sur les élèves
(1) La consommation et le trafic de drogues à l'école : un secret de polichinelle
La drogue, ce n'est un secret pour personne, circule et est consommée dans les établissements scolaires, que ce soit dans les collèges ou les lycées, et même parfois dans les écoles primaires. Ainsi, a indiqué devant la commission Mme Lucile Rabiller, membre conseiller de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, « la consommation est importante, même à l'intérieur des établissements scolaires. Elle concerne les enfants de plus en plus jeune et l'achat de ces produits est extrêmement facile (...). Quand on interroge les enfants et les copains ou les jeunes que l'on connaît sur la présence de drogues dans les lycées, ils répondent généralement que c'est une réalité et une banalité étonnantes et que, dans les cours des lycées, on roule des pétards à la récréation ».
Mme Marie-Christine d'Welles, fondatrice de l'association Enfance sans drogue et présidente de l'Observatoire de la psychiatrie, a également, dans une forme il est vrai excessive, attiré l'attention de la commission sur l'importance du problème des drogues à l'école, déclarant que « la drogue est partout, dans les collèges et les lycées, et les enfants en sont envahis », ajoutant qu'« il suffit de tendre la main pour s'en procurer ». Elle a expliqué que le commissaire de police de Meudon lui avait indiqué estimer « à 70 % ceux qui touchent à la drogue dans les établissements scolaires ».
On rappellera à cet égard les chiffres déjà évoqués sur la prévalence des drogues auprès des jeunes. Tous produits (licites et illicites) confondus, il apparaît selon l'enquête Espad que la quasi totalité (92 %) des jeunes a consommé une substance durant sa vie. En ce qui concerne les drogues licites, la majorité des élèves âgés de 14 à 19 ans a pris de l'alcool (86 %) ou du tabac (78 %). Par ailleurs, un nombre important d'élèves (35 %) a déjà expérimenté à la fois le tabac, l'alcool et le cannabis.
En ce qui concerne les drogues illicites, c'est évidemment le cannabis qui arrive en tête : un lycéen sur trois avoue en avoir essayé et 15 % en consomme régulièrement, une majorité le considérant comme moins dangereux que le tabac ou l'alcool. Quant aux autres substances illicites, certaines sont essayées par plus de 10 % des élèves (tranquillisants ou somnifères hors prescription médicale et produits à inhaler), d'autres par moins de 5 % (par ordre d'importance : champignons hallucinogènes, ecstasy, amphétamines, cocaïne, crack, LSD, héroïne, stéroïdes anabolisants).
Quant au trafic, 741 dealers ont été arrêtés en 2002 dans les établissements scolaires, chiffre ne représentant en réalité qu'une infime partie de ceux pratiquant de telles activités en milieu scolaire . « Les dealers sont dans les cours elles-mêmes », a indiqué à cet égard Mme Edwige Antier, pédiatre, lors de son audition. « Tous les jeunes avec lesquels je parle », a t-elle ajouté, « me disent que le cannabis se vend à l'intérieur de l'établissement scolaire, dans la cour, et qu'on leur en propose ».
L'usage et le trafic se répandent dans tous les types d'établissements, « qu'ils soient classés en zone sensible, que ce soient des établissements chics de centre-ville ou des établissements ordinaires », et se développe « dans tous les milieux », a indiqué Mme Rabiller, ce qu'a confirmé M. Faride Hamana, secrétaire général de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) en soulignant qu'« aucun collège et aucun lycée ne sont épargnés » et que « tous les milieux sociaux sont concernés ».
(2) Les élèves : des cibles particulièrement vulnérables
La fragilité physique et psychique des jeunes adolescents rend souvent désastreuse la consommation de produits stupéfiants, tant sur leur santé, problème déjà évoqué, que sur leurs résultats scolaires. M. Michel Bouchet, chef de la MILAD, a ainsi rapporté devant la commission que « ce sont parfois près de 10 % des élèves ou plus, appartenant aux dernières classes du secondaire, qui ont une consommation intensive pouvant aller jusqu'à de nombreuses prises journalières et entraînant chez eux des pertes mnésiques et de motivation, susceptibles de les conduire à un échec scolaire qui (...) sera l'antichambre de l'exclusion ».
M. Bouchet a indiqué que les policiers spécialisés dans la prévention en milieu scolaire se voyaient souvent expliquer par les enseignants qu'ils reconnaissent les élèves « qui prennent du cannabis parce qu'ils se fichent de tout » et ceux « qui ont pris de l'ecstasy pendant le week-end parce qu'ils ne commencent à émerger qu'à partir du mercredi ou du jeudi ». Il a ajouté que le coût qu'implique une forte consommation (dépenses mensuelles souvent supérieures à 400 euros) « constitue, à lui seul, une des explications de la violence que connaît la vie scolaire (racket, recels et trafics divers) ».
Le lien entre consommation de drogues, notamment de cannabis, et échec scolaire, semble bien établi aujourd'hui . Le ministère de l'éducation nationale rapporte en ce sens que les élèves ayant de mauvais résultats scolaires sont nettement plus nombreux que les « bons » ou les « moyens » à consommer régulièrement du tabac, de l'alcool ou du cannabis. Il indique par ailleurs que les jeunes qui n'aiment pas l'école sont nettement plus nombreux que les autres à consommer régulièrement, quel que soit le produit envisagé. Quant à l'absentéisme scolaire, les élèves concernés sont nettement plus nombreux que les autres à consommer régulièrement des produits stupéfiants, la relation étant surtout marquée avec le tabagisme régulier et la consommation régulière de cannabis.
Mme Edwige Antier a insisté devant la commission sur cette relation entre consommation de cannabis et échec scolaire, qui selon elle « saute aux yeux », en l'expliquant de la façon suivante : « À partir du moment où l'enfant entre au collège et se sent en difficulté, il aura plus tendance à être en révolte, à transgresser et donc à fumer des joints ; de plus, quand il fume, (...) il se lève tard, il n'a plus ses facultés de concentration et ses résultats baissent. Dans les deux sens, c'est donc absolument évident ».
b) Des instruments de prévention rares, sous-utilisés et inefficaces
(1) Les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) : des structures de papier
Initiés en 1990 en tant que comités d'environnement social, les CESC 101 ( * ) devaient constituer la structure centrale initiant et fédérant l'ensemble des actions de prévention menées dans les écoles et établissements scolaires publics, primaires comme secondaires, d'enseignement général comme d'enseignement professionnel. A cet effet, ils regroupent l'ensemble des intervenants concernés, qu'ils ressortissent de l'établissement scolaire (équipe de direction, enseignants, élèves, surveillants, médecins et infirmières scolaires ...) ou qu'ils lui soient extérieurs (parents d'élèves, policiers, gendarmes, magistrats, responsables d'associations ...). Cofinancés par la MILDT et l'éducation nationale depuis 1995, les CESC s'inscrivent dans le cadre des projets d'établissement et fonctionnent souvent en réseaux.
Ils ont pour objectif d'adopter une approche globale des difficultés rencontrées par les jeunes. Si la prévention de la violence constitue à ce titre leur premier axe d'orientation, la prévention des dépendances et des conduites à risques constitue le second axe prioritaire défini par les académies, les autres axes présentant chacun des aspects rattachables au problème des drogues (assurer le suivi des jeunes dans et hors l'école, aider les élèves souffrant de mal-être, renforcer les liens avec les familles, soutenir les acteurs de la lutte contre l'exclusion).
Si leur mise en place par le chef d'établissement n'est pas formellement obligatoire, la très grande majorité des établissements s'en est aujourd'hui dotée (selon les chiffres du ministère de l'éducation nationale, presque les trois-quarts des établissements du second degré en posséderaient en 2002), même si subsistent de grandes disparités entre les académies (le nombre d'établissements dotés d'un CESC se situant dans une fourchette allant de 43 % à 100 %).
Si les CESC réunissaient donc « sur le papier » tous les critères pour devenir les « fers de lance » de la prévention des risques addictifs en milieu scolaire, force est de constater qu'il en a été fort différemment dans la pratique . Mme Lucile Rabiller a ainsi déclaré à la commission que ces comités « n'existent trop souvent que sur le papier » et que « même quand ils ont été mis en place, ils ont très peu fonctionné ». Le docteur Léon Hovnanian a fait un constat similaire en déplorant que « la majorité d'entre eux n'existe que sur les statistiques ministérielles ».
De nombreuses raisons, répertoriées et développées dans un récent rapport parlementaire de mission 102 ( * ) , expliquent cette stérilité des CESC, quel que soit d'ailleurs le domaine d'action considéré. La plus importante est sans doute la faible, voire inexistante implication des acteurs a priori les plus concernés : enseignants, élèves et parents. Si le rapport se félicite de la forte implication des non enseignants (chefs d'établissements, conseillers principaux d'éducation, médecins, infirmières et assistantes sociales), il déplore en revanche le peu d'implication des enseignants, tout en reconnaissant qu'elle provient en grande partie de leur lassitude de s'être souvent fortement engagé de façon bénévole (la présence dans les CESC n'est ni obligatoire, ni rémunérée, ni intégrée dans le temps de travail) lors de la constitution des comités sans avoir perçu de résultats ni de reconnaissance en retour.
Plus encore que les enseignants, élèves et parents désertent les CESC : les premiers percevraient cette structure comme excessivement technocratique et éloignée de leurs préoccupations concrètes ; quant aux seconds, leur évitement des CESC ne serait qu'un révélateur supplémentaire de leur défiance à l'encontre de l'institution scolaire.
Si cette absence de participation de trois de leurs acteurs clefs décrédibilise dès l'origine leur action, les CESC souffrent également d'autres limites. Les premières sont liées aux rapports entre la MILDT et l'éducation nationale à travers eux : la seconde s'est déchargée de sa mission de prévention des dépendances en la déléguant à une structure externe à son administration qui risquerait de la « satelliser » ; les messages des deux structures ne se recoupent pas totalement (préventif pour l'une, éducatif pour l'autre) et provoquent des tensions dans la définition des approches à retenir ; existe une autocensure des projets élaborés dans les CESC pour obtenir la validation et surtout le financement de la MILDT ; l'articulation entre le niveau départemental des chefs de projet et le niveau académique des coordonnateurs de CESC se fait très difficilement ...
Les secondes limites des CESC les concernent plus spécifiquement : ils sont très rapidement dépassés et ne peuvent faire face lorsque les problèmes de dépendance ou de violence deviennent trop intenses ; ils n'ont aucun moyen de contact avec les jeunes en marge du système scolaire ou ayant quitté l'école ; ils ne possèdent que très rarement des indicateurs permettant d'évaluer l'impact des actions qu'ils mènent ; leur création est souvent interprétée comme révélatrice de problèmes sociaux et peut donc stigmatiser les établissements les accueillant...
(2) La diffusion de publications sur les conduites addictives au contenu discutable
Depuis 1999, la direction de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale a diffusé, en partenariat avec la MILDT, une nouvelle collection de guides destinés à la communauté indicative intitulée « Repères pour la prévention des conduites à risques dans les établissements scolaires » et « Repères pour la prévention des conduites à risques à l'école élémentaire ».
Par ailleurs, et toujours en partenariat avec la MILDT, l'éducation nationale a publié en novembre 1999 deux Bulletins officiels hors-série intitulés « Repères pour la prévention des conduites à risques », l'un constituant un guide pratique et l'autre un guide théorique.
Or, ces différentes publications, outre le fait qu'elles sont d'un abord formel parfois peu accessibles, se réfèrent exclusivement à la « philosophie » développée par la MILDT et déjà largement évoquée. « Bien plus que les caractéristiques intrinsèques de chaque produit » , indique l'ancienne présidente de la MILDT, Mme Nicole Maestracci, dans l'un des guides, « c'est le mode d'usage, le comportement de chaque individu, sa vulnérabilité propre, ses motivations à consommer, les conduites à risque associées, qui vont déterminer le risque et le danger ». Mme Maestracci préconise de ce fait « des programmes fondés sur les motivations à consommer qui distinguent l'usage, l'usage nocif et la dépendance ».
Allant plus loin dans cette direction, l'un des B.O. invite à conduire une réflexion avec les adolescents « sur ce qui relève d'une prise de risque acceptable » et insiste sur la nécessité d'intervenir en cas de conduite addictive « tout en permettant les expérimentations nouvelles à cet âge en en valorisant les qualités, et en y reconnaissant les signes de la fin de l'enfance », ce qu'il qualifie de « paradoxe à mille lieues des stigmatisations uniquement négatives ou des surdités et aveuglements reflétant nos incapacités à les reconnaître ».
« En ne proposant pas de prises de risques aux adolescents » poursuit le bulletin, en ne leur octroyant pas de valeur ajoutée en terme de reconnaissance (...), nous risquerions d'être des incitateurs à la prise de risques et de conduire les mineurs à des dangers plus grands ».
Autrement dit, et traduit du jargon inimitable de la rue de Grenelle, si beaucoup de risque rapproche du danger, un peu en éloigne !...
Après avoir précisé que le cannabis n'est pas neurotoxique et représente moins de risques que l'héroïne, l'alcool ou le tabac, et recensé les divers produits psychoactifs en passant sans autre précision de la cocaïne et de l'héroïne aux infusions et médicaments à base de plantes, le Bulletin officiel indique par ailleurs avec quelque provocation que « ce qui est interdit correspond à ce qu'à une époque donnée, une société juge dangereux, quoi que certains en pensent. La loi est le reflet de ce que les représentants des citoyens estiment nécessaire d'interdire. Si on l'estime inadéquate, il est possible, en démocratie, de saisir son député, de voter, et pourquoi pas de chercher à la changer en se faisant élire député ».
De là à inciter à la dépénalisation des drogues, il n'y a qu'un (petit) pas...
(3) Une formation inexistante des personnels
A quelques nuances près selon la nature des fonctions (les personnels de santé scolaire, les professeurs de sciences de la vie et de la terre), la plupart des personnels intervenant en milieu scolaire souffre d'un déficit chronique de connaissances sur les problèmes de drogues et les conduites à risques.
« Pour être intervenue personnellement dans un établissement où la drogue existait », a rapporté devant la commission Mme Rabiller, « je peux vous dire que les conseillers principaux d'éducation, les proviseurs et autres ne connaissent pas bien le sujet. De ce fait, ils évitent d'en parler ou, quand on leur en parle, ils ne répondent pas ou ils disent que cela n'existe pas. Il faut donc prendre en compte cette méconnaissance ».
Afin d'améliorer le niveau de connaissance des intervenants concernés, la MILDT et l'éducation nationale ont organisé plusieurs séminaires destinés aux personnels de service social, médical et infirmier ainsi qu'aux personnels d'inspection, de direction, d'éducation et d'enseignement. Ont ainsi eu lieu plusieurs stages inter académiques en 1998 et en 2000 ainsi que des Rencontres éducatives sur la santé en 2001. Cependant, ces cessions de formation semblent avoir posé plus de problèmes qu'elles n'en ont résolus.
Le bilan des stages inter académiques traduit le regret des stagiaires de ne pas avoir approfondi certains points pourtant cruciaux, tels que l'acquisition d'une culture commune par des personnels appartenant à toutes les catégories de l'éducation nationale (ce qui constituait tout de même l'axe prioritaire du programme triennal en matière de communication), la lisibilité de la politique de prévention, l'appropriation d'outils adaptés ou l'enrichissement des connaissances à travers des contributions d'experts.
Quant aux Rencontres éducatives pour la santé , elles ont fait apparaître la fréquente méconnaissance de la circulaire de 1998 les instituant 103 ( * ) et le fait que la notion même de rencontres éducatives semble peu, voire pas du tout intégrée par les personnels de l'éducation nationale dans leur ensemble.
Ont par ailleurs été mis en place des séminaires nationaux de formation interministérielle en 2000, 2001 et 2003, qui apparaissent également d'une ampleur limitée : rares (une à deux fois par an), courts (deux ou trois jours chacun), ouverts à un public restreint (100 à 200 personnes pour tout le territoire national) et surtout destinés uniquement aux responsables interministériels aux niveaux national et local.
Enfin, et c'est sûrement le point le plus préoccupant, le ministère reconnaît lui-même que « peu de formations ont été assurées dans les académies dans le cadre du plan d'aide à la formation en direction des enseignants », aucun exemple n'étant par ailleurs cité. Si des efforts ont été fournis au niveau interministériel, avec toutefois les limites importantes précédemment évoquées, il semble donc qu'il n'y ait rien de fait, ou presque, en termes de formation à l'attention du corps enseignant . Carence d'autant plus préoccupante que c'est à certains de ses membres que revient, ou plutôt que devrait revenir la responsabilité d'assurer sur le terrain l'éducation des élèves aux risques d'addiction.
Cette quasi inexistence de programmes de formation continue consacrés aux problèmes des drogues et de la prévention des conduites à risques dans leur ensemble n'est nullement compensée par l'introduction de modules y faisant référence dans les écoles de formation des enseignants. « En ce qui concerne les IUFM », a reconnu devant la commission le ministre délégué à l'enseignement scolaire M. Xavier Darcos, « il est vrai qu'il n'y a pas de formation systématique à toutes ces questions pour la bonne raison que les IUFM sont généralistes et qu'il n'est pas certain que nos futurs professeurs se retrouveront dans des situations d'avoir à en connaître finalement ». Bien que le pire ne soit jamais certain, il n'est pas excessif de voir dans ces propos un certain excès d'optimisme.
(4) Un dispositif de prévention sanitaire et social inadapté en raison de la faiblesse de ses moyens
Si le personnel soignant des établissements scolaires aurait, par la nature même de ses activités et de sa formation, naturellement compétence pour intervenir dans le domaine des conduites à risque, tant en ce qui concerne la prise en charge sanitaire que la prévention de ce type de conduites, son investissement en ce domaine semble loin d'être celui que l'on pourrait légitimement escompter.
Cette carence est plus généralement liée au manque de moyens dont souffre la médecine scolaire dans son ensemble. La réduction des postes de médecins scolaires et le nombre notoirement insuffisant d'infirmières scolaires par établissement rendent en effet nécessaire un appel croissant à des vacations extérieures, les personnels soignants n'ayant plus assez de temps ni de moyens à consacrer à la prévention et à la prise en charge des conduites à risque.
C'est ainsi qu'un élève n'aura au mieux que trois contacts avec la médecine scolaire, au cours de la période de scolarité obligatoire, dans le cadre des examens de santé en principe obligatoires (sauf s'il est amené à consulter à d'autres reprises pour des motifs de santé personnels). Ces rencontres aussi brèves qu'épisodiques ne peuvent naturellement pas constituer le support d'actions d'information sur les dangers encourus en cas d'usage de drogues.
c) Des enseignants peu concernés
Sans aller jusqu'à considérer comme révélateurs les cas, certes rares mais néanmoins existants, d'enseignants convaincus d'usage de substances illicites au vu, voire en compagnie de leurs élèves, il est légitime de se demander si, pour des raisons liées à l'histoire contemporaine (mai 68 notamment), une certaine partie de la communauté éducative ne ferait pas preuve d'une complaisance implicite, ou d'une indifférence rapidement interprétée dans le même sens par les élèves, à l'égard de la consommation des drogues dites « douces », et notamment du cannabis.
C'est ce que semble sous-entendre le Bulletin officiel de l'éducation nationale consacré à la prévention des conduites à risques. Exposant le cas d'un lycée « de bonne réputation » où la consommation et le trafic de drogues se sont multipliés, il explique que la réaction des personnels enseignants les divise en trois groupes : le premier réclame avec véhémence une réponse policière immédiate et musclée, le deuxième ne s'estime pas concerné par un problème qu'il considère comme relevant des parents et de la société et le troisième refuse toute attitude répressive au motif que « la faute n'est pas si grave que cela » et que « le haschisch est un élément de la culture des jeunes d'aujourd'hui, le tabac ou l'alcool (étant) bien plus nuisibles ».
Interrogé sur ce point par la commission, le ministre de l'éducation nationale, M. Luc Ferry, ne s'est pas prononcé de façon catégorique. Il a néanmoins reconnu que « pour dire les choses très franchement », il n'avait « jamais entendu parler de cannabis ou d'herbe (dans les établissements scolaires) avant 1968 », analysant cette époque comme ayant paradoxalement « livré les individus à l'univers de la consommation et à l'univers marchand » dont la forme paroxystique résiderait dans l'usage de drogues, « quintessence de la logique de la consommation (...) puisque c'est la consommation à l'état pur ».
De la même façon, tout en précisant qu'il ne fallait pas généraliser « pour ce qui est des mentalités profondes de nos enseignants face à la consommation de cannabis en particulier », le ministre délégué à l'enseignement scolaire, M. Xavier Darcos, a reconnu devant la commission que « toute une génération d'enseignants est arrivée (...) dans les années 1970 » et que « de ce point de vue (...), il y a eu une imprégnation mentale un peu de cette époque ». Indiquant que cette génération d'enseignants partirait à la retraite dans les prochaines années, M. Darcos a précisé que ce « renouvellement qui se dessine (...) permettra de faire évoluer les mentalités » en recrutant « des jeunes gens, de futurs professeurs qui auront une mentalité (...) beaucoup plus consciente de l'évolution récente des évènements ».
Au total, la commission d'enquête estime que l'attitude de l'éducation nationale à l'égard des drogues résulte plus du système que des personnels enseignants eux-mêmes.
d) Des actions de prévention « sous-traitées » aux acteurs extra scolaires
En l'absence de modèle de dispositif de prévention s'imposant à l'ensemble des établissements, les actions préventives sont laissées aux initiatives locales des équipes administratives et pédagogiques . Or, celles-ci se sentant globalement peu concernées par le problème de la prévention des conduites à risques, elles ont très fortement tendance à en sous-traiter la gestion à des intervenants extérieurs au milieu scolaire, qu'ils soient institutionnels ou associatifs.
Dans le guide « Repères » consacré à la lutte contre la drogue et à la prévention des dépendances en milieu scolaire, l'ancienne présidente de la MILDT, Mme Nicole Maestracci, indique très clairement, après avoir souligné que la prévention dans les établissements scolaires ne devait pas se faire « au petit bonheur la chance », qu'aujourd'hui « la majorité des intervenants est issue de la police ou de la gendarmerie », ces deux administrations ayant « occupé un terrain laissé vacant par les autres intervenants, qui n'étaient pas forcément disponibles pour cela ».
Ce constat voilé de démission des personnels enseignants dans la conduite d'actions de prévention pose naturellement « la question de la création de professionnels spécifiquement dédiés à la prévention » reconnaît Mme Maestracci, qui ajoute que « la politique reste très largement fondée sur le volontariat des acteurs, qu'ils soient internes ou externes à l'éducation nationale ». Aussi compétents et méritoires soient les personnels de police et de gendarmerie ou les responsables associatifs amenés à intervenir en milieu scolaire, ils ne constituent pas en effet des professionnels de la prévention dans le domaine des drogues et des conduites à risques, capables d'envisager l'ensemble des problématiques et des enjeux qui y sont liés et de transmettre un message de prévention adapté aux publics adolescents en milieu scolaire.
6. Les parents : des partenaires prioritaires largement oubliés
Trop longtemps l'importance des parents et, plus largement, de la famille a été ignorée dans la démarche de soins envers les jeunes toxicomanes ou même les « simples » usagers. M. Pierre Cardo, député-maire de Chanteloup-les-Vignes, a très longuement insisté sur la démission des structures publiques locales à leur égard. « Nous n'allons plus dans les familles. La présence sociale dans les familles des quartiers difficiles est un voeu pieux et cela fait des années qu'on n'y met plus les pieds » a t-il regretté devant la commission, ajoutant que « vu la distance qui est mise par rapport aux familles, celles-ci n'auront de l'aide que lorsqu'elles connaîtront un gros problème ».
Ce constat n'est pas valable uniquement pour les familles des quartiers difficiles. Interrogée par la commission sur le degré de connaissance général des parents d'élèves en matière de drogues, Mme Lucile Rabiller, membre conseiller de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, a reconnu qu'il était « très faible, d'autant plus que les opinions sont très variables et que ce qu'on entend à droite et à gauche est très contradictoire ». Elle a expliqué que les parents d'enfants utilisant des drogues n'osent pas le plus souvent aborder le sujet avec eux et ne savent pas vers quelles structures se tourner.
Le docteur Edwige Antier, pédiatre, a porté un regard similaire sur l'attitude des parents, indiquant qu'il y avait de leur part « un déni pendant des mois et des mois, voire pendant des années ». Elle a expliqué que le jeune adolescent commence souvent par fumer des cigarettes, « auquel cas les parents considèrent qu'ils n'y peuvent rien (...) et ils passent des compromis », avant d'expérimenter le cannabis dont il camoufle la fumée en mettant des baguettes d'encens dans sa chambre, les parents faisant semblant de ne pas s'en apercevoir de peur de ne savoir quoi faire ou bien banalisant l'acte.
Mme Nadine Poinsot, présidente de l'association Marilou, a renchéri en ce sens en regrettant devant la commission « la démission de certains parents qui ne savent plus quelle position éducative il faut avoir ». Mme Poinsot l'a expliqué par des facteurs socio-historiques, indiquant qu'« il est possible que ce soient des parents de 1968 qui, eux, ont été éduqués « à la dure », qui n'osent plus reproduire ce schéma certes un peu rigide et qui sont devenus, pour le coup, un peu trop laxistes ».
Le ministre de l'intérieur, M. Nicolas Sarkozy, a reconnu lors de son intervention devant la commission que les parents, « malgré l'importance de leur mission éducative, ont été les grands oubliés des politiques passées », précisant que « le premier acteur de la prévention n'est pas un fonctionnaire, mais un père ou une mère de famille informé, responsable, concerné et qui doit être soutenu par la collectivité si besoin est ».
Il est d'autant plus regrettable que les parents aient été si insuffisamment sensibilisés aux problèmes des drogues que les relations qu'ils entretiennent avec leurs enfants sont souvent, malgré eux, à l'origine des problèmes de dépendance : en effet, si l'on cherche à connaître les raisons de conduites à risques des usagers, dans la plupart des cas, « on tombe sur un problème éducationnel, directement lié à l'ambiance familiale qu'ils ont connue et donc aux parents », a expliqué le docteur Francis Curtet devant la commission, avant d'ajouter qu'« il faut centrer toute la prévention sur les parents, chose que l'on a oublié de faire depuis des années ».
M. Serge Lebigot, président de l'association France sans drogue, a confirmé l'origine souvent familiale des problèmes d'addiction chez les adolescents. Il a ainsi indiqué à la commission avoir constaté « en leur posant la question, que de nombreux jeunes sont souvent sous l'emprise du cannabis du fait de problèmes relationnels. Soit la famille est déstructurée, soit ils n'ont plus aucun contact avec elle, soit l'enfant ne parle plus à son père ou la fille à sa mère ».
Insuffisamment informés, parfois responsables malgré eux des conduites « déviantes » de leurs enfants, les parents sont pourtant les premiers concernés et les plus sensibles aux problèmes de dépendance. « Les parents sont très préoccupés par ces questions », a ainsi déclaré Mme Rabiller à la commission, ajoutant qu'un sondage effectué en août 2001 par l'Observatoire des parents, instrument de mesure de l'opinion mis en place par sa fédération de parents d'élèves, indiquait que sept parents sur dix plaçaient l'usage de la drogue par leur enfant en tête de leurs soucis.
« Pour les parents », a abondé en ce sens M. Farid Hamana, secrétaire général de la FCPE, « la consommation d'alcool, de tabac, de médicaments psychotropes, de cannabis ou d'autres drogues est toujours une source d'inquiétude, car ces produits ont des effets sur la santé à court terme et à long terme de leurs enfants, leur capacité d'attention scolaire, donc de réussite et surtout l'expression d'un malaise qu'il est parfois très difficile des cerner ».
Les parents et, plus largement, la famille constituent donc un terrain de prévention particulièrement réceptif qu'il serait enfin temps de réinvestir.
V. UNE POLITIQUE DE RÉDUCTION DES RISQUES AUJOURD'HUI INADAPTÉE AUX NOUVEAUX MODES DE CONSOMMATION
A. LES IMPASSES DE LA POLITIQUE DE RÉDUCTION DES RISQUES
1. La réduction des risques, fondement de la politique de soins aux toxicomanes
a) La naissance d'un concept
« Trop longtemps (...) la drogue a été perçue avant tout comme un problème d'ordre public. (...) Cependant, chacun a en mémoire que le sida a, dans ce domaine comme dans d'autres, profondément modifié notre perception à tous. Avant 1985, les échecs fréquents du sevrage chez les toxicomanes donnaient aux médecins un sentiment d'impuissance, partagé par les pouvoirs publics. Or, le drame du sida nous a obligés à nous engager dans des actions de réduction des risques pour éviter l'hécatombe . Dès lors, on n'a plus considéré le drogué comme un délinquant, mais comme le maillon de la chaîne de l'épidémie et de la transmission. Nous avons été amenés à proposer des traitements de substitution d'abord, mais aussi de l'infection au VIH et plus récemment des hépatites C. Dès lors, je crois que nous avons quitté les débats idéologiques et que la drogue est devenue un problème de santé publique. »
M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, a rappelé en ces termes, devant la commission, la genèse de la politique de réduction des risques.
A titre liminaire, et au plan sémantique, la commission tient à souligner le caractère politique de ce concept qui apparaît pour beaucoup d'intervenants comme une réalité intangible, alors qu'il ne constitue qu'une modalité annexe du traitement et de la lutte contre la toxicomanie.
Au-delà de l'objectif de santé publique de réduction des risques infectieux, cette politique s'attache à atténuer les autres problèmes sanitaires et sociaux résultant aussi bien de l'usage que de la recherche de drogues.
La politique de réduction des risques répond ainsi à une « philosophie » de prise en charge qui se décline en deux dispositifs complémentaires : la réduction des risques au sens strict du terme et les traitements de substitution.
On rappellera que les crédits d'État consacrés à la politique de réduction des risques s'élevaient à 14,6 millions d'euros en 2002, contre 9,5 millions d'euros en 1997.
b) Le dispositif de réduction des risques au sens strict
La politique de réduction des risques au sens strict repose sur un dispositif visant à faciliter l'accès au matériel d'injection et à diffuser des messages préventifs dans une population à haut risque.
Cette politique a été engagée en 1987 avec le décret de mise en vente libre de seringues en pharmacie, signé par Mme Michèle Barzac, alors ministre de la santé. Le dispositif est aujourd'hui élargi ; il est pour l'essentiel financé par l'État, et de manière complémentaire par l'assurance maladie par le biais du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaire.
Différents acteurs participent au dispositif : les équipes de structures de soins spécialisés, les opérateurs associatifs nationaux (Médecins du Monde, les associations qui gèrent les distributeurs automatiques de seringues et celles qui regroupent des professionnels et des associations d' « autosupport » des usagers tels que ASUD), les opérateurs associatifs locaux, les pharmaciens qui vendent les Stéribox et les médecins généralistes.
• La vente libre de seringues en officine
Le Stéribox pharmaceutique (Stéribox à partir de 1994, puis Stéribox 2 depuis 1999) est vendu à un prix modique (environ un euro) grâce à une subvention de l'État. De 1996 à 1999, les ventes de Stéribox ont régulièrement augmenté jusqu'à atteindre 2,8 millions d'unités. On rappellera que la distribution de préservatifs à prix réduit (50 millions d'unités vendues par an) procède de la même politique.
• Les automates
Les distributeurs automatiques (277 en 2001), accessibles à toute heure, récupèrent les seringues usagées et délivrent des trousses de prévention. Ces trousses sont distribuées gratuitement par des associations subventionnées, dans le cadre de leur action de prévention du VIH ou de la réduction des risques chez les usagers de drogues. Elles contiennent notamment une brochure informative et les numéros verts de sida Info Service et Drogues Info Service.
L'implantation des automates, qui peuvent être financés totalement par l'État, relève de la compétence des maires. Si ces distributeurs sont nécessaires en cas d'urgence, il convient de se demander si un tel système d'échange «passif » peut remplacer un contact direct entre le toxicomane et un pharmacien, un médecin ou une association.
• Les programmes associatifs d'échange « actif » de seringues
Le premier programme de ce type a été mis en place par l'association Médecins du Monde en 1989. M. Jean-Pierre Lhomme, responsable des missions « échange de seringues » et « bus méthadone » de cette association, a indiqué lors de son audition : « Ces programmes d'échanges de seringues participent à la diminution des dommages sur le plan infectieux et conduisent, par l'échange actif entre les équipes de prévention et les usagers de drogue, à un éloignement de la voie intraveineuse. »
D'après l'OFDT 104 ( * ) , plus d'une centaine de ces programmes ont été mis en place dans des lieux fixes (associations, pharmacies) ou mobiles (bus, équipes de rue).
NOMBRE ET TYPE DE DISPOSITIFS DE RÉDUCTION DES RISQUES EN 2001
|
Nombre de programmes d'échange de seringues fonctionnant : |
|
|
- dans des pharmacies |
15 |
|
- dans des structures mobiles |
40 |
|
- dans des structures spécialisées fixes |
41 |
|
Nombre de « lieux de contact » ou boutiques |
42 |
|
Nombre de « sleep'in » |
2 |
|
Nombre de bus méthadone |
2 |
|
Nombre d'équipes de proximité |
4 |
Source : DGS/D6A
• Les boutiques créées en 1993, accueillent les usagers de drogues en situation très précaire : 42 fonctionnaient en 2001. Ces lieux de contact proposent l'échange des seringues, une assistance matérielle (douche, aide alimentaire...), des soins infirmiers et des conseils sociaux et juridiques.
• Les « sleep'in » offrent un hébergement de nuit en urgence pour les toxicomanes en situation de grande précarité ainsi qu'un accès à des consultations sanitaires et sociales. En 2001, on comptait deux structures de ce type de 30 places à Paris et à Marseille, deux autres étant actuellement en cours d'installation dans la capitale et à Lille.
• Le testing est un dispositif mis en place dans les soirées « rave » en particulier, pour tester les pilules d'ecstasy.
M. Jean-Pierre Lhomme a indiqué à la commission : « Il est clair que si ce testing, qui a été tellement critiqué, consiste à dire : « Ceci est bon, ceci est mauvais », ce sera complètement nul ! Cependant, je ne pense pas que l'activité de Médecins du Monde soit celle-là. Tout le travail de nos intervenants consiste à bien expliquer les choses en disant : « Le produit que tu prends a des effets toxiques. » ».
Ce dispositif a laissé la commission perplexe quant au rôle de prévention des équipes de Médecins du Monde et quant au message préventif qui est susceptible d'être délivré dans les « raves ». Le « testing » ne peut en tout état de cause pas être la seule action visible des pouvoirs publics dans les « raves ». Ces lieux sont en effet pour les dealers des « espèces de supermarchés vitrines marketing » , selon les termes utilisés par M. Nicolas Sarkozy, lors de son audition.
La commission ne peut que partager les propos tenus par le ministre qui s'est étonné que « l'on n'ait pas fait une fois un exemple en matière de répression sur une rave party, en faisant descendre l'escadron de gendarmerie nationale pour saisir le stock de drogues s'y trouvant ». En ce domaine, l'action des pouvoirs publics ne saurait se réduire au seul financement des associations qui se bornent à contrôler la qualité des produits vendus.
• Le plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances, adopté pour la période 1999-2001, outre le développement des structures de « première ligne » (sleep'in et boutiques), propose de renforcer les équipes, afin d' « éviter l'épuisement des professionnels et la détérioration des conditions d'accueil » , les acteurs de terrain étant en effet souvent les seuls en mesure de maintenir un lien avec les usagers de drogues actifs les plus réfractaires aux institutions.
Il met également l'accent sur une répartition plus satisfaisante du dispositif sur le territoire national, étant rappelé que 70 villes de plus de 40.000 habitants, sur un total de 160, ne disposaient d'aucun programme en 1999.
Force est de cependant de constater que l'ouverture de ces lieux est souvent mal acceptée par les riverains, réticents au regroupement en un seul lieu de toxicomanes en difficulté et marginalisés. Les équipes de proximité sont ainsi appelées à jouer un rôle de médiateur indispensable entre les riverains, le maire, les services de justice, de police et de santé : cinq équipes ont été créées à ce titre à Marseille, Montpellier et Paris.
c) Les traitements de substitution
« Le coût de l'achat d'héroïne, qui génère de nombreux délits, mais surtout la nécessité de prévenir l'épidémie de sida, ont conduit à la mise en place d'une politique de prévention axée sur la mise à disposition des nouveaux produits » constate le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques 105 ( * ) . Devant la commission, M. Jean-François Mattei a estimé ce choix « parfaitement judicieux » .
On rappellera que les traitements de substitution ont été mis en place progressivement à partir de 1994 et se sont développés de manière considérable en direction des consommateurs d'opiacés.
Si une cinquantaine de consommateurs seulement était prise en charge par substitution en 1995, les derniers chiffres fournis par la DGS à la commission indiquent que « les dernières estimations établies à partir des ventes de Subutex et de méthadone font état de 96.000 (équivalents) patients sous traitement de substitution, soit 13.400 sous méthadone et 83.000 sous Subutex (sous l'hypothèse d'une dose quotidienne de 65 mg/jour de méthadone et de 8 mg/jour de Subutex). Au regard de la hausse de la prescription moyenne constatée par les études de l'assurance maladie, les estimations doivent être revues à la baisse et donneraient un total de 75.000 patients sous traitement de substitution en juillet 2002. Le chiffre réel se situe donc entre 75.000 et 96.000 patients bénéficiant de traitements de substitution. »
Le tableau ci-après récapitule les diverses procédures de prescription de la méthadone et de la buprémorphine, ou Subutex.
LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DES TRAITEMENTS DE SUBSTITUTION EN FRANCE
|
Modalités |
Buprémorphine
|
méthadone |
|
Date d'entrée en vigueur effective |
Début 1996 |
1994 |
|
Critères d'inclusion |
Dépendance aux opiacés évaluée par le praticien |
Dépendance aux opiacés évaluée par le praticien + contrôle urinaire (recherche d'opiacés, hors méthadone) |
|
Prescription |
Initiation et suivi en médecine de ville ou en CSST Primo-prescription et poursuite du traitement en cours possibles en milieu carcéral |
Initiation en CSST puis possibilité de suivi en médecine de ville Primo-prescription possible en milieu carcéral si CSST interne ou externe Poursuite du traitement en milieu carcéral Initiation du traitement en milieu hospitalier envisagée |
|
Durée maximum de la prescription |
28 jours |
14 jours |
|
Posologie |
Recommandation maximum 16 mg/jour mais pas de contrainte |
Recommandation maximum 100 mg/jour mais pas de contrainte |
|
Délivrance |
Délivrance en pharmacie dans tous les cas Délivrance fractionnée par période maximale de 7 jours avec la possibilité pour le médecin de demander que le traitement soit délivré en une seule fois pour une période de 28 jours maximum |
Administration supervisée en CSST ou remise du médicament jusqu'à 14 jours Fractionnement maximal de la délivrance en pharmacie à 7 jours |
|
Contrôles urinaires |
Non prévus |
1 ou 2 fois par semaine pendant les 3 premiers mois puis 2 fois par mois. A l'appréciation du médecin si suivi en ville Toujours réalisé au CSST |
|
Paiement des soins |
Droit commun si suivi en ville |
Gratuité puis droit commun si relais en ville |
Source : DGS
En raison de la relative facilité d'accès au Subutex, un déséquilibre s'est progressivement établi en faveur de ce dernier, qui est utilisé aujourd'hui pour 75 % des traitements de substitution. En effet, la méthadone, moins maniable et présentant un certain risque de surdose létale, ne peut être prescrite la première fois que dans un CSST. Bien que le traitement puisse être poursuivi en médecine de ville, cette possibilité est peu utilisée, de sorte que les patients restent suivis dans les centres au détriment de l'accueil de nouveaux patients. L'expérience des bus méthadone de Médecins du Monde autorise un accès plus aisé et sécurisé au produit, conformément à l'esprit de la politique de réduction des risques et d'aide sanitaire et sociale aux toxicomanes.
|
LES BUS MÉTHADONE Les bus méthadone sont un dispositif de « seuil à exigence adaptée » servant à faciliter l'accès à la méthadone dans le cadre d'une démarche de substitution et de prise en compte des problèmes sociaux. Il en existe un à Paris depuis 1998 et un à Marseille depuis 2000. M. Jean-Pierre Lhomme, responsable de ce dispositif, a ainsi justifié sa création devant la commission : « L'accès à la substitution par la méthadone ne nous semblait pas assez souple, ou le cadre nous semblait parfois trop exigeant au regard des possibilités du moment, pour certains usagers de drogues que nous rencontrions dans notre structure de proximité : le programme d'échange de seringues. Les exigences imposées alors pour l'accès à la substitution par la méthadone semblaient trop fortes à ces usagers rencontrés et la buprémorphine au dosage d'accès plus facile, proposée dans un cadre trop lâche pour ces mêmes usagers, facilitait chez eux les mésusages bien connus : infection, trafic, etc. C'est dans ce sens que le programme de méthadone dans la rue, le programme « bus méthadone » a été imaginé : accès à la méthadone plus rapide dans la journée, délivrance quotidienne sur des lieux précis, avec une équipe pluridisciplinaire, un cadrage précis et des règles de fonctionnement claires. » Ce dispositif itinérant vise donc à susciter la demande en allant au devant des usagers, afin de faciliter l'accès aux circuits thérapeutiques et sociaux pour un public fortement marginalisé. D'après les indications fournies à la commission, entre 100 et 120 usagers de drogues y ont recours chaque jour. |
On rappellera également que le plan triennal de 1999 a cherché à réduire les disparités entre les deux produits en termes de durée et de modalités de prescription, de suivi et de délivrance. Les acteurs concernés ont ainsi été invités à réexaminer les protocoles d'application respectifs pour définir des orientations plus adaptées.
Depuis l'arrêté du 20 septembre 1999, relatif à l'application de la réglementation des stupéfiants à certains médicaments à base de buprémorphine, la délivrance maximale de cette dernière a été fractionnée par périodes maximales de sept jours avec la possibilité, pour le médecin, en cas de nécessité, de demander que le traitement soit délivré en une seule fois pour une période de 28 jours maximum. Pour sa part, l'arrêté du 8 février 2000, relatif au fractionnement des médicaments à base de méthadone, fixe l'extension de la durée de prescription de 7 à 14 jours, mais limite à 7 jours sa délivrance en pharmacie.
Force est de constater que le rééquilibrage attendu est pour l'instant resté lettre-morte.
2. Des résultats incontestables en termes de santé publique
a) La réduction des décès par overdose
Outre la diminution des nuisances liées à la consommation de drogue et à des violence qui y sont associées, la politique de réduction des risques a permis une indéniable amélioration de l'état sanitaire de la population toxicomane . L'effet le plus visible des traitements de substitution a d'abord été la diminution sensible du nombre de décès par overdose , ainsi que l'a souligné M. Jean-François Mattei, lors de son audition : « Probable conséquence du développement important de la substitution, les surdoses mortelles ont chuté de 75 % entre 1995 et 1999. Elles sont actuellement stabilisées aux alentours de 120 par an ».
Dans le même sens, M. Jean-Pierre Lhomme s'est également félicité des résultats de cette politique devant la commission : « Les impacts de traitements de substitution se mesures à la réalité des chiffres. On note à cet égard que le nombre d'overdoses a diminué de 84 % entre 1995 et 2001 . »
b) Une action à poursuivre contre la transmission du VIH et surtout de l'hépatite C
La politique de réduction des risques a enregistré des résultats positifs en ce qui concerne l'infection par le VIH.
NOUVEAUX CAS DE SIDA DÉCLARÉS CHEZ LES
USAGERS DE DROGUES
ENTRE 1992 ET 2002
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000* |
2001* |
2002* |
|
1 493 |
1 376 |
1 317 |
962 |
423 |
346 |
326 |
244 |
231 |
166 |
* Données redressées Source : DGS
On notera ainsi que la prévalence de l'infection par le VIH chez les usagers de drogue par injection, prise en charge pour la première fois par un CSST en 1999, n'était plus que de 13 %. Ce résultat a été obtenu, d'une part, grâce aux actions de réduction des risques qui ont permis aux toxicomanes de se procurer facilement un matériel stérilisé en limitant les échanges de seringues, et, d'autre part, grâce aux traitements de substitution qui ont permis de réduire de manière importante la consommation par voie intraveineuse.
M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, a ainsi indiqué à la commission : « La transmission du VIH parmi les toxicomanes s'est considérablement ralentie. La prévalence a été divisée par deux entre 1998 et 2002, passant de 40 à 20 %. Plus encourageante encore, une enquête très récente vient de retrouver une prévalence nulle chez les jeunes toxicomanes de moins de 30 ans. C'est donc une preuve éclatante de l'efficacité de la politique qui a été choisie et conduite. »
La commission observe, en revanche, que les résultats sont beaucoup plus mitigés pour l'hépatite C (VHC). Toutes les études montrent en effet que la prévalence du VHC reste élevée parmi les usagers de drogues (entre 50 et 73 %). L'étude la plus récente, bien que circonscrite à la ville de Marseille, situe la prévalence biologique du VHC à 72,6 %, alors que la prévalence du VIH y est de 20 %.
M. Jean-François Mattei en est convenu devant la commission : « Il faut améliorer la prévention de l'hépatite C. La réduction des risques si efficace sur le VIH vient se heurter à ce virus, dix fois plus contagieux et qui survit mieux sur le matériel d'infection. L'hépatite C infecte encore 40 % des toxicomanes de moins de 30 ans, c'est beaucoup trop. Un renforcement des actions de prévention en direction des usagers de drogues est prévu en 2003. (...) Contrairement au VIH, le traitement de personnes infectées par l'hépatite C reste encore insuffisant, en raison des réticences des patients. Il faut, et c'est un point sur lequel mon ministère va s'appliquer, veiller à une meilleure coordination entre le dépistage et la prise en charge thérapeutique dans le cadre des réseaux de soins toxicomanie ville-hôpital. »
Le dispositif actuel de prévention et de soins pour l'hépatite C apparaît ainsi très insuffisant dans le cas des usagers de drogues par voie intraveineuse. Les données fournies par le dispositif de surveillance épidémiologique pour l'hépatite C permettent de connaître depuis 2000 la proportion de toxicomanes parmi les personnes dépistées et prises en charge pour hépatite : en 2001, les usagers de drogue représentaient 36 % des nouvelles personnes dépistées au VHC. Le nombre de nouveaux cas de contamination au VHC chez les usagers de drogue par injection se situe chaque année entre 2.700 et 4.400 d'après les derniers travaux de l'Institut national de veille sanitaire (INVS).
c) Un contrôle sanitaire et social accru des toxicomanes
La politique de réduction des risques a également permis de développer un contrôle sanitaire et social plus efficace des consommateurs de drogues.
M. François Hervé, président de l'Association nationale des intervenants en toxicomanie (ANIT), a ainsi indiqué, lors de son audition: « Ce sont en fait des structures de première ligne qui ont montré leur capacité à aller au-devant des plus exclus et constituent une passerelle vers le soin. Ces structures doivent sortir de leur précarité actuelle pour être reconnues et pleinement intégrées dans le système de soins ».
Les programmes d'échange de seringues permettent d'engager un travail d'éducation sanitaire et donc de prise en charge de leur santé par les toxicomanes , comme l'a indiqué M. Jean-Pierre Lhomme à la commission : « S'il devient évident et naturel de se protéger contre les virus et les bactéries, cette responsabilisation est opérante et il devient alors plus envisageable de se soucier des effets nocifs des produits ou des drogues que l'on consomme et de s'interroger sur son fonctionnement addictif. (...) Cette prise en compte de son corps chez l'usager de drogues est opérante et productive en termes d'entrée dans le soin non seulement sur le plan somatique mais également sur le plan de la toxicomanie. (...) C'est l'intérêt de prendre les gens où ils en sont, dès le début, et même avant, et de procéder de cette manière en leur proposant des modalités d'entrée dans le soin à la mesure de leur intentionnalité de soins. Si on ne propose que la prévention primaire et, de l'autre côté, le sevrage, il est vrai que l'on rate des choses. »
Il a été indiqué à la commission que 42 % des personnes prises en charge dans le cadre des bus méthadone de Médecins du monde engagent pour la première fois par ce biais une démarche de soins. En prenant en compte la dépendance des usagers, la politique de réduction des risques permet en effet d'entrer en contact avec les plus marginalisés et les plus vulnérables et de leur proposer une offre adaptée de soins et de réinsertion.
La politique de substitution, par son mode d'accès organisé et sécurisé au produit, permet aux intéressés de retrouver d'autres motivations que celle de la seule recherche, de reprendre peu à peu une activité sociale et d'engager une démarche de réinsertion. On notera à cet égard que seulement 4 % des usagers pris en charge par les dispositifs de soins sont actuellement sans logement, ce qui constitue un point positif compte tenu de la marginalisation fréquente des toxicomanes.
Cependant, ces progrès non négligeables enregistrés dans la situation sanitaire et sociale des toxicomanes ne doivent pas occulter les dérives et les conséquences négatives d'une politique de substitution qui doit nécessairement s'articuler avec une politique de prévention primaire et de sevrage.
3. Les carences de la politique de réduction des risques et les effets négatifs induits
a) Le Subutex : une utilisation détournée
Le premier effet pervers résulte du déséquilibre déjà évoqué entre la méthadone et le Subutex dans les traitements de substitution. La prescription excessive du Subutex est à l'origine d'un trafic de ce produit et du détournement de son usage . De nombreux interlocuteurs de la commission ont insisté sur ce point, notamment lors de son déplacement à Valenciennes, ce qui l'a conduite à demander des informations complémentaires à la MILDT et à la CNAMTS.
On rappellera que la CNAMTS publie chaque année les résultats de l'exploitation nationale des données issues du codage des médicaments (MEDIC'AM) : les données fournies depuis 1999 révèlent une évolution importante des quantités remboursées (nombre de boîtes) de Subutex (+ 15,4 % entre 1999 et 2000 et + 6,9 % entre 2000 et 2001), sans que ces chiffres se justifient par une augmentation du nombre des toxicomanes.
Le rapport TREND 2002 (non encore publié) fournit des indications sur l'accessibilité au Subutex et à sa disponibilité. Force est de constater que le Subutex est un produit très accessible car on peut l'acquérir aussi bien sur prescription médicale que dans la rue. La vitalité de son marché parallèle peut s'expliquer par une demande soutenue émanant, d'une part d'une population très marginalisée, notamment en situation irrégulière au regard du séjour, qui n'a pas ou ne souhaite pas avoir accès au système de soins ; d'autre part, de personnes insatisfaites du dosage de leur traitement qui s'approvisionnent dans la rue pour le compléter.
Ce marché parallèle est également soutenu par l'offre : une part non négligeable de la population impécunieuse en traitement a tendance à revendre une partie du produit prescrit afin de se procurer d'autres substances ou « d'améliorer l'ordinaire » ; enfin, la facilité pour obtenir une prescription de Subutex auprès de certains médecins tend à favoriser le développement d'un véritable « nomadisme médical ».
Du fait de cette disponibilité croissante, le prix moyen du comprimé de Subutex de 8 mg tend à diminuer sur le marché parallèle : il était de 3,81 euros en 2001 et de 3,25 euros en 2002. Ce prix au marché noir oscille entre 1,5 euro à Paris et en Seine-Saint-Denis et 10 euros à Dijon.
L'importance de ce trafic clandestin, alimenté par les multi-prescriptions, est cependant difficile à évaluer : selon les résultats de la 14 e enquête OPPIDUM réalisée en octobre 2002, le « deal » comme moyen d'obtention du Subutex varie de 1 % pour les patients sous protocole Subutex à 61 % pour les toxicomanes hors protocole. D'autres études ont tenté d'évaluer la proportion de comprimés de Subutex vendus au marché noir : celle de l'INSERM réalisée en 2000 estime que le tiers des comprimés est obtenu sur le marché parallèle.
Les enquêtes OSIAP (ordonnances suspectes indicateurs d'abus possible) menées de 2000 à 2002 indiquent en revanche peu de signalements d'ordonnances falsifiées concernant le Subutex : les prescriptions de Subutex peuvent en effet être obtenues aisément sans falsification des ordonnances (recours à plusieurs prescriptions ou « nomadisme médical », augmentation des posologies prescrites).
On notera par ailleurs que, depuis 1999, les services répressifs signalent les interpellations pour usage et usage-revente de médicaments de substitution. Ces services ont relevé, en 2000, 151 interpellations pour usage ou usage-revente de buprémorphine et 28 interpellations pour la méthadone.
On ajoutera que les formes de « mésusage » et leur fréquence peuvent varier selon les modalités d'utilisation du Subutex :
- usage dans le cadre d'une prescription médicale et d'un protocole de prise en charge ;
- usage en dehors d'une prescription médicale avec acquisition en dehors des pharmacies ;
- usage mixte avec acquisition sur prescription médicale et par achat dans la rue.
Le dispositif TREND mis en place par l'OFDT fournit quelques indications sur le profil des groupes d'usagers de Subutex hors protocole médical et distingue les usagers de stimulants observés en espace festif qui utilisent ce produit pour gérer la « descente », les personnes très précarisées ou en errance, les jeunes et les adolescents, et les usagers qui auraient été initiés au Subutex au cours de leur détention.
L'importance de la consommation s'explique, comme il a été dit, par sa grande disponibilité sur le marché parallèle, la modicité de son prix et ses propriétés (bien-être, analgésie), qui permettent à certains d'affronter des conditions de vie difficiles. L'usage du Subutex en espace festif « techno », semble en augmentation par rapport à 2001, mais reste très marginal et concernerait des toxicomanes précarisés ou sans domicile fixe vivant en milieu urbain.
Outre ce trafic, le Subutex est fréquemment détourné de ses finalités thérapeutiques. Cette question avait été évoquée par le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques 106 ( * ) : « l'utilisation massive du Subutex et de la méthadone pose de nouveaux problèmes lorsqu'elle est prescrite sans être accompagnée d'un projet thérapeutique. Il semblerait que des toxicomanes débutent avec ces produits, cette crainte est réelle mais difficile à quantifier. »
Dans le même sens, la MILDT a indiqué à la commission : « En 2002, dans l'espace urbain, outre la population classique de personnes dépendantes aux opiacés gérant le manque par usage détourné du Subutex, on observe des personnes plutôt jeunes, ayant des conditions de vie précaires, qui deviennent dépendantes aux opiacés en utilisant du Subutex. Il s'agit d'une population hétérogène : errants marginalisés, migrants (Europe de l'Est, Maghreb) en situation très précaire, prisonniers condamnés à de courtes peines. »
Si certains s'engagent dans la toxicomanie en consommant du Subutex, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes, d'autres, déjà toxicomanes, le détournent de sa finalité thérapeutique en l'utilisant par voie intraveineuse, du fait de sa forme galénique. Ce phénomène a notamment été évoqué par le docteur Didier Jayle, président de la MILDT, lors de son audition : « Il se trouve que c'est une minorité mais cela concerne pas mal de personnes, qui ont une espèce d'addiction à l'injection. (...) Très souvent, les comprimés de Subutex sont écrasés, pilés et injectés. Cela peut avoir des effets sanitaires dramatiques et c'est une source de complications inacceptables quand nous sommes dans un processus d'améliorer justement l'état de santé de ces personnes. »
On rappellera que, parmi les personnes prises en charge au sein des structures bas seuil, 60 % utilisent la voie orale et 46 % la voie injectable ; 17 % snifferaient le Subutex et 4 % l'inhaleraient.
Les modalités d'usage varient selon le mode d'obtention du Subutex : l'utilisation de la voie orale domine chez les personnes ayant recours, de manière exclusive ou non, à un médecin pour obtenir le Subutex. Les personnes l'obtenant hors prescription s'injectent, sniffent et fument plus fréquemment le Subutex que celles l'obtenant par prescription. L'injection est particulièrement pratiquée en milieu urbain, notamment par les anciens héroïnomanes. Ceux qui ont recours au « sniff » ont souvent un système veineux fortement détérioré, cet usage semblant également constituer un mode d'administration privilégié par les jeunes primo-usagers. L'injection de comprimés de Subutex, vectrice de contamination, entraîne notamment des risques importants de thromboses veineuses, d'abcès, de phlegmons et de nécroses de la peau liées aux excipients.
Il a été indiqué à la commission que le mode d'administration détournée du Subutex peut s'expliquer par le fait que les méthodes de substitution ne procurent pas de plaisir aux toxicomanes. Ces derniers cherchent donc à obtenir un effet de « défonce », soit en s'injectant les produits au lieu de les ingérer, soit en les absorbant avec d'autres substances psychoactives (alcool et benzodiazépines notamment), ce qui se traduit par une augmentation des polyconsommations comportant du Subutex. Selon l'OCRTIS, la présence de médicaments de substitution est constatée, en produit associé, dans un certain nombre de surdoses (11 avec présence de Subutex, et 11 avec méthadone en 2001).
b) La prévention primaire et le sevrage : deux priorités négligées
Le docteur Didier Jayle, président de la MILDT, a exprimé devant la commission son souci de mettre en place une politique équilibrée à l'égard des drogues : « La politique de réduction des risques a toute sa place, à condition d'être effectivement articulée avec le soin, la prévention et la répression . Le message que je souhaite faire passer devant cette commission est le nécessaire équilibre entre ces quatre axes, qu'ils soient coordonnés et pas l'objet d'un enjouement l'un plus que l'autre. On doit développer des politiques publiques équilibrées. »
Pour sa part, le docteur Francis Curtet, psychiatre, a indiqué à la commission : « On peut aider carrément les enfants à ne pas se droguer du tout ou à quitter complètement la drogue. Si ce n'était pas faisable, je serais d'accord pour qu'on se rabatte sur la réduction des risques au nom de la résignation, en quelque sorte, mais puisqu'on peut mieux faire, je ne vois pas pourquoi on ne s'efforcerait pas d'y arriver. »
La politique de substitution devrait donc privilégier l'objectif de sortie de la dépendance , sans se focaliser sur la seule réduction des risques. A cet égard, lors son déplacement à l'hôpital Saint-Antoine, la commission a pu s'entretenir avec une patiente en cours de sevrage qui était restée sept années sous traitement de substitution.
Devant la commission M. Jean-François Mattei a rappelé que la politique de réduction des risques ne constituait pas une fin en soi : « La politique de réduction des risques était absolument nécessaire et évitait les morts. Elle a d'ailleurs porté ses fruits, a eu de bons résultats. Il faut la maintenir, c'est une priorité. Cependant, cette politique de réduction des risques n'est pas la politique unique ; elle s'insère dans un ensemble dans lequel il doit y avoir une politique forte de prévention des risques de la toxicomanie d'une manière générale. »
La commission tient à rappeler en effet que l'objectif final de la politique de réduction des risques n'est pas seulement de gérer la toxicomanie, mais de faire sortir les toxicomanes de leur dépendance .
B. L'INADAPTATION DES STRUCTURES DE SOINS AUX NOUVEAUX MODES DE CONSOMMATION : UN SYSTÈME COMPLEXE ET DES ACTEURS MULTIPLES
Les orientations actuelles de la politique de soins en matière de lutte contre la toxicomanie résultent, comme il a été vu, de la priorité donnée au cours des années 1990 à la politique de substitution et de réduction des risques.
Le plan du 21 septembre 1993 préconisait ainsi l'amélioration de la prise en charge des usagers de drogues non seulement dans le dispositif spécialisé, mais aussi dans le dispositif général de soins : augmentation du nombre de places d'hébergement, amélioration de la prise en charge à l'hôpital et constitution de réseaux ville-hôpital-toxicomanie associant les professionnels de la ville et de l'hôpital dans la prise en charge des toxicomanes.
La plupart des préconisations énoncées en 1993 seront confirmées et développées par la suite. Le plan du 14 septembre 1995 s'inscrit dans la continuité des grandes lignes du plan précédent, comme d'ailleurs le plan triennal de 1999-2001.
Le système de prise en charge des toxicomanes relève de deux dispositifs distincts : le dispositif socio-sanitaire spécialisé et le dispositif hospitalier de droit commun.
1. Le dispositif socio-sanitaire spécialisé
Depuis 1992, toutes les structures spécialisées de soins aux usagers de drogues illicites, financées sur fonds publics, sont rangées sous le terme générique de centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST), avec ou sans hébergement.
Les CSST sont financés depuis le 1 er janvier 2003 par l'assurance maladie pour une enveloppe globale de 134 millions d'euros. En 2002, ils étaient financés sur le budget de l'État pour un montant de 107 millions d'euros, auxquels s'ajoutaient des financements complémentaires pour un montant de 27 millions d'euros (MILDT et collectivités locales notamment). Pour les années précédentes, la dotation budgétaire allouée est restée stable et était de l'ordre de 100 millions d'euros.
Ces structures de soins en ambulatoire ou avec hébergement, mises en place depuis les années 1970, assurent la prise en charge médico-psychologique et le suivi socio-éducatif des toxicomanes (aide à l'insertion et à la réinsertion). Elles sont gérées pour 60 % d'entre elles par des associations et pour 40 % par des établissements publics de santé.
La mission des CSST est définie par le décret n° 92-590 du 29 juin 1992 : assurer une prise en charge médico-sociale et une prise en charge sociale et éducative (aide à la réinsertion).
Ces centres doivent donc garantir : l'accueil, l'orientation et l'information des toxicomanes et de leur famille ; le sevrage et son accompagnement lorsqu'il est réalisé en milieu hospitalier ; le soutien à l'environnement familial.
Afin de mener à bien ces missions, les centres de soins élaborent un projet thérapeutique pour une durée de cinq ans qui fixe des objectifs thérapeutiques et socio-éducatifs et en précise les modalités de réalisation et d'évaluation.
Le rapport annuel 2002 de l'OFDT rappelle à cet égard que « la note d'orientation du 5 novembre 1998 de la direction générale de la santé prévoit les évolutions à prendre en compte pour réviser les projets des CSST afin de tisser des relations de partenariat avec les professionnels sanitaires et sociaux du dispositif de droit commun, en particulier avec les médecins généralistes ; décloisonner le dispositif spécialisé et le secteur psychiatrique pour mieux prendre en compte les comorbidités psychiatriques ; prendre en compte les polyconsommations et les nouveaux modes d'usage (consommations associées d'alcool, consommation d'ecstasy). »
D'après les réponses fournies à la commission par la DGS, le dispositif spécialisé de soins aux toxicomanes est ainsi constitué par :
- les CSST en ambulatoire : 141 d'entre eux (sur un total de 201) développent une activité de prise en charge avec traitement par la méthadone, les deux tiers d'entre eux étant gérés par des associations, les autres en gestion hospitalière. Ces centres assurent l'accueil et l'orientation de toutes les personnes ayant un problème lié à la dépendance, les consultations médicales, les soins infirmiers, le suivi psychologique et l'accompagnement social et éducatif adapté à chaque situation. Ils proposent également un soutien aux familles, prennent en charge le sevrage en ambulatoire et le suivi du sevrage en milieu hospitalier, ainsi que les traitements de substitution.
Ces centres gèrent, en outre, des permanences décentralisées d'accueil en ambulatoire. Le nombre de ces permanences est passé de 56 en 1998 à 85 en 2001 grâce à une réorganisation de l'offre réalisée par les DDASS en liaison avec la DGS.
Au cours de ses déplacements, la commission s'est rendue au CSST Saint-Germain Pierre Nicolle. Géré par la Croix Rouge, qui en possède les locaux, il est doté de 45 salariés et d'un budget d'environ 300.000 euros, financé pour 90 % par la sécurité sociale, et accessoirement par la MILDT. Le centre a reçu 563 patients en 2002 et a deux types d'activité : la prise en charge ambulatoire et l'hébergement (centre thérapeutique résidentiel de 17 places et appartements thérapeutiques-relais offrant 20 places).
- les centres thérapeutiques résidentiels et communautaires comportant un hébergement collectif, gérés pour l'essentiel par des associations.
Les 47 structures existantes ont pour objet de rétablir l'équilibre personnel et l'insertion sociale de leurs résidents, avec une prise en charge pluridisciplinaire (médecins, infirmiers, psychologues, éducateurs, assistants sociaux...) et une forte implication de l'entourage.
Avant l'introduction des traitements de substitution, ces centres constituaient une étape en aval du sevrage au cours de laquelle le patient s'engageait à ne plus consommer aucun produit.
Ils peuvent aujourd'hui également gérer, comme c'est le cas pour les centres en ambulatoire, des réseaux d'appartements thérapeutiques et des structures d'hébergement de transition ou d'urgence, ou des réseaux de familles d'accueil.
- les appartements thérapeutiques-relais
Réservés aux personnes en grande difficulté sanitaire ou sociale, ils s'inscrivent dans une dynamique de socialisation. Il s'agit de modes d'hébergement permettant aux toxicomanes d'acquérir une plus grande autonomie, tant sur le plan sanitaire que social, pendant la période de sevrage ou de traitement de substitution.
- les structures d'hébergement de transition ou d'urgence
Les 18 petites structures d'hébergement collectif existantes, gérées par les CSST, accueillent les toxicomanes pour des séjours courts d'une à quatre semaines, pendant une période de transition (attente d'un sevrage, sortie de prison...) et comportent un accompagnement socio-éducatif et sanitaire.
- les réseaux de familles d'accueil sont également gérés par les CSST.
L'accueil en famille, pour une durée qui peut aller du week-end à un séjour de neuf mois, vise à prendre en charge de toxicomanes dans un milieu qui leur donne la possibilité d'accéder à l'autonomie et de renouer avec une vie « normale ». Le CSST de rattachement assure parallèlement un suivi médico-social régulier de la personne accueillie au sein de la famille d'accueil.
Aux côtés de ce dispositif spécialisé, la prise en charge des toxicomanes dépendants est également assurée par les établissements hospitaliers.
2. Le dispositif hospitalier de droit commun
La circulaire du 15 juin 1999 relative à l'organisation des soins hospitaliers pour les personnes toxicomanes fixe cinq objectifs en ce domaine : l'amélioration de la prise en charge aux urgences hospitalières ; le développement des possibilités d'hospitalisation pour sevrage, bilan et soins de la toxicomanie ; l'amorce ou la poursuite d'un suivi des problèmes liés à la dépendance (orientation du patient vers les structures adéquates) ; la formation du personnel hospitalier et le développement des outils d'observation de l'activité hospitalière dans ce domaine.
a) Les équipes de liaison en toxicomanie
Cette prise en charge hospitalière s'appuie sur les équipes de liaison en toxicomanie, créées à la suite de la circulaire du 3 avril 1996, dont le personnel pluridisciplinaire a reçu une formation spécifique. Ces équipes sont dotées en 2002 de 157 équivalents temps plein (ETP) médicaux et 404 ETP non médicaux (infirmières, psychologues, assistantes sociales).
Le ministère de la santé élabore actuellement un guide méthodologique d'orientation pour la pratique quotidienne de cette activité transversale en milieu intra et extra-hospitalier qui devrait être diffusé en juin 2003.
Les équipes hospitalières de liaison en addictologie, qui étaient au nombre de 69 en 1999, sont, en 2002, au nombre de 307. Toutes les régions sont dotées d'au moins une équipe de liaison, à l'exception de trois départements: le Lot, le Lot-et-Garonne et la Haute-Corse. Le rôle de ces équipes s'est rapidement développé, notamment avec la circulaire du 8 septembre 2000 relative à l'organisation des soins hospitaliers.
Elles ont bénéficié de crédits spécifiques régionalisés d'un montant global de 5,79 millions d'euros en 2000, de 7,60 millions d'euros en 2001 et de 5,95 millions d'euros en 2002. Ces crédits ont été attribués aux établissements hospitaliers sous la responsabilité des Agences régionales d'hospitalisation (ARH).
b) Les réseaux ville-hôpital-toxicomanie
Afin d'améliorer l'efficacité du dispositif de prise en charge de droit commun des toxicomanes, dont une bonne partie dépend également de la médecine de ville, la circulaire du 3 avril 1996 avait également prévu la création de réseaux ville-hôpital-toxicomanie, financés conjointement par l'assurance maladie et le budget de l'État.
On rappellera que notre pays compte aujourd'hui 53 réseaux toxicomanie ville-hôpital (RTVH) dans 43 départements. La mise en place de ces réseaux a donné un nouvel élan au dispositif de droit commun en permettant un partenariat plus efficace entre l'hôpital et la médecine de ville.
Ces réseaux ont toutefois des problèmes de personnel et de financement qui les empêchent de fonctionner correctement, ainsi que le docteur Dherbecourt l'a souligné lors du déplacement de la commission à Valenciennes : « Il est indispensable de sensibiliser les professionnels libéraux au fonctionnement en réseau. Pour permettre le développement des réseaux, il est également nécessaire de pérenniser leur financement, la quête de subventions épuisant les intervenants. (...) En 1994, un poste de psychiatre a été créé dans le secteur de Valenciennes pour aider les toxicomanes et leur entourage, mais la trésorerie est insuffisante pour le payer depuis 2002. »
La commission ne peut donc que souligner la complexité du système de prise en charge des toxicomanes, du fait de la multiplicité des structures et des acteurs qui le composent. Si des efforts non négligeables ont été faits en termes d'organisation, le système semble éprouver des difficultés pour s'adapter aux nouveaux modes de consommation.
C. LE PLAN TRIENNAL 1999-2001
1. Un bilan mitigé
S'il a suscité des controverses justifiées, le plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention de la dépendance 1999-2001 comporte cependant deux éléments positifs :
- l'accent est désormais mis sur une prise en charge socio-sanitaire précoce centrée davantage sur l'usage nocif (avant que les consommateurs ne deviennent dépendants). L'objectif est donc d'intervenir plus en amont avant d'avoir à prendre en charge les complications et les pathologies associées aux consommations excessives.
La prise en charge précoce de l'usager constitue un véritable progrès, ainsi que l'a exprimé le professeur Philippe-Jean Parquet, président de l'OFDT, devant la commission : « L'ensemble du dispositif sanitaire, social, réglementaire et législatif français avait comme unique référence la dépendance comme figure emblématique du grand alcoolique et du grand héroïnomane. C'est pourquoi j'ai voulu attirer l'attention de chacun sur la notion d'usage nocif, c'est-à-dire sur les personnes qui n'ont pas les critères de la dépendance, qui ne se reconnaissent pas dépendants, qui ne sont pas perçus par les dispositifs sanitaires et par leur environnement comme dépendants, mais qui connaissent néanmoins d'énormes problèmes. »
- une complémentarité est recherchée entre le système de soins de droit commun et le dispositif spécialisé
Suite à la note d'orientation du 5 novembre 1998 de la DGS précitée, qui avait notamment pour objectif de renforcer les partenariats entre les différentes structures de prise en charge des toxicomanes, le plan triennal de 1999-2001 a cherché à accélérer ce mouvement de décloisonnement. Compte tenu de ces nouvelles orientations, le plan triennal a défini un double objectif :
- améliorer l'organisation du dispositif de prise en charge existant afin d'accroître les possibilités d'accueil, de suivi médico-psycho-social et de soins aux toxicomanes, et développer la couverture nationale ;
- donner à l'offre de soins une meilleure cohérence afin que les actions de prévention, de soins et de réinsertion soient mieux articulées et coordonnées.
S'agissant des réseaux et partant du constat que « fondées sur un partenariat qui s'épuise nécessairement avec le temps, les actions de réseaux sont peu formalisées et leurs modalités d'organisation sont très diverses » et qu'il « faut aujourd'hui mieux les structurer et les doter des moyens nécessaires à leur mission » , le plan triennal a permis de « donner un cadre précis aux activités et d'élaborer un cahier des charges pour l'ensemble des réseaux autour de trois grandes fonctions : coordination et animation, formation des professionnels, suivi et évaluation. »
Parallèlement aux mesures prises en faveur du développement des réseaux ville-hôpital-toxicomanie, la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a permis de renforcer et de pérenniser les réseaux de médecins généralistes et a eu des conséquences positives sur l'efficacité de la prise en charge des toxicomanes par la médecine de ville.
Mme Nicole Maestracci, présidente de la MILDT jusqu'au mois d'octobre 2002, a présenté ainsi les objectifs du plan triennal sur cet aspect à la commission : « Nous avons surtout essayé de mettre en place des réseaux de médecins généralistes qui puissent mieux repérer les consommations abusives avant qu'elles deviennent dépendantes, mieux orienter les personnes sur les structures de soins qui existeraient déjà en partie et mieux travailler avec l'hôpital. Dans ce cadre, nous avons créé des équipes de liaison hospitalières pour aider les différents services hospitaliers à prendre en charge les usagers de drogues et d'alcool à l'hôpital. »
La commission notera cependant qu'un premier bilan du plan triennal 107 ( * ) montre que de nombreux médecins généralistes travaillent hors de ces réseaux. Ils sont alors souvent mal armés, faute d'information mais aussi faute de temps, pour repérer et orienter les consommateurs problématiques. Les résultats du plan triennal apparaissent cependant positifs s'agissant de l'amélioration de l'organisation du dispositif de prise en charge des personnes toxicomanes : les réseaux ville-hôpital-toxicomanie et ceux de médecins généralistes ont été renforcés, de même que les liens entre les structures spécialisées et les structures de droit commun. Des progrès restent toutefois à faire sur la question du partenariat entre les différents acteurs, car il est rare qu'un toxicomane ne soit pris en charge que par une seule structure au cours de son parcours de soins et de réinsertion.
En revanche, l'effort porté sur le dispositif spécialisé a été largement insuffisant, notamment en terme de personnel médical, ainsi que l'a reconnu le professeur Lucien Abenhaïm, directeur général de la santé, lors de son audition : « Le personnel médical infirmier nécessaire pour le suivi manque à la fois en termes quantitatifs et qualitatifs. Il reste insuffisant. En moyenne, un centre dispose de 0,6 équivalent temps plein médical et 0,4, c'est pratiquement toujours un psychiatre, et simplement 1,1 équivalent temps plein infirmier, pour un total d'équivalents temps plein de 7. Les autres sont donc des personnels ni médecins ni infirmiers. »
Le bilan du plan triennal apparaît donc mitigé, même s'il apparaît positif pour le dispositif de droit commun et sur la question des structures. En revanche, le plan triennal n'aborde pas de manière satisfaisante le problème de la prise en charge unique de l'addictologie.
2. Le problème général de l'addictologie : l'élargissement aux drogues licites
Mme Nicole Maestracci, ancienne président de la MILDT a indiqué à la commission : « L'une des principales caractéristiques du plan triennal, dont il a été beaucoup question dans la presse et dans le débat public, a été d'élargir le programme du gouvernement à l'alcool, au tabac, aux médicaments psychoactifs et aux substances dopantes , ce qui ne voulait pas dire, bien entendu, que toutes ces substances allaient avoir le même sort, à la fois sur le plan juridique et en termes de soins ou de prévention, mais simplement que c'étaient les mêmes personnes, bien souvent, qui consommaient plusieurs de ces produits en même temps et qu'il était donc nécessaire d'avoir un programme non cloisonné par produit, tout en tenant compte des spécificités, mais aussi des points communs qui sont beaucoup plus nombreux que les spécificités de chacun des produits. »
La commission rappellera que le plan triennal a en effet proposé « un rapprochement progressif des différentes structures traitant des dépendances, (...) précédé d'une réflexion méthodologique sur les aspects communs et les aspects spécifiques aux différentes conduites addictives. »
Le rapprochement des différentes structures de soins à la dépendance à la drogue, l'alcool, et plus difficilement le tabac, a ainsi été mis en oeuvre, tant au niveau de l'hôpital que du dispositif spécialisé. Cet objectif s'est traduit au niveau de l'hôpital par la circulaire du 8 septembre 2000 relative à l'organisation des soins hospitaliers qui prévoit à terme des équipes travaillant dans les domaines de l'alcoologie, de la toxicomanie et de la tabacologie au sein des établissements hospitaliers. Le plan triennal visait ainsi la mise en place « des établissements publics de santé les plus importants, d'une équipe de liaison en addictologie, à savoir une équipe dans chaque hôpital de plus de 200 lits MCO (médecine, chirurgie, obstétrique) et au moins une par département » .
Ce rapprochement a pour objet de centrer les réponses sur la personne et les comportements et non plus uniquement sur les produits . Il vise également à favoriser les coopérations, les échanges de savoir-faire et à mutualiser les moyens et les outils thérapeutiques. L'objectif est donc clair : les établissements de santé doivent s'intégrer dans le dispositif général de prise en charge des dépendances.
S'agissant du dispositif spécialisé, le rapprochement des CSST, des 250 centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA, ou centres d'hygiène alimentaire et alcoologie - CHAA - avant le 1 er janvier 1999) et du dispositif spécialisé en tabacologie, assuré par les centres d'examen de santé de la CNAM, permet d'atteindre progressivement cet objectif.
On rappellera que les centres d'hygiène alimentaire et alcoologie (CCAA) sont financés depuis le 1 er janvier 1999 par l'assurance maladie et bénéficient, en application de la loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, d'une définition précise de leur mission, d'une reconnaissance juridique et d'un financement stable.
D'après le plan triennal, « l'objectif est de disposer d'environ 600 structures capables de répondre, en fonction des spécificités locales, aux besoins des usagers de drogue, d'alcool et de tabac . Il ne s'agit pas de préconiser une modélisation des structures, mais de mieux utiliser des compétences aujourd'hui dispersées en utilisant un cadre administratif et financier unique. »
De nombreux centres de soins et de prévention en addictologie (CSAPA) devaient donc être mis en place. La décision a toutefois été différée par M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, dans l'attente du nouveau plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies . Tout en affirmant devant la commission : « De mon point de vue, l'alcool, le tabac, le cannabis, l'héroïne et les psychotropes sont des substances que je considère comme des drogues qui, à des degrés divers, aliènent la personne humaine » , M. Jean-François Mattei a insisté sur la distinction entre produits licites et illicites et a indiqué à la commission les raisons de sa position : « Nous nous sommes aperçus qu'il y avait des mécanismes communs, d'où l'action de Mme Maestracci au niveau de la MILDT, qui a été de prendre les choses en les globalisant. Bien sûr, personne ne conteste aujourd'hui que ces mécanismes sont communs. En revanche, pourquoi ai-je hésité ? J'ai repris le problème au niveau des consultants, des patients, des usagers. D'une façon générale, l'alcoolique, sauf le polyconsommateur naturellement, n'est pas forcément celui qui prend des psychotropes, le consommateur de cannabis pas forcément celui qui boit de l'alcool à en devenir un éthylique chronique. Les populations ne sont pas les mêmes. J'avais manifesté un doute sur le fait qu'une personne victime de ce que nous appelons l'alcoolisme mondain, mais bien imprégnée quand même, se présentant à une consultation de sevrage, se retrouve dans la même salle d'attente que des jeunes utilisant d'autres drogues. »
Votre commission ne peut que partager ce doute, même si elle mesure les problèmes posés par la dépendance au tabac et à l'alcool. Elle ne peut en conséquence que se féliciter des propos tenus par M. Jean-François Mattei lors de son audition : « Nous allons dans les semaines à venir, soit avant l'été, soit immédiatement à la rentrée pour ce qui concerne le Sénat, devoir discuter de la nouvelle loi de santé publique. (...) La lutte contre la toxicomanie fera l'objet avec la lutte contre le tabac et l'alcool, qui sont deux autres drogues dévastatrices pour la santé, des orientations prioritaires pour les cinq années à venir. »
3. Une prise en charge inadaptée
a) Une faible prise en compte des nouveaux modes de consommation
La principale faiblesse du dispositif de prise en charge à la française réside dans son inadaptation à la nouvelle population toxicomane et aux changements de modes de consommation et de produits utilisés, en particulier dans le dispositif spécialisé.
En effet, les prises en charge dans les structures de soins pour usage de drogues illicites sont, en grande majorité, liées à l'abus ou à la dépendance aux opiacés (dont 85 % pour l'héroïne), alors même que la consommation d'héroïne diminue au sein de la population toxicomane globale. Toutefois, si les opiacés restent très majoritairement à l'origine de la prise en charge, beaucoup d'usagers en contact avec le système de soins le sont au titre des traitements de substitution.
PRODUITS À L'ORIGINE DE LA PRISE EN CHARGE DANS LES CSST
(en % du nombre de patients pris en charge)
|
1998 |
1999 |
2000 |
|
|
Héroïne |
55,3 |
49,4 |
48,8 |
|
Buprénorphine et méthadone
|
9,1 |
12,0 |
10,2 |
|
Codéïne |
4,0 |
3,5 |
3,1 |
|
Total opiacés |
68,5 |
64,8 |
62,0 |
|
Cocaïne et crack |
5,6 |
6,1 |
6,1 |
|
dont crack |
1,4 |
1,1 |
1,5 |
|
LSD |
0,7 |
0,6 |
0,7 |
|
Cannabis |
17,5 |
21,5 |
24,0 |
|
Amphétamines |
1,9 |
1,5 |
2,1 |
|
dont ecstasy |
0,6 |
0,6 |
1,0 |
|
Solvants |
0,2 |
0,2 |
0,4 |
|
Médicaments psychotropes
|
5,7 |
5,3 |
4,7 |
|
Total |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Les autres consommations interviennent rarement dans les prises en charge, à l'instar notamment de la cocaïne , même si les demandes de traitements ont nettement augmenté entre 1997 et 1999 (+ 80 % en produit primaire, + 33 % en produit secondaire). La cocaïne est souvent prise en charge comme produit secondaire dans les cas de polyconsommation avec les opiacés et cette prise en charge ne concerne donc pas seulement les nouveaux consommateurs « festifs » de cocaïne.
Il en est de même pour l'ecstasy , qui n'est que d'une manière incidente à l'origine des prises en charge de toxicomanes. Ce phénomène est peut-être dû au fait que les usagers d'ecstasy s'adressent surtout aux médecins généralistes ou ont recours plus souvent aux services d'urgence des hôpitaux.
S'agissant du cannabis , dont la consommation a explosé ces dix dernières années, notamment chez les moins de 25 ans, on peut constater une substantielle augmentation des prises en charge par le dispositif spécialisé, même si elle reste bien en deçà des besoins, au regard de la forte augmentation de l'usage et de la consommation à risque du cannabis dans l'ensemble de la population. Or, la prise en charge des consommateurs abusifs et dépendants apparaît indispensable . C'est notamment le constat fait par le docteur Michel Hautefeuille, psychiatre au centre médical Marmottan, devant la commission : « Quel que soit le produit, nous sommes confrontés aux mêmes situations. A l'évidence, en dépit de tout le débat qui existe sur le cannabis, nous constatons d'un point de vue chimique que des gens sont véritablement en souffrance par rapport au cannabis, qu'ils ont un usage véritablement problématique du cannabis et qu'ils viennent nous consulter sur ce point. Ils vont donc être accueillis, suivis, orientés ou pris en charge à Marmottan de la même façon qu'un héroïnomane ou un cocaïnomane même si, parfois, les enjeux sont un peu différents. »
La commission constate cependant qu' il n'existe pas de dispositif de première ligne satisfaisant pour repérer et orienter les très jeunes et adolescents, consommateurs problématiques de produits, notamment de cannabis, ou pour conseiller leurs parents. Les « points accueil et écoute jeunes » (une centaine en 2001) ne répondent qu'imparfaitement à cette demande en raison de leur hétérogénéité et donc de leur faible visibilité pour le grand public. Cela est d'autant plus inquiétant que la psychiatrie est défaillante pour la prise en charge des adolescents, comme l'a montré récemment le rapport d'information du groupe d'études du Sénat sur les problématiques de l'enfance et de l'adolescence sur le thème de l'adolescence en crise 108 ( * ) .
La commission ne peut donc que souligner que la politique de prise en charge ne s'adapte pas suffisamment rapidement aux risques et aux besoins liés à de nouveaux modes de consommation, comme c'est le cas aujourd'hui pour le cannabis et les usages « festifs » d'ecstasy et de cocaïne .
Cette inadaptation a été soulignée par le professeur Philippe-Jean Parquet, président de OFDT, lors de son audition : « Il me semble qu'une politique de santé en général doit essayer d'être adéquate non pas à la population considérée comme homogène, mais à la population dans sa diversité. (...) Cela veut dire que les objectifs doivent correspondre à la diversité des populations et je pense donc que la sagesse d'une politique doit consister à n'éliminer aucune des populations susceptibles d'en bénéficier. Il est très difficile à faire comprendre que ces modalités de consommation et ces populations sont extrêmement diverses ».
La commission estime également que c'est en prenant en compte tous les types de toxicomanies, y compris les cas de consommation excessive de drogue « douce », que l'on évitera certains types d'escalade dans la consommation. Cette analyse a été partagée par le docteur Francis Curtet, psychiatre, lors de son audition : « Un toxicomane, quel que soit le produit qu'il prend et même s'il en est au stade d'une drogue telle que le cannabis, nécessite une prise en charge . On ne va pas attendre qu'il nous lance un SOS monumental avec l'héroïne pour se dire qu'il faut écouter son malaise. Dès lors qu'il fuit avec un produit, il se trompe ; il a un vrai problème auquel il apporte un mauvais remède et une mauvaise solution. Il faut donc évidemment l'aider ».
Outre sa trop lente adaptation aux nouveaux types de produits, d'usage et de consommateurs, la politique de prise en charge souffre également d'un manque de coordination avec la psychiatrie.
b) Des liens insuffisants avec les services psychiatriques
Dans la réalité, de nombreux toxicomanes en grande difficulté souffrent parallèlement de troubles psychiatriques . Cette « double morbidité » n'est pas toujours dépistée à temps et ne permet pas d'orienter le malade vers la structure sanitaire adéquate, ou comportant une dimension psychiatrique dès le début de sa prise en charge. Confrontés à des toxicomanes souffrant parfois de problèmes psychiatriques lourds, les CSST remplissent difficilement leurs missions sanitaires et sociales , ainsi que l'a souligné le professeur Lucien Abenhaïm, directeur général de la santé, devant la commission : « Ces centres sont aujourd'hui débordés par des questions d'ordre social ou psychologique. A chaque fois que j'ai discuté avec des personnes dans ce domaine, elles m'ont fait la remarque que les psychiatres aujourd'hui, je vous prie d'excuser l'expression, se débarrassent de leurs patients qui ont des problèmes psychiatriques, et qui sont toxicomanes, vers les centres de traitement de toxicomanes sous l'angle simplement du traitement de la toxicomanie, alors que parfois la toxicomanie n'est que l'effet secondaire d'un problème psychiatrique. »
Ce problème a également été longuement évoqué lors de l'audition du docteur Michel Hautefeuille, psychiatre au centre médical Marmottan : « Je pense qu'une des raisons pour lesquelles des structures comme Marmottan sont de plus en plus confrontées à des patients qui ont ce qu'on appelle une comorbidité, c'est-à-dire qui sont à la fois toxicomanes et qui ont une pathologie psychiatrique, c'est que les toxicomanes « faciles », si je puis dire, sont pris en charge de façon efficace en médecine libérale. Il y a donc une espèce d'effet de tri ou de tamisage qui fait que ce sont les cas les plus durs et les plus compliqués qui arrivent dans les institutions spécialisées. Il est également évident que le fait d'être de plus en plus confronté à ce phénomène pose aussi le problème du diagnostic et de l'orientation. Il faut être capable, quant on reçoit quelqu'un dans les premières consultations, de voir quel va être le problème le plus important, celui qui est en avant. Bien souvent, une personne véritablement psychotique qui relève d'une prise en charge psychiatrique peut être amenée à utiliser un produit comme l'héroïne parce que cela peut lui permettre de calmer ses angoisses et de se rassembler. Pendant un certain temps, cela peut être un « traitement » de sa psychose. Quant on est confronté à un tel cas, si on ne le prend en charge que du point de vue de sa toxicomanie, cela relève presque de la faute professionnelle. Le vrai problème de ce patient, c'est en effet sa psychose ; sa toxicomanie est une utilisation annexe et, quand on traite sa psychose, on s'aperçoit qu'en même temps, la toxicomanie va disparaître. Dans ce cas, nous avons à effectuer un travail dit de diagnostic différentiel entre ce qui relèverait, d'une part, d'une pathologie majoritairement d'ordre toxicomaniaque et, d'autre part, d'une pathologie majoritairement d'ordre psychiatrique. Pour cela, il est nécessaire de développer des coopérations avec les services de psychiatrie, ce qui est parfois un peu compliqué parce que ces patients sont assez malins ou perdus pour jouer les psychotiques dans les centres pour toxicomanes et les toxicomanes quand on les envoie en consultation dans un service de psychiatrie. Ils jouent sur les deux tableaux, ce qui complique les prises en charge. Ce sont donc des prises en charge lourdes et compliquées parce qu'elles nécessitent une coordination véritablement de tous les jours entre les structures spécialisées et les services de psychiatrie. »
Même s'il n'apparaît pas souhaitable de « psychiatriser » l'ensemble du dispositif de prise en charge, le développement de structures comme celle du centre de jour de l'hôpital Saint-Antoine, que la commission a pu visiter, s'impose à l'évidence.
Les personnes accueillies y sont, en effet, prises en charge en fonction de leurs troubles psychiatriques, afin de tenter de les soigner avant d'aborder l'étape du sevrage des pratiques addictives. Il est également souhaitable que les médecins généralistes des réseaux et les professionnels travaillant dans les CSST soient formés à quelques notions de psychiatrie afin de pouvoir éventuellement orienter leurs patients de la manière la plus satisfaisante.
La politique de prise en charge mise en oeuvre par notre pays doit donc évoluer pour mieux prendre en compte les enjeux de demain dans le domaine de la drogue.
VI. UNE COOPÉRATION INTERNATIONALE QUI MANQUE DE SOUFFLE
A. DES CONVENTIONS INTERNATIONALES BAFOUÉES
1. Le système onusien de contrôle des drogues : un dispositif complexe articulé autour de conventions et d'institutions internationales spécialisées
On rappellera que de nombreuses conventions internationales relatives au contrôle des drogues ont été signées durant la première partie du XX e siècle ; la création de l'ONU après la guerre a permis l'adoption par la quasi totalité des Etats de trois nouvelles conventions constituant l'assise juridique actuelle du système de contrôle international des drogues :
- la convention unique sur les stupéfiants de 1961 et la convention de 1971 sur les substances psychotropes , ayant toutes deux pour objet le contrôle du commerce licite mondial et comportant à ce titre dans leurs annexes des tableaux dans lesquels sont classées les diverses substances psychoactives selon leurs vertus thérapeutiques et leur dangerosité respectives, chaque classe de produit faisant l'objet d'un régime juridique différent. Ces conventions n'ont pas pour objet essentiel de prohiber ; elles visent au contraire à permettre un usage médical et scientifique des produits psychotropes et stupéfiants, mais pas au-delà ;
- la convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes , ayant pour objet la lutte contre le trafic illicite de drogues. Les deux premières conventions n'ayant pas été suffisantes, cette troisième renforce l'arsenal répressif pour lutter contre la production et le commerce illicites, c'est-à-dire s'effectuant en-dehors de tout objectif médical ou scientifique.
Au point de vue institutionnel , le système onusien de contrôle des drogues est constitué de trois organes principaux placés sous la direction du Conseil économique et social :
- la Commission des stupéfiants , structure législative du système qui décide notamment chaque année de l'inscription de nouvelles substances aux tableaux annexés aux conventions de 1961 et 1971, ainsi que de changements de tableaux et d'éventuelles radiations ;
- le Programme des Nations-Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID), organe exécutif siégeant à Vienne chargé notamment d'assister les Etats dans la mise en oeuvre des conventions en leur fournissant des législations anti-drogues « clefs en mains » et en formant leurs fonctionnaires, d'effectuer des études sur la situation de chaque région en termes de production de drogues ainsi que de coordonner les différentes structures et actions menées à l'échelle internationale en matière de contrôle des drogues ;
- l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) , structure judicaire siégeant également à Vienne chargée de contrôler l'exécution des conventions des Etats parties en s'appuyant sur les rapports que ces derniers lui remettent chaque année ainsi que de leur formuler éventuellement des recommandations.
Les trois conventions précitées imposent aux Etats les ayant ratifiées cinq types d'obligations :
- posséder des institutions nationales appropriées au contrôle des drogues ;
- établir une classification nationale des différentes drogues au moins aussi stricte que celle retenue dans les conventions onusiennes ;
- associer à chaque activité liée aux drogues un dispositif pénal déterminé (si l'incrimination de l'usage est laissée à la discrétion de chaque pays, possession et trafic doivent être systématiquement incriminés et poursuivis) ;
- mettre en place des dispositifs de réduction des risques et de diminution de la demande ;
- coopérer avec les trois institutions onusiennes précédemment évoquées dans leur activité de contrôle des drogues.
Ces obligations, que s'engage à respecter chaque Etat ayant adhéré aux traités en les transcrivant notamment au niveaux juridique et institutionnel internes, sont souvent méconnues malgré leur importance primordiale. Comme l'a fait remarquer à cet égard devant la commission M. Jacques Franquet, premier vice-président de l'OICS, « les Etats de droit, qui, à 90 %, ont ratifié (ces conventions), doivent forcément (en) tenir compte (...), sauf, dans des procédures qui existent, à les dénoncer, à s'en retirer ou à en demander des modifications par des voies qui sont indiquées dans les trois conventions ».
Or, M. Franquet s'est dit « frappé de voir que, nulle part, on (ne) rappelle ce que contiennent ces conventions internationales » et qu'il y avait en la matière « un vide en matière de formation des élites et des cadres », notamment en France, sentiment d'ailleurs pleinement partagé par M. Bernard Leroy, conseiller interrégional au programme d'assistance législative du PNUCID.
M. Franquet a en revanche remarqué que la France « a été un Etat moteur dans tout ce processus » de création d'un système de contrôle international. Il a ajouté que notre pays était parmi les « bons élèves sur le plan juridique » en ayant « non seulement ratifié ces conventions, mais (...) également fait la loi de 1970 (qui) a évolué jusqu'en 1996 pour coller précisément aux exigences des conventions ».
Il a toutefois regretté que la France n'ait pas encore intégré dans sa législation pénale les dispositions suggérées par la convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes pour lutter contre le détournement de précurseurs.
2. La situation actuelle dans le monde concernant la production et le trafic illicites de drogues : « des progrès encourageants dans la réalisation d'objectifs encore lointains ».
Cette formule reprend l'intitulé du rapport intérimaire du directeur exécutif du PNUCID 109 ( * ) relatif au respect des objectifs fixés à la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations-Unies en 1998. Il y est ainsi fait état de progrès encourageants, tempérés toutefois par des signes alarmants enregistrés à travers le monde depuis ladite session extraordinaire :
- l'héroïne : avec environ 13 millions d'usagers et 4 400 tonnes produites par an, le marché mondial s'est stabilisé, cachant en réalité d'importants déplacements de la production et du trafic d'une région à une autre. Ainsi, la production a fortement diminué en Birmanie et au Laos, mais a substantiellement augmenté en Afghanistan depuis la chute des Talibans, ce pays étant aujourd'hui le premier fournisseur mondial d'opium alors qu'il n'en produisait quasiment pas voici un quart de siècle. L'héroïne afghane fait l'objet d'un trafic en progression préoccupante en Asie centrale, dans la Fédération de Russie, en Europe orientale et dans les Etats baltes, risquant dans ces pays de provoquer une catastrophe en matière de santé publique si l'infection par le VIH et le sida se propage au-delà du cercle restreint des toxicomanes ;
- la cocaïne : la situation est sensiblement la même que pour l'héroïne, avec une stabilisation, voire une légère décrue de l'offre et de la demande masquant en réalité un déplacement de l'abus et du trafic. Ainsi, parmi les trois pays andins fournisseurs, la Bolivie occupe désormais une place presque marginale et le Pérou est parvenu à réduire de près des deux tiers ses cultures depuis 1995, tandis que la Colombie a vu sa production s'envoler depuis le milieu des années quatre-vingt dix jusqu'à représenter aujourd'hui les trois quarts de la cocaïne illicitement produite dans le monde. Quant au trafic et à la consommation, ils sont stables ou en légère régression en Amérique du sud et aux Etats-Unis (qui continuent toutefois à représenter le premier marché mondial), mais progressent de façon inquiétante en Amérique centrale et dans les Caraïbes ainsi qu'en Europe occidentale (où les saisies ont doublé entre 1998 et 2001) ;
- le cannabis : malgré le manque de données, il est certain qu'il constitue la drogue illicite la plus importante en termes d'offre, de demande et de trafic, les chiffres étant en forte progression sur les cinq continents (les saisies ont augmenté de façon générale de 40 % depuis 1998). Presque toutes les régions signalent une progression de l'abus de cannabis, notamment en Afrique où il représente la drogue la plus consommée. Une distinction plus fine peut être opérée entre la résine de cannabis dont le trafic, concentré aux trois quarts en Europe occidentale, est relativement stable, et l'herbe de cannabis dont le trafic, concernant à 60 % les Amériques, est en forte progression ;
- les drogues de synthèse : en dépit de données là encore lacunaires, il est admis que ce marché, constitué essentiellement des méthamphétamines, ainsi que d'amphétamines et d'ecstasy, continue de se développer dans des proportions sans précédents (l'Europe restant le principal centre de production et de trafic) et pourrait à terme remplacer le marché classique des stupéfiants d'origine végétale. Ces dernières années, le trafic de méthamphétamines s'est nettement développé et concentré en Asie de L'est et du Sud-Est. L'Europe reste par ailleurs le premier centre de production et de commerce d'amphétamines. Enfin, en ce qui concerne l'ecstasy, le trafic ralentit en Europe occidentale (50 % du marché mondial tout de même) et aux Etats-Unis, mais s'intensifie en Asie et en Afrique.
3. Le non-respect par certains Etats de leurs obligations internationales, limite à l'efficacité du système onusien
Le dispositif international de contrôle des drogues a permis d'indéniables avancées : institué à une époque où régnait entre les Etats une quasi liberté en matière de production, distribution et usage de stupéfiants, il a permis de limiter et d'encadrer, à défaut de le réduire véritablement, le commerce international illicite des drogues. Il est permis à ce titre de penser qu'en son absence, la situation actuelle en matière de trafic serait bien pire encore qu'elle ne l'est aujourd'hui .
En ce qui concerne le marché licite des stupéfiants (concernant les seules substances à usage médical), bien plus important en volume que le marché illicite, les conventions ont permis de contrôler leur production et prescription à un tel degré que l'OICS a pu noter dans son rapport 2002 que cette année, comme les précédentes, n'a connu aucun détournement du commerce international de stupéfiants et psychotropes malgré les quantités importantes de substances concernées et le nombre élevé de transactions réalisées.
Ensuite, les conventions onusiennes ont contribué au développement de véritables politiques nationales de réduction de la demande en incitant les Etats à prévenir l'abus des drogues et à prendre des mesures en vue du traitement et de la réhabilitation des toxicomanes. Enfin, elles ont introduit des standards permettant de favoriser l'harmonisation des législations nationales et d'instaurer une coopération judiciaire internationale.
Tous ces apports sont indéniables et plaident pour le maintien, et même pour le renforcement du système international de lutte contre la drogue . C'est ce qu'a d'ailleurs souhaité M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, qui a appelé devant la commission à « un soutien sans faille de l'ONU, qui s'efforce avec une légitime détermination de faire ratifier les trois conventions internationales interdisant la légalisation des drogues et la dépénalisation du cannabis ».
Malgré ces apports, le système souffre de son irrespect par de nombreux Etats qui ont pourtant adhéré à ses traités fondateurs, et ce à plusieurs niveaux.
Tout d'abord, et sans qu'il soit facile de faire le départ entre leur mauvaise volonté et leur manque de moyens, une part non négligeable d'Etats parties aux diverses conventions ne s'acquitte pas ou s'acquitte mal de ses obligations de coopération avec les institutions onusiennes . Bien qu'ils aient l'obligation formelle de présenter chaque année à l'OICS un rapport sur l'évolution de la situation des drogues sur leur territoire, afin que l'organe puisse les synthétiser au niveau mondial et apprécier le respect par les Etats de leurs obligations, une forte proportion d'entre eux, appartenant notamment aux zones Afrique et Océanie, s'abstient de rendre un tel rapport, ou bien le rend tardivement ou de façon incomplète.
Par ailleurs, et sans qu'il soit aisé là encore de faire le partage entre leur mauvaise volonté et leur manque de moyens, de très nombreux Etats ne respectent pas les dispositions des conventions leur faisant obligation, d'une part de limiter aux seules fins médicales et scientifiques la fabrication, le commerce, la distribution et l'utilisation des substances stupéfiantes et psychotropes, d'autre part de prévoir des sanctions dissuasives lorsqu'il s'avère que certaines personnes ont effectué de tels actes à des fins non médicales ou abusives.
En effet, la culture et le commerce illicites de substances psychoactives continue de perdurer à une très vaste échelle dans de nombreuses régions du monde (Afghanistan, Maroc, Bolivie ...), tandis que la fabrication de stimulants de synthèse de type amphétamine ou ecstasy prend une ampleur sans précédent, notamment en Europe. Ce dynamisme du marché mondial des drogues illicites s'accompagne souvent d'une inaction des Etats concernés, voire de leur complaisance lorsque, comme l'a évoqué le criminologue Xavier Raufer à propos de la Bolivie et même de Singapour, ils en retirent un avantage financier.
Or, le dispositif onusien de contrôle des drogues , et notamment l'OICS qui en constitue le « bras judiciaire », ne possède pas vraiment d'instruments adaptés permettant de faire cesser systématiquement toute infraction par un Etat à la législation internationale . M. Franquet a ainsi expliqué que ces instruments, qui vont « du simple avertissement jusqu'à l'embargo (...) des médicaments psychotropes à destination du pays ou venant du pays (litigieux) », posent plusieurs problèmes en pratique : les organes de l'ONU n'y recourent que « petit à petit » ; le processus de sanctions n'est jamais mené jusqu'à son terme (l'embargo n'ayant « jamais été utilisé ») ; l'unanimité qu'ils requièrent n'est que rarement acquise (« on n'est pas prêt, lorsqu'on est à treize autour d'une table et alors que l'on va du Chinois au Français en passant par le Philippin, à accepter des choses de façon unanime ou même aux deux tiers » a indiqué M. Franquet) et leurs effets sont problématiques (de l'avertissement, qui n'est pas réellement contraignant, à l'embargo, « qui fait surtout mal au type qui a besoin de psychotropes pour se soigner de la douleur parce qu'il est en phase terminale du cancer », a remarqué M. Franquet).
Enfin, le système des Nations-Unies souffre d'un débat international engagé sur le cannabis altérant son action à deux niveaux. Tout d'abord, il subit la pression continue Etats ou d'organisations non gouvernementales (telles que le Senlis Council, dont fait partie M. Raymond Kendall, ancien directeur d'Interpol, ou encore The European Foundation) cherchant à obtenir une modification de la classification du cannabis. Il s'agirait de l'extraire des tableaux I des psychotropes et I et IV des stupéfiants, qui sont identiques et le soumettent à une quasi prohibition en raison de l'absence d'effets médicaux connus, à un autre tableau dont le régime de contrôle serait beaucoup plus souple.
Plusieurs arguments ont été avancés en ce sens, notamment l'existence d'effets médicaux et scientifiques liés à l'usage de cannabis (position de l'Angleterre) et le fait qu'il n'y aurait pas d'abus du THC en tant que substance chimique isolée (idée défendue par l'OMS). Or, M. Franquet a successivement rejeté ces deux arguments : le premier parce que les recherches menées sur les bénéfices du cannabis sur la santé « sont loin d'être concluantes », le second parce qu'il reviendrait à faire « un pari sur les abus » et que « la question de l'affichage médiatique » qu'il soulève « chez les gens mal informés ou mal intentionnés » aurait des effets « catastrophiques ».
Par ailleurs, le système de contrôle des drogues des Nations-Unies se trouve confronté à de nombreux Etats tels la Suisse, le Canada, la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal, le Luxembourg ou le Royaume-Uni qui ont assoupli, ou s'apprêtent à assouplir leur législation en matière de cannabis en violation formelle des dispositions internationales précitées . Lors de la réunion de la Commission des stupéfiants à Vienne au mois d'avril dernier, le directeur général du PNUCID, M. Antonio Costa, s'est dit « gravement préoccupé » par ces approches libérales qui « risquent de remettre en cause le régime de contrôle international des drogues » et « ne sont pas en accord avec les trois conventions onusiennes » .
M. Franquet a illustré ces problèmes en se référant à la Suisse, pays autorisant l'usage domestique, mais aussi la fabrication, la transformation, la détention et la commercialisation de cannabis dans certaines limites. Il a à ce propos avoué la relative impuissance de l'OICS, chargé de faire respecter la législation internationale sur les drogues, en tenant devant la commission les propos suivants : « On a dit aux Suisses que c'était illégal par rapport aux conventions et ils nous ont répondu que nous nous méprenions et que c'était à titre interne. Nous leur avons donc répété (...) qu'ils sont dans l'illégalité et qu'ils sont donc passibles des sanctions prévues par les conventions (...). C'est une espèce de menace. (...). C'est un premier geste. Je ne vais pas vous apprendre que, dans le domaine international, les sanctions prennent du temps ».
M. Philip Emafo, président de l'OICS, a confirmé à la délégation s'étant rendue à Vienne que son institution connaissait des problèmes de ce type avec d'autres pays, notamment la Hollande, qui reste insensible aux remarques et mises en garde formulées à plusieurs reprises en raison de sa législation sur le cannabis.
L'analyse de l'application qui est faite de ces conventions internationales montre bien, aussi méritoires soient-elles, que le degré de contrainte qu'elles font peser sur chacun des Etats parties en matière de contrôle des drogues est extrêmement faible. Ceci est d'autant plus vrai qu'elles ne sont assorties d'aucun véritable moyen de sanction, si ce n'est la publicité que les organes de l'ONU peuvent faire de leur non respect. L'objectif d'une éradication totale, ou à tout le moins d'une réduction substantielle de la production et du commerce de drogues illicites dans le monde fixé en 1998 par l'Assemblée générale des Nations-Unies lors de sa vingtième session extraordinaire semble à ce titre loin d'être atteint.
B. L'ABSENCE D'HARMONISATION EUROPÉENNE
Elle se manifeste à un double point de vue : au niveau multilatéral, l'embryon d'une politique européenne de lutte contre les drogues existe mais est largement sous-développé ; au niveau de chaque pays, les disparités entre les différentes législations et pratiques nationales sont trop importantes pour permettre une véritable coopération entre Etats membres.
1. Une politique européenne de lutte contre les drogues embryonnaire
La lutte contre les drogues étant une compétence partagée entre les institutions communautaires et les Etats membres, a été adopté sous présidence portugaise lors du Conseil européen de Feira le plan européen d'action anti-drogue (2000-2004) dont la stratégie globale, comportant onze objectifs généraux et six cibles principales, avait été fixée lors du Conseil européen d'Helsinki.
Le plan d'action traduit en actions détaillées cette stratégie et définit clairement les mesures que devront prendre, au cours des cinq prochaines années, les institutions communautaires et les États membres. Ces mesures visent tant la réduction de la demande que la réduction de l'offre, et insistent sur la nécessité d'une coopération internationale ainsi que d'une information, d'une évaluation et d'une coordination efficaces à tous les niveaux.
Malgré ces objectifs ambitieux et l'appui précieux de l'OEDT, et selon le constat qu'en faisait Mme Nicole Maestracci, ancienne présidente de la MILDT, dans le premier bilan de son plan triennal, « les politiques de drogues ne constituent pas encore une véritable priorité politique » au sein de l'Union européenne : écartelées « entre les premier et troisième piliers, entre la « santé publique » et la « sécurité publique », elle(s) souffre(nt) d'un évident problème de coordination et de décision politique ».
Ces carences sont d'autant plus regrettables que la drogue est considérée par une large majorité d'européens comme un sujet primordial qui devrait être davantage traité, notamment à l'échelle communautaire . Ainsi, selon l'Eurobaromètre qu'a publié l'OEDT en avril 2002, 71 % des citoyens européens estiment que les décisions concernant ce problème constituent une priorité qui devrait être davantage prise en compte dans le cadre de l'Union européenne.
2. Des législations très disparates
Le très faible développement de la politique européenne de lutte contre la drogue tient essentiellement au fait qu'elle met en présence des Etats membres dont l'approche du problème est très variable, allant de dispositifs d'une grande fermeté (Suède) à des politiques considérées comme extrêmement souples, voire laxistes (Pays-Bas) , en passant par toute une palette de systèmes dégradant de façon plus ou moins nuancées ces deux modèles. M. Yves Bot, procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris, a ainsi déploré devant la commission « une disparité entre les législations des pays de la communauté européenne, notamment entre celles des pays qui constituent le noyau dur historique et qui devraient être les plus proches les uns des autres ».
De la même façon, M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, a indiqué à la commission que « la lutte contre le trafic exige un net renforcement de la coopération internationale, tout d'abord au sein de l'Union européenne ». M. Sarkozy a regretté qu'il s'agisse d'un « domaine, hélas, dans lequel chacun de nos pays a choisi une voie spécifique. Certains ont fait le choix de la tolérance à l'égard du cannabis. D'autres se sont engagés dans des expérimentations sur sa dépénalisation ». Le ministre a ajouté que « l'uniformisation des politiques de lutte contre la toxicomanie est hélas prématurée, mais (qu') elle serait pourtant bien souhaitable, les réseaux étant internationaux ».
Le principal point d'achoppement entre les politiques nationales de lutte contre les drogues concerne la législation pénale, et notamment la réglementation de l'usage des drogues. Si tous les pays européens se retrouvent sur la nécessité de développer des volets « prise en charge et prévention » dignes de ce nom, si tous sont également d'accord sur la nécessité de sanctionner lourdement le trafic de stupéfiants, les avis divergent en revanche sur la façon d'appréhender le « simple » usage, voire la culture ou la revente, en ce qui concerne principalement le cannabis.
On relève ainsi, entre les quinze pays membres de l'Union européenne, d'importantes différences de législations, mais aussi de pratiques s'agissant de ce produit : certains considèrent sa consommation comme une infraction pénale, d'autres comme une infraction administrative, tandis que d'autres encore l'admettent ; parmi ceux qui la sanctionnent, certains ne le font que si elle a lieu dans un endroit public tandis que d'autres la punissent même lorsqu'elle intervient dans un lieu privé...
Ces différences nationales quant au principe même de l'incrimination et à ses modalités se doublent de divergences, quel que soit le produit stupéfiant concerné, quant à l'échelle des peines applicables. S'y ajoute une spécificité propre aux Pays-Bas, qui non seulement tolère la consommation de cannabis, mais en autorise également sous certaines limites la culture, la détention et la vente.
Plus encore que les différences de législations concernant la consommation de stupéfiants, c'est cette spécificité néerlandaise qui, aux dires de très nombreux intervenants, pose problème en matière d'harmonisation. Le fait que soit autorisé, dans certains lieux et sous certaines quantités, la vente de cannabis crée en effet un « appel d'air » chez de nombreux consommateurs européens se rendant aux Pays-Bas pour s'approvisionner en herbe et en résine.
Ces travers hollandais et les problèmes qu'ils posent en termes de répression du trafic ont été dénoncés par de nombreuses personnalités auditionnées. M. Yves Bot s'est ainsi demandé si la position hollandaise ne pouvait être interprétée « comme un manque de solidarité » vis-à-vis des autres pays européens, en ce sens qu'elle « introduit le produit ainsi et (...) le diffuse ailleurs ».
M. Michel Bouchet, chef de la MILAD, a également insisté devant la commission sur le « problème de l'harmonisation des législations européennes » qui est « loin d'être finalisée du fait des obstacles qui y sont mis », ajoutant que « les Pays-Bas, notamment, n'ont pas voulu entrer en poursuite pour ce qu'ils appellent les « petits détenteurs » ».
Le ministre de la justice, M. Dominique Perben, a été particulièrement clair, indiquant à ce sujet devant la commission : « le mauvais exemple, ce sont les relations avec la Hollande (...). La vérité, c'est que nous n'avançons pas. Quatorze pays ont une position, dont la France, et un pays est totalement isolé : les Pays-Bas. Dans le domaine de la justice, la règle est celle de l'unanimité et nous ne pouvons pas aboutir à une directive commune en matière de drogues, et en particulier de petit trafic, puisque les hollandais demandent une exception leur permettant de maintenir les ventes de petites quantités en matière de drogue, ce qui est très dommageable. Les quatorze autres pays sont très déterminés, qu'il s'agisse du Nord ou du Sud de l'Europe, et il y a vraiment, aujourd'hui, une position commune très volontariste de l'ensemble de l'Europe. Il n'y a donc que cette difficulté hollandaise ».
Le tableau ci-après établi par le PNUCID permet de mesurer la disparité des législations des Etats européens concernant l'usage des stupéfiants : le constat est éloquent et dispensera la commission de tout commentaire.
Les législations de l'Europe des Quinze face à l'usage non médical de stupéfiants en 2001
Bernard LEROY (Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues).
|
(1) Incrimination directe de l'usage illicite de stupéfiants dans les textes |
(2) Incrimination indirecte de l'usage illicite dans les textes (possession pour usage personnel) |
Remarques, pratiques judiciaires et jurisprudences |
(3) Répression de la détention de stupéfiants en général (trafic illicite) |
|
|
A l l e m a g n e (1973 & 1981) |
L'usage de stupéfiants ne fait pas l'objet d'une incrimination spécifique. |
La possession en vue de l'usage est incriminée spécifiquement et fait encourir en théorie une peine de 3 mois à 5 ans d'emprisonnement. Possibilité de suspendre l'exécution des peines de moins de 2 ans pour entreprendre un traitement. |
En avril 1994, La Cour Constitutionnelle de Karlsruhe - tout en reconnaissant son caractère délictueux - a préconisé de ne plus poursuivre la possession - et même l'importation - de faibles quantités de cannabis en vue de l'usage. |
Peine encourue : 1 à 5 ans d'emprisonnement. Jusqu'à 15 ans en cas de circonstances aggravantes. |
|
A u t r i c h e (1971, 1977 & 1985) |
L'usage de stupéfiants ne fait pas l'objet d'une incrimination spécifique. |
La possession en vue de l'usage est incriminée spécifiquement et fait encourir en théorie une peine allant jusqu'à 6 mois d'emprisonnement, si l'usager ne se soigne pas dans un délai de 2 ans. |
Le Procureur est libre de ne pas poursuivre si l'usager accepte de se soigner. |
Peine encourue : jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. |
|
B e l g i q u e (1921 & 1975) |
L'usage collectif de stupéfiants est incriminé et sanctionné par une peine de 3 mois à 5 ans d'emprisonnement. |
La possession en vue de l'usage ne fait pas l'objet d'une incrimination spécifique. Elle relève de l'incrimination de la détention de stupéfiants au titre du trafic en général. |
(1) Condamnation avec sursis ou différée la première fois, et par la suite, lorsque l'usager accepte de se soigner. (2) La circulaire du 26 mai 1993 recom -mande de distinguer entre usagers occasionnels, usagers réguliers et dealers. |
Peine encourue : 3 mois à 5 ans d'emprisonnement (20 ans en cas de circonstances aggravantes). |
|
D a n e m a r k (1955 & 1976) |
L'usage de stupéfiants ne fait pas l'objet d'une incrimination spécifique. |
La possession en vue de l'usage ne fait pas l'objet d'une incrimination spécifique. Elle relève de l'incrimination de la détention de stupéfiants au titre du trafic en général. |
(2) La possession de cannabis en vue de l'usage en fait ne donne généralement lieu qu'à un avertissement, à une amende ou à une courte peine d'emprisonnement avec sursis. Les peines sont plus sévères pour les autres drogues. |
Peine encourue : jusqu'à 2 ans d'emprisonnement (6 ans en cas de circonstances aggravantes.) |
|
E s p a g n e (1983, 1988 & 1992) |
L' usage en public donne lieu à une sanction administrative (amende, suspension du permis de conduire, etc) infligée par le maire (ou le préfet dans les grandes villes). |
La possession en vue de l'usage donne lieu à une sanction administrative (amende, suspension du permis de conduire, etc) infligée par le maire (ou le préfet dans les grandes villes). |
La loi du 21 février 1992 vise toutes les drogues, y compris le cannabis (aupara- vant l'usage - y compris d'héroïne - était libre). Pour déterminer le degré de sévérité de la sanction administrative, il est tenu compte de la nature de la substance. |
Peine encourue : Cannabis : 10 à 17 ans Autres stupéfiants : 14 à 23 ans d'emprisonnement. |
|
F i n l a n d e (1990 & 1993) |
L'usage de stupéfiants fait l'objet d'une incrimination spécifique et peut être sanctionné d'une peine allant jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. L'exécution de la peine peut être différée si l'usager entreprend de se soigner. |
La possession en vue de l'usage ne fait pas l'objet d'une incrimination spécifique. Elle relève de l'incrimination de la détention de stupéfiants au titre du trafic en général. |
Le procureur est libre de ne pas poursuivre si l'usager accepte de se soigner. |
Peine encourue : jusqu'à 2 ans d'emprisonnement pour la possession de cannabis et jusqu'à 10 ans pour les autres drogues. |
|
F r a n c e (1970 & 1987) |
L'usage de stupéfiants fait l'objet d'une incrimination spécifique et peut être sanctionné d'une peine de 1 an d'emprisonnement. Toutefois, des dispositions alternatives thérapeutiques (astreinte, injonction thérapeutique) peuvent éviter les poursuites. |
La possession en vue de l'usage ne fait pas l'objet d'une incrimination spécifique. Elle relève de l'incrimination de la détention de stupéfiants au titre du trafic en général. |
La circulaire Pelletier (1978) recommandait d'assimiler la possession d'une faible quantité de cannabis à un simple usage. La circulaire Chalandon (1987) préconisait de n'adresser qu'un avertissement aux usagers non dépendants et bien insérés, quelle que soit la drogue utilisée. |
Peine encourue : jusqu'à 20 ans d'emprisonnement (30 ans en cas de circonstances aggravantes). |
|
G r è c e (1970 & 1976) |
L'usage de stupéfiants ne fait pas l'objet d'une incrimination spécifique. |
La possession en vue de l'usage est incriminée spécifiquement et fait encourir en théorie une peine de 10 jours à 5 ans pour les seuls usagers non dépendants. Les toxicomanes n'encourent pas de peine mais sont astreints à un traitement obligatoire. Ils sont considérés comme irresponsables. |
(2) Une expertise médicale (sanction en cas de refus de s'y prêter) détermine s'il y a dépendance ou non. Lors de la première infraction, l'usager de stupéfiants non dépendant peut être dispensé de peine. |
Peine encourue : 5 à 20 ans d'emprisonnement (Perpétuité en cas de circonstances aggravantes). |
|
I r l a n d e (1977 & 1984) |
L'usage de stupéfiants n'est pas incriminé directement, sauf en ce qui concerne - théoriquement - l'usage d'opium qui fait encourir 14 ans d'emprisonnement. |
La possession en vue de l'usage est incriminée spécifiquement et fait encourir une amende les 2 premières fois et ensuite une peine allant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement pour les drogues dites douces. La possession d'autres drogues fait encourir dès la première fois jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. |
(1) (2) L'exécution de la peine peut être suspendue si l'usager accepte de se soigner. Des soins peuvent être imposés aux usagers dépendants. |
Peine encourue : En cas de possession de cannabis : jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. En cas de possession d'autres drogues : jusqu'à perpétuité. |
|
I t a l i e (1975, 1990 & 1993) |
L'usage de stupéfiants ne fait l'objet d'aucune incrimination en Italie. (N.B. Entre 1990 et 1993, la loi italienne avait la particularité d'interdire l'usage mais de ne pas prévoir de sanction.) |
La possession en vue de l'usage n'est pas incriminée depuis le referendum de 1993. La quantité est à l'appréciation du procureur. Obligation est faite à l'usager par le préfet de se soigner. En cas de refus : sanctions administratives (suspension du permis de conduire, retrait du passeport, travaux d'intérêt général). |
Entre 1990 et 1993, une double expertise était nécessaire en cas d'interpellation pour déterminer l'exacte quantité (de principe actif) possédée et l'existence ou non d'un état de dépendance. Le système a échoué du fait de sa complexité. |
Peine encourue : En cas de possession de cannabis : 2 à 6 ans d'emprisonnement. En cas de possession d'autres drogues : 4 à 15 ans d'emprisonnement. |
|
L u x e m b o u r g (1973 & 1989) |
L'usage de stupéfiants fait l'objet d'une incrimination spécifique et fait encourir lorsqu'il est individuel : 3 mois à 3 ans d'emprisonnement, et 1 à 5 ans lorsqu'il est collectif, ou en récidive ou le fait de professionnels de santé. |
La possession en vue de l'usage est incriminée spécifiquement et fait encourir en théorie une peine de 3 mois à 3 ans d'emprisonnement. La prison peut être remplacée par du travail au profit de la communauté (idem pour l'usage illicite). |
(1) Une prise de sang ou une analyse d'urine peuvent être ordonnées à titre de preuve (sanction en cas de refus de s'y prêter). Le procureur peur renoncer à pour- suivre en cas de soins volontaires. Lors de la première infraction, l'usager peut être dispensé de peine. Des soins peuvent être imposés aux usagers dépendants. |
Peine encourue : 1 à 5 ans d'emprisonnement (Perpétuité en cas de circonstances aggravantes). |
|
P a y s-B a s (1928 & 1976) |
L'usage de stupéfiants ne fait pas l'objet d'une incrimination spécifique. Un usager de stupéfiants peut faire l'objet d'une mesure de placement d'office dans un hôpital psychiatrique. |
La possession en vue de l'usage est incriminée et fait encourir en théorie une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 3 mois pour les drogues dites douces, et jusqu'à 1 an pour les drogues dites dures. |
Dans la pratique, la vente de cannabis est tolérée dans les coffee shops (dans les limites de 30 gr jusqu'en 1995. A présent : pas plus de 5 gr). Il en est de même pour la possession en vue de l'usage. La possession d'une dose est tolérée pour les drogues dites dures. |
Peine encourue : En cas de possession de cannabis : jusqu'à 4 ans d'emprisonnement. En cas de possession d'autres drogues : jusqu'à 12 ans d'emprisonnement. |
|
P o r t u g a l (1983 & 1993) |
L'usage de stupéfiants fait l'objet d'une incrimination spécifique et fait encourir jusqu'à 3 mois d'emprisonnement ou 30 jours amende. |
La possession en vue de l'usage est incriminée spécifiquement et fait encourir en théorie une peine allant jusqu'à 3 mois d'emprisonnement ou 30 jours amende si la quantité n'excéde pas trois doses journalières. |
La loi de 1993 qui a sanctionné l'usage - impuni auparavant- oblige le juge à se livrer à un examen approfondi de chaque cas. Dispense de peine la première fois; Avertissement pour les usagers occasionnels. Suspension de peine en cas de demande de soins. |
Peine encourue : 4 à15 ans d'emprisonnement. |
|
R o y a u m e-U n i (1971 & 1986) |
L'usage de stupéfiants n'est pas incriminé directement sauf en ce qui concerne - théoriquement - l'usage d'opium qui fait encourir 14 ans d'emprisonnement. |
La possession en vue de l'usage est incriminée spécifiquement et fait encourir en théorie une peine allant : - jusqu'à 7 ans (Tabl. A) (Héroïne, Lsd, XTC) - jusqu'à 5 ans (Tabl. B) (cannabis, codéine) - jusqu' à 2 ans (Tableau C)(amphet. benzo) |
(2) La possession de cannabis en vue de l'usage en fait ne donne généralement lieu qu'à un avertissement, à une amende ou à une courte peine d'emprisonnement avec sursis. Les peines sont plus sévères pour les autres drogues. |
La possession fait encourir : - perpétuité (Tableau A) - jusqu'à 14 ans d'emprisonnement (Tableau B) et - jusqu' à 5 ans (Tableau C). |
|
S u è d e (1960, 1968 & 1983) |
L'usage de stupéfiants n'est pas incriminé directement. |
La possession en vue de l'usage est incriminée spécifiquement et fait encourir en théorie une peine allant jusqu'à 6 mois d'emprisonnement. Le tribunal peut définir le traitement que devra suivre le condamné. |
Dans la pratique, la possession d'une faible quantité de cannabis ou d'amphétamines en vue de l'usage donne lieu à une amende. La possession d'héroïne ou de cocaïne, même en quantité très faible, est sanctionnée par une peine d'emprisonnement ferme. |
Peine encourue : jusqu'à 3 ans d'emprisonnement (de 2 à 10 ans d'emprisonnement en cas de circonstances aggravantes). |
3. Deux exemples opposés : les Pays-Bas et la Suède
a) L'exemple des Pays-Bas
Compte tenu d'une situation très particulière concernant aussi bien les trafics que la production, la réponse néerlandaise à la question des drogues ne peut que susciter des interrogations, et notamment chez ses voisins.
(1) Les fondements d'une politique singulière
Les orientations du système néerlandais en matière de drogues ont été définies en 1972 par la commission Baan et précisées par deux rapports gouvernementaux (Engelsman en 1985 et Continuité et changement en 1993-1995).
La commission Baan retient pour la première fois le principe de la « tolérance » à l'égard des drogues douces et plus largement l'existence de substances et de modes d'usage à risque « acceptable ». Il préconise une moindre pénalisation de l'usage afin de ne pas sanctionner excessivement des consommateurs dont l'usage resterait « acceptable ». Cet élément caractéristique de la politique néerlandaise des drogues sera officialisé en 1976 avec la révision de la loi sur l'opium de 1916 ; l'objectif est d'éviter l'exclusion sociale des usagers de drogues, à l'époque essentiellement des jeunes usagers de cannabis.
Pour sa part, le rapport Engelsman pose les bases de la politique dite « de limitation des risques », souvent décrite comme « le modèle hollandais ». Par rapport à la période précédente, le contexte a changé, notamment avec le développement de l'usage problématique d'héroïne. La politique des drogues doit se transformer et ne plus être seulement une « politique de la jeunesse » mais de plus en plus une politique de santé publique. Si l'objectif est toujours d'éviter la marginalisation des usagers, la politique de limitation des risques qui en découle vise à la fois les risques sanitaires (objectif de limitation des effets secondaires liés à l'usage de drogues et non plus d'abstinence) et les risques judiciaires. On notera que les non-usagers ont été délibérément tenus à l'écart de ce débat, du fait de leurs « préjugés » et de leurs « réclamations illégitimes ».
Enfin, le rapport Continuité et changement et plusieurs notes gouvernementales définissent « la politique des nuisances », cette notion visant les délits, la présence de seringues, le bruit, la gène occasionnée par les toxicomanes, etc. Cette politique souhaite ainsi prendre en compte les plaintes des non-usagers de drogues, c'est-à-dire les voisins ou les habitants des quartiers confrontés à des rassemblements de toxicomanes ou à l'implantation d'un centre de soins. Ce rapport fait un inventaire détaillé des techniques et des mesures existantes ou préconisées et aborde le problème de la drogue en termes thérapeutiques, judiciaires, administratifs, sanitaires et sécuritaires.
Les Pays-Bas ont donc choisi de fonder leur politique sur le principe de réduction des nuisances, c'est-à-dire l'atténuation des risques et des dangers liés à l'usage de drogues, plutôt que sur l'interdiction de toutes les drogues :
- le but central de la politique néerlandaise est la prévention ou l'atténuation des risques sociaux et individuels découlant de l'usage de drogue ;
- il doit exister un rapport rationnel entre ces risques et les politiques ;
- des politiques différenciées doivent prendre en compte les risques associés aux drogues légalement utilisées à des fins récréatives et médicales ;
- les mesures de répression contre le trafic de drogue (à l'exception du cannabis) constituent une priorité ;
- l'inadaptation de la répression pénale est reconnue en ce qui concerne les aspects autres que le problème du trafic de drogue.
Si l'approche néerlandaise en matière de lutte contre la drogue répond donc à la norme répressive internationale pour l'offre des stupéfiants, elle s'en distingue s'agissant de la consommation : elle considère que l'usage de la drogue n'est le plus souvent qu'une « passade » de jeunesse et insiste sur la prise en charge sanitaire et sociale des consommateurs en recherchant leur intégration dans la société.
(2) Une législation tolérante critiquée par les pays européens
La loi sur les drogues de 1976 (Opiumwet), portant réforme de la loi sur l'opium de 1916, repose sur deux distinctions : celle entre les drogues dures (héroïne, cocaïne et ecstasy depuis un décret ministériel de 1988) qui entraînent un risque « inacceptable » et les drogues douce s (marijuana, haschich) ; celle entre commerce et détention pour la consommation personnelle, le toxicomane n'étant pas considéré comme un délinquant mais comme un sujet de santé publique et de politique sociale.
Si la répression est sévère pour le commerce et le trafic de drogues dures, la démarche pour le simple usage est surtout axée sur la réduction des risques avec un double objectif : prévenir la consommation au moyen de campagnes d'information et traiter les problèmes nés de la consommation grâce à des mesures sanitaires.
LES DROGUES DURES
|
Délit |
Quantité |
Peine encourue |
|
Possession |
< 0,5 g ou < 1 unité de consommation |
Avis de la police (« Police Dismissal ») |
|
0,5-5 g ou 1-10 unités de consommation |
1 semaine - 2 mois |
|
|
Possession et indication de vente (« Dealer Indication ») (c.-à-d. intention de vendre) |
< 15 g ou < 30 unités de consommation |
Jusqu'à 6 mois |
|
15-300 g ou 30-600 unités de consommation |
6-18 mois |
|
|
> 300 g ou > 600 unités de consommation |
18 mois - 4 ans |
|
|
Commerce dans la rue ou à domicile |
< 1 g |
Jusqu'à 6 mois |
|
1-3 g |
6-18 mois |
|
|
> 3 g |
18 mois - 4 ans |
|
|
Commerce de niveau intermédiaire |
< 1 kg |
1-2 ans |
|
> 1 kg |
+ 2 ans |
|
|
Commerce de gros |
> 5 kg |
6-8 ans |
|
Importation et exportation |
< 1 kg |
jusqu'à 3 ans |
|
> 1 kg |
3-12 ans |
Des programmes d'échanges de seringues ont ainsi été élaborés dans les années 1980, afin de prévenir le VIH et les hépatites B et C. Aujourd'hui, 130 programmes sont mis en oeuvre dans une soixantaine de villes néerlandaises. La politique sanitaire en faveur des toxicomanes, dont le coût est de plus de 450 millions d'euros par an, a débouché sur des programmes méthadone de grande ampleur (14.000 bénéficiaires par an pour un nombre total de toxicomanes consommateurs d'héroïne évalué à 28.000).
LES « DROGUES DOUCES »
|
Délit |
Quantité |
Peine encourue |
|
Possession, préparation, transformation, vente, livraison, approvisionnement, transport et fabrication |
Jusqu'à 5 g |
Avis de la police (« Police Dismissal ») |
|
5-30 g |
Amende de 50-150 florins |
|
|
30 g - 1 kg |
Amende de 5-10 florins par g |
|
|
1-5 kg |
Amende de 5.000-10.000 florins et 2 semaines par kg |
|
|
5-25 kg |
Amende max. de 25.000 florins et 3-6 mois |
|
|
25-100 kg |
Amende max. de 25.000 florins et 6-12 mois |
|
|
> 100 kg |
Amende max. de 25.000 florins et 1-2 ans |
|
|
Culture |
Jusqu'à 5 plants |
Avis de la police |
|
5-10 plants |
50 florins par plant (récidiviste : 75 florins par plant) |
|
|
10-100 plants |
25 florins par plant et/ou ½ journée par plant |
|
|
100-1.000 plants |
Amende max. de 25.000 florins et 2-6 mois |
|
|
> 1.000 plants |
Amende max. de 25.000 florins et 6 mois-2 ans |
|
|
Importation et exportation |
La Loi ne fait pas de distinction entre les quantités, mais en pratique l'accusation recommande une peine correspondant aux divisions de quantité pour possession |
Les peines pour possession sont parfois doublées à un maximum de 4 ans et une amende de 100.000 florins |
Si la possession de petites quantités de cannabis pour usage personnel a été dépénalisée aux Pays-Bas, la vente de cannabis reste une infraction au sens de la loi sur l'opium. Les poursuites, selon les directives du Parquet, ne seront intentées que dans certaines situations : ainsi, l'exploitant ou le propriétaire d'un coffee shop, qui n'a pas le droit de servir d'alcool, ne sera pas inquiété s'il observe les règles suivantes :
- ne pas vendre plus de cinq grammes de cannabis à la fois à un même acheteur ;
- ne pas vendre de drogues dures ;
- ne pas faire de publicité pour les drogues ;
- ne pas occasionner de nuisances aux alentours du coffee shop ;
- ne pas vendre de drogue aux mineurs (moins de 18 ans) et ne pas accepter de mineurs dans l'établissement.
On rappellera que le nombre de consommateurs réguliers de drogues dites douces est estimé aux Pays-Bas à 700 000 .
Afin de répondre aux critiques développées au cours des dix dernières années par les Etats voisins ainsi que par la France, sur cette tolérance à l'égard des stupéfiants, les Pays-Bas ont adopté des mesures visant à limiter « les conséquences possibles de la politique néerlandaise, dans le domaine de la coopération avec les autorités étrangères ou encore dans celui des répercussions transfrontalières de cette politique, en matière de recherche et de poursuites des infractions » (directive des procureurs généraux de septembre 1996).
(3) L'amorce d'une législation plus répressive
Dans le droit fil de cette directive, la législation a été en conséquence durcie, notamment à l'égard des vendeurs :
• pour les drogues douces
- afin de lutter contre le développement des lieux de vente illégaux, un amendement à la loi sur les municipalités du 11 mars 1997 permet désormais aux maires de fermer tout logement ou local où des agissements perturbent l'ordre public ;
- la loi dite Damoclès, amendant la loi sur les municipalités, adoptée en avril 1999 et modifiant la loi sur l'opium, permet aux maires de procéder plus facilement à des fermetures administratives de coffee shops, notamment en cas de vente de drogues dures ou d'installation près d'une école ou dans un quartier résidentiel. En raison de l'application rigoureuse de cette loi et de diverses mesures administratives et judiciaires, le nombre de coffee shops a diminué de manière importante, passant de 1.200 en 1995 à 846 en 1999 ;
- pour renforcer la lutte contre la culture intensive du cannabis, une loi de 1997 amendant la loi sur l'Opium a fait passer de deux à quatre ans la peine d'emprisonnement encourue. Le texte interdit la culture sous serre et tolère la seule culture individuelle à l'extérieur. Cette loi, qui traduit tout le paradoxe de la politique néerlandaise, est toutefois rarement appliquée : les coffee shops sont autorisés sans avoir la possibilité de s'approvisionner légalement ;
• pour les drogues dures
- la loi dite Kohnstamm (1998) facilite la fermeture administrative des lieux de vente clandestins (drugsfanden) ;
- la lutte contre le tourisme de la drogue s'est intensifiée depuis la fin des années 90, dans le cadre notamment d'une meilleure coopération franco-néerlandaise ;
- un plan de lutte contre l'ecstasy a également été élaboré en 1997 sous la pression des Etats-Unis, avec la création de l' Unit synthetische drugs (USD) que la commission a pu visiter lors de son déplacement aux Pays-Bas les 24 et 25 avril dernier. Ce plan a été intensifié en 2001.
La politique pénale a également évolué de manière plus restrictive : la directive aux parquets, entrée en vigueur le 1 er octobre 1996, répond à un besoin d'uniformisation de la politique en matière d'action pénale mais vise surtout à prendre en compte les conséquences de la politique de tolérance néerlandaise sur les pays voisins, comme l'a souligné le rapport d'information de M. Nicolas About fait au nom de la Délégation du Sénat pour l'Union européenne 110 ( * ) .
La directive prévoyait, comme cela a été évoqué, une réduction de 30 à 5 grammes de la quantité de drogues douces considérée comme destinée à un usage personnel, et fixait à 50 grammes la quantité maximale qui peut être stockée dans un coffee shop. La publicité pour le cannabis est interdite et la lutte contre les cultures illégales est intensifiée. La directive de 1996 demandait en outre une plus grande fermeté de la part des procureurs, ce qui a été en général le cas.
Par ailleurs, les condamnations prononcées contre les trafiquants sont désormais de plus en plus lourdes . Ainsi, à Amsterdam, en janvier 1997, s'est déroulé le procès d'un important trafiquant : pour la première fois, le ministère public a estimé que les peines prévues par la loi pour ce type de trafic n'étaient pas suffisamment dissuasives.
Enfin, un plan de lutte contre les passeurs de drogues en provenance des Caraïbes et d'Amérique du Sud devrait être prochainement mis en place, sous la pression de l'opinion publique néerlandaise. D'ores et déjà, les capacités de mise en garde à vue à l'aéroport de Schiphol ont été très nettement augmentées.
(4) Les observations de la commission d'enquête
Malgré ces quelques évolutions positives, la commission a pu mesurer, lors de son déplacement aux Pays-Bas, les résultats discutables de la politique de tolérance néerlandaise.
Si la consommation de drogues ne semble pas plus importante aux Pays-Bas que dans l'ensemble des pays développés, il n'en est pas de même de la production et du trafic de stupéfiants. La politique censée maintenir dans des limites strictement définies la production et la consommation de drogues est ainsi peu efficace : augmentation du nombre de coffee shops qui ne respectent pas la réglementation, développement de l'importation et de l'exportation de drogues dures et d'un narco-tourisme européen favorisé par le faible coût des stupéfiants aux Pays-Bas.
Les Pays-Bas sont également le premier producteur d'ecstasy dans le monde, devant la Belgique. Selon Europol, les rejets de produits chimiques en 2000 correspondent à une production de 70 millions de cachets d'ecstasy , et les chiffres fournis par l' Unit synthetische drugs (USD) à la commission quant au nombre de saisies et de découvertes de laboratoires clandestins confirment ce sombre constat.
Les Pays-Bas sont aussi producteurs de cannabis (le Nederwiet) dont les caractéristiques l'assimilent à une véritable drogue dure. En effet, son taux de principe actif THC dépasse parfois 20 %, soit très au-delà des 2,5 % fixés par la commission européenne pour la culture du chanvre industriel et des 4 à 8 % de THC contenu dans le cannabis marocain.
Les Pays-Bas restent par ailleurs le premier pays européen de transit pour les drogues dures (héroïne, crack, cocaïne), les cartels sud-américains étant désormais bien implantés dans les grandes villes néerlandaises, comme d'ailleurs les filières turques et marocaines.
En conséquence, une véritable économie de la drogue s'est développée progressivement aux Pays-Bas (près de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel) qui s'appuie sur le plan logistique sur deux des plus grands centres portuaires et aéroportuaires du monde : le port de Rotterdam et l'aéroport de Schipol.
Si la politique néerlandaise semble enfin évoluer sur cette question, les résistances sont nombreuses, y compris de la part de la population.
Au total, contrairement à beaucoup d'idées reçues et largement diffusées par les tenants d'une dépénalisation des drogues douces, la commission ne peut que constater qu'une politique de tolérance induit une augmentation automatique des trafics et ne les freine nullement.
b) L'exemple suédois
Une délégation de la commission d'enquête s'est rendue en Suède les 20 et 21 mars dernier et a été très favorablement impressionnée par la politique menée en matière de lutte contre les drogues.
On rappellera que la pratique très libérale menée dans ce pays, et notamment la vente libre du cannabis, au début des années 60, s'est traduite par une forte poussée de la délinquance et a conduit les autorités suédoises à revenir à une législation restrictive en 1968 ; il en est résulté une réduction drastique de l'usage du cannabis. Les difficultés économiques des années 90 ont conduit la Suède à réduire les moyens consacrés à la prévention et à la prise en charge des toxicomanes, ce qui a provoqué une nouvelle augmentation de la consommation, par ailleurs alimentée par l'ouverture à l'Europe, ainsi qu'une nouvelle poussée de la délinquance. Dans le droit fil de l'objectif d'une société sans drogue, arrêté à l'unanimité par le Parlement en 1984, une commission a proposé de renforcer le dispositif de lutte contre les drogues, qui a d'ailleurs été largement repris dans le plan national de lutte contre la toxicomanie actuellement en vigueur.
(1) Le constat : une consommation relativement faible
En 2001 111 ( * ) , 10 % des garçons et 9 % des filles de 15 ans ont reconnu avoir déjà essayé au moins une fois une drogue, contre 14 % en 1970, 8 % en 1982 et 3-4 % au début des années 1990. 18 % des conscrits avait expérimenté au moins une fois une drogue (pour 60% d'entre eux du cannabis exclusivement). La grande majorité des jeunes Suédois a une représentation négative des drogues, et seuls 12 % des 15-75 ans ont expérimenté une drogue. Ainsi, la Suède compte 26.000 toxicomanes (définis comme faisant usage d'intraveineuses ou ayant une consommation quotidienne de drogues, ce qui inclue les usagers réguliers de cannabis) alors qu'en France, on estime entre 150.000 et 180.000 le nombre d'usagers d'opiacés ou de cocaïne à problèmes, et à plus de 300.000 le nombre de consommateurs réguliers de cannabis.
La consommation de drogues illicites en Suède est donc faible comparativement à celle d'autres pays européens, même si on constate une augmentation du nombre de consommateurs occasionnels et réguliers. Après le cannabis, le groupe des amphétamines (et non l'héroïne) est la deuxième catégorie de drogues la plus populaire en Suède et le principal groupe à poser problème.
(2) La particularité de l'approche suédoise: l'objectif d'une société sans drogues
Après une politique libérale consistant à réduire les risques (de 1965 à 1967, 120 toxicomanes très dépendants ont pu obtenir des ordonnances de morphine et d'amphétamines), la création en 1965 du comité sur le traitement des toxicomanes a été à l'origine de la loi sur les stupéfiants de 1968, fondement législatif de la politique actuelle en matière de drogue.
Cette politique restrictive est liée au mouvement de tempérance concernant l'alcool. Au début des années 1980, la police s'est concentrée sur le deal de rue plutôt que le gros trafic, les toxicomanes étant considérés comme le moteur de la machine. Depuis 1984, sur décision unanime du Parlement, l'objectif de la Suède est de parvenir à une société sans drogues. En 1998, le gouvernement a créé une commission sur les drogues ayant pour mission d'évaluer le dispositif suédois de lutte contre les drogues et de proposer des mesures d'amélioration, sans dévier de l'objectif général d'une société sans drogue. Dans son rapport rendu en 2000, la commission a proposé des mesures de renforcement du dispositif actuel, en grande partie reprises dans le plan national de lutte contre la toxicomanie pour 2002-2004.
Une des principales nouveautés de ce plan est la création d'un poste de coordinateur national antidrogue, actuellement assuré par M. Björn Fries. 325 millions de couronnes suédoises ont été dégagés pour financer les diverses actions prévues. Les principaux domaines d'actions retenus sont : un programme spécifique pour les établissements pénitentiaires, la prévention, la recherche, des programmes spécifiques à Stockholm, Göteborg, Malmö, le traitement et la réhabilitation.
(3) Une répression déterminée de l'usage comme du trafic
La drogue est considérée comme une menace non seulement pour la santé individuelle, mais aussi la sécurité et le bien-être de tous. Toute consommation est donc perçue comme abusive et il n'y a pas de distinction entre drogue douce et drogue dure, entre consommation récréative et lourde , même si les mentalités changent quelque peu. Depuis 1988, l'abus de drogue constitue un délit et depuis juillet 1993, la police peut procéder, aussi bien dans un lieu privé que public, à l'arrestation de personnes soupçonnées d'être sous l'influence d'un stupéfiant et exiger d'elles un test d'urine ou une prise de sang. Beaucoup d'officiers de police sont formés pour reconnaître les signes et les symptômes des drogues.
Pour les infractions dites mineures (usage ou possession à des fins personnelles de très petites quantités : jusqu'à 6 g pour les amphétamines, 50 g pour le cannabis, 0,5 g pour la cocaïne et 0,39 g pour l'héroïne), les sanctions peuvent être des amendes ou des peines d'emprisonnement (jusqu'à 6 mois), les amendes étant basées sur le revenu du contrevenant. A ce jour, personne n'a été condamné à des peines de prison pour avoir été sous l'influence de drogues. Le procureur a le devoir de poursuivre, peu d'exceptions étant prévues.
La loi sur la contrebande de 2000 régit les importations et les exportations illégales de drogue.
(4) Drogue et prison
En 2000, plus de 5.000 toxicomanes ont été mis en détention, où ils peuvent avoir accès à des programmes de désintoxication. Pendant leur séjour, les détenus n'ont pas droit à des seringues et à des traitements de substitution. Depuis 1998, les personnes ayant un problème de toxicomanie et ayant commis un délit lié à la drogue peuvent avoir accès à un traitement en signant une convention de traitement. Le contrevenant peut alors purger sa peine hors de prison, en établissement, avec ou non une période de probation. Ce système doit être renforcé avec le nouveau plan stratégique 2002-2004.
(5) Une approche globale des soins
La prise en charge des toxicomanes a été organisée depuis les années 1970 selon le modèle de chaîne de soins . Le premier maillon est un travail de proximité, réalisé par les travailleurs sociaux des services sociaux municipaux, qui doivent repérer les populations à risques et essayer de les convaincre de demander de l'aide pour régler leurs problèmes de drogues. Ce travail est cependant moins prioritaire, la police constituant souvent le premier interlocuteur de l'usager de drogue. Elle est tenue d'informer les services sociaux municipaux pour tous les types de consommation de drogues.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur , la police doit obligatoirement et immédiatement informer la commission municipale d'aide sociale. Cette dernière peut prescrire un traitement obligatoire jusqu'à l'âge de 20 ans, en vertu de la loi sur les services sociaux et la loi sur la jeunesse, dite « LVU ». De même, conformément à la loi sur la prise en charge des alcooliques, des toxicomanes et des usagers de solvants volatils, dite « LVM », tant la police que la commission municipale d'aide sociale peuvent émettre une ordonnance de soins immédiats dans le cas d'un usager de drogues âgé de plus de 18 ans, dès lors qu'il met gravement en péril sa propre santé physique ou mentale, court un risque manifeste de ruiner son avenir, ou est susceptible d'infliger des torts sérieux à lui-même ou à un de ses proches.
Le traitement est financé par les services sociaux, qui sont également responsables de la réinsertion sociale et professionnelle (logement, emploi...).
En 1999, 20.000 personnes alcooliques, toxicomanes et consommateurs abusifs de produits pharmaceutiques étaient prises en charge par les services sociaux. La majorité (80 %) de ces personnes a bénéficié d'un traitement ambulatoire, 16% étant en institution, dont 257 en traitement forcé.
Il existe une importante diversité de modes de traitements proposés aux personnes toxicomanes. Les structures sont traditionnellement éloignées du centre ville ou à la campagne. Les unités de désintoxication se trouvent pour la plupart dans des hôpitaux ou des cliniques, comme le centre «Maria pour la jeunesse » visité par la commission d'enquête. Les traitements résidentiels ont une capacité de 6.000 lits et s'adressent indifféremment aux usagers de drogues et aux alcooliques. Les programmes ambulatoires sont pour la plupart dirigés ou financés par les services sociaux communaux qui fonctionnent comme des acheteurs de traitements et passent des contrats avec les institutions.
La conception de société sans drogue et l'abstinence comme instrument principal de traitement conduisent à des traitements principalement psychiatriques et psychologiques . L'introspection élargie au cercle familial est dominante. Des dispositifs sociaux généraux ou spécifiques aux toxicomanes permettent la reprise des études et l'accès au logement. Le plan 2002-2004 vise à inciter les municipalités à investir dans ce domaine, les années 1990 ayant été marquées par un désinvestissement financier et politique des municipalités du fait de la récession économique.
(6) Une réticence à l'égard de la politique de réduction des risques et de substitution
Le traitement médical est de plus en plus sollicité. Ainsi, l'utilisation du Subutex fait l'objet de projets pilotes et semble être de plus en plus accepté. Pour autant, le programme méthadone est restreint à 800 personnes pour toute la Suède, ne s'applique que dans cinq grandes villes et prévoit des conditions d'éligibilité strictes (être âgé de 20 ans ou plus, avoir choisi librement ce traitement, avoir usé d'opiacés depuis au moins quatre ans, être retombé dans la drogue en dépit de traitement répétés et ne pas être un polyconsommateur). L'abstinence doit être totale et les patients sont régulièrement soumis à des tests d'urine. Les listes d'attente peuvent être de deux ans, voire plus. Ce dispositif a fait l'objet d'une évaluation positive en 1997, mais l'abstinence demeure le but. Ceci explique sans doute le stade expérimental du programme d'accès à des seringues propres, qui ne concerne que les villes de Lund et Malmö. En mars 2003, le coordonnateur national des drogues s'est prononcé en faveur de la pérennité de ce projet. Les réticences restent importantes quant à ce programme qui se rapproche d'une politique de réduction des risques, orientation officiellement rejetée en Suède.
(7) La priorité accordée à la prévention
Le plus gros travail de prévention s'effectue dans les écoles , qui doivent fournir une connaissance suffisante sur les dangers de la drogue, l'alcool et le tabac (et ce très tôt et à tous les niveaux du programme scolaire). Ce travail est effectué par les professeurs, par la police ou encore par des anciens toxicomanes et des représentants d'associations . Compte tenu de son ampleur, son contenu fait partie du système de valeurs de chacun et peut être décrit comme un programme d'influence d'opinion. Les autorités locales produisent aussi des brochures à l'attention des parents et des jeunes. A Stockholm, chaque district dispose d'une personne responsable de la prévention en matière de drogue, d'alcool et de tabac. Ces personnes sont coordonnées par l'intermédiaire d'une récente agence de la ville, Precens, chargée de travailler sur l'ingénierie de la prévention.
Au niveau national, l'agence nationale de santé publique , responsable de la prévention pour l'alcool et les drogues, conduit différentes campagnes de prévention dans les médias, et ce depuis 1968. Toute une génération a donc grandi avec ces messages fondés sur la théorie de la « drogue d'introduction », entre autres, selon laquelle les carrières dans le domaine de la drogue commencent par le cannabis, et qui justifie la politique restrictive voire répressive de la Suède. D'ailleurs les mesures de prévention portent une attention particulière sur le cannabis classé parmi les drogues dangereuses.
Le gouvernement et la plus grande majorité de la population restent très attachés à ce modèle. Il n'existe pour ainsi dire aucun débat au sein de la société suédoise sur l'opportunité de revoir la loi.
Si la commission d'enquête ne peut qu'envier les résultats de la politique suédoise en matière de lutte contre la toxicomanie, l'importance des facteurs propres à la Suède (influence luthérienne, niveau de vie...) rend difficile sa transposition en France.
C. DES INSTRUMENTS JURIDIQUES ENCORE INSUFFISANTS
1. Développer la coopération internationale : un objectif essentiel du plan triennal de lutte contre la drogue
Le plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances (1999 - 2002) s'était fixé comme objectif, notamment, de relancer la coopération internationale en matière de lutte contre les stupéfiants en rapprochant « les politiques européennes et internationales des concepts et principes de la politique française de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances ».
Le plan triennal préconisait de donner à la France les moyens de mettre l'accent sur la politique de réduction des risques et des dommages au sein des différentes instances de coopération internationale et européenne soulignait le déséquilibre des actions extérieures françaises en faveur des projets de coopération axés sur la réduction de l'offre et prévoyait enfin de concentrer l'intervention française sur des priorités géographiques et thématiques redéfinies, tenant compte des enjeux de sécurité intérieure pour la France et de la situation socio-sanitaire dans les pays bénéficiaires.
Dans ce cadre, la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie a tenu à élaborer des critères clairs et précis destinés à assurer la cohérence des actions internationales de la France . En 1999, le budget interministériel consacré aux actions internationales représentait plus de 736.400 euros. La MILDT redistribuait ce montant entre les principaux ministères mettant en oeuvre des projets d'aide et de coopération internationales dans le domaine de la lutte contre la drogue, c'est-à-dire le ministère des affaires étrangères, celui de l'intérieur et celui de l'économie et des finances. Ce budget s'élevait à 1.650.714 euros en 2000 et à 1.344.947 euros en 2001.
Afin d'orienter les choix de programmation des différents ministères, la MILDT s'est fixé l'objectif, conformément aux orientations du plan triennal, d'élaborer des critères de sélection et d'évaluation qui seraient appliqués de manière systématique aux demandes ministérielles de financement, afin notamment de parvenir à un ciblage des zones prioritaires permettant de faciliter le financement des projets de coopération internationale .
En fonction des évolutions observées, une nouvelle hiérarchisation des zones prioritaires a été définie : les pays candidats à l'Union européenne, les Balkans et les Etats de la CEI ainsi que l'Afrique.
D'après le rapport d'évaluation du plan triennal élaboré par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), « la mise en oeuvre de cette stratégie de ciblage présente des résultats mitigés. Certes, entre 1999 et 2001, il y a eu une augmentation sensible à la fois des crédits et du nombre de projets dans les pays candidats à l'Union européenne, les Balkans et la CEI. Mais les crédits ont également augmenté en Amérique latine et aux Caraïbes, zone privilégiée jusqu'à présent mais non prioritaire selon le plan triennal, alors qu'ils ont diminué de façon importante pour l'Afrique, pourtant prioritaire en termes de santé publique ».
Malgré la volonté de la MILDT d'attribuer des financements aux zones prioritaires, le ciblage de celles-ci a été appliqué avec beaucoup de souplesse et la sélection a été réalisée dans une logique de projet et non dans une logique d'action globale et stratégique .
Dans ses recommandations stratégiques, l'OFDT insiste sur le fait que « la détermination de zones prioritaires apparaît toujours utile, mais d'autres critères au niveau des relations internationales peuvent imposer de ne pas abandonner des coopérations engagées, tout en continuant à réorienter les programmes vers la réduction de la demande et la réduction des risques et des dommages ».
En outre, l'OFDT réaffirme la nécessité pour la France d'appuyer l'action des organismes internationaux, traditionnellement plus axée vers la réduction de l'offre .
2. Des dispositifs de coopération internationale multiples et d'efficacité inégale
La France participe à différents types de dispositifs de coopération internationale, qu'ils soient bilatéraux, transfrontaliers ou multilatéraux.
Leurs objectifs varient, certaines structures ayant une vocation institutionnelle, d'autres une vocation plus opérationnelle. L'efficacité de ces structures varient également en fonction de la typologie présentée, les dispositifs bilatéraux étant nettement plus efficients que les instances internationales.
Interrogé sur l'efficacité des instruments de coopération internationale, M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, a estimé que la coopération était satisfaisante sur un plan bilatéral mais insuffisante sur le plan multilatéral.
a) Une coopération bilatérale satisfaisante
Les différents services répressifs français impliqués dans la lutte contre le trafic de stupéfiants participent à des dispositifs de coopération bilatérale donnant pleine satisfaction.
Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Nicolas Sarkozy a notamment insisté sur son étroite collaboration avec les ministres de l'intérieur espagnol, britannique et allemand notamment. De même, il a rappelé que le ministère dont il a la charge favorise la carrière des agents acceptant de s'installer à l'étranger et y augmente le nombre de postes disponibles. Il a ainsi indiqué à la commission : « Sur ces dernières semaines, nous avons installé sept personnes de la police française en Roumanie, pour six mois (...). J'en ai prépositionné quatre en Bulgarie sur l'affaire des réseaux de trafiquants de prostitution (...). En Colombie, nous allons aussi installer un certain nombre de fonctionnaires. Notre idée est que plus nous les installons en amont, plus nous sommes efficients et moins nous avons besoin de fonctionnaires ».
A propos de la politique d'envoi de fonctionnaires de police en poste à l'étranger, il a estimé : « C'est (...) une politique systématique. Non seulement je ne veux pas ramener les fonctionnaires en poste à l'étranger, mais je souhaite les développer. (...) Je crois beaucoup à cela. En plus, cela crée des liens avec les services étrangers. Nous allons installer du monde au Pakistan, en Russie aussi ».
L'ensemble des services répressifs participant à la politique nationale de lutte contre les drogues illicites a donc développé un réseau de fonctionnaires en poste à l'étranger , que ce soit les policiers et les gendarmes, dont le réseau implanté à l'étranger est géré par le service de coopération technique internationale de police (SCTIP) au ministère de l'intérieur, ou les services douaniers représentés à l'étranger par leur réseau d'attachés douaniers.
S'agissant des services de police et de gendarmerie, des fonctionnaires, généralistes ou officiers de liaison de l'Office central pour la répression des trafics illicites des stupéfiants (OCRTIS), sont présents en Amérique du Sud -notamment en Bolivie, en Colombie et au Pérou- en Europe -notamment en Turquie, dans tous les pays des Balkans- en Asie centrale, en Afrique du Nord et au Moyen Orient -dans tous les grands pays à l'exception de l'Iran- et enfin en Asie -en Thaïlande et bientôt en Afghanistan où l'implantation est prévue pour septembre 2003.
Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Pierre Mutz, directeur général de la gendarmerie nationale, a indiqué que sa direction privilégiait l'implantation de gendarmes, en tant qu'attachés de sécurité intérieure, dans les différentes ambassades de France à l'étranger, en fonction notamment des accords bilatéraux passés avec les pays hôtes, ce qui permettait de recueillir « des renseignements sur un certain nombre de filières à partir des pays producteurs de drogue ».
Enfin, le réseau des quinze attachés douaniers et attachés douaniers adjoints, implantés majoritairement sur le continent européen, exerce une mission permanente de recueil d'informations et de facilitation des échanges avec les principaux partenaires internationaux de la DGDDI.
b) Une coopération transfrontalière prometteuse
Différents dispositifs de coopération transfrontalière, auxquels participe la France, ont été mis en place en Europe afin, notamment, d'aboutir à une mutualisation plus satisfaisante des moyens matériels et humains mis à la disposition de la politique de lutte contre la drogue.
La France participe ainsi à des dispositifs de coopération transfrontalière police / douane mis en place en Europe, notamment aux centres de coopération policière et douanière (CCPD) et au dispositif de concertation « Hazeldonk ».
(1) Les centres de coopération policière et douanière (CCPD)
L'article 39-4 de la convention d'application des accords de Schengen prévoit que, dans les régions transfrontalières, la coopération peut être réglée par des arrangements entre les ministres compétents des parties contractantes. Dès lors, un comité de coordination de la politique européenne de sécurité intérieure, auquel participaient la police, la douane et la gendarmerie françaises, a adopté une convention cadre à partir de laquelle ont été établis les six accords signés à ce jour par la France avec ses voisins de l'espace Schengen (Italie, Allemagne, Espagne, Belgique, Luxembourg) ainsi qu'avec la Suisse.
La coopération mise en place par ces accords vise, d'une part, à la création de CCPD, qui regroupent dans une même enceinte les représentants des services de police, de gendarmerie et des douanes des deux Etats signataires de l'accord, d'autre part, la coopération directe entre unités correspondantes, situées de part et d'autre de la frontière afin d'améliorer la surveillance de cette dernière.
Actuellement sept CCPD sont entrés en activité : deux en France, un en Allemagne, un en Belgique, un au Luxembourg, un en Suisse et un en Italie. Trois autres CCPD sont prévus le long de la frontière franco-espagnole.
Les CCPD sont des structures d'échange d'informations et devraient permettre aux différents services coopérant d'orienter leurs interventions en vue d'une meilleure appréhension des différents trafics transfrontaliers. Le niveau d'intervention des CCPD est limité aux dossiers se rapportant à la petite et moyenne délinquances.
Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Nicolas Sarkozy a cité l'action des CCPD en exemple et a déclaré « je voudrais qu'à chacune de nos frontières il y ait des patrouilles mixtes, avec le droit de suite. Il est extraordinaire que nos frontières ne soient efficientes que pour nos policiers et gendarmes ».
On notera également au titre de la coopération transfrontalière la signature en février 2003 à Luxembourg d'un accord de coopération policière transfrontalière entre la Belgique, l'Allemagne et le Luxembourg, visant à mettre en place un commissariat commun, constituant le premier exemple de coopération transfrontalière véritablement multilatérale , fournissant un appui pratique en temps réel aux services de police. Ce nouveau bureau, regroupant onze policiers et douaniers des trois pays dans des locaux situés à Luxembourg, ne pourra intervenir de sa propre initiative et permettra surtout un échange d'informations entre autorités. En outre, la France et les Pays-Bas devraient participer à terme à cette structure, afin de lutter de manière efficace et coordonnée contre la criminalité transfrontalière et notamment le trafic de stupéfiants.
(2) Le dispositif de concertation « Hazeldonk »
En 1997, le « groupe de haut niveau franco-néerlandais sur la drogue » a décidé de réactiver les opérations de contrôles conjoints de lutte contre le tourisme de la drogue dits « Hazeldonk » et d'inviter le Luxembourg à participer à ces opérations qui associaient depuis 1994 la France, les Pays-Bas et la Belgique.
Dans ce cadre sont organisées des opérations de contrôles renforcés sur les vecteurs routier et ferroviaire (opérations « étoile ») ainsi que des opérations dites « de grande envergure » qui incluent, en plus du vecteur routier, les vecteurs ferroviaire et aérien. Ces opérations consistaient initialement à mettre en place des équipes d'observation néerlandaises à proximité des coffee shops, de repérer des « objectifs » et de transmettre ces cibles potentielles aux pays d'origine des véhicules pour interception dès retour sur le territoire national. Devant l'insuffisance des résultats de ces opérations, des modifications dans l'organisation ont été apportées, les véhicules suspects étant désormais contrôlés sur le territoire néerlandais. Par ailleurs, des agents des services répressifs français, belges et luxembourgeois sont désormais invités à participer, en qualité d'observateurs, aux opérations sur le territoire néerlandais afin de faciliter les contacts avec les services de police locaux et l'échange d'informations.
Depuis la mise en place de ces nouvelles modalités d'organisation, les résultats de ces opérations se sont améliorés, notamment aux Pays-Bas (amendes infligées, saisies de stupéfiants lors des contrôles et de perquisitions). Le nombre de signalements transmis par les services hollandais s'est accru et leur fiabilité s'est améliorée, même si l'un des points faibles reste le délai de transmission des informations. Les résultats des contrôles réalisés en France restent pour leur part très faibles.
(3) Le dispositif spécifique de coopération transfrontalière douanière
Entre administrations douanières de l'Union européenne, la convention du 18 décembre 1997 relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, dite convention de Naples II, en cours de ratification par les Etats membres, introduit de nouvelles formes de coopération douanière transfrontalière. Ratifiée à ce jour par dix Etats membres, elle est récemment entrée en vigueur dans sept d'entre eux : la France, les Pays-Bas, la Suède, l'Espagne, le Danemark, la Grande-Bretagne et l'Allemagne.
La principale utilité de cette convention réside dans son titre IV relatif aux formes spéciales de coopération, dont certaines s'inspirent de la convention d'application des accords de Schengen (droits d'observation et de poursuite transfrontalières, livraisons surveillées).
La poursuite transfrontalière
L'article 20 de cette convention permet à des agents des douanes de poursuivre sur le territoire d'un Etat membre une personne suite à la constatation en flagrant délit d'une des infractions détaillées à l'article 19-2, pouvant donner lieu à extradition, ou de participation à une telle infraction. Ce droit de poursuite s'exerce après autorisation de l'Etat requis, ou sans autorisation en cas de nécessité urgente.
L'observation transfrontalière
L'article 21 permet aux agents des douanes de continuer une observation commencée sur leur territoire, après autorisation ou sans autorisation en cas de situation urgente, sur celui d'un autre Etat membre.
La livraison surveillée
L'article 22 stipule que les Etats membres s'engagent à ce que des livraisons surveillées puissent être autorisées sur leur territoire dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions susceptibles de donner lieu à une extradition.
Les enquêtes discrètes
L'article 23 autorise un agent d'une administration douanière d'un Etat membre à participer à une enquête sur le territoire d'un autre Etat membre, sous couvert d'une identité fictive. Les modalités de mise en oeuvre de cet article sont déterminées par la législation nationale.
En droit français, la notion d'enquête discrète n'existe pas en tant que telle. La participation d'agents étrangers à des opérations d'infiltration est donc exclue.
Les équipes communes d'enquête
L'article 24 autorise la création de telles équipes, dans les cas où les enquêtes exigent une action simultanée et concertée. Les agents étrangers amenés à participer à ces équipes doivent se conformer au droit en vigueur sur le territoire duquel ils sont amenés à intervenir. En l'absence de précisions concernant le statut des enquêteurs étrangers, ceux-ci ne sont pas habilités à mettre en oeuvre des pouvoirs juridiques sur le sol français.
c) Une coopération multilatérale globalement insatisfaisante
En termes de dispositifs de coopération multilatérale, la lutte contre la drogue repose essentiellement sur deux structures, l'Organisation des Nations Unies et l'Union européenne.
(1) Le dispositif onusien et international de coopération
Le dispositif des Nations Unies de lutte contre la drogue s'articule autour de trois principales conventions internationales, déjà évoquées par le présent rapport, et faisant l'objet d'une application plus que partielle par certains de leurs signataires.
Sur un plan strictement opérationnel, la convention des Nations Unies de 1998 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes met en place un dispositif visant notamment à réprimer et prévenir la contrebande de drogues par le biais d'échange de renseignements à l'échelle internationale, ainsi qu'à combattre le blanchiment. Cette convention constitue le premier instrument universel ayant permis de définir légalement la notion de blanchiment et d'en prévoir la répression, à l'encontre des trafiquants eux-mêmes ainsi que de tous leurs intermédiaires et banquiers.
Le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID) a développé, pour répondre à cette évolution, un programme mondial de lutte contre le blanchiment auquel la France participe. Ce programme met en oeuvre des actions d'assistance technique centrées sur la formation des cadres chargés de la lutte contre le blanchiment ainsi que sur l'aide à la mise en place de structures régionales spécialisées.
Les Nations Unies ont par ailleurs adopté le 15 novembre 2000 une convention contre la criminalité transnationale organisée , premier instrument juridique de lutte contre ce phénomène qui fait obligation aux Etats parties d'instituer dans leur droit pénal national une infraction de blanchiment d'argent.
Plusieurs initiatives multilatérales et transnationales ont ainsi été prises en matière de lutte contre le blanchiment. Le Groupe d'action financière internationale (GAFI) a été créé en 1989 tandis que des organismes régionaux de type GAFI ont été instaurés dans diverses régions du monde (Caraïbes, Asie, Afrique, Amérique du Sud, etc.).
Le GAFI, créé à l'initiative de la France, regroupe actuellement 29 membres et a notamment pour but d'élaborer des normes de référence dans le domaine de la lutte anti-blanchiment. Il a prescrit aux pays membres l'adoption de quarante recommandations considérées comme le socle minimal d'un dispositif national anti-blanchiment devant être intégré dans le droit positif de chaque Etat membre. Ces recommandations sont révisées périodiquement pour tenir compte des changements de tendances en matière de blanchiment et pour contrecarrer de nouvelles menaces. En outre, le GAFI surveille la mise en oeuvre de ses recommandations dans les pays membres grâce à des exercices d'évaluation. Cette procédure permet au GAFI de dresser un panorama des mesures prises pour la lutte contre le blanchiment et de déterminer une liste de pays dans lesquels les quarante recommandations n'ont pas suffisamment fait l'objet de mises en oeuvre. Ainsi, en juin 2000, le GAFI avait publié une liste noire des pays considérés comme non coopératifs dans ce domaine.
Toutefois, il faut noter la faiblesse de la coopération internationale en matière de renseignement financier. La recommandation n° 32 du GAFI encourage en effet l'échange d'informations entre les cellules de renseignement financier des différents pays, mais le vide juridique s'agissant de l'échange d'informations sur les opérations suspectes constitue une lacune significative. C'est pourquoi ces cellules ont souvent cherché à conclure entre elles des conventions bilatérales de coopération. Ce fut notamment le cas de TRACFIN en France.
Plus globalement, les lacunes des dispositifs de coopération multilatérale en termes d'échange de renseignement ont été plusieurs fois exposées à la commission d'enquête.
L'activité d' Interpol a ainsi été sévèrement critiqué à plusieurs reprises devant la commission comme n'exerçant aucun rôle opérationnel au niveau international et ne facilitant que très peu les échanges d'informations entre pays engagés dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants.
M. Gérard Peuch, chef de la brigade des stupéfiants de la préfecture de police de Paris, a ainsi déclaré lors de son audition par la commission que ces rapports avec Interpol étaient nuls et qu'il ne s'agissait, selon lui, que d'un organisme de transit d'informations.
S'agissant des relations entre l'OCRTIS et Interpol, il faut noter que le chef de l'OCRTIS assiste aux réunions d'experts et aux réunions thématiques organisées par Interpol sur le trafic des produits stupéfiants et plus précisément sur les groupes criminels, sur les itinéraires de la drogue ainsi que sur les nouvelles menaces concernant notamment la production des drogues de synthèse ou des précurseurs chimiques.
Par ailleurs, l'OCRTIS centralise et transmet à Interpol l'ensemble des messages d'information et des requêtes des services nationaux dédiés à la lutte contre le trafic de stupéfiants et relatifs à des enquêtes d'envergure internationale : 5.647 courriers ont ainsi été traitées en 2002.
Enfin, la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure donne une base légale aux traitements automatisés de données personnelles mis en oeuvre par la police et la gendarmerie nationales, afin d'étendre la possibilité de consulter ces fichiers au cours d'enquêtes administratives ou de missions de sécurité et de permettre la transmission des données personnelles à des organismes internationaux de coopération policière ou à des services de police étrangers.
(2) Les carences du dispositif européen de coopération « opérationnelle »
Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Nicolas Sarkozy a pointé du doigt les difficultés d'une réelle coopération européenne en matière de lutte contre les drogues. Il a ainsi indiqué que « sur le plan multilatéral, nous nous heurtons au fait qu'il n'existe pas une autorité judiciaire européenne » et que le travail d'Europol portait plus sur la coopération que sur l'opérationnel.
La difficulté au plan européen réside, d'une part, dans la diversité des législations européennes relatives à la lutte contre la drogue, déjà évoquée dans le présent rapport, d'autre part, dans l'absence d'outils de réelle coopération opérationnelle.
Sur le plan du renseignement notamment, l'attention de la commission d'enquête a été attirée à plusieurs reprises sur les difficultés d'échanges d'informations entre pays membres ainsi que sur l'inefficacité d'Europol en termes de mutualisation et de redistribution du renseignement.
L'office européen de police Europol , dont le siège est à La Haye aux Pays-Bas, fonctionne depuis le 1 er juillet 1999 après sa création par les Etats membres de l'Union européenne le 26 juillet 1995.
Europol a pour objet d'améliorer l'efficacité et la coopération internationale des services compétents des Etats membres s'agissant de la prévention des formes graves de criminalité internationale, lorsque des indices concrets révèlent l'existence d'une criminalité organisée touchant au moins deux Etats membres. Ses principales attributions consistent à transmettre et analyser des informations, à fournir des renseignements stratégiques et à aider les services des Etats membres en matière de formation, d'équipement et de coordination des enquêtes.
Le champ de compétences d'Europol, fixé par la convention du 26 juillet 1995 entrée en vigueur en 1998, recouvre notamment le terrorisme, les trafics illicites de stupéfiants, les filières d'immigration clandestine et la traite des êtres humains.
Dans le domaine des stupéfiants, l'OCRTIS, pour la direction centrale de la police judiciaire, participe à tous les fichiers initiés par les Etats membres et gérés par Europol. Via l'Unité nationale Europol (UNE), l'OCRTIS alimente les bases de données thématiques d'Europol et reçoit de ce dernier un important flux d'informations émanant des pays membres.
Pour sa part, la douane française participe à l'échange de renseignements avec les services européens de police et des douanes par le biais d'Europol. Dans ce cadre, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) est l'interlocuteur, pour la douane, de l'UNE. Elle est responsable du traitement des demandes émanant des services. La démarche de la douane vis-à-vis d'Europol vise à établir une complémentarité entre ce réseau d'information et d'échanges de renseignements et le réseau douanier traditionnel d'assistance administrative mutuelle internationale (AAMI), qui reste l'outil privilégié.
Alors que M. Bernard Petit, chef de l'OCRTIS, a fait preuve d'une relative indulgence à l'égard d'Europol lors de son audition par la commission, en estimant qu'on était souvent « sévère avec cet organisme de façon certainement injuste », la commission ne peut que constater une relative inefficacité opérationnelle de cet outil de mutualisation du renseignement au niveau européen.
M. Gérard Peuch, chef de la brigade des stupéfiants de la préfecture de police de Paris a indiqué à la commission : « Quant à Europol, j'ai de temps en temps des fonctionnaires belges ou français d'Europol qui viennent me voir et me demandent ce que je fais. Je fais la même chose : je leur demande ce qu'ils font. Il faut reconnaître que tout reste à faire (...). On les alimente beaucoup, contrairement à ce qu'on pense, c'est-à-dire que l'information va beaucoup sur Europol, mais peu de choses en découlent ». Il a ajouté : « Il faut construire l'Europe sur le plan pénal. A cet égard, il est évident que le trafic des stupéfiants et le terrorisme peuvent être les deux bases fondamentales pour construire quelque chose de solide et de sérieux ».
Les dispositions du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité organisée, présenté en conseil des ministres le 9 avril 2003 par M. Dominique Perben, ministre de la justice, devrait permettre de réaliser de réels progrès en termes d'entraide judiciaire internationale. En effet, le chapitre II du projet de loi vise à améliorer les dispositions relatives à l'entraide internationale. A cette fin, il est introduit dans le code de procédure pénale les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la convention du 29 mai 2000, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'UE, permettant notamment la constitution d'équipes communes d'enquête ainsi que l'application de la décision instituant Eurojust du 28 février 2002.
|
LES ORIGINES DE LA CRÉATION D'EUROJUST * Les débuts laborieux de la coopération judiciaire en matière pénale La coopération judiciaire en matière pénale s'est véritablement développée après la signature du traité de Maastricht, même si des initiatives avaient déjà été prises auparavant. Jusqu'alors, les textes fondant la coopération en matière pénale étaient, pour l'essentiel, les conventions du Conseil de l'Europe sur l'extradition (1957) et l'entraide judiciaire en matière pénale (1959). Le traité de Maastricht a fait de la coopération judiciaire en matière pénale un domaine d'intérêt commun des pays de l'Union européenne. Sur la base de ce traité, de nombreuses actions ont été entreprises sans que des progrès décisifs aient été accomplis. Ainsi, de nombreuses conventions ont été adoptées, par exemple sur l'extradition, le fonctionnement d'Europol, la protection des intérêts financiers, mais la plupart ne sont toujours pas entrés en vigueur. En effet, le traité de Maastricht a prévu qu'une convention ne pouvait entrer en vigueur qu'après ratification par tous les Etats membres de l'Union européenne. Des actions communes ont également été lancées. L'une d'entre elles permettant l'échange de magistrats de liaison afin d'améliorer la coopération judiciaire, la France a rapidement fait usage de la possibilité d'envoyer des magistrats de liaison dans les pays de l'Union européenne et cet instrument souple de coopération semble être très utile. En juin 1998, le Conseil a également adopté une action commune concernant la création d'un réseau judiciaire européen destiné à rendre l'entraide judiciaire bilatérale plus rapide et plus efficace. Aux termes de cette action commune, chaque Etat est invité à désigner des « points de contact » appelés à jouer le rôle d'intermédiaire pour faciliter la coopération judiciaire. Ces points de contact sont ainsi à la disposition tant de leurs autorités judiciaires locales que des points de contact et des autorités judiciaires des autres Etats membres. Les points de contact sont également appelés à fournir des informations pratiques et juridiques aux autorités judiciaires ou points de contact étrangers. Compte tenu de l'existence des magistrats de liaison et du réseau judiciaire européen, l'un des enjeux des négociations sur la création d'Eurojust consistait dans la nécessité d'éviter que les tâches de ces différents instruments soient redondantes et concurrentes. Le traité d'Amsterdam a notamment apporté des modifications aux règles d'adoption des textes de coopération en matière pénale. Il a ainsi prévu un droit d'initiative de la Commission européenne qui était jusqu'alors exclu. Il a en outre limité le nombre de ratifications nécessaires pour qu'une convention puisse entrer en vigueur. Il a enfin donné compétence à la Cour de justice des Communautés européennes pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation des décisions-cadres, décisions ou conventions adoptées dans le cadre du troisième pilier de l'Union européenne. * Le Conseil européen de Tampere et la décision de créer Eurojust Les 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen, réuni à Tampere, a pour la première fois, consacré l'essentiel de ses travaux à la réalisation de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Au cours de cette réunion, le Conseil européen a notamment décidé : - de travailler à la mise en place d'un régime d'asile européen commun devant aboutir à terme sur une procédure d'asile commune et un statut uniforme pour les personnes qui se voient accorder l'asile ; - de rapprocher les législations nationales relatives aux conditions d'admission et de séjour des ressortissants de pays tiers et de lutter contre ceux qui se livrent à la traite des êtres humains et à l'exploitation économique des migrants ; - de définir des normes minimales garantissant un niveau approprié d' aide juridique pour les affaires transfrontalières dans l'ensemble de l'Union ; - d'établir des normes minimales communes pour simplifier le règlement de certains litiges transfrontaliers ou protéger les victimes de la criminalité ; - de renforcer la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires , le principe de reconnaissance mutuelle devant « devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l'Union » ; - de réaliser une étude générale sur la nécessité de rapprocher les législations des Etats membres en matière civile . En matière de lutte contre la criminalité, le Conseil européen a souhaité une intensification de la coopération dans ce domaine, demandant en particulier la mise en place sans délai des équipes communes d'enquête prévues par le traité sur l'Union européenne, notamment pour lutter contre le trafic de drogue, la traite des êtres humains et le terrorisme. Il a également demandé la création d'une académie européenne de police. Enfin, le Conseil européen a décidé la création d'Eurojust : « Afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité organisée, le Conseil européen a décidé la création d'une unité (Eurojust) composée de procureurs, magistrats ou d'officiers de police ayant des compétences équivalentes détachés par chaque Etat membre conformément à son système juridique. Eurojust aura pour mission de contribuer à une bonne coordination entre les autorités nationales chargées des poursuites et d'apporter son concours dans les enquêtes relatives aux affaires de criminalité organisée, notamment sur la base de l'analyse effectuée par Europol ; cette unité devra aussi coopérer étroitement avec le Réseau judiciaire européen, afin notamment, de simplifier l'exécution des commissions rogatoires. Le Conseil européen demande au Conseil d'adopter l'instrument juridique nécessaire avant la fin de l'année 2001 ». |
(3) Un exemple prometteur de coopération multilatérale : la zone Caraïbe
Lors de son déplacement à Saint-Martin, la commission d'enquête a pu constater que des instruments de coopération multilatérale à vocation opérationnelle avaient été mis en place dans la zone Caraïbe.
Le narco-trafic dans cette zone est un trafic organisé, structuré et de portée internationale. Il est le fait d'organisations criminelles et concerne des flux importants de produits diversifiés. La lutte contre le trafic de stupéfiants dans cette zone impose donc, pour être efficace, une réelle coordination internationale entre services répressifs des différents Etats présents dans la région.
Marquée par l'hégémonie des Etats-Unis - présents à travers divers organismes parmi lesquels la JIATFE (Joint interagency task force) de Key West en Floride, la DEA (Drug enforcement administration) ainsi que leurs nombreuses patrouilles de garde-côtes - cette coopération tente de s'organiser par le biais d'une structuration institutionnelle et met l'accent sur la nécessité d'échanger rapidement le renseignement et de monter des opérations coordonnées.
La France s'intègre dans ce schéma de coopération multilatérale car cette zone représente un intérêt stratégique majeur pour les services répressifs français dans leur lutte contre les narco-trafiquants.
Ainsi, l'officier de liaison interministériel auprès de la JIATFE de Key West aux Etats-Unis est pour cette structure le représentant unique de l'ensemble des services français engagés dans la lutte contre le narco-trafic dans la zone Caraïbe, c'est-à-dire, d'après le contenu de sa lettre de mission, les préfets des régions Martinique et Guyane, délégués du gouvernement pour l'action en mer, ainsi que les unités engagées dans la lutte contre le trafic de stupéfiants dans cette région (DNRED, DGGN, DGPN, DGPJ, OCRTIS). Il assure également l'interface avec les officiers de liaison étrangers affectés à la JIATFE. Tous les renseignements et informations relatifs à la lutte contre le narco-trafic doivent préalablement à leur exploitation, dans une perspective d'action opérationnelle ou d'investigation judiciaire, être vérifiés ou enrichis.
De manière générale, dans la zone Caraïbe, le grand nombre d'acteurs, au plan français mais surtout international, rend complexes et parfois opaques les réseaux par lesquels transite l'information. Des progrès pour rationaliser l'échange d'informations ont cependant été réalisés ces dernières années.
Lors de son audition par la commission d'enquête, M. François Mongin, directeur général des douanes et des droits indirects, a ainsi estimé : « Nous avons aujourd'hui une petite équipe de qualité qui n'est pas nombreuse mais qui est bien acceptée dans le paysage et qui, par sa connaissance du terrain (...) arrive à collecter des renseignements et à mener, en coopération avec d'autres services, y compris d'autres pays (je pense en particulier à la DEA américaine), des opérations coordonnées de lutte contre le trafic de drogue ».
En matière douanière, la Conférence douanière inter-caraïbe (CDI), devenue opérationnelle en 1989, compte aujourd'hui 38 membres signataires, parmi lesquels les pays riverains de la zone Caraïbe ainsi que les Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Espagne et la France. La CDI a pour objectif principal de développer la coopération et d'accroître l'échange d'informations entre les administrations douanières de la zone en vue de lutter plus efficacement contre les fraudes douanières, notamment en matière de stupéfiants, qui s'y développent.
A cet égard, la mission de la CDI est d'assister ses membres dans l'accomplissement de leurs fonctions douanières, à savoir la perception et la protection des droits et taxes, la détection et l'interdiction des drogues illicites et autres marchandises prohibées à usage restreint, ainsi que la facilitation du commerce légitime et des échanges internationaux. La CDI vise également à encourager les douanes régionales caribéennes à prendre en compte le rôle actif qui leur revient au niveau national et régional dans la lutte contre toutes les formes de trafics et contre le terrorisme. En outre, la CDI encourage la coopération et le partenariat en développant des liens stratégiques avec les autres administrations ou organisations engagées dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants notamment, ainsi qu'avec les gouvernements de la zone et les acteurs du secteur privé.
Les principales réalisations de la Conférence douanière inter-caraïbe en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants depuis sa création ont été :
- la création d'un Bureau conjoint de renseignement (BCR) à San Juan, Porto Rico, afin de soutenir le Réseau conjoint de renseignement : ce bureau traite l'information et le renseignement, surtout à partir d'analyses de risque. En relation avec le réseau d'officiers de renseignement, il soutient et renforce les capacités de lutte des douanes de la région ;
- la conception et l'implantation dans la zone du système régional de « Clearances » (SRC), visant à lutter contre le trafic de drogues et la contrebande : il s'agit d'un système informatique connecté à internet comprenant quarante postes de travail implantés dans 24 pays de la zone Caraïbe qui saisissent dans une base de données les mouvements des bateaux de plaisance à travers les clearances ;
- la mise en oeuvre d'un programme sur les précurseurs chimiques et les profils à risque : ce programme a pour objet d'améliorer la connaissance des précurseurs chimiques entrant dans la composition des drogues ainsi que celle de leur circulation dans le monde notamment vers les centres de production des drogues de synthèse. Il est accompagné d'un cours sur le trafic de drogues par conteneur ;
- l'adoption d'un programme régional sur l'intégrité : la CDI a reconnu le phénomène de corruption qui se développe dans les rangs des douanes de la région et a mis en place un programme sur l'intégrité impliquant aussi bien les fonctionnaires des douanes que les acteurs économiques du secteur privé.
Enfin, la CDI a adopté un nouveau plan stratégique quinquennal (2003-2008) fondé sur six objectifs : renforcer la coopération et l'échange du renseignement, améliorer le développement et la gestion des ressources humaines, moderniser les législations et procédures, continuer la mise en place de mesures pour combattre la corruption, développer des mesures en faveur du commerce, enfin faire connaître la CDI auprès des gouvernements de la zone et renforcer les relations avec les autres organisations internationales présentes dans la région.
Parallèlement, dans le cadre de l'initiative anti-drogue de l'Union européenne , un bureau de gestion des projets a été créé en 1998 au sein de la zone Caraïbe. Les programmes de création d'unités conjointes de renseignement maritime (National joint headquarters) et de formation interministérielle à l'échelle caribéenne sont parmi les plus visibles des projets gérés par ce bureau. Il a cependant été mis fin à ses activités en janvier 2002.
Cette initiative européenne s'inscrivait dans le droit fil des recommandations du plan d'action de la Barbade (1996) visant à améliorer la lutte contre les stupéfiants et la coopération régionale y afférant, notamment dans le domaine maritime. Au terme de ce plan d'action, le CARCICOM et le PNUCID ont organisé à Trinidad, en décembre 2001, une conférence diplomatique interrégionale dans le but de mobiliser des financements pour la mise en place d'un nouveau projet authentiquement régional. Bien que tardivement, le CARICOM a créé une « task force » sur le crime et la sécurité chargée d'élaborer une stratégie financée par les membres de cette organisation ainsi que par les bailleurs de fonds internationaux.
En outre, s'agissant également de la coopération douanière internationale dans cette zone, il faut noter que la direction interrégionale des douanes Antilles-Guyane fait partie du réseau de correspondants stupéfiants et criminalité organisée (RESCO) de la douane et a initié, à ce titre, en 2002, deux opérations d'envergure, l'une couvrant l'ensemble des pays de la chaîne des petites Antilles, l'autre concentrée sur la coopération interrégionale et les îles de la Dominique et de Sainte-Lucie. Au delà des saisies les ayant ponctuées, ces opérations ont permis de mettre en oeuvre des liaisons institutionnelles et opérationnelles tant dans le domaine du renseignement que de la coopération maritime.
Sur le plan national, ces opérations internationales ont notamment permis la mise en oeuvre de procédures de coopérations interministérielle et interrégionale avec la police (OCRTIS et PAF), la gendarmerie ainsi que la marine nationale (COMAR).
Sur le plan international, la coordination centralisée de ces opérations depuis le PC de transmission de l'interrégion des douanes a contribué à asseoir la crédibilité des Antilles françaises dans la zone auprès des instances coordinatrices américaines (JIATFE de Key West) ou des petites Antilles anglophones (Système régional de sécurité, Barbade). L'intégration d'officier de liaison étrangers auprès du PC d'opération a été un des facteurs déterminants de l'amélioration des échanges avec les partenaires étrangers.
Enfin, s'agissant plus spécifiquement de la coopération bilatérale entre services répressifs sur l'île de Saint-Martin , la commission d'enquête a pu, lors de son déplacement sur cette île, mesurer l'ampleur des progrès restant à faire en la matière.
La coopération douanière s'est développée au cours des dernières années notamment grâce à la signature, le 11 janvier 2002, de la convention entre la France et les Pays-Bas, non encore ratifiée, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre leurs administrations douanières en vue d'appliquer correctement la législation douanière, de prévenir, de rechercher, de constater et de réprimer les infractions douanières dans la région Caraïbe, et notamment sur l'île de Saint-Martin. Cette convention doit permettre une meilleure circulation du renseignement entre les deux administrations douanières ainsi qu'une coopération opérationnelle sur l'île de Saint-Martin.
S'agissant de la coopération entre les autres services répressifs des deux nations représentées sur l'île, la commission d'enquête a pu constater qu'elle est encore embryonnaire et que des efforts de la part des garde-côtes hollandais, de la police hollandaise ainsi que des autorités judiciaires hollandaises de l'île de Saint-Martin étaient indispensables pour mettre en place une réelle coopération bilatérale sur l'île.
d) Les commissions rogatoires internationales : des délais de retour trop longs
Mme Catherine Domingo, substitut du procureur de Bayonne, a souligné lors de son audition les problèmes relatifs aux commissions rogatoires internationales, pour lesquels on observe des délais de retour extrêmement longs de 6 à 18 mois. Par ailleurs, elle a indiqué que les réponses étaient parfois incomplètes, notamment s'agissant de l'Espagne et la Grande-Bretagne, alors que la coopération avec la Belgique était très constructive.
Elle a estimé que la diversité des législations n'était pas en cause, « ces demandes étant moins liées à l'audition de personnes qu'à des vérifications de cartes téléphoniques, d'abonnements ou de situations professionnelles, familiales et bancaires de certaines personnes. Il s'agit plus de problèmes de délais de mise à exécution que de demandes liées à des problèmes de procédure. »
Maître Gérard Tcholakian, du Conseil national des barreaux, a également souligné ces difficultés.
TROISIÈME PARTIE
-
HUMANISME ET RESPONSABILITÉ :
LES DEUX PILIERS D'UNE NOUVELLE POLITIQUE
Les deux premières parties du présent rapport viennent de tirer le signal d'alarme : la France se drogue !
Nos enfants sont de plus en plus nombreux à consommer de plus en plus jeunes des produits de plus en plus dangereux. Certains nous disent que cette banalisation correspond à un phénomène de société irréversible. Il ne servirait à rien de lutter et il faudrait se résigner à accompagner cette évolution. Pourtant, nous ne pouvons pas croire à la fatalité de la drogue.
Bien sûr, la toxicomanie reflète le malaise d'une société qui ne va pas bien. Mais ce phénomène a été exploité par une idéologie permissive qui a trop inspiré une politique molle et des pratiques ou des discours complaisants à l'égard de la drogue. Les responsables politiques ont tendance à baisser les bras parce qu'ils ne mesurent pas la gravité des enjeux mais aussi parce qu'ils finissent par croire ceux qui leur affirment qu'il n'y a rien à faire. Cette démission est inacceptable. Nous avons le devoir collectif de garantir à nos enfants le droit de vivre libres dans une société sans drogue . Alors, que pouvons nous faire ?
Il faut sans doute commencer par essayer de comprendre les causes du succès de tous les produits psychoactifs, licites ou illicites. C'est une condition nécessaire pour éviter les solutions simplistes qui ne peuvent que mener à l'échec. En revanche, des idées simples pour aborder un problème complexe peuvent être les idées fortes garantes du succès. D'abord, en refusant d'être utopiste ou fataliste, on peut se fixer un objectif réaliste : contenir le fléau puis tenter de le faire refluer . Ensuite, il faut adopter une stratégie anti-drogue qui recueille le consensus de la nation. Nous pensons que c'est dans une inspiration humaniste , servie par une volonté politique sans faille, que nous pourrons trouver les solutions acceptables par tous.
La dangerosité de toutes les drogues est avérée. Il n'existe pas de drogues « douces », même si diaboliser certaines d'entre elles serait contre-productif. L'interdit d'usage doit donc être réaffirmé avec force dans des conditions telles qu'il soit compris, accepté et respecté. Il faut l'expliquer pour redonner du sens à la loi. C'est donc, en premier lieu, un changement d'atmosphère et de philosophie qu'il faut instaurer par un message clair. Cela correspond d'ailleurs au souhait exprimé par 75 % des Français.
En second lieu, la guerre à la drogue doit agir sur l'offre et sur la demande. La répression doit frapper durement toutes les formes de trafic et tous les profiteurs d'un système jusqu'ici trop laxiste. En particulier, les « petits » dealers doivent être poursuivis sans relâche, notamment, dans le périmètre des écoles, sans pouvoir s'abriter derrière une indulgence irresponsable pour le « simple » usager.
La demande de consommation de ces produits dangereux ne pourra diminuer que si l'axe central de la nouvelle politique est une prévention réelle, une « prévention totale » , faite d'éducation à la santé, d'information et de formation, de prise en charge psychologique, sanitaire et sociale, de réinsertion et, bien entendu, de sanction.
L'objectif de la prévention doit être d'empêcher de nouvelles personnes de tomber dans la drogue, et d'aider à en sortir celles qui sont sous sa dépendance. Plus elle sera personnalisée, plus elle aura de chances de succès. Elle aura aussi le souci de ne pas stigmatiser l'usager de drogue qui n'est pas un marginal ou un pestiféré, mais une personne en danger. La société a un devoir de solidarité avec tous ses enfants, surtout les plus vulnérables, mais sa compréhension doit être sans faiblesse. La compassion n'est pas la complaisance. L'humanisme ne saurait oublier la responsabilité individuelle ni les devoirs envers la collectivité. Aussi, la personnalisation de la réponse de prévention devra-t-elle trouver sa contrepartie dans le respect absolu des obligations et sanctions prévues par la loi pour l'usager de drogue interpellé.
La sanction dès que l'interdit d'usage est transgressé est un élément clef de la prévention. Il faut qu'elle soit systématique, même si elle doit être proportionnée à la faute. Elle sera aussi suffisamment diversifiée pour offrir au juge une palette complète de réponses à la fois judiciaires et socio-sanitaires susceptibles de s'adapter à chaque situation.
La question de la drogue concerne la société toute entière. Les parents, l'école, les associations, les institutions et tous les citoyens ont un rôle à jouer. C'est un enjeu de santé publique, de sécurité et d'évolution de la nature même de notre société. Réagir est un devoir, avant un désastre annoncé. Il n'est pas trop tard, mais il n'est que temps.
I. UNE RÉPONSE JUDICIAIRE SYSTÉMATIQUE
A. ÉVITER LE PIÈGE DE LA LIBÉRALISATION
Le débat sur la dépénalisation ou la libéralisation des drogues est récurrent. On peut à cet égard citer l'« appel du 18 joint » 1976, signé par M. Bernard Kouchner, devenu par la suite ministre de la santé, les propos de M. Charles Pasqua en 1993 appelant à l'ouverture d'un débat, ou plus récemment l'envoi à tous les députés d'un joint par le Collectif d'information de recherche cannabique (CIRC), le 9 décembre 1997.
Les arguments sont bien connus et paraissent au premier abord séduisants, mais l'analyse de leurs conséquences concrètes conduit à les invalider.
1. Des arguments théoriquement séduisants
Les partisans d'une libéralisation mettent tout d'abord en avant « l'échec » de la loi de 1970, selon eux à l'origine des différents maux attribués normalement à la toxicomanie, avant de présenter les améliorations attendues.
a) L'échec de la loi de 1970, paradoxalement à l'origine de tous les maux
(1) Des résultats paradoxaux
Ainsi que l'a fait observer à la commission d'enquête maître Francis Caballero, président du Mouvement de légalisation contrôlée, « le système actuel s'appelle la guerre à la drogue. Tout est interdit : l'usage, l'incitation et le trafic, évidemment, dans des conditions de sécurité extrêmes. (...) Pour un détenteur de quelques grammes de cannabis, ce qu'on appelle une barrette, le droit positif, qui punit la détention comme un acte de trafic, prévoit une garde à vue de quatre jours avec un avocat au bout de 72 heures, c'est-à-dire trois jours, alors qu'un assassin violeur d'enfants, une racaille qui a fait quinze braquages de banque et a dix meurtres à son actif aura un avocat dès la première heure et, de nouveau, au bout de vingt heures. Je ne parle pas des perquisitions de nuit, de la prescription de vingt ans pour les délits au lieu de trois ans, des peines perpétuelles ou des vingt ans de réclusion pour la culture (...) On a des procédures qui sont aussi dures qu'en matière de terrorisme . »
Malgré tout, les partisans d'une légalisation des drogues considèrent que cette guerre contre les drogues a été un échec, en dépit des sommes colossales investies pour faire appliquer la loi, faire fonctionner les tribunaux et remplir les prisons. Ainsi, au Royaume-Uni, en 1991, la possession de cannabis représentait 75 % de tous les délits liés aux drogues illicites. « En France, on est passé de 2.000 à 100.000 interpellations et de 2.000 personnes dans les prisons françaises au tiers des détenus pour les infractions à la législation sur les stupéfiants », a rappelé maître Francis Caballero. Il s'agit le plus souvent d'affaires mineures qui mobilisent les services de police et engorgent les tribunaux.
Ainsi que l'a indiqué lors de son audition M. François-Georges Lavacquerie, membre du CIRC, en réponse aux déclarations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, M. Nicolas Sarkozy, devant la commission d'enquête, « 90 % des gens ne sont pas punis », ce qui, d'après le ministre, « signifie qu'ils sont dépénalisés de fait. Nous pensons, nous, qu'il ne s'agit pas là d'un laxisme des juges, mais de l'appréciation de la justice que 90 % de ces affaires ne méritaient pas de poursuites réelles et qu'il n'y avait pas là de quoi fouetter un chat. Il n'empêche que ces affaires ont occupé à notre avis d'une manière excessive les services de police et de justice ». Les coûts sociaux de cette prohibition seraient considérables, les usagers de drogues étant considérés comme des délinquants.
Or, la loi n'a pu empêcher l'augmentation de la consommation, la banalisation du cannabis et l'apparition très préoccupante des nouvelles drogues de synthèse.
De plus, le nombre d'injonctions thérapeutiques reste faible (environ 9.000), dont un tiers seulement donne des résultats satisfaisants. Ce chiffre paraît dérisoire par rapport aux 160.000 héroïnomanes et aux 65.000 consultants qui se sont présentés en 1995 dans les centres de soins spécialisés, dont moins de 10 % sont arrivés par le biais d'une injonction thérapeutique. De plus, l'injonction thérapeutique n'est pas adaptée aux usagers de cannabis. Elle ne serait utile que dans certains cas de cannabisme chronique, alors que les usagers de cannabis constituent l'essentiel des personnes interpellées.
(2) Usage de drogue ne signifierait pas forcément toxicomanie
La loi serait un obstacle à l'instauration d'une prévention efficace en refusant de reconnaître qu'à côté de la dépendance peut exister un usage occasionnel, plus ou moins régulier.
L'usage simple n'entraîne pas toujours la dépendance. Ainsi, comme l'indiquait à la commission M. Hugues Lagrange, sociologue, si plus de 7 millions de personnes ont expérimenté le cannabis en France, « seules » 300.000 sont dépendantes du cannabis, ce qui montre combien l'écart est important entre l'expérimentation et l'usage problématique (de 1 à 20).
Dès 1978, le rapport de Mme Monique Pelletier remis à M. Valéry Giscard d'Estaing avait largement souligné que l'auto-destruction n'était pas le destin inéluctable de tous ceux qui consomment de la drogue, y compris les plus dures. Pour certains, ce sont des facteurs d'ordre psychologique ou social qui, bien plus que les propriétés des drogues, déterminent la toxicomanie.
En revanche, cette situation gênerait l'information des usagers de cannabis qui, s'ils ne sont pas jugés, ne disposent d'aucun conseil non plus, comme l'a rappelé maître Francis Caballero lors de son audition.
En outre, il est difficile d'admettre l'amalgame entre l'adolescent fumeur occasionnel de haschich et l'héroïnomane, le premier ayant un comportement festif et initiatique et le second réellement toxicologique.
(3) La dangerosité relative de l'alcool, du tabac et des médicaments
Une certaine confusion s'est instaurée du fait de l'inclusion des drogues licites dans le champ d'intervention de la MILDT et de l'exploitation erronée des conclusions du rapport du professeur Bernard Roques relatif à la classification de la dangerosité des drogues. Le consensus sur l'interdit des drogues illicite s'est érodé, la distinction entre produits licites et illicites ne reposant sur aucune base biologique sérieuse.
Il en va de même s'agissant des polémiques entourant les médicaments psychotropes. Par ailleurs, ainsi que le soulignait M. Alain Ehrenberg lors de son audition, la notion de dépendance est aujourd'hui beaucoup plus large que la dépendance aux drogues et est entrée dans le vaste champ de la souffrance psychique et de la santé mentale (jeu, sexe, nourriture ou drogue illicite).
Dans le même sens, les partisans de la dépénalisation insistent sur le fait que la consommation de cannabis n'est pas mortelle et qu'il n'y a pas de dépendance physique, la dépendance psychique étant modérée (et inférieure à celle entraînée par le tabac, l'alcool ou les médicaments psychotropes). Comme l'a souligné lors de son audition M. François-Georges Lavacquerie, membre du CIRC, « l'alcool tue 40.000 personnes chaque année, il est impliqué en outre dans des dommages causés à autrui très importants et bien documentés et il n'est pas pour autant interdit. Son usage est simplement régi et restreint par un certain nombre de dispositions. Quant au tabac, qui tue 68.000 personnes par an, il est en vente libre absolue. »
En outre, la théorie de l'escalade (selon laquelle le cannabis mène aux drogues « dures ») est fortement contestée, notamment par le rapport Le Dain paru en 1972 au Canada.
L'écart serait donc croissant entre la légitimité sociale d'un usage de cannabis apparemment massif et l'illégalité juridique du produit. L'interdit n'aurait plus de sens.
(4) La légitimité incertaine de la sanction pénale
Les partisans de la libéralisation soulignent qu'il n'existe pas d'autre cas où le risque pris par un individu pour sa santé, sans aucun trouble à l'ordre public, est passible d'une peine d'un an de prison. Ceci leur apparaît plus particulièrement choquant s'agissant d'une consommation à domicile.
Pour maître Francis Caballero, « le fait de punir en théorie d'un an de prison, comme le fait aujourd'hui la loi, un individu majeur et solitaire qui consomme chez lui une substance pour se procurer des sensations est une honte au pays des droits de l'homme ».
Il s'appuie en particulier sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 112 ( * ) . Le droit pénal ne saurait prétendre régir le comportement privé des individus, pour autant qu'ils ne portent pas préjudice à autrui, comme l'a rappelé M. François-Georges Lavacquerie, membre du CIRC. De plus, le suicide n'est plus incriminé.
L'emprisonnement n'a pu empêcher l'explosion de la consommation et peut aggraver le problème d'insertion sociale ou de relation avec les proches souvent à l'origine de l'usage de drogue. De plus, la prison renforce le lien des personnes détenues avec la délinquance.
(5) Une incompréhension croissante de la part des jeunes qui décrédibilise la loi
Ainsi que l'a souligné lors de son audition le docteur Francis Curtet, psychiatre : « On en est arrivé maintenant à un stade dans lequel, pour la majorité des jeunes, le cannabis est considéré comme leur apéritif, en comparaison à l'alcool, qui serait l'apéritif des parents. Cela ne veut pas dire que la majorité des jeunes prend du cannabis, mais si on faisait un micro-trottoir sur ce point, je pense que plus de la moitié des jeunes répondraient que, pour eux, c'est l'équivalent de l'apéritif de leurs parents et que c'est même moins dangereux . » Ils ne comprennent pas l'interdit dont le cannabis fait l'objet, vécu comme une mesure anti-jeunes.
Par ailleurs, le cannabis étant plus ou moins dépénalisé de fait depuis la circulaire Peyrefitte de 1978, complétée par une circulaire Badinter de septembre 1984, conserver une sanction pénale qui n'est pratiquement plus appliquée devient dérisoire et déconsidère la justice aux yeux des adolescents, dont certains n'ont d'ailleurs plus conscience de violer l'interdit tant le phénomène leur paraît banal. Beaucoup estiment qu'interdire une drogue si largement consommée revient à encourager le non-respect de la législation.
Si beaucoup de ces remarques s'appuient sur la réalité, leur interprétation prête à discussion et les solutions préconisées divergent de celles de la commission d'enquête.
Comment gérer la légalisation ? Par un monopole d'Etat ou un système de franchises privées ? Quel type de contrôles pourraient exercer les instances nationales pour garantir la qualité et l'approvisionnement ? Comment et par qui les drogues seraient-elles distribuées (médecins, pharmaciens, débits de tabac ou autres) ? Des exceptions seraient-elles prévues pour les mineurs et certaines catégories spéciales ? Quelles drogues légaliserait-on ? Seul le cannabis, ou bien toutes les autres drogues ?
A toutes ces questions fondamentales, les réponses apportées par les tenants d'une légalisation paraissent peu pertinentes.
b) La proposition d'une légalisation réglementée
Tant le « Mouvement de légalisation contrôlée » que le CIRC entendus par la commission d'enquête ont préconisé une légalisation de l'usage du cannabis, assortie de sa réglementation. En revanche, seul le « Mouvement de légalisation contrôlée » propose d'étendre à terme cette mesure à toutes les drogues.
Au lieu de faire la guerre à la drogue, Maître Caballero propose une lutte civile contre l'abus des drogues, en les légalisant et en les contrôlant. Il préconise de commencer par le cannabis, dont la consommation est selon lui devenue un phénomène de société.
L'Etat serait chargé d'organiser la structure opérationnelle, « L'Etat (étant) fait pour réglementer les vices parce qu'il ne veut pas tuer ses citoyens ni défoncer sa jeunesse ». Il cite à ce propos l'organisation des loteries, interdites au 19 e siècle de peur de provoquer des faillites. L'époque coloniale est en outre régulièrement citée en exemple (kif du Maroc...) par les partisans d'une réglementation de l'usage du cannabis.
Reconnaissant les dangers du cannabis en cas d'abus et dans certaines circonstances (notamment au volant en état d'ivresse cannabique), maître Francis Caballero a estimé qu'il fallait l'interdire au volant (mais sur des bases scientifiques fondées), ainsi qu'aux mineurs : « Je propose la légalisation mais non pas la dépénalisation. Je ne propose pas une dépénalisation de l'usage qui, pour moi, doit rester puni dans les lieux publics, au volant, évidemment, et lorsqu'il prend la forme d'une offre aux mineurs. »
M. François-Georges Lavacquerie, membre du CIRC, a exposé devant la commission d'enquête le projet de son organisation : « Nous avons pensé qu'il serait bon qu'il y ait un système légal de distribution. Pour cela, nous n'avons pas fait de plans sur la comète ni de projets chimériques : nous nous sommes fondés sur deux éléments : le système du cannabistrot hollandais et le régime des alcools et tabacs en France. Le système hollandais fonctionne depuis vingt ans et permet d'empêcher que les mineurs consomment, de tempérer la consommation et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas en contact avec les systèmes délinquants. En dépit du fait que toute l'Europe déboule à Amsterdam, c'est un système qui marche bien. Il souffre de deux contradictions : le fait que le commerce en gros est interdit et donc que l'approvisionnement de ces lieux est illégal ; le fait d'être isolé (...). Nous proposons donc une extension au cannabis du régime des alcools et tabacs, avec une licence particulière et des restrictions à l'entrée aux mineurs (16 ou 18 ans, cela se discute), aux droits de publicité et aux droits de marque, ainsi que la vente en vrac. »
Le docteur Francis Curtet, psychiatre, s'est également prononcé en faveur d'une légalisation contrôlée, soulignant que la situation était devenue intenable vis-à-vis des jeunes qui assimilaient totalement cannabis et alcool. Il a considéré qu'une véritable information permettant une prévention réelle serait alors possible : « Mon idée serait (et je répète que ce serait à contre-coeur) de légaliser carrément le cannabis, mais de l'interdire formellement aux mineurs et de faire enfin cette politique de santé publique et de prévention à l'égard des jeunes qu'on n'a jamais faite(...). Quant aux majeurs, on leur donnera une information exacte. On peut en effet espérer que, comme ils sont majeurs, ils sont enfin capables d'user sans abuser ou même de ne pas user du tout (...). On peut dire aux gosses : « Si on vous l'interdit à vous, c'est parce que vous savez bien que vous êtes à l'âge où vous avez envie de tout essayer, où vous voulez toujours plus que ce qu'on vous propose. Ce n'est pas par hasard qu'on a décidé que c'était à partir de 18 ans que vous pourrez enfin conduire une voiture et non pas à 13 ou 14 ans. C'est parce qu'il faut avoir un sens des mesures et des responsabilités que vous allez acquérir en grandissant. ». Le docteur Francis Curtet a néanmoins reconnu les difficultés d'application de l'interdiction de la vente d'alcool aux mineurs.
Pour sa part, maître Francis Caballero considère que l'interdiction de la vente aux mineurs serait plus effective qu'actuellement, où beaucoup de jeunes fument.
Sans aligner le cannabis sur le tabac et l'alcool, drogues culturelles pour lesquelles il est difficile de revenir en arrière, il appelle à un encadrement intelligent du cannabis, qui « n'est pas culturel mais devient un fait de société ». Certains préconisent même d'instaurer une taxe spéciale conçue pour améliorer les soins destinés aux toxicomanes.
On rappellera que le rapport de la commission de réflexion sur les drogues et la toxicomanie mise en place sous l'impulsion de M. Charles Pasqua et de Mme Simone Veil, alors respectivement ministre de l'intérieur et ministre de la santé, et présidée par le professeur Henrion, s'était en 1995 prononcé à une courte majorité (9 sur 17) en faveur d'une dépénalisation à titre d'essai pendant trois ans de l'usage du cannabis.
La commission d'enquête estime au contraire que les avantages escomptés d'une libéralisation apparaissent pour le moins utopiques.
c) Une vision idyllique et utopique de la légalisation des drogues
Dans le monde merveilleux qui naîtrait à la légalisation, tous les problèmes, liés non aux drogues elles-mêmes, mais au carcan institué par l'interdit, disparaîtraient soudain, pour le plus grand bonheur de tous, c'est-à-dire des personnes raisonnables capables de faire un usage raisonné des drogues...
Outre la création annoncée par maître Caballero de 18.000 emplois permanents dans la distribution, la culture et les services, on observerait des progrès dans les domaines de la santé et de la sécurité.
(1) Des progrès en termes de santé publique
Les économies réalisées sur la répression et l'application de la loi pourraient servir à la prévention et au traitement des abus.
(a) Des drogues de qualité ?
En régime de prohibition, le contrôle de la qualité est impossible. Les usagers ne peuvent vérifier la qualité du produit qu'ils achètent, ni en connaître le taux de THC (s'agissant du cannabis), son effet ou sa durée. Au contraire, la légalisation permettrait d'obtenir du cannabis avec de bonnes conditions de concentration, de bonne qualité et à un prix réduit. Selon maître Caballero, on verrait ainsi disparaître le « shit Tchernobyl mélangé à du pneu ». Les autres drogues seraient débarrassées de toutes les substances nocives qu'elles contiennent du fait de la dilution pratiquée par les revendeurs successifs.
Par ailleurs, les trafiquants qui contrôlent le marché ont intérêt à répandre les produits au plus fort potentiel addictif, ainsi que l'a montré le développement du crack aux Etats-Unis dans les années 1980. La prohibition favoriserait donc la consommation des drogues les plus dangereuses.
(b) Une politique de réduction des risques enfin cohérente
M. Jean-Pierre Lhomme, responsable des missions échanges de seringues et bus méthadone à l'association Médecins du monde, a indiqué à la commission qu'il soutenait la dépénalisation de l'usage de toutes les drogues, leur incrimination constituant un obstacle à la prévention et aux soins.
Tout comme M. Alain Ehrenberg, sociologue, il a estimé qu'en assimilant les usagers de drogues à des délinquants, la loi avait retardé la mise en oeuvre des mesures de réduction des risques attachés aux pratiques d'injection (mises en oeuvre entre 1995 et 1999 seulement) et continuait à en perturber l'application, les lieux d'échanges de seringues et les sleep-in étant autant de circonstances où les services répressifs se trouvaient en porte-à-faux, malgré les décrets, arrêtés et circulaires. Citant l'interdiction de l'usage de l'injection, qui avait pour corollaire la non-vente de seringues en pharmacie, il a souligné que l'absence d'accès à cet instrument empêchait tout contact en matière de prévention vis-à-vis des usagers de drogues.
(2) En termes de sécurité
(a) Les produits étant moins chers, la délinquance induite des toxicomanes diminuerait...
La prohibition vise à dissuader la production, le commerce et l'usage de drogues, entraînant un renchérissement du coût des produits et un effet de rareté. Le rapport entre le prix d'achat à la production pour le paysan et le prix de vente final est ainsi de 1 à 300 pour la marijuana.
Le prix des produits sur le marché clandestin impose au toxicomane dépendant de mobiliser d'importantes ressources pour se procurer le produit. Les usagers dépendants se trouvent ainsi contraints de recourir à des moyens illégaux pour financer une consommation qui excède assez vite leurs moyens financiers. L'usager dépendant devient dans ce système le plus motivé des vendeurs.
(b) ... ainsi que le crime organisé
Le lobby de la légalisation est convaincu que la criminalité et le crime organisé seraient grandement réduits.
Selon maître Francis Caballero, « la guerre à la drogue aujourd'hui ne peut se prévaloir d'avoir vaincu l'ennemi. Elle fait même la fortune des trafiquants (...). Actuellement, cela fournit des emplois au crime organisé, à la racaille et aux trafiquants. Il existe une économie parallèle qui vit aujourd'hui de la distribution de cannabis dans les banlieues. On leur piquerait le business dans les huit jours, de la même manière que Distillers and Co., les fabricants d'alcool américains, ont mis la mafia américaine de Chicago et les bootleggers au chômage trois semaines après l'abrogation de la prohibition ».
Les partisans de la légalisation estiment également que la violence inhérente à un négoce illégal hautement rentable (la guerre des gangs) disparaîtrait du fait de cette légalisation.
De même, en assurant à la fois le maintien d'un prix élevé et d'un haut niveau de risque -mécanisme de « barrière à l'entrée »-, la prohibition faciliterait la prise de contrôle du marché de la drogue par les criminels les plus dangereux et les mieux organisés, notamment lorsque la répression la plus efficace s'exerce au niveau de la vente de rue, et non contre le grand trafic.
(3) Une légalisation sans augmentation de la consommation
Malgré la distribution à bas prix de drogues, la consommation, susceptible d'augmenter au début, plafonnerait rapidement. En effet, le rôle du toxicomane revendeur, facteur de diffusion des drogues, disparaîtrait, de même que l'attrait du fruit défendu.
Maître Francis Caballero et M. François-Georges Lavacquerie se sont appuyés sur l'exemple des Pays-Bas. Pour le CIRC, « l'exemple bien connu et paradoxal, c'est la comparaison entre la France, pays qui est parmi les plus répressifs d'Europe, et la Hollande où, sans être légale, la consommation et l'achat de petites quantités pour les consommateurs est libre : la Hollande a un taux de consommateurs plus faible que celui de la France. »
Par ailleurs, maître Francis Caballero a indiqué que l'explosion redoutée « a déjà eu lieu depuis trente ans, puisqu'on est passé de 800.000 consommateurs estimés dans le premier rapport officiel de 1978, celui de Mme Pelletier, à un niveau de deux à cinq millions de consommateurs estimés (certains parlent de sept millions, sachant qu'il s'agit de savoir s'ils sont chroniques, occasionnels ou autres). »
2. Des avantages incertains
La commission d'enquête ne peut qu'exprimer son scepticisme sur les améliorations escomptées.
a) En termes de sécurité : la disparition du crime, une utopie
Outre certaines études évoquant un lien entre l'administration régulière de cocaïne et d'amphétamines et des comportements paranoïdes, en conséquence directe de l'action des drogues sur le cerveau, la disparition de la délinquance du fait d'une légalisation des drogues apparaît utopique.
Tout d'abord, la légalisation ne priverait pas les sociétés criminelles des profits déjà accumulés.
De plus, il est illusoire d'imaginer que les trafiquants cesseraient du jour au lendemain leur activité pour devenir des citoyens respectueux de l'ordre et de la loi. Il est certain qu'ils chercheraient une reconversion dans d'autres activités tout aussi lucratives (pédo-pornographie, contrefaçon, trafic d'organes...), voire des braquages. M. Xavier Raufer, criminologue entendu par la commission d'enquête, explique l'augmentation des braquages observée en Espagne dans les années 1980 à la suite de la dépénalisation de l'usage de drogues par la concurrence acharnée entre trafiquants et la nécessité pour ceux évincés de trouver d'autres sources de revenus. L'augmentation des braquages en Ile-de-France ces dernières années résulterait également de la dépénalisation de fait de l'usage de drogues en France.
En effet, l'articulation entre toxicomanie et drogue est loin d'être claire. Bien souvent une carrière criminelle est déjà bien entamée avant que l'individu ne commence à user de stupéfiants. De plus, les gros trafiquants ne sont souvent pas usagers de drogues, comme le soulignait lors de son audition M. Bernard Petit, chef de l'OCRTIS.
En outre, même si les drogues étaient légalisées, il resterait vraisemblablement de quoi constituer un marché noir, notamment si certaines classes d'âge étaient interdites de consommation ou si certaines drogues (comme le crack et les drogues de synthèse) n'étaient pas légalisées.
M. Serge Lebigot, président de l'association France sans drogue, a ainsi souligné lors de son audition que « le cannabis qui avait cours il y a trente ans n'est plus le même aujourd'hui. A l'heure actuelle, on trouve différente sortes de cannabis, en particulier le skunk ou même l'aya, qui tournent à 35 % de THC. C'est pratiquement de la drogue dure. Il serait temps que tous ces gens qui font la promotion de ces drogues en disant que c'est une question de liberté nous disent exactement quel genre de drogue ils vendraient, qui la vendrait et qui la contrôlerait. Cela veut dire que l'Etat serait obligé de contrôler une drogue beaucoup plus forte, ce qui n'arrangerait absolument pas la situation, contrairement à ce qu'ils disent. »
M. Xavier Raufer, criminologue, a par ailleurs indiqué à la commission d'enquête que « Dans les pays souches (les calculs sont encore de l'ONU), c'est-à-dire dans ceux où on cultive la coca et le pavot, il reste 1 % du prix de détail. Cela veut dire qu'en gros, c'est ce que cela coûte et que le reste est du pur bénéfice (...). Ils sont donc capables de diminuer les prix et de mettre sur le marché des produits plus attractifs que ceux du gouvernement. Si vous mettez du cannabis sur le marché, les gens vont se dire qu'ils vont pouvoir acheter du cannabis à la SEITA et des joints officiels ou semi-officiels. A partir de ce moment-là, les trafiquants peuvent mettre sur le marché, et même donner, dans un premier temps (ils l'ont fait quand il a fallu passer de la cocaïne à l'héroïne) du black bombay, par exemple, qui est de la résine de cannabis mélangée avec de l'opium. (...). Si on le mélange avec du tabac, cela produit un effet mille fois plus fort. Je pense donc que si l'on se lance dans cette voie, on risque d'entrer dans une partie de bras de fer et une compétition avec des gens qui sont naturellement dépourvus de tout scrupule. C'est le danger. » Or elle ne pourrait être que biaisée, l'Etat étant tenu par les lois et règlements.
Ainsi que l'a souligné M. Yves Bot, procureur de la République de Paris, lors de son audition par la commission d'enquête : « dans le domaine des marchés parallèles, je ne vois pas comment on peut réguler un marché illicite ; soit on le légalise, soit on ne le légalise pas. Le danger que je vois dans des situations en demi-teintes, c'est que justement ces situations cachent ensuite des trafics plus graves ».
Enfin, la consommation valide le trafic international.
S'agissant de l'importance du trafic mondial, qui se chiffre en milliards de dollars, M. Xavier Raufer a indiqué que la problématique « dépasse de très loin le fait de laisser en paix des gens qui veulent faire la fête ».
M. Michel Bouchet, chef de la MILAD, a estimé lors de son audition que « les pays qui ne choisissent pas une politique de réduction de la demande ne peuvent choisir une politique cohérente sur le trafic. En effet, si vous avez le droit de consommer, c'est que vous avez le droit d'acheter quelque part, et c'est donc que quelqu'un a le droit de vendre. C'est la contradiction dans laquelle se trouvent les Pays-Bas. C'est ainsi que de proche en proche, par la consommation, on valide le trafic international » .
Comme l'ont souligné tant M. Yves Bot, procureur de Paris, que M. Bernard Petit, chef de l'OCRTIS, l'usage du cannabis comme infraction pénale permet des investigations en matière de trafic et de commercialisation du cannabis. En cas de légalisation, tout ce champ serait en dehors de l'investigation policière et judiciaire.
b) En termes de santé publique
S'agissant du cannabis, une mesure de libéralisation n'a aucune incidence favorable sur la politique de réduction des risques qui vise essentiellement les drogues injectables.
Il n'est pas certain que la prise en charge des toxicomanes dépendants, notamment par voie intraveineuse, soit meilleure. Pour 60 % des personnes s'étant vu prononcer une injonction thérapeutique, il s'agissait d'un premier contact avec les structures de soins. Or une légalisation ferait disparaître cette contrainte de caractère thérapeutique sur les intéressés.
Si l'injonction thérapeutique était contestée par certains médecins qui récusent l'idée de soins sans volontariat du patient, il n'en reste pas moins que sa conception a évolué et qu'elle n'implique plus automatiquement une cure de sevrage. La circulaire du garde des Sceaux du 17 juin 1999 a d'ailleurs souligné que la rupture d'un lien de dépendance était un processus long et chaotique et qu'une réitération de la consommation ne devait pas immédiatement conduire à parler d'échec.
De même, tant la circulaire du garde des Sceaux que celle du ministre de l'intérieur du 11 octobre 1999 ont souligné que les interpellations pour usage ne devaient pas intervenir à proximité de structures de bas seuil ou des lieux d'échanges de seringues, la politique répressive ne devant contrevenir à la politique de réduction des risques. Elle invitait donc les services répressifs à se rapprocher de ces structures afin de trouver des modalités de fonctionnement. De plus, le simple port d'une seringue ne doit plus constituer à lui seul un motif valable d'interpellation. La situation sur le terrain a donc bien évolué, ainsi que l'a confirmé M. Alain Quéant, sous-directeur à la direction de la police de proximité à la préfecture de police de Paris lors de son audition.
3. Des inconvénients avérés
La commission d'enquête considère qu'une légalisation de l'usage des stupéfiants, ou du cannabis seul, pourrait avoir des conséquences dramatiques et difficilement réversibles.
a) En termes de santé publique
(1) Les dangers avérés du cannabis
Ainsi qu'il a déjà été vu, une consommation régulière de cannabis peut conduire à des ruptures sociales (absentéisme scolaire, délinquance, impossibilité d'assurer un travail stable, situation de rupture familiale), mais également présenter des troubles pour la santé : liens avec la schizophrénie, cancer du poumon. Ceci est particulièrement vrai s'agissant des nouvelles variétés néerlandaises à teneur élevée en principe actif.
S'agissant des autres drogues, la dangerosité est encore plus clairement établie. On peut ainsi se demander comment on pourrait laisser des femmes enceintes se droguer librement.
(2) Le cannabis, porte ouverte vers les drogues dures ?
Si la théorie de la passerelle apparaît incertaine, il n'en reste pas moins qu'une personne ayant déjà expérimenté les effets hallucinogènes comparativement bénins du cannabis sera plus facilement disposée à essayer des drogues aux propriétés plus intenses comme le LSD. Ainsi, la plupart des héroïnomanes se sont initiés avec ce produit.
(3) La nécessaire application du principe de précaution
Ainsi que l'a indiqué M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, lors de son audition devant la commission d'enquête, l'interdiction du cannabis doit être maintenue en vertu du principe de précaution, puisque ses dangers potentiels sont de mieux en mieux connus : « Tout le monde sait d'ailleurs que si le tabac était une substance sollicitant aujourd'hui son autorisation de mise sur le marché, sachant ce que nous savons sur ses effets délétères sur la santé, l'autorisation lui serait refusée ».
Comme l'a rappelé le ministre, une légalisation du cannabis porterait en outre atteinte à la crédibilité du message de prévention à l'égard du tabac.
Par ailleurs, s'agissant de la légalisation des autres drogues, répandre largement sur le marché des drogues puissantes relativement mal connues serait particulièrement risqué. Contrairement à l'héroïne, que l'on peut remplacer par la méthadone, il n'existe pas de dose d'entretien pour la cocaïne ou pour le crack, et aucun produit de substitution ne s'est révélé efficace aux fins de désintoxication.
b) Une décision difficilement réversible
L'un des risques majeurs de la légalisation tient à son caractère difficilement réversible. A la date du jour où l'on a établi le lien entre cigarettes et cancer du poumon, il a fallu trente ans pour renverser les habitudes des adultes en matière de tabagisme, avec des campagnes de sensibilisation prolongées et coûteuses . L'expérience acquise avec le tabac devrait nous enseigner que même la connaissance des effets nocifs d'une substance ne dissuade pas forcément de son usage et qu'il est particulièrement difficile de renoncer aux accoutumances contractées dans la jeunesse.
c) L'incohérence d'un Etat dealer
La porte de sortie consisterait à décider de ne pas valider le trafic international et d'organiser sa propre production, à l'instar du tabac.
Dans ce cas, l'Etat prendrait la responsabilité d'ajouter culturellement un nouveau produit, qui est néfaste en termes de santé et de société aux problèmes déjà difficiles à gérer que sont l'alcool et le tabac 113 ( * ) .
Comme l'a indiqué M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à partir du moment où un pays autoriserait ou tolérerait le cannabis, il se mettrait en situation de devoir prendre la responsabilité de s'assurer de la qualité du produit consommé et donc entrerait dans une démarche de contrôle de la qualité et naturellement de distribution, ce qui n'est pas envisageable.
Ainsi que l'a souligné M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur et de la sécurité intérieure : « Parce que la société a été mauvaise depuis tant d'années sur l'alcool et le tabac, faudrait-il commettre les mêmes erreurs sur la drogue ? (...) Il est vrai que pendant des années, l'Etat a fabriqué des cigarettes. La privatisation de la SEITA remonte à 1994. Jusque là, l'Etat produisait des cigarettes et en même temps finançait les programmes d'information pour détourner les jeunes du tabac : cela n'avait pas de sens. »
Une légalisation induirait donc nécessairement des coûts très importants pour élaborer les programmes éducatifs et sanitaires qui devraient forcément précéder la mise sur le marché de substances psychoactives et contrer les campagnes de marketing des drogues.
d) La responsabilité d'une hausse de la consommation, notamment chez les jeunes
L'importance du facteur clanique a été démontrée à maintes reprises. Ainsi que l'a souligné le professeur Philippe-Jean Parquet, président de l'OFDT : « c 'est l'un des problèmes les plus importants sur lesquels il faut insister. Moins il y a de consommateurs, moins la probabilité d'avoir des personnes qui entrent en consommation est forte. C'est la loi de Lederman, qui existe en alcoologie depuis longtemps . »
L'impact de la disponibilité des drogues sur la consommation a été prouvé à plusieurs reprises : en 1973-1975, alors qu'il y avait une pénurie d'héroïne à New-York, le nombre de consommateurs a baissé, pour remonter ensuite 114 ( * ) . De même, le taux d'abus d'opiacés est plus élevé chez les médecins, les infirmières et les pharmaciens que dans le reste de la population.
Même dans le cas d'addiction au produit, il y a une élasticité considérable de la demande, qui varie en fonction directe du prix.
De plus, le taux de capture, c'est-à-dire la proportion d'usagers sporadiques devenant des usagers coutumiers, serait proche de celui des consommateurs de tabac, soit plus de 50 %. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Suède est revenue à une politique répressive après l'intermède libéral des années 1960.
Maître Francis Caballero a d'ailleurs reconnu lors de son audition que la consommation, à terme, augmenterait forcément. Le plus grave est que cette consommation serait particulièrement sensible chez les jeunes.
Dans l'hypothèse d'une interdiction de vente aux mineurs ou aux moins de seize ans, retenue tant par le CIRC que par le Mouvement de légalisation contrôlée, il est très probable que, comme c'est le cas pour l'alcool et le tabac, les mineurs auraient plus facilement accès aux drogues désormais légales qu'aujourd'hui aux drogues illicites, d'une part du fait de l'indulgence de leurs aînés et d'autre part du fait que les produits seraient plus abordables. L'exemple de l'inapplication de l'interdiction de vente d'alcool aux moins de seize ans est d'ailleurs particulièrement instructif. Les réglementations se rapportant à l'âge des consommateurs seraient très difficiles à appliquer.
Maître Francis Caballero a ainsi indiqué à la commission d'enquête : « Il n'y a pas de sanction dans mon système, pas plus qu'il n'y en a dans le système d'interdiction du tabac ou de l'alcool aux mineurs. On considère que le mineur n'a pas toute sa capacité pour contracter et on le protège sans le punir. En revanche, on punit dans le code des boissons les cafetiers qui vendent de l'alcool aux mineurs de moins de seize ans non accompagnés, ainsi que les supermarchés. Celui qui est puni, c'est le commerçant, qui est facile à contrôler : il y a 38.000 bureaux de tabac à contrôler et non pas des millions de mineurs. » Les avatars de la récente proposition de loi du Sénat visant à sanctionner effectivement la vente de tabac aux mineurs paraissent cependant riches d'enseignements à la commission d'enquête.
En outre, les adolescents sont particulièrement sensibles à l'hypocrisie de nombreux adultes et seraient peu enclins à accepter un discours consistant à dire : « Moi, je peux me le permettre, mais pour toi c'est dangereux ».
e) Les risques d'une immixtion paradoxalement plus importante dans la vie privée
Pour protéger la majorité des non consommateurs de la minorité de consommateurs, il faudrait concevoir de nouveaux tests pour diverses activités (au moins les forces armées, les conducteurs de machines, les chauffeurs-routiers, les professions médicales et tous ceux qui travaillent dans des industries sensibles comme le nucléaire). La question se poserait de savoir si la prohibition des drogues serait partielle (autorisée par exemple en fin de semaine) ou totale.
Le choix des catégories qui seraient interdites de consommation et l'introduction de mesures nécessaires à l'application de cet interdit poseraient toute une série de problèmes juridiques liés aux libertés civiles. Les tests seraient en outre très onéreux et de telles démarches pourraient représenter une immixtion dans la vie privée des individus très supérieure à ce que l'on considère actuellement comme tolérable.
4. Le débat sur la légalisation : un débat biaisé
a) La décision de légaliser ne peut être prise au seul plan national
Ainsi qu'on a trop tendance à l'oublier, la question de la légalisation ne peut pas être réglée au seul plan national. Des conventions internationales fixent la liste des produit stupéfiants et psychotropes. La convention de l'ONU de 1988 exige clairement des parties qu'elles fassent de la possession, de l'achat ou de la culture des drogues soumises à un contrôle un délit lorsqu'elles sont acquises à des fins de consommation personnelle.
Par ailleurs, toute dépénalisation ou légalisation de fait doit être examinée en concertation avec nos partenaires européens, car comme l'a souligné le professeur Bernard Roques, il est très dangereux de laisser subsister de telles discordances au sein de l'Union européenne, d'autant plus que tout changement affectant la politique des drogues, leur trafic ou leurs modes de consommation a des répercussions au-delà des frontières d'un pays. Une législation répressive dans une région a pour effet de déplacer le trafic vers des régions de plus grande tolérance.
En outre, comme l'a rappelé lors de son audition Mme Nicole Maestracci, ancienne présidente de la MILDT : « Le mot « dépénalisation » induit souvent beaucoup de confusion et d'ambiguïté. En Europe, le mot dépénalisation est utilisé par beaucoup de pays pour définir l'absence de peines de prison. Or tous les pays qui ont supprimé la prison (le Portugal, l'Espagne ou l'Italie) ont prévu des sanctions de type administratif qui sont un peu l'équivalent de nos contraventions judiciaires, c'est-à-dire des amendes, des suspensions de permis de conduire, etc. Autrement dit, nous sommes dans une situation qui est, de fait, relativement similaire dans l'ensemble des pays ».
b) Les dommages collatéraux du débat sur la légalisation : des vies gâchées
La commission d'enquête a été particulièrement sensible à l'observation faite par Maître Gérard Tcholakian, du Conseil national des barreaux, selon lequel la profession d'avocat doit faire le constat que « malheureusement, lorsqu'on est usager, on a souvent par nature tendance à basculer à un moment ou à un autre dans la notion de cession. » Or, ces jeunes « ne se rendent pas compte qu'ils entrent dans un processus, à partir de l'usage, qui va faire d'eux de vrais délinquants. Bon nombre de jeunes basculent dans le trafic parce qu'un jour quelqu'un va leur demander de le dépanner, puis qu'ils effectueront un achat groupé pour avoir de meilleurs prix... ».
Il ainsi dénoncé les intellectuels qui réclament un droit à l'usage et oublient de soutenir ces jeunes lorsqu'ils comparaissent devant un tribunal correctionnel , sans prise en compte de leur parcours personnel, « parce qu'ils passent souvent en comparution immédiate, avec des dossiers jugés à l'abattage. Je voudrais donc que l'on pense à ces jeunes qui ne sont pas, à leurs yeux, des trafiquants et qui le découvrent un beau jour dans la réalité d'une interpellation et d'un renvoi devant un tribunal correctionnel .
Le discours sur la légalisation conduit certains jeunes à ne plus avoir conscience du fait qu'il sont en train de franchir un pas. Dans ce discours, on oublie aussi l'approvisionnement, (...) et le fait que se font prendre dans les filets de jeunes lycéens qui finissent par passer plusieurs mois en détention, le temps que l'on prenne la mesure de l'affaire dans laquelle ils sont impliqués. Dans tout cela, il y a des vies gâchées. »
c) Le cannabis n'est pas un phénomène culturel
L'affirmation selon laquelle le cannabis serait un phénomène culturel est à relativiser, ainsi que le reconnaît d'ailleurs l'un de ses plus fervents zélateurs, maître Francis Caballero, pour qui le cannabis est un phénomène de société, mais n'est pas culturel.
En effet, si le chiffre de 10 millions de consommateurs est souvent cité, il s'agit en fait d'expérimentateurs , c'est-à-dire de personnes ayant au moins une fois dans leur vie fumé du cannabis. Mais beaucoup se sont arrêtés ou vont avoir une consommation très occasionnelle. La consommation régulière (10 usages par mois) concerne probablement 250.000 à 300.000 personnes, contre 40 millions de personnes pour l'alcool, même si cette proportion est nettement plus élevée chez les jeunes (6,3 % chez les 18-25 ans contre 1,4 % chez les 18-75 ans), ainsi que l'a indiqué à la commission M. Philippe-Jean Parquet, président de l'OFDT.
Par ailleurs, l'enquête de l'OFDT sur la perception des drogues par les Français, dont les résultats ont été connus en février 2003, montre que 77 % des Français ne sont pas favorables à la vente libre de cannabis , ainsi que l'a souligné M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. En revanche, parmi les 18-24 ans, 39 % y sont favorables, tout comme 55 % des expérimentateurs mais également 14 % des abstinents. S'il est vrai que la situation se dégrade sur ce point -il y a trois ans, seuls 17 % étaient favorables à la vente libre, 24 % des 18-24 ans, 45 % des expérimentateurs et 10 % des abstinents-, M. Jean-Michel Costes, directeur de l'OFDT, a pour sa part indiqué que sur les trois dernières années, la part des Français souhaitant une autorisation sous condition du cannabis était restée stable. Deux tiers des Français sont opposés à cette solution et un tiers y est favorable.
Ainsi que l'a souligné lors de son audition Mme Nicole Maestracci, ancienne présidente de la MILDT, le nombre de personnes considérant le cannabis comme anodin a diminué depuis quatre ans et on constate une meilleure conscience de la réalité des risques.
B. RÉAFFIRMER L'IMPORTANCE DE LA LOI
La commission tient à rappeler que les politiques publiques ont un rôle déterminant à jouer et que la loi se doit de servir de point d'ancrage pour la population.
1. Une loi indispensable pour garder un lien avec les usagers de stupéfiants
La loi permet aux forces de l'ordre et aux magistrats d'interroger les usagers interpellés sur les motivations de leur consommation et donc de les orienter, comme l'a souligné le docteur Francis Curtet, psychiatre.
M. Jean-Pierre Carbuccia-Berland, directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, a rappelé ce point lors de son audition : « Garder l'usage dans les catégories pénales permet de conserver un lien, fût-il dégradé et pénal, avec des populations qui risqueraient sinon d'être totalement à la dérive ». M. Yves Bot, procureur de la République de Paris, a également indiqué que la réponse judiciaire aux interpellations d'usagers permet, à partir d'une procédure qui a au départ un caractère répressif, d'avoir une démarche d'assistance éducative, et donc de prévention, ce qui n'est possible que parce qu'au départ, l'usage de cannabis est prohibé par la loi.
Telle est d'ailleurs l'orientation préconisée depuis des années par les circulaires successives des gardes des Sceaux.
A cet égard, M. Dominique Perben, garde des Sceaux, a réitéré lors de son audition par la commission d'enquête son refus de la banalisation de l'usage de stupéfiants, en affirmant que « le cannabis peut être porteur de dangerosité. Je considère donc que l'interdiction légale de l'usage de stupéfiants doit être réaffirmée suffisamment pour qu'elle soit ancrée dans l'esprit de tout un chacun, et je ne pense pas qu'il soit bon que l'usage du cannabis puisse être vécu avec un sentiment d'impunité. A cet égard, la pénalisation de la conduite sous l'empire de produits stupéfiants a marqué une étape importante. »
2. Le rôle de la loi : poser des repères
Ainsi que l'a indiqué M. Michel Bouchet, chef de la MILAD, lors de son audition par la commission d'enquête, « il n'est pas du rôle de l'Etat d'accompagner ou de valider les déviances et les transgressions sanitairement et socialement dommageables, mais plutôt de mener une politique pénale et préventive propre à les réduire ».
M. Philippe-Jean Parquet, président de l'OFDT, a également estimé qu'« un Etat a comme fonction, au travers de ses lois, d'aider les personnes à faire des choix éclairés ». Ce point a d'ailleurs été souligné par un grand nombre d'intervenants, parmi lesquels le docteur Francis Curtet, psychiatre, et M. Bernard Petit, chef de l'OCRTIS. S'il est arrivé à chacun de faire des excès de vitesse, le fait d'être constitutif d'une infraction montre que c'est dangereux. La loi est là pour poser des balises et dire que c'est dangereux. Le dispositif législatif et réglementaire apparaît ainsi comme un facteur de protection contre la toxicomanie, et légaliser le cannabis reviendrait à donner un avis mensonger à la jeunesse, puisqu'on éliminerait le tabou qui frappe son usage. La loi joue un rôle plus dissuasif qu'incitatif.
Par ailleurs, on voit mal comment faire coexister un interdit d'ordre moral avec une suppression de l'interdit légal, toute interdiction non assortie de sanction devenant une autorisation.
3. La loi impuissante ?
La commission tient à souligner le discours quelque peu paradoxal des tenants de la dépénalisation, qui critiquent fermement dans un premier temps la loi de 1970 et appellent à sa modification, tout en estimant dans un deuxième temps que la loi n'a aucune incidence.
Ainsi, M. Alain Ehrenberg, sociologue au CNRS, a lors de son audition dénoncé la « tendance à fétichiser la loi » dans la politique, en estimant que l'on dépénalise ou non, que l'on légalise ou que l'on maintienne l'interdiction de l'usage privé avec une année d'emprisonnement, rien ne changerait, la loi n'étant qu'un élément d'une politique.
Si la commission d'enquête est tout à fait consciente de la nécessité de mener une politique sur les quatre volets que représentent la répression, la prévention, le soin et l'action internationale, elle se refuse néanmoins à justifier l'inaction.
Certes, M. Hugues Lagrange, sociologue au CNRS, a indiqué qu'en dépit de la diversité des législations en Europe, les structures de consommation n'avaient pas de lien évident avec les législations.
M. Jean-Michel Costes, directeur de l'OFDT, s'est également exprimé sur cette question et a indiqué que l'INSERM et l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies avaient conclu à l'absence de lien entre législation et niveau de consommation. Si la législation sur le cannabis est ferme, en Suède comme en France, les niveaux de prévalence du cannabis sont très éloignés. De même, les pays qui se sont orientés vers des législations plus ouvertes par rapport à l'accès aux produits peuvent avoir des niveaux de prévalence tout aussi disparates.
M. Philippe-Jean Parquet, président de l'OFDT, a souligné pour sa part la remarquable constance de la progression de la consommation de cannabis pendant les années 1990, alors que les politiques publiques avaient fortement varié (du concept de l'abstinence au début des années 1990 à la prise en compte de la réduction des risques au milieu des années 1990, et enfin à l'approche dite globale de prise en compte de l'ensemble des produits à la fin de la décennie).
Mais « affirmer que la législation d'un pays n'influe pas sur la consommation revient à jeter le bébé avec l'eau du bain », comme l'a dit lors de son audition le professeur Renaud Trouvé. Il convient tout d'abord de voir si la législation est appliquée, ce qui n'est certes pas le cas actuellement en France en matière de drogues.
4. L'efficacité de la loi conditionnée par sa crédibilité
Ainsi que l'a indiqué à la commission d'enquête M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, « la sanction a une utilité préventive et éducative, mais encore faut-il qu'elle puisse s'appliquer. »
L'exemple des récents succès rencontrés en matière de politique de sécurité routière, érigée en priorité nationale par le chef de l'Etat, montre l'importance d'une action politique déterminée et volontariste.
Comme l'a relevé le professeur Claude Got : « Une question fondamentale : la répression de l'usager est-elle capable d'avoir une efficacité en matière de prévention ? Ma réponse est oui. Nous avons vu dans le domaine de la sécurité routière à quel point cela pouvait se situer. Actuellement, uniquement par une action psychologique qui est l'anticipation de la loi qui était encore devant le Sénat hier [le projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière] nous avons eu 1.000 tués en moins sur les routes en quatre mois, uniquement parce qu'il y a eu un renforcement de la crédibilité de l'action des policiers et des gendarmes . »
M. Jean-Pierre Carbuccia-Berland, directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, a ainsi relevé lors de son audition : « L'expérience nous a montré que la force de l'interdit était variable en fonction des moyens que l'on mettait en place pour assurer le respect effectif de cet interdit. »
Comme M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, qui estime que « prévention et sanctions savent aussi se conjuguer », M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, a indiqué que « la force de ce discours et sa clarté sera la première des préventions. Il est un signal pour tous, comme nous le voyons en matière de sécurité routière. En matière d'usage des drogues, nous obtiendrons également des résultats par la force du discours, par la prévention que représente le risque de la transgression. »
Or, pour être crédible, la loi doit être comprise .
Mme Nicole Maestracci, ancienne présidente de la MILDT, a d'ailleurs souligné lors de son audition : « Il est clair qu'aujourd'hui la loi et son application ne sont pas suffisamment comprises. Il n'y a pas de loi parfaite, mais en tout cas une bonne loi est celle qui est bien comprise par les gens auxquels elle est censée s'appliquer. »
Ce point a également été soulevé par M. Michel Bouchet, chef de la MILAD : « Il importe aussi, pour que l'action du gouvernement en ce sens soit efficace, qu'elle suscite l'adhésion de la plupart. » Les exemples de la Suède et des Pays-Bas, qui ont tous deux mené des politiques très différentes mais très cohérentes, chacune dans leur logique, et soutenues par la très grande majorité de leur population, amènent à penser que ce point est essentiel.
En outre, s'il est une politique publique exigeant une continuité de l'action publique, indépendamment des alternances politiques, c'est bien de celle de la lutte contre la drogue qu'il s'agit. Mme Nicole Maestracci a estimé pour sa part qu'une période minimale de dix années était nécessaire avant de réellement parvenir à une évolution des mentalités. Or, la France est passée en 15 ans d'une politique restrictive à une politique de gestion du problème des drogues, avec l'instauration dans l'urgence de la politique de réduction des risques, au détriment des autre piliers indispensables que constituent la prévention, la répression et le soin à long terme.
5. Une révision de la loi de 1970 ?
La plupart des personnalités auditionnées par la commission d'enquête ont mis en avant l'obsolescence de la loi de 1970, dans son volet consacré à l'usage, destinée à l'origine à contraindre les héroïnomanes dépendants à se soigner, sous peine d'emprisonnement.
M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, a ainsi estimé lors de son audition : « Il faut donc reconsidérer la loi de 1970 qui a vieilli et qui n'est manifestement plus adaptée aux réalités. En 1970, l'objectif a d'abord été de traiter l'augmentation considérable de l'usage de l'héroïne. La procédure et les sanctions prévues apparaissent aujourd'hui peu adaptées et trop lourdes face à la consommation très importante de nouvelles substances de type cannabis et ecstasy, alors que la plupart des usagers de drogues injectables ont rejoint des programmes dits de substitution ».
Comme l'a précisé M. Didier Jayle, président de la MILDT, à la commission d'enquête : « La réduction des risques a fait que cette loi s'est un peu vidée de sa substance ». En effet, il est difficilement concevable, par exemple, de condamner à un an d'emprisonnement un jeune Centralien ayant fumé un joint pour fêter son admission au concours.
M. Michel Bouchet, chef de la MILAD, a fort justement résumé cette difficulté : « La consommation des stupéfiants ne devient constitutive d'une maladie qu'au stade de la forte dépendance. C'est surtout cette situation que visait la loi de 1970 qui avait pour premier objectif l'orientation sanitaire des héroïnomanes dépendants. Actuellement, environ 90 % des consommateurs n'en sont pas à ce stade. On peut qualifier leur comportement à la fois de ludique et transgressif. N'étant pas dépendants, ils ne justifient pas un traitement sanitaire, mais plutôt un accompagnement psychosocial préventif et une sanction pénale adaptée à laquelle ils sont d'ailleurs accessibles du seul fait qu'ils n'ont pas centré leur vie autour du produit. Ces deux approches, psychosociale et pénale, ne sont d'ailleurs nullement contradictoires. Il faut donc entamer une réflexion sur l'évolution des textes législatifs permettant de mieux appréhender cette transgression de masse à laquelle il conviendrait d'apporter une réponse pénale modernisée, mieux adaptée, en même temps que plus systématique, plus homogène et finalement plus efficace . Bien sûr, ne seraient pas éludées les nécessités relatives aux orientations sanitaires et sociales. Abaisser les seuils et déboucher sur une application plus homogène, plus constante et finalement plus dissuasive qui peut être de nature administrative, à base de suspensions de permis ou d'interdictions de le passer pour les mineurs.»
Néanmoins, M. Dominique Perben, garde des Sceaux, a estimé lors de son audition que : « Si nous devons développer une dynamique publique, c'est davantage en faisant un effort de prévention, de rééducation et de réinsertion, effort qui, lui, n'est pas exclusivement judiciaire, qu'il faut agir, plutôt que de rouvrir un débat à caractère législatif dont les conséquences apparaissent incertaines. Je ne sais pas si la modification de la loi est une priorité. Nous sommes beaucoup plus dans une problématique concrète et pratique de mise en oeuvre des politiques publiques. »
M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, a pour sa part estimé lors de son audition qu'il convenait de « toiletter la loi, pas de se lancer dans un grand chantier législatif ».
Cette position ne peut qu'être partagée par la commission d'enquête.
C. PRÉVOIR UNE SANCTION SYSTÉMATIQUE, GRADUÉE ET COMPRISE
Ainsi que l'a indiqué lors de son audition le professeur Claude Got, « dans la délinquance de masse, il (faut) des sanctions fréquentes, légères pour être acceptables, crédibles, équitables . Ces règles sont en permanence transgressées. On voudrait au contraire augmenter le niveau de la sanction jusqu'à la rendre inapplicable. De temps en temps elle tombera sur quelqu'un, et cela apparaîtra comme une loterie. C'est l'inverse de l'équité. »
1. Un usage qui doit être systématiquement sanctionné
Ainsi que le répètent les circulaires depuis 1971, la commission d'enquête souhaite que toute interpellation d'usager se traduise par un procès-verbal, même simplifié, afin de permettre une réponse judiciaire systématique. Il apparaît en effet encore trop souvent que des interpellations se traduisent par des mains courantes, ainsi que l'a d'ailleurs concédé M. Alain Quéant, sous-directeur de la police territoriale à la direction de la police de proximité de la préfecture de police de Paris.
La commission d'enquête se félicite à cet égard des dispositions contenues dans le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui introduit un nouvel article 40-1 dans le code de procédure pénale posant le principe d'une réponse judiciaire systématique, venant préciser le principe traditionnel de l'opportunité des poursuites, par ailleurs consacré dans la loi.
Ainsi, lorsque les faits sont constitués et l'auteur identifié, le procureur de la République devra apprécier l'opportunité, soit d'engager des poursuites pénales, soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites (en recourant le cas échéant à la plus simple d'entres elles, à savoir le rappel à la loi), et ne pourra classer sans suite que s'il estime que des circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.
2. Une sanction graduée
La commission d'enquête a été particulièrement sensible à la remarque formulée lors de son audition par M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, selon laquelle « prévoir tant d'années de prison n'a pas beaucoup de sens dans la mesure où ce n'est jamais appliqué, mais à l'inverse, parce que les sanctions sont trop lourdes et ne sont pas appliquées, n'en prévoir aucune n'en a plus aucun. »
La commission d'enquête préconise donc de prévoir une contravention en cas de première infraction et de maintenir le délit assorti d'une peine d'emprisonnement d'un an en cas de récidive ou de refus de soins ou d'orientation.
a) Prévoir une contravention pour une première infraction d'usage simple
Punir d'un an d'emprisonnement un usager de drogue occasionnel n'ayant commis aucun autre délit paraît disproportionné et n'est d'ailleurs jamais appliqué.
Selon Mme Nicole Maestracci, ancienne présidente de la MILDT, il semble qu'un consensus se dégage pour des sanctions qui seraient de l'ordre de la contravention. C'est d'ailleurs l'option envisagée par M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
L'emprisonnement pour les usagers de drogues illicites paraît en effet l'une des mesures les plus controversées. Un consensus semble dorénavant se dégager pour dire que la prison n'est pas une sanction adaptée pour le simple usager qui n'a commis aucun autre délit, ainsi que l'a indiqué Mme Nicole Maestracci lors de son audition.
M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, a de même appelé à « gommer la disposition la plus critiquable de la loi de 1970, à savoir la possibilité de prononcer une peine d'emprisonnement à l'encontre de simples usagers. »
Le docteur Francis Curtet, psychiatre ayant exercé pendant 10 ans en prison, a également souligné lors de son audition que « mettre en prison des usagers de drogues ou des toxicomanes est aberrant. Il ne s'agit pas d'un lieu thérapeutique et le risque de suicide est élevé. »
M. Didier Lallement, directeur de l'administration pénitentiaire, a en outre indiqué à la commission d'enquête que « le risque, s'agissant d'usagers simples, était évidemment que l'univers pénitentiaire ne permette pas d'assurer leur plein sevrage et donc qu'au contraire, ils rencontrent d'autres tentations et d'autres consommations de produits stupéfiants. »
Ainsi que l'a indiqué M. Yves Bot, procureur de la République de Paris, « quand on est en présence d'un usager simple, on peut dire qu'il n'est pas besoin de circulaires pour nous dire que l'incarcération n'est pas adaptée ».
Néanmoins, il apparaît que si, au cours des cinq dernières années, le nombre de condamnations à des peines d'emprisonnement ferme pour usage illicite a baissé, passant de 494 cas en 1997 à 395 cas en 2001, « c'est un chiffre qui n'est pas considérable, mais qui n'est pas négligeable », comme l'a reconnu M. Dominique Perben, garde des Sceaux.
La commission d'enquête s'est interrogée sur les motifs ayant conduit des magistrats à prononcer la condamnation à des peines d'emprisonnement ferme de simples usagers, alors même que la circulaire du garde des Sceaux du 17 juin 1999 appelle à considérer la prison comme le « dernier recours ».
M. Yves Bot, procureur de la République de Paris, a fourni une explication en indiquant que le parquet requérait de l'emprisonnement ferme à l'encontre de certaines personnes qui comparaissaient pour usage, et dont on n'avait pu prouver l'implication dans un trafic du fait des difficultés de preuve. Il a néanmoins estimé qu'il s'agissait d'une pratique résiduelle, le code pénal sanctionnant l'aide à la consommation, mais que la politique pénale suivie dans ce cas était légitimée par la volonté de mettre en échec l'argument utilisé par le trafiquant sur lequel on trouve une certaine dose et qui prétend qu'il s'agit de sa consommation personnelle.
La commission d'enquête préconise donc de retenir une contravention de la cinquième classe, pour laquelle une amende modulable jusqu'à concurrence de 1.500 euros peut être prononcée (article 131-13 du code pénal).
M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a, lors de son audition proposé de « prévoir la création d'une échelle de sanctions adaptées permettant de punir réellement et rapidement (...) les mineurs qui consomment occasionnellement du cannabis ou de l'ecstasy (...). Il y a bien sûr l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, un stage, peut-être le recul de l'âge pour passer le permis de conduire, peut-être la confiscation du scooter lorsqu'il y en a un. Le législateur peut en la matière imaginer une panoplie de sanctions adaptées à l'âge ».
La commission d'enquête s'est interrogée sur ces propositions. En effet, il ne faudrait pas que des mesures comme la confiscation du scooter apparaissent comme des mesures « anti-jeunes ». Il faudrait alors prévoir la confiscation de tout véhicule, quel qu'il soit et quel que soit l'âge de la personne. De plus, la notion de confiscation paraît assez novatrice puisque les peines complémentaires prévoient en général l'immobilisation du véhicule pendant une durée maximale de 6 mois, s'agissant d'infractions n'ayant pas de rapport direct avec la conduite d'engins motorisés. Or la confiscation serait définitive, alors même que l'infraction, fumer un joint par exemple dans un parc, n'aurait aucun rapport avec la conduite d'un engin motorisé.
Or peuvent déjà être proposées en cas de contraventions de la cinquième classe les peines complémentaires suivantes (article 131-14 du code pénal) :
- la suspension, pour une durée d'un an au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
- l'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
- le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an au plus ;
- l'interdiction, pendant une durée d'un an au plus d'émettre des chèques autres que ceux certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Des peines de travail d'intérêt général peuvent à cette occasion être proposées pour une durée de 20 à 120 heures (article 131-17 du code pénal).
Une peine complémentaire prévoyant une obligation de soins ou d'orientation vers une structure psychosociale devrait être introduite pour la contravention d'usage de stupéfiants.
b) Conserver le délit en cas de récidive ou de refus de soins
La commission d'enquête préconise de conserver le délit en cas de récidive ou de refus de soins. La récidive pourrait être appréciée dans un délai de trois ans.
La commission d'enquête s'est interrogée sur le point de savoir quelle solution pourrait être trouvée afin d'inciter très fortement les toxicomanes dépendants à suivre des soins, l'injonction thérapeutique se trouvant dépourvue de toute nature coercitive en cas de suppression de la peine d'emprisonnement.
M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, s'est lui-même interrogé sur ce point, estimant qu'il faudrait trouver des sanctions adaptées.
Or il apparaît que s'agissant de personnes bien souvent désocialisées, voire marginalisées, la menace d'amendes apparaissait peu pertinente, alors même qu'elles devaient constituer le public prioritaire de l'injonction thérapeutique.
Ainsi que l'a indiqué lors de son audition Mme Catherine Domingo, substitut du procureur de Bayonne, si la personne n'a pas respecté la mesure d'injonction thérapeutique ou s'il s'agit de multi-récidivistes, il est actuellement possible de prononcer des mesures d'assistance, comme un sursis avec mise à l'épreuve et obligation de soins (la personne étant suivie par le juge d'application des peines).
De tels moyens de pression, justifiés et n'aboutissant pas en pratique à l'incarcération, ne seraient donc plus possibles.
c) Prévoir des solutions pour les personnes dépendantes et refusant les soins
Deux options étaient susceptibles d'être retenues par la commission d'enquête. On peut soit envoyer les toxicomanes n'ayant commis aucun autre délit dans des centres pénitentiaires spécialisés dans les soins aux toxicomanes, soit les envoyer de manière coercitive dans des centres de soins.
(1) Maintenir des peines d'emprisonnement en cas de refus de se soumettre aux soins ou en cas de récidive
En maintenant des peines d'emprisonnement pour les toxicomanes les plus lourds, on conserverait ainsi un moyen de pression, sachant que les mesures alternatives à l'incarcération devraient être privilégiées.
Il s'agirait ainsi de la transposition de la « contrainte par corps », qui prévoit d'incarcérer des personnes refusant de s'acquitter de leurs condamnations pécuniaires. Ici, ce serait le refus de soins qui serait sanctionné.
En outre, la commission d'enquête préconise de créer des centres fermés de traitement de la toxicomanie sur le modèle des centres fermés pour jeunes délinquants.
Les personnes incarcérées pour simple usage à la suite de multiples récidives ou de refus de soins le seraient dans des centres gérés par l'administration pénitentiaire, mais situés en dehors des établissements pénitentiaires existants, où ils recevraient des soins adaptés. Les détenus toxicomanes incarcérés pour d'autres infractions à la législation sur les stupéfiants ou pour d'autres actes de délinquance continueraient à dépendre des UCSA, le but étant d'éviter que de simples usagers se retrouvent au contact de délinquants endurcis, la prison étant considérée par beaucoup comme un milieu criminogène.
De tels centres pourraient permettre de « dépayser » certains jeunes afin de briser les phénomènes de bandes les conduisant à l'addiction.
(2) Etendre la procédure d'hospitalisation d'office aux toxicomanes nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit qu'à Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office de personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
La commission d'enquête suggère que cette procédure soit étendue aux personnes toxicomanes dépendantes ou dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui, le procureur de la République devant alors saisir un médecin de la DDASS afin d'obtenir un certificat médical. Il appartiendrait au procureur de la République de le transmettre au préfet de police, à Paris, ou aux représentants de l'Etat dans le département, afin qu'ils procèdent à cette hospitalisation d'office.
Il est bien évident que ces personnes ne seraient pas hospitalisées dans des hôpitaux psychiatriques, mais dans des services hospitaliers de traitement de la toxicomanie.
Dans cette hypothèse, la peine de prison pour usage de stupéfiant serait supprimée.
Au terme de ces débats, la commission d'enquête a préconisé de retenir la première solution et de conserver la possibilité de prononcer une peine d'emprisonnement à l'encontre de toxicomanes multi-récidivistes et refusant les soins, cette peine devant être accomplie dans des centres pénitentiaires fermés dédiés spécifiquement au traitement de la toxicomanie.
D. CONCILIER LE TRAITEMENT D'UN CONTENTIEUX DE MASSE ET L'ORIENTATION SANITAIRE ET SOCIALE
Ainsi que l'a précisé lors de son audition M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, il convient d'« inventer un dispositif qui évite les écueils des procédures trop lourdes qui encombrent aujourd'hui la justice, qui a bien d'autres choses à faire. »
Néanmoins, il convient de veiller à concilier la systématisation de la réponse judiciaire avec sa nécessaire individualisation . Malgré leur nombre, il conviendrait que ces affaires ne fassent pas l'objet d'un traitement sommaire et indifférencié, mais que soient assurés le repérage des situations présentant des risques particuliers et la mise en oeuvre de mesures utiles et adéquates en fonction des personnalités individuelles, afin de ne pas nuire à l'objectif de prévention de la récidive. Les initiatives menées ces dernières années afin de prendre en compte l'usager de drogue dans sa globalité doivent être maintenues et renforcées.
1. Eviter l'encombrement des juridictions
Ainsi que l'a indiqué à la commission d'enquête M. Yves Bot, procureur de la République de Paris : « Lorsqu'on est dans la salle de permanence d'un parquet entre en ligne de compte la capacité matérielle de la juridiction pour évacuer les affaires dont elle peut être saisie chaque jour. Les procédures se compliquent de plus en plus . Il est utile d'avoir des procédures d'évacuation rapide par des voies qui ne soient pas aussi solennelles que la comparution en justice, comme le plaider coupable , pour pouvoir évacuer et ne pas laisser sans réponse des faits qui sont des infractions importantes et choquantes pour la loi, pour lesquels les victimes ont droit à réparation et les auteurs doivent avoir une sanction, tout en réservant le système judiciaire lourd aux infractions qui sont elles-mêmes les plus lourdes. »
Or, la justice pénale apparaît submergée et la durée moyenne de traitement des affaires pénales ne cesse d'augmenter.
a) Encourager le recours à l'ordonnance pénale pour la contravention d'usage
Les articles 524 et suivants du code de procédure pénale prévoient que toutes les contraventions de police peuvent être soumises à cette procédure, à l'exclusion de celles visant des mineurs.
Le choix de cette procédure appartient au ministère public. Le juge statue alors sans débat préalable par une ordonnance préalable portant soit relaxe, soit condamnation à une peine ainsi que le cas échéant à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues. Si le ministère public ne forme pas opposition de cette ordonnance dans les six jours, elle est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le prévenu peut y former pendant trente jours opposition. L'affaire est alors portée à l'audience du tribunal de police.
Il importera donc que les services de police et de gendarmerie transmettent au parquet tous les éléments permettant d'apprécier la personnalité du prévenu.
b) Etendre le champ de la « procédure simplifiée » pour les usagers de drogues récidivistes, mais ne nécessitant pas d'orientation particulièrement poussée
La commission d'enquête préconise de développer le recours à la procédure simplifiée, prévue à l'article 495 du code de procédure pénale et introduite par la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice.
Cette procédure s'inspire de celle prévue pour les contraventions dans le cadre de l'ordonnance pénale (articles 525 et 526 du code de procédure pénale) 115 ( * ) .
La commission d'enquête préconise de l'étendre au nouveau délit d'usage réitéré de stupéfiants ou de refus de soins proposés. L'article 495 du code de procédure pénale la réserve actuellement aux délits prévus par le code de la route. Cette procédure parait en effet particulièrement bien adaptée s'agissant de consommateurs non dépendants, quoique récidivistes, et bien intégrés socialement, pour lesquels une orientation socio-sanitaire n'est pas nécessaire. Rappelons en effet que la commission d'enquête propose que la récidive s'apprécie dans un délai de trois ans. On ne peut donc pas forcément parler de consommateur régulier à propos d'une personne qui serait interpellée deux fois dans un délai de 18 mois.
En effet, le ministère public ne peut recourir à cette procédure que s'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine. Les forces de l'ordre devront donc être particulièrement sensibilisées à cet aspect.
Si le ministère public choisit cette procédure, il communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende et, le cas échant, à une ou plusieurs peines complémentaires, les peines d'emprisonnement étant exclues 116 ( * ) .
Le ministère public a alors 10 jours pour former opposition ou en poursuivre l'exécution. Le prévenu dispose d'un délai de 45 jours pour former opposition à l'ordonnance, l'affaire étant alors portée devant le tribunal correctionnel (article 495-3). On notera que cette procédure n'est pas applicable aux mineurs.
c) Elargir les mesures de composition pénale à l'obligation de soins
La loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale a instauré la procédure de composition pénale . Celle-ci permet au procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de proposer à une personne majeure qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits de se soumettre à certaines mesures : versement d'une amende de composition, dessaisissement au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit, remise au greffe du tribunal de grande instance du permis de conduire ou du permis de chasser pour une période maximale de quatre mois, réalisation, au profit de la collectivité, d'un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à 18 mois.
La composition pénale peut actuellement être proposée en cas de consommation de stupéfiants. Elle pourrait donc, dans le système proposé par la commission d'enquête, être utilisée en cas de récidive ou de refus de soins. La mesure de composition pénale doit recevoir l'accord de la personne à laquelle elle est proposée. Elle doit être validée par le président du tribunal, qui peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime. Si la personne n'accepte pas la composition ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées ou si la demande de validation est rejetée, le procureur de la République apprécie la suite à donner à la procédure.
Le décret d'application de la loi du 23 juin 1999 a été pris le 29 janvier 2001 (décret en Conseil d'Etat n° 2001-71 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République et à la composition pénale).
On rappellera que le Sénat était favorable à la loi ayant donné naissance à la composition pénale, estimant que l'instauration d'une forme de « plaider coupable » dans notre droit pourrait permettre de soulager les juridictions correctionnelles d'affaires pouvant être réglées autrement.
La loi d'orientation et de programmation pour la justice a porté de quatre à six mois la durée maximale pendant laquelle le permis de conduire ou le permis de chasser peuvent être déposés au greffe du tribunal dans le cadre d'une composition pénale. Par ailleurs, la liste des mesures pouvant être proposées à l'auteur d'un délit a été élargie pour inclure le suivi d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne pourrait excéder trois mois dans un délai ne pouvant être supérieur à dix-huit mois.
L'inscription des compositions pénales exécutées au bulletin n° 1 du casier judiciaire, qui n'est accessible qu'aux seules autorités judiciaires, est désormais prévue, ce qui pourrait inciter les magistrats du parquet à recourir davantage à la composition pénale.
Néanmoins, certains magistrats mettent en avant la lourdeur de cette procédure, qui prévoit la validation des mesures de composition pénale, s'agissant de délits, par le tribunal correctionnel si la personne accepte d'exécuter la mesure proposée par le parquet.
Il conviendrait donc que la Chancellerie opère un premier bilan de cette procédure afin d'apprécier si elle peut s'appliquer utilement au délit d'usage réitéré de stupéfiants ou de refus de soins.
La Chancellerie semble cependant croire en cette procédure, puisque le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité propose de poser le principe qu'en cas d'échec d'une mesure alternative aux poursuites, le parquet doit soit poursuivre, soit mettre en oeuvre une composition pénale, sauf élément nouveau.
De plus, cette procédure serait étendue à tous les délits punis de cinq ans d'emprisonnement au plus et à toutes les contraventions de la cinquième classe. En cas d'échec de la composition pénale, le parquet devrait, sauf élément nouveau, mettre en mouvement l'action publique. La procédure interromprait l'action publique et ne serait plus une simple cause de suspension.
Cette procédure pourrait donc être utilisée en cas de cession ou d'offre de stupéfiants en vue de la consommation personnelle, ce qui pourrait constituer une alternative à l'utilisation de la procédure de comparution immédiate pour les usagers-revendeurs, qui pourrait être réorientée vers les délits de trafic ou les circonstances aggravantes à la cession ou offre de stupéfiants en vue de la consommation personnelle (à des mineurs, dans l'enceinte d'un établissement scolaire ou d'une administration).
La commission d'enquête proposera en conséquence d'ajouter aux mesures susceptibles d'être prononcées une obligation de soins ou d'orientation vers une structure sociopsychologique .
2. Maintenir l'objectif d'orientation sociosanitaire des usagers de drogues à l'occasion de la réponse judiciaire en pérennisant les conventions départementales d'objectifs justice-santé
La commission d'enquête estime que l'objectif de permettre aux usagers de drogues de rencontrer une structure médicale ou sociopsychologique à chaque stade de la procédure judiciaire afin de prendre en compte l'ensemble de leurs difficultés et de prévenir la récidive doit être réaffirmé.
La commission d'enquête considère, tout comme M. Didier Jayle, président de la MILDT, que la mise en place des conventions départementales d'objectifs a permis des premiers résultats encourageants. Ainsi que l'a souligné Mme Nicole Maestracci, ancienne présidente de la MILDT, il s'agit d'une action qui doit s'inscrire dans la durée.
La commission ne peut donc que souscrire aux recommandations émises par l'évaluation de l'ODFT :
- de pérenniser leur financement, afin de garantir la survie des associations intervenant dans ce domaine et de donner aux magistrats des alternatives concrètes ;
- de réorienter leur action vers une coopération accrue entre services répressifs et services de santé et de sensibiliser les forces de l'ordre. Les CDO ne doivent pas se contenter d'abonder les associations ou les structures de prise en charge sanitaire ;
- de développer les permanences d'orientation sociosanitaire dans chaque tribunal de grande instance, de former les magistrats afin de leur permettre de mieux repérer les auteurs d'actes de délinquance ayant des consommations excessives ou problématiques de drogues ;
- de développer les travaux d'intérêt général.
E. HOMOGÉNÉISER LES SANCTIONS
L'un des principaux reproches formulés à l'encontre de la politique répressive à l'égard de l'usage de drogue est de manquer de cohérence et de ne pas traiter de manière égale les usagers. L'OFDT a souligné dans son rapport d'évaluation du plan triennal le manque de cohérence et de vision d'ensemble des actions menées en termes de politique pénale sur l'ensemble du territoire.
La commission d'enquête souligne donc la nécessité d'y remédier.
1. Développer les instructions à l'égard des parquets et mieux informer les magistrats et les forces de l'ordre
Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Dominique Perben, ministre de la justice, a indiqué que le bilan dressé par la MILDT devrait être suivi de l'élaboration d'un guide mémento pour fixer des critères harmonisés et dicter des orientations à suivre.
En outre, il a indiqué qu'un questionnaire « stupéfiants » avait été en décembre 2002 adressé à l'ensemble des parquets généraux, certaines administrations (douanes, police et gendarmerie) ayant émis le souhait de mieux connaître la pratique des parquets, et notamment les critères retenus pour la transaction douanière, pour la distinction entre les infractions d'usage et de détention de stupéfiants, ainsi que pour la mise en oeuvre de réponses judiciaires. Ce questionnaire vise également à mieux connaître les critères retenus par les parquets pour la définition du trafic de transit ainsi que les modalités de traitement de ce type de contentieux.
Il doit également permettre de recueillir les suggestions des parquets.
Les résultats permettront d'établir une cartographie du traitement judiciaire des procédures liées aux stupéfiants, l'objectif étant de faire cesser les distorsions d'un parquet à l'autre, et d'avoir une connaissance des bonnes pratiques des parquets, pour pouvoir les diffuser sur le plan national. Ceci devrait déboucher sur une instruction générale.
Par ailleurs, il a précisé qu'un document méthodologique sur le proxénétisme de la drogue serait diffusé très prochainement aux magistrats, policiers et gendarmes.
La commission d'enquête se félicite de ce volontarisme affiché.
Par ailleurs, le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité vise à prévoir que le ministre de la justice veillera à la cohérence de l'application de la loi pénale sur l'ensemble du territoire de la République. Serait de même consacré le rôle des procureurs généraux en matière de politique pénale, qui animeront et coordonneront l'action des procureurs de la République de leur ressort, ainsi que la conduite des différentes politiques publiques. Ils se feront adresser un rapport annuel sur l'activité et la gestion des parquets ainsi que sur l'application de la loi.
La commission d'enquête souscrit totalement à cette précision.
2. Poursuivre plus fréquemment l'incitation à l'usage
L'article 3421-4 du code de la santé publique sanctionne la provocation à toutes les infractions à la législation sur les stupéfiants, qu'elle ait été ou non suivie d'effets. En 2001, seules 27 condamnations pour provocation à l'usage de stupéfiants ont été prononcées.
La commission d'enquête préconise donc de poursuivre plus fréquemment ce délit.
3. Sanctionner toute infraction à l'égard de mineurs
Ainsi que l'a recommandé M. Dominique Perben, ministre de la justice, « l'accent doit être mis sur les mineurs, qui est le public sensible par excellence. »
S'agissant de mineurs délinquants, il convient de développer les réponses éducatives. A cet égard, l'ordonnance de 1945 prévoit toute une série de réponses éducatives adaptées.
S'agissant de mineurs victimes, la commission d'enquête préconise la plus grande fermeté.
Comme l'a fait observer lors de son audition M. Pierre Mutz, directeur général de la gendarmerie, « bien souvent un dealer donne 50 francs à un gamin de 6-8 ans en lui demandant de faire le guet, mais le gamin ne sait pas vraiment pourquoi, et il n'est pas possible de l'interpeller et de l'interroger. En définitive, les petits dealers sont souvent des mineurs, les gros étant des adultes. Les mineurs ont recours à des enfants pour assurer des rôles d'observation, ce qui rend très difficile l'établissement des faits. »
Or, l'article 227-18 du code pénal sanctionne le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants de cinq ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende. Lorsqu'il s'agit d'un mineur de moins de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende.
De même, l'article 227-18-1 du code pénal sanctionne le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants de sept ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende. Lorsqu'il s'agit d'un mineur de moins de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves aux abords d'un tel établissement, l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende.
Or ces infractions sont très rarement poursuivies. Qu'on en juge !
Ainsi, on relève une condamnation par an pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001 s'agissant du délit d'utilisation de mineurs dans un trafic, avec un quantum de peines de trois mois fermes d'emprisonnement extrêmement faible.
De même, s'agissant du délit de provocation des mineurs à l'usage de stupéfiants, on ne compte que 6 condamnations en 1997, 10 en 1999 et 17 en 2001, avec un quantum de 10 mois.
Le garde des Sceaux, M. Dominique Perben, a d'ailleurs estimé lors de son audition que ce point mériterait de faire l'objet d'une instruction, la faiblesse des poursuites étant manifeste.
Cette faiblesse peut s'expliquer par la volonté des tribunaux de recourir à la procédure de comparution immédiate (jusqu'à il y a peu réservée aux infractions passibles de sept ans maximum d'emprisonnement). S'agissant des peines correctionnelles aggravées (jusqu'à 10 ans d'emprisonnement) prévues à l'égard de celui qui offre ou cède des drogues à un mineur, ou à une personne dans les locaux d'enseignement d'éducation ou de l'administration en vue de sa consommation personnelle (article L. 627, al. 2), la circulaire du 1 er février 1988 du garde des Sceaux estimait qu'il pourrait « s'avérer opportun, à chaque fois qu'il apparaîtra nécessaire de sanctionner rapidement et efficacement des agissements de cette nature, de continuer à exercer les poursuites sur le fondement de l'alinéa 1 de l'article L. 627-2 qui permet le recours à la procédure de comparution immédiate et de réserver l'application du nouvel alinéa 2 aux situations les plus graves ou à celles dans lesquelles l'ouverture d'une information est indispensable. »
Cette difficulté procédurale ayant disparu du fait de l'adoption de la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, la commission d'enquête appelle le garde des Sceaux à prendre des mesures énergiques afin de « relancer » la poursuite de ces infractions.
F. DES PISTES À CREUSER
1. En matière de conduite automobile
a) Prendre en compte les effets des médicaments sur la conduite automobile
Plusieurs personnalités auditionnées par la commission d'enquête ont insisté sur l'opportunité de réfléchir à une meilleure prise en compte de l'influence de certains médicaments sur la conduite automobile.
M. Pierre Mutz, directeur général de la gendarmerie nationale, s'est ainsi déclaré, lors de son audition, convaincu que beaucoup d'accidents inexpliqués étaient dus aux drogues ou aux médicaments. Le professeur Claude Got, expert en sécurité routière, a fait lors de son audition état d'une étude d'une société d'assurance automobile du Québec montrant un risque significativement augmenté d'accident avec les anxiolytiques, et a indiqué à la commission d'enquête que « gérer le problème du cannabis au volant sans gérer celui des médicaments au volant heurte profondément le sens de la cohérence dans l'action publique. »
M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, a également estimé nécessaire de s'intéresser à la conduite sous l'influence de médicaments psychoactifs.
Aussi le docteur Patrick Mura, tout en rappelant que, selon son étude, le facteur de risque pour les médicaments psychoactifs était de 1,7 (contre 2,5 pour le cannabis), a-t-il préconisé de classer les médicaments par ordre de dangerosité et d'interdire la conduite avec les médicaments très dangereux, et s'agissant de médicaments potentiellement dangereux, de les limiter aux déplacements professionnels. Il a rappelé que la loi dite Gayssot avait instauré l'apposition d'un pictogramme, mais que cette mesure s'était révélée inefficace, les sociétés pharmaceutiques, pour des raisons de responsabilité, ayant mis un pictogramme sur toutes les classes de médicaments.
b) Développer les tests comportementaux
La loi du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants permet aux forces de l'ordre de procéder à des contrôles dès lors « qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner (que le conducteur) a fait usage de stupéfiants ».
Le nombre de contrôles susceptibles d'être opérés est donc appelé à croître de manière très significative. Or, sont actuellement utilisées des analyses d'urine, puis de sang. Si ces analyses sont fiables, elles sont coûteuses et contraignantes. Elles ne peuvent être pratiquées par les forces de l'ordre au bord de la route et impliquent le transport des personnes concernées vers des établissements médicaux ou hospitaliers et l'attente des résultats. En 2001, 116.745 accidents corporels ont été dénombrés, faisant 7.720 morts et 153.945 blessés. En prenant l'hypothèse qu'un accident concerne deux véhicules, plus de 232.000 dépistages devraient être effectués chaque année. Il ne paraît donc pas réaliste de procéder à des dépistages systématiques. En pratique, les forces de l'ordre ne font pas les tests d'urine, qui sont trop longs à effectuer, et procèdent directement aux tests sanguins.
Il serait donc souhaitable de mettre en place des tests comportementaux simples qui seraient faits par les forces de l'ordre afin de procéder à un premier tri, les analyses sanguines n'intervenant qu'à titre de confirmation. Ainsi que l'a indiqué lors de son audition un pharmacien toxicologue, des tests comportementaux tout à fait simples et bien codifiés (appelés tests DRE -Drug Recognition Expertise-) sont utilisés depuis 20 ans aux Etats-Unis.
Plusieurs expériences sont d'ores et déjà menées en France. Ainsi, le docteur Mercier-Guyon assure la formation des forces de l'ordre en Haute-Savoie. Par ailleurs, M. Alain Quéant, sous-directeur de la police territoriale à la direction de la police de proximité de la préfecture de police de Paris, a indiqué qu'une expérience pilote était menée dans le XVIII e arrondissement.
La commission d'enquête préconise donc que ces expériences soient généralisées et que les forces de police et de gendarmerie reçoivent la formation nécessaire pour reconnaître certains symptômes susceptibles de révéler une consommation de produits stupéfiants.
c) Cibler les contrôles
Il a été fait état devant la commission d'enquête d'une expérience menée en 2000 en Sarre (Allemagne). Des dépistages de drogues ont été effectués de façon très fréquente au cours des week-ends à proximité des discothèques. La sanction en cas de contrôle positif était la confiscation du permis et l'immobilisation du véhicule jusqu'à ce que des tests indiquent l'abstinence. Cette expérience a permis de constater une diminution de 69 % des décès chez les jeunes de moins de 27 ans en une année, alors que dans un autre Land pris comme témoin où les mêmes contrôles avaient été effectués sans confiscation du permis ni restitution après contrôles, la baisse n'avait été que de 2 %.
La commission d'enquête préconise donc de s'inspirer de cette expérience.
2. Renforcer les pouvoirs d'enquête
M. Gérard Peuch, chef de la brigade de stupéfiants à la direction de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris, a avancé lors de son audition quelques pistes de modifications souhaitables en matière d'enquête :
- donner un réel statut à l'indicateur de police , sur le modèle de « l'aviseur des douanes », « afin de normaliser et de judiciariser les relations que nous pouvons avoir avec ces personnes dont nous avons besoin à 101 %. Les relations que nous entretenons avec les indicateurs de police sont toujours considérées soit comme malsaines, soit comme ambiguës, en tout cas suspectes. C'est une revendication de l'ensemble des personnels de la police judiciaire (...). On ne peut pas continuer à initier des enquêtes en imaginant des faits faux pour mieux protéger un indicateur de police. Il faudrait avoir le courage de dire que nous avons pu traiter une affaire parce que quelqu'un nous a renseignés. ». Un amendement proposé par M. Thierry Mariani lors de l'examen du projet de loi d'adaptation des moyens de la justice va en ce sens ;
- faire bénéficier les policiers étrangers de l'immunité attachée aux opérations contrôlées de livraison de produits stupéfiants (article 706-32 du code de procédure pénale) ;
- reconnaître comme moyens de preuve les moyens dits « proactifs » , c'est-à-dire les moyens scientifiques, comme les balises satellitaires, car « je ne vous cache pas qu'hypocritement, le ministère de l'intérieur les achète à ma demande, mais que je ne dois pas en faire état, c'est-à-dire que je les utilise, mais que, comme ils ne sont pas encore reconnus dans le droit français, on ne sait pas quelle attitude prendre. Est-ce autorisé parce que ce n'est pas interdit ou est-ce interdit parce que ce n'est pas autorisé ? On fait le grand écart entre ces deux notions » ;
- revoir les autorisations de perquisition de nuit . Ainsi que l'a indiqué M. Gérard Peuch : « Quand on est en flagrant délit, il faut saisir le procureur de chaque lieu où une perquisition doit être faite, lequel, sur réquisition écrite, doit saisir le juge des libertés de son tribunal qui accordera ou non la perquisition. Si les perquisitions se déroulent dans plusieurs départements, on devra réveiller tous les substituts et les juges des libertés, alors qu'aucun de ces tribunaux ne connaîtra la procédure et on aura des décisions différentes selon les tribunaux, ce qui n'est pas très cohérent ». Ceci ne semble en toute hypothèse pas de nature à assurer un contrôle effectif des forces de police et prend un temps précieux.
3. Revoir les outils méthodologiques
Ainsi que l'a observé l'OFDT dans son rapport d'évaluation, les outils statistiques de la Chancellerie et des forces de l'ordre sont insuffisants. Il n'est pas possible de suivre le traitement judiciaire d'une personne interpellée.
Il conviendrait d'abord d'assurer la continuité du recueil des données entre les services de police et de gendarmerie et les juridictions, ce qui implique notamment de retenir une définition commune des différentes catégories d'infractions.
Les statistiques judiciaires devraient ensuite permettre, pour chaque catégorie d'infractions, et selon que les auteurs sont majeurs ou mineurs, de connaître les mesures et sanctions prononcées. Ces renseignements devraient être complétés par les statistiques des associations et services qui prennent en charge des personnes sous main de justice.
Resterait enfin à connaître l'incidence de ces mesures sur la prévention de la récidive. Un suivi de cohorte serait utile.
La commission d'enquête proposera de mettre en oeuvre l'ensemble de ces recommandations.
4. Motiver les acteurs
a) Réformer le mode de fonctionnement du fonds de concours « lutte anti-drogue »
Le décret du 17 mars 1995 a créé ce fonds de concours « lutte anti-drogue » destiné à recueillir le produit de la vente des biens confisqués dans le cadre de procédures pénales diligentées du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Le produit des recettes est géré par la MILDT et réparti entre les ministères de l'intérieur (30 %), du budget (30 %), de la défense (20 %), de la justice (10 %) et des affaires sociales (10 %). Ont été affectés à ce fonds 160.000 euros en 2001 et 243.0000 euros en 2002. Ce fonds de concours n'a jamais été alimenté de façon à abonder, comme prévu, les crédits d'équipement des ministères répressifs.
Ainsi qu'en a émis le souhait lors de son audition M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la commission d'enquête préconise d'affecter une partie du produit du fonds de répartition des saisies pour que ces fonds puissent bénéficier aux actions répressives, telles que les infiltrations de policiers et de gendarmes dans les réseaux de trafiquants. Ceci constitue en effet un élément de motivation très important des services. En outre, une circulaire de la Chancellerie du 15 février 2002, relative à la mise en oeuvre du Fonds de concours pour la lutte anti-drogue, fixe des règles précises de fonctionnement et organise le suivi des fonds saisis dans le cadre d'affaires de trafic de stupéfiants ou de blanchiment.
La commission souhaite également que soit assurée la complémentarité de son régime juridique avec les règles spécifiques des saisies douanières.
b) Améliorer la formation des avocats
Maître Gérard Tcholakian, membre de la commission libertés et droits de l'homme au Conseil national des barreaux, a indiqué lors de son audition que le CNB n'avait jamais eu de réflexion particulière et approfondie sur le problème de l'usage des drogues illicites et que les avocats se trouvaient souvent démunis pour remédier au désarroi des familles et les orienter.
La commission d'enquête préconise donc une réflexion sur l'introduction d'une sensibilisation à ces questions lors la formation des élèves avocats et lors de la formation continue.
La formation de ces acteurs essentiels reste encore lacunaire, comme le montre l'inapplication de la circulaire du 17 novembre 1999 sur l'interdiction du territoire aux étrangers, invitant notamment les parquets à se rapprocher des barreaux pour apporter une formation, à la fois aux magistrats et aux avocats, sur les questions relatives à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et aux étrangers présents en France depuis fort longtemps.
5. Développer la prévention « situationnelle »
La prévention « situationnelle », qui recouvre l'ensemble des mesures d'urbanisme, d'architecture ou techniques visant à prévenir les actes délinquants ou à les rendre moins « profitables », a déjà connu une large application pratique dans de nombreux pays européens. Il est en effet désormais admis que certains types de réalisations urbaines ou d'activités économiques peuvent se révéler criminogènes et qu'il est possible d'y prévenir ou d'y réduire les sources d'insécurité en agissant sur l'architecture et l'aménagement de l'espace urbain.
La loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure préconisait d'y recourir. Ce point est particulièrement important, comme le montrent les difficultés des enquêtes dans les banlieues.
La commission d'enquête ne peut que souhaiter un développement de ce type de prévention.
6. Donner un statut à la politique de réduction des risques
La commission d'enquête préconise enfin de donner un cadre juridique adapté à la politique de prévention, et surtout à la politique de réduction des risques, qui même si elle a fait ses preuves, bouscule et contredit les principes d'interdit et d'abstinence sur lesquels se fonde la loi.
G. DÉVELOPPER L'INDISPENSABLE PARTENARIAT
1. Renforcer la coordination nationale
L'utilité d'une réelle coordination entre services répressifs nationaux a déjà été soulignée dans le présent rapport ainsi que par la majorité des personnes auditionnées par la commission d'enquête.
A cet égard, la commission estime que la création en mai 2002 des groupes d'intervention régionaux (GIR), à l'initiative de M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, constitue une réelle innovation, aujourd'hui couronnée de succès et qui devrait être renforcée.
Dans son rapport d'évaluation du plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances (1999-2002), l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies souligne que, d'un point de vue stratégique, les modalités organisationnelles adoptées par les administrations en charge de la lutte contre les trafics pour mieux coordonner leurs actions ne doivent pas être confinées à la coordination horizontale de structures existantes et réduites à la facilitation des conditions d'actions de ces dernières . La commission partage cette analyse et reconnaît la nécessité d'une meilleure intégration verticale des services, à travers la mise en place de structures destinées à piloter de manière plus centralisée l'action répressive. De ce point de vue, la création des GIR constitue une véritable innovation dont les premiers résultats confirment l'efficacité.
Dans le but de renforcer la coordination institutionnelle, la commission d'enquête proposera certains aménagements concernant les deux principales structures de coordination existant en France : les groupes d'intervention régionaux (GIR) et les bureaux de liaison de permanent (BLP). Ces aménagements ont pour priorité essentielle de permettre une réelle mutualisation du renseignement au niveau national, une fluidité de la circulation de l'information ainsi qu'une plus grande efficacité des services d'enquête .
a) L'amélioration du fonctionnement des GIR
D'un point de vue administratif , M. Nicolas Sarkozy a fait part à la commission d'enquête d'une difficulté liée à la spécificité de l'administration des douanes . Il a indiqué : « Nous avons eu un petit problème (...) administratif. Pour que les meilleurs soient volontaires pour intégrer les GIR, il faut que ceux, douaniers, policiers ou gendarmes, qui les intègrent ne soient pas sortis de leur administration et soient reconnus dans une possibilité d'avancement. Je m'en suis ouvert avec M. Mongin, directeur général des douanes, pour mettre ce petit point en place. Cela va se faire ».
La commission souhaite ainsi que soit réglée la question de l'attractivité des postes au sein des GIR pour des fonctionnaires qui doivent faire leur carrière dans leur administration d'origine, afin d'encourager les meilleurs fonctionnaires à la mobilité, sans qu'ils soient oubliés en termes d'avancement par leur administration d'origine. Dans le cadre des GIR, le problème se pose essentiellement pour les fonctionnaires de l'administration des douanes et des services fiscaux.
D'un point de vue juridique , M. François Mongin, directeur général des douanes et des droits indirects, a soulevé, lors de son audition par la commission d'enquête, une difficulté tenant à la spécificité du code des douanes , également soulignée par M. Nicolas Sarkozy devant la commission d'enquête. Il a indiqué que « les agents qui participent aux (...) GIR agissent sur la base du corpus juridique de doctrine qui leur est propre. Les agents des douanes agissent à ce titre sur la base du code des douanes qui est leur seule base de légitimité juridique ». Or les GIR travaillent essentiellement sur la base du code pénal et du code de procédure pénale définissant les pouvoirs d'intervention et d'investigation des officiers de police judiciaire. M. François Mongin a souligné que « toute la difficulté pour les agents des douanes est donc d'arriver à trouver leur place dans un dispositif qui est dominé par la mise en oeuvre du code de procédure pénale et par la difficulté que peuvent avoir ces agents à se situer dans ce cadre alors qu'ils ne sont pas officiers de police judiciaire ».
La commission estime que cette difficulté de nature juridique pourrait être réglée, d'une part, en mettant davantage en oeuvre au sein des GIR des procédures ressortissant du domaine de la police administrative , ce qui permettrait alors aux agents des douanes intégrés dans les GIR d'agir sur la base du code des douanes et aux agents de la direction générale des impôts d'agir sur la base du code général des impôts, d'autre part, en élargissant les compétences des agents des douanes habilités à faire des enquêtes judiciaires prévues par l'article 28-1 du code de procédure pénale .
En effet, d'après les dispositions de cet article, des agents des douanes peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Toutefois, ils n'ont pas compétence, à ce titre, en matière de trafic de stupéfiants, sous réserve de la décision du procureur de la République ou du juge d'instruction territorialement compétent de constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires.
La commission d'enquête estime nécessaire d'élargir les compétences des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires aux affaires concernant le trafic de stupéfiants. A cet égard, le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, présenté en conseil des ministres le 9 avril 2003 par M. Dominique Perben, garde des Sceaux, devrait permettre d'aller dans ce sens.
D'un point de vue opérationnel , la commission d'enquête insiste sur la priorité à donner à une réorganisation de la circulation du renseignement ainsi qu'à la mutualisation des moyens d'action des services répressifs. Lors de ses déplacements à Saint-Martin et Valenciennes notamment, la commission a été informée à plusieurs reprises de la nécessité de positionner le recueil, l'analyse et le partage du renseignement au centre du dispositif répressif de lutte contre le trafic de stupéfiants.
Ainsi, l'analyse du renseignement doit précéder toute action à vocation opérationnelle et le partage du renseignement doit permettre à l'ensemble des acteurs parties prenantes de disposer rapidement de l'intégralité des informations. En outre, la nécessité d'agir en coopération avec les autres administrations avec de très faibles préavis pour intercepter les narco-trafiquants en flagrant délit a été soulignée avec force par les différents services répressifs présents sur l'île de Saint-Martin.
Une des propositions ayant particulièrement attiré l'attention de la commission d'enquête est celle de la création d'un « GIR STUP » permanent intégrant les pôles d'excellence de chaque administration concernée. Actuellement, les GIR ont en effet pour vocation de lutter contre l'économie souterraine et les différentes formes de délinquance organisée. Les infractions traitées par les GIR peuvent ainsi être regroupées en trois agrégats : le trafic de stupéfiants et le « proxénétisme de la drogue », les atteintes aux biens (cambriolages, vols et recels) et les trafics de véhicules volés.
La commission proposera la création de groupes d'intervention régionaux uniquement dédiés à la lutte contre le trafic de stupéfiants . La mise en place de telles unités spéciales permettrait en outre de quantifier sur l'année les opérations concertées de contrôle en matière de trafic de stupéfiants ainsi que les opérations diligentées pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 222-39-1 du code pénal visant le proxénétisme de la drogue.
Enfin, la commission juge également nécessaire de renforcer les moyens humains et budgétaires des GIR , afin de leur garantir une réelle autonomie de fonctionnement . En effet, à l'heure actuelle, les GIR ne disposent pas de moyens propres et ne fonctionnent que par le biais des moyens des services participant à leurs activités.
b) L'amélioration du fonctionnement des bureaux de liaison permanents
Lors de ses déplacements à Saint-Martin et à Valenciennes, deux régions d'implantation des bureaux de liaison permanents, la commission d'enquête a pu mesurer la relative inefficacité de ces instruments de coordination nationale.
Ne disposant d'aucune marge de manoeuvre opérationnelle, les BLP ont pour objectif principal de réguler l'activité des services répressifs en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants en permettant notamment d'éviter les doublons d'enquête et en centralisant les informations qui leur sont fournies par les différents services.
La commission d'enquête proposera un renforcement et une redéfinition des compétences des BLP dans le sens d'une plus grande complémentarité avec l'action des GIR et une mutualisation / redistribution du renseignement. Elle proposera également une généralisation de l'implantation de BLP à toutes les frontières du territoire national.
En conséquence, elle souhaiterait un développement de binômes GIR / BLP , caractérisés par le partage des compétences suivant : des compétences opérationnelles dévolues aux GIR, des compétences en matière de renseignement et de traitement de l'information dévolues aux BLP.
c) Un recours plus systématique à certains outils juridiques aujourd'hui très peu utilisés
Réaffirmer la nécessité d'une plus grande intégration verticale des services en charge de la lutte contre les trafics de stupéfiants et d'un pilotage centralisé de l'action répressive devrait permettre un recours plus systématique aux outils juridiques spécifiques en matière de lutte contre le trafic, mais encore insuffisamment exploités, tels le délit de non justification de ressources ou celui de blanchiment de fonds provenant de tout crime ou de tout délit.
Ces structures centralisées devraient permettre notamment une formation directe des services répressifs aux nouveaux instruments législatifs ainsi qu'une meilleure maîtrise de l'utilisation de l'article 222-39-1 du code pénal.
S'agissant de la répression du blanchiment , qui couvre désormais des activités criminelles dépassant largement le strict champ du trafic de drogue et qui concerne l'ensemble des intermédiaires du monde de la banque, de la finance et du conseil, l'action ne peut plus reposer essentiellement sur les seules performances de TRACFIN, des moyens et des instructions devant être accordés à l'enquête à l'initiative des parquets.
Enfin, on peut imaginer que, dans le cadre de leur action en matière de lutte contre les stupéfiants, les GIR s'adjoignent les services d'un représentant de TRACFIN spécialisé dans la répression du blanchiment.
2. Renforcer les pouvoirs effectifs du maire en matière de prévention et de lutte contre les drogues
De manière récurrente, les maires se plaignent d'apprendre dans la presse certains événements intervenus dans leur commune. Ils souhaitent que leur information ne dépende pas de la qualité de leurs relations personnelles avec les responsables des services de sécurité.
Ainsi que l'a reconnu lors de son audition M. Pierre Mutz, directeur général de la gendarmerie, les problèmes de drogue sont évoqués de façon rarissime avec les élus locaux. Les agents et officiers de police judiciaire s'abritent bien souvent derrière le secret de l'instruction, particulièrement dans les petites communes rurales, où chacun se connaît.
a) Des CLS aux CLSPD
La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a donné une consécration législative aux contrats locaux de sécurité (CLS) prévus par les circulaires interministérielles des 28 octobre 1997 et 7 juin 1999. Cosignés par le préfet, le procureur de la République et le ou les maires concernés, ces contrats associent différents partenaires privés, tels les bailleurs sociaux ou les sociétés de transport (article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales). Les rapports de l'inspection générale de la police nationale ont montré que ces CLS avaient souvent été conclus sur la base de diagnostics locaux de sécurité insuffisants et fait l'objet d'une faible implication des administrations de l'État et d'un suivi insuffisant.
L'annexe de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002 a donc précisé que « l'ancrage des forces de sécurité dans la démocratie locale » serait assuré grâce à la mise en place de conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance amenés en outre à conduire, en matière de prévention, une action de proximité en coordination avec le conseil départemental de prévention. Ces deux conseils ont été créés par le décret n° 2002-999 du 17 juillet 2002.
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) est placé sous la présidence d'un maire et comprend, outre le préfet et le procureur de la République, des élus locaux, des représentants des administrations de l'État et des représentants des associations, organismes et professions concernés par les questions de sécurité. Il se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président et, de droit, à l'initiative du préfet ou de la majorité de ses membres. C'est un lieu d'information et d'organisation de la coopération entre les différents intervenants dans le domaine de la sécurité et de la prévention.
En matière de lutte contre l'insécurité, il favorise l'échange d'informations avec les services de l'État auprès desquels il retranscrit les attentes des populations. Il est en retour informé régulièrement des statistiques et de l'évolution de la délinquance dans le ressort territorial . Au titre de la prévention, il dresse le constat des actions de prévention et définit les objectifs et les actions coordonnées dont il suit l'exécution.
Il constitue ainsi l'enceinte normale d'élaboration, de mise en oeuvre et d'évaluation des contrats locaux de sécurité et son action est conduite en coordination avec celle du conseil départemental de prévention.
b) Une nécessaire information des maires
En outre, le décret du 17 juillet 2002 précise que, indépendamment de l'existence d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, les maires sont informés sans délai des actes graves de délinquance commis dans leur commune et qu'ils sont informés au moins une fois par an de l'ensemble des moyens mis en oeuvre par l'Etat dans la commune. La loi sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003 a pris en compte la modification réglementaire des CLS en CLSPD.
Le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité dit « Perben II » prévoit en outre certaines mesures :
- le maire serait tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Le maire serait alors avisé des suites données ;
- le procureur de la République pourrait également communiquer au maire les éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune qu'il rend publics conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 117 ( * ) ;
- le procureur de la République devrait aviser les maires des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites décidées à l'occasion de leur signalement. Lorsque l'auteur des faits est identifié mais que le procureur de la République déciderait de classer sans suite la procédure, il les aviserait également de sa décision, qui devrait être motivée.
Ces mesures répondraient à un certain nombre de remarques et de propositions émises par la commission des Lois du Sénat lors de la discussion de la loi sur la sécurité quotidienne. Le Sénat avait insisté sur la nécessité pour les maires d'obtenir un véritable droit à l'information en matière de sécurité et de participer aux politiques de sécurité.
c) Le maire, véritable acteur de la lutte contre la délinquance
M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, a indiqué que les questions relatives à la prévention de l'usage des drogues et de la toxicomanie seraient couvertes par le futur projet de loi sur la prévention de la délinquance et que la commune devait avoir un rôle beaucoup plus important, ce en raison de la connaissance fine du terrain qu'ont les maires et les élus.
Si toutes ces mesures ont permis ou permettront une amélioration notable de l'information des maires, nombre d'entre eux considèrent toujours qu'ils ne disposent pas en la matière d'un pouvoir d'animation suffisant. Ainsi que l'a rappelé lors de son audition M. Pierre Cardo, député-maire de Chanteloup-les-Vignes, aux yeux des électeurs, le maire est responsable de la sécurité dans la commune.
La commission d'enquête préconise donc de reprendre certaines des propositions émises par la commission des Lois du Sénat lors de la discussion du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne :
- permettre au maire d'exercer l'action publique pour les infractions intervenues sur la voie publique dans sa commune ;
- encadrer de manière législative la possibilité de prendre un arrêté réglementant la circulation, entre minuit et six heures du matin, des mineurs de moins de treize ans non accompagnés d'une personne responsable d'eux, afin de réduire l'implication d'enfants de plus en plus jeunes dans l'organisation et la protection du « commerce des stupéfiants ». Cet encadrement législatif permettrait de fixer la jurisprudence du Conseil d'Etat et d'assurer l'exécution de ces arrêtés dans de bonnes conditions. En 1997, le Conseil d'Etat, sans se prononcer sur la validité de l'interdiction de circuler en elle-même, avait en effet annulé plusieurs arrêtés en ce qu'ils prévoyaient une exécution forcée en prescrivant le raccompagnement des mineurs. Le Conseil d'État avait considéré qu'à défaut d'habilitation par le législateur, l'exécution par l'administration d'une décision de police sanctionnée pénalement ne pouvait que résulter de l'urgence . Les arrêtés validés par le Conseil d'Etat se réfèrent ainsi à la situation d'urgence pour justifier la reconduite des mineurs. Ils s'en trouvent fortement fragilisés, l'urgence ne pouvant systématiquement être démontrée en la matière. La mesure de reconduite apparaît cependant plus efficace que toute amende pour assurer le succès de l'interdiction de circuler ;
- reconnaître au maire le pouvoir de faire appel aux forces de police étatisées dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de police dans les communes où la police est étatisée (le maire ne disposant à l'heure actuelle que des gardes-champêtres et des polices municipales régies par la loi du 15 avril 1999, qui ont des pouvoirs limités).
M. Dominique Perben, ministre de la justice, a en outre indiqué qu'il avait demandé à M. Daniel Hoeffel, président de l'Association des maires de France et vice-président du Sénat, de désigner un certain nombre de maires afin de participer à un groupe de travail avec des magistrats, en particulier du parquet, « non pas pour fixer le principe d'une information procureur- maire qui va de soi, mais pour essayer de préciser quelle pourrait en être la règle du jeu. Il ne faut pas non plus que le maire se trouve dans une situation dans laquelle il partagerait des informations qu'il n'a pas forcément à partager, y compris dans son intérêt. » Avant l'été, un petit guide méthodologique pourrait paraître. Il serait souhaitable que toutes ces propositions y soient discutées.
En outre, la commission d'enquête préconise, au-delà des textes, de donner des moyens effectifs aux maires .
M. Pierre Cardo député-maire de Chanteloup-les-Vignes, a lors de son audition rappelé que les maires étaient souvent interpellés par les citoyens et appelés à « jouer les assistantes sociales », et que dans l'esprit des administrés, le maire présidait réellement le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, même si ce n'était pas l'analyse des partenaires institutionnels, pour lesquels, selon lui, le maire était une « potiche ». Il a souligné que les diverses réformes législatives intervenues n'avaient pas donné plus de moyens effectifs au maire pour mettre en cohérence les interventions des différentes institutions, qu'elles soient étatiques ou qu'elles dépendent des collectivités territoriales, pour définir la politique sociale du conseil général, de la police, des enseignants, des travailleurs sociaux ou de la caisse d'allocations familiales.
Il a donc préconisé d'ériger le maire en coordinateur d'un réseau, et pour ce faire, d'établir une sorte de code des procédures validé par tous afin de définir clairement la manière dont intervient chaque institution sur le territoire. Le maire chef d'orchestre serait chargé de vérifier le respect des procédures ou d'intervenir pour rectifier, sans autorité hiérarchique, mais par une simple responsabilité fonctionnelle. Ceci permettrait de mettre en place un pôle d'orientation. Ce pôle d'accueil devrait faire circuler l'information entre les différents acteurs concernés par un problème ou une personne à problèmes, afin d'éviter la multiplication de décisions ponctuelles, en établissant au contraire des itinéraires, tant pour les enfants que pour les parents, afin de mener une réelle politique de prévention.
M. Pierre Cardo, député-maire de Chanteloup-les-Vignes, a illustré l'intérêt d'un tel pôle en indiquant qu'un juge des enfants, « qui doit actuellement attendre neuf mois pour avoir la réponse à sa demande d'enquête au service social et à l'aide sociale à l'enfance du fait du manque de disponibilité des services », pourrait recevoir une réponse rapide et apporter une réponse judiciaire réellement adaptée.
Il a indiqué qu'un pôle d'accueil jeunes validé par le président du conseil général des Yvelines et par les différents gardes des Sceaux existait depuis des années, mais que rien n'avait suivi.
La commission d'enquête recommande donc aux partenaires institutionnels de prêter une attention renforcée à ce type de dispositifs, qu'elle estime essentiels.
En outre, l'information du maire s'agissant de la lutte contre les réseaux est primordiale, afin de mieux anticiper les réactions dans les quartiers avec les médiateurs, en cas d'intervention des GIR notamment.
Par ailleurs, il faudrait relier les discussions qui ont lieu dans les commissions locales d'insertion et dans les CLSPD pour repérer les trains de vie ne correspondant pas aux revenus déclarés.
M. Pierre Cardo, député-maire de Chanteloup-les-Vignes, a enfin estimé que les CLSPD devraient aussi être amenés à définir les familles sur lesquelles seraient engagées des actions pour étudier les cas concrets, parler de statistiques étant suffisant.
3. Relancer la coopération internationale
Comme il a déjà été souligné dans le présent rapport, les obstacles à une véritable coopération internationale en matière de lutte contre la drogue sont nombreux. Ils résident notamment dans les différences de nature juridique qui existent entre les Etats amenés à coopérer, du point du vue de la législation ainsi que de l'habilitation juridique des services appelés à travailler de concert. En outre, comme il a été dit, la commission tient à souligner que certains Etats ne jouent toujours pas le jeu de la coopération internationale.
Pourtant, la lutte anti-drogue constitue un domaine prioritaire de la coopération internationale.
a) Les domaines privilégiés de la coopération internationale
La commission a constaté au cours de ses travaux que la coopération internationale devait être impérativement relancée dans certains domaines comme échange de renseignements au niveau international et la circulation de l'information.
S'agissant de la répression du blanchiment de fonds issus du trafic de stupéfiants , l'organisation d'une réelle mutualisation internationale du renseignement doit être envisagée, par le biais d'une réactivation des cellules de renseignement financier à vocation multilatérale , regroupant les principaux pays engagés dans la lutte contre le blanchiment au niveau international. En outre, les informations échangées au niveau de ces cellules devraient pouvoir être utilisées à des fins d'enquêtes ou de poursuites pénales.
Une extension de la coopération policière internationale bilatérale en matière de répression du blanchiment est également souhaitable. En effet, à l'échelle internationale, la coopération étroite entre les forces de police est un préalable pour éviter que les frontières ne soient utilisées par les organisations criminelles. Des officiers de liaison ont été mis en place entre les principaux pays développés et veillent à la bonne transmission des informations opérationnelles entre les services. Cette priorité opérationnelle doit être maintenue et développée.
En outre, les relations multilatérales, comme avec Interpol , sont éminemment utiles en matière d'échange d'informations sur les procédures formellement engagées mais les informations d'investigation sont par nature trop sensibles pour donner lieu à des échanges multilatéraux. Une réflexion en ce sens devrait toutefois être menée.
S'agissant de la lutte contre le trafic international de stupéfiants , l'échange de renseignement et l'analyse commune de ce renseignement doit également être au centre des outils de coopération internationale. La technique du ciblage des passeurs de drogues peut, à cet égard, constituer un domaine privilégié de l'échange d'informations et de la coopération bilatérale entre les autorités aéroportuaires notamment.
Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Bernard Petit, chef de l'Office central pour la répression du trafic des stupéfiants (OCRTIS) a ainsi indiqué que les autorités britanniques et néerlandaises avaient développé, en amont des aéroports, des opérations de ciblage « très rentables ». Il a notamment cité l'exemple du démantèlement d'une filière de passeurs en provenance de Jamaïque.
|
LES PASSEURS DE JAMAÏQUE DÉCOURAGÉS
PAR LA
M. Bernard Petit, chef de l'OCRTIS a exposé cet exemple de coopération bilatérale à la commission d'enquête : « La Jamaïque compte deux aéroports internationaux : Montego Bay et Kingston. De ces deux aéroports, partaient des dizaines de passeurs à destination d'Heathrow qui étaient en train de saturer le système douanier, policier et judiciaire britannique. Lorsque la filière a été clairement identifiée, les autorités britanniques se sont rapprochées des autorités jamaïquaines qui, pendant une semaine, ont conduit des opérations dans les deux aéroports. Les résultats sont sans commentaires : une seule action pendant une semaine a permis, sur les deux aéroports jamaïquains, l'interpellation de 59 passeurs arrêtés à la Jamaïque à la place de 59 passeurs, peut-être, arrêtés à Heathrow, poursuivis en Grande-Bretagne et incarcérés dans le cadre du régime pénitentiaire de Grande-Bretagne. Ces 59 passeurs arrêtés ont permis la récupération de 2.500 boulettes de cocaïne, ce qui représentait 53 kilos, et permis la saisie de 929.000 dollars. Beaucoup plus intéressant : au terme de cette opération, le relais médiatique qui a été fait à l'ambassade de Grande-Bretagne sur place et par la police jamaïquaine a permis de constater que, la semaine même des opérations, cent personnes qui étaient pourtant dûment enregistrées sur les vols à destination d'Heathrow avaient annulé leur vol . Ils ont pris 59 passeurs et 100 passeurs ont sans doute renoncé à venir ». |
L'exemple de cette coopération bilatérale réussie devrait inciter la France à développer ce type d'opérations.
En outre, le développement de la coopération transfrontalière doit demeurer une priorité au sein de l'Union européenne. Comme il a déjà été souligné, la France participe à divers dispositifs de coopération transfrontalière, parmi lesquels les centres de coopération policière et douanière (CCPD). Ces instruments doivent être développés et étendus à plusieurs pays, et non pas seulement deux, comme c'est le cas actuellement. L'exemple récent de la création d'une structure de coopération policière transfrontalière entre le Luxembourg, l'Allemagne et la Belgique doit servir d'exemple.
S'agissant de la coopération entre Etats membres de l'Union européenne, la nécessité d'une réactivation du rôle d'Europol s'impose. Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, a souligné les lacunes de la coopération judiciaire européenne. Il a notamment déclaré : « Sur le plan multilatéral, nous nous heurtons au fait qu'il n'existe pas une autorité judiciaire européenne ». Il a également regretté le caractère non opérationnel d'Europol et appelé de ses voeux une modification de la liste des « eurocrimes », rappelant que le trafic de stupéfiants n'entrait toujours pas dans cette liste.
La commission d'enquête partage ces préoccupations et souhaite voir se développer l'entraide judiciaire internationale, et plus spécifiquement européenne.
A cet égard, elle ne peut qu'être très favorable aux dispositions du chapitre II du titre premier du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité , présenté en conseil des ministres par le garde des Sceaux le 9 avril 2003. Ce chapitre vise en effet à améliorer les dispositions relatives à l'entraide internationale. A cette fin, il introduit dans le code de procédure pénale les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, ainsi que de la décision instituant Eurojust du 28 février 2002. A cet effet, il propose une nouvelle rédaction du titre X du livre quatrième du code de procédure pénale relatif à l'entraide judiciaire internationale, en distinguant désormais deux régimes d'entraide : d'une part celui de l'entraide pénale avec tout Etat, d'autre part celui de l'entraide avec les Etats de l'Union européenne.
Les dispositions générales relatives à l'entraide pénale avec tout Etat visent à clarifier et simplifier les conditions de transmission et d'exécution des commissions rogatoires internationales , tout en préservant les intérêts fondamentaux de la France par la consécration de la « clause de sauvegarde ».
Les dispositions applicables à l'entraide avec les Etats membres de l'UE prévoient une coopération renforcée et plus efficace, notamment par le biais de la constitution d'équipes communes d'enquête et de la possibilité de donner aux agents étrangers détachés en France des pouvoirs de police judiciaire analogues à ceux d'un agent de police judiciaire français.
Enfin, la nature, les missions et les pouvoirs de l'unité Eurojust sont définies conformément à la décision du 28 février 2002 : organe de l'Union européenne, Eurojust est chargé de promouvoir et d'améliorer la coordination et la coopération entre les autorités compétentes des Etats membres dans toutes les enquêtes et poursuites relevant de sa compétence.
La commission d'enquête considère ces dispositions comme pertinentes et souhaite qu'elles puissent être soumises rapidement au Parlement.
b) Des instruments à réactiver : coopération bilatérale et coopération multilatérale
Aujourd'hui, la question se pose de savoir si, en matière de lutte contre les stupéfiants, il importe de développer les outils de coopération bilatérale ou ceux, plus vastes et sans doute moins efficaces, de coopération multilatérale. M. Nicolas Sarkozy a estimé que « la solution à trouver est (...) entre le bilatéral d'aujourd'hui et le multilatéral complet ». Il a ajouté, « en revanche, que les principaux ministres de la justice et de l'intérieur des pays les plus concernés se voient régulièrement pour mettre à l'ordre du jour cela, pour échanger leurs renseignements et agir opérationnellement de concert est tout à fait nécessaire ».
La commission partage cette préoccupation de trouver un moyen terme entre le « tout bilatéral » et le « tout multilatéral », au niveau communautaire notamment.
Enfin, le renforcement de la coopération bilatérale avec les pays producteurs apparaît aujourd'hui prioritaire.
Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Jacques Franquet, premier vice-président de l'Organe international de contrôle de stupéfiants (OICS), a souligné les ambiguïtés d'une coopération internationale avec les pays producteurs, en s'appuyant sur l'exemple du Maroc : « Je me suis rendu au Maroc pour l'OICS pour dire que son attitude n'était pas sérieuse car il était toujours un pays pourvoyeur de cannabis. Sa réponse est toujours la même au premier degré : de quoi vont vivre nos paysans du rif ? En fait c'est un peu court parce qu'on s'aperçoit (...) que le développement économique ne vient pas du trafic de produits stupéfiants et que celui-ci produit même exactement l'inverse. Pour autant, les Marocains nous disent des choses beaucoup plus troublantes (...) : « ce sont bien vos usagers et vos trafiquants qui viennent chercher le cannabis chez nous ». Certains nous disent : « il n'y a qu'à nous donner des millions et on remplacera la culture du cannabis par de l'économie de substitution ». En effet, il faut parler d'économie de substitution et non pas seulement de culture de substitution ».
Dans le même sens, M. Bernard Petit, chef de l'OCRTIS, a déclaré : « Je pense que vis-à-vis du Maroc, il faut être pragmatique et modeste si on veut engranger des résultats. A tout vouloir, on n'a rien. Aujourd'hui, on a besoin d'actions diplomatiques et de plus de coopération opérationnelle . Si on attaque bille en tête sur l'éradication des cultures et les grandes enquêtes internes au Maroc, on risque de se heurter à des difficultés. En revanche, on devrait demander tout de suite aux Marocains de nous aider dans nos enquêtes de façon plus opérationnelle et plus souple, pour que nous en revenions à une coopération policière normale. Ensuite, que les Marocains fassent le ménage ou non chez eux, nous n'en sommes pas là ».
La commission d'enquête estime donc nécessaire de renforcer la coopération bilatérale avec les pays producteurs, du point de vue diplomatique aussi bien qu'opérationnel, coopération qui doit s'intégrer dans un contexte plus large de développement de l'aide internationale aux pays en développement.
A cet égard, M. Nicolas Sarkozy, lors de son audition par la commission d'enquête, s'est déclaré favorable à un approfondissement de la « coopération avec les pays d'origine de ces drogues pour soutenir leur lutte, principalement en participant à la formation de leurs équipes, mais aussi en les aidant à se doter de moyens adaptés sur le plan répressif ».
c) Le renforcement de la coopération internationale douanière
S'agissant plus spécifiquement de la coopération internationale douanière, plusieurs pistes d'amélioration peuvent être proposées.
Dans un premier temps, la commission d'enquête souhaite que la convention entre la France et les Pays-Bas, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre leurs administrations douanières en vue d'appliquer de manière satisfaisante la législation douanière, de prévenir, de rechercher, de constater et de réprimer les infractions douanières dans la région Caraïbe, et notamment sur l'île de Saint-Martin, signée à Philipsburg le 11 janvier 2002, soit rapidement ratifiée.
Elle estime ensuite que les points suivants peuvent constituer des pistes de recherche pour la résolution des obstacles techniques et juridiques à une coopération internationale douanière plus efficace dans le domaine de la lutte contre le trafic de stupéfiants :
- le développement des capacités d'interceptions de communications et/ou de courrier postal sous contrôle judiciaire effectuées par la douane française à partir des renseignements internationaux fournis par ses partenaires ;
- la définition d'une capacité juridique, pour les agents des douanes infiltrés étrangers, pour traverser le pays partenaire, sous garantie judiciaire, en cas de livraisons surveillées internationales pour les produits stupéfiants en collaboration avec les services d'enquête et de recherche douaniers français ;
- l'instauration de la capacité juridique de montage d'opérations de livraisons surveillées internationales avec utilisation de moyens techniques de repérage (balises) pour les produits stupéfiants ;
- le développement de la capacité de mise en oeuvre des poursuites transfrontalières et des observations transfrontalières par des équipes d'intervention mixtes et la pratique courante des livraisons surveillées et des enquêtes discrètes.
A l'avenir, il est vraisemblable que la coopération internationale douanière dans le domaine de la lutte anti-drogue se développera autant sur des logiques de coopération judiciaire que d'assistance mutuelle administrative et qu'elle devra disposer d'une organisation appropriée au montage d'opérations internationales longues et répétées, nécessitant des moyens humains et matériels spécialisés et des garanties juridiques suffisantes.
Les impératifs de l'action opérationnelle et les exigences nationales en matière de résultats conduiront les services douaniers étrangers dotés de pouvoirs judiciaires à étendre leur coopération avec d'autres services de douane, police ou gendarmerie dotés de pouvoirs judiciaires et de moyens d'enquête et d'intervention disponibles.
II. POUR UNE PRÉVENTION DIGNE DE CE NOM
A. ASSURER L'INFORMATION ET LA FORMATION
1. Lancer des campagnes crédibles et ciblées
a) Des campagnes de communication jusqu'à présent contre-productives
La clarté et la facilité d'identification d'une campagne de communication sont la clef de leur efficacité. Sans même évoquer le fond des messages diffusés, il semble bien que les actions menées par la MILDT durant le dernier plan triennal en matière de communication aient pêché par leur opacité et par la multiplicité de leurs objectifs, supports et acteurs.
De ce point de vue, l'OFDT note dans son rapport évaluatif portant sur le deuxième objectif dudit plan que « l'absence d'une parole pédagogique claire des pouvoirs publics se traduisant par une communication éclatée entre différents émetteurs et des messages contradictoires, voire inexacts, et souvent marqués d'une connotation morale a été identifié comme à l'origine d'une information largement déficiente du public. (...). L'information du public (...) ne paraît pas en mesure d'induire des changements sensibles de perception, ni l'adhésion aux objectifs de la politique publique ».
Le manque de précision et l'ambiguïté des messages envoyés en direction de publics mal répartis selon leurs spécificités ont perturbé ces publics dans la réception des informations qui leur étaient destinées. Le double objectif de la campagne de communication lancée en 1999 -informer sur les différents produits et leurs effets sanitaires et sociaux, rappeler le cadre légal dans lequel s'inscrit leur consommation- n'a pas été atteint.
En premier lieu en effet, les perceptions de la dangerosité des drogues ne se sont pas améliorées : selon une enquête récente de l'OFDT , si les drogues dures continuent à être très majoritairement perçues comme dangereuses ou très dangereuses, les opinions à l'égard du cannabis se sont assouplies en raison de la présentation implicitement favorable qui en a été faite et le taux des personnes favorables à sa dépénalisation a augmenté.
S'agissant en second lieu de la connaissance du cadre légal, elle semble de plus en plus problématique . Une part croissante de la population, notamment la plus jeune, a en effet des difficultés à se prononcer sur le régime encadrant la consommation de drogues telles que le cannabis ou l'ecstasy. Les jeunes « sont persuadés, pour beaucoup, que c'est toléré ou même autorisé » a témoigné en se sens le docteur Francis Curtet, attribuant notamment cette carence au fait que ces jeunes « vivent avec une loi qui n'est pas appliquée ».
Il apparaît donc nécessaire de privilégier la cohérence du message et son adéquation à des supports et publics ciblés.
b) La nécessité d'un message plus cohérent
La cohérence du message doit passer nécessairement par l'adéquation entre la réalité scientifique observée et les conséquences normatives qui en découlent. A ce titre, il conviendrait de rappeler dans un premier temps quels sont les dangers réels que fait encourir la consommation de drogues illicites sur l'individu et la société, puis d'expliquer que c'est en raison de ces risques qu'une telle consommation doit être strictement encadrée sur un plan législatif, et éventuellement sanctionnée selon les modalités nouvelles précédemment évoquées. Une telle pédagogie, responsabilisant chaque individu vis-à-vis de lui-même et de ses semblables et lui parlant un « langage de vérité », facilitera l'acceptation et le respect par chacun de la réglementation existante et dépassionnera le débat.
M. Philippe-Jean Parquet, président de l'OFDT, a ainsi indiqué très clairement à la commission que « parmi les facteurs de protection, on peut considérer aussi le dispositif législatif et réglementaire ». Il a estimé qu'un Etat devait avoir « comme fonction, au travers de ses lois et réglementations, d'aider les personnes à faire des choix éclairés, notamment en matière de consommation d'un produit ».
Le volontarisme des acteurs politiques concernés ne semble pas faire de doute à cet égard. Lors de son audition, le ministre de l'intérieur, M. Nicolas Sarkozy, a ainsi déclaré : « La force de ce discours et sa clarté sera la première des préventions. Il est fondamental que le discours public soit clair, car il est un signal pour tous, comme nous le voyons en matière de délinquance routière (où) nous obtenons des résultats par la force du discours, par l'appel à la responsabilité. En matière d'usage des drogues, nous obtiendrons également des résultats par la force du discours, par la prévention que représente le risque de transgression ».
Le ministre de l'éducation nationale est allé dans le même sens, s'étant dit « partisan de consignes de très grande fermeté » et ayant ajouté : « Il faut renforcer la fermeté. Qu'on ne se méprenne pas : à défaut de faire passer des messages plus intelligents, il faut au moins que l'interdit soit clair, ferme et net et que l'on n'hésite pas à appliquer des sanctions disciplinaires, voire plus que réglementaires, c'est-à-dire faire appel à la loi ».
c) Des supports et des publics mieux ciblés
Une fois le contenu du message ainsi déterminé, il faut encore en choisir la forme et les destinataires, en le modulant éventuellement selon leurs caractéristiques. S'agissant du support, l'expérience enseigne qu'il doit correspondre aux attentes d'un public exigeant un maximum d'informations en un minimum de volume, quel que soit l'instrument utilisé (brochure, spot télé ou radio, site internet, intervention orale ...).
De ce point de vue, il ne faut pas confondre la prévention et l'information : si la première peut prétendre à l'exhaustivité, la seconde doit être concise et facilement assimilable . A ce propos, le docteur Francis Curtet a confié à la commission avoir été surpris par le guide « Savoir plus, risquer moins » édité par la MILDT, indiquant qu'« on ne fait pas de la prévention avec 120 pages », mais « avec très peu de mots et de messages pour pouvoir passer. Il n'y a que cela à savoir », a ajouté M. Curtet, « et si vous voulez que les gens le retiennent, il faut que ce soit court. Sinon, ils ne retiendront rien ».
Après avoir effectué cet effort de concision dans l'élaboration du message et veillé à ce qu'il ait un impact satisfaisant, il faut l'adapter aux caractéristiques de chaque public. « Nous savons , a commenté à cet égard le président de l'OFDT, dans tous les domaines de la prévention et de la pathologie, que la capacité à intégrer les informations dépend du niveau de culture (...), que les classes les plus favorisées du point de vue culturel sont les plus sensibles aux campagnes (de prévention) ».
Si elle dépend du capital et de l'environnement culturel de chacun, la capacité à assimiler un message de prévention varie également selon l'âge du public ciblé. Le ministre de l'éducation nationale, M. Luc Ferry, a ainsi commenté une ancienne campagne de prévention contre le virus du sida qui avait du être arrêtée de façon prématurée parce que les jeunes auxquels elles s'adressait l'avaient tournée en dérision : comme elle proclamait que « le virus du sida ne s'attrape pas dans les actes de la vie quotidienne », ils en avaient déduit, non sans humour, que les rédacteurs du tract « ne faisaient pas l'amour tous les jours » !
Des spécialistes de la communication, dans le cadre qui leur serait assigné par des responsables politiques, seraient sans doute les plus à même d'élaborer des messages à l'impact garanti, de tenir compte de ces différences de perception entre les publics et d'éviter les erreurs contre-productives telles que celle précédemment évoquée. Se disant « très déçu par la qualité des spots publicitaires ou des campagnes d'information », le ministre de l'éducation nationale a déclaré à la commission avoir « le sentiment qu'il faudrait, pour être efficace, mobiliser les talents d'un metteur en scène professionnel de très grand talent (...) capable de faire un véritable film au niveau d'un grand réalisateur et non pas au niveau des spots publicitaires habituels ».
Constat totalement partagé par le président de l'OFDT qui a expliqué à la commission que « la lisibilité du dispositif d'aide et la capacité de l'information à être donnée au plus près de la personne » étaient fondamentaux. M. Parquet a déploré en ce sens que « les informations qui sont données (soient) très loin des préoccupations et peu adaptées », estimant que la prévention « doit être faite par des professionnels qui ont cette compétence particulière ».
2. Responsabiliser et former l'ensemble des acteurs
Le problème des drogues n'est pas et ne doit pas être perçu comme étant l'affaire des seules personnes directement touchées par ce fléau. Toute la société est concernée, chacun d'entre nous pouvant être un jour amené à en expérimenter les effets, soit directement comme usager, soit indirectement et plus fréquemment comme parent, membre de la famille, ami, collègue, camarade, victime ou même simple citoyen.
Comme l'a très justement dit devant la commission le directeur général de la gendarmerie nationale, M. Pierre Mutz, le sens de la responsabilité qui nous incombe s'agissant du problème des drogues « doit être partagé par tous. Il n'appartient pas à une catégorie ou à une autre de lutter contre la drogue. C'est toute une chaîne qui doit se mettre en route à partir des parents en continuant par les enseignants, les policiers, les gendarmes et toute la chaîne sociale pour y parvenir ».
S'il revient donc à chacun de se sentir concerné, il est vrai néanmoins que cette prise de conscience ne peut souvent intervenir spontanément tant les phénomènes d'usage et de trafic paraissent souvent lointains. C'est là que les pouvoirs publics doivent agir, en responsabilisant et en formant l'ensemble des acteurs concernés, qu'ils appartiennent à la société civile ou qu'il s'agisse d'acteurs institutionnels.
a) La société civile
(1) Faire des parents et de la famille des interlocuteurs privilégiés
L'information des parents doit être largement renforcée , à la fois dans et en-dehors de l'espace scolaire. Hors du cadre scolaire, il serait utile que la MILDT édite un petit livret d'information spécialement consacré aux parents, les instruisant de façon simple et concrète sur les différents produits et les risques qu'ils représentent, la façon de dépister au plus tôt les problèmes d'addiction, le comportement à adopter lorsqu'ils apprennent que leur enfant se drogue et les structures pouvant leur apporter aide et soutien.
Les conseils sur la conduite à tenir face à un enfant qui se drogue devraient être validés par des spécialistes de la psychologie adolescente. A cet égard, le docteur Curtet formule aux parents concernés toute une série de recommandations. Selon lui, il faut d'abord leur expliquer le plus tôt possible que la toxicomanie « n'est pas une maladie qu'on attrape à l'adolescence » mais un trouble qui se prévient « depuis qu'on porte son enfant et depuis qu'il est né ». Il faut ensuite apprendre aux parents à donner à leur enfant « le droit d'avoir des défaillances de toute nature » et de les exprimer sans pour autant le rejeter. Lorsqu'il est avéré que l'enfant utilise des drogues, il faut éviter de culpabiliser les parents, ce qui ne ferait que les en éloigner davantage. Il faut également dire aux parents d'« oser poser (à l'enfant) des limites justifiées », en les lui expliquant et en lui disant quel intérêt il a à les respecter. Il faut enfin « réfléchir, en tant que parent, au modèle qu'on lui présente (...) en lui parlant des valeurs qu'on lui transmet ».
La nécessaire exemplarité des parents à l'égard de leurs enfants a été également relevée par le professeur Roger Nordmann. Après avoir rappelé qu'il fallait que les familles « ne fuient pas devant leurs responsabilités », M. Nordmann a indiqué à la commission que « les jeunes, contrairement à ce qu'on a prétendu un certain temps, ont besoin d'interdit et il faut donc que les parents ne consomment pas de substances psychoactives vis-à-vis de leurs enfants, qu'ils donnent l'exemple et que si (...) ils s'aperçoivent que leur enfant a consommé, ils n'en fassent pas un rejet ou une culpabilisation mais qu'ils soient au courant des structures d'accueil, qu'il faut absolument développer, de ces jeunes en difficulté, sans attendre de les laisser s'insérer dans une consommation régulière et intensive ».
Dans le cadre scolaire, l'information devrait davantage passer par les réseaux d'écoute et d'aide à la parentalité, ainsi que par les CESC dont l'activité devrait être « revitalisée », de l'avis de tous les intervenants concernés. Les CESC constituent en effet des structures qui, par la multiplicité des acteurs représentés, offriraient un cadre idéal pour procurer aux parents une information adaptée et validée par des spécialistes sur les problèmes de dépistage et de prise en charge des conduites à risques.
A cet égard, il existe une multitude de structures travaillant en partenariat avec le milieu scolaire dont il serait nécessaire de coordonner l'action pour l'orienter davantage vers les parents :
- le système de santé scolaire, en premier lieu (médecins, infirmières, pédiatres, psychologues scolaires), dont on connaît les carences ;
- la protection maternelle et infantile, dont les puéricultrices et les psychologues sont très bien placés pour connaître les familles ;
- les centres médico-psychopédagogiques, centres publics relevant de l'éducation nationale recevant gratuitement les enfants en échec scolaire et faisant de la psychothérapie, ainsi que les centres médico-psychiatriques, relevant du ministère de la santé et accueillant des enfants en plus grande difficulté ;
- sans oublier les médecins de famille, souvent les premiers à être consultés par les parents dont les enfants souffrent d'addiction.
« Le problème », a expliqué à la commission Mme Edwige Antier, pédiatre, « c'est qu'il n'y a pas d'anastomose. Entre l'école et le centre médico-psychiatrique, malheureusement, les relais et les transmissions sont insuffisants ».
Plutôt que de multiplier les intervenants, Mme Antier a préconisé « de créer une mission qui puisse coordonner ces différents services et les sensibiliser. C'est à ce moment là que les familles peuvent être détectées : les choses sont toujours articulées avec l'école et un enfant en difficulté va très vite être en difficulté à l'école. Par conséquent, les parents, qui sont très demandeurs de réussite scolaire, seront sensibilisés par ces difficultés scolaires de leur enfant et pourront ainsi être conduits vers la structure qui prendra en charge l'enfant ».
(2) S'assurer de la crédibilité des acteurs associatifs
Les associations sont particulièrement impliquées dans la gestion des problèmes de drogues puisqu'elles sont à l'origine de la majorité des initiatives en la matière et gèrent les trois-quarts des centres spécialisés. Si de nombreuses personnes y effectuent un travail remarquable, celles-ci connaissent toutefois certaines faiblesses qui avaient été pointées par le rapport public de la Cour des comptes de 1998 sur le dispositif de lutte contre la toxicomanie et auxquelles il n'a pas été remédié depuis, ainsi que l'ont confirmé divers intervenants.
En effet, les associations ont une tendance marquée à agir en « circuits fermés », cherchant à rendre « captifs » les toxicomanes dont elles assurent la prise en charge et ignorant en partie l'intervention des autres acteurs du champ sanitaire et social. De plus, elles se livrent souvent à une quête effrénée de subventions publiques en diversifiant de façon injustifiée leurs activités et obtiennent parfois des fonds en « passant par dessus » les structures départementales censées les attribuer pour s'adresser directement aux ministères ou à la MILDT, qui eux mêmes ne se consultent pas, d'où de fréquents doublons.
D'autre part, certaines d'entre elles, et non des moindres, seraient infiltrées par des courants scientologues les instrumentalisant pour récupérer une nouvelle clientèle particulièrement vulnérable. Enfin, le degré de compétences des divers intervenants en toxicomanie évoluant dans le monde associatif est très hétérogène et fréquemment insuffisant, ce qui est d'autant plus préoccupant que les associations spécialisées en ce domaine ne sont régies par aucun système d'autorisation préalable si elles ne font appel à des concours financiers publics.
Il conviendrait donc de rationaliser l'action des associations en décidant d'un niveau et d'une structure qui aurait compétence pour vérifier la pertinence de leurs projets et la probité de leurs membres, coordonner leur activité et décider de l'attribution des subventions. Une plus grande professionnalisation des intervenants en milieu associatif pourrait être recherchée en mettant au point un système de validation ou de certification des compétences par la MILDT. Un premier effort a déjà été effectué en ce sens à travers la création en 1999 d'une commission de validation des outils de prévention y étant rattachée et dont l'objet est d'examiner et de donner un avis sur les instruments de prévention élaborés par différents acteurs publics et privés ; peut-être serait-il envisageable d'élargir ses compétences à la validation des « acquis professionnels » en matière de prévention.
Enfin, l'Etat et ses institutions devraient prendre leurs responsabilités en réinvestissant les lieux et les personnes dont ils ont sous-traité ou abandonné la prise en charge à des associations. « Peut-on accepter que des associations, avec des habitants relais qu'on a installés et formés comme on a pu, avec leurs qualités et leurs défauts, se substituent de fait aux institutions ? Est-ce ce que veut la République ? » s'est interrogé très justement à ce sujet le député-maire de Chanteloup-les-Vignes, M. Pierre Cardo, lors de son audition.
(3) Impliquer et former davantage les médecins
Les médecins, et notamment le médecin généraliste de famille, devraient être parmi les premiers à être avertis en cas d'usage de drogues , notamment chez les jeunes, afin d'assurer une première prise en charge physiologique et psychologique et d'orienter la personne concernée vers les structures spécialisées les plus adaptées. Plus encore, ils devraient être à même de détecter les premiers symptômes de conduites à risques, dès la préadolescence, afin d'effectuer une réelle action de prévention au plus près des personnes en souffrance.
Les médecins constituent en effet les interlocuteurs privilégiés des personnes concernées par les problèmes de drogues : une récente étude indique en ce sens que 72 % des personnes dont un proche aurait des problèmes d'addiction iraient consulter en priorité un médecin.
Or, les médecins ne semblent pas, dans leur très grande majorité, préparés à de telles tâches ni désireux de les assumer . C'est le constat lucide qu'a fait devant la commission le ministre de la santé, M. Jean-François Mattei, indiquant que les médecins « ne sont pas formés (...) pour des malades toxicomanes » et qu'« une révolution est à faire » sur ce point. M. Mattei s'est dit inquiet et « un peu déconcerté » par « l'état d'esprit du corps médical qui ne va pas chercher les informations dont il a pourtant besoin », expliquant que « cela pose tout simplement la question de la formation médicale continue et également celle pour le médecin d'aller chercher des informations dont il a besoin, y compris sur internet ».
L'implication des médecins doit se faire selon deux axes. Le premier consiste à organiser leur intervention systématique pour prévenir les conduites à risques , ce que M. Mattei a renvoyé à la prochaine loi sur la santé publique où sera selon lui prévue « une consultation de prévention à intervalle régulier par les médecins généralistes ». Le second axe, en amont, repose sur la mise en place à leur égard d'un système de formation sur les produits stupéfiants et les conduites addictives digne de ce nom.
Concernant ce second point, le rapport Roques notait en 1998 qu'il était « indispensable et urgent d'initier des programmes d'enseignement spécialisés sur la toxicomanie (aspects médicaux, socio-culturels et législatifs) auprès des acteurs de santé (médecins, pharmaciens, personnel soignant etc.) » qui devraient être mis en place « sous le couvert de l'éducation nationale dans un nombre limité de villes universitaires ». Il appelait également à « mieux introduire le problème de la toxicomanie dans les enseignements secondaires et universitaires (médecine, pharmacie) ». Ces recommandations restent plus que jamais d'actualité.
Mme Edwige Antier, pédiatre, a insisté de son côté sur le fait qu'« une formation des pédiatres à l'intérieur (de leur) cursus serait vraiment bienvenue », afin que ces derniers puissent être en mesure de dépister les conduites à risques au plus tôt et en tout état de cause à trois stades successifs du développement de l'enfant : « en tant que bébé » d'abord, « quand il commence à se mettre en révolte scolaire ou parentale, quand il connaît l'échec scolaire ou quand il entre dans les phobies » ensuite, et « quand il s'agit d'un grand « ado » devant lequel les parents ferment les yeux » enfin.
Lors de sa visite au centre de jour de l'hôpital Saint-Antoine, la délégation de la commission d'enquête a rencontré des médecins-psychiatres qui ont attiré son attention sur la nécessité qu'il y aurait à mieux former les médecins aux problèmes psychiatriques dont souffrent les toxicomanes, qu'ils ne détectent souvent pas ou face auxquels ils se trouvent démunis.
b) Les acteurs institutionnels
(1) Responsabiliser les élites et les politiques
Si la prévention des conduites à risque est l'affaire de tous, elle est sans conteste d'abord celle des responsables politiques qui doivent se saisir du sujet, l'analyser et y apporter des réponses adéquates. Or, leur perception du problème est largement brouillée, non seulement parce qu'ils ne le connaissent pas bien, mais aussi parce que de nombreux messages contradictoires ont circulé sur ce thème depuis quelques années.
C'est le constat qu'a fait devant la commission M. Bernard Leroy, conseiller interrégional au programme d'assistance législative du programme des Nations-Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID). Il a regretté que les gouvernements n'aient pas de vision d'ensemble du problème des drogues et agissent de façon désordonnée en déléguant leurs pouvoirs à des structures ou des personnes ayant une approche discutable du phénomène et intervenant sans véritable contrôle politique.
M. Jacques Franquet, premier vice-président de l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS), a adhéré à ce constat de démission des élites politiques, ajoutant qu'il y a aujourd'hui « un vide en matière de formation des élites et des cadres ». Prenant l'exemple des chefs de projet départementaux, M. Franquet a regretté leur manque de formation sur les conventions internationales liant la France, ignorance qu'il a rattachée à celle plus globale des responsables politiques et administratifs sur ce point.
Il faudrait à présent, selon M. Bernard Leroy, que des professionnels théorisent et rationalisent les problématiques liées aux drogues afin de fournir une information claire et objective aux décideurs politiques, base indispensable à la prise de décisions éclairées et dépassionnées.
(2) Informer les professionnels du droit sur la dimension humaine du problème des drogues
Avocats et magistrats sont tout spécialement concernés par les problèmes liés à l'usage et au trafic de drogues , soit qu'il défendent les personnes interpellées à ce sujet, soit qu'ils instruisent leur dossier et rendent ensuite un jugement. Or, si leur niveau de connaissances juridiques sur le sujet est souvent exhaustif, leur appréhension du phénomène des drogues se limite souvent au cadre normatif, notamment pénal, régissant leur usage et leur commerce.
En ce qui concerne les seuls avocats, M. Gérard Tcholakian a ainsi indiqué lors de son audition que la commission libertés et droits de l'homme du Conseil national des barreaux (CNB) « n'a jamais eu de réflexion particulière et étoffée sur le problème de l'usage des drogues illicites ». Plus préoccupant, M. Tcholakian a reconnu que, s'agissant des familles de toxicomanes, les avocats ont « souvent le sentiment (...) de ne pas pouvoir répondre à leur attente immédiate s'agissant de l'usage qu'elles ont découvert », mais aussi de ne « pas bien orienter ni répondre à des questions, qu'il s'agisse de la toxicomanie, de l'orientation (qu'ils pourraient) éventuellement donner ou des conseils (qu'ils pourraient) apporter en termes d'orientation ». Il a regretté que « la profession, sur ce point, (ne soit) pas équipée du fait d'un manque de formation à la fois initiale et continue ».
Il y aurait donc un réel travail d'information à effectuer en direction des professionnels du droit dans leur ensemble, afin de les documenter sur les aspects sanitaires et sociaux liés à l'usage de drogues et sur les structures les plus appropriées pour prendre en charge les toxicomanes. Une telle formation pourrait être intégrée dans les programmes de formation initiale et continue de l'Ecole nationale de la magistrature (ENM) pour les magistrats et dans ceux des Ecoles de formation du barreau pour les avocats, ce sur quoi s'est d'ailleurs engagé à réfléchir M. Tcholakian.
(3) Mieux former les acteurs de terrain
A ce niveau de la mise en oeuvre concrète, sur le terrain, des politiques publiques de lutte contre les drogues, il semble que les divers acteurs concernés, malgré leur grande motivation et leur dévouement à la tâche, ne soient pas parfaitement en mesure de remplir leur mission de prévention ou de prise en charge des usagers de drogues en raison des carences de leur formation.
Là également devrait être entrepris, à l'initiative de chaque ministère et en coordination avec la MILDT, un vaste effort de sensibilisation et d'éducation de tous les personnels actifs impliqués à un titre ou à un autre dans la lutte contre la drogue : les éducateurs spécialisés, afin notamment de leur apprendre l'utilité d'un travail en réseau avec l'ensemble des structures intervenant au niveau local ; les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse, dont le directeur, M. Jean-Pierre Carbuccia-Berland, a reconnu que le niveau de formation était encore insuffisant, tout en indiquant que des actions étaient actuellement initiées afin d'y remédier ; les personnels pénitentiaires, que M. Didier Lallement, directeur de l'administration pénitentiaire, a souhaité sensibiliser davantage aux problématiques des conduites à risques ; ou encore les éducateurs sportifs que M. Jean-François Lamour, ministre des sports, s'est engagé à mieux former encore.
Un tel travail de sensibilisation, de formation et d'information devra être mené par des professionnels au plus près des différents acteurs auxquels il s'adresse afin de leur délivrer les connaissances et instruments dont ils ont concrètement besoin. Il ne doit pas être limité à l'un des aspects de la lutte contre la drogue et des phénomènes d'addiction, mais les aborder de façon transversale afin d'irriguer l'ensemble des acteurs concernés d'une véritable culture commune en la matière.
B. ÉRIGER L'ÉCOLE EN « FER DE LANCE DE LA PRÉVENTION »
1. Un lieu de prévention à privilégier
a) Le « flirt avec les drogues », expérience chronique à l'adolescence
Adolescence et drogues sont très souvent liées. Ainsi, le psychiatre Michel Damade, responsable médical du Groupement de recherche sur les conduites addictives, explique que « les problématiques adolescentes sont propices à l'initialisation et à l'abus. Les « crises de l'adolescence » (...) supposent fréquemment des expériences nouvelles incluant prises de risques et « flirt » avec les limites. L'adolescent à la conquête du monde et de lui-même est en même temps fragilisé. Il s'appuie sur ses pairs et sur les adultes référents qui l'entourent ».
Les conséquences de ce « flirt » ne seront pas les mêmes selon la personnalité de l'adolescent et selon le contexte dans lequel elles s'inscrivent. « Chez l'adolescent « normal » », poursuit M. Damade, « les consommations de toxiques (...) sont souvent un phénomène de groupe, culturel, non pathologique, parfois un signal adressé à l'adulte une recherche de repères . Chez l'adolescent en difficulté transitoire », en revanche , « la consommation de substances peut devenir automédication, fuite du mal-être et, à l'occasion, signal d'alarme en direction de l'adulte qui veut bien voir ».
Enfin, poursuit le psychiatre, « il est, en nombre beaucoup plus restreint, des adolescents aux problèmes plus structurels dont les prises de toxiques, volontiers nocives et avec dépendance, sont les symptômes durables de leur dysfonctionnement profond ». Ces trois types de conduite ne donneront naturellement pas lieu aux mêmes types de réponses.
b) Le milieu scolaire, une structure particulièrement adaptée pour une prévention précoce des conduites à risques
On s'accorde généralement à penser que les messages de prévention ont d'autant plus d'impact qu'ils interviennent le plus en amont possible, soit de la conduite qu'ils visent à empêcher (avant que celle-ci n'ait eu lieu), soit du public auquel ils s'adressent (avant qu'il ne soit amené à côtoyer le risque). Or, de ce double point de vue, l'école constitue sans doute le lieu le plus adéquat pour une prévention efficace car les élèves y étant scolarisés, soit n'ont pas encore eu de comportement addictif, soit ont déjà consommé des produits stupéfiants mais demeurent encore largement réceptifs aux conseils et mises en garde leur étant adressés.
A cet égard, l'éducation à la prévention des conduites à risques devrait intervenir le plus tôt possible dans la scolarité, si possible dès l'école primaire, et même dès l'école maternelle. Mme Edwige Antier, pédiatre, a ainsi souligné devant la commission que si un adolescent de 15 ou 16 ans n'est pas sensible à un discours lui expliquant que les produits stupéfiants sont nocifs pour sa santé, « en revanche, à neuf ou dix ans, c'est l'âge béni pour ces informations. C'est en CM1 et CM2 qu'il faut expliquer aux petits comment marche le cerveau et les neurones, comment passe le courant de notre pensée et comment fonctionne notre vie psychique. Ils sont passionnés, à cet âge, par les sciences et les discours des grandes personnes et ils les écoutent (...). Ils sont alors fascinés et (...) on retrouve ces enfants beaucoup moins preneurs et sachant dire non. C'est vraiment au CM1 et au CM2 qu'il y a un énorme effort d'information à faire auprès d'eux ».
Selon la pédiatre, c'est même dès la prime enfance qu'il faudrait intervenir, le dépistage le plus précoce et peut-être le plus efficace des sujets à risque concernant le nourrisson. « Quand une mère vient en consultation avec son bébé, nous pouvons dépister la dépression maternelle », a expliqué Mme Antier. « Or , les enfants qui seront à hauts risques sont souvent des enfants nés de mère déprimée, seule et en souffrance. (...). Il faut remonter aussi loin parce que c'est là que l'enfant ne va pas pouvoir s'amarrer de son socle affectif et de cette sécurité affective de base qui va le rendre ensuite beaucoup plus résistant à toutes ces tentations de paradis artificiels. C'est tout petit que cela se construit ».
2. Une meilleure formation des personnels enseignants pour une meilleure information des élèves
a) La création d'une véritable culture commune sur les conduites à risques
Cet objectif prioritaire du plan triennal de la MILDT n'a jamais été atteint, notamment en milieu scolaire, pour les raisons précédemment évoquées. Il conviendrait donc d'agir énergiquement pour procurer à l'ensemble de la communauté éducative une véritable formation sur les problèmes liés aux conduites addictives, cette action devant s'inscrire dans le cadre de la formation initiale comme dans celui de la formation continue.
En ce qui concerne la formation initiale des personnels enseignants, l'insertion dans les programmes des IUFM de modules de formation portant sur les conduites à risques devrait être favorisée . C'est d'ailleurs ce à quoi s'est engagé le ministre délégué à l'enseignement scolaire, M. Xavier Darcos, qui a indiqué que de tels modules de formation seraient prévus dans le cadre du « plan santé » actuellement finalisé par le ministère de la santé, et que des discussions à ce sujet avaient déjà lieu avec les directeurs d'IUFM.
S'agissant de la formation continue , un effort substantiel devra être fourni par le ministère de l'éducation nationale, mais aussi par les différentes académies, pour mettre en place des sessions de formation régulières ne s'adressant pas uniquement aux responsables de la coordination interministérielle (essentiellement les « personnes ressources » situées auprès des chefs de projet départementaux pour établir un lien entre les plans départementaux de prévention et les projets d'établissements incluant des CESC), mais aussi et surtout à l'ensemble de la communauté enseignante, qu'elle appartienne au secteur primaire ou secondaire.
A cet égard, les programmes de formation ne doivent pas uniquement profiter aux enseignants dont les fonctions sont les plus en rapport avec les problèmes liés aux conduites à risques (professeurs d'éducation physique et sportive ou de sciences de la vie et de la terre). Elles doivent au contraire couvrir le public le plus large possible, chaque enseignant devant être instruit, non seulement sur les différents types de drogues existant et sur les dangers qu'ils représentent, notamment pour les jeunes, mais aussi sur la conduite à tenir face à un élève dont il est avéré qu'il utilise ou revend de tels produits. Trop souvent en effet l'enseignant feint de ne pas se rendre compte de ce comportement, soit parce qu'il s'en désintéresse, soit, le plus souvent, parce qu'il ne sait pas quelle réaction adopter.
La commission ne peut, dans cette optique, qu'encourager le ministre délégué à l'enseignement scolaire a mettre rapidement en oeuvre la mesure qu'il a annoncé lors de son audition, consistant à fournir à tous les professeurs affectés dans des « postes à exigences particulières » (PEP) un accompagnement et une formation continue sur toutes les thématiques propres aux conduites à risques.
Les programmes de formation, initiale comme continue, devront s'appuyer sur les connaissances scientifiques les plus récentes et n'omettre aucune des données épidémiologiques considérées comme acquises en termes de dangerosité des drogues. Il s'agira notamment, sans les surestimer, d'insister sur les dangers sanitaires, scolaires et sociaux que représente potentiellement la consommation de cannabis dès la primo expérimentation. Ces données aujourd'hui consensuelles dans la communauté scientifique ont en effet trop longtemps été ignorées ou minorées.
Enfin, un message très clair devra être transmis aux personnels scolaires sur la conduite à tenir face à des élèves consommateurs ou trafiquants, cette réponse oscillant entre le signalement à la direction de l'établissement pour les faits les moins graves jusqu'à la saisine des services répressifs extérieurs à l'établissement pour les cas les plus graves, en passant par l'orientation vers les structures médicales et par le prononcé de mesures disciplinaires adaptées.
b) L'intégration pérenne de la prévention des conduites à risques dans les programmes scolaires
Les actions pédagogiques concernant la prévention des conduites à risque connaissent aujourd'hui plusieurs limites importantes : elles sont extrêmement peu développées, laissées à l'initiative de chaque politique d'établissement, concentrées sur le collège et le plus souvent intégrées dans des modules d'éducation consacrés aux problématiques sanitaires et sociales où elles sont reléguées à un rang accessoire.
Il conviendrait de remédier à ces carences en définissant au niveau national un programme de sensibilisation aux conduites à risques commun à l'ensemble des académies, obligatoirement intégré au temps scolaire et étalé sur l'ensemble de la scolarité (de l'école primaire à l'université). L'éducation à ces problématiques y serait conduite, en plus des intervenants habituels et d'enseignants qui y auraient été convenablement formés, par des professionnels de la prévention spécialisés dans le domaine des conduites addictives. Elle ferait l'objet d'un module spécifique, qui intégrerait l'ensemble des aspects du problème : sanitaires, psychologiques, sociaux, familiaux, répressifs ...
La mise en place d'un tel programme de formation et d'information des jeunes élèves, qui serait l'occasion de faire passer à leur attention un message conciliant humanisme et fermeté , est certes amitieuse mais indéniablement à la hauteur de l'enjeu que constitue pour toute notre jeunesse la prévention aux problèmes de drogue. Elle ne serait d'ailleurs que la mise en oeuvre sur le terrain, dans une perspective « idéologique » sans doute différente toutefois, d'une mesure qu'évoquait la précédente présidente de la MILDT dans l'un des guides « Repères » de l'éducation nationale lorsqu'elle indiquait qu'« il sera indispensable de définir un « noyau dur » de ce que devraient être les actions de prévention internes à l'éducation nationale, avec un espace-temps qui leur serait dédié et un certain caractère obligatoire ».
« Cette question », poursuivait à raison Mme Maestracci, « devrait s'inscrire dans un cadre juridique plus contraignant. Cela permettrait d'installer ces politiques dans la durée ». C'est ce cadre juridique et cette durée, restés jusqu'à aujourd'hui au stade de la profession de foi, qu'il va désormais s'agir de concrétiser pour redonner à l'éducation nationale la place centrale qu'elle devrait occuper dans la prévention des conduites à risque chez les jeunes.
3. Une réponse systématique aux comportements « déviants »
Si les textes normatifs prévoient de nombreuses mesures internes prononçables dans les établissements scolaires en cas d'infractions, notamment à la législation sur les stupéfiants (de la sanction disciplinaire au signalement aux autorités judiciaires), leur respect est souvent laissé au bon vouloir des chefs d'établissement, qui trop souvent préfèrent ignorer les problèmes signalés ou traiter l'affaire en interne. « De trop nombreux chefs d'établissements n'acceptent pas de reconnaître que les problèmes de drogues existent dans leur établissement » a ainsi déclaré devant la commission Mme Rabiller, ajoutant que « cette attitude est un frein à la prévention ».
C'est effectivement parce que le rappel à la loi et son application le cas échéant sont des moyens de prévention particulièrement efficaces que l'attention des directeurs d'établissement devra être attirée sur la nécessité d'apporter des réponses systématiques à toute infraction à la législation sur les stupéfiants.
Quatre objectifs pourront être assignés en ce sens :
- le premier serait d'informer clairement les élèves sur les risques qu'ils encourent en enfreignant la législation sur les stupéfiants . Si des informations y ayant trait sont mentionnées dans le règlement intérieur de chaque établissement, il ne constitue le plus souvent qu'un document administratif supplémentaire dont aucun élève n'a réellement connaissance. Il conviendrait, par exemple, d'y inscrire très clairement les sanctions prononçables en cas d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de le faire lire à chaque rentrée scolaire par le professeur principal de chaque classe ;
- le deuxième axe consisterait à utiliser effectivement la palette des mesures susceptibles d'être prononcées en cas d'usage ou de trafic avéré , afin de faire respecter la réglementation, au premier rang desquelles la loi sur la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, dite « loi Evin » . Les enquêtes et témoignages recueillis font en effet état de son irrespect généralisé dans les établissements scolaires. La commission ne peut donc que se féliciter des mesures que le ministre de l'éducation nationale a déclaré prendre en concertation avec le ministre délégué à l'enseignement scolaire, consistant à rappeler le contenu de la « loi Evin » et surtout à l'appliquer, non seulement aux élèves mais aussi au corps enseignant dont la conduite doit être exemplaire dans les lieux publics ;
- le troisième axe d'orientation concerne le partenariat à renforcer, voire à établir, entre l'établissement scolaire et le milieu extérieur en ce qui concerne la suite à donner aux infractions signalées dans le périmètre scolaire. Si, en matière de prévention stricto sensu , les services de police et de gendarmerie sont surreprésentés dans les établissements d'enseignement, leur concours n'est pas toujours recherché lorsqu'il s'agit de poursuivre notamment les cas de trafic. Devant la commission M. Pierre Cardo, député-maire de Chanteloup-les-Vignes en a ainsi témoigné : « Il se passe des tas de choses dans les collèges dont on ne nous parle pas obligatoirement. L'éducation nationale nous appelle d'ordinaire pour le partenariat quand cela explose chez elle. En dehors de cela, quand nous proposons de l'aider, nous n'avons pas toujours un accueil très chaleureux. (...). On n'accepte pas (...) une intervention policière sur un jeune dans un collège. (...). Il faudra donc qu'au niveau des formations de base, qu'il s'agisse des enseignants ou des travailleurs sociaux, on insiste aussi sur ce que représente une plainte, l'intervention policière et la nécessité qu'elle puisse avoir lieu lorsque la loi n'est pas appliquée » ;
- enfin, dernière perspective d'évolution envisageable : la mise en oeuvre, autour de l'établissement, d'un périmètre dont le régime juridique en matière pénale serait spécifique. Cette idée, provenant des Etats-Unis et à laquelle le ministre délégué à l'enseignement supérieur s'est dit personnellement favorable devant la commission, consiste à considérer comme circonstance aggravante le fait pour toute infraction à la législation sur les stupéfiants, notamment le trafic, de se dérouler dans les environs immédiats de l'établissement scolaire. C'est en effet dans cette zone en contact direct avec l'école et ses élèves qu'ont lieu la plupart des petits « deals » permettant aux jeunes de s'approvisionner en produits illicites.
S'agissant de l'ensemble de ces mesures, la commission ne peut que se féliciter et appeler à la mise en oeuvre des orientations définies par le ministre délégué à l'enseignement scolaire dans sa communication au conseil des ministres du 26 février 2003, au cours de laquelle il avait déclaré que « les trafics ne doivent pas s'établir dans les établissements. Tout élève surpris à faire du commerce de produits illicites fera l'objet d'une procédure disciplinaire en vue de son exclusion, accompagnée d'un signalement aux autorités judiciaires ».
*
* *
Pour ne pas rester lettres pieuses, ces déclarations d'intention devront s'accompagner d'un effort financier substantiel au profit des actions de prévention. En matière de lutte contre la toxicomanie, la prévention demeure en effet le « parent pauvre » en termes de moyens humains, matériels et financiers. Si le budget total de la MILDT, légèrement inférieur à 50 millions d'euros, est relativement faible par rapport à la moyenne des pays européens équivalents, la part consacrée à la prévention l'est davantage encore.
Le volet budgétaire consacré aux actions de prévention stricto sensu s'élevait ainsi à 12 millions d'euros pour le dernier plan triennal, regroupant pour l'essentiel des crédits déconcentrés aux chefs de projet départementaux, ainsi que des crédits délégués aux différents ministères pour soutenir leurs actions nationales et locales, et des crédits destinés au financement des CESC.
Or, de l'avis même de l'ancienne présidente de la MILDT, Mme Nicole Maestracci, « même si les questions posées par la prévention sont loin de se résumer à des problèmes budgétaires, il est clair que ces crédits demeurent insuffisants pour généraliser les programmes sur l'ensemble des lieux fréquentés par les jeunes ».
Même constat pour le volet budgétaire consacré à la communication qui, s'il est passé de 1,9 million d'euros en 1999 à 4,7 en 2002, reste encore largement insuffisant. A titre de comparaison, le budget communication pour la prévention de la consommation de drogues et d'alcool au Royaume-Uni est équivalent à la presque totalité du budget global de la MILDT !
Enfin, la situation est pire encore pour ce qui est du volet budgétaire consacré à la formation : en ce domaine, les crédits interministériels s'élevaient à 2 millions d'euros en 2002. Cette somme dérisoire par rapport aux enjeux empêche de donner suite aux initiatives de formation de certaines structures : le ministère de l'éducation nationale rapporte ainsi le report en 2002 d'une formation multicatégorielle destinée à des équipes de prévention en milieu scolaire dont le financement, évalué à 577.200 euros, n'a pu être assuré avec les crédits de la MILDT.
L'effort financier indispensable à la mise en place d'une véritable politique de prévention, dont l'ampleur pourrait être estimée par un audit des besoins des différents ministères en la matière, devra s'accompagner d'une amélioration des instruments de suivi et d'évaluation des dépenses engagées. En effet, le rapport de la Cour des comptes de 1998 sur le dispositif de lutte contre la toxicomanie, dont les principales conclusions ont été reprises dans un rapport d'information publié par la commission des finances du Sénat en novembre 2001, a pointé une insuffisante rigueur dans le contrôle de l'utilisation des crédits publics, l'efficience de leur emploi étant très rarement mesurée ex post .
III. UN DISPOSITIF SANITAIRE ET SOCIAL EFFICACE POUR LA PRISE EN CHARGE, LE TRAITEMENT ET LA RÉINSERTION
A. LE NÉCESSAIRE DÉVELOPPEMENT DES STRUCTURES D'ACCUEIL
1. Le renforcement indispensable des capacités en centres d'accueil
a) Des structures d'accueil qui doivent être dotées de véritables moyens
Si le dispositif de prise en charge des toxicomanes, comme il a été vu, est inadapté aux usages et aux consommateurs actuels, il est également très insuffisant en termes de capacités d'accueil. En effet, la politique de réduction des risques qui s'est développée à partir de 1995 en faveur du « tout substitution » dans la prise en charge a conduit à la fermeture de plusieurs lits dans les structures sanitaires et sociales, faute de moyens suffisants.
M. François Hervé, président de l'Association nationale des intervenants en toxicomanie (ANIT), a ainsi attiré l'attention de la commission sur le problème du financement des structures d'accueil dans leur ensemble : « (...) le dispositif spécialisé a été fragilisé par un sous-financement chronique des CSST depuis plusieurs années. Nous en avons à plusieurs reprises informé la représentation nationale. D'autre part, la plupart des actions destinées à l'approche et au soin précoce des jeunes consommateurs repose sur des financements fragiles, non pérennes et remis en cause d'une année sur l'autre à partir non d'une évaluation de la pertinence de l'action, mais de critères purement économiques. »
La commission a pu prendre la mesure de ce problème lors de sa visite du Groupe écoute information dépendance à Valenciennes. Le GREID gère six appartements thérapeutiques et un centre de soins, et travaille dans une perspective de formation et d'insertion des toxicomanes sevrés. La structure connaît un vrai problème de financement car, à côté de la direction générale de la santé (DGS) et des financements de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), ceux du contrat intercommunal de prévention de la délinquance (CIPD) et de la MILDT sont souvent précaires.
Lors de sa visite du GREID, la commission a pu également se rendre compte que les structures d'accueil rencontraient des difficultés du fait de leur statut et de celui de leurs partenaires. Ainsi, alors que le GREID a toujours travaillé grâce à un étroit partenariat avec l'hôpital de Valenciennes, cette articulation particulièrement efficace est aujourd'hui remise en cause d'un point de vue réglementaire. L'association va désormais devoir revoir ses statuts et ses financements : en effet, le mode de rémunération des personnels hospitaliers mis à sa disposition par l'hôpital pourrait être assimilé à un « détournement » des deniers publics.
Outre l'assurance de la pérennité des financements, c'est également une plus grande souplesse dans les statuts des structures d'accueil qu'il faut aujourd'hui promouvoir, afin de permettre un partenariat plus efficace pour la prise en charge. Les CSST, notamment ceux qui sont gérés par des associations, pourraient ainsi plus facilement bénéficier de compétences médicales disponibles grâce aux hôpitaux et des échanges de programmes permettraient de maintenir la motivation des personnels.
b) Des programmes de sevrage à développer
Avec la montée en puissance de la politique de réduction des risques, les moyens financiers, matériels et humains des structures destinées au sevrage ont été sensiblement réduits . Il est donc aujourd'hui nécessaire de remettre l'accent sur l'objectif du sevrage en renforçant l'offre de soins dans ce domaine.
C'est notamment l'un des objectifs sur lequel le docteur Didier Jayle, président de la MILDT, a insisté lors de son audition en prônant un développement des communautés thérapeutiques comme méthode de prise en charge pour le sevrage : « En ce qui concerne la prise en charge, je ne suis pas non plus un partisan du tout substitution et je ne pense pas que la substitution puisse régler tous les problèmes. Il me semble que nous avons peut-être un peu négligé d'autres modes de prise en charge. J'aimerais bien pouvoir relancer ce que nous appelons les programmes sans drogue , qui sont des démarches un peu sur la base des narcotiques anonymes, qui reprennent le mécanisme des alcooliques anonymes, et également réfléchir à des communautés thérapeutiques , extrêmement peu importantes en France à cause des dérives d'une grande association que vous connaissez (le Patriarche). Le principe des communautés thérapeutiques est extrêmement intéressant. Il y a à peu près 50 places dans les communautés thérapeutiques en France, contre plusieurs milliers en Italie par exemple. Je crois qu'il faut vraiment faire un effort dans ce sens. (...) si le Patriarche a pu s'implanter ainsi, c'est parce qu'il n'y avait rien, pas tellement d'autres associations transparentes et honnêtes pour gérer ces problèmes. Le système français en a pâti. Je ne sais pas si nous pouvons renverser la vapeur, mais en tous cas je vais essayer. (...) Quelques communautés thérapeutiques fonctionnent bien. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant, sous réserve d'avoir les garanties (...) de transparence et de respect de la personne humaine. (...) L'association Kate Beary par exemple (...) est intéressante. Il y a des associations dans le Gard, que je n'ai pas encore vues, mais qui me paraissent sérieuses et avec un encadrement professionnel et une gestion saine. Je compte bien faire le tour de tout cela et peut-être inciter à la création de dizaines de communautés thérapeutiques de petite échelle, avec des professionnels et avec une garantie totale de bonne gestion et de respect des personnes. »
Si la commission considère effectivement que le nombre de places d'accueil dans les structures proposant des programmes de sevrage doit être substantiellement augmenté et que certaines méthodes originales doivent être développées, elle estime aussi qu'un contrôle strict de ces nouvelles initiatives doit être mis en place, que l'encadrement doit être pour partie assuré par un personnel médical formé et qu'il doit être procédé à une évaluation régulière.
Elle ne peut que s'inquiéter des possibilités de dérapage évoqués devant elle par le docteur Francis Curtet, psychiatre : « Quant aux communautés thérapeutiques, c'est une chose particulière, différente des post-cures. Il s'agit d'un concept qui nous vient des États-Unis (...), qui voulaient nous l'exporter il y a trente ans. J'étais allé voir ce qui se passait à Phoenix House, dont le principe est le suivant : ce sont d'immenses structures dans lesquelles on entre en tant que toxicomane et où, par le biais de programmes de réhabilitation et, en particulier, de très nombreuses séances d'humiliation, qui me paraissent insupportables, on se réhabilite progressivement, on monte des paliers et on passe du statut d'ex-toxico au statut d'encadrant, comme si le fait d'avoir fait l'expérience du produit donnait la qualité de thérapeute. »
Si les programmes de sevrage purs, par un isolement forcé au début de la prise en charge, puis une aide psychosociale progressive pour éviter les rechutes, peuvent convenir à certains toxicomanes, il apparaît tout aussi indispensable de renforcer les moyens des centres que l'on pourrait qualifier de « mixtes », à l'instar du centre Marmottan, dirigé par le docteur Michel Hautefeuille.
Le centre médical de Marmottan offre trois niveaux de réponse, constituant chacun une unité fonctionnelle : une consultation externe d'hôpital quotidienne et sans rendez-vous, un service d'hospitalisation d'une douzaine de lits pour entamer ou poursuivre une démarche de soins, et une unité de médecine générale qui prend en charge la réduction des risques (mise à disposition de matériel stérilisé) et le soin des pathologies spécifiques comme le sida ou les hépatites. Le centre prend donc en charge des toxicomanes aux différentes étapes de leur parcours de soins, ce qui permet un véritable suivi et la possibilité de passer progressivement d'une étape à l'autre.
Le docteur Michel Hautefeuille a ainsi précisé à la commission la prise en charge du sevrage à Marmottan : « Les demandes qui sont faites par rapport à l'hospitalisation restent essentiellement des demandes de sevrage, soit ce qu'on appelle des sevrages totaux ou globaux, qui concernent les personnes qui consomment un certain nombre de produits et qui veulent tout arrêter, soit ce que nous appelons des sevrages sélectifs, que nous développons de plus en plus, avec des patients qui ont, par exemple, un traitement de substitution avec lequel ils sont assez équilibrés et qu'il ne convient pas de remettre en cause, mais qui, en plus, sont utilisateurs d'autres produits comme l'alcool, les médicaments, la cocaïne, le crack, etc. Nous hospitalisons donc ces patients en leur laissant le traitement de substitution parce que je répète qu'il est adapté et correspond au niveau de leur cursus et de leur évolution personnelle, et nous faisons un sevrage de tous les autres produits. C'est ce qu'on appelle le sevrage sélectif et c'est une chose qui se développe de façon assez importante. Là aussi, Marmottan a été l'une des premières structures à proposer ce type de sevrage. »
L'objectif final devant rester autant que possible le sevrage total, il est certain que les moyens doivent d'abord être renforcés dans ce domaine. Toutefois, la commission considère que la notion de sevrage sélectif mérite d'être développée comme une première étape et comme moyen de lutter contre les nouveaux risques sanitaires liés à la substitution. Dans ce cadre, un certain nombre de places d'accueil pourraient être réservées, dans les centres de soins qui le souhaitent, à ce type de dispositif intermédiaire.
c) Une prise en charge qui doit être élargie
Comme on l'a vu, la prise en charge des toxicomanes telle qu'elle est conçue actuellement se consacre presque exclusivement aux usagers dépendants aux opiacés, pour lesquels les professionnels ont acquis compétence et savoir-faire, alors même que leur nombre diminue progressivement au sein de la population toxicomane globale.
La prise en charge est à construire et à renforcer pour trois types de consommateurs, que la commission considère particulièrement démunis et fragilisés face au problème de la drogue : les parents usagers de produits et leurs enfants, les adolescents et les détenus , dont la situation sera développée plus loin. Ces populations prioritaires avaient déjà été identifiées par la MILDT lors du choix des objectifs du plan triennal 1999-2001.
(1) Les parents usagers de produits et leurs enfants : éviter un engrenage dramatique
Il s'agit à la fois de soutenir les parents usagers de drogues dans leur mission éducative et de permettre aux enfants de surmonter les difficultés rencontrées. Il pourrait être envisagé une prise en charge psychosociale familiale renforcée dans le cadre de certaines structures, ainsi que la mise en place de lits d'urgence pour les parents afin de protéger les enfants des conséquences néfastes de certaines situations de crise.
L'accent doit en outre être porté sur l'aide aux femmes toxicomanes qui attendent un enfant, ainsi que l'avait notamment proposé le plan triennal : « La consommation importante (...) chez les femmes enceintes entraîne (...) des pathologies souvent graves du foetus et du nouveau-né. Ces pathologies, relativement fréquentes et décrites par les spécialistes, sont souvent mal connues du grand public. La gestion des traitements de substitution des futures mères et le sevrage des nouveaux nés doivent être soigneusement pris en compte. Une articulation de ces actions avec celles développées dans les plans « périnatalité » sera établie. »
Quelques associations ont mis en oeuvre des actions novatrices, encore trop rares et expérimentales, qui pourraient servir de modèle à d'autres dispositifs : prévention conduite en partenariat avec les maternités, accueil des parents en difficulté et de leurs enfants, aide à la construction de la parentalité, ou encore thérapies familiales.
La commission souhaite également que le nombre de places réservées aux femmes enceintes ou accompagnées de leurs jeunes enfants soit augmenté dans les CSST, à l'instar de ce qu'elle a pu constater lors de son déplacement au centre de soins Saint-Germain Pierre Nicolle.
(2) Les adolescents usagers : les oubliés de la politique de soins
L'émergence de nouvelles formes de consommation chez les jeunes n'a été suffisamment prise en compte ni par le dispositif spécialisé, ni par l'hôpital, de sorte que les adolescents consommateurs de multiples substances, mais pas toujours dépendants, constituent une population presque invisible en termes d'action publique.
Ainsi, pour M. François Hervé, président de l'ANIT : « Une priorité serait d'insister sur la prévention et l'accès précoce aux soins pour les jeunes adolescents. Quand nous regardons les rapports actuels sur la santé psychique, nous avons de quoi nous inquiéter. »
Il est cependant difficile à cet âge de distinguer les signes qui peuvent révéler un usage nocif de ceux qui relèvent de la « crise de l'adolescence ». Un tel diagnostic nécessite que l'entourage et les professionnels en contact avec l'adolescent (médecins et enseignants, notamment) soient en mesure de reconnaître un certain nombre de signes d'alerte.
En outre, lorsque la consommation de stupéfiants est avérée, l'orientation et la prise en charge des jeunes consommateurs sont complexes en raison de leur difficulté à comprendre la nécessité d'une aide sur un long terme et de l'absence de lieux d'accueil et de soins adaptés pour ceux qui ne recourent pas au dispositif spécialisé et ne vont pas consulter les services généralistes (ces derniers ne se reconnaissent d'ailleurs pas compétents pour traiter les consommations abusives).
Cette difficulté conduit à s'interroger sur l'insuffisance du nombre de lieux de consultation spécifiques pour les adolescents (les points écoute sont peu nombreux) et sur l'opportunité de consacrer des structures spécialisées aux jeunes usagers de produits psychoactifs.
Concernant cette dernière interrogation, la commission souhaiterait que quelques expériences pilotes puissent être développées puis évaluées, à l'instar du CSST Espace du possible, dont elle a rencontré le responsable, M. Jean-Marie Brunnin, lors de son déplacement à Valenciennes. Espace du possible est ainsi géré par l'association départementale du Nord pour la sauvegarde de l'enfance à l'adolescence (ADNSEA) depuis son ouverture en 1987. Il accueille un public adolescent (14 à 23 ans) usager de drogue ou toxicomane. Les réponses proposées par l'établissement sont diversifiées : post-cure (hébergement collectif pour dix jeunes), service d'accueil d'urgence et de transition (six places), familles d'accueil (cinq places), appartements thérapeutiques, consultations spécialisées et service de réduction des risques.
Consciente qu'une réponse spécifique doit être donnée pour la prise en charge des adolescents toxicomanes, la commission souhaiterait également que des lits leur soient réservés dans les nouvelles Maisons de l'adolescent , qui devraient être mises en place à terme dans chaque département. Ces lieux de prise en charge pluridisciplinaire permettraient parallèlement une prise en compte des difficultés sociales, psychologiques ou encore scolaires de ces adolescents, afin de renforcer l'efficacité du traitement en prenant le problème dans toute sa dimension.
d) Des moyens pour une nécessaire réinsertion
(1) Des dispositifs intermédiaires insuffisants
Le manque de places touche aujourd'hui les différents types de structures de prise en charge, mais il est particulièrement flagrant pour les structures d'accueil post-soins (post-cures, appartements thérapeutiques, familles d'accueil, etc.), qui sont pourtant indispensables à la réinsertion sociale des toxicomanes après leur période de sevrage, ou après qu'ils ont recouvré un premier équilibre grâce un traitement de substitution.
La commission notera que quatre centres avec hébergement thérapeutique ont été déconventionnés entre 1999 et 2000. La capacité d'accueil de ces centres a donc été réduite de 19 % en passant de 679 places en 1998 à 569 en 2001.
Cette réduction des moyens a notamment été dénoncée par le docteur Francis Curtet, psychiatre, lors de son audition : « Il y a une dizaine d'années, je râlais déjà parce qu'il n'y avait même pas 1.000 places en post-cure alors qu'on considère qu'il y a entre 150.000 et 200.000 toxicomanes en France. C'était donc dérisoire et la liste d'attente était déjà très importante. La politique de réduction des risques a abouti à ce que , désormais, on n'a même pas 500 places ! On ferme des post-cures et on retire des crédits pour les familles d'accueil. Du coup, les listes d'attente sont énormes, et je vois des parents complètement désespérés parce qu'ils ne savent plus où s'adresser pour trouver une aide alors qu'il y a, partout en France, de nombreuses personnes d'une qualité exceptionnelle qui se demandent quand on va se décider à faire un vrai travail, à mener un véritable combat et à leur donner les moyens de travail. »
Ce type de structure est donc essentiel car beaucoup de toxicomanes rechutent lorsqu'ils retrouvent leur entourage, ainsi que l'a exprimé le docteur Francis Curtet devant la commission : « Quand on voit le nombre de personnes qui peuvent se sortir d'affaire si on prend le temps de les aider, on se dit qu'il est vraiment trop dommage de ne pas le faire. On peut faire ces entretiens sous forme ambulatoire si les problèmes d'angoisse ne sont pas trop importants, mais si l'angoisse est trop importante et s'il ne peut pas se contenter de ces parenthèses qu'on lui fournit dans la semaine et risque de rechuter à tout moment, la seule solution est de lui proposer d'aller en post-cure, c'est-à-dire dans un lieu où, 24 heures sur 24, il peut aborder, au moment où il le veut, les problèmes qui se posent, et ce pendant des mois et des mois. Cela a un rôle essentiel. Et s'il ne parvient pas à vivre en collectivité, il faut trouver une famille d'accueil dans laquelle il peut parler avec des gens à tout moment. »
Outre l'augmentation du nombre de places d'accueil, l'action à mener en direction du dispositif de post-cure doit également concerner le mode de placement. Il apparaît en effet que, pour éviter un retour trop brutal du toxicomane dans son milieu d'origine, il est souhaitable qu'il effectue son séjour en post-cure hors de sa région d'origine. Il apparaît donc nécessaire de développer également un contact entre les différents centres au niveau national pour permettre des échanges, ce qui pose le problème des disparités régionales dans ce domaine.
En outre, les centres ayant des méthodes différentes de post-cure, une telle souplesse permettrait à chaque patient de trouver la formule convenant le mieux à son cas. Cette adaptation à chaque cas doit également être prise en compte par le développement de prépost-cures (un mois au lieu de six) pour préparer les patients les plus fragiles aux difficultés de la réinsertion liées à la post-cure.
(2) Une prise en charge sociale complémentaire indispensable
Si le dispositif de soins doit privilégier une approche médicale de la prise en charge, les aspects sociaux, et notamment l'objectif de la réinsertion, ne doivent donc pas être oubliés. Il est en effet nécessaire de s'intéresser aux problèmes sociaux des usagers de drogues.
Même si plusieurs centres de post-cure ont mis en place des ateliers d'insertion professionnelle afin de mieux prendre en compte la dimension sociale des problèmes, ces ateliers restent souvent coupés de la réalité et ne contribuent pas nécessairement à insérer les usagers dans la vie réelle.
Comme l'avait proposé le plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances (1999-2001), il ne s'agit pas de créer des dispositifs spécifiques qui s'ajouteraient à ceux qui existent déjà, mais de mieux utiliser les dispositifs existants, notamment ceux relevant du RMI, du logement social (Fonds de solidarité logement en particulier), de l'accès aux centres d'hébergement et de réadaptation sociale (CHRS) ou des contrats particuliers de retour à l'emploi (notamment pour les jeunes de moins de 25 ans en grande difficulté et confrontés à un risque d'exclusion professionnelle du fait de leur comportement addictif).
En l'absence de tout bilan du plan triennal sur cet aspect, un effort doit être poursuivi sur la question de l'aide sociale dans les structures de prises en charge des toxicomanes, notamment en fin de parcours de soins. Pour cela, les équipes doivent être informées de l'existence de ces dispositifs pour orienter les patients vers l'interlocuteur adéquat.
2. La nécessaire adaptation de la prise en charge sanitaire des détenus et des mineurs délinquants
a) Les carences du dispositif de prise en charge
(1) Une population à risque
• Une forte proportion de toxicomanes
Les données les plus récentes concernant la drogue en prison résultent de l'enquête sur « la santé à l'entrée en prison » menée au printemps 1997 dans l'ensemble des maisons d'arrêt et des quartiers maisons d'arrêt des centres pénitentiaires 118 ( * ) . Une nouvelle enquête, prévue en 2003, doit permettre de les actualiser.
Selon l'étude de 1997, près du tiers des entrants (32 %) déclare une consommation prolongée et régulière de drogues au cours des douze mois précédant leur incarcération : 25,6 % consommant du cannabis, 14,4 % des opiacés (héroïne, morphine ou opium), 8,9 % de la cocaïne et du crack, 9,1 % des médicaments à des fins toxicomaniaques, 3,4 % des drogues chimiques (ecstasy, LSD, colle, solvants...), 14,6 % enfin étant polytoxicomanes (deux substances consommées hors alcool associé). En outre, 40 % des entrants n'ont eu aucun contact avec le système de soins pendant de l'année précédant leur incarcération.
La visite médicale obligatoire à l'entrée, qui consiste en une radio pulmonaire et un test facultatif de détection du VIH (la prévalence pour le VIH - 1,6 % de la population - est trois à quatre fois supérieure chez les détenus à celle qui est constatée en milieu libre pour une population comparable) et des hépatites B et C, constitue une plaque tournante qui permet d'orienter le détenu à condition qu'il revendique sa toxicomanie. Dans ce cas, son état peut être révélé à l'occasion de consultations psychologiques ou psychiatriques, qui sont en libre accès, ou par un codétenu, étant rappelé que nombre de détenus souffrant de troubles mentaux sont aussi toxicomanes. En règle générale, les consommateurs de cannabis ne sollicitent pas une prise en charge et ne se déclarent pas toxicomanes.
Le docteur Véronique Vasseur, ancien médecin-chef de la prison de la Santé, a déclaré devant la commission : « On voit de moins en moins de toxicomanes en état de manque. J'en ai vu au début, surtout avec le crack, mais on en voit désormais très peu. Comme ils arrivent en général après 48 heures de dépôt, le gros est déjà passé. »
Un repérage systématique de toutes les situations d'abus et de dépendance à l'entrée en détention, par la mise en place d'un outil d'appréciation de la dépendance et de l'abus (« Minigrade ») est en cours de mise en place afin de permettre une meilleure évaluation de la situation des nouveaux arrivants et leur offrir une prise en charge adaptée.
• La protection judiciaire de la jeunesse également confrontée au problème de la toxicomanie
L'étude menée en 1997 sur la santé des entrants en prison et plus spécifiquement sur le problème de la toxicomanie chez les détenus montre que, dans les quartiers pour mineurs, plus du quart des entrants (27 %) déclarent une utilisation habituelle de drogues pendant les douze mois précédant leur interpellation, dont 24 % consommant du cannabis et 4,8 % des opiacés. Cette population présentant à bien des égards les mêmes caractéristiques que celle accueillie dans les structures de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), celles-ci sont également confrontées de manière importante au problème de la toxicomanie chez les mineurs dont elles ont la charge.
Les dernières données disponibles concernant les différentes formes de toxicomanie des mineurs confiés à la PJJ, issues de l'étude INSERM de 1998 réalisée par l'unité 472 de Mme Marie Choquet, confirment l'importance du phénomène. Cette étude témoigne d'un état de santé préoccupant et en particulier d'une importante consommation de substances psychoactives : 40 % des garçons et 32 % des filles accueillis dans les structures de la PJJ déclareraient avoir consommé plus de dix fois dans leur vie une drogue illicite (contre respectivement 10 et 5 % en population normale aux mêmes âges).
Les mineurs de la PJJ, peu enclins aux pratiques d'injection, sont massivement concernés par l'usage de cannabis et les polyconsommations. Leur toxicomanie, sauf exception, ne concerne pas spécifiquement la consommation de produits illicites (les consommation d'alcool et de tabac sont plus importantes que chez les adolescents du même âge) et s'inscrivent souvent dans un ensemble de difficultés mêlant actes déviants, auto ou hétéro agressions et plus généralement troubles du comportement.
Lors de son audition, M. Jean-Pierre Carbuccia-Berland, directeur de la PJJ, a apporté les précisions suivantes : « Le cannabis est évidemment le principal produit utilisé par les jeunes qui nous sont confiés : 31 % des garçons et 21 % des filles peuvent être qualifiés de consommateurs réguliers. On entend par « consommateurs réguliers » ceux qui ont pris plus de quarante fois du cannabis au cours de leur vie. (...) Il va de soi que, si on avait raisonné à un niveau plus bas, c'est-à-dire des consommations irrégulières, le taux aurait été beaucoup plus important. Les produits à inhaler prennent la deuxième place après le cannabis : 15 % des jeunes qui nous sont confiés en ont utilisé à un moment ou un autre. On note toutefois que, contrairement au cannabis, ces produits sont plus souvent et plus facilement abandonnés par les jeunes. En troisième position de ce triste palmarès, on trouve l'ecstasy. 12 % des garçons et 7 % des filles déclarent en avoir consommé au moins une fois. Il y a, en revanche, peu de consommateurs réguliers de ce produit. Les autres produits occupent une place relativement moins importante, même si leur consommation ne peut pas être qualifiée de totalement négligeable. En ce qui concerne l'héroïne, la cocaïne, les amphétamines et les usages toxicomaniaques de médicaments, le chiffre s'établit entre 3 et 8 % selon le sexe et le produit que l'on considère. »
(2) Un dispositif de prise en charge en milieu carcéral inadapté
• Un dispositif mêlant structures intégrées et partenariats extérieurs
Le système de prise en charge des toxicomanes en milieu carcéral a été mis en place après la réforme instituée par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 (faisant suite à une circulaire interministérielle du 14 janvier 1993), qui pose le principe du rattachement de l'ancienne médecine pénitentiaire au ministère de la santé.
La prise en charge des toxicomanes repose désormais pour l'essentiel sur l'équipe de secteur psychiatrique intervenant dans l'établissement pénitentiaire, en liaison étroite avec l'équipe de soins somatiques et les CSST. Ces centres de soins en milieu pénitentiaire (ex antennes toxicomanie depuis le décret du 29 juin 1992) sont au nombre de seize et sont concernés au même titre que les autres par les nouvelles orientations de la MILDT pour la prise en charge de l'ensemble des dépendances, conformément à la note interministérielle du 9 août 2001 relative à la prise en charge sanitaire et sociale des personnes détenues présentant une dépendance aux produits licites ou illicites ou ayant une dépendance abusive. Parallèlement, un certain nombre de CSST extérieurs aux établissements pénitentiaires ont signé une convention de prestation dans le cadre du programme des conventions départementales d'objectifs, afin d'organiser sur le plan sanitaire la prise en charge des usagers incarcérés, la préparation de leur sortie et leur suivi après libération.
Les établissements pénitentiaires prennent en charge les soins somatiques et psychiatriques des détenus via une unité hospitalière implantée en milieu pénitentiaire et rattachée à l'hôpital de proximité (UCSA). Ces unités s'occupent plus particulièrement de la prévention, de l'organisation et des soins ainsi que de leur continuité à la sortie de la détention. En outre, depuis la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, les soins en milieu carcéral sont assurés par des équipes hospitalières relevant du dispositif de droit commun. Depuis l'arrêté du 14 mars 1986, il existe également les services médicaux-psychologiques régionaux hospitaliers (SMPR), qui couvrent l'ensemble de la population carcérale et qui gèrent pour seize d'entre eux un CSST en milieu pénitentiaire. Leur rôle est notamment de coordonner l'ensemble des services de psychiatrie intervenant dans l'établissement.
On rappellera en outre que les derniers textes d'application pris par les autorités de tutelle sanitaires, hospitalières et pénitentiaires conjointement avec la MILDT prévoient une nouvelle organisation des services intervenant en détention, qu'ils soient sanitaires, socio-éducatifs ou de surveillance. La lettre interministérielle de 2001 établit ainsi les orientations relatives à l'amélioration de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes détenues présentant une dépendance aux produits licites (alcool notamment) ou illicites ou ayant une consommation abusive. Elle vise notamment à une plus grande coordination des services appelés à intervenir, tant au sein de la prison qu'au dehors, et à une meilleure organisation des modalités d'intervention locale autour d'un projet clairement établi et d'un responsable nommément désigné.
Les objectifs suivis par cette réorganisation sont les suivants : repérer systématiquement toutes les situations d'abus ou de dépendances, proposer une prise en charge adaptée aux besoins de la personne détenue, développer la prévention (notamment celle des risques associés à la consommation de produits), favoriser les aménagements de peines et préparer la sortie. Pour assurer l'accompagnement de cette mesure et le succès du projet, les administrations concernées ont pris les dispositions nécessaires pour qu'une démarche d'évaluation soit engagée.
Le système de prise en charge des détenus toxicomanes apparaît donc complexe, d'autant plus que la coordination entre ces différents services n'est pas toujours satisfaisante. Certaines initiatives innovantes permettant de développer des partenariats et d'informer les différents acteurs sur le fonctionnement du système ont toutefois vu le jour, à l'instar du site internet créé en 1999 par l'Association pour la promotion de la médecine en milieu pénitentiaire (APMMP), accessible aux intervenants en milieu fermé et aux détenus.
• Administration pénitentiaire et personnel médical : des relations peu satisfaisantes
Ainsi que la commission a pu le constater lors de son déplacement à la maison d'arrêt de la Santé, les rapports entre la direction des établissements et le personnel médical, indépendant depuis la réforme de 1994, sont parfois difficiles.
Cette situation semble d'abord résulter d'une certaine méconnaissance par l'administration de la situation des détenus en matière de toxicomanie. Au moment de l'incarcération, le juge d'instruction transmet à l'administration pénitentiaire une notice précisant l'infraction commise et l'état du détenu qui ne mentionne pas la toxicomanie éventuelle de l'entrant, l'administration, et notamment le chef de détention, n'ayant pas vocation à être l'interlocuteur en matière de toxicomanie.
En outre, la démarche thérapeutique ne s'accompagne d'aucun signalement nominatif à la direction, du fait du respect du secret médical, qui s'applique en prison comme à l'extérieur, même si certains signalements sont parfois effectués sous couvert d'anonymat.
Le secret médical complique en outre l'action de la direction des établissements contre le trafic de stupéfiants, de produits de substitution et de médicaments, ainsi que M. Didier Lallement l'a indiqué devant la commission : « Il s'avère que, dans bien des cas, l'administration pénitentiaire ne connaît pas les prescriptions médicales. Dans certains cas, un petit nombre de choses se savent, mais on nous oppose systématiquement l'argument du secret médical, ce qui ne nous permet pas de savoir qui est sous traitement. Cela pose d'ailleurs tout le problème du trafic des médicaments en détention. (...) J'aspire donc à une meilleure coordination avec les services de santé. Je comprends parfaitement que le secret médical soit un chose essentielle. Pour autant, je pense que des politiques efficaces de prévention et de traitement passeront par une meilleure coordination. »
De son côté, le personnel médical considère que la formation des personnels de l'administration pénitentiaire est insuffisante au regard de la toxicomanie en prison. A la suite de la réflexion engagée en 1999 par la MILDT et par différents ministères pour rédiger un cahier des charges interministériel sur la formation des personnels, un module de formation d'une journée sur les usages et les politiques publiques devait être mis en place à destination des personnels pénitentiaires afin de développer un socle de connaissances communes sur les produits et les usages ; celui-ci a été inscrit dans le cursus de formation continue des agents avant 2002. S'agissant de la formation initiale des personnels, dispensée à l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire (ENAP), 80 % des surveillants stagiaires de la Santé ont suivi une formation initiale spécifique à la détection de ces produits.
Cette incompréhension entre les personnels pénitentiaires et le monde médical nuit à l'efficacité de la lutte contre la drogue en prison, chacun ayant tendance à rejeter sur l'autre la responsabilité de la situation, comme l'a constaté le docteur Véronique Vasseur à propos de l'analyse des décès probablement dus à la drogue en prison, lors de son audition : « Même si on a connaissance de ces doses parce qu'on le sent, on ne peut trouver quelque chose que par des autopsies, et lorsque je m'en suis ouverte à mes confrères, lors d'un congrès de médecine pénitentiaire, ils m'ont répondu que je débarquais et que ce n'était pas l'affaire des médecins mais celle de la pénitentiaire. Je ne suis pas d'accord, étant donné que beaucoup de détenus sont toxicomanes, mais qu'ils sont aussi en prison pour des vols liés à la toxicomanie. »
• La nécessaire adaptation des moyens de la PJJ
Malgré l'interdit pesant sur le trafic et la consommation de drogues, la drogue est une réalité dans les établissements relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que l'a reconnu son directeur, M. Jean-Pierre Carbuccia-Berland devant la commission : « Pour ne considérer que les lieux où le contrôle est le plus strict, c'est-à-dire les foyers d'hébergement, les directives sont clairement que les substances illicites ne doivent ni circuler, ni être consommées. Cependant, on se heurte, sur ce sujet, à des difficultés pratiques. En effet, si on veut contrôler ces éléments, il en découle un certain nombre de procédures de contrôle des locaux, mais aussi de fouilles et d'examens. (...) A ce sujet, je vous rappelle que la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a placé l'ensemble des structures de la protection judiciaire de la jeunesse dans son champ d'application. Cela signifie que les mineurs qui sont hébergés dans ces centres et ces services bénéficient des droits et libertés reconnus à l'ensemble des usagers du secteur social et médico-social, c'est-à-dire que les liens avec les familles, le droit à l'intimité, le droit au respect et un certain nombre d'autres éléments s'appliquent dans les foyers de la protection judiciaire de la jeunesse, sauf -ce sont les décrets que nous sommes en train de travailler en ce moment avec le ministère de la santé- les prérogatives reconnues à l'autorité judiciaire de restreindre ces droits. Je veux dire par là que, si nous voulons avoir un contrôle effectif, nous nous heurtons à une difficulté juridique. La loi est respectée par moment de manière large ou de manière un peu plus stricte, mais toujours avec les problématiques juridiques qui lui sont liées. La question de la fouille d'un gamin dans un foyer de la PJJ, au regard de la législation que je viens d'évoquer, constitue aujourd'hui une difficulté. »
La commission ne peut que souhaiter la publication la plus rapide possible de ces décrets afin d'assouplir les contraintes auxquelles la PJJ est aujourd'hui confrontée dans le domaine de la lutte contre les stupéfiants. Plus largement, ce sont les méthodes de cette administration qu'il faut adapter à l'évolution croissante de ce phénomène.
Lors de son audition, M. Jean-Pierre Carbuccia-Berland a indiqué à la commission les axes de travail suivis par la PJJ dans le domaine de la lutte contre la toxicomanie : « Notre base de travail est évidemment de considérer que la prise de toxiques, quels qu'ils soient, est d'abord une violation de la loi et une transgression de la législation et à partir de là, il nous appartient de conduire, avec les mineurs ou les jeunes qui nous sont confiés, un travail éducatif sur les raisons de cette interdiction, sur la façon dont on peut aborder avec eux l'arrêt de cet engagement qu'ils ont pris et sur la façon dont on peut travailler aussi sur les problématiques de santé. (...) La deuxième possibilité, c'est de prendre en charge cette dimension de la toxicomanie dans ce qui est finalement le deuxième grand volet de la loi de 1970, c'est-à-dire son volet sanitaire, qui consiste à considérer les toxicomanes comme des gens qui relèvent d'un traitement médical et donc à les inscrire dans les politiques de santé et les prises en charge sanitaires que nous conduisons. De ce point de vue, l'enquête épidémiologique (...) de 1998 nous a conduit à « mettre le turbo » sur les politiques sanitaires qui étaient les nôtres et à accroître notre participation à une politique de santé publique construite. »
Cette réflexion a été menée dans trois directions :
- la première consiste à intégrer la dimension sanitaire dans la prise en charge éducative, c'est-à-dire l'état de santé dans la façon dont le mineur est pris en charge. La culture des éducateurs de la PJJ n'est cependant pas tournée naturellement vers cet aspect des problèmes des adolescents accueillis. L'attitude des professionnels témoigne notamment de leurs difficultés à resituer la toxicomanie dans une approche éducative globale dans un contexte souvent complexe et violent, et à s'approprier cette priorité sans l'externaliser ni la banaliser. Des besoins de formation du personnel sur ces questions sont ainsi apparus de façon croissante : la PJJ a renforcé la présence de personnels infirmiers dans ses directions départementales pour assurer un partenariat avec le système sanitaire et servir de référence pour les équipes éducatives confrontées à ce type de problème. La dimension sanitaire a également été prise en compte dans les modules de formation des éducateurs.
La commission notera également que la culture de certains de ces éducateurs souvent issus de la génération de 1968 peut favoriser parfois un certain laxisme à l'égard des « drogues douces ». Concernant l'image du cannabis auprès des jeunes de la PJJ, M. Jean-Pierre Carbuccia-Berland a ainsi indiqué à la commission : « Sur le terrain du cannabis, la relative ambiguïté qui pèse sur l'interdiction frappant ce produit ne rend pas extrêmement aisé un travail éducatif construit et solidement ancré » ;
- le deuxième axe de cette politique de santé consiste à engager au sein de la PJJ une réflexion visant à intégrer la question de la santé mentale et des comportements addictifs dans le champ de la prise en charge éducative ;
- le troisième axe découle de la nécessité d'inscrire l'action de la PJJ dans les grands programmes publics de santé conduits par le ministère. La protection judiciaire de la jeunesse participe ainsi désormais activement aux programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins.
Parallèlement à l'intégration de l'aspect sanitaire dans la prise en charge éducative des mineurs qui lui sont confiés, la collaboration de la PJJ avec la MILDT évolue depuis quelques années :
- au niveau national, la direction participe aux instances du comité interministériel, du comité de pilotage des convention départementales d'objectifs justice-santé (CDO) et à la commission de validation des outils de prévention ;
- au niveau local, les services déconcentrés départementaux sont associés avec les différents partenaires institutionnels concernés, sous l'égide du chef de projet « drogues et dépendances » désigné par le préfet, au comité de pilotage des actions de prévention, notamment au niveau du dispositif des CDO. Ce dernier constitue un outil impliquant localement les services sanitaires et judiciaires afin de construire des réponses coordonnées et adaptées. Les services de la PJJ sont encore insuffisamment investis dans le dispositif CDO, qui a été généralisé en 1999. Il convient toutefois de citer des initiatives locales intéressantes, à l'instar du dispositif Oc-Drogues à Toulouse : l'association travaille dans le champ de la réparation pénale, en lien avec la PJJ, pour les mineurs qui ont été interpellés pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Les perspectives en ce domaine peuvent être ainsi résumées :
- développer l'intégration de la PJJ dans les CDO, notamment dans la prise en compte des consommations de cannabis et les polyconsommations ;
- développer les activités de prévention dans le cadre du travail éducatif ;
- renforcer la place de la question des drogues dans le corpus de formation initiale et continue des éducateurs. Les avancées doivent notamment être poursuivies par la constitution d'une équipe de formateurs sur la toxicomanie à l'échelon régional de l'institution ;
- renforcer les partenariats au niveau local entre les établissements de la PJJ avec les CSST et plus largement les associations qui travaillent à la prise en charge des toxicomanes. L'aide éducative seule est en effet insuffisante pour les mineurs usagers de drogues : le personnel de la PJJ doit pouvoir travailler avec un psychologue, un médecin et une assistante sociale dans le cadre d'une prise en charge collective ;
- approfondir les connaissances en explorant notamment la question du lien entre les comportements délictueux et la modification de l'état de conscience induit par la consommation de stupéfiants chez les mineurs.
La prise en compte du problème de la toxicomanie doit donc faire partie intégrante de la réforme des méthodes d'une institution que chacun s'accorde à reconnaître en crise, ainsi que l'a montré le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs 119 ( * ) , et dont est convenu M. Dominique Perben, garde des Sceaux, devant la commission : «Je suis (...) très conscient des problèmes de cette administration, qui a besoin d'être confortée, davantage guidée et évaluée. »
b) La drogue en prison : une réalité
(1) Les produits de substitution et les médicaments : un moyen de gestion de la détention ?
• Les produits de substitution en prison
Les traitements de substitution sont encore inégalement développés en prison.
Selon l'étude menée en 1997 sur la santé des détenus, 11,8 % d'entre eux déclarent s'être drogués par voie intraveineuse au moins une fois et 6,8 % au cours des douze mois précédant l'incarcération. Or, une minorité d'usagers de drogues par voie intraveineuse continue à consommer en détention. Ce constat fait craindre que des contaminations virales (VIH et VHC) liées à l'usage de drogue par voie intraveineuse et à la réutilisation du matériel d'injection ne surviennent pendant la détention, ce qui justifie la mise en oeuvre d'une politique de réduction des risques.
Le dispositif de réduction des risques en milieu carcéral repose principalement sur des actions d'information et de prévention destinées à l'ensemble des détenus : diffusion d'une brochure d'information et de prévention à chaque entrant, facilitation de l'accès aux préservatifs dans les services médicaux et distribution régulière d'eau de Javel. Il a été récemment renforcé par des actions d'éducation à la santé et de prévention. Depuis septembre 2002, des réunions régionales sont ainsi organisées avec le ministère de la santé, les personnels pénitentiaires et les personnels soignants pour mettre en oeuvre ces actions en les adaptant à chaque établissement.
En cas de problème d'addiction, le détenu bénéficie de consultations spécialisées et son éventuel traitement de substitution doit en principe être poursuivi après vérification, même si toutes les maisons d'arrêt ne sont pas en mesure de respecter cette obligation.
D'après une enquête de 1999 de la direction des hôpitaux et de l'organisation de soins et de la direction de la santé, le recours aux traitements de substitution en milieu carcéral demeure peu répandu (un héroïnomane sur sept contre un sur trois à l'extérieur) et traduit des résistances manifestes de certaines équipes médicales. En 2001, sur 47.000 détenus recensés, 2.548 faisaient l'objet d'un traitement de substitution. Les interruptions dans les traitements de substitution restent importantes : 19 % en 1999 contre 21 % en 1998 (il semble toutefois que ce point soit aujourd'hui en voie d'amélioration). La situation est plus favorable pour les toxicomanes bénéficiant de traitement à la méthadone à l'entrée (0,6 % des entrants contre 6,3 % sous Subutex) dont les interruptions ne s'élèvent qu'à 10 %.
Dix établissements prescrivent à eux seuls 50 % des traitements de substitution, dans le cadre le plus souvent de la poursuite d'un traitement antérieur et 21 % des établissements n'accueillent aucun détenu sous ces traitements. La buprémorphine est plus largement utilisée que la méthadone et concerne 84 % des traitements. Les prévenus sous substitution représentent environ 3,3 % de la population carcérale (dont 2,8 % sous Subutex). Le pourcentage maximum de détenus bénéficiant d'un traitement de substitution est de 16,5 %.
On rappellera que le plan triennal 1999-2001 indiquait : « Tous les détenus doivent avoir accès aux mêmes traitements qu'en milieu libre. Il conviendra de veiller à la continuité du traitement en cas de transfert et à la libération. La proportion d'usagers sous substitution en prison devrait ainsi progressivement rejoindre celle qui prévaut en milieu libre. » Cet objectif est loin d'être atteint et la commission considère pour sa part que l'incarcération peut offrir les conditions d'un sevrage du fait de la coupure qu'elle entraîne avec l'extérieur. Il apparaît en outre que le trafic de Subutex est proportionnellement plus important en prison qu'à l'extérieur
L'existence d'un trafic de Subutex important dans les prisons françaises a été souligné par le docteur Véronique Vasseur lors de son audition : «Le Subutex est prescrit par les médecins généralistes et n'obéit pas aux mêmes règles que les centres de méthadone : il n'y a pas de notion de places. Il peut donc être prescrit par n'importe quel médecin et, très souvent, les détenus arrivent en disant qu'ils sont sous Subutex et qu'ils ont laissé leur ordonnance chez eux. A la prison de la Santé, on a donc effectué un tri pour ne pas inonder la prison de Subutex, parce qu'il y a un énorme trafic et que c'est une monnaie d'échange, puisqu'un cachet de Subutex vaut un paquet de Marlboro. (...) Pour ce qui est de la méthadone, on ne fait que poursuivre la méthadone prescrite à l'extérieur. Elle n'est jamais instituée à l'intérieur. Quant au Subutex, la pratique est complètement différente. Il faut savoir que l'on peut faire des overdoses avec la méthadone, qui est un produit assez dangereux, alors que si le Subutex n'est pas mélangé avec des tranquillisants ou des psychotropes, on arrive à une dose plafond et cela ne grimpe pas puisque c'est une substance qui bloque les récepteurs. Normalement, il n'y a pas de danger. Je précise d'ailleurs que le Subutex ne procure aucun plaisir et que ceux qui en prennent et qui ne sont pas toxicomanes sont extrêmement malades. Ce n'est pas du tout plaisant. Les détenus appellent cela une drogue morte. Ce n'est que parce qu'il est disponible en prison et donné gratuitement qu'ils sont tentés d'en prendre. (...) Lorsqu'un toxicomane est pris en charge dans une unité et un centre méthadone, on ne lui donne pas sa méthadone sans rien faire d'autre ; il y a une prise en charge psychologique très importante. Quand ils arrivent, la méthadone est prise devant l'infirmière et cela ne pose jamais de problème. Cela n'a jamais entraîné aucun trafic, d'autant plus que cela se passe sous forme de sirop. Pour le Subutex, c'est différent. Nous avions essayé de donner le Subutex à la becquée, à l'infirmerie, ce qui voulait dire qu'à un moment de la journée, tous les preneurs de Subutex arrivaient à l'infirmerie. Comme c'était devenu l'enfer, nous avons été obligés d'arrêter parce que cela se faisait avec des bandes de scotch dans la main...Tous les moyens étaient bons. C'est très compliqué, d'autant plus qu'il y a des ruptures de traitement : lorsque les détenus sont accompagnés en centre de rétention, ils n'en ont pas. Comme il y a trop de trafic, le médecin-chef de la préfecture de police a refusé d'en donner. Le Subutex n'est pas la panacée, de toute façon. »
Il a en outre été indiqué à la commission, lors de son déplacement à la prison de la Santé, que les traitements de substitution conduisent certains détenus à s'injecter du Subutex préalablement pilé. Par ailleurs, des cas d'initiation aux produits de substitution sans antécédent de toxicomanie, qui peuvent résulter d'un partage de ces produits entre codétenus dans les mois qui suivent l'incarcération, ont été rapportés, ainsi que des cas de polyconsommations associées à la substitution, notamment avec le cannabis, ainsi que l'a indiqué à la commission le docteur Véronique Vasseur : « même les détenus qui sont traités par méthadone en prennent et on peut dire qu'il y une grande association entre la méthadone et le cannabis, le Subutex et le cannabis, mais beaucoup moins entre l'héroïne et la cocaïne. »
• Des médicaments détournés de leur usage en prison
Si les médicaments psychotropes n'entrent pas dans le champ d'investigation de la commission d'enquête, l'utilisation détournée qui en est trop souvent faite en prison justifie quelques développements.
La commission a été sensibilisée à ce problème lors de l'audition du docteur Francis Curtet, psychiatre : « Vous m'avez demandé s'il me paraissait judicieux ou astucieux de donner de la drogue en prison. C'est une chose qui me révolte profondément. (...) La première chose que j'avais faite avait consisté à interdire le Mandrax (un médicament qui n'existe plus), de même que tous les produits que l'on pouvait dévier à des fins toxicomanogènes. Il n'était pas question de ne pas leur donner de médicaments, à condition qu'il s'agisse de médicaments contre la douleur, l'angoisse ou l'insomnie avec lesquels on ne se défonce pas. C'est ainsi qu'en l'espace de quinze jours ou trois semaines, les gars ont été décrochés physiquement. (...) Par conséquent, une fois passé le manque physique, je ne leur donnais pas de produit, sauf s'ils étaient vraiment très déprimés, parce qu'il n'était pas question de laisser un homme se suicider. »
Pour sa part, le docteur Francis Curtet a indiqué à la commission : « Il y avait parfois une pression importante des autorités pénitentiaires qui me demandaient, en tant que médecin, de les abrutir pour éviter qu'ils mettent tout sens dessus dessous, ce que je refusais de faire en disant que, pour moi, un détenu qui bouge pourra se réinsérer, ce qui risque de ne pas être le cas d'un détenu qui est content sur place et qui ne bouge plus, comme ceux qui, lorsqu'on donne une permission et alors qu'ils doivent rentrer à 18 heures, frappent déjà à la porte à 16 heures, tellement ils ont mal dehors. (...) Je suis très hostile à ces distributions de drogues légales en prison. »
A l'occasion de son déplacement à la prison de la Santé, la commission n'a pas été en mesure d'obtenir des informations sur ce phénomène de la part de l'équipe médicale ; l'ancien médecin-chef de la Santé, le docteur Véronique Vasseur, a toutefois déclaré lors de son audition : « On peut (...) dire que le shit et les psychotropes, qui sont prescrits larga manu par les psychiatres (quand je suis partie, en 2000, sur 700 traitements par semaine, plus de 300 étaient des psychotropes) sont des régulateurs de la détention pour éviter les émeutes. On rencontre en prison beaucoup de patients complètement shootés et hagards du fait des psychotropes, du shit ou des deux à la fois. »
Lors de ce déplacement, la direction de la maison d'arrêt a reconnu l'existence, par détournement de prescriptions médicales, d'un trafic de produits licites, dont le stockage a pu être détecté par le personnel de surveillance lors de l'inspection des cellules. Si la délivrance quotidienne des psychotropes, conformément à la loi santé-justice, permet de réduire ces pratiques sans porter atteinte au secret médical, elle apparaît donc encore insuffisante pour enrayer ce phénomène.
(2) Un trafic difficile à réprimer
• La réalité d'un trafic
Le problème de la drogue en prison est apparu à la fin des années 1970. L'existence indéniable d'un trafic de stupéfiants en prison a été affirmée par le docteur Véronique Vasseur lors de son audition : « Le cannabis rentre très facilement en prison et ce n'est un secret pour personne puisqu'on peut sentir son odeur en se promenant dans les coursives et que les patients avouent en fumer très régulièrement, de la même façon que le tabac. On m'en a déjà proposé et c'est une chose extrêmement banale. On en saisit à l'occasion de rares fouilles et des trafics orchestrés par des détenus ou des surveillants ont été dénoncés et punis, même si cela entre aussi par les familles. Les gros trafics sont organisés avec des complicités, bien évidemment. (...) Alors que tout est fait pour les soigner, je trouve absolument hallucinant qu'on laisse le shit entrer et qu'ils continuent à en fumer. (...) En revanche, pendant huit ans et demi, je n'ai jamais entendu parler de saisies de cocaïne, de crack ou d'héroïne. Il est arrivé simplement deux fois que l'on retrouve des petites seringues à insuline.»
Dans la réalité, la drogue entre en prison selon trois modalités :
- les parloirs permettent d'abord de faire entrer de la drogue en prison, notamment depuis la disparition du dispositif de séparation entre le détenu et sa famille. En 2002, les parquets ont organisé 55 opérations de contrôle, dont la réussite dépend d'un minimum d'effet de surprise et du fait que les fonctionnaires de police et de gendarmerie qui y procèdent sont accompagnés de chiens renifleurs. En revanche, les contrôles de routine sont souvent infructueux et les familles ne sont astreintes qu'au passage sous portique et ne peuvent être fouillées au corps.
Les personnels assurent en outre une surveillance quotidienne à travers le contrôle des effets remis aux détenus et effectuent une fouille corporelle systématique de tout détenu sortant du parloir, en application de l'article D. 275 du code de procédure pénale, rendue plus difficile avec les pratiques de dissimulation buccale ou capillaire. En cas de découverte de produits illicites, la direction alerte le parquet qui peut saisir la brigade des stupéfiants, les familles en cause pouvant être mises en garde à vue.
Lors de son déplacement à la prison de la Santé, il a été indiqué à la commission que les détenus exerçaient fréquemment des pressions sur leur famille, notamment les mères et les soeurs, qui sont de plus en plus souvent acquises à la banalisation de l'usage du cannabis. D'une manière générale, il apparaît que tout est matière à trafic, à troc et à transaction entre les détenus et leurs familles, qui se connaissent et sont l'objet de pressions à l'extérieur ;
- la drogue est également introduite par projection au-dessus des murs, comme c'est le cas pour les téléphones portables. A cet égard, M. Didier Lallement, directeur de l'administration pénitentiaire, a indiqué à la commission : « Nous sommes confrontés à un quasi problème de société : la prison ne fait plus peur. (...) On s'approche donc aujourd'hui de la prison pour y jeter des substances avec des modes opératoires très efficaces (...) : cela consiste tout simplement à mettre les objets que l'on veut introduire dans une balle de tennis et, à l'aide d'une raquette, sans être forcément un très bon joueur, à projeter la balle au-dessus du mur d'enceinte. (...) Les objets projetés de cette façon sont ensuite récupérés par un dispositif très rodé : lorsqu'ils tombent au milieu d'une cour de promenade, même si nous faisons une série de fouilles au même moment, les détenus concernés ramassent l'objet et le projettent en direction des cellules. » Dans les maisons d'arrêt, les murs ont été systématiquement rehaussés mais cette opération n'a pas sensiblement réduit le phénomène. Si la maison d'arrêt de la Santé est épargnée, en raison de sa configuration, par le phénomène des projections de l'extérieur, la drogue est, comme partout, introduite dans les cellules par le système dit des « yo-yo » ;
- la drogue entre enfin en prison lors des réintégrations. A l'occasion d'une extraction médicale ou judiciaire, le détenu est en effet conduit à rencontrer des tiers à l'administration pénitentiaire et fait donc l'objet d'une fouille systématique.
• Les réponses de l'administration pénitentiaire
Les personnels pénitentiaires sont confrontés à des difficultés pratiques pour détecter la consommation ou la revente de drogue, qui s'effectue souvent lors des promenades. En effet, les contrôles réguliers des cellules donnent des résultats décevants au regard du temps passé et du personnel mobilisé (deux heures sont nécessaires, à deux surveillants, pour fouiller une cellule de manière efficace, les trois quarts des fouilles étant ciblées sur signalement). En 2002, 847 infractions à la législation sur les stupéfiants, concernant 953 détenus, ont été constatées et ont fait l'objet de poursuites judiciaires. Ces chiffres sont sans doute loin de la réalité du phénomène même si les fouilles générales des établissements les plus importants, décidées par le garde des Sceaux à la suite de la récente évasion de la maison d'arrêt de Fresnes, se sont traduites par des résultats décevants.
S'agissant de la maison d'arrêt de la Santé, il a été indiqué à la commission une augmentation sensible de la circulation de stupéfiants, qui se traduit notamment par les procédures disciplinaires engagées après découverte de cannabis : 66 sanctions disciplinaires ont été prononcées en 2002, dont 15 pour possession de téléphones portables, contre 5 en 1997. En revanche, depuis quatre ans, aucun détenu n'a été convoqué devant la commission de discipline pour détention de cocaïne, d'ecstasy ou d'héroïne. Si les saisies ne concernent que le cannabis et que les fouilles ne révèlent pas la présence de seringues dans les cellules, cela n'exclut pas que d'autres produits soient dissimulés et consommés ailleurs.
S'agissant d'une éventuelle complicité des personnels et d'une supposée instrumentalisation de la consommation de drogues pour « gérer » la détention, M. Didier Lallement, directeur de l'administration pénitentiaire, a indiqué à la commission : « C'est un discours contre lequel nous luttons pied à pied. (...) Je suis bien conscient qu'il y a, au sein de l'administration pénitentiaire, des opinions de cette nature. Comme je vous l'ai dit tout aussi franchement, nous les combattons avec énergie. Il ne peut être accepté que l'illégalité soit au coeur de ce qui doit être l'application du droit. (...) J'ai la plus grande confiance dans les personnels pénitentiaires, dont je voudrais ici saluer le rôle essentiel, mais nous devons aussi être vigilants par rapport à un certain nombre d'individus qui, bien que faisant partie du personnel pénitentiaire, n'hésitent pas à se rendre complices de tels trafics dont nous les sanctionnons disciplinairement et pénalement. En 2001, ce sont sept agents pénitentiaires qui ont ainsi été impliqués dans des procédures de cette nature et qui ont été sanctionnés, la sanction étant, dans la presque totalité des cas, celle de la révocation. » Lors de son déplacement à la maison d'arrêt de la Santé, il a été indiqué de la même manière à la commission que la participation d'un surveillant à tout type de trafic entraînerait des sanctions disciplinaires et une information du parquet, le problème étant d'identifier et d'apporter la preuve de cette complicité.
La commission souhaiterait par ailleurs que le personnel médical s'implique de manière plus importante dans cette politique de lutte contre les trafics. Le docteur Véronique Vasseur, lors de son audition, a ainsi déclaré : « je ne l'ai pas non plus vue (cette volonté) au niveau de mes collègues médecins, qui disaient que ce n'était pas notre affaire mais celle de la pénitentiaire. A partir du moment où on met en place des structures pour aider les toxicomanes, cela me paraît quand même notre affaire, justement. (...) On pourrait imaginer qu'à chaque fois qu'un détenu « pète les plombs », on puisse éventuellement faire une analyse d'urine. De toute façon cela a une odeur particulière. C'est une chose qui est relativement admise et c'est ce que je trouve extrêmement grave. Le fait qu'il y ait des trafics est autre chose : les détenus ne sont pas des gens honnêtes -c'est l'évidence-, ils trafiquent beaucoup de choses et cela ne peut pas être parfait, mais, en l'occurrence, il s'agit d'une tolérance, à mon avis, pour avoir la paix. »
La lutte contre le trafic et la consommation de drogues en prison doit donc être prioritaire. L'urgence s'impose en ce domaine comme l'a souligné le docteur Véronique Vasseur : « Dans les prisons, la violence augmente sans arrêt, qu'il s'agisse des automutilations, des tentatives de suicide ou des agressions. Je ne dis pas que c'est le fait du cannabis, mais, alors que c'est une population extrêmement perturbée, cela ne va pas s'arranger en prison et on sait que le cannabis peut déclencher des perturbations psychiques. Il faut donc arrêter le massacre. »
c) Un objectif prioritaire : préparer la sortie de la détention
(1) L'exemple des Pays-Bas
A l'occasion de son déplacement aux Pays-Bas, la commission s'est penchée sur le système néerlandais de prise en charge des toxicomanes délinquants et a visité la prison de Hoogvliet, aux environs de Rotterdam.
|
LA PRISON POUR TOXICOMANES DE HOOGVLIET La prison pour toxicomanes de Hoogvliet est opérationnelle depuis 2001 et accueille 192 détenus. La prison est peu sécurisée (pas de barbelés ni de filets mais des caméras et un mur de 5 m de haut), le profil de la population carcérale ne le justifiant pas. Elle comporte un gardien pour cinq détenus. Chaque détenu dispose d'une cellule individuelle, mais on envisage de créer des cellules doubles en raison du manque de places. Les syndicats de surveillants sont opposés à cette formule en raison du fait que 20 % des détenus ont des problèmes psychiatriques. La prison de Hoogvliet a été construite pour répondre particulièrement au problème de la délinquance liée à l'usage des drogues. La population des quartiers les plus exposés de Rotterdam s'est mobilisée contre les nuisances liées à la consommation et à la vente de stupéfiants : 12 % des toxicomanes sous méthadone causaient 85 % des nuisances. Afin de lutter contre la petite délinquance liée à la drogue (vols, agressions, etc.), les différents acteurs (police, justice, travailleurs sociaux, médecins) ont mis en place un programme pénal spécifique pour les toxicomanes, alliant désintoxication et resocialisation. Ce programme est imposé par le juge aux toxicomanes majeurs qui ont commis en cinq ans plus de trois actes délictueux liés à la drogue. Les détenus accueillis à Hoogvliet se partagent en deux catégories, qui occupent des parties séparées de la prison : - 120 non toxicomanes qui dépendent du « régime sobre » (courtes peines de 2-3 mois) ; - 72 toxicomanes qui suivent un programme d'accompagnement pénal progressif de deux ans. Ces derniers sont le plus souvent des héroïnomanes, en moyenne âgés de 30 ans, qui consomment depuis près d'une quinzaine d'années. Chaque détenu est suivi par deux « mentors » et, à la différence des autres prisons néerlandaises, les détenus travaillent en relation directe avec le directeur de la prison. Le programme d'accueil des détenus toxicomanes peut être ainsi présenté : - lors de leur entrée (24 places), de nombreux entrants reçoivent de la méthadone mais tous sont rapidement sevrés. Pendant la première phase, les exercices physiques sont encouragés. Les détenus peuvent également travailler en atelier (toutes les prisons néerlandaises doivent proposer quatre heures de travail par jour aux détenus), aller en bibliothèque et participer à des activités en fin de journée. Les nouveaux entrants s'engagent à suivre le programme jusqu'à son terme en apprenant à gérer leur temps libre et leur agressivité, en participant aux activités et en choisissant un objectif à partir d'une « feuille de route ». Les rares détenus qui ont refusé de suivre le programme ne peuvent participer aux activités, ne sont pas rétribués et restent confinés dans leur cellule ; - dans la section motivation, les détenus disposent de plus de confort ; ils ont plus de possibilités d'activités et prennent leurs repas ensemble ; - dans la phase semi-ouverte, les détenus peuvent progressivement se rendre à l'extérieur et y exercer une activité, à condition de rendre compte de tous leurs déplacements, de leurs rencontres et de respecter les horaires fixés chaque semaine selon un programme individuel. Ils peuvent également travailler au sein de la prison, notamment à la bibliothèque ou la cuisine. Ils ont l'obligation de relever d'une association à l'extérieur de la prison pour engager une resocialisation et préparer leur sortie. Ils se prennent progressivement en charge et cuisinent par exemple eux-mêmes leurs repas. Les cellules sont des chambres individuelles, dépourvues de barreaux aux fenêtres ; il est possible de circuler librement la nuit dans cette partie de la prison. En fin de programme seulement, les détenus peuvent librement avoir un contact avec les visiteurs. A leur sortie, la ville de Rotterdam leur offre un logement provisoire et leur facilite des contacts avec des entreprises. En outre, ils font l'objet d'un suivi par les services sociaux pendant six mois. En revanche, il existe pas de système de post-cure aux Pays-Bas où l'on considère qu'un ancien toxicomane peut à nouveau consommer, s'il le souhaite, même hors de son milieu d'origine. Le principe est plutôt de les « armer » au maximum pendant le temps de prise en charge (sevrage, accompagnement psychologique et social) pour leur permettre de résister ensuite aux tentations. En cas de rechute, le programme pénal pour toxicomane peut être reconduit autant de fois qu'il est nécessaire. De la même façon, si un détenu rechute (des fouilles et des contrôles urinaires sont régulièrement organisés) pendant les deux années du programme, il revient à la phase précédente ou perd certains privilèges. S'il est encore trop tôt pour faire un bilan de cette initiative, les responsables du programme estiment qu'un taux de réussite de 20 % serait satisfaisant au regard de la population accueillie. |
(2) Une nécessaire préparation des détenus à leur libération
Depuis 1997, la prise en charge des toxicomanes en milieu carcéral est complétée par les unités pour sortants (UPS), dispositifs de préparation à la sortie destinés aux personnes incarcérées libérables présentant un problème de dépendance. Initiées en 1992 avec le « quartier intermédiaire sortants » de la maison d'arrêt de Fresnes, sept autres UPS ont été créées depuis dans des centres pénitentiaires à Lille, Lyon, Strasbourg, Marseille, Metz, Nice et à la maison d'arrêt pour femmes de Fresnes. Les UPS sont des unités particulières de détention où sont affectés, en général un mois avant leur sortie, des détenus présentant des problèmes de dépendance. Ils bénéficient d'activités de groupe (sports, théâtre, etc.), de stages d'aide à l'emploi et de conseils pour engager des démarches administratives (notamment pour obtenir un logement). Ces unités s'appuient sur une dynamique de groupe, la direction et l'animation des UPS étant assurées par un CSST en milieu pénitentiaire.
Si la nécessité d'un dispositif d'aide à la sortie est indispensable, notamment pour les détenus anciennement toxicomanes les plus fragiles, certaines dérives ont été observées, qui ont été notamment dénoncées par le docteur Francis Curtet lors de son audition : « Face à cela, c'est un énarque qui m'a dit un jour : « Quand les gens vont en prison, ils décrochent physiquement et quand ils sortent, s'ils ont envie de se droguer, ils risquent d'avoir une overdose dès le premier soir de leur sortie ; il me paraît donc essentiel, avant qu'ils sortent, de les remettre à la drogue pour éviter l'overdose à la sortie ! » (...) C'est ainsi que l'on a décidé de donner du Subutex systématiquement, dans certaines prisons, à un mois de la sortie. Certains médecins-chefs le font, d'autres disent qu'il est hors de question de le faire. De toute façon, certains détenus disent : « Vous êtes fou ? Je suis décroché ; je n'en veux pas ! », mais d'autres sont très contents. Il est vrai qu'ils ont la paix avec cela. »
La commission tient par ailleurs à souligner l'insuffisance du dispositif d'accompagnement lors de la libération des détenus : en effet, le bilan du plan triennal fait apparaître que les capacités d'accueil de ces structures ont été réduites de 27 % entre 1999 et 2001 et que l'on reste, avec environ 10.000 détenus concernés par an, très en deçà des années 1989-1990.
Si ce dispositif mérite d'être développé, il n'a pas le monopole de la prise en charge des détenus ex-toxicomanes en fin de détention puisqu'il s'inscrit dans une politique plus vaste d'aide à la réinsertion exposée par M. Didier Lallement à la commission : « La remise en liberté des personnes toxicomanes doit être préparée, puisqu'on sait, par définition, que ce sont des personnes fragiles. Les personnes sortant de prison sont en situation de fragilité et nous avons une importante politique d'aide à la sortie de prison qui se traduit par des aides aux plus démunis et aux indigents pour se payer une nuit d'hôtel et éventuellement leur billet de retour. Au delà, nous essayons, en relation avec les services soignants, d'assurer une continuité dans la prise en charge des détenus, une fois qu'ils ne le sont plus, avec le dispositif extérieur afin que des liens et des ponts soient établis avec ceux qui concourent, de près ou de loin (associations, collectivités locales, etc.) à cette lutte contre la toxicomanie. C'est difficile. J'observe en effet que la sortie des détenus est quelquefois, pour les associations locales, un sujet qui paraît lointain parce que le détenu ne se réinstalle pas à l'endroit de sa détention : il habite ailleurs. Il y a donc une visibilité dans la continuité qui est assez difficile à avoir. Nous nous y employons notamment avec les services pénitentiaires d'insertion et de probation, puisque vous savez que l'administration pénitentiaire n'agit pas uniquement dans le milieu fermé et qu'elle est aussi composée de 2 000 travailleurs sociaux qui travaillent sur les mesures du milieu ouvert et qui nous permettent, dans la limite de nos moyens, d'assurer cette liaison ».
La commission estime également nécessaire de renforcer les dispositifs de réinsertion, notamment en développant les partenariats avec les structures qui agissent, pour les toxicomanes non détenus, dans le domaine de la post-cure.
B. FAVORISER DES MÉTHODES INNOVANTES DE TRAITEMENT
1. Des modalités nouvelles de prescription des traitements de substitution
a) Un nécessaire rééquilibrage au profit de la méthadone
(1) Un déséquilibre préoccupant
Comme il a été vu, le détournement du Subutex pour un usage toxicomaniaque ou à des fins de trafic est facilité par la fréquence de sa prescription, alors que la méthadone n'est que faiblement prescrite. Lors de son audition, le professeur Lucien Abenhaïm, directeur général de la santé, a ainsi expliqué les raisons de ce déséquilibre : « Notre pays se caractérise par une très grande accessibilité au Subutex, en particulier à la buprémorphine, et une accessibilité moindre à la méthadone. (...) La diffusion du Subutex et la faible diffusion de la méthadone en particulier ont été liées au fait que pendant très longtemps, notre pays a fait l'objet d'une idéologie anti-utilisation de la substitution. (...) Cette politique était très en retard par rapport à celle des autres pays, qui l'utilisaient depuis plusieurs années. La méthadone a donc joué d'une mauvaise image, entretenue par des gens qui étaient contre la politique de substitution en général. Ensuite, d'abord le MS quantun, puis le Subutex ont pu bénéficier d'un préjugé favorable. »
Une telle situation plaide pour un rééquilibrage des prescriptions en faveur de la méthadone, ainsi que l'a reconnu le professeur Lucien Abenhaïm devant la commission : « Les aspects négatifs sont pour nous la faible accessibilité de la méthadone et la prévalence du Subutex. Très clairement, nous pensons que la méthadone devrait se développer beaucoup plus. Le nombre de centres qui l'offrent n'est pas suffisant. Le personnel n'est pas toujours aussi compétent et surtout aussi nombreux que nous le voudrions. Sur 202 centres de soins pour toxicomanes, 48 ne prescrivent pas du tout de méthadone, ce qui est tout à fait anormal. On devrait pouvoir l'offrir dans tous les centres. (...) Pour lutter contre l'utilisation détournée de Subutex, détourner le trafic de Subutex d'une part et l'utilisation détournée par les injections individuelles d'autre part, les deux grands types d'utilisation détournée, nous travaillons sur la disponibilité et la multiplication de l'utilisation de la méthadone, qui ne présenterait pas les mêmes difficultés et qui par ailleurs peut présenter des avantages que le Subutex ne présente pas. »
Les acteurs de terrain appellent également de leurs voeux un tel rééquilibrage comme l'a indiqué M. Jean-Pierre Lhomme, responsable des missions « échange de seringue » et « bus méthadone » à l'association Médecins du monde, devant la commission : « Il nous semble que le cadre réglementaire, notamment la loi de 1970, mais aussi les autres cadres réglementaires, ceux qui encadrent par exemple les traitements de substitution, doivent se nourrir des avancées des propositions de soins et évoluer tout autant à la mesure du contexte. Cela permettrait, entre autres, de rééquilibrer l'actuel ratio méthadone/buprémorphine, qui ne reflète pas vraiment l'adéquation de la qualité de ces deux médicaments de substitution, pour une meilleure prise en charge de l'addiction aux opiacés. »
(2) Les moyens du rééquilibrage méthadone/buprémorphine
Si le plan triennal 1999-2001 avait inscrit le rééquilibrage de la prescription des deux produits de substitution afin de lutter contre l'usage détourné et le trafic du Subutex, le récent bilan qui en est fait par l'OFDT montre que les résultats sont loin d'être à la hauteur des objectifs et que les efforts dans ce sens doivent être poursuivis.
- Etendre la possibilité de primo-prescription de méthadone aux médecins dans les établissements de santé afin d'en faciliter l'accès aux populations à risque accueillies à l'hôpital ou en milieu carcéral, qui ensuite, habituées à ce traitement, seraient moins tentées d'utiliser le Subutex.
Depuis 1995, l'initialisation d'un traitement de substitution à base de méthadone était réservée aux médecins des CSST. Ainsi, en milieu pénitentiaire, la primo-prescription n'était possible que lorsqu'un CSST intervient en prison. Afin de rendre la méthadone plus accessible et d'en faire bénéficier les personnes qui ne fréquentent pas les centres spécialisés de soins, la circulaire du 30 janvier 2002 autorise la prescription de la méthadone par les médecins exerçant en établissement de santé, dans le cadre de l'initialisation d'un traitement de substitution pour les toxicomanes dépendants majeurs aux opiacés. La commission ne dispose pas d'éléments permettant de vérifier sa mise en oeuvre sur le terrain.
- Faciliter le relais de la prescription de méthadone en ville afin que le traitement initialisé en CSST soit poursuivi, ce qui suppose que les intéressés continuent à être pris en charge au titre d'un accompagnement social qui conditionne la réussite du traitement, le médecin de ville n'en ayant ni le temps, ni les capacités en termes de formation.
A cet égard, l'OFDT constate que l'implication des médecins dans la prise en charge des personnes toxicomanes n'a guère évoluée depuis 1998 : le pourcentage de médecins ayant vu au moins un patient toxicomane au cours des douze derniers mois n'a guère évolué pendant la période d'application du plan triennal (79 % en 1998 contre 81 % en 2001), comme d'ailleurs ceux qui ont vu dix patients ou plus (22 % contre 19 %). On notera également que le pourcentage de médecins recevant des patients occasionnels est de moins en moins élevé (75 % en 1998, 63 % en 2001). Par ailleurs, deux médecins sur trois indiquent qu'il leur arrive de refuser de suivre certains patients qui viennent en consultation, les deux raisons les plus fréquemment invoquées étant le fait de « venir pour leur dose » et le refus de « respecter le contrat ». La sensibilisation à la substitution prioritaire à la méthadone apparaît donc indispensable, sauf à entraver le développement de la primo-prescription.
- Préciser les indications respectives des deux traitements aux patients et améliorer leur information sur les conditions nécessaires à leur réussite et sur les risques associés aux mésusages.
b) Une lutte nécessaire contre le trafic de Subutex
(1) La responsabilisation des professionnels de la santé
- Certains médecins prescripteurs négligent l'accompagnement médico-psycho-social de leurs patients, et ne contrôlent pas de manière satisfaisante l'éventuel nomadisme médical de ceux qui viennent les consulter pour un traitement de substitution. Il convient donc de mieux les informer des risques associés au Subutex et de les inciter à ne traiter que des « patients fidèles », certaines prescriptions trop facilement délivrées contribuant à alimenter directement le marché parallèle du Subutex.
Lors de son déplacement au centre de soins Saint-Germain Pierre Nicolle, il a été indiqué à la commission que, si 90 % des médecins font preuve de modération en la matière, les autres, bien connus des différents intervenants en toxicomanie, prescrivent de manière déraisonnable. On notera à cet égard que les contrôles et éventuelles sanctions des caisses primaires d'assurance maladie (le code de la sécurité sociale donne possibilité aux CPAM de convoquer les médecins concernés et de les sanctionner si nécessaire) ne sont mis en oeuvre qu'exceptionnellement : le centre Pierre-Nicolle n'a, par exemple, été contrôlé que deux fois en sept ans pour la prescription de Subutex.
Se pose en outre le problème des prescriptions associées aux traitements de substitution : beaucoup de médecins prescrivent en effet des médicaments psychotropes malgré les risques de polyconsommation et en dépit des mises en garde du Conseil national de l'Ordre des médecins.
- Si les pharmaciens ne sont concernés qu'indirectement par le trafic de Subutex, car ils ne font qu'appliquer les prescriptions des médecins, il est également indispensable de les sensibiliser à cette question : un article du bulletin de l'Ordre national des pharmaciens, publié en février 2003 met ainsi en garde ces derniers contre le trafic de Subutex.
Par ailleurs, un contrôle plus rigoureux de la délivrance du Subutex par les pharmaciens apparaît nécessaire, en liaison avec les prescripteurs. A cet égard, le professeur Lucien Abenhaïm a déclaré lors de son audition : « J'ai rencontré encore très récemment le président du Conseil de l'Ordre national des pharmaciens et nous travaillons avec l'AFSSAPS pour mieux contrôler la dispensation de ces produits. Il faut trouver y compris des modifications au niveau réglementaire. (...) J'ai rencontré le président de l'Ordre des médecins pas plus tard qu'avant-hier ou la semaine dernière pour en parler, pour trouver des mesures, en particulier pour faire des liens entre le prescripteur et le dispensateur. »
- On notera enfin que certains visiteurs médicaux font preuve d'activisme sur ce produit, qui ne devrait pourtant faire l'objet d'aucune publicité et qui est même prescrit à des non-toxicomanes. Il serait sans doute souhaitable d'imposer à la commercialisation du Subutex des règles particulières en interdisant toute activité en ce domaine aux visiteurs médicaux.
Il reste que ces diverses mesures ne pourront être mises en place sans une volonté forte des autorités compétentes, notamment dans l'application des sanctions. La commission se félicite à cet égard des propos tenus devant elle par M. Didier Jayle, président de la MILDT : « Ces pratiques doivent cesser au plus vite. J'ai alerté les autorités compétentes et je pense pouvoir vous dire que dans les semaines qui viennent, des mesures extrêmement énergiques vont être prises à l'encontre de ces prescripteurs qui, par inconscience ou pour d'autres raisons, ont une dérive grave et qui l'est d'autant plus qu'elle risque de nuire à l'ensemble du dispositif de réduction des risques qui est extrêmement positif » , ainsi que par M. Jean-François Mattei : « Deux réunions sur le mésusage et le détournement de buprémorphine au dosage Subutex se sont tenues au cabinet le 14 janvier et le 20 mars pour faire le point sur la situation et envisager diverses mesures. » La commission ne peut que souhaiter que ces mesures soient rapidement mises en oeuvre notamment contre ces prescripteurs.
(2) Une délivrance du Subutex qui doit être contrôlée
• Une délivrance plus régulière
Il apparaît tout d'abord indispensable de fractionner la délivrance de Subutex pour limiter les détournements d'usage. On rappellera à cet égard que l'arrêté du 24 septembre 1999 a précisé que la délivrance du médicament doit être fractionnée par période maximale de sept jours (avec possibilité pour le médecin de demander au pharmacien que le traitement soit délivré en une seule fois pour une période de 28 jours maximum si la situation particulière du patient l'exige), et non plus tous les 28 jours comme auparavant.
Force est cependant de constater que les mésusages de Subutex persistent, voire s'amplifient, comme le font apparaître les informations fournies dans le cadre du réseau TREND 120 ( * ) : « Certains usagers disent écouler le plus souvent une partie de leur prescription soit en la vendant, soit en la troquant contre d'autres produits (cocaïne) ». Devant ces pratiques, la nécessité de durcir à nouveau le cadre d'utilisation du Subutex doit être prise en compte par les autorités sanitaires. La commission ne peut que se féliciter de cette réflexion concernant les traitements de substitution de la préparation d'un projet de circulaire par la DGS et souhaite que ces nouvelles mesures soient rapidement mises en oeuvre afin d'endiguer le phénomène.
• Une personnalisation des filières de soins
Afin d'éviter les détournements tout en conservant les patients dans les systèmes de soins ambulatoires, la CNAMTS propose la mise en place de filières personnalisées de soins. La régulation par les seuls moyens de la réglementation actuelle reste en effet insuffisante, la procédure de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale sur la procédure de soins reposant sur l'accord du patient.
La CNAM a proposé en conséquence au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, par une lettre en date du 31 mars dernier, la mise en place de filières personnalisées de soins. Cette proposition rejoint d'ailleurs celle exprimée depuis quelques mois par les différents intervenants du système de santé (conseils nationaux de l'Ordre des médecins et des pharmaciens, AFSSAPS,...).
Ces filières permettraient d'améliorer le suivi de l'ensemble des traitements de substitution en organisant efficacement les relations entre médecin traitant, pharmacien, patient et assurance maladie : lors des consultations, les patients toxicomanes s'engageraient avec les soignants et le service médical de l'assurance maladie à suivre un protocole de soins.
Le suivi thérapeutique des patients toxicomanes devrait ainsi être amélioré en réservant la prescription et la délivrance des traitements de substitution à des professionnels de santé spécialement formés. Des formations, ou au moins la délivrance systématique d'une information sur les risques associés aux mésusages des traitements de substitution et sur les sanctions encourues par les professionnels en cas de non-respect du mode de délivrance, doivent donc être mises en place pour les médecins et pharmaciens concernés.
Ce dispositif, mis en oeuvre à titre expérimental dans certains départements, destiné à fidéliser les clients « nomades » et à éviter les posologies journalières supérieures à 30 mg, s'est traduit par une réduction de la consommation de 80 %. La commission souhaite que cette expérimentation soit poursuivie et, après validation, éventuellement généralisée sur l'ensemble du territoire national.
c) De nouvelles méthodes de substitution
L'un des mésusages les plus fréquents du Subutex résulte de son injection par voie intraveineuse. Il apparaît nécessaire de modifier sa présentation actuelle sous forme galénique afin d'éviter cette utilisation détournée (on rappellera que la méthadone peut être ingérée sous forme de sirop). Plus largement, il s'agit d'élargir la palette des médicaments utilisables pour la substitution pour répondre à la diversité des situations rencontrées et donc de développer les essais cliniques requis.
Il reste que certains consommateurs d'opiacés sont non seulement dépendants au produit, mais également à son mode d'injection par voie intraveineuse, comme l'a indiqué M. Jean-Pierre Lhomme, responsable à l'association Médecins du monde, lors de son audition. A ce sujet, M. Didier Jayle, président de la MILDT, a indiqué à la commission : « Le fait de concevoir un produit injectable me paraît être une piste à creuser. Elle aurait un autre intérêt, qui est le milieu carcéral. Tout le monde sait qu'on s'injecte des drogues dans les prisons. Toutes les personnes de l'administration pénitentiaire savent que cela se passe, qu'il n'y a pas de programme d'échange de seringues dans les prisons. Cela pose beaucoup de problèmes car cela signifie que l'on reconnaît que l'héroïne circule, de la cocaïne et d'autres produits, car on peut s'injecter n'importe quoi. » Sous réserve d'un contrôle particulièrement strict de la délivrance, ce type de produit, destiné à une catégorie très spécifique de toxicomanes dépendants à l'injection et pendant un temps provisoire, permettrait de ne pas faire courir de risques supplémentaires à ces populations les plus à risque, tout en les engageant dans un porcessus de soins.
Concernant la mise en place d'un programme de distribution d'un produit de substitution injectable, un groupe de travail réunissant la DGS, l'AFSSAPS, la MILDT et l'OFDT a été mis en place en 2001. Dans ce cadre, l'OFDT a confié à un groupe de chercheurs étrangers une recherche documentaire sur les différents essais cliniques concernant les programmes à base d'héroïne médicalisée et injectable et ses incidences dans les principaux pays concernés (Royaume-Uni, Suisse, Allemagne, Espagne, Etats-Unis et Australie).
La commission ne peut qu'être réservée quant au principe même de distribuer de l'héroïne à ce type de toxicomanes, même sous contrôle médical (dans des salles dites d'injection). Une expérience a été menée dans ce domaine à Amsterdam avec l'héroïne et la méthadone : les résultats ne sont pas apparus véritablement concluants, ces programmes ayant fait l'objet d'une évaluation en février 2002, puis d'un débat animé au Parlement néerlandais. Si ces programmes ont été renouvelés, leur nombre n'a pas été augmenté, le Parlement estimant que la prudence devait rester de mise quant à ce type de prise en charge, qui doit rester limité à une petite minorité de toxicomanes.
2. Le nécessaire développement des programmes de recherche sur les drogues
a) Des connaissances encore insuffisantes sur les produits
(1) Un socle de connaissance commun à élaborer
La commission l'a constaté au fil des nombreuses auditions qu'elle a menées : il n'existe pas de socle de connaissances communes sur la question de drogues. Si certains points font l'objet d'un consensus scientifique, les effets dramatiques de la consommation d'héroïne par exemple, d'autres sont encore discutés, comme le montrent les débats actuels sur la dangerosité du cannabis ou des nouvelles drogues de synthèse. Ces divergences d'experts (pharmacologues, toxicologues, médecins, psychiatres, etc.) ne peuvent que nuire à la clarté du message d'information et de prévention et alimenter les débats sur la réglementation à appliquer, notamment en direction des usagers de cannabis. Dans un rapport particulier de 1998, la Cour des comptes a ainsi indiqué : « Les connaissances tant épidémiologiques que scientifiques en matière de toxicomanie demeurent à l'évidence insuffisantes pour fonder l'action publique sur des bases rationnelles. »
Certes, un pas important a été franchi avec l'expertise collective de l'INSERM sur le cannabis : par son caractère scientifique rigoureux, elle répond au discours de ceux qui plaident pour une dépénalisation de ce produit en raison d'une prétendue innocuité.
Le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques indique par ailleurs plusieurs pistes de recherche prioritaires en ce domaine :
- « Il est désormais possible, et sans doute nécessaire et urgent de se préoccuper davantage de l'irruption de nouvelles drogues de synthèse et par conséquent de mettre au point un système d'exploration et de comparaison, propre à donner les premières indications sur leur dangerosité au sens large. Les autorités doivent pouvoir réagir rapidement ; aussi paraît-il indispensable et urgent de doter notre pays d'un outil performant pour comprendre la nature des nouveaux produits. »
Comme il a été dit, la commission souhaite qu'une structure, s'inspirant de l'expérience néerlandaise de l'USD puisse être mise en place en France.
Il conviendrait également que les laboratoires de recherche de l'industrie pharmaceutique s'impliquent dans cette action, notamment s'agissant de :
- la recherche fondamentale sur l'héroïne, pour améliorer les traitements, en particulier à travers l'étude moléculaire des opiacés ;
- l'action des drogues sur l'organisme, à travers les paramètres de la dépendance, les facteurs de vulnérabilité génétique, le caractère réversible des effets psychiques et physiologiques ;
- la recherche en neuropsychiatrie, notamment pour améliorer les connaissances sur l'effet des nouvelles drogues.
(2) Une recherche à dynamiser
• Les carences de l'Etat
Dans son rapport de 1998, la Cour des comptes souligne que l'Etat ne joue pas son rôle en matière de recherche sur la toxicomanie, l'affichage des programmes gouvernementaux successifs relatifs au développement des différents domaines de recherche ne devant pas à cet égard faire illusion. En effet, le plan gouvernemental du 9 mai 1990 comme le programme d'action du 14 septembre 1995 n'ont guère été suivis d'effets, ainsi que le montre la reprise périodique des mêmes objectifs : renforcement de la recherche, mise en place d'un comité d'évaluation, adaptation des messages préventifs...
On rappellera par ailleurs que les chercheurs spécialisés en ce domaine appartiennent souvent à des équipes pluridisciplinaires réparties entre plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques, essentiellement l'INSERM et deux départements du CNRS : celui des sciences de l'homme et de la société et celui des sciences de la vie. Face à cette dispersion, le ministère de la recherche, au sein duquel trois départements différents (biologie, médecine, santé ; sciences humaines et sociales ; sciences politiques, économiques et de gestion) sont concernés, n'a pas joué son rôle d'impulsion et de coordination.
La commission ne peut que déplorer ce manque de coordination et souhaite que le ministère de la recherche joue un rôle central dans la programmation des recherches en toxicomanie, la centralisation des résultats et leur diffusion.
• Les dispositions du plan triennal relatives à la recherche
Le plan triennal 1999-2001 indique pour sa part qu' « il est indispensable de définir une stratégie claire de recherche qui s'inscrive dans la durée, ainsi qu'une organisation qui permette aux décideurs de disposer des connaissances nécessaires à l'élaboration des politiques publiques. » La coordination de la politique de recherche devait donc être effectuée par la MILDT, avec l'aide de l'expertise scientifique de l'OFDT. Plusieurs actions avaient ainsi été définies pour structurer et développer la recherche : effectuer un état des lieux des connaissances, analyser les différents secteurs de la recherche (recherche neurobiologique et clinique, sciences humaines et sociales, agriculture), développer la recherche (pérennisation de nouvelles équipes, création de bourses pour les jeunes chercheurs qui travaillent dans ce domaine, reconnaissance des spécialités liées à l'études des drogues).
La MILDT a procédé en conséquence à la mise en place d'outils et de dispositifs d'aide aux professionnels, à l'instar de la Commission de validation des outils de prévention en janvier 2000 (pour garantir la fiabilité des contenus et assurer une plus grande cohérence des messages de prévention émis par les différents acteurs du terrain) et des livrets de connaissance et publication destinés aux professionnels (10 titres aujourd'hui disponibles gratuitement et tirés à près de 80.000 exemplaires). La formation professionnelle a également été adaptée, notamment pour les professionnels sans formation initiale dans ce domaine.
Selon le bilan du plan triennal (non publié encore) établi par M. Michel Setbon, chercheur au CNRS, au nom de l'OFDT, « le niveau de réalisation (de cet objectif) peut être qualifié de « bon » et conforme aux engagements pour les campagnes généralistes comme pour la formation professionnelle, même si des lacunes ont été identifiées en matière d'effectivité de certains programmes et d'utilisation de certains outils. Par contre, le niveau d'atteinte de l'objectif final (création d'une culture de référence commune entendue comme diffusion et intégration) n'est pas à ce stade évaluable. »
• Des efforts à intensifier
Malgré ces résultats encourageants, les efforts en matière de recherche sur la toxicomanie doivent être intensifiés, et ceci dans plusieurs directions, comme l'a montré l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques :
- susciter des vocations de chercheurs en renforçant l'enseignement relatif aux toxicomanies dans les facultés de médecine par le redéploiement des chaires et des création de postes ;
- lever les obstacles juridiques liés à l'obligation pour les chercheurs d'obtenir l'accord écrit de la famille avant d'engager une autopsie médico-scientifique, tout en respectant la volonté des défunts et de leurs familles. En outre, il apparaît nécessaire de donner aux chercheurs, dans le respect du secret de l'instruction, la possibilité d'accéder aux données relatives à la drogue figurant dans les procédures judiciaires ;
- créer un établissement public de recherche, sous la responsabilité du ministère de la recherche, centralisant et impulsant les études sur la toxicomanie, à l'image du NIDA (National institute on drug abuse) américain.
3. La nécessité de promouvoir de nouveaux savoir-faire
a) Une prise en charge élargie à l'ensemble des produits
Si la prise en charge des toxicomanes aux opiacés apparaît satisfaisante, tout du moins sur un plan technique, certains comportements de consommation nécessitent le développement de nouveaux savoir-faire. Il en est ainsi de la consommation régulière et intensive de cannabis, la consommation de psycho-stimulants, de drogues de synthèse, de benzodiazépines, de crack ou de cocaïne. Cette question est liée à celle du développement de la recherche clinique : un certain nombre d'expérimentations sont en cours, mais il convient d'organiser leur évaluation et leur développement.
Lors de son audition, le docteur Michel Hautefeuille, psychiatre au Centre Marmottan, à ainsi indiqué à propos de l'absence d'une prise en charge spécifique des consommateurs de cannabis malgré les besoins : « A l'évidence, en dépit de tout le débat qui existe sur le cannabis, nous constatons d'un point de vue clinique que des gens sont véritablement en souffrance par rapport a cannabis, qu'ils ont un usage véritablement problématique du cannabis et qu'ils viennent nous consulter sur ce point. Ils vont donc être accueillis, suivis, orientés ou pris en charge à Marmottan de la même façon qu'un héroïnomane ou un cocaïnomane, même si les enjeux sont différent ». L'insuffisance des savoir-faire concernant la consommation de cannabis est d'autant plus problématique que la dépendance n'est pas toujours avérée, notamment au niveau physique.
De la même façon, il est nécessaire de développer des méthodes de prise en charge des usagers de cocaïne, notamment par la recherche d'un traitement de substitution adapté, ainsi que l'a évoqué le docteur Didier Jayle, président de la MILDT, devant la commission : « En ce qui concerne la cocaïne, je crois là qu'il y a vraiment un travail de recherche à faire. Nous ne disposons pas pour la cocaïne des traitements de substitution que nous avons pour l'héroïne. Nous sommes extrêmement démunis dans la prise en charge. En plus, il y a très souvent un contexte de polyconsommations, qui rend les choses très difficile. Là, il faut vraiment stimuler les recherches fondamentales certainement, mais beaucoup aussi les recherches cliniques et ouvrir des centres de référence de traitement pour les personnes dépendantes à la cocaïne et également au crack. »
L'un des enjeux principaux de la recherche clinique est donc actuellement de trouver des moyens de soigner les toxicomanes non héroïnomanes, notamment les usagers de cannabis, de cocaïne et les polyconsommateurs.
b) Une gestion plus satisfaisante des situations de grande précarité
La recherche clinique en matière de drogues doit également prendre en compte la réalité du terrain ; pour cela, elle doit s'articuler avec la recherche d'un dispositif efficace de prise en charge des personnes en marge du système de soins. Rien ne sert en effet de développer de nouveaux modes de prise en charge s'il ne profitent pas à ceux qui en ont le plus besoin.
Comme il a été dit, au-delà de la diminution des risques infectieux qui en constitue l'objectif de santé publique principal, la politique de réduction des risques s'attache à atténuer les problèmes sanitaires et sociaux associés aussi bien à l'usage qu'à la recherche de drogues : complications sanitaires liées à l'utilisation de la voie veineuse ou aux effets pathologiques des produits consommés, dégradation des liens sociaux et familiaux, violence et délinquance associée... La légitimité de la politique de réduction des risques ne se limite pas à la simple distribution de matériel d'injection stérile : en acceptant la dépendance des usagers de drogues, elle permet d'entrer en contact avec les plus marginalisés et les plus vulnérables, et de leur proposer une offre adaptée de soins et de réinsertion.
Toutefois, cette prise en charge des usagers les plus marginalisés s'avère difficile, tant pour les hôpitaux que dans le cadre du dispositif spécialisé. On constate cependant que ce sont ces individus qui choisissent le plus souvent les traitements de substitution par Subutex, délivré par les médecins de ville avec un contrôle plus restreint que pour la méthadone, parce qu'ils sont souvent dans l'incapacité d'envisager une relation quotidienne suivie avec une structure de soins. Ce sont également eux, ainsi que le montrent les données de la MILDT sur le trafic de Subutex, qui font une utilisation détournée de ce produit, à des fins toxicomaniaques ou de trafic.
On imagine donc facilement que l'étape suivante, celle du sevrage et de la réinsertion, est encore plus difficile à mettre en oeuvre pour ce type de populations. Il est donc indispensable de renforcer et de poursuivre le développement des structures destinées aux personnes les plus fragilisées et marginalisées, pour lesquelles une étape intermédiaire apparaît nécessaire entre la distribution du traitement de substitution et, au moment où une action de réinsertion est mise en oeuvre, le passage en appartement thérapeutique ou en famille d'accueil.
Pour permettre une meilleure prise en charge des toxicomanes en situation de grande précarité sanitaire et sociale, qui n'ont parfois ni accès à la substitution, ni même à un programme de réduction des risques, la commission considère que l'effort doit être poursuivi dans le domaine du primo-accueil (« sleep'in » notamment) et des équipes de proximité, afin que ces usagers puissent tous être « accrochés » par le système de soins. Ces structures permettent en effet, à travers leur fonction d'orientation et de médiation en direction du dispositif de prise en charge sanitaire et sociale, de nouer un premier contact avec les toxicomanes marginalisés et de les inciter à demander une aide (traitement de substitution, sevrage voire réinsertion...). Au terme de cette prise en charge, le dispositif de réinsertion doit tenir compte de leur absence de repères à l'extérieur, celle-ci étant de nature à compromettre leur sortie et à favoriser les rechutes : le volet social de la réinsertion doit donc être développé dans les structures de post-cure.
Le développement de ces structures pose toutefois le problème de leur acceptation par les riverains, qui peuvent craindre que leur quartier devienne un point de rassemblement d'usagers de drogues très marginalisés. Ces réticences, qui peuvent être légitimes, doivent être prises en considération et un véritable dialogue doit se développer entre les autorités, les associations et les riverains, notamment via les équipes de proximité.
C. ABORDER LE PROBLÈME DE L'USAGE DES DROGUES EN MILIEU PROFESSIONNEL
1. La législation actuelle en matière de drogue en milieu professionnel
Compte tenu de la réalité de la drogue au travail qui a été évoquée précédemment, les entreprises ne peuvent se désintéresser du problème de la toxicomanie. Les conséquences de la consommation de drogues dans les domaines de la sécurité, de la santé et de la sûreté commandent de mettre en place une politique de lutte contre l'usage de drogues, notamment par la mise en place d'un dispositif de dépistage des toxicomanies au sein des entreprises.
On rappellera cependant que la toxicomanie du salarié peut d'ores et déjà être appréhendée dans le cadre juridique existant, qui est sans doute insuffisant.
a) Les dispositions du code du travail en vigueur
Le code du travail réglemente les rapports sociaux entre les employeurs et les salariés, les conditions d'hygiène et de sécurité au travail dans les entreprises ainsi que l'organisation de la médecine du travail. Il offre trois possibilités pour appréhender la toxicomanie au travail : le pouvoir disciplinaire de l'employeur, l'état de santé du salarié toxicomane et la responsabilité générale qui pèse sur l'employeur en matière d'application des règles d'hygiène et de sécurité.
(1) Toxicomanie du salarié et droit disciplinaire
On rappellera que le chef d'entreprise dispose du pouvoir de fixer les règles nécessaires à la vie de la collectivité de travail et de sanctionner le non respect de ces règles. Dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, l'employeur peut donc être conduit à tirer les conséquences du comportement d'un salarié.
• Comportement du toxicomane au sein de l'entreprise
Comme il a été vu, les effets physiologiques et psychiques associés à la consommation de stupéfiants entraînent des changements de comportement qui peuvent s'avérer problématiques, voire dangereux en milieu professionnel. Dans ce cas, l'employeur peut, selon l'importance et la répétition des faits répréhensibles, prendre à l'égard de la personne considérée soit une sanction au sens de l'article L. 122-40 (avertissement, mise à pied disciplinaire, modification du contrat de travail à titre disciplinaire, rétrogradation, mutation, refus d'une augmentation de salaire ou d'un avancement), soit une mesure de licenciement.
Le fait générateur de la sanction ou du licenciement n'est donc pas lié à l'état de toxicomanie du salarié, mais à certaines manifestations de comportement qui peuvent en résulter. En pratique, le chef d'entreprise pourra d'ailleurs ignorer l'état réel du salarié en cause. Toutefois, la toxicomanie d'un salarié, à supposer qu'elle soit connue et démontrée, peut dans bon nombre d'hypothèses constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, tout en tenant compte des fonctions exercées et du poste occupé par l'intéressé.
• Introduction de la drogue en entreprise par un salarié
L'introduction de la drogue sur les lieux de travail pose divers problèmes juridiques. Plusieurs cas peuvent se présenter : la drogue est introduite pour un usage personnel et consommée dans les locaux de l'entreprise ou son introduction a pour but la revente à d'autres membres du personnel.
L'introduction et la consommation de drogues dans les locaux de l'entreprise et, a fortiori , le trafic de drogues peuvent incontestablement justifier une rupture immédiate du contrat pour faute grave ou même lourde dans certains cas, dès lors naturellement que les faits sont établis.
• Délinquance du salarié toxicomane
Le comportement délictueux du salarié et ses conséquences peuvent également n'avoir aucune incidence sur le lien contractuel avec l'entreprise. C'est par exemple le cas quand un salarié est inculpé, mais laissé en liberté provisoire, pour consommation ou trafic de drogue, ou quand un salarié est incarcéré pour les mêmes raisons.
Le comportement du salarié hors de l'entreprise ne peut, en principe, justifier de mesures disciplinaires de la part de l'employeur puisqu'il se rapporte à sa vie privée. Il en va autrement, selon la jurisprudence, lorsque le comportement, par les échos qu'il a suscités, est de nature à causer un préjudice sérieux et durable à l'entreprise, ou lorsque les agissements peuvent faire courir un risque à l'entreprise ou au personnel. La position hiérarchique du salarié considéré (cadre), comme la nature de l'activité de l'entreprise et du poste (à risque), sont également à prendre en considération pour l'appréciation de la situation.
Selon une jurisprudence constante, l'incarcération du salarié n'implique pas la rupture automatique de son contrat de travail, mais le salarié ne pouvant, et pour cause, assurer les obligations de son contrat, c'est sur ce fondement juridique que la chambre sociale de la Cour de cassation tend à considérer une détention de longue durée comme cas de force majeure autorisant l'employeur à prendre acte de la rupture du contrat, et même à admettre comme non imputable à l'employeur la rupture du contrat d'un salarié dont la durée de détention reste imprévisible. Au regard de ces principes jurisprudentiels, il apparaît que les situations d'inculpation avec ou sans détention, et a fortiori les condamnations pour usage et trafic de drogues, peuvent légitimer dans bon nombre de cas les mesures prises par l'entreprise, même si les faits se sont produits en dehors du temps et des lieux de travail.
(2) Les autres effets de la toxicomanie sur le contrat de travail
• L'injonction thérapeutique
En cas d'injonction du procureur de la République au salarié de subir une cure de désintoxication dans un établissement sanitaire ou de faire l'objet d'une surveillance médicale particulière, le contrat de travail est normalement suspendu, sous réserve des conséquences possibles d'une absence prolongée ou de la nécessité impérieuse pour l'entreprise de pourvoir au remplacement immédiat de l'intéressé. La situation apparaît donc identique à une absence du salarié pour maladie ou pour hospitalisation ordinaire.
• L'inaptitude physique
La toxicomanie du salarié peut conduire le médecin du travail à émettre un avis d'inaptitude, comme il peut le faire à l'embauche, à occuper son emploi. Cet avis s'impose dans tous les cas à l'employeur. Ce dernier n'ayant pas à connaître les raisons de l'inaptitude, il ignorera le plus souvent l'état physique ou psychique du salarié qui a justifié la décision du médecin du travail, état couvert par le secret médical.
L'inaptitude peut être partielle ou temporaire lorsque le salarié ne peut plus, du fait de son état physique ou psychique, assurer normalement son poste de travail. Le médecin du travail peut, selon l'article L. 241-10-1 du code du travail, proposer des mesures de reclassement (mutation, transformation du poste) justifiées par l'état de santé de l'intéressé. Cette inaptitude est totale si le salarié n'est plus en mesure d'assurer un emploi dans l'entreprise. Dans tous les cas, la situation obéit aux mêmes règles que l'inaptitude résultant d'une cause étrangère à la consommation de drogues et peut être traitée conformément au droit commun.
(3) Toxicomanie du salarié et règles d'hygiène et de sécurité
Le problème de la toxicomanie se pose enfin, et même prioritairement, sous l'angle des prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité.
On rappellera que l'employeur est responsable au plan tant civil que pénal, notamment : vis-à-vis des tiers, pour les dommages causés par ses salariés dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions ; pour les infractions à la réglementation de l'hygiène et de la sécurité ; pour son défaut de surveillance dans l'application des règles édictées en la matière.
Le droit du travail reconnaît cependant au chef d'entreprise un pouvoir réglementaire, corollaire de sa responsabilité, propre à assurer le respect des règles et prescriptions. En matière d'hygiène et de sécurité, ce pouvoir s'exprime essentiellement par l'intermédiaire du règlement intérieur, élaboré unilatéralement par l'employeur. Il est également aidé dans sa tâche par l'expertise du médecin du travail.
b) Le rôle central du médecin du travail
(1) Le garant de la situation sanitaire de l'entreprise
Les médecins du travail sont, au regard de la législation du travail, des salariés, soit de l'entreprise, soit du service médical interentreprises. Ils bénéficient, dans l'exercice de leur activité médicale, de l'indépendance professionnelle nécessaire vis-à-vis de l'entreprise ou de l'organisme qui les emploie ; le code de déontologie médicale est à cet égard très explicite.
Le médecin du travail est conseiller de l'entreprise, de la direction, des salariés et des représentants du personnel, notamment en ce qui concerne l'hygiène de l'établissement et la protection des salariés contre les risques d'accidents du travail ou l'utilisation des produits dangereux. A ce titre, il est associé à toutes les actions de prévention des risques dont il est bien souvent l'animateur et participe aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Il peut également être conduit à effectuer, en liaison avec le médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre, des recherches, études et enquête sur toute question d'hygiène et de sécurité.
(2) Un contrôle indispensable à l'embauche
L'emploi d'un salarié sans aptitude médicale délivrée par le médecin du travail engage la responsabilité de l'employeur. Cette aptitude est déterminée lors de la visite médicale préalable à l'embauche, effectuée par le médecin du travail. En tenant compte des conditions de travail du poste considéré, la détermination de l'aptitude médico-professionnelle est une des fonctions essentielles du médecin du travail.
L'article R. 241-48 du code du travail précise que tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauche ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche. Cet examen médical a pour but :
- « de rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
- de s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter ;
- de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ».
Le médecin du travail constitue ainsi au moment de la visite d'embauche un dossier médical qu'il complète après chaque examen médical ultérieur et établit à l'issue de chacun des examens une fiche d'aptitude en double exemplaire, l'un étant remis au salarié et l'autre transmis à l'employeur. L'intéressé est informé des recherches pratiquées et de leurs conséquences. En cas de refus d'examen, l'aptitude ne pourra être déterminée. Le médecin du travail rédigera au vu des résultats la fiche d'aptitude avec ou sans restriction d'aptitude vis-à-vis de la sécurité ou de la sûreté, sans faire apparaître le moindre renseignement pouvant faire soupçonner la raison motivant son avis.
L'avis d'aptitude ou d'inaptitude intègre divers éléments tels que le bilan médical physique et (ou) psychique du salarié et les conditions de travail spécifiques à l'entreprise.
(3) Un suivi continu, notamment pour les postes à risque
Le chef d'entreprise doit faire bénéficier chacun de ses salariés de visites médicales au cours desquelles l'aptitude médico-professionnelle est déterminée en fonction des conditions de travail du poste auquel est affecté ou souhaite être affecté l'intéressé :
- l'article R. 241-49 du code du travail précise que « tout salarié doit bénéficier dans les douze mois qui suivent l'examen effectué en application de l'article R. 241-48, d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Cet examen doit être renouvelé au moins une fois par an. Tout salarié peut bénéficier d'un examen médical sur sa demande » ;
- l'article R. 241-51 du code du travail indique qu'un examen médical doit avoir lieu après une absence pour maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accidents de travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé ;
- l'article R. 241-52 du code du travail précise que le médecin du travail peut prescrire des examens complémentaires nécessaires :
- « à la détermination de l'aptitude médicale aux postes de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
- au dépistage des maladies à caractère professionnel ;
- au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage. »
La seule personne au sein de l'entreprise habilitée à pratiquer de tels examens est le médecin du travail. Il est le seul à pouvoir les prescrire, à en connaître les résultats et à en tirer les conséquences. Tous ces examens et leur environnement sont couverts par le secret médical professionnel. Les prélèvements seront faits par le médecin lui-même ou par un personnel infirmier en lequel il a pleine confiance et sous son entière responsabilité selon un protocole déterminé et dans des conditions permettant la réalisation d'une contre-expertise.
Concernant plus spécifiquement le dépistage de la consommation de stupéfiants, une note du ministère du travail de juillet 1990 consacrée au dépistage de la toxicomanie en entreprise admet que « dans certaines entreprises il existe des postes pour lesquels la détermination de l'aptitude des salariés peut comporter un dépistage de la toxicomanie ». Les postes de travail pour lesquels les salariés sont soumis aux recherches de consommation des produits illicites peuvent concerner tous les échelons de la hiérarchie, y compris le médecin du travail.
Lors des examens prévus par le code du travail, si la consommation de substances illicites ou de produits détournés de leurs fonctions thérapeutiques habituelles ou de leur utilisation normale est suspectée, le médecin du travail n'obtiendra souvent lors de son interrogatoire que des réponses dilatoires ou éloignées de la réalité. Dans cette situation, les signes cliniques sont souvent peu évidents ou même inexistants et le médecin du travail ne pourra établir son diagnostic que sur des examens complémentaires de laboratoire. Ces examens complémentaires devront être effectués dans un cadre strict et limitatif. Le respect de l'anonymat est assuré par le médecin du travail qui choisit l'organisme chargé de les pratiquer. En cas de résultat positif, le médecin du travail conseillera une prise en charge thérapeutique par un service spécialisé.
S'agissant de la détection du cannabis chez un salarié, le docteur Raymond Trarieux a indiqué à la commission : « Ce qui nous préoccupe en médecine du travail, (...) c'est le problème de la dose, notamment pour le haschisch. La dose internationale admise actuellement est 50 ng. Or, si nous considérons les personnes soumises à la consommation, ces 50 ng sont un iceberg, c'est-à-dire qu'il y a 10 % au-dessus et 90 % en dessous. Avec un seuil à 50 ng, (...) nous allons détecter relativement peu de monde. »
L'employeur n'a juridiquement aucun moyen d'exiger pour un salarié un examen particulier complémentaire. Toutefois, il verrait sa responsabilité engagée si l'un de ses salariés toxicomanes provoquait, dans l'exercice de ses fonctions, un accident lié à son état. Il serait alors en droit de remettre en cause la responsabilité du médecin du travail si celui-ci avait délivré des avis d'aptitude au poste, par hypothèse dangereux ou à risque. Ce dernier est soumis à des obligations de résultat (l'hygiène et la sécurité dans l'entreprise), mais aussi de moyens : l'employeur étant en droit de penser que la détermination de l'aptitude est faite en fonction des connaissances médicales du moment.
La commission ne peut donc que constater que les mesures prévues par le code du travail sont largement insuffisantes pour permettre d'endiguer ce phénomène. Des actions devraient être engagées au niveau de chaque entreprise afin que la lutte contre la toxicomanie au travail devienne une véritable priorité sanitaire.
2. La nécessité de mieux prendre en compte la réalité de la drogue au travail
a) Le rôle essentiel des employeurs
(1) La fin d'un tabou ?
S'il a longtemps été tabou, le problème de la drogue au travail semble aujourd'hui faire partie intégrante des problématiques sanitaires et « sécuritaires » des grandes entreprises, ainsi que l'a indiqué le docteur Raymond Trarieux lors de son audition : « Dans certaines entreprises le sujet n'est plus tabou depuis un certain temps, depuis 1985 pratiquement, certaines, ont eu des cas. (...) C'est un peu la même évolution que nous avons observée avec l'alcool au volant. Il ne l'est plus parce que maintenant, tout le monde est conscient qu'il peut avoir chez lui des enfants qui consomment. Nous en entendons de plus en plus parler, ce problème n'est donc plus tabou. La seule difficulté est la mise en place dans les petites entreprises, parce que là la situation est difficile et malheureusement la recherche de drogue coûte cher. A côté de cela, dans d'autres entreprises beaucoup plus importantes, la recherche de drogue fait souvent partie du statut. C'est le cas notamment dans les entreprises aériennes. Dans les entreprises de premier niveau, les gens savent que les salariés auront un contrôle à l'entrée. (...) Dans la SNCF, nous savons parfaitement, puisqu'elle gère elle-même son service médical, que cela fait partie maintenant des recherches classiques et habituelles. C'est passé (...) dans le statut des contrôleurs aériens. C'est également maintenant automatique chez les pilotes de ligne et le personnel navigant lors du renouvellement des licences. De plus en plus cela se met en place, mais dans les grandes entreprises. Le problème surtout dans certains cas (...) est celui de la surveillance des intérimaires et des CDD. »
La commission souhaite donc que l'accent soit mis sur la prise en compte des dangers liés à la toxicomanie en milieu professionnel dans les petites et moyennes entreprises et pour l'ensemble des catégories de personnels mais aussi des produits (y compris les médicaments psychotropes), notamment au travers de campagnes de sensibilisation auprès des chefs d'entreprise.
Un tabou subsiste encore, celui du dopage quotidien. Ce problème a notamment été évoqué devant la commission par le docteur Michel Hautefeuille : « J'emploie le terme de « dopage au quotidien » parce que j'ai une petite expérience clinique par rapport au dopage en milieu sportif et que j'ai le sentiment que les ressorts et les mécanismes sont tout à fait comparables. Dans le milieu sportif, on sait que la pratique du dopage est assez ancienne mais aussi que c'était un tabou, une chose dont il ne fallait pas parler. Dans le monde de l'entreprise, on en est à ce stade : on est actuellement dans le monde de l'entreprise comme on était dans le monde du sport il y a dix ans. A partir du moment où quelqu'un répond à sa charge de travail et qu'il est performant, il peut faire tout ce qu'il veut en toute impunité. Il commence à avoir des soucis quand, malgré la prise de produits ou, parfois, à cause de celle-ci, il n'assure plus. C'est à ce moment-là que les ennuis vont véritablement commencer pour lui. »
(2) La prise en compte de la toxicomanie dans le règlement de l'entreprise
La responsabilité de l'employeur peut être mise en cause suite à des fautes commises par ses salariés. Il peut donc intégrer la question de la lutte contre la toxicomanie dans le règlement intérieur de son entreprise.
Aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail, le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :
- « les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ;
- « les règles générales et permanentes relatives à la discipline et notamment l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ».
Ces mesures d'application sont opposables aux usagers de drogues dans le cadre des examens effectués par le médecin du travail, à condition toutefois que ces recherches soient « justifiées par la nature de la tâche à accomplir » , parce qu'elles répondent à des critères de sécurité et/ou de sûreté au sein de l'entreprise, ou à la sécurité générale de son environnement.
Si ces examens complémentaires sont prévus par le règlement intérieur pour les postes à risque, le protocole retenu pour leur réalisation ne pourra être en opposition avec l'article L. 122-35 du code du travail spécifiant que « le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements, et ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
D'autres dispositions du règlement intérieur autorisant notamment le contrôle par l'employeur des armoires et des vestiaires individuels des salariés, peuvent également concerner le problème de la drogue et sa détention dans les locaux de l'entreprise. Compte tenu de la nécessité de concilier à la fois le respect des libertés individuelles et collectives des salariés et les obligations de l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité, le Conseil d'Etat considère qu'une telle disposition n'est licite que si elle contient certaines précisions : « En dehors des opérations périodiques de nettoyage prévues par le dernier alinéa de l'article R. 232-24 du code du travail et dont les salariés intéressés doivent être prévenus à l'avance, l'employeur ne peut faire procéder au contrôle de l'état et du contenu des vestiaires ou armoires individuelles en présence des intéressés (...) que si ce contrôle est justifié par les nécessité de l'hygiène et de la sécurité. » (C.E., R.N.U.R., 9 octobre 1987).
La commission considère qu'il est difficile de contester que la lutte contre la toxicomanie dans l'entreprise, qui passe notamment par le contrôle de l'introduction de la drogue, ne soit pas une nécessité en matière d'hygiène et de sécurité, et souhaite que de telles mesures soient prévues par les règlements intérieurs des entreprises afin de pouvoir être utilisées en cas de nécessité.
Plus largement, dans le cadre du rappel de l'interdiction stricte de la consommation de stupéfiants en milieu professionnel, les règlements intérieurs des entreprises pourraient évoquer systématiquement cette question et, sans déroger aux principes énoncés dans le code du travail, indiquer que cette interdiction concerne l'ensemble des postes et non pas uniquement ceux considérés comme à risque.
b) Un partenariat à développer avec les différents acteurs de l'entreprise
(1) Engager un dialogue avec les partenaires sociaux
La mise en oeuvre d'une politique efficace de lutte contre les conduites toxicomaniaques au sein de l'entreprise doit évidemment associer les partenaires sociaux, les aménagements du règlement intérieur nécessitant en effet l'avis du comité d'entreprise et, sur la question de la toxicomanie, du CHSCT.
Les partenaires sociaux devront donc être sensibilisés à ce problème afin notamment que le protocole de recherche comme la détermination des postes soumis à surveillance, ainsi que les conditions dans lesquelles un salarié pourra reprendre son poste de travail, puissent être intégrés dans les négociations entre ces partenaires et l'entreprise, sans que la lutte contre la drogue apparaisse comme un moyen de contrôle supplémentaire sur les salariés de la part de la direction. A cet égard, la neutralité du médecin du travail paraît indispensable pour lui permettre de jouer le rôle de tiers.
Ce partenariat devrait être complété par une politique d'information sur les dangers de la drogue et sur son caractère d'interdiction, à l'instar de ce qui a déjà été fait avec succès pour l'alcool.
(2) Une nécessaire sensibilisation des médecins du travail
Force est de constater que la lutte contre la toxicomanie n'est pas dans les faits la préoccupation prioritaire des médecins du travail, ainsi que l'a déploré M. Michel Setbon, chercheur au laboratoire d'économie et de sociologie du travail du CNRS, lors de son audition : « A ma connaissance, ce n'est pas une préoccupation prioritaire des médecins du travail et cela ne donne lieu à aucun relevé quelconque ou à des publications conséquentes sur la question. Cela n'a pas fait partie des priorités, ni même des définitions du champ ou des objectifs du plan triennal. (...) En dehors de quelques traces de lutte contre l'alcoolisme en entreprise, les produits illicites, à ma connaissance, ne font pas partie des recherches systématiques, ou même sporadiques, à l'intérieur du monde du travail pour une raison assez simple : en dehors de la médecine du travail, qui pourrait tomber par hasard sur un cas d'utilisation de produits psychoactifs chez des gens qui sont dans des postes dangereux, exposés ou même normaux, c'est la police qui détecte les usagers de drogues. Or la police n'est pas dans les entreprises. Par conséquent, il n'y a pas grand-chose, en dehors d'une mobilisation du corps des médecins et des inspecteurs du travail qui pensent, d'après ce que j'en sais, que les priorités sont ailleurs. »
La commission estime qu'il convient, parallèlement aux visites médicales et aux dépistages, de développer aujourd'hui l'information sur les dangers associés à la consommation de drogue ou de substances médicamenteuses au travail. En effet, pour le docteur Michel Hautefeuille, auditionné par la commission : « Lorsque, par exemple, un médecin prescrit des anxiolytiques à une certaine dose parce que c'est nécessaire, un certain nombre de patients ne savent pas que, si on dépasse la dose, on entre dans le chemin d'une dépendance tout à fait importante. Chez les personnes dont je parle et qui travaillent en entreprise, il y a souvent, au départ, une prescription médicale qui n'a pas été respectée, par rapport à laquelle ils ont dérapé. C'est ainsi qu'au bout d'un certain nombre d'années, ils se retrouvent avec des quantités énormes de médicaments qui ont souvent des effets contradictoires et qu'ils sont souvent submergés par ces produits. De plus, pour contrecarrer les effets de ces médicaments, ils prennent souvent d'autres produits soit illicites, soit non disponibles en France. »
La commission considère donc que les médecins doivent prendre une place prépondérante dans le dispositif de lutte contre la drogue au travail , comme ils l'ont fait par le passé pour d'autres types de conduites addictives, notamment en développant leur rôle de conseil, ce qui suppose de trouver un équilibre satisfaisant entre les actions conduites au titre de cet objectif et le respect du secret médical , qu'il n'est pas question de remettre en cause, de nier ni d'alléger, comme l'a d'ailleurs rappelé récemment dans une note le Conseil national de l'Ordre des médecins.
*
* *
HUMANISME ET
RESPONSABILITÉ
POUR UNE NOUVELLE POLITIQUE
RÉSUMÉ DES PROPOSITIONS
DE LA
COMMISSION D'ENQUÊTE :
64 propositions autour de 4
priorités
|
I. PRIORITÉ À UNE PRÉVENTION TOTALE Prévention et information 1. Renforcer la coordination interministérielle et privilégier les actions d'information, de prévention et de formation à l'égard des conduites à risques. 2. Lancer une campagne d'information auprès des jeunes sur les dangers sanitaires et sociaux liés à la consommation et au trafic de cannabis, et sur les sanctions pénales encourues. 3. Eriger l'école en fer de lance de la prévention. Aborder les dangers de la drogue dans les programmes scolaires dès le cours moyen. 4. Diffuser des messages de prévention clairs et scientifiquement validés sur les dangers réels de chaque produit, en utilisant des supports adaptés à chaque public. 5. Lancer une campagne d'information auprès des parents afin de leur permettre de détecter des conduites à risques chez l'enfant, et de réagir. 6. Coordonner l'action des structures sanitaires et sociales intervenant en partenariat avec le milieu scolaire, et orienter leur action vers les parents d'élèves. 7. Réactiver les CESC et évaluer régulièrement leur action. 8. Rappeler systématiquement aux élèves les risques disciplinaires et judiciaires encourus en cas d'infraction à la législation sur les stupéfiants. 9. Renforcer les sanctions pénales pour les infractions à la législation sur les stupéfiants constatées dans un périmètre entourant les établissements scolaires. Assurer une véritable formation des acteurs de la prévention en matière de drogue et de toxicomanie 10. Dispenser une formation sur les conduites à risques dans les IUFM ainsi que dans les programmes de formation continue des enseignants. 11. S'assurer de la compétence professionnelle des acteurs associatifs. 12. Prévoir une formation pour les divers acteurs de terrain susceptibles d'être confrontés aux problèmes de dépendance aux drogues et de dopage : médecins, éducateurs sportifs, personnels pénitentiaires, éducateurs de la PJJ et avocats. Développer la politique de recherche 13. Créer une structure de recherche sur les nouvelles drogues de synthèse en s'inspirant de l'expérience néerlandaise. 14. Associer la recherche publique et l'industrie pharmaceutique dans la lutte contre la toxicomanie. 15. Développer la recherche sur les causes de la toxicomanie et créer un établissement public centralisant et impulsant les études sur la toxicomanie, à l'image du National Institute on Drug Abuse américain. 16. Développer les outils statistiques de la chancellerie afin de suivre le parcours judiciaire des usagers de drogues. Prévenir les dangers de toutes les drogues au volant 17. Prendre en compte les effets des médicaments sur la conduite automobile. 18. Introduire dans le programme national de formation à la conduite une information sur les conséquences notamment pénales de l'usage de stupéfiants au volant. 19. Développer les tests comportementaux et cibler les contrôles. Lutter contre la drogue en milieu professionnel 20. Développer une campagne nationale sur les dangers liés à la toxicomanie en milieu professionnel, notamment dans les petites et moyennes entreprises. 21. Rappeler dans le règlement intérieur des entreprises l'interdiction stricte de consommation de stupéfiants pour l'ensemble des postes et non pas seulement les postes à risque. 22. Développer le rôle des médecins du travail dans le respect du secret médical. 23. Associer les partenaires sociaux aux actions de prévention dans les entreprises. |
|
II. POUR UNE POLITIQUE DE SOINS PLUS EFFICACE Développer les structures d'accueil 24. Privilégier le sevrage total ou sélectif en renforçant l'offre de soins, notamment pour les toxicomanes polyconsommateurs sous traitement de substitution. 25. Développer les structures de post-cure et les relations entre les différents centres notamment pour éloigner les toxicomanes de leur région d'origine. 26. Faciliter la réinsertion des toxicomanes en développant l'accompagnement dans des structures d'accueil. 27. Développer les partenariats des structures d'accueil gérées par les associations avec les hôpitaux en pérennisant les financements pour leur permettre de bénéficier des compétences des personnels hospitaliers. 28. Développer les structures d'accueil d'urgence et les équipes de proximité à destination des usagers les plus marginalisés. 29. Renforcer la prise en charge psychosociale des parents usagers de stupéfiants et de leurs enfants. 30. Augmenter le nombre de places réservées aux femmes enceintes ou accompagnées de leurs jeunes enfants en CSST. 31. Mettre en place des lieux de consultation spécifiques pour les jeunes toxicomanes et leur réserver des places dans les nouvelles Maisons de l'adolescent. Contrôler la prescription et la délivrance des produits de substitution 32. Rechercher un rééquilibrage méthadone/Subutex en privilégiant la primo prescription de méthadone par les médecins de ville et exerçant à l'hôpital ; informer les utilisateurs des produits de substitution des risques de mésusage. 33. Informer les médecins des risques résultant de l'association Subutex-médicaments psychotropes et lutter contre le « nomadisme médical » ; renforcer le contrôle des caisses primaires d'assurance maladie sur les médecins prescripteurs de Subutex à l'origine d'un trafic ; inciter les pharmaciens à contrôler de manière rigoureuse la délivrance de Subutex ; interdire aux visiteurs médicaux tout démarchage concernant le Subutex. Lutter contre l'usage et le trafic de drogue en milieu fermé 34. Accompagner la libération des détenus toxicomanes en renforçant les dispositifs de réinsertion, en partenariat avec les structures de post-cure. 35. Réduire le trafic de Subutex en prison et le mésusage des médicaments psychotropes par une sensibilisation du personnel médical. 36. Associer la Protection judiciaire de la jeunesse aux conventions départementales d'objectifs justice-santé, notamment pour prendre en compte les consommateurs de cannabis et les polyconsommateurs et développer les actions de prévention dans le cadre du travail éducatif. 37. Etendre le partenariat entre les établissements de la PJJ, les CSST et les associations assurant la prise en charge des toxicomanes, afin de développer la prise en charge collective des mineurs usagers. |
|
III. POUR UNE RÉPONSE JUDICIAIRE ET ÉDUCATIVE Prévoir des sanctions graduées et systématiques pour les usagers simples 38. Prévoir une contravention de 5 e classe en cas de première infraction pour usage simple de stupéfiant et créer une obligation de soins ou d'orientation vers une structure psychosociale. 39. Conserver le délit en cas de récidive ou de refus de soins. Prévoir en dernier recours un emprisonnement dans des centres fermés de traitement de la toxicomanie pour les multirécidivistes ou réfractaires aux soins. Conserver l'objectif d'orientation psychosociale tout en simplifiant et accélérant les procédures judiciaires 40. Pérenniser les conventions départementales d'objectifs justice-santé. 41. Développer les permanences d'orientation socio-sanitaire dans chaque tribunal de grande instance. 42. Former les magistrats pour leur permettre de repérer les auteurs d'actes de délinquance ayant des consommations excessives ou problématiques de drogues. 43. Développer les travaux d'intérêt général. 44. Etendre le champ de la « procédure simplifiée » aux usagers de drogues récidivistes, mais non dépendants. 45. Elargir les mesures de composition pénale à l'obligation de soins. Homogénéiser les sanctions sur tout le territoire 46. Développer les instructions aux magistrats et les guides méthodologiques destinés aux acteurs du processus judiciaire. 47. Sanctionner le fait de provoquer un mineur à faire usage de stupéfiants ou à trafiquer. Renforcer la coordination nationale 48. Réprimer sévèrement le trafic sous toutes ses formes. 49. Mutualiser le renseignement et mieux faire circuler l'information. 50. Créer des « GIR STUP » dédiés spécifiquement à la lutte contre le trafic de stupéfiants. 51. Implanter des Bureaux de liaison permanents à toutes les frontières du territoire national. 52. Renforcer les moyens budgétaires et en personnel des GIR afin de leur assurer une autonomie de fonctionnement. 53. Elargir au trafic de stupéfiants les compétences des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires. 54. Intégrer des personnels de TRACFIN aux GIR pour mieux lutter contre le blanchiment. 55. Développer des binômes GIR-BLP afin d'associer leurs compétences respectives, opérationnelles, de renseignement et de traitement de l'information. 56. Réformer le fonctionnement du fonds de concours « lutte anti-drogue ». 57. Assurer aux fonctionnaires des services répressifs appelés à participer aux GIR un traitement indemnitaire satisfaisant et des garanties de carrière dans leur administration d'origine. |
|
IV. POUR UNE COOPÉRATION INTERNATIONALE RENFORCÉE 58. Réactiver Europol et inclure le trafic de stupéfiants dans la liste des eurocrimes. 59. Renforcer la coopération bilatérale diplomatique et opérationnelle. 60. Réactiver les cellules de renseignement financier à vocation multilatérale et étendre la coopération policière internationale bilatérale en matière de répression du blanchiment. 61. Développer les opérations coordonnées bilatérales de ciblage des passeurs de drogues. 62. Développer les outils européens de coopération transfrontalière entre plusieurs pays voisins. 63. Accélérer la transmission et l'exécution des commissions rogatoires internationales. 64. Renforcer la coopération internationale douanière et notamment ratifier la convention du 11 janvier 2002 signée entre la République française et le Royaume des Pays-Bas, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre leurs administrations douanières dans la région Caraïbe, en particulier sur l'île de Saint-Martin. |
CONTRIBUTIONS DES GROUPES POLITIQUES
CONTRIBUTION DU GROUPE SOCIALISTE
I. CONSTATS :
Sur le pré-rapport
Méconnaissance de l'évolution mondiale de la consommation de drogues dans les pays développés :
- absence de chiffres : tous les pays sont concernés et connaissent une augmentation de la consommation.
- des chiffres importants ne sont pas communiqués, par exemple pour les Pays-Bas, la consommation avant et après la dépénalisation ainsi que ceux relatifs au suivi sanitaire de la population
- les chiffres confirment-ils ou infirment-ils quil n'y a pas de lien entre les politiques publiques (libérales ou répressives) et les niveaux de consommation du cannabis (OFDT) ?
Sur la commission : qui est orientée
- un titre qui fait de « la lutte » l'unique solution envisagée comme réponse à la consommation des drogues et qui annonce l'esprit de la démarche adoptée par la commission plus fondée sur l'accusation. Ainsi, l'ancienne présidente de la MILDT s'est retrouvée face à un véritable réquisitoire.
- concentration sur le cannabis (et non pas sur la totalité des drogues illicites), vu comme un « fléau social et un facteur criminogène ». Le titre de la commission aurait pu être au début : la lutte contre le cannabis. Il y a eu une inflexion par la suite.
Sur le choix des personnes interrogées
- les experts choisis dans la première partie des travaux de la commission, particulièrement des toxicologues, se sont succédé pour corroborer cette vision alarmiste du cannabis comme facteur puissant de délinquance
- ensuite, un rééquilibrage partiel s'est opéré avec les auditions de sociologues, d'avocats, de médecins.
Sur les trois axes d'étude qui ont dirigé la commission
• L'étude sur l'évolution des politiques publiques de lutte contre la toxicomanie a abouti à ce constat :
- la politique de réduction des risques symbolisée par le livret « savoir plus, pour risquer moins » aurait incité à la consommation. N'aurait-il pas fallu « savoir plus, pour ne pas se droguer du tout » ? a été une interrogation persistante.
- or, deux ministres ont mis en exergue le mérite d'une telle démarche :
Luc Ferry a montré d'une part le courage à ne pas nier les faits, d'autre part a rappelé que l'interdit renforce souvent l'aspect majeur de la tentation
Jean-François Mattei s'est efforcé d'expliquer le rôle primordial joué par la politique de réduction des risques dans la diminution du nombre de personnes atteintes du VIH.
• Sur la définition des drogues et leurs effets sur la santé des consommateurs :
Il n'y a pas de drogues douces ! Mais on conserve la séparation entre drogues illicites et drogues licites. Le champ de la commission reste strictement limité aux drogues illicites alors que de nombreux experts n'établissent pas de frontière et soulignent la dangerosité de l'alcool responsable de 10% des décès.
• Sur la définition d'une politique nationale, forte, claire et cohérente :
Politique de « rupture » de Nicolas Sarkozy : la répression
II - DES OPINIONS CONTRADICTOIRES :
1 - Les intervenants ont des approches très différentes, voire opposées.
2 - Les responsables politiques expriment des opinions différentes.
1 - Plus qu'un problème de police, la drogue est aussi un problème de santé publique : cf. audition de Jean-François Mattei
- subutex et méthadone :
La substitution par subutex est plus maniable que celle par la méthadone.
La transmission du VIH a été ralentie. Le VIH est nul chez les toxicomanes de moins de 30 ans.
Mais face au détournement de subutex, il est nécessaire de prendre des mesures pour contrôler ce phénomène. Les drogués aux opiacés (héroïne, morphine) se réinsèrent socialement. Disparition de la mortalité par overdose
- nécessité du maintien de l'interdiction contre le cannabis sachant que l'on n'autoriserait pas le tabac aujourd'hui, en raison de sa nocivité connue.
2 - « le problème ne se situe pas au niveau de la loi » Dominique PERBEN
Harmonisation de la politique pénale
• Nécessité : - d'une cohérence dans l'application de la loi sur le terrain
- d'un suivi et d'un bilan sur cette harmonisation
• Pour combattre les instigateurs de trafics, le projet de loi sur la grande criminalité offre des réponses
Le problème ne se pose pas au niveau de la loi , car la difficulté réside déjà dans la distinction à établir entre consommateur et trafiquant. Or, on n'est jamais simple consommateur longtemps, on échange, on revend à ses copains... on rentre dans le trafic.
On ne peut donc pas accentuer les conséquences d'une distinction (les seuils), car la distinction n'est pas réelle.
3 - Le cadre législatif doit être rénové : « une politique de rupture » envisagée par Nicolas Sarkozy
Le cadre législatif doit être rénové car l'application actuelle de la loi s'exerce de manière molle, marquée par une forte baisse des sanctions.
• il n'y a pas de drogues douces
• il ne faut pas organiser l'usage des drogues
• il faut une connaissance fine du terrain (or, les maires ne disposent pas d'informations)
• il faut mettre en place une panoplie de sanctions adaptées : TIG, confiscation du scooter,...
III - LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION
64 propositions !, ce serait considérer que rien n'a été fait en la matière, ce qui est contredit par les professionnels et même de nombreux politiques.
C'est essentiellement le cannabis qui est visé par ces propositions. Il faut tarir la source (Maroc pour une large part) et empêcher la vente. Nous sommes pour agir dans ce sens.
Les mesures de police envisagées sont pour certaines tout à fait excessives comme celle visant à permettre aux Maires de décider par arrêté d'un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans.
Il faut souligner le caractère positif de la réunion de la commission d'enquête qui s'est tenue le 27 mai pour examen du rapport.
Une clarification s'est opérée entre ces propositions qui ne sont pas d'égale importance. L'accent doit être mis sur la prévention, l'éducation, la formation, ce qui va dans le bon sens.
IV - CONTRE-PROPOSITIONS :
1 - Tarir la source : une tâche difficile
L'Afghanistan est redevenu premier producteur du pavot, depuis la chute des talibans : 3 500 t en 2002 pour 500 000 récoltants sur une population totale de 16 millions d'habitants, 20% du PIB.
On sait combien il est difficile d'arrêter ces caravanes qui empruntent les anciennes routes de la soie, celles ouvertes par Marco Polo et qui se nourrissent aujourd'hui de la corruption et de la pauvreté.
Ainsi, les mafias génèrent-elles des bénéfices colossaux réinvestis grâce au blanchiment via des banques et des sociétés écrans, et alimentent souvent le terrorisme. Existe-il d'ailleurs une véritable volonté de lutter efficacement contre les paradis fiscaux où l'argent de la drogue est blanchi ?
Oui, il faut lutter contre ces mafias, à travers une réponse policière et judiciaire, mais c'est avant tout une réponse à cette pauvreté qu'il faudra trouver, si l'on veut éteindre durablement le trafic.
Paradoxalement, l'interdit rend ce marché très attrayant, ainsi le gramme de cannabis est au même prix que le gramme d'or. La tâche est donc difficile.
2 - Contre la dépénalisation
Remarque : la politique qui se dessine actuellement rejoint l'esprit de la dépénalisation puisque :
- l'usager ne serait plus condamné à une peine de prison, mais à des sanctions moins sévères (report de l'examen du permis de conduire, confiscation du scooter...)
- or, la dépénalisation est une disposition dangereuse, car incohérente : d'un côté, elle affaiblit l'interdit moral qui pèse sur les consommateurs, mais de l'autre elle réprime les revendeurs.
Or, l'offre n'existe pas sans la demande. Ainsi, on laisse subsister un trafic alimenté par la consommation. Le problème n'est donc absolument pas réglé.
3 - Aider les associations d'aide aux usagers de drogues et pas seulement les C.S.S.T.
En reconnaissant leur rôle et en leur versant les subventions qui leur sont indispensables pour poursuivre leur tâche.
Conclusion :
Il faut renforcer la prévention, la formation, l'éducation, améliorer la connaissance des dangers qui ne se limitent pas aux drogues illicites. Les drogues licites ont été arbitrairement exclues de ces débats.
Il semble que le développement des centres de soins apporte des solutions positives pour les usagers présentant une forte dépendance, mais est-il réaliste d'appliquer l'injonction de soins aux millions potentiels d'usagers de cannabis ?
Par contre, certaines mesures ultra répressives paraissent totalement inadaptées aux problèmes posés. Il en est ainsi de l'interdiction relative à la sortie des enfants de moins de 13 ans non accompagnés la nuit. D'autres, dont on a entendu parler récemment, sont vexatoires comme la confiscation du scooter, le report de l'examen du permis de conduire. Il semble d'ailleurs que sur ce point les ministres concernés aient à s'accorder entre eux.
CONTRIBUTION DU GROUPE COMMUNISTE
RÉPUBLICAIN ET CITOYEN
PREAMBULE
Lors des débats du 12 décembre 2002 relatifs à la constitution d'une commission d'enquête sur la politique nationale de lutte contre les drogues illicites, le groupe communiste républicain et citoyen avait exprimé son objection résolue à « une démarche qui pourrait être politique et idéologique sans aucun socle scientifique sérieux ». Il avait également souligné l'absolue nécessité de placer la démarche engagée dans le prolongement de la politique novatrice menée par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie (la MILDT), laquelle dépassant l'approche purement répressive, avait su développer une action pragmatique fondée sur la prévention et la gestion des risques.
C'est dans cette optique que les sénateurs communistes avait préconisé l'élargissement du champ de la commission à toutes les substances addictives (tabac, alcool, médicaments) et la défense d'une politique résolue en matière de prévention et d'accès aux soins. C'est porteur de cette position qu'ils ont travaillé activement aux travaux de la commission d'enquête.
Les différentes auditions réalisées au sein de cette commission ont d'ailleurs confirmé la légitimité d'une telle approche et particulièrement souligné le fait que l'arsenal législatif et répressif français était le plus important d'Europe et que la punition pénale de l'usager avait, dans le passé, montré toutes ses limites.
Par contre, une véritable politique alliant information, prévention, prise en charge des toxico-dépendants s'avérerait absolument nécessaire. Cette politique, tous l'ont souligné, ne pourra être réellement effective qu'à condition que lui soit alloué des budgets décents et implique un engagement de tous les ministères concernés bien au-delà de l'action policière et judiciaire.
Dans sa première version, le rapport de la commission d'enquête ne reflétait pas, loin s'en faut, toute la richesse de ces auditions : loin de l'approche préconisée et à rebours de toutes les évolutions européennes, le rapport se situait, au contraire, dans le droit fil des politiques sécuritaires menées depuis un an par le gouvernement.
Toute la première partie des quatre-vingt propositions de la commission mettait en avant la répression « systématique » et renforçait la vision de l'usager-délinquant : acceptation très large du trafic de stupéfiants, peine de prison maintenue en cas de récidive, développement des procédures expéditives et désincarnées, valorisation des procédures policières occultes, etc...
Pire encore, les Maires devenaient les vecteurs principaux d'une action policière renforcée au prix d'une municipalisation de la police nationale. Par comparaison, l'action préconisée en matière de lutte contre le trafic, apparaissait insuffisante : insuffisante quant à la question du blanchiment des capitaux sans évocation de la taxation des produits financiers, insuffisante encore du point de vue de la coopération abordée uniquement sous l'angle d'une collaboration policière au lieu d'être une politique en direction et en partenariat avec les pays en voie de développement.
Les sénateurs communistes ne pouvaient s'inscrire dans cette logique. En leur nom, le sénateur Roland MUZEAU a fait part de ses objections en commission. Il a notamment appelé à mettre l'accent sur la nécessité d'une grande loi de santé publique qui mette au rang des priorités nationales l'information, la prévention des conduites à risque, l'éducation ainsi que l'accès aux soins et le soutien des acteurs de terrain. Il a demandé la suppression d'un certain nombre de dispositions telles celles relatives au pouvoir des Maires, aux procédures simplifiées et à certains pouvoirs d'enquête.
Suite aux discussions auxquelles ces suggestions ont conduites et parce que la position initiale de la commission d'enquête n'était pas tenable, on doit noter, de façon positive, l'évolution qui se dessine dans la seconde version du rapport : le volet préventif devient ainsi prioritaire et l'on doit s'en féliciter, le volet répressif étant, pour sa part, allégé pour être recentré sur la lutte contre les trafics et la prise en charge sanitaire des usagers.
Néanmoins, les sénateurs communistes tiennent à noter les insuffisances et réaffirmer leurs positions sur les points suivants :
Le renforcement de la politique interministérielle (MILDT) concernant un très large périmètre de compétences et de propositions sur l'ensemble des pratiques addictives et substances psycho actives (licites et illicites). Qu'il soit pris appui sur les progrès constitués par le décret du 15/09/99.
Le développement et la pérennisation des moyens financiers de la mission interministérielle à hauteur de son accroissement et qu'immédiatement, les réductions budgétaires constatées soient annulées.
Le refus de la focalisation sur le seul cannabis.
Le refus de la pseudo alternative dépénalisation-légalisation.
L'amplification une démarche de prévention et de santé publique par l'adoption d'une grande loi qui mette au rang des priorités nationales l'information, la prévention des conduites à risque, l'éducation et l'accès aux soins.
La suppression de l'emprisonnement pour simple usage de drogue, quel que soit le produit consommé.
Au plan national et international, l'action résolue et coordonnée contre les trafics, le blanchiment et les pratiques mafieuses, mais aussi une véritable politique de coopération avec les pays en voie de développement.
*
* *
* 1 On consultera avec profit ce rapport d'information qui garde toute son actualité : « Que fait la MILDT de son argent ? » (n° 28 - 2001-2002).
* 2 Ce groupe d'études a été naturellement mis en sommeil pendant la durée de la commission d'enquête et devrait être réactivé dès l'automne prochain.
* 3 Nul ne reprendrait à son compte les propos évidemment datés du docteur Henri de Rothschild en 1923, relevant que beaucoup de médecins continuent à distinguer « le stupéfiant détestable qui contribue pour une large part à l'affaiblissement de la race et à la dépopulation si menaçante pour notre pays et le bon verre de notre vin de France, réparateur puissant des forces physiques et morales »...
* 4 Son chiffre d'affaires serait de l'ordre de 500 milliards de dollars par an.
* 5 Ce groupe est aujourd'hui intégré, pour l'essentiel, dans le groupe Union pour un Mouvement Populaire du Sénat.
* 6 Le programme et le compte rendu détaillé de ces déplacements figurent en annexe du rapport.
* 7 Prisons : une humiliation pour la République - n° 449 (1999-2000).
* 8 Comme le manteau de Saint Martin, l'île éponyme est divisée en deux.
* 9 Il est d'usage de désigner ainsi la gendarmerie nationale pour la distinguer des trois armées (terre, air, mer).
* 10 Cette opération aéronavale d'envergure était constituée d'une vedette Couach DF24 de 24 m, susceptible d'atteindre une vitesse de 27 noeuds, d'un intercepteur pneumatique DF 286 Mancel sur motorisé de 500 chevaux permettant d'atteindre une vitesse de 44 noeuds et de rivaliser avec les « speed-boats » des narco-trafiquants, et d'un avion Cessna F406 éclaireur.
La commission rappellera que le dispositif douanier à Saint-Martin a été mis en place en octobre 1990 à l'initiative de M. Michel Charasse, alors ministre délégué au budget, suscitant à l'époque de très vives réticences locales.
* 11 Conformément sans doute aux traditions diplomatiques de la « Sublime Porte », cette délégation était conduite par un ambassadeur.
* 12 Cette chronologie sommaire a été établie notamment à partir du remarquable ouvrage d'Emmanuelle Retaillaud-Bajac, « Les drogues, une passion maudite » (Gallimard) et d'un dossier des Cahiers de la sécurité intérieure (« L'Etat et les stupéfiants : archéologie d'une politique publique répressive », par Igor Charras).
* 13 Jeune officier de marine, Charles Ullmo s'était emparé des codes confidentiels des signaux de la Royale et avait tenté de monnayer son forfait en menaçant de livrer ces informations à l'Allemagne. Arrêté et poursuivi pour tentative de trahison, ce fumeur d'opium fonda sa défense sur l'altération de sa personnalité par la drogue. Le retentissement considérable de cette affaire contribua à développer l'idée que l'usage de la « toufiane » par les officiers de marine constituait un problème de défense nationale.
* 14 Le puissant lobby colonial de l'époque veilla à ce que cette loi n'ait pas de répercussions trop négatives sur le budget des colonies et n'entrave pas le fonctionnement des Régies (d'opium en Indochine, de kif en Tunisie et au Maroc) qui participaient d'une manière non négligeable au financement de la colonisation. On rappellera que le Sénat comportait un « groupe colonial » depuis 1898 et la Chambre des députés depuis 1892, avec des effectifs qui s'élevaient à 200 membres en 1902 au Palais-Bourbon.
Albert Sarraut, qui fut un ardent défenseur des Régies en tant que gouverneur général de l'Indochine et ministre des colonies, dirigea ensuite la « croisade » anti-drogues contre les travailleurs « indigènes », notamment lors de ses passages successifs au ministère de l'intérieur.
* 15 La commission a pu mesurer, lors de son déplacement à Saint-Martin, les ravages de cette drogue dans les ruelles les plus sordides du quartier du ghetto à Marigot, qui est squatté par les crackés.
* 16 Ces substances et procédés dont l'usage est interdit ou restreint sont fixés par un arrêté ministériel du 2 février 2000 reprenant la liste établie par le Comité national olympique (CIO).
* 17 La commission a constaté, lors de son déplacement aux Pays-Bas, que ces comprimés fabriqués dans des « kitchen labs » rudimentaires empruntaient aussi des logos de grandes firmes automobiles ou de vêtements de luxe.
* 18 OEDT, Objectif drogues, L'usage récréatif de drogues : un défi majeur pour l'Union européenne, novembre-décembre 2002.
* 19 La commission d'enquête a pu le constater lors de son déplacement aux Pays-Bas en visitant un « kitchen lab » reconstitué de l'Unité des drogues synthétiques à l'est d'Eindhoven, à condition de disposer des précurseurs nécessaires.
* 20 Enquête Espad (1999) réalisée auprès de 12 000 élèves du second degré de 14 à 19 ans.
* 21 Sondage d'opinion réalisé à la demande de la Direction générale Justice et affaires intérieures de la Commission européenne par The european opinion research group (EORG) dans l'ensemble des pays européens entre le 27 avril et le 10 juin 2002.
* 22 Au sens retenu par l'OFDT et l'OEDT, un tel usage se définit comme la consommation de cannabis ou d'ecstasy plus de dix fois par mois, ou de drogues dures (héroïne ou cocaïne).
* 23 Défini comme le cumul des consommations répétées d'alcool (plus de dix fois par mois), de tabac (au moins une cigarette par jour au cours des trente derniers jours) et le cannabis (plus de dix consommations au cours de l'année).
* 24 Un compte-rendu complet du déplacement de la commission d'enquête à Saint-Martin figure en annexe du présent rapport.
* 25 Elements fournis par M. Raphaël Rous, attaché douanier de la France en poste à Bogota.
* 26 En France : saisie à Lorient en décembre 2002, sur renseignement de la douane de Martinique, de 1.400 kg de cocaïne dissimulés dans deux voiliers transportés par barge depuis la Martinique. Aux Antilles, au large de Saint-Martin : saisie par les services des gardes-côtes de la douane française le 2 février 2003 de 204,9 kg de cocaïne et de 15,8 kg d'héroïne sur le voilier « Daniella ». Les marchandises étaient destinées aux Etats-Unis.
* 27 Le représentant de la délégation marocaine rencontré à Vienne par la commission, lors de la Conférence des stupéfiants de l'ONU, a rappelé sur ce point la lourdeur de l'héritage de la colonisation et indiqué que le Maroc n'avait pas les moyens de contrôler ses côtes.
* 28 Tendances n° 28 - OFDT - Janvier 2003.
* 29 Rapport mondial sur les drogues - PNUCID - Publication des Nations unies - 1996.
* 30 L'impact éventuel de la consommation des drogues sur la santé mentale de leurs consommateurs - Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques - n° 259 (2001-2002).
* 31 Problèmes posés par la dangerosité des drogues - Rapport du professeur Bernard Roques au secrétaire d'État à la santé - Mai 1998.
* 32 Drogues et dépendances - Indicateurs en tendances - OFDT - 2002.
* 33 Toxicomanie et sida - in La revue du praticien - Tome 45 - Juin 1995.
* 34 Le nom du crack provient des craquements émis pendant cette opération.
* 35 Rapport précité.
* 36 Ross A., Vrenisa K., Gorter R., Bacchetti P., Watters J., Osmond D. - HIV seroconversion in intravenous danger users in San Francisco - 1985-1990 - AIDS 1994.
* 37 Aspects moléculaires, cellulaires et physiologies des effets du cannabis. Académie des Sciences. Rapport n° 39 - Avril 1997.
* 38 Tendances n° 28 - OFDT - Janvier 2003.
* 39 Le cannabis : position pour un régime de politique publique pour le Canada - Rapport du comité spécial du Sénat sur les drogues illicites - septembre 2002.
* 40 Les toxicomanes dans la cité. Avis et rapport du Conseil économique et social. Juillet 1999.
* 41 Rapport précité.
* 42 Savoir plus, risquer moins. Drogues et dépendances, le livre d'information - MILDT - avril 2000.
* 43 Tendances n° 28 - OFDT - Janvier 2003.
* 44 Ecstasy - Des données biologiques et cliniques aux contextes d'usage Expertise collective - INSERM - 1998.
* 45 Rapport précité.
* 46 Rapport précité.
* 47 Note d'information du dispositif TREND issu du système SINTES-OFDT - 22 janvier 2003.
* 48 Yves Pélicier et Guy Thuillier, La drogue, Que sais-je, 1992.
* 49 INSERM 2001, Expertise collective, Cannabis, quels effets sur le comportement et la santé ?
* 50 Thèse pour le doctorat en médecine, présentée et soutenue publiquement le 5 septembre 2002 par Jacques Chamayou, sur « Les dangers du haschisch : les dernières découvertes scientifiques sur le cannabis ».
* 51 Loi n° 2002-1094 du 29 août d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.
* 52 Drogues illicites et délinquance : regard sur les travaux nord-américains. Tendances, novembre 2001 OFDT.
* 53 David Cantor : Drug involvement and Offending of incarcerated Youth. Boston. American Society of Criminology, novembre 1995 Les recherches portent sur l'analyse de l'usage de drogues illicites chez les contrevenants (et plus spécifiquement des personnes judiciarisées), des délits commis par les consommateurs (et plus spécifiquement les toxicomanes). Ceci engendre des biais, puisque les contrevenants consommateurs encourent plus de risques d'être arrêtés et condamnés étant donné leur intoxication. De plus, les toxicomanes ont une relation particulière aux drogues non généralisable à l'ensemble des usagers. Enfin, des enquêtes en population générale portent sur les deux comportements avant d'opérer des croisements statistiques.
* 54 Flowers, 1999
* 55 Menée par Arsenault et portant sur une cohorte de 961 adultes nés en 1973 à Dunedin, Nouvelle-Zélande.
* 56 Marie-Danielle Barré, chercheur au centre de recherche sur le droit et les institutions pénales (CESDIP), Toxicomanie et délinquance, du bon usage de l'usager de produits illicites, avec la collaboration de B. Froment et B. Aubusson de Cavarlay, 1994.
* 57 Cette étude basée sur l'observation de la population ayant maille à partir avec les services répressifs avait donc un biais puisqu'elle ne pouvait être représentative de l'ensemble de la population des usagers.
* 58 La délinquance des jeunes - Les 13-19 ans racontent leurs délits, Seuil, 2001.
* 59 Hall, Bell et Careless, 1993.
* 60 Deschenes, Anglin et Speckart, 1991.
* 61 Brochu et coll., 1999.
* 62 Les études de Roth (1994) et de Parker et Auerhahn (1998) indiquent que l'alcool est bien la seule substance psychoactive pour laquelle la relation entre violence et consommation est scientifiquement avérée.
* 63 Martin Killias, « consommation de drogue et criminalité parmi les jeunes dans une perspective internationale », Strasbourg Groupe Pompidou, séminaire sur les « délinquants usagers de drogues et le système pénal », octobre 1998.
* 64 Robert Ballion, Les conduites déviantes des lycéens : enquête sur la délinquance auto-déclarée des collégiens et des lycéens réalisée en 1999 à Grenoble et Saint-Etienne, réalisée par le CADIS centre d'analyse et d'intervention sociologiques, EHESS (école des hautes études en sciences sociales), CNRS avril 1999.
* 65 Siegel Larry J., Joseph J. Senna. Juvenile delinquency, Wadsworth, 2000.
* 66 Patrick Mura, Accidentologie et drogues illicites, Bulletin de l'Académie nationale de médecine, 2002, 186, 19 février 2002
* 67 Leirer, 1989, Aviation, Space and Environmental Medicine.
* 68 Par les laboratoires du NIDA au centre Baltimore en 1996.
* 69 Berghaus.
* 70 Robbes, 1993, puis 1999, National highway traffic safety administration.
* 71 Sexton, The influence of cannabis on driving - Departement of the Environnement, transport and the Regions, UK, 2000.
* 72 Cannabis : quels effets sur le comportement et la santé, Expertise collective, INSERM, 2001.
* 73 L'étude réalisée en octobre 2001 par la division des études de la législation comparée du Sénat indique ainsi que si la loi belge est la seule à avoir fixé des seuils, toutes les législations prévoient des analyses biologiques, les contrôles pouvant être inopinés en Allemagne, en Belgique et en Espagne. Dans les pays où le permis de conduire n'est délivré que pour quelques années (Espagne, Italie et Pays-Bas), la toxicomanie constitue l'un des motifs empêchant le renouvellement du permis de conduire. En Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas, la police peut, lorsqu'elle a des doutes sur l'aptitude d'un conducteur, déclencher une procédure de contrôle qui peut entraîner un retrait, provisoire ou définitif, du permis de conduire. De même, une directive communautaire du 29 juillet 1991 définissant les conditions minimales de délivrance du permis de conduire précise que « le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état de dépendance vis-à-vis de substances à action psychotrope ou qui, sans être dépendant, en abuse régulièrement ».
* 74 Rédigé par un groupe de travail émanant du comité de sécurité routière présidé par M. Georges Lagier.
* 75 Rapport n° 28, session 2001-2002, de M. Roland du Luart, rapporteur au nom de la Commission des finances du Sénat.
* 76 Rapport rédigé sous la direction de MM. Michel Setbon, Olivier Guérin, Serge Karsenty, Pierre Kopp, non encore rendu public.
* 77 Initialement insérées dans le code de la santé publique (articles L. 627 et suivants), les dispositions concernant la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions en matière de stupéfiants ont été regroupées dans les articles 706-26 à 706-32 du code de procédure pénale par la loi du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal. Les règles relatives à l'incrimination et à la répression ont été transférées dans le code pénal aux articles 222-34 à 222-43. Seules demeurent encore dans le code de la santé publique les normes régissant l'usage des stupéfiants (article L. 628), la poursuite, l'instruction et le jugement de ce délit (articles L. 628-1 et suivants), la provocation à la commission de ce délit et à toutes les infractions constitutives de trafic de ces produits (article L. 630) ainsi que la mesure administrative de fermeture d'un établissement dans lequel ont été commis un usage ou l'une de ces infractions (article L. 629-2).
* 78 Il s'agit de systèmes d'inspection radioscopique, ou scanners, permettant de visualiser le contenu de toute une unité de chargement transportée par véhicule poids lourd pour les contrôles qui incombent à la douane. A l'occasion de son déplacement aux Pays-Bas, la commission a pu voir fonctionner le scanner fixe du port de Rotterdam.
* 79 Les 110 autres fonctionnaires de police spécialisés dans la lutte contre les stupéfiants appartiennent aux sections spécialisées des trois divisions de police judiciaire et des trois services départementaux de police judiciaire.
* 80 Mais le fait que l'humanité n'ait jamais connu de société sans crime et sans viol (la Bible raconte que la genèse de l'humanité a commencé avec le meurtre de Caïn...) a-t-il jamais récusé la légitimité d'une lutte contre ces pratiques ?
* 81 Lors de son déplacement à l'Unité des drogues synthétiques (USD) située près d'Eindhoven, il a été indiqué à la commission que les produits précurseurs chimiques « illicites » utilisés dans les kitchen labs néerlandais provenaient principalement de Chine et de Russie.
* 82 Un objectif étant défini comme une personne physique ou morale, un lieu défini avec précision ou un moyen de transport impliqué, ou susceptible de l'être, dans un trafic de stupéfiants et faisant l'objet d'investigations effectives de la part d'un service répressif. Les « objectifs » sont supprimés du fichier dès leur interpellation et un apurement des objectifs est réalisé périodiquement.
* 83 En cas d'urgence ou de crime ou délit flagrant, ils peuvent opérer dans l'ensemble du ressort d'un tribunal de grande instance ; en cas de crime ou délit flagrant, ils peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, les ressorts des tribunaux de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil étant considérés à cet égard comme un seul et même ressort ; en cas d'urgence et sur commission rogatoire du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République dans le cadre d'enquêtes préliminaires ou de flagrance, ils peuvent opérer sur l'ensemble du territoire national, à charge, si le magistrat en décide ainsi, d'être assistés par un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée.
* 84 Les statistiques traduisent l'évolution de l'activité des services de police et de gendarmerie plus qu'une transformation du phénomène lui-même.
* 85 Michel Setbon - GAPP, L'évaluation de l'injonction thérapeutique, 1998
* 86 L. Simmat-Durand, Santé publique 2000, volume 12, n° 3.
* 87 M. Setbon, L'injonction thérapeutique, évaluation du dispositif légal de prise en charge sanitaire des usagers de drogues interpellés, CNRS, mars 1998.
* 88 Soit par une investigation approfondie (enquête sociale, investigation et orientation éducative, prévues par l'article 8 de l'ordonnance) confiée par le juge des enfants à un centre d'action éducative ou à un service du secteur associatif habilité (services d'enquête sociale, d'investigation et d'orientation éducative). La mesure d'investigation et d'orientation éducative pouvant comporter des examens médicaux, médico-psychologiques et psychiatrique ainsi qu'un bilan social semble plus appropriée en raison de sa dimension pluri-disciplinaire ; soit par des expertises réalisées par des professionnels spécialisés en matière de toxicomanie, afin de mieux évaluer la dépendance éventuelle des intéressés.
* 89 Sous la direction de MM. Michel Setbon, Olivier Guérin, Serge Karsenty et Pierre Kopp. Cette évaluation n'a pas encore été rendue publique.
* 90 En utilisant trois types de sources : les données en provenance de 7 parquets franciliens, les données collectées dans le cadre des CDO (estimations du nombre de structures financées et de personnes prises en charge), et les données issues des CCST.
* 91 Parmi les nouveaux patients des CCST, la part des personnes adressées par la justice aux instances socio-sanitaires dans le cadre d'une mesure de classement avec orientation a augmenté et dépassé celle des usagers reçus pour une injonction thérapeutique. En 1999, 3 % des nouveaux patients étaient dans le premier cas et 5,9 % dans le second. En 2002, 5 % des nouveaux patients bénéficiaient d'un classement avec orientation (1.203 personnes) alors que 4,3 % seulement (1.042 personnes) étaient suivis en CSST pour une injonction thérapeutique.
* 92 Rapport sur les orientations de la politique de sécurité intérieure annexé à la loi n°2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.
* 93 L'article 28-1 du code de procédure pénale autorise, pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal (trafic de stupéfiants), le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent à constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes, pris parmi ceux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
* 94 La commission d'enquête a constaté, lors de son déplacement à Saint-Martin, l'existence d'une quinzaine de casinos implantés dans la partie hollandaise de l'île.
* 95 Le premier objectif, traitant de la recherche (« connaître, savoir, comprendre »), visait l'amélioration du dispositif français d'observation pour permettre « d'anticiper les évolutions et de prendre les décisions utiles au bon moment ». Le deuxième objectif, relatif à la communication (« informer le grand public et créer une culture de référence stable »), avait pour but de « mettre à disposition de l'ensemble de la population des informations validées, afin d'améliorer sa capacité à formuler des réponses adaptées », étant précisé que ces informations devaient porter sur « les comportements, les produits ainsi que les politiques conduites » et permettre de « rappeler le cadre de la loi ». Le troisième objectif, ayant trait à la prévention en tant que telle (« systématiser, élargir son champ, tout en rappelant les interdits posés par la loi »), privilégiait une approche « fondée sur les comportements, plus que sur les produits, en distinguant l'usage, l'usage nocif et la dépendance ». Enfin, le quatrième objectif, concernant la formation (« harmoniser les connaissances des principaux acteurs »), cherchait à « créer une culture commune à tous les professionnels de la prévention, de l'éducation, du soin et de la répression ».
* 96 Libération, édition spéciale d'octobre 1998, numéro 5390 bis.
* 97 Circulaire du Premier ministre n° 4.692/SG du 13 septembre 1999 relative à la lutte contre la drogue et à la prévention des dépendances.
* 98 Loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.
* 99 Loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs.
* 100 Loi n° 2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
* 101 Constitués en tant que tels par la circulaire n° 98-108 du 1 er juillet 1998 relative à la prévention des conduites à risques et aux comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté.
* 102 L'école citoyenne : le rôle du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, rapport présenté à Monsieur le Premier ministre par M. Jean-pierre Baeumler, député du Haut-Rhin, janvier 2002.
* 103 Circulaire n° 98-237 du 24 novembre 1998 instituant les Rencontres éducatives sur la santé.
* 104 Drogues et dépendances - Indicateurs et tendances - OFDT - 2002.
* 105 L'impact éventuel de la consommation des drogues sur la santé mentale de leurs consommateurs. Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (Rapport n° 259 (2001-2002).
* 106 L'impact éventuel de la consommation des drogues sur la santé mentale de leurs consommateurs. Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Rapport n° 259 (2001-2002).
* 107 Note remise au directeur de Cabinet du Premier ministre par Mme Nicole Maestracci, alors présidente de la MILDT - 15 juillet 2002.
* 108 Adolescence : comment en sortir ? Les enjeux d'une politique publique - Groupe d'études sur les problématiques de l'enfance et de l'adolescence et commission des Affaires sociales - Rapport d'information n° 242 (2002-2003).
* 109 que la commission a pu rencontrer à Vienne
* 110 « L'évolution de la politique néerlandaise en matière de stupéfiants ». Délégation du Sénat pour l'Union européenne - Rapport d'information n°357 (1996-1997).
* 111 Les chiffres sont issus du rapport 2002 du Centraltbbundet för alkohol-och narkotikattpplysning
* 112 article 4 : « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ; article 5 : « la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société » ; article 8 : « la loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ».
* 113 On rappellera à cet égard le précédent de la Régie de l'opium qui a perduré en Indochine de 1888 jusqu'aux années 50.
* 114 Rapport mondial sur les drogues, 1997.
* 115 instituée par la loi du 3 janvier 1972.
* 116 Si le juge estime un débat contradictoire nécessaire ou envisage une peine d'emprisonnement, il renvoit le dossier au ministère public (article 495-1 du code de procédure pénale).
* 117 Afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
* 118 Etudes et résultats n° 4 - DREES- janvier 1999
* 119 Délinquance des mineurs : la République en quête de respect- Rapport n° 340 (2001-2002)
* 120 Dispositif d'information mis en place par l'OFDT dans le cadre du plan triennal 1999-2001







