Presse
Claude Belot
Table des matières
-
I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE
-
A. LES AIDES DU BUDGET DES SERVICES GÉNÉRAUX
DU PREMIER MINISTRE
- 1. Les aides à la presse à faibles ressources publicitaires
-
2. Les aides à la diffusion
- a) Le fonds d'aide à l'expansion de la presse française à l'étranger (art.10§3)
- b) L'aide au portage (art.10§5)
- c) Le fonds d'aide à la presse hebdomadaire régionale d'information politique et générale (art.10§4)
- d) Les allégements de charges de télécommunication (art.10§2)
- e) Le remboursement à la SNCF des réductions de tarif accordées à la presse (art.10§1)
- 3. Les aides au développement du multimédia
- 4. Les abonnements à l'Agence France Presse
- B. LE FONDS D'AIDE À LA MODERNISATION ET A LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE
- C. BILAN DES AIDES INDIRECTES A LA PRESSE
-
A. LES AIDES DU BUDGET DES SERVICES GÉNÉRAUX
DU PREMIER MINISTRE
- II. OBSERVATIONS DE VOTRE RAPPORTEUR
I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Hors
abonnements de l'État à l'AFP, les crédits inscrits au
budget général consacrés directement aux aides à la
presse, se stabilisent (+0,004%) dans le budget 2002, pour atteindre 38,
98 M€, après la diminution de 1,99 % enregistrée
en 2001.
Avec la dotation de l'AFP, qui croît de 2,44 M€ soit 16
MF contre 5,6 MF dans le précédent budget, les
crédits qui concernent la presse, connaissent une croissance de
+ 1,84 %
pour se monter à
134,87 M€
.
Sur la législature, la croissance des dotations apparaît
limitée : les crédits du chapitre 41-10 passent, ainsi, de
248,8 MF à 255,7 MF soit une augmentation de 6,9 MF
seulement, ce qui représente une croissance annuelle de 1,5% ; les
crédits de l'AFP progressent de façon plus sensible, passant de
578,6 MF à 629 MF, soit une augmentation de 50,4 MF,
ce qui représente une croissance annuelle de 2,2%.
Toutefois, ces seuls chiffres n'épuisent pas l'action du Gouvernement en
matière de presse.
D'abord, l'État n'est pas seulement le client majeur de l'AFP mais aussi
en quelque sorte son actionnaire, un actionnaire au demeurant discret,
puisqu'à ce titre il n'a procédé que par abandon de
créances. Certes, les pouvoirs publics ont acté, en mars dernier,
le principe d'un apport financier, probablement sous le forme d'un prêt
participatif, d'un montant global de 15,2 M€, soit 100 MF. Cela
permet-il de considérer que l'État prend toute sa part à
la mise en oeuvre du plan pluriannuel de développement et de
diversification engagé par sa nouvelle direction ? On peut en
douter, tant ces demi-mesures pourraient se révéler en
définitive des contre-mesures, si cela ne donnait pas à l'agence
les moyens des réformes de structures nécessaires à son
adaptation au marché.
Ensuite et surtout, une bonne partie de l'aide à la presse passe
désormais par le Fonds de modernisation de la presse dont les
crédits viennent compléter de façon substantielle ceux du
chapitre 41-10 : les ressources attendues de ce fonds qui figurent au
compte d'affectation spéciale n°902-32 se montent à
28,993 M€ , soit190,2 MF.
Au total pour 2002,
l'ensemble des moyens publics
consacrés
à la presse écrite hors abonnements à l'AFP est en
croissance sensible de
+ 7,2%
pour atteindre
67,95 M€
, soit 445,7 MF.
A. LES AIDES DU BUDGET DES SERVICES GÉNÉRAUX DU PREMIER MINISTRE
Les aides budgétaires à la presse sont inscrites au chapitre 41-10 et, pour ce qui concerne l'AFP, au chapitre 34-95 du budget des services généraux du Premier Ministre. Il convient, cette année, de souligner une modification de la nomenclature budgétaire, qui tend à regrouper les aides directes à la presse en trois articles : les aides à la diffusion, les aides au maintien du pluralisme et de la diversité des titres et les aides au développement du multimédia.
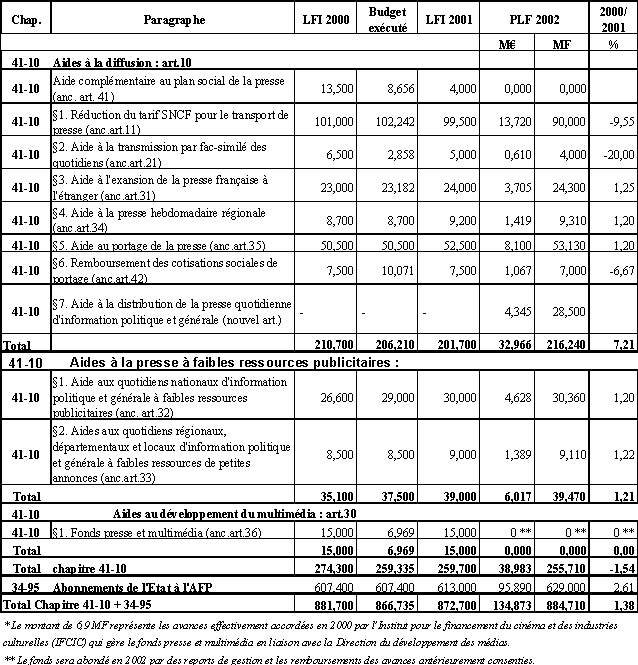
On note
que ces crédits ont fait, au cours de l'exercice 2001, l'objet d'une
série de
mesures de régulation budgétaire
pour un
montant global de 15 MF qui se répartit de la façon
suivante :
- fonds presse et multimédia : 9,45 MF ;
- plan social de la presse parisienne : 3,25 MF ;
- remboursement des cotisations sociales de portage : 2,3 MF.
Dans sa réponse, l'administration précise que « compte
tenu de l'état des besoins et du fait qu'il ne s'agit pas de fonds de
répartition », ces annulations n'ont pas affecté la
gestion des fonds d'aides concernés et n'ont donc pas impliqué de
pénalisation pour leurs bénéficiaires.
1. Les aides à la presse à faibles ressources publicitaires
Ces aides, qui figurent désormais à l'article 20 du chapitre 41-10, devraient s'accroître, en 2002, de + 1,21 % après la nette augmentation de l'année dernière pour atteindre 6,017 M€, soit 39,470 MF.
a) Le fonds d'aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires (art.20§1)
Les
crédits inscrits dans le projet de loi de finances pour 2002 au
paragraphe §1 de l'article 20 sont en croissance de + 1,2 %, ce qui
marque une stabilisation après le rattrapage intervenu en 2000 et 2001,
et place ce poste avec 4,6 M€ soit 30 MF de crédits,
à un niveau supérieur de près de 14 MF à
celui de 1997.
Deux quotidiens, La Croix et L'Humanité, entrent dans cette
catégorie et bénéficient régulièrement de
cette aide régie par le décret n°86-0616 du 12 mars 1986,
modifié par le décret du N°98-0714 du 17 août
1998
et le décret n°2000-1050 du 25 octobre 2000.
La Croix» a reçu 9,4 MF en 1997, 10,9 MF en 1998,
11,4 MF en 1999 et 14 MF en 2000; pour les mêmes
années, L'Humanité a reçu respectivement 6,2 MF,
7,99 MF, 8,3 MF et 14, 8 MF. Sans emploi, qui avait
bénéficié de 70 000 francs en 1999, n'a rien perçu
en 2000.
Les crédits inscrits dans le projet de loi de finances initiale pour
2000 s'élèvent à 26,6 MF. Deux
éléments méritent d'être soulignés pour
justifier l'augmentation de 33 % par rapport au précédent
exercice :
- d'une part, il est apparu nécessaire en cours d'exercice d'abonder le
fonds de 2,4 MF afin de tenir compte des difficultés
rencontrées par les titres concernés en 2000 ;
- d'autre part, le décret du 25 octobre 2000 a modifié le mode
de répartition de la première section du fonds en faveur d'un
titre L'Humanité, dont la diffusion est la plus faible, sans
pénaliser l'autre, La Croix.
Compte tenu de ces modifications, la première section avait
été dotée en 2000 de 28,8 MF et la seconde de 200
000 F.
Cinq quotidiens ont bénéficié de l'aide en 2000 :
L'Humanité, La Croix, au titre de la première section et Le
Quotidien, Mon Petit Quotidien et L'Actu, au titre de la seconde
La répartition a été faite sur la base d'une aide à
l'exemplaire effectivement vendu de 0,0807 F pour la première
section et de 0,0112 F pour la seconde. On rappelle qu'en 1999, la
répartition avait été effectuée sur la base de
0,512 franc par exemplaire vendu avec une diminution de 50% de la subvention
au-delà de 20 millions d'exemplaires.
Il faut préciser que la deuxième section, dont la création
résulte de la réforme de 1997, concerne les quotidiens à
prix très bas, jugés très intéressants sur le plan
de la diffusion de la pensée, mais qui n'ont pas un prix facial
élevé. L'aide que les trois titres concernés recevront,
est très faible mais leur affiliation à cette section leur permet
de bénéficier du tarif postal préférentiel
prévu par l'article D19-2 du code des postes et des
télécommunications.
On remarque qu'avec 30 MF de crédits inscrit pour 2001 et
4,628 M€ soit 30,36 MF pour 2002, l'aide atteint le triple de
celle qui était accordée en 1982.
Votre rapporteur a été informé de la répartition
prévue pour 2001 : 2,3 M€, soit 15, MF iraient à
L'Humanité et 2,2 M€, soit 14,45 MF, à La Croix,
tandis que Mon Quotidien, Le Petit Quotidien et L'Actu se partageraient, pour
leur part, 33 539 €, soit 220 000 F.
b) Le fonds d'aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces (art.20§20)
Les
crédits prévus dans le projet de loi de finances pour 2002
désormais inscrits au paragraphe §2 de l'article 20 du chapitre
41-10, se montent à 1,39 M€, soit 9,11 MF, ce qui
représente une croissance de + 1,22 %.
L'élargissement des conditions d'accès, instauré par le
décret du 20 novembre 1997, a permis de limiter les
conséquences de la hausse des tarifs postaux. En 2000, on comptait 12
bénéficiaires de l'aide - au titre de la première section
- (contre 11 seulement en 1999) avec des subventions s'étageant de 178
685 francs pour la Dordogne libre à 1 157 559 francs pour la
Marseillaise. La dotation de 2000 s'élevait à 7,65 MF.
2. Les aides à la diffusion
Elles
ont été regroupées après divers changements de
nomenclature à l'article 10 chapitre 41-10 des crédits des
services généraux du Premier Ministre.
Les crédits de l'article doivent atteindre 33 M€, soit
216,24 MF. Le taux de croissance par rapport aux dotations 2001 atteint
+ 7,21 % ou + 9,38%, si l'on sort de la base de
référence les crédits de l'ancien article 41 relatif au
plan social de la presse parisienne, qui n'ont pas été reconduits
en 2002.
En tout état de cause, la croissance de ce poste tient, pour une grande
part, à la création d'une nouvelle aide à la distribution
de la presse quotidienne d'information, car si l'on ne tient pas compte de ce
nouveau poste, les crédits consacrés aux aides existantes
diminuent de 5 % ou 7 %, selon que l'on inclut, ou non, les
crédits affectés au plan social dans la base de calcul.
a) Le fonds d'aide à l'expansion de la presse française à l'étranger (art.10§3)
La
dotation budgétaire de ce poste pour 2001 a atteint 24 MF, soit
une augmentation de + 4,34 % par rapport à 2000. On note qu'en
dépit de cette augmentation, on reste encore loin des montants du
début des années 1990 et notamment de 1996, où les
crédits s'étaient montés à 37 MF.
La commission d'attribution a privilégié en 2001 les actions
menées par les éditeurs à titre individuel. En
conséquence, le nombre de bénéficiaires du Fonds est en
hausse sensible : 50 éditeurs ont ainsi été
aidés en 2001, contre 46 en 2000 et 40 en 1999.
Alors que les Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne ( NMPP) avaient
pâti de la baisse de la subvention globale depuis 1996, l'augmentation
des crédits en 2000 puis en 2001, a permis de stopper ce processus. En
2001, l'augmentation de l'aide accordée aux NMPP a été de
160 000 F. Leur subvention passe ainsi à 13,288 MF, soit
55,3 % des crédits du fonds. Elles utilisent essentiellement l'aide
pour abaisser le coût des transports aériens vers les pays les
moins riches, afin d'adapter le prix de vente au niveau de vie local. Par
ailleurs, Unipresse, qui véhicule principalement des titres de presse
spécialisée, a vu sa subvention passer de 4,06 MF en 1999
à 4,10 MF en 2000 et 4,37 MF en 2001, ce qui traduit un
rééquilibrage des aides entre les deux organismes.
Le projet de loi de finances pour 2002 prévoit une dotation en
légère augmentation à 3,7 M€ (24,3 MF).
En ce qui concerne la gestion de l'aide, il faut également souligner que
certaines zones à fort pouvoir d'achat, notamment l'Amérique du
Nord, ainsi que certains pays d'Asie et du Proche Orient, ont été
exclus du bénéfice de l'aide. Au total, en 2000, c'est l'Afrique
qui a reçu un peu plus de la moitié de l'aide au transport et le
Maghreb presque un quart, tandis que l'Amérique du Sud, la zone
Asie-Océanie et le Moyen Orient en représentaient environ
15 %.
b) L'aide au portage (art.10§5)
D'un montant total de 9,2 M€ soit 60,13 MF, cette aide reste une des priorités du Gouvernement. Elle est répartie en deux postes :
-
• Un fonds d'aide au portage qui existe depuis 1997. Doté de
15 MF à l'article 35, aujourd'hui transformé en paragraphe
§5 , ce fonds a bénéficié d'une augmentation
rapide de ses crédits ; ceux-ci sont passés de 45 MF
pour 1998, 49,5 MF pour 1999, 50,5 MF pour 2000 et 52,5 MF
pour 2001, à 53,13 MF dans le projet de loi de finances pour 2002,
soit 8,01 M€, ce qui fait apparaître un taux de croissance de
1,2 %. Elle est répartie, à hauteur de 25 %, au prorata
de la diffusion globale par portage - il s'agit de l'« aide au
stock » - et, à hauteur de 75 %, au prorata de sa
progression au cours des deux dernières années, ce qui est
considéré comme une aide au développement. Pour l'exercice
2001, 2 M€ (13,125 MF) ont été répartis au
titre de l'aide au stock
1(
*
)
. Pour ce qui est de
l'aide au développement, 6 M€ (39,375 MF) ont
été alloués en fonction des exemplaires
supplémentaires portés entre 1998 et 1999 d'une part, entre 1999
et 2000, d'autre part. Conformément au décret, 40 % de la
progression 1998-1999 et l'ensemble de la progression 1999-2000 ont
été prises en compte pour le calcul des aides
2(
*
)
. Au total ce sont 62 journaux qui
bénéficient du régime en 2000 : 8 quotidiens
nationaux ( 18%), 33 quotidiens régionaux (69%) et 21 quotidiens
départementaux ( 13%).
• un paragraphe §6 qui accueille les crédits anciennement inscrits à l'article 42, Remboursement des cotisations sociales de portage : cette aide, instituée en 1995, qui avait culminé à 8 MF en 1998 pour fléchir à 7,5 MF en 1999, n'est plus que de 7 MF dans le projet de budget pour 2002, soit 1,067 M€. Ces crédits visent à compenser intégralement le coût des charges sociales liées au portage des quotidiens nationaux. 10 quotidiens nationaux bénéficient du fonds : : La Croix, Les Échos, France Soir, L'Humanité, l'International Herald Tribune, Libération, Paris-Turf, La Tribune, Le Monde, Le Figaro, ces deux derniers titres absorbant, en 2000, près de 60% de l'ensemble de l'aide. Arrivé à son terme le 31 juillet 2001, le dispositif institué par le décret n° 96-678 du 30 juillet 1996, avait pour objectif de permettre à la presse quotidienne parisienne de combler son retard sur la presse quotidienne régionale, dont la diffusion par portage représente environ 34 % du total de ses ventes annuelles. Cet objectif a été atteint, la diffusion par portage des titres bénéficiaires de l'aide étant passée de 16,5 % en 1996 à près de 25 % de leur diffusion totale en 2000. Il n'est pas envisagé de reconduire les dispositions du décret. Les crédits inscrits pour 2002 permettront de rembourser les dernières sommes au titre des exercices antérieurs .
Créé à l'occasion de la loi de finances
pour
1996 et régi par le décret du 10 mai 1996, ce fonds, qui est
destiné aux hebdomadaires régionaux inscrits sur les registres
de la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse (CPPAP),
était doté de 8 MF en 1998, 8,4 MF en 1999, 8,7
MF en 2000 et 9,2 MF en 2001. Il voit sa dotation pour 2002 augmenter de
1,2 % pour être portée à 1,42 M€ soit
9,2 MF
3(
*
)
.
La dotation du fonds inscrite dans la loi de finances initiale pour 2001,
s'élève à 9,2 millions de francs. 190 publications ont
déposé une demande de subvention; parmi elles, 54 ont
également sollicité le bénéfice de la
deuxième section du fonds. 178 publications ont été
reconnues éligibles à la première section du fonds et 43
à la seconde. Les taux de subvention, appréciés en moyenne
hebdomadaire, s'élèvent respectivement à 7,89 francs pour
la première section, l'aide au numéro s'établissant
à environ 0,15 centimes, et à 9,37 francs pour la seconde,
l'aide au numéro s'établissant à environ 0,18 centimes.
Les crédits inscrits à ce titre dans le projet de loi de finances
pour 2002, atteignent 9,3 MF, soit 1,42 M€. On peut rappeler que le
montant de cette aide était de 5 MF en 1996.
d) Les allégements de charges de télécommunication (art.10§2)
Les
aides relatives aux « Communications téléphoniques des
correspondants de presse », constituent un poste sensible, qui par le
passé avait conduit les assemblées à .intervenir pour en
augmenter les crédits.
L'ancien article 21 devient le paragraphe §2 de l'article 10 du chapitre
41-10 « Aide à la transmission par fac-similé des
quotidiens ». Celui-ci est doté de près de 610 000
€, soit 4 MF, ce qui constitue une régression de 20%.
En fait, les montants inscrits tiennent compte de la consommation des
crédits effective, qui est de 2,86 MF en 2000. On est loin des
ordres de grandeurs des sommes inscrites pour l'aide aux
télécommunications, en début de législature. En
fait
cette sous-consommation s'expliquerait en ce qu'il s'agit de
remboursements sur factures
correspondant aux frais engagés par
certains journaux pour régionaliser l'impression de leurs titres.
e) Le remboursement à la SNCF des réductions de tarif accordées à la presse (art.10§1)
Le paragraphe §1 de l'article 10 du chapitre 41-10 reprend l'ancien article 11, « Réduction de tarif SNCF pour le transport de presse ». Il est doté de 13,7 M€, soit 90 MF contre 99,5 MF de crédits dans le projet de loi de finances pour 2001. On se situe ainsi en dessous des niveaux atteints ces dernières années : 101 MF en 2000, 102 MF en 1999 et 95 MF en 1998. La baisse est considérable par rapport aux crédits inscrits en 1996 et 1997, qui s'étaient élevés respectivement à 119 et 140,4 MF.
3. Les aides au développement du multimédia
L'article 30 nouvellement créé au chapitre 41-10,
accueille les crédits de l'ancien article 36 « Fonds presse et
multimédias ». Ce fonds, créé en 1997 et
géré par l'Institut pour le Financement du Cinéma et des
Industries Culturelles (IFCIC), a pour objet d'accorder aux entreprises de la
presse écrite une avance partiellement remboursable, à hauteur de
30 %, afin de permettre de développer des projets offrant au public
des accès aux contenus des journaux, magazines et revues sur les
nouveaux supports numériques.
Le Fonds, qui a vu sa dotation, longtemps maintenue en francs courants à
15 MF depuis sa création en 1998 en raison de la sous-consommation
des crédits constatée sur ce poste, n'est pas doté pour
2002. La raison alléguée est l'existence de ressources
disponibles par suite des remboursements des avances antérieurement
consenties.
4. Les abonnements à l'Agence France Presse
Le
chapitre 34-95, abonnements souscrits par les administrations au service
d'informations générales de l'AFP, des crédits des
services généraux du Premier Ministre, est doté pour 2002
de 95,9 M€ , soit 629 MF, contre 613 MF en 2001,
607,4 MF en 2000, 600,2 MF en 1999 et 588,7 millions en 1998).
Les dotations sont en croissance de + 2,61 % par rapport à la loi
de finances initiale pour 2001 mais seulement de + 1,5 % par rapport
au budget adopté en mars dernier par le conseil d'administrations avec
l'accord de la tutelle qui devrait faire régulariser les dotations en
loi de finances rectificative.
Ces perspectives budgétaires sont manifestement insuffisantes pour
donner à cet organisme les moyens de se réformer et, à
court terme, de faire face à l'accroissement de ses charges, notamment
par suite de la réduction du temps de travail et, surtout, à la
diminution probable de ses recettes par suite du ralentissement de la
croissance économique.
B. LE FONDS D'AIDE À LA MODERNISATION ET A LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE
On peut
rappeler que c'est l'article 62 de la loi de finances pour 1998 qui a
institué un compte d'affectation spéciale n°902-32
intitulé : «Fonds de modernisation de la presse quotidienne et
assimilée d'information politique et générale »
et l'a alimenté par une taxe de 1 % sur certaines dépenses
de publicité « hors médias ».
Son rendement s'est tout d'abord révélé
décevant : 141,7 MF en 1998 157,2 MF en 1999,
162,8 MF en 2000. On était assez loin des espérances
exprimées lors du vote du dispositif, qui se situaient plutôt aux
alentours de 300 à 400 MF, au point que la ministre de la
culture et de la communication a pris l'initiative de demander au
secrétaire d'État au Budget de « veiller au meilleur
fonctionnement possible de la perception de la taxe afin d'assurer la
pérennité du Fonds de modernisation». En 2001, le produit
attendu de la taxe a été fixé à 24,39 M€
soit 160 MF, ce qui peut paraître optimiste étant
donné la conjoncture.
Au départ, le Fonds était destiné au financement de la
modernisation de la presse. Avec le présent projet de loi de finances,
son objet est étendu également à l'aide à la
distribution de la presse.
Son intitulé est d'ailleurs
modifié pour devenir : « Fonds d'aide à la
modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information
politique et générale, et à la distribution de la presse
quotidienne nationale d'information politique et
générale ».
Les actions initialement éligibles à l'aide du Fonds
4(
*
)
concernent tous les projets de modernisation, qu'il
s'agisse des rédactions, des imprimeries, des services commerciaux ou
des réseaux de distribution, à l'exception des investissements de
simple renouvellement.
La loi de finances répartit les recettes du fonds de modernisation entre
différents chapitres, notamment entre les subventions et les avances.
Des discordances entre cette répartition et les demandes effectives
d'aides sont apparues et ont conduit à opérer des ajustements
permettant de satisfaire l'exécution des dépenses
afférentes aux exercices 1998 à 2000.
La loi de finances pour 2001 a ainsi ventilé 24,39 M€
(160 MF) de ressources prévues en 17,07 M€ (112
MF) de subventions et 7,32 M€ (48 MF) d'avances.
[à actualiser]
|
RÉPARTITION PAR FAMILLE DE PRESSE POUR L'ANNEE 2000 |
TOTAL |
|||
|
|
28/01/2000 |
21/04/2000 |
22/06/2000 |
|
|
Presse Hebdomadaire Régionale |
9 941 637 |
5 911 194 |
3 270 110 |
19 122 941 |
|
Presse Quotidienne Départementale. |
1 892 134 |
2 537 965 |
4 134 707 |
8 564 806 |
|
Presse Quotidienne Nationale |
1 216 785 |
29 467 193 |
3 136 081 |
33 820 059 |
|
Presse Quotidienne Régionale |
37 825 871 |
24 698 422 |
28 775 650 |
91 299 943 |
|
Agences |
1 137 900 |
452 660 |
186 065 |
1 776 625 |
|
TOTAL |
52 014 327 |
63 067 434 |
39 502 613 |
154 584 374 |
C. BILAN DES AIDES INDIRECTES A LA PRESSE
Les aides indirectes peuvent être évaluées à plus de 7 milliards de francs en 2001, et sont à la charge de deux entreprises publiques (La Poste et la SNCF), à hauteur des deux tiers, des collectivités locales en raison de l'exonération de la taxe professionnelle, de l'État, également, du fait d'une fiscalité adaptée à la presse.
-
1998
1999
2000
2001
I- Dépense fiscale de l'État en faveur de la presse
1- Taux super réduit de TVA (1)
(art. 298 septies du CGI)1200(2)
1200(2)
1200(2)
1300(2)
2- Régime spécial de provisions pour investissement
(art. 39 bis du CGI)150(2)
55(2)
50(2)
30(2)
II- Dépense fiscale des collectivités locales
exonération de taxe professionnelle (article 1458 du CGI)1 235 (2)
1 206(2)
1 207 (2)
1182,7(2)
III- Aides indirectes des entreprises publiques
1- Coût du transport postal supporté par La Poste
3350(2)
3252(2)
3104(2)
2850(2)
2- Contribution de l'État au service obligatoire de transport de presse par la poste
1850
1850
1900
1900
TOTAL
7785(2)
7563(2)
7461(2)
7262,7(2)
(1) Dépense fiscale calculée par rapport au taux réduit de TVA de 5,5 %.
(2) Estimations
A en
juger par les statistiques de recettes, la presse continue d'être
globalement en bonne santé, même si le brusque
fléchissement du marché publicitaire après les
évènements dramatiques du 11 septembre dernier, laisse anticiper
une détérioration de la situation.
Du point de vue de l'audience, l'année 2001 se présente encore
globalement sous des auspices favorables. Alors que la presse quotidienne
nationale vient d'annoncer une érosion de 1,9 % de son audience (nombre
de lecteurs par exemplaire qui lisent un journal) au premier semestre, les
journaux de province montrent leur résistance au ralentissement de la
conjoncture : sur les six premiers mois de 2001, l'audience de la presse
quotidienne régionale a progressé de 1 %, avec une diffusion en
hausse de 0,6 %.
« Nous sommes sans aucune visibilité aujourd'hui. a ainsi
déclaré le président du Syndicat de la PQR M. Jean-Louis
Prévost, directeur de La Voix du Nord. Nous nous attendions
déjà à une rentrée moyenne, voire médiocre,
et, depuis les attentats, le comportement des annonceurs est de plus en plus
irrationnel. Ils réservent de l'espace publicitaire, puis annulent. En
tout état de cause, comme à chaque période
électorale, nous savons que le premier semestre 2002 sera difficile sur
le plan publicitaire. (...) Depuis le début de l'année, nous
percevons le ralentissement de la croissance. A fin juin, le chiffre d'affaires
de la PQR était en hausse de 1 %, après une croissance de
7 % en 2000 et de 14 % en 1999. Nous observons de grandes
disparités. La publicité commerciale finit le premier semestre
à + 5 %. En revanche, la publicité nationale et
plurirégionale, qui représente environ 18 % du chiffre d'affaires
de la PQR, est en chute de 25 % en moyenne sur cette période. Sur
septembre, nous sommes pour le moment à -15 %. Par ailleurs, les offres
d'emploi qui avaient été le moteur au premier semestre, avec une
progression de 9,2 %, commencent à fléchir dans certaines
régions. Juillet a marqué une véritable rupture, avec un
recul de 4 % des petites annonces par rapport à juillet 2000 ».
Pour l'année 2000, en dépit de la stagnation des recettes de
vente - +0,9 % pour toutes les catégories mais + 0,2 % pour la
presse nationale d'information générale et politique et
+0,1 % pour la presse spécialisée grand public, contre +1,9%
pour la presse locale et +3,5 % pour la presse technique - le chiffre
d'affaires du secteur se développe avec une croissance de +4,5 %
par suite de la bonne tenue des recettes publicitaires. Celles-ci se sont
accrues de 9 % après 10,8 % en 1999, inversant la tendance du
début des années 1990.
Le Premier ministre rappelait, l'an passé, «
que
l'économie de la presse ne peut-être traitée seulement
à l'aulne des règles de concurrence et commerciale s'il faut
reconnaître que l'attitude soupçonneuse de Bruxelles nous oblige
à être attentifs et rigoureux dans l'attribution de ces
aides
». On ne peut mieux dire.
Notre pays est une exception en Europe où la plupart des pays
connaissent une presse puissante qui n'a en règle générale
que peu ou pas besoin de l'aide de l'État. Certes, l'importance de la
presse au regard de l'objectif politique de pluralisme comme le
caractère très national du secteur par suite de la
barrière linguistique protège encore notre pays des intrusions de
Bruxelles, mais il ne faudrait pas que par une douce insouciance, on estime que
la presse écrite échappe, par la nature même de son
activité, aux principes communautaires relatifs aux aides des
États.
Ces questions de concurrence constituent le fil directeur des observations de
notre rapporteur spécial qui ne porteront pas cette année sur
l'agence France-Presse dans la mesure où il effectue un contrôle
sur pièce et sur place de l'activité de cet organisme et qu'il ne
souhaite pas anticiper sur ses conclusions.
A. DES RÈGLES DU JEU ÉMINEMMENT VARIABLES
Un
regard rétrospectif sur cinq années d'aide à la presse
fait apparaître, une novation, la création d'un financement
extrabudgétaire des aides à la presse, et une constante, - si
l'on peut dire - la variation fréquente des règles du jeu, que ce
soit pour les aides existantes ou pour celles financées par les
nouvelles ressources dans le cadre du fonds de modernisation.
Certes, la faiblesse relative du lectorat et de l'assise capitalistique de la
presse française justifie une aide de l'État pour lui permettre
d'absorber le choc de la concurrence audiovisuelle et de saisir la chance que
lui offre le développement du multimédia et de la
télévision de proximité.
Mais, le souci de votre rapporteur spécial, c'est de ne pas engager
l'État, au nom d'un légitime maintien du pluralisme, dans un
système qui ferait de la presse un secteur durablement assisté,
ce qui non seulement pourrait susciter des interventions des autorités
de Bruxelles, mais encore pourrait finir par affaiblir le secteur au lieu de le
renforcer.
1. Le Fonds de modernisation : le décalage entre intentions et réalisations
Les
déclarations du Gouvernement ont paru, au début, tout à
fait rassurantes à cet égard pour tous ceux qui, comme votre
rapporteur spécial, souhaitent que l'argent public serve à
renforcer le dynamisme des acteurs économiques et non à en faire
un secteur structurellement aidé par l'État.
Les aides accordées
5(
*
)
prennent la forme
de subventions, d'avances remboursables ou de dépenses d'études,
qui doivent s'inscrire en principe dans une
logique de projet
. Ainsi, en
théorie, le montant total de l'aide accordée à un projet,
sous forme de subvention et d'avance, ne peut dépasser 40% du montant
des dépenses éligibles. Le plafond peut cependant être
porté à 50% des dépenses éligibles pour les projets
collectifs.
L'octroi d'une subvention
6(
*
)
ou d'une avance est
subordonné à la conclusion, entre l'État et le
bénéficiaire, d'une convention fixant notamment les conditions
d'attribution de l'aide et prévoyant, s'il y a lieu,
l'échéancier de remboursement de l'avance et de
pénalités applicables. On note au surplus qu'une commission de
contrôle sera chargée de vérifier la conformité de
l'exécution des projets aux engagements pris par les
bénéficiaires des aides versées par le fonds.
L'année dernière il avait fallu que le législateur
intervienne pour accorder le droit au fait ; cette année, on voit
bien que des intentions aux réalités, il y a une marge.
Jusqu'à la fin de l'exercice 2000, les décisions d'aides se
sont traduites par l'octroi de près de 55,34 M€ (363 MF)
de subventions et de 1,68 M€ (11 MF) d'avances.
Le tableau ci-dessous montre en premier lieu que ces chiffres sont loin des
ratios avances/subventions prévus en loi de finances.
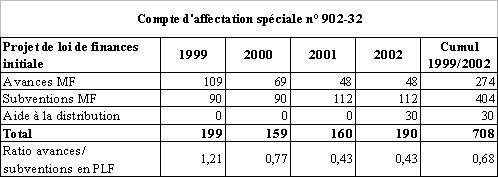
On a
donc toutes les raisons de penser que, même après correction suite
notamment à la loi de finances rectificative pour 2000,
il y a peu de
chances que la proportion affichée en loi de finances initiale soit
finalement maintenue.
Mais en second lieu, on doit souligner que ces chiffres restent très
théoriques car
le montant des reports fin 2000 s'établissait
à 392,7 MF
pour seulement 66,7 MF effectivement
dépensés au cours de l'exercice 2000.
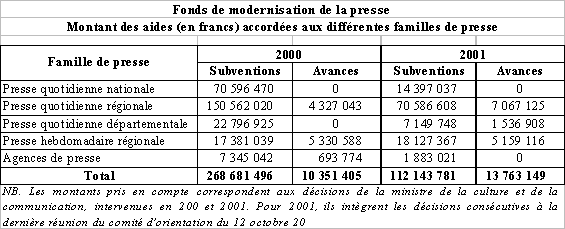
2. La multiplication des aides spécifiques et la tentation des régimes sur mesure
Au delà de l'accumulation des aides ainsi qu'en témoigne le nombre de paragraphes figurant au chapitre 41-10, il faut souligner l'instabilité de règles du jeu continuellement adaptées, qu'il s'agisse des aides indirectes par l'intermédiaire de la Poste ou de la SNCF pour lesquelles on a le sentiment que l'État abuse de sa position dominante - cf. infra - ou d'aides spécifiques, soit supprimées pour être recréées sous une forme voisine comme c'est le cas de l'aide aux télécommunications, soit ajustées aux urgences de l'heure comme dans le cas des aides aux journaux à faibles ressources publicitaires ou de petites annonces.
B. DES DOSSIERS TOUJOURS EN ATTENTE
Si certains dossiers paraissent en quelque sorte mis de côté, d'autres, en revanche, semblent en voie de déblocage, sans pour autant que les problèmes puissent être considérés comme réglés.
1. Des relations avec les services publics postal et ferroviaire non clarifiées
En
application de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990, Les obligations de la
Poste dans le cadre de son service obligatoire, en matière de transport
et de distribution de la presse, sont précisées par les articles
2,3 et 6 de son cahier des charges.
Depuis 1991, et conformément à l'article 38 de ce cahier des
charges, l'État participe à la prise en charge du coût de
ce service. Celle-ci doit en effet recevoir « une juste compensation
financière » à raison des sujétions
particulières qui lui sont imposées du fait du régime
d'acheminement et de distribution de la presse. La participation de
l'État définie dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de
progrès, est régie par un accord de 1996 dit Galmot, valable
jusqu'en 2001.
On peut rappeler que la grille tarifaire précédente, outre les
subventions croisées qu'elle générait, était
considérée par La Poste et la presse comme peu incitative,
notamment dans la mesure où elle ne tenait pas suffisamment compte du
niveau de préparation des dépôts et du degré
d'urgence.
Cet accord donnant donnant avait notamment pour objectif d'assurer un
financement plus équilibré du transport postal de presse, alors
qu'une mission des inspections générales avait
évalué à 28% le taux de couverture par La Poste de ses
coûts en 1993, et d'offrir à la presse un cadre favorable à
son développement, grâce à une souplesse accrue du cadre
réglementaire fixé pour l'accès aux tarifs du transport
postal de presse et à un meilleur contrôle de la qualité de
ce transport.
Le tableau ci-après donne des évaluations provisoires du partage
des coûts du transport postal de la presse entre l'État, la Poste
et la presse depuis 1997.
Ces évaluations se fondent sur des
méthodes de calcul, qui devraient être revues lors de la mise en
place du nouveau système de comptabilité analytique de La
Poste
. Or
la mise en place de ce nouveau système comptable
prévue pour 2000, n'est toujours pas faite, ce qui empêche de
procéder, dans des conditions claires, au bilan d'application des
accords
.
|
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
|
Coût global (1) |
7387 |
7424 |
7458 |
7500 |
|
Recettes (1) |
2137 |
2436 |
2507 |
2750 |
|
Contribution du Budget Général |
1900 |
1850 |
1850 |
2850 |
|
Contribution de La Poste |
3350 |
3138 |
3010 |
2850 |
Source : La Poste. Chiffres en MF
- (1) presse éditeur et associative du régime intérieur (exclut la presse administrative et l'international.)
La
presse a pour sa part subi une revalorisation annuelle de 8,45% en termes
réels des tarifs fixés pour le transport postal de presse, ainsi
que la restructuration et la différenciation de ces tarifs.
On note que l'État, qui estime avoir respecté ses obligations, a
procédé à l'établissement de dispositifs
d'accompagnement de la revalorisation tarifaire pour en limiter les effets dans
les cas les plus difficiles. Un dispositif de plafonnement et
d'étalement des hausses a permis de lisser dans le temps les
évolutions tarifaires les plus importantes sur les cinq années.
Pour compléter ce dispositif, l'État a également mis en
place un observatoire des tarifs postaux de transport de presse sur quatre
années. Il permet aux publications les plus fragilisées de
bénéficier d'un soutien financier. Le montant des mesures
allouées de 1997 à 2000 s'élève à 30
MF et concerne plus de cent publications chaque année.
Cette aide s'est répartie de la façon suivante :
|
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
|
Enveloppe répartie en MF |
9,2 |
8,1 |
6,5 |
6,14* |
|
Nombre de titres bénéficiaires |
106 |
104 |
85 |
78 |
*5,67 MF pour 60 publications au titre de 2000,
auxquels
s'ajoutent 0,47 MF pour 41 publications au titre d'un reliquat à
répartir.
La Fédération nationale de la presse française (FNPF) et
le Syndicat de la presse magazine et d'opinion (SPMI) ont demandé, au
printemps 2000, réparation du préjudice subi du fait de
grèves de La Poste. A l'issue d'une négociation de plusieurs
mois, la FNPF et la SPMI ont obtenu que ces préjudices fassent l'objet
d'une indemnisation forfaitaire
7(
*
)
, l'importance
de ces préjudices - qu'ils résultent du non-acheminement, de
l'acheminement retardé ou des perturbations du courrier - n'étant
pas évaluée.
Compte tenu des divergences entre la presse et La Poste sur la qualité
du service rendu, il a été décidé au sein de
l'observatoire, qui est une instance de dialogue entre l'État, la presse
et La Poste, que seraient mis en place des indicateurs permettant de mesurer la
qualité du service du transport postal de la presse. La mesure en a
été confiée à la SOFRES. Celle-ci a mis en place,
à partir d'avril 2000, un système fournissant des
résultats, mensuels pour les publications urgentes, et trimestriels pour
les publications non urgentes, sur la base d'un panel de plus de 1.000
destinataires recevant au total plus de 60 publications relevant de toutes
les catégories de presse.
Les résultats sont exprimés en « pourcentage de
réception le jour attendu » à J/J+1 du
dépôt pour les quotidiens, à J+1 du dépôt pour
les hebdomadaires, à J+4 du dépôt pour les mensuels et
périodicités plus longues expédiées en non urgent.
En dépit des déclarations ministérielles, il semble
qu'il soit urgent d'attendre. Selon la réponse faite à votre
rapporteur spécial, il a été indiqué que
« 2002 sera une année de transition, qui permettra de tirer
les enseignements des accords Galmot et d'examiner l'état du compte
transport de presse à partir de la comptabilité analytique de La
Poste ».
En fait, il semble que l'on ait décidé de mettre le premier
semestre 2002 entre parenthèses puisqu'il n'y aura pas de reconduction
des hausses tarifaires annuelles prévues par ces accords, tandis que
l'aide de l'État à La Poste était portée de
1,850 milliard à 1,9 milliard de francs, soit 290 millions
d'euros.
En ce qui concerne les
relations avec la SNCF
, on peut rappeler que les
pouvoirs publics ont résilié la convention de 1998 et
demandé au Sernam de prendre à sa charge le différentiel
constaté en 1998 entre les besoins - environ 104,4 MF - et la
dotation budgétaire de 95 MF. Des conventions provisoires ont
été conclues entre l'État et la SNCF pour 1999 et 2000
fixant la compensation à 90 MF.
Il avait été précisé, à votre rapporteur que
« dans un premier temps, l'indemnité compensatrice sera
calculée en fonction des taux précédemment
mentionnés, et ne pourra excéder 90 MF. Dans un second
temps, le montant de l'indemnité sera décompté des
crédits budgétaires et permettra de dégager une somme
affectée au remboursement de la dette de l'État à
l'égard de la SNCF. Ainsi, la dette sera diminuée au minimum de
11 MF en 2000, et de 9,5 millions en 2001. L'arriéré
devrait donc être réduit à 9,559 MF fin
2001 ».
Bref, il semble que l'administration ait trouvé, indépendamment
d'une baisse providentielle des tonnages transportés, le système
miracle permettant d'aboutir à l'extinction de l'arriéré
que l'État avait accumulé vis à vis de la SNCF :
forfaitiser le remboursement ( ou en modifier les modalités de calcul
par l'abaissement des taux de prise en charge, la méthode
annoncée variant selon les années ) et prévoir une
dotation légèrement supérieure audit remboursement, en vue
de permettre l'amortissement de la dette, qui effectivement ne se montait plus
qu'à 6,3 millions de francs au 31 décembre 2000. Il suffisait d'y
penser : la dette disparaît mais les charges réelles, elles,
persistent, au détriment du compte d'exploitation de la SNCF.
2. La diffusion de la presse française à l'étranger en question
Il faut
noter que cette stabilisation de l'aide intervient dans un contexte de
tassement de la diffusion de la presse française à
l'étranger. Ainsi, en 2000, on a assisté à une baisse de
près de 1 % des ventes dans la zone couverte par le fonds et de
plus de 5 % en Union européenne ou en Suisse. Les deux zones
où l'on constate une progression sont l'Europe en dehors de l'Union
européenne et le Maghreb avec une hausse de près de 11 %.
Cette zone bénéficie de la réouverture du marché
algérien depuis 1999 ainsi que de la modernisation des réseaux de
vente au Maroc et en Tunisie.
Les NMPP (Nouvelles messageries de la presse parisienne) indiquent dans un
communiqué récent, une baisse des ventes de 3,7 % en valeur et 5
% en volume, répartie sur toutes les zones sauf le Maghreb. Les
messageries avancent plusieurs raisons. Outre la perte de terrain de la langue
française, le fléchissement des ventes peut s'expliquer par la
concurrence d'une nouvelle presse locale, notamment en Belgique ou en Suisse,
la consultation des journaux sur Internet, mais aussi les difficultés
économiques et politiques dans certaines régions. Le recul est
particulièrement net en Amérique du Sud (- 34,8 % en volume), en
Asie-Océanie (- 21,5 %) mais la baisse touche également des
marchés plus proches comme l'Europe (-5,1 % en Europe francophone et
-8,3 % dans l'Union européenne). Les ventes sont en baisse en Afrique
(-11 %) et au Moyen-Orient (-7,6 %).
Pour le ministère, les chiffres communiqués par les NMPP ne
concernent que les ventes au numéro et ne traduisent pas la situation
des abonnements. Or les abonnements contractés à
l'étranger ont progressé en 2000. Par ailleurs, si les ventes au
numéro, dans l'Union européenne et en Suisse, qui constituent 77
% des exportations NMPP, ont enregistré une baisse, celle-ci ne doit pas
masquer des ventes quasiment stables dans le reste du monde (- 0,8 %) et
des encaissements en légère augmentation.
En dépit de ce que les derniers chiffres pourraient se
révéler meilleurs, il faut aussi, selon votre rapporteur
spécial, s'interroger sur les causes structurelles de ce repli, parmi
lesquelles il faut mentionner l'impact d'Internet sur la diffusion de la presse
française à l'étranger. Aujourd'hui, la plupart des grands
titres sont accessibles en ligne, quelle que soit leur
périodicité ou leur nature, presse d'information politique et
générale ou presse spécialisée.
Alors que, dans un premier temps, la plupart des entreprises de presse ont
utilisé Internet pour s'assurer une certaine lisibilité
internationale, il semble, aujourd'hui, que celui-ci fasse partie
intégrante de leur stratégie de développement. Certains
journaux ont fait le choix de la gratuité, d'autres non. C'est ainsi que
Libération, qui a fait le choix de la gratuité, indique que, en
2000, plus de 40 % des pages lues sont consultées depuis
l'étranger, ce qui représente près de 30.000 visites
quotidiennes essentiellement en provenance du continent nord-américain.
Ce qui semble certain, c'est qu'Internet favorise l'élargissement du
lectorat mais pas des ventes. Sans remettre en cause, bien au contraire, la
légitimité d'une aide à l'exportation physique des
journaux, on voit bien que la présence de la presse française sur
Internet est un élément essentiel pour conserver des liens des
Français de l'étranger et, d'une façon
générale, des francophones avec la France.
3. La crise de la distribution
Le
système de distribution de la presse, fondé sur les principes
« d'équité et d'égalité de traitement et de
solidarité» entre les titres mis en place avec la loi Bichet de
1947, autour des Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne, traverse une
grave crise.
L'État, qui avait accompagné l'effort d'adaptation des
NMPP
8(
*
)
, a pu paraître en retrait, comme
s'il attendait pour intervenir à nouveau de façon active que la
profession se mette d'accord avec elle-même pour trouver un compromis
entre les différentes formes de presse.
La montée en puissance face aux NMPP des Messageries Lyonnaises de
presse - MLP
9(
*
)
, qui résulte notamment de
ce
que les magazines acceptent de plus en plus mal de supporter une bonne
part des coûts d'un système conçu pour les quotidiens,
est tout autant la conséquence d'un défaut de productivité
que le signe de la crise d'un système de mutualisation.
Cependant, malgré sa croissance rapide, ce nouvel acteur reste encore de
faible dimension par rapport au géant que constitue les NMPP, ne
serait-ce que parce qu'elles n'entendent pas distribuer de quotidiens.
Avec 1 742 publications distribuées, les Messageries Lyonnaises
détiennent 15 % du marché national. En l'espace de six ans,
leur chiffre d'affaires ventes a plus que triplé, s'élevant, en
2000, à 3,24 milliards de francs avec un résultat net de 60,4
millions de francs. Pour l'exercice 2001, l'entreprise vise 3,5 milliards de
francs de chiffre d'affaires.
Les NMPP ont enregistré pour l'exercice 1999 des pertes de 521,17
MF et de 108,1 MF pour 2000, en raison des fortes provisions qu'elles ont
constituées pour leur plan de modernisation.
Compte tenu de la situation caractérisée par un déficit
d'exploitation qu'elle estime comme pouvant aller jusqu'à 277 MF
en 2003, la direction avait proposé un plan stratégique de
modernisation, avec pour objectif de réaliser 464 MF
d'économies par an d'ici à 2003, et d'abaisser les coûts de
distribution, qui devraient passer de 9 % à 6 % en 2003.
Pour parvenir à cet objectif, des réductions d'effectifs
étaient prévues touchant l'ensemble des catégories : 429
ouvriers, 129 employés et 239 cadres
10(
*
).
L'accord conclu entre Hachette
11(
*
)
et les éditeurs comptait sur une aide publique
de 200 millions à 250 MF de l'État, aide justifiée
par la prise en compte de la mission « d'intérêt
collectif » que représente la gestion des quotidiens, à
l'origine d'importants surcoûts.
Le gouvernement s'était l'année dernière,
délibérément tenu en retrait. Comme l'avait
précisé la ministre de la culture et de la communication,
l'État est prêt à accompagner une réforme de la
distribution. Encore faut-il qu'elle s'appuie sur « un projet
plausible, chiffré et négocié ». Elle avait
précisé que « le gouvernement a été
sollicité par les NMPP pour apporter une contribution de 1 milliard
à raison de 250 MF par an pendant quatre ans. On peut
s'étonner que cette demande intervienne à un moment où les
comptes des entreprises et des groupes de presse sont
bénéficiaires de la croissance, ce dont je me réjouis. Or
la revendication de l'aide de l'État doit s'accompagner d'une
réelle transparence étayée au moins par une
comptabilité analytique. Pour l'instant, elle n'a fait l'objet d'aucune
justification convaincante »...« Toute aide de
l'État à la distribution de la presse, avait-elle ajouté,
doit être économiquement justifiée, juridiquement
fondée, et évidemment tournée vers les
lecteurs. »
En fait, on voit que, si le ministère des finances n'a pas
accordé aux groupes de presse les quelque 120 MF que ceux-ci lui
demandaient pour la restructuration du système de distribution, c'est
néanmoins
80 MF
soit
12,2 M€
, qui leur
seront réservés
dans le budget pour 2002
, financés
à raison de 4 ,35M€ inscrits au §7 de l'article 10 du
chapitre 41-10 et de 4,57 M€ inscrits au chapitre 05 du compte
d'affectation spéciale n°902-32, auxquels viendraient s'ajouter sur
ce même compte environ 3,3 M€ de crédits de report.
Votre rapporteur spécial ne dispose pas d'éléments
suffisamment précis sur les modalités de cette nouvelle aide et,
notamment, sur les contreparties que l'État pourrait demander
. Il
estime que dans la conjoncture budgétaire actuelle, le mode de
financement envisagé n'est pas irrecevable dès lors que les
masses budgétaires actuelles sont globalement maintenues, ce qui reste
à vérifier.
En effet, il n'est guère contestable que l'aide à la distribution
est une aide à la presse quotidienne nationale. Car il faut admettre
qu'une partie des difficultés des NMPP trouve sa source dans
l'obligation qui leur est faite, de distribuer les quotidiens, dont le
coût est bien supérieur.
Aussi, ne peut-on voir d'objections de principe à une telle aide
dès lors que les intéressés font les efforts de
rationalisation indispensables et que l'argent de l'État ne sert pas
à perpétuer des structures archaïques.
4. Vers une nouvelle donne publicitaire
Reprenant des idées déjà lancées en
début d'année, Madame Catherine Tasca, ministre de la culture et
de la communication s'est, il y a quelques semaines, déclarée
favorable à l'ouverture «ciblée et progressive»
à la publicité télévisée de certains
secteurs actuellement interdits et, en premier lieu, de la presse, tout en
précisant qu'en ce qui concerne la grande distribution, également
interdite de publicité à la télé, «la
réflexion devra être poursuivie».
La presse devient ainsi le candidat idéal pour le test de cette
libéralisation partielle. Selon la ministre, « La presse a un vrai
double intérêt : elle est très partante sur le
numérique hertzien et elle veut se lancer dans la
télévision locale. Pour ce faire, elle a besoin de ressources
supplémentaires ».
L'analyse de la ministre qui paraît faire masse d'éléments
hétérogènes , a le mérite de reconnaître un
fait : la multiplication des canaux que ce soit sur le satellite ou sur le
câble et bientôt sur réseau numérique hertzien rend
caduques les limitations mises en place pour préserver les ressources de
la presse écrite.
Nul doute que les ambitions que cette presse affiche de plus en plus
ouvertement dans le domaine audiovisuel constituent une bonne occasion de
s'aligner sur les pratiques de nos voisins chez qui de telles limitations
n'existent pas.
1
Les subventions ont été
calculées sur la base d'un taux unitaire de subvention résultant
du rapport entre cette dotation et le nombre d'exemplaires total portés
par les bénéficiaires en 2000.
2
Pour ne pas pénaliser les bénéficiaires, en
cas de diminution du nombre d'exemplaires, celui-ci est ramené à
zéro, les valeurs négatives ne sont pas prises en compte. La
progression est donc favorisée, sans que pour autant les éditeurs
dont le nombre d'exemplaires portés baisse soient
pénalisés.
3
Le décret du 20 novembre 1997 a scindé le fonds
d'aide en deux sections, la répartition des crédits entre ces
deux sections étant décidé par le directeur du
développement des médias. Le montant des crédits
affectés à la première section ne peut être
inférieur à 85 % de la dotation globale du fonds.
La seconde section est ouverte aux publications qui, répondant aux
conditions fixées pour bénéficier de la première
section, peuvent en outre justifier :
d'une part, que 50 % au moins des exemplaires parus au cours de l'année
civile précédant l'année d'attribution de l'aide pesaient
moins de cent grammes ;
d'autre part, que leur diffusion payée effective par abonnement postal a
représenté, en nombre d'exemplaires par parution, au moins 50 %
de leur diffusion totale payée.
La répartition du montant global annuel de l'aide accordée au
titre de la première section est définie proportionnellement au
nombre d'exemplaires vendus au numéro, dans la limite d'un plafond de
20 000 exemplaires et d'un plancher de 2 000 exemplaires.
Le montant du taux unitaire de subvention par exemplaire au titre de chaque
section est égal au rapport des crédits alloués à
cette section sur le nombre moyen d'exemplaires effectivement vendus au
numéro par l'ensemble des bénéficiaires.
4
Elles sont définies par le décret n° 99-79 du 5
février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne
et assimilée d'information politique et générale,
modifié par le décret n° 99-356 du 7 mai 1999.
5
Les décisions d'attribution sont prises par le ministre
chargé de la communication après avis d'un comité
d'orientation, présidé par un conseiller d'État.
6 En ce qui concerne les montants de la subvention susceptible d'être
accordée à un projet de modernisation, il convient de distinguer
: la presse quotidienne d'information politique et générale
plafonnée à 12 MF et à 30% des dépenses comprises
dans l'assiette de l'aide, la presse hebdomadaire régionale
d'information politique et générale et les agences
plafonnées à 2 MF et à 30% des dépenses comprises
dans l'assiette de l'aide.
Au titre des avances susceptibles d'être accordées à un
projet de modernisation, le plafonnement est fixé à : pour la
presse quotidienne à 18 MF et à 30% des dépenses, pour la
presse hebdomadaire régionale et les agences à 3 MF et à
30% des dépenses.
7 La réparation consiste en un «droit de tirage»
calculé par l'éditeur sur la base d'un mois de facturation des
affranchissements en post impact et fac-similé. Ce mois est choisi par
l'éditeur sur la période du 1er février 1999 au
31 janvier 2000. L'indemnisation de l'éditeur est égale
à 20 % de la somme en question. Elle vient s'imputer sur la facture de
courriers commerciaux (affranchissements des post impact et fac-similé).
8
Le premier plan quadriennal de modernisation des NMPP (1994-1997),
présenté en juillet 1993, comprenait un volet social,
prévoyant 717 départs échelonnés sur la
période parmi les ouvriers de l'entreprise. Par le protocole d'accord du
27 décembre 1993, l'État a accepté d'apporter sa
participation financière à ce plan social, au moyen d'une
convention Fonds national pour l'emploi (FNE), dérogatoire à la
règle commune pour une somme de 136,4 MF maximum sur l'ensemble de
la période 1994-2001 (année de passage en retraite des ouvriers
partis en 1997) visant assurer le financement partiel des allocations
spéciales FNE. Toutefois, les économies réalisées -
évaluées à 680 MF sur 4 ans ont été
redistribuées aux éditeurs et aux diffuseurs conformément
aux termes de la convention entre l'État et les NMPP. Celles-ci ont
engagé en 1998 un nouveau plan quadriennal de modernisation, dont elles
attendent une économie supplémentaire de 300 à 350 MF
et en conséquence une nouvelle baisse de leur taux d'intervention qui
passerait ainsi de 9 à 7 %, sur la base d'une baisse
supplémentaire des effectifs jusqu'à 2001. Le régime
dérogatoire qui leur avait été accordé en la
matière ayant expiré en juin 1999, les NMPP sont aujourd'hui
soumises au droit commun des congés de conversion et ne
bénéficient plus d'un soutien particulier de l'État pour
leur reconversion.
9 On a vu depuis deux ans un certain nombre de titres quitter les MNPP pour les
MLP. Le passage, en 1999, de l'hebdomadaire Point de vue ainsi que de Marianne
et du mensuel Historia, des NMPP aux MLP ont manifesté une certaine
redistribution des cartes.
10 Le plan prévoyait de nombreuses suppressions de postes :
- une réorganisation des centres et en particulier la suppression de
celui de Bobigny (Seine-Saint-Denis), spécialisée dans la gestion
des invendus,
- une réduction du nombre de dépositaires de 350 aujourd'hui
à près de 200 à l'horizon 2003, en les complétant
par 30 plates-formes logistiques pour sécuriser la distribution des
quotidiens,
- le siège des NMPP devrait voir ses effectifs passer de 744 à
533 personnes.
11 Par ailleurs, à titre de contribution à l'effort de
redressement, Hachette s'est engagé à suspendre la perception de
sa redevance d'opérateur, d'environ 90 MF.







