II. PRINCIPALES OBSERVATIONS
A. LES SUBVENTIONS AU SECTEUR FERROVIAIRE : FAUTE DE RÉFORME ET DE VOLONTÉ POLITIQUE, LA SNCF NE PARVIENT PAS À UN REDRESSEMENT DURABLE
1. Un redressement extrêmement fragile
Même si, depuis la réforme de 1997 et la création de RFF, la situation financière du groupe SNCF s'est incontestablement améliorée, ses progrès sont encore insuffisants et surtout trop fragiles pour assurer son avenir.
Les résultats du groupe SNCF 1996-2000
En millions d'euros
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
|
|
Chiffre d'affaires |
11.754 |
15.617 |
16.552 |
17.216 |
19.839 |
|
EBE |
1.535 |
995 |
1.755 |
1.700 |
1.605 |
|
Résultat d'exploitation |
-466 |
-63 |
428 |
459 |
407 |
|
Résultat financier |
-2048 |
-105 |
-421 |
-319 |
333 |
|
Capacité d'autofinancement/marge brute d'autofinancement |
-400 |
+ 1.006 |
+ 1.399 |
+ 1.318 |
+ 1.223 |
Source : MINEFI
La SNCF
a connu une amélioration de ses principaux indicateurs (chiffre
d'affaires, résultat d'exploitation, résultat financier,
capacité d'autofinancement) sur la période 1996-2000.
Ces progrès s'expliquent surtout par une croissance économique
génératrice d'une croissance des trafics, en particulier pour les
voyageurs, et par une meilleure gestion du « groupe SNCF »
et notamment de ses filiales.
Ainsi, comme le souligne le ministère de l'économie, des finances
et de l'industrie dans son récent rapport sur l'Etat actionnaire,
«
le résultat net consolidé part du groupe progresse
de manière spectaculaire en 2000 (177 millions d'euros contre 51
millions d'euros en 1999)
mais cette progression,
dans un contexte de
dégradation de la rentabilité, résulte
d'éléments exceptionnels
comme les opérations
d'ingénierie financière, la cession de 80 % de France Rail
Publicité ou la contribution au résultat de filiales hors secteur
ferroviaire comme Télécom Développement dont la
contribution atteint 124 millions d'euros
».
Les résultats économiques et financiers de la SNCF en 2000 et 2001
En 2000,
les chiffres sont apparemment bien orientés :
-
le chiffre d'affaires
hors taxes de l'établissement public a
progressé de 14,1 à 14,3 milliards d'euros tandis que le
chiffre d'affaires du « groupe SNCF » progressait de 18,4
à 19,8 milliards d'euros ;
-
le résultat d'exploitation
a progressé de 208 à
256 millions d'euros pour la SNCF mais a diminué de 417 à 412
millions d'euros pour le groupe : en effet, le résultat
d'exploitation
par branche d'activité
du groupe
montre que
le résultat d'exploitation positif de la branche « transport
de voyageurs » a diminué de 365 à 343 millions d'euros,
et que le résultat négatif de la branche « transport de
marchandises » s'est accentué (de -30 à -69 millions
d'euros) ;
- enfin,
le résultat net de la SNCF est redevenu positif
, passant
de -87 millions d'euros en 1999 à + 68 millions d'euros en 2000.
Alors que ces résultats étaient encourageants,
au premier
semestre 2001,
le chiffre d'affaires consolidé du groupe SNCF a
progressé seulement de 2 % pour s'établir à 9,99 milliards
d'euros : cette faible croissance s'explique notamment par les mouvements
sociaux de mars-avril sur la maison-mère. L'excédent brut
d'exploitation (EBE) chute de 29 % et le résultat d'exploitation est
négatif de 17 millions d'euros, contre un résultat positif de 196
millions d'euros au premier semestre 2000. L'impact des mouvements sociaux a
été estimé à 160 millions d'euros pour le groupe,
qui a par ailleurs enregistré la disparition de 46 millions d'euros
d'aides spécifiques de l'Etat.
En prenant en compte le résultat financier (-160 millions d'euros, en
dégradation de 26 millions d'euros) et le résultat
exceptionnel (65 millions d'euros, soit une amélioration de 30 millions
d'euros résultant essentiellement de 94 millions d'euros de plus-values
sur cessions d'actifs immobiliers), le résultat net part du groupe SNCF
s'élève à - 108 millions d'euros au premier semestre 2001
à comparer à + 46 millions d'euros au premier semestre 2000.
2. Les problèmes structurels et l'inaction des pouvoirs publics obèrent le développement futur
L'évolution des résultats de la SNCF confirme
les
observations formulées par votre commission depuis plusieurs
années
. Le développement de la SNCF est bridé par
plusieurs éléments, que l'on peut citer une nouvelle fois :
les difficultés persistantes de l'entreprise dans sa gestion du dialogue
social, les effets de l'accord national du 7 juin 1999 sur l'application des
trente-cinq heures, l'insuffisance des moyens dévolus au fret
ferroviaire.
S'agissant des personnels, on note ainsi, depuis 1998,
une évolution
globale à la hausse des effectifs
, en raison notamment de
l'anticipation des recrutements liés à la mise en oeuvre des 35
heures. En effet, suite à l'accord de juin 1999, 25.000 admissions au
statut sont prévues. L'idée selon laquelle ces modifications ne
pèseraient pas sur l'entreprise car elles «
trouvent leur
équilibre dans les économies et les richesses attendues des
organisations du travail rénovées, mais aussi dans une
progression modérée des salaires
», selon les
termes du ministère de l'équipement, des transports et du
logement, relève de l'utopie.
Evolution des effectifs et des charges de personnel du groupe SNCF 1996-2000
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2000/1996 |
|
|
Effectifs en moyenne annuelle |
209.746 |
207.828 |
210.437 |
210.911 |
216.605 |
+ 3,3% |
|
Charges de personnel (en millions d'euros) |
7.688 |
7.821 |
7.961 |
8.146 |
8.602 |
+ 11,9% |
Source : MINEFI
Le
dialogue social dans l'entreprise SNCF s'était apaisé en
1999
, puisque 53.779 journées avaient été perdues du
fait de grève, contre 180.000 journées en 1998. L'année
2000 a présenté un profil comparable, alors que le premier
semestre 2001 a été marqué par d'importantes grèves.
En effet, la tension syndicale a débouché au premier trimestre
2001 sur un événement important et significatif pour
l'entreprise :
l'abandon du projet « cap
clients »,
pourtant un des éléments clef de la
deuxième phase du projet industriel de la SNCF initié en 1997 et
qui devait se centrer sur trois objectifs : «
le client, l'Europe,
l'efficacité
». Les pouvoirs publics ont conduit la
direction de la SNCF à retirer le projet, pourtant essentiel pour
l'avenir de l'entreprise, sans proposer aucune réforme alternative.
3. L'obligation de développer la productivité du groupe SNCF pour financer les prochains investissements
L'exercice 2000 a constitué une année de
transition
entre l'achèvement des investissements importants liés au
TGV-Méditerranée et l'apparition des conséquences de la
volonté de la SNCF d'augmenter ses investissements dans le
matériel roulant, conformément à sa politique de volume.
Les investissements du groupe SNCF ont représenté seulement
1,17 milliard d'euros en 2000 contre 1,46 milliard d'euros en 1999 et ont
donc pu être largement financés par les flux d'exploitation et les
cessions d'actifs. Mais les engagements consentis par le groupe SNCF dans le
cadre des investissements en matériel roulant liés à son
activité de transporteur ferroviaire s'élèvent à
2,3 milliards d'euros, ce qui obligera la SNCF à l'avenir à
prendre des mesures pour financer ces investissements sans augmenter son
endettement.
Le président de la SNCF, M. Louis Gallois, a annoncé devant
votre commission qu'il y aurait probablement de nouvelles cessions d'actifs du
groupe, notamment mais non exclusivement, des actifs immobiliers.
Le budget de la SNCF en 2002
Le
budget 2002 présenté au CIES de printemps 2001 traduit le besoin
pour la SNCF de faire face à la croissance du trafic voyageur, en
particulier avec la mise en service du TGV Méditerranée, et
l'objectif de montée en charge du trafic fret. Pour le réseau
principal, le programme comporte les caractéristiques suivantes :
-
Grandes lignes
(478 M€) (3.133 MF): paiements au titre de la
livraison des rames Duplex commandées en 1999 et 2000, ainsi que pour la
commande de rames pendulaires pour le projet POLT et de rames Duplex pour le
TGV Est. On notera aussi la poursuite de programmes d'amélioration des
TRN (Trains Rapides Nationaux), et de rénovations de rames.
-
Transport public et régional
(441 M€) (2.895 MF) : Il
s'agit de la continuation du programme engagé les années
précédentes, portant principalement sur l'achat de
matériel neuf, mais aussi sur la rénovation et des
transformations de matériel existant. Il est à noter que ces
investissements, engagés dans le cadre des Services Régionaux de
Voyageurs, n'engagent qu'une part très faible de fonds propres de la
SNCF et sont financés pour la plus grande partie par les régions.
-
Gares
(130 M€) (851 MF) : le budget 2002 comporte principalement
des paiements pour des opérations déjà engagées,
comme les gares nouvelles du TGV Méditerranée, mais aussi de
programmes d'aménagements de certaines gares parisiennes, et d'autres
programmes, comme la suite du réaménagement de la gare
Marseille-Saint-Charles.
-
Fret
(199 M€) (1.307 MF) : il s'agit principalement de
l'acquisition de nouvelles locomotives fret, afin de pouvoir atteindre
l'objectif de 100 GT.k en 2010, mais aussi la poursuite du programme de
révision des locomotives diesel.
-
Matériel et traction
(123 M€) (805 MF) : les
investissements, à 122 M€ (805 MF), portent principalement sur
l'adaptation d'installations et l'acquisition d'outillages dans les
établissements, compte tenu de la mise en service du TGV
Méditerranée et de l'accroissement de la disponibilité des
rames, ainsi que des programmes de maintien de l'appareil de production et
d'amélioration des conditions de travail.
Le reste du programme d'investissement comporte l'acquisition d'engins
d'entretien de la voie et des caténaires dans le cadre de la gestion de
l'infrastructure.
4. Des relations non encore apaisées avec RFF
Depuis
la création de RFF, les relations financières entre les deux
établissements publics du secteur ferroviaire ne se sont pas
entièrement clarifiées. La raison essentielle étant le jeu
à somme nulle auquel se livre l'Etat, qui consiste à retirer
à l'un pour verser à l'autre et inversement.
La SNCF conteste ainsi régulièrement le niveau des péages
d'infrastructure. Dans son document sur la stratégie de l'entreprise, la
SNCF note : «
l'activité fret, avec un résultat
prévisionnel négatif de l'ordre de 300 millions de francs en 2000
ne peut évidemment supporter aucune hausse de ses redevances
».
Par ailleurs, même si une commission de répartition des actifs
entre la SNCF et RFF existe, dirigée par M. Négrier, conseiller
d'Etat, ses décisions sont lentes et contestées devant la
justice, ce qui a amené le président de la SNCF à
souhaiter une révision des textes de partage des actifs entre la SNCF et
RFF.
B. L'INVESTISSEMENT FERROVIAIRE : APRÈS LE DÉCLIN, UN PROGRAMME AMBITIEUX MAIS ENCORE NON FINANCÉ
1. 1997-2000 : le déclin de l'investissement ferroviaire
Depuis 1997, l'investissement ferroviaire n'a cessé de décliner en raison de la diminution des investissements sur ressources propres de la SNCF et de RFF et de l'absence de revalorisation des subventions publiques.
(en milliards d'euros)
|
|
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
|
Total des dépenses d'investissement ferroviaire |
4,28 |
3,69 |
2,96 |
2,79 |
3,16 |
3,32 |
3,06 |
2,59 |
2,48 |
|
Dont financement propre RFF+SNCF |
3,67 |
3,05 |
2,5 |
2,29 |
2,53 |
2,62 |
2,38 |
1,98 |
1,94 |
|
Dont subventions |
0,61 |
0,64 |
0,46 |
0,5 |
0,63 |
0,7 |
0,69 |
0,61 |
0,56 |
Source : CSSPF
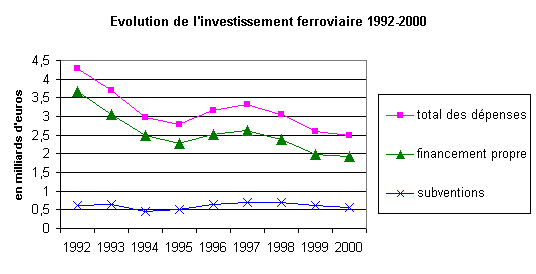
Comme le montre ce graphique, à partir d'un point haut en 1992, les investissements ferroviaires ont diminué jusqu'en 1995 avant de se reprendre puis de diminuer de nouveau à partir de 1997, le point bas étant atteint en 2000. Le réseau ferré n'a ainsi représenté que 13 % des investissements en infrastructures en 2000 contre 32,9 % pour le réseau routier départemental et local et 28 % pour le réseau routier national.
2. 2001-2006 : un programme très ambitieux mais non financé
a) Un programme ambitieux
Après une période de diminution de
l'investissement
ferroviaire, les prochaines années devraient connaître une nette
revalorisation
.
Les contrats de plan signés entre l'Etat et les régions pour la
période 2000-2006 prévoient la mise en oeuvre d'un important
programme de modernisation du réseau ferroviaire classique,
destiné à améliorer la qualité des services offerts
par le chemin de fer et à adapter la capacité du réseau au
besoin de développement de ces services.
Au total,
les projets ferroviaires inscrits dans le cadre des
contrats de plan représentent un programme d'investissements de
près de 3,8 milliards d'euros, avec une participation de l'Etat de 1,2
milliard d'euros
.
Au delà des contrats de plan, pour la période 2001-2004, les
programmes d'investissement sont particulièrement ambitieux puisqu'ils
atteindraient plus de 5,7 milliards d'euros (37 milliards de francs) en 2004.
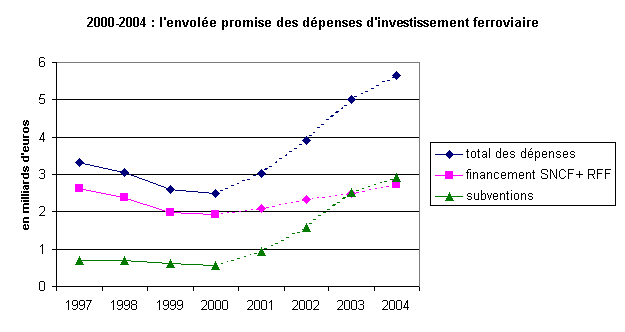
Le total des investissements atteint 5,7 milliards d'euros en 2004 (37,1
milliards de francs)
, dont 3,3 milliards d'euros pour RFF et 2,3 milliards
d'euros pour la SNCF, soit un quasi-doublement des investissements
prévus pour 2001.
Ces chiffres découlent directement des programmes déjà
approuvés
: TGV Est, contrats de plan Etat-Régions du
XIIème plan, renouvellement du parc de locomotives fret, achat de rames
TGV pour faire face à de fortes hausses du trafic et aux nouvelles
dessertes, renouvellement du matériel TER par les régions
autorités organisatrices...
b) Un programme qui, pour le moment, ne peut être financé par
les subventions de l'Etat
La part des investissements du secteur ferroviaire financée par des
subventions publiques devrait augmenter considérablement dès
2001-2002
, compte tenu des nouvelles règles de financement des
projets d'infrastructure introduites lors de la réforme ferroviaire de
1997 (article 4 du décret n°97-444 du 5 mai 1999 relatif aux
missions et aux statuts de RFF) qui empêchent RFF de financer des
investissements sans rentabilité.
Les financements propres prévus par RFF et la SNCF ne devraient couvrir
qu'à peine la moitié des besoins. Le reste du financement doit
s'effectuer grâce à
une montée en puissance des
subventions, qui quadrupleraient sur la période 2001-2004
et
atteindraient dès 2004 un montant de 3 milliards d'euros (20 milliards
de francs) par an.
Le budget de l'Etat, et en particulier le budget des transports terrestres,
ne traduit pas de montée en puissance des subventions publiques :
le budget 2002 prévoit seulement 248 millions d'euros (1,6 milliard
de francs) de subventions aux infrastructures ferroviaires.
Il faudra éventuellement ajouter 152 millions d'euros (1 milliard de
francs) qui seraient versés par l'affectation des dividendes des
sociétés concessionnaires d'autoroutes réformées
à une ligne consacrée à
« l'intermodalité » selon les déclarations du
ministre chargé des transports.
Quant à la création de l'établissement public,
qualifié de « pôle multimodal alpin », qui
doit recevoir les dividendes des trois sociétés concessionnaires
d'autoroutes de la zone (AREA, SFTRF, STMB), il va de soit qu'il ne pourra
toucher de dividendes importants dès 2002 compte tenu de la situation
financière très difficile d'au moins deux sociétés
sur les trois concernées.
Les budgets d'investissements futurs sont donc construits sur
l'hypothèse d'une considérable augmentation de l'effort des
collectivités locales
, et éventuellement d'un accroissement
des dotations de l'Union européenne.
Pour la période longue 2001-2020, et même s'il ne s'agit que de
projections, il faut noter qu'en application des nouveaux schémas de
services collectifs de transport, les besoins d'investissements peuvent
être estimés à 61 milliards d'euros selon la
répartition détaillée ci-dessous.
Projections des besoins d'investissements RFF pour la période
2001-2020
|
Lyon-Turin |
7 |
|
Lignes à grande vitesse |
19 |
|
Contrats de plan Etat/régions |
14 |
|
Développement du réseau classique |
4 |
|
Sécurité, qualité de service, divers |
4 |
|
Régénération |
14 |
|
Total |
61 |
(en milliards d'euros)
c) Un
programme qui, pour autant, n'est pas exceptionnel en Europe
A noter que si le programme d'investissement ferroviaire français pour
la période 2001-2020 est ambitieux, puisqu'en moyenne annuelle, il
représenterait 3,1 milliards d'euros,
les plans d'investissements
ferroviaires annoncés dans l'Union européenne
le sont encore
plus, car ils prévoient généralement des montants
d'investissements équivalents sur des périodes plus courtes
(2001-2010 au maximum).
|
|
Montant du programme |
Période d'investissement |
Rythme moyen d'investissement |
|
Grande-Bretagne |
60
milliards de £
|
2001-2010 |
9,6 Mds € |
|
Allemagne |
39 milliards d'euros |
2001-2005 |
7,8 Mds € |
|
Italie |
62 milliards d'euros |
2001-2010 |
6,2 Mds € |
|
Espagne |
38 milliards d'euros |
2000-2006 |
5,3 Mds € |
|
France |
61 milliards d'euros |
2001-2020 |
3,1 Mds € |
Source : CSSPF
La raison de la « prudence » française est sans aucun doute l'ampleur de la dette ferroviaire et l'absence de solution pour financer les nouveaux investissements.
3. Cinq ans après la création de RFF, l'ampleur de la dette ferroviaire limite fortement les capacités d'investissement
En effet, le secteur ferroviaire supporte un endettement trop lourd qui, même cantonné à RFF depuis la réforme de 1997, pèse énormément sur les choix d'investissement.
Evolution de la dette ferroviaire depuis 1996 (en milliards d'euros)
|
|
1996 |
janv-97 |
déc-97 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 (e) |
|
SNCF |
31,7 |
6,9 |
7,6 |
7,7 |
7,3 |
6,5 |
7,1 |
|
RFF |
- |
20,5 |
21,9 |
22,5 |
22,6 |
23,1 |
23,3 |
|
SNCF+RFF |
31,7 |
27,4 |
29,5 |
30,2 |
29,9 |
29,6 |
30,4 |
|
SAAD |
4,4 |
8,7 |
8,5 |
8,4 |
9,0 |
8,9 |
8,9 |
|
TOTAL |
36,1 |
36,1 |
38,1 |
38,6 |
38,8 |
38,5 |
39,3 |
|
soit en milliards de francs |
236,6 |
236,6 |
249,6 |
253,2 |
254,6 |
252,7 |
258 |
Source : CSSPF
Au 31
décembre 2000, l'endettement global du secteur ferroviaire atteignait
38,5 milliards d'euros soit 252,7 milliards de francs.
On rappellera que RFF ayant le statut d'établissement public à
caractère industriel et commercial, dont plus de la moitié des
recettes est d'origine commerciale, sa dette n'est pas agrégée
à la dette des administrations publiques.
Par ailleurs le « service annexe d'amortissement de la dette
ferroviaire » (SAAD) qui représente tout de même 8,9
milliards d'euros soit 58,4 milliards de francs, est une forme
« d'objet financier non identifié », puisque cette
dette n'est ni agrégée dans les comptes de l'Etat ni dans ceux de
la SNCF ou de RFF.
En dehors d'alimenter cette forme de dette « hors bilan »,
l'Etat n'a pris aucune mesure pour résorber la dette ferroviaire. Il
verse des dotations en capital à RFF (7,5 milliards d'euros sur cinq
ans) pour stabiliser sa dette, sans commencer à la rembourser.
A terme, l'Etat aura le choix entre deux options : soit une reprise pure
et simple de la dette de RFF, soit la création d'une structure de
défaisance, du type de celle utilisée pour résorber la
dette sociale (Caisse d'amortissement de la dette sociale). Il conviendra alors
d'affecter des recettes pérennes à la résorption de la
dette ferroviaire.
C. FRET FERROVIAIRE, INTERMODALITÉ, ET TRANSPORT COMBINÉ :
SIMPLES DÉCLARATIONS OU CHANTIERS DE RÉFORME ?
1. Malgré de nombreuses déclarations, aucune mesure depuis
1997
Le développement du fret ferroviaire, du transport combiné et
plus généralement de l'intermodalité est le principal mot
d'ordre du gouvernement en matière de transport.
Comme le souligne le ministère de l'équipement, des transports et
du logement, l'objectif de croissance du transport combiné rail-route
est l'un des points forts de la politique globale de développement
durable des transports visant au rééquilibrage de l'offre de
transport en faveur des modes plus respectueux de l'environnement et de la
sécurité.
Toutefois, en ce domaine, les résultats de l'entreprise SNCF, les
moyens budgétaires et les investissements en infrastructure sont en
flagrante contradiction avec les déclarations du gouvernement, qui,
depuis 5 ans, dans une période de croissance des échanges, n'a
réalisé aucun progrès en matière de
développement du fret ferroviaire, mais promet beaucoup pour
l'avenir.
Le ministère de l'équipement, des transports et du logement a
fixé un objectif de trafic de 100 milliards de tonnes-km en 2010 pour le
fret ferroviaire, pratiquement le double du trafic actuel (55 milliards de
tonnes-km en 2000).
M. Auguste Cazalet, rapporteur spécial, soulignait l'an dernier
que
l'objectif de doublement du trafic fret d'ici 2010 semblait de plus
en plus inaccessible.
Seule la réalisation d'infrastructures
importantes, comme l'a souligné la commission d'enquête du
Sénat, permettrait de répondre à cet objectifs ambitieux
mais, en l'état actuel des équipements ferroviaires,
irréaliste.
De fait, sur le terrain, aucun progrès n'est enregistré en
matière de fret ferroviaire.
Les mouvements de grève en mars-avril ont eu un fort impact sur les
résultats du premier semestre 2001 de la SNCF (- 12 % environ par
rapport au premier trimestre 2000) et devraient conduire à un nouveau
ralentissement du fret ferroviaire en 2001. Alors qu'une hausse de 4 %
était prévue, celui-ci devrait reculer en 2001, conduisant, selon
les déclarations du directeur général
délégué fret de la SNCF à anticiper un
déficit de l'activité fret de 1 milliard de francs en 2001
(contre 746 millions de francs en 2000).
Par ailleurs, le transport combiné est un bon exemple de l'inaction
des pouvoirs publics.
La Commission européenne a adopté le 18 juillet 2001 les
orientations politiques du Livre Blanc sur la politique des transports :
pour les marchandises, le développement du transport ferroviaire, dans
lequel le transport combiné est intégré, est clairement
affiché comme une des clés du succès de cette politique de
rééquilibrage.
Or, le budget 2002 divise par trois des dotations au transport
combiné qui n'étaient de toute manière pas
affectées directement au développement de ce mode.
La France a en effet énormément de retard. Il n'existe pas
actuellement en France, comme en Suisse ou en Autriche par exemple, de services
de «route roulante» dans lesquels des véhicules routiers
complets (tracteur + semi-remorque) sont transportés sur des wagons
adaptés. La première expérimentation devrait seulement
intervenir «
à partir de fin 2002
» sur l'axe
transalpin Aiton - Turin entre la France et l'Italie. Les résultats de
cette expérimentation permettraient de juger des conditions de
développement d'un tel service en 2005/2006.
Le transport combiné : aucun progrès depuis 1997
Selon le
ministère, «
le système transport combiné
rail-route, bien adapté à l'évolution des systèmes
de production et de commercialisation pourvu qu'il gagne en fiabilité et
en compétitivité, doit être le moteur du
développement du fret ferroviaire. Dans le cadre de l'objectif de
doublement du fret ferroviaire à l'échéance de 10 ans,
avec 100 Gt.km à cet horizon, la part du transport combiné dans
le fret devrait ainsi atteindre 40 %, contre 25 % aujourd'hui.
»
Or, après le point haut de 1997 à 13,9 milliards de
tonne-kilomètres (Gt.km), obtenu grâce à une croissance de
67,5 % en cinq ans,
le transport combiné rail-route a connu un recul
sensible en 1998 et en 1999. L'année 2000 a connu une
légère amélioration, avec un chiffre de 13,8 Gt.km, en
hausse de 3,5 % par rapport à 1999, mais toujours sans atteindre le
résultat de 1997.
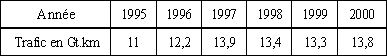
Le ministère souligne que les mauvais résultats en début
d'année ont moins affecté le trafic national (- 7 %) que le
trafic international (- 11 % pour le trafic bilatéral et - 17 % pour le
trafic de transit) où le transport combiné est pourtant plus
pertinent et mieux à même d'être compétitif par
rapport à la route.
Outre les grèves, la qualité du service reste très
insuffisante (20 à 25 % des trains sont en retard par rapport
à l'heure limite de remise dans les terminaux)
2. Une amélioration sans cesse annoncée...
L'échec de la relance du fret ferroviaire est patent, mais le
gouvernement promet des améliorations.
Des mesures de
renouvellement du matériel
sont en effet enfin
prises car le parc des 1.160 locomotives diesels dédiées
à l'activité fret au 1
er
janvier 2000 est
très ancien, avec une moyenne d'âge de 34 ans. Le renouvellement
d'une première tranche de 600 locomotives pour un montant total
d'investissement de 1,3 milliards d'euros a été approuvé
par le comité des investissements économiques et sociaux (CIES)
du 18 septembre 2001. Cette décision est tout de même un peu
tardive compte tenu du délai de livraison de locomotives, qui pourrait
intervenir en 2006. De surcroît, il s'agit d'un simple renouvellement du
parc, qui aurait dû être fait depuis longtemps, et on ne peut en
attendre une explosion du trafic...
Pour ce qui concerne spécifiquement le transport combiné, une
somme modeste, de 9 millions d'euros, serait consacrée à la mise
en oeuvre des opérations inscrites dans les différents contrats
de plan Etat-régions, en particulier pour l'aménagement de
nouvelles plate-formes multimodales. En outre, 2002 verrait l'engagement de
l'expérimentation de l'autoroute ferroviaire entre Chambéry et
Turin.
Les premières opérations de création de nouveaux terminaux
(Bonneuil-sur-Marne, Bayonne-Mouguerre, Lille-Lomme, Bordeaux-Hourcade)
seraient également en voie d'achèvement.
Enfin, le transport combiné rail-route pourrait également
bénéficier de quelques aides de l'Union européenne. Le
programme PACT (Pilot Actions for Combined Transport) a en effet versé
1,5 million d'euros pour des projets concernant directement le territoire
français (services de transport combiné ferroviaire, fluvial ou
maritime) et un nouveau programme communautaire de soutien financier
dénommé "Marco Polo" devrait être créé en
2003, et succéder au PACT sur un champ élargi et avec des moyens
accrus.
D. 2002 : 1ÈRE ANNÉE DE RÉGIONALISATION DES
SERVICES RÉGIONAUX DE VOYAGEURS
1. Les dispositions de la loi solidarité et renouvellement urbains
Il faut rappeler que l'expérience de régionalisation des services
régionaux de voyageurs engagée le 1er janvier 1997 a
enregistré un certain succès : les régions
expérimentales ont connu un développement de recettes
supérieur à celui des autres régions grâce à
la politique de recomposition de l'offre, de dynamique tarifaire et
commerciale, et d'action sur la qualité.
Sur l'initiative du Sénat, la loi d'orientation pour
l'aménagement et le développement durable du territoire du 25
juin 1999 a prolongé l'expérimentation, qui devait se terminer au
31 décembre 1999, jusqu'au 31 décembre 2001.
La loi « solidarité et renouvellement urbains » a
généralisé la régionalisation au 1er janvier 2002,
toutes les régions devenant des autorités organisatrices pour les
transports ferroviaires régionaux.
Cependant, votre commission
soulignait l'an dernier que cette réforme présentait deux
insuffisances majeures :
- le peu de fiabilité des comptes de la SNCF. Il n'existait pas de
répartition fine des coûts de chaque branche d'activité de
la SNCF (fret, voyageurs grandes lignes, TGV, TER...) sur la base de laquelle
pourrait être évaluée correctement le coût des
services régionaux de transport de voyageurs ;
- le gouvernement avait clairement souhaité limiter la compensation aux
régions, en refusant de nombreux amendements sur le fondement de leur
irrecevabilité financière.
Dans ces conditions, votre commission estimait l'an dernier qu'il convenait
d'être très vigilant quant à l'évolution des charges
de ce secteur pour les régions.
A cet égard, la forte revalorisation de la dotation pour 2001 (+ 53
millions d'euros) traduisant une « remise à niveau »
des dotations, montrait que d'importantes subventions devraient intervenir pour
ne pas grever fortement les budgets d'investissement des régions.
De fait, le montant de la compensation versée en 2002 pose
problème aux régions.
2. Quelle compensation ?
Pour 2002, la dotation de l'Etat aux services régionaux de voyageurs
s'élève à 1,5 milliard d'euros.
Que recouvre la dotation aux services régionaux de voyageurs en 2002 ?
Selon le
ministère de l'équipement, le montant indiqué prend en
compte :
- les dotations antérieurement versées à la SNCF et aux
régions ;
- le déficit constaté sur le compte de l'activité TER pour
2000 de la SNCF ;
- le montant de l'indexation prévue par l'article 125 de la loi SRU
appliquée pour 2001-2002 aux dotations antérieures et au
déficit 2000 ;
- la compensation au titre des tarifs sociaux appliqués aux SRV à
la demande de l'Etat;
- la dotation complémentaire pour le renouvellement du matériel
roulant ;
- la révision de la dotation de l'Etat au titre du transfert de
compétence en prévision d'une hausse des redevances d'utilisation
de l'infrastructure pour la circulation des SRV.Cette contribution sera
versée directement aux conseils régionaux
Toujours selon le ministère, «
l'importance de cette
dotation traduit clairement la volonté de l'Etat de faire de la
régionalisation un levier de l'amélioration des services offerts
aux usagers des TER
».
Si l'évaluation de la subvention s'est faite notamment sur un constat
d'audit indépendant,
il n'en reste pas moins que les subventions ne
permettront pas une réelle « remise à
niveau » du service TER
qui a souffert d'un relatif
désintérêt et d'une diminution des subventions pendant de
trop nombreuses années pour pouvoir répondre dans de bonnes
conditions aux exigences de développement de ce nouveau service public
régional.
De fait,
le montant de la dotation nécessaire au renouvellement du
matériel fait actuellement l'objet d'un désaccord entre les
régions et l'Etat
: les premières l'estiment à
1,83 million d'euros et le second ne souhaite accorder que 1,68 million
d'euros.
Enfin, le comité des finances locales réuni le 25 septembre 2001
a souhaité connaître l'avis de la commission consultative
d'évaluation des charges avant de se prononcer définitivement sur
le projet de décret relatif au transfert de compétences en
matière de transports collectifs d'intérêt régional.
D. LA RÉFORME DES TRANSPORTS EN ÎLE DE FRANCE
1. De profonds bouleversements dans le financement des transports en Ile de
France
En 2000, pour la première fois, la contribution de l'Etat au
fonctionnement des transports en Ile-de-France a été
versée directement au syndicat des transports parisiens (STP)
,
autorité organisatrice des transports, qui est responsable de sa
répartition entre les entreprises de transport sur la base d'une
contractualisation avec les entreprises comprenant des engagements sur le
niveau du service rendu.
Par ailleurs, la région Ile-de-France est entrée au conseil
d'administration du syndicat des transports en Ile-de-France (STIF) successeur
du STP, et contribue désormais, comme les autres membres, au financement
de l'exploitation. En contrepartie, la contribution de l'Etat au STIF est
diminuée du même montant et versée à la
région.
Le décret du 6 juillet 2000 modifiant les décrets relatifs
à l'organisation des transports de voyageurs dans la région
parisienne et portant statut du syndicat des transports parisiens
prévoit des conventions pluriannuelles entre la RATP, la SNCF et le STP.
Elles ont pour objectif principal de rompre avec le mécanisme de
l'indemnité compensatrice et de responsabiliser les deux entreprises
publiques sur des objectifs de service (en volume et en qualité), de
trafic et de maîtrise des charges.
2. La situation économique et financière de la RATP
a) De nouvelles modalités de gestion
La signature d'un contrat entre la RATP et le Syndicat des Transports en
Ile-de-France (le STIF) constitue un changement radical des conditions
d'exercice de l'entreprise.
En effet, jusqu'en 1999, les pertes de l'entreprise étaient a posteriori
couvertes par un concours public versé par l'Etat et les
départements d'Ile-de-France. Si le résultat d'un exercice
était positif, il était pris en considération pour
déterminer le besoin en concours public de l'exercice suivant.
L'entreprise n'était donc pas responsabilisée sur
l'évolution de ses charges.
Désormais, la contractualisation avec le STIF permet à la RATP
de mettre en oeuvre une politique d'entreprise.
L'entreprise s'engage vis-à-vis du STIF sur la qualité et la
quantité de service
qu'elle fournit jusqu'en 2003. Cet engagement
sur la qualité est suivi par des indicateurs dont le non-respect donne
lieu à un malus. En cas de dépassement de ces indicateurs,
l'entreprise perçoit un bonus. L'entreprise s'engage également
sur une croissance minimum en volume du trafic payé (0,5 % par an).
En contrepartie, le STIF verse annuellement à l'entreprise,
au-delà des compensations tarifaires, un concours forfaitaire
pré-déterminé qui doit permettre à l'entreprise non
seulement d'être à l'équilibre mais également de
dégager une marge.
Le contrat comporte enfin une clause qui intéresse l'entreprise au
développement des recettes.
Ainsi dans la limite de 2 % par rapport
à l'objectif contenu dans le contrat, l'entreprise et le STIF partagent
le surcroît selon une clef de répartition déterminée
(60 % pour le STIF et 40 % pour la RATP). Au-delà de 2 %, l'ensemble du
surcroît de recettes est conservé par le STIF. Le même
mécanisme joue en cas de recettes inférieures aux objectifs.
L'entreprise perçoit également une commission de 6 % sur les
ventes des titres de transport qu'elle réalise.
b) Une évolution commerciale favorable mais une situation
financière très dégradée
La RATP enregistre une amélioration de ses recettes commerciales en
2000, mais connaît une situation financière très
dégradée et donc très peu satisfaisante.
Le dynamisme du trafic
a permis une progression du chiffre d'affaires de
9,9 % en 2000.
Les recettes totales du trafic (recettes en provenance des
voyageurs et compensations tarifaires versées par le STIF) ont
progressé ainsi de 3,5 %, après application du mécanisme
de partage du surcroît de recettes entre la RATP et le STIF.
Le résultat de la RATP en 2000 n'est en revanche pas significatif. En
effet, avant 2000, le résultat d'un exercice était
perturbé par le versement de concours publics attribués à
la RATP non seulement pour équilibrer l'exercice en cours mais
également pour combler les pertes de l'exercice précédent.
La comparaison par rapport aux objectifs inscrits dans le contrat avec le
STIF permet en revanche de mesurer la performance économique de
l'entreprise.
A cet égard, l'année 2000 est satisfaisante. En
effet, l'entreprise a dégagé un résultat de 22 millions
d'euros tout en provisionnant dans ses comptes 2000 une prime
d'intéressement sur le résultat de l'exercice pour un montant de
9,5 millions d'euros.
Votre rapporteur note cependant que la gestion interne de l'entreprise et sa
situation financière sont très peu satisfaisantes
:
- on peut noter l'évolution très rapide des
charges de
fonctionnement
de la RATP en 2000 (+ 4,5 %) ;
- surtout, la dette financière de la RATP est préoccupante.
L'endettement net de l'entreprise est ainsi passé de 2,4 milliards
d'euros en 1990 à 3,8 milliards d'euros en 2000, soit 7,2 fois la
capacité d'autofinancement de l'entreprise.
Or, l'entreprise bénéficie aujourd'hui du fait que ses
investissements sont en diminution constante
(614 millions d'euros en 2000)
en raison de l'achèvement de la plupart des projets
décidés au titre des Xème et XIème contrats de
plan. En 2000, les projets décidés dans le cadre du XIIème
plan sont encore au stade des études et devraient commencer à
produire leurs effets à compter de 2002 ou 2003. Les investissements
d'entretien, de modernisation et de matériel roulant, qui sont
exclusivement financés sur fonds propres par la RATP, sont relativement
stables depuis 1995 (de 559 millions d'euros à 527 millions d'euros en
2000).
Votre rapporteur estime donc qu'il est urgent de définir les moyens
d'éviter une nouvelle « dérive » des comptes
de la RATP à l'occasion de la mise en oeuvre des engagements du
XIIème plan.
E. LES DOTATIONS EN FAVEUR DU TRANSPORT FLUVIAL
Selon le ministère de l'équipement, des transports et du
logement, «
la dotation prévue pour 2002 en faveur des
voies navigables, soit 80 millions d'euros (524,7 millions de francs) permettra
de poursuivre l'effort de modernisation du réseau sur les voies
structurantes pour le transport de marchandises mais aussi sur les canaux et
rivières voués au tourisme fluvial grâce notamment à
la mise en oeuvre des projets inscrits aux contrats de plan
Etat-régions
».
Or, comme l'a souligné le rapport de la commission d'enquête du
Sénat sur les infrastructures de transport, sur la base d'une estimation
de Voies navigables de France (VNF), le coût de la remise en état
du réseau serait compris entre 1,1 et 2,65 milliards d'euros, et le
coût annuel de maintenance de 68,6 à 83,8 millions d'euros.
Avec une dotation de 80 millions d'euros, le budget des transports ne fait
qu'assurer une simple maintenance, sans réhabilitation.
En matière de
grands projets
, alors que le projet Seine-Est ne
figure pas parmi les objectifs des nouveaux schémas de service
transport, le projet Seine-Nord, qui a pour but de relier la Seine et l'Oise
aux réseaux de canaux du Nord de la France et du Benelux par un canal
à grand gabarit, ne fait aucun progrès.







