M. Thierry FOUCAUD
-
PRINCIPALES OBSERVATIONS DE VOTRE COMMISSION DES
FINANCES
-
PROGRAMME 741 « PENSIONS CIVILES ET
MILITAIRES DE RETRAITE ET ALLOCATIONS TEMPORAIRES
D'INVALIDITE »
-
PROGRAMME 742 « OUVRIERS DES
ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT »
-
PROGRAMME 743 « PENSIONS MILITAIRES
D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ET AUTRES PENSIONS »
-
ANNEXE
Le présent rapport spécial est fait au nom de la commission des finances.
Votre rapporteur spécial ne partage pas l'approche strictement gestionnaire, comptable, qui le contraint : le cadre imposé par la LOLF, et les indicateurs de performance élaborés dans sa lignée évacuent en effet toutes considérations politiques et sociales.
Or votre rapporteur estime que ces considérations sont essentielles, et qu'elles constituent le coeur d'un débat relatif à la solidarité nationale, comme c'est bien évidemment le cas pour la présente mission.
C'est pourquoi il souhaite que les indicateurs retenus pour évaluer les dépenses de l'État au titre des pensions soient reconsidérés, mis en débat public, avec les citoyens, les parlementaires, et les bénéficiaires des régimes de pension.
Il attend de ces indicateurs qu'ils puissent renseigner, et ouvrir la discussion, sur le niveau de vie des retraités de la fonction publique.
A ce sujet, votre rapporteur spécial observe :
•
La nette dégradation du pouvoir
d'achat des retraités tenant au nouveau mode de calcul issu de la loi du
21 août 2003.
•
Que cette dégradation est pour
une part la conséquence de l'indexation de la revalorisation des
pensions sur le taux d'inflation hors tabac retenu par le gouvernement,
mentionné dans le rapport économique, social et financier
annexé au projet de loi de finances. Or cet indice donne une inflation
nettement inférieure à celle observée par l'INSEE.
•
Que cette dégradation tient
également aux charges pesant particulièrement lourd sur les
budgets des retraités, singulièrement la hausse du forfait
hospitalier, le déremboursement de médicaments, le forfait de 1
euro sur les visites médicales, la hausse des complémentaires
santé,...
•
Un décrochage du minimum de
pension par rapport au minimum de traitement.
PRINCIPALES OBSERVATIONS DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
|
*
|
COMPTE D'AFFECTATION SPECIALE « PENSIONS »
•
Le compte d'affectation
spéciale « Pensions » représente
45,25 milliards d'euros
de crédits de paiement, soit
17 % du total des crédits
de paiement du projet de
loi de finances pour 2006, et les dépenses de pension constituent
la partie la plus dynamique des dépenses de personnel.
Malgré leur importance , ces charges sont aujourd'hui disséminées dans le budget de l'Etat et leur financement n'est pas identifié en raison du principe de non affectation des recettes. L'article 21 de la LOLF prévoit ainsi l'instauration d'un « Compte de pensions » en 2006, équilibré en recettes et en dépenses . Les recettes prévues pour financer les opérations du compte d'affectation spéciale doivent être « par nature, en relation directe avec les dépenses concernées », et complétées par des versements du budget général.
Les recettes afférentes aux pensions étant affectées au présent compte d'affectation spéciale (CAS) et ce dernier devant être équilibré, les versements provenant du budget général constituent la charge nette du régime des pensions .
Outre la clarification 2 ( * ) qui résulte de la mise en place du CAS « pensions », un des enjeux principaux est la responsabilisation des gestionnaires qui devront désormais, au titre des programmes dont ils ont la charge, verser les « cotisations employeurs » se rapportant aux fonctionnaires qui en relèvent. S'il ne s'agit jamais ici que d'une individualisation comptable, et non juridique, la contrainte de financement est réelle , car les crédits sont limitatifs , la LOLF n'ayant pas autorisé le recours à des crédits évaluatifs pour le CAS « pensions ». Il importe donc de fixer les taux de contribution ( infra ) avec prudence, dans le cadre d'une gestion rigoureuse susceptible de préfigurer la mise en place d'un régime individualisé.
Afin d'éviter les difficultés de trésorerie, le II de l'article 36 du présent projet de loi de finances portant création du présent CAS propose que l' établissement public de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom procède à un versement exceptionnel 3 ( * ) d'un milliard d'euros au profit de la première section du compte d'affectation spéciale , au plus tard le 20 janvier 2006. Il s'agit de pallier les inconvénients du décalage existant entre le rythme infra-annuel des dépenses et des recettes du compte, qui aboutirait à un excédent des dépenses cumulées sur les recettes cumulées d'environ 800 millions d'euros au mois d'août dans le cadre d'un exercice cependant équilibré sur l'année.
Si le versement prévu contribue à l'amélioration du solde budgétaire à hauteur de 1 milliard d'euros , l'exposé des motifs de l'article 36 précité précise qu'il constitue un « fonds de roulement (...) destiné uniquement à absorber les décalages de trésorerie infra-annuels, [qui] devra être reconstitué à l'identique en fin d'exercice »...
Par ailleurs, il est à noter que le compte opère certaines compensations qui réduisent de 10 milliards d'euros 4 ( * ) le volume de la dépense et des recettes du budget général.
•
Le compte d'affectation
spéciale « Pensions » est composé de
3 programmes
, constituant autant de
« sections »
, dont les moyens sont
récapitulés par le tableau ci-dessous :
Décomposition des moyens du compte d'affectation spéciale « Pension »
( en milliards d'euros )
|
Crédits de paiement pour 2006 |
Part des crédits du compte d'affectation spéciale |
|
|
Programme 741 « Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité » |
40,63 |
89,8 % |
|
Programme 742 « Ouvriers des établissements industriels de l'Etat » |
1,71 |
3,8 % |
|
Programme 743 « Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions » |
2,91 |
6,4 % |
|
Total du compte d'affectation spéciale « Pension » |
45,25 |
100 % |
Le programme 741 comporte ainsi les neuf dixièmes des crédits dévolus au compte de pension.
Si la clarification des conditions de financement du régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat (PCMR) constitue l'objet principal du CAS « Pensions », l'article 21 de la LOLF prévoit plus généralement que sont retracées de droit sur ce compte « les opérations relatives aux pensions et avantages accessoires ». Il a été décidé d'imputer au présent CAS les pensions réunissant les trois conditions suivantes :
1. il doit s'agir d' avantages (et non de versements en contrepartie d'un travail) à vocation viagère ou quasi viagère 5 ( * ) ;
2. l'« Etat » doit en être la personne morale redevable ;
3. le bénéficiaire doit être une personne physique , ce qui exclut les versements effectués par l'État en vue de financer les pensions à la charge d'autres personnes morales (dont certains sont appréhendés par la mission « Régimes sociaux et de retraite »).
Ainsi, les pensions ici retracées sont :
(Au titre du programme 741 « Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité »)
1. les pensions servies au titre du régime des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR) ;
2. les allocations temporaires d'invalidité ;
(au titre du programme 742 « Ouvriers des établissements industriels de l'Etat »)
3. les opérations du fonds de pension des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) ;
4. les opérations du fonds relatif aux rentes accidents du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) ;
(au titre du programme 743 « Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions »)
5. la retraite du combattant ;
6. les traitements attachés à la Légion d'honneur et à la médaille militaire ;
7. les pensions servies au titre du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre (PMIVG) et les allocations rattachées ;
8. les opérations du régime des pensions d'Alsace-Lorraine ;
9. les allocations de reconnaissance des anciens supplétifs ;
10. les pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien ;
11. les pensions servies au titre du régime d'indemnisation spécifique des sapeurs-pompiers volontaires ;
12. les pensions de l'ORTF.
En revanche, les versements ne constituant pas des engagements de l'Etat portant directement sur les pensions n'ont pas vocation à apparaître au sein du CAS « Pensions » . Il en va ainsi :
1. des cotisations que l'Etat verse en tant qu'employeur :
- à diverses caisses de retraite ou fonds au bénéfice de ses agents non titulaires (CNAVTS, IRCANTEC, ARRCO, AGIRC),
- et au régime additionnel institué sur les primes des fonctionnaires 6 ( * ) instauré par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qui sont dues à des personnes morales ;
2. des subventions versées par l'Etat à des régimes de retraite ou des régimes sociaux versant des pensions , qui figurent au sein de la mission « Régimes spéciaux et de retraite ».
Si le présent CAS pouvait être a priori constitué d'autant de programmes -ou de « sections »- qu'il devait lui être imputé de « régimes » de pensions différents, le regroupement de certains régimes, correspondant à des pensions peu nombreuses ou de faibles enjeux financiers, est apparu opportun. Il est à noter que la réunion sur le même programme 741 des pensions civiles et de pensions militaires de retraite n'empêche pas de différentier le taux de la contribution employeur pour ces deux populations ( infra ).
•
Les ressources humaines participant
à la mise en oeuvre des actions du compte d'affectation
spéciale
n'y sont pas retracées
, même
ex post
.
L'article 20 de la LOLF s'y opposant ( infra ), les frais de gestion administrative ne sont pas retracés par le présent CAS. Ils sont supportés par l'action « Gestion des pensions » du programme « Gestion fiscale et financière de l'Etat et du service public local » de la mission « Gestion et contrôle des finances publiques » du budget général.
Ils couvrent essentiellement les frais de personnel, qui correspondent à l'emploi de 1.125 ETPT , dont 442 ETPT au service des pensions , qui concède les pensions de retraite et d'invalidité ainsi que les allocations temporaires d'invalidité, 565 ETPT dans les 27 centres régionaux des pensions (CRP) , services déconcentrés de la direction générale de la comptabilité publique (DGCP), qui paient les pensions, et 118 autres ETPT de la DGCP, correspondant à des fonctions de soutien.
Au total, l'action « Gestion des pensions » représente 66 millions d'euros, mais il subsisterait des difficultés pour analyser les coûts complets, notamment dans la chaîne de liquidation. Cependant, on peut regretter l'absence de clé de répartition analytique dans le « bleu » « Comptes spéciaux ». Il lui est associé un objectif de qualité de service qui s'est traduit par la mise en place de trois indicateurs ( infra ).
Il est à noter que les dépenses de gestion des deux régimes de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE et RATOCEM) sont rattachées au compte, dans une optique de révélation des coûts complets du régime. Mais il s'agit de dépenses d'intervention, correspondant aux frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, qui ne sont donc pas exprimées en ETPT.
PROGRAMME 741 « PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET ALLOCATIONS TEMPORAIRES D'INVALIDITE »
Les finalités du programme « Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité » sont, d'une part, de servir les pensions des fonctionnaires civils et des militaires, d'autre part, de verser l'allocation temporaire d'invalidité. Ainsi, la présente section du CAS « Pensions » est subdivisée en trois actions, dont la première concerne les fonctionnaires civils, et la deuxième les fonctionnaires militaires La troisième action, qui concerne les allocations temporaires d'invalidité, est marginale, puisqu'elle y représente moins de 0,5 % des crédits.
•
Les enjeux et le fonctionnement d'un
compte retraçant les pensions civiles
(action 1)
et
militaires
(action 2)
en 2006
En 2006, le montant des pensions civiles et militaires versées doit s'élever à 38 milliards d'euros , représentant plus de 14 % du budget général . En 1990, le poids des pensions était de 9,3 % du budget.
Le présent programme constitue donc la principale section de la mission « Pensions », dont il comporte l'essentiel des enjeux . Aujourd'hui encore, le régime de l'Etat ne fait l'objet d'aucune individualisation, et les charges de pensions sont retracées à divers endroits du budget : la contribution de l'Etat se confond avec le financement budgétaire des pensions par les différents ministères 7 ( * ) . La mise en place d'un compte permet d'isoler les flux à l'image d'un régime de retraite doté de la personnalité juridique, afin de donner la meilleure représentation du régime de l'Etat .
La mise en place du compte d'affectation spéciale « Pensions » et, en particulier, du présent programme, entraîne une pleine responsabilisation des gestionnaires de programmes, qui devront verser, à proportion des rémunérations d'activité, des « cotisations employeurs » dont le taux est calculé pour équilibrer les charges et les recettes de la présente section du compte de pension . Ainsi, ils ne paieront pas pour les politiques de recrutement passées, alors qu'aujourd'hui, les effectifs pensionnés sont payés à partir des sections budgétaires dont ces derniers relevaient lorsqu'ils étaient en activité.
La « contribution employeur » a été introduite par l'article 63 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, selon lequel « la couverture des charges résultant, pour l'État, de la constitution et du service des pensions prévues par [le code des pensions civiles et militaires de retraite] (...) est assurée par :
« 1° Une contribution employeur à la charge de l'État, assise sur les sommes payées aux agents (...) à titre de traitement ou de solde (...) ;
« 2° Une cotisation à la charge des agents (...), assise sur les sommes payées à ces agents à titre de traitement ou de solde (...) ;
« 3° Les contributions et transferts d'autres personnes morales (...). »
La « contribution employeur » de l'Etat constitue donc la « variable d'ajustement » permettant d' équilibrer les recettes et les dépenses attenantes aux retraites des fonctionnaires civils et militaires compte tenu d'éventuels excédents antérieurs. Il résulte de cette contrainte d'équilibre des taux 8 ( * ) élevés : ils s'élèvent à 49,9 % au titre des personnels civils et à 100 % au titre des personnels militaires, cette différence s'expliquant par celle des situations démographiques respectives, avec 1,6 actif pour un fonctionnaire civil pensionné et 0,8 actif pour un militaire pensionné.
Comme ces rapports démographiques 9 ( * ) doivent se dégrader rapidement avec respectivement 1,3 actif et 0,7 actif par pensionné en 2010 , les taux de contribution sont appelés à être révisés périodiquement , et cela même en cours d'exercice si, en raison d'une mauvaise évaluation, le taux de contribution s'avère insuffisamment élevé.
L'actualisation des taux mettra les dépenses de personnel concernées « sous tension » car ils constitueront, lors des conférences budgétaires, un facteur d'augmentation automatique de l'enveloppe requise pour des effectifs inchangés, et il entraînerait une augmentation automatique des frais de personnel dans une enveloppe inchangée en cas de variation en cours d'exercice.
Cette évolution est à mettre en parallèle avec l'instauration de la fongibilité asymétrique , qui ne permet pas, en cours d'année, de redéployer des crédits vers des dépenses de personnels.
Au total, d'une façon, générale, les ministères et les différents gestionnaires de programmes seront incités à mieux pondérer leurs décisions de recrutements, non seulement en gestion, mais aussi en amont, lors des conférences budgétaires.
Décomposition du compte de retraite des fonctionnaires
Les dépenses au titre des deux premières actions du programme 741 comprennent :
•
les dépenses de
pension
:
- les pensions stricto sensu , y compris celles versées aux anciens personnels de la Poste et de France Telecom ;
- les majorations de pensions versées aux retraités dont la pension est inférieure au minimum vieillesse ;
•
les dépenses de
transfert
:
- les versements à la CNAV et à l'IRCANTEC, au titre des titulaires sans droit à pension ;
- concernant les fonctionnaires civils 10 ( * ) , une charge de compensation inter-régimes, en raison d'une situation démographique relativement favorable.
Figurent en recettes :
•
les cotisations et
contributions
:
- les cotisations salariales au taux, reconduit à l'identique, de 7,85 % ;
- la contribution employeur de l'Etat ( infra ), fixée pour 2006 au taux de 49,9 % pour les personnels civils (soit 22,4 milliards d'euros) , et de 100 % pour les militaires (soit 7,6 milliards d'euros), et la contribution des offices et établissements publics de l'Etat 11 ( * ) au titre des fonctionnaires qu'ils emploient, au taux de 33 % 12 ( * ) ;
- concernant les fonctionnaires civils , une contribution de France Télécom 13 ( * ) et de La Poste 14 ( * ) ;
•
les transferts
:
- concernant les fonctionnaires civils , le versement annuel de l'établissement public affectataire de la soulte versée par France Telecom en 1997 ;
- le remboursement, par le Fonds de solidarité vieillesse, des majorations de pensions au titre du minimum vieillesse ( supra ) ;
- les versements, par la CNAV et l'IRCANTEC, des cotisations patronales au titre de validations de service d'anciens agents non titulaires de l'Etat ;
- concernant les militaires , un transfert de compensation inter-régimes, en raison d'une situation démographique relativement dégradée.
*
Si la différenciation du taux entre personnels civils et personnels militaires est le gage d'une responsabilisation équitable des gestionnaires , le taux de cotisation employeur pour les organismes publics et semi-publics qui emploient des fonctionnaires de l'Etat, actuellement fixé à 33 % , apparaît, en regard, d'une faiblesse que rien ne justifie.
Par ailleurs, les frais de gestion administrative ne figurent pas dans le CAS « Pensions » , mais sont inscrits à la mission du budget général intitulée « Gestion et contrôle des finances publiques ». L'article 20 de la LOLF dispose en effet qu'« il est interdit d'imputer directement à un compte spécial des dépenses résultant du paiement de traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature ».
Il n'y a donc pas de lecture des coûts complets, et la représentation d'un régime des retraites de l'Etat est encore imparfaite .
•
Les allocations temporaires
d'invalidité
(action
3)
L'action « Allocations temporaires d'invalidité » (ATI) permet de financer le risque « accident du travail » dans des conditions analogues à celles du régime général ou de la fonction publique territoriale.
En appliquant la même logique de responsabilisation intégrale des gestionnaires qui a prévalu pour les deux premières actions du présent programme, une « contribution employeur » de l'Etat, fixée au taux de 0,3 % , permet de financer la charge des a llocations temporaires d'invalidité.
LES CRÉDITS ET LA JUSTIFICATION PAR ACTION
Le tableau suivant retrace l'évolution du coût des pensions et le montant des crédits destinés au programme 741 :
Evolution du coût des pensions civiles et militaires de retraite et montant des crédits destinés au programme 741
(en millions d'euros)
|
Crédits de paiement pour 2006 |
Dont dépenses de pension |
Part du budget de la mission |
|||
|
2005 |
2005 |
Variation 2006/2005 |
|||
|
Action 1 « Fonctionnaires civils relevant du code des pensions civiles et militaires » |
32,1 |
27,7 |
29,5 |
6,5% |
79,1% |
|
Action 2 « Militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite » |
8,4 |
8,2 |
8,3 |
1,3% |
20,6% |
|
Action 3 « Allocations temporaires d'invalidité » |
0,14 |
0,14 |
0,3% |
||
|
Total du programme « Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres » |
40,6 |
37,9 |
100,0% |
||
Il apparaît bien que la dépense de pension civile est particulièrement évolutive, avec une progression de 6,5 %. Le tableau suivant retrace l'évolution des différentes lignes composant le CAS « Pensions ».
Evolution des ressources et des charges des pensions des fonctionnaires de l'Etat de 2004 à 2006
(en millions d'euros)
|
EMPLOIS |
Exécution |
LFI |
PLF |
En % des emplois |
Evolution 2006/2005 |
|
2004 |
2005 |
2006 |
|||
|
Pensions |
34.240 |
35.844 |
38.076 |
94,3% |
6,2% |
|
Civils hors PTT |
21.747 |
22.870 |
24.799 |
61,4% |
8,4% |
|
La Poste |
2.797 |
2.925 |
3.121 |
7,7% |
6,7% |
|
France Télécom |
1.637 |
1.740 |
1.832 |
4,5% |
5,3% |
|
Militaires |
8.058 |
8.309 |
8.323 |
20,6% |
0,2% |
|
Complément de pension financé par le FSV |
1 |
0 |
1 |
0,0% |
|
|
Transferts |
2.213 |
2.319 |
2.321 |
5,8% |
0,1% |
|
Compensations (nettes) |
2.133 |
2.239 |
2.240 |
5,6% |
0,0% |
|
Versements à la CNAV et à l'IRCANTEC |
80 |
80 |
81 |
0,2% |
1,3% |
|
TOTAL DES EMPLOIS |
36.453 |
38.163 |
40.397 |
100,0% |
5,9% |
|
RESSOURCES |
Exécution |
LFI |
PLF |
En % des emplois |
2006/2005 |
|
2004 |
2005 |
2006 |
|||
|
Cotisations salariales |
4.751 |
4.693 |
4.840 |
11,7% |
3,1% |
|
Civils hors PTT et militaires |
4532 |
4.472 |
4622 |
11,2% |
3,4% |
|
France Télécom |
219 |
221 |
218 |
0,5% |
-1,4% |
|
Contributions des autres employeurs que l'Etat |
4.710 |
4.772 |
5.006 |
12,1% |
4,9% |
|
Contribution de France Télécom |
1049 |
1.069 |
1.065 |
2,6% |
-0,4% |
|
Remboursement de La Poste |
2829 |
2.920 |
3.104 |
7,5% |
6,3% |
|
Contribution des établissements publics |
832 |
783 |
837 |
2,0% |
6,9% |
|
Transferts |
390 |
418 |
1.411 |
3,4% |
237,6% |
|
Établissement de la soulte F. Télécom |
297 |
327 |
1.360 |
3,3% |
315,9% |
|
Versements de la CNAV et de l'IRCANTEC |
82 |
80 |
50 |
0,1% |
-37,5% |
|
Récupération des indus sur pension |
10 |
10 |
0 |
0,0% |
-100,0% |
|
FSV |
1 |
1 |
1 |
0,0% |
0,0% |
|
TOTAL DES RESSOURCES hors contribution de l'Etat |
9.851 |
9.883 |
11.257 |
27,2% |
13,9% |
|
Contribution de l'Etat
|
26.602 |
28.280 |
30.140 |
72,8% |
6,6% |
|
TOTAL DES RESSOURCES |
36.453 |
38.163 |
41.397 |
100,0% |
8,5% |
•
Concernant les fonctionnaires
civils
, les dépenses de pension, en progression de plus de
6,5 %, s'établissent à
29,5 milliards
d'euros
. Cette évolution se justifie principalement par la
prise en compte des éléments suivants, à partir d'un
montant de dépenses évaluées à 27,7 milliards
d'euros pour 2005 :
- effet des radiations : - 725 millions d'euros, dont 365 millions d'euros d'effet report des radiations de 2005 et 360 millions d'euros au titre de 2006 ;
- effet des entrées : + 2 milliards d'euros, dont 1,2 milliard d'euros 15 ( * ) d'effet report des entrées de 2005 et 0,8 milliard d'euros au titre de 2006 ;
- effet de l' indexation des pensions par référence à l'inflation (1,8 %) : + 510 millions d'euros.
• Concernant les fonctionnaires
militaires
, les dépenses de pension, en progression de plus de
1,3 %, s'établissent à
8,3 milliards
d'euros
. Cette évolution se justifie principalement par la
prise en compte des éléments suivants, à partir d'un
montant de dépenses évaluées à 8,2 milliards
d'euros pour 2005 :
- effet des radiations : - 249 millions d'euros, dont 123 millions d'euros d'effet report des radiations de 2005 et 126 millions d'euros au titre de 2006 ;
- effet des entrées : + 267 millions d'euros, dont la moitié correspond à l'effet report des entrées de 2005 et l'autre moitié à des dépenses nouvelles en 2006 ;
- effet de l' indexation des pensions par référence à l'inflation (1,8 %) : + 120 millions d'euros.
VUE PROSPECTIVE
L'évolution du rapport démographique et du coût des pensions est désormais marqué par l'impact de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et par certaines mesures qui l'ont prolongée (cf. développements en annexe).
•
L'évolution
démographique
Le graphe suivant rend compte des tendances lourdes de l'évolution démographique du régime de l'Etat, fonctionnaires civils et militaires confondus :
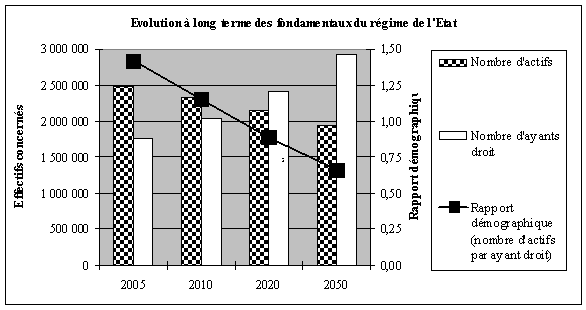 Source : graphe
construit sans pondération du rapport démographique à
partir de documents de travail communiqués sur le site du Conseil
d'orientation des retraites (COR), qui s'appuient sur le modèle de
projection à long terme « Ariane », conçu
notamment pour
évaluer l'impact de la réforme des
retraites de 2003
.
Source : graphe
construit sans pondération du rapport démographique à
partir de documents de travail communiqués sur le site du Conseil
d'orientation des retraites (COR), qui s'appuient sur le modèle de
projection à long terme « Ariane », conçu
notamment pour
évaluer l'impact de la réforme des
retraites de 2003
.
•
L'évolution du besoin de
financement du régime de l'Etat
A législation inchangée, le besoin de financement des régimes de la fonction publique a été évalué par le conseil d'orientation des retraites (COR) à 28 milliards d'euros en 2020 16 ( * ) , ce qui représente 1,3 % du PIB .
La réforme des retraites devait permettre de diminuer ce besoin de financement de 13 milliards d'euros. Le tableau suivant permet de détailler les facteurs de cette inflexion.
Impact des différentes mesures sur le besoin de financement des régimes de la fonction publique en 2020
(en milliards d'euros)
|
Etat |
CNRACL 17 ( * ) |
Total |
|
|
Besoin de financement en 2020, à droit constant |
-20,8 |
-7,5 |
-28,3 |
|
Allongement de la durée d'assurance, création de la décote et de la surcote, et réforme du minimum garanti |
6,8 |
2,8 |
9,6 |
|
Indexation sur les prix |
3,3 |
1,2 |
4,5 |
|
Création du régime additionnel |
-0,4 |
-0,4 |
-0,8 |
|
Majoration du 10 ème dans la fonction publique hospitalière |
- |
-0,2 |
-0,2 |
|
Extension aux hommes de l'avantage de réversion |
-0,05 |
-0,05 |
-0,1 |
|
Extension de la cessation progressive d'activité |
-0,05 |
-0,05 |
-0,1 |
|
Solde des mesures de redressement |
9,6 |
3,3 |
12,9 |
|
Besoin de financement en 2020, après réforme |
-11,2 |
-4,2 |
-15,4 |
Source : réponse au questionnaire budgétaire, jaune « fonction publique » annexé au projet de loi de finances pour 2005
D'après les informations figurant dans le « bleu », l'économie attendue de la réforme pour le régime de l'Etat s'élèverait à 8,5 milliards d'euros en 2020 dont 7,2 milliards d'euros pour les fonctionnaires civils, mais elle n'excèderait pas 1,8 milliard d'euros en 2010 dont 1,6 milliard d'euros pour les fonctionnaires civils et 300 millions d'euros en 2005.
•
Les engagements de l'Etat au titre des
retraites
Un chiffre figurant sur le Compte général de l'administration des finances (CGAF) paru en juin 2003 n'avait pas manqué de frapper les esprits : les engagements de l'Etat au titre des retraites des fonctionnaires et des agents publics relevant des régimes spéciaux se seraient élevés, fin 2002, à 708 milliards d'euros, ce qui représentait près de la moitié du produit intérieur brut.
Réévalués à 940 milliards d'euros fin 2003, le CGAF de l'exercice 2004 les a finalement chiffrés à 890 milliards d'euros compte tenu de la réforme des retraites, soit 55 % du PIB .
Ces engagements correspondent au montant actualisé des pensions restant à verser aux retraités, et qui seront à verser à l'ensemble des actifs à la date d'évaluation, leurs pensions futures étant prises en compte au prorata des années de service effectuées à cette date par rapport au nombre d'années de services au moment du départ à la retraite. Cette méthode, dite des « unités de crédit projetées », est préconisée par la norme comptable IAS 19 pour estimer les avantages de retraite du personnel.
Cependant, les chiffres obtenus sont relativement peu précis car particulièrement sensibles au niveau du taux d'actualisation 18 ( * ) retenu pour les retraites à verser et aux changements de comportements induits par la réforme des retraites , ainsi que le montre le tableau suivant :
Montant des engagements après réforme en fonction du taux d'actualisation retenu
( en milliards d'euros )
|
Taux d'actualisation |
2 % |
2,5 % |
3 % |
|
Engagements après réforme : scénario de changements de comportements lents : |
1 000 |
910 |
830 |
|
Engagements après réforme : scénario de changements de comportements rapides : |
950 |
870 |
790 |
Source : CGAF de l'exercice 2004
Par ailleurs, ces évaluations n'ont aucune implication pratique : l'Etat ne sera jamais mis en faillite, jamais obligé de licencier l'ensemble de ses fonctionnaires, et jamais obligé de leur régler par avance la valeur actualisée de l'ensemble des pensions dues.
Elles ont néanmoins une certaine 19 ( * ) valeur illustrative , et il était légitime de rechercher dans quelle mesure la réforme des retraites des fonctionnaires était susceptible de l'infléchir : bien que les dispositions entraînant une diminution des droits soient d'une application progressive, leur incidence sur le calcul de la masse des pensions versées à l'âge légal d'ouverture des droits à retraite est sensible.
LA PERFORMANCE DU PROGRAMME
Les objectifs du programme correspondent à des engagements pris par l'Etat qui, dès lors qu'il ne les remet pas en cause en cours d'exercice, n'en maîtrise pas l'évolution. Il ne saurait donc être question de poursuivre, du moins à court terme, de véritables objectifs d'« efficacité socioéconomique », mais plutôt d'efficience de la gestion et de qualité du service .
Ainsi, les frais de gestion administrative, bien que figurant à l'action « Gestion des pensions » du programme « Gestion fiscale et financière de l'Etat et du service public local » de la mission « Gestion et contrôle des finances publiques » du budget général, ont ici donné lieu à la production d' un indicateur indiquant le coût unitaire d'une primo-liquidation.
Pour ce qui est de la qualité du service, si aucun indicateur ne figure au sein du présent projet annuel de performance, il est cependant prévu au niveau du programme « Gestion fiscale et financière de l'Etat et du service public local » de la mission « Gestion et contrôle des finances publiques » du budget général trois indicateurs de qualité , respectivement intitulés « Pourcentage de dossiers de départs en retraite urgents traité dans le délai de deux semaines », « Pourcentage de dossiers de demandes de pensions de réversion traités dans le délai d'une semaine » et « Pourcentage des courriers traités dans le délai de trois semaines, pour les correspondances classiques, et de 48 heures, pour les messages électroniques ».
Par ailleurs, malgré l'insignifiance des leviers d'action, deux indicateurs concernant respectivement l' âge moyen de la radiation des cadres et la durée moyenne de cotisation ont été mis en place pour les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat. Il faut se féliciter de ce suivi qui est au fond celui du succès de la réforme des retraites , et peut être, en tant que de besoin, l'inspirateur de réformes à venir.
En revanche, on peut déplorer ici l'absence de l'objectif « Optimiser la prévision de dépenses et recettes de pensions », qui figure dans le projet annuel de performance de la deuxième section du CAS « Pensions » concernant les ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui draine pourtant un volume de crédits bien moins élevé.
Cela, d'autant plus que le versement exceptionnel d'un milliard d'euros par l'établissement public de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom ( supra ) doit être cantonné dans un rôle de « fonds de roulement (...) destiné uniquement à absorber les décalages de trésorerie infra-annuels, [et qui] devra être reconstitué à l'identique en fin d'exercice », ainsi qu'énonce l'exposé des motifs de l'article 36 du présent projet de loi de finances.
|
Observations de votre commission des finances sur le programme 741 « Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité »
*
|
PROGRAMME 742 « OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT »
La deuxième section du compte d'affectation spéciale « Pensions » retrace principalement les opérations du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE). Les plus gros employeurs des ouvriers de l'Etat sont les ministères de la défense (88 % des pensionnés et 77 % de l'effectif cotisants) et de l' équipement (7 % des pensionnés et 18 % de l'effectif cotisant).
Les quatre premières actions de la présente section concernent respectivement les prestations vieillesse et invalidité, les cessations anticipées d'activité, les « autres dépenses spécifiques » et la gestion du régime.
La cinquième et dernière action du programme 742 retrace les dépenses et les recettes du fonds relatif aux rentes accidents du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM).
Le FSPOEIE, dépourvu de personnalité morale, est géré par la Caisse des dépôts et consignations . Ce régime connaît un fort déséquilibre démographique avec, à fin 2004, quelque 57.000 cotisants pour plus de 110.000 pensionnés , soit 0,52 cotisant pour un pensionné .
L'enjeu du programme 742 est celui d'une plus grande transparence concernant les mouvements du FSPOIE, les charges relatives au paiement des pensions n'étant pas, jusqu'alors, retracées dans les comptes de l'Etat. Cependant, à la différence de la première section du CAS « Pensions », le présent programme ne fait pas apparaître des taux de contribution employeurs correspondant à la charge réelle des pensionnés .
En effet, la contribution patronale, maintenue au taux de 24 % , ne permet pas d'équilibrer le FSPOEIE, et une subvention de l'Etat continuera à être versée en complément. Pour 2006, cette subvention sera, comme les années précédentes, répartie au prorata des effectifs des pensionnés relevant des programmes concernés (en lieu et place des sections budgétaires).
Le degré de responsabilisation des gestionnaires demeure donc inchangé par rapport à 2005 . Il est « supérieur » à celui qui prévalait pour les pensions civiles et militaires en l'absence de contribution patronale, mais « inférieur » à celui qui résultera du fonctionnement de la première section du présent CAS avec une contribution patronale d'équilibre entièrement assise sur les effectifs employés (alors que la subvention d'équilibre qui complète la contribution patronale est ici répartie en fonction de la politique de recrutement passée).
Décomposition des opérations relative au FSPOEIE
Les charges du programme 742 comprennent au titre de ses quatre premières actions :
•
les dépenses de
pension :
- les prestations de vieillesse et d'invalidité ;
- les majorations de pensions au titre du minimum vieillesse ;
- le coût de cessation anticipée d'activité financée par les établissements ou organismes sous tutelle du secteur de la défense ;
•
les transferts financiers
à la CNAV et à l'IRCANTEC au titre des titulaires sans
droits ;
•
le coût des charges de
gestion
du régime,
qui est ici pris en compte, à
la différence de la première section du CAS
« Pensions »
.
Figurent en recettes:
• les cotisations et
contributions
:
- les cotisations salariales au taux, reconduit à l'identique, de 7,85 % ;
- une contribution de l'employeur (Etat ou établissement concerné) au taux, reconduit à l'identique, de 24 % (soit 482 millions d'euros en 2006) ;
- la subvention d'équilibre inscrite les programme ministériel rémunérant des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (901 millions d'euros en 2006) ;
• les transferts :
- un transfert de compensation inter-régimes qu'explique une situation démographique ici très dégradée par rapport aux autres régimes de sécurité sociale ;
- diverses recettes dont, notamment, le remboursement par le fond de solidarité vieillesse des majorations de pensions au titre du minimum vieillesse.
*
En définitive, le taux de cotisation employeur , fixé à 24 % depuis le 1 er janvier 1999 (au lieu de 10,34 %) , apparaît étonnamment faible au regard des taux d'équilibre de l'Etat. Pour les fonctionnaires militaires, dont le rapport démographique est cependant plus favorable que celui des ouvriers de l'Etat, le taux d'équilibre est fixé à 100 %... Il conviendrait certainement de réviser à la hausse le taux de 24 % afin d'aboutir à une responsabilisation équitable des gestionnaires.
Cependant, votre commission des finances estime qu'une démarche « jusqu'au-boutiste » entraînerait des effets pervers : faire supporter l'intégralité des coûts des pensions des ouvriers de l'Etat par les cotisations employeurs pourrait avoir un effet totalement dissuasif pour les gestionnaires, alors même que des recrutements s'avèreraient indispensables, et finalement précipiter une dégradation du rapport démographique qui déboucheraient sur de nouvelles augmentations de cotisations. Au total, les gestionnaires seraient injustement pénalisés au titre des effectifs déjà employés.
En tout état de cause, un taux de cotisation de l'ordre de 50 %, qui entraînerait une diminution de la subvention d'équilibre, aboutirait à un financement du FSPOEIE plus conforme à la recherche d'équité et de vérité des coûts imprimée par la LOLF.
LES CRÉDITS ET LA JUSTIFICATION PAR ACTION
Le tableau suivant fait apparaître l'évolution des ressources et des charges du FSPOEIE :
Evolution des ressources et des charges des pensions des fonctionnaires de l'Etat de 2004 à 2006
(en millions d'euros)
|
2005 |
2006 |
Evolution 2006/2005 |
|
|
Pensions |
1 606,5 |
1 636,2 |
1,8% |
|
Frais de gestion |
8,3 |
8,2 |
-1,2% |
|
Divers |
2,2 |
2 |
-9,1% |
|
TOTAL EMPLOIS |
1 617 |
1 646,4 |
1,8% |
|
Retenues pour pensions |
113,1 |
115,9 |
2,5% |
|
Contributions patronales |
344,6 |
354,2 |
2,8% |
|
Compensations démographiques |
159 |
142 |
ns |
|
Contribution du Ministère de la Défense |
133,9 |
127,9 |
-4,5% |
|
Divers produits |
5,8 |
5 |
-13,8% |
|
TOTAL RESSOURCES avant subvention |
756,4 |
745,1 |
-1,5% |
|
Subvention d'équilibre versée par l'Etat |
933,3 |
901,4 |
-3,4% |
|
TOTAL RESSOURCES après subvention |
1 689,7 |
1 646,4 |
-2,6% |
La diminution de la subvention d'équilibre s'explique principalement par la perspective d'un meilleur ajustement des ressources aux emplois.
LA PERFORMANCE DU PROGRAMME
Les objectifs du programme correspondent à des engagements pris par l'Etat qui, dès lors qu'il ne les remet pas en cause, n'en maîtrise pas l'évolution. Il ne saurait donc être question, d'une manière générale, de poursuivre de véritables objectifs d'« efficacité socioéconomique », mais plutôt d'efficience de la gestion et de qualité du service .
Le régime de retraite des ouvriers de l'Etat a été concerné par la réforme des retraites (dont la transposition a été permise par deux décrets 20 ( * ) ), et l'on retrouve ici les indicateurs portant sur l'âge moyen de la radiation des cadres et la durée moyenne de cotisation qui ont été mis en place pour les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat. Ce suivi est intéressant pour évaluer les effets des mesures prises et le potentiel d'évolution du régime.
Pour ce qui est de la qualité du service de la Caisse des dépôts et consignations, on peut regretter qu' aucun indicateur ne figure au sein du présent projet annuel de performance. En revanche, trois indicateurs concernent l'efficience de la gestion : outre le coût unitaire d'une primo-liquidation, déjà prévu pour le programme 741, figure le « Rapport entre les rémunérations servies par l'Etat et le montant des prestations servies », ainsi que le « Taux de récupérations des indus et trop-versés ».
Enfin, l' objectif « Optimiser la prévision de dépenses et recettes de pensions » est particulièrement bienvenu dans le cadre d'une gestion équilibrée du programme, qui impose de calculer une subvention d'équilibre suffisante.
|
Observations de votre commission des finances sur le programme 742 « Ouvriers des établissements industriels de l'Etat »
*
|
PROGRAMME 743 « PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ET AUTRES PENSIONS »
A la différence des deux premières sections du CAS « Pensions », le programme 743 n'obéit pas à une logique contributive : il est entièrement financé par une subvention d'équilibre comprise dans les crédits des différents programmes ministériels. La présente section constitue donc un authentique « compte miroir », qui reflète des mouvements retracés par ailleurs dans le budget général, et donnant lieu aux développements qui s'imposent dans les rapports budgétaires concernés.
Les dépenses recensées comprennent :
- les dépenses afférentes à la « Reconnaissance de la Nation » (action 1), c'est-à-dire la retraite du combattant et les traitements attachés à la Légion d'honneur et à la médaille militaire ;
- les dépenses de « Réparation » (action 2), qui sont les dépenses dues au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- les pensions « Pensions d'Alsace-Lorraine » (action 3), dans le cadre du régime concordataire en vigueur ;
- les « Allocations de reconnaissance des anciens supplétifs » (action 4) versées aux anciens harkis et membres des formations supplétives en Algérie ;
- les « Pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopiens » (action 5) ;
- les « Pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accidents » (action 6) qui concernent plus de 1.800 personnes ;
- les « Pensions de l'ORTF » (action 7) qui comprennent 17 rentes d'accidents du travail à fin 2004 et quelque « 450 allocations surcomplémentaires de retraite ».
LES CRÉDITS PAR ACTION
Le tableau suivant donne les crédits des différentes actions du programme « Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions » :
Décomposition par actions des crédits du programme 743
(en millions d'euros)
|
Crédits de paiement pour 2006 |
Part du budget de la mission |
|
|
Action 1 « Reconnaissance de la nation » |
641,8 |
22,0% |
|
Action 2 « Réparation » |
2143 |
73,6% |
|
Action 3 « Pensions d'Alsace-Lorraine » |
13,9 |
0,5% |
|
Action 4 « Allocation de reconnaissance des anciens supplétifs » |
100 |
3,4% |
|
Action 5 « Pensions des anciens agents de chemin de fer franco-ethiopien » |
0,1 |
0,004% |
|
Action 6 « pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accidents » |
11,9 |
0,4% |
|
Action 7 « Pensions de l'ORTF » |
0,8 |
0,03% |
|
Total du programme « Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions » |
2911,5 |
100% |
LA PERFORMANCE DU PROGRAMME
Votre commission des finances sait gré au responsable du programme de ne pas avoir mis en place d'indicateur de résultat compte tenu des enjeux rencontrés ici, particulièrement réduits en termes de performance. Il renvoie, le cas échéant, aux développements concernant la mesure de la performance dans les rapports budgétaires concernés.
|
|
ANNEXE
LES GRANDES LIGNES DE LA REFORME DES RETRAITES DU 21 AOUT 2003
Notre collègue Adrien Gouteyron a détaillé dans son rapport pour avis 21 ( * ) les principales mesures de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites , dont l'objectif était d'infléchir la dérive financière des régimes de la fonction publique en établissant une nouvelle équité vis à vis des autres régimes.
Il est rappelé que la réforme, qui est entrée progressivement en vigueur à compter du 1 er janvier 2004, concerne, selon des modalités analogues, les trois fonctions publiques (de l'Etat, territoriale et hospitalière), dont les régimes sont très proches.
Ses grandes caractéristiques sont les suivantes :
•
Un niveau de pension pour une
carrière complète inchangé
Le taux de liquidation, établi à 75 %, demeure inchangé , et s'applique à une assiette du calcul toujours égale au traitement correspondant à l'indice effectivement détenu depuis six mois.
Le pourcentage maximal de liquidation et l'assiette du calcul étant ainsi reconduits, le niveau des pensions pour une carrière complète se trouve maintenu.
•
L'augmentation de la durée de
cotisation et l'instauration d'une surcote
La durée de cotisation est portée de 150 trimestres (soit 37 années et demie) en 2003, à 160 trimestres 22 ( * ) (soit 40 années) en 2008 , l'objectif est de stabiliser 23 ( * ) dans le temps le rapport entre la durée d'assurance et l'espérance de vie à la retraite.
Comme l'allongement de la durée de cotisation n'aurait pas suffit, à lui seul, à infléchir les comportements en matière de départ à la retraite, il a été instauré 24 ( * ) une décote et une surcote 25 ( * ) dans le régime de l'Etat : un coefficient de minoration (décote) de 1,25 % par trimestre manquant s'applique au montant de la pension liquidée, dans la limite de 20 trimestres .
La réforme est d' application très progressive : l'allongement de la durée de cotisation de 37 ans et demi à 40 ans s'effectue graduellement de 2004 à 2008, tandis que la décote montera progressivement en puissance de 2006 à 2020, « relayant » l'allongement de la durée de cotisation , le dispositif transitoire étant calibré pour que la décote soit négligeable les premières années. Les tableaux suivants retracent ces évolutions, inscrites dans la loi portant réforme des retraites précitée :
Allongement progressif de la durée de cotisation
|
Année de la liquidation |
Nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire |
|
Jusqu'en 2003 |
150 |
|
2004 |
152 |
|
2005 |
154 |
|
2006 |
156 |
|
2007 |
158 |
|
2008 |
160 |
Instauration progressive de la décote
|
Année de la liquidation |
Taux du coefficient de minoration, par trimestre manquant pour obtenir le pourcentage maximum de la pension |
Age auquel le coefficient de minoration s'annule, exprimé par rapport à la limite d'âge du grade 26 ( * ) |
|
Jusqu'en 2005 |
sans objet |
sans objet |
|
2006 |
0,13% |
limite d'âge moins 16 trimestres |
|
2007 |
0,25% |
limite d'âge moins 14 trimestres |
|
2008 |
0,38% |
limite d'âge moins 12 trimestres |
|
2009 |
0,50% |
limite d'âge moins 11 trimestres |
|
2010 |
0,63% |
limite d'âge moins 10 trimestres |
|
2011 |
0,75% |
limite d'âge moins 9 trimestres |
|
2012 |
0,88% |
limite d'âge moins 8 trimestres |
|
2013 |
1% |
limite d'âge moins 7 trimestres |
|
2014 |
1,13% |
limite d'âge moins 6 trimestres |
|
2015 |
1,25% |
limite d'âge moins 5 trimestres |
|
2016 |
1,25% |
limite d'âge moins 4 trimestres |
|
2017 |
1,25% |
limite d'âge moins 3 trimestres |
|
2018 |
1,25% |
limite d'âge moins 2 trimestres |
|
2019 |
1,25% |
limite d'âge moins 1 trimestre |
La limite d'âge de droit commun étant fixée à 65 ans, l'effet de la décote est donc plafonné à quatre trimestres en 2006, à six trimestres en 2007, etc., jusqu'à 20 trimestres en 2020 pour une liquidation demandée à 60 ans.
Ainsi, force est de constater que la réforme se déploie avec une progressivité suffisante pour modifier les comportements sans jamais véritablement « surprendre » les fonctionnaires : plus ils sont avancés dans leur carrière, plus les modalités de liquidation de leurs pensions seront proches des précédentes. Le graphe suivant permet de rendre compte de cette progressivité, qui devrait cependant impliquer, à terme, un ajustement important des comportements :
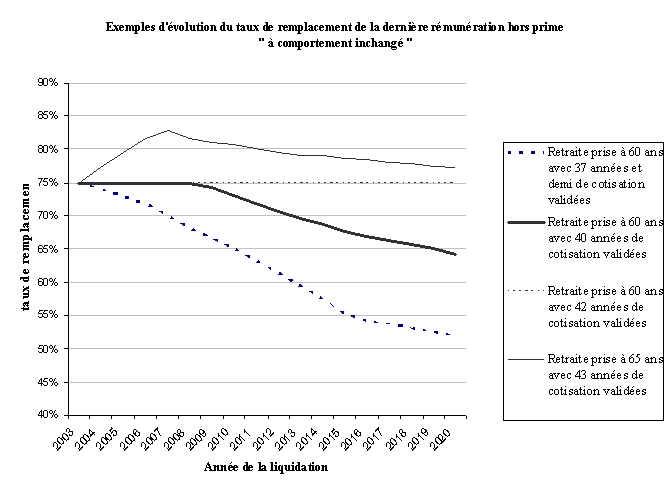
•
L'harmonisation des règles de
liquidation
La principale iniquité vis-à-vis du secteur privé ne résidait pas dans le niveau des pensions, mais dans l'absence de décote en cas de carrière incomplète (c'est-à-dire, jusqu'en 2004, d'une durée inférieure à 150 trimestres).
Les tableaux suivant permettent de comparer, avant puis après réforme, les principales règles de liquidation du régime général et du régime de l'Etat, faisant notamment ressortir ces points d'asymétrie donnant lieu à convergence que constituent la décote et la surcote.
Comparaison des règles de liquidation avant réforme (régime général et régime de l'Etat)
|
REGLES DE LIQUIDATION |
REGIME GENERAL |
FONCTION PUBLIQUE |
|
|
Âge normal de la liquidation |
60 ans |
60 ans 27 ( * ) |
|
|
Durée de cotisation nécessaire à l'obtention d'une retraite à taux plein |
40 ans |
37,5 ans |
|
|
Base de calcul |
Moyenne des 25 meilleures années |
6 derniers mois hors primes |
|
|
Taux de liquidation |
50 % |
75 % |
|
|
Modulation |
|||
|
Proratisation de la pension en fonction de la durée de cotisation |
La proratisation a lieu sur 37,5 ans (150 trimestres) : il est donc pratiqué un abattement de 2,66 % (= 100 / 37,5) sur la pension à taux plein par année manquante pour atteindre les 37,5 ans |
||
|
Décote |
Il est en outre pratiqué une décote de 10 % par année manquante pour atteindre 40 ans (160 trimestres) de cotisation, ou 28 ( * ) 65 ans, cette décote étant plafonnée à 50 % . |
non |
|
|
Surcote |
Au delà de 65 ans , une surcote de 10 % par an est appliquée ; le taux de liquidation ne peut toutefois excéder 50 % |
non |
|
|
REGLES DE LIQUIDATION |
REGIME GENERAL |
FONCTION PUBLIQUE |
||||
|
Durée de cotisation nécessaire à l'obtention d'une pension à taux plein |
40 ans |
40 ans 29 ( * ) |
||||
|
Modulation |
||||||
|
Proratisation de la pension en fonction de la durée de cotisation |
La proratisation a lieu sur 40 ans 30 ( * ) (160 trimestres) : il est donc pratiqué un abattement de 2,5 % (= 100 / 40) sur la pension à taux plein par année manquante pour atteindre les 40 ans |
|||||
|
Surcote |
Au delà de 60 ans et de 40 ans de cotisations , une surcote de 3 % par an est appliquée |
Au delà de 60 ans et de 40 ans de cotisations , une surcote de 3 % par an est appliquée, dans la limite de 15 % (20 trimestres pris en compte) |
|
Maintien en activité au delà de la limite d'âge (65 ans sauf services actifs) |
Sans objet |
Si le pourcentage maximal de la pension n'est pas obtenu à la limite d'âge, possibilité de prolonger l'activité dans la limite de 10 trimestres |
Comparaison des règles de liquidation
après réforme (régime général et
régime de l'Etat)
•
L'unification des
mécanismes de revalorisation des pensions
Les pensions étaient revalorisées par une indexation sur la valeur du point d'indice cumulée, le cas échéant, au dispositif de revalorisation de l'ancien article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat qui permettait, à l'occasion de réformes statutaires applicables aux actifs, de réviser les pensions des retraités s'étant trouvés appartenir aux mêmes corps au moment de leur cessation d'activité.
Depuis le 1 er janvier 2004, le pouvoir d'achat des pensions est garanti par référence à l'évolution de l'indice des prix constaté chaque année -ce que n'assurait pas la référence à la valeur du point d'indice- et dans des conditions de parfaite égalité -que n'assurait pas l'application de l'article L. 16 précité- pour l'ensemble des agents. Les revalorisations suivent ainsi les mêmes règles que pour les pensionnés du secteur privé 33 ( * ) .
• Les autres éléments de
la réforme des retraites de la fonction publique
1) Les modifications résultant de la conciliation des avantages familiaux avec les exigences communautaires
a) Le remplacement de la bonification pour enfants
La mise en oeuvre du principe de droit communautaire de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes a conduit à modifier les modalités de la bonification pour enfant accordée aux femmes fonctionnaires, qui se trouvait en contravention 34 ( * ) à ce principe.
Cet avantage, qui prend la forme d'une bonification d'un an par enfant des années de services effectuées, est remplacé , pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1 re janvier 2004, par une validation des périodes d'interruption ou de réduction d'activité effectivement consacrées à l'éducation d'un enfant ou aux soins donnés à un enfant malade, dont le bénéfice est étendu aux hommes . La période totale ainsi validée peut désormais atteindre une durée de trois ans par enfant, jusqu'à son huitième anniversaire.
Toutefois, une majoration de durée d'assurance de 6 mois est réservée aux femmes fonctionnaires pour chacun des enfants qu'elles ont mis au monde postérieurement à leur recrutement.
b) L'adaptation des autres avantages familiaux
Sur le fondement du même principe de droit communautaire de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, la possibilité de bénéficier d'un départ anticipé lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, est également étendue aux hommes. De même , les modalités de l'attribution d' une pension de réversion actuellement accordées aux veuves de fonctionnaires sont étendues aux veufs de fonctionnaires. Enfin, l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 a mis en conformité le dispositif permettant un départ anticipé 35 ( * ) aux mères de trois enfants en l'ouvrant aux hommes et aux femmes sous condition d'interruption d'activité à l'occasion de la naissance ou de l'accueil de l'enfant.
Il est à noter que la majoration 36 ( * ) de pension accordée aux parents de trois enfants demeure inchangée, s'adressant indifféremment aux femmes et aux hommes.
c) La refonte du minimum garanti
Le montant de référence servant à la détermination du minimum garanti est fixé à un niveau supérieur de 5 % au niveau actuel, soit 993 euros, sa valeur étant exprimée sur la base de l'indice majoré 227 au 1 er janvier 2004. Le minimum garanti ne représente 100 % du montant de référence qu'à la condition d'avoir accompli 40 années de services, afin d'inciter les personnels à prolonger leur activités.
En contrepartie, le nouveau dispositif se révèle moins favorable pour les fonctionnaires dont la durée de cotisation oscille autour de 25 années. Par exemple, pour 25 années de cotisation, à partir de 2013 (terme du dispositif transitoire), il sera attribué 82,5 % de ce montant de référence contre 100 % aujourd'hui.
2) La création d'un régime public de retraite additionnelle pour les fonctionnaires
Le régime de rémunération applicable aux fonctionnaires présente la spécificité de comprendre, le cas échéant, des primes ou indemnités qui n'entrent pas dans l'assiette de calcul de la retraite. Aussi la réforme comporte-t-elle la mise en place d'un régime public par répartition, dont les ressources sont constituées de cotisations au taux de 10 % sur une assiette composée des primes et indemnités non prises en compte dans l'assiette de calcul de la retraite plafonnées à 20 % du traitement indiciaire brut total, versées à égalité par les salariés et les employeurs, et dans lequel les droits s'acquièrent sous forme de points.
3) La prise en compte des carrières longues
L'article 23 de la loi portant réforme des retraites a ouvert la possibilité d'un départ anticipé pour les assurés ayant commencé leur activité un certain âge ; le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeune et eu une longue carrière, a instauré un droit au départ anticipé à compter du 1 er janvier 2004, suivant des conditions reprises par le tableau suivant :
Conditions du droit à départ
anticipé dans le régime général
|
Date d'ouverture |
Âge du début de carrière |
Âge de départ |
Durée d'assurance validée |
Durée d'activité ayant donné lieu à cotisation |
|
1 er janvier 2004 |
moins de 16 ans |
56 ans ou 57 ans |
42 ans |
42 ans |
|
1 er janvier 2004 |
moins de 16 ans |
58 ans |
42 ans |
41 ans |
|
1 er janvier 2004 |
moins de 17 ans |
59 ans |
42 ans |
40 ans |
Dans le cadre de la réforme des retraites, qui tend à unifier les règles de liquidation des différents régimes obligatoires, publics et privés, il aurait été anormal d'instaurer un dispositif en faveur des « carrières longues » qui n'eût pas profité aux fonctionnaires , ces derniers connaissant, au surplus, l'extinction progressive du congé de fin d'activité (CFA), décidée en loi de finances pour 2003.
Ainsi, l'article 119 de la loi de finances pour 2005 a introduit dans le code des pensions civiles et militaires de retraite un article L. 25 bis nouveau , aux fins de mise en place d'un nouveau dispositif accordant aux fonctionnaires le bénéfice du départ anticipé en retraite pour carrière longue.
Les caractéristiques de ce dispositif sont retracées par le tableau suivant, qui fait apparaître, pour seule différence avec le régime général, une mise en oeuvre progressive :
|
Date d'ouverture |
Âge du début de carrière |
Âge de départ |
Durée d'assurance validée |
Durée d'activité ayant donné lieu à cotisation |
|
1 er janvier 2008 |
moins de 16 ans |
56 ans ou
|
42 ans |
42 ans |
|
1 er juillet 2006 |
moins de 16 ans |
58 ans |
42 ans |
41 ans |
|
1 er janvier 2005 |
moins de 17 ans |
59 ans |
42 ans |
40 ans |
Conditions du droit à départ
anticipé dans le régime de l'Etat
4) La prise en compte de la situation de certaines catégories
D'une part, des mesures spécifiques sont prévues pour permettre une seconde carrière aux enseignants, dont certains ressentent, selon l'exposé des motifs du projet de loi, « un besoin de renouvellement professionnel et une aspiration à changer de métier entre 40 et 50 ans ».
D'autre part, il est prévu d'accorder une majoration de durée d'assurance d'un dixième aux personnels des services actifs de la fonction publique hospitalière dont la limite d'âge est d'au moins 60 ans, pour les agents atteignant leur âge d'ouverture des droits à partir de 2008.
5) Mesures diverses
- La procédure de validation des services auxiliaires est accélérée;
- le rachat des d'années d'études est organisé ;
- la possibilité est offerte aux fonctionnaires travaillant à temps partiel de verser une cotisation majorée en vue d'augmenter la durée des services admissibles en liquidation ;
- les modalités de l'attribution d'une pension de réversion actuellement accordées aux veuves de fonctionnaires sont étendues aux veufs de fonctionnaires en application du principe de droit communautaire de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
- en vue de favoriser l'allongement de la durée d'activité, le régime de cumul d'un emploi et d'une pension est modifié, et des possibilités de maintien en activité au delà de la limite d'âge sont offertes ;
- les modalités de travail à temps partiel pour élever un enfant sont assouplies ;
- le régime de la cessation progressive d'activité est adapté et modulé, tandis que les droits des fonctionnaires bénéficiant d'un congé de fin d'activité sont préservés, ainsi que ceux des fonctionnaires affectés à France Telecom bénéficiant d'un congé de fin de carrière.
* 1 Moins de 30 % le 24 octobre, soit deux semaines après la limite fixée par la LOLF.
* 2 Le jaune bisannuel « Fonction publique » dresse cependant un tableau retraçant les emplois et les ressources du régime de l'Etat.
* 3 Conformément au IV de l'article 46 de la loi de finances pour 1997, l'établissement public de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom reverse de façon progressive au budget de l'État les 5,7 milliards d'euros correspondant à la « soulte France Télécom » alors versée en compensation du transfert à l'État de la charge de retraite de ses anciens agents fonctionnaires. Pour 2006, le versement de l'établissement public, majoré d'un milliard d'euros, doit ainsi s'élever à 1,36 milliard d'euros. Après ce versement, la soulte restant due s'élèvera à 2,3 milliards d'euros.
* 4 La création du CAS « Pensions » se traduit par une différence de périmètre en dépenses de moins 10,027 milliards d'euros et de moins 10,271 milliards d'euros en recettes.
* 5 La condition que l'allocation soit strictement viagère n'est pas exigée, permettant par exemple d'imputer sur le compte les allocations temporaires d'invalidité (ATI) versées leurs cinq premières années (à l'issue desquelles elles peuvent être conférées à titre viager) ; cette condition suppose néanmoins que le versement ait vocation à s'étendre sur une période relativement « longue », ce qui exclut l'ensemble des indemnisations liées au chômage.
* 6 Ce régime est alimenté par des cotisations fixées au taux de 10 % portant sur une assiette de primes plafonnées à 20 % du traitement indiciaire brut total. En 2005, le montant des cotisations versées doit s'établir à 1,4 milliard d'euros, dont la moitié est à la charge des employeurs publics (Etat, collectivités locales et hôpitaux).
* 7 En début d'année, les crédits des différents ministères étaient transférés sur le chapitre 32-97 du budget des charges communes, sur lequel figuraient les diverses charges de pension ; ce chapitre comprenait aussi, dès le projet de loi de finances, les crédits correspondant à l'effet annuel de l'augmentation des effectifs pensionnés et du montant unitaire des pensions, et aux charges de pension dues au titre des agents de France Télécom et de La Poste, des pensions d'Alsace-Lorraine et des agents fonctionnaires de l'Etat détachés dans divers organismes publics et semi-publics. En règle générale, les fonctionnaires retraités des budgets annexes étaient inclus dans les effectifs des ministères de rattachement et les fascicules du budget général portaient, à ce titre, les crédits de pension y afférents. Toutefois, le budget annexe de l'Aviation civile reprenait la logique de « coût complet » retenue pour les fascicules du budget général.
* 8 Les taux de contribution doivent couvrir les dépenses de l'exercice compte tenu d'éventuels excédents antérieurs, et sont appelés à être révisés périodiquement, même en cours d'exercice (une augmentation des taux mettrait alors les programmes concernés « sous tension », avec une augmentation automatique des frais de personnel dans une enveloppe inchangée), compte tenu des besoins structurels du régime. Ce « pilotage » doit être assuré au niveau de chaque section.
* 9 Il s'agit de rapports démographiques « pondérés », qui rapportent le nombre d'actifs cotisants au nombre de retraités de droit direct et de « reversataires », le nombre de ces derniers étant pondéré par le taux de réversion (50 %).
* 10 Les mécanismes de solidarité inter-régimes comprennent la compensation généralisée et de la compensation spécifique vieillesse. Ils visent à compenser les disparités démographiques et de capacité contributive entre les différents régimes de retraite.
* 11 A partir de 2000, les charges de pensions des fonctionnaires de l'Etat détachés dans divers organismes publics et semi-publics ont été couvertes par des crédits inscrits en loi de finances.
* 12 Ce taux était déjà appliqué à la plupart des organismes publics concernés.
* 13 Depuis 1997, les charges de pensions des fonctionnaires retraités de France Télécom (alors transformée en société anonyme) sont couvertes par des crédits inscrits en loi de finances. Ces charges correspondent aux retraites liquidées postérieurement au versement de la soulte, qui n'a eu pour objet que de compenser auprès de l'Etat la charge des pensions des fonctionnaires de France Télécom alors déjà liquidées.
* 14 Depuis 2000, les charges de pensions des fonctionnaires retraités de La Poste sont intégralement couvertes par des crédits inscrits en loi de finances et compensées exactement par une contribution de la Poste (il n'y a pas eu de « soulte »).
* 15 L'importance de l'effet report résulte du regroupement au mois de septembre des départs en retraite des enseignants.
* 16 Cette évaluation repose sur l'hypothèse d'un taux de chômage stabilisé à 4,5 % en 2010 (projection correspondant au « scénario macroéconomique de référence » du COR).
* 17 Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dont relèvent les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.
* 18 Le taux d'actualisation retenu dans le CGAF de l'exercice 2004 est de 2,5 %.
* 19 Les comparaisons internationales seraient éclairantes, mais leur réalisation se heurte à de nombreux obstacles méthodologiques. Il peut être cependant avancé que ces engagements représenteraient 33 % du PIB aux Etats-Unis.
* 20 Voir notamment le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat prévoyant en particulier l'instauration d'une décote progressive à l'image de celle instaurée pour les fonctionnaires (voir annexe infra).
* 21 Rapport pour avis n° 383 (2002-2003) au nom de la commission des finances.
* 22 A l'issue de la période transitoire (2004-2008) instaurée par l'article 66 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
* 23 Dans cette perspective, la durée de cotisation doit être portée progressivement (y compris pour le régime général et les régimes alignés) à 41 années de 2008 à 2012, sous réserve de l'évolution des conditions démographiques, économiques et sociales. Ensuite, la stabilisation du rapport précité commanderait une augmentation plus lente de la durée de cotisation, jusqu'à 41 années et trois trimestres en 2020.
* 24 Le premier rapport du Conseil d'orientation des retraites (2001) en avait fait une piste privilégiée pour assurer l'égalité entre les régimes.
* 25 Un mécanisme de surcote a été instauré afin d'encourager la poursuite de l'activité des fonctionnaires civils ayant atteint l'âge de 60 ans, et dont la durée d'assurance est suffisante pour obtenir le pourcentage de liquidation maximum (160 trimestres requis en 2008). Ainsi, il s'appliquera un coefficient de majoration (surcote), fixé à 0,75 % par trimestre supplémentaire, dans la limite de 20 trimestres.
* 26 Dans le mécanisme de la décote, si le nombre de trimestres manquant pour atteindre 160 trimestres s'avère supérieur au nombre de trimestres séparant la date de départ en retraite de la limite d'âge (65 ans dans le régime général), la décote s'applique en retenant ce dernier nombre de trimestres. Ainsi, en toute circonstance, la décote s'annule à la limite d'âge. Dans le présent dispositif transitoire, la limite d'âge est en quelque sorte « bonifiée » d'un nombre décroissant de trimestres.
* 27 55 ans (exemple : policier) voire 50 ans (exemple : infirmière) pour les personnels classés en « service actif » (emplois dangereux ou pénibles).
* 28 Il est retenu le calcul le plus favorable.
* 29 Augmentation progressive de la durée de cotisation de 37 ans et demi en 2003 à 40 ans en 2008.
* 30 Augmentation progressive de la durée de cotisation de 37 ans et demi en 2003 à 40 ans en 2008. La valeur de l'annuité s'établira alors à 1,875 % ( = 75 % / 40).
* 31 L'atténuation du régime de la décote dans le régime général devant en ramener le taux annuel de 10 % à 5 % s'effectue progressivement jusqu'en 2013 au rythme de 0,5 points par an . Son instauration dans les régimes de la fonction publique s'effectuera progressivement de 2005 à 2020.
* 32 Il est retenu le calcul le plus favorable.
* 33 A long terme, il est a priori difficile d'évaluer ce qu'impliquera pour les pensionnés de la fonction publique, et, symétriquement, pour les régimes de la fonction publique, la fin de l'indexation des pensions sur la valeur du point, en terme de gain ou de perte. Il peut être avancé que la nouvelle indexation protègera les pensionnés d'un changement de politique salariale qui privilégierait les primes et les mesures particulières au détriment de l'augmentation de la valeur du point, et qu'à l'inverse, elle limiterait les incidences budgétaires d'une politique active de revalorisation de la fonction publique qui se baserait essentiellement sur la valeur du point. Naturellement, il ne peut être exclu, à terme, que ce mode de revalorisation n'induise un certain « décrochage » du pouvoir d'achat des pensions par rapport à l'évolution générale des salaires. Lors de la réforme des retraites, l'évaluation de l'impact de cette mesure, qui devait procurer plus de 4 milliards d'euros d'économie à l'horizon 2020, étaye cette hypothèse.
* 34 CJCE, Griesmar c/France, 29 novembre 2001 ; CE Griesmar, 29 juillet 2002.
* 35 A partir de 15 années de service. La décote doit cependant s'appliquer.
* 36 Majoration de 10 %, puis de 5 % supplémentaires par enfants à partir du quatrième. La majoration totale est écrêtée, la pension liquidée ne pouvant excéder le dernier traitement brut.







