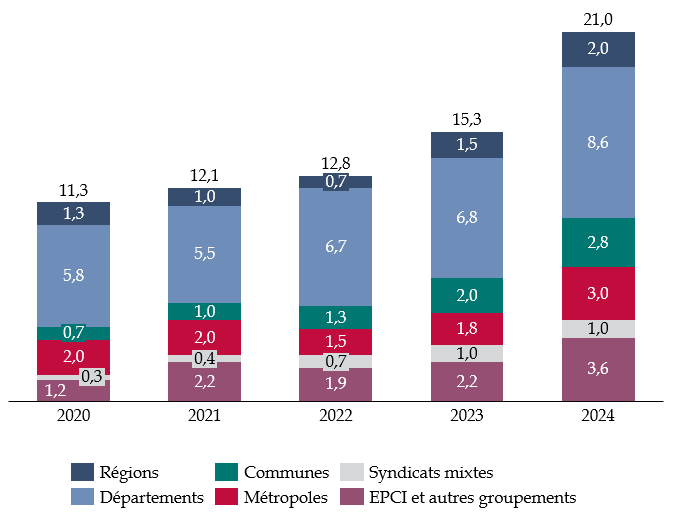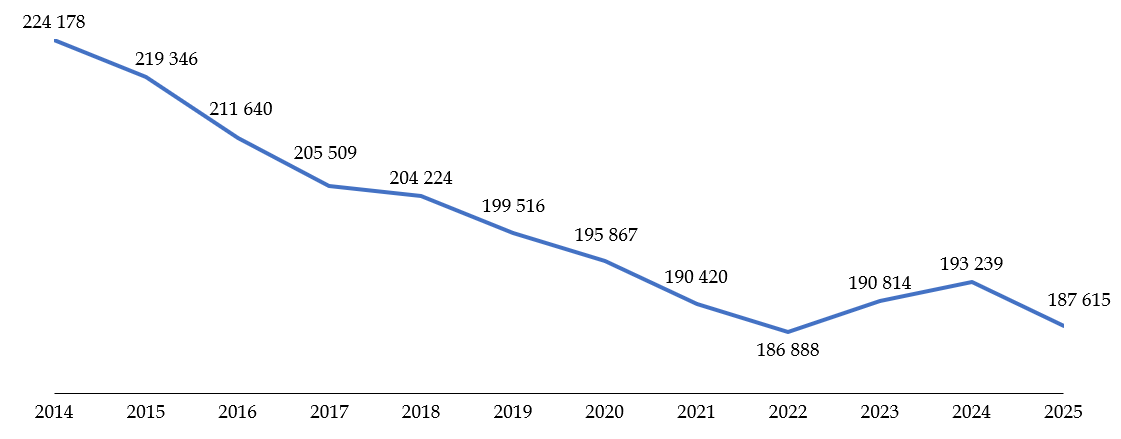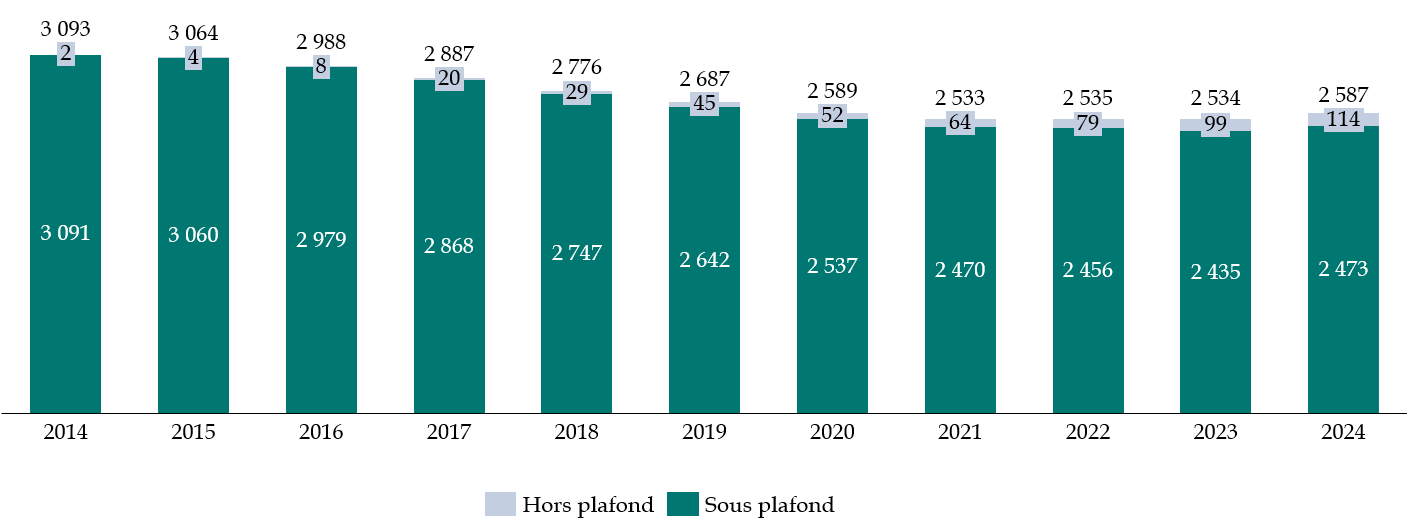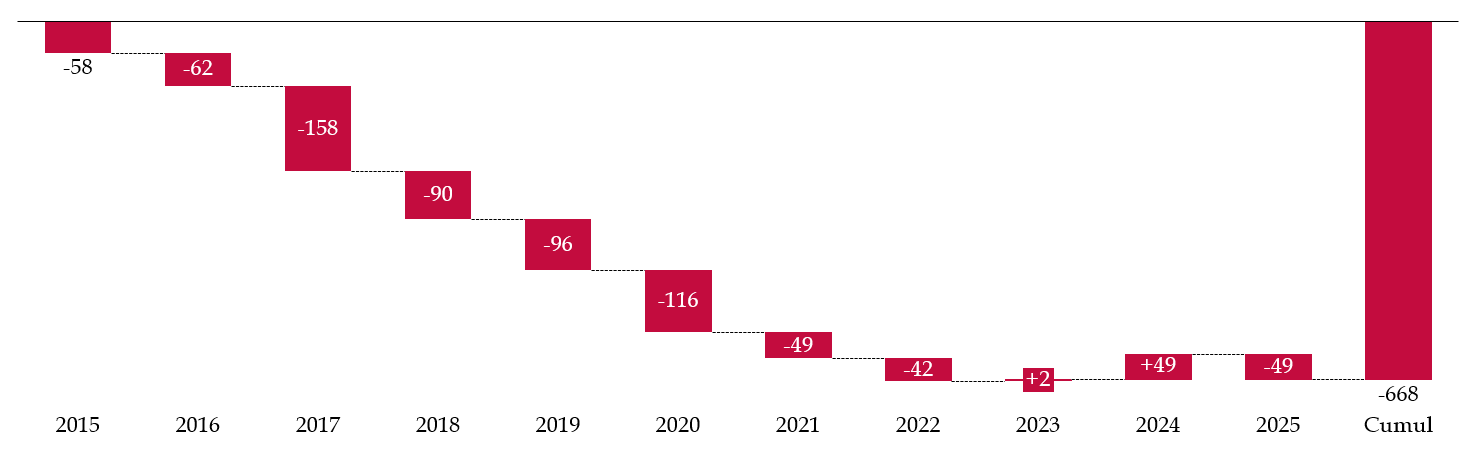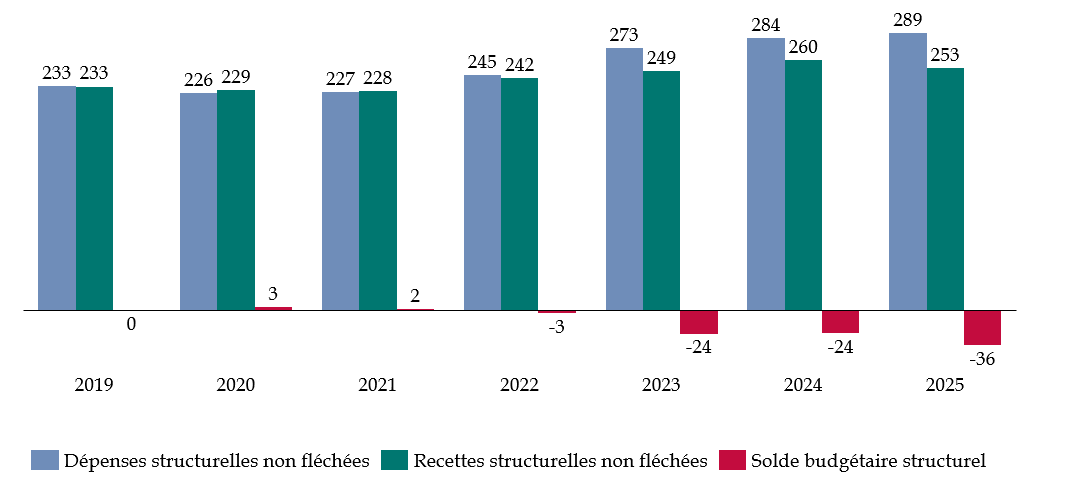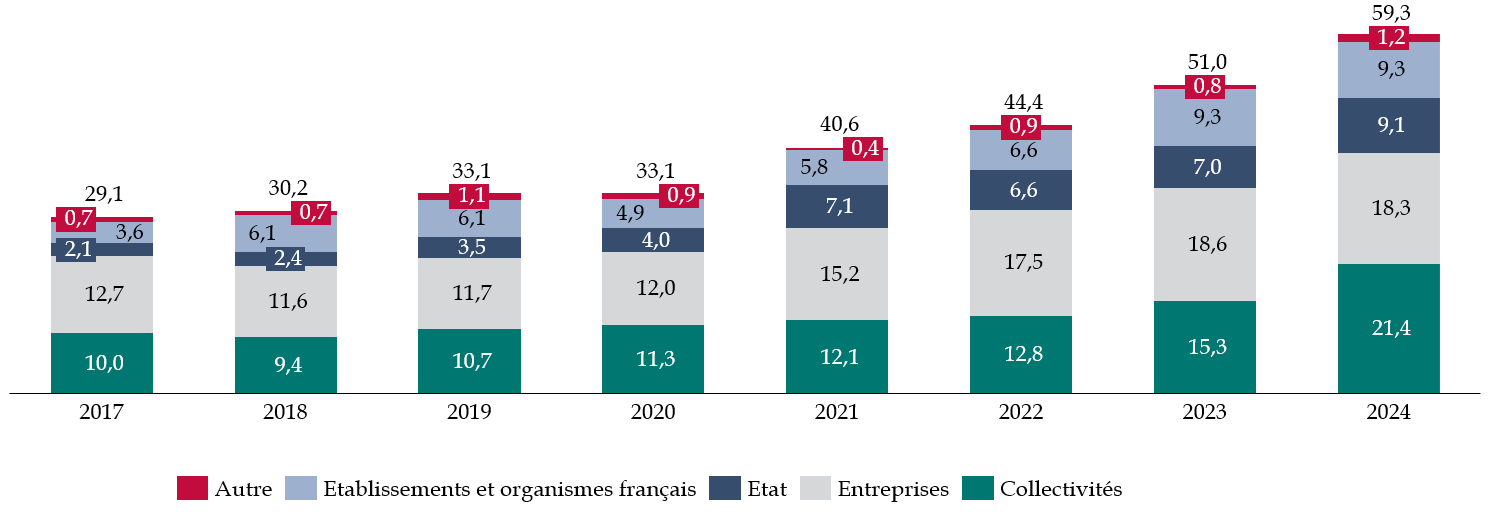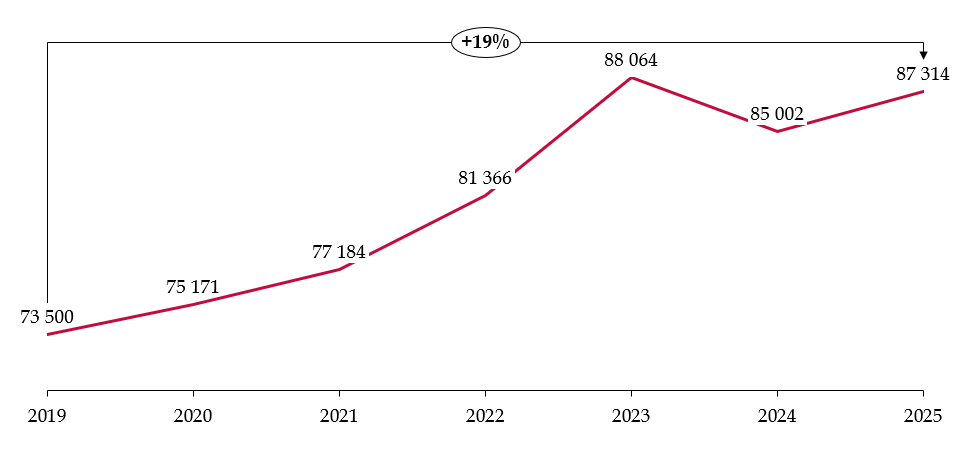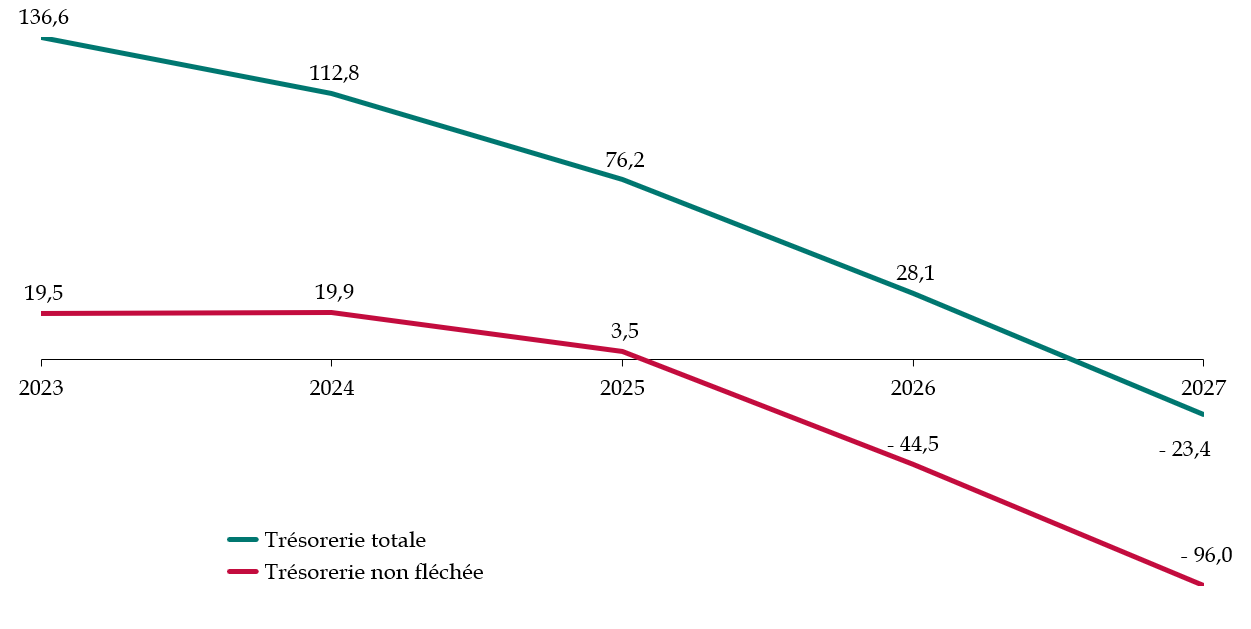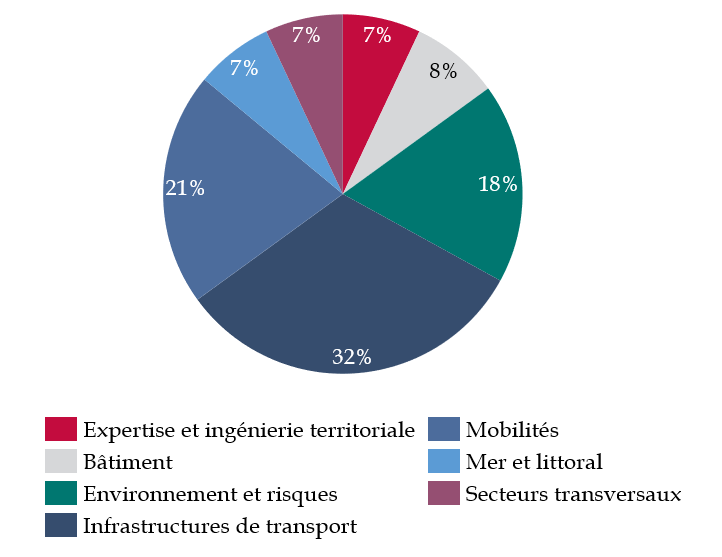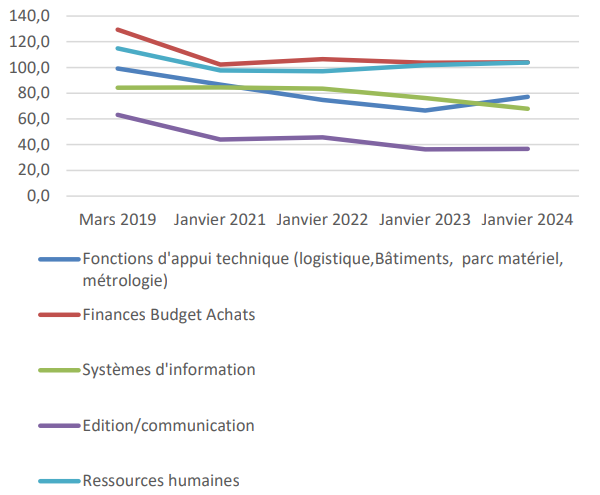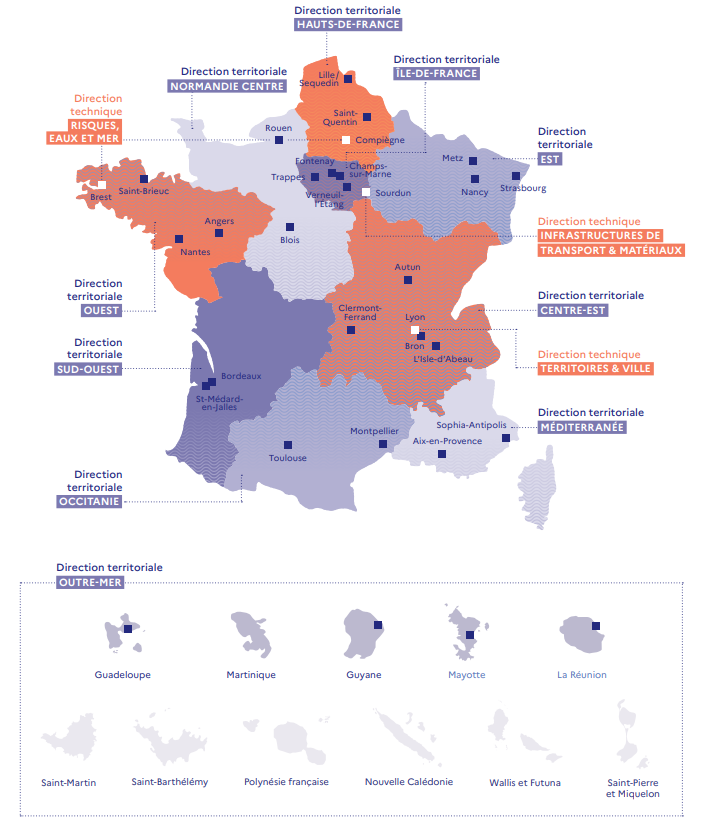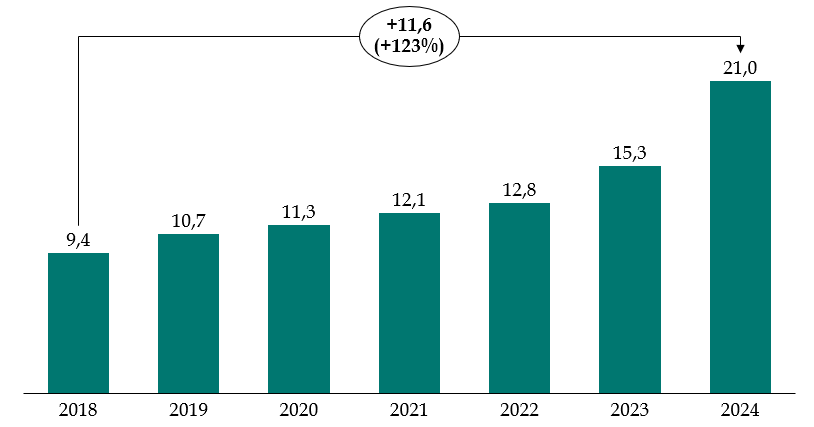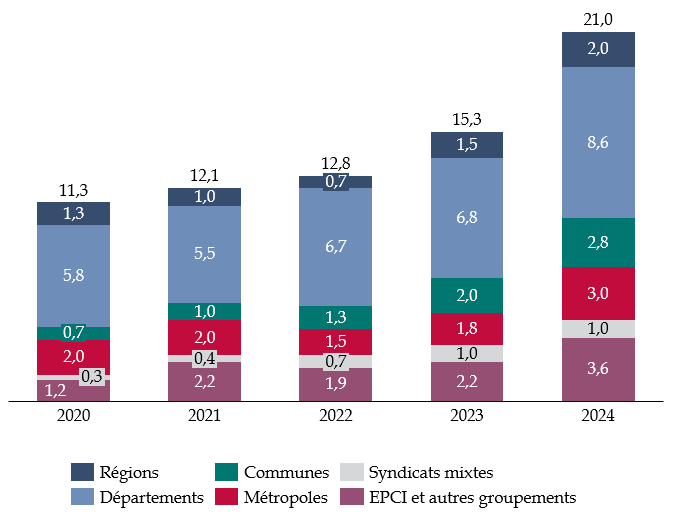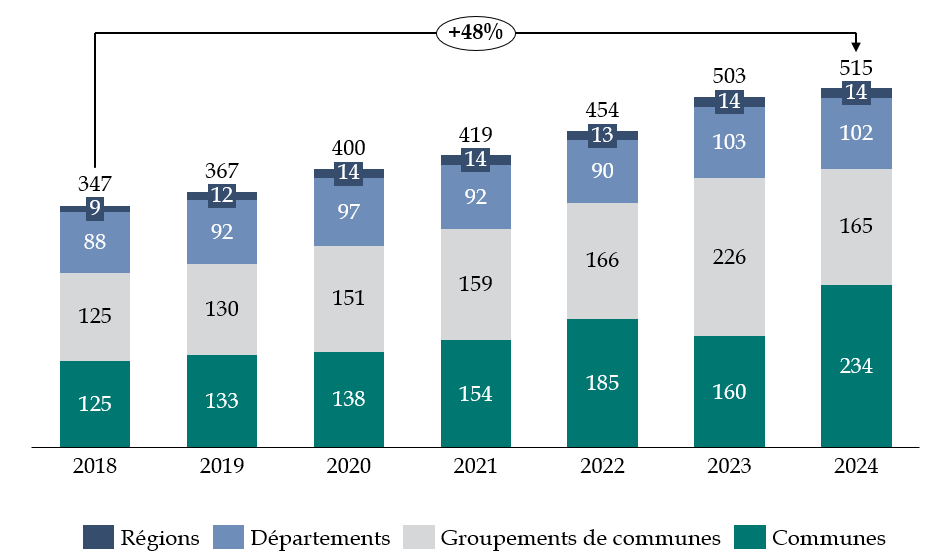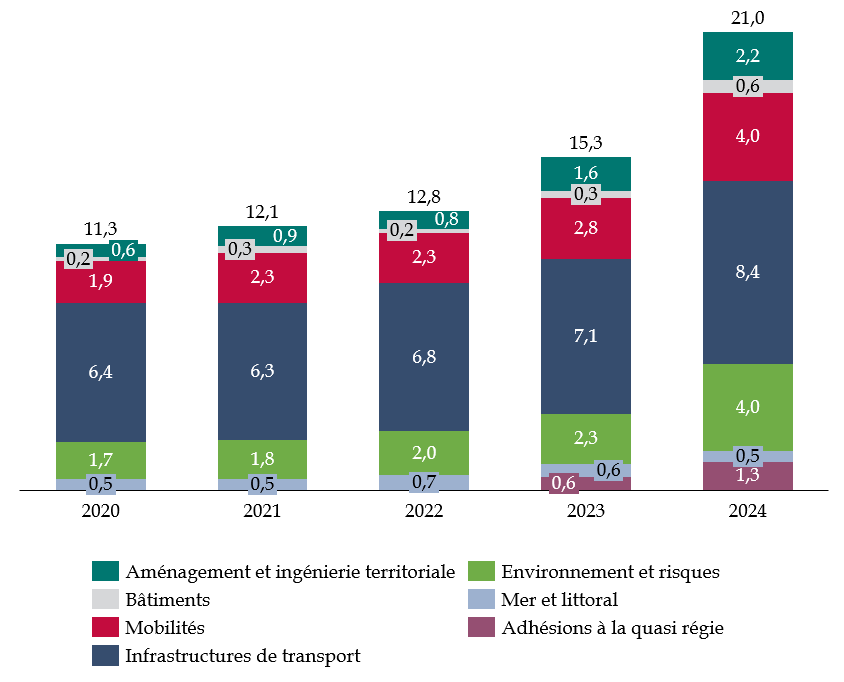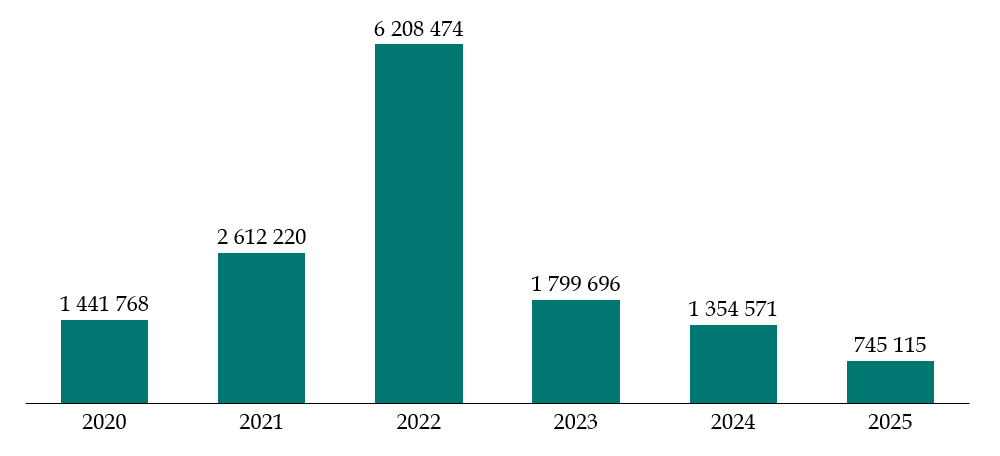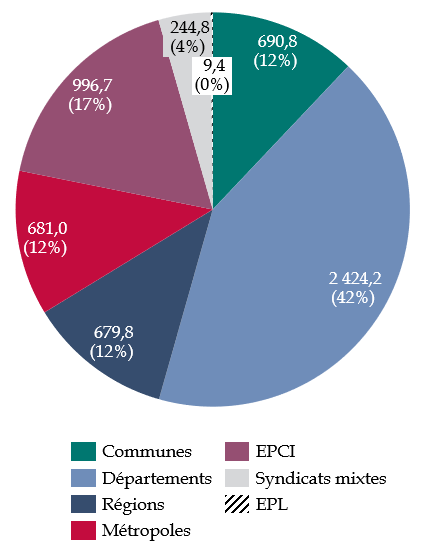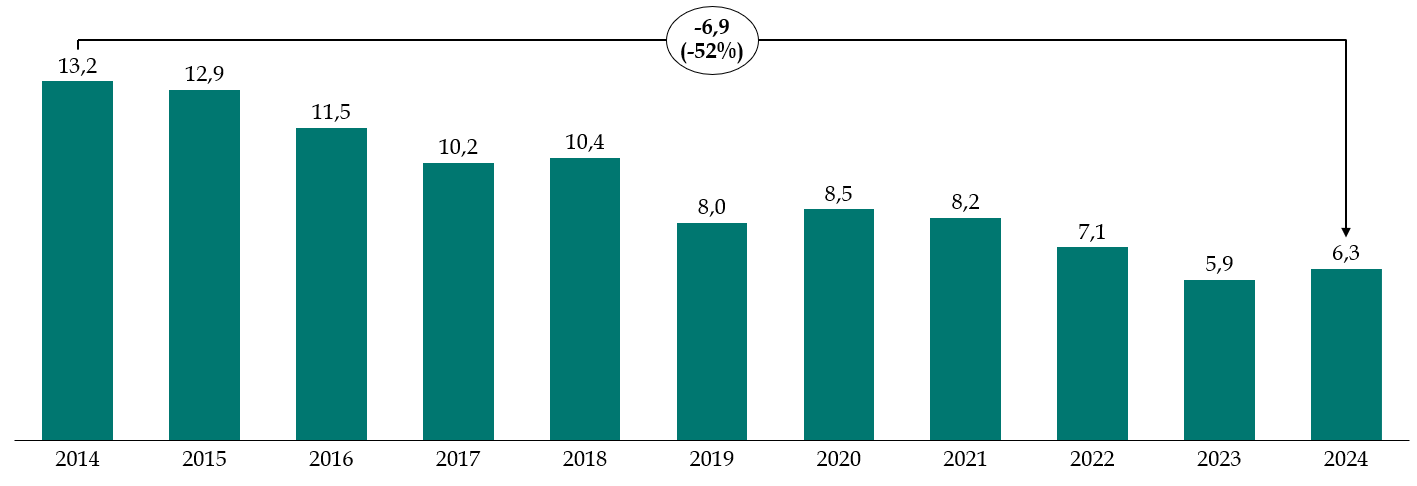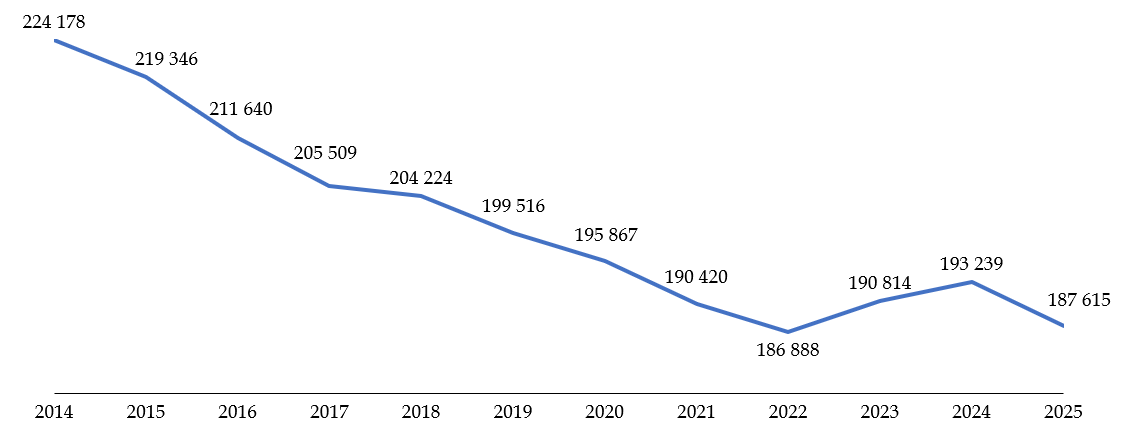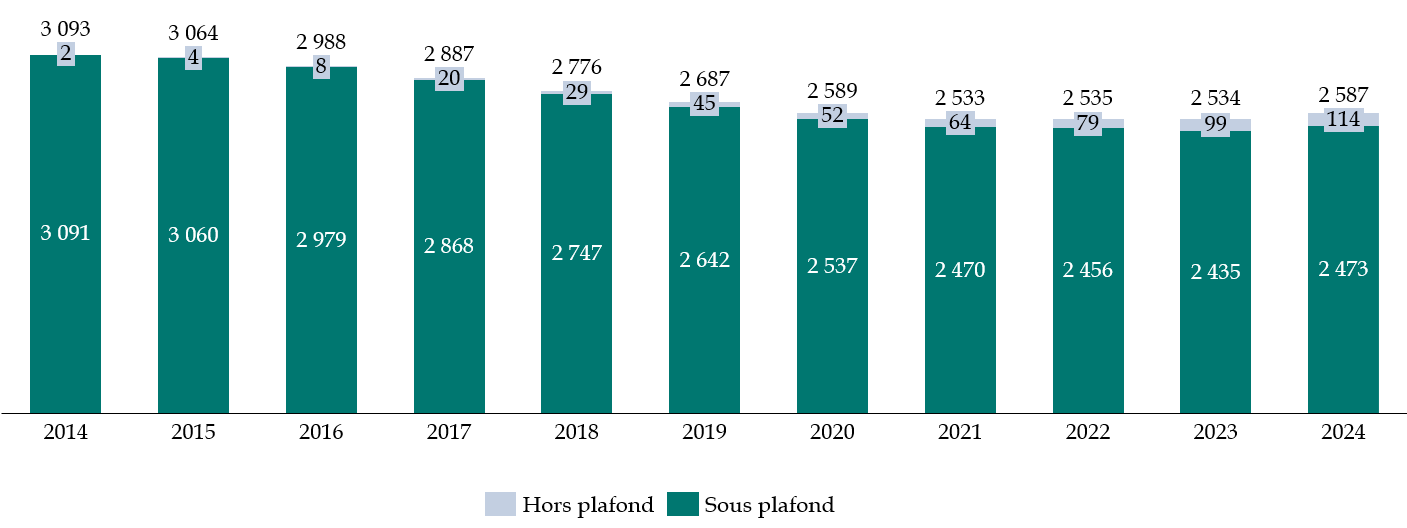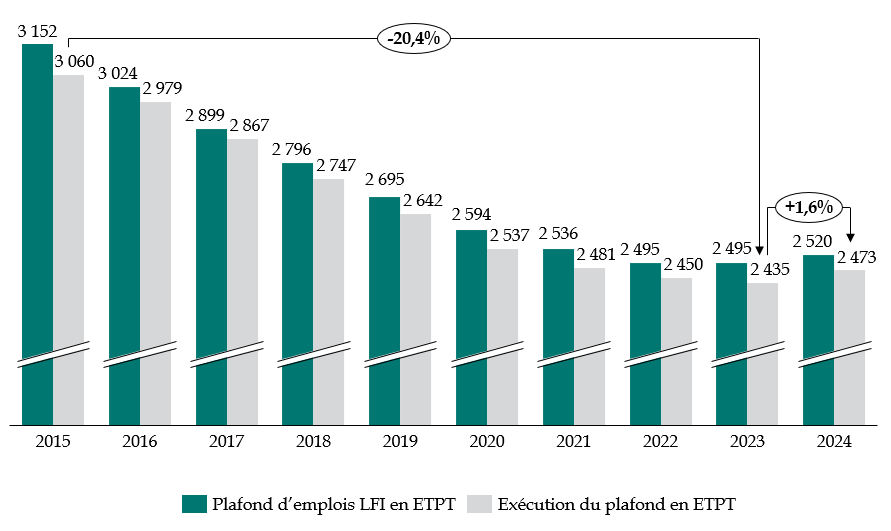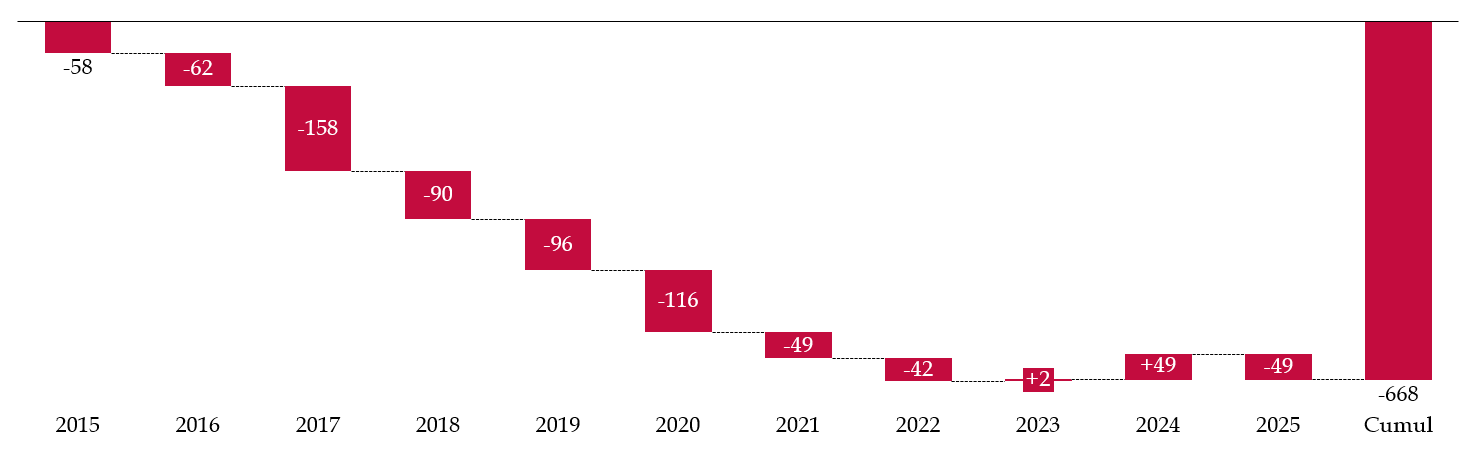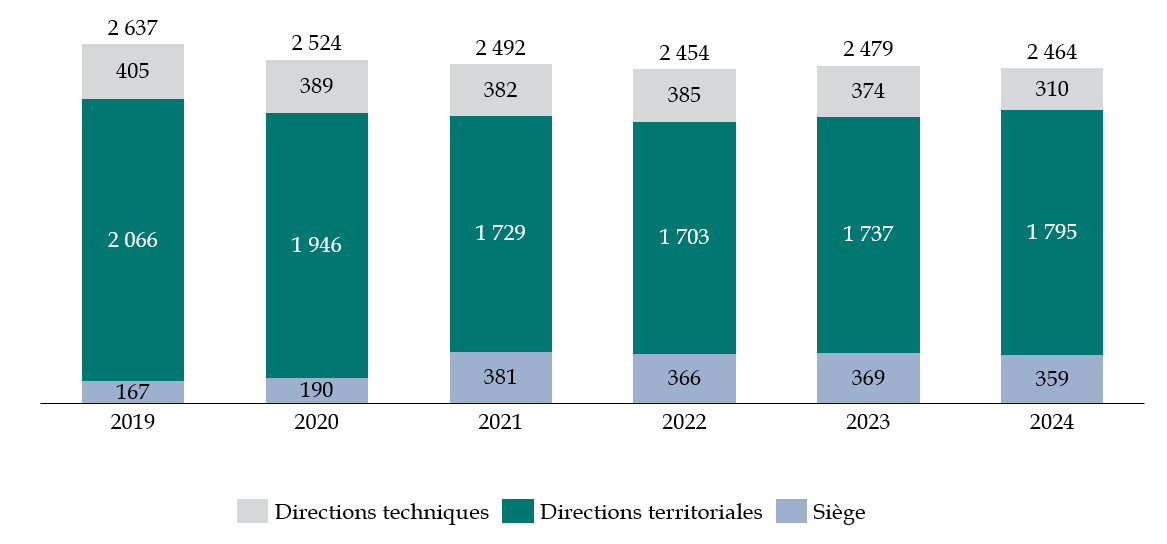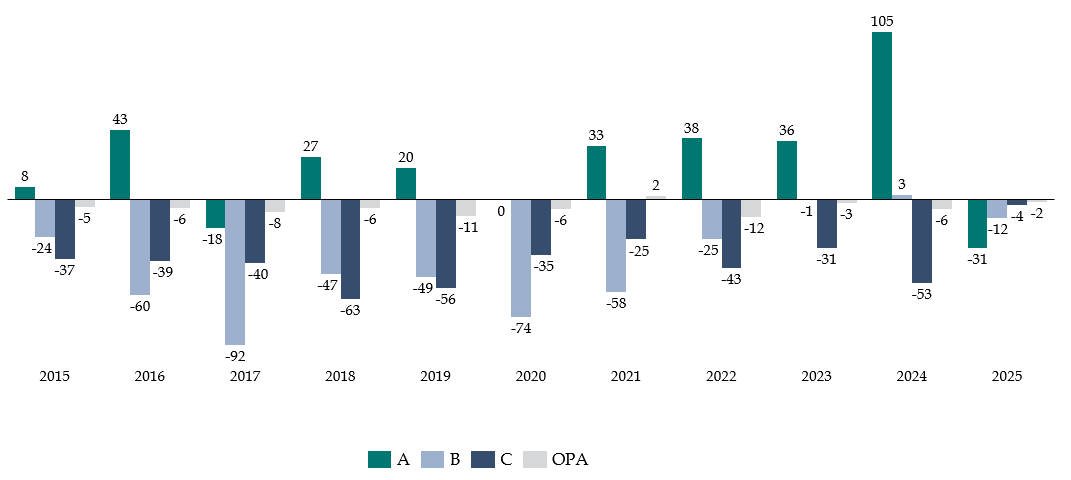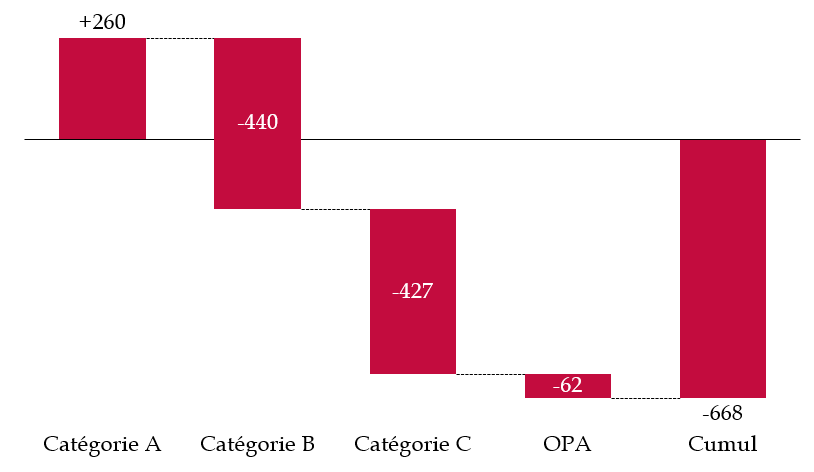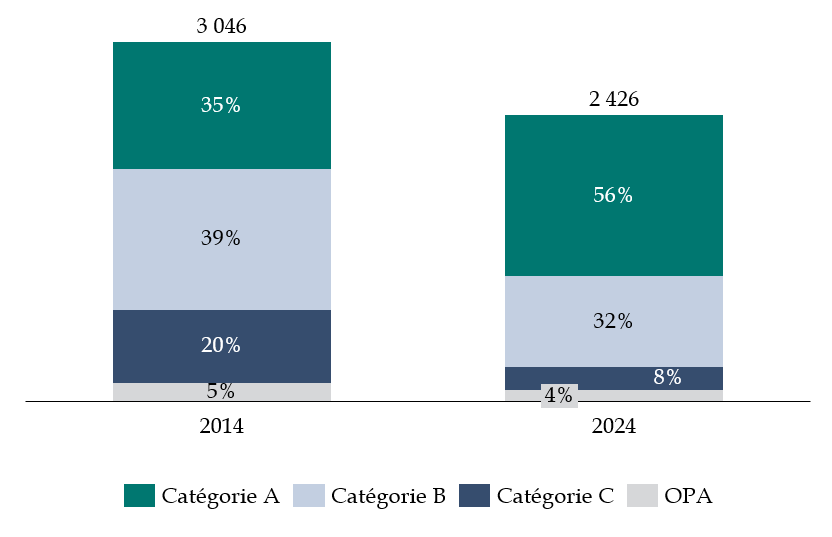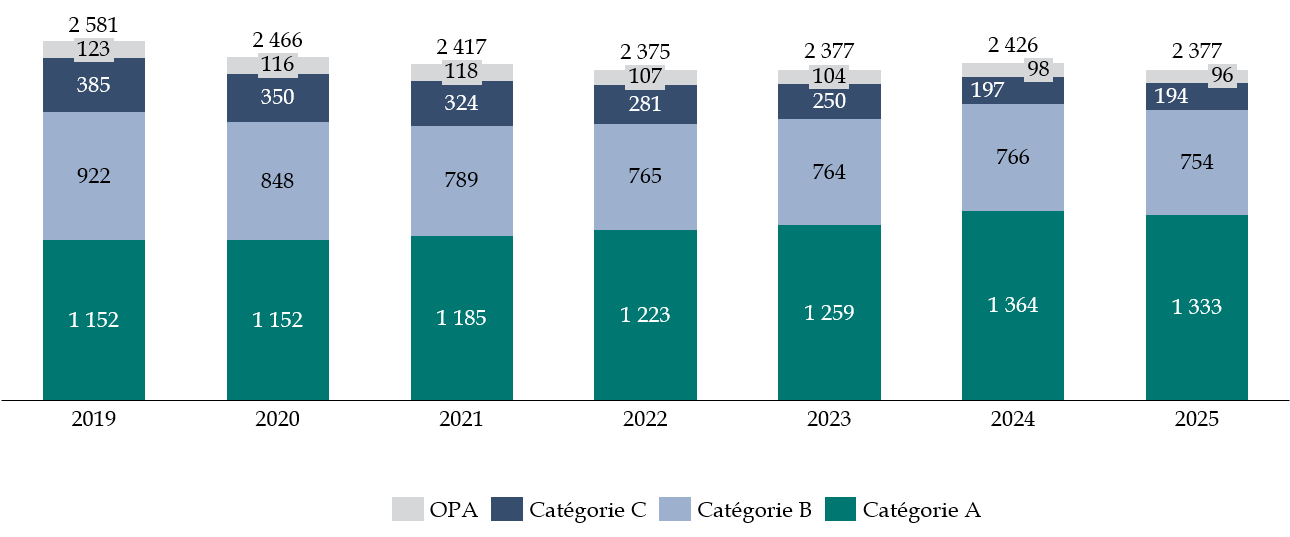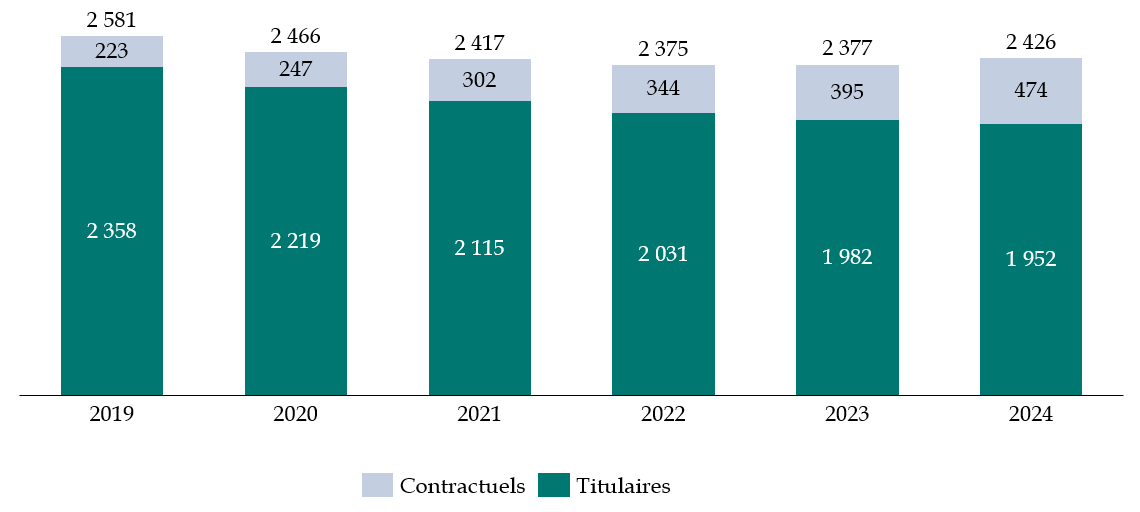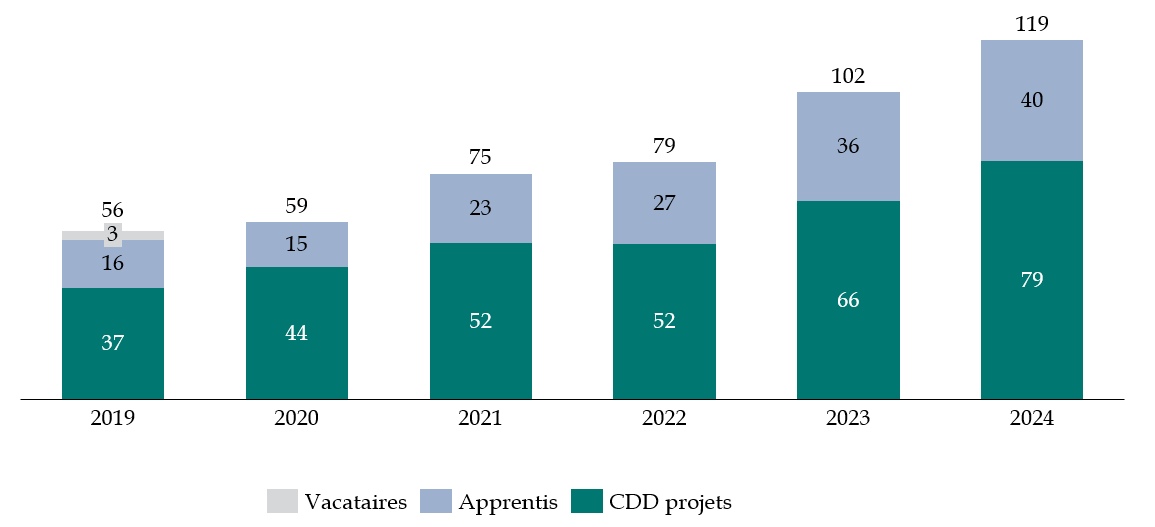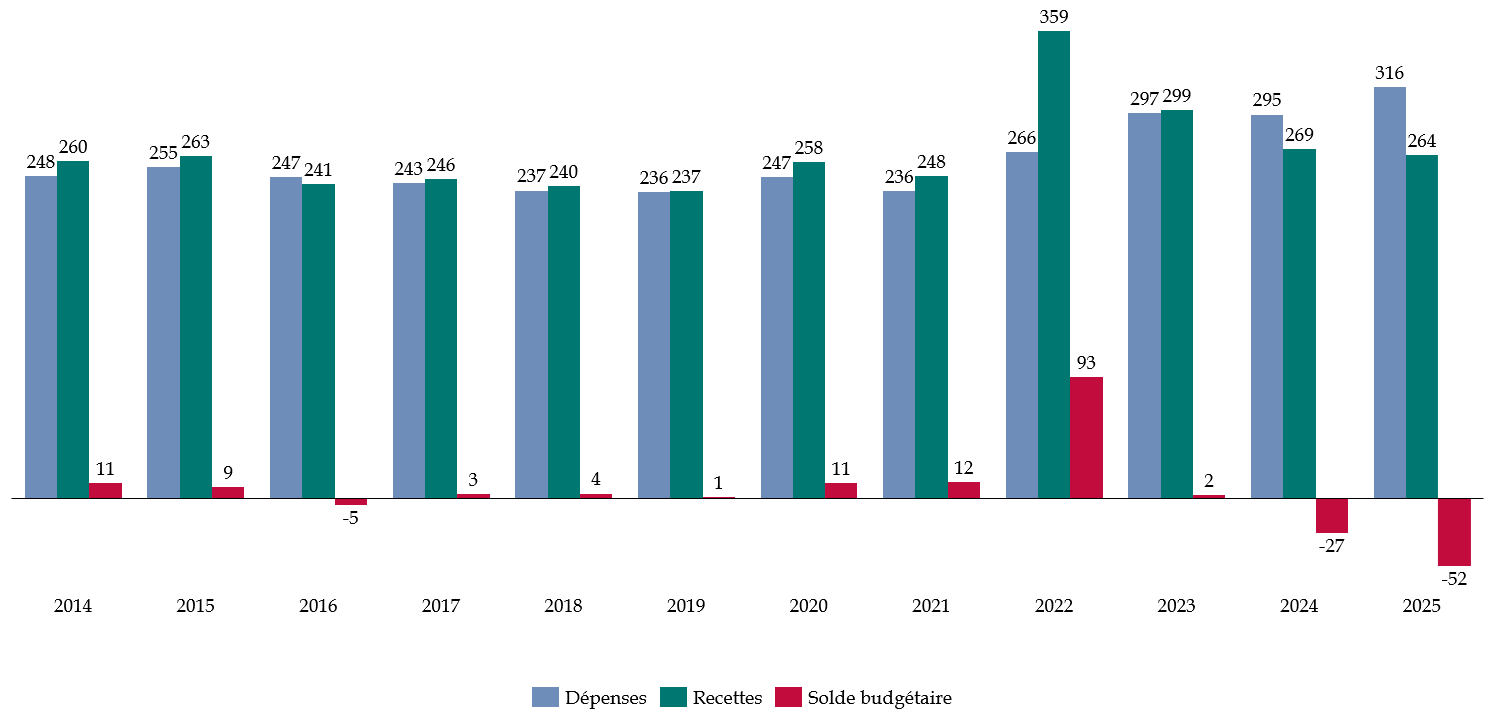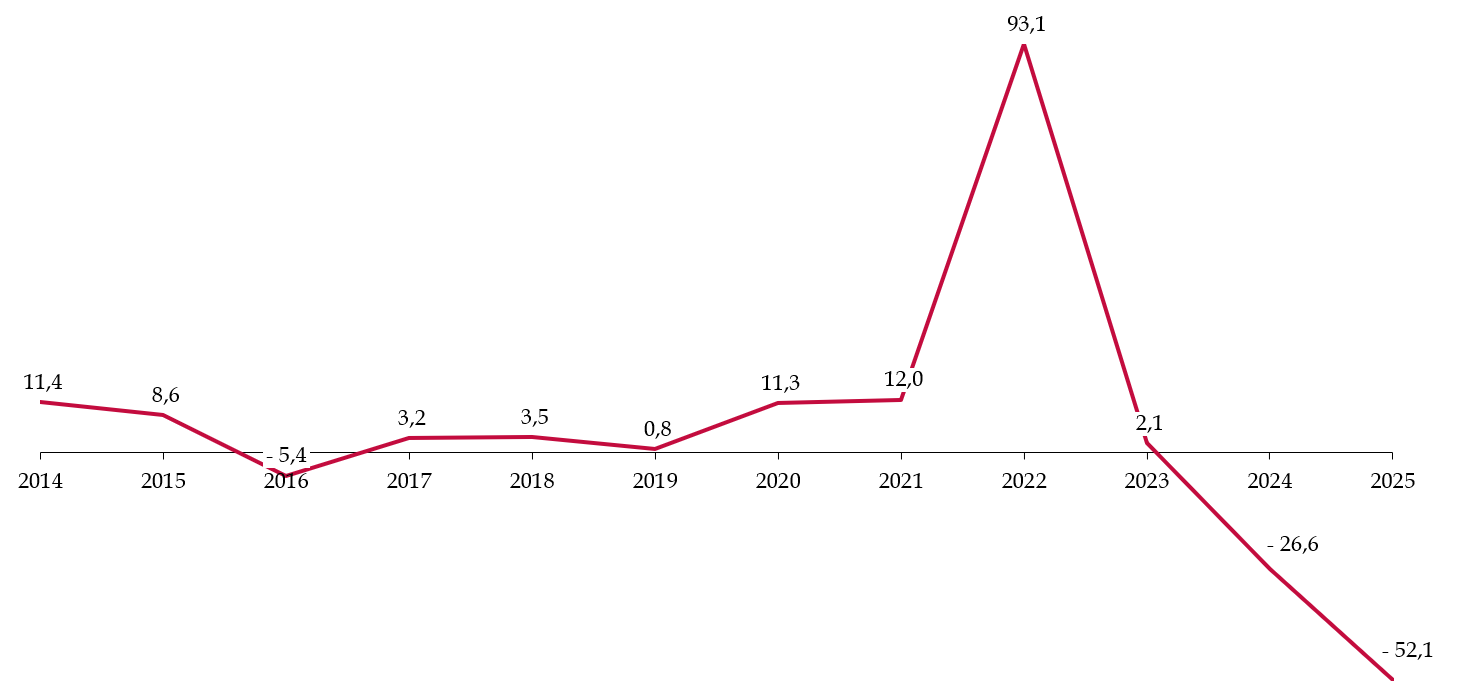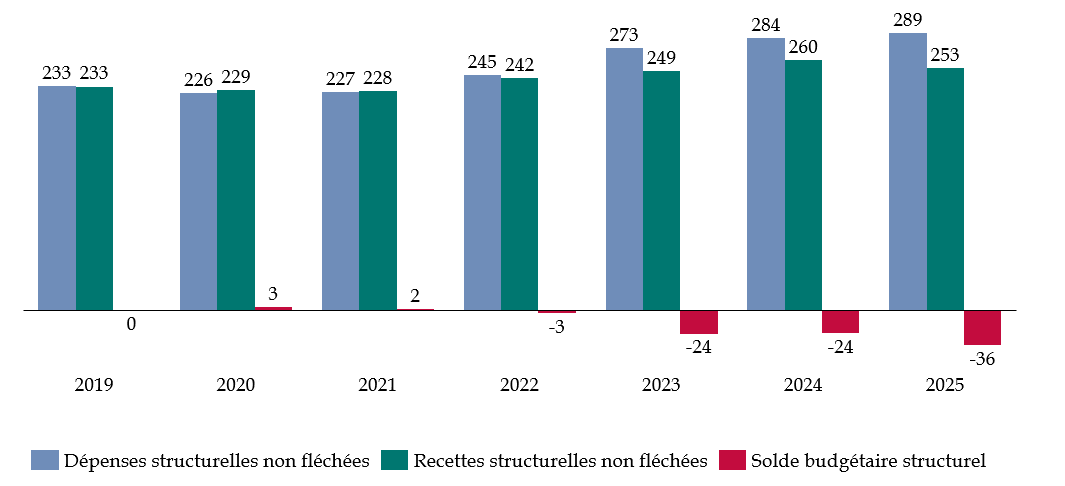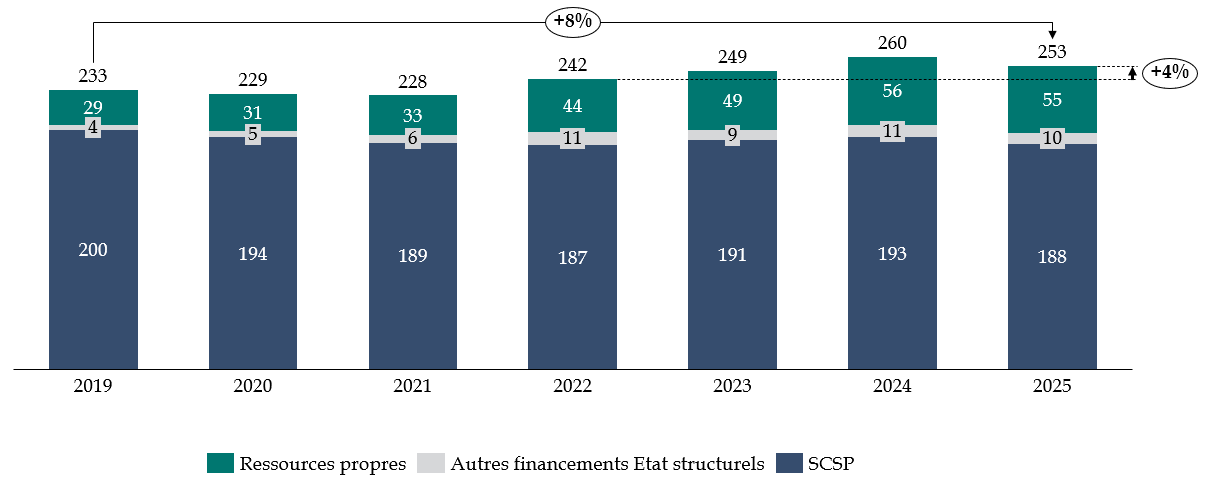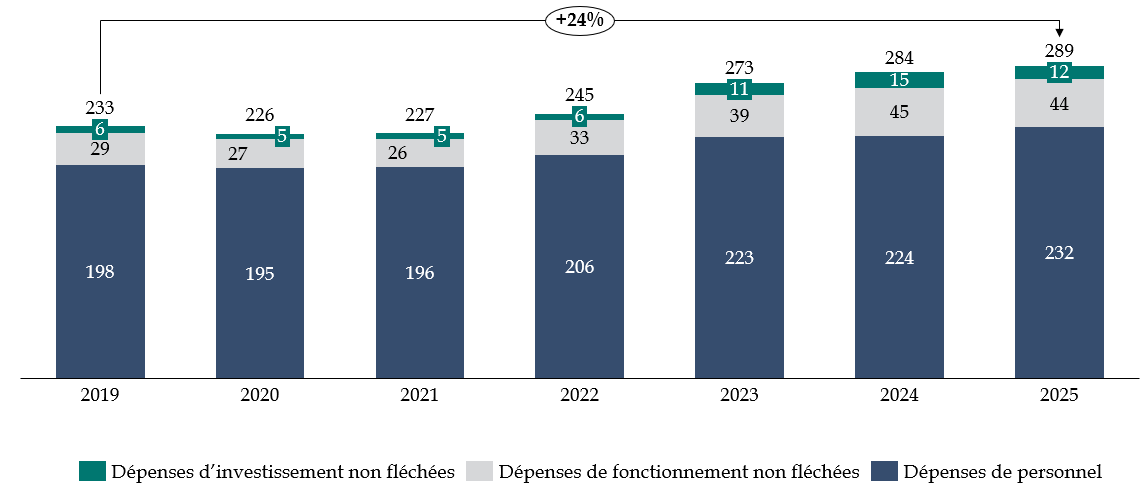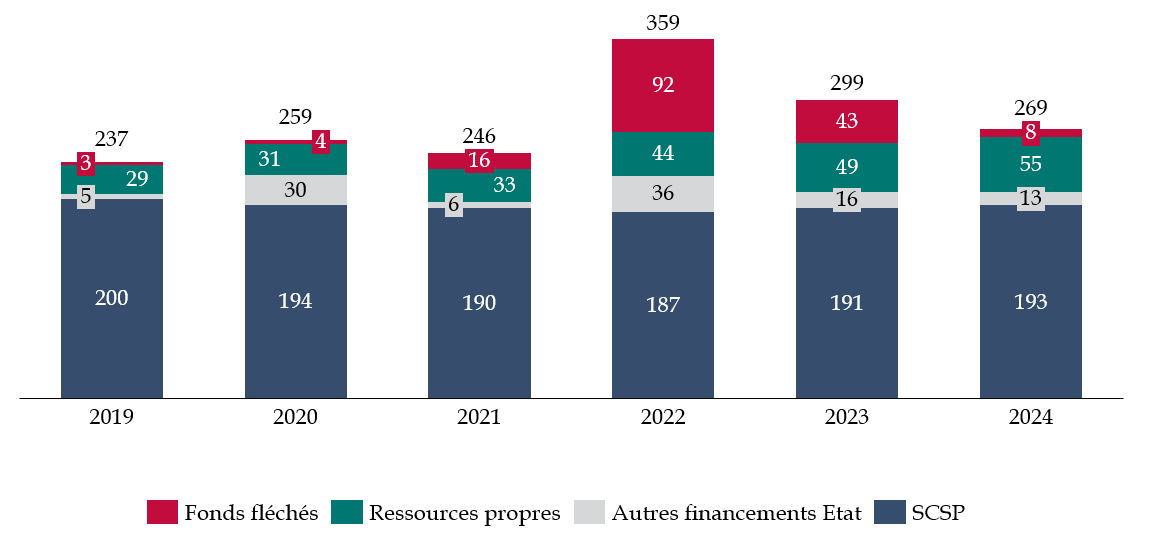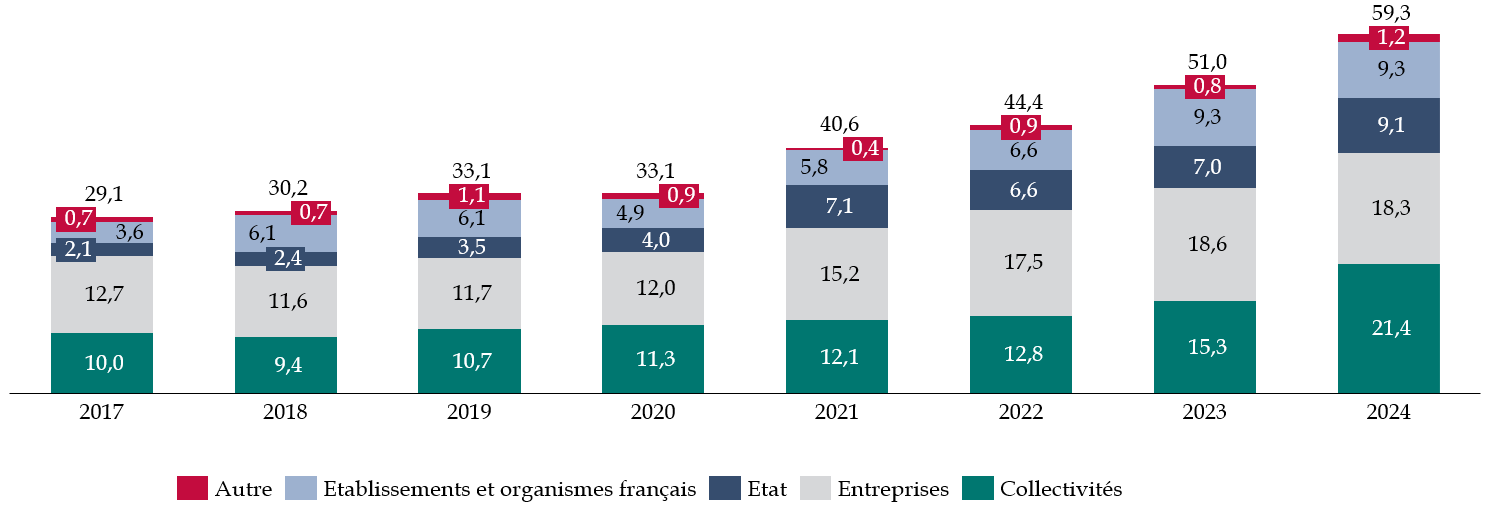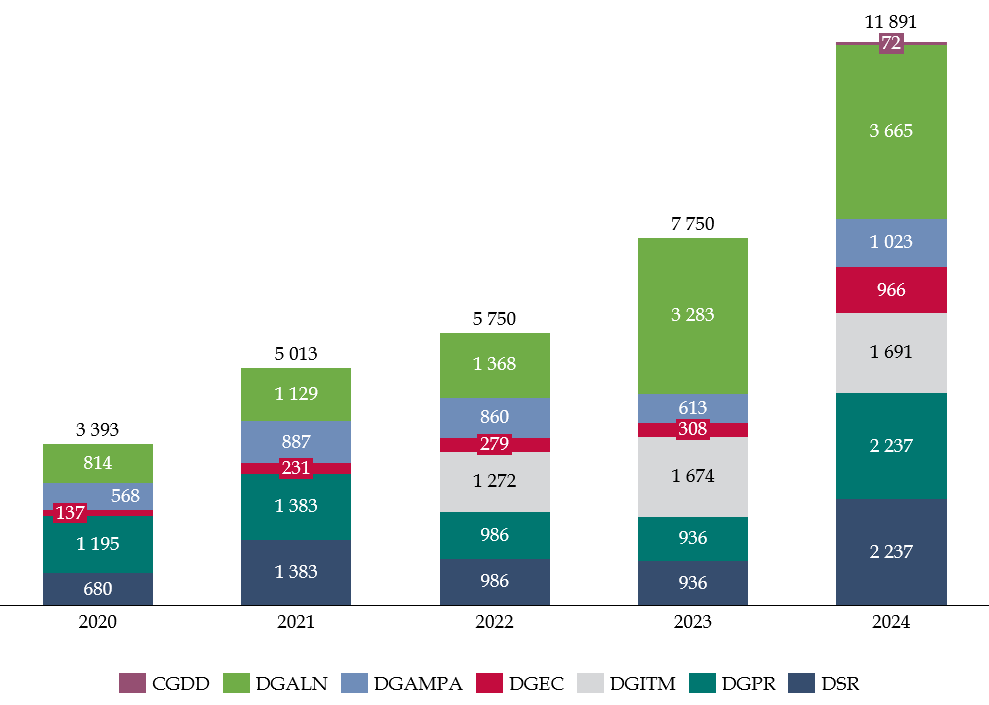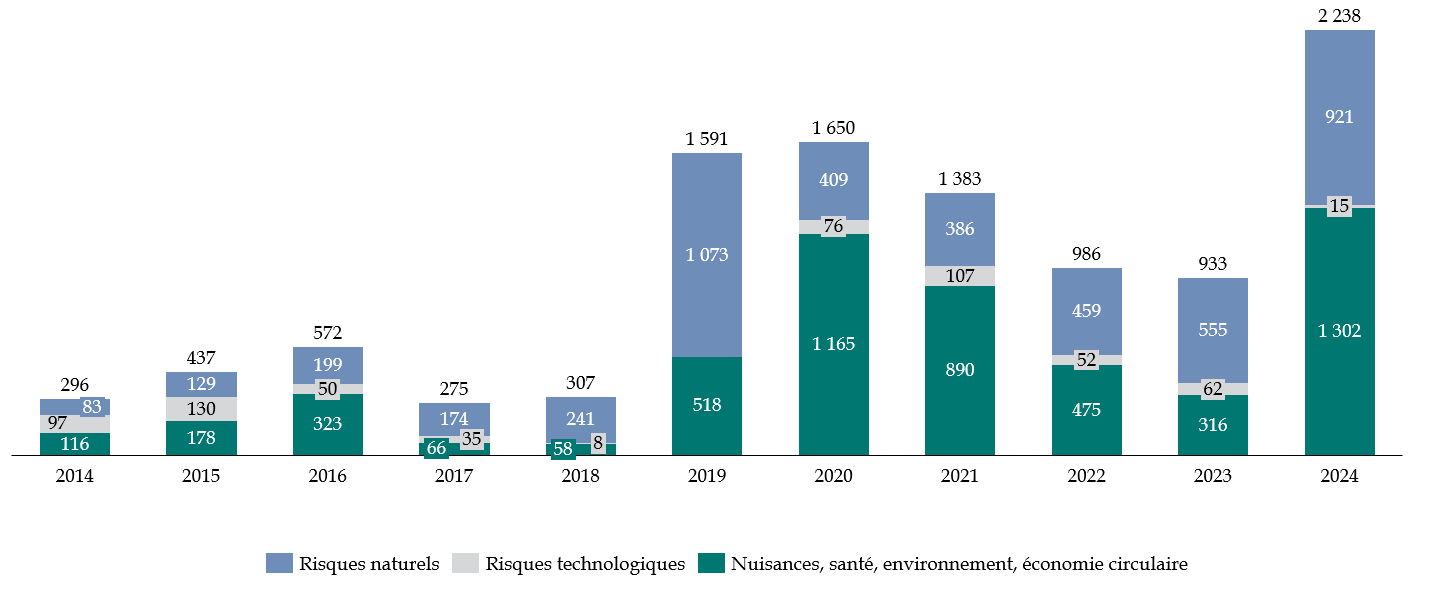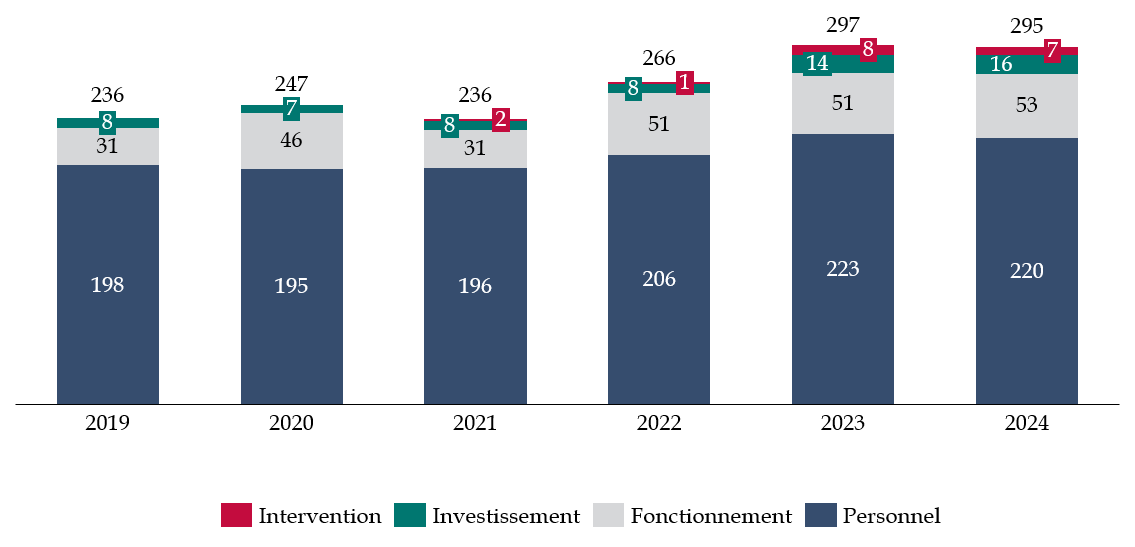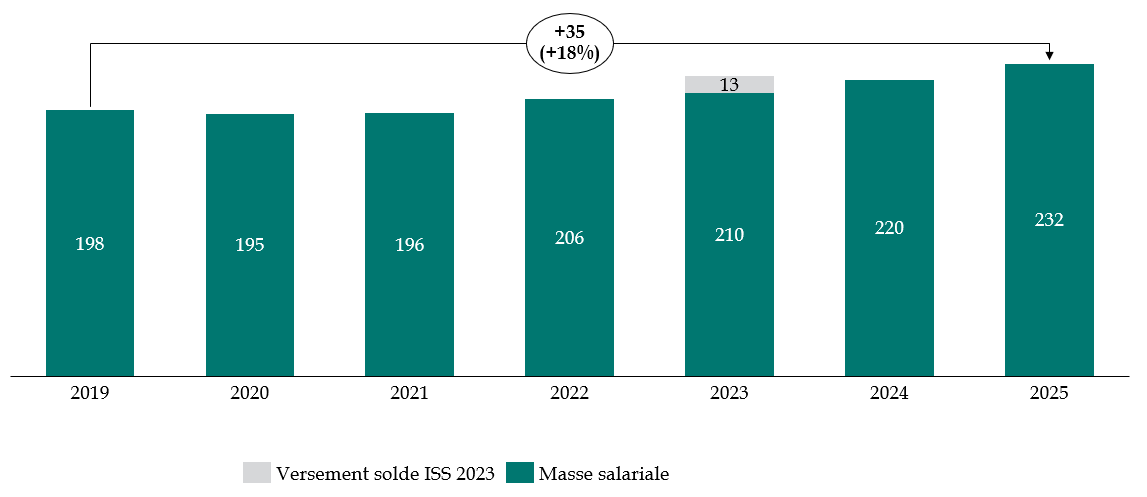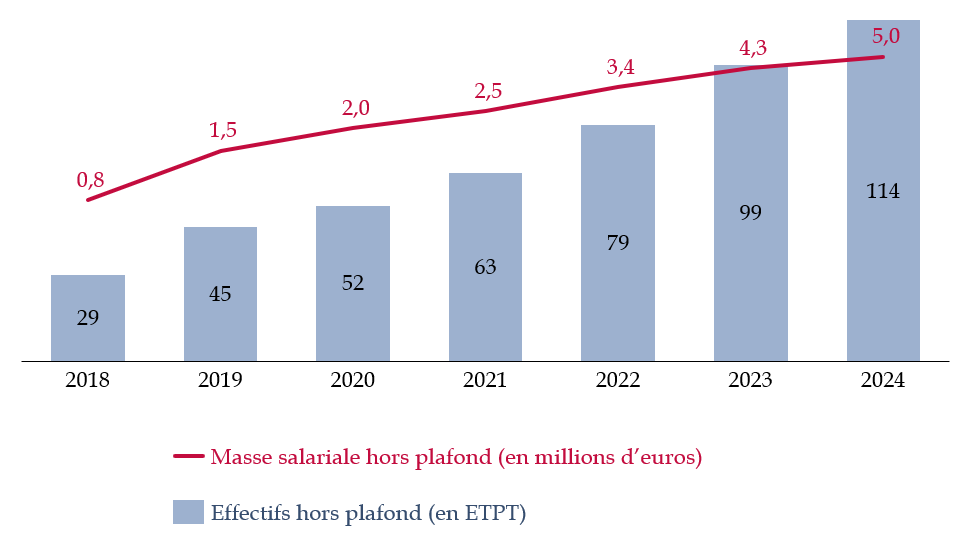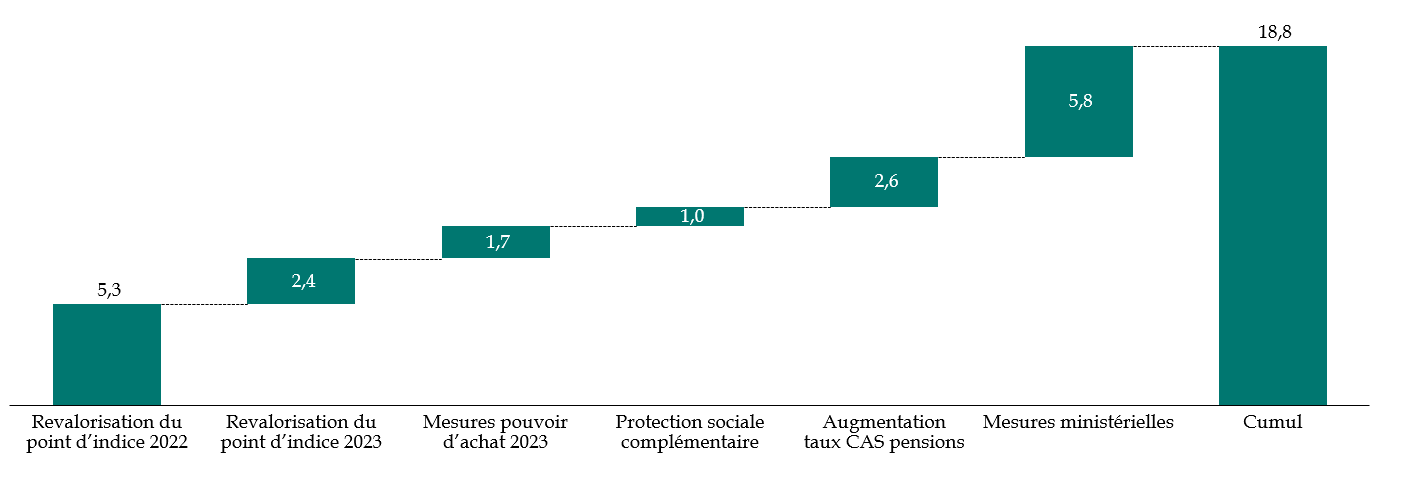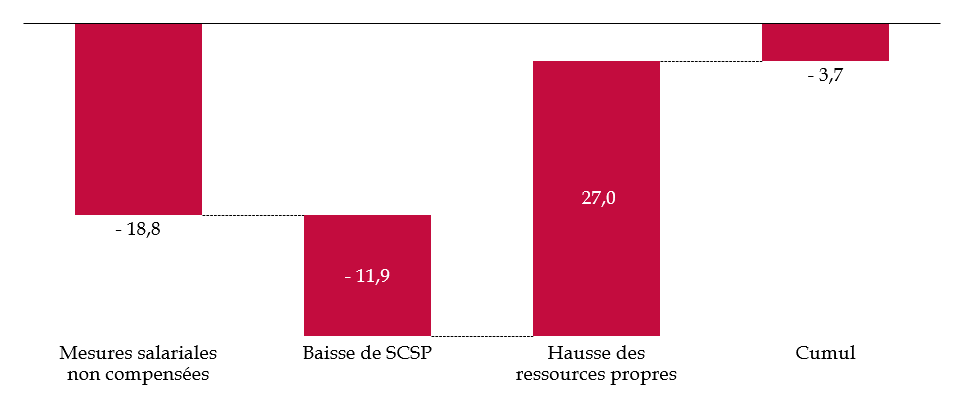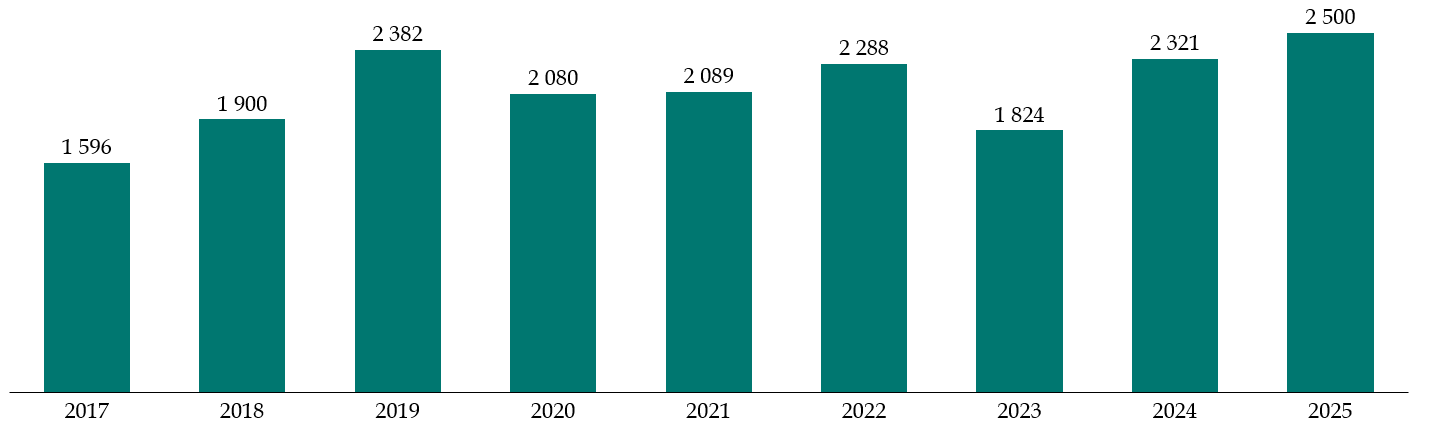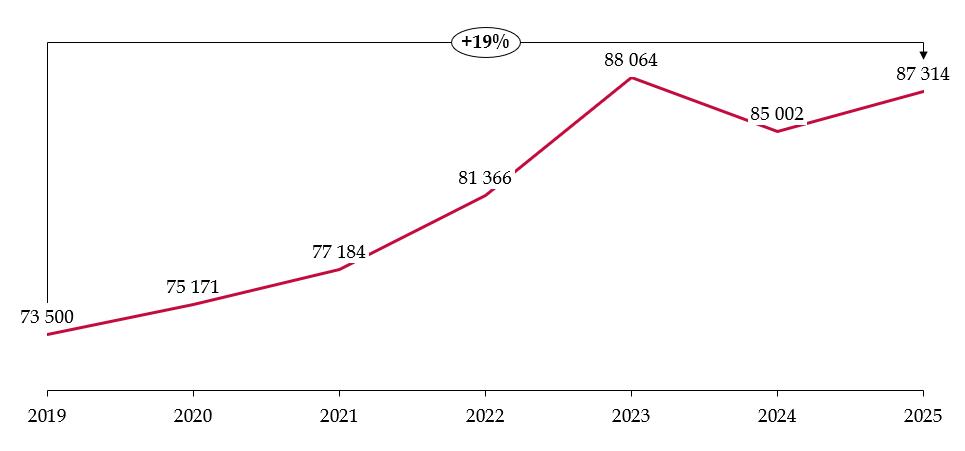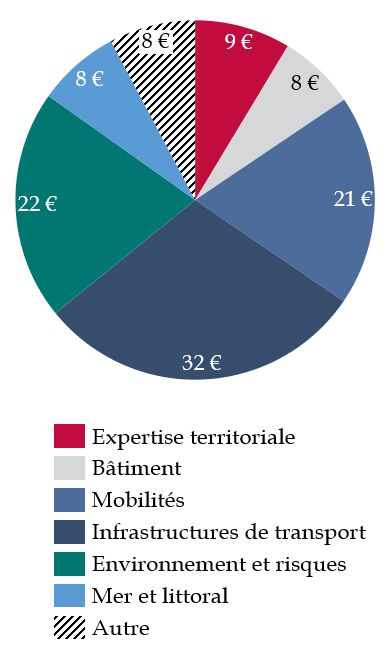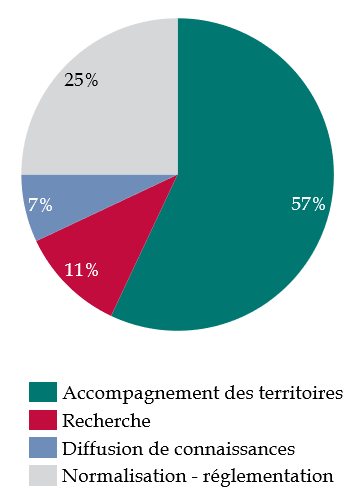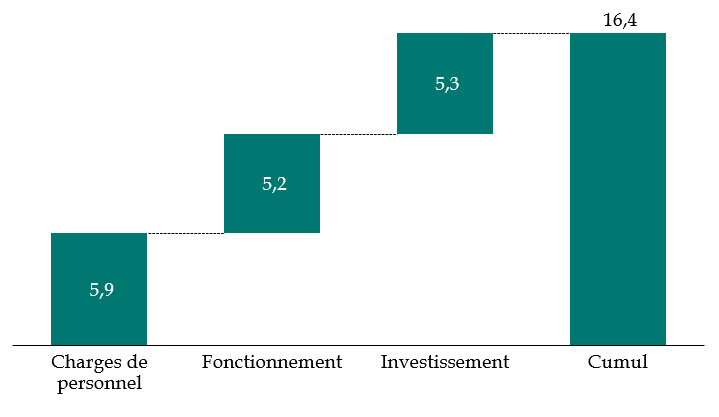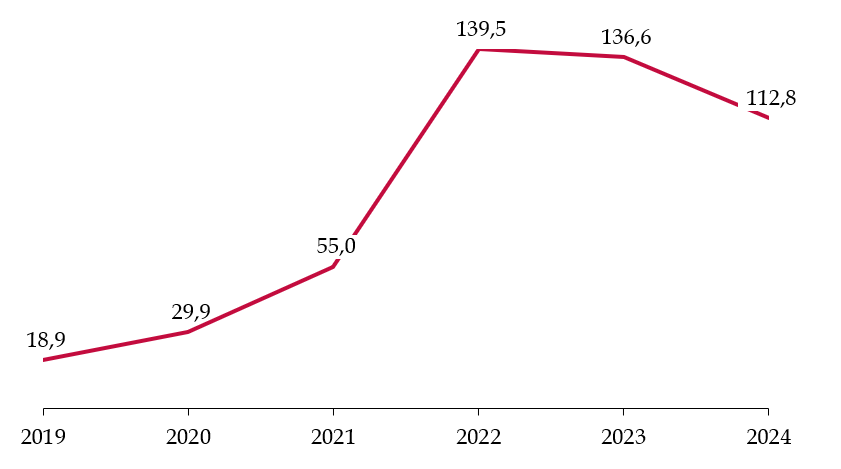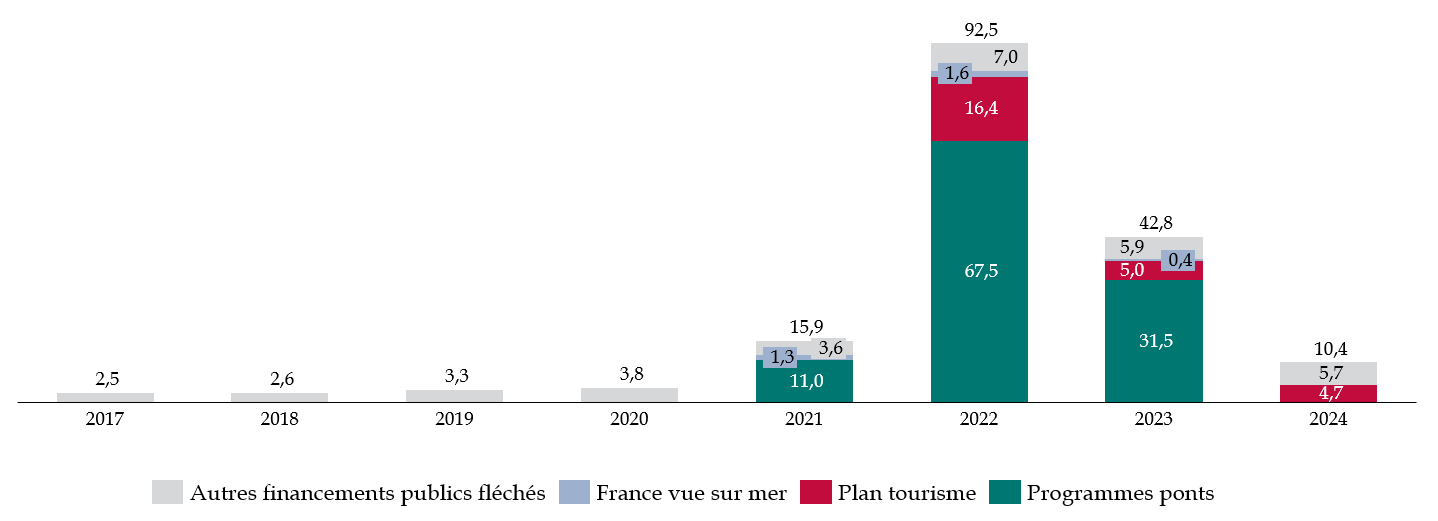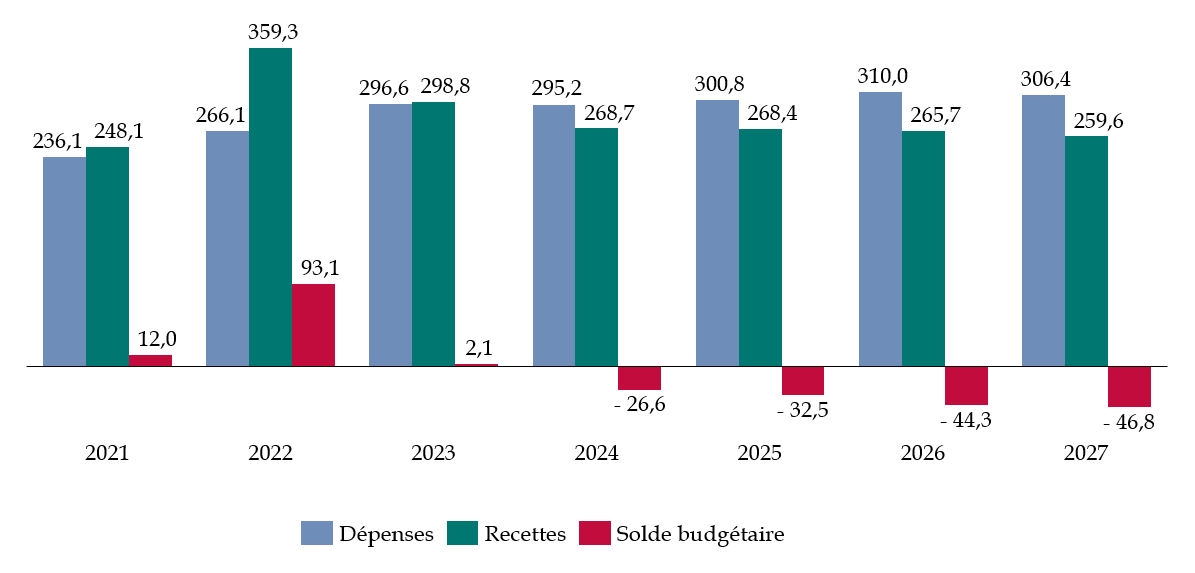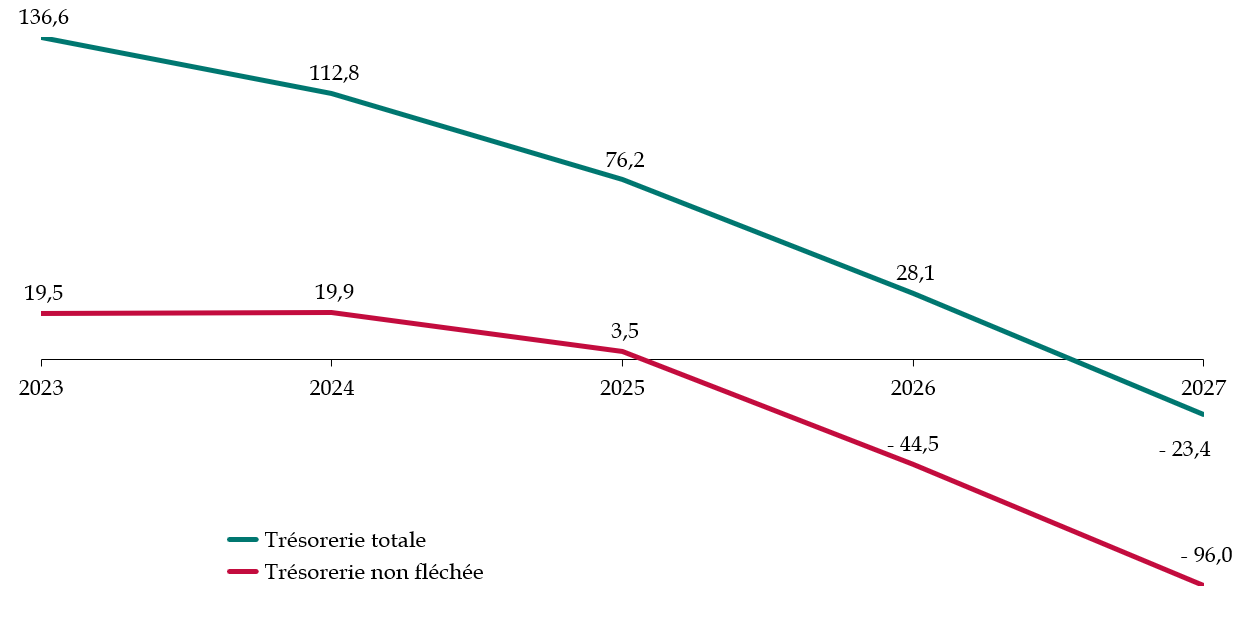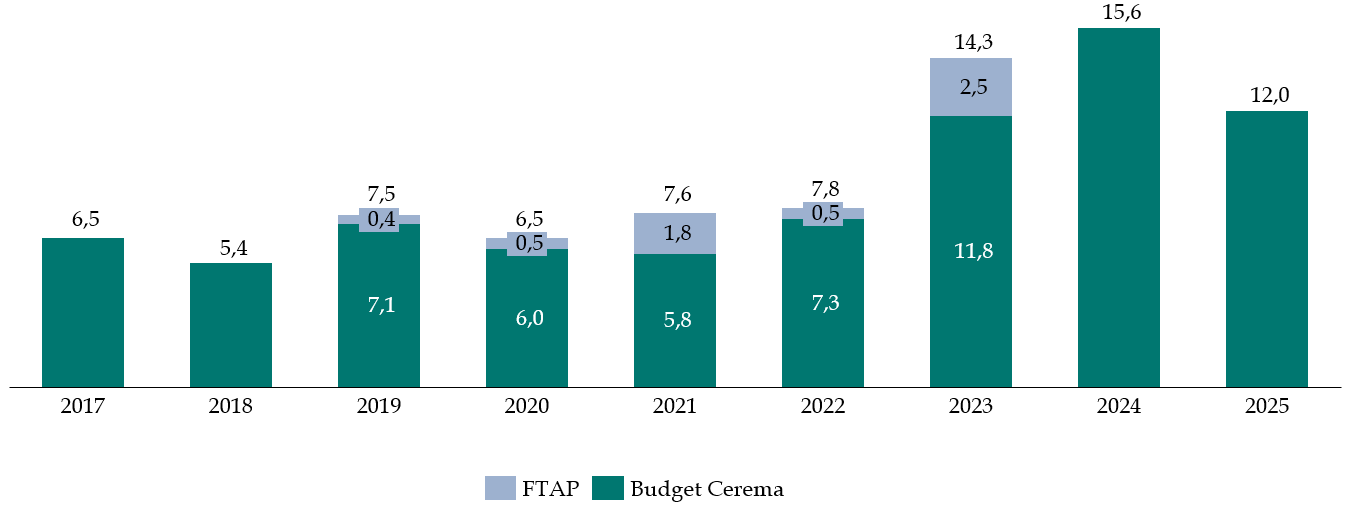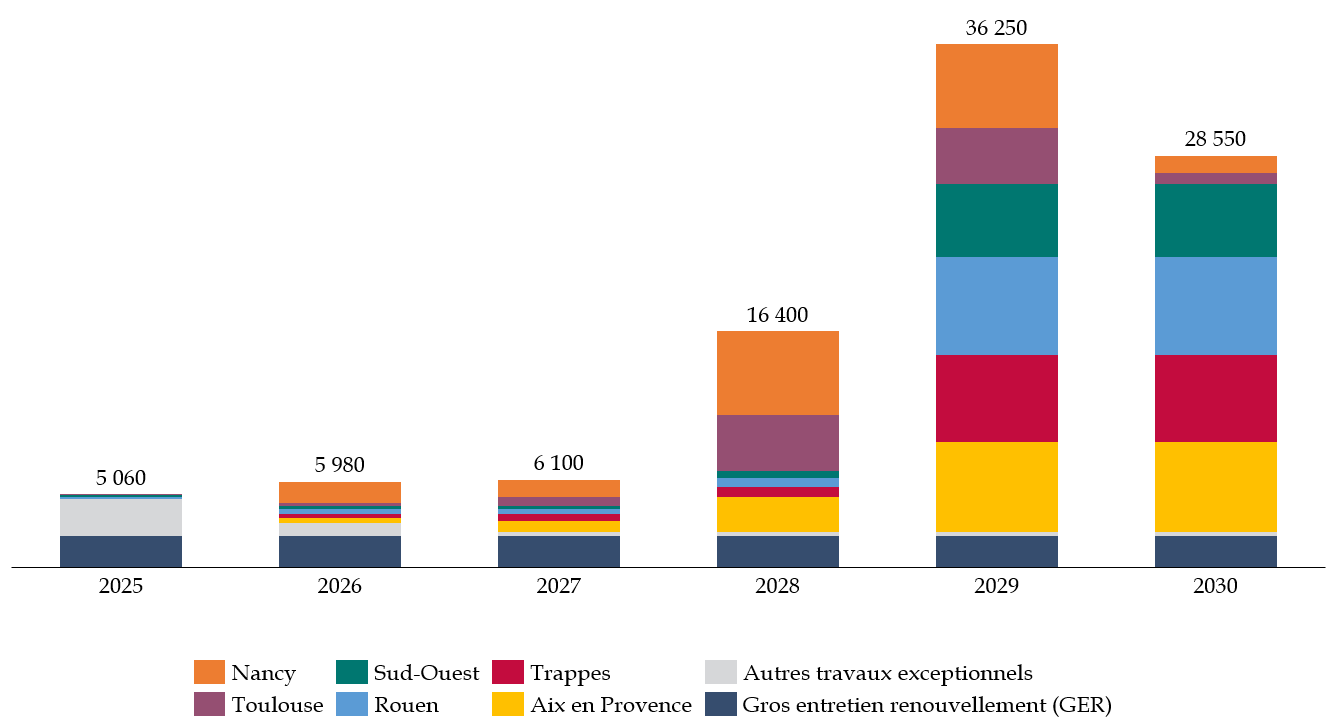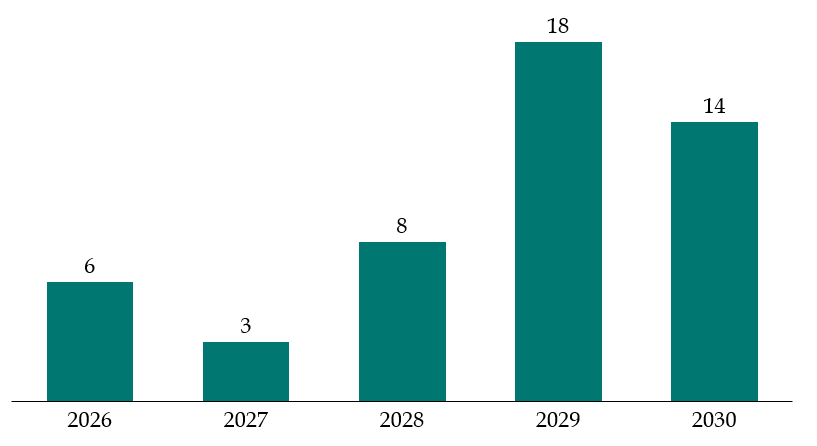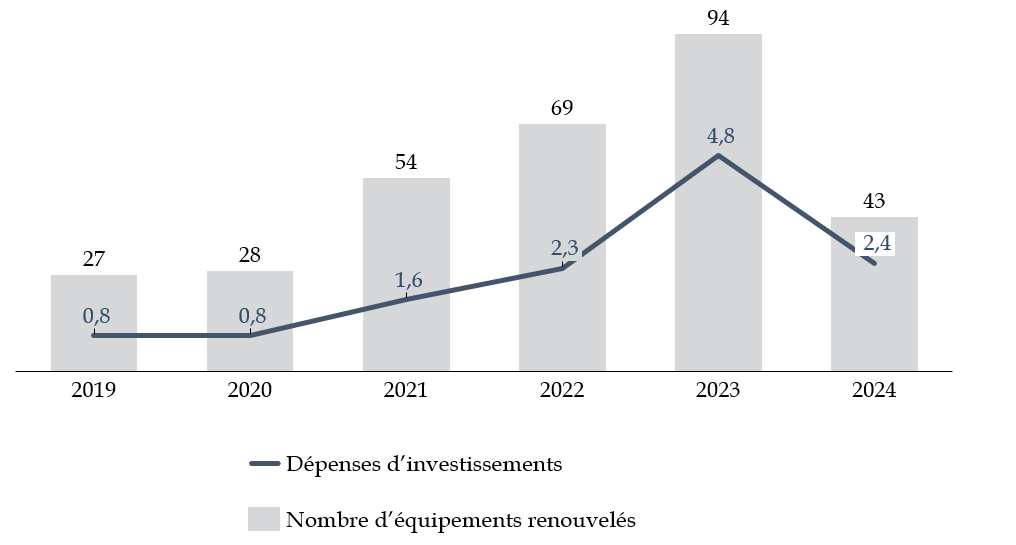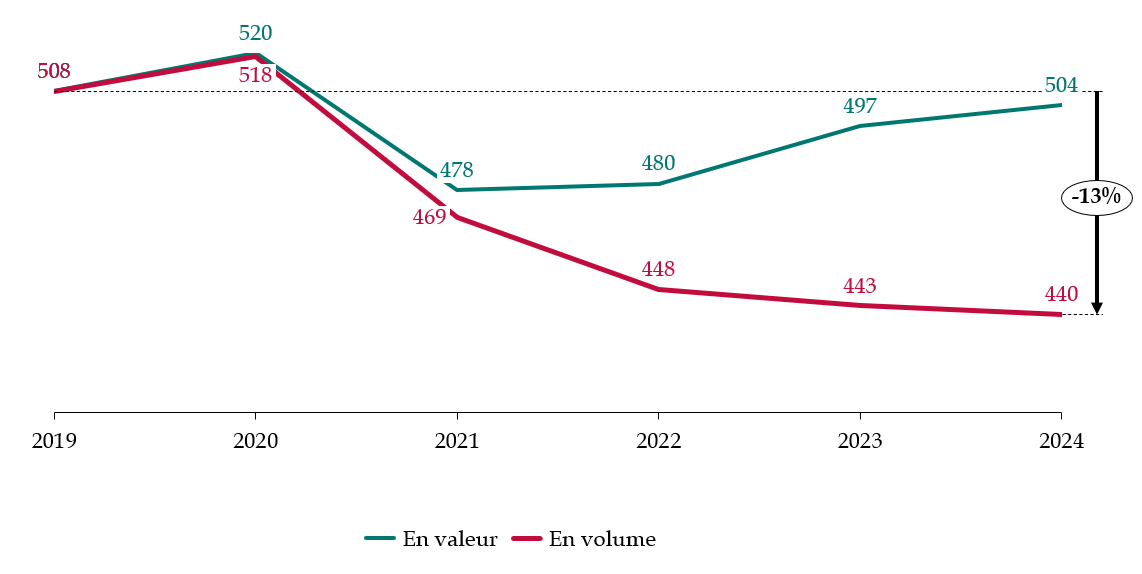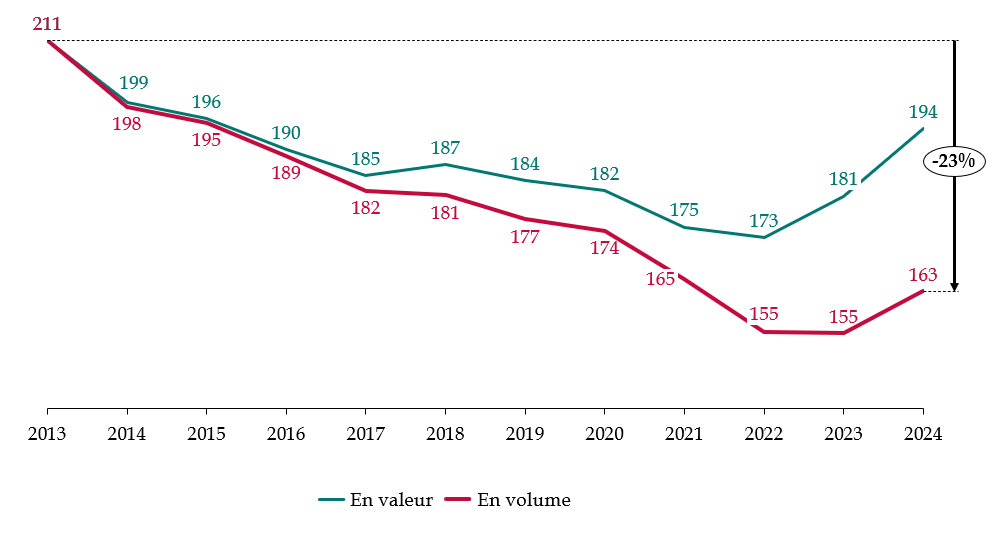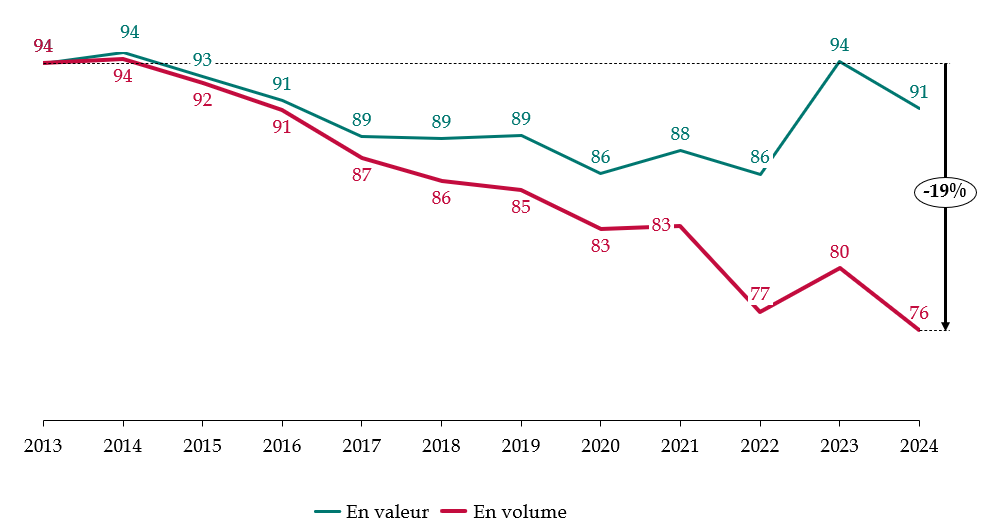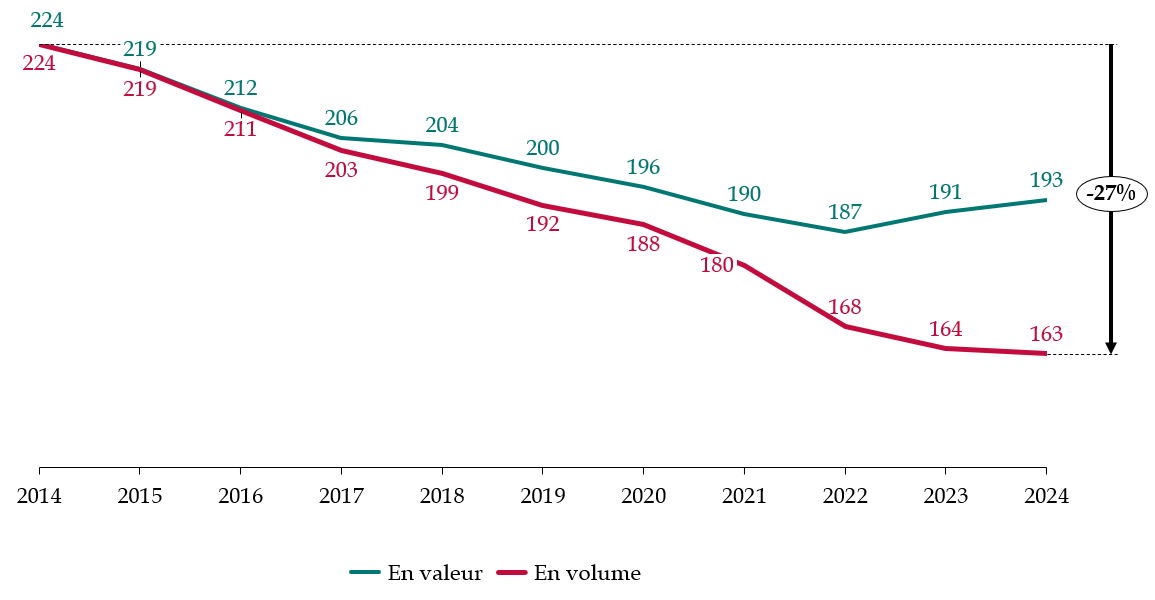- L'ESSENTIEL
- LISTE DES RECOMMANDATIONS
- PREMIÈRE PARTIE
PRÉSERVER L'INGÉNIERIE PUBLIQUE EXPERTE
DU CEREMA À L'HEURE OÙ L'ADAPTATION
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE RÉVOLUTIONNE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
- I. LA NÉCESSITÉ D'UNE
INGÉNIERIE PUBLIQUE DE L'ÉTAT
- A. LE BESOIN D'UNE INGÉNIERIE PUBLIQUE
ÉTATIQUE COMPLÉMENTAIRE DU SECTEUR PRIVÉ
- 1. Les services de l'État comme les
collectivités ne pourraient pas se passer de l'expertise du Cerema
- a) Certaines politiques publiques
déployées par les services de l'État dépendent de
l'appui technique du Cerema
- b) La concentration des capacités
d'ingénierie de pointe de l'État en matière
d'aménagement du territoire au sein d'un établissement
national : un moyen de parvenir à la mutualisation de cette
expertise technique, gage de son efficacité et de son efficience
- c) Une capacité de projection rapide unique
et précieuse après une crise ou une catastrophe naturelle
- d) Les collectivités ont besoin de
l'expertise du Cerema
- a) Certaines politiques publiques
déployées par les services de l'État dépendent de
l'appui technique du Cerema
- 2. L'ingénierie du Cerema est source d'une
gestion plus efficiente des finances publiques et de gains
socio-économiques
- 3. Alors que l'adaptation au changement climatique
bouleverse les enjeux d'aménagement du territoire, l'ingénierie
du Cerema est plus que jamais nécessaire
- 4. Il existe un espace pour une relation
complémentaire avec les bureaux d'études privés
- 1. Les services de l'État comme les
collectivités ne pourraient pas se passer de l'expertise du Cerema
- B. UN POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DU CEREMA
CONCENTRÉ SUR L'EXPERTISE DE HAUT NIVEAU
- A. LE BESOIN D'UNE INGÉNIERIE PUBLIQUE
ÉTATIQUE COMPLÉMENTAIRE DU SECTEUR PRIVÉ
- II. LE CEREMA A CONDUIT À SON TERME UNE
RESTRUCTURATION AMBITIEUSE
- I. LA NÉCESSITÉ D'UNE
INGÉNIERIE PUBLIQUE DE L'ÉTAT
- DEUXIÈME PARTIE
BASCULEMENT VERS LES COLLECTIVITÉS :
LE CEREMA EN QUÊTE D'UN NOUVEL ÉQUILIBRE
- I. HISTORIQUEMENT ESSENTIELLEMENT TOURNÉ
VERS LES SERVICES DE L'ÉTAT, LE CÉRÉMA S'ORIENTE DE PLUS
EN PLUS VERS LES COLLECTIVITÉS
- A. PRÉVUE DÈS LA CRÉATION DU
CEREMA, CETTE ÉVOLUTION S'EST ACCÉLÉRÉE
DEPUIS 2018
- B. LA FIN DES DROITS DE TIRAGE DES
MINISTÈRES SUR LA SUBVENTION DU CEREMA, UN TOURNANT
STRATÉGIQUE
- C. UNE NÉCESSAIRE COORDINATION DES
EXPRESSIONS DE BESOIN DES MINISTÈRES ET UN BESOIN DE SIMPLIFICATION DE
LA PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DU CEREMA
- A. PRÉVUE DÈS LA CRÉATION DU
CEREMA, CETTE ÉVOLUTION S'EST ACCÉLÉRÉE
DEPUIS 2018
- II. UN NOUVEAU MODÈLE QUI CHERCHE ENCORE
SES MARQUES
- III. « MEZZA VOCE », DES
RÉSERVES S'EXPRIMENT DANS LA SPHÈRE DES ADMINISTRATIONS DE
L'ÉTAT
- A. LE NOUVEAU STATUT SUSCITE DES RÉSERVES
QUANT À LA PERTE D'INFLUENCE DE L'ÉTAT QUI DEMEURE POUR AUTANT LE
PRINCIPAL FINANCEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
- B. DES ADMINISTRATIONS REGRETTENT LA
RÉORIENTATION DES ACTIVITÉS DU CEREMA EN DIRECTION DES
COLLECTIVITÉS AU DÉTRIMENT DES PRESTATIONS QUI LEUR
ÉTAIENT AUPARAVANT DÉLIVRÉES
- A. LE NOUVEAU STATUT SUSCITE DES RÉSERVES
QUANT À LA PERTE D'INFLUENCE DE L'ÉTAT QUI DEMEURE POUR AUTANT LE
PRINCIPAL FINANCEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
- I. HISTORIQUEMENT ESSENTIELLEMENT TOURNÉ
VERS LES SERVICES DE L'ÉTAT, LE CÉRÉMA S'ORIENTE DE PLUS
EN PLUS VERS LES COLLECTIVITÉS
- TROISIÈME PARTIE
LE CEREMA EST ENGAGÉ DANS UNE IMPASSE FINANCIÈRE
- I. LA RESTRUCTURATION DU CEREMA S'EST TRADUITE PAR
UNE CONTRACTION EXTRÊMEMENT FORTE DE SES MOYENS
- A. DEPUIS LA CRÉATION DU CEREMA, UNE
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC EN « CHUTE
LIBRE »
- B. UNE RÉFORME STRUCTURELLE QUI A CONDUIT
À LA RÉDUCTION DE PRÈS DE 20 % DES EFFECTIFS
- 1. La baisse des effectifs du Cerema est-elle sur
le point d'atteindre un point de rupture ?
- 2. Un repyramidage des effectifs au service de la
réforme du positionnement stratégique du Cerema
- 3. Une hausse sensible de la part des agents
contractuels pour attirer des compétences rares
- 4. Une augmentation substantielle des effectifs
hors plafond
- 1. La baisse des effectifs du Cerema est-elle sur
le point d'atteindre un point de rupture ?
- A. DEPUIS LA CRÉATION DU CEREMA, UNE
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC EN « CHUTE
LIBRE »
- II. UN MODÈLE FINANCIER EN
PÉRIL
- A. UNE SITUATION FINANCIÈRE
PROFONDÉMENT DÉGRADÉE
- 1. Un déficit structurel préoccupant
qui se creuse dangereusement
- 2. « Les arbres ne montent pas jusqu'au
ciel » : jusqu'à quel point le Cerema pourra-t-il
compenser la baisse de sa dotation de l'État par l'augmentation de ses
ressources propres ?
- 3. Les dépenses du Cerema sont fortement
contraintes par le poids et le dynamisme de sa masse salariale
- a) L'évolution très dynamique de sa
masse salariale en dépit des réductions d'effectifs contraint
fortement les dépenses du Cerema
- b) Comment se répartissent les
dépenses du Cerema entre ses différents domaines
d'intervention ?
- c) Le plan de retour à l'équilibre
mis en oeuvre en 2025 : un effort indispensable de maîtrise des
dépenses de fonctionnement
- a) L'évolution très dynamique de sa
masse salariale en dépit des réductions d'effectifs contraint
fortement les dépenses du Cerema
- 4. Un niveau de trésorerie non
fléchée déjà dans le rouge
- 1. Un déficit structurel préoccupant
qui se creuse dangereusement
- B. UN ÉTABLISSEMENT FINANCIÈREMENT
EN SURSIS
- A. UNE SITUATION FINANCIÈRE
PROFONDÉMENT DÉGRADÉE
- III. UN PATRIMOINE IMMOBILIER CONSÉQUENT,
DANS UN ÉTAT DE DÉGRADATION INDIGNE, ET UN PARC
D'ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES À
PRÉSERVER
- A. INDISPENSABLES AU MAINTIEN DES CAPACITÉS
D'EXPERTISE DU CEREMA, SES INVESTISSEMENTS NE DOIVENT PAS REDEVENIR UNE
VARIABLE D'AJUSTEMENT BUDGÉTAIRE SAUF À HYPOTHÉQUER
L'AVENIR DE L'OPÉRATEUR
- B. UN PATRIMOINE IMMOBILIER HÉRITÉ
DU PASSÉ DANS UN ÉTAT DE DÉGRADATION INDIGNE
- C. ATOUT STRATÉGIQUE DU CEREMA, SON PARC
D'ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DOIT ÊTRE MAINTENU
À NIVEAU
- A. INDISPENSABLES AU MAINTIEN DES CAPACITÉS
D'EXPERTISE DU CEREMA, SES INVESTISSEMENTS NE DOIVENT PAS REDEVENIR UNE
VARIABLE D'AJUSTEMENT BUDGÉTAIRE SAUF À HYPOTHÉQUER
L'AVENIR DE L'OPÉRATEUR
- I. LA RESTRUCTURATION DU CEREMA S'EST TRADUITE PAR
UNE CONTRACTION EXTRÊMEMENT FORTE DE SES MOYENS
- QUATRIÈME PARTIE
L'IMPÉRATIF DE S'EXTRAIRE D'UNE NAVIGATION BUDGÉTAIRE « À VUE » VOUÉE À L'ÉCHEC :
DANS UN CONTEXTE BUDGÉTAIRE CONTRAINT,
L'ÉTAT DOIT ASSUMER DES CHOIX STRATÉGIQUES POUR L'AVENIR DU CEREMA
- I. DES PRÉALABLES INDISPENSABLES : LA
DÉFINITION DES MISSIONS « SOCLES » DE
L'ÉTABLISSEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT D'UNE VÉRITABLE
COMPTABILITÉ ANALYTIQUE
- II. DANS UN CONTEXTE DE TENSION BUDGÉTAIRE
EXTRÊME, L'IMPÉRATIF DE DÉFINIR UN SCÉNARIO
RÉALISTE ET STRUCTUREL PERMETTANT D'ASSURER L'ÉQUILIBRE FINANCIER
DE L'OPÉRATEUR SUR LE LONG TERME
- A. MORTIFÈRE, LE PILOTAGE BUDGÉTAIRE
« À VUE » DE TYPE « RABOT »
A CONDUIT À L'IMPASSE FINANCIÈRE ACTUELLE
- B. L'ÉTABLISSEMENT DOIT GAGNER EN
PRODUCTIVITÉ ET MOBILISER DE NOUVEAUX GISEMENTS DE RESSOURCES
PROPRES
- C. LE NÉCESSAIRE RENFORCEMENT DE LA TUTELLE
DE L'ÉTABLISSEMENT
- D. POUR EXTRAIRE L'ÉTABLISSEMENT DES AFFRES
D'UN PILOTAGE BUDGÉTAIRE « À VUE »,
L'ÉTAT DOIT LUI TRACER AU PLUS TÔT UNE STRATÉGIE DE LONG
TERME CLAIRE ET SOUTENABLE
- A. MORTIFÈRE, LE PILOTAGE BUDGÉTAIRE
« À VUE » DE TYPE « RABOT »
A CONDUIT À L'IMPASSE FINANCIÈRE ACTUELLE
- III. AU-DELÀ DU SEUL CEREMA, UN BESOIN DE
MIEUX STRUCTURER L'OFFRE D'INGÉNIERIE TERRITORIALE PUBLIQUE
- A. L'OFFRE D'INGÉNIERIE TERRITORIALE
PUBLIQUE SOUFFRE ENCORE D'UN MANQUE DE LISIBILITÉ
- B. LE CEREMA, L'ADEME ET L'ANCT ONT MIS EN oeUVRE
DE PREMIÈRES MESURES POUR COORDONNER LEURS ACTIVITÉS ET
CLARIFIER LEURS CHAMPS D'INTERVENTIONS RESPECTIFS
- C. DES MUTUALISATIONS PARTIELLES DE SERVICES AINSI
QUE LE DÉPLOIEMENT « D'OFFRES UNIQUES » DEVRAIENT
ÊTRE PRIVILÉGIÉS
- A. L'OFFRE D'INGÉNIERIE TERRITORIALE
PUBLIQUE SOUFFRE ENCORE D'UN MANQUE DE LISIBILITÉ
- I. DES PRÉALABLES INDISPENSABLES : LA
DÉFINITION DES MISSIONS « SOCLES » DE
L'ÉTABLISSEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT D'UNE VÉRITABLE
COMPTABILITÉ ANALYTIQUE
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LISTE DES DÉPLACEMENTS
- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI
(TEMIS)
N° 835
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2024-2025
Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 juillet 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des finances (1) sur la
transformation
du
Centre d'études et
d'expertise sur les
risques, l'environnement,
la mobilité et
l'aménagement (Céréma), un
modèle de
mutualisation en devenir
?,
Par M. Vincent CAPO-CANELLAS,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.
L'ESSENTIEL
M. Vincent Capo-Canellas, rapporteur spécial des crédits du programme 159 de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », a présenté le mardi 8 juillet 2025 les conclusions de son contrôle sur la transformation du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema).
I. PRÉSERVER L'EXPERTISE DU CEREMA À L'HEURE OÙ L'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE RÉVOLUTIONNE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
A. L'ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS ONT BESOIN DE L'EXPERTISE DU CEREMA
Le Cerema est le bras armé de l'État s'agissant de l'expertise technique en matière d'aménagement du territoire et d'infrastructures. La mutualisation de cette capacité d'expertise au sein d'un opérateur de l'État unique est un facteur d'efficience des moyens publics, au contraire de son éventuelle dispersion au sein de différentes administrations. Le Cerema s'est aussi rendu indispensable par sa capacité à projeter rapidement une expertise technique de haut niveau après une crise, notamment une catastrophe naturelle. Maintes fois éprouvée, cette capacité sera de plus en plus mobilisée en raison du changement climatique.
Alors que l'État a de moins en moins les moyens de soutenir financièrement les collectivités, il n'est pas sans intérêt que celles-ci puissent recevoir un appui technique de la part d'un opérateur tel que le Cerema. L'appui expert du Cerema est devenu indispensable pour nombre d'entre-elles, notamment dans la phase amont de la définition d'un projet d'aménagement ou au moment d'aborder une thématique transversale complexe telle qu'une stratégie d'adaptation au changement climatique, un sujet qui révolutionne les enjeux d'aménagement du territoire et renforce la légitimité de l'opérateur, devenu une référence en la matière.
De nombreuses dimensions de l'activité du Cerema permettent de mieux maîtriser la dépense publique et sont génératrices de gains socio-économiques, des aspects qui mériteraient d'être d'avantage pris en compte : l'expertise prévient l'apparition de risques ou désordres plus importants et évite des dépenses plus importantes.
B. DEPUIS 2018, LE CEREMA S'EST PROFONDÉMENT RESTRUCTURÉ
À compter de 2018, pour atteindre l'objectif, que lui avait fixé le Gouvernement, de parvenir à réduire de 20 % ses effectifs et sa subvention pour charges de service public (SCSP), le Cerema a mis en oeuvre une restructuration profonde de son organisation. Cette réforme a notamment consisté en des réorganisations de ses implantations territoriales, un regroupement de ses laboratoires, des polarisations d'activités ainsi qu'une optimisation de l'organisation de ses fonctions supports.
Dans le cadre de sa restructuration, le Cerema s'est interrogé sur le périmètre de ses missions, opérant un exercice de réforme structurelle que l'État quant à lui a tant de mal à concrétiser. À l'issue de cette réforme, le Cerema a réduit le nombre de ses secteurs d'intervention de 66 à 21 renonçant à intervenir dans plusieurs domaines. Le programme de restructuration du Cerema s'est traduit par la suppression de 350 postes et la transformation substantielle de 800 autres. Dans le même temps, du fait des gains de productivité générés, la capacité de production de l'établissement aurait augmenté de 10 %.
En parallèle de sa restructuration et dans le but de concentrer ses moyens en baisse sur les actions pour lesquelles sa plus-value est la plus substantielle, le Cerema poursuit une clarification de son positionnement stratégique. Il recentre son activité sur des prestations de conseil et d'expertise pointues plutôt que sur des interventions techniques plus opérationnelles qui relèvent davantage, lorsqu'elles existent, des agences techniques départementales. Pour cette raison, en matière d'accompagnement des collectivités, le « coeur de cible » du Cerema est constitué des régions, des départements et des groupements de communes de 50 000 habitants et plus qui disposent de services techniques suffisamment étoffés pour valoriser les expertises pointues de l'opérateur. Il s'attache en outre à développer une offre plus étoffée en direction des petites communes adhérentes.
II. VIRAGE VERS LES COLLECTIVITÉS : LA RECHERCHE D'UN NOUVEL ÉQUILIBRE
A. L'ACTIVITÉ DU CEREMA S'ORIENTE DE PLUS EN PLUS VERS LES COLLECTIVITÉS
À sa création, les activités du Cerema étaient quasi-exclusivement orientées vers les services de l'État (encore 90 % en 2018). Depuis 2018, à la faveur notamment d'une révision des modalités de la programmation annuelle de ses activités, l'établissement se tourne de plus en plus vers les collectivités. Cette réforme doit cependant être prolongée afin de simplifier les procédures et coordonner les commandes passées par les services de l'État.
Le virage du Cerema vers les collectivités est encouragé par ses tutelles, y compris pour des raisons budgétaires, dans le but de développer les ressources propres de l'opérateur. Ainsi, les ressources propres que le Cerema perçoit de la part des collectivités ont plus que doublées entre 2018 et 2024, passant de 9 à 21 millions d'euros par an. Alors qu'en 2018, 347 collectivités avaient contractualisé avec le Cerema, elles étaient 515 en 2024 pour un total de 2 314 prestations délivrées.
Évolution par type de collectivité
des ressources propres annuelles
perçues par le Cerema
(2020-2024)
(en millions d'euros)
Source : Commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
B. LE STATUT DE QUASI-RÉGIE CONJOINTE CONDUIT À DE NOUVEAUX ÉQUILIBRES
Afin de surmonter des blocages qui contraignaient le virage du Cerema vers les collectivités, le législateur a entendu lui donner un nouveau statut de quasi-régie conjointe faisant de lui un établissement partagé entre l'État et les collectivités. Une réforme de la gouvernance du Cerema s'en est suivie, accordant une place beaucoup plus significative aux collectivités. La quasi-régie conjointe procure aux collectivités adhérentes un accès facilité au Cerema puisqu'elles peuvent recourir à ses services sans mise en concurrence. Les premiers résultats observés témoignent d'une indéniable dynamique. En mai 2025, 1 013 collectivités avaient adhérées à la quasi-régie1(*) et le Cerema vise 1 500 adhérents à l'horizon 2027.
La mise en oeuvre de ce nouveau statut suppose pour le Cerema comme son corps social, de construire de nouveaux repères et d'évoluer au sein d'un nouvel équilibre. Ce nouveau modèle est porteur de transformations importantes pour les personnels, d'autant qu'elles interviennent après de nombreuses et profondes évolutions, et suppose un travail de pédagogie renforcé ainsi que des consignes managériales très claires.
La dynamique des adhésions témoigne de la bonne réputation du Cerema auprès des collectivités. L'enjeu pour l'opérateur sera désormais de parvenir à entretenir cette relation de confiance et de ne pas décevoir les attentes placées en lui. Il s'agira pour lui de fidéliser ses adhérents en répondant à leurs besoins avec le niveau de qualité attendu. Or, dans un contexte de contrainte significative exercée sur ses moyens, notamment humains, cela représentera un vrai défi.
Le nouveau statut du Cerema suscite certaines réserves au sein de l'État. Exprimées à ce jour « à bas bruit », les critiques portent notamment sur la perte d'influence des représentants de l'État dans la gouvernance alors même que le budget de l'État demeure le principal financeur du Cerema. Constatant que le poids des ressources propres issues des collectivités restera limité dans le budget total de l'établissement, certains estiment notamment que « le jeu n'en valait pas la chandelle ». Par ailleurs, plusieurs directions d'administration centrale partenaires du Cerema notent, non sans parfois un certain regret, la diminution des activités de l'opérateur pour leur compte. S'il est encore trop tôt pour faire le bilan du nouveau statut du Cerema, il sera nécessaire d'en réaliser une évaluation approfondie à l'horizon 2027, après quatre années de mise en oeuvre.
III. LE CEREMA EST ENGAGÉ DANS UNE IMPASSE FINANCIÈRE
A. LE CEREMA A CONNU UNE CONTRACTION TRÈS SÉVÈRE DE SES MOYENS
Depuis sa création, le Cerema s'est vu imposer une forte diminution de sa subvention pour charges de service public (SCSP). Le montant de sa dotation a ainsi diminué de 37 millions d'euros, soit 17 %. Dans le même temps, ses effectifs ont été réduits de 18 %.
Évolution de la SCSP versée au Cerema (2014-2025)
(en milliers d'euros)
Source : commission des finances du Sénat d'après les documents budgétaires du Cerema
Au fil des schémas d'emplois négatifs successifs qu'il a connu, le Cerema a supprimé 668 équivalents temps plein (ETP) depuis sa création. Il serait vraisemblablement difficile d'aller plus loin dans cette voie sans une nouvelle restructuration significative ou une remise en cause du nouveau modèle de l'opérateur.
Évolution des effectifs du Cerema (2014-2024)
(en ETPT)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Cumul des schémas d'emplois du Cerema (2015-2025)
(en ETP)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Dans le même temps, afin de concrétiser sa stratégie visant à recentrer son rôle sur le conseil et l'expertise de haut niveau, le Cerema a conduit une politique de repyramidage de ses effectifs au bénéfice des ingénieurs de catégorie A. Les postes occupés par des agents de catégorie B et C ont ainsi été les plus concernés par les suppressions d'effectifs.
B. UN MODÈLE FINANCIER EN PÉRIL
La lecture de l'équilibre budgétaire du Cerema a été compliquée ces dernières années par les flux financiers, décalés dans le temps, en recettes comme en dépenses, liés à la participation de l'établissement à certains grands programmes nationaux. Ces phénomènes expliquent les fluctuations très significatives du déficit budgétaire annuel du Cerema observées entre 2022 et 2025.
Après retraitement des opérations en recettes comme en dépenses qui relèvent de ces dispositifs fléchés, il apparaît que le solde budgétaire structurel du Cerema s'est nettement dégradé depuis 2022 en raison, d'une part, de la baisse de sa SCSP et, d'autre part, du dynamisme de ses charges de personnel et de ses autres dépenses de fonctionnement. L'établissement connaît aujourd'hui un déficit structurel substantiel d'une vingtaine de millions d'euros par an.
Dépenses et recettes structurelles du Cerema (2019-20252(*))
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires du Cerema
Depuis la création du Cerema, ses tutelles l'on fortement incité à développer ses ressources propres pour compenser la réduction continue de sa SCSP et, plus récemment, pour absorber la hausse de ses charges de personnel. Leur montant a globalement doublé depuis 2018, passant de 30 à 60 millions d'euros par an. En 2025, le Cerema anticipe cependant une stabilisation de ses ressources propres. Les principaux gisements en la matière n'ont-ils pas déjà été exploités ? Si cette observation se confirmait, elle remettrait en cause le modèle selon lequel le Cerema se trouve sommé d'accroître ses ressources propres dans le but principal de compenser la baisse continue de sa dotation et d'absorber les charges supplémentaires qui lui sont parfois imposées de l'extérieur. « Les arbres ne montent pas au ciel » et il est possible que ce modèle, qui a permis à l'État de réaliser des économies, ait fini par atteindre ses limites.
Ressources propres du Cerema (2017-2024)
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Le budget du Cerema est très contraint par le poids et le dynamisme de sa masse salariale qui représente presque 80 % du total de ses dépenses. Or, en dépit de la baisse sensible des effectifs de l'établissement, ses charges de personnel connaissent une augmentation très dynamique : entre 2019 et 2025, elles enregistrent une hausse de 35 millions d'euros (+ 18 %) pour atteindre 232 millions d'euros. Cette évolution résulte principalement de deux phénomènes.
Le premier, essentiellement exogène, correspond aux mesures ayant pour conséquence d'augmenter le traitement indiciaire ou les indemnités versés aux agents rémunérés par l'opérateur. D'après le Cerema, depuis 2019, les charges exogènes non compensées de ce type auraient conduit à majorer structurellement sa masse salariale de près de 19 millions d'euros par an, dégradant d'autant ses équilibres financiers. Le deuxième phénomène explicatif est quant à lui endogène et résulte de la politique de repyramidage des effectifs du Cerema. Ce phénomène a un coût pour l'établissement qui, depuis 2019, est estimé entre 2 et 2,5 millions d'euros par an, en lien avec l'augmentation du coût moyen par agent qui aura progressé de 19 % entre 2019 et 2025.
Coût moyen par agent (2019-20253(*))
(en euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
La hausse importante des dépenses de fonctionnement constatée depuis 2022 nécessitait de réaliser des économies pérennes. La forte contrainte budgétaire imposée par la loi de finances pour 2025 a obligé l'établissement à appliquer un plan de retour à l'équilibre prévoyant 16,5 millions d'euros d'économies, dont 11 millions d'euros sur les dépenses de fonctionnement et les charges de personnel. Même si l'établissement entend pérenniser ces économies, elles ne suffiront pas à rééquilibrer sa situation financière.
Compte-tenu de son déséquilibre budgétaire structurel, le Cerema n'a eu d'autre choix que de mobiliser sa trésorerie fléchée pour assurer ses dépenses courantes, notamment celle qu'il est tenu de redistribuer aux collectivités dans le cadre du programme « ponts ». Le conseil d'administration de l'établissement avait lui-même revendiqué la nécessité de recourir à cette forme de « cavalerie budgétaire ». Le paradoxe est que tout en regrettant cette situation, l'État a pu dans le même temps justifier la baisse significative de la SCSP du Cerema, notamment en 2025, par le fait que celui-ci disposait d'une trésorerie abondante. Il s'agit là d'un cas d'école symptomatique des injonctions contradictoires devant lesquelles le Cerema a pu être placé par l'État au cours de ces dernières années. Il est tout de même étonnant que l'État ait pu recourir sciemment à un système aussi « baroque » et aussi éloigné des règles élémentaires de bonne gestion des deniers publics.
Aujourd'hui, les trajectoires financières prévisionnelles les plus actualisées sont extrêmement préoccupantes. Elles prévoient, dans une hypothèse de stabilisation de la SCSP du Cerema, un creusement de son déficit et un niveau de trésorerie négatif en 2027. Le Cerema est engagé dans une impasse financière manifeste, et ce, à très court terme. Une analyse plus fine révèle même que la trésorerie non fléchée de l'établissement, la seule dont il dispose réellement, deviendra négative dès 2026.
Trésorerie prévisionnelle en fin d'année du Cerema à horizon 2027
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
IV. L'ÉTAT DOIT DÉCIDER DU RÔLE QU'IL ENTEND DONNER AU CEREMA
A. L'ÉTAT DOIT ASSUMER LES CHOIX STRATÉGIQUES QUI DÉTERMINERONT L'AVENIR DU CEREMA
Le Cerema se trouve aujourd'hui à un point de bascule existentiel. D'ici 2027, l'État doit impérativement lui donner une orientation stratégique claire et financièrement soutenable. L'impératif de visibilité doit se substituer à l'incertitude permanente d'un pilotage budgétaire « à vue », sans cap ni boussole, qui finirait par menacer la pérennité même de l'opérateur.
1. Une tutelle à renforcer pour que l'État réaffirme pleinement son rôle de décideur stratégique...
L'exercice actuel de la tutelle sur l'opérateur, beaucoup trop effacé, ne semble pas compatible avec ce besoin de réaffirmation de la position de l'État. L'exercice de la tutelle du Cerema se trouve compliqué par son positionnement ambigu entre le ministère chargé de la transition écologique et le ministère chargé de l'aménagement du territoire. En outre, les moyens et le « poids » dans les arbitrages interministériels du commissariat général au développement durable (CGDD), tutelle métier de l'opérateur, sont trop limités. Il est aujourd'hui indispensable de renforcer la tutelle du Cerema.
2. ...définisse les activités « socles » du Cerema...
Le premier des choix stratégiques que devront assumer les tutelles du Cerema, et qui aurait dû être fait depuis longtemps déjà, consiste à détourer précisément ce qui relève des missions de service public « socles » de l'établissement, c'est-à-dire ses activités dont le coût de production a vocation à être financé par sa SCSP. Aujourd'hui, la délimitation du périmètre des missions de service public « socles » du Cerema, choix stratégique s'il en est, ne fait pas intervenir ses tutelles. Elle est le résultat de procédures de conventionnements bilatérales négociées entre la direction du Cerema et les différentes administrations centrales, sans coordination ni cadre harmonisé.
3. ...et fixe au Cerema une stratégie de long terme claire et soutenable
Au plus tard au cours de l'année 2026, l'État doit décider clairement de ce qu'il entend faire du Cerema, de sa vision stratégique de long terme pour l'établissement, et lui fixer un cadre propre à sécuriser la soutenabilité de son modèle économique. En tenant compte des fortes contraintes qui pèsent sur les finances publiques, trois scénarios alternatifs semblent se dessiner.
Un premier scénario serait celui du statu quo organisationnel et d'une augmentation de la SCSP de l'établissement pour combler son déficit structurel. Compte-tenu de l'état des comptes publics, cette hypothèse semble improbable à court terme.
Un deuxième scénario serait au contraire celui du statu quo en termes de moyens financiers, c'est à dire le gel durable de la SCSP. Toutes choses égales par ailleurs, cette situation aboutirait à une impasse financière dès 2027. Aussi, ce scénario supposerait-il une nouvelle réforme structurelle profonde de l'établissement se traduisant par une révision à la baisse, probablement substantielle, de son champ d'intervention, notamment pour le compte des services de l'État. À ce jour, aucune réflexion de la sorte n'a été entreprise par l'État. Or, une telle réforme nécessiterait d'être pensée très en amont et accompagnée d'une solide étude d'impact.
Un troisième scénario, hybride, pourrait induire une légère augmentation de la SCSP en contrepartie de gains de productivité dégagés par une réforme de l'organisation du temps de travail, par un programme ambitieux de diffusion de l'intelligence artificielle ainsi que par un nouveau recentrage des missions du Cerema. Ce scénario pourrait même être rendu plus soutenable par la recherche de compensations budgétaires à la hausse de la SCSP du Cerema dans un cadre plus large que celui du programme 159 du budget de l'État qui ne dispose plus d'aucune marge en la matière.
4. Le Cerema doit faire sa part du chemin
Le Cerema doit également faire sa part du chemin, notamment pour gagner la confiance de sa tutelle financière. Sur ce plan, un premier enjeu relève de la transparence du coût de ses prestations. Le modèle économique dual du Cerema, qui s'appuie à la fois sur des activités « socles » financées par sa SCSP et sur des activités commerciales rémunérées, suppose une comptabilité analytique très fine permettant de séparer les flux financiers de ces deux sphères. Cette « muraille de Chine » doit prévenir les « subventions croisées ». En l'occurrence, l'État souhaite avoir la garantie que la SCSP ne serve pas à financer des activités commerciales, notamment à destination des collectivités. Pour améliorer la transparence de ses coûts, le Cerema a développé une première forme de comptabilité analytique. Il lui revient désormais de l'affiner et de la généraliser à toutes ses activités pour mesurer avec la plus grande précision possible le coût complet de ses activités commerciales et pouvoir le comparer avec ses ressources propres.
Le Cerema doit aussi réaliser de nouveaux gains de productivité. Dans cette perspective, la direction de l'opérateur a engagé des négociations sociales au sujet de deux pistes de réforme de l'organisation du temps de travail : un projet de révision des règles de compensation des temps de déplacement et la forfaitisation du temps de travail des cadres. Une autre piste prometteuse relève de la diffusion de l'intelligence artificielle qui pourrait à terme représenter une amélioration de performance de 10 %.
B. AU-DELÀ DU SEUL CEREMA, UN BESOIN DE MIEUX STRUCTURER ET DE RENDRE PLUS LISIBLE L'OFFRE D'INGÉNIERIE TERRITORIALE PUBLIQUE
L'offre d'ingénierie territoriale publique souffre d'un manque de lisibilité. Cela vaut notamment pour les grands opérateurs de l'État qui y participent, en particulier le Cerema, l'Ademe et l'ANCT. Pour pallier à l'effacement d'une tutelle qui n'a pas pu, pas su ou pas voulu jouer son rôle d'arbitre, de premières initiatives ont été prises par ces trois opérateurs pour articuler leurs périmètres et coordonner leurs actions. C'est dans ce cadre qu'ils ont commencé à traiter les cas de redondances identifiés. Cependant, à des fins de lisibilité et de mise en cohérence des politiques publiques de l'État, il est nécessaire d'approfondir ce travail. Si une fusion de ces trois opérateurs n'apparaît ni réaliste, ni pertinente à court terme, des mutualisations de services, notamment s'agissant de leurs fonctions transverses seraient envisageables et souhaitables pour dégager des gains de productivité.
LISTE DES RECOMMANDATIONS
Recommandation n° 1 : pour le recueil des expressions de besoin des administrations de l'État à l'endroit du Cerema, développer/organiser une coordination approfondie par la tutelle de l'établissement.
Recommandation n° 2 : simplifier la procédure de programmation annuelle des activités du Cerema pour qu'elle consomme moins de temps à ses personnels, permettant ainsi de dégager des gains de productivité.
Recommandation n° 3 : prévoir une évaluation du nouveau statut de quasi-régie conjointe du Cerema à l'horizon 2027.
Recommandation n° 4 : définir les activités « socles » du Cerema ayant vocation à être financées par sa subvention pour charges de service public (SCSP).
Recommandation n° 5 : développer et généraliser à l'ensemble des activités de l'établissement une comptabilité analytique plus fine, permettant d'identifier le coût complet exhaustif des différentes prestations réalisées par l'opérateur.
Recommandation n° 6 : l'établissement doit activer les leviers dont il dispose pour réaliser des gains de productivité, notamment en matière d'organisation du temps de travail et de diffusion de l'intelligence artificielle, ainsi que pour développer les ressources propres qu'il perçoit au titre des prestations délivrées aux entreprises.
Recommandation n° 7 : alors que le pilotage budgétaire « à vue » fait actuellement peser une menace existentielle sur l'établissement, il est impératif qu'une tutelle étatique renforcée lui fixe, au plus tard au cours de l'année 2026, un nouveau cap stratégique soutenable financièrement.
Recommandation n° 8 : en attendant que ce nouveau cap stratégique soit défini, la situation financière extrêmement délicate de l'opérateur suppose a minima de stabiliser sa subvention pour charges de service public en 2026.
Recommandation n° 9 : afin de réaliser des gains de productivité, procéder à la mutualisation de services du Cerema exerçant des fonctions transverses (publications et diffusion des connaissances) avec d'autres opérateurs de l'État qui interviennent dans des champs comparables, en particulier l'Ademe.
PREMIÈRE PARTIE
PRÉSERVER
L'INGÉNIERIE PUBLIQUE EXPERTE
DU CEREMA À L'HEURE OÙ
L'ADAPTATION
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE RÉVOLUTIONNE
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
I. LA NÉCESSITÉ D'UNE INGÉNIERIE PUBLIQUE DE L'ÉTAT
A. LE BESOIN D'UNE INGÉNIERIE PUBLIQUE ÉTATIQUE COMPLÉMENTAIRE DU SECTEUR PRIVÉ
1. Les services de l'État comme les collectivités ne pourraient pas se passer de l'expertise du Cerema
a) Certaines politiques publiques déployées par les services de l'État dépendent de l'appui technique du Cerema
Depuis sa création, le Cerema concentre les moyens et les capacités d'ingénierie de l'État dans les domaines de l'aménagement du territoire et des infrastructures. Il est devenu le bras armé de l'État en matière d'expertise technique et opérationnelle sur ces champs d'intervention. Son expertise technique pointue est incontournable pour de nombreux services de l'État, principalement sur les périmètres des ministères chargés de la transition écologique et de l'aménagement du territoire. Les compétences d'ingénierie qu'il déploie sont aujourd'hui indispensables à la mise en oeuvre des politiques publiques portées par ces ministères, tout particulièrement s'agissant de la réalisation de projets territoriaux complexes, innovants ou qui supposent d'adopter une approche pluridisciplinaire.
Le caractère incontournable de l'ingénierie publique déployée par le Cerema s'observe notamment dans ce qui constitue le coeur de son activité historique, à savoir l'expertise technique en matière d'infrastructures de transports. Ainsi, en ce qui concerne l'évaluation de l'état des chaussées ou des ouvrages d'art, le Cerema constitue la référence nationale et dispose même à ce titre d'une renommée européenne et mondiale. Aux dires de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM), dans ces domaines, l'État ne pourrait pas se passer de l'expertise du Cerema. Sur ce même champ d'intervention, compte-tenu du réseau routier qu'ils gèrent, les départements sont d'ailleurs tout aussi dépendants des compétences de cet établissement public.
Au-delà des infrastructures de transport, d'autres directions d'administrations centrales ont indiqué au rapporteur que l'expertise du Cerema leur était indispensable pour mettre en oeuvre certaines politiques publiques dont elles ont la responsabilité.
Ainsi, pour la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN), le Cerema est « un acteur indispensable » en ce qui concerne la connaissance et le suivi des emprises foncières, notamment dans le cadre de la politique de zéro artificialisation nette (ZAN), mais également des enjeux littoraux, en particulier s'agissant de la prévention du risque lié au recul du trait de côte.
De son côté, la direction générale de la prévention des risques (DGPR) estime avoir impérativement besoin de l'appui du Cerema s'agissant notamment de la sécurité des ouvrages hydrauliques ou encore du suivi et du confortement des sites instables.
Aujourd'hui, pour l'accomplissement de ses missions d'élaboration, de mise en oeuvre et d'évaluation de la politique de sécurité routière, la délégation à la sécurité routière (DSR) dépend très fortement des compétences techniques dont dispose le Cerema. D'après la DSR, l'appui du Cerema lui est notamment indispensable « pour assurer la fiabilité des données d'accidentalité routière, la production du bilan annuel de l'observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), la production de supports méthodologiques, l'organisation de formations à la sécurité routière, le suivi d'expérimentations et la réalisation d'évaluations de dispositifs de la politique de sécurité routière ainsi que la production d'études pluriannuelles d'importance ».
Dans ces domaines, la DSR met en exergue certaines « activités régaliennes » qui pourraient « difficilement être réalisées par le privé » et pour lesquelles elle « ne peut que s'appuyer sur le Cerema ». Il s'agit de ses missions réglementaires, de la production d'études et d'évaluations sur des sujets ou des données sensibles, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur des outils sensibles en particulier les fonctions d'administrateur de base de données partagées avec l'ONISR, de la production des bilans annuels d'accidentalité routière ou encore de l'appui technique à la politique de contrôle automatisé. La DSR ajoute que « le maillage territorial et thématique du Cerema lui permet d'être l'un des deux seuls acteurs français en capacité de produire des analyses complexes en sécurité routière, l'université Gustave Eiffel étant l'autre acteur central mais sur un champ moins directement applicable au terrain ».
b) La concentration des capacités d'ingénierie de pointe de l'État en matière d'aménagement du territoire au sein d'un établissement national : un moyen de parvenir à la mutualisation de cette expertise technique, gage de son efficacité et de son efficience
De par sa dimension nationale couplée à un réseau d'implantations décentralisées, le Cerema peut se prévaloir d'une expérience unique en France en ce qui concerne l'expertise technique des projets relatifs à l'aménagement du territoire. De par son histoire et celle des différentes entités dont il est le fruit, parce qu'il intervient sur l'ensemble du territoire et dispose d'une taille critique lui permettant d'apporter son appui à un nombre significatifs de projets relatifs à son périmètre d'activité, le Cerema dispose, dans ces domaines, d'une vision globale, d'un historique et d'une expérience inégalables.
Cette forme de mutualisation nationale de l'expertise technique de pointe sur les sujets d'aménagement du territoire au sein d'un opérateur de l'État unique constitue incontestablement un facteur d'efficacité et d'efficience des moyens publics engagés à cette fin.
En effet, une dispersion, voire un « saupoudrage » de cette capacité d'expertise au sein de différentes administrations de l'État et des collectivités territoriales se traduirait par une situation sous-optimale. La concentration des moyens correspondants au sein d'un opérateur national a plusieurs avantages. Elle permet en effet :
- de réaliser des économies de moyens, évitant que plusieurs entités publiques se dotent de ce type de capacités, ce qui induirait nécessairement des situations de doublons et une allocation inefficiente des compétences concernées ;
- de disposer d'une capacité d'expertise publique pointue et de très haut niveau sur des domaines spécifiques en concentrant une équipe d'experts atteignant une taille critique et bénéficiant d'un effet d'émulation par un phénomène de réseau4(*) ;
- de capitaliser sur un historique et des expériences issus de la confrontation à un grand nombre de projets de terrain réalisés sur l'ensemble du territoire national ;
- de valoriser la richesse et la diversité de ces expériences pour diffuser largement sur le territoire les connaissances et les bonnes pratiques qui en résultent, notamment à travers de grands programmes nationaux « massifiés » caractérisés par des économies d'échelle et une efficience décuplées en comparaison d'expertises qui seraient délivrées de façon disparates sur le territoire par différents acteurs disposant chacun de moyens limités.
Les travaux de recherche conduits par le Cerema et la façon dont ils infusent dans l'activité d'ingénierie opérationnelle renforcent également les avantages résultant de la mutualisation à l'échelle nationale de ces moyens d'expertise.
c) Une capacité de projection rapide unique et précieuse après une crise ou une catastrophe naturelle
L'une des caractéristiques qui rend le Cerema indispensable aujourd'hui réside dans sa capacité à projeter très rapidement une expertise technique de très haut niveau après la survenance d'une crise, notamment d'une catastrophe naturelle. Cette capacité inédite en France a été maintes fois éprouvée ces dernières années et le sera malheureusement sans aucun doute de plus en plus dans les années à venir en raison des effets résultant des dérèglements climatiques.
Si le Cerema n'est pas un acteur de la gestion de crise proprement dite, une mission et une responsabilité qui relève des services de l'État, il peut intervenir en appui technique dans l'immédiate après-crise. Dans ce cadre, le Cerema est mobilisé au titre de son expertise en matière d'analyse des risques (inondations, mouvements de terrain, submersions, etc.) ou de diagnostic des désordres structurels. Appui précieux à la décision publique, cette expertise a vocation à éclairer rapidement les autorités locales ou nationales, notamment pour hiérarchiser des interventions, sécuriser des sites ou encore mettre en oeuvre des solutions de remédiation.
Le référentiel d'interventions du Cerema dans l'immédiate après-crise
Lorsque son expertise est mobilisée par les services de l'État, des collectivités territoriales ou encore des gestionnaires d'infrastructures dans l'immédiate après-crise, le Cerema peut notamment être amené à procéder aux types d'interventions suivants :
- réaliser des diagnostics techniques rapides, notamment sur des ouvrages d'art, d'autres infrastructures de transport, des cavités, des écoulements en crue ou encore des glissements de terrains ou de talus ;
- conseiller sur la mise en place de mesures conservatoires (restriction de circulation, balisage, sécurité des personnes, etc.) ;
- proposer des solutions techniques, de confortement temporaire ou de reconstruction ;
- réaliser des levés par drones pour évaluer l'étendue des dégâts (zones inondées, glissements de terrain, etc.) ;
- mettre à disposition des ponts de secours ;
- participer à la priorisation des travaux, en évaluant l'état des infrastructures touchées.
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Le commissariat général au développement durable (CGDD), tutelle métier de l'établissement, considère à ce titre que le Cerema se distingue par « une capacité de projection d'expertise robuste » et constitue souvent l'unique recours de l'État lorsqu'il a besoin d'une analyse technique sensible après la survenance d'une catastrophe naturelle, tout particulièrement si des infrastructures de transports sont concernées ou en cas d'aléas naturels complexes. Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) a lui aussi vanté auprès du rapporteur cette capacité de mobilisation rapide de l'expertise du Cerema dans l'immédiate après-crise. Aucune autre entité publique ni un acteur privé ne serait d'après lui en mesure de se substituer au Cerema dans ce domaine. Cette capacité de projection rapide d'une expertise technique de très haut niveau dont dispose l'État constitue un atout précieux pour la puissance publique et apparaît comme une plus-value majeure de l'opérateur.
L'expertise en matière de gestion de crise et de reconstruction du Cerema a ainsi été mobilisée par l'État après le passage du cyclone Irma en 2017 ou des tempêtes Alex en 2020 et Fiona en 2022. Mobilisé pour apporter son appui au syndicat de l'eau et de l'assainissement de Mayotte (Lema) afin d'endiguer la crise de la gestion de l'eau à Mayotte, le Cerema est intervenu dès les premières heures après le passage du cyclone Chido pour rétablir l'accès de la population à l'eau potable. Le Cerema doit par ailleurs également intervenir dans la reconstruction du territoire par l'intermédiaire de l'établissement public de reconstruction et de refondation de Mayotte. Plus récemment, en février 2025, le Cerema a été mobilisé dans le cadre des inondations en Ille-et-Vilaine afin de réaliser des levés par drones à grande échelle pour cartographier les zones affectées.
La mobilisation de l'expertise du Cerema dans la phase d'immédiate après-crise est tout sauf une activité anecdotique pour l'opérateur. En effet, pour la seule année 2024, le Cerema a été amené à réaliser 283 interventions d'urgence parmi lesquelles 221 en métropole et 62 en outre-mer.
Au-delà de l'immédiate après-crise, l'expertise du Cerema est également de plus en plus fréquemment sollicitée lors de la phase suivante, de long terme, consistant à analyser les enseignements de l'évènement et à les prendre en compte dans les choix stratégiques d'aménagement du territoire, en particulier en matière de prévention et pour promouvoir des approches de reconstruction visant à rendre le territoire moins vulnérable aux aléas. Cette mission, en fort développement, s'inscrit notamment dans les enjeux de l'adaptation des infrastructures et des territoires au changement climatique, un axe d'intervention devenu stratégique et structurant pour le Cerema (voir infra). À ce titre, il est à noter que le nouveau projet stratégique 2025-2028 du Cerema fait de la prévention des risques naturels, de la résilience des infrastructures, de la gestion de l'eau et de la sécurité des territoires littoraux et maritimes des priorités pour l'établissement.
Au-delà de la phase d'urgence, l'appui
apporté par le Cerema
dans la période
d'après-crise
Au-delà des réponses d'urgence à une crise environnementale, l'appui du Cerema est de plus en plus sollicité au cours de la phase postérieure d'après-crise dans une perspective de prévention des risques, de résilience et de préparation des territoires. Dans ce cadre, son action peut notamment l'amener à couvrir les domaines suivants :
- connaissance des aléas (inondations, mouvements de terrain, séismes, retrait gonflement des argiles, etc.) ;
- surveillance et observation, en lien avec des dispositifs comme Vigicrues ou Candhis ;
- maîtrise de l'urbanisation et réduction de la vulnérabilité ;
- préparation aux situations d'urgence, à travers des exercices de simulation et des guides pratiques ou encore animation des communautés d'acteurs de la gestion de crise ;
- retour d'expérience, pour améliorer les politiques publiques et les outils d'intervention.
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Lors d'un déplacement sur le site de la direction territoriale Hauts-de-France à Lille, le rapporteur s'est notamment vu présenter l'appui apporté par l'opérateur aux territoires ayant été touchés par les inondations qui ont affecté le département du Pas-de-Calais durant l'hiver 2023-2024. Après avoir été mobilisé dans la phase d'immédiate après-crise (notamment pour réaliser des diagnostics de stabilité d'ouvrages d'art ou des analyses de risques géotechniques), le Cerema a apporté son appui à l'équipe d'experts placée auprès du préfet délégué à la reconstruction dans le cadre de l'exercice de retour sur expérience puis pour organiser la phase de concertation devant aboutir à la construction d'un plan de résilience territoriale destiné à définir les stratégies d'aménagement du territoire en intégrant les enseignements tirés des phénomènes survenus et des aléas qui en sont à l'origine.
Pour réduire structurellement la vulnérabilité des territoires concernés par ce type d'aléas et dans une perspective d'adaptation aux effets du changement climatique, le Cerema fait notamment porter ses efforts sur les enjeux de reconstruction après la survenance d'une catastrophe naturelle, une reconstruction qui doit rendre le territoire moins vulnérable aux aléas auxquels il est exposé. L'établissement mobilise à cette fin des équipes pluridisciplinaires de relèvement et de reconstruction5(*).
d) Les collectivités ont besoin de l'expertise du Cerema
Alors que l'État a de moins en moins les moyens de soutenir financièrement les collectivités, notamment pour s'assurer qu'elles disposent des moyens d'ingénierie qui leur sont nécessaires, il n'est pas sans intérêt que celles-ci puissent recevoir un appui technique de la part d'un opérateur tel que le Cerema. Autrefois essentiellement consacrées aux services centraux et territoriaux de l'État, la réorientation progressive des activités de l'opérateur vers les collectivités (voir infra) n'est à ce titre pas anodine.
L'appui expert du Cerema est devenu indispensable pour nombre de collectivités, notamment dans la phase amont de la définition d'un projet d'aménagement d'envergure ou encore pour éclairer les décideurs publics locaux sur l'approche et les méthodologies à adopter au moment où ils s'apprêtent à aborder des sujets transversaux complexes tels que la stratégie d'adaptation au changement climatique d'un territoire.
Par ailleurs, le Cerema est de plus en plus sollicité par les collectivités dans une rôle de tiers de confiance, notamment dans leurs relations avec des bureaux d'études privés.
2. L'ingénierie du Cerema est source d'une gestion plus efficiente des finances publiques et de gains socio-économiques
Bien qu'il soit difficile voire impossible d'en estimer l'ampleur, de par leur nature, de nombreuses dimensions de l'activité du Cerema permettent de mieux maîtriser la dépense publique locale comme nationale et sont génératrices de gains socio-économiques.
a) L'activité du Cerema se traduit par une gestion des deniers publics plus économe
Notamment parce que l'expertise et l'expérience accumulée par le Cerema permet aux maîtres d'ouvrages publics de dimensionner au plus juste leurs projets d'infrastructures mais aussi d'optimiser la gestion et l'entretien d'ouvrages, ce qui est un vecteur d'allongement de leur durée de vie, certaines prestations de l'opérateur permettent d'éviter des dépenses publiques. Cependant, ce volume de dépenses publiques évitées, parce qu'elles ne se sont jamais matérialisées, est par définition extrêmement difficile à estimer de façon globale. Il ne peut être perçu que de façon ponctuelle sur des projets concrets.
Des exemples de cette nature peuvent notamment être mis en évidence à travers les prestations de conseil en matière géotechnique délivrées par le Cerema aux maîtres d'ouvrages publics. Certains ont ainsi été présentés au rapporteur au cours de son déplacement sur le site de l'opérateur à Sequedin (Nord).
De par sa profondeur historique, sa taille critique et son périmètre national mais également grâce à ses implantations territoriales, le Cerema a développé un niveau d'expertise et surtout accumulé une expérience avec lesquels la plupart des bureaux d'études privés ne peuvent rivaliser. Sur chaque territoire, les équipes de l'opérateur assurent de façon continue le suivi d'ouvrages, tels que des talus ou des ponts, depuis plusieurs dizaines d'années. Cette expérience du Cerema lui permet de conseiller aux maîtres d'ouvrages publics des dimensionnements d'ouvrages optimisés au regard des aléas alors que des opérateurs privés disposant parfois d'une expérience moins fournie, peuvent avoir tendance, par souci de précaution, à proposer des ouvrages qui pourraient s'avérer surdimensionnés. Lors de phases critiques de projets d'infrastructures, dans la perspective d'éviter des surcoûts, le Cerema peut ainsi être sollicité pour des prestations de conseil par des maîtres d'ouvrages, dans un rôle de tiers de confiance, afin d'expertiser des propositions faites par des bureaux d'études privés.
Le Cerema a notamment présenté au rapporteur l'exemple d'un projet de contournement routier porté par un département pour lequel la prestation de conseil de l'opérateur a permis au maître d'ouvrage de réaliser une économie de 12 millions d'euros.
En mutualisant à l'échelle nationale la mise en oeuvre d'outils exigés par des normes législatives ou réglementaires, l'activité du Cerema permet également d'optimiser l'efficience de la dépense publique. Il en va notamment de l'outil de suivi de l'artificialisation des sols qu'il développe en lien avec la politique du zéro artificialisation nette (ZAN). D'après les éléments communiqués au rapporteur, en moyenne, le coût de cet outil revient pour le Cerema à environ 2 euros pour le territoire d'une commune. Il va de soi que si un tel outil n'était pas mutualisé à l'échelle nationale son coût global cumulé pour les finances publiques en serait largement majoré.
Certaines innovations développées par le Cerema permettent également d'optimiser la gestion des deniers publics. Il en va ainsi de l'outil de conseil numérique « UrbanVitaliz » qui a reçu le prix de l'innovation du salon des maires en 2021. Développé par le Cerema, cet outil gratuit de conseil numérique destiné aux élus est né du constat de l'illisibilité des dispositifs publics d'accompagnement à destination des collectivités en matière de revitalisation des friches. Il aurait permis à de nombreuses collectivités d'éviter le recours à des prestations de conseil dont le coût unitaire est estimé entre 8 000 et 12 000 euros et qui auraient eu pour seule vocation d'aider les élus à se retrouver dans le maquis d'une politique publique illisible. D'après les estimations du Cerema, cet outil aurait permis d'éviter entre 3,7 et 5,6 millions d'euros de dépenses publiques. Cet outil pourrait très vraisemblablement être dupliqué pour de nombreuses politiques publiques et générer ainsi des économies non négligeables.
b) L'activité du Cerema génère des gains socio-économiques difficile à chiffrer
Au-delà de leurs effets sur l'optimisation de la dépense publique, la plupart des prestations du Cerema génèrent également des gains socio-économiques qui mériteraient de faire l'objet d'une estimation afin de mesurer les bénéfices collectifs qui résultent de l'activité de l'opérateur. Compte-tenu du périmètre large des interventions du Cerema et du caractère transversal des dimensions qu'il couvre en matière notamment d'aménagement du territoire et d'adaptation au changement climatique, les gains socio-économiques générés par ses activités bénéficient directement ou indirectement à un grand nombre de secteurs économiques et d'individus.
Essentielles pour le Cerema, ses missions de diffusion de connaissance, de méthodologies et autres bonnes pratiques dans ses divers domaines de compétences, se traduisent également par des gains socio-économiques. Cependant l'évaluation de ces derniers est d'autant plus ardue qu'il apparaît extrêmement complexe, une fois la diffusion réalisée, sous forme de guide, de formations ou d'autres supports de diffusion, d'en suivre l'appropriation par les acteurs auxquelles elle est adressée.
Les gains socio-économiques résultant des activités d'expertise du Cerema peuvent également servir le développement et la souveraineté industrielle nationale, en particulier à travers ses missions normatives, d'homologation et de certification. Le rapporteur a notamment pris conscience de ces enjeux à l'occasion d'une visite d'un laboratoire d'essais du Cerema consacré aux aciers, sur le site de Sequedin (Nord). Si aujourd'hui l'essentiel de l'acier utilisé en France est issu d'une production nationale ou européenne, une évolution des équilibres sur les marchés internationaux pourrait résulter de la politique conduite par l'administration américaine. Une telle évolution ne serait pas sans risque pour les aciéries françaises et européennes. À ce titre, les activités normatives et de certification du Cerema en la matière ne sont pas anodine et emportent des enjeux de souveraineté industrielle.
Ces activités occupent une place importante dans les missions du Cerema. Ainsi, l'établissement est-il aujourd'hui en France le premier prestataire d'audits et d'essais des grands organismes certificateurs du génie civil et des équipements de la route. Il se positionne même désormais pour être reconnu comme organisme certificateur en tant que tel s'agissant de certains produits de construction, tels que les granulats.
Le rapporteur observe que le fait que les gains socio-économiques résultant des activités du Cerema soient si peu valorisés, un phénomène qui s'ajoute à la méconnaissance plus générale, du grand public mais aussi des décideurs politiques, du contenu même de ces activités, expose tout particulièrement l'opérateur aux campagnes d'économies budgétaires mises en oeuvre pour mieux maîtriser la dépense publique (voir infra).
3. Alors que l'adaptation au changement climatique bouleverse les enjeux d'aménagement du territoire, l'ingénierie du Cerema est plus que jamais nécessaire
Alors qu'une nouvelle étude scientifique publiée le 18 juin dernier6(*) confirme qu'au niveau mondial, l'objectif de contenir l'augmentation des températures à 1,5 degré est devenu inatteignable, il ne fait pas de doute que les conséquences du réchauffement climatique vont profondément affecter les modes de vie mais également les façons d'aménager le territoire. Aussi, les enjeux de l'adaptation aux effets des dérèglements climatiques sont-ils devenus absolument déterminants, en premier lieu en ce qui concerne les conceptions et les approches relatives à l'aménagement du territoire.
Pourtant, dans un tel contexte, le rapporteur est frappé et préoccupé par un paradoxe : dans un monde rendu plus complexe par les enjeux d'adaptation au changement climatique et par la rapidité des évolutions techniques et technologiques, la France continue de souffrir d'une pénurie structurelle d'ingénieurs. Un autre paradoxe tient au fait qu'alors que ces enjeux bouleversent les conceptions de l'aménagement du territoire, amenant par conséquent les autorités nationales comme locales à se réinterroger en profondeur sur ces questions, l'intérêt du maintien d'une capacité d'ingénierie publique experte dans ces domaines est parfois remis en cause.
Parce que l'ensemble de ses domaines d'intervention est affecté par les effets des dérèglements climatiques, le Cerema ne pouvait ignorer l'enjeu primordial de l'adaptation des territoires et des infrastructures. Il en a fait le fil rouge de son nouveau projet stratégique, s'affirmant, dans le domaine de l'expertise technique, comme l'établissement de référence en matière d'adaptation des territoires et des infrastructures au changement climatique. Ce fil rouge stratégique irrigue désormais l'essentiel des activités du Cerema, que ce soit pour le compte des services de l'État ou bien des collectivités.
Dans cette perspective, le Cerema développe actuellement une série de programmes et de prestations centrés sur les enjeux d'adaptation. C'est le cas notamment du programme global d'accompagnement baptisé « Territoires adaptés au climat de demain ». Celui-ci a pour objet d'anticiper et de planifier les stratégies territoriales d'adaptation dans la perspective d'une augmentation des températures de 4 degrés d'ici à la fin du siècle. D'autres programmes sont ciblés sur des thématiques spécifiques telles que par exemple l'adaptation des bâtiments ou de la voirie urbaine.
Le Cerema développe également des outils de connaissance, d'anticipation et de gestion de certains risques liés au changement climatique ainsi que de définition des stratégies d'adaptation qu'ils supposent. Il en va ainsi notamment de la problématique du recul du trait de côte pour laquelle l'établissement a acquis une expertise reconnue.
Sur le sujet des infrastructures de transport, le Cerema pilote actuellement, pour le compte de la DGITM, la production d'une étude relative à l'adaptation des réseaux routiers au changement climatique.
En 2021, un rapport inter-inspections produit par le conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et l'inspection générale de l'administration (IGA)7(*) saluait le nouveau positionnement stratégique du Cerema sur les thématiques d'adaptation au changement climatique : « le grand mérite de la direction actuelle (...) est d'avoir donné une identité forte au Cerema comme agence climat et territoires de demain ». Cependant, ce même rapport soulignait que cette évolution n'allait pas de soi, supposait d'intégrer de nouvelles compétences, d'acquérir de nouvelles expertises et n'était pas anodine pour les personnels de l'établissement : « faire du Cerema une agence de la transition écologique dans les territoires constitue en effet un tournant stratégique dans le domaine de ses compétences ». Le rapport précité soulignait notamment l'enjeu pour le Cerema d'être capable de « renforcer son expertise et sa notoriété sur les domaines émergents sans abandonner le socle de ses compétences de base ». Certaines des organisations syndicales représentatives auditionnées par le rapporteur lui ont également signalé que cette évolution significative du positionnement de l'établissement était exigeante pour ses agents.
4. Il existe un espace pour une relation complémentaire avec les bureaux d'études privés
a) Le Cerema entretien des relations étroites avec les bureaux d'études privés
Au cours de sa mission de contrôle, le rapporteur a constaté les liens qui unissaient les sphères de l'ingénierie publique et de l'ingénierie privée. Loin de constituer deux mondes qui s'ignorent, elles sont reliées par de fortes interactions. Ce constat se vérifie tout particulièrement s'agissant des relations établies entre le Cerema et les fédérations représentant les bureaux d'études privés. Le Cerema a notamment noué des partenariats avec les deux principales fédérations représentant les bureaux d'études privés, à savoir Syntec, pour les gros bureaux d'études, et Cinov, pour les plus petits.
Depuis 2019, une convention-cadre structure le partenariat entre le Cerema et Syntec-ingénierie. Cette convention a été renouvelée en novembre 2023 pour la période 2023-2026. Elle prévoit des actions communes et des collaborations autour d'axes spécifiques, notamment la résilience des infrastructures, le programme national ponts, l'eau, l'adaptation au changement climatique, un projet de jumeau numérique au service des territoires, ou encore la formation. Depuis novembre 2022, le Cerema a également formalisé un partenariat avec Cinov sous la forme d'une convention-cadre d'une durée de trois ans.
Le partenariat entre le Cerema et la
fédération Cinov
qui représente les petits bureaux
d'études privés
Souhaitant renforcer la complémentarité entre les ingénieries publique et privée, la fédération Cinov et le Cerema ont signé une convention-cadre de partenariat, d'une durée de trois ans, le 23 novembre 2022.
Ce partenariat s'articule autour de trois objectifs principaux :
- instaurer des échanges durables entre la fédération Cinov et le Cerema par la mise en place d'une gouvernance structurée (comité de pilotage annuel) ;
- favoriser une meilleure connaissance mutuelle des compétences et capacités respectives, en instaurant des échanges d'informations réguliers entre les personnels du Cerema et les adhérents de la fédération Cinov ;
- identifier des complémentarités techniques sur les différentes thématiques communes et expérimenter des modes de collaboration adaptés.
Ce partenariat couvre plusieurs domaines d'intérêt commun :
- infrastructures et transports ;
- bâtiment ;
- mobilité, environnement et risques ;
- expertise et ingénierie territoriale ;
- mer et littoral.
À l'échelle des territoires, certaines des fédérations régionales de Cinov ont engagé des échanges avec les antennes du Cerema, permettant d'être mieux identifié et de mener des actions de communication conjointes même si la connaissance par le Cerema des expertises représentées au sein de la fédération est encore très incomplète.
Au niveau national, un comité de pilotage de la convention permet de manière régulière d'échanger sur l'avancement des actions permises dans la cadre de la convention et a permis d'instaurer un dialogue ouvert et franc entre les instances dirigeantes du Cerema et de la fédération Cinov.
Source : contribution écrite de la fédération Cinov à la mission de contrôle
Dans le cadre de ces partenariats, le Cerema délivre notamment des formations à destination des bureaux d'études privés dans la perspective d'accompagner leur montée en compétences sur des domaines d'expertise de l'opérateur. D'après le Cerema, l'accompagnement technique et méthodologique qu'il délivre aux acteurs privés dans le cadre de ces actions de formation ou à travers des collaborations opérationnelles, notamment pour le déploiement de programmes nationaux, leur permet de « monter en compétences sur des sujets complexes tels que la transition écologique, la résilience des territoires ou encore la gestion durable des infrastructures »8(*).
Les interactions entre le Cerema et les bureaux d'études privés se caractérisent également par des échanges d'information et le partage de bonnes pratiques. En outre, le Cerema et les bureaux d'études privés collaborent à la production de guides techniques, de chartes ou de documents de référence. Ils répondent également parfois ensemble à des consultations en France comme à l'international, notamment auprès de guichets dédiés à la recherche et à l'innovation. Le Cerema souligne que « ces collaborations renforcent la mutualisation des expertises et permettent de promouvoir une ingénierie française innovante et de qualité »9(*).
Enfin, les allers-retours d'ingénieurs entre les sphères publiques et privées, mutuellement bénéfiques, sont monnaie courante et participent notamment à parfaire l'expérience et la compétence de la filière de l'ingénierie en France.
b) Le marché de l'ingénierie territoriale : un partage équilibré à respecter entre le Cerema et les bureaux d'études privés
La direction actuelle du Cerema a promu un repositionnement et un recentrage de l'activité de l'établissement sur l'expertise de pointe dite de « deuxième niveau » (voir infra) plutôt que sur de l'appui technique opérationnel relevant de l'ingénierie dite de « premier niveau ». Ce repositionnement stratégique doit notamment permettre au Cerema de ne pas concurrencer frontalement les bureaux d'études privés et d'occuper des espaces le plus souvent non couvert par ces acteurs. C'est à tout le moins une revendication affirmée du directeur général du Cerema qui rappelle régulièrement que son établissement n'a pas vocation à se positionner sur des activités qui peuvent être assurées de façon efficace par le secteur privé.
S'agissant du marché de l'ingénierie territoriale à destination des collectivités, le principal champ sur lequel sont susceptibles de se confronter les acteurs publics et privés, la stratégie poursuivie par le Cerema l'amène à intervenir dans la phase amont des projets. L'expertise fine de l'opérateur associée à son expérience tant locale que nationale doit alors lui permettre de conseiller la collectivité pour l'aider à concevoir son projet. Cette phase est parfois qualifiée de pré assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO). Il peut s'agir également d'aider une collectivité à définir la façon d'aborder une question nouvelle et complexe à l'image d'une stratégie territoriale d'adaptation au changement climatique.
Ce positionnement stratégique du Cerema apparaît comme complémentaire avec celui des acteurs privés du secteur. En effet, après l'intervention du Cerema en amont du processus, notamment pour affiner les méthodes, procédures et stratégies du maître d'ouvrage, permettant au projet d'atteindre un premier stade de maturité, des bureaux d'études privés sont mobilisés pour les phases plus opérationnelles de mise en oeuvre.
Dans une contribution écrite adressé au rapporteur spécial, si elle entend rester vigilante, la fédération Cinov salue le nouveau positionnement du Cerema : « nous soutenons les orientations récentes annoncées par la direction du Cerema sur une concentration de l'activité d'ingénierie dans les phases en amont des projets et sur le principe de ne pas entrer en concurrence avec le secteur privé. Néanmoins, nous espérons que ces orientations se concrétisent ».
Dans cette même contribution, Cinov a néanmoins signalé au rapporteur des situations s'apparentant selon elle à de la concurrence déloyale de certains acteurs de l'ingénierie publique au détriment des bureaux d'études privés. Cependant, il semble que les situations relevées par cette fédération professionnelle ne concernent le Cerema que dans des proportions très marginales. Les opérateurs d'ingénierie publique visés par la fédération sont principalement des sociétés d'économies mixtes locales (SEML), des sociétés publiques locales (SPL), des agences locales d'énergie (ALE) ou encore des agences techniques départementales (ATD).
La fédération Cinov ne cache pas cependant son inquiétude quant au nouveau statut de quasi-régie conjointe du Cerema qui lui permet de contracter avec les collectivités adhérentes sans mise en concurrence préalable (voir infra). Sur ce sujet, elle considère que « la coexistence entre une ingénierie publique bénéficiant d'un accès direct aux marchés et une ingénierie privée soumise aux appels d'offres crée un déséquilibre préoccupant »10(*).
c) Un effet d'entraînement de l'ingénierie publique sur le secteur privé
Les relations entre ingénieries publique et privée vont même au-delà d'une simple complémentarité, à certains égards, le marché de l'ingénierie privé dépend de l'existence d'une offre d'ingénierie publique. Cette réalité, qui a notamment été signalée aux rapporteurs par les fédérations représentatives des bureaux d'études privés, est particulièrement perceptible s'agissant des activités du Cerema.
Sans l'appui apporté par le Cerema aux collectivités dans la définition de certains de leurs projets, nombre d'entre eux ne verraient jamais le jour, ce qui constituerait une perte d'activité sèche pour le marché de l'ingénierie privé, très largement mobilisé dans leur mise en oeuvre opérationnelle. Dans sa contribution à la mission de contrôle, la fédération Cinov souligne l'importance de cet effet d'entraînement pour les bureaux privés généré par l'activité de l'opérateur : « le Cerema joue un rôle de tiers de confiance qui irrigue directement le marché privé de l'ingénierie. En fixant les référentiels techniques, en sécurisant les données de base et en cadrant les premières études, il réduit les incertitudes juridiques et méthodologiques qui freinent les investissements publics. Les bureaux d'études peuvent alors intervenir plus vite et sur des cahiers des charges clairement stabilisés ».
Au-delà même des prestations de conseil délivrées aux collectivités par l'établissement, la mise à disposition gratuite de guides méthodologiques d'aide à la décision permet également l'émergence de projets locaux qui alimentent le chiffre d'affaires du secteur : « le Cerema aide les collectivités à formaliser leurs besoins en matière de sobriété foncière, de mobilité ou de gestion des risques, puis ouvre ses bases de données et ses outils d'aide à la décision. Cette ingénierie publique gratuite ou mutualisée sécurise la phase programmative et crée un « pipeline » de projets solvables qui échoit ensuite naturellement aux bureaux d'études privés via les marchés publics »11(*).
Les fédérations représentatives des bureaux d'études privés ont également souligné auprès du rapporteur le rôle indispensable d'un opérateur comme le Cerema pour amorcer de grands programmes nationaux d'ingénierie qui stimulent ensuite largement l'activité du secteur.
À cet égard, l'organisation de la première phase du programme « ponts » est souvent présentée comme un modèle de complémentarité entre ingénieries publique et privée.
Dans un premier temps, le Cerema a commencé par définir le cadre général et la méthodologie du recensement et du diagnostic des ouvrages d'art. Dans un deuxième temps, des bureaux d'études privés sont intervenus sur place pour réaliser les diagnostics selon les règles fixées par l'opérateur qui a réalisé des contrôles pour s'assurer de la qualité des prestations réalisées. Dans un troisième temps, les diagnostics ont donné lieu à des marchés de travaux qui ont également alimenté le secteur privé.
Dans sa contribution à la mission de contrôle, la fédération Cinov a mis en exergue la relation complémentaire entre ingénieries publique et privée observée dans le cadre de ce programme : « après avoir élaboré la méthodologie de recensement des ouvrages et mobilisé les financements, le Cerema sous-traite les visites de terrain aux bureaux d'études, leur apportant ainsi un marché immédiatement opérationnel et normalisé. Les milliers de diagnostics produits servent ensuite de base aux contrats de maîtrise d'oeuvre, générant un effet de levier mesurable sur la commande privée ».
Lors de son audition, le président de la fédération Syntec-ingénierie a quant à lui affirmé au rapporteur que « sans le Cerema il n'y aurait pas eu de programme ponts ».
Les acteurs privés attendent un « effet de lancement » similaire de l'intervention du Cerema dans le cadre de la reconstruction de Mayotte suite au passage du cyclone Chido : « l'État a confié au Cerema la définition du schéma de reconstruction et la coordination des diagnostics post catastrophe. Les cabinets locaux et nationaux sont appelés dans un second temps pour la maîtrise d'oeuvre et l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, sur la base de normes et de priorités hiérarchisées par le Cerema ».
La fédération Cinov synthétise ainsi les relations de complémentarité entre le Cerema et l'activité des bureaux d'études privés : « en définitive, l'utilité du Cerema pour la filière privée se mesure autant par l'effet de volume (des marchés supplémentaires, massifiés et finançables) que par l'effet de qualité : référentiels homogènes, données de confiance, innovations éprouvées, autant d'éléments qui abaissent les coûts de transaction et stimulent la concurrence au bénéfice des territoires ».
B. UN POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DU CEREMA CONCENTRÉ SUR L'EXPERTISE DE HAUT NIVEAU
1. Quatre grandes missions recouvrant six domaines d'expertise
Établissement national de référence pour l'expertise technique relative à l'aménagement du territoire et aux infrastructures, le Cerema intervient dans les six domaines d'activités suivants :
- expertise et ingénierie territoriale ;
- bâtiment ;
- mobilités ;
- infrastructures de transport ;
- environnement et risques ;
- mer et littoral.
Sur le périmètre que recouvre ces six domaines d'expertise, le Cerema exerce quatre grandes missions :
- la production et la diffusion de référentiels techniques, de guides méthodologiques d'appui à la décision publique ou d'évaluation des politiques publiques ainsi que la contribution aux activités de mise à jour de la doctrine technique, de normalisation et de certification12(*) ;
- l'accompagnement des territoires face aux risques et aux défis climatiques à travers des prestations d'expertise technique, innovante et pluridisciplinaire destinées tant aux services déconcentrés de l'État qu'aux collectivités ;
- la capitalisation, la valorisation et la diffusion de connaissances13(*) tout particulièrement en matière d'aménagement du territoire, de mobilité et de transition écologique14(*) ;
- la conduite d'activités de recherches15(*) et d'innovation.
Le volume d'activité du Cerema reste encore aujourd'hui concentré sur ses domaines de compétences historiques, en particulier les infrastructures de transport et la mobilité pour plus de 50 %, même si des problématiques plus émergentes se développent de façon dynamique, à l'image de l'environnement et des risques.
Répartition de l'activité du Cerema entre ses domaines d'expertise en 2024
Source : commission des finances, d'après le projet stratégique 2025-2028 du Cerema
2. Une stratégie de recentrage sur l'expertise de « deuxième niveau »
Le Cerema poursuit depuis plusieurs années une clarification de son positionnement stratégique. Cette évolution a pris une dimension plus substantielle dans le cadre de la réforme structurelle qu'a conduit l'établissement à partir de 2019 et dans un contexte de réduction sensible de ses moyens humains et financiers. Plus largement, cette évolution stratégique s'inscrit également dans l'historique de la transformation de l'offre d'ingénierie territoriale publique depuis les lois de décentralisation.
La stratégie poursuivie par la direction du Cerema consiste à recentrer l'activité et les moyens de l'établissement sur des prestations d'expertise pointues, parfois qualifiées d'ingénierie de « deuxième niveau » plutôt que sur des interventions techniques plus opérationnelles qui relèvent de l'ingénierie de « premier niveau ».
La définition des ingénieries dites
de « premier niveau »
et de
« deuxième niveau »
L'ingénierie dite de « premier niveau » recouvre des interventions techniques ciblées, opérationnelles, relativement simples et rapides à mettre en oeuvre.
L'ingénierie de « deuxième niveau » recouvre quant à elle des prestations d'expertise plus stratégique, nécessitant de mobiliser des approches plus intégrées, souvent pluridisciplinaires et intervenant en amont de la conception de projets. Elle s'inscrit généralement dans le temps long et a notamment vocation à apporter un appui dans la conception de politiques publiques ou encore la prise de décision sur des enjeux substantiels d'aménagement du territoire ou de transition écologique.
Exemples de prestations d'ingénierie de « deuxième niveau » proposées par le Cerema :
- l'élaboration d'un schéma directeur de mobilité durable à l'échelle intercommunale ;
- une étude d'impact du recul du trait de côte sur les stratégies d'aménagement et de relocalisation ;
- une stratégie territoriale d'adaptation au changement climatique (climat, biodiversité, risques) ;
- un accompagnement à la mise en oeuvre d'un projet de territoire ou d'une stratégie bas carbone intégrée.
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses écrites du Cerema au questionnaire du rapporteur
Afin d'analyser cette évolution stratégique du positionnement du Cerema, il n'est pas inutile de se tourner vers le passé pour examiner l'historique de la transformation de l'offre d'ingénierie territoriale publique de proximité depuis la décentralisation.
Dans les années 1980, en matière d'ingénierie territoriale de « premier niveau », les collectivités pouvaient bénéficier de l'appui des services de l'État, plus particulièrement des directions départementales de l'équipement (DDE) et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt (DDAF) à travers le dispositif d'assistance technique à la gestion communale (ATGC). À partir de 2001, cet appui a été mis en oeuvre dans le cadre du nouveau mécanisme de l'assistance technique pour raisons de solidarité et d'aménagement du territoire (Atesat). Inscrit dans une tendance, amorcée après les lois de décentralisation, à la réduction progressive des moyens et des effectifs de l'État consacrés à l'appui en ingénierie des collectivités, les capacités de l'Atesat ont été petit à petit réduites avant que le dispositif ne soit entièrement supprimé en 2014. Le principe défendu à l'époque était que l'appui en ingénierie de « premier niveau » qui était auparavant fourni aux communes par l'Atesat le soit désormais par les départements à travers des agences techniques départementales. En parallèle, les collectivités qui en avaient les moyens ont étoffé leurs services techniques ou développé des outils diversifiés (sociétés publiques locales, sociétés d'économie mixtes, conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, agences d'urbanisme, etc) ayant vocation à intervenir dans le domaine de l'ingénierie de proximité.
Alors qu'environ 70 agences techniques départementales (ATD) ont été créées aujourd'hui, l'accompagnement technique en ingénierie de proximité des petites communes apparaît comme très hétérogène sur le territoire16(*). Dans le même temps, plusieurs milliers de chargés de mission recrutés par de petites collectivités sont aujourd'hui largement co-financés par des subventions de l'État. Tandis que le système actuel ne semble pas donner satisfaction, de nombreux acteurs locaux regrettent encore l'appui qui était fourni par l'Atesat aux petites communes qui n'ont pas les moyens d'entretenir de services techniques consistants.
Dans leur rapport précité de 2021, le CGEDD et l'IGA observaient notamment que « ce mouvement général aura laissé dans la difficulté de nombreux territoires (dont les territoires ruraux notamment) ne disposant pas de ressources suffisantes pour faire face à leurs besoins ou pour être simplement en mesure de répondre et de pouvoir bénéficier des appels à projets et à manifestation d'intérêt, de plus en plus complexes et nombreux, qui structurent désormais la politique d'appui de l'État au bénéfice des territoires ».
C'est avec ce contexte historique sensible et chargé en toile de fond que le Cerema, lui-même confronté à une diminution importante de ses moyens, a entrepris de recentrer ses missions sur la dimension pour laquelle sa plus-value est la plus significative, à savoir l'expertise technique, et sur son coeur de cible, les collectivités dotées d'une taille critique leur permettant de disposer d'un service technique suffisamment étoffé. En effet, le positionnement stratégique du Cerema comme référent de « deuxième niveau », suppose qu'il puisse intervenir auprès d'équipes d'ingénierie de « premier niveau » dotées d'une compétence et d'une technicité suffisante.
Le directeur général du Cerema a notamment décrit cette problématique lors de son audition du 18 mars 2025 devant la commission d'enquête du Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État : « l'activité du Cerema repose avant tout sur l'apport d'une expertise. Notre rôle n'est pas d'intervenir sur des aspects de proximité. Pour garantir un échange constructif avec nos experts, une ingénierie territoriale minimale s'avère indispensable. C'est notamment ce qui pose difficulté dans les très petites communes. Lorsqu'une municipalité ne dispose que d'un secrétaire général de mairie présent un jour par semaine, l'intervention d'un expert du Cerema ne produit pas d'effet tangible. C'est pourquoi nous avons privilégié une approche fondée sur les intercommunalités. À partir de 10 000 à 15 000 habitants, une intercommunalité dispose généralement d'un embryon de service technique, permettant une collaboration efficace avec nos équipes ».
En toute hypothèse, et alors que l'Atesat mobilisait environ 4 000 équivalents temps plein (ETP) avant sa suppression, le Cerema, dans sa configuration actuelle, n'aurait pas les moyens de se substituer à ce dispositif en proposant systématiquement un service d'ingénierie de proximité pour le compte des petites communes qui n'en sont pas dotées et qui ne peuvent bénéficier de l'appui d'une ATD ou de leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Aussi réel soit-il, le Cerema n'est aujourd'hui clairement pas calibré pour répondre à ce besoin.
Les positionnements respectifs et l'articulation
des interventions du Cerema
et des agences techniques départementales
(ATD)
Le Cerema entretient des relations à la fois au niveau national et local avec les agences techniques départementales (ATD). Au niveau national, le Cerema est en contact avec l'association nationale des directrices et directeurs d'agences techniques départementales (ANDATD) avec laquelle le Cerema organise des webinaires d'informations sur des sujets techniques ou des programmes d'accompagnement. À l'échelle locale, des prises de contact ont été engagées afin de favoriser l'interconnaissance entre équipes et de mieux coordonner les interventions sur le terrain. Cette coordination permet de chaîner les actions : dans certains cas, le Cerema oriente certaines sollicitations vers les ATD lorsque leur intervention est plus adaptée, renforçant ainsi l'efficacité de la réponse technique apportée aux collectivités.
Par ailleurs, à la fin de l'année 2024, un groupe de travail associant des agents du Cerema et des ATD a été mis en place pour renforcer les coopérations entre les deux structures. Le Cerema et les ATD ont engagé une analyse conjointe de leurs activités. Cette démarche a permis d'identifier de manière plus précise leurs complémentarités. Il en ressort un constat partagé : une très forte synergie existe entre les deux structures, ouvrant la voie à un partenariat renforcé au bénéfice des territoires.
Les champs d'interventions thématiques techniques se recoupent largement de manière globale, même si localement la situation est plus nuancée en fonction des compétences et des services que l'ATD a choisi de développer.
Toutefois le positionnement de ces interventions est largement distinct. Le Cerema intervient dans des phases souvent amonts et stratégiques (par exemple pour conduire une démarche globale de résilience sur une commune). Les ATD vont apporter une aide très opérationnelle comme la maîtrise d'oeuvre, soit un mode d'intervention que le Cerema ne conduit pas et pour lequel son projet stratégique ne prévoit aucune orientation pour aller dans ce domaine. Dans certains champs d'activité l'ATD peut proposer des services complémentaires comme un appui administratif et juridique.
En matière de bénéficiaires, les ATD travaillent pour de petites collectivités et majoritairement de petites communes et communautés de communes. Le Cerema intervient pour un panel plus varié de collectivités, allant des régions aux départements, aux métropoles et grandes villes, aux intercommunalités. Le Cerema intervient pour de petites communes dans certaines situations mais de manière en fait très marginale. Ceci s'explique à la fois par son travail de développement méthodologique qui est généralement réalisé avec des partenaires d'une taille suffisante.
Source : réponses écrites du Cerema au questionnaire du rapporteur
Cependant, compte-tenu des « trous dans la raquette » actuels de l'offre d'ingénierie de « premier niveau » sur le territoire, plusieurs acteurs ont alerté le rapporteur sur les risques que certaines petites communes rurales n'aient plus accès à une ingénierie de base. À cet égard, a minima pendant une phase de transition, en dérogation de son repositionnement stratégique, il semble nécessaire que le Cerema continue de délivrer un appui de proximité à des communes rurales dépourvues de solutions d'ingénierie dans une période critique marquée par l'accélération des problématiques relatives à l'adaptation au changement climatique. Cependant, pour les raisons décrites supra, cette solution ne pourra être que temporaire, le Cerema ayant par la suite vocation à être remplacé par d'autres acteurs.
Dans leur rapport précité de 2021, le CGEDD et l'IGA soulignaient à ce titre que l'échelon des groupements de communes, à condition qu'ils atteignent une taille critique suffisante, estimée à au moins 50 000 habitants, devrait constituer la strate de référence pour mutualiser des services techniques d'ingénierie de proximité susceptibles de répondre aux besoins des petites communes rurales : « les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) devraient être l'échelon le plus pertinent pour mettre en place un socle d'ingénierie mutualisée. Les 1 254 EPCI n'ont pas tous la taille critique, en-deçà de 50 000 habitants (975 EPCI), pour disposer de cette ingénierie de premier niveau qui satisferait en particulier aux besoins des espaces ruraux. Il convient donc pour les pouvoirs publics d'encourager la consolidation de l'ingénierie territoriale ».
Les auteurs de ce même rapport précisaient que cette nécessaire consolidation progressive de l'ingénierie territoriale de proximité devrait permettre au Cerema de s'installer pleinement dans le rôle d'expert de « deuxième niveau » auquel il aspire et qui correspond désormais à ses compétences ainsi qu'aux moyens dont il dispose : « il conviendrait en premier lieu de favoriser la consolidation de l'ingénierie territoriale, afin de permettre à l'établissement public de se positionner clairement comme référent technique des ingénieries locales de premier niveau ».
Par ailleurs, alors que la lisibilité de l'offre d'ingénierie territoriale fait défaut aujourd'hui, l'un des moyens d'optimiser les capacités existantes serait de constituer une véritable cartographie des outils d'ingénierie de « premier niveau » disponibles au sein des départements, des EPCI ou d'autres structures locales.
II. LE CEREMA A CONDUIT À SON TERME UNE RESTRUCTURATION AMBITIEUSE
A. UN MODÈLE DE FUSION RÉUSSI
Créé en 2014, le Cerema est né d'une fusion de onze entités constituées d'anciens services de l'État :
- les huit centres d'études techniques de l'équipement (CETE) et leurs laboratoires ;
- trois services techniques centraux : le centre d'étude sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU), le centre d'études techniques, maritimes et fluviales (CETMEF) et le service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements (SETRA).
Le Cerema comptait alors 3 250 agents. Sa création visait à rassembler et à coordonner le réseau scientifique et technique de l'État permettant un pilotage unifié, la conduite d'une stratégie d'ensemble cohérente et la réalisation de synergies entre ses composantes. Alors qu'il était auparavant quasi exclusivement orienté vers le conseil et l'expertise pour le compte des services de l'État, la création du Cerema avait aussi pour vocation de faire bénéficier les collectivités de ce réseau.
À l'époque, ce nouvel établissement public est défini comme un centre de ressources et d'expertises scientifiques et techniques interdisciplinaires apportant son concours à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques publiques dans les champs des ministères chargés du développement durable, de l'urbanisme, des transports et, pour ce qui concerne les enjeux de sécurité routière, de l'intérieur.
Ayant fait l'objet d'un protocole d'accord signé avec les organisations syndicales, cette fusion a été bien vécue par les personnels. Sa mise en oeuvre peut être considérée comme une réussite. Le rapporteur a notamment pu le mesurer lors de ses échanges avec les différentes organisations syndicales représentatives de personnel du Cerema, l'une d'entre elles évoquant notamment le regroupement de onze « services frères » qui exerçaient des métiers très proches et qui, avant la fusion, pouvaient être amenés à se faire concurrence les uns les autres.
B. « CEREM'AVENIR » : UNE RÉFORME STRUCTURELLE SALUÉE
Pour atteindre l'objectif, que lui avait fixé le Gouvernement de l'époque, de parvenir à réduire de 20 % ses effectifs et sa subvention pour charges de service public (SCSP) tout en rendant plus lisible son offre de services et en la tournant davantage vers les collectivités, le Cerema a été amené à mettre en oeuvre une restructuration profonde de son organisation.
Celle-ci a été initiée en 2018 par des travaux préparatoires visant à dresser un état des lieux et à définir les grandes orientations de la réforme envisagée. Les principes généraux de cette réforme ont été présentés au conseil d'administration du 17 avril 2019 avant d'être formalisés dans un projet d'établissement approuvé en juillet 2020. Le 1er janvier 2021, le programme de réforme, baptisé « Cerem'Avenir » est entré dans sa phase de mise en oeuvre concrète.
Cette réforme a notamment consisté en des réorganisations des directions techniques et territoriales de l'établissement, un regroupement de ses laboratoires sur six sites ainsi que des polarisations géographiques de certaines activités (voir infra). Cette réforme comportait surtout un volet d'optimisation de l'organisation des fonctions support particulièrement substantiel à travers notamment la mutualisation des fonctions financières et comptables, le regroupement des fonctions informatiques ainsi que celui des fonctions communication, édition et diffusion des connaissances.
Les grands principes organisationnels de la restructuration du Cerema
- Réorganisation des directions techniques autour des fonctions de pilotage des secteurs d'activité et de portage de l'expertise technique ;
- Réorganisation des directions territoriales, de leurs départements métier et équipes de production, ainsi que de leurs équipes de support, avec un resserrement de la ligne hiérarchique et une meilleure identification des fonctions commerciales, management de projet et encadrement d'équipes ressources ;
- Création d'agences dans certaines directions territoriales, chargées d'une double fonction de représentation auprès des acteurs et responsables territoriaux et de portage de l'action commerciale (prospection, vente, suivi...) ;
- Regroupement des activités d'essais « chaussées » de laboratoire, auparavant exercées dans les 17 sites des anciens laboratoires régionaux de ponts et chaussées, dans 6 entités interrégionales ;
- Polarisations et spécialisations d'activités au sein des différentes directions techniques et territoriales ;
- Regroupement des activités de prototypes au sein d'un unique département d'études et de conception des prototypes ;
- Mutualisation des fonctions financières et comptables au sein de 3 centres financiers mutualisés et de 2 services facturiers ;
- Regroupement des fonctions informatiques au sein d'une nouvelle direction des systèmes d'information ;
- Regroupement des fonctions communication, édition et diffusion des connaissances au sein d'une nouvelle direction de la stratégie et de la communication ;
- Mutualisation des fonctions supports de certaines directions au sein de directions déléguées aux ressources, à Lyon et en Ile-de-France ;
- Réorganisation de la fonction recherche par la création de groupes de recherche dédiés constituant les équipes de recherche du Cerema, dans l'objectif de confirmer la place de l'activité recherche dans l'établissement et de poursuivre son développement en synergie avec les secteurs d'activité par l'insertion des équipes de recherche du Cerema dans le monde académique et par une valorisation de la formation par la recherche au sein de l'établissement ;
- Réorganisation des fonctions commerciale et formation donnée ;
- Création d'une délégation Occitanie et préfiguration d'une délégation Outre-Mer, dans l'objectif d'une mise en place à l'horizon 2022.
Source : réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Au-delà de l'ampleur de cette restructuration organisationnelle, le Cerema s'est interrogé sur le périmètre de ses missions, réalisant un véritable exercice de réforme structurelle que l'État, au fil de nombreuses tentatives avortées, a tant de mal à appliquer à son propre domaine d'intervention. Pour conduire cette réforme structurelle, le Cerema a passé l'ensemble de ses missions au crible de deux critères :
- premièrement, mérite-t-elle d'être prise en charge par la puissance publique ou le secteur privé est-il en mesure de la mettre en oeuvre de façon suffisamment efficace ?
- deuxièmement, si l'intervention publique se justifie, le Cerema est-il l'entité publique de référence la plus à même de l'assurer ?
Au terme de cet exercice, le Cerema a réduit le nombre de ses secteurs d'interventions de 66 à 21, renonçant à intervenir dans plusieurs domaines tels que par exemple les risques industriels, le contrôle des règles de construction, les systèmes d'information du logement ou encore la biodiversité marine.
En matière de ressources humaines, le programme de restructuration du Cerema s'est traduit par la suppression de 350 postes et la transformation substantielle de 800 autres. Pour mener à bien cette réforme dans sa dimension ressources humaines, le Cerema a appliqué un dispositif d'accompagnement social pour lequel il a largement recouru aux différents outils prévus par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique cofinancés par le fonds d'accompagnement interministériel ressources humaines (FAIRH).
D'après l'évaluation réalisée par la direction du Cerema, ce programme de restructuration, notamment en raison de la mutualisation des fonctions supports et de la hausse de la part relative des effectifs productifs, aura permis à l'établissement d'accroître sa capacité de production de l'ordre de 10 %.
Évolution des effectifs des fonctions support du Cerema (2019-2024)
(en ETP)
Source : réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
L'ampleur de la réforme structurelle mise en oeuvre par le Cerema est reconnue et saluée par ses tutelles. Pour sa tutelle métier, le commissariat général au développement durable (CGDD), cette réforme constitue « une réussite en termes de transformation interne et de stratégie »17(*). La direction du budget, sa tutelle budgétaire, reconnaît également les efforts réalisés par l'établissement considérant que « la réforme a apporté des gains d'efficience », notamment par les mesures « d'optimisation des ressources humaines et financières ».
C. UN RÉSEAU D'IMPLANTATIONS TERRITORIALES RÉFORMÉ ET ENTIÈREMENT DÉCONCENTRÉ
Établissement public entièrement déconcentré dont le siège est établi à Lyon, le Cerema compte 27 implantations en métropole et en outre-mer.
L'organisation des implantations territoriales du Cerema se structure principalement autour de trois directions techniques spécialisées dont les compétences s'étendent à l'ensemble du territoire national et de dix directions territoriales généralistes qui exercent leurs activités au sein d'une zone géographique délimitée mais qui comprennent également parfois des pôles spécialisés qui disposent d'un champ d'action géographique plus étendu.
Les implantations du Cerema
Source : projet stratégique 2025-2028 du Cerema
En 2023, pour élargir ses activités dans ces territoires, le Cerema a créé une direction territoriale outre-mer composée de trois agences : une agence « Océan indien » constituées de deux implantations, à La Réunion et à Mayotte, une agence « Guyane », et une agence Antilles, créée en février 2024, implantée en Guadeloupe dont l'activité couvre à la fois la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint Barthélémy.
Les directions techniques pilotent, structurent et garantissent au niveau national les compétences et l'expertise de l'établissement dans leurs domaines d'actions. Elles élaborent les offres de référence du Cerema ainsi que des référentiels méthodologiques et techniques dans ces domaines.
Comme le soulignait le rapport précité du CGEDD et de l'IGA en 2021, les directions territoriales sont quant à elles dotées d'un triple rôle « commercial, de direction de projets et d'encadrement des équipes de production ». Ces directions ont une vocation généraliste en ce sens qu'elles ont vocation à maintenir des capacités de production de base territorialisées pour répondre aux demandes locales des collectivités ou des services déconcentrés de l'État ainsi que pour déployer localement des programmes nationaux sans avoir à faire appel aux compétences d'autres directions territoriales. Pour le Cerema, elles constituent en quelque sorte « des portes d'entrée » pour accéder aux principales offres et compétences de l'établissement.
Comme évoqué supra, cette organisation n'est pas aussi rigide qu'il n'y paraît et, pour des domaines de production spécifiques, certaines directions territoriales comportent des « pôles d'expertise », « centres de référence » ou « équipes spécialisées » qui ont un périmètre d'action plus large que celui de la direction et qui peut aller jusqu'à l'échelle nationale. En outre, pour maintenir des équipes d'experts de taille critique, certaines activités de base ayant vocation à être assurées par les directions territoriales peuvent être gérées en binôme par deux directions territoriales voisines.
La souplesse d'organisation des directions territoriales du Cerema
Le choix des activités polarisées ou non est assez fin et ne s'applique pas a` l'ensemble d'un grand domaine. Par exemple, dans le domaine de l'ingénierie du territoire (A) le secteur de l'expertise territoriale intégrée (A1) fait partie des activités socles, présentes dans chaque direction territoriale, et n'est pas polarise'. En revanche, la connaissance et la mobilisation du foncier (A2) est polarisée sur la direction territoriale Hauts-de-France et fait l'objet d'un copilotage par un expert de la direction territoriale et un expert de la direction technique territoires et villes.
Un appui des directions techniques aux directions territoriales et une collaboration étroite entre pôles techniques et directions territoriales sont en effet nécessaires pour faire fonctionner cette organisation, l'objectif étant de rendre disponible une ingénierie de référence sur tout le territoire, qui soit a` la fois capable de proposer des réponses aux problèmes récurrents des territoires et de décliner localement des offres « cousues main ».
Néanmoins, sur certaines des activités socles, les directions territoriales sont également constituées en binômes, de façon a` maintenir une masse critique opérationnelle minimale. Dans le domaine des mobilités (C), pour la connaissance, la modélisation et l'évaluation des mobilités (C2) mais aussi pour les systèmes de transports intelligents, les trafics et la régulation (C3), les directions territoriales Hauts-de-France/Est, Normandie-Centre/Ouest, Méditerranée/Sud-Ouest, Centre-Est/Ile de France sont ainsi les binômes compétents.
Des équipes de production « spécialisées » ou « en pointe » sur certaines activités ont également été définies. Par exemple, toujours dans le domaine des mobilités, il existe un socle, un pôle et des équipes spécialisées. Le socle est constitué' par l'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour les enquêtes de déplacements, les simulations dynamiques ou les évaluations socio-économiques sommaires, le pôle concerne les évaluations complexes (direction territoriale Ouest et direction territoriale Méditerranée) et des équipes spécialisées existent lorsqu'il s'agit de mobilité routière (Sud-Ouest et Méditerranée) ou d'applications satellitaires pour la mobilité (Sud-Ouest).
Source : le rôle du Cerema en matière d'appui aux collectivités territoriales, rapport du CGEDD et de l'IGA, juin 2021
L'organisation territoriale de l'établissement a été substantiellement révisée par la réforme Cerem'Avenir. L'incidence la plus visible de cette réforme a été le regroupement des anciens laboratoires d'essais, qui étaient au nombre de 17, sur seulement 6 sites, désormais qualifiés d'agences. La réforme s'est également traduite par des mouvements de polarisation et de spécialisation d'activités de production ainsi que par des mutualisations de services, en particulier s'agissant des fonctions support.
Son réseau d'implantations territoriales représente indéniablement un atout indispensable et une force pour le Cerema. Il lui permet d'être aux prises et en phase avec les attentes des territoires et de pouvoir répondre efficacement à leurs besoins. D'après les études du Cerema présentées par son directeur général au rapporteur, la proximité géographique des implantations joue un rôle déterminant dans l'accès des territoires à l'expertise de l'établissement. Plus un territoire est éloigné géographiquement d'une implantation du Cerema, moins il a accès aux services de l'opérateur. C'est notamment pour cette raison que la direction de l'établissement envisage de créer une antenne de la direction territoriale Sud-Ouest à Brive.
Les atouts du réseau d'implantations du Cerema
Du fait de ses 27 implantations locales sur l'ensemble du territoire, le Cerema est un acteur clé pour le déploiement de la méthode de territorialisation, essentielle pour adapter les objectifs nationaux aux réalités locales.
Cette approche permet de confronter les visions nationales avec les perspectives locales afin de convenir d'objectifs partagés et adaptés aux spécificités de chaque territoire.
Le Cerema joue ainsi un rôle essentiel pour la cohésion de tous les territoires en mobilisant ses compétences en matière d'expertise technique et d'innovation pour soutenir les collectivités territoriales et les acteurs locaux dans la mise en oeuvre des objectifs de la planification écologique et de la cohésion territoriale.
Il facilite en outre la cohérence et la coordination des efforts entre l'État et les différents niveaux de collectivités par la production de connaissances et la mise à disposition d'outils d'information adaptés.
Source : réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Pour autant, l'actuel réseau des implantations territoriales du Cerema est issu d'un compromis entre la réduction des moyens alloués à l'opérateur et l'enjeu de répondre à de nouveaux besoins sur les territoires, notamment pour le compte des collectivités. Aussi, ce réseau aura-t-il encore probablement à évoluer. Cette considération avait notamment été soulevé par les auteurs du rapport précité du CGEDD et de l'IGA : « la cartographie actuelle résulte d'une adaptation a` la baisse des effectifs et d'un compromis entre, d'une part, le souci de ne pas fermer les implantations historiques du Cerema et, d'autre part, celui de garantir une présence correspondant aux besoins nouveaux des territoires. Il n'est donc pas certain qu'elle soit encore pleinement adaptée et il est probable qu'elle devra encore évoluer ».
À ce titre, à la demande notamment du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, le Cerema expérimente aujourd'hui18(*) le positionnement d'un expert référent de l'établissement dans chaque département.
Sur ce sujet, le rapporteur appelle néanmoins le Gouvernement à être cohérent dans les objectifs qu'il fixe au Cerema et à ne pas lui donner d'injonctions contradictoires entre, d'un côté, une contraction sévère de ses moyens humains et financiers et, de l'autre, une demande de densification de sa présence sur les territoires.
DEUXIÈME
PARTIE
BASCULEMENT VERS LES COLLECTIVITÉS :
LE CEREMA EN
QUÊTE D'UN NOUVEL ÉQUILIBRE
I. HISTORIQUEMENT ESSENTIELLEMENT TOURNÉ VERS LES SERVICES DE L'ÉTAT, LE CÉRÉMA S'ORIENTE DE PLUS EN PLUS VERS LES COLLECTIVITÉS
A. PRÉVUE DÈS LA CRÉATION DU CEREMA, CETTE ÉVOLUTION S'EST ACCÉLÉRÉE DEPUIS 2018
De par les missions qui étaient, à l'origine, réalisées par les organismes fusionnés lors de la création du Cerema, avec pour prédominance les domaines des infrastructures de transport, les interventions de l'établissement étaient essentiellement orientées vers les services de l'État. Ainsi, comme le notait le CGEDD et l'IGA dans leur rapport de 2021 précité, « jusqu'en 2018, l'activité du Cerema était quasi exclusivement orientée au profit de l'État puisque 90 % de ses prestations répondaient aux commandes des administrations de deux ministères », à savoir les ministères chargés de la transition écologique et de la cohésion territoriale.
Cependant, l'objectif du développement progressif des activités du Cerema pour le compte des collectivités lui est consubstantiel dans la mesure où, comme précisé supra, cet objectif constituait l'une des justifications à l'origine de la création de l'établissement. Si peu d'évolutions ont permis d'avancer vers cet objectif au cours des premières années d'existence du Cerema, une impulsion notable a été engagée à partir de 2018, dans un contexte plus général de réformes et de redéfinition des orientations stratégiques de l'établissement. Cette nouvelle dynamique a notamment été permise par une révision profonde des modalités de programmation des activités de l'établissement pour le compte des directions d'administrations centrales qui s'est matérialisée par la fin des droits de tirage de ces dernières sur la subvention pour charges de service public du Cerema (voir infra).
Depuis, y compris pour des raisons budgétaires, afin de développer les ressources propres de l'établissement dans la perspective de compenser la diminution de la subvention annuelle que lui verse le budget de l'État, cet accroissement du volume d'activité du Cerema vers les collectivités a été très encouragé par ses tutelles. À ce titre, cet objectif occupait également une place centrale dans la réforme structurelle conduite par l'établissement dans le cadre du programme Cerem'Avenir.
Cependant, au-delà des aspects purement budgétaires, ce tournant du Cerema vers les collectivités est une évolution cohérente dans un contexte où, tendanciellement, les collectivités sont amenées à jouer un rôle toujours plus majeur dans des politiques d'aménagement du territoire rendues elles-mêmes plus complexes par les enjeux d'adaptation au changement climatique. Pour relever ces nouveaux défis, les collectivités ont de plus en plus besoin d'un accompagnement et d'une expertise de haut niveau, qu'aujourd'hui seule une capacité d'ingénierie publique de taille critique et mutualisée semble pouvoir leur fournir de manière efficiente.
L'inflexion de l'activité du Cerema vers les collectivités a été formalisée en 2021 dans les documents stratégiques de l'établissement, à savoir son projet stratégique 2021-2023 et son contrat d'objectifs et de performance 2021-2024.
Cette bascule progressive peut notamment se mesurer par l'évolution des ressources propres issues de la commercialisation par l'établissement de prestations pour le compte des collectivités. Ainsi, les ressources propres issues des collectivités ont plus que doublé en six ans, passant de 9 millions d'euros en 2018 à plus de 21 millions d'euros en 2024.
Évolution des ressources propres annuelles
perçues par le Cerema
sur le segment des collectivités
(2018-2024)
(en millions d'euros)
Source : Commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Historiquement, parmi les collectivités, les départements, de par leurs compétences en matière routière, sont les principaux clients du Cerema. Cependant, si les sommes versées par ces derniers pour rémunérer des prestations réalisées par l'établissement ont progressé régulièrement ces dernières années, pour atteindre 8,6 millions d'euros en 2024, leur part relative dans le total des ressources propres du Cerema provenant des collectivités, si elle demeure prépondérante, est plutôt orientée à la baisse au bénéfice notamment des groupements de communes.
Évolution par type de collectivité
des ressources propres annuelles perçues
par le Cerema
(2020-2024)
(en millions d'euros)
Source : Commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Cette évolution est corrélée à celle de la décomposition par domaines d'intervention de la valeur des prestations délivrées par le Cerema aux collectivités, une évolution qui traduit la contraction de la part relative du secteur historique des infrastructures de transport au bénéfice de domaines plus émergents tels que la mobilité et la gestion des risques naturels (voir infra).
En cohérence avec le positionnement stratégique du Cerema sur l'expertise de haut niveau dans un rôle d'appui aux services d'ingénierie de « premier niveau » des collectivités qui ont les moyens d'en être dotées, les cibles les plus naturelles de l'opérateur sont dorénavant les régions, les départements, les métropoles et autres groupements de communes de plus de 50 000 habitants.
La bascule du Cerema vers les collectivités s'observe aussi dans l'évolution du nombre de collectivités qui contractualisent chaque année avec l'établissement. Ainsi, en 2024, 515 collectivités ont contractualisé avec le Cerema, dont la quasi-totalité des régions et des départements, contre 347 en 2018. En 2024, le Cerema a ainsi produit 2 314 prestations à la demande directe des collectivités.
Évolution du nombre annuel de
collectivités
ayant contractualisé avec le Cerema
(2018-2024)
Source : Commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Le secteur des infrastructures de transport demeure le principal domaine d'intervention de l'établissement auprès des collectivités, en premier lieu au bénéfice des départements. Il représente ainsi 40 % des ressources propres que le Cerema perçoit de la part des collectivités. Cependant, si le montant des prestations consacrées à ce secteur continue de progresser (+ 2 millions d'euros par an entre 2020 et 2024), sa part relative diminue quant à elle puisqu'elle atteignait encore 57 % en 2020.
En revanche, comme l'illustre le graphique ci-après, les domaines de l'aménagement et de l'ingénierie territoriale, des mobilités ou de l'environnement et des risques ont vu à la fois leur valeur et leur part relative s'accroître de manière substantielle ces dernières années. Le dynamisme de ces domaines d'intervention dans les ressources propres du Cerema témoigne du fait que, dans un contexte marqué par les enjeux de transition écologique, les collectivités ont des besoins d'expertise de plus en plus prégnants dans ces secteurs.
Évolution par domaine d'intervention des
ressources propres annuelles
perçues par le Cerema auprès des
collectivités (2020-2024)
(en millions d'euros)
Source : Commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Concernant le domaine des mobilités, le Cerema observe ainsi « une demande croissante pour l'accompagnement des nouvelles mobilités, notamment le développement des cheminements piétons, des pistes cyclables et des lignes de covoiturage ». S'agissant du secteur de l'environnement et des risques, il constate « une augmentation des sollicitations sur la gestion de l'eau et la prévention des inondations »19(*).
Il est également à noter qu'outre les prestations délivrées par le Cerema à la demande directe des collectivités et à leurs frais, l'établissement fournit aussi des prestations de conseil et d'accompagnement dans le cadre de programmes nationaux initiés par l'État pour le compte des collectivités. À ce titre, le Cerema pilote la mise en oeuvre du programme « ponts » mais il participe également à d'autres programmes nationaux tels que par exemple le plan national de résorption des décharges littorales.
Le Cerema contribue aussi à la mise en oeuvre de plusieurs programmes portés par l'agence nationale de cohésion des territoires (ANCT) tels que par exemple les programmes petites villes de demain, action coeur de ville ou encore territoires d'industrie. Dans le cadre d'une convention signée avec l'ANCT, le Cerema contribue chaque année, sur son propre budget, au financement de ces programmes ainsi qu'à des sollicitations ponctuelles de l'agence, à travers la fourniture aux collectivités de prestations. Le Cerema finance pour moitié le coût de ces prestations. L'autre moitié lui est remboursé par l'ANCT.
Coût annuel pour le Cerema des prestations
qu'il délivre aux collectivités
sur demande de
l'ANCT20(*)
(en euros)
Source : réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Par ailleurs, le Cerema assure une animation technique territoriale pour une sensibilisation, une acculturation et un accompagnement des acteurs locaux sur ses domaines d'intervention. Par cette animation technique le Cerema s'emploie à « affirmer sa présence sur les territoires et à diffuser connaissances et méthodes aux techniciens des services déconcentrés et des collectivités mais également de plus en plus aux élus »21(*).
Enfin, d'autres activités du Cerema, notamment en matière de capitalisation et de diffusion de connaissances, de publications de référentiels et autres guides pratiques, si elles ne sont pas directement adressées aux collectivités, peuvent également leur être utiles en particulier si elles portent sur des compétences qu'elles assument.
B. LA FIN DES DROITS DE TIRAGE DES MINISTÈRES SUR LA SUBVENTION DU CEREMA, UN TOURNANT STRATÉGIQUE
En 2019, une étape décisive a contribué à donner au Cerema la latitude nécessaire pour concrétiser le virage vers les collectivités annoncé dès sa création en 2014. Cette étape a consisté en une réforme structurelle des procédures de programmation des activités du Cerema qui a conduit à supprimer le mécanisme des droits de tirage sur la subvention pour charges de service public (SCSP) de l'établissement dont bénéficiait jusqu'alors les principales directions centrales ministérielles destinataires de ses services.
En effet, jusqu'en 2018, ces dernières disposaient chacune d'une « enveloppe de droits de tirage », exprimée en pourcentage, sur la SCSP du Cerema, ce qui, en pratique, conduisait à leur permettre de mobiliser de façon « discrétionnaire », dans la limite de leur « enveloppe », les personnels de l'établissement pour répondre à leurs besoins. Aussi, la direction du Cerema disposait-elle d'une marge de manoeuvre très contrainte sur la construction de sa programmation d'activités annuelle, dans les faits très dépendante des décisions prises par les directions centrales.
Cette réforme a été actée par une circulaire de la secrétaire générale du ministère de la transition écologique et solidaire du 26 octobre 2018 ainsi que par une délibération du conseil d'administration du Cerema datée du 3 juillet 2019.
Depuis cette réforme, la direction du Cerema dispose d'une marge de manoeuvre beaucoup plus grande dans la définition de sa programmation d'activité et, par-là même, de ses orientations stratégiques. Objet de fortes réticences de la part des directions d'administrations centrales concernées22(*), cette réforme avait alors été présentée par la direction de l'établissement comme une condition préalable indispensable au déploiement du programme de restructuration qui devait conduire à réduire de 20 % les moyens financiers et humains du Cerema.
En 2021, dans leur rapport précité, le CGEDD et l'IGA soulignaient l'importance symbolique de cette réforme sur l'équilibre des relations entre le Cerema et les directions centrales dans le cadre de l'exercice de programmation des activités de l'établissement : « le nouveau processus de programmation a supprimé la notion d'enveloppe et fait évoluer, en parallèle, la relation de « commanditaire » a` fournisseur vers celle de « bénéficiaire », en liaison avec les politiques publiques portées par les directions d'administration centrales ».
Depuis la fin du système des droits de tirage, dans la perspective de mieux encadrer la programmation des activités du Cerema au bénéfice des administrations centrales et pour lui donner davantage de lisibilité, l'établissement conclut avec ces directions des protocoles-cadres pluriannuels. Négociés entre la direction concernée et le Cerema, ils ont entre autres pour vocation de distinguer ce qui relève des missions socles, afin d'être prises en charge financièrement en intégralité par le budget du Cerema, d'autres activités dites « partenariales » qui devront être financées ou cofinancées par les directions elles-mêmes. Ces protocoles sont déclinés en conventions annuelles qui détaillent les projets portés par le Cerema à la demande des directions centrales23(*) ainsi que leur financement. Ce système de contractualisation fait l'objet de dispositifs de pilotage et de suivi entre l'établissement et les directions centrales concernées.
C. UNE NÉCESSAIRE COORDINATION DES EXPRESSIONS DE BESOIN DES MINISTÈRES ET UN BESOIN DE SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DU CEREMA
1. Un besoin impératif de coordonner les commandes étatiques
La réforme des modalités de programmation des activités que le Cerema délivre à la demande des directions d'administrations centrales a donné à l'établissement les moyens de définir ses orientations stratégiques et d'opérer le virage vers les collectivités qui était attendu de lui depuis sa création. Cependant elle n'a pas résolu le problème de l'absence de coordination des expressions de besoins exprimées au Cerema par les différents services de l'État.
Problématique en termes de cohérence, de lisibilité et d'efficience de l'action publique de l'État, cette situation pose également des difficultés à l'établissement : « actuellement, les interventions du Cerema résultent d'une multitude de sollicitations émanant des différentes directions d'administration centrale et des services déconcentrés, ce qui peut entraîner un manque de lisibilité et d'efficacité dans la programmation des activités »24(*).
En 2021, dans leur rapport, le CGEDD et l'IGA avaient également mis en exergue le défaut de coordination des commandes passées par les services de l'État au Cerema, ajoutant que leur articulation avec l'action des collectivités locales devait également être améliorée : « les commandes de l'État apparaissent aujourd'hui cumuler deux défauts. Il n'existe pas de coordination de ces demandes, qui permettrait pourtant de les mettre en adéquation avec des orientations prioritaires du Gouvernement, d'une part, et, d'autre part, elles prennent en compte de façon insuffisante le fait que la plupart des politiques mises en oeuvre par le ministère de la transition écologique nécessitent un travail conjoint entre l'État et les collectivités locales. La tutelle doit désormais remédier à ces insuffisances ».
Auditionnés par le rapporteur, les services de la direction du budget considèrent également que l'absence de coordination des commandes étatiques formulées au Cerema constitue un défaut substantiel du système actuel, y compris en termes de visibilité pour l'établissement, qu'il conviendrait de corriger : « les services de l'État passent commande de manière décentralisée, avec une hétérogénéité des besoins et des modalités contractuelles. Cette dispersion peut compliquer la lisibilité des engagements financiers pour le Cerema. Les commandes sont souvent annuelles et dépendent des arbitrages budgétaires des ministères, ce qui empêche le Cerema d'anticiper ses ressources et de planifier ses effectifs de manière optimale. Les commandes peuvent parfois se recouper ou être redondantes, faute d'une approche centralisée et stratégique des besoins en ingénierie publique »25(*).
En réponse au questionnaire du rapporteur, le commissariat général au développement durable (CGDD), tutelle métier du Cerema, reconnaît que son rôle de coordination des commandes étatiques est à ce jour limité, tout ou presque étant décidé dans une relation bilatérale entre les administrations et la direction du Cerema : « la programmation des activités de l'établissement est établie en lien étroit avec les directions générales métier sur les domaines qui les concernent. La tutelle CGDD a un rôle de coordination, mais les orientations métier sont établies par les directions générales dans les protocoles pluriannuelles, les conventions annuelles ou les contrats des grands programmes confiés à l'établissement ».
Aujourd'hui, les administrations établissent chacune de leur côté leurs demandes à l'égard du Cerema, transmettent de façon isolées leurs expressions de besoin puis négocient seules avec l'établissement la programmation qui relève de leurs domaines de compétences. Ce fonctionnement en silo, sans coordination ni supervision, n'est ni satisfaisant, ni pas optimal. Il ne permet pas de garantir la lisibilité et la cohérence de l'action publique au sein même de la sphère étatique. Le rapporteur estime que ce système doit être révisé et qu'il appartient à une tutelle métier renforcée (voir infra), d'opérer ce travail de coordination en amont des expressions de besoins formulées par les directions d'administrations centrales à l'endroit du Cerema.
Le Cerema a pris l'initiative de réaliser cette année un bilan consolidé de sa programmation 2024 dans le but de donner aux différentes directions d'administration centrale une vision transversale de l'activité de l'établissement. Cette démarche, en rendant plus lisible l'action globale de l'établissement a notamment pour finalité de contribuer à améliorer l'articulation et la cohérence entre les demandes formulées par les administrations de l'État. Le Cerema souhaite que ce travail constitue un moyen « d'identifier les axes d'amélioration potentiels du dispositif actuel et d'évaluer la pertinence d'éventuelles évolutions dans les modalités de programmation, notamment pour optimiser la coordination avec les services de l'État et assurer une meilleure visibilité budgétaire ».
Le rapporteur considère que ce travail et les enseignements qui en seront tirés pourraient constituer des supports utiles pour éclairer la conception du dispositif de coordination et de pilotage des expressions de besoins étatiques qui doit impérativement être mis en oeuvre sans délai par la tutelle du Cerema.
Recommandation n° 1 : pour le recueil des expressions de besoin des administrations de l'État à l'endroit du Cerema, développer/organiser une coordination approfondie par la tutelle de l'établissement.
2. Une procédure de programmation annuelle de l'activité du Cerema trop complexe et trop coûteuse
Préparée par les services du Cerema sous la responsabilité de son directeur général, dans le cadre d'une procédure inclusive intégrant l'ensemble des acteurs bénéficiaires des activités de l'établissement ainsi que ses principaux partenaires, le programme d'activités annuel est, in fine, arrêtée par son conseil d'administration.
Le processus de programmation annuelle de l'établissement s'appuie sur le conseil stratégique du Cerema et les travaux réalisés au sein de six comités d'orientations thématiques et des comités d'orientations territoriaux organisés dans chaque région.
La programmation des activités du Cerema s'opère en deux étapes. Une première étape stratégique aboutit au programme annuel d'activités de l'établissement arrêté par le conseil d'administration qui est composé « d'opérations ». Les opérations constituent un ensemble de projets concourant à un objectif de politique publique concernant différents types de bénéficiaires.
Dans un deuxième temps, cette programmation est déclinée de manière beaucoup plus fine à travers la définition de projets précis et l'élaboration d'une planification d'activités.
Aujourd'hui, au dire de plusieurs de ses protagonistes, cette procédure apparaît comme excessivement lourde. Dans un contexte de très forte contrainte budgétaire, elle consomme notamment énormément de temps du travail des personnels du Cerema qui y participent. Certaines directions d'administration centrale reconnaissent également le caractère « complexe et chronophage » de la comitologie mise en oeuvre aujourd'hui pour construire la programmation annuelle de l'établissement.
Dans la situation actuelle, alors que le Cerema est confronté à des difficultés financières certaines et que l'État lui-même se trouve soumis à une très forte contrainte budgétaire, les gains de productivité qui peuvent être générés par une simplification du processus de programmation annuelle des activités de l'établissement ne peuvent être ignorés. Aussi, le rapporteur recommande-t-il au Cerema et à sa tutelle, en concertation avec les partenaires de l'établissement, d'engager sans délai une réflexion permettant d'aboutir à une réforme des modalités de préparation de la programmation annuelle de l'opérateur.
Recommandation n° 2 : simplifier la procédure de programmation annuelle des activités du Cerema pour qu'elle consomme moins de temps à ses personnels, permettant ainsi de dégager des gains de productivité.
II. UN NOUVEAU MODÈLE QUI CHERCHE ENCORE SES MARQUES
Annoncé au moment de sa création et engagé depuis plusieurs années, le mouvement du Cerema vers les collectivités s'est cependant retrouvé confronté à des blocages devenus insurmontables sans un changement de statut de l'établissement. Ce constat est à l'origine du nouveau modèle juridique de l'opérateur, devenu un outil commun partagé entre l'État et les collectivités territoriales dans le cadre d'un système original de quasi-régie conjointe.
Avant le changement de statut du Cerema opéré par les dispositions de l'article 159 de la loi « 3DS »26(*) de février 2022, l'article 45 de la loi du 28 mai 201327(*) réservait quasi exclusivement le Cerema aux services de l'État. Si l'établissement pouvait « prêter concours (...) aux services déconcentrés de l'État dans leurs missions d'assistance aux collectivités territoriales », ce n'est « qu'à titre accessoire » que l'opérateur était autorisé à réaliser des prestations « directement pour le compte de tiers autres que l'État »28(*).
Article 45 de la loi n° 2013-431 du
28 mai 2013 portant diverses dispositions
en matière
d'infrastructures et de services de transports avant sa modification
en
février 2022 par l'article 159 de la loi
« 3DS »
Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement assure, essentiellement à la demande de l'État, des activités de conseil, d'assistance, d'études, de contrôle, d'innovation, d'expertise, d'essais et de recherche. Il peut prêter concours, dans ses domaines de compétences, aux services déconcentrés de l'État dans leurs missions d'assistance aux collectivités territoriales, notamment pour des raisons de solidarité nationale ou pour la mise en oeuvre des politiques publiques.
À ces fins, l'État peut faire appel au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement dans le cadre du 1° de l'article 3 du code des marchés publics.
À titre accessoire, l'établissement peut réaliser les prestations définies au premier alinéa du présent article directement pour le compte de tiers autres que l'État.
Source : loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports
Le deuxième alinéa de ce même article prévoyait que l'État pouvait, selon un système de quasi-régie29(*), passer commande au Cerema sans être tenu de procéder à une mise en concurrence préalable. En vertu des normes du droit européen de la concurrence, ce système de quasi-régie d'État était cependant conditionné au fait que les prestations « accessoires » du Cerema réalisées en dehors du cadre de cette quasi-régie, notamment pour le compte des collectivités ou d'acteurs privés, ne dépassent pas 20 % de son activité. Or, avant la réforme prévue par la loi « 3DS », compte-tenu notamment de la bascule progressive du Cerema vers les collectivités, cette limite fatidique était sur le point d'être atteinte.
Ainsi, à l'orée de la décennie 2020, le Cerema, duquel ses tutelles exigeaient qu'il développe ses ressources propres, notamment émanant des collectivités, pour compenser la baisse continue de la dotation annuelle qui lui était versée par l'État, se retrouvait-il confronté à une double impasse, juridique et budgétaire.
Outre cette impasse, le Cerema estimait à l'époque que les complexités des règles de la commande publique et la lourdeur des procédures afférentes constituaient un frein, pour lui comme pour certaines collectivités, dans le développement de leurs relations commerciales. Les difficultés invoquées alors par l'établissement avaient notamment été signalées dans le rapport de 2021 du CGEDD et de l'IGA (voir encadré ci-après).
Avant son changement de statut, les
difficultés invoquées par le Cerema
dans ses relations
juridiques avec les collectivités dans le cadre
des règles de
la commande publique
Le Cerema constate que compte tenu de sa qualité d'intervenant expert, les formules juridiques permettant de faire bénéficier les collectivités de ses compétences ne sont pas toujours aisées a` définir et que le temps de préparation de ces contrats est très consommateur d'énergie.
Autant les services juridiques des collectivités sont a` l'aise avec les procédures les plus classiques de la commande publique, autant la mise au point des contrats de partenariat de différents types leur apparait plus complexe, alors même que dans le même temps, les collectivités souhaitent trouver le moyen de traduire une relation de confiance avec l'expert neutre et impartial que représente pour elles le Cerema.
Les marchés de type recherche développement ou services innovants sont également contraignants pour mettre en oeuvre des innovations techniques.
Le Cerema souligne enfin que l'établissement n'est pas par tradition organisé pour répondre de façon importante à des appels d'offres.
Source : le rôle du Cerema en matière d'appui aux collectivités territoriales, rapport du CGEDD et de l'IGA, juin 2021
C'est dans la perspective de poursuivre le virage du Cerema vers les collectivités, en répondant aux impasses et aux difficultés qui menaçaient de l'entraver, que le changement de statut juridique de l'établissement a été adopté par le Parlement en février 2022 dans le cadre de la loi « 3DS ».
A. LES PREMIERS RÉSULTATS DE LA QUASI-RÉGIE CONJOINTE ENTRE L'ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS
1. Un nouveau statut, une gouvernance réformée et un accès facilité au Cerema pour les collectivités adhérentes
L'article 159 de la loi « 3DS » a révisé le statut juridique du Cerema pour en faire un établissement public partagé entre l'État et les collectivités. Désormais, conformément aux nouvelles dispositions de l'article 45 de la loi du 28 mai 2013, les collectivités peuvent adhérer à l'établissement afin de participer à sa gouvernance et pouvoir accéder à ses services selon le modèle de la quasi-régie30(*), c'est-à-dire par simple voie conventionnelle, sans qu'une procédure de mise en concurrence préalable ne soit requise.
Article 45 de la loi n° 2013-431 du
28 mai 2013 en vigueur aujourd'hui
après sa modification par
l'article 159 de la loi « 3DS »
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent demander à adhérer au Cerema.
Les demandes d'adhésion sont soumises à l'approbation du conseil d'administration.
Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement exerce des activités de conseil, d'assistance, d'étude, de contrôle, d'innovation, d'expertise, d'essais, de recherche, de formation et d'intervention. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements adhérents du Cerema.
L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents peuvent faire appel au Cerema dans le cadre des articles L. 2511-1 à L. 2511-5 du code de la commande publique.
À titre accessoire, l'établissement peut réaliser les prestations définies au troisième alinéa du présent article pour le compte de tiers autres que l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents.
Source : loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports
En vertu des dispositions du code de la commande publique, pour qu'une relation de quasi-régie puisse être instaurée entre des pouvoirs adjudicateurs (en l'occurrence ici les collectivités adhérentes au Cerema) et la personne morale concernée (en l'occurrence le Cerema), trois conditions cumulatives doivent être réunies :
- les pouvoirs adjudicateurs doivent exercer conjointement sur la personne morale un contrôle analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services, c'est-à-dire une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de l'entité en question ;
- la personne morale doit réaliser 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent, ou par d'autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ;
- le capital de la personne morale ne doit pas comporter de participations privées.
Pour que le Cerema respecte la première de ces trois conditions, celle du contrôle des pouvoirs adjudicateurs, sa gouvernance devait être réformée pour y faire une place plus significative aux collectivités. La réforme de la gouvernance de l'établissement était donc une condition préalable indispensable à la mise en oeuvre de son nouveau statut juridique de quasi-régie conjointe.
Alors que ses grandes lignes sont établies par les dispositions de l'article 46 de la loi du 28 mai 2013 modifié par l'article 159 de la loi « 3DS », les détails de cette nouvelle gouvernance sont fixés par un décret du 27 décembre 201331(*), lui-même modifié en juin 202232(*) pour traduire les évolutions rendues nécessaires par le changement de statut.
La nouvelle gouvernance du Cerema a été concrètement mise en place en mai 2023 avec l'installation à la fois de son nouveau conseil d'administration et de son conseil stratégique. Elle a sensiblement renforcé le poids des collectivités dans les instances de l'établissement, leur donnant un rôle substantiel dans la détermination des orientations stratégiques de l'opérateur comme dans la définition de sa programmation.
Le conseil d'administration de l'établissement se compose désormais de 20 représentants des collectivités et de leurs groupements, de 6 représentants de l'État et le directeur général de l'ANCT, de 3 personnalités qualifiées et de 5 représentants des personnels. Avec 40 voix sur un total de 100, contre 35 pour les représentants de l'État, 15 pour les personnalités qualifiées et 10 pour les représentants des personnels, les collectivités territoriales et leurs groupements disposent d'une majorité relative au sein de cette instance.
Si une majorité qualifiée au bénéfice des collectivités territoriales et de leurs groupements est exigée pour l'adoption des délibérations relatives aux décisions qui les concernent directement, l'État disposent néanmoins d'une minorité de blocage.
Le conseil stratégique se compose quant à lui de 34 membres dont 20 représentants des collectivités, 13 de l'État et le directeur général de l'ANCT.
Le conseil d'administration comme le conseil stratégique sont présidés par des représentants des collectivités adhérentes.
Les représentants des collectivités adhérentes sont également majoritaires au sein des autres instances de l'établissement, en particulier celles qui participent à la programmation annuelle des activités du Cerema : les comités d'orientation thématiques nationaux ainsi que les comités d'orientation territoriaux organisés dans chaque région.
Dans le cadre de ce nouveau modèle, les collectivités qui font le choix d'adhérer peuvent attribuer au Cerema des marchés publics par simple voie conventionnelle, sans application des obligations de publicité et de mise en concurrence exigées par le code de la commande publique. Les collectivités adhérentes s'engagent sur une durée de quatre ans et s'acquittent d'une cotisation selon leur démographie ou en fonction de leur type, selon un barème délibéré en conseil d'administration. Le premier barème, dont le détail est présenté dans le tableau ci-après, avait été voté par le conseil d'administration du 6 octobre 2022 qui a précédé le lancement de la campagne d'adhésion.
Barème de cotisations des collectivités adhérentes à la quasi-régie conjointe
(en euros)
|
Catégories de collectivités |
Montant de la contribution en année pleine |
Montant de la contribution au titre de l'année 2023 |
|
Communes et groupements de 10 000 habitants et moins |
500 € |
250 € |
|
Communes et groupements de 10 001 à 39 999 habitants |
0,05 € par habitant |
Abattement de 50 % sur le montant issu du barème applicable en année pleine |
|
Communes et groupements de plus de 40 000 habitants |
2 000 € |
|
|
Départements |
2 500 € |
1 250 € |
|
Régions |
5 000 € |
2 500 € |
Source : réponses du CGDD au questionnaire du rapporteur
Par ailleurs, les collectivités adhérentes disposent d'autres avantages tels qu'un interlocuteur dédié ou encore un accès exclusif et gratuit à des webinaires. Par ailleurs, elles reçoivent en avant-première l'ensemble des guides techniques diffusés par l'établissement et peuvent bénéficier d'un premier diagnostic gratuit relatif à l'adaptation au changement climatique
2. De premiers enseignements qui semblent témoigner de l'enclenchement d'une dynamique vertueuse
Les premiers résultats quantitatifs observés après le changement de statut du Cerema semblent manifester une véritable dynamique. En mai 2025, 1 013 collectivités avaient adhérées, dont 16 régions, 87 départements, 476 communes et 434 groupements de collectivités.
Le Cerema reçoit en moyenne entre 5 et 10 demandes d'adhésions par mois depuis le 1er trimestre 2024 après avoir enregistré 831 adhésions dès l'année 2023. Ce démarrage a été plus rapide qu'anticipé puisqu'à l'origine, l'établissement ne visait que 600 adhésions en 2023. À l'horizon 2027, le Cerema a désormais pour objectif l'adhésion de 1 500 collectivités.
Les effets de cet engouement initial se lient également dans la progression des ressources propres que l'établissement perçoit des collectivités. Depuis la mise en place de la quasi-régie conjointe, ces recettes ont en effet réalisé un bond de 64 % (8,2 millions d'euros), passant de 12,8 millions d'euros en 2022 à 21 millions d'euros en 2024 alors qu'elles n'avaient progressées que de 36 % (3,4 millions d'euros) entre 2018 et 2022.
La dynamique née du nouveau modèle s'observe aussi dans le nombre de contrats conclus par le Cerema avec des collectivités adhérentes qui s'inscrivent dans le cadre du système de quasi-régie. Au nombre de 91 en 2023, pour environ 900 000 euros, ils se sont élevés à 515 en 2024 pour un montant de 5,7 millions d'euros, soit 27 % du montant total des ressources propres provenant des collectivités perçues cette année-là par l'établissement (21 millions d'euros). Par ailleurs, ce montant correspond exactement à la hausse de ces ressources propres observée entre 2023 et 202433(*).
Répartition des recettes issues
en 2024 des contrats de quasi-régie
conclus par le Cerema avec
des collectivités adhérentes
(en milliers d'euros et en %)
EPCI : établissements publics de coopération intercommunale.
EPL : établissements publics locaux.
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
B. DE NOUVEAUX REPÈRES À TROUVER ET UNE FIDÉLISATION À CONSTRUIRE
1. Le corps social du Cerema doit apprendre à fonctionner dans un nouveau cadre et au sein de nouveaux équilibres
Le nouveau modèle du Cerema est porteur de transformations importantes pour son corps social et ses personnels qu'il est essentiel de ne pas sous-estimer, d'autant qu'elles succèdent à de nombreuses et profondes évolutions qu'a connu l'établissement depuis sa création. Lors de ses échanges avec les organisations syndicales représentatives, le rapporteur a pu mesurer la prégnance de ces transformations.
Le virage progressif vers les collectivités d'un établissement qui consacrait auparavant quasi exclusivement ses activités aux services de l'État ne va pas de soi, en particulier dans un contexte de forte contraction de ses moyens financiers et de ses effectifs. Alors que les services de l'État réclament un maintien du niveau et du volume de prestations, les personnels du Cerema, y compris pour des raisons budgétaires, sont incités à accroître leurs actions pour le compte des collectivités.
Le nouveau modèle économique du Cerema, qui accompagne son virage vers les collectivités, suscite aussi parfois une forme d'inconfort chez certains personnels. En effet, les missions de service public dites « socles » que l'établissement accomplit pour le compte de l'État sont financées par son propre budget puisqu'en pratique celui-ci est essentiellement abondé par la subvention annuelle qu'il perçoit du budget de l'État. Budgétairement, ces activités sont ainsi perçues comme des dépenses de l'établissement qu'il convient de maîtriser. En revanche, les prestations délivrées aux collectivités à leur demande sont rémunérées par ces dernières et assimilées budgétairement à des recettes qui améliorent la situation financière du Cerema et qu'il convient de développer.
L'activité des personnels du Cerema et le sens qu'ils lui attachent sont nécessairement affectés par ces enjeux. Lors de ses échanges avec les syndicats, le rapporteur a observé qu'il semblait subsister parfois un certain flottement et des incertitudes, notamment en termes de priorisation des activités pour le compte de tel ou tel destinataire. Une telle situation est compréhensible dans la phase de transition actuelle mais elle devra être résolue dans les meilleurs délais à travers un travail de pédagogie renforcé quant aux évolutions du modèle de l'établissement et des consignes managériales très claires quant aux nouveaux fonctionnements, aux nouveaux repères et aux nouveaux équilibres que ces évolutions impliquent pour le corps social, l'enjeu étant de préserver le sens que les personnels, pour l'essentiel très investis et passionnés, associent à leur travail.
2. Une relation de confiance avec les collectivités adhérentes à préserver et à faire fructifier
La dynamique actuelle des adhésions témoigne de la bonne réputation du Cerema auprès des collectivités et de la confiance qu'elles placent en la qualité de ses prestations et de son expertise. Le défi qui s'annonce désormais pour l'opérateur sera de faire vivre cette relation de confiance, de la cultiver et de ne pas décevoir les attentes placées en lui. Pour cela il lui faudra parvenir à fidéliser ses adhérents en répondant à leurs besoins avec le niveau de qualité qui caractérise aujourd'hui les services qu'il rend.
Le Cerema en a conscience et considère à ce titre que « la nécessité de fidéliser les collectivités devient un enjeu stratégique ». En effet « l'adhésion des collectivités au Cerema étant limitée à une période de quatre ans, il est crucial de leur démontrer, tout au long de cette période, la valeur ajoutée de l'expertise fournie afin d'assurer leur réengagement à l'issue de ce cycle »34(*).
Or, dans un contexte de contrainte significative des moyens, notamment humains, de l'établissement, prospecter tant de nouveaux clients et viser un tel accroissement d'activité sans remettre en cause profondément les missions qu'il réalise par ailleurs pour ses partenaires historiques, principalement les services de l'État, apparaît en soi comme une forme de défi.
Certains s'inquiètent quant à la capacité véritable de l'opérateur, dans les circonstances actuelles de tension sur ses effectifs, à pouvoir répondre efficacement et dans des délais raisonnables aux besoins des nombreuses collectivités qui ont déjà adhérées et qui vont adhérer dans les mois et les années à venir à la quasi-régie. Une des craintes parfois exprimée est que, faute de moyens suffisants, l'opérateur doivent se résoudre à délivrer des prestations « au rabais » ne répondant pas au standard d'excellence qui est aujourd'hui associé à ses expertises. Une telle perspective si elle venait à se réaliser, serait extrêmement dommageable pour l'établissement et risquerait de fragiliser son principal capital, à savoir son « image de marque » aujourd'hui incontestée.
Si dans les années à venir l'établissement n'était pas en mesure de répondre à l'attente placée en lui par les nombreuses collectivités adhérentes, le nouveau système produirait de la déception et, dans un « scénario noir », pourrait in fine aboutir à un phénomène de « retour de bâton » qui entacherait la réputation de l'opérateur. Pour conjurer le risque d'une telle issue, et alors que les effectifs de l'établissement restent l'objet d'une très forte contrainte, certains en viennent à considérer qu'il serait peut-être plus prudent de plafonner le nombre d'adhésions. La direction du Cerema a elle-même conscience de cet enjeu et, alors qu'elle envisageait à l'origine parvenir à 2 000 adhérents, elle n'en viserait plus que 1 500 à 1 800.
Cette situation pose nécessairement la question des moyens humains de l'établissement. Sur ce sujet, le rapporteur appelle l'État à la cohérence et à ne pas donner des injonctions contradictoires au Cerema. On ne peut pas lui demander, d'une part, d'augmenter son volume d'activité auprès des collectivités, notamment pour accroître le montant de ses ressources propres, tout en maintenant le niveau de prestations destiné aux services de l'État, et, d'autre part, de poursuivre la réduction de ses moyens humains. Une telle équation est manifestement insoluble. Le CGDD, tutelle métier du Cerema, souligne à ce titre que « le déploiement de l'activité de l'établissement pour les collectivités nécessite des moyens humains et techniques à la hauteur des ambitions ». Aussi, ajoute-t-il qu'aujourd'hui « forte des orientations ministérielles promouvant une accentuation de son appui aux collectivités et à leurs groupements, la tutelle demande de conserver à l'établissement les moyens humains et techniques à la hauteur des enjeux et ambitions de la nation en matière climatique »35(*).
La direction du budget reconnaît désormais que la réduction continue des effectifs de l'opérateur est peut-être sur le point d'atteindre un point de rupture. Elle estime en effet que « de nouvelles diminutions drastiques du plafond d'emplois pourraient nuire au développement de la quasi-régie et des activités du Cerema »36(*).
Au-delà de ces questions de volumes d'effectifs, faire fructifier le lien de confiance qui existe aujourd'hui avec les collectivités adhérentes suppose une adaptation de l'offre de services du Cerema et de son positionnement qui ne sont pas sans conséquences sur son personnel et induisent de développer et mettre en pratique de nouvelles compétences. Le Cerema souligne à ce titre que la transformation qu'il traverse passe notamment par « une évolution de la culture interne, avec des agents capables non seulement d'apporter une expertise technique, mais aussi d'accompagner les élus et les techniciens dans la mise en oeuvre de projets complexes ». Pour répondre aux attentes de ses adhérents, l'établissement pourrait même devoir s'aventurer sur des terrains nouveaux pour lui comme les enjeux d'acceptabilité locale des projets d'aménagement pour lesquels il est sollicité : « un autre défi important réside dans l'acceptabilité sociale des projets. Le Cerema ne peut pas se limiter à un simple accompagnement technique. Il doit aussi aider les collectivités à convaincre et fédérer autour des transitions qu'elles engagent, notamment en facilitant le dialogue et en prenant en compte les préoccupations citoyennes »37(*).
L'opérateur a également tout intérêt à développer de nouveaux outils propices à structurer et à inscrire dans le temps son partenariat avec les collectivités adhérentes. La conclusion de conventions-cadres pluriannuelles apparaît par exemple comme un bon moyen de fidéliser les collectivités et d'instaurer une relation de confiance inscrite dans la durée. Ce nouveau cadre partenarial est développé par le Cerema depuis son changement de statut. Ainsi, depuis 2023, l'établissement a-t-il conclu 46 conventions de ce type avec 16 communes, 16 groupements de communes, 11 départements et 3 régions.
Ce type de conventions semble présenter des avantages réciproques pour les deux parties. Si elle assure à la collectivité que ses besoins d'expertise prioritaires pourront être couverts à moyen terme par le Cerema, elle permet aussi à l'établissement de disposer d'une visibilité pluriannuelle accrue sur son activité, lui permettant notamment d'optimiser l'allocation de ses moyens, ainsi que sur ses ressources prévisionnelles. Le rapporteur soutient le développement de cette pratique vertueuse.
Les avantages des conventions-cadres conclues entre les collectivités et le Cerema
Ces conventions permettent d'établir des plans de charges prévisionnels, ce qui aide à la planification des ressources humaines et matérielles nécessaires pour mener à bien les projets. Cela assure une meilleure gestion des ressources et une allocation efficace des budgets. En ayant des engagements financiers clairs et définis à l'avance, les conventions offrent une certaine stabilité financière. Cela permet de sécuriser un volant de recettes, facilitant ainsi la gestion financière à moyen et long terme.
Ces conventions renforcent les relations entre les parties prenantes, favorisant une meilleure coordination et coopération pour la mise en oeuvre des politiques publiques et des projets d'intérêt commun.
Les conventions cadres encouragent l'innovation en permettant le développement de projets pilotes et de démonstrateurs technologiques. Cela favorise l'expérimentation et l'adoption de nouvelles technologies et approches. Elles permettent de capitaliser sur les connaissances et les compétences acquises, favorisant ainsi le transfert de technologies et de savoir-faire vers d'autres projets et territoires.
Enfin, les conventions cadre offrent un cadre flexible pour ajuster les actions et les priorités en fonction de l'évolution des besoins et des contextes locaux.
Source : réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
III. « MEZZA VOCE », DES RÉSERVES S'EXPRIMENT DANS LA SPHÈRE DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT
A. LE NOUVEAU STATUT SUSCITE DES RÉSERVES QUANT À LA PERTE D'INFLUENCE DE L'ÉTAT QUI DEMEURE POUR AUTANT LE PRINCIPAL FINANCEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
Au cours de ses travaux, le rapporteur a perçu que le nouveau statut du Cerema suscite certaines réserves au sein de l'État. À ce jour, celles-ci restent cependant exprimées « à bas bruit » et une remise en cause de la réforme n'est pas à l'ordre du jour.
Alors que l'État demeure très largement le principal financeur du budget du Cerema, via la subvention annuelle qu'il lui verse, la perte d'influence de ses représentants dans les instances de gouvernance du Cerema au bénéfice des collectivités est parfois source d'interrogations. Dans la sphère des services de l'État, certains considèrent même que le caractère majoritaire des collectivités dans les instances de gouvernance est contestable, ces dernières étant elles-mêmes clientes de l'établissement. Elles se retrouvent de ce fait notamment amenées à adopter les grilles des tarifs commerciaux qui leur seront appliquées par l'opérateur.
Par ailleurs, dans les cercles de l'État, certains appuient leurs réserves sur le montant « limité » de ressources propres supplémentaires que l'établissement peut raisonnablement attendre de son virage vers les collectivités, rapporté au budget total du Cerema.
B. DES ADMINISTRATIONS REGRETTENT LA RÉORIENTATION DES ACTIVITÉS DU CEREMA EN DIRECTION DES COLLECTIVITÉS AU DÉTRIMENT DES PRESTATIONS QUI LEUR ÉTAIENT AUPARAVANT DÉLIVRÉES
Après l'amorce du virage du Cerema vers les collectivités et plus encore depuis son changement de statut, les enjeux de l'équilibre à trouver entre prestations délivrées aux services de l'État d'un côté et aux collectivités de l'autre se sont exacerbés. Ces enjeux s'inscrivent dans un contexte où l'établissement, partenaire historique des services de l'État qui disposaient encore jusqu'en 2018 de droits de tirage sur son budget, reste essentiellement financé par le budget de l'État. En effet, certes en diminution depuis la création du Cerema, la subvention pour charges de service public qui lui est allouée chaque année représente encore près de 190 millions d'euros, soit 70 % du total des recettes annuelles de l'établissement.
Plusieurs des administrations de l'État partenaires du Cerema s'émeuvent de l'érosion progressive du volume d'activité qui leur est consacré, notamment pour permettre à l'établissement de se tourner davantage vers les collectivités.
La délégation à la sécurité routière (DSR) a signalé au rapporteur que « le nombre et le poids des activités réalisées par le Cerema en sécurité routière n'a cessé de diminuer depuis sa création »38(*). Le montant du budget du Cerema consacré aux activités de sécurité routière aurait ainsi été réduit de 40 % en sept ans, passant de 15,5 millions d'euros en 2017, correspondant au droit de tirage de 7,5 % dont disposait alors la DSR sur le montant annuel de la subvention de l'opérateur, à 9,5 millions d'euros en 2024.
La DSR insiste également sur les conséquences des baisses d'effectifs qui ont affectées les agents du Cerema qui se consacrent tout particulièrement aux enjeux de sécurité routière. En raison de ces contraintes en moyens humains, « les activités programmées ont parfois pris du retard dans leur calendrier de réalisation, faute d'agents disponibles ou identifiés pour les conduire ou déjà fortement sollicités par d'autres demandeurs tels que les collectivités locales ».
La DSR souligne que la réduction du volume d'activité réalisé pour son compte par le Cerema s'explique en partie par la bascule progressive de l'établissement vers les collectivités : « la réorientation des priorités du Cerema en direction des collectivités locales, puis la mise en adéquation de cette réorientation avec les textes fondateurs du Cerema, par le biais de l'article 159 de la loi « 3DS », autorisant l'établissement à travailler en quasi-régie pour le compte des collectivités locales, a mécaniquement eu une incidence sur l'activité réalisée pour le compte de la DSR, les capacités de l'établissement n'étant pas extensibles. Les besoins de la DSR, non-inscrits dans le socle régalien, sont donc conditionnés chaque année, à l'accord du Cerema qui les envisage au regard des orientations et priorités qu'il souhaite donner à ses activités ».
Depuis la création du Cerema, la direction générale de la prévention des risques (DGPR) a quant à elle constaté une baisse de près de 7 millions d'euros du montant que l'opérateur consacre chaque année sur son propre budget aux prestations réalisées pour celle-ci.
Évolution de la part du budget du Cerema
consacré chaque année
à des activités
réalisées à la demande de la DGPR
(en millions d'euros)
Source : commission des finances, d'après les réponses de la DGPR au questionnaire du rapporteur
La DGPR considère que ce phénomène résulte principalement de la réorientation stratégique du Cerema vers les collectivités ainsi que vers de nouvelles thématiques situées hors du champ d'intervention de la direction. En effet, pour la DGPR, la raison principale de cette diminution « n'est pas la contrainte budgétaire que subit l'établissement mais le choix de redéployer ses actions soit thématiquement soit vis-à-vis de nouveaux partenaires dans un contexte de moyens humains limités voire en diminution »39(*).
La DGITM a quant à elle signalé au rapporteur qu'elle avait constaté que le Cerema pouvait être amené à traiter avec moins de diligence qu'auparavant certaines des activités récurrentes historiques qu'il lui délivre, notamment s'agissant de l'évaluation annuelle de l'état des chaussées.
S'il est encore trop tôt pour faire le bilan du nouveau statut du Cerema, le rapporteur estime nécessaire d'engager une évaluation approfondie du modèle de quasi-régie conjointe à l'horizon 2027, après quatre années de mise en oeuvre.
Recommandation n° 3 : prévoir une évaluation du nouveau statut de quasi-régie conjointe du Cerema à l'horizon 2027.
TROISIÈME PARTIE
LE CEREMA EST ENGAGÉ DANS
UNE IMPASSE FINANCIÈRE
I. LA RESTRUCTURATION DU CEREMA S'EST TRADUITE PAR UNE CONTRACTION EXTRÊMEMENT FORTE DE SES MOYENS
Depuis sa création, le Cerema s'est vu imposer une diminution très significative de ses moyens humains et financiers, par ailleurs extrêmement liés les uns aux autres compte tenu du poids que représente sa masse salariale dans le budget total de l'établissement.
Les premières années de l'opérateur ont été rendues extrêmement difficiles par ce contexte faute d'une véritable révision stratégique de son rôle et de ses missions. Cette situation a été très durement ressentie, allant jusqu'à provoquer une crise débouchant sur la démission du président et du directeur général de l'établissement à l'automne 2017.
Dès la fin de l'année 2017, dans son rapport spécial relatif au projet de loi de finances pour 2018, le rapporteur avait alerté sur cette situation préoccupante : « la baisse continuelle de ses moyens associée à l'absence de réflexion stratégique de l'État pour l'établissement ne pourra pas continuer indéfiniment au risque de fragiliser définitivement un opérateur au sein duquel le malaise social est palpable ».
Après cette phase de crise au cours de laquelle la pérennité même de l'établissement semblait questionnée, une réflexion stratégique a enfin été amorcée. Elle allait être traduite par le programme de restructuration Cerem'Avenir et l'ensemble des transformations structurelles qui l'ont accompagné. Observant cette évolution positive, le rapporteur notait ainsi dans son rapport spécial relatif au projet de loi de finances pour 2019 que la nouvelle direction de l'établissement semblait « avoir jeté les bases d'un projet stratégique à même de remobiliser les agents et être en mesure de faire de la contrainte financière que subit le Cerema une opportunité de transformation ».
En engageant une transformation profonde de ses missions et de son organisation, l'établissement s'est installé dans une situation moins inconfortable dans laquelle il a été en mesure de se restructurer pour parvenir à préserver ses capacités de production et son expertise avec des moyens sensiblement réduits. Cette réduction de moyens n'en a pas moins été extrêmement substantielle et, comme le soulignaient le CGEDD et l'IGA dans leur rapport de 2021, elle a largement guidé les réformes ambitieuses réalisées par l'opérateur au cours de la période recente : « ce principe cardinal de réduction continue (...) influence fortement les démarches de véritable réorganisation et de transformation du Cerema qui se sont engagées depuis 2019 ».
A. DEPUIS LA CRÉATION DU CEREMA, UNE SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC EN « CHUTE LIBRE »
La principale ressource du budget du Cerema est constituée par la subvention pour charges de service public (SCSP) qui lui est versée chaque année par l'État. Cette subvention est retracée dans les crédits de l'action 11 « Études et expertises en matière de développement durable » du programme 159 « Expertise, information géographique et météorologie » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » du budget de l'État.
Depuis sa création et jusqu'en 2022, le Cerema s'est vu imposer une diminution continue de cette subvention. Sur cette période, le montant de sa dotation a été réduit de 37 millions d'euros, soit 17 %.
Évolution de la SCSP versée au Cerema (2014-2025)
(en milliers d'euros)
Source : commission des finances du Sénat d'après les documents budgétaires du Cerema
La trajectoire de baisse de la SCSP du Cerema a été infléchie à partir de 2023. En deux ans, entre 2022 et 2024, elle a ainsi progressé de 3,4 % (6,4 millions d'euros) pour atteindre 193,2 millions d'euros.
Toutefois, cette augmentation doit être relativisée du fait des mesures exogènes imposées à l'opérateur, décidées par le Gouvernement ou par son ministère de tutelle, qui ont, sur la même période, conduit à majorer significativement les charges de personnel de l'établissement. D'après le Cerema, le cumul de ces mesures représenterait ainsi plus de 10 millions d'euros par an dont 7,7 millions d'euros pour les seules augmentations du point d'indice de la fonction publique en 2022, puis en 2023.
Par ailleurs, la loi de finances pour 202540(*) et le décret d'annulation de crédits du 25 avril 202541(*) ont prévu une nouvelle diminution significative de la SCSP du Cerema. Sous réserve de nouvelles évolutions en cours de gestion, celle-ci pourrait ainsi s'établir à 187,6 millions, soit une baisse de 5,6 millions d'euros (- 2,9 %) par rapport à 2024.
Le Cerema observe que le ratio de couverture de ses charges de personnel par sa subvention ne cesse de décroître, passant de 99 % en 2020 à 83 % en 2025.
B. UNE RÉFORME STRUCTURELLE QUI A CONDUIT À LA RÉDUCTION DE PRÈS DE 20 % DES EFFECTIFS
1. La baisse des effectifs du Cerema est-elle sur le point d'atteindre un point de rupture ?
Depuis la création du Cerema et jusqu'en 2023, ses effectifs ont connu une diminution continue, passant de 3 093 équivalents temps plein travaillés (ETPT) à 2 534 ETPT, soit une baisse de 559 ETPT (18 %) sur la période.
Évolution des effectifs sous-plafond et hors plafond du Cerema (2014-2024)
(en ETPT)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Comme l'illustre le graphique ci-après, s'agissant des effectifs sous plafond d'emplois, la baisse est plus significative encore puisqu'elle atteint 20 % (625 ETPT).
Évolution du plafond d'emploi du Cerema et de son exécution (2015-2024)
(en ETPT)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires
L'ampleur des baisses d'effectifs du Cerema est également perceptible dans la succession des schémas d'emplois négatifs qu'a connu l'établissement jusqu'en 2022, avec notamment une acmé observée entre 2017 et 2020, période au cours de laquelle les réductions annuelles moyennes des effectifs ont atteint 115 équivalents temps plein (ETP).
Cumul des schémas d'emplois du Cerema (2015-2025)
(en ETP)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Les effectifs du Cerema avaient fini par être stabilisés en 2023. Notamment à l'initiative d'un amendement déposé par le rapporteur, la loi de finances initiale pour 2024 avait prévu une augmentation de 25 ETP des effectifs de l'opérateur. Cependant, au cours de l'exercice, l'établissement a sur-exécuté de presque 100 % ce schéma d'emplois, augmentant ses effectifs à hauteur de 49 ETP. La loi de finances pour 2025 a prévu une nouvelle réduction des effectifs de l'opérateur à hauteur de 49 ETP, soit un retour à la situation qui prévalait en 2023.
Au total, le cumul des schémas d'emplois depuis sa création jusqu'en 2025 aura conduit à une réduction des effectifs du Cerema à hauteur de 668 ETP.
L'ampleur des baisses d'effectifs qu'a connu l'établissement depuis sa création est incontestable. Celles-ci ont d'ailleurs peut-être atteint un niveau tel qu'il serait vraisemblablement difficile d'aller plus loin dans cette voie sans une nouvelle restructuration significative ou une remise en cause du nouveau modèle de l'opérateur davantage orienté vers les collectivités. À ce titre, si « la direction du budget estime que les baisses d'effectifs n'ont pas eu de répercussion substantielle sur la qualité des missions exercées par l'opérateur ». Elle a signalé au rapporteur que « néanmoins, de nouvelles diminutions drastiques du plafond d'emplois pourraient nuire au développement de la quasi-régie et des activités du Cerema ».
Les grandes transformations stratégiques traversées par l'opérateur se lisent aussi dans les évolutions de la répartition des effectifs entre les différentes composantes du Cerema.
Il en va notamment ainsi de la restructuration de l'établissement menée à bien dans le cadre du programme Cerem'Avenir. À titre d'exemple, l'augmentation du nombre d'agents affectés au siège en 2021 témoigne du mouvement de mutualisation des fonctions supports.
Dans le même temps, le renforcement récent, depuis 2023, des effectifs affectés dans les directions territoriales s'explique par le développement des activités du Cerema réalisées pour le compte des collectivités ainsi que par la création de son nouveau statut de quasi-régie conjointe.
Évolution de la répartition des
effectifs du Cerema
entre les directions et le siège
(2019-2024)
(en ETP)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
2. Un repyramidage des effectifs au service de la réforme du positionnement stratégique du Cerema
Décomposition en catégories de
personnels
des schémas d'emplois du Cerema (2015-202542(*))
(en ETP)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Les postes occupés par des personnels de catégorie C et dans une moindre mesure ceux de catégorie B ainsi que par des ouvriers des parcs et ateliers (OPA), ont été les plus touchés par les suppressions d'effectifs. Entre 2014 et 2025, les postes relatifs à ces catégories de personnels devraient ainsi diminuer à hauteur de 929 ETP. Dans le même temps, depuis la création du Cerema, les postes occupés par des personnels de catégorie A ont quant à eux augmenté à hauteur de 260 ETP.
Cumul des schémas d'emplois du
Cerema
décomposé par catégories de personnels
(2015-202543(*))
(en ETP)
OPA : ouvriers des parcs et ateliers.
Source : commission des finances du Sénat d'après les documents budgétaires du Cerema
Ces évolutions différenciées traduisent une politique de repyramidage des effectifs de l'opérateur qui a constitué le principal levier de mise en oeuvre des réformes relatives au positionnement stratégique de l'opérateur dans un rôle de conseiller et d'expert de haut niveau (voir supra).
Pour cela, l'opérateur devait procéder à une élévation globale de l'expertise de ses personnels ainsi que se doter de nouvelles compétences. Ces nouveaux besoins expliquent le phénomène de repyramidage des effectifs du Cerema au profit des postes occupés par des agents de catégorie A. Pour mener à bien ces évolutions, l'établissement a notamment conçu un plan de développement des compétences présenté dans l'encadré ci-après.
Le plan de développement des compétences destiné à élever le niveau d'expertise des personnels du Cerema en cohérence avec son nouveau positionnement stratégique
La politique de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (Gpeec) du Cerema a donné lieu à la mise en place d'un plan de développement des compétences pour adapter l'établissement aux enjeux précisés dans son projet de service et son contrat d'objectif et de performance, notamment la capacité à répondre aux défis que constitue l'adaptation au changement climatique.
Ce plan, finalisé sur la période 2024-2026 s'articule selon trois axes :
- capter de nouveaux viviers et garantir le recrutement de compétences clés ;
- accompagner la montée en compétence dès la prise de fonction des agents et favoriser le transfert des savoirs et des pratiques ;
- renforcer l'expertise technique et scientifique et la fidéliser.
Il repose dans un premier temps sur l'identification, via un outil dédié permettant aux agents de déclarer selon trois niveaux (initiation, maîtrise, expertise) les compétences qu'ils mobilisent pour l'exercice de leurs missions. Cette identification permet ensuite une évaluation des écarts entre les compétences déclarées et celles requises pour l'exercice des missions de l'établissement, à la fois par direction et également par secteur d'activité.
L'analyse de cette évaluation permet de déterminer des plans d'action sur les différents secteurs : recrutements prioritaires à envisager, plan de formation, accompagnement individuel des agents, tutorat, transfert des pratiques, etc.
Le plan permet d'alimenter les échanges entre la DRH et les directions à l'occasion d'un dialogue de gestion mené deux fois par an, permettant de finaliser les recrutements prioritaires dans le respect des contraintes liées au schéma d'emploi.
Source : réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Les effectifs sous plafond du Cerema s'élevaient à 2 426 ETP en 2024, composés à 56 % de personnels de catégorie A. Depuis la création du Cerema, en raison du phénomène de repyramidage, cette part a considérablement augmenté. En effet, en 2014, les personnels de catégorie A ne représentaient que 35 % des effectifs sous plafond de l'établissement.
Comparaison de la répartition des effectifs
sous plafond du Cerema
par catégories de personnel entre 2014 et
2024
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Évolution des effectifs sous plafond du Cerema (2019-202544(*))
(en ETP)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
3. Une hausse sensible de la part des agents contractuels pour attirer des compétences rares
Toujours dans la perspective de mettre en cohérence ses compétences avec son nouveau positionnement stratégique, le Cerema augmente depuis plusieurs années ses recrutements d'agents sous contrats. Ainsi, alors qu'elle ne représentait que 8,6 % en 2019, la part représentée par les agents publics contractuels dans le total des effectifs sous plafond du Cerema s'est élevée à 19,5 % en 2024. Sur la même période, leur volume a plus que doublé, passant de 223 à 474 ETP.
La direction du Cerema comme le CGDD, sa tutelle métier, expliquent notamment ce phénomène par la difficulté à trouver dans le vivier des fonctionnaires titulaires certaines des compétences très pointues que l'établissement recherche.
Dans ses réponses au questionnaire du rapporteur, le CGDD observe ainsi que « le Cerema rencontre des difficultés de recrutements, notamment de titulaires, les postes à pourvoir nécessitant pour la plupart une expertise et une parfaite maîtrise du domaine de compétence qui leur sont attachées ». Il ajoute que « la baisse des recrutements de fonctionnaires techniques contraint l'établissement à se tourner vers le secteur privé pour maintenir ses compétences »45(*).
Évolution des effectifs de fonctionnaires titulaires et de contractuels (2019-2024)
(en ETP)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Le turnover important des agents contractuels, généralement recrutés sur des périodes courtes, se traduit inévitablement par une certaine fragilité quant au maintien sur le long terme des compétences, de l'expertise et de l'expérience du Cerema. Le rapporteur a pu constater que ce sujet, s'il est identifié par la direction de l'établissement et sa tutelle métier, suscite de réelles craintes au sein des personnels et des organisations syndicales. Plus généralement, cette problématique, absolument centrale pour l'avenir du Cerema, soulève des enjeux relatifs à son attractivité dans des domaines d'expertise marqués par des phénomènes de rareté et la concurrence sur les marchés de l'emplois correspondants qui en résultent.
4. Une augmentation substantielle des effectifs hors plafond
Sans compenser, loin s'en faut, la baisse de ses emplois sous plafond, le Cerema a nettement augmenté le nombre de ses effectifs hors plafond depuis sa création. Alors qu'ils étaient au nombre de 2 ETP en 2014, ils ont représenté 119 ETP en 2024. Depuis 2019, leur nombre a été plus que multiplié par deux.
Le Cerema a particulièrement insisté auprès du rapporteur sur l'importance que revêt pour lui ses emplois hors plafond : « les effectifs hors plafond sont une ressource extrêmement importante pour pouvoir assurer la réalisation de certains projets sur ressources propres et permettre la poursuite du développement de l'établissement, dans un contexte d'effectifs sous plafond contraints »46(*).
Évolution des effectifs hors plafond du Cerema (2019-2024)
(en ETP)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Les effectifs hors plafond du Cerema se décomposent en deux catégories : d'une part des apprentis et, d'autre part, des contrats à durée déterminée (CDD) attachés à des projets financés par ressources externes et ayant été l'objet d'une procédure de mise en concurrence. L'établissement n'est donc pas en mesure de recruter des emplois hors plafond pour les activités réalisées auprès des collectivités dans le cadre de son nouveau modèle de quasi-régie.
Entre 2019 et 2024, ces deux catégories d'emplois hors plafond ont augmenté dans des proportions significatives. Les effectifs d'apprentis ont augmenté de 24 ETP, soit une multiplication par 2,5. Le Cerema a signalé au rapporteur toute l'importance qu'il attachait à sa politique d'apprentissage, soulignant son attachement « à cette voie de formation des techniciens et ingénieurs de demain »47(*). Les CDD sur projets définis avec un financement intégral par des partenaires externes publics ou privés ont quant à eux été multipliés par deux sur la même période, progressant de 42 ETP.
Pour le Cerema, ces CDD revêtent une importance toute particulière dans le domaine de la recherche. Il considère en effet que leur augmentation au cours des dernières années « a permis d'assurer l'ensemble des recrutements nécessaires au développement de projets structurants pour le Cerema et/ou nécessitant des compétences particulières (projets collaboratifs sur appels à projets, projets de recherche partenariale financés par les entreprises dans le cadre de l'Institut Carnot Cérema Effi-sciences devenu Clim'adapt) »48(*).
Alors que la limite des effectifs hors plafond a été établie à 122 ETPT en 2025, le Cerema estime que son besoin se situerait en réalité autour de 140 ETPT.
II. UN MODÈLE FINANCIER EN PÉRIL
A. UNE SITUATION FINANCIÈRE PROFONDÉMENT DÉGRADÉE
1. Un déficit structurel préoccupant qui se creuse dangereusement
La lecture de l'équilibre budgétaire du Cerema a été compliquée ces dernières années par les flux financiers, décalés dans le temps, en recettes comme en dépenses, résultants de la participation de l'établissement à certains grands programmes nationaux. En effet, dans ce cadre de ces programmes d'intervention, le Cerema est amené à instruire des dossiers pour distribuer des fonds publics.
En pratique, dans le cadre de la mise en oeuvre de ces programmes le Cerema se voit dans un premier temps allouer une dotation de l'État qui vient gonfler ses recettes budgétaires l'année considérée. Il est à noter que les montants ainsi perçus constituent pour l'opérateur une trésorerie dite « fléchée », qui certes augmente temporairement son niveau de trésorerie globale, mais sur laquelle il ne dispose d'aucune marge de manoeuvre quant à son utilisation finale. À moyen terme, c'est donc une trésorerie dont l'établissement ne « dispose » pas.
Car en effet, le Cerema a ensuite pour charge, dans un second temps, de distribuer ces sommes aux bénéficiaires après instruction de leurs dossiers, procédure qui se traduit alors par des dépenses budgétaires pour l'établissement.
Le décalage temporel entre la perception des enveloppes et leur redistribution rend l'analyse des équilibre budgétaires de l'établissement difficilement lisible. Des soldes budgétaires excédentaires peuvent ainsi être constatés les années au cours desquelles l'opérateur perçoit des montants importants de recettes fléchées et, inversement, des soldes budgétaires déficitaires peuvent être observés au moment où ces sommes sont redistribuées à leurs bénéficiaires finaux.
Cette situation est nouvelle pour le Cerema. Elle s'observe depuis la mise en oeuvre du plan de relance dans le cadre duquel l'établissement a été amené à piloter plusieurs programmes d'intervention de cette nature. Il s'agit du programme « ponts », qui a été prolongé après sa première phase de diagnostics des ponts des collectivités, du programme France vue sur mer et du plan tourisme.
Dépenses, recettes et solde budgétaire du Cerema (2014-202549(*))
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires du Cerema
Ces phénomènes expliquent les fluctuations très significatives du déficit budgétaire annuel du Cerema entre 2022 et 2025. L'excédent de 93 millions d'euros constaté en 2022 provient ainsi de la perception de recettes fléchées pour un montant quasi équivalent. Inversement, une part des déficits observé en 2024 ou prévu dans le cadre du budget initial pour 202550(*), s'explique par les dépenses liées à la redistribution des recettes fléchées perçues au cours des années antérieures.
Évolution du solde budgétaire du Cerema (2014-202551(*))
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires du Cerema
Afin de mesurer le solde budgétaire structurel de l'établissement, il convient ainsi de retraiter les opérations en recettes comme en dépenses qui relèvent de dispositifs fléchés. Or, cet exercice révèle que le solde budgétaire structurel du Cerema s'est nettement dégradé depuis 2022.
En effet, en ne retenant que les recettes (la SCSP, les ressources propres non fléchées et les versements des administrations centrales dans le cadre de leurs conventions avec le Cerema) et les dépenses (les charges de personnel ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'investissement non fléchées) que l'on peut considérer comme structurelles, on observe que depuis l'année 2023, exercice marqué notamment par le phénomène d'inflation et des mesures salariales prises en faveur des fonctionnaires, l'établissement se trouve dans une situation budgétaire caractérisée par un déficit structurel substantiel, équivalant potentiellement à une vingtaine de millions d'euros par an. Au regard des données du budget initial de l'année, le déficit prévisionnel pour 2025 était même plus élevé mais le plan de retour à l'équilibre (voir infra) mis en oeuvre en cours de gestion par le Cerema devrait permettre de le maîtriser.
D'après les éléments qui ont été communiqués au rapporteur par le Cerema comme par ses tutelles, il semble qu'en pérennisant les mesures de maîtrise de la dépense prises dans le cadre de ce plan de retour à l'équilibre, le déficit structurel de financement des missions de base de l'établissement sur son périmètre d'intervention actuel se situerait entre 15 et 20 millions d'euros par an.
Le creusement du déficit budgétaire structurel du Cerema s'explique par une progression de ses dépenses plus rapide que celles des recettes. Entre 2019 et 2025, les premières progresseraient de près de 25 % quand les secondes n'augmenteraient que d'environ 8 %. Depuis 2022, les recettes structurelles n'augmenteraient que d'environ 4 % contre une hausse de près de 18 % des dépenses.
Dépenses, recettes et solde
budgétaire structurels non fléchés
du Cerema
(2019-202552(*))
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires du Cerema
S'agissant des recettes structurelles, la baisse substantielle de la SCSP de l'opérateur a été compensée par l'accroissement de ses ressources propres ainsi que par les co-financements versés par les administrations centrales dans le cadre des conventions qu'elles ont conclues avec le Cerema.
Recettes structurelles non fléchées du Cerema (2019-202553(*))
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires du Cerema
L'accroissement des dépenses structurelles de l'établissement s'explique principalement par l'augmentation de ses charges de personnel. En effet, celles-ci ont progressé de 34 millions d'euros depuis 2019 et de 26 millions d'euros (+ 13 %) entre 2022 et 2025. L'augmentation des dépenses structurelles a aussi pour origine, depuis 2021, la progression très dynamique des dépenses de fonctionnement non fléchées de l'opérateur. Sur cette période, ces dernières se sont en effet accrues de près de 20 millions d'euros (+ 70 %). Enfin, dans une moindre mesure, l'augmentation des dépenses d'investissement, très insuffisantes jusqu'en 2022 (voir infra), a aussi contribué à l'augmentation des dépenses structurelles du Cerema sur la période récente.
Dépenses structurelles non fléchées du Cerema (2019-202554(*))
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires du Cerema
2. « Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel » : jusqu'à quel point le Cerema pourra-t-il compenser la baisse de sa dotation de l'État par l'augmentation de ses ressources propres ?
Depuis la création du Cerema, ses tutelles l'on fortement incité à développer ses ressources propres, c'est-à-dire essentiellement ses recettes commerciales, pour compenser la réduction continue de la subvention pour charges de service public (SCSP) que lui verse l'État et, plus récemment, pour absorber la hausse de ses charges de personnel, partiellement due à des décisions que l'établissement ne maîtrise pas. Le virage progressif de l'établissement vers les collectivités ainsi que le nouveau statut de quasi-régie conjointe qui en a résulté s'inscrivent dans ce mouvement.
À ce titre le CGEDD et l'IGA écrivaient dans leur rapport de 2021 que, parallèlement à la baisse continue de sa SCSP, « le principal objectif fixé à l'établissement depuis sa création vise au développement de ses ressources propres à partir de ses activités au profit des tiers, dont les collectivités territoriales ».
Recettes du Cerema (2021-2024)
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires du Cerema
Selon la prise en compte ou non de certains financements apportés par l'État en sus de la SCSP, le montant retenu de ressources propres pour une année peut légèrement varier mais celles-ci ont globalement doublé entre 2019 et 2024 passant de 30 millions d'euros à 60 millions d'euros. Dans le même temps, la SCSP de l'établissement se repliait de 7 millions d'euros (- 3,5 %). Si l'on inclut 2025, la baisse de la SCSP atteint même 11,9 millions d'euros, soit - 6 % sur la période.
Ressources propres du Cerema (2017-2024)
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Sur la période récente, le segment le plus dynamique au sein des ressources propres du Cerema a été celui des collectivités avec un doublement des recettes depuis 2019 (+ 10,7 millions d'euros). Ce dynamisme s'explique par la réorientation de l'activité de l'établissement vers celles-ci (voir supra). Les recettes commerciales provenant des entreprises privées ont aussi soutenu la hausse des ressources propres du Cerema. Elles ont en effet augmenté de 6,6 millions d'euros (+ 56 %) depuis 2019. Les co-financements alloués par les administrations centrales ont également progressé sur la période.
Historiquement, et jusqu'au changement de statut du Cerema en 2023, le segment des entreprises était le principal pourvoyeur de ressources propres de l'établissement. S'il demeure dynamique, il a été supplanté en 2024 par les recettes provenant des collectivités. Au cours de cet exercice il a quand même représenté 18,3 millions d'euros de recettes soit environ un tiers du total des ressources propres du Cerema.
Les interventions de l'établissement pour le compte d'entreprises concernent principalement son domaine d'expertise historique, à savoir les infrastructures. Elles sont essentiellement tournées vers les organismes de certifications, les sociétés concessionnaires d'autoroutes, de grandes entreprises de travaux publics ou des bureaux d'études.
Il est à noter que l'activité du Cerema en matière de certification, de normalisation et de labellisation a généré à elle seule 4,8 millions de recettes en 2024.
Les activités de recherche de l'établissement constituent aussi un vecteur important de partenariats commerciaux avec les entreprises, notamment dans le cadre de contrats de recherche et développement. Le Cerema souligne ainsi qu'à travers ses douze équipes de recherche, son institut Carnot et le « Cerema lab », il « valorise sa recherche appliquée en la mettant au service des entreprises, renforçant ainsi les liens entre innovation publique et acteurs économiques », ce qui lui permet « d'accompagner les entreprises dans l'expérimentation et l'industrialisation de solutions innovantes »55(*).
Les relations contractuelles entre le Cerema et les entreprises
Le Cerema collabore avec les entreprises à travers deux principales formules contractuelles :
- les marchés de droit privé : ces contrats permettent au Cerema de fournir des prestations aux entreprises dans le cadre de ses expertises (études, diagnostics, conseils, etc.). Ils sont régis par le droit privé et offrent une grande souplesse dans leur mise en oeuvre, sans seuil réglementaire spécifique ;
- les contrats de recherche et développement : ces accords visent à développer conjointement des innovations ou des solutions techniques avec des entreprises, notamment dans les domaines de la mobilité, de l'aménagement, des infrastructures ou encore de la transition écologique. Ils permettent un partage des résultats et des droits de propriété intellectuelle, favorisant ainsi le transfert de technologie et l'innovation.
Source : réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Depuis la réforme de la programmation des activités du Cerema en 2019 (voir supra) et en raison de la baisse continue de la SCSP de l'établissement, les directions d'administration centrale avec lesquelles il est en partenariat sont de plus en plus amenées à co-financer certains des projets auxquels elles demandent à l'opérateur de participer. Les règles générales de ces cofinancements sont fixées dans des conventions-cadres pluriannuelles et les montants précisés dans des conventions annuelles (voir supra).
Co-financements versés par les directions
centrales d'administration
dans le cadre des conventions qui les lient avec
le Cerema (2020-2024)
(en milliers d'euros)
CGDD : commissariat général au développement durable.
DGALN : direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature.
DGAMPA : direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
DGEC : direction générale de l'énergie et du climat.
DGITM : direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités.
DGPR : direction générale de la prévention des risques.
DSR : délégation à la sécurité routière.
Source : réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Les modalités de ces co-financements varient d'une convention-cadre à l'autre. Elles résultent des négociations bilatérales entre le Cerema et la direction d'administration centrale concernée sans qu'aucun cadre général commun ni aucune coordination ne soit fixés en amont. Comme le rapporteur l'a déjà souligné, ce système de fonctionnement n'est pas optimal. Il en résulte un maquis désordonné sans ligne directrice. Il doit ainsi impérativement être réformé afin qu'une tutelle forte prenne les responsabilités d'établir un cadre commun permettant d'harmoniser les principes qui régissent les relations financières entre le Cerema et les services de l'État. En amont, cette tutelle devra également avoir défini ce qui relève des missions de service public « socles » de l'établissement, ayant vocation à être intégralement financées par sa SCSP, les autres activités demandées au Cerema ayant vocation à être financées par les services de l'État concernés eux-mêmes.
À titre d'exemple, la convention-cadre conclue entre la délégation à la sécurité routière (DSR) et le Cerema prévoit un système original de co-financement, le seul exemple de ce type à ce jour. Le cofinancement de la DSR porte sur l'ensemble des activités réalisées pour son compte par le Cerema selon des pourcentages modulés en fonction d'un critère d'importance associé aux différentes prestations programmées.
Un autre mode de co-financement, plus « habituel », consiste à identifier, dans le domaine d'intervention de la direction concernée, un périmètre de missions « socles » que le Cerema doit financer à 100 % sur son propre budget. Les autres missions de service public situées hors de ce périmètre, parfois qualifiées « d'actions partenariales », ont en revanche vocation à être co-financées par la direction concernée.
Les relations financières entre le Cerema et la DGPR fonctionnent par exemple sur ce principe. En effet, la convention-cadre triennale conclue entre l'opérateur et la direction définit notamment « les principes de financement selon le type d'actions menées : actions socles, faisant partie des coeurs de métiers du Cerema financées intégralement par la SCSP de l'établissement, et actions partenariales spécifiques cofinancées au taux de 30% par la DGPR ». La DGPR a précisé au rapporteur que ce taux de 30 % peut parfois être « ajusté à la hausse sur certaines actions quand de façon justifiée elles nécessitent l'engagement de charges externes très spécifiques et exceptionnelle »56(*).
Co-financements de la DGPR pour des projets réalisés pour son compte par le Cerema dans le cadre des conventions conclues entre les deux entités (2014-2024)
(en milliers d'euros)
Source : réponses de la DGPR au questionnaire du rapporteur
Outre leurs caractères disparates, les modèle de co-financements prévus dans les conventions avec les directions d'administration centrales n'apportent qu'une visibilité financière très relative au Cerema. Leur application effective, non contraignante, dépend de l'évolution des dotations budgétaires annuelles allouées à ces services. La période actuelle de forte contrainte sur le budget de l'État renforce cette incertitude. Ainsi, la DSR souligne que le dispositif de cofinancement existant sera maintenu « tant que la DSR dispose des crédits suffisants pour lui permettre d'attribuer cette subvention complémentaire »57(*) à la SCSP du Cerema.
Le Cerema bénéficie également de fonds européens pour une moyenne d'environ 4 millions d'euros par an. Ainsi, en 2025, il compte 46 conventions portant sur des projets européens et escompte percevoir 4,5 millions d'euros de recettes à ce titre au cours de cet exercice.
Après plusieurs années d'augmentation significative, en 2025, le Cerema anticipe une stabilisation de ses ressources propres. Est-ce à dire que la dynamique ne ferait que s'interrompre en raison notamment du climat économique incertain et du contexte de contrainte budgétaire qui affecte tant l'État que les collectivités ? Une autre hypothèse, moins optimiste, serait que le Cerema approche peut-être une sorte de plafond au-delà duquel les marges de nouvelles ressources seront plus limitées et plus complexes à mobiliser.
Le rapporteur observe que cette perspective remet en question le modèle selon lequel le Cerema se trouve sommé d'exploiter, avec autant de diligence que possible, le gisement de ses ressources propres potentielles dans le but principal de compenser la baisse continue de sa dotation et d'absorber les charges supplémentaires qui lui sont parfois imposées de l'extérieur, essentiellement sur le champ de sa masse salariale.
Le rapporteur rappelle que « les arbres ne montent pas au ciel » et qu'il est possible que ce modèle, qui a permis à l'État de réaliser des économies substantielles depuis la création de l'opérateur, ait d'ores et déjà atteint ses limites.
En toute hypothèse, il souligne que le dynamisme des ressources propres de l'établissement et les déterminants qui en sont à l'origine devront faire l'objet d'une surveillance et d'une analyse particulièrement attentives au cours des mois et des années à venir. La pérennité du modèle économique de l'établissement dépendra en effet de la justesse de l'analyse prospective relative à la réalité du potentiel d'accroissement à moyen terme de ses ressources propres. Une surestimation de ce potentiel pourrait mettre en péril l'avenir d'un établissement qui se trouve d'ores et déjà dans une situation financière extrêmement délicate.
3. Les dépenses du Cerema sont fortement contraintes par le poids et le dynamisme de sa masse salariale
Dépenses du Cerema (2019-2024)
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires du Cerema
a) L'évolution très dynamique de sa masse salariale en dépit des réductions d'effectifs contraint fortement les dépenses du Cerema
Sa masse salariale constitue l'essentiel des dépenses du Cerema. En 2024, celle-ci représentait en effet 75 % des dépenses totale de l'établissement. Cependant, si l'on ne retient que les dépenses structurelles, la proportion tutoie plutôt les 80 %.
Entre 2019 et 2025, les charges de personnel de l'établissement ont augmenté de 35 millions d'euros (+ 18 %) pour atteindre 232 millions d'euros.
Évolution de la masse salariale du Cerema (2021-202558(*))
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
L'ampleur de la hausse exceptionnelle observée en 2023 s'explique en partie par une dépense ponctuelle. Il s'agit d'une régularisation relative à la résorption de l'année de décalage de l'indemnité de sujétions spéciales (ISS) pour 13 millions d'euros. Un phénomène identique, mais dans une moindre proportion a concerné l'exercice 2022. En retraitant ce phénomène, la masse salariale de l'établissement aurait progressé de 7 millions d'euros entre 2022 et 2023 puis de 10 millions d'euros entre 2023 et 2024.
La nouvelle hausse significative des charges de personnel attendue en 2025 s'explique principalement par l'augmentation de 4 points du CAS pensions (2,6 millions d'euros), l'obligation de protection sociale complémentaire des agents (1,5 million d'euros), le phénomène de repyramidage des effectifs (2,5 millions d'euros), l'effet GVT59(*) (2 millions d'euros) ou encore la réévaluation de l'enveloppe dédiée à la rémunération des emplois hors plafond.
L'essentiel des charges de personnel du Cerema rémunèrent ses effectifs sous-plafond. Les emplois hors plafond représentent quant à eux environ 5 millions d'euros du total de la masse salariale de l'établissement. Comme l'illustre le graphique ci-après, ce montant a progressé au fur et à mesure de l'augmentation du volume des effectifs hors plafond.
Évolution des effectifs hors plafond du
Cerema
et de la masse salariale correspondante (2018-2025)
(en ETPT et millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires du Cerema
Malgré la baisse sensible des effectifs du Cerema au fil des années, ses charges de personnel ont donc connu une augmentation très dynamique. Ce résultat résulte principalement de deux phénomènes, l'un exogène et l'autre endogène à l'établissement.
Le premier phénomène explicatif, essentiellement exogène, correspond aux mesures ayant pour conséquence d'augmenter le traitement indiciaire ou les indemnités versés aux agents rémunérés par l'opérateur. La plupart de ces mesures sont décidées, soit par le Gouvernement lorsqu'elles s'appliquent sur un périmètre interministériel, soit par le ministère chargé de l'écologie pour ses propres personnels. Dans un cas comme dans l'autre, le Cerema ne dispose pas de marge de manoeuvre et il est amené à appliquer ses mesures à ses propres agents s'ils sont concernés.
D'après le Cerema, depuis 2019, les charges exogènes non compensées de ce type auraient conduit à majorer structurellement ses charges de personnel de près de 19 millions d'euros par an, dégradant d'autant ses équilibres financiers.
Cumul depuis 2019 du coût pérenne en
année pleine des mesures salariales
non compensées
exogènes au Cerema ayant eu pour conséquence
de majorer ses
charges de personnel
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Entre 2019 et 2025, si l'on compare, d'une part le coût pour l'établissement des charges exogènes non compensées et la baisse de sa SCSP avec, d'autre part la hausse de ses ressources propres, on observe que le Cerema n'est d'ores et déjà pas totalement parvenu à compenser ces phénomènes par son activisme visant à développer ses recettes commerciales. En effet, comme l'illustre le graphique ci-après, la comparaison de ces différents phénomènes fait apparaître un solde négatif de 3,7 millions d'euros qui a conduit à dégrader d'autant les équilibres financiers du Cerema au cours de la période considérée.
Effets cumulés depuis 2019 sur
l'équilibre financier de l'établissement
des mesures
salariales exogènes non compensées, de la baisse de sa SCSP
et
de la hausse de ses ressources propres
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les données issues des réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur et des documents budgétaires de l'établissement
Cette analyse renforce le rapporteur dans sa conviction que le modèle par lequel l'État impose au Cerema de financer des mesures salariales qui lui sont exogènes et de compenser la baisse de sa dotation budgétaire par de nouvelles recettes commerciales a atteint ses limites. Poursuivre dans cette voie ne serait vraisemblablement pas viable financièrement pour l'établissement.
Le deuxième phénomène explicatif de la hausse des charges de personnel de l'opérateur malgré la succession de schémas d'emplois négatifs qu'il a connu est quant à lui endogène et résulte du repyramidage de ses effectifs. Ce repyramidage, qui se traduit par une augmentation de la part des agents de catégories A et A+ par rapport aux agents de catégories B ou C, est indissociable de la réforme stratégique du Cerema qui vise à recentrer l'opérateur sur le conseil et l'expertise de haut niveau (voir supra).
Du fait de la rémunération plus élevée des agents de catégories A et A +, ce phénomène a un coût pour l'établissement qui se traduit par un effet haussier sur le dynamisme de ses dépenses de personnel. Pour la seule année 2025, le coût du repyramidage est ainsi estimé à environ 2,5 millions d'euros. Depuis 2019, l'incidence du repyramidage sur l'augmentation des charges de personnel se situe entre 2 et 2,5 millions d'euros par an (voir graphique ci-après).
Effet du phénomène de repyramidage
des effectifs
sur les charges de personnel annuelles du Cerema
(2017-202560(*))
(en milliers d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
L'effet haussier sur les charges de personnel du phénomène de repyramidage se lit également dans l'évolution du coût annuel moyen par agent (voir graphique ci-après). Celui-ci aura progressé de 19 % entre 2019 et 2025, passant de 73 500 euros à 87 314 euros.
Coût moyen de la rémunération par agent (2019-202561(*))
(en euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Le rapporteur observe que le mouvement de repyramidage a peut-être aujourd'hui atteint ses limites. Ce mouvement est désormais gelé. Il souligne également que le cas échéant, sans remettre en question la stratégie de l'établissement, s'il apparaissait que le phénomène avait été poussé trop loin dans certains secteurs, notamment sur des postes d'encadrement ou de chargés de mission, il pourrait être envisagé des ajustements au cas par cas susceptibles de générer quelques économies sur la masse salariale.
b) Comment se répartissent les dépenses du Cerema entre ses différents domaines d'intervention ?
Si la décomposition des dépenses du budget du Cerema continue de faire la part belle à ses domaines historiques d'expertise, au premier rang desquels les infrastructures de transport, les évolutions stratégiques récentes de l'opérateur conduisent à un phénomène de diversification. Ainsi, pour 100 euros dépensés par le Cerema, 32 euros seront consacrés aux infrastructures de transports mais également 22 euros à l'environnement et la gestion des risques ou encore 21 euros aux mobilités.
Décomposition par domaines d'intervention
de 100 euros
du budget du Cerema en 2025
(en euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après le programme d'activité 2025 du Cerema
Les dépenses du Cerema peuvent également être décomposées selon les modalités d'intervention de l'opérateur, selon qu'il s'agisse de prestations d'accompagnement direct des acteurs des territoires mais aussi d'activités de recherche, de diffusion et de valorisation des connaissances ou encore de normalisation et de participation à la réglementation technique.
Cette analyse montre que la majorité de l'activité du Cerema (57 % en 2025) consiste en des interventions visant à accompagner les acteurs des territoires dans leurs projets, que ce soit les collectivités ou bien les services déconcentrés de l'État. Ses missions de normalisation et de contribution à la réglementation technique représentent également près d'un quart des activités du Cerema. La recherche occupe une part croissante dans les activités du Cerema. Elle représente en effet 11 % du programme d'activité 2025 contre seulement 7 % en 2024.
Décomposition par modalités d'intervention des activités du Cerema en 2025
(en %)
Source : commission des finances du Sénat, d'après le programme d'activité 2025 du Cerema
c) Le plan de retour à l'équilibre mis en oeuvre en 2025 : un effort indispensable de maîtrise des dépenses de fonctionnement
La hausse des dépenses de fonctionnement constatée depuis 2022 (voir supra) nécessitait, comme le CGDD l'avait indiqué au rapporteur à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2025, de « travailler sur des pistes d'économies pérennes »62(*).
La contrainte budgétaire extrêmement forte qui a suivi l'adoption de la loi de finances pour 2025, du fait de la baisse sensible de la SCSP du Cerema qu'elle a prévu, a rendu impératif la conception et la mise en application d'un plan de retour à l'équilibre.
Pour la seule gestion 2025, ce plan prévoit des économies de 19,5 millions en autorisations d'engagement (AE) et de 16,4 millions d'euros en crédits de paiement (CP). L'effort représente environ 6 % des dépenses structurelles de l'établissement, ce qui n'est pas négligeable.
Décomposition en crédits de paiement
(CP) des économies
prévues dans le cadre du plan de retour
à l'équilibre du Cerema
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
En CP, ce plan de retour à l'équilibre porte d'une part, pour deux tiers (11,1 millions d'euros), sur les charges de personnel (5,9 millions d'euros) et les dépenses de fonctionnement (5,2 millions d'euros) et, d'autre part, pour un tiers, sur les dépenses d'investissement (5,3 millions d'euros).
Alors qu'il existe des besoins majeurs en la matière qui déterminent la capacité de l'établissement à préserver ses moyens d'expertise technique (voir infra), le rapporteur insiste sur le fait que les dépenses d'investissement ne peuvent pas redevenir durablement la variable d'ajustement qui permettrait d'équilibrer la situation financière du Cerema. Une telle perspective, véritable « fuite en avant », serait délétère et compromettrait l'avenir de l'établissement. Dans le cadre des orientations stratégiques lisibles et de long terme qu'elles devront tracer pour le Cerema (voir infra), ses tutelles devront veiller à ce que ce « scénario noir » ne se réalise pas.
Comme cela a été indiqué dans les développements supra, à lui seul, ce plan ne permet pas de rééquilibrer la situation budgétaire de l'établissement qui affiche un déficit structurel estimé entre 15 et 20 millions d'euros par an. Or, d'après le Cerema et le CGDD, ce plan de retour à l'équilibre, dont les mesures en fonctionnement et en charges de personnel doivent être pérennisées, constitue « l'économie maximale que l'établissement peut atteindre tout en préservant son niveau d'activité actuel ». L'un comme l'autre souligne la tension qu'il génère au sein du corps social de l'établissement.
Un effort d'économies supplémentaire passerait nécessairement par une réduction du périmètre des missions de l'opérateur, une décision qui devrait nécessairement être prise et assumée par ses tutelles et non laissée une fois encore à la responsabilité de la seule direction de l'établissement. Le rapporteur réitère à nouveau sa mise en garde en la matière : l'État doit dorénavant donner un cap stratégique clair et cohérent au Cerema et arrêter de lui imposer des injonctions contradictoires. Si l'État décide que le Cerema doit à nouveau « réduire sa voilure », c'est à ses tutelles, en coordination avec les directions d'administrations centrales bénéficiaires des activités de l'opérateur, de prendre leurs responsabilités pour lui signifier les missions auxquelles il devra renoncer.
4. Un niveau de trésorerie non fléchée déjà dans le rouge
Depuis 2020, le niveau de trésorerie global de l'établissement s'est sensiblement accru en raison des programmes d'intervention qu'il a été conduit à piloter, notamment dans le cadre du plan de relance (voir supra).
Niveau de trésorerie du Cerema en fin d'année (2019-2024)
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Le graphique ci-après retrace les financements fléchés qu'a reçu le Cerema dans le cadre de ces programmes et qui ont conduit à faire gonfler provisoirement la trésorerie de l'établissement.
Financements fléchés perçus par le Cerema (2017-2024)
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires du Cerema
Dans la mesure où le Cerema ne dispose pas de cette trésorerie fléchée qui devra in fine être redistribuée aux bénéficiaires finaux des programmes concernés, il est essentiel de suivre le niveau de la trésorerie non fléchée, c'est-à-dire structurelle, de l'établissement.
Or, celle-ci ne représentait à la fin de l'année 2024 que 19,9 millions d'euros, soit tout juste le seuil prudentiel exigé par la circulaire du Premier ministre datée du 23 avril 2025, c'est-à-dire la garantie d'un mois de fonctionnement courant.
En 2025, le niveau de trésorerie non fléchée du Cerema est d'ores et déjà passé sous le seuil prudentiel. À la fin de l'année, les prévisions les plus actualisées évaluent son niveau à environ 3,5 millions d'euros. Sans le plan de retour à l'équilibre, la trésorerie non fléchée aurait même basculé en territoire négatif dès cette année.
Le rapporteur constate que cette situation inquiétante est amenée à s'aggraver en raison du déficit budgétaire structurel du Cerema. Si rien n'est fait d'ici-là, elle deviendra alarmante dès 2026, menaçant de façon très concrète la pérennité financière de l'opérateur (voir infra).
B. UN ÉTABLISSEMENT FINANCIÈREMENT EN SURSIS
Dans un rapport daté du mois de juin 202163(*), le conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et l'inspection générale de l'administration (IGA) avaient « tiré la sonnette d'alarme » quant à la situation et aux perspectives financières du Cerema. Leur constat était sans appel. « Non soutenable depuis son origine », « la trajectoire financière et budgétaire » de l'établissement ainsi que le « déséquilibre structurel » de son modèle économique engageaient « son pronostic vital ». Le rapport signalait déjà un phénomène de « cavalerie financière » qui ne pouvait être viable sur le long terme.
Synthèse des alertes sur la situation et
les perspectives financières
du Cerema ainsi que sur l'exercice de sa
tutelle formulées en juin 2021
par la mission inter-inspections
consacrée au rôle du Cerema
en matière d'appui aux
collectivités territoriales
Selon le rapport de la mission, « la trajectoire financière et budgétaire » du Cerema « engage son pronostic vital ». Elle est « non soutenable depuis son origine ». Son modèle économique est en « déséquilibre structurel » depuis sa création.
Le rapport souligne notamment que « le budget n'a jamais été' en mesure de dégager un excédent d'exploitation susceptible d'alimenter une capacité' d'autofinancement pour ses investissements : l'intégralité' des investissements réalisés (a` un niveau cependant très insuffisant) l'a été' a` partir d'opérations additionnelles ou circonstancielles de régulation (opérations fléchées notamment) ainsi que par un mécanisme de « cavalerie financière » s'appuyant sur le décalage des flux en recettes et en dépenses de ces opérations additionnelles ou circonstancielles, dont le volume est devenu croissant avec le temps. En d'autres termes, une partie des investissements non pris en charge directement par des ressources additionnelles a été' financée en flux, a` partir de droits constatés de décaissements futurs sur d'autres opérations additionnelles ».
La mission soulignait l'injonction paradoxale à laquelle est soumise le Cerema alors que l'État réduit ses moyens en lui demandant d'augmenter ses ressources propres mais sans formaliser de diminution des prestations délivrées par l'établissement aux services de l'État : « il ne peut y avoir de développement de recettes propres nettes dans un contexte de maintien ou de diminution continue de la capacité' globale de production, avec une forte baisse des effectifs, sans la fixation préalable a` due proportion d'un objectif identifie' et assume' de diminution des prestations d'ingénierie pour le compte de l'État ce qui n'a pas été' fait, ni en 2014, ni depuis ».
Le rapport soulignait que « les injonctions paradoxales adressées au Cerema aboutissent a` une impasse ». Il ajoutait que « le modèle économique adopté pour le Cerema a engagé l'établissement sur une trajectoire financière, mortifère dans le temps ».
La mission considérait que « pour mettre en oeuvre ce projet stratégique, comme pour asseoir la crédibilité' du projet de transformation de l'établissement en agence commune a` l'État et aux collectivités locales, le maintien a` leur niveau actuel du nombre d'emplois (2 600) et de la subvention pour charge de service public (SCSP) apparait comme une condition essentielle ».
Enfin, le rapport pointait ce qu'il considérait comme des manquements de la part de l'État. La mission qualifiait à ce titre que les tutelles de l'établissement de « lacunaires » et elle leur reprochait « l'absence de définition d'une stratégie de l'établissement ».
Source : commission des finances du Sénat, d'après le rapport de la mission conduite par le CGEDD et l'IGA sur « le rôle du Cérema en matière d'appui aux collectivités territoriales : renforcer son activité au bénéfice des collectivités locales », juin 2021
Au regard de la situation actuelle, force est de constater que bon nombre des constats réalisés par les inspections en 2021 étaient justifiés. Alors que dès la fin de l'année 2021 le rapporteur avait interpelé le Gouvernement sur les conclusions de ce rapport lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2022, il regrette que le travail des inspections n'ait pas été suffisamment pris au sérieux.
1. La cavalerie budgétaire à laquelle le Cerema a été contraint par l'État s'apparente à une véritable « fuite en avant »
Compte-tenu de son déséquilibre budgétaire structurel, accru en 2025 par une nouvelle baisse de sa SCSP conjuguée à une hausse sensible de sa masse salariale, le Cerema n'a eu d'autre choix que de mobiliser sa trésorerie fléchée, notamment celle qu'il est tenu de redistribuer aux collectivités dans le cadre du programme « ponts », pour assurer ses dépenses courantes, en particulier ses charges de personnel.
Suffisamment inhabituel pour être signalé et symbolique de la gravité de la situation, dans une motion du 22 octobre 2024 relative aux moyens financiers du Cerema64(*), le conseil d'administration de l'établissement avait lui-même revendiqué la nécessité de recourir à cette forme de « cavalerie budgétaire ». La motion soulignait ainsi que l'effort financier demandé au Cerema était « totalement impossible dans son épure budgétaire sauf à toucher aux crédits d'intervention ». Elle était même plus explicite en précisant que si la baisse de sa SCSP prévue par le projet de loi de finances devait être confirmée, « l'établissement serait ainsi contraint, pour assurer son fonctionnement, déjà resserré autour des missions opérationnelles, de prendre sur les moyens votés par le Parlement, consacrés aux collectivités (programme ponts, etc) ». Or, la diminution a finalement été accrue de 2 millions d'euros en cours d'examen.
Le principe de « cavalerie budgétaire » a ensuite été validé par ce même conseil d'administration via l'adoption du budget initial pour 2025. Dans les réponses faites au rapporteur, le Cerema lui a confirmé la nécessité d'utiliser au cours de la gestion actuelle des fonds issus de sa trésorerie fléchée pour honorer ses dépenses courantes : « dans un contexte de réfaction de la dotation servie par l'État au titre de la SCSP, les crédits mobilisés pour l'allocation de ces subventions constituent de la trésorerie qui supporte les besoins de l'établissement en termes de fonds de roulement nécessaire à son fonctionnement »65(*).
La situation a pu être améliorée par la mise en oeuvre d'un plan de retour à l'équilibre, mais n'est bien évidemment pas viable et s'apparente à une véritable « fuite en avant » financière.
Le paradoxe est que tout en regrettant cette situation, l'État a pu dans le même temps justifier la baisse significative de sa SCSP imposée au Cerema, notamment en 2025, par le fait que, contrairement à d'autres de ses homologues, notamment du programme 159, il disposait d'un niveau de trésorerie élevé qui lui permettrait de supporter cet effort. Pour le rapporteur, cette situation est un cas d'école symptomatique des injonctions contradictoires devant lesquelles le Cerema a pu être placé par l'État au cours de ces dernières années.
Le rapporteur s'étonne tout de même que l'État ait pu se résoudre à un système aussi « baroque » et aussi éloigné des règles élémentaires de bonne gestion des deniers publics. Il ne serait bien évidemment pas raisonnable de poursuivre sur cette voie sauf à vouloir « reculer pour mieux sauter » et retenir une vision « court-termiste ».
2. Alors que sa trésorerie sera épuisée en 2027, le « compte à rebours » de la survie financière du Cerema est lancé
Les trajectoires financières prévisionnelles du Cerema les plus actualisées sont extrêmement préoccupantes. En retenant des hypothèses de stabilisation de sa SCSP et de ses effectifs, d'une augmentation modérée de ses ressources propres, d'une baisse significative de ses dépenses de fonctionnement, liée notamment à la pérennisation des mesures prises dans le cadre du plan de retour à l'équilibre de 2025, le déficit budgétaire de l'établissement continuerait de se creuser jusqu'à approcher les 47 millions d'euros en 2027.
Dépenses, recettes et solde budgétaire prévisionnelle du Cerema à horizon 2027
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Ces modélisations financières prévoient que la trésorerie globale du Cerema, intégrant la trésorerie fléchée, basculerait en territoire négatif en 2027. Cette situation pourrait même intervenir plus tôt si certaines des hypothèses retenues n'étaient pas vérifiées. Le rapporteur constate que le Cerema est engagé dans une impasse financière manifeste, et ce, à très court terme. Une analyse plus fine révèle que la trésorerie non fléchée de l'établissement, la seule dont il dispose réellement, deviendra quant à elle négative dès 2026.
Un des scénarii envisagés pour atténuer cet effondrement rapide de la trésorerie de l'établissement serait de ralentir le rythme de décaissement des dépenses d'intervention liées aux grands programmes. Cependant, cette solution ne ferait que décaler encore un peu plus la résolution des problèmes structurels du Cerema. En outre, elle créerait une situation de tension entre l'établissement et ses partenaires, susceptible de nuire à sa réputation. Cette méthode ne consisterait une nouvelle fois qu'à « reculer pour mieux sauter ».
Trésorerie prévisionnelle en fin d'année du Cerema à horizon 2027
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
III. UN PATRIMOINE IMMOBILIER CONSÉQUENT, DANS UN ÉTAT DE DÉGRADATION INDIGNE, ET UN PARC D'ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES À PRÉSERVER
A. INDISPENSABLES AU MAINTIEN DES CAPACITÉS D'EXPERTISE DU CEREMA, SES INVESTISSEMENTS NE DOIVENT PAS REDEVENIR UNE VARIABLE D'AJUSTEMENT BUDGÉTAIRE SAUF À HYPOTHÉQUER L'AVENIR DE L'OPÉRATEUR
Jusqu'en 2022, les dépenses d'investissement étaient particulièrement insuffisantes, oscillant entre 5 et 8 millions d'euros par an. Faisant les frais de la contrainte appliquée aux moyens financiers de l'opérateur ses dépenses d'investissement étaient alors utilisées comme des variables d'ajustement budgétaire. Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2022, le rapporteur avait alerté le Gouvernement sur les risques d'une situation de nature à compromettre les capacités d'expertise du Cerema et par là à hypothéquer à terme son avenir.
Le rapport précité de juin 2021 réalisé par la mission conjointe du CGEDD et de l'IGA avait notamment mis en garde contre le déficit chronique d'investissement très préoccupant du Cerema. Les montants d'investissement annuels de l'opérateur étaient alors très éloignés du plancher de 14 millions d'euros annuels que la mission estimait indispensable au maintien des capacités de l'établissement.
À la faveur notamment de financements alloués par le fonds pour la transformation de l'action publique (FTAP) dans le cadre de la transformation de l'établissement, les dépenses d'investissement du Cerema ont pu être portées à 14,3 millions d'euros en 2023 puis à 15,6 millions d'euros en 2024. Compte-tenu des contraintes budgétaires, le niveau des investissements de l'établissement pourrait se limiter à 12 millions d'euros en 2025.
Évolution des dépenses d'investissement du Cerema depuis 2017
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Les dépenses d'investissement du Cerema se décomposent en quatre grands ensembles : les équipements scientifiques et techniques, l'informatique, les travaux immobiliers et la flotte de véhicules.
Pour les années à venir, le Cerema entend parvenir à consacrer au minimum 12 millions d'euros par an à ses dépenses d'investissement dans la perspective de « poursuivre l'investissement productif métier mais aussi de faire quelques travaux de remise en état immobilière »66(*).
Le rapporteur considère qu'il est en effet indispensable de sanctuariser un volume d'investissement minimum, dont le bon seuil semblerait plutôt se situer autour de 15 millions d'euros, faute de quoi l'établissement creuserait encore davantage sa « dette grise ». Malgré les difficultés budgétaires du moment, il est impératif de ne pas céder à la facilité d'utiliser les dépenses d'investissement comme une variable d'ajustement sauf à réenclencher une spirale d'obsolescence lourde de menace pour le futur de l'établissement.
B. UN PATRIMOINE IMMOBILIER HÉRITÉ DU PASSÉ DANS UN ÉTAT DE DÉGRADATION INDIGNE
1. « Un cordonnier particulièrement mal chaussé »
À sa création, le Cerema a hérité d'un parc immobilier aussi vaste que vétuste qui cumule aujourd'hui une série de problèmes. Sur les 180 bâtiments du Cerema (240 000 m2), datant pour la plupart des années 1970 voire avant, 170 sont en très mauvais état.
La vétusté de nombre d'emprises du Cerema n'offre pas de conditions de travail décentes aux personnels qui y travaillent, exposés notamment à des amplitudes thermiques très inconfortables. La performance énergétique catastrophique de nombreux bâtiments du Cerema, assimilables à des « passoires thermiques », génère des surconsommations d'énergie massives tout comme les coûts qu'elles induisent pour le budget de l'établissement. Les bâtiments de l'opérateur sont également très peu adaptés aux personnes en situation de handicap. Par ailleurs, du fait de son ancienneté, le patrimoine immobilier de l'opérateur est concerné par la présence d'amiante. Enfin, l'ampleur du parc immobilier dont il a hérité à sa création n'est plus calibré pour les effectifs actuels du Cerema. Avec une moyenne de 32,8 m2 par agent, sa sous-densité le place très loin des standards recommandés par la direction de l'immobilier de l'État (DIE).
Les laboratoires d'essais, dont certains ont été visités par le rapporteur au cours de ses déplacements, représentent 37 % de la surface bâtie du Cerema et présentent un degré de vétusté particulièrement flagrant. L'établissement souligne qu'ils « n'ont pas pu être modernisés, faute de moyens, à hauteur des enjeux et des exigences imposées par notre niveau d'expertise. Des actions ponctuelles ont été menées pour assurer le strict cadre réglementaire obligatoire des essais, et ces surfaces demandent à être repensées en termes d'environnement maitrisé, d'acoustique, de conditions de travail et de secours électrique »67(*).
Le rapporteur observe que cette situation peut, à certains égards, être considérée comme un comble pour un opérateur qui fait figure de référence en matière d'expertise relative à la performance énergétique des bâtiments. Si les partenaires du Cerema s'en tenaient à l'état des bâtiments dans lesquels l'opérateur les accueille, ce qui fort heureusement n'est pas le cas, ils pourraient légitimement être animés de quelques doutes.
Les organisations syndicales entendues par le rapporteur ont notamment souligné ce paradoxe qui peut tout de même, d'après elles, fragiliser la crédibilité de l'opérateur. Le représentant de l'une d'entre-elles soulignait à ce titre que « la question de la légitimité de l'opérateur peut être amenée à se poser lorsqu'il ne peut pas lui-même rénover ses bâtiments quand bien même cela constitue l'une de ses compétences » ; la situation est la même « lorsqu'un client reçu au Cerema constate des trous dans la chaussée des voies d'accès à ses locaux ».
Le CGDD, tutelle métier de l'établissement, confirme que les travaux immobiliers qu'a été en capacité de réaliser le Cerema à ce jour sont très loin du compte et ont principalement consisté à répondre à des situations d'urgence susceptibles de menacer la sécurité des personnels : « le parc immobilier du Cerema est vétuste. Les opérations courantes et travaux ponctuels jusqu'en 2021 n'ont permis qu'un maintien en état d'usage très relatif pour pallier les situations d'insécurité pour les occupants »68(*).
2. Entre les enjeux de cessions et de rénovations, un système actuel qui tend à rendre l'équation impossible pour le Cerema
Ayant fait le constat de la sous-densité de son patrimoine immobilier, le Cerema souhaite n'en conserver pour ses propres services qu'environ la moitié. C'est dans cette perspective qu'il a proposé un schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) dans lequel il prévoit de concentrer ses activités sur 90 bâtiments.
Dans le cadre de la préparation de ce schéma, l'établissement a identifié sept sites devant faire l'objet de travaux de rénovation en priorité. Il s'agit des sites de Bron/Lyon, Aix-en-Provence, Rouen, Trappes, Toulouse, Nancy et Saint-Médard-en-Jalles/Bordeaux, soient les sites de production les plus importants du Cerema, disposant des plus grandes surfaces de bâti occupées (plus de 6 000 m2).
Les étapes et le calendrier prévisionnel du programme de rénovation de ces sept sites sont prévus par le Cerema de la façon suivante :
- diagnostic du parc en 2022 ;
- faisabilités et valorisation en 2023 ;
- établissement des programmes en 2023 et 2024 ;
- études en 2025 et 2026 ;
- réalisation des travaux entre 2026 et 2030.
Par ailleurs, l'établissement prévoit un programme de rénovation (un projet de « gros entretien renouvellement » ou « GER ») plus progressif, pour un coût annuel moyen de 2,2 millions d'euros, dans le but de maîtriser la dégradation du reste de son parc immobilier « avec des opérations anticipées à fort retour sur investissement, par exemple des remplacements de production de chaleur ou des opérations d'étanchéité et d'isolation des toitures assorties de mise en place de panneaux photovoltaïques »69(*).
D'ici à 2030, le coût total cumulé des travaux immobiliers prioritaires identifiés par le Cerema représenterait près de 100 millions d'euros avec des pics de dépenses attendus entre 2028 et 2030.
Besoin d'investissements immobiliers identifiés par le Cerema d'ici à 2030
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Dans son SPSI, le Cerema a également réalisé un exercice théorique d'évaluation du coût que représenterait la remise en état de l'intégralité de son parc immobilier actuel afin notamment de le rendre conforme aux normes réglementaires prévues par le décret tertiaire. Ce coût avoisinerait les 400 millions d'euros.
Compte tenu de sa situation et de ses perspectives financières actuelles, le Cerema n'a pas les moyens de financer par lui-même les rénovations les plus urgentes de son patrimoine immobilier. Pour cela, il envisage de recourir à plusieurs leviers.
Il souhaiterait premièrement pouvoir financer une part de ces travaux par la valorisation d'une partie de son patrimoine. Outre des revenus de location, il souhaiterait pouvoir récupérer des revenus de cession que l'État percevrait de la vente de certains éléments du patrimoine aujourd'hui occupé par le Cerema.
Deuxièmement, le Cerema, soutenu en ce sens par le CGDD, a sollicité à l'État l'allocation d'une subvention spécifique pour la rénovation de son patrimoine immobilier sur la période s'étalant entre 2026 et 2030. En cumul sur la période, la subvention demandée atteindrait environ 49 millions d'euros (voir graphique ci-après).
Enfin, troisièmement, une fois son SPSI approuvé, le Cerema entend candidater à des appels à projets de la direction de l'immobilier de l'État (DIE).
Subventions demandées par le Cerema pour
financer la rénovation
de ses sept implantations identifiées
comme prioritaires
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Le projet de SPSI du Cerema a été présenté en conseil d'administration en mars 2024 et le CGDD a indiqué au rapporteur en soutenir pleinement les principes : « le CGDD s'est positionné en accord avec les grands principes de la stratégie présentée dans ce document SPSI : maintien du maillage territorial, rationalisation du parc immobilier en accord avec les indicateurs de la DIE, engagement urgent des travaux sur des sites prioritaires »70(*). Cependant, le rapporteur a été informé que ce SPSI fait l'objet de réserves substantielles de la DIE qui ne l'a toujours pas approuvé.
Dans le même temps, la direction du Cerema, estime qu'au titre de cessions déjà réalisées pour un total de 6,5 millions d'euros, la DIE aurait dû lui reverser 50 % des revenus de cession, soit environ 3,2 millions d'euros. Plus généralement, la mobilisation de 50 % du produit des cessions futures pour financer la rénovation des bâtiments qui seraient conservés par le Cerema est un élément central du modèle de financement envisagé par l'établissement. Pourtant, cette affectation ne serait pas garantie, le ministère en charge de l'écologie réclamant de pouvoir disposer de ces sommes.
Dans un tel contexte, le rapporteur observe que l'opérateur ne disposerait d'aucune incitation à optimiser son parc immobilier. Il constate que la situation est aujourd'hui paralysée, aggravant la dégradation des conditions de travail des personnels de l'établissement. Il est impératif que les tutelles de l'établissement et la DIE parviennent à débloquer cette situation au plus vite comme le CGDD l'a assuré au rapporteur dans ses réponses écrites : « comme la DIE, le CGDD fera le maximum pour soutenir l'établissement dans la mise en oeuvre de sa stratégie immobilière ».
C. ATOUT STRATÉGIQUE DU CEREMA, SON PARC D'ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DOIT ÊTRE MAINTENU À NIVEAU
Son parc d'équipements scientifiques et techniques constitue pour le Cerema un actif stratégique qui détermine ses facultés à faire valoir son expertise. D'une valeur estimée à environ 100 millions d'euros, ce parc se compose d'environ 1 700 équipements d'une valeur unitaire supérieure à 10 000 euros. Ces équipements sont répartis entre 20 implantations (laboratoires ou départements d'études). Environ la moitié de ces équipements sont des matériels ou installation fixes en laboratoires, l'autre moitié est composée des équipements d'essais, de mesures ou de prélèvements in situ.
Indispensables à l'accomplissement des missions du Cerema ces équipements sont notamment employés pour la réalisation d'expertises, d'études, d'essais et de contrôles mais également pour les activités de recherche et d'innovation ou encore de certification.
Or, à l'orée de la décennie 2020, ce parc présentait des signes inquiétants d'obsolescence. En effet, comme l'avait souligné le rapport précité du CGEDD et de l'IGA en 2021, les investissements annuels en la matière étaient très insuffisants. Cette situation menaçait les capacités de production et d'expertise de l'établissement. Le Cerema a confirmé au rapporteur la situation critique dans laquelle se trouvait son parc d'équipement au début des années 2020. L'établissement a en effet « vu ce parc se dégrader et vieillir au fil des années, avec une obsolescence qui a été amplifiée par des montants d'investissement insuffisants pour son maintien à niveau »71(*).
Au début des années 2020, le parc des équipements scientifiques et techniques du Cerema présentait des signes d'obsolescence préoccupants
De nombreux matériels utilisés par le Cerema n'ont pu être renouvelés les années passées faute d'investissement suffisants. Pourtant, ces matériels continuaient d'être utilisés pour assurer la continuité de l'activité, mais avec un fonctionnement dégradé et des difficultés liées au vieillissement des matériels qui tombaient souvent en panne avec des coûts importants de maintenance et de réparation.
L'obsolescence pouvait aussi porter sur des technologiques anciennes qui continuaient d'être utilisées, en décalage avec les outils plus modernes existants sur le marché (par exemple, des matériels avec des systèmes de pilotage informatiques sous DOS, ou des capteurs d'anciennes générations peu performants).
À titre d'exemple, les matériels d'essais sur les matériaux de chaussées dont plusieurs avaient plus de 30 ans, ont pu être renouvelés, pour la plupart d'entre eux, via le plan exceptionnel d'investissement mis en place par le Cerema en 2022 et 2023
Source : réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Afin de traiter ces phénomènes d'obsolescence, le Cerema a lancé un plan d'investissement exceptionnel, spécialement consacré à son parc d'équipements, qu'il a déployé entre 2022 et 2023 pour un montant de 5,3 millions d'euros qui s'est ajouté à l'enveloppe d'investissement courante, soit plus de 7 millions d'euros investis sur ces deux années.
Dépenses d'investissement consacrés
au renouvellement
des équipements scientifiques et techniques du
Cerema (2019-2024)
(en millions d'euros et en nombre d'équipements)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
En réponses au questionnaire du rapporteur, le Cerema a souligné l'importance du rattrapage d'investissements qui a pu être réalisé à partir de 2022 : « les investissements réalisés ces dernières années, et en particulier le plan exceptionnel d'investissement de 2022 - 2023, ont permis de moderniser et développer de manière ciblée le parc d'équipement existant sur des activités stratégiques portées par le Cerema, et notamment les six laboratoires interrégionaux du Cerema ainsi que les pôles spécialisés mises en place lors de Cerem'avenir »72(*).
Il convient désormais de veiller à maintenir à niveau ce parc d'équipements si essentiel pour le Cerema. Pour cela, un niveau d'investissement annuel minimum de 1,5 million d'euros est requis.
Au-delà de ces dépenses de renouvellement courant nécessaires pour maintenir en état le parc actuel, des investissements complémentaires seront ponctuellement nécessaires pour moderniser les équipements du Cerema afin que les capacités et l'expertise de l'établissement ne se retrouvent pas frappées d'un déclassement technologique. Le Cerema aura notamment besoin de moderniser ses « outils d'auscultation des chaussées ou d'ouvrages d'art avec des méthodes plus innovantes et automatisées (certaines méthodologies utilisées aujourd'hui pour ausculter un patrimoine d'infrastructure sont en effet dépassées et peuvent être largement optimisées et rendues plus efficientes). Ces nouvelles méthodologies innovantes passent par des nouvelles méthodes d'acquisition des données (mesures) et donc de nouveaux matériels »73(*).
QUATRIÈME PARTIE
L'IMPÉRATIF DE S'EXTRAIRE
D'UNE NAVIGATION BUDGÉTAIRE « À VUE »
VOUÉE À L'ÉCHEC :
DANS UN CONTEXTE
BUDGÉTAIRE CONTRAINT,
L'ÉTAT DOIT ASSUMER DES CHOIX
STRATÉGIQUES POUR L'AVENIR DU CEREMA
I. DES PRÉALABLES INDISPENSABLES : LA DÉFINITION DES MISSIONS « SOCLES » DE L'ÉTABLISSEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT D'UNE VÉRITABLE COMPTABILITÉ ANALYTIQUE
Sa situation et ses perspectives financières démontrent que le Cerema se trouve aujourd'hui à un point de bascule existentiel. D'ici 2027, année au cours de laquelle il se retrouverait matériellement en situation de « faillite », l'État doit impérativement lui donner une orientation stratégique claire et financièrement soutenable. Ses tutelles ont la responsabilité de lui dresser le cadre d'un modèle économique viable à long terme. Indispensable à la pérennité de l'établissement, l'impératif de visibilité doit dorénavant se substituer à l'incertitude permanente d'un pilotage budgétaire annuel, voire infra-annuel, « à vue », sans cap ni boussole, dont la poursuite aboutirait naturellement à l'impasse financière annoncée.
Le premier des choix stratégiques que devront assumer les tutelles du Cerema consiste à détourer précisément ce qui relève des missions de service public « socles » de l'établissement, c'est-à-dire ses activités dont le coût de production a vocation à être intégralement compensé par sa subvention pour charges de service public (SCSP). Les autres activités du Cerema auront vocation à être rémunérées ou, a minima, cofinancées selon des règles harmonisées dont le cadre aura été fixé par la tutelle de l'établissement. Cette clarification du modèle de financement du Cerema est conditionnée par la généralisation à l'ensemble de ses activités d'une comptabilité analytique plus fine permettant d'identifier le coût complet exhaustif des prestations qu'il réalise pour chacun de ses partenaires.
A. L'ÉTAT DOIT ENFIN DÉFINIR PRÉCISÉMENT LES ACTIVITÉS « SOCLES » DE L'ÉTABLISSEMENT ET LE RÔLE QU'IL ENTEND AINSI LUI DONNER
Lors de son contrôle, le rapporteur a constaté que les missions de service public « socles » du Cerema ayant vocation à être financées par sa SCSP n'avaient jamais été précisément définies. En conséquence, à ce jour, en l'absence de délimitation de ce périmètre, il n'est pas possible d'évaluer le calibrage approprié des moyens alloués à l'opérateur et en particulier le « bon » niveau de sa SCSP.
Le rapporteur observe que ce « flou » est très insécurisant pour l'établissement puisqu'il ne dispose d'aucune garantie quant au maintien d'un niveau de dotation suffisant pour lui permettre d'assurer ses missions de service public les plus essentielles. Cette situation est également très critiquable d'un point de vue de bonne gestion des deniers publics dans la mesure où l'État n'a jamais défini clairement les activités de l'établissement pour lesquelles il devait lui verser une dotation et, par exclusion, celles qui devaient être rémunérées par leurs bénéficiaires.
Le rapporteur constate qu'à ce jour, le calcul du montant de la SCSP du Cerema ne repose pas sur l'évaluation rationnelle des coûts de production de l'établissement sur un périmètre de missions de services public essentiel ayant vocation à être financé par une dotation annuelle du budget de l'État. Ce calcul ne repose que sur un exercice, réalisé chaque année lors de préparation du projet de loi de finances, consistant à estimer la baisse de dotation que le Cerema serait à même de supporter au regard notamment de l'évaluation du potentiel de développement de ses ressources propres. Ce procédé de budgétisation « rustre » a conduit au creusement d'un important déficit structurel et, par voie de conséquence, à l'impasse financière actuelle.
Par ailleurs, comme il a déjà pu le souligner, le rapporteur considère que le système actuel, par lequel les missions socles de l'établissement sont négociées entre le Cerema lui-même et les directions d'administrations centrales n'est pas satisfaisant.
Conscient de cette situation, le CGDD a signalé au rapporteur qu'il entend, dans les mois à venir, en coordination avec l'établissement, les directions d'administrations centrales concernées et la direction du budget, réaliser un travail de définition du « socle » d'activité du Cerema. Ce travail aura vocation à se traduire dans une révision du décret constitutif de l'établissement. La tutelle métier du Cerema a précisé au rapporteur avoir engagé « la réflexion sur la soutenabilité du modèle économique de l'établissement afin d'assurer le financement à coût complet de ses activités socle, ses missions d'appui aux politiques publiques et ses activités concurrentielles ».
Recommandation n° 4 : définir les activités « socles » du Cerema ayant vocation à être financées par sa subvention pour charges de service public (SCSP).
B. L'ENJEU DE MESURER DE FAÇON EXHAUSTIVE LE COÛT COMPLET DES PRESTATIONS DÉLIVRÉES PAR LE CEREMA
La logique interne inhérente au modèle économique dual du Cerema, qui s'appuie à la fois sur des activités « socles » financées par la subvention pour charges de service public que lui verse chaque année le budget de l'État, et sur des activités commerciales destinées à être rémunérées par leurs bénéficiaires, suppose que l'opérateur dispose d'une comptabilité analytique très fine permettant d'établir une séparation rigoureuse entre les deux sphères. Parfois qualifié de « muraille de Chine », ce principe doit prévenir les phénomènes dits de « subventions croisées » par lesquels l'État ou les clients commerciaux de l'établissement seraient amenés à co-financer de manière détournée des activités qui ne relèvent pas de leur sphère.
En l'occurrence, plus précisément, l'État, et en particulier le ministère chargé des comptes publics, souhaite avoir la garantie que la SCSP du Cerema ne soit pas indirectement employée à financer des activités de nature commerciale à destination des collectivités ou d'autres partenaires du Cerema. Cette exigence indispensable est un principe élémentaire du bon usage des deniers publics. Pour être suffisamment robuste et crédible, une telle garantie ne peut passer que par une comptabilité analytique fine et rigoureuse permettant d'assurer une véritable étanchéité entre les deux composantes du modèle économique de l'opérateur.
Or, en 2021, le rapport précité du CGEDD et de l'IGA faisait le constat qu'une telle garantie n'existait pas : « la mission constate qu'a` ce jour la politique financière de l'établissement vis-a`-vis de ses clients collectivités locales n'apparait pas assez clairement. Pour obtenir 11,3 millions de recettes en 2020, il a fallu mobiliser 7 millions de dotation, contre 4,4 millions en 2019 pour 10 millions de recettes. Le Cerema considère que les 7 millions sont a` comptabiliser sur une base pluriannuelle. Il conviendra dans l'avenir, indépendamment de l'éventuelle évolution du cadre juridique, de mieux distinguer en termes de plan d'affaires les recettes attendues sans mobilisation de la dotation de l'établissement de celles nécessitant des cofinancements ».
Les tarifs des prestations commerciales du Cerema sont votés chaque année par son conseil d'administration. Ils sont établis en fonction du coût de revient complet journalier de l'établissement par grandes catégories d'agents : A +, A, B et C. Il est à noter que les collectivités adhérentes se voient appliquer un rabais de 5 % sur ces tarifs pour tenir compte du temps administratif « économisé » en raison du système de quasi-régie.
Dans le cadre des coopérations avec d'autres acteurs publics, le Cerema applique en 2025 les tarifs qui figurent dans la grille ci-dessous.
Grille tarifaire 2025 pour les
coopérations du Cerema
avec d'autres personnes publiques
(en euros par jour)
|
Catégorie de personnel |
Coût de revient complet journalier |
|
A + (expert de haut niveau) |
1 383 euros |
|
A (ingénieur - chargé d'étude) |
937 euros |
|
B (technicien supérieur) |
676 euros |
|
C (technicien d'essais) |
586 euros |
Source : réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Pour les prestations d'études, quelque soient les marchés et les clients concernés, la grille tarifaire est établie selon un prix de vente journalier défini par famille de fonctions type. Les tarifs en vigueur en 2025 sont présentés dans la grille ci-après.
Grille tarifaire 2025 pour les prestations d'études du Cerema
(en euros par jour)
|
Famille de fonctions type |
Prix de vente journalier hors taxes |
|
Expert de haut niveau |
1 450 euros |
|
Directeur de projet - directeur de recherche |
1 400 euros |
|
Chef de projet - chargé de recherche |
1 000 euros |
|
Ingénieur d'études senior |
950 euros |
|
Ingénieur d'études - chargé d'études |
750 euros |
|
Technicien supérieur - assistant d'études |
650 euros |
|
Technicien d'essais - projeteur |
600 euros |
Source : réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
D'après le Cerema et au regard d'études comparatives réalisées tous les ans avec les grilles des bureaux d'études privés, ces tarifs correspondent aux « standards de prix » du marché.
Afin d'améliorer la transparence du coût et des modalités de financement de ses différentes prestations, le Cerema a développé en 2021 une première forme de comptabilité analytique à partir d'un outil appelé Nova (voir encadré si-après). Destiné à suivre plus précisément le coût des activités de l'établissement, cet outil renseigné par les agents a été étendu à tous les personnels en 2025.
Présentation par le Cerema de sa nouvelle comptabilité analytique Nova
Une comptabilité analytique a été mise en place en 2021, à laquelle tous les agents sont désormais soumis, qui permet un suivi rigoureux des projets afin d'améliorer l'efficacité et la transparence des interventions.
Le suivi analytique de l'activité du Cerema inclut l'organisation matricielle de l'établissement, qui nécessite d'intégrer deux dimensions pour piloter les projets, tant au service des collectivités que de l'État : le portefeuille du secteur d'activité et l'échelle d'intervention (nationale, régionale). L'activité projets est suivie selon les 4 modalités d'intervention et des domaines thématiques.
Cette démarche repose sur l'outil Nova, une « solution logicielle de gestion de portefeuille de projets », qui fait l'objet d'une amélioration continue.
Depuis 2021, l'établissement mesure grâce à Nova :
- le nombre de jours travaillés sur projet par an par agent actif et par domaines d'activité ;
- la répartition des projets régionaux/nationaux ;
- répartition des projets par nature de financements tiers / mixte /SCSP ;
- l'activité croisée, c'est-à-dire les temps passés pour des projets d'autres directions.
Depuis 2024, la comptabilité analytique intègre une nomenclature budgétaire par destination permettant un suivi précis des recettes et des dépenses par destination avec une structuration en trois niveaux :
- activités (ex. production, recherche, diffusion des connaissances) ;
- domaines (ex. expertise territoriale, normalisation) ;
- secteurs (ex. mobilité, infrastructures).
Ce système apporte des données comparables à une comptabilité analytique, permettant une meilleure anticipation budgétaire, une optimisation des ressources et ainsi un pilotage plus fin.
Depuis le 1er juillet 2024 (pour une pleine opérationnalité au 1er janvier 2025), mise en place du suivi généralisé des temps :
- qui complète et prolonge la comptabilité par projets mise en place en 2021 ;
- et qui concerne désormais 100 % des agents du Cerema, y compris ceux des directions supports.
Source : réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Jusqu'à aujourd'hui, cet outil ne permettait cependant d'analyser qu'une partie limitée de l'activité de l'établissement. Ainsi, les résultats qu'a pu consulter le rapporteur ne portaient que sur les « projets » conduits par le Cerema, c'est-à-dire les activités de recherche, les essais et mesures en laboratoires, les expertises techniques ou les formations. Ils ne valorisaient pas à ce stade les activités d'appui à la production (développement commercial, animation réseaux locaux, montage de projets et facturation) ou encore les fonctions support (ressources humaines, finances, secrétariat général, services informatiques, communication).
Alors que l'évaluation exhaustive des coûts complets des activités réalisées par l'opérateur est une exigence très forte de sa tutelle financière dans le cadre des négociations budgétaires, il est essentiel que le Cerema affine sa comptabilité analytique. Il s'agit notamment de mesurer avec la plus grande précision possible le coût complet de ses activités commerciales pour pouvoir le comparer avec les ressources propres qu'il perçoit à ce titre. Cet élément constitue un enjeu de transparence et de crédibilité essentiel pour le Cerema vis-à-vis de sa tutelle financière. Susceptible d'objectiver les équilibres du modèle économique dual de l'opérateur, il semble être un préalable incontournable à la définition par l'État d'un cadre stratégique de long terme et soutenable financièrement pour l'établissement.
Cet enjeu paraît avoir été pris en compte par la tutelle métier de l'établissement. En effet, le CGDD a indiqué au rapporteur travailler avec le Cerema sur un projet de comptabilité analytique plus performant qu'aujourd'hui. Il souligne par ailleurs que « le contrat d'objectifs et de performance en cours de renouvellement prévoit que l'établissement s'appuie sur l'outil de comptabilité analytique pour assurer une plus grande transparence sur les différents flux de financement de ses missions auprès de la tutelle et de ses partenaires »74(*).
Recommandation n° 5 : développer et généraliser à l'ensemble des activités de l'établissement une comptabilité analytique plus fine, permettant d'identifier le coût complet exhaustif des différentes prestations réalisées par l'opérateur.
Au-delà de la question de la couverture du coût complet des prestations commerciales du Cerema par ses recettes tarifaires, il existe aujourd'hui un différentiel estimé par l'établissement à environ 40 millions d'euros par an entre le coût des activités qu'il délivre aux collectivités et les ressources propres qu'il perçoit de leur part. Cela signifie qu'au moins 20 % de la SCSP du Cerema sont aujourd'hui dirigés vers le financement de prestations aux collectivités. En effet, en 2024 alors que le total des dépenses engagées par le Cerema au titre de ses activités destinées aux collectivités avoisinerait les 60 millions d'euros, les prestations commerciales rémunérées par les collectivités n'ont rapporté que 21 millions d'euros à l'opérateur.
D'après le Cerema, cet écart aurait trois origines principales :
- les cofinancements à la charge de l'opérateur dans le cadre du déploiement de grands programmes nationaux et des sollicitations de l'ANCT ;
- les cofinancements de projets exploratoires (réutilisation des eaux usées, gestion du trait de côte, résorption des décharges littorales, etc.) ;
- le coût de l'animation territoriale au profit des collectivités (journées techniques, webinaires, formations, entretien - conseil, etc.).
II. DANS UN CONTEXTE DE TENSION BUDGÉTAIRE EXTRÊME, L'IMPÉRATIF DE DÉFINIR UN SCÉNARIO RÉALISTE ET STRUCTUREL PERMETTANT D'ASSURER L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE L'OPÉRATEUR SUR LE LONG TERME
A. MORTIFÈRE, LE PILOTAGE BUDGÉTAIRE « À VUE » DE TYPE « RABOT » A CONDUIT À L'IMPASSE FINANCIÈRE ACTUELLE
Le rapporteur estime que le pilotage budgétaire « à vue » de type « rabot » indiscriminé tel qu'il a été pratiqué ces dernières années pour le Cerema, a atteint ses limites. Celles-ci sont apparues de manière évidente, en 2025, lorsqu'en raison des contraintes budgétaires extrêmes dues à la dérive incontrôlée des finances de l'État, la baisse de la dotation annuelle du Cerema l'a contraint à recourir à un procédé de « cavalerie budgétaire » afin d'assurer sa survie financière à court terme. Ce constat, accablant s'il en est, témoigne à quel point le système, tel qu'il a fonctionné ces dernières années, n'est plus viable. Voie sans issue, mortifère, il a placé l'établissement au bord du gouffre financier.
Cette situation doit conduire à une réflexion profonde des tutelles de l'opérateur quant au rôle que l'État entend lui assigner, aux missions de service public essentielles qu'il doit assurer et aux moyens humains et financiers dont il doit disposer pour garantir la continuité de ces activités « socles ». Plus largement, l'État doit désormais donner à l'opérateur ce qu'il ne lui a pas encore accordé à ce jour, à savoir une visibilité de long terme et un cadre dans lequel il sera à même de déployer un modèle économique soutenable dans la durée.
Faute d'une vision stratégique de long terme, il n'est pas raisonnable d'exposer le Cerema et son corps social à la nécessité d'opérer chaque année des « bricolages budgétaires » destinés à faire entrer son budget dans « une cote mal taillée ».
Dans le même temps, l'établissement doit poursuivre ses efforts de productivité et continuer de mobiliser des gisements de ressources propres pour lesquels il a identifié certaines opportunités.
B. L'ÉTABLISSEMENT DOIT GAGNER EN PRODUCTIVITÉ ET MOBILISER DE NOUVEAUX GISEMENTS DE RESSOURCES PROPRES
1. Des gains d'efficience en termes d'organisation du temps de travail
Dans le cadre d'un projet de réforme de l'organisation du temps de travail des agents de l'opérateur, la direction du Cerema a identifié deux pistes de gains de performance potentiellement significatifs. Celles-ci font actuellement l'objet de négociations avec les organisations syndicales représentatives des personnels. La première consisterait à réviser les règles de compensation des temps de déplacement et la seconde viserait à forfaitiser le temps de travail des cadres.
Selon la direction du Cerema, l'expérience a en effet révélé « certains dysfonctionnements liés à la compensation des heures » des agents de l'établissement, « notamment lors des déplacements ». Un compteur spécifique a été institué à la création du Cerema pour recenser les heures de déplacement puis les récupérer. Le nombre d'heures ou de jours de récupération ne fait l'objet d'aucun plafonnement. D'après les chiffres transmis au rapporteur par la direction, en 2024, 2 512 agents du Cerema ont utilisé ce compteur, pouvant générer parfois plusieurs dizaines de jours de récupération sur une même année. Ainsi, en 2024, si 2 068 agents avaient pu générer de 1 à 12 jours annuels de récupération, 444 comptabilisaient plus de 12 jours. La direction estime que « la juxtaposition de ce régime de temps de trajet compensé avec le régime de récupération d'heures généré par les cycles d'horaires variables ainsi qu'avec le régime de congés annuels et de jours de réduction du temps de travail génère un impact important sur la productivité de l'établissement ».
La direction du Cerema estime que « des outils de suivi et une réflexion sur l'équilibre entre les heures effectuées et les heures compensées ont permis d'établir les bases d'un réajustement efficient des dispositifs existants »75(*). Aussi, une négociation sociale a-t-elle été lancée dans la perspective de modifier le règlement intérieur du temps de travail afin de plafonner le nombre maximum de jours de récupération de temps de déplacement.
La généralisation du forfait pour les 400 cadres de l'établissement vise, là encore, à contenir l'accumulation du nombre de jours de rattrapage qui pèse sur la productivité du Cerema.
Dans le contexte de forte contrainte budgétaire actuel, au regard de la situation financière de l'opérateur et pour donner à ses tutelles de nouveaux gages de gestion rigoureuse de ses moyens, il est important que, dans le cadre d'un dialogue social renforcé avec les organisations syndicales, l'établissement parvienne à dégager de nouveaux gains de productivité, y compris si nécessaire en faisant évoluer les règles de son organisation du travail.
2. Saisir les opportunités de l'intelligence artificielle
La diffusion de l'intelligence artificielle au sein des activités du Cerema semble constituer une piste prometteuse de gains d'efficience que l'établissement évalue à au moins 10 % d'ici à 2028.
Le Cerema a d'ores et déjà identifié neuf chantiers prioritaires qui sont autant de domaines dans lesquels le déploiement d'outils d'intelligence artificielle serait susceptible d'avoir l'incidence la plus sensible en matière de gains de performance. Il s'agit notamment des domaines de la gestion, des ressources humaines, de la rédaction (d'études, de guides, d'ouvrage, etc.) et de la retranscription, ou encore de la recherche documentaire.
Pour le Cerema, à terme, appliqués à l'ensemble de ses effectifs, les gains d'efficience permis par l'intelligence artificielle pourraient représenter entre 250 et 300 ETP et 12 % de sa masse salariale, soit près de 30 millions d'euros. Cependant, pour parvenir à ces résultats, le Cerema estime que les dépenses d'investissement nécessaires représenteraient de 2 à 3 millions d'euros par an.
Les projets de développement des outils
d'intelligence artificielle
pour améliorer la performance des
activités du Cerema
Pour atteindre ces résultats, plusieurs chantiers d'intelligence artificielle pourraient être déployés. Les fonctions support pourraient bénéficier d'outils automatisant les traitements administratifs, la comptabilité ou encore la gestion documentaire, avec des gains rapides à court terme. Dans la production de rapports et d'études, l'IA pourrait accélérer le traitement des données techniques, générer automatiquement des résumés ou aider à la rédaction, permettant une amélioration progressive sur le moyen terme.
Les chercheurs pourraient utiliser des outils d'IA pour analyser rapidement de grands ensembles de données ou modéliser des scénarios, ce qui optimiserait leurs projets. Enfin, des outils collaboratifs basés sur l'IA pourraient améliorer la coordination et la gestion des ressources humaines à l'échelle de l'établissement.
Source : réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
3. Des ressources propres complémentaires à chercher du côté des entreprises
Si ces dernières années il a d'ores et déjà largement mobilisé les différents leviers dont il disposait en matière de développement de ses ressources propres et que certains gisements, notamment s'agissant des collectivités, pourraient se tarir, au moins temporairement, en particulier du fait des contraintes renforcées qui pèsent sur les finances publiques, le Cerema comme ses tutelles s'accordent à considérer que certaines opportunités restent à saisir sur le segment des entreprises.
Les pistes du Cerema pour développer ses
activités commerciales
avec les entreprises
Le Cerema dispose de plusieurs leviers pour développer ses ressources propres auprès des entreprises privées. Parmi les principales pistes identifiées figure la valorisation de ses plateformes technologiques, en particulier le centre d'Expérimentation et de Recherche (CER) et la plateforme Pavin. Ces outils permettent de proposer des prestations de tests, d'essais, d'évaluations et d'accompagnement à l'innovation dans des domaines à forte demande de la part des industriels, notamment la mobilité intelligente, les infrastructures durables ou les matériaux innovants.
Le développement de l'activité de prototypage constitue également un axe de progression. Le Cerema possède un savoir-faire reconnu dans la conception de dispositifs techniques pour des applications spécifiques, notamment en instrumentation et suivi environnemental.
Enfin, l'international représente un levier important de croissance. Le Cerema peut intervenir pour le compte d'entreprises françaises engagées à l'export, en apportant son expertise technique dans le cadre de projets à l'étranger. Il peut également être sollicité directement par des entreprises étrangères.
Source : réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Les opportunités les plus sérieuses semblent concerner les activités de recherche et d'innovation du Cerema ainsi que le développement de ses activités de certification et d'homologation. D'ici à 2028, le Cerema vise ainsi une augmentation de 2 millions d'euros des ressources propres en provenance des entreprises.
Recommandation n° 6 : l'établissement doit activer les leviers dont il dispose pour réaliser des gains de productivité, notamment en matière d'organisation du temps de travail et de diffusion de l'intelligence artificielle, ainsi que pour développer les ressources propres qu'il perçoit au titre des prestations délivrées aux entreprises.
C. LE NÉCESSAIRE RENFORCEMENT DE LA TUTELLE DE L'ÉTABLISSEMENT
Comme il a déjà pu l'écrire dans les développements précédents du présent rapport, au cours de sa mission de contrôle, le rapporteur a fait le constat d'une tutelle de l'État sur l'établissement trop effacée.
Cette situation n'est d'ailleurs pas propre à l'exercice de la tutelle sur le Cerema. Certains vont jusqu'à considérer qu'il n'existe pas de « culture de la tutelle » au sein de l'administration de l'État. Pourtant, tous les acteurs s'accordent à dire que l'État disposerait en réalité de tous les leviers nécessaires à l'exercice d'une vraie tutelle sur ses opérateurs, qu'il s'agisse des objectifs qu'il fixe aux directeurs d'établissements qui peuvent faire varier sa rémunération annuelle jusqu'à 20 %, de la possibilité, le cas échéant, de révoquer ces mêmes directeurs ou bien encore celle de s'opposer à des délibérations.
Dans ces conditions, les directions des opérateurs disposent d'une (trop ?) grande latitude pour orienter les politiques publiques qui relèvent de leur domaine d'intervention, voire parfois pour étendre ce domaine. Ainsi, la rédaction de leurs différents projets stratégiques ou autres contrats d'objectifs et de performance est pour l'essentiel laissée à la liberté des opérateurs eux-mêmes, une caractéristique qui n'est pas de nature à garantir leur légitimité aux yeux des services du ministère chargé des comptes publics au moment des arbitrages budgétaires. En effet, comme c'est le cas pour le Cerema, cette latitude laissée aux opérateurs n'est souvent qu'un leurre puisqu'en réalité, elle les rend vulnérables aux coupes budgétaires décidées en loi de finances.
L'exercice de la tutelle du Cerema se trouve par ailleurs compliqué par son positionnement inconfortable entre le ministère chargé de la transition écologique et le ministère chargé de l'aménagement du territoire. Le rapporteur a le sentiment que cette situation n'incite ni l'un ni l'autre des ministères à se saisir pleinement de la tutelle de l'établissement.
En outre, et alors qu'il est par ailleurs mobilisé pour un très grand nombre d'autres missions, il faut reconnaître également que les moyens et le « poids » politique dans les arbitrages interministériels du commissariat général au développement durable (CGDD), tutelle métier de l'opérateur, sont trop limités.
Par ailleurs, l'exercice de la tutelle ne constitue pas son coeur de métier et, au sein de son organigramme, elle n'est d'ailleurs exercée que par un simple « bureau de la tutelle » aux moyens très modestes. Le déséquilibre manifeste, et souvent souligné, de la relation de tutelle qui s'établit entre un chef de bureau et un directeur d'établissement public est caractéristique du peu de considération que l'État porte à l'exercice de la tutelle de ses grands opérateurs.
Ce déséquilibre et le positionnement inconfortable du bureau de la tutelle du CGDD est même exacerbé par le fait que le Cerema a pour partenaire de grandes directions d'administration de ses deux ministères de tutelles avec lesquelles il négocie sa programmation et définit ses missions essentielles ainsi que leurs conditions de financement. Le rapporteur constate qu'il est objectivement très compliqué pour le CGDD de se faire une vraie place au milieu de ce système.
Alors qu'il est devenu indispensable qu'un État beaucoup plus interventionniste prenne la responsabilité de déterminer le périmètre des missions « socles » du Cerema et lui trace le cadre d'une stratégie de long terme assortie d'un modèle économique soutenable et résilient, il apparaît aujourd'hui incontournable de renforcer la tutelle du Cerema, tant en termes de moyens que de poids symbolique. Cette réforme pourrait par exemple conduire à la confier, ainsi que par la même occasion celles de Météo-France et de l'IGN, au secrétaire général du ministère de la transition écologique.
Cette réforme pourrait même avoir pour ambition une centralisation de la tutelle des grands opérateurs des ministères de la transition écologique et de l'aménagement du territoire, notamment de l'Ademe, du Cerema et de l'ANCT, afin d'assurer la cohérence des politiques publiques sur lesquelles ils interviennent en commun. Cette évolution pourrait permettre de mieux coordonner leurs actions et d'éviter que ne se créent des chevauchements entre leurs différents périmètres d'intervention.
D. POUR EXTRAIRE L'ÉTABLISSEMENT DES AFFRES D'UN PILOTAGE BUDGÉTAIRE « À VUE », L'ÉTAT DOIT LUI TRACER AU PLUS TÔT UNE STRATÉGIE DE LONG TERME CLAIRE ET SOUTENABLE
La poursuite du pilotage budgétaire annuel « à vue » tel qu'il a été pratiqué ces dernières années, sans que le Cerema ne dispose de visibilité sur son avenir, ne peut être poursuivi, sauf à aboutir à la faillite financière annoncée dès 2027, voire même avant.
Au plus tard au cours de l'année 2026, l'État doit décider clairement de ce qu'il entend faire du Cerema, de sa vision stratégique de long terme pour l'établissement et du périmètre des missions de service public essentielles dont il doit assurer la continuité. Dans un deuxième temps, pour donner à l'établissement la visibilité qui lui manque aujourd'hui cruellement et garantir la mise en oeuvre sur le long terme de cette stratégie, l'État doit lui assurer les conditions d'un modèle économique soutenable dans la durée, prévoyant notamment les moyens nécessaires à une couverture optimisée des coûts relatifs à la production de ses missions de service public « socles ».
Cette réflexion stratégique sur le futur du Cerema, le rôle qu'entend lui assigner l'État, son périmètre d'intervention et la définition des paramètres d'un modèle économique viable sur le long terme s'inscrit dans un contexte de contraintes extrêmement fortes sur les finances publiques. Au cours des prochaines années, en particulier s'agissant du projet de loi de finances pour 2026, la possibilité de dégager des moyens publics supplémentaires pour équilibrer le modèle économique du Cerema sera nécessairement très limitée. À court terme, dans ces conditions, il apparaît peu probable que les crédits alloués au programme 159 de la mission « Écologie, développement et mobilité » du budget de l'État, depuis lequel est versé la SCSP du Cerema, puissent être significativement majorés.
Trois grandes familles de scénarios stratégiques entre lesquels l'État devra trancher de façon explicite, semblent aujourd'hui se dessiner.
Un premier scénario serait celui du statu quo organisationnel et d'une augmentation de la SCSP de l'établissement, via une procédure de « rebasage », afin de combler le déficit structurel actuel et de renflouer la trésorerie du Cerema pour la repositionner au-dessus du seuil prudentiel fixé par la circulaire du Premier ministre datée du 23 avril 2025.
C'est le sens de la demande effectuée par le Cerema et soutenue par sa tutelle métier, le CGDD, dans le cadre des conférences de budgétisation relatives à la préparation du projet de loi de finances pour 2026. Le Cerema et le CGDD ont ainsi demandé un rebasage de la SCSP à hauteur de 37,2 millions d'euros dès 2026, dans une perspective de « rattrapage du déficit structurel du modèle » économique de l'établissement et de compensation des coûts liés à la protection sociale complémentaire et à l'augmentation du taux du CAS pensions. À cette demande s'ajoute celle d'une subvention complémentaire de 6 millions d'euros pour les investissements de rénovation du parc immobilier du Cerema.
Compte-tenu de l'état actuel des finances publiques et de la contrainte forte qui pèse sur le budget de l'État, ces demandes pourront vraisemblablement difficilement être satisfaites en 2026. Aussi, ce scénario d'un rebasage de la SCSP de l'établissement sans évolution organisationnelle apparaît-il peu réaliste à court terme.
Un deuxième scénario serait au contraire celui du statu quo en termes de moyens financiers, c'est à dire le gel durable de la SCSP de l'établissement à son niveau actuel. Toutes choses égales par ailleurs, cette situation aboutirait à une impasse financière dès 2027, la trésorerie du Cerema basculant alors en territoire négatif.
Aussi, ce scénario supposerait-il une nouvelle réforme structurelle profonde de l'établissement se traduisant par une révision à la baisse, probablement substantielle, de son champ d'intervention, notamment pour le compte des services de l'État. Il reviendrait alors à l'État d'assumer pleinement ce choix et de lui signifier clairement et explicitement lesquelles de ses missions le Cerema devra abandonner et lesquelles il devra au contraire prioriser et sanctuariser. Lors de sa mission de contrôle, le rapporteur a pu constater qu'aucune réflexion de la sorte n'a à ce jour été entreprise par l'État. Or, une telle réforme nécessiterait d'être pensée très en amont et accompagnée d'une solide étude d'impact pour s'assurer de ne pas fragiliser des capacités et des missions essentielles réalisées à ce jour par le Cerema, notamment lorsqu'elles revêtent des enjeux importants de sécurité des personnes et des biens, d'interventions d'urgence suite à des catastrophes ou encore de durabilité et d'adaptation des infrastructures.
Un troisième scénario, hybride, pourrait induire un rebasage partiel de la SCSP et, en parallèle, des gains de productivité dégagés par une réforme de l'organisation du temps de travail, par un programme ambitieux de diffusion de l'intelligence artificielle ainsi que par un nouveau recentrage des missions du Cerema qui serait formalisé par le travail nécessaire de détourage de ses activités « socles ». Ce scénario, qui pourrait par exemple être construit dans la perspective de la préparation du projet de loi de finances pour 2027, semble être le plus réaliste pour ne pas remettre en cause profondément le rôle et la plus-value du Cerema dans le contexte budgétaire actuel.
Ce scénario pourrait même être rendu plus soutenable par la recherche de compensations budgétaires du rebasage partiel de la SCSP du Cerema dans un cadre plus large que celui du programme 159 qui ne dispose d'aucune marge de manoeuvre en la matière. En effet, tout le monde s'accorde à dire, y compris la direction du budget, que le programme 159, très fortement affecté par les économies budgétaires depuis plus de dix ans, modeste et essentiellement composé des SCSP de Météo-France, de l'IGN et du Cerema, ne dispose plus d'aucune marge de manoeuvre d'économies budgétaires. Ce constat est renforcé par la situation financière extrêmement délicate de l'IGN qui se trouve dans une impasse similaire à celle du Cerema.
Sur la période récente, entre 2019 et 2024, si le montant des crédits de paiement (CP) consommés sur le programme 159 présente une certaine stabilité en valeur, et si l'on tient compte de l'inflation, il apparaît qu'ils ont accusé une baisse de 13 % en volume.
Évolutions en valeur et en volume des
crédits de paiement (CP) consommés
sur le programme 159
de la mission « Écologie, développement et
mobilité »
du budget de l'État
(2019-2024)
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat
Par ailleurs, comme l'illustre les graphiques ci-après, depuis une dizaine d'année, les subventions versées aux opérateurs du programme 159 sont quant à elles en nette diminution, que ce soit en euros courants ou en euros constants.
Évolutions en valeur et en volume de la
subvention versée
à Météo-France
(2013-2024)
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat
Évolutions en valeur et en volume de la subvention versée à l'IGN (2013-2024)
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat
Évolutions en valeur et en volume de la subvention versée au Cerema (2014-2024)
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat
Afin de disposer structurellement de davantage de marges de manoeuvre budgétaire pour piloter les subventions versées aux opérateurs actuellement rattachés au programme 159, une reconfiguration de la maquette budgétaire de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » pourrait le cas échéant être envisagée.
Recommandation n° 7 : alors que le pilotage budgétaire « à vue » fait actuellement peser une menace existentielle sur l'établissement, il est impératif qu'une tutelle étatique renforcée lui fixe, au plus tard au cours de l'année 2026, un nouveau cap stratégique soutenable financièrement.
En toute hypothèse, si les décisions stratégiques relatives à l'avenir du Cerema devaient n'être prises que dans le courant de l'année 2026, les moyens financiers alloués à l'opérateur dans le cadre de la loi de finances pour 2026, au premier rang desquels le montant de sa SCSP, devraient nécessairement être stabilisés, sauf à précipiter la faillite annoncée.
Recommandation n° 8 : en attendant que ce nouveau cap stratégique soit défini, la situation financière extrêmement délicate de l'opérateur suppose a minima de stabiliser sa subvention pour charges de service public en 2026.
III. AU-DELÀ DU SEUL CEREMA, UN BESOIN DE MIEUX STRUCTURER L'OFFRE D'INGÉNIERIE TERRITORIALE PUBLIQUE
A. L'OFFRE D'INGÉNIERIE TERRITORIALE PUBLIQUE SOUFFRE ENCORE D'UN MANQUE DE LISIBILITÉ
L'offre d'ingénierie territoriale publique est très dispersée entre une pluralité d'acteurs, hétérogène entre les territoires et globalement peu lisible pour les élus locaux. Elle est éparpillée entre des opérateurs nationaux de l'État, les agences techniques départementales, des services techniques d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des syndicats d'économie mixtes (SEM) ou encore des établissements publics locaux (EPL). Les cartographies de l'ingénierie territoriale pilotées par l'ANCT à l'échelle des départements ont certes constitué une avancée mais des progrès restent encore à accomplir en la matière.
Un effort de clarification des périmètres d'intervention des opérateurs de l'État qui agissent dans le domaine de l'ingénierie territoriale est également nécessaire en raison des imbrications qui ont pu se développer au fil du temps. À ce titre, la coordination des champs d'intervention et des rôles respectifs du Cerema, de l'Ademe et de l'ANCT semble revêtir un enjeu tout particulier pour assurer la cohérence et la lisibilité de la mise en oeuvre des politiques publiques de l'État auxquelles ils prennent part et éviter les potentiels doublons.
À première vue, les vocations principales de ces trois opérateurs se distinguent : le recueil des besoins des collectivités et le pilotage de grands programmes nationaux à leur intention pour l'ANCT, le conseil et l'expertise technique pour le Cerema et l'instruction de dossiers de financements pour l'Ademe. Cependant des recoupements et des doublons ont pu émerger entre le champ des missions de ces différents opérateurs, notamment du fait des grands programmes nationaux lancés dans le cadre du plan de relance et sur lesquels les trois opérateurs ont été mobilisés. En outre, la recherche de ressources propres pour équilibrer le budget des opérateurs suscite presque naturellement des phénomènes de concurrence et des « frottements » entre les domaines d'intervention des uns et des autres.
Le Cerema considère notamment qu'avec l'Ademe, « des enjeux de lisibilité et d'articulation se posent. D'une part, certaines collectivités rencontrent des difficultés pour identifier le bon interlocuteur en fonction de leurs besoins spécifiques. D'autre part, des recoupements de missions peuvent être observés, notamment dans l'accompagnement des collectivités à la transition écologique, où les interventions du Cerema et de l'Ademe se rejoignent parfois sans coordination explicite »76(*).
B. LE CEREMA, L'ADEME ET L'ANCT ONT MIS EN oeUVRE DE PREMIÈRES MESURES POUR COORDONNER LEURS ACTIVITÉS ET CLARIFIER LEURS CHAMPS D'INTERVENTIONS RESPECTIFS
Afin d'articuler leurs domaines d'action respectifs, l'Ademe et le Cerema ont pris l'initiative de mettre en place des dispositifs de coordination. Tous les trois mois, ils organisent ainsi des comités exécutifs communs réunissant les directions des deux établissements afin notamment de coordonner leurs actions, de mettre en oeuvre des projets communs, de rapprocher leurs offres et leurs modalités d'intervention, voire, le cas échéant de procéder à la mutualisation de services. Si cette initiative est intéressante, le rapporteur considère que ces réunions pourraient être plus fréquentes.
Ces échanges ont notamment eu pour fonction de balayer l'ensemble des champs d'intervention des deux opérateurs afin d'identifier les domaines dans lesquels ils se recoupent. Suite à ce premier travail d'identification, une feuille de route a été établie pour clarifier les rôles respectifs des deux établissements. Pour chacun de ces domaines, les deux opérateurs discutent afin de convenir duquel est le plus légitime pour intervenir.
Les principaux domaines sur lesquels des redondances ont été identifiées sont les mobilités douces, la maitrise du foncier (notamment la politique du zéro artificialisation nette), le bâtiment, l'urbanisme, la requalification des friches, les énergies renouvelables, la production de guides méthodologiques ou des études à destination des collectivités relatifs aux enjeux de transition écologique.
Il apparaît notamment en effet que, bien que moins « techniques », certaines études de l'Ademe sont très proches des guides produits par le Cerema. Récemment des guides communs à double en-tête de l'Ademe et du Cerema ont ainsi commencé à être diffusés, notamment, en mai dernier, un guide au sujet de la mobilité en zones rurales et périurbaines77(*).
Sur le domaine de l'adaptation au changement climatique, pour lequel le Cerema se revendique comme étant l'agence de référence et qu'il a placé au coeur de ses orientations stratégiques, de par son caractère très transversal, aucun des deux établissements n'a pu se résoudre à se désengager. Par ailleurs, d'autres opérateurs y contribuent également. Faisant le constat que ce sujet ne pourrait être concentré sur un seul opérateur, la ministre de la transition écologique a décidé d'en faire l'objet d'une expérimentation, celle de la construction d'une offre unique articulée entre plusieurs opérateurs : la « mission adaptation » (voir infra).
L'articulation du Cerema avec l'ANCT s'opère quant à elle dans le cadre des conventions pluriannuelles qui lient les deux entités78(*).
C. DES MUTUALISATIONS PARTIELLES DE SERVICES AINSI QUE LE DÉPLOIEMENT « D'OFFRES UNIQUES » DEVRAIENT ÊTRE PRIVILÉGIÉS
Après avoir étudié cette option, le rapporteur estime qu'à court terme, l'hypothèse d'une fusion entre le Cerema, l'Ademe et l'ANCT serait coûteuse et trop complexe. Néanmoins, la situation actuelle n'est pas satisfaisante et, en attendant qu'une éventuelle fusion intervienne, plusieurs pistes doivent être creusées afin, d'une part de rendre l'offre de ces opérateurs plus lisibles et plus cohérente et, d'autre part, de réaliser des gains de productivité et des économies immédiates.
Le Cerema et l'Ademe ont fini par prendre l'initiative de se réunir autour d'une table pour identifier les domaines d'intervention sur lesquels leurs activités pouvaient se superposer, entrer en concurrence, voire être en discordance
Afin de clarifier l'intervention des trois opérateurs et d'assurer leur complémentarité, il apparaît avant tout nécessaire que l'État, le cas échéant via une tutelle mutualisée, leur impose de se recentrer sur leur vocation première et ce qui fait leur originalité. C'est-à-dire :
- une ANCT chargée du dialogue avec les associations d'élus et la direction générale des collectivités locales (DGCL) pour définir les grands besoins des collectivités et piloter de grands programmes nationaux ;
- un Cerema qui fournit les prestations de conseil et d'expertise technique visant à traduire concrètement des projets d'aménagement ;
- une Ademe qui instruit les dossiers et attribue les financements.
D'après le rapporteur, seule une articulation de ce type permettrait d'assurer une réelle complémentarité entre ces trois opérateurs dans le domaine de l'ingénierie territoriale.
Pour les domaines dans lesquels plusieurs opérateurs de l'État sont compétents, le modèle de « l'offre unique » proposé dans le cadre de la « mission adaptation », si le bilan de l'expérience confirme sa pertinence, pourrait être dupliqué sur d'autres politiques publiques que la seule adaptation des territoires au changement climatique.
Mise en oeuvre en novembre 2024, la « mission adaptation » réunie le Cerema, l'Ademe, l'office français de la biodiversité (OFB), les agences de l'eau, Météo-France, la banque des territoires, l'ANCT ainsi que l'agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale (Anap). Elle avait été saisie par environ 70 collectivités entre sa création et le mois de mai 2025.
Présentation de la « mission adaptation » par le Cerema
L'objectif de la Mission adaptation est de permettre aux collectivités de s'engager dans des dynamiques d'adaptation ou de passer d'actions ponctuelles à des démarches plus intégrées en ayant accès, de manière simplifiée et facilitée, aux ressources des opérateurs de l'État. En organisant ces ressources autour d'un service commun mutualisé d'accueil et de conseil, orientation, la mission adaptation permet :
- d'améliorer la lisibilité des offres des opérateurs publics :
La réalisation de projets d'adaptation liés aux contextes territoriaux fait appel à plusieurs corpus disciplinaires, portés par plusieurs opérateurs. Pour faciliter leur compréhension et leur accès, la mission adaptation met en relation les collectivités locales avec les opérateurs de l'État.
- de simplifier les démarches des collectivités :
Les référents de la mission adaptation orientent vers le bon service, opérateur, dispositif en fonction du besoin, pour aider à initier, déployer ou amplifier une démarche (pouvant aller de la stratégie au projet opérationnel).
- de rationaliser l'offre des opérateurs :
Jusqu'en 2024, les outils et méthodes portés par les différents opérateurs étaient en général complémentaires mais juxtaposés sans articulation. La mission adaptation, les organise et facilite leur mobilisation.
Ce type de dispositif est possiblement applicable à toute politique publique qui nécessite la mobilisation de plusieurs corpus disciplinaires et de ce fait une clarification sur les parcours à suivre et les acteurs à mobiliser. Le dispositif propose une orientation, un conseil, qui sont dispensés par des spécialistes, et permettent une mobilisation directe des bons interlocuteurs pour mobiliser une ressource, un service, une aide.
Source : réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur
Si l'hypothèse d'une fusion immédiate des trois opérateurs doit être exclue, le rapporteur estime que la mutualisation de certains de leurs services, notamment s'agissant de fonctions transverses, est tout à fait imaginable et même souhaitable. Elle permettrait à ces opérateurs de réaliser des gains de productivité.
Alors que la publication de guides à double en-tête a montré les synergies qui pouvaient exister entre le Cerema et l'Ademe dans le domaine de la diffusion des connaissances, cette étape pourrait par exemple constituer la première marche vers un rapprochement et une mutualisation des services en charge de cette activité dans ces deux opérateurs. Progressivement, d'autres services transverses pourraient également être mutualisés afin de réaliser des gains de productivité pouvant aller jusqu'à quelques dizaines d'ETP sur le périmètre des deux agences.
Recommandation n° 9 : afin de réaliser des gains de productivité, procéder à la mutualisation de services du Cerema exerçant des fonctions transverses (publications et diffusion des connaissances) avec d'autres opérateurs de l'État qui interviennent dans des champs comparables, en particulier l'Ademe.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mardi 8 juillet 2025 sous la présidence de M. Claude Raynal, président, la commission a entendu une communication de M. Vincent Capo-Canellas, rapporteur spécial, sur la transformation du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), un modèle de mutualisation en devenir ?
M. Claude Raynal, président. - Nous poursuivons nos travaux par un contrôle budgétaire sur la transformation du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema).
M. Vincent Capo-Canellas, rapporteur spécial. - Chers collègues, j'ai pensé qu'il serait intéressant que la commission des finances se penche sur le Cerema, et ce à plusieurs titres.
D'abord, c'est un opérateur plutôt méconnu. Il a 27 représentations en province, et est peu représenté à Paris. Rares sont ceux qui ont une vision claire de son rôle, de son positionnement ainsi que de ses missions.
Ensuite, il a été soumis à des réductions de moyens substantielles depuis sa création en 2014 et il a mené à bien une réforme structurelle remarquable dont l'État pourrait s'inspirer.
Enfin, depuis deux ans maintenant, la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi 3DS, a fait du Cerema un outil unique, partagé entre l'État et les collectivités, autour d'un statut de quasi-régie conjointe.
Un peu plus de dix ans après la création du Cerema, j'ai considéré qu'il était nécessaire de mesurer les incidences des transformations récentes qu'il a connues et de se pencher sur ses perspectives, notamment financières.
Le Cerema est aujourd'hui l'outil d'expertise technique de référence de l'État dans les domaines de l'aménagement du territoire et des infrastructures. Dans ces domaines, il dispose de compétences de pointe uniques en France et reconnues à l'international. Dans une perspective d'efficacité, mais aussi d'efficience des finances publiques, il apparaît pertinent de concentrer ces compétences pointues au sein d'un opérateur national unique plutôt que de les saupoudrer sur le territoire.
Le Cerema est également indispensable à l'État du fait de sa capacité à projeter très rapidement son expertise après une catastrophe naturelle ou un événement climatique exceptionnel. Les conséquences du réchauffement climatique vont accentuer ces phénomènes et leur fréquence.
Depuis qu'il a développé son offre à destination des collectivités, le Cerema leur est devenu indispensable, notamment dans les phases amont de leurs projets d'aménagement ou lorsqu'une autorité locale amorce ses réflexions à propos d'un sujet complexe et pluridisciplinaire. C'est un lieu d'expertise pour les grands projets d'aménagement. Les enjeux de l'adaptation au changement climatique, qui pourraient devenir l'élément central de l'aménagement du territoire, en sont le meilleur exemple.
Par ailleurs, ses interventions permettent bien souvent de mieux maîtriser la dépense publique et d'éviter des dépenses inutiles ou résultant de défauts d'entretien d'infrastructures, grâce à des diagnostics techniques précoces.
Le Cerema a mené à bien, entre 2018 et 2022, une profonde restructuration de son organisation pour atteindre en cinq ans l'objectif d'une réduction de 20 % de sa subvention et de ses effectifs, objectif qui lui avait été fixé par l'État. Cette réforme a notamment amené l'opérateur à se questionner sur son périmètre d'intervention. À l'issue de ce processus, il a abandonné plusieurs de ses domaines d'action. Il a fait là ce que l'État ne sait pas faire ; il a réalisé la réforme que l'État n'a jamais su mener à bien.
En parallèle de cette réforme, le Cerema a aussi décidé de clarifier son positionnement stratégique en recentrant son rôle sur le conseil et l'expertise de haut niveau. Il dispose de bureaux techniques de très haut niveau, d'une expertise très pointue. De ce fait, il s'adresse plus naturellement aux collectivités de 50 000 habitants ou plus qui disposent d'un véritable service technique, sans pour autant abandonner les petites communes trop souvent dépourvues d'offre d'ingénierie de proximité.
Le virage du Cerema vers les collectivités constitue une évolution importante de son rôle et de son activité. Afin de poursuivre plus avant cette orientation, la loi 3DS a fait du Cerema un établissement partagé entre l'État et les collectivités et permis à ces dernières de recourir à ses services en quasi-régie, c'est-à-dire sans mise en concurrence. Ce nouveau statut a suscité un intérêt important de la part des collectivités. Plus de 1 000 d'entre elles ont déjà adhéré au Cerema. Désormais, le défi sera d'entretenir à long terme la confiance placée par les collectivités dans le Cerema.
Si personne ne remet en cause officiellement le nouveau statut du Cerema, j'ai néanmoins pu constater qu'il suscitait des réserves au sein de certaines administrations de l'État. Certains regrettent la perte d'influence des représentants de l'État dans les instances de gouvernance, quand bien même le budget de l'État reste largement le premier financeur du Cerema. En parallèle, des services de l'État regrettent que le développement des activités du Cerema vers les collectivités se fasse parfois au détriment des prestations qui leur sont délivrées.
S'il est encore trop tôt pour dresser un bilan exhaustif du nouveau statut, il faudra nécessairement en faire une évaluation complète après quatre à cinq années de mise en oeuvre, à l'horizon 2027.
J'en viens désormais à la situation et aux perspectives financières du Cerema.
À l'heure où je vous parle, le Cerema est financièrement en sursis. Depuis cette année, il ne peut assurer ses charges courantes qu'en puisant dans la trésorerie fléchée de programmes dont il doit reverser les fonds aux collectivités, notamment le programme Ponts. Ce n'est pas caché, le conseil d'administration le déplore, mais il n'a pas d'autres solutions. Cette méthode n'aura qu'un temps. Cette forme de « cavalerie budgétaire » n'est bien évidemment pas viable. Dès 2027, si rien n'est fait, le Cerema se retrouverait en situation de faillite virtuelle puisque son niveau de trésorerie deviendrait négatif. Lorsque l'on évoque le sujet avec les directions de Bercy, inutile de vous dire qu'elles « regardent un peu leurs chaussures », mais elles conviennent qu'elles en ont été informées et qu'il n'y avait pas d'autres solutions à court terme.
Comment a-t-on pu en arriver à pareille situation ? Depuis sa création, le Cerema a été confronté à une diminution continue de sa subvention pour charges de service public. Pour compenser cette baisse de recettes, ses tutelles l'ont incité à accroître ses ressources propres, notamment en se tournant vers les collectivités. Toutefois, « les arbres ne montent pas au ciel », et cette logique a ses limites. Nous les avons peut-être déjà atteintes, notamment car les collectivités se trouvent elles-mêmes confrontées à de fortes contraintes budgétaires.
Malgré la baisse sensible de ses effectifs, la masse salariale du Cerema, qui représente 80 % du total de ses dépenses - c'est normal, l'expertise demande des cadres de bon niveau -, est très dynamique, et ce pour deux raisons : d'une part, un phénomène exogène résultant des mesures salariales décidées par le Gouvernement ou par le ministère de la transition écologique et le plus souvent non compensées et, d'autre part, un phénomène, endogène celui-ci, qui a pour origine le repyramidage des effectifs du Cerema lié à son recentrage sur le conseil et l'expertise de pointe ; les recrutements se font principalement en catégorie A.
Depuis 2021 et la mise en place du plan de relance, s'est ajouté un autre élément qui a contribué à brouiller la lisibilité des équilibres financiers du Cerema. Celui-ci a été mobilisé pour mettre en oeuvre des programmes nationaux d'intervention à destination des collectivités pour lesquels il perçoit des financements qu'il doit redistribuer aux bénéficiaires finaux après instruction de leurs projets. Ce phénomène a conduit, momentanément et artificiellement, à gonfler la trésorerie globale de l'établissement, le rendant ainsi vulnérable aux mesures transversales d'économies budgétaires.
Le résultat est qu'aujourd'hui le Cerema affiche un déficit structurel de près de 20 millions d'euros ; il survit à la faveur d'un système de « cavalerie budgétaire » et, toute chose égale par ailleurs, il ne pourrait plus assurer ses charges courantes, c'est-à-dire la paie de ses agents, à l'horizon 2027. Cette situation regrettable résulte largement des injonctions contradictoires de l'État au Cerema et de son incapacité à lui fixer un cadre stratégique au sein duquel il pourrait déployer un modèle économique soutenable.
Pour l'avenir du Cerema, l'heure est grave et ce que j'appelle le pilotage budgétaire à vue, sans cap ni boussole, n'est plus envisageable puisqu'il conduit l'établissement dans une impasse. C'est à l'État de prendre pleinement ses responsabilités et de donner enfin au Cerema un cap stratégique clair et la visibilité financière qui lui manque.
Pour y parvenir, il faudra nécessairement renforcer la tutelle métier du Cerema. Cette tutelle est assurée par le commissariat général au développement durable (CGDD), dont ce n'est pas le coeur d'activité, et qui dispose, me semble-t-il, de moyens et d'un poids dans les arbitrages trop limité. De façon plus générale, l'exercice de la tutelle de l'État sur ses grands opérateurs se pose, notamment dans le domaine de l'écologie. La commission d'enquête sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État présidée par M. Barros et rapportée par Mme Lavarde a également dressé ce constat et recommandé que l'État exerce une véritable tutelle sur ses opérateurs.
Cette tutelle renforcée devra d'abord déterminer le rôle qu'entend donner l'État au Cerema en définissant ses missions socles, c'est-à-dire celles qui doivent être couvertes par sa subvention. Étonnamment, ce travail n'avait jamais été réalisé et l'identification des activités essentielles de l'opérateur est aujourd'hui le résultat de négociations entre le Cerema et les directions d'administrations centrales.
Ensuite, au plus tard l'année prochaine, l'État doit fixer clairement au Cerema une stratégie de long terme assortie d'un modèle économique soutenable.
Trois scénarios pourraient être envisagés.
Le premier serait celui du statu quo organisationnel et d'une augmentation de la subvention de l'établissement pour compenser son déficit structurel. Le contexte budgétaire actuel rend cette hypothèse improbable.
Le deuxième serait au contraire celui du statu quo financier, à savoir une stabilisation en volume de la subvention de l'établissement. Ce scénario supposerait une nouvelle réforme très substantielle de l'organisation du Cerema et l'abandon de nouvelles missions. C'est alors à l'État qu'il reviendrait de lui signifier les missions auxquelles il devrait renoncer. À ce stade, je n'ai constaté aucune réflexion sérieuse de l'État à ce sujet. Aussi, cette hypothèse me paraît peu réaliste.
Le troisième scénario, hybride, consisterait à augmenter légèrement la subvention du Cerema tout en exigeant qu'il réalise des gains de performance ; des pistes ont été identifiées. Ce scénario me semble le plus prometteur. Je ne vois pas comment passer le cap de 2027 autrement.
Dans le cadre de mes travaux, je me suis aussi intéressé à la cohérence et à la lisibilité de l'offre d'ingénierie publique territoriale. Dire qu'elle est perfectible est un euphémisme. J'en veux notamment pour preuve l'articulation entre les grands opérateurs de l'État qui interviennent dans ce domaine, au premier rang desquels le Cerema, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) et l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). Si une fusion entre ces opérateurs ne me paraît pas pertinente à court terme, je suis convaincu que des mutualisations de services, notamment dans le domaine des fonctions supports, sont souhaitables.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Le rapporteur spécial a réalisé une analyse minutieuse, tout en exposant plus largement les principaux enjeux. Dans mon département, sur un certain nombre de chantiers, dans lesquels le Cerema intervient aux côtés des collectivités territoriales, je constate que la première des préoccupations concerne la réduction de la capacité d'ingénierie et d'expertise publique dans les territoires. En raison d'un problème d'attractivité des métiers, un certain nombre d'agents ne font plus toute leur carrière dans l'expertise publique. Ainsi, alors que nous aurions besoin de plus de compétences, nous faisons face à une carence.
Aussi, ne pourrions-nous pas mieux partager les missions entre le personnel ? Des personnels très compétents et qualifiés sur certains sujets, mais qui ne peuvent entièrement les exploiter dans leur collectivité, pourraient les mettre au service d'une autre selon des modalités à définir.
Mme Christine Lavarde. - Les réflexions du rapporteur spécial s'inscrivent dans la continuité des travaux de la commission d'enquête sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État. Le Cerema, que nous avons auditionné, résulte de la fusion de onze structures. Lorsqu'il a été créé, l'État avait une vision assez claire de ses attentes à l'égard de cet organisme : il s'agissait notamment de réduire assez significativement les effectifs, en suivant une trajectoire sur cinq ans. Cette visibilité a permis au directeur du Cerema de remplir les objectifs assignés par l'État. Cependant, dix ans ont été nécessaires à la nouvelle entité pour recréer un esprit unique et à se penser comme Cerema, et non comme ancien Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements (Sétra) ou ancien Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (Certu).
Il est désormais urgent que l'État se ressaisisse de son véritable rôle de tutelle. Je pense également que ça ne devrait pas être au CGDD, qui assure, entre autres, la tutelle de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), de Météo France et du Cerema, de remplir cette mission.
Je veux enfin revenir sur la recommandation n° 9. Je ne jette pas la pierre au rapporteur spécial : alors que je suis moi-même rapporteur spécial du programme 217, il a fallu que je sois chargée du rapport de cette commission d'enquête pour que je découvre que, depuis octobre 2023, le ministère de l'écologie a créé un service à compétence nationale chargé de la gestion administrative et du versement des salaires de l'ensemble des agents du ministère affecté en administration centrale ou déconcentrée ! Vingt-deux services de gestion ont ainsi été agglomérés. Or il me semble que la gestion des fonctions support devrait se faire au sein de l'administration centrale plutôt qu'entre opérateurs.
C'est le troisième ministère à se doter d'un tel service. Nous pourrions en étendre les missions.
Je signale enfin que les agents publics du Cerema, en outre, sont en position normale d'activité et non en détachement. C'est un cas à part, parmi les agences que nous avons étudiées avec le président de la commission d'enquête Pierre Barros.
M. Stéphane Sautarel. - Je remercie le rapporteur spécial pour son travail. Néanmoins, à l'entendre, je m'interroge sur notre capacité à réformer le Cerema. Aucune des trois hypothèses présentées ne m'a séduit : je préfère réfléchir à une quatrième. L'État, qui a abandonné l'ingénierie aux collectivités, a voulu ensuite recréer des structures telles que le Cerema et l'ANCT, alors que des structures publiques et le secteur privé offraient déjà des solutions. Nous devrions nous questionner sur le fondement même d'une telle structure dans la sphère publique et des financements qui y sont rattachés.
En outre, on insiste souvent sur la nécessité d'offrir de l'ingénierie à nos collectivités sur nos territoires. Cependant, si nous allions réellement dans le sens de la simplification, nous aurions peut-être besoin de moins d'ingénierie. Or j'ai l'impression que nous avons souvent tendance à complexifier précisément pour justifier les besoins !
M. Claude Raynal, président. - Je pense que le système de regroupement d'agences se traduit le plus souvent par un affaiblissement : on regroupe, on fait des économies, on s'en occupe moins, le système doit trouver ses propres ressources, cela fonctionne un temps, puis finalement on observe qu'il est nécessaire que l'État affecte à l'agence des programmes permanents, tels que le programme « Ponts » pour le Cerema... En l'absence de ce type de grands programmes, l'équation se complique. Je pense que c'est un processus difficile à vivre pour les personnels de ces agences. Je ne tire donc pas tout-à-fait les mêmes conclusions que vous, mais il me semble que le mécanisme de fusion donne souvent lieu à ce résultat. Même si l'organisme fait des efforts, ceux-ci ne sont pas payés en retour.
M. Thierry Cozic. - L'utilisation de crédits fléchés pour des dépenses courantes aura-t-elle une incidence sur le programme national « Ponts » et sur les collectivités devant réaliser des travaux sur ces ouvrages ?
M. Vincent Capo-Canellas, rapporteur spécial. - Le Cerema est un peu le mouton à cinq pattes : il est doté de compétences très différentes, allant de la réflexion sur l'adaptation du bâti et des techniques de construction aux enjeux relatifs à la qualité de l'air et au confort thermique. Si la sphère publique ne dispose pas de bureaux d'études et de centres de recherche pour penser ces questions, nous risquons de rater un certain nombre de révolutions dans le domaine de la construction à l'avenir.
Le Cerema dispose d'une infinie compétence dans beaucoup de domaines, qui ont été très largement recentrés sur les sujets sur lesquels la puissance publique doit conserver une position dominante. À ce titre, on pourrait qualifier de régaliennes les activités qu'exerce le Cerema.
Le Cerema doit également garder la main sur la certification et la normalisation. Ainsi, son activité entretient des liens importants avec la compétitivité du pays et de certaines de nos industries dans les domaines qu'il couvre.
On pourrait finalement comparer le Cerema à un couteau suisse : on estime parfois qu'il n'en fait pas assez, mais à la moindre crise, on sollicite son expertise : inondations, effondrements, dommages sur des infrastructures, notamment des ponts, et les risques qui en découlent...
Pour bien calibrer un projet d'infrastructure, notamment ses fondations au regard des caractéristiques géotechniques du sol, le rôle de tiers de confiance du Cerema, qui délivre une expertise indépendante, est important. En effet, les entreprises privées ont souvent tendance, par prudence, à prendre des marges de sécurité qui peuvent être excessives et renchérir le coût de l'investissement, au risque qu'il ne soit finalement pas réalisé...
Le Cerema représente donc une expertise très importante en matière d'ingénierie publique, d'infrastructures et d'adaptation au changement climatique. Cette expertise est parfois assez mal monétisée - j'ignore, d'ailleurs, si elle est monétisable. Peut-être est-ce le cas pour son activité de normalisation, mais cela ne suffira pas à modifier la donne en matière budgétaire. La subvention a été réduite de 20 % : cela finit par produire des effets.
Par ailleurs, le Cerema s'est beaucoup réformé. Il est l'exemple d'un organisme qui a fait des choix - difficiles - pour identifier les sujets sur lesquels l'État devait garder sa compétence et qui n'étaient pas déjà traités ailleurs au sein de la sphère publique. Le Cerema a tout de même divisé par trois ses domaines d'intervention. Faut-il réduire encore aujourd'hui son périmètre d'activité ? C'est la question.
N'oublions pas, toutefois, que la fusion n'a pas été simple. Au risque de paraître provocateur, je dois souligner que la crise du covid a permis de réduire les tensions internes. Jusqu'en 2019, la période est restée difficile. Lorsque l'activité a pleinement repris après 2020, la réforme était bouclée. Mais il me paraît un peu cynique de dire que, puisque le Cerema a su s'adapter, malgré la diminution de sa subvention, nous pouvons poursuivre la dynamique. Cela ne fonctionnera pas - c'est d'ailleurs ce que disait le président Raynal.
L'attractivité des métiers est une autre problématique. Alors que l'on faisait auparavant carrière dans les directions départementales de l'équipement (DDE), puis sur le terrain, avant de devenir expert, nous devons désormais nous demander comment développer et conserver cette expertise.
Des allers-retours s'effectuent parfois, dans le respect des règles déontologiques qui prévalent : certains agents sont issus des collectivités, notamment des départements pour ce qui concerne les routes, d'autres du secteur privé, ou bien ils y poursuivent leur carrière. Pour préserver l'ingénierie, les modalités d'échanges avec le privé me semblent plutôt pertinentes.
Il existe un réseau de partage de l'expertise, notamment sur les routes, avec les départements. Faut-il aller plus loin ? Je reste assez prudent. Il est en tout cas crucial de conserver ce vivier d'expertise. Il est aussi utile que des experts nationaux ou internationaux puissent être mobilisés sur les équipements en difficulté. L'expertise, c'est aussi de la recherche, de la collaboration, des échanges, des colloques.
Madame Lavarde, un cap pluriannuel avait été donné dans le cadre de la fusion : il convient d'en fixer un nouveau, qui ne pourra se résumer en une réduction budgétaire.
Par ailleurs, nous avons hésité à intégrer la recommandation n° 9. Plutôt que le versement des salaires que vous mentionniez, nous visions principalement la mutualisation de fonctions support telles que la diffusion d'information, les publications, la communication avec la mise en place d'outils communs qui rendront les productions de ces établissements plus accessibles aux collectivités notamment.
Nous pourrions donc modifier la recommandation n° 9 pour préciser les services visés.
Monsieur Sautarel, je défends la capacité de la structure à se réformer, mais il y a une limite à tout. Le corps social risque de se heurter trop brutalement à un problème de sens. Comme l'a souligné Christine Lavarde, en outre, cette adaptation a finalement pris dix ans.
Il ne faut pas abandonner l'appui territorial. Je n'appliquerais pas la politique de la coupe à la hache sur le sujet. La réponse aux collectivités dans les domaines de l'aménagement du territoire, des risques, de l'accompagnement au changement climatique, de la mer et des littoraux, des bâtiments ou encore des infrastructures réside dans les territoires. Si nous la supprimons, il ne restera plus grand-chose. Et si les agences techniques départementales ont parfois pris le relais, elles se situent plutôt sur le premier niveau, pour les opérations d'accompagnement simple de la collectivité dans la rédaction d'un cahier des charges, par exemple. Dès lors qu'une expertise plus technique est nécessaire, le Cerema représente l'outil de très haut niveau auquel il faut faire appel.
Le président Raynal a raison : si nous ne faisons rien, la suite du scénario est prévisible. Était-ce l'intention de départ ? Je ne le crois pas. À l'occasion de mes déplacements, j'ai observé des agents mobilisés sur le terrain, au service des collectivités, experts dans de nombreux domaines difficiles à appréhender à l'échelle nationale. La tutelle doit en prendre conscience : ce rapport vise aussi à tirer le signal d'alarme. Cependant, l'obstacle est très proche de nous. Nous pourrons passer l'année 2026, à condition de ne pas sabrer les crédits. Mais pour 2027, nous devrons soit réinjecter des crédits, soit trouver un scénario mixte...
Monsieur Cozic, le programme national « Ponts » ne sera pas affecté. Le Cerema a obtenu les crédits y afférents et les décaisse sur plusieurs années. Ces crédits ont entraîné un effet d'aubaine en matière de trésorerie, mais également un effet pervers : lors de l'élaboration du budget, le Cerema semble disposer d'une trésorerie suffisante, alors qu'il s'agit seulement de crédits destinés à ce programme. Mais l'argent qui lui est alloué sera bien versé - c'est d'ailleurs à ce moment-là que la trésorerie du Cerema deviendra négative.
M. Claude Raynal, président. - Je vous propose donc de modifier la recommandation n° 9 pour tenir compte des échanges.
Il en est ainsi décidé.
La commission a adopté les recommandations du rapporteur spécial, ainsi modifiées, et autorisé la publication de sa communication sous la forme d'un rapport d'information.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
CEREMA
- M. Pascal BERTEAUD, directeur général ;
- Mme Marie-Claude JARROT, présidente du conseil d'administration et maire de Montceau-les-Mines.
Ministère de la transition écologique
- M. Guillaume LEFORESTIER, secrétaire général du ministère de la transition écologique ;
- M. Olivier CORMIER sous-directeur au service de la transformation ministérielle et de l'animation du réseau.
Ministère délégué chargé de la ruralité
- Mme Françoise GATEL, ministre déléguée à la ruralité ;
- M. Tristan ROCHAS, conseiller spécial en charge des affaires parlementaires et de l'aménagement rural ;
- M. Jean-Victor ROUX, conseiller institutions locales, finances et simplifications pour la ruralité.
Direction du Budget - 4e sous-direction Budgets des transports, de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, de la transition énergétique, de l'égalité des territoires, et du logement et de la ville
- M. Thomas ESPEILLAC, sous-directeur.
Commissariat général au développement durable
- M. Brice HUET, commissaire général au développement durable ;
- M. Thierry COURTINE, chef du service recherche et innovation ;
- Mme Claire SALLENAVE, sous-directrice de l'animation scientifique et technique.
Direction générale des infrastructures des transports et des mobilités (DGITM))
- M. Rodolphe GINTZ, directeur général ;
- M. Nicolas BINA, conseiller élus et communication.
ADEME
- Mme Patricia BLANC, directrice générale déléguée ;
- M. Laurent PICHARD, secrétaire général.
Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)
- Mme Agnès REINER, directrice générale déléguée à l'appui opérationnel et stratégique ;
- Mme Émilie CHAPEAU, adjointe au chef du pôle au pôle interface et contrats territoriaux.
Mission d'inspection commune à l'inspection générale des finances (IGF), à l'inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) et à l'inspection générale de l'administration (IGA) relative aux opérateurs qui interviennent dans le domaine de l'ingénierie sur les territoires
- M. Guillaume CHOISY, inspecteur général à l'IGEDD.
Syntec-Ingénierie
- M. Michel KAHAN, président ;
- Mme Anne ZIMMERMANN, directrice influence et métiers.
Association des maires de France (AMF)
- M. Michel PY, maire de Leucate et membre du comité directeur.
Département de France
- M. Bruno FAURE, président du Cantal.
Intercommunalités de France
- M. Laurent TROGRLIC, secrétaire national ;
- Mme Charlotte SORRIN-DESCAMPS, directrice générale adjointe ;
- Mme Montaine BLONSARD, responsable des relations avec le Parlement
Syndicat CFDT UFETAM
- M. Claude GUILLET.
Syndicat FNEE
- M. Bruno PIEL, secrétaire général de la CGT CEREMA et membre de la direction fédérale de la FNEE CGT ;
- M. Didier BATON, élu CGT au conseil d'administration.
Syndicat NP2E FO
- M. Olivier GLEIZES, membre du CSA et de la F3SCT CEREMA, membre du CSA et de la F3SCT ministérielle au sein de la direction territoriale méditerranée ;
- M. Arnaud GANAYE -, responsable du cartel FO CEREMA et membre du CSA CEREMA au sein de la direction territoriale Haut de France ;
- Mme Emmanuelle CHIRON -, membre du CSA et du CA CEREMA au sein de la direction territoriale Centre-Est.
Syndicat UNSA développement durable
- M. Frédéric BRUNET ;
- Mme Hélène CHASSAGNOL ;
- Mme Marilyne HUET-DUMOULIN.
LISTE DES DÉPLACEMENTS
Direction territoriale Centre-Est (Lyon) et cité des mobilités (Bron) du Cerema - 2 juin 2025
Direction territoriale Hauts-de-France du Cerema (Lille) - 12 juin 2025
TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI (TEMIS)
|
N° de la proposition |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier prévisionnel |
Support |
|
1 |
Pour le recueil des expressions de besoin des administrations de l'État à l'endroit du Cerema, développer/organiser une coordination approfondie par la tutelle de l'établissement |
Ministère de la transition écologique, ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation |
2026 |
Tous supports |
|
2 |
Simplifier la procédure de programmation annuelle des activités du Cerema pour qu'elle consomme moins de temps à ses personnels, permettant ainsi de dégager des gains de productivité |
Cerema, ministère de la transition écologique, ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation |
2026 |
Tous supports |
|
3 |
Prévoir une évaluation du nouveau statut de quasi-régie conjointe du Cerema à l'horizon 2027 |
Ministère de la transition écologique, ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, ministère chargé des comptes publics |
2027 |
Mission d'évaluation chargée de produire un rapport |
|
4 |
Définir les activités « socles » du Cerema ayant vocation à être financées par sa subvention pour charges de service public (SCSP) |
Ministère de la transition écologique, ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation |
2026 |
Décret |
|
5 |
Développer et généraliser à l'ensemble des activités de l'établissement une comptabilité analytique plus fine, permettant d'identifier le coût complet exhaustif des différentes prestations réalisées par l'opérateur |
Cerema |
2026 |
Comptabilité analytique |
|
6 |
L'établissement doit activer les leviers dont il dispose pour réaliser des gains de productivité, notamment en matière d'organisation du temps de travail et de diffusion de l'intelligence artificielle, ainsi que pour développer les ressources propres qu'il perçoit au titre des prestations délivrées aux entreprises |
Cerema |
2025-2028 |
Documents internes au Cerema |
|
7 |
Alors que le pilotage budgétaire « à vue » fait actuellement peser une menace existentielle sur l'établissement, il est impératif qu'une tutelle étatique renforcée lui fixe, au plus tard au cours de l'année 2026, un nouveau cap stratégique soutenable financièrement |
Ministère de la transition écologique, ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, ministère chargé des comptes publics |
2026 |
Documents établissant la stratégie de l'État pour le Cerema |
|
8 |
En attendant que ce nouveau cap stratégique soit défini, la situation financière extrêmement délicate de l'opérateur suppose à minima de stabiliser sa subvention pour charges de service public en 2026 |
Ministère chargé des comptes publics, Parlement |
2025 |
Loi de finances pour 2026 |
|
9 |
Afin de réaliser des gains de productivité, procéder à la mutualisation de services du Cerema exerçant des fonctions transverses (publications et diffusion des connaissances) avec d'autres opérateurs de l'État qui interviennent dans des champs comparables, en particulier l'Ademe |
Cerema, ministère de la transition écologique, ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation |
2026 |
Mutualisations de services |
* 1 Dont 16 régions, 87 départements, 476 communes et 434 groupements de collectivités.
* 2 Budget initial 2025 avant mise en oeuvre du plan de retour à l'équilibre en cours de gestion.
* 3 Pour 2025, la donnée retenue est prévisionnelle.
* 4 Cette considération a notamment été mise en évidence le 18 mars 2025 par Philippe Berteaud, directeur général du Cerema, lors de son audition devant la commission d'enquête du Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État : « à titre d'exemple, nous comptons environ 300 spécialistes des ouvrages d'art, dont 20 à 30 experts internationaux de très haut niveau. Si ces spécialistes étaient répartis au niveau régional, cela ne représenterait qu'un ou deux experts par région, ce qui n'est pas suffisant pour assurer un niveau de compétence adéquat. L'expertise et l'ingénierie nécessitent un travail en réseau. C'est sur cette base que repose l'idée du Cerema : un établissement d'expertise de second niveau, avec une mutualisation à l'échelle nationale ».
* 5 Qui s'appuient notamment sur les enseignements du projet de recherche RELEV (Reconstruction des territoires : leviers pour anticiper les catastrophes naturelles) visant, après le passage du cyclone Irma, à mieux comprendre les stratégies de gestion de reconstruction post-catastrophe.
* 6 Indicators of Global Climate Change 2024: annual update of key indicators of the state of the climate system and human influence, 19 juin 2025.
* 7 Le rôle du Cerema en matière d'appui aux collectivités territoriales, CGEDD et IGA, juin 2021.
* 8 Réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur.
* 9 Réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur.
* 10 Contribution écrite de la fédération Cinov à la mission de contrôle.
* 11 Contribution écrite de la fédération Cinov à la mission de contrôle.
* 12 En particulier dans les domaines de la mobilité, des ouvrages d'art, des équipements de la route, des chaussées et terrassements, de la géotechnique ou encore des systèmes de transports intelligents.
* 13 À travers la mise en ligne de données, diverses publications (ouvrages, guides techniques, essentiels, etc) souvent considérés comme des références par les acteurs intervenant dans les domaines concernés ou la réalisation de formations destinées aux collectivités, aux services de l'État comme au secteur privé (petits bureaux d'études notamment).
* 14 À ce titre, le Cerema collecte, produit et diffuse des données statistiques dans des domaines tels que l'environnement, le littoral, les mobilités, la sécurité routière, l'énergie, les transports, le logement ou encore la construction.
* 15 Le Cerema compte 12 équipes de recherche, 150 chercheurs statutaires et 50 doctorants.
* 16 À ce sujet, lors de son audition du 18 mars 2025 devant la commission d'enquête du Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État, le directeur général du Cerema déclarait : « les agences techniques départementales présentent une forte hétérogénéité. En Haute-Garonne, par exemple, l'agence technique départementale regroupe plus de cent agents et propose un large éventail de services aux collectivités. Toutefois, cette capacité varie fortement d'un département à l'autre : certaines agences techniques départementales disposent de moyens beaucoup plus réduits, tandis que d'autres n'existent tout simplement pas. Une autre difficulté, de nature plus politique, réside dans les relations entre les collectivités et les conseils départementaux. Par le passé, les maires pouvaient s'adresser directement à l'État, notamment via les directions départementales de l'équipement ou les directions départementales de l'agriculture, qui étaient perçues comme des interlocuteurs neutres. Aujourd'hui, certaines petites communes hésitent à solliciter leur conseil départemental, ce qui complexifie encore davantage l'accès à l'ingénierie territoriale ».
* 17 Réponses du CGDD au questionnaire du rapporteur.
* 18 Dans vingt départements.
* 19 Réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur.
* 20 Le montant très significatif constaté en 2022 s'explique par le lancement de grands programmes nationaux par l'ANCT.
* 21 Réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur.
* 22 Dans leur rapport de 2021, le CGEDD et l'IGA soulignait notamment à ce titre que « les administrations centrales de l'État, principales commanditaires des prestations du Cerema, ont eu du mal à intégrer la logique de fonctionnement d'un établissement public autonome et cette difficulté demeure ».
* 23 Descriptif, livrables attendus, nombre de jours d'intervention, coût total, etc.
* 24 Réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur.
* 25 Réponses de la direction du budget au questionnaire du rapporteur.
* 26 La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
* 27 La loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports.
* 28 Article 45 de la n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports avant sa modification en février 2022 par l'article 159 de la loi « 3DS ».
* 29 Également appelé « in house ».
* 30 Dans le cadre des articles L. 2511-1 à L. 2511-5 du code de la commande publique.
* 31 Le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 relatif au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema).
* 32 Le décret n° 2022-897 du 16 juin 2022 modifiant le statut du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema).
* 33 Celles-ci sont en effet passées de 15,3 millions d'euros en 2023 à 21 millions d'euros en 2024.
* 34 Réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur.
* 35 Réponses du CGDD au questionnaire du rapporteur.
* 36 Réponses de la direction du budget au questionnaire du rapporteur.
* 37 Réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur.
* 38 Réponses de la délégation à la sécurité routière (DSR) au questionnaire du rapporteur.
* 39 Réponses de la direction générale de la prévention des risques (DGPR) au questionnaire du rapporteur.
* 40 Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
* 41 Décret n° 2025-374 du 25 avril 2025 portant annulation de crédits.
* 42 Les chiffres 2025 sont prévisionnels.
* 43 Les chiffres 2025 sont prévisionnels.
* 44 Les chiffres 2025 sont prévisionnels.
* 45 Réponses du CGDD au questionnaire du rapporteur.
* 46 Réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur.
* 47 Réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur.
* 48 Réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur.
* 49 Pour 2025 les données sont celles du budget initial avant la mise en oeuvre du plan de retour à l'équilibre (voir infra).
* 50 Avant mise en oeuvre du plan de retour à l'équilibre (voir infra).
* 51 Pour 2025, données prévisionnelles.
* 52 Budget initial 2025 avant mise en oeuvre du plan de retour à l'équilibre en cours de gestion.
* 53 Budget initial 2025 avant mise en oeuvre du plan de retour à l'équilibre en cours de gestion.
* 54 Budget initial 2025 avant mise en oeuvre du plan de retour à l'équilibre en cours de gestion.
* 55 Réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur.
* 56 Réponses de la DGPR au questionnaire du rapporteur.
* 57 Réponses de la DSR au questionnaire du rapporteur.
* 58 Pour 2025, prévisions figurant dans le budget initial de l'établissement.
* 59 Glissement, vieillesse, technicité.
* 60 Pour 2025, la donnée retenue est prévisionnelle.
* 61 Pour 2025, la donnée retenue est prévisionnelle.
* 62 Réponses du CGDD au questionnaire budgétaire du rapporteur spécial relatif au projet de loi de finances pour 2025.
* 63 « Le rôle du Cérema en matière d'appui aux collectivités territoriales : renforcer son activité au bénéfice des collectivités locales », juin 2021.
* 64 Adopté à l'unanimité des représentants des collectivités et des personnels ainsi que des personnalités qualifiées, les représentants de l'État n'ayant pas pris part au vote.
* 65 Réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur.
* 66 Réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur.
* 67 Réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur.
* 68 Réponses du CGDD au questionnaire du rapporteur.
* 69 Réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur.
* 70 Réponses du CGDD au questionnaire du rapporteur.
* 71 Réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur.
* 72 Réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur.
* 73 Réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur.
* 74 Réponses du CGDD au questionnaire du rapporteur.
* 75 Réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur.
* 76 Réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur.
* 77 Territoires ruraux et péri-urbains : des clés pour réussir son projet de mobilité, Cerema et Ademe, mai 2025.
* 78 Une première convention avait couvert la période 2020 et 2023 tandis que la convention actuelle, signée à la fin de l'année 2023 concerne les années 2024 à 2026.