Le Sénat français et les collectivités territoriales
Dernière mise à jour le 24 octobre 2007
III. LA GESTION ADMINISTRATIVE : LE SERVICE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
La création de ce service, en janvier 1998, a traduit la volonté de mieux affirmer, sur le plan administratif, la vocation constitutionnelle du Sénat à assurer la représentation des collectivités territoriales 3 ( * ) .
Sa mission s'étend à tous les aspects de la gestion locale décentralisée avec, en outre, le souci d'une grande ouverture en direction des acteurs locaux et des fonctionnaires territoriaux, grâce notamment aux nouvelles technologies. Sur le plan international, le service s'est attaché en premier lieu, à donner une dimension européenne à ses interventions, et en second lieu, à s'impliquer dans des missions de coopération décentralisée entre collectivités françaises et étrangères.
A. LES FONCTIONS DU SERVICE
1. Les consultations juridiques et financières relatives aux collectivités locales
La mission première du service est d'apporter aux sénateurs l'assistance administrative dont ils peuvent avoir besoin dans leurs relations avec les collectivités locales. Relèvent notamment de cette mission les cinq objectifs suivants :
· la fourniture aux sénateurs de consultations juridiques sur les questions intéressant l'administration locale et la décentralisation, en réponse à des problèmes concrets qu'ils se posent eux-mêmes dans l'exercice de leurs mandats locaux ou que les élus locaux de leur circonscription leur ont soumis ;
· la préparation, le cas échéant, de propositions de loi, d'amendements ou de questions au Gouvernement, sur les sujets relatifs à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales, à leurs compétences et à leur système de financement ;
· la réalisation d'études de fond sur les grands dossiers reflétant les préoccupations des élus locaux : sécurité juridique de l'action publique locale, finances locales, fonction publique territoriale, coopération intercommunale, urbanisme, interventions économiques des collectivités locales, statut de l'élu local, droit électoral, usage des nouvelles technologies... ;
· l'évaluation de l'impact d'une législation déterminée, en termes institutionnels ou financiers ;
· l'analyse de toutes les mesures législatives intéressant les collectivités locales au fur et à mesure de leur adoption et de leur promulgation ; et la publication d'un document annuel « Bilan législatif de la décentralisation » réunissant ces analyses.
2. Le développement de la communication institutionnelle avec les élus locaux et l'ensemble des acteurs du monde local
Outre une active politique de communication en direction des acteurs locaux (présentée ci-après), le Service des collectivités territoriales conduit les deux types de communication suivants :
· Communication en direction des grandes associations d'élus locaux
Le service a développé ses contacts avec les grandes associations d'élus locaux (Association des maires de France, Assemblée des départements de France, Association des régions de France, ainsi que les autres grandes associations d'élus locaux). Il est amené à participer aux congrès de ces associations et, le cas échéant, à marquer la présence du Sénat lors des manifestations annexes (Salon des maires, en particulier). Les relations avec les associations d'élus reposent sur des échanges d'informations et la recherche d'une coordination des actions entre le Sénat et ces associations, coordination qui trouve notamment à s'exprimer auprès de la Délégation française au Comité des régions de l'Union européenne 4 ( * ) .
· Colloques, Rencontres, Journées de réflexion et d'études
Le service organise ou participe à l'organisation de colloques dans l'enceinte du Palais du Luxembourg. Ces colloques mettent en présence aux côtés des parlementaires, des élus locaux, des fonctionnaires territoriaux, des universitaires, des représentants institutionnels (administrations, associations) ainsi, le cas échéant, que des partenaires de la gestion locale, permettant de confronter les points de vue et de faire émerger des propositions sur des thèmes intéressant les collectivités locales. Le service suit également et apporte, le cas échéant, sa participation aux Colloques ou Journées d'études organisés à l'extérieur, sur des sujets concernant la gestion locale.
3. Le Secrétariat de l'Observatoire de la Décentralisation
Créé par le Bureau du Sénat le 30 décembre 2004 et mis en place à partir de janvier 2005, l'Observatoire sénatorial de la décentralisation est chargé de suivre les nouveaux transferts de compétences, de personnels et de moyens financiers aux collectivités territoriales, de veiller au respect des garanties financières que le Sénat a fait inscrire dans la Constitution et de formuler des propositions d'amélioration de la décentralisation.
Le Service des collectivités territoriales est chargé d'en assurer le secrétariat.
4. Les actions européennes
Le service assure, en liaison avec le service des Affaires européennes, le suivi de travaux consacrés aux collectivités territoriales ou susceptibles d'avoir des conséquences pour elles, qui sont menés au sein de l'Union européenne, d'une part, du Conseil de l'Europe, d'autre part.
A ce titre, il apporte une assistance aux sénateurs membres de la délégation française au Comité des régions de l'Union européenne 5 ( * ) et prépare ainsi chacune des sessions plénières de celui-ci en fournissant, le cas échéant, à ses membres les informations qui peuvent les aider à prendre position, à partir notamment des travaux du Sénat. Il peut aussi assurer des missions d'expertise auprès du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe.
En outre, le service met un de ses fonctionnaires à la disposition de l'antenne du Sénat à Bruxelles dans le cadre d'une mission de soutien aux porteurs de projets locaux qui souhaitent bénéficier de financements communautaires. Chaque dossier fait l'objet, si nécessaire, d'un suivi auprès de la Commission européenne et des services français chargés de la mise en oeuvre des crédits européens dans les collectivités locales (SGAR et DATAR). Le service réalise des documents d'étude accessibles sur www.carrefourlocal.org, relatifs aux fonds structurels et à leur mode d'emploi.
5. La dimension internationale : la coopération décentralisée
Le service des Collectivités territoriales du Sénat français accueille des stagiaires : parlementaires, élus locaux et fonctionnaires étrangers, qui souhaitent obtenir des informations sur l'organisation territoriale en France et sur le modèle français de décentralisation.
Il est chargé du secrétariat des travaux de la Délégation du Bureau du Sénat à la Coopération décentralisée. Les interventions de celle-ci ont vocation à s'exercer notamment en direction des pays qui souhaitent bénéficier des actions de développement conduites par les collectivités françaises. Les actions encouragées ou développées par le Sénat s'exercent dans le cadre bilatéral ou unilatéral en s'appuyant sur des thématiques privilégiées : formation institutionnelle, développement durable, protection du patrimoine, gestion de l'eau, action touristique...
Ces activités sont assurées en étroite collaboration avec le service des Relations internationales.
B. ORGANIGRAMME ADMINISTRATIF
Placé sous l'autorité d'un directeur, le service des Collectivités territoriales compte neuf administrateurs, quatre administrateurs adjoints, un secrétaire administratif et quatre secrétaires.
Les administrateurs du service participent tous aux fonctions de conseil juridique. Toutefois, la technicité de certains dossiers imposant une spécialisation, chacun est, en outre, investi de responsabilités spécifiques : finances locales, urbanisme, action européenne ...
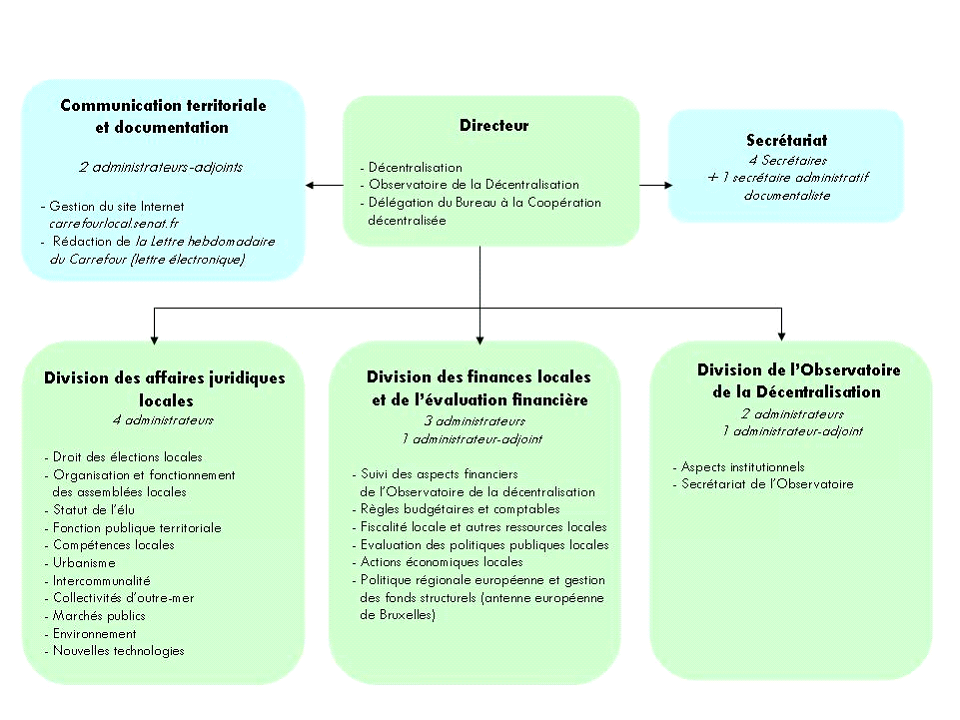
C. UN EXEMPLE DE TRANSPOSITION DU « MODÈLE » FRANÇAIS : LE SERVICE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DU SÉNAT DU ROYAUME DU CAMBODGE
La création ex nihilo d'un service des Collectivités territoriales au sein de l'administration du Sénat du royaume du Cambodge avait été approuvée, dans son principe, dès avant les élections sénatoriales de janvier 2006, par le comité permanent du Sénat (équivalent cambodgien du Bureau). Elle a immédiatement suivi ces élections sénatoriales qui ont ouvert la deuxième législature de cette assemblée 6 ( * ) .
Ce service, regroupant dix-neuf collaborateurs au total, est en cours de mise en place. Si son concept même s'inspire du modèle développé par le Sénat français, il convient de souligner que l'organisation de ce nouveau service s'est éloignée d'emblée du modèle sur deux points.
En premier lieu, l'articulation choisie est très différente de celle de son homologue français. Une structure régionalisée a, en effet, été retenue. Chaque bureau a en charge une ou plusieurs régions du Cambodge ( voir organigramme ci-après).
En second lieu, sa mission consiste à réunir une documentation, principalement statistique, sur chacune de celles-ci et à répondre aux questions et demandes de recherches des sénateurs. Elle est donc sensiblement plus étroite que celle de son homologue français.
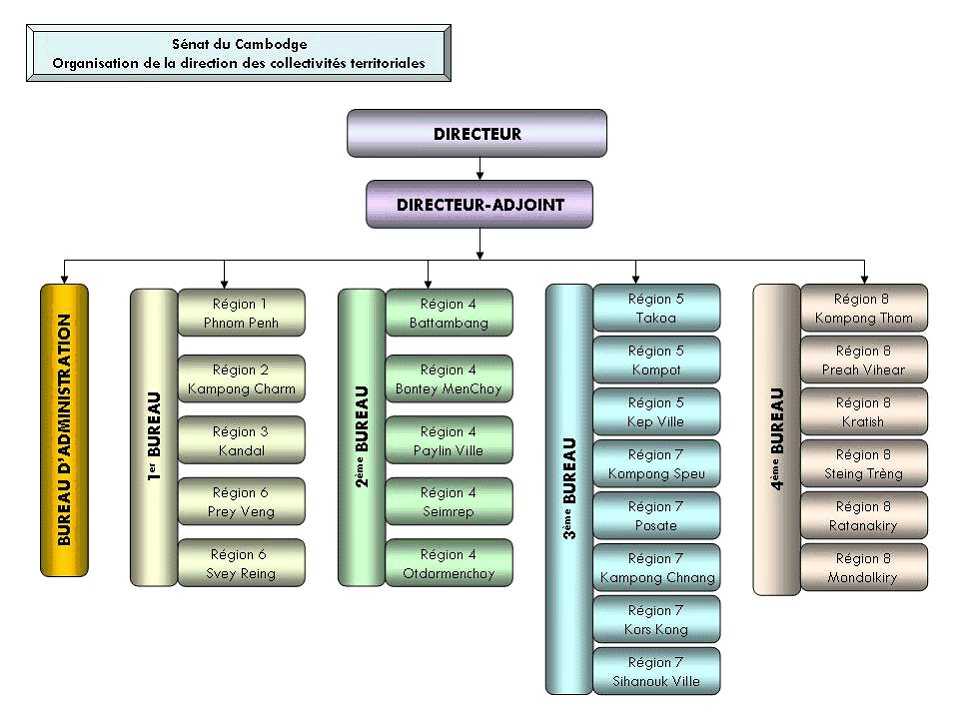
* 3 Le Sénat avait créé dès 1974 une division des Collectivités locales au sein du service des Etudes législatives. Cette division a été agrégée au nouveau service des Collectivités territoriales.
* 4 Ne pas confondre ce Comité, composé de 317 membres (et d'un nombre égal de suppléants), qui relève des structures de l'Union européenne, avec le Congrès des pouvoirs régionaux et locaux, qui relève des structures du Conseil de l'Europe.
* 5 Soit quatre sénateurs (deux au titre des régions et deux au titre des départements) dans la délégation renouvelée pour la période 2006 à 2010.
* 6 Créé par la révision constitutionnelle du 4 mars 1999, le Sénat cambodgien a, pour sa première législature (1999-2006) été composé de membres désignés par les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et proportionnellement au nombre de sièges de députés détenus par eux. Une loi du 20 juin 2005 a décidé que les sénateurs seront désormais élus, dans le cadre de huit circonscriptions régionales, par un collège électoral composé de députés ainsi que de tous les conseillers communaux élus dans la région (aux 57 sénateurs ainsi élus, s'ajoutent des sénateurs nommés par le Roi et deux sénateurs élus par l'Assemblée nationale).







