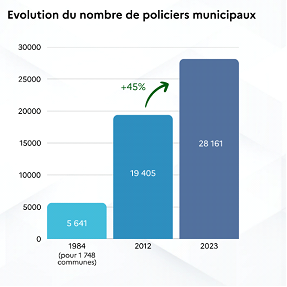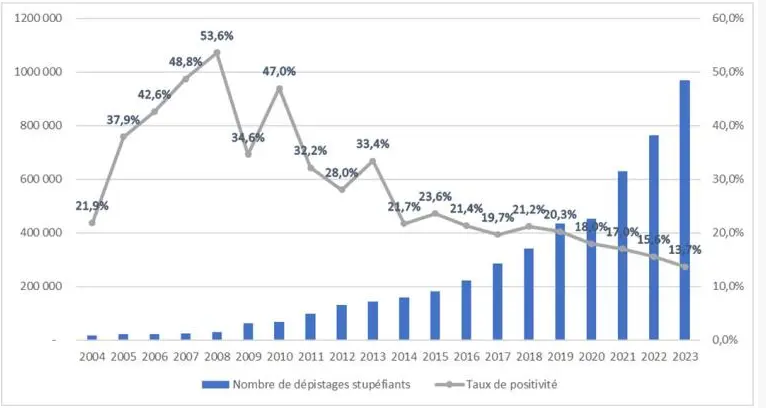ÉTUDE D'IMPACT
PROJET DE LOI
relatif à l'extension des prérogatives, des moyens, de l'organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres
NOR : INTD2522911L/Bleue-1
28 octobre 2025
TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS 10
TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION 12
TITRE IER - LE RÔLE DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES CHAMPÊTRES DANS LE MAINTIEN DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE SOUS LA RESPONSABILITÉ DU MAIRE 17
Article 1er - Réaffirmer le rôle des agents de police municipale et des gardes champêtres dans le continuum de sécurité 17
TITRE II - LES PRÉROGATIVES DES POLICES MUNICIPALES 24
CHAPITRE IER - LA CRÉATION DE SERVICES DE POLICE MUNICIPALE À COMPÉTENCE JUDICIAIRE ÉLARGIE 24
Article 2 - Étendre les prérogatives de police judiciaire des agents de police municipale et des gardes champêtres afin de leur permettre de constater certains délits limitativement énumérés 24
Article 3 - Extension du domaine des relevés d'identité réalisés par les agents de police municipale et les gardes champêtres 47
CHAPITRE II - LE RAPPROCHEMENT DES COMPÉTENCES DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES CHAMPÊTRES 56
Article 4 - Octroi de nouvelles prérogatives aux policiers municipaux et gardes champêtres 56
CHAPITRE III - MESURES DE DE COORDINATION AVEC LE NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 79
Article 5 - Habilitation du Gouvernement à opérer par ordonnance les coordinations nécessaires avec la future ordonnance de réécriture du code de procédure pénale 79
TITRE III - LES NOUVEAUX MOYENS D'ACTION DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES CHAMPÊTRES 83
Article 6 - Autoriser les caméras aéroportées pour les services de la police municipale 83
Article 7 - Etoffement de l'équipement des gardes champêtres 97
Article 8 - Permettre l'utilisation des dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation (LAPI) 114
Article 9 - Possibilité de financement par les régions de l'équipement des polices municipales ou des systèmes de vidéoprotection 123
TITRE IV - LA FORMATION DES POLICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES CHAMPÊTRES 128
Article 10 - Permettre au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de recruter des fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale et des gardes champêtres 128
Article 11 - Formation et dispense de formation des policiers municipaux 136
Article 12 - Renforcer le régime de la formation professionnelle des gardes champêtres et l'aligner sur le dispositif rénové des policiers municipaux 146
TITRE V - MUTUALISATION ET COORDINATION DES POLICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES CHAMPÊTRES ENTRE COMMUNES 154
Article 13 - Elargissement du recours aux assistants temporaires de police municipale et alignement du régime de mutualisation événement exceptionnel/catastrophe 154
Article 14 - Renforcement des dispositifs de mutualisation et de coordination applicables aux policiers municipaux et gardes champêtres 163
TITRE VI - CONTRÔLE ET DÉONTOLOGIE DES POLICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES CHAMPÊTRES 178
Article 15 - Harmonisation et clarification des dispositions sur l'agrément et la prestation de serment des agents de police municipale et création d'un agrément préfectoral pour les gardes champêtres 178
Article 16 - Création de la faculté de contrôler le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) dans le cadre de ses activités de formation des fonctionnaires de police municipale 193
Article 17 - Étendre aux gardes champêtres le code de déontologie des agents de police municipale 200
Article 18 - Étendre la compétence de la commission consultative des polices municipales (CCPM) à la thématique des gardes champêtres 206
TITRE VII - DISPOSITIONS D'ADAPTATION DANS LES OUTRE-MER 212
Article 19 - Dispositions d'adaptation dans les outre-mer 212
INTRODUCTION GÉNÉRALE
Ainsi que l'ont mis en lumière les violences urbaines de l'été 2023, ou encore récemment l'attaque du 22 février 2025 à Mulhouse, les polices municipales jouent un rôle déterminant dans la sécurité au quotidien de nos concitoyens, en complémentarité avec les forces de sécurité intérieure.
Or, alors que la place des polices municipales, au sein du continuum de sécurité, n'a cessé de s'affirmer au cours des dernières décennies, en atteste la croissance continue du nombre de policiers municipaux, qui a augmenté entre 2012 et 2023 de 45 %, pour atteindre aujourd'hui plus de 28 000 agents, et que, dans le même temps, les formes de délinquance et d'incivilité auxquelles elles font face, souvent en première ligne, n'ont cessé d'évoluer, aucune loi majeure spécifiquement dédiée aux polices municipales n'est intervenue depuis la loi fondatrice n° 99-291 du 15 avril 1999, dite loi « Chevènement ».
Certes, des évolutions législatives et réglementaires ponctuelles sont intervenues et ont permis de :
- renforcer certaines de leurs compétences : que ce soit en matière de lutte contre l'insécurité routière1(*), de protection des personnes contre les chiens dangereux2(*), de sécurité dans les transports3(*), de la lutte contre les dépôts de déchets4(*), au travers de l'élargissement de la liste des infractions que les agents de polices municipales peuvent relever5(*), ou, à compter de 20176(*), dans un contexte de menace terroriste élevée, pour la sécurisation des périmètres de protection de certains événements d'abord limités aux manifestations récréatives, sportives et culturelles rassemblant plus de 300 personnes7(*), possibilité élargie en 2021, au-delà de tout seuil8(*) ; de même en matière de vidéoprotection, avec la possibilité, depuis 20219(*), pour les policiers municipaux d'accéder aux images issues des commerces situés dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression et de vol10(*) ;
- adapter certains de leurs équipements : en 201611(*), une expérimentation des caméras piétons pour les policiers municipaux a ainsi été lancée avant d'entrer dans le droit commun en 201812(*). Les gardes champêtres ont fait l'objet d'une expérimentation semblable en 202113(*). Les policiers municipaux sont aussi désormais autorisés à utiliser des équipements permettant d'immobiliser les véhicules14(*) et leurs services peuvent constituer des brigades cynophiles15(*). Une disposition visant à autoriser le recours à des drones aux policiers municipaux a toutefois été censurée à deux reprises par le Conseil constitutionnel, en 202116(*) et en 202217(*). La carte professionnelle, les tenues, les équipements et les véhicules des gardes champêtres sont par ailleurs désormais encadrés18(*) ;
- faciliter les possibilités de mutualisation : dès 2002, a été introduite19(*) la possibilité pour un établissement public de coopération intercommunale de recruter et d'équiper des agents de police municipale, en 200720(*) la possibilité de procéder à une mutualisation par voie de convention et, en 202121(*), la possibilité de recourir à un syndicat de communes.
En dépit de ces évolutions indéniables et continues, certains freins juridiques et techniques persistent et entravent les polices municipales dans leur capacité à agir toujours plus efficacement, au service de la tranquillité publique, dans un rapport de proximité avec les citoyens.
En effet, outre la question de l'accès à certains types d'équipements, comme la vidéo-verbalisation ou le recours à des drones sous l'autorité du préfet, demeure la question du possible élargissement des prérogatives des policiers municipaux à des délits du quotidien clairement circonscrits, comme par exemple le défaut d'assurance22(*), la conduite sans permis23(*), ou l'occupation illicite de hall d'immeuble24(*), auxquels les polices municipales sont régulièrement confrontées et qui constituent une partie du terreau de l'insécurité au quotidien. Réclamé par un certain nombre d'élus, voté à deux reprises par le législateur, cet élargissement s'est heurté à deux reprises (201125(*), 202126(*)) à la censure du Conseil constitutionnel. La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure conférait ainsi la qualité d'agent de police judiciaire aux agents du cadre d'emplois des directeurs de police municipale, lorsque la convention de coordination en disposait ainsi27(*). La loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés conférait à titre expérimental la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de police municipale. Les deux textes de loi ont été censurés en ce qu'ils méconnaissaient l'article 66 de la Constitution, qui prévoit que l'exercice de la police judiciaire doit se faire sous la direction, le contrôle et la surveillance de l'autorité judiciaire. Pour autant, dans sa décision du 20 mai 2021, le Conseil constitutionnel a précisé les critères à remplir pour permettre une telle évolution.
C'est partant de ce constat, porté par de nombreux élus et inscrit dans plusieurs rapports parlementaires28(*), de la nécessité de lever certains freins juridiques et techniques et à nouveau mis en exergue à l'occasion des violences urbaines de l'été 2023, qu'une concertation, intitulée « Beauvau des Polices municipales », a été engagée, dans la lignée du discours de la Sorbonne de la Première ministre, Élisabeth Borne, en avril 2024, sous l'égide du ministre de l'intérieur, en lien étroit avec le garde des sceaux, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, d'une part, et d'élus et de représentants de l'association des maires de France, d'autre part.
Poursuivie par le ministre d'État, ministre de l'intérieur, Bruno Retailleau et le ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur, François-Noël Buffet, cette concertation a donné lieu à de nombreux échanges, notamment avec les associations d'élus.
Plusieurs ateliers de travail ont été organisés à Lyon29(*), Metz30(*), Meaux31(*) et Le Havre32(*), associant l'État, des parlementaires, des corps de contrôle, des élus et association d'élus, ainsi que des organisations syndicales de polices municipales. S'en sont suivies de nombreuses rencontres bilatérales avec les associations d'élus, les organisations syndicales et le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
Les travaux se sont articulés autour des mots d'ordre suivants :
- les polices municipales et les gardes champêtres sont et doivent rester une police de proximité, au service de la tranquillité publique et n'ont pas vocation à se substituer aux forces de sécurité intérieure, avec qui ils doivent agir en parfaite complémentarité et en étroite collaboration, comme plus généralement avec l'ensemble des acteurs du continuum de sécurité. Ce principe doit être consacré par la loi ;
- il revient aux maires qui emploient les polices municipales et les gardes champêtres de définir leur doctrine d'intervention33(*), dans le respect du cadre fixé par la loi et le règlement. La libre administration des collectivités territoriales a ainsi été au centre des réflexions conduites et un élément structurant des évolutions proposées par le présent projet de loi ;
- il est nécessaire de permettre aux maires qui le souhaiteraient de doter leurs policiers municipaux de prérogatives judiciaires élargies à des délits du quotidien strictement circonscrits, en les confortant dans leur rôle de police de proximité et de renforcer la capacité à agir sur le terrain des policiers municipaux et des gardes champêtres ;
- toute prérogative supplémentaire appelle des responsabilités et des modalités de contrôle accrues, notamment par l'autorité judiciaire ;
- les gardes-champêtres sont des acteurs essentiels de la sécurité dans les territoires ruraux, le rôle doit être reconnu, au même titre que celui des polices municipales. Les textes doivent être ajustés pour faire converger, lorsque cela apparaît nécessaire et pertinent, les dispositions relatives aux polices municipales et aux gardes-champêtres, des possibilités de mise en commun entre service de police municipale et gardes champêtres doivent également être proposées ;
- une attention particulière doit être portée aux évolutions souhaitables dans les Outre-mer.
En réponse à ces orientations et fidèle aux trois grands piliers consacrés par la loi « Chevènement » (1. les polices municipales ont vocation à travailler en complémentarité des forces de sécurité de l'État, 2. elles doivent disposer de moyens adaptés aux missions qui sont les leurs, et 3. faire l'objet d'un contrôle adéquat34(*)), le présent projet de loi, qui vise ainsi à compléter le droit, tel qu'il découle principalement de la loi de 1999 et au regard des évolutions précédemment rappelées, entend ouvrir la possibilité aux communes qui le souhaitent, dans des conditions permettant de satisfaire aux exigences posées par le juge constitutionnel, que leurs agents disposent de prérogatives judiciaires élargies.
Pour autant, ces prérogatives élargies ne sont qu'un des aspects de la réforme que le Gouvernement entend mener. Il est par exemple prévu d'autoriser les communes à recourir à la lecture automatisée de plaques d'immatriculation aux fins de faciliter la vidéo-verbalisation, de supprimer l'obligation de commissionnement par le maire qui pèse sur les agents avant qu'ils ne puissent relever les infractions à la police de l'urbanisme35(*).
Par ailleurs, ainsi qu'a permis de l'établir le cycle de concertation du Beauvau des polices municipales, les employeurs territoriaux sont fortement préoccupés par la formation initiale des agents de police municipale, et les délais avant leur mise à l'emploi. Les dispositions du présent projet de loi visent dès lors à aligner le régime des policiers municipaux et des gardes champêtres sur le droit commun de la fonction publique territoriale, en proposant des dispenses au regard des acquis de l'expérience, qui pourront être décidées par le CNFPT.
Complété par des modifications réglementaires pour notamment rendre le CNFPT autonome quant à la formation à l'armement - en lui permettant d'acquérir et de stocker des armes dans ses nouveaux centres de formation -, le projet de loi doit également permettre une accélération des formations. Une circulaire viendra parallèlement refondre le processus d'instruction par les préfectures des demandes d'agrément et d'autorisation de port d'arme. Ce train de mesures sera vraisemblablement de nature à permettre une mise à l'emploi plus rapide sur la voie publique des agents recrutés par les collectivités.
A plus long terme, pour simplifier les démarches des collectivités et des agents, tout en fiabilisant le contrôle par l'État, un projet de transformation numérique est prévu, pour dématérialiser les différents processus, fluidifier les échanges entre les différentes parties - dans le format actuel, la rédaction des conventions de coordination peut être particulièrement longue - et offrir une réponse globale au sujet de la consultation des fichiers de police.
Le projet de loi vise par ailleurs à faciliter les mutualisations entre communes, à la fois de policiers municipaux mais également de policiers municipaux et de gardes champêtre.
Il sera complété de différentes mesures réglementaires visant notamment à renforcer les dispositifs de reconnaissance du rôle des polices municipales et des gardes-champêtres au service du continuum de sécurité.
TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS
|
Article |
Objet de l'article |
Consultations obligatoires |
Consultations facultatives |
|
1er |
Réaffirmer le rôle des agents de police municipale et des gardes champêtres dans le continuum de sécurité |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
|
2 |
Étendre les prérogatives de police judiciaire des agents de police municipale et des gardes champêtres afin de leur permettre de constater certains délits limitativement énumérés |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) Groupe interministériel permanent de la sécurité routière (GIPSR) |
Sans objet. |
|
3 |
Extension du domaine des relevés d'identité réalisés par les agents de police municipale et les gardes champêtres |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
|
4 |
Octroi de nouvelles prérogatives aux policiers municipaux et gardes champêtres |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
|
5 |
Habilitation du Gouvernement à opérer par ordonnance les coordinations nécessaires avec la future ordonnance de réécriture du code de procédure pénale |
Sans objet. |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
|
6 |
Autoriser les caméras aéroportées pour les services de police municipale |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) |
Sans objet. |
|
7 |
Etoffement de l'équipement des gardes champêtres |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) |
Sans objet. |
|
8 |
Permettre l'utilisation des dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation (LAPI) |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) Groupe interministériel permanent de la sécurité routière (GIPSR) Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) |
Sans objet. |
|
9 |
Possibilité de financement par les régions de l'équipement des polices municipales ou des systèmes de vidéoprotection |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
|
10 |
Permettre au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de recruter des fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale et des gardes champêtres |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) |
Sans objet. |
|
11 |
Formation et dispense de formation des policiers municipaux |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) |
Sans objet. |
|
12 |
Renforcer le régime de la formation professionnelle des gardes champêtres et l'aligner sur le dispositif rénové des policiers municipaux. |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) |
Sans objet. |
|
13 |
Elargissement du recours aux assistants temporaires de police municipale et alignement du régime de mutualisation événement exceptionnel/catastrophe |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
|
14 |
Renforcement des dispositifs de mutualisation et de coordination applicables aux policiers municipaux et gardes champêtres |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) Conseil supérieur de la fonction publique (CSFPT) |
Sans objet. |
|
15 |
Harmonisation et clarification des dispositions sur l'agrément et la prestation de serment des agents de police municipale et création d'un agrément préfectoral pour les gardes champêtres |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
|
16 |
Création de la faculté de contrôler le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) dans le cadre de ses activités de formation des fonctionnaires de police municipale |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
|
17 |
Étendre aux gardes champêtres le code de déontologie des agents de police municipale |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
|
18 |
Étendre la compétence de la commission consultative des polices municipales (CCPM) à la thématique des gardes champêtres |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
|
19 |
Dispositions d'adaptation dans les outre-mer |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) Congrès de Nouvelle-Calédonie |
Sans objet. |
TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION
|
Article |
Objet de l'article |
Textes d'application |
Administration compétente |
|
1er |
Réaffirmer le rôle des agents de police municipale et des gardes champêtres dans le continuum de sécurité |
Néant. |
Sans objet. |
|
2 |
Étendre les prérogatives de police judiciaire des agents de police municipale et des gardes champêtres afin de leur permettre de constater certains délits limitativement énumérés |
Décrets en Conseil d'Etat Décret simple Arrêtés |
Ministère de l'intérieur Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) Ministère de la justice Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) |
|
3 |
Extension du domaine des relevés d'identité réalisés par les agents de police municipale et les gardes champêtres |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
4 |
Octroi de nouvelles prérogatives aux policiers municipaux et gardes champêtres |
Décret en Conseil d'Etat |
Ministère de l'Intérieur Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) |
|
5 |
Habilitation du Gouvernement à opérer par ordonnance les coordinations nécessaires avec la future ordonnance de réécriture du code de procédure pénale |
Ordonnance |
Ministère de la Justice Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) |
|
6 |
Autoriser les caméras aéroportées pour les services de police municipale |
Arrêtés |
Ministère de l'intérieur Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) Direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes (DEPSA) |
|
7 |
Etoffement de l'équipement des gardes champêtres |
Décrets en Conseil d'Etat |
Ministère de l'intérieur Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) |
|
8 |
Permettre l'utilisation des dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation (LAPI) |
Néant. |
Sans objet. |
|
9 |
Possibilité de financement par les régions de l'équipement des polices municipales ou des systèmes de vidéoprotection |
Néant. |
Sans objet. |
|
10 |
Permettre au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de recruter des fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale et des gardes champêtres |
Décrets en Conseil d'Etat |
Ministère de l'intérieur Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation Direction générale des collectivités locales (DGCL) |
|
11 |
Formation et dispense de formation des policiers municipaux |
Décrets en Conseil d'Etat |
Ministère de l'intérieur Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation Direction générale des collectivités locales (DGCL) |
|
12 |
Renforcer le régime de la formation professionnelle des gardes champêtres et l'aligner sur le dispositif rénové des policiers municipaux. |
Décrets en Conseil d'Etat |
Ministère de l'intérieur Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation Direction générale des collectivités locales (DGCL) |
|
13 |
Elargissement du recours aux assistants temporaires de police municipale et alignement du régime de mutualisation événement exceptionnel/catastrophe |
Néant. |
Sans objet. |
|
14 |
Renforcement des dispositifs de mutualisation et de coordination applicables aux policiers municipaux et gardes champêtres |
Néant. |
Sans objet. |
|
15 |
Harmonisation et clarification des dispositions sur l'agrément et la prestation de serment des agents de police municipale et création d'un agrément préfectoral pour les gardes champêtres |
Décret en Conseil d'Etat |
Ministère de l'intérieur Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) Direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes (DEPSA) Ministère de la justice Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) |
|
16 |
Création de la faculté de contrôler le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) dans le cadre de ses activités de formation des fonctionnaires de police municipale |
Décret en Conseil d'Etat |
Ministère de l'intérieur Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) Direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes (DEPSA) Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation Direction générale des collectivités locales (DGCL) |
|
17 |
Étendre aux gardes champêtres le code de déontologie des agents de police municipale |
Néant. |
Sans objet. |
|
18 |
Étendre la compétence de la commission consultative des polices municipales (CCPM) à la thématique des gardes champêtres |
Décret en Conseil d'Etat |
Ministère de l'intérieur Direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes (DEPSA) |
|
19 |
Dispositions d'adaptation dans les outre-mer |
Néant. |
Sans objet. |
TABLEAU D'INDICATEURS
|
Indicateur |
Objectif et modalités de l'indicateur |
Objectif visé (en valeur et/ou en tendance) |
Horizon temporel de l'évaluation (période ou année) |
Identification et objectif des dispositions concernées |
|
Nombre de communes ou intercommunalités ayant opté pour l'octroi de compétences judiciaires élargies |
Cet indicateur vise à mesurer l'impact de l'octroi d'une possibilité pour les communes et les intercommunalités de disposer d'un service de police municipale à compétences judiciaires élargies et à évaluer la manière dont les communes et les intercommunalités se sont emparés de cette option. |
Augmentation |
Annuel |
Article 2 Étendre les prérogatives de police judiciaire des agents de police municipale et des gardes champêtres afin de leur permettre de constater certains délits limitativement énumérés Nouvel article L. 512-8 du code de la sécurité intérieure |
|
Nombre d'agents de police municipale disposant de prérogatives de polices judiciaires élargies en détaillant le nombre de personnes ayant des fonctions d'encadrement mentionnés au nouvel article L. 512-9 du CSI |
Cet indicateur vise à mesurer l'impact de l'octroi de nouvelles prérogatives de police judiciaire aux agents de police municipale. |
Hausse en % du nombre d'agents disposant des nouvelles prérogatives |
Annuel |
Article 2 Étendre les prérogatives de police judiciaire des agents de police municipale et des gardes champêtres afin de leur permettre de constater certains délits limitativement énumérés Nouveaux articles L. 512-8 et L. 512-9 du code de la sécurité intérieure |
|
Nombre d'amendes forfaitaires délictuelles émises par les agents de police municipale |
Cet indicateur vise à mesurer l'utilisation par les services de police municipale à compétences élargies de la procédure d'amende forfaitaire délictuelle pour verbaliser les délits pour lesquels ils sont compétents (nouvel article L. 512-15 du CSI). |
Augmentation |
Annuel |
Article 2 Étendre les prérogatives de police judiciaire des agents de police municipale et des gardes champêtres afin de leur permettre de constater certains délits limitativement énumérés Nouvel article L. 512-15 du code de la sécurité intérieure |
|
Nombre de communes ayant recouru à l'expérimentation |
Rapport d'évaluation remis par la commune ayant recouru à l'expérimentation au Gouvernement |
5 ans à compter de la promulgation de la loi (soit 2031) |
Article 6 Autoriser, à titre expérimental, les caméras aéroportées pour les services de police municipale |
TITRE IER - LE RÔLE DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES CHAMPÊTRES DANS LE MAINTIEN DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE SOUS LA RESPONSABILITÉ DU MAIRE
Article 1er - Réaffirmer le rôle des agents de police municipale et des gardes champêtres dans le continuum de sécurité
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Les missions des agents de police municipale et des gardes champêtres sont actuellement prévues par le code de la sécurité intérieure (CSI), auquel renvoient les articles du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs au rôle du maire en matière de prévention de la délinquance et de police municipale.
Ainsi, le titre Ier du livre V du CSI, auquel renvoie l' article L. 2212-5 du CGCT, définit les missions confiées aux agents de police municipale. L' article L. 511-1 du CSI prévoit notamment que « sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ».
De même, les missions des gardes champêtres sont prévues au titre II du livre V du CSI, auquel renvoie l' article L. 2213-17 du CGCT. L' article L. 521-1 du CSI dispose ainsi que « les gardes champêtres concourent à la police des campagnes. Ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale ».
En outre, la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du CSI prévoit les conditions dans lesquelles est conclue une convention permettant de coordonner les interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat (police et gendarmerie nationales).
Toutefois, en-dehors de ces conventions, aucune disposition n'indique explicitement comment se coordonnent l'exercice des missions de maintien de la tranquillité publique des forces de sécurité locales et nationales dans le cadre plus général d'une politique de sécurité et de prévention de la délinquance cohérente36(*).
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Il appartient au législateur d'assurer, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public (voir CC, 28 juillet 1989, Loi relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France, n°89-261 DC), précisé par la jurisprudence constitutionnelle comprenant notamment la sécurité des personnes et des biens et la prévention des atteintes à l'intégrité physique des personnes, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la fraude, ou bien la prévention des actes terroristes et de la récidive.
En outre, en vertu des articles 72 et 72-2 de la Constitution, les collectivités territoriales " s'administrent librement par des conseils élus " et bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement "dans les conditions prévues par la loi ".
L'article 34 de la Constitution dispose quant à lui que la loi détermine les principes fondamentaux « de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources »
Les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités et le livre V du code de la sécurité intérieure s'inscrivent dans ce cadre pour définir, d'une part, les compétences du maire en matière de police municipale et d'autre part, les conditions d'exercice des polices municipales.
Or, aucune disposition ni ne mentionne explicitement que les polices municipales sont placées, en dehors de l'exercice des compétences judiciaires, sous l'autorité du maire, ni ne définit le cadre général de leur intervention.
Compte tenu des dispositions législatives récentes relatives aux attributions de la police municipale et des gardes champêtres, et la montée en compétence de ces forces dont le présent projet de loi constitue la dernière incarnation, la définition dans la loi du cadre dans lequel elles exercent leurs missions est une évolution attendue.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La disposition envisagée ne se heurte à aucune règle conventionnelle.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Le rapport publié par la Cour des comptes en octobre 2020 identifiait trois modes d'organisation concernant l'organisation des polices locales ou municipales en Europe et leur place par rapport à celles des autres forces de la sécurité intérieure :
- Pays ne disposant pas de polices municipales : Pays-Bas et Royaume-Uni ;
- Pays dans lesquels les polices municipales ou locales assument un rôle prépondérant dans la gestion de la sécurité publique : Allemagne et Belgique ;
- Les pays dans lesquels les polices municipales ne jouent qu'un rôle complémentaire dans la sécurité intérieure, au côté de polices nationales : Italie, Espagne.
Par l'organisation de ses forces de sécurité intérieure, la France est considérée comme appartenant au troisième groupe.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Les polices municipales et les gardes champêtres jouent un rôle actif dans le maintien de la tranquillité publique, en complément des forces de police et de gendarmerie nationales.
Toutefois, aucune disposition n'indique explicitement comment s'inscrit, dans le cadre plus général d'une politique de sécurité et de prévention de la délinquance cohérente et coordonnée, l'exercice des missions de maintien de la tranquillité publique, prenant en compte l'ensemble des forces de sécurité.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le présent article a pour objectif de prévoir dans la loi le rôle de proximité des polices municipales qui, sous l'autorité du maire, contribuent au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la tranquillité publiques, ainsi qu'au continuum de sécurité37(*) dans le cadre d'une action coordonnée avec les forces de sécurité de l'Etat.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Une option aurait pu consister à considérer que les dispositions actuelles permettent d'ores et déjà aux agents de police municipale et aux gardes champêtres d'exercer leur mission de maintien de la tranquillité publique, sous l'autorité du maire et de manière coordonnée avec les forces de sécurité de l'Etat.
Toutefois, cette option présente l'inconvénient d'être peu lisible et de ne pas affirmer le rôle primordial des polices municipales dans le quotidien des populations, en tant que composante de la police de la tranquillité, de la salubrité et de la sécurité publiques ainsi que de la politique de prévention de la délinquance, en lien avec les forces de sécurité de l'Etat.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La présente disposition prévoit de rétabli un article L. 2211-2 du CGCT consacrant le rôle des polices municipales dans le continuum de sécurité, en posant les principes suivants :
- les agents de polices municipale et les gardes champêtres concourent, sous l'autorité du maire, à la police de la tranquillité, de la salubrité et de la sécurité publiques et à la politique de prévention de la délinquance dans le cadre de leurs missions fixées au livre V du code de la sécurité intérieure ;
- ils peuvent en outre participer aux actions de prévention de la délinquance, en coordination avec les forces de sécurité de l'Etat.
Cette mesure va dans le sens des conclusions de la mission d'information sur les polices municipales de la commission des lois du Sénat publiée en mai 2025, qui posaient deux principes directeurs pour l'action des polices municipales :
- La préservation de la pleine autorité du maire sur l'action des polices municipales. Pour que les policiers municipaux puissent se voir accorder des prérogatives judiciaires supplémentaires, il est nécessaire de les placer sous la direction, le contrôle et la surveillance de l'autorité judiciaire. Le présent article réaffirme que les polices municipales demeurent sous l'autorité du maire, à l'image de ce qui existe du côté des forces de sécurité de l'Etat, avec une autorité administrative, le préfet qui est responsable des missions de sécurité, sans préjudice de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire dès lors qu'elles font usage de leurs prérogatives de police judiciaire ;
- La préservation d'un champ de missions centré sur la tranquillité publique et la sécurité du quotidien, s'inscrivant en complémentarité avec l'action des forces de sécurité intérieure.
La présente disposition réaffirme en effet qu'il ne saurait y avoir de substitution, mais bien une complémentarité, l'État restant garant de la sécurité publique sur le territoire, quels que puissent être les choix politiques locaux.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article rétabli l'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Le présent article n'est contraire à aucun texte international ou européen.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le présent article n'engendre ni coût, ni charge de travail supplémentaire en tant que tel sur les collectivités territoriales.
Il confirme que les polices municipales demeurent sous l'autorité du maire, sans préjudice de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire dès lors qu'elles font usages de leurs prérogatives de police judiciaire.
Ce fonctionnement correspond à celui des forces de sécurité intérieure, le préfet, autorité administrative, étant responsable des missions de sécurité, sans préjudice là encore de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire dès lors que les forces de sécurité intérieure de l'Etat font usage de leurs prérogatives de police judiciaire.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Le présent article vise une meilleure coordination dans le maintien de l'ordre et de la tranquillité publics, ainsi que dans la politique de prévention. S'inscrivant en écho avec les compétences renforcées des services de police municipale et les gardes-champêtres prévues dans le présent projet de loi, cet article contribuera à la lisibilité de l'action de tous les acteurs par les usagers.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Le présent article vise une meilleure coordination dans le maintien de l'ordre et de la tranquillité publics, ainsi que dans la politique de prévention.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été saisi pour avis, à titre obligatoire, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, et a rendu un avis favorable en date du 2 octobre 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Le présent article s'applique à l'ensemble du territoire hexagonal.
Il s'applique pour les communes dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il s'applique également dans les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
En l'absence de mention expresse d'extension, il ne s'applique pas en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Il ne s'applique pas non plus dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les TAAF, en l'absence de communes et donc de police municipale dans ces collectivités.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne nécessite pas de texte réglementaire d'application.
TITRE II - LES PRÉROGATIVES DES POLICES MUNICIPALES
CHAPITRE IER - LA CRÉATION DE SERVICES DE POLICE MUNICIPALE À COMPÉTENCE JUDICIAIRE ÉLARGIE
Article 2 - Étendre les prérogatives de police judiciaire des agents de police municipale et des gardes champêtres afin de leur permettre de constater certains délits limitativement énumérés
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Chaque commune peut choisir de créer ou non un service de police municipale ( art L. 511-1, 1er alinéa, du code de la sécurité intérieure). Le nombre de collectivités optant pour cette possibilité a doublé en quarante ans, passant de 1 748 en 1984 à 3 812 en 202338(*). Les services de police municipale se sont également étoffés, le nombre d'agents de police municipale a ainsi été multiplié par 5, passant de 5 641 agents en 1984 à 28 161 en 202339(*).
Les services de police municipale ne constituent pas un ensemble homogène et répondent à des réalités très différentes. Ainsi, si près de la moitié des services de police municipale sont composés de moins de trois agents de police municipale, plusieurs de ces services regroupent plus d'une centaine d'agents40(*). En fonction du nombre d'agents, les services de police municipale disposent de modalités de fonctionnement et de missions très différentes.
En outre, chaque maire fixe, dans les limites de la loi, la doctrine d'emploi de sa police municipale41(*). Dès lors, les missions et les moyens attribués à chaque police municipale sont très variables sur le territoire.
La loi fixe un socle de compétences attribuées aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, qui les exercent dans les limites territoriales de la commune qui les emploie. Ces prérogatives relèvent de la police administrative ou de la police judiciaire.
Les missions de police judiciaire des agents de police municipale
Les prérogatives de police judiciaire des agents de police municipale sont principalement définies par le code de procédure pénale et le code de la sécurité intérieure.
Conformément au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale (CPP), les agents de police municipale ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint (APJA). A ce titre, ils ont pour missions :
- De seconder dans l'exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire (OPJ) ;
- De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques, notamment au maire, et à tout OPJ territorialement compétent, de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
- De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres.
Les prérogatives de police judiciaire des agents de police municipale consistent essentiellement à constater des contraventions.
Les agents de police municipale sont ainsi compétents pour constater, par procès-verbal :
- les contraventions aux arrêtés de police du maire42(*) ;
- les contraventions aux dispositions du livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat43(*), telles que la divagation d'animaux dangereux ou l'abandon d'ordure, de déchets, de matériaux et autres objets, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes44(*) ;
- les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat45(*) ;
- les infractions à la police de la conservation du domaine public routier 46(*);
- l'infraction d'outrage sexiste et sexuel lorsqu'elle constitue une contravention ou lorsqu'elle constitue le délit prévu à l'article 222-33-1-1 du code pénal47(*) ;
- les infractions mentionnées à l'article L. 2241-1 du code des transports en matière de transport collectif de voyageurs48(*) ;
- les infractions forestières, conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier ;
- certaines infractions au code de l'environnement49(*) ;
- les infractions à la législation sur les chiens dangereux 50(*);
- Les infractions de vente de protoxyde d'azote prévues à l'article L. 3611-3 du code de la santé publique51(*).
Les agents de police municipale sont également compétents pour constater, par rapport, le délit d'occupation illicite des halls d'immeuble prévu par l'article L. 272-4 du code de la sécurité intérieure.
En application de l'article 78-6 du CPP, les agents de police municipale sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux de constatation des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorise à constater, ainsi que des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative spécifique.
Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police municipale peuvent également recueillir les éventuelles observations du contrevenant.
L'alinéa 2 de l'article 21-2 du CPP précise que les agents de police municipale « adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République ».
Enfin, dès lors que la procédure d'amende forfaitaire, prévue aux articles 529 et suivants du CPP, est applicable aux contraventions que les agents de police municipale sont habilités à constater, ils peuvent faire usage de cette procédure. Celle-ci, applicable aux contraventions dont la liste est fixée à l'article R.48-1 du CPP, permet d'éteindre l'action publique par le paiement d'une amende forfaitaire dont le montant est fixé, pour chaque classe de contraventions, à l'article R. 49 du CPP.
Les missions de police judiciaire des gardes champêtres
Contrairement aux agents de police municipale, les gardes champêtres ne disposent pas, de manière générale, de la qualité d'agent de police judiciaire adjoint. En application du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale, ils ne disposent de cette qualité que lorsqu'ils constatent les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les gardes champêtres sont habilités à constater les infractions suivantes :
- contraventions aux règlements et arrêtés de police du maire52(*) ;
- contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat53(*) ;
- contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, telles que la filouterie de péage ou le refus d'obtempérer à une injonction d'enlever un objet troublant la circulation54(*) ;
- infractions forestières mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-4 du code forestier ;
- infractions au code de l'environnement55(*) ;
- infractions à la législation sur les chiens dangereux56(*) ;
- infractions de vente de protoxyde d'azote prévues à l'article L. 3611-3 du code de la santé publique57(*) ;
- délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés58(*).
En application de l'article L. 522-4 du code de la sécurité intérieure, les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le Conseil constitutionnel affirme avec constance, depuis sa décision n° 2011-625 du 10 mars 2011, « qu'il résulte de cet article 66 [de la Constitution] que la police judiciaire doit être placée sous la direction de l'autorité judiciaire ».
S'agissant des agents de police municipale, il a ainsi jugé « [...] que cette exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas respectée si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire » 59(*).
Les OPJ opèrent ainsi le rôle d'intermédiaire entre le procureur de la République et les agents de police municipale dans l'exercice de leurs prérogatives de police judiciaire. Toutefois, pour que l'article 66 de la Constitution soit respecté, le lien entre les agents de police municipale et les OPJ doit être effectif.
C'est dans le cadre de ce contrôle que le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure qui attribuaient aux agents municipaux le pouvoir d'opérer des contrôles d'identité à des fins de police judiciaire et conféraient aux membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale la qualité d'APJ, au motif que ces agents n'étaient pas mis à la disposition des OPJ.
Dans le cadre de la loi « sécurité globale »60(*), le législateur a fait le choix de placer les agents de police municipale, dans le cadre de l'exercice de leurs prérogatives judiciaires non pas à la disposition des OPJ, mais à celle des directeurs de police municipale. Le Conseil constitutionnel a adapté son contrôle à cette configuration.
Dans sa décision n° 2021-817 DC, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de la loi sécurité globale qui octroyaient de nouvelles prérogatives de police judiciaire aux agents de police municipale au motif que l'exigence de placement de la police judiciaire sous le contrôle de l'autorité judiciaire « ne serait pas respectée si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition d'officiers de police judiciaire ou de personnes présentant des garanties équivalentes ».
Le Conseil constitutionnel a procédé par comparaison avec les dispositions du code de procédure pénale relatives aux liens entre le procureur de la République et les OPJ. Il a notamment relevé que n'étaient pas prévues :
- La possibilité pour le procureur de la République d'adresser des instructions aux directeurs et chefs de service de police municipale ;
- L'obligation pour les directeurs et chefs de service de police municipale de tenir le procureur de la République informé sans délai des infractions dont ils ont connaissance ;
- L'association de l'autorité judiciaire aux enquêtes administratives relatives à leur comportement ;
- La notation des directeurs et chefs de service de police municipale par le procureur général.
Le Conseil a dès lors considéré que le législateur n'avait pas assuré un contrôle direct et effectif du procureur de la République sur les directeurs et chefs de service de police municipale.
S'agissant de la condition de « garanties équivalentes à celles des OPJ », bien que la disposition de la loi sécurité globale ait prévu que les directeurs et chefs de service de police municipale soient tenus de suivre une formation et de satisfaire à un examen technique pour être habilités à exercer leurs missions de police judiciaire, le Conseil constitutionnel a constaté qu'« il n'est pas prévu qu'ils présentent des garanties équivalentes à celles exigées pour avoir la qualité d'officier de police judiciaire »61(*), sans toutefois préciser ses motifs sur ce point.
Eclairée par la jurisprudence constitutionnelle, le présent article étend les garanties envisagées en 2021. Tout d'abord, l'exercice des missions de police judiciaire élargies des services de police municipale est conditionnée à des conditions capacitaire d'encadrement et de continuité d'activité, déclinée dans une section dédiée de la convention de coordination prévue à article L. 512-4 du CSI validées par le préfet et le procureur de la République, étant précisé que ces deux autorités peuvent décider de la suspension immédiate de ces facultés judiciaires en cas de dysfonctionnements ou de méconnaissance du cadre législatif ou règlementaire.
Ensuite, s'agissant des personnels d'encadrement, ceux-ci sont habilités par le procureur général, notés par cette même autorité, placés sous la direction du procureur de la République, à qui ils doivent rendre compte sans délai des infractions dont ils ont connaissance, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction. Enfin, s'agissant de l'ensemble des agents du service de police municipale, ceux-ci peuvent se voir délivrer des instructions générales ou particulières de la part du procureur de la République et sont placés sous l'autorité effective et permanente des personnels d'encadrement.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Il ressort du rapport de la Cour des comptes sur les polices municipales daté d'octobre 202062(*) que l'existence d'une police locale n'est pas une caractéristique commune à l'ensemble des Etats européens et que, lorsqu'elle existe, les missions qui lui sont confiées varient d'un Etat à l'autre.
En premier lieu, certains Etats, tels que les Pays-Bas ou le Royaume-Uni ne disposent pas d'une police locale.
En second lieu, dans certains Etats, tels que l'Allemagne ou la Belgique, la police locale dispose de prérogatives importantes. A titre d'exemple, en Allemagne, chaque Land est responsable de l'ordre public et de la sécurité et dispose d'une police urbaine en uniforme, assimilable aux polices municipales de par leurs missions de préservation et de tranquillité publique. Les missions des agents de cette police recouvrent la prévention mais également la lutte contre les délits commis sur la voie publique. La police nationale, chargée de la sécurité, de la police criminelle et du maintien de l'ordre, ne s'associe pas à ces missions de sécurité publique.
Enfin, en dernier lieu, certains Etats, tels que l'Italie ou l'Espagne disposent d'une police locale chargée de missions complémentaires à celles de la police nationale.
En Espagne, seules les villes de plus de 5 000 habitants peuvent créer une police municipale. Elle exerce des missions de police de proximité, aux côtés des autres forces de sécurité, avec des compétences de police judiciaire très réduites. Ces services de polices sont notamment en charge de l'application des arrêtés locaux, des questions de circulation routière, de stationnement et de la surveillance des bâtiments municipaux. Elle collabore également avec les forces de sécurité de l'Etat et des communautés autonomes pour la protection lors des manifestations et le maintien de l'ordre dans les grands rassemblements humains. Chaque mairie peut étendre les compétences de ses policiers municipaux en fonction des exigences de la municipalité.
En Italie, les polices municipales exercent des pouvoirs de police administrative dans les matières relevant de la compétence des communes. Elles sont également chargées des fonctions de police de la route et, de manière accessoire, de sécurité publique et de police judiciaire. S'agissant de leurs prérogatives de police judiciaire, les agents de police municipale sont placés sous la responsabilité de la magistrature.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Le cadre d'exercice des polices municipales n'a pas été profondément modifié depuis la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales alors que les enjeux relatifs à la sécurité ont évolué. La place prise par les services de police municipale dans le continuum de sécurité63(*) et leurs capacités humaines et opérationnelles appellent dès lors un changement de compétence pour une partie d'entre elles.
L'intervention du législateur est doublement justifiée d'une part pour étendre les compétences de police judiciaire des agents de police municipale à la constatation de certains délits (1) et d'autre part pour créer un cadre d'exercice de ces nouvelles prérogatives (2).
(1) Les compétences de police judiciaire des agents de police municipale et des gardes champêtres recouvrent principalement la constatation de plusieurs contraventions et de certains délits dont la liste est strictement limitée par la loi. Toutefois, ces agents ne sont actuellement pas habilités à constater certains délits, pourtant aisément constatables, ne nécessitant pas d'actes d'enquête et s'inscrivant pleinement dans les missions traditionnelles de la police municipale, police de la proximité et de la tranquillité du quotidien. En tant que partenaire essentiel des forces de sécurité intérieure, engagées dans la lutte contre la délinquance du quotidien au sein d'un continuum de sécurité, l'octroi d'une compétence de constatation d'infractions délictuelles paraît légitime et nécessaire.
(2) L'exercice, par les agents de police municipale de nouvelles prérogatives de police judiciaire, nécessite au préalable d'établir un cadre juridique afin que ces derniers soient placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ce cadre d'exercice relève de la procédure pénale et nécessite donc l'adoption de dispositions d'ordre législatif.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le présent article poursuit un triple objectif.
En premier lieu, il vise à attribuer aux agents de police municipale de nouvelles prérogatives de police judiciaire afin de leur permettre de faire face à la délinquance du quotidien et d'y apporter les réponses adéquates.
En deuxième lieu, il vise à conforter la spécificité de la police municipale dans son rôle de police de proximité, de la tranquillité du quotidien et de la salubrité publique. L'objectif est ainsi de renforcer la complémentarité de la police municipale avec les forces de sécurité intérieure de l'Etat.
Enfin, en dernier lieu, l'objectif de l'article 2 est de s'adapter à chaque spécificité du territoire en laissant le choix à chaque collectivité de doter ces agents de police municipale de nouvelles prérogatives de police municipale.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
3.1.1 Octroyer à l'ensemble des agents de police municipale de nouvelles compétences de police judiciaire
L'extension des prérogatives de police judiciaire des agents de police municipale ne peut s'envisager qu'à la condition que ces derniers soient placés sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire, exigence résultant de l'article 66 de la Constitution.
Aux termes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, cette exigence implique que les agents de police municipale soient mis à la disposition des officiers de police judiciaire (OPJ) ou de personnes présentant des garanties équivalentes.
Or, il n'apparaît pas envisageable que chaque agent de police municipale soit mis à la disposition d'un OPJ ou d'une personne présentant des garanties équivalentes.
En premier lieu, le lien entre les OPJ et les agents de police municipale apparaît trop distendu pour que cette exigence soit remplie. Par ailleurs, il n'apparaît pas souhaitable de placer l'ensemble des agents de police municipale à la disposition des OPJ, ce qui entraînerait une charge d'activité trop importante pour ces derniers.
En second lieu, seuls les agents de police municipale exerçant leurs missions au sein de services atteignant une taille critique pourront être considérés comme mis à la disposition d'un personnel d'encadrement, chef de service ou directeur de police municipale, lequel devra présenter des garanties équivalentes à celles des OPJ. En revanche, cette condition ne pourra pas être remplie par les services de police municipale ne comportant pas de personnels d'encadrement ou dont l'encadrement n'est pas suffisant.
3.1.2 Octroyer aux directeurs et chefs de service de police municipale la qualité d'officier de police judiciaire (OPJ)
Il a été envisagé de conférer à certains directeurs et chefs de service de police municipale la qualité d'OPJ.
Toutefois, cette option présente deux difficultés et a donc été écartée.
En premier lieu, au regard des compétences octroyées par le code de procédure pénale aux OPJ, l'octroi d'une telle qualité aux directeurs et chefs de service de police municipale de la qualité d'OPJ entraînerait une confusion entre le rôle de la police municipale et celui des forces de sécurité intérieure. Or, la volonté est d'assurer une complémentarité entre ces deux entités et de conforter la police municipale dans son rôle de police de la proximité, de la tranquillité du quotidien et de la salubrité publique.
En deuxième lieu, les polices municipales ne disposent pas et ne souhaitent pas disposer de moyens qui correspondent à une véritable capacité d'OPJ, s'agissant notamment des locaux de garde à vue, des services d'enquête judiciaire, ou encore de la capacité à traiter des commissions rogatoires des juges d'instruction. L'attribution de cette qualité serait donc en partie vide de sens pour certaines prérogatives particulièrement attentatoires aux libertés individuelles, comme la faculté de l'OPJ de placer une personne en garde à vue, impliquant un niveau de contrôle et de garantie sans rapport avec l'utilisation réelle des prérogatives judiciaires.
3.1.3 Octroyer aux policiers municipaux la qualité d'agent de police judiciaire (APJ)
Il a également été envisagé d'octroyer la qualité d'APJ aux agents de police municipale.
Toutefois, doter les policiers municipaux de la qualité d'agent de police judiciaire (APJ), prévue à l'article 20 du code de procédure pénale, entraînerait un accroissement significatif de leurs compétences en matière de police judiciaire. Les agents de police judiciaire disposent, en effet, de nombreuses prérogatives de police judiciaire au titre desquelles figurent notamment :
- la possibilité de procéder, sous le contrôle des officiers de police judiciaire, à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office (article 75 du CPP). À ce titre et sur autorisation du procureur de la République, les APJ peuvent procéder à des réquisitions, saisies ou auditions ;
- la possibilité d'effectuer des contrôles d'identité, sur ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire (article 78-2 et suivants du code de procédure pénale) ;
- la possibilité de constater par procès-verbal toute infraction (crime, délit ou contravention).
Octroyer la qualité d'APJ aux agents de police municipale aurait ainsi pour conséquence de leur attribuer une compétence générale en matière d'enquête judiciaire. L'exercice d'une telle compétence entraînerait un accroissement des tâches d'ordre administratif et par conséquent une présence diminuée sur le terrain à rebours de la raison d'être des policiers municipaux, ceux-ci devant rester une police de proximité dédiée à la tranquillité du quotidien et la salubrité publique.
3.1.4 Domaine pluricommunal
Deux options ont été écartées pour la mise en oeuvre de prérogatives de police judiciaire élargies dans l'hypothèse où la police municipale est mise à la disposition de plusieurs communes :
- une décision par vote majoritaire : cette option aurait eu pour conséquence de doter de prérogatives de compétences judiciaires élargies les agents de police municipale d'une commune malgré son refus, ce qui n'apparaît pas souhaitable. Cette capacité doit résulter d'une volonté affirmée par chaque commune concernée ;
- une décision individuelle de chaque commune, indépendamment du choix des autres : une telle option aurait abouti à un régime particulièrement complexe dans la mesure où un agent de police municipale aurait disposé de compétences différentes en fonction du territoire sur lequel il se trouve. Ainsi, à titre d'exemple, un même agent de police municipale serait compétent pour constater tel délit dans la commune A, mais ne serait plus compétent pour constater le même délit dès lors qu'il se trouverait dans la commune voisine B.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le présent article étend les prérogatives de police judiciaire de certains agents de police municipale et gardes champêtres (1) et créé un cadre d'exercice de ces nouvelles prérogatives (2).
(1) Le présent article autorise les agents de police municipale et les gardes champêtres à constater, par procès-verbal, huit délits. Ces délits s'inscrivent dans le cadre des missions traditionnelles de la police municipale64(*), sont aisément constatables, ne nécessitent généralement pas d'actes d'enquête et peuvent faire l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle y compris en cas de récidive. La liste de ces délits est la suivante :
- infractions de vente à la sauvette prévues aux articles 446-1 et 446-2 du code pénal ;
- infraction de vol dans les conditions prévues à l'article 311-3-1 du code pénal ;
- infraction d'inscription, signe ou dessin ayant entraîné un dommage léger prévue au II de l'article 322-1 du code pénal ;
- infraction d'entrave à la circulation prévue à l'article L. 412-1 du code de la route ;
- infraction d'occupation illicite de hall d'immeuble prévue à l'article 272-4 du code pénal ;
- infraction d'outrage sexiste et sexuel aggravé prévue à l'article 222-33-1-1 du code pénal ;
- infraction de vente d'alcool aux mineurs prévue à l'article L.3353-3 du code de la santé publique ;
- infraction d'usage de stupéfiants prévu à l'article L. 3421-1 et suivants du code de la santé publique.
L'octroi de cette compétence de constatation permettra aux agents de police municipale de faire usage de la procédure d'amende forfaitaire délictuelle (AFD) dès lors qu'elle est applicable aux délits concernés et à condition de se voir remettre volontairement les objets ayant servi à la commission des infractions. Toutefois, l'utilisation de cette procédure nécessite au préalable de doter les agents de police municipale, de terminaux électroniques aux fins d'établir le procès-verbal électronique relatif à l'infraction concernée.
Figure également un neuvième délit : l'infraction de conduite malgré invalidation du permis de conduire, prévue à l'article L. 224-16 du code de la route, qui ne peut pas faire l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle, mais qui est aisément constatable car la notification de l'invalidation figure au Système national des permis de conduire (SNPC), auquel les policiers municipaux ont déjà accès.
En outre, le présent article octroie de nouvelles prérogatives de police judiciaire aux personnels d'encadrement de la police municipale afin d'accroitre l'autonomie des services de police municipale dans le traitement des procédures judiciaires. Ces agents pourront ainsi :
- ordonner, après accord du procureur de la République, la destruction ou la remise à des organisations caritatives ou humanitaires s'agissant des denrées périssables, des objets remis volontairement aux agents de police municipale dans le cadre de la procédure d'AFD ;
- ordonner, après accord du procureur de la République, l'immobilisation et la mise en fourrière de véhicule en cas de constatation d'une contravention ou d'un délit pour lesquels la peine de confiscation est encourue ;
- procéder ou faire procéder au moyen d'un éthylomètre aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique ;
- procéder ou faire procéder, en cas de crime ou délit flagrant, à la consultation, l'extraction, la copie et la transmission, d'initiative, au procureur de la République et aux officiers de police judiciaire, de données issues des systèmes de vidéoprotection.
S'agissant de ces deux dernières prérogatives, les personnels d'encadrement pourront faire réaliser les actions concernées par les agents placés sous leur autorité si bien qu'une présence physique, effective et constante, des encadrants, de jour comme de nuit, ne sera pas nécessaire65(*).
Ainsi, l'extension des prérogatives judiciaires confiées aux personnels d'encadrement de la police municipale et, dans une moindre mesure, à leurs subordonnés demeure limitée à un nombre réduit d'infractions et à la réalisation d'un nombre d'actions procédurales modiques.
Ce faisant, le risque de complexification procédurale tenant à la superposition de régimes procéduraux différents, selon que l'infraction constatée par un service de police municipal à compétences judiciaires élargies relève on non du présent dispositif, apparaît très modeste.
(2) L'article 2 définit le cadre d'exercice des nouvelles prérogatives de police judiciaire par les agents de police municipale.
Le dispositif retenu n'est pas applicable à l'ensemble des services de police municipale. Les nouvelles prérogatives de police judiciaire ne pourront être exercées que par les services qui remplissent les conditions suivantes.
En premier lieu, la collectivité doit en faire expressément la demande. Cette condition n'est pas nouvelle s'agissant d'un service de police municipale. Ainsi, à titre d'exemple, l'armement des agents de police municipales est limité aux communes qui ont font expressément la demande. Cette condition vise à laisser à chaque commune, le choix d'élargir à de nouvelles prérogatives de police judiciaire les compétences de ses agents de police municipale et gardes champêtres.
Cas spécifique des mutualisations
Lorsque la police municipale est mise à la disposition de plusieurs communes, l'attribution de nouvelles prérogatives de police judiciaire aux policiers municipaux résulte d'une décision conjointe prise par les communes, l'EPCI ou le syndicat de commune concerné. Les communes décident ainsi, à l'unanimité, de mettre en oeuvre, ou non, les nouvelles prérogatives de police judiciaire.
Cette modalité permet de s'aligner sur le régime existant en matière de port d'armes66(*).
En deuxième lieu, l'extension des prérogatives de police municipale est limitée aux services de police municipale disposant d'un nombre suffisant de personnels d'encadrement, eu égard à la taille et à l'organisation du service. Cette condition permet de s'assurer que dans le cadre de l'exercice de leurs nouvelles prérogatives, les agents de police municipale et gardes champêtres seront en permanence mis à disposition de personnels disposant de garanties équivalentes à celles d'un OPJ. Cette condition est un préalable indispensable à l'octroi de ces compétences.
Dès lors qu'un service de police municipale remplit ces conditions, l'exercice des prérogatives de police judiciaire élargies sera encadré par une section spécifique de la convention de coordination prévue à l'article L. 512-4 du CSI. Ainsi, ces prérogatives ne pourront être mises en oeuvre qu'après la signature, par le maire, le préfet et le procureur de la République, de cette convention et sous réserve du respect de ses stipulations. Deux procédures sont prévues en cas de manquement grave ou répété aux stipulations de la convention de coordination :
- Le procureur de la République ou le préfet pourront, après mise en oeuvre de la procédure contradictoire, s'opposer à ce que le service de police municipale exerce ses missions de police judiciaire élargies ;
- En cas d'urgence, ces mêmes autorités, pourront décider de la suspension immédiate de l'exercice de ces missions de police judiciaire.
Enfin, en dernier lieu, le cadre d'exercice des nouvelles prérogatives de police judiciaire répond à l'exigence constitutionnelle, selon laquelle la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire67(*). S'agissant des agents de police municipale, le contrôle est décliné sur deux niveaux :
(a) les agents de police municipale sont mis à la disposition de personnels d'encadrement présentant des garanties équivalentes à celles des OPJ. Le respect de cette exigence du Conseil constitutionnel implique que seuls les services de police municipale disposant d'un nombre suffisant de personnels d'encadrement pourront se doter de nouvelles prérogatives de police judiciaire. Cette condition permet de s'assurer que la police municipale sera encadrée de façon suffisante et en capacité d'assurer ces missions étendues en permanence, de jour comme de nuit. A cet égard, la section spécifique de la convention de coordination devra indiquer les modalités d'organisation du service de police municipale afin de s'assurer du respect de cette condition. Si la détermination du niveau d'encadrement qui y correspond ne relève pas de la loi, l'importance des enjeux d'une telle réglementation supposent l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat. Par ailleurs, cette exigence implique que les personnels d'encadrement suivent une formation validante équivalente à celle d'OPJ et dont le contenu sera fixé par arrêté.
(b) Les personnels d'encadrement sont eux-mêmes placés sous le contrôle direct et effectif du procureur de la République. Afin de répondre à cette exigence, le présent article reprend les garanties précédemment prévues par la loi « sécurité globale » :
- habilitation de ces agents par le procureur général près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation de l'agent ;
- possibilité pour le procureur général de refuser, suspendre ou retirer cette habilitation ;
- placement de ces personnels, ainsi que de leurs subordonnés, sous la direction du procureur de la République ;
- placement de ces personnels sous la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l'instruction.
En outre, la présente mesure insère les garanties supplémentaires suivantes :
- Possibilité pour le procureur de la République d'adresser des instructions aux agents de police municipale directement ou par l'intermédiaire des personnels d'encadrement ;
- Obligation pour ces personnels de tenir le procureur de la République informé sans délai des infractions dont ils ont connaissance ;
- Notation de ces personnels par le procureur général. Cette évaluation est prise en compte pour la notation administrative des agents concernés ;
- Association de l'autorité judiciaire aux enquêtes administratives relatives au comportement des personnels d'encadrement.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent insère un chapitre 2 bis composé de 7 sections au sein du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure intitulé « Polices municipales à compétences judiciaires élargies » comportant les articles L.512-8 à L.512-20.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Outre des impacts budgétaires pour l'Etat (cf.4.2.3) pour réceptionner et traiter les procédures d'AFD, devront également être impliqués dans le projet les éditeurs privés qui fournissent des terminaux de verbalisation électronique contraventionnelle aux unités de police municipale, actuellement au nombre de 8, puisque ceux-ci devront adapter leurs logiciels de relevé d'infraction en se conformant aux spécifications émises par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI).
4.2.3. Impacts budgétaires
L'extension des compétences des policiers municipaux à la constatation de délits pouvant faire l'objet de la procédure de l'AFD nécessitera l'adaptation de l'application informatique mise à disposition par le ministère de l'intérieur qui permet de tenir une gestion des carnets de verbalisation, d'enregistrer les paiements, et/ou retraits de points et d'établir automatiquement un bordereau de chèques destiné à la trésorerie.
L'émission d'amendes forfaitaires délictuelles et leur recouvrement aura un effet de recettes pour l'Etat, dont le volume dépendra du nombre de collectivités souhaitant utiliser le dispositif et des réalités locales de la petite délinquance éligible à l'AFD.
En prenant le total des effectifs de polices municipales (tous cadres d'emplois confondus) des 109 collectivités employant au moins 1 directeur de police municipal (DPM), on obtient 7 213 agents qui pourraient théoriquement recourir à la procédure d'AFD (à nouveau, l'hypothèse maximaliste), une fois les travaux de transformation numérique menés à bien, tous les agents équipés, et le personnel d'encadrement formé.
S'agissant des coûts du projet, une première estimation porte le besoin de financement pour l'ANTAI à 2,5 millions d'euros environ pour l'évolution de ses propres chaînes et pour la construction de la plate-forme de tests destinée aux éditeurs de solutions de verbalisation électronique évoqués au 4.2.2 ci-dessus, auxquels s'ajouteraient, toujours pour l'ANTAI, de l'ordre de 150.000 euros par éditeur souhaitant investir dans les développements demandés pour effectuer avec eux les tests de traitement de bout en bout et pour les assister dans la mise au point (soit 1,2 M euros en tout, si les 8 éditeurs actuels devaient tous s'engager dans la démarche). Ces dépenses s'échelonneraient sur 18 mois environ.
Des coûts récurrents s'y ajouteront par la suite en fonction des besoins de qualification d'évolutions techniques ou juridiques ultérieures, a minima lors de la mise en place ultérieure de nouveaux délits forfaitisés, notamment pour effectuer les tests de recette avec les éditeurs.
Les coûts pour les autres administrations de l'État impliquées dans la gestion des AFD (notamment ministère de la Justice et direction générale des finances publiques) restent à évaluer, mais devraient, en principe, être d'ampleur sensiblement moindre.
S'agissant des recettes, l'émission d'amendes forfaitaires délictuelles et leur recouvrement aura cependant également un effet de recettes pour l'Etat, dont le volume dépendra du nombre de collectivités souhaitant utiliser le dispositif et des réalités locales de la petite délinquance éligible à l'AFD, et des taux de paiement (spontané ou suite à recouvrement par le comptable public). Des recettes d'environ 1,5 M euros peuvent être estimées de la manière suivante :
La police et la gendarmerie nationales comptent 253 000 agents68(*), et ont relevé en 2024 un total de 500 330 AFD69(*). De façon simplifiée, si l'on rapporte le nombre d'agents de police municipale pouvant être habilités à celui des forces de sécurité de l'État, on obtient 7 213 / 253 000 = 2,6 %. En admettant que les agents de police municipale aient une activité comparable s'agissant des AFD, cela donnerait, en prenant 2,6 % de 500 330 AFD, un total annuel de 14 264 AFD par les agents de police municipale. Cette estimation peut être affinée, les agents de police municipale ne pouvant relever toutes les AFD existantes (dont celle relative au défaut d'assurance, laquelle compte pour 204 700 soit 41 % dans le total relevé en 2024 par la police et la gendarmerie nationales). Dans le détail, en appliquant le ratio des effectifs par infraction qui serait ouverte aux agents de police municipale, on obtient :
- vente à la sauvette : 450 AFD (2,6 % de 15 800). Le montant de l'AFD est de 300 euros.
- vol simple : 775 AFD (2,6 % de 27 200). Le montant de l'AFD est de 300 euros.
- occupation espace commun d'immeuble : 245 AFD (2,6 % de 8 600). Le montant de l'AFD est de 200 euros.
- usage illicite de stupéfiants : 5 599 AFD (2,6 % de 196 400). Le montant de l'AFD est de 200 euros.
Soit un total, bien sûr théorique, pour ces 4 infractions, de 7069 AFD supplémentaires par an, soit, au regard des montants des AFD une recette théorique de 1 536 300 euros. Ce chiffrage est basé sur l'hypothèse d'un paiement de l'amende forfaitaire ni minorée (auquel cas la recette serait moindre) ni majorée (auquel cas la recette serait augmentée).
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sur un plan budgétaire, l'extension des compétences des policiers municipaux à la constatation de délits pouvant faire l'objet de la procédure de l'AFD nécessitera l'équipement des agents de police municipale du dispositif de procès-verbal électronique connecté au centre national.
L'extension des compétences judiciaires des agents de police municipale et des gardes champêtres impose un élargissement de leur mise à disposition auprès du procureur de la République et donc une organisation du travail différente pour les collectivités qui en feront le choix.
Des efforts d'organisation et de formation seront également nécessaires pour ces collectivités, étant rappelé que ces nouvelles prérogatives sont facultatives. Un impact sur leurs finances et sur leur organisation est donc à prévoir mais ne peut être précisément chiffré car il dépendra de l'échelle du dispositif qu'elles choisiront. Toutefois, cette extension, facultative et par voie législative, des prérogatives de police judiciaire des agents de police municipale et des gardes champêtres afin de leur permettre de constater certains délits limitativement énumérés, ne constitue pas un transfert de compétence au sens des articles L. 1641-1 et suivants du CGCT et n'entrainera donc pas de compensation financière de l'Etat aux communes.
Ces formations ont vocation à être réalisées par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Au titre de l'article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure, le CNFPT perçoit une redevance due pour prestations de services, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre.
Sans présager du contenu exact de la formation ou de son organisation précise (présence physique ou à distance), de façon schématique, en retenant une durée semblable à celle de la formation pour les OPJ au sein de la police nationale70(*), soit 14 semaines (14 X 5 jours), et un coût de formation par agent et par jour de 175 euros pour le CNFPT, il est possible d'obtenir un total de 12 250 euros par agent formé. L'organisation d'un examen sanctionnant la réussite ou l'échec du candidat serait à ajouter à ce coût théorique.
En ce qui concerne Paris et la petite couronne :
La Ville de Paris et les communes de la petite couronne sont régies par des dispositions spécifiques en termes d'ordre public et de forces de sécurité en raison des compétences de la préfecture de police dans ce domaine. Le nouvel article L. 512-8, créé par le projet de loi, s'articule avec le droit existant en ce qui concerne les communes relevant de la préfecture de police de Paris, de la façon suivante :
La ville de Paris, comme les autres communes, pourra, pour ses agents de police municipale, décider, en application du nouvel article L. 512-8 du CSI, de leur confier l'exercice de prérogatives de police judiciaire élargies. En revanche, les catégories d'agents de la ville de Paris qui ne sont pas des policiers municipaux, tels que les agents d'accueil et de surveillance (AAS) et les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police, lesquels disposent d'un statut particulier et sont mentionnés à l' article L. 531-1 du CSI, sont exclus du champ d'application du présent projet de loi
Il convient de relever que ces deux catégories d'agents disposent déjà d'une compétence en matière contraventionnelle qui est identique à celle des policiers municipaux (article R. 15-33-29-3 du code pénal), tel que cela est prévu par les dispositions législatives (articles L. 531-1 et L. 532-1 du CSI) et que ces compétences ont encore récemment été renforcées en novembre 2023 par l'extension de la possibilité d'émettre des contraventions relatives à l'interdiction de l'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation. La ville de Paris disposant d'une police municipale, ce corps est celui qui a vocation à utiliser les compétences nouvelles attribuées par le présent projet de loi.
A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de Police sera l'autorité signataire de la convention, en application de l'article L. 2512-13 du CGCT et de l'article 73 du décret du 29 avril 2004 modifié, qui prévoit que :
« I.-Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police a la charge de l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, et, dans la limite des matières relevant de ses attributions, de la sécurité des populations. A ce titre :
1° Il exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 2214-4 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que par les articles L. 132-10, L. 226-1, L. 229-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 334-1, L. 334-2, L. 511-1 et L. 512-4 à L. 512-7 du code de la sécurité intérieure en matière d'ordre public ; »
En effet, l'article L. 512-8 CSI créé par le présent texte vise expressément l'article L.512-4.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Techniquement, l'évolution de la procédure de verbalisation de délits au travers de la procédure d'AFD nécessitera des études juridiques et des évolutions techniques coordonnées dans les différents systèmes d'information de l'État contribuant à la gestion de cette procédure, qui sont placés sous la responsabilité d'administrations différentes : ANTAI, ANFSI, DGFiP, ministère de la Justice.
Une charge particulière pèsera sur l'autorité judiciaire, qui devra exercer un contrôle direct et effectif sur les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale (notamment concernant l'habilitation, la notation et les éventuelles procédures administratives à leur encontre) et qui donnera les instructions aux agents de police municipale dans leurs missions de police judiciaire.
S'agissant de la procédure d'habilitation, il existe 146 directeurs et 577 chefs de police municipale, soit 723 personnels d'encadrement sur tout le territoire national. Si l'on retient une estimation de 15 minutes pour procéder à une habilitation d'un personnel d'encadrement de police municipale au sein d'un parquet général, et que l'on admet que (hypothèse maximaliste) toutes les collectivités qui le peuvent optent pour une police municipale à prérogatives élargies, en multipliant le nombre de personnels à habiliter par le temps nécessaire pour chaque habilitation ([723 X 15] / 60 = 180,75), on peut évaluer à 181 heures agent le coût de la mesure « habilitation par le parquet général ».
En retenant 1 607 heures par an et par agent, le coût est de 0,11 ETP, à répartir sur les différents parquets généraux. Cette estimation peut être modérée, du fait de ce que les agents de police municipale ne seront vraisemblablement pas tous habilités, et ceux qui le seront ont vocation à le rester (nonobstant les retraits, suspensions ou autres cessations de fonctions).
S'agissant de l'estimation du nombre de procédures classiques71(*), dans les cas où les policiers municipaux ne pourraient pas recourir à la procédure d'AFD et où ils devraient solliciter les OPJ localement compétents, lesquels pourraient établir une procédure, en reprenant les pourcentages de 2024 pour les forces de l'État s'agissant de la part des AFD parmi l'ensemble des délits enregistrés, cela donne une estimation du nombre de procédures classiques qui seraient occasionnées pour la police municipale, à savoir :
- 13 pour les occupations en réunion d'espaces communs d'immeuble (95% d'AFD) ;
- 1768 pour l'usage illicite de stupéfiants (76% d'AFD) ;
- 202 pour les ventes à la sauvette (69 % d'AFD) ;
- 14 725 pour les vols simples 5 % d'AFD).
Pour l'ensemble des parquets sur le ressort desquels officieraient des agents de police municipale à compétences judiciaires élargies, si toutes les collectivités en faisaient le choix, on arriverait théoriquement à une augmentation du nombre de procédures classiques de l'ordre de 17 000 environ, à répartir sur l'ensemble du territoire national (soit 0,6 % de l'activité des parquets72(*)).
Il convient de remarquer que, déjà aujourd'hui, les policiers municipaux, sur le fondement de l'article 73 du code de procédure pénale, procèdent à des interpellations et sont donc à l'origine de la saisine de services enquêteurs, ce qui pourrait conduire à minorer l'évaluation ainsi obtenue.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
L'octroi de nouvelles prérogatives à certains agents de police municipale et gardes champêtres devraient permettre de lutter contre la délinquance du quotidien et d'apporter une réponse pénale rapide et efficace aux délits auxquels sont confrontés ces agents.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
L'octroi de nouvelles prérogatives à certains agents de police municipale et gardes champêtres devraient permettre de lutter contre la délinquance du quotidien et d'apporter une réponse pénale rapide et efficace aux délits auxquels sont confrontés ces agents.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été saisi pour avis, à titre obligatoire, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, et a rendu un avis favorable en date du 2 octobre 2025.
Le groupe interministériel permanent de sécurité routière (GIPSR) a été saisi pour avis, à titre obligatoire, en application du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de sécurité routière, et a rendu un avis favorable en date du 15 septembre 2025.
Par ailleurs, dans le cadre du « Beauvau des polices municipales », afin d'échanger sur le thème des polices municipales, le ministère de l'intérieur a organisé entre mars 2024 et avril 2025 plusieurs rencontres qui se sont successivement tenues à Paris, Lyon, Meaux, Metz et au Havre. Ces sessions ont permis de concerter les principaux acteurs concernés par l'évolution des compétences des polices municipales (élus locaux, forces de sécurité intérieure, directeurs de service de police municipale, gardes champêtres, syndicats etc.).
Il ressort du Beauvau des polices municipales73(*) que l'évolution des compétences de police judiciaire des polices municipales fait l'objet d'un consensus dans son principe.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
Aux termes de l'article 112-2 du code pénal, les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont d'application immédiate à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur.
Toutefois, la mise en oeuvre effective de la procédure d'AFD nécessitera un temps de développement incompressible d'au moins 18 mois, tant pour les services de l'Etat que pour les éditeurs privés fournissant les collectivités locales, puisqu'en application des dispositions du code de procédure pénale, celle-ci s'appuie exclusivement sur une solution de verbalisation électronique qui doit faire l'objet d'adaptations substantielles (cf. supra).
5.2.2. Application dans l'espace
Ces dispositions seront applicables sans adaptation sur l'ensemble du territoire hexagonal, y compris les collectivités et départements d'outre-mer, par la mise à jour de l'article « compteur LIFOU » du code de procédure pénale (article 804). Un article spécifique relatif à l'application des dispositions aux collectivités d'Outre-mer complète ce projet de loi sur les points qui nécessitent des adaptations et des extensions du régime juridique.
Toutefois, pour la procédure d'AFD, les délais d'adaptation des outils numériques évoqués au 5.2.1 pourraient être plus longs pour certaines collectivités d'outre-mer, en fonction des spécificités du droit local et de l'outillage existant.
5.2.3. Textes d'application
La mise en oeuvre du présent article nécessite l'adoption des textes réglementaires suivants :
- Un décret en Conseil d'Etat afin de déterminer le seuil à partir duquel un service de police municipale pourra mettre en oeuvre les compétences de police judiciaire élargies (nouvel article L.512-9 du CSI) ;
- Un décret en Conseil d'Etat afin de déterminer le contenu obligatoire de la section spécifique aux compétences de police judiciaire élargies de la convention de coordination prévue à l'article L. 512-4 du CSI ainsi que les modalités des procédures prévues au nouvel article L. 512-10 du CSI en cas de manquement d'un service de police municipale aux stipulations de la convention de coordination ;
- Un décret en Conseil d'Etat afin de fixer les conditions d'octroi, de refus, de retrait et de suspension de l'habilitation des personnels d'encadrement (nouvel article L.512-12 du CSI) ;
- Un décret simple afin de déterminer les conditions de destruction des objets volontairement remis lors de l'établissement d'une amende forfaitaire délictuelle (nouvel article L. 512-18 du CSI) ;
- Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice afin de déterminer les spécifications auxquelles doivent satisfaire les équipements utilisés aux fins de faire usage de la procédure d'amende forfaitaire délictuelle (nouvel article L. 512-20 du CSI) ;
- Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice afin de déterminer le contenu du cadre national de mise en oeuvre de la verbalisation par amende forfaitaire délictuelle (idem) ;
- Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice afin de déterminer les obligations de formation et d'examen technique s'imposant aux personnels d'encadrement des services de police municipale à compétence judiciaire élargies, les obligations de formation technique et déontologique s'imposant aux agents de police municipale et aux gardes champêtres pour l'exercice de leurs compétences à caractère judiciaire et les modalités d'information des maires et, le cas échéant, des élus en charge de la police municipale sur les conditions d'exercice spécifiques de leur autorité hiérarchique sur les personnels d'encadrement (nouvel article L. 512-11 du CSI) ;
- Une actualisation de l' arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en oeuvre de traitements automatisés dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités (Acte réglementaire unique RU - 009 - Communes : gestion des infractions pénales).
Article 3 - Extension du domaine des relevés d'identité réalisés par les agents de police municipale et les gardes champêtres
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Aux fins de dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils sont habilités à constater, les policiers municipaux et les gardes champêtres peuvent procéder à aujourd'hui des recueils d'identité. Cette opération consiste à demander à l'intéressé son identité, sans exiger la présentation d'un document justificatif. Elle est possible, même en l'absence de texte74(*).
Les policiers municipaux et gardes champêtres peuvent également procéder à des relevés d'identité en application de dispositions spécifiques. Le relevé d'identité consiste à exiger la présentation d'une pièce d'identité et à en relever les éléments. La seule finalité de cette opération est de permettre l'établissement du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette finalité est expressément énoncée à l' article 78-6 du code de procédure pénale (CPP).
S'agissant des agents de police municipale, l'article 78-6 du CPP les habilite à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser (par exemple, arrêts ou stationnements dangereux, gênants ou abusifs réprimés par les articles R.417-9 à R.417-13 du code de la route) ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse (telle que l'article L.141-1 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy).
S'agissant des gardes champêtres, l' article L. 522-4 du code de la sécurité intérieure (CSI) les habilite à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale (précité) pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent.
En cas de refus ou d'impossibilité par l'intéressé de justifier de son identité, l'agent qui opère le relevé d'identité n'est pas habilité à retenir la personne concernée contre son gré. Il doit alors en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire (OPJ), qui peut lui ordonner sans délai de lui présenter le contrevenant ou de le retenir le temps nécessaire à son arrivée, ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. A défaut d'un ordre en ce sens donné par l'OPJ, l'agent ayant procédé au relevé d'identité ne peut pas retenir le contrevenant.
La présentation du contrevenant à un OPJ doit lui permettre de procéder à une vérification d'identité, procédure prévue à l' article 78-3 du CPP. Dans le cadre de cette procédure, l'intéressé est retenu et mis en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité. L'OPJ procède alors aux opérations de vérification nécessaire.
Seuls les OPJ peuvent procéder à des vérifications d'identité. La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que le temps strictement exigé par l'établissement de son identité et pour une durée qui ne peut excéder 4 heures. Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé.
Les contrôles d'identité, prévus à l' article 78-2 du CPP, interviennent dans un cadre différent en ce qu'ils ne sont pas rattachés à la finalité de dresser le procès-verbal de constatation d'une infraction. Les contrôles d'identité peuvent être effectués dans un cadre de police judiciaire ou de police administrative. Ils sont effectués par les OPJ ou, sous leur ordre et leur responsabilité, par les agents de police judiciaire et certains agents de police judiciaire adjoints et consistent à contraindre une personne de rester sur place aux fins de révéler son identité.
Les agents de police municipale et les gardes champêtres n'étant actuellement habilités qu'à constater des contraventions et à procéder à des relevés d'identité dans ce cadre, l'objectif de l'article est de permettre à ces agents de procéder à des relevés d'identité aux fins d'établir les procès-verbaux des délits qu'ils seront habilités à constater.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le Conseil constitutionnel a contrôlé à plusieurs reprises des dispositions relatives aux contrôles d'identité.
Dans sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel a censuré la disposition qui octroyait aux agents de police judiciaire adjoints (APJA), et en particulier aux agents de police municipale, la possibilité d'opérer des contrôles d'identité sur le fondement de l'article 66 de la Constitution duquel il résulte que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire.
Le Conseil constitutionnel a ainsi relevé que « l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas respectée si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire » ; et « qu'en confiant [...] [le pouvoir de procéder à des contrôles et des vérifications d'identité] aux agents de police municipale, qui relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, [la disposition concernée] méconnaît l'article 66 de la Constitution » 75(*).
En revanche, la question du relevé d'identité n'a pas fait l'objet de décision du Conseil Constitutionnel.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) s'est prononcée à de nombreuses reprises sur la thématique des contrôles d'identité.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour que les contrôles d'identité ne portent pas en soi une atteinte à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit à la liberté et à la sûreté, ni à l'article 2 du protocole n°4 de la Convention européenne des droits de l'homme, lequel garantit la liberté de circulation76(*).
La Cour considère, en revanche, qu'un contrôle d'identité effectué par la police peut relever de la vie privée de la personne qui y est soumise et donc s'analyser en une ingérence dans la vie privée de celle-ci protégée par l'article 8 de la Convention. La Cour a ainsi jugé que le recours à des pouvoirs légaux de contrainte imposant à quiconque de se plier, en tout lieu et à tout moment, à un contrôle d'identité et à une fouille minutieuse de sa personne, de ses vêtements ou de ses effets personnels, est constitutif d'une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée, laquelle doit donc être prévue par la loi, légitime et nécessaire.
Le contrôle d'identité d'une personne appartenant à une minorité ethnique entre dans le champ de l'article 8 de la Convention dès lors que la personne qui a fait l'objet du contrôle peut prétendre de manière défendable que c'est peut-être en raison de ses caractéristiques physiques ou ethniques qu'elle a fait l'objet du contrôle. Tel peut être le cas notamment lorsque la personne contrôlée soutient que le contrôle n'a porté que sur elle (ou sur des personnes présentant les mêmes caractéristiques qu'elle) alors qu'aucun autre motif propre à le justifier n'était apparent ou qu'il ressort des explications des agents qui l'ont mené qu'il était motivé par les caractéristiques physiques ou ethniques de la personne. Dans un tel cas, la Cour opère un contrôle au regard des dispositions de l'article 14 de la Convention, qui interdit la discrimination, combiné à l'article 8, relatif au droit au respect de la vie privée.77(*)
Dans le cadre d'une allégation de violation de l'article 14 de la Convention, il revient au requérant d'établir l'existence d'une différence de traitement, puis à l'Etat en cause de démontrer que cette différence de traitement était justifiée.
Malgré sa jurisprudence abondante sur les contrôles d'identité78(*), aucun arrêt ne concerne spécifiquement les relevés d'identité.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Le relevé d'identité constitue le corollaire nécessaire à la constatation de l'infraction en ce qu'il permet d'obtenir l'identité de la personne aux fins de dresser le procès-verbal.
Dans la mesure où l'article 2 du présent projet de la loi étend les compétences de certains agents de police municipale et gardes champêtres à la constatation de plusieurs délits, il est nécessaire de leur permettre de relever l'identité des intéressés aux fins de dresser les procès-verbaux de constatation de ces délits.
Pour cela, il convient de modifier en ce sens l'article 78-6 du code de procédure pénale et l'article L. 522-4 du code de la sécurité intérieure, deux dispositions de niveau législatif.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif de cet article est de permettre aux agents de police municipale et aux gardes champêtres de procéder à des relevés d'identité pour l'ensemble des infractions qu'ils sont habilités à constater. Ces relevés d'identité leur permettront de procéder à la rédaction des procès-verbaux de constatation de ces infractions.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Deux options ont été écartées :
- Attribuer aux policiers municipaux la possibilité de faire des vérifications d'identité, procédure prévue à l'article 78-3 du code de procédure pénale.
Cette procédure consiste, à la suite d'un refus ou d'une impossibilité de justifier de son identité dans le cadre d'un relevé d'identité, à retenir la personne concernée pour le temps strictement nécessaire à l'établissement de son identité. Aux termes de l'article 78-3 du code de procédure pénale, « si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé ». En tout état de cause, cette durée ne peut excéder quatre heures et s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue. Les vérifications d'identité, comme les mesures de garde à vue, relèvent de la compétence exclusive des officiers de police judiciaire (OPJ).
Cette option a été écartée car constituant par nature une mesure de contrainte, qu'il semblait raisonnable de réserver aux OPJ (rétention de 4 heures, prise d'empreintes digitales ou de photographies si la personne maintient son refus de justifier son identité).
En outre, il n'est pas envisageable de doter les polices municipales de geôles et de capacités de garde à vue qui leur donneraient une autonomie dans la gestion des procédures diligentées à la suite d'interpellations auxquelles ils auraient procédé. Dans ces conditions, tout usage de la coercition hors des cas graves ne peut se faire qu'en coordination avec les forces de gendarmerie et de police nationales.
- Attribuer aux policiers municipaux la possibilité de procéder à des contrôles d'identité.
Le contrôle d'identité est une procédure visant la recherche d'infractions. Seuls sont compétents pour procéder à des contrôles d'identité, les OPJ, les agents de police judiciaire (APJ) et les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l' article 20 du code de procédure pénale.
En application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les contrôles d'identité peuvent être effectués dans un cadre judiciaire, en cas de raison plausible de soupçonner qu'il existe un lien entre une personne et une infraction réelle ou supposée ou sur réquisitions du procureur de la République. Les contrôles d'identité peuvent également être réalisées dans un cadre administratif, en cas de risque d'atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, ou dans le cadre de contrôles frontaliers.
Le contrôle d'identité peut permettre la révélation d'infraction de toute nature. Ainsi, contrairement au relevé d'identité pour lequel il est possible de limiter à certaines infractions la compétence des agents habilités à y procéder, tel n'est pas le cas du contrôle d'identité.
Dès lors, il convient de réserver ces opérations aux agents disposant d'une compétence générale pour la constatation de toute infraction : contravention, délit ou crime, tels que les OPJ et APJ.
Par ailleurs, octroyer une telle compétence ne s'inscrit pas dans le cadre des missions traditionnels des agents de police municipale. Or, afin d'assurer une complémentarité entre les forces de sécurité de l'Etat et la police municipale, celle-ci doit conserver sa particularité de police de proximité, de tranquillité du quotidien et de salubrité publique.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le présent article étend le champ de l'article 78-6 du code de procédure pénale afin de permettre aux agents de police municipale de procéder à des relevés d'identité pour l'ensemble des infractions qu'ils sont habilités à constater.
Cet article étend également le champ d'application de l'article L. 522-4 du code de la sécurité intérieure aux fins de permettre aux gardes champêtres de procéder à des relevés d'identité pour l'ensemble des infractions qu'ils sont habilités à constater.
Le terme d'« infractions » permet d'englober à la fois les contraventions, pouvant d'ores-et-déjà être constatées, et les délits, qui pourront désormais l'être.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article modifie, d'une part, l'article 78-6 du code de procédure pénale et, d'autre part, l'article L. 522-4 du code de la sécurité intérieure.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Le présent article est conforme aux textes internationaux et européens mentionnés supra.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le renforcement de la capacité des policiers municipaux et gardes champêtres à procéder à des relevés d'identité, corolaire de l'extension de leurs compétences matérielles prévue par les dispositions du présent projet de loi, permettra d'accroitre leurs capacités de verbalisation. Pour les collectivités territoriales, l'impact technique de cette évolution s'avère modeste et l'impact financier est nul.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La charge administrative nouvelle est relative dès lors que les agents de police municipale et gardes champêtres sont déjà autorisés à procéder à des relevés d'identité et que le présent article vise simplement à étendre le cadre matériel desdits relevés.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
En permettant aux agents de police municipale et aux et gardes champêtres de relever l'identité de l'ensemble des individus qu'ils seront habilités à verbaliser, la répression des troubles à l'ordre public gagne nécessairement en efficacité. En effet, il est vain d'espérer le recouvrement d'amende forfaitaire dressées à l'encontre d'individus dont l'identité n'est pas connue. Ce faisant, le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques s'en trouveront renforcés.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
L'extension des capacités d'action des agents de police municipale et des gardes champêtres participe au renforcement du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été saisi, à titre obligatoire, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, et a rendu avis favorable en date du 2 octobre 2025.
Les principaux acteurs concernés par l'évolution des compétences des polices municipales (élus locaux, forces de sécurité intérieure, directeurs de service de police municipale, gardes champêtres, syndicats etc.) ont été consultés dans le cadre du « Beauvau des polices municipales » qui a débuté le 5 avril 202479(*) et s'est clôturé en mars 2025 :
- À Lyon, le 21 février 2025, les sujets afférents aux prérogatives, au cadre général d'action, aux armements et aux équipements des polices municipales ont été évoqués.
- Le 4 mars 2025, à Metz, était abordée la question de la formation et de la reconnaissance des policiers municipaux et des gardes champêtres, ainsi que des enjeux sociaux liés à ces métiers.
- Le 6 mars 2025 à Meaux, les thématiques de la déontologie, de la responsabilité et de la protection fonctionnelle des policiers municipaux étaient discutées.
- Enfin, le 10 mars 2025 au Havre, la mutualisation des moyens entre communes et la coordination entre polices municipales et forces de sécurité intérieure étaient au coeur des échanges80(*).
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Aux termes de l' article 112-2 du code pénal, les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont d'application immédiate.
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Le présent article s'applique sur l'ensemble du territoire hexagonal.
Les dispositions du présent article sont applicables de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte) ainsi que dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution qui relèvent en la matière de l'identité législative (Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).
S'agissant de la modification de l'article 78-6 du code de procédure pénale, l'application de cette modification en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie est conditionnée à la mise à jour de la référence mentionnée à l' article 804 du code de procédure pénale.
S'agissant de la modification de l'article L. 522-4 du
code de la sécurité intérieure, l'application de cette
modification en Polynésie française nécessite de mettre
à jour la référence mentionnée à l'
article
L. 545-1 du code de la sécurité intérieure. En
revanche, conformément aux
articles
L. 546-1 et suivants du code de la sécurité
intérieure, l'
article
L. 522-4 du même code n'est pas applicable en
Nouvelle-Calédonie. L'article 19 du présent projet de loi
procède aux mises à jour nécessaires.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne nécessite pas de texte d'application.
CHAPITRE II - LE RAPPROCHEMENT DES COMPÉTENCES DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES CHAMPÊTRES
Article 4 - Octroi de nouvelles prérogatives aux policiers municipaux et gardes champêtres
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
- Sur le dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants sur les conducteurs de véhicules en l'absence d'infraction ou d'accident
Les dispositions du code de la route mentionnées infra prévoient les cadres juridiques de dépistage de l'imprégnation alcoolique et de l'usage de stupéfiants.
- Dépistages de l'imprégnation alcoolique des conducteurs et accompagnateurs des élèves conducteurs de véhicules
Les dispositions du code de la route prévoient trois cadres juridiques de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
En premier lieu, le premier alinéa de l' article L. 234-3 du code de la route impose aux officiers (OPJ) ou agents de police judiciaire (APJ) et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, aux agents de police judiciaire (APJA) adjoints, de soumettre, le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur, aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique lorsque celui-ci est l'auteur présumé d'une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou qu'il est impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.
En deuxième lieu, le second alinéa de l'article L. 234-3 (précité) permet aux officiers ou agents de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, aux agents de police judiciaire adjoints, de soumettre, le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur, aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique lorsque celui-ci est l'auteur présumé d'une infraction au code de la route, ou est impliqué dans un accident de la circulation.
En troisième lieu, l' article L. 234-9 du code de la route permet, sur l'instruction du Procureur de la République ou sur l'initiative des officiers ou agents de police judiciaire, à ces derniers ainsi qu'aux APJA, sur l'ordre et sous la responsabilité des OPJ, de soumettre, tout conducteur ou tout accompagnateur de l'élève conducteur, aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident.
En application de l'alinéa 4 de l' article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, les gardes champêtres sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route. En revanche, ils ne sont pas habilités à procéder à ces épreuves dans le cadre de l'article L. 234-9 précité (contrôles préventifs). En effet, en application du 3° de l' article 21 du code de procédure pénale, les gardes champêtres ne disposent du statut d'APJA que lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure. Or, la mention des APJA à l'article L. 521-1 n'est pas suffisante pour attribuer aux gardes champêtres une telle compétence.
- Dépistages de l'usage de stupéfiants sur les conducteurs et accompagnateurs des élèves conducteurs de véhicules
Le volume global de dépistages de stupéfiants réalisés en France a été multiplié par plus de quarante entre 2004 et 2023, passant de 15 905 à 968 102. Le dépistage étant le plus souvent réalisé lorsque les forces de l'ordre ont une suspicion d'usage de stupéfiants, le taux de positivité général reste important, bien qu'en baisse quasi continue sur l'ensemble de la dernière décennie du fait de l'augmentation des contrôles préventifs. Il passe ainsi de 32,2% de positivité en 2011 à 13,7% en 2023, et de 9,3% à 6% en cas d'accidents sur cette même période.
L'article L.235-2 du code de la route prévoit également trois cadres juridiques de dépistages de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
En premier lieu, le premier alinéa de l'article L. 235-2 du code de la route impose aux officiers ou agents de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité des OPJ, aux agents de police judiciaire adjoints, de procéder, sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, aux épreuves de dépistage de l'usage de stupéfiants.
En deuxième lieu, l'alinéa 2 de l'article L. 235-2 du code de la route permet aux OPJ ou APJ, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des OPJ, aux APJA, de procéder aux épreuves de dépistage de l'usage de stupéfiants sur tout conducteur ou accompagnateur d'élève conducteur qui est impliqué dans un accident matériel de la circulation, ou est l'auteur présumé d'une infraction au code de la route, ou s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.
En troisième lieu, les alinéas 3 et 4 de l'article L. 235-2 du code de la route permettent, sur l'instruction du procureur de la République ou sur l'initiative des officiers ou agents de police judiciaire, à ces derniers ainsi qu'aux APJA, sur l'ordre et sous la responsabilité des OPJ, de soumettre, tout conducteur ou tout accompagnateur de l'élève conducteur, aux épreuves de dépistage de l'usage de stupéfiants, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raison plausible de soupçonner un usage de stupéfiants.
En application de l'alinéa 4 de l' article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, les gardes champêtres sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnés aux deux premiers alinéas à l'article L. 235-2 du code de la route. En revanche, ils ne sont pas habilités à procéder aux épreuves de dépistage préventifs mentionnés aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 235-2. En effet, en application du 3° de l' article 21 du code de procédure pénale, les gardes champêtres ne disposent du statut d'APJA que lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure. Or, la mention des APJA à l'article L. 521-1 n'est pas suffisante pour attribuer aux gardes champêtres une telle compétence.
- Sur la prescription de mesure de mise en fourrière
L'article R. 325-12 du code de la route définit la mise en fourrière comme « le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule ».
Les articles L. 325-1 à L. 325-1-2 du code de la route déterminent les cas dans lesquels un véhicule peut être immobilisé et placé en fourrière.
En premier lieu, l'article L. 325-1 du code de la route permet l'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et, le cas échéant, l'aliénation ou la livraison à la destruction dans deux hypothèses :
- lorsque la circulation ou le stationnement du véhicule contrevient à une disposition du code de la route ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route et compromet la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun81(*) ;
- lorsqu'un véhicule, qui se trouve sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, est privé d'éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols82(*).
Dans ces deux hypothèses, ces opérations sont effectuées à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire (OPJ) territorialement compétents. L'immobilisation des véhicules peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétences, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure. Les gardes champêtres et agents de police municipale sont ainsi compétents pour décider d'une immobilisation s'agissant des infractions qu'ils sont habilités à constater.
En deuxième lieu, l'article L. 325-1-1 du code de la route permet à l'OPJ ou à l'agent de police judiciaire (APJ), avec l'autorisation préalable du procureur de la République, de faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière d'un véhicule, en cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la 5e classe prévu par le code de la route ou le code pénal lorsque la peine de confiscation est encourue.
En dernier lieu, l'article L. 325-1-2 du code de la route permet à l'OPJ ou à l'APJ, avec l'autorisation préalable du préfet, de faire procéder à titre provisoire à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l'auteur s'est servi pour commettre une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ou pour commettre l'une des infractions énumérées à l'article L. 325-1-2 du code de la route. L'OPJ ou l'APJ en informe immédiatement le procureur de la République. Conformément au II de l'article L. 325-1-2 du code de la route, lorsque l'immobilisation ou la mise en fourrière prévue à l'article L. 325-1-1 de ce même code n'est pas autorisée par le procureur de la République dans un délai de 7 jours, le véhicule est restitué à son propriétaire.
En application de l'article L. 325-2 du code de la route, la mise en fourrière peut être prescrite par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, et, à Paris, les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique. Cette prescription permet aux agents de police municipale, gardes champêtres, et à Paris, aux agents de surveillance de Paris, habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière, à ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils, et de conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière, en utilisant, le cas échéant.
La notion d'agent qui occupe ces fonctions est de nature à permettre aux brigadiers chefs principaux de prescrire une mesure de mise en fourrière. Conformément au second alinéa de l'article 2 décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, les brigadiers chefs principaux, second grade du corps des agents de police municipale, sont chargés, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de police municipale, de l'encadrement des gardiens et des brigadiers.
- Sur la restitution des animaux en situation de divagation
Un animal en situation de divagation est sous la responsabilité du maire (articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales).
Aux termes de l'article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime :
« Chaque commune ou, lorsqu'il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d'une fourrière apte à l'accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. [...]
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de garde. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. / Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-13 du présent code peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l'article L. 212-10, lorsque cet animal n'a pas été gardé à la fourrière. Dans ce cas, l'animal est restitué après paiement d'un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du maire ».
Cette réglementation permet actuellement une restitution des animaux errants trouvés et identifiés sans délai uniquement par les agents listés au 1er alinéa de l'article L. 212-13 du même code, lequel renvoie aux agents mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'aux agents des douanes. Ainsi, en l'état du droit, les agents de police municipale et les gardes champêtres ne peuvent pas restituer les animaux sans délai et sont tenus de les apporter à la fourrière.
- Sur la constatation d'infractions à l'urbanisme
Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, « les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés ».
Cette réglementation fixe ainsi les conditions dans lesquelles certains agents publics peuvent constater les infractions pénales aux règles applicables en matière de certificat d'urbanisme (titre Ier), d'autorisations et de déclarations préalables (titre II), de constructions (titre III) d'aménagements (titre IV) et de contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux (titre VI).
A l'échelle locale, il est donc possible de permettre à des agents territoriaux de constater les infractions précitées, sous réserve que ceux-ci soient commissionnés par le maire et assermentés devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont domiciliés, en application des articles R. 480-3 et R. 610-1 du code de l'urbanisme.
Aucune disposition ne dispensant les agents de police municipale ni les gardes champêtres de ces formalités, les agents de ces cadres d'emplois ne peuvent constater les infractions aux règles d'urbanisme sans remplir préalablement ces conditions.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
- Sur le dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants sur les conducteurs de véhicules en l'absence d'infraction ou d'accident
Dans sa décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, le Conseil constitutionnel a relevé, s'agissant des dispositions de l'article 55-1 du code de procédure pénale relatif aux opérations de prélèvements externes sur toute personne susceptible de fournir des renseignement sur des faits ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, « que l'expression « prélèvement externe » fait référence à un prélèvement n'impliquant aucune intervention corporelle interne ; qu'il ne comportera donc aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des intéressés ; que manque dès lors en fait le moyen tiré de l'inviolabilité du corps humain ; que le prélèvement externe n'affecte pas davantage la liberté individuelle de l'intéressé ; qu'enfin, le prélèvement étant effectué dans le cadre de l'enquête et en vue de la manifestation de la vérité, il n'impose à la personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction aucune rigueur qui ne serait pas nécessaire » .
- Sur la prescription de mesure de mise en fourrière
Sans objet.
- Sur la restitution des animaux en situation de divagation
L'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant « la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ».
La modification du service public des fourrières animales relève donc du domaine de la loi.
- Sur la constatation d'infractions à l'urbanisme
L'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant « la préservation de l'environnement » et « la procédure pénale ».
Par conséquent, la modification des conditions dans lesquelles des agents sont habilités à constater des infractions pénales relève du domaine de la loi.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
- Sur le dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants sur les conducteurs de véhicules en l'absence d'infraction ou d'accident
L'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales consacre l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants infligés ou facilités par des agents de l'Etat.
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur la thématique des interventions médicales forcées en vue de l'obtention d'une preuve d'infraction.
La Cour précise que l'article 3 de la Convention n'interdit pas en tant que tel le recours à une intervention médicale contre la volonté d'un suspect en vue de l'obtention de la preuve de sa participation à une infraction. Toutefois, l'intervention doit être justifiée de manière convaincante au vu des circonstances de l'affaire. Cela vaut en particulier lorsque l'intervention vise à recueillir à l'intérieur du corps de la personne la preuve matérielle de l'infraction même dont elle est soupçonnée. La nature particulièrement intrusive d'un tel acte exige un examen rigoureux de l'ensemble des circonstances. Il est nécessaire de prendre en compte la gravité de l'infraction en question. Les autorités doivent également démontrer qu'elles ont envisagé d'autres méthodes pour obtenir des preuves. En outre, l'intervention ne doit pas faire courir au suspect le risque d'un préjudice durable pour sa santé83(*).
Dans une autre affaire, la Cour a conclu que le requérant avait été soumis à un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 lorsqu'il avait subi de force, au poste de police, la pose d'une sonde aux fins de prélèvement d'un échantillon d'urine visant à déterminer s'il était impliqué dans une infraction au code de la route en matière de stupéfiants. La Cour a noté que le recours à un cathéter n'était pas nécessaire dès lors que les autorités avaient obtenu le même élément de preuve en prélevant un échantillon du sang du requérant et que la façon dont la mesure avait été mise en oeuvre avait également occasionné au requérant des douleurs physiques et des souffrances mentales84(*).
A contrario, la Cour a jugé que le prélèvement, par un médecin, d'échantillons de sang et de salive sur un suspect contre sa volonté aux fins d'établir sa participation à une infraction n'avait pas atteint le degré minimum de gravité requis au regard de l'article 385(*). La Cour a notamment relevé que le prélèvement de sang par un médecin n'est que de très courte durée et ne cause que des dommages corporels mineurs et ne peut être considéré comme occasionnant une souffrance physique ou morale intense.
- Sur la prescription de mesure de mise en fourrière
L'article 2 du Protocole n°4 de la CEDH garantit la libre circulation :
« Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Il a notamment été jugé que l'annulation d'un permis de conduire n'entrait pas dans le champ d'application de la liberté de circulation, puisque l'article 2 du Protocole n°4 ne s'applique pas aux choix personnels quant à l'utilisation de tel ou tel moyen de transport (CEDH, Mazni c. Roumanie, 28 septembre 2004).
La Cour a rappelé que le droit à la liberté de circulation, tel que reconnu aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du Protocole n°4, a pour but d'assurer le droit, garanti à toute personne, de circuler à l'intérieur du territoire duquel elle se trouve, ainsi que de le quitter ; ce qui implique le droit de se rendre dans un pays de son choix dans lequel elle pourrait être autorisée à entrer. Toutefois, il n'inclut pas les choix personnels quant à l'utilisation des moyens de transport.
En l'occurrence, la Cour estime que le requérant a eu la possibilité de circuler librement, à sa guise, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le fait qu'il soit interdit de conduire et qu'il ait dû emprunter d'autres moyens de transport pour ses déplacements, lui causant ainsi un certain désagrément, ne saurait changer ce constat d'ordre factuel et ne saurait entraîner une méconnaissance du droit du requérant de circuler librement.
- Sur la restitution des animaux en situation de divagation
Par la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987, signée par la France le 18 décembre 1996, le Conseil de l'Europe a retenu l'« obligation morale de respecter toutes les créatures vivantes et gardant à l'esprit les liens particuliers existant entre l'homme et les animaux de compagnie ». Au demeurant, s'agissant de l'exploitation de fourrières, il convient de relever que selon l'article 13 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, «Lorsqu'ils formulent et mettent en oeuvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l'espace, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux.»
Par ailleurs, la traçabilité de certains animaux est une exigence issue du droit de l'Union européenne, notamment du règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicable aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles. Cette réglementation impose ainsi l'identification et l'enregistrement de certains animaux pour des raisons de santé publique et de contrôle sanitaire, facilitant d'autant la possibilité de les identifier et de les rendre à leur propriétaire.
Ainsi, en élargissant aux policiers municipaux et aux gardes champêtres la possibilité de restituer des chiens et chats identifiés, la mesure s'inscrit pleinement dans une logique de mise en oeuvre des engagements internationaux et conventionnels de la France en matière de bien-être animal.
- Sur la constatation d'infractions à l'urbanisme
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacre à son article 8, le principe selon lequel « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». La protection de la vie privée et du domicile implique notamment les constructions où une personne y fait des séjours réguliers86(*).
De plus, l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention précise que « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour règlementer l'usage des biens conformément à l'interdit général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».
Aussi, en matière de constatation sur des propriétés privées d'éventuelles infractions au code de l'urbanisme, la CEDH a pu retenir, s'agissant de la procédure de visite domiciliaire, sous certaines conditions, par les agents en charge de l'urbanisme (comprenant notamment ceux visés par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme qui inclut dans ce projet de loi les agents de police municipale et les gardes champêtres) afin de vérifier la conformité des travaux ne pose pas de problème au sens de l'article 8, notamment au regard des buts poursuivis de prévention des infractions pénales, de la protection de la santé et de la protection des droits et libertés d'autrui87(*).
En l'occurrence, les agents de police municipale et aux gardes champêtres sont d'ores et déjà compétents pour constater des infractions au code de l'urbanisme sur des constructions, particulièrement des habitations, sous réserve d'être expressément commissionner par le maire. La suppression de l'obligation de commissionnement est sans effet quant au respect des obligations conventionnelles de la France.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
- Sur le dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants sur les conducteurs de véhicules en l'absence d'infraction ou d'accident
En l'état du droit, la compétence des gardes champêtres en matière de dépistage de l'imprégnation alcoolique et de l'usage de stupéfiants sur les conducteurs de véhicule est limitée aux hypothèses d'accident de la circulation, de suspicion d'infraction au code de la route ou, s'agissant des dépistages de l'usage de stupéfiants, de suspicion d'usage de stupéfiants. Cette compétence est prévue par une disposition législative.
Au regard de cette compétence, il est cohérent de leur permettre de procéder à ces contrôles dans un cadre préventif, en l'absence d'infraction ou d'accident préalable dès lors que ces contrôles sont effectués sous la responsabilité des OPJ. L'attribution de cette compétence nécessite d'intervenir par voie législative.
- Sur la prescription de mesure de mise en fourrière
L'article L. 325-2 du code de la route limite la possibilité de prescrire une mesure de mise en fourrière aux chefs de police municipale ou agents qui occupent ces fonctions. Ainsi, les gardes champêtres et les agents de police municipale qui n'occupent pas de fonctions de chefs de police municipale ne disposent pas de la compétence de prescrire une mise en fourrière.
Afin d'étendre la compétence d'une telle opération à l'ensemble des agents de police municipale et aux gardes champêtres, une modification de l'article L. 325-2 du code de la route est nécessaire.
- Sur la restitution des animaux en situation de divagation
Le maire est responsable de la lutte contre la divagation animale sur le territoire de sa commune, au titre de ses pouvoirs de police spéciale :
- Il est ainsi tenu de prendre toute mesure contre la divagation des chiens et des chats (article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime) ;
- La fourrière animale est un service public. Le maire est compétent pour organiser ce service que sa commune est tenue d'avoir sur son territoire (selon l'article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime précité). La commune doit ainsi disposer ou avoir une convention avec une fourrière.
Tout animal trouvé divagant est porté à la fourrière qui doit rechercher le propriétaire de l'animal (article L. 211-25 du code rural et de la pêche maritime). A l'issue d'un délai franc de garde de 8 jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, celui-ci est considéré comme abandonné. Entretemps, son propriétaire peut venir le récupérer, après avoir payé les frais de garde. S'il refuse, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire.
Par dérogation prévue au 6e alinéa de l'article L211-24 du code rural et de la pêche maritime, les agents listés aux 1° à 6° de l'article L. 205-1, auquel renvoie l'article L. 212-13, peuvent restituer les animaux identifiés sans délai. Les agents de police municipale et les gardes champêtres ne sont pas mentionnés dans cette liste.
Or, ces agents agissent quotidiennement sur le territoire de la commune et sont à même d'identifier les animaux et de les restituer à leurs propriétaires.
Par conséquent, donner ce pouvoir de restitution sans délai de ces animaux trouvés et identifiés permettra d'éviter une procédure de placement de ces animaux et un encombrement des services des fourrières municipales. Cette mesure est donc bénéfique tant pour les administrés que pour l'organisation des services.
- Sur la constatation d'infractions à l'urbanisme
Le maire dispose de différentes prérogatives au titre de la police spéciale de l'urbanisme. Il détient notamment des pouvoirs suivants :
- lorsqu'il constitue l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme, il est tenu, en vertu du troisième alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, de faire dresser le procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 480-4 (méconnaissance des règles d'urbanisme ou des prescriptions imposées lors de travaux) et L. 610-1 du même code (infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme) ;
- il peut solliciter du juge d'instruction l'interruption des travaux et doit, le cas échéant, en assurer l'exécution, si besoin par des mesures coercitives. La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés sont effectuées par l'un des agents visés à l'article L. 480-1 du même code qui dresse procès-verbal (article L. 480-2 du code de l'urbanisme) ;
- une fois le procès-verbal dressé en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, il peut mettre en demeure le contrevenant, éventuellement sous astreinte, de se mettre en conformité aux règles d'urbanisme (article L. 481-1 du même code).
Le 2e alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme prévoit que ces infractions sont constatées par tout officier ou agent de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques assermentés et commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la Culture.
Ainsi, les policiers municipaux et les gardes champêtres doivent être spécifiquement commissionnés pour constater ces infractions alors même qu'ils auraient, du fait de leur statut et de leurs fonctions, vocation à y procéder.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le présent article a pour objectif de renforcer le rôle de police de proximité des agents de police municipale et des gardes champêtres au quotidien et de faciliter la mise en oeuvre de leurs prérogatives.
- Sur le dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants sur les conducteurs de véhicules en l'absence d'infraction ou d'accident
Cette disposition poursuit un double objectif.
En premier lieu, elle permet de corriger une incohérence relative aux compétences des gardes champêtres en matière de dépistage de l'imprégnation alcoolique et de l'usage de stupéfiants. Il n'apparaît en effet pas cohérent que ces agents ne puissent pas procéder à de telles dépistages dans un cadre préventif dès lors que les garanties prévues par la loi (dépistages effectués sous le contrôle d'un OPJ) sont identiques à celles prévues pour les contrôles effectués en cas d'accident ou d'infraction au code de la route, pour lesquels les gardes champêtres sont d'ores et déjà compétents.
En second lieu, l'attribution d'une telle compétence constituera un levier supplémentaire pour lutter contre l'insécurité routière en zone rurale, en augmentant le nombre d'agents habilités à procéder à des contrôles préventifs de dépistage d'alcoolémie et d'usage de stupéfiants.
En outre, l'attribution d'une telle compétence permettra d'aligner les compétences des gardes champêtres sur celles des agents de police municipale en matière de dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants.
- Sur la prescription de mesure de mise en fourrière
Cette disposition poursuit un double objectif.
Elle vise en premier lieu à prendre en compte les spécificités de chaque territoire, s'agissant notamment des communes rurales et des communes ne disposant que de peu d'agents de police municipale. Au sein de ces communes, lorsque le service de police municipale ne dispose pas de chef de service de police municipale ou de brigadier-chef principal pouvant exercer ces fonctions, aucun agent ne peut prescrire une mesure de mise en fourrière, ce qui est de nature à entraîner des difficultés dans le cadre de la mise en oeuvre de cette mesure (appel à d'autres services, délais de mise en oeuvre, ...).
Elle vise, en second lieu, en étendant la compétence pour prescrire une mise en fourrière à de nouveaux agents à fluidifier ces opérations.
- Sur la restitution des animaux en situation de divagation
Cette disposition poursuit l'objectif de renforcer la lutte contre les divagations d'animaux en permettant une restitution de celui-ci plus efficace, simplifiant cette procédure si l'animal est identifié, en ajoutant au 5ème alinéa les agents de police municipale et les gardes champêtres à la liste des agents pouvant restituer ces animaux sans délai.
- Sur la constatation d'infractions à l'urbanisme
Cette disposition poursuit l'objectif de renforcer l'application des règles d'urbanisme sur le territoire communal, en simplifiant la procédure permettant d'habiliter les agents de police municipale et les gardes champêtres à constater les infractions afférentes.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
- Sur le dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants sur les conducteurs de véhicules en l'absence d'infraction ou d'accident
L'option consistant à conférer à l'ensemble des gardes champêtres une compétence pour procéder aux opérations de vérifications destinés à établir la preuve de l'état alcoolique et faire procéder aux vérifications en vue d'établir si la personne a fait usage de stupéfiants a été écartée pour les raisons suivantes.
En premier lieu, les gardes champêtres ne disposent pas de compétence aux fins de constater les délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique prévu à l'article L. 234-1 du code de la route et de conduite après usage de stupéfiants prévu à l'article L. 235-1 du même code. Dès lors, l'intérêt opérationnel de leur attribuer une telle prérogative apparaît fortement limité.
En deuxième lieu, le refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique est constitutif d'un délit prévu à l'article I de l'article L. 234-8 du code de la route, que les gardes champêtres ne sont pas habilités à constater. Il ne serait donc ni cohérent ni opérationnel de leur permettre de procéder à de telles vérifications dès lors qu'en cas de refus par la personne concernée, les gardes champêtres ne disposeraient d'aucun moyen pour faire face à une telle situation.
Enfin, les vérifications en vue d'établir que la personne concernée a fait usage de stupéfiants nécessitent : d'une part, la réquisition d'un médecin, interne en médecine ou infirmier et, d'autre part, la gestion des scellés résultant du prélèvement sanguin. Ces opérations n'entrent pas dans les missions traditionnelles des gardes champêtres, lesquels ne disposent pas des moyens nécessaires aux fins d'assurer la gestion de tels scellés.
- Sur la prescription de mesure de mise en fourrière
Les dispositions actuelles limitent la possibilité de prescrire une mesure de mise en fourrière aux seuls chefs de police municipale ou agent occupant ces fonctions. Afin de gagner en efficacité, il apparaît nécessaire d'octroyer une telle prérogative à l'ensemble des agents de police municipale et gardes champêtres.
- Sur la restitution des animaux en situation de divagation
Une option aurait pu consister à modifier les règles d'accueil des animaux identifiés, en augmentant les capacités d'accueil. Cependant, les capacités des fourrières étant engorgées, cette solution aurait nécessité des coûts supplémentaires sans garantie d'efficacité pour restituer les animaux.
- Sur la constatation d'infractions à l'urbanisme
Une option aurait pu consister à rappeler aux communes la possibilité de commissionnement dont elles disposent afin de permettre à des agents territoriaux de constater les infractions aux règles d'urbanisme.
Toutefois, cette option n'est pas apparue suffisante pour améliorer l'application du droit de l'urbanisme et n'aurait pas permis de faciliter l'exercice de cette mission par les agents de police municipale et par les gardes champêtres, qui disposent déjà de prérogatives proches.
3.2. DISPOSITIF RETENU
- Sur le dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants sur les conducteurs de véhicules en l'absence d'infraction ou d'accident
Le présent article permet aux gardes champêtres, sur l'instruction du procureur de la République ou sur l'initiative des officiers ou agents de police judiciaire, et sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, d'une part, de procéder à des dépistages d'imprégnation alcoolique sur tout conducteur de véhicule et tout accompagnateur de l'élève, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident ; et d'autre part, de procéder à des dépistages de l'usage de stupéfiants sur tout conducteur de véhicule et tout accompagnateur de l'élève conducteur, aux épreuves de dépistage, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raison plausible de soupçonner un usage de stupéfiants.
- Sur la prescription de mesure de mise en fourrière
Le dispositif retenu permet d'étendre la compétence de mise en fourrière d'un véhicule aux gardes champêtres et à tout agent de police municipale.
- Sur la restitution des animaux en situation de divagation
L'option retenue consiste à permettre aux agents de police municipale et aux gardes champêtres de restituer sans délai les animaux errants trouvés et identifiés sur le territoire de la commune en les ajoutant à la liste des agents déjà compétents prévue au sixième alinéa de l'article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime.
En application de son pouvoir de police administrative, le maire est responsable des animaux en état de divagation (article L. 2212-2 du CGCT et L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime) et il est tenu d'assurer un service public de fourrière (article L.211-24 du code rural et de la pêche maritime).
Ce projet de loi vient renforcer leur rôle au contact de la population des polices municipales et des gardes champêtres. Les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire (article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure) et les gardes champêtres concourent à la police des campagnes (article L. 521-1 du même code). A ce titre, ils peuvent être considérés comme légitimes à intervenir dans la lutte contre les animaux errants.
La nouvelle compétence envisagée entend renforcer ce rôle en accélérant les procédures de restitution, sans remettre en cause la procédure de placement en fourrière en cas d'impossibilité d'identifier l'animal ou de le restituer dans l'immédiat à son propriétaire.
- Sur la constatation d'infractions à l'urbanisme
L'option retenue consiste à supprimer la nécessité pour les agents de police municipale et les gardes champêtres d'être commissionnés par le maire et assermentés pour constater les infractions au code de l'urbanisme.
Les agents de police municipale sont nommés par le maire (ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale), agréés par le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés, en application de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure (CSI). L'agrément a pour objet de vérifier que l'intéressé présente les garanties d'honorabilité requises pour occuper cet emploi (CE, 6 avril 1992, 119653 ; CE, 10 juillet 1995, 148139, 148146).
S'agissant des gardes champêtres, ils sont nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés, aux termes de l'article L. 522-1 du CSI.
Ces agents présentent ainsi, en raison de leur statut, des garanties leur permettant de constater des infractions.
Il convient de souligner que le présent projet de loi propose de renforcer encore davantage ces garanties, notamment en introduisant un agrément préfectoral préalable à l'exercice des fonctions de garde champêtre et en renforçant les mesures de contrôle déontologique.
Par conséquent, les conditions de commissionnement et d'assermentation requises en matière d'urbanisme n'apparaissent pas présenter, compte tenu des procédures existantes, d'intérêt particulier s'agissant des agents de police municipale et des gardes champêtres.
La suppression de ces formalités permettrait de simplifier les procédures sans remettre en cause les garanties attachées à l'exercice de la mission de constatation des infractions aux règles d'urbanisme.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
- Sur le dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants sur les conducteurs de véhicules en l'absence d'infraction ou d'accident
Cette disposition nécessite de modifier l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure.
- Sur la prescription de mesure de mise en fourrière
Cette disposition nécessite de modifier l'article L. 325-2 du code de la route.
Des coordinations devront, par ailleurs, être effectuées aux articles R. 325-9, R. 325-11, R. 325-14, R. 325-15, R. 325-16, R. 325-22, R. 344-2 et R. 344-4 du code de la route.
- Sur la restitution des animaux en situation de divagation
Le présent article modifie également l'article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime en ajoutant parmi les agents pouvant restituer, par dérogation, les animaux identifiés sans délai lorsque cet animal n'a pas été gardé à la fourrière, les agents de police municipale et les gardes champêtres.
- Sur la constatation d'infractions à l'urbanisme
Le présent article modifie enfin le premier aliéna de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme en ajoutant, parmi les agents habilités à constater les infractions aux du même code, les agents de police municipale et les gardes champêtres. Cette modification a pour effet de dispenser ces agents d'être préalablement commissionnés par le maire et assermentés.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Le présent article est conforme aux textes internationaux et européens mentionnés supra.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
- Sur le dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants sur les conducteurs de véhicules en l'absence d'infraction ou d'accident
Sans objet.
- Sur la prescription de mesure de mise en fourrière
1) S'agissant des agents de police municipale
Environ 16 000 agents de police municipale sont enregistrés dans le SI-Fourrières, soit 57,1 % des 28 000 agents existants (3 125 services sur 3 812 recensés sur le territoire).
En 2024, 571 232 procédures ont été gérées en 2024 au moyen du SI Fourrières, dont 199 931 ont été initiées par les policiers municipaux. Il ressort donc que 35 % des mises en fourrière ont été prescrites par des policiers municipaux.
Parmi les 159 021 véhicules mis en destruction après abandon en 2024, 55 657 résultent d'une mise en fourrière prescrite par des policiers municipaux.
Les coûts engendrés sont les suivants :
- Le budget DGPN de 2024, consacre 16 M€ à l'indemnisation des gardiens de fourrière, soit environ 5,6 M€ pour les mises en fourrière prescrites par des policiers municipaux (35% du total).
- Pour approcher le coût par agent de PM des mises en fourrière, il est proposé de partir de l'imputation sur le budget DGPN de 5,6M€ en 2024, et de répartir ce coût sur les 16 000 agents de PM déjà dans le SI. Cela nous amène à une moyenne de 350€ par agent.
2) S'agissant des gardes champêtres
Ils sont au nombre de 602 sur le territoire, employés par 265 communes.
Si l'on raisonne par comparaison, et que 57,1% des gardes champêtres venaient à s'enregistrer dans le SI-Fourrières, nous obtiendrions un total de 344 agents.
A raison de 350€ par agent en moyenne, nous arriverions à un coût global annuel de 120 400€.
Dans l'hypothèse où tous les gardes champêtres venaient à s'enregistrer dans le SI, le coût théorique serait de 602 x 350€ = 210 700€.
- Sur la restitution des animaux en situation de divagation
Sans objet.
- Sur la constatation d'infractions à l'urbanisme
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
- Sur le dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants sur les conducteurs de véhicules en l'absence d'infraction ou d'accident
Le I de l'article 4 du présent projet de loi étend les prérogatives de gardes champêtres en leur permettant d'effectuer des dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants dans un cadre préventif. En cela, cet article permet d'aligner sur ce point les compétences des gardes champêtres sur celles octroyées aux agents de police municipale.
- Sur la prescription de mesure de mise en fourrière
L'extension des compétences judiciaires des policiers municipaux et des gardes champêtres en matière de prescription de mise en fourrière conduirait d'une part à une augmentation des coûts opérationnels liés à la logistique de l'enlèvement et d'autre part à une hausse des recettes générées liées aux amendes de stationnement ou des frais de garde des véhicules.
- Sur la restitution des animaux en situation de divagation
La mesure relative aux restitutions d'animaux aura pour effet de désengorger les services de fourrières animales et d'en réduire les coûts de fonctionnement, en facilitant la restitution sans délai de certains animaux.
- Sur la constatation d'infraction à l'urbanisme
La mesure relative à la suppression du commissionnement pour les policiers municipaux et les gardes champêtres constitue quant à elle une mesure de simplification, permettant d'éviter le recours à un commissionnement.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
- Sur le dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants sur les conducteurs de véhicules en l'absence d'infraction ou d'accident
Cette mesure permettra d'augmenter le nombre d'agents compétents aux fins de réaliser des contrôles préventifs de dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants. Elle poursuit un objectif de renforcement de la sécurité routière par une augmentation du nombre de ces contrôles. En effet, comme indiqué précédemment, l'augmentation du nombre de contrôles entraine corrélativement une baisse du nombre de conducteurs ayant fait usage de stupéfiants.
- Sur la prescription de mesure de mise en fourrière
L'extension de la compétence de prescription d'une mise en fourrière à l'ensemble des agents de police municipale et gardes champêtres permettra d`assurer l'efficacité et la fluidité des mises en fourrière par les services de police municipale et, par voie de conséquence, d'assurer une fluidité de circulation sur la voie publique.
- Sur la restitution des animaux en situation de divagation
Dès lors qu'elle favorise la restitution sans délai des animaux identifiés, sans les placer en fourrière, cette mesure permet de faciliter la lutte contre la divagation des animaux errants et est de nature à améliorer le service public des fourrières animales en limitant le risque d'engorgement de celles-ci. En raccourcissant le délai de restitution des animaux à leurs propriétaires, elle répond également à une préoccupation sociétale croissante en matière de bien-être animal.
- Sur la constatation d'infractions à l'urbanisme
La suppression du commissionnement des agents de police municipale et des gardes champêtres est de nature à assurer une meilleure application des règles d'urbanisme, lesquelles régissent l'utilisation qui est faite du sol - notamment en déterminant la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions - en tenant compte des différents enjeux du territoire (sociaux, économiques et environnementaux notamment).
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
- Sur le dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants sur les conducteurs de véhicules en l'absence d'infraction ou d'accident
La mise en place de cette compétence est de nature à renforcer la sécurité des usagers de la route.
- Sur la prescription de mesure de mise en fourrière
L'extension de la compétence de prescription d'une mise en fourrière à l'ensemble des agents de police municipale et gardes champêtres permettra d'assurer l'efficacité et la fluidité des mises en fourrière par les services de police municipale et par voie de conséquence, d'assurer une fluidité de circulation sur la voie publique.
- Sur la restitution des animaux en situation de divagation
Cette mesure est de nature à faciliter la restitution sans délai des animaux errants à leur propriétaire, lorsque ceux-ci n'ont pas été gardés à la fourrière. Si le propriétaire de l'animal doit au préalable s'acquitter d'un versement libératoire forfaitaire, cette procédure lui évite de payer les frais de garde en lui permettant de récupérer sans délai son animal. Outre cet aspect financier, cette restitution plus rapide est bénéfique aux propriétaires du point de vue de leur lien affectif avec l'animal.
- Sur la constatation d'infractions à l'urbanisme
La suppression du commissionnement et de l'assermentation actuellement requis pour les agents de police municipale et les gardes champêtres est de nature à renforcer l'application des règles d'urbanisme qui s'imposent notamment aux particuliers.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
- Sur le dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants sur les conducteurs de véhicules en l'absence d'infraction ou d'accident
Sans objet.
- Sur la prescription de mesure de mise en fourrière
Sans objet.
- Sur la restitution des animaux en situation de divagation
En facilitant la restitution sans délai des animaux identifiés, sans les placer en fourrière, évitant d'engorger celles-ci avec des animaux qui peuvent être restitués plus rapidement, cette mesure entend faciliter la lutte contre la divagation des animaux errants et réduire leurs effets sur l'environnement, les autres animaux et les personnes.
- Sur la constatation d'infractions à l'urbanisme
En simplifiant la procédure permettant d'habiliter les agents à constater les manquements aux règles d'urbanisme - comportant notamment des considérations environnementales - cette mesure tend à augmenter le nombre d'agents pouvant procéder à une telle constatation. Elle est donc de nature à favoriser une constatation plus rapide de ces infractions, et par là même à réduire les impacts environnementaux pouvant être causés par des travaux réalisés en contrevenant aux règles d'urbanisme.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été saisi pour avis, à titre obligatoire, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, et a rendu un avis favorable en date du 2 octobre 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Aux termes de l'article 112-2 du code pénal, les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont d'application immédiate.
Le présent article entrera en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
- Sur le dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants sur les conducteurs de véhicules en l'absence d'infraction ou d'accident
Le dispositif s'applique de plein droit sur l'ensemble du territoire hexagonal et dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte), régies par le principe de l'identité législative.
S'agissant de la Polynésie française, l'application de cet article nécessite de modifier l'article L. 545-1 du code de la sécurité intérieure. Un article spécifique relatif à l'application des dispositions aux collectivités d'Outre-mer complète ce projet de loi sur les points qui nécessitent des adaptations et des extensions du régime juridique
S'agissant de la Nouvelle Calédonie, l'équivalent de l'article L. 521-1 du CSI repose sur les articles L. 546-2 et L. 546-5 du CSI, mais ces articles ne permettent pas aux gardes champêtres de procéder aux épreuves de dépistage en application du code de la route.
- Sur la prescription de mesure de mise en fourrière
Le dispositif s'applique de plein droit sur l'ensemble du territoire hexagonal et dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte), régies par le principe de l'identité législative.
S'agissant de la Polynésie française, la rédaction de l'article L. 325-2 du code de la route applicable à ce territoire est prévue à l'article L. 343-1 du même code.
S'agissant de la Nouvelle-Calédonie, la rédaction de l'article L. 325-2 du code de la route applicable à ce territoire est prévue à l'article L. 344-1 du même code.
Un article spécifique relatif à l'application des dispositions aux collectivités d'Outre-mer complète ce projet de loi sur les points qui nécessitent des adaptations et des extensions du régime juridique.
- Sur la restitution des animaux en situation de divagation
Le dispositif s'applique de plein droit sur l'ensemble du territoire hexagonal et dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte), régies par le principe de l'identité législative, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'application de la mesure en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie nécessite la modification des articles L. 275-5 et L. 275-10 du code rural et de la pêche maritime, lesquels prévoient respectivement les conditions d'application dans ces territoires de l'article L. 211-24 du même code. Un article spécifique relatif à l'application des dispositions aux collectivités d'Outre-mer complète ce projet de loi sur les points qui nécessitent des adaptations et des extensions du régime juridique
- Sur la constatation d'infractions à l'urbanisme
Le dispositif s'applique de plein droit sur l'ensemble du territoire hexagonal et dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte), régies par le principe de l'identité législative.
5.2.3. Textes d'application
- Sur le dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants sur les conducteurs de véhicules en l'absence d'infraction ou d'accident
Sans objet.
- Sur la prescription de mesure de mise en fourrière
Un décret en Conseil d'Etat devra permettre de procéder aux coordinations rendues nécessaires dans la partie réglementaire du code de la route, par la modification de l'article L. 325-2 de ce code.
- Sur la restitution des animaux en situation de divagation
Sans objet.
- Sur la constatation d'infractions à l'urbanisme
Sans objet.
CHAPITRE III - MESURES DE DE COORDINATION AVEC LE NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Article 5 - Habilitation du Gouvernement à opérer par ordonnance les coordinations nécessaires avec la future ordonnance de réécriture du code de procédure pénale
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
L'article 2 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice a autorisé le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance à la réécriture de la partie législative du code de procédure pénale afin d'en clarifier la rédaction et le plan, ainsi qu'à la modification de toute autre disposition de nature législative rendue nécessaire par cette réécriture.
Cette refonte est effectuée à droit constant, sous la seule réserve des modifications nécessaires pour88(*) :
- assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ;
- harmoniser l'état du droit ;
- remédier aux éventuelles erreurs ou omissions ;
- abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;
- procéder aux adaptations terminologiques utiles, notamment pour revoir les dispositions dont la formulation peut paraître remettre en cause la présomption d'innocence.
L'ordonnance doit être prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, soit jusqu'au 20 novembre 2025. A compter de la publication de l'ordonnance, le Gouvernement disposera d'un délai de six mois pour déposer devant le Parlement un projet de loi de ratification de l'ordonnance.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. »
Il ressort de ces dispositions que le Gouvernement, à son initiative, peut être autorisé par le Parlement à prendre par ordonnance des mesures qui sont en principe du domaine de la loi.
Une disposition d'habilitation ne peut résulter que d'un projet de loi ou d'un amendement déposé par le Gouvernement89(*).
L'article 38 de la Constitution n'exclut de la délégation que les domaines que la Constitution réserve aux lois organiques, aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale90(*). Toutes les autres matières que l'article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi peuvent faire l'objet d'une habilitation à légiférer par ordonnance91(*), quelle que soit leur importance et quelle que soit l'éminence des principes en cause.
La loi d'habilitation ne saurait avoir pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en application de l'article 38 de la Constitution, de respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle, ainsi que les normes internationales et européennes applicables92(*).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Conformément à l'article 2 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice (précitée), l'ordonnance de refonte du code de procédure pénale doit être publiée avant le 20 novembre 2025, et le projet de loi de ratification de cette ordonnance déposé au Parlement dans un délai de six mois suivant sa publication. A compter de la date de publication de l'ordonnance de refonte du code, le Gouvernement ne sera plus habilité à modifier les dispositions de cette ordonnance qui relèvent du domaine de la loi.
Or, plusieurs dispositions du présent projet de loi modifient des dispositions du code de procédure pénale dans sa rédaction actuelle ou sont relatives à la procédure pénale. A titre d'exemple, l'article 3 modifie l' article 78-6 du code de procédure pénale relatif aux relevés d'identité.
Par conséquent, dans la mesure où l'élaboration du présent projet de loi intervient avant l'adoption de l'ordonnance opérant la refonte du code de procédure pénale (examiné par le Conseil d'Etat en octobre 2025), il est nécessaire de permettre au Gouvernement de procéder aux coordinations nécessaires entre les dispositions relatives à la procédure pénale résultant du présent projet de loi - qui modifient le code de procédure pénale dans sa rédaction actuelle - et l'ordonnance de réécriture du code de procédure pénale.
Cette habilitation pourra aussi permettre au Gouvernement de déplacer certaines dispositions nouvelles du présent projet de loi, relevant avant tout de la procédure pénale, dans le nouveau code de procédure pénale, en fonction de l'architecture retenue dans ce dernier, à des fins de cohérence et de lisibilité de la norme.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif est de permettre de procéder aux coordinations et aux adaptations nécessaires entre le présent projet de loi et l'ordonnance de réécriture du code de procédure pénale (insertion des modifications apportées au code de procédure pénale et à des dispositions relevant de la procédure pénale par le présent projet de loi dans le nouveau code de procédure pénale).
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Compte tenu de l'incompatibilité du calendrier de refonte du code de procédure pénale par ordonnance avec celui du présent projet de loi, aucune autre option n'a pu être envisagée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le dispositif retenu vise à autoriser le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à procéder par voie d'ordonnance aux coordinations et aux adaptations nécessaires entre les dispositions du présent projet de loi relevant du code de procédure pénale et l'ordonnance de refonte du code de procédure pénale.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
L'impact des dispositions envisagées est limité en ce que l'habilitation ne vise qu'à permettre d'effectuer les coordinations et les adaptations nécessaires entre l'ordonnance de réécriture du code de procédure pénale et le présent projet de loi.
L'ordonnance ne visera qu'à opérer des modifications de forme (insertion des modifications apportées au code de procédure pénale et à des dispositions relevant de la procédure pénale par le présent projet de loi dans le nouveau code de procédure pénale).
5. JUSTIFICATION DU DÉLAI D'HABILITATION
Il résulte de l'article 38 de la Constitution que l'habilitation à légiférer par ordonnance ne peut être donnée au Gouvernement que pour un délai limité.
Le délai d'habilitation sollicité de six mois doit permettre d'opérer les coordinations et les adaptations nécessaires entre les dispositions du présent projet de loi et les dispositions de l'ordonnance relative à la réécriture du code de procédure pénale.
Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
TITRE III - LES NOUVEAUX MOYENS D'ACTION DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES CHAMPÊTRES
Article 6 - Autoriser les caméras aéroportées pour les services de la police municipale
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
En l'état du droit, le recours à la captation d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs (notamment des drones) est possible au moyen de différents dispositifs déjà prévus par la loi.
Les caméras aéroportées peuvent être employées par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ( article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure - CSI).
La loi encadre strictement l'usage de ces dispositifs, qui ne peuvent être déployés que pour des finalités et selon des modalités strictement définies.
Le recours à ces dispositifs de captation d'images n'est autorisé que pour assurer :
- La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ;
- La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ;
- La prévention d'actes de terrorisme ;
- La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ;
- La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;
- Le secours aux personnes.
Le recours à ce dispositif est conditionné à l'autorisation écrite et motivée du Préfet, délivrée pour une durée de trois mois maximum et pour un périmètre géographique bien délimité. L'autorisation fixe en outre le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. Le préfet peut mettre fin à tout moment à l'autorisation s'il estime que les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies. Les caméras aéroportées peuvent également être employées par les agents des douanes dans l'exercice de leurs missions de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées et de tabac et de surveillance des frontières (même article L. 242-5 du CSI) ainsi que par les pompiers au titre de leurs missions de sécurité civile ( article L. 242-6 du code de la sécurité intérieure).
Enfin, ces caméras aéroportées peuvent être mises en oeuvre dans le cadre de missions de police judiciaire et dès lors qu'un tel usage est exigé par les nécessités d'une enquête ou d'une instruction portant sur un délit ou crime, une procédure de recherche d'une personne en fuite ou une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition ( articles 230-47 à 230-53 du code de procédure pénale).
L'objet de la disposition proposée est de prévoir un cadre permettant l'usage des caméras aéroportées par les services de police municipale tout en assurant son caractère strictement nécessaire et proportionné.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée.
Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif ( décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012).
En outre, dans sa décision portant sur la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ( décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022), le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions permettant l'usage de drones par les services de police municipale dans la mesure où le législateur n'avait pas apporté de garanties suffisantes pour opérer une conciliation équilibrée entre, d'une part, les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public, et d'autre part, le droit au respect de la vie privée.
Compte tenu des motifs de cette censure, le projet de loi prévoit de nouvelles garanties pour mieux encadrer l'usage des caméras aéroportées par les services de police municipale : à titre d'exemple, la finalité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles est circonscrite à celles particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l'ordre public et le préfet pourra mettre fin à l'autorisation qu'il a délivrée si les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies (voir aussi la rubrique « 3.2 Dispositif retenu »).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Afin d'assurer le respect de la vie privée, le droit de l'Union européenne encadre strictement les conditions de mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel, au travers des textes suivants :
- Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données - RGPD) ;
- La directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil directive européenne du 27 avril 2016 (dite « police-justice »). Cette directive, concernant les traitements à des fins pénales ou de sécurité publique, a été transposée au titre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les dispositifs de caméras aéroportées relèvent de ce cadre juridique, en tant qu'opérations de captation d'images portant sur des données à caractère personnel (visage des personnes notamment). Au regard des finalités poursuivies et des services responsables de leur mise en oeuvre, les traitements envisagés pour les services de police municipale relèveront de la directive « police-justice », qui prévoit des garanties adaptées aux enjeux des traitements concernés.
La mise en oeuvre de tels traitements doit donc respecter les grands principes énoncés par le droit européen de la protection des données et rappelés à l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978. En particulier, les données doivent être d'une part, collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et, d'autre part, adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. De plus, le principe de minimisation impose que chaque traitement comprenne le nombre le plus restreint possible de données et d'accédants.
La mesure proposée, qui s'inspire largement du dispositif existant pour les caméras aéroportés employées par les services de la police et de la gendarmerie nationales, a été conçue de sorte à respecter ces grands principes, cet équilibre ayant été validé par le CNIL et le Conseil d'Etat.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
L'intégration des drones au sein des forces locales de sécurité varie selon les pays, celles du Royaume-Uni y ayant largement recours avec un cadre d'emploi peu contraignant pour des cas d'usage multiples. À l'inverse, dans d'autres pays (Italie, Espagne), leur domaine d'emploi, bien que parfois étendu, reste étroitement encadré.
Au Royaume-Uni, une grande majorité des forces de police utilisent des drones. La British Transport Police assure par exemple des interventions sur le réseau ferroviaire de tout le pays à partir de drones prépositionnés dans des boites mobiles, et pilotés depuis sa salle de commandement de la capitale, à Londres. De plus, les enforcement officers (agents d'exécution, ou agents de la force publique), dont plusieurs milliers relèvent de différents councils (autorités locales), qui ne sont pas des « policiers » mais ont un champ de compétences similaire à celui de la police confiée aux maires français, peuvent utiliser des drones. Les images captées peuvent être partagées avec les forces de police.
En Italie, l'usage des drones par la police locale italienne est très encadré. Elle doit obtenir une reconnaissance formelle pour des finalités spécifiques. De manière générale, les polices locales ne peuvent pas exercer automatiquement des fonctions réservées à la police d'État italienne. Il y a deux autorisations à avoir pour faire volet des drones :
- Une autorisation technique provenant de l'ENAC (l'Office national de l'aviation civile) qui dépend du ministère des infrastructures et des transports : toutes les FSI utilisant des drones en Italie doivent s'y conformer ;
- Une autorisation d'emploi : si l'usage est lié à la sécurité publique, il faut un accord du ministère de l'Intérieur (généralement les préfectures de rattachement des communes font une délégation).
Il convient ensuite se conformer aux règles strictes de l'ENAC (enregistrement des appareils et tenir à jour toute la documentation ENAC pour suivi) et de l'UE et que chaque pilote soit formé avec une attestation spécifique et reconnue. Les communes doivent également souscrire à une assurance adaptée aux opérations visées. Enfin, si le drone capte des données ou images, il faut nommer un responsable et procéder à une évaluation d'impact, expliciter la finalité visée, la durée de conservation des données, les mesures de sécurité, l'information au public et prévoir une procédure de mission (checklist pré-vol, journal de vol, archivage, accès).
A Rome, les drones sont utilisés par exemple pour :
- le contrôle environnemental (décharges illégales, pollution, dépôts sauvages) ;
- le suivi des incendies toxiques et des abus d'occupation du sol ou construction illégale ;
- la surveillance lors d'événements, la sécurité urbaine, etc.
En Espagne, les polices municipales peuvent avoir recours aux drones pour tout type de manifestation ou de troubles à l'ordre public. A titre d'exemple, elles ont récemment utilisé ce type de dispositif lors de manifestations.
Si les drones ne sont pas utilisés dans le cadre de la protection de la sécurité des personnes et des biens, ils peuvent être déployés en vue de lutter contre les infractions environnementales ou routières.
La captation et la conservation des données sont restreintes par la loi organique 7/2021 du 26 mai portant sur la protection des données personnelles traitées à des fins de prévention, de détection, d'enquête et de poursuites pénales, dont l'objectif est de garantir les meilleurs standards de protection des droits fondamentaux et des libertés des citoyens. Dans son article 8, elle prévoit une durée de conservation fixée au temps strictement nécessaire. Une revue doit être effectuée tous les 3 ans. Les données ne peuvent être conservées plus de 20 ans, sauf motifs exceptionnels. L'article 6 précise que le recueillement des données est réalisé dans un cadre déterminé, explicite et légitime. Leur traitement est soumis aux principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité.
En outre, l'utilisation des drones par les polices municipales est limitée à leurs démarcations territoriales et nécessite, dans le cadre de certains événements, un accord préalable du délégué du gouvernement (équivalent du préfet), compétent au niveau local.
Le dispositif a été soumis au contrôle de l'Agence étatique de protection des données, qui constitue l'équivalent de la CNIL en France.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
L'usage des caméras aéroportées par des autorités publiques, y compris pour des finalités légitimes et restreintes, soulève des enjeux en termes de garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Le Conseil d'Etat, saisi d'une demande d'avis par le Gouvernement, a considéré que : « l'intervention d'un acte réglementaire autorisant le traitement des données personnelles collectées par une caméra aéroportée employée dans des missions de police générale ou à des fins de police judiciaire ne peut fournir une base légale suffisante à la captation d'images voire de sons par les autorités publiques au moyen de ce procédé. [...] cette captation relève de matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution, celui-ci pouvant seul, en en fixant les éléments principaux, définir les conditions permettant d'assurer la conciliation entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public, comme il l'a fait pour la vidéoprotection et les caméras individuelles. Le Conseil d'État estime donc qu'il est nécessaire de fixer un cadre législatif d'utilisation des caméras aéroportées par les forces de sécurité et les services de secours » (avis n° 401214 du 20 octobre 2020). En effet, les atteintes susceptibles d'être portées au droit à la vie privée induisent la nécessité d'un encadrement législatif de tels usages.
Les premières dispositions relatives à l'usage de drones par les polices municipales à titre expérimental ont été votées dans la loi pour une sécurité globale préservant les libertés (art. 47), mais censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-817 du 20 mai 2021 (§ 133 à 141), dans laquelle il a relevé que l'autorisation n'était pas limitée dans le temps, qu' aucune condition n'entourait la transmission en temps réel des images captées au poste de commandement, l'information des personnes n'était pas spécifiquement prévue et qu'il n'existait pas de contingentement du nombre de drones pouvant être utilisés, le cas échéant simultanément par les différents services de l'État et ceux de la police municipale.
De nouvelles dispositions de même nature ont été insérées dans la loi relative et à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (art. 15) mais, dans sa décision n° 2021-834 du 20 janvier 2022 (§ 34 à 39), le Conseil constitutionnel a de nouveau censuré l'utilisation de drones par les agents de police municipale à titre expérimental. Pour censurer le dispositif, il a jugé que la finalité permettant le recours à ces drones pour les besoins de sécurisation des manifestations sportives, récréatives ou culturelles aurait dû être circonscrite à celles particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l'ordre public. Il a également relevé qu'il n'était pas prévu que le préfet puisse mettre fin à tout moment à l'autorisation délivrée quand il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.
Afin d'accompagner le renforcement de la place et du rôle des policiers municipaux dans l'édifice de la sécurité globale, il apparaît nécessaire de les doter de moyens d'action supplémentaires pour leur permettre d'accomplir leurs missions de manière plus efficace, en complémentarité avec les services de l'Etat. Autoriser les services de police municipale à recourir à des caméras aéroportées participe de cette évolution.
Il convient donc de réintroduire ces dispositions en les assortissant de garanties particulières tendant à assurer leur conformité à la Constitution, comme l'a également proposé le rapport d'information sénatorial du 28 mai 202593(*).
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Les caméras aéroportées ont vocation à être utilisées par les services de police municipale pour des finalités précises et limitativement énumérées par les dispositions proposées. Elles offrent une dimension opérationnelle certaine au regard des moyens conventionnels de surveillance ou d'appui aux missions dont les policiers municipaux ont la charge. Elles permettent, en effet, des capacités de captation complémentaires aux outils existants, notamment les systèmes de vidéoprotection et les caméras individuelles.
Toutefois, et comme pour les caméras aéroportées mises en oeuvre par les services de l'Etat, l'objectif poursuivi par le Gouvernement consiste à n'autoriser de tels usages pour les services de police municipale que lorsque le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs s'agissant du droit au respect de la vie privée.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Cf. point suivant
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'article proposé a pour objet d'autoriser les services de police municipale à procéder à des traitements d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs pour des finalités de police administrative. Or, comme l'a indiqué le Conseil constitutionnel (décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012, Loi relative à la protection de l'identité), « la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif ».
En application de ces principes et afin d'assurer une conciliation entre les atteintes portées au droit à la vie privée et l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public, le dispositif de captation d'images pour les services de police municipale est précisément défini dans l'ensemble de ses composantes.
Les dispositions proposées instituent un nouvel article L. 242-7 du code de la sécurité intérieure pour autoriser, à titre expérimental et pour une durée fixée à cinq ans, les services de police municipale à mettre en oeuvre des caméras aéroportées. A l'issue, les communes qui auront bénéficié de cette expérimentation devront remettre au Gouvernement un rapport d'évaluation. Ces dispositions prévoient en outre que le Gouvernement remettra au Parlement un rapport d'évaluation générale de la mise en oeuvre de l'expérimentation.
Le dispositif encadre fortement l'usage des drones par les services de police municipale afin de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 2022.
En premier lieu, la possibilité de mettre en oeuvre ce dispositif n'est ouverte qu'aux seuls services de la police municipale, et seulement lorsque ces services interviennent dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, parmi celles clairement prévues par le code général des collectivités territoriales
En deuxième lieu, la mise en oeuvre du dispositif est limitée, dans sa portée, à la poursuite de cinq finalités strictement définies et légitimes, visant :
- La sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ainsi que des grands rassemblements de personnes particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l'ordre public, pour la mise en oeuvre des prérogatives prévues au 3° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- La régulation des flux de transport aux fins d'assurer la sécurité publique ;
- Le secours aux personnes ;
- La prévention des risques naturels ou d'atteinte à l'environnement pour la mise en oeuvre des prérogatives mentionnées au 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- La protection des bâtiments et installations publics communaux et intercommunaux et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation.
Ces cinq finalités permettent d'englober des situations pour lesquelles le recours aux drones répond à des besoins opérationnels réels pour l'autorité municipale dans le cadre des missions de police qui sont les siennes, tels que : la sécurisation d'évènements de grande ampleur se déroulant sur le territoire de la commune et qui, pour des raisons de configuration des lieux, peuvent être difficiles à surveiller par le simple déploiement de policiers municipaux au sol ; la visualisation, au sein d'une agglomération, d'un lieu sur lequel un accident de la route bloquant la circulation s'est produit pour organiser un itinéraire de substitution au bénéfice des usagers de la route et prévenir ainsi les risques de suraccidents ; la surveillance d'un cours d'eau dans le cadre d'une alerte pour risque de crue dans le but d'évacuer prioritairement les habitations les plus exposées aux risques d'inondation ; la protection de bâtiments publics communaux ou intercommunaux lors d'épisodes de violence urbaine, tels que les écoles, les bibliothèques ou les mairies, fortement dégradés à l'été 2023.
Ainsi, conformément aux principes fondamentaux qui régissent le droit de la protection des données à caractère personnel (licéité et loyauté de la collecte, caractère déterminé, explicite et légitime des finalités), les traitements d'images par drones poursuivent en l'espèce des finalités précises, clairement justifiées par l'intérêt général et légitimes au regard des services chargés de leur mise en oeuvre.
Pour tirer les conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et notamment de la décision du 20 janvier 2022, la finalité relative à la sécurisation « des manifestations sportives, récréatives ou culturelles » a été circonscrite à celles qui sont « particulièrement exposées » à des risques de troubles graves à l'ordre public. Sont aussi visés les « grands rassemblements », qui ne l'était pas dans le dispositif expérimental prévue par la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure et censuré par le Conseil constitutionnel, mais qui tient expressément compte du 3° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) définissant les prérogatives de la police municipale94(*).
Si deux autres finalités ont été ajoutées par rapport à ce précédent dispositif expérimental, elles recouvrent à la fois les prérogatives de la police municipale, dont la liste prévue à l'article L. 2212-2 n'est pas exhaustive, et des besoins opérationnels réels. En effet, la finalité « prévention des risques naturels ou d'atteinte à l'environnement » recoupe celle visée au 5° de cet article (« Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure »). De même, la finalité « protection des bâtiments et installations publics communaux ou intercommunaux et de leurs abords immédiats » entre globalement dans l'objectif de bon ordre et de sécurité publique que poursuivent les pouvoirs de police municipale s'agissant des bâtiments et installations dont les collectivités territoriales sont propriétaires et qui font l'objet de graves dégradations, comme cela peut être le cas lors d'épisodes de violences urbaines.
Par ailleurs, les traitements qui seront mis en oeuvre sur le fondement de l'article L. 242-7 du code de la sécurité intérieure seront soumis aux mêmes obligations et garanties d'ordre général que celles applicables aux services de l'Etat, mentionnées aux articles L. 242-1 et à L. 242-4 du même code et déclarées conformes à la Constitution.
Les dispositifs aéroportés devront être employés de telle sorte qu'ils ne visent pas à recueillir les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces dispositifs conduit à visualiser de tels lieux, l'enregistrement doit être immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées devront être supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
Outre ces garanties générales, tendant à assurer la proportionnalité du recours aux caméras aéroportées par les services de police municipale et à limiter l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée, le dispositif proposé améliore le contrôle préalable à leur mise en oeuvre en prévoyant une autorisation préfectorale subordonnée, d'une part, à une demande du maire ou des maires territorialement compétents et, d'autre part, à l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat et, dans le cas d'une mise en commun d'agents en application des articles L. 512-1-2 et L. 512-2, d'une convention conclue dans les conditions précisées à l'article L. 512-5.
Cette autorisation écrite et motivée, susceptible de recours devant le juge administratif et qui ne peut excéder une durée de trois mois, porte sur un périmètre géographique réduit au strict nécessaire. En outre, elle doit fixer le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique, y compris aux services de l'État. Surtout, conformément à l'exigence du Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 janvier 2022, les dispositions proposées prévoient que le préfet peut mettre fin à son autorisation dès lors que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies ou lorsque les conditions de mise en oeuvre nuisent à l'efficacité de la coordination opérationnelle avec les forces de sécurité de l'Etat. Enfin, pour qu'une bonne coordination des interventions entre la police municipale et les forces de sécurité intérieure soit assurée, la nouvelle rédaction prévoit expressément le cas où l'autorité préfectorale devient, par l'ampleur de l'évènement qu'il convient de sécuriser ainsi que de sa gravité, le directeur des opérations de secours, en lieu et place de l'autorité municipale. Dans ce cadre, il peut mobiliser les drones déployés par la ou les communes concernées.
Les évolutions proposées conduisent à ne pas reprendre la procédure d'urgence qui avait été relevée par le Conseil constitutionnel comme motif de censure. Aussi, les dispositions proposées apportent des garanties similaires à celles qui entourent le dispositif prévu pour les services de l'Etat. Ainsi, la durée maximale de conservation des images est fixée à sept jours et les enregistrements seront conservés sous la responsabilité du chef de service, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire. Enfin, les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
Il convient de rappeler que les dispositions en vigueur retiennent le principe, en complément d'une information générale du public organisée par le ministre de l'intérieur, d'une information particulière sur l'usage de caméras aéroportées, délivrée par tout moyen approprié aux personnes dont l'image est captée, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis. Les exceptions à ce principe d'information seront précisées au sein des mesures réglementaires d'application de l'article.
Les personnes filmées disposent également d'un droit d'accès dans le cadre de la loi du 6 janvier 1978 précitée. En effet, cette loi s'applique par nature en la matière, puisqu'elle constitue le droit commun s'agissant de la protection des données, permettant ainsi d'assurer le caractère proportionné de l'ensemble des caractéristiques des traitements, y compris des accédants autorisés.
Par ailleurs, un arrêté du ministre de l'intérieur précisera les conditions et les modalités de la formation des agents de police municipale pour qu'ils puissent assurer certaines de missions en ayant recours à la captation vidéo aéroportée.
Enfin, les modalités de contrôle interne du droit commun s'appliqueront aussi, afin qu'un contrôle de l'opportunité de la mise en oeuvre du dispositif puisse être opéré : diffusion d'instruction, respect du cadre d'emploi, formation des agents, contrôle hiérarchique, traçabilité des opérations, poursuites disciplinaires en cas de mésusage. Le préfet pourra également révoquer une autorisation, ou ne pas la renouveler, s'il estime que des manquements ont eu lieu. Par ailleurs, la CNIL disposera de tous les pouvoirs de contrôle et de sanction que lui reconnaissent les articles 19 et 20 de la loi du 6 janvier 1978.
Afin de permettre au Parlement d'évaluer l'efficacité et la pertinence du dispositif, il est prévu que le Gouvernement remette un rapport d'évaluation générale de la mise en oeuvre de l'expérimentation six mois avant le terme de l'expérimentation. A ce rapport seront annexés les rapports d'évaluation communaux qui auront été remis au Gouvernement trois mois plus tôt. Les critères d'évaluation de l'expérimentation seront fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article rétablit l'article L. 242-7 du code de la sécurité intérieure. Il en résulte un chapitre cohérent et consolidé qui sera relatif à l'ensemble des caméras aéroportées, auquel vient s'ajouter un cadre nouveau, expérimental, pour les services de police municipale.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Le présent article s'inscrit pleinement dans le cadre européen de la protection des données à caractère personnel en vigueur.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Les services de police municipale sollicitant une autorisation d'employer des caméras aéroportées devront constituer un dossier de demande comportant suffisamment d'éléments permettant de justifier cet usage. Ils devront également organiser les modalités de réponse aux demandes d'exercice des droits des personnes ayant fait l'objet d'enregistrements.
Aux fins d'utilisation des caméras aéroportées par les services de police municipale, le maire ou les maires territorialement compétents devront avoir conclu une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat prévue à l'article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure. Lorsque les agents de police municipale sont mis à disposition de plusieurs communes en application des articles L. 512-1-2 et L. 512-2, elles devront avoir conclu une convention dans les conditions précisées à l'article L. 512-5. Ces conventions devront prévoir cette faculté et les conditions de coordination de l'utilisation de ces moyens avec les forces de sécurité intérieure territorialement compétentes.
En outre, les communes devront financer l'acquisition d'aéronefs si elles souhaitent bénéficier de cette expérimentation et ainsi pouvoir solliciter une autorisation d'employer des caméras aéroportées. Le coût de cette acquisition variera entre 12 000 et 25 000 euros selon les caractéristiques du drone (notamment son poids) et les accessoires et options retenues par les communes. Il ne tient pas compte des éventuelles remises qui pourraient être consenties en fonction des volumes de commande passés. Il n'est pas possible de calculer un coût global pour ces équipements, la mise en oeuvre du dispositif étant facultatif et à la main des maires, et le coût dépendant également du type et du nombre d'évènements, la plupart par nature imprévus, pouvant conduire au déploiement des drones.
Enfin, les communes qui auront bénéficié de cette expérimentation devront, au plus tard neuf mois avant le terme de cette expérimentation, remettre au Gouvernement un rapport d'évaluation.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
L'instruction des demandes d'autorisation de recours aux caméras aéroportées émanant du maire ou des maires territorialement compétents représentera une charge supplémentaire pour les services préfectoraux, qui ont toutefois déjà connaissance des principes applicables en la matière et de la procédure, compte tenu de la délivrance des autorisations pour les services de l'Etat déjà prévue à l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Le dispositif retenu permettra de renforcer l'efficacité de l'action des services de police municipale, au bénéfice de la sécurité des citoyens, notamment lors de manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou lors de grands rassemblements de personnes particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l'ordre public.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Le dispositif retenu ne crée pas d'obligation nouvelle pour les particuliers. Par ailleurs, les personnes ayant fait l'objet d'une captation d'images au moyen d'un aéronef pourront exercer leurs droits (accès et effacement des données) auprès du service, responsable du traitement.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été saisi pour avis, à titre obligatoire, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, et a rendu un avis favorable le 2 octobre 2025.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a été consultée pour avis, à titre obligatoire, sur le fondement de l'article 8-I-4°-a) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et a rendu un avis par une délibération n° 2025-083 du 25 septembre 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Le présent article s'applique à l'ensemble du territoire hexagonal ainsi que dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.
Le présent projet de loi actualise, par ailleurs, les compteurs des articles L. 285-1 et L. 286-1 du code de la sécurité intérieure afin de rendre cette disposition, qui figure dans le titre IV du livre II de ce code, applicable respectivement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Toutefois, le présent article ne s'applique pas dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les TAAF, en l'absence de communes et donc de police municipale dans ces collectivités.
5.2.3. Textes d'application
Un arrêté du ministre de l'intérieur précisera les conditions et les modalités de la formation que les agents des services de police municipale recevront aux fins d'assurer leurs missions à l'aide de caméras aéroportées.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixera les critères d'évaluation de l'expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement.
Par ailleurs, les dispositions réglementaires du CSI relatives aux caméras aéroportées utilisées par les forces de sécurité intérieure devront être modifiées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés afin de prendre en compte le présent article. Ce décret définira les modalités d'application de ces dispositions, en ce qui concerne notamment l'utilisation des données collectées, les mesures techniques mises en oeuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images. Le décret devra également préciser les exceptions au principe d'information du public. Les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont, par ailleurs, applicables de plein droit, notamment s'agissant des pouvoirs de contrôle et de sanction de la CNIL.
Article 7 - Etoffement de l'équipement des gardes champêtres
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
- Permettre aux gardes champêtres d'utiliser des caméras individuelles
L'utilisation des caméras individuelles (« caméras piétons ») est encadrée dans le code de la sécurité intérieure (CSI) aux articles L. 241-1 à L. 241-3. Ce cadre juridique, propre à chaque catégorie d'utilisateurs, permet aux forces de sécurité intérieure (article L. 241-1), aux agents de police municipale (article L. 241-2) ainsi qu'aux services de sécurité civile (article L. 241-3) de procéder, dans l'exercice de leurs missions et en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit, ou est susceptible de se produire, un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. Ces articles déterminent notamment les modalités selon lesquelles s'effectuent les enregistrements, leur durée de conservation, les conditions d'accès et de transmission des données captées, ainsi que la façon dont doit être donnée l'information au public et aux personnes concernées.
Ce cadre juridique a initialement été développé pour les interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale. Le bilan positif de l'expérimentation, initiée par le ministre de l'intérieur en 2012, a conduit à la pérennisation de la mesure par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. Cet encadrement spécifique a ainsi permis de sécuriser l'utilisation des caméras piétons en tirant notamment les conséquences de l'inadaptation des dispositions relatives à la vidéoprotection (au regard des finalités et des modalités d'utilisations différentes) pour régir l'usage de ces caméras individuelles.
L'utilisation des caméras individuelles a ensuite été autorisée pour d'autres agents publics de sécurité, dans un premier temps à titre expérimental, avec un cadre juridique similaire à celui applicable aux forces de sécurité intérieure (article L. 241-1 du CSI), notamment :
- Les agents de police municipale (article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016(précitée)) ;
- Les agents des services de sécurité civile (article 1 de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique) ;
- Les gardes champêtres (article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés). Les modalités selon lesquelles les gardes champêtres ont pu procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions ont été précisées par le décret n° 2022-1235 du 16 septembre 2022 portant application de l'article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés et relatif à la mise en oeuvre à titre expérimental de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des gardes champêtres. Le ministère de l'Intérieur a également diffusé une note d'information le 14 novembre 2022 relative aux modalités de mise en oeuvre des caméras individuelles par les gardes champêtres et des traitements de données à caractère personnel provenant de ces caméras individuelles (comprenant un modèle d'arrêté préfectoral, un modèle d'analyse d'impact, une doctrine d'emploi et le formulaire Cerfa adéquat).
Dans un second temps, à la suite d'un bilan positif, le législateur a permis de façon pérenne aux agents de police municipale (loi n° 2018-697 du 3 août 2018 précitée qui a créé l'article L. 241-2 du CSI) et des services de sécurité civile ( loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels (dite loi « Matras ») ayant introduit l'article L. 241-3 du CSI) de faire usage des caméras individuelles pour les besoins de leurs interventions.
Le présent projet de loi prévoit ainsi de modifier le CSI afin de pérenniser l'utilisation des caméras individuelles par les gardes champêtres en calquant le régime juridique applicable sur celui prévu à l'article L. 241-2 du CSI pour les policiers municipaux.
Par ailleurs, en-dehors du CSI, plusieurs dispositions se trouvant notamment au sein du code des transports, du code de l'administration pénitentiaire et du code de la défense, permettent à d'autres agents d'utiliser des caméras individuelles. A titre d'illustration, la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports prévoit plusieurs mesures en matière de port des caméras individuelles par les conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou par autocar ou encore par les agents mentionnés au 4° du I de l' article L. 2241-1 du code des transports95(*). Le régime juridique prévu par ces dispositions éparses emprunte au cadre général dégagé par le CSI.
- Armement des gardes champêtres
A l'inverse des dispositions spécifiques encadrant l'armement des agents de police municipale prévues par les articles L. 511-5 et suivants du code de la sécurité intérieure (CSI), le cadre juridique de l'armement des gardes champêtres est peu étayé et renvoie à celui de droit commun de l'armement.
L' article L. 312-4 du CSI dispose que « L'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments de catégorie A ou B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat ».
L' article R. 522-1 du CSI précise quant à lui que : « Les gardes champêtres peuvent être armés dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25. L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale. »
Par conséquent, d'une part, les matériels, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie (dont la catégorie B) destinés aux gardes champêtres peuvent être acquis et détenus par :
- les collectivités territoriales qui emploient des gardes champêtres au sein d'une armurerie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires chargés d'une mission de police que sont les gardes champêtres ( article R. 312-22 du CSI) ;
- les gardes champêtres eux-mêmes ( article R.312-24 du CSI).
En outre, la liste des armes que les gardes champêtres peuvent porter dans ce cadre n'est pas limitative, contrairement à la liste des armes que peuvent porter les agents de police municipale ( article R. 511-12 du CSI).
Par ailleurs, l'autorisation de port d'armes aux gardes champêtres est délivrée par le maire et est visée par le préfet, en application de l' article R. 312-25 du CSI, ce qui diffère des agents de police municipale qui sont armés par une décision du préfet à la demande du maire.
Enfin, la seule obligation de formation préalable à l'armement des gardes champêtres concerne les armes de catégorie B,1°. Ils ne sont donc pas soumis à ce type de formation pour les autres types d'armes.
Compte tenu du renforcement des compétences des gardes champêtres par le présent projet de loi, notamment en matière judiciaire, la création d'un cadre juridique propre à l'armement des gardes champêtres est nécessaire et la différence de traitement entre les agents de police municipale et les gardes champêtres ne se justifie plus.
Le présent article vise donc à aligner le régime de l'armement des gardes champêtres avec celui des agents de police municipale.
Ainsi, par analogie avec l'article L. 511-5 (précité), cet article prévoit que l'autorisation de port d'arme des gardes champêtres sera délivrée par le préfet de département (et non plus par le maire), sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions du service de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat.
De plus, il renvoie vers un décret en Conseil d'Etat le soin de :
- définir, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent porter une arme ;
- déterminer les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale, et les conditions de leur utilisation par les agents ;
- déterminer les modalités de la formation préalable à l'armement des gardes champêtres.
En outre, le décret en Conseil d'Etat viendra préciser les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent faire usage de leurs armes, en les alignant avec celles des agents de police municipale.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
- Permettre aux gardes champêtres d'utiliser des caméras individuelles
L'utilisation de caméras individuelles implique de concilier des droits constitutionnellement garantis avec les besoins opérationnels des agents. Il s'agit notamment de s'assurer que les mesures encadrant l'usage des caméras individuelles ne portent pas une atteinte disproportionnée et injustifiée au droit à la vie privée ainsi qu'aux droits de la défense et à un procès équitable (article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen).
A cet égard, dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, le Conseil constitutionnel a estimé conformes à la Constitution les articles L. 241-1 et L. 241-2 du CSI ainsi que l'expérimentation introduite par l'article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés permettant aux gardes champêtres d'utiliser des caméras individuelles.
Le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur avait poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions en apportant plusieurs garanties de nature à ne pas porter une atteinte excessive au droit à la vie privée. Le Conseil a en outre considéré que les dispositions contestées devant lui ne méconnaissaient ni les droits de la défense ni le droit à un procès équitable avec toutefois une réserve d'interprétation sur ce point ainsi formulée : « le législateur a expressément imposé que les caméras individuelles soient munies de dispositifs techniques garantissant l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre d'une intervention. Toutefois, ces dispositions ne sauraient s'interpréter, sauf à méconnaître les droits de la défense et le droit à un procès équitable, que comme impliquant que soient garanties jusqu'à leur effacement, l'intégrité des enregistrements réalisés ainsi que la traçabilité de toutes leurs consultations » (point 120 de la décision).
Afin de fonder sa décision, le Conseil constitutionnel a souligné l'importance des points suivants :
Les finalités poursuivies par l'enregistrement sont précisément définies et légitimes ;
- L'enregistrement n'est pas permanent et il ne peut être déclenché uniquement lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. Le déclenchement de l'enregistrement n'est donc pas un choix discrétionnaire de l'agent ;
- Le port des caméras est apparent, un signal visuel indique si la caméra enregistre et il est prévu une information générale du public ;
- Les personnes filmées sont informées lors du déclenchement de l'enregistrement et la dérogation prévue est limitée aux cas dans lesquels cette information est rendue impossible pour des raisons purement matérielles et indépendantes des motifs de l'intervention ;
- La transmission des images captées est circonscrite et limitée aux cas où la sécurité des agents et militaires, ou celle des biens et des personnes, est menacée ;
- Il appartient, en tout état de cause, à l'autorité judiciaire de veiller au respect du principe de loyauté dans l'administration de la preuve et d'apprécier la valeur probante des enregistrements issus des caméras individuelles lorsqu'ils sont produits devant elle ;
- Les agents auxquels sont fournies les caméras individuelles ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent que lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions.
Le Conseil constitutionnel, dans la mesure où l'expérimentation permettant aux gardes champêtres de procéder à des enregistrements de leurs interventions au moyen de caméras individuelles a été conçue dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents de la police municipale, a estimé conforme à la Constitution le dispositif expérimental issu de l'article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.
Le projet de loi pérennise cette expérimentation, dans les mêmes conditions.
- Armement des gardes champêtres
L'évolution des dispositions relatives aux gardes champêtres s'inscrit dans le cadre des objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions (décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021) ; ces missions seront réalisées sous le contrôle de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle aux termes de l'article 66 de la Constitution.
Dans le texte proposé, l'action des gardes champêtres demeure encadrée par le législateur et dirigée par le maire, conformément à la libre administration des collectivités territoriales, qui a valeur constitutionnelle (Décision n° 79-104 DC du 23 mai 1979) et est inhérente à l'organisation décentralisée de la République. Les gardes champêtres opèrent ainsi sous contrôle du législateur et dans le respect des droits et garanties constitutionnels.
L'armement des gardes champêtres et des policiers municipaux, sur lequel le Conseil constitutionnel ne s'est jamais prononcé, s'inscrit dans ce cadre.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
- Permettre aux gardes champêtres d'utiliser des caméras individuelles
Afin d'assurer le respect de la vie privée, le droit de l'Union européenne encadre strictement les conditions de mise en oeuvre du traitement de données à caractère personnel, au travers des textes suivants :
- Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (dit « Règlement général sur la protection des données - RGPD ») ;
- La directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil directive européenne du 27 avril 2016 (dite « police-justice »). Cette directive, concernant les traitements à des fins pénales ou de sécurité publique, a été transposée au titre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'usage des caméras individuelles relève de ce cadre juridique, en tant qu'opérations de captation d'images portant sur des données à caractère personnel (visage des personnes notamment). La mise en oeuvre de tels traitements doit donc respecter les grands principes énoncés par le droit européen de la protection des données et rappelés à l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978. En particulier, les données doivent, d'une part, être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et, d'autre part, adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. De plus, le principe de minimisation impose que chaque traitement comprenne le nombre le plus restreint possible de données et d'accédants.
- Armement des gardes champêtres
Sans objet.
- Financement des équipements par les conseils régionaux
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Plusieurs pays de l'Union européenne tels que l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la République tchèque ou encore la Suède ont doté leurs agents de police de caméras individuelles (« body-worn cameras » ou « bodycams »). Ces Etats membres demeurent soumis aux obligations issues du règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de la directive européenne du 27 avril 2016 (dite « police-justice ») concernant les traitements à des fins pénales ou de sécurité publique.
En Belgique, la loi sur la fonction de police prévoit que, dans l'exercice de leurs missions de police administrative et judiciaire, les membres du cadre opérationnel de la police peuvent faire usage de leur caméra individuelle pendant la durée et en tous lieux de leur intervention, dans les situations suivantes :
- En cas d'incident d'une certaine gravité, notamment s'il y a des indices concrets de risques d'émergence de la violence, d'utilisation de la contrainte, d'atteinte à l'intégrité de membres des services de police ou de l'appelant ou encore de tiers ;
- Lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire, en fonction du comportement des personnes, d'indices matériels ou de circonstances de temps et de lieu, qu'il y a des personnes qui sont recherchées, ou qui ont tenté de commettre une infraction ou se préparent à la commettre, ou qui ont commis une infraction, ou qui pourraient troubler l'ordre public ou qui l'ont troublé ;
- En cas de nécessité de recueillir des preuves matérielles d`infractions et d'identifier les personnes impliquées ;
- Lors de l'exécution de missions au cours desquelles les services de police prêtent main forte lorsqu'ils y sont légalement requis ;
- Lors de l'exécution de missions au cours desquelles les services de police sont requis pour notifier et mettre à exécution les mandats de justice.
L'utilisation des caméras doit être visible et les données enregistrées peuvent être conservées au minimum trente jours à compter de l'enregistrement.
- Armement des gardes champêtres
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
- Permettre aux gardes champêtres d'utiliser des caméras individuelles
L'utilisation des caméras individuelles par les gardes champêtres a été prévue à titre expérimental par l'article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. L'expérimentation a pris fin le 24 novembre 2024, conformément aux dispositions du décret n° 2022-1235 du 16 septembre 2022 portant application de l'article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés et relatif à la mise en oeuvre à titre expérimental de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des gardes champêtres.
Le Gouvernement finalise le rapport d'évaluation de la mise en oeuvre de l'expérimentation, qui se fonde sur les rapports transmis par les communes concernées, lesquels présentent un bilan positif96(*). On peut notamment noter que les rapports adressés par les communes ayant expérimenté le recours à ces caméras individuelles97(*) au profit de leurs gardes champêtres insistent sur le caractère efficace et dissuasif de ces dispositifs. Le constat d'une responsabilisation des personnes filmées98(*) et d'un plus grand respect envers les gardes champêtres est partagé. Dans l'un des rapports, il est ainsi précisé que « L'impact que ces agents ont pu constater est identique à celui des policiers municipaux d'Agde. Les conflits se désamorcent du fait que les personnes voient la présence des caméras individuelles sur le [gilet pare-balles] et singulièrement lorsque les agents annoncent que l'intervention est enregistrée. ».
Si l'utilité du dispositif de caméras piétons a principalement résidé dans le caractère dissuasif du port de l'équipement, son exploitation a aussi présenté un grand intérêt en termes d'enregistrement, de consultation ultérieure ou d'extraction de données dans le cadre de procédures judiciaires, puisque certains enregistrements ont pu servir à l'établissement de preuves (refus d'obtempérer, dépôts de déchets, feux, animaux dangereux).
Enfin, le port de caméras piétons est particulièrement apprécié par les agents et n'a pas suscité de réaction défavorable de la population. Ce port a un caractère rassurant pour les gardes champêtres concernés99(*) qui agissent souvent seuls, le plus souvent en l'absence de témoins. Le fait de disposer d'une caméra-piéton leur est d'autant plus utile pour sécuriser leur action.
Le bilan de l'expérimentation est ainsi favorable à la pérennisation de la mesure afin que les bénéfices tirés de l'utilisation des caméras individuelles par les gardes champêtres perdurent. Cette pérennisation est aussi une proposition du rapport d'information sénatorial du 28 mai 2025100(*).
- Armement des gardes champêtres
Le régime de l'armement des agents publics et en particulier celui des agents de police municipale sur lequel il est question de s'aligner ( article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure) étant prévu par la loi, un vecteur législatif est nécessaire pour préciser celui applicable aux gardes champêtres.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
- Permettre aux gardes champêtres d'utiliser des caméras individuelles
L'objectif poursuivi étant de tirer les conséquences positives de l'expérimentation de l'usage des caméras individuelles et de fixer un cadre légal encadrant les conditions et modalités d'usage de ces caméras ainsi que le traitement des enregistrements audiovisuels effectués par les gardes champêtres.
La pérennisation et la généralisation de l'utilisation des caméras piétons par les gardes champêtres imposent de définir un cadre juridique adéquat et proportionné permettant de concilier les objectifs poursuivis et les droits et libertés des personnes enregistrées, conformément aux exigences constitutionnelles et conventionnelles.
- Armement des gardes champêtres
Par ailleurs, cet article vise à sécuriser les modalités d'armement des gardes champêtres, compte tenu des prérogatives croissantes qui leur sont accordées, en créant un régime similaire à celui des agents de police municipale. En effet, dans la mesure où les compétences des agents de police municipale et celles des gardes champêtres sont alignée par le présent projet de loi, le régime juridique de l'armement de ces agents doit par cohérence être aligné.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
- Permettre aux gardes champêtres d'utiliser des caméras individuelles
L'expérimentation prévue à l'article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ne permet pas d'offrir un cadre juridique pérenne à l'utilisation, par les gardes champêtres, de caméras individuelles.
- Armement des gardes champêtres
La différence entre le régime juridique applicable à l'armement des agents de police municipale par rapport à celui régissant l'armement des gardes champêtres ne se justifie plus à la lumière de l'évolution des compétences des gardes champêtres. Il est donc nécessaire d'aligner le régime juridique entourant l'armement des gardes champêtres avec celui applicable aux agents de police municipale. C'est pour cette raison qu'un statu quo n'a pas été envisagé.
3.2. DISPOSITIF RETENU
- Permettre aux gardes champêtres d'utiliser des caméras individuelles
Il s'agit de compléter le chapitre Ier (relatif aux caméras individuelles) du titre IV (relatif aux caméras mobiles) du livre II du CSI par un nouvel article L. 241-4 pérennisant, en dur dans ce code, l'expérimentation prévue à l'article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. Le cadre juridique prévu par l'article L. 241-4 du CSI apporte des garanties équivalentes à celles applicables à l'utilisation des caméras individuelles par les agents de police municipale telles que fixées à l'article L. 241-2 du même code ; la rédaction retenue à l'article L. 241-4 étant ainsi calquée sur celle de l'article L. 241-2 du CSI.
Par conséquent, il est prévu que, dans l'exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. L'autorisation est subordonnée à la demande préalable du maire. Lorsque l'agent est employé dans les conditions prévues à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.
L'enregistrement n'est pas permanent. De plus, les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle ces agents sont affectés.
Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.
En-dehors des cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout d'un mois.
- Armement des gardes champêtres
Le dispositif retenu est similaire à celui existant pour les agents de police municipale, compte tenu de la proximité de leurs missions. Il prévoit la délivrance de l'autorisation de port d'arme des gardes champêtres par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions du service de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat. Le cas échant, lorsque le garde champêtre est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues aux articles L. 522-2 et L. 522-2-1 du CSI, la demande de port d'arme est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.
De plus, le dispositif retenu prévoit que les gardes champêtres autorisés à porter une arme selon les nouvelles modalités peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 511-5-1 du CSI, c'est-à-dire dans les mêmes conditions que les agents de police municipale. En application de l'article L. 435-1 du CSI, ils peuvent donc faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui, ce qui renvoie à la légitime défense.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
D'une part, le présent article complète le chapitre Ier (relatif aux caméras individuelles), du titre IV (relatif aux caméras mobiles) du livre II du code de sécurité intérieure par l'ajout d'un nouvel article L. 241-4.
L'article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés est par conséquent abrogé.
D'autre part, le présent article crée deux nouveaux articles dans le chapitre II (Nomination, agrément et modalités d'exercice) du titre II (gardes champêtres) du livre V (polices municipales) du code de la sécurité intérieure. Ainsi, ce dernier est complété par deux articles L. 522-6 et L. 522-7.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
La rédaction proposée à l'article L. 241-4 du CSI est conforme aux exigences issues du droit de l'Union européenne et, en particulier, aux dispositions du RGPD et de la directive police-justice susmentionnés.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
- Permettre aux gardes champêtres d'utiliser des caméras individuelles
Au total, au 31 décembre 2024, les collectivités territoriales concernées emploient 608 gardes champêtres susceptibles d'être équipés de caméras individuelles.
Le coût unitaire constaté en ligne varie de 170 à 350 euros TTC pour un dispositif complet comprenant :
- Une caméra individuelle ;
- Ses accessoires (tels que harnais, batterie, connectiques, etc.) ;
- La maintenance de la caméra pour la durée de l'expérimentation.
Chaque commune doit également se doter d'un support informatique sécurisé permettant de stocker les données dont le coût unitaire estimé s'établit à 1 700 €.
Ce support sécurisé est susceptible d'être mutualisé dans le cadre des établissements publics de coopération intercommunale qui emploient un garde-champêtre et le mettent à disposition de plusieurs communes.
De plus, les projets d'équipements des gardes champêtres en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (FIPD) défini à l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. De 2022 à 2025, les orientations du Gouvernement s'agissant du FIPD ont intégré le financement des caméras piétons pour les gardes champêtres. Ce dernier figure dans le programme S, « subventions d'équipement », dans le dispositif « équipements pour les polices municipales, les gardes champêtres » ; les caméras peuvent être subventionnées au taux de 50 % avec u plafond unitaire de 200 euros. Ainsi, cela est susceptible d'alléger considérablement les charges nouvelles pour les communes concernées.
Peu de demandes de financement au titre de ce fonds ont été présentées. S'agissant le plus souvent de communes de taille modeste, généralement en milieu rural, employant au mieux quelques gardes champêtres, il est vraisemblable que les maires et leurs administrations soient moins au fait de ces dispositifs, voire n'y recourent pas en raison du poids réel ou estimé des démarches administratives.
En tout état de cause, et conformément au principe de libre administration ainsi qu'aux dispositions du nouvel article L. 241-4 du CSI, ces nouvelles dispositions constituent une faculté offerte aux communes et non une obligation. En conséquence, seules les communes volontaires équiperont leurs gardes champêtres de caméras individuelles. Ainsi, s'il est possible d'estimer un coût unitaire des caméras individuelles, il n'est pas possible d'estimer un coût global des impacts financiers pour les communes.
- Armement des gardes champêtres
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
- Permettre aux gardes champêtres d'utiliser des caméras individuelles
La demande d'autorisation du port des caméras individuelles par les gardes champêtres doit être préalablement présentée par le maire. Lorsque l'agent susceptible d'être équipé de caméras individuelles est employé dans les conditions prévues à l'article L. 522-2 du CSI, la demande doit être présentée conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.
Les services responsables des traitements mis en oeuvre au moyen des caméras individuelles seront assujettis aux obligations qui découlent de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ils seront notamment tenus d'organiser les modalités de réponse aux demandes d'exercice des droits des personnes ayant fait l'objet d'enregistrements.
Enfin, une information générale du public sur l'emploi de ces caméras par les gardes champêtres est organisée par le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle ces agents sont affectés.
- Armement des gardes champêtres
Les maires ne seront plus compétents pour délivrer les autorisations de port d'arme à leurs gardes champêtres. En effet, les gardes champêtres seront autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme.
En outre, ils devront conclure une convention de coordination avec les forces de sécurité de l'Etat s'ils souhaitent armer leurs gardes champêtres, sur le modèle de ce qu'ils font déjà s'agissant de leurs agents de police municipale. Afin de laisser aux collectivités un temps d'adaptation suffisant, un délai de 24 mois est prévu avant l'entrée en vigueur de ces dispositions.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
- Permettre aux gardes champêtres d'utiliser des caméras individuelles
Il est prévu que le représentant de l'Etat dans le département autorise les gardes champêtres, dans l'exercice de leurs missions de police des campagnes, à faire usage des caméras individuelles. Cette autorisation est subordonnée à la demande préalable du maire ou, lorsque le garde champêtre est employé dans les conditions prévues à l'article L. 522-2 du CSI, d'une demande établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté. Les services préfectoraux concernés devront ensuite instruire ces demandes.
Les services responsables des traitements mis en oeuvre au moyen des caméras individuelles seront assujettis aux obligations qui découlent de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ils seront notamment tenus d'organiser les modalités de réponse aux demandes d'exercice des droits des personnes ayant fait l'objet d'enregistrements.
Enfin, une information générale du public sur l'emploi de ces caméras par les gardes champêtres est organisée par le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle ces agents sont affectés.
- Armement des gardes champêtres
Les services préfectoraux, au lieu de simplement viser l'autorisation de port d'arme, devront la délivrer, ce qui entraînera une nouvelle charge de travail qui sera toutefois limitée eu égard au nombre de gardes champêtres sur le territoire (602 gardes champêtres dont 216 armés au 31 décembre 2023).
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
L'amélioration de l'équipement des gardes champêtres facilite l'accomplissement de leurs missions et concourt à l'objectif de sécurité publique.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Le dispositif retenu ne crée pas d'obligations nouvelles pour les particuliers. Par ailleurs, les personnes ayant fait l'objet d'une captation d'images au moyen d'une caméra individuelle pourront exercer leurs droits auprès du service responsable du traitement.
L'amélioration de l'équipement des gardes champêtres facilite l'accomplissement de leurs missions et concourt à l'objectif de sécurité publique.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a été saisie pour avis, à titre obligatoire, sur le fondement de l'article 8, I, 4°, a) de la loi du 6 janvier 1978 et a rendu un avis par une délibération n° 2025-083 du 25 septembre 2025.
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été saisi pour avis, à titre obligatoire, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, et a rendu un avis favorable le 2 octobre 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française à l'exception des dispositions du III du présent article qui entreront en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois suivant celui de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Les dispositions des I, III et IV du présent article s'appliquent à l'ensemble du territoire hexagonal, à l'exception des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.
Elles s'appliquent de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et à Mayotte), sans adaptation particulière. Elles s'appliquent également à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, qui relèvent du principe d'identité législative pour les mesures envisagées, sans adaptation particulière.
L'article L. 241-4 du CSI, modifié par le I du présent article, les articles L. 522-6 et L. 522-7 du CSI, ajoutés par le III du présent article, et le IV du présent article sont également applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, collectivités régies par le principe de spécialité législative, par mention expresse d'application. A cet effet, le I de l'article 19 du présent projet de loi prévoit, d'une part, la mise à jour des compteurs figurant aux articles L. 285-1 et L. 286-1 du CSI, pour l'application dans ces deux collectivités du I du présent article, et d'autre part, la mise à jour des compteurs et adaptations figurant aux articles L. 545-1 et L. 546-1 du CSI, pour l'application dans ces deux collectivités du III du présent article. Le V de l'article 19 du présent projet de loi prévoit l'application du IV du présent article en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Le II du présent article s'applique sur l'ensemble du territoire français hexagonal. Il s'applique également de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et à Mayotte), ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, qui relèvent du principe d'identité législative en la matière, sans adaptation particulière. Cette mesure visant à abroger l'article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, qui n'était pas étendu en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, elle n'est pas applicable dans les collectivités relevant du principe de spécialité législative en la matière.
5.2.3. Textes d'application
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sera adopté afin de préciser les modalités d'application du nouvel article L. 241-4 du CSI, en particulier en ce qui intéresse les informations transmises au ministère de l'intérieur par les communes mettant en oeuvre des caméras individuelles, ainsi que les conditions d'utilisation des données collectées.
Un autre décret en Conseil d'Etat sera également nécessaire pour les dispositions des III et IV de l'article, afin de modifier l'article R. 522-1 du CSI.
Article 8 - Permettre l'utilisation des dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation (LAPI)
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
En l'état du droit, le recours à des dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation (LAPI) est autorisé à différents services pour des missions très variées :
Pour les services de l'Etat s'agissant de la prévention et de la répression de la criminalité grave :
- Par les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes, en tous points appropriés du territoire et en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, à des fins de police judiciaire et de police administrative (articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) ;
- à titre expérimental, pour les agents des douanes affectés au sein d'un service spécialisé de renseignement, pour détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées au dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que de la constatation de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions (article 19 de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces) ;
- par les services de police et de gendarmerie nationales, ainsi que par les services et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité ou désignés par le ministre chargé des transports, en association avec des systèmes de pesage en marche des véhicules, aux fins de faciliter la constatation des infractions aux règles du code de la route relatives au poids maximum autorisé des véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions ( article L. 130-9-2 du code de la route).
Par les services de l'Etat et les services de police municipale pour la police de la circulation :
- par les services de police et de gendarmerie nationales et de police municipale, afin de faciliter la constatation des infractions résultant de la violation des règles de circulation relatives à l'usage des voies réservées par l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d'occupants, notamment dans le cadre du covoiturage et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ( article L. 130-9-1 du code de la route) ;
- par les services de police et de gendarmerie nationales et de police municipale, aux fins de constater les infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités (CGCT) (zones à faibles émissions mobilité) et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que la recherche de leurs auteurs (article L. 2213-4-2 du CGCT) ;
Par les services de police municipale s'agissant de constater le non-paiement du stationnement :
- Cette faculté de recourir à la technologie LAPI dans un cadre non répressif a été ouverte en conséquence de la dépénalisation du stationnement payant à compter du 1er janvier 2018 organisée par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (le non-paiement du stationnement payant n'est plus passible d'une contravention, mais remplacé par une redevance forfaitisée d'occupation du domaine public, le « forfait post-stationnement » ou FPS).
L'objet de la disposition proposée est de prévoir un cadre permettant l'usage de dispositifs de LAPI par les services de police municipale et les gardes champêtres pour d'autres infractions au code de la route que celles précédemment exposées, qu'ils sont aujourd'hui habilités à constater à raison de leurs attributions respectives. Les infractions concernées ne sont que des contraventions prévues par la partie réglementaire du code de la route pour lesquelles le titulaire du certificat d'immatriculation est responsable ou redevable pécuniairement.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée.
Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif ( décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012).
Afin d'assurer la proportionnalité de la mesure, le champ infractionnel pour lequel les agents de police municipale et aux gardes-champêtres seront autorisés à recourir à des dispositifs de LAPI a été strictement circonscrit et ne concerne que les infractions qu'ils sont aujourd'hui habilités à constater à raison de leurs attributions respectives et pour lesquelles le titulaire du certificat d'immatriculation est responsable redevable pécuniairement. Il s'agit des infractions mentionnées : d'une part aux articles R. 417-1 à R. 417-13 du code de la route : arrêts et stationnements gênants, dangereux ou abusifs, et d'autre part à l'article R.121-6 du même code, notamment :
- L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence (4°) ;
- Le franchissement et le chevauchement des lignes continues (6°) ;
- Les vitesses maximales autorisées (8°) ;
- Le franchissement des passages à niveau (10° ter) ;
- La circulation d'un véhicule en marche normale sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation (16°).
Les dispositifs approchants au dispositif proposé, à savoir les articles L. 130-9-1 et L. 130-9-2 du code de la route, ont été créés, respectivement, par les articles 39 et 103 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, qui n'ont pas fait l'objet d'un examen par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Afin d'assurer le respect de la vie privée, le droit de l'Union européenne encadre strictement les conditions de mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel, au travers des textes suivants :
- Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données - RGPD) ;
- La directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil directive européenne du 27 avril 2016 (dite « police-justice »). Cette directive, concernant les traitements à des fins pénales ou de sécurité publique, a été transposée au titre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les dispositifs de LAPI, en tant qu'opérations de captation d'images portant sur des données à caractère personnel (numéro d'immatriculation du véhicule, photographie du véhicule et de ses éventuels occupants). Au regard des finalités poursuivies et des services responsables de leur mise en oeuvre, les traitements envisagés pour les services de police municipale relèveront de la directive « police-justice », qui prévoit des garanties adaptées aux enjeux des traitements concernés. La mise en oeuvre de tels traitements doit donc respecter les grands principes énoncés par le droit européen de la protection des données et rappelés à l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978. En particulier, les données doivent être, d'une part, collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et, d'autre part, adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. De plus, le principe de minimisation impose que chaque traitement comprenne le nombre le plus restreint possible de données et d'accédants.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Dans la mesure où, d'une part, les récents dispositifs de LAPI créés pour les services de police municipale (en matière de voies réservées ou de zone à faible émission) ont été autorisés par la loi et où, d'autre part, les prérogatives de police judiciaire des agents de police municipale intéressent la procédure pénale au sens de l' article 34 de la Constitution, il apparaît nécessaire qu'une mesure législative autorise ces services, ainsi que les gardes champêtres, à utiliser de tels dispositifs à des fins de constatation de certaines infractions pénales.
L'extension de l'usage des LAPI par les polices municipales est également proposée par le rapport d'information sénatorial du 28 mai 2025101(*).
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Il s'agit de compléter le Titre III du Livre Ier du code de la route par un nouvel article L. 130-9-3. Ce nouvel article permet aux services de police municipale, dont les agents de surveillance de la ville de Paris font partie (ayant été absorbés dans le corps des agents de la police municipale de Paris), et aux gardes champêtres, de mettre en oeuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules pour faciliter la constatation des contraventions prévues par la partie réglementaire du code de la route pour lesquelles le titulaire du certificat d'immatriculation est responsable ou redevable pécuniairement, conformément aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du même code, mais aussi pour permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.
Il est en outre prévu une interconnexion au système d'immatriculation des véhicules (SIV), pour lesquels ces services sont déjà accédants. En effet, tant les services de police municipale, que les agents de surveillance de la ville de Paris et les gardes champêtres sont accédants au SIV en vertu de l'article L. 330-2 du code de la route qui vise, à son 4° bis, les agents de police judiciaire adjoints (ce que sont les agents de police municipale en vertu de l' article 21, 2° du code de procédure pénale ainsi que les agents de surveillance de la ville de Paris en vertu de l'article 21, 1° quater du même code) de même qu'expressément les gardes champêtres. Ils ne sont toutefois rendus accédants, en toute logique, qu'aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au code de la route qu'ils sont habilités à constater ainsi que des infractions liées à l'abandon et au dépôt de déchet illégal qu'ils sont habilités à constater.
Les infractions visées par ce nouvel article L. 130-9-3 sont :
- les infractions visées aux articles R. 417-1 à R. 417-13 du code de la route : arrêts et stationnements gênants, dangereux ou abusifs102(*) ;
- les infractions visées à l' article R. 121-6 du code de la route, relatives notamment au franchissement et au chevauchement des lignes continues, aux vitesses maximales autorisées, au dépassement ou aux signalisations imposant l'arrêt des véhicules.
Toutes les infractions visées par la partie réglementaire du code de la route ne pourront toutefois être concernées par le dispositif, dès lors que pour le constat de certaines d'entre elles (par exemple l'absence de port de la ceinture de sécurité ou l'usage du téléphone tenu en main), le dispositif de LAPI n'apparaît pas adapté, en l'état des solutions technologiques existantes.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Il a été envisagé d'autoriser les agents de police municipale et les gardes-champêtres à recourir à des dispositifs LAPI pour un champ infractionnel plus large, incluant la constatation des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets. Cette hypothèse a finalement été abandonnée, en l'absence de besoin opérationnel identifié.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le présent article prévoit de doter les services de police municipale et les gardes champêtres de dispositifs de LAPI pour le constat des infractions au code de la route qu'ils sont aujourd'hui habilités à constater à raison de leurs attributions respectives mais pour lesquelles le recours à un tel dispositif leur est interdit en l'état des textes, alors qu'il faciliterait grandement et sécuriserait le constat de ces infractions par ces agents.
Il s'agit ainsi d'une mesure fortement attendue de la part des communes et sur laquelle l'attention des services de l'Etat est régulièrement appelée au regard de l'apport que peuvent avoir ces caméras LAPI en termes de sécurité du quotidien.
Les services de police municipale peuvent déjà recourir à de tels dispositifs pour constater certaines infractions. Le présent article étend le recours à ces dispositifs à d'autres infractions (stationnement des véhicules, franchissement et chevauchement des lignes continues, dépassement des vitesses maximales autorisées, dépassement ou signalisations imposant l'arrêt des véhicules), infractions pour le constat desquelles les services de police et de gendarmerie nationales sont déjà autorisés à recourir à ces dispositifs. Il s'agit donc, outre de doter les polices municipales et les gardes champêtres d'outils pleinement efficaces pour le constat des infractions qu'ils sont autorisés à relever, d'assurer une certaine cohérence avec le droit en vigueur, qui prévoit déjà que, pour la poursuite d'infractions de même nature, les services de police et de gendarmerie nationales peuvent recourir à des dispositifs de LAPI.
L'interconnexion au SIV permettra de faciliter grandement l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, responsable ou redevable pécuniairement de cette infraction, sauf à démontrer qu'il n'en est pas l'auteur.
Afin de permettre la consultation du système d'immatriculation des véhicules, le présent article prévoit également que les données collectées seront conservées huit jours au maximum avant d'être effacées, sauf en cas de nécessité dans le cadre d'une procédure pénale.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article procède à la création d'un nouvel article L. 130-9-3 du code de la route.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Le présent article est conforme aux textes internationaux et européens mentionnés supra.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Les LAPI s'adaptent en fonction des différents usages. Sur le marché, ces dispositifs se présentent sous la forme d'un kit complet, d'unités de capture ou de caméras de lecture de plaques. Leur prix varie de 1 000 à plus de 5 000 euros selon la marque choisie et selon que le logiciel de captation est couplé ou pas à une caméra de vidéo classique.
L'impact budgétaire pour une commune reste cependant très limité car de très nombreuses communes se sont déjà dotées de tels systèmes, sans pouvoir les utiliser. Faute de pouvoir le faire en l'absence de texte les y autorisant, elles ont donc mis ces dispositifs à disposition des forces de sécurité intérieure à titre gratuit (par voie de convention).
Par ailleurs, la commune aura toujours le choix de se doter ou non de tels dispositifs. Il ne s'agit que d'une faculté pour elle.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Les communes qui le souhaitent pourront mettre des LAPI à la disposition de leurs policiers municipaux et gardes champêtres afin de permettre la constatation d'infractions au code de la route.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
La mise en oeuvre de dispositifs de LAPI par les agents de police municipale et les gardes champêtres a pour objectif de faciliter la constatation d'infractions au code de la route et participe ainsi à l'amélioration des conditions de sécurité routière au bénéfice de la société.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été saisi pour avis, à titre obligatoire, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis favorable en date du 2 octobre 2025.
En application de l'article 2 du décret n°75-360 du 15 mai 1975 modifié relatif au comité interministériel de la sécurité routière, les dispositions envisagées ont été soumises groupe interministériel permanent de la sécurité routière (GIPSR) qui a émis un avis favorable lors de sa séance du 15 septembre 2025.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a été consultée pour avis, à titre obligatoire, sur le fondement de l'article 8-I-4°-a) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et a rendu un avis par une délibération n° 2025-083 du 25 septembre 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
L'article entrera en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
La mesure envisagée s'applique à l'ensemble du territoire hexagonal y compris dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.
L'article 19 du présent projet de loi modifie l'article L. 143-1 du code de la route pour l'application de ces dispositions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert aucun texte réglementaire d'application.
Par ailleurs, la mise en oeuvre des dispositifs de contrôles prévus au présent article sera autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
Article 9 - Possibilité de financement par les régions de l'équipement des polices municipales ou des systèmes de vidéoprotection
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
En application de l' article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la région peut contribuer au financement des projets mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l' article L. 211-7 du code de l'environnement (e.g. aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, lutte contre la pollution...) présentant un intérêt régional et dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte.
Par ailleurs, le même article prévoit que les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet Etat-région ou dans les contrats de convergence.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'article 34 de la constitution réserve au législateur la détermination des « principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources » et le conseil constitutionnel a eu l'occasion de consacrer le principe de la libre administration des collectivités territoriales (voir par exemple la décision CC n°2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010, Commune de Besançon et autres).
En vertu des articles 72 et 72-2 de la Constitution, les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus » et « bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement », mais chacune d'elles le fait « dans les conditions prévues par la loi » (voir la décision n°2011-146 QPC du 8 juillet 2011, Département des Landes).
De même, « si le législateur peut, sur le fondement des dispositions des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations et à des charges, c'est à la condition que celles-ci répondent à des exigences constitutionnelles ou concourent à des fins d'intérêt général, qu'elles ne méconnaissent pas la compétence propre des collectivités concernées, qu'elles n'entravent pas leur libre administration et qu'elles soient définies de façon suffisamment précise quant à leur objet et à leur portée » (décision CC n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain).
Ainsi, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, du 7 août 2015 a supprimé la clause générale de compétence pour les régions et les départements. Désormais, ces deux catégories de collectivité ne peuvent agir que dans le cadre des compétences que la loi leur attribue. Le financement des équipements de sécurité par les régions doit ainsi être autorisé et encadré par un texte législatif.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
A la suite de la suppression de la clause générale de compétence pour les régions et les départements issue de la loi NOTRe du 7 octobre 2015 précitée, la création d'un cadre juridique propre à la nouvelle possibilité pour les régions de financer l'équipement des polices municipales ou les systèmes de vidéoprotection nécessite un vecteur législatif.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le présent article vise à renforcer les possibilités de financement liés à la sécurité par les collectivités territoriales.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
La loi NOTRe du 7 août 2015 a supprimé la clause générale de compétence pour les régions et les départements. Désormais, ces deux catégories de collectivité ne peuvent agir que dans le cadre des compétences que la loi leur attribue. Le financement des équipements de sécurité par les régions doit donc être autorisé et encadré par un texte législatif.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le dispositif retenu consiste à modifier l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin de permettre à la région de financer également des projets inscrits aux contrats de plan Etat-régions ou aux contrats de convergence pour améliorer l'équipement de la police municipale et le développement de la vidéoprotection.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article modifie l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le financement par les régions étant facultatif, l'impact ne peut pas être mesuré.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
L'amélioration de l'équipement des gardes champêtres facilite l'accomplissement de leurs missions et concourt à l'objectif de sécurité publique.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
L'amélioration de l'équipement des gardes champêtres facilite l'accomplissement de leurs missions et concourt à l'objectif de sécurité publique.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été saisi pour avis, à titre obligatoire, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, et a rendu un avis favorable le 2 octobre 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Le présent article s'applique à l'ensemble du territoire hexagonal.
Les modifications au II de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales s'appliquent de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et à Mayotte), sans adaptation particulière.
En application, respectivement, des articles LO 6213-6, LO 6313-6 et LO 6413-5 du code général des collectivités territoriales, les modifications apportées au II de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution. Ne sont applicables, à ces collectivités, concernant les dispositions du titre unique du livre 1er du code général des collectivités territoriales, que les dispositions en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007.
En application du principe de spécialité législative et des dispositions de l'article L. 1811-3 du code général des collectivités territoriales, l'article L. 1111-10 n'est pas applicable en Polynésie française.
En application du principe de spécialité législative, les dispositions de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent également pas dans les îles Wallis et Futuna et aux Terres Australes et Antarctiques Françaises.
De même, cet article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable aux communes en Nouvelle-Calédonie qui sont régies, en la matière, par le code des communes de la Nouvelle-Calédonie et dans lequel il n'existe pas de dispositions analogues. Les dispositions du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas non plus aux provinces et à la Nouvelle-Calédonie.
5.2.3. Textes d'application
La présente mesure ne nécessite aucun texte d'application.
TITRE IV - LA FORMATION DES POLICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES CHAMPÊTRES
Article 10 - Permettre au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de recruter des fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale et des gardes champêtres
1. ETAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Les polices municipales constituent la force de sécurité de proximité et du quotidien sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Après une période de progression régulière mais contenue (+ 2,5 % par an) au cours de la décennie 2010-2020, avec toutefois un pic de recrutements en 2015 et 2016 après les attentats qui ont frappé la France, les effectifs de policiers municipaux ont entamé une phase de croissance plus dynamique depuis 2022. Le nombre de policiers municipaux est aujourd'hui de plus de 30 000 contre un peu plus de 19 000 en 2010.
Avant d'être opérationnels, ces nouveaux fonctionnaires doivent être formés compte tenu des prérogatives particulières qui leur sont reconnues. Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), établissement public sui generis qui regroupe les collectivités territoriales et leurs établissements au sens de l'article L. 451-1 du code général de la fonction publique territoriale (CGCT), a seule compétence pour assurer la formation des fonctionnaires de la filière police municipale (policiers municipaux et gardes champêtres). Le CNFPT estimait à 11 000 le nombre de nouveaux policiers et gardes champêtres à former sur la période 2020-2026, afin de tenir compte de la progression de la demande de recrutement et des départs en retraite.
Il appartient donc au CNFPT de disposer des moyens humains et matériels pour répondre à cette demande de formation, qu'il s'agisse de formations initiales et communes à tous les policiers municipaux ou de formations continues et / ou spécialisées (armement, brigade cynophile, etc.) à l'initiative des maires ou présidents d'EPCI. A titre d'illustration, le CNFPT assure la formation initiale d'environ 2 500 policiers municipaux par an depuis 2022103(*).
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'article 34 de la Constitution dispose que la loi détermine les principes fondamentaux « de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ».
Par ailleurs, en vertu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, le CNFPT est un établissement public à caractère administratif dédié à la formation des agents des collectivités territoriales qui n'est soumis à aucune tutelle de l'Etat.
Par conséquent, permettre au CNFPT de recruter « directement » au sein de ses effectifs des fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale doit relever de la loi.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Les missions que peuvent aujourd'hui exercer les fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale sont précisées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure (CSI). Il en est de même de leurs autorités d'emploi qui ne peuvent être que le maire ou le président de l'EPCI. Les missions des gardes champêtres sont quant à elles définies à l'article L. 521-1 du CSI.
Le CNFPT ne peut aujourd'hui procéder au recrutement de policiers municipaux ou de gardes champêtres pour assurer ses missions de formation des agents de ces cadres d'emplois, alors même que les formations, compte tenu de leur contenu très spécialisé, ne peuvent être dispensées que par des personnels des administrations et établissement publics de l'Etat chargés de la formation des gendarmes et policiers nationaux ou par des policiers municipaux.
Le CNFPT ne peut ainsi, en l'état du droit actuel, avoir recours qu'à la mise à disposition de policiers municipaux par leur collectivité aux fins d'assurer ponctuellement des missions de formation. Cette solution n'est satisfaisante ni pour la collectivité qui emploie le fonctionnaire, dès lors que celui-ci est absent de son service, ni pour le CNFPT qui n'a aucune maîtrise de ses capacités de formation, ni pour l'agent, dont la rémunération est réduite quand il est mis à disposition du CNFPT pour exercer des missions de formateur.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le CNFPT est aujourd'hui confronté à une demande croissante des besoins de formations des agents territoriaux, notamment dans les cadres d'emplois de la police municipale et des gardes champêtres, et donc à un besoin plus important de formateurs.
Le CNFPT a déjà pris plusieurs mesures permettant d'augmenter ses capacités d'accueil en formation et ainsi réduire les délais d'entrée en formation. Il a notamment ouvert, depuis 2023, quatre centres de formation spécifiquement dédiés aux formations des policiers municipaux. Sa capacité de formation a ainsi été portée à 3 000 policiers municipaux par an et, dans le même temps, il a réduit les délais d'entrée en formation à deux mois après le recrutement de l'agent par une collectivité, voire un mois pour la moitié des effectifs concernés.
L'article 9 doit permettre au CNFPT de recruter « directement » au sein de ses effectifs des fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale aux fins d'exercer en qualité de formateur, de participer à l'ingénierie de formation ou d'assurer la gestion des centres de tir et armureries adossées. Les collectivités territoriales qui mettent aujourd'hui à disposition leurs agents seront progressivement moins mises à contribution et disposeront à terme pleinement de leurs effectifs pour exercer leurs missions sur le territoire communal. Le CNFPT disposera de formateurs « à temps plein », placés sous son autorité. Cela contribuera notamment à une plus grande uniformisation des formations entre les différents centres.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Le maintien de la situation actuelle (la mise à disposition) ne permet pas d'accompagner le développement par le CNFPT de ses capacités de formation afin de répondre à la forte demande des employeurs territoriaux. En l'état du droit, une autre position statutaire existe, le détachement dans un cadre d'emplois, par exemple de la filière administrative ou technique, dans lequel le CNFPT est autorisé à recruter par.
Comme exposé ci-dessus, les formations ne peuvent être dispensées que par des membres des forces de sécurité nationales ou par des policiers municipaux. Aussi, le fonctionnaire d'un cadre d'emplois de la police municipale qui serait recruté au CNFPT par détachement dans un autre cadre d'emplois ne pourrait pas exercer les missions de formateur des agents recrutés dans la filière police municipale mais uniquement des fonctions « administratives » liées à l'ingénierie de formation par exemple, ce qui n'est pas suffisant pour répondre aux besoins croissants de formation des agents dans cette filière.
Une première option aurait pu consister à lever la condition tenant à l'appartenance du formateur aux forces de sécurité nationales ou à la police municipale. Cependant, le contenu de la formation étant strictement lié aux missions particulières exercées par les policiers municipaux et gardes champêtres, cela requiert une technicité et une maîtrise des conditions d'exercice des missions que d'autres profils ne maitrisent par définition pas. Afin de garantir la qualité de la formation, le maintien de la condition tenant à la qualité du formateur doit être maintenue.
Cette option n'a donc pas été retenue.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le dispositif retenu par le Gouvernement est celui du recrutement direct d'un fonctionnaire membre d'un cadre d'emplois de la police municipale, dit recrutement « au statut ».
Il s'agit en effet d'ouvrir au CNFPT la possibilité de recruter en tant que tels des fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale (policiers municipaux ou gardes champêtres) pour assurer des missions de formation, sans disposer des prérogatives dévolues aux policiers municipaux et aux gardes champêtres, qu'ils ne peuvent exercer que lorsqu'ils exercent leurs missions sous l'autorité d'un maire ou d'un président d'EPCI.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article modifie les articles L.511-1 et L.521-1 du CSI afin d'ouvrir la possibilité au CNFPT de recruter directement des agents des cadres d'emplois de la filière police municipale (policiers municipaux et gardes champêtres), en complément du recours déjà possible pour le CNFPT au détachement dans un autre cadre d'emplois ou à la mise à disposition par une collectivité territoriale ou un EPCI.
Par ailleurs, l'article L. 522-3 du CSI est également modifié afin d'être mis en cohérence avec la nouvelle rédaction de l'article L. 521-1.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le CNFPT est un établissement public sui generis, compétent pour la formation statutaire de l'ensemble des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Il n'est pas sous la tutelle de l'Etat mais « regroupe les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 à l'exclusion de la ville de Paris et de ses établissements » au sens de l' article L. 451-1 du code général de la fonction publique (CGFP).
Doté de l'autonomie financière, il est dirigé par un conseil d'administration, paritairement composé de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales des agents territoriaux. Instance décisionnelle de l'établissement, le conseil d'administration prend les décisions stratégiques dans les domaines de compétence du CNFPT. Il définit les règles générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.
La mesure prévue par le présent article aura donc un impact sur les effectifs et la masse salariale du CNFPT, étant précisé que la mesure prévue par le présent article résulte d'une demande du CNFPT.
Le coût prévisible de cette mesure n'est pas mesurable ; toutefois le recrutement direct de fonctionnaires de police municipale devrait avoir pour corollaire un moindre recours aux mises à disposition d'agents de la filière police municipale que le CNFPT remboursait aux collectivités employeuses.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
La mesure doit permettre d'accroitre les capacités de formation du CNFPT et ainsi d'accélérer la mise à l'emploi de policiers municipaux recrutés par les collectivités territoriales afin de répondre à un besoin de sécurité accru de leurs habitants.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national de l'évaluation des normes (CNEN) a été saisi pour avis, à titre obligatoire, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis favorable le 2 octobre 2025.
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) a été saisi pour avis, à titre obligatoire, en application de l'article L. 244-1 du code général de la fonction publique (CGFP) et a rendu un avis favorable le 17 septembre 2025.
Au titre des consultations facultatives, le Beauvau des polices municipales a été le cadre de nombreux échanges entre les élus locaux, les représentants des organisations professionnelles de policiers municipaux et les différents services de l'Etat.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Ces dispositions entreront en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
La mesure s'applique sur l'ensemble du territoire hexagonal.
Elle s'applique de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et à Mayotte), sans adaptation particulière.
Elle s'applique également à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, qui relèvent du principe d'identité législative pour la mesure envisagée, sans adaptation particulière. En revanche, le CNFPT n'est pas compétent dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative (Polynésie française et Nouvelle-Calédonie).
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne nécessite pas en tant que tel de textes d'application.
Néanmoins, les décrets en Conseil d'Etat portant statut particulier des cadres d'emplois de directeurs de police municipale et de gardes champêtres doivent être modifiés pour prévoir expressément que leurs membres peuvent exercer au CNFPT : ainsi, seront modifiés l'article 2 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale et l'article 2 du décret n° 94-731 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres).
La modification législative n'appelle pas d'autre texte d'application dès lors que les décrets en Conseil d'Etat portant statut particulier des deux autres cadres d'emplois renvoient pour la définition des missions statutaires aux seules dispositions modifiées du CSI :
- décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale (1er alinéa de l'article 2 « Les membres de ce cadre d'emplois exercent les missions mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure. »)
- décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale (1er alinéa de l'article 2 « Les chefs de service de police municipale exercent les missions mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure. »).
Le décret n° 2024-614 du 26 juin 2024 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la police municipale et des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des gardes champêtres peut être mis en oeuvre par le CNFPT, sans adaptation (article1er : « L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique peut instituer une indemnité spéciale de fonction et d'engagement composée d'une part fixe et d'une part variable. »).
Article 11 - Formation et dispense de formation des policiers municipaux
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Les fonctionnaires territoriaux des cadres d'emplois de la police municipale sont soumis à des dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle obligatoire, dérogatoires au droit commun de la fonction publique territoriale, en raison de la spécificité de leurs missions et des prérogatives qui peuvent leur être reconnues.
Ce cadre spécifique est fixé, non par le code général de la fonction publique (CGFP), mais par le code de la sécurité intérieure (CSI), notamment son article L. 511-6. Il comprend une formation initiale statutaire obligatoire et une formation continue obligatoire dont l'organisation est confiée au Centre national de formation de la fonction publique territoriale (CNFPT).
La durée de la formation initiale obligatoire est fixée par les décrets statutaires des trois cadres d'emplois de la police municipale : six mois pour les agents de police municipale de catégorie C et neuf mois pour les chefs de service de police municipale de catégorie B et les directeurs de police municipale de catégorie A. Contrairement aux autres filières de la fonction publique territoriale, cette formation doit être réalisée avant la prise de poste effective de l'agent recruté par la collectivité : tant que le policier municipal n'a pas satisfait à son obligation de formation et recueilli les agréments du préfet et du procureur de la République, il ne peut exercer ses missions.
La durée de la formation continue obligatoire est, en application de l'article R. 511-35 du CSI, fixée à dix jours minimum par période de cinq ans pour les agents de police municipale et à dix jours minimum par période de trois ans pour les directeurs et les chefs de service de police municipale.
L'article L. 511-7 du code de la sécurité intérieure prévoit quant à lui que les agents nommés au sein des cadres d'emplois de la police municipale peuvent, dans les conditions fixées dans leurs statuts particuliers, être dispensés de tout ou partie de la formation d'intégration (donc de la seule formation initiale d'application) compte tenu de leurs expériences professionnelles antérieures. Ainsi, afin de faciliter leur recrutement dans la police municipale, un régime de dispense partielle a été instauré au bénéfice des policiers nationaux et gendarmes détachés ou intégrés au sein des cadres d'emplois de la police municipale. La durée de leur formation initiale d'application est automatiquement réduite à trois mois pour les agents de police municipale et à quatre mois pour les chefs de service de police municipale et les directeurs de police municipale.
Enfin, l'article L. 412-57 du code de communes, créé par l'article 9 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés donne la possibilité aux communes qui le souhaitent d'instaurer un dispositif d'engagement de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de la titularisation de l'agent. En cas de rupture de cet engagement, le fonctionnaire relevant des cadres d'emplois de la police municipale doit rembourser à la commune ou à l'établissement public la somme correspondant au coût de sa formation initiale, à l'exclusion de la rémunération qu'il a perçue pendant cette période.
Par dérogation à l'article L. 511-6 du CSI, la formation des agents de police municipale de Paris est assurée par la Ville de Paris. La Ville de Paris peut à cet effet passer une convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale ainsi qu'avec le CNFPT, conformément à l'article L. 533-3 du CSI.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'article 34 de la Constitution dispose que la loi détermine les principes fondamentaux « de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ».
La modification des règles relatives à la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux doit par conséquent être opérée par la loi.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Il est apparu nécessaire de clarifier le cadre juridique de la formation des policiers municipaux, en le rapprochant du droit commun de la fonction publique territoriale, tout en conservant sa spécificité sur certains aspects, ce qui nécessite de modifier certaines dispositions législatives du CSI.
S'agissant des dispenses de formation, à la différence du mécanisme de droit commun de la fonction publique territoriale, le CNFPT ne peut pas procéder à des dispenses ciblées et individualisées de tout ou partie de la durée de la formation continue ou de la durée des formations spécialisées (formations à l'armement, aux monitorats ou aux brigades cynophiles) des agents de police municipale. En effet, le pouvoir réglementaire ne peut en l'état du droit prévoir un dispositif de dispense de formation que pour la seule formation initiale d'application. Ce cadre législatif est aujourd'hui inadapté, car il ne permet pas d'adapter le contenu des formations aux acquis des agents issus des douanes, de l'administration pénitentiaire, des forces armées ou de la sécurité privée, qui ont pu acquérir dans ces fonctions antérieures des expériences et savoir-faire professionnels communs avec certaines parties des formations dispensées dans les cadres d'emplois de la police municipale. L'introduction de ces adaptations en faveur de l'ensemble des formations (initiales, continues et de spécialisation) permettrait de gagner en efficience et de réduire les coûts de formation supportés par les collectivités.
Enfin, s'agissant du dispositif d'engagement de servir mis en oeuvre depuis 2022, il ne semble pas avoir atteint son objectif initial qui était la fidélisation des agents, et peut même apparaître en contradiction avec l'objectif recherché d'attractivité de la filière police municipale. En 2023, l'engagement de servir a concerné environ 10% des agents formés par le CNFPT (285 clauses d'engagement à rapporter aux 2 874 agents ayant suivi la formation initiale). Par ailleurs, le dispositif produit parfois des effets contraires à l'objectif recherché puisque, dans les zones en tension, l'absence d'engagement de servir dans une collectivité peut être un argument de recrutement.
Dans les faits, ce sont les dispositions de droit commun prévues à l'article L. 512-25 du CGFP qui sont le plus souvent mises en oeuvre. De manière automatique, lorsque la mutation d'un fonctionnaire territorial intervient dans les trois années qui suivent sa titularisation, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil doit verser une indemnité à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine qui a supporté soit le temps d'indisponibilité de l'agent pendant ses formations obligatoires, soit le coût de formations non obligatoires. A défaut d'accord entre les collectivités sur le montant de l'indemnité, celle-ci est égale à la somme de la rémunération perçue par l'intéressé pendant le temps de formation obligatoire (formation d'intégration et formation de professionnalisation) et du coût de toute formation complémentaire suivie, le cas échéant, au cours de ces trois années.
Le dispositif d'engagement de servir, qualifié de « fausse bonne idée ? » par le rapport d'information sur les missions et l'attractivité des polices municipales du 19 juillet 2023 de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l'Assemblée nationale, doit donc être supprimé et remplacé par un mécanisme plus adapté.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le présent article poursuit plusieurs objectifs.
Il rapproche tout d'abord le régime de la formation professionnelle des fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale du dispositif de droit commun de la fonction publique territoriale, tel qu'encadré par le CGFP (articles L. 422-21 et s.), pour le clarifier tout en conservant sa spécificité. Il vise en outre à permettre au CNFPT et à la Ville de Paris de conventionner avec l'ensemble des administrations et établissement publics de l'Etat pour alléger les coûts de certaines formations sans dégrader la qualité de la formation. En effet, le CNFPT et la Ville de Paris resteront in fine responsables de la qualité des formations (mesure n°1).
Sur le même principe d'harmonisation et de simplification, cet article élargit les cas de dispense à toutes les formations. Sur le modèle du droit commun de la fonction publique territoriale, le CNFPT pourra procéder à des dispenses ciblées et individualisées de tout ou partie de la durée des différentes formations suivies par les fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale, après appréciation des expériences professionnelles et formations de chacun (mesure n°2).
Enfin, il supprime le dispositif optionnel relatif à l'engagement de servir en lui substituant un mécanisme automatique de remboursement entre collectivités, sur le modèle de l'article L. 512-25 du CGFP (mesure n°3).
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Mesure n° 1 : Harmonisation du régime de la formation professionnelle des policiers municipaux
Option non retenue : conserver le cadre existant.
Le cadre actuel de la formation des policiers municipaux se décline en une « formation initiale d'application » (FIA) et une « formation continue » qui recouvre des formations périodiques obligatoires communes à l'ensemble des fonctionnaires de ces cadres d'emplois et des formations obligatoires liées à l'exercice de certaines prérogatives décidées au cas par cas par le maire ou le président de l'EPCI en fonction des besoins spécifiques de la collectivité employeur.
Si la formation des policiers municipaux est principalement régie par des dispositions du CSI, elle s'inscrit dans le cadre général posé par le CGFP qui distingue, s'agissant des formations obligatoires, « formation d'intégration » et « formations de professionnalisation ».
Ces différences de terminologie nuisent à la lisibilité du dispositif, d'autant que l'article L.511-6 du CSI dans sa rédaction en vigueur renvoie la définition de la formation initiale aux dispositions du CGFP.
Il apparaît donc nécessaire d'opérer un alignement entre la terminologie utilisée dans le cadre des formations des agents de la police municipale avec celle utilisée pour l'ensemble de la fonction publique territoriale.
Mesure n° 2 Mécanisme de dispense
Option non retenue : Elargir les cas de dispense de tout ou partie de la durée de la formation sans modifier le cadre législatif.
Les régimes de dispense actuellement prévus par l'article L. 511-7 du CSI ne concernent que la formation initiale d'application des agents nommés au sein des cadres d'emplois de la police municipale, dont la réalisation conditionne leur entrée en fonctions.
La formation continue et les formations spécialisées sont donc exclues du dispositif, ce qui ne permet pas au pouvoir réglementaire d'introduire de mécanisme de dispense pour ces formations réalisées au cours de la carrière des agents.
Cette option, qui ne permet pas d'élargir sans base légale les cas de dispenses de formation, n'a donc pas été retenue au regard de l'objectif poursuivi par le Gouvernement.
Mesure n° 3 Suppression de l'engagement de servir
Option non retenue : Maintenir le dispositif de l'engagement de servir en complément du nouveau dispositif de remboursement entre collectivités.
Compte tenu des effets pervers constatés dans la mise en oeuvre du dispositif actuel d'engagement de servir, il ne peut être maintenu et doit être remplacé par un mécanisme calqué sur le dispositif de droit commun de remboursement entre collectivités, en prévoyant une durée de mise en oeuvre adaptée aux besoins de la filière, de trois ans après la validation d'une formation de spécialisation. Ce dispositif propre à la filière police municipale s'articulera avec le mécanisme de remboursement de droit commun prévu par l'article L. 512-25 du CGFP qui s'applique dans les trois années qui suivent la titularisation de tout fonctionnaire territorial.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La clarification du cadre législatif de la formation des policiers municipaux
Le dispositif retenu par le Gouvernement est celui d'une formation professionnelle des fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale s'articulant en :
- une formation d'intégration (l'actuelle formation initiale d'application) ;
- des formations de professionnalisation périodiques (l'actuelle formation continue) ;
- ainsi que des formations de spécialisation, catégorie spécifique aux policiers municipaux qui comprend par exemple les formations à l'armement, aux monitorats ou aux brigades cynophiles.
Est néanmoins conservée la spécificité du régime de financement de la formation professionnelle des policiers municipaux : à la différence du régime de droit commun de la fonction publique territoriale, les formations de professionnalisation resteront financées par la collectivité d'emploi et non par la cotisation obligatoire du 1° de l'article L. 451-7 du CGFP (actuellement fixée à 0,9%). La collectivité employeur versera également au CNFPT un montant forfaitaire lié aux dépenses qu'elle a engagées au titre des formations de spécialisation.
Le dispositif proposé précise par ailleurs les missions du CNFPT en matière de formation des policiers municipaux et des gardes champêtres. Il assouplit le dispositif de conventionnement existant pour permettre au CNFPT et à la Ville de Paris de conventionner avec des administrations de l'État autres que celles assurant la formation des gendarmes et policiers nationaux.
L'élargissement des cas de dispense
Le choix d'étendre le mécanisme de dispense au vu des acquis des expériences professionnelles à toutes les formations suivies par les policiers municipaux en modifiant les articles L.511-6 et L.511-7 du CSI a été validé par le CNFPT, qui est en accord avec l'idée d'un alignement sur le régime de droit commun.
Toutes les formations suivies par les fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale seront ainsi susceptibles de se voir appliquer le régime de dispense.
Le CNFPT pourra donc adapter la durée de toutes ces formations en fonction des acquis de l'expérience et des formations antérieures des agents. Les modalités d'application de ce dispositif seront fixées par des textes réglementaires.
La suppression de l'engagement de servir
Le même article supprime le dispositif optionnel relatif à l'engagement de servir qui portait sur les seuls agents de police municipale dans les trois années au plus suivant leur titularisation, prévu aux articles L. 412-57 du code des communes et L. 423-10 du code général de la fonction publique, qui n'a pas atteint l'objectif recherché d'attractivité des collectivités qui souhaitent l'imposer à leurs fonctionnaires. Lui est substitué un dispositif automatique de remboursement entre collectivités dans les trois années qui suivent la validation d'une formation de spécialisation par un agent de police municipale. Ce dispositif vient en complément du mécanisme de remboursement prévu à l'article L. 525-15 du code général de la fonction publique qui trouve à s'appliquer pour la période de trois ans après la titularisation.
La création d'un troisième dispositif aurait été une source de complexité, ce qui a conduit à retenir plutôt son remplacement par un nouveau dispositif automatique de remboursement entre collectivités.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article modifie les articles L. 511-6, L. 511-7 et L. 533-3 du code de sécurité intérieure, ainsi que l'article L. 451-6 du code général de la fonction publique.
Il abroge l'article L. 412-57 du code des communes et l'article L. 423-10 du code général de la fonction publique, relatifs à l'engagement de servir.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet
4.2.3. Impacts budgétaires
L'impact budgétaire du présent article pour les collectivités employeurs et pour le CNFPT est, dans le pire des cas, nul, et potentiellement positif.
Le rapprochement du dispositif de formation des policiers municipaux avec le cadre juridique général des fonctionnaires territoriaux s'effectue à périmètre constant : même volume de formation, répartition identique de la charge financière entre le CNFPT (la formation d'intégration, actuelle formation initiale d'application, qui continuera d'être financée par la cotisation de 0,9% de la masse salariale) et les collectivités territoriales (formations de professionnalisation périodiques - l'actuelle formation continue et formations de spécialisation, dont le coût est facturé par le CNFPT aux collectivités).
La facilitation des dispenses devrait permettre de réduire la durée des formations et donc leur coût global, au bénéfice du CNFPT ou des collectivités en fonction du type de formations concernées.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Outre une simplification et une plus grande lisibilité du cadre législatif de la formation des policiers municipaux, l'extension du mécanisme de dispense doit permettre de raccourcir, lorsque cela est justifié par le parcours et les formations antérieurs de l'agent, la durée des formations. Les conséquences sont :
- Une diminution du temps d'indisponibilité de l'agent pour son employeur, voire une mise à l'emploi plus rapide ;
- Une diminution des dépenses de formation supportées par l'employeur territorial.
Le CNFPT pourra conventionner avec davantage d'administrations et d'établissements publics de l'Etat, ce qui facilitera son action de formation compte tenu du caractère très spécifique de certaines formations, en particulier la formation des brigades cynophiles de police municipale. Il tirera ainsi parti des infrastructures de formation existantes afin de les mutualiser avec les services de l'Etat sans qu'il soit nécessaire d'en créer de nouvelles. Cela permettra in fine aux communes de disposer d'agents de police municipale bien formés à un coût rationnalisé.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
La mesure doit permettre d'accroitre les capacités de formation du CNFPT et ainsi d'accélérer la mise à l'emploi de policiers municipaux recrutés par les collectivités territoriales afin de répondre à un besoin de sécurité accrue de leurs habitants.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national de l'évaluation des normes (CNEN) a été saisi pour avis, à titre obligatoire, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et a rendu un avis favorable le 2 octobre 2025.
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) a été saisi pour avis, à titre obligatoire, en application de l'article L. 244-1 du code général de la fonction publique (CGFP) et a rendu un avis favorable le 17 septembre 2025.
Au titre des consultations facultatives, le Beauvau des polices municipales a été le cadre de nombreux échanges entre les élus locaux, les représentants des organisations professionnelles de policiers municipaux et les différents services de l'Etat.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
La mesure s'applique sur l'ensemble du territoire hexagonal.
Elle s'applique de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et à Mayotte), sans adaptation particulière.
Elle s'applique également à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, qui relèvent du principe d'identité législative pour la mesure envisagée, sans adaptation particulière.
En revanche, dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative, cette mesure ne s'applique pas. En Polynésie-française, l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs prévoit que les statuts particuliers de chaque cadre d'emplois sont établis par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie-française, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française. En Nouvelle-Calédonie, c'est une compétence locale.
5.2.3. Textes d'application
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article et précise la liste des formations de spécialisation ainsi que leurs modalités.
De plus, les décrets en Conseil d'Etat portant statut particulier des cadres d'emplois de directeurs de police municipale, de chefs de service de police municipale et d'agents de police municipale doivent être modifiés pour prévoir expressément les modalités de dispense.
Le décret n° 2021-1920 du 30 décembre 2021 pris pour l'application de l'article L. 412-57 du code des communes relatif à l'engagement de servir des policiers municipaux sera abrogé.
Article 12 - Renforcer le régime de la formation professionnelle des gardes champêtres et l'aligner sur le dispositif rénové des policiers municipaux
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le cadre d'emplois des gardes champêtres est un des cadres d'emplois de la filière de la fonction publique territoriale police municipale. 602 gardes champêtres étaient dénombrés en 2023104(*). Ils étaient 1 450 en 2010. Les communes disposant de gardes champêtres sont essentiellement des communes rurales, notamment en Alsace-Moselle en application de l'article L. 523-1 du code de la sécurité intérieure (CSI).
Contrairement aux trois autres cadres d'emplois de la police municipale, les gardes champêtres ne sont pas soumis à des dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle obligatoire. Aucune disposition du code de sécurité intérieure ne prévoit en effet de dispositions relatives à la formation des gardes champêtres. Ils sont donc soumis aux dispositions de droit commun de la fonction publique territoriale, et doivent suivre, en application de l'article L. 422-21 du Code général de la fonction publique (CGFP), une formation professionnelle tout au long de la vie. Cette formation comprend notamment des formations d'intégration (ou « formation initiale statutaire ») et des formations de professionnalisation dispensées tout au long de la carrière et définies par les statuts particuliers des différents cadres d'emplois.
Le décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres prévoit la formation initiale statutaire dont la durée est de 3 mois. Cette formation alterne sessions d'enseignement théorique (48 jours), stages en collectivité (10 jours) et stages pratiques d'observation (12 jours) et son organisation est confiée au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
A l'instar des trois autres cadres d'emplois de la filière police municipale, cette formation doit être réalisée avant la prise de poste effective de l'agent recruté par la collectivité : tant que le garde champêtre n'a pas satisfait à son obligation de formation et recueilli les agréments du préfet et du procureur de la République, il ne peut exercer les missions dévolues aux gardes champêtres.
En revanche, à la différence des autres cadres d'emplois de la police municipale, le décret précité du 24 août 1994 ne prévoit pas le suivi d'une formation continue obligatoire pour les membres du cadre d'emplois des gardes champêtres. De plus, contrairement aux cadres d'emplois de la police municipale, le CSI ne contient pas de dispositions relatives à la formation des gardes champêtres.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'article 34 de la Constitution dispose que la loi détermine les principes fondamentaux « de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ».
La modification des règles relatives à la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux doit par conséquent être opérée par la loi.
Par ailleurs, cette mesure est conforme à la libre administration des collectivités territoriales, qui a valeur constitutionnelle ( Décision n° 79-104 DC du 23 mai 1979) et est inhérente à l'organisation décentralisée de la République.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La nécessité de renforcer le régime de la formation professionnelle des gardes champêtres est un constat partagé par les différents acteurs. L'objectif poursuivi par le Gouvernement est de l'aligner sur le dispositif rénové des policiers municipaux (trois catégories de formation, mécanisme de dispense, dispositif de remboursement entre collectivités en cas de mobilité ...) tout en conservant sa spécificité sur certains aspects.
D'une part, il est essentiel que les gardes champêtres puissent suivre, comme le font les agents de police municipale, une formation de professionnalisation périodique organisée par le CNFPT afin d'adapter leurs pratiques professionnelles aux évolutions des normes législatives et réglementaires.
D'autre part, les gardes champêtres doivent pouvoir bénéficier d'un système de dispense de formation afin d'adapter le contenu des formations aux acquis des agents pour gagner en efficience et permettre de réduire les coûts de formation supportés par les collectivités.
Un chapitre relatif aux formations des gardes champêtres au sein du titre II du livre V de la partie législative du code de la sécurité intérieure doit donc être créé pour porter notamment ces nouvelles obligations de formation et en cohérence avec les dispositions relatives à la formation des agents de police municipales, déjà présentes au sein du CSI et renforcées par le présent projet de loi.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le présent article poursuit plusieurs objectifs.
Il rapproche tout d'abord le régime de la formation professionnelle des gardes champêtres de celui des autres cadres d'emplois de la police municipale, tel que rénové dans le présent projet de loi (mesure n°1).
Il est également prévu, sur le modèle du droit commun de la fonction publique territoriale, que le CNFPT puisse accorder des dispenses ciblées et individualisées de tout ou partie de la durée des différentes formations suivies par les gardes champêtres, après appréciation des expériences professionnelles et formations de chacun (mesure n°2).
Enfin, il est prévu, comme pour les autres cadres d'emplois de la police municipale, un dispositif automatique de remboursement entre collectivités dans les trois années qui suivent la validation d'une formation de spécialisation par un garde champêtre (mesure n°3).
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Mesure n° 1 : Harmonisation du régime de la formation professionnelle des gardes champêtres et des policiers municipaux
Option non retenue : statu quo
Le cadre actuel de la formation des gardes champêtres se décline en une « formation initiale d'application » (FIA) et des formations obligatoires liées à l'exercice de certaines prérogatives décidées au cas par cas par le maire ou le président de l'EPCI (formation armement).
En revanche, ils ne sont soumis à aucune « formation continue obligatoire ».
Cette différence avec les autres cadres d'emplois de la police municipale ne permet pas aux gardes champêtres de se former périodiquement et donc d'adapter leurs pratiques professionnelles aux évolutions des normes législatives et réglementaires.
Cette option n'a donc pas été retenue au regard de l'objectif poursuivi par le Gouvernement.
Mesure n° 2 : Mécanisme de dispense
Option non retenue : statu quo.
Aucun mécanisme de dispense n'est actuellement mis en place pour les gardes champêtres. Cela ne tient pas compte des acquis et des expériences et formations antérieures de ces agents.
Dans un objectif d'harmonisation et d'efficience, cette option n'a donc pas été retenue.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'alignement du cadre législatif de la formation des gardes champêtres sur celui rénové des policiers municipaux : le dispositif retenu par le Gouvernement est celui d'une formation professionnelle des gardes champêtres s'articulant en :
- une formation d'intégration (l'actuelle formation initiale d'application) ;
- des formations de professionnalisation périodiques (elles n'existent pas aujourd'hui pour les gardes champêtres mais correspondent à l'actuelle formation continue des policiers municipaux) ;
- et des formations de spécialisation, catégorie spécifique aux policiers municipaux et aux gardes champêtres qui comprend par exemple les formations à l'armement.
Est reprise le régime spécifique de financement de la formation professionnelle des policiers municipaux : à la différence du régime de droit commun, les formations de professionnalisation sont financées par la collectivité d'emploi et non par la cotisation obligatoire du 1° de l'article L.451-7 du CGFP (le « 0,9% »). La collectivité versera également un montant forfaitaire lié aux dépenses qu'elle a engagées au titre des formations de spécialisation.
La mise en place des cas de dispense pour toutes les formations :
Toutes les formations suivies par les gardes champêtres sont concernées par le régime de dispense. Sur le modèle du droit commun de la fonction publique territoriale, le CNFPT pourra procéder à des dispenses ciblées et individualisées de tout ou partie de la durée des différentes formations suivies par les gardes champêtres.
Des textes réglementaires préciseront le dispositif.
L'instauration d'un dispositif automatique de remboursement entre collectivités dans les trois années qui suivent la validation d'une formation de spécialisation :
Le Gouvernement a fait le choix d'instaurer un nouveau dispositif automatique de remboursement entre collectivités dans les trois années qui suivent la validation d'une formation de spécialisation par un garde champêtre. Ce dispositif vient en complément du mécanisme de remboursement prévu à l'article L525-15 du code général de la fonction publique qui trouve à s'appliquer pour la période de trois ans après la titularisation. Cette instauration vise à traiter de façon cohérente le cadre d'emplois des gardes champêtres avec les autres cadres d'emplois de la filière « police municipale », concernées par ce remboursement. Les gardes champêtres auront notamment vocation à suivre des formations à l'armement organisées par le CNFPT, potentiellement coûteuses. Le mécanisme de remboursement permet de se prémunir contre le débauchage d'agents entre communes.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article crée, au sein du titre II « Gardes champêtres » du livre V « Polices municipales » de la partie législative du code de la sécurité intérieure, un chapitre IV « Formations » composé des articles L. 524-1 et L. 524-2.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Outre une harmonisation et une plus grande lisibilité du cadre législatif de la formation de tous les cadres d'emplois de la filière « police municipale », l'instauration d'une formation de professionnalisation permettra aux gardes champêtres d'adapter leurs pratiques professionnelles aux évolutions des normes législatives et réglementaires, et l'extension du mécanisme de dispense leur permettra de raccourcir, lorsque cela est justifié par le parcours et les formations antérieurs de l'agent, la durée des formations.
Par ailleurs, la formation de professionnalisation, nouvellement créée pour les gardes champêtres, sera financée par la collectivité d'emploi.
Depuis le 1er janvier 2024, la tarification de la formation de professionnalisation des agents de police municipale (actuellement formation continue obligatoire) a été fixée par le CNFPT à 150 euros la journée.
Dès lors, dans l'hypothèse d'une formation de professionnalisation de 10 jours par période de 5 ans (à l'instar de ce qui prévu pour les agents de police municipale), le coût pour une collectivité, de la formation de professionnalisation d'un garde champêtre, sera de 1 500 euros tous les cinq ans. Ce coût sera moindre en cas de dispense de la durée de formation.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national de l'évaluation des normes (CNEN) a été saisi pour avis, à titre obligatoire, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et a rendu un avis favorable le 2 octobre 2025.
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) a été saisi pour avis, à titre obligatoire, en application de l'article L. 244-1 du code général de la fonction publique (CGFP) et a rendu un avis favorable le 17 septembre 2025.
Par ailleurs, le Beauvau des polices municipales a été le cadre de nombreux échanges entre les élus locaux, les représentants des organisations syndicales et professionnelles et les différents services de l'Etat et le CNFPT a également été consulté.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
La mesure s'applique sur l'ensemble du territoire hexagonal.
Elle s'applique de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et à Mayotte), sans adaptation particulière.
Elle s'applique également à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, qui relèvent du principe d'identité législative pour la mesure envisagée, sans adaptation particulière.
En revanche, dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative, cette mesure ne s'applique pas. En Polynésie-française, l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs prévoit que les statuts particuliers de chaque cadre d'emplois sont établis par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie-française, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française. En Nouvelle-Calédonie, c'est une compétence locale.
5.2.3. Textes d'application
Un décret en Conseil d'Etat, modifiant d'une part la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure pour instaurer la formation de professionnalisation et listant d'autre part les formations de spécialisation, doit être pris.
Le décret en Conseil d'Etat portant statut particulier du cadre d'emplois de garde champêtre doit être modifié pour prévoir expressément les modalités de dispense.
TITRE V - MUTUALISATION ET COORDINATION DES POLICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES CHAMPÊTRES ENTRE COMMUNES
Article 13 - Elargissement du recours aux assistants temporaires de police municipale et alignement du régime de mutualisation événement exceptionnel/catastrophe
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
La dénomination d'usage « assistants temporaires de police municipale »(ATPM) correspond aux agents titulaires d'une commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou des agents non titulaires, chargés d'assister temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques et stations classées relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ( article L.511-3 du Code de la sécurité intérieure - CSI). Ces communes sont classées par arrêté préfectoral selon des critères fixés par un arrêté du 16 juin 2023. A titre d'exemple, une station de tourisme doit disposer d'une capacité d'hébergement diversifié et de qualité destinée à une population non permanente, mettre en place une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristique, mettre en avant des ressources naturelles du site et du patrimoine ou encore disposer de commerces de proximité (services de restauration, commerces de bouche, un marché hebdomadaire, etc.). La liste des communes concernées est disponible sur le site internet de la direction générale des entreprises105(*).
Pour qu'un ATPM puisse exercer ses fonctions, il doit recevoir, comme les agents de la police municipale, l'agrément du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, ainsi que du procureur de la République. Cet agrément a pour objet de vérifier que les intéressés présentent les garanties d'honorabilité requises pour exercer leur mission.
Les ATPM sont donc chargés d'assister temporairement les agents de police municipale. Ils peuvent participer à des missions de surveillance de la voie publique ou d'autres missions de police administrative relevant de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. En revanche, ils n'ont pas vocation à se substituer à un agent de police municipale. En outre, l'ATPM n'a pas la qualité d'agent de police judiciaire adjoint, il ne peut donc pas constater des infractions par procès-verbal ( article 21 du code de procédure pénale). Il appartient aux agents de police municipale qu'il accompagne de verbaliser ces infractions. Enfin, un ATPM ne peut pas être armé, seuls les agents de la police municipale pouvant l'être en application de l'article L. 511-5 du CSI.
Les missions des ATPM correspondent le plus souvent dans les faits à un besoin saisonnier. Il s'agit de répondre à un pic d'activité des services correspondant à un déplacement important de touristes dans la commune. Ce pic d'activité correspond généralement aux périodes de flux touristiques durant la haute saison. C'est pour cette raison qu'actuellement seules les communes touristiques et stations classées peuvent bénéficier du recours aux ATPM.
En parallèle, l'article L. 211-11-1 du CSI permet la désignation par décret d'un grand événement ou d'un grand rassemblement exposé à un risque d'actes de terrorisme en raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation. Cette désignation permet à l'autorité administrative de contrôler toute personne, à l'exception des spectateurs, souhaitant accéder au lieu où se déroule ce grand événement ou ce grand rassemblement, grâce à la réalisation d'enquêtes administratives. Si une enquête administrative met en évidence des risques pour la sécurité publique, la personne concernée ne pourra pas accéder aux sites accueillant le grand événement ou le grand rassemblement. Ces grands événements ou grands rassemblements sont très limités à la fois en nombre et dans le temps. Il s'agit d'événements majeurs exposés à des risques importants tels que, pour l'année 2024, les jeux Olympiques et Paralympiques, le 80ème anniversaire du Débarquement, le sommet de la Francophonie, le forum de Paris sur la Paix ou encore l'inauguration de la cathédrale de Notre-Dame de Paris.
Les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont mis en lumière l'utilité de permettre aux communes de pouvoir recourir à des ATPM lors de grands évènements ou lors de grands rassemblements au sens de l'article L. 211-11-1 du CSI, afin de renforcer les services de police municipale durant leur durée. En effet, en raison de l'afflux important de personnes susceptibles de résulter de l'organisation de grands événements, ces communes peuvent se trouver dans des situations proches de celles des communes touristiques ou des stations classées qui sont les seules à pouvoir recourir à des ATPM.
Le présent article vise donc à élargir le recours aux ATPM afin de permettre aux communes qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement au sens de l'article L. 211-11-1 du CSI d'en disposer.
Par ailleurs, le code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit plusieurs régimes permettant la mise en commun de tout ou partie des moyens et des effectifs des agents de police municipale et des gardes champêtres à titre temporaire, afin de faire face à l'un des évènements suivants :
- une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif ;
- un afflux important de population ;
- une catastrophe naturelle ou technologique.
Les agents concernés peuvent alors exercer des missions de police administrative, à l'exclusion de missions de police judiciaire, dans les conditions définies par les articles L. 512-3 (agents de police municipale) et L. 522-2-1 du CSI (gardes champêtres), dans le cadre d'une mise en commun pour une durée déterminée entre plusieurs communes.
Les dispositifs prévus actuellement diffèrent tant au regard des conditions géographiques des communes pouvant y recourir que des modalités de leur mise en oeuvre.
Ainsi, la mise en commun des agents est possible :
- en cas de manifestation exceptionnelle ou d'afflux important de population, entre des communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération. La mise en commun de gardes champêtres est également ouverte entre communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
- en cas de catastrophe naturelle ou technologique, entre des communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à des départements limitrophes.
Par ailleurs, le recours à ces différents dispositifs est soumis à autorisation préfectorale, qui prend la forme d'un arrêté. Par dérogation, en cas de catastrophe naturelle ou technologique, il peut être procédé à la mise en commun par arrêtés municipaux concordants des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l'objet d'une convention cadre préalable entre ces communes et le représentant de l'Etat dans le département.
En 2023, le nombre de mises en commun temporaires d'agents de police municipale, par arrêtés préfectoraux ou par convention-cadres a été de 232 (selon les statistiques de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques - DLPAJ - du ministère de l'intérieur).
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'article 34 de la Constitution dispose que la loi détermine les principes fondamentaux « de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ».
La modification des conditions de mise en commun d'agents territoriaux doit par conséquent être fixée par la loi.
Ces modifications respectent la libre administration des collectivités territoriales, consacrée par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 79-104 DC du 23 mai 1979 Nouvelle-Calédonie car elles ne contraignent pas ces dernières à avoir recours à ces dispositifs de mises en commun, mais en aménagent et simplifient les possibilités pour elles de recourir à des ATPM.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Les disparités actuelles entre les différents dispositifs de mise en commun temporaire de moyens et d'effectifs entre communes présentent une complexité difficile à justifier. En effet, l'objet de ces différents régimes est de permettre aux communes de se coordonner afin de pouvoir répondre à une situation nécessitant un accroissement ponctuel de ressources.
Ainsi, une limitation trop stricte des conditions géographiques permettant de recourir à ces dispositifs peut nuire à l'objectif poursuivi, en empêchant la mise en commun entre communes proches mais ne remplissant pas strictement les critères fixés par la loi.
De même, l'obligation d'autorisation préalable par le représentant de l'Etat pour chaque mise en commun apparaît excessive, en particulier lorsqu'un évènement présente une récurrence importante. A ce titre, la conclusion d'une convention cadre préalable entre ces communes et les représentants de l'Etat, déjà permise en cas de catastrophe naturelle ou technologique, est de nature à simplifier les procédures de recours aux dispositifs de mise en commun tout en fixant les conditions et modalités qui devront être respectées.
Enfin, l'extension proposée nécessite de modifier les cas de recours aux ATPM qui sont fixés par la loi (article L. 511-3 du CSI).
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
D'après les dernières données dont dispose le ministère de l'intérieur, 181 communes touristiques ou stations classées ont fait appel à 846 ATPM en 2023 afin de renforcer leurs effectifs de police municipale.
Toutefois, l'afflux de touristes et de population susceptible d'être généré par l'organisation de grands événements ou de grands rassemblements dans une commune n'est pas pris en compte et les communes concernées ne peuvent pas recourir à l'aide d'ATPM alors que les besoins présentent des similitudes avec ceux observés dans les communes touristiques durant la haute saison. Dans les deux cas, on constate un afflux de personnes au sein d'une commune, ce qui nécessite d'adapter les dispositifs de sécurité publique. En participant à des missions de surveillance de la voie publique ou d'autres missions de police administrative relevant de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, les ATPM peuvent alors alléger la charge pesant sur les effectifs de PM habituels, comme sur les Forces de sécurité intérieure.
L'objectif poursuivi est de traiter de la même façon ces communes qui rencontrent des problématiques similaires.
Par ailleurs, le présent article a pour objectif de faciliter le recours et la mise en oeuvre des dispositifs temporaires de mise en commun des agents de police municipale et des gardes champêtres pour permettre à des communes ou groupements disposant de telles forces de contribuer collectivement à la gestion d'évènements ponctuels.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Une option, similaire au statu quo, aurait pu consister à simplement rappeler aux communes les possibilités dont elles disposent actuellement lorsqu'elles doivent mobiliser davantage de personnels pour encadrer des évènements exceptionnels.
Toutefois, cette option n'est pas apparue suffisante pour améliorer la lisibilité des dispositifs en vigueur, ni pour réduire les obstacles liés à des conditions de recours pouvant être trop restrictives pour s'adapter aux réalités locales.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'article vise à élargir le recours aux ATPM afin de permettre aux communes qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement au sens de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure d'en disposer, compte tenu de l'afflux temporaire de population susceptible d'en résulter.
Aucune modification de la procédure d'agrément des ATPM ou de leurs missions n'apparaît nécessaire.
Par ailleurs, l'option retenue consiste à harmoniser, dans le sens d'un assouplissement, les régimes temporaires de mise en commun d'agents de police municipale ou de gardes champêtres prévus en cas d'évènement particulier.
D'une part, le présent article assouplit les conditions géographiques de recours à la mise en commun des agents, en prévoyant que celle-ci peut s'effectuer entre communes limitrophes ou appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou à une même agglomération, ou à un même département ou à des départements limitrophes.
Actuellement, sauf si elles remplissent entre elles un autre critère, les communes appartenant à un même département ou à des départements limitrophes peuvent uniquement mettre en commun des agents de police municipale ou des gardes champêtres en cas de catastrophe naturelle ou technologique. L'appartenance à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne permet de recourir qu'au dispositif de mise en commun de gardes champêtres en cas de manifestation exceptionnelle ou d'afflux important de population.
D'autre part, le présent article assouplit le régime d'autorisation du représentant de l'Etat en permettant aux maires de ne soumettre qu'une convention de cadrage préalable à celui-ci, comme cela est prévu aujourd'hui pour les catastrophes naturelles et technologiques. Il pourra alors être procédé à la mise en commun par arrêtés municipaux concordants des maires des communes concernées.
Cette mesure va dans le sens des conclusions de la mission d'information sur les polices municipales de la commission des lois du Sénat publiées en mai 2025, dont la proposition n° 2 consiste à « assouplir les conditions légales de mutualisation de policiers municipaux ».
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
L'article L. 511-3 du CSI doit être modifié afin d'ajouter le cas des communes qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement au sens de l'article L. 211-11-1 pendant la durée de celui-ci.
Par ailleurs, le présent article modifie, d'une part, l'article L. 512-3 du CSI relatif à la mise en commun temporaire d'agents de police municipale en cas d'évènement exceptionnel et, d'autre part, l'article L. 522-2-1 du même code, qui prévoit le dispositif équivalent applicable aux gardes champêtres.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Les communes qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement au sens de l'article L. 211-11-1 CSI pourront faire intervenir des ATPM pendant la durée de celui-ci.
Cette nouvelle possibilité est facultative pour les communes concernées et ne crée donc pas de charge nouvelle obligatoire pour les collectivités.
Dans la mesure où les ATPM assistent des agents de police municipale, cette évolution ne pourra concerner que les 4 640 communes qui disposent d'au moins un agent de police municipale (données au 31/12/2023). Une commune sans agent de police municipale ne peut en effet pas recruter d'ATPM.
Cette mesure devrait aussi faciliter le recours aux dispositifs de mise en commun de moyens et d'effectifs existants en cas d'évènement exceptionnel, dans la mesure où elle améliore leur lisibilité et assouplit le régime d'autorisation préfectorale afférent.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les services préfectoraux seront mobilisés pour agréer les ATPM après enquête administrative, de même que les procureurs de la République.
Le nombre d'agréments supplémentaires dépendra du nombre d'ATPM recrutés par les communes, qui n'est toutefois pas prévisible avec précision.
En tout état de cause, la charge supplémentaire rapportée à l'ensemble des missions des préfectures et des procureurs devrait être limitée compte tenu du nombre restreint de grands événements ou de grands rassemblements au sens de l'article L. 211-11-1 du CSI (12 en 2024, 13 en 2023, 10 en 2022, 6 en 2021).
Cette mesure devrait favoriser le développement de conventions cadres préalables entre les communes et le représentant de l'Etat, au lieu et place des autorisations délivrées pour chaque évènement.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
La mesure permettra de renforcer la sécurité lors des grands événements et des grands rassemblements par une présence accrue sur la voie publique de personnes dont la mission est de prévenir les troubles à l'ordre public et de favoriser le bon déroulement de ces évènements exceptionnels concernant un nombre significatif de personnes, en facilitant la mise à disposition des ressources nécessaires à leur gestion.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été saisi pour avis, à titre obligatoire, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis favorable en date du 2 octobre 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
La mesure s'applique sur l'ensemble du territoire hexagonal.
Elle s'applique de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et à Mayotte), sans adaptation particulière.
Elle s'applique également à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, qui relèvent du principe d'identité législative pour la mesure envisagée, sans adaptation particulière.
En revanche, dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative (Polynésie-française et Nouvelle-Calédonie), cette mesure ne s'applique pas.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert aucun texte d'application.
Article 14 - Renforcement des dispositifs de mutualisation et de coordination applicables aux policiers municipaux et gardes champêtres
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
- S'agissant de la mise en commun des policiers municipaux et des gardes-champêtres
Le code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit plusieurs régimes permettant à une collectivité de bénéficier de la mise à disposition d'agents de police municipale ou de gardes champêtres recrutés par un autre employeur. Les agents mis à la disposition de la commune agissent alors sous l'autorité du maire de la commune sur le territoire de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ces dispositifs de mise en commun d'agents de police municipale d'une part, de gardes champêtres d'autre part sont prévus :
- Pour les polices pluricommunales, aux articles L. 512-1 et L. 512-1-1. En 2023, le ministère de l'intérieur en dénombre 509.
- Pour les polices intercommunales, aux articles L. 512-1-2 et L. 512-3. En 2023, le ministère de l'intérieur comptait respectivement 30 polices intercommunales mises en oeuvre par un syndicat de communes et 61 par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP).
Les possibilités de mise en commun de gardes champêtres sont quant à elles définies à l'article L. 522-2 du même code, et correspondent pour partie aux possibilités accordées aux collectivités pour les policiers municipaux. Il a été recensé 42 dispositifs de mutualisation en 2023106(*).
A ce jour, aucun cadre juridique ne prévoit expressément la mise en commun de policiers municipaux et de gardes champêtres agissant de conserve sur un même territoire.
A ce jour, les communes peuvent mettre en commun leurs agents de police municipale ou leurs gardes champêtres en adoptant, pour chacune de ces deux catégories d'agents, une convention de mutualisation qui permet de définir les modalités de cette coopération. Afin d'assurer au mieux la coordination entre ces différentes forces de sécurité municipales ou intercommunales, il est proposé que les communes mettant en commun des policiers municipaux et des gardes champêtres dans un cadre pluricommunal puissent désormais adopter une seule et même convention de mutualisation pour procéder à la mise en commun de ces deux catégories d'agents.
Il est également proposé d'ouvrir aux syndicats de communes créés en vue de recruter des policiers municipaux sur le fondement de l'article L. 512-1-2 du CSI la possibilité de recruter également des gardes champêtres.
Enfin, il est proposé d'intégrer, en plus des policiers municipaux, les gardes champêtres dans le seuil de trois agents défini à l'article L. 512-4 du CSI impliquant l'adoption obligatoire d'une convention de coordination avec les forces de sécurité intérieure.
- S'agissant de la mise en commun d'agents municipaux non policiers municipaux pour la vidéoprotection
Afin de prévenir et de lutter contre la délinquance, les communes peuvent s'équiper de systèmes de vidéoprotection dont les images peuvent être visionnées depuis un centre de supervision urbain (CSU)107(*).
Certaines communes peuvent décider de mutualiser leurs équipements de vidéoprotection au sein d'un même centre.
Ainsi, elles peuvent mettre en commun leurs dispositifs de vidéoprotection lorsqu'elles sont membres d'un EPCI, d'un syndicat mixte fermé ( article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales) ou ouvert restreint ( article L. 5721-8 du même code), qui exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance ( article L. 132-14 du CSI).
Ces communes peuvent également mettre en commun leurs dispositifs de vidéoprotection, dans le cadre d'une mise en commun d'équipement par convention, moyennant une participation financière en application de l'article L. 1311-15 du CGCT. Les modalités de mise en place d'une telle mutualisation ont été précisées dans l'instruction du gouvernement du 4 mars 2022 relative à la mise en oeuvre des dispositions de la loi n°2021-646 du 25 mai 2021.
Depuis la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes ou des EPCI exerçant la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance peuvent, en application de l'article L. 132-14 du CSI, mettre à disposition des communes un centre de supervision urbain (CSU). Conformément à l'article L. 132-14-1 du même code, les agents recrutés pour y travailler sont « pendant le visionnage des images prises sur le territoire d'une commune, [...] placés sous l'autorité exclusive du maire de cette commune ».
Les communes peuvent également, en application de l'article L. 1311-15 du CGCT, mettre en commun un CSU.
Dans cette hypothèse, des policiers municipaux peuvent être mis en commun sur le fondement de l'article L. 511-1 du CGCT. Ils sont alors compétents pour visualiser les images prises sur le territoire de chacune des communes associées.
En revanche, aucune disposition ne permet aux autres agents territoriaux de visualiser des images autres que celles de la commune qui les emploie.
Il est proposé de prévoir un cadre permettant la mise en commun de ces agents territoriaux, indifféremment de leur statut, afin que ceux-ci puissent visualiser, sous l'autorité du maire concerné, les images de l'ensemble des communes associées.
- S'agissant de l'extension de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat aux gardes champêtres
La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat (la police et la gendarmerie nationales) est un dispositif qui ne concerne actuellement que les agents de police municipale. Une telle convention de coordination est obligatoire lorsque la commune compte au moins trois agents de police municipale ( article L. 512-4 du CSI) ou encore lorsque la commune souhaite armer ses agents ( article L. 512-1 du CSI) ou les faire travailler la nuit ( L. 512-6). 3544 communes étaient dotées d'une telle convention au 31 décembre 2023108(*).
L'objectif poursuivi par cette convention est de préciser, après réalisation d'un diagnostic préalable des problématiques de sûreté et de sécurité auxquelles est confronté le territoire, les missions complémentaires prioritaires, notamment judiciaires, confiées aux agents de police municipale ainsi que la nature et les lieux de leurs interventions, eu égard à leurs modalités d'équipement et d'armement. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales. Elle précise la doctrine d'emploi du service de la police municipale. Elle a donc vocation à traduire la répartition des missions entre les agents de police municipale et les forces de l'ordre à l'échelle locale en fonction des besoins du territoire.
Compte tenu de l'accroissement des compétences des gardes champêtres ainsi que de l'alignement du régime de l'armement des gardes champêtres avec celui des agents de police municipale prévu par le présent projet de loi, cet article vise à étendre le dispositif des conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat aux gardes champêtres.
De plus, cet article permet la conclusion d'une telle convention, à la demande du maire, lorsque la commune compte moins de trois emplois de garde champêtre ou d'agent de police municipale.
Enfin, par cohérence, il permet d'inclure le nombre de gardes champêtres dont dispose la commune dans le déclenchement du seuil de trois agents, impliquant l'obligation de conclure une telle convention de coordination.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
- S'agissant de la mise en commun des policiers municipaux et des gardes-champêtres
L'article 34 de la Constitution dispose que la loi détermine les principes fondamentaux « de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ».
La modification des conditions de mise en commun d'agents territoriaux doit par conséquent être fixée par la loi.
- S'agissant de la mise en commun d'agents municipaux non policiers municipaux pour la vidéoprotection
L'article 34 de la Constitution dispose que la loi détermine les principes fondamentaux « de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources » ainsi que les règles concernant « la procédure pénale ».
La modification des conditions dans lesquelles des agents administratifs habilités peuvent visionner les images issues de la vidéoprotection doit par conséquent être fixée par la loi.
- S'agissant de l'extension de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat aux gardes champêtres
L'article 34 de la Constitution dispose que la loi détermine les principes fondamentaux « de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ».
L'extension de la convention de coordination des interventions de de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat aux gardes champêtres doit être fixée par la loi puisque l'existence de celle-ci conditionnera la délivrance de l'autorisation de port d'armes aux gardes champêtres et le travail de nuit.
De plus, l'évolution des dispositions relatives aux polices municipales et aux gardes champêtres s'inscrit dans le cadre des objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions (décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le présent article s'inscrit dans le cadre du respect des traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (droit à la liberté et à la sûreté, l'interdiction de la discrimination, liberté d'expression, etc.).
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
- S'agissant de la mise en commun des policiers municipaux et des gardes-champêtres
Avec son système réparti entre les forces de sécurité intérieure nationale, dont font partie la police nationale et la gendarmerie nationale, et les agents de police municipale et les gardes champêtres, la France se situe en Europe parmi les pays où les polices municipales jouent un rôle complémentaire dans la sécurité intérieure aux côtés des forces nationales, tels que la Belgique, l'Espagne et l'Italie.
- S'agissant de la mise en commun d'agents municipaux non policiers municipaux pour la vidéoprotection
Les pays européens voisins permettent à des polices locales de visionner et d'exploiter des images de vidéoprotection dans des conditions strictes. Par exemple, la Suisse impose des critères stricts, tant dans ces modalités d'application que dans les conditions d'utilisation, des données recueillies par les pouvoirs municipaux. L'usage de caméras de vidéoprotection est soumis à une exigence de proportionnalité, avec une recherche du moyen le moins intrusif pour atteindre l'objectif poursuivi en limitant le périmètre du champ de vision des caméras et en autorisant le visionnage à un nombre restreint de personnes désignées.
- S'agissant de l'extension de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat aux gardes champêtres
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
- S'agissant de la mise en commun des policiers municipaux et des gardes-champêtres
Dans son rapport d'octobre 2020 relatif aux polices municipales, la Cour des comptes recommandait d'encourager la mutualisation des moyens humains et matériels des polices municipales au niveau des intercommunalités, en promouvant la dualité d'autorité (entre l'autorité gestionnaire et celle fonctionnelle).
Ne souhaitant pas multiplier les structures intercommunales ni complexifier d'autant les liens intercommunaux, il n'apparait pas opportun de permettre aux communes de créer des syndicats de communes pour recruter des gardes champêtres. Néanmoins, les disparités actuelles entre les différents dispositifs de mise en commun entre agents de police municipale et les gardes champêtres entraînent l'impossibilité pour des communes qui ont recruté des agents de police municipale en créant un syndicat de communes de procéder à une mise en commun similaire de leurs gardes champêtres.
Pourtant, des territoires qui disposent déjà d'une mise en commun de policiers municipaux peuvent également avoir besoin de mettre en commun des gardes champêtres, notamment dans les territoires ruraux, sans avoir à créer une nouvelle structure de mutualisation.
Dans ce contexte, permettre à des communes de mettre en commun des policiers municipaux et des gardes champêtres selon les modalités des articles L. 512-1 et L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, par une seule convention, semble opportun et facteur de simplification. L'extension aux syndicats de policiers municipaux du recrutement de gardes champêtres en vue de leur mise en commun paraît également opportune.
En cohérence avec cette mise en commun facilitée des policiers municipaux et des gardes champêtres, il convient d'étendre l'obligation pour les communes concernées de conclure avec l'Etat une convention de coordination, telle que prévue à l'article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'elles emploient au moins trois agents de police municipale et/ou gardes champêtres.
- S'agissant de la mise en commun d'agents municipaux non policiers municipaux pour la vidéoprotection
La mise en commun de moyens et d'effectifs entre communes au sein d'un centre de supervision urbain (CSU) permet à celles-ci de renforcer l'efficience du dispositif et de réaliser des économies d'échelle.
En l'état, les effectifs de police municipale qui font l'objet d'une mise en commun dans le cadre d'une convention intercommunale au titre de l'article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure sont compétents pour consulter l'ensemble des images prises dans le CSU mutualisé. A l'inverse, les autres agents territoriaux ne relevant pas du cadre d'emploi de la police municipale (c'est-à-dire tous les autres agents fonctionnaires ou contractuels), dépendent exclusivement de la commune qui les ont recrutés, et la loi ne leur permet pas de consulter les images prises sur le territoire d'une autre commune membre du CSU. Cette limitation semble aller à l'encontre de l'esprit de la mise en commun des dispositifs de prévention de la délinquance et il est nécessaire de permettre cette possibilité dans le cadre de la convention de mise en commun des dispositifs de vidéoprotection.
- S'agissant de l'extension de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat aux gardes champêtres
Compte tenu de l'accroissement des compétences des gardes champêtres ainsi que l'alignement du régime de l'armement des gardes champêtres à celui des agents de police municipale, il est nécessaire d'étendre le champ d'application de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat aux gardes champêtres.
De plus, le paysage des collectivités territoriales montre que des brigades mixtes (gardes champêtres et agents de police municipale) sont régulièrement constituées. Dès lors, il est devenu pertinent de permettre la conclusion d'une telle convention lorsque la commune compte moins de trois emplois de garde champêtre ou d'agents de police municipale.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
- S'agissant de la mise en commun des policiers municipaux et des gardes-champêtres
Le présent article autorise la mutualisation des agents de police municipale et les gardes champêtres par une convention unique et non plus par deux conventions distinctes telle que prévues en l'état actuel du droit aux articles L 512-1 et L. 522-2 du code de la sécurité intérieure.
Ce même article permet la mutualisation des gardes champêtres et des policiers municipaux par la création d'un syndicat de communes unique afin de faciliter le recrutement, les interventions de ces agents tout en permettant des économies d'échelle.
Enfin, cet article renforce et améliore la coordination entre les polices municipales ou les gardes champêtres avec les services de l'Etat, en étendant l'obligation de conclure la convention de coordination prévue à l'article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure, lorsque les communes emploient sur ces fonctions au moins trois agents.
- S'agissant de la mise en commun d'agents municipaux non policiers municipaux pour la vidéoprotection
Le présent article a pour objectif de permettre aux collectivités qui ont mis en commun leurs dispositifs de vidéoprotection dans des centres de supervision urbains, par simple convention, de mettre en commun leurs agents territoriaux recrutés pour visionner les images captées depuis le centre de supervision urbain. Cette disposition aura pour effet d'aligner la mutualisation des agents communaux dans les CSU, mutualisés par simple convention, avec celle des agents communaux recrutés dans des CSU gérés par des établissements publics de coopération intercommunales ou des syndicats de communes.
- S'agissant de l'extension de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat aux gardes champêtres
Cette mesure a pour objectif de renforcer la coordination entre les gardes champêtres, les agents de police municipale et les forces de sécurité de l'Etat.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
- S'agissant de la mise en commun des policiers municipaux et des gardes-champêtres
Les possibilités de mutualisation de gardes champêtres sont déjà très nombreuses et souples, la mutualisation entre communes, quel que soit leur proximité géographique ou leur relation institutionnelle, étant possible.
Aussi, la création d'un nouveau type d'établissement public de coopération intercommunale ne parait pas nécessaire pour répondre à un besoin de sécurité identifié. En outre, une telle création s'oppose au souhait de simplification administrative.
- S'agissant de la mise en commun d'agents municipaux non policiers municipaux pour la vidéoprotection
Le recours à la mise à disposition des agents territoriaux mis en commun dans le cadre d'un CSU commun a été envisagé. Néanmoins, seuls les agents sous statut de fonctionnaire ou en contrat à durée indéterminée peuvent faire l'objet d'une mise à disposition. Aussi, la solution de la mise en commun, sans conséquence statutaire, paraît plus adaptée.
- S'agissant de l'extension de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat aux gardes champêtres
Aucune autre option n'a été envisagée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
- S'agissant de la mise en commun des policiers municipaux et des gardes-champêtres
Le dispositif permet aux communes qui mettent en commun par convention leurs agents de police municipale, en application de l'article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure, de mettre en commun par cette même convention des gardes champêtres, également mis en commun conformément à l'article L. 522-1 du code précité.
Le dispositif retenu permet également d'autoriser les syndicats de communes créés pour mettre en commun les agents de police municipale à recruter également des gardes champêtres.
Enfin, la mise en commun des agents de police municipale et les gardes champêtres étant facilitée, il était impératif d'aligner pour les gardes champêtres la règle obligeant les collectivités à conclure une convention de coordination avec les services de l'Etat à partir de trois agents de police municipale (disposée à l'article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure) en étendant cette obligation pour les services employant au moins trois gardes champêtres ou trois policiers municipaux ou gardes champêtres.
- S'agissant de la mise en commun d'agents municipaux non policiers municipaux pour la vidéoprotection
Le dispositif retenu consiste à étendre les compétences territoriales, en matière de visionnage, des agents territoriaux affectés dans des CSU mise en commun par convention au sens de l'article L. 1311-15 du CGCT à l'ensemble des communes membres de ce CSU.
- S'agissant de l'extension de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat aux gardes champêtres
Cette mesure étend aux gardes champêtres le champ d'application de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat.
Il permet, de plus, à la demande du maire, la conclusion d'une convention de coordination lorsque le service comporte moins de trois emplois de garde champêtre ou d'agent de police municipale.
Par cohérence, l'obligation de conclure une convention de coordination lorsque la commune compte au moins trois agents de police municipale est étendue afin de prendre également en compte le nombre de gardes champêtres dont dispose la commune.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
- S'agissant de la mise en commun des policiers municipaux et des gardes-champêtres
Le présent article modifie l'article L. 512-1 du code de la sécurité en complétant son troisième alinéa.
Il modifie également l'article L. 512-1-2 du code de la sécurité intérieure en complétant le 1er alinéa du I.
Pour intégrer ce nouveau dispositif dans le régime des conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat, l'article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure est également modifié en permettant à cette convention d'intégrer les gardes champêtres mis en commun.
Par cohérence et réciprocité avec la modification des articles L. 512-1-2 et L. 512-4 du code de la sécurité intérieure, il convient de modifier également ce code dans sa partie relative aux conventions de coordination conclues entre les collectivités et l'Etat lorsque ces premières emploient des gardes champêtres, en créant un nouvel article L. 522-8.
- S'agissant de la mise en commun d'agents municipaux non policiers municipaux pour la vidéoprotection
Le présent article entend permettre aux communes qui utilisent des équipements collectifs de vidéoprotection de mettre en commun leurs agents agréés conformément aux dispositions de l'article L. 132-14-1 du code de la sécurité intérieure, comme c'est déjà le cas pour les agents mis à disposition par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par les syndicats mixtes qui mettent en place un centre de supervision urbain (CSU). Il modifie le code de la sécurité intérieure en complétant la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier, en la complétant par un nouvel article L. 132-7-1.
- S'agissant de l'extension de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat aux gardes champêtres
L'article L. 512-4 du CSI est modifié et il est créé un nouvel article L. 522-8 du CSI.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Le présent article est conforme aux textes internationaux et européens en vigueur.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
- S'agissant de la mise en commun des policiers municipaux et des gardes-champêtres
En permettant l'adoption d'une convention unique pour procéder à la mise en commun de policiers municipaux et de gardes champêtres, cette mesure s'inscrit dans une logique de simplification et de clarification du droit.
La mise en commun est également facilitée par ce projet de loi qui permet à un syndicat de communes déjà compétent pour recruter des policiers municipaux, de recruter en outre des gardes champêtres. La coordination des actions des policiers municipaux et des gardes champêtres avec les services de l'Etat, particulièrement ses forces de sécurité intérieure, en sera également renforcée par l'extension aux gardes champêtres de l'obligation de conclure des conventions de coordination.
Ces mesures de simplification n'engendrent donc par elles-mêmes ni charge de travail ni recrutement supplémentaire.
- S'agissant de la mise en commun d'agents municipaux non policiers municipaux pour la vidéoprotection
Cette mesure devrait faciliter le recrutement d'agents territoriaux dans les CSU créés par convention entre communes, leur permettant de réaliser certaines économies d'échelle en ouvrant la mise en commun de leurs agents territoriaux, en permettant à ceux-ci de visionner l'ensemble des images captées au sein du CSU.
Elle devrait permettre d'assurer une cohérence entre les CSU créés par des établissements publics de coopération intercommunale et syndicats de communes et les CSU créés par simple convention entre communes moyennant une participation financière.
- S'agissant de l'extension de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat aux gardes champêtres
Le régime des conventions de coordination pour les gardes champêtres est aligné sur celui applicable aux agents de police municipale. Une telle convention sera donc obligatoire si la commune emploie au moins trois agents de police municipale, au moins trois gardes champêtres, ou si la somme des agents de police municipale et des gardes champêtres est au moins égale à trois.
Cela aura un impact sur les collectivités ayant déjà au moins trois gardes champêtres ou si la somme de leurs agents de police municipale et de leurs gardes champêtres est égale à trois puisque la collectivité devra se doter d'une telle convention dès l'entrée en vigueur de la loi. Cela impactera donc un ETP qui aura la charge de réaliser celle-ci en lien avec le procureur de la République et le représentant de l'Etat dans le département.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
- S'agissant de la mise en commun des policiers municipaux et des gardes-champêtres
Cette mesure devrait permettre le déploiement de structures pluricommunales ou intercommunales plus cohérentes pour les gardes champêtres et les policiers municipaux. Cela devrait permettre une approche plus globale de la gestion des ressources humaines ainsi que du déploiement des effectifs chargés de la sécurité sur le territoire des communes membres. Cette mesure devrait favoriser le développement de conventions de coordination entre les collectivités et l'Etat, favorisant l'action coordonnée des différentes forces de sécurité intérieure.
- S'agissant de la mise en commun d'agents municipaux non policiers municipaux pour la vidéoprotection
Permettre de mutualiser plus aisément des agents communaux au sein des CSU favorise une meilleure couverture de visionnage par le CSU, facilitant d'autant le signalement et la répression d'infractions, tout en favorisant le respect de l'ordre public.
- S'agissant de l'extension de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat aux gardes champêtres
Le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République et les forces de sécurité de l'Etat seront sollicités pour l'élaboration de la convention de coordination qui permettra, in fine, de faciliter leur action par une meilleure coordination avec les agents de police municipale et gardes champêtres. Les services sont d'ores et déjà sollicités pour l'élaboration des conventions ainsi les procédures sont déjà opérationnelles et des effectifs au sein des préfectures sont dédiées à cette mission. De plus, les effectifs des gardes champêtres sont relativement bas (602 en 2023). Enfin, les conventions de coordination sont renouvelées tous les trois ans, la charge de travail est donc répartie.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
- S'agissant de la mise en commun des policiers municipaux et des gardes-champêtres
Cette mesure est de nature à assurer une meilleure cohérence de l'action des policiers municipaux et des gardes champêtres, pour leurs compétences respectives, sur l'ensemble du territoire couvert par la convention pluri-communale prévue à l'article L. 512-1 et au I° de l'article L 522-2 du code de la sécurité intérieure ou par le syndicat de communes. L'ordre public, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques peuvent ainsi être plus aisément assurés, en coordination avec les services de l'Etat.
- S'agissant de la mise en commun d'agents municipaux non policiers municipaux pour la vidéoprotection
En l'état du droit, seuls les policiers municipaux mis en commun sont compétents pour visionner l'ensemble des images captées sur leur territoire de compétence par les équipements d'un CSU créé par simple convention entre communes, les autres agents territoriaux étant limité au territoire de la commune qui les emploie. La mesure envisagée permet de recruter plus aisément des agents qui seraient compétents sur l'ensemble des communes du CSU, permettant de redéployer les agents de police municipale dans l'espace public et d'assister au mieux leur travail via les équipements de vidéoprotection, assurant la sécurité de la population.
- S'agissant de l'extension de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat aux gardes champêtres
Cette mesure a pour objectif de renforcer la coordination entre les différents acteurs de la sécurité (gardes champêtres, agents de police municipale, police et gendarmerie nationales) afin de garantir l'ordre public, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été saisi pour avis, à titre obligatoire, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis favorable en date du 2 octobre 2025.
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) a été saisi pour avis, à titre obligatoire, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis favorable en date du 17 septembre 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
La mesure s'applique sur l'ensemble du territoire hexagonal.
Elle s'applique de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et à Mayotte), sans adaptation particulière.
Elle s'applique également à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, qui relèvent du principe d'identité législative pour la mesure envisagée, sans adaptation particulière.
En revanche, dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative, cette mesure ne s'applique pas dans les îles Wallis-et-Futuna et elle nécessite l'insertion d'une mention expresse d'application dans les collectivités de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
Le tableau ci-dessous détaille les articles à modifier :
|
Polynésie française |
Modification de l'article L. 545-1 du code de la sécurité intérieure |
|
Nouvelle-Calédonie |
Modification de l'article L. 546-1 du code de la sécurité intérieure |
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert aucun texte d'application.
TITRE VI - CONTRÔLE ET DÉONTOLOGIE DES POLICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES CHAMPÊTRES
Article 15 - Harmonisation et clarification des dispositions sur l'agrément et la prestation de serment des agents de police municipale et création d'un agrément préfectoral pour les gardes champêtres
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
1.1.1 Agrément et prestation de serment des agents de police municipale
A - Concernant l'agrément
La nomination par l'autorité territoriale en qualité d'agent de police municipale ne suffit pas pour l'exercice de leurs fonctions. Les agents doivent préalablement avoir été agréés en application de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure (CSI).
Compte tenu de la spécificité des missions de police administrative et de police judiciaire des policiers municipaux, ces derniers sont soumis à un dispositif particulier de double agrément, par le représentant de l'État dans le département et par le procureur de la République.
Le double agrément des agents de police municipale a pour objet de vérifier que ces agents présentent les garanties d'honorabilité et de moralité requises pour occuper les fonctions d'autorité auxquelles ils ont été nommés par les maires.
L'autorité d'emploi, à savoir le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, doit solliciter l'agrément, dès la nomination de l'agent en qualité de stagiaire. Pendant la période de stage, la préfecture instruit le dossier d'agrément dont l'objet est de vérifier les garanties d'honorabilité présentées par l'agent. Cela nécessite la conduite d'une enquête administrative pour vérifier que l'agent appelé à être titularisé réunit les conditions de moralité professionnelle.
Une procédure similaire s'applique pour l'agrément par le procureur de la République.
Cet agrément reste valable tant qu'ils continuent d'exercer la fonction d'agent de police municipale. En cas de recrutement par un autre employeur sur le ressort d'un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés dans délai.
En cas de refus du préfet et/ou du procureur de la République d'accorder l'agrément, précédé d'une procédure contradictoire préalable, le policier municipal ne peut plus exercer ses fonctions. L'autorité d'emploi doit donc en tirer les conséquences et mettre un terme au stage de l'intéressé qui, faute d'agrément, ne peut être titularisé. L'agent est soit licencié soit réintégré dans son corps ou cadre d'emploi d'origine en application de l'article 7 du décret n° 2006-1391 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale.
En outre, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du CSI, l'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'État ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président d'EPCI. En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation.
Le suivi des agréments des agents se fait par téléphone, messagerie électronique et par courrier papier, ce qui implique des délais de traitement, une charge administrative pour chaque acteur, le dossier de l'agent n'étant pas partagé ni toujours numérisé. Cette gestion est assurée par la préfecture de département et ne permet pas un suivi optimal en cas de changement de département et d'un suivi centralisé au plan national dans la perspective de l'attribution d'un numéro d'identification de l'agent.
Il n'existe actuellement pas de chaîne de traitement dématérialisée et automatisée des agréments de ces agents. Ainsi, le préfet, le procureur de République, les collectivités employeuses, le CNFPT et les agents territoriaux ne disposent pas d'outil partagé de suivi dématérialisé et réactif pour le suivi des différentes phases du processus de traitement des agréments (dépôt de la demande, instruction par les services, décisions d'autorisation, de suspension, ou de retrait d'agrément). Ce manque existe déjà aujourd'hui mais va s'accentuer avec les dispositions d'extension de prérogatives prévues par ce projet de loi et ne peut donc rester en l'état, sous peine de créer un décalage inacceptable entre des compétences augmentées pour ces agents et l'incapacité pour les services de l'État et des collectivités à assurer leurs missions de délivrance et contrôle.
Il a été constaté plusieurs incohérences dans la rédaction actuelle de l'article L. 511-2 du CSI qui prévoit cet agrément, que le présent article propose de corriger :
- un renvoi à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aujourd'hui abrogé et repris à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique ;
- l'information du procureur de la République du nouveau lieu d'affectation en cas de mutation de l'agent dans le ressort d'un autre tribunal judiciaire est prévue, mais pas celle du représentant de l'Etat en cas de mutation dans un autre département ;
- en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à la consultation de l'autorité d'emploi de l'agent, mais le représentant de l'Etat dans le département doit quant à lui toujours consulter pour avis simple cette autorité d'emploi ;
- l'absence d'information mutuelle entre le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République.
B - Concernant la prestation de serment
L'assermentation prévue par l'article L. 511-2 du CSI constitue un préalable obligatoire pour exercer les fonctions d'agent de police municipale. Elle confère notamment la « force probante » aux procès-verbaux relevant des compétences de police judiciaire de ces agents.
L'assermentation est une prestation de serment qui constitue un engagement solennel pour l'agent de police municipale ou le garde champêtre de respecter les règles déontologiques inhérentes à leurs missions.
L'assermentation doit être sollicitée après l'obtention du double agrément par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République.
L'assermentation reste valable tant que l'agent continue d'exercer ses fonctions, même en cas de mutation dans une autre commune ou dans un autre département.
En l'absence d'un texte général sur l'assermentation des agents de police municipale, celle-ci est déterminée par les dispositions des articles L. 130-7 et R. 130-9 du code de la route qui précisent que la formule du serment est la suivante : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ».
Néanmoins, il est considéré que le serment prêté en vertu de ces dispositions vaut pour la constatation de toute infraction relevant de leur compétence, et non seulement celles au code de la route.
L'autorité territoriale doit adresser une demande d'assermentation au tribunal judiciaire du lieu de résidence de l'agent.
En application de l'article R. 212-2 du code de l'organisation judiciaire, la prestation de serment est reçue à l'audience d'une des chambres du tribunal judiciaire. Après avoir été convoqué, l'agent se rend auprès du tribunal compétent et prête serment devant le président.
En parallèle, les dispositions de l'article L. 515-1 A du CSI introduites par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République prévoient que « préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police municipale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment ».
Or, ces dispositions entretiennent l'ambigüité sur la formule de serment qui doit être prononcée par les policiers municipaux. Le présent article comprend une disposition visant à clarifier les dispositions applicables en matière de prestation de serment des agents de police municipale en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat.
1.1.2 S'agissant des gardes champêtres
Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés, en vertu de l'article L. 522-1 du CSI.
L'agrément a pour objet de vérifier que ces agents présentent les garanties d'honorabilité et de moralité requises pour occuper les fonctions d'autorité auxquelles ils ont été nommés par les maires.
Compte tenu de l'accroissement des compétences des gardes champêtres, le présent article vise à étendre le dispositif particulier de double agrément, par le représentant de l'État dans le département et par le procureur de la République, des agents de police municipale, aux gardes champêtres. En effet, la différence de traitement entre ces agents ne se justifie plus dès lors que leurs compétences tendent à se rapprocher, le présent projet de loi prévoyant, par ailleurs, d'étendre les prérogatives de police judiciaire des gardes champêtres à la constatation par procès-verbal de neufs nouveaux délits :
- infractions de vente à la sauvette prévues aux articles 446-1 et 446-2 du code pénal ;
- infraction de vol dans les conditions prévues à l'article 311-3-1 du code pénal ;
- infraction d'inscription, signe ou dessin ayant entraîné un dommage léger prévue au II de l'article 332-1 du code pénal ;
- infraction d'entrave à la circulation prévue à l'article L. 412-1 du code de la route ;
- infraction de conduite malgré invalidation du permis de conduire prévu à l'article L. 224-16 du code de la route ;
- infraction d'occupation illicite de hall d'immeuble prévue à l'article L. 272-4 du code de la sécurité intérieure ;
- infraction d'outrage sexiste et sexuel aggravé à l'article 222-33-1-1 du code pénal ;
- infraction de vente d'alcool aux mineurs prévue à l'article L. 3353-3 du code de la santé publique ;
- infraction d'usage de stupéfiants prévue à l'article L. 3421-1 et suivants du code de la santé publique.
1.1.3 S'agissant de la création d'un numéro d'identification individuel et d'un registre national des agréments
Il n'existe actuellement pas de chaîne de traitement dématérialisée et automatisée des agréments de ces agents. Ainsi, le préfet, le procureur de République, les collectivités employeuses, le CNFPT et les agents territoriaux ne disposent pas d'outil partagé dématérialisé et réactif pour le suivi des différentes phases du processus de traitement des agréments (dépôt de la demande, instruction par les services, décisions d'octroi, de suspension, ou de retrait d'agrément).
Il n'y a donc pas d'annuaire centralisé et fiable des identités des agents de PM et des gardes champêtres auquel comparer les demandes d'accès aux fichiers.
Le présent article, en prévoyant la création d'un numéro d'identification individuel inscrit dans un registre national, permettra précisément de pallier cette lacune.
Un tel registre qui prendra la forme d'une base automatisée, et donc d'un traitement de données personnelles, devra être autorisé par décret en Conseil d'Etat pris après de la CNIL. Cette base constituera un socle fiable, unique et évolutif intégrant le numéro d'identification de chaque agent (RIO) et permettant la création d'un annuaire des agents concernés, puis la mise en place d'un dispositif d'authentification forte et centralisé.
Cette authentification sera en outre indispensable pour permettre aux agents de police municipale et aux gardes champêtres d'accéder en mobilité, de façon sécurisée et tracée, à certains fichiers, nécessaires à l'accomplissement efficace de leurs missions actuelles et à venir avec l'entrée en vigueur de ce projet de loi. En effet, les modalités de connexion des agents de police municipale et des gardes champêtres aux différents fichiers existants ne répondent pas à une politique d'ensemble. Ces accès sont principalement possibles au moyen des seuls ordinateurs fixes installés dans les bureaux109(*), ce qui ne facilite pas l'action des agents sur le terrain qui ne peuvent pas réaliser les consultations en autonomie. Ces accès, de même que ceux existant en mobilité pour certains fichiers110(*), ne répondent pas aux exigences de sécurité, de protection des données, d'authentification et de traçabilité des accès. Ces connexions reposent parfois sur des solutions techniques obsolètes et peu adaptables.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'évolution des dispositions relatives aux polices municipales s'inscrit dans le cadre des objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions (décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021).
L'action de la police municipale demeure encadrée par le législateur et dirigée par le maire, conformément à la libre administration des collectivités territoriales, qui a valeur constitutionnelle (décision n° 79-104 DC du 23 mai 1979) et est inhérente à l'organisation décentralisée de la République.
En outre, l'article 34 de la Constitution dispose que la loi détermine les principes fondamentaux « de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ».
L'octroi, le retrait ou la suspension de l'agrément des agents de police municipale et des gardes champêtres administrée par le ministère de l'intérieur doit donc être fixée par la loi (article L.511-2 du CSI pour les policiers municipaux et l'article L.522-1 du CSI pour les gardes champêtres - qui sera actualisé par le présent projet de loi).
Le projet de loi prévoit également que le ministère de l'intérieur leur attribue un numéro d'identification individuel, inscrit dans un registre national, afin d'en faciliter la gestion et le suivi. Ce registre respectera le droit au respect de la vie privée garantie par l'article 2 de la Déclaration de 1789111(*).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Afin d'assurer le respect de la vie privée, le droit de l'Union européenne encadre strictement les conditions de mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel. Ainsi, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données - RGPD). L'attribution d'un numéro d'identification individuel, inscrit dans un registre national, afin de faciliter la gestion et le suivi des policiers municipaux et des gardes champêtres sera conforme au RGPD.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Avec son système réparti entre les forces de sécurité intérieure nationale, dont font partie la police nationale et la gendarmerie nationale, et les agents de police municipale et les gardes champêtres, la France se situe en Europe parmi les pays où les polices municipales jouent un rôle complémentaire dans la sécurité intérieure aux côtés des forces nationales, tels que la Belgique, l'Espagne et l'Italie.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Le livre V « Polices municipales » du CSI décrit les processus de nomination, d'agrément, de port d'armes et de contrôle exercé par le ministère de l'intérieur sur les agents de police municipale et les gardes champêtres.
Compte tenu de l'accroissement des prérogatives des gardes champêtres, il a été jugé nécessaire d'instaurer un agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département aux gardes champêtres, comme cela est déjà le cas pour les agents de police municipale. En effet, l'agrément a pour objet de vérifier que les agents présentent les garanties d'honorabilité et de moralité requises pour occuper les fonctions d'autorité auxquelles ils ont été nommés par les maires.
De plus, l'absence d'un texte précisant la formule du serment pour les gardes champêtres et les agents de police municipale alors même que l'assermentation permet de donner force probante aux procès-verbaux et l'ambiguïté des dispositions de l'article L. 515-1 A du CSI nécessitaient une clarification des dispositions en la matière.
Le présent projet de loi propose d'attribuer des prérogatives de police judiciaire ciblées, d'une part aux agents de police municipale et aux gardes champêtres et d'autre part aux personnels d'encadrement des polices municipales. Il est en particulier proposé d'étendre la compétence des agents de police municipale et des gardes champêtres à la constatation simplifiée par voie d'amende forfaitaire délictuelle, ce qui implique de procéder à des vérifications en se connectant à certains fichiers.
L'exercice de ces nouvelles prérogatives implique également de répondre à l'exigence constitutionnelle112(*), selon laquelle la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire et les agents doivent avoir suivi une formation apportant des garanties suffisantes, proche de celle suivie par les officiers de police judiciaire.
En cas de manquement grave ou répété, le procureur de la République ou le préfet doit en effet être en mesure de suspendre ou de mettre fin à l'attribution des prérogatives supplémentaires, sans délai. La politique de sécurité et de justice qui relève de l'Etat doit être contrôlée de manière effective.
A cette fin, l'identification et le suivi des policiers municipaux et des gardes champêtres dans un registre national, au moyen d'un numéro d'identification, apparaît nécessaire.
Or, actuellement, il n'existe pas de base centralisée des policiers municipaux en France. Pour connaître l'état des effectifs, le ministère de l'intérieur interroge chaque préfecture, celle-ci faisant ensuite remonter les déclarations des mairies de façon annuelle. Le suivi est donc perfectible. En ce sens, la création d'un numéro individuel permet de renforcer le suivi et le contrôle de ces mêmes agents.
L'article L. 511-4 du CSI prévoit que le port de la tenue et de la carte professionnelle sont obligatoires. Le port du RIO, et, partant, la création du registre correspondant, doit donc être de niveau législatif.
Dès lors, une mesure de niveau législatif est nécessaire afin de modifier les articles L. 511-2, L. 511-4, L. 522-1 et L. 522-5 du CSI.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
2.2.1. S'agissant des agents de police municipale
Le premier objectif poursuivi est de tirer les conséquences de l'adoption du code général de la fonction publique et d'harmoniser les pouvoirs du procureur de la République et du représentant de l'Etat dans le département dont les différences ne se justifient pas. En effet, les agents de police municipale sont agréés par ces deux autorités ; il est donc normal qu'elles disposent des mêmes informations et des mêmes pouvoirs.
Le deuxième objectif poursuivi est de clarifier les dispositions existantes afin de préciser expressément que la formule de la prestation de serment des agents de police municipale est définie par décret en Conseil d'Etat.
La formule qui sera retenue par décret en Conseil d'Etat devra retranscrire les principes définis par l'article L. 515-1 A du code de la sécurité intérieure (servir avec dignité et loyauté la République, principes de liberté, d'égalité et de fraternité, respect de la Constitution).
2.2.2. S'agissant des gardes champêtres
Le présent article a pour objet d'instaurer un agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département aux gardes champêtres, comme cela est déjà le cas pour les agents de police municipale.
De plus, ce double agrément et cette assermentation (dont la formule de serment sera fixée en décret en Conseil d'Etat) restent valables tant que le garde champêtre continue d'exercer des fonctions de garde champêtre. Cette précision a pour objet de donner une portée nationale aux agréments afin d'éviter une lourdeur administrative.
Une mesure transitoire est prévue pour dispenser les gardes champêtres déjà en poste d'un nouvel agrément et pour laisser le temps aux services concernés de s'organiser.
2.2.3. S'agissant du numéro d'identification individuel
Le présent article prévoit un registre national des policiers municipaux et des gardes champêtres, identifiés par un numéro unique, ce qui s'inscrit dans les objectifs de modernisation de l'action publique et les orientations politiques du gouvernement issues de la concertation du Beauvau des Polices Municipales :
- Mettre en oeuvre de véritables parcours modernisés pour les agents de police municipale et les gardes champêtres tout en simplifiant l'accès de l'usager à l'Administration ;
- Garantir l'exercice des compétences confiées aux agents de police municipale et aux gardes champêtres ;
- Renforcer le contrôle et le pilotage des autorités compétentes par la mise à disposition d'outils performants ;
- Renforcer la lutte contre la fraude ;
- Contribuer à la sécurisation de l'espace national par le contrôle des conditions d'octroi et de maintien des agréments aux agents de police municipale et aux gardes champêtres ;
- Contribuer à donner aux collectivités territoriales employeuses une assurance en temps réel de la validité des agréments et autorisations délivrés à leurs agents de police municipale et aux gardes champêtres (accès fichiers, port de l'armement etc.)
- Permettre la constitution d'un annuaire nécessaire préalable à la mise en place à un dispositif d'authentification forte nécessaire pour les seuls agents agréés en matière d'amendes forfaitaires délictuelles et d'accès aux fichiers.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Une option aurait pu consister à maintenir le suivi des agréments par les préfectures.
Toutefois, le dispositif actuel ne permet pas un suivi efficace et réactif des agents par chacun des acteurs compétents en matières d'agréments, de formation et de suivi administratif des dossiers. Ce dispositif, non numérisé et organisé dans chaque département, n'est ni harmonisé, ni unifié, ce qui empêche la constitution d'un annuaire unique des agents, et partant la mise d'une authentification forte, préalable indispensable en vue de l'ouverture d'accès contrôlés et suivis, conforme aux exigences définies par la législation et par la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le présent article vise à modifier l'article L. 511-2 du CSI afin de :
- supprimer le renvoi à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aujourd'hui abrogé et faire référence à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique ;
- prévoir l'information du représentant de l'Etat en cas de mutation de l'agent dans un autre département, sur le modèle de l'information du procureur de la République déjà prévue en cas de mutation dans le ressort d'un autre tribunal judiciaire ;
- en cas d'urgence, prévoir que l'agrément puisse être suspendu par le représentant de l'Etat dans le département sans qu'il soit procédé à la consultation de l'autorité d'emploi de l'agent sur le modèle de ce que peut déjà faire le procureur de la République ;
- prévoir l'information mutuelle du représentant de l'Etat dans le département et du procureur de la République s'agissant des décisions d'agrément, de suspension ou de retrait ;
- préciser que la formule de la prestation de serment des policiers municipaux est définie par décret en Conseil d'Etat.
De plus, la présente disposition instaure un agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département aux gardes champêtres. Il vient également préciser que le double agrément et l'assermentation restent valables tant que le garde champêtre continuer d'exercer les fonctions de garde champêtre.
Par ailleurs, la création par la loi d'un registre national des agents de police municipale et des gardes champêtres permet de constituer un moyen moderne et partagé permettant une gestion plus efficiente des agents par l'ensemble des acteurs chargés de leur suivi et de leur contrôle, notamment en cas de changement de département. Il permet également l'instauration d'un dossier numérisé de l'agent pendant la durée de sa carrière tout en simplifiant le suivi des obligations associées, par les collectivités territoriales, le CNFPT et l'administration de l'Etat.
Ce registre constitue également la première brique indispensable d'une architecture numérique robuste seule à même, à travers la création d'un annuaire national permettant de vérifier les identités, puis la mise en place d'une authentification forte, de permettre l'exercice de compétences nouvelles et en mobilité, constituant en cela une avancée décisive pour acter la place des policiers municipaux et des gardes champêtres dans le continuum de sécurité.
Enfin, en complément de l'instauration du registre national, le présent article impose à l'ensemble des agents de police municipale et aux gardes champêtres le port apparent, sur leur tenue, de leur numéro d'identification individuel.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
D'une part, le présent article modifie les articles L. 511-2, L. 511-4 du code de la sécurité intérieure relatifs à l'agrément et à la tenue des policiers municipaux.
D'autre part, le présent article procède à la modification des articles L. 522-1 et L. 522-5 du code de la sécurité intérieure s'agissant de l'agrément et de la tenue des gardes champêtres.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Le présent article est conforme aux textes internationaux et européens mentionnés supra.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet
4.2.3. Impacts budgétaires
Dans l'attente de la réalisation d'un cadrage fonctionnel et technique, il est difficile d'être précis sur les coûts, qui dépendront principalement de la complexité fonctionnelle qui sera demandée et du choix retenu initialement soit de concevoir un traitement ex-nihilo soit de s'adosser sur un traitement déjà existant de dépôt de demande d'agrément et d'instruction.
Le développement d'un portail permettrait donc de faciliter les démarches des collectivités, tout en facilitant le suivi par les préfectures et le ministère (par exemple, dans le cas des agents qui changent de département).
Toutefois, sans s'adosser à un traitement existant et au vu de projets similaires dans sa cinématique, un budget de 7 à 10 millions d'euros hors titre 2, étalés sur 3 ans paraît réaliste (réalisation, exploitation, hébergement cloud, AMOA, homologation de sécurité, AIPD...) hors modules optionnels.
Une trajectoire d'effort budgétaire à consacrer à ce projet serait d'environ 3,5 à 4 millions d'euros en 2026 et 2027 et 2 à 3 millions en 2028.
Enfin, la mutualisation des informations entre le procureur de la république et le préfet n'entraînera pas de frais supplémentaires puisqu'elle pourra avoir lieu par voie dématérialisée.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Les dispositions imposeront à l'autorité d'emploi de l'agent d'informer les représentants de l'Etat des départements de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice en cas de recrutement par voie de mutation d'un agent de police municipale qui exerçait auparavant ses fonctions dans un autre département. Cette information pourra être faite par voie postale ou dématérialisée.
Le nouveau dispositif (mesure législative et décret en Conseil d'Etat) conduira également à modifier la formule que les agents doivent prononcer lors de leur prestation de serment.
Les gardes champêtres devront obtenir un double agrément pour exercer leurs fonctions et prononcer un serment dont la formule sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
Par ailleurs, l'attribution des numéros d'identification et la gestion du registre national est confié à l'Etat (ministère de l'intérieur). Pour autant, ce registre pourrait par exemple permettre aux communes de vérifier l'agrément de leurs agents de police municipale.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les services préfectoraux seront informés en cas d'arrivée dans leur département d'un agent de police municipale bénéficiant d'un agrément préfectoral obtenu dans un autre département. De même, les services préfectoraux de l'ancien lieu d'exercice seront informés que l'agent n'exercice plus ses fonctions dans le département.
Le représentant de l'Etat dans le département pourra suspendre en cas d'urgence l'agrément d'un agent sans consulter au préalable son autorité d'emploi, ce qui lui permettra de prendre des décisions plus rapidement.
Le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République s'informeront mutuellement des décisions prisées (agréments, suspensions, retraits).
Le nouveau dispositif (mesure législative et décret en Conseil d'Etat) conduira également à modifier la formule que les agents doivent prononcer lors de leur prestation de serment.
Comme c'est le cas actuellement pour l'agrément des policiers municipaux, les services préfectoraux pourront communiquer au SNEAS113(*) les éléments nécessaires à la conduite des enquêtes administratives prévues par l'article L114-1 du code de la sécurité intérieure, préalablement à la décision d'agrément des 602 gardes champêtres.
A plus long terme, le projet de dématérialisation du processus facilitera la communication des pièces justificatives par les collectivités aux préfectures.
Enfin, cette disposition implique la mise en oeuvre d'une équipe projet dédiée, et durable en vue de la conception et à la réalisation de ce registre national. Elle implique de renforcer les équipes des directions concernées (notamment la DEPSA et la DTNUM du ministère de l'intérieur).
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
L'agrément a pour objet de vérifier que les agents présentent les garanties d'honorabilité et de moralité requises pour occuper les fonctions d'autorité auxquelles ils ont été nommés par les maires. La mise en place d'un double agrément (par le préfet et par le procureur de la république) pour les gardes champêtres renforce les exigences déontologiques à leur égard renforçant ainsi le lien de confiance entre la population et les forces de sécurité au sens large.
Le port sur la tenue du numéro d'identification individuel des agents de polices municipale et des gardes champêtres renforcera la transparence de leur action et le lien de confiance dans les relations police-population.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Cette mesure pourra à terme faciliter les démarches et la numérisation des dossiers des candidats aux fonctions de police municipale et de garde champêtre. De plus, l'attribution par le ministre de l'Intérieur d'un numéro d'identification individuel pour les policiers municipaux et les gardes champêtres, inscrit dans un registre national et porté de manière apparente vise à renforcer la transparence de l'action publique et à renforcer le lien entre les agents et la population.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Cette mesure facilitera la constitution de dossiers dématérialisés et limitera l'empreinte carbone en limitant le recours aux dossiers papier.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été saisi pour avis, à titre obligatoire, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, et a rendu un avis favorable en date du 2 octobre 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La procédure d'agrément des gardes champêtres entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française et ne s'applique pas aux gardes champêtres recrutés avant son entrée en vigueur.
Les autres dispositions de du présent article entrent en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
La mesure s'applique sur l'ensemble du territoire hexagonal.
Elle s'applique de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et à Mayotte), sans adaptation particulière.
Elle s'applique également à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, qui relèvent du principe d'identité législative pour la mesure envisagée, sans adaptation particulière.
En revanche, dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative, cette mesure ne s'applique pas dans les îles Wallis-et-Futuna et elle nécessite l'insertion d'une mention expresse d'application dans les collectivités de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
Le tableau ci-dessous détaille les articles à modifier et à supprimer.
|
Polynésie française |
Modification de l'article L. 545-1 du code de la sécurité intérieure |
|
Nouvelle-Calédonie |
Modification des articles L. 546-1 et L. 546-1-1 du code de la sécurité Suppression de l'article L. 546-3 du code de la sécurité intérieure |
5.2.3. Textes d'application
Le présent article requiert un décret en Conseil d'Etat afin de fixer la formule du serment des agents de police municipale et des gardes champêtres et d'encadrer le registre national au regard de la législation sur les traitements de données et des garanties subséquentes.
Article 16 - Création de la faculté de contrôler le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) dans le cadre de ses activités de formation des fonctionnaires de police municipale
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Actuellement, l'article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) donne la possibilité au maire, au président de l'établissement public de coopération intercommunale, au représentant de l'Etat dans le département ou au procureur de la République de demander au ministre de l'intérieur de saisir les services d'inspection générale de l'Etat pour réaliser une mission de vérification portant sur l'organisation et le fonctionnement d'un service de police municipale. La mise en oeuvre de ce dispositif demeure rare : entre 1999 et 2025, l'Inspection générale de l'administration a été saisie à trois reprises à cette fin.
En pratique, le service en charge de la réalisation de l'inspection émet un rapport exhaustif sur la situation du service de police municipale ainsi que des recommandations.
A cette fin, il peut notamment :
- Vérifier le registre d'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions ainsi que l'état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire (article R. 511-33 du CSI) ;
- Avoir accès aux informations mentionnées à l'article R. 241-10 du CSI : les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de police municipale dans les circonstances et pour les finalités prévues à l'article L. 241-1 du CSI ; le jour et les plages horaires d'enregistrement ; l'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ; le lieu où ont été collectées les données (article R. 241-12 du CSI).
Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est un établissement public paritaire déconcentré dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public. Il a quatre missions principales : la formation, l'observation, l'organisation des concours des cadres d'emplois A+, et l'apprentissage. Son financement résulte principalement d'une cotisation obligatoire, versée par les employeurs territoriaux, ayant, au moins, au premier janvier de l'année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget ou un PEC (parcours emploi compétences), dès la date de leur recrutement. Cette cotisation est assise sur la masse des rémunérations de leurs agents, telles qu'elles apparaissent sur leurs états URSSAF mensuels ou trimestriels, soumises à cotisation URSSAF, au titre de l'assurance-maladie.
La formation des agents de police municipale est assurée et organisée par le CNFPT (article L. 511-6 du CSI).
Elle comprend une formation initiale statutaire et une formation continue obligatoires. Elle peut également comprendre des formations spécialisées :
- La formation préalable à l'armement pour les services de police municipale armés à la demande du maire ;
- Il en découle des formations d'entraînement au maniement des armes ;
- La formation dédiée au brigade cynophile de police municipale.
La formation initiale obligatoire est fixée par les décrets statutaires des trois cadres d'emplois de la police municipale : six mois pour les agents de police municipale de catégorie C et neuf mois pour les chefs de service de police municipale de catégorie B et les directeurs de police municipale de catégorie A.
La formation continue obligatoire est, en application de l'article R. 511-35 du CSI, fixée à dix jours minimums par période de cinq ans pour les agents de police municipale et à dix jours minimums par période de trois ans pour les directeurs et les chefs de service de police municipale.
La formation préalable à l'armement et les formations d'entraînement au maniement des armes sont encadrées par l'arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et aux certificats de moniteur de police municipale en maniement des armes et de moniteur de police municipale en bâtons et techniques professionnelles d'intervention.
La formation dédiée au brigade cynophile de police municipale est encadrée par les articles R. 511-34-1 à R. 511-34-7 du CSI.
La professionnalisation de la formation des policiers municipaux et la création des quatre centres dont certains comportent des armureries traduisent une montée en puissance du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) en la matière.
Le présent article ouvre dès lors la possibilité, à la demande du président du CNFPT, du procureur de la République ou du préfet localement compétent, que soit demandée une vérification par les inspections de l'État des activités de formation des policiers municipaux au sein du CNFPT.
En outre, il est ajouté un renvoi à un décret d'application compte tenu des enjeux de procédure et de coordination qui devront être traités en lien avec l'ensemble des administrations concernées.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'évolution des dispositions relatives aux polices municipales s'inscrit dans le cadre des objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions (décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021).
L'action de la police municipale demeure encadrée par le législateur et dirigée par le maire, conformément à la libre administration des collectivités territoriales, qui a valeur constitutionnelle (Décision n° 79-104 DC du 23 mai 1979) et est inhérente à l'organisation décentralisée de la République. La police municipale opère ainsi sous contrôle du législateur et dans le respect des droits et garanties constitutionnels.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Compte tenu des prérogatives croissantes du CNFPT en matière de formation des agents de police municipale, notamment à l'armement, et depuis la création des centres de formation (au nombre de 4 : à Aix-en-Provence, à Montpellier ; à Meaux-Villenoy et à Angers), il est apparu nécessaire d'ouvrir la possibilité au président du CNFPT, au préfet ou au procureur, de demander au ministre de l'intérieur ou au ministre chargé des collectivités territoriales, d'engager une mission de vérification portant sur les activités du centre en matière de formation aux agents de police municipale. Ces inspections garantiront la qualité des formations délivrées par le CNFPT.
De plus, la Cour des comptes dans son rapport « Les polices municipales » d'octobre 2020, recommandait d'ores et déjà de renforcer les contrôles externes des polices municipales.
Enfin, une mesure législative est nécessaire pour modifier l'article L. 513-1 du CSI.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif poursuivi est, compte tenu du renforcement des prérogatives du CNFPT en matière de formation des policiers municipaux, notamment à l'armement, de pouvoir y effectuer une mission de vérification.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Il aurait pu être envisagé de maintenir le cadre juridique actuel. Toutefois, cette option a été écartée. En effet, la montée en professionnalisme, l'accroissement de l'armement, le renforcement des prérogatives des policiers municipaux ont mis l'accent ces dernières années sur l'importance de leur formation et sa qualité.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'article vise, compte tenu du renforcement des prérogatives du CNFPT en matière de formation des policiers municipaux, notamment à l'armement, d'ouvrir la possibilité d'y effectuer une mission de vérification et de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat pour fixer les modalités d'application du dispositif.
Cette mission de vérification peut être demandée par le président du CNFPT, par le procureur de la République, par le préfet de police ou le représentant de l'Etat dans le département au ministre de l'intérieur ou au ministre chargé des collectivités territoriales. A cette fin, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales fixera les modalités de cette vérification et désignera notamment le service d'inspection générale de l'Etat en charge de celle-ci.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article modifie l'article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le président du CNFPT deviendra compétent pour également participer, s'agissant de ses activités de formation des agents de police municipale, au déclenchement et au cadrage d'une mission de vérification par les services d'inspection générale de l'Etat.
Les centres de formation du CNFPT pourront être inspectés par les services d'inspection générale de l'Etat afin que les conditions de formation des agents de police municipale puissent être auditées. Ces inspections garantiront la qualité des formations délivrées par le CNFPT.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Le ministère de l'intérieur et le ministère chargé des collectivités territoriales deviendront compétents pour participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux missions de vérification de l'organisation et du fonctionnement des activités de formation des fonctionnaires de police municipale réalisés par le CNFPT.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Cette mesure met en place un dispositif de contrôle de l'organisme en charge de la formation des policiers municipaux permettant ainsi une meilleure formation de ceux-ci.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN), a été saisi pour avis, à tire obligatoire, en application de l'application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, et a rendu un avis favorable le 2 octobre 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La mesure entrera en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
La mesure s'applique sur l'ensemble du territoire hexagonal.
Elle s'applique de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et à Mayotte), sans adaptation particulière.
Elle s'applique également à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, qui relèvent du principe d'identité législative pour la mesure envisagée, sans adaptation particulière.
En revanche, dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative, cette mesure ne s'applique pas dans les îles Wallis-et-Futuna et elle nécessite l'insertion d'une mention expresse d'application dans les collectivités de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
Le tableau ci-dessous détaille les articles à modifier.
|
Polynésie française |
Modification de l'article L. 545-1 du code de la sécurité intérieure |
|
Nouvelle-Calédonie |
Modification de l'article L. 546-1 du code de la sécurité intérieure |
5.2.3. Textes d'application
Le présent article nécessitera la prise d'un décret d'application en Conseil d'Etat afin de fixer les modalités d'application du dispositif de contrôle des services de police municipale par les services d'inspection générale de l'Etat.
Article 17 - Étendre aux gardes champêtres le code de déontologie des agents de police municipale
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le code de déontologie des agents de police municipale a été créé par l'article 10 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales. Cette loi a mis en place le cadre actuel des services de police municipale et a assuré leur reconnaissance comme un élément important du paysage sécuritaire français.
La création d'un code de déontologie des agents de police municipale avait plusieurs objectifs dont notamment la fixation de règles de conduite communes à l'ensemble des policiers municipaux en lien avec les devoirs des fonctionnaires : neutralité, probité, loyauté, ..., mais également, la mise en cohérence avec la police et la gendarmerie nationales qui en sont dotés.
Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes. Ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et aux arrêtés de police municipale ( L. 521-1 du code de la sécurité intérieure). À cette fin, ils peuvent relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent ( L. 522-4 du code de la sécurité intérieure).
Ils disposent également de compétences spécialisées, décrites dans plusieurs codes, notamment en matière :
- de circulation et stationnement ( art. L. 130-4 du code de la route) ;
- d'environnement ( L. 332-20 du code de l'environnement pour les réserves naturelles, L. 428-20 du code de l'environnement pour la police de la chasse, L. 541-44 du code de l'environnement pour la police des déchet, L. 415-3 du code de l'environnement pour la protection du patrimoine naturelle, L. 437-1 du code de l'environnement pour la police de la pêche en eau douce) ;
- de dépistage d'alcoolémie ( L. 521-1 du code de la sécurité intérieure) ;
- de forêt ( L. 161-4 du code forestier) ;
- funéraire ( L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales).
Si leur nombre est en constante diminution (602 au 31/12/2023 d'après les dernières données du ministère de l'intérieur, contre 1240 en 2012), ils contribuent activement à la prévention des troubles à l'ordre public sous l'impulsion du maire. Plusieurs dispositions du présent projet de loi visent d'ailleurs à renforcer leurs compétences afin de les harmoniser avec celles des agents de police municipale.
Ce rapprochement des pouvoirs des gardes champêtres avec les agents de police municipale justifie qu'ils soient soumis aux mêmes obligations déontologiques. Or aujourd'hui, si les agents de police municipale sont soumis à un code de déontologie prévu par l'article L. 515-1 du code de la sécurité intérieure et établi par un décret en Conseil d'État ( articles R. 515-1 à R. 515-21 du code de la sécurité intérieure), tel n'est pas le cas des gardes champêtres.
Certes les gardes champêtres sont soumis aux obligations générales des agents publics définies notamment aux articles L. 121-1 et suivants du code général de la fonction publique (obligation d'exercer ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité, neutralité, etc.), mais compte tenu des prérogatives croissantes qui leurs sont accordées, il apparaît nécessaire, comme pour les agents de police municipale, de formaliser les exigences déontologiques qui leur sont spécifiquement applicables dans un code de déontologie.
Dans cette perspective, le présent article vise à étendre aux gardes champêtres le code de déontologie applicable aux agents de police municipale. À cette fin, il crée un nouveau chapitre au sein du titre du code de la sécurité intérieure consacré aux gardes champêtres, avec un nouvel article renvoyant au code de déontologie des agents de police municipale, étendu aux gardes champêtres.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'évolution des dispositions relatives aux polices municipales et aux gardes champêtres s'inscrit dans le cadre des objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions (décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021) ; ces missions seront réalisées sous le contrôle de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle aux termes de l'article 66 de la Constitution. La police municipale intervient en outre dans les limites fixées par la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, dont les articles 9 et 12 précisent le cadre applicable à la nécessité des mesures prises pour interpeller les personnes et à celle d'une force publique indispensable à la garantie des droits.
Dans le texte proposé, l'action de la police municipale et des gardes champêtres demeure encadrée par le législateur et dirigée par le maire, conformément à la libre administration des collectivités territoriales, qui a valeur constitutionnelle (Décision n° 79-104 DC du 23 mai 1979) et est inhérente à l'organisation décentralisée de la République. La police municipale et les gardes champêtres opèrent ainsi sous contrôle du législateur et dans le respect des droits et garanties constitutionnels.
En outre, le présent article vise à garantir notamment le principe de non-discrimination et d'égalité (article 1er de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen), la liberté d'expression (article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen) sous réserve du respect des devoirs liés à leurs fonctions.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le présent article s'inscrit dans le cadre du respect des traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (droit à la liberté et à la sûreté, l'interdiction de la discrimination, liberté d'expression, etc.).
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Le code de déontologie des agents de police municipale étant prévu par la loi, un vecteur législatif est nécessaire pour l'étendre aux gardes champêtres.
En outre, compte tenu du renforcement des prérogatives des gardes champêtres par le présent projet de loi, il convient de les soumettre au respect d'un code de déontologie commun avec les policiers municipaux.
Cette extension est apparue nécessaire car même s'ils sont soumis aux obligations générales des agents publics, la particularité de leurs missions nécessite de formaliser des exigences déontologiques spécifiques (usage de l'arme, l'utilisation de la contrainte, etc.)
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif poursuivi est, de faciliter la compréhension des exigences déontologiques applicables aux gardes champêtres en synthétisant les droits et devoirs applicables à ces derniers dans l'exercice de leurs fonctions. De plus, cet article a vocation à renforcer la confiance de la population à l'égard des gardes champêtres. Enfin, il permet une cohérence juridique avec les agents de police municipale et les forces de l'ordre.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Il aurait pu être envisagé de soumettre les gardes champêtres à un code de déontologie spécifique. Toutefois, les différences entre les gardes champêtres et les agents de police municipale, qui tendent à se réduire, ne le justifie pas. A titre de comparaison, la police et la gendarmerie nationales sont soumises à un code de déontologie commun prévu à l'article L. 434-1 du CSI.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le présent article étend aux gardes champêtres le code de déontologie prévu à l'article L. 515-1 du CSI. L'article L. 515-1 figurant dans le titre consacré aux polices municipales, le présent article crée également, pour des raisons de lisibilité, un nouveau chapitre au sein du titre du code de la sécurité intérieure consacré aux gardes champêtres, avec un nouvel article L. 522-12 renvoyant au code de déontologie prévu à l'article L. 515-1.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Dans le titre du CSI consacré aux gardes champêtres, le présent article crée un chapitre dédié à la déontologie des gardes champêtres et un article L. 522-12 renvoyant au code de déontologie des policiers municipaux.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Le présent article est conforme aux textes internationaux et européens en vigueur.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Les gardes champêtres devront désormais respecter les dispositions d'un code de déontologie commun avec les policiers municipaux. Cette mesure n'engendre aucun coût budgétaire et aucune modification des droits et devoirs des gardes champêtres vis-à-vis du maire. Ce code de déontologie facilite la compréhension pour les gardes champêtres et les agents de police municipale de leurs droits et devoirs dans l'exercice de leurs fonctions respectives.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Le renforcement des exigences déontologiques des gardes champêtres profitera à l'ensemble de la société, tant en améliorant la qualité du service rendu qu'en renforçant le lien de confiance entre la population et les forces de sécurité au sens large.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été saisi pour avis, à titre obligatoire, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis favorable en date du 2 octobre 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
La mesure s'applique sur l'ensemble du territoire hexagonale.
Elle s'applique de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et à Mayotte), sans adaptation particulière.
Elle s'applique également à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, qui relèvent du principe d'identité législative pour la mesure envisagée, sans adaptation particulière.
En revanche, dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative, cette mesure ne s'applique ni dans les îles Wallis-et-Futuna ni en Nouvelle-Calédonie. Elle nécessite l'insertion d'une mention expresse d'application pour la collectivité de la Polynésie française, c'est-à-dire une modification de l'article L. 545-1 du code de la sécurité intérieure. L'article 19 du présent projet de loi procède à cette insertion.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article nécessitera la prise d'un décret en Conseil d'Etat afin d'adapter et mettre en cohérence le contenu du code de déontologie des policiers municipaux prévu par les articles R. 515-1 à R. 515-21 du code de la sécurité intérieure pour y inclure les gardes champêtres.
Article 18 - Étendre la compétence de la commission consultative des polices municipales (CCPM) à la thématique des gardes champêtres
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
La Commission consultative des polices municipales (CCPM) est prévue à l'article L. 514-1 du CSI. Le détail de sa composition et son fonctionnement sont prévus dans la partie réglementaire du CSI (respectivement articles R. 514-1 à R. 514-5 et R. 514-6 à R. 514-11).
Il s'agit d'une instance consultative auprès du ministre de l'Intérieur composée de huit maires ou adjoints au maire (répartis par collège selon le nombre d'habitants de leur commune), de huit représentants de l'État et de huit représentants des agents de police municipale.
Cette commission est obligatoirement consultée sur le contenu des arrêtés du ministre de l'intérieur relatif aux équipements des polices municipales (tenues, véhicules, carte professionnelle, etc.) et sur le code de déontologie des agents de police municipale (article L. 515-1 CSI).
Elle peut également être saisie de toute autre question intéressant plus généralement l'organisation et le fonctionnement des polices municipales. L'article 15 de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a complété l'article L. 514-1 du CSI pour préciser que : « La commission consultative des polices municipales traite de tous sujets concernant les polices municipales, à l'exception des sujets liés au statut des agents ».
Elle se réunit en moyenne une fois par an depuis sa création en 2010. Toutefois, elle n'a pas été réunie en 2020, 2021, 2022 en raison du contexte sanitaire, ni en 2024 en raison de l'organisation du « Beauvau des Polices municipales » qui a donné lieu à de nombreuses concertations avec les membres représentés dans cette commission sans qu'une réunion formelle de celle-ci n'apparaisse nécessaire. Elle s'est donc réunie pour la dernière fois le 16 mai 2023, réunion au cours de laquelle elle a notamment rendu un avis favorable à l'arrêté réglementant l'utilisation de herses par les agents de police municipale.
En raison des problématiques similaires rencontrées par les policiers municipaux et les gardes champêtres (même autorité d'emploi, mêmes lieux d'intervention, mêmes prérogatives, mêmes équipements), il est apparu nécessaire d'élargir le champ de compétences de la CCPM afin qu'elle puisse traiter des thématiques des gardes champêtres. Ce besoin apparaît d'autant plus nécessaire que plusieurs dispositions du présent projet de loi tendent à harmoniser les compétences des policiers municipaux et des gardes champêtres.
Le présent article étend donc le périmètre de compétence de la CCPM à tous les sujets concernant les gardes champêtres, à l'exception de ceux liés au statut des agents. Il modifie, par conséquent, sa composition, sans modifier le nombre de ses membres. La commission est renommée : « commission consultative des polices municipales et des gardes champêtres ».
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'évolution des dispositions relatives aux polices municipales et aux gardes champêtres s'inscrit dans le cadre des objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions ( décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021) ; ces missions seront réalisées sous le contrôle de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle aux termes de l'article 66 de la Constitution. La police municipale intervient en outre dans les limites fixées par la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, dont les articles 9 et 12 précisent le cadre applicable à la nécessité des mesures prises pour interpeller les personnes et à celle d'une force publique indispensable à la garantie des droits.
Dans le texte proposé, l'action de la police municipale et des gardes champêtres demeure encadrée par le législateur et dirigée par le maire, conformément à la libre administration des collectivités territoriales, qui a valeur constitutionnelle ( Décision n° 79-104 DC du 23 mai 1979) et est inhérente à l'organisation décentralisée de la République. L'élargissement du champ de compétence de la CCPM, au sein de laquelle sont représentés les élus locaux, va dans ce sens. La police municipale et les gardes champêtres opèrent ainsi sous contrôle du législateur et dans le respect des droits et garanties constitutionnels.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
En raison des problématiques similaires rencontrées par les policiers municipaux et les gardes champêtres (même autorité d'emploi, mêmes lieux d'intervention, mêmes prérogatives, mêmes équipements), il est apparu nécessaire d'élargir le champ de compétences de la CCPM afin qu'elle puisse traiter des thématiques des gardes champêtres. Ce besoin apparaît d'autant plus nécessaire que plusieurs dispositions du présent projet de loi tendent à harmoniser les compétences des policiers municipaux et des gardes champêtres.
Le présent article étend donc le périmètre de compétence de la CCPM à tous les sujets concernant les gardes champêtres, à l'exception de ceux liés au statut des agents. Dès lors, une mesure législative est nécessaire pour modifier l'article L. 514-1 du CSI.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif poursuivi est, compte tenu du renforcement des prérogatives des gardes champêtres par le présent projet de loi, d'étendre le champ de compétences de la CCPM aux sujets les concernant.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Plutôt que de créer une commission spécifique, ce qui aurait constitué une charge supplémentaire, il est proposé d'étendre les compétences de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 514-1 du CSI et dont le détail de sa composition et le fonctionnement sont prévus dans la partie réglementaire du CSI (respectivement aux articles R. 514-1 à R. 514-5 et R. 514-6 à R. 514-11).
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'article vise à étendre la compétence de la CCPM à tous les sujets concernant les gardes champêtres, à l'exception des sujets statutaires. En conséquence, il modifie la composition de la CCPM afin de mentionner les gardes champêtres, sans modifier le nombre de membres, en précisant qu'elle est composée pour un tiers de représentants des maires ou adjoints au maire des communes employant des agents de police municipale ou des gardes champêtres ou faisant partie d'un établissement public de coopération intercommunale employant des agents de police municipale ou des gardes champêtres, pour un tiers de représentants de l'État et, pour le dernier tiers, de représentants des agents de police municipale ou des gardes champêtres choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux.
En outre, la commission est renommée : « commission consultative des polices municipales et des gardes champêtres ».
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article modifie l'article L. 514-1 du CSI pour y intégrer les gardes champêtres.
De plus, dans une logique de mise en cohérence, la référence à la « commission consultative des polices municipales » est remplacée par une référence à la « commission consultative des polices municipales et des gardes champêtres » dans l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre V de la partie législative du code de la sécurité intérieure, et dans toutes les dispositions législatives en vigueur, notamment les articles L. 511 4 et L. 515 1 du même code.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
L'extension aux gardes champêtres de la compétence de la CCPM n'aura pas d'impact sur le budget de cette commission, le nombre de membres la composant n'étant pas modifié.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Les gardes champêtres disposeront désormais de représentants à la CCPM qui pourra aborder tous les sujets les concernant, à l'exception des sujets statutaires. Le nombre de membres de la CCPM ne sera pas modifié, toutefois, un décret en Conseil d'Etat est nécessaire afin de prévoir, dans les dispositions réglementaires, la présence des gardes champêtres.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La composition de la CCPM sera modifiée par un décret en Conseil d'Etat, sans modification du nombre de ses membres.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été saisi pour avis, à titre obligatoire, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités locales et a rendu un avis favorable le 2 octobre 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
La mesure s'applique sur l'ensemble du territoire hexagonal.
Elle s'applique de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et à Mayotte), sans adaptation particulière.
Elle s'applique également à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, qui relèvent du principe d'identité législative pour la mesure envisagée, sans adaptation particulière.
En revanche, dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative, cette mesure ne s'applique ni dans les îles Wallis-et-Futuna ni en Nouvelle-Calédonie. Elle nécessite l'insertion d'une mention expresse d'application pour la collectivité de la Polynésie française, c'est-à-dire une modification de l'article L. 545-1 du code de la sécurité intérieure. L'article 19 du présent projet de loi procède à cette insertion.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article nécessitera la prise d'un décret en Conseil d'Etat afin de redéfinir la composition précise de la CCPM (modification de l'article R. 514-1 du CSI afin d'y inclure les représentants des gardes champêtres) et d'adapter la dénomination de la CCPM dans les textes réglementaires la mentionnant.
TITRE VII - DISPOSITIONS D'ADAPTATION DANS LES OUTRE-MER
Article 19 - Dispositions d'adaptation dans les outre-mer
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
- Concernant le code de la sécurité intérieure
De manière générale, les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux agents de police municipale et aux gardes champêtres sont applicables de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte) ainsi que dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution qui relèvent en la matière de l'identité législative (Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).
Concernant les conditions d'application dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution qui relèvent de la spécialité législative (les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises), les dispositions du présent projet de loi s'appliquent dans les conditions suivantes :
- La plupart des dispositions relatives aux polices municipales et aux gardes champêtres sont applicables en Polynésie française, par mention expresse d'application.
- La plupart des dispositions relatives aux polices municipales sont applicables en Nouvelle-Calédonie, par mention expresse d'application. Cependant, les dispositions relatives aux gardes-champêtres sont régies, en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, par des dispositions spécifiques, à savoir les articles L. 546-2 à L. 546-7.
Au regard de l'objet de ce projet de loi, ses dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer dans les îles Wallis et Futuna, ni dans les Terres australes et antarctiques françaises, collectivités qui ne comportent pas de communes ni donc de polices municipales.
- Concernant le code de la route
L'État est compétent en matière de circulation routière et de transports routiers en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces collectivités sont régies par le code de la route de droit commun. Les dispositions contenues dans ce projet d'arrêté s'appliquent donc de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion et à Mayotte) ainsi que dans la collectivité régie par l'article 74 de la Constitution qui relève de l'identité législative pour les matières traitées par ce projet (Saint-Pierre-et-Miquelon).
Par contre, la compétence en matière de circulation routière et de transports routiers appartient à la collectivité à Saint-Martin (L.O. 6314-3 CGCT) et Saint-Barthélemy (article L.O. 6214-3 CGCT), en Polynésie française (article 90, 15° et 34 L.O. n° 2004-192), en Nouvelle-Calédonie (article 22, 12° et 13° L.O. n° 99-209) et dans les îles Wallis et Futuna (article 40, 17° du décret n°57-811), qui disposent de codes de la route locaux. Toutefois, certaines dispositions, peuvent y être rendues applicables en fonction de leur objet. C'est notamment le cas des articles L. 130-9-3 et L. 325-2 du code de la route, créés ou modifiés par le présent projet de loi.
- Concernant le code de procédure pénale
De manière générale, le code de procédure pénale est applicable de plein droit dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de l'article 74 régies par le principe d'identité législative en la matière (Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon). Il est également applicable sur mention expresse d'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
- Concernant le code rural et de la pêche maritime
Les dispositions du code rural et de la pêche maritime sont applicables de plein droit dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de l'article 74 régies par le principe d'identité législative en la matière (Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon). Certaines dispositions de ce code sont également applicables sur mention expresse d'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. C'est notamment le cas de l'article L. 211-24 modifié par le présent projet de loi qui est étendu en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les îles Wallis et Futuna ne comportant pas de police municipale.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Les dispositions prévues par le projet de loi ont vocation à être appliquées sur l'ensemble du territoire, y compris dans les collectivités d'outre-mer, à l'exception des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, au regard de l'objet du projet de loi.
La Constitution opère une distinction entre les différentes collectivités d'outre-mer :
- Les collectivités soumises au principe d'identité législative (collectivités de l'article 73, ainsi que certaines collectivités relevant de l'article 74). Dans ces collectivités, les lois et règlements sont applicables de plein droit, sous réserve d'adaptation ;
- Les collectivités soumises au principe de spécialité législative (collectivités de l'article 74 et Nouvelle-Calédonie). Dans ces collectivités, dans les matières pour lesquelles l'Etat demeure compétent, les lois et règlements n'y sont applicables que sur mention expresse d'application, sous réserve d'adaptation.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Les extensions et adaptations des dispositions applicables en outre-mer sont opérées par un texte de même niveau normatif que les dispositions applicables sur le territoire hexagonal.
Dans ce cadre, soit le projet de loi prévoit lui-même les extensions et adaptations nécessaires pour son application dans les outre-mer, soit ces extensions et adaptations sont opérées ultérieurement par le Gouvernement par le mécanisme des ordonnances.
L'article 19 du projet de loi prévoit ainsi l'extension en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'ensemble des dispositions codifiées relevant de la compétence de l'Etat, par la mise à jour des compteurs figurant dans les codes impactés par ce projet de loi.
Certaines dispositions, non codifiées, font, par ailleurs, l'objet de simples mentions expresses d'application.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le premier objectif, général, est l'application des dispositions de ce projet sur l'ensemble du territoire, à l'exception des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.
Le second objectif, propre à la Nouvelle-Calédonie, est l'harmonisation du cadre légal relatif aux gardes champêtres avec le cadre national.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
L'article 74-1 prévoit une habilitation permanente du Gouvernement à étendre et adapter des dispositions législatives dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. Dans ce cadre, les collectivités de l'article 73 se trouvent exclues de ce dispositif, ce qui restreint le champ d'application de cette procédure. De plus, l'article 74-1 oblige une ratification de l'ordonnance dans un délai de 18 mois suivant sa publication, sans laquelle l'ordonnance devient caduque.
Par ailleurs, le recours à une ordonnance de l'article 38 de la Constitution aurait pu être envisagé mais est créateur de complexité, en ce qu'il interdit l'extension immédiate des textes réglementaires d'application des dispositions de droit commun, dans l'attente des prescriptions de l'ordonnance en cause.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le présent article du projet de loi prévoit ainsi l'extension en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'ensemble des dispositions codifiées relevant de la compétence de l'Etat, par la mise à jour des compteurs figurant dans les codes impactés par ce projet de loi.
Le I de l'article 19 prévoit l'extension en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions modifiées du code de la sécurité intérieure, par la mise à jour des compteurs figurant aux articles L. 155-1, L. 156-1, L. 285-1, L. 286-1, L. 545-1 et L. 546-1 du code de la sécurité intérieure.
Par ailleurs, l'extension des dispositions relatives aux gardes champêtres en Nouvelle-Calédonie nécessite la suppression des dispositions particulières applicables à cette collectivité, prévue aux articles L. 546-2 à L. 546-7, afin de prévoir, au sein de l'article L. 546-1, que les articles de droit commun relatifs aux gardes champêtres sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au sein de ce même article.
En outre, les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à la formation et à la déontologie des policiers municipaux et des gardes champêtres ne sont pas étendues en Nouvelle-Calédonie en raison de la compétence de la collectivité en la matière.
Le II de l'article 19 prévoit l'extension dans les collectivités d'outre-mer des dispositions modifiées du code de la route, par la mise à jour des compteurs figurant aux articles L. 143-1, L. 343-1 et L. 344-1 du code de la route.
A ce titre, l'extension en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 130-9-3 du code de la route, créé par le présent projet de loi, nécessite une réécriture complète de l'article L. 143-1 du code de la route. Tel est l'objet du 1° du II de l'article 19.
Le III de l'article 19 prévoit l'extension dans les collectivités d'outre-mer des dispositions modifiées du code de procédure pénal par la mise à jour du compteur figurant à l'article 804 du code de procédure pénale.
Le IV de l'article 19 prévoit l'extension dans les collectivités d'outre-mer des dispositions modifiées du code rural et de la pêche maritime par la mise à jour des compteurs figurant aux articles L. 275-5 et L. 275-10 du code rural et de la pêche maritime.
Enfin, le V de l'article 19 prévoit également l'application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du IV de l'article 7 et du IV de l'article 15, dispositions non codifiées du présent projet de loi prévoyant une entrée en vigueur différée des modifications prévues articles L. 522-1, L. 522-6 et L. 522-7 du code de la sécurité intérieure.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
La disposition envisagée vise à modifier les articles L. 155-1, L. 156-1, L. 285-1, L. 286-1 et L. 545-1, L. 545-2, L. 546-1 et L. 546-1-1 du code de la sécurité intérieure, les articles L. 143-1, L. 343-1 et L. 344-1 du code de la route, l'article 804 du code de procédure pénale ainsi que les articles L. 275-5 et L. 275-10 du code rural et de la pêche maritime. Ces articles définissent les dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer.
Par ailleurs, les articles L. 546-2 à L. 546-7 du code de la sécurité intérieure sont abrogés.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
L'application de certaines mesures dans les Outre-mer nécessitera des adaptations techniques substantielles. C'est en particulier les cas pour la procédure électronique des amendes forfaitaires délictuelles, en raison des particularités locales (gestion de certains fichiers, compétences des collectivités, franc pacifique, etc.).
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Les dispositions qui modifient l'article L. 546-1 et suppriment les articles L. 546-2 à L. 546-7 du code de la sécurité intérieure, nécessitent la consultation du Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
La loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prévoit en effet, dans son article 90, que "Le congrès est consulté par le haut-commissaire : 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie ;".
Or, ce projet de loi supprime les articles L. 546-2 à L. 546-7 du code de la sécurité intérieure, qui sont des dispositions particulières relatives aux gardes-champêtres en Nouvelle-Calédonie, afin de rendre applicable le droit commun relatif aux gardes champêtres, tout en prévoyant des adaptations spécifiques pour son application en Nouvelle-Calédonie.
Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a été saisi le 16 septembre 2025 et a rendu un avis favorable le 3 octobre 2025.
En application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été saisi le 8 septembre 2025 et a rendu un avis favorable le 2 octobre 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Sans objet.
5.2.2. Application dans l'espace
L'objet même de cet article est de définir les dispositions du présent projet de loi applicables dans les collectivités d'outre-mer.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert pas de texte d'application.
* 1 La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne facilite le contrôle des véhicules, la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière étend le champ des infractions qu'ils peuvent constater, la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure permet les mises en fourrière de véhicule par les policiers municipaux.
* 2 Loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.
* 3 Article 20 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs
* 4 LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
* 5 Article 50 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.
* 6 Article 1 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
* 7 Par référence à l' article L613-3 du CSI.
* 8 Article 4 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.
* 9 Article 40 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.
* 11 Article 40 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.
* 12 Article 3 de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique.
* 13 Article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.
* 14 Article 18 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés .
* 15 Article 12 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.
* 16 Décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 - Loi pour une sécurité globale préservant les libertés.
* 17 Décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022Loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
* 18 Article 17 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.
* 19 Article 43 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
* 20 Article 4 de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
* 21 Article 8 de la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.
* 22 Article L324-1 du code de la route.
* 23 Article L221-2 du code de la route.
* 25 Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 - Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
* 26 Décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 - Loi pour une sécurité globale préservant les libertés
* 27 CAYREL L., DIEDERICHS O. - avec le concours de l'IGPN et de l'IGGN, Rapport sur le rôle et le positionnement des polices municipales, Inspection Générale de l'Administration, MIOMCTI, décembre 2010, 102 p., pp.21-22
* 28 ROYER-PERREAUT L., VINCENDET A., députés, Rapport d'information sur les missions et l'attractivité des polices municipales, n° 1544, déposé le mercredi 19 juillet 2023.
* 29 François-Noël Buffet donne un nouvel élan au Beauvau des Polices municipales, Communiqué de presse du MI, 21 février 2025
* 30 Beauvau des polices municipales : François-Noël Buffet poursuit ses concertations sur le terrain, Communiqué de presse du MI, 4 mars 2025
* 31 François-Noël Buffet et Laurent Marcangeli conduisent ensemble la troisième concertation du Beauvau des polices municipales, Communiqué de presse du MI, 7 mars 2025
* 32 François-Noël Buffet clôture les concertations du Beauvau des polices municipales, Communiqué de presse du MI, 10 mars 2025
* 34 Projet de loi n° 815 relatif aux polices municipales déposé le 1er avril 1998.
* 35 Article L. 480-1 du code de l'urbanisme.
* 36 Voir à ce sujet le livre blanc de la sécurité intérieure « Le lien direct avec la population est indispensable au bon exercice des missions de police et contribue à la visibilité et à la légitimité des forces. Dès lors, orienter les polices municipales principalement vers une présence de proximité ne doit pas revenir à leur déléguer cette compétence, mais à mieux répartir entre tous les acteurs une mission attendue par la population. Cette offre nouvelle doit se faire en complémentarité de l'offre de sécurité que déploient la police et la gendarmerie, et non pas en substitution, et sur la base de conventions de coordinations claires, précises et contraignantes pour les parties signataires. » (p.47)
* 37 Ce concept est notamment défini dans le livre blanc de la sécurité intérieure : « L'idée cardinale défendue au travers du continuum de sécurité consiste à rappeler que les forces de sécurité intérieure ne peuvent pas seules répondre à l'ensemble des problèmes de sécurité. Parce d'autres d'acteurs peuvent jouer leur rôle dans le cadre d'un partenariat renforcé, encore faut-il leur donner les moyens en étendant leurs compétences. ».
* 38 25 propositions pour donner aux polices municipales les moyens de lutter contre l'insécurité du quotidien, Rapport d'information n° 671 (2024-2025), déposé le 28 mai 2025.
* 39 Ibid.
* 40 Ibid.
* 41 « Les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques » ( art L. 511-1, al 1er, du code de la sécurité intérieure).
* 43 Article R.15-33-29-3 du CPP.
* 45 Article R. 130-2 du code de la route.
* 46 Article L. 116-2 du code de la voirie routière.
* 47 Avant-dernier alinéa de l'article 21 du CPP.
* 48 Avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1 du CSI.
* 49 Articles L. 331-20, L. 415-1, L. 437-1, L. 541-44 et L. 581-40 du code de l'environnement.
* 50 Article L. 215-3-1 du code rural et la pêche maritime.
* 51 Article L. 3631-2 du code de la santé publique.
* 52 Deuxième alinéa de l' article L. 521-1 du CSI.
* 53 Article R.15-33-29-3 du CPP.
* 54 Article R. 130-3 du code de la route.
* 55 Articles L. 216-3, L. 231-5, L. 331-20, L. 332-20, L. 362-5, L. 415-1, L. 428-20, L. 437-1, L. 541-44 et L. 581-40 du code de l'environnement.
* 56 Article L. 215-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
* 57 Article L. 3631-2 du code de la santé publique.
* 58 Article 24 du code de procédure pénale.
* 59 Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, cons. 59.
* 60 Loi n°2021-646 du 25 mai 2021, Pour une sécurité globale préservant les libertés.
* 61 Ibid. paragr. 11
* 62 Rapport de la Cour des comptes « les polices municipales » d'octobre 2020.
* 63 https://www.info.gouv.fr/communique/10494-remise-du-rapport-d-un-continuum-de-securite-vers-une-securite-globale.
* 64 Préservation des atteintes au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publiques ( art L. 511-1, 1er alinéa, du code de la sécurité intérieure).
* 65 Cf. par comparaison la reconnaissance des instructions générales émises par les officiers de police judiciaire à l'attention des agents de police judiciaire pour la réalisation de contrôles d'identité (article 78-2 du code de procédure pénale).
* 66 Alinéa 2 de l'article L.511-5 du code de la sécurité intérieure.
* 67 Article 66 de la Constitution, mentionné par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 sur la loi sécurité globale (§ 4 et suivants)
* 68 Cour des comptes, La répartition des zones de compétence entre la police et la gendarmerie nationales, 13 janvier 2025, 125 p.
* 69 SSMSI, Les amendes forfaitaires délictuelles : un dispositif en plein essor, n°76, juillet 2025, 10 p.
* 70. « La formation de la police judiciaire repose sur trois blocs : la formation initiale, au terme de laquelle les commissaires et les officiers acquièrent automatiquement la qualité d'OPJ, la formation dite du « bloc OPJ », qui permet aux gardiens de la paix d'obtenir cette qualification en cours de carrière [...]. La formation du « bloc OPJ » relève de la compétence exclusive de la DCRFPN et est assurée par des formateurs dédiés. Elle conditionne l'obtention de la qualification pour les gardiens comptant au moins trois ans d'ancienneté, après le passage d'un examen technique et sur avis conforme d'une commission. La formation a été modifiée à plusieurs reprises : en 2009 avec une refonte autour de l'approche par compétences, puis en 2015 et en 2019 avec l'introduction d'enseignements à distance inspirés du modèle de la gendarmerie, afin de réduire le temps passé par les stagiaires hors de leur domicile. Elle s'étend actuellement sur 14 semaines, dont cinq semaines d'enseignement à distance et neuf en présentiel. » Cour des Comptes, la formation des policiers, février 2022, 164 p.
* 71 Il s'agit des procédures pour lesquelles une enquête de police est diligentée.
* 72 En 2021, les parquets ont enregistré 2 797 232 affaires délictuelles, d'après le site du ministère de la Justice.
* 73 https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques-de-presse/francois-noel-buffet-cloture-concertations-du-beauvau-des-polices.
* 74 Circulaire du 26 mai 2003 relative aux compétences des polices municipales, page 9.
* 75 Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi d'orientation et de programmation de la sécurité intérieure, cons. 59 et 60.
* 76 CEDH, Affaire Basu c. Allemagne, 18 octobre 2022, requête n° 215/39, § 43 et 44.
* 77 CEDH 20 févr. 2024, Wa baile c/ Suisse, nos 43868/18 et 25883/21 ; Basu c. Allemagne, n° 215/19, 18 octobre 2022, et Muhammad c. Espagne, n° 34085/17, 18 octobre 2022.
* 78 https://ks.echr.coe.int/fr/web/echr-ks/
* 79 https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques-de-presse/lancement-dun-cycle-de-rencontres-autour-du-statut-et-du-role-des.
* 80 https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques-de-presse/francois-noel-buffet-donne-nouvel-elan-au-beauvau-des-polices
* 81 Alinéa 1 de l'article L. 325-1 du code de la route
* 82 Alinéa 2 de l'article L. 325-1 du code de la route
* 83 CEDH, 11 juillet 2006, Affaire Jalloh c. Allemagne, n°548110/00, paragraphes 70 et 71
* 84 CEDH, 2 juillet 2019, Affaire R.S c. Hongrie, n°65290/14
* 85 CEDH, 5 janvier 2006, Affaire Schmidt c. Allemagne, n° 32352/02
* 86 CEDH, 18 janvier 1918, Affaire fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (fnass) et autres c. France, n°48151/11 et 77769/13, paragraphe 154.
* 87 CEDH, 16 mai 2019, Halabi, 66554/14 paragraphes 58 et 61.
* 88 Ces réserves sont, à l'exception de la dernière, celles qui figurent habituellement dans les articles d'habilitation à procéder à des codifications ou recodifications à droit constant.
* 89 Décision n° 2004-510 du 20 janvier 2005.
* 90 Décision n°99-421 du 16 décembre 1999, cons. 15.
* 91 Décision n° 99-421 du 16 décembre 1999, cons. 8.
* 92 Décision n°2003-473 du 26 juin 2003, cons. 10.
* 93 « 25 propositions pour donner aux polices municipales les moyens de lutter contre l'insécurité du quotidien », rapport d'information n° 671(2024-2025) déposé le 28 mai 2025 (II.B.3.b ; proposition n° 8).
* 94 La notion de « grands rassemblements » visée se distingue de celle prévue à l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure qui peut être désignée par décret.
* 95 Déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025-878 DC du 24 avril 2025, Loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports.
* 96 Le ministère de l'Intérieur a été informé de ce que l'expérimentation a été conduite au moyen de 16 caméras employées par 39 agents affectés sur 138 communes réparties dans 8 départements. Il s'agit : dans le département des Alpes-Maritimes (06) de la commune du Broc ; dans le département de l'Indre-et-Loire (37) de la commune de Monnaie ; dans le département du Loiret (45) de la commune de Loury ; dans le département de l'Oise (60) de la commune d'Ansauvillers ; dans le département des Pyrénées-Orientales (66) de la commune de Vernet-les-Bains ; dans le département du Haut-Rhin (68) du syndicat de la Brigade Verte ; dans le département de l'Essonne (77) de la communauté de commune de l'Orée de la Brie et dans le département du Var (83) les communes de Revest-les-Eaux et de Beausset.
* 97 Seules deux communes n'ont pas fait remonter d'observations sur cette expérimentation.
* 98 « Les gens se calment » note le maire d'Ansauvillers dans l'Oise.
* 99 « Le
résultat est immédiat et permet d'améliorer notoirement
les conditions de travail des gardes
champêtres », note le
rapport de la Brigade verte du département du Haut-Rhin.
* 100 « 25 propositions pour donner aux polices municipales les moyens de lutter contre l'insécurité du quotidien », rapport d'information n° 671(2024-2025) déposé le 28 mai 2025 (II.B.3.b ; proposition n° 9).
* 101 « 25 propositions pour donner aux polices municipales les moyens de lutter contre l'insécurité du quotidien », rapport d'information n° 671 (2024-2025) déposé le 28 mai 2025 (II.B.3.b ; proposition n° 8).
* 102 L'article 8 du projet de loi renvoie aux infractions « prévues par la partie réglementaire du code [de la route] pour lesquelles le titulaire du certificat d'immatriculation est responsable ou redevable pécuniairement, conformément au chapitre 1er du titre 2 du livre 1er [de ce code] ». L'article L. 121-2, qui figure dans ce chapitre 1er, mentionne trois catégories d'infractions : 1° celles à la réglementation sur le stationnement, qui sont prévues aux articles R. 417-1 à R. 417-13 de ce code, pour lesquelles les policiers municipaux et les gardes champêtres sont compétents ; 2° celles relatives à l'acquittement des péages, prévues aux articles R. 419-1 et R. 419-2 de ce code, mais pour lesquelles les policiers municipaux et les gardes champêtres ne sont pas compétents (art. R. 130-2 et R. 130-3 de ce code) ; 3° celles relatives au dépôt d'ordure, qui figure dans le code pénal (art. 635-8 et R. 644-2).
* 103 Ont ainsi été formés : 2 672 policiers municipaux en 2022, 2 873 en 2023 et 2 416 en 2024
* 104 https://www.data.gouv.fr/datasets/police-municipale-effectifs-par-commune.
* 105 https://www.entreprises.gouv.fr/espace-entreprises/s-informer-sur-la-reglementation/stations-classees-et-communes-touristiques.
* 106 Enquête statistiques relatives aux polices municipales 2023 réalisée par le ministère de l'intérieur
* 107 Un centre de supervision urbain (souvent abrégé CSU) est une structure mise en place par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale pour gérer les dispositifs de vidéoprotection installés sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public.
* 108 Enquête statistiques relatives aux polices municipales 2023 réalisée par le ministère de l'intérieur
* 109 L'accès au système d'immatriculation des véhicules et au système national du permis de conduire est possible pour les agents désignés et habilités par le préfet au moyen d'un ordinateur fixe en utilisant le Web service « Portail Polices Municipales » au moyen d'un certificat numérique RGS**, avec carte à puce et code.
* 110 Un accès au fichier des objets volés et signalés (FOVeS) est possible en mobilité pour les agents de police municipale seulement au moyen des terminaux de PV électronique mais il s'agit un accès limité de type hit/no hit : après la saisie de l'immatriculation du véhicule, les agents reçoivent seulement la consigne de contacter la police ou la gendarmerie si le véhicule est signalé ou volé. Un accès aux fichiers déclaration et identification de certains engins motorisés (DICEM), fichier national unique des cycles identifiés (FNUCI) et du système d'information fourrière est également possible pour les agents de police municipale seulement, avec une application ou un portail dédié sur Internet.
* 111 Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, Loi portant création d'une couverture maladie universelle
* 112 Article 66 de la Constitution, visé par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 sur la loi sécurité globale (§ 4 et suivants)
* 113 Service national des enquêtes administratives et de sécurité.