3. Le déplacement au Danemark du président et du rapporteur général de votre commission des finances : la globalisation n'est pas une fatalité pour l'emploi
Du fait d'un modèle fiscal et social original, la mondialisation n'est pas perçue au Danemark comme aussi dangereuse que dans certains pays industrialisés. Au contraire, patronat et syndicats plaident à l'unisson pour la mondialisation : les visions développées dans leurs documents de communication externe sont, de ce point de vue, extrêmement proches.
La population, la classe politique et les milieux syndicaux partagent tous la conviction que le succès de l'Etat-providence repose sur une dynamique associant efficacité et réactivité des entreprises en termes d'investissements et de gestion de personnel, un bon positionnement dans la compétition mondiale, et un financement sain et soutenable des budgets publics, garants de la continuité du système de protection sociale. Cette attitude, certes typique de celle des petits pays très ouverts sur l'extérieur, qui doivent s'adapter pour faire face à la compétition internationale, montre que nos partenaires ont pour certains d'entre eux, plus nombreux qu'on ne l'imagine souvent, réussi leur adaptation à la globalisation et que les délocalisations peuvent, sinon être supprimées, voir leurs effets en termes d'emplois neutralisés par des créations d'activités et d'emplois.
Le taux de chômage s'établit à moins de 6 % de la population active. Le marché danois du travail est ainsi dynamique, malgré un coût salarial parmi les plus élevés d'Europe et une durée annuelle du travail parmi les plus réduites.
a) Un modèle fiscal atypique ?
Le Danemark a adopté en 1987 une réforme fiscale d'envergure : entre 1987 et 1989, les cotisations sociales versées par les employeurs ont été pratiquement supprimées tandis que le manque à gagner pour les finances publiques a été compensé par une augmentation de 3 points du taux de TVA, qui s'établit à 25 %. Ce niveau du taux de TVA, inchangé depuis lors, a été fixé dans le cadre d'un compromis tripartite entre le gouvernement, le patronat et les syndicats.
Ce sont essentiellement les impôts d'Etat et la fiscalité locale , auxquels s'ajoutent quelques cotisations sociales à la charge des seuls salariés, qui financent les dépenses de santé, la politique de l'emploi, l'éducation et la formation professionnelle, ainsi que le premier étage du système de retraites.
|
Structure comparée des prélèvements au Danemark (2002) |
|||
|
(en %) |
|||
|
Danemark |
UE à 15 |
OCDE |
|
|
Impôt sur le revenu des personnes physiques |
53,2 |
25,8 |
26,0 |
|
Impôt sur les sociétés |
5,8 |
8,6 |
9,3 |
|
Cotisations sociales |
3,4 |
28,1 |
25,4 |
|
Taxes sur la propriété |
3,5 |
4,9 |
5,5 |
|
Taxe générale sur la consommation |
19,9 |
18,6 |
18,7 |
|
Taxes spécifiques sur la consommation |
11,4 |
9,9 |
11,3 |
|
Divers |
0,5 |
1,9 |
1,8 |
|
TOTAL |
100 |
100 |
100 |
|
Source : ministère danois des finances |
|||
L'essentiel du financement du système de protection sociale relève ainsi des ménages, par le biais de l'impôt sur le revenu et de la TVA. Par voie de conséquence, l'imposition venant grever les coûts de production des entreprises est réduite au minimum . Les entreprises ne supportent pratiquement plus de cotisations sociales depuis 1987. Le seul élément restant à leur charge est leur contribution partielle au « deuxième étage » du système de retraites, qui en comporte trois, et qui peut s'analyser comme un élément de salaire différé.
Selon les informations communiquées à votre président et à votre rapporteur général, la hausse de la TVA opérée au Danemark en 1987, en contrepartie de la quasi-annulation des charges sociales payées par les employeurs sur les salaires, n'a pas eu d'effet d'entraînement particulier sur l'inflation ou sur les hausses salariales obtenues dans les conventions collectives. En outre, la compétitivité des entreprises danoises a été préservée 16 ( * ) , alors même que les conventions collectives pluriannuelles prévoient des hausses de salaires substantielles. La part des exportations dans le PIB en atteste : elle est supérieure à 35 %, tandis que la balance des paiements courants est positive et atteint 2,7 % du PIB.
b) La flex-sécurité
Le modèle danois repose sur un système dit de « flex-sécurité » combinant une grande flexibilité du marché de l'emploi, un niveau élevé de prestations en cas de chômage et une politique d'« activation » énergique des aides aux chômeurs. Le Danemark se caractérise ainsi par un taux d'activité des femmes et des 50-64 ans sensiblement supérieur à celui de la France. La productivité du travail est élevée et la politique de formation professionnelle jugée efficace de sorte que le « chômage frictionnel » est faible : les entreprises trouvent à « employer toute la population intéressante ».
Il y a là, sinon matière à inspiration, du moins à réflexion ...
*
* *
Ce dernier exemple est particulièrement intéressant, selon votre commission des finances. Il montre que des pays européens, où le coût du travail est élevé, le poids des prélèvements important, peuvent réussir leur adaptation à la globalisation de l'économie, sans « nivellement par le bas », à condition que des réformes structurelles déterminées soient réalisées. Tous les pays de l'ex-Europe des 15 présentent, face aux pays émergents, des caractéristiques très proches, en termes de coût du travail notamment. Or, peu de pays ont un taux de chômage aussi élevé que la France 17 ( * ) .
Taux de chômage dans l'ex-Europe des 15 en 2004
(en % de la population active)
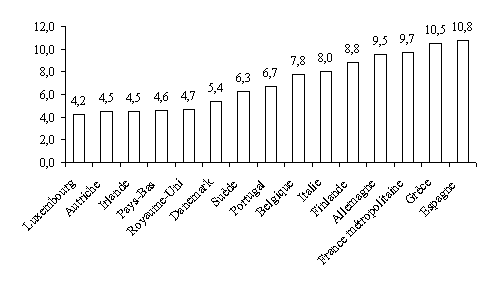
Source : Eurostat, données non désaisonnalisées et harmonisées
Ceci prouve à l'évidence que les délocalisations ne constituent pas une fatalité, ou du moins que les destructions d'emplois qu'elles occasionnent, peuvent être compensées par une dynamique de création d'emplois.
Petit pays, grand pays, zone euro, hors zone euro : aucun de ces critères ne permet d'expliquer pourquoi la France, du point de vue de l'emploi, réussit moins bien que ses partenaires dans la globalisation de l'économie. Dans le mouvement des délocalisations, la France est ainsi placée face à ses responsabilités et ses contradictions.
* 16 Il faut toutefois attirer l'attention sur les spécificités du Danemark, qui expliquent peut-être en partie ce succès. Sur le plan économique, on doit relever l'importance du secteur des services, qui représente environ 70 % du PIB et l'absence de grande industrie concentrée dans des bassins d'emploi localisés et qui pourraient poser des problèmes aigus de reconversion. Sur le plan social, il existe une forte tradition de concertation entre les partenaires sociaux, de sorte que la législation prend un caractère subsidiaire.
* 17 L'Espagne, qui a encore un taux de chômage légèrement supérieur à la France, part d'un niveau très élevé.







