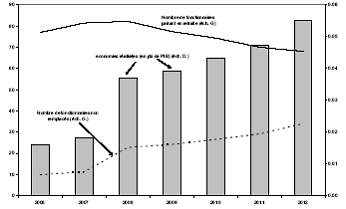Rapport d'information n° 81 (2007-2008) de M. Joël BOURDIN , fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification, déposé le 12 novembre 2007
Synthèse du rapport (107 Koctets)
Disponible au format Acrobat (1,3 Moctet)
-
AVANT-PROPOS
-
CHAPITRE I - UN CONTEXTE INCERTAIN
-
CHAPITRE II - UN POUVOIR D'ACHAT AU SOUTIEN DE LA
CROISSANCE ?
-
I. UNE MODÉRATION SALARIALE
INEXORABLE ?
-
A. UN POUVOIR D'ACHAT FREINÉ PAR LA
MODÉRATION SALARIALE
-
B. LES VOIES D'UNE EVOLUTION PLUS DYNAMIQUE DU
POUVOIR D'ACHAT
-
A. UN POUVOIR D'ACHAT FREINÉ PAR LA
MODÉRATION SALARIALE
-
II. RETOUR SUR LES CONDITIONS D'UNE FORTE
AUGMENTATION DE LA DEMANDE DES MÉNAGES
-
I. UNE MODÉRATION SALARIALE
INEXORABLE ?
-
CHAPITRE III - VERS UNE NOUVELLE DYNAMIQUE DE
L'INVESTISSEMENT ?
-
CHAPITRE IV - VERS UNE ÉLÉVATION DU
RYTHME DE LA CROISSANCE POTENTIELLE ?
-
I. PRODUCTIVITÉ ET CONTENU EN EMPLOIS DE LA
CROISSANCE
-
II. PRODUCTIVITÉ ET CROISSANCE
POTENTIELLE
-
III. LES PRÉMICES D'UN RESSAUT DE LA
CROISSANCE POTENTIELLE DANS LA ZONE EURO
-
I. PRODUCTIVITÉ ET CONTENU EN EMPLOIS DE LA
CROISSANCE
-
CHAPITRE V - QUELLE CONTRIBUTION DU COMMERCE
EXTÉRIEUR À LA CROISSANCE ?
-
CHAPITRE VI - UNE CROISSANCE
PÉNALISÉE PAR UNE CHUTE DES PRIX DE L'IMMOBILIER ?
-
CHAPITRE VII - QUELLE POLITIQUE BUDGÉTAIRE
POUR QUELLE CROISSANCE ?
-
I. UN OBJECTIF DE FORTE RÉÉPARGNE
PUBLIQUE AU MOYEN D'UNE NETTE RÉDUCTION DU POIDS DES DÉPENSES
PUBLIQUES
-
II. UN ENGAGEMENT QUI SUPPOSE UNE REPRISE
ÉCONOMIQUE SOUTENUE ALIMENTÉE PAR UN CHANGEMENT DES COMPORTEMENTS
ÉCONOMIQUES DES AGENTS PRIVÉS
-
III. UNE RÉDUCTION STRUCTURELLE DES
DÉPENSES PUBLIQUES QUI MANIFESTE UN CHOIX AUX ENJEUX IMPORTANTS
-
I. UN OBJECTIF DE FORTE RÉÉPARGNE
PUBLIQUE AU MOYEN D'UNE NETTE RÉDUCTION DU POIDS DES DÉPENSES
PUBLIQUES
-
CHAPITRE VIII - LE DÉSENDETTEMENT PUBLIC,
QUELLE SOUTENABILITÉ ?
-
I. VERS UNE RÉDUCTION STRUCTURELLE DE LA
DETTE PUBLIQUE ?
-
II. QUELLE PORTÉE ATTRIBUER À LA
SURVEILLANCE DES SITUATIONS BUDGÉTAIRES À PARTIR DES PERSPECTIVES
DE DETTE PUBLIQUE ?
-
A. LA ROBUSTESSE RELATIVE DE LA SURVEILLANCE DES
POSITIONS BUDGÉTAIRES À PARTIR DES PERSPECTIVES DE LA DETTE
PUBLIQUE
-
B. UNE MÉTHODE QUI PEUT CONDUIRE À
FIGER LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE, EN CAS D'INTERPRÉTATION
EXCESSIVE
-
C. LA RÉDUCTION DE LA DETTE PUBLIQUE, UNE
PRIORITÉ JUSTIFIÉE DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE ?
-
A. LA ROBUSTESSE RELATIVE DE LA SURVEILLANCE DES
POSITIONS BUDGÉTAIRES À PARTIR DES PERSPECTIVES DE LA DETTE
PUBLIQUE
-
I. VERS UNE RÉDUCTION STRUCTURELLE DE LA
DETTE PUBLIQUE ?
-
CHAPITRE IX - LA POLITIQUE
MONÉTAIRE : ENJEUX ET QUESTIONS
-
EXAMEN EN DÉLÉGATION
-
ANNEXE : RAPPORT DE L'OFCE
N° 81
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008
|
Annexe au procès-verbal de la séance du 12 novembre 2007 |
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la délégation pour la planification (1) sur les perspectives macroéconomiques et les finances publiques à moyen terme (2008-2012) ,
Par M. Joël BOURDIN,
Sénateur.
(1) Cette délégation est composée de : M. Joël Bourdin, président ; M. Pierre André, Mme Évelyne Didier, MM. Joseph Kergueris, Jean-Pierre Plancade, vice-présidents ; MM. Yvon Collin, Claude Saunier, secrétaires ; MM. Bernard Angels, Gérard Bailly, Yves Fréville, Yves Krattinger, Philippe Leroy, Jean-Luc Miraux, Daniel Soulage .
AVANT-PROPOS
La philosophie de l'exercice présenté dans ce rapport d'information mérite d'être rappelée. Disons-le d'emblée : à l'heure où l'évaluation des politiques publiques - à laquelle votre Délégation a consacré un rapport d'information 1 ( * ) pour en montrer les conditions et en rappeler l'urgence - revient au rang des projets prioritaires, le Sénat trouvera, dans le présent rapport, un exercice d'évaluation de la politique économique à moyen terme proposée au pays.
La Délégation du Sénat à la Planification présente une projection à moyen terme des finances publiques , associée à une projection d'ensemble de l'économie française, réalisée à l'aide de modèles macroéconomiques .
Ce choix de présenter à la Haute Assemblée des travaux d'une technicité et d'une complexité certaines est motivé par deux raisons essentielles :
- Premièrement , une projection réalisée à l'aide d'un modèle macroéconomique assure la cohérence comptable de l'ensemble des résultats , et plus particulièrement la cohérence entre les résultats en matière de finances publiques (solde public, dette, prélèvements obligatoires...) et les résultats relatifs aux principaux agrégats macroéconomiques (croissance, emploi, chômage...).
Une projection réalisée à l'aide d'un modèle permet ainsi d'illustrer les liens complexes entre l'évolution des finances publiques et celle de la croissance : quel est l'impact d'une politique d'ajustement budgétaire sur la croissance ? Quel est l'impact de tel rythme de croissance économique sur l'évolution du solde public et de la dette ?...
Certains objecteront que les modèles macroéconomiques sont « trop keynésiens », c'est-à-dire qu'ils surestiment l'impact restrictif (ou expansionniste) d'une diminution (ou d'une augmentation) des dépenses publiques. D'autres estimeront, au contraire, que les modèles sont « insuffisamment keynésiens » parce qu'ils sous-estiment l'impact des finances publiques sur la croissance.
Mais quel qu'il soit, ce type d'objection est respectable mais un peu secondaire, car l'objectif d'une projection n'est pas de donner des résultats indiscutables - surtout à un horizon de moyen terme - mais, au contraire, en évaluant, à sa manière, les conséquences des choix de politique économique, d'ouvrir une discussion pouvant se référer à des enchaînements probables et réalistes .
Ainsi, on peut par exemple soutenir qu'une réduction de la dépense et du déficit publics aura un impact positif sur la croissance. Une projection à l'aide d'un modèle montrera précisément à quelles conditions une baisse de la dépense publique et du déficit public aura effectivement un impact favorable sur la croissance : par exemple, que les ménages anticipant une baisse de la dette publique, donc de leurs impôts futurs diminuent suffisamment leur épargne pour compenser la « réépargne » publique (enchaînement dit « ricardien »). Chacun pourra ainsi juger si ce type d'enchaînement est susceptible d'être vérifié ou, à tout le moins, son « réalisme ».
- Deuxièmement , en faisant le choix de présenter chaque année une projection à moyen terme des finances publiques au moment du débat budgétaire, votre Délégation souhaite enrichir l'analyse de la loi de finances par une mise en perspective pluriannuelle . En effet, une politique budgétaire s'apprécie, aussi, sur la durée d'un cycle économique , sur sa capacité à amortir les fluctuations cycliques, à freiner la conjoncture en cas de « surchauffe », ou au contraire à la soutenir dans la situation inverse. Sur ce plan, le principe d'annualité budgétaire fixe un cadre d'analyse trop étroit, que ce type de travaux permet d'élargir.
D'ailleurs, à partir de 1993, les gouvernements successifs se sont également efforcés, sous des formes variables, d'insérer la loi de finances de l'année dans une « programmation » pluriannuelle des finances publiques, obligation désormais consacrée par la loi organique sur les lois de finances.
Pour réaliser ce type de travaux, votre Délégation a eu longtemps recours à la méthode qui lui paraissait la plus économe pour les deniers publics : recourir, sur une base contractuelle, aux outils et aux équipes du Ministère de l'Économie et des Finances. Dans le cadre de cette prestation de services, votre Délégation assumait l'entière responsabilité des hypothèses et des résultats de ces simulations.
Cependant, à partir du milieu des années 1990, le débat public s'est crispé sur les critères d'adhésion à l'Union économique et monétaire, et plus particulièrement sur le critère de déficit public de 3 %.
Dès lors, l'exercice réalisé par votre Délégation devenait délicat, puisqu'il pouvait conduire à afficher des projections de déficit public différentes de celles transmises par le Gouvernement aux autorités bruxelloises, sur la base de travaux réalisés avec le concours technique des mêmes services du Ministère de l'Économie et des Finances...
Il a ainsi dû être mis un terme à cette collaboration.
Néanmoins, malgré la difficulté à sortir ces travaux d'une certaine confidentialité, malgré leur caractère parfois répétitif, votre Délégation a souhaité les poursuivre, en recourant à un nouveau prestataire, l' Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) .
Pourquoi cette constance ?
Les deux motivations d'origine n'ont pas disparu. S'y est cependant ajoutée une troisième, essentielle aujourd'hui.
La coordination des politiques économiques en Europe est inscrite dans le Traité d'Amsterdam (article 99). En pratique, les Etats membres disposent de deux outils pour coordonner les politiques budgétaires : les Grandes orientations de politique économique (GOPE) et le Pacte de stabilité et de croissance . Ces deux outils sont complétés par une réflexion dans le cadre d'une enceinte informelle de discussion entre les ministres des Finances de la zone euro - l'Eurogroupe 2 ( * ) .
Outre un aspect « coercitif », le Pacte de stabilité et de croissance comprend un volet « préventif » sous la forme des programmes de stabilité pluriannuels , présentés à la fin de chaque année N (le budget est voté pour l'année N+1 et une projection est réalisée par les gouvernements pour les années N+2 à N+4). Ce programme comporte un ou des scénarios macroéconomiques, souvent peu détaillés, et l'ensemble des mesures prévues pour aboutir à une position budgétaire « proche de l'équilibre ou en léger excédent » sur le moyen terme.
Ces programmes nationaux constituent donc le pivot autour duquel devrait se construire la coordination des politiques économiques des Etats membres, coordination essentielle et indispensable pour que l'Union européenne puisse mettre en oeuvre des politiques économiques.
Il faut en effet rappeler qu'à défaut d'une coordination des politiques économiques, « pensée » et conçue au niveau de l'Union, les Etats membres peuvent être conduits à mettre en oeuvre des stratégies individuelles non coopératives , qui au total pénalisent la croissance de l'ensemble des partenaires de l'Union 3 ( * ) .
La crédibilité des programmes de stabilité et de convergence a été assez largement altérée par les entorses qui leur ont été souvent faites au stade de leur exécution par les Etats. Elle doit donc être renforcée, ce qui en suppose une évaluation plus poussée qu'actuellement par les autorités européennes, mais également au sein des Etats membres eux-mêmes.
C'est précisément ce à quoi s'efforce votre Délégation dans ce rapport d'information annuel : évaluer si les engagements budgétaires à moyen terme du Gouvernement sont compatibles avec les objectifs de croissance affichés, et, plus précisément, montrer à quelles conditions les engagements budgétaires qui sont pris sont compatibles avec l'objectif de croissance affiché et, le cas échéant, explorer des trajectoires alternatives .
Tel est le sens de l'exercice présenté ci-après qui, au-delà de son objectif d'évaluation macroéconomique du programme de stabilité et de convergence, permet, en creux, de poser les principales questions de politique économique qui se posent à un horizon de cinq ans.
Ce faisant, votre Délégation est le seul organe public extérieur au Gouvernement, au service du Sénat et de ses commissions permanentes, à apporter au débat public, régulièrement, à travers un éclairage quantitatif sur les perspectives à moyen terme de l'économie française et de ses finances publiques, des éléments d'évaluation de l'impact des politiques en question .
*
* *
CHAPITRE I - UN CONTEXTE INCERTAIN
Toute projection économique à moyen terme est tributaire d'hypothèses concernant son contexte ainsi que de prévisions relatives à son point de départ.
Les modèles économétriques ne peuvent « capturer » l'ensemble des phénomènes économiques même si leur système d'exploitation, leur « logiciel », est très développé.
Il est, en particulier, le plus souvent nécessaire de nourrir le modèle de données relatives au contexte économique international - les modèles sont rarement mondiaux - et aux équilibres monétaires - les taux d'intérêt ne sont pas systématiquement modulés par les modèles.
Par ailleurs, un nombre plus ou moins grand d'événements économiques échappent à toute prédestination ou du moins sont dépendants des marges de manoeuvre des agents économiques. Tel est, en particulier, le cas des orientations imprimées à la politique budgétaire ou à la politique monétaire.
C'est d'ailleurs à l'exploration des effets de tel ou tel de ces choix qu'est assez largement consacré le présent rapport.
Enfin, il est toujours possible d'envisager des ruptures. Les modèles permettent de le faire de façon rigoureuse. Construits sur l'identification des relations existant entre des variables économiques interdépendantes à partir d'observations réalisées dans le passé sur longue période, ils n'empêchent pas, au contraire, de mesurer quelles pourraient être les incidences de changements de ces relations.
Réducteurs d'incertitudes pour l'esprit, les modèles n'ont pas l'ambition de restituer un monde sans aléas qui n'existe pas.
Au cours de ce rapport, plusieurs de ces aléas seront envisagés à mesure que l'exposé le rendra nécessaire.
Dans le présent chapitre introductif, il s'agit, en saisissant l'occasion de la présentation des équilibres économiques prévus pour 2007 et 2008, qui sont les années de base de la projection à l'horizon 2012, de faire état de quelques incertitudes importantes concernant l'environnement de cette projection.
L'actualité est riche d'inconnues qui pourraient affecter, plus ou moins, les résultats de l'économie française à moyen terme tels que les travaux de simulation conduisent à les envisager :
•
la
croissance
économique mondiale
continuera-t-elle à être aussi
dynamique que dans le passé récent ?
•
le
prix du
pétrole
, à supposer qu'il se tende, peut-il remettre en
cause les perspectives de croissance économique ?
Le scénario d'environnement international à moyen terme, qui sert de cadre à la projection de l'économie française a été élaboré à partir d'une hypothèse médiane suivant les estimations de croissance potentielle réalisée par l'OCDE -ou par le FMI pour les zones hors OCDE- pour les années 2009-2012 :
•
le
taux de change
euro-dollar monte jusqu'à mi 2008
(
1,50 dollar
pour 1 euro
) et
se stabilise ensuite
à
1,40 dollar pour 1 euro ;
•
de son côté,
le cours du pétrole se stabiliserait à 67 dollars le baril
en 2008
.
Ces hypothèses appellent chacune une discussion, compte tenu de leur poids sur les résultats de la projection de l'économie française que l'actualité vient rappeler avec une particulière acuité.
La croissance mondiale en 2006 a atteint un sommet à 5,2 % après plusieurs années d'accélération.
Cependant, celle-ci semble désormais stoppée et les perspectives de maintien d'une forte croissance économique mondiale paraissent dépendre, plus que jamais, de la capacité des économies tierces à prendre le relais de la croissance des Etats-Unis, et de l'absence d'accident monétaire international .
Comme le montre le graphique n°1 ci-dessous, le ralentissement aux Etats-Unis, engagé en 2006 n'a pas empêché l'accélération vers un rythme de croissance inégalé de l'activité mondiale.
Ces développements laissaient augurer une configuration plutôt inédite où, malgré une faiblesse de l'économie des Etats-Unis, le reste du monde continuerait à croître fortement.
Mais ces perspectives sont fragiles. Les risques de voir les Etats-Unis manquer leur atterrissage en douceur grandissent. Elles sont, par ailleurs, suspendues à la capacité des autres zones économiques à résister aux tensions qui pourraient accentuer un déclin relatif des Etats-Unis, au premier rang desquelles se situe le risque de change.
GRAPHIQUE N° 1
CROISSANCE PAR TÊTE AUX ÉTATS-UNIS ET DANS LE MONDE
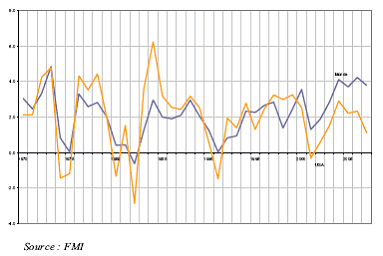
L'exceptionnelle croissance économique mondiale de ces dernières années s'est déployée sur fond de déséquilibres croissants.
Déséquilibres internationaux avec le creusement des déficits extérieurs des uns et l'augmentation des excédents des autres.
Déséquilibres internes aussi. Dans une économie d'endettement et d'épargne abondante, les comportements des acteurs économiques ont souvent manqué de cohérence.
Pour les cinq ans à venir, les scénarios économiques, relativement optimistes, ici présentés sont suspendus à l'absence d'un des accidents que ces déséquilibres laissent entrevoir.
On l'a dit, l'essentiel des propos sera centré ici sur les Etats-Unis. On aurait pu aussi aborder les doutes sur la soutenabilité de la croissance économique des grands pays émergents, dont, au premier plan, la Chine. Le taux d'investissement 4 ( * ) y atteint des niveaux extraordinaires, qui témoignent d'une incapacité de la demande domestique chinoise à rentabiliser les projets qui voient le jour. Les larges excédents extérieurs chinois opèrent aujourd'hui le bouclage d'une situation qui, sans eux, engendrerait une crise de capacités, et probablement, la déconvenue des prêteurs. Ils permettent à la Chine de financer sa croissance et, en sus, de financer le Reste du Monde, et notamment les Etats-Unis.
Une question essentielle reste toutefois posée : la Chine pourra t-elle toujours compter à l'avenir sur son environnement extérieur pour se développer ? Le pays dispose de beaucoup de marges de manoeuvre pour réorienter sa croissance vers une préférence plus marquée pour ses résidents.
Mais, cette réorientation à son tour n'est-elle pas annonciatrice d'un défi pour ceux dont l'endettement extérieur dépend, pour son financement, des fonds asiatiques ? Défi aussi, peut-être, si la transition chinoise se traduisait par une croissance plus modérée pour ces économies qui n'auraient fait que le pari d'être entraînées par les autres.
I. QUELLE CROISSANCE ÉCONOMIQUE AUX ETATS-UNIS ?
Au cours de la phase d'expansion et, même dans la récente période de ralentissement, l'économie des Etats-Unis a reposé sur un fort dynamisme de la demande des ménages .
La consommation et l'investissement en logement des ménages ont été si dynamiques, confortés qu'ils étaient par des conditions monétaires favorables et des anticipations de croissance économique bien orientées, que le taux d'épargne des ménages tangente la valeur zéro aux Etats-Unis.
Ces fondements pourraient être ébranlés sous l'effet de deux processus :
- le premier est lié au retournement des conditions monétaires ;
- le second pourrait être plus sérieux encore : il s'agit des perspectives de croissance économique qui paraissent marquer le pas sous l'effet d'un ralentissement des progrès de productivité.
A. LES ETATS-UNIS : « DESPERATE HOUSEHOLDS5 ( * ) » OU « SUPERFED » ?
La crise dite « de subprime » est emblématique des effets problématiques du retournement des conditions monétaires aux Etats-Unis. Elle ne doit pas faire perdre de vue tout ce que l'efficacité de la politique monétaire aux Etats-Unis a apporté à ce pays en termes de croissance économique et de bien-être social. En outre, son extension à d'autres segments des emprunteurs est douteuse.
Il n'en reste pas moins qu'elle illustre les problèmes que pose un certain activisme de la politique monétaire quand il se conjugue avec une défaillance de la surveillance bancaire.
|
Retour sur la crise des « subprime » 6 ( * ) Depuis les années quatre-vingt-dix, les Américains les moins solvables peuvent bénéficier d'un crédit immobilier hypothécaire moyennant un taux majoré. La valeur de marché du bien emprunté vient en garantie de l'emprunt, dont une partie est libellée à taux variable. Les banques prêteuses, afin de minimiser leur exposition au risque, ont revendu leurs créances à des fonds communs de placement (technique de « titrisation »), dont les parts ont été souscrites aussi bien par des organismes spécialisés dans les placements risqués à haut rendement que par des filiales de grandes banques commerciales ou des investisseurs institutionnels. La hausse des taux d'intérêt depuis 2005 a entraîné une baisse des prix de l'immobilier résidentiel et, par un effet de ciseau -difficultés de remboursement croissantes assorties d'une diminution de la valeur des biens venant en garantie des prêts-, les incidents de paiements se sont multipliés à partir de 2006 7 ( * ) , si bien que certains établissements de crédit se sont trouvés en défaut au mois de juillet 2007 . Si le volume des prêts « subprime », évalué à 1.300 milliards de dollars, ne représente qu'environ 13 % de l'encours total des prêts immobiliers américains, la titrisation 8 ( * ) des créances représentatives de ces prêts a entraîné une diffusion de la crise à un large éventail d'établissements financiers. Une rupture de confiance sur les marchés financiers Depuis juillet 2007, en Amérique et en Europe, les banques répugnent à se consentir des prêts , malgré l'étendue des liquidités dont elles disposent par ailleurs, tant qu'elles sont dans l'ignorance mutuelle de leurs degrés d'exposition au risque. La pratique des engagements « hors bilan » ne favorise pas l'émergence d'une information rapide et exhaustive sur l'exposition des établissements de crédit qui ont heureusement, par ailleurs, engrangé d'importants bénéfices dans la période récente 9 ( * ) . Les taux monétaires ont augmenté et un mouvement de « fuite vers la qualité » a fait baisser le rendement des titres d'Etat. Au total, la crise affecte principalement le marché interbancaire et les marchés des actifs titrisés . La correction boursière d'août 2007, d'une amplitude du même ordre que celle d'avril 2006, a cependant dépassé 10 %. Selon un diagnostic largement partagé, la crise financière est la conséquence d'une rupture de confiance sur les marchés, les opérateurs ayant acheté des titres plus risqués qu'ils ne le pensaient. Les agences de notation ont largement contribué à la mauvaise appréciation du risque que comportaient ces actifs. Ce défaut d'information conduit le marché à traiter avec circonspection non seulement les actifs risqués, adossés de façon substantielle à des « subprimes », mais aussi des actifs non risqués, qui contiennent peu ou pas de « subprimes ». |
Source : Synthèse des prévisions à court terme pour l'économie française. Octobre 2007. Service des Etudes économiques et de la Prospective du Sénat.
Le resserrement rapide des conditions de crédit après des années de politique monétaire, peut-être trop accommodante, semble être l'origine principale d'une crise qui touche les ménages les plus fragiles, les établissements bancaires et les épargnants, ainsi que les propriétaires immobiliers.
Dans ces conditions, il est à remarquer, pour s'en féliciter, que les autorités monétaires des Etats-Unis ont su faire machine arrière.
Il demeure que l'efficacité de ce retournement d'orientation est sujette à interrogations : un effet de richesse très négatif s'est produit ; les ménages sont aux Etats-Unis déjà fortement endettés ; les prix immobiliers se replient, réduisant la valeur des hypothèques sur lesquelles sont assis de nombreux emprunts bancaires.
Dans ces conditions, la transmission de la politique monétaire à l'économie réelle pourrait avoir perdu un peu de son efficacité. Cette crainte semble d'autant plus aiguë que l'économie réelle pourrait elle-même reposer sur des ressorts moins puissants que par le passé .
B. LES ETATS-UNIS, QUELLE CROISSANCE POTENTIELLE ?
Une partie importante du dynamisme économique des Etats-Unis, observé ces dernières années, provient des gains de productivité qui y ont été réalisés.
La productivité globale des facteurs de long terme (colonne PGF de long terme, dans le tableau ci-dessous) s'est accélérée aux Etats-Unis entre 1990 et 2005 (quand elle ralentissait dans la zone euro).
LES SOURCES DE LA CROISSANCE POTENTIELLE DE LONG TERME
(croissance en %, contributions en points
de %)
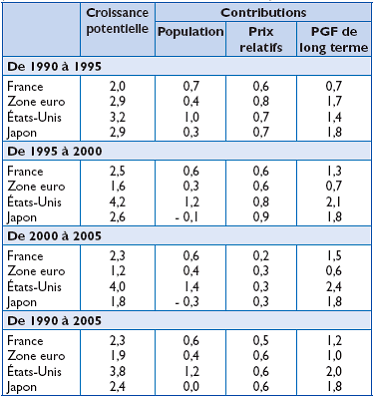
Source : Bulletin de la Banque de France, n° 155. Novembre 2006.
En outre, les Etats-Unis sont parvenus à mettre en oeuvre des politiques macroéconomiques qui leur ont permis de connaître une croissance effective en ligne avec cette croissance potentielle.
PIB RÉEL ET POTENTIEL : COMPARAISON DES TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN DE 1990 À 2005 - (en %)
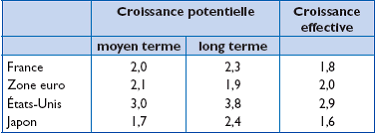
Source : Bulletin de la Banque de France, n° 155. Novembre 2006.
Or, il semble se produire, depuis 2003, un ralentissement des gains de productivité aux Etats-Unis (tandis que dans la zone euro une accélération intervient).
GRAPHIQUE N° 2
PRODUCTIVITÉ PAR TÊTE CORRIGÉE DU
CYCLE
(ensemble de l'économie, glissement annuel
en %)
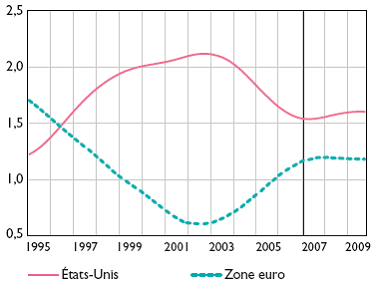
Source : BEA, BLS, Eurostat, INSEE, prévisions OCDE, Banque de France.
Si cette inflexion devait être confirmée, cela signifierait qu'avec une augmentation identique de l'emploi, les Etats-Unis connaîtraient une moindre augmentation des richesses que dans le passé.
Cette perspective pèserait sur le pouvoir d'achat aux Etats-Unis, infléchirait sans doute le rythme de la demande domestique et contribuerait à freiner la demande adressée par les Etats-Unis au Reste du Monde.
Le déficit extérieur des Etats-Unis s'en trouverait réduit, ce qui diminuerait les pressions à la baisse sur le dollar.
Mais, dans le même temps, un phénomène aux effets inverses pourrait intervenir : le rapprochement des perspectives de rendement entre Etats-Unis et Europe contribuerait à une appréciation de l'euro .
Celle-ci viendrait accentuer, en la complexifiant, la nécessité pour l'Europe de rattraper le niveau de développement technologique des Etats-Unis, condition essentielle à une croissance économique plus autonome .
Au vu des années de croissance molle observées en Europe dans le passé, et des retards pris dans l'allocation de notre richesse au développement de notre formation et de notre recherche, cette prise de relais devrait s'opérer dans des conditions d'autant plus difficiles que les priorités comptables semblent l'emporter en Europe sur celles qu'impose une volonté sans faille de croissance.
II. INCERTITUDES SUR LE PRIX DU PÉTROLE
Les projections ici présentées sont construites à partir d'une hypothèse conventionnelle d'un prix du baril de pétrole de 67 $ à partir de 2008 .
Les résultats des scénarios à moyen terme seraient défavorablement influencés si ce prix devait se tendre .
L'équilibre actuel du marché du pétrole, avec un prix de l'ordre de 100 $, ne peut être extrapolé. Les perspectives de la croissance mondiale pourraient justifier un prix moins élevé que celui connu actuellement, qui doit sans doute, pour partie, son niveau à des turbulences passagères. Cependant, il est légitime de tester en variante l'effet d'un prix du pétrole plus élevé.
Votre Délégation a produit plusieurs simulations des effets d'une telle hausse dans des rapports récents 10 ( * ) . Ces travaux montrent que les résultats d'une hausse du prix du pétrole dépendent de sa propagation ou non à d'autres coûts de production , les salaires en particulier, et des réactions de la politique monétaire face à l'inflation qu'elle engendre. Par ailleurs, des considérations hors-modèle interviennent au premier rang desquelles les conditions de recyclage des excédents pétroliers réalisés par les pays exportateurs.
Fondamentalement, la hausse du pétrole opère un prélèvement extérieur sur les pays consommateurs, leurs entreprises et leurs ménages.
Elle a une première dimension qui est d' accélérer l'inflation . Cet impact dépend du déclenchement d'effets de « second tour ». Ceux-ci interviennent si les ménages expriment avec succès des revendications salariales conduisant à l'enclenchement d'une spirale prix-salaires.
Dans une telle hypothèse, il faut ajouter la perspective d'une réaction de politique monétaire : une hausse des taux d'intérêt peut intervenir avec pour effet de réduire, plus que le choc pétrolier le fait par lui-même, le rythme de la croissance économique.
La hausse du prix du pétrole a, en effet, en elle-même une seconde dimension : elle réduit le rythme de croissance économique . Cet effet résulte de la décélération du pouvoir d'achat qu'entraîne le supplément d'inflation qu'elle induit ou/et de la dégradation du commerce extérieur qui s'en suit.
Ces impacts peuvent varier en intensité selon plusieurs paramètres :
• un pays qui connaît un ressaut d'inflation
plus prononcé que ses partenaires voit sa
compétitivité-prix en pâtir et la dégradation de ses
performances extérieures ajoute alors un effet récessif à
la hausse initiale des prix du pétrole ;
• les conditions du « recyclage de la rente
pétrolière » peuvent atténuer l'impact
dépressif de la hausse des prix du pétrole si les investissements
des pays exportateurs de pétrole vers les pays consommateurs
augmentent.
Au total, les effets de la hausse du prix du pétrole, en principe inflationnistes et récessifs, sont ainsi susceptibles de varier fortement entre un risque maximal de stagflation (combinaison d'inflation et de récession) et un épisode, plus transitoire, de ralentissement économique .
Aussi, ne peut-on pas envisager ces impacts à l'aune d'une simulation unique. Votre rapporteur se permet, à ce propos, de renvoyer aux travaux de votre Délégation précédemment signalés qui envisagent la série de scénarios la plus exhaustive possible, et, en particulier, les effets de très long terme, structurels, d'une élévation durable du prix du pétrole.
Pour donner un ordre de grandeur des incidences d'une tension sur les prix du pétrole, on peut ici mentionner une simulation publiée dans le rapport sur les Comptes de la Nation associé au projet de loi de finances 2006 qui présente pour singularité remarquable d'envisager les effets d'un passage du prix du baril de 66,6 $ (qui est, à peu près, le niveau conventionnel retenu pour les projections du présent rapport) à 100 $ (qui est, à peu près, le prix actuel du baril) .
CONSÉQUENCE D'UNE HAUSSE DU PRIX DU
PÉTROLE DE 100 % EN SIX TRIMESTRES
(taux
d'intérêt réels et taux de change
constants)
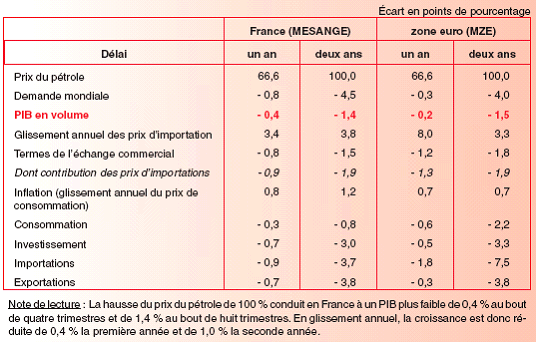
Source : L'économie française, 2005-2006
Au bout de deux ans, suite à ce doublement du prix du baril, le PIB est inférieur de 1,4 point au niveau atteint sans lui .
Le déficit de croissance atteint 0,4 point au bout d'un an, puis 1 point la seconde année, sous l'effet d'une décélération de la demande domestique, amputée par une perte de pouvoir d'achat du fait des tensions sur les prix, et de la profitabilité des entreprises. En outre, la demande extérieure adressée à la France diminue malgré l'accélération des importations des pays producteurs.
Ces résultats, déjà éclairants, pourraient être plus défavorables si la compétitivité-prix devait se dégrader (dans l'hypothèse d'une tension salariale, par exemple) ou si les taux d'intérêt réels devaient se tendre, toutes hypothèses qui ne sont pas incluses dans la simulation ici restituée .
CHAPITRE II - UN POUVOIR D'ACHAT AU SOUTIEN DE LA CROISSANCE ?
Certaines hausses de prix concernant l'énergie et l'alimentation, abondamment commentées, renforcent l'acuité d'une réflexion sur le pouvoir d'achat. Toutefois, les risques d'un regain de vigueur de l'inflation paraissent surestimés. En effet : d'une part, la vigueur de l'euro atténue l'effet de la hausse des matières premières ; d'autre part, le lien entre l'indice des prix des matières premières et l'indice des prix alimentaires est assez distendu en France. Au total, d'après l'OFCE, après avoir atteint 2 % en 2007, le taux d'inflation reviendrait à 1,6 % à la fin de 2008, avec la disparition des effets de base liés à l'énergie. Pour la période 2009-2012, les simulations de votre Délégation font ressortir un taux annuel d'inflation constant de 1,9 % dans les deux scénarios, qui respecterait la cible de la Banque centrale européenne (2 %).
En somme, sous réserve de nuances microéconomiques importantes 11 ( * ) , le pouvoir d'achat ne semble pas véritablement menacé par l'inflation. En revanche, les projections laissent entrevoir un dynamisme, qui serait de nature à peser sur la croissance, à moins que les ménages n'acceptent de s'endetter davantage .
I. UNE MODÉRATION SALARIALE INEXORABLE ?
Les scénarios de la Délégation sont bâtis sur une hypothèse de modération salariale qui combine ses effets sur le revenu disponible des ménages à ceux de la réduction du déficit public. Le pouvoir d'achat global des ménages augmente , mais pas assez pour que le pouvoir d'achat par ménage soit suffisamment dynamique pour nourrir la demande des ménages au niveau nécessaire à la cohérence de la prévision de croissance.
Ce constat invite à explorer des voies qui permettraient des évolutions plus favorables. En particulier, il incline à une autre orientation des politiques économiques en Europe.
A. UN POUVOIR D'ACHAT FREINÉ PAR LA MODÉRATION SALARIALE
Les gains individuels de pouvoir d'achat peuvent se déduire de l'accroissement des salaires d'activité , de la progression de l' emploi ainsi que de l'évolution des transferts publics associés aux scénarios qui sont explorés :
• Dans le scénario central proposé par
votre Délégation, les
gains
de
productivité par tête s'élèvent
uniformément à 1,7 % l'an
, soit une performance
conforme à la tendance de long terme. Dans le scénario
« haut », les gains de productivité sont
majorés de 0,5 point, en cohérence avec le
différentiel de croissance du PIB du scénario
« haut », fixé à 3 % eu lieu de
2,5 %. Par ailleurs,
le partage de la valeur ajoutée
demeurerait inchangé.
Dans le scénario central,
il en résulte une progression contenue des revenus individuels du
travail
: la masse des salaires réels progresserait de
2 % en moyenne annuelle sur la période 2007-2012.
•
Dans les deux scénarios,
les dynamiques observées sur le marché du travail ne sont pas
perturbées et
le chômage peut se réduire
selon une pente similaire.
On observera que :
- dans l'hypothèse d'une hausse des gains de productivité plus rapide que celle des salaires, la croissance serait moins riche en emplois et le niveau du chômage baisserait moins vite ;
- dans l'hypothèse d'une déformation du partage de la valeur ajoutée en faveur des salaires, il conviendrait de s'interroger sur l'impact du renchérissement du coût du travail et de la baisse de la profitabilité des entreprises sur le rythme des créations d'emplois et de l'activité économique.
Dans chacune des deux projections , des créations nettes d'emplois du même ordre de grandeur interviennent sur la période 2007-2012 -185.000 en moyenne dans le scénario bas, 187.000 en moyenne dans le scénario haut- , quoique selon un rythme légèrement différent.
• Enfin, l'impulsion négative des
administrations publiques (
cf. chapitre VII
) se manifeste
par un
fort ralentissement des dépenses publiques et notamment
des prestations sociales
, qui, après avoir progressé en
moyenne annuelle de 2,5 % sur la période 1997-2007, ne
progresseraient plus que de 1,2 % en moyenne annuelle sur la
période 2007-2012, cela aussi bien dans le scénario central que
dans le scénario « haut ».
*
Pour que la croissance économique atteigne le rythme supposé, il faut que l'impulsion économique négative donnée par la politique budgétaire soit compensée par une accélération de la demande privée qui suppose, pour les ménages, une diminution de l'épargne : sur la période 2007-2012, alors que le revenu disponible brut augmente en moyenne de 2,1 % par an, la consommation progresse cependant au rythme de 2,9 %. Le taux d'épargne doit alors diminuer beaucoup : de 15,7 % en 2007 à 12,7 % en 2012. Le tableau suivant donne le détail de ces évolutions (scénario central) :
REVENU, CONSOMMATION ET ÉPARGNE DES MÉNAGES
|
Croissance en volume, en % |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
87-97 |
97-07 |
07-12 |
|
Revenu disponible brut |
2,9 |
3,0 |
2,0 |
2,5 |
2,2 |
2,0 |
2,0 |
1,8 |
2,8 |
2,1 |
|
Salaire réel |
2,4 |
2,9 |
1,9 |
1,7 |
1,9 |
1,9 |
2,3 |
1,7 |
2,9 |
2,0 |
|
Prestations sociales |
2,2 |
2,5 |
1,3 |
1,0 |
1,2 |
1,4 |
1,2 |
2,5 |
2,5 |
1,2 |
|
Consommation des ménages |
2,8 |
2,6 |
2,8 |
2,9 |
3,0 |
2,9 |
2,7 |
1,3 |
2,8 |
2,9 |
|
Taux d'épargne des ménages |
15,4 |
15,7 |
15,1 |
14,7 |
14,0 |
13,3 |
12,7 |
14,2 |
15,7 |
14,2 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE
*
Les perspectives de modération salariale qui viennent d'être retracées suscitent trois séries d'observations :
• Dans la projection du scénario central, la
faible dynamique des salaires d'activité dans le secteur
marchand
-2 % d'augmentation moyenne sur la période
2007-2012-
se traduit par de faibles gains du pouvoir d'achat
sur la période (progression annuelle moyenne du revenu
disponible brut de 2,1 %). Les salaires sont pourtant tirés par une
croissance économique qui, elle-même, est supérieure
à la croissance potentielle estimée pour le futur proche.
Ajustés sur l'évolution les gains de productivité par tête, l es gains de pouvoir d'achat par tête des salariés ne devraient pas dépasser 1,7 % par an ( cf. tableau 10 du rapport annexé de l'OFCE ). Compte tenu de l'augmentation tendancielle du nombre des ménages, le gain de pouvoir d'achat par ménage serait même inférieur, de l'ordre de 1,2 % .
•
Les perspectives
décrites
pourraient être qualifiées de vertueuses, pour être
conformes à une exigence de modération salariale
souvent énoncée : elles permettent de contenir les
coûts salariaux unitaires, facteur important de la
compétitivité extérieure, et respectent les conditions de
l'arbitrage capital-travail qui lui sont considérées comme
favorables ainsi que nécessaires à l'élévation du
niveau de l'investissement pour répondre à l'objectif d'une
accélération du rythme de la croissance potentielle.
Il existe à cet égard une incertitude pour ceux qui estiment que le taux de chômage non accélérateur d'inflation (le NAIRU), c'est-à-dire le taux de chômage en deçà duquel les salaires -et les prix- augmentent, se situerait encore, en France, à un niveau élevé, de l'ordre de 8 %. Cette hypothèse est écartée de nos projections : le taux de chômage y reflue nettement, sans tensions inflationnistes. Les évolutions récentes du marché du travail et du chômage en France -le NAIRU était encore récemment évalué à 9 %-, ainsi que l'absence d'enclenchement d'une spirale prix-salaires dans de nombreux pays où le chômage est très inférieur, peuvent ou bien susciter le doute quant à la validité théorique du NAIRU, ou bien montrer qu'à la faveur d'évolutions structurelles, le NAIRU est susceptible de refluer rapidement.
• La modération salariale que décrit la
projection du modèle central est une
modération salariale
globale, qui ne préjuge pas des modalités de répartition
des salaires
.
Dans la période la plus récente, le SMIC a augmenté nettement plus que le salaire médian ( graphique n° 2 ) dans un contexte de progression modérée des revenus du travail. De fait, des « coups de pouce » successivement apportés au SMIC de 2003 à 2005 avaient été programmés (par la loi « Fillon » 12 ( * ) ), afin de permettre sa convergence avec les rémunérations mensuelles minimales résultant de la réduction du temps de travail (loi « Aubry » 13 ( * ) ), qui, exprimées en rémunération horaire, s'avéraient supérieures au SMIC. Au 1 er juillet 2006, le SMIC a augmenté de 3,05 %, dont un nouveau « coup de pouce » de 0,3 %. Cependant, au 1 er juillet 2007, le SMIC a été revalorisé de 2,10 %, soit une stricte application de la formule du minimum légal 14 ( * ) .
Au total, la part des salariés au SMIC se rapproche aujourd'hui de 16 % 15 ( * ) . Parmi les pays européens ayant mis en place un salaire minimum, un tel degré de banalisation est inédit, même si le SMIC apparaît relativement élevé par comparaison avec les autres rémunérations minimales en Europe.
GRAPHIQUE N°
2
ÉVOLUTION DU SMIC NET EN PROPORTION DU
SALAIRE HORAIRE NET MÉDIAN
(en %)
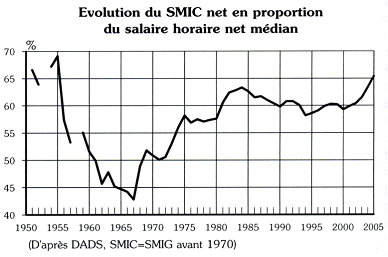
Source : REXECODE
Conjointement à la convergence des rémunérations minimales, un renforcement substantiel du dispositif général d'allègement de cotisations sociales sur les salaires a permis de limiter l'impact de la hausse du SMIC (+ 11,4 % de 2003 à 2005 en termes réels) sur le coût du travail (+ 4,6 % de 2003 à 2005 en termes réels) afin de préserver la compétitivité des entreprises et l'« employabilité » des personnes les plus faiblement productives. Pour éviter une « trappe à SMIC », l'allègement s'étend aux rémunérations qui lui sont supérieures : il décroît linéairement pour s'annuler à 1,6 fois le SMIC.
Compensées par une dotation budgétaire puis l'affectation du produit de certaines taxes à la Sécurité sociale, les exonérations de cotisations sociales ont représenté un transfert croissant des administrations publiques en direction des employeurs de salariés faiblement rémunérés , sans lequel l'augmentation du SMIC n'aurait pas été supportable.
Avec le mécanisme des exonérations de charges générales, l'augmentation des salaires marchands aux alentours du SMIC a une répercussion directe sur les dépenses publiques qui hypothèque les projets de réduction du déficit public .
|
LA MÉCANIQUE BUDGÉTAIRE
La charge pour les finances publiques liée aux exonérations de charges générales sur les bas salaires, qui doit s'élever à 21,5 milliards 16 ( * ) d'euros en 2007, est appelée à progresser spontanément avec les salaires concernés, sauf si les exonérations de cotisations sociales n'étaient plus intégralement compensées, ce qui poserait alors des problèmes considérables de financement de la protection sociale. En soi, ce mécanisme automatique complique considérablement la « maîtrise » des dépenses publiques, pivot de la programmation pluriannuelle du Gouvernement. Avec une masse salariale augmentant de 4 %, c'est une dépense supplémentaire de 800 millions d'euros qui intervient . L'objectif de maintenir constantes les dépenses budgétaires en euros courants impose donc de réduire les autres dépenses d'autant. |
Encore en 2007, des allégements de cotisations sociales supplémentaires ont été consentis en faveur des très petites entreprises. Cependant, il semble que de nouvelles extensions du dispositif d'exonération ne soient plus concevables dans une stratégie de désendettement public 17 ( * ) .
En bref, les objectifs de politique budgétaire devraient rendre indisponible un instrument qui a pu, dans le proche passé, permettre une progression dynamique du pouvoir d'achat du SMIC qui engendre par ailleurs une augmentation de la proportion des salariés touchant le salaire minimum.
B. LES VOIES D'UNE EVOLUTION PLUS DYNAMIQUE DU POUVOIR D'ACHAT
Outre une augmentation de la productivité qui faciliterait une augmentation des salaires (cf. infra) , deux issues sont envisageables pour parvenir à une trajectoire de pouvoir d'achat plus ascendante : un partage de la valeur ajoutée plus favorable aux salariés et un ajustement moins rigoureux des dépenses publiques. Le nouveau dispositif d'exonération des heures supplémentaires, relativement coûteux, est susceptible de s'inscrire dans cette voie.
1. Une déformation du partage de la valeur ajoutée plus favorable aux salaires
La voie d'une déformation du partage de la valeur ajoutée plus favorable aux salaires est souvent évoquée pour lever les contraintes pesant sur la progression du pouvoir d'achat. Stabilisée en France autour de 65 % de la valeur ajoutée depuis le début des années quatre-vingt dix - un niveau, certes, historiquement faible ( cf. graphique n° 3 ) -, une augmentation de cette part supposerait toutefois de s'écarter des tendances observées en Europe ces dernières années.
GRAPHIQUE N°3
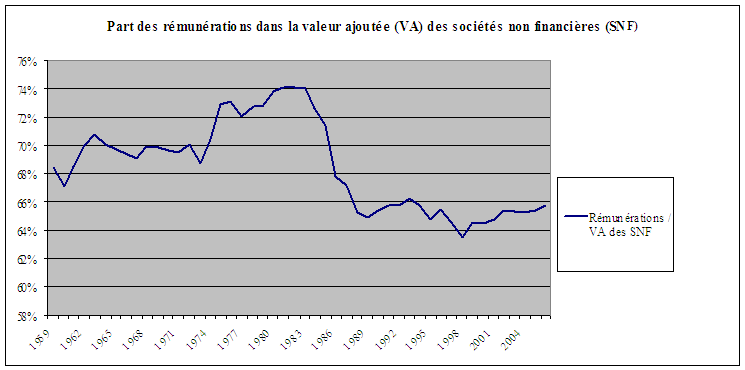
Source : d'après données INSEE
Dans le contexte d'un chômage encore important, il est peu probable qu'une telle évolution se généralise spontanément. En outre, la globalisation financière, la mondialisation, au moins partielle, des marchés nationaux de l'emploi et les politiques de désinflation compétitive à l'oeuvre en Europe empêchent, en pratique, qu'un tel ajustement puisse intervenir durablement dans un seul pays.
Si cet objectif devait être recherché, il faudrait, à tout le moins, qu' une coordination des politiques en Europe aille dans ce sens. La question de l'opportunité d'une telle évolution doit être posée. Ce rapport ne prétend pas y répondre mais simplement mettre en évidence les effets envisageables d'un tel choix conduit au niveau de l'Union européenne :
- un supplément de demande interviendrait et, l'Union européenne étant relativement fermée à l'extérieur, la croissance y serait mécaniquement plus dynamique, à peu près à hauteur de cette demande supplémentaire ;
- le coût du travail en Europe augmenterait, ce qui réduirait la compétitivité-prix de l'Union européenne, sauf à ce que la Banque centrale européenne (BCE) accompagne cette politique par une gestion accommodante du taux de change ( cf. chapitre IX) ;
- pour l'essentiel, les autres risques sont du côté de l'offre ; la réduction de la profitabilité des entreprises pourrait les inciter à réduire leurs investissements, ce qui pénaliserait les efforts entrepris pour augmenter le rythme de la croissance potentielle en Europe, tandis que la hausse du coût du travail pourrait conduire à un arbitrage capital/travail défavorable à l'emploi, particulièrement à l'emploi non qualifié.
2. Un ajustement des finances publiques moins rigoureux
Une réépargne publique aurait un impact globalement défavorable sur le pouvoir d'achat des ménages.
Dans les deux scénarios, les finances publiques ne soutiendraient plus le niveau de vie des ménages. Bien au contraire, elles pèseraient sur celui-ci dans l'hypothèse où la norme de progression des dépenses publiques associée à une réduction énergique du déficit structurel serait suivie.
Les perspectives d'évolution de la masse salariale dans le secteur non-marchand seraient particulièrement moroses en cas de réduction rapide du besoin de financement public. L'ensemble des transferts nets entre administrations publiques et ménages jouerait au détriment du revenu de ces derniers, les obligeant à une désépargne pour maintenir le rythme de leur demande.
Une politique des finances publiques plus souple permettrait des gains de pouvoir d'achat supérieurs, aussi bien par le canal des revenus d'activité que par celui des transferts entre administrations publiques et ménages ; le rythme de l'ajustement budgétaire s'en trouverait cependant, au moins provisoirement, ralenti.
3. Le bilan d'une nouvelle dépense fiscale et sociale : le dispositif d'exonération des heures supplémentaires
Bien que peu favorables au pouvoir d'achat, les deux scénarios enregistrent cependant les effets du nouveau dispositif concernant les heures supplémentaires .
Votre Délégation a demandé à l'OFCE d'isoler, au sein de ses simulations, l'impact de la nouvelle mesure sur les projections à moyen terme. Les résultats complets du travail de l'OFCE figurent en annexe du présent rapport .
a) Bilan en l'absence d'une augmentation significative du nombre d'heures travaillées
Dans une hypothèse centrale, où la nouvelle mesure n'engendrerait pas une augmentation significative du nombre d'heures travaillées ( cf. chapitre IV) , elle n'en aura pas moins un impact notable sur la demande ainsi que sur les transferts entre les administrations publiques, les ménages et les entreprises.
En effet, le dispositif dédié aux heures supplémentaires prévoit, côté employeur, une réduction forfaitaire des charges patronales afférentes et un renforcement des allègements généraux (ciblé sur le recours aux heures supplémentaires) et, côté salariés, une exonération des charges salariales et d'impôt sur le revenu.
En 2008 18 ( * ) , au prix d'une augmentation du besoin de financement des APU de 0,2 point de PIB, la mesure permettrait un supplément de croissance de 0,2 % (0,3 % à l'horizon de 2012), grâce au soutien de la demande intérieure. La consommation des ménages serait stimulée par un revenu plus dynamique, qui progresserait de 0,6 % (0,7 en 2012) 19 ( * ) .
Une partie de ce supplément de revenu serait épargnée par les ménages - le taux d'épargne augmenterait de 0,2 point en 2008 -, l'autre serait consommée. Ce surcroît de consommation serait en partie capté par l'extérieur, l'autre stimulerait en retour l'activité et l'investissement des entreprises, ce dernier augmentant de 0,3 % en 2008 (0,7 % en 2012). Par ailleurs, la hausse du PIB et une très légère baisse de coût du travail engendrées par la mesure permettraient de créer près de 73.000 emplois, à l'horizon de 5 ans, ce qui représente une baisse de 0,3 point du taux de chômage.
Quoiqu'il en soit, la diminution de la capacité de financement des APU (-0,2 point de PIB) résultant de la mesure persiste jusqu'en 2012, ce qui signifie que l'impact expansionniste de la mesure ne suffit pas à la financer (cf. tableau n° 5 de l'annexe OFCE portant sur la défiscalisation des heures supplémentaires) .
b) Impact de la mesure dans l'hypothèse d'un relèvement substantiel du nombre d'heures supplémentaires
Dans ce deuxième scénario, les entreprises satureraient le contingent légal d'heures supplémentaires (220 heures par an) des salariés qui en effectuent déjà (37 % des salariés à temps complet). La durée du travail augmenterait alors de 0,8 % pour l'ensemble des salariés 20 ( * ) .
Le besoin supplémentaire de financement des APU s'élèverait à 0,3 point de PIB en 2012 au terme d'un scénario alternatif dans lequel le dispositif engendrerait une augmentation du temps de travail.
Si l'impact positif sur le PIB atteindrait alors 0,4 point tandis que le revenu des ménages serait appelé à progresser de 0,9 point, la mesure ne créerait plus d'emplois à terme 21 ( * ) (cf. tableau n° 6 de l'annexe OFCE portant sur la défiscalisation des heures supplémentaires) .
II. RETOUR SUR LES CONDITIONS D'UNE FORTE AUGMENTATION DE LA DEMANDE DES MÉNAGES
Dans le scénario retenu par la Délégation, la condition d'une désépargne privée imposée par la stratégie de désendettement public suppose une baisse inaccoutumée du taux d'épargne des ménages, que des politiques volontaristes pourraient cependant accompagner.
A. LA DEMANDE DES MÉNAGES DEVRA CROÎTRE PLUS QUE LE REVENU...
1. Vue générale
Dans le contexte d'ajustement structurel des comptes publics, une des conditions déterminantes pour la croissance réside dans l'enclenchement d'un processus de désépargne des agents privés, en particulier des ménages. La question se pose donc de savoir quelles sont les conditions et les conséquences d'un tel enchaînement.
La croissance de la consommation à long terme (et son inverse, le taux d'épargne) dépend traditionnellement du revenu, du chômage, de l'inflation et des taux d'intérêt.
A priori , dans le moyen terme, la seule évolution attendue, susceptible d'avoir un impact significatif sur la propension à consommer des ménages, serait celle du chômage , qui jouerait positivement. Les perspectives de baisse du chômage pourraient réduire la propension des ménages à constituer une épargne de précaution , d'autant plus que la baisse programmée du besoin de financement des administrations publiques pourrait diminuer le besoin d'épargne des ménages.
Ce dernier enchaînement suppose toutefois que le raisonnement selon lequel l'effort actuel d'épargne des ménages comporte un provisionnement des tensions financières qu'engendreraient à terme des finances publiques déficitaires, soit valide.
Enfin, dans la même perspective, les projections démographiques publiées par l'INSEE en 2006 se traduisent par un important allègement des besoins de financement des systèmes de pension et de santé que les ménages sont appelés à prendre en compte -ce qui suppose un effort d'explication rompant avec l'expression d'un pessimisme parfois excessif concernant l'état futur des finances publiques.
2. La nécessité d'une forte diminution du taux d'épargne
Dans la période récente, jusqu'en 2006, la consommation a augmenté davantage que le revenu disponible brut des ménages. Le taux d'épargne s'est alors nettement replié (recul de 2 points entre 2002 et 2005).
Toutefois, à la faveur d'une relative accélération du revenu disponible brut (+ 2,9 % en 2006 puis + 3 % en 2007 22 ( * ) ), le taux d'épargne des ménages s'est finalement redressé, partant de 14,9 % en 2005, à 15,4 % en 2006 puis 15,7 % en 2007 d'après l'OFCE voire 16,3 % d'après l'INSEE.
D'une façon générale, à court terme, le taux d'épargne des ménages suit une évolution parallèle au rythme de progression de leurs revenus, en raison d'une certaine inertie des comportements de consommation.
Le graphique n° 4 rend compte de ces évolutions :
GRAPHIQUE N° 4
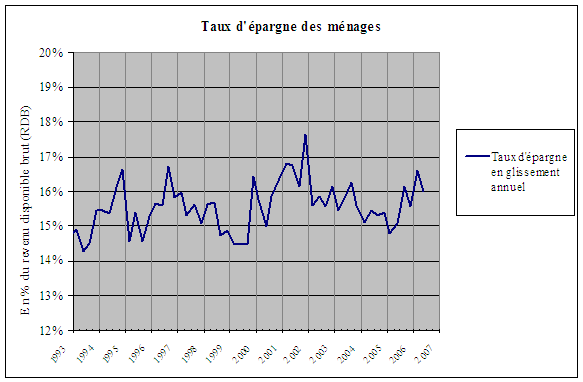
Source : à partir de données INSEE
Or, le revenu disponible brut évoluerait moins favorablement à partir de 2008 (voir supra ), aussi bien dans le scénario central (+ 2,1 % en moyenne sur la période 2007-2012) que dans le scénario haut (+ 2,2 % en moyenne sur la période 2007-2012 ). Dès lors, le taux d'épargne est logiquement appelé à diminuer.
La question se pose, néanmoins, de la crédibilité des prévisions de croissance à moyen terme, qui impliquent une baisse historique du taux d'épargne pour représenter, en 2012, seulement 12,7 % du RDB dans le scénario central, voire 12 % dans le scénario « haut ».
B. ... CE QUI EST ENVISAGEABLE SOUS CERTAINES CONDITIONS VOLONTARISTES
1. Certains facteurs susceptibles de peser sur l'évolution du taux d'épargne...
Pour évaluer la vraisemblance d'une diminution marquée du taux d'épargne à moyen terme, il convient de revenir sur les déterminants de l'épargne susceptibles de connaître des variations substantielles dans les prochaines années. Certains travaux récents, conduits au Sénat par votre Commission des finances et par votre Délégation, ont respectivement mis en évidence le rôle des effets de richesse liés à l'augmentation de valeur du patrimoine immobilier des ménages 23 ( * ) , et l'impact de l' expansion du crédit 24 ( * ) .
Dans le premier cas, il a été expliqué que, sur la période 2002-2005, les effets de richesse ont permis aux ménages de réduire leur épargne.
Dans le second cas, on a montré que, sur la même période, la progression du crédit aux ménages -qui a joué un rôle sur la hausse des prix des actifs immobiliers, phénomène naturel tant que l'offre de logements ne s'ajuste pas- a libéré la consommation de ceux qui en ont profité.
Après une hausse transitoire du taux d'épargne en 2006-2007, ces derniers phénomènes sont-ils appelés à déterminer une nouvelle et forte baisse du taux d'épargne ?
Parmi les facteurs de doute , figurent l'éventualité d'un atterrissage brutal des prix de l'immobilier et les incertitudes sur la soutenabilité d'un endettement des ménages qui approche aujourd'hui 70 % de leur revenu ( cf. graphique ci-dessous ), surtout si les taux d'intérêt se trouvaient durablement orientés à la hausse. En effet, les tensions sur les taux d'intérêt engendrées, depuis l'été 2007, par la crise des « subprime », seraient de nature, si elles s'amplifiaient, à peser sur la consommation (quoique rien ne permette aujourd'hui de privilégier un tel scénario).
GRAPHIQUE N° 5
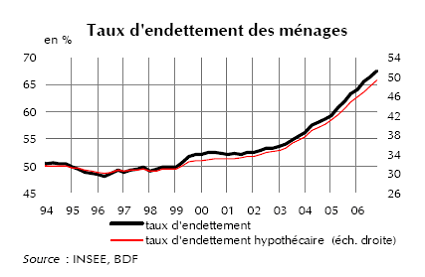
Parmi les facteurs encourageants , on mentionnera que le taux d'endettement des ménages en France demeure très nettement inférieur à celui d'autres pays , notamment anglo-saxon, et que leur « resolvabilisation » s'amorcerait dans l'hypothèse, plus vraisemblable, d'un atterrissage en douceur des prix de l'immobilier consécutif à une reprise de l'offre de logements.
En outre, si l'endettement des ménages atteint, certes, des niveaux sans précédent en France, que l'on rapporte leur dette à leur revenu disponible brut (68,4 % en 2006) ou à leur épargne brute (4,5 années d'épargne en 2006), il apparaît que, rapporté au patrimoine des ménages, cet endettement a, au contraire, décru : le ratio de la dette des ménages sur leur patrimoine a reflué de 9,7 % en 1998 à 8,3 % en 2006 (malgré une légère remontée cette année-là). En effet, le patrimoine des ménages, qui représentait six années de revenus en 2002, en représente désormais plus de huit depuis 2006, grâce à une hausse très marquée du patrimoine immobilier.
2. ...nécessitent d'être potentialisés par une action volontariste
Votre rapporteur entend souligner que beaucoup dépendra de la capacité de la France à valoriser les différents atouts dont elle dispose.
D'un point de vue conjoncturel, le maintien de conditions monétaires accommodantes est une nécessité à laquelle la BCE devrait être sensible, compte tenu de l'absence de tensions inflationnistes prévisibles et des efforts entrepris pour assainir les comptes publics.
Sur un plan structurel, il apparaît essentiel qu'une politique cohérente d'accès des ménages au crédit soit définie . Un certain nombre de mesures ont déjà été prises en ce sens, comme la mise en place d'un système d'hypothèque rechargeable, ou l'amélioration des conditions d'accès au crédit des personnes subissant un handicap. Il faut aller plus loin : d'une part, lever les obstacles économiques à la diffusion du crédit ; d'autre part, rééquilibrer les relations entre emprunteurs et banquiers, ce dont augurerait favorablement la perspective de l'introduction d'une plus grande concurrence dans le secteur bancaire ( voir infra chapitre sur la productivité ).
Votre rapporteur ne peut, à ce sujet, que rappeler les recommandations qu'il a récemment formulées, dans le cadre du rapport précité, sur l'ensemble de ces problèmes.
*
Si la demande des ménages est un déterminant de la croissance, la croissance, en retour, favorise le pouvoir d'achat des ménages et, partant, la demande qu'ils expriment.
L'impulsion budgétaire négative programmée les cinq prochaines années pèserait sur la croissance, à hauteur de 0,5 % de PIB par an et, dans un scénario central basé sur une croissance annuelle de 2,5 %, l'effort des ménages pour aboutir à une croissance sous-jacente de 3,1 % est exigeant. Des objectifs économiques aussi divergents deviennent plus facilement conciliables dans l'hypothèse d'une forte augmentation de la productivité , qui permet aux entreprises d'augmenter plus facilement les rémunérations.
Le scénario « haut » prévoit en ce sens une augmentation annuelle de la productivité par tête de 2,2 % et les gains de pouvoir d'achat individuel des salariés du secteur pourraient progresser au même rythme annuel (2,2 %), dans le cadre d'un partage inchangé de la valeur ajoutée ( cf. tableau 10 bis du rapport annexé de l'OFCE ). Les conditions et l'opportunité d'une hausse structurelle des gains de productivité sont discutées dans le chapitre du présent rapport consacré à la productivité (cf. chapitre IV) .
Par ailleurs, compte tenu de la forte propension à importer de l'économie française (l'élasticité des importations à la demande intérieure est proche de deux), une productivité renforcée, portée par une intensification de l'innovation et de l'investissement, serait favorable à notre compétitivité et ainsi de nature à éviter qu'une hausse du pouvoir d'achat ne vienne, parallèlement à une amélioration de la croissance française, dégrader le solde extérieur (cf. chapitre V) . En bref, les progrès du pouvoir d'achat se traduiraient alors plus pleinement en croissance intérieure.
CHAPITRE III - VERS UNE NOUVELLE DYNAMIQUE DE L'INVESTISSEMENT ?
Depuis 2004, l'investissement est à nouveau bien orienté en France. Toutefois, le niveau d'investissement requis pour la réalisation du scénario de croissance envisagé par le gouvernement devrait encore progresser sensiblement , ce qui suppose que les entreprises aient non seulement les ressources financières leur permettant de mener à bien de nouveaux projets, mais encore, en premier lieu, des perspectives de débouchés suffisantes ...
I. UNE ÉVOLUTION BIEN ORIENTÉE À COURT TERME
Avec une croissance de la FBCF 25 ( * ) de 4,7 %, l'année 2006 a confirmé la reprise de l'investissement amorcée deux années auparavant (3,6 % de croissance en 2004 et 2,8 % en 2005). Le taux d'investissement 26 ( * ) s'est redressé de 1,3 point depuis le point bas atteint début 2003.
L'OFCE estime qu'en 2007, la FBCF croitrait de 4,7 % malgré de mauvaises performances au deuxième trimestre (+ 0,4 % en volume), engendrées par une baisse temporaire des profits liée à des versements importants d'impôts sur les bénéfices des sociétés et à un ralentissement de l'activité au deuxième trimestre 2007.
Selon l'Office, la croissance de l'investissement serait inférieure en 2008 à celle de 2007 (+ 3,5 %) en raison d'un effet d'acquis moins favorable. Elle resterait cependant assez dynamique en raison d'une profitabilité élevée des entreprises, de l'apparition de tension sur les capacités de production ( cf. graphique n° 1 ci-dessous) et d'une croissance relativement soutenue.
GRAPHIQUE N° 1
TENSIONS SUR LES CAPACITÉS DE PRODUCTION
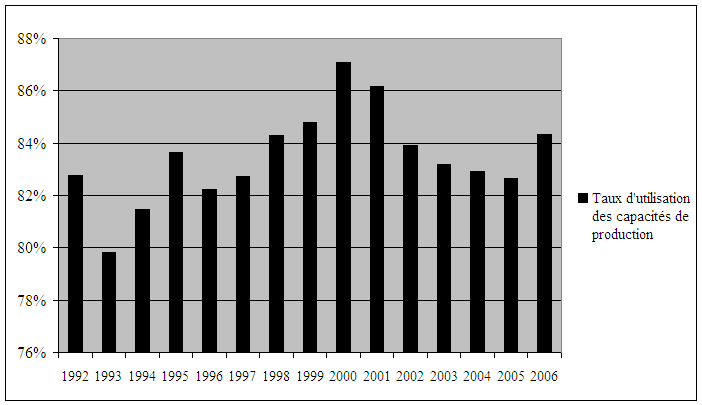
(1) industrie hors énergie et industrie
agro-alimentaire (IAA)
Champ : France métropolitaine et
DOM
Source : Insee, Comptes nationaux base 2000.
II. DES SCÉNARIOS QUI SUPPOSENT UNE CROISSANCE SOUTENUE DE L'INVESTISSEMENT À MOYEN TERME
A. LES PERSPECTIVES OFFERTES PAR UNE ACCÉLÉRATION DE L'INVESTISSEMENT
Le taux d'investissement des sociétés non financières est globalement en baisse depuis la fin des années 1950, où il atteignait 25 %.
Ce mouvement structurel est toutefois corrigé par des rebonds cycliques durant les phases de forte croissance de la fin des années 1980 et de la fin des années 1990.
Aussi bien dans le scénario central que dans le scénario « haut » présentés par votre Délégation, la croissance économique décrite passe par un investissement qui se renforce, évolutions que retrace le graphique suivant :
GRAPHIQUE N° 2
COMPORTEMENT D'INVESTISSEMENT DANS LES DEUX SCÉNARIOS
En % de la valeur ajoutée
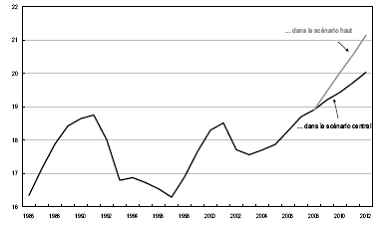
Sources : INSEE, prévisions OFCE
Dans le compte central, l'investissement des entreprises évoluerait à un rythme de 4,3 % en moyenne annuelle (6,3 % dans le scénario « haut »). Sa progression serait plus rapide que celle observée sur la période récente ( 3,5 % entre 1987 et 2007 ). Le taux d'investissement des entreprises se redresserait progressivement, de 17,7 % en 2007 à 20 % en 2012 dans le scénario central (voire 21,2 % dans le scénario haut), soit un niveau de 13 % supérieur à la moyenne de la période 1987-2007.
Ces évolutions supposent une orientation plus favorable de la demande des entreprises.
Elles restent néanmoins cohérentes avec ce qu'il est permis d'observer dans les épisodes de reprise économique. Ainsi, entre 1997 et 2000, l'augmentation annuelle moyenne de l'investissement des entreprises s'est élevée à près de 7 % en volume (contre 4,3 % dans le compte central). De fait, une progression rapide de l'investissement des entreprises est une perspective habituelle quand l'économie sort d'un point bas du cycle.
En revanche, le maintien sur plusieurs années de telles augmentations serait inusuel.
Il est à noter que, dans les deux scénarios, l'effort des entreprises est couplé à un effort des ménages (baisse substantielle du taux d'épargne), de manière à contrecarrer une impulsion budgétaire 27 ( * ) fortement négative (- 0,6 point de croissance du PIB sur la période 2008-2012) afin d'autoriser une croissance néanmoins élevée : 2,5 % en moyenne dans le scénario central.
Cette augmentation progressive du taux d'investissement est aussi de nature à limiter les tensions sur l'appareil productif , et contribue ainsi à la possibilité d'une forte diminution du taux de chômage (commune aux deux scénarios, voir infra ) sans que ne se manifestent de tensions inflationnistes .
Il reste que le contenu en importations des investissements est relativement élevé par rapport à celui de la consommation des ménages , ce qui, à court terme 28 ( * ) , est susceptible de dégrader la contribution du commerce extérieur par rapport à une situation où la croissance est « tirée » par la consommation.
Les deux scénarios, qui reposent sur l'hypothèse, en partie conventionnelle, selon laquelle le commerce extérieur cesserait de contribuer négativement à la croissance, ne comprennent pas de tels effets. Ils peuvent, sous cet angle, être qualifiés d'optimistes, même si l'hypothèse de neutralité du commerce extérieur, formulée à partir d'une situation fortement dégradée, revient seulement à envisager que le déficit extérieur ne se creuserait pas davantage.
B. LES CONDITIONS D'UNE ACCÉLÉRATION DE L'INVESTISSEMENT
L'investissement est la variable économique la plus fluctuante des grandes données macro-économiques et celle qui est la plus sensible aux fluctuations de l'activité.
Le comportement d'investissement des entreprises fait l'objet d'un grand nombre de travaux théoriques et empiriques. Leur but est d' identifier les déterminants de l'investissement des entreprises et de mesurer la façon dont la politique économique, par exemple à travers la fiscalité des entreprises et des ménages et le niveau des taux d'intérêt, peut influencer leur comportement.
Les conclusions des différentes approches conduisent à souligner l'interdépendance des facteurs d'offre et de demande.
Dans le contexte actuel d'une relative abondance des liquidités et de taux d'intérêts n'atteignant pas un niveau dissuasif, votre Délégation observera que le volume de la demande anticipée par les entreprises paraît constituer, dans la généralité des cas, une variable décisive.
1. Retour sur les déterminants de l'investissement
D'un point de vue théorique, trois conditions majeures sont généralement considérées comme essentielles pour l'investissement.
• En premier lieu, l'
existence de
débouchés
: la FBCF doit permettre de satisfaire un
supplément de demande des produits ou services proposés par
l'entreprise. Toutefois, lorsque l'entreprise n'utilise pas pleinement sa
capacité de production, elle peut accroître sa production sans
investir. La FBCF intervient donc quand le taux d'utilisation des
équipements est proche de son niveau maximum. De fait, le taux
d'utilisation moyen des capacités de production (TUC) dépasse
rarement 90 %.
Ainsi, l'évolution de l'investissement est fortement corrélée au niveau de la demande anticipée et au taux d'utilisation des capacités de production . Par voie de conséquence, elle se trouve également corrélée à la progression du PIB (dont l'évolution de la consommation et de l'investissement se trouvent être les déterminants majeurs). En vertu du principe de l'« accélérateur» 29 ( * ) , toute variation de la demande entraînerait mécaniquement une variation de la FBCF qui lui est supérieure, à condition qu'il n'existe pas de capacité de production inemployée. Cette représentation permet d'expliquer la « nervosité » de l'investissement en réaction aux variations de l'activité.
• En second lieu, une
capacité
financière suffisante
pour autoriser l'effort d'investissement
est requise. Les contraintes de financement sont déterminées par
le coût de l'équipement prévu et par la structure
financière de l'entreprise.
L e coût du capital fixe dépend du taux d'intérêt réel , que l'entreprise s'endette en émettant des obligations ou en recourant au crédit bancaire.
Si une accélération de l'inflation allège les charges financières, la désinflation pénalise au contraire les entreprises endettées. Plus le taux d'endettement 30 ( * ) est élevé, plus l'inflation est faible avec des taux nominaux d'intérêt élevés, et plus les entreprises sont encouragées à améliorer leur structure financière 31 ( * ) avant d'investir .
La rentabilité économique du capital , enfin, sert de « curseur » à l'entreprise. La rentabilité économique du capital fixe est égale au rapport de l'excédent brut d'exploitation (EBE) au stock de capital fixe (K). Elle est une fonction croissante du taux de marge (EBE / VA) qui, dépendant du taux de salaire réel et de la productivité du travail, rend compte du partage de la valeur ajoutée allant aux profits de l'entreprise. Lorsque la part des salaires dans la valeur ajoutée se réduit, le taux de marge, toutes choses étant égales par ailleurs, s'améliore. Tant que la rentabilité économique du capital est supérieure au taux d'intérêt réel, l'entreprise peut élever son taux d'endettement. Elle améliore ainsi sa rentabilité financière , qui dépend du différentiel entre la rentabilité économique et le coût de financement de l'entreprise. Lorsque le taux d'intérêt réel devient supérieur à la rentabilité économique, la rentabilité financière diminue d'autant plus vite que le taux d'endettement est élevé et la priorité revient alors au désendettement.
• En troisième lieu,
l'investissement
doit être profitable.
La profitabilité
est
la différence entre le taux de
rentabilité du capital et le taux d'intérêt réel
à long terme des marchés financiers.
Une
profitabilité trop faible, en raison de taux d'intérêts
réels élevés, est susceptible d'entraîner une
éviction de l'investissement physique
par des placements
financiers.
2. Le rôle déterminant de la demande
a) L'intérêt d'améliorer la capacité financière des entreprises
La rentabilité économique du capital est un déterminant essentiel de l'investissement. Elle est une fonction croissante du taux de marge qui, depuis le début des années 1990, se situe à un niveau historiquement élevé, ainsi qu'il ressort du graphique suivant :
GRAPHIQUE N° 3
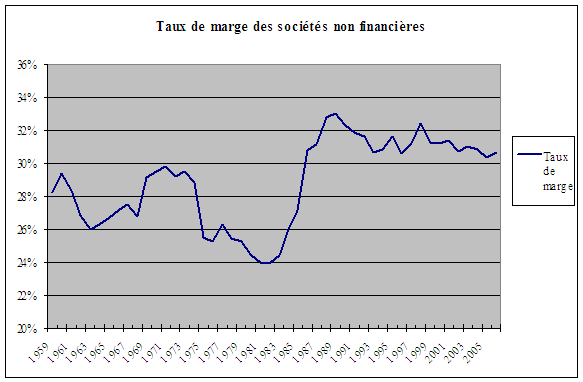
Source : d'après données INSEE
Il est à noter que, pour accompagner l'accélération de l'investissement, le scénario central retient l'hypothèse d'une maîtrise des coûts salariaux ( cf. tableau 8 du rapport de l'OFCE en annexe ) favorable à la bonne tenue des taux de marge, qui progresseraient de près de 2 points sur la période 2008-2012.
Le précédent rappel des déterminants de l'investissement souligne par ailleurs le rôle central des taux d'intérêt, qui interviennent non seulement dans le calcul économique de l'entreprise (les gains attendus de l'investissement doivent permettre de couvrir son coût, qui comprend des intérêts d'emprunt), mais encore dans son calcul financier (le gain actualisé de l'investissement doit être supérieur à celui que procure la rémunération d'un placement à long terme).
Contrairement à une opinion répandue, les taux d'intérêt réels ne peuvent être considérés, aujourd'hui, comme historiquement bas ou « plutôt accommodants », ainsi que le fait apparaître le graphique suivant :
GRAPHIQUE N° 4
TAUX NOMINAL ET RÉEL DEPUIS 1973 32 ( * )
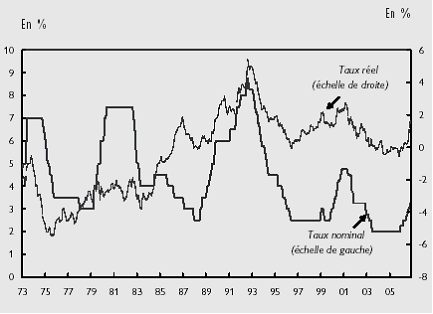
Sources : Bundesbank, BCE et Eurostat
Tout au plus, le principal taux directeur de la banque centrale européenne, aujourd'hui fixé à 4 %, peut-il être considéré comme « neutre ». Un taux d'intérêt réel « neutre » renvoie à l'idée d'un taux en phase avec la croissance potentielle de l'économie ; ainsi, la valeur de 2 % en termes réels est le plus souvent retenue.
Les scénarios présentés sont assis sur une stabilité des taux d'intérêt. Cette hypothèse paraît être une condition majeure de la croissance décrite dans ces scénarios. Sa plausibilité peut être appréciée en fonction d'une série de raisonnements :
•
A court terme
, des tensions sont
intervenues sur les taux d'intérêt en conséquence de la
crise des subprime. Elles ont incité les banques centrales à
réagir, pour l'une, à baisser ses taux d'intervention
(Réserve fédérale des Etats-Unis), pour l'autre (la BCE)
à se contenter de ne pas les augmenter. Ainsi, les capitaux en
provenance des pays émergents cherchant à s'investir étant
structurellement très abondants, la crise de liquidité actuelle
pourrait bien n'être que passagère.
• Dans la zone euro,
à moyen
terme
, la tendance à la réduction des déficits
publics devrait se traduire par une moindre demande d'emprunt public et donc
aller dans le sens d'une baisse des taux d'intérêt.
Par ailleurs, le cycle monétaire aux Etats-Unis devrait jouer. Un desserrement des conditions monétaires pourrait intervenir. Dans ces conditions, l'eurogroupe pourrait, à la faveur d'une prise de conscience collective, décider de tenir compte du handicap que constitue le cours de l'euro face au dollar pour la compétitivité de la zone euro. La BCE pourrait être incitée à ce que ses taux d'intérêts ne suivent pas une pente éloignée de ceux de la FED, qui s'est fixé, elle, des objectifs plus résolument orientés vers la croissance ( cf. chapitre IX ) 33 ( * ) .
Ces facteurs de détente doivent toutefois être mis en balance avec les orientations de taux que seraient susceptibles d'engendrer les tensions inflationnistes liées, par exemple, à une hausse du prix des matières premières dans le contexte d'une activité mondiale qui demeurerait soutenue.
Quoi qu'il en soit, la mise en place d'une politique monétaire plus accommodante pourrait favoriser une accélération de l'investissement des entreprises , dans le contexte d'une situation financière des entreprises qui s'est globalement assainie ces dernières années ( cf. graphique n° 5 ci-dessous ) et de l'existence de besoins de rattrapage.
L'actuelle crise de liquidité interbancaire donne à ce propos, de façon probablement passagère, une acuité particulière, même si la réflexion sur un meilleur accès des entreprises au crédit, notamment des PME, mérite d'être poursuivie.
GRAPHIQUE N° 5
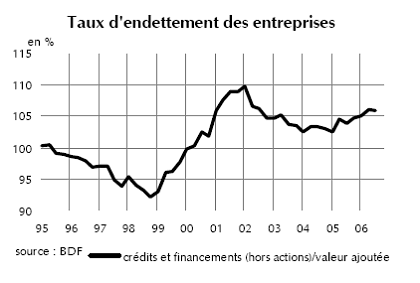
b) La nécessité de restaurer la crédibilité de la croissance
Votre Délégation observe qu'à moyen terme, dans un contexte où les taux d'intérêts réels demeureraient fondamentalement proches de la neutralité, la rentabilité économique dépendra aussi de la demande effective . A cet égard, il peut être éclairant de rappeler les résultats d'une enquête relativement ancienne, qu'il convient de mettre en perspective avec le graphique ( supra ) retraçant l'évolution des taux d'intérêt réels :
POIDS DES DIFFÉRENTS FREINS À
L'INVESTISSEMENT
SELON LES CHEFS D'ENTREPRISE
|
% des chefs d'entreprises citant cette cause |
1992 |
1998 |
|
Taux d'intérêt |
84 |
12 |
|
Demande |
75 |
78 |
|
Fonds propres |
64 |
50 |
|
Rentabilité |
60 |
58 |
|
Endettement |
57 |
23 |
Source : Enquête de conjoncture INSEE, 4 e trimestre 1999
Ce rapprochement suggère que, depuis la fin des années quatre-vingt dix, le frein principal à l'investissement se situe du côté de la demande anticipée.
Pour que les entreprises prennent la décision d'investir, il faut avant tout conforter leurs perspectives, ce qui plaide pour une politique de croissance.
Si, dans l'économie mondialisée, la propension à investir dans les zones qui offrent des coûts de production réduits est forte, l'importance des perspectives locales de chiffre d'affaires ne doit pas être négligée.
Même si la croissance en zone euro est moins rapide que dans les pays émergents, une bonne orientation de l'activité, même sur un rythme moins élevé, y recèle encore des occasions d'augmenter les chiffres d'affaires qui se comparent avec d'autres zones.
|
La mondialisation de l'investissement Avec 65 milliards d'euros en 2006 34 ( * ) (montant identique à 2005), la France se situe à la troisième place 35 ( * ) parmi les pays de l'OCDE (hors Luxembourg) comme pays d' accueil des investissements directs étrangers (IDE) 36 ( * ) . Mais avec 92 milliards d'euros en 2006 (97 milliards d'euros en 2005), la France est demeurée le deuxième plus grand pays investisseur dans les pays de l'OCDE (derrière les Etats-Unis). Les comparaisons de rentabilités économiques sur les différents territoires constituent le déterminant majeur de l'investissement des grandes entreprises. On peut ainsi identifier deux raisons principales d'investir à l'étranger : la diminution des coûts de production et l'accès à certains marchés , ce dernier mobile étant le plus susceptible de profiter au territoire français . Les investissements directs étrangers permettent à la fois d'accéder aux secteurs innovants des pays développés et de trouver, sur place, des débouchés à la production. Les perspectives de croissance locales constituent donc un facteur décisif pour attraire l'investissement étranger en France et pour y maintenir l'investissement national . Réciproquement, la recherche de moindres coûts est susceptible d'encourager l'investissement à l'étranger, qu'il s'agisse de délocalisations ou de « non-localisations ». Naturellement, il serait vain d'inciter à une plus grande maîtrise des coûts salariaux pour réduire utilement le très grand écart des rémunérations entre les anciennes démocraties industrialisées et les pays en voie de développement. La question posée aujourd'hui est plutôt celle de l'identification des secteurs à forte valeur ajoutée dans lesquels il s'agit de garder on de conquérir une place de premier rang, et d'y favoriser l'intensité de l'investissement en recherche et développement. Quoi qu'il en soit, les mouvements d'investissement transnationaux sont marqués par une grande volatilité . Par exemple, après avoir enregistré un recul continu entre 2000 (193 milliards d'euros investis) et 2004 (46 milliards d'euros investis), depuis 2005, l'investissement français a enregistré l'effet de nombreuses opérations d'acquisitions de firmes étrangères. Pour les grandes entreprises cotées en bourse, la croissance externe constitue, en effet, le moyen d'éviter de devenir, elles-mêmes, victimes d'une offre publique d'acquisition (OPA), en devenant trop onéreuses. S'il s'agit d'investissements souvent lourds et risqués, ils ne créent pas, d'un point de vue macroéconomique, de richesses supplémentaires puisque les entreprises en question existent déjà. On observe ainsi que la capacité d'investissement des « entreprises du CAC 40 » est largement utilisée pour des opérations qui ne débouchent pas sur le développement de nouvelles capacités de production . D'une façon générale, le bilan de l'investissement mondial pour la France dépend, pour une partie substantielle, de déterminants aussi complexes, difficilement mesurables ou peu généralisables que l'attractivité des territoires, les opportunités d'acquisitions et les mouvements financiers intra-groupes. |
A ce propos, on peut être sensible aux considérations exposées par Jean-Paul FITOUSSI, président de l'OFCE, sur les causes de l'accélération considérable de la productivité aux Etats-Unis dans les années 90, quand il estime que celle-ci était « la conséquence d'une gestion de l'activité, qui, à l'échelle du pays réduit le risque d'investissement. (...) Aux Etats-Unis, on a à peu près huit années de croissance par décennie, une année de récession, et une année de croissance molle. En Europe, on a habituellement trois années de croissance par décennie, une ou deux années de récession, et cinq années de croissance molle. Ce qui fait qu' un investisseur sur un marché européen est soumis à un risque d'activité beaucoup plus important que son correspondant sur le marché américain ».
Ainsi, il semble qu'une crédibilité restaurée en termes de perspectives de croissance serait de nature à favoriser une dynamique d'accumulation plus rapide du capital.
Cette considération pose, en premier lieu, la question de la capacité de la zone euro à appliquer une stratégie de croissance autonome. Y répondre suppose que soient clairement et mieux posés, à l'échelle de la zone euro, les termes de la coordination des politiques économiques en son sein, notamment entre la politique monétaire et la politique budgétaire ( cf. chapitre IX ).
En définitive, il paraît souhaitable d'orienter les politiques économiques vers un objectif de forte croissance, non seulement en France mais aussi en Europe : elle seule offre la garantie de débouchés constants à la production, condition première de l'investissement, lui-même condition forte de l'élévation du rythme de la croissance potentielle .
CHAPITRE IV - VERS UNE ÉLÉVATION DU RYTHME DE LA CROISSANCE POTENTIELLE ?
L'élaboration de scénarios macroéconomiques à moyen terme suppose la fixation préalable d'une hypothèse fondamentale, relative à l'évolution de la productivité du travail .
Cette hypothèse est centrale, à un double titre : à court terme , elle détermine l'évolution de l'emploi et du chômage en fonction de la croissance - c'est-à-dire le contenu en emploi de la croissance - ; à moyen terme, elle détermine les capacités de croissance durable, sans tensions inflationnistes, de l'économie française - c'est-à-dire sa croissance potentielle -, qui influe sur la croissance effective , mais aussi sur la définition de la politique économique , et notamment des politique budgétaire et monétaire souhaitables.
Cette ambivalence de la productivité peut placer la politique économique face à un conflit d'objectifs 37 ( * ) : dans un contexte de faible croissance, il peut être rationnel de mettre en oeuvre des politiques d'enrichissement du contenu en emplois de la croissance - donc de ralentir les gains de productivité - afin de lutter contre le chômage, mais ces mêmes politiques peuvent contribuer à terme, si elles sont maintenues au-delà des circonstances qui les avaient initialement justifiées, à abaisser le potentiel de croissance et à affaiblir structurellement l'économie.
|
DÉFINITIONS DE LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL La productivité par tête est le rapport entre la production et le nombre de personnes employées (PIB/salariés). La productivité horaire est le rapport entre la production et le nombre d'heures travaillées (PIB/nombre d'heures travaillées). |
I. PRODUCTIVITÉ ET CONTENU EN EMPLOIS DE LA CROISSANCE
Dans une perspective de court/moyen terme, les facteurs de demande sont déterminants pour la croissance économique : environnement international et demande étrangère, politique budgétaire et demande publique, évolutions salariales et consommation des ménages, etc.
A ces horizons, l'hypothèse retenue en matière de productivité du travail ne fait que déterminer le contenu en emploi de la croissance, ce que l'on peut déduire de la simple identité comptable suivante : le PIB est égal au produit de la production par personne employée (c'est-à-dire la productivité du travail) par le nombre d'emplois .
Ainsi, pour un taux de croissance donné, la croissance de l'emploi sera d'autant plus faible que l'évolution de la productivité sera forte .
Dans le scénario central réalisé pour le présent rapport, qui correspond au « scénario bas » associé à la programmation pluriannuelle des finances publiques, la croissance du PIB ressort à 2,5 % par an en moyenne à l'horizon 2012. L'hypothèse d'évolution de la productivité du travail est fixée à 1,7 % : on en déduit que la progression de l'emploi total est de 0,8 % par an en moyenne 38 ( * ) . Sur la base d'une progression de la population active qui ralentit de 0,3 % par an à 0,2 % par an de 2008 à 2012, le taux de chômage diminue sensiblement : il serait ramené de 8,2 % en 2007 à 6 % en 2012 .
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI ET DU CHÔMAGE À MOYEN TERME (SCÉNARIO CENTRAL)
|
Variations |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
87-97 |
97-07 |
2007-2012 |
|
Emploi total (milliers) |
190 |
245 |
150 |
198 |
192 |
191 |
197 |
77 |
264 |
185 |
|
Emploi salarié marchand (en %) |
0.8 |
1.4 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
0.5 |
1.5 |
1.0 |
|
Population active
|
0.6 |
0.4 |
0.3 |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.3 |
0.7 |
0.2 |
|
Taux de chômage (BIT) |
9.0 |
8.2 |
7.9 |
7.5 |
7.0 |
6.5 |
6.0 |
10.7 |
9.9 |
7.2 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE
Dans le scénario « haut », le supplément de croissance (0,5 point, pour atteindre 3 %) est identique à celui de l'augmentation de la productivité, qui accélère par hypothèse pour atteindre 2,2 %. Les créations d'emplois y seraient donc du même ordre de grandeur que dans le compte central, et le taux de chômage s'établirait, de la même façon, à 6 % en 2012 .
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI ET DU CHÔMAGE À MOYEN TERME (SCÉNARIO HAUT)
|
Variations |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
87-97 |
97-07 |
2007-2012 |
|
Emploi total (milliers) |
190 |
245 |
150 |
202 |
192 |
196 |
197 |
77 |
264 |
187 |
|
Emploi salarié marchand (en %) |
0.8 |
1.4 |
1.0 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
0.5 |
1.5 |
1.1 |
|
Population active
|
0.6 |
0.4 |
0.3 |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.3 |
0.7 |
0.2 |
|
Taux de chômage (BIT) |
9.0 |
8.2 |
7.9 |
7.5 |
7.0 |
6.5 |
6.0 |
10.7 |
9.9 |
7.2 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE
Dans le scénario central, l'hypothèse de gains de productivité du travail de 1,7 % par an est purement tendancielle : elle correspond à la prolongation de l'évolution moyenne de la productivité enregistrée depuis une vingtaine d'années, corrigée des évolutions de la durée du travail 39 ( * ) . Autrement dit, elle correspond à une double hypothèse de prolongation tendancielle de l'évolution de la productivité horaire et de stabilisation de la durée du travail.
*
Il est à noter qu'à très court terme, les évolutions de la productivité sont marquées par le « cycle de productivité » : dans une phase d'accélération de l'activité, les entreprises tardent à ajuster l'emploi, ce qui entraîne une augmentation de la productivité. Dans une phase de ralentissement, le phénomène inverse se produit. Le graphique n° 1 suivant rend compte du caractère heurté de l'évolution de la productivité à court terme :
GRAPHIQUE N° 1
PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL DANS LES BRANCHES MARCHANDES
(Glissement annuel, en %)
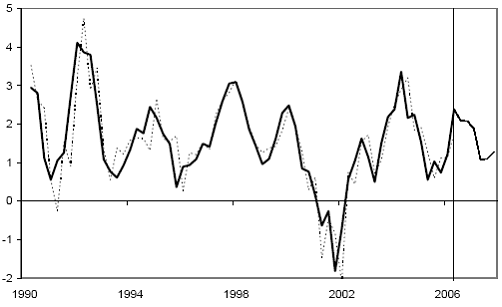
Légende : les valeurs connues et ajustées de la productivité du travail sont respectivement affichées en gras et en pointillé.
Source : Comptes nationaux, modèle e-mod.fr
II. PRODUCTIVITÉ ET CROISSANCE POTENTIELLE
A. UN LIEN DIRECT ENTRE PRODUCTIVITÉ, CROISSANCE POTEN-TIELLE ET EMPLOI
1. La croissance potentielle à moyen terme de l'économie française
Dans une perspective structurelle, les facteurs d' offre (main d'oeuvre disponible, efficacité - ou productivité - de cette main d'oeuvre) sont déterminants : on peut en déduire par addition la croissance maximale que l'économie peut atteindre sans tension sur les capacités de production, donc sans tension inflationniste, croissance que l'on nomme « croissance potentielle » .
Ce concept est d'autant plus important qu'à un horizon de moyen terme, la croissance effective tend à rejoindre la croissance potentielle , sauf si la politique économique pèse durablement sur la croissance (pour respecter la contrainte d'assainissement budgétaire par exemple).
A partir de l'identité comptable exposée précédemment ( PIB = productivité du travail x emploi) , la croissance potentielle de l'économie française ressort aujourd'hui à 2 % (soit 1,7 % (gains productivité) + 0,3 % (augmentation de la main d'oeuvre disponible). A moyen terme, en raison de l'inflexion de la hausse de la population active ( supra ) », la croissance potentielle s'infléchirait légèrement, pour s'établir à 1,9 % (soit 1,7 % (gains productivité) + 0,2 % (augmentation de la main d'oeuvre disponible).
|
PORTÉE DE LA RÉFLEXION SUR LA CROISSANCE POTENTIELLE Les estimations de croissance potentielle participent largement à la définition de la politique monétaire de la Banque centrale et aux conditions de surveillance des positions budgétaires effectuée dans le cadre du Pacte de stabilité et de croissance européen : lorsque l'activité évolue en dessous de son potentiel, le risque inflationniste est plus faible et la Banque centrale peut en tenir compte pour la fixation des taux d'intérêt à court terme. Par ailleurs, plus la croissance potentielle est forte, moins l'assainissement budgétaire est difficile à conduire . Par exemple, la dépense publique devrait, en 2007, augmenter de 2 % en volume. L'appréciation que l'on peut porter sur la politique budgétaire discrétionnaire varie selon le niveau de la croissance potentielle. Dans le cas présent, celui d'une croissance potentielle de 2 %, la dépense publique augmente comme l'activité et l'effort structurel est nul 40 ( * ) . Dans le cas d'une croissance potentielle supérieure, établie par exemple à 3 %, la réduction du déficit public structurel serait de 0,5 point de PIB 41 ( * ) , ce qui caractérise une politique d'assainissement budgétaire marqué. |
2. Des perspectives démographiques désormais plus favorables
Les chiffres précédents tiennent compte des dernières projections démographiques de l'INSEE. Exposées en détail dans le précédent rapport d'évaluation de la politique économique à moyen terme de votre Délégation, elles se sont traduites par un rehaussement des perspectives de population en âge de travailler. Cette amélioration s'est ajoutée aux effets attendus de la réforme des retraites de 2003 en termes de maintien sur le marché du travail des populations jusqu'alors en état de liquider leurs pensions.
Au total, au lieu de se réduire, la population active devrait légèrement augmenter .
Cette révision des projections démographiques a conduit à réviser les perspectives de croissance de l'économie française et détendu considérablement les contraintes pour les finances publiques associées aux projections démographiques qui précédaient.
Le taux de croissance potentielle, recalculé par l'OFCE, s'est trouvé supérieur de 0,4 point par an sur la période 2006-2010, et de 0,3 point au cours de la période 2011-2050 malgré une hypothèse minorant les gains de productivité du travail de 0,1 point 42 ( * ) par rapport aux hypothèses précédentes.
Une révision de même sens, mais de moindre ampleur, est intervenue en Italie et en Espagne.
3. Les conditions d'une croissance effective soutenue par la productivité
Quand les facteurs d'offre l'emportent sur les facteurs de demande pour déterminer la croissance effective de l'économie, une accélération de la productivité n'est pas défavorable à l'emploi.
Dans une telle configuration, la productivité du travail ne détermine plus le contenu en emploi de la croissance mais la capacité de croissance de l'économie .
Une accélération de la productivité se traduira ainsi par une augmentation de la croissance potentielle mais aussi de la croissance effective, pour une croissance identique de l'emploi .
Par exemple, pour une croissance de 2 % par an, avec une productivité qui augmente de 1,7 % par an, l'emploi augmentera de 0,3 % ; avec une productivité qui progresse de 2,2 % l'an (scénario haut), la croissance à moyen terme sera de 2,5 % - niveau de la croissance potentielle -, et l'augmentation de l'emploi sera toujours de 0,3 %.
Le « bouclage » macroéconomique entre ces deux rythmes de croissance s'effectue via la distribution du revenu : dans le premier cas, les salaires - évoluant en ligne avec la productivité - augmentent de 1,7 % par an ; dans le deuxième, ils progressent de 2,2 % par an.
A long terme, il est habituel de considérer que les salaires évoluent comme la productivité , ce qui revient à une stabilisation du partage de la valeur ajoutée entre salaires et profits.
B. LES MOYENS D'UNE RELANCE DE LA CROISSANCE POTENTIELLE
Les « réformes structurelles » , dont l'objectif est d'augmenter la croissance potentielle de l'économie, passent généralement par deux voies : l' augmentation de la main d'oeuvre disponible et l' augmentation de la productivité du travail.
1. L'augmentation de la main d'oeuvre disponible
Le levier de l'emploi est évoqué dans le Rapport économique, social et financier (RESF) annexé au projet de loi de finances pour 2008.
Le gouvernement y formule les hypothèses sous-jacentes au scénario central, « associé à une croissance potentielle qui augmente progressivement pour atteindre elle-même 2,5 % à l'horizon 2012 » . D'après le RESF 2008, « ce scénario tient compte des conséquences du vieillissement démographique avec l'arrivée à l'âge de la retraite des classes nombreuses du baby-boom (...). Il intègre surtout les effets des réformes structurelles sur le marché du travail qui contribueraient à un repli sensible du taux de chômage d'équilibre, rapprochant ainsi l'économie française du plein-emploi fin 2012. Dans le même temps, le taux d'emploi augmenterait pour se rapprocher de l'objectif de Lisbonne, soit 70 % » .
Dans le « scénario haut » du RESF 2008 « la croissance annuelle atteint 3 % dès 2009, avec une croissance potentielle sous-jacente progressivement renforcée pour atteindre elle aussi 3 % à l'horizon 2012 ». Ce scénario suppose « une hausse plus importante du taux d'emploi que dans le scénario [central] ».
De fait, la France mobilise insuffisamment la main d'oeuvre dont elle dispose. Bien qu'ayant progressé de 4 points depuis 1994, le taux d'emploi 43 ( * ) des 15-64 ans en France, établi à 63 % en 2006, reste en dessous de la moyenne des pays de l'Union européenne (64,7 % dans l'UE 25) et de la zone euro (64,6 %) , notamment de celui des pays anglo-saxons (71,5 % au Royaume-Uni) ou scandinaves (73,1 % en Suède).
Le « document pour l'Eurogroupe » du 14 septembre 2007, qui décrit la trajectoire pluriannuelle des finances publiques françaises en anticipant sur le programme de stabilité qui sera présenté en décembre 2007, précise que « le Gouvernement français souhaite se rapprocher au maximum de l'objectif européen figurant dans la stratégie de Lisbonne, soit un taux d'emploi de 70 %. Une hausse du taux d'emploi de 62,3 % aujourd'hui à 70 % en 2012 augmenterait le taux de croissance du PIB de plus de 1 % par an sur les 5 prochaines années » . Dans la perspective d'une telle embellie du taux d'emploi, l'évaluation du supplément de croissance paraît modeste : qu'un rehaussement d'au moins 12 % de l'emploi conduise à un supplément de croissance n'excédant guère 5 % suppose des rendements par tête fortement décroissants. Mais il est vrai que l'élasticité de la productivité au taux d'emploi semble négative (voir infra ).
A l'horizon du moyen terme, les marges de hausse du taux d'emploi concernent particulièrement les travailleurs de plus de 55 ans. Les concernant, ce taux est notoirement faible en France, où il s'établit, en 2006, à 37,6 % contre 41,7 % dans la zone euro.
Le gouvernement présente comme autant de politiques concernant le marché du travail susceptibles de rehausser le taux d'emploi :
- les réformes du service public de l'emploi ;
- l'augmentation de l'écart de revenu entre les bénéficiaires de minima sociaux et les travailleurs ;
- l'exonération des heures supplémentaires ;
- la suppression des dispositifs de préretraites ;
- l'augmentation moyenne des durées de cotisation, résultant aussi bien de la réforme des retraites de 2003, qui continue à déployer ses effets, que d'un « alignement » des régimes spéciaux, voire d'un nouvel allongement de la durée normale de cotisation que justifierait la progression de l'espérance de vie.
*
Outre les rigidités du marché du travail, le gouvernement estime que « les réglementations sur les marchés des biens et des services sont aussi, le plus souvent, des obstacles à l'emploi » 44 ( * ) en s'appuyant sur plusieurs études mettant en évidence que le niveau élevé de la réglementation en France et le degré insuffisant de la concurrence y pèsent sur l'emploi. Un renforcement de la concurrence aurait des effets désinflationnistes favorisant une accélération de la demande et diversifierait en même temps les occasions d'emploi.
Dans une autre formulation, l'ambition de ce type de mesure est de faire en sorte que l'augmentation de la croissance potentielle s'accompagne d'une augmentation de la croissance effective.
|
LA PORTÉE D'UN RENFORCEMENT DE LA CONCURRENCE EN FRANCE 45 ( * ) Une étude récente 46 ( * ) suggère que 500.000 emplois supplémentaires pourraient être créés en France si la réglementation était alignée sur celle du pays de l'OCDE le plus « vertueux » en matière de concurrence, soit une hausse d'environ 1,2 point du taux d'emploi. Des simulations du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi montrent qu'une réduction d'environ 50 % des marges concentrée dans quelques services marchands (commerce de détail, hôtellerie-restauration et intermédiation financière) sous l'effet d'une concurrence accrue, permettrait d'augmenter à terme le PIB de 1,2 % et créerait 250.000 emplois. Sous l'hypothèse d'un plein effet de ces mesures à l'horizon 2012, une concurrence accrue dans ces secteurs « générerait 0,25 % de croissance et 50.000 emplois supplémentaires par an » . Des simulations réalisées à l'aide d'un modèle du FMI fournissent des ordres de grandeur encore plus élevés. Ils suggèrent que l'accroissement de la concurrence sur les marchés des biens et services relèverait à terme le niveau du PIB de 5 % à 8 % (soit entre 0,5 % et 1 % par an au cours des prochaines années). Les gisements de croissance se situent davantage dans l'accroissement de la concurrence sur le marché des services (entre +4 % et +7 % d'activité à terme) que sur les marchés des biens échangeables où la concurrence est déjà élevée. |
Les mesures envisagées par le Gouvernement 47 ( * ) pour supprimer les réglementations jugées inutiles et favoriser la concurrence concernent notamment les règles d'ouverture des commerces le dimanche, le calcul du seuil de revente à perte (deuxième étape de la réforme de la loi Galland), les professions règlementées et le secteur bancaire.
Toutes ces perspectives sont sans doute souhaitables. Il reste qu'en situation de sous-emploi conjoncturelle, il est un peu hardi de tabler sur une élévation structurelle du taux d'emploi, surtout lorsque la politique des finances publiques est susceptible de peser sur la demande .
2. L'augmentation de la productivité du travail
Dans le scénario central, le RESF 2008 évoque « un coup d'arrêt à la tendance baissière observée depuis le début des années 80 sur le nombre d'heures travaillées par tête , en lien avec le nouveau régime d'exonérations fiscales et sociales sur les heures supplémentaires et complémentaires entrant en vigueur le 1 er octobre » , qui préserverait la croissance potentielle. A l'appui du scénario « haut », le même document invoque « une dynamique d'accumulation du capital plus rapide [qui] viendrait aussi soutenir la croissance potentielle ».
Dans le « document pour l'Eurogroupe » précité, il est précisé que « le second scénario intègre un effet rapide des réformes structurelles menées par le Gouvernement. Dans ce scénario, la croissance annuelle atteint 3 % dès 2009, avec une croissance potentielle sous-jacente progressivement renforcée en raison d'un dynamisme accru de l'emploi, de l'investissement et de la productivité globale des facteurs , et qui atteint 3 % à l'horizon de la période de projection ».
Les trois facteurs susceptibles de concourir à l'augmentation de la productivité du travail sont identifiés : durée du travail, intensité capitalistique et productivité globale des facteurs (PGF). L'intensité capitalistique et la PGF déterminent la productivité horaire du travail qui, combinée à la durée du travail, détermine la productivité du travail.
|
LES DÉTERMINANTS DE LA PRODUCTIVITÉ HORAIRE DU TRAVAIL Dans une approche dite de « comptabilité de croissance », l'évolution de la productivité horaire résulte de deux déterminants comptables : l' intensité capitalistique , ou rapport capital/travail ; elle explique la part de l'évolution de la productivité résultant de l'augmentation de la quantité ou de la qualité des machines mises à la disposition des travailleurs ; la productivité globale des facteurs (PGF), c'est-à-dire l'augmentation de la production qui ne peut pas s'expliquer par l'augmentation des deux facteurs de production (capital et travail) ; on considère que la PGF mesure le « progrès technique » au sens large, dont les déterminants sont essentiellement l'innovation et les progrès organisationnels. La PGF est aussi qualifiée de « résidu inexpliqué » (ou « résidu de Solow »). |
Il convient à ce stade d'évaluer l'impact des trois facteurs susceptibles de favoriser les gains de productivité et donc d'augmenter la croissance potentielle :
a) Le nombre d'heures travaillées
Le nombre d'heures travaillées a un impact direct 48 ( * ) sur la productivité du travail, puisque celle-ci (la productivité par tête) résulte du produit de la productivité horaire et de la durée du travail.
Le RESF 2007 invoquait déjà, à l'appui de la croissance potentielle, « un relèvement du nombre d'heures travaillées par tête ». Il était alors légitime de s'interroger sur les conditions dans lesquelles pourrait intervenir un relèvement de la durée du travail.
Aujourd'hui, le gouvernement semble compter sur le nouveau régime d'exonérations fiscales et sociales sur les heures supplémentaires pour mettre un terme à la tendance baissière observée ces dernières années concernant le nombre d'heures travaillées par tête (cf. citation supra ).
Or, à court terme , la recherche d'une augmentation de la durée du travail se traduit instantanément par une accélération de la productivité par tête et donc par une croissance moins riche en emplois. Une évolution de cette nature paraît peu souhaitable dans un contexte de sous-emploi. Elle ne semble d'ailleurs pas réellement anticipée puisqu'aussi bien la mesure ici commentée est désormais présentée comme une « mesure du pouvoir d'achat ».
Sans doute, peut-on observer que les allègements de cotisations sociales votés se traduiraient par une plus grande « modération salariale ». Le taux de marge des entreprises s'améliorant et les coûts salariaux unitaires diminuant, ce qui renforce la compétitivité-prix, un supplément de croissance pourrait être attendu de la contribution du commerce extérieur. Cet enchaînement correspondrait à une politique de désinflation compétitive .
A moyen terme , en outre, si toutefois le taux de chômage diminue suffisamment, ainsi que le laissent envisager les projections présentées dans ce rapport, une augmentation de la durée du travail permet d'augmenter la productivité par tête et la croissance potentielle .
b) L'intensité capitalistique
« Une dynamique d'accumulation plus rapide du capital » aboutirait à augmenter l'intensité capitalistique. Le Gouvernement 49 ( * ) part du principe que « les décisions d'investissement dépendent pour une grande part du coût auquel les entreprises peuvent se financer » et conclut que « la réduction du coût de financement est (...) un levier puissant pour favoriser l'accumulation du capital nécessaire à la croissance ».
Dans cette perspective, des mesures seraient prises en faveur de la réduction du coût de financement des entreprises. D'une façon générale, le gouvernement s'est donné pour objectif « de ramener la fiscalité des entreprises dans la moyenne européenne » 50 ( * ) .
Il reste que la crédibilité d'une croissance forte et durable demeure un facteur primordial pour entraîner une dynamique d'accumulation plus rapide du capital, ce qui pose la question de la capacité de la zone euro à appliquer une stratégie de croissance autonome (cf. chapitre III) . Enfin, l'orientation sectorielle de la main d'oeuvre qui se dessine en faveur des services à la personne pourrait peser sur la composante capitalistique de la productivité.
c) La productivité générale des facteurs (PGF)
La PGF résulte d'une utilisation plus efficace de la combinaison capital-travail via, notamment, une réorganisation du travail ou l'introduction d'innovations.
L'augmentation de la PGF résulte en particulier de l'arrivée d'entreprises nouvelles, plus innovantes que les entreprises existantes. Elle est caractéristique d'une économie où domine le processus d'innovation, et non celui d'imitation , c'est-à-dire d'une économie qui évolue à la « frontière technologique », autrement dit au stade le plus avancé - par rapport aux autres pays - du développement technologique.
Le Gouvernement entend oeuvrer en faveur de l'innovation : réforme et renforcement du crédit d'impôt recherche (CIR), rapprochement d'OSEO 51 ( * ) et de l'Agence de l'innovation industrielle (AII), incitation à la protection des innovations, réorientation de la recherche publique vers les secteurs les plus porteurs de débouchés industriels, nouveaux pôles de compétitivité, statut de « jeune entreprise universitaire »...
Partant du constat que la capacité d'innovation et de croissance des PME est « une des clefs des économies mondialisées », la Banque de France observe 52 ( * ) , pour sa part, qu'« un accompagnement spécifique des PME » durant les phases de ralentissement de l'activité pourrait être pertinent pour préserver leur effort d'innovation...
Enfin, l'accroissement de la qualification de la main d'oeuvre et une meilleure attractivité du territoire pour les personnes très qualifiées, seraient recherchés par le Gouvernement.
Pour utiles qu'elles soient, ces mesures ne paraissent pas susceptibles de participer à une élévation sensible de la PGF avant plusieurs années. Dans le cadre d'un rapport d'information sur l'impact macroéconomique de l'augmentation des dépenses de recherche 53 ( * ) , votre Délégation avait été conduite à distinguer deux périodes successives : le temps pour semer, le temps pour récolter . Au cours de la première période (4 à 5 ans), l'investissement en recherche et développement (R&D) pèse sur les déficits public et extérieur sans contrepartie immédiate en termes d'amélioration de l'offre. Au cours de la période suivante, l'investissement en R&D donne des résultats importants en termes de gains de productivité et de croissance, grâce à des innovations de processus (qui permettent de baisser les prix) et des innovations de produits (qui permettent d'améliorer la qualité). Pour obtenir les bénéfices de la deuxième période, il faut maîtriser les déséquilibres et les tensions inhérents à la première période 54 ( * ) .
Par ailleurs, votre délégation indique qu'elle entend porter une appréciation sur le rapport du ministère de l'économie des finances et de l'industrie intitulé « Technologies clés 2010 », étude prospective présentée en 2006 55 ( * ) dont l'objectif est d'identifier quelles seront les technologies les plus importantes pour l'industrie française à moyen terme. MM. Joseph Kergueris et Claude Saunier, membres de votre délégation, seront ainsi les auteurs d'un rapport d'information sur l'évaluation de la stratégie dite « Technologies clés 2010 », à paraître au premier semestre 2008.
Au total, le Gouvernement estime, dans le « document pour l'Eurogroupe » précité, que « les études disponibles montrent que les réformes engagées en France sont à la hauteur de l'objectif d'augmenter la croissance potentielle de 1 % à terme ». Sur la période 2008-2012, les « réformes structurelles sur le marché du travail » contribueraient à un rehaussement du PIB de 0,5 % par an et les « politiques pro-concurrentielles dans les services marchands », à un rehaussement du PIB de 0,3 % par an.
Il apparaît qu'un tel processus conditionne la crédibilité de la programmation financière pour les cinq ans à venir . Or, avec la perspective d'une croissance potentielle globalement inchangée dans la simulation de l'OFCE (fléchissant même de 2 % à 1,9 % en raison d'une moindre augmentation de la population active), le support pour une croissance effective de 2,5 % se trouve significativement affaibli.
III. LES PRÉMICES D'UN RESSAUT DE LA CROISSANCE POTENTIELLE DANS LA ZONE EURO
A. LA PRODUCTIVITÉ EN FRANCE ET DANS LE MONDE : UN PAYSAGE CONTRASTÉ
Au sein de l'Union européenne et des grands pays industrialisés, l'éventail de la productivité par tête et de la productivité horaire est large, ainsi que le montrent les deux tableaux infra . Il ressort que si la productivité par tête et la productivité horaire des Etat-Unis sont supérieures à la celles de la zone euro, la productivité horaire française, parmi les plus élevées de la zone euro, serait 56 ( * ) même supérieure à celle des Etats-Unis .
Productivité par personne occupée (2006) Productivité horaire (2005)
Base 100 pour l'Union européenne à 27 Base 100 pour l'Union européenne à 15
|
Zone euro |
110,3 |
UE (à 27 pays) |
100 |
|
Luxembourg |
183,3 |
Hongrie |
74,8 |
|
Belgique |
134,5 |
République tchèque |
71,2 |
|
Irlande |
132,1 |
Slovaquie |
70,4 |
|
France |
125,3 |
Portugal |
67,9 |
|
Autriche |
122 |
Estonie |
63,7 |
|
Pays-Bas |
114,4 |
Pologne |
61,5 |
|
Finlande |
111,5 |
Lituanie |
58,6 |
|
Royaume-Uni |
110,6 |
Lettonie |
52,9 |
|
Suède |
110,1 |
Roumanie |
38,3 |
|
Italie |
109,5 |
Bulgarie |
35,3 |
|
Danemark |
108,4 |
PAYS HORS UE |
|
|
Grèce |
106,6 |
Norvège |
160 |
|
Allemagne |
106,4 |
Etats-Unis |
140,3 |
|
Espagne |
100,3 |
Suisse |
108,8 |
|
Malte |
88,2 |
Islande |
107,6 |
|
Chypre |
85,6 |
Croatie |
61,4 |
|
Slovénie |
84,7 |
Turquie |
42,6 |
|
Zone euro |
102,1 |
UE (à 25 pays) |
91,4 |
|
Luxembourg |
164,6 |
Slovaquie |
57,6 |
|
Belgique |
126,8 |
Portugal |
57,5 |
|
France |
119,7 |
Hongrie |
54,9 |
|
Pays-Bas* |
119,7 |
République tchèque |
52,2 |
|
Allemagne |
110 |
Estonie |
45,2 |
|
Irlande |
105,1 |
Pologne |
44,8 |
|
Danemark |
102 |
Lituanie |
43,6 |
|
Suède |
101,5 |
Lettonie* |
35,7 |
|
Autriche |
99,2 |
Bulgarie |
30,4 |
|
Finlande |
94,6 |
Roumanie |
n.c. |
|
Italie |
90,8 |
||
|
Espagne |
89,9 |
||
|
Royaume-Uni |
89,8 |
PAYS HORS UE |
|
|
Malte* |
73,4 |
Norvège |
160,6 |
|
Grèce* |
72,1 |
Etats-Unis |
116,7 |
|
Chypre |
69,5 |
Suisse** |
100 |
|
Slovénie* |
69 |
Islande |
89,9 |
D'après les dernières données Eurostat disponibles ; le PIB a été exprimé en SPA 57 ( * ) par personne occupée et par heure de travail. * données 2004 ** donnée 2003
Cependant, le haut niveau de la productivité horaire constaté dans de nombreux pays européens est souvent partiellement attribué à la faiblesse de la durée du travail et du taux d'emploi :
- concernant la durée du travail, ses rendements seraient globalement décroissants en raison d'effets de fatigue. Des travaux économétriques concordants montrent une élasticité négative de la productivité horaire à la durée du travail, de l'ordre de -0,4 ;
- le taux d'emploi présenterait aussi un rendement par tête décroissant, les personnes les moins productives étant, d'une façon générale, les premières à être exclues de l'emploi ; les travaux de la Banque de France estiment à -0,4/0,5 l'élasticité de la productivité au taux d'emploi.
Ainsi, le bon niveau de la productivité horaire dans certains pays européen, par rapport aux États-Unis, ne s'expliquerait pas uniquement par l'efficacité économique mais aussi par une durée du travail plus courte et des taux d'emploi plus faibles .
Inversement, on peut rappeler que les délocalisations exercent un impact favorable sur la productivité, les activités délocalisées étant généralement les moins productives ; ce phénomène profite particulièrement à la productivité des Etats-Unis.
B. LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES DE PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL DANS LA ZONE EURO ET AUX ETATS-UNIS
1. L'importance confirmée de la contribution des services
Les contributions sectorielles à la croissance de la productivité sont relativement homogènes. Les services y apportent la plus forte contribution, ainsi qu'il ressort du tableau suivant :
CONTRIBUTIONS SECTORIELLES À LA CROISSANCE DE PRODUCTIVITÉ NATIONALE
|
France |
Allemagne |
Zone euro |
États-Unis |
|
|
Agriculture |
||||
|
1995-2006 |
-0,01 |
0,02 |
-0,01 |
0,01 |
|
1995-2000 |
0,07 |
0,03 |
0,04 |
0,00 |
|
2000-2006 |
-0,08 |
0,00 |
-0,05 |
0,02 |
|
Construction |
||||
|
1995-2006 |
-0,06 |
-0,18 |
-0,03 |
0,00 |
|
1995-2000 |
-0,17 |
-0,22 |
-0,09 |
0,01 |
|
2000-2006 |
0,04 |
-0,16 |
0,01 |
0,00 |
|
Commerce |
||||
|
1995-2006 |
0,29 |
0,33 |
0,28 |
0,73 |
|
1995-2000 |
0,33 |
0,33 |
0,34 |
0,74 |
|
2000-2006 |
0,26 |
0,32 |
0,22 |
0,73 |
|
Industrie |
||||
|
1995-2006 |
0,37 |
0,37 |
0,22 |
0,24 |
|
1995-2000 |
0,56 |
0,15 |
0,30 |
0,36 |
|
2000-2006 |
0,21 |
0,56 |
0,13 |
0,12 |
|
Finance |
||||
|
1995-2006 |
0,45 |
0,61 |
0,45 |
0,74 |
|
1995-2000 |
0,58 |
0,84 |
0,62 |
0,63 |
|
2000-2006 |
0,34 |
0,42 |
0,30 |
0,84 |
|
Autres services |
||||
|
1995-2006 |
0,03 |
0,19 |
0,06 |
0,04 |
|
1995-2000 |
-0,02 |
0,29 |
0,07 |
-0,23 |
|
2000-2006 |
0,08 |
0,11 |
0,07 |
0,30 |
|
Ensemble des secteurs |
||||
|
1995-2006 |
1,08 |
1,33 |
0,96 |
1,76 |
|
1995-2000 |
1,35 |
1,43 |
1,27 |
1,51 |
|
2000-2006 |
0,85 |
1,25 |
0,69 |
2,01 |
Source : données Banque de France
Ces dix dernières années, le commerce et la finance présentent la plus grande contribution à l'augmentation de la productivité dans les différents pays . Dans la zone euro, les contributions du commerce et de la finance sont moins importantes qu'aux États-Unis. Par ailleurs, les contributions de ces secteurs fléchissent en zone euro, alors qu'elles restent stables ou augmentent aux États-Unis. Le constat dressé pour la zone euro vaut pour la France.
2. La fin du « rattrapage » européen au milieu des années quatre-vingt-dix
Après une longue période, consécutive à l'après-guerre, durant laquelle la productivité dans la zone euro a progressé deux fois plus vite qu'aux Etats-Unis, un phénomène majeur est survenu ces 10 dernières années : l'accélération de la productivité aux Etats-Unis et sa décélération en Europe.
ÉVOLUTION COMPARÉE DE LA
PRODUCTIVITÉ HORAIRE DU TRAVAIL
DANS LA ZONE EURO ET AUX
ÉTATS-UNIS
Taux de croissance moyen
|
1951-1960 |
1961-1970 |
1971-1980 |
1981-1990 |
1991-1995 |
1996-2000 |
2001-2006 |
|
|
Zone euro |
5,0 % |
5,8 % |
4,0 % |
2,5 % |
2,1 % |
1,7 % |
0,9 % |
|
Etats-Unis |
2,5 % |
2,6 % |
1,6 % |
1,4 % |
1,0 % |
2,3 % |
2,3 % |
Source : Groningen Growth and Development Centre, Total Economy Database, January 2007
Une explication est communément avancée : les États-Unis ont pro?té sans entraves de l'essor des technologies de l'information et de la communication (TIC), contrairement à l'Europe, aux prises avec des restructurations sectorielles et de nombreuses rigidités structurelles, dans le contexte aggravant d'un faible taux d'emploi.
3. Une convergence récente de la productivité aux États-Unis et dans la zone euro
Il se trouve qu'on observe, aux États-Unis, une baisse notable de la productivité du travail depuis 2005 , dont la dernière révision annuelle 58 ( * ) des comptes nationaux souligne l'acuité :
UNE BAISSE MARQUÉE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR TÊTE AUX ÉTATS-UNIS
|
2004 |
2005 |
2006 |
1 er semestre 2007 |
|
|
Taux (avant révision) |
2,8 % |
1,6 % |
1,5 % |
0,5 % |
|
Taux (après révision) |
2,5 % |
1,5 % |
1 % |
0,3 % |
Source : Bureau of Economics Analysis
Cette diminution traduit une augmentation de l'emploi parallèle à un moindre accroissement de la production. Or, ni le nombre d'heures travaillées ni d'éventuelles mutations sectorielles n'expliquent cette baisse, particulièrement vive dans l'industrie manufacturière et le secteur immobilier.
Dans le même temps, la productivité a accéléré dans la zone euro , passant de 0,2 % en 2002 à 1,4 % en 2006. La tendance paraît être à la poursuite de ce mouvement et, pour la première fois depuis 1995, la croissance de la productivité par tête dans la zone euro pourrait connaître durablement un rythme supérieur à celui des Etats-Unis.
Il convient cependant, afin d'apprécier justement la portée de l'évolution de l'écart de productivité entre les Etats-Unis et l'Europe, d'isoler certains facteurs :
- les écarts de conjoncture, qui sont responsables, à court terme, du cycle de la productivité ( supra ) ;
- le rendement décroissant du temps de travail et du taux d'emploi ( supra ).
En « retranchant » leurs effets, il a été possible de calculer, pour les Etats-Unis et la zone euro, une évolution de la productivité qu'on qualifiera de « structurelle ». La croissance de cette productivité tend à converger depuis 2004 même si, au sein de la zone euro, la situation demeure relativement contrastée.
GRAPHIQUE N° 2
PRODUCTIVITÉ PAR TÊTE CORRIGÉE DU
CYCLE
HORS EFFETS DES VARIATIONS DU TAUX D'EMPLOI
Augmentation en glissement annuel (%)
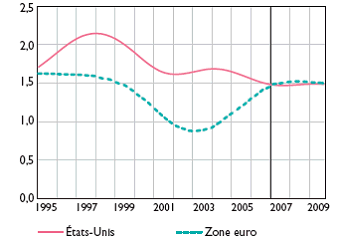
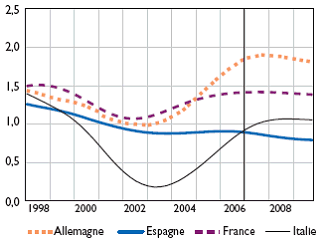
Sources : BEA, BLS, Eurostat, INSEE, Banque de France, prévisions OCDE
C. L'AMORCE D'UN RESSAUT DE LA CROISSANCE POTENTIELLE EN FRANCE ET DANS LA ZONE EURO ?
1. Une explication structurelle à moyen terme
Aux Etats-Unis , dans l'attente d'un ressaut technologique, la productivité du travail ralentirait en raison d'une certaine saturation de la diffusion des TIC et, peut-être, d'une plus grande sélectivité des investissements en TIC à la suite de l'éclatement de la « bulle Internet » en 2000. Ce ralentissement ne concernerait que les activités non industrielles.
Inversement, elle accélèrerait dans la zone euro , d'abord en raison de la fin de restructurations pénalisantes pour la productivité ; elles ont principalement concerné le secteur allemand de la construction et les secteurs industriels allemands et espagnols. Cette accélération pourrait se poursuivre, au bénéfice d'une diffusion plus rapide des TIC, grâce aux réformes structurelles en cours, qu'il s'agisse :
- de la fluidification du marché du travail ;
- de l'amélioration du niveau d'éducation ;
- de l'intégration et l'approfondissement des marchés financiers en Europe, afin de rendre l'accès au crédit des entreprises et des ménages aussi simple et avantageux que dans les pays anglo-saxons ;
- de l'arrêt de politiques d'enrichissement du contenu de la croissance en emplois menées en France comme dans certains pays européens 59 ( * ) depuis le début des années 1990 (allègements de charges pour les travailleurs non qualifiés, baisse de la durée du travail grâce au développement du temps partiel ou à la baisse de la durée légale hebdomadaire...).
Une augmentation des gains de productivité, de nature structurelle, succédant, plus de dix ans après, à celle que les Etats-Unis ont connue, ne peut être exclue .
Une hausse du taux d'emploi, en phase avec la stratégie de Lisbonne, serait susceptible de peser sur l'évolution de la productivité dans la zone Euro. Mais il est difficile d'évaluer son impact final sur la croissance potentielle de la zone, qui dépend de l'évolution combinée de la productivité et de l'emploi.
A plus long terme, il convient d'envisager l' impact du vieillissement de la population sur l'évolution de la productivité par tête , qui est ambivalent. Si le vieillissement est parfois considéré, dans une approche microéconomique intuitive, comme un frein à la croissance potentielle, il pourrait aussi constituer, paradoxalement, le moteur d'une dynamique d'innovation 60 ( * ) qui permettrait de desserrer la contrainte démographique.
2. Une interprétation historique à plus long terme
Le récent redressement de la productivité dans la zone euro est bien relatif, et sa forte décélération observée depuis les années quatre-vingt constitue la seule évolution véritablement marquante depuis l'après guerre. Elle illustre l'idée que l'Europe peine à passer d'un modèle d'imitation , caractéristique d'une économie en phase de rattrapage, à un modèle d'innovation continue , qui lui permettrait de se maintenir au voisinage de la « frontière technologique » ( supra ).
Dans une économie en phase de rattrapage , le moteur de la productivité réside dans l'imitation des processus et des stratégies sectorielles les plus productifs. Des institutions économiques adaptées à cet objectif ont ainsi fourni le cadre dans lequel se sont déroulées les « Trente Glorieuses »
Au contraire, dans une économie qui se situe à la « frontière technologique », la capacité à innover en permanence est la condition de l'augmentation de la productivité et de la performance économique. C'est pourquoi l'enjeu essentiel pour la France concerne la capacité de ses entreprises à redresser leur investissement en recherche et développement (R&D) .
CHAPITRE V - QUELLE CONTRIBUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR À LA CROISSANCE ?
Une dégradation continue du solde extérieur français s'est engagée depuis 2003. Cette tendance, qui contribue négativement à la croissance, est-elle appelée à se poursuivre, à s'interrompre, voire à s'inverser, avec une contribution à la croissance du commerce extérieur qui redeviendrait positive ?
Il faut d'abord observer que la dégradation récente obéit essentiellement à des facteurs exogènes - hausse des prix du pétrole, appréciation de l'euro et politique de désinflation compétitive poursuivie par l'Allemagne depuis 2000 - que les ressorts plus structurels de notre commerce extérieur n'ont pas permis de surmonter.
Les facteurs exogènes pèsent encore négativement sur le commerce extérieur en 2007-2008 et devraient continuer d'amputer la croissance française telle qu'elle résulte du dynamisme de ses composantes domestiques.
Pour le moyen terme , l'arrêt de cette dégradation dépend de la réponse à trois questions :
- la stratégie de compétitivité poursuivie par l'Allemagne va-t-elle être prolongée, et, le cas échéant, suivie par d'autres pays de la zone euro ?
- l'accélération de la croissance et de la demande dans les pays hors zone euro ne met-elle pas en évidence une faiblesse structurelle des entreprises françaises à l'exportation, qui pourrait peser sur la compétitivité à long terme de l'économie française ?
- la gestion du taux de change de l'euro correspond-elle aux intérêts de la zone euro et de notre pays en particulier ? 61 ( * )
I. À MOYEN TERME, LE RETOUR À UNE NEUTRALITÉ DE LA CONTRIBUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR À LA CROISSANCE ?
A. UNE DÉGRADATION DU SOLDE EXTÉRIEUR ESSENTIELLEMENT CONJONCTURELLE EN 2006-2008
Après les excédents engrangés dans la seconde moitié des années 1990, le déficit apparu en 2004 n'a cessé de se creuser (graphique n° 1).
•
En 2006
, le déficit des
transactions courantes
62
(
*
)
a atteint le niveau record, depuis la fin des
années quatre-vingt, de 22,5 milliards d'euros (il s'élevait
à 15,7 milliards en 2005). Les exportations de biens et services
ont augmenté de 6,7 %, tandis que les importations progressaient de
8,5 %.
Ce creusement du déficit a représenté une contribution négative à la croissance de 0,5 point de PIB en 2006 . Le graphique n° 1 permet de suivre l'évolution du solde des transactions courantes et celles, différentiées, du solde des biens et de celui des services.
GRAPHIQUE N° 1
LE SOLDE DES TRANSACTIONS COURANTES :
UNE FORTE
DÉGRADATION DEPUIS 2002
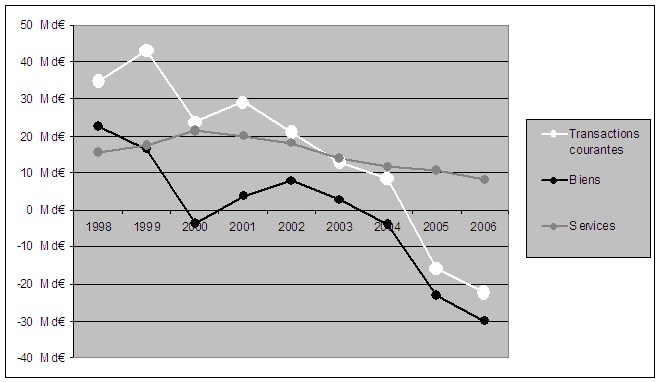
Source : d'après données Banque de France révisées en juin 2007
Concernant les échanges extérieurs de biens en 2006, la forte augmentation des exportations (8,9 %) ne compense pas celle des importations (10,2 %).
En réalité, les importations se sont accrues sous le seul effet de la facture énergétique -le déficit énergétique s'est creusé de 8,4 milliards- qui masque une légère amélioration du solde des biens hors énergie -l'excédent hors énergie s'est redressé de 2,2 milliards-, ainsi que l'illustre le graphique n° 2 :
GRAPHIQUE N° 2
ÉVOLUTION DU SOLDE DES BIENS, AVEC ET HORS ÉNERGIE (EN MILLIARDS D'EUROS)
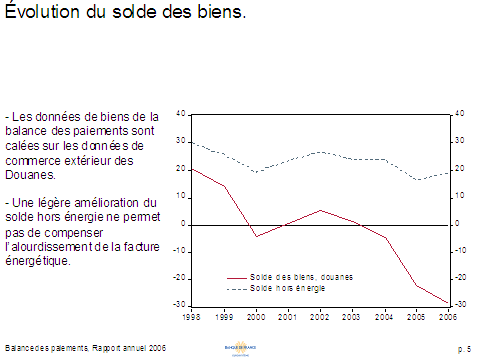
Source : Banque de France
Le solde des échanges extérieurs de services contribue également à limiter le déficit des transactions courantes en 2006, bien que l'excédent se soit réduit de 2,4 milliards . Toutefois, le solde des voyages (tourisme et voyages professionnels) ainsi que celui des services de transport s'améliorent légèrement 63 ( * ) .
•
En 2007
, malgré un
environnement international relativement porteur, à l'exception
notable de l'évolution de la demande intérieure
allemande
qui subit le choc d'une augmentation de la TVA, la hausse du
prix des produits énergétiques et l'appréciation de l'euro
entraîneraient un nouveau creusement du déficit extérieur,
quoique de moindre ampleur qu'en 2006. Pour ce qui concerne les exportations,
il apparaît que les parts de marché se sont stabilisées au
premier semestre, après cinq ans de contraction quasi continue.
Au total, le gouvernement anticipe un déficit des échanges de biens et services de 24,3 milliards d'euros, soit une dégradation de 2,5 milliards d'euros . En moyenne, les instituts de conjoncture estiment que le commerce extérieur devrait continuer à contribuer négativement à la croissance, à hauteur de 0,4 point de PIB.
•
En 2008
,
la fin de la
politique de désinflation compétitive menée en
Allemagne
pourrait s'y traduire par une
hausse des
salaires
réels de 1,6 % en 2008,
ce qui
représenterait une rupture importante avec les tendances
récentes
. En effet, en moyenne, les salaires réels
allemands ont connu, entre 2002 et 2006, une baisse annuelle de 0,5 %.
Dès lors, l'évolution de la demande allemande cesserait de peser
sur le commerce extérieur de la France.
Selon le gouvernement, le déficit des échanges de biens et services ressortirait alors à 24,6 milliards d'euros, soit une quasi-stabilisation . Toutefois, les instituts de conjoncture prévoient que le commerce extérieur contribuerait encore négativement à la croissance, à hauteur de 0,3 point de PIB.
GRAPHIQUE N° 3
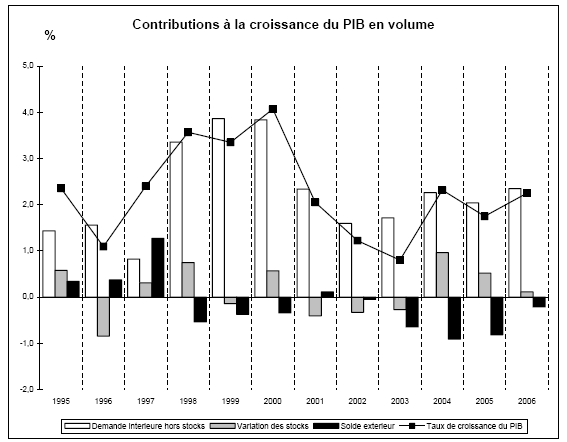
Demande intérieure hors stocks : consommation des ménages et des administrations + investissement (FBCF : formation brute de capital fixe)
Source : Tableau de l'Economie française - INSEE
• L'impact des
chocs
extérieurs
- hausse du prix du pétrole,
appréciation de l'euro et politique allemande de contraction des
coûts salariaux - sur la croissance de l'économie
française fait l'objet d'une évaluation sur la période
2004-2008 à l'aide du modèle
e-mod
de l'OFCE.
En 2008, le « coût », exprimé en point de croissance du PIB, de ces chocs extérieurs , via une meilleure orientation de la demande allemande, un tassement de la détérioration du PIB lié au choc pétrolier et malgré une nouvelle aggravation de l'impact négatif des conditions monétaires, refluerait de 0,9 point en 2007 à 0,7 point en 2008.
Cet amoindrissement global de l'impact des chocs négatifs correspond quantitativement à la moindre dégradation anticipée de la croissance liée au choc pétrolier (- 0,2 point en 2008 après -0,4 point en 2007). L'aggravation du choc lié aux conditions monétaires (- 0,5 point en 2008 après -0,2 point en 2007) compenserait exactement la disparition du choc lié aux réformes allemandes (aucune contribution en 2008 après -0,3 point en 2007).
GRAPHIQUE N° 4
IMPACT DES CHOCS EXTÉRIEURS SUR LA CROISSANCE FRANÇAISE
Impacts sur l'économie française de chocs...
En moyenne annuelle, %
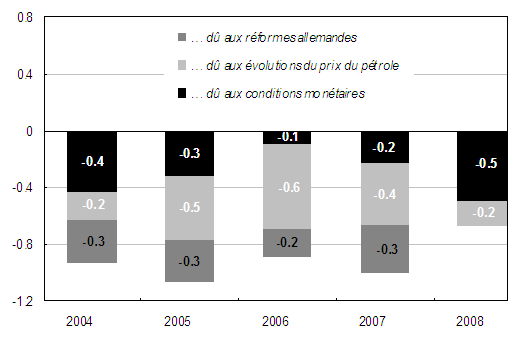
Note : L'impact du prix du pétrole et du taux de change sur l'activité est un impact cumulé. Il dépend des variations aux instants t, t-1 et t-2.
Sources : INSEE, comptes trimestriels, OFCE, e-mod.fr de 2007 à 2008.
Globalement, la contribution négative du commerce extérieur à la croissance - solde des évolutions des exportations et des importations - irait en diminuant : -0,5 point de PIB en 2006, -0,3 point de PIB en 2007 puis -0,2 point de PIB en 2008 selon l'OFCE.
B. UNE STABILISATION CONVENTIONNELLE DU DÉFICIT EXTÉRIEUR EN 2009-2012
L'OFCE a prolongé ses prévisions de solde extérieur à court terme à partir des deux scénarios macroéconomiques du gouvernement. Par convention, la compétitivité française (compétitivité-prix) se stabiliserait à partir de 2009 (il aurait semblé trop arbitraire, en effet, de retenir en projection une hypothèse différente) tandis qu'il ne serait plus constaté de décalage conjoncturel vis-à-vis de nos principaux partenaires.
Au total, la contribution du commerce extérieur à la croissance serait nulle de 2009 à 2012, cette évolution étant, pour partie, conventionnelle .
Dans le scénario central, les importations et les exportations progresseraient à un rythme analogue (+ 5,5 % par an en moyenne pour les importations sur la période 2008-2012 et + 5,7 % par an en moyenne pour les exportations sur le même période). La réalisation de ces projections suppose ainsi que les importations, qui ont progressé de 6 % en moyenne de 1998 à 2007, ralentissent légèrement et que les exportations, qui ont progressé de 4,3 % en moyenne sur la même période, accélèrent franchement.
II. LE POIDS DES ALÉAS SUR L'ÉVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR
Les résultats du commerce extérieur français sont d'autant plus décevants qu'ils ont été obtenus dans une période de forte croissance du commerce mondial (+ 6,7 % par an en moyenne entre 1999 et 2008).
GRAPHIQUE N° 5
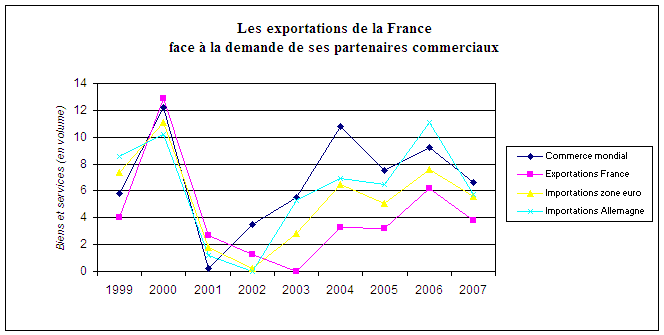
Source : World Economic Outlook, octobre 2007
Les performances de la France en matière d'exportations (croissance en volume) ont été inférieures à la moyenne de l'ensemble des pays de la zone euro à partir de 2003 (graphique n° 6), mais elles ont souffert, jusqu'en 2006, d'un décalage conjoncturel, notamment avec l'Allemagne (graphique n° 7).
GRAPHIQUE N° 6
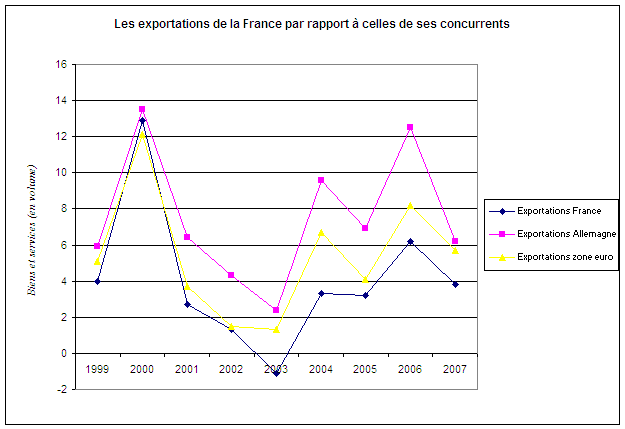
Source : World Economic Outlook, octobre 2007
GRAPHIQUE N° 7
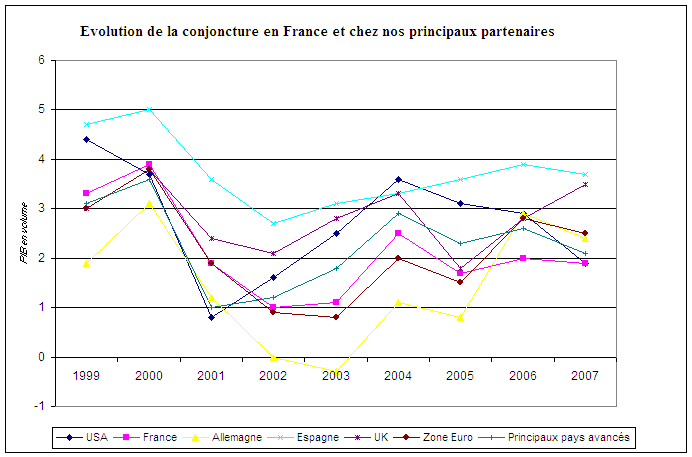
Source : World Economic Outlook, octobre 2007
En ce qui concerne plus particulièrement notre voisin d'outre-Rhin qui est, en même temps, notre premier partenaire commercial, la forte reprise de ses importations, depuis 2003, puis l'accélération sensible de sa croissance, en 2006 (+ 2,9 %) n'ont eu qu'un effet limité sur les résultats de nos échanges.
Certes, le rythme de l'augmentation en volume de nos exportations s'est sensiblement accéléré (passant de + 3,2 % en 2005 à + 6,2 %), mais il est resté inférieur, en 2006, à celui de nos importations (+ 8,5 %), et le déficit de la France a continué de se creuser.
La faiblesse du dollar par rapport à l'euro, l'atonie de la demande intérieure allemande, de 2002 à 2006, et les chocs pétroliers fournissent des explications convaincantes à nos difficultés même si certains font valoir que l'exemple de l'Allemagne montre qu'il est possible de concilier un excédent commercial important (5,3 % du PIB), un euro fort et une accélération du rythme de l'activité économique .
Cette dernière vision semble mésestimer la singularité de la situation économique de l'Allemagne, engagée dans une politique de désinflation compétitive qu'il serait dangereux de généraliser en Europe et dont l'insertion dans la mondialisation présente des caractéristiques structurelles qui lui sont propres.
Il reste qu'en plus des conditions conjoncturelles, la bonne santé de nos échanges extérieurs semble suspendue à des mesures structurelles .
En particulier, face à la mondialisation, la capacité d'innovation d'un pays comme la France doit progresser pour jouxter la « frontière technologique ».
A. LES RISQUES MACROÉCONOMIQUES PESANT SUR LE SCÉNARIO CONVENTIONNEL
Un certain nombre d'aléas peuvent affecter le scénario de moyen terme. L'évolution du solde extérieur de la France dépend en effet d'un certain nombre de facteurs :
• En premier lieu,
l'évolution du prix
des matières premières et, notamment, du pétrole, est
déterminante
(voir chapitre I du présent
rapport)
. En 2005, la détérioration du solde des
transactions courantes est provenue, pour moitié, de l'alourdissement de
la facture énergétique qui a alors représenté
près de 2,5 % du PIB. En 2006, cette facture
énergétique a empêché que la balance des
transactions courantes ne se redresse (
supra
). Certes,
l'appréciation de l'euro a pour effet de limiter l'effet négatif
sur l'activité de la hausse du prix du brent (-0,6 point en 2006,
puis -0,4 point en 2007 et -0,2 point en 2008 d'après l'OFCE).
Mais, il s'agit là de considérations à relativement
brève échéance et, de plus, il n'est pas
nécessairement indiqué de combattre le mal par le mal.
• En deuxième lieu, la
compétitivité française pourrait être
également affectée par des
fluctuations du taux de change
euro/dollar
. D'après les prévisions de l'OFCE, ce taux
de change s'apprécierait jusqu'au deuxième semestre 2008 (le
seuil de 1,5 dollar pour un euro serait atteint) pour s'établir en
moyenne à 1,44 dollar sur l'ensemble de l'année 2008.
A l'horizon 2012, le dollar demeurerait vulnérable, du fait de l'ampleur des déficits extérieurs américains, malgré une légère amélioration, perceptible en 2007. Or, si le dollar se dépréciait fortement, la compétitivité-prix française vis-à-vis de l'extérieur de la zone euro serait affectée. Le coût des approvisionnements hors zone euro, et notamment la facture pétrolière, diminuerait cependant. Quoi qu'il en soit, la question de l'émergence d'une véritable politique de change dans la zone euro se pose avec de plus en plus d'acuité ( cf. chapitre IX ).
• En troisième lieu, la croissance et la
compétitivité-coût relatives de la France pourraient
être affectées par la
poursuite de politiques de
désinflation compétitive
à l'intérieur de
la zone euro. En effet, on peut craindre que la stratégie de
compétitivité poursuivie par l'Allemagne, grâce à la
modération salariale et la diminution des cotisations sociales, ne soit
imitée par d'autres pays
64
(
*
)
. La France elle-même s'interroge sur
l'opportunité d'une « TVA sociale ». Ces politiques,
pour rentables qu'elles puissent être à court terme pour les pays
qui les engagent (et qui en acceptent l'éventuel coût social),
sont de nature foncièrement non coopératives car elles
pèsent sur le commerce extérieur des pays qui ne les pratiquent
pas et compromettent les anticipations de croissance de l'ensemble de la zone
économique concernée. Elles pèsent ainsi sur la croissance
à moyen terme.
B. QUEL IMPACT DES FACTEURS STRUCTURELS ?
Un récent rapport du Conseil d'analyse économique (CAE) 65 ( * ) souligne l'impact des facteurs microéconomiques dans l'évolution récente du commerce extérieur français. D'après ces travaux, les écarts de spécialisation en termes sectoriels et géographiques n'expliquent qu'une fraction des écarts de performance entre la France et l'Allemagne 66 ( * ) :
- entre 1998 et 2003, 9 % seulement de l'écart de croissance entre les exportations allemandes et françaises proviendraient d'un effet de structure sectorielle, c'est-à-dire du fait que la France serait spécialisée dans des secteurs économiques relativement moins dynamiques ;
- quant à l'orientation géographique des exportations françaises, elle serait certes relativement défavorable, mais ce facteur n'expliquerait que 6 % de l'écart de performance entre la France et l'Allemagne.
Par conséquent, le rapport du CAE estime qu'il faut s'interroger principalement sur la performance de nos entreprises, celles-ci perdant régulièrement des parts de marché par rapport à l'Allemagne, notamment lorsque la croissance s'accélère dans les pays importateurs.
De fait , la France a un peu reculé sur son marché de prédilection, l'Europe (qui représente les deux tiers de ses ventes à l'étranger) , tout en enregistrant un déficit important avec les pays d'Asie émergents, qui constituent le principal moteur de la croissance du commerce mondial et dans lesquels elle n'a pas effectué de percée significative. Le tableau suivant illustre ce propos :
ÉVOLUTION ET SITUATION DES PARTS DE MARCHÉ DE LA FRANCE
|
PART DANS LES EXPORTATIONS FRANÇAISES EN 2006 |
PART DU MARCHÉ DE LA FRANCE |
SOLDE EN 2006 (milliards d'€) |
||
|
2001 |
2006 |
|||
|
Union européenne |
65,8 |
10,5 |
10,0 |
- 7,6 |
|
PECO |
5,2 |
7,9 |
7,9 |
+ 1,6 (1) |
|
Asie émergente |
5,7 |
3,8 |
3,9 |
- 18,2 |
|
Proche Orient |
3,1 |
8,6 |
8,7 |
+ 1,3 |
(1) En ce qui concerne seulement les nouveaux membres de l'Union européenne (République tchèque, Slovaquie, Pologne, Slovénie, Pays baltes, Roumanie, Bulgarie).
Source : Rapport économique, social et financier - PLF 2008
La question se pose alors de la compétitivité de la France. Votre rapporteur relève que, depuis la deuxième moitié des années quatre-vingt dix, l'augmentation de la productivité en France compense presque intégralement la hausse des coûts salariaux, pour aboutir à une quasi stabilité des coûts salariaux unitaires . Sur cette période, le graphique suivant montre que l'évolution de la compétitivité-coût de la France est, certes, moins favorable que celle d'une Allemagne qui tire ici les bénéfices d'une longue période de rigueur salariale, mais qu'elle se trouve en revanche plus favorable que celles de l'Espagne et l'Italie.
GRAPHIQUE N° 8
COÛTS SALARIAUX UNITAIRES RELATIFS DANS LE SECTEUR PRIVÉ
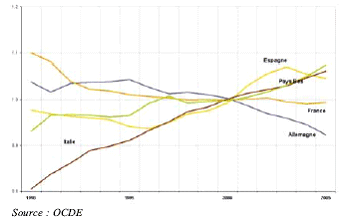
Ces données sont confirmées par le tableau suivant, qui montre les efforts de marge réalisés par les entreprises françaises pour maintenir leurs situations de marché :
ÉVOLUTION DES INDICES DE COMPÉTITIVITÉ
1995 = 100
|
Compétitivité prix (1) |
Compétitivité coût (1) |
Effort de marge relatif (2) |
|
|
2000 |
110,3 |
112,9 |
97,1 |
|
2004 |
105,4 |
101,1 |
104,2 |
|
2005 |
106,9 |
100,9 |
105,9 |
|
2006 |
108,0 |
99,6 |
108,4 |
(1) rapport entre les prix et les coûts (principalement salariaux) des exportations de la France et celles des 24 principaux pays de l'OCDE.
(2) Compétitivité prix/compétitivité coût.
Source : Rapport économique, social et financier - PLF 2008
Les causes structurelles de la dégradation du commerce extérieur de la France seraient donc plutôt d'ordre microéconomique et liées à la compétitivité hors-prix des entreprises françaises : variété et positionnement en gamme des produits, comportements de prix, taille des entreprises.
Votre rapporteur observe toutefois, à partir du graphique n° 9 ci-dessous, que si la France connaît depuis 2002 d'importantes pertes de parts de marché, cette évolution succède à quinze années de stabilisation . Sur la période 1986-2002, les parts de marché de la France ont fluctué autour d'une moyenne relativement stable.
GRAPHIQUE N° 9
PART DE MARCHÉ MONDIAL EN VOLUME DE LA FRANCE
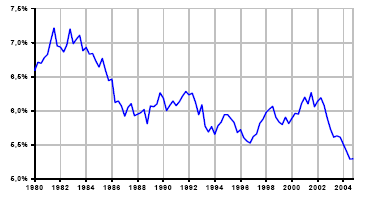
Source : INSEE, comptes nationaux trimestriels, calculs DGTPE
Or, les pertes constatées au cours de la période 1992-1997 coïncident avec des mouvements de parité entre le dollar et l'euro.
Au total, il est vraisemblable que la part des facteurs conjoncturels dans la dégradation du commerce extérieur français l'emporte sur la part structurelle et qu'en conséquence, l'évolution de la contribution du commerce extérieur à la croissance soit principalement suspendue aux variables macroéconomiques ci-dessus identifiés.
Cette analyse ne remet toutefois pas en cause le diagnostic sur la recherche, l'innovation et l'investissement en France, qui sont le gage d'une meilleure compétitivité hors-prix et apparaissent donc susceptibles d'amoindrir la sensibilité du commerce extérieur aux différents risques conjoncturels ( cf. chapitre III ).
CHAPITRE VI - UNE CROISSANCE PÉNALISÉE PAR UNE CHUTE DES PRIX DE L'IMMOBILIER ?
La question posée ici a un double aspect :
•
Faut-il craindre pour la France
une forte baisse des prix de l'immobilier
au cours des
prochaines années ?
• La
crise du crédit immobilier
américain peut-elle
, en raison des effets de défiance
qu'elle provoque,
avoir des conséquences en chaîne sur
l'économie mondiale
?
I. L'ÉVOLUTION RÉCENTE DES PRIX IMMOBILIERS EN FRANCE : UN CYCLE EN PHASE DE RETOURNEMENT ?
Depuis 1975, les prix immobiliers ont connu trois phases haussières entrecoupées de deux phases de repli, chaque cycle durant environ dix ans.
GRAPHIQUE N° 1
INDICE DE PRIX DES LOGEMENTS ANCIENS CORRIGÉ DE
L'INFLATION :
FRANCE ENTIÈRE
1985 = 100 - Écart à la tendance en %
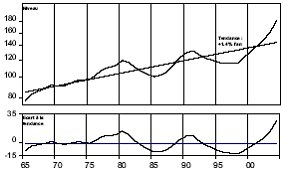
Sources : Jacques Friggit (Conseil Général des Pont et Chaussées), calculs OFCE
Certes, les cycles immobiliers présentent des disparités géographiques et n'ont pas, sur le long terme historique, de périodicité récurrente. Néanmoins, il est légitime de se demander, à l'issue d'une décennie haussière, si le point haut du cycle n'est pas désormais atteint.
A. UNE DÉCENNIE D'AUGMENTATION DES PRIX IMMOBILIERS
D'après l'indice Notaires-INSEE du prix des logements anciens, les prix immobiliers ont augmenté (en termes nominaux) de 95 % entre 2001 et 2006. Cette hausse est-elle purement cyclique, ou comporte-t-elle une dimension « spéculative » , c'est-à-dire déconnectée des fondamentaux économiques ?
Une étude réalisée en juin 2005 par le Service des Études économiques et de la Prospective à la demande de la Commission des Finances du Sénat, s'appuyant sur les travaux de l'OFCE 67 ( * ) et d'autres organismes de prévision économique, aboutissait à la conclusion suivante : malgré une hausse continue - dix années consécutives - et rapide - plus de 7 % par an en moyenne en valeur réelle -, le niveau des prix de l'immobilier au printemps 2005 n'obéissait pas à une logique spéculative . Cette conclusion s'appuyait sur un double constat :
• tout d'abord, le
ratio de
solvabilité des ménages
68
(
*
)
restait en 2005 à un niveau soutenable et
nettement supérieur à celui d'avant la crise immobilière
de 1991-1992 ;
• ensuite, le
rendement relatif global de
l'immobilier
(écart entre la somme du rendement locatif et des
plus-values annuelles avec les placements obligataires), s'est fortement accru
depuis 1998, ce qui pourrait conduire à un
« soupçon » de formation de bulle
spéculative. Mais cet écart reste cohérent, contrairement
à 1990, avec la hausse du rendement des actions.
Ces éléments conduisaient l'OFCE, comme d'autres organismes, à considérer que l'évolution des prix de l'immobilier n'obéissait pas à une logique spéculative, mais relevait d'une évolution cyclique . Cette approche cyclique privilégiait logiquement l'hypothèse d'un « atterrissage en douceur » des prix de l'immobilier.
L'OCDE a, pour sa part, identifié une légère surévaluation des prix immobiliers en France, ne justifiant pas de correction brutale. Une surchauffe est, en revanche, mise en évidence dans d'autres pays (Royaume-Uni, Espagne, Pays-Bas et Irlande). Le Japon et l'Allemagne connaissent quant à eux une situation de sous-évaluation des prix.
GRAPHIQUE N° 2
PRIX DES LOGEMENTS CORRIGÉS DE
L'INFLATION
1987 T1 = 100
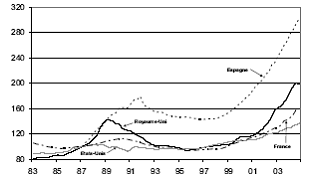
Source : OFCE (d'après Ministerio de vivienda, Halifax, National Assoiation of Realtors, INSEE)
B. UN RALENTISSEMENT CONFORTANT L'HYPOTHÈSE D'UN « ATTERRISSAGE EN DOUCEUR »
De fait, le ralentissement des prix de l'immobilier en France est resté très progressif : depuis un pic à près de 16 % en 2004, la croissance de l'indice des prix des logements anciens Notaires-INSEE a atteint près de 15 % en 2005 et 9,9 % en 2006. Au deuxième trimestre 2007, la hausse des prix était de 6,7 % en rythme annuel. D'après la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) 69 ( * ) , le rythme annuel de progression des prix atteint 4,7 % au troisième trimestre 2007. Au cours de ce troisième trimestre, la FNAIM a toutefois constaté une baisse des prix (- 0,9 %), ce qui tend à accréditer l'hypothèse d'un retournement de cycle.
Cette évolution s'explique principalement par le déséquilibre qui est apparu progressivement entre l'offre et la demande de logement : l'augmentation des taux du crédit immobilier, combinée à l'arrivée sur le marché de nouveaux logements mis en chantier auparavant, a entraîné un ralentissement des prix.
Après une période de forte augmentation de l'investissement en logements au cours des années 2004 et 2005 70 ( * ) , on observe un gonflement des stocks de logements neufs. Il s'est produit un ralentissement du rythme de construction, dont les effets ne seront pas immédiats en raison des délais particulièrement longs d'ajustement entre l'offre et la demande sur le marché immobilier.
GRAPHIQUE N° 3
NOMBRE DE LOGEMENTS AUTORISÉS/COMMENCÉS
(variation des 12 derniers mois par rapport aux 12 mois
précédents)
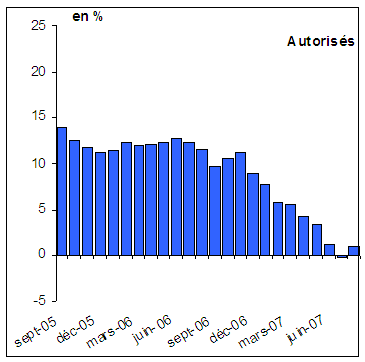
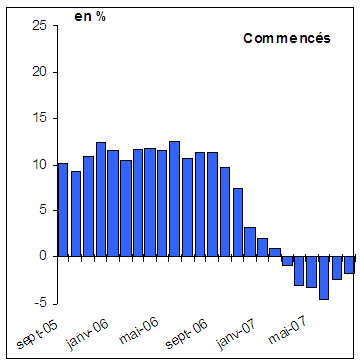
Source : MEDAD/SESP, Sitadel
En ce qui concerne la demande, la diminution des marges bancaires ne suffit plus à amortir la hausse des taux. Jusqu'en juin 2007, les emprunteurs ont continué à bénéficier de conditions de crédit avantageuses 71 ( * ) malgré la hausse des taux longs. Depuis l'été, on observe toutefois une augmentation plus nette des taux du crédit immobilier. Au troisième trimestre 2007, le taux d'intérêt moyen pour un crédit immobilier est ainsi passé de 4,08 % à 4,4 % (contre 3,36 % fin 2005).
La durée des prêts , qui avait fortement augmenté depuis 2001 (à un rythme moyen de l'ordre de 6 mois par an jusqu'en 2003, puis de l'ordre de 12 mois par an de 2004 à 2006) tend à se stabiliser 72 ( * ) .
Le nouveau dispositif de crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts d'emprunt supportés pour l'acquisition ou la construction d'une habitation principale devrait être un facteur d'amélioration de la solvabilité des ménages , s'il n'a pas d'impact sur les prix immobiliers. Cette mesure, mise en place par l'article 5 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, s'applique aux acquisitions et constructions réalisées à compter du 6 mai 2007. Le projet de loi de finances pour 2008 prévoit un renforcement du dispositif, puisque le crédit d'impôt serait porté de 20 % à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement. D'après des simulations réalisées par le courtier en crédit immobilier Empruntis, cet avantage fiscal représente - pour un emprunt de 200.000 euros sur 20 ans au taux de 4,80 % - une baisse du taux d'intérêt de 0,2 point de pourcentage pour un célibataire, 0,35 point pour un couple sans enfant et 0,41 point pour un couple avec deux enfants.
Le tassement de la demande n'est pas encore visible dans les statistiques d'encours de crédits des ménages , contrairement à ce que l'on observe aux Etats-Unis. En 2006, la croissance des prêts à l'habitat, qui forment l'essentiel de la dette des ménages, se poursuit à un rythme soutenu (+ 15 %). L'endettement des ménages français a certes progressé au cours des dernières années (de 55 % du revenu disponible en 2000 à 69 % en 2007), mais il reste, en moyenne, très modéré par rapport à d'autres pays (Espagne, Royaume-Uni ou États-Unis où il atteint 130 % de leur revenu).
Dans ce contexte, le tassement du marché immobilier français pourrait s'opérer graduellement . Le déséquilibre qui vient d'apparaître entre l'offre de logements neufs et la demande de logement des ménages, contribuerait à un ralentissement ou même à une baisse des prix. Toutefois, des enchaînements cumulatifs de baisse des prix sont peu probables : en effet, le dynamisme du marché depuis une dizaine d'années a reposé sur l'accession à la propriété de particuliers, qui ont acheté pour se loger et qui, contrairement aux spéculateurs, ne vendront pas en cas de recul de prix. Sous réserve que les taux d'intérêt n'augmentent pas au-delà du raisonnable, la baisse des prix devrait rendre solvables de nouveaux ménages, ce qui conduirait à une contraction de l'offre excédentaire.
Au total, les projections à moyen terme présentées dans ce rapport excluent le risque d'une crise immobilière majeure pouvant pénaliser la croissance.
Ce scénario pourrait toutefois être perturbé, en cas de transmission à la France du retournement du marché immobilier en cours aux Etats-Unis, par le biais d'une déstabilisation du système financier international.
II. L'IMMOBILIER FAIT-IL PESER UN RISQUE SUR LA CROISSANCE ?
Les marchés immobiliers sont par essence nationaux (voire même locaux). Ils s'influencent assez peu entre eux. La crise immobilière américaine pourrait néanmoins faire peser un risque sur l'Europe par le biais de son impact sur le secteur bancaire ; et, le cas échéant, par le biais de ses répercussions sur la croissance des États-Unis.
A. LA CRISE DU CRÉDIT IMMOBILIER AMÉRICAIN : UN PHÉNOMÈNE NON TRANSPOSABLE
De façon générale, les marchés immobiliers sont avant tout des marchés locaux animés par des acteurs nationaux. Il en résulte une désynchronisation des cycles immobiliers.
La situation du marché immobilier américain résulte de circonstances particulières propres à ce pays. De 1995 à 2006, le nombre de ménages américains propriétaires a augmenté d'environ 15 millions, atteignant 69 % de l'ensemble des ménages américains. Pendant, cette période, l'augmentation des prix fut sans précédent. Entre 1995 et 2006, l'indice de l'OFHEO (Office of Federal Housing Enterprise Oversight) a augmenté de 4,6 % en moyenne annuelle avec une accélération en 2004 et 2005 (+ 10,1 % en 2005). Certes, cette augmentation des prix était cohérente avec les fondamentaux de l'économie américaine (accroissement des revenus des ménages, diminution des taux d'intérêt). Par ailleurs, l'effet qualité a joué un rôle important dans cette évolution, en raison de l'ampleur des travaux d'entretien et d'amélioration de l'habitat réalisés au cours de la période (MacCarthy et Peach, 2004). Néanmoins, à partir de 2002-2003, la hausse des prix s'est accompagnée d'une prise de risques croissante. Le maintien de taux d'intérêt à un niveau bas et une concurrence exacerbée entre banques ont permis à des ménages autrefois exclus des circuits de financement d'accéder à la propriété immobilière. Des crédits dits « subprime » (c'est-à-dire de qualité inférieure) ont été consentis à des emprunteurs pour lesquels le ratio dette/revenu dépassait 55 % et/ou le ratio prêt/valeur du bien excédait 85 %. Ce segment « subprime » représentait 13 % de l'encours total de crédit hypothécaire en 2006. Les deux tiers de ces prêts ont été consentis à taux ajustables, c'est-à-dire des taux fixes transformables en taux variables à l'issue d'une période prédéterminée (en général 2 ans). Ces prêts, consentis sur la base d'une anticipation de hausse des prix immobiliers entraînent une augmentation de la charge de la dette au cours du temps, qui accroît le risque de défaut quand les taux d'intérêt se tendent et que la situation économique devient plus hésitante.
Cette catégorie de prêts à risques n'a pas d'équivalent en France , où les ménages apparaissent « sous-endettés » en comparaison avec leurs homologues des pays développés 73 ( * ) . Les ménages français sont principalement endettés à long terme et à taux fixes (ou à taux variables capés), ce qui atténue les effets d'une tension sur les taux d'intérêt. La préférence pour les mécanismes de caution, plutôt que pour les garanties hypothécaires, ainsi qu'une grande sélectivité du crédit de la part des banques, ont contribué à exclure un assez grand nombre des ménages de l'accès à la propriété. Ces caractéristiques du marché français du crédit immobilier, qui limitent la capacité d'endettement des ménages, atténuent la réactivité de l'économie aux évolutions de taux d'intérêt, ce qui constitue usuellement un frein à la croissance mais amoindrit par ailleurs les risques.
Les différences structurelles entre pays, telles que celles existant entre la France et les Etats-Unis, entraînent un fonctionnement différencié des effets de patrimoine , c'est-à-dire de la propension marginale à consommer la richesse immobilière. Des travaux de l'OCDE ont montré que ces effets étaient d'autant plus importants que le marché hypothécaire national était de grande taille, efficient et réactif 74 ( * ) .
B. LE RISQUE D'UNE CRISE DE CONFIANCE GÉNÉRALISÉE
Des risques demeurent toutefois notamment en raison du caractère mondial du marché du refinancement du crédit hypothécaire.
Dans le but de se prémunir des risques encourus, les banques américaines ont eu recours à la titrisation. Celle-ci qui consiste en la vente de leurs créances à des institutions qui prennent en charge le risque, ce qui permet aux banques de prêter sans que cela n'affecte leurs ratios prudentiels. Ce mécanisme de mutualisation et donc de dispersion des risques constitue un canal de transmission de la crise américaine. Une hausse du taux de défaut aux États-Unis est en effet susceptible d'affecter la distribution du crédit en Europe, si les investisseurs détenant des créances titrisées exigent des primes de risque plus élevées.
Plus largement, les asymétries d'information entraînent une incertitude quant à l'ampleur et la localisation des risques de perte, ce qui accroît les phénomènes de défiance.
En outre, le marché hypothécaire aux États-Unis bénéficie d'une garantie publique implicite sur des montants considérables d'engagements. Certaines évaluations conduisent à estimer que ces engagements représentent plus de la moitié du montant de la dette publique aux États-unis. Une montée des défauts et une contagion à des segments autres que le « subprime » pourraient provoquer un gonflement des besoins de financement publics aux États-Unis, qui représente un risque important pour le système financier international.
Enfin, on ne peut pas exclure que la crise immobilière soit le prélude à une récession aux Etats-Unis , par le biais d'une augmentation de l'épargne des ménages. Or, même si l'économie américaine devait ne plus conditionner, autant que par le passé, la croissance de l'économie mondiale, sa part dans le PIB mondial et son poids financier demeurent prédominants.
|
IMMOBILIER ET CROISSANCE : LES ENCHAÎNEMENTS MACROÉCONOMIQUES Dans son étude précitée 75 ( * ) réalisée pour le Sénat, l'OFCE avait mis en évidence, sur la base de travaux empiriques, un « modèle immobilier », dans lequel l'évolution des prix de l'immobilier a un impact sur la croissance au travers de deux enchaînements : - le premier est enclenché par les mouvements de taux d'intérêt : une baisse des taux (les effets sont symétriques en cas de hausse) entraîne une augmentation de l'endettement et donc une hausse des prix de l'immobilier. Celle-ci contribue elle-même à une accélération de l'endettement. Dans ce processus, de plus en plus de ménages concrétisent une plus-value immobilière, ce supplément de liquidité étant utilisé pour augmenter leur consommation. C'est donc par le biais de l'endettement et du développement du crédit que se matérialiserait l'impact de la « richesse immobilière » des ménages sur leur consommation. - le second enchaînement est déterminé par l' évolution du chômage et du revenu : la baisse du chômage et la progression du revenu entraînent une augmentation de l'endettement, une baisse des taux d'épargne, une accélération de la croissance et ainsi de suite. Rétrospectivement, le « modèle immobilier » constitué par ces deux enchaînements explique de manière robuste une partie des écarts conjoncturels récents entre la France et les États-Unis (où l'endettement hypothécaire a constitué un soutien très significatif à la consommation), d'une part ; entre la France et l'Allemagne où la stagnation du revenu n'a pas permis à la baisse des taux d'intérêt de « mordre » (via le canal de l'endettement) sur la conjoncture, d'autre part. Ce modèle permet donc de simuler les aléas qui conduiraient à diverger du scénario sous-jacent de stabilisation des prix de l'immobilier qui a été retenu dans les projections macroéconomiques présentées dans ce rapport : - le premier aléa serait celui d'une hausse des taux d'intérêt à long terme qui pourrait être due à un choc inflationniste dans le monde (hausse des prix du pétrole, crise du dollar due au déficit extérieur américain...) ou à un krach immobilier. Cette hausse des taux d'intérêt aurait un impact sur l'endettement (du fait de la dégradation de la solvabilité des emprunteurs) et entraînerait une baisse des prix de l'immobilier. Sous l'hypothèse d'une hausse des taux d'intérêt de 2 points et d'une baisse des prix de l'immobilier de 10 % , le niveau du PIB serait inférieur de 1,6 % en 2011 76 ( * ) et le taux de chômage supérieur de près de 1 point. - le deuxième aléa résiderait dans une correction des prix de l'immobilier : le ralentissement des prix de nature cyclique observé actuellement serait amplifié par l'attentisme des ménages. Si l'on retient l'hypothèse que cette « surréaction » se traduirait par une baisse de 15 % des prix de l'immobilier, le « modèle » élaboré par l'OFCE estime la perte de croissance à 5 ans à -0,3 % (+0,2 point pour le taux de chômage). Une nette correction des prix de l'immobilier, si elle ne s'accompagne pas d'une hausse des taux d'intérêt , aurait donc un impact négatif sur l'activité, mais elle ne constituerait pas pour autant une menace de premier ordre pour la croissance à court/moyen terme . Source : Perspectives économiques 2007-2011, rapport n° 89 (2006-2007) de M. Joël Bourdin |
Face aux phénomènes de défiance cumulatifs et à leurs conséquences sur la croissance mondiale, la crise de l'été 2007 a montré que les banques centrales avaient un rôle très important à jouer. Ce rôle consiste à rétablir la confiance en assurant la liquidité du marché afin de limiter les effets de contagion d'une crise financière à l'économie « réelle ».
Certes, la crise récente a montré qu'une réaction appropriée des banques centrales pour rétablir la liquidité du marché interbancaire était susceptible de venir limiter la propagation des difficultés. Au cours des mois d'août et septembre 2007, la Fed et la BCE ont exercé leur rôle de « prêteur en dernier ressort ». Elles ont cependant réagi différemment. La Fed a baissé ses taux ; la BCE n'a que renoncé à augmenter les siens.
Néanmoins, la crise a aussi mis en lumière les lacunes de la supervision bancaire et suscité des interrogations sur le rôle qu'auraient dû jouer, a priori , les banques centrales et les agences de notation.
CHAPITRE VII - QUELLE POLITIQUE BUDGÉTAIRE POUR QUELLE CROISSANCE ?
Dans le présent chapitre, on s'efforce d'évaluer à quelles conditions les objectifs de la politique budgétaire pour les cinq ans à venir sont compatibles avec le sentier de croissance économique projeté sur la même période.
La politique budgétaire des Etats de l'Union européenne, et plus encore celle des Etats ayant adopté l'euro, est étroitement encadrée par les règles du Pacte de stabilité et de croissance, même si, comme l'avait souhaité notre Délégation, ces règles ont été quelque peu assouplies.
Le Pacte de stabilité et de croissance n'est pas l'unique source des contraintes que doit envisager la politique budgétaire en France. Même si les règles européennes n'existaient pas, il existerait un « principe de réalité » qui commanderait d'éviter les erreurs de politique budgétaire.
Cela étant, tout le problème est de définir ce qu'est une politique budgétaire sans erreurs, autrement dit ce qu'est une bonne politique budgétaire.
Et, sur ce point, la définition du Pacte de stabilité et de croissance, dès l'origine très peu pertinente comme l'a montré la nécessité où les Etats se sont trouvés de la réformer, ne parvient toujours pas à convaincre en dépit des amendements qui lui ont été apportés.
En promouvant des objectifs fondés sur des conceptions plutôt inspirées par des travaux concluant à la nocivité de la politique budgétaire, le pacte européen conforme les politiques budgétaires des Etats membres dans le sens d'une sous-utilisation d'un des principaux instruments qui leur reste pour piloter l'activité économique 77 ( * ) .
Cette logique qui repose sur des justifications empruntant plus à la théorie qu'aux vérifications empiriques jure par trop avec le « principe de réalité » qu'on a évoqué.
Il n'est donc pas étonnant que les programmes de stabilité ou de convergence élaborés par les Etats membres comportent des objectifs qui, quoique conformes aux règles européennes, déconcertent un peu l'analyse et se trouvent souvent contraires dans la pratique.
Ce « modus vivendi » peut bien être devenu une sorte de nouveau compromis européen, il n'est pas pour autant recommandable de continuer à en user.
A l'heure où la coordination des politiques économiques en Europe est chahutée de toutes parts, en particulier dans un domaine essentiel aux finances publiques, les prélèvements obligatoires, alors que les politiques économiques non-coopératives reprennent le dessus et tandis que le dialogue avec les autorités monétaires reste presque inexistant, il est souhaitable qu'un sursaut intervienne pour que l'Europe offre aux Etats un cadre propice à des politiques budgétaires réalistes.
I. UN OBJECTIF DE FORTE RÉÉPARGNE PUBLIQUE AU MOYEN D'UNE NETTE RÉDUCTION DU POIDS DES DÉPENSES PUBLIQUES
La programmation financière projette un processus de réépargne des administrations publiques qui est fondé sur une rupture dans le partage du revenu national : les moyens alloués aux dépenses publiques seraient en proportion structurellement réduits.
A. UNE FORTE RÉÉPARGNE PUBLIQUE...
La programmation financière associée au projet de loi de finances pour 2008 et qui devrait préfigurer le programme de stabilité élaboré pour satisfaire à nos obligations européennes du Pacte de stabilité et de croissance, prévoit le retour à l'équilibre des comptes publics en 2012 dans un « scénario bas » à 2,5 % de croissance économique , ou, dès 2010 , si la croissance devait atteindre le rythme de 3 % en volume.
CAPACITÉ (+) OU BESOIN (-) DE FINANCEMENT PAR SOUS-SECTEURS
|
Points de PIB |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
|
Scénario BAS |
Administrations publiques |
-2,4 |
-2,3 |
-1,7 |
-1,2 |
-0,6 |
0,0 |
|
Etat |
-1,9 |
-2,2 |
-1,9 |
-1,6 |
-1,2 |
-0,8 |
|
|
Org. divers d'administration centrale |
-0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
|
|
Administrations locales |
-0,2 |
-0,2 |
-0,2 |
-0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Administrations sociales |
-0,2 |
0,0 |
0,1 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
|
|
Scénario HAUT |
Administrations publiques |
-2,4 |
-2,3 |
-1,3 |
-0,3 |
0,5 |
1,3 |
|
Etat |
-1,9 |
-2,2 |
-1,7 |
-1,1 |
-0,7 |
-0,3 |
|
|
Org.divers d'administration centrale |
-0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
|
|
Administrations locales |
-0,2 |
-0,2 |
-0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
|
|
Administrations sociales |
-0,2 |
0,0 |
0,3 |
0,5 |
0,8 |
1,0 |
|
Source : Projet de loi de finances pour 2008. Rapport économique, social et financier (RESF)
Cet objectif passe par une diminution du besoin de financement de 2,4 points de PIB dans l'hypothèse où la croissance économique serait de 2,5 % à partir de 2009.
Avec 3 % de croissance , non seulement le besoin de financement serait effacé mais encore les administrations publiques dégageraient une capacité de financement croissante qui s'élèverait à 1,3 point de PIB en 2012 . Au total, dans ce dernier cas, le solde public connaîtrait une « amélioration » de 3,7 points de PIB .
Ces évolutions correspondent à des engagements de politique économique . En effet, le rapport économique, social et financier précise que les variations du solde nominal proviendraient , pour l'essentiel, dans les deux scénarios, de modifications du solde structurel .
|
SOLDE STRUCTUREL ET EFFORT STRUCTUREL _____ I- Détermination du solde structurel Le solde des administrations publiques est affecté par la position de l'économie dans le cycle. On observe ainsi un déficit de recettes et un surplus de dépenses (notamment celles qui sont liées à l'indemnisation du chômage), qu'on peut juger transitoire, lorsque le PIB est inférieur à son niveau potentiel et, à l'inverse, un surplus de recettes et une diminution des dépenses, qu'on peut aussi qualifier de transitoire, lorsqu'il lui est supérieur. L'indicateur usuel de solde structurel vise à corriger le solde public effectif de ces fluctuations liées au cycle. La méthode d'évaluation du solde structurel consiste à calculer, en premier lieu, la partie conjoncturelle du solde public, c'est-à-dire celle qui s'explique par les écarts entre la conjoncture observée et les tendances « normales » de la croissance, selon une méthodologie largement commune aux organisations internationales. En pratique, ce calcul repose notamment sur l'hypothèse que les recettes conjoncturelles évoluent au même rythme que le PIB, et que les dépenses - à l'exception notable des allocations chômage - ne sont pas sensibles à la conjoncture. Le solde structurel est ensuite calculé comme un « résidu » , par différence entre le solde effectif et sa partie conjoncturelle. Cet indicateur constitue une référence internationale pour l'appréciation de l'orientation des politiques budgétaires. Une fois les effets de la conjoncture éliminés, on retrouve dans les évolutions du solde structurel : - l'effet des variations de la dépense publique, mesuré par l'écart entre la progression de la dépense et la croissance potentielle : lorsque la dépense publique croît moins vite que la croissance potentielle, cela correspond bien, si les prélèvements obligatoires ne sont pas diminués d'autant, à une amélioration structurelle des comptes publics ; à l'inverse, si l'augmentation des dépenses publiques est plus rapide que la croissance potentielle, il y a toutes choses égales par ailleurs du côté des prélèvements obligatoires, une dégradation de la situation structurelle des comptes publics ; - les mesures nouvelles concernant les prélèvements obligatoires, pour lesquelles les mêmes appréciations peuvent être portées mutatis mutandis . II- L'effort structurel Cependant, à côté de ces facteurs effectivement représentatifs de l'orientation de la politique budgétaire, le solde structurel, tel qu'il est défini pour les organisations internationales, en recouvre d'autres, sans doute moins pertinents : - Le solde structurel est affecté par des « effets d'élasticité » des recettes publiques. L'hypothèse, en pratique, d'élasticité unitaire des recettes au PIB 78 ( * ) , retenue dans le calcul du solde conjoncturel, n'est en effet valable qu'à moyen-long terme. À court terme en revanche, on observe des fluctuations importantes de cette élasticité. Pour l'Etat par exemple, l'amplitude de l'élasticité apparente des recettes fiscales est forte, du fait notamment de la variabilité de l'impôt sur les sociétés : l'élasticité des recettes fiscales nettes peut ainsi varier entre zéro et deux. Retenir l'hypothèse d'une élasticité unitaire, comme le font les organisations internationales, revient donc à répercuter entièrement en variations du solde structurel les fluctuations de l'élasticité des recettes, alors même que ces fluctuations s'expliquent largement par la position dans le cycle économique. L'interprétation des variations du solde structurel s'en trouve donc sensiblement brouillée. - D'autres facteurs peuvent également intervenir comme les variations des recettes hors prélèvements obligatoires (les recettes non fiscales de l'Etat, par exemple). Par construction, ces évolutions n'étant pas tenues pour conjoncturelles viennent affecter le solde structurel, ce qui n'est pas toujours fidèle à l'esprit qui préside à la distinction entre situations conjoncturelle et structurelle des comptes publics. Afin de s'en tenir aux facteurs dont la nature structurelle est le mieux établie, on peut donc retirer du solde structurel les effets d'élasticité et, par souci de simplicité, la variation des recettes hors prélèvements obligatoires . L' indicateur qui en résulte, que l'on peut qualifier d'« effort structurel » ou de « variation discrétionnaire du solde structurel » retrace les seuls effets combinés des variations des dépenses publiques et des mesures nouvelles de prélèvements obligatoires décidées par les pouvoirs publics. L'écart entre l'indicateur de variation du solde structurel et celui de l'effort structurel peut être important. Source : d'après le Rapport économique, social, et financier, annexé au projet de loi de finances pour 2004. |
Ces prévisions ne sont donc tributaires de l'environnement économique que pour leurs composantes conjoncturelles , qui, dans les deux hypothèses , sont mineures .
PERSPECTIVES DES FINANCES PUBLIQUES À L'HORIZON
2012
VARIATIONS DU SOLDE PUBLIC -
(en points de
PIB)
|
Scénario BAS |
Scénario HAUT |
|
|
Variations structurelles |
2,2 |
3,2 |
|
Variations conjoncturelles |
0,2 |
0,5 |
|
Total |
2,4 |
3,7 |
Source : Projet de loi de finances pour 2008. Calculs de l'auteur.
Dans le scénario bas , la croissance économique est de 2,5 %, soit légèrement supérieure au potentiel de croissance économique en France que le programme de stabilité estime à 2,3 %. La partie conjoncturelle de la variation du solde public nominal, celle qui correspond à l'effet sur le solde public d'une croissance effective supérieure au potentiel de l'économie, est, par conséquent, limitée, de 0,2 point de PIB. La composante structurelle du solde gagne, quant à elle, 2,2 points de PIB sur les 2,4 points de variation totale du solde. Ce gain correspond aux exigences du Pacte de stabilité et de croissance d'une variation positive et structurelle de la capacité de financement des administrations publiques des Etats-membres de 0,5 point de PIB par an .
Dans le scénario haut , la croissance économique est de 3 %. Une partie de ce scénario repose sur l'éventualité d'une élévation du rythme de la croissance potentielle en France qui passerait à 2,7 % l'an (contre 2,3 % dans le scénario bas). Cette embellie de la croissance potentielle réduit mécaniquement l'estimation de la composante conjoncturelle de la variation du solde public. Dans ce scénario, celle-ci est donc limitée à 0,5 point de PIB tandis que la variation de la composante structurelle s'élève à 3,2 points de PIB. Le solde structurel augmente de 0,8 point de PIB par an (contre 0,5 point dans le scénario bas) soit davantage que ce que demandent nos engagements européens.
En conséquence de ces évolutions et compte tenu des scénarios de croissance sous-jacente, le solde dépasserait, dès 2008, les exigences quantitatives d'un solde stabilisant la dette publique dans le PIB (tableau ci-dessous).
ÉVOLUTION DE LA CAPACITÉ DE FINANCEMENT
ET DE LA DETTE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES -
(en % du
PIB)
|
En % du PIB |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
89--98 |
99--08 |
09--12 |
|
Scénario bas |
||||||||||
|
Solde public |
-2.5 |
-2.4 |
-2.3 |
-1.7 |
-1.2 |
-0.6 |
0.0 |
-3.9 |
-2.6 |
-0.9 |
|
Solde public stabilisant la dette publique |
-2.9 |
-2.4 |
-2.6 |
-2.8 |
-2.7 |
-2.6 |
-2.6 |
|||
|
Impulsion budgétaire* |
-0.8 |
-0.1 |
-0.2 |
-0.4 |
-0.5 |
-0.5 |
-0.5 |
|||
|
Dette publique |
64.2 |
64.2 |
64 |
63.2 |
61.9 |
60.2 |
57.9 |
47.3 |
61.9 |
60.8 |
|
Scénario haut |
||||||||||
|
Solde public |
-2.5 |
-2.4 |
-2.3 |
-1.3 |
-0.3 |
0.5 |
1.3 |
-3.9 |
-2.6 |
0.1 |
|
Solde public stabilisant la dette publique |
-2.9 |
-2.4 |
-2.6 |
-3.1 |
-3.0 |
-2.9 |
-2.7 |
|||
|
Impulsion budgétaire* |
-0.8 |
-0.1 |
-0.2 |
-0.4 |
-0.5 |
-0.5 |
-0.5 |
|||
|
Dette publique |
64.2 |
64.2 |
64.0 |
62.5 |
60.0 |
57.2 |
53.4 |
47.3 |
61.9 |
58.3 |
* calculée à partir de la variation du solde structurel (y compris charges d'intérêts) avec une hypothèse de croissance du PIB de 2,2 % par an sur l'ensemble de la période
Sources : INSEE, Rapport économique, social et financier 2008, prévisions OFCE.
Le stock de dette publique rapporté au PIB diminuerait fortement.
*
* *
Au total, la programmation financière à l'horizon 2012 témoigne non seulement de l'observation de la norme du Pacte de stabilité et de croissance d'une « amélioration » structurelle des comptes publics de 0,5 point de PIB par an, mais encore de la prise en compte des exigences de provisionnement identifiées par la Commission européenne pour stabiliser durablement la dette publique au niveau de 60 points du PIB (voir chapitre VIII) .
B. ... AU MOYEN D'UNE NETTE RÉDUCTION DU POIDS DES DÉPENSES PUBLIQUES
Les variations du déficit public résulteraient dans les deux cas d'une nette diminution du niveau des dépenses publiques relatif au PIB, dans un contexte de réduction des prélèvements obligatoires, d'ampleur modérée .
LES DÉPENSES PUBLIQUES ET LES
PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES À L'HORIZON 2012
(EN POINTS DE PIB)
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Variation
|
||
|
Scénario BAS |
Dépense publique |
53,2 |
52,6 |
51,9 |
51,2 |
50,6 |
49,9 |
- 3,3 |
|
Progression en volume |
2,0 |
1,4 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,2 |
- |
|
|
Prélèvements obligatoires |
44,0 |
43,7 |
43,5 |
43,4 |
43,4 |
43,4 |
- 0,6 |
|
|
Scénario HAUT |
Dépense publique |
53,2 |
52,6 |
51,6 |
50,7 |
49,8 |
48,9 |
- 4,3 |
|
Progression en volume |
2,0 |
1,4 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,2 |
- |
|
|
Prélèvements obligatoires |
44,0 |
43,7 |
43,7 |
43,7 |
43,7 |
43,7 |
- 0,3 |
|
Source : Projet de loi de finances pour 2008. Rapport économique, social et financier (RESF)
1. Une norme serrée de progression des dépenses publiques
Pour les dépenses publiques , leur progression en volume serait, identique dans les deux scénarios, de 1,3 % l'an en moyenne entre 2007 et 2012 et, pour la période de 2009 à 2012 , de 1,1 % .
Compte tenu du différentiel de croissance économique entre les deux scénarios, la programmation des dépenses publiques se traduit par un repli de leur part relative dans le PIB , de 3,3 points de PIB dans le scénario bas , et de 4,3 points dans le scénario haut .
Ces engagements correspondent à des variations différentes des dépenses de chaque catégorie d'administrations publiques :
•
pour l'Etat
, la norme d'une
stabilisation des dépenses en volume est élargie aux
prélèvements sur recettes au profit des collectivités
locales et de l'Union européenne
79
(
*
)
;
•
pour les administrations de
sécurité sociale
, les dépenses
s'accroîtraient à un rythme un peu inférieur à
2 % en volume, tirées principalement par les dépenses
maladie (l'ONDAM serait un peu au-dessous de 2 % en volume) et de retraite
(la projection ne tient pas compte des mesures nouvelles qui pourraient
intervenir après le rendez-vous sur les retraites de 2008) ;
•
pour les administrations publiques
locales
, une progression en volume des dépenses, de 1,4 %,
est prévue.
L'engagement portant sur les dépenses publiques ne profiterait pas directement à due proportion aux agents économiques privés puisque, sur le front des prélèvements obligatoires, le recul de la pression fiscale serait modéré .
Au cours de la période couverte par la programmation financière, la réduction des dépenses publiques permettrait donc, un peu, de réduire les prélèvements et, beaucoup, « d'améliorer » la capacité de financement des administrations publiques .
2. Une faible réduction du taux de prélèvements obligatoires
S'agissant des prélèvements obligatoires , le taux de pression fiscalo-social serait ramené à 43,7 points de PIB contre 44 points en 2007 dans le scénario bas où il baisserait ainsi de 0,6 point de PIB. La moitié de cette réduction serait acquise en 2008. Au-delà, entre 2009 et 2012, la réduction du taux de prélèvements obligatoires serait de 0,3 point de PIB. Dans le scénario haut, une stabilisation interviendrait après 2008. Dans ce dernier scénario, le taux de pression fiscale ne serait réduit que de 0,3 point de PIB par rapport au niveau de départ.
Les deux tableaux ci-dessous détaillent les évolutions relatives aux prélèvements obligatoires selon les estimations de l'OFCE.
COMPTE SCÉNARIO BAS :
ÉVOLUTION
DES RECETTES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES*
(en % du
PIB)
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
89-98 |
99-08 |
09
|
|
|
TVA |
7,3 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,5 |
7,3 |
7,4 |
|
Autres impôts sur les produits |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,4 |
4,2 |
4,1 |
|
Impôts sur la production |
4,3 |
4,2 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
3,9 |
4,2 |
4,1 |
|
Impôt sur le revenu des ménages
|
7,8 |
7,5 |
7,6 |
7,4 |
7,4 |
7,3 |
7,3 |
5,5 |
7,9 |
7,4 |
|
Impôt sur les sociétés |
2,9 |
3,0 |
3,1 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
2,0 |
2,6 |
3,0 |
|
Autres impôts sur le revenu
|
1,0 |
1,0 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
1,0 |
0,9 |
0,9 |
|
Cotisations employeurs |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
11,4 |
11,1 |
11,1 |
|
Cotisations salariées et non salariées |
5,4 |
5,3 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
6,8 |
5,2 |
5,1 |
|
Impôts en capital |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
0,4 |
|
Prélèvements obligatoires |
44,2 |
44,0 |
43,7 |
43,5 |
43,4 |
43,4 |
43,4 |
42,9 |
43,9 |
43,4 |
* Les différences avec les chiffres mentionnés plus haut résultent d'un problème d'arrondis.
Sources : INSEE, Rapport économique, social et financier 2008 (RESF), prévisions OFCE.
COMPTE SCÉNARIO HAUT :
ÉVOLUTION
DES RECETTES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES*
(en % du
PIB)
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
89-98 |
99-08 |
09-12 |
|
|
TVA |
7,3 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,5 |
7,3 |
7,4 |
|
Autres impôts sur les produits |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,4 |
4,2 |
4,1 |
|
Impôts sur la production |
4,3 |
4,2 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
3,9 |
4,2 |
4,1 |
|
Impôt sur le revenu des ménages
|
7,8 |
7,5 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
5,5 |
7,9 |
7,6 |
|
Impôt sur les sociétés |
2,9 |
3,0 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
2,0 |
2,6 |
3,1 |
|
Autres impôts sur le revenu
|
1,0 |
1,0 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
1,0 |
0,9 |
0,9 |
|
Cotisations employeurs |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
11,4 |
11,1 |
11,1 |
|
Cotisations salariées et non salariées |
5,4 |
5,3 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
6,8 |
5,2 |
5,1 |
|
Impôts en capital |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
0,4 |
|
Prélèvements obligatoires |
44,2 |
44,0 |
43,7 |
43,7 |
43,7 |
43,7 |
43,7 |
42,9 |
43,9 |
43,7 |
Sources : INSEE, Rapport économique, social et financier 2008 (RESF), prévisions OFCE.
Après avoir diminué de 0,5 point de PIB entre 2006 et 2008, les prélèvements obligatoires (PO) baisseraient de 0,2 point de PIB en 2009 (4,1 milliards d'euros), en raison principalement de la montée en charge de la loi TEPA et de la modification du crédit d'impôt recherche. Dans le cadre de la loi TEPA, les prélèvements obligatoires baisseraient de 2 milliards d'euros en 2009, dont 1,1 milliard pour l'exonération des heures supplémentaires, 0,74 milliard pour le crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunts et 0,18 milliard pour l'allègement des droits de succession.
Dans la continuité des mesures acquises, le taux de PO diminuerait de 0,1 point de PIB en 2010, puis se stabiliserait en 2011 et 2012.
Dans le cas du scénario haut, ces effets jouent aussi mais l'élasticité des recettes fiscales serait supérieure à l'unité sous l'effet de la croissance soutenue qui y est décrite, ce qui viendrait en compenser les effets.
Il est important ici de souligner que la projection des recettes publiques est réalisée à législation constante . Elle est cohérente avec les engagements européens que pourrait prendre la France dans le cadre du programme de stabilité à venir, si celui-ci, comme il est acquis, respecte les grandes lignes de la programmation financière à moyen terme associée au projet de loi de finances pour 2008.
Il reste que des réaménagements de la fiscalité pourraient intervenir à la suite des travaux annoncés de revue générale des prélèvements obligatoires.
II. UN ENGAGEMENT QUI SUPPOSE UNE REPRISE ÉCONOMIQUE SOUTENUE ALIMENTÉE PAR UN CHANGEMENT DES COMPORTEMENTS ÉCONOMIQUES DES AGENTS PRIVÉS
Toute stratégie concernant les finances publiques peut être appréciée au regard de sa cohérence avec des objectifs économiques, qui en constituent le substrat et sur lesquels elle exerce une influence en retour.
Sous cet angle, la programmation décrite plus haut se révèle « volontariste ».
A. VERS UNE CROISSANCE POTENTIELLE PLUS FORTE ?
En premier lieu, les deux scénarios macroéconomiques associés à la stratégie des finances publiques s'inscrivent dans un contexte d'élévation du rythme de la croissance potentielle de l'économie française telle qu'elle est le plus souvent estimée .
Dans le « scénario bas », la croissance atteint un rythme annuel de 2,5 %. Elle est supérieure de 0,2 point par an à la croissance potentielle, telle qu'elle est estimée dans le rapport associé au projet de loi de finances pour 2008 (2,3 %). Par ailleurs, cette dernière estimation, qui table sur une élévation régulière du potentiel de croissance économique jusqu'à 2,5 % en 2012, excède celle produite par l'OFCE, d'environ 0,4 point à la fin de la projection, et, plus généralement, l'ensemble des estimations de croissance potentielle fournies par les organismes d'études économiques.
La rupture est encore plus nette dans le « scénario haut » puisque le rythme de croissance de 3 % qu'il décrit est assis sur une élévation de la croissance économique potentielle vers un rythme annuel de 2,7 %. L'écart avec la tendance évaluée généralement atteint alors 0,8 point, ce qui est considérable.
L'accélération de la croissance économique potentielle , qui appelle des transformations qui sont discutées dans le présent rapport, est elle-même une condition forte de plausibilité des scénarios économiques ici évalués .
B. VERS UNE NETTE ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE SPONTANÉE ?
De plus , la croissance économique effective décrite dépasserait le rythme de la croissance potentielle, et ce en dépit d'une politique budgétaire qui exercerait des effets restrictifs sur l'activité économique .
L'impulsion économique donnée par la politique budgétaire , orientée vers un effort de réépargne des administrations publiques , freinerait la croissance, de 0,5 point de PIB, par an, dans le scénario dit « bas » et de l'ordre de 0,8 point de PIB par an dans le scénario qualifié de « haut » .
Autrement dit, compte tenu de la politique budgétaire programmée, il faudrait pour suivre les rythmes de croissance annoncés que la croissance économique spontanée se redresse par rapport à l'existant et tende, dans le premier scénario, vers une croissance en volume de 3 % et dans le second scénario vers une croissance en volume de 3,8 %.
Il faudrait donc que les comportements spontanés des agents privés soient particulièrement dynamiques pour compenser l'impulsion budgétaire qui serait, quant à elle, défavorable à la croissance 80 ( * ) .
La probabilité statistique que de tels scénarios se produisent peut sembler assez faible. Depuis 1979, soit sur 27 ans, le taux de croissance effectif n'a excédé 3 % que six années, et 4 % que deux années. Encore s'agissait-il d'épisodes où la politique budgétaire avait été plutôt neutre.
D'un point de vue plus économique , u ne telle perspective n'est envisageable que si la réépargne publique devait être compensée par un processus de désépargne privée.
Le déficit des administrations publiques peut être analysé comme un mécanisme par lequel l'Etat s'endette au profit des agents privés. Une réduction structurelle du déficit public suppose que ce mécanisme d'intermédiation financière joue moins, et que ses bénéfices pour les agents privés soient réduits .
Face à ce qui constitue une raréfaction de leurs moyens, les agents privés pour maintenir leur demande (consommation et investissement) doivent s'endetter davantage ou épargner moins, c'est-à-dire modifier leurs comportements.
D'une manière ou d'une autre, la réépargne publique doit être compensée par moins d'épargne privée pour que la croissance reste inchangée.
L'augmentation de la demande des agents privés, nécessaire pour respecter le sentier de croissance décrit par la programmation, s'élève à 0,5 point de PIB dans le premier scénario et à 0,8 point de PIB dans le second.
• Le tableau ci-dessous illustre
les
conditions économiques associées à trois scénarios
de politique budgétaire
réalisés l'an dernier par
l'OFCE à la demande de votre Délégation, pour quantifier
les critères de cohérence entre une croissance économique
donnée et les politiques budgétaires variant dans leur objectif
« d'assainissement »
81
(
*
)
.
PRINCIPALES VARIABLES MACROÉCONOMIQUES ASSOCIÉES AUX TROIS PROJECTIONS
|
SCÉNARIO
|
SCÉNARIO TENDANCIEL
|
SCÉNARIO ALTERNATIF |
|
|
Croissance du PIB
|
2,2 |
2,4 |
2,2 |
|
Taux d'épargne des ménages
|
13,6 |
14,3 |
14,4 |
|
Taux d'investissement des entreprises
|
19,5 |
19,2 |
18,9 |
|
Taux de chômage |
7,9 |
7,2 |
8 |
C'est dans le scénario tendanciel que la croissance économique était la plus soutenue. Dans les deux autres scénarios, l'activité progressait de façon équivalente. La croissance dans ces deux scénarios n'apparaît pas nettement décalée avec celle du scénario où l'impulsion économique de la politique budgétaire était nulle.
On ne peut toutefois pas en conclure que les choix de politique budgétaire sont indifférents. En effet, dans ces deux scénarios, si la croissance résistait, c'était que les choix budgétaires qu'ils retraçaient étaient compensés par une modification du comportement des agents privés. Le taux d'épargne des ménages devait baisser sensiblement (principalement dans le scénario central où cette baisse doit être durablement accusée) et le taux d'investissement des entreprises devait augmenter .
*
Les résultats des simulations réalisées l'an dernier illustrent le « pari » sur lequel repose toute politique budgétaire restrictive : dans un tel contexte, l e besoin de financement des agents privés doit se creuser pour que le besoin de financement public soit réduit sans impact négatif sur la croissance .
Dans l'hypothèse où une telle flexion des comportements n'interviendrait pas, à supposer que la croissance économique spontanée suive juste le rythme de la croissance potentielle, l'effort d'ajustement structurel 82 ( * ) conduirait à une croissance moyenne de l'ordre de 1,8 % par an dans le scénario bas 83 ( * ) .
Les enchaînements stabilisants que suppose une politique de réduction radicale du déficit public ne sont évidemment pas hors de portée mais ils supposent plusieurs conditions plus ou moins maîtrisables exposées tout au long du présent rapport.
En toute hypothèse , dans une stratégie budgétaire comme celle décrite par le programme du Gouvernement , un accompagnement par la politique monétaire semble non seulement justifié (compte tenu des effets de l'ajustement budgétaire sur le rythme de croissance) mais aussi nécessaire à la cohérence de la politique budgétaire .
En effet, la condition d'endettement supplémentaire net des agents privés les place dans la situation de devoir compenser des ressources gratuites 84 ( * ) , celles perçues auprès des administrations publiques, par des ressources coûteuses car affectées d'un taux d'intérêt (soit que les agents s'endettent, soit qu'ils renoncent à une épargne productrice d'intérêts ce qui revient au même).
Dans ces conditions, plus le contexte financier que connaissent les agents privés est détendu, plus il est facile pour eux de prendre le relais des administrations publiques.
Or, alors que les politiques budgétaires annoncées comportent une réduction des déficits publics, on doit observer que la BCE manifeste régulièrement, et la concrétise généralement 85 ( * ) , son intention de durcir la politique monétaire.
Cette orientation, qui semble injustifiée au regard des perspectives d'inflation dans la zone euro (cf. chapitre IX) est de nature à freiner la croissance mais aussi à faire obstacle à la réduction des déficits publics programmée en Europe.
Cette conclusion souligne l'importance d'une meilleure coordination des politiques économiques en Europe, notamment des politiques budgétaires et monétaires .
III. UNE RÉDUCTION STRUCTURELLE DES DÉPENSES PUBLIQUES QUI MANIFESTE UN CHOIX AUX ENJEUX IMPORTANTS
La programmation financière à l'horizon de 2012 annonce le choix de modérer la part des ressources économiques allouées aux dépenses publiques. Il s'agit d'une rupture de tendance qui doit être vue comme une réforme structurelle majeure.
A. UN ENGAGEMENT D'ALLOUER MOINS DE RESSOURCES AU FINANCEMENT DES INTERVENTIONS COLLECTIVES
Le repli du poids des dépenses publiques que retracent les deux scénarios à moyen terme du Gouvernement ne provient pas de la perspective d'une croissance économique qui, nettement supérieure au potentiel de croissance, allègerait facialement le niveau relatif des dépenses publiques.
Il résulte de l'engagement de réduire de façon structurelle la place des dépenses publiques dans l'allocation du revenu national.
Même dans le « scénario bas », qui n'implique pourtant pas de rupture franche avec la croissance économique potentielle de long terme, la norme fixée pour les dépenses publiques est très inférieure à la croissance économique potentielle 86 ( * ) .
Cela signifie concrètement que l'engagement pris est que les richesses créées sur la base des forces naturelles de l'économie française, en rythme de croisière, iront moins qu'aujourd'hui financer des choix collectifs .
Il s'agit d'une réforme structurelle de très grande ampleur , à la fois quantitativement puisque cet engagement porte sur 2,5 points de PIB (en volume pour la période 2009-2012), et qualitativement en ce qu'il suppose un recul de la part prise par l'Etat dans le fonctionnement économique et social du pays .
B. UNE NORME TRÈS STRICTE D'ÉVOLUTION DES DÉPENSES PUBLIQUES
La norme de progression annuelle des dépenses publiques - 1,1 % en volume -, posée dans la programmation financière à horizon 2012, représente une contrainte très forte .
La progression ainsi prévue dépasse en rigueur les évolutions de longue période, et ce, assez nettement .
Sur longue période, la croissance des dépenses publiques a été de l'ordre de 2 % par an, en volume.
GRAPHIQUE N° 1
CROISSANCE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE EN VOLUME DEPUIS 1970
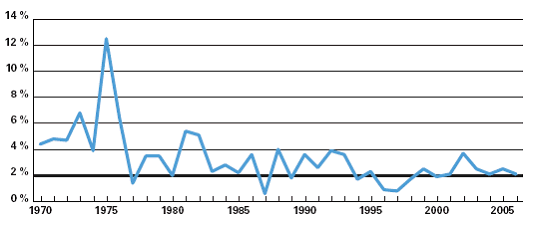
Source : La dépense publique. PLF pour 2008.
Au cours des dix dernières années, qui coïncident avec les efforts entrepris pour adopter l'euro et la mise en place du Pacte de stabilité et de croissance - qui limite les marges de manoeuvre de la politique budgétaire -, la dépense publique a, ce nonobstant, progressé de 2,25 % l'an.
Au total, les dépenses publiques ayant augmenté plus que le PIB au cours des années 2002-2006, leur équivalent en points de PIB s'est accru, de 0,8 point.
La programmation financière à l'horizon 2012 prend ainsi nettement la contre-pente de ces évolutions :
• le taux de croissance annuel des dépenses
publiques serait divisé par deux (1,1 % en volume contre
2,25 % observés) ;
• un reflux du poids relatif au PIB des
dépenses publiques se produirait (-3,3 ou -4,3 points du PIB, selon
le scénario envisagé) contre une augmentation
(+ 0,8 point de PIB) depuis 2002.
Au vu des tendances récentes des dépenses publiques, la norme relative aux dépenses publiques , telle qu'elle est décomposée par catégorie de dépenses, ressort comme inégalement contraignante .
Pour l'Etat, le respect d'une stabilisation en volume n'est pas très éloigné des performances réalisées en 2006.
Pour les administrations de sécurité sociale, le ralentissement observé en 2006 devrait être maintenu sur la durée.
Pour les collectivités locales, la norme implique un freinage sensible.
Cependant, la dynamique des dépenses publiques ne peut pas être appréciée en fonction des seules évolutions passées .
La dynamique des dépenses publiques est, pour une partie importante d'entre elles, plus ou moins autonome.
Plus de 60 % des dépenses publiques sont des dépenses de transfert et de protection sociale qui résultent soit de droit acquis, comme pour les retraites (plus de 12 points de PIB sur un total de dépenses publiques de 53,4 points de PIB), soit de phénomènes économiques et sociaux sur lesquels l'action est tantôt un peu aléatoire (le volume des chômeurs), tantôt peu désirable (les dépenses de santé) sauf à recueillir des fruits d'une meilleure efficacité des prestations fournies.
Au demeurant, le champ juridique traduit bien la réalité d'une grande autonomie de cette catégorie des dépenses publiques, pour la plupart, comprises dans le champ des lois de financement de la sécurité sociale. Pour ces dépenses, il n'est pas question de crédits, provisions financières qu'il est toujours possible d'ajuster, mais de perspectives ou d'objectifs de dépenses.
Or, la croissance spontanée de ces dépenses pourrait être importante au cours des prochaines années du fait notamment du changement démographique.
Quant aux autres dépenses, celles qui correspondent à la production de biens et services par les administrations publiques, elles représentent 40 % du total des dépenses publiques en France.
Une partie importante d'entre elles peut être considérée comme « semi-rigides », celles associées aux traitements et salaires. La masse salariale représente 87 milliards d'euros sur un total de dépenses pour l'Etat de 267 milliards d'euros, soit près du tiers. Sans même qu'intervienne de mesure de pouvoir d'achat, elle s'accroît de l'ordre de 1,8 % par an.
Par ailleurs, si la situation des dépenses publiques en France, en particulier leur niveau relativement élevé, doit beaucoup aux choix de passer par des systèmes collectifs pour assurer la protection sociale, elle est relativement peu influencée par le niveau relatif des dépenses consacrées aux biens et services publics, comme le montre le tableau ci-après.
APERÇU DE QUELQUES DÉPENSES PUBLIQUES DE
PRODUCTION DE BIENS
ET SERVICES DANS DIFFÉRENTS PAYS EN 2004
(EN POINTS DE PIB)
|
France |
Allemagne |
Japon 1 |
Suède |
RoyaumeUni |
États-
|
UE-25 |
|
|
Administration 2 |
7,1 |
6,05 |
2,7 |
7,7 |
4,6 |
4,3 |
6,7 |
|
Défense |
2,2 |
1,1 |
0,9 |
2,0 |
2,5 |
3,8 |
1,7 |
|
Sécurité |
1,1 |
1,6 |
1,3 |
1,4 |
2,5 |
1,9 |
1,7 |
|
Santé |
7,3 |
6,1 |
6,0 |
7,1 |
6,7 |
6,8 |
6,4 |
|
Éducation |
6,4 |
4,05 |
3,9 |
7,5 |
5,5 |
5,5 |
5,4 |
|
Total |
24,1 |
18,9 |
14,8 |
25,7 |
21,8 |
22,3 |
21,9 |
|
Total dépenses publiques |
53,4 |
46,9 |
32,0 |
57,3 |
42,1 |
33,0 |
47,6 |
1
2000
2
Seule une
fraction, majoritaire au demeurant, de ces dépenses peut être
considérée comme productrice de biens et services publics, ce qui
explique que le total excède le chiffre cité juste
précédemment.
Dans ce domaine, la France alloue une proportion de ses richesses à peu près analogue à celle observée par ses homologues aux principales fonctions financées sur fonds publics.
L'essentiel de ces dépenses est constitué de salaires versés aux agents contribuant à l'action de l'Etat. En ce domaine des gains de productivité ont été annoncés. A supposer qu'ils s'élèvent à un peu plus de 1 % l'an (soit l'hypothèse d'une diminution des effectifs de 6 % en 5 ans), l'économie ainsi réalisée s'élèverait, selon les estimations demandées à l'OFCE, à 0,22 point du PIB. Dans l'hypothèse où la moitié de ces économies seraient redistribuées, l'économie de dépenses serait divisée par deux.
*
* *
Au total, la norme de progression des dépenses publiques, que fixe la programmation financière associée au projet de lois de finances pour 2008, appellera davantage que des efforts de productivité : une véritable redéfinition des conditions de la protection sociale, notamment pour répondre au glissement des dépenses de retraite, et la fixation des priorités d'économies passant par une révision de fond de l'intervention publique.
CHAPITRE VIII - LE DÉSENDETTEMENT PUBLIC, QUELLE SOUTENABILITÉ ?
La programmation pluriannuelle des finances publiques à l'horizon 2012 projette une forte réduction du poids de la dette publique dans le PIB.
Ses motivations semblent essentiellement liées à un principe de prudence financière. Les marges de manoeuvre budgétaires qu'elle permettrait de regagner n'apparaissent supérieures aux coûts qu'elle peut impliquer que dans certaines conditions financières ou économiques particulières.
La programmation des finances publiques conduit à examiner l'impact de court terme d'une stratégie de désendettement public mais aussi à s'interroger, plus structurellement, sur les enjeux d'un renoncement de l'Etat à l'emprunt.
I. VERS UNE RÉDUCTION STRUCTURELLE DE LA DETTE PUBLIQUE ?
La programmation financière pour 2012 dessine des scénarios de baisse continue et prononcée de la dette publique, au moyen d'une élévation structurelle du taux d'autofinancement des administrations publiques .
Cette orientation manifeste un choix financier , dont l'équilibre est incertain.
Ses effets économiques peuvent être appréciés diversement selon les enchaînements qui pourraient l'accompagner.
A. UNE RÉDUCTION DU POIDS DE L'ENDETTEMENT PUBLIC RÉSULTANT D'UNE HAUSSE DE L'AUTOFINANCEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
Dans la programmation pluriannuelle des finances publiques , le poids de la dette publique dans le PIB recule continûment sous l'effet d'une « amélioration » structurelle du solde public. La réduction des dépenses publiques, qui en constitue le support, est presque entièrement consacrée au désendettement des administrations publiques , qui est donc l'objectif principal de la politique budgétaire 87 ( * ) .
Le ratio dette publique/PIB, qui, avec 64,2 %, excède en 2007 le plafond européen de 60 %, diminue dans les deux scénarios prévus par le programme de stabilité à horizon 2012.
Après une très légère réduction en 2008 (- 0,2 point de PIB), le recul s'amplifie. En 2012, la dette publique représente 57,9 points de PIB dans le « scénario bas » et 53,4 points dans le « scénario haut ».
Le niveau relatif de la dette publique est ainsi allégé de près de 10 % dans le premier scénario et de 17 % dans le second .
ÉVOLUTIONS DE LA DETTE PUBLIQUE DANS LE
PROGRAMME DE STABILITÉ 2012
(EN POINTS DE PIB)
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Variation
|
|
|
Scénario BAS |
64,2 |
64,0 |
63,2 |
61,9 |
60,2 |
57,9 |
- 6,3 |
|
Scénario HAUT |
64,2 |
64,0 |
62,5 |
60,0 |
57,2 |
53,4 |
- 10,8 |
Source : Projet de loi de finances pour 2008. Rapport économique, social et financier (RESF)
Ces résultats proviennent de deux phénomènes qui vont dans le même sens :
• le
solde public atteint un niveau
stabilisant
la dette publique
dès le début de la
période
et, comme il « s'améliore »
continûment, il provoque une diminution constante du rapport de la dette
publique au PIB qui va s'amplifiant ;
• en outre, le rapport économique, social et
financier relève que des
cessions d'actifs publics
interviendraient
avec pour effet une réduction de la dette
publique.
|
PRÉCISIONS DE MÉTHODE SUR LE CALCUL DU DÉFICIT PUBLIC Le déficit public au sens de la « comptabilité européenne » ne résulte pas de la simple différence entre les recettes des administrations publiques et leurs dépenses. Les protocoles financiers annexés au Traité de l'Union économique et monétaire comportent une définition précise du mode de calcul du déficit public. Cette définition s'appuie sur les concepts de la Comptabilité nationale. Celle-ci distingue les opérations non financières des agents économiques de leurs opérations financières. Le « déficit public au sens de Maastricht » qui, normalement, ne doit pas excéder 3 points de PIB, est égal au solde des opérations non financières des administrations publiques. Son calcul exclut les ressources financières et des emplois financiers. Ainsi, les recettes issues de la vente d'actifs publics ne sont pas comptées en recettes lors du calcul du déficit public. En revanche, quand elles ne donnent pas lieu à des emplois alternatifs, elles peuvent être utilisées pour réduire la dette publique. Dans ces conditions, la dette publique varie en fonction non seulement du déficit public mais également du flux net des opérations financières. |
Sur ce dernier point, la projection de la dette publique ne fait, toutefois, pas apparaître l'effet des cessions d'actifs publics dans le « scénario bas » . Seul le « scénario haut » semble retracer l'impact de telles cessions, à hauteur d'environ 0,2 point de PIB par an.
En bref, l'essentiel de la décrue du rapport de la dette publique au PIB proviendrait de la réduction du déficit public . Comme celle-ci serait d'origine structurelle, pour sa plus grande partie, la réduction du poids de la dette publique dans le PIB serait elle-même structurelle .
Comme on l'a expliqué dans le chapitre précédent du présent rapport, le taux d'autofinancement des administrations publiques connaîtrait une élévation structurelle .
Ses caractéristiques méritent d'être ici rappelées : elle résulterait d'une nette réduction des dépenses publiques , et non d'une hausse des prélèvements obligatoires . Ceux-ci diminueraient modestement mais l'effort « d'économies » surpasserait de loin ce repli si bien que le besoin de financement des administrations publiques s'effacerait plus ou moins progressivement et avec plus ou moins d'ampleur dans les deux scénarios.
B. UNE OPÉRATION À L'ÉQUILIBRE FINANCIER INCERTAIN ET À L'IMPACT MACROÉCONOMIQUE RISQUÉ
La réduction de la dette publique dégagerait des marges de manoeuvre financières qui, au regard des conditions présentes de financement de la dette publique et des risques macroéconomiques associés à une augmentation de l'épargne des administrations publiques, n'établissent pas clairement l'intérêt de poursuivre un tel objectif.
Le bilan coût-avantages de la stratégie de désendettement est cependant susceptible de varier considérablement en cas de tensions sur les conditions financières et selon les enchaînements macroéconomiques qu'on lui associe.
Sa justification principale semble provenir d'une volonté de provisionnement destinée à assurer la soutenabilité à long terme des comptes publics conformément aux recommandations européennes résultant de la prise en compte des perspectives à long terme de la dette publique.
1. Un impact financier à court terme discutable
Les marges de manoeuvre financière résultant de la réduction de la dette publique apparaissent faibles au regard des risques financiers encourus à court terme .
La réduction de la dette publique décrite dans la programmation pluriannuelle est, comme on l'a indiqué, particulièrement importante. Rien que dans le scénario bas où son ampleur est plus limitée, elle s'élève à 10 % du niveau initial de la dette. Un tel allègement est susceptible de procurer une économie de charges d'intérêt de 0,22 point de PIB par an au terme de la projection, mais pourrait coûter a priori 2,0 points de croissance (qui correspondent au cumul des effets négatifs sur l'activité économique que pourrait receler l'impulsion budgétaire liée à la réduction du déficit public) soit, compte tenu du taux de prélèvements obligatoires de 44 %, 0,9 point de PIB de recettes fiscales.
Cette arithmétique déplaisante n'apparaît pas dans la programmation des finances publiques puisque, dans le scénario macroéconomique qui lui est associé, la baisse du déficit public ne pèserait pas sur l'activité. Les agents privés l'absorbent et seul est affiché le gain de la réduction du besoin de financement public.
Il faut toutefois observer en toute rigueur que le gain ainsi décrit serait réservé aux administrations publiques, puisque, dans une telle hypothèse les agents privés prennent le relais de l'endettement, ce qui alourdit leurs charges financières (ou diminue leurs gains financiers).
Au total, l'équilibre financier d'une réduction de la dette publique de 10 %, aux conditions actuelles du coût de la dette et de prélèvements obligatoires, suppose que l'ajustement budgétaire n'obère pas la croissance économique de plus de 0,45 point de PIB. Or, un objectif de réduction de la dette publique de cet ordre nécessite, s'il est recherché via une augmentation structurelle de la capacité de financement des administrations publiques, une impulsion budgétaire négative qui est susceptible de peser sur la croissance économique au-delà de ce seuil .
2. ... dont l'équilibre est susceptible de varier selon le contexte financier et les enchaînements macroéconomiques engendrés par la réduction de l'endettement public
Les ordres de grandeur précédemment exposés pourraient différer si une tension sur le coût de la dette se produisait . Elle rendrait plus « rentable » la réduction de la dette. Mais, comme elle n'épargnerait vraisemblablement pas les agents privés, elle compliquerait aussi les conditions d'un ajustement budgétaire économiquement indolore.
En outre, les effets du désendettement public sont susceptibles d'appréciations nettement contrastées selon les enchaînements macroéconomiques qu'on lui associe .
En effet, le bilan coûts-avantages et la stratégie de désendettement public ne dépend pas que du contexte monétaire et financier. Des variables purement économiques conditionnent ses prolongements. Si le secteur privé prend le relais de l'endettement public, les risques sur la croissance à court terme sont conjurés. Reste posée la question de la justification économique d'une politique programmant le renoncement des administrations publiques à tout appel public à l'épargne .
Dans certains travaux théoriques , la diminution de la dette publique produit ipso facto une amélioration de la demande des agents privés (théorème d'équivalence de Ricardo-Barro) qui réduisent l'épargne constituée pour eux dans la perspective des futurs prélèvements nécessaires à la baisse de l'endettement public.
En outre, des arguments plus concrets sont fournis à l'appui d'une réduction du niveau de la dette publique :
- son impact favorable en termes d'assouplissement des conditions de financement (baisses des taux d'intérêt) ;
- la suppression d'un effet d'éviction qu'engendreraient les emprunteurs souverains à l'encontre des agents privés.
Ces points de vue semblent manquer un peu de réalisme ou, du moins, de nuances :
• l'ensemble des études consacrées aux
épisodes où le reflux de la dette publique n'a pas
entraîné de contraction de l'activité souligne l'existence
de causalités extérieures au processus d'ajustement
budgétaire ;
• par ailleurs,
le contexte économique
actuel ne semble pas caractérisé par une quelconque insuffisance
d'épargne
. L'augmentation des dettes publiques n'a pas tari la
très (trop) forte progression des dettes privées observée
ces dernières années ; en particulier, elle n'a pas
entraîné de tensions sur les taux d'intérêt. Au
contraire, quand de telles tensions sont intervenues sur les marchés,
une réorientation de l'épargne vers les titres publics
est intervenue
avec pour effet une détente des conditions de
financement de l'endettement public.
*
* *
Au total, la trajectoire de réduction de la dette publique à l'horizon 2012 apparaît très volontariste aux conditions actuelles. Toutefois, elle pourrait être interprétée comme la résultante d'une politique de provisionnement destinée à stabiliser le niveau de la dette publique compte tenu de perspectives de plus long terme .
Elle répondrait à un objectif de soutenabilité durable des comptes publics sur lequel quelques observations s'imposent .
II. QUELLE PORTÉE ATTRIBUER À LA SURVEILLANCE DES SITUATIONS BUDGÉTAIRES À PARTIR DES PERSPECTIVES DE DETTE PUBLIQUE ?
L'Union européenne a construit son espace économique et monétaire intégré sur l'idée qu'une dette publique équivalant à 60 points de PIB dans chacun des Etats représentait un niveau acceptable d'endettement public .
Le niveau ainsi retenu semble n'avoir été dû qu'à une situation essentiellement circonstancielle. Il s'agissait de la moyenne de la dette publique observée au moment des négociations du futur « Traité de Maastricht ». Ce choix semble donc n'avoir pas traduit une réflexion économique particulièrement approfondie .
Pourtant, il manifeste des arbitrages implicites importants :
• le
premier d'entre eux
consiste
à
s'accorder sur l'importance de la dette publique comme
indicateur de situation économique du nouvel ensemble
;
• le
second
revient
à
fixer une norme pour la politique budgétaire
.
Par ailleurs, le souci de surmonter les difficultés liées à la surveillance des positions budgétaires à partir de la seule norme relative aux soldes publics a été pour beaucoup dans la proposition de s'attacher davantage à la situation, présente et à long terme, de la dette publique .
Cette dernière est sans doute susceptible de déboucher sur des analyses plus riches mais il faut reconnaître que la fixation d'une norme d'évolution de la dette publique porte, en elle, de façon implicite une norme de déficit public puisque, aux opérations financières près, la dette publique varie en fonction du besoin de financement public. En ce sens, la surveillance des politiques budgétaires fondée sur le critère de la dette publique, renvoie aux modalités traditionnelles de surveillance basées sur le déficit public.
De fait, la surveillance de la position budgétaire des Etats au regard des perspectives de la dette publique aboutit essentiellement à formuler des recommandations quant au niveau souhaitable de leur solde public .
La programmation financière à l'horizon 2012 associée au projet de loi de finances pour 2008 témoigne d'une étroite conformité avec les analyses de soutenabilité de l'endettement public publiées par la Commission européenne . En particulier, la réduction de la dette publique qu'elle décrit peut être vue comme résultant de la mise en oeuvre de ces recommandations.
Or, la surveillance des positions budgétaires conduite à partir des perspectives de dette publique, pour utile et stimulante qu'elle soit, est assise sur quelques approximations qu'il faut identifier et comporte des risques macroéconomiques non négligeables .
A. LA ROBUSTESSE RELATIVE DE LA SURVEILLANCE DES POSITIONS BUDGÉTAIRES À PARTIR DES PERSPECTIVES DE LA DETTE PUBLIQUE
La surveillance des positions budgétaires à partir des perspectives d'endettement public est plus ou moins robuste. Des scénarios alternatifs permettent de mesurer ces aléas auxquels elle est soumise.
1. La méthode de la Commission
La méthode développée par la Commission consiste à construire des indicateurs quantitatifs (dénommés S1 et S2) mesurant l'écart entre la position budgétaire présente appréciée à partir du niveau du solde public primaire structurel et ce qu'elle devrait être pour satisfaire à des objectifs alternatifs de stabilisation de la dette publique à 60 points du PIB (en 2050 ou à un horizon infini), compte tenu des contraintes résultant de l'effet du vieillissement démographique sur la dynamique spontanée des finances publiques 88 ( * ) .
La méthode décompose l'indicateur en trois éléments distincts :
• le
premier élément
est relatif à l'
écart entre le solde
primaire
89
(
*
)
structurel actuel
et le
solde
primaire structurel
qui permettrait de
stabiliser le poids relatif de la dette publique sur longue
période
;
• le
deuxième
élément
mesure
l'effort à réaliser
en matière de solde public primaire
pour atteindre un
ratio « dette publique/PIB »
de
60 points en 2050
; plus un pays est initialement
éloigné de ce ratio plus l'effort à entreprendre est
important ;
• le
troisième
élément
résulte du calcul de l'impact sur la
position budgétaire des
perspectives liées aux
changements démographiques
susceptibles d'intervenir dans la
période sous revue.
La dynamique de certaines dépenses publiques dépend étroitement de facteurs démographiques . Une population plus âgée suppose, à structure de dépenses constante, davantage de dépenses de pension et de santé. Lorsque la population jeune diminue, les dépenses d'éducation sont moins nécessaires. Enfin, si la population active régresse, les perspectives de chômage peuvent devenir moins fortes, laissant augurer une réduction des dépenses consacrées à pallier les conséquences du non-emploi.
Les projections démographiques pour l'Union européenne dessinent globalement un vieillissement de la population et une diminution des jeunes et des actifs. C'est dans ce contexte que la Commission européenne établit régulièrement des projections de dépenses publiques à horizon long, 2030 et 2050.
PROJECTIONS DE L'ÉVOLUTION DE LA CROISSANCE DES DÉPENSES PUBLIQUES ENTRE 2004 ET 2030/2050 (en points de PIB)
|
Retraites |
Santé |
Dépendance |
Chômage |
Éducation |
Total sans "dépendance" |
Total sans "Education" |
Total |
||||||||||||||
|
Niveau |
Evolution/2004 |
Niveau |
Evolution/2004 |
Niveau |
Evolution/2004 |
Niveau |
Evolution/2004 |
Niveau |
Evolution/2004 |
Evolution/2004 |
Evolution/2004 |
Evolution/2004 |
|||||||||
|
2004 |
2030 |
2050 |
2004 |
2030 |
2050 |
2004 |
2030 |
2050 |
2004 |
2030 |
2050 |
2004 |
2030 |
2050 |
2030 |
2050 |
2030 |
2050 |
2030 |
2050 |
|
|
Belgique |
10,4 |
4,3 |
5,1 |
6,2 |
0,9 |
1,4 |
0,9 |
0,4 |
1,0 |
2,3 |
-0,5 |
-0,5 |
5,6 |
-0,6 |
-0,7 |
4,1 |
5,3 |
5,1 |
7,0 |
4,5 |
6,3 |
|
Danemark |
9,5 |
3,3 |
3,3 |
6,9 |
0,8 |
1,0 |
1,1 |
0,6 |
1,1 |
1,5 |
-0,3 |
-0,3 |
7,8 |
-0,4 |
-0,3 |
3,4 |
3,7 |
4,4 |
5,1 |
4,0 |
4,8 |
|
Allemagne |
11,4 |
0,9 |
1,7 |
6,0 |
0,9 |
1,2 |
1,0 |
0,4 |
1,0 |
1,3 |
-0,4 |
-0,4 |
4,0 |
-0,8 |
-0,9 |
0,6 |
1,7 |
1,8 |
3,6 |
1,0 |
2,7 |
|
Grèce |
- |
- |
- |
5,1 |
0,8 |
1,7 |
- |
- |
- |
0,3 |
-0,1 |
-0,1 |
3,5 |
-0,5 |
-0,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Espagne |
8,6 |
3,3 |
7,1 |
6,1 |
1,2 |
2,2 |
0,5 |
0,0 |
0,2 |
1,1 |
-0,4 |
-0,4 |
3,7 |
-0,7 |
-0,6 |
3,3 |
8,3 |
4,0 |
9,1 |
3,3 |
8,5 |
|
France |
12,8 |
1,5 |
2,0 |
7,7 |
1,2 |
1,8 |
0,3 |
0,1 |
0,2 |
1,2 |
-0,3 |
-0,3 |
5,0 |
-0,5 |
-0,5 |
1,9 |
2,9 |
2,5 |
3,7 |
2,0 |
3,2 |
|
Irlande |
4,7 |
3,1 |
6,4 |
5,3 |
1,2 |
2,0 |
0,6 |
0,1 |
0,6 |
0,7 |
-0,2 |
-0,2 |
4,1 |
-0,9 |
-1,0 |
3,2 |
7,2 |
4,3 |
8,8 |
3,3 |
7,8 |
|
Italie |
14,2 |
0,8 |
0,4 |
5,8 |
0,9 |
1,3 |
1,5 |
0,2 |
0,7 |
0,4 |
-0,1 |
-0,1 |
4,3 |
-0,8 |
-0,6 |
0,9 |
1,1 |
1,8 |
2,4 |
1,0 |
1,7 |
|
Luxembourg |
10,0 |
5,0 |
7,4 |
5,1 |
0,8 |
1,2 |
0,9 |
0,2 |
0,6 |
0,3 |
-0,0 |
-0,1 |
3,3 |
-0,5 |
-0,9 |
5,2 |
7,6 |
6,0 |
9,1 |
5,4 |
8,2 |
|
Pays-Bas |
7,7 |
2,9 |
3,5 |
6,1 |
1,0 |
1,3 |
0,5 |
0,3 |
0,6 |
1,8 |
-0,2 |
-0,2 |
4,8 |
-0,2 |
-0,2 |
3,5 |
4,4 |
4,0 |
5,2 |
3,8 |
5,0 |
|
Autriche |
13,4 |
0,6 |
-1,2 |
5,3 |
1,0 |
1,6 |
0,6 |
0,4 |
0,9 |
0,8 |
-0,1 |
-0,1 |
5,1 |
-0,9 |
-1,0 |
0,5 |
-0,7 |
1,8 |
1,2 |
0,9 |
0,2 |
|
Portugal |
11,1 |
4,9 |
9,7 |
6,7 |
-0,1 |
0,5 |
0,5 |
0,1 |
0,4 |
1 |
-0,1 |
-0,4 |
5,1 |
0,6 |
-0,4 |
4,1 |
9,7 |
4,9 |
10,5 |
4,3 |
10,1 |
|
Finlande |
10,7 |
3,3 |
3,1 |
5,6 |
1,1 |
1,4 |
1,7 |
1,2 |
1,8 |
1,5 |
-0,4 |
-0,4 |
6,0 |
-0,6 |
-0,7 |
3,5 |
3,4 |
5,3 |
5,9 |
4,7 |
5,2 |
|
Suède |
10,6 |
0,4 |
0,6 |
6,7 |
0,7 |
1,0 |
3,8 |
1,1 |
1,7 |
1,1 |
-0,2 |
-0,2 |
7,3 |
-0,7 |
-0,9 |
0,3 |
0,5 |
2,0 |
3,1 |
1,3 |
2,2 |
|
Royaume-Uni |
6,6 |
1,3 |
2,0 |
7,0 |
1,1 |
1,9 |
1,0 |
0,3 |
0,8 |
0,4 |
-0,0 |
-0,0 |
4,6 |
-0,5 |
-0,6 |
1,9 |
3,2 |
2,7 |
4,6 |
2,2 |
4,0 |
|
Rép. Tchèque |
8,5 |
1,1 |
5,6 |
6,4 |
1,4 |
2,0 |
0,3 |
0,2 |
0,4 |
0,2 |
-0,0 |
-0,0 |
3,8 |
-0,9 |
-0,7 |
1,6 |
6,8 |
2,6 |
7,9 |
1,8 |
7,2 |
|
Hongrie |
10,4 |
3,1 |
6,7 |
5,5 |
0,8 |
1,0 |
0,6 |
0,3 |
0,6 |
0,2 |
-0,0 |
-0,0 |
4,5 |
-1,0 |
0,7 |
2,8 |
7,0 |
4,1 |
8,3 |
3,1 |
7,6 |
|
Pologne |
13,9 |
-4,7 |
-5,9 |
4,1 |
1,0 |
1,4 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,5 |
-0,4 |
-0,4 |
5,0 |
-2,0 |
-1,9 |
-6,1 |
-6,8 |
-4,1 |
-4,8 |
-6,1 |
-6,7 |
|
Suède |
7,2 |
0,5 |
1,8 |
4,4 |
1,3 |
1,9 |
0,7 |
0,2 |
0,6 |
0,3 |
-0,2 |
-0,2 |
3,7 |
-1,5 |
-1,3 |
0,1 |
2,3 |
1,8 |
4,1 |
0,3 |
2,9 |
|
Slovénie |
11,0 |
3,4 |
7,3 |
6,4 |
1,2 |
1,6 |
0,9 |
0,5 |
1,2 |
0,5 |
-0,1 |
-0,1 |
5,3 |
-0,7 |
-0,4 |
3,9 |
8,4 |
5,1 |
10,1 |
4,4 |
9,7 |
|
EU-25 |
10,6 |
1,3 |
2,2 |
6,4 |
1,0 |
1,6 |
0,9 |
0,3 |
0,7 |
0,9 |
-0,3 |
-0,3 |
4,6 |
-0,7 |
-0,6 |
1,3 |
2,8 |
2,3 |
4,1 |
1,6 |
3,4 |
|
EU-15 |
10,6 |
1,5 |
2,3 |
6,4 |
1,0 |
1,6 |
0,9 |
0,3 |
0,7 |
0,9 |
-0,2 |
-0,2 |
4,6 |
-0,6 |
-0,6 |
1,6 |
3,0 |
2,6 |
4,3 |
1,9 |
3,7 |
|
EU-12 |
11,5 |
1,6 |
2,6 |
6,3 |
1,0 |
1,5 |
0,8 |
0,2 |
0,6 |
1,0 |
-0,3 |
-0,3 |
4,4 |
-0,7 |
-0,6 |
1,7 |
3,2 |
2,6 |
4,4 |
1,9 |
3,8 |
|
EU-10 |
10,9 |
-1,0 |
0,3 |
4,9 |
0,9 |
1,3 |
0,4 |
0,1 |
0,3 |
0,4 |
-0,2 |
-0,2 |
4,7 |
-1,5 |
-1,3 |
-1,8 |
0,0 |
-0,2 |
1,7 |
-1,7 |
0,3 |
|
EU-9 |
8,8 |
1,6 |
4,8 |
5,5 |
0,9 |
1,3 |
0,5 |
0,2 |
0,5 |
0,3 |
-0,1 |
-0,1 |
4,4 |
-1,1 |
-0,9 |
1,4 |
5,1 |
2,7 |
6,5 |
1,6 |
5,6 |
Source : Commission européenne 2005.
Au total, pour l'Union européenne à 15, le niveau relatif des dépenses publiques devrait augmenter de 3,7 points de PIB à l'horizon 2050 (1,9 point de PIB en 2030) du fait des changements démographiques, tels qu'ils sont prévus.
Les dépenses de pension s'accroîtraient de 2,3 points de PIB (+ 1,5 point dès 2030) ; les dépenses de santé de 1,6 point de PIB (+ 1 point en 2030) et les dépenses liées à la dépendance de 0,7 point de PIB (+ 0,3 point en 2030).
Dans le sens contraire, les dépenses de chômage seraient allégées de 0,2 point de PIB et les dépenses d'éducation de 0,6 point de PIB .
Les projections pour la France tablent sur des changements d'un peu plus faible ampleur. Le total des dépenses publiques liées à l'âge augmenterait de 3,2 points de PIB (- 0,5 point par rapport à la moyenne de l'Union européenne à 15).
Les retraites gagneraient 2 points de PIB en 2050 (+ 1,5 point en 2030). Les dépenses de santé progresseraient de 1,8 point de PIB et celles liées à la dépendance de 0,2 point de PIB .
Les indemnités de chômage et les dépenses d' éducation se replieraient quant à elles de 0,4 et 0,6 point de PIB respectivement.
Certains pays de l'Union européenne connaîtraient des évolutions considérables des dépenses publiques liées à l'âge : la Belgique (+ 6,3 points de PIB) ; le Danemark (+ 4,8 points de PIB), l'Espagne (+ 8,5 points de PIB) ; l'Irlande (+ 7,8 points de PIB) ; le Luxembourg (+ 8,2 points de PIB) ; les Pays-Bas (+ 5 points de PIB) ; le Portugal (+ 10,1 points de PIB) et la Finlande (+ 5,2 points de PIB).
Des quatre grands pays de l'Union européenne, le Royaume-Uni serait celui qui ferait face à la variation la plus importante (+ 4 points de PIB). Les trois autres (France, Allemagne et Italie) figurent au rang des pays où les évolutions seraient les plus modérées .
2. Les résultats de la surveillance de la Commission
INDICATEURS DE SOUTENABILITÉ DES FINANCES
PUBLIQUES
POUR L'UNION EUROPÉENNE
(EN POINTS DE PIB
D'ÉCART DU SOLDE PUBLIC PRIMAIRE)
|
S1 |
S2 |
||||||
|
Total |
IBP |
DR |
LTC |
Total |
IBP |
LTC |
|
|
Belgique |
0,4 |
-3,5 |
0,2 |
3,7 |
1,8 |
- 3,5 |
5,3 |
|
Danemark |
- 4,2 |
- 6,1 |
- 1,0 |
3,0 |
- 2,2 |
- 6,1 |
3,9 |
|
Allemagne |
3,5 |
1,5 |
0,2 |
1,7 |
4,4 |
1,6 |
2,8 |
|
Grèce |
3,2 |
2,1 |
0,8 |
0,4 |
3,0 |
2,2 |
0,9 |
|
Espagne |
0,2 |
- 2,7 |
- 0,6 |
3,5 |
3,2 |
- 2,7 |
5,9 |
|
France |
3,2 |
1,3 |
0,1 |
1,8 |
4,0 |
1,4 |
2,6 |
|
Irlande |
- 0,8 |
- 3,1 |
- 1,2 |
3,5 |
2,9 |
- 3,1 |
6,0 |
|
Italie |
3,4 |
1,3 |
0,8 |
1,3 |
3,1 |
1,3 |
1,8 |
|
Luxembourg |
4,6 |
1,2 |
- 1,8 |
5,2 |
9,5 |
1,2 |
8,3 |
|
Pays-Bas |
- 0,2 |
- 3,1 |
- 0,4 |
3,3 |
1,3 |
- 3,1 |
4,4 |
|
Autriche |
0,1 |
- 0,9 |
- 0,1 |
1,0 |
0,3 |
- 0,8 |
1,1 |
|
Portugal |
7,9 |
3,6 |
0,3 |
4,1 |
10,5 |
3,8 |
6,7 |
|
Finlande |
- 3,3 |
- 5,0 |
- 1,6 |
3,3 |
- 0,9 |
- 5,1 |
4,2 |
|
Suède |
- 2,7 |
- 3,1 |
- 1,0 |
1,5 |
- 1,1 |
- 3,1 |
2,0 |
|
Royaume-Uni |
3,4 |
1,6 |
- 0,2 |
1,9 |
4,9 |
1,8 |
3,2 |
|
UE-12 |
2,3 |
0,1 |
0,1 |
2,1 |
3,5 |
0,2 |
3,3 |
|
UE-25 |
2,1 |
0,2 |
0,0 |
1,9 |
3,4 |
0,3 |
3,0 |
Note de lecture :
IBP : retard dû à la position
budgétaire initiale ;
DR : retard par rapport à
l'objectif d'un ratio « dette publique/PIB » à
60 points en 2050 ;
LTC : contraintes sur le solde public
primaire liées aux changements démographiques.
Source : Services de la Commission
Les commentaires qui suivent sont centrés sur le premier indicateur (indicateur S1), qui mesure l'écart entre le solde public primaire actuel et celui qui serait nécessaire au respect de la norme relative à la dette publique (60 % du PIB) en 2050.
Pour l'Union européenne à 25, il faudrait augmenter la capacité de financement de 2,1 points de PIB pour atteindre l'objectif fixé . L'essentiel de cet effort serait rendu nécessaire par les perspectives liées aux évolutions démographiques. Celles-ci se traduiraient par un supplément de 4,1 points de PIB de dépenses publiques en 2050. Une amélioration immédiate du solde public primaire de 1,9 point de PIB permettrait d'éviter qu'une dérive par rapport à l'objectif d'une dette publique de 60 points de PIB en 2050 n'intervienne, dès lors que les autres conditions seraient remplies.
Pour la France , l'effort à entreprendre est plus important . Le niveau du solde public primaire devait être « amélioré » de 3,2 points de PIB pour qu'en 2050 le poids de la dette publique dans le PIB soit de 60 % . Le solde public primaire devrait être augmenté de 1,3 point de PIB par rapport au niveau atteint en 2005, pour que la dette publique soit stabilisée au niveau qui était alors le sien. En outre, l'écart par rapport à un objectif de dette publique de 60 points de PIB suppose un effort supplémentaire égal à 0,1 point de PIB de supplément de capacité de financement. L'augmentation prévisible des dépenses publiques du fait des changements démographiques s'élève à 3,2 points de PIB pour la France en 2050 par rapport au niveau de 2004. Elle appelle un supplément de capacité de financement de 1,8 point de PIB qui, appliquée dès l'année de départ, permettrait de disposer d'un ratio « dette publique/PIB » à 60 % en 2050, à condition de satisfaire toutes les autres exigences.
3. Une surveillance à la robustesse relative
Sur le plan technique, plusieurs observations s'imposeraient. Elles sont trop nombreuses pour le présent rapport qui ne permet que d'en mentionner quelques unes.
L'appréciation portée sur la situation de la dette publique dépend étroitement de celle relative à la croissance économique potentielle ainsi que des projections démographiques à long terme 90 ( * ) .
Deux pays connaissant un même niveau de dette publique et un même niveau du déficit public supportent pourtant des contraintes différentes de soutenabilité de leurs comptes publics, dès lors que leurs perspectives de croissance sont différenciées.
Il est donc nécessaire de poser des hypothèses sur le niveau futur de la croissance potentielle des différents pays pour estimer l'écart entre leur situation budgétaire présente et une situation budgétaire soutenable.
Or, même si les hypothèses élaborées en ce domaine ne sont nullement fantaisistes , s'appuyant sur des perspectives raisonnables d'évolution de la population active et des gains de productivité, il existe des discussions légitimes qui témoignent de l'existence d'incertitudes importantes sur les évolutions économiques à long terme qui sont susceptibles de modifier significativement l'appréciation de la soutenabilité budgétaire .
Le rapport 2006 de la Commission européenne sur la soutenabilité à long terme des finances publiques dans l'Union européenne en fournit d'ailleurs des illustrations, dont l'une peut être considérée comme involontaire et particulièrement significative .
L'indicateur de soutenabilité budgétaire de la France, mentionné dans le rapport, semble légèrement surestimer l'effort à entreprendre pour stabiliser la dette publique à son niveau de départ .
L'estimation de la soutenabilité de la situation budgétaire en France est conduite par la Commission sur la base des résultats disponibles en 2005, et en fonction des perspectives démographiques alors connues. Le niveau du déficit structurel était alors de 3,2 points de PIB , se décomposant en un déficit primaire structurel de 0,6 point de PIB et des charges d'intérêt égales à 2,6 points de PIB . La dette publique atteignait 66,2 points de PIB . La recommandation implicite au premier terme de l'indicateur de soutenabilité budgétaire (S1), calculé par la Commission (celui portant sur l'effort à entreprendre au vu de la situation initiale des pays) suggère que la France « améliore » son déficit primaire structurel de 1,3 point de PIB pour stabiliser la dette publique au niveau alors atteint. Cela équivalait à passer d'un déficit primaire structurel de 0,6 point à un excédent primaire structurel de 0,7 point de PIB. Or, cet objectif de solde structurel, qui revenait à fixer un objectif de déficit de 1,9 point de PIB, paraît excéder ce qui était alors nécessaire pour stabiliser la dette publique au taux de 66,2 % du PIB.
Avec un déficit de 1,9 point de PIB, il suffisait pour stabiliser la dette publique d'une croissance de 2,9 % en valeur, soit dans l'hypothèse raisonnable d'une hausse du prix du PIB de 1,5 %, une croissance en volume de 1,4 %, très nettement inférieure à la croissance économique potentielle de longue période, telle que les nouvelles projections démographiques, alors non disponibles, la laissent suggérer. A supposer que celle-ci se replie vers un rythme à long terme de 1,7 %, comme le suggèrent les nouvelles perspectives de population active, avec une augmentation des prix du PIB de 1,5 %, le solde nécessaire pour stabiliser la dette publique à un niveau de 66,2 % du PIB (niveau de 2005) s'accommode d'un déficit public total de 2,1 points de PIB, soit un excédent primaire structurel de 0,5 point de PIB (contre le 0,7 point suggéré par la Commission).
On s'accordera pour reconnaître que, quantitativement , la question soulevée ici n'est pas déterminante, même si un ajustement de 0,2 point de PIB, en soi non négligeable, représente 6,2 % du chemin prescrit par l'indicateur (S1) de soutenabilité de la Commission, et 15,4 % de celui nécessité, selon elle, par la situation de départ des finances publiques de la France.
Cependant, sur un plan plus qualitatif , l'exemple ici développé traduit l'existence d'incertitudes - sur le niveau à venir de la croissance économique - qui affectent la robustesse du diagnostic posé sur la soutenabilité des finances publiques.
Dans son rapport précité, la Commission illustre quelques unes de ces incertitudes et leur impact sur l'appréciation de la soutenabilité des positions budgétaires dans l'Union européenne.
Trois hypothèses différentes de celles posées dans la simulation centrale de la Commission sont explorées :
• celle d'une
accélération des
gains de productivité
égale à 0,25 point
entre 2005 et 2015 ;
• celle d'une
augmentation du taux d'emploi
des « seniors »
de 5 points entre 2005 et
2015 maintenu au-delà ;
• celle d'une
augmentation du taux d'emploi
général
de 1 point entre 2005 et 2015 maintenu
au-delà, et provenant, soit d'une augmentation de l'offre de travail,
soit d'une baisse des tensions inflationnistes que provoque souvent la
réduction du taux de chômage (hypothèse de baisse du NAIRU
-
voir chapitre II
).
On doit souligner que ces hypothèses alternatives, qui peuvent être cumulées sous certaines conditions de cohérence, ont deux sortes d'effets sur les indicateurs de soutenabilité budgétaire tels qu'ils sont construits par la Commission, qui sont susceptibles de se conjuguer :
• elles
augmentent le niveau de la croissance
potentielle
en accroissant la population employée et en
augmentant son efficacité productive ;
• elles
jouent sur les équilibres
démographiques
qui conditionnent l'impact du vieillissement de
la population sur les finances publiques et l'appréciation qu'on peut
porter sur leur soutenabilité présente.
IMPACT SUR LA VALEUR DE L'INDICATEUR DE
SOUTENABILITÉ (S2)
DE QUELQUES HYPOTHÈSES ÉCONOMIQUES
(EN POINTS DE PIB)
|
Hypothèses |
Accélération des gains de productivité |
Augmentation du taux d'emploi des Seniors |
Augmentation de l'emploi due à une hausse de l'offre de travail |
Augmentation de l'emploi due à une baisse du NAIRU |
|
Belgique |
- 0,3 |
- 0,3 |
- 0,2 |
- 0,5 |
|
Danemark |
0,0 |
- 0,4 |
- 0,1 |
- 0,4 |
|
Allemagne |
0,0 |
- 0,1 |
- 0,1 |
- 0,3 |
|
Grèce |
- |
- |
- |
- |
|
Espagne |
- 0,6 |
- 0,1 |
- 0,1 |
- 0,2 |
|
France |
- 0,3 |
- 0,4 |
- 0,2 |
- 0,3 |
|
Irlande |
0,0 |
- 0,1 |
- 0,1 |
- 0,3 |
|
Italie |
- 0,4 |
0,0 |
- 0,1 |
- 0,2 |
|
Luxembourg |
- 0,1 |
- |
- |
- |
|
Pays-Bas |
0,0 |
- 0,1 |
- 0,1 |
- 0,7 |
|
Autriche |
- 0,6 |
- 0,4 |
- 0,2 |
- 0,5 |
|
Portugal |
- 0,9 |
- 0,2 |
- 0,2 |
- 0,4 |
|
Finlande |
- 0,4 |
- 0,3 |
- 0,1 |
- 0,3 |
|
Suède |
- 0,2 |
- |
- 0,1 |
- 0,4 |
|
Royaume-Uni |
- 0,3 |
- 0,1 |
- 0,1 |
- 0,2 |
|
UE-25 |
- 0,3 |
- 0,2 |
- 0,1 |
- 0,3 |
|
UE-12 |
- 0,3 |
- 0,2 |
- 0,1 |
- 0,3 |
Source : Services de la Commission
Pour l'Union européenne à 25 , l'écart de soutenabilité est réduit de 0,6 à 0,8 point de PIB selon le scénario d'augmentation de l'emploi retenu quand on cumule les effets des différentes hypothèses posées en variante.
L'amélioration du solde public primaire structurel requise pour stabiliser à l'infini la dette publique au niveau de 60 points de PIB n'est plus de 3,4 points de PIB mais, alternativement, de 2,8 ou 2,6 points de PIB (une stabilisation du niveau de la dette publique à horizon 2050 réclamerait un effort ramené de 2,1 à 1,5 ou 1,3 point de PIB).
Pour la France , la contrainte de stabilité est abaissée de 0,9 ou 1 point de PIB. L'écart de soutenabilité infinie passe de 4 à 3 points de PIB ( à horizon 2050 , il n'est plus que de 2,3 ou 2,2 points de PIB).
Chacune des hypothèses exerce un effet analogue du point de vue quantitatif même si l'augmentation du taux d'emploi des seniors a un impact légèrement supérieur (0,4 point de PIB) puisqu'il augmente, à la fois, le taux de croissance potentiel et réduit la durée de service des pensions.
*
* *
Au-delà des difficultés résultant de la robustesse seulement relative des projections de dette publique sur lesquelles sont fondées les recommandations concernant la politique budgétaire, il faut encore observer que l'appréciation de la soutenabilité budgétaire à partir des perspectives longues de la dette publique conduit à figer la politique budgétaire au service d'un objectif financier discutable .
B. UNE MÉTHODE QUI PEUT CONDUIRE À FIGER LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE, EN CAS D'INTERPRÉTATION EXCESSIVE
La surveillance des positions budgétaires à partir des perspectives de long terme de la dette publique peut déterminer la politique budgétaire dans un sens défavorable à la croissance économique à travers deux effets éventuels :
•
En premier lieu
, la méthode
de surveillance des situations budgétaires actuelles à partir des
perspectives de long terme de l'endettement public,
telles qu'une
situation au fil de l'eau
conduit à les envisager, a le
mérite de mettre en évidence la nécessité d'une
action.
Elle présente, en revanche, une faille de taille aux prolongements éventuels dangereux . Les recommandations auxquelles elle aboutit reposent sur des processus encore à venir appréciés en fonction des circonstances du moment - les effets du vieillissement démographique sur les dépenses publiques de pension, en particulier -, dont il faudrait anticiper les incidences financières immédiatement, en relevant à court terme la capacité de financement des administrations publiques.
Cette approche risque d'être comprise pour ce qu'elle n'est pas et de déboucher sur des décisions regrettables .
Dans le fond, elle revient à indiquer, qu'à législation constante , la dynamique des dépenses publiques - telle que liée à la démographie notamment - implique une augmentation de la dette publique, qui, pour être prévenue appelle une « amélioration » immédiate du solde public, dans des proportions qui sont fournies comme une illustration des efforts à entreprendre.
Le danger est que les gouvernements s'engagent dans ce processus « d'amélioration » en considérant l'indicateur de soutenabilité pour ce qu'il n'est pas, à savoir une norme intangible de soutenabilité .
Il ne s'agit, en effet, nullement d'une norme intangible. Construite sur la base du droit existant, elle est, en effet, susceptible d'évoluer avec celui-ci.
Par exemple, une modification de la législation de sorte que les effets des dépenses publiques liées à l'âge sur la dette publique soient contrecarrés peut intervenir. Une diminution des droits à pension ou une augmentation des prélèvements destinés à les financer sont disponibles en ce sens. A supposer que de telles mesures soient prises, la soutenabilité de la position budgétaire des pays qui les entreprennent s'améliore et le niveau d'exigence sur le solde public, tel qu'il résulte des opérations de recettes et de dépenses actuelles, se détend. En bref, la norme de soutenabilité en est modifiée .
Cette flexibilité de la norme de soutenabilité ne doit pas être ignorée sous peine de rendre des arbitrages éventuellement inappropriés .
En effet, négliger cette propriété invite à modifier l'équilibre présent des comptes publics en considérant comme acquis que les équilibres futurs ne sauraient être infléchis.
Cette option conduit à modifier les choix publics tels qu'ils se traduisent dans les comptes publics au nom de perspectives, qui, en fait, supposent le maintien de systèmes qu'il est peu probable de voir conservés.
Pour illustrer le propos, on peut indiquer que prendre au pied de la lettre les indicateurs de soutenabilité de la Commission européenne, c'est imaginer qu'aucune réforme du système de pensions n'interviendrait et qu'il faudrait aussi réduire les dépenses publiques actuelles ou/et augmenter, immédiatement, les prélèvements obligatoires pour dégager une capacité de financement public.
Une telle interprétation porte en elle un arbitrage en faveur des dépenses publiques de pension et à l'encontre d'autres dépenses publiques. Il peut être lourd de conséquences si, parmi les secondes, sont « sacrifiées » des dépenses d'avenir .
•
En second lieu
, il apparaît
que toute méthode reposant sur des perspectives à long terme des
dépenses publiques est susceptible d'aboutir à l'identification
de problèmes de soutenabilité dès lors qu'on pose deux
hypothèses :
- d'une part, celle d'un dynamisme des dépenses publiques supérieur à la croissance économique ;
- d'autre part, celle d'une stabilisation de la pression fiscalo-sociale.
Ces hypothèses sont, l'une et l'autre, discutables :
- il est possible d'envisager une inversion du différentiel de croissance entre dépenses publiques et croissance économique générale ;
- il est possible, également, d'imaginer que les choix futurs d'allocation du revenu national concernent concomitamment les dépenses publiques et les financements nécessaires.
Dans l'oubli de ces éventualités, on mettra toujours en évidence le renforcement de la contrainte présente « d'assainissement » des finances publiques.
Le coup de projecteur ainsi donné a pour conséquence de geler l'instrument budgétaire comme arme de stabilisation conjoncturelle au-delà du jeu des stabilisateurs automatiques.
Puisque l'objectif affiché est « d'améliorer » le solde structurel, toute politique budgétaire discrétionnaire contra-cyclique s'en trouve néces-sairement écartée.
C. LA RÉDUCTION DE LA DETTE PUBLIQUE, UNE PRIORITÉ JUSTIFIÉE DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE ?
On a indiqué plus haut, ce que le seuil de 60 points du PIB devait à des circonstances historiques .
Il est beaucoup plus difficile de le justifier par des données économiques ou financières .
Au demeurant, ce que l'Union européenne défend à ses Etats, elle l'autorise à tous les autres agents et l'endettement des ménages dans de nombreux pays européens excède ce plafond.
En outre, il importe d'écarter deux sources de confusion sur l'appréciation de la dette publique :
•
la dette publique dont il est question dans
les débats de politique économique ne donne pas une image
fidèle de la situation patrimoniale de l'Etat.
Il s'agit d'une
dette brute et non d'une dette nette des actifs des administrations publiques.
Or, pour apprécier la soutenabilité d'une dette quelle qu'elle
soit, il faut à tous le moins déduire de cette dette les actifs
disponibles qu'elle peut avoir financé. Au demeurant, pour l'Etat, le
diagnostic est plus complexe. Il lui appartient, et c'est l'essence même
de la justification de son intervention, de financer des transferts et des
biens et services qui ne lui bénéficient pas. Ce faisant, une
partie majoritaire de ses emplois de fonds profite aux agents privés. La
comptabilité publique et la Comptabilité nationale ne retracent
pas correctement ces opérations qui n'ont pas de contrepartie au bilan
de l'Etat. Il serait pourtant judicieux de valoriser les actifs incorporels
créés par les dépenses publiques afin de mieux
appréhender la situation d'endettement des administrations publiques.
•
la dette publique n'est pas la dette de la
Nation
. La dette de la Nation, à un instant donné, est
le résultat d'un cumul des besoins de financement de l'ensemble des
agents économiques qui détermine la capacité de
financement de la Nation. Son niveau traduit la capacité de financer la
demande domestique à partir des ressources nationales. Un besoin de
financement de la Nation oblige à solliciter l'épargne du Reste
du Monde.
Une capacité de financement signifie qu'une épargne nationale est disponible pour financer les besoins du Reste du Monde.
Il peut exister un lien entre le besoin de financement public et le besoin de financement de la Nation - et donc entre dette publique et dette de la Nation - mais ce lien n'est en rien automatique. Une augmentation de la dette publique peut entraîner une hausse de la dette de la Nation, ou, au contraire, s'accompagner d'une réduction de cette dette.
En Europe, les situations en matière de dette publique et de besoin de financement de la Nation sont marquées par une grande diversité.
DETTE PUBLIQUE BRUTE (en % du PIB)
|
Pays |
1980 |
1985 |
1990 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
Belgique |
74,1 |
115,2 |
125,7 |
106,3 |
103,2 |
98,5 |
94,3 |
93,2 |
|
Allemagne |
31,2 |
40,7 |
42,3 |
58,8 |
60,3 |
63,8 |
65,5 |
67,9 |
|
Espagne |
16,4 |
41,4 |
42,6 |
55,6 |
52,5 |
48,9 |
46,2 |
43,1 |
|
France |
20,8 |
30,3 |
35,3 |
56,2 |
58,2 |
62,4 |
64,4 |
66,6 |
|
Irlande |
69,0 |
100,5 |
93,1 |
35,3 |
32,1 |
31,1 |
29,7 |
27,4 |
|
Italie |
56,9 |
80,5 |
94,7 |
108,7 |
105,5 |
104,2 |
103,9 |
106,6 |
|
Pays-Bas |
44,0 |
67,5 |
73,7 |
50,7 |
50,5 |
51,9 |
52,6 |
52,7 |
|
Zone euro |
33,7 |
50,6 |
57,0 |
68,3 |
68,1 |
69,3 |
69,7 |
70,6 |
|
Danemark |
39,1 |
75,0 |
62,0 |
47,4 |
46,8 |
44,4 |
42,6 |
35,9 |
|
Royaume-Uni |
53,2 |
52,7 |
34,0 |
38,1 |
37,6 |
39,0 |
40,4 |
42,4 |
Source : Commission européenne
CAPACITÉ DE FINANCEMENT DE LA NATION 1961-2004 (en points de PIB)
|
Pays |
Moyenne 1961-1990 |
Moyenne 1991-95 |
Moyenne 1996-2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
Belgique |
0,3 |
3,8 |
5,0 |
4,0 |
4,8 |
4,4 |
3,6 |
2,5 |
|
Allemagne |
1,2 |
-1,3 |
-0,9 |
0,0 |
2,2 |
2,1 |
3,9 |
4,2 |
|
Espagne |
-1,4 |
-0,3 |
-3,4 |
-2,6 |
-3,0 |
-4,8 |
-6,5 |
|
|
France |
-0,2 |
2,0 |
1,1 |
0,8 |
-0,3 |
-0,6 |
-2,1 |
|
|
Irlande |
3,1 |
2,4 |
0,0 |
-0,6 |
0,1 |
-0,8 |
-3,0 |
|
|
Italie |
0,1 |
2,0 |
0,4 |
-0,3 |
-0,7 |
-0,4 |
-0,9 |
|
|
Pays-Bas |
4,0 |
4,2 |
5,0 |
5,9 |
5,6 |
8,4 |
6,8 |
|
|
Zone euro |
-0,2 |
0,9 |
0,2 |
0,9 |
0,5 |
0,9 |
0,2 |
|
|
Danemark |
1,7 |
1,1 |
3,1 |
2,6 |
3,2 |
2,3 |
3,0 |
|
|
Royaume-Uni |
1,6 |
-1,3 |
-2,1 |
-1,5 |
-1,3 |
-1,5 |
-2,0 |
|
|
Europe 15 |
-0,4 |
0,7 |
0,0 |
0,7 |
0,5 |
0,6 |
ND |
|
|
Etats-Unis |
-0,3 |
-0,9 |
-2,4 |
-3,7 |
-4,4 |
-4,7 |
-5,6 |
-6,3 |
Source : Commission européenne
Au total, la zone euro dispose d'une capacité de financement qui témoigne d'une capacité d'épargne. A l'inverse, le Royaume-Uni et, surtout, les Etats-Unis connaissent des besoins de financement qui persistent depuis de nombreuses années.
Ces constats conduisent à tirer des conclusions entièrement contraires à celles qui fondent les recommandations de réduire la dette publique :
• la
croissance dans l'Union
européenne n'est pas freinée par un déficit
d'épargne
mais par un déficit de
« projets » ;
• la
valeur de l'euro
- qui
d'ailleurs s'est appréciée depuis plusieurs années -
n'est pas sous la menace d'une dépréciation
résultant de l'accumulation de dettes
;
• la
compétitivité de la zone
euro ne semble nullement en danger du fait d'un risque d'écarts
d'inflation avec le Reste du Monde.
Dans ces conditions, la normativité du plafond de la dette publique pose un dernier problème, de fond . Une dette publique supérieure à 60 points de PIB est-elle intolérable ; faut-il se tenir à ce plafond coûte que coûte ?
L'augmentation de la croissance potentielle, telle qu'elle est posée en objectif par les gouvernements européens (dans le cadre de la « Stratégie de Lisbonne »), et telle que son éventualité est posée dans la programmation financière à l'horizon 2012, appelle des « investissements » matériels (en infrastructures notamment) et immatériels (en formation, en recherche...). Par ailleurs, le souci de protection de l'environnement, le développement durable, réclame aussi des investissements. Ces projets nécessitent des financements et, compte tenu de leur nature et de leurs effets sur le rythme structurel de la croissance économique, il est cohérent qu'une partie de ce financement provienne d'emprunts.
Dans ces conditions, une politique de renoncement à l'emprunt public, qu'implique un objectif de réduction de l'endettement public au moyen d'une élimination des besoins de financement des administrations publiques, suppose que le secteur privé prenne le relais dans des domaines où l'intervention publique est souvent la règle, pour des raisons, que la théorie économique explique de façon souvent satisfaisante, tenant à l'improbabilité d'une intervention des agents privés .
*
* *
Au total, accorder une priorité à la diminution de la dette publique témoigne, aux yeux de votre rapporteur, d'une inversion des valeurs.
Sans doute, ne doit-on pas s'en désintéresser. Mais, l'objectif prioritaire de toute politique économique est de rechercher les moyens d'élever la croissance, durablement.
Dans cette optique, la question principale qui est posée pour les finances publiques est que l'intervention de l'Etat contribue à cet objectif. A fortiori, il faut tout faire pour qu'elle ne soit pas un obstacle sur ce chemin.
La soutenabilité du désendettement public mérite en ce sens plus d'attention.
De même, il faut pleinement s'associer aux propos récents de M. le Président de la République, à l'occasion du bicentenaire de la Cour des Comptes : « A ceux qui réclament des politiques comptables, je dis que la France a besoin de politiques économiques, non de politiques comptables. Je leur dis que le rationnement comptable de la dépense met du désordre dans l'Etat, accroît les gaspillages et alourdit les déficits au lieu de les réduire. Je leur dis que le rationnement est une mauvaise politique et que la bonne politique c'est de chercher à accroître l'efficacité de la dépense » .
CHAPITRE IX - LA POLITIQUE MONÉTAIRE : ENJEUX ET QUESTIONS
Le premier objectif fixé à l'eurosystème est la stabilité des prix. Globalement, celle-ci est vérifiée sans qu'on puisse attribuer pleinement cette performance à la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).
En outre, les perspectives de croissance mériteraient d'être mieux prises en compte dans la gouvernance monétaire de la zone euro.
I. UNE ÉVOLUTION DES PRIX EN LIGNE AVEC LA CIBLE D'INFLATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
A. L'OBJECTIF DE STABILITÉ DES PRIX TEL QU'INTERPRÉTÉ PAR LA BANQUE CENTRALE EUROPÉNNE
Le traité de Maastricht 91 ( * ) sur l'Union européenne a confié à la Banque centrale européenne (BCE) 92 ( * ) la stabilité des prix comme objectif principal. Suivant le modèle de la Bundesbank (ou, depuis 1994, celui de la Banque de France), l'indépendance de la BCE vis-à vis du pouvoir politique a été garanti par l'article 107 93 ( * ) du traité précité.
Le concept de stabilité des prix n'est pas défini dans le traité, mais la BCE, se donnant pour objectif une progression de l'indice des prix à la consommation harmonisé de la zone euro inférieure à 2 %, en a assuré l'interprétation. Il est à noter que la Banque de France avait eu le même objectif depuis 1996.
La BCE a défini deux « piliers » qui lui permettent d'évaluer les risques d'inflation dans la zone euro . En premier lieu, elle effectue une « analyse monétaire », c'est-à-dire qu'elle étudie l'évolution d'un certain nombre d' agrégats monétaires 94 ( * ) dans une perspective de contrôle direct de la masse monétaire. A l'origine, le rôle central de la masse monétaire a été signalé par l'annonce d'un taux de croissance annuel de référence pour l'agrégat M3, fixé à 4,5 %.
En second lieu, elle suit l'évolution de certains indicateurs économiques et financiers tels que les salaires, les prix des matières premières, les taux de change, la confiance des consommateurs et des entreprises.
Il se trouve qu'un nombre croissant de banques centrales abandonne une stratégie fondée sur une stricte maîtrise des agrégats, car le lien entre masse monétaire et inflation tendrait à se distendre.
De fait, l'agrégat M3 a progressé très fortement ces dernières années, actuellement à un rythme annuel supérieur à 10 %, sans accélération manifeste des prix.
B. LES MOYENS DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE
Outre la disposition du monopole d'émission des billets, la BCE pilote la liquidité du marché monétaire et le coût de refinancement des banques.
|
LE PILOTAGE DE LA LIQUIDITÉ PAR LA BCE Le système européen de banques centrales (SEBC) 95 ( * ) effectue des opérations d'« open market » , offre des facilités permanentes et assujettit les établissements de crédit à la constitution de réserves obligatoires sur des comptes ouverts sur les livres du SEBC 96 ( * ) . Ces opérations de politique monétaire définies par la BCE sont exécutées dans tous les Etats membres selon des modalités uniformes. Parmi les opérations d'open market de la BCE - il s'agit de cessions de titres auprès de la banque centrale avec engagement de rachat à terme -, les « opérations principales de refinancement » constituent le principal canal de refinancement du secteur financier et jouent un rôle pivot dans la poursuite des objectifs du SEBC. Le taux de l ' opération principale de refinancement (également dit « taux des appels d'offres » et encore « taux refi » ou « taux repo »), auquel la BCE accorde un volume plus ou moins important de pensions 97 ( * ) , constitue un taux plancher : le taux d'intérêt à court terme ne peut descendre plus bas. Il s'agit du principal taux directeur de la BCE , celui qui fait d'ailleurs l'objet d'une communication « grand public ». Deux facilités permanentes sont proposées aux établissements de crédit. Le taux des facilités de prêt marginal (plafond qui permet aux banques un refinancement automatique et illimité) et le taux de la facilité de dépôt (taux plancher qui permet aux banques d'être rémunérées sur leurs prêts à la BCE). Ces deux taux constituent le plafond et le plancher entre lesquels oscille le taux de l'argent au jour le jour entre banques (dépôts interbancaires « en blanc », c'est-à-dire sans être gagés par des titres), dont la mesure est l'Eonia 98 ( * ) . L'Eonia, avec l'Euribor 99 ( * ) , qui couvre les durées allant d'une semaine à un an, sont les deux taux de référence du marché monétaire de la zone euro. Par exemple, l'Euribor à 3 mois sert de référence («benchmark ») pour beaucoup de prêts variables, des fonds monétaires et certains produits structurés. L'ensemble de ces taux, à commencer par le taux « refi », influent sur les conditions de refinancement des banques ; leurs variations se transmettent ainsi aux taux des crédits proposés aux entreprises et aux particuliers. |
C. UNE MAÎTRISE DE L'INFLATION AVÉRÉE
L'évolution du taux d'inflation dans la zone euro s'est trouvée en ligne avec la cible de la BCE. De 1998 à 2006, en moyenne annuelle, elle est restée comprise entre 1,1 % et 2,3 %, malgré la menace, non avérée, d'un fort ressaut les années du passage à l'euro (2001-2002).
TAUX DE CROISSANCE DE L'INDICE HARMONISÉ DES
PRIX À LA CONSOMMATION
DANS LA ZONE EURO
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
moyenne 1998-2006 |
|
1,1 % |
1,1 % |
2,1 % |
2,3 % |
2,2 % |
2,1 % |
2,1 % |
2,2 % |
1,9 % |
1,9 % |
Sur la même période, l'évolution de l'inflation hors alimentation et énergie montre que l'économie de la zone euro est, de façon structurelle, globalement exempte de tensions inflationnistes, ainsi qu'il ressort de l'examen du graphique n° 1 suivant :
GRAPHIQUE N° 1
ÉVOLUTION COMPARÉE DE L'INFLATION
ET
DE L'INFLATION HORS ALIMENTATION ET ÉNERGIE
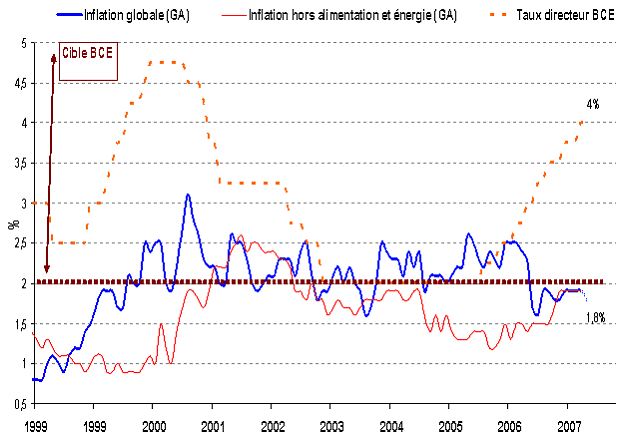
Sources : Covéa Finance/ Bloomberg/ Datastream
Sur l'ensemble de la période 1998-2006, le rythme annuel moyen de l'inflation dans la zone euro (1,9 %) est inférieur de 1 point à celui de la moyenne européenne (2,9 %). Dans la période récente, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis oscille autour de 3 %.
Ces performances contrastées paraissent toutefois refléter deux processus moins favorables : un écart de croissance négatif au détriment de la zone euro avec un taux de chômage élevé ; une appréciation continue de l'euro qui freine les prix mais aussi la croissance économique.
II. UN OBJECTIF À DÉFINIR : REHAUSSER LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE
Ainsi qu'il a été vu dans les chapitres concernant la croissance potentielle et l'investissement, la crédibilité des politiques économiques en termes de volonté de croissance est essentielle pour qu'intervienne effectivement une croissance économique plus forte. Le désir et la capacité d'innover et d'investir sur le territoire européen en dépendent.
Dans une économie mondialisée, la confiance dans la zone euro pour appliquer une stratégie de croissance autonome est ainsi déterminante. Or, parallèlement au contrôle de l'inflation, une banque centrale a naturellement vocation à favoriser la croissance, d'une part en facilitant le financement de l'économie, d'autre part en mettant en oeuvre une politique de change qui ne constitue pas un handicap pour l'activité économique.
A. FAVORISER LE FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE
Ainsi que le souligne l'OFCE 100 ( * ) , « l'intensification de la concurrence résultant de la mondialisation contribue à la désinflation mondiale . L'intégration croissante de la Chine au commerce international et la libéralisation progressive des échanges de services devraient favoriser le maintien des pressions à la baisse des prix. De fait, il semble important de ne pas surestimer les risques d'inflation au sein de la zone euro ».
Il est possible que la politique monétaire relativement rigoureuse récemment menée par la BCE (les deux dernières hausses, intervenues en mars et juin 2007, succèdent à six relèvements successifs depuis 2005) n'ait que peu d'effet sur une inflation dont la composante énergétique est forte.
L'ajustement est alors susceptible de peser sur les autres composantes de l'indicateur d'inflation globale, dont l'évolution n'est pourtant pas alarmante (cf. graphique n° 1 ci-dessus) .
Il n'est donc pas illégitime de poser la question de l'opportunité des dernières hausses du taux d'intervention de la BCE, que justifierait la progression de l'agrégat M3, alors même que le lien entre les agrégats monétaires et l'inflation serait ténu 101 ( * ) tandis qu'en revanche, le retard de croissance accumulé par la zone euro nécessiterait plutôt des politiques macroéconomiques volontaristes , propices à l' investissement et à l' élévation de la croissance potentielle .
L'échec relatif de la stratégie de Lisbonne, qui mise largement sur les progrès dans l'éducation et l'innovation ainsi que sur l'accroissement des dépenses de recherche et développement pour accroître le potentiel de croissance, montre que la contradiction entre la politique monétaire de la BCE et les objectifs de croissance à long terme ne sont pas qu'apparents.
|
Or, aucun texte ne s'opposerait à ce que la politique de la BCE participe au soutien de la croissance, et aucun texte ne fixe à 2 % la limite au-delà de laquelle la stabilité des prix ne serait plus vérifiée . |
La relative indifférence de la BCE aux perspectives de croissance serait d'autant plus regrettable que la politique budgétaire des Etats membres de la zone euro est contrainte par les programmes se stabilité. Ainsi, se trouve compromise de facto toute possibilité de « policy mix » , c'est-à-dire d'une combinaison calculée de la politique budgétaire et de la politique monétaire, qu'on voudrait au service de la croissance.
Pour l'avenir, la capacité de la zone euro à appliquer une stratégie de croissance autonome dépend clairement de note capacité à poser les termes de la coordination des politiques économiques .
Alors que l' assainissement budgétaire en Europe progresse, conformément aux voeux de l'autorité monétaire, concourant ainsi à écarter encore plus les tensions inflationnistes, alors que l'essentiel de l'augmentation récente des prix du pétrole et des matières premières est absorbée dans un contexte de modération salariale , ces éléments ne semblent pourtant pas pris en considération dans la conduite de la politique monétaire. Cela n'est pas de nature à améliorer, dans le Monde, la confiance des agents économiques dans la capacité de la zone euro à appliquer une stratégie de croissance autonome.
B. EXERCER UNE POLITIQUE DE CHANGE
1. Une politique de change quasi inexistante dans la zone euro
En théorie, une Banque centrale peut orienter le taux de change de la monnaie. En tant que telle, la BCE peut intervenir de deux façons : directement, sur le marché des changes en utilisant ses réserves monétaires, et indirectement par la fixation de ses taux directeurs, qui ont une influence sur l'attractivité de l'euro et donc sur son cours. Dans la zone euro, il a été décidé que le régime de change applicable à l'euro serait un régime de flottement pur , comme pour les monnaies de nombreux autres grands pays industrialisés.
La BCE est pleinement chargée de la conduite de la politique de change , mais celle-ci est arrêtée par le Conseil de l'Union européenne (Conseil Ecofin), réunissant les ministres de l'économie et des finances de l'Union. Les instances politiques ont ainsi théoriquement la maîtrise de cette politique , même si les orientations adoptées ne doivent pas entrer en contradiction avec l'objectif de stabilité des prix.
Mais les autorités politiques ont jusqu'à présent adopté une attitude prudente . Ainsi, les ministres des finances de l'UE ont décidé, en décembre 1997, « de ne formuler des orientations générales en matière de change que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque le taux de change de l'euro subit des divergences manifestes et persistantes ». Concrètement, aucune orientation générale ne semble avoir été formulée jusqu'à présent.
De fait, la stratégie de politique monétaire de l'Eurosystème ne prévoit pas d'objectif de taux de change , au motif, très discutable techniquement, que les décisions de politique monétaire visant à maintenir un objectif de taux de change sont susceptibles de se révéler incompatibles avec l'objectif de la stabilité des prix.
Ce n'est que lorsque la BCE estime que l'évolution du taux de change constitue une menace pour le taux d'inflation qu'elle en vient à exercer une politique de change qui n'est, en réalité, qu'une autre manière de poursuivre l'objectif de stabilité des prix de la politique monétaire.
2. Le coût de l'euro fort
a) Une évolution pro-cyclique du cours de l'euro dans la zone euro
Depuis 1999, on observe que l'euro s'apprécie lorsque la croissance ralentit et se déprécie quand l'activité économique accélère, ce qui ne sert pas la croissance de la zone euro. L'OFCE 102 ( * ) relève que « [l'euro] dépend entièrement de l'option anti-inflationniste de la BCE : la stabilité des prix est parfaitement réalisée dans la zone euro depuis 2001 au prix d'une forte instabilité du taux de change ».
Le graphique suivant rend compte de l'évolution pro-cyclique du change dans l'Eurosystème :
GRAPHIQUE N° 2
LA PRO-CYCLICITÉ DU TAUX DE CHANGE DANS LA ZONE EURO
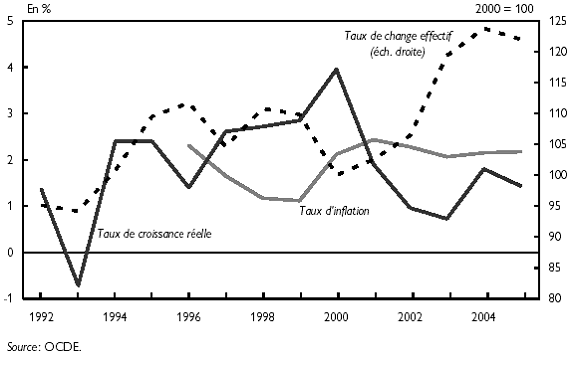
A l'inverse, les Etat-Unis mènent une politique de change soit neutre, soit contra-cyclique, ainsi que le graphique suivant le fait apparaître :
GRAPHIQUE N° 3
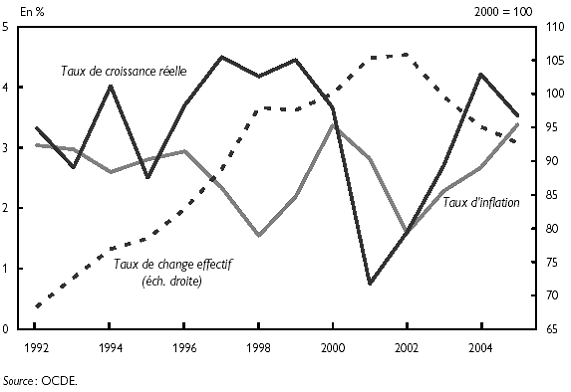
L'euro s'étant apprécié de près de 50 % par rapport au dollar entre 2000 et 2005, certaines voix se sont alors élevées, notamment en France, pour critiquer la force de l'euro qui provoquerait, selon toute vraisemblance, une perte de compétitivité des entreprises européennes. La France paraît néanmoins isolée au sein de la zone euro dans cette critique du taux de change.
Au motif que l'Allemagne s'en satisfait, plusieurs voix estiment que les problèmes de compétitivité de la France ne proviendraient pas du taux de change, mais seraient de nature essentiellement structurelle (voir chapitre V) .
Cette appréciation semble ignorer la singularité de la situation économique allemande. L'évolution de son commerce extérieur fait plutôt figure d'exception dans l'Union européenne. Elle peut être en grande partie attribuée à une politique de désinflation compétitive (modération salariale, diminution des cotisations sociales et renforcement de la fiscalité indirecte) qui se traduit par un appauvrissement relatif des ménages allemands et pèse sur les échanges extérieurs des partenaires.
Or, plutôt que de faire de l'Allemagne un modèle à suivre, il serait légitime de craindre, pour la croissance de l'ensemble de la zone euro, que la stratégie de compétitivité poursuivie unilatéralement par l'Allemagne soit imitée par les autres pays de la zone .
b) Le poids des conditions monétaires sur l'économie française
Dans les projections de votre Délégation, l'euro devrait continuer de s'apprécier pour culminer à 1,50 dollar au deuxième trimestre 2008 ; il s'établirait à 1,44 dollar en moyenne sur l'ensemble de l'année 2008, soit une augmentation de 6 % par rapport à 2007. Au-delà, les parités de l'euro sont stabilisées par convention (1,40 dollar pour 1 euro).
En raison des délais de transmission d'une
appréciation de la monnaie sur l'activité, le dernier ressaut du
dollar ne deviendrait pleinement sensible qu'en 2009
103
(
*
)
, mais il aurait tout de
même un impact négatif sur la croissance française de
près de 0,5 point l'année prochaine contre -0,2 point
en 2007 et
-0,1 point en 2006. Certes, cette appréciation de
l'euro permettrait de limiter l'impact négatif sur l'activité de
la hausse du prix du brent (-0.2 point en 2008 contre -0,4 point en
2007 et -0,6 point en 2006). Libellé en euros, le prix du
pétrole devrait baisser de près de 6 % en 2008
104
(
*
)
.
Le tableau suivant retrace l'impact du choc des conditions monétaires sur l'économie française, observé et attendu pour 2007 et 2008 ; il montre que le niveau du change de l'euro devrait avoir amputé la croissance de 0,3 point en moyenne sur la période 2004-2008 :
IMPACT DES CONDITIONS MONÉTAIRES SUR LA CROISSANCE FRANÇAISE
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
|
En points de PIB |
-0,4 |
-0,3 |
-0,1 |
-0,2 |
-0,5 |
Source : donnée OFCE
Il est probable qu'à moyen terme, le dollar demeure vulnérable du fait de l'ampleur du déficit extérieur américain. Or, si le dollar venait à se déprécier fortement, la compétitivité-prix française vis-à-vis de l'extérieur de la zone euro connaîtrait un choc supplémentaire, même si le coût des approvisionnements hors zone euro, et notamment la facture pétrolière, diminuerait parallèlement.
La question de la politique de change dans la zone euro s'en poserait avec une acuité renforcée.
EXAMEN EN DÉLÉGATION
Au cours de sa réunion du mercredi 7 novembre 2007 , tenue sous la présidence de M. Joël Bourdin , président , la délégation pour la planification a procédé à l'examen du rapport d'information sur les perspectives de l'économie française et des finances publiques à l'horizon 2012, de M. Joël Bourdin, rapporteur .
M. Joël Bourdin, rapporteur , a d'abord souligné que le rapport annuel de la délégation avait pour objectif d'apporter au débat public, à travers une simulation quantitative, une évaluation de la stratégie des finances publiques définie par les gouvernements successifs. Il a indiqué que le rapport procédait à l'exploration des perspectives économiques à moyen terme au travers de deux scénarios, réalisés grâce au modèle macroéconomique de l'OFCE, repris de la programmation à moyen terme des finances publiques associée au projet de loi de finances pour 2008. Le premier scénario, dit scénario « central », retient l'hypothèse d'une réduction annuelle du déficit public structurel de 0,5 point de PIB, ce qui correspond précisément aux exigences du « pacte de stabilité et de croissance » européen. Malgré cette impulsion négative sur la demande, la croissance s'élève à 2,5 % par an, à compter de 2009. Les comptes publics se trouveraient juste à l'équilibre en 2012 et, dès 2011, le poids de la dette publique serait quasiment ramené à 60 points de PIB. Dans le second scénario, l'hypothèse sous-jacente est celle d'une amélioration structurelle du déficit public de l'ordre de 0,8 point de PIB, donc plus énergique que celle requise par le pacte de stabilité, dans le contexte d'une croissance annuelle de 3 % à compter de 2009. Les comptes publics présenteraient un excédent à partir de 2011 et le poids de la dette publique dans le PIB passerait en dessous de 60 % dès 2010.
M. Joël Bourdin, rapporteur , a précisé que le scénario central, qui conjuguait un fort ajustement budgétaire avec une croissance soutenue, nécessitait que la « réépargne publique », que représente la baisse du déficit public, soit compensée par une désépargne privée.
En raison de l'impulsion économique a priori négative de l'orientation des dépenses publiques jusqu'en 2012, il faudrait, pour suivre les rythmes de croissance annoncés, que la croissance économique spontanée se redresse et tende, dans le premier scénario, vers une croissance en volume de 3 % et, dans le second scénario, vers une croissance en volume de 3,8 %.
Le comportement des ménages est la clé du désendettement de l'Etat. En effet, dans le scénario central, malgré la réduction du déficit budgétaire qui pèse sur le pouvoir d'achat, la demande des ménages ne fléchit pas en raison d'une baisse prononcée de leur taux d'épargne. Celui-ci doit reculer de 3 points entre 2007 et 2012, pour se situer alors à 12,7 points de leur revenu. Cette baisse est nécessaire pour que la consommation des ménages augmente, en moyenne, de près de 3 % par an, alors que leur revenu disponible progresserait à un rythme n'excédant guère 2 %. Les perspectives de pouvoir d'achat sont réduites par l'hypothèse posée d'un parallélisme entre l'évolution de la productivité et du salaire par tête (1,7 % par an), tandis que les engagements de réduction du déficit public et de baisse des dépenses publiques exerceraient un effet défavorable sur le bilan des relations financières entre les ménages et l'Etat.
M. Joël Bourdin, rapporteur , s'est ensuite interrogé sur la plausibilité d'une baisse notable du taux d'épargne des ménages. Dans un passé récent, le taux d'épargne des ménages a déjà diminué dans des proportions importantes, si bien que l'inflexion anticipée ne paraît pas invraisemblable. Par ailleurs, une baisse des déficits publics peut conforter l'idée qu'il est moins nécessaire d'épargner. Enfin, si l'endettement des ménages français approche aujourd'hui le niveau record de 70 % de leur revenu, ce taux demeure très inférieur à celui observé dans d'autres pays : par exemple, 130 %, en Espagne, en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis.
Quoi qu'il en soit, la « désépargne » des ménages est essentiellement suspendue à l'évolution des taux d'intérêts, et donc à la politique de la Banque centrale européenne (BCE). L'évolution des taux d'intérêt constitue par ailleurs un déterminant fondamental de l'investissement, dont la hausse est également requise pour la réalisation des scénarios de croissance : pour sa contribution à l'augmentation de la demande et au renforcement de la croissance potentielle.
A taux d'intérêts réels inchangés, la rentabilité économique de l'investissement dépendrait surtout de la demande effective. Depuis la fin des années quatre-vingt dix, les taux d'intérêts réels ne se situent plus à un niveau intrinsèquement problématique pour l'investissement et, au sein des entreprises, le maillon le plus faible du processus décisionnel se situerait plutôt du côté de l'anticipation de la demande, ce qui plaide pour une politique prioritairement orientée vers la croissance.
Puis, M. Joël Bourdin, rapporteur , a observé que, depuis la crise mondiale de 2001 consécutive à l'éclatement de la « bulle Internet », les Etats-Unis avaient utilisé les leviers budgétaire et monétaire pour relancer l'activité avec succès alors que celle de la zone euro restait engluée dans une « croissance molle ». De fait, avec une politique monétaire au service exclusif de la stabilité des prix, des politiques budgétaires bridées et une politique de change quasi-inexistante, la gouvernance de la zone euro s'avère défavorable à la croissance. Dans ce contexte, les pays de la zone peuvent chercher à capter une part de la croissance de leurs partenaires par des politiques de compétitivité ou de concurrence fiscale. C'est ce que fait l'Allemagne depuis dix ans, et la France réfléchit aujourd'hui à une TVA sociale. Or, si tous les pays d'un ensemble relativement peu ouvert sur l'extérieur, comme l'est la zone euro, mènent des politiques de désinflation compétitive, les avantages différentiels que chacun peut en attendre s'annulent, tandis que la croissance de l'ensemble de la zone se ralentit.
M. Joël Bourdin, rapporteur, a ensuite estimé que dans un contexte de politiques macroéconomiques globalement restrictives, il serait difficile, malgré certaines réformes structurelles, de rehausser la productivité du travail au niveau de celle des Etats-Unis, ainsi que se le recommande pourtant l'Europe à elle-même dans sa « Stratégie de Lisbonne ». Le récent redressement de la productivité observé dans la zone euro semble bien relatif ; en réalité, la forte décélération observée depuis les années quatre-vingt constitue la seule évolution véritablement marquante depuis l'après-guerre. Elle illustre l'idée que l'Europe peine à passer d'un modèle d'imitation, caractéristique d'une économie en phase de rattrapage, à un modèle d'innovation continue, qui lui permettrait de se situer à la « frontière technologique ». C'est pourquoi la France doit comprendre que l'enjeu essentiel est celui de sa capacité à redresser l'investissement de ses entreprises, son effort de recherche-développement et la qualité de son capital humain.
Enfin, M. Joël Bourdin, rapporteur , a analysé la dépense publique. La stratégie du Gouvernement est dictée par un objectif de réduction de la dette publique résultant d'un strict contrôle des dépenses. Celles-ci progresseraient, à partir de 2008, à un rythme de l'ordre de 1 % en volume. Les dépenses de l'Etat seraient particulièrement contraintes, car la norme de progression « zéro volume » serait étendue, dès 2008, aux prélèvements sur recettes pour les collectivités locales et l'Union européenne. Il semble qu'une norme d'évolution des dépenses publiques aussi stricte suppose des économies qui vont au-delà de ce qu'on peut attendre d'une meilleure gestion. Outre l'inertie de certaines dépenses - 60 % des dépenses publiques sont des dépenses de transfert et de protection sociale -, il faut compter avec les priorités affichées, notamment celles fixées par la stratégie de Lisbonne, telles que l'enseignement, la recherche ou l'innovation.
M. Joël Bourdin, rapporteur , a également estimé que l'objectif d'un renoncement de l'Etat à l'emprunt paraissait discutable. L'augmentation de la croissance potentielle voulue par les Gouvernements européens suppose de lourds « investissements » matériels (en infrastructures notamment) et immatériels (en formation, en recherche...). Le souci de protéger l'environnement, le développement durable, réclame encore d'autres investissements. Ces projets nécessitent des financements et, compte tenu de leur nature et de leurs effets sur le rythme structurel de la croissance économique, il serait cohérent qu'une partie de ce financement provienne d'emprunts. Une politique de renoncement à l'emprunt public suppose que le secteur privé prenne le relais dans des domaines où l'intervention publique est souvent la règle et, finalement, se pose ainsi la question de la « soutenabilité de la réduction de la dette publique » quand celle-ci est recherchée par des moyens comptables. Or, cette question est négligée par les recommandations de politique budgétaire de la Commission européenne, établies sur la base de perspectives à long terme d'évolution des dettes publiques.
Selon M. Joël Bourdin, rapporteur , les trajectoires de soutenabilité budgétaire décrites à partir des perspectives de la dette publique à long terme appellent trois séries d'observations.
En premier lieu, il se pourrait que la croissance potentielle en Europe soit supérieure aux estimations actuelles. Outre le redressement structurel qui semble se dessiner avec l'augmentation de la productivité, les projections démographiques à l'horizon 2050 publiées par l'INSEE en juillet 2006 ont montré que l'« atout démographique » de la France devrait finalement perdurer alors qu'on le croyait provisoire, ce qui se traduirait par un relèvement de 0,3 point de PIB des perspectives de croissance potentielle et permettrait de diminuer de 0,2 point de PIB l'effort nécessaire pour parvenir à une stabilisation de la dette publique à long terme. Ces considérations illustrent la robustesse relative du diagnostic porté sur la soutenabilité des finances publiques.
En deuxième lieu, la dette publique dont il est question dans le débat public est une dette brute, qui n'est pas corrigée des emplois qu'elle finance et de leur impact sur la croissance structurelle. Or, il serait justifiable de raisonner en dette nette des actifs corporels ou incorporels produits par l'intervention publique et de mieux tenir compte de la rentabilité macroéconomique des dépenses publiques.
En troisième lieu, la dette publique n'est pas la dette de la Nation et, à une augmentation de l'endettement public, peut correspondre ou non une progression de la dette de la Nation. La Commission européenne et la BCE demandent régulièrement que la dette publique en Europe soit réduite, alors que la zone euro dispose en réalité d'une capacité globale de financement, reflet de sa capacité d'épargne. A l'inverse, le Royaume-Uni et, surtout, les Etats-Unis connaissent des besoins de financement qui persistent depuis de nombreuses années. On peut en déduire que la croissance dans l'Union européenne n'est pas freinée par un déficit d'épargne mais plutôt par un déficit de « projets », que la valeur de l'euro - qui d'ailleurs s'est appréciée depuis plusieurs années - n'est pas sous la menace d'une dépréciation résultant de l'accumulation de dettes et que la compétitivité de la zone euro n'encourt aucun danger du fait d'un risque d'écart d'inflation avec les économies situées hors de la zone.
Un large débat s'est alors ouvert.
M. Yves Fréville s'est déclaré en accord avec la tonalité et les conclusions du rapport. Selon lui, dans un contexte de haute conjoncture économique mondiale, la croissance française est proche de son potentiel, et la question est de savoir pourquoi elle s'établit à 2 % et non à 3 %. Il s'est aussi interrogé sur l'avenir de notre croissance et de nos finances publiques dans l'hypothèse d'un retournement de conjoncture. Au sujet du pouvoir d'achat, M. Yves Fréville a estimé que le problème était moins celui de l'évolution globale du revenu disponible que celui de sa redistribution et a, par ailleurs, jugé contestable de relancer l'économie par la consommation. Par ailleurs, l'investissement ne souffre pas du niveau des taux d'intérêts, mais bien de la demande anticipée. Quant au commerce extérieur français, il pâtit des insuffisances de la spécialisation de notre appareil de production, ce qui devrait inciter à conforter nos atouts. Enfin, une diminution des dépenses publiques n'est soutenable qu'à la condition que l'investissement privé prenne le relais. Le problème de l'orientation de l'investissement public se pose également. Puis, M. Yves Fréville a rappelé que la politique monétaire et la politique de change entraient immanquablement en conflit, dès lors qu'elles reposaient sur un instrument commun -les taux d'intérêt-, la question étant aujourd'hui de trouver d'autres instruments pour asseoir ces politiques.
M. Bernard Angels a estimé que le « scénario haut » de la programmation financière du projet de loi de finances pour 2008 n'était pas crédible. Il a estimé que soumettre aux mêmes exigences de stabilité des pays dont la structure des dépenses publiques est différente - ce qui apparaît clairement pour la politique sociale - est illogique. Par ailleurs, une politique de soutien au pouvoir d'achat ne peut se passer de favoriser aussi l'investissement ; ainsi, des politiques européennes plus orientées vers l'investissement et la croissance apparaissent nécessaires. Enfin, le budget pour 2008 ne s'inscrit pas dans le scénario requis puisque les dépenses non productives augmentent au travers de mesures fiscales qui ne sont pas toujours appropriées, ce qui engendrera immanquablement un sursaut de rigueur à moyen terme.
Abordant les dépenses publiques, M. Yves Fréville a souligné l'intérêt et la difficulté de réformer certaines bases de calcul, qu'il s'agisse, par exemple, de la dotation générale de fonctionnement (DGF), par trop inégalitaire, ou de la taxe professionnelle, dont le calcul est actuellement défavorable à l'investissement.
M. Joël Bourdin, rapporteur , ayant rappelé qu'une consommation dynamique, nécessaire pour la réalisation du scénario gouvernemental, impliquait une baisse du taux d'épargne, M. Yves Fréville a estimé qu'il importait de donner à l'épargne une orientation plus productive, signalant que les 1.500 milliards d'euros placés dans l'assurance-vie participaient indirectement au financement du déficit budgétaire.
M. Joël Bourdin, rapporteur , a indiqué que le déficit du commerce extérieur avait pu coûter jusqu'à 0,9 point de croissance à la France, ces dernières années. Outre-Rhin, les excédents commerciaux peuvent s'expliquer par le contenu en innovation de la production, les prix étant loin de déterminer le succès de l'Allemagne. Au total, l'investissement s'avère primordial et son renforcement suppose que les perspectives économiques se dégagent.
La délégation a alors donné un avis favorable unanime à la publication du rapport d'information sur les perspectives économiques et des finances publiques à l'horizon 2012, de M. Joël Bourdin, rapporteur.
ANNEXE : RAPPORT DE L'OFCE
|
Perspectives de l'économie française à l'horizon 2012 et
La défiscalisation des heures
supplémentaires :
|
Octobre 2007
Perspectives de l'économie française à l'horizon 2012 105 ( * )
1. Conception générale de l'exercice
Cette projection de l'économie française à l'horizon de six ans--de 2007 à 2012--a été réalisée par l'Observatoire Français des Conjonctures Economiques (OFCE) à l'aide de son modèle de simulation de l'économie française ( e-mod.fr ). Son approche est essentiellement macro-économique.
Le but de cet exercice est d'obtenir des indications quant aux scénarios possibles d'évolution des finances publiques. Si les simulations affichées pour les années 2007 et 2008 reprennent dans les grandes lignes les perspectives de prévision pour l'économie française élaborée par le gouvernement en octobre 2007, les quatre années suivantes représentent davantage une extrapolation dans le cadre de la politique économique définie dans le programme pluri-annuel du gouvernement. Il s'agit donc d'une illustration des questions, hypothèses et choix devant lesquels se trouvent aujourd'hui les responsables de la politique économique.
Afin de mettre à la disposition des membres du Sénat une telle « illustration », les évolutions macro-économiques suivent délibérément une vision tendancielle reposant sur des hypothèses généralement admises :
• Le scénario d'environnement international à moyen terme, qui sert de cadre à la projection de l'économie française a été élaboré à partir d'une hypothèse médiane suivant les estimations de croissance potentielle réalisée par l'OCDE ou par le FMI pour les zones hors OCDE pour les années 2009-2012.
• Le taux de change euro-dollar monte jusqu'à mi 2008 (1,50 dollar pour un euro) et se stabilise ensuite à 1,40 dollar pour un euro. De son côté, le cours du pétrole se stabiliserait à 67 dollars le baril en 2008.
• Les prix des partenaires commerciaux de la France évolueraient de façon à stabiliser la compétitivité française à partir de 2009. La demande extérieure adressée à la France demeurerait dynamique sur l'ensemble de la période.
• Les scénarios reposent sur l'hypothèse d'une contribution nulle des variations de stocks.
• En ce qui concerne la durée du travail, nous l'avons supposé inchangée à l'horizon de notre étude. Nous supposons que la défiscalisation des heures supplémentaires n'entraînera pas d'augmentation de la durée du travail mais une hausse du pouvoir d'achat des salariés qui faisaient déjà des heures supplémentaires. Nous avons toutefois mené une étude sur l'impact éventuel d'une augmentation de la durée du travail sur l'économie française 106 ( * ) .
• Comme l'OFCE l'a déjà exploré dans des travaux antérieurs, une croissance supérieure à la croissance potentielle suppose deux types de conditions. D'une part, une demande et une offre soutenues sont nécessaires tant du côté des ménages (au travers de leur revenu disponible brut) que des entreprises (au travers de leur investissement qui est une partie de la demande et qui permet d'augmenter les capacités de production afin de pouvoir satisfaire la demande). D'autre part, une évolution structurelle dans la formation de prix et des salaires est nécessaire. Le NAIRU doit se réduire afin de permettre une baisse du chômage observé sans que des tensions inflationnistes ne se déclenchent et compromettent le processus de croissance.
Deux scénarios pour l'économie française ont été envisagés à l'horizon 2012. Ils sont bâtis sur les hypothèses retenues dans la programmation pluriannuelle des finances publiques 107 ( * ) . Plus précisément, traditionnellement cette programmation s'appuie sur deux scénarios macroéconomiques : le premier repose sur une hypothèse de croissance « basse » de 2,5 %, le second sur une hypothèse « haute » de croissance à 3 %. :
I.1. Le compte central : scénario à 2,5 %
C'est sur la base du premier scénario que nous avons élaboré notre compte central. La croissance de l'économie serait supérieure à son potentiel de long terme (qui passe de 2,0 % à 1,9 % sur la période en raison d'une moindre croissance de la population active). La progression du PIB serait contrainte par une forte impulsion négative de la politique budgétaire (en moyenne -0,6 % du PIB par an). Cette hypothèse se fonde sur les projections gouvernementales de réduction du déficit public (qui passerait dans ce scénario de -2,3 % en 2008 à 0 % en 2012) afin de satisfaire aux engagements européens de la France. La politique budgétaire nécessite de ce fait un contrôle strict des dépenses publiques qui progresseraient de 1,1 % en moyenne annuelle au cours de la période 2009-2012 contre plus de 2,5 % observés au cours des 10 dernières années. Cette contraction suppose une baisse de l'emploi public et un blocage des salaires du secteur non marchand. Ce « compte central » repose donc sur une croissance sous-jacente (i.e. hors impulsion) de 3,0-3,1 % qui nécessite une baisse du taux d'épargne des ménages (de 15,1 % en 2008 à 12,7 % en 2012), une hausse du taux d'investissement des entreprises (18,9 % en 2008 à 20,0 % en 2012) et entraîne une baisse du taux de chômage (de 7,9 % en 2008 à 6,0 % en 2012).
I.2. Un scénario de croissance forte
Dans le second scénario, nous supposons que le supplément de croissance (0,5 point) s'accompagne d'un supplément de productivité du travail de même ampleur. Les salaires progressant au même rythme que la productivité, le supplément d'activité ne demande pas un effort beaucoup plus important aux agents privés. Le taux de chômage diminuerait de la même manière qu'au cours du scénario « bas » alors que les finances publiques reviendraient plus rapidement à l'équilibre et seraient même excédentaires en 2012 (1.3 %)
1- Evolution de la capacité de financement...
|
En % du PIB |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
87-97 |
97-07 |
07-12 |
|
...dans le scénario « bas » |
-2.5 |
-2.4 |
-2.3 |
-1.7 |
-1.2 |
-0.6 |
0.0 |
-3.7 |
-2.6 |
-1.4 |
|
...dans le scénario « haut » |
-2.5 |
-2.4 |
-2.3 |
-1.3 |
-0.3 |
0.5 |
1.3 |
-3.7 |
-2.6 |
-0.8 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
II. Principaux résultats pour les années 2007-2008
Par convention, la projection prolonge à l'horizon du moyen terme les prévisions à court terme (2007-2008) du gouvernement qui sont, à l'exception des hypothèses sur les finances publiques, très proches de celles que l'OFCE vient de présenter 108 ( * ) .
II.1. Le scénario international
Alors que la croissance mondiale en 2006 a atteint un sommet à 5,2%, l'année 2007 s'annonçait jusqu'au mois de juin comme excellente. La fin de la déflation au Japon, comme le renforcement du cycle d'investissement en Europe signifiaient que plus de pays allaient participer à l'expansion de l'après 2000 et que les records de croissance ne demandaient qu'à être battus. Ni l'instabilité géopolitique, ni le choc pétrolier et la hausse vertigineuse des matières premières, ni l'accumulation des déséquilibres ne paraissaient à même d'infléchir la trajectoire de l'économie.
1. Croissance par tête Etats-Unis et monde
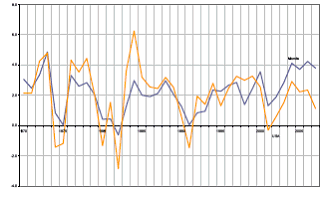
Source : FMI
Le ralentissement américain engagé en 2005 n'avait pas alors sonné le glas du régime d'expansion inégalé dans l'histoire du monde moderne. A l'heure de l'accès au développement d'une moitié de l'humanité, l'essoufflement d'un leader ne fait plus baisser la moyenne du peloton. Les zones émergentes - Asie, Amérique latine, pays de l'Europe de l'Est - ont continué à croître plus rapidement que les grandes économies industrielles de la planète, masquant l'effet du ralentissement américain sur la croissance mondiale. Et dans la vieille Europe, la zone euro a retrouvé en 2006 suffisamment de tonus pour égaler la performance des Etats-Unis. Le découplage de la croissance entre les Etats-Unis et le reste du monde s'est donc produit dès 2005 et il semblait alors possible que la croissance des pays en voie de développement suffise à porter la croissance mondiale.
Les enchaînements du mois d'août 2007 et la crise des subprimes changent aujourd'hui la vision de l'économie mondiale. A un modèle de l'économie inspiré de l'équilibre général où des marchés de plus en plus complets permettent de prendre en compte de façon de plus en plus optimale les contingences, la fragilité du château de cartes financier a substitué un autre modèle où les asymétries d'information sont la règle. Ce monde est à la fois plus complexe et plus dangereux. D'une série d'excès et de spéculations hasardeuses est parti un mouvement qui ressemble de plus en plus à une crise systémique.
2. Spreads sur obligations privées, économie mondiale
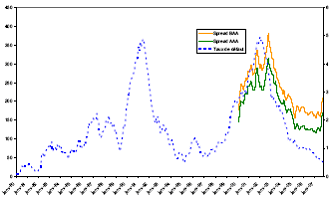
Source : Moody's
Partout les conditions de financement se sont durcies. Les banques des pays développés font face à des taux sur le marché interbancaire majorés et qui s'écartent depuis plusieurs semaines des taux directeurs des banques centrales, bien que ces dernières aient conduit des opérations massives d'injection de liquidités. Les spreads de taux pour le financement obligataire des entreprises privées, quelles que soient leurs notations ont augmenté brusquement de plus de 50 points de base (graphique 2). Cette hausse du taux du marché interbancaire ou des spreads s'apparente à un durcissement endogène des conditions monétaires. Il n'est qu'une facette du stress que subit le système financier. Les taux à court terme plus élevés sont d'autant plus difficiles à intégrer dans les comportements que ces mouvement ne sont ni anticipés, ni compris et que l'on n'est pas sûr que demain le resserrement sera encore plus fort. Et au-delà, la défiance envers tout agent qui souhaite se financer à court terme et les rumeurs incessantes sur les difficultés de telle institution bancaire ou de tel fond rendent le financement à court terme parfois impossible. A un prix plus élevé se surimpose un rationnement quantitatif qui peut compromettre la viabilité d'agents qui n'ont rien à voir avec les subprimes . La persistance de ce stress conduira à des défauts. Ces défauts amplifieront la défiance et les rumeurs, ils augmenteront les risques portés par les survivants. Le château de cartes peut alors s'écrouler et ceci d'autant plus vite que le village global est devenu petit et que les liens tissés sont étroits.
3. Indicateur de stress du marché interbancaire USA
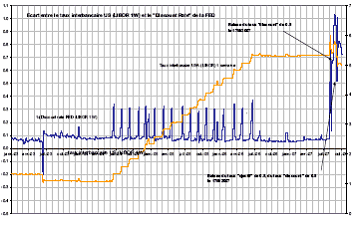
Source : Moody's
4. Indicateur de stress du marché interbancaire européen
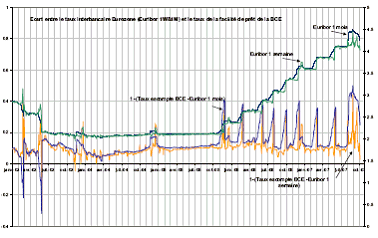
Source : Moody's
Qui sème le vent récolte la tempête
Le feu est parti là où on ne l'attendait pas, c'est-à-dire d'un segment du crédit immobilier aux Etats-Unis, les subprimes, dont l'enjeu n'était a priori pas planétaire, tout au plus national au regard des autres foyers de risque qui se sont accumulés depuis plusieurs années. Pourtant, la défaillance de quelques emprunteurs à risque aux Etats-Unis, incapables d'honorer les échéances de leur crédit immobilier, a fait l'effet d'une bombe sur les marchés financiers, rappelant que l'éparpillement du risque le rend anonyme et par conséquent non identifiable. Situation paralysante pour tous les acteurs, chacun se demandant si le terrain du voisin est ou non miné, mais aussi embarrassante pour les observateurs s'interrogeant sur la profondeur de la crise.
Le point de départ de cette crise a été largement analysé : des ménages en situation de spéculation, comptant sur la hausse à venir à deux chiffres des marchés immobiliers pour soit extraire des liquidités, soit renégocier un emprunt qui arrive dans sa phase de reset soit liquider une situation nette suffisamment positive pour justifier que l'on tente le coup. Ces ménages spéculateurs sont des ménages pauvres, attirés par la perspective d'une vie meilleure, séduits par un montage financier auquel ils ne comprenaient pas grand-chose mais dont tous, de leurs voisins à leur courtier, des médias aux pouvoirs publics, leur assuraient que le rêve allait devenir réalité (voir « La fin de l'American Dream », dans le dossier de prévision de la revue de l'OFCE d'avril 2007, n°101).
Derrière ces spéculateurs mal informés, d'autres, plus riches, engageaient les sommes correspondantes dans des fonds aux rendements extraordinaires et étaient les créanciers des premiers sans vraiment le savoir. Après une demi-décennie de croissance rapide des prix de l'immobilier, stimulée en partie par des taux d'intérêt bas, la fable semblait vraisemblable. D'un côté des ménages vivaient mieux, de l'autre des capitaux avaient une rentabilité exceptionnelle. Et plus les prix montaient, plus la fable se renforçait, plus les candidats à la loterie où l'on ne perd pas étaient nombreux. Plus d'argent affluait et les prix montaient encore. L'histoire a pris fin avec la remontée des taux d'intérêt, avec les premières difficultés face à des montages particulièrement audacieux, ou parce que l'audace de ces montages croissait à mesure que les possibilités des précédents avaient été épuisées. Et lorsqu'elle a pris fin, parce que les ménages concernés étaient en position spéculative, la chute a été terrible : ventes forcées, dans l'urgence, chute des prix entraînant d'autres ménages dans le maelstrom, assèchement des liquidités pour les fonds qui finançaient les subprimes, et donc hausse des primes ou fin des renégociations avantageuses. Beaucoup on eu à payer l'addition et son montant a été d'autant plus lourd qu'elle a été présentée à tous en même temps.
La baisse des taux d'intérêt comme la hausse des taux d'intérêt ont été des déclencheurs essentiels de ce mouvement. Mais c'est la mise en position de spéculateurs de nombreux individus, doublée d'une information très parcellaire sur les risques pris qui est la cause profonde de cette crise. Il est souhaitable que la politique monétaire ait un impact sur l'activité économique. Il est dommageable qu'elle se double de bulles spéculatives ; il est terrible que celles-ci soient le fait d'acteurs inconscients.
L'affaire des subprimes n'est pas terminée. On va sans doute découvrir d'autres ménages spéculateurs sans le savoir. Leur fortune passée va brusquement se muer en une infortune sans fond. D'autres investisseurs vont découvrir la nature exacte de leurs engagements et des risques qu'ils ont pris. Mais les pertes encaissées par les uns ou les autres ne devraient pas excéder un montant que l'économie mondiale doit pouvoir absorber sans grande difficulté. Les estimations les mieux « informées » 109 ( * ) tablent entre 100 et 200 milliards de dollars. Au-delà du désastre pour quelques individus, cela signifie un impact à peine notable sur l'économie américaine et très faible sur l'économie mondiale.
Or le mouvement de panique qui s'en suit est d'une tout autre ampleur. Si le stress financier provoqué par la défiance généralisée, le rationnement quantitatif du financement à court terme ou la hausse des taux de court terme persiste c'est en milliers de milliards de dollars que les conséquences se chiffreront. La forte imbrication de la finance à l'échelle mondiale, produit de la globalisation ainsi que des innovations financières est un formidable accélérateur de la croissance mais aussi des crises.
Incendie circonscrit mais pas encore maîtrisé
Les interventions rapides des banques centrales ont évité le pire, c'est-à-dire l'assèchement du marché interbancaire par l'injection massive de liquidités. La baisse des taux directeurs par la FED à la mi septembre illustre une fois de plus la réactivité des autorités monétaires américaines. L'intervention de la banque centrale américaine a rétabli les taux à court terme sur le marché interbancaire au niveau d'avant la crise (graphique 3). Cette intervention n'a pas suffit à rétablir la confiance et à éviter la crise systémique. Elle permet toutefois de réduire la pression sur le secteur bancaire qui peut à nouveau se financer à des conditions « normales ». La FED se substitue au marché interbancaire en fournissant des liquidités aux institutions financières qui n'en trouvent pas et ce à un prix qui n'est pas plus haut que ce que l'on pouvait anticiper avant l'été. Les autres marchés à court terme sont loin d'être retournés à un fonctionnement correct, mais une digue importante a été renforcée par cette intervention. La BCE a seulement interrompu son cycle de hausse des taux et prend un singulier risque à ne pas suivre la FED dans la baisse des taux directeurs. La pression sur les banques européennes est donc forte, bien que d'abondantes liquidités, à un taux proche de ses taux directeurs, soient injectées par la BCE. Cela suffira-t-il à empêcher la mise en difficulté d'établissements financiers de la zone euro au-delà de ce que doit coûter l'apurement de la crise des subprimes ?
La croissance malgré tout
Les conséquences de la crise de défiance seront réelles. Elles seront d'autant plus importantes que la confiance est rétablie tardivement et les politiques économiques et principalement les politiques monétaires jouent un rôle décisif dans une sortie honorable de cet épisode. Nous avons choisi d'être confiants dans la capacité des autorités mondiales à éteindre l'incendie et éviter le pire. Dès lors, la croissance prévaudra, quelle que soit la peur que l'on garde après un avertissement presque sans frais.
Les années 2007 et 2008 s'annoncent de la même veine que les précédentes quoiqu'en léger ralentissement, avec des croissances prévues de 4,9 et 4,5 % respectivement pour l'économie mondiale. La recomposition du paysage de la croissance fera toujours la part belle aux économies en développement qui dans leur ensemble croîtront de plus de 7 % chacune des deux années, Chine en tête avec des rythmes supérieurs à 10 %. En face, les vieilles économies industrielles font pâle figure, notamment les Etats-Unis, qui, très affectés par la crise immobilière, descendront sous les 2 % de croissance en 2007 et en 2008, en même temps que sous les performances de la zone euro à 2,6 et 2,5 % respectivement. Au total, la croissance mondiale resterait proche de 5 % en 2007 et reproduirait en 2008 le scénario d'un ralentissement comme celui de 2005, qui n'a pas eu finalement de conséquences fâcheuses.
Le ralentissement de l'économie américaine est inévitable
Aux Etats-Unis, la croissance est entrée dans une phase de repli conjoncturel depuis le printemps 2006. Depuis 2004, la hausse des taux d'intérêt sur fond d'endettement élevé des ménages a fait plonger le marché de l'immobilier. Les ventes de logements chutent dans le neuf et l'ancien et les prix baissent sensiblement dans certains Etats. L'investissement en logements a déjà diminué de 4,6 % en 2006 et l'ajustement devrait être nettement plus violent en 2007 avec un repli de 16,1 % selon nos prévisions. Les stocks de logements invendus continuent d'augmenter et les délais de ventes s'allongent. Dans ces conditions, les mises en chantier et permis de construire replongent depuis le printemps, et l'activité dans la construction pourrait connaître une chute encore plus marquée au troisième trimestre avant de se stabiliser.
Si jusqu'à cet été, l'économie américaine a fait montre d'une bonne résistance à la crise immobilière, les limites apparaissent actuellement de plus en plus ouvertement. Suite à la crise qui agite les marchés financiers depuis août, la Réserve Fédérale a amorcé une nouvelle phase de détente monétaire le 18 septembre dernier. Le taux objectif des Fed Funds a baissé de 50 points de base à 4,75 %. Ce soutien à l'économie devrait se poursuivre les prochains mois : les taux descendraient à 3,25 % au deuxième trimestre 2008. Ce faisant, la Fed prévient d'une correction excessive et d'un enchainement dépressif cumulatif qui conduirait l'ensemble de l'économie vers la récession, mais n'évite pas la propagation à l'ensemble des agents. Le surendettement des ménages demeure et les baisses de prix des logements dans de nombreux Etats ne permettent plus de faire jouer les refinancements pour rembourser.
Le ralentissement de la consommation des ménages devrait se poursuivre sous l'effet principalement des contraintes financières des ménages endettés, de la baisse des prix immobiliers et d'un accès beaucoup plus strict au crédit. La hausse du taux d'épargne depuis la mi 2006 en est l'illustration et cette tendance devrait s'accentuer dans les prochains trimestres. Sans entrer dans un scénario dépressif où la baisse des prix de l'immobilier continuerait et mettrait des millions de ménages en défaut, l'assainissement financier des ménages pèsera en 2008 sur la consommation, via la hausse du taux d'épargne. Après 3,1 % en 2006, la consommation privée ne progresserait que de 2,6 % en 2007 et 1,2 % en 2008. La demande intérieure serait également affectée par la baisse de l'investissement à partir de la fin 2007, alors qu'on observe déjà un fort ralentissement des commandes de biens de capital. Le commerce extérieur devrait fournir un soutien opportun à la croissance en 2008 (0,7 point de contribution). La baisse du dollar face aux autres monnaies devrait consolider les gains de parts de marchés des producteurs américains et stimuler les exportations, face à une demande adressée moindre qu'en 2007. Les importations devraient freiner sensiblement du fait de la situation conjoncturelle. La croissance devrait connaître un tassement plus marqué dans le courant du deuxième semestre 2007. Après 2,9 % en 2006, elle atteindrait 1,9 % en 2007 et 1,8 % en 2008.
L'économie mondiale se révèlerait particulièrement résistante
En l'absence de contagion de la crise à d'autres marchés immobiliers (Espagne, Royaume-Uni), l'économie européenne devrait bien résister au ralentissement américain car la dynamique de croissance enclenchée parait solide. Par ailleurs, la vigueur des économies émergentes (Chine, Inde et Russie en tête) permettra de maintenir la croissance mondiale à un rythme élevé : 4,9 % en 2007 et 4,5 % en 2008 après une année 2006 record (5,2 %). Les contributions à la croissance mondiale calculées en parité de pouvoir d'achat (poids 2005) sont édifiantes. En 2006 la Chine a contribué à elle seule à 1,5 point de croissance alors que les Etats-Unis et l'Union Européenne apportaient chacun 0,6 point. Ainsi en 2007, la contribution des pays industrialisés ralentirait à 1,2 point, tandis que les pays en développement contribueraient à hauteur de 3,7 points à la croissance mondiale.
Le dynamisme des économies asiatiques permettrait ainsi à l'économie mondiale de résister au ralentissement outre-atlantique. La Chine a enregistré en 2006 sa meilleure performance depuis la crise asiatique, avec 10,8 % de croissance annuelle, et semble bien partie pour battre un nouveau record de croissance en 2007, le glissement annuel du PIB s'établissant à 11,9 % au deuxième trimestre. L'économie chinoise donne des signes de surchauffe avec un emballement des marchés financiers et immobilier. Cependant l'excès d'offre lié aux surcapacités productives accumulées protège la Chine d'une dérive inflationniste majeure. Portée par la perspective des jeux olympiques de Pékin en 2008, la croissance chinoise atteindrait 11,3 % en 2007 et 10,6 % en 2008. Le ralentissement de l'économie américaine devrait inciter le gouvernement chinois à accélérer les réformes afin de soutenir la demande intérieure.
L'Inde n'est pas en reste avec une croissance de 9,4 % en 2006 malgré de mauvaises performances dans le secteur agricole, qui compte pour 18,5 % du PIB et plus de la moitié de la population active. En Corée du Sud, le PIB a connu en 2006 son plus fort taux de croissance depuis quatre ans (5 %) grâce au dynamisme de la consommation des ménages. C'est la demande intérieure qui devait continuer à tirer la croissance en 2007 et 2008, avec une accélération de l'investissement et une contribution modérée du commerce extérieur. Dans le reste de la zone Asie, les moteurs traditionnels que sont les exportations et l'investissement ont été très dynamiques en 2006. Si la zone devrait souffrir du ralentissement de l'économie américaine, les marges de manoeuvres dégagées par la modération de l'inflation pour la politique monétaire, et par la baisse des déficits publics pour la politique budgétaire, donneraient des moyens suffisants aux gouvernements pour éviter un refroidissement brutal de l'économie.
Au-delà de l'Asie, c'est l'ensemble des pays en développement qui a connu en 2006 des rythmes de croissance record (5,8 % en excluant l'Asie). Depuis quatre ans, l'Amérique latine a su tirer parti d'un environnement international réel et financier très favorable pour remettre sa croissance en marche, consolider sa base productive et surtout réduire ses déséquilibres internes et externes. Fortement exportatrice de matières premières alimentaires et industrielles, elle a profité de la hausse des cours mondiaux pour améliorer ses termes de l'échange tandis que la vigueur de la demande mondiale, notamment en provenance d'Asie, lui a permis d'engranger des excédents commerciaux sans précédent (plus de 50 milliards de $ en 2006 sur la région) et stimuler une croissance déjà solidement ancrée sur ses composantes internes. La crise financière de cet été a également frappé les marchés émergents d'Amérique latine. Les Bourses locales ont chuté entre 10 et 20 % en juillet-août avant de rebondir en septembre. Les spreads sur les titres de dette souveraine restent à des niveaux historiquement bas malgré la hausse qui a commencé début 2007. L'amélioration des fondamentaux et la moindre vulnérabilité aux chocs externes devraient protéger les pays d'Amérique latine d'un retrait des capitaux au profit de placement plus sûrs. L'économie mexicaine serait la plus touchée par le retournement conjoncturel aux Etats-Unis, avec une croissance de 2,7 % en 2007 et 2,5 % en 2008 après 4,8 % en 2006. Dans l'ensemble, la croissance en Amérique latine ralentirait (4,4 % en 2007 et 3,7 % en 2008) après avoir atteint un haut de cycle en 2006 (5 %).
Une dynamique similaire s'est enclenchée en Russie où les revenus pétroliers ont permis l'amélioration de l'excédent commercial et la réduction de la dette publique passée de 90 % à moins de 10 % du PIB en l'espace de sept ans. Cet afflux de devises accompagné d'une envolée du crédit a dopé la demande intérieure : la consommation et l'investissement ont bondi respectivement de 11,2 % et 13,9 %, entraînant une hausse de 30 % des importations. Cependant, la surchauffe guette la Russie qui subit une accélération de l'inflation depuis la fin 2006. La croissance devrait atteindre un pic à 6,8 % en 2007, après 6,7 % en 2006, et ralentir légèrement en 2008 autour de 6,2 %. L'économie est très dynamique dans la plupart des nouveaux pays membres de l'Union Européenne, tirée par des flux de capitaux exceptionnels, une expansion du crédit, la baisse du chômage et la progression rapide des salaires. Mais l'inflation accélère depuis le début de l'année, et devrait atteindre 8 % en Hongrie en 2007. Pour y faire face les banques centrales polonaise et tchèque ont déjà procédé à des hausses de taux d'intérêt, et devraient poursuivre le resserrement monétaire au cours des prochains trimestres. La croissance ralentirait donc en 2008 à 5,4 %, contre 6 % en 2007 et 6,5 % en 2006, mais resterait dynamique, portée par une demande intérieure toujours en forte expansion et par la bonne santé de l'économie allemande.
Au Japon, le cycle de reprise qui avait débuté en 2002 a pris fin au deuxième trimestre 2007. Le PIB japonais a reculé de 0.4 % en rythme trimestriel, plombé par un fort recul de l'investissement. En même temps, la consommation privée marque le pas, tandis que les exportations ralentissent sous l'effet d'une baisse de la demande en provenance des Etats-Unis. L'environnement international est devenu incertain, et le Japon traverse de surcroît une crise politique majeure qui s'est soldée le 12 septembre par la démission du Premier ministre Shinzo Abe. Les prix baissent à nouveau depuis février 2007 avec la fin de l'effet de base lié à la hausse des prix du pétrole. L'inflation sous-jacente (hors alimentaire et énergie) qui connaît une inflation négative depuis fin 1998 s'établit à -0,2 % en août. Les perspectives de croissance ont été revues à la baisse depuis la dernière prévision et l'on anticipe désormais une croissance de 1,9 % en 2007 et 2008, après 2,2 % en 2006. Le Japon devrait cependant sortir de la déflation courant 2008, le dynamisme du marché du travail permettant de mettre un terme à la spirale désinflationniste.
Singularité européenne
Depuis les turbulences du début de la décennie, la situation conjoncturelle de la zone euro est marquée par la singularité. Singularité de la politique monétaire, bien moins réactive en Europe qu'aux Etats-Unis, singularité de la politique budgétaire, corsetée ici, volontariste là-bas, singularité de la position européenne vis-à-vis de la dépréciation du dollar quand dans le même temps la Chine a ancré sa monnaie sur la devise américaine, singularité finalement des performances de croissance, la zone euro n'ayant que peu profité d'un environnement international pourtant très porteur.
Cette singularité marquera encore les années 2007 et 2008, mais gardera un tour plus favorable, comme en 2006. Pas du fait d'un relâchement de la discipline monétaire ou budgétaire en Europe, ni d'une prise en charge de la question du taux de change de l'euro, mais d'une croissance interne plus forte de ce côté-ci de l'Atlantique.
Les ferments de la reprise de l'activité en 2006 en Europe, mettant en jeu les facteurs internes de la croissance, resteront à l'oeuvre dans la seconde moitié de 2007 et en 2008 : l'investissement des entreprises resterait dynamique, même si le pic de croissance a été atteint en 2006, et la consommation des ménages profitera toujours du dynamisme du revenu, porté par la hausse des salaires individuels et par les créations d'emplois. Les ménages seront aussi les principaux bénéficiaires de la politique budgétaire, qui prendra un caractère expansionniste pour la première fois depuis 2003.
La poursuite de l'appréciation de l'euro jusqu'à 1,50 dollar à l'horizon 2008 privera toutefois l'Europe de près d'un demi point de croissance, quand dans le même temps le ralentissement américain pèsera sur les débouchés des exportateurs européens. Au total, le PIB de la zone euro ralentirait légèrement par rapport aux 2,9 % de 2006, à 2,6 % en 2007 et à 2,5 % en 2008. C'est dire que la meilleure performance de l'Europe sur les Etats-Unis proviendra davantage de la médiocrité des seconds que de l'excellence de la première.
5. Indicateurs de rigueur monétaire et budgétaire
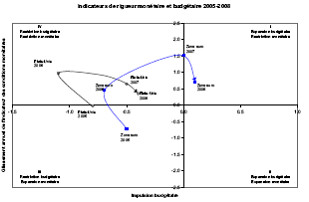
Source : Calculs OFCE
Le soutien des politiques économiques en jeu
Dans ce contexte qui comporte un certain nombre de risques pour l'économie mondiale, le soutien des politiques monétaires et budgétaires pourrait se révéler essentiel. La Réserve Fédérale, toujours prompte à réagir, a déjà enclenché un cycle de baisse des taux d'intérêt qui va permettre de détendre les conditions de crédit. Les taux directeurs perdraient plus de 2 points entre août 2007 et la fin 2008. Accompagnées d'un recul du dollar, les conditions monétaires aux Etats-Unis s'amélioreraient donc à l'horizon 2008. Du point de vue des finances publiques, après deux ans d'effort budgétaire important, le Trésor américain serait en mesure de relâcher temporairement la contrainte. Ainsi, l'impulsion cumulée pour 2007-08 serait de -0.9 point de PIB (tableau 2), en recul d'un point par rapport à 2005-06 (-1.9 point de PIB).
2. Positions budgétaires aux états-Unis, en Europe et au Japon
A. CROISSANCE DU PIBII. EN % |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
MOYENNE
|
A. ZONE EURO |
1,6 |
2,9 |
2,6 |
2,5 |
2,4 |
B. ETATS-UNIS |
3,1 |
2,9 |
1,9 |
1,8 |
2,4 |
C. ROYAUME-UNI |
1,8 |
2,8 |
3,0 |
2,0 |
2,4 |
D. JAPON |
1,9 |
2,2 |
1,9 |
1,9 |
2,0 |
E. SOLDE PUBLIC
|
|||||
G. ZONE EURO |
-2,4 |
-1,6 |
-1,0 |
-0,9 |
-1,5 |
H. ETATS-UNIS |
-3,6 |
-2,6 |
-3,2 |
-3,6 |
-3,3 |
I. ROYAUME-UNI |
-3,2 |
-2,6 |
-2,3 |
-2,2 |
-2,6 |
J. JAPON |
-6,4 |
-2,4 |
-2,5 |
-2,6 |
-3,5 |
K. IMPULSION BUDGÉTAIRE*
|
|||||
M. ZONE EURO |
-0,5 |
-0,7 |
0,0 |
0,1 |
-0,3 |
N. ETATS-UNIS |
-0,8 |
-1,1 |
-0,5 |
-0,4 |
-0,7 |
O. ROYAUME-UNI |
-0,5 |
-0,8 |
-0,3 |
-0,4 |
-0,5 |
P. JAPON |
-1,1 |
-1,2 |
-1,2 |
-0,3 |
-1,0 |
* Opposée de la variation du solde structurel primaire. Un chiffre positif indique une politique budgétaire expansionniste.
Sources : Comptes nationaux, Eurostat, calculs et prévision OFCE octobre 2007.
En zone euro, le relâchement de la contrainte budgétaire redonnerait un peu d'air à l'économie. Après plusieurs années de restrictions budgétaires imposées par le Pacte de stabilité, tous les pays à l'exception du Portugal devraient afficher en 2007 un déficit inférieur à 3 % du PIB (tableau 2). Le déficit cumulé de la zone s'est amélioré de 1,4 point de PIB entre 2005 et l'estimation prévue pour 2007, passant de -2,4 % à -1 % du PIB de la zone. L'impulsion serait neutre en 2007 et 2008, avec des marges de manoeuvre pour une relance budgétaire si le besoin s'en faisait sentir.
Car il ne faudra pas trop compter sur la BCE pour détendre sa politique monétaire en 2007. Avec l'effet de base lié aux prix du pétrole, l'inflation pourrait repasser au dessus de la barre des 2 % au quatrième trimestre 2007 et au premier de 2008. Si la crise financière ne s'avère que passagère, la BCE maintiendrait le statu quo jusqu'au printemps 2008, attendant une fenêtre de tir pour relever ses taux de 25 points de base. Elle pourrait ensuite les baisser au deuxième semestre 2008, motivée par l'envolée de l'euro et une modération de l'inflation. L'économie européenne pâtirait de la hausse de l'euro face au dollar et aux monnaies asiatiques. Les conditions monétaires se détérioreraient en 2007 avant de se détendre un peu en 2008 grâce à deux baisses des taux d'intérêt.
La réduction des tensions inflationnistes dans les pays développés a permis de mettre un terme au resserrement des politiques monétaires. Dans une économie mondiale toujours abreuvée d'épargne, les taux d'intérêt longs restent bas, et pourraient même diminuer encore si l'inflation reste sous contrôle. Cependant l'inflation accélère dans un certain nombre de pays émergents en forte croissance. C'est le cas pour la Chine et l'Inde, l'Afrique du Sud, la Hongrie et les pays Baltes en Europe de l'Est, ou encore l'Uruguay et le Venezuela en Amérique du Sud pour ne citer que les principaux. Ces pays connaissent en conséquence un resserrement monétaire, mais l'impact sur l'économie réelle est amoindri par la possibilité qu'ont les agents de se financer ailleurs. Dans un monde en excès d'épargne avec une quasi-parfaite mobilité des capitaux (la Chine étant l'exception qui confirme la règle), la tentation est grande d'aller chercher les fonds dans les pays qui proposent des taux d'intérêt défiant toute concurrence (Japon, Suisse en particulier). Le seul inconvénient de cette stratégie est que l'emprunteur encourt alors un risque de change. Tant que la monnaie du pays « débiteur » s'apprécie, il gagne sur les deux tableaux puisque le montant à rembourser s'amenuise avec le temps. Cependant, cela accroit la vulnérabilité aux variations du taux de change pour les pays émergents. Comme l'a illustré la crise asiatique, une attaque spéculative sur la monnaie peut rapidement avoir des conséquences désastreuses sur la sphère réelle lorsqu'elle entraîne la faillite des débiteurs qui ne sont plus capables de faire face à leurs échéances. Ainsi un pays fortement endetté en monnaie étrangère doit-il faire preuve d'une vigilance accrue quant à la gestion de son taux de change. Il sera tenté de limiter l'appréciation rapide de sa monnaie afin d'éviter un retournement brutal des anticipations.
Par ailleurs, les tensions inflationnistes présentes dans les pays émergents ont peu vocation à se propager au reste du monde. En effet, l'insuffisance de l'offre face à la demande concerne principalement le marché intérieur. Les marchés d'exportations sont soumis à une telle concurrence qu'une accélération des prix serait rapidement étouffée dans l'oeuf.
Et si le dollar dérapait ?
L'équilibre de la croissance mondiale repose sur une abondance de liquidités qui permet de financer à bas coût le déficit courant américain. Echaudés par les crises financières de la fin des années 1990, les pays en développement sont contraints de maintenir une épargne élevée afin d'accumuler des réserves de change qui leur permettent de préserver la stabilité de leurs taux de change et de se prémunir contre d'éventuelles attaques spéculatives. L'épargne dégagée par les pays asiatiques et les pays producteurs de pétrole finance la croissance américaine et explique le bas niveau des taux longs. Elle a permis aux Etats-Unis de financer leur déficit en évitant une dépréciation significative du dollar.
Mais le retournement de l'économie américaine pourrait bien sonner le glas de cet équilibre périlleux. Une croissance plus faible aux Etats-Unis pourrait détériorer la soutenabilité du déficit courant américain, qui atteignait 5,9 % du PIB au deuxième trimestre 2007. La dépréciation en cours du dollar pourrait entraîner un retournement des anticipations des intervenants sur le marché des changes, et enclencher des mécanismes en chaîne conduisant à une glissade incontrôlée de la monnaie américaine. En particulier, les investisseurs détenant des positions ouvertes en yen sous forme de carry trade pourraient couper leurs positions afin de se prémunir contre les pertes liées à la dépréciation de la monnaie dans laquelle ils ont investi. Cette fuite soudaine et massive de capitaux précipiterait la chute du dollar. Cette chute pourrait être accentuée par une diversification des réserves de change des pays asiatiques, qui ne verraient plus dans le dollar une monnaie de réserve suffisamment solide.
Un tel décrochage du billet vert aurait des conséquences très dommageables pour l'économie mondiale. Pour les Etats-Unis, elles se limiteraient à un risque d'inflation importée qui pourrait se traduire par des hausses de taux. Mais pour le reste du monde et l'Europe en particulier, l'appréciation de l'euro accentuerait les pertes de parts de marché à l'exportation. Privée d'un moteur de croissance externe, la reprise en cours en Europe pourrait bien tourner court. D'autant que le vieux contient serait également affecté par la hausse des taux longs, dont les évolutions sont très corrélées aux taux américains. Les marchés immobiliers espagnol et français pourraient se retourner, les marchés boursiers corrigeraient privés du soutien des LBO et de la dégradation des perspectives de profit. La recrudescence des faillites de ménages ou d'entreprises surendettés engendrerait la hausse des primes de risque et l'on pourrait assister à un credit crunch. Il faudrait alors beaucoup plus qu'un simple retournement de tendance sur le marché des changes pour rétablir la situation.
Mais si les conséquences sur la croissance de ce scénario « catastrophe » seraient négatives, il permettrait au moins la résorption d'une partie des déséquilibres mondiaux. Les marchés immobiliers retrouveraient des niveaux de valorisation plus conformes au pouvoir d'achat des ménages, le déficit courant américain se résorberait sous la double influence d'une moindre croissance aux Etats-Unis et d'une compétitivité-prix accrue des exportations américaines et les excédents commerciaux des pays asiatiques diminueraient, incitant ceux-ci à privilégier une croissance davantage tirée par la demande interne.
Et si la crise immobilière annonçait une récession ?
Au vu de la conjonction des reculs de l'investissement en logement et des récessions survenues aux Etats-Unis depuis la deuxième guerre mondiale, l'éventualité d'un scénario plus noir que celui d'un ralentissement aux Etats-Unis n'est pas à exclure. Selon la source officielle du National Bureau of Economic Research, organisme chargé de la datation des cycles aux Etats-Unis, l'économie américaine a enregistré 10 récessions (graphique 6) depuis 1945. Au cours de la même période, l'investissement en logement a reculé significativement 11 fois. Au total, sur les 11 corrections de l'immobilier recensées, 9 ont précédé une récession.
Subsistent toutefois quelques exceptions qui ne font pas de l'immobilier un précurseur sans faille des récessions : les chutes de l'investissement en logements en 1965 et en 1994 n'ont pas fait plonger l'activité, et la récession de 2001 ne s'est pas accompagnée d'un recul significatif de l'immobilier. Au vu de l'expérience passée, il n'en demeure pas moins que la crise actuelle a significativement accru la probabilité d'une récession qui ne traduirait finalement que le jeu du cycle de l'endettement.
6- FBCF en logements et récessions* aux Etats-Unis
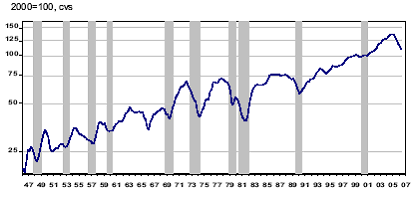
* : bandes grisées verticales
Source : BEA.
La vigueur de l'expansion dans les pays émergents depuis quelques années a laissé supposer que l'économie américaine n'est plus la source principale de croissance dans le monde. La relative insensibilité de l'économie mondiale aux soubresauts de l'économie américaine sous-tend le scénario de croissance décrit ici. Il suppose que les pôles soient suffisamment autonomes et que la contraction du débouché américain n'affecte que modérément les différentes zones, c'est-à-dire que le commerce intra zone reste dynamique ou que leur croissance repose davantage sur la demande intérieure que sur la demande extérieure. C'est le cas de l'Amérique latine et des pays de l'Est, en particulier de la Russie qui affiche un boom de sa demande intérieure, stimulée par le haut niveau du prix des matières premières. Que les marchés des produits de base viennent à se retourner, sous l'impulsion de la moindre croissance américaine, et le ralentissement des pays de l'Est ou de l'Amérique Latine accompagnera probablement celui des Etats-Unis.
La Chine, dont le degré d'exposition à un retournement de conjoncture s'est sensiblement accru depuis dix ans du fait de la montée de son degré ouverture, est susceptible de pâtir du ralentissement américain. Mais la croissance chinoise, qui dépend aussi du dynamisme de l'activité dans la zone euro et sur le continent asiatique ainsi que des efforts du gouvernement pour rééquilibrer la croissance dans un sens plus favorable à la demande intérieure, pourra passer au travers de la faiblesse américaine. Une croissance moindre qu'escomptée chez les partenaires commerciaux des chinois hors Asie, ou l'absence de politique de rééquilibrage, pèserait sur le dynamisme de l'économie chinoise, et, compte tenu des interdépendances des économies, sur celui de l'ensemble de la zone Asie. Dans ce contexte, le Japon, mais aussi l'Amérique latine qui réalise une bonne part de ses excédents commerciaux avec l'Asie, subiraient à la fois les conséquences du ralentissement américain et de celui de la Chine.
Le schéma de croissance dans la zone euro pour 2007 et 2008 repose sur le dynamisme de la demande intérieure, entretenu par l'investissement, les hausses de salaires, et l'orientation expansionniste de la politique budgétaire, notamment en France. Mais à supposer que les forces internes de croissance viennent à faiblir, la zone euro souffrirait doublement de la contraction des débouchés extérieurs aux Etats-Unis et de la chute du dollar.
II.2. En France
Au cours de l'été, les mauvaises nouvelles sur le front économique se sont succédées : crise financière internationale initiée par l'éclatement de la bulle immobilière aux Etats-Unis, chiffres de croissance du deuxième trimestre décevants pour la zone euro, hausse du prix du brent avoisinant 80 dollars le baril, nouveau recul du dollar par rapport à l'euro. Nous pensons, cependant, que ces événements ne sont pas suffisants pour casser l'élan de croissance amorcé en 2006 en zone euro et par conséquent hypothéquer les perspectives de reprise en France à l'horizon 2008.
Tout d'abord, l'onde de choc de la crise financière ne semble pas en mesure de menacer la prospérité mondiale et restera principalement cantonnée à l'économie américaine : le ralentissement économique, consécutif à la crise du secteur des prêts immobiliers à risque ( subprimes ), devrait y être plus brutal qu'escompté au printemps dernier, mais pas aussi fort qu'en 2001 après l'éclatement de la bulle internet. Ce ralentissement de l'économie américaine rognera quelque peu la croissance mondiale mais n'interrompra pas son dynamisme, en particulier dans les zones avec lesquelles les pays de la zone euro ont plus d'échanges commerciaux (en premier lieu les pays d'Europe centrale et orientale). La demande adressée aux économies de la zone euro accélèrera, permettant enfin, une période de croissance plus durable dans la zone euro qu'auparavant.
Car depuis le ralentissement majeur de l'économie mondiale en dernières années, la zone euro, et plus particulièrement les grands pays - Allemagne, France, Italie - sont restés englués dans une phase de croissance médiocre. L'ajustement nécessaire des bilans et des appareils de production après l'euphorie de la fin des années 1990 a été d'autant plus laborieux qu'aucun instrument de politique économique n'a été mobilisé pour maintenir la croissance à flot. L'appréciation de l'euro, inévitable sans politique de change, des politiques non coordonnées voire non coopératives et une politique budgétaire corsetée n'ont évidemment rien arrangé au marasme de l'après bulle internet.
Cette phase est, semble-t-il, derrière nous. En 2006, quelques économies de la zone euro ont joué le rôle d'avant-garde (Allemagne, Espagne, Pays-Bas notamment). Le renforcement de l'investissement a constitué la rampe de lancement de la croissance européenne, renforcée par une consommation et des marchés immobiliers soutenus par des taux d'intérêt à long terme qui sont restés bas. Les autres économies de la zone euro, et en particulier la France, vont maintenant prendre la relève, tant l'Europe est aujourd'hui intégrée. Et c'est avec un décalage de quelques trimestres, largement expliqué par un ajustement budgétaire réalisé davantage en 2005 et 2006 qu'en 2004, que la France suivra le mouvement.
Une croissance française inférieure à celle de la zone euro depuis 2005
Dans la période récente (2005-2006), la croissance française se caractérise par des performances inférieures, pour la première fois depuis la mise en place de la monnaie unique, à celles enregistrées dans le reste de la zone euro (graphique 7).
7. Évolution du PIB en France et chez ses partenaires de la zone euro
En %, moyenne annuelle glissante En point de PIB, moyenne annuelle
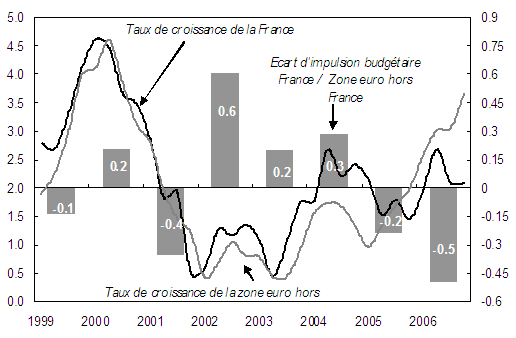
Sources : INSEE, comptes trimestriels, OFCE , e-mod.fr de 2007 à 2008.
Ainsi, au cours de la période 1997-2002, l'économie française, stimulée par un marché du travail dynamique et une baisse du taux d'épargne des ménages, a enregistré un surplus annuel de croissance de 0,3 point par rapport au reste de la zone euro et de plus d'un point par rapport à ses deux principaux partenaires, l'Allemagne et l'Italie.
Suite à l'éclatement de la bulle Internet, la reprise des années 2002-2004, confirme ce schéma : certes molle en France (1,5 % en moyenne annuelle), celle-ci est toujours supérieure à celle observée dans le reste de la zone (1,1 %). Ce supplément de croissance s'explique en grande partie par une politique budgétaire plus expansionniste dans l'hexagone qu'en moyenne dans les autres pays de la zone.
Depuis 2005, cette logique s'est inversée. Les politiques budgétaires sont, en moyenne, devenues moins restrictives en zone euro qu'en France, freinant alors les performances relatives de cette dernière : la reprise engagée dès 2005 dans la plupart des économies de la zone (2,3 %) a été retardée et d'une ampleur moindre pour l'économie française (2,0 %), permettant à la zone euro de combler son retard de croissance accumulé depuis 2002 avec l'hexagone (graphique 8).
8. Niveau du PIB en indice en France et chez ses partenaires
de la zone euro
1999=100
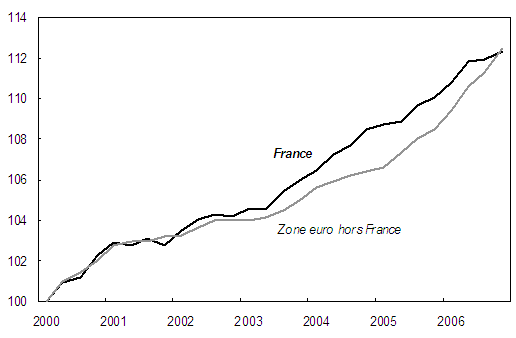
Sources : INSEE, comptes trimestriels, OFCE , e-mod.fr de 2007 à 2008.
2007 en demi-teinte
L'activité économique décrite par les comptes trimestriels de l'INSEE pour le premier semestre 2007 - particulièrement le deuxième trimestre 2007 (0,3 %) - est décevante et bien plus faible que suggérée par les enquêtes de conjoncture auprès des entreprises et des ménages. On s'attendait cependant à ce que l'activité au cours du premier semestre soit bridée par deux événements ponctuels. D'une part, par les effets restrictifs des cinq hausses successives du taux directeur de la Banque Centrale Européenne (BCE) au cours de l'année 2006, qui, compte tenu des délais de transmission de la politique monétaire à l'activité, se sont faits sentir en ce début d'année. D'autre part, par la mise en place depuis le 1 er janvier de la TVA sociale en Allemagne qui renforce la politique de désinflation compétitive menée outre-Rhin depuis le début des années 2000. Si le ralentissement est apparemment plus fort que prévu, il ne nous apparaît toutefois pas si inquiétant : rappelons d'abord que celui-ci se base sur une estimation provisoire de l'activité qui peut être significativement révisée dans les versions ultérieures des comptes trimestriels. L'analyse des révisions passées nous indique qu'en période de reprise, les comptes préliminaires ont tendance à sous estimer l'activité. Par ailleurs, signalons que depuis le premier trimestre 2007, les volumes des comptes trimestriels sont présentés aux prix de l'année précédente chaînés et non plus à prix constants de l'année 2000. Ce changement méthodologique a induit une révision à la baisse de 0,1 point de la croissance au premier trimestre, expliquant une partie de la révision de la croissance escomptée pour l'année 2007. Ensuite, le ralentissement de la croissance de l'investissement productif observé au cours du deuxième trimestre résulte essentiellement d'une dégradation temporaire de la rentabilité des entreprises au cours du second semestre 2006. Ces dernières ont dû effectuer des versements importants d'acompte au titre de l'Impôt sur les Sociétés (IS) après les bénéfices records enregistrés l'an dernier. Mais ce phénomène n'est que transitoire. La situation financière des entreprises est en réalité en nette amélioration, avec une profitabilité du capital très élevée, et de bonnes conditions de financement. Dans ces conditions, le cycle d'investissement nécessaire à une reprise durable n'est pas remis en cause : l'investissement productif des sociétés non financières devrait croître à un rythme de 4,7 % en 2007, rythme toutefois largement inférieur à ceux observés au cours des dernières périodes de reprise (8,6 % en moyenne au cours de la période 1998-2000). Enfin, le redressement des enquêtes de conjoncture amorcé en 2006 s'est confirmé au premier semestre 2007, laissant envisager un rebond prochain de l'activité (graphique 9).
9. Indicateurs synthétiques du climat des affaires
100 = moyenne de longue période
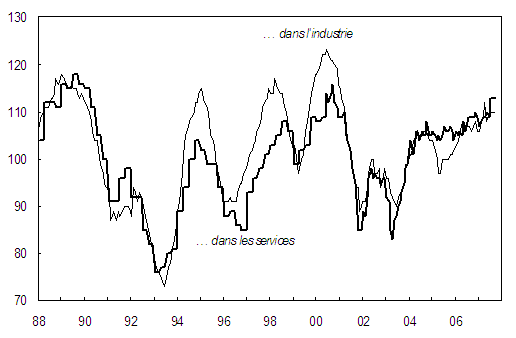
Source : INSEE.
L'indicateur avancé de l'OFCE, qui exploite l'information contenue dans ces enquêtes, confirme ce schéma : l'économie française devrait connaître un rebond au cours du second semestre, avec des hausses du PIB de 0,7 % aux troisième et quatrième trimestres, assurant une croissance de 1,9 % en moyenne en 2007 110 ( * ) .
2008 : relâchement des contraintes extérieures
L'année 2008 s'annonce plutôt bien : les contraintes qui bridaient la croissance ces dernières années se desserrent, notamment celles liées aux effets de la politique de désinflation compétitive menée en Allemagne et à la forte augmentation du prix du pétrole. L'inflation est maîtrisée, les grandes économies de la zone euro se portent mieux, le taux d'épargne des ménages, élevé, laisse des marges de progression pour la consommation, d'autant que le pouvoir d'achat des ménages devrait être soutenu par la baisse du chômage et l'entrée en vigueur du « paquet fiscal ».
Ce dynamisme de la demande intérieure est facilité par l'atténuation des contraintes qui avaient pesé fortement sur l'économie française depuis 2004. Certes, l'euro devrait continuer de s'apprécier atteignant un niveau historique au deuxième trimestre 2008 (1 € = 1,5 $) et s'établir à 1,44 dollar en moyenne sur l'ensemble de l'année 2008, soit une augmentation de 6 % par rapport à 2007. Compte tenu des délais de transmission d'une appréciation de la monnaie sur l'activité, l'impact de cette nouvelle forte hausse en 2008 se fera sentir essentiellement en 2009 mais rognera tout de même la croissance française de près d'½ point l'année prochaine contre -0,2 point en 2007 et -0,1 point en 2006. Mais, dans le même temps, cette appréciation de l'euro permettra de limiter l'impact négatif sur l'activité de la hausse du prix du brent (-0.2 point en 2008 contre -0,4 point en 2007 et -0,6 point en 2006). Ainsi, libellé en euros, le prix du pétrole devrait baisser de près de 6 % en 2008. Par ailleurs, la fin de la politique de désinflation compétitive menée outre-Rhin se traduira par une hausse des salaires réels en Allemagne de 1,5 % en 2008 (contre -0,5 % en moyenne entre 2002 et 2006). Cela soutiendra nos exportations et limitera nos pertes de parts de marché.
Au total, après avoir amputé la croissance
d'1 point en 2007, et de 0,9 point en 2006 et 1,1 point en 2005,
l'impact cumulé de l'ensemble des contraintes
- extérieures
et de politique budgétaire - rognerait la croissance de 2008 de moins de
0,7 point (graphique 10).
10. Impacts sur l'économie française de chocs...
En moyenne annuelle, %
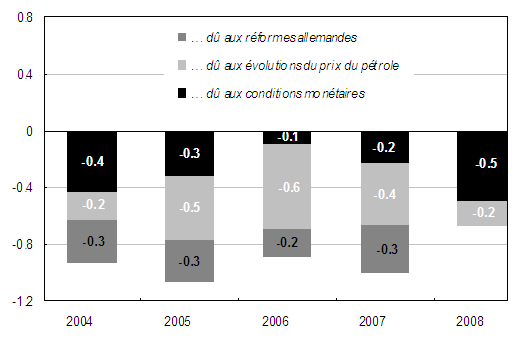
Note : L'impact du prix du pétrole et du taux de change sur l'activité est un impact cumulé. Il dépend des variations aux instants t, t-1 et t-2.
Sources : INSEE, comptes trimestriels, OFCE , e-mod.fr de 2007 à 2008.
III. Présentation des résultats macro-économiques à moyen terme (2009-2012)
III.1. Le scénario central
L'évolution du PIB et de ses principales composantes est décrite dans le tableau 3 ci-dessous :
3 - Evolution du PIB et de ses principales composantes 2006-2012
|
En % |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
87-97 |
97-07 |
07-12 |
|
PIB en volume |
2.2 |
1.9 |
2.25 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
1.9 |
2.2 |
2.5 |
|
Importations |
7.9 |
5.0 |
5.0 |
5.9 |
5.5 |
5.5 |
5.4 |
4.5 |
6.0 |
5.5 |
|
Consommation des ménages |
2.8 |
2.6 |
2.8 |
2.9 |
3.0 |
2.9 |
2.7 |
1.3 |
2.8 |
2.9 |
|
FBCF des SNF-EI |
4.7 |
4.3 |
4.0 |
5.0 |
4.5 |
4.9 |
4.6 |
1.5 |
4.2 |
4.6 |
|
Exportations |
6.6 |
3.5 |
4.9 |
6.2 |
6.0 |
5.8 |
5.8 |
6.5 |
4.3 |
5.7 |
|
Contributions |
||||||||||
|
Demande intérieure hors stocks |
2.4 |
2.3 |
2.4 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
1.6 |
3.0 |
2.5 |
|
Solde extérieur |
-0.5 |
-0.3 |
-0.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.4 |
-0.5 |
0.0 |
|
Variations de stocks |
-0.3 |
-0.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-0.1 |
-0.3 |
0.0 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
A moyen terme (2009-2012) et compte tenu des contraintes portant sur les finances publiques, il est supposé que la croissance se stabilise à un niveau supérieur à son potentiel (observé en moyenne depuis 1978 à 2,5 %), ce denier ralentissant avec la croissance de la population active (passant de 2 % à 1,9 % à partir de 2010).
Le tableau 3 reprend pour référence les moyennes constatées sur les cycles précédents : 1987-96 et 1997-2006. On constate que, en l'absence d'impulsion positive de la politique économique et à croissance de l'activité identique, ce scénario implique un comportement des agents privés nettement plus dynamique que dans l'histoire récente.
Le tableau 4 décrit l'évolution des contributions à la croissance du PIB en projection :
4 - Contribution à la croissance 2006-2012
|
En % |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
87-97 |
97-07 |
07-12 |
|
PIB en volume |
2.2 |
1.9 |
2.25 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
1.9 |
2.2 |
2.5 |
|
Importations |
-2.4 |
-1.6 |
-1.7 |
-2.0 |
-1.9 |
-2.0 |
-2.0 |
-1.0 |
-1.8 |
-2.0 |
|
Dépenses des ménages |
1.8 |
1.6 |
1.7 |
1.8 |
1.8 |
1.7 |
1.6 |
0.8 |
1.9 |
1.8 |
|
Dépenses des administrations |
0.4 |
0.4 |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
0.3 |
0.3 |
0.7 |
0.5 |
0.3 |
|
Investissement des entreprises |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
0.2 |
0.5 |
0.6 |
|
Exportations |
1.9 |
1.1 |
1.5 |
2.0 |
1.9 |
2.0 |
2.0 |
1.4 |
1.3 |
2.0 |
|
Variations de stocks |
-0.3 |
-0.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-0.1 |
-0.3 |
0.0 |
|
Demande intérieure hors stock |
2.4 |
2.3 |
2.4 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
1.6 |
3.0 |
2.5 |
|
Solde extérieur |
-0.5 |
-0.3 |
-0.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.4 |
-0.5 |
0.0 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
III.2. Le scénario « haut »
Dans ce scénario, la croissance est plus élevée. Le PIB croît de 3 % en volume par an au cours de la période 2009-2011. Nous supposons ici que les partenaires de la France connaissent également le même supplément de croissance, impliquant une contribution toujours neutre du commerce l'extérieur. Le maintien de la demande adressée à la France par ses partenaires commerciaux entraîne une augmentation des volumes d'importations et d'exportations par rapport au scénario central.
3bis - Evolution du PIB et de ses principales composantes 2006-2012
|
En % |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
87-97 |
97-07 |
07-12 |
|
PIB en volume |
2.2 |
1.9 |
2.25 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
1.9 |
2.2 |
2.9 |
|
Importations |
7.9 |
5.0 |
5.0 |
7.3 |
6.4 |
6.2 |
6.2 |
4.5 |
6.0 |
6.2 |
|
Consommation des ménages |
2.8 |
2.6 |
2.8 |
3.2 |
3.3 |
3.2 |
3.1 |
1.3 |
2.8 |
3.1 |
|
FBCF des SNF-EI |
4.7 |
4.3 |
4.0 |
7.3 |
7.0 |
6.7 |
6.6 |
1.5 |
4.2 |
6.3 |
|
Exportations |
6.6 |
3.5 |
4.9 |
7.9 |
7.0 |
6.6 |
6.6 |
6.5 |
4.3 |
6.6 |
|
Contributions |
||||||||||
|
Demande intérieure hors stocks |
2.7 |
2.4 |
2.4 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
1.5 |
2.7 |
2.9 |
|
Solde extérieur |
-0.5 |
-0.3 |
-0.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.4 |
-0.5 |
0.0 |
|
Variations de stocks |
-0.3 |
-0.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-0.1 |
-0.3 |
0.0 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
Le tableau 4bis décrit l'évolution des contributions à la croissance du PIB en projection. La plus forte contribution à la croissance des dépenses des agents privés (0,8 point de l'investissement des entreprises contre 0,6 dans le compte central et 2,0% de la consommation des ménages contre 1,8 % dans le compte central), explique l'écart de croissance avec le compte central.
4bis - Contribution à la croissance 2006-2012
|
En % |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
87-97 |
97-07 |
07-12 |
|
PIB en volume |
2.2 |
1.9 |
2.25 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
1.9 |
2.2 |
2.9 |
|
Importations |
-2.4 |
-1.6 |
-1.7 |
-2.5 |
-2.3 |
-2.2 |
-2.3 |
-1.0 |
-1.8 |
-2.3 |
|
Dépenses des ménages |
1.8 |
1.6 |
1.7 |
2.0 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
0.8 |
1.9 |
2.0 |
|
Dépenses des administrations |
0.4 |
0.4 |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
0.3 |
0.3 |
0.7 |
0.5 |
0.3 |
|
Investissement des entreprises |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
0.2 |
0.5 |
0.8 |
|
Exportations |
1.9 |
1.1 |
1.5 |
2.5 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
1.4 |
1.3 |
2.3 |
|
Variations de stocks |
-0.3 |
-0.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-0.1 |
-0.3 |
0.0 |
|
Demande intérieure |
2.7 |
2.4 |
2.4 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
1.5 |
2.7 |
2.9 |
|
Solde extérieur |
-0.5 |
-0.3 |
-0.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.4 |
-0.5 |
0.0 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
A. Les ménages
Avec une hausse sur un an inférieure à 2 % au 2 ème trimestre 2007, la consommation des ménages a marqué le pas depuis la seconde moitié de 2006, passant sous le rythme moyen de hausse de 2,3 % l'an qui s'était instauré en 2001. Ce faisant, le taux de croissance de la consommation n'a fait que rejoindre la borne basse de son intervalle de fluctuations, ce qui n'invalide pas ce régime de progression (graphique 11).
La consommation n'a pas eu un rôle vraiment moteur de la croissance lors de la reprise de l'activité engagée à la mi-2005, à la différence des reprises de la fin des années 80 ou des années 90. Cette caractéristique est probablement la contrepartie du soutien à l'activité qu'a représenté la consommation durant la phase de ralentissement du début des années 2000. En conservant un comportement de dépense plutôt dynamique pour une phase de ralentissement, les ménages ont évité à l'économie française un creux plus marqué, mais ont aussi pour un temps amputé sa capacité de rebond une fois les turbulences passées, lissant sa trajectoire de moyen terme.
La consommation a en effet été soutenue durant la phase basse du cycle par le recul du taux d'épargne, 1,5 point entre 2002 et 2006. La baisse des taux d'intérêt longs sur la période a poussé les ménages à s'endetter, notamment dans l'immobilier. Liée à l'expansion du crédit, la forte progression des prix de l'immobilier témoigne du dynamisme des transactions qui a permis à beaucoup de ménages de concrétiser leurs plus-values. La fraction de ces plus-values consommée sans contrepartie en termes de revenu explique la baisse du taux d'épargne.
11 : Taux de croissance de la consommation des ménages
En %, t/t-4
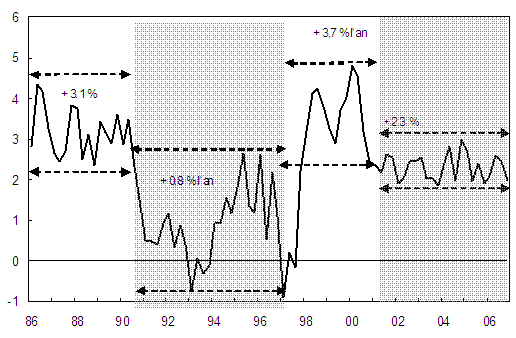
Sources : INSEE, calculs et prévisions OFCE.
Depuis la seconde moitié de 2006, ces facteurs qui avaient poussé à la baisse du taux d'épargne jouent en sens inverse. La remontée des taux d'intérêt longs a entamé la capacité d'endettement des ménages et tempéré le dynamisme de l'immobilier, freinant la consommation et provoquant une remontée du taux d'épargne, sensible dans la première moitié de l'année 2007. Cet effet a été renforcé par la mise en application de la réforme fiscale du gouvernement Villepin qui avait institué des réductions d'impôts en 2007. Ce supplément de revenu, qui n'est habituellement pas consommé en totalité, est pour partie épargné, contribuant alors la remontée du taux d'épargne en 2007.
Les derniers chiffres concernant la consommation de produits manufacturés en juillet et en août confortent ce scénario d'une reprise des dépenses dans la seconde moitié de l'année 2007 (graphique 12). Avec des hausses de 0,9 % en juillet et de 1 % en août, faisant suite à une progression déjà conséquente de 1,5 % en juin, la consommation de produits manufacturés devrait augmenter d'environ 4,5 % au troisième trimestre 2007 par rapport au même trimestre de l'année précédente, rythme nettement plus élevé que celui des trimestres précédents et qui témoigne d'une reprise déjà en cours.
12 : Taux de croissance de la consommation de produits manufacturés
En %, t/t-4
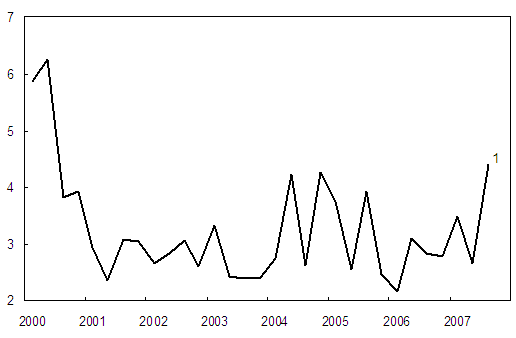
1 : 3 ème trimestre 2007 calculé avec les seules données de juillet et d'août
Source : INSEE.
A.1. Scénario central
Le RDB porte, dans ce scénario, la marque de la faiblesse des prestations sociales inscrite dans la programmation pluriannuelle des finances publiques. Le fort recul du chômage prolongera la baisse des versements d'indemnités. La fin de la montée en charge des retraites anticipées (loi Fillon), et du dispositif de la Prestation d'accueil du jeune enfant (Paje), contribuera au ralentissement des prestations sociales, de même que la réforme de l'assurance maladie qui s'est traduite par une inflexion de la progression des dépenses de santé.
5 - Principales caractéristiques de l'évolution du compte des ménages
|
En volume, en % |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
87-97 |
97-07 |
07-12 |
|
Revenu disponible brut |
2.9 |
3.0 |
2.0 |
2.5 |
2.2 |
2.0 |
2.0 |
1.8 |
2.8 |
2.1 |
|
Salaire réel |
2.4 |
2.9 |
1.9 |
1.7 |
1.9 |
1.9 |
2.3 |
1.7 |
2.9 |
2.0 |
|
Prestations sociales |
2.2 |
2.5 |
1.3 |
1.0 |
1.2 |
1.4 |
1.2 |
2.5 |
2.5 |
1.2 |
|
Consommation des ménages |
2.8 |
2.6 |
2.8 |
2.9 |
3.0 |
2.9 |
2.7 |
1.3 |
2.8 |
2.9 |
|
Taux d'épargne des ménages |
15.4 |
15.7 |
15.1 |
14.7 |
14.0 |
13.3 |
12.7 |
14.2 |
15.7 |
14.2 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
A.2. Scénario « haut »
Dans ce scénario, la plus forte croissance de la productivité du travail se transmet aux salaires ce qui soutient le revenu des ménages. Cette progression du revenu permet à la consommation des ménages de croître à un rythme supérieur à celui anticipé dans le scénario central. L'effort demandé aux ménages est toutefois plus fort : le taux d'épargne baisse de 3,1 points contre 2,4 dans le scénario précédent.
5bis - Principales caractéristiques de l'évolution du compte des ménages
|
En volume, en % |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
87-97 |
97-07 |
07-12 |
|
Revenu disponible brut |
2.9 |
3.0 |
2.0 |
2.4 |
2.1 |
2.3 |
2.3 |
1.8 |
2.8 |
2.2 |
|
Salaire réel |
2.4 |
2.9 |
1.9 |
2.2 |
2.4 |
2.3 |
2.7 |
1.7 |
2.9 |
2.3 |
|
Prestations sociales |
2.2 |
2.5 |
1.3 |
1.0 |
1.2 |
1.5 |
1.2 |
2.5 |
2.5 |
1.2 |
|
Consommation des ménages |
2.8 |
2.6 |
2.8 |
3.2 |
3.3 |
3.2 |
3.1 |
1.3 |
2.8 |
3.1 |
|
Taux d'épargne des ménages |
15.4 |
15.7 |
15.1 |
14.4 |
13.4 |
12.7 |
12.0 |
14.2 |
15.7 |
13.8 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
13. Taux d'épargne des ménages...
En % du RdB

Sources : INSEE, prévisions OFCE.
B. Les entreprises, l'emploi et le chômage
L'année 2006 a confirmé la reprise de l'investissement amorcée deux années auparavant, avec une croissance de la formation brute de capital fixe (FBCF) de 4,7 % après 3,6 % en 2004 et 2,8% en 2005. Le taux d'investissement en volume (en % de la valeur ajoutée (VA) des sociétés non financières (SNF)) s'est redressé de 1,3 point depuis le point bas atteint début 2003. Il s'élève au deuxième trimestre 2007 à 18,7 % de la VA, soit un niveau légèrement supérieur à celui de 2001, avant que les entreprises ne subissent le contre coup de l'explosion de la bulle Internet. En 2007, la FBCF croitrait de 4,3 % malgré la mauvaise performance du deuxième trimestre (0,4 % en volume). Ce trou d'air s'explique essentiellement par une baisse des profits des SNF au second semestre 2006 due à des versements importants d'impôts sur les bénéfices des sociétés mais aussi par un ralentissement de l'activité au deuxième trimestre 2007. Les profits des entreprises s'étant relevés au 1 er semestre 2007 et la croissance devant être plus dynamique au second semestre 2007, la FBCF se redresserait sur la fin de l'année (0,4 % au 3 ème trimestre et 1,2 % au 4 ème trimestre). En 2008, la croissance de l'investissement serait inférieure à celle de 2007 (4,0 %) en raison d'un effet d'acquis moins favorable. Elle resterait cependant assez dynamique en raison d'une profitabilité élevée des entreprises, de l'apparition de tension sur les capacités de production et d'une croissance soutenue.
Du côté du marché du travail, à la mi-2007, la situation s'est nettement améliorée, notamment grâce à des créations d'emplois plus nombreuses dans le secteur marchand (+150 500 au premier semestre 2007, après +168 000 en 2006). Le gouvernement a également poursuivi la relance des contrats aidés non marchands (+15 000 au premier semestre 2007, après +39 000 en 2006) du plan de cohésion sociale. Dans notre scénario, alors que le gouvernement va relâcher la pression sur les emplois aidés (-34 000 en 2008), les chefs d'entreprise vont chercher à restaurer leurs gains de productivité, engendrant ainsi de moindres créations d'emplois marchands (120 600 en 2008, après 281 100 en 2007). En conséquence, la baisse du chômage connaîtrait un ralentissement en 2008 (-49 100 personnes, après -188 400 en 2007).
B.1. Scénario central
Les principales caractéristiques du compte des entreprises et de l'évolution de l'investissement sont reprises dans le tableau ci-dessous :
6 - Principales caractéristiques du compte des entreprises
|
En volume, en % |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
87-97 |
97-07 |
07-12 |
|
Taux d'investissement |
18.3 |
18.7 |
18.9 |
19.2 |
19.4 |
19.7 |
20.0 |
17.4 |
17.8 |
19.4 |
|
Investissement |
4.7 |
4.3 |
4.0 |
5.0 |
4.5 |
4.9 |
4.6 |
1.5 |
4.2 |
4.6 |
|
Taux d'autofinancement |
60.6 |
59.5 |
66.0 |
67.7 |
71.2 |
73.5 |
75.7 |
83.2 |
79.1 |
69.4 |
|
Taux de marge |
37.7 |
37.8 |
38.0 |
38.5 |
39.0 |
39.4 |
39.7 |
39.1 |
38.0 |
38.8 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
Dans le scénario central, une croissance de l'activité de 2,5 % annuelle nécessite également un soutien de la part des entreprises. La croissance de l'investissement devrait être soutenue notamment au cours des deux premières années (2009-2010). Cela se traduit par une hausse sensible du taux d'investissement (0,3 point chaque année), qui atteindrait 20 % de la valeur ajoutée en 2012, niveau encore jamais atteint.
7 - Emploi et Chômage
|
Variations |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
87-97 |
97-07 |
07-12 |
|
Emploi total (milliers) |
190 |
245 |
150 |
198 |
192 |
191 |
197 |
77 |
264 |
185 |
|
Emploi salarié marchand (en %) |
0.8 |
1.4 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
0.5 |
1.5 |
1.0 |
|
Population active (en %) |
0.6 |
0.4 |
0.3 |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.3 |
0.7 |
0.2 |
|
Taux de chômage (BIT) |
9.0 |
8.2 |
7.9 |
7.5 |
7.0 |
6.5 |
6.0 |
10.7 |
9.9 |
7.2 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
Retenant 1,7 % comme hypothèse de progression annuelle de la productivité du travail et une progression de la population active de 0.2-0.3 % par an, la croissance permettrait de créer suffisamment d'emplois (195 000 en moyenne annuelle) pour absorber les nouveaux entrants sur le marché du travail et donc faire baisser le taux de chômage. Ce dernier s'établirait à 6 % en 2012.
B.2. Scénario « haut »
Dans l'hypothèse d'une reprise économique plus forte, l'effort demandé aux entreprises serait plus fort. Le taux d'investissement progresserait à un rythme deux fois plus important que dans le compte central (0,6 point par an contre 0,3 dans le compte central).
6bis - Principales caractéristiques du compte des entreprises
|
En volume, en % |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
87-97 |
97-07 |
07-12 |
|
Taux d'investissement |
18.3 |
18.7 |
18.9 |
19.5 |
20.0 |
20.6 |
21.2 |
17.4 |
17.8 |
19.9 |
|
Investissement |
4.7 |
4.3 |
4.0 |
7.3 |
7.0 |
6.7 |
6.6 |
1.5 |
4.2 |
6.3 |
|
Taux d'autofinancement |
60.6 |
59.5 |
66.0 |
68.0 |
70.6 |
72.7 |
74.2 |
83.2 |
79.1 |
69.1 |
|
Taux de marge |
37.7 |
37.8 |
38.0 |
38.6 |
39.2 |
39.6 |
40.0 |
39.1 |
38.0 |
38.9 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
Le supplément de croissance étant identique à celui de la productivité, les créations d'emplois seraient du même ordre de grandeur que dans le compte central. Le taux de chômage finirait également à 6 % en 2012.
7bis - Emploi et Chômage
|
Variations |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
87-97 |
97-07 |
07-12 |
|
Emploi total (milliers) |
190 |
245 |
150 |
202 |
192 |
196 |
197 |
77 |
264 |
187 |
|
Emploi salarié marchand (en %) |
0.8 |
1.4 |
1.0 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
0.5 |
1.5 |
1.1 |
|
Population active (en %) |
0.6 |
0.4 |
0.3 |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.3 |
0.7 |
0.2 |
|
Taux de chômage (BIT) |
9.0 |
8.2 |
7.9 |
7.5 |
7.0 |
6.5 |
6.0 |
10.7 |
9.9 |
7.2 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
14. Taux d'investissement des entreprises dans le scénario...
En % de la VA
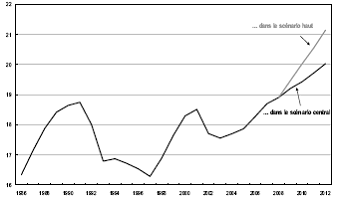
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
C. Les prix
Depuis un an, l'inflation mesurée par l'indice des prix à la consommation a fortement ralenti : proche de 2 % en glissement annuel à l'été 2006, elle est, un an plus tard, tout juste supérieure à 1 % (graphique 15). Mais ce ralentissement n'est pas appelé à durer. Il est lié au recul des prix du pétrole, d'environ 28 % entre juillet 2006 et janvier 2007. Ce recul s'est mécaniquement répercuté sur la composante « énergie » de l'indice des prix à la consommation, dont la progression annuelle de plus de 10 % il y a un an s'est annulée pour faire place à l'heure actuelle à une baisse. Les effets désinflationnistes de la baisse du prix du pétrole sont arrivés à leur terme. D'abord par un effet de base de calcul des évolutions d'une année sur l'autre, les prix à venir de l'énergie seront moins dépréciés par rapport à leur niveau d'un an auparavant. Par ce simple effet mécanique, le creux de la désinflation a été atteint à l'été 2007. À cet effet, s'ajoutera le regain du prix du brut depuis son point bas du début d'année, mais guère au-delà des plus hauts de l'année précédente, de sorte qu'au-delà de ces embardées, la pression inflationniste liée au pétrole ne devrait pas s'accentuer.
15 : Taux d'inflation en France
En %, t/t-12
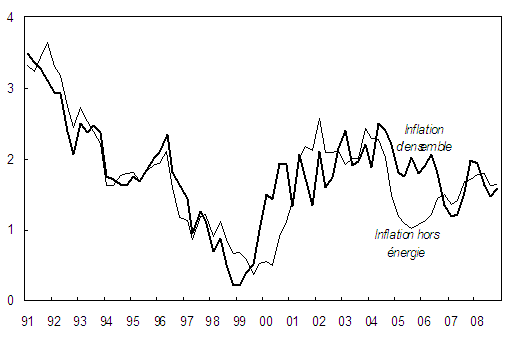
Sources : INSEE, calculs et prévisions OFCE.
L'inflation hors énergie à évolué dans un sens opposé à celui de l'inflation d'ensemble depuis la mi-2005. En phase d'accélération depuis la mi-2005, où elle a atteint un point bas à 1 %, l'inflation hors énergie s'est redressée pour atteindre 1,4 % à l'été 2007. Ce regain relève pour partie d'un phénomène induit de diffusion de la hausse du prix du pétrole en 2004 et en 2005 aux prix des produits incorporant du pétrole. Mais cette inflation n'a pas dégénéré en effets de second tour, selon lesquels la hausse du coût des approvisionnements en énergie est répercutée par les entreprises sur les prix de vente, suscitant en retour des revendications salariales de la part des ménages, confrontés à l'érosion de leur pouvoir d'achat. L'économie française, tout comme les économies développées dépendantes de l'extérieur pour leurs approvisionnements en pétrole, est restée prémunie de l'enclenchement d'une spirale prix-salaires qui par le passé, s'est résolue en une récession. Les entreprises sont restées sages en matière de prix, contraintes par la concurrence des pays émergents, dans un contexte d'appréciation de l'euro, à modérer la hausse des prix de vente. La composante « produits manufacturés » de l'indice des prix recule d'ailleurs continûment depuis le début de 2005, même si depuis lors, le rythme de la baisse a ralenti.
La flambée du prix des matières premières alimentaires sur les marchés internationaux fait craindre un regain de vigueur de l'inflation liée aux produits alimentaires en France (graphique 16). Ces craintes paraissent toutefois bien exagérées. La vigueur de l'euro atténue fortement la hausse des matières premières. Exprimées en dollar, les matières premières alimentaires on crû de 85 % depuis leur point bas d'octobre 2001. Converties en euro, les matières premières n'ont plus augmenté que de 22 %. Le lien entre les variations de l'indice du prix des matières premières et l'indice des prix alimentaires en France est par ailleurs lâche et ne permet pas de transposer l'amplitude des fluctuations du premier sur le second. La dernière vague de hausse des matières premières s'est semble-t-il déjà répercutée sur l'indice des prix alimentaires dont la hausse est restée cantonnée sous 2 %, et bien loin de ses records de 2001 à plus de 6 %.
16 : Prix alimentaires
En %, t/t-4
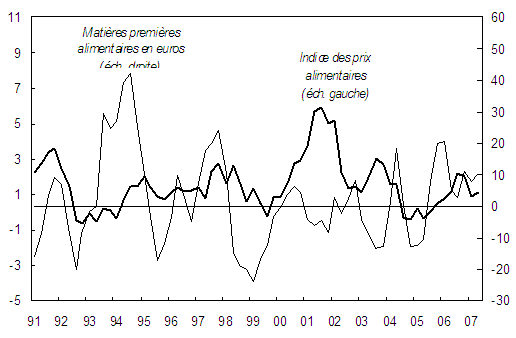
Sources : INSEE, calculs OFCE.
L'effet des salaires sur l'inflation provient davantage de la baisse du chômage depuis la mi-2005, lié à la reprise de l'activité dans la seconde moitié de l'année. L'accélération des salaires réels, qui en 2005 et en 2006 ont crû plus vite que la productivité, témoigne du plus grand dynamisme du marché du travail. La poursuite des créations d'emplois et de la baisse du chômage dans la seconde moitié de 2007 et en 2008 accentuera ces tensions, mais l'accélération des prix hors énergie resterait modérée, bridée par les facteurs désinflationnistes. Au total, l'inflation d'ensemble rebondirait à 2 % en 2007 en glissement annuel, et une fois les effets de base liés à l'énergie disparus, reviendrait à 1,6 % à la fin 2008.
C.1. Scénario central et scénario haut
Les progressions du salaire horaire réel et de la productivité par tête se suivraient, atteignant progressivement leur croissance de moyen terme de 1,7 % par an dans le compte central et 2,2 dans le scénario « haut ».
8 - Prix et salaire
|
En % |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
87-97 |
97-07 |
07-12 |
|
Prix à la consommation |
1.4 |
1.0 |
1.8 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
2.3 |
1.2 |
1.9 |
|
Salaire horaire réel |
2.0 |
2.4 |
1.6 |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
1.2 |
2.3 |
1.7 |
|
Productivité par tête |
1.3 |
0.8 |
1.6 |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
1.6 |
1.1 |
1.7 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
8bis - Prix et salaire
|
En % |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
87-97 |
97-07 |
07-12 |
|
Prix à la consommation |
1.4 |
1.0 |
1.8 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
2.3 |
1.2 |
1.9 |
|
Salaire horaire réel |
2.0 |
2.4 |
1.6 |
2.2 |
2.2 |
2.2 |
2.2 |
1.2 |
2.3 |
2.1 |
|
Productivité par tête |
1.3 |
0.8 |
1.6 |
2.2 |
2.2 |
2.2 |
2.2 |
1.6 |
1.1 |
2.1 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
Dans ces scénarios, l'inflation resterait au-dessous de la cible de la BCE alors que le taux de chômage termine à 6,0 % de la population active. Ce résultat, dans notre analyse modélisée, suppose une baisse du taux de chômage d'équilibre. Ce concept, issu de la théorie du « chômage naturel » de Milton Friedman (1968), a connu des appellations diverses : NAIRU, NAWRU, chômage de long terme ou chômage structurel. Elle repose sur l'idée selon laquelle au-dessous de ce niveau « naturel », toute baisse du chômage observé a, dans un premier temps, pour contrepartie une accélération de l'inflation ; puis dans un deuxième temps, du fait de la spirale prix-salaires qui découle de cette inflation, le taux de chômage revient à son niveau structurel initial. Au total, la baisse du chômage, n'aura donc été que transitoire, tandis que ses conséquences inflationnistes seraient définitives. Selon cette théorie, les politiques actives de la demande d'inspiration keynésienne sont inadéquates pour combattre le chômage d'équilibre ; seules des réformes structurelles permettraient de diminuer ce niveau « naturel ».
Cette analyse a fait l'objet d'abondantes controverses quant à ses soubassements théoriques mais également sur sa validité empirique. Par ailleurs, certains éléments théoriques permettent d'entrevoir une baisse de ce chômage non inflationniste. Les théories de l'hystérèse montrent comment ce chômage a augmenté avec le taux de chômage observé, du fait de son impact sur le capital humain. A l'inverse, une baisse du taux de chômage devrait amener une baisse du taux de chômage d'équilibre. Avec l'expérience d'une longue période d'absence d'inflation et le renforcement de la crédibilité de la banque centrale européenne, les anticipations sur les prix se modifient, permettant une baisse du chômage d'équilibre. Les baisses de taux d'intérêt passées permettent une augmentation progressive du taux d'investissement, ce qui limite les tensions potentielles sur l'appareil productif. Le NAIRU peut baisser graduellement en réaction aux politiques structurelles sur le marché du travail (réforme de l'indemnisation du chômage en 1993, abaissement de charges patronales, prime à l'emploi, PARE,...). Les politiques structurelles sur le marché des biens (politique de concurrence, dérégulation) et sur les marchés financiers (dérégulation) peuvent aussi diminuer le NAIRU.
En l'absence de baisse du taux de chômage d'équilibre et dans l'hypothèse où il n'y a pas de réponse de la banque centrale qui viserait à ralentir fortement l'évolution des prix, l'inflation augmenterait, entraînant une perte de compétitivité et amputerait alors la croissance. A terme, le taux de chômage reviendrait alors à son niveau d'équilibre, proche du scénario central.
D. Les échanges extérieurs
Après un léger mieux au premier trimestre 2007, imputable à l'allègement de la facture énergétique, le déficit commercial français a atteint un nouveau record au deuxième trimestre, à 7,9 milliards d'euros. Le déficit cumulé pour le premier semestre atteint désormais 13,8 milliards d'euros, et laisse présager le creusement du déficit annuel, qui avait atteint 25,2 milliards d'euros en 2006. La dégradation du commerce extérieur français a amputé la croissance de 0,3 point au deuxième trimestre, après une contribution positive (+ 0,2 point) au 1 er trimestre.
17. Commerce extérieur français
Biens et services en volume, indice 100 en 2000 Biens et services en valeur
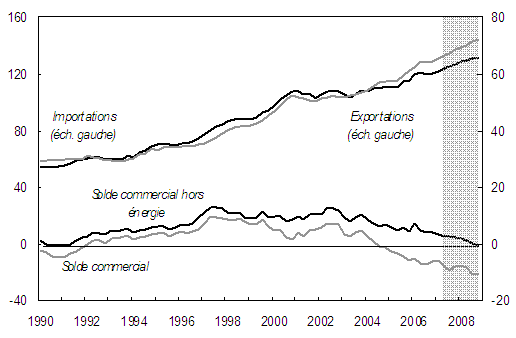
Sources : INSEE, comptes trimestriels, OFCE, e-mod.fr de 2007 à 2008.
Ce creusement du déficit commercial français provient en premier lieu du dynamisme des importations, tirées par un euro en constante appréciation et une demande intérieure vigoureuse. Leur croissance de 1,9 % au 2 ème trimestre porte l'acquis de croissance à 3,3 %. Malgré l'impact attendu de la hausse de TVA allemande, les exportations ont été relativement soutenues (+1,4 au T1 et +0,9 % au T2), en partie par un effet de rattrapage du faible second semestre 2006. Les parts de marché se sont stabilisées au premier semestre, après 5 ans de chute quasi-continue. Compte tenu des délais de transmission, l'appréciation de l'euro en 2006, qui se poursuivrait jusqu'à mi-2008, pèserait davantage sur les exportations françaises à l'horizon de notre prévision.
18. Taux de pénétration des importations et parts de marché à l'exportation
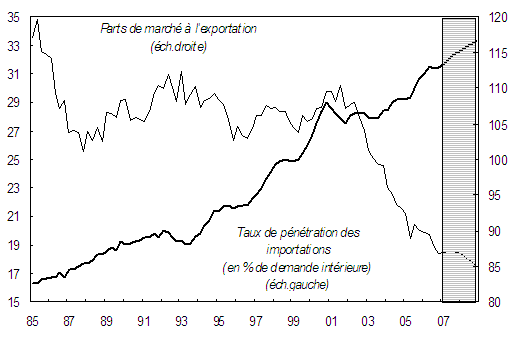
Sources : FMI, données nationales, OFCE, e-mod.fr de 2007 à 2008.
D.1. Scénario central
En l'absence de décalage conjoncturel et en supposant une stabilisation de la compétitivité-prix française, la contribution du commerce extérieur serait nulle dans nos deux scénarios sur l'horizon de l'analyse.
9 - Principales caractéristiques de l'évolution des échanges extérieurs
|
En % |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
87-97 |
97-07 |
07-12 |
|
Importations (volume) |
7.9 |
5.0 |
5.0 |
5.9 |
5.5 |
5.5 |
5.4 |
4.5 |
6.0 |
5.5 |
|
Exportations (volume) |
6.6 |
3.5 |
4.9 |
6.2 |
6.0 |
5.8 |
5.8 |
6.5 |
4.3 |
5.7 |
|
Demande étrangère |
9.9 |
5.2 |
4.9 |
6.2 |
6.0 |
5.8 |
5.8 |
6.1 |
6.5 |
5.9 |
|
Contribution extérieure |
-0.5 |
-0.5 |
-0.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.4 |
-0.5 |
0.0 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
9bis - Principales caractéristiques de l'évolution des échanges extérieurs
|
En % |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
87-97 |
97-07 |
07-12 |
|
Importations (volume) |
7.9 |
5.0 |
5.0 |
7.3 |
6.4 |
6.2 |
6.2 |
4.5 |
6.0 |
6.2 |
|
Exportations (volume) |
6.6 |
3.5 |
4.9 |
7.9 |
7.0 |
6.6 |
6.6 |
6.5 |
4.3 |
6.6 |
|
Demande étrangère |
9.9 |
5.2 |
4.9 |
7.9 |
7.0 |
6.6 |
6.6 |
6.3 |
6.6 |
6.8 |
|
Contribution extérieure |
-0.5 |
-0.5 |
-0.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.4 |
-0.5 |
0.0 |
Sources : INSEE, prévisions OFCE.
IV. Tendances des finances publiques
Dans les deux comptes retenus, les hypothèses macroéconomiques à court terme, c'est-à-dire pour 2007 et 2008, sont identiques et sont calées sur celles du gouvernement.
De 2009 à 2012, les deux scenarios se distinguent par les hypothèses concernant les finances publiques et la croissance et sont alignés sur les hypothèses du scénario bas et du scénario haut de la programmation pluriannuelle des finances publiques (PPFP) 2009-2012.
IV.I. Les finances publiques pour 2007 et 2008
En 2006, le déficit public a été ramené à 2,5 % du PIB après avoir atteint 2,9 % en 2005 et 3,6 % en 2004. La réduction du déficit entre 2004 et 2006 s'est faite grâce à une hausse des prélèvements obligatoires (PO) liée à un fort dynamisme des assiettes fiscales. Les années 2007 et 2008 sont marquées par des allègements fiscaux importants, de plus de 20 milliards d'euros sur les deux années cumulées, soit une impulsion du coté des PO de plus de 1,1 point de PIB. Les réductions de déficit public à 2,4 % du PIB en 2007 et 2,3 % en 2008 se feraient grâce à une impulsion négative du côté de la dépense publique (-0,3 points de PIB en 2007 et -0,5 en 2008) et à une forte élasticité des recettes fiscales au PIB qui permet de réduire le déficit public de 0,5 point de PIB en 2007 et 0,1 en 2008. D'autre part, le gouvernement table sur une croissance de 2 % en 2007 et 2,3 % en 2008 (tableau 10).
10. Principaux agrégats des finances publiques 2006-2008
|
En points de PIB |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Capacité de financement des APU |
-2,5 |
-2,4 |
-2,3 |
|
Taux de prélèvement obligatoire (en % du PIB) |
44,2 |
44,0 |
43,7 |
|
Dépenses publiques (DP) (en % du PIB) |
53,4 |
53,2 |
52,6 |
|
Taux de croissance des DP (en volume, déflaté par l'IPC hors tabac) |
2,1 % |
2,0 % |
1,4 % |
|
Taux de croissance des DP (en volume, déflaté par le prix du PIB) |
1,5 % |
1,6 % |
1,2 % |
|
Dette publique (en % du PIB) |
64,2 |
64,2 |
64,0 |
Source : Rapport économique, social et financier 2008.
IV.I.I. Les dépenses publiques en 2007 et 2008
En 2007, les dépenses publiques seraient plus dynamiques que prévues (2,0 % en volume déflaté par l'IPC hors tabac contre 1,4 % prévu dans la loi de finances pour 2007) en raison principalement du dérapage des dépenses de la branche maladie, l'ONDAM dépassant de 2,9 milliards d'euros le montant initialement prévu. L'accélération de la croissance des dépenses de santé s'explique par la nette augmentation des soins de ville dont l'enveloppe a été dépassée de 2,8 milliards d'euros en raison de la vigueur des prescriptions constatées ces derniers mois et les revalorisations tarifaires des médecins généralistes. De même, les prestations de retraite ont été plus vigoureuses que prévues en 2007 (5,5 % en valeur contre 5% initialement prévu) en raison des départs massifs en retraite (environ 750 000), alors même que le rythme des départs anticipés ne s'est pas infléchit (environ 110 000). En revanche, les prestations familiales décélèrent en 2007 (2,9 % en valeur) avec l'arrivée à maturité de la Prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) et de la décroissance en volume des principales prestations d'entretien (allocations familiales et complément familial). Aussi, la baisse du chômage en 2007 a permis une nouvelle décrue des dépenses d'assurance chômage (-6 %). A ce titre, le déficit du régime général de la sécurité sociale (- 11,7 milliards d`euros) auquel s'ajoute celui du Fonds de solidarité vieillesse et du Fonds de financement des prestations sociales agricoles (-2,6 milliards au total) est partiellement compensé par les régimes de retraite complémentaire qui affichent un excédent de 8,2 milliards d'euros et l'UNEDIC qui présente un excédent de 3 milliards. Au total, la situation des administrations de sécurité sociale est beaucoup moins dégradée que laisserait penser la seule situation du régime général en 2007. Le taux de croissance des dépenses des administrations publiques locales resterait dynamique en 2007 en raison de la forte croissance des dépenses de fonctionnement liée à la poursuite des transferts de compétences, notamment les nouvelles charges de personnel liées au transfert des personnels techniques des lycées et des collèges. Enfin, les dépenses de l'Etat ont crû comme l'inflation en 2007, soit 0 % en volume pour la cinquième année consécutive. Ce bon chiffre reste cependant supérieur à ce que prévoyait le PLF 2007(baisse de 1,25 % en volume des dépenses de l'Etat).
En 2008, le gouvernement prévoit un ralentissement significatif de la croissance de la dépense publique (1,4 % en volume en déflatant par les prix à la consommation et 1,2 % en volume en déflatant par les prix du PIB), contribuant ainsi à réduire le déficit structurel de 0,5 point de PIB. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement table sur une stabilisation en euros constants des dépenses de l'Etat grâce notamment au non remplacement de 22 800 fonctionnaires qui partent en retraite. Du côté de la sécurité sociale, le gouvernement prévoit une croissance de l'ONDAM de 2,8 % en euros courants, niveau jamais atteint depuis 1999 (le rythme moyen de l'ONDAM est de 5,1 % par an depuis 2000), ce qui nécessite des mesures d'économies de l'ordre de 2 milliards d'euros, notamment par la mise en place d'une franchise médicale. Le gouvernement compte également sur un ralentissement significatif des dépenses de retraite (4,9 % en valeur) et de la branche famille (2,5 %), ainsi que sur une baisse des prestations chômage en lien avec l'amélioration du marché du travail. Enfin, le gouvernement table sur une maîtrise de l'évolution des dépenses des collectivités locales, et des prélèvements locaux, en raison des échéances électorales du mois de mars 2008.
IV.I.II. Les prélèvements obligatoires en 2007 et 2008
En 2007, le taux de PO baisserait de 0,2 point de PIB pour s'établir à 44 % alors que l'ensemble des mesures fiscales votées pour l'année 2007 représentent 0,7 point de PIB. Aux mesures qui avaient été antérieurement décidées par le gouvernement Villepin pour un montant de 11,4 milliards d'euros (modification du barème de l'IRPP, revalorisation de la prime pour l'emploi, création du « bouclier fiscal », réforme de la taxe professionnelle, abaissement du taux réduit sur les plus-values à long terme...), s'ajoutent les mesures du paquet fiscal votées cet été dont certaines auront des effets dès 2007 (1,3 milliard d'euros lié aux allègements de charges salariales sur les heures supplémentaires et 360 millions d'euros pour la réforme des droits de successions et de donations). Les baisses programmées de prélèvements obligatoires, qui représentent 0,7 point de PIB en 2007 sont en partie compensées par le dynamisme des recettes fiscales dont l'élasticité au PIB resterait nettement supérieure à l'unité pour la quatrième année consécutive (0,5 point de PIB).
En 2008, le taux de PO diminuerait de 0,3 point de PIB pour s'établir à 43,7 % du PIB. Les différentes mesures votées représentent un allègement de prélèvements de 8 milliards d'euros en 2008 qui profiteront essentiellement aux ménages (5,8 milliards d'euros). Les 1,8 milliards d'euros de baisse de prélèvements pour les entreprises sont le résultat de mesures votées avant 2007, celle concernant le dégrèvement de la taxe professionnelle représentant à elle seule plus de 2 milliards. Les mesures liées au paquet fiscal représentent une diminution des prélèvements obligatoires de 6,8 milliards d'euros pour 2008, dont 3,8 milliards liés aux allègements de charges et la défiscalisation des heures supplémentaires. Les autres grandes mesures sont celles concernant la réforme des droits de successions et donations (1,6 milliard) et celles relatives à l'ISF et au bouclier fiscal 111 ( * ) (1,1 milliard). La mesure concernant les crédits d'impôt sur les intérêts d'emprunt hypothécaires ne représente que 440 millions d'euros en 2008 malgré le doublement de la mesure dans le PLF 2008 car elle se limite finalement uniquement aux emprunts contractés après le vote de la loi et n'a pas d'effet sur ceux contractés antérieurement dans un délai maximum de cinq ans comme cela avait été initialement présenté. Enfin, les mesures décidées dans la PLFSS 2008 visant principalement à renflouer les caisses de la sécurité sociale vont représenter une hausse des prélèvements obligatoires à hauteur de 2,6 milliards d'euros, la principale mesure concernant la mise en place d'un prélèvement à la source sur les contributions sociales et fiscales sur les dividendes pour 1,9 milliards d'euros. Par ailleurs, le gouvernement, retient une élasticité des recettes fiscales au PIB de 1,1. Les recettes ont connu une augmentation nettement supérieure à celle du PIB depuis 2004, représentant un gain fiscal cumulé de 1,6 point de PIB en quatre ans. Cela s'explique par le dynamisme des impôts assis sur les revenus du capital et les plus-values (impôt sur le revenu, CSG, droits de mutation, ISF) en raison de la hausse cyclique du prix des actifs immobiliers et financiers, de la forte croissance de l'impôt sur les sociétés liée à l'augmentation des bénéfices fiscaux et de la hausse de la TVA en raison de l'accroissement de la part de la consommation des ménages dans le PIB. Cependant, rien ne garantit, à court ou moyen terme, que ce phénomène se poursuive en raison de la cyclicité des assiettes fiscales. En effet, sur longue période, cette élasticité est en moyenne égale à 1, les recettes fiscales tendant spontanément à croître comme le PIB nominal. Selon le Rapport du Sénat réalisé à l'occasion du débat d'orientation budgétaire pour 2008, les recettes publiques seraient supérieures de 1,2 point de PIB à leur moyenne de longue période en 2006. Et toujours selon ce rapport, les recettes publiques risquent donc, d'ici à 5 ans, de tendre spontanément à augmenter moins vite que le PIB de façon à converger vers leur équilibre de long terme.
IV.II. Les finances publiques de 2009 à 2012
Conformément au PPFP fourni par le gouvernement au moment de la présentation du PLF 2008, le rythme de croissance des dépenses publiques connaîtrait un infléchissement significatif dès 2008 et ce jusqu'en 2012. Ces dernières augmenteraient en moyenne de 1,1 % en volume sur la période 2009-2011 permettant une diminution de plus de 2,6 points de la part des dépenses publiques dans le PIB en l'espace de 4 ans dans le cas du scénario bas et de 3,6 points pour le scénario haut pour s'établir respectivement à 49,9% et 48,9 % du PIB en 2012 (tableau 11). A titre de comparaison, le rythme moyen de la dépense publique en volume était de 2,5 % sur les vingt dernières années, de 2,1 % sur les dix dernières et de 2,4 % sur les cinq dernières.
Dans la lignée du PPFP, les taux de PO diminueraient de 0,2 point de PIB en 2009 et de 0,1 en 2010 puis se stabiliseraient entre 2010 et 2012 dans le scénario bas. Dans le scénario haut, les taux de PO resteraient stables à 43,7 % du PIB entre 2008 et 2012, en raison d'un dynamisme spontané des recettes fiscales au PIB plus important lié à une croissance plus forte. Dans les deux scénarios, le niveau des taux de PO repasserait sous le niveau moyen de la période 1995-2006.
11. Principaux agrégats des finances publiques 2009-2012
|
En points de PIB |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
|
Scénario bas |
Capacité de financement des APU |
-1.7 |
-1.2 |
-0.6 |
0.0 |
|
Taux de prélèvement obligatoire (en % du PIB) |
43.5 |
43.4 |
43.4 |
43.4 |
|
|
Dépenses publiques (DP) (en % du PIB) |
51.9 |
51.2 |
50.6 |
49.9 |
|
|
Taux de croissance des DP* (en volume) |
1.0 |
1.1 |
1.2 |
1.2 |
|
|
Dette publique (en % du PIB) |
63.2 |
61.9 |
60.2 |
57.9 |
|
|
Scénario haut |
Capacité de financement des APU |
-1.3 |
-0.3 |
0.5 |
1.3 |
|
Taux de prélèvement obligatoire (en % du PIB) |
43.7 |
43.7 |
43.7 |
43.7 |
|
|
Dépenses publiques (DP) (en % du PIB) |
51.6 |
50.7 |
49.8 |
48.9 |
|
|
Taux de croissance des DP* (en volume) |
1.0 |
1.1 |
1.2 |
1.2 |
|
|
Dette publique (en % du PIB) |
62.5 |
60.0 |
57.2 |
53.4 |
* déflatées par le prix du PIB
Source : Rapport économique, social et financier 2008.
IV.II.I. Les prélèvements obligatoires de 2009 à 2012
Après avoir diminué de 0,5 point de PIB entre 2006 et 2008, les prélèvements obligatoires devraient continuer à baisser de 0,2 point de PIB en 2009 (4,1 milliards d'euros), en raison principalement de la montée en charge de la loi TEPA, de la modification du crédit d'impôt recherche et du contrecoup lié aux mesures de prélèvements sur les dividendes en 2008. Dans le cadre de la loi TEPA, les prélèvements obligatoires baisseraient de 2 milliards d'euros en 2009, dont 1,1 milliard pour l'exonération des heures supplémentaires, 0,74 milliard pour le crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunts et 0,18 milliard pour l'allègement des droits de succession. Les mesures décidées dans le cadre du PLF 2008 ainsi que le contrecoup du prélèvement à la source des recettes de CSG sur les dividendes entraîneraient une diminution des prélèvements de plus de 3,4 milliards d'euros (2,1 milliards pour la fiscalité sur les dividendes, 0,8 milliard pour la modification du crédit d'impôt recherche et 0,57 milliard pour le doublement du crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts d'emprunt). En revanche, certaines mesures augmentent les PO en 2009, dont 0,5 milliard d'euros pour les indemnités de mise à la retraite et 0,5 milliard pour l'institution d'un prélèvement de 25 % sur les distributions des bénéfices.
Dans la continuité de 2009, les taux de PO diminueraient de 0,1 point de PIB en 2010, puis se stabiliseraient en 2011 et 2012 (tableau 12).
Dans le cas du scénario haut, les baisses programmées de PO en 2009 et 2010 seraient compensées par une élasticité des recettes fiscales au PIB supérieure à l'unité en 2009 et 2010 en raison d'une croissance de l'activité de 3 % (tableau 12bis).
12. Compte scénario bas : Evolution des recettes des administrations publiques
|
% de croissance annuelle en volume |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
89--98 |
99--08 |
09--12 |
|
TVA |
7.3 |
7.4 |
7.4 |
7.4 |
7.4 |
7.4 |
7.4 |
7.5 |
7.3 |
7.4 |
|
Autres impôts sur les produits |
4.1 |
4.1 |
4.1 |
4.1 |
4.1 |
4.1 |
4.1 |
4.4 |
4.2 |
4.1 |
|
Impôts sur la production |
4.3 |
4.2 |
4.1 |
4.1 |
4.1 |
4.1 |
4.1 |
3.9 |
4.2 |
4.1 |
|
Impôt sur le revenu des ménages (dont CSG) |
7.8 |
7.5 |
7.6 |
7.4 |
7.4 |
7.3 |
7.3 |
5.5 |
7.9 |
7.4 |
|
Impôt sur les sociétés |
2.9 |
3.0 |
3.1 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
2.0 |
2.6 |
3.0 |
|
Autres impôts sur le revenu et le patrimoine |
1.0 |
1.0 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
1.0 |
0.9 |
0.9 |
|
Cotisations employeurs |
11.1 |
11.1 |
11.1 |
11.1 |
11.1 |
11.1 |
11.1 |
11.4 |
11.1 |
11.1 |
|
Cotisations salariées et non salariées |
5.4 |
5.3 |
5.1 |
5.1 |
5.1 |
5.1 |
5.1 |
6.8 |
5.2 |
5.1 |
|
Impôts en capital |
0.5 |
0.5 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.5 |
0.4 |
|
Prélèvements obligatoires |
44.2 |
44.0 |
43.7 |
43.5 |
43.4 |
43.4 |
43.4 |
42.9 |
43.9 |
43.4 |
Sources : INSEE, Rapport économique, social et financier 2008, prévisions OFCE..
12bis. Compte scénario haut : Evolution des recettes des administrations publiques
|
% de croissance annuelle en volume |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
89--98 |
99--08 |
09--12 |
|
TVA |
7.3 |
7.4 |
7.4 |
7.4 |
7.4 |
7.4 |
7.4 |
7.5 |
7.3 |
7.4 |
|
Autres impôts sur les produits |
4.1 |
4.1 |
4.1 |
4.1 |
4.1 |
4.1 |
4.1 |
4.4 |
4.2 |
4.1 |
|
Impôts sur la production |
4.3 |
4.2 |
4.1 |
4.1 |
4.1 |
4.1 |
4.1 |
3.9 |
4.2 |
4.1 |
|
Impôt sur le revenu des ménages (dont CSG) |
7.8 |
7.5 |
7.6 |
7.6 |
7.6 |
7.6 |
7.6 |
5.5 |
7.9 |
7.6 |
|
Impôt sur les sociétés |
2.9 |
3.0 |
3.1 |
3.1 |
3.1 |
3.1 |
3.1 |
2.0 |
2.6 |
3.1 |
|
Autres impôts sur le revenu et le patrimoine |
1.0 |
1.0 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
1.0 |
0.9 |
0.9 |
|
Cotisations employeurs |
11.1 |
11.1 |
11.1 |
11.1 |
11.1 |
11.1 |
11.1 |
11.4 |
11.1 |
11.1 |
|
Cotisations salariées et non salariées |
5.4 |
5.3 |
5.1 |
5.1 |
5.1 |
5.1 |
5.1 |
6.8 |
5.2 |
5.1 |
|
Impôts en capital |
0.5 |
0.5 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.5 |
0.4 |
|
Prélèvements obligatoires |
44.2 |
44.0 |
43.7 |
43.7 |
43.7 |
43.7 |
43.7 |
42.9 |
43.9 |
43.7 |
Sources : INSEE, Rapport économique, social et financier 2008, prévisions OFCE.
IV.II.II. Les dépenses publiques de 2009 à 2012
L'hypothèse d'une croissance des dépenses publiques de 1,1 % par an en volume de 2009 à 2012 (tableaux 13 et 13bis) suppose un ajustement fort, compte tenu de l'évolution rapide des dépenses liées au vieillissement de la population (retraites et santé principalement). Le ralentissement des dépenses publiques serait tiré par l'ensemble des sous-secteurs de l'administration publique.
Premièrement, les dépenses de l'Etat, qui croissent à un rythme proche de l'inflation depuis 2003, devraient progressivement ralentir, pour se stabiliser en euros courants à l'horizon de la projection. La révision générale des politiques publiques, en couvrant tous les champs de l'action publique, devrait permettre d'atteindre cet objectif, notamment en arrivant à moyen terme à ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux partant à la retraite (voir encadré).
|
Encadré : Impact du non remplacement à la retraite d'un fonctionnaire sur deux de 2008 à 2012 Selon le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, 372 000 agents de l'Etat prendront leurs retraites de 2008 à 2012 (graphique encadré). Ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux revient donc à supprimer 186 000 emplois dans la fonction publique d'Etat, soit une baisse de 8% du nombre d'agents. De 2008 à 2012, 82 % des départs à la retraite de la fonction publique d'Etat se concentreront dans trois ministères : Education, Défense et Intérieur. Cette règle du non remplacement d'un fonctionnaire sur deux aboutirait en particulier à une réforme en profondeur de l'enseignement en France car 57 % des départs en retraite de la fonction publique auront lieu dans les rangs du ministère de l'Education (17 % pour la Défense et 8 % pour l'Intérieur). Cette réduction des effectifs devait permettre d'économiser 5,8 milliards d'euros sur 5 ans, soit 0,3 point de PIB. Cependant, cet objectif de non remplacement d'un fonctionnaire sur deux devrait finalement être progressif et celui-ci serait atteint seulement en 2012. En 2008, selon le PLF, 22 800 fonctionnaires ne devrait pas être remplacés, soit un sur 3,6 (et non pas un sur deux comme cela avait été initialement annoncé). Si l'on suppose que ce ratio diminuera progressivement pour atteindre un sur deux en 2012 (graphique encadré), le nombre de fonctionnaires non remplacés sera de 137 000 sur cinq ans, soit une réduction des effectifs de l'Etat de 6 %. Les économies réalisées seraient finalement de 4,3 milliards d'euros sur 5 ans, soit 0,22 point de PIB. A titre de comparaison, un supplément de croissance du PIB de 0,1 % chaque année de 2008 à 2012 rapporterait à l'Etat plus de 4 milliards d'euros en recettes fiscales. Enfin, si la moitié des économies générées par la mesure sont redistribuées aux fonctionnaires sous forme de salaires, le déficit public serait réduit ex ante de seulement 0,1 point de PIB en 2012. Economies liées au non remplacement des départs en retraite d'un certain nombre d'agents de l'Etat En milliers En % du PIB
Sources : Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, calculs OFCE. |
Avec un rythme de croissance en volume inférieur à 2 % sur l`ensemble de la période de programmation, les dépenses des administrations de sécurité sociale seraient particulièrement contenues. La croissance de l'ONDAM ne dépasserait pas 2 % en volume à moyen terme (3 % en valeur en moyenne de 2009 à 2012 (tableaux 14 et 14bis)) en raison de la poursuite des efforts structurels de maîtrise des dépenses d'assurance maladie. Au regard du passé récent, cette hypothèse suppose une véritable modification des comportements en terme de dépenses de santé. Ces dernières ont en effet crû en moyenne de 4,7 % en valeur entre 1998 et 2007 alors même que les effets du vieillissement de la population ont eu très peu d'impact sur cette période. Les prestations chômage diminueraient fortement avec le recul du chômage (-4,5 % en moyenne entre 2008 et 2012) et les dépenses de la branche famille s'infléchiraient avec l'arrivée à maturité de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE). En revanche, la branche vieillesse resterait dynamique avec l'arrivée progressive à l'âge de la retraite de la génération du baby-boom (4,7 % en valeur de 2009 à 2012).
Enfin, sur la période de projection 2009-2012, les dépenses des administrations publiques locales ralentiraient significativement par rapport à la période récente pour croître en moyenne de 1,4 % par an en volume.
13. Compte scénario bas : Evolution des dépenses des administrations publiques
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
89--98 |
99--08 |
09--12 |
|
|
en points de PIB |
||||||||||
|
Ensemble des dépenses |
53.4 |
53.2 |
52.6 |
51.9 |
51.2 |
50.5 |
49.9 |
52.5 |
52.8 |
50.9 |
|
Dont : |
||||||||||
|
Dépenses de fonctionnement |
18.8 |
18.6 |
18.3 |
18.0 |
17.7 |
17.3 |
17.0 |
19.1 |
18.8 |
17.5 |
|
Intérêts versés |
2.6 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.4 |
2.3 |
2.3 |
3.1 |
2.8 |
2.4 |
|
Prestations et autres transferts versés |
28.5 |
28.6 |
28.4 |
28.0 |
27.8 |
27.5 |
27.3 |
26.9 |
27.9 |
27.7 |
|
Acquisition nette d'actifs non financiers |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.4 |
3.4 |
3.3 |
3.3 |
3.4 |
3.3 |
3.3 |
|
Taux de croissance en volume* |
||||||||||
|
Ensemble des dépenses |
1.5 |
1.6 |
1.2 |
1.0 |
1.1 |
1.2 |
1.2 |
2.6 |
2.2 |
1.1 |
|
Dont : |
||||||||||
|
Dépenses de fonctionnement |
1.3 |
0.8 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
2.3 |
1.7 |
0.7 |
|
Intérêts versés |
-1.4 |
-1.3 |
2.2 |
0.7 |
0.3 |
-0.4 |
-1.5 |
5.6 |
-0.7 |
-0.2 |
|
Prestations et autres transferts versés |
1.8 |
2.3 |
1.4 |
1.3 |
1.5 |
1.6 |
1.7 |
2.7 |
2.6 |
1.5 |
|
Acquisition nette d'actifs non financiers |
3.1 |
2.2 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
1.2 |
1.2 |
0.7 |
3.5 |
1.1 |
13bis. Compte scénario haut : Evolution des dépenses des administrations publiques (déflaté par les prix du PIB)
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
89--98 |
99--08 |
09--12 |
|
|
en points de PIB |
||||||||||
|
Ensemble des dépenses |
53.4 |
53.2 |
52.6 |
51.6 |
50.7 |
49.8 |
48.9 |
52.5 |
52.8 |
50.3 |
|
Dont : |
||||||||||
|
Dépenses de fonctionnement |
18.8 |
18.6 |
18.3 |
17.9 |
17.5 |
17.1 |
16.7 |
19.1 |
18.8 |
17.3 |
|
Intérêts versés |
2.6 |
2.5 |
2.5 |
2.4 |
2.4 |
2.3 |
2.2 |
3.1 |
2.8 |
2.3 |
|
Prestations et autres transferts versés |
28.5 |
28.6 |
28.4 |
27.9 |
27.5 |
27.1 |
26.8 |
26.9 |
27.9 |
27.3 |
|
Acquisition nette d'actifs non financiers |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.4 |
3.3 |
3.3 |
3.2 |
3.4 |
3.3 |
3.3 |
|
taux de croissance en volume* |
||||||||||
|
Ensemble des dépenses |
1.5 |
1.6 |
1.2 |
1.0 |
1.1 |
1.2 |
1.2 |
2.6 |
2.2 |
1.1 |
|
dont : |
||||||||||
|
Dépenses de fonctionnement |
1.3 |
0.8 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
2.3 |
1.7 |
0.7 |
|
Intérêts versés |
-1.4 |
-1.3 |
2.2 |
0.7 |
0.3 |
-0.4 |
-1.5 |
5.6 |
-0.7 |
-0.2 |
|
Prestations et autres transferts versés |
1.8 |
2.3 |
1.4 |
1.3 |
1.5 |
1.6 |
1.7 |
2.7 |
2.6 |
1.5 |
|
Acquisition nette d'actifs non financiers |
3.1 |
2.2 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
1.2 |
1.2 |
0.7 |
3.5 |
1.1 |
* déflatés par le prix du PIB
Sources : INSEE, Rapport économique, social et financier 2008, prévisions OFCE.
14. Compte central scenario bas : Evolution des prestations sociales en valeur
|
2006 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
91--98 |
99--08 |
09--12 |
|
|
Répartition |
|||||||||||
|
Vieillesse-Survie |
45 |
5.2 |
5.5 |
4.9 |
4.5 |
4.7 |
4.8 |
4.9 |
4.7 |
4.6 |
4.7 |
|
Santé |
35 |
3.3 |
4.1 |
2.8 |
2.8 |
3 |
3.1 |
3.2 |
4.2 |
4.6 |
3.0 |
|
Emploi |
7 |
-6.2 |
-6.0 |
-3.4 |
-3.8 |
-4.7 |
-4.7 |
-4.7 |
2.7 |
1.5 |
-4.5 |
|
Maternité, famille, logement, pauvreté et exclusion |
13 |
2.8 |
2.6 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
4.8 |
2.7 |
2.3 |
|
Total des prestations |
100 |
3.3 |
3.8 |
3.3 |
3.1 |
3.3 |
3.4 |
3.5 |
4.4 |
4.1 |
3.3 |
Sources : DREES, Rapport économique, social et financier 2008, prévisions OFCE.
14bis. Compte central scenario haut : Evolution des prestations sociales en valeur
|
2006 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
89--98 |
99--08 |
09--12 |
|
|
Répartition |
|||||||||||
|
Vieillesse-Survie |
45 |
5.2 |
5.5 |
4.9 |
4.5 |
4.7 |
4.8 |
4.9 |
4.7 |
4.6 |
4.7 |
|
Santé |
35 |
3.3 |
4.1 |
2.8 |
2.8 |
3 |
3.1 |
3.2 |
4.2 |
4.6 |
3.0 |
|
Emploi |
7 |
-6.2 |
-6.0 |
-3.4 |
-3.8 |
-4.7 |
-4.7 |
-4.7 |
2.7 |
1.5 |
-4.5 |
|
Maternité, famille, logement, pauvreté et exclusion |
13 |
2.8 |
2.6 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
4.8 |
2.7 |
2.3 |
|
Total des prestations |
100 |
3.3 |
3.8 |
3.3 |
3.1 |
3.3 |
3.4 |
3.5 |
4.4 |
4.1 |
3.3 |
Sources : DREES, Rapport économique, social et financier 2008, prévisions OFCE.
IV.II.II Evolutions du déficit et de la dette publics de 2009 à 2012
Le ralentissement significatif de la dépense publique permet de ramener les finances publiques à leur équilibre en 2012 dans le cas du scénario bas et à 2010 dans celui du scénario haut. Dans le scénario bas, le déficit public baisserait de 2,3 points de PIB entre 2008 et 2012 et de 3,6 points dans le scénario haut (tableau 15). Dans le scénario bas, l'impulsion budgétaire moyenne est de -0,5 point de PIB par an entre 2008 et 2012 et de -0,8 point dans le scénario haut. La dette publique baisserait de plus de 6 points de PIB entre 2008 et 2012 dans le scénario bas pour atteindre 57,9 % du PIB à l'horizon de notre projection. Dans le scénario haut, cette baisse serait de plus de 10 points de PIB en l'espace de 4 ans en raison d'une réduction plus rapide des déficits liés à une croissance de l'activité plus rapide dans ce scénario.
15. Evolution de la capacité de financement et de la dette des administrations publiques
|
En % du PIB |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
89--98 |
99--08 |
09--12 |
|
Scénario bas |
||||||||||
|
Solde public |
-2.5 |
-2.4 |
-2.3 |
-1.7 |
-1.2 |
-0.6 |
0.0 |
-3.9 |
-2.6 |
-0.9 |
|
Solde public stabilisant la dette publique |
-2.9 |
-2.4 |
-2.6 |
-2.8 |
-2.7 |
-2.6 |
-2.6 |
|||
|
Impulsion budgétaire* |
-0.8 |
-0.1 |
-0.2 |
-0.4 |
-0.5 |
-0.5 |
-0.5 |
|||
|
Dette publique |
64.2 |
64.2 |
64 |
63.2 |
61.9 |
60.2 |
57.9 |
47.3 |
61.9 |
60.8 |
|
Scénario haut |
||||||||||
|
Solde public |
-2.5 |
-2.4 |
-2.3 |
-1.3 |
-0.3 |
0.5 |
1.3 |
-3.9 |
-2.6 |
0.1 |
|
Solde public stabilisant la dette publique |
-2.9 |
-2.4 |
-2.6 |
-3.1 |
-3.0 |
-2.9 |
-2.7 |
|||
|
Impulsion budgétaire** |
-0.8 |
-0.1 |
-0.2 |
-0.9 |
-0.8 |
-0.8 |
-0.8 |
|||
|
Dette publique |
64.2 |
64.2 |
64.0 |
62.5 |
60.0 |
57.2 |
53.4 |
47.3 |
61.9 |
58.3 |
* calculée à partir de la variation du solde structurel (y compris charges d'intérêts) avec une hypothèse de croissance du PIB de 2,2 % par an sur l'ensemble de la période
** * calculée à partir de la variation du solde structurel (y compris charges d'intérêts) avec une hypothèse de croissance du PIB de 2,2 % par an de 2006 à 2008 et de 2,7 % de 2009 à 2012.
Sources : INSEE, Rapport économique, social et financier 2008, prévisions OFCE.
La défiscalisation des heures supplémentaires : quels impacts micro et macro-économique 112 ( * )
La défiscalisation des heures supplémentaires et son exonération de cotisations sociales est centrale dans le dispositif du nouveau gouvernement. Concrètement, la rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires sera majorée de 25 % quelque soit la taille de l'entreprise, ne sera soumise ni à l'impôt sur le revenu ni aux cotisations sociales salariées et bénéficiera d'une réduction de cotisations employeurs. Elle vise donc à redonner du pouvoir d'achat aux salariés français en abaissant le coût du travail et en augmentant leur durée du travail.
Avant d'exposer les résultats et les mécanismes macro-économiques résultant d'une telle mesure (V), nous rappellerons les principes de la mesure (I), puis nous ferons rapidement un état des lieux des pratiques d'heures supplémentaires et complémentaires au sein des entreprises (II.1.) ainsi que des taux de cotisations employeurs et salariés en vigueur (II.2.). Nous détaillerons ensuite le coût global pour les finances publiques d'une telle mesure (III) ainsi que son impact sur le coût du travail des entreprises (IV).
I. Principe
La mesure s'appliquerait à l'ensemble des salariés des secteurs public et privé. Elle concernerait aussi bien les heures complémentaires (HC) effectuées par les salariés à temps partiel que les heures supplémentaires (HS) et choisies effectuées par les salariés à temps complet, y compris ceux placés sous un régime de forfait. Elle s'appliquerait à compter du 1 er octobre 2007.
La mesure comporte plusieurs volets :
A. Réduction forfaitaire des charges patronales
Une réduction forfaitaire des charges patronales est calibrée de la manière suivante : 1,5 € par heure supplémentaire effectuée par les entreprises de moins de 20 salariés et 0,5 € dans les entreprises de plus de 20 salariés.
B. Alignement de la majoration des HS
Cette mesure propose l'alignement des heures supplémentaires sur le taux minimal de 25 % dans toutes les entreprises.
C. Aménagement de l'allègement Fillon
Pour les salariés à temps complet, cette mesure propose un aménagement de l'allègement « Fillon » de façon à neutraliser l'effet des heures supplémentaires sur le taux d'exonération. Pour ce faire, le nombre d'heures supplémentaires, entrant dans le calcul du salaire horaire, est pris en compte en incluant le taux de majoration qui leur est appliqué.
Cela revient à modifier la formule actuelle (1) :
Allègement = (u/(seuil-1))*Salmens*(1,6 Smich/Salhor -1) (1)
Avec :
• Salmens correspond au salaire mensuel brut incluant les majorations pour les heures supplémentaires,
• Salhor, le salaire horaire calculé de la manière suivante :
Salhor= Salmens /(HN+HS) avec HN, les heures de travail « normales » et HS, le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié,
• seuil = 1,6 quelle que soit la situation de l'entreprise,
• u = 0,26 pour les entreprises de plus de 20 salariés et 0,281 pour ceux de moins de 20 salariés.
La nouvelle formule neutralisant les effets des majorations sur le calcul des allégements s'écrit alors :
Allègement = (u/(seuil-1))*Salmens*(1,6Smich/SalhorN -1) (2)
avec
• SalhorN = Salmens/(HN+(1+TxMaj)HS),
• TxMaj = 0,25 pour les entreprises de plus de 20 salariés et 0,1 pour les entreprises de moins de 20 salariés.
D. Exonération d'IRPP
Cette mesure permet aux salariés d'exonérer d'impôt sur le revenu les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires effectuées dans la seule limite d'une majoration de 25 %.
E. Exonération des charges salariales
Cette mesure comporte également une réduction des charges salariales égale au montant de la CSG, CRDS ainsi que de toutes les cotisations légales et conventionnelles.
II. Etat des lieux
II.1. Les heures supplémentaires et complémentaires au sein des entreprises
II.1.1. Les heures supplémentaires
Selon l'Insee, 37 % des salariés à temps complet du secteur privé effectuent des heures supplémentaires. Ces derniers ont effectué 57 heures supplémentaires en moyenne au cours de la période 2001-2004. Nous pensons que cette évaluation, issue de l'enquête ACEMO sous-estime considérablement le nombre d'heures supplémentaires réellement effectué dans l'hexagone. Outre le taux important de non réponse à cette question et de la non prise en compte des entreprises de moins de 10 salariés dans cette enquête 113 ( * ) , les entreprises ont tendance à ne pas déclarer les heures supplémentaires effectuées de façon structurelle et qui sont intégrées dans l'horaire collectif, ainsi que celles compensées par un repos compensateur. Autrement dit, dans cette enquête seules les heures supplémentaires rémunérées à un taux majoré et effectuées occasionnellement pour faire face à un surcroît d'activité sont comptabilisées.
Notre estimation corrigée de cette sous-estimation des heures supplémentaires donne un volume moyen de 58 heures pour les salariés à temps plein du secteur privé, estimation qui est cohérente avec un volume global d'heures supplémentaires rémunérées d'environ 900 millions par an sur le champ des allégements de charges dits « Fillon ». Cette estimation est plus de 2,5 fois supérieure à celle proposée par l'INSEE. Concernant la répartition de ce volume d'heures supplémentaires entre les entreprises de plus ou moins 20 salariés, nous reprenons les résultats de l'enquête ACEMO qui indique que 75 % de ces heures supplémentaires sont effectuées dans les entreprises de moins de 20 salariés.
Par ailleurs, les cadres n'effectuant pas d'heures supplémentaires rémunérées, nous avons fait l'hypothèse que ces heures supplémentaires concernent les salariés dont la rémunération est comprise entre le Smic horaire et 2 fois le Smic horaire (correspondant au 1 er décile de rémunération des cadres). Cela correspond à un salaire horaire moyen d'environ 1,33 fois le Smic, niveau très proche du salaire médian pour l'économie française.
II.1.2. Les heures complémentaires
Selon l'Insee, plus de 17 % des salariés du secteur privé sont à temps partiel. Ils travaillent en moyenne 23 heures par semaine et plus d'un tiers d'entre eux aimerait travailler plus. Selon l'enquête ACEMO, le volume annuel moyen d'heures complémentaires se montait à 43 heures pour les salariés à temps partiel des entreprises de 10 salariés et plus. A l'instar de l'estimation des heures supplémentaires, nous avons retenu un volume d'heures complémentaires rémunérées cohérent avec celui annuel issu du champ des allégements de charges dits « Fillon » et qui s'élève à 120 millions par an, soit 36 heures complémentaires par an et par salariés à temps partiel.
Enfin, les salariés à temps partiel étant, en moyenne, moins bien rémunérés que ceux à temps complet, nous avons retenu un salaire horaire moyen des heures complémentaires de 1,2 fois le Smic.
II.2. Les taux de cotisations employeurs et salariés
Cette mesure propose une exonération des charges salariales ainsi qu'une réduction des cotisations employeurs.
Comme nous le rappelle le tableau 1, les taux de cotisations employeur sont différents selon la taille.
Tableau 1. Taux de cotisations employeur et salarié selon la taille
En %
|
Entrepreneur |
Salarié |
|||||
|
Smic |
1,2 Smic |
1,33 Smic |
>1,6 Smic |
|||
|
CSG |
7.28 |
|||||
|
CRDS |
0.49 |
|||||
|
Sécurité sociale |
30.3 |
30.3 |
30.3 |
30.3 |
7.5 |
|
|
Chômage |
4.15 |
4.15 |
4.15 |
4.15 |
2.4 |
|
|
Retraites complémentaires |
5.7 |
5.7 |
5.7 |
5.7 |
3.8 |
|
|
Autres |
||||||
|
. moins de 20 salariés |
4.73 |
4.73 |
4.73 |
4.73 |
||
|
. plus de 20 salariés |
6.13 |
6.13 |
6.13 |
6.13 |
||
|
Réduction Fillon |
||||||
|
. moins de 20 salariés |
-28.1 |
-15.6 |
-9.5 |
0 |
||
|
. plus de 20 salariés |
-26 |
-14.4 |
-8.8 |
0 |
||
|
Taux cotisation |
21.5 |
|||||
|
. moins de 20 salariés |
44.9 |
44.9 |
44.9 |
44.9 |
||
|
. plus de 20 salariés |
46.3 |
46.3 |
46.3 |
46.3 |
||
|
Taux cotisation après Fillon |
||||||
|
. moins de 20 salariés |
16.8 |
29.3 |
35.4 |
44.9 |
||
|
. plus de 20 salariés |
20.3 |
31.8 |
37.5 |
46.3 |
||
Source : URSAFF
III. Coût pour les finances publiques ex-ante et caeteris paribus 114 ( * )
Nous évaluons ici le coût ex ante de cette mesure, c'est-à-dire sans prendre en compte l'effet du bouclage macroéconomique et en considérant inchangée la durée du travail.
Les calculs qui suivent se basent donc sur un volume annuel d'heures supplémentaires de 900 millions et de 120 millions d'heures complémentaires. Concernant la répartition de ce volume d'heures supplémentaires entre les entreprises de plus ou moins 20 salariés, nous reprenons les résultats de l'enquête ACEMO qui indique que 75 % de ces heures supplémentaires sont effectuées dans les entreprises de moins de 20 salariés. Enfin, nous retenons un salaire horaire moyen de 1,33 Smic pour la rémunération des heures supplémentaires et de 1,2 Smic pour les heures complémentaires.
III.1. Coût lié aux salariés à temps complet...
III.1.1. ... dû aux baisses de charges patronales
D'après nos estimations, le coût lié aux baisses de charges patronales serait au maximum de 340 millions d'euros.
Il se décompose de la manière suivante :
A. Réduction forfaitaire
Le coût pour les finances publiques s'élèverait à 1,115 milliard d'euros par an (1 milliard pour les entreprises de moins de 20 salariés et 115 millions pour les entreprises de plus de 20 salariés).
B. Alignement de la majoration des HS
L'alignement de la majoration des heures supplémentaires au taux de 25 % ne toucherait que les entreprises de moins de 20 salariés et permettrait un supplément de recettes fiscales de 1,4 milliards d'euros par an.
C. Aménagement de l'allégement Fillon
L'aménagement de l'allégement Fillon coûterait 570 millions d'euros aux finances publiques chaque année (345 millions pour les entreprises de moins de 20 salariés et 225 millions pour les entreprises de plus de 20 salariés).
III.1.2. ... dû à l'exonération de charges salariées
Le coût de l'exonération de charges salariales est de 2,4 milliards d'euros par an (1,7 milliard d'euros pour les salariés des entreprises de moins de 20 salariés et 700 millions pour les salariés des entreprises de plus de 20 salariés).
III.1.3. ... dû à la baisse de l'IRPP
Le coût de l'exonération de l'impôt sur le revenu des rémunérations versées au titre des heures supplémentaires effectuées est de 1,4 milliards d'euros par (1 milliard d'euros pour les salariés des entreprises de moins de 20 salariés et 400 millions pour les salariés des entreprises de plus de 20 salariés).
III.2. Coût lié des heures complémentaires...
III.2.1. ... dû aux baisses de charges patronales
Le coût pour les finances publiques s'élèverait à 150 millions d'euros par an (134 millions pour les entreprises de moins de 20 salariés et 16 millions pour les entreprises de plus de 20 salariés).
III.2.2. ... dû à l'exonération de charges salariées
Le coût de l'exonération de charges salariales est de 291 millions d'euros par an (209 millions d'euros pour les salariés des entreprises de moins de 20 salariés et 82 millions pour les salariés des entreprises de plus de 20 salariés).
III.2.3. ... dû à la baisse de l'IRPP
Le coût de l'exonération de l'impôt sur le revenu des rémunérations versées au titre des heures supplémentaires effectuées est de 135 millions d'euros par an.
Le tableau 2 récapitule l'ensemble des coûts pour les finances publiques. Le coût global de la mesure serait alors d'un peu plus de 4,6 milliards d'euros et ce quel que soit le scénario de baisse forfaitaire retenu, dont 500 millions d'euros au titre des heures complémentaires.
Tableau 2. Récapitulatif du coût ex ante de la mesure
En milliard d'euros
|
Salarié à temps... |
.. complet |
... partiel |
Total |
||||
|
Taille de l'entreprise |
< 20 |
> 20 |
< 20 |
> 20 |
|||
|
Charges employeurs |
|||||||
|
Réduction forfaitaire |
1 |
0,115 |
0,134 |
0,016 |
1,265 |
||
|
Alignement majoration |
-1,4 |
- |
- |
- |
-1,4 |
||
|
Aménagement « Fillon » |
0,345 |
0,225 |
- |
- |
0,57 |
||
|
Charges salariales |
1,7 |
0,700 |
0,209 |
0,082 |
2,691 |
||
|
IRPP |
1 |
0,400 |
0,101 |
0,034 |
1,535 |
||
|
Total |
2,645 |
1,440 |
0,444 |
0,132 |
4,661 |
||
Source : Calcul OFCE. Le tableau indique le coût en milliards d'euro par rapport à la situation actuelle des différentes strates de la mesure. Un signe moins indique un gain budgétaire.
IV. Quelles conséquences sur le coût du travail ex-ante et caeteris paribus
Cette mesure aurait différentes implications sur le coût du travail global et sur celui des heures complémentaires et supplémentaires.
Concernant ces dernières, l'impact sur leur coût diffère selon la taille de l'entreprise et le niveau du salaire horaire.
Comme l'illustre le tableau 3, les heures supplémentaires coûteraient moins une fois la mesure adoptée pour les entreprises employant plus de 20 salariés. Toutefois, malgré cette baisse de coût, l'heure supplémentaire coûterait toujours davantage que l'heure normale. A 1,33 Smic, l'heure supplémentaire verrait son coût baisser de 7 à 8% et son surcoût par rapport à l'heure normale ne serait plus de 25% mais de 15 à 16 %.
Pour les entreprises de moins de 20 salariés, le coût lié à l'alignement de la majoration à 25 % des heures supplémentaires serait compensé pour un salaire horaire de 1,28 smic. Au-delà, l'heure supplémentaire coûterait davantage après réforme qu'avant réforme. A 1,33 smic, salaire horaire moyen d'une heure supplémentaire, le surcoût serait de 0,6 % par rapport à la situation actuelle.
Tableau 3. Impact sur les heures supplémentaires et complémentaires
En %
|
Salaire en proportion du Smic |
1 |
1.1 |
1.2 |
1.33 |
2.0 |
|
Surcoût d'1 HS |
|||||
|
Entreprises de < 20 salariés |
-5,2 |
-3,0 |
-1,2 |
0,6 |
8,0 |
|
Entreprises de > 20 salariés |
-11,2 |
-10,3 |
-9,6 |
-7,8 |
-1,7 |
|
Différence de coût entre HS et HN |
|||||
|
Entreprises de < 20 salariés |
2,2 |
5,4 |
7,8 |
10,1 |
18,8 |
|
Entreprises de > 20 salariés |
11,0 |
12,1 |
13,0 |
15,3 |
22,9 |
|
Surcoût d'1 HC |
|||||
|
Entreprises de < 20 salariés |
-15,4 |
-13,2 |
-11,6 |
-10,0 |
-6,2 |
|
Entreprises de > 20 salariés |
-5,0 |
-4,3 |
-3,8 |
-3,3 |
-2,1 |
Source : Calcul OFCE. La première partie du tableau indique la différence de coût entre une heure supplémentaire après la mesure et avant la mesure. Un signe moins signifie qu'une heure supplémentaire coûte moins cher après la mesure. Le deuxième partie du tableau indique après la mesure la différence de coût entre une heure normale et une heure supplémentaire. La dernière partie du tableau est l'équivalent pour les heures complémentaires de la première partie.
Tableau 4. Impact sur le coût du travail
En %
|
Salaire proportion du Smic |
1 |
1.1 |
1.2 |
1.33 |
2.0 |
|
Salarié à temps complet |
|||||
|
Entreprises de < 20 salariés |
-0,2 |
-0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
|
Entreprises de > 20 salariés |
-0,5 |
-0,5 |
-0,4 |
-0,3 |
-0,1 |
|
Salarié à temps partiel |
|||||
|
Entreprises de < 20 salariés |
-1,2 |
-1,1 |
-0,9 |
-0,8 |
-0,5 |
|
Entreprises de > 20 salariés |
-0,4 |
-0,2 |
-0,2 |
-0,2 |
-0,1 |
Source : Calcul OFCE, Le calcul est fait sur la base d'une situation moyenne d'une durée de travail sans heures supplémentaires de 36.3 heures par semaine, et de 1.3 heures supplémentaires par semaine, soit 58 heures supplémentaire par an et par salarié. Sur le temps partiel la durée normale est de 23 heures auxquelles s'ajoutent 2 heures complémentaires par semaine.
S'agissant des heures complémentaires, quel que soit le niveau de salaire de référence ou de la taille de l'entreprise, leur coût baisserait avec la réforme. Et contrairement aux heures supplémentaires, l'heure complémentaire coûterait moins cher qu'une heure normale.
Enfin, comme l'indique le tableau 4, pour les entreprises de plus de 20 salariés, cette mesure permettrait au mieux une baisse du coût du travail de 0,5 % pour les salariés qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel. Pour les entreprises de moins de 20 salariés, la baisse peut atteindre jusqu'à 1,2 % pour leurs salariés à temps partiel. Concernant ceux à temps complet, le coût est très légèrement inférieur jusqu'à 1,2-1,3 smic et supérieur au-delà.
V. Impacts macroéconomiques d'une telle mesure
À partir des éléments discutés dans les parties précédentes, il est possible de construire trois scénarios macroéconomiques.
Dans le premier (scénario A), l'hypothèse est que cette mesure ne sera pas suffisamment incitative pour que les employeurs recourent davantage aux heures supplémentaires. La durée du travail serait donc inchangée. Nous levons cette hypothèse dans le deuxième scénario (scénario B). Ne disposant pas de l'élasticité des heures supplémentaires à leurs coûts, nous supposons que les entreprises vont saturer la contrainte légale des heures supplémentaires (220 heures par an) de leurs salariés qui en effectuaient déjà (37 % des salariés à temps complet). La durée du travail augmenterait alors de 0,8 % pour l'ensemble des salariés. Enfin dans le troisième scénario (scénario C), partant du scénario B, nous introduisons un effet d'offre favorable lié à la hausse de la durée du travail.
Nous évaluons ces scénarios à l'aide du modèle macroéconomique de l'OFCE, e-mod.fr .
|
Encadré : e-mod.fr Estimé dans le cadre fourni par la comptabilité nationale, le modèle trimestriel de l'OFCE, e-mod.fr 115 ( * ) , est centré sur l'étude de l'économie française. Ce modèle permet d'analyser des politiques macroéconomiques, fiscales et budgétaires. Il est également utilisé comme un outil d'analyse de la conjoncture et sert à la prévision à court terme et à la simulation de moyen terme. Il impose un cadre comptable rigoureux et assoit les exercices de prévision sur des équations de comportement. Le secteur productif est décomposé en sept branches (agriculture et agroalimentaire, énergie, produits manufacturés, bâtiment et travaux publics, commerce, services marchands et services non marchands) et cinq agents sont distingués (ménages, sociétés et quasi-sociétés, institutions financières, administrations publiques, reste du monde). Le modèle est construit à partir de l'hypothèse d'un fonctionnement « néo-keynésien » de l'économie. En période de sous-utilisation des capacités de production, la demande globale (consommation, investissement, variations de stocks, exportations) contraint l'offre et détermine à court terme la production. Cependant, ce modèle de demande est tempéré par le fait que le niveau de la production rétroagit sur les prix et par ricochet sur les comportements de demande. Une baisse de la production réduit l'emploi, si bien que le nombre de chômeurs augmente. Le taux d'utilisation des capacités de production diminue. Le relâchement des tensions sur le marché du travail et des biens et services diminue les coûts de production et donc les prix, ce qui tend à restaurer la demande. Les conditions de l'offre jouent à court terme sur le commerce extérieur, via la compétitivité et les tensions sur les capacités de production, et, sur la consommation, via l'inflation. La dynamique prend en compte les comportements de stockage. Enfin, à moyen terme, le modèle retrouve une dynamique plus classique, avec un état stationnaire réglé par un chômage d'équilibre. |
V.1. Impacts macroéconomiques de la défiscalisation des heures supplémentaires sans augmentation de la durée du travail
Les principaux résultats de ce scénario, résumés dans le tableau 5, sont les suivants :
A l'horizon de 5 ans, cette mesure permet un supplément de croissance de 0,3 % grâce à un soutien de la demande intérieure. La consommation des ménages serait stimulée par un revenu plus dynamique. Une partie de ce supplément de revenu serait épargnée par les ménages - le taux d'épargne augmenterait de 0,1 point -, l'autre serait consommée. Ce surcroît de consommation serait en partie capté par l'extérieur - augmentation des importations de 0,6 % -, l'autre stimulerait l'activité et l'investissement des entreprises en retour - augmentation de 0,7 %-.
Cette mesure, via son impact expansionniste et la très légère baisse de coût du travail, permettrait de créer près de 73 000 emplois à l'horizon de 5 ans, ce qui représente une baisse de 0,3 point du taux de chômage.
Un supplément d'inflation est à attendre d'une telle mesure (augmentation des prix de consommation de 0,7 % à l'horizon de 5 ans), qui ne remettrait pas en cause l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages mais viendrait dégrader la compétitivité de l'économie française (baisse des exportations de 0,2 %).
L'impact expansionniste ne permettrait pas de financer cette mesure. Le déficit des administrations publiques (APU) s'aggraverait de 0,2 point de PIB à l'horizon de 5 ans.
Tableau 5 : Impact de la défiscalisation des heures supplémentaires
(Scénario A)
|
En écart au compte central, en % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
PIB total en volume |
0.2 |
0.2 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.4 |
|
Importations |
0.5 |
0.5 |
0.6 |
0.8 |
0.6 |
0.9 |
|
Dépenses des ménages |
0.4 |
0.5 |
0.6 |
0.8 |
0.6 |
0.9 |
|
Dépenses des administrations |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Investissement des entreprises |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.7 |
0.7 |
1.2 |
|
Exportations |
0.0 |
0.0 |
-0.1 |
-0.1 |
-0.2 |
-0.3 |
|
Contributions à la croissance |
||||||
|
Variations de stocks |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Demande intérieure |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.6 |
0.5 |
0.7 |
|
Solde extérieur |
-0.1 |
-0.2 |
-0.2 |
-0.3 |
-0.2 |
-0.4 |
|
Prix de la consommation |
0.0 |
0.1 |
0.2 |
0.4 |
0.7 |
1.2 |
|
Prix du PIB |
0.0 |
0.0 |
0.2 |
0.4 |
0.7 |
1.2 |
|
Salaire horaire réel |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|
Revenu des ménages |
0.6 |
0.6 |
0.7 |
0.8 |
0.7 |
0.9 |
|
Productivité par tête, marchand |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-0.1 |
-0.1 |
|
Productivité horaire, marchand |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-0.1 |
-0.1 |
|
Durée du travail |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Effectifs totaux (en milliers) |
9 |
34 |
50 |
66 |
73 |
81 |
|
Effectifs totaux (en %) |
0.0 |
0.1 |
0.2 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
|
Taux de chômage BIT (en point) |
0.0 |
-0.1 |
-0.2 |
-0.2 |
-0.3 |
-0.3 |
|
Capacité de fin. (en point de PIB) |
||||||
|
Sociétés non financières |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Sociétés financières |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
APU |
-0.2 |
-0.2 |
-0.2 |
-0.2 |
-0.2 |
-0.3 |
|
Ménages et EI |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
0.0 |
|
ISBLSM |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Extérieur |
-0.1 |
-0.1 |
-0.1 |
-0.2 |
-0.1 |
-0.3 |
|
Taux d'épargne des ménages |
0.2 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
|
Taux de marge des SNF |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Sources : Comptes trimestriels, INSEE, calculs auteurs
V.2. Impacts macroéconomiques de la défiscalisation des heures supplémentaires avec augmentation de la durée du travail
La défiscalisation des heures supplémentaires poursuit trois objectifs : accroître le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent, réduire le coût du travail et inciter à une durée du travail plus longue. Si les deux premiers objectifs semblent être atteints, le dernier est moins évident dans la mesure où le coût de l'heure supplémentaire reste, quel que soit le cas de figure étudié, supérieur à celui de l'heure normale.
Contrairement au scénario précédent, nous faisons maintenant l'hypothèse que les entreprises auront davantage recours aux heures supplémentaires. Nous supposons que les entreprises vont saturer la contrainte légale des heures supplémentaires (220 heures par an) de leurs salariés qui en effectuaient déjà (37 % des salariés à temps complet). La durée du travail augmenterait alors de 0,8 % pour l'ensemble des salariés.
Sous cette nouvelle hypothèse, l'impact sur l'emploi devient ambigu. En effet, des effets de sens contraire se superposent :
Le premier, déjà décrit dans le premier scénario, est positif et relatif à la baisse du coût du travail et à la hausse du pouvoir d'achat des salariés. A cela s'ajoute un nouvel effet positif : face à la baisse du coût des heures supplémentaires, les entreprises seraient incitées à augmenter le temps de travail des salariés en place, en particulier dans les secteurs où le recrutement de la main-d'oeuvre connaît des tensions (bâtiment, hôtellerie ou santé). La rémunération et la défiscalisation de ces heures supplémentaires permettraient une augmentation du pouvoir d'achat irriguant l'ensemble de l'économie avec un effet positif sur l'emploi.
Le deuxième est négatif pour l'emploi : en abaissant le coût d'une heure supplémentaire, cela incite les entrepreneurs à allonger la durée du travail, favorisant alors la situation des insiders (salariés) au détriment de celle des outsiders (les chômeurs). Cela engendre une augmentation de la productivité par tête des salariés français, positive pour la croissance potentielle de l'économie française, mais défavorable à court terme à l'emploi.
A l'horizon de 5 ans, le deuxième effet continuerait de l'emporter sur le premier. Si cette mesure permet bien un supplément d'activité - 0,4 % -, la hausse induite de la productivité du travail lui serait supérieure (0,6 %). Cela engendrerait une baisse de l'emploi de 0,2 % et une hausse du chômage de 0,2 point. A l'instar du premier scénario, le supplément de croissance ne permettrait pas à cette mesure d'être financée. Le déficit s'aggraverait de 0,3 point de PIB.
Tableau 6 : Impact de la défiscalisation des heures supplémentaires
(Scénario B)
|
En écart au compte central, en % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
PIB total en volume |
0.1 |
0.2 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.5 |
|
Importations |
0.2 |
0.3 |
0.6 |
0.7 |
0.7 |
0.8 |
|
Dépenses des ménages |
0.2 |
0.3 |
0.6 |
0.7 |
0.7 |
0.8 |
|
Dépenses des administrations |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
|
Investissement des entreprises |
0.1 |
0.2 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
0.8 |
|
Exportations |
0.0 |
0.1 |
0.1 |
0.2 |
0.3 |
0.3 |
|
Contributions à la croissance |
||||||
|
Variations de stocks |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
|
Demande intérieure |
0.1 |
0.2 |
0.5 |
0.6 |
0.6 |
0.7 |
|
Solde extérieur |
0.0 |
-0.1 |
-0.1 |
-0.1 |
-0.1 |
-0.2 |
|
Prix de la consommation |
-0.1 |
-0.3 |
-0.6 |
-0.9 |
-1.0 |
-1.1 |
|
Prix du PIB |
-0.1 |
-0.4 |
-0.7 |
-1.0 |
-1.0 |
-1.2 |
|
Salaire horaire réel |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-0.1 |
-0.1 |
|
Revenu des ménages |
0.4 |
0.6 |
0.8 |
0.9 |
0.9 |
1.0 |
|
Productivité par tête, marchand |
0.6 |
0.8 |
0.8 |
0.7 |
0.6 |
0.6 |
|
Productivité horaire, marchand |
0.0 |
0.0 |
0.1 |
0.0 |
-0.1 |
-0.2 |
|
Durée du travail |
0.6 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
|
Effectifs totaux (en milliers) |
-104 |
-113 |
-84 |
-54 |
-38 |
-19 |
|
Effectifs totaux (en %) |
-0.4 |
-0.5 |
-0.3 |
-0.2 |
-0.2 |
-0.1 |
|
Taux de chômage BIT (en point) |
0.4 |
0.4 |
0.3 |
0.2 |
0.1 |
0.1 |
|
Capacité de fin. (en point de PIB) |
||||||
|
Sociétés non financières |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Sociétés financières |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
APU |
-0.2 |
-0.3 |
-0.3 |
-0.3 |
-0.3 |
-0.3 |
|
Ménages et EI |
0.2 |
0.2 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
|
ISBLSM |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Extérieur |
-0.1 |
-0.1 |
-0.2 |
-0.2 |
-0.2 |
-0.1 |
|
Taux d'épargne des ménages |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|
Taux de marge des SNF |
0.0 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
Sources : Comptes trimestriels, INSEE, calculs auteurs
Bien entendu, d'autres hypothèses sur l'incitation à l'augmentation de la durée du travail peuvent être envisagées. Le tableau 7 fait la synthèse des principaux résultats.
Tableau 7 : Différentes hypothèses sur l'augmentation de la durée du travail
|
PIB |
Emploi (milliers) |
Chômage |
Déficit (milliards) |
|
|
h = 0,8 % |
0,4 |
-38 |
0,1 |
-3,8 |
|
h = 1,6 % |
0,5 |
-157 |
0,6 |
-5,1 |
|
h = 2,0 % |
0,6 |
-231 |
0,8 |
-5,9 |
|
h = 3,0 % |
0,7 |
-383 |
1,4 |
-7,7 |
Sources : Comptes trimestriels, INSEE, calculs auteurs
V.I1I. Impacts macroéconomiques de la défiscalisation des heures supplémentaires avec augmentation de la durée du travail et effet d'offre
Les principaux résultats de ce scénario, résumés dans le tableau 8, sont les suivants :
Nous supposons ici que la hausse de la durée du travail donne un supplément de flexibilité aux entreprises, ce qui leur permet de gagner en compétitivité. La principale différence avec les résultats obtenus dans le scénario B se situe au des performances à l'exportation.
Tableau 8 : Impact de la défiscalisation des heures supplémentaires
(Scénario C)
|
En écart au compte central, en % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
PIB total en volume |
0.2 |
0.4 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
0.7 |
|
Importations |
0.5 |
0.8 |
1.0 |
1.1 |
1.0 |
1.3 |
|
Dépenses des ménages |
0.4 |
0.6 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.2 |
|
Dépenses des administrations |
0.0 |
0.0 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
|
Investissement des entreprises |
0.3 |
0.5 |
0.8 |
0.9 |
1.0 |
1.3 |
|
Exportations |
0.2 |
0.3 |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.5 |
|
Contributions à la croissance |
||||||
|
Variations de stocks |
0.0 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
|
Demande intérieure |
0.3 |
0.5 |
0.7 |
0.8 |
0.8 |
1.0 |
|
Solde extérieur |
-0.1 |
-0.1 |
-0.2 |
-0.2 |
-0.1 |
-0.3 |
|
Prix de la consommation |
-0.1 |
-0.4 |
-0.6 |
-0.8 |
-0.9 |
-0.9 |
|
Prix du PIB |
-0.1 |
-0.5 |
-0.7 |
-0.9 |
-0.9 |
-0.9 |
|
Salaire horaire réel |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
|
Revenu des ménages |
0.5 |
0.7 |
0.9 |
1.0 |
1.0 |
1.1 |
|
Productivité par tête, marchand |
0.7 |
0.9 |
0.9 |
0.8 |
0.7 |
0.7 |
|
Productivité horaire, marchand |
0.2 |
0.1 |
0.2 |
0.0 |
-0.1 |
-0.1 |
|
Durée du travail |
0.6 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
|
Effectifs totaux (en milliers) |
-100 |
-98 |
-63 |
-30 |
-12 |
13 |
|
Effectifs totaux (en %) |
-0.4 |
-0.4 |
-0.3 |
-0.1 |
0.0 |
0.1 |
|
Taux de chômage BIT (en point) |
0.4 |
0.4 |
0.2 |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
|
Capacité de fin. (en point de PIB) |
||||||
|
Sociétés non financières |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Sociétés financières |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
APU |
-0.2 |
-0.2 |
-0.2 |
-0.2 |
-0.1 |
-0.1 |
|
Ménages et EI |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ISBLSM |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Extérieur |
-0.1 |
-0.2 |
-0.2 |
-0.2 |
-0.1 |
-0.2 |
|
Taux d'épargne des ménages |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Taux de marge des SNF |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
Sources : Comptes trimestriels, INSEE, calculs auteurs
* 1 « Placer l'évaluation des politiques publiques au coeur de la réforme de l'Etat ». Rapport n° 392 (2003-2004) du 30 juin 2004. Sénat. Délégation pour la Planification. MM. Joël Bourdin, Pierre André et Jean-Pierre Plancade.
* 2 La coordination entre les politiques budgétaires et la politique monétaire est quant à elle, de facto, inexistante.
* 3 Comme l'illustrera ce rapport d'information.
* 4 Part des investissements dans la valeur ajoutée.
* 5 Households signifie « ménages » en anglais.
* 6 Les « subprime » désignent les prêts consentis aux emprunteurs qui n'offrent pas les garanties suffisantes pour bénéficier du taux d'intérêt le plus avantageux ( prime rate ).
* 7 Au quatrième trimestre de l'année 2006, les retards de paiement de la part des ménages figurant dans catégorie « subprime » ont atteint le taux de 13,3 % ; en avril 2007, Fannie Mae et Freddie Mac, les deux plus grosses sociétés de prêts immobiliers aux Etats-Unis, ont proposé d'allonger de trente à quarante ans les remboursements des prêts, pour limiter le nombre de défaillances d'emprunteurs.
* 8 Les actifs (créances commerciales et flux futurs : loyers, redevances et, en particulier, remboursements de crédit) sont « titrisés » lorsqu'ils sont cédés à une structure ad hoc qui émet des titres de créance représentatifs de ces actifs ; il s'agit soit de titres à court terme, les ABCP (asset backed commercial paper), soit de titres à moyen ou long terme, les ABS (asset backed securities).
* 9 Il est cependant peu douteux que certaines restructurations auront lieu dans le secteur bancaire.
* 10 Voir en particulier : le rapport d'information n° 105 (2005-2006), de MM. Joseph Kergueris et Claude Saunier, sur « La hausse des prix du pétrole : une fatalité ou le retour du politique » et le rapport d'information n° 97 (2005-2006), de M. Joël Bourdin, sur « Renouer avec les bénéfices de la croissance ».
* 11 L'indice des prix est basé sur un panier de consommation type ; il ne saurait donc décrire la réalité de l'évolution des prix pour les différents profils de consommateurs. Dans cette perspective, l'INSEE a récemment proposé de construire différents indices de prix catégoriels (selon l'âge, le revenu, la zone d'habitation...).
* 12 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi du 17 janvier 2003.
* 13 La loi de réduction du temps de travail du 19 janvier 2000 a créé les « garanties mensuelles de rémunération » (GMR), destinées aux salariés passés aux 35 heures. La mise en place du système des GMR avait pour objectifs de maintenir le niveau de la rémunération mensuelle des salariés payés au niveau du SMIC lors du passage aux 35 heures, et d'assurer ensuite une progression mesurée de leur pouvoir d'achat.
* 14 Le SMIC est revalorisé chaque année, au 1 er juillet, de telle sorte que l'accroissement annuel du pouvoir d'achat du SMIC ne soit pas inférieur à la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat des salaires horaires moyens des ouvriers. En outre, lorsque l'indice national des prix à la consommation (hors tabac) atteint un niveau supérieur d'au moins 2 % à l'indice constaté lors de l'établissement de la valeur immédiatement antérieure, le SMIC est revalorisé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice donnant lieu au relèvement. Ainsi, l'inflation constitue le plancher d'indexation du SMIC en l'absence d'évolution plus favorable du pouvoir d'achat du salaire moyen ouvrier.
* 15 La proportion de salariés payés au niveau du SMIC est passée de 8,1 % à 15,1 % entre 1991 et 2006 ; à cette date, selon l'INSEE, 27 % des salariés à temps complet du privé et du semi-public, touchaient moins de 1,3 fois le SMIC.
* 16 22,7 milliards en 2008 hors mesure « heures supplémentaires ».
* 17 D'après le gouvernement, un projet de loi, présenté au printemps 2008, conditionnerait les exonérations de cotisations sociales à une politique salariale dynamique, tout en modifiant le mode et le calendrier de revalorisation du salaire minimum.
* 18 Projection utilisant le modèle e-mod.fr. de l'OFCE.
* 19 Un supplément d'inflation est à attendre (augmentation des prix de consommation de 0,7 % à l'horizon de 5 ans) ; sans remettre en cause l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages, il viendrait dégrader la compétitivité de l'économie française au même horizon (baisse des exportations de 0,2 %).
* 20 L'OFCE produit un troisième scénario retenant l'hypothèse selon laquelle la hausse de la durée du travail procurerait un supplément de flexibilité aux entreprises leur permettant de gagner en compétitivité. La principale différence avec les résultats obtenus dans le deuxième scénario se situe au niveau des performances à l'exportation (cf. tableau n° 8 de l'annexe OFCE portant sur la défiscalisation des heures supplémentaires).
* 21 Elle s'avèrerait même, dans un premier temps, défavorable à l'emploi (voir document en annexe).
* 22 L'évolution du RDB en 2007 enregistre notamment la contribution positive de la réforme de l'impôt sur le revenu.
* 23 Rapport n° 6 (2005-2006) de M. Philippe MARINI, au nom de la commission des finances : « Les perspectives du marché immobilier et son contexte macroéconomique », 5 octobre 2005.
* 24 Rapport n° 261 (2005-2006) de M. Joël BOURDIN, au nom de la délégation du Sénat pour la planification : « L'accès des ménages au crédit en France », 16 mars 2006.
* 25 Formation brute de capital fixe. La FBCF désigne l'investissement dans la Comptabilité nationale.
* 26 FBCF exprimée en % de la valeur ajoutée (VA) des sociétés non financières (SNF). Le taux d'investissement des entreprises représente la part de la richesse créée par elles, affectée à l'acquisition des moyens de production durables (bâtiments, équipements...).
* 27 On nomme impulsion budgétaire la variation du solde structurel primaire d'une année sur l'autre. Elle représente la partie discrétionnaire de la politique budgétaire.
* 28 A plus long terme, si l'on admet qu'il existe un lien entre gains de productivité et accumulation de l'investissement, un effet de compétitivité positif est susceptible de s'enclencher, ce qui est favorable à une contribution positive du commerce extérieur.
* 29 Albert Aftalion (1874-1956) a montré que si la technique de production est fixe (pour produire N fois plus, il faut N fois plus d'équipements), toute variation de la demande entraîne mécaniquement une variation de la FBCF plus fortes que les variations initiales de la demande de produits.
* 30 Le taux d'endettement est le rapport de l'endettement obligataire et bancaire aux fonds propres, ces derniers étant le capital apporté par les actionnaires et les profits mis en réserve
* 31 La structure financière de l'entreprise est le résultat des comportements d'endettement antérieurs.
* 32 De 1973 à 1998, le taux nominal est celui fixé par la Bundesbank. Le taux directeur de la BCE est utilisé à partir de 1999. L'inflation de la zone euro est retenue pour le calcul du taux d'intérêt réel.
* 33 Aujourd'hui, les anticipations de réduction du différentiel de taux court avec les Etats-Unis sont responsables de l'appréciation continue de l'euro face au dollar.
* 34 Les IDE entrant en France représentent 15,5 % de la formation brute de capital fixe . Les 18.000 filiales des sociétés étrangères implantées en France créent 17 % de la valeur ajoutée totale du pays et emploient 1,9 millions de personnes (soit un salarié sur 7).
* 35 Elle a accueilli 9 % du total des flux d'IDE dans l'OCDE, derrière les Etats-Unis (20 %) et le Royaume-Uni (15 %).
* 36 D'après le rapport de l'OCDE : « Trends and recent developpments in foreign direct investment » du 21 juin 2007. Trois catégories d'IDE sont identifiés : capital social (quote-part du capital social détenu à partir d'un investissement nouveau, d'un rachat de société...), bénéfices réinvestis (les bénéfices ou pertes des entreprises affiliées sont pour partie incorporés à leur capital social sous la forme de réserves, qui constituent les bénéfices réinvestis) et autres opérations (flux bilatéraux de prêts entre l'investisseur et la société affiliée ou des mouvements financiers entre sociétés affiliées).
* 37 La « Stratégie de Lisbonne » offre une illustration européenne de ce « dilemme » :
- elle met l'accent sur l'innovation, la recherche et l'enseignement supérieur, et sur la relation positive : innovation-productivité-croissance potentielle-niveau de vie ;
- mais, elle met aussi l'accent sur la compétitivité donc sur la maîtrise des coûts salariaux (qui évolueraient donc moins vite que la productivité) afin de permettre à la fois de protéger l'emploi non qualifié et d'améliorer les positions européennes sur les marchés mondiaux.
* 38 L'hypothèse de productivité posée ici est inférieure à celle que retient la programmation du Gouvernement (qui n'est pas tendancielle). Le tableau fait apparaître une progression de 1 % dans le secteur marchand, mais elle se combine à une baisse de l'emploi dans le secteur non marchand.
* 39 Sur la période 1995-2005, la réduction de la durée du travail a eu un fort impact sur la productivité du travail : la productivité horaire a ainsi progressé de 1,7 % par an mais la durée du travail a baissé de 0,7 % par an (sous l'effet des « 35 heures » et aussi du développement du travail à temps partiel), de sorte que la productivité du travail, combinaison de l'évolution de la productivité horaire et de la durée du travail, a progressé d'à peine 1 % par an.
* 40 Cf. premier encadré du chapitre VII pour une définition de cette notion.
* 41 Si la croissance est de 3 %, l'augmentation de la dépense publique de 2 % et que les dépenses publiques représentent 50 % du PIB, la réduction du déficit structurel est équivalente à 0,5 % du PIB.
* 42 Dans les projections de croissance potentielle du scénario central, les gains annuels de productivité du travail sont de 1,7 % contre 1,8 % dans les projections du COR sous l'effet de l'augmentation plus rapide de la population active mais également de son vieillissement.
* 43 Le taux d'emploi est la proportion de personnes disposant d'un emploi parmi celles en âge de travailler (15 à 64 ans). Le taux d'emploi reflète la capacité d'une économie à utiliser ses ressources en main-d'oeuvre. Il convient de distinguer la population en âge de travailler de la population active, qui, regroupant la population ayant un emploi et les chômeurs, recouvre les individus présents sur le marché du travail.
* 44 Le « document pour l'Eurogroupe » précité, souligne qu'« une concurrence accrue incite les entreprises à être plus efficaces et à réduire leur taux de marge. La baisse des prix qui en résulte stimule le pouvoir d'achat des ménages. L'augmentation induite de la demande soutient l'emploi ».
* 45 Etudes citées par le Gouvernement dans le « document pour l'Eurogroupe » (supra).
* 46 Nicoletti, G. et S. Scarpetta, « Regulation, productivity and growth: OECD evidence », Economic Policy, avril 2003. Etude citée par Cahuc, Kramarz et Zylberberg, « Les ennemis de la concurrence et de l'emploi », Commentaire, n° 114, juillet 2006.
* 47 Le Président de la République a demandé à M. Jacques Attali de présider une Commission en charge de l'identification des « freins à la croissance ». Cette commission a débuté ses travaux le 30 août 2007. Elle a fait une première série de propositions au mois d'octobre et rendra prochainement ses conclusions et ses propositions.
* 48 Néanmoins, ainsi que montrent des estimations convergentes (notamment : « Les évolutions de la productivité structurelle du travail dans les principaux pays industrialisés », par Renaud BOURLÈS et Gilbert CETTE, dans le Bulletin de la Banque de France n° 150, juin 2006), une augmentation de 1 % de la durée du travail n'entraîne pas une augmentation équivalente de la productivité du travail. Elle se traduit, en effet, par une baisse de 0,4 % de la productivité horaire. Le gain de productivité du travail imputable à l'augmentation de la durée du travail n'est donc in fine que de 0,6 %.
* 49 « Document pour l'Eurogroupe » du 14 septembre 2007.
* 50 En particulier, le Président de la République a annoncé une réflexion générale sur une réforme de la taxe professionnelle. Par ailleurs, une « revue générale des prélèvements obligatoires » (RGPO) devrait fournir prochainement les bases d'une réforme du système fiscal français propre à le rendre « plus efficace et plus favorable à l'emploi ».
* 51 OSEO a pour mission de financer et d'accompagner les PME, en partenariat avec les banques et les organismes de capital-investissement, dans les phases les plus décisives du cycle de vie des entreprises.
* 52 Bulletin de la Banque de France, septembre 2007.
* 53 Rapport d'information Sénat n° 391, 2003-2004, de M. Joël BOURDIN, au nom de la Délégation du Sénat pour la Planification.
* 54 Une partie de l'échec de la stratégie de Lisbonne, à l'échelle européenne, et notamment pour l'objectif d'augmentation des dépenses de recherche jusqu'à 3 % du PIB, peut ainsi s'expliquer par l'incapacité des autorités européennes - politique et monétaire - à créer l'environnement macroéconomique favorable qui permettra de surmonter les tensions transitoires provoquées par une stratégie d'investissement massif dans la recherche.
* 55 Cette étude est périodique ; instaurée en 1995, elle est menée tous les 5 ans.
* 56 Si les comparaisons internationales de productivité sont fragilisées par certains biais inhérents aux méthodes d'expression unifiée du PIB, la médiocre fiabilité des statistiques sur la durée du travail ajoute un volant d'incertitude supplémentaire pour ce qui concerne les comparaisons internationales de productivité horaire .
* 57 Les chiffres de base sont exprimés en standards de pouvoir d'achat (SPA), c'est-à-dire dans une monnaie commune tendant à éliminer les différences de niveaux de prix entre les pays, et permettant ainsi des comparaisons du PIB en volume entre les pays aussi significatives que possible.
* 58 Révision annuelle des comptes nationaux du Bureau of Economics Analysis de juillet 2007.
* 59 Notamment aux Pays-Bas avec le développement du temps partiel ou en Allemagne avec les réformes « Hartz ».
* 60 Des historiens de l'économie américaine ont souligné que la relative pénurie de main-d'oeuvre à la fin du XIXe siècle a contribué à ce que les États-Unis devancent la Grande-Bretagne en matière d'innovations technologiques (Duggan E.-P., « Machines, Markets, and Labor: The Carriage and Wagon Industry in Late-Nineteenth-Century Cincinnati », The Business History Review, vol. 51, n° 3, automne 1977). Le centre d'analyse stratégique s'interroge sur un éventuel impact positif du vieillissement sur la dynamique d'innovation au Japon (note de veille n° 77 du 5 octobre 2007).
* 61 Cette question est traitée dans le chapitre IX du présent rapport, consacré à la politique monétaire.
* 62 La balance des transactions courantes décrit les échanges de biens et services et les flux de revenus entre la France et l'étranger.
* 63 L'excédent touristique, en particulier, atteint 12 milliards et se rapproche de l'excédent de 14 milliards enregistré en 2000. À l'inverse, les « autres services » enregistrent une poussée des importations en 2006 : globalement à l'équilibre de 2002 à 2005, leur solde est déficitaire de presque 4 milliards en 2006 (source : Banque de France).
* 64 L'Espagne, par exemple, dont le déficit extérieur atteint près de 10 % du PIB, mais qui bénéficie d'un excédent budgétaire, pourrait ainsi diminuer la fiscalité à la charge des entreprises pour améliorer sa compétitivité.
* 65 « Évolution récente du commerce extérieur français », Rapport de MM. Patrick Artus et Lionel Fontagné, Conseil d'analyse économique (2006).
* 66 « Analyse descriptive du décrochage récent des exportations françaises », Hervé Boulhol et Laure Maillard (Ixis CIB), complément D du rapport précité du CAE.
* 67 Rapport Sénat n°6, session 2005-2006, de M. Philippe Marini, au nom de la Commission de Finances.
* 68 C'est-à-dire l'annuité de remboursement de crédit logement pour un nouvel accédant rapportée au revenu moyen (avec une hypothèse de surface standard).
* 69 A propos des divergences et complémentarités existant entre les deux principaux outils de mesure des prix de l'immobilier ancien, voir « La mesure des prix immobiliers : de nombreuses sources, diversement exploitées », Note de la Délégation pour la Planification du Sénat (septembre 2007).
* 70 Hors terrains, la formation brute de capital fixe (FBCF) en logements s'est accrue de 4,9 % en volume en 2005, soit un rythme supérieur à 2004 (4,4 %). Pour les seuls logements neufs, cette FBCF a progressé de 9 % en volume en 2005 (7,8 % en 2004). La formation brute de capital fixe en logement comprend les acquisitions de logements neufs (hors valeur des terrains), les travaux d'amélioration et de gros entretien, les acquisitions de logements d'occasion nettes des cessions de ces mêmes logements (hors terrain d'assiette) et l'ensemble des frais et droits inhérents à ces opérations (source : Comptes du Logement, Edition 2007, DAEI/SESP et DGUHC). Elle ne retrace pas les achats de logements anciens.
* 71 A ce sujet voir le rapport d'information sur « L'accès des ménages au crédit en France », n° 261 (2005-2006) de M. Joël Bourdin au nom de la délégation pour la Planification.
* 72 Source : Crédit Logement/CSA (Observatoire du financement des marchés résidentiels).
* 73 A ce sujet voir le rapport d'information sur « L'accès des ménages au crédit en France » (op. cit.)
* 74 « Housing markets, wealth and the business cycle », Document de travail du département des affaires économiques de l'OCDE, n° 394 (2004).
* 75 Cf. Rapport Sénat, n° 6, 2005-2006, de Monsieur Philippe MARINI, au nom de la Commission des Finances.
* 76 Ce qui signifie que le taux de croissance annuel serait inférieur de 0,3 point par an environ.
* 77 Le Pacte de stabilité et de croissance pousse d'ailleurs plus loin la logique qui lui est sous-jacente puisque dans des conditions qu'il faut reconnaître ambiguës, il comporte des règles qui, pour certaines, obligent les Etats à renoncer à financer leurs interventions par l'appel public à l'épargne.
* 78 Cela signifie qu'une hausse nominale de 1 % de l'activité se traduit par une hausse de 1 % des recettes publiques.
* 79 En théorie, cet élargissement ne signifie pas a priori que ces deux catégories de prélèvements sur recettes devraient être stabilisées en volume, mais seulement que l'estimation de la règle de progression des dépenses de l'Etat sera conduite en tenant compte de la variation des prélèvements en question.
* 80 Il y a là, à la fois, une condition de compatibilité entre la politique budgétaire décrite et le scénario économique qui l'accompagne et une justification implicite d'une politique budgétaire, qui sans ce ressaut de croissance, apparaîtrait excessivement restrictive.
* 81 Dans le « scénario central », on s'était « calé » sur la programmation des finances publiques associée au projet de loi de finances pour 2007 qui était construite sur des hypothèses analogues à celles posées cette année (l'impulsion budgétaire y était toutefois légèrement plus négative, de 0,2 point dans chacun des deux scénarios alors présentés) ; dans le « scénario tendanciel », les dépenses publiques augmentaient comme la croissance potentielle ; dans le « scénario alternatif », la dette publique était stabilisée à 60 points de PIB (alors qu'elle se réduisait continûment dans le scénario central au-dessous de cette valeur).
* 82 Décrit dans le scénario dit « bas ».
* 83 Et même de 1,4 % si la croissance potentielle ne se redressait pas par rapport à ses tendances actuelles.
* 84 Du point de vue macroéconomique, ces ressources ne sont évidement pas gratuites puisque la dette publique est contractée moyennant le paiement d'intérêts. Ainsi, la baisse de la dette publique qui accompagne la réduction du déficit public procure une économie d'intérêts. Mais, pour que celle-ci bénéficie aux agents privés, il faut qu'elle leur soit restituée, ce que ne prévoit pas la programmation des finances publiques.
* 85 Face à la récente crise des « subprime », la BCE a maintenu inchangé son taux d'intervention, contrairement à ce qui semblaient être ses intentions initiales.
* 86 Du moins à la croissance économique potentielle telle qu'estimée dans le document.
* 87 La diminution des dépenses publiques n'est pas « restituée » aux agents privés sous forme de baisse des prélèvements obligatoires.
* 88 Techniquement, il s'agit d'identifier à quel niveau de capacité de financement, il conviendrait de se situer à court terme pour que la dette publique soit respectueuse du plafond de 60 points de PIB à long terme.
* 89 On rappelle que le solde public primaire est égal aux recettes moins les dépenses publiques hors charges d'intérêt.
* 90 Ce dernier point a été largement développé par votre Délégation dans son dernier rapport consacré aux perspectives économiques et des finances publiques à moyen terme (2007-2011). Rapport d'information n° 89 (2006-2007).
* 91 Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992 ; il prévoyait, outre les modalités transitoire du passage à la monnaie unique, l'organisation de la gouvernance monétaire une fois l'union monétaire réalisée, le 1 er janvier 2002.
* 92 Cet objectif est plus précisément confié au SEBC (système européen de banque centrale), composé de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales. Les organes de décision de la BCE dirigent le SEBC.
* 93 En vertu duquel ni la BCE ni une banque centrale nationale ne peuvent solliciter ni accepter des instructions de la part des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des Etats membres ou de tout autre organisme.
* 94 De M3 (qui rassemble l'argent disponible immédiatement ou à très court terme pour l'achat de biens) à ses composantes et ses contreparties, en particulier l'encours des crédits.
* 95 Voir note supra.
* 96 La politique de réserves obligatoires, qui sont déposées auprès de la banque centrale selon un pourcentage des dépôts inscrits au bilan des banques commerciales, a perdu de son impact depuis le début des années quatre-vingt dix. Elle demeure néanmoins en vigueur dans le cadre de l'eurosystème.
* 97 C'est-à-dire de prêts gagés.
* 98 Euro OverNight Index Average. L'Eonia est la moyenne, pondérée par les montants, des taux effectivement traités sur le marché monétaire interbancaire de l'euro pendant la journée par un large échantillon de grandes banques, pour les dépôts/prêts jusqu'au lendemain ouvré.
* 99 Euro interbank offered rate. L'Euribor est calculé en effectuant une moyenne quotidienne des taux prêteurs sur 13 échéances communiqués par un échantillon de 57 établissements bancaires les plus actifs de la zone Euro.
* 100 Lettre de l'OFCE n° 278 du 7 décembre 2006.
* 101 Certains auteurs doutent même que ce lien soit pertinent en période de faible inflation : cf. P. De Grauwe et M. Polan, 2005 : « Is inflation always and everywhere a monetary phenomenon ? », Scandanivian Journal of Economics 107(2) p. 239-259.
* 102 Revue de l'OFCE n°100, janvier 2007.
* 103 Avec un impact négatif sur la croissance française de l'ordre de -0,7 point de PIB.
* 104 Sous l'hypothèse d'une stabilisation du cours du pétrole à 67 dollars le baril.
* 105 Cette note a été rédigée par Eric Heyer et Mathieu Plane, département analyse et prévision, OFCE.
* 106 Pour plus de détails se référer à Heyer Eric : « La défiscalisation des heures supplémentaires : quels impacts micro et macro-économique ».
* 107 Pour plus de détails, se référer au Rapport économique, social et financier (2007), tome 1, pages 88-93.
* 108 Cette partie reprend la synthèse rédigée sous la direction de Xavier Timbeau (2007), « La peur au ventre », Revue de l'OFCE , n°103, octobre.
* 109 Par exemple, Ben Bernanke avait fin juillet évalué les pertes potentielles entre 50 et 100 milliards de dollars. Le FMI dans des déclarations au cours du mois de septembre 2007 a porté l'évaluation à 170 milliards. Il est impossible d'évaluer la répartition de ces pertes entre les ménages endettés, les banques impliquées directement dans les prêts risqués, les investisseurs institutionnels ou privés qui ont pris des risques à travers des hedge funds ou des produits dérivés.
* 110 Cette estimation est à prix chaînés. A prix constants de l'année 2000, la croissance pour 2007 serait de 2,1 %.
* 111 Pour un détail sur les mesures du paquet fiscal, voir la lettre de l'OFCE n° 288 « le choc fiscal tiendra t-il ses promesses ? », E.Heyer, M.Plane et X.Timbeau, juillet 2007.
* 112 Cette note a été rédigée par Eric Heyer, Département Analyse et Prévision, OFCE.
* 113 Cette non prise en compte des petites entreprises est préjudiciable pour le sujet qui nous intéresse ici dans la mesure où l'on sait par ailleurs que le recours aux heures supplémentaires est plus intensif dans les entreprises qui n'ont pas réduit la durée du travail. Or le taux de passage aux 35 heures est inversement proportionnel à la taille de l'entreprise.
* 114 A total d'heures supplémentaires constantes
* 115 Pour plus de détails le lecteur pourra se référer à Chauvin, Dupont, Heyer, Plane et Timbeau (2002) : « Le modèle France de l'OFCE : La nouvelle version e-mod.fr », Revue de l'OFCE, n°81, avril.