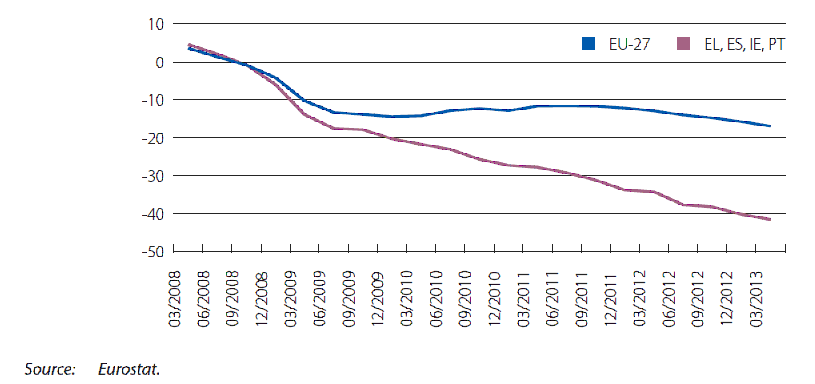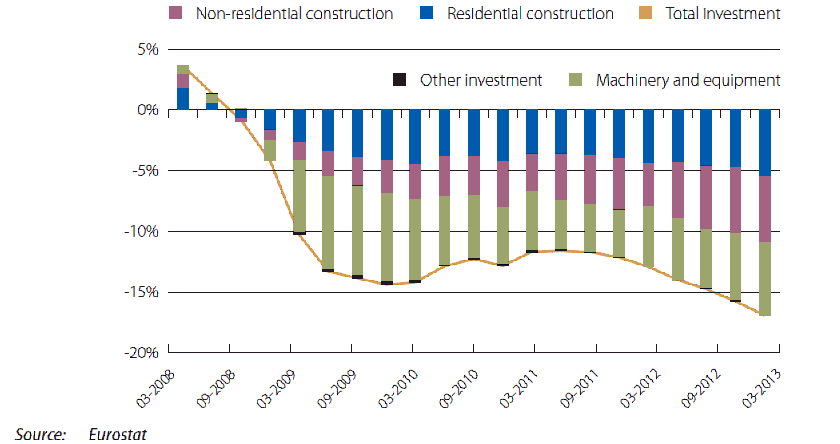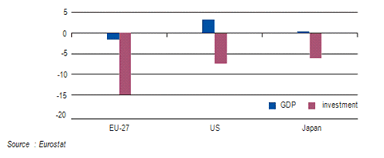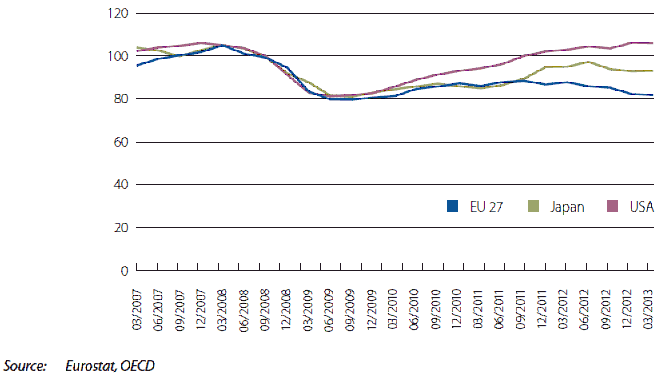Rapport d'information n° 393 (2016-2017) de M. Pierre-Yves COLLOMBAT , fait au nom de la Délégation sénatoriale à la prospective, déposé le 9 février 2017
Disponible au format PDF (6,1 Moctets)
-
AVANT-PROPOS
-
PREMIÈRE PARTIE : LA MÉCANIQUE
DES CRISES
-
DEUXIÈME PARTIE : DIX ANS DE CRISES,
CHRONIQUE DES ÉVÉNEMENTS
-
TROISIÈME PARTIE : POURQUOI LA CRISE
OU LA GRANDE TRANSFORMATION DE L'EMPIRE AMÉRICAIN
-
I. UN ORDRE MONDIAL FLOTTANT
-
II. LA RESTAURATION LIBÉRALE OU LA NOUVELLE
IDÉOLOGIE DOMINANTE
-
III. LA NOUVELLE LUTTE DES CLASSES ET
L'OBSOLESCENCE DÉMOCRATIQUE
-
A. DÉFLATION DES REVENUS DU TRAVAIL ET
ENDETTEMENT
-
B. LA CROISSANCE DES PATRIMOINES PRIVÉS PAR
RAPPORT AUX REVENUS
-
C. LA CROISSANCE DES INÉGALITÉS DE
REVENUS
-
A. DÉFLATION DES REVENUS DU TRAVAIL ET
ENDETTEMENT
-
IV. LA FINANCIARISATION DE
L'ÉCONOMIE
-
V. L'EUROPE, PRÉCURSEUR ET BONNE
ÉLÈVE
-
I. UN ORDRE MONDIAL FLOTTANT
-
QUATRIÈME PARTIE : UNE CRISE QUI N'EN
FINIT PAS DE FINIR
-
I. LA MACHINE À CRISES FINANCIÈRES
EST TOUJOURS LÀ
-
A. LES FACTEURS DE CRISES
FINANCIÈRES
-
B. LA LIQUIDITÉ
-
C. LA MÉDECINE DU DIABLE
-
D. UN OLIGOPOLE BANCAIRE TOUJOURS « TROP
GROS POUR FAIRE FAILLITE » ET TOUJOURS AUSSI PEU RASSURANT
-
E. UN PASSÉ QUI NE PASSE PAS
-
F. SISYPHE RÉGULATEUR
-
A. LES FACTEURS DE CRISES
FINANCIÈRES
-
II. CRISE DE LANGUEUR ÉCONOMIQUE
-
A. UNE SORTIE DE CRISE EN TÔLE
ONDULÉE
-
B. LES ÉTATS-UNIS ET L'EUROPE FACE À
LA CRISE
-
1. Des problèmes communs
-
a) Comment relancer la machine
économique ?
-
b) Comment relancer le moteur que constitue
l'investissement public, sans augmenter l'endettement du même
nom ?
-
c) Comment relancer la consommation ?
-
d) Comment faire face aux conséquences
économiques du vieillissement de la population ?
-
e) Comment réduire la
spéculation ?
-
f) Comment enfin sortir de l'impasse ?
-
g) Au final, le bilan n'est pas brillant
-
a) Comment relancer la machine
économique ?
-
2. Des stratégies bien
différentes
-
3. Les causes structurelles de la stagnation de la
zone euro
-
1. Des problèmes communs
-
C. EN ATTENDANT LA LOCOMOTIVE
-
1. Des résultats de la lutte contre la
pauvreté moins brillants qu'on ne le dit
-
2. Ralentissement de la locomotive chinoise et
risque de crise bancaire
-
3. Les pays producteurs de pétrole
réduisent leurs réserves de devises
-
4. Vers une
« démondialisation » ?
-
5. Conclusion : un équilibre mondial
instable
-
1. Des résultats de la lutte contre la
pauvreté moins brillants qu'on ne le dit
-
A. UNE SORTIE DE CRISE EN TÔLE
ONDULÉE
-
III. LA RÉVOLTE CONTRE LES
ÉLITES
-
I. LA MACHINE À CRISES FINANCIÈRES
EST TOUJOURS LÀ
-
CONCLUSION : QUAND L'HISTOIRE
BÉGAIE
-
ANNEXES
N° 393
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017
|
Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 février 2017 |
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la délégation sénatoriale à la prospective sur
Une crise en quête de fin
Quand l'Histoire bégaie
Par M. Pierre-Yves COLLOMBAT
Sénateur
|
Cette délégation est composée de : M. Roger Karoutchi, président ; M. Gérard Bailly, Mme Corinne Bouchoux, M. Yvon Collin, Mme Annie David, MM. Alain Fouché, Philippe Kaltenbach, Mmes Fabienne Keller, Sylvie Robert, MM. Henri Tandonnet et Yannick Vaugrenard, vice - présidents ; Mme Pascale Gruny, MM. Jean-Jacques Lozach et Jean-François Mayet, secrétaires ; M. Philippe Bonnecarrère, Mme Nicole Bonnefoy, MM. Pierre Charon, Alain Chatillon, Pierre-Yves Collombat, Robert del Picchia, Francis Delattre, Mme Évelyne Didier, M. Louis Duvernois, Mme Dominique Estrosi Sassone, M. Bruno Gilles, Mme Dominique Gillot, MM. Loïc Hervé, Éric Jeansannetas, Philippe Leroy, Jean-Claude Luche, Franck Montaugé, Robert Navarro, Yves Rome, Jean-Yves Roux, Jean-Pierre Sueur et Alain Vasselle. |
AVANT-PROPOS
Mesdames,
Messieurs,
L'objectif initial de cet exercice de prospective était d'évaluer, presque dix ans après la crise ouverte en 2007 et à ce jour non terminée, les probabilités de réédition d'un nouveau krach financier, ce qui, de l'avis unanime, serait fatal à l'ordre du monde actuel. Plus j'avançais dans ce dossier complexe, plus je mesurais combien l'entreprise était présomptueuse.
Présomptueuse parce que toute tentation de prédire l'avenir ne saurait qu'être ridicule, à plus forte raison dans le domaine financier. Toutes les conditions d'un nouveau krach systémique seraient-elles réunies que cela ne garantirait aucunement qu'il aura effectivement lieu ! Comme nous l'a dit Henri Sterdyniak lors de son audition 1 ( * ) , la caractéristique de ce contexte particulier est d'être « une instabilité stable qui n'a aucune rationalité. Elle est insoutenable et, paradoxalement, le système tient bon ». Rien à voir avec les sciences naturelles où les mêmes causes produisent immanquablement les mêmes effets. De plus, en l'occurrence, on n'est jamais certain que les mêmes causes soient réunies : non seulement elles sont innombrables mais, en interagissant, elles se modifient.
C'est en cela aussi que l'entreprise était présomptueuse : le système financier n'est pas isolable du complexe de forces politiques, d'intérêts économiques, idéologiques et sociaux qui ont présidé à sa naissance comme à son fabuleux développement et qui lui ont permis de résister, jusque-là, à la faillite. Comment se limiter à la seule analyse du système financier et de ses faiblesses, assortie de quelques préconisations censées permettre d'éviter un nouveau krach, si l'on constatait qu'au terme de dix ans d'interventions des États, des institutions internationales et des banques centrales, des doutes sérieux demeuraient quant à la stabilité dudit système financier ? Impossible d'imaginer les évolutions possibles sans retour préalable sur les conditions d'installation de cette nébuleuse.
Le système financier en place n'étant pas là par hasard, sa résilience dépendra autant de la capacité de ce complexe de forces et d'intérêts à continuer à l'imposer quelles qu'en soient les conséquences économiques, sociales et politiques que de sa capacité à se réformer de lui-même. Car il n'est pas illégitime de considérer que le système financier ne se réformera que s'il ne peut faire autrement et après avoir mené toutes les batailles d'arrière-garde : seule la défection de ses soutiens, sous la pression des événements, rendra l'événement possible.
Impossible, aussi, de comprendre ce qui s'est passé et ce qui pourrait se passer en ignorant comment fonctionne une économie monétaire moderne, le circuit économique et ses acteurs - système bancaire et marchés financiers en particulier -, la nature de la monnaie et les formes sous lesquelles elle se présente ; en ignorant l'origine des crises financières et comment elles se diffusent.
Ce sera l'objet de la première partie du rapport. Ceux qui trouveraient ce détour délibérément didactique, inutile, pourront l'enjamber sans problème. J'ai cependant la faiblesse de penser que cette incursion sur la planète « finance », incursion que l'on renouvellera au fil des pages, s'imposait dès lors qu'on ne souhaitait pas seulement s'adresser à des spécialistes familiers du jargon volontiers ésotérique des économistes et encore plus des financiers.
La deuxième partie du rapport sera une chronique de la crise ou plutôt du chapelet de crises qui se sont succédé à partir de 2007.
L'ambition de la troisième partie sera de montrer que cette première « Grande crise » du XXI e siècle n'est ni le produit du hasard ni seulement de fautes techniques qui auraient pu être évitées, mais celui des mutations géopolitiques, idéologiques, politiques, sociales, institutionnelles de l'Empire américain qui ont suivi l'abandon des accords de Bretton Woods. La nouvelle Grande crise n'est pas que le produit du système financier, même si sa responsabilité est écrasante, c'est celle du système global, tout particulièrement de l'idéologie qui le sous-tend. Toute tentative de le réformer sera vouée à l'échec tant qu'on négligera de le prendre en compte. Ces mutations concernant directement le coeur de l'Empire, les États-Unis, et leurs provinces européennes, indirectement la planète entière, nous nous efforcerons de rendre compte de cette diversité, sur fond d'unité.
L'objet de la quatrième partie sera d'abord de dresser un état des lieux après dix ans de crise, l'état du système financier - est-il toujours aussi instable et dangereux ? -, l'état économique, social et politique de l'Empire. Ce préalable rempli, en conclusion, nous succomberons à la tentation d'esquisser quelques-uns des scénarios d'évolution de la situation pensables, en restant très conscients des limites de cet exercice. Mais, sans risque de formulation du pensable, pas d'action politique possible.
Au vu de la nature de l'objectif recherché, il va de soi que les analyses développées ici, et plus encore les conclusions du rapport, n'engagent que leur auteur ; nullement, de près ou de loin, la délégation sénatoriale à la prospective, encore moins le Sénat. Que le président de la délégation et mes collègues soient remerciés de m'avoir accordé cette liberté d'investigation et de ton.
PREMIÈRE PARTIE : LA MÉCANIQUE DES CRISES
« Je ne suis qu'un banquier faisant le travail de Dieu. »
Lloyd Blankfein, P-DG de Goldman Sachs
Entretien au Sunday Times - 8 novembre 2009
I. LE FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE ET LES BANQUES
A. LE DOUBLE CIRCUIT D'ALIMENTATION MONÉTAIRE DE L'ÉCONOMIE
Très schématiquement, l'économie est alimentée en monnaie par deux sources : le circuit financier de recyclage de l'épargne et le système bancaire.
1. Le circuit financier
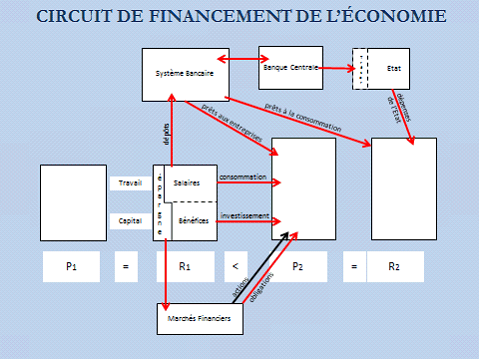
Pour faire simple, disons que ce système recycle l'épargne - ce qui n'a pas été consommé - pour qu'elle ne reste pas économiquement stérile - la fameuse « trappe » à liquidité de Keynes. Y interviennent les bourses et plateformes d'échanges, l'ensemble des acteurs de marchés, qui commercialisent auprès du public les actions et les obligations émises par les entreprises à la recherche de financements.
Ce schéma hypersimplifié est celui qui correspond au principe, passé en maxime grâce à Helmut Schmidt : « Ce sont les bénéfices d'aujourd'hui qui font les investissements de demain et les emplois d'après-demain . » Sans l'intervention des banques, ce circuit ne produit ni valeur ni monnaie. Il se contente de recycler et éventuellement de redistribuer entre les participants les sommes qui le traversent. Utile dans tous les cas de figure, cette intervention est d'autant plus indispensable que la part des revenus réinjectée dans le circuit financier est faible. Comme on le verra 2 ( * ) , c'est ce qui s'est produit avec l'abandon du « pacte fordiste » et la montée des inégalités. L'endettement des entreprises, du travailleur-consommateur et des budgets publics est alors venu compenser les pertes de revenus du travailleur-consommateur.
2. Le circuit bancaire
Le système bancaire a, pour sa part, le privilège, qualifié à tort de régalien puisque ce sont des banques privées qui l'exercent, de créer de la monnaie, simplement en inscrivant un dépôt dans la colonne « passif » de son bilan et un prêt dans sa colonne « actif ». Comme le dit l'adage, dans une économie monétarisée : « Les prêts font les dépôts. » En d'autres termes, la monnaie scripturale fait le crédit 3 ( * ) .
Dès lors que l'État décide de privatiser banques, entreprises ou équipements publics, ce privilège accordé aux banques commerciales devient une formidable machine à transférer, à crédit et par remboursement sur les bénéfices futurs, le patrimoine public dans des mains privées. De quoi rester admiratif !
La garantie de cette nouvelle monnaie, ce sont les dépôts des clients de la banques - salaires et économies des particuliers, trésorerie des entreprises -, ses fonds propres et les emprunts contractés auprès d'autres banques ou d'investisseurs.
L'entrepreneur pourra réaliser ses investissements, payer les employés supplémentaires avec cet argent sorti du néant. La banque recevra des intérêts pour ce service. Au final, le prêt remboursé et le dépôt dépensé disparaîtront des lignes de comptes de la banque mais des richesses et des revenus nouveaux auront été créés entre-temps.
Donc, contrairement au principe d'Helmut Schmidt, ce sont non pas seulement, loin de là, les bénéfices d'aujourd'hui qui créent la richesse de demain mais le crédit. Cette maxime n'est pas un théorème économique mais un slogan politique permettant de justifier la limitation de la part réservée aux salaires dans le partage de la valeur ajoutée produite chaque année.
B. BANQUES, CRÉDIT ET BILANS BANCAIRES
1. Les revenus des banques
Ils ont pour origine essentielle la transformation d'emprunts (ou équivalents) à court terme à taux d'intérêts faibles (dépôts à vue, comptes épargne, emprunts auprès d'autres banques, d'entreprises, de fonds divers ou de particuliers) en prêts à plus ou moins long terme à un taux plus élevé. La différence des taux entre emprunts (nul dans le cas des dépôts à vue) et prêts fait le gain de la banque. La banque remplit une fonction d'intermédiation.
Le niveau du taux des prêts accordés dépend en principe du risque pris par la banque (risque de solvabilité). Selon la vulgate bancaire, l'intérêt reçu rémunère le risque pris par le banquier. Un débiteur solvable peut donc prétendre à un taux moindre que celui qui l'est moins. « On ne prête qu'aux riches » dit l'adage bourgeois.
Les banques vivent également de l'escompte, opération de crédit à court terme contre rétribution, le banquier se substituant au détenteur d'une créance (chèque, facture par exemple) pour son recouvrement. De plus en plus souvent, elles facturent aussi à leurs clients les services qu'elles leur rendent. Cette ressource, longtemps marginale, devient de plus en plus importante. Viendront s'y ajouter, prenant de plus en plus de place, les gains issus d'opérations spéculatives.
2. Banque centrale et banques commerciales
En cas de besoin, les banques peuvent obtenir de la monnaie auprès de la banque centrale, seule à pouvoir émettre la « monnaie banque centrale », la seule échangeable contre tout ce qui a une valeur, d'où son nom d'« équivalent général ». Une banque doit pouvoir rembourser en monnaie banque centrale les dépôts, à tout moment, et les emprunts qu'elle a contractés, à leur échéance.
Si elle ne le peut pas, elle connaît une crise de liquidité. Celle-ci peut être temporaire - le temps d'échanger un titre (une reconnaissance de dette) contre de la monnaie - ou se transformer en crise de solvabilité si ce qu'elle doit rembourser (passif) dépasse ce qu'elle peut vendre (actif) parce qu'il a perdu de sa valeur. Elle est alors en situation de faillite.
Maîtresse du robinet de la liquidité, qu'elle ouvre plus ou moins en faisant varier les taux directeurs, en reprenant plus ou moins facilement et à des taux plus ou moins attractifs les titres possédés par les banques commerciales, la banque centrale peut ainsi réguler l'émission du crédit et donc l'inflation et l'activité économique. En théorie en tout cas, comme le montre le peu d'effets de la politique de « quantitative easing » 4 ( * ) .
3. Les bilans bancaires
Pour comprendre comment fonctionne le système et où sont les risques, il faut s'arrêter un moment sur les bilans bancaires et aussi sur ce qui prendra progressivement une place de plus en plus importante : le mystérieux « hors-bilan ».

Source : d'après Jézabel
Couppey-Soubeyran : « Le risque dans tous ses
états »
(Conférence, École nationale des
Ponts et Chaussées, 9 septembre 2014)
• La colonne de droite du tableau en partie double rassemble ce que la banque doit, bien que les fonds propres fonctionnent en réalité comme un matelas de protection au cas où une partie des actifs ferait défaut. Les actionnaires, dans ce cas, perdraient leur mise.
Les prêts et emprunts interbancaires sont les échanges à court terme entre banques permettant d'assurer l'équilibre du bilan au jour le jour. Ces opérations sont indispensables compte tenu de la circulation des chèques entre elles.
Les crédits à la clientèle et le portefeuille de titres qui rapportent à la banque (intérêts, plus-values) présentent aussi un risque en cas de défaillance du débiteur ou de l'émetteur de titres. Les seuls fonds propres et dépôts ne suffisant pas à compenser ces risques, la banque doit les couvrir en empruntant à court terme (certificats de dépôt) ou plus long terme (obligations).
D'une manière générale, avec le temps, les fonds propres, qui sont la vraie garantie de solvabilité de la banque, se sont rétrécis comme peau de chagrin.
Voilà une centaine d'années, des taux de 15 % à 20 % de fonds propres étaient fréquents : en 1840, les banques américaines étaient même financées en fonds propres à hauteur de plus de 50 %. Ce taux était plutôt de 3 % au début des années 2000, voire de 1,5 % en 2007. En clair, un ratio de fonds propres de 3 % signifie que 97 % des actifs sont financés à crédit. Et donc que la banque est vulnérable à la dépréciation de quelques pourcents seulement de ses actifs.
Qui plus est, lorsque l'on mentionne les « ratios » de fonds propres, on ne sait pas toujours de quoi on parle. Petite subtilité, en effet, il y a les « vrais fonds propres » (c ore equity dans le jargon) - actions et bénéfices non distribués - et des « quasi-fonds propres », en fait des titres (obligations) transformables en actions et des titres subordonnés, c'est-à-dire qui, en cas de problème, sont remboursés en dernier, contre une rémunération plus forte. En conséquence, un ratio de fonds propres de 3 % ou 5 % peut cacher un ratio « Core » encore plus faible. D'où la préférence à accorder, quand on veut avoir une photographie ressemblante de la vulnérabilité d'une banque, à un ratio plus fiable : le levier d'endettement . Un taux de 3 % de fonds propres, cela signifie qu'à chaque euro de fonds propre correspondent 32,33 euros de dettes exigibles, pour la plupart à très court terme, voire particulièrement volatiles s'agissant le plus souvent de créances en dollars.
Le levier d'endettement est d'autant plus fiable que, on le verra en étudiant la réforme prévue par les accords de Bâle III 5 ( * ) , les ratios imposés par ces accords sont calculés d'une bien étrange manière : en rapportant les fonds propres non pas à l'endettement ou à l'actif, mais à un actif « pondéré par le risque ». Le résultat peut être spectaculaire.
• La colonne de gauche représente les biens et les produits bancaires suscitant des revenus à la banque. En cas de défaillance (défaut d'un emprunteur, perte de valeur de titres devenus invendables), les créanciers de la banque (passif), craignant que celle-ci ne puisse faire face à ses engagements, risquent de retirer leur mise (cas des déposants) ou ne pas la renouveler s'agissant de prêts à court terme. Le véritable matelas de sécurité, c'est donc bien les fonds propres.
4. Le hors-bilan
Sous ce terme anodin se cache l'une des failles principales de la surveillance du système bancaire. En effet, si le bilan retrace l'ensemble des opérations passées d'un exercice, toutes celles qui sont en attente ne sont pas reprises. Il est simplement fait obligation aux banques de mentionner qu'elles existent.
Cette fissure de la surveillance est devenue une faille avec le développement de la titrisation, la banque étant généralement considérée comme un simple intermédiaire, et surtout avec l'explosion des CDS 6 ( * ) , sortes de garanties, d'assurances, consenties par la banque à un client ou à une autre banque ou prises pour se couvrir. On verra plus loin que les montants en jeu sont aussi considérables que difficiles à cerner.
C'est cet entrelacs de garanties et contre-garanties qui rend le système bancaire globalement vulnérable 7 ( * ) .
C. LES MARCHÉS FINANCIERS ET LA SPÉCULATION
Nous avons dit, dans un souci de simplification, que les marchés financiers et les institutions qui les supportent se contentaient de recycler l'épargne qui, à défaut, resterait économiquement stérile. Dit aussi que, sans l'intervention des banques commerciales, ce circuit ne produisait ni valeur ni monnaie. La réalité est nettement plus compliquée, du fait :
- qu'entre les acteurs intervenant sur et autour des marchés les titres échangés fonctionnent comme une quasi-monnaie tant qu'on est capable d'attribuer un prix à chacun ;
- que les marchés fonctionnent, et de plus en plus, comme des machines à bulles spéculatives et comme des casinos.
1. La nature plurielle de la monnaie
Quelque part, un titre monétaire obtenu en échange d'un bien ou d'un service (billet de banque, dépôt bancaire...) est un droit de tirage sur la richesse commune à ceux qui partagent la même monnaie. C'est une « promesse » de consommation future pour celui qui le possède, un titre convertible en un bien de même valeur, l'un des problèmes étant la conservation dans le temps de cette valeur. Or, celle-ci pourra varier en fonction de l'évolution du rapport entre la richesse disponible et la quantité de monnaie en circulation, et aussi de la crédibilité de l'autorité qui garantit cette monnaie. Ainsi tient-on généralement l'État pour seul légitime à « battre monnaie » puisque seul capable de garantir, éventuellement par le cours forcé, que la monnaie en circulation ne deviendra pas une « monnaie de singe ». Si l'Histoire peut accréditer ce sentiment largement fondé s'agissant des économies prémodernes, peu monétarisées et largement agricoles, il ne correspond aucunement à la complexité des économies modernes monétaires. Plutôt que de la monnaie au singulier, il serait plus exact de parler de monnaies au pluriel.
La plus ancienne est la monnaie émise par les banques centrales, plus ou moins sous le contrôle des États selon les époques. Vient ensuite la monnaie scripturale émise par les banques commerciales et enfin, aujourd'hui, fonctionnant comme une monnaie quand tout va bien, ce qu'on peut appeler une « quasi-monnaie », composée de titres financiers échangeables entre eux et au final contre de la monnaie banque centrale.
Pour bien faire comprendre ce qu'est la monnaie, son rôle très particulier dans la machine économique, John Kenneth Galbraith racontait, avant tout exposé technique, un apologue dont est librement inspiré celui qui suit.
Dans une minuscule principauté imaginaire, l'ensemble des besoins des habitants était satisfait par huit commerçants et artisans pratiquant chacun 25 % de marge bénéficiaire.
Un matin, le tailleur voit, débarquant d'une splendide voiture, un homme décidé, habillé du dernier chic. Une fois dans la boutique, sans discuter les prix, il achète pour 1 000 florins de costume qu'il règle par chèque sur la banque locale, au nom de...Rothschild.
Le tailleur ne revient ni des 250 florins de bénéfice qu'il vient de faire, ni de celui à qui il le doit. Se souvenant qu'il devait achever la construction de sa maison, tout heureux, il endosse le chèque et se précipite chez le maçon pour lui conter l'affaire et lui demander de venir terminer le travail qu'il avait dû arrêter faute de moyens. Il paie avec le chèque de 1000 florins que le maçon endosse à son tour, ébloui lui aussi par ce bénéfice inattendu de 250 florins et plus encore qu'il puisse le devoir à Rothschild.
Le manège se répète ainsi jusqu'au huitième artisan-commerçant qui, lui, se rend à la banque pour y déposer le chèque où Rothschild est censé avoir son compte... et apprend que le chèque est une contrefaçon sans valeur. Dépité et furieux, il retourne auprès de celui qui lui avait remis le chèque, avec celui-ci auprès du sixième escroqué et ainsi de suite, jusqu'au premier de la chaîne. Désemparés, les voilà tous devant le banquier qui leur tient à peu près ce langage : « Messieurs, vous avez deux solutions. La première, vous laissez votre collègue avec son chèque sans provision sur les bras. Il fera probablement un procès à celui dont il le tient, ce dernier au précédent ; jusqu'au premier berné qui pourra légitimement plaider la bonne foi. Seule chose certaine dans ce genre d'aventure judiciaire : elle coûtera à tous, plus que chacun ne peut espérer en retirer.
« La seconde solution, celle que je vous recommande, serait de vous arranger. Après tout, chacun a réalisé 1 000 florins de travaux et 250 florins de bénéfice, comme l'attestent vos livres de comptes. En acceptant de mettre la moitié de ces 250 florins dans un pot commun, vous réunirez 1 000 florins et de quoi honorer le chèque en bois qui ne sera plus qu'un mauvais souvenir. »
Ainsi, 1 000 florins de monnaie de singe ont-ils produit 8 000 florins de PIB de la principauté et 1 000 florins de bénéfices dans les livres de comptes de ses brillants entrepreneurs.
On l'aura compris, pour que le système marche, la circulation des créances qui fonctionnent ainsi comme une « quasi-monnaie » ne doit pas s'arrêter, le moment crucial étant celui de sa transformation en monnaie banque centrale, le seul « équivalent général » accepté par tous. Tant que ce moment est différé, les affaires peuvent continuer.
Compte tenu des difficultés qu'aurait engendrées la faillite de l'appareil productif de la principauté, on peut parier que sa banque centrale aurait échangé le chèque en bois présenté par la banque où les artisans ont leur compte, contre des florins, le chèque allant dormir pour l'éternité dans son bilan. C'est en tous cas ainsi que les choses se sont passées lors des crises systémiques, les banques centrales (Fed, BCE, BoE 8 ( * ) ...) rachetant aux banques commerciales les titres dépréciés, voire sans valeur, qui plombaient leurs bilans. Mais comme c'est profondément immoral, mieux vaut entourer cela d'un halo de brume.
Fondamentalement, le système économico-financier mondial fonctionne comme celui de notre principauté imaginaire. Il est parcouru, inextricablement liés, de flux de biens et de monnaies plus ou moins « liquides », c'est-à-dire plus ou moins facilement échangeables contre d'autres monnaies et d'autres biens, selon une gradation allant de la monnaie banque centrale (équivalent général) aux reconnaissances de dettes qui n'ont qu'une fiabilité d'emprunt, en passant par la monnaie scripturale des banques.
Le moteur du système, c'est le crédit, premier créateur de monnaie ; la fausse (créances douteuses des bilans) comme la vraie, garantie en bout de course par les banques centrales et les États. Ce sont autant de droits de tirage sur une fraction de la richesse du monde.
Comme dit l'économiste Pierre-Noël Giraud dans son ouvrage éponyme, la finance, dans son ensemble, n'est jamais qu'un « commerce de promesses » 9 ( * ) . Tant que la confiance règne, tout va bien, le prix des actifs, les dividendes et les taux d'intérêt augmentent. Quand le commerce des promesses devient spéculation et s'emballe, le doute sur leur qualité s'installe, la liquidité d'une bonne partie du flux monétaire disparaît, le système bancaire se bloque et c'est le krach.
2. La spéculation
La valeur des titres censés financer l'économie qui s'échangent sur les marchés - des actions par exemple - dépend non pas seulement, voire même de moins en moins, du revenu qu'on en espère - fonction lui-même de la santé économique des entreprises qui les émettent - mais de l'engouement ou de la défiance pour le titre . L'engouement fait monter les prix, ce qui en retour augmente l'engouement, dans l'espoir de revendre avant que le château de cartes ne s'effondre.
Le premier à avoir analysé ce qui allait devenir l'une des caractéristiques des marchés financiers « modernisés » d'aujourd'hui, c'est John Maynard Keynes, dans la Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie , ouvrage publié en 1936, alors même que la Grande crise n'était pas achevée.
Keynes entend par « spéculation » la tendance à investir non pas en fonction des revenus tirés de l'entreprise, de l'activité dont on acquiert un titre de propriété (action), mais en fonction de ce qu'on imagine que les autres pensent de l'évolution de la valeur de ce titre de propriété en bourse, en fonction de la tendance, du « consensus » : « Le risque d'une prédominance de la spéculation [sur le revenu issu de l'entreprise] tend à grandir à mesure que l'organisation des marchés financiers progresse. Dans une des principales bourses des valeurs du monde, à New York, la spéculation [...] exerce une influence énorme [...] Il est rare, dit-on, qu'un Américain place de l'argent "pour le revenu" ainsi que nombre d'Anglais le font encore ; c'est seulement dans l'espoir d'une plus-value qu'il est enclin à acheter une valeur. Cela n'est qu'une autre manière de dire que, lorsqu'un Américain achète une valeur, il mise moins sur le rendement escompté que sur un changement favorable de la base conventionnelle d'évaluation, ou encore qu'il fait une spéculation au sens précédent du mot. Les spéculateurs peuvent être aussi inoffensifs que des bulles dans un courant régulier d'entreprise. Mais la situation devient sérieuse lorsque l'entreprise n'est plus qu'une bulle d'air dans le tourbillon spéculatif. Lorsque, dans un pays, le développement du capital devient le sous-produit de l'activité d'un casino, il risque de s'accomplir en des conditions défectueuses. Si on considère que le but proprement social des bourses de valeurs est de canaliser l'investissement nouveau vers les secteurs les plus favorables sur la base des rendements futurs, on ne peut revendiquer le genre de succès obtenu par Wall Street comme un éclatant succès du laisser-faire capitaliste [...]
« Devant le spectacle des marchés financiers modernes, nous avons parfois été tentés de croire que si, à l'instar du mariage, les opérations d'investissement étaient rendues définitives et irrévocables, hors le cas de mort ou d'autre raison grave, les maux de notre époque pourraient en être utilement soulagés ; car les détenteurs de fonds à placer se trouveraient obligés de porter leur attention sur les perspectives à long terme et sur celles-là seules . »
3. La fonction économique nouvelle de la spéculation
La spéculation n'est pas plus dangereuse pour le financement de l'économie que les casinos tant qu'elle reste marginale, qu'elle ne représente, comme écrit Keynes, seulement que quelques « bulles » dans le courant d'investissement dont l'économie a besoin et tant que les spéculateurs risquent uniquement leur propre argent. Elle le devient quand c'est l'entreprise qui apparaît comme support de la spéculation et inversement l'un des moteurs essentiels de l'économie. C'est précisément ce qui s'est passé.
a) L'entreprise parasitée par la spéculation
Les revenus spéculatifs vont, en effet, prendre de plus en plus de place à côté des dividendes pour les actionnaires. On est loin de l'image d'Épinal de l'Investisseur garant du bon fonctionnement de l'économie.
Résultats à court terme et valorisation financière des entreprises qui en découle deviennent l'objectif prioritaire des actionnaires comme des gestionnaires. S'ils concèdent un droit d'existence à l'entreprise, c'est comme support de la spéculation, au détriment de l'investissement, de l'emploi et des salaires, perversion principale du système et cause systémique de la crise.
Un taux de 15 % de ROE (« return on equity »), c'est-à-dire de rendement des fonds investis, souvent pour une courte période, devient l'objectif normalement attendu des entreprises, objectif intenable sans suppressions massives d'emplois par des fusions-acquisitions, des délocalisations et diverses acrobaties, comme le rachat de ses propres actions par une entreprise, pour en faire grimper le cours et rassurer les actionnaires.
Les stock-options sont un autre moyen d'améliorer la rémunération des cercles dirigeants des entreprises et de lier leurs intérêts à ceux des actionnaires. Ce qui guide les grands managers est non plus le pouvoir par la construction d'un empire industriel, comme au temps du capitalisme managérial des Trente Glorieuses décrit par John Kenneth Galbraith, mais l'enrichissement patrimonial.
Le rêve des libéraux les plus extatiques serait que la rémunération du travail, par la distribution d'actions négociables ou qui se valoriseraient à l'infini, se substitue au salaire. Ainsi prendrait fin la lutte des classes, du moins le pensent-ils !
Les entreprises pouvant être achetées à crédit, on peut s'enrichir facilement en leur faisant payer, une fois acquises, le remboursement de l'emprunt ayant servi à les acquérir. Si l'opération n'est pas assez juteuse, reste à la revendre par morceaux, la valeur des actifs de l'entreprise étant souvent plus élevée que son prix de vente.
La valeur de l'action d'une entreprise comptant tout autant que le dividende versé, il peut aussi être plus intéressant pour les managers de racheter leurs propres actions pour en faire monter le prix, plutôt que d'investir la liquidité dont dispose l'entreprise pour la rendre plus productive. D'autant que, en période de stagnation économique, nombre de grandes entreprises regorgent de cash . Ce qui manque, ce sont les consommateurs.
Une autre conséquence fâcheuse de cette transformation de l'entreprise en support de la spéculation, c'est de la soumettre à la dictature du court terme. Son développement, ses investissements sont pensés non plus sur le long terme mais en fonction de la rentabilité immédiate. L'avenir est ainsi sacrifié au court terme.
Signe qui ne trompe pas, la diminution de la durée moyenne de détention des actions . De l'ordre d'un an en 1930 à la bourse de New York, elle grimpe à sept ans et trois mois en 1960 pour redescendre à un an en 2010. Même chute pour la bourse de Londres : sept ans en 1970, huit mois en 1985 et en 2010, après une baisse quelques années plus tôt. Selon une enquête de la Banque de France, en 1999, la durée de détention moyenne des actions françaises cotées était de huit mois, ce qui est du même niveau.
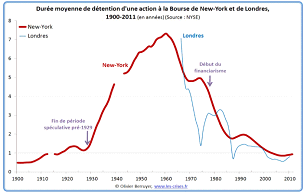
Cela dit, après l'explosion du trading haute fréquence (THF) 10 ( * ) , on peut s'interroger sur la signification de ces moyennes quand on sait que cette pratique récente sur les actions représenterait globalement quelque 90 % des ordres et 40 % des échanges (75 % des échanges aux États-Unis et 30 % en Europe). En fait, faute de chiffres fiables, on conclura simplement :
- que les durées de détention des actions varient de façon abyssale selon les types d'investisseurs, vocable qui n'a plus aucun sens s'agissant du THF ;
- que cette excroissance monstrueuse qu'est devenu le THF sur le corps économique serait sans grande portée pratique si elle ne signifiait pas une neutralisation de fonds qui seraient mieux employés ailleurs et que cette pratique ne mettait pas les entreprises à la merci d'une bouffée spéculative délirante.
b) La spéculation, moteur économique
Dopée par la hausse régulière du prix des biens et par les prêts hypothécaires « rechargeables », c'est-à-dire augmentables en fonction de la hausse des biens qui les garantissent, la spéculation immobilière a été l'un des moteurs essentiels de la croissance économique mondiale des dix années précédant la crise dite des « subprimes », du nom de ces prêts hypothécaires accordés par wagons à des débiteurs peu, voire non solvables.
La consommation des ménages américains conditionnant 70 % de la croissance des États-Unis et 30 % de la croissance mondiale, personne n'avait intérêt à décourager la bulle financière qui se constituait. On estime à 13 % du PIB américain le produit de cette spéculation immobilière, responsable en 2005-2006, selon les spécialistes, de la moitié de la croissance. Sans elle, la Grande-Bretagne et la zone euro seraient entrées en récession avant la crise, tout particulièrement l'Espagne. Hormis l'Allemagne, qui devait sa faible croissance à ses exportations, c'est largement l'endettement immobilier des ménages qui a alimenté la progression du PIB jusqu'à la crise. Pour les années de référence, on lui devait 5 % de la hausse des PIB espagnol et britannique, et la moitié des 2 % de croissance française.
Ces possibilités spéculatives vont se trouver décuplées par le rajeunissement d'un vieil outil, le prêt hypothécaire devenu « rechargeable », et par une innovation, la « titrisation » 11 ( * ) . Les titres dérivés de crédits hypothécaires 12 ( * ) représentaient, en 2007, 5 200 milliards de dollars, contre 4 900 milliards de dollars pour les obligations d'État du Trésor américain. À part ça, c'est l'endettement public qui serait à l'origine de la crise de 2008, dit-on !
c) Quand les banquiers peuvent se prévaloir de leur propre turpitude
Mais la spéculation n'est pas seulement un danger pour l'entreprise, elle l'est aussi pour les déposants des banques quand celles-ci se mettent à spéculer avec les dépôts qui leur ont été confiés , au risque de les voir s'envoler si les choses tournent mal.
Illégale aux États-Unis depuis le Glass-Steagall Act (1933), l'une des premières mesures de Roosevelt, cette pratique sera progressivement réintroduite dès le milieu des années 1970 avant d'être légalisée par le Financial Services Modernization Act, sous l'administration de Bill Clinton (1999).
En France, l'obligation de séparation des banques de dépôt et d'investissement sera effective jusqu'à la loi bancaire Mauroy-Delors (1984), créant le modèle français de banque universelle.
Au moment de la crise, il deviendra clair que ce privilège accordé aux banquiers de pouvoir spéculer avec des fonds qui ne leur appartiennent pas et sans l'accord de leurs propriétaires représente un moyen de chantage à l'intervention des États en cas de catastrophe . Sous la menace de voir emportée dans la déroute une foule de déposants et d'épargnants qui n'y sont pour rien, de voir à leur tour en difficulté les établissements avec lesquels la banque faillie est en relation d'affaires, les États et les banques centrales sont obligés de venir à son secours. « Too big to fail », pourquoi se priverait-elle d'en profiter ? D'autant plus que cette garantie assurée gratuitement par l'État permet aux grandes banques d'emprunter sur les marchés à des taux plus bas que les petites...
4. L'impératif de la liquidité
En cas de besoin, les banques peuvent obtenir la monnaie la plus liquide auprès de la banque centrale. C'est aussi, dans la zone où elle a cours légal, la seule à être totalement liquide, c'est-à-dire à conserver sa valeur quelle que soit la quantité échangée. Que l'on dépense 100 euros ou 100 000 euros, les billets gardent la même valeur.
Sur le marché des titres, il en va différemment. Celui qui vend dix mille actions a toutes les chances que leur prix unitaire soit plus bas que s'il n'en vendait que cent. Plus un marché assure la stabilité des prix indépendamment des quantités échangées, plus il est dit liquide. On l'aura compris : plus les marchés sont étroits, moins ils sont liquides, d'où la recherche de leur globalisation. Rien à voir avec une croisade contre la xénophobie.
On l'aura aussi compris : maintenir la liquidité des marchés, garante de « l'échangeabilité » des titres à tout moment, est essentiel à leur bon fonctionnement. Corrélativement, pour que des titres soient échangeables, il faut qu'on en connaisse le prix à tout moment. Le prix étant fourni par le marché, il est tout aussi essentiel d'entretenir les achats et les ventes des titres, même sans finalité économique ou financière, essentiel qu'il y ait des « teneurs de marché ».
C'est l'une des justifications du trading haute fréquence et de la spéculation elle-même. La spéculation crée le besoin de spéculation.
II. COMMENT FABRIQUER UNE CRISE SYSTÉMIQUE ?
A. LA MÉCANIQUE DES CRISES D'ORIGINE FINANCIÈRE
Comme le corps humain ne peut vivre si la circulation du sang s'arrête, la nouvelle économie moderne ne peut fonctionner si le circuit financier des créances se bloque au niveau bancaire.
Autrement dit, si les banques ne peuvent plus faire face aux demandes de remboursement de leur passif (dépôts et dettes), soit parce qu'elles manquent de fonds propres, soit parce qu'elles ne peuvent mobiliser (vendre) leurs actifs à temps ou à un prix suffisant, la défiance s'installe sur leur fiabilité et le circuit interbancaire se bloque. Pour l'éviter, il suffit de croire à cette impossibilité. D'où l'importance de la transparence des opérations conduites par les banques.
Une crise est d'abord une crise de liquidité : l'impossibilité temporaire de transformer une partie suffisante des actifs en monnaie banque centrale. La fourniture de cette liquidité par la banque centrale en contrepartie de ces créances permet généralement de restaurer la confiance et de remettre en marche la « pompe à phynance » pour parler comme le père Ubu. Quand cette impossibilité temporaire de faire face à ses engagements devient permanente, du fait notamment de la mauvaise qualité des actifs, la crise de liquidité devient crise de solvabilité . Si la ou les banques ne sont pas recapitalisées (rachat par une autre banque ou nationalisation), elles font faillite (résolution).
C'est ce qui s'est passé en 2008.
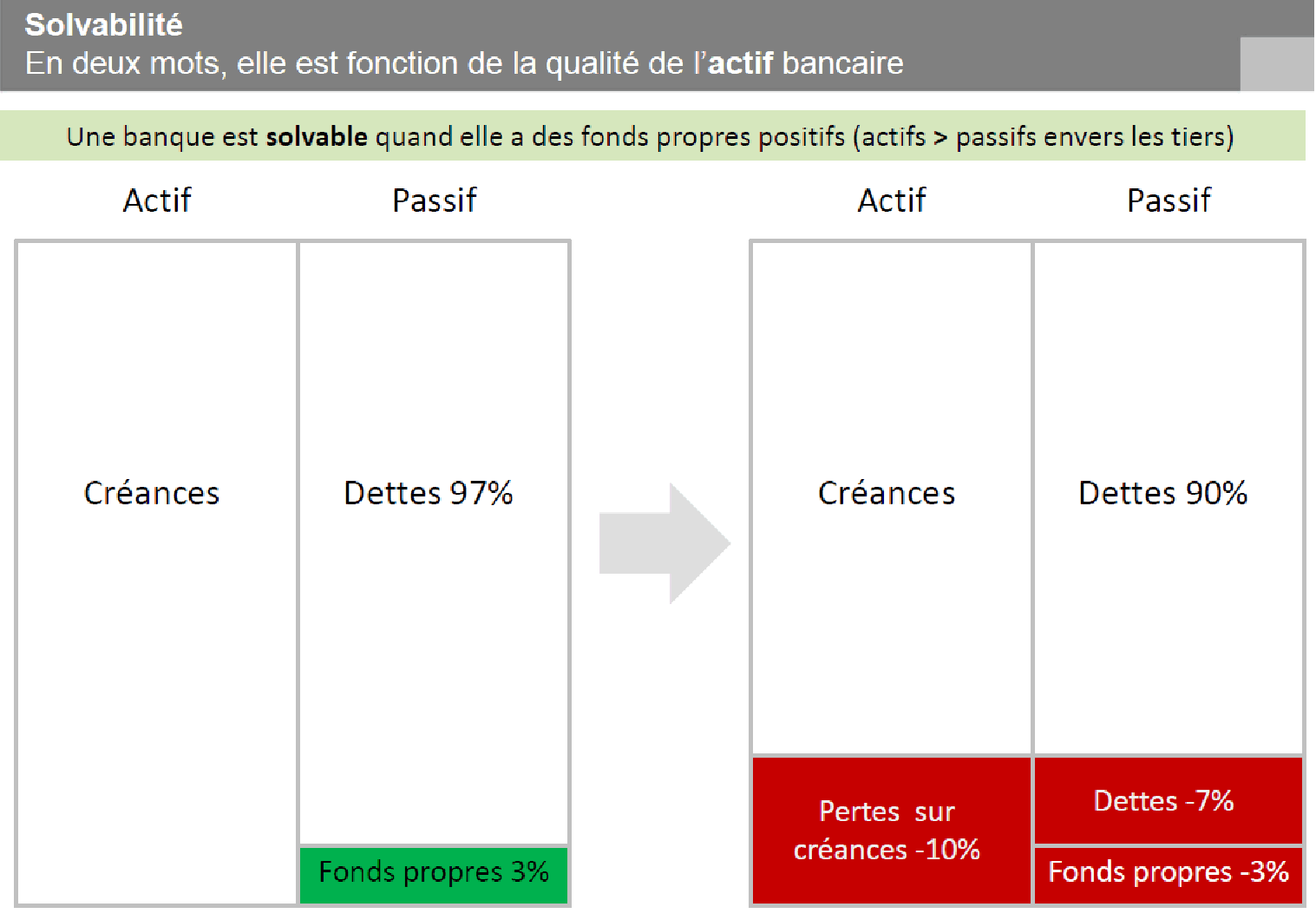
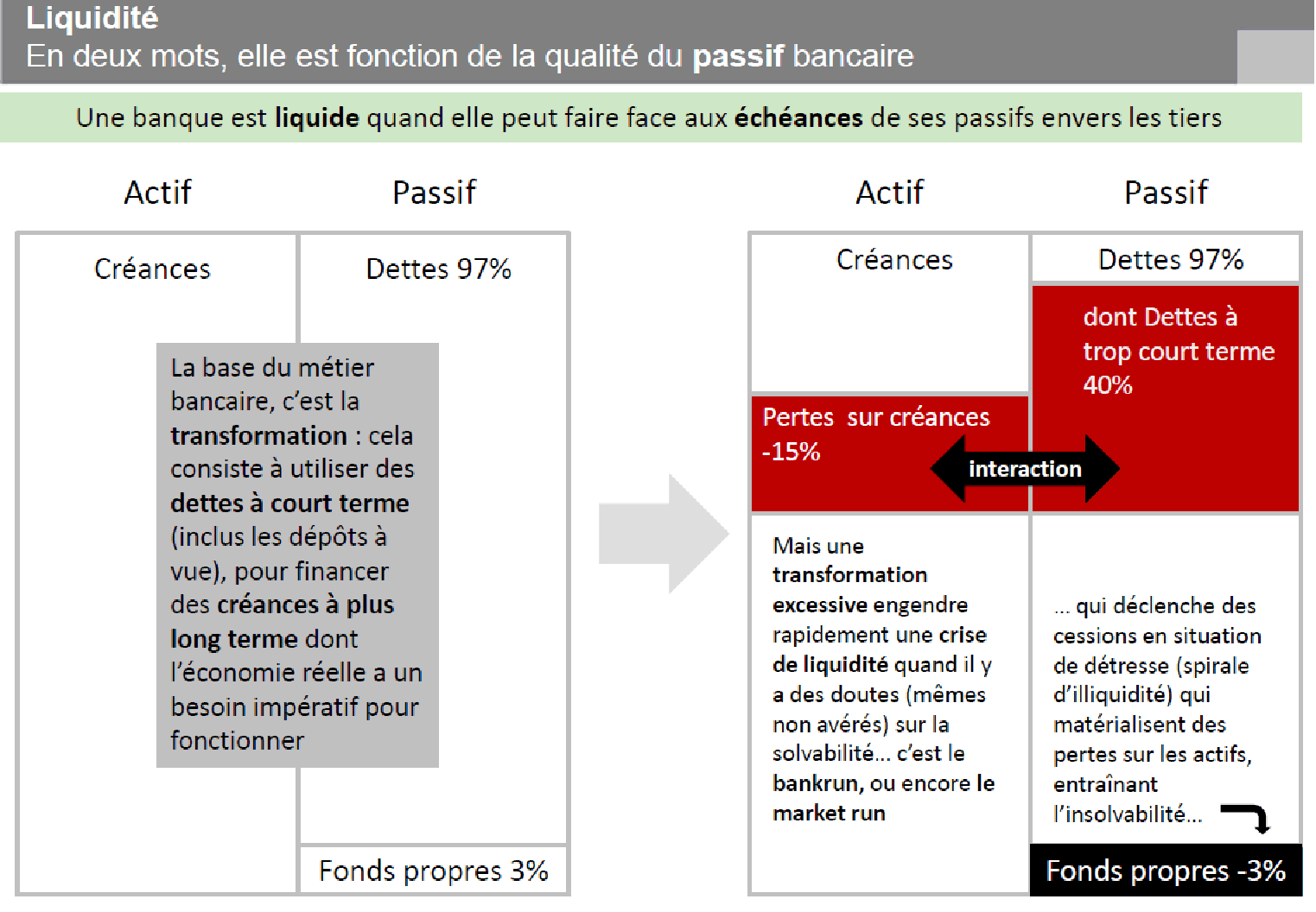
Source : Jézabel Couppey-Soubeyran :
« Risques bancaires. Le risque dans tous ses
états »
(Conférence, École nationale des
Ponts et Chaussées, 9 septembre 2014)
B. LES FACTEURS FACILITANT LES CRISES FINANCIÈRES
Le carburant des crises, c'est l'abondance de liquidités (de capitaux) qui stimule la spéculation, donc les prises de risques, et donc la mise en circulation de créances douteuses. Dans un premier temps, stimulée par la montée des prix (des valeurs immobilières, des actions, des obligations, des titres, des garanties, etc.), tout va bien. Puis le doute s'installe et tout peut s'écrouler. Les spéculateurs à crédit ne peuvent rembourser leurs emprunts, ni les banques récupérer leurs mises, leurs créances étant devenues invendables. La possibilité pour les banques de mobiliser les dépôts qui leur sont confiés pour spéculer à crédit est un puissant facteur de risque.
De même, moins les banques sont résilientes, plus les risques de crise sont grands. La résilience des banques dépend d'abord de l'importance du ratio entre leurs fonds propres et leur niveau d'endettement (emprunts pour équilibrer leur passif), de la volatilité de ce passif (emprunts à plus ou moins long terme), de l'importance et surtout de la qualité de leurs actifs. Autrement dit : plus ils rapportent, plus ils sont risqués.
Le but de la régulation est notamment d'édicter des normes prudentielles et de contrôler leur mise en oeuvre, de s'assurer de la qualité des produits financiers mis en circulation, d'organiser le renflouement des établissements en difficulté ou leur « résolution ».
C. LES CRISES SYSTÉMIQUES
Jusqu'en 2008, toutes les crises financières sont restées limitées à un secteur d'activité et un secteur géographique restreints. La crise de 2008, comme celle de 1929, est une crise financière systémique en ce qu'elle est mondiale et touche l'ensemble du système : banques, marchés, assurances, etc. Cette contamination générale a été rendue possible par l'élargissement du champ d'intervention (mondialisation, banques universelles) des établissements bancaires, leurs interconnexions multiples, l'enchevêtrement des garanties et contre-garanties qu'elles s'accordent entre elles qui fait que, quand l'une est touchée, les autres le sont aussi, la dématérialisation complète des échanges qui ont crû de manière exponentielle et l'opacité qui en résulte. Le moindre soupçon de défiance peut avoir des effets catastrophiques.
Du système financier, la coagulation de la circulation monétaire se propage alors à l'économie tout entière. La crise bancaire s'étend au financement des investissements et de la trésorerie des entreprises au moment même où ce crédit serait indispensable aux opérateurs du marché financiers confrontés à leurs pertes spéculatives et qui, anticipant une baisse des profits des entreprises, vendent leurs titres. C'est au moment où les entreprises ne peuvent plus se refinancer sur le marché des actions qu'elles sont confrontées au resserrement du crédit bancaire. Situation particulièrement critique pour les PME qui n'ont même pas accès au marché financier.
Faisant face à une chute de la valeur de leurs actifs, les entreprises réduisent leur activité, processus activé aussi par la baisse des prix. Avec les conséquences que l'on sait sur l'emploi. Le crédit immobilier et à la consommation devient plus cher et plus difficile à obtenir, réduisant d'autant la consommation et l'activité du BTP.
La crise bancaire est devenue économique et, avec la montée du chômage, sociale et politique.
DEUXIÈME PARTIE : DIX ANS DE CRISES, CHRONIQUE DES ÉVÉNEMENTS
I. UNE CRISE IMPRÉVUE
Début juillet 2007, Christine Lagarde, nouvelle ministre française de l'économie, des finances et de l'emploi, installant le comité chargé de « moderniser » la Place de Paris sur le modèle de Londres, déclarait : « L'avenir est devant nous. Il y a eu une Belle Époque ? Préparons-en de sublimes ! » 13 ( * ) Comme les autres responsables politiques, comme la quasi-totalité des acteurs financiers et des économistes de la planète, à l'exception de quelques-uns, elle ignorait encore que la première Grande crise globale du XXI e siècle avait débuté aux États-Unis, début février 2007, dans l'indifférence générale, avec la chute de l'indice censé mesurer la solidité des titres adossés à des créances hypothécaires appelés à une célébrité mondiale, les « subprimes ».
Plus rares encore furent ceux qui avaient repéré le caractère quasi délictueux des pratiques qui s'étaient installées progressivement, avec la bénédiction des autorités fragilisant le système, et devaient entraîner la catastrophe :
- William K. Black, qui avait expliqué le rôle de la fraude dans la crise des « savings and loans » et dans la crise des subprimes . « La fraude est apparue dans le système financier à partir des pratiques des courtiers en prêts hypothécaires. Ils ont créé des prêts sur des maisons qui n'existaient pas. Ils ont aussi survalorisé la valeur des biens immobiliers qu'ils finançaient, grâce à des taux d'intérêt bas auprès de familles vulnérables qui ne pouvaient, sur le long terme, rembourser leurs prêts. » 14 ( * ) ;
- Gary Dymski, qui, travaillant sur le caractère semi-crapuleux du système des subprimes dès 2005, avait repéré le danger constitué par la répétition de bulles spéculatives 15 ( * ) ;
- selon Jean-François Gayraud, il est même de la nature du système d'être criminogène puisqu'il s'est affranchi de toute régulation.
|
Un capitalisme criminogène
Audition de Jean-François Gayraud
16
(
*
)
,
|
|
• La délinquance financière : un phénomène systémique généralisé Le capitalisme tel que nous le vivons a changé de visage : à partir des années 1930, le capitalisme a été régulé, il arrivait à juguler les déviances et les crises financières. Depuis les années 1980, le capitalisme est radicalement différent, devenant excessivement dérégulé, excessivement financiarisé et excessivement mondialisé. Ce capitalisme est criminogène, au sens où il est porteur d'incitations et d'opportunités à la fraude tout à fait inédites. Il laisse des portes grandes ouvertes pour la déviance, et nous n'avons pas su nous en rendre compte de manière globale. Par exemple, la première loi de dérégulation du système financier américain qu'a fait voter Ronald Reagan en 1982, une fois élu à la Maison-Blanche - le Garn-St. Germain Depository Institutions Act - , a abouti quelques années après à l'effondrement total des caisses d'épargne aux États-Unis, les savings and loans . Il y a eu un enchaînement causal évident et indubitable, un effondrement qui s'est fait dans une ambiance de fraude généralisée : ce fut une pure crise criminelle. La fraude est devenue centrale car la déréglementation libère beaucoup d'énergies négatives qui restent impunies. C'est une loi de Gresham 17 ( * ) de grande envergure qui se produit : les comportements mauvais et frauduleux prennent le pas sur les comportements honnêtes, les mauvais acteurs effacent les bons. L'acteur frauduleux et criminel dispose d'un avantage concurrentiel car il ne respecte pas les règles. Or, ce diagnostic criminel n'est jamais fait. Ce diagnostic devrait être effectué pour les grands événements macroéconomiques, les crises financières, et pour les outils juridico-financiers que l'industrie financière nous impose de manière régulière. Toutes les crises financières naissent de la dérégulation, et toutes ont une dimension criminelle très forte mais occultée. La variable criminelle change de nature et d'intensité selon les crises, selon les pays et selon les périodes : au Japon, le crime organisé était très présent dans la genèse des fraudes ; en revanche, dans la crise des subprimes , nous retrouvons plutôt de la criminalité en col blanc. Une crise financière naît de la conjonction d'une bulle immobilière et d'une bulle financière, conjonction dans laquelle la fraude a un rôle tout à fait central... Dans une prochaine crise, on trouvera forcément une dose de fraude considérable. La fraude est une causalité immédiate et profonde, c'est beaucoup plus qu'un simple détonateur. Il y a tellement de facteurs de fragilité et de vulnérabilité dans le système financier actuel qu'en réalité la crise peut venir d'horizons différents. Tout est interconnecté du fait de la mondialisation, la crise peut venir d'un effondrement du marché dû au trading haute fréquence, du shadow banking chinois, du système pétrolier à l'international, etc. |
|
• Un phénomène difficile à évaluer avec précision On ne peut mesurer l'illégal et l'invisible. Seules des estimations approximatives peuvent être données. Elles sont très bien faites en Italie sur le chiffre d'affaires des mafias, l'économie mafieuse représenterait 8 % à 10 % du PIB. Pour la criminalité financière, c'est le niveau d'activité des services de police et de justice que l'on va mesurer, plus que le niveau réel de fraude financière. Quelles devraient être les priorités des services de police ? Pourquoi la criminalité financière n'est-elle pas la priorité des États ? Quelles sont les priorités de l'État en matière répressive ? Ces questions sont fondamentales. Tout cela ne peut pas bien se terminer, les dégâts sociaux sont gigantesques. Depuis les années 1980, toutes les grandes crises financières et toutes les grandes fraudes ont révélé une sismicité de plus en plus fréquente. Les microprédations sont souvent invisibles, contrairement aux crises financières. D'ailleurs, le récent livre vert de la Commission européenne sur la titrisation ne contient aucun mot sur la crise financière, aucun mot sur la fraude, alors même que la titrisation fut au coeur de cette crise. Voilà encore un rapport qui a forcément été inspiré par le lobby bancaire. |
|
• Un phénomène qui ne relève pas d'abord du domaine de la morale Il ne faut surtout pas raisonner en termes de morale, c'est un piège intellectuel. Inéluctablement, les questions de criminalité et de fraude en matière financière vont renvoyer à des cas individuels ; or, ce n'est pas le sujet. Nous sommes face à un système qui incite à la fraude, il faut donc placer l'analyse au niveau systémique, identifier les mécanismes incitatifs, pour bien replacer cette succession de « faits divers » dans leur contexte et surtout leur véritable dimension. À ce titre, l'affaire Madoff est intéressante. Nous pouvons y voir une affaire ponctuelle, une escroquerie individuelle. En réalité, cette affaire n'était qu'une caricature de l'économie américaine, devenue une gigantesque pyramide de Ponzi. Cet homme a pu agir impunément aussi longtemps du fait d'un système dérégulé, et sa fraude n'aurait probablement pas été découverte sans la crise de 2008 qui l'a révélée. Le problème doit donc être posé sur le terrain non pas de la morale mais de l'analyse rationnelle et systémique. Il faut interroger les lois, savoir si elles incitent à ces comportements frauduleux. Poser la question criminelle permet de poser la question du crime de manière systémique. Chez Paul Krugman ou Joseph Stiglitz, on retrouve bien l'idée d'une concomitance et d'une corrélation entre la dérégulation, la survenance des crises financières, la montée des inégalités et la criminalité sur les marchés. Il y a même selon moi un phénomène de causalité entre dérégulation-crises financières-inégalités-fraudes : quand on pense inégalités, on doit forcément penser criminalité. À un moment donné, dans un système hyper-financiarisé, on ne peut survivre qu'avec de la prédation criminelle. Par ailleurs, nous ne savons plus punir ni même interdire. À l'évidence, certains mécanismes et produits devraient être interdits, notamment le trading haute fréquence. Cela pourrait se faire par le biais d'une loi claire et précise ou bien par la mise en place d'une taxe dissuasive, ou encore par la mise en place de limites quant au nombre de transactions permises sur une journée, ce qui permettrait au moins de ralentir le dispositif. Les traders et les libéraux se justifient par leurs besoins de liquidité, mais tout cela est fictif et crée de l'hyper-spéculation. Il devrait y avoir une autorisation de mise sur le marché, comme en matière médicale, ce qui serait une manière d'interdire ou de réguler en amont. Autrefois, le monde politique pouvait dominer la finance ; depuis les années 1980, c'est l'inverse : la finance domine le politique. La problématique est géopolitique, cela pose un problème de rapport de force. Jean-Claude Juncker a contribué à la transformation du Luxembourg en paradis fiscal. Quand les chefs d'États européens en font le président de l'Eurogroupe, on est confondu ou par la naïveté ou par le cynisme... |
|
• Un impensé de la pensée économique Ce qui me semble important et fondamental, c'est qu'il y a une quasi totale incapacité des économistes et des financiers à penser la question criminelle, le diagnostic criminel n'est jamais fait. L'histoire même de la science économique explique cela : la discipline économique s'est autonomisée dès le XVIII e siècle en se fondant sur un positivisme un peu étroit. Les économistes, comme Jean-Baptiste Say, considèrent que le crime reste une catégorie subjective, relative, qui n'a pas de pertinence dans la réflexion économique et financière. Jean-Baptiste Say faisait remarquer : « Voler un portefeuille, c'est un déplacement de richesse. » En réalité, lorsque le crime se systématise, plutôt qu'un déplacement de valeur, cela devient, soit de la destruction de valeur, soit une transformation du mode de fonctionnement des marchés. Il y a un péché originel de la science économique que l'on retrouve chez les économistes classiques mais aussi encore plus chez les libéraux. Pour ces derniers, le crime n'est pas un sujet, il peut avoir des vertus positives, il va être blanchi par les marchés qui s'autorégulent. Seul Keynes a su penser la déviance. Il parlait des « instincts animaux » en croyant en l'irrationalité des marchés et des acteurs économiques. À l'inverse, pour le prix Nobel Jean Tirole, la variable criminelle n'existe pas. Le diagnostic criminel n'est pas compris par les économistes de droite, de gauche et encore moins d'extrême gauche. Par exemple, les Économistes atterrés évacuent le facteur criminel. Pour eux, la « théorie du voleur », le crime, n'est qu'une opération de diversion. |
|
• Un brouillage des limites entre le licite et l'illicite Les phénomènes frauduleux sont souvent issus du risque, de mauvais investissements ou de sociétés ayant mal tourné. Les infractions financières n'ont pas l'évidence intellectuelle ni matérielle qu'ont les crimes de droit commun. Il y a une problématique d'identification intellectuelle, de caractérisation juridique et de matérialisation au sens de la visibilité. Cette difficulté est un argument de défausse pour les financiers, les économistes qui nient ces comportements. Par exemple, le trading haute fréquence pose une vraie difficulté sur ce que va être un délit d'initié dans ce marché-là. Par ailleurs, plusieurs sens peuvent être attribués à la notion de conflit d'intérêts. On peut y voir une avancée intellectuelle dans la lutte anti-corruption, dans la mesure où cette notion permettrait de concevoir l'amont de la corruption. On peut aussi y voir un concept qui vient diluer la notion même de corruption à un moment où l'on ne peut plus ou ne veut plus sanctionner : c'est une théorisation d'un échec. La dérégulation permet de brouiller la frontière entre le licite et l'illicite. Cela se remarque dans le phénomène des carrières croisées. À partir du moment où l'on permet ces aller-retour bien avant la retraite, cela entraîne une intrication de la corruption dans une gestion des carrières. Ce phénomène mêle le légal et l'illégal, l'illégal étant absorbé par le légal. La notion de corruption est dépénalisée au travers de la notion de conflit d'intérêts : c'est un aveu d'échec. |
|
• L'arme du droit pénal Le droit pénal n'est pas simplement un outil punitif, il permet aussi de réguler les marchés. Le droit pénal est une masse critique de droits que l'on place dans les mécanismes des marchés, ce qui permet aux acteurs sains d'avoir les mêmes avantages concurrentiels que les acteurs malsains. Le droit pénal doit jouer son rôle, c'est fondamental car, s'il n'y a pas d'actions au niveau national, d'autres agiront à notre place et dans un contexte de guerre économique. La lutte anti-corruption au niveau international, c'est l'arme des forts, donc des puissances impériales. Quand les entreprises françaises se comportent mal à l'export, elles se placent en situation de grande difficulté à l'égard du système fédéral américain qui dispose des outils nécessaires pour les sanctionner. Par exemple, BNP Paribas a violé, pendant dix ans, des lois sur l'embargo ; elle est devenue la banque centrale d'un État génocidaire, le Soudan ; et cela en toute conscience. Au niveau national, elle n'a jamais été sanctionnée, ce sont les Américains qui l'ont fait. Par conséquent, quand la France ne sanctionne pas ses entreprises, des puissances étrangères le font. Si on avait une vraie justice financière, on pourrait davantage réguler des comportements qui sont systématiquement déviants. La France n'arrive pas à comprendre la matière pénale, considérée par les élites comme de basse condition intellectuelle ou comme un artefact d'une domination des élites. Ce diagnostic n'a jamais été fait, sauf aux États-Unis où la FCIC 18 ( * ) a sorti un rapport de 622 pages, rapport qui apporte un diagnostic criminel. L'analyse criminelle n'est pas suffisamment posée dans un certain nombre de produits et de mécanismes juridico-financiers, par exemple, le trading haute fréquence : n'est-ce pas un délit d'initié qui ne dit pas son nom ? Ne rend-il pas invisibles des fraudes permanentes ? Enfin, il y a une forme d'asymétrie dans l'information et dans la compréhension des phénomènes. En effet, le savoir est très largement monopolisé par le monde financier, il n'y a pas de contre-pouvoir. En définitive, seul le point de vue de ces lobbies est défendu dans le débat public, ce qui est d'autant plus problématique que les évolutions des marchés financiers se font de plus en plus par la pratique ; c'est la finance qui impose ses techniques et ses produits qu'ensuite les États sont obligés de suivre. |
|
• Les États, porte-parole des lobbies bancaires Lorsqu'elles sont en position défensive, les institutions financières savent se rappeler aux États en leur faisant croire qu'elles ont une nationalité. La France et l'Allemagne ont été les porte-parole de leurs lobbies bancaires lors de la crise grecque. Les États se croient obligés d'être les porte-parole de leurs lobbies bancaires mais quelle est la contribution réelle à l'économie française de ces banques ? C'est cela la vraie problématique. Dans l'affaire Dexia, jamais personne n'aura enquêté, personne ne sait ce qu'il s'est passé alors même que les contribuables français et belges ont payé et vont continuer de payer pendant une génération. Par ailleurs, il n'y a plus de césure entre les élites bancaires et les élites politico-administratives. Il y a davantage d'inspecteurs des finances dans les banques françaises qu'à l'Inspection des finances. La capture cognitive est absolue. |
En ce début d'été 2007, le « mainstream » économique est loin de ces considérations désobligeantes et, fin août, Daniel Cohen peut titrer l'un de ses articles parus dans Le Monde : « La crise de 1929 n'aura pas lieu . » 19 ( * )
Les marchés baignaient eux aussi dans la quiétude. En juin 2007, l'indice VIX, mesurant l'inquiétude des investisseurs, « se situait à son point bas historique, c'est-à-dire un peu au-dessous de son niveau actuel. Un an plus tard, il sera à son plus haut. À l'évidence, les marchés ne jouaient plus leur rôle d'anticipation des risques » 20 ( * ) .
La crise immobilière clairement installée, il faudra plus d'un an et la faillite de Lehman Brothers, le 15 septembre 2008, pour que, hors États-Unis, ces mêmes décideurs politiques et financiers réalisent qu'ils seraient aussi concernés. Comme d'ordinaire, une théorie économique ad hoc , celle du « découplage » de l'économie européenne en plein développement et de l'économie américaine, venait rassurer les « investisseurs ».
À la fin de septembre 2008, le ministre français du budget, Éric Woerth, peut encore déclarer : « La crise est venue d'une manière extrêmement violente mais la reprise peut être extrêmement forte . » 21 ( * )
Quant au gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, il avouera honnêtement en janvier 2009 : « Je pensais qu'après l'été la crise américaine serait digérée. Et puis, la faillite de Lehman Brothers a tout changé. » 22 ( * )
II. UN CHAPELET DE CRISES FINANCIÈRES
À y regarder de près, cette première Grande crise du XXI e siècle est d'abord un chapelet de crises bancaires qui se succèdent et interréagissent, rendues techniquement possibles par l'explosion de la liquidité, une interconnexion des intérêts et une totale liberté de spéculation accordée, suivant des tempos et des modalités différents selon les pays, à un système financier globalisé 23 ( * ) . Un chapelet de crises bancaires dont la plus importante, celle qui va donner le branle au système financier international, est incontestablement étasunienne mais qui ne se résume pas à elle.
La crise des subprimes étasunienne n'a fait que révéler, en Europe, une crise déjà là et qui n'attendait que l'étincelle pour exploser 24 ( * ) .
A. LES CRISES SPÉCULATIVES EUROPÉENNES
Si, dans la plupart des crises du vieux continent, entre, certes, une part de crise étasunienne, l'essentiel est imputable aux opérations spéculatives juteuses mais hasardeuses des banques européennes, notamment britanniques, allemandes et françaises.
Les difficultés de l'Irlande et de l'Espagne, qui renvoient à la spéculation organisée, avec la complicité des pouvoirs publics, par un secteur immobilier surdimensionné, apparaissent avant la crise des subprimes . L'endettement privé qui en découle y est de plus renforcé par le développement du crédit à la consommation. En revanche, ces deux pays sont des modèles de vertu en matière d'endettement public.
Même schéma, à quelques nuances près, pour la Grande-Bretagne, qui, au terme de cinq mois de rebondissements, devra nationaliser Northern Rock dès le mois de février 2008 : on y constate un secteur bancaire hypertrophié, ainsi qu'une spéculation immobilière et un endettement privé particulièrement importants.
La chute du mur de Berlin et la conversion brutale à l'ultralibéralisme des pays autrefois sous influence soviétique ont aussi suscité l'appétit des banques britanniques, allemandes, françaises et scandinaves, éblouies par le taux de croissance de ces nouveaux convertis. Si la crise venue des États-Unis marque le commencement de la fin, c'est que le terrain avait été bien préparé.
Autre exemple significatif de cette frénésie du développement et de la consommation à crédit, la crise islandaise, un pays un temps au top du développement mondial. Débutant début 2008, elle touchera la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, l'Allemagne et les pays scandinaves. L'attribution d'un prêt du FMI à l'Islande, à la fin de 2008, marque la fin de cette épopée viking !
La bulle immobilière et, d'une manière générale, l'endettement à crédit des pays du sud de l'Europe ont été facilités par l'afflux de capitaux en provenance des deux partenaires les plus importants : l'Allemagne et la France. Du fait du mode de construction de la zone euro, cette crise spéculative du même type que les précédentes se transformera en crise des dettes souveraines (publiques), sorte de crise dans la crise.
B. LA CRISE FINANCIÈRE AMÉRICAINE ET SES SUITES
1. La crise financière américaine
Comme on l'a dit 25 ( * ) , une dizaine d'années avant le début de la crise, la spéculation immobilière, aux États-Unis et dans une bonne partie de l'Europe, est devenue le moteur du développement. Ce boom est évidemment financé à crédit par le biais de prêts hypothécaires. La valeur de l'immobilier ne cessant de monter, l'opération paraît sans risque pour les banquiers.
Les prêts étant « rechargeables », dès que la valeur du bien dépasse suffisamment le montant du prêt, l'emprunteur peut obtenir une « rallonge » de son prêt, lui permettant de financer sa consommation. Le crédit à la consommation, dont les prêts rechargeables ne sont qu'une des modalités, seront le second moteur économique du système.
Cette belle mécanique va s'emballer à partir du moment où, aux États-Unis, la vente de prêts immobiliers aux personnes pouvant les rembourser ne suffisant pas, des petits malins décident d'attaquer le marché, bien plus vaste, de ceux dont on pouvait penser qu'il y avait des chances sérieuses qu'ils ne pourraient les rembourser qu'avec difficulté. Là est l'origine immédiate de la Grande crise qui n'aurait pas été possible sans la complicité des pouvoirs publics.
a) L'arnaque des subprimes
Différentes dispositions permettent d'allécher le client qui se demanderait pourquoi on lui fait un si beau cadeau : la perspective de pouvoir obtenir d'autres prêts à la consommation, l'absence d'apport personnel (prêts à hauteur de 100 % du bien, voire plus), différé de remboursement du capital les premières années, taux progressifs, etc., auxquels s'ajouteront des dispositions fiscales (déductibilité des intérêts de l'impôt sur le revenu). Une armée de démarcheurs peu scrupuleux sur le respect des règles prudentielles en matière de prêts va permettre de faire bonne moisson.
Pour le prêteur il n'y a que des avantages. Les taux étant d'autant plus forts que les risques de défaillance du débiteur sont grands, ces placements sont d'un bon rapport et tout est fait pour qu'ils soient sans risque pour lui : assurance à la charge du débiteur, biens en garantie qui se valorisent chaque jour et surtout titrisation des créances qui permet de repasser à quelqu'un d'autre les risques . La technique est la suivante. Les créances hypothécaires sont revendues à un ou plusieurs tiers qui les transforment en « titres ». « Titriser » consiste à faire des paquets de créances (ici, prêts hypothécaires) pouvant être à leur tour revendus. En faisant avec les « paquets » d'autres « paquets » plus gros susceptibles d'être vendus par petits morceaux, on crée des produits dérivés de crédits ou CDO ( collateralized debt obligations ). Étendus à toute espèce de créances, ces « produits dérivés de crédits » joueront un rôle de plus en plus important dans les échanges financiers.
Les seuls produits dérivés de crédits hypothécaires (RMBS) représentaient en 2007, 5 200 milliards de dollars, soit plus que les obligations du Trésor américain, 4 900 milliards de dollars.
Si les titres qui rapportent le plus sont ceux qui présentent le plus de risques, les acheteurs le savent d'autant moins que ces produits dérivés sont généralement notés comme sûrs par des agences ayant une conception très élastique de la déontologie. Il faut bien vivre ! Ainsi a-t-on trouvé des sicav monétaires notées AAA, la note la plus haute, proposées par des banques ayant pignon sur rue, infestées de créances douteuses. D'ailleurs, qu'importe, puisque les titres changeront rapidement de mains !
Une fois formatés et reformatés, les titres se mettent à circuler partout dans le monde entier. Ils sont d'un rapport alléchant et tout lien avec des débiteurs américains peu solvables a disparu. Ils permettent aux institutions financières d'augmenter leurs bénéfices et leur chiffre d'affaires en offrant à leurs clients des titres d'un rendement supérieur à ceux de la concurrence. Cela explique que des institutions bancaires, en principe sérieuses, s'en soient donné à coeur joie, avant de déchanter.
Ainsi, par le canal de titres qui les ont rendus méconnaissables, les subprimes américains ont-ils contaminé la planète bancaire, attirée par les perspectives de gains qu'ils offraient. Autre avantage, les titres, ne faisant généralement que transiter par les comptes, ne figurent pas au bilan tout en améliorant les bénéfices.
b) Du «Big short » à la crise bancaire
Reste à expliquer pourquoi et comment la success story s'est terminée en drame, comment des pratiques spéculatives immobilières semi-frauduleuses ou totalement frauduleuses dans quelques États des États-Unis ont pu infecter les systèmes financiers du monde entier.
La catastrophe ne serait pas arrivée si, outre la titrisation, un autre produit financier miracle n'avait pas été inventé - les CDS ( credit default swaps ) -, amplifiant la spéculation et accélérant la diffusion de ses effets 26 ( * ) .
Au départ, les CDS sont des sortes de contrats d'assurance destinés à protéger contre les aléas de la conjoncture (hausse du prix d'un produit pour l'acheteur et baisse pour le vendeur, variation du cours d'une devise pour un importateur ou un exportateur, défaillance d'un débiteur d'une créance hypothécaire, variation du taux de refinancement d'un emprunt etc.). À l'arrivée, ce sont des « armes de destruction massive » comme dira Warren Buffett, permettant la spéculation à la baisse et à crédit en donnant l'assurance de pouvoir vendre à terme un bien que, généralement, on ne possède pas ( shorting ), à un prix garanti ou de recevoir la différence entre la valeur du bien au cours prévu et celle qu'il a au terme.
Le film d'Adam McKay, The Big short , retrace bien comment la spéculation à la baisse de quelques observateurs de l'augmentation régulière du nombre de défaillances de détenteurs de prêts hypothécaires, rejoints, dès que le marché des titres hypothécaires s'est mis à baisser, par les banques qui les avaient créés, a débouché sur son effondrement et le krach.
La technique consiste à acquérir des options de vente de titres hypothécaires auprès d'une banque, laquelle s'engage à les acheter (Goldman Sachs, par exemple) à un prix inférieur au cours qui reste plutôt orienté à la hausse. Si ces acquisitions de CDS sont suffisamment importantes, elles peuvent susciter un doute quant à la fiabilité des titres, amorçant puis accélérant la chute de leurs cours. Au terme prévu par le contrat, ses détenteurs achètent des titres dévalués qu'ils vendent, au prix qu'ils avaient avant leur chute, au fournisseur de CDS. La différence, déduction faite des frais d'achat des CDS, est pour eux. Un véritable « casse » !
À compter de l'été 2007 qui voit l'une des plus prestigieuses banques d'investissement des États-Unis - Bear Stearns - entrer en agonie, les responsables américains doivent constater qu'il se passe quelque chose de sérieux. D'autant que suivront les faillites en cascade des grands établissements bancaires spécialisés dans l'immobilier, jusqu'à la clef de voute du système représentée par les deux géants du crédit hypothécaire, Fannie Mae et Freddie Mac, qui devront être nationalisés.
c) La crise bancaire
À partir de l'été 2008, la crise immobilière se propage à l'ensemble du système bancaire.
Le doute généralisé sur la solidité réelle des établissements bancaires, dont on ignore la valeur et le volume des créances douteuses de leurs bilans et plus encore celui des produits dérivés hors bilan, est à l'origine d'une crise majeure de liquidité puis de solvabilité, nécessitant l'intervention massive de l'État et de la Réserve fédérale américaine - la Fed - au nom du principe : « Trop gros pour faire faillite » ( Too big too fail ).
Ces interventions prennent plusieurs formes : recapitalisations (nationalisations plus ou moins déguisées), apports de garanties, rachats de titres devenus non négociables et facilitation de la reprise des banques en faillite par de plus grosses, moins exposées. Au point que le sénateur républicain du Kentucky, Jim Bunning, pourra dire : « Quand j'ai ouvert mon journal hier, j'ai cru que je m'étais réveillé en France. Mais non, il s'avère que le socialisme règne en maître en Amérique. » 27 ( * ) Cet ancien professionnel de baseball était assez candide pour ignorer que le libéralisme, c'est aussi la socialisation des pertes, pour le plus grand bien de tout le monde, évidemment.
Élément du dispositif, le plan Paulson de sauvetage de l'économie américaine - TARP 28 ( * ) - visera d'abord à racheter les créances « toxiques » liées aux subprimes pour passer le cap, en rétablissant les échanges interbancaires et la confiance dans l'institution financière. La crise s'étendant et devenant aussi économique, il prendra la forme, à la mi-novembre 2008, d'apports en capital, accompagné d'une relance du crédit à la consommation. Une partie des 800 milliards de dollars (7 % à 8 % du PIB américain) de l'autorisation d'engagement consentie avec réticence par le Congrès sera utilisée par le plan de relance économique - ARRA 29 ( * ) - engagé par Barack Obama dès sa prise de fonction à la présidence.
Au final, les 245 milliards de dollars engagés dans le plan de sauvetage des banques au titre du TARP auraient été remboursés par celles-ci.
d) La crise assurancielle
Des banques, la crise gagne le secteur de l'assurance, devenu une activité essentielle de l'industrie financière. Appelé en garantie, le système ne peut faire face à l'explosion des sinistres. L'État américain et la Fed sauveront le géant mondial de l'assurance AIG de la faillite et indirectement les grandes banques américaines et européennes qui y étaient assurées. Les instruments financiers inventés pour protéger les opérateurs des aléas du marché (« produits dérivés ») et sécuriser le système se sont retournés contre ce dernier.
e) La chute de Lehman Brothers
La crise sera à son paroxysme avec la faillite, le 15 septembre 2008, de Lehman Brothers, quatrième plus grande banque d'investissement des États-Unis (25 000 employés dans le monde), faute d'intervention du Trésor et de la Fed. D'une crise financière du secteur immobilier, on est passé à une crise financière globale, avant qu'elle ne devienne économique et sociale.
|
La faillite de Lehman Brothers et le sauvetage d'AIG Pour les amateurs d'explications simples et réconfortantes, c'est la seule cause de la Grande crise, et l'avoir permise une faute contre le bon sens de l'État américain. Les amateurs de complots y voient aussi un épisode de la guerre entre Lehman Brothers et JP Morgan, autant dire entre la finance juive et la finance protestante. Pour d'autres, il s'agirait plutôt d'une manoeuvre de Goldman Sachs par l'intermédiaire de son ancien président Henry Paulson, devenu secrétaire du Trésor américain. Ce que l'on peut constater, en tous cas, c'est que les responsables américains placés dans une situation intenable devaient faire des choix entre les établissements à sauver en priorité, tous plus gros les uns que les autres, notamment Merrill Lynch, et surtout le premier assureur du monde, AIG, clef de voute au final de tout l'édifice. Compte tenu de l'état de fatigue dans lequel se trouvaient les fonctionnaires du Trésor ou de la Fed alors à la manoeuvre, l'erreur pure et simple n'est pas non plus exclue. C'est en tous cas ce que pense Jacques Sapir : « Un gouvernement ne peut traiter qu'un nombre limité de problèmes simultanément, c'est le phénomène de saturation cognitive. Par exemple, lors de la faillite de Lehman Brothers, les agents du Trésor et de la Fed étaient épuisés, ils avaient dû gérer une succession de crises depuis mars 2008 (Bear Stearns, première et deuxième crises de Fannie Mae, et enfin Lehman Brothers). In fine, les États et les banques centrales commettent forcément des erreurs s'il y a épuisement physique. » 30 ( * ) Quoi qu'il en soit, en septembre 2008, le bilan de Lehman Brothers était catastrophique et, de plus, falsifié. Il était de 700 milliards de dollars pour un capital de 25 milliards, soit un levier de 27, le reste de la ressource étant assurée à court terme ! Quant aux investissements à risques, rien qu'entre 2006 et le premier trimestre 2008 ils étaient passés de 86 milliards à 275 milliards de dollars. S'agissant du hors-bilan, avec ses 1,2 million de CDS, signés avec 930 000 contreparties pour une valeur faciale de 39 000 milliards de dollars, il était encore moins rassurant pour les créanciers ! Après coup, on s'apercevra aussi : - que le système de surveillance et de contrôle des risques pris par les traders avait été trafiqué. Le chef du contrôle des risques qui s'en était plaint a été licencié sans que cela émeuve la Sec 31 ( * ) ; - de diverses irrégularités comptables permettant de dissimuler l'état réel du bilan et de frauder le fisc 32 ( * ) . |
Le lundi 6 octobre 2008, l'indice Dow Jones perd 700 points et passe sous la barre des 10 000 points pour la première fois depuis 2004 : le vrai krach commence alors, avec la plus forte baisse en une semaine constatée sur la plupart des places mondiales.
2. Les conséquences européennes de la crise américaine
Partie des États-Unis, du fait de la globalisation financière, la crise s'est propagée aux pays possédant des actifs hypothécaires américains généralement acquis en s'endettant 33 ( * ) : Allemagne, Grande-Bretagne, Suisse, Japon, Chine. Elle ravivera la crise des pays et des banques déjà empêtrés dans la spéculation immobilière - Irlande, Espagne, Royaume-Uni - ou l'endettement - pays de l'ancienne zone d'influence soviétique, Islande et pays du sud de l'Europe. Une fois déclenchée, prêteurs imprudents et emprunteurs seront touchés.
La première manifestation de la crise américaine en Europe est précoce : la fermeture temporaire de trois fonds de titres hypothécaires de BNP Paribas dès août 2007 34 ( * ) . Le système financier allemand gavé de créances juteuses mais à haut risque étasuniennes et européennes - Grande-Bretagne, Irlande, Espagne - sera, avec le système britannique, clairement le plus exposé.
Le feu couvera sous la cendre jusqu'au début de l'année 2008 : en février, Crédit Suisse annonce 1,9 milliard d'euros de perte d'actif et se recapitalise de 6,5 milliards d'euros ; UBS doit aussi procéder à une recapitalisation à hauteur de 3,9 milliards d'euros. La vague de recapitalisation et de nationalisations s'amplifie.
Au terme de cinq mois de rebondissements, la banque Northern Rock est nationalisée en février 2008 par le gouvernement britannique. Suivront Bradford & Bingley, Royal Bank of Scotland, HBOS et Lloyds TSB. Au final, les Britanniques, en injectant l'équivalent de 25 % de leur PIB annuel, procéderont à une quasi-nationalisation de leur système financier.
En août 2008, la banque allemande IKB est bradée 137 millions d'euros à un fonds américain. Puis, en janvier 2009, l'État allemand fusionne et renfloue la Commerzbank et la Dresdner Bank, et, en juin de la même année, nationalise en urgence Hypo Real Estate, une banque de la taille de Lehman Brothers. Les banques régionales allemandes - Landesbanken -, qui avaient beaucoup batifolé, sont renflouées par les Länder . WestLB est démantelée aux frais de l'État fédéral. Selon La Tribune : « En tout, plus de 200 milliards d'euros de garanties sur les actifs "toxiques" ont été émis par l'État fédéral via son fonds, la SoFFin. » 35 ( * ) Des instituts publics comme HSH Nordbank devront aussi être sauvés du naufrage. Au total, cela représente un coût de 240 milliards d'euros pour le contribuable allemand.
La Belgique, la Luxembourg et les Pays-Bas nationalisent Fortis.
En France, à part Dexia 36 ( * ) , sauvée temporairement par ses parrains franco-belges, se produisent non pas des faillites bancaires mais une série « d'accidents de marché » d'institutions financières en principe au-dessus de tout soupçon d'activité spéculative : Société Générale, BNP Paribas, les groupes Caisses d'épargne et Crédit Agricole 37 ( * ) . Au début du mois d'octobre 2008, les choses se gâtent. En écho à l'effondrement du Dow Jones, le CAC40 perd 9 %, l'indice FTSE 100 britannique, 7,9 %, et le DAX allemand, 7,1 %.
Le marché interbancaire donnant des signes de thrombose, la BCE injecte 50 milliards puis 250 milliards d'euros et commence à baisser son taux directeur qu'elle n'avait cessé d'augmenter depuis 2006. Signe de l'incompréhension de ses responsables sur ce qui est en train de se passer, sa dernière augmentation remontait à juillet 2008 !
Après des interventions en urgence et en ordre dispersé, les États européens, réalisant enfin l'ampleur du problème et stimulés par les Américains, les pays de la zone euro et la BCE, se mettent enfin d'accord, le 12 octobre 2008, sur un « plan d'action concerté » de traitement non seulement de la crise de liquidité mais aussi de la crise de solvabilité 38 ( * ) :
- le plan français prévoit 360 milliards d'euros d'engagements sous la forme de garanties payantes des prêts interbancaires et de 40 milliards d'euros pour recapitaliser les banques qui seraient en difficulté ;
- le plan allemand de 480 milliards d'euros est de facture identique : 400 milliards d'euros de garanties et 80 milliards d'euros de recapitalisation ;
- les plans espagnol et autrichien, de 100 milliards d'euros, portent essentiellement sur des garanties.
C. UNE CRISE DANS LA CRISE : LA CRISE DE LA ZONE EURO
C'est sur ce fond de fragilisation des banques des principaux pays européens et des États, dont la chute des rentrées fiscales et le sauvetage financier du système bancaire ont fait exploser le solde budgétaire et l'endettement que va survenir la crise grecque. Une crise grecque que le mode de construction de la zone euro et l'aveuglement de ses dirigeants allaient transformer, selon la formule de James K. Galbraith, en « tragédie européenne » 39 ( * ) .
1. L'adhésion en fraude de la Grèce à la zone euro
En 1999, à la veille de la création de l'euro, la Grèce est très loin de remplir les conditions d'adhésion en matière de déficits. La manoeuvre, laissée aux bons soins de Goldman Sachs, Eurostat étant alors désorganisé par un scandale financier interne, les responsables politiques regardant ailleurs, va consister à en dissimuler le déficit réel. La filiale britannique de la banque étasunienne vend alors à la Grèce et au gouvernement socialiste de Costas Simitis un swap en devises permettant de transformer la dette grecque en dollars en dette en euros mais...inscrite hors bilan. Goldman Sachs empoche sa commission et la dette grecque en dollars a disparu du bilan.
En 2006, Goldman Sachs revend une partie du swap à la National Bank of Greece, première banque commerciale du pays dirigée par un ancien de chez Goldman Sachs, et, en novembre 2011, un autre ancien de Goldman Sachs, Mario Draghi, devient président de la BCE.
2. La crise de 2010-2014
En octobre 2009, à peine arrivé au pouvoir, le nouveau chef du gouvernement grec, le socialiste Georges Papandréou, annonce que le déficit budgétaire du pays pour 2009 était non pas de 6 % du PIB, comme le prétendait son prédécesseur issu de la droite libérale, mais de 15,6 %. Le 23 avril 2010, il appelle à l'aide le FMI et ses partenaires de la zone euro.
Coup politique pour salir un adversaire, convaincre le FMI et l'Europe du sérieux de la situation et de l'aider à en sortir, préparer le pays aux mesures de restriction qui allaient suivre ? Une polémique politicienne s'ensuivit. Quoi qu'il en soit, même si le déficit était plutôt de 12,7 % que de 15,6 % du PIB, on était loin des 3 % de Maastricht. Résultat : dégradation de la note A attribuée à la Grèce par les agences de notation, ce qui lui avait permis d'emprunter sans problème jusque-là. Panique, spéculation à la banqueroute grecque, difficultés de financement, explosion des taux... Sont alors réunis tous les ingrédients d'une crise majeure, crise non seulement grecque mais de la zone euro elle-même, la défiance des marchés envers la Grèce et la spéculation au krach pouvant se reporter sur d'autres pays, comme le Portugal et l'Espagne.
Ce qu'on craint le plus, c'est qu'une défaillance de l'État grec ne fragilise un peu plus les banques grecques et européennes en Grèce, déjà incapables de rembourser leurs dettes envers les bailleurs privés - banques, assureurs, fonds d'investissement ou de pension, etc. - auxquels elles ont fait appel pour abonder leur passif. Les banques françaises sont très engagées - 57 milliards d'euros d'engagements, particulièrement du Crédit Agricole -, ainsi que les banques allemandes, à hauteur de 34 milliards d'euros. À l'examen des plans qui seront imposés au gouvernement grec, on comprendra que le but est de sauver non pas la Grèce mais les banques grecques et surtout étrangères ainsi que ceux qui, par leurs prêts, leur ont permis de prendre des risques.
La manoeuvre va consister à transformer les dettes des banques en Grèce en dette de l'État grec, avec un abattement de 107 milliards d'euros, soit 52 % de la dette envers des investisseurs privés, et à la compenser par un prêt à l'État grec (aux frais des contribuables grecs) d'instances internationales ou de pays européens : FMI, BCE, FESF 40 ( * ) , divers pays européens, notamment l'Allemagne et la France 41 ( * ) .
Suivront deux plans « d'aide » en 2010 et 2011, respectivement de 110 milliards et de 130 milliards d'euros, montants à prendre avec précaution dans la mesure où les prêts sont débloqués au compte-gouttes dans un brouillard total.
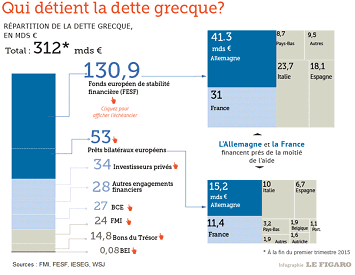
Surtout cette « aide » est assortie de telles conditions que le pays, véritablement saigné, va être plongé dans une récession sans précédent l'empêchant de rembourser une dette qui, loin de se réduire, augmentera.
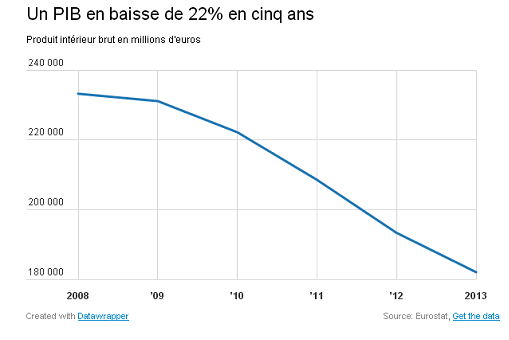
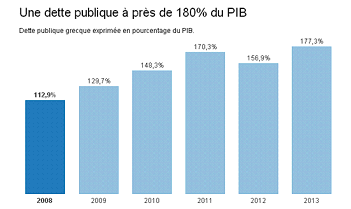
Entre mars 2010 et janvier 2013, pas moins de sept plans d'austérité se succéderont, ce qui donne une idée de la qualité de l'expertise de la Troïka : FMI, BCE et Commission européenne ! Ils comprennent tous des mesures destinées à augmenter les recettes publiques (augmentation du taux d'impôts existants, notamment de la TVA ; création de nouveaux impôts, modification des barèmes, élargissement de l'assiette de ceux qui existent) et à diminuer les dépenses publiques (baisses successives des salaires et suppression des avantages sociaux existants dans le public et le privé ; baisse des pensions publiques et privées et recul de l'âge du départ à la retraite ; durcissement des conditions d'attribution des aides sociales ; coupes dans les budgets de la sécurité sociale et de l'armée ; suppression d'emplois de fonctionnaires, etc.). S'y ajoutent des mesures de stricte observance libérale : dérégulation du marché du travail et des services (transports, énergie), privatisations (ports et aéroports, poste, énergie, paris sportifs, banques, entreprises d'État).
L'ensemble de ces mesures d'austérité était censé rapporter 91,55 milliards d'euros, plus 50 milliards d'euros au titre des privatisations 42 ( * ) .
Selon les calculs des experts, le plan de stabilisation grec était parfaitement tenable sans nouvelle restructuration de la dette. Leur pari étant que l'endettement baisserait plus vite que les restrictions budgétaires imposées au gouvernement ne feraient baisser le PIB, jusqu'au point d'équilibre où la dette deviendrait soutenable. C'est le contraire qui s'est produit : l'activité économique et les rentrées fiscales se sont effondrées en même temps que la dette, creusant le chômage et la pauvreté. Le FMI lui-même, par la voix de son économiste en chef, Olivier Blanchard, devait honnêtement reconnaître, en décembre 2012, que les modèles utilisés pour évaluer les effets sur la croissance des mesures d'austérité étaient erronés : « Les multiplicateurs budgétaires étaient plus élevés que ceux postulés par les prévisionnistes. » 43 ( * )
Au final, le ratio dette-PIB, qui devait être de 153 % en 2015, sera de 177 % (100 % en 2007), malgré 107 milliards d'euros d'annulation de dette sur les créanciers privés ( haircut ou « coupe de cheveux »). Le PIB, quant à lui, aura chuté de 25 % par rapport à 2009.
À la fin de 2014, le pays était à terre.
Rien d'étonnant donc que les partis qui ont amené le pays où il est (Pasok de gauche et Nouvelle Démocratie de droite) soient laminés aux élections législatives 44 ( * ) .
3. La crise de 2015
Aux élections anticipées de janvier 2015, Syriza (coalition Gauche radicale et Verts) obtient 49,7 % des sièges, soixante-dix-huit de plus qu'aux élections précédentes de 2012, ce qui permettra à son leader, Alexis Tsipras, avec l'apport de l'Anel, le parti des Grecs indépendant, et de ses treize sièges, de constituer une majorité à la Boulé. Nouvelle Droite obtient 25,3 % des sièges, soit cinquante-trois de moins, et le Pasok, 4,3 % des sièges, en baisse de vingt.
Élu avec des objectifs qui se révéleront à l'usage contradictoires - obtenir de la Troïka un allégement de la dette grecque tout en restant dans la zone euro -, Alexis Tsipras demande une réouverture des négociations, ce qu'il était en droit de faire aux termes du précédent accord, la Grèce ayant rétabli, en janvier 2014, son excédent primaire 45 ( * ) .
Au terme de six mois de négociations sous tension et de chantage, les banques grecques sous perfusion, les Grecs, consultés par référendum le 5 juillet 2015, rejetteront à plus de 60 % les propositions de la Troïka, résultat que commentera, en ces termes, Alexis Tsipras : « J'ai tout à fait conscience que le mandat que vous m'avez confié n'est pas celui d'une rupture avec l'Europe, mais un mandat pour renforcer notre position aux négociations afin de rechercher une solution viable. »
Sauf que la Troïka et les chefs de gouvernements européens l'entendent d'une autre oreille. Le Premier ministre grec acceptera finalement, le 12 juillet 2015, à Bruxelles, une reddition sous des conditions pires que celles qui avaient été refusées. Rester dans la zone euro aux conditions imposées ou partir, c'était à prendre ou à laisser. Ne se résolvant pas à laisser, les Grecs, encouragés par les négociateurs français qui s'attribuèrent l'insigne honneur de l'exploit, ont pris.
Contesté dans son propre parti pour avoir signé de tels accords, Alexis Tsipras sera confirmé dans ses fonctions de Premier ministre par les Grecs lors de nouvelles élections législatives convoquées en septembre 2015. Avec quelles perspectives, pour les Grecs et pour l'Europe ? Toute la question est là.
L'accord de Bruxelles est en effet inapplicable tel quel, comme le pense la plupart des économistes. Si la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, est formelle - « l'allégement » de la dette grecque est « inévitable » -, l'Allemagne et l'Eurogroupe ne veulent pas en entendre parler. Pour l'heure, ils acceptent seulement un allongement de la durée des remboursements, autrement dit, la transformation des Grecs en débiteurs éternels.
Le prédécesseur de Christine Lagarde à Washington, Dominique Strauss-Khan, est du même avis : « [Les] conditions de cet accord, quant à elles, sont proprement effrayantes pour qui croit encore à l'avenir de l'Europe. Ce qui s'est passé le week-end dernier est pour moi fondamentalement néfaste, presque mortifère. » 46 ( * )
Position identique de Romano Prodi, ancien président de la Commission européenne, deux fois chef du gouvernement italien, pour qui « tout le monde sait depuis longtemps que le Grèce ne pourra rembourser la totalité de sa dette » : les conditions imposées à la Grèce l'ont été « de la pire manière qui soit. On a transformé un petit problème en un énorme problème [...] La confiance qui doit être à la base des relations entre les pays européens a été anéantie. Nous avons évité le pire, mais nous avons créé le mal. » 47 ( * )
4. Une tragédie européenne
Sur le fond, rien n'est encore réglé.
Au début du mois de décembre 2016, les discussions sur l'allégement de la dette grecque ont repris avant d'être suspendues à la suite de l'annonce du Premier ministre grec de rétablir, pour les plus petites pensions de retraite, un treizième versement annuel et de reporter la hausse de la TVA sur les îles de l'est égéen tant que durera la crise des réfugiés !
La situation sociale et politique est toujours aussi tendue. Des signes de rejet des réfugiés désormais bloqués en Grèce du fait de l'absence de politique européenne en la matière commencent à apparaître.
Le chômage est de 25 %.
La dette publique, qui était de 113 % du PIB en 2008 atteint désormais 181 %.
« L'économie hellène est très loin de se redresser. Le PIB de la Grèce est toujours inférieur de près de 25 % à son niveau de 2009. Après une timide embellie en 2014, il a de nouveau reculé en 2015 (- 0,2 %). Et il devrait encore plonger de 0,3 % cette année, selon la Commission européenne . » 48 ( * )
Faute d'une Banque centrale clairement habilitée à financer directement la dette publique et mettant ainsi les États à l'abri de la spéculation, on a bricolé un système de financement collectif de plus en plus complexe : Mécanisme européen de solidarité financière (MESF), Fonds européen de stabilité financière (FESF), Mécanisme de stabilité financière (MES), Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'Union économique et monétaire (TSCG).
Faute d'un minimum de gouvernance politique démocratique, pour ne pas dire de bon sens et d'humanité, le résultat est là.
Cinq ans pour ne pas régler au fond la situation d'un pays dont le PIB représente seulement 3 % de celui de la zone euro, sans garantie que le dispositif fonctionnera avec des pays plus importants comme le Portugal, l'Espagne ou l'Italie s'ils se trouvaient menacés, et surtout en installant directement, une austérité budgétaire et sociale mortifère en Grèce et la stagnation économique dans la majorité des pays de la zone euro : pas vraiment une réussite !
Il faudra attendre le 9 mars 2015 pour que la BCE engage, en contravention avec son mandat, ce qui indisposera l'Allemagne, un vaste programme - 1 000 milliards d'euros - de rachat de dettes publiques et privées détenues par les banques, un swap échangeant des obligations plus ou moins solides contre de la monnaie banque centrale, dans l'espoir que les banques bénéficiaires se mettront à prêter à l'économie.
III. LA CRISE ÉCONOMIQUE
Les tableaux ci-après montrent que la crise financière est devenue économique dès 2008, le choc le plus important étant supporté durant l'année 2009, particulièrement en termes de chômage. Tous les critères vont dans le même sens : croissance économique, degré de mobilisation de l'appareil de production, chômage.
Comme on le développera plus loin 49 ( * ) , la grande différence entre les États-Unis et la zone euro, c'est que les premiers, réagiront très vite, puissamment et surtout en ne séparant pas remise en ordre de la sphère financière et relance économique : politique des taux directeurs, mise en place d'un plan d'aide à la consommation dès 2008 et de relance (ARRA) dès 2009, politique massive de quantitative easing .
Rien à voir avec la politique timorée des responsables de la zone euro, préoccupés avant tout par le redémarrage du système financier, l'activité étant censée suivre. Mais peut-on reprocher à des banquiers, essentiellement chargés de faire respecter les traités, de ne se préoccuper que de leur pré carré ? Le reproche s'adresse beaucoup plus aux architectes d'un système censé fonctionner sans direction politique démocratique légitime.
Quoi qu'il en soit, les résultats sont en faveur des États-Unis.
Au quatrième trimestre 2015, la zone euro a juste récupéré son niveau d'activité du dernier trimestre 2007, alors qu'il est 11 % plus élevé aux États-Unis. Même si les différences de résultats en termes d'emplois sont plus difficiles à apprécier au vu du caractère très discutable des modalités de comptabilisation, ils semblent eux aussi meilleurs.
• Taux de croissance et taux de chômage
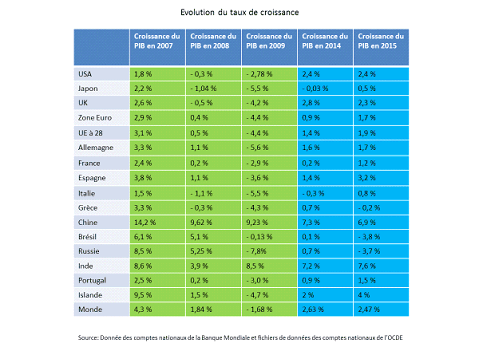
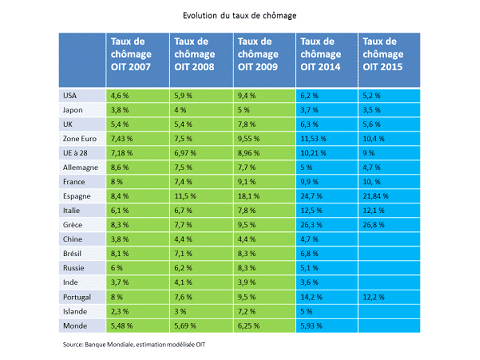
• Taux directeurs Fed et BCE
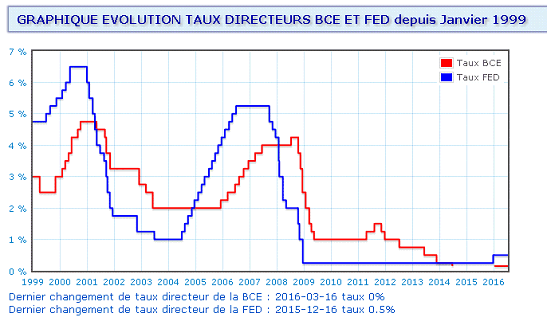
La Fed a abaissé plus vite et plus fortement ses taux directeurs que la BCE. On note que, en 2009 et en 2011, la BCE est tentée de remonter ses taux, comme si l'inflation menaçait. Il faudra attendre l'arrivée de Mario Draghi pour que les politiques convergent de part et d'autre de l'Atlantique.
• Niveau d'activité économique
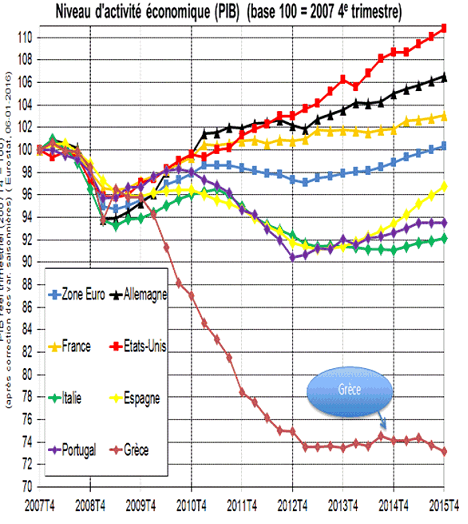
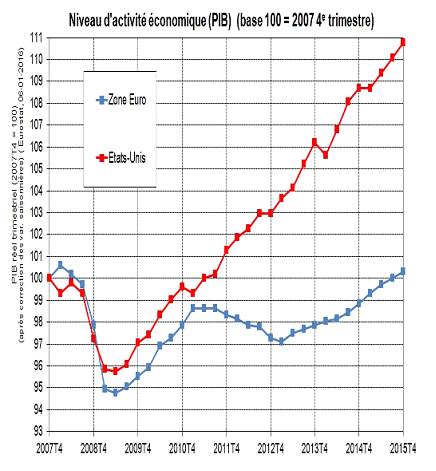
Ces graphiques, que l'on doit à Thomas Piketty, montrent bien que la crise économique est partout dès 2008, un peu plus vive dans la zone euro qu'aux États-Unis cependant. Ils montrent aussi la plus grande efficacité de la gestion étasunienne de la crise économique. À noter les destins divergents de l'économie grecque et de l'Allemagne, la gradation des situations entre les autres membres de la zone euro.
• Degré de mobilisation de l'appareil de production
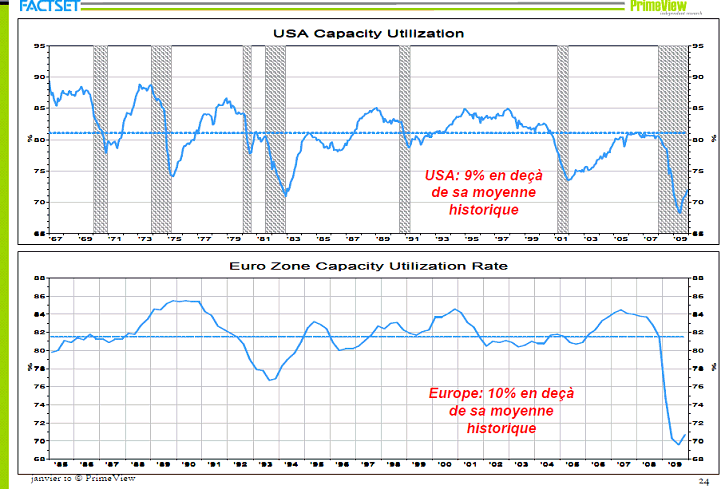
Source : Factset janvier 2010
TROISIÈME PARTIE : POURQUOI LA CRISE OU LA GRANDE TRANSFORMATION DE L'EMPIRE AMÉRICAIN
«
Comment a-t-on pu laisser s'installer un
système financier
aussi dangereux ?
»
« Comment se fait-il que personne n'ait prévu [la crise] ? »
Élisabeth II d'Angleterre
Telles sont les deux questions, faussement naïves, posées par la Reine d'Angleterre aux professeurs, un peu gênés, de la London School of Economics lors de sa visite à ce haut lieu du libéralisme, en novembre 2008.
La réponse à la première question, c'est que le système financier qui accouche de la première grande crise après celle de 1929 s'est imposé parce qu'il était une partie de la réponse aux contraintes géopolitiques auxquelles vont se trouver confrontés les États-Unis au début des années 1970 et parce qu'il répondait aux intérêts du petit groupe social qu'on appellera par facilité, avec l'historien et essayiste étasunien Christopher Lasch, les « élites » 50 ( * ) des pays développés.
Ce n'est ni le produit du hasard, ni d'une série d'erreurs fortuites, encore moins de la captation d'un outil utile à tous, détourné au profit d'une minorité. Il est le produit d'une mutation globale : des cadres mentaux, des principes et des règles présidant jusque-là au gouvernement et au fonctionnement de l'Empire américain - terme plus exact que celui, généralement utilisé, de monde occidental -, aux relations entre ses composantes. Il est donc vain d'espérer de quelque réforme technique un changement significatif de son fonctionnement et des résultats qui en découleraient.
Et si personne n'a vu venir la crise, c'est tout simplement parce qu'elle était impensable dans la vision du monde conforme au nouveau credo libéral.
On peut dater de la dénonciation unilatérale des accords de Bretton Woods par les États-Unis, en 1971, le début de cette grande transformation qui renvoie au néant l'ordre de l'après-guerre et les Trente Glorieuses.
Inspiré par Keynes et les New Dealers, voulus par Roosevelt et signés dès juillet 1944, avant même la fin de la guerre donc, les accords de Bretton Woods organisent l'ordre mondial en instituant un « système de change-or » liant chaque monnaie au dollar, lui-même convertible en or au taux fixe de 35 dollars l'once. Le taux de change entre le dollar et les autres monnaies fixé, celui-ci ne pouvait fluctuer que dans une fourchette de #177; 1 %. Des variations plus importantes étaient possibles seulement si le pays pouvait démontrer qu'il ne pouvait faire autrement au regard de sa balance des paiements et de son niveau de réserves en dollars. Deux institutions de moindre importance, mais qui eurent une plus grande longévité, venaient compléter le dispositif : le FMI et la Banque mondiale.
Faute du système de recyclage des excédents proposé par Keynes mais refusé par les États-Unis, un tel système ne pouvait fonctionner qu'autant que les comptes extérieurs américains étaient assez excédentaires pour garantir leurs réserves d'or.
Ce fut le cas au cours des premières années de l'après-guerre, jusqu'à ce que la montée en puissance des concurrents-amis (Japon puis, surtout, Allemagne), la guerre du Vietnam et la « Grande société » imaginée par Lyndon Johnson pour en compenser les effets politiques et sociaux calamiteux, financées à crédit, inversent les flux.
De pays excédentaire devenu de plus en plus déficitaire, les États-Unis vont dénoncer unilatéralement, le 15 août 1971, les accords de Bretton Woods, mettant ainsi fin à la convertibilité du dollar en or et de toutes les monnaies. Les accords de la Jamaïque signés le 8 janvier 1976 graveront dans le marbre la mise en flottement des monnaies.
Ce sont les mutations significatives déclenchées par cet événement majeur que nous allons analyser. Elles affectent le nouvel ordre mondial, la conversion des « élites » à une version renouvelée du libéralisme, le réveil d'une forme inversée de lutte des classes, la transformation du système financier, avant de finir par un focus sur le bon élève de la modernité : l'Europe, et en particulier la France.
I. UN ORDRE MONDIAL FLOTTANT
A. LE NOUVEAU ROI DOLLAR
L'abandon de l'étalon-or et le dollar flottant inauguraient une ère nouvelle, ce que l'envoyé du président Nixon, John Bowden Connally, venu annoncer aux Européens et aux Japonais, sous le choc, la fin à la convertibilité du dollar en or, traduisit par la formule : le dollar, « c'est notre monnaie, mais c'est votre problème ».
Il en est résulté quatre conséquences.
• Première conséquence : l'effondrement du dollar par rapport à l'or déclenchant une inflation persistante et un transfert considérable de richesse des pays pauvres, dont les réserves étaient en dollars, vers les pays riches en or. La lutte contre cette inflation servira de justification aux politiques de restrictions salariales qui vont marquer l'après-Bretton Woods, même quand il n'y aura plus de risque d'inflation.
• Deuxième conséquence : libérés de la contrainte de l'étalon-or, tout en restant la seule monnaie de réserve mondiale, les États-Unis vont disposer du pouvoir exorbitant de vivre à crédit sans risque de voir leur monnaie se déprécier. Leur puissance économique et militaire qui en fait le refuge des capitaux du monde, comme on l'a vu encore en 2008, en pleine crise, les met à l'abri de cet écueil. Ce seront les grands gagnants du nouvel ordre monétaire. Grâce aussi au fait que « l'étrange aptitude du magicien à créer de la monnaie à partir de rien a une explication. Derrière lui se tient un homme avec un fusil » 51 ( * ) : autrement dit, la puissance militaire américaine.
• Troisième conséquence : libérés de la contrainte de l'équilibre de leurs échanges extérieurs, les États-Unis vont se faire les propagandistes d'un credo libre-échangiste à vocation mondiale, aussi inéluctable que le retour du Messie, présentant en outre le triple avantage de doper le chiffre d'affaires, les bénéfices et la valorisation boursière de leurs multinationales, de limiter l'inflation grâce à l'importation de produits à bas prix et de peser sur les salaires sous la menace des délocalisations. La dernière élection présidentielle étasunienne a montré que la méthode pouvait aussi entraîner des retours de flammes.
• Quatrième conséquence : la création de ce qui allait devenir le premier marché financier mondial, celui de l'échange des devises. À partir du début des années 1970, la dette américaine ne va cesser de grimper ; les dépenses militaires aussi. « On touche là, en dernière analyse, à l'essence de la domination militaire mondiale des États-Unis : quelques heures après avoir décidé, ils peuvent bombarder, à volonté, n'importe quel point du globe. Aucun autre État n'a jamais rien eu qui ressemble, même de loin, à ce type de capacité. On pourrait fort bien soutenir que c'est ce pouvoir-là qui maintient la cohésion du système monétaire international organisé autour du dollar . » 52 ( * )
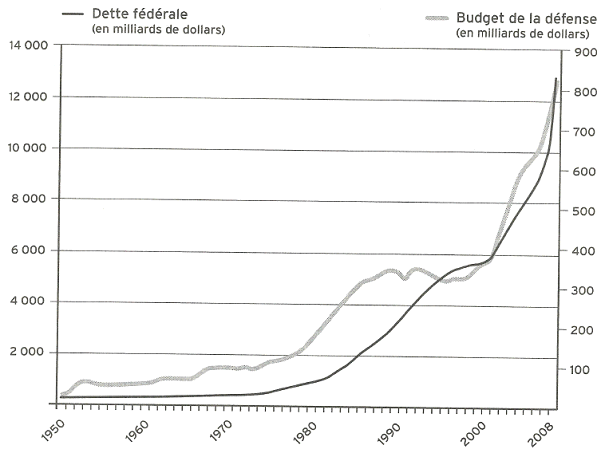
On aura remarqué que cet aspect du problème - voir le graphique ci-avant - est en général passé sous silence par les analystes économiques dissertant sur le dynamisme des États-Unis.
Autre privilège du dollar, celui d'être la devise utilisée pour vendre ou acheter du pétrole dont plusieurs producteurs incontournables sont sous la protection étasunienne. Le fait que nombre de transactions sont réalisées en dollars, que les compensations passent par des chambres étasuniennes, voire que les ordres transitent par des serveurs numériques qui y sont installés, va accorder aux États-Unis un contrôle juridique et judiciaire sur elles, infligeant des amendes, parfois colossales, aux entreprises étrangères qui auraient pu, partout dans le monde, enfreindre la légalité étasunienne, autrement dit, leurs décisions de politique étrangère 53 ( * ) .
B. LE « MINOTAURE PLANÉTAIRE »54 ( * )
1. Un déséquilibre des échanges structurels
La plus grande économie mondiale étant dispensée d'équilibrer ses comptes, les dollars et les bons du Trésor américain qu'ils permettent d'acheter vont s'accumuler hors des États-Unis : le solde s'élevait à 3 000 milliards de dollars en 2005, soit 23 % du PIB.
Surtout, va s'installer un système de déficits et d'excédents jumeaux, globalement de l'ordre de 2 000 milliards de dollars, entre un petit nombre de pays. Un système de déficits jumeaux non seulement chronique mais croissant fortement avec l'entrée de la Chine à l'OMC, en novembre 2001.
Cette relation Chine-États-Unis va devenir emblématique : « La Chine exporte vers l'Amérique tandis que ses investissements en titres obligataires américains aident les États-Unis à maîtriser leur inflation et leurs taux d'intérêt, encourageant ainsi chez eux une croissance accélérée et la création d'emplois. » 55 ( * )
Ce petit nombre de pays concernés permet de relativiser le lieu commun selon lequel nous assisterions à une mondialisation irrésistible des échanges commerciaux. Malgré leur importance, ils ne concernaient avant la crise et actuellement encore qu'un nombre limité de pays , ce qui ressemble plus à une rationalisation de la production des multinationales et à une optimisation de leurs revenus qu'à la généralisation du « doux commerce » cher à Adam Smith.
2. Wall Street, machine à recycler les excédents et à financer les déficits
L'objectif des pays excédentaires étant de maintenir un niveau d'exportation garantissant leur emploi et leur croissance, leurs excédents monétaires sont essentiellement réinvestis dans les pays déficitaires, surtout aux États-Unis. Dans le cas contraire, la monnaie du pays excédentaire s'apprécierait, renchérissant d'autant ses exportations.
En outre, ces placements produisent des revenus financiers pour les pays commercialement excédentaires, plus exactement pour les propriétaires de ces capitaux, en perpétuant les équilibres politiques et les déséquilibres commerciaux mondiaux.
« Tant que les investisseurs étrangers expédiaient chaque jour des milliards de dollars vers Wall Street, de leur plein gré et pour des raisons strictement liées à leur propre profit, les déficits jumeaux des États-Unis étaient financés et le monde pouvait continuer de tourner, au petit bonheur la chance, autour de l'axe américain », résume Yanis Varoufakis dans son livre Le Minotaure planétaire 56 ( * ) .
Les États-Unis se contentent d'aspirer les capitaux excédentaires des autres pays, puis d'émettre la monnaie permettant de continuer à acheter leurs excédents, devenant, pour reprendre de nouveau les termes de Yanis Varoufakis, « l'acheteur de premier recours, sur lequel tout le monde comptait. Leur déficit commercial devint la locomotive qui sortit la production et le commerce mondiaux de l'ornière dans laquelle ils s'étaient embourbés dans les années 1970... Il n'est donc pas surprenant, lorsque le Minotaure fut mortellement blessé en 2008, que le monde se retrouva de nouveau dans l'ornière » 57 ( * ) .
Si ces retours profitent aux États-Unis, ils diminuent d'autant la consommation des habitants du pays excédentaire, les capacités d'investissement de ses entreprises et globalement sa capacité de dynamisation économique avec lesquels il est en relation, comme c'est le cas pour l'Allemagne en Europe.
Ils viennent aussi alimenter en permanence un flot de liquidités propice au développement des bulles spéculatives.
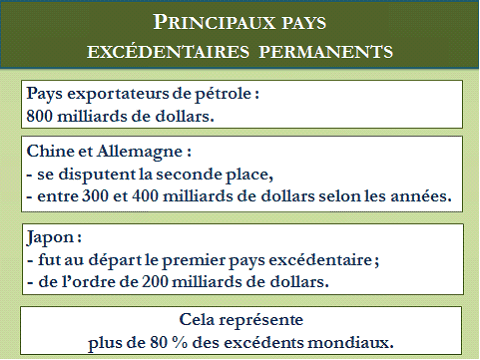
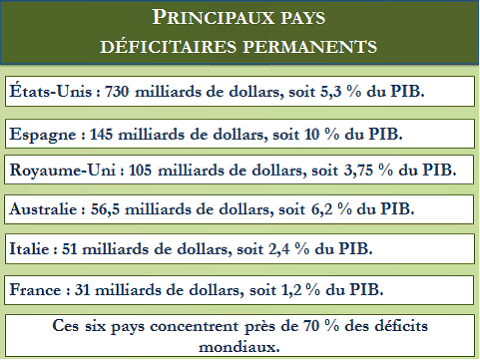
3. Le couple improbable : États-Unis-Chine
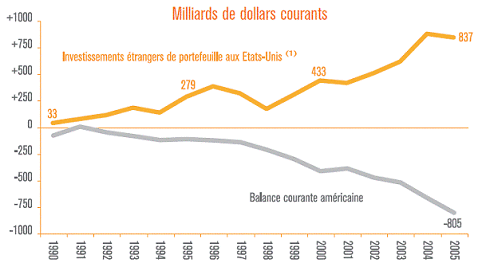
Ainsi la Chine se retrouvera-t-elle le premier investisseur des États-Unis, même en titres gagés sur des emprunts hypothécaires. Au moment du déclenchement de la crise des subprimes , elle en aurait détenu quelque 100 milliards de dollars et aurait engagé 400 milliards de dollars en actions de Fannie Mae et Freddie Mac, clefs de voûte du système hypothécaire américain.
Grâce à la Chine, l'économie américaine et, avec elle, l'économie mondiale ont pu se refinancer à peu de frais, ce qui, en maintenant des taux d'intérêt bas, alimentait la bulle spéculative.
4. L'Allemagne, faux Minotaure européen
En 2008, les exportations de l'Allemagne représentent 1 000 milliards d'euros, soit 40 % de son PIB, et son excédent commercial s'élève à 7 % du PIB, record mondial. Elle est devenue, devant la Chine, le premier exportateur mondial.
Il est de bon ton de vanter les vertus de l'Allemagne, qu'il conviendrait d'imiter. En réalité, le développement de celle-ci se fait largement au détriment de ses partenaires européens. Ne réinjectant pas ses excédents financiers en pouvoir d'achat interne, elle réduit les débouchés des pays qui, comme la France, figuraient au rang de ses principaux partenaires commerciaux. Équilibrés dans les années 1990, les échanges franco-allemands, sous l'effet des politiques ultra restrictives de l'Allemagne, sont devenus très déséquilibrés. En 2007, les exportations intracommunautaires allemandes représentaient 624 milliards d'euros et les importations 497 milliards d'euros, soit un excédent de 127 milliards.
Les exportations extracommunautaires s'élevaient à 340 milliards d'euros et les importations à 273 milliards d'euros, soit un excédent de 67 milliards, inférieur de moitié à l'excédent intracommunautaire.
La cure d'austérité que s'est infligée l'Allemagne au début des années 2000 pour doper ses exportations, et donc en limitant d'autant l'accès de son marché intérieur à ses partenaires européen, en a fait, selon les mots de Guillaume Duval 58 ( * ) : « Un boulet pour l'Europe » 59 ( * ) .
L'Allemagne est un faux Minotaure européen parce que, si elle accumule les excédents, à la différence de la Chine, ces excédents - sauf pour spéculer - sont insuffisamment réinvestis chez ses partenaires de la zone euro et sa consommation intra-européenne trop faible.
C. LA SPÉCULATION SUR LES MONNAIES ET LE « CARRY TRADE »
La fin des parités fixes entre monnaies remplacées par des taux de changes flottants va ouvrir un vaste champ d'action à la spéculation. Spéculation sur les évolutions des parités, au besoin en les suscitant par des achats ou des ventes massifs de devises ou de dérivés ; spéculation sur les différences de taux d'intérêts selon les pays, taux d'autant plus élevés que la monnaie est fragile.
Le jeu consiste à jouer sur la différence de taux d'intérêt entre les pays : par exemple, emprunter dans un pays à faible taux pour replacer cet argent converti en dollars dans un autre où les taux sont plus élevés ou l'investir dans des opérations aussi risquées que lucratives. Cette technique a d'abord été employée pour exploiter les écarts de politiques monétaires entre le Japon, où les taux étaient bas, et d'autres pays. C'est l'une des activités des hedge funds 60 ( * ) , installés ou non dans les paradis fiscaux. Les sommes en jeu sont littéralement astronomiques. Avant la crise, on estimait ces mouvements de fonds à 1 000 milliards d'euros.
D. MONDIALISATION ET GLOBALISATION
Champions du libre-échange du temps où leur balance extérieure était excédentaire, les États-Unis en restent les actifs propagandistes, devenus déficitaires. D'autant que leurs multinationales ne craignent personne et que, de toute manière, c'est aux États-Unis que viendront se recycler les excédents en dollars des pays étrangers. Sans compter des avantages à tirer, à moyen et long terme, d'une conversion au libéralisme des pays encore en développement englués dans l'étatisme et, à court terme, de l'importation de marchandises à bas coût susceptibles de peser sur l'inflation comme sur les salaires.
1. Les outils de cette politique
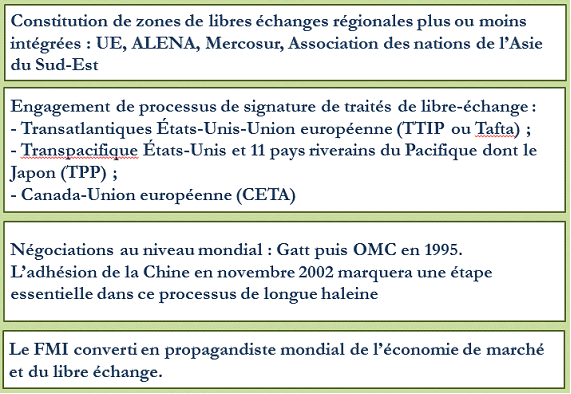
2. « Mondialisation » et « globalisation »
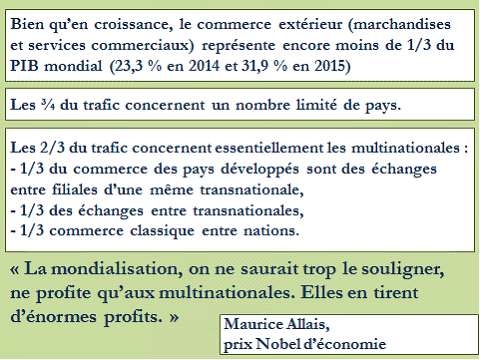
La mondialisation est l'aspect extensif du phénomène (pays et territoires concernés), la globalisation, son aspect intensif (volumes, intensité des échanges, intégration des différentes structures concernées). C'est à cela que l'on doit la prospérité des paradis fiscaux indispensables à l'optimisation fiscale, sport favori des multinationales.
La globalisation est une notion applicable essentiellement au niveau financier : constitution autour d'un oligopole d'une trentaine de très grands établissements d'un réseau mondial de banques interconnectées.
3. Globalisation et crises
Le lien entre la violence des crises et l'importance de l'intégration économique mondiale depuis 1800 est explicité dans le schéma suivant.
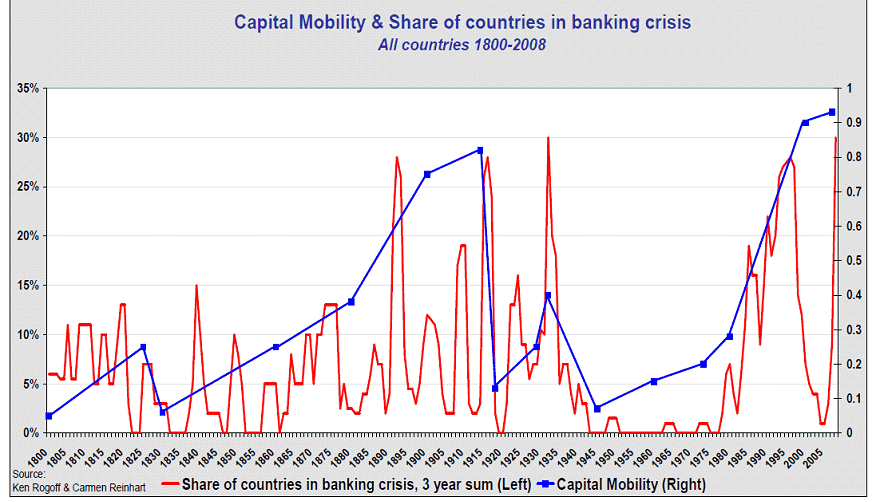
Source : Prime View independent research Globalisation et crises (commentaire)
On note, sur ces courbes, une corrélation nette entre le nombre de pays en crise bancaire depuis plus de trois ans (échelle de gauche) et le degré de mobilité du capital (échelle de droite), autrement dit, entre libéralisation financière et globalisation des crises bancaires. Celles-ci s'expliquent parce que l'afflux de capitaux engendre une explosion des crédits distribués, qui entraîne une inflation galopante des actifs douteux (immobilier, matières premières, actions), lesquels déclencheront la crise. Il y a bien un lien entre nombre et importance des crises et mobilité du capital.
Les périodes qui ressemblent le plus à la nôtre sont 1890-1914 et celle des années 1930.
La première avant-guerre a été une période de fort développement du libre-échange, marquée par une succession de crises financières touchant jusqu'à 20 % du PIB mondial, juste avant le déclenchement du premier conflit mondial.
Lors de la grande crise, 42 % du PIB mondial étaient concernés.
À partir des années 1980 et de la mise en place du nouveau modèle de développement intervient une série de crises récurrentes. La mobilité du capital n'ayant jamais été aussi forte qu'en 2008, il n'y a aucune difficulté à comprendre que la crise financière ait été globale.
II. LA RESTAURATION LIBÉRALE OU LA NOUVELLE IDÉOLOGIE DOMINANTE
L'un des aspects majeurs des mutations de l'après-Bretton Woods, c'est le renouvellement de l'idéologie dominante en matière économique et politique : quasi-disparition de la scène idéologique (médias, mainstream de la théorie économique, éléments de langage bureaucratiques et politiques) du keynésianisme, qui avait été au coeur du New Deal , de la reconstruction d'après-guerre en Europe et du nouvel ordre mondial symbolisé par Bretton Woods, et restauration de l'idéologie libérale.
C'est ce libéralisme revisité qui va inspirer les politiques des gouvernements et des bureaucraties dans tout l'Empire et au-delà, après la disparition de l'URSS et les « modernisations » chinoises.
A. LES LIBÉRALISMES
Bien que fidèle pour l'essentiel aux principes libéraux classiques, ce néolibéralisme se décline selon diverses chapelles, celles qui eurent le plus d'influence étant l'ultralibéralisme des pays anglo-saxons (École de Chicago, Milton Friedman, prix de la Banque de Suède) et le néolibéralisme européen (néolibéralisme autrichien et ordolibéralisme allemand). C'est ce dernier qui inspirera directement la politique monétaire et économique de l'Allemagne et indirectement la construction de l'Europe.
À noter cependant :
• une différence essentielle entre les deux côtés de l'Atlantique, s'agissant du rôle de l'État, censé ne jouer aucun rôle pour les Anglo-Saxons alors qu'il est indispensable à la création et au fonctionnement d'une « concurrence libre et non faussée » pour les ordolibéraux européens. D'où l'exploit que représente l'institution d'un « libéralisme bureaucratique » pour régir l'Europe, d'un ordre libéral qui ne peut exister sans réglementation ; le rôle de l'État est sensiblement différent : se faire le plus petit possible dans un cas, ne pas agir mais créer les conditions du bon fonctionnement des marchés dans l'autre ;
• que, dans la réalité, les principes sont largement contournés, s'agissant notamment du rôle de l'État, constamment appelé à la rescousse, et de l'importance des oligopoles, à commencer par l'oligopole bancaire. Disons qu'il s'agit d'une concurrence à géométrie variable.
L'idéologie qui s'installe peut être figurée par trois cercles concentriques :
- au centre, une théorie économique à prétention scientifique ;
- une première couronne, sorte de manuel de politique économique ;
- une couronne extérieure en forme de théorie du comportement humain et du bon fonctionnement de la société en général.
C'est, au sens propre, une idéologie pour ne pas dire une religion du marché, ce que résume bien cette citation d'Alain Minc : « Je ne sais pas si les marchés pensent juste, mais je sais qu'on ne peut pas penser contre les marchés. » 61 ( * )
B. LE CREDO LIBÉRAL
1. Un anti-étatisme théorique absolu
Son principe de base : la totale disparition de l'État du jeu économique et social. Selon la formule de Ronald Reagan : « Dans cette crise actuelle, l'État n'est pas la solution à notre problème ; l'État est le problème . » 62 ( * )
Cela signifie, non seulement la suppression de toute planification fut-elle incitative, l'abstention de toute action ou intervention au travers d'entreprises publiques ou d'un système de financement public, de toute réglementation susceptible de fausser le jeu de l'offre et de la demande, notamment sur le marché du travail, mais aussi celle de tout système de protection sociale qui ne soit pas assuré par le jeu du marché.
Pour Ludwig von Mises 63 ( * ) , par exemple, il n'y a aucune différence entre la planification incitative, le NKVD 64 ( * ) soviétique, l'économie de guerre et la Gestapo nazie, les chantiers de l'État fédéral américain durant la crise de 1929 et les taux d'impôts confiscatoires du New Deal , la SNCF et la sécurité sociale. On ne peut, sans contradiction, être démocrate et économiquement interventionniste à un quelconque degré : « L'insoluble contradiction de la politique des partis de gauche en Angleterre, en France et aux États-Unis, est qu'ils s'adonnent à l'économie dirigée, sans se rendre compte que, par là, ils préparent les voies à la dictature et à la suppression des droits civiques. La confusion de toutes les notions est arrivée à ce point qu'ils se proposent de sauver la démocratie avec l'aide des soviets [...] Il faut s'en rendre compte : le monde a le choix entre la démocratie politique et le système économique basé sur la propriété privée, d'une part, et de l'autre, l'économie dirigée et la dictature. La démocratie et l'économie dirigée sont inconciliables. » 65 ( * )
Il est d'autant plus important de réduire l'État à la portion congrue que, en régime démocratique, les gouvernants, tributaires de leurs électeurs, sont tentés de leur donner satisfaction au travers de législations sociales pernicieuses.
D'où la faveur accordée au gouvernement des « experts », des commissions désignées et des hautes autorités administratives. En la matière, les institutions européennes approchent de la perfection. Cela ne contribuera pas pour rien à l'obsolescence des systèmes démocratiques qui en résultera et, comme on le verra 66 ( * ) , au déclenchement de réactions non conventionnelles à cet état de fait.
2. L'économie comme système de marchés autorégulés
Pour les libéraux, le système économique est un ensemble de marchés concurrentiels, emboîtés. Ils interréagissent, d'où les effets de contagion quand un déséquilibre apparaît sur l'un d'entre eux, mais aussi la possibilité de leur correction.
Ces marchés sont très divers et d'extension variable mais, plus ils sont larges, plus parfaite est la concurrence : marchés de produits, de biens et de services ; marchés financiers au sens large (marché de capitaux, marché monétaire, marché des changes, etc.), marché du travail... Selon leur nature, ils peuvent être locaux, nationaux, internationaux. L'objectif est d'élargir le plus possible chacun de ces marchés afin de se rapprocher le plus possible de la situation de concurrence parfaite.
Le moteur de l'économie (et de la vie en société), c'est la concurrence mais une concurrence entre des acteurs censés être égaux. Ce qui n'existe quasiment jamais, ou en tous cas jamais longtemps.
Le régulateur des échanges, c'est le prix, produit d'une confrontation de l'offre et de la demande. Il permet la meilleure allocation (utilisation) possible de ces biens quantitativement limités nécessaire à la production de la richesse que sont le capital et le travail.
Le système économique, si aucune intervention étatique ne vient perturber son fonctionnement, est autorégulé, toute situation de déséquilibre entraînant une réaction qui le fait revenir à l'équilibre. De même, un bon fonctionnement des marchés financiers suppose une absence de régulation qui viendrait perturber le jeu autorégulateur de l'offre et de la demande.
Progressivement, partout où il existait, l'encadrement du crédit et des changes sera supprimé. Dans la zone euro, ce pouvoir échappera même aux États. Confusion entre banques de dépôts et banques d'affaires, allègement des réglementations en matière de fonds propres, de fiabilité des emprunteurs et des produits financiers proposés sur le marché, allègement des contrôles formeront la feuille de route des réformateurs.
De cette liberté de spéculation sortira la multiplication des scandales, le dernier de grande magnitude, le scandale Madoff, venant après une kyrielle d'autres. Le premier moment de stupeur et d'indignation passé, on n'en tire aucune conclusion. Il s'agit d'une question morale ne relevant pas de l'économie politique.
Dire que le système économique est autorégulé, cela veut dire qu'il crée lui-même son propre ordre, indépendamment de toute intervention extérieure et au total qu'il est un ordre naturel (un ordre naturel-artificiel pour les ordolibéraux, ce qui n'est pas banal).
Là est le fondement théorique de l'exclusion du politique de l'ordre économique, notamment de la demande permanente de déréglementation. Les seules réglementations licites sont celles qui permettent le libre jeu de la concurrence.
Le renversement qu'introduira le néolibéralisme, c'est que non seulement le politique n'a aucune légitimité à intervenir dans la sphère économique, mais que l'ordre économique est la vérité de l'ordre politique lequel doit fonctionner selon les mêmes règles que l'économie.
Pour Keynes, la ligne de partage entre les économistes passe là : « Il y a, d'un côté, ceux qui croient que le système économique existant est, dans le long terme, un système qui s'autorégule, même si c'est avec des grincements, des gémissements, des secousses et des retards [...] De l'autre côté, il y a ceux qui rejettent l'idée selon laquelle le système économique existant peut être qualifié, en quelque sens que ce soit, d'autorégulateur . » 67 ( * )
S'agissant des marchés financiers, Minsky ira plus loin. Pour lui, ils sont « naturellement instables », les situations de stabilité (donc peu propices au profit) suscitant les prises de risques et donc les crises.
|
Hyman P. Minsky
Audition de Jean-Gabriel Bliek
Hyman P. Minsky avait montré que le « système financier était naturellement instable ». Pour lui, « la stabilité est déstabilisante » (instabilité intrinsèque de la finance). Plus la stabilité est forte, plus les gens recherchent le profit et sont attirés par les activités les plus risquées. Dans une économie monétaire, c'est-à-dire dans une économie fondée sur le crédit et l'endettement, la croissance de l'économie est entretenue par l'endettement des agents économiques. À la phase de création monétaire correspondant à l'émission du crédit succède la phase de destruction monétaire par le remboursement. Le système financier est intimement lié au capitalisme. En effet, le phénomène de la dette permet le lien entre le système financier et le système réel. Dans une économie stable, rechercher des occasions de profit nécessite qu'il y ait une différence entre le prix des actifs réels et le prix de la dette. Plus l'économie est stable, plus les actifs réels très rémunérateurs à rechercher sont risqués. Pour financer l'acquisition de ces biens susceptibles de se valoriser, on suscite une vague d'endettement qui peut ne pas être remboursé si le profit escompté pour rembourser les prêts n'est pas au rendez-vous. Naturellement, par la dynamique du capitalisme, un système stable va vers l'instabilité. Pour stabiliser le capitalisme, Minsky préconise que les salaires soient suffisamment élevés pour ne pas recourir à l'emprunt. La baisse des salaires réels, la dérégulation financière ont, au contraire, renforcé l'instabilité du capitalisme. |
Une analyse approfondie de la théorie libérale excédant notre sujet, nous nous contenterons d'observer que l'idée même de crise systémique est impensable dans ce système.
On l'aura compris, si la notion de crise comme incident passager nécessaire au retour à l'équilibre fondamental est concevable selon la théorie, celle de crise structurelle du système lui-même ne l'est pas . D'où l'aveuglement de tous les responsables politiques et financiers, de la grande majorité des économistes, encore en 2008 alors même que la crise bat son plein.
3. « L'offre crée la demande », selon Jean-Baptiste Say
Constatant que l'équilibre du marché économique ne s'établit pas toujours naturellement à un niveau permettant la mobilisation complète des capacités productives, créant ainsi du chômage ; constatant qu'il ne suffisait pas d'attendre pour que les choses changent, Keynes avait fait admettre que seule l'augmentation de la demande par l'intervention de l'État pouvait faire repartir la machine, autant dire en créant une offre nouvelle. Il s'inscrivait ainsi en faux contre le principe de Say admis par la théorie, selon lequel « l'offre crée la demande » avec les revenus créés par la production nouvelle elle-même (salaires, dividendes, intérêts). Pour Keynes, le principe n'était valable qu'autant que tous les revenus produits étaient tous dépensés et ne venaient pas finir dans une « trappe à liquidité », « trappe » d'autant plus profonde que les revenus de la production sont inégalement répartis.
Les néolibéraux inversent de nouveau l'ordre des causes et des conséquences : le dynamisme d'une économie, donc de l'emploi, dépend non pas des débouchés mais de sa capacité à produire une offre créatrice de débouchés, autrement dit, compétitive. Ce sera l'alpha et l'oméga des nouvelles politiques de lutte contre le chômage de masse permanent qui avaient succédé aux Trente Glorieuses avec deux leviers principaux : la baisse du coût du travail ainsi que la baisse des impôts sur les entreprises et sur les hauts revenus pour favoriser l'investissement. S'y ajouteront, dans le meilleur des cas, modernisation de l'appareil productif et formation de la main-d'oeuvre.
4. De l'État libéral à « l'État prédateur »
a) L'exemple étasunien
«
On peut trouver avec le ciel certains
accommodements
»
Molière -
Tartufe
On le sait, la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher, Premier ministre de mai 1979 à novembre 1990, sera la première à mettre en oeuvre les principes et préconisations néolibérales. Les États-Unis de Ronald Reagan, arrivé au pouvoir en janvier 1981, suivront. D'abord sur un mode flamboyant - hausse astronomique du taux directeur de la Fed pour juguler l'inflation, politique antisyndicale, réduction des impôts sur les entreprises et les hauts revenus, recherche de l'équilibre budgétaire fédéral, déréglementations, etc. -, avant de tourner le dos aux principes d'équilibre budgétaire et de contrôle de la masse monétaire chers aux néolibéraux - pour sortir de la récession occasionnée par la hausse du taux directeur - et d'adopter une forme de keynésianisme monétaire dégradé, ce qu'autorisait le statut privilégié du dollar. Les réductions de l'imposition des plus riches assorties d'une augmentation des dépenses publiques, notamment militaires, financées par le déficit budgétaire sont venues alimenter la forte reprise, de 1983 à la fin de la décennie. Selon James K. Galbraith : « Cette forme conservatrice de politique keynésienne effaçait l'obstacle historique au keynésianisme : l'opposition féroce des très riches [...] Dans le keynésianisme version Reagan, le prix à payer pour la prospérité n'était plus le renversement des rapports sociaux établis mais leur perpétuation. » 68 ( * )
De fait, l'État était non plus hors-jeu mais essentiel au bon fonctionnement du système. Sous Georges H. W. Bush qui succédera à Ronald Reagan, les « bases du conservatisme de libre marché ont été abandonnées », observe James K. Galbraith. « Elles ont été remplacées par les structure d'un État prédateur, la capture des administrations publiques par la clientèle privée d'une élite au pouvoir », tout particulièrement dans le secteur financier dont la surveillance a été confiée à ceux qui étaient les moins enclins à l'exercer et qui le conduiront au naufrage 69 ( * ) . À ne pas oublier non plus, la ressource constituée par le libre accès des firmes à la recherche publique sans contrepartie financière 70 ( * ) .
Aux États-Unis, les polémiques sur les vertus et l'impératif catégorique d'équilibre budgétaire n'ont donc plus qu'une portée politicienne depuis que Bill Clinton a réussi par deux fois à équilibrer le budget fédéral. Après avoir liquidé ce qui pouvait rester de régulation du système financier et tenté de revenir à l'équilibre budgétaire, les Démocrates, face à la crise, ont eux aussi laissé filer les déficits sous les cris horrifiés de Républicains convertis à la rigueur budgétaire depuis qu'ils n'occupent plus la Maison-Blanche.
Pourtant, le principal sujet d'étonnement est non pas que l'économie étasunienne ne fonctionne pas selon les principes néolibéraux mais que les responsables européens croient ou font semblant de croire qu'elle le fait, s'obstinant à placer leur salut dans la politique de l'offre, l'équilibre budgétaire, en même temps que dans une fiscalité minimale et la réduction de l'État social.
Pour James K. Galbraith, les Européens passent à côté de la réalité étasunienne en oubliant que la démocratie sociale issue du New Deal , enrichie par Johnson et quoique modestement par Obama existe aussi aux États-Unis. Caisse de retraite publique, Medicare et Medicaid , assurance des dépôts bancaires, universités publiques, structures de financement du logement, armée et son pré carré scientifique, réglementation protéiforme sont les « structures permanentes d'un État providence typiquement américain, défectueux sur des points importants mais riche et solide sur d'autres qui ont maintenu la stabilité et le dynamisme des États-Unis [...] Le fanatisme du marché est un produit américain, mais porte clairement la mention "réservé à l'exportation" ». Opération particulièrement réussie, comme on le verra avec la construction européenne.
b) L'exemple français
Conformes aux principes libéraux, selon d'autres voies que celles empruntées par les États-Unis, les vagues successives de privatisations en France représentent aussi un transfert des moyens et de la richesse publique à ceux qui peuvent l'acquérir, généralement à crédit. Tous les domaines seront concernés : entreprises publiques, équipements (autoroutes) et surtout appareil bancaire, opération stimulée par la mise en place de la monnaie unique européenne. On se limitera ici au système financier, coeur de nos préoccupations.
En 1980, les banques centrales dites indépendantes sont l'exception : la Fed américaine depuis 1913 et la Bundesbank allemande. Le 4 août 1993, sous le gouvernement d'Édouard Balladur, la Banque de France est dotée d'un statut d'indépendance conformément aux dispositions du traité de Maastricht soutenu par François Mitterrand et le parti socialiste. Comme dira Lionel Jospin, lors du colloque organisé par la Banque de France pour la célébration de son bicentenaire, le 30 mai 2000 : « L'indépendance des banques centrales s'est imposée comme une nécessité pragmatique », afin d'assurer la nécessaire stabilité des prix, ce qui est le principe officiel assigné au Système européen de banques centrales puis à la BCE.
La Banque centrale d'Espagne suivra (1994), puis celle d'Angleterre (1997, sous le gouvernement de Tony Blair), puis celle du Japon en 1998, etc. En matière d'indépendance des banques centrales, la France et les pays de la zone euro iront plus loin que les États-Unis eux-mêmes et évidemment que le Japon. La BCE est en fait totalement irresponsable, ce qui n'est pas le cas de la Fed. Comme le fait remarquer Michel Aglietta : « Comme il n'existe ni exécutif public, ni a fortiori de parlement souverain, on ne voit pas devant quelle instance représentative la BCE pourrait être responsable. » 71 ( * )
Les privatisations concerneront aussi les banques commerciales et les organismes de régulation élevés au rang d'autorités administratives indépendantes. En France, la droite ouvre le ban avec la privatisation de Paribas, de la Société Générale, du CCF, etc. Le reste suivra sous des gouvernements de gauche comme de droite. Suivra aussi la privatisation du secteur des assurances. Une part de l'augmentation de la valeur du capital privé par rapport au capital public aura pour origine ces transferts.
La migration du capital
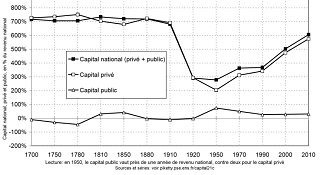
Source : Thomas Piketty. On observe qu'à partir de 1980 l'augmentation du capital national de la France est uniquement due à celle du capital privé.
Mais, la partie la moins connue et pourtant la plus extraordinaire de cette grande transformation du système bancaire français est le démantèlement du réseau constitué autour de la Caisse des dépôts et consignations et de l'ensemble du réseau mutualiste ou coopératif : Crédit agricole, Caisses d'épargne, Banques populaires.
Nous y reviendrons un peu plus loin 72 ( * ) avec l'analyse d'un cas emblématique : Dexia.
III. LA NOUVELLE LUTTE DES CLASSES ET L'OBSOLESCENCE DÉMOCRATIQUE
«
C'est la lutte des classes. Ma classe est en
train de la gagner.
Elle ne devrait pas
. »
Warren
Buffett
73
(
*
)
«
Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945, et de
défaire méthodiquement
le programme du Conseil national de la
Résistance.
»
Denis Kessler
74
(
*
)
Les deux citations en exergue rappellent que la mutation idéologique qui a guidé la reconstruction de l'Empire américain sur des bases nouvelles après la rupture des accords de Bretton Woods était non pas le pur produit d'une illumination intellectuelle mais une arme politique au service d'intérêts matériels et sociaux puissants bien précis.
Le plus intéressant, c'est la réserve du milliardaire américain Warren Buffett sensible aux risques de déstabilisation sociale et politique liés à cette reprise de la lutte des classes sur les ruines des compromis de l'après-guerre - New Deal aux États-Unis, programme du CNR en France et Welfare state en Grande-Bretagne -, face à l'enthousiasme militant de l'ex-maoïste et actuel P-DG du groupe de réassurance Scor.
Cette conversion, parmi beaucoup d'autres, au nouvel ordre mondial est significative d'un fait politique majeur : la neutralisation du corps électoral, l'alternance au pouvoir, dans chaque pays, des deux camps d'accord sur l'essentiel interdisant toute remise en cause démocratique de l'ordre libéral. Le problème, c'est que cette indéniable facilité a rendu très difficile, sinon impossible, la réforme paisible d'un système que seules des crises de plus en plus graves semblent pouvoir ébranler faute de pouvoir le faire évoluer.
Tout aussi préoccupant, le fait que ce nouvel ordre se traduit non pas seulement par une répartition plus inégalitaire des revenus et des patrimoines mais par une dissociation du corps social tout entier, sur le modèle des pays autrefois qualifiés de sous-développés. Tel est le propos du livre de Christopher Lasch La Révolte des élites 75 ( * ) : « Naguère, c'était la "révolte des masses" qui était considérée comme la menace contre l'ordre social et la tradition civilisatrice de la culture occidentale. De nos jours, cependant, la menace principale semble provenir de ceux qui sont au sommet de la hiérarchie sociale et non pas des masses [...]
« L'évolution générale de l'histoire récente ne va plus dans le sens d'un nivellement des distinctions sociales, mais de plus en plus vers une société en deux classes où un petit nombre de privilégiés monopolisent les avantages de l'argent, de l'éducation et du pouvoir [...] De nos jours, la démocratisation de l'abondance - l'attente de chaque génération de se voir bénéficier d'un niveau de vie qui était hors de portée de ses prédécesseurs - a cédé la place à un retournement où des inégalités séculaires commencent à se réinstaurer, quelques fois à une vitesse terrifiante, et parfois si progressivement que nous ne nous en rendons pas compte. »
Et pour finir, cette observation de Lasch sur la vie politique des États-Unis, il y a plus de vingt ans mais d'une actualité brûlante : « On assiste à des batailles idéologiques furieuses sur des questions annexes. Les élites qui définissent ces questions ont perdu tout contact avec le peuple. Le caractère irréel et artificiel de notre vie politique reflète à quel point elle s'est détachée de la vie ordinaire, en même temps que la conviction secrète que les vrais problèmes sont insolubles. »
Sans l'expliquer à lui seul, ce désenchantement s'enracine dans un double mouvement caractéristique de l'après-Bretton Woods : une régression de la part des revenus du travail face à ceux du capital et une augmentation des inégalités qu'il s'agisse des revenus du travail ou des patrimoines.
Jusqu'à la crise de 2007, les effets économiques et sociaux de ces évolutions seront masqués par un remède miracle qui, à l'usage excessif qui en sera fait, se révélera catastrophique : l'endettement, endettement public et plus encore privé.
A. DÉFLATION DES REVENUS DU TRAVAIL ET ENDETTEMENT
Selon la théorie, le marché du travail, comme les autres marchés, est autorégulé : quand les salaires sont trop hauts, l'activité ralentit, le chômage augmente et cette pression entraîne un retour des salaires à leur niveau d'équilibre. Cette autorégulation suppose donc l'absence de grains de sable comme les syndicats et une absence d'encadrement par un code du travail ou l'existence d'un niveau de salaire minimum.
Ce sera le thème des innombrables « réformes du marché du travail » qui se succéderont dans tous les pays, tout particulièrement aux États-Unis et en Grande-Bretagne mais aussi ailleurs en Europe, encouragées par Bruxelles et la BCE, au nom de la croissance économique et de la lutte contre le chômage.
Ce retour à la politique de l'offre marquera aussi une rupture du « pacte fordiste », du nom de l'industriel bien connu qui pensait qu'en payant correctement ses ouvriers il créait la demande qui lui permettrait d'écouler les voitures qu'il produisait.
1. La « modernisation » du marché du travail
Moderniser le marché du travail signifie empêcher une augmentation des salaires au-delà de ce que les gestionnaires d'entreprises et leurs actionnaires jugent acceptable au regard de la concurrence et de leurs exigences. Au nom, une fois encore, de la lutte contre le chômage et l'inflation. Plusieurs méthodes vont être mises en oeuvre, des plus brutales au plus subtiles.
• La répression syndicale sera la méthode Reagan (11 000 licenciements lors du conflit des contrôleurs aériens), Bush et Thatcher, mais, dès les années 1970, une offensive patronale se déploie aux États-Unis contre les syndicats, avec notamment des licenciements illégaux de syndicalistes. Entre 1960 et 1990, le taux de syndicalisation y passe de 30,4 % à 13,5 %.
En Grande-Bretagne, Margaret Thatcher, sortie victorieuse des conflits violents avec les puissants syndicats des mineurs, des dockers et des imprimeurs, limite les droits syndicaux et de grève. Son offensive est relayée par les employeurs. Les effectifs syndicaux britanniques passent de 13,2 millions en 1979 à 8,9 millions en 1989 puis 7,4 millions en 2003.
Bien qu'il n'y ait eu aucune répression syndicale en France, on y observe aussi une baisse très importante des effectifs, qui passent de 3,6 millions en 1979 à 2,2 millions en 1989, pour se stabiliser autour de 1,8-1,9 million à partir des années 1990 76 ( * ) .
• La précarisation de l'emploi et le travail à temps partiel sont une autre méthode. Partout, le travail à temps partiel augmente :
- il passe de 16,7 % de l'emploi total en 1996 en Allemagne, à 26 % en 2007 ;
- en 2007, il représente 46,8 % de l'emploi aux Pays-Bas, 25 % en Grande-Bretagne et en Suède, 19,7 % pour l'ensemble de la zone euro ;
- à 17,2 %, contre 16,3 % en 1996, la France résiste plutôt mieux.
En même temps, le nombre de personnes ayant un deuxième travail en plus de leur emploi principal augmente. Entre 1983 et 2007, il est multiplié par 3,1 en Allemagne, 3,3 aux Pays-Bas, 3,2 en Espagne, 2 en Grande-Bretagne. Il varie peu dans une France qui renâcle à se laisser moderniser. Cela représente plus de 1,4 million de personnes en Allemagne et plus d'un million au Royaume-Uni.
• Plus indirectes sont l'arme de la concurrence internationale et la crainte des délocalisations, ou l'arme de l'immigration , particulièrement de l'immigration temporaire, voire illégale. Très utilisée aux États-Unis et en Grande-Bretagne, plus l'Europe s'agrandira, plus elle jouera à plein jusqu'à la crise.
• La « désinflation compétitive » française puis allemande est aussi à mettre au rang des moyens utilisés pour peser sur le coût du travail :
- désindexation des salaires sur l'inflation (suppression de « l'échelle mobile des salaires », 1982-1983) en France, tout en maintenant une forme d'indexation, à géométrie variable, pour le Smic ;
- invention de la « désinflation compétitive » que l'Allemagne portera à son point de perfection. C'est Gerhard Schröder et Hans Eichel qui imposent aux travailleurs allemands une réforme drastique du système d'assurance maladie et des retraites et qui parviennent, avec le soutien des entreprises industrielles exportatrices, à une réforme de la rémunération de la main-d'oeuvre aboutissant à ce que les Allemands travaillent beaucoup plus pour le même revenu, voire pour gagner moins.
L'établissement d'une monnaie européenne unique sera le levier rendant présentable cette politique. C'est officiellement, en effet, pour éviter une sortie du franc du « serpent monétaire » que François Mitterrand remplace la politique de relance économique des débuts de la gauche au pouvoir par la rigueur. Comme le montre l'encadré ci-dessous - « Un Américain à Paris » -, la réalité est probablement plus complexe et la dimension idéologique de la décision évidente.
|
Un Américain à Paris : Robert Eisner Le « tournant de la rigueur » vu par un Keynésien Rober Eisner, professeur d'économie à l'Université Northwestern, est l'auteur de nombreux ouvrages et articles. Il présidera l'Association américaine d'économie en 1988-1989. Durant l'hiver 1982-1983, professeur invité à l'Université de Paris-Nanterre, il rédige, à la demande du Commissariat général du Plan un rapport sur les travaux des commissions constituées dans le cadre de l'élaboration du IX e Plan et sur les documents préliminaires à celui-ci 77 ( * ) . Le document est aujourd'hui introuvable mais nous en connaissons la substance au travers d'un article publié dans le revue Challenge (juillet-août 1983) : « Which way for France » (Quelle voie pour la France). Cette disparition du rapport des rayons des bibliothèques et la faible publicité donnée aux positions de Robert Eisner sont bien évidemment sans rapport avec le fait qu'elles n'étaient guère favorables à la manière dont le « tournant de la rigueur » avait été pris. Pour lui, le changement à 180 degrés de la politique économique du gouvernement Mauroy s'est imposé d'abord pour des raisons non pas objectives, mais culturelles : l'obsession des élites et de la classe politique française de la « monnaie forte ». En effet, écrit-il : « Le déficit extérieur français n'a rien d'exceptionnel et, surtout, résulte pour l'essentiel des nouvelles importations de pétrole. Les chiffres l'attestent : pour 1981, le déficit extérieur total s'élevait à 46 MF, pour 62 MF de déficit envers les pays de l'OPEP, compensé largement par un excédent d'exportations militaires de 45 MF. « Il est impossible de faire comprendre aux Français que, tant qu'existe le cartel des pays de l'OPEP dont la balance des paiements est excédentaire, il est impossible d'éviter que les autres nations ne soient pas déficitaires. Comment faire comprendre aux responsables français que la situation actuelle s'analyse comme l'échange par les pays pétroliers de leur capital enterré sous forme de pétrole, en capital sous forme d'investissements dans les autres pays ? La France n'a ni raison, ni intérêt, à refuser cette loi, à refuser de prendre sa part des dettes à l'égard de l'étranger, dettes qui sont la simple contrepartie des actifs, des pays de l'OPEP. « Allons plus loin : les déficits commerciaux et l'emprunt à l'étranger peuvent fort bien persister très longtemps dans les pays en forte croissance, comme en témoignent les États-Unis depuis une centaine d'années. Si vraiment les Français croient qu'un investissement massif est nécessaire pour soutenir la productivité et la croissance, ils ne devraient avoir ni crainte ni honte à emprunter à l'étranger pour financer cet investissement. Le fruit attendu de cette croissance devrait largement financer le remboursement des intérêts puis du capital. Si, en revanche, on a des doutes sur la capacité des investissements à générer les revenus qui permettront de rembourser l'emprunt, alors il ne faut pas le contracter, indépendamment de toute considération sur la balance des paiements. « On doit observer que, même à son niveau jugé élevé de 93 milliards de francs en 1982, le déficit commercial français n'a jamais dépassé 3 % du PIB. L'OCDE a estimé la dette extérieure française en 1982 à 14,5 milliards de dollars, soit aussi 3 % du PIB. Le ministre français Jacques Delors a admis une augmentation de la dette extérieure de 8,8 milliards de dollars, soit moins de 2 % du PIB. L'ensemble de la dette extérieure française, nette, a été estimé par l'OCDE à 45 milliards de dollars, environ 9 % du PIB. Au taux d'intérêt réel de 5 %, le coût du service de la dette extérieure représente seulement 0,45 % du PIB annuel et un peu moins de 2 % des exportations en valeur. Si le taux réel d'intérêt était deux fois plus élevé (c'est-à-dire 10 %) et la dette extérieure deux fois plus élevée également, le coût du service de la dette ne représenterait que 1,8 % du PIB et environ 9 % des exportations. Ces chiffres justifient-ils un tel ralentissement de l'économie française ? » La réponse est évidemment « non » et rigueur ne signifie pas forcément « stagnation » avec son cortège de chômeurs. Le gouvernement de la gauche, ne manque, en effet, pas de moyens. Robert Eisner précise : « On avance avec raison que le talon d'Achille d'un marché libre, d'une économie capitaliste est le chômage : il y est souvent élevé et, dans les périodes de récession, insupportablement élevé. Il en résulte un énorme gâchis, tant des ressources humaines que du capital. Mais, s'il est vrai que dans une économie mixte, les socialistes ne peuvent défier les lois et rapports économiques fondamentaux, ne peuvent-ils pas, tout en les respectant, au moins éliminer le chômage involontaire ? « Avec la nationalisation du système bancaire, des industries clés et sa solide majorité parlementaire, le gouvernement [socialiste] dispose de tous les instruments d'une politique budgétaire et monétaire de [soutien de la demande en vue du] plein emploi. Pour un gouvernement de gauche, soutenu par les travailleurs et leurs syndicats, il devrait être possible de faire accepter une limitation des hausses du coût du travail résultant du plein emploi. De fait, il a déjà réduit l'indexation qui avait beaucoup contribué à l'inflation. « Le gouvernement peut aussi se servir des nationalisations, en respectant les règles du marché, pour orienter la production vers les types d'investissement et de consommation, tant du secteur public que du secteur privé, correspondant le mieux aux préférences sociales et individuelles. Il n'est pas nécessaire de réarmer, comme l'avait fait l'Allemagne nazie, pour rétablir le plein emploi ; ni comme Keynes l'avait facétieusement suggéré il y a un demi-siècle de [payer la moitié des chômeurs à déterrer ce que l'autre moitié avait été payée à enterrer pour relancer la consommation et rétablir le plein emploi !] Les plans ambitieux de révolution technologique en France permettent, peut-être pour la première fois, de concevoir des politiques de plein emploi parfaitement productives. » Quand bien même l'obsession du déficit extérieur, de l'équilibre budgétaire et du franc fort serait politiquement incontournable, il y a d'autres moyens que celui qui a été choisi - la mise au ralenti de l'appareil économique - pour y parvenir. Le remède de fond est de rendre la France moins dépendante de ses exportations, en orientant plus l'économie nationale vers le marché intérieur. Ce qui fait dire à Robert Eisner : « L'obsession de la balance extérieure commerciale risque d'être très dangereuse pour l'économie française. Elle repose sur le postulat d'une croissance par les exportations industrielles, qui met la France à la merci du reste du monde. Une chose est de viser l'excellence technologique, une autre d'espérer être tellement en avance sur le reste du monde qu'il acceptera d'échanger ses produits peu coûteux contre nos produits de haute technologie. Cela revient à subordonner son avenir à la capacité et à la volonté du reste du monde d'acquérir sa production. Un régime socialiste peut contrôler son propre marché. Si ce marché produit efficacement des biens utiles, les citoyens les achèteront. Il est plus sûr de produire directement pour la consommation intérieure que de s'en remettre excessivement à l'exportation pour assurer la consommation des ménages. Certes, il ne faut pas négliger l'importance du commerce extérieur, l'allocation des ressources ne doit pas être biaisée en sa faveur. Elle ne doit pas être supérieure à ce qu'elle serait si le libre jeu des avantages comparatifs et de la spécialisation internationale jouait. » Robert Eisner évoque alors un remède, les taux de change flottants, qui permet de regagner la compétitivité qu'une monnaie surévaluée fait perdre : « Maintenir une monnaie surévaluée pour s'assurer des avantages à l'échange n'est pas une bonne chose. Cela crée inéluctablement des déficits [...] Le franc était probablement surévalué par rapport au mark et au florin hollandais et les dévaluations du 21 mars pourraient bien ne pas avoir été suffisantes pour le corriger [totalement]. La France aurait eu meilleur compte à menacer de sortir du SME tout en laissant le franc flotter [...] L'indépendance économique, sans protectionnisme, signifie pour la France miser sur la croissance économique, la réduction du chômage et s'affranchir de la déflation allemande [...] Une monnaie surévaluée engendre un déficit commercial que l'on tente de corriger par une conversion de la production intérieure vers l'exportation et l'importation des produits que l'on ne fabrique plus. Cette façon de voir dispose de solides soutiens en France. « C'est pourtant un gaspillage des ressources du pays. Cela revient, en effet, à importer à un prix sous-évalué, du fait du taux de change, de plus en plus de produits, payés l'exportation d'une production interne coûteuse. Cela revient à mobiliser les ressources nationales vers l'exportation pour permettre aux riches Français d'acheter de coûteuses Mercedes à des prix artificiellement bas. » À défaut de mise en flottement du franc, Robert Eisner prône « une dévaluation partielle ou déguisé [...] Celle-ci pourrait prendre la forme d'une surtaxe générale sur toutes les importations et, si les pays étrangers l'acceptent sans représailles, de subventions à l'exportation. » Cette solution ne va pas sans inconvénients, mais, pour le professeur d'économie américain, serait « préférable de très loin à la solution classique adoptée par le gouvernement français : réduire le déficit extérieur au prix d'un ralentissement de l'économie française. » Robert Eisner évoque ensuite d'autres mesures sur lesquelles il serait trop long de revenir, qu'il juge préférable à la déflation. Ultime concession de sa part, si le gouvernement maintient son objectif de déflation, « celle-ci ne saurait être qu'une aberration temporaire, permettant ensuite de tout jouer sur la maximisation de la croissance et de l'emploi. [...] Une fois qu'on saurait ce que la France " peut" faire et doit faire, les forces du marché et l'initiative individuelle pourraient alors être libérées avec pour objectif la croissance la plus élevée possible et le véritable plein emploi. « Telle serait la preuve et la seule du succès de l'expérience socialiste française. » Ce ne fut pas le cas. Pour l'heure, constate Robert Eisner : « Le 25 mars [1983], le cours de l'économie française a brutalement changé, au moins à court terme [comme on sait, ce sera pour longtemps], si ce n'est pour les cinq prochaines années du Plan. La rigueur, malgré les démentis répétés du gouvernement, s'est traduite en austérité. [...] Remarquons l'extraordinaire brutalité des mesures d'austérité du gouvernement socialiste : il retire deux fois plus à la demande interne qu'il n'avait injecté dans son premier programme de croissance. » Or, ces mesures ne s'imposent que si le rétablissement de la balance des paiements devient l'objectif essentiel de la politique économique et si les prévisions très pessimistes quant à la croissance mondiale et à l'évolution du prix du pétrole se vérifient. Robert Eisner fait observer : « Ce que les Français ne semblent pas voir, c'est que la réalisation de leurs prévisions pessimistes quant à l'évolution de l'économie mondiale, conjuguée au maintien de la réduction du déficit de la balance des paiements comme objectif prioritaire, aurait pour conséquence d'imposer à leur économie une cure de déflation toujours plus grande [...] Si, en revanche, comme nous le pensons et ce que justifient toutes les prévisions, les prix du pétrole continuent à baisser alors qu'une reprise se manifeste aux États-Unis, comme dans le reste du monde, la France aura brisé pour rien le rêve socialiste. » |
C'est aussi au nom des engagements de Maastricht, l'euro créé, que la BCE impose des taux d'intérêt directeurs plus élevés que ceux de nos concurrents et des politiques budgétaires restrictives.
2. Les conséquences de la « déflation » des revenus du travail
a) Régression de la part des salaires dans la répartition de la valeur ajoutée des entreprises
Au vu de la difficulté de l'évaluation du phénomène, de l'importance des conventions adoptées par les chercheurs, il n'est pas étonnant que les estimations du phénomène varient d'un pays à l'autre et d'une étude à l'autre. Mais, d'une manière générale, on peut s'accorder sur les points suivants :
- de la fin des années 1950 à 1975/1980-1983, selon les pays, la part des salaires dans la valeur ajoutée croît, légèrement au cours des années 1960, avec une accélération au début des années 1970 ;
- à partir du point d'inflexion, elle baisse, de l'ordre de 7 % à 12 % selon les études et les pays.
En Europe, d'après la Commission européenne 78 ( * ) , depuis 1975, la part du travail dans la valeur ajoutée aurait baissé de 12 %. En France, l'inflexion se situe en 1982-1983 pour atteindre un niveau nettement inférieur à ce qu'il était en 1960 : « Dans l'Europe des quinze, la période 1960-1980 est caractérisée par l'augmentation régulière de la part des revenus du travail dans la plupart des pays de la zone, tandis que la période de 1981 à 2006 est caractérisée par un déclin de cet indicateur. »
Pour la période 2000-2005, il apparaît qu'elle continue à diminuer pour l'ensemble des pays de l'OCDE, en particulier l'Allemagne, alors qu'elle reste stable en France.
Variation de la part des revenus du travail dans le partage de la valeur ajoutée des entreprises, moyenne de 15 pays de l'OCDE
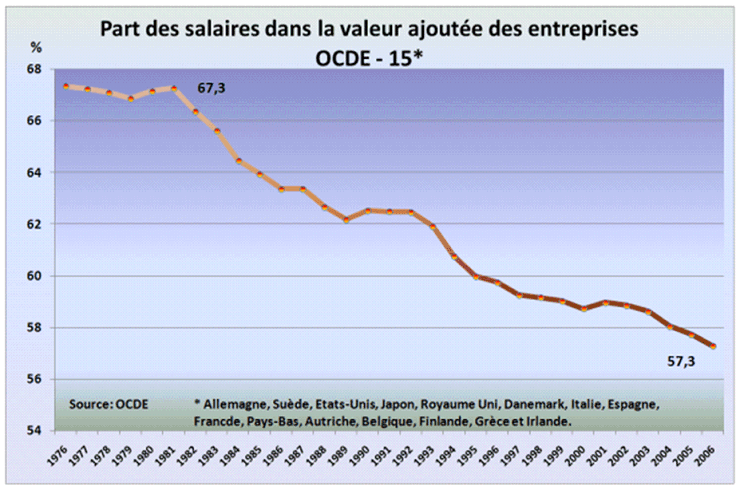
b) Régression des revenus du travail en général par rapport à ceux du capital
Les travaux de Thomas Piketty 79 ( * ) permettent d'apprécier, sur l'exemple du Royaume-Uni et de la France, l'évolution des revenus du travail par rapport à ceux du capital (loyers, profits, dividendes, intérêts), sur le long terme.
Les deux graphiques suivants montrent que, tendanciellement, les revenus du travail augmentent et ceux du capital baissent en France jusqu'en 1980 et au Royaume-Uni jusqu'en 1970. Au point haut, les revenus du travail atteignent 70 % du revenu national en France (plus de 85 % durant la Seconde Guerre mondiale) et 80 % au Royaume-Uni, contre respectivement 20 % pour les revenus du capital. Par référence au point haut, la baisse de la part des revenus du travail par rapport à ceux du capital est de 7 % à 8 %.
On verra un peu plus loin, en étudiant l'évolution des inégalités de revenus, qu'aux États-Unis aussi les revenus du capital prendront de plus en plus de place dans la croissance des hauts revenus.
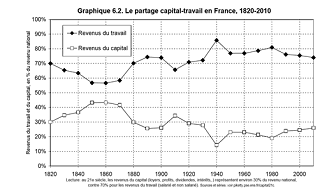
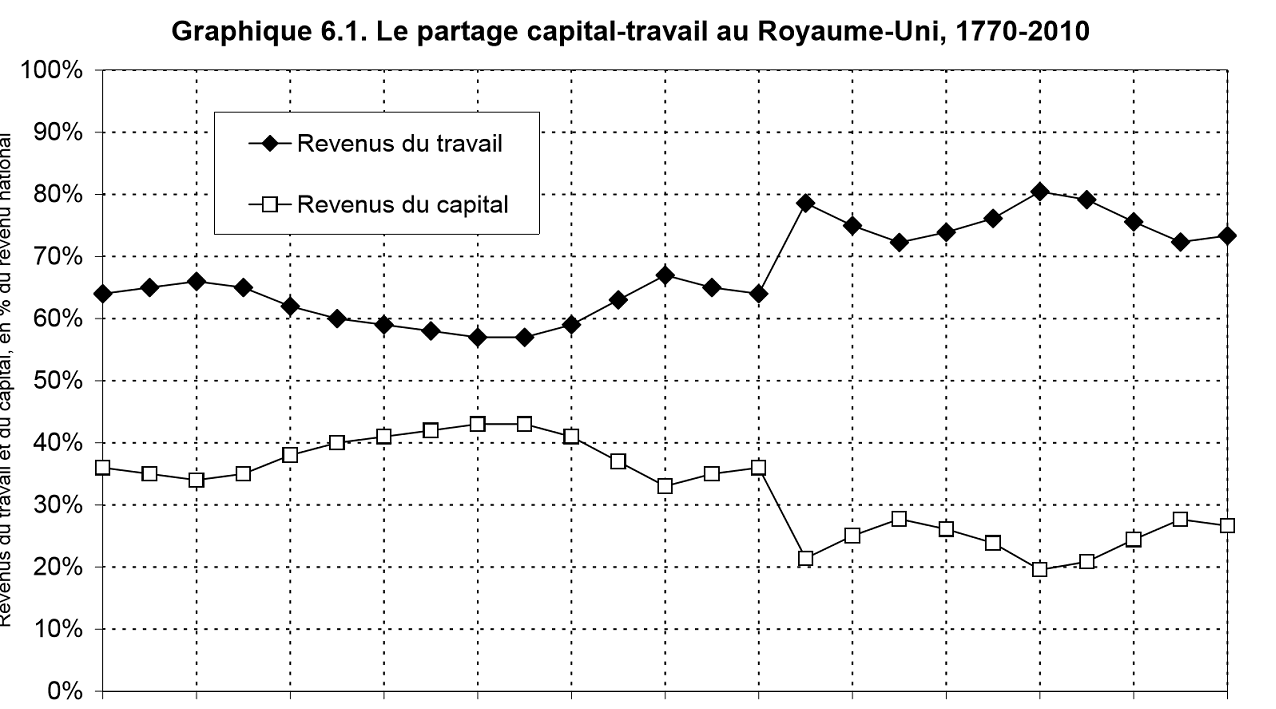
Source : Thomas Piketty - Le Capital au XXI e siècle - Seuil -2013
3. L'endettement, moteur de la croissance
C'est donc une véritable « déflation salariale », pour reprendre l'expression de l'économiste français Jean-Luc Gréau, et plus largement une « déflation des revenus du travail », qui s'est opérée dans tous les pays développés depuis le tournant 1975-1983.
a) Un endettement général
La solution pour y remédier - aux antipodes des principes libéraux -, ce qui ne manque pas de saveur, sera l'endettement privé (entreprises et ménages) et public (États, institutions sociales, collectivités territoriales). Engagée aux États-Unis, diffusée par les pays anglo-saxons ou sous influence anglo-saxonne, la recette a été appliquée, plus ou moins ouvertement, dans tous les pays. Là où elle le sera modérément, comme en France et en Allemagne, la croissance sera moins forte.
À partir des années 1980, le taux global d'endettement va augmenter dans tous les pays de l'OCDE, avec, jusqu'à récemment, deux variantes :
- le modèle anglo-saxon marqué par des États plutôt moins endettés que la moyenne et des ménages très endettés. Avec la crise, il cumulera forte dette des ménages (dont une partie insolvable) et explosion de la dette publique ;
- le modèle européen continental, ou plutôt « maastrichtien », marqué par une dette publique plus forte et un endettement des ménages plus faible. En France, dans la polémique sur l'endettement public, les zélotes de l'équilibre budgétaire oublient soigneusement ce point. La crise a montré qu'à tout prendre l'endettement incontrôlé des ménages était plus dangereux que celui de l'État. Les exemples irlandais et espagnol sont là pour le montrer si subsistait encore un doute là-dessus.
b) La dette des ménages, principal moteur de la croissance
Aux États-Unis, la dette des ménages aura progressé de 80 % sous l'ère Bush, passant de 5 919 milliards de dollars en 1998 à 13 827 milliards de dollars en 2007, soit pratiquement l'équivalent du PIB (14 545 milliards de dollars) et plus que la dette de l'État.
En Europe, la Grande-Bretagne bat des records aussi. La barre des 100 % du PIB est franchie en 2006.
L'Espagne suit : 78 % du PIB en 2006.
L'Allemagne se situe autour de 60 %, en baisse par rapport à la flambée qui avait suivi la réunification.
La France est encore à 43 % du PIB en 2006.
En termes de pourcentage du revenu disponible, autre manière de mesurer l'endettement des ménages, les États-Unis atteignent les 140 % en 2008, la Grande-Bretagne, 180 % et la zone euro, 80 %. Au début de 2009, l'endettement des ménages espagnols atteint 130 % du revenu disponible brut !
Cet endettement s'est développé à partir de deux types de crédit : le crédit immobilier principalement mais aussi le crédit à la consommation, les deux étant liés dans les « prêts hypothécaires rechargeables ».
Le crédit à la consommation, notamment sous la forme de cartes de crédit autorisant des découverts, joue un rôle essentiel aux États-Unis mais aussi au Canada, en Grande-Bretagne, au Danemark, etc. Aux États-Unis, son volume était, en 2007, supérieur à celui des crédits hypothécaires subprimes à l'origine immédiate de la crise.
À cela s'ajoute, notamment aux États-Unis toujours, l'endettement pour financer des études qui atteint des proportions considérables.
Le croisement des courbes de l'endettement des ménages et du chômage montre clairement le rôle du premier dans la croissance.
Exemple sur la période 1995-2002
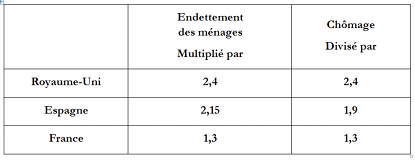
A contrario , et très clairement, le déclenchement de la crise est dû à une inversion de la tendance, le désendettement des ménages aux États-Unis et en Grande-Bretagne en 2008. « L'arrêt de la hausse des taux d'endettement des ménages (aux États-Unis, dans la zone euro hors Allemagne, au Royaume-Uni) est la cause essentielle de la crise. » 80 ( * )
B. LA CROISSANCE DES PATRIMOINES PRIVÉS PAR RAPPORT AUX REVENUS
À partir de 1970, parfois avant, on note une croissance du patrimoine privé, variable selon les pays mais notable partout et surtout nettement plus importante que les revenus en général, qui pourtant comprennent ceux qui sont produits par le patrimoine, lesquels augmentent eux-mêmes plus vite que ceux du travail.
On peut y voir le produit d'un triple phénomène :
- une augmentation plus rapide des revenus du capital que du travail (revenus spéculatifs notamment) ;
- une augmentation plus rapide des revenus supérieurs du travail ;
- et une inflation totalement occultée de la valeur des patrimoines (plus-values de placements financiers et immobiliers).
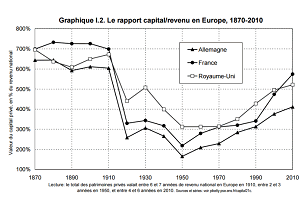
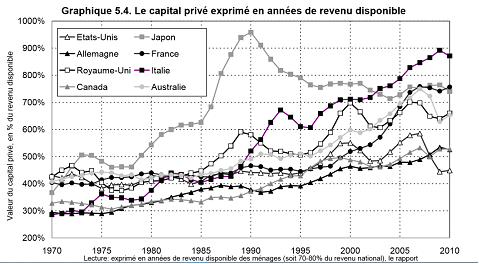
Source : Thomas Piketty - Le Capital au XXI e siècle - Seuil - 2013
Par rapport au revenu national, le patrimoine privé double quasiment en France et en Allemagne, un peu moins en Grande-Bretagne, à partir de 1970 alors que la part des revenus du capital, dans le même temps, augmente de 7 % à 8 %.
C. LA CROISSANCE DES INÉGALITÉS DE REVENUS
Pression sur les revenus du travail, inégalités grandissantes des revenus du travail, augmentation des patrimoines privés et des revenus qui vont avec, rien d'étonnant à ce que la distribution des revenus soit de plus en plus inégalitaire.
Plus la minorité concernée est étroite - le décile, le centile et le millime supérieurs -, plus l'écart se creuse dans les pays anglo-saxons. Si l'on observe aussi cette évolution sur le vieux continent, elle est nettement plus modérée.
Le graphique ci-dessous mesure la part de revenu national des États-Unis revenant aux 10 % des plus hauts revenus. Elle représente quelque 33 % dans les années 1970 et 50 % juste avant la crise de 2008 qui l'a fait baisser de 2,5 %. Au terme du processus, les effets du New Deal sont complètement gommés.
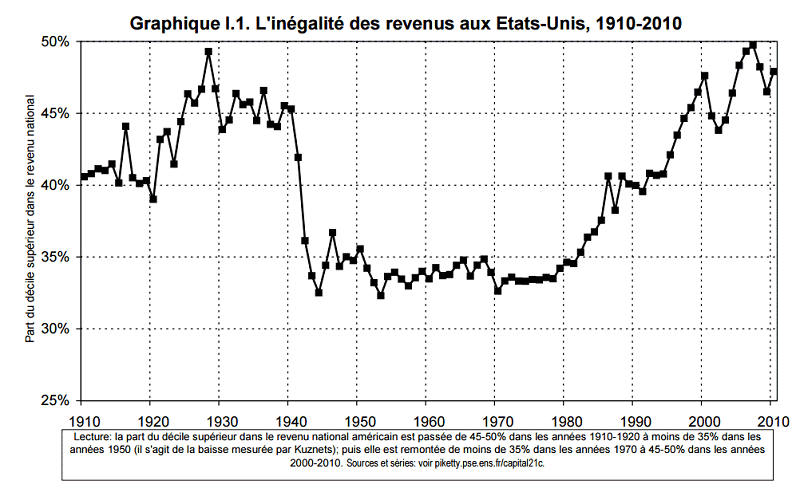
On note, à partir de 1970, pour le décile et plus encore le centile supérieur aux États-Unis, la part notable des plus-values spéculatives dans leur revenu (Voir graphique 8.8).
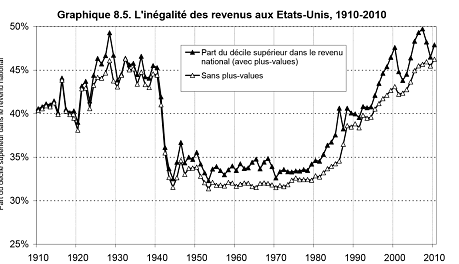
Warren Buffett a parfaitement raison : les plus riches sont les gagnants de cette lutte des classes menée à fronts renversés.
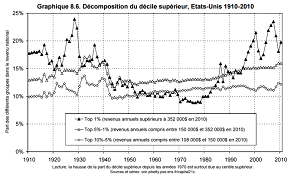
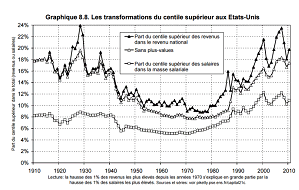
On observe des évolutions comparables, quoique à un niveau inférieur à celui des États-Unis, dans les autres pays anglo-saxons (Grande-Bretagne surtout).
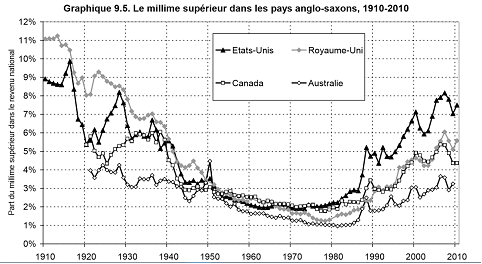
L'évolution française est très sensiblement différente puisque la part du revenu national allant au décile supérieur baisse jusqu'en 1982 pour atteindre 30 % (valeur proche des 33 % étasuniens de 1970), pour remonter ensuite, mais seulement de 3 %, ce qui n'a rien à voir avec les 50 % étasuniens.
Les autres pays de l'Europe continentale et le Japon connaissent des évolutions comparables, l'Allemagne après une baisse de la part des hauts revenus, enregistrant une hausse de 3 % à partir de 2003.
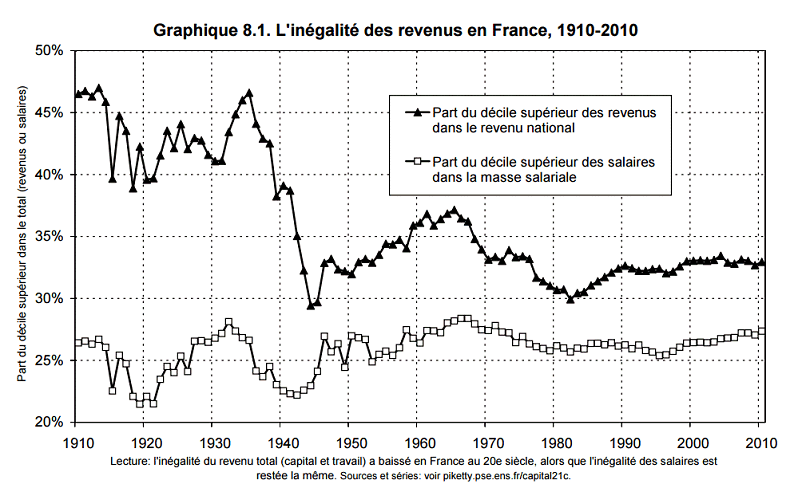
IV. LA FINANCIARISATION DE L'ÉCONOMIE
A. L'OLIGOPOLE BANCAIRE
Le triomphe idéologique et politique du libéralisme va s'accompagner d'une profonde transformation des systèmes bancaires qui, ne l'oublions pas, avaient financé les Trente Glorieuses.
Ce mouvement de fond sera considérablement facilité par la mondialisation des échanges et la dématérialisation des opérations financières. Cette « globalisation » est d'abord celle du noyau dur du système bancaire constitué en un véritable oligopole mondial.
Les schémas ci-après permettent de suivre cette évolution.
1. La transformation des structures du système
a) Le système bancaire étasunien avant les années Reagan
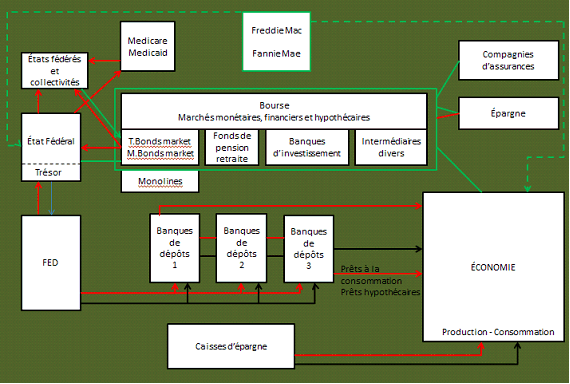
Plusieurs éléments sont à noter.
• Conformément au Glass-Steagall Act, une stricte séparation entre le système des banques de dépôt commerciales et les banques d'investissement ou d'affaires.
Au côté des banques commerciales, les caisses d'épargne jouent un rôle important dans le financement de l'immobilier hypothécaire (Caisses mutuelles d'épargne MSBs et Association d'épargne et de crédit SLAa). Elles reçoivent des dépôts et proposent des prêts. Elles représenteront jusqu'à 40 % des dépôts bancaires, ce qui, leur gestion parfois hasardeuse les ayant fragilisées, peut expliquer leur exécution au début de la présidence Reagan, Paul Volker étant président de la Fed. Cet épisode n'est pas sans rappeler le sort réservé en France - sur un mode plus civilisé - aux réseaux des banques coopératives et mutualistes.
• La « maison personnelle » jouant un rôle tout particulier d'assurance contre les mauvais jours dans un pays où la mobilité des travailleurs est forte, l'importance du marché immobilier et du nombre des acteurs qui y interviennent (caisses d'épargne, banques commerciales et autres), l'importance du marché hypothécaire pour en assurer la liquidité et l'existence d'organismes de garantie eux-mêmes garantis par l'État fédéral (Freddie Mac et Fannie Mae, tout particulièrement).
• La double source de financement de l'économie : les prêts bancaires et le recours aux marchés.
• Le recours aux marchés aussi pour le financement des États fédérés et des collectivités, avec un peu de prêts bancaires. La banque centrale, par l'émission de T-Bonds, et le marché financent l'État fédéral. Les États fédérés et les pouvoirs locaux émettent des M-Bonds dont la qualité, pour les plus petits, est garantie par des organismes spécialisés, les Monolines. Avec la crise, ils seront le tombeau de Dexia.
• L'État fédéral, qui finance une partie de l' aide sociale ( Medicaid et Medicare ), l'autre l'étant par les fonds de pension alimentés par les administrations ou les entreprises et par les intéressés. Ceux qui ne relèvent pas du dispositif s'adressent aux compagnies d'assurance, elles-mêmes acteurs de marché.
Comme on voit, les intervenants aux marchés sont nombreux et le rôle de ceux-ci déjà important, bien supérieur dans le financement de l'économie qu'en Europe, et notamment en France où l'intermédiation bancaire sous contrôle de l'État tient une place essentielle.
• Le marché interbancaire : il relie les banques de dépôts entre elles et la Fed veille sur sa liquidité. Comme toutes les banques centrales, celle-ci fixe aussi les taux directeurs qui donnent le « la » à tous les autres taux.
Elle peut ainsi agir sur la marche de l'économie, en montant les taux quand il y a un risque d'inflation, en les baissant en cas de stagnation ou de récession. Au côté de ces outils « conventionnels », le quantitative easing , non conventionnel, permet d'injecter de la monnaie banque centrale par le rachat massif de créances (obligations souveraines, actions d'entreprises, etc.) ouvrant la possibilité pour les banques d'émettre de nouveaux prêts aux entreprises dans l'espoir de relancer la machine économique.
b) Le système bancaire français avant 1984
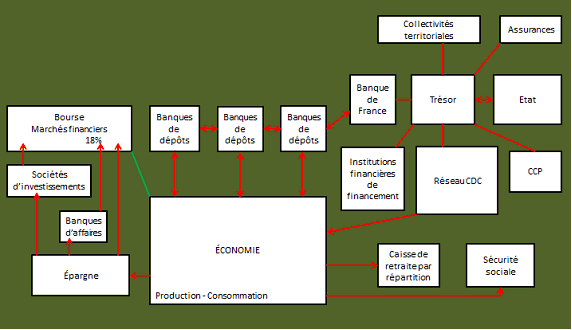
Plusieurs éléments sont à noter.
• Le financement par la bourse et les marchés financiers est particulièrement faible (18 %) par rapport aux États-Unis où il est essentiel.
• Les banques d'affaires, qui jouent un faible rôle, sont séparées des banques de dépôts assurant, par leurs prêts, une part du financement de l'économie.
• La spécificité du système français est le rôle de l'État et du secteur public :
- rôle essentiel du réseau financier autour de la CDC qui recycle les dépôts obligatoires et les fonds des caisses d'épargne, banques mutualistes, CCP ainsi que des collectivités et des notaires. La CDC et un certain nombre d'« institutions financières » spécialisées jouent un rôle de financeurs de l'économie. Une redistribution à caractère social permet de stabiliser la consommation ;
- la plupart des banques et des compagnies d'assurance sont nationalisées ;
- les caisses de retraites et de sécurité sociale n'interviennent pas sur les marchés ;
- les taux d'intérêts, le crédit, l'action des banques et le change sont strictement réglementés ainsi que les mouvements de capitaux vers l'extérieur ;
• la Banque de France qui a été nationalisée peut faire crédit à l'État.
c) Le système bancaire aujourd'hui
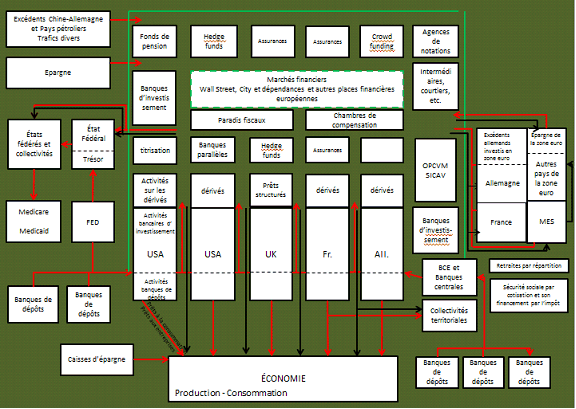
Sur fond d'unité entre les deux rives de l'Atlantique, la partie droite du schéma reprend les spécificités de la zone euro et la partie gauche celles des États-Unis.
Les choses ont beaucoup changé en un peu moins de quarante ans.
• Au coeur du dispositif, un énorme complexe oligopolistique , structuré autour d'une trentaine de banques aux dimensions planétaires, appelées désormais « systémiques », interconnectées (marché interbancaire, prêts à court et moyen terme, acquisitions d'actions et d'obligations, dérivés, titres, prêts structurés, etc.) et dominant les marchés financiers.
• De fait, le noyau bancaire est entouré d'un gigantesque anneau d'organismes et d'acteurs, agissant en liaison avec lui, improprement appelé, selon moi, shadow banking .
On passe, en effet, insensiblement des activités classiques de banques (prêts à l'économie par transformation des dépôts), à de plus récentes (activités sur les dérivés, prêts structurés), voire non bancaires (titrisation, participation ou gestion de hedge funds , shadow banking , etc.) et surtout aux activités de marché désormais dominantes : recherche ou placements de financements pour tiers, tenue de marché, trading haute fréquence et spéculation pour leur compte propre souvent avec l'argent des dépôts ou emprunté. S'y ajouteront, de plus en plus, des activités d'assureur sous toutes leurs formes. L'organisation la plus achevée est celle de la « banque universelle » , modèle qui fait la fierté française, déjà capable comme BNP Paribas d'offrir des services de téléphonie mobile 81 ( * ) et, demain, de beaucoup d'autres !
|
Le shadow banking Sous cette étiquette sont en fait regroupées des activités très différentes et pas forcément sulfureuses, ce que pourrait laisser croire le qualificatif de « finance de l'ombre ». Il s'agit en fait de toutes les activités financières ne figurant pas au bilan des banques, donc aussi les activités des banques hors bilan, au point qu'on s'interroge sur l'intérêt d'une telle notion. Ainsi participe du shadow banking : les banques d'affaires (productrices ou non de produits dérivés), les hedge funds , les fonds de titrisation, les fonds monétaires, les fonds de pension, les mutuelles d'assurance vie, les fonds négociés en bourse, les organismes de capital-investissement, les sociétés de garantie de crédit, les trusts de gestion d'actifs (immobiliers, par exemple), les sociétés d'affacturage (crédit inter-entreprises), etc. On peut y joindre les établissements de crédit à la consommation, le micro-crédit, le crowdfunding (financement participatif), les plateformes de monnaies virtuelles (bitcoin, par exemple) Le système de crédit hypothécaire des États-Unis en fait partie, Freddie Mac et Fannie Mae n'étant cependant plus comptabilisées depuis que ces agences ont reçu la garantie de l'État. Avec une définition aussi extensive, il n'est pas étonnant que le poids financier du shadow banking - par ailleurs difficile à évaluer avec certitude - soit très important. Le Conseil de stabilité financière, qui l'estimait à 75 000 milliards de dollars à la fin de 2013, pronostiquait que les 80 000 milliards de dollars seraient atteints en 2014. Ce qui représenterait (hors places offshore où sont domiciliés la plupart des hedge funds ) 25 % des actifs financiers mondiaux, la moitié du poids des banques classiques et l'équivalent du PIB mondial. Outre son poids de plus en plus grand, le principal problème posé par le shadow banking , ce sont ses liens avec le système bancaire lui-même qui, d'une part, pratique des opérations relevant du shadow banking , d'autre part, l'alimente en crédit. Il occupe donc une place systémique essentielle. À se demander d'ailleurs si l'usage de la notion de « système bancaire parallèle » n'est pas un trompe-l'oeil : le système financier et le shadow banking ne vivent pas dans des mondes parallèles mais sont intimement mêlés. |
Si, dans certains pays européens, comme l'Italie, voire aux États-Unis où le système bancaire est moins oligopolistique qu'en France malgré la présence de mastodontes bancaires, existent toujours d'importants réseaux de banques de détail, ces dernières sont cependant à la merci des tempêtes que soufflent périodiquement les grandes banques systémiques.
• Autour des autels des marchés, outre le système bancaire oligopolistique, rôde une cohorte de partenaires-concurrents et de servants spécialisés : intermédiaires et courtiers, hedge funds , fonds de pension, chambres de compensation et, bien sûr, les agences de notation sans lesquelles beaucoup de titres seraient invendables, ainsi que les paradis fiscaux nécessaires au recyclage des fonds de provenance inavouable.
À noter aussi, pour mémoire, les banques d'investissement classiques et les organismes de placement en valeurs immobilières, ainsi que les sociétés d'investissement à capital variable collecteurs d'épargne publique.
Pour être complet, il faudrait ajouter, particulièrement pour la version étasunienne du système, tous les organismes de garantie intervenant notamment dans le domaine immobilier et des M-Bonds (obligations émises par les collectivités infrafédérales).
• On l'aura remarqué, si les relations entre l'État américain et la Fed n'ont pas changé, il en va différemment dans la zone euro. Les États membres, à la différence de ce qui continue de se passer aux États-Unis, peuvent se financer non plus directement auprès de leur banque centrale mais uniquement sur les marchés qui disposent ainsi d'une rente perpétuelle, et désormais placés en position de les dominer.
En cas de problème, l'aide publique à un État de la zone euro ne peut être assurée que par l'intermédiaire d'un organisme inventé durant la crise, sorte de substitut européen d'un sous-FMI, le Mécanisme européen de stabilité (MES). Financé par les pays membres, il emprunte sur les marchés pour prêter aux pays en difficulté.
Précisons que c'est non pas l'État fédéral américain qui « bat monnaie » mais la Fed, consortium de banques privées créé par le Congrès, dont le président est nommé par celui des États-Unis avec l'approbation du Congrès mais fonctionnant hors supervision publique. Le mécanisme est le suivant : « La Federal reserve "prête" de l'argent au gouvernement des États-Unis en achetant des bons du Trésor, puis elle monétise la dette publique américaine en prêtant à d'autres banques l'argent que lui doit désormais l'État. » 82 ( * )
• Autres différences entre les États-Unis et l'Europe continentale :
- aux États-Unis, les collectivités infrafédérales se financent sur les marchés ; quant au système social, une partie est financée par l'État fédéral et les collectivités, une autre par des fonds de pensions alimentées par les bénéficiaires ou enfin des assurances ;
- en revanche, les collectivités du vieux continent complètent le plan de financement de leurs investissements majoritairement par l'emprunt. Le système social est financé pour partie par des cotisations, pour partie par l'impôt.
• La liquidité entrant dans la machine financière et/ou en sortant est d'origine diverse : les banques centrales (création de monnaie banque centrale) ; les États (emprunts et émission d'obligations) ; les banques de dépôts (création de monnaie scripturale) ; les particuliers (placements sur les marchés, emprunts) ; les entreprises (placements d'excédents, achats ou ventes d'actions ou obligations) ; le recyclage des excédents des balances des paiements, etc.
2. L'accélérateur de la dématérialisation
La dématérialisation concerne non pas seulement l'enregistrement des données, des ordres et leur transmission mais aussi leur gestion instantanée et la prise de décision. L'arbitrage informatique par algorithmes occupe une place de plus en plus grande avec les risques d'emballement que cela comporte quand les ordinateurs se mettre à vendre en masse au-dessous d'une cote donnée !
Ces technologies de l'information assorties de l'usage de modèles mathématiques font que les financiers n'ont jamais été aussi puissants. Elles leur permettent de mobiliser, en quelques minutes, des capitaux énormes avec lesquels ils pourront déstabiliser ou acquérir pratiquement qui ils veulent. La spéculation en est facilitée d'autant, le nec plus ultra étant celle qu'autorise le trading haute fréquence.
Conséquence de ce bouleversement technique : l'opacité encore plus grande du système rendant régulation et contrôle quasiment impossibles et l'augmentation de son instabilité ainsi que sa dépendance au court terme, la spéculation et inversement les paniques boursières et financières pouvant se propager désormais à la vitesse de la lumière autour du globe.
Les coffres-forts ont laissé la place aux ordinateurs, les mystérieuses chambres de compensation où sont tenus les comptes de milliers de sociétés, de milliardaires, de mafias ou de tyrans plus ou moins exotiques, tiennent lieu de livres de comptes. Cette dématérialisation des échanges financiers n'est pas pour rien non plus dans le développement des paradis fiscaux et de la délinquance financière.
Il convient d'évoquer également la généralisation des cartes de crédit dont la gestion est confiée à des entreprises à but lucratif sans possibilité de réel contrôle de leur fonctionnement et des frais qu'elles facturent à leurs clients. Comme on sait, l'explosion de ce type de crédit est l'une des causes de la crise de 2008.
Sans oublier des indicateurs dont on ne sait pas vraiment à quoi ils renvoient, des méthodes d'évaluation des risques (de la solidité des entreprises ou de la fiabilité des titres) elles-mêmes risquées quand elles ne sont pas malhonnêtes, des théories qui se contredisent et qui sont bien incapables de prévoir quoi que ce soit, des mouvements de capitaux et des compensations dont personne ne voit rien sinon les conséquences quand elles sont catastrophiques, des décisions des autorités monétaires élaborées dans le secret...
Tout fait du monde de la finance une boîte noire et qui tient à le rester.
B. L'INDUSTRIE FINANCIÈRE OU LE TRIOMPHE DE LA « FINANCE CASINO »
Ce dernier quart de siècle sera aussi celui de la naissance d'une véritable industrie financière aux mains des plus grosses banques qui vont en user et abuser, comme la crise le montrera. Ses objectifs sont, comme toujours, séduisants : sécuriser les échanges financiers tout en permettant de prendre des risques, donc de gagner plus d'argent sans risque, ou du moins à un niveau de risque défini et assumé.
Deux voies complémentaires seront explorées : le partage du risque et la mesure de celui-ci. Le problème, c'est que loin de se limiter à sécuriser les échanges économiquement utiles, ces nouveaux produits permettront de porter la spéculation à un niveau inégalé.
1. Du partage du risque à la spéculation sans frontières
a) La titrisation
« Titriser » consiste à faire des paquets de créances (prêts hypothécaires, obligations, etc.) pouvant être à leur tour négociés. En faisant avec les « paquets » d'autres « paquets » plus gros susceptibles, après labélisation par une agence de notation, d'être vendus par petits morceaux, on crée des produits dérivés de crédits ou CDO ( collateralized debt obligations ). Étendus à toute espèce de créance, ces « produits dérivés de crédits » joueront un rôle de plus en plus important dans les échanges financiers et dans la crise des subprimes . Sans CDO, la crise serait restée locale et sectorielle.
La titrisation transfère le risque - et les gains supplémentaires à attendre de cette prise de risque - d'abord au fabricant des titres, puis à l'ensemble de ceux qui les achèteront. Dans la version pour enfants, cette technique, en diffusant le risque sur un grand nombre d'acquéreurs, diminue l'impact pour chacun d'une éventuelle défaillance des créanciers situés au début de la chaîne. Le risque global s'en trouverait ainsi diminué.
Dans la version pour adultes, le risque étant transmis à d'autres, la tentation est forte de « titriser » des créances douteuses, donc de haut rapport. En mélangeant des créances présentant des degrés de risques très différents pour fabriquer des titres que les fées agences de notation transformeront en produit sûrs, le doute s'installe sur la valeur dudit produit. Ainsi débuta la crise, quand il fut impossible de donner une valeur aux titres hypothécaires faute d'acquéreurs et donc d'apprécier la solvabilité des banques qui en avait achetés ou fabriqués.
Non seulement les titres possédés risquaient de plomber l'actif mais, même si les titres fabriqués et vendus contre des liquidités avaient disparu du bilan, la structure ad hoc (véhicule), créée pour cela et toujours liée à la banque, n'en restait pas moins redevable des intérêts dus aux acheteurs des titres même si elle ne percevait plus les revenus de la matière première des titres.
Ce qui signifie que, si la titrisation de prêts consentis par les banques permet de les faire disparaître du bilan et donc de rouvrir, à fonds propres identiques, de nouvelles capacités de prêts, on ne peut en conclure que les risques liés à l'opération ont disparu. Simplement qu'il est plus difficile de les percevoir et de les évaluer.
b) « L'or des fous »83 ( * )
• Une nouvelle technique d'assurance
Au départ, il s'agissait d'appliquer les techniques de l'assurance utilisées par les producteurs agricoles pour garantir un prix de vente de leur récolte indépendamment des fluctuations d'un marché volatil. Ces nouveaux outils vont prendre la forme de contrats à terme, de gré à gré, donc bien plus difficiles à contrôler que des échanges sur les marchés régulés, contrats fermes puis à option. Ainsi seront inventées des garanties contre les variations de prix de certains produits et marchandises, de taux (de change, d'intérêt), etc.
Exemple : un exportateur étasunien a conclu un marché de livraison à terme, libellé en dollars, avec un importateur européen. Si le dollar baisse par rapport à l'euro, l'importateur européen gagne la différence en euros, ce qui l'intéresse. En revanche, si le dollar monte par rapport à l'euro, il devra payer davantage en euros. S'agissant de l'évolution du cours des devises, exportateur et importateur ont donc des intérêts contraires, qui deviennent complémentaires si leur but est de neutraliser les turbulences du marché des changes. Pour ce faire, il leur suffira de conclure un contrat stipulant que, en cas de baisse du dollar, l'importateur remboursera ses gains à l'exportateur et que ce sera l'inverse en cas de hausse du dollar. Leur banque se chargera de rédiger le contrat et d'en garantir l'exécution contre rétribution.
Mais les choses vont se compliquer et surtout prendre un cours nouveau avec l'invention, par les banquiers de JP Morgan en 1994, des « dérivés de crédit » , les plus célèbres étant les CDS, ou credit default swaps . Dérivés de crédit car la garantie recherchée concerne non plus des biens ou des marchandises, mais des titres de crédit, des créances : obligations, titres hypothécaires, etc. Garantie que le débiteur (l'entreprise ou l'État émetteurs de l'obligation, l'emprunteur...) ne fera pas défaut, que le titre conservera sa valeur, que le gain attendu sera bien au rendez-vous, etc.
Il y a transfert, contre rétribution, du risque lié à ces titres de crédit à une ou plusieurs contreparties - vendeurs de protection - sans transfert des titres. Ces contreparties - essentiellement des banques - s'engagent à suppléer les débiteurs défaillants, par exemple à rembourser les obligations émises par une entreprise en faillite ou un État devenu insolvable. Le prix de la garantie dépend de l'importance du risque encouru et de la demande, paramètres en principe liés puisque l'augmentation de la demande témoigne théoriquement d'une inquiétude quant à la solvabilité des débiteurs.
Qui dit transfert de risques dit incitation à la prise de risques, donc à la spéculation, les titres risqués étant ceux qui rapportent le plus. Plusieurs innovations vont faciliter la transformation des dérivés de crédit, instruments au départ utiles puisque permettant de sécuriser les investissements, en « armes de destruction massive » pour reprendre l'expression de Warren Buffett. Parmi ces innovations : la possibilité d'acheter des CDS sans posséder les titres qu'ils garantissent (comme si on s'assurait contre l'éventuel accident d'une voiture qu'on ne possède pas), les contrats optionnels...
• Des « armes de destruction massive »
Cette possibilité de séparer le contrat de garantie (le CDS) de ce qu'il garantit (le sous-jacent), de le vendre à tout moment, va transformer le CDS en titre , titre sur la valeur duquel on va pouvoir spéculer à moindre frais. Non seulement la valeur du CDS va varier en fonction de l'évolution de la valeur sur le marché de la créance qu'il garantit - la rumeur de défaillance d'une entreprise ou d'un État fera baisser le prix de ses obligations et monter celui des CDS qui les garantissent - mais, en cas de défaut, c'est le montant garanti des obligations qui sera remboursé au spéculateur sans qu'il ait jamais à les posséder ! Les marchés se trouvent donc transformés en casino où des mises modestes (le coût initial du CDS) peut rapporter très gros, d'autant plus que l'on peut aider le sort en spéculant à la baisse des sous-jacents que l'on aura garantis.
Les produits dérivés sont devenus des armes de destruction massive pour au moins quatre raisons : leur déconnexion de l'économie réelle, leur volume, leur rôle dans l'interconnexion des grandes banques systémiques mondiales, au point de rendre impossible la faillite de l'une d'elle sans que l'ensemble ne tombe, l'impossibilité d'une estimation exacte et plus encore d'une limitation des prises de risques.
- Déconnexion de l'économie réelle : selon Christophe Nijdam, secrétaire général de Finance Watch au moment de son audition 84 ( * ) , et depuis membre des Stakeholders Groups de l'Autorité bancaire européenne (EBA) et de l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), on pourrait se passer des garanties accordées à 75 % des montants notionnels. « C'est quatre fois plus important que ce qui pourrait être justifié par l'économie réelle. »
- Volume : selon Christophe Nijdam, toujours, le montant notionnel total des produits dérivés est de l'ordre de dix fois le PIB mondial, le danger principal venant de leur accumulation dans les très grandes banques. Ainsi, précise Jézabel Couppey-Soubeyran 85 ( * ) : « La BNP a un bilan équivalent au PIB français. Son hors-bilan équivaut à vingt-quatre fois le PIB français. Le montant notionnel de produits dérivés hors bilan des trente banques systémiques dans le monde s'élève à 720 000 milliards de dollars de notionnels dérivés. »
- Risques d'interconnexion . Ils viennent de ce que les émetteurs de garanties se garantissent souvent eux-mêmes auprès d'autres émetteurs de garanties, d'où un enchevêtrement de garanties et contre-garanties interbancaires, sécurisant par temps calmes mais rendant très fragile le système en cas de crise. Certaines banques, comme AIG aux États-Unis, se sont même spécialisées dans la réassurance, ce qui lui vaudra d'être sauvé par l'État américain, avec les banques qu'elle garantissait (Goldman Sachs, Société Générale, etc.) qui, autrement, auraient été emportée par leurs engagements aventureux. Même scénario pour Fannie Mae et Freddie Mac, institutions privées de garantie des prêts hypothécaires, elles-mêmes garanties par l'État.
Le Monde, en décembre 2013, raconte ainsi l'épisode AIG 86 ( * ) : « L'assureur américain AIG, qui fut sauvé de la faillite par un prêt massif de l'État en 2008, détenait ainsi pour plus de 1 600 milliards de dollars de CDS (credit default swap) "Comme personne ne savait qui détenait les CDS vendus ou échangés par AIG, ces derniers ont contribué à propager la panique dans tout le système", rappelle Christophe Nijdam, qui a travaillé sur les marchés dérivés dès les années 1980 au sein de plusieurs établissements financiers. Un risque systémique que les dérivés font toujours planer sur le système financier. »
Le même Christophe Nijdam, de préciser lors de son audition : « Quand on revient à la crise de 2008 des subprimes, il s'agissait de crédits immobiliers. Cette crise aurait pu rester locale en l'absence de produits dérivés, plus spécifiquement de CDS. Entre les sous-jacents des subprimes et le montant des risques accumulés autour des CDS, c'est devenu une crise systémique. C'est en cela que les produits dérivés justifiés au départ peuvent devenir une machine infernale . » 87 ( * )
Étonnant effet boomerang d'inventions créées pour sécuriser les marchés !
- Impossibilité d'une estimation exacte des engagements extravagants pris par les émetteurs de produits dérivés et encore plus d'une limitation des prises de risque car ils ne figurent pas au bilan des banques. Ceux-ci retraçant uniquement les mouvements financiers effectifs, ils sont rejetés hors bilan à l'exception des recettes et des dépenses issues des ventes et des achats de CDS. Le hors-bilan, en effet, enregistre les droits et obligations contractées par la banque, susceptibles d'avoir un impact sur sa situation future. On le voit, à la différence des prêts, les CDS permettent aux banques de faire du business sans besoin de fonds propres supplémentaires.
Ainsi que l'écrit un spécialiste, « une activité notable du banquier est la prise ou réception d'engagements significatifs (opérations de hors-bilan) sans qu'il y ait transfert de fonds. Il peut en découler que ces engagements ne génèrent pas d'écritures comptables dans les systèmes généraux. La non-prise en compte de ces éléments peut être difficile à déceler » 88 ( * ) .
Ce que, en 2003, Warren Buffett traduira par le jugement politiquement plus incorrect que l'on connaît mais qui mérite d'être repris en entier : « Je considère les produits dérivés comme étant des armes de destruction massive, véhiculant le risque, qui même s'il est latent actuellement est potentiellement mortel. »
Avec l'explosion des produits dérivés, la « finance casino » fait donc un saut qualitatif important : protéger des variations des marchés les acteurs économiques devenus une infime minorité est un objectif secondaire ; il s'agit beaucoup plus désormais de permettre à la masse des spéculateurs qui n'y sont pas exposés d'en profiter en pariant sur l'évolution à la hausse ou à la baisse de tout ce qui peut varier : valeurs, taux, indices... Ils n'ont même pas à acquérir le sous-jacent qui sert de référence pour, si le pari est gagnant, encaisser leurs gains... ou leurs pertes, s'il ne l'est pas.
Ces merveilleux instruments permettent non seulement de profiter de la volatilité naturelle des marchés, mais d'influencer et d'amplifier les mouvements moutonniers des « investisseurs ». Ils permettent de spéculer à la baisse, donc de provoquer des catastrophes juteuses, de parier sur l'évolution du taux d'intérêt ou de la valeur d'obligations qu'on ne possède pas, sur le taux d'intérêt futur d'emprunts auxquels on n'a nullement l'intention de souscrire, etc.
2. L'industrie du risque
«
C'est l'équivalent financier de
l'alchimie.
»
Benoît Mandelbrot
89
(
*
)
Longtemps technique, mélange d'intuition, d'expérience, de codification plus ou moins changeantes de recettes et de pratiques, la finance, en rencontrant les mathématiques du hasard, la statistique et le calcul des risques, s'est métamorphosée en science, ou du moins a réussi à le faire croire.
On a vu, à l'usage, que la grenouille qui avait voulu se faire plus grosse que le boeuf en a connu le destin ; sauf qu'à la différence de la fable on l'entend toujours coasser. Une orthodoxie financière progressivement élaborée, perfectionnée et méthodiquement diffusée s'est ainsi imposée.
Benoît Mandelbrot détaille : « Le concept fondamental en est : les prix ne sont pas prévisibles, mais leurs fluctuations peuvent être décrites par les lois mathématiques du hasard. Par conséquent, le risque est mesurable et gérable. » 90 ( * )
Cette « théorie moderne de la finance » résulte du croisement entre le modèle des variations des cours boursiers de Louis Bachelier exposé dans sa thèse de 1900, des lois de la physique et des dernières sophistications mathématiques.
L'axiome central de la thèse de Bachelier et des outils de gestion du risque qui en découleront est que les variations des cours autour de la moyenne sont uniquement le produit du hasard. Les investisseurs, selon la vulgate libérale, étant censés disposer des mêmes informations, aucune raison particulière ne les pousse dans un sens ou dans un autre. Aléatoires, ces variations se distribuent selon la courbe de Gauss-Laplace : concentration de petites variations autour de la moyenne et probabilités de plus en plus faibles de variations extrêmes. Les pertes et les gains se distribuent donc de la même façon : forte probabilité de petites pertes (ou gains), faible probabilité de pertes (ou gains) moyennes, très faible probabilité de pertes (ou gains) sévères. Autrement dit, plus on s'éloigne de la moyenne des cours, plus les pertes et les gains sont importants mais moins ils sont fréquents. Par construction, de probabilité infime, la possibilité de pertes massives, de krach est, de fait, impossible.
Autre axiome : les variations de cours sont pratiquement continues. La nature, en physique comme en économie (Alfred Marshall), ne procède pas par sauts. Ce qui permet de mobiliser les mathématiques des fonctions continues et des équations différentielles largement utilisées en physique. « La continuité est une hypothèse fondamentale de la finance conventionnelle » rappelle Benoît Mandelbrot, ajoutant : « Les mathématiques de Bachelier, Markovitz, Sharpe et Black-Scholes supposent toutes une variation continue d'un prix au suivant. Sans cette dernière, leurs formules ne marchent tout simplement pas. »
C'est sur cette base que sera élaborée toute une panoplie d'outils d'évaluation et de gestion des risques boursiers utilisés par les agences de notation et les gestionnaires de portefeuilles.
Deux exemples : la « théorie moderne du portefeuille » de Markowitz (prix de la Banque de Suède) et la « formule magique » de Black et Scholes (eux aussi prix de la Banque de Suède)
• La théorie de Markowitz, c'est la courbe de Gauss « façon paysanne » : ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. Selon lui, les perspectives d'évolution de chaque action sont analysables en termes de gain et de risque. L'estimation la plus probable du gain est donnée par la moyenne de tous les cours que l'on peut attendre avant la vente. Le risque (volatilité, façon dont la valeur fluctue autour de sa moyenne), par la variance et l'écart-type de la distribution.
Pour une valeur, l'estimation de la volatilité future est faite à partir d'échantillons passés, la distribution étant considérée comme normale (vérifiant la courbe de Gauss).
On peut ainsi comparer les actions (gains et risques) et constituer des portefeuilles pouvant être soit stables, en mélangeant des actions qui n'évoluent pas dans le même sens (à la hausse et à la baisse) selon la conjoncture (croissance ou récession, stabilité politique, etc.), soit « efficients », c'est-à-dire produisant un gain maximal pour un risque minimal. Pour chaque niveau de risque choisi, on peut constituer un portefeuille permettant le maximum de gain ou, inversement, pour un niveau de gain, un portefeuille présentant le risque minimum.
Entre deux portefeuilles d'investissement, le meilleur est celui qui a la meilleure performance moyenne attendue avec l'exposition au risque la plus faible.
« Markovitz et consorts ont transformé l'investissement qui n'était qu'un jeu fait de tuyaux boursiers et d'intuition, en une ingénierie financière peuplée de moyennes, de variances et d'indices d'aversion au risque. » 91 ( * )
• De nombreuses innovations suivront, les plus intéressantes pour la spéculation étant celles qui permettent d'exploiter la volatilité des cours en choisissant « d'investir » sur les valeurs (actions, monnaies, marchandises) les moins stables, donc potentiellement les plus rentables. La formule magique de Black et Scholes qui rencontre alors un grand succès est de celles-là. « Elle a permis l'émergence d'un type entièrement nouveau de commerce, ne portant pas sur les actions ou les liquidités, mais sur leur volatilité. Les opérateurs peuvent ainsi bâtir des combinaisons élaborées d'options qui ne sont pas censées rapporter pour une valeur spécifique du cours, mais simplement lorsque les prix fluctuent plus fortement, à la hausse ou à la baisse, que la normale. Ils peuvent aussi faire l'inverse : concevoir un paquet d'options qui ne rapportent que si les cours restent stables. En ce sens, on peut dire que la formule attribue un prix au risque. » 92 ( * )
Le problème, c'est que ces théories reposent sur une modélisation inadéquate du fonctionnement des marchés : les cours ne se distribuent pas aléatoirement, sans lien les uns avec les autres, selon la courbe de Gauss. Ils ne varient pas non plus de manière continue d'où l'impossibilité de leur appliquer les mathématiques du continu. « Il ne fait pas de doute que les prix financiers bondissent et sautent - à la hausse et à la baisse . » 93 ( * ) Les prix, les cours, les taux, etc., ne glissant pas, par petits sauts, de manière continue mais procédant par sauts brusques, des hausses brutales du niveau des pertes deviennent possibles. La continuité n'existant pas, Wall Street l'a organisée, confiant à des « spécialistes », la mission d'équilibrer, par leurs interventions, les achats et les ventes. Devenus spéculateurs, on leur doit une part du krach de 1997 ! Les marchés sont donc en partie, et parfois en très grande partie, des créations et non une donnée naturelle (voir la fabrication de la liquidité).
Surtout, comme le montrera Mandelbrot, la distribution des cours boursiers ne vérifie pas les présupposés sur lesquelles repose la courbe de Gauss.
• « Il y a bien trop de variations, soit très grandes, soit très petites, et pas assez de moyennes » 94 ( * ) pour que l'on puisse considérer que le modèle brownien représente adéquatement le fonctionnement du marché.
• Les variations ne sont pas indépendantes les unes des autres comme au jeu de pile ou face. Au contraire, les prix s'influencent les uns les autres, à court terme et probablement à long terme. La volatilité procède par « bouffées » : « Les variations de prix se concentrent clairement en fonction de leur taille. Les grandes variations arrivent par rafales, comme une fusillade ou des tirs d'artillerie ; elles sont suivies par de longues séries de petites variations semblables à des bruits de pistolets à bouchon [...] La volatilité n'est pas constante, comme le prévoit la théorie standard, mais varie dans le temps. Les turbulences extrêmes des marchés sont la norme et non l'exception. » 95 ( * )
• Élément plus fâcheux sur le plan pratique, les variations de grande, voire de très grande, ampleur sont bien plus fréquentes que prévues par la loi normale, ce qui donne des « queues épaisses aux distributions. Les queues de distribution ne disparaissent pas autour de la moyenne, comme le prévoit la loi normale, mais décroissent selon une "loi de puissance" » . Ce qui signifie que, moins une variation est fréquente, plus son ampleur sera forte et aussi que, les variations faibles étant les plus fréquentes et non les variations moyennes, cela n'a aucun sens de faire des prévisions sur la base de moyennes.
Il en résulte que les risques de krach et leur magnitude sont bien plus élevés que prévu.
Selon Benoît Mandelbrot, si les variations de prix vérifiaient la distribution statistique « en cloche », une variation de plus de cinq écarts-types de l'indice Dow Jones ne pourrait intervenir que tous les 7 000 ans ; elles interviennent en réalité tous les trois-quatre ans.
La probabilité d'une variation de dix écarts-types de la moyenne est égale à 1 suivi de 23 zéros. En réalité, elles ne sont pas rares.
Une chute des cours de l'amplitude du krach de 1987 ne devrait pouvoir se reproduire que tous les 15 milliards d'années, soit l'âge de l'univers. Or, on a déjà pu l'observer durant la Grande crise de 1929. Selon Benoît Mandelbrot, avec ces théories, chacun risque plus d'être vaporisé par une météorite que d'être ruiné par un krach financier. On comprend pourquoi les « experts ès risques financiers » n'ont pas vu venir le krach de 2008 !
On comprend aussi pourquoi, ayant constaté que la variation des cours ne vérifiait pas la courbe en cloche, les financiers professionnels, à partir de leur expérience et de leur intuition, ont procédé à divers bricolages pour obtenir des modèles donnant des résultats plus proches de la réalité, notamment en réservant un traitement particulier des queues de courbe pour tenir compte de la fréquence plus grande que prévue des résultats exceptionnels.
Conclusion de Benoît Mandelbrot : « L'économie financière, en tant que discipline, en est là où était la chimie au XVI e siècle : c'était un ramassis de savoir-faire, de sagesse populaire fumeuse et de spéculations grandioses . » 96 ( * )
C. À QUOI SERT RÉELLEMENT LE MARCHÉ FINANCIER ?
Dans un entretien au magazine Times en juillet 2015, le fondateur du groupe financier Vanguard, John Bogle, nous donne une bonne idée de la fonction actuelle des marchés en expliquant que, s'il s'échange annuellement 32 000 milliards de dollars de titres à Wall Street (soit presque le double du PIB des États-Unis), le besoin annuel en capital pour financer les sociétés américaines, sous la forme d'introduction en bourse ou d'augmentation de capital, est seulement de 250 milliards de dollars (1 %). « Donc, si je calcule bien, 99 % de ce que nous faisons dans cette industrie consiste en des échanges d'une personne avec une autre dans le seul intérêt de l'intermédiaire. C'est un gâchis considérable de ressources. » Pour lui, les traders bénéficient d'une sorte de péage qui ne renvoie à aucun service effectif : « Les études ne cessent de le montrer, les traders ne font rien qui a une valeur. Ils ne savent pas quelles actions vont monter et pourquoi. Ils ne savent pas quels types d'actifs vont être plus performants cette année ou les suivantes. Personne ne sait. C'est cela la vérité... C'est pourquoi les traders ont besoin que vous fassiez des transactions et beaucoup. Parce que c'est comme cela qu'ils gagnent de l'argent... »
Quant à la contribution des banques au financement de l'économie réelle, elle est très variable selon les établissements , les plus gros étant ceux qui, proportionnellement à leur taille (et donc aux risques qu'ils font courir au système), y contribuent le moins. Les tailles de bilans ne sont pas comparables. Ainsi le bilan de la banque universelle BNP Paribas (1 900 milliards d'euros) est-il du niveau du PIB de la France. Cet exemple est tout à fait représentatif d'un phénomène général.
Au tournant des années 1990-2000, en effet, les bilans bancaires européens ont explosé ( cf le rapport Liikanen et les travaux du Conseil européen du risque systémique), avec le développement des activités de marchés qui vont progressivement, en valeur et relativement, prendre de plus en plus de place : « tenue de marchés », autant dire spéculation dont le THF représente la quintessence ; acquisitions de titres (actif) et émissions d'emprunts (passif) pour les financer.
Dans les bilans, la part des dépôts et des services offerts classiquement par une banque de détail diminuent. En même temps que les tarifs des services bancaires augmentent en flèche, du fait, nous a expliqué Jézabel Couppey-Soubeyran lors de son audition 97 ( * ) , de la « situation du secteur bancaire en position dominante sur ce marché et donc en position de faire le prix, ce qui défavorise le consommateur et compromet la stabilité financière. »
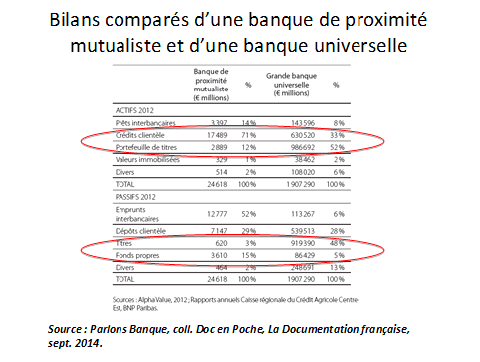
Dans le graphique proposé ci-dessus par Jézabel Couppey-Soubeyran 98 ( * ) , les crédits à la clientèle représentent, dans le cas de la banque de proximité, 71 % des actifs, contre 33 % pour la banque universelle dont l'essentiel de l'activité est tourné vers les marchés financiers (52 %).
Certes, 1 euro de fonds propres de la banque universelle produit 7,3 euros de prêts quand 1 euro de fonds propres de la banque de proximité n'en produit que 4,8, soit un multiplicateur de 1,5. Mais c'est au prix d'un levier d'endettement de 21,1 contre 5,8, soit un multiplicateur de 3,6. Surtout, un levier d'endettement bien au-delà de la limite de sécurité estimée à 10 %-12,5 % par les spécialistes.
De plus, s'agissant des très grandes banques, 33 % du bilan de crédits à la clientèle, déjà peu glorieux, cachent la misère de l'activité de crédit aux entreprises pourtant censée être « La » mission, avec un L majuscule, des banques.
Jézabel Couppey-Soubeyran donne l'ordre de grandeur suivant : « La part du crédit aux entreprises au bilan agrégé du secteur bancaire français s'élève à 10 %. La part du crédit aux PME à 5 %, alors que les banques sont censées financer les entreprises qui ont le moins de possibilités alternatives de financement. On se demande ce qu'il en est des 95 % restants... L'activité des grandes banques européennes n'est plus tournée vers l'activité de crédit aux entreprises de taille moyenne et intermédiaire. Pourquoi ne cherche-t-on pas à savoir pourquoi ? On préfère se dire que les entreprises européennes sont trop dépendantes du crédit bancaire et alors on fait l'union des marchés de capitaux pour diversifier leurs possibilités de financement. Mais, par ce biais, on réintroduit la dette et la titrisation, soit deux ingrédients majeurs de la crise des subprimes. »
Si on suit l'analyse de John Bogle, il y a tout lieu de penser que l'union des marchés de capitaux au niveau européen profitera plus aux banques qu'à l'économie réelle.
Ce qui nous amène à la question de fond évoquée par Gunther Capelle-Blancard lors de son audition 99 ( * ) , à savoir « l'utilité sociale de la finance » : « Lord Adair Turner a été le premier à introduire cette notion, il était responsable de l'autorité de régulation britannique (Financial Services Authority). » Avant de conclure : « Même s'il est difficile de les quantifier, on a légitimement l'idée qu'on a affaire à des activités presque parasitaires, au sens biologique du terme. Il n'y a pas de déconnexion : le parasite se nourrit de la bête, le développement du parasitaire n'a pas d'utilité, il n'y a pas de déconnexion, il y a même une symbiose entre eux. Si on coupe ce lien, le parasite meurt. [...] Quand on regarde le schéma d'organisation du système financier actuel, polarisé sur les marchés, sorte de batteur à liquidités géant plutôt que sélecteur des ressources en capitaux en vue de leur affectation économique optimale, on se pose en effet la question de l'utilité sociale d'une machine dont l'essentiel des organes travaille pour la machine elle-même quand elle ne se transforme pas en une dangereuse « machine à bulles ».
À quoi sert le système financier au terme d'une quarantaine d'années de « modernisation » ? Essentiellement à lui-même.
V. L'EUROPE, PRÉCURSEUR ET BONNE ÉLÈVE
Si les États-Unis sont l'épicentre de la « Grande transformation libérale de l'Empire », les pays européen et l'Europe, par des voies spécifiques, y ont joué un rôle essentiel. Il apparaît même que, sur certains points - désétatisation économique et financière, place accordée à la régulation - et sur le plan théorique, ils ont fourni des efforts de transformation plus conséquents. L'exemple français est particulièrement significatif, comme on l'a vu 100 ( * ) , et comme en témoigne l'aventure Dexia tout à fait emblématique.
Quant à la construction européenne, contrairement à ce qu'on pense généralement, elle s'est faite non pas contre les États-Unis mais à leur instigation. Le pays qui imposera finalement sa vision de l'Europe nouvelle, c'est l'Allemagne, revenue du désastre nazi et qui s'était elle-même reconstruite autour de sa monnaie et de son économie et non d'un État que tout le monde préférait oublier.
A. LE RÊVE D'UNE INSTITUTION POLITIQUE SANS POLITIQUE
Comme le montre Michel Foucault dans son cours au Collège de France 101 ( * ) , c'est le modèle ordolibéral qui inspirera les refondateurs de la nouvelle Allemagne, notamment Ludwig Erhard. Faute de pouvoir installer un État acceptable par les vainqueurs, c'est autour d'une économie concurrentielle régulée par le droit seul que va se reconstruire l'Allemagne et que pourra exister un État uniquement préoccupé au départ de créer les conditions d'existence d'un marché libre. La manière ordolibérale de concevoir l'économie et le rôle de l'État est tout à fait spécifique.
Selon Michel Foucault, pour l'ordolibéralisme allemand, « entre une économie de concurrence et un État [...], le rapport ne peut [...] être de délimitation réciproque de domaines différents. Il ne va pas y avoir le jeu du marché qu'il faut laisser libre, et puis le domaine où l'État commencera à intervenir, puisque précisément le marché, ou plutôt la concurrence pure, qui est l'essence même du marché, ne peut apparaître que si elle est produite, [...] produite par une gouvernementalité active [...] Le gouvernement doit accompagner de bout en bout une économie de marché [...] Il faut gouverner pour le marché plutôt que gouverner à cause du marché ». Cette « concurrence libre et non faussée » étant produite et garantie par le droit, des organismes indépendants et des cours de justice, l'État devient inutile au fonctionnement social tout entier. Tel est le principe fondamental de la construction européenne. Il ne faut jamais l'oublier, si l'on veut comprendre la logique de ses dirigeants et de décisions qui peuvent apparaître stupides, ce qu'elles ne sont pas.
L'existence d'instance décisionnelles dotées d'une légitimité démocratique - Conseil européen, Parlement -, aux pouvoirs bridés par le nombre et des règles strictes - par exemple, le Parlement n'a pas de pouvoir d'initiatives -, ne sont que des concessions témoignant du caractère encore imparfait de la construction. Une fois achevée, l'observation des règles suffira à faire fonctionner l'Union, sans que rien ne puisse venir perturber le cours des choses, en tous cas pas les peuples qu'elle est censée unir. Comme dira Jean-Claude Juncker au moment de la dernière crise grecque : « Il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens. » 102 ( * )
Le mode de construction de la zone euro illustre parfaitement ce rêve d'une oeuvre humaine autorégulée, pouvant fonctionner sans choix humains.
L'euro est la tentative inouïe, c'est-à-dire jamais vue, de créer une monnaie sans pouvoir souverain pour la légitimer, l'administrer et la gouverner en cas de crise.
Une monnaie sans système de recyclage des excédents ni de garantie mutuelle permanent des dettes (euro-obligations par exemple) et sans possibilité d'assistance financière directe entre États. Le rôle du système des banques centrales y est réduit au minimum, uniquement chargé d'éviter que les banques, dotées de l'essentiel du pouvoir de création monétaire à travers le crédit, ne fassent faillite, de lutter contre l'inflation, existante ou probable, et de regarder l'euro s'apprécier ou baisser.
Garant de cet ordre : le respect de quelques règles budgétaires simples par les États sous la surveillance du « haut clergé » financier central.
La crise le montrera, faute de mécanisme de péréquation ou de redistribution des excédents allemands, ce qui suppose des décisions politiques lourdes, le système n'est pas viable.
Il faudra attendre l'arrivée du rusé Mario Draghi à la tête de la BCE pour voir réintroduite en fraude, une gouvernance active - mais non démocratique - du système. Mario Draghi pour qui, comme le bourdon, l'euro est un mystère de la nature : il n'aurait pas dû voler, avoue-t-il et pourtant, « il a volé plusieurs années ».
Comme fera remarquer Jacques Sapir lors de son audition 103 ( * ) , « il ne peut y avoir une finance, des marchés de biens libéralisés et un système de change fixe, ce qui est le cas avec l'euro. L'euro n'est pas une monnaie, c'est un système de change fixe, facteur de rigidités insupportables. Cela bloque la parité des changes entre les pays à un niveau donné ». Un système de change fixe entre des monnaies zombies. Le résultat, c'est une monnaie sous-évaluée pour l'Allemagne et surévaluée pour les autres membres de la zone.
On l'a vu, le mode de construction de la zone euro n'a pas facilité le règlement de la crise grecque et des crises annexes (Irlande, Espagne, Portugal). La difficulté sera encore plus grande si le système bancaire italien était à son tour menacé.
B. L'EUROPE, CHAMPIONNE DU LIBRE-ÉCHANGE
Contrairement à ce que croient ceux qui pensent que l'Europe actuelle a été construite à la fois pour supprimer les barrières entre ses membres et pour les protéger collectivement de la destruction de leurs emplois, le projet, dès le départ, vise non pas la construction d'un marché mondial par la convergence progressive de zones économiques relativement homogènes, ce qui pouvait se concevoir, mais à édifier, le plus vite possible et quelles que soient les conditions de production des pays, le grand marché mondial uniquement régulé par les prix et où les mouvements financiers seraient totalement libres.
Comme le montre un très éclairant rapport d'information sénatorial 104 ( * ) , sous la pression des Allemands, libéraux convaincus comme on vient de le voir, le traité de Rome instituant la CEE est suffisamment ambigu pour permettre plusieurs interprétations. Voici le témoignage de Jean-François Deniau, l'un des négociateurs français, rapporté par les auteurs du rapport : « Le but du traité de Rome, était-ce bien de créer une Communauté européenne fondée sur une Union douanière ? Ou était-ce seulement de relancer un mouvement mondial de libéralisation des échanges à partir de l'Europe, comme l'avaient envisagé certains initialement ? S'occuper de droits de douane, était-ce seulement l'occasion, le moyen, je dirais presque le prétexte, pour faire l'Europe ? Ou était-ce la vraie finalité ?
« Le sixième alinéa du préambule apporte la réponse : soigneusement ambiguë. On peut même dire que tout le traité de Rome est un traité soigneusement ambigu. »
Ce sixième alinéa sera ainsi rédigé : « Les Chefs des États membres [...] désireux de contribuer, grâce à une politique commerciale commune, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux, [...] ont décidé de créer une Communauté économique européenne [...] »
À la notion de préférence communautaire, que les Français voulaient faire inscrire dans le traité, notamment en matière agricole, sera préférée celle de « non-discrimination ».
En même temps, l'article 44 du traité prévoit que « les prix minima ne doivent pas être appliqués de manière à faire obstacle au développement d'une préférence naturelle entre les États membres ». Pareille disposition rappelle, en termes alambiqués, la préférence communautaire mais vaut seulement pour la période de transition suivant l'entrée en vigueur du traité.
En fait, ce qui tient lieu de préférence communautaire, c'est le tarif extérieur commun... qui est particulièrement bas. Il sera donc combattu pied à pied par les États-Unis, dans le cadre du Gatt, un levier de pouvoir à leur main.
Comme le fait remarquer le rapport sénatorial : « Ce sont toujours les États-Unis qui sont à l'origine des cycles de négociations du Gatt et un certain nombre d'entre eux sont lancés en réaction à un progrès dans la construction de la Communauté. C'est ainsi que le cycle de Dillon suit la création du marché commun, que le cycle de Tokyo suit l'élargissement et que le cycle d'Uruguay suit l'Acte unique européen. On a ainsi le sentiment que chaque progrès intérieur dans la constitution de la Communauté doit être compensé par un avantage concédé par celle-ci sur le plan international. »
La négociation Dillon se conclut, le 16 juillet 1962, par des concessions tarifaires importantes de la communauté : un taux moyen du tarif extérieur moyen de 6,5 % avec des variations très importantes possibles selon les domaines. En 1972, le taux pour les produits industriels sera ramené à 6,9 % en moyenne alors que celui des États-Unis se situe à 11,1 %, celui de la Grande-Bretagne à 11,6 % et celui du Japon à 10,1 %.
Dans le domaine de l'agriculture, les Étasuniens obtiendront la renonciation définitive à toute taxe sur les graines oléagineuses en contrepartie de leur acceptation du système de prélèvement communautaire. D'autres concessions importantes suivront.
Apparaîtront aussi des produits de substitution non soumis au tarif extérieur commun, le statut particulier de l'agriculture sera supprimé, les tarifs progressivement abaissés.
« Au fil des élargissements, les tendances favorables au libre-échange n'ont cessé de se renforcer. La succession des cycles de négociation a permis à ces dernières de l'emporter et de démanteler les outils d'une "préférence communautaire" qui, aux yeux des autres parties prenantes aux négociations du Gatt, n'est toujours apparue que comme l'utilisation des outils traditionnels du protectionnisme. » 105 ( * )
La messe étant dite, l'article 44-2 du traité de Rome sera abrogé par le traité d'Amsterdam 106 ( * ) .
Le 10 mars 2005, statuant sur une requête du gouvernement espagnol, la CJCE, Cour de justice des communautés européennes, conclut que la préférence communautaire est un principe qui n'a pas une valeur juridique mais une valeur politique. Voilà qui est rassurant !
Conclusion du rapport sénatorial précité : « Ce tarif extérieur, symbole de la préférence communautaire, n'est presque plus utilisable comme instrument, en raison de nos engagements internationaux, et notamment de la consolidation de nos droits de douane auprès de l'OMC [...] En tout état de cause, toute mesure unilatérale de relèvement de ses tarifs douaniers par l'Union européenne se traduirait immédiatement par des plaintes de nos concurrents, une condamnation par l'organe de règlement des différends de l'OMC et à tout le moins, le versement de compensations [...] Que peut faire l'Union si elle ne peut utiliser la protection tarifaire ? L'Union européenne doit promouvoir ses valeurs, notamment en termes de respect de l'environnement, de normes sociales, etc., et ainsi, d'une certaine manière, exporter son modèle. Certes, il faut remarquer que l'Organisation mondiale du commerce ne permet pas d'inclure dans les négociations commerciales des thèmes comme ceux-ci, mais des liens peuvent être faits grâce aux résultats obtenus dans d'autres organisations, comme l'Onu pour l'environnement (protocole de Kyoto), l'Organisation internationale du travail pour les normes sociales, ou l'Unesco (convention sur la diversité culturelle). Il faut également faire observer que, sous réserve de non-discrimination, l'article XX du Gatt permet des restrictions à la libéralisation pour un certain nombre de motifs légitimes (santé publique, environnement, protection des espèces). L'OMC condamne cependant toute utilisation abusive de cette clause, comme l'a montré un contentieux opposant les États-Unis et des pays tiers sur le thème de la protection des tortues . »
Si même les tortues ne peuvent être protégées, les agriculteurs n'ont aucune chance.
Rappelons enfin que l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Europe (ex-article 56 TCE) prévoit que : « 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. 2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. »
La conclusion de Maurice Allais - économiste français lauréat du prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel -, c'est que les difficultés de l'Europe viennent de ce qu'au lieu de se constituer comme une unité à l'abri du dumping extérieur parce que certains de ses membres y trouvaient mieux leur compte, elle s'était ouverte aux quatre vents du libre-échangisme. Comparant les taux de croissance, de chômage et l'évolution des emplois dans l'industrie après et avant 1974 (date d'adhésion de la Grande-Bretagne à la Communauté), il en conclut 107 ( * ) que c'est « la politique de libre-échange mondialiste poursuivie par l'Organisation de Bruxelles (qui) a entraîné à partir de 1974 la destruction des emplois, la destruction de l'industrie, la destruction de l'agriculture, et la destruction de la croissance ».
« Incontestablement la politique de libre-échange mondialiste que met en oeuvre l'Organisation de Bruxelles est la cause majeure, de loin la plus importante, du sous-emploi massif et de la réduction de la croissance que l'on constate. Pour y remédier, la construction européenne doit se fonder sur le rétablissement de la préférence communautaire et du contrôle des mouvements de capitaux, condition véritable de l'expansion, de l'emploi et de la prospérité. Ce principe a d'ailleurs une validité universelle pour tous les pays ou groupes de pays... La libéralisation totale des mouvements de biens, de services et de capitaux à l'échelle mondiale, objectif affirmé de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à la suite du Gatt, doit être considérée à la fois comme irréalisable, comme nuisible, et comme non souhaitable.
« Elle n'est possible, elle n'est avantageuse, elle n'est souhaitable que dans le cadre d'ensembles régionaux économiquement et politiquement associés, groupant des pays de développement économique comparable, chaque association régionale se protégeant raisonnablement vis-à-vis des autres. »
À en juger par les remous suscités en Europe par le TTIP et le CETA, qui outre les problèmes d'équité concurrentielle entendent soumettre les décisions des États à des arbitrages par des instances privées, par la campagne des élections présidentielles étasuniennes dans laquelle l'Aléna 108 ( * ) en particulier et le libre-échangisme rendu responsable des délocalisations, du déclassement social d'une bonne partie de la population et de la ruine de villes entières occupent une place centrale, il semble que la mondialisation n'ait pas été heureuse pour tout le monde.
Sur les ruines des accords de Bretton Woods s'est donc reconstruit un ordre monétaire, financier et économique mondial, avec le dollar dans le rôle de monnaie de réserve de fait, quelle que soit la quantité émise et la production de liquidités pour moteur : monnaie banques centrales pour combler les déficits commerciaux ou budgétaires des États souverains, monnaie scripturale des banques commerciales pour pallier l'insuffisance de la demande des ménages et alimenter le turbo spéculatif, quasi-monnaie produite par l'industrie financière.
Le résultat en est un endettement colossal, des États, des entreprises et des ménages engagés dans une fuite en avant perpétuelle, avec les banques et les marchés comme boussoles et animateurs. Banques et marchés dont le rôle traditionnel de financeurs de l'économie par le recyclage de l'épargne et le crédit aux entreprises est devenu subsidiaire.
On aura compris qu'un tel système ne peut fonctionner que par une fuite en avant de plus en plus difficile à supporter par les laissés-pour-compte de l'ordre nouveau.
C. LE CAS DEXIA
L'histoire de Dexia s'inscrit dans celle de la « modernisation » libérale du système de crédit aux collectivités locales françaises, partie elle-même de la grande histoire de la modernisation libérale du système financier français et mondial 109 ( * ) .
Cette grande transformation touchera le système de financement public, alors construit autour de la Caisse des dépôts et consignations, les institutions coopératives et mutualistes (Crédit Agricole, Caisses d'épargne, Crédit mutuel, Banques populaires). L'histoire tortueuse et peu claire de cette mutation patiemment conduite d'alternances en alternances, qui voit interférer intérêts politiques, corporatistes et privés, reste à écrire. Ce qui suit en retrace un chapitre particulièrement instructif.
1. L'ascension et la chute de la Maison Dexia
a) La marginalisation du système « Caisse des dépôts » dans le financement des collectivités
Dans la première moitié des années 1980 s'opère un double tournant : suppression de l'autorisation préfectorale préalable en matière d'emprunt (lois de décentralisation), disparition des prêts bonifiés et du système spécifique de financement des collectivités territoriales, dont la CDC et le réseau des Caisses d'épargne constituent le coeur.
Jusque-là, les collectivités, pour le financement de leurs investissements, négociaient avec les ministères des subventions spécifiques et, en complément, des prêts bonifiés assis sur l'épargne collectée via le livret A. Le marché obligataire auquel il était fait appel au travers de la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (Caecl) apportait un complément de ressources. Émanation de la CDC, la Caecl, créée en 1966, avait le statut d'établissement public administratif.
Progressivement, pour les collectivités, le produit de la collecte du livret A réservé de plus en plus au financement du seul logement social, est remplacé par l'appel au marché obligataire au travers de la Caecl, puis au marché tout court avec l'ouverture de celui des collectivités locales à toutes les banques à partir de 1986.
Les vingt ans qui suivent seront ceux de l'achèvement du passage d'un système de financement des collectivités locales assis sur l'épargne, des circuits de collecte et de redistribution spécialisés essentiellement public ou parapublic 110 ( * ) , à un système assis sur l'appel généralisé aux marchés financiers totalement privé. Ce au nom d'une optimisation de l'allocation des ressources et du moindre coût.
b) Dexia : une histoire franco-belge
En 1987, le gouvernement Chirac décide de banaliser le financement des collectivités territoriales. Elles ne disposent plus des ressources des fonds d'épargne désormais réservées au logement social et à la politique de la ville et doivent s'adresser aux banques, lesquelles se financent sur le marché.
La Caecl devient le Crédit local de France (CLF), filiale dotée du statut d'institution financière spécialisée, intervenant sur le marché concurrentiel. Celui-ci réalise alors 44 % des prêts aux collectivités territoriales. En 1991, partiellement privatisé par le gouvernement Rocard, il est introduit en bourse (la CDC détient 25 % du capital). Totalement privatisé en 1993 par le gouvernement Balladur, il quitte le giron de la CDC qui en demeure cependant l'un des principaux actionnaires.
Dexia, créée en 1996 sous le gouvernement Juppé, est introduite en bourse en 1999, sous le gouvernement Jospin.
Le groupe de droit belge, Dexia SA, dont la CDC contrôle 12 % du capital, résulte de la fusion du CLF et d'une banque de dépôts, le Crédit communal de Belgique. Dexia SA est constitué de trois entités principales :
- Dexia Banque (DBB) ; Belgique ;
- Dexia Crédit Local (Dexia CL) avec sa filiale, Dexia Municipal Agency (DMA), chargée de refinancer sur le marché les prêts consentis aux collectivités territoriales ; France ;
- Dexia Banque International (BIL) ; Grand-Duché de Luxembourg.
L'expansion du groupe paraît ne plus pouvoir s'arrêter. Il va contrôler : une banque universelle en Turquie (Deniz Bank), un rehausseur de crédit aux États-Unis (FSA), acquis en 2000 111 ( * ) . Et disposer de multiples filiales spécialisées dans le financement des collectivités locales en Italie (Dexia Crediop), Espagne (Dexia Sabadell), Autriche (Dexia Kommunalkredit Bank), Slovaquie, Canada (Dexia Crédit Local Canada), États-Unis (Dexia Crédit Local New York Branch)...
Il intervient partout, comme dans le financement du métro de Santiago du Chili en 1998. Dexia Asset management (société de gestion d'investissement) est présente à travers le monde. Dexia Investor Service, société gestionnaire de titres est créée en 2006 avec RBC (Royal Bank of Canada) 112 ( * ) .
L'ascension de Dexia, qui devient le leader mondial incontesté du financement des collectivités territoriales, est fulgurante. Entre sa création et 2007, ses encours sont multipliés par sept. Jusqu'à la chute de Lehman Brothers, tout paraissait aller pour le mieux. Encore au second trimestre 2008, le groupe est bénéficiaire. Comme résume, en 2008, la collaboratrice de la CDC, auteur d'un « Que sais-je ? » consacré à la Caisse des dépôts 113 ( * ) : « L'établissement [la CDC] a ainsi fait naître et contribué à développer une belle entreprise financière européenne. »
Un géant, mais un géant aux pieds d'argile.
c) Dexia : une histoire tellement française
Mais l'histoire de Dexia, au travers de celle de Pierre Richard, son démiurge, est aussi emblématique d'un phénomène caractéristique de ces trente dernières années, phénomène trop évident pour être perçu : la mutation de la crème de la noblesse d'État, pour reprendre l'expression de Pierre Bourdieu, en caste de managers privés, installée à son compte, donneuse d'ordres, de conseils intéressés au pouvoir politique et de leçons de morale au bon peuple et à ses élus mineurs.
Il s'agit, en quelque sorte, de la forme occidentale policée des « oligarques » de l'ex-URSS et de ses satellites, issus eux aussi pour la plupart des cercles du pouvoir soviétique.
X-Ponts, conseiller technique de Valéry Giscard d'Estaing, directeur général des collectivités locales (DGCL) en 1978, directeur général adjoint de la CDC, il a en charge le département des prêts aux collectivités locales avant de devenir président du CLF lors de sa création en 1987, puis son P-DG à sa privatisation. Initiateur de la fusion du CLF avec le CCB, il devient co-président de Dexia SA, président, vice-président, administrateur de divers comités, conseils de la nébuleuse Dexia.
Titulaire des décorations les plus prestigieuses, il fait partie de ces hommes d'influence que l'on retrouve partout où il faut être : média, instituts, festivals culturels, grandes écoles et, bien sûr, conseils d'administration ou de surveillance de banques et grandes entreprises. « Pierre Richard : le banquier de choc qu'on n'attendait pas » titre L'Expansion du 27 avril 2000, sous le charme.
Personnellement, ce que je préfère, c'est son rapport Solidarité et performance. Les enjeux de la maîtrise des finances publiques, paru en 2006. D'une originalité stupéfiante, il en ressort que, si les collectivités locales ne sont pas pour grand-chose dans la croissance accélérée des dépenses publique, elles doivent néanmoins se serrer la ceinture (déjà !) : parce que l'État, au travers de ses concours, finance 37 % de leurs recettes, parce que les dépenses locales, notamment de personnel, augmentent plus vite que le PIB, parce qu'elles investissent en fonction du calendrier électoral.
Conclusion ébouriffante d'originalité, elle aussi : « Le pilotage de la dépense publique locale ne peut reposer que sur le principe de responsabilité. » Ce qui signifie se passer des échelons administratifs inutilement coûteux, contractualiser, clarifier les compétences et les responsabilités, mutualiser, limiter les financements croisés et l'impact des normes, le tout guidé par le principe de performance et de contrôle démocratique.
On aura reconnu quelques bonnes pages de l'actuel dictionnaire des idées reçues sur les collectivités territoriales. Venant de gestionnaires de ce calibre, on oscille entre l'éclat de rire et les larmes.
Pierre Richard, dont le salaire atteint 1,775 million d'euros en 2005, quitte son poste de P-DG à la fin de cette même année, tout en continuant à présider le conseil d'administration de Dexia. Il bénéficie alors, outre de la retraite classique, d'une rente de 583 000 euros par an sur vingt ans (retraite complémentaire dite « chapeau »), qu'il cumule, jusqu'en 2008, avec les 400 000 euros attachés à sa charge de président.
Pierre Richard et Axel Miller, le directeur exécutif, devront démissionner en septembre 2008, à la suite du naufrage de la « belle entreprise financière européenne », qui aura dû être renflouée par les État belges et français. Ils seront remplacés, le premier, par l'ancien ministre belge Jean-Luc Dehaene, et le second, par Pierre Mariani, en tant qu'administrateur délégué. Cet ancien inspecteur des finances passé par BNP Paribas a été le directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, ministre du budget entre 1993 et 1995.
Pierre Richard conserve le bénéfice de sa retraite « chapeau » 114 ( * ) , nécessitant alors un provisionnement de 11,6 millions pour la banque.
« La mise en cause des responsabilités des dirigeants a essentiellement consisté en leur éviction », estimera sobrement la Cour des comptes 115 ( * ) à propos des dirigeants français de Dexia, ajoutant : « Elle s'est accompagnée du maintien contestable d'avantages financiers, notamment en matière de retraites chapeaux [...] En définitive, à la suite du sauvetage public, les mesures sanctionnant la responsabilité du management 116 ( * ) ont été très insuffisantes. Elles n'ont pas été à la hauteur du coût pour les finances publiques des opérations de sauvetage. »
d) La chute finale
La thrombose du marché interbancaire, à la suite de la faillite de Lehman Brothers, fauche de plein fouet Dexia, pourtant apparemment en pleine forme. En six mois, elle perd 80 % de sa valeur boursière.
Le 30 septembre 2008, les États français (3 milliards d'euros), belge (3 milliards d'euros) et luxembourgeois (376 millions d'euros) recapitalisent Dexia pour éviter une faillite risquant d'emporter un système où tout est imbriqué. L'État français se porte en outre garant des emprunts émis par la banque. En contrepartie, la Commission européenne demande la mise en place d'un plan de résolution de Dexia 117 ( * ) .
Les « bijoux de famille » sont progressivement vendus : dès 2008, vente de FSA, puis des filiales italienne, espagnole, slovaque, turque, etc.
En juillet 2010, Dexia passe avec succès les stress tests du Comité européen des contrôleurs bancaires (CEBS en bruxellois), autrement dit, n'a pas besoin d'être recapitalisée pour pouvoir faire face à une nouvelle crise 118 ( * ) . Il est clair pourtant - ce que souhaite d'ailleurs Bruxelles - que la Maison Dexia doit être démembrée. Le lent naufrage continue donc, inexorablement.
En octobre 2010, Dexia Banque Belgique est rachetée par l'État belge pour 4 milliards d'euros. Les trois États renouvellent leur garantie aux emprunts du groupe.
La Commission européenne acceptera de porter le plafond de garantie de 45 milliards à 55 milliards d'euros en juin 2012, puis à 85 milliards d'euros en décembre de la même année, en validant le plan de résolution du groupe après nouvelle recapitalisation de celui-ci. En novembre 2012, en effet, France et Belgique ont dû injecter 5,5 milliards d'euros supplémentaires de fonds propres. Dans la foulée, la banque publie une nouvelle perte de 1,2 milliard d'euros au troisième trimestre.
e) Sur les ruines de Dexia
En 2008, Dexia assurant 40 % des prêts aux collectivités, on aurait pu croire son remplacement urgent. Il faudra pourtant quatre ans pour voir émerger un nouveau dispositif de financement dont la complexité n'a d'égal que la fragilité 119 ( * ) .
Il est constitué de deux pièces :
- une pièce résiduelle, Dexia CL, dont l'État français est actionnaire au travers de la holding Dexia SA, dont il détient 44 % du capital et l'État belge, 51 %. Son rôle est la gestion du bilan résiduel de la banque, notamment cession d'actifs et « désensibilisation » 120 ( * ) des créances pourries ;
- la pièce réellement opérationnelle, la Société de financement local (Sfil), créée en février 2013, qui assure actuellement 20 % des prêts aux collectivités. C'est une banque totalement publique dont le capital est détenu à 75 % par l'État, à 20 % par la CDC et à 5 % par la Banque postale.
Le hic, c'est que la Sfil a racheté, pour exercer le même rôle qu'avec Dexia CL, Dexia municipal agency (DMA). Or cette filiale de Dexia CL, autrefois chargée du refinancement des prêts aux collectivités, est bourrée d'actifs toxiques. Avec DMA, rebaptisée Caisse française de financement local (Caffil), la Sfil a acquis un savoir-faire, mais aussi les cadavres de ses placards.
Au final, outre la « désensibilisation » des actifs douteux, la Sfil refinance, via la Caffil, les prêts à moyen et long terme, que la Banque postale propose, en partenariat avec la CDC, aux collectivités territoriales et aux établissements publics de santé. On admirera la simplicité du montage.
Les volumes de financement envisagés sont de l'ordre de 5 milliards d'euros par an.
2. Un héritage toxique
a) Qu'est-ce qu'un prêt toxique ?
Les prêts « toxiques » sont une variété de « dérivés de crédit structurés », à savoir en l'espèce des prêts dont le taux varie non plus en fonction d'un indice général (Libor, Euribor, etc.), comme dans les prêts à taux variables classiques, mais selon des périodes en fonction d'indices complexes et opaques, appelés aussi « exotiques » 121 ( * ) ; des prêts dont l'annuité sera maintenue constante, à la demande du client, en différant plus ou moins l'amortissement en contrepartie d'une prime.
Les prêts dits « toxiques » en rajoutent sur la sophistication et l'opacité des formules d'évolution des taux. Leur caractéristique est que des taux initiaux alléchants masquent leurs risques d'évolution et le niveau de rémunération du banquier. Surtout, ces contrats inversent la responsabilité du risque.
Le principe des prêts « toxiques », en effet, c'est le transfert du coût du risque sur l'emprunteur. Ce n'est plus le prêteur qui garantit un taux à l'emprunteur mais l'emprunteur qui garantit une rentabilité au prêteur.
La bonification de taux d'intérêts consentie, en début de remboursement et aussi longtemps que les conditions de validité de cette garantie (vérifiées périodiquement), ne changeront pas, a pour contrepartie la prise en charge par l'emprunteur des risques inhérents à ce type de financement. Plus les taux court terme et les taux de change sont volatils, plus les gains, mais aussi les risques, peuvent être grands. Plus la durée du prêt est longue, plus l'espoir de gain, mais aussi le risque, est fort.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un troisième larron vient interférer dans la relation entre le client et le banquier (Dexia) : la banque de couverture avec laquelle le prêteur a passé un accord de garantie ( swap ou contrat d'échange de taux d'intérêt).
En l'espèce, la banque Dexia (D) qui prête à la collectivité C à un taux inférieur au cours du marché au moment de la conclusion du prêt, demande à une autre banque, Goldman Sachs par exemple (GS) 122 ( * ) , de lui verser la différence de taux entre le taux payé par C et un taux de référence contractuel. D transfère sur GS le coût de la bonification de son prêt. La contrepartie est double pour GS : le paiement par D d'une prime durant la durée du contrat et l'encaissement du différentiel de taux en cas de franchissement de la « barrière », de l'indice de référence. Quand les taux s'envolent pour C, ce qui est généralement le cas, c'est GS qui récupère la mise et non D.
En fait, le swap entre D et GS reprend, à l'envers, les clauses du prêt de D à C.
Sa gestion impose aux partenaires de procéder régulièrement à des « appels de marge », c'est-à-dire des virements d'une sorte de caution liquide ( cash collatéral) garante des gains de l'un ou de l'autre en fonction des variations des indices de référence.
Ainsi, pour un prêt dont le taux varie à partir du franchissement d'un niveau de change euro-franc suisse par exemple, tant que la barre n'est pas franchie, c'est GS qui est appelé, compensant ainsi à D le coût de la bonification consentie à C. À l'inverse quand la barre est franchie, c'est GS qui bénéficie de l'augmentation de taux payée par C.
Cela explique la difficulté à renégocier les prêts. En l'espèce, renégocier les conditions du prêt avec C ne dispense pas D de verser à GS ce qu'il lui doit. D'où les soultes énormes demandées par D à C pour accepter la résiliation des emprunts, pénalités d'autant plus fortes que la durée du prêt est longue.
Quand tout fonctionne normalement suffisamment longtemps, les échanges entre D et GS, les gains et les pertes théoriquement s'équilibrent. La rémunération finale de GS correspond à ce que lui verse D en contrepartie du swap . In fine , ce que C paiera à D intègre le coût du swap , la marge de D et le coût de la ressource au prix du marché. Mais comme on finira peut-être par l'admettre, les marchés ont quelque peine à vérifier les modèles mathématiques censés en donner l'image et il peut arriver que le débiteur soit défaillant !
b) « Y'a pas le feu au lac »
Créés dans les années 1990, les produits financiers « exotiques » vont voir leur marché exploser, en toute liberté.
À la fin de 2011, l'enquête parlementaire relative aux prêts toxiques 123 ( * ) en recensera plus de 10 688 pour quelque 32 milliards d'euros d'encours contractés par les seuls collectivités territoriales et organismes publics. L'encours des produits « très risqués » en représente quelque 16 milliards d'euros, la moitié.
L'encours des « prêts sensibles » détenus par la seule Sfil, après l'acquisition de DMA, représente 8,2 milliards d'euros, dont 4 milliards d'euros « très sensibles » 124 ( * ) . Le montant des indemnités que pourraient demander les banques de couverture pour abandonner leurs créances est estimé globalement à 5,4 milliards d'euros et à 4,2 milliards d'euros pour les seuls prêts sensibles 125 ( * ) .
Depuis 2005, les spécialistes savent que les prêts miraculeux distribués par Dexia et ses concurrents (Caisse d'épargne, Crédit Agricole, Société Générale, banques étrangères) sont des « bombes à retardement », pour reprendre le titre de l'article de Michel Klopfer d'avril 2007 126 ( * ) . L'état des lieux qui suivra le sauvetage de Dexia par les États français, belges et luxembourgeois en 2008, les premiers audits de collectivités montrent qu'il y a de quoi s'inquiéter.
Mais tel n'est pas l'avis de l'État désormais actionnaire principal de Dexia. Espérant que le problème se résoudra progressivement de lui-même, il n'entend pas s'immiscer dans « une affaire qui relève exclusivement des collectivités » , pour reprendre l'expression du secrétaire d'État aux collectivités de l'époque. Sa seule initiative sera de charger en 2009 un « médiateur », Éric Gissler, de l'élaboration d'une Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales. Il faudra attendre les premières conclusions judiciaires des conflits en cours pour que l'État commence à bouger ; et encore, à pas comptés.
Parallèlement à l'affaire des prêts toxiques, la « résolution ordonnée » de Dexia, dont Bruxelles impose le démantèlement, et la mise en place d'un système de financement des collectivités de substitution se poursuivent. Mais curieusement, comme on l'a dit, loin de mettre le nouveau dispositif de financement des collectivités à l'abri de la contamination des actifs pourris de Dexia, ses concepteurs ne trouvent rien de mieux que de les loger dans son coeur, la Sfil et sa filiale, la Caffil !
Devant l'inertie de l'État, le refus des banques de renégocier à des conditions acceptables, les élus locaux organisent la riposte judiciaire... avec succès, d'où une accélération de l'histoire. L'État inscrit alors une ligne budgétaire d'aide de 50 millions d'euros en loi de finances rectificative pour 2012. Elle sera portée l'année suivante en loi de finances pour 2014 à 100 millions d'euros par an sur quinze ans 127 ( * ) , en réaction au jugement du tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre, en date du 8 février 2013, qui condamne Dexia pour défaut de mention du taux effectif global (TEG) dans le fax de confirmation des prêts consentis. Il substitue, en outre, le taux légal en vigueur (0,04 %) au taux contractuel !
Aux termes du projet de loi de finances pour 2014, non seulement le bénéfice de l'aide financière de l'État aux collectivités est subordonné au renoncement à poursuivre les prêteurs devant les tribunaux, mais sont validés rétroactivement les contrats contestés pour défaut de mention du TEG 128 ( * ) .
L'affaire paraissait réglée.
N'était le TGI de Nanterre qui récidive, le 7 mars 2014, en sanctionnant l'absence des éléments permettant de calculer le TEG : taux et durées de période. Le taux légal est encore une fois substitué au taux contractuel.
N'était le Conseil constitutionnel qui, tout en validant la création du fonds d'aide, censure la validation rétroactive des contrats la jugeant trop générale 129 ( * ) .
c) « Y'a le feu au lac »
Cette fois, « il y a le feu au lac ». Un nouveau projet de loi est donc déposé et adopté en première lecture au Sénat par 138 voix pour, 48 contre et 156 abstentions le 13 mai 2014.
Son titre rassurant - « projet de loi de sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public » - cache une vulgaire « loi d'amnistie des organismes de crédits condamnés pour infraction au code de la consommation », code qui subordonne la validité des contrats de prêts à la fourniture des informations permettant d'en connaître le taux réel, autrement dit, ce qui devra finalement être remboursé.
Encore une fois, l'État a capitulé devant un système financier dont il est devenu lui-même partie prenante, préférant dissuader les collectivités de demander justice en contrepartie d'une aide financière (la carotte) et en les privant de leur principale arme juridique, les dispositions du code de la consommation (le bâton). Contrairement à d'autres pays 130 ( * ) , la France fait le dos rond et modifie la réglementation avec effet rétroactif comme un vulgaire État offshore plutôt que d'utiliser l'arme du droit et les moyens de pression dont dispose un État qui entend bien renégocier.
Même les banques de contrepartie ne sont pas intouchables. Ainsi, la ville de Saint-Étienne a-t-elle obtenu gain de cause devant le TGI de Paris, contre Royal Bank of Scotland, qui lui demandait le versement des intérêts de deux swaps contestés. Motif : un contrat n'est valide qu'autant qu'il est licite, ce qui pour la Cour n'était pas le cas. S'il s'agit d'un jugement non pas au fond mais en référé, cette jurisprudence montre que le combat n'est perdu qu'après qu'il a été livré, pas avant.
En tous cas, si le but était de « désensibiliser » les prêts toxiques par la renégociation, ce n'était pas en désarmant l'une des parties que l'on pouvait espérer y parvenir.
QUATRIÈME PARTIE : UNE CRISE QUI N'EN FINIT PAS DE FINIR
Au terme d'une petite dizaine d'années de crises, après onze G20, des interventions financières massives des États et des banques centrales, de multiples réformes du système financier, on s'interroge toujours sur le niveau de probabilité d'une nouvelle crise financière systémique, étant entendu que personne, même les responsables financiers, optimistes par fonction, ne se risque à assurer qu'il est nul.
Toute crise systémique étant le produit, à des doses variables, d'un système financier dangereux et d'interventions publiques inadaptées dont les effets viennent aggraver un contexte économique et sociopolitique déprimé, avant de tenter une réponse de conclusion et afin de l'étayer, on tentera d'abord d'évaluer l'évolution de la dangerosité du système financier au terme de ces dix années de réformes avant d'envisager le contexte économique, social et politique dans lequel il se déploie.
I. LA MACHINE À CRISES FINANCIÈRES EST TOUJOURS LÀ
Deux éléments de diagnostic :
«
La finance mondiale est devenue une
énorme centrale nucléaire bâtie en dehors de toutes normes
de sécurité. Pour au moins trois raisons : l'interconnexion
des opérations, la masse des capitaux,
la dangerosité du
combustible.
»
Jean-Michel Naulot
131
(
*
)
.
«
Les gouvernements ont démissionné
face aux marchés financiers.
»
Jacques de
Larosière
132
(
*
)
.
Pourtant, le G20 de Cannes en 2011 avait annoncé 133 ( * ) , s'agissant des établissements financiers d'importance systémique mondiale, de sérieuses réformes : « Ces établissements seront soumis à une supervision renforcée, à une nouvelle norme internationale pour les régimes de résolution et, à partir de 2016, à des ratios de fonds propres plus élevés. Nous ne tolérerons pas un retour des comportements observés dans le secteur financier avant la crise, et nous contrôlerons étroitement la mise en oeuvre de nos engagements concernant les banques, les marchés dérivés de gré à gré et les pratiques de rémunération. »
Autre souci du G20 alors, faire « face aux risques posés par les transactions à haute fréquence et la liquidité opaque » 134 ( * ) , domaines dans lesquels, compte tenu du coût des équipements techniques et des qualités exigées des traders , de leur opacité, excellent les très grands établissements.
Malgré ces déclarations martiales, la machine à crises financières est toujours là. Tout simplement parce que penser supprimer les inconvénients du système financier en le conservant est aussi vain que d'espérer supprimer la face cachée de la lune.
La liquidité est toujours plus abondante, la spéculation aussi active et le système toujours aussi fragile, voire plus. Force est même de constater que le remède administré au malade a entretenu, sinon aggravé, la maladie.
A. LES FACTEURS DE CRISES FINANCIÈRES
1. Les crises : quelques rappels
• Le carburant des crises, c'est l'abondance de liquidités (de capitaux) qui stimule la spéculation, donc les prises de risques et donc la mise en circulation de créances douteuses. Dans un premier temps, dopée par la montée des prix (des valeurs immobilières, des actions, des obligations, des titres, des garanties, etc.), tout va bien. Puis le doute s'installe et l'édifice s'écroule. Les spéculateurs à crédit ne peuvent rembourser leurs emprunts, les banques récupérer leurs mises, leurs créances étant devenus non vendables. La suite, on la connaît.
• La possibilité pour les banques de mobiliser les dépôts qui leur sont confiés pour spéculer à crédit est un puissant facteur de risque.
• Moins les banques sont résilientes , plus les risques de crise sont grands. La résilience des banques dépend d'abord de l'importance du ratio entre leurs fonds propres et leur niveau d'endettement (emprunts pour équilibrer leur passif), de la volatilité de ce passif (emprunts à plus ou moins long terme), de l'importance et surtout de la qualité de leurs actifs . Ce qui signifie que, plus ceux-ci rapportent, plus il y a de chances qu'ils soient risqués.
• Le but de la régulation est prioritairement d'édicter des normes prudentielles et de contrôler leur mise en oeuvre, de contrôler la qualité des produits financiers mis en circulation, d'organiser le renflouement des établissements en difficulté ou leur « résolution ».
2. Les crises systémiques
Jusqu'à 2008, toutes les crises financières sont restées limitées à un secteur d'activité et un secteur géographique limités.
La crise de 2008, comme celle de 1929, est une crise financière systémique en ce qu'elle est mondiale et touche l'ensemble du système financier (banques, marchés, assurances, etc.). Cette contamination de l'ensemble du système a été rendue possible par l'élargissement du champ d'intervention ( mondialisation, banques universelles ) des établissements bancaires, leurs interconnexions multiples , l'enchevêtrement des garanties et contre-garanties qu'elles s'accordent entre elles, ce qui fait que quand l'une est touchée, les autres le sont aussi, du fait de la dématérialisation complète des échanges qui ont crû de manière exponentielle et de l'opacité en résultant. Le moindre soupçon de défiance peut avoir des effets catastrophiques.
Du système financier, la coagulation de la circulation monétaire se propage alors à l'économie tout entière.
B. LA LIQUIDITÉ
1. Des sources anciennes de liquidité toujours aussi abondantes
a) Un commerce mondial toujours aussi déséquilibré
Les déficits et excédents extérieurs en 2015 sont les suivants :
- États-Unis : - 505 milliards de dollars (+6 % par rapport à 2013) ;
- Chine : + 562 milliards de dollars (en hausse du fait d'une baisse de 13 % des importations) ;
- Allemagne : + 248 milliards d'euros (dont 105 milliards d'euros avec les États-Unis, soit + 20 %).
Les États-Unis bénéficient toujours des avantages procurés par le « roi dollar » et la zone euro pâtit toujours d'une monnaie unique sous-évaluée pour l'Allemagne mais surévaluée pour les autres pays et sans mécanisme de péréquation significative ni de recyclage des excédents allemands.
b) Un endettement public en augmentation, un endettement privé en lente diminution dans la plupart des pays développés mais en forte croissance en Chine
Partout, depuis le début de la crise, à l'exception de l'Allemagne, l'endettement public aura augmenté.
Recordman, le Japon, qui consolide sa place après une phase de restriction, a repris sa politique expansive sous Shinzo Abe : 234 % du PIB en 2014, avec une prévision de 258 % en 2019.
En 2017, la France devrait aussi passer de 104 % à 119 % alors que l'endettement baisserait encore en Allemagne, revenant de 80 % à 68 %
Quand Barack Obama arrive aux affaires en 2007, le montant de la dette publique est de 9 000 milliards de dollars ; il dépasse aujourd'hui 19 000 milliards de dollars, avec une autorisation de découvert à 20 000 milliards de dollars pour 2017. La dette publique fédérale sera passée de 64,4 % du PIB en 2007 à 103 % en 2016
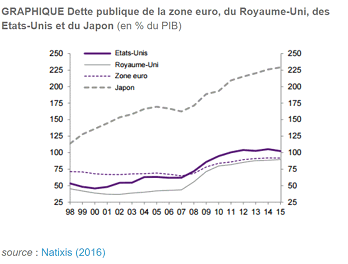
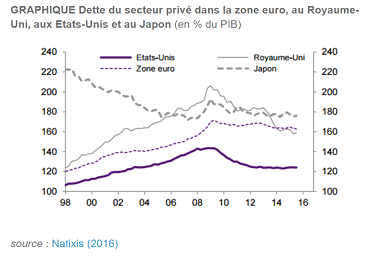
• Dette privée :
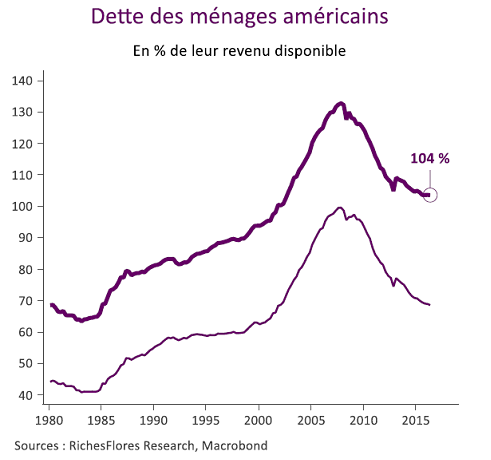
|
Dette du secteur privé (zone euro, en % du PIB) - Eurostat |
||||||
|
France |
Irlande |
Grèce |
Pays-Bas |
Royaume-Uni |
Allemagne |
|
|
2008 |
122 |
240 |
112 |
214 |
186 |
109 |
|
2014 |
143 |
260 |
138 |
229 |
158 |
100 |
Au sein des pays émergents, entre 2007 et 2014, la dette privée a grossi de 57 000 milliards de dollars, pour atteindre 200 000 milliards de dollars, soit 286 % du PIB mondial, contre 269 % en 2007. La Chine représente une part importante de cet endettement (quadruplement). Selon McKinsey, si l'endettement privé a diminué dans un certain nombre de pays où il était élevé (États-Unis, Royaume-Uni, Espagne), il a augmenté dans d'autres.
En 2010, l'endettement privé total aux États-Unis (y compris le secteur financier) représentait 257 % du PIB, soit 37 928 milliards de dollars, ainsi décomposé :
- dette hypothécaires des ménages : 68,2 %, soit 10 101 milliards de dollars ;
- crédit à la consommation : 16,4 %, soit 2 425 milliards de dollars ;
- entreprises : 74,2 %, soit 10 957 milliards de dollars ;
- secteur financier : 97,9 %, soit 14 445 milliards de dollars ; les prêts étudiants ne semblent pas comptabilisés.
Il faut préciser qu'une part du désendettement des ménages étasuniens est due non pas au remboursement de leurs dettes, ce dont ils étaient bien incapables, mais à l'annulation de celles-ci au titre de la loi sur les faillites personnelles, spécificité américaine.
L'endettement total de la Chine (282 % du PIB, dont 125 % pour les entreprises) est difficile à évaluer réellement compte tenu de l'importance du shadow banking, qui alimente la spéculation immobilière et l'endettement des collectivités locales. Leur endettement aurait triplé en sept ans, pour atteindre 1 700 milliards de dollars.
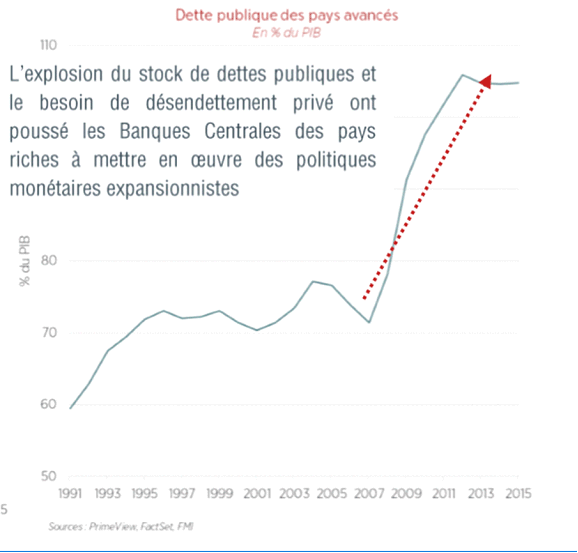
Source : PrimeView Facset, FMI
• L'explosion de la dette publique à partir de 2008 dans les pays avancés
S'agissant de l'Europe, les banques ont souscrit largement à ces émissions de dettes, avec le double inconvénient de raréfier d'autant le financement de l'activité économique et de fragiliser les établissements des pays prêteurs en principe les plus solides 135 ( * ) .
2. Les nouveaux geysers de liquidités : quantitative easing et taux d'intérêt bas
À ces sources traditionnelles de liquidité vont s'ajouter celles qui sont engendrées par les remèdes utilisés pour soigner la crise, sous deux formes : des taux d'intérêts bas, qui stimuleront l'endettement, et l'injection de liquidités par les banques centrales, notamment sous la forme du quantitative easing , lequel s'analyse comme le rachat par les banques centrales de créances (obligations, hypothèques...), dans le but, qui en Europe en tous cas n'a pas été atteint, d'inciter les banques commerciales à prêter à l'économie, donc de la stimuler. Où l'on retrouve la question de la politique de l'offre en l'absence de demande. En réalité, tout particulièrement aux États-Unis, c'est la spéculation qui a été suscitée, comme on va le voir.
Cette injection massive de liquidités depuis 2008 se traduit par une forte croissance des bilans des banques centrales (Fed et BCE) et par une modification structurelle de ceux-ci.
Ainsi le bilan de la BCE s'est-il gonflé de titres dont une partie liée à la politique monétaire et de créances sur les établissements de crédit (rachat de créances des banques commerciales), alors que, dans le bilan de la Fed, ce qui domine, ce sont les titres adossés à des hypothèques (assainissement du marché immobilier) et des titres du trésor (endettement de l'État).
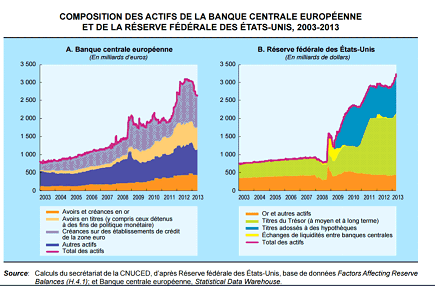
a) Le quantitative easing
Stimuler l'économie par l'injection de liquidités est une pratique ancienne des gouvernements étasuniens, que la crise va porter à des sommets inégalés. Relancés dès l'automne 2008, les plans vont se succéder - TARP de Bush, puis ARRA d'Obama -, suivis de politiques de quantitative easing (QE), auxquelles Royaume-Uni et Japon emboîteront rapidement le pas. La Chine, dès le contrecoup de la crise, fera encore mieux.
La BCE, tout à sa lutte contre une inflation inexistante, se contentera d'abord d'assouplir ses conditions de rachat des créances des banques commerciales avant de se lancer, avec Mario Draghi (2015), dans une politique de QE décomplexée.
Entre 2000 et 2014, avec une nette accélération durant la crise, le volume de liquidités mondiales ne cesse d'augmenter. S'il se stabilise à partir de 2014 et jusqu'à ce jour, avec l'arrêt des injections massives de la Fed, l'équilibre semble instable, la BCE continuant, elle, sur sa lancée.
Entre 2000 et 2008, le bilan global des banques centrales au niveau mondial avait déjà augmenté de 10 000 milliards de dollars, essentiellement du fait de l'acquisition d'actifs étrangers par les banques centrales des pays émergents excédentaires, afin d'évider une trop forte appréciation de leurs monnaies (42 % pour la Chine avec Hong Kong et Taïwan).
À partir de 2008 et jusqu'à aujourd'hui, l'augmentation des bilans est essentiellement due aux banques centrales des pays développés, les banques centrales des pays émergents liquidant progressivement leurs devises pour financer l'endettement public produit par la crise à moindre coût. Une augmentation de 10 400 milliards de dollars entre 2008 et 2014, dont les trois quarts dus à la Fed, la BCE et la Banque du Japon. Pour la BCE, il s'est d'abord agi d'enrayer la spéculation sur les dettes souveraines susceptibles de mettre à mal la zone euro : en septembre 2016, le seuil de 1 000 milliards d'euros de titres détenus par la BCE, soit près de 15 % de la dette européenne, sera franchi.
Puis, comme pour les autres pays, il s'agira de fournir de la liquidité, de faire baisser les taux dans l'espoir de susciter la demande intérieure et l'activité économique, de stimuler l'inflation, ce qui, venant de la BCE, ne manque pas de sel. Outre la stimulation de l'économie et la relance de l'inflation, pour le Japon, il s'agira aussi de se passer le plus possible de financements extérieurs.
b) Des taux d'intérêt historiquement bas
C'est le second pilier de cette politique de relance par la facilitation de l'endettement. À noter, pour la première fois dans l'Histoire, des taux d'intérêt négatifs (obligations allemandes, par exemple). Il y a tellement de liquidités en circulation que, ne pouvant la mettre dans un coffre-fort, on paie pour les mettre à l'abri !
Là encore, on note une différence de tempo dans les réactions de la Fed et de la BCE, parfois, comme en 2009 et 2011, à contretemps.
Taux directeurs Fed et BCE
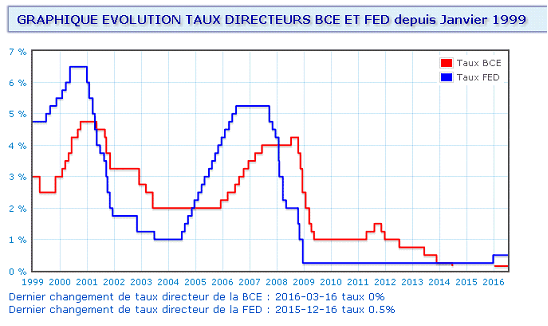
C. LA MÉDECINE DU DIABLE
À l'usage, le traitement de la crise se révélera aussi dangereux que la crise elle-même. L'abondance de liquidités va doper la spéculation, augmentant le risque de crise, les taux bas, paradoxalement stimuler les cours des obligations en perturbant la fonction d'intermédiation des banques ainsi que l'assurance vie.
1. Bulle en formation sur les actions des entreprises étasuniennes
Le 12 août 2016, au terme d'un mouvement haussier régulier, les trois principaux indices boursiers de la bourse de New York - Dow Jones, S&P 500, Nasdaq - battent des records, retrouvant leurs niveaux du 30 décembre 1999, veille de ce qui allait devenir le krach du Nasdaq. À ce jour, les indices sont toujours à un très haut niveau.
Cela signifie que, en un peu plus de sept ans, la valeur des trente plus grosses entreprises américaines aura été globalement multipliée par 2,8. Et ce malgré un endettement atteignant 70 % du PIB et qui risque de peser lourdement en cas de retournement de la conjoncture. La valeur de leur rachat atteint aujourd'hui deux fois leur chiffre d'affaires, ce qui est exceptionnel et rejoint la situation de l'année 2000.
Comme dans les années 2000, au cours desquelles les nouvelles technologies laissaient entrevoir une économie si nouvelle que le prix de leurs actions pouvait monter infiniment, l'idée se répand de nouveau qu'on est entré dans une période miraculeuse de taux réels tangentant 0, voire de taux négatifs, d'argent issu d'une génération spontanée, et de valorisation boursière continue des actions des entreprises. Il n'y aurait pas de raison à ce que le phénomène s'arrête. Ce d'autant plus que les bénéfices réels des entreprises sont en hausse et que les créances douteuses, pense-t-on, seront emportées par le mouvement ou rachetées par la Fed. Autant de facteurs qui poussent à prendre des risques. À ce niveau de taux d'intérêt, aucun autre investissement n'est plus performant. D'où la migration de l'essentiel des fonds spéculatifs vers New York.
Tirées par Wall Street dont les indices ne cessent de grimper, les autres bourses dans le monde, avec des hauts et des bas et parfois des sous-performances pour des causes locales, suivent le mouvement.
2. Apparition du risque de taux
En même temps que cette bulle sur les actions des sociétés étasuniennes, une autre bulle mondiale est en formation, celle des obligations souveraines et des entreprises. L'Europe, où les obligations des États allemands et français sont l'objet d'un fort engouement malgré la faiblesse de leur taux (certains négatifs), n'est pas en reste.
Paradoxalement, la crise pourrait venir d'une hausse des taux qui ne resteront pas éternellement aussi bas . Le mécanisme est le suivant : quand les taux en général baissent, la valeur des obligations à la revente augmente parce que leur taux reste constant jusqu'à échéance et que la possibilité d'emprunter moins cher dope les nouvelles acquisitions, donc la valeur d'échange de l'obligation. En revanche, en cas de hausse des taux, les obligations anciennes deviennent moins rentables, la spéculation à crédit sur les acquisitions nouvelles plus onéreuses et leur cours baisse. En effet, une obligation valant au départ 100 euros et procurant un intérêt de 1 euro équivaut à un titre valant 91,82 euros rapportant 10 %. Plus les taux sont bas, plus l'effet des hausses d'intérêt est ravageur. Ainsi, selon Christophe Nijdam, une augmentation de 1 % du taux pour une obligation à taux 0 d'une durée de trente ans, occasionne une perte double de celle qu'entraîne une hausse de taux de 5 % à 6 % sur la même durée de trente ans. « Avec de telles obligations, une banque risque de perdre deux fois plus que dans des scénarios antérieurs. Cela va toucher les fonds propres, et créer une crise de liquidité. Tout le monde essaie de vendre au même moment, ce qui crée le risque. » 136 ( * )
En outre « Aujourd'hui, à peu près 80 % du volume des produits dérivés sont des produits dérivés de taux. Une hausse des taux aura non seulement un impact sur le marché obligataire mais aura aussi un impact plus important sur le marché des dérivés, une hausse des taux va créer des chocs importants.
« Quant aux États-Unis, la patronne de la Fed a augmenté d'un quart de pourcent les taux, cela a augmenté la volatilité. Une hausse des taux a un impact négatif sur le capital très fort. La volatilité correspond à la variabilité de la valeur ; quand on est dans un environnement de taux proche de zéro, cette variabilité est mécaniquement beaucoup plus forte que quand on a des taux plus élevés. C'est mécanique et cela a des conséquences sur les obligations mais aussi sur les bourses. »
D'où la crainte d'une augmentation brusque des taux d'intérêts. « Si la bulle obligataire éclatait après avoir duré des années, ce serait cataclysmique » prédit Patrick Artus. 137 ( * )
Pareil éclatement pourrait survenir à tout moment, d'une panique sans cause apparente ou, plus sûrement, d'un relèvement des taux de la BCE. Un effondrement de la valeur des obligations s'ensuivrait, alors même que le coût de l'emprunt à taux variable qui avait servi à les acquérir augmenterait.
L'éclatement d'une de ces deux bulles puis nécessairement celui de l'autre prendrait alors des allures de krach systémique encore plus violent que celui de 2007-2008, dont le monde ne s'est pas encore remis, au moment où les moyens d'intervention des gouvernements et des banques centrales ont atteint leurs limites et que la crise économique, toujours en attente de règlement, se transforme lentement en crise sociale et politique.
D'où la situation cornélienne dans laquelle se trouvent les banques centrales : continuer cette politique de taux bas et de QE, c'est alimenter la spéculation et donc augmenter le risque de krach ; l'arrêter, c'est prendre le risque non seulement de ralentir l'activité économique 138 ( * ) mais aussi de déclencher un effondrement des marchés des actions et des obligations aux conséquences imprévisibles. Sauf à croire que les règles de la physique financière ont changé, viendra bien un moment où les taux d'intérêt cesseront de baisser et la valeur des titres de monter. Ce sera l'heure de vérité !
3. La fonction d'intermédiation de l'institution bancaire menacée
La situation est d'autant plus cornélienne que la permanence de taux d'intérêt bas porte atteinte au fonctionnement régulier de l'institution bancaire, du système d'assurance vie, des fonds de retraite et des fonds d'investissement non spéculatifs en général. D'où les mises en garde du FMI et de la BCE dans leurs derniers rapports sur la stabilité financière mondiale 139 ( * ) .
La fonction traditionnelle d'intermédiation des banques - emprunter à court terme et prêter à moyen ou long terme et se rémunérer sur la différence de taux - se trouve ainsi remise en question, avec la tentation pour les banques de consentir des prêts plus risqués et d'arrondir les bénéfices par des aventures spéculatives, celle aussi d'augmenter les coûts des « services » à la clientèle, avec le risque de la voir se tourner vers des substituts bancaires, certes plus accueillant mais encore moins sûrs.
Ainsi, après avoir classé le faible niveau des taux d'intérêt parmi les facteurs d'évolution positifs - probablement du point de vue économique -, le FMI comme la BCE, à l'origine de cette politique pour l'Europe, préfèrent évoquer « la faiblesse des bénéfices dans le secteur financier » et en soulignent les dangers : des taux d'acquisition sur le marché très bas ne permettent plus des différentiels de taux des prêts à la clientèle, et donc des bénéfices aussi grands que lorsqu'ils sont hauts.
4. Menaces sur l'assurance vie
Autres institutions financières menacées, les compagnies d'assurance vie, souvent liées à des banques et particulièrement importantes en Europe, en France notamment, où elles jouent un rôle majeur dans le domaine des retraites.
Le FMI souligne : « Les tests de résistance réalisés par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles font apparaître que 24 % des assureurs risquent de ne pas pouvoir tenir leurs exigences de solvabilité dans un scénario de persistance des faibles taux d'intérêt. Le secteur compte un portefeuille de 4 400 milliards d'euros d'actifs dans l'Union européenne et présente une interconnexion forte et croissante avec le système financier dans son ensemble, d'où un risque de contagion. » 140 ( * )
De son côté, dans son rapport couvrant la période du 1 er avril 2014 au 31 mars 2015, la Banque des règlements internationaux (BRI) note : « Parallèlement, le profil de risque des actifs des compagnies d'assurance s'est dégradé au cours des dernières années, quoique à partir d'un profil de référence prudent. Pressées par la réglementation et leurs mandats institutionnels de détenir essentiellement des titres de la catégorie investissement, les compagnies d'assurance ont vu la composition de leurs actifs se modifier, les titres les mieux notés cédant du terrain face aux titres les moins bien notés dans cette catégorie. » 141 ( * )
D'où une nouvelle double contrainte ( double bind ), la contradiction dans laquelle se trouvent les banquiers centraux : rehausser nettement leur taux directeur, comme le Trésor étasunien en a la tentation (sans le faire vraiment jusque-là), c'est risquer de compromettre la faible croissance économique obtenue à grand peine ; ne pas le faire, c'est placer le système bancaire et assuranciel devant de grandes difficultés.
Et, encore une fois, la simple perspective de modification du niveau du taux directeur risque d'engendrer des emballements incontrôlables des marchés financiers !
5. La fuite en avant dans la prise de risque
Autre paradoxe, parmi les recommandations du FMI pour éviter une crise de l'assurance vie, celle d'augmenter leurs portefeuilles aux actions (de l'ordre de 8 % seulement aujourd'hui en France), plus rémunératrices mais aussi plus risquées. Déjà, on l'a dit, la BRI, dans son rapport de 2015, note que la qualité des actifs des compagnies d'assurance est en baisse.
En baisse aussi la qualité des placements des fonds de pension étasuniens qui, pour obtenir un meilleur rendement, remplacent leurs placements classiques par des placements alternatifs - immobilier, fonds spéculatifs, capital investissement et matières premières. Selon la BRI, « la part de ces placements dans les portefeuilles d'actifs des fonds de pension [est passée] de 5 % en 2001 à 15 % en 2007 puis à 25 % en 2014 . » 142 ( * )
Comme si rien ne s'était passé, l'éloge de la prise de risque fait retour dans les médias sous la plume d'experts et d'universitaires.
Premier exemple retentissant des résultats potentiels de cette politique de prises de risques : l'effondrement du plus gros fonds de pension public du monde, le japonais Government Pension Investment Fund (GPIF). Ce gestionnaire de l'épargne retraite des salariés japonais a perdu plus de 5 000 milliards de yens (près de 45 milliards d'euros) sur l'exercice 2015-2016 143 ( * ) .
Comme l'expliquent Les Échos : « Habitué à miser essentiellement sur des placements peu risqués - à hauteur de 70 % de son portefeuille -, il s'est lancé sur des produits plus rémunérateurs afin de s'adapter au vieillissement accéléré de la population japonaise, qui ne peut plus se satisfaire des rendements faibles des obligations. » 144 ( * )
Le portefeuille des obligations japonaises a été réduit de moitié, remplacé par des actions (internationales ou japonaises) et des obligations étrangères (notamment des emprunts spéculatifs étasuniens, européens ou de pays émergents). Le ralentissement économique chinois, la stagnation et la baisse du yen japonais ainsi que la baisse du rendement des obligations européennes et étasuniennes ont fait le reste.
Belle illustration de cette caractéristique essentielle du système financier globalisé : à peine un facteur de déstabilisation est-il endigué qu'il réapparaît sous une autre forme ailleurs. À peine une solution à un problème est-elle évoquée qu'elle en crée un autre, encore plus redoutable.
Ainsi la rémunération des dépôts à court terme des banques à la BCE, non seulement ne leur rapportant plus rien mais leur coûtant du fait des taux d'intérêts négatif, se trouvent-elles encombrées desdits dépôts à vue. De là à faire payer les « comptes courants » des déposants, le pas a été franchi seulement par quelques banques étrangères pour les dépôts des grandes entreprises (taux négatifs).
Mesure qui, si elle se généralisait, pourrait entraîner une fuite des clients potentiellement dangereuse pour la banque et les déposants eux-mêmes.
• Première conclusion : les moyens de lutte contre la crise utilisés jusque-là ne semblent pas avoir fait reculer les risques de déstabilisation du système, au contraire ; simplement en avoir créé d'autres tout aussi pernicieux.
• Seconde conclusion : le premier facteur de déstabilisation du système financier est la conséquence du traitement utilisé contre la crise : l'abondance de liquidités et la politique des taux bas, d'un côté, stimulant la spéculation ainsi que les profits, de l'autre, pénalisant l'activité bancaire traditionnelle ; poussant dans tous les cas à la prise de risque.
Comme l'observe Jean-Michel Naulot : « Dès lors que les possibilités de rendements se raréfient, on cherche à placer les liquidités là où elles subsistent, c'est-à-dire, généralement, dans des activités à risque. Comme le disait un de mes amis de conviction libérale, quand l'argent ne coûte rien, on ne peut faire que des bêtises. » 145 ( * )
Doit-on pour autant faire porter le chapeau de la situation actuelle aux seuls États et banques centrales, comme le laisse à penser cette observation de Gérard Rameix 146 ( * ) , par ailleurs tout à fait exacte : « Les banquiers centraux et les États ont fait deux choses : ils ont imposé aux banques une discipline beaucoup plus forte, qui a conduit les banques françaises à réduire leurs positions spéculatives, ils ont baissé les taux pour faire repartir le système. Donc, d'un côté, ils sécurisent et de l'autre, ils prennent des risques pour des raisons macroéconomiques. »
Ce serait dédouaner un peu vite les banques de leur choix de privilégier l'activité spéculative au financement - certes moins rentable - de l'économie.
D. UN OLIGOPOLE BANCAIRE TOUJOURS « TROP GROS POUR FAIRE FAILLITE » ET TOUJOURS AUSSI PEU RASSURANT
«
Les banques qui sont trop importantes pour faire
faillite
sont trop importantes pour exister.
»
Mervyn
King,
ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre.
«
On est loin d'être dans un monde
libéral au sens littéral du terme,
le secteur bancaire
européen est au contraire assis
sur une formidable rente qu'il
cherche à préserver. »
Jézabel
Couppey-Soubeyran,
maître de conférences en sciences
économiques
à l'université Paris I.
Sans l'interconnexion planétaire des grandes banques, la carambouille immobilière étasunienne, au départ relativement localisée, ne serait pas devenue le krach général et mondial que l'on sait. Dix ans après, constatons que, si, globalement, la profitabilité des grandes banques systémiques n'a pas faibli, la stabilité de quelques-unes est problématique et que la plupart, malgré des progrès, reste encore sous-capitalisée. Quant aux interconnexions entre elles, elles sont toujours aussi nombreuses et difficiles à mettre à jour. Autant dire, pour reprendre l'expression de Jean-Michel Naulot, que l'« énorme centrale nucléaire bâtie en dehors de toutes normes de sécurité » est toujours là.
1. Banques en péril
L'hypothèse de la défaillance d'un établissement bancaire européen systémique n'est pas qu'une vue de l'esprit. Actuellement, HSBC, Crédit Suisse et, surtout, la plus grande banque d'Allemagne, Deutsche Bank, connaissent de graves difficultés.
a) Les tribulations de la Deutsche Bank
Avec un bilan de 2 200 milliards d'euros (73 % du PIB allemand), la Deutsche Bank est à la fois la plus grande banque d'Europe et la plus exposée au risque « produits dérivés » : entre 54 000 milliards d'euros (dix-huit fois le PIB de l'Allemagne) et 75 000 milliards d'euros (vingt-cinq fois le PIB de l'Allemagne) selon les estimations ! Même si, en cas de crise, la facture ne sera pas de ce niveau au terme de la compensation des gains et des pertes, celle-ci risque quand même d'être salée et surtout, entre-temps, elle aura entraîné dans sa chute beaucoup d'autres établissements bancaires.
Le problème, c'est que la Deutsche Bank ignore le montant de toutes ses contreparties sur le marché des dérivés. En cas de défaillance, de problème, elle perdrait sa couverture et devrait assumer le risque sur ses fonds propres, ce qui, au vu de l'interconnexion du système, créerait un choc systémique. Telle était la situation d'AIG en 2008 avant d'être sauvé par l'État américain.
Comme les entreprises allemandes ont compensé l'atonie de la croissance interne du pays après 2000 par l'exportation, la Deutsche Bank est allée chercher fortune dans des aventures extérieures plus juteuses mais plus risquées. Ayant acquis Morgan Grenfell en Grande-Bretagne et Bankers Trust aux États-Unis, le marché des taux fixes devient sa principale source de profit. Elle sera aussi, selon l'expression de Romaric Godin, une « immense machine à recycler les excédents allemands » 147 ( * ) .
Tout lui a été bon : immobilier (titrisation des subprimes américains, immobilier espagnol et irlandais), prêts à la Grèce, spéculation sur les matières premières et le pétrole, marché des devises et scandale du Libor, marché des certificats de CO 2 et surtout produits dérivés, la Deutsche Bank est de toutes les aventures et de tous les scandales. Série de scandales qui l'amènera progressivement à réduire la voilure. L'appui du gouvernement allemand et de la BCE lui permettra « d'éviter une restructuration de la dette irlandaise, et de repousser suffisamment celle de la dette grecque pour que la Deutsche Bank puisse vendre ses titres (en grande partie, du reste, à la BCE, dans le cadre du programme appelé SMP en 2010-2011). » 148 ( * )
Au début de 2014, elle se retire du processus de fixation du prix de l'or et de l'argent qui sert de référence pour les échanges de métaux précieux et réduit son activité sur le marché des métaux.
En mai 2015, elle se voit infliger une pénalité de 55 millions par la Sec 149 ( * ) pour avoir minimisé ses pertes éventuelles liées à des produits structurés en 2008. Les dirigeants ne seront pas mis en cause ce qui amènera, en 2016, le lanceur d'alerte qui avait permis à l'enquête d'aboutir à refuser sa prime de 8,25 millions de dollars en signe de protestation. 150 ( * )
En 2015, elle doit verser une amende de 2,2 milliards d'euros au Royaume-Uni et aux États-Unis pour échapper aux poursuites dans l'affaire du Libor. Rien que depuis 2012, cela lui a coûté 12,7 milliards d'euros en frais juridiques !
Nouveau revers, en septembre 2016, les États-Unis réclament 14 milliards de dollars à la Deutsche Bank pour solde de tout compte de sa contribution à la crise des subprimes 151 ( * ) . Une transaction à hauteur de 7,2 milliards de dollars sera finalement conclue.
Même si les soutiens ne lui manquent pas - ainsi le gendarme des marchés financiers allemand BaFin a-t-il finalement renoncé à poursuivre la banque au terme d'une enquête suscitée par cette accumulation d'affaires et de mauvais résultats -, la dégringolade est sévère. Cotée 113,15 euros à la veille de la crise, le 31 mai 2007, l'action Deutsche Bank valait 12,32 euros dix ans plus tard, le 20 août 2016. Au cours des douze derniers mois, elle a encore perdu la moitié de sa valeur.
En 2008, Josef Ackermann, alors président suisse du directoire de la Deutsche Bank, plastronnait. « J'aurais honte si nous acceptions de l'argent public pour faire face à la crise ». La banque, qui se targuait de viser une rentabilité de 25 % des fonds propres, venait d'acheter Postbank (11 millions de clients). Aujourd'hui, des bruits de vente de cette filiale ont couru avant d'être démentis.
En avril 2014, la Deutsche Bank doit augmenter ses fonds propres de 1,5 milliard d'euros et enregistre une perte de 6,8 milliards d'euros en 2015.
Au terme d'une analyse de la solidité des plus grandes banques de la planète, le FMI conclut que « les liens de la Deutsche Bank avec les plus grandes banques mondiales en font le principal facteur de risque pour le système financier dans son ensemble » 152 ( * ) .
Au même moment, la Fed annonce que la branche américaine de la banque allemande avait échoué au deuxième round des stress tests CCAR pour la deuxième année de suite. D'après le régulateur américain, les préparatifs de Deutsche Bank en cas de krach ne sont ni appropriés, ni raisonnables d'où le refus de son plan d'investissement. À la suite de cette nouvelle, le titre s'est retrouvé au niveau le plus bas depuis trente ans.
La Deutsche Bank est arrivée en dernière position du classement de la capacité de résistance publié en juillet 2016 par l'Agence bancaire européenne (ABE).
La Deutsche Bank est « un colosse aux pieds d'argile, et ce fait est en grande partie le fruit du modèle économique allemand dit de "stabilité" » 153 ( * ) . La Deutsche Bank est un Lehman Brothers en puissance que l'État allemand ne pourra laisser tomber.
La conclusion de l'étude fouillée de Romaric Godin est édifiante : « Reste une question : comme on l'a vu, Deutsche Bank n'est qu'un symptôme, celui d'un modèle économique néfaste et dangereux, mais pourtant érigé en référence dans la zone euro. Et celui d'un système financier européen qui n'a pas été aussi maîtrisé qu'on le croyait et qui continue à s'appuyer sur la garantie implicite des États. Si l'on en finit avec Deutsche Bank, une autre banque prendra le relais. La menace sur la stabilité n'est pas toujours où Wolfgang Schäuble et Jens Weidmann voudraient qu'elle soit. Tant que les excédents allemands ne se réduiront pas, c'est la stabilité économique de l'Europe qui sera en danger. » 154 ( * )
b) HSBC
La seconde banque systémique la plus fragile, selon le FMI, c'est la britannique HSBC, dont les difficultés (baisse du chiffre d'affaires, des bénéfices, des effectifs...) remontent à 2008. Née voilà cent cinquante ans à Hong Kong du trafic de l'opium, la banque s'établira en Grande-Bretagne et essaimera dans le monde entier : Amérique latine, Mexique, Turquie, France, États-Unis, Suisse... Ses effectifs atteindront jusqu'à 330 000 salariés.
La valeur de l'action de HSBC Holding est passée de 14,89 euros en août 2006 à 6,26 euros dix ans plus tard. Entre temps la banque se trouve mêlée à différents scandales : organisation d'évasion fiscale à grande échelle (« Swissleaks ») par sa filiale suisse, manipulation des changes avec six autres grandes banques, scandale du blanchiment d'argent appartenant au cartel mexicain de la drogue... En 2013, HSBC sera condamnée à 2,46 milliards de dollars d'amende par la justice étasunienne pour infraction à la réglementation boursière.
c) Crédit Suisse
Établissement parmi les plus interconnectés du monde, Crédit Suisse est le troisième sur la liste du FMI. En difficulté, le Crédit Suisse (ainsi que la Deutsche Bank) a été retiré au début du mois d'août 2016 du panel de banques retenues pour l'indice Stoxx Europe 50, lequel regroupe les cinquante principales capitalisations boursières européennes.
Il faut dire que sa valorisation ne cesse de baisser : de 29,76 dollars en octobre 2013, l'action du CS est passée à 11,9 dollars en août 2016, en chute de 45 % depuis le début de l'année.
Question scandales, le Crédit Suisse, à côté des établissements déjà cités, fait figure d'enfant de coeur, son nom apparaissant seulement dans celui de la Fifa (blanchiment d'argent) et des « Panama Papers ».
2. Une solvabilité pour temps calme
Nous l'avons vu, le G20 de Cannes des 3 et 4 novembre 2011 avait pris la résolution de réduire la dangerosité de la centrale atomique constituée par l'oligopole d'énormes banques systémiques (50 341 milliards de dollars d'actifs en 2012, soit 70 % du PIB mondial), qui, dominant les marchés interbancaires, obligataires et financiers, ceux des taux d'intérêts, des changes, des matières premières et des métaux précieux, des produits dérivés, est à l'origine du krach de 2007-2008.
« Nous sommes convenus , déclare le communiqué final, d'un ensemble de mesures qui visent à ce qu'aucun établissement financier ne puisse être considéré comme "trop important pour pouvoir faire faillite" et à éviter au contribuable d'assumer le coût de la résolution des banques. »
Il publiait en même temps, une liste de vingt-neuf banques systémiques, dont cinq françaises : BNP Paribas, Dexia, Groupe Crédit Agricole, BPCE et Société Générale.
Si ces établissements bancaires sont sûrs d'être sauvés par la puissance publique et par le contribuable en dernier ressort, c'est que les volumes des créances et des dettes inscrites à leurs bilans sont si énormes, l'écheveau de leurs engagements et contreparties réciproques de leurs hors-bilans si considérable, que la chute de l'un d'entre eux entraînerait, de proche en proche, celle des autres, la paralysie de la machine économique, la ruine des épargnants et des déposants.
Après dix ans de crise et cinq ans après Cannes, où en sommes-nous ? Les établissements bancaires sont-ils moins interconnectés, leur solvabilité s'est-elle améliorée significativement, le volume des dérivés de crédits et de produits structurés moins considérables ?
Malgré les restructurations et les évolutions législatives dans tel ou tel pays, malgré l'évolution de la réglementation internationale, malgré même l'amélioration des ratios de solvabilité officiels, la réponse n'est toujours pas vraiment rassurante. Voyons cela.
a) Le besoin de recapitalisation des banques systémiques
Ce qui a rendu si dangereuses les trop grosses banques, c'est d'avoir pu gonfler leurs actifs en s'endettant au point que leurs capitaux propres censés permettre de faire face aux défaillances ne représentent presque plus rien.
Rappelons que, voilà une centaine d'années, des taux de 15 % à 20 % de fonds propres étaient fréquents, notamment aux États-Unis, où, en 1840, ils atteignaient même, voire dépassaient, 50 %. Ce taux était plutôt de 3 % au début des années 2000, voire de 1,5 % en 2007.
Un ratio de fonds propres de 3 %, cela signifie que 97 % des actifs sont financés à crédit. Autrement dit, chaque euro de capital propre a permis d'emprunter 32,3 euros et donc de produire un actif de 33,3 euros, sources de revenus. C'est ce qu'on appelle, dans le patois financier, « l'effet de levier ».
L'intérêt des banquiers et de pouvoir disposer d'un effet de levier maximum, ce qui, on l'aura compris, signifie, en cas de problème, un risque d'insolvabilité maximum aussi. Trois raisons à cela.
• La rémunération des dirigeants dépend généralement de l'évolution du ratio bénéfices-capitaux propres. Plus on peut emprunter et moins les capitaux propres sont importants, plus la rémunération est forte.
• Ceux qui financent cette dette bancaire en achetant des obligations pensent qu'une banque systémique ne peut faire faillite, peu leur importe donc leurs ratios d'endettement réel. D'autant que cette garantie implicite de l'État-sauveur permet un endettement à moindre coût.
• L'intérêt de la dette est déductible de l'impôt sur les bénéfices, ce qui n'est pas le cas des dividendes sur les fonds propres.
On comprend donc le peu d'enthousiasme du lobby bancaire pour des exigences en fonds propres plus contraignantes.
Ainsi, en 2015, le groupe Crédit Agricole, avec un capital de 49,3 milliards d'euros, présente-t-il un actif de 1 723 milliards d'euros, soit près de trente-cinq fois la mise. Ce qui signifie aussi que la défaillance de moins de 3 % de ses débiteurs suffirait à le placer en situation de faillite. On comprend l'acharnement mis par le Gouvernement français (et allemand, le problème étant le même pour lui) à retarder le plus possible une restructuration de la dette grecque. Loin aussi du prêchi-prêcha sur le thème : « Quand on fait des dettes, on les rembourse. »
Améliorer la stabilité du système financier passe donc, soit par une augmentation des capitaux propres obligatoires, soit par une diminution des actifs et plus probablement par les deux.
Comme on pouvait s'y attendre, c'est surtout la première méthode qui a été privilégiée mais en embrouillant les choses de telle manière que l'on se met à douter des résultats.
b) Bâle III ou comment sauver les apparences
Lors des négociations internationales dites de Bâle III, tout s'est joué sur la définition des « fonds propres » et sur la construction de l'indice censé mesurer la solvabilité des établissements.
Le ratio le plus significatif est « capital propre réellement disponible/montant de l'endettement (ou de l'actif) ». Selon Alan Greenspan, ex-mage de la Fed et grand magicien de la planche à billets, le levier d'endettement doit être inférieur à 10. Autrement dit les « fonds propres » doivent représenter au moins 10 % de l'endettement. C'est cet indice qui, sous le nom de Core Tiers 1, est généralement pris pour référence. Mais avec des aménagements tels, lors des accords de Bâle III (2010) qui servent aujourd'hui de référence, qu'il en perd sa signification.
Ces accords ont, en effet, compliqué les choses, non seulement en distinguant des capitaux propres de différentes qualités au lieu de s'en tenir au seul « capital réellement disponible » mais surtout en remplaçant la dette à prendre en compte (passif) par un actif pondéré, pondération laissée à l'appréciation des banques s'agissant des établissements systémiques.
Même le secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurría, a trouvé le tour de passe-passe un peu gros : « Nous avons besoin d'un ratio de levier simple - le montant des capitaux nécessaires pour une quantité donnée du total des actifs - afin de contrôler le problème des banques ayant un capital trop faible. Les règles de Bâle ont malheureusement donné aux banques de grandes possibilités pour éviter de telles limites via la soi-disant "optimisation de la pondération", ceci ayant pour résultat le fait que les banques n'ont pas toujours les capitaux nécessaires pour faire des affaires en toute sécurité. Cela est particulièrement vrai en Europe, où 700 milliards d'euros seraient nécessaires pour mettre les banques en conformité. » 155 ( * )
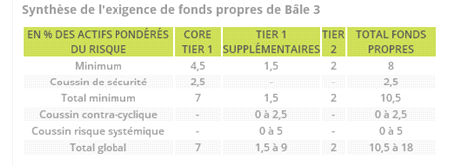
Bâle III impose donc aux banques un minimum de « total capital » de 8 % de l'actif auquel est ajouté un « coussin de sécurité » de 2,5 %, le tout pondéré en fonction du risque. Les établissements systémiques, pour leur part, devront progressivement y ajouter jusqu'à 5 %, soit au total 15,5 % maximum, d'ici au 1 er janvier 2019. L'objectif est d'atteindre de 11,5 % à 13 % pour les banques systémique et 10,5 % pour les autres, d'ici le 1 er janvier 2019.
De leur côté, les États-Unis imposent, depuis juillet 2015, un supplément de capital propre à huit de leurs établissements systémiques : JP Morgan (+ 4,5 % de ses actifs pondérés du risque), Citigroup (+ 3,5 %), Goldman Sachs (+ 3 %), Morgan Stanley (+ 3 %), Bank of America (+ 3 %), Wells Fargo (+ 2 %), State Street (+ 1,5 %), Bank of New York Mellon (+ 1 %). Ces banques doivent donc, soit réduire leurs actifs, notamment les plus risqués, soit augmenter leur capital propre.
Le comité de suivi des accords de Bâle peut donc annoncer en 2015 que, à la fin de décembre 2014, la moyenne du « total capital » en pourcentage du capital pondéré pour les banques d'ampleur systémique était de 13,1 %, contre quelque 7,5 % en 2011, voire un peu plus pour les banques de plus petite taille. Beau progrès !
Sauf qu'on le doit plus à la magie de la pondération qu'à une recapitalisation significative. Le mode de calcul du besoin de capitaux propres laisse pantois.
Dans son rapport de 2015, la BRI, commentant le graphique ci-dessous - dans un patois financier dont on vous fera grâce -, explique qu'entre mi-2011 et mi-2014, si les actifs, une fois pondérés baissent, ce qui permet de faire apparaître une amélioration de 45 % du ratio CET1 de solvabilité, les actifs réels, eux, augmentent. En réalité les banques sont toujours aussi fragiles.
« Pour économiser sur les fonds propres réglementaires, les banques sont incitées à biaiser leurs estimations du risque à la baisse » conclut la BRI 156 ( * ) .
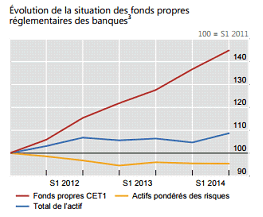
Le graphique ci-dessus montre que, si les fonds propres « officiels » (CET1) ont pu augmenter de 45 % (courbe du haut), c'est que la pondération des actifs (courbe du bas) a fait baisser des actifs réels qui augmentaient de 10 % (courbe du milieu).
Particulièrement édifiante, la latitude laissée aux dirigeants des très grandes banques, dont la rémunération, à actifs équivalents, augmente quand baissent les fonds propres, d'effectuer eux-mêmes cette pondération ! Est-il excessif de parler de favoritisme des pouvoirs publics en faveur des établissements systémiques, par ailleurs les plus dangereux ?
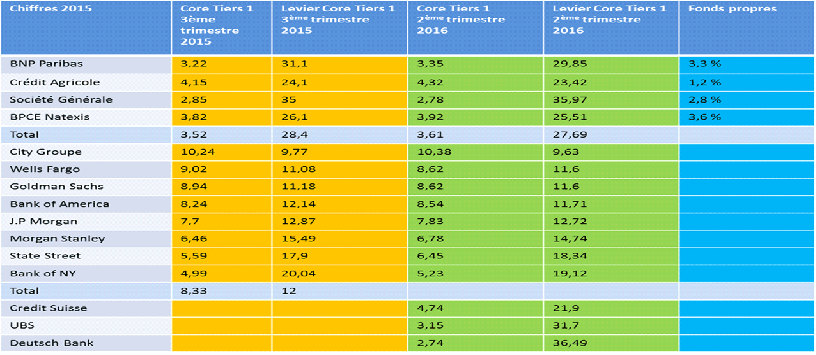
Le tableau ci-dessus nous donne une bonne radiographie de la centrale atomique : au deuxième trimestre 2016, une seule des banques systémiques mondiales sur les quinze étudiées présente un ratio de levier d'endettement inférieur à 10 ou un ratio Core T1 réel supérieur à 10, la banque étasunienne Citigroup. Beaucoup d'autres et tout particulièrement les banques européennes, au rang desquelles les quatre banques systémiques françaises, en sont très loin.
Au final, s'il y a un progrès de la solvabilité de l'oligopole systémique par rapport à 2007, il est très relatif s'agissant des banques européennes dont les ratios de solvabilité réelle se situent toutes au-dessous de 5 %. Certes, 3 % ou 4 %, c'est mieux que 2 %, mais l'augmentation est-elle pour autant significative ?
Quant aux banques étasuniennes, il faut y regarder à deux fois. Leur mode de comptabilisation des produits dérivés à l'actif de leur bilan, pour ne rien dire de leurs engagements en cas de problème repris au hors-bilan, en minimise considérablement le montant.
Une fois traduit en normes européennes, aucune banque en 2012 ne présentait un levier d'endettement inférieur à 13 et deux seulement un ratio de solvabilité réelle supérieur à 6 %. Pas de quoi être rassuré, donc, malgré l'intense communication sur le thème de l'amélioration de la solvabilité des grandes banques et les déclarations des optimistes fonctionnels, dont la première préoccupation est de calmer le jeu.
L'avis des observateurs moins directement intéressés est nettement plus réservé.
Pour le Parlement européen, en juin 2015 : « L'augmentation des fonds propres réels n'a que très peu augmenté depuis la crise. »
La Commission Vickers (responsable de la réforme britannique) et les chercheurs du Comité de Bâle pensent qu'un ratio de 16 % à 20 % de fonds propres par rapport à l'actif pondéré serait préférable aux 10,5 %-13 %.
Christophe Nijdam précise 157 ( * ) : « Avant la crise, les fonds propres, c'était 1,5 % du bilan non pondéré par les risques, notamment pour certaines banques britanniques systémiques comme RBS, donc 98,5 % étaient empruntés (inclus les dépôts des clients). Avec la réglementation, on monte à 3 % en 2018. Si l'on voulait se débarrasser de cette fragilité particulière des banques systémiques, françaises et autres européennes, il leur faudrait 6 % de fonds propres supplémentaires. »
Ce qui fait hurler les gardiens du temple pour qui les banques universelles françaises sont un modèle de stabilité.
Commentant le mode de calcul du ratio de solvabilité des banques européennes, Jézabel Couppey-Soubeyran 158 ( * ) explique : « Les banques calibrent au mieux leurs modèles internes pour minimiser le poids du risque de leurs actifs et la charge en fonds propres qui va avec. En clair, les banques sous-estiment les risques de leurs actifs. Le système fonctionne encore comme cela aujourd'hui. Certes, les exigences ont été renforcées, les fonds propres redéfinis, mais l'utilisation des modèles internes des banques ou des ratios pondérés par les risques n'a pas été remise en cause.
« Une solution anglo-saxonne aurait pu être envisagée : la mise en place d'un ratio très simple rapportant les fonds propres au total des actifs, soit la part des fonds propres dans le bilan. Ce ratio dit de levier est certes fruste comparé au ratio pondéré et certains voient dans le renoncement à ajuster le ratio en fonction des risques des actifs une forme de "paresse intellectuelle". Ce serait toutefois un bon moyen de couper court aux manipulations de risques. »
Commentant les résultats des stress tests auxquels la BCE a soumis cent trente banques européennes en 2014, après avoir rappelé que vingt-cinq d'entre elles ont été recalées (essentiellement italiennes), elle note que si le ratio retenu (au moins 5 % de fonds propres) avait été celui qui vient être indiqué (ratio de levier), elles auraient été soixante-quinze, dont vingt banques allemandes, y compris évidemment la Deutsche Bank, à être identifiées comme insuffisamment capitalisées.
Ayant aussi noté que la BCE a réévalué de 20 %, par rapport aux estimations antérieures, le volume des créances douteuses dans le bilan des banques, Jézabel Couppey-Soubeyran conclut 159 ( * ) : « Fin 2014, la BCE s'est bien gardée de communiquer des résultats qui pouvaient être inquiétants. La capacité de résistance des banques européennes à un choc éventuel a été surestimée. Si un choc survenait, les banques ne seraient sans doute pas en capacité de l'absorber, tout dépend de l'ampleur du choc. On ne peut pas considérer que les banques européennes sont solides aujourd'hui. »
3. Pas de séparation pour les banques
«
Les banques croissent à
l'international
mais elles reviennent toujours chez elles pour
mourir.
»
Mervyn King,
ancien gouverneur de la Banque
d'Angleterre.
«
Les idées qui ont été mises
sur la table par Michel Barnier
sont des idées, je pèse mes
mots, qui sont irresponsables
et contraires aux intérêts de
l'Union européenne.
»
Christian Noyer,
gouverneur
de la Banque de France.
a) Ce pourrait être une obligation de morale politique
L'un des moyens les plus efficaces de réduire la taille des banques et d'éviter le chantage à l'intervention de l'État en cas de faillite au nom du sauvetage des déposants, c'est de séparer banques de dépôts et banques d'affaires . Comme le dit crûment Maurice Allais : « il faut empêcher les banques de spéculer avec l'argent qu'elles créent comme il faut empêcher les filiales des banques ou les fonds d'investissement de spéculer avec de l'argent prêté par les banques. On n'empêchera jamais la spéculation mais il faut que les spéculateurs spéculent avec leur argent, pas avec celui des autres. » Autrement dit, il faut supprimer la garantie publique au casino bancaire, garantie qui lui permet par ailleurs de s'endetter à un coût inférieur à celui des établissements non systémiques.
Il faut empêcher la confusion entre la gestion prudente des banques de dépôts pour assurer la sécurité des fonds qui leur ont été confiés et la gestion « active », pour ne pas dire risquée, d'établissements dont le but est l'enrichissement, au prix du risque, de leurs clients. Il faut empêcher les conflits d'intérêts qui naîtront de cette dualité d'objectifs.
Des établissements bancaires plus petits, aux activités spécifiques bien distinguées, c'est aussi plus de transparence et de meilleurs contrôles. Accessoirement, c'est réduire le besoin de fonds propres des banques de dépôts dont les activités sont moins risquées, les bilans plus transparents et donc réduire pour eux le risque infondé d'illiquidité. C'est raréfier les occasions d'embolie du réseau interbancaire.
Il est significatif que le Banking Act ou Glass-Steagall Act, du nom du sénateur Carter Glass et du représentant Henry Steagall qui défendirent la loi au Congrès, fut la toute première mesure importante de Roosevelt après son arrivée à la Maison-Blanche en mars 1933. Adoptée par la Chambre des représentants à 262 voix contre 19 et par acclamation au Sénat, la loi Glass-Steagall sera signée dès le 16 juin 1933 par le Président Roosevelt. Elle instituait une incompatibilité rigoureuse entre les activités de banque de dépôts ( commercial banking ) et celles de banque d'affaires ( investment banking ). Une banque de dépôts ne peut posséder une banque d'affaires ni, inversement, une banque d'affaires posséder une banque de dépôts. Une banque de dépôts ne peut acheter, vendre ou négocier des titres financiers, ni une banque d'affaires accepter des dépôts. Le but est de protéger les dépôts, d'empêcher la spéculation à partir de dépôts, pratique alors mise en évidence par la commission des affaires bancaire et monétaire du Sénat. Particulièrement concernée, la banque d'affaires new-yorkaise Goldman Sachs.
Un fonds fédéral de garantie des dépôts bancaires sera par ailleurs créé. L'État fédéral garantit les dépôts bancaires individuels, intégralement jusqu'à 10 000 dollars, à 75 % entre 10 000 dollars et 50 000 dollars, 50 % au-delà.
Au terme de plusieurs tentatives, il sera définitivement mis fin au Glass-Steagall Act sous la présidence Clinton en 1999. Les banquiers d'affaires pourront de nouveau utiliser les dépôts de leurs clients pour investir et spéculer sur les marchés.
Sur ce chapitre, plus moderne que les États-Unis, la France reviendra dès 1984 sur la séparation entre banques de dépôts et d'affaires via la loi bancaire. Il lui faudra cependant une dizaine d'années pour voir le triomphe du modèle de « banque universelle » qui en sera l'aboutissement.
b) Les illusions perdues
La crise de 2007-2008 faisant apparaître les conséquences du privilège accordé aux banquiers de pouvoir spéculer avec l'argent des déposants, la question de la séparation des catégories de banques redevient d'actualité. Le secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurría, fait remarquer : « Comme nous l'avons d'abord proposé au sommet du G20 en 2009, la séparation de la banque commerciale de celle des activités de titres, notamment celle des produits dérivés, est essentielle pour éviter l'interfinancement des prises de risque excessives liées au phénomène du too-big-to-fail. » 160 ( * ) Mais, comme d'ordinaire, devant l'opposition du lobby bancaire, on complexifiera le problème pour éviter de le régler vraiment.
Trois solutions étaient possibles :
- la seule vraiment efficace, la séparation totale. Personne n'en voudra ;
- la holding coiffant deux entités distinctes, ce à quoi revient la solution britannique, solution qui maintient un lien financier entre banque de dépôts et banque d'investissement ;
- la solution européenne du transfert à une filiale des activités jugées spéculatives ou, selon la loi française de séparation bancaire, des activités qui « ne sont pas utiles à l'économie » . Dans ce cas, non seulement les liens sont maintenus mais l'efficacité du dispositif dépend de la nature et du volume de ce qui sera transféré. En l'espèce, pas grand-chose.
Les premiers à réagir et à le faire sérieusement ont été les Britanniques particulièrement échaudés par la crise qui coûtera au final 67 milliards de livres sterling (120 milliards de livres sterling au départ) à l'État et à la Banque d'Angleterre. Leur système sera réorganisé sur deux points : réforme de la régulation et surtout, à la suite du rapport Vickers (2011), la séparation à horizon 2019 des activités liées aux dépôts et celles d'investissement. Il ne s'agit donc pas d'une séparation des établissements selon leurs activités mais, à l'intérieur d'un même établissement, de la séparation des activités.
La solution étasunienne, en passe de mourir étouffée sous le papier, était nettement plus light. « Était » car il semble que Donald Trump veuille mettre fin au « Dodd-Frank Act » adopté en juillet 2010. Ce qui nous dispensera de rentrer dans les détails. S'il faut y voir évidemment le pouvoir du lobby bancaire, force est aussi de constater que comparativement à la Grande-Bretagne et à la France, le système bancaire étasunien est nettement moins oligo-monopolistique, donc moins vulnérable à la faillite de l'un de ses constituants.
Quant à la solution européenne, après un départ brillant avec le rapport Liikanen et le projet de réforme de Michel Barnier alors commissaire européen, on l'attend toujours. Entre autres mesures, le projet Barnier interdisait aux banques de dépôts de spéculer pour leur propre compte sur les produits financiers s'échangeant sur les marchés (actions, obligations, produits financiers complexes...), ainsi que sur les matières premières. Il donnait le pouvoir aux autorités de contrôle d'imposer le cantonnement, dans une filiale séparée, des activités de marché jugées à hauts risques pour le compte de tiers : négoce de produits dérivés complexes, l'essentiel des opérations de titrisation, « tenue de marché » (nécessaire à garantir la liquidité des produits achetée, autrement dit garantie de pouvoir les revendre). La réforme est toujours bloquée au Parlement européen.
c) La « banque universelle » fait de la résistance
Défendant bec et ongle son modèle de « banque universelle », la France ne sera pas pour rien dans cet enlisement du projet européen. Prenant les devants, elle adoptera un placebo sous le nom de loi de « séparation et de régulation des activités bancaires », un projet qui pourtant visait rien moins qu'à « remettre la finance au service de l'économie réelle » . Présentée à la fin de 2012 au Parlement par Pierre Moscovici, la loi sera publiée le 27 juillet 2013.
Poser ainsi le problème, c'était vider dès le départ la réforme de tout contenu. Tout simplement parce que, le système bancaire de la France étant une pièce essentielle de son économie (rôle, poids économique, emploi), tout ce qui est bon pour lui est forcément bon pour la France et parce que toutes les activités financières peuvent être utiles ou spéculatives selon l'usage qu'on en fait, voire sont toujours à deux faces.
Comme prévu, au final, les activités devant être filialisées ne représentent pas grand-chose : 1 % des revenus de la Société Générale, reconnaît Frédéric Oudéa, son P-DG, lors de son audition par la commission des finances de l'Assemblée nationale, à la surprise des députés présents et de la rapporteure du projet, Karine Berger, persuadés de son caractère avant-gardiste. Ne sont concernés ni les prêts aux hedge funds , ni le trading haute fréquence, ni les opérations sur produits dérivés. « Avec la définition que le projet de loi donne du market making, les positions sur produits dérivés de crédits qui ont entraîné la faillite de la banque AIG à Paris auraient été qualifiées d'utiles » juge le secrétaire général de Finance Watch de l'époque, Thierry Philipponnat, lors de son audition à l'Assemblée nationale le 5 février 2013.
Selon Christophe Nijdam : « Sur une banque spécifique comme la BNP, Liikanen aurait séparé 13 % des activités en termes de produit net bancaire (chiffre d'affaires d'une banque). La proposition, qui est entrée en vigueur de M. Moscovici, prévoyait 0,5 % du chiffre d'affaires, par rapport à l'activité totale. Le projet français était beaucoup moins ambitieux que le projet européen, vingt-six fois moins ambitieux dans le cas d'espèce. »
Encore une fois, rien d'étonnant puisque l'essentiel était de préserver le modèle de « banque universelle » patiemment et opiniâtrement construit depuis la loi de 1984 et qui devait assurer à la France une place de premier plan en Europe, faute d'un appareil industriel aussi puissant que celui de l'Allemagne. « Ce qui m'a encore plus marqué, nous dira Gunther Capelle-Blancard lors de son audition 161 ( * ) , c'est l'argument selon lequel le secteur financier allait devenir une spécialité de la France, non pas juste parce qu'il s'agit d'activités à forte valeur ajoutée, donc que c'est très rémunérateur, mais parce que c'est non polluant, c'est formidable, c'est "très créatif". »
Dominé par les « grands corps », pratiquant intensément le « revolving doors » entre les sommets de l'État et ceux de la haute finance, un aussi bel outil de pouvoir et de carrière devait être à tout prix conservé.
Ce choix politique essentiel ne pouvait être remis en cause, quels qu'en soient les risques et les interrogations - de plus en plus nombreuses - sur l'efficacité réelle de ce modèle bancaire « made in France ».
D'où les propos politiquement incorrects, inhabituels dans la bouche d'un des gardiens du temple, rappelés en exergue. Christian Noyer récidivera d'ailleurs dans un entretien au nouveleconomiste.fr 162 ( * ) : « Je suis absolument convaincu, certain, que la séparation est une fausse bonne idée. C'est une idée qui ne résout rien et qui crée des risques considérables pour le financement de l'économie, donc pour la croissance. » Suit un long plaidoyer qui aurait été plus convainquant s'il avait apporté une réponse au problème posé par un système aussi oligopolistique : l'existence de liens si nombreux et si entremêlés entre des établissements d'une telle taille que l'un ne peut tomber sans entraîner les autres.
Conclusion de Jézabel Couppey-Soubeyran 163 ( * ) : « Cette loi bancaire ne satisfait ni les partisans de la séparation ni les plus réticents. Il ne faut pas seulement se contenter d'isoler les activités spéculatives utiles au financement de l'économie, il faut les décourager. »
4. Touche pas à mon industrie financière !
L'une des transformations majeures du système financier ce dernier quart de siècle a été l'apparition et le développement d'une véritable industrie financière aux mains des plus grosses banques, les seules à pouvoir assumer les investissements intellectuels et matériels qu'elle appelle. Se croyant dotées des outils lui permettant de prendre des risques - donc de gagner plus d'argent -, sinon en toute sécurité, du moins à un niveau de risque défini et assumé, elles vont en user et abuser, comme la crise le montrera. Ces outils permettront d'élever la « finance casino », non seulement au rang de machine à cash mais d'une mystique. Le mot du P-DG de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, à l'occasion d'un entretien au Sunday Times 164 ( * ) - « Je ne suis qu'un banquier faisant le travail de Dieu. » -, est révélateur de ce sentiment de toute-puissance de la finance.
Deux produits se sont retrouvés particulièrement sur la sellette, compte tenu de leur rôle dans la crise des subprimes : les produits dérivés type CDS et la titrisation.
a) Les produits dérivés type CDS
Deux effets sont particulièrement en cause : la possibilité de déstabiliser n'importe quelle valeur par la spéculation à la baisse, l'interconnexion des membres de l'oligopole bancaire par le jeu des garanties et garanties de garanties, supprimant toute cloison étanche entre eux. Comme le rappelle Angel Gurría 165 ( * ) , l'interfinancement des prises de risque excessives liées au phénomène du too-big-to-fail est largement dû aux produits dérivés et à la titrisation. Ce sont ces activités de titrisation et l'industrie des produits dérivés logées dans les très grandes banques, cet enchevêtrement de financements réciproques tout autant que la taille de leur bilan, qui les rendent systémiques et dangereuses.
Un interfinancement qui n'apparaît pas dans les bilans et très mal dans le hors-bilan, ce qui pousse à la panique. Ainsi, en octobre 2008, on estimait que les établissements qui avaient vendu des CDS devraient débourser 400 milliards de dollars, ce qui a largement contribué à nourrir la panique financière mondiale. Finalement, une fois toutes les compensations réalisées entre ventes et achats de CDS, il en aurait coûté de 6 milliards à 8 milliards ; 6 à 8 milliards de dollars « seulement », mais parce que les plus grosses banques et les réassureurs ont été sauvés de la faillite par les États et les banques centrales 166 ( * ) .
Pour Christophe Nijdam : « C'est une grenade dégoupillée, ce qui ne veut pas dire qu'elle va exploser. » 167 ( * )
Comme rappelé plus haut, le G20 de Cannes en 2011 s'était engagé à mettre sous contrôle les marchés dérivés de gré à gré, « les transactions à haute fréquence et la liquidité opaque ». Qu'en a-t-il été ?
Constatons que leur production se développe à un rythme plus allègre que celui de la régulation, qui avance à pas comptés.
En 2007-2008, 90 % des produits dérivés étaient échangés sur les marchés de gré-à-gré, donc non réglementés. Désormais, le règlement sur les marchés d'instruments financiers (règlement Mifir sur la base de la directive Mifid 2), voté par le Parlement européen le 15 avril 2014, obligera les produits dérivés standardisables et suffisamment liquides à être négociés sur une plateforme de négociation et à passer par des chambres de compensation, chargées de s'interposer entre l'acheteur et le vendeur. Cette chambre enregistrant le contrat et valant contrepartie, elle contrôlerait ipso facto la qualité de la demande.
Alors que des chambres de compensation sont déjà partiellement en place aux États-Unis, la Commission de Bruxelles en est encore à la finalisation de sa réglementation. Elle étudie, en particulier, la mise en place d'une taxe de 0,01 % sur les transactions des produits dérivés ; étude particulièrement complexe à en juger par sa longueur.
Selon Christophe Nijdam, « cette taxe réduirait de 75 % les volumes d'échange de ces instruments, d'après une estimation faite par la Commission européenne au moment du lancement de l'idée d'une taxe sur les transactions financières (TTF), c'est-à-dire l'essentiel de la part spéculative ». À condition qu'elle soit un jour appliquée, ce qui est loin d'être gagné d'avance.
Pour les produits les plus risqués, il est, en outre, envisagé de demander à ces chambres de mettre de côté un pourcentage de la valeur notionnelle des contrats pour faire face aux défaillances éventuelles.
b) La titrisation
Pas question non plus d'interdire la titrisation, bien au contraire. L'Europe notamment entend la relancer mais en rendant ces produits plus transparents, par le biais d'une sorte de standardisation. La Banque des règlements internationaux note : « Cela étant, l'évaluation des risques que présente ce type de lots restera empreinte d'une incertitude considérable, dont il ne faudrait pas faire abstraction, sous peine d'augmenter fortement la probabilité d'une grave sous-capitalisation pour certaines tranches. » 168 ( * )
Si personne ne met en doute l'intérêt de la titrisation, nécessaire notamment au recyclage des obligations sécurisées émises par les banques pour augmenter leur passif et pouvoir continuer à prêter, le désaccord porte sur ce qu'il serait licite de titriser et comment, jusqu'à quel degré de sophistication. Ainsi, Finance Watch conteste la titrisation sans transfert de la propriété des créances objets de la titrisation, ou « titrisation synthétique » admise par la Commission européenne. Dans ce cas, seul le risque est transféré, risque lui-même couvert par un CDS.
Pour Jérôme Glachant 169 ( * ) , la titrisation ne crée pas en elle-même de risque systémique tant qu'elle est associée à des investissements et des placements de long terme (par exemple, le crédit immobilier ou aux entreprises). Le problème apparaît, comme en 2007, lorsque ces produits deviennent le support d'une spéculation à crédit.
Cela dit, comment éviter le mésusage d'un produit financier puisque c'est devenu la règle ?
c) Le trading haute fréquence
En ce domaine, la régulation avance aussi mais sans vraiment traiter le fonds du problème ; l'argument de l'obligation d'assurer la liquidité des marchés domine toujours.
Pour Martin Merlin, directeur des marchés financiers au sein de la DG Fisma 170 ( * ) de la Commission européenne 171 ( * ) , ce sont les besoins de liquidité qui expliquent qu'on ne l'interdise pas malgré son intérêt strictement nul pour la collectivité. « Je ne pense pas que ces firmes puissent penser à l'intérêt général ou du moins l'avoir pour première motivation. La proportion des ordres passés par ces firmes sur une journée est massive, deux tiers des ordres sont passés par ces firmes. Cette activité ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain, cela risquerait d'assécher le marché et poser un problème de liquidité massif. »
La directive et le règlement Mif 2 apportent un début d'encadrement des négociations dites « algorithmiques » puisque, à ce niveau de rapidité, seuls des automates algorithmiques peuvent prendre les décisions.
On en est encore à la consultation afin de définir les paramètres des ordres et leur encadrement : largeur des pas de cotation (intervalle minimum entre deux cotations), prix enclenchant la décision, niveau de liquidité du produit, manière de gérer l'ordre après sa soumission, coupe-circuits permettant de geler les marchés électroniques en cas d'emballement du dispositif, etc.
La question de la possibilité ou non de taxer les annulations d'ordres a été posée.
E. UN PASSÉ QUI NE PASSE PAS
Un facteur majeur de crise, voire de crise systémique comme on l'a vu en 2008, c'est le stock de créances douteuses - des créances « non performantes » dans le patois financier - à l'origine de l'embolie du système d'échanges interbancaires.
1. Un volume de créances douteuses en augmentation
Or, loin de diminuer, leur volume dans les bilans bancaires et les produits dérivés au hors bilan augmentent. À cela s'ajoutent toutes celles qui sont stockées dans les « bad banks », dans l'attente de jours meilleurs.
Ayant plus que doublé depuis 2009, le volume des créances douteuses de la zone euro se monterait aujourd'hui à 1 000 milliards d'euros selon le FMI, à 900 milliards d'euros selon la BCE, soit un ratio créances douteuses-total des prêts consentis bien supérieur à celui des États-Unis. Ce que les banques européennes contestent, faisant valoir que la méthode de comptabilisation des États-Unis réduit immédiatement la valeur des créances douteuses alors qu'en Europe, on les maintient à leur valeur d'acquisition tout en provisionnant pour risque ; faisant valoir aussi qu'outre-Atlantique une bonne partie des créances douteuses, celles qui sont issues de la crise des subprimes , se retrouvent dans les bilans des agences nationalisées Fannie Mae et Freddie Mac et non dans ceux des banques.
Certes, mais, comme le remarque le FMI, conserver des titres à leur valeur d'achat alors qu'ils ne valent plus rien ou si peu, cela permet de reculer le moment d'afficher un bilan vraiment représentatif de l'actif réel de la banque. Le FMI critique une « supervision insuffisamment poussée » , ce qui en clair signifie que les banques européennes ne sont pas vraiment contrôlées.
Pour le FMI et la BCE, des bilans ainsi alourdis réduisent la capacité de prêts des banques à l'économie et les fragilisent. Aussi la BCE envisage-t-elle d'y remédier par la création de « bad banks », au niveau national ou européen. On reste en attente des propositions que fera le Comité sur les actifs toxiques qui vient d'être créé. Un de plus.
2. Un facteur de fragilisation important du système bancaire européen
Particulièrement concernés, les pays du Sud de la zone euro où les créances douteuses représentent, selon le FMI, 34 % de l'actif du bilan des banques grecques, 18 % de celui des banques italiennes et 12 % de celui des banques portugaises.
• C'est l'Italie, qui connaît une véritable inflation de crédits à risques et le PIB nettement le plus important, qui inquiète le plus. « Les prêts douteux augmentent sans cesse, observe Jacques Sapir . Ils sont proches de 15 % à 20 % là où ils devraient être à 5 %. » 172 ( * )
Résultat, aux tests de résistance de la BCE en octobre 2015, neuf des quinze banques italiennes auditées n'ont pas réussi les stress tests . Elles devront être recapitalisées. Par qui ? Toute la question est là.
Pour Jacques Sapir, « la situation des banques italiennes est aujourd'hui critique » 173 ( * ) . Elle posera un problème à la zone euro. D'autant plus qu'il ne s'agit pas des séquelles d'une crise immobilière qui n'a pas touché l'Italie mais de créances de petites et moyennes entreprises mises en faillite par la crise économique qui s'éternise.
Estimé à 185 milliards d'euros en janvier 2015 par la Banque d'Italie, le volume des crédits douteux est aujourd'hui évalué à 360-400 milliards d'euros, dont 70 milliards à 100 milliards devront être couverts, soit par l'État, soit par d'autres mécanismes publics.
Le problème, c'est que ces banques devant être recapitalisées, l'Europe impose depuis janvier 2016 qu'elles le soient par leurs déposants ( bail-in ) ou leurs créanciers qui sont souvent de petits épargnants qui croyaient faire là un placement de père de famille, et non par l'État ( bail-out ), ce qui n'est pas possible et risque d'entraîner une crise politique grave !
Le Gouvernement italien, passant outre l'intransigeance allemande, a fait voter fin décembre 2016 au Parlement un plan d'aide de 20 milliards d'euros aux banques du pays. Un montant inférieur au besoin d'aide publique estimé à 70 milliards d'euros, soit 4,4 % du PIB, et une augmentation du déficit budgétaire de l'État susceptible de fragiliser, une fois de plus, l'euro.
« Tout le monde comprend qu'une sortie de l'Italie de l'euro sera l'acte de décès de la monnaie unique. La crise grecque de l'été 2015 n'a été que le hors-d'oeuvre ; la crise italienne sera LA crise de la zone euro », pronostique Jacques Sapir 174 ( * ) .
Avec plus de sept cents établissements pour la plupart de petite taille, le système bancaire italien est donc dans la tourmente : Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etrurie, Nuova Cari Ferrara et Nuova Cari Chieti (rachetées) ; Monte dei Paschi di Siena (sauvée par le gouvernement italien) ; Intelsat San Paolo ; Mediobanca ; Unicredit, la première banque d'Italie et établissement systémique, qui a perdu, lui, plus de 60 % de sa valeur en un an.
La dette publique italienne est ainsi passée de 106 % du PIB en 2008 à 133 % en 2015, d'où la baisse de valeur des obligations d'État, ce qui est, une anomalie dans le contexte euphorique du marché des obligations souveraines.
Comme pour la crise grecque, les pays dont les banques sont très présentes en Italie sont également concernés. C'est le cas de la France dont les banques (BNP Paribas, Crédit Agricole, BPCE et Société Générale) sont exposées à hauteur de 12,4 % du PIB français dans la péninsule, beaucoup plus que les banques allemandes. On se rappelle qu'en 2011 les attaques spéculatives contre l'Italie, qui d'ailleurs n'aboutiront pas, était conçues comme prélude à une offensive contre les banques françaises très exposées dans la péninsule.
Encore une fois, l'Italie (PIB : 1 900 milliards d'euros), ce n'est pas la Grèce (PIB : 350 milliards d'euros). Si les instances européennes y appliquent la méthode de résolution des problèmes utilisée en Grèce, il y a du souci à se faire.
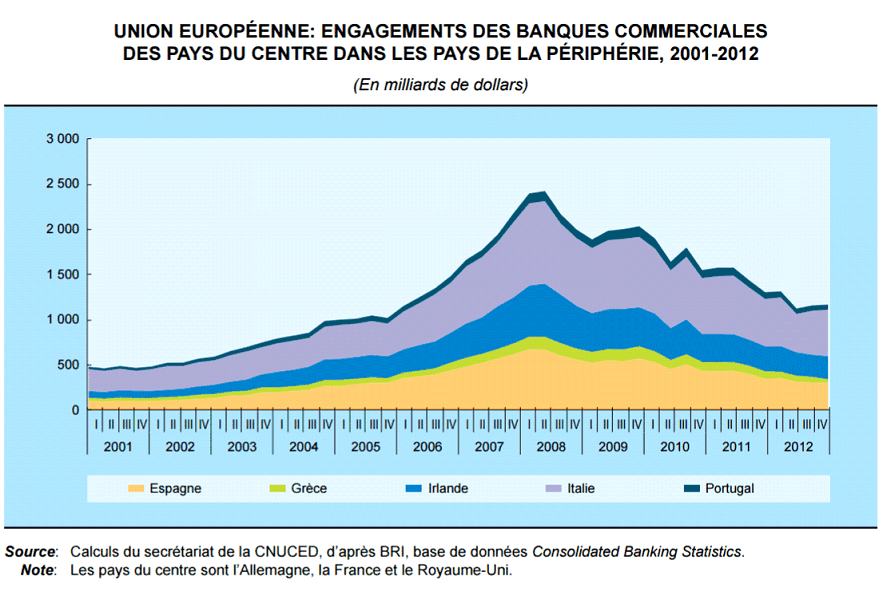
• Au Portugal , les problèmes n'ont pas manqué non plus, réglés jusque-là au coup par coup : Espirito Santo ; Banif ; Caixa Geral de Depósitos (CGD), la principale banque du Portugal (22 % des prêts du pays) qui aurait besoin d'une recapitalisation de 4 milliards d'euros, soit 2,5 % du PIB portugais. Ce qui pose la même question d'une intervention publique qu'en Italie.
Le problème, c'est que si ces interventions de l'État portugais étaient acceptées par Bruxelles, elles risqueraient de faire douter de la capacité du pays à poursuivre le remboursement de l'aide d'urgence de 78 milliards d'euros consentie par la Commission en mai 2011 contre un plan de rigueur qui a été suivi. Les remboursements devaient s'échelonner jusqu'en 2026.
Cela risque aussi d'augmenter une dette qui se montait déjà à 130 % du PIB fin 2015, avec ce que cela signifie en termes de spread et de déficit budgétaire (4,4 % en 2015).
Quant à l'économie portugaise et au taux de chômage passé de 8 % en 2007 à 12,3 % en 2015...
• En Espagne , le scandale Bankia, produit de la réunion de plusieurs caisses d'épargne, banque introduite en bourse puis sauvée par l'État, n'est pas terminé et la crise immobilière continue à peser sur des bilans qui s'enrichissent de créances plus que douteuses. Pour l'heure cependant, la tendance est clairement à l'optimisme avec ce qui ressemble à un redémarrage économique.
• Mais les banques du sud de l'Europe ne sont pas les seules à connaître des problèmes. En Autriche , Hypo Alpe Adria (HAA) est en grave difficulté depuis 2014 à cause d'une de ses filiales spécialisée dans les investissements à risque. Après une aide de 5,5 milliards d'euros, l'État autrichien a cessé ses interventions à fonds perdus. Le problème, ce sont ses liens avec des banques allemandes : Düsseldorf Hypotherkenbank, BayernLB et Dexia Kommunalbank.
Déjà, en pleine crise (avril 2009), un rapport secret du BaFin allemand, l'autorité de surveillance des marchés en Allemagne, était rendu public évaluant les actifs toxiques des seules banques allemandes... à 816 milliards d'euros, au grand dam du gouvernement de Berlin. Outre Deutsche Bank, il n'est pas sûr que le système bancaire allemand, notamment les Länder Banks, ait traversé la crise sans cicatrices.
Surtout, les banques les plus dangereuses, ne sont pas celles qu'on attendrait, celles des « pays du club Med » pour reprendre une expression qu'affectionnaient les média du Nord au moment de la crise grecque, mais HSBC, Crédit Suisse et surtout la première banque d'Allemagne, la Deutsche Bank.
Au terme de cette revue de détail de l'Europe bancaire qui n'est guère rassurante, la France et son système bancaire font figure, par comparaison, de havre de stabilité... Avec des ombres qui ne sont pas accessoires, comme l'insuffisance manifeste de fonds propres et leurs engagements qui s'avèrent à risque en Italie, après la Grèce. À cela s'ajoutent diverses affaires à rebondissement aux États-Unis et même en France, avec l'affaire Kerviel et la contestation possible du dégrèvement fiscal qui en est résulté. En même temps, la tendance est à la baisse des effectifs depuis la crise, régulièrement ponctuée de plans de réduction du personnel et de fermetures d'agences. Au vu, notamment, des perspectives offertes par les Fintech, le chiffre non étayé, d'une possible baisse de 60% des effectifs circule.
« Ces Fintech, nous dit Jérôme Glachant, professeur des Universités en sciences économiques 175 ( * ) , c'est simplement l'irruption des nouvelles technologies de l'information dans le domaine bancaire et financier. Elles attaquent un secteur particulier qui est une industrie de service reposant sur la confiance et la capacité à traiter l'information. Le secteur financier en général doit pouvoir utiliser cette technologie pour pouvoir améliorer son efficacité.[...]
« Le phénomène en France est cinq à dix fois moins important qu'aux États-Unis. Les Fintech s'attaquent à des segments du type "la banque privée" : des robots-conseillers qui cherchent à capter l'épargne et ensuite à donner des conseils en épargne à bas coût à des particuliers qui cherchent à placer leur argent, notamment des contrats d'assurance servant de support à ces placements d'épargne. Aux États-Unis, cela s'est beaucoup développé : en 2015, le leader gagnait 10 % d'encours tous les mois. [...] Autre exemple : les plateformes de crowdfunding. [...] Donc, petit à petit, une fraction de l'épargne est allouée de manière désintermédiée, en dehors du système bancaire. »
Graphique 1
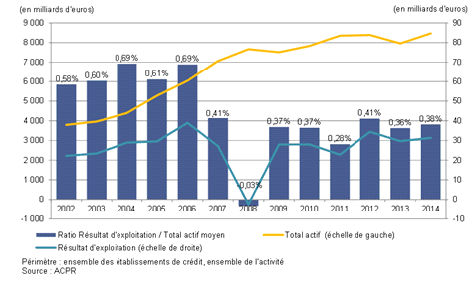
Le graphique 1 montre la croissance continue des actifs avant et après crise, même si la croissance après crise est moins forte qu'avant. Il montre aussi un rétablissement des résultats de l'activité.
Les graphiques 1 et 2 illustrent le fait que le maintien du produit net bancaire nécessite une augmentation des actifs, ce qui est un facteur de fragilisation.
Graphique 2
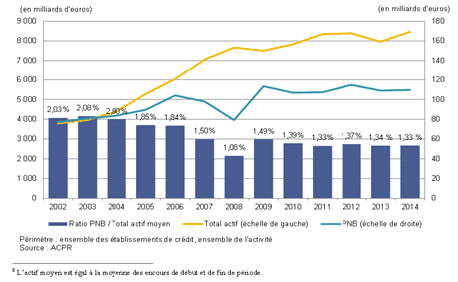
Pour conclure et globalement, à en croire les rapports de la BCE 176 ( * ) et du FMI 177 ( * ) , organismes pourtant fonctionnellement optimistes, loin de se réduire, les risques de déstabilisation du système financier européen et mondial ont augmenté au cours des dernières années .
• Pour la BCE , même si « les tensions systémiques restent contenues dans la zone euro », par rapport à novembre 2015, « la plupart des risques se sont accrus ».
Commentant les résultats des stress tests auxquels la BCE a soumis les cent trente plus gros établissements bancaires européens, Jézabel Couppey-Soubeyran conclut 178 ( * ) : « Je partage votre inquiétude sur la question. Je pense que beaucoup d'acteurs, la Banque centrale européenne elle-même, ont surestimé la capacité de résilience des banques européennes. »
• Dans son rapport d'avril 2015 qui concerne la planète, cette fois, faisant une balance entre les événements d'évolution favorables et défavorables, le FMI conclut, lui aussi, que « les risques qu'ils font peser sur la stabilité financière se sont accentués ».
Il faut dire que, malgré les apparences, les grandes banques américaines ne seraient pas plus sûres que les banques européennes. Selon le Wall Street Journal , à l'issue des tests annuels de résistance, les régulateurs auraient, en effet, estimé que la moitié des huit plus grandes ne pourraient faire face à une crise sans l'intervention des pouvoirs publics 179 ( * ) .
Mais à part ça...
F. SISYPHE RÉGULATEUR
La crise de 2008 a remis en question le mouvement de dérégulation de ces quarante dernières années de libéralisation. Les déclarations des G20 de 2008 et 2010 sont particulièrement martiales.
Sauf que vouloir réguler un système conçu pour favoriser une spéculation rémunératrice sans empêcher celle-ci relève de la quadrature du cercle. D'autant plus qu'un tel système est toujours censé être autorégulateur. Dans l'intention, il s'agit d'empêcher les excès du système pour mieux le conserver, ce que précisément firent les New Dealers et les reconstructeurs européens d'après-guerre qui, eux, ne tenaient pas les marchés pour autorégulateurs, avant d'être désavoués.
On voit bien la contradiction si, comme dit Alain Minc, « on ne peut pas penser contre les marchés », pourquoi les empêcher d'aller au bout de leurs pensées ?
D'où la situation intenable du régulateur dès lors qu'il accepte de s'inscrire dans cette contradiction. Jean-Michel Naulot nous dit : « Quand vous faites un texte réglementaire au niveau national ou européen, vous avez toujours une étude d'impact. Il y a plusieurs manières de la lire : ou bien vous essayez de voir si vous n'avez pas fait d'erreurs, si vous n'êtes pas en train de faire une bêtise, ou bien vous vous demandez si cela va réduire le business. Si votre contrainte est « il ne faut surtout pas réduire le business - les banquiers utilisent le terme passe-partout de "liquidités" -, si vous ne voulez pas toucher au volume d'affaires, alors vous êtes sûrs de ne pas faire de réforme ! »
Cette première contradiction - vouloir réguler en laissant intacte la machine à faire du business - est en plus renforcée par une difficulté bien réelle : l'impossibilité de prévoir où sera la prochaine faille du système de régulation. « Aujourd'hui, on met en place des normes qui vont permettre d'éviter la crise d'hier » nous dit Gunther Capelle-Blancard 180 ( * ) .
La créativité du système financier n'est jamais prise en défaut, notamment quand il s'agit de faire disparaître des bilans - partie émergée de l'iceberg - les engagements des banques. Ainsi, le « partenariat » avec des investisseurs institutionnels (assurances, fonds d'investissement privés, hedge funds ), permettant à ceux-ci d'investir, directement ou indirectement, par des fonds spécifiques dans l'économie, avec la bénédiction des gouvernements, alors qu'ils devaient se limiter jusque-là à des placements non risqués...
Le problème c'est qu'actuellement, ils ne rapportent plus grand-chose.
Sisyphe-régulateur est donc toujours en retard d'un rocher à remonter, en même temps que sous la pression du lobby bancaire.
1. Le lobby bancaire et sa rhétorique
Jézabel Couppey-Soubeyran, dans son livre Blablabanque 181 ( * ) , analysant la rhétorique du lobby bancaire relève trois types d'arguments mobilisés pour justifier qu'on ne touche pas à un système qui fonctionne parfaitement tout seul :
- l'effet pervers , le remède serait pire que le mal. Les chercheurs font souvent assaut d'ingéniosité, nous dit-elle, pour repérer ces possibles effets pervers sans toujours se rendre compte de l'usage qui sera fait de leurs arguments. Ainsi, les ratios de fonds propres imposés par Bâle III, dont on a vu ce qu'il faut en penser, sont censés dissuader les banques de prêter aux entreprises (on a vu aussi l'entrain qu'elles y mettent), l'alourdissement des contraintes imposées aux banques profiter au shadow banking (comme s'il n'était pas déjà un sous-produit de l'activité bancaire) ;
- l'inanité : cela ne sert à rien, puisque de toute façon la mesure sera tournée, sinon détournée ;
- la mise en péril : cela va casser quelque chose. Très à la mode, la mise en péril de la croissance, comme si, encore une fois, c'était la première préoccupation du système bancaire. En revanche, effectivement, le rendement des activités à caractère spéculatif risque d'être diminué... Mais c'est précisément le but de la régulation !
« Les banques ne veulent pas que l'on décèle leurs dérives, les universitaires sont peu nombreux sur le sujet et n'ont pas intérêt à le faire s'ils sont bien insérés dans le système. On ne fait pas carrière en éclairant le citoyen. » 182 ( * )
Mais, ce qui fait la force du lobby bancaire, ce n'est pas seulement ses capacités rhétoriques et son chantage à la stagnation économique si on osait le contrarier, c'est aussi sa porosité avec les pouvoirs en général , médiatiques, économiques et politico administratifs.
On le constate évidemment aux États-Unis et sur les sommets de l'Europe particulièrement encombrés d'anciens ou de futurs collaborateurs de Goldman Sachs et en relation directe avec le lobby bancaire durant les périodes où la BCE définit sa politique monétaire, comme l'a « révélé », si l'on peut dire car c'est un secret de Polichinelle, le New York Times récemment 183 ( * ) . S'en est suivie une série de gesticulations sur la communication, licite ou non, de la BCE évacuant le problème de fond : un cénacle de financiers en charge de l'intérêt général peut-il être indépendant du monde de la finance ? Poser la question ainsi serait, y répondre.
On le constate en France, où la noblesse d'État a élevé le « r evolving doors » avec le système financier au rang d'un des beaux-arts. Au nom de la compétence évidemment. Compétence, cependant qui ne va pas jusqu'à la capacité à prévenir les crises et à en soigner les effets économiques et sociaux quand elles leur ont échappé.
Tout cela bien sûr dans le strict respect de règles déontologiques spécialement conçues pour éviter tout soupçon de conflit d'intérêt.
Ce « mal français », note Gunther Capelle-Blancard, qui ne concerne pas seulement la finance, l'a gagné plutôt tardivement : « L'évolution est notable depuis les années 1980. La finance employait alors des personnes à peine diplômées. Quoi qu'on en dise, échanger des titres, c'est bête et méchant. Sauf que cela rapporte beaucoup d'argent : d'où une grande sélection par la suite. C'est la reproduction de classe. On en a fait des stars, avec le côté créatif de la finance. »
2. Les stratégies de neutralisation et de contournement
Quand la demande publique de régulation est trop forte, reste à essayer de neutraliser les réformes dès leur conception et ensuite lors de leur mise en oeuvre, en retardant le plus possible leur entrée en vigueur, par un choix judicieux de ce qui fera l'objet de la réforme, de qui l'appliquera et avec quels moyens. Il ne faut en aucun cas toucher à l'essentiel : la remise en cause de l'oligopole bancaire et la réduction des moyens de faire du business .
a) La fiction commode de l'autorégulation
Une manière la plus parfaite de contourner la contradiction entre le principe des marchés autorégulés et l'existence de régulateurs, c'est de demander au régulé d'être le régulateur .
Ainsi pour l'application de Bâle III, ce n'est pas le régulateur qui fixe les règles de pondération des risques, mais chaque banque, selon son propre système de calcul ! Ce qui donne des écarts très importants entre banques. Une bonne partie de la réforme a ainsi été vidée de sa substance, les banques pouvant diminuer par deux ou trois leurs besoins en fonds propres.
Tant que ce ne sera pas un régulateur réellement indépendant qui définira les normes, ces pseudo-contraintes seront inopérantes.
b) Des autorités de contrôle aux moyens limités
Conformément à la doctrine, l'État ne pouvant intervenir directement dans le fonctionnement des marchés, leur régulation est très largement confiée à des autorités administratives indépendantes, indépendantes de l'État mais très rarement du monde de la finance. Au nom de la compétence évidemment. Si la Sec 184 ( * ) est composée de personnalités liées au pouvoir politique, ce qui est un comble pour un pays censé plus libéral que la France, dans notre pays la régulation est éclatée entre deux autorités administratives - AMF et Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - et un Haut conseil à la stabilité financière, plus politique puisque placé auprès du ministre de l'économie et des finances chargé de surveiller la stabilité du système financier.
Ces autorités, même le HCSF, sont composées essentiellement de personnalités dont le métier est la finance et de membres de la noblesse d'État, ce qui est le cas de la plupart des autres AAI 185 ( * ) .
Dire cela n'est pas minimiser leur travail qui est énorme, notamment celui de l'AMF, encore moins mettre en doute leur probité mais souligner la modestie de leurs moyens, l'étroitesse de leurs marges de manoeuvre légale et plus encore le frein inévitable que constitue une trop grande proximité intellectuelle et sociologique avec ceux qu'ils doivent contrôler. Quand on est persuadé que le plus important c'est que tourne la machine financière, sans jamais douter que là est l'intérêt collectif, il ne faut pas s'étonner de la modestie des résultats obtenus.
Pour prendre un exemple, l'Autorité des marchés financiers s'appuie sur l'expertise de quatre cent soixante-dix collaborateurs pour veiller à la protection de l'épargne investie en produits financiers, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés, tout en apportant son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international.
« Tous les jours, sur le marché secondaire, des milliards d'euros sont échangés sur Euronext à Paris ou à Amsterdam, ou à Bruxelles ou à Lisbonne », nous a précisé le président de l'AMF, Gérard Rameix 186 ( * ) . « Nous sommes en capacité de vérifier l'exactitude des informations émises. De plus, nos ordinateurs reçoivent toutes les transactions, tous les ordres donnés à l'achat, à la vente. À la même heure, des échanges peuvent être effectués sur une plateforme à Londres. En ce cas, nous pouvons obtenir de nos collèges britanniques des éléments d'information. Dans l'ensemble, nous avons une assez bonne visibilité, ce qui ne veut pas dire que nous vérifions chaque transaction. Une cellule de surveillance peut poser des questions et une enquête est susceptible d'être ouverte en cas d'incohérences. » Certes, mais cette visibilité est-elle suffisamment large et surtout permet-elle de repérer les mouvements de fond susceptibles de déboucher sur une crise majeure ? On peut en douter.
Ce qui frappe aussi, c'est la dépendance des régulateurs aux informations fournis par les régulés.
À la question : « Avez-vous les moyens de vérifier la fiabilité des informations qui vous sont transmises ? », Gérard Rameix répond que l'AMF n'est pas responsable des informations qui lui sont transmises, ajoutant : « Si l'on s'aperçoit qu'une information diffusée par un émetteur est erronée ou incomplète, nous effectuons des diligences auprès de l'émetteur pour nous assurer du respect de la réglementation. En revanche, nous n'exerçons pas les missions des auditeurs au sens comptable. Nous interrogeons les commissaires aux comptes en tant que de besoin. Il n'appartient pas à l'AMF de vérifier en détail les éléments comptables ou de considérer que tel ou tel bilan présente des inexactitudes. Ce qui est essentiellement vérifié, c'est que les documents d'information à destination du public concernant un émetteur ou un produit financier respectent la réglementation applicable . [...] L'AMF n'est pas juge de l'opportunité des opérations financières, notamment des introductions en bourse. Lorsqu'elle octroie un visa, l'AMF vérifie que le document d'information est complet et compréhensible et que les informations qu'il contient sont cohérentes. Le visa de l'AMF n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération ni authentification des éléments comptables et financiers présentés » 187 ( * )
Apparemment, seul le HCSF, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances et qui se réunit trois à quatre fois par an, peut intervenir directement pour corriger, sinon stopper, des processus spéculatifs en cours. Ainsi le gouverneur de la Banque de France, membre du HCSF, peut-il « proposer de demander aux banques qui financent l'immobilier, en cas de bulle, de provisionner une partie de leurs crédits afin de freiner le financement de l'immobilier. » Nous ignorons si le cas s'est présenté.
c) Gagner du temps
C'est l'un des moyens les plus efficaces de vider les intentions réformatrices de leur contenu le plus urticant. Le meilleur exemple est certainement celui de la réforme ambitieuse de la loi Dodd-Frank, ambitieuse car elle envisageait une réforme des institutions de contrôle, des banques, des marchés, une nouvelle protection des consommateurs, etc. Ambitieuse, puisque prévoyant des dispositions comme l'obligation pour les banques de conserver dans leur bilan 5 % des crédits titrisés, une définition stricte des fonds propres avec l'obligation pour les établissements systémiques d'un levier d'endettement au maximum de 15, l'obligation pour les banques de présenter un plan de solution (testament) en prévision d'une crise, la supervision des agences de notation par la Sec, etc.
Mais qui trop embrasse, mal étreint. Au final, la loi de 848 pages au départ, après concertation avec les intéressés, s'est transformée en un texte de 2 300 pages. Au terme de six ans, au moment où Barack Obama va quitter la Maison-Blanche, le quart des quatre cents dispositions du texte n'est pas encore applicable... Et Donald Trump, qui a fait campagne sur ce thème, va l'abolir !
Il en va partout ainsi, plus le temps passe, les menaces de crise ont beau rester les même, plus l'urgence à réguler faiblit.
3. Des réformes en trompe-l'oeil
Au fil des années, la liste des organismes de supervision, de coordination, les directives et réglementations, les lois mêmes n'ont pas manqué, pour un résultat limité si leur objectif était de réduire significativement l'instabilité du système financier, tout à fait satisfaisant s'il s'agissait de préserver la liberté de manoeuvre du système financier de faire du business , pour reprendre l'expression de Jean-Michel Naulot.
a) Les réformes essentielles en stand-by ou dévitalisées
Mis à part au Royaume-Uni et encore, nulle part la séparation des banques commerciale des banques d'investissement n'a été réalisée. À en juger par ce qui est en train de se passer aux États-Unis, la tendance est plutôt à la retraite.
S'agissant de la résilience des établissements, on a vu aussi les limites théoriques et pratiques de Bâle III. Même si les États-Unis ont été plus rigoureux, apparemment les résultats aux tests de résistance sont moins brillants que ne le laissaient supposer des ratios de levier meilleurs que ceux des banques européennes. Ne serait-ce que parce que l'on ne tient pas compte des engagements réciproques des établissements systémiques entre eux, à l'origine pourtant des catastrophes majeures comme on l'a vu avec Lehman Brothers.
S'agissant de la titrisation, dont on a observé les effets dans la crise des subprimes , non seulement elle ne recule pas dans les pays anglo-saxons mais l'Europe voit dans cette pratique un moyen pour les banques ou les entreprises de se procurer de la liquidité.
Elle a été entendue. Un exemple, l'émission en avril 2014 par cinq banques française - BNP Paribas, BPCE, le Crédit Agricole, HSBC France et Société Générale - de 2,65 milliards d'euros de titres adossés sur des crédits accordés aux entreprises. Par ailleurs, BNP Paribas réfléchit à la titrisation de ses financements de matières premières, qui comprennent les lignes de crédit accordées aux gros courtiers comme Glencore, installés en Suisse. On le voit, les projets de titrisation ne se limitent pas au financement du secteur productif, mais concernent de nouveau des opérations de nature spéculative !
Quant à la régulation des hedge funds , on l'attend toujours. Pourtant, elle serait indispensable, notamment la limitation de leur « effet de levier », c'est-à-dire le montant des actifs que peuvent détenir ces fonds, par rapport à leurs fonds propres. Jean-Michel Naulot propose de le limiter à 5 alors qu'il est largement plus élevé. Aujourd'hui encore, 12 % des hedge funds britanniques - domiciliés la plupart du temps dans des paradis fiscaux - ont des effets de levier supérieurs à 50 ! Oublié qu'en mars 2008 un modeste hedge fund avec un effet de levier de 31, Carlyle Capital (qui gérait 670 millions de dollars), a entraîné dans sa chute la banque d'investissement américaine Bear Stearns à laquelle il avait emprunté 21 milliards de dollars !
Aux États-Unis, à peine rédigée, la réglementation issue de la loi Dodd-Frank risque fort d'être mort-née.
b) L'Union bancaire et l'Union des marchés de capitaux
La mise en chantier d'une Union bancaire assortie d'une Union des marchés de capitaux (UMC) se veut une réponse « ambitieuse » à la sécurisation du système financier européen.
Constatons qu'à peine nés l'Union bancaire et le nouveau mode de résolution ( bail-in ) viennent d'être remis en cause par la décision de l'État italien d'intervenir à hauteur de 20 milliards d'euro pour sauver les banques de la péninsule.
Constatons aussi que l'UMC est plus une harmonisation des règlements nationaux relatifs aux marchés de capitaux et recherche de financement alternatifs de l'économie qu'une régulation destinée à éviter les crises.
• Le mécanisme de supervision unique (MSU)
C'est le premier volet de l'Union bancaire. Entré en vigueur en janvier 2014, il a été confié à la BCE qui se trouve ainsi en charge de la supervision de deux cent soixante banques dont cent trente transnationales, soit 30 000 milliards d'euros d'actifs.
Ainsi, comme nous l'avons évoqué, une vague de stress test s auxquels ont été soumis les cent trente établissements transnationaux a-t-elle été lancée. Commentant ses résultats, Jézabel Couppey-Soubeyran nous a dit 188 ( * ) : « L'exercice a été mené avec sérieux. Pour autant, la BCE a masqué quelques résultats inquiétants notamment en matière de capitalisation des banques. Elle s'est appuyée sur le ratio réglementaire, lequel permet l'évaluation de la capitalisation des banques, c'est-à-dire de leur capacité d'absorption des pertes en cas de difficulté. » Or, les ratios réglementaires issus de Bâle III, pondérés par les risques que les banques estiment avec leurs modèles internes, permettent à ces dernières d'afficher un niveau de solvabilité très supérieur à celui qu'elles obtiendraient avec un ratio simple, non pondéré par les risques. En clair, le ratio réglementaire embellit la situation. De plus, les modèles de pondération des actifs sont très variables d'un établissement à l'autre, ce qui rend les évaluations faiblement comparables entre elles et ne permet pas de dégager une vision globale de l'état du système.
Autre problème, les tests de résistance permettent seulement d'apprécier la solidité des établissements pris un par un alors que c'est l'extraordinaire interdépendance du système bancaire qui crée le risque systémique. Comme le fait remarquer Martine Orange 189 ( * ) , quand la banque américaine Lehman Brothers a fait faillite, elle avait un niveau de fonds propres correspondant à 11,5 % de son bilan. Mais la multiplicité de ses engagements et de ses contreparties ne permettait pas d'évaluer réellement ses risques. Le refus unanime d'instaurer une réelle séparation entre banques de dépôts et d'investissement est la preuve que l'on n'est pas près de régler le problème.
Enfin, le constat une fois fait de l'insuffisance de fonds propres ou la présence d'un volume trop important de créances douteuses dans les bilans, comme ce fut le cas, on l'a vu, de neuf des quinze banques italiennes testées, que se passe-t-il ? Pas grand-chose !
• Le mécanisme de résolution unique (MRU) et le fonds de garantie des dépôts européen
« Bail-in » ou « bail-out », telle est la question ? Autrement dit, en cas de faillite, faut-il faire payer l'État, comme ce fut largement le cas durant la crise, ou les créanciers de la banque, y compris les déposants, créanciers à titre gratuit ? Rappelons pour mémoire que le montant des aides publiques au secteur bancaire et financier a été de 1 616 milliards d'euros (13 % du PIB de l'Union européenne) entre octobre 2008 et le 31 décembre 2011 (chiffres cités par Martine Orange et rapport sénatorial).
Voté le 15 avril 2014, le MRU est une institution relativement indépendante puisqu'il garde un lien avec la BCE et qu'il doit rendre des comptes au Parlement européen. Il est constitué d'un conseil de résolution unique et d'un fonds de résolution commun financé par le secteur bancaire.
Après le traitement massif des faillites bancaires par l'injection lourde de capitaux des États ( bail-out ) et dont on sait qu'elle aura du mal à être répétée en cas de crise majeure, la mode est désormais au bail-in , autrement dit au sauvetage par les apporteurs de crédits, les déposants et les détenteurs de titres subordonnés 190 ( * ) . En revanche, il n'est pas prévu de mettre à contribution les bonus des managers auxquels on doit une partie au moins du problème. Un oubli sans doute.
Cette technique utilisée la première fois lors de la crise chypriote est désormais inscrite dans la loi bancaire française, l'État ne garantissant plus les dépôts au-dessus de 100 000 euros contre 200 000 dollars aux États-Unis et ensuite une aide dégressive ; disposition dont il n'est pas sûr que les clients des banques aient saisi toute la portée.
Le choix qui a été fait semble imparable. Or ce n'est pas le cas et la crédibilité de la solution choisie n'est pas assurée. Le choix de mettre à contribution les déposants en cas de problème n'était pas le seul possible.
On aurait pu commencer par sécuriser le système en imposant aux banques des ratios de fonds propres beaucoup plus élevés et en leur interdisant de spéculer avec l'argent qu'elles créent ou celui des autres. Pour Maurice Allais : « On n'empêchera jamais la spéculation , mais il faut que les spéculateurs spéculent avec leur argent, pas avec celui des autres. » Ce n'est pas le choix qui a été fait. Non seulement les banques pourront continuer, sans qu'ils le sachent, à spéculer avec l'argent des déposants mais ceux-ci devront assumer une partie du risque, à hauteur de 8 % des besoins, en payant pour ça vu la poussée des frais bancaires ! Il n'est pas certain, d'ailleurs, que cette mesure mise en application depuis janvier 2016 en vertu de la loi Moscovici, soit connue des intéressés qui devront se consoler en pensant que pour les Chypriotes la ponction variait de 37,5 % à 60 %.
Il n'a pas non plus été question, évidemment, de donner à la BCE les capacités d'intervention de la Fed, en cas de crise, ni même d'étendre le rôle du MES. Côté institutionnel européen, tout étant bloqué, on devra se contenter de bricoler. Mais sera-ce suffisant, sera-ce même un progrès vers la stabilité ? Difficile d'en être convaincu.
Après la question de la pertinence du choix de cette solution, se pose en effet celle des incertitudes quant à sa capacité réelle de stabilisation du système financier.
Par exemple, non seulement la mise à contribution des déposants et de certains des propriétaires d'obligations subordonnées, véritables placements de « père de famille » - comme on l'a vu lors de la faillite récente de quatre banques régionales italiennes - ne représente pas un modèle de justice mais d'autres banques étant souvent propriétaires de ces obligations subordonnées, le risque de propagation de la crise par ce canal s'en trouve augmenté.
Que penser aussi des dépôts des trésoreries des entreprises et de l'ensemble des opérations de placement de leurs excédents de trésorerie ponctuels ? Outre les risques de retraits préventifs, il y a ceux de mise en difficulté des entreprises elles-mêmes.
Pour faire face à la crise éventuelle, comme d'ordinaire, est prévu un mécanisme dont la complexité peine à masquer les insuffisances. Pour faire simple, outre diverses dispositions réglementaires, disons qu'il comprend deux volets :
- un dispositif destiné à renforcer les capacités de renflouement interne ou « mécanisme relatif à la capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) » qui ressemble fort à un renforcement d'exigences de fonds propres (de l'ordre de 6 %) souffrant des mêmes défauts que ses semblables ;
- un fonds de résolution unique (FRU) alimenté par les banques devant atteindre 1 % des dépôts garantis de l'ensemble des banques européennes, soit 55 milliards d'euros, à l'horizon de huit ans. Cette mutualisation ne sera que progressive à partir de « compartiments » nationaux. Chiffre à comparer au 34 000 milliards d'euros que représentait le total des bilans des banques de la zone euro, soit 3,5 fois le PIB de la zone !
En termes très diplomatiques, Richard Yung indique ceci dans un récent rapport d'information sénatorial : « L'Union bancaire a significativement progressé mais se trouve dans une situation déséquilibrée où les progrès de la mutualisation de la supervision et de la résolution se heurtent à une mutualisation du financement encore trop embryonnaire. L'asymétrie entre le substantiel transfert de souveraineté qui a été consenti et le financement qui reste encore en grande partie national ne peut perdurer sans mettre en péril la crédibilité de l'Union bancaire. » 191 ( * )
Comme remarque par ailleurs André Sapir 192 ( * ) , chercheur associé au think-tank Bruegel : « Le système n'est pas toujours très cohérent et encore en phase de transition. En gros, il y a le fonds européen de résolution et chaque État a son petit casier, ce qui à terme n'est pas viable. »
Quoi qu'il en soit, à voir la taille des bilans des banques européennes et particulièrement ceux des grandes banques systémiques, en l'absence d'un prêteur en dernier recours qui ne peut être que la BCE ou un MES doté de moyens propres suffisants, qui peut croire à la fiabilité de cette construction ? Croire même que la garantie des dépôts jusqu'à 100 000 euros pourra être assurée sans intervention des États ? Où l'on retrouve toujours le même problème : à ne pas séparer la protection des déposants de celle des banques à finalité spéculative, on le rend insoluble.
Autre problème, la manière de concevoir et d'organiser la résolution.
L'idée, en cas de problème, c'est de séparer l'établissement bancaire touché en deux : d'un côté, l'équivalent d'une « bad bank » avec les actifs douteux, le capital propre et une partie des obligations préalablement identifiée (le matelas supplémentaire de protection ou TLAC) ; de l'autre, l'actif de qualité et au passif l'autre partie de la dette pour poursuivre une activité bancaire. Cela s'appelle sauver les meubles mais pas vraiment assainir.
La lourdeur et le caractère très formaliste de la mise en oeuvre du dispositif alors que chacun sait qu'en cas de crise, le risque systémique doit être géré dans l'urgence et le secret, avec l'appui de la Banque centrale n'est pas non plus de nature à rassurer.
c) Le système européen de supervision
Abondance de bien ne nuisant pas, outre la mécanique de l'Union bancaire et de l'Union des marchés de capitaux, a été mis en place un système européen de supervision avec la création d'une Autorité bancaire européenne (ABE), d'une Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), d'une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et du Comité européen du risque systémique (CERS).
Une refonte des réglementations prudentielles applicables aux banques et aux marchés a été engagée.
Parmi la vague de directives qui ont été prises, la directive et le règlement relatifs aux marchés des instruments financiers (Mifid et Mifir) adoptés en avril 2014 sont les plus intéressants en ce qu'ils prévoient l'obligation de faire transiter les opérations sur les produits dérivés par des chambres de compensation.
Mais, selon Jean-Michel Naulot, seuls seront concernés 40 % des produits dérivés : toutes les opérations de change vont rester en dehors de ce système, tout comme les dérivés de matières premières, les produits « non liquides ». Au lieu de généraliser cette obligation, on a choisi une solution entre deux alors que 92 % des produits dérivés aujourd'hui sont traités entre acteurs financiers, ce qui permet de relativiser leur intérêt pour l'économie ! C'est-à-dire entre des « asset managers », des banques et des hedge funds . « Si on veut rétablir l'équilibre entre l'économie réelle et la finance, nous a dit Jean-Michel Naulot, il va falloir réduire ce business ! Et le marché ne va pas pour autant s'effondrer. Au contraire, il sera beaucoup plus résilient, comme dans le passé. Jusque dans les années 1970-1980, l'économie était parfaitement financée. Et le système était beaucoup moins fragile. »
Au terme de cette revue des illusions perdues, ne nous reste plus qu'à imaginer le Sisyphe régulateur aussi heureux que celui de Camus.
*
En 2012, le rapport Liikanen mettait en exergue sept grands problèmes affectant le secteur bancaire européen : la prise de risque reste excessive, les banques sont trop complexes et trop grosses pour être véritablement contrôlées, le système est fragile et encore sous-capitalisé, la supervision reste faible, l'interconnexion des mastodontes bancaires crée un risque systémique pour l'économie tout entière, il existe de fortes distorsions de concurrence et le niveau de régulation européen reste trop faible. Cinq ans plus tard, il ne semble pas que les choses aient beaucoup changé.
S'agissant du système financier britannique, le coup passa si près que l'effort de recapitalisation effectué et une réglementation plus stricte l'ont rendu plus résilient.
Quant au système étasunien, son caractère moins oligopolistique que le système européen malgré de très grandes banques, son niveau moyen de fonds propres sûrs plus élevé, une activité régulatrice dotée de plus de moyens laisseraient à penser qu'il a gagné en stabilité, n'était l'importance de la production de dérivés et des activités spéculatives.
II. CRISE DE LANGUEUR ÉCONOMIQUE
«
L'économie a souffert de la crise, le
secteur bancaire non.
»
Jézabel
Couppey-Soubeyran,
maître de conférences en sciences
économiques
à l'université Paris I.
Les gouvernements et les banques centrales n'ont ménagé ni les réunions mondiales, régionales et locales, ni les lois et les règlements, ni les milliers de milliards pour sortir le système financier de l'embolie à laquelle son autorégulation l'avait conduit.
S'il n'est pas plus stable aujourd'hui qu'avant la crise, voire par certains de ses côtés encore moins, si les raisons d'inquiétude sont toujours là, constatons qu'après une baisse spectaculaire durant la crise la valeur des actifs bancaires a été largement reconstituée.
Pour les banques françaises, elle est passée de 7 000 milliards d'euros en 2007 à 8 500 milliards d'euros en 2014 (dont 6 037 milliards d'euros pour les quatre banques systémiques, chiffre de 2015).
L'activité sur les produits dérivés est toujours florissante au niveau mondial. L'encours notionnel des produits dérivés s'élevait à 625 000 milliards de dollars en 2012. De même, le shadow banking qui, comme son nom ne l'indique pas, se situe dans l'orbite des banques, aurait dépassé, selon le Conseil de stabilité financière, institution parente du G20, 67 000 milliards de dollars d'activité, ce qui équivaut environ à la somme des PIB de tous les pays de la planète.
« Bénéfices impressionnants » des banques américaines en 2015 peut titrer Le Monde le 21 janvier 2016. Les six plus importants établissements ont réalisé 91 milliards de dollars de bénéfices.
Les banques européennes apparaissent comme la seule véritable ombre au tableau. Moins profitables que leurs homologues américaines, leur valorisation bancaire, après une courte remontée en 2011, est retombée au niveau de la période de crise.
Il faut dire que l'existence de mastodontes en grande difficulté pèse lourdement dans ces résultats.
Tout cela n'est rien cependant à côté de l'état de l'économie.
A. UNE SORTIE DE CRISE EN TÔLE ONDULÉE
Après une crise, la période qui suit peut prendre trois formes.
• Une reprise économique forte
Elle permet plus ou moins rapidement de retrouver le niveau de croissance passé ; c'est ce que prévoit la théorie et qui s'est, au cas japonais près, réalisé jusqu'à ces dernières années.
• Un nouvel effondrement économique
Il survient après une période plus ou moins longue de redressement trop fragile pour durer. Cela pourrait être le cas de la Russie, qui connaîtra trois crises sévères entre 1998 et 2014.
Trop dépendante de ses exportations de matières énergétiques, elle retrouvera des taux de croissance largement supérieurs à 5 % entre 2000 et 2008, avant de pâtir de la crise mondiale en 2009 et de l'effondrement des cours du pétrole à partir de 2014.
Il n'est pas impossible non plus que la Chine ait du mal à se relever de la crise mondiale, qui a provoqué un effondrement de son taux de croissance en 2009. Cela reste la grande inconnue.
• Une interminable convalescence, dite en « tôle ondulée »
Elle se caractérise par une reprise de l'activité mais à un niveau en moyenne inférieur à celui de l'avant-crise, régulièrement ponctuée de baisses et de hausses, pouvant laisser présager, tantôt un nouvel effondrement, tantôt la fin de la crise.
C'est ce que vit le Japon.
C'est ce à quoi ressemble la situation actuelle de l'Europe et, quoique à un niveau moyen de croissance supérieur, celle des États-Unis.
Aux États-Unis, entre 2010 et 2015, les taux de croissance annuelle oscillent entre 2,5 % et 1,5 %. Ceux de la zone euro et de l'Union européenne à vingt-huit, entre 1 % et - 0,4 %, l'Union européenne à vingt-huit étant plus souvent proche du maximum que la zone euro.
Croissance en berne, sous-utilisation des capacités productives, haut niveau de sous-emploi, telles sont les caractéristiques de la situation.
1. Une croissance en berne
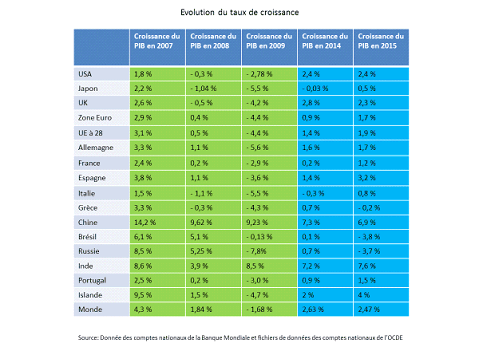
Globalement, dans tous les pays, la crise a entraîné une chute brutale du taux de croissance, dès 2008 et plus nettement encore à partir de 2009.
Celle-ci a été immédiatement suivie d'une reprise importante en 2010 - sauf cas particulier, comme la Grèce -, qui parfois se prolonge sur 2011 - France, Pays-Bas, Grande-Bretagne. On retrouve le modèle standard, la reprise suivant inéluctablement l'effondrement. On se souvient de cette déclaration au micro de RTL d'Éric Woerth alors ministre du Budget, le 26 septembre 2008 : « La crise est venue d'une manière extrêmement violente mais la reprise peut être extrêmement forte. »
En même temps l'inflation repart, la sortie de crise paraît acquise.
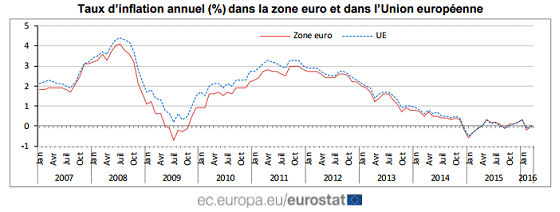
À partir de là, on entre dans une configuration nouvelle. Au lieu d'une confirmation de la reprise, contrairement aux prévisions, dès 2011, souvent et plus encore dans la zone euro en 2012, la croissance baisse de nouveau puis semble se stabiliser, et ce à un niveau inférieur à l'avant-crise pour l'ensemble des pays. Tous les pays industrialisés de l'OCDE sont concernés.
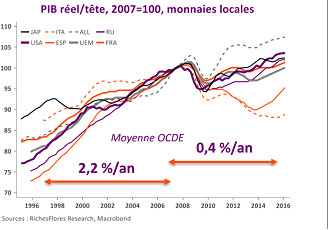
C'est probablement dans la zone euro que le phénomène est particulièrement net, zone euro qui a le plus de mal à se remettre de la crise. Cela dit, bien que restant à un niveau élevé - à la fiabilité des statistiques près -, le taux de croissance de la Chine a été divisé par deux, passant sous la barre des 7 %, considérée comme le plancher en deçà duquel le consensus politique de la modernisation lancée par Deng Xiaoping risquerait d'être remis en cause.
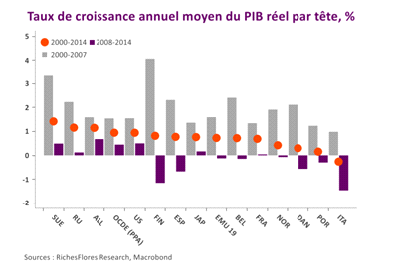
Le taux de croissance semble se caler sur celui du Japon, en déflation depuis 1990.
2. Une baisse de l'investissement et une sous-utilisation des capacités productives en Europe
Le graphique suivant, issu d'un rapport de la Banque européenne d'investissement publié en 2013 193 ( * ) , présente le taux d'utilisation des capacités de l'industrie européenne. Il s'agit de l'investissement total (y compris immobilier) et en machines et équipements productifs.
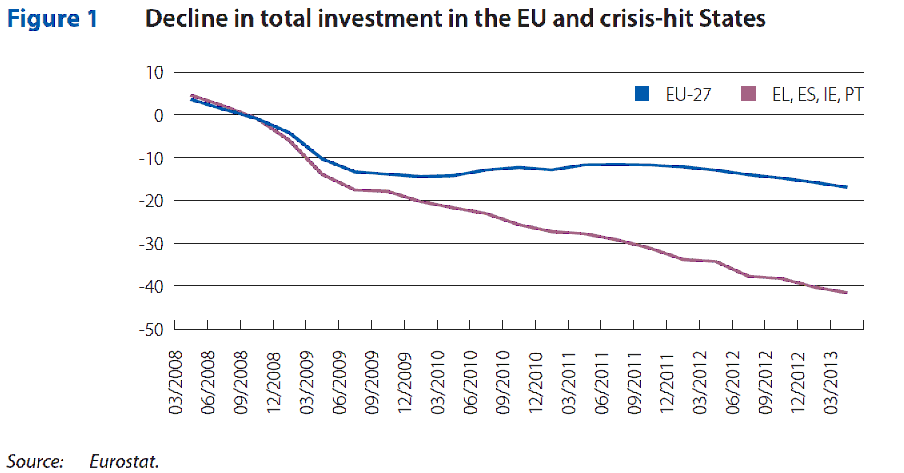
Le tableau ci-dessous, tiré d'une note de la Société Générale 194 ( * ) , illustre l'écart entre la production réelle et celle que permettrait le potentiel économique s'il était pleinement utilisé.
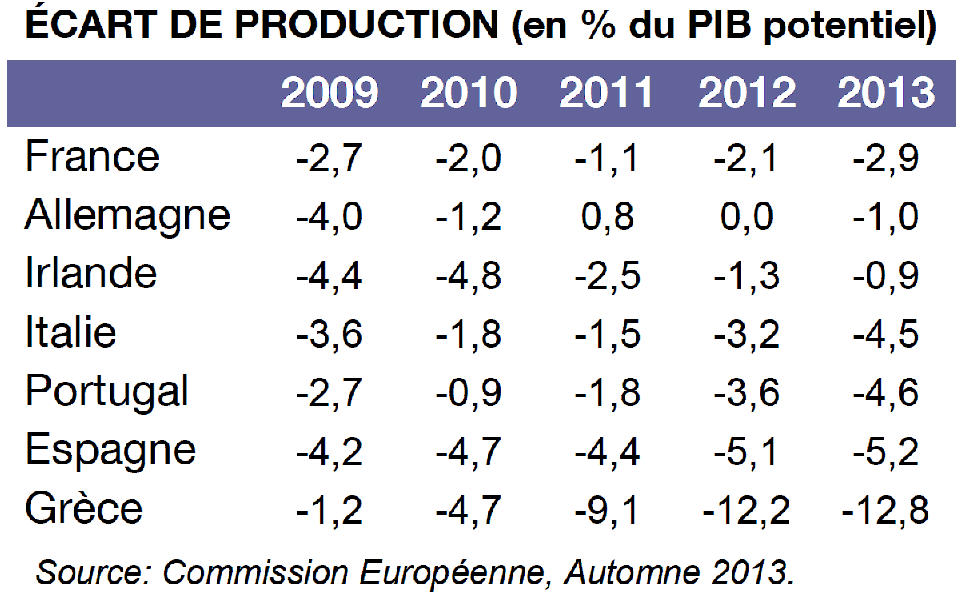
3. Des niveaux de chômage améliorés au prix du sous-emploi et d'une dégradation des conditions de travail
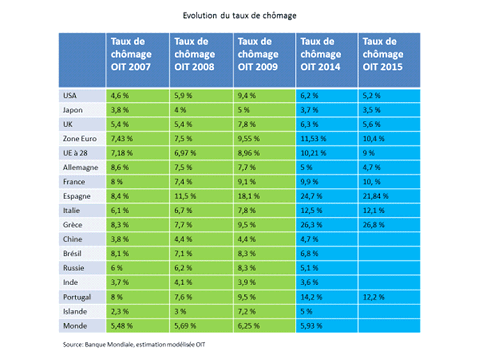
a) Quel niveau de chômage ?
Les taux de chômage officiels restent généralement plus élevés qu'avant la crise, quoique en réduction par rapport à leur point haut de 2007, avec des exceptions là aussi. Ils masquent des réalités non seulement moins brillantes mais encore plus contrastées.
Comme on s'en doute, en effet, les modes de calcul des taux de chômage, évidemment variables d'un pays à l'autre, présentent un certain nombre de biais, qui, s'ils ne faussent pas la perception des évolutions en tendance, minimisent fortement le nombre de personnes ne trouvant pas leur place sur le marché du travail et, donc, dans la société.
Si on recalcule le taux de chômage en intégrant les personnes qui ont été découragées de rechercher un emploi de plus en plus aléatoire et celles qui, faute de mieux, travaillent à temps partiel contraint et forcé, les résultats sont nettement différents.
|
Taux de chômage
recalculé
|
On constate d'ailleurs que l'écart entre taux officiels et taux recalculés est d'autant plus important que le marché de l'emploi est dégradé, ce qui est compréhensible dans la mesure où les demandeurs d'emplois sont d'autant plus dissuadés de chercher un emploi qu'ils ont peu de chance de réussir. Ainsi, à cette aune, les États-Unis sont loin du plein emploi malgré les bons chiffres officiels - taux légèrement supérieur à 5 %.
Si l'on réintègre dans la cohorte des chômeurs officiels les personnes qui, désireuses de travailler, n'ont pas effectué les démarches nécessaires, on obtient un taux de chômeurs proche de 8,5 %. Si l'on ajoute celles qui travaillent à temps partiel sans l'avoir voulu - on est considéré comme travaillant à temps partiel à partir d'une heure de travail par semaine -, on obtient un taux supérieur à 12 %.
Par ailleurs, le taux de participation des 25-54 ans - nombre d'actifs par rapport à la population concernée - baisse.
Il y a bien une amélioration de la situation par rapport à 2009-2010, mais on n'a pas encore retrouvé celle d'avant-crise. Surtout, le chômage reste à un niveau élevé.
Il y a bien aussi une baisse du nombre d'emplois à temps partiel par rapport à la période de crise où ils avaient été massivement utilisés, mais celui-ci reste élevé.
Surtout, sur la période 2008-2015, le salaire médian réel (hors inflation) aura baissé de plus de 4 %.
Les chiffres ci-dessus et les graphiques suivants sont largement empruntés à Prime View (octobre 2015 pour les États-Unis et avril 2016 pour l'Europe) ainsi qu'au blog de Philippe Waechter 195 ( * ) , directeur de la recherche économique chez Natixis Asset Mangement.
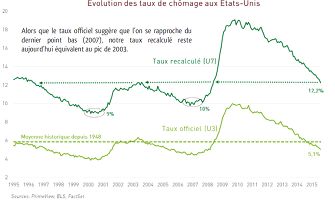
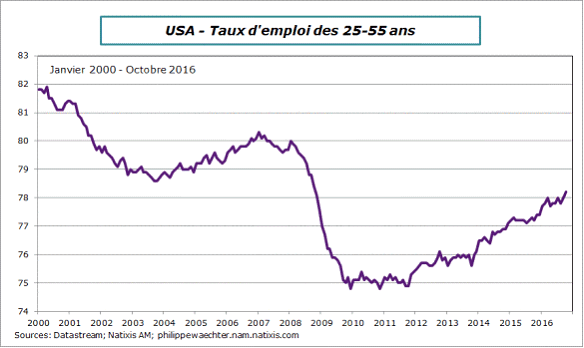
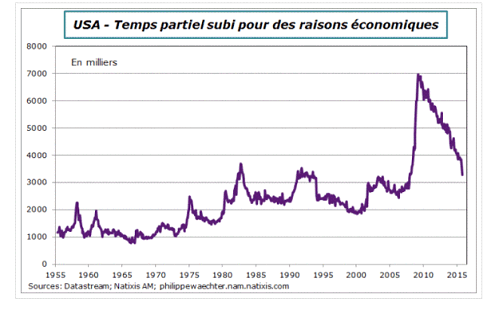
Les chiffres européens sont tout aussi impressionnants.
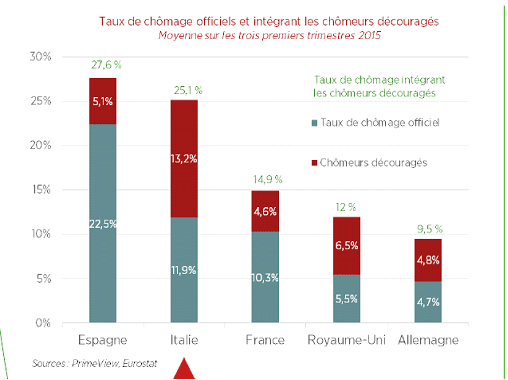
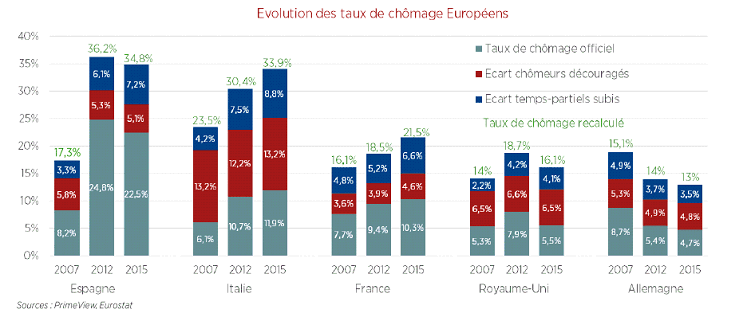
On remarque la situation particulière de l'Allemagne et du Royaume-Uni, ainsi que les taux faramineux atteint par l'Espagne et l'Italie.
S'agissant de la France, selon les chiffres officiels, la croissance continue du chômage, stabilisée depuis la fin de 2014, s'est inversée au second trimestre 2016, à 9,6 %, un niveau cependant supérieur à l'avant-crise. En revanche, le taux d'emploi des 15-64 ans a retrouvé son niveau d'avant-crise.
b) La dégradation des conditions de travail
Ces chiffres masquent des pondérations différentes des remèdes utilisés contre la crise : longueur moyenne du temps de travail annuel, importance du travail à temps partiel, rémunération du travail.
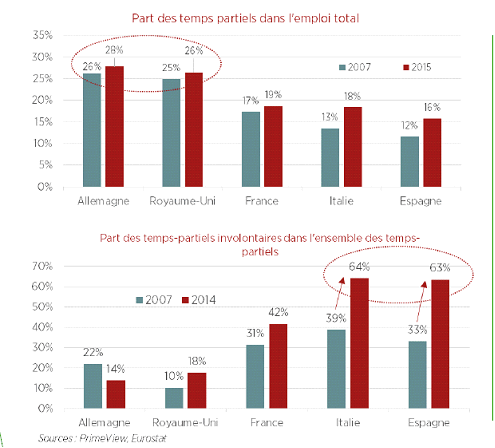
Il apparaît que les Britanniques ont privilégié la baisse des salaires, levier qu'avait déjà utilisé l'Allemagne avant la crise. Britanniques et Allemands ont également recouru au travail à temps partiel. Dans ces deux pays, ce type d'emploi représente structurellement plus du quart des emplois. Cela explique que, durant la crise, l'augmentation du temps partiel a été moins forte et surtout mieux ressentie qu'en Italie, Espagne ou France.
L'Allemagne a utilisé le chômage partiel durant le gros de la crise et l'augmentation des emplois à temps partiels ensuite. La réduction du temps de travail observée a pour origine l'augmentation des emplois à temps partiel et non un « partage » administré de ce temps de travail. Le coût du partage repose non pas sur l'entreprise, mais sur l'employé.
En revanche, le Royaume-Uni a surtout utilisé la « modération » salariale : le salaire réel moyen a baissé de plus de 6 % entre 2007 et 2014. Résultat : baisse des salaires assortie d'une augmentation du temps partiel et du nombre d'heures ouvrées !
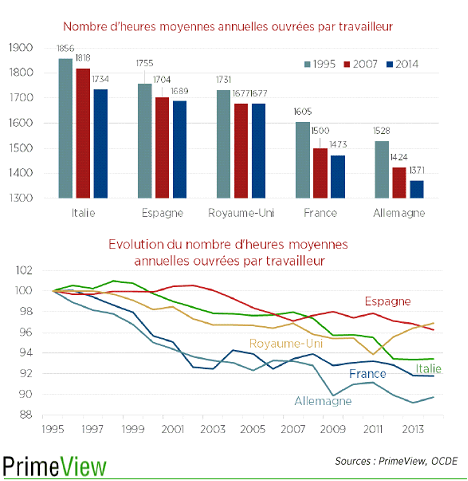
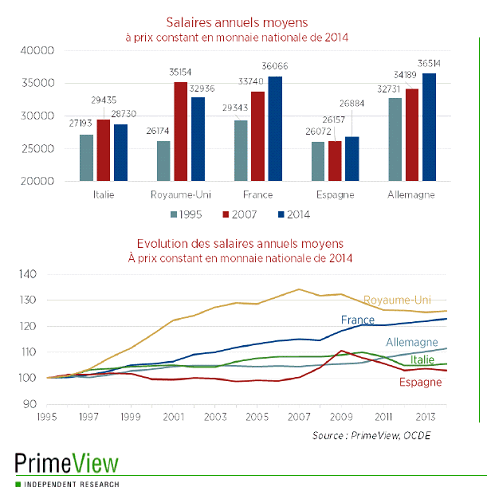
c) Partout, une insertion des jeunes toujours aussi difficile
La baisse du taux de participation des 15-24 ans renvoie, certes, à l'allongement des études mais aussi à la difficulté permanente de leur accès à un marché du travail très dégradé.
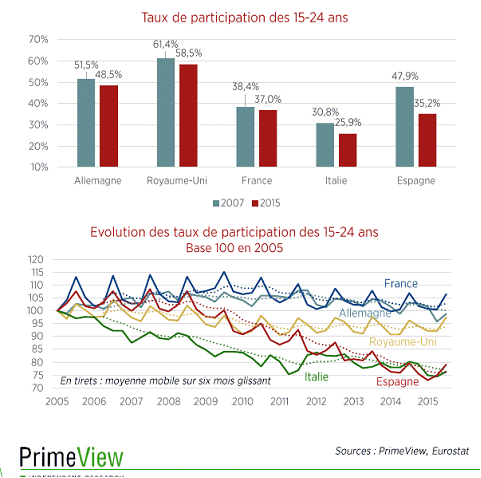
B. LES ÉTATS-UNIS ET L'EUROPE FACE À LA CRISE
1. Des problèmes communs
Sur le fond, les États-Unis et l'Europe, confrontés aux mêmes problèmes, ont eu le même type de réponses et la même incapacité à sortir de leurs contradictions.
Ces contradictions résultent de l'application du modèle économique de l'après-Bretton Woods, dans un contexte tout à fait nouveau. D'où les problèmes insolubles auxquels se trouvent brutalement confrontés les responsables politiques.
a) Comment relancer la machine économique ?
La question doit être précisée : comment relancer une machine économique dont le dynamisme reposait jusque-là largement sur l'endettement, au moment même où le désendettement privé et public devient, selon l'orthodoxie libérale, d'une impérieuse nécessité, sans augmenter les revenus du travail, ce qui nuirait à la compétitivité, sans augmenter - voire en diminuant - le nombre d'agents publics ou les transferts sociaux, pour ne pas nuire à l'équilibre budgétaire ?
Les graphiques suivants sont issus d'une publication de l'économiste Véronique Riches-Flores, fondatrice et présidente de RichesFlores Research 196 ( * ) . Rappelons que depuis la crise l'endettement privé a baissé dans les pays développés 197 ( * ) et que les conditions du travail, y compris les salaires, se sont détériorées 198 ( * ) . En particulier depuis 2008, aux États-Unis, le salaire médian réel (hors inflation) a perdu plus de 4 % 199 ( * ) .
b) Comment relancer le moteur que constitue l'investissement public, sans augmenter l'endettement du même nom ?
Pour le FMI 200 ( * ) , relancer l'investissement public est en effet indispensable ; à condition de respecter certaines règles :
« L'augmentation de l'investissement public a un effet particulièrement fort sur la production si : 1. Cet investissement intervient en période de ralentissement économique et de politique monétaire accommodante, cette dernière limitant la hausse des taux d'intérêt face à l'accroissement de l'investissement. 2. L'efficience de l'investissement public est élevée, en ce sens que le surcroît de dépenses d'investissement n'est pas gaspillé, mais alloué à des projets ayant un rendement élevé. 3. L'investissement public est financé par l'emprunt, et non par une augmentation d'impôts ou la réduction d'autres dépenses, les deux options entraînant des baisses similaires du ratio dette publique/PIB. »
Mais force est de constater la baisse du niveau de l'investissement public durant la période.
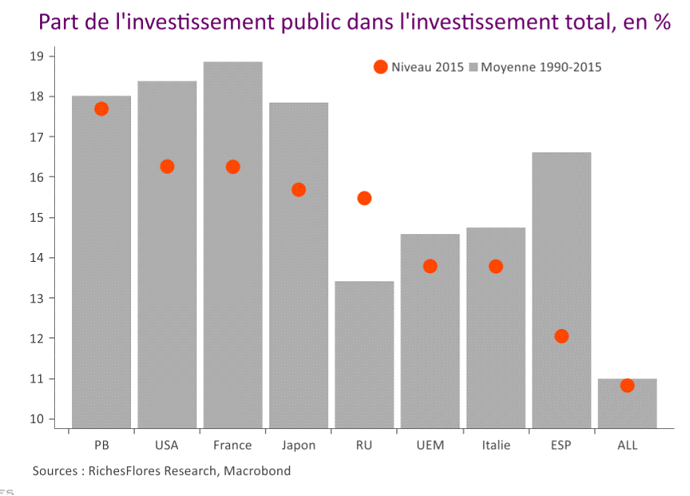
Le graphique ci-dessous est particulièrement instructif, dans la mesure où il montre que même l'endettement public massif de l'État fédéral étasunien s'est accompagné de restrictions budgétaires hors service de la dette : à partir de 2010, le solde primaire devient en effet positif.
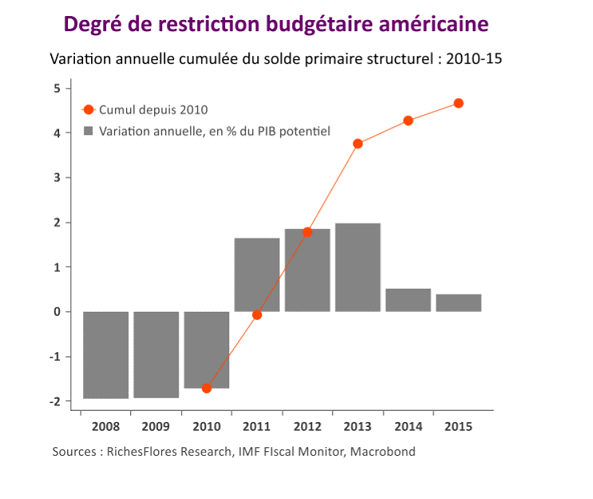
Comme on le verra un peu plus loin, l'effet contracyclique de son solde négatif, entre 2008 et 2010 - financement de l'ARRA notamment -, sera contrebalancé par la politique clairement procyclique des États fédérés, majoritairement gouvernés par des Républicains, qui rétabliront leurs finances en licenciant en masse, en réduisant l'investissement au minimum et en utilisant les ressources transférées par le fédéral pour se désendetter.
Résultat, si l'endettement fédéral s'est bien poursuivi, il n'a pas eu tous les effets escomptés sur l'investissement.
Même constat, évidemment, s'agissant de l'Europe, comme le montre le graphique ci-dessous, sauf que le déficit primaire des années 2008-2010 n'a même pas servi à financer un effort en matière d'investissement.
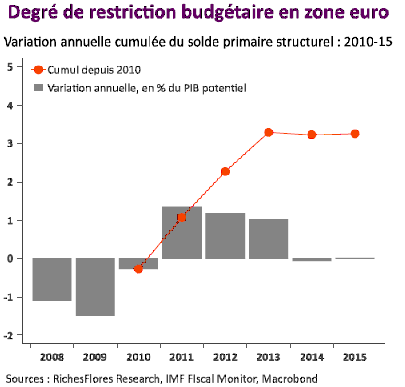
Comme le note l'économiste Véronique Riches-Flores : « La restriction budgétaire a absorbé une trop large partie des effets attendus des politiques monétaires. Le resserrement des politiques budgétaires est intervenu beaucoup trop tôt. Avec un multiplicateur budgétaire minimum de 0,5, il aurait respectivement confisqué 2,5 et 1,5 points de PIB aux États-Unis et en zone euro depuis 2010. La vérité est vraisemblablement supérieure de plus d'un point dans chacun des deux cas. » 201 ( * )
c) Comment relancer la consommation ?
En effet, comment relancer la consommation tout en diminuant le nombre d'agents publics et sans augmenter ni les transferts sociaux, ni les déficits ni les dettes publiques ?
Déficits et dettes sont puissamment dopés par la baisse des recettes consécutives au blocage de l'économie, puis à sa stagnation, pour les premiers, et par le sauvetage du système bancaire, pour les secondes.
Comme le montrent les graphiques 202 ( * ) , la tendance est aussi à la baisse des transferts sociaux.
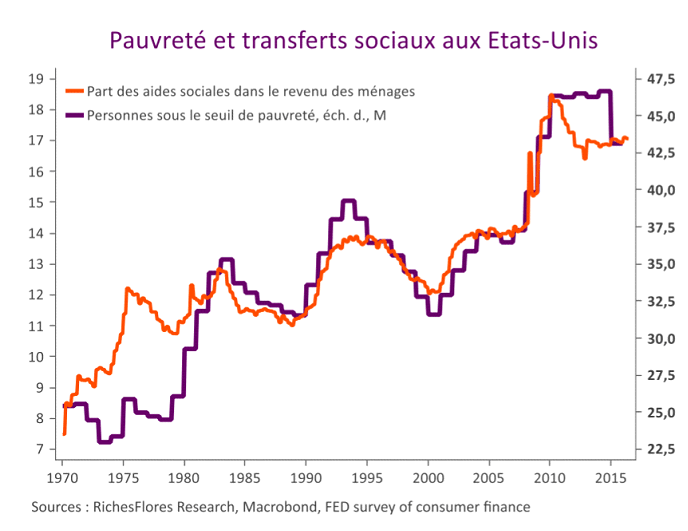
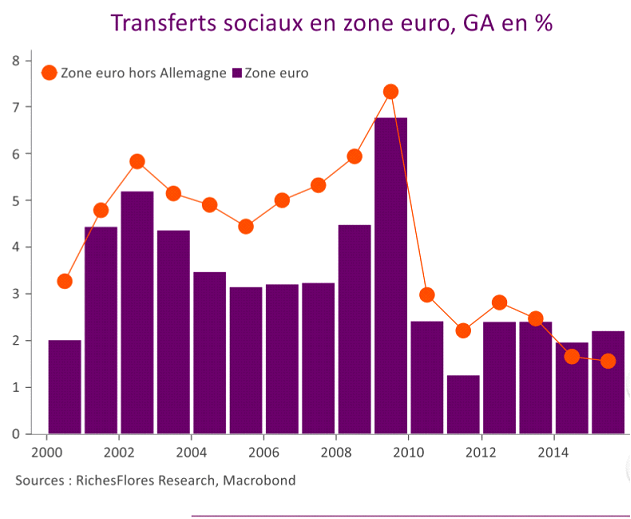
Conséquence : les inégalités ont continué à augmenter aux États-Unis et globalement en Europe, avec des exceptions, les résultats obtenus étant très dépendant des politiques locales et des écarts hérités du passé.
Une reprise par la consommation s'en trouve d'autant entravée.
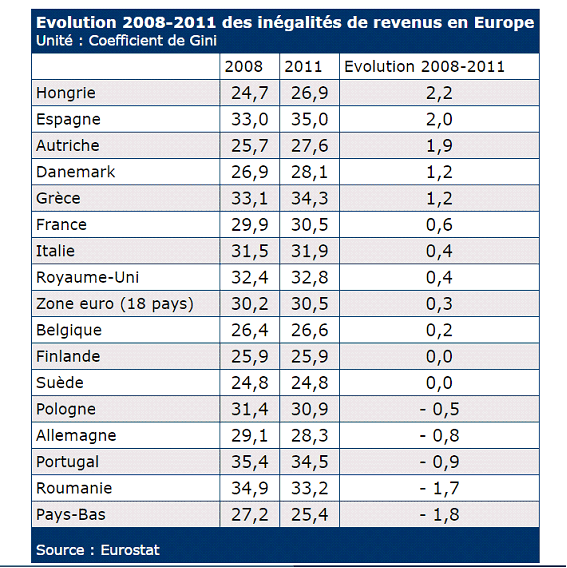
d) Comment faire face aux conséquences économiques du vieillissement de la population ?
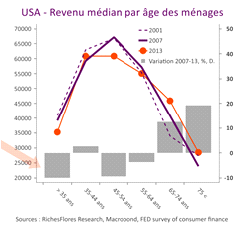
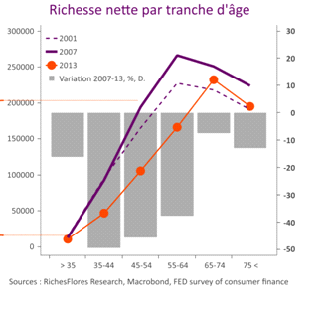
L'essentiel de la richesse se constitue entre 25 et 55 ans. C'est aussi la classe d'âge qui consomme le plus. Or c'est elle qui a été le plus affectée par la crise, notamment dans son volet immobilier. Le nombre des propriétaires, notamment aux États-Unis, chute fortement durant la crise, en même temps que les loyers augmentent.
De plus, le vieillissement de la population entraîne une baisse de la propension à consommer.
e) Comment réduire la spéculation ?
Comment réduire une spéculation qui a failli faire exploser le système financier mais qui, en même temps, est indispensable à son bon fonctionnement et à l'origine des bouffées de croissance économiques qui permettent à la machine de fonctionner ?
Comment mettre en place un système de financement de l'économie réelle qui ne soit pas le diverticule de caution d'utilité sociale d'un système financier parasitaire fonctionnant selon ses propres règles et à ses propres fins ?
Comme nous l'avons vu, le peu qui aura été fait sous l'effet de la panique initiale pour limiter la spéculation sera progressivement désactivé.
Quant au système financier à l'origine de la crise, personne n'envisage sérieusement de le réformer, encore moins de l'utiliser à d'autres tâches que l'enrichissement de ses pratiquants.
f) Comment enfin sortir de l'impasse ?
Comment enfin sortir de l'impasse créée par le remède employé pour stopper l'effondrement du système financier, l'injection massive de liquidités ? Remède du diable qui, certes, a permis de sauver le système financier et, dans un premier temps, de relancer la machine économique, mais qui se révélera non seulement dangereux pour la stabilité du système financier lui-même mais de moins en moins opérant en matière économique.
Reprenant l'expression de Keynes, de plus en plus d'économistes pensent que l'Europe serait tombée dans une « trappe à liquidité », à savoir une situation où :
- les investisseurs, devenus prudents, faute de perspectives économiques de redémarrage économique et de débouchés nouveaux, préfèrent conserver liquides leurs avoirs plutôt que de les investir ;
- les politiques monétaires conventionnelles (baisse des taux directeurs, injection de liquidités) n'ont plus aucun effet sur la croissance économique. Pas plus, d'ailleurs, que les politiques non conventionnelles.
En Europe, cette « trappe » ressemble fort à un gouffre, des taux directeurs proches de zéro et l'injection de liquidités de la BCE alimentant la spéculation plutôt que la croissance économique.
Le problème, c'est qu'arrêter cette politique risquerait d'avoir des conséquences immédiatement catastrophiques. On gagne donc du temps en la continuant.
Toutes choses inégales par ailleurs, la Fed, embarrassée par la bulle d'actif qu'elle a créée (voir supra ) est dans la même situation. Cesser trop brutalement cette politique risque de la crever avec les risques qui vont avec.
g) Au final, le bilan n'est pas brillant
Les déficits et la dette publique ont augmenté au détriment de l'investissement public et sans effet significatif sur les dépenses courantes. La variation des dépenses publiques dépendant essentiellement des taux de croissance et du taux de chômage, la réduction sur dix ans des dépenses courantes des pays de l'OCDE n'a été que de 0,3 %, rappelle Véronique Riches-Flores 203 ( * ) . La principale victime de la rigueur budgétaire a été l'investissement public, alors qu'il est essentiel à toute reprise.
Si l'endettement des ménages a diminué, surtout dans les pays qui en avaient le plus abusé, c'est au prix de leur solvabilité, donc d'une restriction de la demande (consommation et investissement) et d'une baisse des rentrées fiscales potentielles. Les catégories sociales les plus touchées sont celles qui sont les plus susceptibles de stimuler la demande.
En même temps, les salaires réels ont baissé, parfois fortement, et les inégalités ont augmenté.
Au regard de l'attentisme des acteurs économiques, les politiques monétaires accommodantes n'ont abouti qu'à faire tourner un peu plus vite l'économie casino.
Ce bilan vaut globalement pour les deux côtés de l'Atlantique.
Cela dit, force est de constater, s'agissant des pays anciennement développés, que c'est dans la zone euro que les résultats sont non seulement les plus mauvais, mais que les perspectives d'amélioration sont les moins visibles.
Tentons de savoir pourquoi.
2. Des stratégies bien différentes
Face à la crise financière, comme nous l'avons déjà indiqué 204 ( * ) , l'attitude des États-Unis et celle de la zone euro ont été très différentes.
a) Plus grande réactivité et moindre dogmatisme idéologique du côté étasunien
Les États-Unis ont réagi très vite et très puissamment, ne séparant pas sauvetage du système financier et relance économique, alliant : politique des taux directeurs, plan d'aide à la consommation dès 2008 et relance (ARRA) dès 2009, politique massive de quantitative easing . Alors que, jusqu'à l'arrivée de Mario Draghi, la BCE compte sur les banques pour faire repartir l'économie et que les plans européens de relance se limitent à des effets d'annonce.
Autant que libéraux, les États-Unis sont pragmatiques. La vulgate libérale n'y a pas pris la forme de pensée unique et les keynésiens n'y font pas figure de secte exotique. Au contraire, l'existence de figures de premier plan alimente un débat ouvert et public, ce qui n'est pas le cas en Europe, tout particulièrement en France.
On sait là-bas que la stabilité du système financier lui-même, que la sortie de crise effective dépendent du retour de l'économie à son niveau d'activité d'avant-crise, ce qui est impossible sans une politique de relance vigoureuse. Que d'autres forces ou intérêts s'y opposent ne signifie pas que ce type d'intervention soit tenu pour un non-sens, ce qui, jusqu'à une date très récente, était le cas sur le vieux continent.
Pour les orthodoxes européens, les pouvoirs publics n'ont aucune légitimité à intervenir dans le domaine économique. Le retour à bonne fortune de l'économie dépendant d'abord et quasi exclusivement de la restauration du niveau de profitabilité du système bancaire. Priorité au sauvetage du système financier donc, le redémarrage de l'économie viendra de surcroît.
À y regarder de près, les « politiques financières non conventionnelles » et les taux directeurs bas utilisés des deux côtés de l'Atlantique ont des significations différentes.
Pour la BCE , même si elle espère ainsi faire baisser l'euro et donc stimuler l'exportation, il s'agit d'abord de donner les moyens aux banques de prêter à l'économie dans l'espoir de la voir redémarrer. On sait que cet espoir ne fut pas vérifié, les entreprises n'empruntant que si elles ont l'espoir de débouchés et les banquiers préférant des spéculations plus rentables que l'aide aux entreprises 205 ( * ) . Rappelons que, en Europe, 80 % des crédits à l'économie sont d'origine bancaire, contre 20 % aux États-Unis où les entreprises font plus appel aux marchés financiers.
Pour la Fed , en revanche, le QE vise d'abord à maintenir des taux d'intérêts bas favorables à l'activité économique et à éviter un effondrement des obligations, à commencer par celles qui sont émises par les entreprises.
Pour la Fed, le premier des dangers, c'est la déflation. Ainsi Ben Bernanke, l'avant-dernier gouverneur de la Fed, promettait-il de larguer des valises de dollars du haut d'un hélicoptère si elle montrait le bout du nez. Pour la BCE, le premier des dangers, c'est l'inflation d'où, pendant longtemps, sa politique des taux directeurs. Le jour où la BCE, s'apercevant enfin que, sans inflation, il n'y aurait pas de désendettement indolore, l'injection de liquidités et la baisse des taux n'ont plus eu aucun effet.
Interrogé par le journal L'Opinion, Patrick Artus, directeur de la recherche et des études de Natixis, précise : « Personne ne critique les politiques de "quantitative easing" lancées aux États-Unis puis au Royaume-Uni fin 2008, début 2009. Ce qu'on peut blâmer en revanche, c'est la poursuite du QE dans ces deux pays jusqu'en 2014, alors que leurs économies sont reparties depuis longtemps. Et le déploiement de mesures similaires au Japon et en Europe trop tardivement. Qu'espère la BCE quand elle fait du quantitative easing en 2015 ? Les banques de la zone euro sont déjà inondées de liquidités, tout le monde a du cash plein les poches. Le seul effet notable, c'est la dépréciation de l'euro. C'est une politique non coopérative qui a un effet transitoire, car on ne fait pas baisser son taux de change de 15 % tous les ans. » 206 ( * )
b) Un exemple de politique de relance économique keynésienne : l'ARRA
Un exemple parlant de cette différence d'attitude : la politique de relance économique du Gouvernement fédéral étasunien en direction des pouvoirs locaux, États fédérés et autres collectivités durant la crise, alors même qu'administrés majoritairement par des Républicains hostiles, arc-boutés sur une politique de désendettement, ceux-ci faisaient tout pour la faire échouer, notamment en licenciant les fonctionnaires par milliers.
L'ARRA 207 ( * ) , le plan de relance économique des États-Unis, l'un des tout premiers actes de Barack Obama à son arrivée à la Maison-Blanche puisqu'il est engagé dès le mois de février 2009, est sur ce point significatif 208 ( * ) .
L'ARRA représente une politique contracyclique de relance de la croissance et de l'emploi. Un plan de 787 milliards de dollars, soit 5,6 % du PIB de 2009, une politique menée par l'État fédéral, le Trésor et la Fed. Objectif visé : préserver entre 1,2 et 3 millions d'emplois, soit entre 0,7 % et 1,8 % du taux de chômage.
Pour réussir, une telle politique devait s'appuyer sur les États fédérés (et les pouvoirs locaux qui en dépendent), en grande difficulté budgétaire (ces États, sauf le Vermont, doivent respecter la règle d'or de l'équilibre budgétaire en vertu de leur Constitution).
Le problème, c'est que l'aide fédérale, qui représentait environ un tiers du déficit budgétaire local à combler, n'a même pas été utilisée pour maintenir les effectifs de fonctionnaires locaux qui furent licenciés en grand nombre, encore moins pour investir mais essentiellement pour se désendetter. Sous direction très majoritairement républicaine, les États fédérés ont clairement mené une politique procyclique qui a réduit les effets de la politique fédérale. Washington a même eu beaucoup de difficultés à maintenir l'aide sociale à un niveau suffisant.
c) Des résultats en faveur des États-Unis
Qu'il s'agisse de l'emploi, de la croissance et de l'investissement, comme le montrent les graphiques et tableaux ci-après, les résultats sont en faveur des États-Unis.
• Emploi
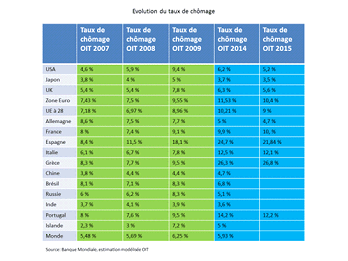
• Croissance
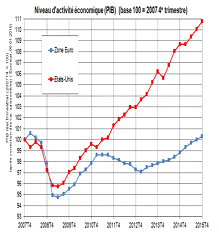
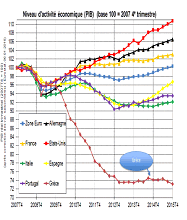
Source : Thomas Piketty (Blog)
• Investissement
Résultats aussi en faveur des États-Unis en matière d'investissement total ou d'investissements importants (Voir graphiques ci-dessous 209 ( * ) ).
|
Recul de l'investissement total
|
|
Recul de l'investissement brut dans l'Union
européenne
Variation de l'investissement et du PIB entre 2008 et
2012
|
|
Évolution de l'indice de formation brute de
capital fixe réelle
Données trimestrielles corrigées des effets de calendrier et des variations saisonnières, calculées en volumes chaînés exprimés en monnaie nationale (année de référence : 2005) et normalisées en fonction de la moyenne des quatre trimestres de 2008. |
Pendant que les États-Unis, au gros de la crise, mobilisaient les finances fédérales pour relancer leur économie, l'Europe surveillait l'équilibre des finances publiques, particulièrement la France, où les collectivités locales, qui pourtant assurent 70 % de l'investissement public civil, verront leurs ressources financières régulièrement amputées. Le redémarrage économique est censé découler mécaniquement et fatalement d'un retour aux équilibres gravé dans le marbre à Maastricht et d'une diminution des ressources de l'État, des collectivités locales et des organismes sociaux. Il n'y a pas à sortir de ça. D'ailleurs on y est resté.
Il faut bien un économiste étasunien de renommée mondiale comme Paul Krugman pour s'en étonner !
« La seule chose à mettre au crédit de l'Europe est paradoxalement celle que l'on critique depuis toujours, à savoir l'ampleur et la générosité de l'État providence, qui a contribué à réduire l'impact de la crise.
« Et elle n'est pas à sous-estimer. La sécurité sociale et l'ampleur des aides en termes d'assurance chômage et d'aide à l'insertion ont contribué à maintenir, du moins jusqu'à maintenant, un niveau de pauvreté sociale bien inférieur à celui que connaissent les États-Unis. De plus, ces programmes permettront de soutenir la consommation en pleine crise.
« Mais de tels "stabilisateurs automatiques" ne peuvent se soustraire à une réelle action.
« Pourquoi l'Europe sombre ? Le manque de gouvernance fait partie intégrante de son histoire. Les dirigeants bancaires européens, qui ont complètement sous-estimé l'ampleur de la crise, se comportent encore aujourd'hui de manière complaisante. Pour entendre aux États-Unis l'équivalent des diatribes d'ignorant proférées par le ministre des finances allemand, il faut se tourner vers, ... eh bien, les Républicains. » 210 ( * )
Paradoxe des paradoxes , donc, c'est par la remise en question de l'héritage de l'État providence qui a limité les dégâts de la crise financière en Europe que ses dirigeants entendent la faire sortir de la crise !
Ce qui incite fortement à penser que les fautes de gouvernance - ce qui, par parenthèse, supposerait qu'il y en eut une - sont loin d'expliquer les difficultés de l'Europe à surmonter la crise. Force est de constater qu'elles renvoient malheureusement à des causes structurelles plus profondes.
3. Les causes structurelles de la stagnation de la zone euro
Si aucune économie ne s'est encore remise, dix ans après le début de la crise des subprimes , si l'Europe et les États-Unis, confrontés à des problèmes communs, ont essentiellement mis en oeuvre des remèdes « libéraux-compatibles », parmi les pays avancés, la zone euro, comme on vient de le voir, est particulièrement à la peine. Si la différence de stratégie face à la crise n'y est certes pas pour rien, elle n'explique pas l'essentiel : un mode de construction de la monnaie unique et des principes de fonctionnement de la zone qui la rendent inapte à la prise des bonnes décisions en temps utile.
a) Une absence de gouvernance politique légitime
Dépourvue d'une gouvernance politique assise sur une légitimité démocratique la rendant capable de décider, l'Europe se trouve privée de capacité de réaction et de décision en temps réel face à une crise sérieuse. Comme l'écrit Paul Krugman dans la tribune précitée : « L'Europe se révèle structurellement faible par temps de crise. » C'est le moins qu'on puisse dire !
Elle le doit à son mode de construction conforme au rêve ordolibéral d'une gouvernance par les règles en lieu et place d'un gouvernement politique 211 ( * ) . Comme s'il suffisait de figer les parités des anciennes monnaie en les assortissant de contraintes budgétaires gravées dans le marbre des traités et de censeurs vigilants chargés de les faire respecter pour régler le problème.
Citons de nouveau Jacques Sapir 212 ( * ) : « Il ne peut y avoir une finance, des marchés de biens libéralisés et un système de change fixe, ce qui est le cas avec l'euro. L'euro n'est pas une monnaie, c'est un système de changes fixes, facteur de rigidités insupportables. Cela bloque la parité des changes entre les pays à un niveau donné. »
Faute d'un mécanisme de redistribution des excédents, cette absence de liberté d'ajustement des parités en fonction de l'évolution des compétitivités respectives est tout particulièrement pénalisante pour les pays du Sud, lesquels, on l'a vu, ont encaissé le gros du choc du chômage.
Même un problème aussi minuscule que celui posé par la Grèce, qui représentait à l'époque 3 % du PIB de la zone, n'est toujours pas réglé sur le fond. Quant aux moyens utilisés pour mater le berceau de notre civilisation, ils sont simplement indignes d'une Europe qui, forte de ses valeurs universelles, prétendait vouloir réunir les peuples.
Peut-on encore croire, comme se plaisent à le faire les gouvernements français, que les réformes dont dépend l'avenir de l'Europe passent par un « couple » franco-allemand qui n'existe que pour les Français ? André Sapir, chercheur associé au think-tank Bruegel 213 ( * ) , souligne ainsi : « L'Allemagne doit davantage consommer. Elle est allée trop loin dans sa quête de compétitivité, sans doute une conséquence de la réunification de 1990. Ce qui entraîne des déséquilibres non négligeables. Que ce soit l'Allemagne ou la France, ces deux pays doivent trouver des solutions politiques dans la zone euro. » Certes, mais cela a-t-il quelque chance d'aboutir quand le système est à ce point dépourvu d'institution susceptible de trancher des noeuds gordiens de plus en plus serrés ?
b) Un système institutionnel autobloquant
À y regarder de près, les contradictions dans lesquelles se sont enfermés les Européens font de la zone euro un système autobloquant. Il est tout de même paradoxal, en effet, que le chômage soit plus important dans la zone euro - dont les initiateurs annonçaient qu'elle serait le moteur économique de l'Europe - que dans l'Union à 28 !
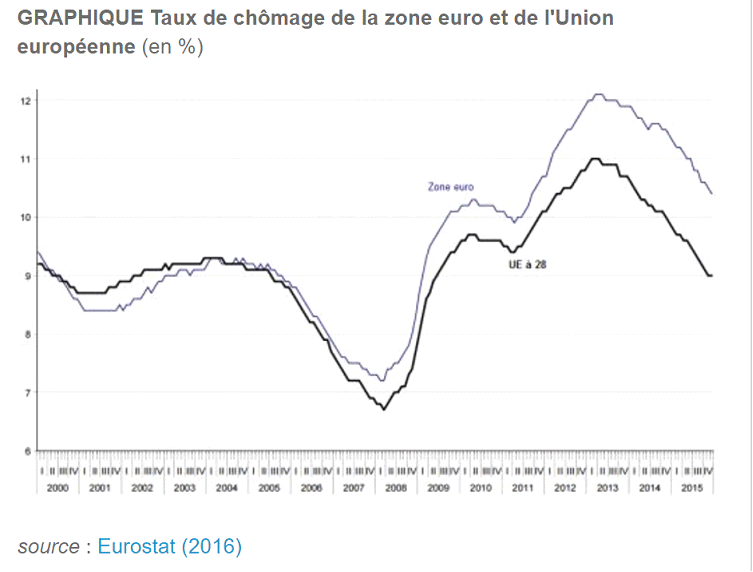
• Un système de parités fixes facteur de dépression en cas de crise
Le système des parités fixes au sein de la zone devient paralysant quand l'arrêt de liquidités en provenance des pays du Nord, au moment des crises, coïncide avec une obligation de désendettement et de réduction des dépenses des pays du Sud. La classique dévaluation externe n'étant pas possible, ces pays doivent recourir à une forme de « dévaluation interne » - réduction des dépenses publiques, baisse des salaires, des pensions et retraites - pour limiter leurs achats extérieurs et augmenter leur compétitivité, la solution de l'investissement technologique n'étant pas applicable, en tout cas à court ou moyen terme.
Voici ce qu'on peut lire dans une publication de la Société Générale : « Des coûts unitaires du travail toujours trop élevés dans les pays de la périphérie (par rapport aux pays du nord de la zone euro), conjugués à une forte contraction de la demande globale ont entraîné dans ces pays des chutes d'emplois et de production dignes des pires épisodes de dépression économique. Et parce que les processus de désendettement et de dévaluation interne ne sont pas encore achevés, la croissance effective en Europe devrait rester durablement inférieure à la croissance potentielle. » 214 ( * )
Comme le montre le graphique ci-dessous, extrait de la publication précitée, dans tous les pays de la zone, la crise s'est traduite par une baisse du coût unitaire du travail dans le but d'améliorer la compétitivité. Mais en Europe, c'est dans les pays du Sud, à l'exception de l'Italie, et en Irlande, particulièrement frappée par la crise, que cette baisse a été la plus forte.
Quand se conjuguent baisse des salaires et désendettement, il ne faut pas s'étonner de trouver la dépression au rendez-vous. Une dépression qui frappe, certes, d'abord les pays les plus faibles de la zone, mais qui se répercute inévitablement sur les autres.
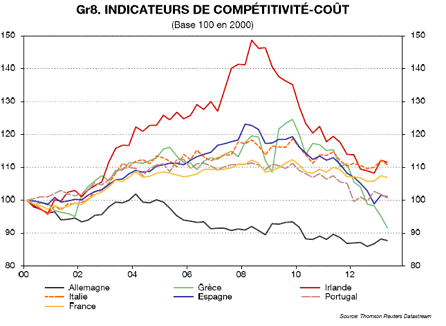
• Des échanges déséquilibrés sans système de recyclage des excédents
Comme le montre le graphique ci-dessous 215 ( * ) , en 2014, la zone euro présente un important excédent courant de 3,4 % du PIB qui, n'étant pas recyclé dans la zone, stérilise sa dynamique économique interne.
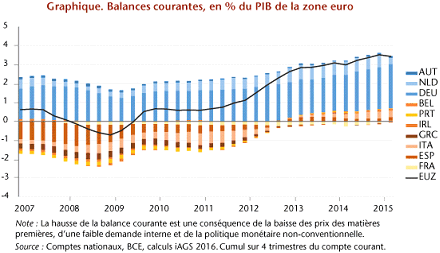
• Un carcan budgétaire et idéologique interdisant toute politique de la demande, au niveau des États membres comme de l'Union européenne
C'est pourtant d'un manque de demande - consommation des ménages et investissements des entreprises - que l'Europe souffre et l'heure reste à la politique de l'offre (salaires bas) et au manque d'investissement (échec des politiques de taux bas, des politiques monétaires conventionnelles et non conventionnelles, des politiques fiscales ou de financement des transferts sociaux favorables aux entreprises).
- La consommation, moteur économique
On a complètement oublié qu'en Europe, comme aux États-Unis et dans tous les grands pays développés, le moteur de l'économie, c'est la consommation. Il suffit de regarder les courbes pour s'en apercevoir : si l'Europe n'est pas en plus mauvais état, c'est que le niveau de consommation, notamment du fait des « amortisseurs sociaux », a bien résisté, bien plus que l'investissement et que les exportations sur lesquels on continue à miser, au moment même où la demande extérieure se contracte (voir plus bas).
Certes, il ne peut y avoir de reprise solide sans redémarrage de l'appareil de production. Néanmoins, sans augmentation de la demande, on ne voit pas pourquoi ceux qui sont aux commandes cesseraient d'utiliser leurs liquidités à autre chose qu'au rachat de leurs propres actions, ce qui augmente les dividendes et la valeur desdites actions, au rachat d'entreprises concurrentes ou, tout bonnement, à l'augmentation des dividendes distribués ?
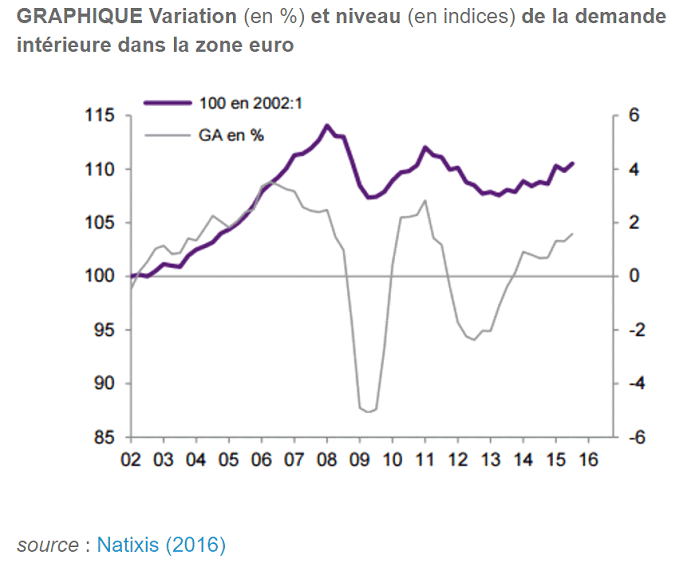
- L'investissement public
L'une des contradictions majeures, c'est d'un côté la nécessité de relancer l'investissement public, l'investissement privé se dérobant, et, de l'autre, l'impossibilité de le financer par le déficit budgétaire public, compte tenu du carcan des critères de convergence. Quant à l'idée que ce financement pourrait être directement ou indirectement assuré par la BCE, ce qui aurait l'avantage de n'engendrer aucun coût pour les budgets, on ne peut même pas en rêver.
Depuis qu'il a été popularisé par Keynes, l'investissement public a cet avantage d'entraîner, par ricochet, d'autres investissements et une consommation supplémentaire. C'est ce qui s'appelle « l'effet multiplicateur ».
Alors qu'il devrait augmenter, il a diminué en Europe, globalement de 17 % entre 2007 et 2013, et de beaucoup plus dans les pays particulièrement touchés par la crise immobilière.
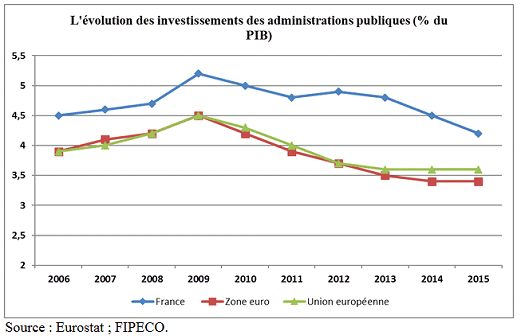
Le FMI n'est pas le seul à plaider pour une relance par l'investissement public 216 ( * ) , et donc pour un desserrement du carcan budgétaire. L'OCDE, le G20, la BCE depuis l'appel de Mario Draghi en août 2014, même la Commission européenne plus récemment, s'accordent pour dire qu'une politique monétaire sans politique budgétaire adaptée est vouée à l'échec. Pour l'instant, rien n'a bougé.
Les 315 milliards d'euros du plan Juncker mettent du temps à être consommés et en mettront encore plus à produire leurs effets. Quant aux 80 milliards d'euros qui seraient théoriquement nécessaires pour mobiliser à 100 % les capacités productives de la machine économique européenne, ils restent des sujets de discours et d'exégèse des messages subliminaux de Wolfgang Schäuble. Pourtant, il suffit de comparer ces chiffres aux 800 milliards de dollars de l'ARRA mobilisés en urgence pour réaliser que l'on est encore loin de ce qu'il faudrait faire si les responsables européens voulaient mettre en oeuvre une vraie politique de relance économique du vieux continent.
Christophe Nijdam, secrétaire général de Finance Watch au moment de son audition 217 ( * ) , et depuis membre des Stakeholders Groups de l'Autorité bancaire européenne (EBA) et de l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), fait l'analyse suivante : « Il faudrait relancer l'investissement public, les infrastructures, les grands travaux, cela pourrait fonctionner. En revanche, on ne relancera pas la demande par le marché unique des capitaux. De même, on ne peut pas relancer la croissance en commettant la même erreur qui avait été commise pendant la crise, c'est-à-dire en endettant le consommateur. La crise de 2008 a été une crise de l'endettement global, sur longue durée, les gens se sont endettés pour maintenir leur niveau de vie ; ce qui a fortement touché l'économie. Pour vous donner une image, pendant la bulle internet de 1999 à 2001, les gens jouaient au casino avec leur argent, ils perdaient, cela s'arrêtait là. À l'inverse, dans une bulle de l'endettement, les gens vont jouer au casino avec l'argent des autres, ce qui entraîne un effet domino et une crise globale. » Il précise : « Ce n'est pas un problème d'octroi de crédits, c'est un problème de demande globale, de confiance consommateur. »
c) Un système bancaire oligopolistique qui ne joue pas le rôle qu'il est censé jouer
Retrouvant la question précédemment abordée 218 ( * ) , nous nous contenterons d'y renvoyer, nous limitant à rappeler que le fonctionnement parasitaire du système financier est une entrave majeure au dynamisme économique.
Gunther Capelle-Blancard nous l'a rappelé 219 ( * ) : « Même s'il est difficile de les quantifier , on a légitimement l'idée qu'on a affaire à des activités presque parasitaires, qui se développent, au sens biologique du terme. Il n'y a pas de déconnexion [entre finance et économie réelle] : le parasite se nourrit de la bête, le développement du parasitaire n'a pas d'utilité, il n'y a pas de déconnexion, il y a même une symbiose entre eux. Si on coupe ce lien, le parasite meurt. » Après avoir rappelé la liste des catastrophes qui ont suivi la formation des bulles spéculatives de ces trente dernières années, il ajoute : « Quand on fait le bilan : pendant les fameuses Trente Glorieuses et même dix ans après, il n'y a rien eu. Pendant quarante ans, les entreprises se finançaient. Depuis maintenant trente ans, les bulles se multiplient. »
On ne peut que constater une déconnexion complète de ce que peuvent faire les banques centrales et un hypothétique redémarrage de l'économie. Des mondes parallèles.
D'autres systèmes ont existé qui ont donné satisfaction, d'autres peuvent de nouveau exister. L'épargne est aujourd'hui abondante en Europe, rien que les Français ont de côté aujourd'hui un peu plus de 10 000 milliards d'euros, environ 16 % de leurs revenus. Ne serait-il pas temps de recréer des circuits financiers de financements directs de l'économie, notamment des PME-PMI, ou en tous cas de développer les institutions existantes ?
La séparation des banques de dépôts et d'affaires irait dans le même sens : les dépôts serviraient exclusivement à l'émission de prêts.
Parmi toutes les mauvaises raisons invoquées avec succès jusque-là pour éviter la fin du modèle de banque universelle, citons l'argument selon lequel séparer, en Europe, les banques de dépôts et d'investissement reviendrait à livrer la « gestion d'actifs » à la concurrence étasunienne. Sauf que le classement des gestionnaires d'actifs mondiaux montre qu'une telle séparation n'aurait pas cet effet, soit que la partie bancaire des établissements est faible (cas d'Axa Groupe, huitième gestionnaire d'actifs mondial), soit qu'après scission la partie gestion d'actifs des grandes banques européennes reste largement suffisante pour résister à la concurrence. C'est le cas de BNP Paribas, dixième gestionnaire d'actifs mondial, qui demeurerait avant Goldman Sachs, quinzième seulement au classement, avec 1 042 milliards de dollars d'actifs. À noter qu'au classement 2013 des cinq cents principaux gestionnaires d'actifs mondiaux du cabinet Towers Watson 220 ( * ) , l'Europe place neuf établissements parmi les trente premiers, dont quatre français parmi les vingt premiers.
Notons, enfin, que le système bancaire étasunien est plus concurrentiel que le système européen. Outre la garantie implicite des pouvoirs publics de ne pas faire faillite, ce qui lui permet de se financer à des tarifs privilégiés, il dispose d'une clientèle, sinon captive, du moins pour laquelle changer de banque est ressenti, à en croire les enquêtes d'opinion, comme difficile.
C. EN ATTENDANT LA LOCOMOTIVE
À s'en tenir aux économies développées, les perspectives de sortie de la crise économique restent pour le moins incertaines ; encore plus si l'on tient compte du vieillissement de leur population, dont l'effet déflationniste sur la consommation - telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui en tous cas - est probable et dont les conséquences sur les budgets publics et la répartition de la richesse ne sont pas encore mesurées.
Peut-on compter sur une nouvelle révolution technologique ou verte pour relancer la machine ? On peut toujours l'espérer, sans être certain qu'elles produiront des effets avant longtemps en l'absence d'un choc politique qui les rendraient incontournables.
Le salut viendra-t-il d'une mondialisation enfin heureuse, du développement des pays « émergents » qui, de producteurs, deviendraient consommateurs, offrant les débouchés de leurs immenses marchés aux industries et aux services des pays développés ? Tel était en tous cas le présupposé de la « mondialisation heureuse ».
Malheureusement les résultats, déjà moins brillants que prévus avant la crise, le sont encore moins après.
1. Des résultats de la lutte contre la pauvreté moins brillants qu'on ne le dit
Selon la Banque mondiale, en 1981, 1,99 milliard de personnes vivaient avec 1,9 dollar par jour ou moins. Ils n'étaient plus que 896 millions en 2012, soit une baisse de quelque 1,1 milliard, due, pour 753 millions de personnes, à la Chine, soit 68 % de la baisse.
Si la référence la plus basse retenue par la Banque mondiale, 1,25 dollar par jour, est prise en compte, on obtient le graphique ci-dessous.
Il montre que la chute de la grande pauvreté dans le monde est essentiellement due à la Chine, à laquelle on peut ajouter l'Asie du Sud-Est, placée dans la zone d'influence de la Chine et l'Inde. En Amérique latine, elle stagne et, dans la zone subsaharienne, elle augmente, ce qui pourrait expliquer, au moins en partie, sa déstabilisation.
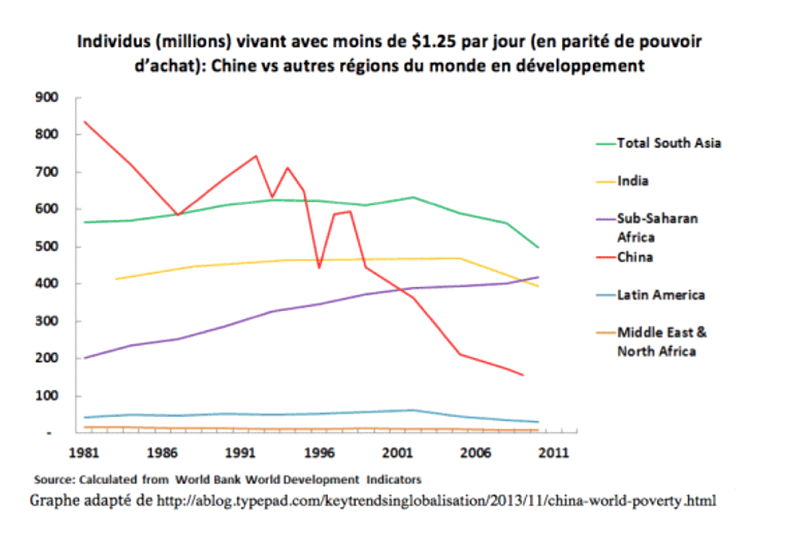
2. Ralentissement de la locomotive chinoise et risque de crise bancaire
S'il est un grand marché dont les fervents du libre-échange et de la mondialisation rêvent, c'est bien le marché chinois. Ils pourraient bien être déçus.
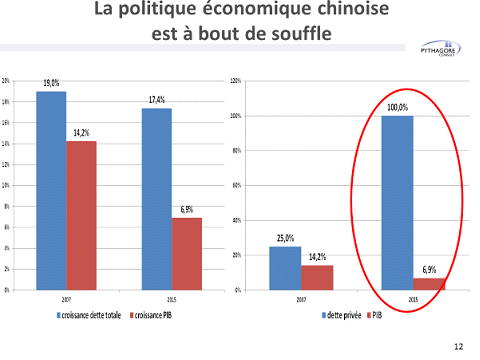
Les moteurs de la croissance chinoise sont non pas la consommation et l'augmentation du pouvoir d'achat, même si les salaires ont beaucoup augmenté au cours des dernières années, mais l'investissement - immobilier et infrastructures -, les échanges extérieurs et l'endettement.
L'industrie représente 40 % du PIB et pèse 45 % de la consommation mondiale de métaux. Après une chute importante en 2009, le taux de croissance de la production industrielle s'est rapidement redressé, mais pour entamer une lente décroissance : une baisse de moitié entre 2010 et 2016. La baisse de près de 60 % de la croissance mondiale depuis 2007 l'a profondément affectée. Réciproquement, le ralentissement de l'économie chinoise pénalise la croissance mondiale à laquelle la Chine a contribué à hauteur de 34,3 % entre 2008 et 2013, contre 17,7 % pour les États-Unis et seulement 4,5 % pour la zone euro. C'est dire qu'une panne de la locomotive chinoise ne resterait pas sans effet.
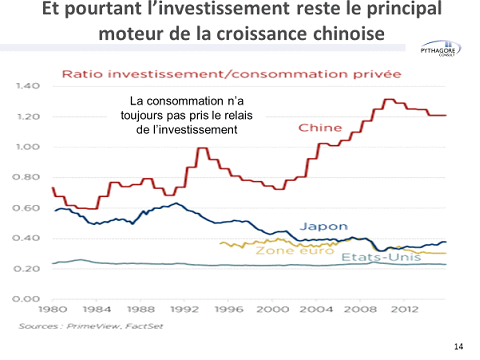
Dans le même temps, dans le secteur manufacturier tourné vers l'exportation, la productivité des entreprises de l'Empire du Milieu augmentant moins vite que les salaires, la rentabilité des entreprises chinoises baisse. Ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour les pays développés en voie de désindustrialisation, les délocalisations devenant moins rentables mais qui, à court terme, est source de possibles perturbations.
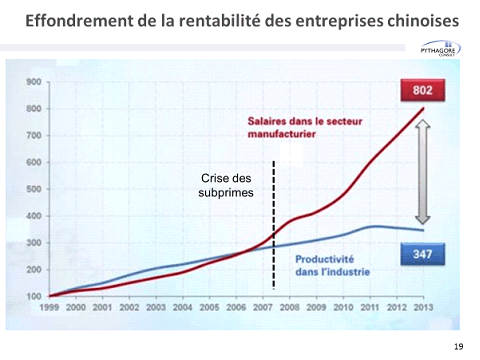
Le taux d'épargne de la Chine représente 47 % du PIB, soit le plus élevé du monde. Rappelons qu'il est de 30 % du PIB en Inde, de 20 % en France, de 18 % aux États-Unis et de 16 % au Brésil. Le partage de la valeur ajoutée, 25,3 %, y est cependant l'un des plus défavorables aux salariés du monde. Par comparaison, il se situe à 65,1 % aux États-Unis, 64,6 % en France, 61,9 % au Japon et 60,5 % en Allemagne.
Quant à la consommation des ménages, elle stagne toujours au-dessous de 40 % du PIB (37,4 %) contre 60 %-70 % dans les pays industrialisés : États-Unis, 68,4 % ; Royaume-Uni, 64,7 % ; France 55,2 % ; zone euro 55,9 %.
Cela signifie que le rêve de voir la Chine devenir le « Grand marché » qui tirera la croissance mondiale n'est pas près de se réaliser. Cela supposerait le transfert d'au moins 20 % du PIB vers la consommation intérieure. À cela une bonne raison : la régression, voire la quasi-disparition de l'ancien système de service public (enseignement supérieur, hôpitaux), de retraite et d'assistance sociale, sans remplacement, a eu pour conséquence une très forte épargne de précaution de la part des Chinois.
Durement frappée par la crise mondiale, la Chine a réagi par un surcroît d'endettement : depuis 2007, injections successives à hauteur de 13 %, de 30 %, puis de 22 %, et enfin de 44 % du PIB. En 2015, la dette totale de la Chine, publique et privée, qui représentait 151 % du PIB en 2006, était passée à 255 %. Elle devrait atteindre 281 % en 2016.
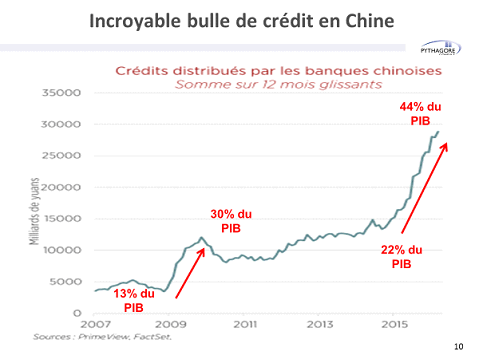
Jean-Luc Buchalet 221 ( * ) , du Cercle des analystes indépendants, explique : « Selon la Banque des règlements internationaux, lorsque le ratio dette/PIB progresse de plus de 10 % par rapport à sa tendance long terme, il y a un risque systémique bancaire ». En 2016, ce ratio est de plus de 30 % ! »
Au début du mois d'août 2016, le FMI s'en est inquiété, invitant la Chine à réagir « de toute urgence » face à cette envolée de l'endettement de ses entreprises et à cesser de doper son économie à crédit.
C'est dire que non seulement la substitution d'une économie assise sur la consommation intérieure des ménages à une économie de l'investissement dans les infrastructures et l'exportation à tout crin n'est pas pour demain. C'est dire aussi qu'un sérieux risque d'embolie du système financier n'est pas une vue de l'esprit. L'accélération de la fuite des capitaux contre laquelle lutte le gouvernement chinois n'est pas vraiment bon signe.
3. Les pays producteurs de pétrole réduisent leurs réserves de devises
La baisse des cours du pétrole ayant déséquilibré les budgets des pays producteurs, ceux-ci ont été obligés de réduire leurs importations et de puiser dans leurs réserves, diminuant d'autant les flux venant alimenter les économies développées.
Apparaissent aussi des risques de déstabilisation, leurs systèmes sociaux et la paix sociale étant largement financés par la rente pétrolière. À 30 dollars le baril, les réserves financières de l'Arabie saoudite couvrent seulement deux années de déficit budgétaire. Parmi les pays les plus en difficulté figurent la Libye, le Venezuela, l'Arabie Saoudite, l'Algérie, l'Irak et la Russie. Pour l'heure, la remontée des cours du brut a renvoyé le problème au second plan des urgences mais rien ne dit qu'il ne resurgira pas bientôt. À la suite des restrictions de la production, le prix du baril est remonté au-dessus de 50 dollars, niveau qui permet d'équilibrer les comptes de nombreux pays. Reste à savoir pour combien de temps.
4. Vers une « démondialisation » ?
La religion de la compétitivité n'a de sens que dans l'hypothèse où c'est du commerce extérieur que dépend la croissance future. Or, pour la première fois depuis la création de l'OMC, avec la crise, la tendance du commerce extérieur est décroissante et inférieure à la croissance du PIB.
Non seulement le volume des échanges de marchandises est en baisse mais aussi celui des engagements financiers, ce qui est encore plus significatif.
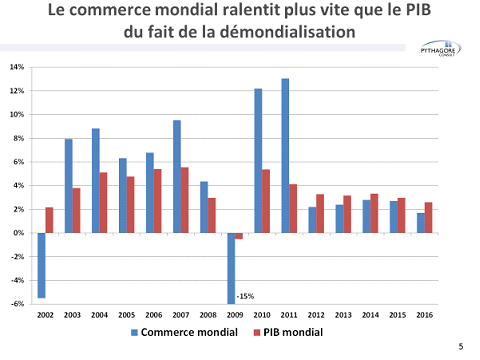
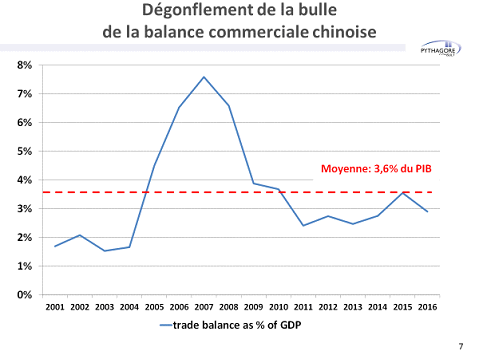
La locomotive des échanges internationaux connaît donc elle aussi des ratés.
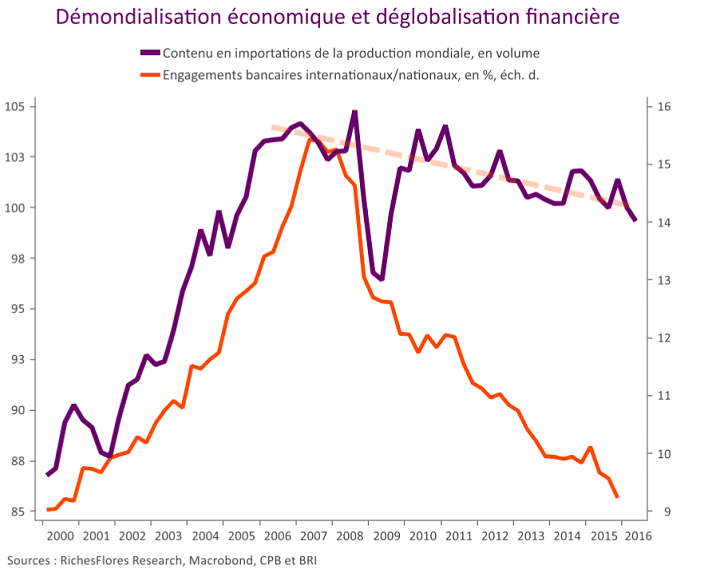
5. Conclusion : un équilibre mondial instable
L'origine de la crise de 2008 a été l'excès de dettes privées dans les pays riches industrialisés, des marchés actions et immobiliers survalorisés et la dissémination des risques qui vont avec, via la titrisation des subprimes et les CDS.
On peut se poser la question de savoir si le risque majeur ne serait pas aujourd'hui dans les pays émergents, qui ont tiré la croissance mondiale pendant quinze ans au prix d'un endettement colossal pour financer leurs investissements, le cas de la Chine étant emblématique.
Il se pourrait que la crise de 2008 ait bouleversé ce fragile château de cartes.
III. LA RÉVOLTE CONTRE LES ÉLITES
Nous l'avons vu 222 ( * ) , la révolution libérale qui a suivi la rupture des accords de Bretton Woods était non pas le pur produit d'une illumination intellectuelle, mais une arme politique au service d'intérêts matériels et sociaux puissants.
Cette forme nouvelle de lutte des classes, cette « révolte des élites » pour reprendre l'expression de Christopher Lasch, disions-nous, était significative de deux faits majeurs.
• Un fait social
On observe non seulement une répartition de plus en plus inégalitaire des revenus et des patrimoines, mais aussi une dissociation du corps social entre deux classes, où un petit nombre de privilégiés monopolisent les avantages de l'argent, de l'éducation et du pouvoir, la classe moyenne devant se partager inégalitairement entre l'une ou l'autre.
• Un fait politique
On constate la neutralisation du corps électoral, l'alternance au pouvoir dans chaque pays de deux camps d'accord sur l'essentiel, à savoir interdire, avec le secours d'une bureaucratie de l'expertise et du droit, toute remise en cause démocratique de l'ordre libéral ; avec le risque de paralyser toute réforme paisible du système, seules des crises de plus en plus graves pouvant le faire évoluer.
Il se pourrait bien que ce soit ce à quoi nous assistions dans de nombreux pays ; parfois, depuis une quinzaine d'années, mais avec une accélération depuis la crise.
Élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, victoire du Brexit en Grande-Bretagne, scores électoraux impressionnants de l'improbable mouvement « Cinq étoiles » et élimination de Matteo Renzi arrivé en sauveur de Italie voilà moins de trois ans, montée de l'extrême droite partout en Europe (FN en France, AfD en Allemagne, Ukip en Grande-Bretagne, parti de la liberté en Autriche, etc.), installation dans la durée de mouvements séparatistes en Catalogne, Italie du Nord, Flandre, autant d'événements, pour les plus récents non prévus par les sondages et en tout cas non souhaités par les médias, les partis alternant jusqu'ici au pouvoir et les électeurs « raisonnables ».
Quant à l'échec laborieux de Norbert Hofer, la personnalité indépendante et respectée de son adversaire à l'élection présidentielle autrichienne n'y est probablement pas pour rien. L'élection d'Alexander Van der Bellen est cependant un désaveu des partis qui ont gouverné l'Autriche depuis la fin de la guerre et dont les candidats ont été éliminés dès le premier tour du scrutin. Quant à la sortie de l'ombre de l'extrême droite et des mouvements séparatistes, son ancienneté a fait oublier qu'elle surprit aussi au départ.
La façon la plus simple et la plus immédiate de gommer ces désagréments quand on pense qu'il n'y a pas, pour parler comme Margaret Thatcher, d'alternative au système en place, mais qu'on ne peut plus nier qu'ils existent, est de leur dénier toute signification. Le mot valise « populisme », remis à l'honneur pour la circonstance, sert à cela. Il permet, en effet, de transformer en xénophobe raciste qui on veut : d'authentiques racistes et de non moins authentiques antiracistes, toutes les nuances de ceux qui ne se reconnaissent pas dans l'Europe telle qu'elle fonctionne, toutes les gradations de sceptiques sur la capacité de la « concurrence libre et non faussée » à réguler souverainement le monde et la vie des gens, etc. Un qualificatif qui, surtout, dispense de chercher d'autres raisons à ces comportements jugés aberrants que des tares morales (racisme, sexisme, volonté de puissance...) ou intellectuelles et un manque d'éducation.
Le problème, c'est que l'arme se retourne facilement contre ses utilisateurs.
A. LA REVANCHE DES « PITOYABLES »
À l'occasion d'un gala organisé à New York, le 16 septembre 2016, par LGBT pour soutenir la candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine, Hillary Clinton déclare, sous les rires des participants : « Pour généraliser, en gros, vous pouvez placer la moitié des partisans de Trump dans ce que j'appelle le panier des pitoyables . Racistes, sexistes, homophobes, xénophobes, islamophobes. Vous n'avez qu'à choisir. » Comme on a pu le voir à la télévision, la réponse des partisans de Donald Trump a été de transformer ce « pitoyable » en badge ostensiblement porté. Ce type de réaction n'est pas spécifique aux États-Unis, on l'a observé à l'occasion du référendum britannique sur l'appartenance à l'Union européenne et généralement à l'apparition de tout événement sortant du jeu régulier des institutions. Les insultes se retournent alors contre leurs auteurs. Réaction de Beppe Grillo après les élections de Donald Trump : « Ils prétendent que nous sommes sexistes, homophobes, démagogues et populistes. Ils ne réalisent pas que des millions de gens ne lisent plus leurs journaux et ne regardent plus leur télévision. » 223 ( * )
C'est pourtant cette fracture entre ce qu'on a coutume d'appeler les élites de la culture, du pouvoir, de la finance et une partie qui n'en finit pas de s'agrandir de la population à laquelle il faudrait remédier si l'on entend éviter la catastrophe. Une population qui peut très bien voter différemment lorsque le candidat et son programme lui conviennent. Michael Moore qui, lui, avait prévu la victoire de Donald Trump n'a pas manqué de le relever : « Vous devez accepter que des millions de gens qui avaient voté pour Barack Obama ont cette fois changé d'avis. Ils ne sont pas racistes. » 224 ( * )
Certes les institutions politiques et les médias dominants ont eu, pour leurs défenseurs, l'énorme avantage d'assurer la permanence du système en place, quoi qu'en puissent penser ceux qui en connaissent surtout les mauvais côtés. L'heure semble cependant venue de s'inquiéter de l'incapacité du système à donner une réponse aux attentes de ces avis dissidents. Sa capacité de digestion, comme on l'a vu en matière de régulation du système financier, est stupéfiante. Jusqu'à quand ? Telle est la question. Serge Halimi écrit très justement 225 ( * ) : « Si un homme presque universellement décrit comme incompétent et vulgaire a pu devenir président des États-Unis, c'est que, désormais, tout est possible. » On n'attendra pas longtemps pour le voir !
À en juger par l'idéologie et les traditions d'une partie des « antisystèmes » comme des défenseurs du système, l'avenir pourrait bien parodier le conseil ironique de Brecht ainsi résumé : « Le peuple ayant perdu la confiance du Gouvernement, il serait plus simple pour lui de dissoudre le peuple et d'en élire un autre. » 226 ( * ) Ce qu'un éminent universitaire américain traduit dans la prestigieuse revue Foreign Policy , sous le titre « Trump a gagné parce que ses électeurs sont ignorants, vraiment », par : « La démocratie a pour vocation de mettre en oeuvre la volonté populaire. Mais qu'en est-il si le peuple ne sait pas ce qu'il fait ? » 227 ( * )
Nous allons voir que les peuples sont moins inconséquents qu'il n'y paraît.
B. LA RÉVOLTE DES CLASSES MOYENNES
Nous l'avons dit, la rançon de la restauration libérale, c'est, dans tous les pays, malgré des différences, la baisse des revenus du travail, l'augmentation des inégalités de revenus et de patrimoines 228 ( * ) . Le constat portait sur l'évolution de la part revenant aux 10 % les plus riches de la population ainsi que sur l'évolution de la part revenant à chacune de ses fractions jusqu'au premier millième. Il apparaissait que l'augmentation était d'autant plus importante que la fraction de population concernée rétrécissait.
Une question essentielle n'était pas directement abordée : qu'en est-il, non pas de l'évolution du sort des plus riches par rapport à celui de l'ensemble de la population, mais de celle de la situation des classes moyennes et des plus pauvres ?
1. La leçon de l'éléphant
« Loin de s'atténuer comme on
l'escomptait,
les inégalités de revenus se sont
accentuées depuis un quart de siècle. »
Branko
Milanovic
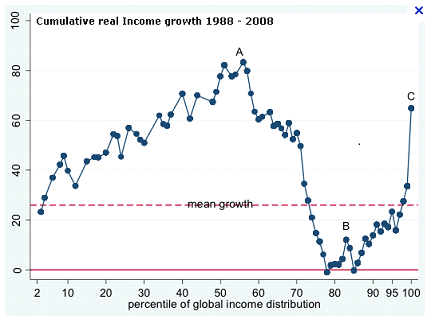
Ce graphique de l'économiste Branko Milanovic, ancien directeur de la recherche de la Banque mondiale, retrace l'évolution des revenus, hors inflation, de 1988 à 2008, au niveau mondial. La distribution des revenus est découpée en parts de 1 % qui seront placées en fonction de leur évolution. On obtient une courbe qui a la silhouette d'un éléphant.
On constate que, pour les personnes situées au voisinage de la médiane (point A), principalement des Chinois et des Indiens, le revenu a augmenté de 80 % durant la période. On a vu ce que la régression de la pauvreté dans le monde devait à la Chine et, quoique à un moindre degré, à l'Inde. En revanche, la partie basse, entre A et B, qui correspond aux revenus des classes moyenne des pays développés, traduit une nette dégradation de leur situation. Au contraire, le point C qui correspond au centile le plus élevé de la distribution vérifie ce que nous savions déjà.
Voici ce qu'a déclaré Branko Milanovic au magazine suisse L'Hebdo le 23 juin 2016 : « Lorsqu'on examine les données économiques, on remarque que l'avènement de [Donald Trump, Marine Le Pen, l'AfD] va de pair avec le déclin de la classe moyenne dans presque tous les pays industrialisés.
« Les revenus réels de beaucoup de travailleurs modestes n'ont qu'à peine augmenté en Occident ces vingt-cinq dernières années, alors que ceux des plus riches ont explosé. Au milieu des années 1970, aux États-Unis, le pourcentage le plus riche de la population empochait 8 % du revenu national. Aujourd'hui, c'est à peu près 20 %. Bien des gens sont déçus, ce qui se répercute sur leurs choix d'électeurs.
« Il a fallu du temps pour que les gens comprennent ce qui se passe. Aux États-Unis, en tout cas, la crise financière a été un déclencheur décisif. Auparavant, les gens gagnaient déjà peu, mais ils se sentaient plus riches parce que leur banque les fournissait en crédits bon marché et que la valeur de leur maison augmentait. Lorsque la bulle a éclaté, ils ont compris d'un coup qu'il ne leur restait pas grand-chose.
« Les différences sont particulièrement criantes en Amérique, mais le modèle est le même dans d'autres économies occidentales. L'inégalité n'a reculé dans aucun pays. Même la Suède, avec sa tradition sociale-démocrate, est devenue plus inégale. Or, selon les populistes, c'est la mondialisation qui en est responsable.
« [Les populistes] n'ont en tout cas pas tout à fait tort. La plupart des économistes attribuent la montée des inégalités à trois facteurs indépendants les uns des autres : le progrès technologique, la politique de dérégulation et une concurrence croissante de la part de pays comme l'Inde et la Chine. Je suis convaincu que ces trois facteurs sont en lien avec la mondialisation.
« [Les] critiques de la mondialisation ont affirmé que l'ouverture des frontières appauvrirait les pays pauvres et enrichirait les riches. Ironie de l'histoire, c'est le contraire qui s'est produit : dans les pays riches, la classe moyenne est sous pression, tandis que dans les pays pauvres une classe moyenne a vu le jour. N'oublions pas qu'en Chine et en Inde, les revenus ont parfois fortement augmenté. Et l'on parle ici de 1,5 à 2 milliards de personnes concernées. Pour ces gens, la mondialisation aura été un bénéfice et ces années passées auront été de bonnes années.
« [Aux] États-Unis, l'inégalité a atteint une ampleur qui menace des acquis essentiels. Lorsque l'accès à une bonne formation est interdit à des salariés "normaux" parce qu'ils ne peuvent se payer l'université, lorsque les super-riches peuvent, avec leur argent, in?uencer l'agenda politique, on a les caractéristiques d'un pouvoir ploutocratique dont la stabilité ne peut être assurée que par un appareil sécuritaire sans cesse plus important. »
2. Le Royaume désuni : un Brexit moins imprévu qu'il n'y paraissait
En 2006, rappelle Véronique Riches-Flores, 24 % des Britanniques avaient un revenu compris entre une fois et deux fois le revenu moyen européen. En 2014, ils n'étaient plus que 13 % ! Les graphiques ci-dessous confirment l'appauvrissement important d'une partie des Britanniques en fonction de leur catégorie sociale et de la région où ils résident.
• Alors que 32 % seulement des Britanniques avaient un niveau de vie inférieur à la moyenne de l'UE, avant la crise, ils sont 68 % dans ce cas après
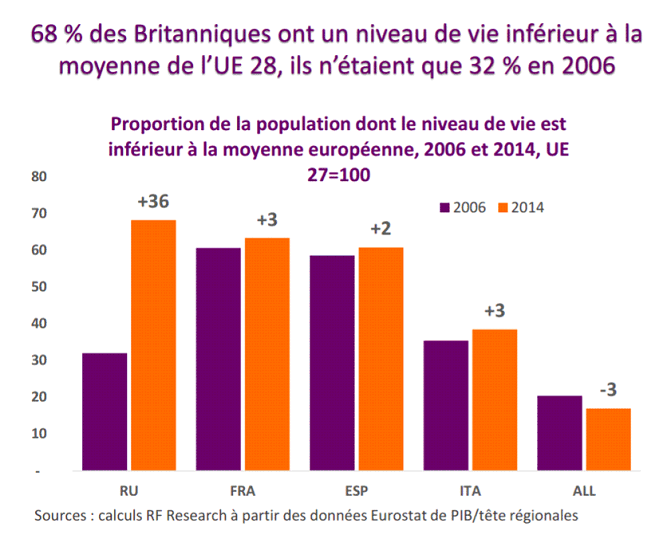
• En 2006, 17 % des Britanniques ont un revenu juste supérieur à la moyenne (entre 100 et 124), ils ne sont plus que 11 % en 2014 (entre 96 et 123).
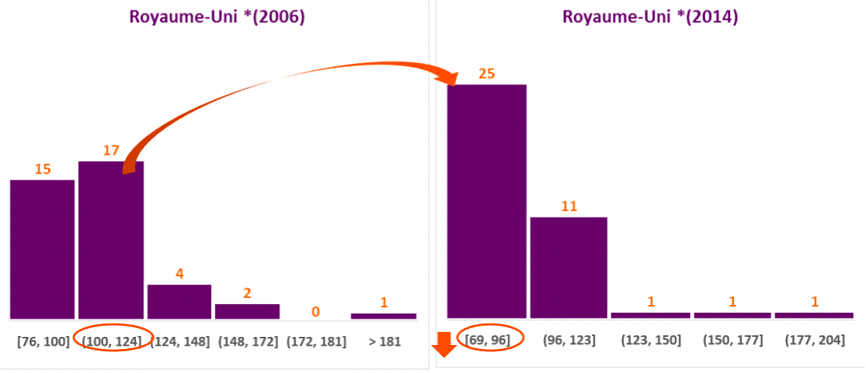
• Liste des régions ayant subi un déclassement durant la période, soit 44 millions d'habitants. La Grande-Bretagne ne se résume pas au Grand Londres.
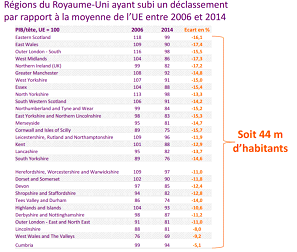
• Évolution de la situation des régions durant la crise
Plus la couleur est chaude, plus la situation s'est améliorée et, inversement, plus elle est froide, plus elle s'est dégradée. De nombreuses parties de l'Angleterre sont ainsi passées en zone froide.
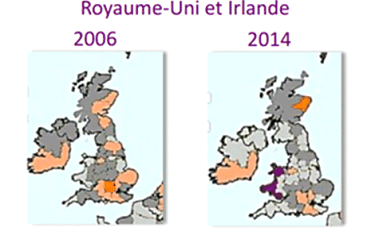
3. Les raisons du vote Trump
a) La situation des ouvriers
Comme on le sait, le succès de Donald Trump a tenu au passage aux Républicains des électeurs de quatre États de la « ceinture de la rouille » : Ohio, Wisconsin, Pennsylvanie et Michigan. Pendant que Trump y a fait campagne contre le libre-échange et les délocalisations, Hillary Clinton boudait ces États qui, jusque-là, votaient démocrate et où la situation des ouvriers n'avait pas cessé de se dégrader. Dans le Wisconsin, comme l'explique Jérôme Karabel dans Le Monde diplomatique 229 ( * ) , « entre 1975 et 2014, les revenus médians des travailleurs blancs sans diplôme ont décliné de plus de 20 %, avec une chute de 14 % entre 2007 et 2014 ».
Michael Moore avait pronostiqué, alors que tous les sondages indiquaient une nette victoire d'Hillary Clinton, que c'est dans ces États qu'elle perdrait les élections.
b) La question du logement
Un autre élément à prendre en compte, étonnamment oublié dans les analyses, est l'impact de la crise immobilière sur les électeurs dans un pays où la population est plus mobile que sur le vieux continent.
La propriété immobilière n'est pas seulement un moyen de se loger mais aussi une sorte d'assurance et une garantie permettant d'emprunter en cas de besoin.
Ce que montrent les graphiques ci-après, c'est l'explosion du prix des habitations, le gros de la crise passée, en même temps que la baisse du taux de propriétaires. C'est aussi l'inflation des loyers en même temps que la baisse des salaires.
C'est, au final, un transfert de ressources des locataires aux propriétaires et plus d'incertitudes pour une partie de la population qui, jusque-là, « s'en sortait ».
On peut présumer raisonnablement que ce malaise s'est traduit dans les urnes.
• Diminution du nombre de propriétaires, hausse des loyers
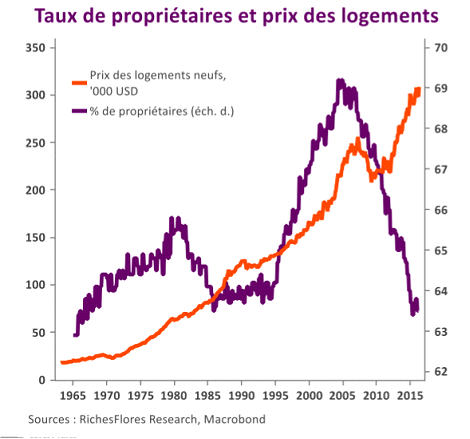
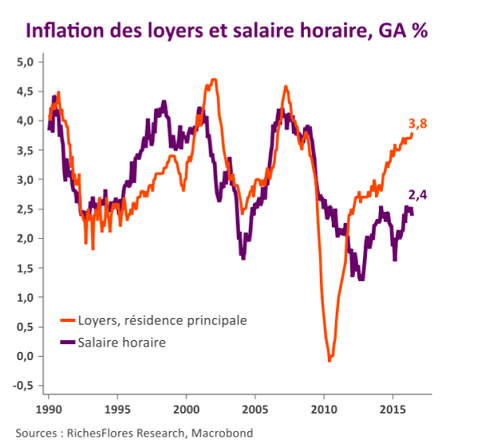
• Transfert historique des revenus des locataires vers les propriétaires
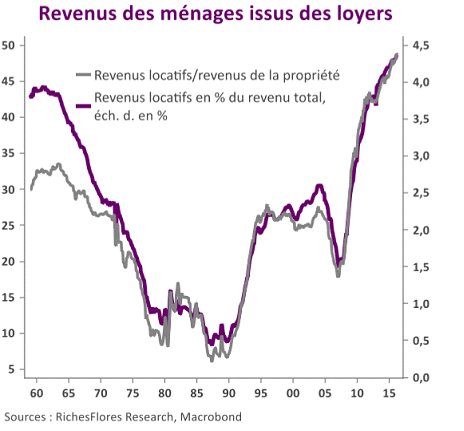
c) La fracture entre les États de la Fédération
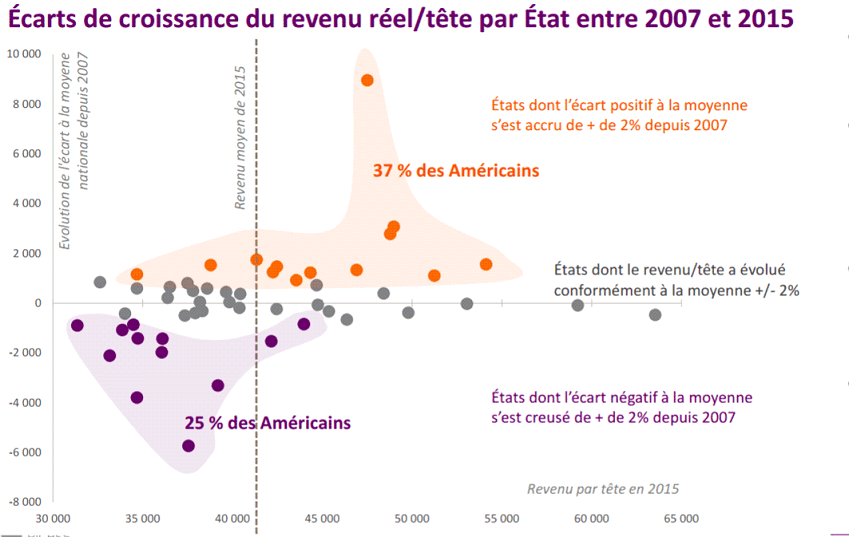
Les États les plus pauvres ont souvent vu leur position relative s'aggraver depuis 2008 :
- les activités de services y sont en retrait par rapport à la moyenne nationale, les gisements d'emploi, peu qualifiés, sont trop faibles, le taux de participation à la vie économique y a particulièrement baissé ;
- la moindre mobilité de la population (crise immobilière, avancement de l'âge) installe ces États dans un retard chronique ;
- d'où la frilosité des consommateurs, un sentiment d'insécurité et la rancoeur de la population.
Comme le montre le graphique ci-dessus, douze États américains représentant 25 % de la population ont vu leur revenu par tête diminuer de plus de 2 % par rapport à la moyenne depuis 2007. Treize États représentant 37 % de la population l'ont vu augmenter de plus de 2 %. Pour vingt-quatre États, la variation se situe entre une baisse de 2 % et une hausse de 2 %.
4. L'Europe
• En Europe, si la paupérisation relative de la Grande-Bretagne est spectaculaire, il faut constater que dans tous les pays, à l'exception de l'Allemagne, le niveau de vie par habitant aura régressé avec la crise.
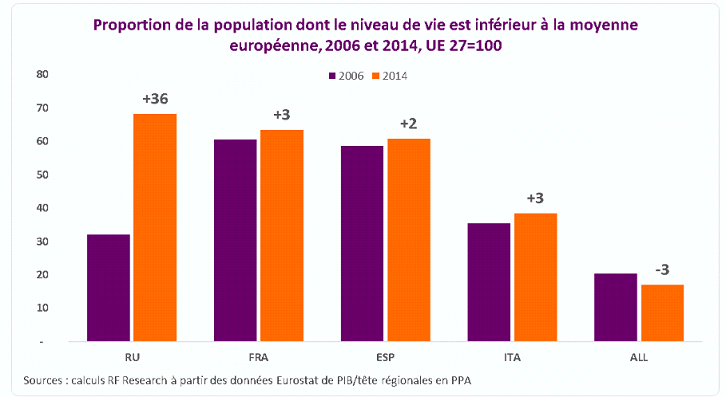
• Particulièrement significatif est le diagramme que l'on doit à Riches-Flores Research 230 ( * ) , qui représente l'évolution du PIB par habitant et de la croissance entre l'avant crise (2000-2007) et la crise (2008-2015). On constate un glissement de l'ensemble des pays - à l'exception de l'Allemagne, qui reste stable mais doit se contenter d'un développement au ralenti - vers la zone de couleur froide signifiant un ralentissement de la croissance, voire pour beaucoup, une décroissance, cas de l'Italie, de l'Espagne, de la Grèce évidemment, de l'Autriche, et de bien d'autres. Pour certains pays, même si la croissance reste positive, elle est nettement inférieure à ce qu'elle était dans la période antérieure.
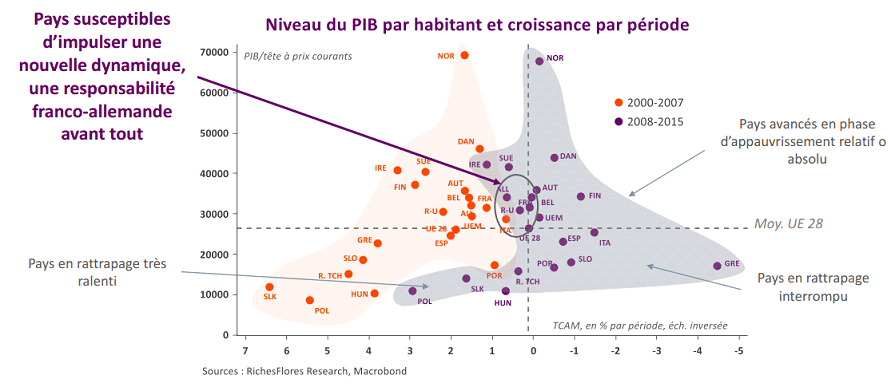
• L'histogramme ci-dessous montre, de son côté, la croissance de la pauvreté, y compris en Allemagne, entre l'avant-crise et la période de crise.
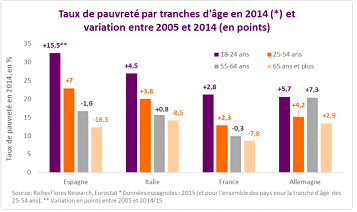
5. Le cas autrichien
La montée de l'extrême droite en Autriche, pays européen riche où les inégalités sont relativement réduites et le taux de pauvreté faible, passe pour inexplicable, sauf à évoquer une tradition ancienne et l'âge moyen de la population. Il suffit de regarder le diagramme ci-dessus qui présente le niveau de PIB par habitant et la croissance par période pour commencer à se douter qu'il pourrait y avoir aussi d'autres raisons.
• La première est certainement la stagnation de la croissance .
Au cours des cinq dernières années, le chômage a progressé dans ce pays habitué au plein emploi, passant de 4 % à 6 % de la population active. Surtout, il a fortement augmenté pour les plus de cinquante ans. Depuis 2011, la croissance plafonne à moins de 1 %. Les revenus stagnent, voire reculent.
• À cela s'ajoute la peur de l'immigration, vécue comme une forme de mondialisation à domicile. Elle est d'ailleurs très présente à Vienne, où plus d'une personne sur cinq est d'origine étrangère. Une peur activée par le flux des réfugiés en 2015, à comparer avec les réactions en France qui a accueilli moins de 100 000 réfugiés.
• Quoi qu'il en soit, selon les observateurs, la peur du déclassement a été omniprésente durant la campagne électorale présidentielle.
CONCLUSION : QUAND L'HISTOIRE BÉGAIE
Notre époque d'incertitudes et de troubles a, sans conteste, des airs de déjà-vu ; pour parler clair, d'entre-deux-guerres. Sur un mode mineur certes, les conséquences financières, économiques et sociales de la première Grande crise du XXI e siècle ont été bien moins dramatiques que celles de la Grande crise précédente. Quant aux émeutes électorales d'aujourd'hui, on ne saurait, à ce jour, les comparer aux bouleversements politiques d'alors, n'était qu'elles témoignent du même rejet des institutions en place et du personnel politique, n'était qu'elles sont grosses de troubles à venir si aucune réponse ne leur est apportée.
Derrière ce rejet point une profonde inquiétude quant à la capacité du nouveau libéralisme de trouver une issue à la crise, ce qu'avaient su faire les New Dealers et leurs alliés en leur temps. Pour dire les choses autrement, sont remis en question les a priori qui ont servi à justifier l'abandon de la régulation financière et économique mise en place avant même la fin de la Seconde Guerre mondiale : les lois économiques sont des lois naturelles auxquelles on ne peut que se soumettre, ce qui délégitimait toute intervention politique ; il est possible d'organiser le système économique et, plus largement, l'ensemble de la vie sociale sur la base de marchés concurrentiels autorégulateurs pour le plus grand bien de l'Humanité et de la planète.
On a un peu vite oublié que ce sont précisément les questions qui ont taraudé les années trente quand il devint évident qu'on ne pourrait sortir de la crise globale dans laquelle s'enfonçaient l'Europe et l'Amérique sans remettre en cause l'ordre libéral qui avait dominé le XIX e siècle.
C'est ce changement de « paradigme », cette « Grande transformation » que décrit Karl Polanyi dans son livre éponyme 231 ( * ) .
« Au début des années trente, le changement intervint brusquement. Les événements marquants en furent l'abandon de l'étalon-or par la Grande-Bretagne ; les plans quinquennaux en Russie, le lancement du New Deal ; la révolution nationale-socialiste en Allemagne et l'effondrement de la SDN, au profit d'empires autarciques. Alors qu'à la fin de la Grande Guerre les idéaux du XIX e siècle l'emportaient, alors que leur influence avait dominé la décennie suivante, tout vestige avait disparu en 1940 du système international et, quelques rares enclaves exceptées, les nations vivaient dans un cadre entièrement neuf. »
L'origine du cataclysme, Polanyi la révèle quelques pages plus loin : « L'entreprise utopique par laquelle le libéralisme a voulu créer un système de marchés autorégulateurs. Pareille thèse semble investir ce système de pouvoirs presque mythiques ; elle suppose, ni plus ni moins, que l'équilibre des puissances, l'étalon-or et l'État libéral, ces principes fondamentaux du XIX e siècle tenaient tous leur forme, en dernière analyse, d'une unique matrice commune, le marché autorégulateur. »
D'où cette impression de déjà-vu, que l'Histoire se répète.
Cette analyse, voulue la plus large possible disions-nous en avant-propos, devait nous permettre de donner forme à quelques-uns des scénarios d'évolution pensables de cette crise en quête de fin. Parvenus à son terme, que pouvons-nous raisonnablement penser ?
D'abord qu'après dix ans de crise la probabilité de réédition d'un krach du système financier d'ampleur équivalente n'a pas diminué, bien au contraire . Les quelques dispositions pour rendre le système moins instable, qui ont pu lui être imposées sous le coup de l'émotion et la pression des opinions publiques, non seulement ont laissé intact l'essentiel mais ont été largement compensées par les effets négatifs du traitement utilisé pour le sortir du coma et réanimer l'économie : l'injection massive de liquidités et des taux directeurs aux limites du pensable.
Tous les ingrédients, anciens comme nouveaux, d'un nouveau krach sont donc là et aucun des spécialistes que nous avons rencontrés, même ceux dont la fonction est d'être optimistes, ne se risque à dire que le danger est derrière nous. Révéler des origines inédites d'une potentielle crise est même devenu un genre éditorial de la presse économique qui aime à se faire peur, de temps en temps.
L'hypothèse d'un nouveau krach financier, à moyen terme, ne saurait donc être écartée, loin de là. Pour nous, ce n'est pas, cependant, le scénario le plus probable. S'il devait se réaliser, ce serait probablement davantage comme conséquence d'événements collatéraux, notamment politiques, que comme cause première. Cela dit avec toutes les précautions d'usage, au regard de la difficulté à démêler l'écheveau des causes et des effets.
Que l'instabilité du système financier n'ait pas diminué n'implique pas nécessairement la réédition d'un krach systémique, tant sont nombreux les paramètres à prendre en considération. Comme l'observe Henri Sterdyniak 232 ( * ) cité au tout début du rapport, la caractéristique de notre situation est d'être « une instabilité stable qui n'a aucune rationalité. Elle est insoutenable et, paradoxalement, le système tient bon ».
Soyons-en persuadés, en cas de nouvel incendie, les pompiers centraux inonderont de nouveau le bâtiment en feu, fût-ce au risque de le rendre encore plus inhabitable. Le système financier vivant sur lui-même et pour lui-même, en cas de thrombose, ses anges gardiens institutionnels trouveront bien l'anticoagulant qui le sauvera une fois encore. L'irrationalité des systèmes, en effet, ne dit rien de leur durée de vie. L'Histoire est riche d'organisations irrationnelles qui ont longtemps survécu.
Dans cette grande transformation de l'Empire américain tardif, la mutation du système financier n'est qu'un élément d'un complexe plus vaste d'intérêts idéologiques et politiques, économiques et sociaux. Sa défaillance technique à elle seule ne suffira pas à imposer son abandon, même pas sa réforme. La justification rituelle servira encore : les dysfonctionnements du système sont la preuve non pas qu'il doit être mis à la réforme mais qu'on n'a pas appliqué les règles avec suffisamment de zèle ou assez longtemps.
Peut-on pour autant s'attendre, dans un délai raisonnable, à une reprise spontanée de l'activité économique qui remettrait l'appareil productif sur la trajectoire de développement de l'avant-crise ? Nous le pensons encore moins.
Si la théorie de la reprise rapide devait être vérifiée, elle l'aurait été depuis longtemps ! Comme nous l'avons vu 233 ( * ) , malgré le maquillage des chiffres, la crise de langueur économique est durablement installée, particulièrement en Europe dont le destin ressemble de plus en plus à celui du Japon, mais avec un niveau de chômage largement supérieur, ce qui n'est pas un détail 234 ( * ) .
Sauf intervention des responsables politiques qui auraient compris qu'il est temps de frapper fort et de changer de médecine, le scénario le plus probable, c'est la prolongation de ce purgatoire économique pour une durée indéterminée. Indéterminée mais pas éternelle dans la mesure où, comme on le voit déjà, cette situation entre chien et loup risque fort de dégénérer en une série de crises politiques qui bousculeront nécessairement l'ordre financier et économique en place, avec des effets totalement imprévisibles.
Qui, en effet, aurait prévu que ce serait le président du principal pays bénéficiaire de la restauration libérale, entouré d'une garde rapprochée issue de Goldman Sachs, qui serait le premier à la remettre en cause ? Plus exactement les conséquences sociales et territoriales de cette restauration, tout en se gardant de contester la logique du système. Déréguler 235 ( * ) un peu plus les flux financiers et, en même temps, rigidifier les échanges de marchandises et d'hommes, il y a comme une contradiction dont le résultat risque d'être détonant. « America First », scande Donald Trump. Comme s'il n'en était jamais allé autrement, grâce au dieu dollar et à l'US Army ! Qu'une poignée d'autres pays y ait trouvé aussi son compte ne change rien à l'affaire. Impossible de toucher seulement à quelques pièces du système sans remettre en cause son équilibre, avec le saut dans l'inconnu que cela représente.
Il aura suffi de quelques jours seulement pour que les contradictions du projet de Donald Trump apparaissent. Ainsi celles de sa politique du dollar. « En ce qui concerne le dollar, Donald Trump est son propre pire ennemi » pouvait-on lire dans le Financial Times du 25 janvier 2017 236 ( * ) . Il entend faire baisser le dollar pour faciliter les exportations américaines en même temps qu'il annonce des politiques qui, en faisant grimper les taux d'intérêts (grands travaux, hausse des taux directeurs), en augmentent l'attrait. Plutôt qu'à une baisse du dollar, c'est à sa hausse qu'il faut s'attendre, ce qui aurait pour conséquence, selon des économistes comme Joseph Stiglitz, une crise de la dette dans certains pays émergents, débouchés par ailleurs des exportations étasuniennes. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas bien comment concilier le statut du dollar, monnaie de réserve et refuge, et celui de monnaie faible.
De même, on ne voit pas bien comment interdire l'immigration aux États-Unis et continuer à bénéficier, à domicile et à l'extérieur, d'une main-d'oeuvre, à bas coût pour partie d'entre elle, très qualifiée pour l'autre partie, sans avoir eu à la former. La Silicon Valley est en émoi et la liste des P-DG de multinationales étasuniennes ayant manifesté leur opposition à une remise en question de la politique libre-échangiste qui fait leur fortune ne cesse de s'allonger 237 ( * ) . Le nouveau président des États-Unis ne semble pas avoir réalisé qu'il vient de donner le coup d'envoi à un nouvel épisode de la lutte des classes dans son pays.
Ces derniers événements, en tout cas, confirment la tendance générale à l'exacerbation des contradictions politiques entre pays et à l'intérieur de chaque pays, la Grande-Bretagne et les États-Unis jouant désormais le rôle de principal trublion. Le fait que ce soit deux pays où les effets sociaux de la restauration libérale ont été particulièrement marqués n'y est probablement pas pour rien.
Quelles sont les réponses possibles à cette situation de moins en moins lisible selon les grilles de lecture habituelles ? Autrement dit, quelles sont les voies de sortie de crise restant encore ouvertes ?
Pour les plus optimistes, à moins que ce ne soient les réalistes de l'impossible, le salut passe par la réforme d'un système monétaire international qui a institutionnalisé les changes flottants, les déséquilibres des balances extérieures et intronisé le Roi dollar, en même temps que par une sécurisation sans état d'âme du système financier international.
Ils ont certes raison, mais où trouver le nouveau Roosevelt susceptible de conduire le bal ? Visiblement pas aux États-Unis, et encore moins ailleurs. Jamais la question n'a été évoquée, même au plus fort de la crise, et qui peut penser que la puissance impériale acceptera, au terme d'une négociation paisible, de se dépouiller des instruments de sa puissance ? Quel gouvernement est prêt à promouvoir réellement des échanges régulés entre partenaires selon leurs capacités productives, en lieu et place de la concurrence, certes libre, mais armée ?
Pourquoi les responsables politiques qui ont construit le système financier en place, qui l'ont sauvé du naufrage au prix fort, proposeraient-ils de brider ce qu'ils tiennent pour le moteur du système économique ? Pourquoi l'oligopole bancaire et ses alliés accepteraient-ils mieux aujourd'hui ce qu'ils ont toujours refusé, même au pire moment de la crise ? Les réformes Potemkine qui se sont finalement imposées ont laissé le système inchangé sur le fond et la tendance, chez les Anglo-Saxons, est plutôt au démontage du peu qui a été fait.
S'agissant des Européens, et de la France en particulier, il est clair que c'est la question de l'Europe, plus exactement celle du mode de construction de l'Europe ainsi que de la zone euro, celle de leurs objectifs et de leurs modes de fonctionnement qui se trouvent posées, avec encore plus d'acuité qu'hier. Il s'agit non plus seulement de réformer une institution qui a dépossédé les peuples de leur souveraineté en contrepartie d'une souveraineté collective qu'on attend toujours, un système qui aggrave les déséquilibres entre membres au lieu de les réduire au fil du temps, mais, en urgence, d'en faire l'outil d'affirmation du Vieux continent face à l'Empire qu'il aurait dû être et qu'il ne fut jamais.
Deux approches sont envisageables.
Pour les européistes convaincus, la sortie de crise passe par le haut, c'est la sortie fédérale. Pour eux, la solution aux dysfonctionnements de l'Europe, ce n'est pas moins d'Europe, mais plus d'Europe. D'ailleurs, selon la légende, ne s'est-elle pas construite de crises en crises surmontées ?
Certes, mais pour quels résultats ? Pas une meilleure protection des crises venues de l'extérieur, on l'a vu en 2007. Pas une meilleure dynamique économique, plus d'emplois et moins de chômage. Si, aujourd'hui, les peuples continuent à rêver d'Europe, le projet européen a cessé d'être l'utopie réaliste qu'il était encore il n'y a pas si longtemps. Les peuples se méfient désormais des promesses de lendemains qui chantent non tenues et supportent de plus en plus mal de se voir imposer un destin auquel ils croient de moins en moins.
Philippe Séguin, à la tribune de l'Assemblée nationale, le 5 mai 1992, lors du débat préalable à la ratification référendaire du traité de Maastricht, mettait déjà en garde les petits malins qui pensaient pouvoir construire l'Europe en forçant la main de ses peuples : « [Quand], du fait de l'application des accords de Maastricht, notamment en ce qui concerne la monnaie unique, le coût de la dénonciation sera devenu exorbitant, le piège sera refermé et, demain, aucune majorité parlementaire, quelles que soient les circonstances, ne pourra raisonnablement revenir sur ce qui aura été fait.
« Craignons alors que, pour finir, les sentiments nationaux, à force d'être étouffés, ne s'exacerbent jusqu'à se muer en nationalismes et ne conduisent l'Europe, une fois encore, au bord de graves difficultés, car rien n'est plus dangereux qu'une nation trop longtemps frustrée de la souveraineté par laquelle s'exprime la liberté, c'est-à-dire son droit imprescriptible à choisir son destin. »
Face à un Donald Trump, même contesté chez lui, on a du mal à évaluer ce que pèsent les dirigeants européens et même s'ils entendent vraiment peser.
La seconde approche, faute de solution fédérale, serait de se limiter à quelques réformes, certes sectorielles, mais susceptibles à la fois de sécuriser durablement le système financier européen, ce qui éviterait d'avoir à intervenir en catastrophe, et d'engager une politique économique de sortie de crise et donc de redonner un avenir au vieux continent.
La sécurisation du système bancaire passe prioritairement et en urgence par la séparation réelle des banques de dépôts et des banques d'affaires, la limitation stricte du levier d'endettement des banques et de l'ensemble des acteurs financiers ( hedge funds en particulier), l'assèchement des bilans bancaires de leurs créances douteuses. Le reste suivrait progressivement.
Les chances de voir réussir de telles réformes qui ont jusque-là été tenues en échec sont cependant infimes. Qui aurait intérêt à mécontenter le lobby bancaire, lequel n'entend pas voir réduites ses possibilités de business et de profit ? On a vu cela suffisamment en détail pour n'avoir pas à y revenir. Pour la plupart des responsables politiques et financiers, dont l'aptitude à croire ce qui les arrange n'est jamais prise en défaut, le gros du danger est derrière nous. Certes, la crise s'éternise mais on est sorti de l'urgence et les « émeutes électorales » sont sans rapport avec la situation économique et sociale. Une simple affaire de psychologie, d'ignorance et d'éducation des masses. Une partie des électeurs, incapables de comprendre où est leur intérêt véritable, égarés par des démagogues, ont simplement des comportements inappropriés. Argument suprême, ces bouffées de colère électorale, ici ou là suivies ou précédées de protestation dans la rue ou de grèves, n'ont encore débouché sur rien de constructif. Mais le risque justement est qu'elles débouchent sur des solutions essentiellement destructrices.
S'agissant de la politique de sortie de crise toujours en souffrance, elle passe nécessairement par une réforme de la zone euro et de son mode de fonctionnement. On sait très bien ce qui la paralyse et qui, en bloquant le développement économique égalitaire de ses membres, pénalise l'ensemble. Nous avons largement développé la question 238 ( * ) . Constatons que l'Allemagne, grande bénéficiaire du système, continue de faire prévaloir son point de vue et que la France préfère la satisfaction d'amour propre d'une illusoire codirection de l'Europe avec l'Allemagne à la défense de ses intérêts. Intérêts économiques plus proches de ceux de l'Italie ou de l'Espagne que de ceux de l'Allemagne. Il est vrai que le choix français initial de l'industrie bancaire plutôt que de l'industrie n'est pas pour rien dans la permanence de cette attitude.
Pour le reste, ce n'est certainement pas le poussif « plan Juncker », qui permettra d'enclencher une quelconque dynamique économique européenne, sauf dans les discours. Si c'était le cas, on l'aurait déjà constaté. Mais, là aussi, on ne voit pas pourquoi l'Allemagne accepterait de modifier un système qui lui réussit si bien et cesserait de s'opposer à tout aménagement, même mineur.
En conclusion, la réforme de la zone euro par un perfectionnement progressif des institutions et le jeu naturel de négociation entre partenaires animés du même idéal, que l'on continue de présenter non seulement comme souhaitable mais possible, est donc une illusion totale. Avec la crise, les masques sont tombés. L'Union européenne est de moins en moins un outil de coopération entre Européens et de plus en plus un champ où s'affrontent des intérêts contradictoires. S'il en fallait une preuve, la tragédie grecque en est le dramatique et pitoyable exemple. Notre conviction est que l'Union européenne n'est pas réformable dans le cadre des traités tels qu'ils sont.
Dans cette hypothèse, quelle serait, pour la France, la politique la plus réaliste et donc la plus susceptible, à terme, de préserver ses intérêts, ceux des Français et probablement aussi ceux l'Europe, qui risque autrement de ne pouvoir survivre aux conséquences politiques de la perpétuation du purgatoire économique actuel ?
• La première des urgences serait de renoncer à l'illusion d'une possible réforme progressive de la zone euro qui, en supprimant les contradictions internes qui la bloquent, en ferait un outil de développement pour l'ensemble des partenaires.
Le vice de l'euro résulte, en effet, d'un mode de construction non seulement dépourvu d'un système de redistribution des excédents permettant d'atténuer les effets pervers des déséquilibres internes mais paralysé par un carcan réglementaire de contraintes budgétaires compliquant encore la lutte contre la dépression.
Comme le souligne Jacques Sapir, l'euro n'est pas une monnaie unique mais un système de parités fixes entre des monnaies zombies, des euros nationaux, convertibles entre eux par un système de parités fixes de un pour un. La crise chypriote, par laquelle, du jour au lendemain, les euros de l'île n'ont plus été convertibles et les dépôts bancaires ont été taxés, ce qui revenait à en dévaluer la valeur, a montré que le système était sécable. Preuve aussi qu'aujourd'hui tous les euros ne se valent pas.
Le résultat, c'est une monnaie sous-évaluée pour l'Allemagne, la seule bénéficiaire du système, et surévaluée pour tous les autres membres de la zone. Le résultat, c'est qu'en cas de crise, faute de pouvoir dévaluer leur monnaie, les pays en difficulté n'ont plus que le choix de la « dévaluation interne » par la baisse des salaires et de l'investissement. Autant de facteurs de dépression d'abord localement et de proche en proche, dans la zone tout entière. Pouvoir dévaluer sa monnaie est un levier de sortie de crise essentiel. Comme l'a montré Paul Krugman, l'Islande, qui a fortement dévalué sa monnaie, a retrouvé plus rapidement de bien meilleurs résultats économiques que l'Irlande, engluée dans l'euro.
Quand se conjuguent contraintes salariales pour cause de compétitivité interne et impératifs d'équilibre budgétaire et de désendettement pour satisfaire aux contraintes des traités, il ne faut pas s'étonner de retrouver la tôle ondulée au rendez-vous.
Par ailleurs, le refus de toute monétisation de la dette publique ou sociale, au mieux crée une rente perpétuelle pour les banques (aux frais du contribuable), au pire expose les États au chantage spéculatif des marchés. Avant l'euro, trésors et banques centrales nationales surveillaient le taux de change. Ils ont désormais les yeux rivés sur le spread . Considérable progrès de la souveraineté !
Le dilemme de tout gouvernement français est donc le suivant : continuer à faire le dos rond face à une crise qui s'éternise, en tentant de faire croire qu'on réglera le problème en durcissant une politique de l'offre qui n'a jamais donné de résultats (ixième loi de flexibilité, fiscale ou d'amélioration de la formation), ou envisager sérieusement une sortie de la zone euro.
Ce qui permettrait à la France de retrouver de la compétitivité ainsi qu'un rééquilibrage des échanges. Ce qui mettrait un terme au carcan budgétaire que l'on s'est volontairement imposé et permettrait de retrouver une indépendance totale à l'égard des marchés financiers. Agiter le spectre de la faillite n'est qu'un épouvantail. Une monnaie souveraine ne peut être déclarée en faillite si le gouvernement emprunte dans cette monnaie. En cas de sortie de l'euro, la dette antérieure libellée en euros selon le principe de la loi monétaire sera simplement renommée en monnaie nationale.
• La seconde des urgences , selon nous, serait une modification substantielle des circuits de financement des entreprises, particulièrement des petites et des moyennes, les grandes et très grandes n'étant pas logées à la même enseigne. On pourrait pour cela s'inspirer de l'organisation existant avant les bouleversements des années 1980-1990, en créant, ou plutôt en recréant, des circuits de financement à partir de l'épargne régionale, très abondante (développement de la BPI, de la Banque postale et élargissement des missions de la CDC...).
Affranchis des contraintes budgétaire maastrichtiennes, le versant stimulation de la demande serait de doper l'investissement public par de grands chantiers, du type couverture du territoire en haut et très haut débit 239 ( * ) ou lignes à grande vitesse (LGV), en y associant les collectivités territoriales dont l'action locale constitue un multiplicateur naturel de l'effet des investissements.
On pourrait aussi, suprême audace, revoir la politique salariale dans un sens favorable à la consommation.
En formulant ces propositions - tout aussi réalistes que le Brexit réputé impossible tant qu'il n'a pas été réel -, on a bien conscience de prêcher dans le désert.
Il est malheureusement vain d'espérer du jeu normal des institutions politiques existantes un projet réformiste préventif significatif, encore moins des mesures effectives, sans y avoir été contraint par les événements.
Si sortie de la crise de langueur économique il y a, pensons-nous, elle ne procédera pas du fonctionnement régulier d'institutions complètement bloquées mais de leur dysfonctionnement, avec ce que cela suppose d'incertitudes, d'imprévus, de risques et probablement de chaos. Notre hypothèse est qu'elle ne peut résulter que d'un bouleversement des équilibres politiques actuels sous la pression, comme nous l'avons évoqué, de la révolte des perdants de la restauration libérale contre ses bénéficiaires.
Pure hypothèse car, pour l'instant, les « élites » continuent à ne voir dans ces émeutes électorales que leur dimension de protestation, leur déniant toute capacité de remise en question du système lui-même : grand « n'importe quoi » ou vaine agitation, en un mot « populisme » ! Puisque, selon la formule consacrée, « there is no alternative », il ne peut pas en être autrement.
Doté d'une capacité de récupération renversante, le système continue de tout digérer. Pas plus que les marchés n'avaient vu venir la crise immobilière des subprimes , bien installés dans leur bulle, s'inquiètent-ils aujourd'hui des barbares qui les menacent de l'extérieur. Le bocal est bien étanche.
Ainsi, dès le surlendemain de l'élection du « candidat antisystème » Donald Trump, qui avait fait campagne contre Wall Street, l'indice Dow Jones battait-il des records ! « Les marchés ont mis trois jours pour digérer le Brexit, trois heures pour digérer l'élection de Trump et trois minutes pour digérer le non au référendum italien » , se sont étonnés les observateurs de la planète « finance ».
C'est là que les leçons du passé peuvent servir. Non qu'on en puisse tirer quelque réponse aux problèmes actuels très différents de ceux d'hier, mais des leçons de prudence, vertu politique cardinale selon Aristote.
Première leçon , ne pas traiter à la légère, pire par le mépris, les manifestations de défiance des électeurs. Elles ont toujours une signification. Les « émeutes électorales » ne sont pas « n'importe quoi » mais la manifestation du refus de jouer à la fausse démocratie, celle où le porteur de bulletin de vote n'a le choix qu'entre des variantes d'une unique politique dont les insuffisances sont manifestes. Loin d'être des comportements irrationnels, ce sont des gestes de délégitimation d'un système politique qui s'est laissé réduire au rôle de serviteur des marchés, de policier et d'infirmier social en charge de la paix publique. Or un système politique sans légitimité ne peut survivre longtemps.
Seconde leçon , on ne laisse pas impunément couver la désespérance sans s'exposer à des retours de flammes. Plus longtemps la réponse sera différée, plus hautes seront les flammes.
Marx rappelle, dans Le 18 brumaire de Louis Bonaparte , que, lorsqu'il arrive à l'Histoire de se répéter, c'est la première fois sous forme de tragédie et la seconde, de farce. Constatons que non seulement on ne voit toujours pas la fin de celle qui continue de se jouer, mais qu'elle est de moins en moins bonne.
ANNEXES
AUDITION DE JEAN-MICHEL NAULOT
(26 novembre 2015)
Roger Karoutchi, président . - Mes chers collègues, je suis heureux d'accueillir, en votre nom, Jean-Michel Naulot, ancien banquier d'affaires éminent, ancien membre du Collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF), que j'ai moi-même eu plaisir à croiser dans une vie antérieure.
Nous devons sa présence parmi nous ce matin à Pierre-Yves Collombat, qui a souhaité engager une réflexion prospective sur l'avenir et les risques du système financier et bancaire. Une réflexion qui se veut donc dynamique, pas statique, pour ne pas risquer d'empiéter sur les compétences de la commission des finances. Cela fait en effet des années que l'on parle de la crise financière et des errements du système, sans que, pour autant, on en ait la maîtrise ou, au moins, une vision suffisamment claire.
Partant de ce constat, le travail que Pierre-Yves Collombat s'est proposé d'engager s'annonce dense et nous serons amenés à débattre des conclusions qu'il aura tirées. Je ne suis pas persuadé que celles-ci feront consensus au sein des membres de la délégation, mais au moins disposerons-nous d'une base de réflexion sérieuse et approfondie sur le sujet.
De par ses responsabilités successives, Jean-Michel Naulot a exercé des fonctions à la fois de gestion et de contrôle, d'opérateur et de contrôleur. Voilà deux ans, il a publié un livre qui a fait sensation venant de quelqu'un d'aguerri au milieu financier. Son titre est loin d'être rassurant : Crise financière. Pourquoi les gouvernements ne font rien . C'est peut-être ce qui a tout de suite attiré l'oeil de Pierre-Yves Collombat, lui qui a toujours l'esprit critique aiguisé. Je lui laisse d'ailleurs immédiatement la parole.
Pierre-Yves Collombat, rapporteur . - Je tiens d'abord à vous remercier, monsieur le président, d'avoir accepté ma suggestion de recherche prospective. Je dois dire, monsieur Naulot, que j'ai lu votre ouvrage avec beaucoup de plaisir. Vous avez réellement fait un effort de clarté, ce qui n'est pas si courant dans ce genre de publication.
Je voudrais partir d'une de vos citations, qui résume assez bien le sujet et le problème. Vous écrivez ainsi, aux pages 64 et 65 de votre ouvrage : « Le risque systémique n'a rien de commun aujourd'hui à ce qu'il était au siècle dernier. L'écart est à peu près le même que celui qui existe entre la guerre conventionnelle et la guerre nucléaire. La finance mondiale est devenue une énorme centrale nucléaire bâtie en dehors de toutes normes de sécurité. Pour au moins trois raisons : l'interconnexion des opérations, la masse des capitaux, la dangerosité du combustible. » Voilà un bon point de départ pour notre réflexion ! Je suis d'ailleurs preneur d'éléments chiffrés sur cette masse des capitaux, en particulier les différentes catégories qui la composent, et le rôle que jouent les produits dérivés.
Jean-Michel Naulot, ancien banquier, ancien membre du Collège de l'Autorité des marchés financiers . - Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de votre accueil et de l'intérêt que vous portez à mes travaux. Je commencerai par dire que je suis loin d'être un « ultra ». Initialement, d'ailleurs, j'avais choisi comme sous-titre à mon livre : Pourquoi les gouvernements font si peu . Mais l'éditeur n'a pas trouvé cela assez vendeur et s'est décidé pour Pourquoi les gouvernements ne font rien .
Je tiens à le souligner, j'ai pris énormément de plaisir à exercer, pendant trente-sept années, le métier de banquier d'affaires, au sein d'établissements français : Indosuez, le Crédit agricole, Natixis. Je l'ai fait avec passion, aux côtés, pour l'essentiel, de groupes du CAC 40. Le fait d'apporter son assistance à des groupes d'une telle envergure, particulièrement dans les périodes de crise, vous donne le sentiment d'être réellement utile.
Je me suis, par exemple, beaucoup occupé de PSA Peugeot-Citroën. Au cours de l'été 2008, PSA était entouré de vingt-six ou vingt-huit banques, je ne me souviens plus exactement. Six mois plus tard, en janvier 2009, on n'en comptait plus que quatre et demi, pour être très précis, et uniquement des banques françaises. C'est dire la violence des réactions, dans le monde de la finance, quand les difficultés surgissent. En pareil cas, on ne peut plus compter que sur très peu d'amis. Cela n'a pas eu beaucoup d'écho à l'époque mais, pendant la crise de 2000-2003, ce ne sont pas moins de cinq ou six groupes du CAC 40 qui ont failli faire faillite. Idem en 2007-2009.
L'un des aspects du métier de banquier d'affaires que j'ai particulièrement apprécié, c'est ce que les Anglo-Saxons appellent le team spirit . Cet esprit d'équipe, on le retrouve aussi un peu en politique, quand tout le monde s'entend bien.
Roger Karoutchi, président . - Cela dépend...
Yannick Vaugrenard . - ...et ne dure jamais longtemps !
Jean-Michel Naulot, ancien banquier, ancien membre du Collège de l'Autorité des marchés financiers . - À partir de la fin de 2003, j'ai eu la chance d'intégrer le Collège de l'Autorité des marchés financiers. L'occasion m'en fut donnée par le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Jean-Louis Debré, qui me connaissait bien et avait pu mesurer mon scepticisme au sujet de la finance au cours des années précédentes. J'y ai accompli deux mandats absolument passionnants, au sein d'équipes remarquables. À partir du printemps 2007, j'ai présidé la commission des marchés financiers, qui est une commission de place. Cela m'a donné un écho très intéressant de ce qu'il se passait réellement sur la place financière, indépendamment des contacts que j'avais par ailleurs.
Je compte, parmi mes vieux amis, Michel Barnier, qui fut commissaire au marché intérieur et aux services financiers. J'ai beaucoup discuté de ces sujets avec lui, suivant de très près ce qu'il se passait à Bruxelles. J'ai quitté l'AMF à la fin de l'année 2013. C'est au cours de ma dernière année de mandat que j'ai écrit ce livre. Libéré d'un devoir de réserve encore plus contraignant que celui que j'avais connu comme banquier, retrouvant avec un très grand plaisir une totale liberté d'expression, je me suis efforcé de bannir la langue de bois pour dresser, à destination notamment des jeunes et des étudiants, un tableau aussi fidèle et complet que possible, balayant l'ensemble des sujets liés à la finance, les thématiques actuelles, les grands chantiers en cours, les problèmes récurrents.
Ce livre n'est aucunement un règlement de comptes à l'égard du monde de la finance. Il exprime bien au contraire une angoisse qui me taraude depuis de longues années. En 1995, j'avais publié une tribune dans Le Figaro , pour alerter sur le fait que l'on était en train de construire un « gigantesque casino mondial de la finance ». Avec le recul, aujourd'hui, je me dis vraiment que, à l'époque, je ne faisais que dénoncer l'épaisseur du trait, tant les problèmes actuels n'ont rien à voir, par leur gravité, avec ceux de 1995. Ils se sont même amplifiés depuis 2007.
La crise de 2007 mérite d'ailleurs que j'en dise un mot car les éléments qui la caractérisent sont aujourd'hui encore très présents. J'ai grandement ressenti le fait que celle-ci n'avait pas du tout été anticipée. Prenez les déclarations faites à l'époque par les analystes financiers, les dirigeants de banques, les responsables politiques.
Pierre-Yves Collombat, rapporteur . - Celles de la ministre de l'économie de l'époque, Christine Lagarde, sont restées célèbres !
Jean-Michel Naulot, ancien banquier, ancien membre du Collège de l'Autorité des marchés financiers . - Absolument.
Le VIX, qui est l'indice de volatilité du marché financier américain, reflète le niveau de stress des investisseurs. Au mois de juin 2007, c'est-à-dire deux mois avant ce fameux 9 août 2007 qui marqua le début de la crise systémique - j'étais alors de permanence à l'AMF et chacun sentait le sol trembler sous ses pieds -, cet indice se situait à son plus bas historique, c'est-à-dire un peu au-dessous de son niveau actuel. Un an plus tard, il sera à son plus haut. À l'évidence, les marchés ne jouaient plus leur rôle d'anticipation des risques.
Deuxième élément étonnant : au printemps 2007, les marchés connaissaient une situation de surliquidité. Comme aujourd'hui. N'écoutez pas ceux qui vous disent qu'il y a un problème de liquidités dans les marchés, de distribution de crédit. Les multinationales n'ont actuellement aucun problème de financement, les marges, pour les mieux notées d'entre elles, sont du même ordre que celles du printemps 2007. Abondance de liquidités, donc. Or le lendemain, même pas le surlendemain, de la faillite de Lehman Brothers, le monde a fait face à une pénurie de liquidités : tout s'est arrêté. Au cours des trois mois suivants, tout nouveau crédit se décidait au niveau du président, et encore, à l'arraché.
Cet élément est important. Comment expliquer ce paradoxe d'une pénurie brutale de liquidités alors que le système financier connaissait un excès de liquidités ? En réalité, c'est cette surabondance de liquidités qui l'a fragilisé, car, dès lors que les possibilités de rendements se raréfient, on cherche à placer les liquidités là où elles subsistent, c'est-à-dire, généralement, dans des activités à risque. Comme le disait un de mes amis de conviction libérale, « quand l'argent ne coûte rien, on ne peut faire que des bêtises ».
Troisième élément : la transmission de la crise financière à l'économie dite « réelle », comme en 2001-2003 du reste, mais de manière beaucoup plus intense. Tout est allé extrêmement vite. Il ne se passait pas quinze jours sans que les prévisions de profits des groupes faites par les analystes financiers soient réajustées à la baisse.
Compte tenu de la situation actuelle, mon discours n'est pas franchement optimiste. Les analogies que j'ai pu établir entre la crise de 1929, celle de 2007 et la situation actuelle me conduisent à penser que les signes caractéristiques d'une crise systémique restent prégnants aujourd'hui : une dette élevée, des liquidités abondantes, un retard dans la régulation. Le problème est de savoir quand la bulle va éclater ; comme aurait dit Keynes, il ne manque qu'une petite aiguille pour venir la crever.
Aujourd'hui, comme en 1929 et 2007, la dette privée atteint des niveaux très élevés. Or peu de monde en parle, il n'est question que de la dette publique. Les pays vertueux en matière de dette publique sont souvent ceux, Allemagne à part, qui affichent une dette privée très élevée : Canada, Australie, Pays-Bas, Danemark. Un regard sur le passé montre que c'est souvent la dette privée qui provoque les crises, comme en 1929, comme en 2007. Le niveau de dette publique en zone euro, avant la crise de 2007, avant celle de 2010, était extrêmement raisonnable. En 2007, la dette publique française ne représentait que 64 % du PIB.
De nos jours, le niveau de la dette, publique comme privée, atteint des sommets. Contrairement à ce que prétendent certains journaux, la dette publique des États-Unis est très importante : si l'on ajoute à la dette fédérale, 105 % du PIB, la dette des collectivités locales et celle des États, le total monte à près de 125 %. La dette globale, publique et privée, est considérable. La situation est analogue au Royaume-Uni et au Japon, qui bat tous les records. Le niveau de la dette dans la zone euro est historique, inédit. Voilà qui est tout de même extrêmement préoccupant.
Deuxième phénomène inquiétant : l'abondance de liquidités. Ne l'oublions pas, les banques privées créent de la monnaie à l'instar des banques centrales. De 2000 à 2007, le régulateur prudentiel a poussé les banques à créer énormément de monnaie. À l'époque, 90 % de la création monétaire venaient des banques. D'où un effet de levier massif. Récemment, les modalités de calcul des ratios prudentiels des banques ont été durcies. Celles-ci créent beaucoup moins de monnaie.
En ce qui concerne la « monnaie banque centrale », la base monétaire, elle peut prendre trois directions. Soit l'économie réelle, via les banques. Soit la Banque centrale européenne (BCE). Je lisais ce matin un article sur le site de L'Agefi selon lequel la BCE devrait probablement annoncer un durcissement de son taux, négatif, auquel elle rémunère les réserves déposées par les banques. Ce taux, actuellement fixé à -0,2 %, passerait à -0,4 %, voire -0,5 %. On commence vraiment à marcher sur la tête ! L'objectif est d'empêcher les banques d'aller placer leurs liquidités à la BCE. Lorsque la monnaie ne va qu'un tout petit peu vers l'économie réelle et moins à la BCE, elle va dans la troisième direction que sont les actifs financiers - financement des hedge funds , etc. C'est ce qui se produit depuis quelques années.
Troisième et dernière caractéristique de la période récente : le retard dans la régulation. C'est le point essentiel de mon livre, ce qui m'a mis dans une franche colère ces dernières années. Par rapport à la feuille de route fixée lors du G20 qui s'est tenu le 2 avril 2009, l'Europe a fait à peu près le tiers du chemin - hommage en soit rendu à mon ami Michel Barnier, qui s'est battu courageusement -, les États-Unis, le quart. J'étais admiratif de ce que faisait Obama au cours de sa première année de mandat, mais j'ai rapidement déchanté : tout s'est arrêté avec le vote de la loi Dodd-Frank en juillet 2010 et les transpositions qui ont suivi.
Finalement, l'un des points les plus inquiétants, c'est l'influence des lobbies financiers, que j'ai vu constamment à l'oeuvre, notamment à Bruxelles, et qui freine les velléités d'action des gouvernements et des parlementaires européens. Ils sont cependant dans leur rôle et exercent, pour certains, leur mission avec beaucoup d'habileté.
Fort de mon expérience de régulateur, j'ai résumé les neuf manières d'exercer ce « travail de conviction » auprès de l'autorité politique.
Premièrement : pratiquer la connivence. Ce que j'appelle le « lobbying mondain » : invitation à déjeuner, en week-end ; au début, on ne parle jamais de finance, le sujet n'est abordé que très progressivement. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il a été nommé, j'avais conseillé à Michel Barnier de refuser toute invitation dès le départ, et c'est ce qu'il a fait.
Deuxièmement : profiter du déséquilibre des rapports de force. Il se trouve que les régulateurs britanniques sont deux à trois fois plus nombreux que leurs homologues allemands ou français au sein des différents groupes de travail et autres task forces . En plus, on y parle l'anglais, donc vous comprendrez qu'ils excellent dans l'art de la sémantique, toujours prompts à proposer, ici, un changement de mot, là, un ajout de virgule. C'est un véritable travail d'orfèvre et, reconnaissons-le, ils sont d'une compétence redoutable.
Troisièmement : gagner du temps. Systématiquement, les lobbyistes s'attachent à retarder la sortie des textes en posant toutes sortes de questions. Michel Barnier avait pour habitude d'appeler cela « le temps de la démocratie ». Je lui préférais la formule « le temps des lobbies ».
Quatrièmement : détourner de leur objet les études d'impact. Avant la mise en oeuvre de tout texte réglementaire, aux États-Unis comme en Europe, est lancée une étude d'impact, une consultation de place. Normalement, cette consultation doit permettre au régulateur de vérifier qu'il n'a pas fait d'erreurs dans son texte. Mais naturellement les lobbies utilisent cette procédure pour tenter de remettre en cause l'essentiel.
Pour ne pas avoir à appliquer un texte, il n'y a rien de mieux que de le dénaturer en le complexifiant au maximum. Au début de son premier mandat, le président Obama avait chargé l'un de ses conseillers, Paul Volcker, de préparer un texte sur l'interdiction du prop trading , la spéculation pour compte propre des banques. Après son examen par le Congrès, il était passé de trente-neuf pages à trois cents pages. Paul Volcker avait donné cette explication : « Il fallait répondre aux questions posées par les lobbyistes. Et après , avait-il ajouté, ils disent que c'est trop compliqué, qu'ils ne peuvent pas l'appliquer ».
Cinquièmement : faire preuve d'une innovation financière sans limites. Le phénomène s'est accéléré depuis 2007, par exemple dans le domaine du trading à haute fréquence. J'ai en mémoire un exemple particulièrement parlant : l'AMF avait refusé d'accorder son agrément à un fonds collectif lancé par une très grande banque de la place, qu'elle jugeait illisible, trop complexe et risqué pour les investisseurs ; trois semaines après, elle l'a vu revenir sous l'appellation EMTN - Euro Medium Term Note -, c'est-à-dire une obligation structurée échappant à toute réglementation. Voilà le jeu auquel se livrent parfois les professionnels et qui rend notre métier difficile.
Sixièmement : se prévaloir de la transparence. Il faut se méfier de ceux qui ne cessent de plaider en faveur de l'éthique, de la transparence, car c'est souvent un moyen détourné pour ne pas agir sur l'essentiel. Les Anglo-Saxons sont très férus de transparence.
Septièmement : avancer le risque d'une atteinte à la liquidité du marché. C'est le refrain entonné, dans neuf cas sur dix, pour freiner toute velléité de réforme. Cela a commencé en 2009-2010 avec le problème des ventes à découvert.
Huitièmement : défendre le market making quel que soit le sujet de la réforme. Il faut le savoir, la qualification de market maker - être contrepartie des activités clientèle - ouvre la voie à toutes sortes de dérogations réglementaires.
Neuvièmement : préserver la compétitivité de place. Ce qui m'a le plus marqué au cours de mes dix années à l'AMF, c'est le fait que, sur chaque projet de réforme des structures bancaires et des marchés financiers, les professionnels, mais aussi les gouvernements, brandissent le risque de porter atteinte à la compétitivité des banques.
Je le dis très modestement, je m'étais fixé une ligne rouge à ne pas franchir : la compétitivité de place doit passer après la prise en compte du risque systémique. C'était pour moi essentiel. Je me dois, par exemple, de rappeler que quatre banques françaises détiennent aujourd'hui l'équivalent de quarante fois le PIB français en encours notionnels de produits dérivés dans leur hors-bilan. D'aucuns rétorquent que, si les banques françaises ne le font pas, les banques américaines vont le faire. C'est ce type de raisonnement qui tue toute évolution de la réglementation.
La douzaine de chantiers sur lesquels travaillent les régulateurs depuis la crise représentent un travail considérable. Je vais donc me contenter de les citer. Il y a bien sûr la réforme des banques, qui comprend elle-même plusieurs chantiers. De nouvelles règles prudentielles visent notamment à augmenter les ratios de fonds propres. C'est une simple remise à niveau après les excès des années 2000. La mise en place progressive de l'union bancaire s'articule autour de trois volets que sont la supervision, la résolution et la garantie des dépôts. On peut relever que cette dernière s'élève, en France, à 100 000 euros au lieu de 250 000 dollars aux États-Unis. La Commission européenne propose de mutualiser cette garantie. Il a été décidé de mettre à contribution, en cas de difficultés d'une banque, les dépôts supérieurs à cette garantie de 100 000 euros, soit un seuil relativement bas.
Pour ce qui concerne la réforme des structures bancaires, actuellement en discussion au Parlement et au Conseil européens, ma conviction est faite : il faut interdire le prop trading - opérations pour compte propre des banques systémiques - et acter la séparation des activités les plus risquées. Je crains que cela n'aboutisse pas.
Les hedge funds , tout comme le trading à haute fréquence et les produits dérivés, nous exposent à un risque qui peut être systémique. Le problème de la liquidité des chambres de compensation en cas de crise n'est toujours pas réglé. Pour la régulation des marchés de matières premières, des réformes simples auraient pu être décidées. On a préféré multiplier les dérogations. En 2007-2008, tous les prix suivaient la même courbe de variation, on se demande pourquoi : multiplication par deux, division par trois en très peu de temps. Lorsqu'il était ministre de l'agriculture avant de devenir commissaire européen, Michel Barnier m'avait dit vouloir s'atteler en priorité aux conditions de fonctionnement des marchés de matières premières. Aujourd'hui, le bilan est malheureusement très décevant tant les lobbies ont été actifs.
La Mifid II est l'abréviation de la directive sur les marchés d'instruments financiers, sur laquelle la Commission travaille depuis 2010. La Mifid I, qui dérégulait complètement les marchés des actions, a été publiée en novembre 2007, alors que nous étions déjà en pleine crise. Au moment de sa prise de fonctions, en 2004, le commissaire Charlie McCreevy avait affirmé qu'au cours de son mandat il faudrait « faire un effort permanent pour s'assurer que les marchés ne sont pas trop régulés » . Ce fut un succès total... La Mifid II est censée entrer en application en janvier 2017, certains parlent même de janvier 2018. Huit années, cela illustre bien ce que j'appelais le « temps des lobbies ».
Je voudrais souligner l'ampleur prise par le phénomène du shadow banking . Il représenterait, selon le chiffre officiel que je rappelle dans mon livre, 25 % de la finance mondiale. Je pense que la vérité est plus proche du tiers, voire pas loin de la moitié. La semaine dernière, Benoît Coeuré a cité le chiffre de 38 %, ce qui m'a surpris de la part d'une autorité officielle, membre du directoire de la BCE.
Enfin, je ne peux manquer de souligner, même très brièvement, les dysfonctionnements du marché du carbone, sujet important en cette période de COP 21.
J'en viens aux questions de gouvernance.
En 2008-2009, les communiqués du G20 étaient à ce point remarquables que je les avais presque appris par coeur : d'une très grande précision, je sentais que chaque mot avait été soigneusement pesé. Un bémol, cependant, sur celui du 2 avril 2009. Le G20 avait prévu le contrôle, en matière de hedge funds , des gérants « et » des fonds. Au dernier moment, les Anglais ont fait remplacer « et » par « ou » ; résultat : seuls les gérants, tous basés à Londres, font l'objet de contrôles, et personne ne se penche sur les fonds, majoritairement situés dans les paradis fiscaux.
Cela étant, les textes étaient tout à la fois contraignants et d'une grande clarté, et traduisaient une réelle volonté politique. Je repense à cette période comme à un rayon de soleil dans une atmosphère fort pénible. Force est de constater, depuis, que les communiqués du G20 ne font plus référence aux questions financières. Le G20 se concentre sur les enjeux géopolitiques et a délégué son travail au Conseil de stabilité financière. La grande différence, c'est que ce dernier est composé essentiellement de représentants des banques centrales, même si les gouvernements sont présents. Il est aujourd'hui présidé par Mark Carney, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, le même qui, l'année dernière, s'était dit prêt à développer, si nécessaire, le shadow banking pour développer la place de Londres.
Je me suis posé la question : puisque le G20 ne joue plus son rôle, ne faudrait-il pas envisager la mise en place d'un organisme indépendant, qui puisse faire un rappel à l'ordre sur les chantiers en cours ?
Le Comité de Bâle réunit les experts des banques centrales autour de la régulation prudentielle. Les normes arrêtées sont ensuite validées au travers de directives. Ainsi, le 26 juin 2004, le Comité de Bâle a adopté un dispositif, dit de « pondération des risques », qui a révolutionné la régulation des banques et qui subsiste aujourd'hui. Aucun débat n'a eu lieu. La directive est entrée en application en 2006 et personne, en dehors des cercles d'experts, n'en discute aujourd'hui. Ne serait-il pas normal que le commissaire assiste aux réunions les plus importantes ? Michel Barnier avait exigé d'être présent à celles de l'autorité comptable internationale, l'IASB, même si elles étaient très techniques.
Le Comité européen des risques systémiques (CERS) constitue un outil de surveillance très important. Sa création avait été recommandée dans un rapport de 2008 rédigé par Jacques de Larosière. Il est chargé de faire de la prospective sur les risques. Une structure analogue existe aux États-Unis, disposant d'un effectif extrêmement restreint : quinze personnes, dont dix ont le droit de vote. Elle est présidée par le secrétaire américain au Trésor, autrement dit l'exécutif, entouré de Janet Yelen et des présidents des autorités de régulation.
En Europe, le CERS réunit une centaine de personnes. La BCE, par l'intermédiaire de Mario Draghi, en assure la présidence. Estimant qu'elle prévient déjà parfaitement tous les risques, elle cherche à réduire ce comité à sa plus simple expression. Là aussi, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, l'autorité politique est complètement absente. Ce Comité européen des risques systémiques devrait être présidé soit par le président du Conseil européen, soit par le commissaire aux marchés financiers, en tout cas par une autorité politique. Il faut une représentation plus importante de l'autorité politique, ne serait-ce que pour lui permettre d'en savoir davantage sur ce qu'il se passe réellement dans le monde de la finance.
Par ailleurs, vous avez certainement entendu parler du projet d'Union des marchés de capitaux (UMC). C'est l'objectif de la mandature en matière de régulation financière à Bruxelles. Là encore, la question de la gouvernance se pose : les gouvernements européens ont-ils véritablement eu leur mot à dire ? Y a-t-il eu débat ? La première fois que Jean-Claude Juncker l'a évoqué, c'était en juillet 2014, quatre mois avant que la nouvelle mandature soit en place. Juncker s'était auparavant occupé de la place luxembourgeoise. Pour l'épauler, il peut compter sur le Commissaire européen à la stabilité financière, aux services financiers et à l'Union des marchés de capitaux, qui n'est autre que Jonathan Hill, très lié tout de même à la City.
Tous deux ont décidé de réviser, si nécessaire, certains des textes établis par la mandature précédente, que je trouve déjà fort insuffisants. Pour leur projet d'UMC, ils souhaitent en fait s'inspirer du modèle anglo-saxon. Actuellement, en Europe, les trois quarts du financement viennent des banques et le reste du marché. L'idée est non pas d'inverser ce rapport, Juncker et Hill prônent un ratio de 60-40, mais de donner beaucoup plus d'importance aux marchés, par le développement de la titrisation, des placements privés, etc. De par mon expérience, je peux dire que l'évolution ne pourra être que marginale. En outre, il revient aux banques, qui connaissent les risques sur les contreparties, de faire leur métier, faute de quoi on affaiblit le système.
Dernière remarque à propos de la gouvernance : les trois institutions européennes qui arrêtent les textes législatifs dans le cadre du trilogue ne laissent que peu de place aux parlements nationaux. La persistance des risques financiers ne devrait-elle pas inciter les parlementaires à s'exprimer ?
Pour répondre à votre question, monsieur le rapporteur, si j'ai comparé la finance mondiale à une « énorme centrale nucléaire bâtie en dehors de toutes normes de sécurité », c'est parce que j'ai ressenti les choses de cette façon en tant que banquier. Je suis convaincu que, avec quelques mesures simples, sur chacun des dossiers que j'évoquais, il est possible de corriger la situation actuelle. Ayons bien à l'esprit que les financements interbancaires ont cessé dès le lendemain de la faillite de Lehman Brothers. Je me répète, dès lors que la confiance disparaît et que les liquidités sont surabondantes, le système est fragilisé.
L'ensemble des produits dérivés, gérés par dix-huit grandes banques internationales, représente un montant de 720 000 milliards de dollars, auxquels il faut ajouter 80 000 milliards de dollars qui passent par les marchés organisés. Au total, cela fait 800 000 milliards de dollars, soit dix fois le PIB mondial. En 2007, les montants étaient exactement les mêmes. Ces produits dérivés sont échangés à 90 % entre établissements financiers : l'interconnexion, elle est là. Comment peut-on les considérer comme des instruments de couverture au service de l'économie réelle quand la part avec les entreprises ne s'élève qu'à 7 % ou 8 % ?
Pierre-Yves Collombat, rapporteur . - Ma question va peut-être vous paraître quelque peu naïve mais arrêtons-nous un instant sur la notion même de liquidités. Chacun le sait, il y a la monnaie créée par les banques centrales et celle qui est fabriquée par les banques, notamment lorsqu'elles accordent des prêts. J'en suis arrivé à la conclusion que se fabriquent également ce que j'appellerais des « quasi-monnaies », c'est-à-dire des titres différents et des créances différentes qu'on s'échange finalement comme de la monnaie. Mais, comme leur liquidité est moindre, il arrive un moment où tout coagule et bloque le système. Est-ce que je me trompe ?
Jean-Michel Naulot, ancien banquier, ancien membre du Collège de l'Autorité des marchés financiers . - C'est effectivement ce qu'il se passe en matière de shadow banking . Si tous les échanges et prêts de titres peuvent être comparés à de la monnaie, ils sont en fait beaucoup plus fragiles. Ceux-ci se sont développés de manière exponentielle depuis la précédente crise. La vente à découvert est déjà un exercice qui n'est pas évident : on vend un actif que l'on ne possède pas, qu'il faut emprunter ; on le rachète plus tard, souvent dans la journée. Les trois quarts des opérations se font intraday . Depuis 2008, les prêts de titres se sont développés de manière exponentielle.
Il est écrit en toutes lettres dans un rapport du FMI qui date de l'automne 2012 : « À un instant donné, un même titre peut être revendiqué par deux acteurs et demi. » D'après les estimations - il n'existe aucun relevé officiel -, ces « prêts-emprunts » de titres représenteraient autour de 20 000 milliards de dollars. Pour donner un ordre de grandeur, la finance internationale, c'est un peu plus de 300 000 milliards de dollars. Cette quasi-monnaie est d'une grande vulnérabilité.
Aux États-Unis, les ETF, qui sont des fonds indiciels cotés en bourse, représentent des encours de 3 000 milliards de dollars. C'est à peu près le montant des hedge funds , l'effet de levier en moins. À la différence des autres OPCVM, ils se caractérisent par le fait qu'il est possible d'en sortir à tout moment, un clic de souris suffit. Il se trouve que ces ETF prêtent l'intégralité de leurs titres. Vous imaginez bien ce qu'il pourrait se passer.
Les pensions funds , c'est-à-dire les fonds qui gèrent les retraites dans les pays anglo-saxons, sont un petit peu plus réglementés que les mutual funds , qui sont des fonds ordinaires. Mais tout cela est assez peu réglementé aux États-Unis, ce qui me fait craindre que la prochaine crise ne vienne de là. Voilà un point de vulnérabilité par rapport à l'Europe, où le système est beaucoup mieux sécurisé.
Yannick Vaugrenard . - Je vous remercie, monsieur Naulot, de toutes ces informations précises. Elles ont le mérite d'être d'une grande clarté et, pour certaines d'entre elles, viennent conforter ce que nous percevions déjà.
Parmi les chiffres que vous avez cités, j'en ai trouvé un particulièrement frappant : les banques françaises détiennent l'équivalent de quarante fois le PIB en produits dérivés et, à l'échelle de la planète, l'ensemble de ces produits représente 800 000 milliards de dollars, soit dix fois le PIB mondial. Autrement dit, la question, aujourd'hui, est de savoir non pas s'il y aura de nouveau une crise financière, mais quand elle aura lieu et d'où elle partira.
Voilà qui est tout de même assez préoccupant. J'entends bien la réponse qui vous a été faite à ce sujet. En même temps, il est compréhensible que les banques françaises hésitent à agir seules, car elles se feraient alors avoir, pour parler simplement. Il n'est pas envisageable que la France, ni l'Europe d'ailleurs, agisse seule et se décide, par exemple, à interdire le trading à haute fréquence ou la titrisation. Dès lors, pouvons-nous imaginer une forme de gouvernance mondiale de l'ensemble de ces activités liées à la finance et de moins en moins à l'économie réelle ? C'est à mes yeux la question centrale. Elle est éminemment politique. Mais, faute d'action en ce sens, on court à la catastrophe.
D'autre part, vous avez évoqué le Comité de Bâle. Que pensez-vous de Bâle III ? Souvent, les banques françaises se réfugient derrière les normes édictées dans le cadre de Bâle III pour ne pas prêter suffisamment, notamment aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire. Est-ce vraiment le cas ou ne s'agit-il que d'un prétexte ?
Par ailleurs, il a beaucoup été question de la crise pétrolière de 1974. N'oublions pas les aspects monétaires et ce fameux 15 août 1971, lorsque Nixon annonça la fin de la convertibilité du dollar en or. Cela a entraîné une instabilité monétaire. Pour éviter la spéculation actuelle, la solution pourrait-elle être d'instaurer la convertibilité du dollar ou des monnaies internationales, je ne sais, avec l'or ou d'autres matières premières ?
Jean-Michel Naulot, ancien banquier, ancien membre du Collège de l'Autorité des marchés financiers . - Voilà trois énormes questions !
Bien sûr, je crois à une gouvernance mondiale et, d'abord, à une gouvernance européenne, même s'il convient de bien séparer les chantiers en cours. Dans le domaine de la régulation, rien ne pourra se faire sur le plan national. Les marchés de capitaux étant ouverts les uns sur les autres, il faut une gouvernance européenne, voire mondiale.
Si personne ne commence à donner l'exemple, on risque d'attendre longtemps. C'est exactement le cas de la taxe sur les transactions financières. Je comprends très bien que tous les banquiers s'y opposent. La problématique est pourtant tout simple : corriger l'hypertrophie de la finance.
J'ai été un praticien passionné des produits dérivés, et ce dès 1984. Cela peut donner le meilleur comme le pire. Je me souviens qu'à l'époque on a pu, par ce biais, couvrir les exportations de LVMH à Tokyo. Un outil très utile, donc. Le problème, c'est que toute innovation financière est aussitôt détournée de ce pour quoi elle a été conçue. Prenons l'exemple du marché des matières premières, dont l'accès était interdit aux banquiers à la suite de la crise de 1929. Goldman Sachs a convaincu le régulateur américain qu'il fallait y apporter de la liquidité ; aujourd'hui, 85 % des transactions sur les matières premières sont faites par des financiers.
Je suis heureux, monsieur le sénateur, que vous m'interrogiez sur Bâle III et le financement des PME, car le sujet est véritablement important. En juin 2004, je l'ai rappelé, le Comité de Bâle a introduit le système de la « pondération des risques », une vraie révolution dans l'allocation des financements. Ce dispositif, mis en place à l'occasion de Bâle II, est une véritable « boîte noire », comme je l'explique dans mon livre.
À partir de 2005-2006, je vais vous dire ce qu'il se passait puisque j'étais moi-même banquier. Je caricature à peine. Quand j'accordais un crédit de 100 millions à une multinationale du CAC 40 très bien notée, j'inscrivais dans la déclaration réglementaire 12 millions ou 15 millions au lieu de 100 millions. Pour une autre multinationale du CAC 40 moins bien notée, j'inscrivais 60 millions ou 65 millions. Comme il ne pouvait être question de multiplier la marge appliquée à l'entreprise moins bien notée par quatre, par cinq ou par six, la « calculette » du comité de crédit attribuait généralement le crédit à l'entreprise la mieux notée.
C'est de là que vient le pouvoir des agences de notation. Puisque, du jour au lendemain, les banques ont pu diviser le montant de leurs fonds propres réglementaires d'un tiers, de moitié, quelquefois davantage, le système a contribué à accélérer très fortement la création monétaire par les banques. Le régulateur prudentiel porte ainsi une responsabilité terrible dans la précédente crise.
Cette « boîte noire » a introduit un biais réglementaire dans l'allocation des ressources. Une PME, aujourd'hui, est de fait pénalisée. De plus, elle n'offre pas les mêmes promesses en termes de rentabilité sur les opérations annexes au crédit. Les banquiers appellent cela le side business . Si c'est un hedge fund qui sollicite un crédit, il aura la priorité, car ce crédit n'engage qu'une très faible consommation de fonds propres pour la banque en raison des garanties offertes via les titres empruntés.
C'est l'allocation des ressources qui est en jeu. Il faudrait que l'autorité politique, notamment les parlementaires, s'intéresse à ce système profondément inéquitable. La politique monétaire et celle de supervision microprudentielle ressortent du domaine des banques centrales, mais l'autorité politique ne peut se désintéresser de l'allocation des ressources, de la supervision macroprudentielle. À l'heure actuelle, les multinationales n'ont aucun problème de financement, les marges n'ont jamais été aussi faibles. Le problème est ailleurs. Jusqu'en 2005, avant qu'un banquier ne fasse crédit, il analysait la qualité des dirigeants, la stratégie, les ratios financiers. C'était tout simple. Aujourd'hui, les banquiers vous le diront, la « calculette », si elle ne prend pas toujours la décision, joue un rôle très important.
Ce nouveau système est allé tellement loin que le régulateur prudentiel a été obligé d'apporter un certain nombre de correctifs. Une pondération standardisée, pour les seules toutes petites PME, a été imposée. Je plaide pour un retour à une pondération standardisée globale, fixée par le régulateur et fort peu discriminante. Qu'il faille tenir compte du fait qu'une multinationale présente moins de risques qu'une petite entreprise, d'accord. Mais cela ne doit pas aboutir à de telles inégalités.
Pour en revenir à ce qu'il s'est passé en 1971-1973, je n'aurais pas la prétention de répondre ni bien ni complètement à votre question. Pour moi, le fait que les Américains aient décidé d'abandonner toute contrainte dans la gestion, toute discipline, c'est le « péché originel ». Le déficit commercial américain reste à des niveaux astronomiques.
Je suis membre d'un jury de thèse sur la création monétaire qui reprend notamment les idées de Jacques Rueff, lesquelles sont, à mon avis, d'une grande actualité sur la nécessité d'un retour à un ordre monétaire international. Mais il ne faut pas rêver. Dans les années trente, la France était à ce point plongée dans la crise qu'un retour à l'équilibre n'était pas possible. En 1935, Jacques Rueff qui conseillait Pierre Laval, alors chef du gouvernement, avait dénoncé les risques d'une « déflation sauvage ». Il l'avait lui-même reconnu : « Notre politique était rationnelle mais absurde . » Dans le monde actuel, la flexibilité complète des monnaies en permanence est la norme, il n'y a qu'en zone euro où des États souverains ont des parités fixes.
Henri Tandonnet . - Le pacte de stabilité rime-t-il encore à quelque chose au regard de ce que font les banques à côté ?
Jean-Michel Naulot, ancien banquier, ancien membre du Collège de l'Autorité des marchés financiers . - C'est un peu le jeu des vases communicants. D'un côté, la banque centrale européenne finance allègrement les États. Je ne sais si c'est conforme à l'esprit ni même à la lettre des traités... De l'autre, les gouvernements européens s'efforcent de respecter des pactes de stabilité très rigoureux. J'ai le sentiment qu'on risque de le payer très cher d'ici peu de temps. Si l'Europe promouvait une politique d'investissement beaucoup plus agressive, tout serait mieux équilibré.
Pierre-Yves Collombat, rapporteur . - Pour résumer votre pensée, je dirais que la Fed ou la BCE jouent un rôle de pompier incendiaire. Mon intime conviction, la voici : le système est allé tellement loin, il est tellement bloqué politiquement que plus aucune régulation sérieuse n'est possible avant l'inéluctable catastrophe.
Jean-Michel Naulot, ancien banquier, ancien membre du Collège de l'Autorité des marchés financiers . - Malheureusement, je partage votre conclusion. Les trains sont lancés, rien de plus ne se fera en matière de régulation financière. À la prochaine crise, on risque de prendre conscience des réformes à engager, mais comment fera-t-on dès lors qu'on ne pourra plus s'appuyer ni sur la politique budgétaire ni sur la politique monétaire ?
Roger Karoutchi, président . - Je vous remercie, monsieur Naulot, de tous ces éclairages. Nous l'avons tous compris, la situation est bien pire que ce que nous pouvions imaginer, même si aucun d'entre nous n'était globalement très optimiste. Nous vivons en quelque sorte sur un volcan, en apparence très tranquillement. Cela souligne d'autant plus l'intérêt du travail qu'engage Pierre-Yves Collombat. Nul doute que nous ne manquerons pas de vous contacter de nouveau.
Pierre-Yves Collombat, rapporteur . - Je rappellerai un proverbe moyen-oriental : « L'excès de malheurs fait rire. »
Roger Karoutchi, président . - Ce sera le mot de la fin !
AUDITION DE JAMES KENNETH GALBRAITH
(26 mai 2016)
Roger Karoutchi, président . - Mes chers collègues, nous avons l'honneur d'accueillir ce matin James Kenneth Galbraith, professeur d'économie américain, francophone et, comme me l'a confié de nombreuses fois notre collègue Pierre-Yves Collombat, qui est à l'origine de cette rencontre, révolutionnaire devant l'éternel, hétérodoxe et très contestataire. Monsieur le professeur, je vous remercie vivement d'avoir accepté de venir débattre avec nous d'un sujet pour le moins compliqué. Je salue également la présence parmi nous de collègues membres des commissions des finances et des affaires économiques que nous avons conviés à cette réunion.
La rencontre de ce matin s'inscrit dans le cadre de l'étude que mène Pierre-Yves Collombat sur l'avenir et les risques du système financier et bancaire. Lors d'une précédente audition, Jean-Michel Naulot, ancien banquier, nous avait annoncé que la crise financière de 2008 n'était qu'une répétition générale, avant que ne survienne une crise encore plus dure dans les années à venir. Monsieur le professeur, vous êtes un universitaire et économiste reconnu, vous avez publié un certain nombre d'ouvrages et vous êtes incontestablement l'un de ceux que l'on écoute, que l'on soit d'accord ou non avec vous, pour savoir ce qui risque de se passer.
Notre délégation a une mission importante au sein du Sénat : celle d'alerter et d'informer sur un certain nombre d'événements susceptibles de se produire à l'avenir. Je laisse à l'initiateur de cette rencontre, Pierre-Yves Collombat, que je remercie, le soin de préciser le contexte.
Pierre-Yves Collombat, rapporteur . - Je tiens tout d'abord à vous remercier, monsieur le président, d'avoir permis cette audition. Nous ne sommes pas des pythonisses mais l'objet de notre travail est tout de même d'essayer de voir comment la situation peut évoluer. En particulier, se maintiendra-t-elle telle qu'elle est aujourd'hui ? Si oui, jusqu'à quand ? Après avoir misé sur la Chine et sur les « Brics », sans vrais résultats, pouvons-nous espérer des États-Unis une reprise et que faut-il en attendre ? Allons-nous au contraire vers un nouveau crash financier et une nouvelle crise généralisée ? Monsieur le professeur, vous êtes un observateur bien placé pour répondre à toutes ces questions.
Subsidiairement, j'ai cru comprendre que donner une priorité au redressement du système bancaire ne fera pas repartir la machine. Il faut au contraire d'abord faire repartir l'économie et mobiliser des moyens équivalents à ceux qui ont été utilisés au moment du New Deal avant de pouvoir redresser le système financier et retrouver un régime de croisière. Voilà l'opposé de la politique menée en Europe. C'est pourquoi j'aimerais connaître votre sentiment sur cette stratégie de fond.
James Kenneth Galbraith, économiste . - Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis ravi d'avoir ce matin l'occasion de partager avec vous certaines idées, dont la plupart ont été développées dans un livre publié voilà deux ans et qui s'intitule, en français, La Grande crise. Comment en sortir autrement . Je dirai également quelques mots sur la situation en Europe, dans le prolongement de mon dernier ouvrage Crise grecque, tragédie européenne , qui paraît aujourd'hui et qui couvre mon travail du premier semestre de l'année 2015 à Athènes. Je vais commencer par la situation générale de l'économie et aborder notamment les conséquences de la grande crise financière de 2007-2009.
Tout d'abord, en quoi consiste cette crise ? Pour certains économistes et dévots de l'économétrie, elle n'est qu'un événement comme un autre, un choc de croissance somme toute classique, un déséquilibre temporaire que l'on n'aurait pas pu anticiper. Les promoteurs de telles idées n'ont pu qu'être déçus au cours des dernières années. Si l'économie retrouve un certain équilibre, la situation reste très inconfortable pour ceux qui ont la responsabilité du bonheur commun. La relance, s'il y en avait une, n'est pas satisfaisante, selon ce que l'on aurait pu attendre de notre expérience acquise depuis l'après-guerre.
Dès lors, cette crise a-t-elle une autre signification, signale-t-elle un changement profond dans les conditions de notre vie économique ? Auquel cas nous serions confrontés à des questions fondamentales. En tout état de cause, la prudence dicte de prendre en compte pareille hypothèse. Il existe une lacune dans la discipline d'économie conventionnelle : celle de la question des ressources, surtout énergétiques. Les économistes de l'après-guerre ont pris l'habitude de négliger cette question et de se comporter comme si les ressources étaient librement disponibles, de les considérer comme un don de la nature. Voilà la pensée qu'on inculque depuis quarante ans à l'université américaine aux étudiants en économie. On leur enseigne également la théorie de la « malédiction des ressources naturelles », selon laquelle, à l'inverse, les pays qui en sont dépourvus, comme le Japon, seraient par nature plus actifs, plus entrepreneuriaux, et donc plus riches. Aujourd'hui, nous pouvons le dire, cette approche est obsolète. Si les États-Unis ont connu une relance supérieure à celle de l'Europe après la crise financière, c'est notamment grâce à la « bulle » de schiste qui a créé une différence sur le coût des ressources entre les deux continents. De plus, les difficultés du Japon proviennent en partie de la catastrophe de Fukushima.
Existe-t-il une règle générale sur laquelle nous pouvons nous appuyer ? Je pense pouvoir répondre par l'affirmative. De surcroît, elle est relativement simple. Les ressources deviennent plus chères car davantage de ressources sont nécessaires pour les extraire. Le haut niveau de développement que nous avons atteint s'explique par les investissements que nous avons consentis dans le passé. Il nous faut dépenser davantage en termes réels pour maintenir en fonction l'ensemble de ces investissements, c'est-à-dire l'ensemble de nos capitaux accumulés. Décarboner l'économie, s'adapter au changement climatique suppose de mobiliser les ressources nécessaires : capital, recherche et heures de travail. Il est donc inévitable de dépenser moins ailleurs, que ce soit pour les nouveaux investissements, le développement ou la consommation de masse. Pour les coûts de production, la différence n'est pas très grande. Cependant, une proportion même assez petite peut faire la différence entre une économie de croissance, une économie de stagnation, voire une économie en déclin.
Il faut choisir entre le renouveau et le maintien d'un certain niveau de consommation, c'est-à-dire la reproduction simple de la situation précédente, surtout dans un contexte d'accroissement de la population couplée à une hausse en proportion de la population hors travail - chômeurs, retraités, jeunes.
En pareil cas, d'aucuns entendent poursuivre une politique d'austérité. Cette approche est, à mes yeux, erronée, dans la mesure où elle mène au gaspillage des ressources actuelles dont nous avons besoin. Elle peut être assimilée à une politique de la passivité, de la non-action, au moment même où il faudrait agir. Il importe d'investir pour renouveler nos sources d'énergies et promouvoir les énergies soutenables et renouvelables. Cela n'est pas neutre financièrement, car, parallèlement, nous devons continuer à offrir aux populations un haut niveau de services, en termes de transport, de communication, de santé, d'éducation, d'enseignement. Il serait inconcevable d'en revenir aux normes de confort en vigueur au XVIII e ou XIX e siècle.
Troisième point, il faut économiser sur les moyens de consommation qui ne sont pas strictement nécessaires, augmenter la consommation commune et minimiser les excès, surtout ceux qui sont dangereux, maintenir une distribution de la consommation qui soit plus égalitaire qu'avant. Parmi les activités considérées comme trop dangereuses, je citerai l'armement, les banques et le charbon.
Quatrième point, il faut protéger les plus vulnérables. Les assurances sociales deviennent encore plus importantes dans la situation actuelle. Souvenons-nous que ce sont elles qui nous ont aidés à sortir de la Grande Dépression des années trente. Les États-Unis n'ont pas attendu le retour à la prospérité pour mettre en oeuvre le New Deal et poser les bases de l'État providence.
Cinquième point, j'y insiste, il faut choisir de minimiser les dépenses les moins utiles et les plus dangereuses, comme l'armement. De même, le système financier est devenu depuis vingt ou trente ans beaucoup trop coûteux en ressources réelles, à l'image du charbon et du pétrole. Misons sur la musique, la science et la culture. Les politiques actuellement menées en Europe et aux États-Unis n'opèrent pas de distinctions pourtant essentielles. Elles entraînent une réduction du niveau de vie des individus sans protéger les plus vulnérables, sans préserver les systèmes essentiels et faire de provisions pour un avenir soutenable, pour une planète sur laquelle nos descendants pourront vivre.
En définitive, quelle est l'alternative à privilégier ? Ce n'est ni une politique de croissance à outrance ni le keynésianisme des années trente ; c'est une politique intelligente, adaptée à la situation actuelle, à nos besoins et à nos contraintes, une politique qui s'inscrit néanmoins dans l'esprit de John Maynard Keynes, qui a prononcé cette phrase célèbre : « Quand les conditions changent, il faut changer d'avis. » Je crois fondamental d'abandonner toute idéologie ou dogmatisme qui dirige la politique économique, notamment en Europe, avec pour résultat l'obligation, pour les pays du Sud, surtout la Grèce, de rembourser les dettes et la privatisation de tous les biens communs et publics, y compris les plages grecques. Cette politique renforce le chômage et l'émigration de la population active. Elle est promise à un échec fondamental qui va changer la nature de cette Europe qui s'est construite depuis cinquante ans.
Roger Karoutchi, président . - Devant pareil optimiste, je donne sans attendre la parole à Pierre-Yves Collombat.
Pierre-Yves Collombat, rapporteur . - « Pessimisme de la raison et optimisme de la volonté », disait quelqu'un... Quand je lis Les Échos , j'ai l'impression que les États-Unis vont nous sortir de la crise, que tout est reparti, que le chômage a disparu, ou quasiment. Tout cela est-il fondé ?
Sur le plan structurel, la politique, menée notamment en Europe, donne la priorité au sauvetage du système financier, au motif qu'il n'y aurait pas d'autre possibilité. Vous semblez penser le contraire.
James Kenneth Galbraith, économiste . - Les États-Unis ont aussi donné la priorité au sauvetage du système financier, et c'est problématique. Notre système financier est très concentré, trop puissant et sans la moindre responsabilité à l'égard de la loi et de la justice. Les fraudes incommensurables qui nous ont menés à la crise n'ont suscité aucune réaction. Malgré cette erreur de notre politique d'après-crise, les États-Unis ont profité de deux avantages par rapport à l'Europe : d'abord, la bulle de schiste, que j'ai déjà mentionnée, d'où un coût des ressources provisoirement allégé, mais, surtout, un système d'assurances sociales qui a fonctionné de façon très efficace juste après la crise, avec une augmentation rapide des dépenses du secteur public avoisinant 9 % du Pib en 2009. Je parle de la sécurité sociale, des assurances chômage, des assurances santé, tout ce système méprisé mais qui fonctionne depuis cinquante ans à une échelle continentale. En Europe, en revanche, la stabilisation automatique opérée par la protection sociale a joué dans les pays riches du Nord mais pas dans ceux du Sud - Espagne, Italie, Grèce -, ce qui plonge l'Europe dans une crise sans fin pour l'instant. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les pays menacés de banqueroute puissent soutenir l'activité économique de leur population. La Grèce a perdu un quart de ses revenus depuis cinq ans.
Roger Karoutchi, président . - Après la crise de 2007-2008, un certain nombre de réformes ont été menées au niveau du système bancaire et financier international. Aujourd'hui, ce dernier est-il plus solide ou encore plus fragile, car toujours déconnecté de l'économie réelle ?
James Kenneth Galbraith, économiste . - Il m'est un peu difficile de répondre. Je ne vois pas de résurgence de cette espèce de bulle complètement frauduleuse qui a touché le marché des hypothèques et des titres avant 2007. Cependant, il reste toujours des problèmes de dettes souveraines, de dettes dans le tiers-monde, dans le secteur énergétique et ailleurs. Nous pouvons également citer le problème des dérivés, des credit default swaps : nous avons du mal à les identifier et, partant, les institutions les plus vulnérables de ce point de vue.
Je crois que nous ne pourrons jamais dire que le système financier, tel que nous l'avons construit, est hors de danger. Dans la crise relativement profonde des marchés internationaux et des taux de change observée depuis un an, une grande banqueroute est certainement possible. Après 2008-2009, les États-Unis ont été confrontés à une difficulté supplémentaire, qui est l'impossibilité de considérer au niveau politique un second sauvetage financier. Il a déjà été extrêmement ardu de faire passer le projet de loi présenté à la fin de 2008. Le Congrès n'ira de nouveau dans cette direction que sous la menace d'une catastrophe totale.
Yannick Vaugrenard . - À la suite d'un certain nombre d'auditions que la délégation à la prospective a réalisées, la conclusion que nous pouvons en tirer est que la crise financière de 2008 peut se répéter. Il s'agit juste de savoir où et quand. La réponse que vous venez de nous apporter semble aller dans ce sens. Selon vous, une possibilité d'accord politique au niveau international pour éviter cette financiarisation de l'économie, qui a atteint un niveau inédit, est-elle possible ? Deuxième point, la révolution numérique imposera probablement une évolution sociétale considérable. Pensez-vous que l'ensemble des politiques publiques prenne ce phénomène suffisamment en compte et comment faire pour que tel soit le cas ? Troisième point, il semble que le creusement des inégalités affaiblisse la croissance alors que leur diminution la soutient. Qu'en pensez-vous ? Enfin, vous avez cité Keynes tout à l'heure : « Quand les conditions changent, il faut changer d'avis. » Cette affirmation est vraie sur le plan économique mais pas sur le plan philosophique.
James Kenneth Galbraith, économiste . - Mon père a eu cette phrase : « Les économistes économisent surtout leurs idées. Ils font en sorte que celles qu'ils ont retenues à l'université leur servent toute la vie. »
Je suis favorable à la mise en oeuvre d'un contrôle du système financier et d'une définanciarisation de l'économie. Cela a été fait une fois, entre les années trente et soixante-dix. Le système bancaire a alors été placé sous le contrôle des États, surtout ici en France. J'ai conduit une étude sur le système bancaire et financier dans la France d'après-guerre. Il intégrait les opérations des banques en visant des objectifs publics de reconstruction et de gouvernement du pays. Mis en place avec, notamment, la Caisse des dépôts et consignations, le Crédit foncier et le Crédit agricole, il a fonctionné jusqu'à un certain point.
Dans un contexte où le développement de l'économie doit prendre une autre direction, ce genre d'instruments est utile. Les banques actuelles ne servent que les objectifs fixés par leurs dirigeants. Il est injustifiable que les gouvernements de nos pays, de nos continents, soient dirigés par nos banques. Cette situation mènera à la ruine.
Comment réformer le système ? Je ne prétends pas avoir toutes les solutions. Dans un monde bouleversé par la révolution numérique, les banques sont devenues, aussi incroyable que cela puisse paraître, des institutions conçues pour échapper au droit national, régional et continental. J'ai réalisé une étude s'échelonnant sur une vingtaine d'années sur l'évolution des inégalités dans le monde. Ma conclusion est que les inégalités sont liées de façon très étroite à l'évolution du système financier. Ce sont les industries de haute technologie, financées par les banquiers, qui ont donné les milliardaires de la Silicon Valley. Les statistiques aux États-Unis le montrent très clairement, ceux qui ont profité le plus sont ceux qui ont su capitaliser sur les innovations technologiques et sur le pouvoir financier.
Quelles sont les conséquences de cette révolution numérique ? Les économistes ont été beaucoup trop optimistes sur la capacité du marché privé à remplacer les emplois en train d'être détruits par les avancées technologiques. La situation actuelle fait penser à celle qu'a connue le transport à cheval au moment de l'arrivée de l'automobile. Sauf que, aujourd'hui, il s'agit de trouver du travail à des êtres humains, à ceux qui sont ou vont être déplacés. De nouvelles institutions dédiées à cet objectif sont à créer. Toute révolution technologique apporte des opportunités énormes à la population, du moins à celle qui est en activité et a une source de revenus personnelle. D'où la nécessité d'augmenter la proportion du revenu national dédiée à l'environnement, à la culture et aux soins des personnes âgées, autant de secteurs qui ne peuvent être automatisés avec les ordinateurs et les smartphones. Comme le secteur privé ne le fera pas spontanément, cette responsabilité revient à des institutions publiques ou qui relèvent du secteur non lucratif.
Philippe Dominati . - Vous soulignez l'efficacité de la protection sociale aux États-Unis, qui fonctionne très bien avec 9 % du Pib, et sa faiblesse en Europe, notamment en France, où près du double y est consacré. Est-ce parce que ce secteur est ouvert à la concurrence en Amérique du Nord quand il est régi par un État monolithique chez nous ? Ma seconde interrogation concerne les ressources naturelles. La recherche et l'exploitation du pétrole et du gaz de schiste par fracturation ont permis aux États-Unis d'être exportateurs en ce domaine. Cet investissement répond-il à votre théorie ?
James Kenneth Galbraith, économiste . - Je précise que les 9 % en question représentent l'augmentation des dépenses d'assurances sociales dans le Pib pour une année et pas le total du budget qui y était consacré en 2009-2010. Cette hausse a été décidée pour soutenir la population américaine, notamment les chômeurs et les retraités. Ainsi, la majorité d'entre elle n'a pas connu de chute profonde de ses revenus personnels, même si, bien sûr, elle a vu la valeur de ses biens immobiliers et de son épargne baisser. Cette décision a permis de stabiliser de manière assez efficace le niveau d'activité économique agrégé au niveau de l'ensemble des États-Unis, à la différence de l'Europe.
Quant à la fracturation hydraulique, on ne sait pas exactement où cette méthode va mener ni combien de temps elle pourra être utilisée. De nombreux problèmes sont à déplorer. La construction de nouveaux puits a, il me semble, presque cessé après la chute du prix du pétrole. De nombreux autres sont stoppés temporairement, mais pourront être remis en production dès qu'ils redeviendront rentables. Quant à savoir combien de temps cette bulle va durer, la question est d'ordre géologique. Je le sais d'autant mieux que j'habite moi-même le Texas. Je connais des personnes qui travaillent sur cette question mais elle reste sans réponse. Certains sont optimistes, d'autres pessimistes. Tout le monde le sait, il s'agit d'une solution limitée dans le temps, sur une échelle de quelques décennies.
Anne-Catherine Loisier . - Que pensez-vous de la séparation entre banque de dépôt et banque d'affaires ? Qu'en est-il aux États-Unis ? Au sujet des inégalités, quel jugement portez-vous sur le projet de revenu universel ?
James Kenneth Galbraith, économiste . - Je suis favorable à la séparation des banques d'affaires et des banques commerciales, dont l'origine remonte au Glass-Steagall Act. Elle permet aux banques commerciales de bénéficier des assurances sur les dépôts et du soutien du gouvernement, et de « laisser tomber » les banques d'affaires si elles font banqueroute. Je ne pense pas que ce soit une solution complète au regard de la situation actuelle. Aux États-Unis, les banques sont trop grandes, ce qui rend inenvisageable une réelle régulation de ce genre de Béhémoth. Déconcentrer le système bancaire et réduire l'échelle de ces institutions seraient de bonnes idées. Le sénateur Sanders a d'ailleurs développé l'idée d'une concurrence entre petites institutions pour lutter contre la monopolisation du système financier. Je ne suis pas non plus convaincu par cette théorie. À l'âge informatique, que vous ayez un grand nombre de petites institutions ou un petit nombre de grandes, elles auront la même activité.
À la différence de mon ami Yanis Varoufakis, qui y est favorable, j'ai des doutes sur le revenu universel, à la fois d'ordre économique et politique. Économiquement, il importe de privilégier en priorité un système d'assurance pour les retraités, les malades, les jeunes ainsi qu'un accès universel à l'éducation et l'enseignement supérieur. Politiquement, une société qui fonctionne de façon satisfaisante doit imposer à ses membres d'exercer une activité, ce qui paraît difficilement conciliable avec une garantie de revenus. Cette idée circule depuis cinquante ans aux États-Unis. Je me souviens d'une discussion à ce sujet à la Convention nationale des démocrates en 1972. Elle rencontre de nombreuses résistances politiques et il est difficile de défendre ceux qui, bien que aptes au travail, ne font rien contre ceux qui travaillent. Je ne préfère pas mener cette bataille.
Alain Vasselle . - Je prolongerai le propos de notre collègue Philippe Dominati sur la protection sociale. Vous avez expliqué qu'au moment de la crise, en 2009, les États-Unis avaient apporté un soutien à ceux en difficulté en augmentant de 9 % du Pib les aides en leur direction. J'aimerais que vous soyez plus explicite : le système de protection sociale français est-il moins performant et moins réactif que celui des États-Unis ? L'image que nous avons, ici, en France, du système américain est celle d'un système beaucoup moins solidaire que le nôtre, donné souvent comme exemple dans le monde.
Pierre-Yves Collombat, rapporteur . - Il existe une différence fondamentale entre les deux systèmes : aux États-Unis, c'est l'État qui paye alors que notre système est paritaire, c'est-à-dire financé par les entreprises et les bénéficiaires.
James Kenneth Galbraith, économiste . - Le paradoxe est apparent : notre système est moins performant mais il a répondu plus efficacement à la crise. M. Collombat vient de le mentionner, les dépenses de l'État en termes d'assurances sociales et de chômage n'ont pas été financées immédiatement par des impôts ni par des entreprises. L'État américain a consacré 9 % du Pib en plus pour compenser la chute de l'économie privée alors en cours. Il s'agit d'une injection assez radicale, destinée à stabiliser le malade puis à le récupérer. Toutefois, il n'existe pas, à mon sens, une très grande différence entre le fonctionnement du système aux États-Unis et celui de l'Allemagne et, peut-être, de la France. Le problème de l'Europe réside dans la construction d'une économie continentale complètement intégrée mais sans protection et stabilisation à pareille échelle. Toute une partie de l'Europe s'est retrouvée plongée dans la crise sans possibilité de se stabiliser. La Grèce est dans cette situation depuis 2010. Elle ne représente que 2 % du Pib européen, l'Espagne, presque 10 %, et l'Italie, 20 %.
La crise des institutions européennes doit ses origines à la domination des idées néo-libérales, ultra-orthodoxes, « néo-von-hayekiennes », promues, entre autres, par M. Schäuble, que j'ai eu l'occasion de rencontrer au cours de cette fameuse période s'échelonnant entre janvier et juillet 2015. Laisser ces idées diriger l'économie du continent est une invitation très claire à la catastrophe, qui ne tardera pas.
Franck Montaugé . - Sur la question de la place de la finance dans la gouvernance mondiale, la taxation des transactions financières, via la mise en oeuvre de la taxe Tobin, vous semble-t-elle un enjeu toujours pertinent ? Sinon, que pouvons-nous faire ?
Autre écueil fondamental : les paradis fiscaux, qui permettent l'extraction de sommes considérables hors des circuits officiels. Gabriel Zucman, professeur à l'université de Berkeley, propose la mise en place - utopique ? - d'un cadastre financier, qui permettrait de localiser les moyens financiers et de suivre leurs mouvements à la trace. Qu'en pensez-vous ?
Au sujet de la transition énergétique, considérez-vous que le nucléaire est un moyen d'y participer ? Qu'en est-il de la fixation du prix de la tonne de carbone sur le marché des quotas, qui reste le point nodal dont découlent nombre de décisions ?
Enfin, chacun sait que c'est la démocratie technique qui mène le monde, plus encore aujourd'hui qu'hier. Quid de la relation du citoyen à l'évolution des technologies, de son implication ?
James Kenneth Galbraith, économiste . - Je le confesse, je ne suis pas un expert de la transition énergétique mais je considère que priorité doit être donnée à la décarbonisation. Pour la mettre en oeuvre, il faut prendre des risques. Le nucléaire en est certainement un. Quant à la démocratie technique, je ne vois pas à quoi cela correspond exactement.
Franck Montaugé . - La problématique est la suivante : comment associer les citoyens, sans qu'ils en soient forcément experts, à ces questions qui conditionnent leur vie en société et leur avenir ?
James Kenneth Galbraith, économiste . - C'est une question très importante, mais la seule idée que je peux porter en la matière consiste à insister sur la nécessité de faire évoluer nos systèmes d'éducation et d'enseignement, pour permettre à la population d'appréhender les enjeux actuels. Aux États-Unis, les CV et les parcours scolaires ne sont pas du tout adaptés au monde moderne. Aussi curieux que cela puisse paraître, le Texas est toujours agité par le débat sur l'enseignement de l'évolution et de la création dans les écoles. Ici, vous êtes un peu plus avancés, du moins je l'espère. Tout ce qui peut permettre d'ouvrir la discussion et d'inviter au débat doit être encouragé.
Par ailleurs, j'ai passé une partie de ma carrière à militer pour l'ouverture de la Réserve fédérale américaine, la Fed. J'étais membre de l'équipe de la Commission bancaire de la Chambre des représentants aux États-Unis entre 1974 et 1980, au moment où ont commencé les auditions publiques ouvertes entre le Congrès et le Président de la Fed. Ce système perdure depuis maintenant quarante ans. Comme quoi des actions lancées à l'âge de vingt-trois ans peuvent parfois avoir des conséquences à la fois durables et remarquables. Je n'y aurais pas pensé à l'époque. Grâce à cette ouverture vers le Congrès et le grand public, la qualité des dirigeants de notre Banque centrale s'est grandement améliorée depuis lors.
En Europe, vous avez malheureusement construit une banque centrale complètement fermée sur elle-même, aux mains, si je puis m'exprimer ainsi, de quelques « mollahs », autour du « califat » de M. Draghi. C'est une invitation à être gouvernés par des personnes médiocres. Je ne dis pas que ce soit le cas de M. Draghi, mais force est de constater que les objectifs et motivations de toutes ces personnes ne sont pas clairs. En 2011, un certain président de la Banque centrale européenne pour faire plier le gouvernement d'Irlande, l'avait menacé en ces termes : « Une bombe explosera à Dublin. » Voilà qui aurait été inconcevable si la Banque centrale avait une responsabilité envers le Parlement européen et le grand public. Je crois que l'avantage d'une démocratie répandue, technique comme vous dites, c'est qu'elle oblige les dirigeants à être plus « responsables » ; ce n'est pas mauvais en soi.
Je connais bien James Tobin pour avoir été son étudiant. Je ne pense pas que la taxe Tobin, qui a pris depuis des décennies une importance symbolique, soit une solution. Contrairement à ce que certains pensent, elle ne pourrait résoudre que quelques-uns des nombreux problèmes actuels. Une régulation efficace du système financier ne passera pas par l'instauration de mécanismes automatiques. Il faut des personnes qui savent ce qu'elles font, indépendantes, autonomes et qui puissent intervenir auprès des banques pour empêcher les conspirations frauduleuses. Il est dans la nature humaine de chercher le profit. De plus, les banquiers ne sont pas des anges. Des policiers sont nécessaires dans ce secteur, comme dans les autres.
Bernard Lalande . - Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il fallait adapter la production de ressources à l'accroissement de la population et des besoins, ce qui nécessite de focaliser les investissements sur ce delta entre ressources et besoins. Cette approche suppose-t-elle d'engager des investissements plutôt que de verser des dividendes ? Implique-t-elle une stabilisation des coûts salariaux dans l'entreprise, de façon à adapter la formation des individus à cette nouvelle gestion des ressources ?
James Kenneth Galbraith, économiste . - Je répondrai par l'affirmative sur les deux points. Il faut avoir un planning des investissements et plafonner certains revenus. Depuis les années soixante-dix, profitant de modifications structurelles sur le plan fiscal, les dirigeants des grandes entreprises ont pu s'accorder des rémunérations extravagantes par rapport à celles de leurs prédécesseurs. Auparavant, les entreprises se finançaient par leurs propres moyens et la première tâche de leurs dirigeants était donc de maintenir les revenus entrepreneuriaux. Après 1980, aux États-Unis et dans le monde entier, les directions et les actionnaires ont été beaucoup mieux rémunérés, et les entreprises obligées de s'endetter pour investir. Cette construction institutionnelle est beaucoup moins stable et représente un aspect important du problème.
Annie David . - Monsieur Galbraith, le discours que vous nous avez délivré est assez inhabituel et il m'a beaucoup plu. Je pense, notamment, au dernier point que vous venez de soulever : le transfert en termes de financement qui s'est effectué au sein des entreprises, au détriment de l'investissement et au profit des actionnaires, lequel a complètement déséquilibré un système qui aurait dû permettre à tous de vivre décemment des richesses créées.
Je voulais aussi revenir sur la révolution numérique. Ne pensez-vous pas que les richesses qu'elle va permettre de dégager, ainsi que les nouveaux emplois qu'elle va créer, même si elle en détruira d'autres, peuvent permettre d'envisager une diminution du temps de travail ? En France, nous travaillons trente-cinq heures par semaine ; je crois possible d'aller jusqu'à trente-deux heures. La révolution numérique ne devrait-elle pas être mise au profit du progrès social et du plus grand nombre ?
James Kenneth Galbraith, économiste . - C'est une question aussi intéressante qu'importante. La révolution numérique ouvre de nombreuses possibilités, notamment celle d'augmenter le niveau de vie en permettant à chacun de communiquer facilement et à moindre coût avec le monde entier. Parallèlement, les moyens de communication sont monopolisés et privatisés à un niveau inédit. Ainsi, les entreprises réduisent le coût du travail et le nombre des emplois dont elles ont besoin, d'où une réduction de l'activité économique et une augmentation du chômage.
Avant de penser à tirer avantage de la technologie, il importe de disposer d'institutions capables d'assurer des revenus suffisants aux ménages. C'est le problème que nous n'avons pas encore résolu et qui va s'approfondir. Les dirigeants des universités, des écoles et des services de santé sont soumis à la pression d'utiliser des moyens automatisés et de réduire leur personnel. Le loisir est-il la solution ? Cela dépend du type de société. En France, vous avez des villes très agréables. La population peut se consacrer davantage aux loisirs, sans risque de détérioration de ses conditions de vie. Pour les Américains, je n'en suis pas sûr. J'ai l'impression que, pour une grande partie de la population, le travail, c'est la vie sociale. Les Américains aiment être au bureau parce que l'alternative est de se trouver dans une petite maison en banlieue avec un chien, un chat et une voiture. En outre, aux États-Unis, les salariés ont à peine deux semaines de congés par an.
Roger Karoutchi, président . - Monsieur le professeur, je tiens à vous remettre, au nom du Président du Sénat, la médaille du Sénat gravée à votre nom. C'est un grand honneur pour le Sénat de vous avoir reçu. Je laisse à Pierre-Yves Collombat le soin de conclure.
Pierre-Yves Collombat, rapporteur . - Même si tous les propos qui ont été tenus ce matin ne nous y incitent pas forcément, efforçons-nous d'être optimistes. Votre avant-dernier livre, s'intitule La grande crise : Comment en sortir autrement. Je vous pose donc la question !
James Kenneth Galbraith, économiste . - Le seul fait de poser la question est déjà un signe de progrès. C'est un début. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ce fut pour moi un grand honneur d'être parmi vous et de participer à cette discussion. J'ai fait mes études en français voilà quarante-huit ans en Bretagne. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de m'en servir un peu.
Roger Karoutchi, président . - Encore merci, monsieur le professeur.
PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE
PRÉALABLE
(15 décembre 2016)
Roger Karoutchi, président . - Mes chers collègues, Pierre-Yves Collombat nous présente ce matin son analyse sur l'avenir et les risques du système financier et bancaire. Tel un oracle de Delphes des temps modernes, il va nous donner son avis sur les perspectives, ou l'absence de perspectives, en la matière.
Sans plus attendre, je lui donne la parole.
S'appuyant sur un PowerPoint, Pierre-Yves Collombat, sénateur du Var, rapporteur, présente les grandes lignes de son rapport.
Roger Karoutchi, président . - Nous vous remercions pour ce travail considérable qui retrace la situation tout en proposant un bilan. Le mieux serait que chacun prenne le temps d'intégrer les données du rapport et que nous prévoyions une réunion en début d'année prochaine pour en reparler. D'un point de vue davantage prospectif, au-delà des évolutions et des politiques mises en place depuis cinquante ans, pouvons-nous cibler les éléments qui sont encore à risque ?
Pierre-Yves Collombat, rapporteur . - Ceux-ci figurent dans la version initiale du rapport mais, faute de temps, je n'ai pas pu les développer ce matin. Pour faire court, je dirai que les facteurs de risque d'autrefois continuent de jouer, auxquels s'ajoutent ceux qui sont apparus récemment.
Roger Karoutchi, président . - Nous voilà rassurés...
Pierre-Yves Collombat, rapporteur . - Le paradoxe, c'est que le Samu arrivera toujours à temps pour faire survivre ce système même s'il ne finance plus l'économie. Améliorer le fonctionnement de l'économie réelle est la seule voie possible pour réformer le système.
Roger Karoutchi, président . - Nous rouvrirons le débat au début de l'année prochaine. Il nous reste encore un peu de temps pour quelques réflexions ou questionnements.
Franck Montaugé . - Je remercie Pierre-Yves Collombat pour cet énorme et très intéressant travail. En plagiant, en laïc convaincu, le « Et Dieu dans tout ça ? » de Jacques Chancel, j'ai envie de dire : « Pierre-Yves Collombat, et la politique dans tout ça ? » Vous citiez Christopher Lasch : « Le caractère irréel et artificiel de notre vie politique reflète à quel point elle s'est détachée de la vie ordinaire, en même temps que la conviction secrète que les vrais problèmes sont insolubles. » Une fois le constat établi et dans l'optique de notre prochaine réunion, quelles orientations les politiques devraient-ils prendre au niveau national ou européen pour minimiser les risques d'une nouvelle crise et refonder un système plus juste et moins inégalitaire ?
Yannick Vaugrenard . - À mon tour je veux remercier le rapporteur pour ce travail immense, même si je reste circonspect sur sa conclusion, que je trouve en partie contradictoire. D'un côté, on nous dit que le système se régulera de lui-même pour éviter le pire ; de l'autre, on nous assure que la politique a son importance. Je souhaite que nous osions faire des propositions politiques fortes. Nous mesurons les conséquences de la crise de 2008 : victoire du Brexit, de Donal Trump, sondage révélant que 30 % des Français considèrent la possibilité d'un système autre que démocratique dans notre pays. En tant que délégation à la prospective, nous nous devons d'être ambitieux. Osons proposer une gouvernance mondiale, quand bien même l'objectif serait difficile à atteindre. Nous sommes assis sur un volcan. Une nouvelle crise financière éclatera, c'est certain, mais nous ne savons pas quand. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire des propositions audacieuses.
Gérard Bailly . - Je salue moi aussi le travail important qu'a réalisé notre collègue. La zone euro et la France disposent-elles des bons outils pour apaiser la crise ? Les pompiers qui sont intervenus ont-ils pris les bonnes décisions ? Nous sommes assis sur un volcan, cela vient d'être dit. Mais qui tient l'allumette ? Le savons-nous vraiment ? La gouvernance mondiale prendra-t-elle les décisions qui s'imposent pour éviter que l'incendie n'éclate ? Voilà ce que nous devons déterminer.
Pierre-Yves Collombat, rapporteur . - Un certain nombre d'éléments de réponse figurent d'ores et déjà dans la version initiale du rapport. Le message que j'ai voulu passer, c'était de dire que la réponse est politique. Il ne s'agit pas, contrairement à ce que d'aucuns prétendent, d'un problème technique. Mon idée de départ, c'était d'analyser le système pour identifier les points de blocage et y apporter des solutions. Je n'ai pas souhaité continuer dans cette voie, et ce pour deux raisons.
D'une part, le système n'est pas isolé, il est un élément d'un ensemble même s'il fonctionne selon sa logique. D'autre part, on aura beau faire toutes les propositions possibles, aussi géniales soient-elles, elles ne seront pas appliquées. Je n'ai pas l'intention de faire un de ces rapports dans lesquels figurent des préconisations toutes plus pertinentes les unes que les autres et qui, l'encre n'ayant pas encore séché, finissent à la poubelle. J'ai récemment publié un rapport d'information avec notre collègue Catherine Troendlé sur l'évolution de l'activité des services départementaux d'incendie et de secours aux personnes. Nous avons reconnu, dès l'avant-propos, ne pas nous faire d'illusions sur le devenir de nos propositions, compte tenu du poids des habitudes et des enjeux de pouvoir.
En tout état de cause, la réponse ou, plutôt, les réponses seront forcément politiques. Il y a d'ailleurs non pas un système financier, mais un système tout court, fait d'un enchevêtrement d'intérêts contradictoires, opposant des personnes convaincues d'agir pour le bien de l'Humanité.
Quand bien même nous en appellerions à un retour à Bretton Woods ou à quelque chose d'approchant, cela ne servirait à rien, le système étant dans un tel état de décomposition. En revanche, je pense possible de faire un certain nombre de propositions réalistes, notamment s'agissant de l'Europe et de ses blocages structurels. Pour cela, il faudrait déjà accepter de nous confronter aux Allemands, ce qui suppose, au préalable, que nous-mêmes soyons convaincus de la nécessité d'agir.
Je reprendrai à mon compte la formule prêtée à Antonio Gramsci : « Il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. »
J'évoquais précédemment l'idée selon laquelle il serait possible de contourner la difficulté en faisant des modes de financement de l'économie réelle qui, en quelque sorte, court-circuitent le système. Quand on voit comment la France a fait capoter le rapport Liikanen... Et que dire du rapport Barnier, de la manière dont il est passé à la trappe !
Je suis là pour réagir en politique, en essayant de faire avancer un certain nombre de pistes, en espérant améliorer les choses.
Je ne pense pas qu'il y aura un krach financier, même si toutes les raisons techniques sont réunies car, de toute façon, il y aura des interventions extérieures qui arrêteront le massacre, mais au prix d'un blocage supplémentaire. C'est la raison pour laquelle je pense que ce sont plutôt les impacts économiques, politiques de ces politiques perdues d'avance qui nous permettront de faire avancer les choses. Un peu comme ce qui s'est passé avant-guerre : financièrement, la crise était quasiment réglée mais elle a fait de tels dégâts politiques que tout a explosé.
Il y a effectivement possibilité de faire ressortir un certain nombre de points. Je crois que l'on sera plus utile simplement en donnant quelques éclairages, en soumettant quelques idées, plutôt qu'en faisant des propositions qui n'ont strictement aucune chance d'être reprises. Mais ce n'est en aucun cas pour minimiser le rôle du politique.
Roger Karoutchi, président . - Nous nous reverrons donc en début d'année prochaine pour une réunion conclusive. D'ici là, chacun aura pu prendre connaissance du projet de rapport qui vous sera adressé préalablement. Je veux de nouveau saluer le travail colossal effectué par Pierre-Yves Collombat et son effort de synthèse. Si on arrive à formuler des propositions réalistes et pragmatiques, quelques propositions de meilleure gestion, on aura fait oeuvre utile.
ADOPTION DU RAPPORT
(9 février 2017)
Roger Karoutchi, président . - Mes chers collègues, nous allons entendre Pierre-Yves Collombat nous présenter le rapport sur l'avenir et les risques du système financier et bancaire, un sujet ô combien important sur lequel il n'a pas ménagé ses efforts ; je le remercie vivement pour l'ampleur de son investissement. Ce rapport fera date ; il est polémique, juste ce qu'il faut. J'espère qu'il fera réagir, qu'il provoquera le débat.
Pierre-Yves Collombat, rapporteur . - Monsieur le président, mes chers collègues, merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer en toute liberté, ce qui est le propre de cette délégation. Je vous avais présenté une première version de ce rapport en décembre, j'en ai remanié la conclusion ; la thèse centrale ne change pas mais je la précise, en tenant compte des remarques que vous m'aviez faites, en particulier sur le manque de propositions.
Nous vivons une situation totalement paradoxale : après dix ans de crise, la probabilité « technique » de réédition d'un krach du système financier d'ampleur équivalente à celui de 2007-2008 n'a pas diminué, bien au contraire. Les quelques dispositions destinées à rendre le système financier moins instable qui ont pu lui être imposées sous le coup de l'émotion, non seulement ont laissé intact l'essentiel mais ont été largement compensées par les effets négatifs du traitement utilisé contre la crise. Tous les ingrédients d'un nouveau krach sont donc réunis.
Cependant, aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce n'est pas le scénario que je privilégierais. Plus exactement, si un nouveau krach devait se produire, il serait moins le déclencheur d'une nouvelle crise économique, comme ce fut le cas en 2007-2008, que la conséquence d'événements politiques engendrés par la crise économique actuelle. Le vrai danger, en effet, c'est l'incapacité structurelle du système à se réformer et le désaveu populaire qui en résulte ; lequel s'exprime dans toute l'Europe et maintenant aux États-Unis au travers de ce que j'ai appelé des « émeutes électorales », qui, à chaque fois, surprennent ceux qui ont l'habitude d'être surpris.
Deux raisons m'ont poussé à revoir ma conclusion.
En premier lieu, j'ai voulu tenir compte des remarques qui ont suivi ma présentation de décembre. Il m'a alors été reproché, amicalement, de ne pas faire de propositions de réformes ou d'actions susceptibles d'éviter que le risque de krach, toujours potentiel, ne se réalise, ni de présenter des mesures susceptibles d'amorcer une sortie de la crise économique. Crise économique qui s'éternise et qui, en s'éternisant, nourrit une crise politique aux conséquences déstabilisatrices totalement incontrôlables.
Je me suis focalisé sur deux points qui me paraissent essentiels : la réforme ou la sortie de la zone euro et la transformation du système de financement de l'économie. Je le souligne dans le rapport, ledit système est largement parasitaire au sens où il n'est que très partiellement au service du financement de l'économie réelle. C'est d'ailleurs l'un des leviers sur lequel il serait le plus facile d'agir dans le cadre d'une éventuelle réforme. Cela dit, loin de moi l'idée de renoncer à mon scepticisme quant à la lucidité des élites politiques européennes et françaises devant le danger qui menace et quant à leur incapacité à remettre en cause les remèdes utilisés jusque-là contre la crise. Cette position n'a rien de contradictoire. Ce n'est pas parce que la raison nous dit ce qu'il faudrait faire, que c'est ce qui va se passer ! Je pense avoir suffisamment insisté sur les enjeux idéologiques, de pouvoirs et d'intérêts derrière la grande restauration libérale de cette petite cinquantaine d'années, pour que l'on comprenne mon scepticisme.
Pour la plupart des responsables, la crise serait derrière nous ; on parle à n'en plus finir de savoir si la croissance sera de 1,1 % ou 1,2 %, comme si cela avait de l'importance, sans voir le lien entre les récents résultats électoraux en Europe ou aux États-Unis et le purgatoire économique dans lequel la crise nous a plongés. Un mot suffit à tout expliquer : « populisme ». En d'autres termes : « Circulez, il n'y a rien à voir ! » Le problème, c'est que plus on attendra en se payant de mots, plus la situation deviendra difficile à gérer.
En second lieu, ce qui m'a également amené à revoir ma conclusion, c'est que, depuis décembre dernier, on a pu apprécier les premiers effets de l'élection de Donald Trump à la présidence américaine. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ses premières décisions ont surpris ! Qui, en effet, aurait prévu que ce serait le président du principal pays bénéficiaire du système en place, entouré d'une garde rapprochée issue de Goldman Sachs, qui serait le premier à remettre le système en cause ? Plus exactement, à en contester un certain nombre d'effets tout en laissant la bride sur le cou à Wall Street ! L'un des constats que j'ai pu faire et sur lequel j'ai particulièrement insisté, c'est qu'il y a, y compris en Grande-Bretagne, un accroissement des inégalités tant sociales que territoriales. Tous les territoires ne bénéficient pas ou ne pâtissent pas, au même titre, de ce nouveau système. D'où les tensions perceptibles et à venir. Pas sûr que Donald Trump réalise qu'il rouvre là une sorte de guerre civile à l'issue plus qu'incertaine...
Notre époque prend de plus en plus des airs de déjà-vu, autant dire d'avant-guerre. Et il n'est jamais bon de laisser trop longtemps l'Histoire bégayer.
Mon but premier avec ce rapport - dont les analyses n'engagent que moi -, outre d'essayer de comprendre comment on en est arrivé là, est de montrer qu'il y a urgence à réagir. Et je ne suis pas le seul à faire ce diagnostic. Je citerai Jean-Michel Naulot, qui a été banquier, que nous avons auditionné et qui, dans son dernier livre, Éviter l'effondrement, écrit ceci : « Une génération de responsables politiques nous a conduits à une situation véritablement explosive à force de déréglementation financière et de marche forcée vers le fédéralisme. Plus les dirigeants maintiendront ce cap, plus ils feront monter les populismes. Quelques mesures radicales seraient pourtant de nature à corriger l'hypertrophie de la finance. En Europe, une place plus grande pourrait être faite à la souveraineté nationale. La régulation financière et le droit souverain des peuples à choisir une politique sont les seules voies susceptibles d'éviter un véritable effondrement et de revivifier la démocratie. Mais une course contre la montre est engagée. » Dans Libération du 6 février dernier, le même Jean-Michel Naulot estime que Donald Trump « est une de ces petites aiguilles qui pourraient crever la bulle financière ».
Là est le principal enseignement de ce travail, il est politique, mais je ne crois pas que les responsables veuillent voir cet aspect de la réalité. Merci encore de m'avoir donné la possibilité d'en parler. Ce ne sont pas les sujets de débat qui nous manquent !
Roger Karoutchi, président . - Quoique je ne partage pas toutes vos idées - souvent révolutionnaires -, j'avoue que je souscris à vos analyses. J'ai rencontré bien des responsables financiers, nombre d'entre eux m'ont semblé marcher au bord du précipice avec le sentiment que les choses se régleraient d'elles-mêmes et que le système se réformerait de l'intérieur. Je suis sidéré par ce comportement de la classe dirigeante financière - plus que par celui du monde politique, parce que les politiques, pour beaucoup, doivent le plus souvent se cantonner à écouter les experts -, qui leur sert un langage bien trop technique. Aussi, je partage votre conclusion qu'un tel système ne peut pas perdurer. Il risque d'exploser avec des dégâts considérables. Et je partage aussi l'étonnement de voir les financiers aussi sereins au bord du volcan...
Annie David . - N'étant pas spécialiste de la finance, j'apprécie que ce rapport me fasse aborder et comprendre un sujet et des données complexes. À l'évidence, on se voile bien trop la face : si on laisse faire, c'est parce qu'il y a des gagnants, des intérêts en présence, ceux des financiers ; et il y a aussi de plus en plus de perdants. C'est pourquoi il faut rétablir plus d'égalité dans la financiarisation, et admettre que le système financier participe de moins en moins à l'économie réelle, alors que nous vivons dans le réel, pas dans les bulles spéculatives.
Aussi ce rapport est-il un outil à mettre entre toutes les mains. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Nombreux sont ceux qui savent, ils le manifestent même dans la rue, mais ne sont pas entendus. Et ceux qui sont en position de changer le système ne le font pas, préférant regarder ailleurs. Cela fait longtemps, au sein du groupe CRC, que nous déplorons cet état de fait. Nous appelons à changer l'Europe, qui était une belle innovation mais qui s'est grippée en chemin, au point de se retourner contre les Européens eux-mêmes.
Puisse ce rapport faire évoluer les choses et je me réjouis que l'impulsion vienne cette fois d'une autre groupe politique que du CRC car, trop souvent, on ne nous écoute pas, du seul fait que nous sommes communistes !
Yannick Vaugrenard . - J'ai assisté avec plaisir à plusieurs auditions préparatoires à l'établissement de ce rapport, tout en y apprenant beaucoup et en voyant nos idées confortées. L'Histoire, parfois, bégaie, vous l'avez dit. La crise d'aujourd'hui montre que nous pouvons être à l'aube d'une confrontation internationale majeure, le repli sur soi économique est susceptible d'entraîner une nouvelle guerre mondiale. Notre rôle de politiques, tout particulièrement au sein de notre délégation à la prospective, c'est de donner l'alerte, j'espère que ce rapport y contribuera. Nous savons qu'un risque majeur est devant nous, il faut en tenir compte ; qu'ensuite les responsables ne veuillent pas l'entendre, c'est leur affaire, nous aurons assumé notre mission.
La crise de 2007 a été réglée non par les organisations financières mais par la puissance publique, par le politique. Dès lors, ne faut-il pas anticiper, pour que les politiques se saisissent des risques actuels ? La période électorale est propice ; avec ce rapport qui lance une véritable alerte, nous aurons joué notre rôle d'empêcheurs de tourner en rond.
Roger Karoutchi, président . - Je vais vous raconter une anecdote qui n'est pas anecdotique. En 2008, j'ai assisté à une réunion tout à fait surréaliste où des responsables financiers - ceux de la Banque de France, de la Banque centrale européenne - nous expliquaient qu'il ne fallait rien faire : la crise était là mais nous devions rester les bras croisés parce qu'elle allait se résorber d'elle-même, le marché allait tout régler. Le président de la République n'a pas accepté ce diagnostic ; il a convoqué l'ensemble des présidents des groupes politiques du Parlement pour leur demander s'ils étaient d'accord avec ce laisser-faire : pas un ne l'a été, et tous ont accepté de voter, en quelques jours, hors délais constitutionnels, une loi de régulation importante. C'est parce que le pouvoir politique a repris la main qu'on a enrayé la crise. Mais les financiers, eux, continuaient d'être persuadés que le système allait s'autoréguler, sans aucun égard pour les conséquences sociales qui en résulteraient pour la population.
Jean-François Mayet . - La thèse défendue par Pierre-Yves Collombat a fait l'objet de millions de pages depuis vingt ans, l'antithèse probablement un peu moins ; mais, en réalité, de quoi parlons-nous ? De quelle crise parlons-nous ? De la crise française, européenne, mondiale ? Un Allemand parlera de crise, parce que le thème est à la mode, mais les Allemands ont quasiment tous du travail ; et si la crise est de n'avoir plus, comme avant, une croissance élevée, il faut le dire.
L'Histoire bégaierait ? Peut-être, mais je ne suis pas sûr que l'après-guerre soit comparable à aujourd'hui ; parce qu'alors il fallait reconstruire, il y avait du travail partout ; et l'équilibre a été retrouvé par le travail.
La crise, c'est d'abord la faillite du politique, elle tient à ce que les politiques ne font pas bien leur travail : la finance n'est qu'un outil. Si la crise de 2007-2008 a été réglée, c'est parce que des dirigeants ont agi, en particulier le président Obama, en muselant ses acteurs financiers, et le président Sarkozy, en tapant du poing sur la table. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'une révolution ni d'idées révolutionnaires pour régler le problème. Regardons plutôt ce que font les Espagnols : sans bruit, ils sont parvenus à faire baisser l'inflation, le chômage, et la production repart. Certes, c'est là une thèse libérale, mais je l'assume parfaitement. Quand les problèmes sont compliqués, il faut une solution simple : produire à pas cher, pour distribuer, et faire que les politiques assument leur rôle. En France, on aime à donner des leçons au monde, comme si ça marchait bien chez nous ; on traite Trump d'imbécile mais, quand il demande aux industriels américains de fermer leurs usines à l'étranger pour rapatrier les emplois aux États-Unis, il est tout à fait dans son rôle, il défend l'emploi américain !
L'avenir ne me semble donc pas aussi sombre que vous le dites, à condition d'être courageux et de ne pas laisser croire qu'on rase gratis - et que chacun travaille avec l'envie d'y aller. Je ne suis pas inquiet. Sommes-nous à la veille d'une nouvelle guerre mondiale ? La crise de 1929 était d'abord économique et le nazisme a bien d'autres causes...
Louis Duvernois . - Je remercie le rapporteur pour ce document consistant, de référence, qui nous invite à trouver des pistes pour être plus vigilants et plus fermes. La crise est là et, comme le dit Jean-François Mayet, elle marque une faillite du monde politique. Roger Karoutchi vient de nous donner un exemple édifiant, de l'intérieur, où l'on voit combien il faut réagir vite et fort. J'ai trouvé dans le rapport ces deux citations de la Reine d'Angleterre, s'exprimant devant la London School of Economics , temple de la formation des élites économiques outre-Manche, que je me plais à citer : « Comment a-t-on pu laisser s'installer un système financier aussi dangereux ? » « Comment se fait-il que personne n'ait prévu [la crise] ? » Au-delà de la crise politique, le sujet est celui de la formation des décideurs. Devant notre délégation, l'économiste James K. Galbraith posait la question : comment les citoyens peuvent-ils participer à la gouvernance de la cité sans être des experts ? Il y a un lien entre la faillite du politique et la formation des élites. Les formations dispensées dans les grandes universités américaines, comme dans nos écoles, ne sont pas adaptées au monde moderne. Le rapport illustre la nécessité de former autrement les élites.
Gérard Bailly . - Les pays européens sont endettés à des degrés très divers. Quelles en seront les conséquences ? Qui est fautif ? Le traité européen n'est pas adapté pour régler cette question. Que faire ?
Cher collègue Collombat, j'ai deux petites questions à vous adresser : si, demain, un banquier vous téléphone, après la parution de votre rapport, pour vous reprocher de « l'allumer », que lui répondrez-vous ? Enfin, si vous étiez président, puisque c'est le titre d'une émission de radio, que feriez-vous ?
Yannick Vaugrenard . - Rien ne sert de jouer les Cassandre, mais il faut avoir une vision objective de la situation, qui a changé par rapport à celle de l'entre-deux guerres. La crise de 1929 a été suivie de l'essor de la mondialisation. Les frontières sont devenues des lignes imaginaires pour le monde de la finance. La financiarisation s'est développée : 10 % seulement des échanges boursiers sont liés à l'économie réelle. La spéculation s'est développée. Nous devons en tenir compte, y réfléchir collectivement. En tant que responsables politiques, il nous appartient d'anticiper, pour éviter de nous retrouver contraints de répondre dans l'urgence lorsque la crise arrive. Enfin, il me semble essentiel que, dans le cadre de la formation de nos élites économiques et financières, comme celle de tous nos concitoyens, l'accent soit mis sur le développement de l'esprit critique.
Annie David . - L'Europe est une belle aventure mais il faut la réformer. Comment faire pour que la BCE se mette au service de l'économie réelle ? Que pensez-vous de la proposition des frères Bocquet d'organiser une Cop fiscale, qui réunirait tous les dirigeants pour débattre de la financiarisation et de la fiscalité ? Pareille initiative témoignerait de la volonté des dirigeants politiques d'agir.
Jean-François Mayet . - Que se passerait-il ensuite ? Croyez-vous que chacun rentrera dans son pays pour rebâtir son système financier ? La mondialisation est un fait. Que les politiques prennent leurs responsabilités car chacun ne pourra pas régler les problèmes dans son coin.
Mme Annie David . - Je n'ai pas dit cela ! Bien au contraire, c'est une question que nous devons traiter ensemble et au niveau mondial. Arrêtons avec les préjugés et les stéréotypes : ce n'est pas parce que je suis une femme communiste que je ne dis que des bêtises !
Jean-François Mayet . - Je n'ai rien dit de tel !
Roger Karoutchi, président . - Si M. Collombat arrive à convaincre tout le monde, je propose qu'il soit le seul candidat à l'élection présidentielle !
Chacun sait que je suis un libéral, classique, de droite. Voilà quelques années, j'ai représenté la France à l'OCDE et participé à deux réunions du G20. J'ai vu comment la technocratie financière y a pris le pouvoir. Le G7, qui est devenu ensuite le G8 puis le G20 par élargissement, avait précisément été créé pour permettre au pouvoir politique de reprendre la main. Les premiers G20 étaient très politiques, ils réunissaient les chefs d'État ou de gouvernement. Or, progressivement, ce sont les ministres des finances qui y ont été délégués. Ainsi, cette instance, qui devait être un instrument de contrôle politique international, est devenue un lieu de rencontre de financiers partageant la même formation, la même vision du monde. Les dirigeants politiques nationaux ont cédé la place à une technostructure.
Il est vrai, comme Jean-François Mayet l'a rappelé, que nos gouvernements peuvent en faire plus pour l'emploi, la croissance, la formation. Toutefois on a laissé prospérer au niveau international un système qui fait fi des États, croit pouvoir s'autoréguler, fait croire aux dirigeants élus qu'ils n'ont pas la compétence technique pour intervenir. Ces experts nous disent qu'il faut laisser faire, laisser passer, et ne surtout pas intervenir, pour ne pas faire de bêtises ! J'ai assisté hier matin à une réunion de la commission des finances sur la compétitivité de la place de Paris. Je suis parti ! Ces financiers ont tout raté mais ils sont très fiers et nous expliquent, en employant un vocabulaire horriblement technique, qu'après tout mieux vaut laisser faire...
Pierre-Yves Collombat, rapporteur . - J'ai volontairement souhaité aborder ce sujet technique de manière large, en le replaçant dans une perspective historique ou sociologique. Je voulais montrer que le système, car il s'agit bien d'un système, ne s'était pas installé par hasard. Toutes les pièces sont imbriquées, on ne peut bouger un élément sans impacter les autres. Du coup, il est très difficile de faire des réformes. Sans soubresaut majeur, il ne se passera strictement rien. On se focalise sur l'aspect technique mais il ne faut pas oublier l'aspect idéologique, sur lequel j'aurais souhaité insister encore davantage, ni le fait que cette organisation profite à certains intérêts. C'est pourquoi Donald Trump n'est pas au bout de ses peines. Il a envie de donner satisfaction à tout le monde, mais ce système, par nature, produit des inégalités, sociales et territoriales, et les renforce.
Selon l'idéologie dominante, le système s'autorégule, il faut laisser faire et ne pas intervenir. On a oublié que Keynes nous avait montré que l'intervention publique était parfois nécessaire, même si l'on peut discuter de ses modalités. Ronald Reagan expliquait, en arrivant au pouvoir, que l'État n'était pas la solution mais le problème. C'est pourtant lui qui l'a remis sur le devant de la scène peu après. Mais passons, nous n'en sommes pas à une contradiction près... Dans ce cadre de pensée, une crise systémique n'est pas pensable. D'où les questions, faussement naïves, d'Élisabeth II d'Angleterre rappelées précédemment. Il y a seulement des accidents passagers. Fondamentalement, cela pose la question de l'éducation, de la compréhension des mécanismes, des débats d'idées. Le paradoxe est que nous sommes beaucoup plus sclérosés en Europe qu'aux États-Unis. Il y a beaucoup plus de débats là-bas. Un Galbraith en France n'est pas envisageable. D'où aussi l'aspect didactique de mon rapport, que certains pourront trouver quelque peu pesant. J'ai voulu rendre lisible un langage faussement ésotérique, voire fumeux. Certains raisonnements sont contre-intuitifs : il m'a ainsi fallu du temps pour comprendre comment on pouvait spéculer à la baisse !
Il est facile de mettre en cause les responsables politiques. Mais n'oublions pas qu'ils sont élus ! En revanche, gare à la paresse intellectuelle, à la pensée unique, aggravée par l'éteignoir médiatique. On nous fait prendre pour argent comptant certaines idées. Non, la mondialisation n'est pas naturelle. Il y a eu des périodes dans l'histoire où elle s'est développée, d'autres où elle a régressé. C'est aussi un phénomène politique. Dire cela n'est pas être hostile à la mondialisation, mais c'est rappeler que l'on ne pourra modifier les choses que si les responsables politiques ouvrent les yeux et proposent des solutions. Toutefois, comme tout est lié, c'est très difficile.
Si j'étais président ? J'essaierais de construire un système de financement différent, permettant de soutenir nos entreprises. Jézabel Couppey-Soubeyran, maître de conférences en sciences économiques, nous l'a dit : aujourd'hui, 5 % seulement de l'activité bancaire servent au financement des entreprises. Je cite aussi dans le rapport un milliardaire américain selon lequel Wall Street ne finance qu'un infime pourcentage de l'économie américaine. On a créé la BPI, la Banque publique d'investissement. Il faut mobiliser l'épargne au service des PME-TPE. C'est une proposition modeste mais bien plus intéressante que les programmes électoraux actuels qui ne font que décliner à l'envi les mêmes sornettes, à savoir des versions de l'économie de l'offre. Or, il ne suffit pas de produire pour que les gens achètent ! En 2008, les Européens ont commencé à injecter des milliards dans l'économie alors que les Américains l'avaient fait depuis longtemps.
Je suis pessimiste en raison et optimiste en volonté. L'Europe devra évoluer si elle veut s'en sortir. On a eu du mal à soutenir la Grèce qui ne représente pourtant que 3 % du PIB européen. Comment ferons-nous si l'Italie, dont le PIB avoisine les 2 000 milliards d'euros, rencontre à son tour de graves problèmes ? Les rustines ne suffiront pas... Mais l'immobilisme profite à l'Allemagne qui bénéficie du niveau de l'euro, alors qu'il est surévalué pour nous. Il appartient au gouvernement français de poser la question de l'ajustement des parités. Tant qu'on ne trouvera pas un moyen de recycler les excédents des uns pour compenser les déficits des autres, on n'en sortira pas ! Le système est autobloquant. Les peuples étaient pro-européens ; l'Union européenne était une utopie réaliste, elle est pourtant devenue un épouvantail. Il n'y aurait pas de crise ? Mais la situation économique, même en Allemagne ou en Espagne, n'est pas glorieuse et reste très fragile, même s'il ne faut pas non plus verser dans le catastrophisme.
J'ai voulu donner des éléments de compréhension. Par exemple, les inquiétudes autour de Bâle III - soit dit en passant, c'est une vraie escroquerie - sont exagérées. Les banques ne pourront plus prêter à l'économie ? Aujourd'hui, l'essentiel de l'actif bancaire ne vise pas à financer l'économie mais à faire du cash . Les journaux annonçaient hier que BNP Paribas enregistrait plus de 7 milliards d'euros de bénéfice en 2016. Tant mieux, mais il faudrait surtout qu'ils servent à financer l'économie.
Il convient aussi de trouver des débouchés. On dit qu'il nous faut conquérir des marchés à l'étranger. Mais comme les autres font pareil, on n'en sort pas ! Il est temps de mener ensemble une politique d'offre et de demande. Il est rassurant que le FMI, la Banque des règlements internationaux, même la Commission européenne, commencent à plaider pour des investissements publics. Si j'étais président, enfin, je n'aurais pas ponctionné les finances des collectivités territoriales...
Roger Karoutchi, président . - Sur ce point, vous faites l'unanimité !
Pierre-Yves Collombat, rapporteur . - Elles réalisent en effet 70 % de l'investissement public, avec un effet de levier élevé.
Roger Karoutchi, président . - Merci. Votre rapport nous alerte sur le risque d'explosion d'un système financier virtuel, qui survit au bord du précipice. Le retour du politique ne serait pas superflu.
Mes chers collègues, il me reste maintenant à vous demander formellement l'autorisation de publier, sous la forme d'un rapport d'information, le travail de notre rapporteur.
La délégation autorise à l'unanimité la publication du rapport d'information sous le titre « Une crise en quête de fin - Quand l'Histoire bégaie ».
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
Philippe Auberger , ancien député, président du Comité d'audit de la Banque de France
Jean-Gabriel Bliek , économiste
Gunther Capelle-Blancard , professeur des Universités en sciences économiques, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Jézabel Couppey-Soubeyran , maître de conférences en sciences économiques, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
James Kenneth Galbraith , économiste
Jean-François Gayraud , essayiste
Jérôme Glachant , professeur des Universités en sciences économiques, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Jérôme Kerviel , ancien trader à la Société Générale
David Koubbi , avocat de Jérôme Kerviel
Jean-Michel Naulot , ancien banquier, ancien membre du collège de l'Autorité des marchés financiers
Gérard Rameix , président, Autorité des marchés financiers
Jacques Sapir , économiste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales
Henri Sterdyniak, conseiller scientifique à l'Observatoire français des conjonctures économiques
Laure Tertrais , conseillère du président, Autorité des marchés financiers
Déplacement à Bruxelles (6 avril 2016)
Sylvie Goulard , députée européenne
Chantal Hugues , conseillère, cabinet de Jonathan Hill, commissaire européen à la stabilité financière, aux services financiers et à l'union des marchés de capitaux
Martin Merlin , directeur, direction des marchés financiers, Commission européenne - DG Fisma
Christophe Nijdam , alors secrétaire général de Finance Watch, depuis membre des Stakeholders Groups de l'Autorité bancaire européenne (EBA) et de l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA)
Almoro Rubin de Cervin , chef d'unité, Commission européenne - DG Fisma
André Sapir , chercheur associé, think-tank Bruegel
* 1 Audition du Conseiller scientifique à l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) - 4 février 2016.
* 2 Voir infra, dans la troisième partie, le développement intitulé « La nouvelle lutte des classes et l'obsolescence démocratique ».
* 3 Voir infra.
* 4 Le Quantitative easing (QE) ou assouplissement quantitatif est une pratique monétaire consistant sur longue période en le rachat massif, par une banque centrale, de titres de dettes aux acteurs financiers (obligations, bons du trésor, titres hypothécaires, etc.).
* 5 Voir la quatrième partie.
* 6 Credit default swaps - en français, « contrats dérivés sur défaut de crédit ».
* 7 Voir, infra, au sein de la troisième partie, le développement intitulé « La financiarisation de l'économie ».
* 8 Federal Reserve, Banque centrale européenne, Bank of England.
* 9 Le commerce des promesses. Petit traité sur la finance moderne - Seuil - 2001.
* 10 Transactions financières exécutées à grande vitesse, en quelques microsecondes, grâce à l'utilisation d'algorithmes informatiques. Cette pratique, dominante aux États-Unis depuis 2005, s'est imposée dans le système boursier international, ce qui peut poser des problèmes réglementaires et éthiques.
* 11 Voir infra, dans la troisième partie, le développement intitulé « La financiarisation de l'économie ».
* 12 RMBS, Residential Mortgage Backed Security.
* 13 Discours prononcé lors des rencontres financières internationales organisées par Paris Europlace le 5 juillet 2007.
* 14 Audition de Jean-Gabriel Bliek, économiste - 10 décembre 2015.
* 15 James Galbraith recense, dans un article « Mais qui sont ces économistes ? », les divers courants économiques de pensée, refoulés par les deux écoles dominantes (École de Chicago et École du MIT), dans les marges de ce qui est tenu pour la « Science » économique : Marxistes, Keynésiens à ne pas confondre avec les Néo-Keynésiens et surtout Minsky, pour lesquels les marchés, notamment financiers, sont non pas autorégulateurs mais structurellement instables. Article paru en anglais dans la revue Thought & Action (automne 2009), sous le titre « Who are these economists, anyway? ». Version française publiée en partenariat avec l'Initiative internationale pour repenser l'économie (www.i-r-e.org). En France, Paul Jorion, dans son ouvrage L'Implosion (Fayard, 2008), a été le premier à repérer le risque majeur constitué par la crise immobilière étasunienne.
* 16 Docteur en droit, diplômé de l'IEP de Paris et de l'Institut de criminologie de Paris, ancien élève de l'École nationale supérieure de police, Jean-François Gayraud est commissaire divisionnaire. Ses travaux visent à éclairer le lien entre criminalité et crises financières dans le contexte de dérégulation des marchés. Il est notamment l'auteur de « La Grande fraude : Crime, subprimes et crise financière » (Éditions Odile Jacob - 2011), « Le Nouveau capitalisme criminel » (Éditions Odile Jacob - 2014), « L'Art de la guerre financière » (Éditions Odile Jacob - 2016).
* 17 Thomas Gresham (1519-1579), financier anglais, fondateur de la bourse de Londres. Selon la loi de Gresham : « Lorsque deux monnaies sont en circulation, l'une considérée comme bonne, l'autre considérée comme mauvaise, la mauvaise monnaie chasse la bonne. »
* 18 The Financial Crisis Inquiry Commission.
* 19 Le Monde - 28 août 2007.
* 20 Audition, en séance plénière, de Jean-Michel Naulot, ancien banquier, ancien membre du Collège de l'Autorité des marchés financiers, président de la Commission des marchés de 2007 à 2013 - 26 novembre 2015. Voir le compte rendu joint en annexe.
* 21 Entretien à RTL - 26 septembre 2008.
* 22 Le Monde - 27 janvier 2009.
* 23 Cet état de fait étant le résultat de politiques sur les motivations desquelles on reviendra infra. Voir la troisième partie.
* 24 « Le problème n'était pas seulement lié aux "subprimes" américains, des banques européennes comme Dexia prenaient aussi des risques excessifs pour avoir plus de profits. » Jacques Sapir - Audition du 14 janvier 2016. C'est avec ses déboires américains que débuteront les ennuis de Dexia.
* 25 Voir supra, le développement intitulé « La spéculation, moteur économique ».
* 26 Voir, infra, la troisième partie.
* 27 Propos tenus lors d'une audition publique le 13 juillet 2008.
* 28 Troubled Asset Relief Program.
* 29 American Recovery and Reinvestment Act.
* 30 Audition du 14 janvier 2016.
* 31 Securities and Exchange Commission, le « gendarme de la bourse » américain.
* 32 Informations tirées de la recension de l'ouvrage d'Oonagh McDonald, Lehman Brothers, a crisis of value (Manchester University Press, 2016), par Christian Chavagneux (AlterEcoPlus, 18 mars 2016).
* 33 On peut lire dans une note du FMI de janvier 2009 cette prédiction : « La crise se déroulera différemment en Europe qu'aux États-Unis car les économies de ces pays n'ont pas la même structure. Alors que l'Europe ne détient que très peu d'actifs toxiques qui lui sont propres, les banques européennes possédaient une grande quantité d'actifs américains douteux et avaient davantage utilisé l'effet de levier que les banques américaines. Nous pouvons donc nous attendre à une plus forte inversion du levier financier en Europe qu'aux États-Unis. » Visiblement, le FMI minimise les effets potentiels de la spéculation intra-européenne.
* 34 BNP Paribas suspend temporairement les transactions pour trois de ses fonds (2 milliards d'euros) adossés à des titres immobiliers américains. En effet, pour pouvoir vendre ou acheter des titres, il faut en connaître la valeur sur le marché. Celle-ci devenant dérisoire quand tout le monde veut se débarrasser de titres douteux, voire nulle s'il n'y a plus preneur, la manoeuvre consiste à cesser les cotations le temps de laisser passer l'orage. Son effet ne peut évidemment qu'être temporaire.
* 35 Romaric Godin - « De quoi la Deutsche Bank est-elle le nom ? » - La Tribune - 27 septembre 2016.
* 36 Voir, infra, le développement intitulé « Le cas Dexia ».
* 37 Au palmarès : le groupe Caisses d'épargne annonce 750 millions d'euros de pertes ; le groupe Crédit Agricole, 250 millions d'euros, du fait de sa filiale Calyon (indemnisée à hauteur de 2,3 milliards d'euros par AIG) ; Natixis, adossé au réseau de la Banque Populaire et des Caisses d'épargne aurait perdu près de 1 milliard d'euros, etc. Le groupe BNP Paribas annoncera avoir dégagé 3 milliards d'euros de profits en 2008. À noter que le groupe bénéficiera d'un remboursement de 4,9 milliards d'euros de la part d'AIG. Les principales pertes seront celles de la Société Générale, empêtrée dans ce qui allait devenir l'affaire Kerviel, mais qui recevra 2,3 milliards d'euros d'aide de l'État au titre du préjudice subi et 11,9 milliards d'euros d'AIG (La Tribune, 16 mars 2009).
* 38 On aura noté qu'il s'agit d'une réponse non pas de l'Europe mais de pays européens, chacun de son côté.
* 39 Crise grecque, tragédie européenne - Seuil - 2016. Voir compte rendu, joint en annexe, de son audition en séance plénière de la délégation, le 26 mai 2016.
* 40 Fonds européen de stabilité financière.
* 41 Aujourd'hui, il n'existe plus de marché de la dette grecque proprement dite. Selon le think-tank Bruegel, les banques de la zone euro possédaient, à la fin de 2013, 12 milliards d'euros seulement d'obligations grecques, contre 128 milliards en 2008, essentiellement logées dans des banques allemandes. Quant au risque de spéculation sur les émissions souveraines, c'est seulement à partir du moment où la BCE décidera de racheter ces créances sur le marché secondaire qu'il disparaîtra.
* 42 Sera mis en place un fonds de privatisation sur le modèle allemand créé lors de la réunification (Treuhand), piloté par l'Eurogroupe. Reste à savoir si l'effondrement du prix des actifs lui permettra de récupérer les 50 milliards d'euros attendus.
* 43 Dans le patois des devins d'aujourd'hui, cela donne : « Si nous rassemblons ces données [ce qui s'est réellement passé] et que nous utilisons la série de coefficients inscrits dans nos tableaux, cela suggère que les multiplicateurs réels étaient substantiellement au-dessus de 1 dès le début de la crise [ce qui signifiait que la dette continuait à augmenter] alors qu'on pensait qu'ils se situeraient autour de 0,5 [ce qui signifiait qu'elle devait baisser]. » Olivier Blanchard et Daniel Leigh - Note sur le travail de recherche du FMI : Erreurs dans les prévisions de croissance et multiplicateurs budgétaires - janvier 2013. Au vu de ces résultats, quelques mauvais esprits se demandèrent même si « l'erreur » n'était pas volontaire. Comment penser, en effet, qu'une réduction du budget entre 2010 et 2013 équivalant à 16 % du PIB n'entraînerait qu'une réduction de 3,4 % de celui-ci à cette même période ?
* 44 Rendues nécessaire par l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé la Boulé de rassembler une majorité suffisante permettant d'élire un nouveau Président de la République.
* 45 C'est l'excédent budgétaire non compris les dépenses liées au remboursement de la dette. Il est donc clair qu'à partir de 2014 ce sont seulement les charges de la dette qui expliquent le déficit budgétaire grec.
* 46 « À mes amis allemands » - Déclaration en anglais, en allemand et en français, publiée en ligne le 18 juillet 2015.
* 47 Entretien au journal Le Monde - 21 juillet 2015.
* 48 Le Monde Économie - 13 juillet 2016.
* 49 Voir, au sein de la quatrième partie, le développement intitulé « Des stratégies bien différentes ».
* 50 La Révolte des élites - Christopher Lasch - Éditions Climats - 1999.
* 51 Dette : 5 000 ans d'histoire - David Graeber - Les liens qui libèrent - 2013.
* 52 Ibid.
* 53 À cet égard, un rapport de l'Assemblée nationale est parfaitement édifiant (L'extraterritorialité de la législation américaine - Rapport d'information Assemblée nationale n° 4082 (2016-2017) du 5 octobre 2016, de Pierre Lellouche et Karine Berger, fait au nom de la commission des affaires étrangères et de la commission des finances en conclusion des travaux d'une mission d'information constituée le 3 février 2016) : tout échange en dollars est susceptible de relever de la justice étasunienne. Depuis 2008, de l'ordre de 20 milliards de dollars d'amende ont été infligés aux banques et entreprises européennes pour des faits commis hors du territoire américain ; ce qui n'a rien à voir avec le redressement fiscal infligé à Apple, pour des faits ayant eu lieu sur le territoire européen et dont, pour l'instant, on ne connaît pas l'issue. Dans un article du Monde diplomatique daté du 1 er janvier 2017, Jean-Michel Quatrepoint avance le chiffre de 40 milliards de dollars.
* 54 Titre d'un ouvrage de Yanis Varoufakis - Éditions du Cercle - 2014.
* 55 Déclaration de Wu Yi, Vice-première ministre chinoise en visite aux États-Unis en mai 2007.
* 56 Le Minotaure planétaire. L'ogre américain, la désunion européenne et le chaos mondial - Yanis Varoufakis - Éditions du Cercle - 2014.
* 57 On peut particulièrement s'inquiéter des effets que pourrait avoir la politique de Donald Trump visant à faire disparaître ces excédents et déficits jumeaux.
* 58 Rédacteur en chef du mensuel Alternatives économiques, il a travaillé pendant plusieurs années dans l'industrie allemande.
* 59 Dans un article au titre évocateur, « L'Allemagne prédatrice », paru dans Libération du 28 décembre 2006, il considère que c'est la cure d'austérité draconienne pour abaisser le coût du travail que s'inflige l'Allemagne depuis une douzaine d'années, sous « gouvernances » chrétienne et sociale-démocrate confondues, qui en fait un « boulet pour l'Europe ». La position de Guillaume Duval évoluera par la suite, en intégrant d'autres dimensions du problème (Voir son ouvrage Made in Germany - Seuil - 2013).
* 60 De « hedge » signifiant répartir les risques, se couvrir. Les hedge funds englobent une grande variété de fonds utilisant des stratégies pour se couvrir contre la baisse des marchés, dans une recherche de performance maximale.
* 61 La Mondialisation heureuse - Plon - 1997.
* 62 Premier discours d'investiture - 20 janvier 1981.
* 63 Économiste autrichien (1881-1973), défenseur du capitalisme et du libéralisme classiques, auteur de L'Action humaine, traité d'économie, publié en 1949, critique du socialisme, selon lui voué à l'échec pour cause de non-fixation du prix par le marché.
* 64 Ancêtre du KGB.
* 65 « Économie dirigée et démocratie » - Publié (en français) dans Aujourd'hui, première année, numéro 10, daté du 15 octobre 1938, pp. 495-499.
* 66 Voir infra la quatrième partie.
* 67 Propos tenus lors d'une émission radiodiffusée « La pauvreté dans l'abondance : le système économique est-il autorégulateur ? » - 1934.
* 68 L'État prédateur - Seuil - 2009.
* 69 Autant qu'on en puisse juger à cette heure, il semble que ce soit la politique envisagée par le nouveau président des États-Unis, Donald Trump. De là à penser que les résultats seront les mêmes, il y a un pas que nous ne franchirons pas !
* 70 Voir Mariana Mazzucato - The Entrepreneurial State - Anthem - 2013.
* 71 La Banque centrale européenne - Conseil d'analyse économique - La Documentation française - 2002.
* 72 Voir, infra, le développement intitulé « Le cas Dexia ».
* 73 CNN - 19 juin 2005.
* 74 Challenges - 4 octobre 2007.
* 75 La Révolte des élites et la trahison de la démocratie - Christopher Lasch - Éditions Climats - 1999.
* 76 1,8 million de syndiqués, c'est 8 % des salariés. Selon une étude de la Dares de mai 2016, ce taux serait de 11 %.
* 77 « Le IX e Plan : compte rendu et évaluation des rapports sur la première phase » (Commission nationale du Plan, Paris).
* 78 Rapport sur l'emploi 2007 - Commission européenne.
* 79 Le Capital au XXI e siècle - Seuil - 2013.
* 80 Patrick Artus - Flash économie - Natixis - février 2009.
* 81 La Tribune - 7 août 2012.
* 82 Dette : 5 000 ans d'histoire - David Graeber - Les liens qui libèrent - 2013.
* 83 Titre d'un ouvrage de Gillian Tett - Le jardin des livres - 2011.
* 84 Audition du 6 avril 2016 dans le cadre du déplacement à Bruxelles.
* 85 Maître de conférences en sciences économiques - Audition du 18 février 2016.
* 86 « Les produits dérivés dépassent leur niveau d'avant-crise » - Marie Charrel - Le Monde Économie - 17 décembre 2013.
* 87 Audition du 6 avril 2016 dans le cadre du déplacement à Bruxelles.
* 88 Jean-Luc Siruguet - « Le contrôle comptable bancaire » - Revue Banque Édition, page 86.
* 89 Une approche fractale des marchés : Risquer, perdre et gagner - Éditions Odile Jacob - 2005.
* 90 Ibid.
* 91 Benoît Mandelbrot - Ibid.
* 92 Ibid.
* 93 Ibid.
* 94 Ibid.
* 95 Ibid.
* 96 Ibid. Préface de la 2 e édition.
* 97 Audition du 18 février 2016.
* 98 Dans le cadre d'une conférence, « Risques bancaires. Le risque dans tous ses états », donnée à l'École nationale des ponts et chaussées le 9 septembre 2014.
* 99 Professeur des Universités en sciences économiques - Audition du 28 janvier 2016.
* 100 Voir, supra, au sein de la sous-partie « La restauration libérale ou la nouvelle idéologie dominante », le développement intitulé « L'exemple français ».
* 101 Naissance du biopolitique - 1979.
* 102 Le Figaro - 29 janvier 2015.
* 103 Audition du 14 janvier 2016.
* 104 La notion de préférence communautaire - Rapport d'information Sénat n° 112 (2005-2006) du 1 er décembre 2005 de Jean Bizet, Robert Bret, Hubert Haenel et Roland Ries, fait au nom de la délégation pour l'Union européenne.
* 105 Ibid.
* 106 Signé le 2 octobre 1997 et entré en vigueur le 1 er mai 1999.
* 107 L'Europe en crise. Que faire ? - Éditions Clément Juglar - 2005.
* 108 Accord de libre-échange nord-américain, entré en vigueur en 1994.
* 109 Voir, supra, au sein de la sous-partie « La restauration libérale ou la nouvelle idéologie dominante », le développement intitulé « De l'État libéral à "l'État prédateur" ».
* 110 Au terme du processus, la CDC ne finance plus directement que des investissements jugés prioritaires ou « innovants » : logement, politique de la ville, transport, développement du numérique et des énergies nouvelles. Soit à peine 6 % du financement du secteur public local.
* 111 Les collectivités étasuniennes (Voir supra, le développement consacré au système bancaire aujourd'hui) qui empruntent peu aux banques font appel quasi exclusivement au marché financier pour financer leurs investissements, par émission de muni-bonds ou M-bonds. Celles qui n'ont pas une surface suffisante pour obtenir des conditions avantageuses font appel à des « rehausseurs de crédits », compagnies financières qui, contre rétribution, se portent garantes de la fiabilité de l'emprunteur. Spéculant aussi sur les titres immobiliers, elles seront quasiment toutes emportées par la crise des subprimes. Dexia y perdra 1,5 milliard d'euros de moins-values.
* 112 RBC Dexia Investor Service se classe alors « dans le top 10 des banques dépositaires globales, avec approximativement 2 milliards de dollars d'actifs clients en dépôt », selon une publicité de l'époque.
* 113 La Caisse des Dépôts - Jeanne Schpilberg-Katz - Collection « Que sais-je ? » - Presses universitaires de France - 2008 - page 40.
* 114 Son montant initial sera ramené à 300 000 euros en 2013 par « accord amiable » avec la direction de Dexia.
* 115 Dexia : un sinistre coûteux, des risques persistants. - Rapport public thématique - juillet 2013.
* 116 Pierre Richard, pour emblématique qu'il soit, n'est ni le seul responsable ni le seul à avoir été récompensé pour ses exploits. La Cour déplore dans son rapport qu'à des sanctions l'État ait préféré des « accords transactionnels » largement favorables aux faillis. Ainsi, pour plusieurs « fonctionnaires d'origine », dont deux ont repris des fonctions à l'inspection générale et à l'Insee : l'un a touché 725 000 euros d'indemnités, l'autre plus de 670 000 euros (Le Monde du 19 juillet 2013). Pierre Mariani, après avoir accumulé des milliards d'euros de pertes durant son bref passage à la tête de Dexia, quittera le groupe en août 2012, avec 941 000 euros en rémunérations et primes pour son activité en 2012 et une gratification de 675 000 euros pour continuer à gérer plusieurs filiales du groupe jusqu'à leur cession (Les Échos du 6 avril 2013). Qui a dit que « le libéralisme, c'est le choix du risque » ? Apparemment, pas pour tout le monde.
* 117 « Résolution » est le terme élégant en usage chez les banquiers pour « mise en faillite », plus vulgaire il est vrai.
* 118 L'Expansion - 23 juillet 2010.
* 119 Parallèlement se met en place, sur l'initiative des associations d'élus cette fois et malgré le manque d'enthousiasme de Bercy, sur le modèle américain, une Agence française des investissements locaux (Affil). Autorisée par un amendement à la loi de séparation et de régulation des activités bancaires en mars 2013, il faudra attendre au moins un an encore pour qu'elle soit opérationnelle.
* 120 Dans le langage « euphémisé » des banquiers, la « désensibilisation » est l'opération de vente (généralement à perte) ou de renégociation (à perte aussi) des actifs à risque qui imposent des provisions de protection.
* 121 Par exemple, l'un des plus simples, l'écart de taux de change franc suisse-dollar.
* 122 Les principales banques concernées sont : JP Morgan, Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank.
* 123 Rapport Assemblée nationale n° 4030 (2011-2012), de Claude Bartolone, président, et Jean-Pierre Gorges, rapporteur, fait au nom de la commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux.
* 124 Ibid.
* 125 Ibid.
* 126 « Il faut provisionner les bombes à retardement » - Article paru dans La Gazette des communes du 9 avril 2007.
* 127 Alimentée pour moitié par le contribuable et les banques.
* 128 II de l'article 92 du projet de loi de finances pour 2014 adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 19 décembre 2013 : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les contrats de prêt et les avenants à ces contrats conclus antérieurement à la publication de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale, en tant que la validité de la stipulation d'intérêts serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global prescrite par l'article L. 313-2 du code de la consommation, dès lors que ces contrats et avenants indiquent de façon conjointe : 1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ; 2° La périodicité de ces échéances ; 3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt. »
* 129 Décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 du 29 décembre 2013 (partiellement conforme).
* 130 Notamment, le gouvernement des États-Unis, qui ne passe pas pour être hostile aux banques, utilise largement l'arme judiciaire contre ce que l'on nomme, outre-Atlantique, les « Banksters ». Ainsi, dans l'affaire des subprimes, le renoncement à poursuivre de l'État a coûté 86 milliards de dollars aux contrevenants entre 2010 et 2013. UBS, qui plaidait coupable - une première -, s'est vu infliger une amende de 2,5 milliards de dollars pour complicité d'évasion fiscale. Que l'on sache, UBS, qui a pratiqué ce sport à grande échelle en France, n'a pas eu ce genre de désagrément dans l'Hexagone (Voir Antoine Peillon - Ces 600 milliards qui manquent à la France - Seuil - 22 mars 2012).
* 131 Crise financière. Pourquoi les gouvernements ne font rien. - Seuil - 2013. Et audition du 26 novembre 2015.
* 132 Les Échos - 10 juin 2016.
* 133 Déclaration finale du G20 - 4 novembre 2011.
* 134 Ibid.
* 135 Voir supra.
* 136 Audition du 6 avril 2016 dans le cadre du déplacement à Bruxelles.
* 137 L'Opinion - 17 janvier 2016.
* 138 Quoique l'effet économique du QE soit loin d'être avéré.
* 139 BCE : rapport semestriel sur la stabilité financière - FSR 1 er semestre 2016 mai 2016 ; FMI : rapport sur la stabilité financière dans le monde (Avril 2015) et Bulletin du 11 avril 2016.
* 140 Rapport sur la stabilité financière dans le monde - avril 2015.
* 141 85 e rapport annuel - 1 er avril 2014 au 31 mars 2015 - 28 juin 2015.
* 142 Ibid.
* 143 Les Échos, 1 er juillet 2016, et Mediapart, 4 juillet 2016.
* 144 « Le plus grand fonds de pension du monde enregistre une perte de 45 milliards d'euros. » - Les Échos - 1 er juillet 2016.
* 145 Compte rendu, joint en annexe, de l'audition de Jean-Michel Naulot par la délégation - 26 novembre 2015.
* 146 Président de l'Autorité des marchés financiers - Audition du 21 juin 2016.
* 147 Romaric Godin - « De quoi la Deutsche Bank est-elle le nom ? » - La Tribune - 27 septembre 2016.
* 148 Ibid.
* 149 Securities and Exchange Commission, le « gendarme de la bourse » américain.
* 150 L'Express - 21 août 2016.
* 151 Les Échos - 18 septembre 2016.
* 152 Reuter - 30 juin 2016.
* 153 Romaric Godin - « De quoi la Deutsche Bank est-elle le nom ? » - La Tribune - 27 septembre 2016.
* 154 Ibid.
* 155 Article paru dans l'édition Europe du Wall Street Journal - 7 novembre 2012.
* 156 85 e rapport annuel - 1 er avril 2014 au 31 mars 2015 - 28 juin 2015.
* 157 Audition du 6 avril 2016 dans le cadre du déplacement à Bruxelles.
* 158 Audition du 18 février 2016.
* 159 Ibid.
* 160 Article paru dans l'édition Europe du Wall Street Journal - 7 novembre 2012.
* 161 Audition du 28 janvier 2016.
* 162 11 janvier 2016.
* 163 Audition du 18 février 2016.
* 164 8 novembre 2009.
* 165 Article paru dans l'édition Europe du Wall Street Journal - 7 novembre 2012.
* 166 Christian Chavagneux - « Lehman Brothers : les véritables dessous d'une faillite » - alternatives-economiques.fr - 18 mars 2016.
* 167 Audition du 6 avril 2016 dans le cadre du déplacement à Bruxelles.
* 168 85 e rapport annuel - 1 er avril 2014 au 31 mars 2015 - 28 juin 2015.
* 169 Professeur des Universités en sciences économiques - Audition du 31 mars 2016.
* 170 Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l'Union des marchés de capitaux.
* 171 Audition du 6 avril 216 dans le cadre du déplacement à Bruxelles.
* 172 Cité par Challenges - 2 avril 2015.
* 173 « Italie, la crise qui vient. » - Blog sur la Russie et l'Europe - 8 juillet 2016.
* 174 Ibid.
* 175 Audition du 31 mars 2016.
* 176 Rapport semestriel sur la stabilité financière - FSR - 1 er semestre 2016- mai 2016.
* 177 Rapport sur la stabilité financière dans le monde - Avril 2015 - et Bulletin du 11 avril 2016.
* 178 Audition du 18 février 2016.
* 179 Les Échos du 13 avril 2016.
* 180 Audition du 28 janvier 2016.
* 181 Blablabanque. Le discours de l'inaction, éditions Michalon 2015.
* 182 Audition de Jézabel Couppey-Soubeyran du 18 février 2016.
* 183 Voir Les Échos du 3 novembre 2016.
* 184 Securities and Exchange Commission, le « gendarme de la bourse » américain.
* 185 Autorités administratives indépendantes.
* 186 Audition du 21 juin 2016.
* 187 Ibid.
* 188 Audition du 18 février 2016.
* 189 « Une union bancaire européenne qui n'en a que le nom » - Mediapart - 19 décembre 2013.
* 190 Obligations de longue durée mieux rémunérées que les obligations ordinaires mais dont le remboursement en cas de problème n'est pas prioritaire et considérées comme de quasi-fonds propres.
* 191 L'Union bancaire : « Un mariage de raison et après ? » - Rapport d'information Sénat n° 747 (2015-2016) du 30 juin 2016 de Richard Yung, fait au nom de la commission des affaires européennes.
* 192 Audition du 6 avril 2016 dans le cadre du déplacement à Bruxelles.
* 193 L'investissement et le financement d'investissements en Europe - Banque européenne d'investissement - 14 novembre 2013.
* 194 Marie-Hélène Duprat - EcoNote n° 22 - Département des études économiques de la Société Générale - Décembre 2013.
* 195 www.philippewaechter.nam.natixis.com
* 196 Hélicoptère Keynes - Véronique Riches-Flores (www.richesflores.com) - Septembre 2016.
* 197 Voir, supra, « Un endettement public en augmentation, un endettement privé en lente diminution dans la plupart des pays développés mais en forte croissance en Chine ».
* 198 Voir supra, « Des niveaux de chômage améliorés au prix du sous-emploi et d'une dégradation des conditions de travail ».
* 199 Selon Jean-Luc Buchalet, du Cercle des analystes indépendants.
* 200 Le moment est-il propice à une relance des investissements dans les infrastructures ? Les effets macroéconomiques de l'investissement public - Perspectives de l'économie mondiale - Octobre 2014.
* 201 Hélicoptère Keynes - Véronique Riches-Flores (www.richesflores.com) - Septembre 2016.
* 202 Ibid.
* 203 Hélicoptère Keynes - Véronique Riches-Flores (www.richesflores.com) - Septembre 2016.
* 204 Voir supra, au sein de la deuxième partie, le développement intitulé « La crise économique ».
* 205 Voir supra.
* 206 Patrick Artus - L'Opinion - 17 janvier 2016.
* 207 American Recovery and Reinvestment Act.
* 208 Les collectivités territoriales des États-Unis : les enseignements à tirer de modèles économiques univoques - Communication de Pierre-Yves Collombat dans le cadre d'un rapport préparatoire d'un projet de rapport sur le rôle économique des collectivités locales, faite devant la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales le 28 juin 2011.
* 209 Ces graphiques sont issus de la publication « L'investissement et le financement d'investissements en Europe » (disponible uniquement en anglais) - Banque européenne d'investissement - 14 novembre 2013.
* 210 Tribune « A continent adrift » (« Un continent à la dérive »), parue le 16 mars 2009 dans le New York Times.
* 211 Voir, supra, au sein de la troisième partie, le développement intitulé « Le rêve d'une institution politique sans politique ».
* 212 Audition du 14 janvier 2016.
* 213 Audition du 6 avril 2016 dans le cadre du déplacement à Bruxelles.
* 214 Marie-Hélène Duprat - EcoNote n° 22 - Département des études économiques de la Société Générale - Décembre 2013.
* 215 Sébastien Villemot et Bruno Ducoudré - Quelle stratégie pour le rééquilibrage interne de la zone euro ? - OFCE - 5 janvier 2016.
* 216 On l'a vu supra.
* 217 Audition du 6 avril 2016 dans le cadre du déplacement à Bruxelles.
* 218 Voir, au sein de la troisième partie, le développement intitulé « À quoi sert réellement le marché financier ? »
* 219 Professeur des Universités en sciences économiques - Audition du 28 janvier 2016.
* 220 Voir Le Monde Éco&Entreprise du 11 novembre 2014.
* 221 Tribune « L'orgie bancaire chinoise », parue sur le site Boursorama le 19 octobre 2016.
* 222 Voir, au sein de la troisième partie, le développement intitulé « La nouvelle lutte des classes et l'obsolescence démocratique ».
* 223 Cité par Serge Halimi, dans Le Monde diplomatique du 1 er décembre 2016, lui-même citant le New York Times du 14 novembre 2016.
* 224 Cité par Serge Halimi, dans Le Monde diplomatique du 1 er décembre 2016, lui-même citant des propos tenus sur MSNBC le 11 novembre 2016.
* 225 Le Monde diplomatique - 1 er décembre 2016.
* 226 Propos retrouvé dans un tract rédigé durant l'invasion soviétique de la RDA en 1953 et qui finalement ne sera pas distribué.
* 227 Cité par Serge Halimi, dans Le Monde diplomatique du 1 er décembre 2016, lui-même citant Jason Brennan, « Trump won because voters are ignorant, literally », Foreign Policy, Washington, DC, 10 novembre 2016.
* 228 Voir, au sein de la troisième partie, le développement intitulé « La nouvelle lutte des classes et l'obsolescence démocratique ».
* 229 « Comment perdre une élection ? » - Jérôme Karabel - Le Monde diplomatique - 1 er décembre 2016.
* 230 « Avec ou sans l'Europe du Brexit à l'EUxit » - Juin 2016.
* 231 La Grande Transformation - 1944 -Traduction Gallimard 1983.
* 232 Conseiller scientifique à l'Observatoire français des conjonctures économiques - Audition du 4 février 2016.
* 233 Voir supra, au sein de la quatrième partie, le développement intitulé « Crise de langueur économique ».
* 234 Pour reprendre les derniers chiffres dont nous disposons (Eurostat, 31 janvier 2017), l'économie de la zone euro aura crû de 1,7 % en 2016, contre 1,9 % en 2015. Que ce soit, pour la première fois depuis longtemps, un peu plus qu'aux États-Unis n'est pas spécialement rassurant.
* 235 Ainsi l'offensive vient-elle d'être lancée par le sénateur Patrick McHenry - vice-président des services financiers - contre la présidente de la Fed, sommée de cesser immédiatement toute négociation avec le Comité de Bâle sur la régulation bancaire internationale (Les Échos du 3 février 2017).
* 236 Cité par Le Monde du 1 er février 2017.
* 237 Le Monde du 2 février 2017.
* 238 Voir supra, au sein de la quatrième partie, le développement intitulé « Les causes structurelles de la stagnation de la zone euro ».
* 239 Achever la couverture du pays en haut débit figure d'ailleurs au programme de plusieurs candidats à l'élection présidentielle de 2017, certains ayant passé de longues années au pouvoir, sans que quiconque s'étonne que le problème puisse encore se poser !